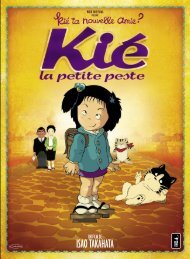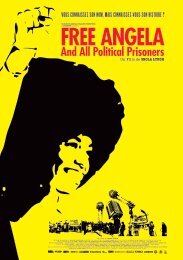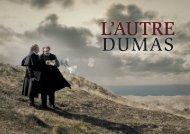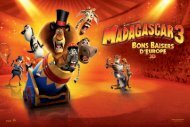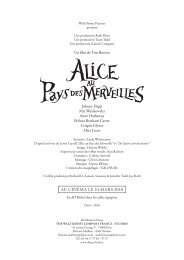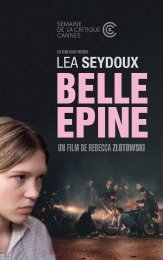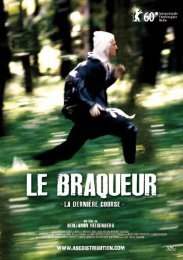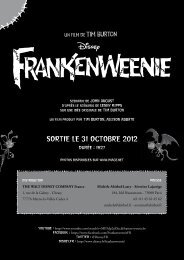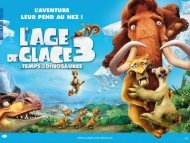Hannah Arendt - Sophie Dulac Distribution
Hannah Arendt - Sophie Dulac Distribution
Hannah Arendt - Sophie Dulac Distribution
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Au cinEma le 24 avril<br />
Editorial<br />
Contrairement à ce que son titre pourrait<br />
laisser penser, <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong><br />
n’est pas un biopic, ou biographie<br />
filmée. Le film de Margarethe Von Trotta<br />
se concentre en effet sur une période relativement<br />
courte de la carrière de la philosophe<br />
allemande naturalisée américaine :<br />
sa couverture, pour le compte du magazine<br />
américain The New Yorker, du procès<br />
à Jérusalem du criminel nazi Adolf<br />
Eichmann (1961), et ses conséquences.<br />
Une période courte, donc, mais ô<br />
combien passionnante et déterminante :<br />
c’est en observant le terne Eichmann, en<br />
écoutant sa défense, qu’<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong><br />
forge son concept de « banalité du mal ».<br />
Ce concept, aujourd’hui central dans<br />
la pensée du totalitarisme nazi, fut mal<br />
compris à l’époque. Il lui valut un déluge<br />
de critiques d’une rare violence, en Israël<br />
comme aux États-Unis, y compris de la<br />
part de ses amis et collègues…<br />
Véritable thriller intellectuel, le film de<br />
Margarethe Von Trotta raconte ces mois<br />
au cours desquels <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> (interprétée<br />
par l’actrice Barbara Sukowa) sut<br />
faire preuve d’une force morale à toute<br />
épreuve pour défendre sans compromission<br />
la complexité de sa pensée.<br />
Il constitue autant un hommage à une<br />
femme remarquable, qu’un hymne à la<br />
pensée.<br />
un Hymne a la pensÉe (Analyse)<br />
Habituellement, les films font d’un procès un<br />
événement dramatique voire paroxystique du<br />
scénario. En choisissant la période du procès<br />
d’Adolf Eichmann comme pilier de son film sur<br />
<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong>, Margarethe Von Trotta aurait<br />
pu nous faire suivre les débats au sein du tribunal,<br />
qui, finalement, prennent peu de place<br />
dans le long métrage. La réalisatrice allemande<br />
a préféré être fidèle à son personnage, en la plaçant<br />
au centre de l’intrigue, en dévoilant son<br />
quotidien, intimement, pour finalement la placer<br />
en pleine lumière dans un amphithéâtre. Ce<br />
n’est pas le procès Eichmann qui est l’enjeu du<br />
film, même s’il en est déclencheur, mais bien le<br />
procès intenté aux articles de la philosophe sur<br />
le procès Eichmann. Aussi, la cinéaste opte pour<br />
un final où <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> se défend face à ses<br />
élèves et ses confrères.<br />
Ce n’est pas simplement une leçon de théorie<br />
politique qu’elle assène. C’est une véritable plaidoirie<br />
pour justifier ses écrits dans le New Yorker,<br />
pour expliquer son processus de réflexion.<br />
Ce long monologue, filmé comme s’il avait lieu<br />
dans un tribunal, est un hymne à la pensée. En<br />
avocate de sa propre cause, <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> sait<br />
qu’elle ne convaincra pas ses collègues mais<br />
cherche à persuader la future élite du pays. En<br />
trois temps Von Trotta montre tour à tour des<br />
élèves conquis, des professeurs méprisants et<br />
<strong>Arendt</strong>, seule. Elle est sans doute moins isolée,<br />
mais elle est blessée.<br />
Le film souligne qu’elle a eu le courage de<br />
rompre avec son Maître, Heidegger, avec son<br />
pays, l’Allemagne, qu’elle est parvenue à mettre<br />
(suite de l’article en page 3)<br />
© Heimat films<br />
Document non contractuel.<br />
Sommaire<br />
p. 1 Éditorial<br />
Un hymne à la pensée (analyse)<br />
p. 2 Repères,<br />
Entretien avec Annabel Herzog<br />
p. 3 Un Hymne à la pensée (suite),<br />
Ressources<br />
p. 4 Questions à M. Von Trotta,<br />
Filmographie de M. Von Trotta,<br />
En ligne<br />
Un film de Margarethe Von Trotta<br />
avec Barbara Sukowa, Alex Milberg…<br />
France/Allemagne – 2012 – 1h50<br />
<strong>Distribution</strong> : <strong>Sophie</strong> <strong>Dulac</strong> <strong>Distribution</strong><br />
Au cinéma le 24 avril<br />
1961 - La philosophe juive allemande<br />
<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> est envoyée à Jérusalem par<br />
le New Yorker pour couvrir le procès d’Adolf<br />
Eichmann, responsable de la déportation<br />
de millions de Juifs. Les articles qu’elle<br />
publie, et sa théorie de «la banalité du mal»<br />
déclenchent une controverse sans précédent.<br />
Son obstination et l’exigence de sa pensée se<br />
heurtent à l’incompréhension de ses proches<br />
et provoquent son isolement.
2<br />
HANNAH ARENDT<br />
RepÈres<br />
1925<br />
© Heimat films<br />
ENTRETIEN : DR. ANNABEL HERZOG<br />
© Heimat films<br />
<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> rencontre Martin<br />
Heidegger, alors professeur à l’université<br />
protestante de Marbourg, dont elle<br />
sera l’élève et la maîtresse. Malgré leurs<br />
désaccords intellectuel et politique dans<br />
les années 30, elle témoignera en sa faveur<br />
lors de son procès en dénazification après<br />
la guerre.<br />
1933<br />
À 27 ans, <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> quitte l’Allemagne<br />
nazie pour la France où elle sera internée<br />
dans un camp en 1940. Elle s’enfuira et<br />
arrivera aux USA en 1941, où elle s’installe.<br />
1951<br />
Naturalisée américaine, <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong><br />
devient conférencière et professeur en<br />
philosophie politique dans plusieurs<br />
grandes universités du pays. Elle publie<br />
Les Origines du totalitarisme.<br />
1958<br />
Elle publie Condition de l’homme moderne.<br />
11 AVRIL 1961<br />
Début du procès à Jérusalem d’Adolf<br />
Eichmann, SS qui avait échappé à la justice<br />
après la capitulation allemande. Le procès<br />
dura 8 mois. Il est condamné à mort par<br />
pendaison le 31 mai 1962. Il est le seul civil<br />
à avoir été exécuté par Israël.<br />
1963<br />
Parution des articles de la philosophe dans<br />
le New Yorker puis publication de Eichmann<br />
à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal.<br />
© Heimat films<br />
© Heimat films<br />
« Elle voulait voir Eichmann<br />
de ses propres yeux. »<br />
Le Dr. Annabel Herzog est la repsonsable de la Division de la théorie politique et gouvernementale à<br />
l’École des sciences politiques de l’Université de Haïfa. Elle a obtenu son doctorat en philosophie politique<br />
de l’Université de Paris VII - Denis Diderot. Elle a étudié la théorie politique et des philosophes tels que<br />
Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida et <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong>. Parmi ses ouvrages publiés, elle a coordonné<br />
<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> : totalitarisme et banalité du mal (PUF, 2011).<br />
En quoi <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> était-elle une<br />
philosophe majeure à cette période ?<br />
<strong>Arendt</strong> avait écrit l’une des premières théories<br />
du totalitarisme (c’est-à-dire, une analyse des<br />
points communs entre nazisme et stalinisme)<br />
et son livre était considéré par beaucoup<br />
comme le meilleur sur le sujet. Son deuxième<br />
(chronologiquement) grand livre The Human<br />
Condition traite du politique en général, à une<br />
époque où le sujet était peu ou mal étudié<br />
(on considérait que le libéralisme d’un côté<br />
et le marxisme de l’autre avaient tout dit sur<br />
le sujet). Les deux livres lus ensemble (Origins<br />
of totalitarianism et Human Condition) offrent<br />
une analyse originale de la modernité et de<br />
ses risques de destruction du politique, et une<br />
redéfinition du politique comme domaine de<br />
la liberté et de l’innovation.<br />
Quelle était sa motivation pour assister au<br />
procès Eichmann ?<br />
Elle avait écrit l’ouvrage majeur sur le<br />
totalitarisme (et donc sur le nazisme) mais elle<br />
n’avait jamais vu « de près » les responsables<br />
du désastre. Elle voulait les entendre<br />
s’expliquer. Elle voulait voir ça de ses propres<br />
yeux et juger.<br />
Comment peut-on définir l’impact de son<br />
analyse du procès Eichmann ?<br />
Ce n’est pas son analyse du procès qui a<br />
changé quelque chose dans sa philosophie<br />
parce que son analyse n’est compréhensible<br />
que dans le cadre de sa philosophie et de ses<br />
catégories. Son analyse est un exemple, un<br />
cas particulier de sa philosophie. Elle a analysé<br />
Eichmann comme exemple et conséquence<br />
de la destruction du politique qu’a été, selon<br />
elle, le nazisme –destruction survenant au<br />
terme du vaste processus d’effondrement du<br />
politique qui a constitué la modernité.<br />
Dans le film, on l’entend dire que « Le pire<br />
mal est celui qui est accompli par des gens<br />
sans motifs, des gens banals. » Pouvez-vous<br />
préciser sa pensée ?<br />
Elle n’a pas exactement dit ça. La banalité<br />
du mal est humaine et n’est pas liée à<br />
l’absence de motifs mais à l’idéologie. Elle<br />
a dit qu’Eichmann n’avait pas de motifs<br />
personnels contre les Juifs. Cela ne veut pas<br />
dire qu’il n’avait pas de motifs. Il avait toute<br />
l’idéologie nazie comme motif, et ce n’est<br />
pas rien. Mais ces motifs ne provenaient<br />
pas de sa propre pensée, de son propre<br />
jugement. Dire que ce type d’attitude est<br />
banal signifie que l’attitude n’est pas fondée<br />
en raison –n’est pas profonde, argumentéemais<br />
provient de clichés et de préjugés. La<br />
banalité n’est pas l’absence d’importance<br />
ou l’absence d’humain, mais l’absence de<br />
raison, la superficialité de l’argument, les<br />
phrases toutes faites et les prétextes qui<br />
remplacent la pensée. Le problème et la force<br />
du totalitarisme est qu’il a réussi à détruire la<br />
pensée. Elle est très proche d’Orwell dans son<br />
roman 1984.
HANNAH ARENDT 3<br />
Dans le film, malgré la polémique violente<br />
qu’entraînent ses écrits sur le procès<br />
Eichmann, elle résiste au rejet de ses<br />
confrères, à l’opinion publique. Elle semble<br />
placer la pensée au dessus des émotions, de<br />
la politique.<br />
© Heimat films<br />
Elle voulait en effet mettre la pensée audessus<br />
des émotions, comme la plupart<br />
des philosophes. Elle était philosophe,<br />
pas journaliste ou publiciste. Elle n’a pas<br />
été vraiment incomprise. Les gens qui<br />
l’ont attaquée avaient certaines raisons<br />
idéologiques de le faire (et elle le savait très<br />
bien).<br />
Comment pourrait-on aujourd’hui définir<br />
l’impact et l’actualité de ses écrits, et<br />
notamment La banalité du mal ?<br />
H. <strong>Arendt</strong> est une des plus grandes<br />
philosophes politique du 20 ème siècle, peutêtre<br />
la plus grande. La banalité du mal n’est<br />
pas son concept le plus important. Son<br />
analyse de la modernité et de la politique<br />
comme action et liberté est de plus en plus<br />
actuelle.<br />
Pour finir, <strong>Arendt</strong> est indissociable<br />
d’Heidegger (mais décidant de rompre<br />
avec son Maître). Dans le film, on les voit<br />
ensemble puis rompre. Pouvez-vous<br />
nous expliquer en quoi cette rupture est<br />
fondamentale dans son œuvre ?<br />
Sa relation avec Heidegger a été maintes<br />
fois étudiée et souvent de façon ridicule. Ils<br />
étaient ensemble quand elle était étudiante<br />
et qu’il était son professeur, il lui a beaucoup<br />
appris, et ils se sont séparés parce qu’il était<br />
marié et qu’elle était son étudiante. Elle ne<br />
lui a jamais pardonné son « épisode » nazi,<br />
mais il avait été son grand amour et donc il<br />
a beaucoup compté pour elle, même après<br />
la guerre. Il y a de bons et gros livres, et des<br />
colloques sur l’influence de Heidegger sur ses<br />
écrits et sur ceux d’autres philosophes de la<br />
même époque.<br />
La pensée d’<strong>Arendt</strong> doit beaucoup<br />
à Heidegger, mais elle s’en éloigne<br />
radicalement à cause de l’engagement de<br />
Heidegger dans les années 30. Sa critique<br />
contre la philosophie heidéggerienne est une<br />
critique de sa non-résistance à la domination.<br />
Dans The Life of the Mind elle entre dans les<br />
détails de la philosophie de Heidegger et<br />
interprète sa non-résistance à la domination<br />
comme refus de la volonté, soit refus de<br />
l’origine de la liberté responsable. Et donc<br />
l’œuvre d’<strong>Arendt</strong> est à comprendre comme<br />
réponse à ce refus, et comme revalorisation<br />
de la liberté responsable notamment par<br />
l’action et la politique.<br />
Propos recueillis par Vincy Thomas<br />
un Hymne a la pensÉe<br />
Le film souligne qu’elle a eu le<br />
courage de rompre avec son<br />
Maître, Heidegger, avec son<br />
pays, l’Allemagne, qu’elle est<br />
parvenue à mettre de la<br />
distance avec Israël.<br />
tèmes totalitaires de l’Histoire. Privés de pensée,<br />
sans motifs particuliers, ils sont prisonniers du<br />
système pour lequel ils travaillent. Ce schéma<br />
est transposable encore actuellement, et pas<br />
uniquement dans le monde politique.<br />
De la même manière, la deuxième partie du film<br />
va démontrer que ses amis, en Israël ou à l’Université,<br />
sont prisonniers d’autres schémas, annihilant<br />
toutes formes de réflexions « neutres »<br />
ou au moins « distantes ». Chacun est « piégé »<br />
par ses dogmes : Israël se construit alors dans<br />
la douleur, et les différents procès contre les<br />
Nazis, Nuremberg en tête, sont là pour évacuer<br />
(SUITE article P.1)<br />
de la distance avec Israël. « Je n’aime que mes<br />
amis » dit-elle à un moment donné. Mais <strong>Arendt</strong><br />
constate aussi, avec le scandale que ses écrits<br />
provoquent, qu’elle a peu d’amis. Margarethe<br />
Von Trotta accentue le contraste entre la philosophe,<br />
luttant contre ses émotions, posée, libre,<br />
et des amis ou collègues, qui sont eux en proie à<br />
leurs passions et dépendants de leur passé.<br />
C’est une dialectique intéressante et enrichissante<br />
qui nous est alors proposée. Le procès<br />
d’Adolf Eichmann tout d’abord permet à <strong>Arendt</strong><br />
de concevoir sa théorie de la banalité du mal,<br />
où par absence d’idéologie, des hommes ordinaires<br />
vont devenir complices d’un des pires sysle<br />
mal et révéler les horreurs du IIIe Reich. Dans<br />
tous les cas, au début des années 60, il n’est pas<br />
concevable d’atténuer les monstruosités d’un<br />
homme, un SS, en le déresponsabilisant partiellement<br />
sous prétexte qu’il n’obéissait qu’à<br />
un système.<br />
En voulant réfléchir aux racines du « Mal »,<br />
<strong>Arendt</strong> a provoqué ses amis, qu’ils soient Juifs<br />
ou intellectuels, en les confrontant à une vérité<br />
: leur pensée est subjective tant qu’ils ne se<br />
débarrassent pas de leurs idéologies formatées,<br />
imposées par leur époque.<br />
Car il n’y a pas d’ambivalence sur son discours :<br />
elle explique bien que le pire mal est celui qui<br />
est accompli par des individus incapables de<br />
penser sans « motifs » réels. La monstruosité<br />
se double d’une forme d’immoralité. L’Histoire<br />
lui donnera raison tant <strong>Arendt</strong> est aujourd’hui<br />
considérée comme l’une des plus grandes intellectuelles<br />
du XX ème siècle. La philosophe, et le<br />
film insiste avec justesse sur ce point, souhaitait<br />
éclairer notre monde sur le chaos « moral »<br />
qui y régnait et qui y règne toujours ; elle voulait<br />
propager son goût pour le libre arbitre. C’est ce<br />
qu’elle fait passer comme message à ses élèves,<br />
qui ne sont pas encore enfermés dans des théories<br />
et des doctrines.<br />
Margarethe Von Trotta fait l’éloge d’une femme<br />
dont l’indépendance (intellectuelle) prime<br />
par dessus tout, comme s’il s’agissait du seul<br />
moyen de résister au totalitarisme et à la banalité<br />
du mal. A ce titre <strong>Arendt</strong> est l’exact opposé<br />
d’un Eichmann ou plus généralement d’une<br />
pensée unique. La réalisatrice souligne par la<br />
même occasion le coût affectif et le sacrifice<br />
humain que représente cette indépendance.<br />
Vincy Thomas, février 2013<br />
RESSOURCES<br />
FILMS<br />
Un spécialiste, portrait d’un criminel moderne, documentaire d’Eyal Sivan et<br />
Rony Brauman (éd. Montparnasse). Film réalisé à partir de 350 heures d’images<br />
d’archives.<br />
Eichmann, fiction de Robert Young (2007). Le scénario est basé sur le déroulé<br />
du procès et les notes prises pendant les interrogatoires d’Eichmann durant<br />
sa détention en Israël.<br />
Livres<br />
Le cas Eichmann : vu de Jérusalem, de Claude Klein (Gallimard, coll. « La suite<br />
des temps », 2012). Etude consacrée au procès Eichmann, au jugement et aux<br />
polémiques qui en ont découlé.<br />
<strong>Arendt</strong> et Heidegger : le destin du politique, de Dana R. Villa (Payot, 2008). Etude<br />
de la théorie de l’action politique de <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> à travers l’influence de la<br />
pensée politique aristotélicienne et sa déconstruction heideggérienne.<br />
<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> : biographie, de Elisabeth Young-Bruchi (éditions Pluriel, 1986).
4<br />
HANNAH ARENDT<br />
QUESTIONS à MARGARETHE VON TROTTA<br />
« Comment regarder une femme dont<br />
l’activité principale est la pensée ? »<br />
Qu’est-ce qui vous a enthousiasmé<br />
concernant <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> ?<br />
La problématique de la réalisation d’un film<br />
sur une philosophe. Comment regarder<br />
une femme dont l’activité principale est la<br />
pensée. J’ai bien évidemment eu peur de<br />
ne pas lui rendre justice. La représentation<br />
cinématographique a donc été bien plus<br />
complexe que celle de Rosa Luxemburg,<br />
notamment. Ces deux femmes étaient<br />
extrêmement intelligentes, dotées d’une<br />
forte personnalité, capables de relations<br />
amicales et amoureuses et toutes deux<br />
intellectuelles, provocant tant par la pensée<br />
que par le verbe. La vie d’<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong><br />
n’a pas été aussi dramatique que celle de<br />
Rosa Luxemburg – elle n’en a pas moins été<br />
importante et touchante.<br />
© Heimat films<br />
Pourquoi avez-vous choisi de centrer le film<br />
sur le procès Eichmann de 1961 ?<br />
Nous voulions raconter l’histoire d’<strong>Hannah</strong><br />
<strong>Arendt</strong> sans réduire l’importance de sa vie et<br />
de son œuvre, sans pour autant avoir recours<br />
à la biographie tentaculaire classique. Après<br />
avoir soupesé toutes les options, l’idée de<br />
se focaliser sur les quatre années pendant<br />
lesquelles elle a travaillé sur le rapport et sur<br />
le livre Eichmann s’est imposée comme une<br />
évidence pour dépeindre au mieux la femme<br />
et son œuvre. La confrontation entre <strong>Hannah</strong><br />
<strong>Arendt</strong> et Adolf Eichmann nous a permis non<br />
seulement de mettre en exergue le contraste<br />
inouï entre ces deux personnages, mais aussi<br />
de mieux comprendre les années sombres de<br />
l’Europe du 20ème siècle. <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> a fait<br />
la fameuse déclaration suivante, « Personne n’a<br />
le droit d’obéir ». Avec son refus catégorique<br />
d’obéir à quoi que ce soit d’autre que ses<br />
propres connaissances et convictions, elle ne<br />
pouvait être plus différente d’Eichmann que<br />
quiconque.<br />
Vous avez pu rendre de manière précise le<br />
personnage “non-pensant” d’Eichmann par<br />
les images d’archives en noir et blanc du<br />
procès.<br />
On ne peut montrer la vraie « banalité du<br />
mal » qu’en observant le vrai Eichmann. Un<br />
acteur ne peut que déformer l’image, en<br />
aucun cas il ne pourrait la préciser. En tant que<br />
spectateur, on pourrait admirer la grandeur<br />
d’interprétation de l’acteur mais ce serait<br />
au détriment de la médiocrité d’Eichmann.<br />
Eichmann était incapable de formuler ne<br />
serait-ce qu’une phrase grammaticalement<br />
correcte. Il était incapable de penser de façon<br />
sensée à ce qu’il faisait et cela transparaissait<br />
dans sa façon de parler. Il n’y a qu’une scène<br />
avec Barbara Sukowa qui a vraiment lieu dans<br />
la salle d’audience et dans ce cas précis, parce<br />
qu’il fallait avoir recours à un acteur, on ne<br />
voit Eichmann que de dos. Nous avons filmé<br />
toutes les autres scènes de la salle d’audience<br />
dans la salle de presse, là où le procès était<br />
en fait retransmis sur plusieurs moniteurs.<br />
De cette façon, nous avons pu utiliser le<br />
vrai Eichmann, par le biais de séquences<br />
d’archives pour tous les moments clé.<br />
Vous terminez le film par un disours<br />
d’<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> de plus de huit minutes,<br />
véritable morceau de bravoure pour<br />
l’actrice. Pourquoi ce choix audacieux ?<br />
De nombreuses personnes pensaient qu’un<br />
film sur <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong> devait s’ouvrir<br />
sur un discours. Or, il commence par une<br />
conversation entre amies qui parlent de leur<br />
mari. Nous voulions que le discours final<br />
incarne le moment où le public comprend les<br />
conclusions mises en évidence par la pensée<br />
d’<strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong>.<br />
Ce n’est qu’après l’avoir vu se forger un avis<br />
sur le personnage d’Eichmann et vu les<br />
nombreuses attaques tellement virulentes et<br />
bien souvent injustifiées dont elle a fait l’objet<br />
que l’on a envie de l’écouter si longuement. Le<br />
charme de sa personnalité et de sa pensée a<br />
d’ores et déjà opéré.<br />
Margarethe Von Trotta<br />
Filmographie sélective<br />
1975 : L’Honneur perdu de Katharina<br />
Blum (Die Verlorene Ehre der<br />
Katharina Blum oder: Wie Gewalt<br />
entstehen und wohin sie führen kann)<br />
1981 : Les Années de plomb<br />
(Die Bleierne Zeit)<br />
1986 : Rosa Luxemburg<br />
(Die Geduld der Rosa Luxemburg)<br />
1995 : Les Années du mur<br />
(Das Versprechen)<br />
2003 : Rosenstrasse<br />
2006 : Je suis l’autre (Ich bin die Andere)<br />
2009 : Vision - Aus dem Leben der<br />
Hildegard von Bingen<br />
2012 : <strong>Hannah</strong> <strong>Arendt</strong><br />
© Manfred Breuersbrock<br />
En ligne : le site pédagogique du film<br />
Enseignants, retrouvez un dossier pédagogique en ligne<br />
(Histoire, Philosophie, Allemand) sur le site Zérodeconduite.net :<br />
www.zerodeconduite.net/hannaharendt<br />
Ce document vous est proposé par :<br />
Zéro de conduite .net<br />
Lʼactualité éducative du cinéma