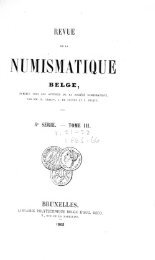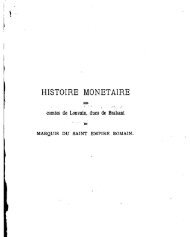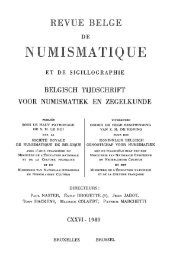PDF Printing 600 dpi
PDF Printing 600 dpi
PDF Printing 600 dpi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
REVUE BELGE<br />
DE.<br />
NUMISMATIOUE<br />
ET DE SIGILLOGRAPHIE<br />
PUButE.<br />
SOUS lES AUSPICES DE LA SOCIÊTÊ ROYALE DE NUMISMATIOllE<br />
AVEC LE CONCOURS DU GOUVERNEMENT<br />
DIRECTEURS:<br />
MM. VICTOR TOURNEUR, MARCEL HOC<br />
ET PAUL NASTER<br />
1951<br />
TOME QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME<br />
BRUXELLES<br />
5. RUE DU MUSÉE<br />
1951
MÉLANGES<br />
N otes el Documents<br />
A propos des coins des :monnaies d'Ainos. - Tons ceux qui<br />
se sont livrés à des travaux de comparaison de coins monétaires<br />
d'après les pièces qui en sont issues ont rencontré de grandes difficuItés<br />
et des doutes. A la suite d'échanges de vues, l'auteur du<br />
livre Ainos, ils Hisiory and Coinaqe, 474-·341 B. C. et l'auteur du<br />
compte rendu paru dans le tome précédent de cette revue, p. 231-233,<br />
sont en mesure de présenter quelques mises au point au sujet de<br />
certaines identifications de coins qui avaient été proposées.<br />
AB, nOS 13, 14 et 16: il n'y a certainement qu'un seul coin; les<br />
mesures qu'on peut prendre sur le nO 14 induisent en erreur, parce<br />
que cette représentation est très légèrement agrandie.<br />
A30, nOS 50 et 51 : deux coins différents.<br />
A166, nOS 269 et 270 : deux coins.<br />
A206, n0 8 331 et 341, et A206jl, nv 342: fort probablement un<br />
seul coin, qui a été retravaillé pour 342; les différences sont dues à<br />
des défauts de frappe et au degré d'usure respectif des pièces.<br />
A 226, TIos 365, 367 à 369 et 366 : un seul coin; le TI0 366 est reproduit<br />
d'après un moulage de moulage, ce qui en a assez fort altéré<br />
l'aspect.<br />
A228, nOS 371 et :n2: probablement un seul coin; pour en avoir<br />
le cœur net il faudrait pouvoir comparer les exemplaires eux-mêmes.<br />
A252, nOS 418 à 420, et A 253, nO 421 : certainement deux coins<br />
différents.<br />
J. M. F. MAyet P. NASTER.<br />
Contorniates à La Haye. Mme A. N. Zadoks-Josephus .Iitta,<br />
attachée au Cabinet des Médailles à La Haye, a publié dans Mnemosyne,<br />
s. IV, IV, 1951, p. 81-92, les contorniates de cette institution.<br />
C'est une collection assez importante, puisqu'elle groupe 47 numéros,<br />
dont plusieurs proviennent de la collection Six, acquise en 1901.<br />
L'auteur, tout en suivant la classification d'Alfôldi, n'admet pas sa<br />
thèse concernant le caractère anti-chrétien de ces pièces. Elle les<br />
considère comme des monuments à caractère festival destinés à<br />
-servir de présents entre personnes de classe-moyenne; leur fabrication<br />
doit avoir été entreprise par des firmes commerciales privées,<br />
et non par les ateliers de monnaies. P. N.
158 MÉLANGES<br />
Numismatique celtique. - Sous le titre Dm Kelliska mynl och<br />
antik historia (Fornuânnen, h. 1-2, 1951, p. 1-20, 137-158), traduit<br />
par l'auteur lui-même Sur les monnaies celtiques et l'histoire du monnayage<br />
ancien, M. Carl-Axel MOBERG a publié le texte d'une conférence<br />
donnée, à Stockholm, le 28 mars 1950, devant une assernbl ée de<br />
numismates et d'humanistes. Il le fait suivre d'une analyse en<br />
langue française, qui facilite, est-il besoin de le dire, considérablement<br />
notre compréhension.<br />
M. Moberg reproche à la science de la numismatique dite, souvent<br />
très improprement, celtique, ses principales insuffisances et son impuissance<br />
à contribuer à l'établissement de sources historiques.<br />
La chronologie du monnayage de la Gaule, en particulier, se détermine<br />
par le terminus post quem de l'hégémonie monétaire romaine,<br />
qui n'a suivi que d'assez loin sans doute la conquête, à une date imprécise.<br />
Quant à ses commencements, les savants confrontent des<br />
points de vue contradictoires.<br />
Le médiocre crédit, que M. Moherg accorde aux tentatives d'attribution<br />
des monnaies propres aux cités gauloises nommées par César,<br />
témoigne d'un scepticisme qui me paraît un peu périmé et imprudent;<br />
mais on doit louer la vaste érudition de l'auteur, à qui l'on<br />
peut savoir gré d'avoir fait le point sur les débats, sans prétendre<br />
verser lui-même quelque pièce nouvelle au dossier.<br />
J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.<br />
Vente d'une collection de monnaies de Brabant. - Notre<br />
ancien confrère M. Johannes J. Verdebout, originaire de nos régions<br />
flamandes, a vendu la belle collection de monnaies brabançonnes<br />
qu'il avait réunie (National American Numismatic Association Convention,<br />
Auction Sale, Hotel Schroeder, Milwaukee, Wisconsin, 25<br />
29 août 1950, nOS 538-644). La plupart des numéraires depuis l'époque<br />
mérovingienne jusqu'au XIX e siècle y sont représentés dans une<br />
certaine mesure. On y rencontre 25 pièces en or, 147 en argent et<br />
156 en cuivre. Les indications de James Kelly, l'auteur du catalogue,<br />
et les nombreuses illustrations montrent jusqu'à quel point cette<br />
collection avait été réunie avec goût et sévérité dans le choix des<br />
exemplaires, dont plusieurs sont rares. M. Verdebout possède encore<br />
une collection non moins intéressante de monnaies flamandes.<br />
Si de celle-ci le sort est également d'être vendue, il est à souhaiter<br />
que les amateurs belges puissent en être avertis. P. N.<br />
Une :m.édai.lle inédite de Notre-Dam.e de Tongre. - Nous<br />
avons présenté à l'assemblée générale tenue à Ath, le 29 juin 1947,<br />
une médaille faisant partie de notre collection. Voici sa description:<br />
Dans un encadrement ovale - en argent doré - composé d'une<br />
couronne de feuilles de laurier surmontée d'un nœud de ruban dans<br />
lequel passe un anneau'formant bélière, deux plaques estampées<br />
en argent. Ces plaques représentent, au droit: Notre-Dame de<br />
Tongre couronnée et entourée de nuages et de six. têtes d'anges ai-
NOTES ET DOCUMENTS 159<br />
Iées ; au revers: monogramme couronné de la Sainte Vierge, en bas<br />
un cœur enflammé transpercé d'un glaive.<br />
Médaille ovale, 50 x 32 mm.<br />
Le même revers se retrouve sur la médaille décrite par M. Hoc sous<br />
le nO 4 (RBN, 1931 p. 59 et pl. IV, 4). Celle-ci est attribuée au XVIIe<br />
siècle. L'encadrement de la nôtre, qui est de style Louis XVI, nous<br />
la fait classer au XVIIIe siècle. Rappelons (Histoire de Notre-Dame de<br />
Tongre ... , Tournai, Casterman, 1842, In-I Sv, p. 89 et 93) qu' dès 1777<br />
on procéda à la reconstruction du sanctuaire, que le pape Pie VI<br />
par une bulle datée du 9 novembre 1780 y érigea une confrérie sous<br />
le titre de la Bienheureuse Vierge Marie Immaculée, qu'un bref daté<br />
du 20 novembre de la même année accorda une indulgence plénière<br />
en forme de Jubilé. C'est en effet le 2 février 1781 que fut fêté le<br />
septième centenaire du pèlerinage de Notre-Dame de Tongre. Serait-ce<br />
à l'occasion d'un de ces événements importants que notre<br />
médaille, plus fiche que celles déjà publiées, aurait été fabriquée?<br />
Ajoutons à titre documentaire que la vignette reproduite RBN,<br />
1931, p. 60 porte un écu losangé aux armes d'Ongnies (de sinople à<br />
la fasce d'hermines) vraisemblablement de mademoiselle Antoinette<br />
d'O gnies, comtesse de Villervalle, dame de Tongre-Notre-Dame en<br />
1651. .Iean-C. JADOT.<br />
Ville de Verviers - Médaille du Tricentenaire (1651-1951). <br />
La ville de Verviers célèbre en l'année 1951 le troisième centenaire<br />
de son admission au rang des « Bonnes Villes 1) de l'ancienne Principauté<br />
de Liège.<br />
Jusqu'à cette époque (1651), le bourg de Verviers, muni d'une industrie<br />
textile florissante, soldait de lourds impôts (ad valorem)<br />
à la mense épiscopale Iiègeoise sans cependant être admis à l'organisme<br />
qui en déterminait les bases.
160 MÉLANGES<br />
En effet, le pouvoir législatif de la Principautét et en particulier<br />
la fixation officielle des impôts, dépendait exclusivement de. la volonté<br />
des trois États qui devaient les décréter d'un vote unanime.<br />
Ces trois États comprenaient: le chapitre cathédral ou Ordre<br />
Primaire, composé des soixante chanoines tréfonciers de Saint-Lambert;<br />
l'Ordre Equestre, réunissant les nobles du pays possédant un<br />
certain nombre de quartiers, et, enfin, le Tiers-État, comprenant la<br />
(l représentation I} des bourgmestres des vingt-deux Bonnes Villes de<br />
la Principauté liègeoise.<br />
Après de nombreuses et successives démarches opérées auprès du<br />
prince Ferdinand de Bavière, son successeur immédiat et neveu,<br />
Maximilien-Henri, électeur de Cologne et prince-évêque de Liège,<br />
répondit enfin, le quatre décembre mil six cent cinquante et un,<br />
à la demande des Verviétois, désirant vivement voir le chef de leur<br />
municipalité participer aux délibérations du Tiers-État. Dorénavant,<br />
le bourgmestre de la Ville de Verviers aura voix délibérative au<br />
troisième Ordre de l'État épiscopal au même titre que les Maires des<br />
vingt-deux autres «Bonnes \ illes 1) pour décider l'assiette et l'importance<br />
de toutes les taxes fiscales à percevoir.<br />
Pour devenir une « ville », au sens archaïque du mot, il fallait<br />
d'ailleurs que des fortifications militaires soient spécialement aménagées<br />
autour de la cité. C'est pour cela qu'un mur d'enceinte fut<br />
construit à ce moment, avec ses diverses portes, pour donner accès<br />
à l'agglomération: portes de Heusy, d'Ensival, de Sommeleville,<br />
etc....<br />
La médaille commémorative, célébrant le tricentenaire de cette<br />
admission, est due au talent du médailleur bien connu M. Armand<br />
Bonnetain et les devises latines doivent leur rédaction à la grande<br />
érudition de M. V. Tourneur, secrétaire perpétuel de l'Académie<br />
royale cle Belgique.<br />
j<br />
1
TROUVAILLES 161<br />
Le droit porte l'effigie du prince-évêque Maximilien-Henri de<br />
Bavière, avec la devise (latine): En l'année 1651, Maximilien-Henri<br />
prince et évêque de Liège, changea le Bourg de Verviers en Ville:·<br />
Villam Verviam Urbem instituit.<br />
Le revers porte en son milieu: l'hôtel de vîlle de Verviers, construit<br />
par l'architecte liégeois Barth. Renoz en 1775, avec, au devant,<br />
le Perron, dominant une fontaine, érigé en 1732, qui remplaçait<br />
d'ailleurs un autre emblème de ce genre dont on n'a pas conservé<br />
le souvenir. On sait que le Perron était la représentation symbolique<br />
des « libertés liègeoises l) et qu'il se trouvait érigé dans toutes les<br />
bourgades principales constituant les Bans de la Principauté.<br />
La devise latine rappelle l'anniversaire: (1 post tria saecula, non<br />
veterior, clare vlresclt 1951 1). « Après trois siècles, sans ressentir le<br />
poids de l'âge, la Cité reverdit brillamment. J) Il Y a là Ulle allusion,<br />
une paraphrase du vieil adage (1 vert et vieux f} que l'on attribue,<br />
faussement d'ailleurs, à la ville de Verviers, mais qui est de tradition.....<br />
A remarquer: les glands et les feuilles de chêne servant de tirets<br />
ct qui constituent les « meubles 1) de l'écu de la ville de Verviers.<br />
Xavier JANNE D'OTHÉE.<br />
Trouvailles<br />
Trouvaille de sesterces à Froidmont (1949). - Un ouvrier a<br />
trouvé, probablement en 1949, un trésor de bronzes romains à une<br />
profondeur de 30 à 40 cm dans une cour d'usine à Froidmont près<br />
de Tournai. Les pièces avaient été enfouies sous de grosses pierres,<br />
dans un coffret de fer, qui n'a laissé que des traces. Ces bronzes sont<br />
au nombre de 140 ; la -plupart, 130 au moins, sont des sesterces. les<br />
autres des dupondii. Ils sont très fort usés par le frai. J'ai encore<br />
vu quelques pièces dans leur gangue épaisse et résistante d'oxydation.<br />
La plupart avaient pourtant déjà été nettoyées par l'inventeur;<br />
le résultat obtenu est très satisfaisant et même meilleur que<br />
celui que j'ai obtenu par des procédés apparemment moins brutaux.<br />
L'ouvrier les avait jetées dans du vinaigre bouillant où il<br />
les a laissées ensuite pendant deux jours sans entretenir la température,<br />
après quoi il les a frottées de laine de fer, tandis que j'ai réduit<br />
les oxydes et sels de cuivre dans un bain de soude caustique et des<br />
granules de zinc en opérant à 45° (v. p. 81).<br />
Si la plupart des pièces peuvent bien être attribuées au règne de<br />
tel ou tel empereur, il est en général devenu impossible de les identifier<br />
exactement. Malgré les notes plus détaillées que j'ai pu prendre,<br />
je me limite ici à un inventaire très sommaire,parce qu'il serait oiseux<br />
de donner des descriptions plus longues ou des renvois à des ou-<br />
REV. BELGE DE NUl\'L, 1951. - 11.
162 MJ~LANGES<br />
vrages de référence, lorsqu'on n'est pas certain de reconnaître les<br />
types ou les légendes. Sauf indication contraîre, la tête est à dr.<br />
1. - 19 g 64.<br />
VESPASIEN (69-70) (1 ou 2 pièces) :<br />
TITUS (79-81) (probablement,sinon Vespasien) (1 ou aucune pièce) :<br />
2. - 18.81.<br />
DOMITIEN (81-96) (5 pièces) :<br />
3-6. 17.84, 20.18, 22.50, 27.25.<br />
7. Probablement un dupondius. 1;").1 (L<br />
NERVA (96-98) (4 pièces) : .<br />
8. ~. FORTVNA AYGVST. Fortune debout à<br />
corne d'abondance. 21.99.<br />
9-10.· 20.65, 23.03.<br />
11. Tête à g. 18.05.<br />
cr<br />
1:>' ,<br />
• [gouvernail] ;<br />
TRAJAN (98-117) (11 pièces):<br />
12-18. - 20.46, 20.82, 21.82, 22.00, 22.14, 22.83, 24.31.<br />
19. Au droit, contremarque en petits losanges sur la chevelure de<br />
l'empereur. 22.76.<br />
20-22. Probablement de Trajan. 21.12, 22.01, 23.20.<br />
HADRIEN (117-138) (51 pièces) :<br />
2:j. [HADRIA}ANVS AV{GVSTVS]; R;7. [ADVENTVS J, 2 personnages.<br />
24.29. Cohen, 81.<br />
24. ~. Afrique couchée. 25.66. C., 142.<br />
25. R;7. Clémence. 25.28. C., 509.<br />
26. R,"'. Félicité (?). 21.77. f. C., 623.<br />
27. ~. [F]OHT[VNA J, Fortune à g. ; gouvernail; corne dahondance.<br />
22.21. C. 770, 772.<br />
28-29. Probablement id. 24.57, 26.29.<br />
30. R7. Hilaritas : enfant et palme à g. ; à dr., enfant. A l'exergue,<br />
[COlS III. 26.28. C., 817.<br />
31. TR]AIANVS HAD [ ]. ~. [IOVI CVSTODI] (?).<br />
22.41. C., 861 (pour le revers).<br />
32. R;. Liberalîté (1). 21.34. C" 922.<br />
33. R7. M[ONETA]. 23.36. C., 968.<br />
34-39. ~. Rome casquée assise à g. 20.44, 21.15, 21.68,21.79,23.02,<br />
23.46. C., 342.<br />
40-41. Probablement id. 21.08, 23.13.<br />
42. RJ. Victoire à dr. 23.95.<br />
43-59. ~. Figure féminine, types variés et peu reconnaissables.<br />
19.06, 20.39, 20.70, 20.87, 20.93, 21.02, 21.10, 21.16,21.54,<br />
22.27, 22.67, 22.88, 23.16, 24.13, 24.30", 24.48, 26.75.
'l'ROUVAILLES 163<br />
60-64. RJ. Deux personnages long-vêtus se faisant face. 20.44, 21.00,<br />
21.01, 23.28, 25.33.<br />
65. ~. Cavalier à g. 18.47.<br />
66-67. RJ. Aucun type reconnaissable. 19.44, 22.33.<br />
68. Probablement Hadrien; RI. id. 23.17.<br />
69. Id.; R;1. Neptune à g., le pied droit levé posé sur un socle. 21.85.<br />
70-73. Dupondii: RI. inidentifiable. 8.91, 9.17, 10.95, 14.21.<br />
Ptèceindéterrninée du 1 er siècle ou du début du He (1 pièce) :<br />
74. - 17.87.<br />
ANTONIN LE PIEUX (138-161) (15 pièces) :<br />
7.5. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III j RJ. SECVRITAS<br />
AVG. 26.22. C., 780.<br />
76. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI; RJ'. S[ALVS AVG<br />
COS HII]. 24.36. C., 732.<br />
77. Id .... PI [ ) ; RI. [SALlVS AVG CrOS mn. 23.22. C., 728 ou<br />
732.<br />
78. Id.... TR P XVII; Ri'. INDVLGENTIA AVG COS IIII. 23.79.<br />
C.,454.<br />
79. Id...... XVI ou XVII ou XVIII; RJ. Id. 20.37. C., 452 ou 454<br />
ou 456.<br />
80. ANTONINVS AVG PIVS P P [ ]; RJ'. [TR POjT XX (COS<br />
IIII]. 23.48. C., 1008.<br />
81. Id TR P XXII; R1. Petit temple. 23.82. C., 332.<br />
82. Id TR P XXIII; R;7. [PI]ETA[TI AVGj COS [IIIl]. 20.25<br />
C., 621.<br />
83. [ANTONINV]S AVG PIVS [ ]; Rf. PRO[VIDENTIAE<br />
DEOR]VM, foudre. 24.86. C., 682.<br />
84. [ ]VG PIVe ]; ~. Annone. 22.17. Cf. BMC, IV, pl. 28,<br />
1 et 44, 2.<br />
85. ANTONINVSAVG P[ 1; R;1. Louve allaitant les jumeaux.<br />
20.11 Cf. C., 917.<br />
86. RJ. Salus (1). 25.41.<br />
87. [ ]NINVS [ ] ; RJ. Figure féminine à g. faisant une libation<br />
j à g., autel. 21.59.<br />
88. Traces. 18.60.<br />
89. Dupondius. R;7. comme au nO 87. -14.57.<br />
FAUSTINE<br />
(9 pièces):<br />
90. ~. AETERNITAS. 22.73. C., 15, 17, 19 ou 20.<br />
91-92. R;7. Personnage féminin assis à g. sur un trône; globe; sceptre.<br />
19.77, 20.11.<br />
93-98. Légende DIVA FAVSTINA chaque fois partiellement conservée;<br />
R;1. Figure féminine, types variés et non reconnaissables.<br />
18.18, 21.17, 21.76, 32.70, 33.05, 34.52.
164 MÉLANGES<br />
MARC AURÈLE, césar (13~-161) (3 pièces) :<br />
99. [ ]LIVS CAE[ ]; R;7. I-IONOS. 22.45. C., 237.<br />
100. AVRELIVS CAESAR AVG PII FIL; Rj'. Probablement [TH<br />
POT I1( ?)CJOS II, figure féminine de face, la tète ,ù dr.,<br />
deux épis dans la main g. 22.55. C., 603 ou 614.<br />
101. [ lM AVRELIVS A[ ]; Rj'. Figure féminine de face.<br />
19.32.<br />
In., empereur (161-180) (6 pièces) :<br />
102. ]ANTON[]; l~. Moneta ou Justitia. 22.17.<br />
1Ô3. M ANTONI[NVS ]; l~. Home casquée assise à g. sur un<br />
trône; un bouclier contre le pied du trône; une lance dans<br />
la main gauche levée. 25,42.<br />
104. R;7. Victoire à dr.; à dr., sur lm tronc, bouclier avec [VIC] 1<br />
PA[R]. 17.52. Cf. BMC, IV, pl. 79, 6 et SO, 3 (sur la pièce<br />
on dirait pourtant que le personnage du revers a le torse<br />
drapé).<br />
105. [ lM AVREL ANTON [ ]; Rj'. Figure féminine ù<br />
g., faisant une offrande au-dessus d'un autel allumé.T'avantbras<br />
g. le long du corps. 23.15.<br />
106. R;7., Id., main g. levée. 18,45.<br />
107. Rj'. Personnage féminin allant à g., un sceptre ou une torche<br />
dans la main g. 24.21.<br />
FAUSTINE, la jeune (11 pièces) :<br />
108. FAVSTINA AVGVSTA; Rj'. DIANA LUCIF. 20.45. C., 86.<br />
109. [FAVSTINA] AVGVSTA; R,7. FECYNDITAS. 19.85. C., 100.<br />
110. FAVSTINA AV[GVSTA]; RJ. [IVNONI HEGINAE]. 23.41.<br />
C., 142.<br />
111. FAVSTINA AVGVSTA; RJ. [MATHI MAGNAEI. 17.96. C.,<br />
169.<br />
112. FAVSTINA A VG PlI [ ]; Rj'. Diane. 21.09. C., 206.<br />
113. FAVSTINA AVGVSTA; R;i'. Personnage assis à g., un sceptre<br />
dans le bras g. 21.28.<br />
114-115. R;7. Personnage féminin assis à g. sur un trône, une corne<br />
d'abondance dans le bras g. 20.94, 23.34.<br />
116. R;i'. Figure féminine debout, une torche (?) dans la main g.<br />
23.10.<br />
117. [FAVSTI]NAE AVG ANTONI[NI PlI FIL]; R;i'. Figure féminine<br />
debout, le bras g. levé. 23.53.<br />
118. Dupondius, FAVSTINA AVGVSTA; R;7. Figure féminine à g.<br />
15.34.<br />
COMMODE (176-192) (8 pièces) :<br />
119. L AVREL COMMODVS [ ] ; Jupiter nicéphore assis à g.<br />
sur un trône; sceptre. 22.45.<br />
120. Peut-être un dupondius. RJ. [P M TR P VIIn IMP VI COS
TROUVAILLES 165<br />
JIll P P] ou bien [TR P VIII IMP VI COS IIII P Pl, Minerve<br />
courant à dr., main dl'. levée; bouclier. 14.95. C.,<br />
425 ou 881; RIC, III, p. 413, 400 ou p. 410, 368 a, b.<br />
121. L AVREL COMMODVS AVG [ J; RJ. Minerve casquée<br />
à g., main dl'. tendue en avant, main g. posée sur son bouclier;<br />
à g., thymiatérlon (?). 24.53.<br />
122. ~. [P M TR P XI IMP VII COS IIU P PJ, à l'exergue, [CONC<br />
MILl, Concorde tenant deux étendards. 16.09. C., 54-58.<br />
12:~. [ COM]MODVS ANT[ ] ; lÇ. Probablement fP M TR<br />
P XIII IMP] VIII C[OS V P Pl. à l'exergue; FOR [RED].<br />
personnage assis à g., dans le bras g., corne d'abondance.<br />
16.56. C., 153.<br />
124. M AVREL [ 1 FELIX AVG BRrT; Rj'. Figure féminine<br />
de face. 18.32.<br />
125. Sous Commode. DIVVS M ANTONrN[VS PIVS1; R;1. Indéchiffrable.<br />
19.13.<br />
126. Dupondius. RJ. Victoire allant à dl'. ; à dr., sur un tronc, bouclier<br />
13.78.<br />
Probablement COMMODE (3 pièces) :<br />
127. RJ. Figure à g., faisant une libation au-dessus d'un autel. 16.07.<br />
128. R]. Figure féminine à g. ; corne d'abondance. 15.60.<br />
129. Dupondius, R]. Probablement: LIBER[ALITAS VII P M TR<br />
P XV IMP VIII COS VI], Libéralité à g. ; tessère; corne<br />
d'abondance. 14.47. C., 320.<br />
MARC AURÈLE OU COMMODE (5 pièces) :<br />
130-132. ~. Figure féminine â g.<br />
133-134. - 20.14, 21.66.<br />
UN ANTONIN (1 pièce) :<br />
135. R]. Personnage féminin à g. ; corne d'abondance. 15.24.<br />
136. [ ] INA[<br />
23.87.<br />
CRI8PINE (1 pièce):<br />
J; Rf· Personnage féminin (Salus?) assis à g.<br />
MACRIN (217-218) (1 pièce):<br />
.137. IMP CAES M OPEL SEV MA[CRI]NV[S AVG]; Rf. SECVRI<br />
TAS TEM[PORJVM, Sécurité de face, la tête à g., les jambes<br />
croisées, accoudée à une colonne basse. 21.43. C., 123,<br />
Pièces non attribuées (3):<br />
138-139. 17.68, 20.91.<br />
140. 1 sesterce laissé dans l'état original. 19.72.<br />
Le moment d'enfouissement de ce trésor est daté par le sesterce<br />
de Macrin (137) et se situe pendant ce règne on peu ap l'ès, vers 220.
166 MÉLANGES<br />
Cette pièce clef est la seule qui soit dans un état de conservation<br />
assez satisfaisant. Il est pourtant étonnant que les successeurs de<br />
Commode ne soient pas représentés, de sorte que 25 à 30 années<br />
d'émissions, de 192 au moins jusqu'au jour d'enfouissement, n'auraient<br />
laissé aucun témoin dans cet ensemble dont la pièce de Macrin<br />
fait bien partie.<br />
II n'est certes pas sans intérêt d'attirer l'attention sur le fait que<br />
les sesterces circulaient très longtemps, même quand leurs types<br />
étaient déjà presque entièrement effacés. L'abondance et le succès<br />
de ceux d'Hadrien ont été particulièrement grands puisqu'une cinquantaine<br />
de pièces sont de cet empereur. Plus de la moitié des<br />
pièces signalées sont des monnaies d'Hadrien ou antérieures à lui.<br />
Nous devons regretter que l'incertitude subsiste au sujet de l'endroit<br />
précis de la découverte et de la composition du trésor. Ainsi<br />
cette trouvaille perd, en attendant d'éventuels compléments d'information,<br />
une partie de sa valeur de source pour l'histoire de notre<br />
pays.<br />
P. NASTER.<br />
Trouvaille de rnonnaîes des xve et XVIe siècles à Courtrai<br />
(1947). - En septembre 1947, une équipe d'ouvriers, travaillant au<br />
raccordement d'égout d'une maison sise au Sud-Ouest de la Grand'<br />
Place de Courtrai, découvrit un petit<br />
vase contenant 340 monnaies, pour<br />
la plupart en argent. La découverte<br />
eut lieu à la profondeur de 2 m 80,<br />
au niveau dit « Leie » (Lys). Le petit<br />
vase a 15 cm en hauteur et 14 en diamètre;<br />
sa panse est globuleuse et le<br />
col est haut de 5 cm environ; de<br />
part et d'autre, sont attachées deux<br />
anses verticales.<br />
Grâce à l'obligeance de l'un des inventeurs,<br />
j'ai pu examiner toute la<br />
trouvaille, qui était déjà partagée et<br />
qu'il a reconstituée en vue de cette<br />
étude. Aussi, s'il manque des pièces,<br />
dans le catalogue qui suit, leur nom<br />
bre doit être réduit.<br />
DUCHÉ DE BRABANT (67 pièces)<br />
PHILIPPE LE BON (1430-1467):<br />
1. Double gros vierlander : DE WITTE, 478. Très usé, 2 g 16.<br />
2. Gros vierlander: W., 479. Très usé, 0.92.<br />
CHARLES LE TÉMÉRAIRE (1467-1477) :<br />
. 3-4. Patard: W., 504. - 2.13, 2.31.
TROUVAILLES 167<br />
P~ILIPPE LE BEAU, minorité (1482-1494) :<br />
5. Pièce de 6 gros: \V., 552. - 2.44.<br />
6. Pièce de 1 1/2 gros: W., 555. Usée, 1.32.<br />
7. Gros: W., 579....BVR'.BR7r [marque d'atelier]; R;. très usé:<br />
M7tXU'I[ JH:P~T'o R9[ ]. - 0.94 (morceau manque).<br />
8. Simple briquet: W., 588. '" BVRGVNDI6 +BR~+ ; R'j• ... . ~uno<br />
+DI'+lR9Z- 2.32.<br />
PHILIPPE LE BEAU, majorité (1494-1506) =<br />
9-11. Toison d'argent: W.,. 605.<br />
Astérisque au début de la légende du droit; Rf.<br />
9) .....STIPH:IUQIEl ...JtUO*lR97 - 3.21.<br />
10) Id. - 3.33.<br />
11) Iq.•..•OQI'*7rttO'" 1502. - 3.39.<br />
12. Double sol: W.• 608. DOffiIUVffi+1tU'ü+lR96. - 3.02.<br />
13-14. Double sol: W., 609. Ponctuation par *.<br />
13) OOOlIUV*7t·* 150R. - 2.91.<br />
14) OVX*BVRG*BRn:*z; R7......·DIHU*TI:[UtO*1502.<br />
- 2.79.<br />
15-16. Sol ou patard: W. 611. Ponctuation par quatre-feuilles.<br />
15) R7 SIT+nO -ffi6'+DO- illU+B8 - IH::ID'TV. (fragment<br />
manque).<br />
16) ..... BVRG'+BR~; ~. id. - 2.70.<br />
17-19. Sol ou patard: W., 612.<br />
17) .... -BV [probablement R+BR1tBJ; R7. SIT+.Q[ 0]0 <br />
nUt+BEI- ItEID'TV. Contremarque: édlfice à trois<br />
tours (Kampen). - 2.28.<br />
18) Fort usé. Contremarque qui n'a pu être identifiée. <br />
1.91.<br />
19) Fort usé. Contremarque de Kampen. - 2.17.<br />
:W. Réal d'argent: W., 627. ----:- 3.35.<br />
CHARLES-QUINT, minorité (1506-1515) :<br />
21-24. Double sol: W., 635.<br />
21) 8(;'*8*Z ; ~. (couronne) ... üOffiIILV* 1509.-2.89.<br />
22) B'*B'; RJ•••• DOffiIQV)*~' 1512. - 3.0t.<br />
23) .,. BG'*B; RJ..... OOffiIU'*1t110'*1512. - 2.89.<br />
24) Id.; R;. (couronne) -., DOillIUV*IT'* 1513. - 2.93.<br />
25. Sol: W., 636.... OVU'+BG'+B'. - 2.63.<br />
26-27. Gros: W., 637. - 1.12 (très usé), 1.44.<br />
CHARLES-QUINT (1515-1555) :<br />
28. Patard: W., 654. RJ•••• BB - naO'TV. - 2.19.<br />
29. Réal d'Espagne: W., 657. Pas de ponctuation au début de la<br />
légende,... CASTxLEG'+; R;.... BVRG'+B'. - 3.30.
168 MÉLANGES<br />
30-39. Vlieger : W.,672.... BO'x IMP' (M et Pliés) ; Rj. DA - MICHx ...<br />
30-34) 1536: 5.39, 5.94 (2), 5.97, 6.10 (petit morceau coupé).<br />
35-37) 1537: 5.80, 5.89, 6.08.<br />
. 38) 1539: .... S... - 5.86.<br />
39) 1552: Ponctuation par . comme dans DE WITTE:<br />
'KAROLVS' ... ·HISPA·... 1552' j Ri. DA-MIHI'VIRTV<br />
-COTR-HOSTESTV-OS: (main d'Anvers). - 5.98.<br />
40-43. Double Carolus ou réal d'argent: "V'l., 674.<br />
40) RJ• •••MICH... --.:. 3.07.<br />
41} RO' ; RI . .. . MICHI.... - :t05.<br />
42) ROMx ; rq. id. - 2.65.<br />
43) Id IMP (M et Pliés) ... ; rq. id. - 3.06.<br />
44-49. Demi-réal d'argent ou simple Carolus: \V., 677 (Anvers).<br />
44) 2.81.<br />
45) Fin de la légende du droit illisible. - 2.81.<br />
46) Couronne entre la fin et le début de la légende (pas de<br />
marque d'Anvers). - 2.85.<br />
47-49) .... IMP (M et Pliés)... - 2.73, 2.82, 2.87.<br />
50. Demi-réal d'argent: W.,678 (Maastricht). Ponctuation par étoiles<br />
à cinq rayons, toujours seules....H-ISP~*... ;R7 ...VIRTVT*<br />
COVITR'1t*HOSTES*TVOS. - 2.90.<br />
51. Patard olt sol: W., 679. KAROL - D+G+RO-·IMP (M et P<br />
liés) +Z+H - ISP+REX j R,7.... VIRTVTE ... - 2.28.<br />
PHILIPPE II, 1 r e période (1555-1576) :<br />
52. Daldre Philippus: W., 713. Comme fig. pl. XLII, 1573. - 34.16.<br />
53-55. Cinquième de daldre Philippus: W., 722.<br />
53) 1571. Rj. Point de part et d'autre de la couronne. - 6.77.<br />
54-55) 1572. -.:.... 5.78 (rognée), 6.74.<br />
56. Id.: W., 724....DVX·B (date: 67) ; rq. Point de part et d'autre<br />
de la couronne. - 6.80.<br />
57-58. Dixième de daldre Philippus: W., 729. 1572 j R;'•• au début<br />
de la légende.<br />
;')7) 3.39.<br />
58) Seulement trois étincelles de part et d'autre. - 3.33.<br />
59. Vingtième de daldre Philippus: W., 734 ... BRA'; RI. date<br />
157[ ] (probablement 1576). - 3.27.<br />
60. Demi-daldre de Bourgogne; W., 738. Droit, légende sans point<br />
au début, point à la fin; 1569. - 14.62.<br />
61-62. Double courte noire: W., 757. - 2.79, 3.42.<br />
63-65. Id. : W., 757 ou 758. Très mal conservés (Anvers).<br />
Sous Philippe II: LES ÉTATS DE BRABANT:<br />
66. Sou: W., 777. - 1.42.<br />
PHILIPPE II~ 2e période (1580-1598):<br />
67. Liard: 'V., 858 .... BR' 1-593. - 4.95.
TROUVAILLES<br />
169<br />
COMTÉ DE FLANDRE (47 pièces)<br />
PHILIPPE LE BON (1430-1467):<br />
68. Double patard: DESCHAMPS DE PAS, 59, pl. IV, 55. - 2.43 (rogné).<br />
69. Id.: D. d. P., 60, pl. IV, 56. - 2.95 .<br />
CHARLES LE TÉMÉRAIRE (1467-1477) :<br />
70-71. Double patard: D. d. P., 64, pl. IV, 60. - 2.24, 2.36.<br />
72-80. Double gros: D. d. P., 65, pl. IV, 6l.<br />
72-79) 1.85, 1.96, 1.99, 2.15, 2.16, 2.32, 2.38, 2.49.<br />
80) ...DVX :BVRG :QO :FL. - 2.28.<br />
81. Demi-gros: D. d. P., 67, pl. XIII, 63. - 0.60 (fort rogné).<br />
PHILIPPE LE 'BEAU, minorité (1482-1494) :<br />
82. Patard: D. d, P., 3, pl. XIV, 2... ~'L. - 2.39.<br />
83. Double patard: D. d, P., 7, pl. XIV, 5.... FI17tllDR. - 2.83.<br />
84. Gros: D. d. P., 11, pl. XIV, 7. Ponctuation par étoiles à six<br />
rayons; fin de la légende du droit illisible; ~ BanaD* <br />
~nlm~* - [m81t*]D - Offi.[InO]. - 1.19.<br />
85. Patard: D. d. P., 95, pl. III, 57. Rf' ••• PïtT s; -2.16.<br />
PHILIPPE LE BEAU, majorité (1494-1506) :<br />
86. Demi-gros: D. d. P., 102, pl. IV, 63. - 0.62.<br />
87-88. Double patard: D. cl. P., 119, pl. VI, 74.<br />
87) 3.02.<br />
88) Droit, couronne qui ne coupe pas la légende, comme pl.<br />
VIII, 86. - 2.74.<br />
89-91. Patard: D. d. P., 120, 121, pl. VI, 75.<br />
89) SIT·.·Uo-maU"'DO-SUIIUJ.B -6U8DI. -:- 2.46.<br />
90) R7 D - Offiln", - Bana. - 2.59.<br />
91} FL; ~. SIT",no - maU"'D - llI"'B6U - EIDlür.<br />
- 2.75.<br />
92. Id.: ibiâ., 123, pl. VI, 76. Rf'. SITJ.no - mau- DUIJ.B8 <br />
naDIa. - 2.18.<br />
93. Réal d'argent: D. d. P., 147, pl. VIII, 94. ~....nVST'~R~1505x<br />
- 3.21.<br />
CHARLES-QUINT, minorité (1506-1515) :<br />
94. Double patard: D. d. P., 7, pl. I, 4. Rf. (fleur de lis) SIT + 1.10<br />
illaH + DOffiIY.1I + Bana + DIGTV +. - 2.91.<br />
CHARLES-QÙINT (1515-1555):<br />
95-101. Vlieger : D. d. P., 25, pl. III, 18.<br />
95) 1536 j R7. DAxM - ICHlxVIR -TVT+CO'T - R+<br />
HOSTE' : - +TVO·. - 6.04.<br />
96) ... ROM'.IMP.~·HISP·REX·1537; RJ. :DA' - MICH:
170 MÉLANGES<br />
VI - RTV:CO' - TR'HOS'T - VOS: - 5.83..<br />
97) 1539: ; Rf.: DA' - MICH'VI - RTV;CO - TR'HOS'<br />
T - VOS: - 5.81.<br />
.98) Id.... MICH:... - 5.92.<br />
99) .. ROM·IMP:~:HISP'·REX·1539; 1\7. :DA' - .MICH<br />
['VI] - RTV:CO - TR'HOS'T - VOS:. - 6.04.<br />
100) ... ROM'·IMP':~:HISP'·REX·1540· ;1\7. :DA' - MICI:<br />
VI - RTV':CO' - TR'HOST - VOS:. - 5.58.<br />
101) KAROLVSxDxGxROx IMP (M et P liés)xSxHISP x<br />
REXx1540; R;. DA ~ MICHxVI - RTVxCO<br />
TR+HOS+T - VOS. - 5.78.<br />
102. Vlieger: cf. D. d. P., 27.<br />
'CAROLV"D:G'ROM" IMP'H COTRV'D:BVRG:1531';<br />
1\7. (fleur de lîs) 'DA:M - ICH:.VIHSP'.REXCOTR - A'<br />
HOSTES - TVOS (Donc, pièce tréflée droit sur<br />
revers; au revers, traces de la queue de l'aigle du<br />
droit). - 5.88.<br />
103. Réal: D. d. P., 28, pl. III, 19. R;. (fleur de lis) DA,M>V' <br />
TUTE')(CO' - 11/1/ (tréflage) - ..SxTVOS. - 3.04.<br />
PHILIPPE II, 1 r e période (1555-1576) :<br />
104. Cinquième de daldre Philippus: Hoc, 38. 1566. - 6.7B.<br />
105-107: Id. : H., 39.<br />
105) Contremarque: lion à g. ; dans ovale de grènetis. <br />
6.78.<br />
106, 107) ... COMES :.... - 6.75, 6.97.<br />
108. Demi-daldre de Bourgogne: H., 55....FLAN (fleur de lis):<br />
1569. - 14.67.<br />
109. Quart de daldre de Bourgogne: H., 57. 1568. - 7.30.<br />
110-111. Id.: H., 58. 1570.<br />
110) 7.33.<br />
111) ... COMES:.. 7.:)4.<br />
112-113. Double courte noire: H., 81-84. Conservation insuffisante<br />
pour voir la variété. - 3.01, 3.24.<br />
CHARLES II (1665-1700) (l'appartenance à cc trésor paraît<br />
douteuse) :<br />
114. Liard: H., 84~ 1692. - 3.39.<br />
PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE (3 pièces)<br />
LOUIS DE BOURBON (1456-1482):<br />
115. Double patard: CHESTRET, 348-350. Différent invisible; suivant<br />
les signes de séparation, probablement nv 348 LXXXI.<br />
- 2.48.<br />
JEA.N DE HORN (14S4-150S) :<br />
116. Postulat: Ch., 386. Or très pâle....hoHIl, ... - 2.03.
TROUVAILLES<br />
171<br />
GEORGES D'AuTRICHE (1544-1557):<br />
117. Double patard: Ch., 476.... L~OD11. - 2.55.<br />
DUCHÉ DE LUXEMBOURG (4 pièces)<br />
PHILIPPE LE BEAU, majorité (1494-1506) :<br />
118-120. Double gros: BERNAYS et VANNÉRUS, 218.<br />
118) 1501 (millésime pas donné par B. et V.). - 2.20.<br />
11.9) 1502. - 2.33.<br />
120) 1503. - 2.46.<br />
121. Gros: B. et V., 219. RJ....TIllO ~ 1503. (fragment).<br />
SEIGNEURIE DE MALINES (1 pièce)<br />
PHILIPPE LE BEAU, minorité (1482-1494) :<br />
122. Denier de 6 gros'; L. VAN DEN BERGH,35. rt;. +SIT~UomaUart<br />
(sic, sans tréflage) ~ DOillIUr: B~DICTVm' - 2.72.<br />
COMTÉ DE NAMUR (2 pièces)<br />
PHILIPPE LE BEAU, majorité (1494-1506);<br />
123. Patard: CHALON, 215. - 2.49 (trouée).<br />
124. Id.: Ch., 216. Date illisible. - 2.57.<br />
SEIGNEURIE DE TOURNAI (3 pièces)<br />
Sous Philippe II : ÉTATS DE TOURNAI (1578-1580) :<br />
125. Daldre des États, 1579 : A. DE WITTE, Num. des États du Hainaut<br />
et des États du Tournaisis, dans Bull. Soc. hist, et litt. de<br />
Tournai, 22, 1889, p. 91-92. - 25.39.<br />
PHILIPPE II, 2 e période (1577-1598):<br />
126. Liard: COCHETEUX, RBN, 1853, p. 259 cf. XIII-i et pl. XV, 15.<br />
Le millésime en 4 chiffres: 15(tour)85. - 4.94.<br />
ALBERT ET ISABELLE (1599-1621) (l'appartenance à ce trésor<br />
paraît douteuse):<br />
127. Sol: Hoc, RBN, 1934, p. 42, 11. 1616. - 1.60.<br />
DUCHÉ DE GUELDRE (11 pièces)<br />
PHILIPPE LE BEAU, minorité (1488 et 1492) :<br />
128. Gros: cf. VAN DER CHUS, p. 105 et pl. XIV, 1 ; cf. ROEST, 299-303.<br />
RJ· +R6FOR~nTIOIO[ JPo8T*GRVR~*p~Xr J. Croix<br />
fleuronnée; au centre, point. - 2.27.<br />
129. Oordstulver (1/4 sou) : V. D. CH., p. 108 et pl. XV, 10 ; ROEST,<br />
346. - 0.60.
172 MÉLANGES<br />
CHARLES D'EGMONT (1492-1538):<br />
130. Snaphaan: V. D. CH., p. 163 et pl. XVIII, 38; ROEST, 47355. -<br />
6.25. .<br />
PHILIPPE II, pc période (1555-1576) :<br />
131. Demi-daldre Philippus: V. D. CH., p. 202 et pl. XXVI, 17. <br />
14.32.<br />
132-137. Cinquième de daldre Philippus:<br />
132) V. D. CH., p. 204 et pl. XXVI, 22 ; ROEST, 61.8. 15 (croix<br />
posée obliquement) 63; R7. DOMlUS'MIHI'ADIV<br />
TOR. - 6.70.<br />
133) V. D. CH., 23. - 6.76.<br />
134-135) V. D. CH., 24; R., G25. - 5.97, 6.50.<br />
136) V. D. CH., 26; R., 627. - 6.75.<br />
137) V. D. CH., 27; R., 648-651. Contremarque, lion dans<br />
ovale de grènetis. - 5.30.<br />
PHILIPPE II, 2 e période (1577-1598) :<br />
138. Zestienstuiverpenning: DE VOOGl', 3. 1577. - 12.04.<br />
COMTÉ PUIS PROVINCE DE HOLLANDE (11 pièces)<br />
PHILIPPE LE BEAU, majorité (1494-1506) :<br />
139. Toison d'argent: V. D. CH., pl. XXII, 24. - 3.21.<br />
140-141. Double gros: V. D. CH., pl. XXII, 29. - 2.91, 2.93.<br />
142. Id.: V. D. Cr-L, p. 527 et pl. XXIII, 36. - 2.00.<br />
143. Id.: ibid., 39. - 2.52. .<br />
144-145. Id.: ibiâ., 48. - 2.35 (trouée), 2.68.<br />
PHILIPPE II, 1 r e période (Hi55-1576) :<br />
146~147. Cinquième de daldre Philippus: V. D. CH., 30.<br />
146) 6.68.<br />
147) ... D:G:... - 6.69.<br />
PROVINCE:<br />
148-149. Liard: VERI{ADE, 310-311, pl. 57, 1-2. Millésime îllisible,<br />
1576-1579. - 6.32, 6.83.<br />
SEIGNEURIE D'UTRECHT (1 pièce)<br />
PHILIPPE II, pe période (1555-1576) :<br />
150. Cinquième de daldre Philippus: V. D. CH., 5. 1571. - G.79.<br />
COMTÉ ET VILLE DE GRONINGUE (1 pièce)<br />
1:')1. Stuiver, 1507: VAN DER CHIJS, De m. v. Friesl., Gron. en Drenthe,<br />
p. 510-511 et pl. XVI, 129-132. Trop usé pour reconnaître
TR OUVAILl~ES 173<br />
les variétés éventuelles de légende et de ponctuation. - 1.49<br />
(troué à trois endroits).<br />
COMTÉ DE HORNES (2 pièces)<br />
PHILIPPE DE MONTMORENCY (1540-1562) :<br />
152-153. Double escalin ou sprenger: VAN DER CHUS, Leenen u.<br />
Brab. en Limb., p. 142 et pl. XII, 16. - 6.76, 7.00.<br />
SOUVERAINETÉ DE '8 HERENBERG (1 pièce)<br />
FRÉ.DÉnIe DE BERG (1577-1580):<br />
154. Ecu, L')7:o): C. A. SERRURE,... 's Hecrenberq, p. 97, 73 et pl.<br />
6, 73. - 24.:0)0.<br />
ROYAUME DE FRANCE (8~~<br />
LOUIS XI (1461-1483):<br />
pièces)<br />
155. Gros de Roi: HOFFMANN, 12; DIEUDONNÉ, Calal., 1639 ss.;<br />
LAFAURIE, 532. Point flanquant à g. le 1 de LVDOVIQVS;...<br />
UEH*GR~al~*... Légende fort rognée; marque d'atelier pas<br />
reconnue. - 2.93.<br />
CHARLES VIII (1483-1498) :<br />
156. Blanc de Provence: H., 14; DIEUDONNÉ, 1808; LAFAURIE, 565.<br />
:+ :K7tROLVS FR701CORVM:REX'L-T; Rf. +SITlIoME~:<br />
DOMI't.lI BEQEDITVM. Laurent Pons (?) à Tarascon, 1488.<br />
- 1.53.<br />
157. Carolus ou dizain: H. tH ; DIEUDONNÉ, cf. 1822; LAFAURIE) 568.<br />
+K~ROLVS~FR~naORVffi~R6X; RJ. +SIT no~l1EU DVII<br />
IB]avr6DlaTVill. Point (creux) sous la Be lettre: Poitiers,<br />
1488-1489. - 1.94.<br />
LOUIS XII (1497-1515):<br />
158. Dizain Ludovicus : H., 39; DIEUDONNÉ, 2066; LAFAURIE, 614.<br />
X (grande L ornementée) II. Trèfle et point 12 e : Lyon. - 2.16.<br />
FRANÇOIS 1 (1515-1547):<br />
159-161. Douzain à la croisette: H., 108_<br />
1) H et point 9~: La Rochelle.<br />
159) +FRANCISCVS.D-GRA.FRANCORVMRX (sic)<br />
(fontaine) ;. ~. + SIT:NOMEN:J?OMINI.... <br />
1.87.<br />
160) Id.; séparation par: ...FRANCORVM:REX. - 2.12.<br />
2) 1: Limoges.<br />
1(1) Id. Légende fort effacée; particularités éventuelles<br />
et point 10 e indéchiffrables. - 2.18 (cassée).
174 MÉLANGES<br />
HENRI II (1547-1559) :<br />
162-192. Douzain aux croissants: H., 74. Sauf indication contraire,<br />
au revers, H dans les il et 4 e quartiers de la croix.<br />
1) A: Paris.<br />
162-163) Point 18 e : id....FRANCORj'.. ; RJ. entre NOMEN<br />
et DNI, merlette; 155'1. - 2.19, 2.31.<br />
164) Sans point. JY'. croisette (?) dans 0 de NOMEN;<br />
1557 suivi d'une étoile au-dessus d'un croissant.<br />
- 2.45.<br />
2) B et point 15 e : Rouen.<br />
Hi5) ... FRANCORV'REX; RJ ••• 'DNI (cornet) BENE<br />
D ÎCTVM '1549; H dans 'les 2 8 et a- quartiers,<br />
- 2.40.<br />
166-167) Id., RJ.••NOMEN (ciboire) DNI BENEDICTVM<br />
1551 ; H au 1 et au 4. - 2.06, 2.34. .<br />
3) C et point 1g e : Saint-Lô.<br />
168) ... FRANCQRV'REX (tête de loup); RJ • •••BENE<br />
DICTVM (bourdon et coquille) 1551 (le point<br />
sous le T peut avoir disparu à la suite d'un tré<br />
Ilage), Tête de loup = Saint-Lô. - 2.32.<br />
169) Id. RJ. point sur le T de BENEDICTVM. Point<br />
au droit invisible, pièce écrasée et usée. - 1.84.<br />
170) Id. Points visibles. 1552. - 2.30. Surfrappée à<br />
peine des coins d'un gros de six blancs de Charles<br />
IX.<br />
171) Id. 1553. - 2.39.<br />
4) D et point 12 e : Lyon.<br />
172) ... DE~ G FRANCORV.REX·P; RJ SIT·NOMEN<br />
DNI·BENEDICTVM·1551·F. - 2.38.<br />
5) F et point 7e· : Angers.<br />
173) HENRIÇVS·2·DEI·G·FRANCORVM·REX (pomme<br />
de pin) ; R;7. SIT·NOMEN·DNI BENEDICTVM·<br />
1550 (pomme de pin). - 2.08.<br />
174) ... PRANCORV·REX [ 1; RJ. SIT:NOMEN:DNI:<br />
BENEDICTV:1551 (sphère). H dans les 2 e et<br />
. 3e quartiers. - 2.00.<br />
175) Id.; 1\7. SIT NOMEN ... DICT [11 1551 (différent<br />
en forme de carafe retournée). - 2.26.<br />
6) G et point 8e : Poitiers.<br />
176 et 177) 1550, mufle de lion. - 2.25,_ 2.31.<br />
178) 1551, id. - 2.21.<br />
179) Sans point 8 e• HENRICVS·U· ... (trèfle); Iq ••••1557<br />
(trèfle; mufle de lion); H dans les 2 e et 3e<br />
quartiers. - 2.10.<br />
7) H et point 9 c : La Rochelle.<br />
180.) ... ~'D ·G·PRANCORVM·REX (léopard à g.)<br />
2.36.<br />
181) Id. Rien après REX. - 2.40.
TROUVAILLES 175<br />
8) K: Bordeaux.<br />
182) +HENRICVS'D :G'FRANCORVM'REX' (bateau)<br />
',R'; Rf. +SITNOMEN'D'BENEDICTVM'1551,<br />
(bateau)'R', - 2.41.<br />
183) Id., sans points de séparation de REX à la fin j<br />
Rf •••NOMENDBENEDICTVM·1552·..., - 2.19.<br />
184) +HENRICVS:D:G: .... ; R,7. SIT·NOMEN:D:B....<br />
1556...., H au deux et au trois, - 1.98.<br />
185) FRANCORVM : ; RI. Id. 1557, sans points<br />
de la date à la fin. - 2.20.<br />
9) P et point 13 e : Dijon.<br />
186) ... ·DEI·G· ... OIY·REX (trèfle? fleur de lis?); Ri.<br />
SIT·NOMENDNIBENEDICTV. JB (liés) 1550'.<br />
- 2.39. .<br />
10) S et point 14e : Troyes.<br />
187) ... FRANCORV·REX; ~....BENEDICTV·1551 (pe<br />
.tit E surmonté d'un croissant). - 2.06.<br />
188) Id. 1553. - 2.27.<br />
11) 9 et point 11e : Rennes.<br />
189) ·DEI·... FRANCOR'REX'; Ri' ... ·DNI·... "M'<br />
(feuille de chêne) 1550. - 2.30. .<br />
190) Id. Rîen après REX. - 2.40.<br />
191) Id. W.....VM (coquille) 1551 - 2.04.<br />
192) .,. FRANCOR' .. ; R;•••••VM (?) 1552. - 2.34.<br />
193-194. Douzain aux croissants de Dauphiné.<br />
193) Avec l'écu du royaume, cf. DIEUDONNÉ, Manuel, II,<br />
p. 326. HENRICVS'2 (renversé)'DEI"G'(globe crucigère,<br />
renversé par rapport à la légende) 'FRAN<br />
CORV'REX'; ~. +SIT ....VM·1550 :0', H au deux<br />
et au trois, couronne au un et au quatre. - 2.30.<br />
194) Avec l'écu écartelé France-Dauphiné, H. 79. +HEN<br />
RICVS'D'G'FRANCORVM'REX (sans 2, renversé,<br />
ni annelet sous N); Ri. +SITNOMEZ"'D'BEVIEDI<br />
TVM. 155z, H au un et au quatre, dauphin au deux<br />
et au trois. L'alignement des lettres des Iégendes est<br />
très irrégulier. - 2.04.<br />
CHARLES IX (1560-1574) :<br />
195-218. Gros de six blancs: H. 31.'<br />
1) D et -point 12e' : Lyon.<br />
195) 'CARO'IX'D'G'FRAN'RE'X1570 (étoile)'(trèfle)' ;<br />
RJ. + SIT·...DNI ...VM. - 3.14.<br />
2) I et point lOe : Limoges.<br />
196) +CAROIX'D'G'PRAN'REX'1569'I' (pélican).<br />
3.01.<br />
197) +CAROLV'IX'D'Ç:'FRAN'REX'1571 I (tour). <br />
2.97.
176 MÉLANGES<br />
198) +CAROLVS-IX'D 'G'PRANC' .... - 2.97.<br />
199) +CARO'IX'D'G'FRAN'REX'1572' ... - 2.85.<br />
200) +CAROL' ..... 1572 1 (tour).;- 2.90.<br />
201) +CAROLVS, IX'D 'G'PRANCO'REX(probabiement<br />
point sous D); Ri' ••• BENEDIC' 1572 1 [ ].<br />
3.03.<br />
3} K: Bordeaux,<br />
202) CARO'IX'D (X aux jambages courbés en forme de<br />
tenailles) G'FRANC'REX'M'D tx-x-r.:« lettre<br />
K marquant l'atelier flanquée d'un point de<br />
part et d'autre (un point dans le D de la date) ;<br />
RJ.+ 'SIT' ... VM' : (nef, posée horizontalement,<br />
le mât à dr.) : M. - 3.17.<br />
203) Id. Pas de point dans le D de la date et un point<br />
après cette lettre. - 3.11.<br />
4} M: Toulouse.<br />
204) CARO'IX'D-G'FRAN-REX'1571 /i: +: ; RJ. >l< SIT'<br />
......VM. - 3_02.<br />
205) ._. D'G ....REX· (différent en forme de libellule?)<br />
1571. La marque de l'atelier u'est pas certaine.<br />
Légendes entre de très légers traits circulaires<br />
à l'intérieur des cercles de grènetis. - 2.88.<br />
5) N et point 4 e : Montpellier.<br />
206) xCAROLVS", IXxDxG+FR[ ]; ~. +SIT+NO-<br />
MEoN+{ ]1575 (rose, dont la forme stylisée<br />
fait penser davantage à une hermine). <br />
2.79.<br />
B) R: Villeneuve-Saint-André.<br />
207) 'CARO'IX'D'G'FRAN'REX' (R et M en monogramme)'1569';<br />
RJ- +:SIT NOMEN' ..... VM·.<br />
Filets le long des grènetis. - 2_74.<br />
208) ... D'G' .... 1570; Py. [ ]MEN DNI'BENE-<br />
D ICT[ ] (I de DNl et point liés). Filet à<br />
l'intérieur du cercle de grènetis extérieur. - 2.93.<br />
209) Id. 157Z; RJ. SIT- ... Cercles de grènetis simples. <br />
2.93.<br />
7) S et point 12 e : Troyes.<br />
210-211) 'CAROLVS-IX'DEI'G'FRANCO (petit 1 dans<br />
le C) 'REX- ; RJ. +SIT- .... BENEDIC (petit 1<br />
dans le C)· (IDR en monogramme)' 1569.<br />
3.07, 3.14.<br />
212) Id. Forme légèrement différente du monogramme.<br />
1571. ~ 3.02.<br />
213-214) Id. 1572. Probablement mêmes coins de droit<br />
pour autant que le tréflage permette d'en juger:<br />
défaut identique entre S et le début de la légende.<br />
- 3.03, 3.12.<br />
215) Id. RI. ....BENED I[ 1]574. - 3.23.
TROUVAILLES 177<br />
216) Id.....FRANCOR;· (toujours petit I dans le C);<br />
1574. - 3.17.<br />
8) 9: Rennes.<br />
217) 'CAROLVS 'IX (petit point - accidentel? - sous<br />
1) ·D·G'FRANCO·R"1(1569· ; Rj. +SIT' .....VM·.<br />
-3.07.<br />
9) Atelier dont le différent n'a pas été reconnu.<br />
218) [ ] O'IX'D'G'FRA[N']RE[ ]; R;.+SI[T<br />
IBE(NIED ICTVM' - 2.82.<br />
219. Douzain; H. 34. I et point 10c : Limoges. 1573. - 1.94.<br />
HENRI III (1574-1589);<br />
220-22~L Franc au col plat; H. 20.<br />
1) A et lettre 18 e ; Paris.<br />
220) .....POL·REX; RJ. +SI1' ...DOMINI:B.....W (très<br />
épais) 1576. - 14.24.<br />
221, 222) Id.....PüLREX. - 13.86, 14.00.<br />
223) Id. Fin des légendes illisible. - 14.02.<br />
2) B et point 15 e ; Rouen.<br />
224) Sans point secret. Le buste dépasse le cercle, en .<br />
dessous vers la dr.Ri'......BENEDICT (couronne<br />
d/éptnes avec deux clous de la Passion) 1576' <br />
- 14.09.<br />
225) Id .... POLOREX'; RJ. Id., probablement même<br />
date. - 14.03.<br />
226) Avec point secret. 'HENRICUS'III'DG'F~AN'ET'<br />
POLO'REX'; Rj...... BENEDICTV (sphère)<br />
1577. - 14.13. .<br />
3) F et point 7 e : Angers.<br />
227, 228) Point secret au droit seulement. Au droit, en<br />
dessous, 1576, et sous le buste, au-dessus de la<br />
date, F; ~...... VM (tête de lion à dr.), - 14.11,<br />
14.12.<br />
4) T : Nantes.<br />
229) Point dans le D de D'G, ponctuation peu certaine<br />
à la suite de tréflage ; Hl . ..... .VM (rose) 1576. ~<br />
14.14.<br />
230. Franc à la fraise: H. 25. A; Paris. Point dans le 0 de POL;<br />
Hl.....157:]. Pas pesé, monté en bijou en 1950.<br />
231-236. Demi-franc au col plat: H. 23.<br />
1) A et point ISe; Paris.<br />
231-233) R:f• ... ...VM W 1576. - 6.97, 6.98, 7.01.<br />
2) B et point 15 e ; Rouen.<br />
234) Légende assez rognée; Rf..... (couronne d'épines et<br />
deux clous de la Passion) 1576. - 7.00.<br />
235) Pas de lettre d'atelier; R{'. Id. - 7.12.<br />
3) 9; Rennes.<br />
236) .... D (point dans la lettre) : G' .... (hermine) ; Ri', date<br />
probablement 1576 (peut-être 1578). - 7.04.<br />
REV. BELGE DE NUM., 1951. - 12.
178<br />
237. Quart de franc à la fraise: H. 26. T: Nantes. La date 1576<br />
au droit en bas; ~. ·S IT'NOMEN'DOMINI"BENEDIC'TVM'<br />
(2 e point dans le C), la légende commençant en bas, T en dessous.<br />
- 3.62.<br />
EvEcHÉ puis ARCHEVÊCHÉ DE CAMBRAI<br />
(40 pièces)<br />
MAXIMILIEN DE BERGHES (évêque, 1556-1559;<br />
archevêque, 1559-1570):<br />
238-269. Pièce de cinq patards: ROBERT, Numismatique de Cambrai,<br />
p. 158-160.<br />
a) période 1556-1559:<br />
238) ROBERT, 1. ... D:j:CA ..... CAMERA; Rf R. 1. - 7.16.<br />
239) R. 4. ~. NEC+ - CITO+ - NEC+TE - MERE.<br />
-7.13.<br />
b) période 1559-1570:<br />
240, 241) R. 6; Rf. cf. R. 11 : VlEC' - CITO' - lhEC'<br />
TE - MERE: - 7.27, 7.51.<br />
242-244) R. 7; Rf. N retournés. - 6.98, 7.27, 7.40.<br />
245) R. 7.....CAM; Rf. Id. - 6.95.<br />
246) Id.; Rf. Ponctuation par trèfles. - 7.31.<br />
247, 248) R.7 ; Rf· t~EC+-+CITO+-~EC+TE-MERE.<br />
- 6.98, 7.17.<br />
249) Id.;~. tVIEC+-+CITO+-lhEC+TE-MERE:j:<br />
7.06.<br />
250) Id....CA; oR]• ..\NEC..\-CITO"'-NEC (trèfle dans<br />
le C}TE-MERE'" - 7.24..<br />
251-253) R. 9 ARCEPS ....CAM: - 6.86, 7.18, 7.55.<br />
254) R. 9 CAM:. - 7.01.<br />
255) Id.; Rf. R. 13 avec trèfle finaL - 7.18.<br />
256) Id.; R]. R. 9 .......NEC...T-EMERE. - 6.73.<br />
257) R. 11; Rf. comme 240. - 7.32.<br />
258) R. 12 D+CA ......CA+; ~. N retournés. - 7.35.<br />
259) R. 12 n:l:G.... D:l:CA ... CA:!:; Rf. aNECZ-C TO:<br />
-VlEC+TE-MEREt. - 7.22.<br />
260) Id P:CO - 6.95.<br />
261) R. 13. - 6.60.<br />
262, 263) Id.; R;. avec trèfle finaL - 6,45, 7.13.<br />
264, 265) R. 13 j RJ. J.NECJ.-CITO'" - NEC (trèfle<br />
dans le C)TE-MERE.... - 6,46, 7.19.<br />
266) Id.; RJ. deux trèfles superposés au début et à la<br />
fîn. - 7.01.<br />
267, 268) Id.; Rf. J.NEC.·.-.·.CITO.·.-NEC.·.TE-ME<br />
RE.·..- 7.18, 7.24.<br />
269) R. 13, mais ponctuation par croisettes; RJ. trèfle<br />
final. --..:. 7.20.<br />
270-273. pièce de cinq gros: ROBERT, p. 160-161.
TRbUVAiLLES 179<br />
270) R. z, 1561; RJ. +/IEC+-+CITO+-,-+MEC+-TE<br />
MERE. - 3.59.<br />
271) R. 3; 1561. - 3.62.<br />
272, 273) +·M·,·A'.'B",·D·,·G","ARCHIEPS",·(boucle)·,·D'.·<br />
CA·,·S'··IMP·.'P·.·1561; ~..:.NEC·:·-·:·CITO·:·--:<br />
NEC·:·TE-MERE·;·. - 3.64, 3.66.<br />
274. Patard: ROBERT t p. 162 t 5. - 2.29.<br />
LOUIS DE BERLAIMONT (1570-1596) :<br />
275-276. Seizième de thaler: ROBERT, p. 184-185.<br />
275) R. 1, mais mîllésime 73, ... DA:CA... - 2.83.<br />
276) R. 4, millésime 76; RI. pas de point au début de la<br />
légende. - 2.88.<br />
277, Pièce de deux deniers: ROBERT, p. 177, 1-7, et pl. XXV, 5,<br />
Trop effacé pour lire les légendes; fragment manque.<br />
VILLE DE METZ (2 pièces)<br />
278. Gros: F. DE SAULCY, Rech. s. 1. mon. de la cité de Melz, p. 101<br />
102, pl. 3, 8a. °So STEPHAN°.... - 2.10..<br />
27 \. Id.: SAULCY, pl. 3. 8 h (V). - 2.19.<br />
DUCHÉ DE LORRAINE (2 pièces)<br />
CHARLES III, majorité (1555-1576) :<br />
280. Teston: F. DE SAULCTY t Rech. s. 1. monn. des ducs héréâ. de<br />
Lorraine, p. 148 et pl. XIX, 7. (croix de Lorraine) CARO'D:G:<br />
CAL'LOTA'R'B:GELDUX (point après LOTA: défaut de<br />
coin ?). - 8.99.<br />
281) Id.: SAULCY, p. 150 et pl. XXI, 4. (croix de Lorraine) CARO:<br />
D:G:CAL:LüTA:B:GEL:DUX; RJ. (croix de Lorraine) MO-<br />
NETA ·NOVA· - 9.23.<br />
ROYAUME DE CASTILLE PUIS D'ESPAGNE (16 pièces)<br />
FERDINAND V ET ISABELLE (1474-1504; 1474-1516) :<br />
282-284. Pièce de quatre réaux: HEISS, p. 125-126, 78 t 79, et pl. 21.<br />
282) FERNANDVS [ ] S l1tl; ~. :-:REX'ET'RE-<br />
GINA'CASTELE'LEGIONIS, type posé verticalement.<br />
- 13.72.<br />
283) .... ELISABETùDoGo id.; Rf. '" CASTùLEGIONI<br />
[S.A]RA, type dirigé vers la g. - 13.60.<br />
284) ... _~ET~ELISABETA~D~G~ {fIl?; ~. Id. ~sls. <br />
10.85.<br />
285-289. Pièce de deux réaux: H.) p. 126 et pl, 21 80, 82 S8.<br />
285) FERNANDVS'ET'ELISABE' slf!; RJ +REX'ET<br />
REGINA'CAST'LEGIONIS: '.1.* - 6.33.<br />
286) FERNANDVS:ET'ELISAB[ET']D id., R;7. [+]REX<br />
'ET'REGINA'CASTELE'LEGIO, type vers la<br />
dr. - 6.73. .
180 MÉLANGES<br />
287) FERYlAv.lDVS~ET~EL ISABED 11/i; ~. f'REX<br />
ET REGlViAcCASToLEGIO~AR· °01 ' type<br />
à dl'. - 6.66.<br />
288) FERNANDVSoEToELISABEToDoG Til; Rj'. +REX<br />
~.ET~REGINA~CAST~LEGIONIS~A~type à g., en<br />
dessous, M. - 6.75.<br />
289) FERNANDVS~ELISAVEun" '1 n; ~. +RE3)~ERE<br />
GINA~ CASTE (petit 1 dans le C)oLEGIO, type<br />
à g., en dessous, B. - 6.69.<br />
290-295. Réal: H. p. 126, 81 5S., pl. 21-22, 81, 85 55.<br />
290) FERNANDVSoEoToELISABT (hermine) S;<br />
Rj7. REXoETREGINAoCASTLEoGIOuAo, type Ù<br />
g. en oblique vers le haut. - 3.31.<br />
:l91) .....BET ; RJ •••• CASToLEG IONoAR 1S - 3.37.<br />
292) RJ + REX ET REGIf IG ARA - 2.71<br />
293) FERNANDVS'ET ELISABET'DEI *i*; Rj'. +<br />
REX'ETREGIN°CAST IoLEG ION 'ARAG' si<br />
type à g. - 2.75.<br />
294). F 1tlRfLJtltDUS:ffT:8ld8JtBEIT; Rj. X+XBaI:<br />
D:G:RUX:aT'R8GIll7\:07\ST8I1, type à g.,<br />
en dessous, B. - 2.91.<br />
295) Trop rogné pour lire les légendes; Rj'. type à dl'. <br />
2.12.<br />
CHARLES-QUINT (1515-1555):<br />
296. Pièce de quatre réaux: H., p. 146 et pl. 27, 6. Dr: Fin de la<br />
légende illisible. - 12.35.<br />
297. Réal: H., p. 147 et pl. 27, 11. Dr: REGS M I. - 3.30.<br />
ROYAUME DE NAVARRE (5 pièces)<br />
FERDINAND II D'ARAGON (V de Castille) 1512-1516) :<br />
298-301. Blanc: HEISS, III, p. 46 et pl. 148, 9.<br />
298) ....rrHVlI ; Rf. +SIT:Uomall Do.ffiJllI:B8R8<br />
DITV:, F dans les 1er et 4e quartiers de la<br />
croix, deux points entre les lobes du quatrefeuilles.<br />
- 3.02.<br />
. . ,rriIV; R;7••••• B81l8bIQTV:, croix posée comme<br />
une croix de Saint-André, F au-dessus et en dessous,<br />
pas de points entre les lobes. - 3.15.<br />
300) RJ. . •. R8n8DlT, croix posée normalement, F<br />
dans les 2 e et 3 e quartiers, deux points entre les<br />
lobes du quatre-feuilles. - 3.14.<br />
301) R;7. Id. sans ponctuation finale, id., id. - 3.23.<br />
302. Gros: H., p. 46 et pl. 148,10.°+° entre le début et lafin de la<br />
légende; R,7. ·.·SIT~T,10ME"K:DOM [ ]DI, F comme au<br />
nv 300. - 2.81.
TROUVAILLES 181<br />
DUCHÉ DE MILAN (25 pièces)<br />
CHARLES-QUINT (1535-1556):<br />
303-323. Pièce de 8 sous ou 3 deniers: Corpus, V, p. 238, 76.<br />
2.16, 2.17, 2.26, 2.30, 2.38, 2.43, 2.50, 2.59, 2.63, 2.68 (2),<br />
2.70 (2), 2.72, 2.74, 2.75 (2), 2.76, 2.79 (2), 2.82.<br />
Deux pièces ont été frappées du même coin de droit, deux autres<br />
du même coin de revers. Ces dernières portent en outre<br />
au droit I'empreinte d'un coin, différent pour chaque pièce,<br />
mais obtenu par l'emploi de poinçons identiques: les colonnes<br />
d'Hercule et la couronne impériale ont été enfoncées dans le<br />
coin de façon indépendante. De plus, ces poinçons sont identiques<br />
à ceux qui ont servi à la fabrication du coin des deux<br />
pièces avec le même droit. La direction relative des coins est<br />
arbitraire comme d'ailleurs, semble-t-il, pour toutes les pièces<br />
de ce trésor.<br />
Une pièce est contremarquée d'un lion à g. dans un cadre ovale.<br />
324. Id.: C., 77. - 2.75.<br />
325-32lL Id.: C., 80. - 2.73, 2.74.<br />
327. Id. CAROLV S'V'IMP'; Rf. = C., 76. - 2.68.<br />
REPUBLIQUE DE VENISE (4 pièces)<br />
AUGUSTIN BARBARIGO, 74 e doge (1486-1501) :<br />
328. Marcello ou demi-livre: Corpus, VII, p. 196, 121. - 2.70.<br />
ANDREA GRITTI, 77° doge (1523-1539) :<br />
329. Marcello ou demi-livre: C., p. 245, 50. - 2.76.<br />
330. Id.: C., p. 251, 106. - 3.15.<br />
331. Id.: C., p. 262, 190. - [pas pesée].<br />
RÉPUBL {QUE DE BOLOGNE (1 pièce)<br />
332. Grossone: cf. Corpus, X, pl. III, 1-3 (République, xvs s.) ou<br />
pl. II, 30, 31, 36, 37 (période papale XVC-XVI C siècle)? Devant<br />
le lion, écu meublé de trois ailes. - 3.15.<br />
DUCHÉ DE MODÈNE (3 pièces)<br />
ALPHONSE II n'ESTE (1559-1597):<br />
333. Jule: Corpus, IX, p. 221, 16, cf. pl. XVI, 10, 11. - 3.10.<br />
334. Id.: C., 24. Au droit, signe de séparation: +. - 2.96.<br />
335. Id.: C., cf. p. 222, 29. * ·NOB.... ; R;7. S GEMINIAN (A et N<br />
liés) MVTINEN·PON. - 3.07.
182 MÉLANGES<br />
DUCHÉ DE SAXE (1 pièce)<br />
FRÉDÉRIC, GEORGES ET JEAN (1500-1525) :<br />
336. Gros à l'ange ou Schr-eckenberger : Cat. L. Welzl von Wellenheim,<br />
II, 2, 5557; Cat. Thomsen, 7581. - 4.49.<br />
ARCHIDUCHÉ DE CARINTHIE (1 pièce)<br />
CHARLES, fils de Ferdinand 1 (1565-1590) :<br />
337. Ducat: MILLER ZU AICHHOLZ, LOEHR et HOLZMAIR, p. 61.<br />
CAROLVS'DEI' G'ARCHI'DUX' (tête du sceptre): ; R;7.·AUS<br />
TRIAE'ET'CARINTHIAE'ZC'76 (AE chaque fois liés).<br />
3.46.<br />
ROYAUME D'ANGLETERRE (3 pièces)<br />
HENRI VIII (1509-1547) :<br />
338-339. Gros: BROOKE 1, p. 185, 2 e émission (1526-1544), Londres.<br />
338) (rose) h8"UR' Q'x VIIIox DI'+ G'+ R'+ itGL'+ Z+<br />
~"fRitna'+ ;R;1(rose) POSVI+ DElV~it+ DIVTOR<br />
+EI':illEIV+. - 2.28.<br />
339) .... D'.... ; R;7.. +DIVTO +R' ~ mav*. - 2.22.<br />
ÉDOUARD VI (1547-1553):<br />
340. Fine shilling: BR., p. 189, 3e période (1550-1553).<br />
y. eDW2tRD'. VI. D'.G'.2tGI1.FRit'.Z. hIB'.<br />
ReX, rose à g., XII à dr. ; R; POSVI -DaV.<br />
7rD - IVTOR6. - illaV.ffi· y. - 6.38.<br />
Ce trésor est, comme on a pu le constater, relativement important.<br />
Il se compose de 325 monnaies en argent, 1 en or (le nO 337), 1 en or<br />
pâle (no 116) et 13 en bronze ou cuivre. Il ne contient en somme<br />
aucune pièce qui soit vraiment inconnue. Par contre, les deux tiers<br />
des pièces sont des variétés qui ne semblent pas encore avoir été<br />
signalées. .<br />
L'établissement de la date d'enfouissement n'est pas aisé. En effet,<br />
à voir la composition du trésor dans son.ensemble, on situerait sa<br />
constitution et, partant, son enfouissement à la fin du XVIe siècle,<br />
vers 1580. Tout un groupe de pièces sont datées des années 1575 à<br />
1579 : les nOS 59 et 66 pour le Brabant, 125 pour Tournai, 138 pour<br />
la Gueldre, 148 et 149 pour la Hollande. 220 à 237 pour la France,<br />
276 pour Cambrai et 337 pour la Carinthie. Seules quatre pièces sont<br />
postérieures à 1579 : un liard brabançon (n ° 67) de 1593, un liard et<br />
un sol tournaisiens (nO e 126 et 127) de 1585 et de 1616 et, enfin, un<br />
liard flamand (nv 114) de 1692.<br />
Nous pouvons en conséquence poser ainsi le problème: ou bien,<br />
au moins les quatre pièces qui causent quelque difficulté ne font pas<br />
partie du trésor et y ont été ajoutées dans la suite par les inventeurs;
TR.OUVAILLES 183<br />
ou bien. ces pièces représentent le reste de peu de valeur (3 cuivres<br />
et 1 billon, en mauvais état) d'un bon lot de pièces qui, plus récentes<br />
et, par le fait même, en principe, assez bien conservées, auraient été<br />
distraites et ne nous auraient pas été soumises pour examen; ou bien,<br />
ce trésor a été rassemblé jusque vers 1580 comme fruit d'une épargne<br />
relativement modeste, mais n'a été enfoui que bien plus tard, après<br />
1691, et quatre monnaies y ont été ajoutées par les possesseurs successifs.<br />
Devant la difficulté d'admettre avec toutes les autres pièces celle<br />
de 1692 au moins, j'ai demandé .1 celui .les lrventeurs qui m". peemis<br />
d'étudier la tro rvaille si cette dernière pièce était bien de même<br />
provenance. Il n'a pas nié qu'elle aurait pu venir d'un niveau supérieur<br />
et que l'un des ouvriers l'aurait jointe au lot après la découverte<br />
du vase. Il pourrait d'~'i lors en être de même de celle de<br />
1616, celles de 1585 et de 1593 pouvant à la rigueur avoir fait partie<br />
du trésor primitif. Il est en effet également peu probable que,<br />
dans une même tranchée de travail, on trouve ainsi un trésor et encore<br />
quatre monnaies isolées. D'autre part, je n'ai aucun motif particulier<br />
pour douter de la bonne foi des inventeurs. Comme le trésor<br />
a été d'abord dispersé et a dû être recomposé, il est aussi possible<br />
qu'entretemps deux ou trois pièces étrangères à la trouvaille se<br />
soient introduites.<br />
Le trésor n'a certainement pas comporté toute une suite de pièces<br />
de la fin du XVIe et de tout le XVIIe siècle. Dans ce cas en effet, à<br />
voir le nombre de pièces antérieures à 1580, il aurait certainement<br />
été constitué au moins de trois ou quatre fois plus de monnaies.<br />
Or, le vase ne pourrait guère contenir plus de pièces que celles que<br />
nous avons examinées. Il faut donc certainement écarter cette hypothèse.<br />
•<br />
La troisième supposition avancée plus haut, à savoir que plus d'un<br />
siècle s'est passé entre la constitution et l'enfouissement de cette<br />
petite réserve et qu'entretemps quatre petites pièces y ont été ajoutées<br />
par hasard, par accident, sans que les possesseurs successifs<br />
aient jamais dû entamer ce modeste fonds, doit certainement être<br />
moins retenue que la première.<br />
A cause de ces incertitudes, il est inutile de vouloir rechercher les<br />
circonstances précises dans lesquelles ce vase rempli de monnaies<br />
a été enfoui. Tout au plus peut-on penser aux campagnes d'Alexandre<br />
Farnèse.<br />
Mais rien ne nous empêche de considérer en toute confiance le<br />
trésor dans son état de 1579. Il n'est pas sans intérêt de souligner<br />
sa composition très variée. Presque toute l'Europe occidentale, hormis<br />
les principautés allemandes, y est représentée, mais avant tout<br />
le royaume de France, le Brabant, la Flandre, Cambrai, l'Espagne<br />
et Milan. Nous n'y trouvons qu'une pièce en or, une autre qui ne<br />
mérite guère ce nom tant l'alliage est de bas titre (nO 116) et peu<br />
de très grosses pièces en argent (daldres : nOS 52 et 125). Là encore,<br />
pons avons sans doute un indice de la condition modeste de l'épar-
184 MÉLANGES<br />
gnant, Celui-ci s'est contenté de pièces courantes, dans un état de<br />
conservation souvent médiocre.<br />
Quant à l'abondance de numéraire français par rapport aux monnaies<br />
des Pays-Bas, on ne peut invoquer un choix spéculatif basé<br />
sur la qualité du métal. Si, en effet, les francs d'Henri III sont au<br />
titre de 10 deniers 10 grains (DIEUDONNÉ, Manuel, II, p.332) et les<br />
daldres Philippus, demis, cinquièmes et dixièmes de daldres Philippus<br />
en Flandre et en Brabant seulement de 10 d. (Hoc, RBN,<br />
1925, p. 17; DE WITTE, II, p. 224-226), les douzains d'Henri II et<br />
les gros de six blancs de Charles IX ne sont d'autre part qu'à 3 d.<br />
16 g. et 4 d, respectivement (DIEUDONNÉ, D. C., p. 323 et 328). Les<br />
relations de commerce et de voisinage entre Courtrai et la France<br />
expliquent suffisamment cette abondance.<br />
Notons encore la présence d'un grand nombre de pièces fort usées<br />
de Philippe le Beau ou de ses prédécesseurs dans nos régions. Elle<br />
prouve également que l'esprit de spéculation n'a pas présidé à la<br />
constitution de cet ensemble de monnaies.<br />
Ce trésor contenait, outre les pièces étudiées, un ornement en<br />
argent doré. Celui-ci date très vraisemblablement de la 1 r e moitié<br />
du XVIe siècle, suivant le renseignement fourni obligeamment par<br />
Mlle Aline Bara, assistante des Musées royaux d'Art et d'Histoire à<br />
Bruxelles, à qui je l'avais soumis.<br />
P. NASTER.<br />
Farts divers<br />
Cinquantième anniversaire de la fondation de la Société<br />
royale ( Les Amis de la Médaille d'Art)) - Pour fêter ce jubilé,<br />
la Société des Amis de la Médaille d'Art a organisé dans la grande<br />
salle d'exposition de la Bibliothèque royale à Bruxelles, du 15 au 30<br />
juin, une exposition des médailles éditées par elle depuis sa fondation<br />
en 1901. ainsi que des œuvres de ses membres artstes.<br />
L'inauguration fut un succès: une centaine de personnalités tant<br />
officielles que du monde des arts y assista. Après une brève allocution<br />
de M. Jules Simon, conseiller à la Cour de Cassation, président,<br />
M. Marcel Hoc conservateur du Cabinet des Médailles fit l'historique<br />
de la Société.<br />
S. M. la Reine Élisabeth, présidente d'honneur de la Société, daigna<br />
honorer de sa vtsite cette exposition le jeudi 21 juin. Accompagnée<br />
de la baronne Carton de Wiart et du général chevalier de Nève de<br />
Roden, la Reine fut reçue par MM. M. Hoc et J. Jadot qui lui présentèrent<br />
les artistes. La Reine s'entretint avec ceux-ci et s'intéressa<br />
vivement aux œuvres exposées.<br />
En commémoration de cette visite la médaille du SOc anniversaire<br />
confiée à M. Armand Bonnetain représentera les traits de la Reine.<br />
J. J.
FAITS DIVERS 185<br />
Expositions numismatiques. - A l'initiative des Amitiés belgepolonaises<br />
a eu lieu, le 29 mai à 20 heures, au Cabinet des Médailles<br />
de la Bibliothèque royale, une séance commémorative du 90 e anniversaire<br />
de la mort de Joachim Lelewel. Elle a consisté en une exposition<br />
d'ouvrages et de souvenirs du grand historien numismate et en<br />
une conférence du conservateur sur le séj our de Lelewel à Bruxelles.<br />
Le Cabinet des Médailles a participé à plusieurs manifestations artistiques<br />
en prêtant divers objets faisant partie de ses collections.<br />
On a pu voir à Lille, à l'Exposition de la Toison d'or, une suite de<br />
monnaies émises dans nos principautés par les ducs de Bourgogne<br />
et des médailles à l'effigie de ceux-ci. Cinq médailles de Jehan de<br />
Candida représentant Marie de Bourgogne, Jehan le Tourneur, Nicolas<br />
de Ruter, Jehan de la Gruthuse, Jehan Carondelet, ont figuré- à<br />
l'Exposition «Le Siècle de Bourgogne », qui s'est tenue successivement<br />
à Dijon, Amsterdam et Bruxelles.<br />
A l'Exposition organisée par la Bourse de Bruxelles, du 7 au 15<br />
juillet, à l'occasion du 150 e anniversaire de sa création, ont figuré<br />
les monnaies qui ont eu cours dans notre pays pendant le Consulat,<br />
l'Empire et la période hollandaise, ainsi que les premières monnaies<br />
du Royaume de Belgique.<br />
Les expositions organisées à Verviers pour célébrer le 350 e anniversaire<br />
de son admission au rang des Bonnes Villes de la Principauté<br />
de Liège ont comporté une section de Numismatique. Le Cabinet<br />
des Médailles exposait une collection' des monnaies émises par<br />
tous les princes-évêques depuis l'époque de Notger jusqu'à la vacance<br />
du siège de 1792, tandis que M. le professeur X. Janne d'athée avait<br />
disposé dans les vitrines une série de médailles commémoratives des<br />
événements marquants de la ville de Verviers et de la région. Le<br />
10 août, à 18 heures, M. Janne d'athée a fait dans les locaux de<br />
l'Exposition une causerie sur l'intérêt économique, politique et historique<br />
de la Numismatique. C'est à Verviers que s'est tenue, du<br />
22 au 25 juillet, la 34 e session du Congrès de la Fédération Archéologique<br />
et Historique de Belgique. La section (1 Sciences auxiliaires de<br />
l'Histoire 1), présidée, par M. Marcel Hoc, avait à son programme<br />
les communications numismatiques et sigillographiques suivantes:<br />
(f Essai de règles sur la publication des sceaux ), par Mme 'I'ourneur-Nicodème;<br />
(c Les médailles du XVIe siècle, Gilles Hooftman,<br />
Peter Panhuis, Jean Celasse et leurs descendants 1), par M. Joseph de<br />
Beer; (1 A propos des termes monétaires usités dans les textes anciens<br />
», par M. Marcel Hoc; « Les trouvailles de monnaies: importance<br />
historique et aspects juridiques 1), par M. Paul Naster; (1 Les<br />
médaillons du général Jean André van der Meersch », par M. Jean<br />
Jadot.<br />
Le 1 er septembre s'est ouverte à Liège l'Exposition de l'Art mosan.<br />
La numismatique y était représentée par les monnaies de Liège depuis<br />
l'époque gauloise jusqu'à la fin du XVnIe siècle et par une série<br />
de sceaux-matrices. On remarquait en outre un choix d'œuvres des<br />
artistes médailleurs liégeois. Les séries exposées appartiennent au
186 MÉLANGES<br />
Cabinet des Médailles de Bruxelles, au Cabinet des Médailles de la<br />
Bibliothèque Nationale de Paris, au Séminaire de Saint-Trond, à<br />
l'Institut Archéologique liégeois, au Musée Archéologique de Namur.<br />
On trouvera dans le catalogue, bien présenté, de cette exposition<br />
une intéressante étude de J. Pirlet sur les médailleurs liégeois restés<br />
au pays' ainsi qu'un article très fouillé de Jean Babelon sur les médailleurs<br />
liégeois .en France.<br />
De grandes manifestations d'art ont eu lieu à Madrid: une- Exposition<br />
nationale de Numismatique et une Exposition internationale<br />
de Médailles. Le Cabinet de Bruxelles a exposé une suite de portraits<br />
en médailles des souverains et des gouverneurs généraux des Pays-Bas<br />
sous les Habsbourg d'Espagne. S. A. le Prince de Ligne, ambassadeur<br />
de S. M. le Roi des Belges, a prêté des médailles à l'effigie des<br />
princes de sa Maison, des médailles offertes au prince Eugène de<br />
Ligne à l'occasion de ses missions à Rome et à Saint-Pétersbourg et<br />
un choix de monnaies et de médailles de la collection de Belœil. La<br />
Société des Amis de la Médaille d'Art a présenté la collection complète<br />
des médailles qu'elle a éditées depuis sa fondation en 1901.<br />
Au nombre des conférences, nous notons celle de M. Marcel Hoc<br />
sur la politique monétaire pratiquée aux -Pays-Bas pendant les XVIe<br />
et XVIIe siècles et celle de M. Frans Van Heesvelde : Étude des premiers<br />
Philippusdaldres avec titre de roi d'Angleterre frappés dans<br />
les Pays-Bas espagnols en 1557-58-59. A l'occasion de ces expositions,<br />
la Fédération internationale des Éditeurs de médailles, dont<br />
le secrétariat général est assumé par M. Walton-Fonson, a tenu à<br />
Madrid son IVe Congrès. F. BAILLION.<br />
Deuxièz:ne Exposition-Concours à Paris, mai-juin 1951. <br />
Comme en 1949, le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale,<br />
la Société française de Numismatique et l'Administration des Monnaies<br />
et Médailles avaient organisé cette année une Exposition<br />
Concours de Numismatique. Celle-ci s'est tenue à Paris du 17 mai<br />
au 30 juin. Trente-et-un sujets avaient été proposés aux concurrents,<br />
qui pouvaient traiter librement celui .qu'ils avaient choisi.<br />
Les points de vue politique, économique, monétaire, religieux, iconographique<br />
y étaient spécialement retenus sous des aspects variés.<br />
Plus de soixante vitrines avaient été garnies avec goût et compétence,<br />
souvent avec originalité et un grand souci esthétique ou didactique.<br />
La plupart de ces présentations étaient l'œuvre d'amateurs divers,<br />
participant vraiment au concours; quelques contrfbut.ions émanaient<br />
de marchands-numismates ou de représentants de collections officielles<br />
qui restaient évidemment hors du concours. La collaboration<br />
a été internationale, comptant des envois de Suisse, d'Italie, des<br />
États-Unis et de Belgique. Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque<br />
royale de Belgique y présentait un choix démonstratif des<br />
antoniniani trouvés à Grotenberge.<br />
Lors de la proclamation des résultats du concours le 17 mai, nous<br />
5lVOPS appris avec joie le succès de notre confrère le Dr J.-B. Colbert
FAITS DIVERS 187<br />
de Beaulieu qui figure en tête de palmarès avec un grand prix pour<br />
sa vitrine exposant la méthode à appliquer dans la recherche et la<br />
localisation des ateliers monétaires de la Gaule celtique. A l'ouverture<br />
solennelle le 18 mai, où une foule nombreuse se pressait dans les<br />
grandes salles de la Monnaie, nous avons noté parmi les personnalités<br />
présentes M. le baron Guillaume, ambassadeur de Belgique, qui<br />
a montré un vif intérêt pour divers des sujets traités.<br />
Jusqu'à la fin, cette exposition a pu enregistrer un succès très<br />
mérité. Pour conserver le souvenir de cette manifestation de numismatique,<br />
les organisateurs ont édité un beau catalogue de 191 p.<br />
et 15 pl., contenant des notices très circonstanciées sur les divers<br />
su] ets traités. P. N.<br />
La Nmnismatique au Musée des chemins de fer à Bruxelles.<br />
- A l'occasion du 25 e anniversaire de sa fondation, la Société<br />
Nationale des Chemins de fer belges a inauguré le 30 octobre 1951,<br />
dans les locaux désaffectés de l'ancienne gare du Nord à Bruxelles,<br />
un musée des chemins de fer.<br />
La Section numismatique compte 204 médailles. Parmi ces pièces,<br />
citons la médaille commémorative de I'Inauguration en 1862 du<br />
chemin de fer de Varsovie à Brornberg, par Michaux; la médaille des<br />
chemins de fer éthiopiens, par Chaplain ; la médaille de I'Inauguration<br />
des chemins de fer ottomans, gravée par L. J. Hart en 1855 ;<br />
la pièce de E. Saroldi rappelant l'Exposition de Milan de 1906 qui<br />
commémorait l'ouverture du tunnel du Simplon.<br />
Mentionnons spécialement la belle médaille commémorative du<br />
centenaire des chemins de fer allemands en 1935. Cette œuvre de<br />
Eyermann joint à une stylisation sobre et de bon goût un réalisme<br />
remarquable dans le choix des figures et des sujets.<br />
Les médailles sont disposées avec art dans des vitrines du meilleur<br />
aspect.<br />
A côté des médailles d'art, on voit des insignes et des breloques<br />
d'une qualité moindre sans doute, mais qui constituent d'émouvants<br />
témoins de la vie laborieuse des cheminots.<br />
Il y a lieu de féliciter la Société Nationale des Chemins de fer de la<br />
réalisation de cet important musée. En particulier, on rendra hommage<br />
à l'initiative et aux efforts constants et couronnés de succès<br />
de Ml' Winand, l'actif délégué de la Société.<br />
F. BAILLION.<br />
Un nouveau bulletin nw:nis:rnatique aux Pays-Bas. -.:. Le [(0<br />
ninklijk Nederlands Genooischap voor Muni- en Penningkunde et la<br />
Vereniging voor Pennitujkunsl éditent ensemble depuis janvier 1951<br />
un périodique trimestriel destiné à établir entre les membres de ces<br />
associations un contact plus régulier que ce n'était le cas par le seul<br />
Jaarboek uoor Muni- en Petuiinqkuruie. Le nom de cette nouvelle<br />
publication est De Geuzenpenninq, titre qui, s'il n'est pas un programme)<br />
est au moins un symbole pour les numismates des (1 Pays-
188 MÉLANGES<br />
Bas du Nord ». Le bulletin contient des articles de vulgarisation et<br />
surtout des nouvelles numismatiques, de l'intérieur et de l'extérieur,<br />
de même que quelques comptes rendus d'ouvrages utiles aux collectionneurs.<br />
Par son allure, il fait assez penser à la Gazelle numismatique<br />
suisse, trimestrielle elle aussi, dont la création remonte à l'année<br />
19:')0 seulement. Ce sont là deux initiatives intéressantes, surtout<br />
pour les amateurs; elles méritent de réussir pleinement<br />
P. N.<br />
Congrès. - Les numismates professionnels ont tenu leur premier<br />
congrès international à Genève du 11 au 14 mai 1951. Une douzaine<br />
de pays étaient représentés. Les congressistes ont fondé l'Association<br />
internationale des numismates professionnels, dont M. L. S.<br />
Ferrer de Londres a accepté la présidence et M. H. A. Cahn de Bâle<br />
le secrétariat. Parmi les objectifs qu'ils se sont proposés, nous pouvons<br />
relever ceux-ci qui n'intéressent pas seulement le cercle<br />
des marchands: faire valoir auprès des autorités la différence entre<br />
les monnaies de collection et les monnaies courantes, diffuser rapidement<br />
tous renseignements utiles sur les pièces fausses et sur les<br />
vols de monnaies, établir un centre pour les expertises de pièces<br />
douteuses, faciliter la publication d'ouvrages numismatiques d'intérêt<br />
international.<br />
Un Congrès international de Numismatique se tiendra à Paris en<br />
1953. Le Bureau du Comité international de Numismatique, qui<br />
s'est réuni à Paris en mai 1951, prépare Ies travaux et a déjà arrêté<br />
les grands thèmes qui devront en ordre principal retenir l'attention<br />
des participants, inspirer leurs communications, discussions et échanges<br />
de vues. P. N.<br />
La Nuznismatique en Israël. - La Société de Numismatique<br />
d'Israël a tenu sa première session les 30 et 31 mars 1951. Les travaux<br />
étaient exclusivement consacrés à la numismatique antique<br />
d'Israël, qui recèle encore tant de problèmes très difficiles et importants<br />
pour l'ancienne histoire juive. MM. Reifenberg, Kanael, Kindler,<br />
Kadman-Kaufmann et Mildenberg ont présenté des communications<br />
en la matière. P. N.<br />
Le Cabinet nuznism.atique de Barcelone. - Il nous est parvenu<br />
une plaquette intéressante au sujet de l'unique cabinet numismatique<br />
d'Espagne. Elle est due à la plume du directeur M. J.<br />
Ai\lOROS, Noticia acerca del Gabineie Numismâtico de Cataluiia y su<br />
Musee, Barcelone, 1949, 39 p., plans, pll. (Ayuntamiento de Barcelona,<br />
Gabinete Numlsmatico de Cataluüa, Série B, nv 1). Après<br />
l'historique du Cabinet, nous y trouvons des considérations sur les<br />
musées numismatiques en général, une justification de l'arrangement<br />
dans les salles ct 'exposition, un guide sommaire à travers celles-ci<br />
et de nombreux plans et photos. Rien que par ce petit livre, et plus<br />
encore par une visite sur place, on se rend compte de tout le bénéfice
FAITS DtVERS 189<br />
tiré par le conservateur de ses médailliers et de l'espace dont il disposait<br />
pour organiser ses salles de musée, de travail et de service. Grâce<br />
à la présentation des pièces dans les vitrines et de cartes spéciales aux<br />
parois, grâce encore au choix de photos d'œuvres d'autres arts qui<br />
contribuent à évoquer une époque, il est incontestable que le but<br />
éducatif que le directeur s'était proposé a été largement atteint:<br />
Environ 3.000 pièces ont été exposées sur les 92.000 que possède le<br />
cabinet. La collection comporte également du papier-monnaie et<br />
des billets de banque, dont un choix figure dans des vitrines.<br />
P. N.<br />
Société royale (1 Les Am.is de la Médaille d'Art 1). - Assemblée<br />
générale tenue au Palais des Académies le 12 novembre 1950.<br />
En l'absence du président, Monsieur M. Hoc, vice-président, ouvre<br />
la séance à 10 h. 4S en présence de 17 membres. S'étaient excusés<br />
MM. Simon, Tourneur; vander Elst, Janne d'Othée, Giltay Veth,<br />
F. 1 isch et van Campenhout.<br />
M. Hoc souhaite la bienvenue aux membres présents et spécialement<br />
à M. Laloire, membre fondateur. Le procès-verbal de la séance<br />
du 26 mars 1950 est lu et adopté. Suivant le désir exprimé par<br />
M. Tourneur, il ne sera pas exécuté de médaille à son effigie dans la<br />
série annuelle de la Société. Le choix d'un autre sujet est reporté à<br />
la prochaine séance, sur proposition de plusieurs membres.<br />
On examine les dernières œuvres de MM. les artistes: de M. Bija,<br />
un médaillon en plâtre d'Hésiode; de M. de Bremaecker, le portrait<br />
de M. Eug. Walton et une plaquette: basket-hall ; de M. Hollemans,<br />
3 médailles religieuses; de M. Horvet, N.-D. de Fatima; de M. Ledel,<br />
Association pharmaceutique et Centenaire de la Banque nationale;<br />
de M. van Dionant, 60 c anniversaire de la Croix-Rouge de<br />
Schaerbeek et ~ inistrés.<br />
M. Hoc entretient l'assemblée de l'Exposition internationale de<br />
l'art de la médaille, tout récemment organisée à Amsterdam et qui<br />
réunit des œuvres choisies de plus de 250 artistes contemporains appartenant<br />
à 16 pays. Après avoir analysé les tendances actuelles de<br />
la médaille d'art, il s'est attaché à montrer le rôle que celle-ci est appellée<br />
à tenir dans le mouvement de rapprochement culturel des<br />
peuples. Et il a souhaité qu'à I'exemple de la Hollande, de la France<br />
et de la Suisse, de semblables manifestations puissent avoir lieu<br />
dans notre pays.<br />
La séance est levée à 12 h,<br />
Assemblée générale tenue au Palais des Académies le 8 avril 1951.<br />
La séance est ouverte à 10 h. 30 par le conseiller Simon, président,<br />
20 membres étaient présents, 13 s'étaient excusés. Le président prononce<br />
I'éloge de M. Velge, 1er président du Conseil d'État, membre<br />
décédé. MM. Clotman, Philippson et l'abbé Riche sont démissionnaires.<br />
MM. Hollemans et Fischweiler ont été nommés membresartistes<br />
par le Comité. '
190<br />
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 12 novembre<br />
1950, celui-ci est adopté. Puis le secrétaire fait rapport sur<br />
l'activité de la Société ell 1950. Le trésorier présente les comptes de<br />
la Société et le contrôleur les approuve. On examine le projet de<br />
budget pour 1951. Le montant de la cotisation reste fixé à 150 et<br />
175 Ir.<br />
Le président annonce à l'assemblée qu'il y aura lieu de fêter le<br />
5De anniversaire de la Société. En effet la Société hollandaise-belge des<br />
Amis de la Médaille d'Art a été constituée, au Palais des Académies,<br />
le 24 mars 1901. Placée sous la présidence d'Alphonse de Witte, elle<br />
comportait deux sections, l'une belge, l'autre hollandaise, ayant<br />
chacune à sa tête un comité directeur. Elle tenait ses séances alternativement<br />
à Bruxelles et à La Haye. Après la guerre 1914-18, les<br />
deux sections se sont séparées de commun accord. La Ste belge des<br />
Amis de la Médaille d'Art reprit son activité sous la présidence de<br />
M. Tourneur.<br />
La médaille de l'exercice commémorera cet anniversaire. Une<br />
exposition sera organisée.<br />
Messieurs les artistes présentent leurs œuvres, on examine: de<br />
A. Bonnetain, Tricentenaire de Verviers; de A de Cuyper, Firme<br />
Gevaert; de M. Hollemans: fragment d'un bas-relief, réduction<br />
directement négative représentant le prophète Ézéchiel; de M. van<br />
Dionant, 7 médailles concernant l'élevage et celle du chirurgien en<br />
chef des hôpitaux de Lisbonne.<br />
Monsieur M. Hoc, dans une causerie sur le style de la médaille<br />
moderne, étudie l'évolution du figuratif à l'abstrait et montre comment<br />
la synthèse et le symbole peuvent convenir aux exigences de<br />
l'art de la médaille. Le président le remercie 'chaleureusement au<br />
nom de l'assemblée.<br />
La séance est levée à 12 h.<br />
Le Secrétaire,<br />
Jean JADOT.<br />
Bibliographie<br />
The American Numismatic Society Museum Notes, IV. New<br />
York, The Am. Num. Soc., 1950, in-Sv, 130 p., 24 pl. <br />
Prix: $ 5.<br />
Les Museum Noies de la Société américaine de Numismatique paraissent<br />
avec une régularité tellement grande depuis leur création<br />
qu'on pourrait les prendre pour une publication annuelle. En principe,<br />
il n'en est pourtant pas ainsi.<br />
Ce quatrième tome contient 8 articles de numismatique antique,<br />
3 consacrés respectivement à des monnaies mérovingiennes, polo-
Ëi1:lLiOGRAPH1E 191<br />
naises et coloniales espagnoles, 4 ayant trait a l'Orient: la Transoxiane,<br />
un atelier ommeyade, le monnayage d'argent de Mahomed II<br />
à Constantinople et un bloc en bronze ayant servi à l'impression de<br />
papier-monnaie en Chine vers 1287 de notre ère et qui serait le plus<br />
ancien connu.<br />
Voyons en quelques mots les neuf premiers de ces articles susceptibles<br />
d'intéresser directement les lecteurs de notre revue.<br />
C. H. V. SUTHERLAND met une nouvelle fois en garde contre les<br />
anciennes classifications de monnaies par le style. Au contraire,<br />
en se basant sur un groupement plus rigoureux, suivant les méthodes<br />
exactes modernes, il faut essayer de dégager les caractéristiques<br />
d'un style d'une époque, ou mieux de quelques esprits créateurs<br />
d'une époque, en tenant compte du fait qu'en gravure monétaire il<br />
n'y a probablement pas eu tant de grands maîtres proportionnellement<br />
au grand nombre d'artisans plus modestes qui travaillaient à<br />
côté d'eux et à leur suite (p. 1-12).<br />
D. M. ROBINSON, fidèle aux traditions de Newell, analyse (p. 13<br />
28 et pl. I-VI) un trésor de 40 pièces trouvées à Mégalopolis ; il Y a<br />
21 tétradrachmes d'Alexandre, 1 de Philippe III, 2 de Lysimaque,<br />
14 de Ptolémée 1l et 2 octodrachmes d'Arsinoé r1. Ce trésor typiquement<br />
péloponnésien du Ille siècle, enfoui probablement peu avant<br />
222, est l'indice d'une large intervention financière de l'Égypte dans<br />
le Péloponnèse contre la Macédoine.<br />
S. P. NOE étudie (p. 29-41) l'origine des cistophores, création pergaménienne<br />
de l'époque d'Attale I, destinée surtout aux transactions<br />
à l'intérieur du royaume dont le centre commercial était Apamée<br />
de Phrygie, les tétradrachmes de type royal continuant à être<br />
en usage dans les villes de la côte.<br />
Mme A. BALDWIN BRETT décrit (p. 43-54) les émissions des Séleucides<br />
à Ascalon. Le différent de cet atelier est une colombe. Les<br />
roisqui y ont frappé monnaie sont Antiochus III et IV, Alexandre 1<br />
BaIa, Tryphon, Antiochus VII (1), Démétrius II (2 d règne), Alexandre<br />
II Zébina, Antiochus VIII et IX.<br />
Le même auteur présente ensuite une étude (p. 55-72) sur le type<br />
de l'Athèna Alkidèmos à Pella. La déesse, un des types archaïsants<br />
les plus réussis et les plus répandus, a aussi été appelée Athèna Promachos<br />
ou Athèna Alkis. Un passage de Tite-Live nous livre son<br />
vrai nom. Elle était la déesse tutélaire de Pella, la capitale des Macédoniens.<br />
En général, elle brandit le foudre; parfois, une lance.<br />
L'auteur signale d'autres Athènas archaïsantes sur des monnaies,<br />
de même que les divers monnayages où se rencontre le type étudié<br />
et dont le plus ancien exemplaire est de Ptolémée 1. A Pella même,<br />
elle apparaît la première fois comme'type sous Antigone Gonatas<br />
en 277.<br />
Mme A. A. BOYCE édite (p. 73-77) une monnaie du musée, frappée<br />
à Périnthe sous Gallien et représentant au revers Héraclès nettoyant<br />
les écuries ct'Augias, sujet très rare comme type monétaire<br />
qui se rencontre dans trois autres ateliers seulement.
192 MÉLANGES<br />
Mme M. THOMPSON publie (p. 79-89) quelques acquisitions récentes<br />
du médaillier grec. Au total, 9 pièces dont plusieurs inédites: 1 de<br />
Cibyra en Cilicie (?), 3 d'Elaeusa-Sébastè, 1 de Bostra, 4 de Ptolémée<br />
de Maurétanie.<br />
D. P. DICKIE et R. D. PARROTT donnent (p. 91-96) le catalogue des<br />
pièces mérovingiennes de l'A. N. S. Museum: 7 tiers de sous imitant<br />
des monnaies de Justin 1 ou de Justinien et 26 trientes ou deniers<br />
au nom de rois mérovingiens ou de cités.<br />
Ces courts résumés suffisent il souligner la grande variété et le<br />
grand intérêt des articles qui, sous le titre modeste de « notes a,<br />
composent ce volume. La présentation matérielle est en tout point<br />
digne des sujets traités. P. N.<br />
ASKEW (Gilbert), A Catalogue 01 Greek Coins. London,<br />
Seaby, 1951, in-8°, 119 P» figg. - Prix: f, -/7/6.<br />
Ce volume n'est en somme pas un ouvrage de numismatique {recque<br />
mais un catalogue de marchand, présenté par la firme Seaby.<br />
Si nous le signalons néanmoins, c'est à cause de la présence de quelques<br />
pages d'introduction (p. 7-17) et par l'allure même du catalogue<br />
où se trouvent groupées 2.185 pièces, intéressantes et caractéristiques,<br />
de toutes les régions relevant de la numismatique dite (l grecque<br />
1). Les notions exposées dans l'introduction le sont de façon<br />
fort claire et rendront certainement de bons services aux débutants<br />
à l'intention desquels elles sont rédigées en manière d'initiation.<br />
On y trouve des indications concernant l'origine de la monnaie, les<br />
types monétaires grecs, les étalons et les noms de monnaies grecques,<br />
les grandes subdivisions chronologiques et les principales ères en<br />
usage dans l'antiquité. Un tableau des alphabets archaïques ou<br />
régionaux, de petites cartes sommaires seront également appréciés<br />
de ceux qui consulteront cette liste de pièces choisies à prix marqué.<br />
P. N.<br />
Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. V, Ashmolean Museum,<br />
Evans Collection, Part l, Italy. Londres, pubI. for the<br />
British Academy, G. Cumberlege, Oxford University Press,<br />
1951, in-fv, texte, 8 pl. - Prix: 25 sh,<br />
L'Académie Britannique continue la publication de la Sylloge,<br />
déjà très fournie, par un premier fascicule consacré aux collections<br />
universitaires d'Oxford. Celles-ci comptent plus de 30.000 pièces.<br />
L'édition commence par les séries offertes par Sir Arthur Evans<br />
qui constituent à la fois le don le plus récent et le plus important.<br />
Le donateur s'était proposé avant tout'un but pédagogique; il avait<br />
remarqué des lacunes dans les médailliers d'Oxford et il a choisi<br />
dans le sien propre des pièces qui devaient combler ces lacunes.<br />
Mais quatre séries l'avaient particulièrement intéressé et sont passées
BIBLIOGR.APH1E 193<br />
pour les trois quarts environ à l'Ashrnolean Museum: l'Italie et la<br />
Sicile, l'Illyrie, la Thrace avec les régions plus septentrionales et,<br />
enfin, la Crète. .<br />
Ce fascicule groupe les 369 num éros de l'Italie. Nous y rencontrons<br />
les noms de cités dont les monnaies ne sont pas très fréquemment<br />
représentées dans des collections privées, à savoir, en Apulie:<br />
Neapolis, Salapia; en Calabre: Graxa, Uxentum. Quant à l'abondance<br />
des exemplaires, c'est surtout Métaponte qui mérite une mention.<br />
On pourrait regretter que les reproductions manquent de finesse,<br />
défaut malheureusement général dans la Sylloge, au grand<br />
désavantage des plus belles pièces.<br />
Le texte fournit, comme dans les volumes précédents, les indications<br />
essentielles, claires et concises. Il est de la main de J. G. MILNE,<br />
conservateur-adjotnt, et est sans doute sa dernière œuvre, puisque,<br />
au moment de mettre sous presse ce compte rendu, nous apprenons<br />
le décès de ce brillant numismate à qui la numismatique grecque<br />
doit tant de travaux remarquables.<br />
Souhaitons néanmoins que bientôt d'autres fascicules nous fassent<br />
connaître la suite de cette riche collection. P. NASTER.<br />
NAVILLE (Lucien), Les monnaies d'or de la Cyrénaïque<br />
(450 à 250 avant J.-C.). Genève, Atar S. A., 1951, in-4°,<br />
125 p., frontisp., VIII pl.<br />
L'auteur reprend dans ce volume une partie du travail fourni<br />
par E. S. G. Robinson dans le plus récent des catalogues de monnaies<br />
grecques du Musée Britannique, Calal, 0/ the Greek Coins 01<br />
Cyrenaica, Londres, 1927. Il craint que de ce fait la critique lui<br />
adresse des blâmes. Ces craintes sont superflues. En effet, le travail,<br />
commencé avant 1927 et qui vraiment eût été suspendu à notre<br />
dommage, précise et modifie beaucoup de points du catalogue britannique<br />
auquel le numismate suisse se plaît à se référer.<br />
Si l'étude couvre deux siècles, ce sont surtout les années 331 à 305<br />
qui sont abondamment représentées. Au total, 1043 exemplaires<br />
sont rangés sous 262 numéros, représentant 134 coins de droit et<br />
219 de revers. Le catalogue groupe ces émissions en 12 périodes.<br />
Il est solidement agencé, bien que, évidemment, des discussions<br />
puissent être ouvertes concernant certains points de la chronologie.<br />
La présentation des pièces dans le texte, autant que le choix d'exemplaires<br />
représentatifs de chaque combinaison de coins dans les planches,<br />
est excellente. Les émissions de l'or sont chaque fois situées en<br />
termes brefs dans le cadre des émissions d'argent et de bronze; de<br />
même, les événements marquants au point de VOe historique S1ît<br />
signalés de façon très succincte. On aurait pu souhaiter, malgré<br />
l'existence de l'étude récente de Robinson, que la portée historique<br />
de ces monnayages et, éventuellement, leur sens politique soient<br />
soulignés davantage. Une fois pourtant, nous trouvons une bonne<br />
REV. BELGE DE NUM•• 195'1. - 13.
194 MÉLANGES<br />
mise au point dans cet ordre d'idées, au sujet de la révolte de Magas<br />
(p. 83-84).<br />
La partie la plus savante de l'ouvrage est consacrée à la métrologie<br />
(p. 96-107 et 2 annexes p. 108-112). Il s'agit là non seulement<br />
du numéraire d'or, mais également de celui en argent dont l'étude<br />
est nécessaire pour mettre au point le rapport de 1',01' à l'argent, qui<br />
a souvent varié pendant cette période assez courte. On peut regretter<br />
que dans cette partie l'auteur soit quelquefois, pour des points essentiels<br />
dans sa démonstration, un peu affirmatif sans donner ses<br />
preuves ou ses références, p. ex. quand il dit que sous Alexandre,<br />
dans son empire, le rapport or/argent était de 1 à 10, ou lorsqu'il<br />
énonce le rapport entre la livre romaine et la mine attique.<br />
Notons, alors que le texte n'a pas mis ce point en lumière, que,<br />
dans les tableaux consacrés aux poids des pièces, ces monnaies d'or<br />
sont groupées par tranches de trois centigrammes chaque fois, alors<br />
que pour tant d'autres monnayages il faut procéder au moins par<br />
cinq ou dix centigrammes. Ceci a été possible grâce à la très grande<br />
régularité des poids de ce numéraire en or et est donc en l'occurrence<br />
pleinement justifié.<br />
Pour finir, l'auteur rejette, à bon droit ce me semble, après vérification<br />
des cas discutés et de bien d'autres, le façonnage des coins à<br />
l'aide de poinçons. Il rejoint là, par d'autres voies ct pour les coins<br />
en creux, ce que le soussigné a développé au sujet des coins en relief,<br />
pour les revers des monnaies incuses de Grande-Grèce (RBN, 93,<br />
1947, p. 5-17).<br />
La présentation matérielle est de premier ordre. Si le lecteur peut<br />
facilement lire e au lieu de 0 comme initiale d'un nom d'artiste<br />
sous le no 251, il regrettera de trouver, dans un ouvrage qu'on peut<br />
dire spécialisé, par deux fois, p. 83 et 84, la métathèse, courante<br />
mais affreuse, de y et i dans Libye et Libyens, dont l'orthographe<br />
exacte ailleurs atteste que ce n'est qu'une vilaine coquille.<br />
M. Naville n'a pas disposé, pour les exemplaires du Cabinet des<br />
Médailles à Bruxelles, de l'indication de la position relative des<br />
coin s. En empruntant son système pratique pour la marquer à<br />
l'aide des 12 chiffres du cadran d'une horloge, je fais suivre les renseignements<br />
qui lui ont manqué et qui donnent quelques compléments<br />
d'information: 22a, III ; 24c, X; 47a, XII; 63a, II ; 69a, XI<br />
(à remarquer, alors que X dans les cas cités par l'auteur); 72b, 1 ;<br />
77c, II (à noter, alors que XII ou X dans les cas relevés) ; 82a, XII ;<br />
84a, XII; 85c, XI; 87b, XII (certainement et non XI malgré la<br />
remarque 1 de la p. 11); 109b, IVjV; 122b, VI; 160a, XI j 187b,<br />
XI/XII. V/VI; 242a, XII. Il y a lieu de citer en outre une drachme<br />
d'or aux types de celles d'Alexandre le Grand dont les moulages<br />
n'auront pas été communiqués à l'auteur; elle doit figurer sous le<br />
110 238, pèse 4 g 24 et présente la direction de coins 1.<br />
Il est sans doute inutile de résumer. Quiconque aura remarqué<br />
que cet ouvrage se classe parmi les toutes bonnes monographies<br />
consacrées à la numismatique grecque depuis près de cinquante ans.<br />
P. NASTER.
BiBLIOGRAPHIE 195<br />
SEYRIG (Henri), Notes on Syrian Coins. New York, The<br />
American Numismatic Society, 1950, in-Sv, 35 p., II pl.<br />
(Numismatic Noies and Monoqraphs, 119). - Prix: $ 2.<br />
Le nombre d'idées et de faits que l'auteur présente et discute dans<br />
les 35 pages de « notes » qu'il nous livre est vraiment impressionnant. '<br />
L'essentiel concerne l'usurpateur Tryphon.<br />
Une première partie est consacrée à 118 tétradraohmes trouvés à<br />
Khan el-Ab de sur l'embouchure du Nahr el-Barid, près de l'ancienne<br />
Orthosie. Ces pièces constituent une partie d'un, de deux ou même<br />
peut-être de trois trésors, de Tryphon à Ptolémée IV. Compte tenu<br />
de l'état des pièces, il faut probablement grouper ensemble 33 tétradrachmes<br />
de Tryphon et 4 d'Antiochus VIII ensuite 66 de Ptolémée<br />
II et 1 de Ptolémée III I enfin 14 de Ptolémée IV. De Tryphon<br />
il y a 13 pièces datées, toutes de sa 4e et dernière année, alors que<br />
celles de sa 3 e année sont bien plus connues. Les circonstances dans<br />
lesquelles trois trésors auraient été amenés ainsi au même endroit<br />
font l'objet de plusieurs hypothèses.<br />
Un deuxième paragraphe traite du casque comme type monétaire.<br />
L'auteur tend à y voir l'attribut du grand dieu d'Apamée, Zeus représenté<br />
comme guerrier.<br />
En troisième lieu, il étudie les ateliers phéniciens de Tryphon: à<br />
côté d'Ascalon et de Byblos, c'est surtout Ptolemaïs qu'il faut retenir,<br />
bien que le monogramme de cet atelier ne se trouve pas sur les pièces,<br />
où l'on voit comme caractéristique un épi posé contre l'épaule de<br />
l'aigle, de la 1e à la 3 e année de Tryphon.<br />
Ensuite sont examinées les dates de 'I'ryphon, qui avait abandonné<br />
la datation par l'ère des Séleucides. TI semble d'après les monnaies<br />
et contrairement à Josèphe, qu'il ait régné une partie de 142/141<br />
jusqu'au début de 139/138, soit au total deux années et deux fractions<br />
d'année. - Toutefois, dit l'auteur (p. 15), si les pièces de Tryphon<br />
et celles d'Antiochus VII trouvées à Khan el-Abde forment vraiment<br />
un trésor, il faudrait donner raison à Josèphe (règne de 139;138<br />
à 136/135). P. 6, sans être très affirmatif, il avait pourtant tendance<br />
à grouper ensemble ces tétradrachmes. - De même, dans le 5 e paragraphe,<br />
en considérant les débuts d'une nouvelle série de tétradrachmes<br />
frappés à Aradus jusqu'en 46/45 et dont le plus ancien<br />
exemplaire connu, publié ici pour la première fois, est de 138/137,<br />
l'auteur laisse le lecteur sous l'impression (p. 17-19) qu'à ce moment<br />
Tryphon était effectivement encore en vie. Il est vrai que rlen n'indique<br />
que ce monnayage n'aurait pu commencer en 139/138, année<br />
où Antiochus VII était arrivé à Séleucie-en-Piérte et s'était sans<br />
doute, comme le suggère l'auteur, attaché les services de la flotte<br />
d'Aradus en autorisant la cité à frapper de nouveau des tétradrachmes.<br />
L'inscription du titre TYPOY JEPAE KAI AL'YAOY sur des<br />
monnaies de Tyr de 141/140 serait par contre également due aux<br />
incursions de Tryphon contre lesquelles il fallait se protéger par<br />
tous les moyens.
196 MÉLANGES<br />
Enfin, un tableau synoptique du monnayage de Tryphon termine<br />
ce premier chapitre où il est avant tout question de problèmes numismatiques<br />
se situant autour de l'histoire de cet usurpateur.<br />
Dans un second chapitre, le savant directeur de l'Institut français<br />
d'Archéologie à Beyrouth examine des abréviations sur des monnaies<br />
de Syrie et de Phénicie. Il étudie d'abord les différents des monnaies<br />
d'Aradus, où on voit: 1 0 une date en grec, 2 0 une lettre phénicienne,<br />
marquant un numéro de série ou une officine, et 3° un groupe de 2<br />
(une fois 3) lettres grecques. Il relève 24 de ces groupes; il faudrait<br />
y voir soit les initiales du nom du monétaire (abréviation par suspension,<br />
ce qui est assez général en grec), soit, dans des cas plus nombreux<br />
en l'occurrence, l'initiale et la dernière lettre (N ou E) du<br />
nom (abréviation par contraction, ce qui est en général plus rare,<br />
mais se trouve tout de même depuis l'époque archaïque).<br />
Sur des monnaies autonomes de Tyr se trouve aleph ou beth ; sur<br />
d'autres, de Sidon, on voit ç (6) accompagné de A ou B. Il faut voir<br />
là l'indication du semestre d'exercice des magistrats monétaires et<br />
l'auteur justifie son interprétation par quelques parallèles dans l'épigraphie<br />
syrienne et phénicienne pour d'autres fonctions.<br />
Enfin, M. Seyrig relève comment les dates sont introduites SUi' des<br />
monnaies de Syrie, de Phénicie et de Palestine. L est employé,<br />
soit de façon constante, soit de manière occasionnelle dans nombre<br />
de villes qui avaient été sous domination ptolémaïque; nulle part,<br />
on ne le rencontre dans les parties centrales des possessions de Séleucides.ETOYL'<br />
se rencontre dans quelques cités, mais à l'époque tardive<br />
seulement. Les monnaies des Séleucides, sauf exceptionnellement<br />
certaines émises dans des ateliers phéniciens ou palestiniens, ont<br />
des dates sans formule ou sigle qui les introduise; c'est également<br />
le cas pour diverses villes. Sous Tryphon, il est fait usage de L,<br />
précisément parce qu'il n'était pas un Séleucide,<br />
Comme on le voit, ce fascicule est plein d'idées neuves, présentées<br />
avec clarté et concision. A part sans doute une certaine imprécision<br />
dans la question des dates de Tryphon, toutes les hypothèses avancées<br />
semblent être plausibles, toutes les mises au point sont convaincantes.<br />
Peu de problèmes de numismatique séleucide pourront désormais<br />
être examinés sans recours à cet ouvrage, d'allure pourtant modeste.<br />
P. NASTER.<br />
SUTHERLAND (C. H. V.)~ Coinaqe in Roman Imperial Pulicy,<br />
31 B. C. - A. D. 68. Londres, Methuen, 1951, in-Sv,<br />
XI +220 p., XVII pl. - Prix: 21 s.<br />
Cet ouvrage est destiné, ainsi que nous l'apprend l'introduction, à<br />
l'historien de l'Empire romain et non pas au numismate. Ce dernier<br />
ne pourra pourtant pas s'en passer pour peu qu'il désire mettre ses<br />
recherches sur un niveau supérieur. L'auteur dégage les préoccupations<br />
de l'empereur, d'Auguste à Néron, en matière monétaire (émis-
BIBLIOGRAPHIE 197<br />
sions, ateliers et, surtout, choix des types et des légendes) et les<br />
projette sur l'arrière-plan de son attitude psychologique devant le<br />
pouvoir ou de ses soucis politiques ou dynastiques. Cette politique<br />
monétaire est évidemment la conséquence de la politiqué générale;<br />
celle-ci pourtant nous est souvent seulement révélée, dans ses arcanes<br />
et ses mobiles privés, par l'expression claire, bien que sommaire;<br />
qu'en donnent les monnaies.<br />
La portée utile du choix réfléchi des types avait déjà été comprise<br />
dès la fin de la République: les types allégoriques des vertus sont<br />
lancés, à titre d'allusion ou d'information, avec un minimum de<br />
commentaire verbal; au droit sont figurés de grands personnages<br />
du passé, jusqu'à ce que, sous César, on y représente les grands hommes<br />
du moment. .<br />
Dès sa victoire d'Actium (31 av. J.-C.), Auguste, dont la situation<br />
politique ne pouvait se stabiliser qu'à force de doigté et de patience,<br />
s'occupe lui-même du choix des types, comme instrument de propagande<br />
politique d'une grande importance dans la conduite de l'empire.<br />
Il met l'accent sur la Victoria, surtout dans les ateliers d'Orient,<br />
et sur la Pax; des ·pièces comme les tétradrachmes cistophoriques,<br />
où il se dit libertatis populi Romani vindex, avec au revers la Paix,<br />
ont la valeur d'un manifeste. En 27, au moment de la prise de pouvoir<br />
définitive, il se fait représenter, ciuibus seroatcis, la tête nue, ce<br />
qui est encore une forme consulaire du portrait, et s'intitule avec prudence<br />
Auguslus S. C. (Auguste par décret du Sénat). Par ailleurs<br />
l'attention du public est attirée sur les événements les plus grandioses<br />
du moment, p. ex. les succès remportés contre les Parthes, et sur les<br />
motifs qui devaient stimuler la fierté nationale. Après réception du<br />
proconsulare itnperium, en 23, Auguste insiste dans son monnayage<br />
en bronze sur la puissance tribunicienne, seule source de sa grande<br />
auctoritas, tandis que sur l'or et l'argent, destinés avant tout aux<br />
armées, le pouvoir de Yimperaior continue à être 'mis en relief. Au<br />
moins dès 25 av. J.-C., Auguste se préoccupe fort de sa succession et,<br />
l'un après l'autre, ceux en qui il avait mis ses espoirs disparaissent.<br />
Parmi eux, Agrippa et ses fils Gaius et Lucius occupent une large<br />
place dans le numéraire d'Auguste. Tibère est adopté en 4 ap. J.-C. ;<br />
depuis 9 ap. J.-C., on le voit associé à Auguste ou même figuré et<br />
cité seul dans de nombreuses séries monétaires.<br />
Tibère, jadis avide du pouvoir, n'y tenait plus guère, lorsque le<br />
moment de la succession était arrivé en 14 ap, J.-C. Son monnayage<br />
est la continuation de celui d'Auguste et présente moins d'actualité<br />
que ce dernier. A part les types célébrant Auguste divinisé, il ne<br />
relate rien de particulier concernant le changement de princeps.<br />
C'est Séjan qui, dans ses plans de succession à Tibère, saisit I'Importance<br />
de l'emploi de la monnaie. Dans ce domaine pourtant, il agit<br />
avec circonspection. Ni sa disgrâce ni la question de la succession<br />
n'influencent l'empereur dans le choix des types monétaires.<br />
Caligula (Gains) souligne d'abord par les monnaies sa parenté avec<br />
Auguste; plus tard, il ajoute à cette idée celle de la solidité de la mai-
198 MÉI.ANGES<br />
son impériale, telle qu'elle existe à ce moment. Alors que son acceptation<br />
du titre de pater patriae est commémorée par les monnaies,<br />
la crise qui l'oppose vers le même moment au Sénat est passée sous<br />
silence, Caligula d'ailleurs s'embarrassait de moins en moins de l'opinion<br />
publique et, par là, son monnayage comporte particulièrement<br />
peu d'informations.<br />
Claude, outre des allusions à sa parenté impériale, célèbre surtout<br />
sa polîtique immédiate: Pax (combinée avec des symboles de Victoria,<br />
Felicitas, Salus et Pudor), Cons tan lia, Libertes, Cérès ou un<br />
medius de blé en rapport avec Ses travaux à Ostie pour faciliter<br />
l'importation de blé. Tout cela dès sa première année, en quantité<br />
très abondante et de qualité excellente. Il ne célèbre des événements<br />
comme son retour de Bretagne qu'avec un retard de plusieurs années,<br />
tandis que les jeux séculaires p. ex. n'ont laissé aucun souvenir numismatique.<br />
Sa seconde femme, Agrippine, va prendre une grande place dans<br />
les types et dans l'administration monétaire. De 52 à 54, année<br />
de la mort de Claude, l'accent est mis avant tout sur elle-même et<br />
son fils Néron.<br />
Celui-ci n'a que 17 ans au moment de la succession. La place<br />
d'Agrippine reste d'abord prépondérante sur les monnaies: c'est<br />
elle-même qui s'en occupe. Après avoir secoué la tutelle de sa mère<br />
et celle du Sénat, en 58, Néron se tourne de plus en plus vers la civilisation<br />
hellénistique, mais son monnayage reste essentiellement romain<br />
d'esprit et d'exécution. Après ses réformes monétaires de 64,<br />
une très grande variété de types et de valeurs, d'une grande beauté,<br />
sortent des ateliers: la Concordia auqusia, pour célébrer des vertus<br />
familiales dont on pouvait douter; Roma, en rapport avec la reconstruction<br />
de la ville après l'incendie; le temple de Janus, fermé, pour<br />
souligner le retour de la paix .: le port d'Ostie, des congiaires, l'annone,<br />
le macellum Augusti (marché aux légumes) en relation avec sa politique<br />
alimentaire; Yaâlocutio et la decursio marquant son attitude<br />
militaire; la Securitas et Victoria enfin, en manière de conclusion<br />
à tout cela. Les sentiments philhellènes de l'empereur se traduisent<br />
p. ex. par un Apollon citharède, mais on constate qu'entretemps il<br />
néglige complètement, dans les monnaies comme dans la réalité, la<br />
question de sa succession.<br />
Ainsi donc, on assiste à l'élaboration d'un monnayage impérial<br />
relativement centralisé et contrôlé. De nombreux motifs exigeaient<br />
une production énorme de numéraire: l'étendue de l'empire, les<br />
campagnes fréquentes avec des troupes nombreuses une agriculture<br />
et un commerce en développement constant, une grande absorption<br />
de monnaies par delà les frontières. Quant aux types, il fallait tenir<br />
compte de toutes les tendances, de toutes les régions, mais surtout<br />
de Rome et de l'Italie. L'empereur devait se poser en princeps,<br />
veillant à l'inviolabilité des frontières, ce qui est figuré par des types<br />
militaires comme l'adlocutio cohortium et par Victoria et Pax, et incamant<br />
la sagesse de l'administration civile, marquée par les divers
BIBLIOGRAPHIE 199<br />
types de vertus, telles Iustitia, Pie las, Clementia, Conslanlia, Moderatio.<br />
L'ouvrage se termine par deux annexes proprement numismatiques.<br />
Dans une première, l'auteur traite des divers ateliers et trace,<br />
par règne, l'histoire de leurs émissions. Certains aspects techniques<br />
ont pu être poussés plus loin que dans le corps de l'ouvrage même,<br />
p. ex. la chronologie des émissions de Tibère. Dans le second appendice,<br />
nous trouvons de façon claire l'essentiel du système monétaire<br />
[ulio-claudien, subissant des variations assez légères pendant ce siècle,<br />
jusqu'en 64. Il est superflu d'ajouter que d'utiles index sont<br />
placés en fin de volume.<br />
L'exposé est serré, solide, passionnant même, bien qu'il suppose<br />
connu un minimum de connaissances historiques, nécessaires à la<br />
compréhension de la démonstration. Par contre, l'auteur explique<br />
toujours à suffisance les données numismatiques et techniques requises,<br />
pour que quiconque puisse suivre sans hésitation son argumentation.<br />
Comme on le voit par ce résumé insuffisant d'un livre qui ne se<br />
résume pas, tant il est condensé, ni historiens ni numismates ne peuvent<br />
ignorer cet ouvrage. Il se classe parmi les grandes contributions<br />
que la Grande-Bretagne a fourni à la numismatique et à l'histoire<br />
de l'Empire romain ces dernières années et qui ont déjà tant<br />
fait pour montrer des voies nouvelles aux chercheurs.<br />
P. NASTER.<br />
PINK (Karl), Einjührung in die Kellische Miinzkunde mit<br />
besonderer Beriicksichtiqunq Oesterreichs. Vienne, 1950, petit<br />
in-d>, 55 p., 8 pl., -1 carte. (Archaeologia Austriaca, fase. 6).<br />
La publication d'un travail d'ensemble sur la numismatique celtique,<br />
cet événement rare, retient toujours de très près l'attention<br />
des numismates spécialisés. On espère y trouver quelques acquisitions<br />
nouvelles, dans ce domaine si souvent établi sur la conjecture.<br />
Ainsi en est-il de la courte, mais substantielle étude que vient de<br />
faire paraître M. Karl Pink, conservateur du Cabinet de Vienne,<br />
dans la collection Archaeologia Ausiriaca, éditée par les soins de<br />
l'Institut d'Anthropologie et de l'Institut de Préhistoire de l'Université<br />
de Vienne, sous le titre dont voici la traduction littérale: « Introduction<br />
à la numismatique celtique avec particulière considération<br />
de l'Autriche 1).<br />
L'auteur nous avait déjà donné une monographie sur le monnayage<br />
d'or des Celtes de l'Est (1936), une autre sur le numéraire d'argent<br />
des Celtes du Norique (1937), suivies d'un article sur le monnayage<br />
des Celtes de l'Est et de leurs voisins (1939). Cette fois, M. Pink a<br />
voulu élargir son sujet et traiter en historien autant qu'en numismate<br />
des questions dont il a fait le tour, dans le cadre général de la numismatique<br />
des Celtes. Il la divise en quatre groupes: groupe de l'Espagne<br />
et du Sud de la France, groupe
200 MÉLANGES<br />
du Centre (Bohême, Allemagne et Suisse) et groupe de l'Est. Sa bibliographie<br />
fait l'objet d'un choix sévère, sans étalage vain. Il insiste<br />
sur l'ouvrage de base qu'est pour la Gaule et au titre général le<br />
Traité des Monnaies gauloises, auquel il se réfère sans cesse. Déplorant<br />
les conditions d'extrême concision imposées par les circonstances,<br />
il relève, non sans amertume, que M. Blanchet a pu consacrer<br />
à son sujet pas moins de 550 pages et 560 illustrations. On s'explique<br />
que pour un travail de fond, ayant nécessité une vaste enquête<br />
et un remarquable esprit de synthèse, M. Pink ne se contente pas<br />
sans humeur du cadre étriqué d'une introduction.<br />
Comme entrée en matière, le lecteur voit un rapide tableau des.<br />
migrations des Celtes. M. Pink écrit qu'on les a appelés à bon droit<br />
(1 les lansquenets de l'antiquité », Camille Jullian (Hist. de la Gaule,<br />
l, p. 324-325) avait vigoureusement réagi contre cette (l comparaison<br />
outrancière 1), empruntée à Mommsen.<br />
La chronologie des groupes monétaires est assurément une question<br />
capitale. M. Pink en expose les données 'et signale la controverse<br />
entre M. Adrien Blanchet et Sir George Cyril Brooke. Les conditions<br />
économiques et politiques entre Rome et la Gaule, estime-t-il, expliquent<br />
l'entrée de l'or macédonien en Gaule bien avant la défaite de<br />
Bituit, en 12i. Et il écrit: «nous pouvons fixer le début du monnayage<br />
en Gaule aux environs du milieu du Ile siècle avant J .-C.<br />
C'est vers la même époque que les Boïens et les Celtes de l'Est commencèrent<br />
aussi à frapper monnaie », Une conclusion de cette importance<br />
mériterait à elle seule une plus longue étude.<br />
Je. voudrais me borner à relever ce qui nous intéresse plus particulièrement<br />
en fonction de l'étude des monnaies de la Gaule. Ce compte<br />
rendu demeurera donc très incomplet et se tiendra systématiquement<br />
à l'écart des chapitres essentiels de la contribution de l'auteur,<br />
ceux qui concernent l'Est et l'Autriche. Les lignes consacrées à<br />
l'art des monnaies celtiques de la Gaule me font quelque peine.<br />
M. Pink se range au nombre des pessimistes et n'y voit que lourdeur,<br />
dégénérescence, abâtardissement dans le grotesque. Ce sont ses<br />
mots. On ne saurait être moins sensible au penchant naturel de nos<br />
aïeux pour un mode d'expression dont il nous arrive de goûter le<br />
charme, quand on cesse d'y chercher la raison. Un seul peuple<br />
celtique fit montre, pense M. Pink, d'un véritable génie créateur,<br />
c'est celui des Boïens de Bohême. Trois éléments issus de l'art de La<br />
Tène en feraient l'originalité. Ce sont des signes de la joie de conquérir<br />
les espaces, à savoir: le triskële, la figuration des têtes coupées<br />
et la croix gammée (p. 8). Le triskèle et les têtes coupées ne<br />
sont pas spécifiques aux monnayages de l'Est et se voient souvent<br />
en Gaule.<br />
Suit l'étude des monnayages celtiques en eux-mêmes. Avant de<br />
consacrer 32 pages, c.-à-d. plus de deux tiers de cette partie de son<br />
travail, aux groupes monétaires du Centre de l'Europe, aux groupes<br />
de l'Est et aux groupes celtiques en Autriche, M. Pink commence<br />
par examiner le groupe de l'Espagne et du Sud de la France, dont
BffiLIOGRAPHIE 201<br />
je ne retiendrai qu'un développement sur les monnaies à la croix<br />
des Volques Tectosages, ce peuple émigré des régions du Main vers<br />
Toulouse, Narbonne et Béziers. On a trouvé des monnaies à la croix,<br />
analogues à celles de nos Tectosages, en Wurtemberg et en Bade,<br />
en Autriche et en Suisse. MM. A. Blanchet et Robert Forrer en font<br />
état dans leurs ouvrages. Toutefois, M. Karl Pink insiste sur la<br />
trouvaille de Lauterach, près de Bregenz, dans le Vorarlberg, décrite<br />
en 1880, en ce qu'elle comprenait, à côté de deux pièces des Tectosages,<br />
du module normal de 13 mm, une série de deniers de la République<br />
romaine, dont le plus récent datait du début du 1 er siècle avant<br />
notre ère. Le savant viennois conclut qu'après leur assujétissement<br />
définitif par les Romains (donc, en 106), une partie des Tectosages<br />
du Languedoc retourna d'où elle était venue, chez ses frères de la<br />
forêt Hercynienne (les seuls Volques Tectosages dont parle César).<br />
Son numéraire aurait continué de circuler avec la monnaie locale,<br />
qui en serait dérivée. M. Adrien Blanchet, remarquons-le, avait déjà<br />
formulé dans son Traité (p. 1472, note 1) une hypothèse analogue.<br />
A propos du monnayage d'6r du groupe de l'Ouest, M. Pink écrit:<br />
(1 ainsi, à toutes les époques de l'antiquité, l'or constitua la monnaie<br />
extérieure Il (p. 15). Sans s'arrêter autrement sur ce jugement, ne<br />
peut-on se demander si pareille proposition trouve vraiment une<br />
vérification aussi universelle?<br />
Dans sa révision rapide des principaux types issus du statère macédonien,<br />
le conservateur du Cabinet de Vienne consacre un paragraphe<br />
au cheval androcéphale. dont personne, souligne-t-il, n'a jamais<br />
donné d'explication rationnelle. Il propose ceci: on constate, principalement<br />
dans le Sud de la France, la présence, au-dessus du cheval<br />
figurant au revers, d'une réplique réduite de la tète meublant le<br />
droit (ici les exemples sont une pièce trouvée en Corrèze et une autre<br />
près de Limoges). M. Pink croit que « l'imagination déchaînée de ces<br />
gens-là I) aura suggéré au graveur de coin l'amusante fantaisie de<br />
pourvoir tout simplement le cheval lui-même de cette tête humaine.<br />
Et ainsi s'expliquerait, sans aucun recours à des mythologies locales,<br />
la grosse tête disproportionnée du cheval androcéphale des monnaies<br />
attribuées aux Aulerques et aux Osismes. Cette explication est<br />
sans' aucun doute trop facile, car on ne manquera pas d'objecter que<br />
le cheval androcéphale apparaît de bonne heure dans l'archéologie<br />
et bien avant le monnayage des Gaulois.<br />
L'auteur relève d'intéressantes observations, appuyées par une<br />
précieuse liste de près de cent trouvailles, faites en Autriche, relatives<br />
à la circulation des monnaies parmi les populations de l'Est en<br />
incessants remous et en rapports commerciaux avec les centres de la<br />
Gaule, notamment Bibracte. De sorte que la règle dégagée pour la<br />
Gaule par M. Blanchet, surIe caractère local habituel des trésors,<br />
ne trouverait pas là-bas son application.<br />
L'excellent ouvrage de M. Pink n'apporte peut-être pas de solution<br />
nouvelle aux problèmes de la numismatique de la Gaule, abordés<br />
accessoirement du reste, mais il est assurément indispensable
202 MÉLANGES<br />
à qui veut bien connaître l'état de la question sur le numéraire celtique<br />
de l'Est et du Centre et, bien entendu, selou le propos particulier<br />
de l'auteur, sur la monnaie celtique d'Autriche.<br />
J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.<br />
LAFAURIE (Jean), Les monnaies des rois de France. 1. Hugues<br />
Capet à Louis XII. Paris, E. Bourgey; Bâle, Monnaies<br />
et Médailles, 1951. in-dv, XXIV+ 148 p., 30 pl. et figg. dans<br />
le texte.<br />
Cet ouvrage, le premier d'une série qui doit réunir en quatre volumes<br />
toutes les monnaies royales françaises, contient la suite des<br />
émissions d'Hugues Capet à Louis XII (987-1515), soit toute la<br />
production médiévale. Il est l'œuvre de M. Jean Lafaurie, du Cabinet<br />
des Médailles de la Bibliothèque Nationale, dont nous avons pu<br />
apprécier les nombreux inventaires de trouvailles. Il nous fait bien<br />
augurer des volumes en préparation.<br />
La confection d'un Corpus des monnaies françaises, du genre de<br />
celui que l'Italie a entrepris et qui, sans être achevé, comporte déjà<br />
vingt gros volumes în-4°, s'avérait malaisée à mener à bonne fin.<br />
Aussi n'est-ce pas un catalogue de toutes les variétés de coins et de<br />
tous les exemplaires existants que nous présente M. Lafaurie, mais<br />
une description des types de monnaies. Ce- catalogue de types a le<br />
mérite d'être complet sans négliger, bien au contraire, les émissions<br />
diverses et parfois très nombreuses qui ont suivi la création d'un<br />
type nouveau. On trouvera dans ce recueil les données essentielles<br />
et, en outre, tous les dé tails qui permettront aux collectionneurs de<br />
classer avec précision et certitude les exemplaires en leur possession.<br />
On sait combien sont nombreux les travaux consacrés à la numismatique<br />
française. M. Lafaurie a réuni les éléments épars dans les<br />
manuels, catalogues de vente, inventaires de collections. Il utilise<br />
ces travaux selon toutes les exigences de la critique, marquant l'importance<br />
et la valeur de chacun d'eux, corrigeant telle attribution,<br />
précisant telle appellation, rectlf'iant la suite donnée antérieurement<br />
de telles émissions. Nous voyons par exemple que l'écu d'or est<br />
bien la seule monnaie d'or authentique de S. Louis et nous apprenons<br />
à quelles collections ont appartenu et appartiennent actuellement<br />
les huit exemplaires, de coins variés, de cette monnaie. Quant à<br />
l'agnel d'or, dont la paternité a été longtemps attribuée au même<br />
souverain, le style de la pièce et les documents qui en font mention<br />
ne permettent pas de faire remonter cette monnaie au delà du règne<br />
de Philippe IV le Bel. On suivra avec intérêt le classement des<br />
gros tournois aux différents règnes. Mais nous ne pouvons nous<br />
arrêter ici à tous les types décrits dans ce catalogue.<br />
Le classement est en gros celui de Hoffmann. Les monnaies sont<br />
réparties pour chaque règne en trois grands groupes: monnaies d'or,<br />
monnaies d'argent, monnaies noires, et dans chaque groupe classées<br />
par valeur de compte .décroissante, Les pièces sont datées d'après
BIBLIOGRAPHIE 203<br />
les ordonnances de fabrication ou les exécutoires; à défaut de ces<br />
documents, par les listes d'émission ou les procès-verbaux de remise<br />
des boîtes.<br />
Au début de chaque règne on lit un historique du monnayage et<br />
une liste des ateliers. Dans chacun des trois groupes, après avoir<br />
décrit le type de la monnaie, l'auteur en indique l'origine, en retrace<br />
l'évolution et relève les appellations fournies par les textes. Il caractérise<br />
ensuite les émissions successives avec leur date, leurs marques<br />
distinctives, les poids et titres nouveaux, ceux-ci réduits pour<br />
la facilité du lecteur en grammes et en millièmes. Il prend soin d'indiquer<br />
le poids légal et les poids d'exemplaires examinés ou signalés.<br />
Notons encore pour chaque pièce des références bibliographiques et<br />
l'indication de valeur d'après les cotes d'Hoffmann et de Ciani et<br />
les prix réalisés aux grandes ventes publiques.<br />
De nombreuses figures insérées dans le texte facilitent grandement<br />
l'étude des types. Des tables bien composées accompagnent l'ouvrage:<br />
titre et poids des monnaies, différents d'atelier, ateliers monétaires,<br />
carte des ateliers du royaume en 1418-1421-<br />
Ce volume, de consultation très aisée, sera pour les historiens et<br />
les collectionneurs l'instrument indispensable pour le classement des<br />
types de monnaies et de leurs émissions successives.<br />
Marcel Hoc.<br />
BERGHAUS (Peter), Warungsgrenzen des Westfiilischen Oberwesergebieles<br />
im Spâttni Ile/a lter. Hambourg, Museum für<br />
Hamburgische Geschichte, Abt. Münzkabinett, 1951, pet.<br />
in-4°, xn+110 p., l pl., 10 cartes. (Numismatische Studien,<br />
1).<br />
Par cet ouvrage, le professeur Walter HAVERNICK, conservateur du<br />
Cabinet des Monnaies du Musée de Hambourg, inaugure une nouvelle<br />
collection dont il assume la direction. Ce premier volume et le deuxième,<br />
qui sera analysé ci-après, sortis de presse à peu près au même<br />
moment, font augurer au mieux de la suite de cette série. La présentation<br />
est excellente, autant que la matière développée.<br />
M. Berghaus fait une étude de géographie numismatique, qui<br />
consiste à reporter sur une carte ou sur une série de cartes, suivant<br />
des périodes caractéristiques, la circulation d'un. numéraire ou d'un<br />
nombre restreint de numéraires. Après avoir fait rapidement l'historique<br />
de la méthode, il l'applique en la poussant plus loin que ses<br />
prédécesseurs, à une région très limitée qu'il appelle le Haut-Weser<br />
westphalien et qui se situe dans le Lippe, à peu près à mi-chemin<br />
entre Paderborn au sud et Minden au nord. La période examinée<br />
s'étend de l'époque où cette région s'est séparée, au point de vue<br />
monétaire, de la Westphalie, vers 1276, à 1493, date de la dernière<br />
mention des monnaies étudiées. Le domaine du numéraire considéré<br />
est limité par celui de la Westphalie à, l'O., au N.-D. et parfois au
204 MÉLANGES<br />
N., par l'argent en lingots de Brème au N., par le numéraire léger<br />
bas-saxon au N.-E. et à l'E. et par les monnaies de Hôxter-Brakel<br />
et Warburg au S.-E. et au S. Le monnayage est effectué avant tout<br />
dans les ateliers de Herford, Lerngo et Bielefeld, et également à Blornberg,<br />
Horn et Vlotho. L'auteur examine successivement pour chaque<br />
atelier le droit de battre monnaie, la liste des maîtres des monnaies,<br />
l'organisation de l'atelier et du monnayage, les monnaies elles-mêmes<br />
avec renvoi aux trouvailles et, enfin, les contremarques sur des monnaies<br />
étrangères, de valeur en général assez importante.<br />
Ensuite vient la partie essentielle, consacrée à l'aire de circulation<br />
du numéraire en question. Après trois sections qui ne sont pas accompagnées<br />
de cartes et qui traitent de la monnaie dans la région<br />
successivement jusqu'au xrrs siècle, puis jusqu'en 1240 et enfin de<br />
1240 à 12'7H, l'auteur divise en neuf sections la période 1276 à 1493.<br />
Ces subdivisions sont dictées par l'histoire même de ce monnayage<br />
et par les fluctuations dans le cours des monnaies. Chacune de ces<br />
sections est accompagnée d'une carte montrant par des signes variés<br />
la localisation des citations des divers numéraires, de la contrée<br />
envisagée et des régions limitrophes, dans les pièces d'archives,<br />
comptes, relevés d'impôts ou d'intérêt, ou pièces similaires. La<br />
dimension du signe augmente suivant que le nombre de citations<br />
pour un même lieu est élevé. (Le nombre de documents analysés<br />
doit être considérable). Ainsi se dessine la carte de la circulation<br />
d'un numéraire; en comparant les cartes des diverses périodes on<br />
suit le développement de cette aire ou le rétrécissement de ses limites.<br />
On voit également de façon claire à quel numéraire concurrent il se<br />
hutte dans chacune des directions. Le texte fournit en outre les<br />
données des trouvailles, qui confirment les indications des archives,<br />
avec lin peu moins de précision toutefois, l'aire de circulation pratique<br />
d'un numéraire étant presque toujours. de proche en proche,<br />
plus vaste que son aire juridique, où il était la valeur suivant laquelle<br />
étaient stipulées les sommes réclamées ou reçues.<br />
L'auteur constate que ce domaine numismatique correspond en<br />
l'occurrence à des limites naturelles de la région et nullement à des<br />
subdivisions territoriales. Cette contrée du Haut-Weser westphalien<br />
est une région frontière et transitoire entre la Westphalie et la Basse<br />
Saxe, avec un caractère propre bien prononcé. Cette situation est<br />
expliquée par les événements historiques et est confirmée par des constatations<br />
relevant de domaines bien variés: la forme des agglomérations,<br />
de la maison paysanne, des charpentes, du berceau, divers<br />
aspects du folklore. entre autres concernant les coutumes et la terminologie<br />
de la moisson, et, enfin, la langue. Ce n'est qu'en architecture<br />
religieuse que les influences westphaliennes sont nettes. En<br />
direction nord-sud, l'isolement est plus grand encore, parce que le<br />
Weser, coupant diverses montagnes, situées en sens transversal, qui<br />
forment comme autant de barrières, n'a pas été, comme le Rhin par<br />
exemple, une artère de pénétration qui a soudé les unes aux autres<br />
les diverses régions de son bassin.
BIBLIOGRAPHIE 205<br />
Comme on le voit, pareille étude est de toute première importance<br />
en ce qui concerne la méthode développée et suivie et les résultats<br />
remarquables par leur précision et leur nouveauté. Cet exemple<br />
mérite de trouver ailleurs application. Du moment que celui qui<br />
veut s'y consacrer dispose de pièces d'archives et de trouvailles inventoriées<br />
en nombre suffisant, il peut, avec du soin et du discernement,<br />
arriver à des résultats précis pour l'histoire numismatique et<br />
économique.<br />
P. NASTER.<br />
WIELANDT (Friedrich), Der Breisgauer Pfennig und seine<br />
Mûnzstëtien. Ein Beitrag zur Miinz- und Geldgeschichie des<br />
A lemannenlandes im Mittelalter. Hambourg, Museum Iür<br />
Hamburgische Geschichte, Abt. Münzkabinett, 1951, pet. in<br />
4°, 112 p., 1 carte, 3 pl. (Numismalische Studien, 2).<br />
Cette monographie présente une grande affinité dans son esprit<br />
et sa méthode avec la précédente. Elle concerne l'histoire du denier<br />
de Brisgau, c.-à-d. du numéraire de Brisgau à l'époque du denier<br />
médiéval, frappé dans des ateliers appartenant pour la plupart à la<br />
région, avec l'argent provenant des mines locales. Cc denier apparaît<br />
un peu avant le milieu du XIIe siècle; son centre originel est. Fribourg.<br />
Il n'a jamais été exclusif en Brisgau de tout autre numéraire<br />
et, d'autre part, son aire s'est étendue au delà des limites de la région<br />
en direction E. et S.-E., dans le domaine d'autres numéraires. Son<br />
extension, qui est surtout marquée au XIIIe siècle, se situe dans 1e<br />
cadre du développement économique de la contrée ou d'une des<br />
villes. Depuis le milieu du XIVe siècle, le denier de Brisgau est partout<br />
en recul. Ceci est dû en grande partie à la conclusion de conventions<br />
monétaires entre des cités ou contrées situées à la périphérie<br />
du Brisgau, p. ex. l'entente entre Zurich, Bâle et le duché d'Autriche<br />
en 1344, ou bien à la constitution d'unions entre ateliers de la région<br />
étudiée, p. ex. l'union de Schaffhouse en 1377. Avant de disparaître<br />
ainsi graduellement avec les autres à la fin du XIVe siècle, le denier<br />
de Fribourg avait donné naissance dès le début de ce même siècle<br />
au rappen, dont l'origine n'est donc pas à proprement parler suisse,<br />
Cette étude, dont l'objet principal est l'étendue du domaine du<br />
denier de Brisgau, est basée presque exclusivement sur l'analyse de<br />
documents d'archives, comptes et relevés de cens, impôts ou fermages.<br />
Leur nature est avant tout ecclésiastique au XIIIe siècle, civile<br />
au XIVe, Il n'y a qu'un document traitant le sujet dans son ensemble,<br />
mais pour un moment déterminé seulement, le Liber decimationis<br />
du diocèse de Constance, daté de 1275. L'examen des trouvailles et<br />
des monnaies elles-mêmes (sauf en ce qui concerne leur aspect -bractéates<br />
ou pièces à deux faces - et leurs types) n'intervient que dans<br />
une faible mesure, même pour l'établissement du poids du marc<br />
en usage et du denier qui en dépend et qui aurait pesé:
206 MÉLANGE:s r<br />
vers 1200, 0 g 496 à raison de 480 d. au marc de fin<br />
et en 1349, 0 g 333 à raison de 720 d. au marc de fin,<br />
après des allègements et affaiblissements successifs.<br />
Pour chacun des ateliers ou seigneuries pris en considération et<br />
pour autant que les documents le permettent, l'auteur fait en bref<br />
l'histoire de la cité ou de la seigneurie, puis celle des émissions, des<br />
maîtres des monnaies, des types et de la valeur des deniers. Peut-être<br />
peut-on regretter que la partie .cartographique ne soit pas aussi développée,<br />
aussi analytique que dans l'étude de M. P. Berghaus, recensée<br />
plus haut.<br />
Cette monographie a, dans son objet même, un intérêt avant tcut<br />
régional et concerne surtout l'Allemagne méridionale et la Suisse<br />
septentrionale. Mais l'ouvrage revêt, comme le précédent, un caractère<br />
plus général par la méthode suivie. Il importe en numismatique<br />
de ne pas seulement décrire des pièces, ou même des trésors,<br />
ou faire l'histoire d'un type ou d'un atelier, mais d'étudier pour une<br />
période assez longue, délimitée par la nature même du sujet, le numéraire<br />
de toute une région, formant un bloc monétaire assez homogène.<br />
On est ainsi plongé pleinement dans l'histoire économique de<br />
cette contrée, et par contre-coup dans celle des régions environnantes<br />
dont elle a subi les influences ou la concurrence, ou dont elle a,<br />
au contraire, conditionné l'économie.<br />
P. NASTER.<br />
HANS (Dr. J.), Zwei Johrhurulerte Maria-Theresien-Taler,<br />
1751-1951. Klagenfurt, Selbstverlag Dr. J. Hans, 1950, in-SOt<br />
60 p., 1 pl. - Prix: 30 Sch.<br />
La faveur accordée au thaler à l'effigie de l'impératrice Marie<br />
Thérèse et portant la date de 1780 est un phénomène qui touche<br />
tant à la numismatique qu'à l'histoire économique, à l'ethnographie<br />
et à l'histoire de la civilisation. M. Hans, spécialiste d'histoire économique<br />
orientale, a choisi pour la publication de son travail l'année<br />
du 200e anniversaire de la création du thaler de Marie-Thérèse. L'auteur<br />
a déjà par de nombreux articles montré combien il s'intéressait<br />
à cette question.<br />
La principale monographie sur ce sujet, thèse de M. E. Fischel,<br />
date de 38 ans déjà; le présent ouvrage sera d'autant mieux accueilli<br />
qu'il traite spécialement de l'histoire récente de ce monnayage.<br />
En guise d'introduction, M.Hans rappelle les origines de cette<br />
émission et décrit la pièce. Puis il dresse un tableau statistique des<br />
émissions, année par année, et atelier par atelier. Furent frappés<br />
de 1751 à 1949: 320 millions de thalers parmi lesquels 130 millions<br />
durant ces trente dernières années.<br />
Jusqu'en 1935, les ateliers ci-après les frappèrent: Vienne, Hall,<br />
Günzburg, Kremnitz, Carlsbourg, Milan, Venise et Prague. Ensuite<br />
ce fut à Rome, Londres, Paris, Bruxelles (en 1937: 3.145.000; en<br />
1938: 6.700.000), Vienne et même Bombay (en 1940-41 : 18.864.576).
BIBLiOGRAPHIE 207<br />
Dans le troisième chapitre, l'auteur traite de l'histoire de cette<br />
pièce de 1751 à 1914 et il explique le rôle des Arabes dans son succès<br />
et sa propagation dans les régions occupées par ceux-ci. Dans les chapitres<br />
suivants, il s'occupe plus spécialement du thaler en Éthiopie<br />
jusqu'en 1936 et de la concurrence entre la lire et le thaler en Afrique<br />
orientale.<br />
L'auteur s'intéresse ensuite aux deux émissions faites hors d'Autriche<br />
de 1935 à 1946, celles-ci découlant d'un accord intervenu en<br />
1935 entre l'Italie et l'Autriche, accord par lequel l'Autriche abandonnait<br />
en quelque sorte pendant 25 ans le droit de frapper des thalers.<br />
Un chapitre traite ensuite de la démonétisation du thaler en<br />
Abyssinie par les Italiens, puis de la réapparition de celui-ci, par<br />
l'entremise des troupes anglaises (1940-45). Enfin, par suite du dualisme<br />
existant en Abyssinie entre l'Ostafrika-Schilling et le thaler,<br />
celui-ci est démonétisé en 1945.<br />
L'auteur s'attache enfin aux régions d'Arabie où le thaler a encore<br />
cours (1949) ; il termine par un chapitre sur le prix de l'argent<br />
et des considérations sur le marché monétaire. Afin de donner une<br />
vue d'ensemble sur l'évolution du thaler durant ces trente dernières<br />
années, il dresse une table chronologique des faits principaux concernant<br />
ce monnayage. Un index alphabétique permet de retrouver<br />
facilement toute question.<br />
Cet intéressant opuscule est, nous le pensons, une mise au point<br />
définitive; il s'adresse plus aux économistes qu'aux numismates, vu<br />
l'ampleur des questions qu'il embrasse.<br />
J. JADOT.<br />
MILES (George C.), Rare Islamic Coins. New York, The<br />
American Numismatic Society, 1950, in-Sv, xI+138 p., X pl.<br />
- Prix: $ 5.<br />
L'auteur projette d'éditer une série d'ouvrages analogues à celui-ci<br />
dans lesquels il ferait connaître des monnaies islamiques rares ou<br />
inédites, faisant pour la plupart partie des collections de l'American<br />
Numismatic Society. Il fait aussi appel à d'autres collections parmi <br />
lesquelles il faut signaler avant tout l'anciennecollection Yacoub Artin<br />
Bey, devenue collection Robert C. H. Brock, actuellement au musée<br />
de la University of Pennsylvania. Il procède autant que possible par<br />
ordre chronologique. Les pièces dont un exemplaire avait déjà été<br />
cité ou décrit dans des publications difficilement accessibles ont été<br />
reprises ici, lorsque la présence d'un autre exemplaire dans les collections<br />
examinées en fournissait l'occasion.<br />
Dans une première section sont décrites 68 pièces d'émissions<br />
arabes dites d'avant la réforme, imitant pour la plupart des monnaies<br />
sassanides ou byzantines et qui sont asiatiques, africaines ou espagnoles.<br />
Une deuxième partie concerne des monnaies ommeyades,<br />
de l'Est et de l'Ouest; on y dénombre 7 pièces en or, dinars ou divisions,<br />
23 dirhems et 23 monnaies en cuivre. La troisième et dernière
208 MÉLANGES<br />
section est consacrée aux monnayages abassîdes: 109 pièces en or,<br />
143 en argent et 46 en cuivre, Au total nous avons là la publication<br />
de 419 monnaies sous 408 numéros.<br />
A diverses reprises, l'auteur signale en passant le nombre d'exemplaires<br />
de tel genre conservés au musée de l'A.N.S. et dont il publie<br />
seulement un choix suivant le but qu'il s'est proposé; ce nombre est<br />
en général élevé et dévoile quelque peu la richesse de ce médaillier<br />
en ce domaine de la numismtique: p. ex. 230 dirhems et 300 cuivres<br />
de la deuxième section, là où chaque fois 21 pièces du musée sont<br />
publiées; une cinquantaine de byzantine-arabes dont seulement 4 se<br />
trouvent ici.<br />
Cet ouvrage ne constitue P:13 un simple catalogue, une sèche énumération.<br />
Pour beaucoup de pièces il marque leur place dans l'ensemble<br />
des exemplaires connus ou commente en détail leur intérêt<br />
historique particulier, qui, pour une quarantaine au moins, est considérable<br />
au point de vue politique, militaire, monétaire ou épigraphique.<br />
Trois index, un en arabe, des noms et titres arabes, un des ateliers<br />
et un des personnages cités complètent le texte et en rendent la consultation<br />
très aisée. Enfin, une suite de dix planches comporte une<br />
illustration assez abondante qui nous montre que l'état de conservation<br />
des pièces n'est pas inférieur à leur valeur scientifique.<br />
Dans le détail, les spécialistes de tel ou tel monnayage pourront<br />
peut-être soulever un doute, critiquer ou rejeter une hypothèse, mais,<br />
dans l' ensemble, il ne paraît pas y avoir de critique à formuler. Ce<br />
travail n'est pas seulement une excellente mise en route d'un catalogne-général<br />
des collections islamiques de l'A.N.S., mais encore un<br />
ouvrage auquel tout qui étudie l'Islam des quatre premiers siècles de<br />
l'Hégire devra se référer. Nous ne pouvons qu'en féliciter l'auteur<br />
dont l'activité a déjà été si féconde dans un domaine bien méconnu<br />
et ingrat de la numismatique.<br />
P. NASTER.<br />
FORIEN DE ROCHESNARD (Jean-Georges), Les monnaies des<br />
prisonniers de guerre en France pendant la guerre 1914-1918.<br />
Auxerre, 1950, in-4°, 47 P» figg.<br />
Cet ouvrage coustitue une importante contribution à l'étude du<br />
papier-monnaie. L'auteur décrit environ 6.500 billets de prisonniers<br />
de guerre. Le classement est bien conçu et groupe sous diverses rubriques<br />
les billets mentionnés. Nous trouvons ainsi: les billets passepartout<br />
; les billets émis par les régions militaires; ceux portant un<br />
nom de camp: cette dernière catégorie est la plus fournie; les billets<br />
des compagnies détachées; les monnaies métalliques émises par les<br />
camps de prisonniers et d'internés civils; les billets des camps français<br />
stationnés à l'étranger, en l'occurrence ceux de la 251 e Cie, stationnée<br />
à Milan; les billets des camps étrangers en France, camps<br />
belges, américains et anglais.
13îBLIOGRAPH1E 209<br />
Les premiers billets émis pour les prisonniers de guerre ou les înternés<br />
l'ont été pendant la -guerre du Transvaal de 1899 à 1902 et<br />
étaient en usage dans les camps de Ceylan et de Sainte-Hélène.<br />
Avant cette guerre, on réglait le travail des prisonniers de guerre en<br />
monnaie du pays où ils étaient internés ou on ne les payait pas du<br />
tout.<br />
Dès 1914, tous les États belligérants émirent des billets pour prisonniers<br />
et internés. Cette monnaie spéciale rendait l'évasion plus<br />
difficile. Jusqu'en 1918, la plupart des camps portent le nom du<br />
lieu où ils sont stationnés. Après cette date, les camps sont divisés<br />
en compagnies qui sont employées à réparer les dégâts causés par<br />
la guerre. Ces compagnies changent souvent de lieu de stationnement<br />
et on indique généralement sur les billets le numéro de la compagnie<br />
au lieu du nom du camp.<br />
Certaines compagnies ont été dissoutes sans avoir émis de billets.<br />
L'auteur a utilisé les catalogues connus, tels ceux de Forbin et<br />
de Ch. Denis. Il a trouvé en outre bon nombre de renseignements<br />
dans les catalogues de vente de la Maison J. Schulman, à Amsterdam.<br />
Mentionnons que la collection A. Keller, de Berlin, comporte<br />
7.950 billets de tous pays et que la collection personnelle de M. Forien<br />
de Rochesnard compte 6.250 billets de tous pays.<br />
Signalons, p. 6 et 7, un curieux tableau des fleurons figurant sur<br />
les billets de prisonniers. L'auteur a relevé 140 impressions différentes.<br />
La disposition typographique est agréable et d'une excellente<br />
présentation. Elle facilite grandement la consultation de ce volume<br />
d'une utilité incontestable. F. BAILLIDN.<br />
(Joseph), Jean Scheylve, bourgmestre d'Anvers,<br />
DE BEER<br />
chancelier de Brabant, et ses deux médailles, 1575. Anvers,<br />
Imprimeries Générales Lloyd Anversois S. A., 1950, in-dv,<br />
24 p.<br />
M. J. de Beer nous donne des précisions sur la personnalité de<br />
Jean Scheyfve et sur les deux médailles à l'effigie de celui-ci.<br />
Du crayon généalogique de la famille qu'il a dressé avec le plus<br />
grand soin, il ressort que Jean Scheyfve, né en 1513, décédé en 1581,<br />
était fils non de Jean et de Jeanne de Berchem, mais d'un Jean<br />
Scheyfve, forgeron ou maréchal-ferrant de son état, et d'Adélaïde<br />
Wouters. Après avoir situé le personnage, M. de Beer décrit sa carrière<br />
d'échevin et bourgmestre d'Anvers et de chancelier de Brabant<br />
et il évoque ses démêlés avec le cardinal Granvelle. Il décrit ensuite<br />
les deux médailles à son effigie, dont il peut confirmer par des actes<br />
authentiques l'attribution à Jacques .Jonghelinck.<br />
Les testaments et codicilles de Jean Scheyfve montrent que c'est<br />
par la volonté expresse de celui-ci seul que les deux médailles ont été<br />
REV. BELGE DE NUM., 1951. - 14.
210<br />
confectionnées. Il devait en être fait quatre en or du grand module<br />
pour être remises à ses fils Édouard et Maximilien, au fils aîné de sa<br />
fille Marguerite, épouse de Christophe d'Assonville, et au fils unique<br />
de sa fille Marie; une certaine quantité du petit module en or, en<br />
argent et en vermeil (l pour être conservées par chacun comme souve<br />
nir et être distribuées à certaines personnes et amis en souvenir<br />
de lui j).<br />
Cette étude, très documentée et circonstanciée, contient en outre<br />
des détails sur la garde-robe et les bijoux de Jean Scheyfve et la<br />
description de la sépulture somptueuse qu'il avait par testament ordonné<br />
d'ériger en l'église Ste-Gudule à Bruxelles. La situation économique<br />
et les troubles religieux de l'époque auront empêché les héri<br />
tiers d'exé cuter les volontés du défunt. M. H.<br />
BABELON (Jean) et JACQUIOT (Josèphe), Histoire de Par-is<br />
d'après les médailles de la Renaissance au XXe siècle. Paris,<br />
Imprimerie Nationale de France, 1951, in-d>, 112 p., dont<br />
25 pl. Tiré à 1000 exemplaires numérotés. - Prix: 1800 Ff.<br />
La célébration du second millénalre de Paris a donné lieu à des<br />
manifestations nombreuses et diverses. Un album de médailles Illustrant<br />
les faits commémorés ne serait-il pas le monument le plus<br />
complet et le plus apte à perpétuer le souvenir de l'événement?<br />
M. J. Babelon souligne à nouveau, dans l'introduction, la (1 valeu .<br />
du témoignage apporté devant l'Histoire par une collection de médaîlles<br />
». Et précisément ce recueil de médailles choisies avec goût,<br />
le commentaire qui les introduit, la description qui les accompagne<br />
en sont I'éloquente et splendide démonstration.<br />
M. Babelon s'en tient au XVIe siècle, le bel âge de la médaille,<br />
dont il retrace les débuts et le magnifique essor. C'est ensuite toute<br />
la vie de Paris de Henri IV à nos jours - ses monuments, ses rois,<br />
ses passions, ses rêves, ses artistes, ses écrivains, ses penseurs - qui<br />
se trouve évoquée pas à pas en rapport avec les médailles par Mlle<br />
Jacquiot. Et il faut louer tout autant la grâce du commentaire que<br />
les choix des médailles.<br />
Cet ouvrage,composé à l'aide de caractères romains de la Commission<br />
.Iaugeon MDCXCIII et illustré de reproductions en double ton,<br />
se recommande aux bibliophiles et aux amateurs de belles médailles.<br />
Le livre est de ceux qui apprennent à voir. Marcel Hoc.
SOCfÉTÉ ROYA LE DE NUMI8MATIQUE<br />
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF<br />
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX<br />
Séance tenue au Cabinet des Médailles à Bruxelles le 13<br />
mai 1950.<br />
La séance est présidée par M. M. Hoc, président.<br />
Le président commence par faire l'éloge de M. Théry, correspondant<br />
étranger, décédé.<br />
M. J. Bingen parle de Philippe-Louis Roettiers, graveur général<br />
de 1719 à 1732. Petit-fils de l'orfèvre anversois dont sont issus tous<br />
les graveurs Roettiers de France, d'Angleterre et des Pays-Bas,<br />
Philippe 1II Roettiers est généralement appelé Philippe-Louis, quelquefois<br />
Philippe le Jeune. On ignore où et quand il est né. De 1714<br />
à 1718, il collabore activement à l'œuvre de son père Philippe, graveur<br />
général des Pays-Bas méridionaux. Pendant ces- années, il<br />
signe ses meilleures médailles et quelques jetons. Par lettres patentes<br />
du 16 mai 1719, il succède à son père décédé comme graveur général.<br />
Philippe-Louis vécut dans des conditions matérielles assez pénibles<br />
et ne jouit que de fort peu de considération. Après la mort de son<br />
père, il n'a produit que trois médailles et de nombreux jetons, e.a,<br />
des jetons d'étrennes. Son œuvre se caractérise par le manque d'inspiration,<br />
l'impuissance à se renouveler, le peu de grâce des effigies.<br />
PIns encore que son père, Philippe-Louis est un graveur médiocre<br />
plutôt qu'un artiste créateur. Il mourut vers le 15 décembre 1732.<br />
Ce fut son cousin Jacques Roettiers qui lui succéda.<br />
M. F. Baillion présente une médaille inédite de Fréderlc Hagenauer<br />
à l'effigie du comte Thomas von Rieneck, chanoine du chapitre de<br />
Cologne. La carrière artistique du médailleur allemand est d'abord<br />
esquissée. L'œuvre étudiée date de 1536. On y voit le buste du personnage<br />
à gauche, Imberbe, portant la barrette doctorale et, sur la<br />
poitrine, une croix attachée à une chaîne ornée. Au pourtour, une<br />
longue inscription en deux lignes indique le nom et les titres du<br />
chanoine. Le revers est caractéristique de la facture habituelle de<br />
Hagenauer: une date (ANNO SALUTIS MDXXXVI) accompagnant<br />
un écu (celui des Rieneck, à cinq fasces). Dans le recueil de Habich<br />
consacré à la médaille allemande au XVIe siècle, sont signalées cinq<br />
autres médailles analogues, mais toutes différentes par certains détails,<br />
parfois importants. La pièce commentée n'est certainement<br />
pas Inférieure à I'une d'entre elles,<br />
Le Secrétaire,<br />
Paul NASTER.
212 SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE<br />
Assemhlée générale tenue à Anvers le 16 juillet 1950.<br />
La Société royale de Numismatique a été reçue à 10 h 30 à l'Hôtel<br />
de ville d'Anvers où M. l'échevin Moris, au nom de l'administration<br />
communale, adressa des paroles de bienvenue à l'assemblée. Il y fut<br />
répondu par M. Hoc, président, et M. le vicomte Terlinden, viceprésident.<br />
Après la visite des magnifiques salons de l'Hôtel de ville. les membres<br />
se dirigèrent vers la Maison des Bouchers pour y tenir leur réunion<br />
dans un cadre non moins évocateur d'un grand passé.<br />
La séance est ouverte à 11 h 05 par le président. Étaient en outre<br />
présents: MM. V. Tourneur, président d'honneur, le vicomte Terllnden,<br />
vice-président, P. Naster, secrétaire, J. Jadot, trésorier, Ch.<br />
vander Elst, contrôleur, J. de Beer, J. Ph'let, Ch. Gillis de Sart<br />
T'ilman, G. Boeykens, écuyer P. van der Vrecken, F. Baillion, Dr B.<br />
Dujardln, Dr J. Desneux, M. Cocquyt, membres effectifs; MM. P.<br />
Renard, F. Van I-Ieesvelde, F. Mattheessens, L. Casterman, M. Grégoire,<br />
W. Herssens, C. Meert, J. Bingen, J. Fléron, correspondants<br />
régnicoles; M. H. Schneider, correspondant étranger.<br />
Assistaient également à la séance M. H. Enno van Gelder, conservateur<br />
du Cabinet des Médailles il La Haye et secrétaire du Konink<br />
Iijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, M. Ch.<br />
Seltman, professeur à l'Université de Cambridge, et Mme J. Chittenden,<br />
tous deux membres de la Royal Numismatic Society.<br />
S'étaient excusés: MM. A. Blanchet, H. Mattingly, Jkhr F. Beelaerts<br />
van Blokland, membres honoraires; MM. Ed. Laloire, baron<br />
M. de Schaetzen, Mme V. Tourneur, MM. Dr V. Lallemand, P. Clotman,<br />
Vl. Proot, G. Boulogne, chevalier Ph. de Schaetzen, L. Fourez,<br />
E. Minet, chan. J. Vandervorst, membres effectifs; MM. l'abbé A.<br />
Van Bockryck, O. Malaise, X. Janne d'Othée, J.-M. Gyselinck, J.<br />
De '''Vaele, J. Hoc, correspondants régnicoles; MM. R. Pflieger,<br />
Dr J.-B. Colbert de Beaulieu, L. St. Forrer, correspondants étrangers.<br />
Après lecture, le procès-verbal de l'assemblée générale tenue à<br />
Bruxelles le 5 mars 1950 est adopté.<br />
L'assemblée approuve le texte d'une adresse à la Société de Numismatique<br />
du Nord de la France, nouvellement réorganisée et dont<br />
l'activité se développe avant tout dans le domaine de la numismatique<br />
des anciens Pays-Bas.<br />
Le président, M. M. Hoc, esquisse en quelques traits la place d'Anvers<br />
dans la numismatique. A peine y a-t-il moyen de mentionner<br />
la très grande production de numéraire dans les ateliers d'Anvers.<br />
Dans le domaine de la médaille, Q. Metsys inaugure la brillante suite<br />
de médailleurs du XVIe siècle. Nombreux sont les méreaux de famille,<br />
des gildes et corporations, ceux qui ont trait à la vie charitable.<br />
Il en va de même des dénéraux ajustés pour les transactions dans la<br />
grande cité commerciale. Les sceaux également offrent de riches<br />
séries.
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX 213<br />
M. F. Van Heesvelde parle des daldres philippus au titre de roi<br />
d'Angleterre frappés à Anvers par Philippe II de 1557 à 1559, alors<br />
qu'en 1558 déjà, le roi avait perdu ce titre, lors du décès de Marie<br />
Tudor. Le modèle des coins de la nouvelle monnaie est dû à Giovanni<br />
Poggini, médailleur florentin. Ce dernier avait déjà exécuté,<br />
en 1556, deux médailles à l'effigie du roi. Il existe 3 types différents<br />
de droit et autant de revers pour les monnaies. Dès les premiers<br />
types, de petites modifications sont apportées à tel ou tel détail;<br />
dans les deuxièmes types, les légendes se modifient de diverses manières,<br />
le buste s'écarte du modèle de Poggini ; en 1558 apparaissent<br />
les troisièmes types: le buste est tourné à droite et la gravure est<br />
plus lourde. Tout cet exposé est illustré d'un choix de daldres philippus,<br />
chacun en un grand carton séparé, où l'attention est attirée<br />
par des moyens très pratiques (agrandissements photographiques,<br />
dessins, flèches) sur les détails qu'il importe de remarquer spécialement.<br />
Divers membres louent le conférencier pour l'originalité de<br />
cette présentation et le soin avec lequel elle est faite.<br />
M. V. Tourneur commente une médaille de Jehan de Candida qui<br />
lui était inconnue quand il publia son travail sur ce médailleur en<br />
1914-19. On y voit Carondelet coiffé d'un chaperon, refait d'après<br />
le buste de la médaille qui était déjà connue. Carondelet est appelé<br />
ici chancelier de Bourgogne, alors que la médaille est datée de 1479.<br />
Or, il n'est chancelier de Bourgogne que du 26 juin 1480 jusqu'au<br />
12 juillet 1480, date de son congé. Il faut sans doute interpréter<br />
1479 comme étant simplement la date reprise de la première médaille.<br />
Au revers, on voit les armes de Carondelet,<br />
M. J. Bingen signale l'importance de l'atelier anversois de Philippe<br />
l'orfèvre. Philippe Roettiers, fils, revint aux Pays-Bas pour assumer<br />
la charge extraordinaire de premier graveur général, lors de l'introduction<br />
du balancier dans les Monnaies en 1684. Vingt-trois ans<br />
plus tôt, son frère Jean avait été appelé à Londres pour tailler les<br />
carrés destinés au nouveau balancier. Ceci s'explique par les connaissances<br />
techniques que les Roettiers avaient acquises dans I'atelier<br />
anversois de leur père Philippe. On sait en effet que cet atelier<br />
frappa vers 1655 une médaille de Jean Roettiers par estampage mécanique<br />
et qu'en 1659 une « presse », probablement un balancier, y<br />
fonctionnait.<br />
A midi, les membres se rendirent au Musée Mayer van den Bergh,<br />
où, grâce à l'obligeance de M. L. Jacobs van Merlen, une exposition<br />
spéciale et choisie de pièces tirées des collections numismatiques du<br />
Musée les attendait. Ils purent admirer en outre les médailles exposées<br />
dans les vitrines et, parmi elles, celle de Q. Metsys reproduisant<br />
les traits de Christine Metsys, sœur de l'artiste.<br />
Quelques membres ont visité la riche collection de M. Ch. vander<br />
Elst, contrôleur de la Société.<br />
Après le déjeuner servi au Musée du Sterckshof à Deurne, le COl1<br />
servateur en chef de celui-ci, M. Joseph de Beer, fit à ses confrères
214 SQCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE<br />
les honneurs de son musée. Il inaugura à cette occasion la Salle Osterrieth,<br />
en souvenir de ce grand numismate anversois, de son vivant<br />
membre de- la Société: un choix de pièces numismatiques ayant<br />
appartenu à cet amateur était exposé et fut commenté par leur conservateur<br />
actuel.<br />
Le Secrétaire,<br />
Paul NASTER.<br />
Le Président,<br />
Marcel Hoc.<br />
Séance tenue au Cabinet des Médailles à Bruxelles le18 novem.hre<br />
1950.<br />
La séance est présidée par M. M. Hoc, président.<br />
Le président commence par annoncer qu'une exposition-concours<br />
de Numismatique sera organisée, pour la deuxième fois, à la Monnaie<br />
de Paris du 17 mai au 30 juin 1951. Il rappelle quel est l'objet de ce<br />
genre de manifestation numismatique et engage nos membres à y<br />
participer.<br />
M. M. Hoc décrit les monnaies frappées à Tournai pendant le siège<br />
de 1709.<br />
Son propos n'est pas de faire d'après les sources, abondantes et diverses,<br />
un exposé critique des faits ni d'étudier les nombreuses médailles<br />
qui leur ont été consacrées à l'époque. Il ne retient que les<br />
monnaies obsidionales émises par le lieutenant général marquis de<br />
Surville, qui commandait la place pour le roi de France. Investie<br />
par les troupes alliées le 27 juin, celle-ci capitula le 28 juillet; la<br />
garnison se retira alors dans la citadelle, qui se rendit le 2 septembre.<br />
Les monnaies frappées à Tournai pendant ce siège sont des pièces<br />
de 20 patards en argent et des pièces de 8 et de 2 patards en cuivre.<br />
La fabrication commença dès les premiers jours de juillet; le cours<br />
du numéraire d'argent fut autorisé par le Parlement le 13 juillet,<br />
l'émission des pièces de cuivre le fut le 20 juillet. Dès le 29 du même<br />
mois, jour OLI fut signée la capitulation de la ville, tout ce numéraire<br />
était (1 retiré 1). Or, il s'en rencontre des exemplaires dans toutes les<br />
collections. Le nombre considérable des exemplaires conservés nous<br />
porte à croire que l'ordre de retrait n'a pas été exécuté à la lettre.<br />
On trouve d'ailleurs de ces pièces qui ont été revêtues d'inscriptions<br />
commémoratives au burin; il s'agit en l'occurrence de pièces conservées<br />
à titre de «( souvenirs ».<br />
Les pièces de 20 patards portent un buste lauré dans lequel tous<br />
les écrivains contemporains du siège ont vu le portrait du marquis<br />
de Surville en personne. La présence insolite sur des monnaies obsidionales<br />
de l'effigie du commandant d'une place assiégée a donné<br />
lieu à de vives discussions (REN, 1854 et 1855). On a voulu y voir<br />
le portrait de Philippe V, petit-fils de Louis XIV, ou un buste repris<br />
d'un poinçon quelconque. Arguant de l'opinion unanime des écrivains<br />
contemporains du siège, ainsi que du silence de Surville et de<br />
ses proches en fac.e de l'émotion soulevée par cette figure, et compte<br />
tenu des çonditfons d'exécution q:ui ne fleJ1l1.ettai~nt guère une res-
EXTRAîTS DES PROCÈS-VERBAUX 215<br />
semblance avec tel ou tel modèle, M. Hoc se montre disposé à admettre<br />
l'avis de Ch. Cocheteux que l'effigie de la monnaie d'argent<br />
est celle du gouverneur. Quant aux pièces de cuivre, elles portent,<br />
celles de 8 patards les armes de Surville à trois forces, celles de 2 patards<br />
la tour, symbole de la ville assiégée.<br />
Cette communication a été suivie d'un échange de vues auquel<br />
ont pris part M. le Dr B. Dujardin, qui a suggéré de considérer<br />
cette effigie comme celle de Louis XIV, et M. L. Fourez, qui a donné<br />
de précieuses indications sur la mentalité tournaisienne à l'époque<br />
étudiée.<br />
M. J. Jadot a noté au cours de ses lectures certains passages ayant<br />
trait à des médailles frappées ou gravées à Gand au commencement<br />
du 1g e siècle. Il a pu en reconnaître quelques-unes parmi celles qui<br />
sont conservées au Cabinet des Médailles. Il cite notamment une<br />
médaille décernée le 10 juillet 1800 à un amateur qui avait acheté<br />
le tableau vendu le plus cher à une vente publique; une médaille<br />
décernée par l'Académie de Gand le 14 janvier 1802 au sculpteur<br />
Joseph Inghels pour une statue de neige de 5 m 80 de hauteur; la<br />
médaille gravée par P. J. Tiberghîen et décernée le 10 octobre 1802<br />
à Daniel Poelman, de la confrérie des arquebusiers de St-Antoine.<br />
Ensuite, il rappelle que les indigents pouvaient mendier à certains<br />
endroits de la ville et portaient une médaille de plomb avec l'inscription<br />
« Bedelaer van de stad l) (1802). Différentes médailles furent<br />
décernées aux lauréats des Expositions des Beaux-Arts à Gand<br />
de 1804 à 1814; quelques-unes sont gravées par Tiberghien. Le<br />
16 février 1805, le Conseil communal décida d'offrir une médaille à<br />
Liévin Bauwens. M. Jadot dit un mot des origines des Floralies<br />
gantoises et des médailles y données comme prix; il montre encore<br />
une médaille en bronze et une en argent frappées en 1819 en commémoration<br />
de la pose de la première pierre du palais de l'Université.<br />
Il termine sur une note humoristique en rappelant que le 1 mai 1820<br />
le Sénat académique de l'Université décerna une médaille en argent<br />
à un ventriloque nommé Alexandre.<br />
A la fin de la séance, les membres ont pu prendre connaissance<br />
des dernières publications numismatiques parvenues au siège de la<br />
Société.<br />
Le Secrétaire,<br />
Paul NA8TER.<br />
Séance tenue au Cabinet des Médailles à Bruxelles le 13 janvier<br />
1951.<br />
La séance est présidée par M. M. Hoc, président.<br />
Le Dr B. Dujardin commente quelques autographes de sa collection<br />
écrits par des numismates ou traitant d'un point de numismatique.<br />
Outre un portrait de Juste Lipse dédié par lui-même à Spinola,<br />
ce sont des lettres de Juste Llpse, de Spanheim, d'Alexandre-Xavier<br />
Panel, garde du cabinet des médailles du roi d'Espagne; une missive
216 SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMiSMATIQUE<br />
de Gérard Van Loon au professeur Réga, accompagnant un opuscule<br />
de Puteanus; des lettres de Van Manen, de Millin de Grand<br />
Maison, de J. Lelewel, du duc de Luynes, de Pozzi, de Renier Chalon<br />
à Henri DelmoUe, concernant la Société des Agathopètes, de<br />
C. P. Serrure au même Delmotte, de Vlasto. Il y a enfin une lettre<br />
adressée par Albert Mockel au Dr Dujardin lui-même concernant le<br />
goût de collectionneur de J.-M. de Hérédia et d'Henri de Régnier:<br />
le second collectio nna an moins des intailles, tandis que le premier<br />
formula au sujet des monnaies cette définition ({ les monnaies, ces<br />
sonnets de la sculpture 1),<br />
M. H. Schneider traite des imitations et des contrefaçons du noble<br />
à la rose d'Édouard IV d'Angleterre dans les Pays-Bas, Il fait<br />
d'abord circuler des nobles, nobles à la rose et angelots d'or anglais<br />
à côté de leurs imitations et contrefaçons flamandes et hollandaises.<br />
Il existe déjà une littérature abondante sur les nobles, angelots d'or<br />
et « Ship ryal 1) émis officiellement en Hollande et en Flandre et<br />
imitant les pièces anglaises correspondantes. Mais les contrefaçons<br />
dites « flamandes) du noble il la rose d'Édouard IV et du noble<br />
d'Henri VI, pièces non officielles, ont été jusqu'à présent négligées<br />
et par les numismates anglais et par ceux des Pays-Bas. Pourtant,<br />
tout récemment IV!. Anthony Thompson, d'Oxford, a fait sur la matière<br />
un exposé d'une importance primordiale pour la connaissance<br />
de la numismatique de nos régions.<br />
Les nobles à la rose d'Édouard IV ont été des pièces particulièrement<br />
répandues dans toute l'Europe, comme en témoignent entre<br />
autres les contremarques de Dantzig, de Riga, de Gorinehem et<br />
d'Ypres, Cettc diffusion dura plus d'un siècle après la mort<br />
d'Édouard IV et ce ne fut que vers la fin du XVIe siècle que ces pièces<br />
ont été contrefaites en grand nombre, pour circuler jusqu'au milieu<br />
du XVIIe comme une véritable monnaie internationale. Les plus<br />
anciennes de ces contrefaçons remonteraient au début du XVIe -siècle.<br />
La plupart de celles qui sont dites « flamandes 1) sortent de l'atelier<br />
de Gorinchem et datent de peu avant 1590. Cette restitution à Gorinchem<br />
a pu être faite par M. Thompson grâce à l'étude des poinçons,<br />
let tres et marques monétaires. Ces mêmes caractéristiques se retrouvent<br />
sur une pièce qui se classe entre la série des contrefaçons et<br />
celle des imitations et qui porte en outre un point secret et les armoiries<br />
des seigneurs d'Arkel. Le Cabinet des Médailles de La Haye<br />
possède une pièce qui a la même parenté de signes monétaires que les<br />
contrefaçons, mais qui porte en abréviation l'indication ({ Moneta<br />
domîni Arkelensis ad valorem Edwardi Il. Sur cette pièce, on voit<br />
également les armoiries des seigneurs d'Arkel sur l'écusson dans la<br />
main du « roî », Il est donc certain que les autorités municipales de<br />
Gorinchem, usant du droit de battre monnaie qui jadis appartenait<br />
aux seigneurs d'Arkel, ont fait frapper un très grand nombre de<br />
nobles à la rose, jusqu'à ce que les autorités hollandaises firent fermer<br />
de force cet atelie-r en 1589, après de nombreuses interventions<br />
contre ses activités illégales.
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX 211<br />
M. Ch. vander Elst fait un exposé au sujet du florin dit d'Albert<br />
de Bavière considéré comme une pièce du Hainaut (Chalon, suppl.<br />
l, nO XVI et De witte; suppl., p. 27). Ce florin porte au droit l'effigie<br />
de saint Jean-Baptiste et la légende +.S.IOHA NNES.B. avec<br />
un petit écu fascé; au revers, le lis de Florence et la légende D UX.AL<br />
BERTVS. Albert de Bavière fut régent en Hainaut de 1358 à 1389<br />
pour son frère Guillaume III, aliéné; il 'fut comte de 1389 à 1404.<br />
Il est peu probable qu'Albert ait frappé en son propre nom pendant<br />
la régence. De Witte a douté de l'attribution, qu'il faut donner à<br />
Albert d'Autriche. Ceci est confirmé par une trouvaille faite il y a<br />
une trentaine d'années dans un monastère limousin. Outre un florin<br />
dit d'Albert de Bavière, on y reconnut un ange d'or, lm lion d'or<br />
et un pavillon de Philippe VI de France (1328-1350) et un florin<br />
de Jeanne de Provence (1352-1362). Ces cinq pièces étaient dans<br />
un état de conservation excellent; la date d'enfouissement doit être<br />
proche de 1362. D'autre part, l'écu fascé marque la maison d'Autriche,<br />
il faut alors plutôt voir dans l'Albertus du florin Albert II<br />
d'Autriche (1330-1358).<br />
M. le Dr J. Desneux profite de la publication récente de l'étude<br />
de M. May sur le monnayage d'Aïnos pour faire circuler deux tétradrachmes<br />
et une diobole de cet atelier. Il souligne les qualités de<br />
ces pièces.<br />
Le Secrétaire,<br />
paul NASTER.<br />
Séance tenue au Cabinet des Médailles à Bruxelles le 5 mai<br />
1951.<br />
La séance est présidée par M. le vicomte Terlinden, vice-président.<br />
M. P. Naster entretient l'assemblée d'une trouvaille de plus de<br />
2.400 antoniniani faite à Grotenberge en Flandre Orientale en mai<br />
1950. Seize empereurs et impératrices sont représentés, s'échelonnant<br />
de Gordien III à Postume. Les pièces de Postume sont les plus<br />
nombreuses: plus de 1.850. Il Y en a deux parmi elles qui sont datées<br />
de la ge puissance tribunicienne et du 4e consulat. La constitution<br />
du trésor est par conséquent postérieure au 10 décembre 266,<br />
tout en étant vraisemblablement antérieure à la fin du règne de Posturne<br />
en automne 268. Certains types sont représentés par un nombre<br />
très élevé d'exemplaires pouvant aller jusqu'à 459. L'examen<br />
de deux de ces séries nombreuses et de deux suites plus réduites de<br />
22 exemplaires chacune permet de procéder à une étude approfondie<br />
des coins. On constate ainsi que les coins de revers sont, comme chez<br />
les Grecs, plus nombreux que ceux de droit; il se produit des chevauchements<br />
et des combinaisons diverses: un coin de droit peut même<br />
servir avec des coins de revers de type différent. Ceci ébranle la chronologie<br />
proposée récemment et l'attribution à certaines officines.<br />
La question du poids théorique des pièces est commentée à la lumière<br />
d'un graphique; la présence d'une pièce de poids particulièrement<br />
REV. BELGE DE NUM., 1951. - 15.
218 SOCIÉTÉ ~OYAi.E DE NtJ'iYriSMATtQUE<br />
bas et d'une autre, des mêmes coins, exceptionnellement lourde<br />
incite à la plus grande rigueur dans cette étude. Quelques considérations<br />
sur le nettoyage et sur des microphotographies montrant la<br />
structure de l'alliage, dont la teneur en fin est connue par analyse<br />
chimique, terminent cet exposé.<br />
M. J. Bingen, parlant de Jacques Roettiers et des émissions de<br />
1749, rappelle d'abord la situation monétaire déplorable des Pays<br />
Bas autrichiens à la veille des réformes de. 1749. Le système bi-métallique<br />
est vicié par un rapport inexact de l'or et de l'argent; l'évaluation<br />
fantaisiste des espèces étrangères, l'insuffisance de la frappe<br />
dans les ateliers nationaux, la circulation de pièces de mauvais aloi<br />
rognées ou fausses, aggravent désespérément une situation due à<br />
l'incapacité et à l'inertie des maîtres généraux. L'intervention énergique<br />
et compétente du conseiller Bosschaert va amener une série<br />
importante de réformes: création d'une Jointe des monnaies; exploitation<br />
par l'État des Hôtels des Monnaies; liberté, provisoire d'ailleurs,<br />
de la circulation de l'or, de l'argent, des espèces étrangères;<br />
enfin, le 19 septembre 1749, la grande ordonnance de Marie-Thérèse<br />
sur le nouveau monnayage qui inaugure des émissions particulièrement<br />
abondantes de toute la gamme des monnaies d'or, d'argent et<br />
de cuivre, qui va du double souverain à la pièce de 10 liards. A ce propos,<br />
M. Bingen analyse des lettres envoyées au conseiller Bosschaert<br />
par le graveur général Jacques Roettiers du 19 mars au 1 juillet 1749.<br />
On y assiste à la naissance, souvent laborieuse, des coins destinés à<br />
la frappe, par Anvers et Bruges, de quelques dénominations d'or et<br />
d'argent. L'élaboration des légendes et des types, le travail de l'effigie<br />
impériale diversement appréciée peuvent y être suivis en détail.<br />
Dans sa lettre du 19 mars 1749, Jacques Roettiers fait même connaître<br />
ses idées sur la réforme monétaire projetée. Enfin M. Bingen<br />
explique comment une nouvelle erreur dans le rapport or largent<br />
vicia la réforme et entraîna un réajustement des différentes dénominations.<br />
Le Secrétaire,<br />
Paul NASTER.
NÉCROLOGIE<br />
HUBERT VAN DE WEERD<br />
Le professeur H. Van de Weerd, né le 5 novembre 1878 à.Eelen<br />
en Limbourg, est décédé à Bruxelles le 30 mai 1951. Avec lui disparaît<br />
une des grandes figures de l'archéologie nationale en Belgique.<br />
Il avait fait les études de philologie classique à l'Université de Louvain.<br />
Ses premières publications traitèrent de l'histoire des légions<br />
romaines et parurent dans le Musée belge en 1901 et 1903. Pendant<br />
toute sa carrière, il se consacra avant tout à l'étude de l'antiquité<br />
romaine et bientôt ce fut plus spécialement l'histoire des Tungri<br />
(1913) et de la cinitas Tungrorum (1914) qui allait l'occuper et lui<br />
permettre d'unir à sa spécialité scientifique son amour du sol natal.<br />
Tongres fut dès lors l'objet principal de ses recherches et de ses publications.<br />
Voulant enrichir le nombre de ses sources, il conçut le<br />
projet d'entreprendre des fouilles dans sa cité de prédilection. Ce<br />
sont dans notre pays les premières de l'espèce, menées suivant des<br />
méthodes tout à fait modernes et rigoureusement scientifiques.<br />
Elles furent conduites en 1930, 1931, 1934 et 1935 avec la collaboration<br />
de son ami M. J. Breuer.<br />
En 1923, il avait été nommé professeur à l'Université de Gand.<br />
Il y forma beaucoup d'élèves et son enseignement archéologique et<br />
pratique y fait époque et y a créé une tradition. Il a consigné-la<br />
synthèse de ses travaux et de sa carrière dans un ouvrage de haute<br />
classe, un manuel d'archéologie gallo-romaine des Pays-Bas (Inleiding<br />
loi de Gallo-Romeinsche archeologie der Nederlaruien. Anvers,<br />
1944) ; un chapitre important y est consacré à la numismatique de<br />
la période étudiée.<br />
Depuis longtemps d'ailleurs, le professeur Van de Weerd avait<br />
accordé à la numismatique la place qui lui revenait dans ses recherches.<br />
Nommé correspondant régnicole de la Société royale de Numismatique<br />
en 1931 et élu membre en 1946, il avait publié dans la<br />
Revue belge de Numismatique, 83, 1931, p. 15-26, en collaboration<br />
avec M. R. De Maeyer, des monnaies romaines trouvées au cours de<br />
fouilles, sous le titre Les fouilles de Brunehaut-Liberchies.<br />
En 1948, des Miscellanea lui furent offerts par ses nombreux disciples<br />
et amis, sous la forme du tome XVIII de L'Antiquité classique.<br />
On peut y lire, p. XXIX à xxxv, sa bibliographie qui compte 108 numéros.<br />
Le professeur Van de Weerd ne laissera pas seulement le souvenir<br />
d'un grand savant, d'un initiateur et créateur d'école, mais encore<br />
d'un chrétien à la foi solide, d'un homme de cœur, d'un Flamand<br />
ardent, tout dévoué à son Limbourg natal et à son Université.<br />
H. ROOSENS.
LISTE DES MEMBRES<br />
DE LA<br />
SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE<br />
(30 septembre 1950)<br />
PRINCIPALES<br />
ABRÉVIATIONS<br />
B. belges (depuis 1830). Lg. Liège<br />
Br. Brabant Lx. Luxembourg<br />
cur. (monn.) curieuses M. monnaies (souvent omis)<br />
Déc. décorations Méd. médailles<br />
Dén. dénéraux Mér, méreaux<br />
FI. Flandre N. Namur<br />
Fr. France Pap. papales<br />
G. grecques P.-B. anciens Pays-Bas<br />
GI. glyptique R. romaines<br />
Ga. gauloises rel. (méd.) religieuses<br />
H. Hainaut S. sceaux<br />
Ins. insignes Seign. seigneuriales<br />
J. jetons T. Tournai<br />
Membrea d'honneur<br />
S. M. Léopold III .... . . . .<br />
S. A. le Prince de Ligne, château de Belœil<br />
6. 3. 1921<br />
29. 6. 1930<br />
Membres honoraires (1)<br />
MM.<br />
1. BLANCHET (J.-Adrien). membre de l'Institut, bibliothécaire<br />
honoraire à la Bibliothèque nationale, boul, Émile Augier, 10,<br />
Paris, XVIe (Ga.• J., S., Antiq.) 2. 7. 1899<br />
2. VAN KERKWIJK (A. O,), directeur honoraire du Cabinet des<br />
Médailles, Villa Sonnevanck, .Iulianaweg, 26, Doorn 6. 3. 1927<br />
3. MA.JKOWSKI (Le chanoine Edmond), K6rnik kola Poznanla<br />
(Pologne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. 3. 1934<br />
/ MATTINGLY (Harold), conservateur honoraire au British Museum,<br />
Gonville & Caïus College, Cambridge (Angleterre). 10. 3. 1946<br />
5. BEELAERTS VAN BLOKLAND (Le Jonkheer F.),vice-président du<br />
Conseil d'État, Bazarstraat, 13, La Haye (tél. 182341) (Méd.<br />
hist. P.-B.) ...•....•.........•. 29. 6. 1947<br />
(1) Le nombre des membres honoraires est limité à quinze,
222 LISTE DES MEMBRES<br />
6. BABELON (Jean), conservateur du Cabinet des Médailles de la<br />
Bibliothèque nationale, rue de Rennes, 106bis, Paris. VIe.. 5. 3. 1950<br />
7. SERAFINI (Le marquis Camillo),gouverneur de la Cité du Vatican,<br />
directeur du Cabinetnumismatique dela Bibliothèque vatittcane,<br />
Cité du Vatican .<br />
8. NOE (Sydney T.), conservateur des collections de I'Amerlcan<br />
Numismatic Society, Broadway between 155th and 156th<br />
streets, New York 32, N. Y., U.S.A.<br />
MM.<br />
Membres effectifS (1)<br />
1. LALOIRE (Édouard), conservateur honoraire aux Archives<br />
générales du Royaume, av. Brugman, 270, Uccle .....<br />
2. TOURNEUR (Victor), secrétaire perpétuel de l'Académie royale<br />
de Belgique, ch. de Boitsfort. 102, Boitsfort . . . . . . . •<br />
3. COPPIETERS T' WALLANT (J.-B.), commissaire d'arrondissement,<br />
av. Prince Charles, 9, Knocke-Le Zoute .....<br />
4. DE VINCI{ DEDEUXÛRP (Le baron), rue BelIiard, 159, Bruxelles<br />
5. HENNET (Le général Robert), professeur émérite à l'École<br />
militaire, rue Defacqz, 65, Bruxelles (tél. 370934) (M.)<br />
6. Hoc (Marcel), conservateur du Cabinet des Médailles de la<br />
Bibliothèque royale, rue Henri Marichal, 19, Ixelles<br />
7. DE BEER (Joseph), conservateur du Musée du Sterckshof,<br />
Hooftvunderlei, 160, Deurne (Anvers) (tél. 350207) (Br., Ft,<br />
Lg., Seign., Méd, hist. 16 0 -17 11 , Mér., Dén., Déc., S.) ..•.<br />
8. DE SCHAETZEN DE SCHAETZENHOFF (Le baron Marcel), membre<br />
du Conseil héraldique, rue Royale, 87, Bruxelles<br />
9. PIRLET (Jules), notaire, rue Sainte-Véronique, 20, Liège<br />
(tél. 61445) (Lg, : Méd., J.) .<br />
10. GILLIS DE SART-TILMAN (Charles), major aviateur de complément,<br />
rue Marie-Thérèse, 47, Bruxelles<br />
11. CREMER DE MONTY (Auguste), château de Pêtaheid, Hodimont-Verviers<br />
(tél. 12764) (B., Méd. rel. 17 c -18 e , S.)<br />
12. TOURNEUR (Mme Victor), archiviste honoraire aux Archives<br />
générales du Royaume, ch. de Boitsfort, 102, Boitsfort ..<br />
13. BOEYK.ENS (Germain), brasseur, Asper .<br />
14. LALLEMAND (Victor). docteur en médecine, av. Winston Churchill,<br />
4, Uccle, (tél. 448421) (Lg., r.s., N., H.) .<br />
15. CLOTMAN (Pierre), rue Longue du Sel, 41, Alost (Pays div. : M.,<br />
Méd., J., Mér., Dén.) .•...............<br />
6. 7. 1902<br />
7. 3. 1909<br />
10. 3. 1912<br />
5. 3. 1922<br />
4. 3. 1923<br />
6. 3. 1927<br />
4. 3. 1928<br />
3. 3. 1929<br />
2. 3. 1930<br />
1. 3. 1931<br />
1. 3. 1936<br />
6. 3. 1938<br />
3. 3. 1940<br />
16. VAN DER VRECIŒN (L'écuyer Paul), ch. de Bruxelles, 130,<br />
Mons (tél. 315.36) (P.-B. mérid.) 10. 3. 1946<br />
17. BAILLION (Fernand), conservateur adjoint au Cabinet des<br />
Médailles de la Bibliothèque royale, rue du Musée, 5, Bruxelles<br />
18. DUJARDIN (Le docteur Benott), professeur honoraire à l'Université,<br />
rue de l'Industrie, 13, Bruxelles<br />
(1) Le nombre des membres effect~fs est lilnit~ à trente-cinq.
LISTE DES MEMBRES 223<br />
19. PaOOT (William), colonel pharm., ~ Le Moniat s , Anseremme<br />
20. BREUER (Jacques), conservateur aux Musées royaux d'Art et<br />
et d'Histoire, square Marie-José, 1, Woluwe .....•<br />
21. BOULOGNE (Germain), rue des Représentants, 21, Jemappes<br />
22. MICHAUX (Prosp.), exp. en tableaux, rue du Péage, 68, Anvers<br />
23. DEMEESTER DEBETZENBROECK(Hervé), av. AlphonseXIII,20,<br />
Uccle. . . . . . . . . . . . . • .• 7. 3. 1948<br />
24. DESNEUX (Jules), docteur en médecine, rue Montoyer, 27,<br />
Bruxelles .....•...............<br />
25. DE SCHAETZEN (Le chev. Philippe), rue de Maestricht, 6,<br />
Tongres (tél. 26) (Gallo-rom.) .<br />
26. JAnOT (Jean), av. Louise, 22, Bruxelles (tél. 118625)<br />
(18 e : M., Méd., J., Ins., Méd. rel., Déc. ; Mér. brux.; S., GI.)<br />
27. TERLINDEN (Le vicomte), professeur émérite à l'Université de<br />
Louvain, rue du Prince royal. 85, Ixelles (tél. 127322) (R.) 6. 3. 1949<br />
28. NAsTER (Paul), bibliothécaire au Cabinet des Médailles de<br />
la Bibliothèque royale, rue Berckmans, 32, Bruxelles<br />
29. VANDER ELST (Charles), docteur en droit, rue Longue de l'Hôpital,<br />
32, Anvers (tél. 333980) (H., T. ; Méd. et J. P.-B.; Th.<br />
Van Berekel) .<br />
30. FOUREZ (Lucien), juge au Tribunal de 1 r e Instance, rue Joseph<br />
Hoyois, 2c, Tournai (tél. 125.13) (S. P.-B.) . . . . . . .<br />
31. NoWÉ (Henri), archiviste de la ville, rue Abraham, 13, Gand<br />
(tél. 532.53) (Coll. Ville de Gand) ....•...... 5. 3. 1950<br />
32. COCQUYT (Marcel), av. Émile Duray, 36, Ixelles<br />
33. MINET (Le commandant Ernest), av. Général Eisenhower, 38,<br />
Schaerbeek ...................•<br />
34. VANDERvonST (Le chanoine J.), professeur à l'Université<br />
de Louvain, rue Frédéric Lints, 170, Louvain<br />
Correspondants régnicoles (1)<br />
MM.<br />
1. CHAALIER (Pierre), ingénieur, rue Jean Jaurès, 265, Montignies-sur-Sambre<br />
•........•.•<br />
2. TINCHANT (Paul), av. des Arts, 19, Bruxelles<br />
3. RENARD (Paul), avocat, rue Fabry, 14, Liège<br />
4. VAN BOCKRIJCIC (L'abbé Albert), curé à Sint-Huibrechts-<br />
Hern, Limbourg (R.) . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. DUMOULIN (Alexis), boulevard Ad. Max, 77, Bruxelles •.<br />
6. DESMAIZIÈRES (Le vic h ) , château de et à Heers (Limbourg)<br />
7. LANOTTE (L'abbé André), secrétaire de l'Évêché, Namur.<br />
8. BONNETAIN (Robert), rue de l'Écuyer, 23, Bruxelles (tél.<br />
180643) (G., R., Ga.; Méd. anc.) . . • . • . .<br />
9. 3. 1919<br />
6. 3. 1932<br />
5. 3. 1933<br />
3. 3. 1935<br />
(1) Le nombre des correspondants régnicoles, en principe limité à soixante,<br />
est porté, à titre exceptionnel, à soixante-cinq.
224 LISTE DES MEMBRES<br />
9. DE WALSGHE (Jules), m-effier à la Cour de Cassation, rue Sallaert,<br />
13, Bruxelles<br />
10. VERHULST (Louis), directeur général honoraire au Ministère<br />
des Finances, rue des Éburons, 83, Bruxelles (Lg., N., Lx. :<br />
M., Méd., J., Mér.)<br />
11. CLESSE (J. A.), docteur en médecine, Trois-Ponts<br />
12. STEISEL (Oswald), administrateur-délégué de la Ste Anonyme<br />
de l'Union des Papeteries, av. de l'Uruguay, 59, Bruxelles<br />
13. LECOCQ (Yvan), major, rue Aviat. Thieffry, 46, Bruxelles<br />
14. VAN HEESVELDE (Franz), agent de change, av. de Belgique,<br />
16, Anvers<br />
15. VERLINDE (Georges),commissaire des Monnaies, rue Hôtel des<br />
Monnaies, 97, Bruxelles (tél. 373948) (M. mod.)<br />
16. GONDRY(Maurice),général, rue Général Lartigue, 63, Woluwe<br />
St-Lambert (tél. 337688) (P.-B. mérid. ; Méd. hist., J.)<br />
17. HAUTRIVE (Robert), agent de change, rue du Commerce, 21,<br />
Jambes (R., J. N.)<br />
18. DE JONGHE (Robert), agent de change, ch. d'Alsemberg,<br />
604, Uccle<br />
19. VAN ZUYLEN (Le baron Philippe), rue de la Science, 37, Bruxelles<br />
20. ROSART (Fernand), directeur de la Société belge de Banque,<br />
square François Riga, 26, Bruxelles<br />
21. PIETERS (Jules), secrétaire communal de Serskamp<br />
22. MALAISE (Oscar), premier substitut du Procureur du Roi, rue<br />
Grande, 68, Dinant (tél. 368) (G.)<br />
23. JANNE D'OTHÉE (Xavier), professeur à l'Université de Liège,<br />
rue de la Banque, 10, Verviers (tél. 11683) (Lg., P.-B.: M.,<br />
Méd., J.)<br />
24. SYMOENS (René), conservateur des Hypothèques, rue St<br />
Quentin, 69, Bruxelles (tél. 334288) (P.-B. mérid., B.)<br />
25. MATTHEESSENS (Frans). avocat, 6 Berkendael o. Sint-Mariaburg-lez-Anvers<br />
(tél. Kapellen 742654) (Or m. â.)<br />
26. VAN NECK (Hugues), journaliste, av. de la Constitution, 11,<br />
Ganshoren<br />
27. DECOSTER (Gaston), orfèvre, rue Royale, 102, Bruxelles<br />
28. CARPENTIER (Jean). brasseur, Iseghem<br />
29. REMION (José), notaire, av. de Monbijou, 6, Malmédy.<br />
30. MICHAUX (Étienne), secrétaire comptable, quai Sainte-Barbe,<br />
21, Liège (B., surtout région Visé: M., Méd., Déc.) .<br />
31. CASSART (L'abbé Jean), inspecteur diocésain, ruede Tournai, 3,<br />
Templeuve (Méd. rel.)<br />
32. BERQUIN (Ch.R.), conserv. du Musée, Grand' Place, 8, Nieuport<br />
(tél. 23127) (B.)<br />
33. DALLEMAGNE (G. ct), lie. en phil. et Iet., rue des Pierres, 6.<br />
Bruxelles<br />
34. CASTERMAN (Louis), éditeur, rue de la Tête d'Or, 7, Tournai<br />
35. HOF~A,N (Georges), rue Longue du Sel, 41, Alost •<br />
7. 3. 1937<br />
6. 3. 1938<br />
5. 3. 1939<br />
3. 3. 1940<br />
10. 3. 1941i<br />
2. 3. 1947<br />
7. 3. 1948,
LISTE DES MEMBRES<br />
225<br />
36. MERTENS (Joseph), docteur en phil. et let., rue Hi Brouns, 4,<br />
Machelen (Brabant) (R. et Ga. trouv. en Belg.)<br />
37. G'YSELINCK (Jean-Marie), docteur en droit, av. Eugène Ysaye,<br />
37, Anderlecht (tél. 210309) (B., Méd.)<br />
38. GRÉGOIRE (Marcel), av. Carton de Wiart, 72, Jette.<br />
39. GOCHEL (Félix), thier.des Critchions, 107. Chênée<br />
40. HERSSENS (Willy), Heuvelstraat, 32, Boechout-Lierre (tél.<br />
Anvers 812524) (M. et J. P.-B. ; B., Fr.)<br />
41. DE W AELE (K.). pharmacien, Ankerstraat, 158, St-Nicolas<br />
(Waes) (tél. 506) (FI., P.-B., Fr., Angl., Pap.)<br />
42. HOLLENFELTZ (Pierre), av. de Belgique, 44, Anvers.<br />
43. D'AsPREMONT L'YNDEN (Le comte Geoffroy), ministre de Belgique<br />
au Liban et en Syrie, Beyrouth (Liban)<br />
44. LACROIX (Léon), chargé de cours à l'Université de Liège,<br />
rue des Glacis, 153,.Liège (G.)<br />
45. DESMIT (Joseph), industriel, place Constantin Meunier, 13,<br />
Uccle (tél. 446042) (M. 16°-20 0 s.]<br />
46. DRESSE DE LÉBIOLES (Paul), docteur en phil. et. Iet., av.<br />
Frank!. Roosevelt, 134, Bruxelles (tél. 472382) (G., Antinoüs)<br />
47. Hoc (Jean), substitut de l'Auditeur militaire, rue Henri<br />
Marichal, 19, Ixelles<br />
48. MEERT (Christian), exploitant forestier, ch. de Charleroi,<br />
76, Saint-Gilles, Bruxelles (tél. 374543) (Dinant: M., Méd.,<br />
Mér.)<br />
49. FRÈRE (Hub.), avocat, quai des Carmes, 26, .Iemeppe-s.-Meuse<br />
(tél. 339196) (Lg.)<br />
50. BINGEN (Jean), docteur en phil. et 1eL, av. des Mimosas, 97,<br />
Woluwe-St-Plerre (tél. 345721) (G., R., Méd. et J. 17 0-18° s.)<br />
51. GOFFIN (abbé Jos.), curé à Jesseren (Limbourg)<br />
5~. GILQN (Alb.), chef d'école, rue du Cimetière, 2, Temploux<br />
(Lg., N.)<br />
53. CARÊME (F. Jean), av. Van Put, 58, Anvers<br />
54. FLÉnoN (Jos.), assistant en pharmacie, rue du paradis, 57,<br />
Verviers (tél. 18621 ou 11718) (G., R., Méd.)<br />
55. DE MARTELAERE(René), rue des Capucines, 23, Anvers (Fr.)<br />
56. KESTERS (chan. Hub.), vicaire général de I'Evêché de Liège,<br />
rue de l'Évêché, Liège (P.~B., Lg.)<br />
57. DANCKAERS (Charles), pharmacien-chimiste, ch. de Merchtem,<br />
37, Wemmel<br />
58. COPIN (Jean), pharrnaclen-chimtste, rue de Cureghem, 1, Bruxelles<br />
(tél. 122888) (B., allem., russ.)<br />
59. DE RUYTER (Théo), greffier provincial, rue Clémentine, 5, Anvers<br />
(tél. 375301) (B., Br., Méd. Anv. et B.)<br />
60. MUo LALLEMAND (Jacqueline), lie. en phil. et let., avenue Voltaire,<br />
139, Schaerbeek (R. Alexandrie et Vo s.) . .<br />
pl. SCHINDEL (Pierre C.), dr en sc. chirn., av. de la Jonction. 60,<br />
Bruxelles (tél, 449160) (G., R.~ • . .<br />
6. 3. 1949<br />
5. 3. 1950<br />
4. 3. 1951
226 LISTE DES MEMBRES<br />
62. DE MEYER (Norbert-Jean), professeur d'athénée, rue Demont,<br />
19, Ypres (P.~B. mérid., B.; Lx., Congo h.) ....•..<br />
6·3. DE WALSCHE (Louis), docteur en médecine, rue de la Victoire,<br />
185. Bruxelles (Ga.) ............•<br />
MM.<br />
Correspondants étrangers (1)<br />
1. FORRER (L.), Homefield road, 24, Bromley (Kent, Angleterre) 15. 5. 1899<br />
2. STEARNS (Foster), Litt. H. D~, Exeter, N. H., U.S.A. (Chev.<br />
Rhodes et Malte) .•.............•.• 6. 5. 1919<br />
3. BRETT (Mrs Agnès), 136-36, Maple Avenue, Flushing, New<br />
York, U.S.A. 10. 6. 1919<br />
4. HUBER (R.), ingénieur, square Daubenton, 8, Lille (tél.<br />
745-91) (Fr., mailles; Méd. Fr., B. ; Mér, Ft) . . . . . . . 18. 3. 1926<br />
5. JUNGFLEISCH (Marcel), membre de l'Institut d'Égypte, rue<br />
Saptieh, 32, Le Caire (Égypte) (Égypte, surtout: Islam,<br />
verre) 27. 12. 1928<br />
6. HouzÉ DE L'AuLNOIT (Gérard), rue Royale, 53, Lille 28. 11. 1930<br />
7. PFLIEGER (Robert-P.) square de Meeüs, 22A, Bruxelles (tél.<br />
110805) (G. arg. et or; or: R,; Fr.) ..•....... 17. 10. 1945<br />
8. DADSON (E. F.), Chesham Place, 12, Londres S. W. 1.<br />
9. SCHULMAN (Jacques), numismate, Keîzersgracht, 448, Amsterdam<br />
.<br />
10. HEUERTZ (Jean), archiviste de la Caisse d'Épargne de l'État,<br />
rue de Prague, 11, Luxembourg (tél. 25-60) (M., S.). 27. 11. 1946<br />
11. SCHl\IIT (Aloyse), numismate, route d'Esch, 31, Luxembourg 14. 2. 1947<br />
12. DELMONTE (A.), numismate, ch. de la Hulpe, 21, Uccle ..<br />
13. FRANCESCHI (Bartolomeo), numismate, rue de la Croix de<br />
Fer, 10, Bruxelles ..•............•.<br />
14. BEELAERTS VAN BLOKLAND (Le Jkhr M. A.), Ridderlaan, 18,<br />
La Haye 5. 3. 1947<br />
15. GIBBS (Howard D.), Room 402, Columbia Building, Pittsburgh,<br />
Pa, U.S.A. (Écus, obsid., néeess., contrem., cur.) 24. 9. 1947<br />
16. HARPES (Jean), docteur en médecine, rue Aldringer, 2,<br />
Luxembourg (tél. 80-72) (Lx.; R. et Ga. en rapp. Gd. Duché<br />
Lux. : Archéol.). . . . . . . . . . . . . . • . 27. 2. 1948<br />
17. CAMPILL (Maurice), ingénieur, rue Marte-Adëlatde, 24, Luxembourg<br />
(tél. 31-90) (Lx.) 30. 3. 1948<br />
18. SCHNEIDER (Herbert), av. de Mérode, 29, Anvers (tél. 396421)<br />
(Or: Angl., Br., FI.) •..............•<br />
19. COLBERT DE BEAULIEU (J.-B.), docteur en médecine, av. Palissy,<br />
12, Joinville-le-Pont (Seine, France) (Ga.) 12. 6. 1948<br />
20. DE CA.RVALHO RÊGO (Heitor), rua David Camptsta, 103-404-<br />
Botafogo, Rio de Janeiro. . • . • . • . . • • . • • . 22. 10. 1948<br />
(1 ~ ~e nombre qe~ co~~espondants étrallser~ est Iimtté 4 cent,
LISTE DES MEMBlms 227<br />
21. GnIEnSON (Philippe), professeur d'Université, Gonville &<br />
Caïus College, Cambridge (Angleterre) . . . . . . 25. 2. 1949<br />
22. JONGKEES (J. H.), chargé de cours il 'Université d'Utrecht,<br />
Drift, 25, Utrecht (Pays-Bas) (G.) . . . . . . . . . . 23. 4. 1949<br />
23. SCHULMAN (Hans), numismate, 545 Fifth Avenue, New York<br />
17, N. Y., U.S.A. (Amér.Tat., Ind., Can., cur. et indig.) . 20. 5. 1949<br />
24. FORRER (Leonard St.), numismate, Piccadilly, 175, Londres W.l.<br />
25. CAHN (Herbert A.), dr. phil., numismate. Malzgasse, 25, Bâle<br />
(G., R) ..•......•.......... 25. 7. 1949<br />
26. BOURGEY (Em.), numismate, rue Drouot, 7, Paris ....<br />
27. TORREY (Edw. T.), Box 566, Madison, Wlsc., U.S.A. . ••<br />
28. CREPY (Max) , président de la Société de Numismatique du<br />
Nord, rue du Lazaro, 25, Marcq-en-Barœul (Nord; France)<br />
(Méd. Renalss., Gl.) 4. 3. 1951<br />
29. THOMPSON (J. D. Anthony), attaché au Heberden Coin Boom,<br />
Ashrnolean Museum, Oxford (XVIe S. rapp. Angl. et P.-B.) ..<br />
30. CLAIN-STEFANELLI (Vladimir), dr. phil., via dei Funari, 22,<br />
Rome (tél. 563802) (G., R., MM.) .<br />
31. ffECHT (Robert), ancîen membre de l'École américaine de<br />
Rome, Juniper road, 3809, Baltlmors, Md, U. S. A. (G.) .<br />
Bureau de la Société pour les années 1949 à 1951<br />
Président d'honneur<br />
Président<br />
Vice-Président<br />
Secrétaire<br />
Trésorier<br />
Contrôleur<br />
M. Victor TOURNEUR.<br />
M. Marcel Hoc.<br />
M. le v» TERLINDEN.<br />
M. Paul N ASTER.<br />
M. Jean JADOT.<br />
M. Charles v ANDER ELS1·.<br />
Comm.ission de la Revue pour les années 1949 à 1951<br />
MM. Victor TOURNEUR.<br />
Marcel Hoc.<br />
Paul NASTER.
Table des Matières<br />
MÉMOIRES<br />
Léon LACROIX, L'omphalos, attribut d'Asclépios, selon le témoignage<br />
des monnaies (pl. 1 et II) 5<br />
Jules DESNEUX, Symboles entomologiques sur les tétradrachmes de<br />
Mendè (pL III et IV) 19<br />
Paul NASTER, La trouvaille d'antoniniani de Grotenberge et le<br />
monnayage de Postume (pl. V) 25<br />
Mlle Jacqueline LALLEMAND, Le monnayage de Domitius Domitianus<br />
(pl. VI) 89<br />
J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, La trouvaille de Saint-Jacques-dela-Lande.<br />
Nouvelles constatations (pl. VII) . 105<br />
Philip GRIERSON, Un denier d'Henri 11 d'Allemagne frappé à<br />
Dinant 117<br />
Mme M. TOURNEUR-NICODÈME, Les sceaux du duc de Brabant<br />
Jean 1 121<br />
Mme M. TOURNEUR-NICODÈME, Le grand sceau de Marie-Thérèse<br />
. pour le Conseil de Gueldre (pl. VIII) 129<br />
Joseph DE BEER, Quelques sceaux de Herenthout et de ses seigneurs<br />
les van Reynegom de Buzet (pl. IX) 135<br />
Émile BROUETTE, Sceaux de l'abbaye et des abbesses de Salzinnes<br />
(pl. X) 153<br />
MÉLANGES<br />
Notes et docum.ents. - A propos des coins des monnaies d'Ainos,<br />
par MM. J. M. F. MAyet P. NASTER. - Coniorniaies<br />
à La Haye, par M. P. NASTER. - Numismatique celtique,<br />
par M. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU. - Vente d'une collection<br />
de monnaies de Brabant, par M. P. NASTER. - Une<br />
médaille inédite de Notre-Dame de Tongre, par M. J. JADOT.<br />
- Ville de Verviers, Médaille du tricentenaire (1651-1951),<br />
par M. X. JANNE D'OTHÉE. 157<br />
Trouvailles. - Trouvaille de sesterces à Froidmont (1949). <br />
Trouvaille de monnaies des XVe et XVIe siècles à Courtrai<br />
(1947), par M. P. NASTER 161<br />
Faits divers. - Cinquantième anniversaire de la fondation de<br />
la Société royale « Les Amis de la Médaille d'Art 1), par
TA:I3LE DES MATIÈRES<br />
M. J. JADûT. -Expositions numismatiques, par M. F. BAIL<br />
LION. - Deuxième Exposition-Concours à Paris, mai-juin<br />
1951, par M. P; NASTER. - La numismatique au Musée<br />
des chemins de ter à Bruxelles, pxr M. F. BAILLION. - Un<br />
nouveau bulletin numismatique aux Pays-Bas. - Congrès.<br />
- La numismatique en Israël. - Le Cabinet numismatique<br />
de Barcelone, par M. P. NASTER. - Société royale « Les<br />
Amis de la Médaille d'Art, par M. J. JADûT 184<br />
Bibliographie. - 1 he American Numismaiic Society Museum<br />
Notes, 1V. - G. ASKEW, A Catalogue of Greek Coins. <br />
Sylloge Nummorum Graecorum, Vol. V, Ashmolean. Museum,<br />
Evans Collection, Part I, llaly. - L. NAVILLE, Les<br />
monnaies d'or de la Cyrénaïque (450 à 250 avant J.-C.). <br />
H. SEYRIG, Noies on Syrian Coins. - C. H. V. SUTHER<br />
LAND, Coinage in Roman Imperial Policy, 31 B. C. - A. D.<br />
68, par M. P. NASTER. - K. PINK, Einfûhrunq in die<br />
Keltische MünzJcunde mil besoruierer Berücksichligung Oesterreichs,<br />
par M. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU. - J. LA<br />
FAURIE, Les monnaies des rois de France. I. Hugues Capet<br />
à Louis XII, par M. M. Hoc. - P. BERGHAUS, Wtïrungsgrenzen<br />
des Westjâlischen Oberuieserqebietes im Spiiitnittelaller.<br />
- Fr. \VIELANDT, Der Breisqauer Pfennig und seine<br />
Mtinzeiiitlen, Ein Beitrag zur Münz- und Geldgeschichte<br />
des Alemannenlandes im Mitielalter, par M. P. NASTER.<br />
- J. HANS, Zwei Jahrhunderte Maria-Theresien-Toler,<br />
1751-1951, par M. J. JADOT. - G. C. MILES, Rare lslamic<br />
Coins, par M. P. NASTER. - J.-G. FORIEN DE ROCHES<br />
NARD, Les monnaies des prisonniers de guerre en France<br />
pendant la guerre 1914-1918, par M. F. BAILLION. - J. DE<br />
BEER, Jean Scheyfve, bourgmestre d'Anvers, chancelier de<br />
Brabant, et ses deux médailles, 1575. - J. BABELON et J.<br />
JACQUIOT, Histoire de Paris d'après les médailles de la Renaissance<br />
au XXe siècle, par M. M. Hoc. 190<br />
SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE<br />
Extraits des procès-verbaux. - Séance tenue au Cabinet des<br />
Médailles à Bruxelles le 13 mai 1950. - Assemblée générale<br />
tenue à Anvers le 16 juillet 1950. - Séance tenue au Cabinet<br />
des Médailles à Bruxelles le 18 novembre 1950. <br />
Séance tenue au Cabinet des Médailles à Bruxelles le 13<br />
janvier 1951. - Séance tenue au Cabinet des Médailles à<br />
Bruxelles le 5 mai 1951 211<br />
Nécrologie. - Hubert Van de Weerd, par M. H. ROOSENS 219<br />
Liste des rnembr-es 221<br />
Table des znatières 229