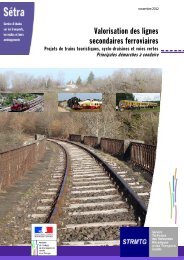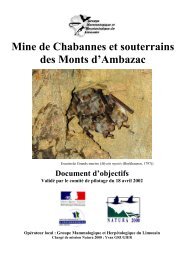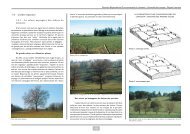2006_PAPI_Tome3_cartographie_thematique_EPIDOR - DREAL ...
2006_PAPI_Tome3_cartographie_thematique_EPIDOR - DREAL ...
2006_PAPI_Tome3_cartographie_thematique_EPIDOR - DREAL ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La question vitale est maintenant de conserver à minima ce qu’il reste en termes de<br />
populations et de garantir des conditions de circulation suffisante au sein d’un<br />
potentiel d’habitat minimum, à même d’assurer le renouvellement de leur<br />
population. Dans cet espace de vie minimum, on doit adopter un très haut niveau<br />
d’exigence.<br />
Pour certaines espèces dont la situation a été trop altérée, le maintien de la situation<br />
actuelle n’est plus suffisant et il faut restaurer certains axes de migration. C’est le cas<br />
du saumon par exemple qui n’a pas encore trouvé une situation d’équilibre, des<br />
problèmes de libre circulation l’empêchant encore d’atteindre ses sites de<br />
reproduction avec facilité. L’anguille nécessite également des améliorations pour<br />
espérer enrayer le déclin rapide qu’elle subit actuellement.<br />
Les espèces holobiotiques<br />
Pour les espèces d’eau douce, il est important de maintenir ou rétablir une circulation<br />
suffisante, pour assurer un minimum d’échanges entre les populations de différents<br />
sous bassins et entretenir un certain brassage génétique. Mais le niveau d’exigence en<br />
terme d’efficience des axes migratoires n’est pas forcément aussi élevé que celui des<br />
amphihalins puisque la migration n’est en général pas obligatoire.<br />
Sur certains bassins en très bon état écologique, qui présentent des écosystèmes<br />
particulièrement préservés, il existe également un enjeu à conserver les derniers<br />
milieux de référence et donc à ne pas dégrader la situation.<br />
7.4 L’enjeu énergétique<br />
Sur les axes migratoires à poissons migrateurs amphihalins, situés plutôt sur les<br />
grandes rivières et sur les parties aval des bassins versants, on rencontre des pentes<br />
faibles et donc de faibles chutes susceptibles de faire l’objet d’une exploitation<br />
hydroélectrique. L’exploitation de ces chutes ne peut en général s’envisager qu’au fil<br />
de l’eau et absolument pas pour la production d’électricité de pointe. Mais ces<br />
portions aval de cours d’eau, qui drainent de grands bassins versants, présentent<br />
aussi des débits importants ; l’enjeu énergétique devient d’ailleurs d’autant plus<br />
important que l’on va vers l’aval.<br />
Les ouvrages hydroélectriques existants sur les axes classés migrateurs produisent<br />
plus de 244 GWh/an dont 181 GWh/an pour les trois ouvrages concédés de<br />
Bergerac, Tuilière et Mauzac et 34 GWh/an pour la centrale de Bar sur la Corrèze. La<br />
position aval des trois premiers leur confère une responsabilité majeure dans les<br />
succès migratoires du bassin Dordogne-Vézère. Pour les 67 autres ouvrages<br />
hydroélectriques présents sur les axes à migrateurs, l’enjeu énergétique (≈ 29<br />
GWh/an pour les 18 plus importants avec information de productible) est faible par<br />
rapport à la production du bassin (> 3 233 GWh/an), alors que l’enjeu<br />
environnemental peut être considéré comme très élevé.<br />
Toujours sur les axes à grands migrateurs, le potentiel qu’offrent les 900<br />
aménagements non hydroélectriques reste limité : environ 87 GWh/an sous réserve<br />
janvier 2012 30