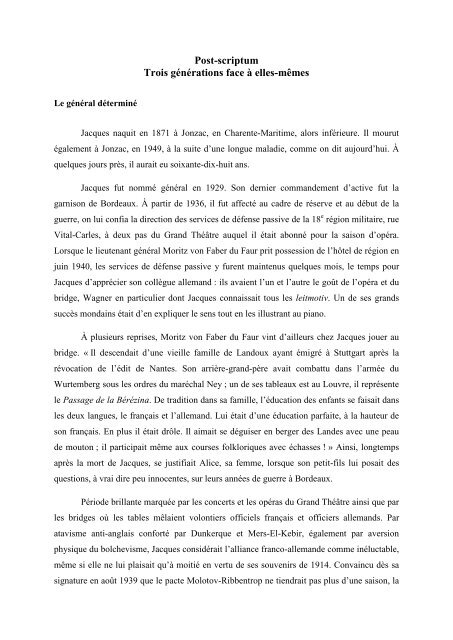Post-scriptum Trois générations face à elles-mêmes
Post-scriptum Trois générations face à elles-mêmes
Post-scriptum Trois générations face à elles-mêmes
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Post</strong>-<strong>scriptum</strong><br />
<strong>Trois</strong> <strong>générations</strong> <strong>face</strong> <strong>à</strong> <strong>elles</strong>-<strong>mêmes</strong><br />
Le général déterminé<br />
Jacques naquit en 1871 <strong>à</strong> Jonzac, en Charente-Maritime, alors inférieure. Il mourut<br />
également <strong>à</strong> Jonzac, en 1949, <strong>à</strong> la suite d’une longue maladie, comme on dit aujourd’hui. À<br />
quelques jours près, il aurait eu soixante-dix-huit ans.<br />
Jacques fut nommé général en 1929. Son dernier commandement d’active fut la<br />
garnison de Bordeaux. À partir de 1936, il fut affecté au cadre de réserve et au début de la<br />
guerre, on lui confia la direction des services de défense passive de la 18 e région militaire, rue<br />
Vital-Carles, <strong>à</strong> deux pas du Grand Théâtre auquel il était abonné pour la saison d’opéra.<br />
Lorsque le lieutenant général Moritz von Faber du Faur prit possession de l’hôtel de région en<br />
juin 1940, les services de défense passive y furent maintenus quelques mois, le temps pour<br />
Jacques d’apprécier son collègue allemand : ils avaient l’un et l’autre le goût de l’opéra et du<br />
bridge, Wagner en particulier dont Jacques connaissait tous les leitmotiv. Un de ses grands<br />
succès mondains était d’en expliquer le sens tout en les illustrant au piano.<br />
À plusieurs reprises, Moritz von Faber du Faur vint d’ailleurs chez Jacques jouer au<br />
bridge. « Il descendait d’une vieille famille de Landoux ayant émigré <strong>à</strong> Stuttgart après la<br />
révocation de l’édit de Nantes. Son arrière-grand-père avait combattu dans l’armée du<br />
Wurtemberg sous les ordres du maréchal Ney ; un de ses tableaux est au Louvre, il représente<br />
le Passage de la Bérézina. De tradition dans sa famille, l’éducation des enfants se faisait dans<br />
les deux langues, le français et l’allemand. Lui était d’une éducation parfaite, <strong>à</strong> la hauteur de<br />
son français. En plus il était drôle. Il aimait se déguiser en berger des Landes avec une peau<br />
de mouton ; il participait même aux courses folkloriques avec échasses ! » Ainsi, longtemps<br />
après la mort de Jacques, se justifiait Alice, sa femme, lorsque son petit-fils lui posait des<br />
questions, <strong>à</strong> vrai dire peu innocentes, sur leurs années de guerre <strong>à</strong> Bordeaux.<br />
Période brillante marquée par les concerts et les opéras du Grand Théâtre ainsi que par<br />
les bridges où les tables mêlaient volontiers officiels français et officiers allemands. Par<br />
atavisme anti-anglais conforté par Dunkerque et Mers-El-Kebir, également par aversion<br />
physique du bolchevisme, Jacques considérait l’alliance franco-allemande comme inéluctable,<br />
même si elle ne lui plaisait qu’<strong>à</strong> moitié en vertu de ses souvenirs de 1914. Convaincu dès sa<br />
signature en août 1939 que le pacte Molotov-Ribbentrop ne tiendrait pas plus d’une saison, la
collaboration lui semblait le seul rempart contre Moscou. L’engager avec un descendant de<br />
huguenot, homme du monde et cultivé qui plus est, tout se présentait sous les meilleurs<br />
auspices.<br />
Fin 1942, Moritz von Faber du Faur fut muté en Autriche et, en accord avec la<br />
préfecture, son successeur décida de changer la structure de la défense passive. Du haut en<br />
bas… Officiellement atteint par la limite d’âge et surtout ébranlé par les convictions proalliées<br />
de son gendre, un des dirigeants du Comité des forges, qui lui conseilla fortement de<br />
quitter Bordeaux <strong>à</strong> l’annonce de la chute de Stalingrad, Jacques finalement se laissa<br />
convaincre. Il n’en continua pas moins <strong>à</strong> y entretenir des relations ambiguës, en correspondant<br />
régulièrement avec Philippe Henriot * qu’il avait bien connu <strong>à</strong> l’époque où il était député de la<br />
ville, élu sur un programme d’une grande simplicité : « Antiparlementaire, anticommuniste,<br />
antimaçon et antisémite » ! Ayant souhaité donner l’exemple en adhérant <strong>à</strong> la milice dès<br />
janvier 1943, un an après il devint secrétaire d’État <strong>à</strong> l’Information et <strong>à</strong> la Propagande dans le<br />
gouvernement Laval. Flatté d’avoir un membre du gouvernement parmi ses amis, Jacques<br />
redoubla d’ardeur avec des lettres de plus en plus fréquentes.<br />
Malgré les conseils répétés de son fils <strong>à</strong> se consacrer <strong>à</strong> ses recherches sur les<br />
hiéroglyphes égyptiens, puis sa « gentillesse » <strong>à</strong> lui poster son courrier et <strong>à</strong> déchirer ses lettres<br />
<strong>à</strong> Henriot, Jacques ne comprit – peut-être – l’ambiguïté de sa correspondance qu’<strong>à</strong> l’annonce<br />
fin juin 1944, de l’exécution de son ami milicien.<br />
Le père de Jacques était notaire <strong>à</strong> Jonzac, notable entre les notables : conseil<br />
municipal, fabrique de la paroisse, une belle propriété <strong>à</strong> la campagne, presque un petit château<br />
en bord de Seugne… Un immense réservoir de souvenirs pour Jacques. Depuis la faillite<br />
suivie du suicide de son père en 1894, alors qu’il était tout juste aspirant sorti de<br />
Polytechnique, Jacques n’était jamais revenu <strong>à</strong> Jonzac, préférant se réfugier dans ce qu’il<br />
appelait ses « ombres de jeunesse ». Après de longues réflexions, il décida de transformer ses<br />
ombres en matière tangible. Il quitta Bordeaux et s’installa <strong>à</strong> Jonzac.<br />
* Philippe Henriot (1889-1944), professeur, se lance en politique, d’abord sur un programme de droite catholique<br />
et devient député de Bordeaux en 1932. Puis il radicalise son programme vers l’extême-droite pour l’élection de<br />
1936 qui le voit réélu. Dès les premiers mois de Vichy, il se consacre principalement au journalisme dans des<br />
chroniques régulières <strong>à</strong> Radio Paris et <strong>à</strong> Gringoire, devenant un des soutiens les plus brillants du régime. Il se<br />
voit nommé en janvier 1944 secrétaire d’État <strong>à</strong> l’Information et <strong>à</strong> la Propagande, tout en poursuivant sa<br />
production journalistique en accentuant ses positions contre le « complot judéo-bolchevique ». Le 28 juin 1944,<br />
il est exécuté dans son propre ministère par un commando de résistants déguisés en miliciens. Le gouvernement<br />
lui organise des obsèques nationales <strong>à</strong> Notre-Dame de Paris : ce sera la dernière grande manifestation du<br />
gouvernement Laval, avec une messe solennelle dite par le cardinal Suhard (ce qui lui vaudra d’être écarté deux<br />
mois plus tard des cérémonies de la Libération).
« Mon général », le saluait-on dans la rue. D’abord avec réticence… Certains même<br />
refusaient de le voir. Était-ce le fait du suicide qui avait entraîné des pertes chez de nombreux<br />
clients de l’étude ? Ou son rôle <strong>à</strong> Bordeaux qui suscitait des rumeurs ? À la libération de la<br />
ville, le climat changea du tout au tout.<br />
Le 3 septembre 1944, des maquisards de la colonne Soulé, celle qui quelques jours<br />
plus tôt s’était accrochée aux Allemands de Barbezieux, traînaient avec eux un gros canon<br />
autrichien de 105 millimètres monté sur roues qu’ils avaient installé sur la benne d’un camion<br />
gazogène. Problème, ils ne savaient pas comment régler son angle de tir ! On leur indiqua<br />
l’adresse d’un vieux général, artilleur qui plus est. C’est ainsi que repris par la technique de<br />
son métier, le correspondant de Philippe Henriot, anti-communiste viscéral, participa <strong>à</strong> la<br />
libération de Jonzac auprès d’un groupe FTP largement dominé par des républicains<br />
espagnols ! Deux caractéristiques, communistes et espagnols, qu’il considérait comme la lie<br />
de la société…<br />
Jacques fut dès lors de toutes les commémorations au monument aux morts, toujours<br />
en grand uniforme et, <strong>à</strong> son enterrement le 3 août 1949, un détachement de la musique<br />
militaire de Bordeaux vint lui rendre les honneurs en exécutant sur la place de l’église la<br />
marche funèbre de l’Héroïque, alors que la sortie de son cercueil s’était faite au son de la<br />
« Marche des pèlerins » de Tannhäuser jouée <strong>à</strong> l’orgue par son cousin Robert Musso.<br />
Parcours étrange quand on l’analyse plus d’un demi-siècle après, parcours pourtant<br />
d’évidence lorsqu’on lui associe quelques clefs propres <strong>à</strong> son temps. De l’enfance de Jacques,<br />
on ne sait pas grand-chose : excellent élève chez les pères, attiré par l’armée dès son plus<br />
jeune âge, sa personnalité disparaît derrière ce qui reste du souvenir des années heureuses<br />
d’avant le suicide. Comme si l’enfance de Jacques n’était que l’ombre projetée de ce qui se<br />
passait autour de lui. La seule couleur que souvent il en exprimait était celle du collège<br />
Stanislas où il était pensionnaire, « Stan » dont il évoquait l’émulation avec émoi.<br />
Jacques, soudain déclassé par la faillite de son père, avait une cousine qui s’appelait<br />
Alice. Une cousine dont tout indiquait la fortune, entre modernisme parisien et aisance<br />
personnelle. Elle jouait au tennis, avait été une des premières jeunes filles <strong>à</strong> passer son permis<br />
de conduire et pratiquait le patin <strong>à</strong> glace ainsi que la gymnastique suédoise… Son père, agent<br />
de change, avait réussi <strong>à</strong> se créer un joli magot fait de plusieurs propriétés et d’un réseau<br />
mondain où il recrutait sa clientèle. Son salon tenu par sa femme <strong>à</strong> la gorge épanouie, toujours<br />
pleine de bijoux, était fréquenté entre autres par la belle Otero, José-Maria de Hérédia et de
nombreux étrangers. Jacques, <strong>à</strong> la fois impressionné et rebuté, les appelait volontiers d’un mot<br />
datant de ces années 1880, des « rastaquouères », assimilés <strong>à</strong> des Espagnols de tripot. Parmi<br />
eux, quelques mondains juifs…<br />
Jamais Jacques ne parlait de juifs ou d’israélites en les évoquant ; il disait d’un ton<br />
rieur « vos amis les bons bretons… » et faisait suivre la formule de leur nom ! Entre Jacques<br />
et sa cousine Alice, existait non pas une différence de famille, mais tout simplement un écart<br />
de mentalité et de choix de carrière. Jacques était le premier dans sa lignée <strong>à</strong> sortir de Jonzac,<br />
il était encore empreint des préjugés de sous-préfecture et son choix ne pouvait qu’être orienté<br />
vers le service public, en l’occurrence l’armée. La migration vers Paris de la lignée d’Alice<br />
datait de loin : d’abord locale avec son arrière-grand-père quittant Baignes-Saint-Radegonde,<br />
gros bourg du sud charentais, pour devenir médecin-chef des hôpitaux d’Angoulême, puis<br />
parisienne avec son grand-père qui termina sa carrière comme chef de service <strong>à</strong> la trésorerie<br />
de la Seine, enfin brillante et surtout opulente avec la charge d’agent de change de son père, et<br />
la chaire de médecine de son oncle qui était en même temps un amateur immodéré de courses<br />
automobiles, d’où l’étonnant permis de conduire de sa nièce.<br />
« Mes parents étaient peu favorables au mariage avec ton grand-père, mais ils me<br />
laissèrent le choix. Lui n’était pas non plus très <strong>à</strong> son aise dans ce qui allait devenir sa bellefamille.<br />
Pour montrer sa réserve, il décida de ne jamais profiter de mon argent, qu’il<br />
provienne de ma dot ou de ma part d’héritage. Et il tint parole », racontera Alice <strong>à</strong> son petitfils.<br />
Non sans ajouter avec malice que cela n’avait pas favorisé l’évolution du patrimoine !<br />
Alice était de son temps, elle adorait les litotes.<br />
Mis <strong>à</strong> part les bons bretons, sujets de quelques bisbilles sans importance, l’apparition<br />
des juifs, ou plutôt d’un juif, provoqua un drame dont Alice ressassa sans cesse la gravité pour<br />
elle et son mari. Le 14 janvier 1898, des crieurs de journaux parcoururent Paris en annonçant<br />
le J’accuse de Zola. Alice et Jacques étaient mariés depuis l’été précédent et, comme<br />
première application de la décision de Jacques de vivre de sa solde d’officier, ils avaient loué<br />
un petit trois-pièces en étage, rue des Abbesses. Alice était enceinte de quelques mois et<br />
quand Jacques remonta <strong>à</strong> l’appartement, un numéro de L’Aurore <strong>à</strong> la main, le visage comme<br />
démesuré par la colère, « ce sont les juifs » criait-il, elle fut soudain envahie par la panique, se<br />
mit <strong>à</strong> trembler et fut prise d’une fausse couche. Ce souvenir, le seul qu’elle ait conservé de<br />
l’affaire Dreyfus, la poursuivra jusqu’<strong>à</strong> la fin de sa vie.
C’est sans doute la seule fois où Jacques, pourtant si réservé et sans rien en lui<br />
d’hystérique, hurla le mot « juif ».<br />
Quarante-cinq ans plus tard, Jacques reçut une photo de ses petits-enfants autour de<br />
leur mère. Parce que tout en elle évoquait un moment de sérénité, de béatitude familiale<br />
même, cette photo essaima partout dans la famille de Jacques, jusque chez des cousins<br />
lointains, <strong>à</strong> la façon d’un symbole dont chacun tirait sa propre leçon. Elle éclairait en tout cas<br />
un aspect de la guerre, heureux pour ceux qui l’avaient vécu, et l’adhésion sans doute naïve de<br />
Jacques aux thèses de la race pure.<br />
Une prairie tout juste fauchée, un paysage de montagnes dont on devine une vallée <strong>à</strong> la<br />
fois profonde et sombre, au premier plan une jeune femme assise avec ses enfants… Elle en<br />
tient deux dans ses bras, un nourrisson sans cheveux et un gros bébé bouclé, tandis que l’aîné<br />
encore en barboteuse regarde la scène d’un air attendri. C’est l’été, la jeune femme est en robe<br />
<strong>à</strong> fleurs, elle porte un chignon bas et des chaussures <strong>à</strong> petits talons qui laissent penser que la<br />
voiture n’est pas loin, probablement derrière celui qui tient l’appareil. La belle-fille et les<br />
petits-enfants de Jacques dans le Vercors, photo prise durant l’été 1943 par son fils, médecin<br />
du chantier de jeunesse de Die…<br />
Ce portrait de famille trônait dans un cadre posé sur le bureau de Jacques ainsi que sur<br />
la table de nuit d’Alice et sur l’étagère du cosy-corner dont leur fils et leur belle-fille étaient<br />
fiers de dire qu’il faisait moderne. Surtout, pour le valoriser, Jacques racontait qu’il l’avait<br />
envoyé <strong>à</strong> son ami Philippe Henriot pour qu’il le publie dans Gringoire * comme exemple<br />
d’une « famille française régénérée » ! À l’opposé de tous ces rastaquouères dont la France<br />
avait tant souffert, aimait-il ajouter !<br />
Personne dans la famille de Jacques ne sait si l’envoi de la photo au « Goebbels<br />
français » est un fait avéré ou s’il relève d’une simple moquerie familiale <strong>à</strong> l’égard d’un<br />
général hors d’âge ; toujours est-il que la tradition s’en est transmise avec le temps et qu’elle<br />
est devenue une des dimensions de la photo elle-même, transformant le souvenir d’un simple<br />
après-midi dans la montagne en symptôme des ambiguïtés de la collaboration et de son<br />
antisémitisme latent.<br />
La source principale de ce texte concernant Jacques provient des nombreuses<br />
confidences qu’Alice, sa femme, fit <strong>à</strong> son petit-fils. Elle considérait en effet de son devoir de<br />
transmettre ce qu’elle savait de la tradition familiale et de la vie de son mari. Elle pensait<br />
* Gringoire est le principal hebdomadaire de droite pendant l’entre-deux-guerres. D’abord lié aux mouvements<br />
de la droite catholique, son repliement sur Vichy en 1940 correspond <strong>à</strong> une évolution progressive de son contenu<br />
vers un collaborationnisme actif. Il cesse de paraître en mai 1944.
même que ce passage de relais serait une assurance <strong>à</strong> retrouver Jacques dans la grande foule<br />
peuplant le paradis. Ne pas y parvenir était son inquiétude majeure devant la mort. Elle vivait<br />
sa religion de façon simple et naïve, presque primitive, où l’enfer, le purgatoire et le paradis<br />
possédaient la même vigueur que celle des jugements derniers des fresques médiévales.<br />
Jacques s’en moquait gentiment. Rien n’y faisait, elle continuait d’être angoissée <strong>à</strong> l’idée du<br />
jour de la Résurrection des morts. Jacques était certes croyant, mais d’une foi éthérée, quasi<br />
mathématique. Son Dieu ressemblait <strong>à</strong> un infini lumineux ou <strong>à</strong> un point d’orgue parfait ;<br />
quant <strong>à</strong> sa religion, elle tenait comme chez Wagner d’une sorte de mythologie, plus biblique<br />
qu’évangélique, rendue nécessaire pour faire adhérer <strong>à</strong> cet infini dans lequel, de toute façon,<br />
l’homme était destiné <strong>à</strong> se fondre. En dépit de ces visions aussi opposées, ils pratiquaient<br />
ensemble, respectant les rites avec une conviction empreinte de mondanité.<br />
L’objecteur de conscience égaré<br />
Paul naquit en 1872 <strong>à</strong> Orgeval, dans l’Aisne. Il s’éteignit de sa belle mort en 1956 <strong>à</strong><br />
Chavignon, un village se trouvant <strong>à</strong> quinze kilomètres d’Orgeval. Il avait quatre-vingt-quatre<br />
ans.<br />
De la même génération que Jacques, avec un an de moins, Paul était tout son contraire.<br />
Autant Jacques était un petit sec <strong>à</strong> la coiffure lisse et lustrée, prenant soin de sa santé avec des<br />
régimes stricts et du vin – toujours de grand cru – limité <strong>à</strong> un fond de verre et uniquement le<br />
soir, autant Paul était plutôt corpulent et le dépassait d’une demi-tête qu’il avait ronde et<br />
frisée, souvent le cheveu fou comme pour accentuer une allure d’artiste bon-enfant ; il aimait<br />
la table, assis derrière sa serviette nouée autour du cou, et adorait le vin ou plutôt une piquette<br />
achetée au tonneau qu’il buvait <strong>à</strong> foison et qu’il compensait chaque jour par deux heures de<br />
marche. Leurs retraites respectives furent aussi très différentes : Jacques se mit <strong>à</strong> recopier de<br />
façon incessante, quasi maladive, des hiéroglyphes, Paul se donna pour mission d’identifier<br />
les cadavres des soldats allemands morts au Chemin des Dames. Une pulsion d’évasion chez<br />
Jacques, un besoin prégnant d’utilité et d’identité historique chez Paul. Lorsqu’il mourut sept<br />
ans après Jacques, il n’eut droit ni aux fanfares ni aux grandes orgues, mais <strong>à</strong> une quinzaine<br />
d’intimes suivant frileusement son cercueil sous une pluie froide de fin mars jusqu’au<br />
minuscule cimetière d’Orgeval qui n’avait pas vu autant de monde depuis des années.
Paul venait d’une famille de blatiers installée <strong>à</strong> Goudelancourt-lès-Berrieux, un village<br />
d’une cinquantaine d’habitants, au nom bouseux s’il en est. Son père y fit ses débuts comme<br />
instituteur avant de créer l’école d’Orgeval, <strong>à</strong> huit kilomètres… et encore moins d’habitants.<br />
Il y était une sorte de maître-jacques, tenant sa classe unique, assurant le secrétariat de la<br />
mairie et cultivant sans charrue un lopin de quelques gros sillons. Il eut trois fils, tous destinés<br />
<strong>à</strong> l’enseignement. Curieusement, Paul qui avait fait construire <strong>à</strong> Chavignon un caveau où<br />
reposait sa femme, insista pour être enterré <strong>à</strong> Orgeval, <strong>à</strong> même la terre, alors qu’il ne parlait<br />
jamais de ses racines et avait rompu avec ses frères aînés, comme s’il se considérait comme<br />
un fils prodigue revenant vers son père au dernier jour du voyage. Il avait pourtant conduit<br />
des recherches généalogiques sur sa famille, laissant de nombreuses notes manuscrites,<br />
aujourd’hui disparues, sur Goudelancourt et son grand-père Nicolas, comme sur Orgeval et<br />
son père Alphonse, dit Basile. L<strong>à</strong> encore, il différait de Jacques dont les cousinages, même<br />
lointains, étaient soigneusement et mondainement entretenus.<br />
C’est <strong>à</strong> l’université de Lille que Paul devint « bi-licencié » car le doyen de sa faculté<br />
lui conseilla de ne pas tenter l’agrégation <strong>à</strong> cause de la modestie de ses origines. Bi-licencié<br />
en allemand et en lettres classiques, il patienta plusieurs années avec un poste de simple<br />
répétiteur <strong>à</strong> Laon qu’il brocarda toute sa vie en Laon-terne, tout en se présentant comme le<br />
Laon-pion de service ! En 1902, il avait trente ans ; dès qu’il reçut sa nomination <strong>à</strong> Tourcoing<br />
comme répétiteur en charge d’un cours d’allemand, il épousa Maria, une jeunesse de<br />
Chavignon de onze ans de moins que lui. Puis en 1908, il fut enfin nommé professeur de<br />
lettres classiques au lycée de Péronne. L<strong>à</strong>, il se décida d’abord <strong>à</strong> voyager principalement vers<br />
l’Allemagne où il avait conservé des amis du temps de ses études, puis <strong>à</strong> lui faire des enfants,<br />
deux filles, coup sur coup.<br />
Le 27 août 1914, les officiels désertèrent Péronne et les militaires oublièrent de faire<br />
sauter comme prévu les ponts sur la Somme. Le lendemain en fin d’après-midi, les Uhlans de<br />
la 2 e armée de von Bülow entraient dans la ville.<br />
De ce jour d’été au printemps 1919, la famille de Paul vécut dispersée. Maria et ses<br />
filles furent vite évacuées vers l’arrière puis ballottées <strong>à</strong> travers des zones proches du front en<br />
fonction des offensives qui le faisaient avancer ou reculer. Évacuation puis rapatriement,<br />
administrativement les mots comptent… Leurs pérégrinations entre Picardie, Paris, Haute-<br />
Saône et Brie pourraient d’ailleurs constituer un bon baromètre de la confiance de l’état-major
<strong>face</strong> aux mouvements prévisibles du front : plus les zones des armées s’agrandissaient en<br />
déplaçant les populations civiles vers le sud, plus le moral était au bas…<br />
Quant <strong>à</strong> Paul, dès le 29 août, il se vit réquisitionné comme traducteur-interprète auprès<br />
de l’état-major de la 2 e armée. Pendant cinq ans, il fut lui aussi ballotté d’une ville <strong>à</strong> l’autre,<br />
côté allemand, dans un mouvement de balancier inverse <strong>à</strong> celui affectant sa famille. Pendant<br />
cinq ans, personne n’eut la moindre nouvelle de ce qu’il devenait au point que Maria,<br />
considérée comme veuve de guerre, toucha une pension de réversion en provenance du<br />
ministère de l’Instruction publique ! Pendant cinq ans, le statut de Paul fut celui de<br />
« prisonnier civil », un cran en-dessous de celui des prisonniers militaires quant <strong>à</strong> ses droits.<br />
Une fois les retrouvailles effectuées, le bon vin chaud installé sur la table et les<br />
furoncles guéris, vint peut-être le pire. Dès la rentrée scolaire de 1919… L’administration se<br />
méfiait de lui, comme de tous les prisonniers civils, alors que leurs compagnons militaires<br />
étaient portés aux nues. Considéré comme ayant été ce que vingt-cinq ans plus tard on<br />
appellera « collabo », on lui refusa un poste de traducteur-interprète en Allemagne occupée et<br />
surtout la reconduction de son poste au lycée de Péronne.<br />
Sa fille, Marcelle, laisse un livre, Chétives Olives, consacré <strong>à</strong> la « vie tragique » de ses<br />
parents : « De graves déceptions les attendaient quand mon père se décida <strong>à</strong> aller voir leur<br />
maison de Péronne, espérant bien retrouver au moins les meubles. Il ne retrouva rien.<br />
Maison déménagée, en parfait état, juste une tasse <strong>à</strong> l’anse cassée sur le rebord d’une<br />
fenêtre. Dans les grands drames de la vie, il y a d’abord, quand on survit, un bonheur<br />
aveuglant qui gicle sur vous. Et puis la vie reprend, on se met <strong>à</strong> regretter les choses. Des<br />
choses qu’on aimait, du foyer qu’on avait créé, rien ne subsiste. C’est tout un pan de<br />
l’existence et de la personnalité qui s’écroule. Jamais mes parents ne s’en remirent<br />
complètement. J’ai vu leur souffrance encore, bien longtemps après. Quand ils vinrent <strong>à</strong><br />
Jonzac pour les noces d’or de [Jacques qui] leur montrait les meubles qu’il aimait et en disait<br />
l’origine familiale. Eux n’avaient rien qui leur venait de famille. » Leur existence n’avait été<br />
et ne serait qu’« une chute sans fin d’existences chétives / Et qui tombent sans bruit ainsi que<br />
des olives. 1 »<br />
Paul fut affecté au Cateau, <strong>à</strong> un simple poste de collège, comme professeur de<br />
français. La maison qu’on lui avait réservée n’avait plus de carreaux ; les vitres avaient été<br />
remplacées par des plaques de mica… D’où des pièces sombres en plein jour… Il y resta deux<br />
ans puis obtint un poste – toujours en collège – <strong>à</strong> Soissons. L<strong>à</strong>, il fut logé dans un
araquement d’urgence pour sinistrés de guerre dont il ne voulut jamais déménager : « Nous<br />
sommes des réfugiés, nous le resterons toute notre vie. » Il parlait de moins en moins s’isolant<br />
dans son monde écroulé en une sorte d’égarement qui le conduisait tous les soirs au bistrot. Il<br />
fuyait, il se fuyait et rentrait <strong>à</strong> la maison les souliers pleins de boue…<br />
Toute son énergie, tout ce qui restait de ses fins de mois et de ses dommages de<br />
guerre, il le mit dans la construction d’une maison <strong>à</strong> Chavignon, le village de sa femme, au<br />
fond d’une vallée qui se situe très exactement entre le Chemin des Dames et l’Ailette, <strong>à</strong><br />
quelques centaines de mètres du fort de la Malmaison, autrement dit en plein milieu d’une<br />
double bataille qui dura d’avril 1917 <strong>à</strong> octobre 1918, sans surtout oublier l’épisode des<br />
mutineries qui y prirent naissance et y furent les plus durement réprimées.<br />
Une fois la maison construite, il attendit sa retraite pour quitter le baraquement de<br />
Soissons. Ce fut l’époque où il commença <strong>à</strong> s’intéresser <strong>à</strong> l’histoire de Chavignon dont il<br />
publiera après-guerre la monographie, basée sur l’observation que le malheur frappe le village<br />
au moins une fois par siècle. Au début du V e siècle, un enfant de Cerny-en-Laonnois, village<br />
situé <strong>à</strong> huit kilomètres de Chavignon et <strong>à</strong> cinq d’Orgeval, passait par son pays prendre<br />
possession de l’évêché de Reims auquel il venait d’être élu. Il s’appelait Rémi et fut très vite<br />
sanctifié après sa mort, comme l’apôtre des Francs. Arrivé <strong>à</strong> Chavignon où régnait la<br />
canicule, il demanda <strong>à</strong> boire. On lui ferma plusieurs fois la porte au nez. À la dernière maison,<br />
on lui donna un gobelet plein de purin. Il le but, puis excommunia le village en le frappant<br />
d’anathème : « Chavignon, tu es maudit pour l’éternité ; toutes les trois <strong>générations</strong>, le<br />
malheur tombera sur les tiens. » Et en remontant l’histoire <strong>à</strong> partir de la destruction totale du<br />
village due <strong>à</strong> la bataille du Chemin des Dames, il parvint <strong>à</strong> reconstituer les effets de la<br />
malédiction.<br />
Est-ce pour en atténuer le malheur ou plus vraisemblablement pour guérir en lui son<br />
sentiment de vie ruinée, toujours est-il qu’il commença <strong>à</strong> amasser des noms de soldats<br />
allemands tués au Chemin des Dames. Il les trouvait en fouillant les nombreuses fosses<br />
communes du plateau ; il récupérait les plaques d’identité, écrivait ensuite aux autorités<br />
allemandes pour leur signaler le corps retrouvé, et non plus disparu, Verschollen. Il fixait<br />
alors la plaque sur une petite croix de bois qu’il puisait dans les réserves qu’il s’était fait<br />
fabriquer, puis allait la ficher dans une bande de terrain bordant l’ancien fort de la Malmaison.<br />
Il faisait tout cela avec le cantonnier Devorcine, de cette famille qui, pendant les deux<br />
occupations de 1914 et 1940, se distingua comme la principale source d’information locale du
commandement allemand… Rien <strong>à</strong> voir avec les cimetières militaires officiels richement<br />
entretenus par le Souvenir français, comme <strong>à</strong> Vauxaillon, <strong>à</strong> quelques kilomètres de<br />
Chavignon, son cimetière était pauvre et boueux, mais sa joie se manifestait chaque fois qu’il<br />
redonnait une identité <strong>à</strong> un Verschollen et qu’en retour il recevait une lettre de remerciement,<br />
qu’elle provienne d’un bureau militaire ou d’une famille qui retrouvait ainsi la trace d’un des<br />
siens. En revanche, les Unbekannt, les inconnus <strong>à</strong> cause d’une plaque absente ou détériorée, le<br />
rendaient profondément triste. La liste végéta pendant l’occupation allemande, même si de<br />
nouveaux morts étaient apparus en mai 1940. Puis elle prit de l’ampleur <strong>à</strong> partir de 1945. Ce<br />
qui valut <strong>à</strong> Paul une réputation douteuse de vieux fou aux nuances post-collabo, avant que,<br />
l’Europe prenant corps, il ne devienne après sa mort une sorte de figure tutélaire pour avoir<br />
été <strong>à</strong> l’origine d’un grand cimetière militaire allemand, dorénavant aux croix de bronze,<br />
faisant se déverser les marks, puis les euros, dans les quelques commerces de Chavignon.<br />
Contrairement <strong>à</strong> Jacques qui se plaisait <strong>à</strong> raconter ses découvertes, ses rencontres ou<br />
ses émotions musicales, et le faisait fort bien, Paul avait la réputation d’être un « taiseux ».<br />
Certes en marchant, il fredonnait des airs d’opérette car sa femme en était friande et le traînait<br />
au théâtre de Soissons, mais il n’aimait pas les discussions et encore moins les confidences<br />
sur ce qu’il pensait. Sa fille le constate dans son livre et, sans doute par respect pour sa<br />
retenue, n’insiste pas. Elle évoque seulement <strong>à</strong> deux reprises des opinions fortement marquées<br />
<strong>à</strong> droite. Une droite résolue, « farouchement réactionnaire » mais, l<strong>à</strong> encore contrairement <strong>à</strong><br />
Jacques, une droite farouchement anticatholique, la messe selon lui n’étant bonne que pour les<br />
femmes. Il ne pratiquait pas, sauf pour les cérémonies familiales qu’il concédait <strong>à</strong> Maria,<br />
considérant la religion comme une hypocrisie sociale. Curieusement, il se plaisait <strong>à</strong> revenir<br />
sans cesse sur le sujet autour d’un pichet de vin, avec le curé dont il disait qu’il était la seule<br />
personne <strong>à</strong> Chavignon avec qui il était possible de vraiment parler.<br />
Il reprochait <strong>à</strong> l’ensemble du monde politique français son intraitable anti-germanisme<br />
qui alimentait l’esprit revanchard allemand, il avait été contre le traité de Versailles mais<br />
détestait plus encore les hypocrisies de type faux pacifisme <strong>à</strong> la Briand ou les gesticulations<br />
engendrées par la Société des Nations. Ce dégoût des deux hypocrisies, politique et religieuse,<br />
était un de ses thèmes favoris et sa misanthropie, dans le peu de phrases dont il honorait son<br />
entourage, reste sans doute la marque intime de son personnage.<br />
Brisé, frustré, aigri, « il ne désirait pas évoluer avec son temps », en dit sa fille. Il<br />
préférait se tenir <strong>à</strong> l’écart, Chavignon étant devenu son Aventin et son travail de mémoire
dans les fosses communes sa seule ambition. Abonné <strong>à</strong> la très germanophobe Action française<br />
dont le fond de sa bibliothèque croulait sous les numéros, y ayant aussi conservé de nombreux<br />
exemplaires de Signal, la revue de propagande nazie, son tiraillement était évident. Il<br />
débouchait sur une claustration psychologique. Comme une sorte d’objecteur de conscience<br />
réfutant tout engagement hors de sa mission de résurrection, Paul était devenu <strong>à</strong> sa façon un<br />
pacifiste dont l’activisme muet contre la guerre demeurait essentiellement ambigu. Entaché de<br />
germanophilie trop oublieuse de la réalité, il s’aveuglait lui-même dans sa propre souffrance.<br />
Et son œuvre ne prit sens qu’une fois débarrassée de ses équivoques.<br />
Sa fille fut celle qui organisa cet épurement de la mémoire. D’abord, et cela dès le<br />
déménagement qui suivit la mort de Paul, en jetant <strong>à</strong> la poubelle ses revues et ses livres<br />
chargés de soufre. Puis en occultant dans Chétives Olives toute mention directe <strong>à</strong> des idées<br />
politiques qui pouvaient sembler compromettantes. Les rares fois où elle les évoque, c’est<br />
pour les prendre <strong>à</strong> son propre compte et en minimiser ainsi la portée chez son père. « Il avait<br />
horreur des francs-maçons » qu’il accusait d’être <strong>à</strong> l’origine de ses déboires pour l’avoir fait<br />
ficher au ministère, d’abord comme pro-allemand avant la guerre, puis comme prisonnier civil<br />
douteux après l’armistice. « Il allait jusqu’<strong>à</strong> haïr ceux qu’il appelait les "frères trois-points".<br />
Faut-il ranger cette répulsion parmi les idées préconçues dont je le disais dépourvu ? Ai-je,<br />
moi aussi, bien enracinée en moi, cette répulsion ? On se connaît si peu. À la rentrée scolaire<br />
1939, au lycée de Montauban, comme pour tous les fonctionnaires de France, on nous a<br />
demandé de signer sur ordre de Vichy, une déclaration sur l’honneur affirmant que nous<br />
n’étions pas francs-maçons. J’ai signé en pensant : quelle horreur d’être franc-maçon.<br />
Personne n’aurait dû signer une pareille infamie. C’était une lâcheté destinée <strong>à</strong> singulariser<br />
et rejeter les francs-maçons. Une espèce d’étoile jaune. Aussi lâches avons-nous tous été en<br />
ne portant pas tous l’étoile jaune. Nous avons tous été complices. »<br />
Cette claire apparition des juifs dans un texte qui n’en fait pas mention ailleurs et les<br />
trois « tous » soulignés par l’italique dirigent évidemment le regard vers Paul. D’autant<br />
qu’elle fait suite <strong>à</strong> un long paragraphe sur les « vertus » de sa « petite cellule familiale » où<br />
« ne s’affichaient pas les vraies valeurs de la vie, mais où <strong>elles</strong> se vivaient ». Puis quelques<br />
lignes après : « Comment avait-il réagi au moment de l’affaire Dreyfus ? Je ne le saurai<br />
jamais. »<br />
Lecteur assidu de Maurras dont le « nationalisme intégral » était fortement teinté<br />
d’antisémitisme, conservant également dans ses papiers personnels des numéros de Signal, le
principal vecteur de la propagande nazie dans les pays occupés que, grâce <strong>à</strong> ses nombreuses<br />
photos, son petit-fils trouvait plus agréable <strong>à</strong> feuilleter que la grisâtre Action française, Paul<br />
n’échappait pas aux débordements de son siècle. Même si par la vocation qu’il s’était donnée<br />
d’identifier les morts occultés par l’histoire, il cherchait <strong>à</strong> s’en retirer… Au prononcé du<br />
verdict de 1945 qui le condamnait <strong>à</strong> la réclusion perpétuelle et <strong>à</strong> la dégradation nationale,<br />
Charles Maurras déclara : « C’est la revanche de Dreyfus ! 2 » Il y a quelque chose de<br />
terrifiant dans cette apostrophe qui résume une vie en impasse. Il y a quelque chose de<br />
terrifiant dans les silences obstinés de Paul et peut-être plus encore de sa fille <strong>face</strong> au grand<br />
œuvre d’une vie qu’il convient de protéger de toute imperfection.<br />
Le couple dans sa bulle<br />
Marcelle naquit en 1914 dans une cave de Péronne d’où l’on entendait le canon et<br />
d’où, <strong>à</strong> travers la lucarne, on voyait les projecteurs balayer l’horizon. Une religieuse aida <strong>à</strong><br />
l’accouchement. Marcelle était la fille de Paul et de Maria. Elle mourut en 2001 <strong>à</strong> Alès où sa<br />
fille Anne patiemment l’aidait <strong>à</strong> supporter son âge délabré. Elle avait toujours été angoissée <strong>à</strong><br />
l’idée du « naufrage » que représente la vieillesse ; elle tenait le mot du général de Gaulle et<br />
souvent s’y référait. Elle avait quatre-vingt-sept ans. Ayant fait Normale sup’ lettres, en<br />
octobre 1938 Marcelle fut nommée pour son second poste professeur de français-latin-grec au<br />
lycée de Montauban. Elle était déj<strong>à</strong> clairement de gauche, participant aux nombreux meetings<br />
occasionnés par la guerre d’Espagne et le recrutement des Brigades internationales.<br />
Michel naquit en 1910 <strong>à</strong> Triel-sur-Seine, dans une chambre douillette de l’imposante<br />
maison de son grand-père, l’agent de change. Un médecin accoucheur était présent, assisté<br />
d’une sage-femme. Michel était le fils de Jacques et d’Alice. Il mourut d’une rupture<br />
d’anévrisme <strong>à</strong> Jonzac en 1949. Il venait tout juste d’avoir trente-neuf ans. Sportif par nature,<br />
escrime et cheval, un brin artiste avec son violoncelle et, pour amuser les copains, sa scie<br />
musicale, pas intellectuel pour un sou, Michel choisit la médecine militaire, d’abord <strong>à</strong><br />
Bordeaux, puis <strong>à</strong> Lyon. Ses années d’études laissent le souvenir de c<strong>elles</strong> d’un joyeux noceur,<br />
préférant courir les filles dans sa petite auto décapotable que préparer ses examens.<br />
Nommé lieutenant en 1937, en charge du service de santé du 7 e Spahi stationné <strong>à</strong><br />
Montauban, il rencontra Marcelle au café Sans Souci un dimanche après-midi d’octobre 1938,
puis il lui proposa de lui apprendre le Lambeth Walk, la nouvelle danse <strong>à</strong> la mode, au Club<br />
nautique de la ville. Deux mois après, ils se mariaient.<br />
Rien, si ce n’est le hasard des nominations administratives, ne prédisposait<br />
l’intellectuelle de gauche, fille d’un misanthrope brisé par l’existence, <strong>à</strong> épouser un fils de<br />
général, médecin militaire bon vivant habitué <strong>à</strong> goûter les plaisirs de la vie. Qui plus est fiancé<br />
<strong>à</strong> une héritière des bouchons bordelais… Deux mondes, deux façons d’être, une sorte<br />
d’attirance des contraires, le coup de foudre et le scandale ! Ils invitèrent leurs parents <strong>à</strong> un<br />
simple mariage civil <strong>à</strong> Montauban, ceux de Chavignon effrayés <strong>à</strong> l’idée que leur fille épouse<br />
un spahi marocain, ceux de Bordeaux avant tout soucieux de leur situation mondaine après<br />
des fiançailles rompues. Puis, dès la fin du déjeuner, ils filèrent pour romantiquement se<br />
marier <strong>à</strong> l’église d’Argelès en présence de quelques amis. Commençait ce qu’ils appelaient<br />
leur bulle * .<br />
Les années qui suivirent, jusqu’<strong>à</strong> la fin de la guerre, furent de la plus grande<br />
insouciance, comme répondant au nom du café où ils s’étaient connus. « Enfin, étiez-vous si<br />
insouciants, si inconscients après Munich et pendant que tonnaient sur toutes les ondes les<br />
mots hitlériens ? (…) Nous étions jeunes, nous avions envie de vivre, de rire, d’aimer. C’était<br />
notre avant-guerre. (…) Et Michel croyait vraiment ses propres mots : "Nous sommes une<br />
petite cellule bien abritée du monde que rien ne peut atteindre". (…) Ainsi avons-nous vécu<br />
notre destin, sûrs, follement sûrs que nous étions tous les deux <strong>à</strong> l’abri, hors du monde… La<br />
bulle de savon… » Plusieurs fois, dans ce texte de Marcelle qu’avant de sombrer elle donna <strong>à</strong><br />
chacun de ses enfants comme pour compenser sa retenue de toute une vie <strong>à</strong> leur égard, elle<br />
évoque ses « années Michel » comme c<strong>elles</strong> d’une petite cellule protectrice qui, seulement<br />
après-guerre, éclatera comme une « bulle de savon »<br />
Après le Lambeth Walk, on fait du cent <strong>à</strong> l’heure en traction-avant, on monte <strong>à</strong> cheval,<br />
on skie, on joue, on écoute de la musique, on achète un meuble au nom anglais du dernier<br />
chic, on reçoit, on est reçu, on déménage souvent mais peu importe, on fait des enfants qu’on<br />
emmène en promenade dans le Vercors et dont on montre la photo… À aucun moment de<br />
cette tranche de vie n’apparaît la guerre.<br />
Et pourtant, elle avait commencé pour eux avec l’Espagne. Après l’ouverture des<br />
frontières décidée par le gouvernement français en vue de la chute de Barcelone, en décembre<br />
3<br />
.<br />
* Ce texte consacré <strong>à</strong> Michel et Marcelle tire l’essentiel de ses sources d’un écrit inédit de Marcelle destiné <strong>à</strong> ses<br />
enfants : Michel, 33 pages dactylographiées, mai 1990. Sources complétées par quelques recherches<br />
d’environnement, dont plusieurs entretiens avec des personnes les ayant connus.
1938 Michel fut nommé médecin du camp d’Argelès en charge de l’installation de son service<br />
de santé. Il y resta <strong>à</strong> peine trois mois, le temps d’y épouser Marcelle, et se vit affecté au camp<br />
nouvellement ouvert de Judes <strong>à</strong> Septfonds où, l<strong>à</strong> aussi, il établit le service de santé. Argelès et<br />
Septfonds étaient destinés l’un et l’autre <strong>à</strong> être des camps d’internement des républicains<br />
espagnols, hâtivement élaborés sous la pression de l’afflux des réfugiés et pour lesquels les<br />
spahis assuraient une grande part du service d’ordre. Judes, dont la construction commença en<br />
février 1939, ouvrit le 10 mars : le camp situé dans une ancienne lande <strong>à</strong> moutons avait pour<br />
mission de dégager celui d’Argelès, surpeuplé ; il devait recevoir quinze mille miliciens<br />
espagnols répartis en quarante-quatre baraquements. Le service de santé en comprenait cinq :<br />
un réservé aux douches et aux latrines, quatre <strong>à</strong> l’infirmerie. Ces derniers étaient les seuls au<br />
début <strong>à</strong> bénéficier de châlits superposés aux bat-flancs inférieurs <strong>à</strong> 20 cm et supérieurs <strong>à</strong> 150<br />
cm, alors que dans les autres baraquements les réfugiés dormaient sur de la paille <strong>à</strong> même le<br />
sol. En outre, l’intendance militaire leur mettait <strong>à</strong> disposition des « fournitures de couchage<br />
auxiliaire », autrement dit des couvertures, en plus de la paille constituant le matelas.<br />
Fin août 1939, quarante-huit heures avant la mobilisation générale, le 7 e Spahis et son<br />
service de santé au grand complet furent secrètement envoyés <strong>à</strong> Annemasse puis <strong>à</strong><br />
Valentigney et Pfetterhouse. Michel fut ensuite affecté en avril 1940 au camp de Livron <strong>à</strong><br />
Caylus auprès du tout nouveau régiment d’infanterie légère où étaient regroupés les<br />
« joyeux », c’est-<strong>à</strong>-dire les droits communs ayant purgé leur peine ou la terminant en prison<br />
centrale. Le 17 juin 1940, lorsque pour la première fois le maréchal Pétain parla <strong>à</strong> la radio<br />
pour annoncer « le cœur serré » qu’il allait demander l’armistice aux Allemands, Michel et<br />
Marcelle se trouvaient dans un café <strong>à</strong> Caylus, au milieu d’une foule de gens, plutôt jeunes.<br />
Applaudissements, rires, embrassades, la salle fut soulevée d’un enthousiasme sans pareil. On<br />
allait cesser le combat, la guerre était terminée. Assis dans un coin, un vieux couple pleurait.<br />
Lui, surtout. Il avait combattu en 1917 sous les ordres de Pétain. Le calme revenu, quelqu’un<br />
lui demanda pourquoi ces larmes. Il répondit seulement : « On a perdu la guerre, on va<br />
souffrir énormément et notre vieux maréchal n’y pourra rien. » Ce jour-l<strong>à</strong>, ils apprirent aussi<br />
la débâcle du 7 e Spahis qui se résumait en une fuite vers la Suisse avec armes et bagages,<br />
comme au temps de ces « bourbakis » occultés par l’histoire officielle, car honteux pour<br />
l’armée française * .<br />
* 87000 soldats en déroute durant le terrible hiver 1871… Leur chef, le général Bourbaki ne trouva d’autre<br />
solution <strong>à</strong> sa défaite que de se réfugier en Suisse dans des conditions pitoyables. « La différence essentielle, une<br />
affaire de saison : l’été pour le 7 e Spahis, l’hiver pour les bourbakis », aimait <strong>à</strong> répéter Michel. De longues<br />
négociations entre Vichy et Berne aboutiront finalement au rapatriement du 7 e Spahis au tout début de 1941.
En octobre 1940, Michel fut nommé médecin du nouveau chantier de jeunesse 14, dit<br />
le Camp des maréchaux, situé <strong>à</strong> Sauveterre-de-Comminges, <strong>à</strong> quelques kilomètres de Saint-<br />
Gaudens, où lui naquit un fils. Il y resta trois mois, le temps d’y créer un service de santé, et<br />
fut envoyé au chantier de jeunesse 29 de Formiguères. Deux mois après, ce fut Grignan pour<br />
un nouveau chantier de jeunesse, le groupement 14, dit Le Coq… Chaque fois, tant pour les<br />
camps que pour les chantiers, tous nouveaux et souvent improvisés, donc sans grands moyens,<br />
son rôle consistait <strong>à</strong> établir l’infirmerie puis un service de santé en bonne et due forme.<br />
Grignan se révélant insuffisant <strong>à</strong> regrouper l’ensemble des jeunes de huit départements du<br />
Sud-Est, dont les Bouches-du-Rhône qui en était le pourvoyeur principal avec Marseille * , il<br />
fut décidé de transférer le groupement 14 <strong>à</strong> Die et de fortement le développer. En juin 1941,<br />
Michel prit la direction du grand service de santé projeté. À cette occasion, le chantier 14<br />
changea de nom, devenant « Duguesclin », plus valorisant que le naïf « Le Coq ». En août<br />
1941, le chantier était au complet : dix sous-groupes disséminés dans le massif voisin du<br />
Vercors pour des missions d’aménagement forestier et de travaux de défrichement, les<br />
services centraux installés <strong>à</strong> Die. Notamment celui de santé. Son rôle se divisait en deux : une<br />
tournée sanitaire trois fois par semaine auprès des infirmeries rattachées <strong>à</strong> chacun des dix<br />
sous-groupes et la gestion de l’hôpital.<br />
Dès son arrivée <strong>à</strong> Die, Michel commença par organiser l’hôpital du chantier, d’autant<br />
que la visite prévue pour le 9 août de « Deladu », le général de La Porte du Theil, devait être<br />
un succès. Chacun s’activa <strong>à</strong> astiquer le moindre bouton de guêtre, tant au propre qu’au<br />
symbolique : on installa un grand mât <strong>à</strong> l’entrée du poste de commandement et chaque service<br />
et sous-groupe dut se trouver une appellation. Pour l’hôpital, ce fut « Capitaine Jean Vial » du<br />
nom d’un compagnon de Bournazel, le fameux spahi mort dans l’Atlas en 1933<br />
Installé dans un bel hôtel du XVIII e siècle en plein centre-ville, l’hôpital Capitaine<br />
Jean Vial comportait quatre-vingts lits en plus des quarante lits répartis dans les dix sousgroupes<br />
; outre Michel, il comprenait trois médecins, un pharmacien, un dentiste et cinq<br />
infirmières, sans compter les « chantiers » en charge de l’entretien, au nombre d’une<br />
**<br />
.<br />
L’été précédant sa mort, en 1949, Michel emmena sa famille visiter le fameux panorama de Lucerne qui met en<br />
scène l’hiver des bourbakis.<br />
* Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse, Drôme, Hautes-Alpes, Var et Vaucluse. Les indications<br />
qui suivent concernant le chantier 14 sont tirés de la brochure établie par Pierre de La Bretèque, un grand<br />
chimiste marseillais : Le Groupement 14 Duguesclin, histoire du groupement racontée par les anciens, Amicale<br />
des Anciens du 14 e CJF, 1995.<br />
** Cavalier passionné, ancien de l’école du Service de santé des armées de Lyon et toujours sentimentalement<br />
attaché au burnous rouge des spahis, Michel est <strong>à</strong> l’origine du nom car le médecin-capitaine Jean Vial sortait de<br />
Lyon, comme lui. Il s’était rendu célèbre en donnant les derniers soins au « cavalier rouge », Henry de<br />
Bournazel, avant de s’assurer un grand succès de librairie avec la biographie qu’il lui consacra, puis de mourir au<br />
combat en 1940. Voir Jean Vial, Le Maroc héroïque, Hachette, Paris, 1938.
vingtaine 4 . « Les médecins étaient tous très jeunes, <strong>à</strong> peine sortis de l’école et <strong>à</strong> peine plus<br />
âgés que nous, les jeunes du chantier. D’où la bonne atmosphère qui régnait entre eux et nous,<br />
alors qu’on aurait pu les considérer comme des planqués. Parfois, on se moquait d’eux en<br />
disant qu’ils étaient des "médecins de chèvres" ; mais comme chez Pagnol *** , c’était pour<br />
rigoler », évoque Armand Andreotti **** . Il conserve de Michel un souvenir assez précis, celui<br />
d’un « chef bon vivant <strong>à</strong> l’esprit baraque », autrement dit d’un homme affable, très attaché au<br />
chantier. « De lui, on parlait en bien. Son hôpital était impeccable. La cuisine y était tellement<br />
magnifique par rapport <strong>à</strong> nos gam<strong>elles</strong> qu’on se serait volontiers porté malade ! »<br />
« À Die, nous habitions dans une vieille maison dans une rue très calme, raconte<br />
Andrée, la femme de Gilbert Pradoura, un des médecins de l’équipe du chantier de jeunesse.<br />
Un jour, j’ai entendu des bruits bizarres de l’autre côté de l’esplanade ; il s’agissait du marché<br />
aux cochons : chaque année, les éleveurs venaient y vendre de jeunes porcs aux paysans du<br />
Diois afin qu’ils les engraissent. En fin de marché, je suis descendue, j’ai parlé <strong>à</strong> un éleveur <strong>à</strong><br />
qui restait un petit cochon de soixante kilos. On ne mourait pas de faim mais on avait peu <strong>à</strong><br />
manger… Il me dit qu’il avait un garage tout proche de chez moi et qu’on pourrait s’arranger.<br />
Discrètement, bien entendu. À cette époque, il fallait quand même faire attention ; les<br />
accusations de marché noir étaient courantes. Quand mon mari est rentré de l’hôpital pour<br />
déjeuner, je lui ai raconté ma folie… Et le lendemain matin, <strong>à</strong> la première heure, coup de<br />
sonnette. Ce n’est jamais bon <strong>à</strong> cette heure-l<strong>à</strong>, ai-je pensé. C’était un jeune du chantier, il<br />
portait une lettre du médecin-chef, Michel. Je peux vous assurer qu’en ouvrant l’enveloppe, je<br />
n’avais nullement la conscience tranquille, je me disais que j’avais été découverte et que cela<br />
risquait de causer des ennuis <strong>à</strong> mon mari. La lettre était très courte : elle me demandait de<br />
négocier un autre cochon ! Une fois acheté, tous les quatre, aidés d’un charcutier, nous avons<br />
cuisiné les deux bêtes. Et nous avons bien mangé, bien bu et bien ri. Le marché noir, ce n’était<br />
peut-être pas bien, mais on en avait besoin ! C’est le seul souvenir que je garde d’un contact<br />
intime avec Michel et Marcelle. Sinon, on se rencontrait dans Die. L’atmosphère entre les<br />
gens du chantier était cordiale, sympathique même, mais nous étions plus jeunes et la<br />
hiérarchie jouait, il était médecin-chef… Surtout, Michel et Marcelle étaient tournés vers eux<strong>mêmes</strong><br />
et vers leurs enfants. Marcelle était belle et cultivée. Elle ne savait pas faire la cuisine.<br />
Ces cochonnailles pendant plusieurs semaines, ça l’arrangeait… »<br />
*** L’expression « médecin de chèvres » apparaît chez Pagnol quand Fanny enceinte se décide <strong>à</strong> consulter !<br />
**** Âgé de quatre-vingt-cinq ans, président de l’Amicale des anciens du chantier de jeunesse Duguesclin, il<br />
possède une faconde mi-partie italienne et marseillaise qui lui vient de son grand-père toscan installé marchand<br />
de charbon après avoir épousé une poissonnière du Vieux Port ; lui-même était tailleur après avoir hésité <strong>à</strong> se<br />
lancer dans le music-hall grâce <strong>à</strong> un premier prix de chant obtenu <strong>à</strong> l’Alcazar <strong>à</strong> sa sortie du chantier de jeunesse.
Avec le temps, les chantiers de jeunesse se révélèrent une des institutions vichystes les<br />
plus ambiguës : groupes paramilitaires destinés <strong>à</strong> régénérer la jeunesse française (version<br />
pétainiste officielle) et <strong>à</strong> la préparer <strong>à</strong> prendre les armes contre l’occupant (version cryptée<br />
largement diffusée en leur sein), ils étaient dirigés par le général de La Porte du Theil * .<br />
La plupart des chantiers s’étiolèrent dès mi 1943 : certains furent purement et<br />
simplement dissous pour être vidés de leurs effectifs au profit du STO tandis que d’autres<br />
rejoignirent directement les maquis. D’où un jugement historique nuancé <strong>à</strong> leur égard que<br />
partagèrent tous les grands acteurs de la Libération et dont François Mauriac résume au mieux<br />
l’essence : « Je me suis dit souvent que la seule idée féconde qu'il eût fallu retenir de Vichy<br />
c'était les chantiers de la jeunesse. Sous un régime où tout finissait par pourrir, il y eut<br />
pourtant, de ce côté-l<strong>à</strong>, un commencement de réussite, une amorce de formation dont certains<br />
demeurent encore marqués.<br />
5<br />
»<br />
Gilbert Pradoura était donc un des adjoints de Michel. Lors de la dissolution du<br />
chantier Duguesclin le 16 novembre 1943, il décida de rester <strong>à</strong> Die et de s’y installer comme<br />
médecin libéral. Les plus nombreux parmi les jeunes du chantier ayant rejoint les maquis du<br />
Vercors et certains d’entre eux connaissant parfaitement le terrain des environs, ils décidèrent<br />
de faire sauter un train remontant des Alpes vers Valence. Un vieux train aux wagons de bois<br />
plein de permissionnaires allemands allant passer Noël <strong>à</strong> la maison. L’attentat eut lieu <strong>à</strong><br />
quelques kilomètres de la gare de Die. Le nombre des blessés par fractures et surtout celui des<br />
grands brûlés se monta <strong>à</strong> plus d’une centaine, les médecins de Die furent immédiatement<br />
réquisitionnés par la préfecture, ainsi que les religieuses de l’hôpital civil de la ville et les<br />
infirmières encore en poste au chantier de jeunesse. L’évacuation et la prise en charge des<br />
blessés s’effectua en quelques heures, les officiers allemands en restèrent ébahis. Un médecincapitaine<br />
remercia tout particulièrement Gilbert Pradoura en lui donnant un petit mot<br />
manuscrit en allemand pour attester son « incroyable dévouement ». Parallèlement <strong>à</strong> sa<br />
clientèle privée, ce dernier créa alors un centre de soins pour résistants dans une ferme située<br />
en sortie de Die. Sans doute dénoncé dans le cadre des opérations du Vercors, il fut arrêté par<br />
la Gestapo en juillet 1944 ; il sortit alors le petit mot de son collègue allemand et se vit vite<br />
relâché.<br />
* Joseph de La Porte du Theil (1884-1976) reste l’exemple même du caractère équivoque de la période : démis<br />
de ses fonctions en janvier 1944, arrêté par la Gestapo et interné en Allemagne puis en Autriche, il fut se voit<br />
condamné <strong>à</strong> l’indignité nationale par la Haute Cour de justice après la Libération. Comme quoi les b<strong>elles</strong><br />
ambiguïtés ne résistent pas aux mouvements extrêmes du balancier politique !
Quelques jours avant l’attentat, Michel et Marcelle avaient quitté Die pour rejoindre<br />
Jonzac. Michel fut affecté <strong>à</strong> l’hôpital de La Rochelle. Que cela soit d’ailleurs avant ou<br />
pendant les huit mois de la poche, quasi chaque semaine il revenait <strong>à</strong> Jonzac où Marcelle<br />
s’habituait facilement. « Il y avait tout le beurre qu’on voulait sur la table », avait-elle<br />
coutume de dire en rappelant son arrivée chez ses beaux-parents. « Et les boutiques étaient<br />
normalement approvisionnées. »<br />
Un jour de courses, pour acheter des chaussures, elle rencontra madame Ombre, une<br />
veuve de la première guerre et son fils Élie. Ils étaient arrêtés sur le pont, manifestement<br />
fatigués et perdus. Ils traînaient avec eux une vieille valise sanglée…<br />
Avec les Ombre, Die soudain envahit le calme de Jonzac, cette ville teintée pour elle<br />
de bourgeoisie locale et de marmaille <strong>à</strong> élever. Chaque fois qu’il faisait beau, Michel et<br />
Marcelle prenaient la voiture et montaient dans le Vercors. La ferme des Ombre était leur<br />
promenade préférée. Ils leur achetaient du miel et du fromage, ils montraient les agneaux aux<br />
enfants, savourant le plein bonheur de la montagne. Une photo d’été de Marcelle et de ses<br />
trois bambins exprime au mieux la plénitude qu’ils trouvaient l<strong>à</strong>, <strong>à</strong> quelques pas de la ferme<br />
des Ombre. Ils en étaient tellement fiers qu’ils la firent tirer en de nombreux exemplaires<br />
qu’ils envoyèrent <strong>à</strong> toute leur famille…<br />
Le fils aîné des Ombre était facteur <strong>à</strong> Die et franc-garde de la milice ; le cadet, simple<br />
d’esprit, s’occupait des moutons. Dans les jours qui suivirent l’attentat, la montagne fut<br />
fouillée dans les moindres recoins. Et Élie, qui ne comprenait rien et riait d’un air bête, fut<br />
arrêté par les Allemands. Comme beaucoup d’autres… Ils les jetèrent dans un train. Juste<br />
avant le départ prévu, un sous-officier ouvrit la porte du wagon où se trouvait Élie et le fit<br />
descendre pour le relâcher. Il remonta <strong>à</strong> la ferme en criant partout que son frère l’avait fait<br />
libérer. Deux jours plus tard, un groupe du maquis mit la ferme sens dessus dessous, sans<br />
trouver Élie parti descendre du foin de la grange qu’ils tenaient dans les alpages. Le soir<br />
même, madame Ombre s’assura de l’essentiel, du pain et quelques billets, libéra les bêtes et<br />
décampa <strong>à</strong> pied <strong>à</strong> travers la montagne, jusqu’<strong>à</strong> la gare de Crest, cherchant <strong>à</strong> tout prix <strong>à</strong> éviter<br />
Die. Élie portait la valise.<br />
Ce récit, Marcelle l’apprit en plusieurs jours, tellement madame Ombre se montrait<br />
craintive. Mais, sa vie durant, Marcelle le racontera <strong>à</strong> ses enfants, leur disant chaque fois<br />
qu’elle avait rencontré la guerre sur le pont de pierre de Jonzac. Madame Ombre et Élie<br />
restèrent chez Michel et Marcelle, ou plutôt chez les parents de Michel, jusqu’au printemps
1945, lui au jardin, elle <strong>à</strong> la cuisine. Jacques prit l’habitude de parler d’Élie comme de « notre<br />
crétin des Alpes », ce qui faisait rire ses amis mais crispait fortement Marcelle…<br />
Survint entre temps la Libération. Pour préparer son défilé, un rassemblement se fit<br />
place du Champ de foire. Ce fut le jour qu’Élie choisit pour repiquer un semis d’oignons bien<br />
que ce ne fût guère la saison. Le potager de la maison de Jacques se situait légèrement audessus<br />
du champ de foire, derrière un mur qui, vu de la place paraissait très haut. Quelques<br />
résistants furent alertés par les mouvements d’Élie qui sans cesse se baissait puis se levait. Ils<br />
sonnèrent <strong>à</strong> la porte : « Mon général, il y a un espion dans votre jardin. – Vous n’y êtes pas,<br />
c’est notre crétin des Alpes, il repique des oignons ! »<br />
Rencontrer la guerre <strong>face</strong> <strong>à</strong> une fermière marquée par les ans, voil<strong>à</strong> qui oblige au<br />
dépassement de soi ; prendre conscience de sa laideur devant un imposteur rendu hystérique<br />
par les dérèglements du moment entraîne le dégoût. Juste après la scène de l’espion du<br />
potager, le défilé s’organisa entre la place de la République et celle du Château. Avec force<br />
bleu-blanc-rouge, il était mené par le groupe des maquisards arrivés des Pyrénées, la colonne<br />
Soulé <strong>à</strong> qui Jacques venait d’apprendre <strong>à</strong> manier leur canon autrichien. Suivaient quelques<br />
rares prisonniers allemands et plusieurs jeunes femmes tondues. Au premier rang du marais<br />
des spectateurs, un des trois pharmaciens de Jonzac se montrait déchaîné <strong>à</strong> crier des « Qu’on<br />
les fusille ! » ou encore « À poil ! ». Il était connu dans les salons de la ville pour avoir<br />
toujours tenu des propos plus que favorables <strong>à</strong> la collaboration, sans toutefois s’y être jamais<br />
mouillé. Écœurée, Marcelle lui jeta <strong>à</strong> la figure : « Vous n’avez pas honte ! »<br />
Puis elle rentra chez elle. Autant le souvenir de madame Ombre de son fils lui voilait<br />
la gorge, autant celui du pharmacien ivre de lui-même la mettait dans un état d’évident mépris<br />
qu’elle partageait avec ses enfants. De retour <strong>à</strong> Die, madame Ombre trouva sa grange<br />
incendiée. Le pharmacien continua de parader dans son petit monde. Et Marcelle s’engagea<br />
dans l’action sociale.<br />
Jusqu’<strong>à</strong> ce qu’elle quitte Jonzac <strong>à</strong> la mort de Michel, elle s’occupa d’enfants de la<br />
Ville en bois, un quartier de La Rochelle parmi les plus défavorisés, où régnaient le taudis et<br />
le pire des dénuements, celui de la misère morale. Elle organisait leur placement dans des<br />
fermes du Jonzacais et leur alphabétisation durant leurs jours de repos. Elle se montrait aussi<br />
très fière de couvrir quelques actions illégales comme le détournement de sacs de charbon ou<br />
l’accueil de jeunes femmes prêtes <strong>à</strong> avorter. Ce qui plusieurs fois provoqua de vives critiques<br />
de la part de Michel qui manifestement ne comprenait plus sa femme.
Ce raccord au factuel n’éclaire pourtant qu’en partie la question du comment Michel et<br />
Marcelle vécurent leur guerre. Entre l’anecdote du cochon et « l’esprit baraque », entre les<br />
déplacements incessants dus aux services de santé <strong>à</strong> créer qui donnent un sentiment de<br />
véritable goût au métier et l’attirance manifeste vers Jonzac qui ressemble <strong>à</strong> un retour au nid,<br />
les contradictions sont manifestes.<br />
Michel, le texte inédit écrit par Marcelle, mentionne rarement leurs opinions durant ces<br />
années. Elles sont toujours enfouies au plus profond de leur bulle d’optimisme amoureux. La<br />
politique ? Michel ne cachait pas qu’il ne s’en était jamais vraiment préoccupé. Il laissait<br />
Marcelle le guider. Ce qu’elle fit sans excès afin de ne pas le mettre en position délicate<br />
envers son métier. La religion ? Marcelle avait hérité de son père Paul un mépris ostensible <strong>à</strong><br />
son égard qu’en bonne normalienne elle nourrissait d’une pincée d’opium du peuple. Michel,<br />
lui, s’en tenait aux rites de la messe, comme Jacques, avec un goût particulier pour la musique<br />
religieuse qu’il considérait comme une des expressions les plus b<strong>elles</strong> de la culture<br />
européenne. Face <strong>à</strong> ces divergences, Marcelle se mit du bout des lèvres <strong>à</strong> la messe et dès avant<br />
la création du fameux festival, elle accompagna Michel aux master-classes que donnait Pablo<br />
Casals dans une école de Prades * , non pas tant qu’elle aimât Bach mais pour leurs<br />
promenades en montagne qui lui rappelaient Die.<br />
« Non, ni Michel ni moi n’étions inconscients. Depuis février 1934, lui de son côté,<br />
moi du mien, nous avions pris résolument parti contre tout mouvement fasciste, (…) nous<br />
avions vibré <strong>à</strong> la victoire du Front populaire, en opposition l’un et l’autre d’ailleurs avec nos<br />
familles. Sans doute cette joie, l’enthousiasme au moment des premiers congés payés en<br />
particulier, nous avait un peu masqué l’approche imminente de la guerre. La guerre<br />
d’Espagne nous y avait ramenés cruellement. Personne ne pouvait raisonnablement croire<br />
qu’on éviterait la guerre avec les nazis. Après tout, chaque être humain est mortel. Chacun de<br />
nous le sait et cependant vit sans être obsédé par cette idée. Ainsi savions-nous avec notre<br />
raison, notre intelligence, qu’une guerre était inévitable. Mais <strong>à</strong> ce savoir n’adhéraient pas<br />
notre influx vital et notre sensibilité. Peut-être étions-nous davantage poussés <strong>à</strong> prendre de la<br />
vie tout ce qu’elle pouvait nous donner ?»<br />
» "Je voudrais être un dur", disait souvent Michel. Bien sûr, c’était exactement ce<br />
qu’il n’était pas et ne pourrait jamais être. Trop sensible, trop compréhensif, trop analyste de<br />
ses sentiments, trop tendre pour être jamais un "dur", trop humain en un mot. Deux fois, je<br />
* Pablo Casals (1876-1873) est le plus grand violoncelliste de son temps qu’aujourd’hui certains considèrent<br />
comme le précurseur du renouveau de la musique baroque en Europe. Réfugié <strong>à</strong> Prades <strong>à</strong> la fin de la guerre<br />
d’Espagne, il y donna des cours d’interprétation avant de fonder le fameux festival de Prades en 1950.
l’ai vu croire qu’il pouvait devenir un dur. Au moment de la débâcle espagnole, quand il s’est<br />
heurté <strong>à</strong> tout ce qu’une armée en déroute, après plusieurs années de guerre atroce, peut<br />
traîner de bassesse, de violence, de brutalité bestiale. Parce qu’un Espagnol avait osé<br />
manifester, en me voyant, qu’il me trouvait <strong>à</strong> son goût, Michel s’était jeté sur lui et l’aurait<br />
étranglé (…) par mépris pour cette frange de sous-humanité que le camp d’Argelès mettait en<br />
évidence. Au début du régime de Vichy, j’ai vu ressortir en lui les rancœurs qu’il avait<br />
connues en médecine hospitalière où les étudiants juifs s’octroyaient la part du lion. Je l’ai vu<br />
prêt <strong>à</strong> adopter toute la pensée pétainiste d’anti-démocratie, de mépris, de violence et de<br />
racisme. J’ai eu très peur, car tout cela m’avait toujours fait horreur. Cela a duré des jours,<br />
même pas des semaines, et je l’ai retrouvé avec ses nuances, sa pensée critique, tout sauf un<br />
"dur". 6 »<br />
Très probablement, son métier confronté aux réalités de la guerre dans les camps<br />
d’internement puis de façon plus sereine et plus scout dans les chantiers de jeunesse devait<br />
amener Michel <strong>à</strong> une vision des choses moins idyllique que celle <strong>à</strong> laquelle – peut-être – il<br />
avait rêvé aux temps du Front populaire, mais aussi plus modérée que celle de sa femme qui,<br />
manifestement le dominait en ce domaine. Couple étrange que tout aurait dû séparer, l’armée<br />
et l’organisation des camps qui plus tard serviront <strong>à</strong> parquer les juifs contre Normale Sup’ et<br />
les manifestations pour les brigades internationales ; couple uni grâce <strong>à</strong> l’isolement du monde<br />
dans lequel il se niche. Même devant le désastre des camps dont Marcelle retient la « soushumanité<br />
».<br />
Après la guerre, Michel et Marcelle s’inscrivirent un moment au MRP, le parti<br />
démocrate-chrétien, puis vite en furent déçus et le laissèrent tomber. Lui pour se consacrer <strong>à</strong><br />
une troupe de scouts et <strong>à</strong> un club de football, elle pour rejoindre le chantier d’insertion monté<br />
par un Jonzacais d’origine, prêtre ouvrier docker <strong>à</strong> la Ville en bois. C’était l<strong>à</strong> leur<br />
tempérament : lui en retrait par rapport aux duretés de la vie ; elle mettant son énergie <strong>à</strong> s’y<br />
plonger. Il croyait probablement encore <strong>à</strong> leur bulle d’autrefois, elle le rassurait, elle le<br />
protégeait. Elle n’y croyait probablement plus. Sauf sans doute <strong>à</strong> l’égard de ses enfants…<br />
Michel avait dix ans de moins que Sylvain Lévy et Marcelle trois ans de moins<br />
qu’Erna. Les deux couples se trouvèrent « réfugiés » en Charentes. Mais pour un parcours de<br />
guerre opposé. D’un côté, la précarité de l’existence, les lois anti-juives, une cache et une<br />
angoisse permanente rendant quasi impossible le concept même de cocon familial protecteur.<br />
Pire, la seule façon que les Lévy eurent de le concevoir aboutit <strong>à</strong> le désagréger par la<br />
séparation d’avec leur fille. Plus tard, une fois la guerre terminée, ce cocon désiré et manqué<br />
de Montbron explique leur rêve américain et sa réalisation. Au moment où celui-ci prit corps,
où très concrètement ils obtinrent un passeport sur lequel figuraient côte <strong>à</strong> côte la mère et la<br />
fille, c’est-<strong>à</strong>-dire en 1947, en plein début de ce qui allait devenir la guerre froide, Michel et<br />
Marcelle entreprirent des démarches d’émigration. Leurs raisons étaient probablement<br />
similaires <strong>à</strong> c<strong>elles</strong> des parents de Josie : la crainte de nouveaux débordements et le sentiment<br />
régnant <strong>à</strong> l’époque en France d’un pays sans avenir. Ce fut d’abord l’Australie. Mais le<br />
diplôme de médecine de Michel n’y étant pas reconnu, ils se tournèrent vers l’idée d’un<br />
kibboutz en Israël. L’affaire en resta au niveau du rêve. On les vit ensuite fréquenter la<br />
communauté utopiste de Lanza del Vasto <strong>à</strong> La Genétouze, en pleine lande du sud charentais,<br />
une autre bulle, communautaire cette fois. La longue absence d’une bulle protectrice avivait la<br />
volonté des Lévy, sa longue habitude affaiblissait la détermination de Michel et de<br />
Marcelle… Au point de l’annihiler.<br />
L’adolescent tourmenté<br />
François naquit en 1940 <strong>à</strong> Saint-Gaudens, <strong>à</strong> quelques kilomètres du chantier de<br />
jeunesse de Sauveterre-de-Comminges, dont son père supervisait l’installation du service de<br />
santé. Il était le fils de Michel et de Marcelle, fortement marqué par son enfance jonzacaise.<br />
Dans son propre album photographique figure la photo prise pendant l’été 1943 près de la<br />
ferme de madame Ombre. François y est encore en barboteuse. Quant <strong>à</strong> la légende de la<br />
photo, elle se compose de deux vers de Hâfez * : « Le doux souffle de la brise répandra son<br />
musc encor, / Le vieux monde de nouveau retrouvera sa jeunesse. » Poétique de l’insouciance<br />
telle que la vivaient ses parents ou démarque inconsciente de la famille française régénérée<br />
qui se retrouverait dans Gringoire ? Identitairement, la petite juive cachée de Lesterps et<br />
l’enfant de Jonzac ont un point commun : ils sont des produits de la guerre. Au sens d’un écho<br />
qui perdure et agit en eux comme un mythe d’origine permettant bien des projections. Dans la<br />
douleur d’un déracinement puis d’une lente reconstruction psychique chez Josie, dont Ne dis<br />
jamais ton nom est <strong>à</strong> la fois l’outil et la métaphore. Dans le fantasme plutôt confortable chez<br />
François où tout s’est toujours atténué en une sorte de désenchantement rampant…<br />
De même que Marcelle découvrit la guerre, autrement dit la réalité, en rencontrant les<br />
Ombre sur le pont de pierre de Jonzac, François prit conscience de sa propre réalité<br />
lorsqu’elle lui lut une lettre d’Élie Ombre postée <strong>à</strong> Die quelques jours avant la mort de son<br />
père. Elle était courte et étrange. Elle demandait des nouv<strong>elles</strong> du chien Puck qu’Élie, dès le<br />
* Poète persan du XIVe siècle dont l’œuvre célèbre les plaisirs de la vie.
jour de son arrivée <strong>à</strong> Jonzac, avait calmé alors que depuis des jours il aboyait et montrait ses<br />
crocs si furieusement qu’on avait été obligé de l’enfermer dans une ancienne volière. Surtout,<br />
elle conseillait <strong>à</strong> la famille de prendre garde aux jours <strong>à</strong> venir car « un grand malheur »<br />
risquait de survenir. Le nom même des Ombre et le souvenir de leur grange en ruine, aux<br />
murs noircis par le feu, le poursuivraient longtemps comme l’image d’une période<br />
déboussolée dans laquelle il ne devrait pas se perdre. L’été précédent, ses parents l’avaient<br />
emmené en voyage entre la Suisse insouciante où sa mère avait acheté plusieurs paires de bas<br />
nylon qu’on ne trouvait pas en France et le Vercors encore blessé par sa guerre. En montant<br />
vers la ferme des Ombre, son père avait fredonné les accents lents des violonc<strong>elles</strong> qui<br />
ouvrent L’Hymne <strong>à</strong> la joie, les répétant plusieurs fois tout en faisant semblant de lâcher le<br />
volant devant chacun des tournants de la petite route de montagne. C’est le dernier souvenir<br />
que François conserve de lui.<br />
Longtemps après vint la mort de sa mère. Parce qu’elle en devinait le moment proche<br />
et que sans doute elle voulait éviter un trop grand naufrage vis-<strong>à</strong>-vis de ses enfants devenus<br />
adultes et même âgés, Marcelle organisa un partage de ses meubles. Pour chacun d’eux, ce fut<br />
un moment poignant, terrifiant même. Comme ce l’est toujours en famille lorsque les<br />
souvenirs frissonnent d’une charge brutale d’émotion. François prit quelques Pléiades dont il<br />
savait qu’ils lui avaient été chers, le Journal de Gide, La Guerre et la paix de Tolstoï, les<br />
Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand, ainsi que les deux grands tomes in-quarto d’une<br />
splendide édition de 1930 d’El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Puis il nota en<br />
première page quelques mots au crayon pour les situer dans ses propres souvenirs. « Ces deux<br />
tomes bien abîmés, "récupérés" le 16 mars 1998 dans le déménagement de Sèvres valant<br />
partage des affaires de ma mère, possèdent leur part d’histoire familiale. Ils auraient été<br />
donnés <strong>à</strong> mon père par un réfugié espagnol du camp d’Argelès en 1939, juste après la chute<br />
de Barcelone. Ils viendraient du sac de l’archevêché de la ville par les républicains et<br />
auraient fait partie des collections privées de l’archevêque. Quel sac ? Quel troc ? La<br />
légende dorée de leur arrivée dans ma bibliothèque ne le dit pas. »<br />
François les avait toujours connus installés en bas des rayonnages du salon, car ils sont<br />
particulièrement épais et lourds ; partout, ils avaient suivi ses parents. Du coup, leurs reliures<br />
de cuir doré et leurs gravures protégées par du papier de soie faisaient partie de son<br />
attachement <strong>à</strong> son père disparu. Argelès et son camp devenaient pour lui le point de départ<br />
d’une reconstruction de souvenirs autour des républicains espagnols internés en France.<br />
Légende dorée, légende de l’ombre ?
De l’histoire de ses parents, François ne connaissait que des bribes. Surtout<br />
lorsqu’<strong>elles</strong> concernaient la guerre. Longtemps, parce que sa mère jamais ne le démentait, il<br />
crut que le lieu de sa naissance, Saint-Gaudens, était dû <strong>à</strong> un camp d’internement proche.<br />
Pendant de nombreuses années, il se documenta sur les camps du Sud-Ouest, notamment sur<br />
celui de Gurs, le seul <strong>à</strong> avoir bénéficié de publications importantes, sans jamais chercher<br />
vraiment quel pouvait être ce camp proche de Saint-Gaudens ! Il pensait au camp-hôpital de<br />
Noé mais les dates ne coïncidaient pas ** . En fait, il mélangeait tout, les lieux, les dates, tout.<br />
Quant <strong>à</strong> Septfonds, il s’agissait bien un camp pour Espagnols, mais il se trouvait loin de Saint-<br />
Gaudens et son père y avait créé le service de santé dix-huit mois avant sa naissance ! Depuis<br />
son plus jeune âge, l’histoire de ses origines lui trottait dans la tête.<br />
La réalité se voyait escamotée par cette focale donnée aux réfugiés espagnols.<br />
Pourquoi l’Espagne et non les chantiers de jeunesse ? Évidemment le beau Don Quijote !<br />
François adorait regarder ses gravures, <strong>elles</strong> l’entraînaient ailleurs, dans un univers héroïque.<br />
Irréel… Sur le même rayonnage que celui du Don Quijote, reposait aussi l’album de ses<br />
parents où figuraient deux photos d’un jeune homme inconnu. La première, véritable portrait<br />
de preux tiré sur papier cartonné, le montrait partant pour les brigades internationales, un fusil<br />
<strong>à</strong> la main et une couverture roulée aux épaules ; sur la seconde, plus petite et plus floue, prise<br />
par un amateur, on le voyait appuyé sur une béquille. Lui manquait la jambe gauche. Deux<br />
mentions en-dessous : « François, 1937 » et « François, 1938 ». « C’était un ami, il avait<br />
choisi les brigades ». De sa mère, jamais il n’arriva <strong>à</strong> en savoir plus, bien que sa gêne <strong>à</strong> en<br />
parler indiquait un je ne sais quoi de trouble et lui laissait penser que le François en question<br />
avait eu pour elle une importance plus grande que celle d’un simple ami. D’où cet amalgame<br />
semi-conscient entre un idéal brisé et des camps d’internement, entre un François inconnu qui<br />
le ramenait <strong>à</strong> son prénom et un père <strong>à</strong> qui, pour ne pas le considérer comme un vulgaire<br />
geôlier, il inventait de b<strong>elles</strong> brigades internationales en réaction <strong>à</strong> son milieu familial<br />
ouvertement partisan de Franco, bien que ce dernier ne fût qu’un rastaquouère !<br />
Le Don Quijote n’était pas le seul livre <strong>à</strong> attirer François dans la bibliothèque de sa<br />
mère, car il avait vite compris que, hormis quelques partitions de violoncelle entassées en bas,<br />
sous l’album photo et la collection de timbres, le choix et le classement des livres relevaient<br />
de sa mère, comme les ballons, les bicyclettes, le canoë et le chien Puck faisaient partie du<br />
domaine de son père. Sa mère avait une amie juive, femme d’un dentiste lorrain réfugié <strong>à</strong><br />
Jonzac et qui avait décidé de s’y installer, au moins pour un temps. L’une et l’autre lisaient<br />
** Destiné aux Espagnols âgés ou handicapés n’ayant pu être engagés dans les compagnies de travailleurs<br />
étrangers, le camp-hôpital de Noé fut ouvert seulement en février 1941.
eaucoup et échangeaient leurs livres, généralement achetés rue Sainte-Catherine <strong>à</strong> Bordeaux<br />
où <strong>elles</strong> allaient régulièrement faire des courses avec leurs enfants. L’amie juive conseillait la<br />
mère de François en matière de « textes lazaréens » comme elle appelait les premiers récits<br />
concernant l’univers concentrationnaire * , tandis qu’<strong>à</strong> l’inverse cette dernière la guidait dans<br />
des choix plus littéraires.<br />
Un soir, n’ayant plus rien <strong>à</strong> lire, sa mère téléphona <strong>à</strong> son amie pour lui demander de lui<br />
prêter un livre. Puis elle envoya François le chercher. C’était La Vingt-cinquième heure de<br />
Virgil Georghiu<br />
**<br />
. Un gros livre dont l’amie juive lui dit que plus tard il pourrait le lire…<br />
François avait <strong>à</strong> peine dix ans mais il se considérait déj<strong>à</strong> comme ayant dépassé le cap de<br />
l’enfance. Son père venait de mourir et un conseil de famille s’était tenu la veille de<br />
l’enterrement lui faisant savoir qu’en tant qu’aîné des enfants, il en était maintenant<br />
responsable. C’est ainsi que le premier livre pour adultes que lut François fut La Vingtcinquième<br />
heure ! Naturellement, il ne comprit pas tout, loin de l<strong>à</strong>, mais se fit un devoir de le<br />
lire jusqu’au bout pour se prouver qu’il n’était plus un enfant. Il lui en resta le sentiment<br />
vague mais permanent du désastre auquel sont confrontés les individus <strong>face</strong> aux absurdités<br />
policières et aux injustices quotidiennes qu’<strong>elles</strong> génèrent. Ion, le paysan du Danube, est un<br />
juif pour les Roumains, un roumain pour les Hongrois, un hongrois pour les Allemands, un<br />
allemand pour les Américains… Selon les besoins du moment ! Traité comme du bétail,<br />
ballotté de camp en camp et d’identité en identité… Son histoire se termine par une<br />
conférence de presse organisée par les services américains qui, ayant vérifié son itinéraire,<br />
souhaitent tirer profit de sa relaxe pour l’image exemplaire de leur armée… « Keep smiling »,<br />
lui répète l’officier de presse américain… Ce furent les premiers mots anglais appris par<br />
François, <strong>à</strong> la façon d’un apprentissage de l’hypocrisie sociale. Il vécut dès lors comme<br />
modelé par les deux mots de l’officier américain, se gardant d’exprimer ce qu’il développait<br />
en lui d’indocile.<br />
Plus tard, il se mit <strong>à</strong> noter sur un cahier les citations qu’il retenait des livres lus car sa<br />
mère n’aimait surtout pas qu’on les souligne, même au crayon. La première citation de son<br />
* La figure de Lazare, le ressuscité de l’Évangile selon saint Jean (Jean 11), est en effet des caractéristiques<br />
répétées de la symbolique des récits d’après-guerre. Jean Cayrol (1911 – 2005), ancien déporté <strong>à</strong> Mauthausen<br />
pour faits de Résistance devenu un des éditeurs du Seuil, est l’inventeur de l’expression « littérature<br />
lazaréenne », remplacée ensuite par « récits lazaréens ». Il en est aussi un contributeur par ses œuvres,<br />
notamment en 1953 avec le texte de Nuit et brouillard, le documentaire d’Alain Resnais consacré <strong>à</strong> ce qui ne<br />
s’appelle pas encore la Shoah.<br />
** Virgil Georghiu (1916 – 1992), prêtre orthodoxe roumain, est l’auteur de La Vingt-cinquième heure, roman<br />
publié chez Plon en 1949, préfacé par Gabriel Marcel. En 1967, Henri Verneuil en tira un film avec Anthony<br />
Quinn dans le rôle principal, celui d’un paysan pris pour un juif, et passant de camp en camp, roumain, hongrois,<br />
allemand, pour finalement échouer dans une prison américaine.
premier cahier pouvait sembler en opposition avec cet alignement sur la bibliothèque<br />
familiale : « Il est affreux de ressembler <strong>à</strong> son père, <strong>à</strong> sa mère, de se prévoir. » Elle est de<br />
Paul Nizan dans La Conspiration… Juste en-dessous, il nota le « Keep smiling » de Georghiu.<br />
Son immersion dans l’univers de la déportation connut un autre moment fort. En 1956,<br />
sortait Nuit et brouillard d’Alain Resnais. Le film rencontra le succès, non pas tant dans les<br />
circuits commerciaux qui avaient tendance <strong>à</strong> le bouder car il leur faisait peur, mais au sein des<br />
milieux associatifs. Les trains, les camps, les barbelés, les miradors, les ombres aux yeux<br />
brûlants et aux pyjamas rayés… Dans une salle outillée de simples bancs, François découvrit<br />
les premières images de l’horreur et de la honte. Saisi par la noirceur. À la fin de la projection,<br />
il sortit pour vomir le long d’une haie de troènes. Toute sa vie, il conservera devant ses yeux<br />
le plan où un bulldozer entasse dans un grand fossé des cadavres nus, si décharnés qu’ils en<br />
sont devenus flasques et élastiques.<br />
La présence de cette séquence le renvoyait immanquablement <strong>à</strong> son père. Certes, il<br />
savait qu’il n’existe aucun rapport direct entre les infirmeries des camps pour réfugiés<br />
espagnols et ceux de l’extermination des juifs. Il y voyait toutefois une filiation qui le<br />
troublait. Une filiation qui, plus tard, lui ferait se poser la question de ce que lui-même aurait<br />
fait dans des situations de carrière similaires. Ce n’était nullement une affaire d’idéologie,<br />
mais de penchant social, comme le « Keep smiling » du paysan du Danube.<br />
Son univers spirituel s’en voyait chamboulé. Dieu lui paraissait inutile. Et l’Homme<br />
terriblement décevant. Sa crise d’adolescence ignora l’habituelle révolte, elle se confina en<br />
questionnements tourmentés. Il avait toujours préféré l’histoire sainte <strong>à</strong> la prière, considérant<br />
celle-ci comme un rite <strong>à</strong> respecter. Dès lors, il l’abandonna sauf <strong>à</strong> faire semblant lorsqu’il<br />
accompagnait sa grand-mère <strong>à</strong> la messe. Au retour, il l’interrogeait sur qui était vraiment son<br />
père, tout en lui inventant des carnets scolaires qui la rassuraient et en lui affirmant qu’il<br />
continuait <strong>à</strong> pratiquer la musique avec une contrebasse trop encombrante pour la transporter<br />
jusqu’<strong>à</strong> Jonzac… C’est sans doute lors de ces dialogues que François prit le goût de poser des<br />
questions tout en se montrant réticent <strong>à</strong> donner des réponses <strong>à</strong> c<strong>elles</strong> qui lui étaient adressées.<br />
« Ton père était un adorable menteur, lui répondait sa grand-mère. Il se créait des<br />
mondes <strong>à</strong> lui, souvent drôles, et il aimait berner son entourage avec des petits mensonges qu’il<br />
était facile de démasquer. Il s’en amusait, il disait que cela l’empêchait d’étouffer. Et cela<br />
faisait partie de son charme. Les filles adoraient… Il racontait qu’il était né <strong>à</strong> Honolulu, qu’il<br />
avait fait le rallye Paris-Deauville avec sa décapotable, qu’il avait plumé Sacha Guitry au<br />
black jack de la Grande Côte, qu’il était descendu dans la tombe de Toutankhamon avec son<br />
oncle René, qu’il avait participé <strong>à</strong> l’émeute des Croix de feu du 6 février 1934 avec son oncle
André… Tout était faux. Au moins en partie. Ce qui était vrai, c’est qu’il jouait bien du<br />
violoncelle et qu’il animait magnifiquement les soirées avec sa scie musicale. Ton grand-père<br />
aurait voulu qu’il fasse une école militaire. Pas Polytechnique, il n’était pas du tout matheux,<br />
mais Saint-Cyr par exemple… Il lui répondait qu’il avait horreur d’une seule chose en<br />
musique, les marches militaires. Il savait aussi qu’avec son père il valait mieux composer,<br />
c’est comme ça qu’il a finalement choisi la médecine militaire. Je ne sais pas si cela lui<br />
plaisait vraiment, il a mis huit ans <strong>à</strong> décrocher son diplôme… – Et la politique ? – Ta mère le<br />
poussait <strong>à</strong> s’y intéresser, je crois qu’il faisait semblant. Au fond, il s’en moquait. Quand il<br />
était enfant, il aimait l’idéal ; après, il se l’est gardé pour lui parce que la vie oblige <strong>à</strong><br />
transiger. Ta mère représentait une grande partie de cet idéal. Puis, elle aussi s’est vue<br />
contrainte <strong>à</strong> transiger. » Peu <strong>à</strong> peu, François ressembla <strong>à</strong> ses parents, il se mit <strong>à</strong> considérer la<br />
vie comme un jeu, savourant tout <strong>à</strong> la fois, insouciance, culture et carrière, sachant<br />
parfaitement qu’il enfouissait sa part d’idéal et qu’il en craindrait les retours d’amertume. Ou<br />
les espérerait…<br />
1 Marcelle Simoneau, Chétives Olives, hors commerce, Le Croît vif, 1992, p. 7.<br />
2 Alain-Gérard Slama, notice Maurras du Dictionnaire des intellectuels français, Jacques Julliard et Michel<br />
Winock (dir.), Le Seuil, 1996.<br />
3 Marcelle Simoneau, Michel, inédit, mai 1990, pp. 11, 15, 21, 28.<br />
4 Pierre de La Bretèque, op. cit., p. 101 sq.<br />
5 François Mauriac, De Gaulle, Grasset, 1964.<br />
6 Marcelle Simoneau, Michel, op.cit., pp. 12 et 25.