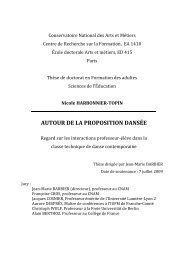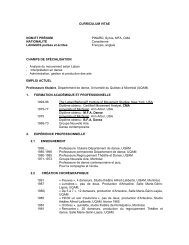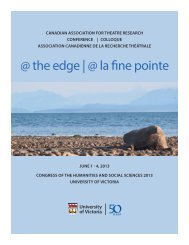1 Nicole Harbonnier-Topin Professeur au Département de danse de ...
1 Nicole Harbonnier-Topin Professeur au Département de danse de ...
1 Nicole Harbonnier-Topin Professeur au Département de danse de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1<br />
<strong>Nicole</strong> <strong>Harbonnier</strong>-<strong>Topin</strong><br />
<strong>Professeur</strong> <strong>au</strong> <strong>Département</strong> <strong>de</strong> <strong>danse</strong> <strong>de</strong> l’université du Québec à Montréal (UQAM)<br />
Case postale 8888, succursale Centre-ville<br />
MONTRÉAL (Québec) H3C 3P8 CANADA<br />
Tel: 514 987 3000 poste 2455<br />
Fax : 524 987 4697<br />
harbonnier-topin.nicole@uqam.ca<br />
Jean-Marie Barbier<br />
<strong>Professeur</strong> <strong>au</strong> Conservatoire National <strong>de</strong>s Arts et Métiers (CNAM)<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche sur la Formation (CRF)<br />
Case 232 - 2, rue Conté<br />
75003 PARIS, France<br />
Tél: 01.40.27.26.98<br />
Fax: 01.40.27.28.43<br />
jean-marie.barbier@cnam.fr<br />
« Voir pour faire plus et faire pour voir mieux »<br />
Résumé<br />
Des recherches neuroscientifiques récentes sur l’interaction cérébrale lors <strong>de</strong><br />
l’observation du mouvement d’<strong>au</strong>trui ainsi que l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> terrain menée dans cinq<br />
classes techniques <strong>de</strong> <strong>danse</strong> contemporaine à un nive<strong>au</strong> préprofessionnel, nous<br />
amènent à relativiser le présupposé selon lequel l’apprentissage par imitation serait<br />
superficiel et aliénant. Un modèle d’analyse conçu à partir du concept d’« activité »<br />
nous a permis <strong>de</strong> faire ressortir les forces et les limites <strong>de</strong> la configuration<br />
pédagogique « démonstration – reproduction du modèle », mo<strong>de</strong> traditionnel<br />
d’apprentissage dans la classe technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong>. Nous proposons la notion <strong>de</strong><br />
communication « ostensive-résonante » pour rendre compte <strong>de</strong> l’interaction<br />
particulière mise en jeu par le professeur <strong>de</strong> <strong>danse</strong> contemporaine dans ce mo<strong>de</strong><br />
pédagogique traditionnel.<br />
Mots clés : <strong>danse</strong>, enseignement, interactions, activité, communication, imitation,<br />
résonance, neurones miroir.
2<br />
Introduction<br />
En nous intéressant à la formation <strong>de</strong>s professeurs <strong>de</strong> <strong>danse</strong>, nous avons été amenés à<br />
revisiter le mo<strong>de</strong> pédagogique traditionnel utilisé pour la formation <strong>de</strong>s <strong>danse</strong>urs,<br />
mo<strong>de</strong> que nous intitulerons « démonstration / reproduction du modèle ». Nous le<br />
perpétuons comme une évi<strong>de</strong>nce <strong>au</strong>ssi bien dans les formations initiales du <strong>danse</strong>ur<br />
que dans les formations <strong>de</strong> formateurs. Or, la valeur <strong>de</strong> ce mo<strong>de</strong> pédagogique semble<br />
plus reposer sur le caractère habituel d’une pratique qui a fait ses preuves que sur une<br />
réflexion approfondie et argumentée. Notre intention, dans cet article, est, tout en<br />
dévoilant les éléments constituants <strong>de</strong> cette pratique, d’en faire ressortir ses forces et<br />
ses limites pour l’apprentissage <strong>de</strong> l’étudiant.<br />
Les découvertes neuroscientifiques récentes sur le système « miroir » ainsi qu’une<br />
recherche <strong>de</strong> terrain menée dans cinq classes techniques <strong>de</strong> <strong>danse</strong> contemporaine,<br />
nous amènent à relativiser les présupposés, trouvés dans la littérature, selon lesquels<br />
l’apprentissage par « reproduction » serait superficiel et aliénant. Nous commencerons<br />
par exposer ces différentes perspectives contradictoires sur l’enseignement en <strong>danse</strong><br />
contemporaine. Nous évoquerons ensuite les recherches sur les « neurones miroir »<br />
qui nous invitent à appréhen<strong>de</strong>r le fon<strong>de</strong>ment biologique <strong>de</strong> l’imitation. Nous<br />
présenterons enfin notre recherche <strong>de</strong> terrain dont les résultats ten<strong>de</strong>nt à proposer une<br />
nouvelle formulation du processus d’imitation.<br />
1. Entre tradition et nécessité, une relation intercorporelle incontournable<br />
Il nous f<strong>au</strong>t reconnaître que dans la réalité, telle qu’elle se pratique actuellement, la<br />
classe technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong> contemporaine, dans le cadre <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong> <strong>danse</strong>urs<br />
professionnels, s’inscrit dans une logique <strong>de</strong> formation à la performance <strong>de</strong> h<strong>au</strong>t<br />
nive<strong>au</strong> et <strong>de</strong> polyvalence du <strong>danse</strong>ur. Cela veut dire que l’on assiste actuellement à<br />
une uniformisation <strong>de</strong> la formation du <strong>danse</strong>ur, qui tend à transcen<strong>de</strong>r les styles<br />
esthétiques, notamment classique, jazz et contemporain. Nous soulignons <strong>de</strong>ux<br />
conséquences à cet état <strong>de</strong> fait : la classe « technique » s’impose comme la base <strong>de</strong> la<br />
formation 1 et la situation d’enseignement-apprentissage dans cette classe<br />
1 La formation <strong>de</strong> <strong>danse</strong>ur contemporain inclut également <strong>de</strong>s classes d’improvisation et <strong>de</strong> composition<br />
chorégraphique qui sollicitent largement son potentiel créatif. Cependant, toutes les institutions <strong>de</strong> formations<br />
préprofessionnelles en <strong>danse</strong> contemporaine posent la classe technique quotidienne, voire la classe <strong>de</strong> ballet,<br />
comme une base obligatoire et nécessaire.
3<br />
« technique » est infiltrée par une tradition <strong>de</strong> transmission, <strong>de</strong> type « démonstrationreproduction<br />
du modèle », issue <strong>de</strong> la <strong>danse</strong> classique, et ce, malgré les ruptures<br />
esthétiques intervenues <strong>au</strong> cours <strong>de</strong> l’histoire.<br />
1.1. Un corps discipliné et rentable opposé <strong>au</strong> corps poétique<br />
Quelques <strong>au</strong>teurs ont tenté <strong>de</strong> dénoncer les risques et les incohérences <strong>de</strong><br />
l’apprentissage par reproduction par rapport <strong>au</strong> projet initial <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnité en <strong>danse</strong>,<br />
axé plutôt vers le développement d’une gestuelle personnelle (Ganne, 1998, p. 95). Le<br />
processus d’apprentissage à l’œuvre dans l’action <strong>de</strong> reproduction s’apparente à ce<br />
qui est communément compris comme <strong>de</strong> l’« imitation ». Or, pour les <strong>au</strong>teurs cités ciaprès,<br />
l’imitation a m<strong>au</strong>vaise presse, car elle présuppose un apprentissage plus ou<br />
moins passif avec un risque <strong>de</strong> standardisation et <strong>de</strong> normalisation <strong>de</strong>s corps (Ganne,<br />
1998; Ginot & L<strong>au</strong>nay, 2002; Lefebvre, 1998; Puja<strong>de</strong>-Ren<strong>au</strong>d, 1976), générant un état<br />
<strong>de</strong> dépendance, voire d’aliénation et <strong>de</strong> soumission <strong>de</strong> l’apprenant, et une<br />
appropriation perçue comme relativement superficielle (Vellet, 2003, pp. 134, 215).<br />
L’infiltration du modèle classique à l’intérieur <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong><br />
contemporaine constitue un <strong>au</strong>tre terrain <strong>de</strong> contestation. Ginot et L<strong>au</strong>nay (2002)<br />
s’insurgent vigoureusement contre « le modèle académique, disciplinaire et soucieux<br />
<strong>de</strong> rentabilité » (Ginot & L<strong>au</strong>nay, 2002, p. 107) qui prév<strong>au</strong>t dans la formation<br />
professionnelle du <strong>danse</strong>ur contemporain. Toutes <strong>de</strong>ux se désolent <strong>de</strong> constater que<br />
« l’apprentissage <strong>de</strong> la technique classique est posé comme une évi<strong>de</strong>nce universelle,<br />
base indispensable et fondamentale <strong>de</strong> toute formation professionnelle en <strong>danse</strong>, futelle<br />
contemporaine » (ibid. p.108).<br />
Dans l’ouvrage collectif L’enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong>, et après ? (Bruni, 1998),<br />
Lefebvre conteste « l’hégémonie <strong>de</strong> l’apprentissage technique dans le cadre du<br />
diplôme d’état <strong>de</strong> professeur <strong>de</strong> <strong>danse</strong> français » (Lefebvre, 1998, p. 87), et<br />
Ganne « l’impérialisme <strong>de</strong> la <strong>danse</strong> classique qui voudrait occuper tout le territoire »<br />
(Ganne, 1998, pp. 90,91). Ces <strong>de</strong>ux <strong>au</strong>teurs s’inquiètent <strong>de</strong> voir, à travers une<br />
normalisation <strong>de</strong>s corps, les élèves transformés en « machines corporelles »<br />
(Lefebvre, 1998, p. 87). Cela génère, selon Lefebvre, « <strong>de</strong>s corps maîtrisés, qualifiés,<br />
exercés et dociles » <strong>au</strong> détriment d’un « corps poétique » (ibid. p. 88).
4<br />
Un certain nombre <strong>de</strong> textes (F<strong>au</strong>re, 1998; Ginot & L<strong>au</strong>nay, 2002; L<strong>au</strong>nay, 2001;<br />
Lefebvre, 1998) dénoncent également le modèle disciplinaire <strong>de</strong> la classe <strong>de</strong> <strong>danse</strong>,<br />
modèle largement à l’œuvre dans la <strong>danse</strong> classique. Tous attribuent <strong>au</strong>x « valeurs<br />
productivistes » (Lefebvre, 1998, p. 88) ou <strong>au</strong> « souci <strong>de</strong> rentabilité » (Ginot &<br />
L<strong>au</strong>nay, 2002, p. 107) la persistance <strong>de</strong> ce modèle dans l’enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong>.<br />
Le texte <strong>de</strong> L<strong>au</strong>nay (L<strong>au</strong>nay, 2001) s’appuie, quant à lui, sur <strong>de</strong>s témoignages <strong>de</strong><br />
<strong>danse</strong>urs pour souligner « la puissance <strong>de</strong>s relations d’emprise » (ibid. p. 92) entre le<br />
professeur et l’élève. L’<strong>au</strong>teure décrit l’entraînement en <strong>danse</strong> comme un « rituel » à<br />
la gloire du « corps absolu » (ibid. p. 93). D’après cet <strong>au</strong>teur, ce corps absolu envahit<br />
l’imaginaire et le rêve du <strong>danse</strong>ur, et c’est précisément ce qui « contribue à renforcer<br />
les figures du pouvoir » (ibid. p.93).<br />
Nous voyons, dans ces diverses réflexions, une dénonciation radicale <strong>de</strong> la tendance à<br />
la rationalisation et à la rentabilité qu’a connue l’enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong> dès le<br />
début <strong>de</strong> la professionnalisation du métier <strong>de</strong> <strong>danse</strong>ur. Cette réflexion pourrait<br />
également révéler la prise <strong>de</strong> conscience impuissante <strong>de</strong> notre enfermement dans une<br />
idéologie <strong>de</strong> corps et dans <strong>de</strong>s habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> perception qui ont perdu la quête du sens<br />
du geste.<br />
1.2. La relation intercorporelle, une ouverture constructive vers l’altérité et<br />
la poésie du geste<br />
Par ailleurs, plusieurs écrits font ressortir la valeur irremplaçable <strong>de</strong> la relation<br />
intercorporelle entre le professeur et les élèves à l’œuvre dans cette tradition <strong>de</strong><br />
transmission <strong>de</strong> la <strong>danse</strong>.<br />
Notons <strong>au</strong> passage que l’absence <strong>de</strong> codification du<br />
mouvement en <strong>danse</strong> contemporaine confère une dimension indispensable et<br />
incontournable à la démonstration-en-acte par le professeur <strong>de</strong> sa phrase <strong>de</strong> <strong>danse</strong>,<br />
démonstration qui joue alors le rôle <strong>de</strong> « partition » avec la particularité d’être une<br />
« partition » à la fois vivante et éphémère.<br />
Puja<strong>de</strong>-Ren<strong>au</strong>d (1976), par exemple, propose que la modulation rythmique proposée<br />
par le professeur dans sa proposition dansée trouve une résonance corporelle chez<br />
l’élève, provoquant un désir <strong>de</strong> bouger: « le geste du professeur pourrait avoir sur le<br />
corps <strong>de</strong> l’élève cet impact immédiat comparable à celui <strong>de</strong> la musique » (Puja<strong>de</strong>-<br />
Ren<strong>au</strong>d, 1976, p. 105). Louppe (1994), <strong>de</strong> son côté, décrit la transmission du<br />
mouvement comme un « moment initiatique », elle parle d’une « empreinte » qui
5<br />
voyagerait d’« un corps à l’<strong>au</strong>tre » (Louppe, 1994, p. 16) et <strong>de</strong> « contagions<br />
mystérieuses » (ibid. p.17) qui la font conclure que « la transmission corps à corps<br />
<strong>de</strong>meure essentielle, non dans une quête d’exactitu<strong>de</strong> » (ibid. p.17), précise-t-elle,<br />
mais pour incorporer l’acte poétique. Godard (1992), à l’instar <strong>de</strong> Louppe, confirme la<br />
nature essentielle <strong>de</strong> la communication intercorporelle dans la transmission <strong>de</strong> la<br />
<strong>danse</strong>, en la justifiant cependant par les limites du langage verbal et la nécessité du<br />
savoir-faire du <strong>danse</strong>ur <strong>de</strong> passer par les « couches profon<strong>de</strong>s du non<br />
verbal… » (Godard, 1992, pp. 141-142). Godard associe encore cette communication<br />
intercorporelle à un phénomène empathique qui, à son avis, passe complètement<br />
inaperçu dans la réflexion pédagogique (Godard & Louppe, 1993, p. 70).<br />
Dans son essai, Danses <strong>de</strong> l’écriture, courses dansantes et anthropologie <strong>de</strong> la<br />
kinesthésie, Foster (1998) abon<strong>de</strong> dans le sens <strong>de</strong> Godard, et propose que le lien<br />
empathique soit une <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’expérience <strong>de</strong> <strong>danse</strong>. Par leurs efforts<br />
pour « incarner le mouvement d’un <strong>au</strong>tre corps », l’<strong>au</strong>teur postule que les élèves<br />
apprennent ainsi « à ressentir ce à quoi ressemble le mouvement d’un <strong>au</strong>tre corps […]<br />
et […] cultivent leur sensibilité <strong>au</strong>x relations entre apparence visuelle et sensation<br />
proprioceptive » (Foster, 1998, p. 110).<br />
Dans la même veine que Foster, le chorégraphe américain, Merce Cunningham,<br />
s’extasie à propos <strong>de</strong> <strong>danse</strong>urs qui apprennent <strong>de</strong>s séquences dansées à partir <strong>de</strong> la<br />
seule observation du mouvement par un phénomène pouvant être <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong><br />
l’absorption kinesthésique: « Quand je regar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>danse</strong>urs apprendre <strong>de</strong>s pas,<br />
certains ont besoin d’indications très claires […] d’<strong>au</strong>tres <strong>danse</strong>urs voient, ils vont<br />
commencer à bouger, ils n’ont pas besoin <strong>de</strong> poser <strong>de</strong> questions. Ils ne font<br />
qu’absorber à travers la pe<strong>au</strong>. C’est merveilleux à regar<strong>de</strong>r. C’est une intelligence<br />
viscérale. C’est très kinesthésique, la capacité à absorber quelque chose <strong>de</strong> la manière<br />
dont les anim<strong>au</strong>x le font. » (Roseman, 2001, p.:45).<br />
Cette métaphore <strong>de</strong> l’absorption est également utilisée par le <strong>danse</strong>ur Edward Villella<br />
quand il évoque son activité d’imitation <strong>au</strong> moment <strong>de</strong> l’apprentissage d’une<br />
chorégraphie, pendant laquelle, précise-t-il, le chorégraphe ne prononce <strong>au</strong>cune<br />
parole : « On <strong>de</strong>vrait trouver un mot qui suggérerait un corps observant et absorbant<br />
[…] Vos yeux absorbent <strong>de</strong> la personne qui est en train <strong>de</strong> démontrer. C’est du corps à<br />
corps, <strong>de</strong> l’esprit à esprit ». (Roseman, 2001, p. 15).
6<br />
L<strong>au</strong>nay (2001), quant à elle, fait ressortir la dimension constructive <strong>de</strong> la<br />
confrontation <strong>au</strong> mouvement <strong>de</strong> l’<strong>au</strong>tre à partir <strong>de</strong> nombreux témoignages récoltés<br />
<strong>au</strong>près <strong>de</strong> <strong>danse</strong>urs: « prendre le geste d’<strong>au</strong>trui, c’est travailler à s’altérer, à s’articuler,<br />
à se reconfigurer, se rêver ou se jouer <strong>au</strong>trement » (L<strong>au</strong>nay, 2001, p. 94). Elle assimile<br />
également le phénomène <strong>de</strong> contagion intercorporelle à <strong>de</strong>s processus d’induction<br />
pouvant aller jusqu’à la transe. Pour finir, elle souligne l’aspect effectivement<br />
constructif <strong>de</strong> cette intercorporéité en précisant d’une part, « qu’elle suppose une<br />
suspension <strong>de</strong> son jugement et d’<strong>au</strong>tre part, qu’elle permet un repérage analytique <strong>de</strong><br />
ses coordinations privilégiées ».<br />
2. La relation intercorporelle, un fonctionnement biologique inné<br />
Ces notions « d’impact immédiat », <strong>de</strong> « contagion », d’« empathie »,<br />
d’« absorption » et d’« induction » que les <strong>au</strong>teurs cités ci-<strong>de</strong>ssus avancent, reçoivent<br />
d’ailleurs, <strong>de</strong>puis une quinzaine d’années, une confirmation, voire une validation<br />
scientifique, avec les recherches sur les « neurones miroir » (Rizzolatti, Fogassi, &<br />
Gallese, 2001). Ces recherches ont pu établir l’existence d’un système neural pouvant<br />
constituer la base biologique <strong>de</strong> ces interactions entre un observateur et un observé,<br />
phénomènes qui sous-tendraient, entre <strong>au</strong>tres, le processus d’imitation. Ces<br />
phénomènes sont notamment formulés par Decety (2004) en termes <strong>de</strong><br />
« résonance motrice » (Decety, 2004, p. 72) ou encore par Berthoz et Petit (2006) <strong>de</strong><br />
« contagion motrice » (Berthoz & Petit, 2006, p. 237) et pourraient s’expliquer, selon<br />
Gallese (2005), par un processus <strong>de</strong> « simulation intégrée » (embodied simulation) 2<br />
(Gallese, 2005).<br />
2.1. De la simulation à la compréhension du geste d’<strong>au</strong>trui<br />
Cette notion <strong>de</strong> « simulation intégrée » proposée et définie par Gallese comme étant<br />
un « mécanisme fonctionnel <strong>au</strong>tomatique, inconscient et pré-réflexif dont la fonction<br />
est <strong>de</strong> modéliser les objets, agents et événements » (ibid.), postule un mécanisme <strong>de</strong><br />
modélisation <strong>de</strong> l’action qui s’avère également capable <strong>de</strong> prédire les conséquences<br />
d’actions accomplies par d’<strong>au</strong>tres. Ce mécanisme permettrait à l’observateur, non<br />
seulement d’utiliser ses propres ressources pour pénétrer par l’expérience le mon<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s <strong>au</strong>tres <strong>au</strong> moyen d’un processus <strong>de</strong> simulation direct, <strong>au</strong>tomatique et inconscient,<br />
mais <strong>au</strong>ssi <strong>de</strong> comprendre l’intention <strong>de</strong> l’action <strong>de</strong> l’<strong>au</strong>tre. Ce mécanisme dépasse<br />
2 Traduit par « simulation intégrée » par Anne-Marie Varig<strong>au</strong>lt, (Gallese, 2004)
7<br />
donc la seule dimension visuo-spatiale du mouvement, il intègre également une<br />
dimension cognitive. Par ailleurs, si ce mécanisme est <strong>au</strong>tomatique, cela veut dire que<br />
nous n’avons pas le choix <strong>de</strong> l’utiliser ou non. C’est un mécanisme reconnu comme<br />
biologiquement inné, qui fonctionne cependant, nous allons le voir, avec certaines<br />
conditions.<br />
Par exemple, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s ont clairement démontré que l’observation <strong>de</strong> l’action est<br />
largement dépendante du répertoire d’actions apprises <strong>de</strong> l’observateur (Calvo-<br />
Merino, Glaser, Grèzes, Passingham, & Haggard, 2005). Nous en déduisons que nous<br />
ne pouvons véritablement « simuler » une action par sa seule observation que si nous<br />
l’avons nous-mêmes déjà expérimentée. Dans le cas contraire, seul le codage visuel<br />
est activé, et le nive<strong>au</strong> <strong>de</strong> compréhension en termes visuels n’est évi<strong>de</strong>mment pas du<br />
même ordre que le codage en termes moteurs. La conséquence que Grammont<br />
propose <strong>de</strong> tirer pour l’apprentissage <strong>de</strong> nouve<strong>au</strong>x mouvements l’amène à inverser la<br />
fonction didactique <strong>de</strong> la démonstration du professeur. Ce ne serait pas tant la<br />
démonstration et les explications verbales du professeur qui influeraient sur les<br />
représentations motrices <strong>de</strong> l’étudiant, mais plutôt la pratique motrice et<br />
l’entraînement préalables <strong>de</strong> l’étudiant qui l’ai<strong>de</strong>raient à mieux comprendre la<br />
démonstration et les explications du professeur (Grammont, 2003, p. 15). Ce serait en<br />
construisant <strong>de</strong> nouvelles représentations à travers sa propre pratique que l’individu<br />
élargirait ses capacités <strong>de</strong> perception, <strong>de</strong> représentation et <strong>de</strong> compréhension <strong>de</strong>s<br />
actions observées sur <strong>au</strong>trui (ibid. p.16).<br />
Nous nous retrouvons alors <strong>de</strong>vant la problématique suivante : la confrontation <strong>de</strong><br />
l’étudiant <strong>au</strong> mouvement d’<strong>au</strong>trui lui ouvre un chemin vers <strong>de</strong> nouvelles potentialités<br />
gestuelles mais sa capacité <strong>de</strong> « résonance » <strong>au</strong> mouvement <strong>de</strong> l’<strong>au</strong>tre par<br />
l’observation est conditionnelle à son expérience préalable <strong>de</strong> ce même mouvement.<br />
Autrement dit, il f<strong>au</strong>t « voir » pour « faire plus » mais il f<strong>au</strong>t <strong>au</strong>ssi « faire » pour<br />
« voir mieux».<br />
2.2. De la facilitation <strong>de</strong> réponse à l’ouverture vers <strong>au</strong>trui<br />
Concernant l’aspect cognitif <strong>de</strong> l’imitation, l’équipe <strong>de</strong> Rizzolatti distingue plusieurs<br />
nive<strong>au</strong>x selon les centres cérébr<strong>au</strong>x impliqués. Ces chercheurs formulent le nive<strong>au</strong> <strong>de</strong><br />
base comme une « tendance <strong>au</strong>tomatique à reproduire un mouvement observé » dont<br />
la conséquence serait « une facilitation <strong>de</strong> réponse » : « In our view, a fundamental
8<br />
phenomenon that forms the basis of imitation is that which has been referred to as<br />
‘response facilitation’ — the <strong>au</strong>tomatic ten<strong>de</strong>ncy to reproduce an observed movement.<br />
Response facilitation can occur with or without an un<strong>de</strong>rstanding of the meaning of<br />
what has been observed » (Rizzolatti, et al., 2001, p. 667) 3 .<br />
Retenons pour le moment que, même si ce mécanisme fonctionne à un nive<strong>au</strong> préréflexif,<br />
d’une part, il génère une véritable activité <strong>de</strong> simulation chez l’observateur et,<br />
d’<strong>au</strong>tre part, il permet un accès à la compréhension <strong>de</strong> l’action observée. En réponse<br />
<strong>au</strong>x détracteurs <strong>de</strong> l’apprentissage traditionnel <strong>de</strong> la <strong>danse</strong> académique qui n’y voient<br />
qu’une réduction à « l’apprentissage d’un co<strong>de</strong> gestuel et <strong>de</strong> savoir-faire modélisant et<br />
réduits à <strong>de</strong>s conditionnements » (Lefebvre, 1998, p.:87), peut-être pourrions-nous<br />
suggérer que le processus d’appropriation à l’œuvre dans la configuration typique <strong>de</strong><br />
la classe technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong>, « démonstration – reproduction du modèle », n’est pas<br />
<strong>au</strong>ssi passif ; <strong>de</strong> même, la modélisation à l’œuvre n’est peut-être pas <strong>au</strong>tant matière à<br />
conditionnement que certains semblent le supposer. Nous pourrions <strong>au</strong>ssi proposer<br />
que cet accès direct <strong>au</strong> mouvement <strong>de</strong> l’<strong>au</strong>tre soit plutôt, <strong>au</strong> contraire, une facilitation<br />
vers l’altérité et vers la connaissance. Sans évacuer la possibilité que la situation<br />
pédagogique <strong>de</strong> la classe <strong>de</strong> <strong>danse</strong> puisse éventuellement donner lieu à <strong>de</strong>s effets<br />
néfastes ou pervers évoqués par les <strong>au</strong>teurs cités en amont, nous suggérons que le<br />
processus imitatif ne conduit pas fatalement à un conditionnement.<br />
3. La recherche <strong>de</strong> terrain : L’analyse <strong>de</strong>s interactions professeur-élèves à<br />
travers le filtre du concept d’« activité »<br />
Un premier point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> notre recherche (<strong>Harbonnier</strong>-<strong>Topin</strong>, 2009, p. 13) est<br />
que la configuration typique que nous avons intitulé « démonstration-reproduction du<br />
modèle » traduit seulement le point <strong>de</strong> vue d’une appréhension extérieure dont la<br />
dimension interactionnelle n’a jamais été approfondie, à notre connaissance, dans une<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> terrain située. Un <strong>de</strong>uxième point qui découle du premier est que ce qui est<br />
appréhendé ne rend pas compte <strong>de</strong> l’activité réelle <strong>de</strong>s protagonistes <strong>de</strong> cette<br />
interaction particulière. De plus, nous ne savons pas comment les acteurs <strong>de</strong> la<br />
situation, professeurs et étudiants, vivent cette situation d’apprentissage et il serait, à<br />
3 Traduit par nous : Un phénomène fondamental qui forme la base <strong>de</strong> l’imitation, est celui qui a été<br />
référé comme « une facilitation <strong>de</strong> réponse » - la tendance <strong>au</strong>tomatique à reproduire un mouvement<br />
observé. La facilitation <strong>de</strong> réponse peut avoir lieu avec ou sans compréhension <strong>de</strong> la signification <strong>de</strong> ce<br />
qui a été observé.
9<br />
notre avis, instructif <strong>de</strong> les consulter à ce sujet, surtout à la lumière <strong>de</strong>s découvertes<br />
réalisées à propos du « système miroir ».<br />
C’est précisément dans le but <strong>de</strong> lever cette ambigüité entre activité supposée, activité<br />
réelle et le vécu <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> la situation, que cette recherche a été menée. Face à ce<br />
paradoxe entre une pratique qui se perpétue comme une évi<strong>de</strong>nce et une connotation<br />
péjorative du processus d’imitation, nous avons fait le projet d’i<strong>de</strong>ntifier ce qui est<br />
effectivement observable et <strong>de</strong> le croiser avec ce qui fait sens chez les acteurs, en<br />
termes d’interactions, dans cette configuration typique « démonstration-reproduction<br />
du modèle ». Pour ce faire, nous avons choisi <strong>de</strong> passer par le concept d’activité (<strong>au</strong><br />
singulier) avec ses déclinaisons en termes <strong>de</strong> préférences, d’associations et <strong>de</strong><br />
couplage d’activités (<strong>au</strong> pluriel) 4 .<br />
Le passage par le concept d’activité nous permet une triple opération. Premièrement,<br />
il nous permet d’adopter « un point <strong>de</strong> vue extérieur » (Barbier & Galatanu, 2000, pp.<br />
16-17) par rapport <strong>au</strong>x référentiels <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> la situation. Or, le fait que ce point<br />
<strong>de</strong> vue extérieur permette une <strong>de</strong>scription détaillée <strong>de</strong>s éléments constituant la<br />
situation est propice, comme le souligne Barthélémy, à la rupture avec le caractère<br />
évi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cette pratique (Barthélémy, 1990, p. 195). Deuxièmement, si nous suivons<br />
Barbier et Galatanu qui comprennent le concept d’activité comme faisant partie<br />
<strong>de</strong> « désignations relatives à la fois <strong>au</strong>x processus et <strong>au</strong>x sujets humains impliqués,<br />
porteuses d’une relation d’inférence » (ibid.), nous entrevoyons donc la possibilité <strong>de</strong><br />
décrire ce que nous observons en termes <strong>de</strong> différents « faire » qui incluraient à la fois<br />
le processus et les sujets impliqués dans le processus. Troisièmement décrire une<br />
situation observée, c’est comme tendre un miroir <strong>au</strong>x acteurs <strong>de</strong> cette situation. Nous<br />
anticipons ainsi un potentiel réflexif à cette <strong>de</strong>scription, ce potentiel réflexif<br />
apparaissant notamment à travers la notion <strong>de</strong> « préférences » d’activités, représentées<br />
dans cette recherche, par la fréquence et la durée relative que les sujets accor<strong>de</strong>nt à<br />
certaines activités.<br />
Par ailleurs, La mise en évi<strong>de</strong>nce d’associations particulières entre les activités<br />
observées nous a aidés à caractériser d’une part, les invariants communs <strong>au</strong>x cinq<br />
séquences observées, cela correspond à la « typicalité » (Schutz, Noschis, & Caprona,<br />
1987) <strong>de</strong> cette situation pédagogique, et d’<strong>au</strong>tre part, les variations possibles à<br />
4 Centre <strong>de</strong> Recherche sur la Formation du Conservatoire National <strong>de</strong>s Arts et Métiers (CNAM)
10<br />
l’intérieur <strong>de</strong> la configuration <strong>de</strong>s différentes séquences, cela correspond <strong>au</strong> jeu<br />
possible, à la part <strong>de</strong> subjectivité, à l’intérieur <strong>de</strong> cette configuration typique.<br />
En <strong>de</strong>rnier lieu, afin <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à un examen plus attentif <strong>de</strong>s interactions entre le<br />
professeur et les élèves, nous nous sommes appuyés sur la notion <strong>de</strong> « couplage<br />
d’activités » inspirée <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> « couplage structurel » introduite par Maturana<br />
(Maturana, 1977) et Varela (Varela, 1989, p. 64) et reprise par Theure<strong>au</strong> dans sa<br />
théorie du « Cours d’action » (Theure<strong>au</strong>, 2004). Tout en nous offrant une <strong>de</strong>scription<br />
<strong>de</strong>s interactions professeur-élèves, en termes d’activités, cette notion <strong>de</strong> couplage<br />
nous a permis également <strong>de</strong> faire ressortir <strong>au</strong>tant la dimension dynamique <strong>de</strong>s rapports<br />
d’influence entre les <strong>de</strong>ux catégories <strong>de</strong> sujets que la typicalité <strong>de</strong> ces rapports dans la<br />
configuration « démonstration-reproduction du modèle » que nous étudions. Par<br />
ailleurs, afin <strong>de</strong> mieux comprendre la dynamique <strong>de</strong> ces rapports qui mettent en jeu,<br />
<strong>de</strong> manière importante, l’activité <strong>de</strong> communication du professeur, nous avons fait<br />
appel à la théorie pragmatique <strong>de</strong> la communication proposée par Sperber et Wilson<br />
(Sperber & Wilson, 1989) avec, notamment, la notion <strong>de</strong> communication « ostensiveinférentielle<br />
». Cette notion nous a aidés à caractériser le type <strong>de</strong> communication très<br />
particulier à l’œuvre dans cette situation d’enseignement.<br />
Trois catégories <strong>de</strong> questions nous ont intéressés dans cette recherche :<br />
1. I<strong>de</strong>ntifier les différentes activités du professeur et <strong>de</strong>s étudiants et voir<br />
comment ces activités s’articulent dans l’interaction entre les <strong>de</strong>ux catégories<br />
<strong>de</strong> sujets ;<br />
2. Comment le passage par l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s activités et interactivités nous<br />
permet d’abor<strong>de</strong>r le rôle <strong>de</strong> la démonstration dansée du professeur pour<br />
l’apprentissage <strong>de</strong> l’étudiant ;<br />
3. Quels sont les ressorts et les limites <strong>de</strong> cette configuration pédagogique pour<br />
l’apprentissage <strong>de</strong> l’étudiant.<br />
3.1. Trois mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recueil <strong>de</strong> données<br />
Le terrain <strong>de</strong> recherche s’est porté sur la classe technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong> contemporaine<br />
dans <strong>de</strong>ux institutions <strong>de</strong> formation préprofessionnelle <strong>de</strong> <strong>danse</strong> <strong>de</strong> Montréal. La<br />
recherche se présente sous la forme d’une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>scriptive et comparative <strong>de</strong> cinq<br />
séquences sélectionnées à partir <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong> cinq classes <strong>de</strong> <strong>danse</strong> données par
11<br />
cinq professeurs différents, trois femmes et <strong>de</strong>ux hommes, tous les cinq possédant une<br />
soli<strong>de</strong> expérience d’enseignement. Le choix <strong>de</strong>s professeurs s’est fait sur la seule base<br />
<strong>de</strong> leur objectif commun, à savoir former <strong>de</strong>s <strong>danse</strong>urs professionnels. Leur plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong> affinité avec la <strong>danse</strong> classique est donc une simple coïnci<strong>de</strong>nce et n’a<br />
pas constitué un critère <strong>de</strong> choix.<br />
Nous avons effectué trois mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recueil <strong>de</strong> données :<br />
- Un entretien biographique avec chaque professeur. L’entretien, <strong>de</strong> type semistructuré<br />
avait pour objectif <strong>de</strong> faire évoquer, par les participants, les souvenirs<br />
les plus marquants en rapport avec leur propre formation en <strong>danse</strong>. Les propos<br />
ainsi recueillis ont servi d’indices sur l’axiologie sous jacente à l’activité<br />
pédagogique actuelle du professeur en question.<br />
- Des enregistrements vidéo dans les cinq classes <strong>de</strong> <strong>danse</strong> observées.<br />
L’enregistrement vidéo a servi <strong>de</strong> support d’une part, à l’observation <strong>de</strong>s<br />
activités effectives <strong>de</strong>s acteurs à partir <strong>de</strong> laquelle a été effectuée l’analyse, et<br />
d’<strong>au</strong>tre part, à l’entretien d’<strong>au</strong>to confrontation <strong>de</strong>s participants (professeur et<br />
élèves) à la recherche.<br />
- Des entretiens d’<strong>au</strong>to-confrontation avec chaque professeur et quelques<br />
étudiants volontaires. Il s’agissait d’amener les participants à évoquer, le plus<br />
concrètement possible, les activités <strong>au</strong>xquelles ils avaient participé et à<br />
s’exprimer sur la manière dont ils les avaient vécues, avec le support <strong>de</strong><br />
l’enregistrement vidéo. Les verbalisations ainsi recueillies ont contribué à<br />
rendre compte <strong>de</strong> certaines constructions <strong>de</strong> sens opérées par les acteurs en<br />
relation avec les différents éléments <strong>de</strong> la situation.<br />
3.2. Une catégorisation <strong>de</strong>s activités « typiques » <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> la<br />
classe technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong><br />
A travers l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s cinq séquences, nous avons mené l’analyse en <strong>de</strong>ux étapes. La<br />
première étape, <strong>de</strong> type <strong>de</strong>scriptif, a elle-même été décomposée en <strong>de</strong>ux volets. Un<br />
premier volet a consisté à i<strong>de</strong>ntifier les activités « typiques » (Schutz, et al., 1987) <strong>de</strong><br />
la situation d’enseignement considérée. Cela nous a permis <strong>de</strong> préciser, en termes<br />
d’activités, ce qui constitue la configuration que nous avons appelée plus h<strong>au</strong>t<br />
« démonstration – reproduction du modèle ». Le <strong>de</strong>uxième volet <strong>de</strong> cette étape s’est<br />
attaché à caractériser les particularités <strong>de</strong> chaque cas en termes <strong>de</strong> préférences,
12<br />
d’associations et <strong>de</strong> couplages d’activités, à partir <strong>de</strong>s activités « typiques »<br />
i<strong>de</strong>ntifiées <strong>au</strong>paravant.<br />
Ensuite, la <strong>de</strong>uxième étape, <strong>de</strong> type compréhensif, s’est attachée à relier le sens que<br />
les sujets attribuent en situation à leurs interactions. L’objectif <strong>de</strong> cette étape était <strong>de</strong><br />
mettre en évi<strong>de</strong>nce, <strong>au</strong>tant les « ressorts » pour l’apprentissage, que les conditions et<br />
les limites, inhérents à cette configuration traditionnelle <strong>de</strong> transmission.<br />
La première étape d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s activités nous a amené à concevoir un modèle<br />
d’analyse sous la forme d’une catégorisation détaillée <strong>de</strong>s activités observées <strong>au</strong>ssi<br />
bien chez le professeur que chez les étudiants à partir d’une séquence, d’une durée<br />
allant, selon les cas, <strong>de</strong> 13 à 20 minutes, sélectionnée dans l’enregistrement vidéo <strong>de</strong><br />
chaque classe <strong>de</strong> <strong>danse</strong>. Cette séquence correspond à l’apprentissage d’une phrase <strong>de</strong><br />
<strong>danse</strong>, relativement complexe, proposée par le professeur vers la fin du cours. Elle<br />
débute, dans tous les cas, avec la « démonstration » du professeur pour se terminer<br />
avec la « performation <strong>au</strong>tonome » <strong>de</strong>s élèves.<br />
Cette catégorisation a été développée en i<strong>de</strong>ntifiant, dans un premier temps, les grands<br />
groupes d’activités pour chaque catégorie d’acteurs. C’est ainsi que l’activité du<br />
professeur consiste essentiellement en <strong>de</strong>ux groupes d’activités, l’activité <strong>de</strong><br />
« communication d’action » et l’activité d’ « observation <strong>de</strong>s étudiants ». Chez les<br />
étudiants, <strong>de</strong>ux grands groupes d’activités ont été repérés, l’activité d’<br />
« appropriation » et l’activité <strong>de</strong> « performation ».<br />
Chaque groupe d’activités a ensuite été décomposé en différents nive<strong>au</strong>x <strong>de</strong> sousactivités<br />
jusqu’<strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>de</strong>s activités minimales, Fillietaz parlerait « d’unités<br />
praxéologiques minimales » (Filliettaz, 2002, p. 146). Nous avons repéré huit à dix<br />
activités minimales selon le groupe d’acteurs considéré (professeur ou étudiants).<br />
Une fois la catégorisation d’activités posée, l’observation minutieuse <strong>de</strong> la séquence<br />
s’est passée <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>de</strong>s unités d’action. Chaque unité d’action a été repérée,<br />
chronométrée et située dans le déroulement temporel <strong>de</strong> la séquence. Ces trois<br />
opérations ont été reportées dans un table<strong>au</strong> à double entrée intégrant ensemble les<br />
activités du professeur et <strong>de</strong>s étudiants: en abscisse le déroulement temporel ainsi que<br />
le chronométrage <strong>de</strong> chaque unité d’action, et en ordonnées la catégorisation <strong>de</strong>s<br />
activités. Ce table<strong>au</strong> a non seulement offert une représentation visuelle du découpage
Activités <strong>de</strong>s étudiants<br />
Performation<br />
Appropriation<br />
Activités du professeur<br />
Communication d'action<br />
En<br />
réaction<br />
Proposition<br />
d'action<br />
13<br />
<strong>de</strong> la séquence selon toutes les unités d’action repérées, mais il a surtout permis <strong>de</strong><br />
faire émerger les associations d’activités du professeur, la simultanéité <strong>de</strong>s activités<br />
dans le collectif <strong>de</strong>s étudiants ainsi que les couplages d’activités entre le professeur et<br />
les étudiants.<br />
Dans le table<strong>au</strong> ci-après qui représente un extrait <strong>de</strong> la séquence du professeur Dora,<br />
nous constatons par exemple que dans les unités d’action 1 à 6, le professeur associe<br />
systématiquement les activités « faire quoi faire » avec « dire quoi faire » et que dans<br />
les unités d’action 2, 3, et 4, ces mêmes activités du professeur sont couplées avec les<br />
activités « faire avec », « faire après » et « regar<strong>de</strong>r sans faire » <strong>de</strong>s étudiants.<br />
Classe DORA, Proposition 11, durée totale 13'<br />
Unités d'action 1 2 3 4 5 6<br />
Déroulement temps 0' 28 1'28 1'53 2'35 2'57<br />
durées activités en secon<strong>de</strong>s 28 60 25 42 22 18<br />
gestion <strong>de</strong> l'espace collectif<br />
Présenter la proposition<br />
Expliquer la proposition<br />
Faire pour soi<br />
Réagir à l'interrogation <strong>de</strong>s étudiants<br />
Réagir à la performation <strong>de</strong>s étudiants<br />
Écho-Résonnance<br />
En réaction<br />
Performer pour soi<br />
Observer la performation<br />
Faire quoi faire<br />
Dire quoi faire<br />
Faire comment faire<br />
Dire comment faire<br />
Question - Réponse<br />
Accompagner le faire par le dire<br />
Évaluer le faire<br />
Faire avec * 10 9 9 7 2<br />
Faire après * 3 3 1 3 3 3<br />
Regar<strong>de</strong>r sans faire * 1 3 3 9 7<br />
Questionner * 1<br />
Répondre<br />
Faire pour soi exercice * 1<br />
Faire pour soi répétition<br />
Performation-exposition<br />
* les chiffres correspon<strong>de</strong>nt <strong>au</strong> nombre d'étudiants impliqués dans l'activité<br />
Figure 1 : Catégorisation et durée <strong>de</strong>s activités, associations et couplages d’activités<br />
d’un extrait <strong>de</strong> la séquence <strong>de</strong> la classe <strong>de</strong> Dora<br />
À partir du chronométrage <strong>de</strong>s unités d’action, un calcul <strong>de</strong> la durée totale pour<br />
chaque catégorie d’activité a pu être réalisé. La comparaison <strong>de</strong>s durées totales <strong>de</strong>s<br />
différentes activités, entre les séquences, a fait émerger les préférences en termes<br />
d’activités et d’associations d’activités ainsi que les types <strong>de</strong> couplages privilégiés<br />
dans chacune d’elles. Dans la séquence <strong>de</strong> Dora (figure 2), par exemple, les <strong>de</strong>ux<br />
activités préférées du professeur sont la « présentation <strong>de</strong> la proposition » et
14<br />
l’« observation », alors que ce sont les activités que nous avons appelées d’« échorésonance<br />
» (<strong>Harbonnier</strong>-<strong>Topin</strong>, 2009, p. 188) (« faire avec », « faire après » et<br />
« regar<strong>de</strong>r sans faire ») qui dominent chez les étudiants.<br />
Figure 2 : Préférences <strong>de</strong>s activités dans la<br />
séquence <strong>de</strong> Dora<br />
Activités du professeur<br />
Pr Présentation <strong>de</strong> la proposition<br />
Ex Explication <strong>de</strong> la proposition<br />
Réac Questions, réponses<br />
Afd<br />
Accompagner le faire par le<br />
dire<br />
Évf Évaluer le faire<br />
Oé Observation <strong>de</strong>s étudiants<br />
Fs Faire pour soi<br />
Org Organisation <strong>de</strong> l'espace<br />
Activités <strong>de</strong> l'étudiant<br />
Fav Faire avec<br />
Fap Faire après<br />
Rsf Regar<strong>de</strong>r sans faire<br />
Réac Questions, réponses<br />
Fse Faire pour soi exercice<br />
Fsr Faire pour soi répétition<br />
Perf Exp Performation-exposition<br />
En termes <strong>de</strong> couplages d’activités (professeur / étudiants), six princip<strong>au</strong>x types <strong>de</strong><br />
couplages ont été distingués. Ils sont récapitulés dans le table<strong>au</strong> ci-après :<br />
<strong>Professeur</strong><br />
Étudiants<br />
Type 1 Présentation (faire et dire quoi faire) écho-résonance<br />
Type 2 Explication (faire et dire comment faire) écho-résonance + performation pour soi<br />
Type 3<br />
Propositions d’action + en réactions +<br />
observation<br />
écho-résonance + en réactions + performation pour soi<br />
Type 4 gestion <strong>de</strong> l’espace<br />
préparation à la performation + performation pour soi<br />
Type 5 observation<br />
performation-exposition<br />
Type 6 évaluation<br />
regar<strong>de</strong>r sans faire<br />
Figure 3 : Couplages typiques <strong>de</strong> la classe technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong><br />
L’examen chronologique <strong>de</strong> l’occurrence <strong>de</strong>s couplages pendant les différentes<br />
séquences a fait ressortir une certaine invariance qui a rendu possible une<br />
schématisation ou encore une représentation <strong>de</strong> la « typification » (Schutz, et al.,
15<br />
1987) <strong>de</strong> la tradition dans l’enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong>. La séquence commence<br />
invariablement avec la présentation <strong>de</strong> la proposition dansée en « faire » et en « dire »<br />
par le professeur couplée systématiquement avec les activités d’écho-résonance <strong>de</strong>s<br />
étudiants (type 1). Elle se termine systématiquement avec la performation-exposition<br />
<strong>de</strong>s étudiants couplée avec l’observation du professeur (type 5), la plupart du temps<br />
suivie d’une évaluation du professeur (type 6). Entre ce début et cette fin, le<br />
professeur apporte <strong>de</strong>s explications (type 2), l’étudiant pose <strong>de</strong>s questions <strong>au</strong>xquelles<br />
le professeur répond (type 3), le professeur organise l’espace collectif (type 4).<br />
Appliquons cet examen chronologique à la séquence <strong>de</strong> Dora dans le table<strong>au</strong> qui suit :<br />
Figure 4: chronologie <strong>de</strong>s couplages d’activités pendant la séquence <strong>de</strong> Dora<br />
Lors <strong>de</strong> cette première étape <strong>de</strong> l’analyse, nous avons également effectué un repérage<br />
minutieux du registre lexical privilégié par chaque professeur. Les princip<strong>au</strong>x<br />
registres répertoriés ont été les temps music<strong>au</strong>x, les mots du corps, les mots d’espace,<br />
les verbes d’action, le vocabulaire <strong>de</strong>s pas <strong>de</strong> <strong>danse</strong> (arabesque, pirouette…), les mots<br />
<strong>de</strong> latéralité, les mots <strong>de</strong> relation gravitaire (s’enfoncer dans le sol, vers la terre,<br />
s’alléger vers le ciel…), les métaphores et les onomatopées.<br />
La <strong>de</strong>uxième étape concernant l’i<strong>de</strong>ntification du sens <strong>de</strong>s activités pour les sujets a<br />
consisté à relier les propos recueillis en entretien d’<strong>au</strong>toconfrontation chez le<br />
professeur et ses étudiants à chaque moment <strong>de</strong> la séquence afin <strong>de</strong> mettre en<br />
perspective les intentions <strong>de</strong> l’enseignant avec le sens construit par chacun <strong>de</strong>s<br />
étudiants. L’analyse proprement dite a consisté à relever les convergences et les
16<br />
divergences <strong>de</strong>s propos <strong>de</strong>s différents acteurs suivant les catégories d’activités<br />
i<strong>de</strong>ntifiées.<br />
4. Résultats <strong>de</strong> la recherche : Entre dépendance et <strong>au</strong>tonomie<br />
Les invariants repérés dans les activités et associations d’activités ainsi que dans la<br />
chronologie <strong>de</strong>s couplages d’activités <strong>de</strong>s cinq séquences analysées met en évi<strong>de</strong>nce<br />
<strong>au</strong> moins <strong>de</strong>ux éléments centr<strong>au</strong>x dans la tradition <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong>.<br />
Tout d’abord, il ressort nettement que la proposition dansée, créée et communiquée<br />
par le professeur, occupe une place première et centrale et organise toutes les activités<br />
<strong>de</strong>s sujets tel un « attracteur » (Durand, S<strong>au</strong>ry, & Sève, 2006, p. 76) selon la<br />
perspective <strong>de</strong>s systèmes dynamiques.<br />
Ensuite, les « rapports <strong>de</strong> place » (Barbier, 2006, p. 186) particuliers entre le<br />
professeur et les étudiants générés par cette situation typique d’enseignement<br />
montrent une certaine hégémonie discursive et décisionnelle <strong>de</strong> la fonction du<br />
professeur <strong>de</strong> <strong>danse</strong>, <strong>au</strong>tant en termes <strong>de</strong> contenus <strong>de</strong> « savoirs », d’organisation<br />
d’activités que <strong>de</strong> régulation <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong>s étudiants.<br />
Par ailleurs, il est apparu nettement que la pério<strong>de</strong> d’observation <strong>de</strong>s élèves par le<br />
professeur occupe un temps conséquent dans son activité. Notons que les<br />
verbalisations <strong>de</strong>s professeurs soulignent la particularité « empathique-kinesthésique »<br />
<strong>de</strong> leurs processus interprétatifs pendant cette pério<strong>de</strong>. C'est-à-dire que leur<br />
compréhension <strong>de</strong> ce qui se passe chez l’étudiant passe par l’expérimentation<br />
physique, réelle ou simulée, <strong>de</strong> ce qu’ils observent chez celui qui effectue le<br />
mouvement dansé.<br />
En ce qui concerne les étudiants, le fait d’avoir distingué avec précision leurs<br />
différentes activités nous a permis <strong>de</strong> constater d’une part, une répartition importante<br />
<strong>de</strong>s étudiants dans les différentes activités d’appropriation (« faire avec », « faire<br />
après », « regar<strong>de</strong>r sans faire »), ce qui dénote <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> choix personnels <strong>de</strong><br />
stratégie d’apprentissage, et d’<strong>au</strong>tre part, un volume temporel important accordé à la<br />
« performation pour soi », c'est-à-dire à l’activité <strong>au</strong>tonome <strong>de</strong>s étudiants. Par ailleurs,<br />
nous avons été surpris <strong>de</strong> constater que plus le professeur était généreux dans son<br />
« faire » et dans son « dire », plus le volume temporel <strong>de</strong> l’activité <strong>au</strong>tonome <strong>de</strong>s<br />
étudiants « performation pour soi » était important. Ces trois constats relativisent
17<br />
quelque peu la vision docile et machinale que certains <strong>au</strong>teurs attribuent <strong>au</strong> type<br />
d’apprentissage en cours dans la classe technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong>, notamment par<br />
reproduction et répétition (Lefebvre, 1998, pp. 87-88).<br />
4.1. Plusieurs logiques d’enseignement pour un même mo<strong>de</strong> pédagogique<br />
L’analyse nous a <strong>au</strong>ssi permis <strong>de</strong> repérer <strong>de</strong>s singularités dans chacune <strong>de</strong>s séquences.<br />
Nous avons pu en déduire une certaine logique d’enseignement-apprentissage<br />
particulière à chacune d’elle (figure 4). Par exemple, dans le cas <strong>de</strong> la séquence <strong>de</strong><br />
Dora, l’activité privilégiée du professeur est la présentation <strong>de</strong> la proposition<br />
accompagnée d’un registre lexical privilégiant les temps music<strong>au</strong>x et les activités<br />
privilégiées <strong>de</strong>s étudiants sont celles <strong>de</strong> l’écho-résonance (« faire avec », « faire<br />
après » et « regar<strong>de</strong>r sans faire »). La logique d’enseignement-apprentissage qui<br />
découle <strong>de</strong> cette configuration particulière d’activités correspond à une recherche <strong>de</strong><br />
clarté <strong>de</strong> la présentation <strong>de</strong> la proposition dansée <strong>de</strong> la part du professeur, ce qui va<br />
générer chez les étudiants <strong>de</strong>s activités qui vont, entre <strong>au</strong>tres, leur faciliter la<br />
mémorisation <strong>de</strong> la proposition. Dans un tout <strong>au</strong>tre registre, la logique<br />
d’enseignement-apprentissage <strong>de</strong> la séquence <strong>de</strong> Sabine fait ressortir l’abondance <strong>de</strong>s<br />
explications réactives et préventives du professeur <strong>au</strong> service <strong>de</strong> l’exercice <strong>au</strong>tonome<br />
<strong>de</strong>s étudiants (performation pour soi). Ou encore, la préférence accordée à<br />
l’observation <strong>de</strong>s étudiants dans la séquence <strong>de</strong> Quentin laisse la porte ouverte <strong>au</strong>x<br />
activités <strong>de</strong> performation pour soi et <strong>au</strong>x questions <strong>de</strong>s étudiants.<br />
<strong>Professeur</strong>s Dora Octave Quentin Sabine Thérèse<br />
préférences<br />
activités professeur<br />
Présentation<br />
Accompagner le faire<br />
par le dire +<br />
Explication<br />
En réaction +<br />
observation<br />
En réaction-Explication<br />
+ gestion <strong>de</strong> l'espace<br />
collectif<br />
Observation + gestion<br />
<strong>de</strong> l'espace collectif<br />
préférences<br />
activités étudiants<br />
Écho-résonance +<br />
Performation-<br />
Exposition<br />
Performation (pour soi<br />
+ exposition)<br />
En réaction -<br />
Performation pour soi<br />
Performation pour soi<br />
Performation-<br />
Exposition<br />
Logique<br />
d'enseignementapprentissage<br />
une clarté <strong>de</strong> la<br />
présentation du<br />
professeur pour la<br />
mémorisation <strong>de</strong> la<br />
proposition par les<br />
étudiants.<br />
un accompagnement du<br />
professeur <strong>de</strong> la<br />
performation <strong>de</strong>s<br />
étudiants<br />
une observation du<br />
professeur ouverte à<br />
l’exercice <strong>au</strong>tonome<br />
et <strong>au</strong>x questions les<br />
étudiants<br />
une explication réactive<br />
et préventive du<br />
professeur <strong>au</strong> service <strong>de</strong><br />
l’exercice <strong>au</strong>tonome <strong>de</strong>s<br />
étudiants<br />
une attitu<strong>de</strong><br />
observatrice du<br />
professeur <strong>de</strong> la<br />
performationexposition<br />
<strong>de</strong>s<br />
étudiants<br />
Types couplages Type 1 Types 5 Type 3 Type 2 Type 4, 5<br />
Lexique temps music<strong>au</strong>x verbes d'action onomatopées<br />
relation gravitaire,<br />
métaphores<br />
Figure 5 : Logiques d’enseignement-apprentissage <strong>de</strong>s cinq classes <strong>de</strong> <strong>danse</strong><br />
vocabulaire <strong>de</strong>s pas<br />
<strong>de</strong> <strong>danse</strong>, temps<br />
music<strong>au</strong>x
18<br />
Nous pouvons en déduire que la nature <strong>de</strong>s interactions peut être très diverse malgré<br />
une certaine invariance dans la nature <strong>de</strong>s activités dans lesquelles s’engagent les<br />
sujets.<br />
Nous pouvons souligner <strong>au</strong>ssi que si les activités <strong>de</strong> la configuration « typique » ne<br />
changent pas radicalement, son évolution est perceptible, notamment, à travers <strong>de</strong>ux<br />
indicateurs : la proportion temporelle accordée à l’activité <strong>de</strong> « performation pour<br />
soi » et à l’activité « en réaction » <strong>de</strong>s étudiants, en fait les <strong>de</strong>ux activités qui se<br />
situeraient plus à la marge du strict schéma « démonstration-reproduction ». C'est-àdire<br />
que nous avons constaté, <strong>de</strong> manière assez surprenante, que dans les séquences où<br />
le professeur était particulièrement généreux, notamment dans ses activités<br />
d’explication (« faire comment faire » et « dire comment faire »), la proportion<br />
d’activité <strong>au</strong>tonome <strong>de</strong>s étudiants était particulièrement importante et la<br />
communication verbale qui est traditionnellement quasiment à sens unique, du<br />
professeur vers les étudiants, évolue vers une communication plus interactive dans<br />
laquelle les étudiants ont davantage l’opportunité <strong>de</strong> prendre la parole. Il semblerait<br />
donc que la qualité <strong>de</strong> l’accompagnement verbal du professeur, quand il porte sur<br />
l’explication procédurale du mouvement favorise l’activité <strong>au</strong>tonome <strong>de</strong> l’étudiant et<br />
a tendance à faire évoluer la configuration typique traditionnelle vers une<br />
configuration où l’initiative <strong>de</strong> l’étudiant est davantage sollicitée.<br />
4.2. La communication ostensive-résonante du professeur<br />
Pour ce qui touche <strong>au</strong>x constructions <strong>de</strong> sens réalisées par les sujets, les propos<br />
recueillis dans les entretiens d’<strong>au</strong>toconfrontation nous donnent quelques indications<br />
sur les ressorts, les conditions et les limites <strong>de</strong> cette situation traditionnelle<br />
d’enseignement pour l’apprentissage <strong>de</strong>s étudiants. Un <strong>de</strong>s princip<strong>au</strong>x ressorts pour<br />
l’apprentissage rési<strong>de</strong> dans l’activité <strong>de</strong> présentation <strong>de</strong> la proposition, « faire quoi<br />
faire », du professeur, largement évoquée par les étudiants. Ils perçoivent cette<br />
présentation comme une précieuse information qui dépasse le seul aspect <strong>de</strong>scriptif<br />
pour leur donner accès <strong>au</strong> processus même du mouvement. Nous pourrions<br />
reconnaître, dans cet accès <strong>au</strong> processus du mouvement par la seule observation <strong>de</strong><br />
celui-ci, le phénomène <strong>de</strong> « résonance » décrit par les recherches sur les « neurones<br />
miroir ». En examinant toutes les verbalisations recueillies <strong>au</strong>près <strong>de</strong>s étudiants en<br />
lien avec la captation <strong>de</strong>s éléments procédur<strong>au</strong>x du mouvement, et elles sont
19<br />
nombreuses, nous pouvons remarquer le rapport étroit établi avec la compréhension<br />
du mouvement : une étudiante nous précise ce que la clarté du corps du professeur lui<br />
permet <strong>de</strong> voir en termes <strong>de</strong> « transfert <strong>de</strong> poids, d’énergie, d’oppositions <strong>de</strong><br />
direction », une <strong>au</strong>tre nous mentionne que le simple fait <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r lui permet <strong>de</strong><br />
« comprendre les chemins » que prend le professeur dans son mouvement, un <strong>au</strong>tre<br />
insiste sur le fait que c’est la démonstration dansée du professeur qui <strong>au</strong>rait été<br />
déterminante pour sa compréhension globale du mouvement, une <strong>au</strong>tre souligne le<br />
bénéfice qu’elle tire <strong>de</strong> la clarté corporelle du professeur, « j’ai juste à la regar<strong>de</strong>r et…<br />
je comprends ». D’<strong>au</strong>tres étudiants mettent en avant la qualité du mouvement perçue<br />
dans la démonstration dansée du professeur avec tout l’aspect convaincant et<br />
stimulant que cela peut avoir sur leur propre compréhension et performation du<br />
mouvement. Certains vont jusqu’à évoquer clairement un phénomène <strong>de</strong> transfert<br />
entre le corps du professeur et le leur, « le fait <strong>de</strong> voir dans le corps <strong>de</strong> quelqu’un<br />
d’<strong>au</strong>tre <strong>au</strong>ssi, ça me permet <strong>de</strong> faire 5 ». Tous ces témoignages nous incitent à<br />
transposer la notion <strong>de</strong> communication « ostensive-inférentielle » développée par<br />
Sperber et Wilson (Sperber & Wilson, 1989, pp. 80-81), notion qui caractérise la<br />
communication verbale, à la communication dansée du professeur qu’il nous semble<br />
opportun <strong>de</strong> qualifier d’ « ostensive-résonante » (<strong>Harbonnier</strong>-<strong>Topin</strong>, 2009, p.351).<br />
4.3. Mimétisme <strong>de</strong> l’étudiant et discours du professeur<br />
Par ailleurs, la nature du contenu <strong>de</strong>s récits d’intégration que les étudiants nous ont<br />
livrés nous suggère que la richesse du discours procédural du professeur<br />
accompagnant son mouvement (activité « dire comment faire ») constitue <strong>de</strong><br />
véritables occasions <strong>de</strong> co-construction qui dépassent une conception superficielle <strong>de</strong><br />
l’apprentissage par imitation. Notons <strong>au</strong> passage que la combinaison du geste et <strong>de</strong> la<br />
parole dans la communication du professeur semble avoir un impact particulièrement<br />
efficace sur le sentiment d’intégration <strong>de</strong>s étudiants : « Elle est extrêmement habile<br />
verbalement et elle arrive à le rendre dans son corps, fait que j’ai <strong>de</strong>ux moyens pour<br />
comprendre, j’ai verbalement puis j’ai juste à la regar<strong>de</strong>r… j’ai <strong>de</strong>ux portes d’entrée<br />
qui sont hyper efficaces ».<br />
5 Un rapprochement intéressant serait à faire entre ce témoignage et l’article <strong>de</strong> Jacob et Jeannerod :<br />
Jacob, P., & Jeannerod, M. (1999). Quand voir, c'est faire. Unpublished working paper. Institut <strong>de</strong>s<br />
Sciences Cognitives <strong>de</strong> Lyon
20<br />
L’importance <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’accompagnement verbal du professeur, qui représente<br />
un <strong>au</strong>tre fait saillant <strong>de</strong> cette recherche, est tout à fait congruente avec la notion <strong>de</strong><br />
« transmission matricielle » proposée par Vellet (Vellet, 2003) dans une recherche<br />
s’intéressant à la communication du chorégraphe vers ses <strong>danse</strong>urs. Par cette notion,<br />
l’<strong>au</strong>teur fait référence à un type <strong>de</strong> discours du chorégraphe qui porte sur les sources<br />
profon<strong>de</strong>s du mouvement : « La transmission matricielle contient les éléments à la<br />
source du mouvement qui conditionnent les manières d'engager et <strong>de</strong> produire le geste<br />
(et que nous avons précé<strong>de</strong>mment nommés " éléments <strong>de</strong> la profon<strong>de</strong>ur" ». (Ibid.<br />
p.215)<br />
Par contre, les propos recueillis dans la présente recherche ten<strong>de</strong>nt à contredire<br />
l’opposition que ce même <strong>au</strong>teur fait entre la « transmission matricielle » et la<br />
« transmission mimétique ». Dans le mimétisme, nous dit cet <strong>au</strong>teur, la saisie ne peut<br />
consister qu’en une « image extérieure » et l’action <strong>de</strong> reproduction s’inscrit dans un<br />
« enjeu réducteur et aliénant. » (Ibid. p. 243). Seule la transmission « matricielle »<br />
permettrait <strong>de</strong> donner accès à <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur du mouvement.<br />
Premièrement, nous avons pu voir que la communication du professeur associe<br />
constamment le « faire » et le « dire ». La transmission n’est donc jamais que<br />
mimétique. Par ailleurs, plusieurs témoignages recueillis <strong>au</strong>près <strong>de</strong>s étudiants <strong>de</strong> notre<br />
recherche, contredisent la dimension « <strong>de</strong> surface » évoquée ci-<strong>de</strong>ssus. Pour finir, la<br />
répétition à l’i<strong>de</strong>ntique dont parle cet <strong>au</strong>teur est quelque chose qui, à notre avis,<br />
n’existe pas dans la réalité. Ce n’est pas un corps qui exécute le mouvement mais bien<br />
une personne porteuse <strong>de</strong> toute son histoire. Or, l’histoire <strong>de</strong> chacun est tellement<br />
singulière et unique qu’une reproduction à l’i<strong>de</strong>ntique est absolument impossible.<br />
Prenons par exemple le témoignage <strong>de</strong> cet étudiant qui, en plus d’associer le<br />
professeur à son processus d’appropriation, exprime clairement qu’il s’agit bel et bien<br />
finalement d’un cheminement personnel : « […] pis <strong>de</strong> le voir le faire une fois pour<br />
moi c’est comme / bon ça c’est son chemin maintenant moi j’dois trouver le mien. »<br />
Nous suggérons d’envisager plutôt une complémentarité et non une opposition entre<br />
ces <strong>de</strong>ux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transmission que sont le mimétisme et le discours « matriciel ». Là<br />
où le mimétisme gestuel offre un accès global, rapi<strong>de</strong> et direct <strong>au</strong> mouvement observé,<br />
une vision « syncrétique globale » diraient Vigarello et Vivès (Vigarello & Vives,<br />
1986, p. 239), le discours « matriciel », par un fonctionnement analogique, permettrait
21<br />
<strong>de</strong> favoriser <strong>de</strong>s associations entre le nouve<strong>au</strong> et le connu et d’orienter l’attention vers<br />
<strong>de</strong>s éléments particuliers pouvant s’avérer efficaces pour ai<strong>de</strong>r à la production du<br />
mouvement.<br />
4.4. La résonance, une alternative à l’imitation?<br />
Nous proposons <strong>de</strong> formuler différemment cette question du mimétisme à la lumière<br />
du phénomène <strong>de</strong> résonance avancé par les recherches sur le système miroir. La<br />
proposition dansée du professeur va rencontrer chez l’étudiant une résonance plus ou<br />
moins rapi<strong>de</strong> et aisée selon la plus ou moins gran<strong>de</strong> expérience dans le mouvement <strong>de</strong><br />
ce <strong>de</strong>rnier. Ce n’est pas tant le processus mimétique qui est en jeu que l’étendue du<br />
répertoire moteur <strong>de</strong> l’observateur. C’est un fait que cette situation traditionnelle<br />
d’enseignement bénéficie plus <strong>au</strong>x étudiants les plus expérimentés car ils sont plus<br />
rapi<strong>de</strong>s à s’approprier le mouvement par la seule observation <strong>de</strong> celui-ci. C’est<br />
probablement une <strong>de</strong>s principales limites à cette situation d’apprentissage. Les<br />
étudiants moins expérimentés peinent à mémoriser et atteignent difficilement, voire<br />
pas du tout, l’étape <strong>de</strong> la « performation-exposition ». Prenons par exemple le<br />
témoignage <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux étudiantes qui évoquent l’écart entre leur propre répertoire<br />
moteur et celui du professeur. L’une parle du temps que cela lui prend pour intégrer le<br />
mouvement du professeur à qui elle reconnaît une logique <strong>de</strong> mouvement qui ne lui<br />
est pas familière : « […] mais <strong>de</strong>s fois ça prend du temps à le sentir, parce que, c’est<br />
ça, elle a une logique qui est qui est à elle, <strong>de</strong>s fois j’ai remarqué que dans ses trajets<br />
<strong>de</strong> bras ou <strong>de</strong> mains que ça me prend un petit moment, là, […] »<br />
L’<strong>au</strong>tre se désole <strong>de</strong> ne pas arriver à voir la dynamique du mouvement du professeur.<br />
Nous émettons l’hypothèse que son expérience en <strong>danse</strong> est tellement éloignée <strong>de</strong><br />
celle du professeur que sa perception <strong>de</strong> la proposition pourrait en être altérée : « […]<br />
mais je pense que ça m’ai<strong>de</strong>rait <strong>de</strong> voir la dynamique là du mouvement, mais ce n’est<br />
pas comme ça que je le vois, j’le vois plus comme une forme… »<br />
4.5. Mimétisme et maîtrise du mouvement par l’étudiant<br />
Par ailleurs, les propos <strong>de</strong>s étudiants nous permettent <strong>de</strong> faire ressortir d’<strong>au</strong>tres limites<br />
à cette situation traditionnelle d’enseignement. Celle qui ressort <strong>de</strong> manière<br />
particulièrement importante concerne la dimension aléatoire du « faire » et le<br />
sentiment d’impuissance quant à une maîtrise immédiate <strong>de</strong> leur performation. Cela
22<br />
favorise un fort sentiment d’échec et une attitu<strong>de</strong> <strong>au</strong>to-dénigrante quant à leurs<br />
facultés d’apprentissage. Nous voyons que la crainte exprimée par Puja<strong>de</strong>-Reyn<strong>au</strong>d<br />
quant <strong>au</strong> blocage possible <strong>de</strong> l’étudiant face à la « perfection distanciatrice » (Puja<strong>de</strong>-<br />
Ren<strong>au</strong>d, 1976, p. 118) du mouvement du professeur trouve là une réalité : « […] le<br />
savoir risque d’être imaginé par l’élève comme bloqué, contenu dans le corps du<br />
professeur » (ibid. : 104) par le fait <strong>de</strong> « sa perfection distanciatrice ». Cette crainte<br />
transparaît également dans les propos d’un <strong>de</strong>s professeurs ayant participé à l’étu<strong>de</strong><br />
qui pense qu’une trop gran<strong>de</strong> implication <strong>de</strong> sa part dans sa démonstration dansée<br />
risque <strong>de</strong> provoquer, chez l’étudiant, un sentiment <strong>de</strong> trop grand décalage qui<br />
favorisera le découragement chez ce <strong>de</strong>rnier.<br />
Par ailleurs, il est intéressant <strong>de</strong> relever la réticence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux professeurs pour un trop<br />
grand investissement dans leur présentation en « faire quoi faire » <strong>de</strong> la proposition.<br />
L’un est pris par le dilemme <strong>de</strong> démontrer avec trop ou pas assez <strong>de</strong> clarté la<br />
proposition dansée. Il pense que le fait d’être assez clair dans sa démonstration dansée<br />
favorise un mimétisme constructif <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> l’étudiant. Par contre, s’il est trop clair<br />
dans sa démonstration, il prendra trop <strong>de</strong> place et risquera d’imposer une finition du<br />
mouvement dont, <strong>de</strong> son point <strong>de</strong> vue, l’étudiant <strong>de</strong>vrait être le seul responsable.<br />
L’<strong>au</strong>tre professeur souhaite tellement que les étudiants apprennent seuls qu’il dit ne<br />
donner que le « squelette <strong>de</strong> la phrase » en espérant, inférons-nous, que ce sera <strong>de</strong> la<br />
responsabilité <strong>de</strong>s étudiants d’apporter leur part personnelle d’interprétation.<br />
Ces propos pourraient témoigner en faveur d’une intention <strong>de</strong> dévolution, du<br />
professeur à l’étudiant, du pouvoir <strong>de</strong> performation <strong>de</strong> la proposition dansée. En ayant<br />
un investissement moindre dans la présentation <strong>de</strong> la proposition, ces professeurs<br />
pensent laisser plus <strong>de</strong> place à une appropriation plus personnelle <strong>de</strong> cette proposition<br />
par l’étudiant. Il est intéressant <strong>de</strong> voir ici que cette dévolution, en situation, n’est pas<br />
envisagée par le canal verbal explicite, mais par le canal corporel, plus suggestif, avec<br />
un potentiel d’impact sur l’étudiant probablement plus fort.<br />
Mais n’est-ce pas justement reconnaître un pouvoir important à la démonstration<br />
dansée, que <strong>de</strong> la mettre en sourdine par crainte d’imposer sa propre interprétation <strong>au</strong><br />
détriment <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> l’étudiant ? N’est-ce pas également en méconnaître l’impact<br />
« résonnant », à la fois inévitable et nécessaire, pour l’apprentissage <strong>de</strong> l’étudiant ?
23<br />
Conclusion<br />
Nous n’affirmons pas qu’il faille conserver coûte que coûte, tel quel, le mo<strong>de</strong><br />
pédagogique traditionnel « démonstration-reproduction du modèle » dans la classe<br />
technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong>. En revanche, nous proposons <strong>de</strong> ne pas ignorer l’intérêt <strong>de</strong> notre<br />
fonctionnement « résonnant » <strong>au</strong> mouvement d’<strong>au</strong>trui tout en reconsidérant les<br />
activités <strong>de</strong> l’enseignement traditionnel. Ce mo<strong>de</strong> pédagogique traditionnel <strong>de</strong><br />
transmission fait apparaître un certain nombre d’activités possibles ainsi qu’un certain<br />
type d’agencements entre elles (associations et couplages d’activités), c’est ce que<br />
nous avons i<strong>de</strong>ntifié dans cette recherche. Cela sous entend que d’<strong>au</strong>tres activités et<br />
d’<strong>au</strong>tres types d’agencements d’activités <strong>de</strong>meurent improbables. Ne pourrions-nous<br />
pas envisager que ces activités et agencements d’activités improbables <strong>de</strong>viennent<br />
possibles ? Par exemple : La proposition dansée, élément central <strong>de</strong> cette<br />
configuration d’activités, doit-elle être obligatoirement créée et démontrée par le<br />
professeur ? Doit-elle rester l’élément central organisant toutes les <strong>au</strong>tres activités ?<br />
La présentation <strong>de</strong> la proposition dansée, doit-elle forcément intervenir <strong>au</strong> début <strong>de</strong> la<br />
séquence ? Nous espérons, par cette recherche, ouvrir une porte pour la créativité du<br />
professeur <strong>de</strong> <strong>danse</strong> qui osera jouer avec ses activités, dut-il être imité !<br />
Bibliographie<br />
Barbier, J.-M. (2006). Rapports entre sujets et activités. In J.-M. Barbier & M. Durand<br />
(Eds.), Sujets, activités, environnements (pp. 175-220). Paris: PUF.<br />
Barbier, J.-M., & Galatanu, O. (2000). La singularité <strong>de</strong>s actions:quelques outils<br />
d'analyse L'Analyse <strong>de</strong> la singularité <strong>de</strong> l'action : séminaire du Centre <strong>de</strong><br />
recherche sur la formation du CNAM tenu en 1997 et 1998 (pp. 13-48). Paris:<br />
Presses universitaires <strong>de</strong> France.<br />
Barthélémy, M. (1990). Voir et dire l'action Les formes <strong>de</strong> l'action (pp. 195-226).<br />
Paris: École <strong>de</strong>s h<strong>au</strong>tes étu<strong>de</strong>s en sciences sociales.<br />
Berthoz, A., & Petit, J.-L. (2006). Phénoménologie et physiologie <strong>de</strong> l'action. Paris:<br />
Odile Jacob.<br />
Bruni, C. G. (1998). L'enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong> et après! Sammeron, France:<br />
GERMS.<br />
Calvo-Merino, B., Glaser, D. E., Grèzes, J., Passingham, R. E., & Haggard, P. (2005).<br />
Action Observation and Acquired Motor Skills: An fMRI Study with Expert<br />
Dancers. Cerebral cortex, 15, 1243-1249. Retrieved from<br />
http://cercor.oxfordjournals.org/content/full/15/8/1243<br />
Decety, J. (2004). L'empathie est-elle une simulation mentale <strong>de</strong> la subjectivité<br />
d'<strong>au</strong>trui? In A. Berthoz & G. Jorland (Eds.), L'empathie (pp. 53-85). Parie:<br />
Odile Jacob.<br />
Durand, M., S<strong>au</strong>ry, J., & Sève, C. (2006). Apprentissage et configuration d'activité:<br />
une dynamique ouverte <strong>de</strong>s rapports sujets-environnements. In J.-M. Barbier
24<br />
& M. Durand (Eds.), sujets, activités, environnements, approches transverses<br />
(pp. 61-83). Paris: PUF.<br />
F<strong>au</strong>re, S. (1998). Les processus d'incorporation et d'appropriation du métier <strong>de</strong><br />
<strong>danse</strong>ur. Sociologie <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s d'apprentissage <strong>de</strong> la <strong>danse</strong> "classique" et <strong>de</strong><br />
la <strong>danse</strong> "contemporaine",. Unpublished dissertation, Université Lumière<br />
Lyon 2., Lyon.<br />
Filliettaz, L. (2002). La parole en action : éléments <strong>de</strong> pragmatique psycho-sociale.<br />
Québec: Éditions Nota bene.<br />
Foster, S. L. (1998). Danses <strong>de</strong> l’écriture. Courses dansantes et anthroplogie <strong>de</strong> la<br />
kinesthésie. Littérature, 112, 100-111.<br />
Gallese, V. (2004). La mise en phase intentionnelle. Le système miroir et son rôle<br />
dans les relations interpersonnelles. Interdisciplines, (16 novembre 2004), 14.<br />
Retrieved from http://www.interdisciplines.org/mirror/papers/1<br />
Gallese, V. (2005). Embodied simulation: from neurons to phenomenal experience.<br />
Phenomenology and the Cognitive Sciences, 4, 23-48.<br />
Ganne, M. (1998). Artiste / pédagogue, enseignant / pédagogue: qui fait quoi? pour<br />
qui? In C. G. Bruni (Ed.), L'enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong> et après! (pp. 90-98).<br />
Sammeron: GERMS.<br />
Ginot, I., & L<strong>au</strong>nay, i. (2002). L'école, une fabrique d'anticorps? Art Press spécial,<br />
23(Médium <strong>danse</strong>), 106-111.<br />
Godard, H. (1992). Le déséquilibre fondateur: Le corps du <strong>danse</strong>ur, épreuve du réel.<br />
Art Press, hors série n°13 "20 ans, l'histoire continue" Entretien avec<br />
L<strong>au</strong>rence Louppe, 138-143.<br />
Godard, H., & Louppe, L. (1993). Synthèse II, "À l'écoute du corps". Nouvelles <strong>de</strong><br />
Danse, 17, 69-76.<br />
Grammont, F. (2003). L'action dans le miroir. Annales <strong>de</strong> la Fondation Fyssen, 18,<br />
11-17.<br />
<strong>Harbonnier</strong>-<strong>Topin</strong>, N. (2009). Autour <strong>de</strong> la proposition dansée. Regard sur les<br />
interactions professeur-élève dans la classe technique <strong>de</strong> <strong>danse</strong><br />
contemporaine Unpublished Dissertation, Conservatoire National <strong>de</strong>s Arts et<br />
Métiers, Paris.<br />
L<strong>au</strong>nay, I. (2001). Le don du geste. revue Protée "Danse et altérité", 20(2).<br />
Lefebvre, B. (1998). Art et technique, art et enseignement. In C. G. Bruni (Ed.),<br />
L'enseignement <strong>de</strong> la <strong>danse</strong> et après! (pp. 87-89). Sammeron: GERMS.<br />
Louppe, L. (1994). Transmette L'indicible. Nouvelles <strong>de</strong> Danse, 20 (La transmission),<br />
16-20.<br />
Maturana, H. (1977). biology of language: the epistemology of reality. In G. A. Miller<br />
& E. Lenneberg (Eds.), Psychology and Biology of Language and Thought<br />
(pp. 27-64). New York: Aca<strong>de</strong>mic Press.<br />
Puja<strong>de</strong>-Ren<strong>au</strong>d, C. (1976). Danse et narcissisme en éducation. Paris: ESF.<br />
Rizzolatti, G., Fogassi, L., & Gallese, V. (2001). Neurophysiological mechanisms<br />
un<strong>de</strong>rlying the un<strong>de</strong>rstanding and imitation of action. Paper presented at the<br />
Nature Neuroscience Reviews. Retrieved from<br />
www.nature.com/reviews/neuro<br />
Roseman, J. L. (2001). Dance masters : interviews with legends of dance. New York:<br />
Routledge.<br />
Schutz, A., Noschis, K., & Caprona, D. d. (1987). Le chercheur et le quotidien<br />
phenomenologie <strong>de</strong>s sciences sociales. Paris: Méridiens Klincksieck.<br />
Sperber, D., & Wilson, D. (1989). La pertinence communication et cognition. Paris:<br />
Éditions <strong>de</strong> Minuit.
25<br />
Theure<strong>au</strong>, J. (2004). Le cours d'action : métho<strong>de</strong> élémentaire (2e éd. ed.). Toulouse:<br />
Octarès éditions.<br />
Varela, F. J. (1989). Autonomie et connaissance : essai sur le vivant. Paris: Éditions<br />
du Seuil.<br />
Vellet, J. (2003). Contribution à l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s discours en situation dans la transmission<br />
<strong>de</strong> la <strong>danse</strong>. Discours et gestes dansés dans le travail d'Odile Duboc.<br />
Unpublished dissertation, Université <strong>de</strong> Paris 8, Paris.<br />
Vigarello, G., & Vives, J. (1986). Discours <strong>de</strong> l’entraîneur et technique corporelle.<br />
Revue EPS, 200-201, 146-153.