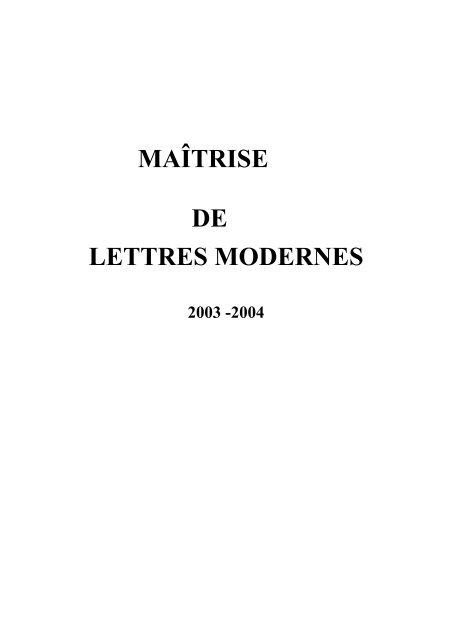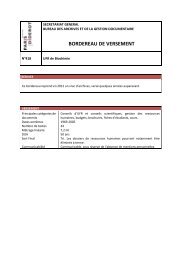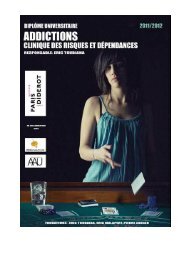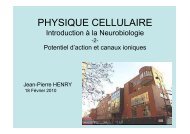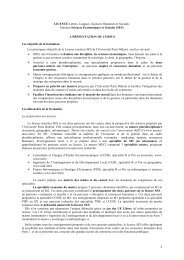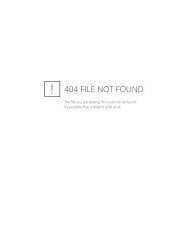MAÃTRISE DE LETTRES MODERNES - Université Paris Diderot ...
MAÃTRISE DE LETTRES MODERNES - Université Paris Diderot ...
MAÃTRISE DE LETTRES MODERNES - Université Paris Diderot ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MAÎTRISE<br />
<strong>DE</strong><br />
<strong>LETTRES</strong> MO<strong>DE</strong>RNES<br />
2003 -2004
Coordination de la maîtrise<br />
Nathalie Piégay-Gros<br />
Secrétariat du 2 e cycle<br />
Université <strong>Paris</strong> 7-Denis <strong>Diderot</strong><br />
UFR Sciences des textes et Documents<br />
Tour 34-44, 2 e étage, bureau 206.<br />
2, place Jussieu<br />
75251 <strong>Paris</strong> cedex 05<br />
case 7010<br />
Tel : 01 44 27 - 6352 - 57 80<br />
Fax : 01 44 27 78 69<br />
E-Mail : bardet@paris7.jussieu.fr<br />
2
Conditions d'accès<br />
Licence complète et présentation du titre lors de l'inscription pédagogique de septembre.<br />
Pour toute dérogation, s'adresser à l'U.F.R.<br />
Organisation des études<br />
La maîtrise, qui est une initiation à la recherche, comporte un enseignement de deux semestres<br />
et de 4 UE :<br />
La mention finale est attribuée en fonction du total des quatre notes obtenues à ces UE.<br />
SEMESTRE 1<br />
Cours de maîtrise (46 U 11 ML4) : 6 pts ECTS<br />
Coeff. 2<br />
Un cours de 3 h par semaine, 4 groupes au choix ;<br />
Nous attirons l'attention des étudiants sur le fait que l'inscription à l'un des quatre cours est<br />
définitive. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert.<br />
Le cours de maîtrise a pour objet de compléter les connaissances littéraires des étudiants. Il porte sur une<br />
question générale et inscrit plusieurs œuvres à son programme. Il donne lieu à deux exercices : une<br />
dissertation (travail terminal sur table, de quatre heures) et un bref dossier d'environ six pages<br />
dactylographiées (interligne 2).<br />
Une présence régulière à ces cours est exigée.<br />
Séminaire 1 (46 U 12 ML4) : 6 pts ECTS<br />
Coeff. 1<br />
Un séminaire de 2 h par semaine<br />
SEMESTRE 2<br />
Séminaire 2 (46 U 21 ML4) : 6 pts ECTS<br />
Coeff. 1<br />
Un séminaire de 2 h par semaine<br />
Rédaction d’un mémoire (4U22 ML4) : 42 pts ECTS<br />
Coeff. 6<br />
Travail personnel, rédaction et soutenance.<br />
Rédaction d’un mémoire sous la direction d’un enseignant, et soutenance devant un jury<br />
composé de deux enseignants, en juin ou en septembre.<br />
Ce mémoire est une étude, d'une cinquantaine de pages, dactylographiées, rédigée sous la<br />
direction d'un enseignant qui en a fixé le sujet en accord avec l'étudiant.<br />
Le mémoire de maîtrise est un texte original dans lequel rien ne peut être cité sans figurer entre<br />
guillemets avec en note renvoi à la source.<br />
Dépôt du sujet et choix du directeur de maîtrise à faire courant septembre. Une réunion sera<br />
organisée à cet effet.<br />
3
Les étudiants doivent présenter en une dizaine de lignes leur projet de recherche sur un<br />
formulaire à retirer au secrétariat et à rendre impérativement avant la fin septembre.<br />
Une commission examinera les demandes des étudiants qui n'auraient pas trouvé de directeur de<br />
mémoire, et les orientera vers un enseignant dont la spécialité correspond à leur projet.<br />
4
ENSEIGNANTS SUSCEPTIBLES <strong>DE</strong> DIRIGER <strong>DE</strong>S<br />
MÉMOIRES <strong>DE</strong> MAÎTRISE ET <strong>DE</strong>A<br />
46 U22 ML4<br />
S UJETS ET DOMAINES CONCERNES<br />
CHRISTOPHE BI<strong>DE</strong>NT<br />
Maurice Blanchot, Robert Antelme, Louis-René Des Forêts.<br />
Littérature du XX e siècle.<br />
Théâtre contemporain (textes et esthétiques).<br />
Samuel Beckett, Bernard-Marie Koltès<br />
BERNA<strong>DE</strong>TTE BRICOUT<br />
Contes.<br />
Mythes littéraires.<br />
Littératures orales.<br />
Littérature pour la jeunesse.<br />
MARC BUFFAT<br />
Histoire de la poétique et de la rhétorique.<br />
<strong>Diderot</strong> ; littérature du XVIII e siècle.<br />
Cinéma.<br />
PIERRE CHARTIER<br />
Théâtre.<br />
Littérature du XVIII e siècle.<br />
JACQUELINE CHENIEUX-GENDRON<br />
Domaine surréaliste : poésie roman, arts plastiques<br />
ANNE-MARIE CHRISTIN<br />
Illustration.<br />
Littératures de la description au XIX e siècle.<br />
Marques formelles de l'écriture dans le texte (systèmes non alphabétiques, typographie, mise en<br />
page, communication multi-médias).<br />
Influence réciproque des cultures japonaise et française depuis 1850.<br />
JEAN-PATRICE COURTOIS<br />
Littérature du XVIIIe siècle.<br />
Littérature et idées au XVIIIe siècle.<br />
Littérature contemporaine.<br />
Poésie contemporaine.<br />
ANNY DAYAN-ROSENMAN<br />
Littérature au XX e siècle, la littérature et la guerre : Robert Antelme, Romain Gary, Patrick<br />
Modiano, Georges Perec, Vercors, Elie Wiesel.<br />
Littérature et cinéma.<br />
PASCAL <strong>DE</strong>BAILLY<br />
Littérature du XVII e siècle.<br />
Les écritures comiques, satiriques et militantes à la Renaissance et à l’Age classique.<br />
5
JEAN <strong>DE</strong>LABROY<br />
Littérature du XIXe siècle.<br />
JOSE-LUIS DIAZ<br />
La représentation de l'écrivain (XVII e - XX e siècle).<br />
Balzac, Stendhal, Sand, Musset, les romantiques en général.<br />
Autobiographies et correspondances.<br />
Sociabilités littéraires.<br />
FLORENCE DUMORA<br />
Poétique et imaginaire.<br />
Littérature et philosophie.<br />
Littérature des XVIe et XVIIe siècles.<br />
FLORENCE DUPONT<br />
Etudes latines.<br />
LAURENT FLIE<strong>DE</strong>R<br />
Roman français d’aujourd’hui.<br />
Poésie française du XXe siècle.<br />
Jeu verbal et expérimentations formelles.<br />
Littérature et métiers du livre.<br />
DANIEL FONDANÈCHE<br />
Paralittérature ; science-fiction, fantastique, policier.<br />
FRANCOISE GAILLARD<br />
Textes du XIX e siècle et du XX e siècle.<br />
Théorie de la littérature.<br />
Approches philosophiques.<br />
EVELYNE GROSSMAN<br />
Littérature du XX e siècle.<br />
Théorie littéraire - Approches psychanalytiques.<br />
Littérature comparée (domaines anglo-américain, italien, polonais).<br />
GENEVIEVE JOLY<br />
Edition critique des textes du Moyen Âge.<br />
Traductions de textes du Moyen Âge.<br />
Etudes de morpho-syntaxe, de syntaxe et de lexicologie à partir de textes en ancien français<br />
(chansons de geste, romans arthuriens, romans de Chrétien de Troyes).<br />
JULIA KRISTEVA<br />
Littérature moderne et contemporaine.<br />
Littérature et psychanalyse.<br />
Etudes sémiologiques.<br />
RICHARD LASZLO<br />
Littérature et psychanalyse.<br />
Poésie.<br />
Littérature fin XIXe et XXe siècles.<br />
Relations culturelles entre l’Europe et le monde arabo-musulman.<br />
Didactique de la littérature en FLE.<br />
FRANÇOISE LAVOCAT<br />
Littérature comparée avant 1800 (domaines français, italien, espagnol, anglais).<br />
Roman. Théâtre. Théories esthétiques.<br />
Rapports entre danse et littérature, arts du spectacle.<br />
6
CHANTAL LIAROUTZOS<br />
Littérature du XVIè siècle – Récits de voyage –<br />
Littérature de vulgarisation XVIème – XVIIème siècle<br />
FRANCIS MARMAN<strong>DE</strong><br />
XX e siècle, notamment : Georges Bataille, Maurice Blanchot, Michel Leiris, Marguerite Duras.<br />
Questions de littérature actuelle.<br />
ERIC MARTY<br />
Poésie fin XIX e et XX e siècles.<br />
Littérature contemporaine.<br />
Autobiographie au XXe siècle.<br />
Théorie de la littérature (Barthes).<br />
MARIE-FRANCOISE MELMOUX-MONTAUBIN<br />
La littérature fin de siècle.<br />
CLAU<strong>DE</strong> MURCIA<br />
Littérature et cinéma.<br />
Littérature comparée.<br />
JACQUELINE NACACHE<br />
Cinéma hollywoodien classique (histoire, récit, esthétique, mode de production).<br />
Jeune cinéma français des années 1990.<br />
Histoire de la critique cinématographique.<br />
Le jeu de l’acteur.<br />
.<br />
VINCENT NYCKEES<br />
Sémantique synchronique et historique.<br />
Lexicologie.<br />
Analyse des métaphores.<br />
Théorie du langage.<br />
BRIGITTE OUVRY-VIAL<br />
Histoire éditoriale (œuvres, genres, revues, collections, archives ou correspondances d'auteurs et<br />
éditeurs)<br />
Pratiques éditoriales (rédaction, lecture, impression, constitution de recueils œuvres complètes,<br />
aspects graphiques).<br />
Liens entre production éditoriale et production littéraire, impacts sur le statut social et culturel de<br />
l'auteur, du savoir, de l'écriture.<br />
PIERRE PACHET<br />
Ecrivains du XXe siècle.<br />
Littérature personnelle et intime.<br />
SYLVIE PATRON<br />
Critique et théorie littéraire au XXe siècle.<br />
Travail sur les revues.<br />
Littérature du XXe siècle ;<br />
Théâtre.<br />
ANNE PAUPERT<br />
Littérature médiévale (en particulier, genres narratifs et poésie, écriture du moi).<br />
Paroles de femmes dans la littérature française du Moyen Age.<br />
Œuvre de Christine de Pizan.<br />
Culture populaire et culture savante/oral et écrit dans la littérature médiévale.<br />
PAULE PETITIER<br />
Michelet – Questions d'histoire.<br />
Géographie, topographie, espace.<br />
L’histoire des idées et des savoirs au XIXe siècle.<br />
NATHALIE PIÉGAY-GROS<br />
Théorie du récit - Questions de poétique.<br />
Surréalisme.<br />
Nouveau roman.<br />
Aragon.<br />
7
CRYSTEL PINÇONNAT<br />
Littérature comparée du XXe siècle (domaines français, nord-américain, latino-américain et<br />
espagnol) : le roman urbain.<br />
Littératures "mineures", émergentes et littératures d'immigration (champs afro-américain,<br />
amérindien, chicano, anglo-indien et "beur").<br />
Le roman d'inspiration picaresque au XXe siècle.<br />
ANNIE RENONCIAT<br />
Histoire de l'image dans ses rapports au livre et à l'édition (1750-1950).<br />
Illustration, bandes dessinées, imagerie populaire et enfantine.<br />
GUY ROSA<br />
Hugo.<br />
Autres auteurs et questions au XIX e siècle.<br />
Génétique littéraire (études de manuscrits, « sources », etc.).<br />
Histoire de l'édition littéraire au XIX e siècle.<br />
MARTIN RUEFF<br />
Littérature et philosophie.<br />
REGIS SALADO<br />
Littérature comparée du XXe siècle.<br />
Oeuvres narratives (Domaines anglo-saxon, espagnol, portugais).<br />
Etudes de réception des textes - travaux concernant James Joyce<br />
MICHEL SANDRAS<br />
Les relations entre la prose et la poésie aux XIX e et XX e siècle.<br />
YANNICK SÉITE<br />
XVIII e siècle<br />
BERNARD SICHÈRE<br />
Philosophie contemporaine.<br />
Littérature et psychanalyse.<br />
Littérature du XX e siècle (Proust, Céline, Genet).<br />
CARINE TREVISAN<br />
Littérature et Histoire au XX e siècle.<br />
Autobiographie et fiction au XX e siècle.<br />
Proust, Céline, Aragon.<br />
JEAN VIGNES<br />
Littérature française du XVIe siècl.e<br />
Poésie.<br />
Poésie et musique.<br />
FRANCOISE VOISIN-ATLANI<br />
Écriture et Oralité.<br />
Théorie(s) littéraire(s) et Linguistique.<br />
Auteurs du XX e siècle, en particulier :<br />
Butor - Des Forêts - Perec - Queneau - Roussel – Sarraut<br />
8
LISTE <strong>DE</strong>S COURS <strong>DE</strong> MAÎTRISE<br />
THÉORIES, ŒUVRES, TEXTES<br />
• Les étudiants qui s’intéressent aux questions éditoriales peuvent suivre et faire valider comme cours<br />
de maîtrise le cours de licence de Brigitte OUVRY-VIAL : Interprétation éditoriale des textes<br />
intitulé « Editer, critiquer » (voir la brochure de licence, UE méthodologie, ECUE Métiers du<br />
livre).<br />
• Les étudiants qui s’intéressent à l'ancien français, notamment dans la perspective de la préparation<br />
des concours (CAPES et/ou agrégation de lettres modernes) peuvent suivre et faire valider comme<br />
séminaire de maîtrise /<strong>DE</strong>A l'ECUE de Geneviève JOLY (Ancien Français – Etude approfondie<br />
LF 311 C et LF 321 C). On en trouvera le descriptif dans la brochure de licence.<br />
• Le latin et le grec en maîtrise<br />
1 Préparation à la version latine d'agrégation.<br />
Les étudiants de maîtrise qui envisagent de passer le concours de l'agrégation de Lettres Modernes en<br />
2004-2005doivent dès cette année se préparer à l'épreuve de version latine.<br />
Ils peuvent s'ils ont un bon niveau (licence groupe fort) suivre les cours de version latine pour<br />
l'agrégation et le CAPES (mercredi matin 9h-11H) cours hebdomadaire, annuel.<br />
Pour les autres est créé cette année un cours d'entraînement et de remise à niveau en version latine,<br />
de deux heures tous les quinze jours, annuel (mercredi 13h-15h)<br />
2. Préparation à la recherche<br />
Les étudiants qui se destinent à la recherche (<strong>DE</strong>A puis thèse), tout spécialement ceux qui travaillent<br />
sur les littératures modernes (16ème, 17ème, 18ème ) ou le Moyen Age ont tout intérêt à suivre pour<br />
leur formation un cours de latin correspondant à leur niveau et/ou le cours d'histoire de la littérature<br />
latine destinée aux étudiants de CAPES (mercredi matin 11h-12h)<br />
Ils peuvent aussi, dans le même esprit, suivre l'initiation au grec , 1er ou 2d niveau.<br />
9
Groupe 1<br />
Michel Sandras<br />
premier semestre,<br />
Le choix des formes<br />
Dans un carnet de 1908, juste avant de commencer à écrire la Recherche, Marcel Proust note :<br />
«Je sens que j’ai dans l’esprit comme un lac de Genève invisible la nuit. J’ai là quatre visages de<br />
jeunes filles, deux clochers, une filière noble, avec l’hortensia normand, un “allons plus loin”<br />
dont je ne sais pas ce que je ferai.» Un roman? un essai? une suite de poèmes en prose?<br />
L’interrogation de Proust concerne peu ou prou de nombreux écrivains contemporains.<br />
Le cours se propose de réfléchir sur le choix des formes littéraires dans leurs rapports avec la<br />
matière (dans le sens où l’on peut dire matière à poème ou matière à réflexion). On se<br />
demandera pourquoi l’écrivain, tenu jadis au genre et au style impliqués par le sujet, ou<br />
choisissant une forme à l’exclusion de toute autre (pour des raisons diverses) peut hésiter<br />
aujourd’hui entre la fiction romanesque, l’essai, le journal intime ou le poème, entre la prose<br />
continue ou la suite de fragments, publie des recueils mêlant vers et proses, ou invente des<br />
formes nouvelles qui jouent sur les rapports entre prose et poésie. On étudiera en même temps<br />
quelques formes hybrides caractéristiques de la littérature d’aujourd’hui.<br />
Le cours prendra appui sur divers textes d’auteurs français et étrangers du XXe siècle (Proust,<br />
Walter Benjamin, Henri Michaux, Philippe Jaccottet, Yves Bonnefoy, Pascal Quignard,<br />
Jacques Réda, Michel Leiris).<br />
Un polycopié rassemblera quelques textes courts.<br />
Indications bibliographiques<br />
M. Proust, Contre Sainte-Beuve, Folio<br />
W. Benjamin, Sens unique, Une enfance berlinoise, 10/18; «Haschich à Marseille», Œuvres,<br />
tome II, Folio Essais (ou Ecrits français, Folio)<br />
H. Michaux, Ecuador, Gallimard, L’Imaginaire— L’Espace du dedans, Poésie/ Gallimard<br />
R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil<br />
Y. Bonnefoy, Rue Traversière et autres récits en rêve, Poésie /Gallimard<br />
P. Quignard, La Leçon de musique, Folio<br />
M. Leiris, Le Ruban au cou d’Olympia, Gallimard<br />
Ph. Jaccottet, La Semaison, I, Gallimard; Cahier de verdure, Poésie/Gallimard<br />
J. Réda, L’Herbe des talus, Folio<br />
10
Groupe 2<br />
J.-L. DIAZ<br />
1 er SEMESTRE<br />
POUR UNE HISTOIRE <strong>DE</strong>S IMAGINAIRES LITTERAIRES<br />
<strong>DE</strong> MME <strong>DE</strong> STAËL A MALLARME<br />
En cette période comprise entre la fin des Lumières et l’époque symboliste, le statut et les<br />
limites mêmes de la littérature changent en profondeur. Le « sacre de l’écrivain » donne une<br />
place éminente au sujet de la littérature, promu matière à fantasmes et personnage<br />
mythologique : le voici l’objet des attentions des critiques, des biographes et des lecteurs - avant<br />
d’être déclaré suspect en raison du dogme de l’« impersonnalité ». Mais c’est l’ensemble de<br />
l’espace littéraire qui devient objet de représentation : l’œuvre et le livre, le nom d’auteur et la<br />
page de titre, le lecteur et le public, la gloire et la postérité, le cénacle et la mansarde, la poésie<br />
et le roman, sans oublier la littérature.<br />
Le cours se propose d’insister sur la chronologie et les différents aspects de ce phénomène<br />
multiforme, en privilégiant les genres qui fournissent matière à une telle réflexion : manifestes,<br />
préfaces, dédicaces, arts poétiques, correspondances, critiques, biographies, courrier des<br />
lecteurs, romans mettant en scène le monde littéraire, poèmes sur la poésie et le poète, littérature<br />
panoramique, satires, etc.<br />
TEXTES <strong>DE</strong> REFERENCE<br />
ROUSSEAU, Lettres à Malesherbes ; (1762), Les Confessions (1782-1789).<br />
MME de STAËL, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales<br />
(1800) ; Corinne (1807) ; De l’Allemagne (1810).<br />
STENDHAL, Journal (1800-1817) ; lettres à Pauline Beyle (1800-1815) ; Racine et Shakespeare<br />
(1823-1825) ; Vie de Henry Brulard (1835).<br />
HUGO, Préfaces ; Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie (1862) ; William Shakespeare<br />
(1864).<br />
BALZAC, Correspondance (1819-1829), « Avertissement » du Gars (1829); Préfaces; Illusions<br />
perdues (1836-1843); « Étude sur M. Beyle » (1840); La Muse du département (1843-1844);<br />
Modeste Mignon (1844).<br />
MUSSET, Correspondance (1827-1833); Préface des Contes d’Espagne et d’Italie (1830);<br />
Dédicace de La Coupe et les Lèvres (1832); Le Poète déchu (1839).<br />
Préfaces Jeune-France : Pétrus Borel, Philothée O’Neddy, Charles Lassailly…<br />
GAUTIER, Préfaces des Jeunes France, romans goguenards (1833) et de Mademoiselle de<br />
Maupin (1835).<br />
MURGER, Scènes de la vie de bohème (1851).<br />
FLAUBERT, Correspondance (t. I et II, Pléiade); Mémoires d’un fou; Novembre et autres textes<br />
de jeunesse (G-F); La première Éducation sentimentale (1845); L’Éducation sentimentale<br />
(1869).<br />
ZOLA, Correspondance avec Cézanne et Jean-Baptistin Baille (1859-1864) (t. I); Le Roman<br />
expérimental (1880); L’Œuvre (1884).<br />
11
GONCOURT, Charles Demailly (1860); Journal de la vie littéraire (1851-1896).<br />
MALLARME, Correspondance (Folio); Le Mystère dans les lettres; Crise de vers.<br />
Isidore DUCASSE, Poésies (1869).<br />
RIMBAUD, Lettres du « Voyant », mai 1871 (à Georges Izambard et à Paul Demeny).<br />
VALLES, Le Bachelier (1881).<br />
VERLAINE, Les Poètes maudits (1884).<br />
HUYSMANS, À rebours (1884).<br />
SARTRE, Les Mots (1964).<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Claude ABASTADO, Mythes et rituels de l’écriture, Bruxelles, Éditions Complexe, 1979.<br />
Paul BENICHOU, Le Sacre de l’écrivain (1750-1830), <strong>Paris</strong>, José Corti, 1973.<br />
Jean GOULEMOT et Daniel OSTER, Gens de lettres, écrivains et bohèmes. L’imaginaire<br />
littéraire, 1630-1900, <strong>Paris</strong>, Minerve, 1992.<br />
Daniel OSTER, L’Individu littéraire, <strong>Paris</strong>, PUF, coll. « Écriture », 1997.<br />
José-Luis DIAZ, L’Écrivain imaginaire, Klincksieck, 2004.<br />
« Images de l’écrivain », Textuel, n° 22, 1989.<br />
« Écrire à l’écrivain », Textuel, n° 27, 1994.<br />
« La Gloire », Textuel, n° 34, 1998.<br />
N.B : Une bibliographie plus complète et une chronologie seront distribuées aux étudiants<br />
12
Marie-Françoise Montaubin<br />
Groupe 3.<br />
1 er semestre<br />
Roman de l'artiste et roman artiste : littérature et<br />
peinture au XIXe siècle<br />
Ecrire un roman qui soit une ouvre d'art, rivaliser avec le<br />
peintre, composer comme le musicien : telle est l'ambition<br />
de nombre de romanciers du XIXe siècle, fascinés par les<br />
mystères de la création artistique à travers laquelle ils<br />
interrogent leur propre pratique de l'écriture. De Balzac à<br />
Octave Mirbeau en passant par Gautier, les frères Goncourt,<br />
Zola et Huysmans, le personnage de l'artiste s'impose au<br />
cour de l'ouvre, avec ses corollaires nécessaires : le<br />
modèle, la maîtresse, l'atelier, le tableau, mais aussi la<br />
folie, la destruction ... On en suivra les avatars pour<br />
voir comment les métamorphoses de l'artiste accompagnent<br />
une métamorphose du genre et de l'écriture romanesques.<br />
On travaillera sur les textes suivants :<br />
Balzac, Le Chef d'ouvre inconnu, G.F.<br />
Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, Folio classique<br />
Edmond et Jules de Goncourt, Manette Salomon, Folio<br />
classique<br />
Huysmans, A rebours, Folio classique<br />
Zola, L' Oeuvre, Folio<br />
Jean Lorrain, Monsieur de Phocas, Folio<br />
Octave Mirbeau, Dans le ciel (le texte n'existe pas en<br />
édition de poche. Voir éventuellement dans Ouvre<br />
romanesque, édition Buchet/Chastel, t. 2. Mais le texte<br />
sera distribué en photocopies en début d'année).<br />
L'essentiel est d'abord de lire ces textes.<br />
Une bibliographie critique sera distribuée en début d'année.<br />
13
LISTE <strong>DE</strong>S SÉMINAIRES COMMUNS<br />
A LA MAITRISE ET AU <strong>DE</strong>A<br />
Les séminaires<br />
s’ordonnent autour de<br />
trois axes de recherche<br />
privilégiés :<br />
• Littérature et<br />
esthétique<br />
• Littérature et histoire<br />
culturelle<br />
• Littérature, théorie<br />
littéraire et sciences<br />
humaines<br />
Ces séminaires<br />
regroupent en<br />
règle générale des<br />
étudiants de <strong>DE</strong>A<br />
et des étudiants de<br />
maîtrise. Seront<br />
demandés aux<br />
étudiants des<br />
travaux en<br />
rapport avec leur<br />
niveau d’études et<br />
de formation.<br />
Les étudiants<br />
choisiront<br />
librement deux<br />
séminaires parmi<br />
les enseignements<br />
proposés.<br />
Les horaires seront précisés ultérieurement.<br />
14
Littérature<br />
et<br />
esthétique
Christophe BI<strong>DE</strong>NT<br />
LE THEATRE ENTRE <strong>DE</strong>UX FANTASMES<br />
Si à l’origine d’un enseignement, comme le formule Roland Barthes, il faut accepter de toujours<br />
placer un fantasme, eh bien, plaçons-en deux : il s’agira de considérer pourquoi le théâtre<br />
contemporain, depuis ce qu’il est convenu de reconnaître comme la naissance de la mise en<br />
scène, a envisagé sa relation aux arts entre le fantasme d’un « art total » et celui d’un « art en<br />
liberté ».<br />
On s’interrogera sur quelques écoles (l’expressionnisme, le constructivisme…) et sur certaines<br />
signatures singulières (Craig, Meyerhold, Artaud, Brecht, Kantor…).<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Gallimard Folio/Essais.<br />
• Bertolt Brecht, Petit Organon pour le théâtre, L’Arche.<br />
• Edward Gordon Craig, De l’art du théâtre, Circé.<br />
• Jean-François Dusigne, Le Théâtre d’art, Théâtrales.<br />
• Tadeusz Kantor, Le Théâtre de la mort, L’Age d’homme.<br />
• Vsevolod Meyerhold, Ecrits sur le théâtre, 4 volumes, L’Age d’homme.<br />
• Oskar Schlemmer, Théâtre et abstraction, L’Age d’homme.<br />
• Bruno Schulz, Traité des Mannequins, in Les Boutiques de cannelle, Gallimard.<br />
16
Jacqueline CHÉNIEUX-GENDRON<br />
RECEPTION DU SURREALISME<br />
<strong>DE</strong> JULES MONNEROT ET MAURICE BLANCHOT (1945) A GAËTAN PICON (1976)<br />
Les récentes expositions, en 2002, à <strong>Paris</strong>, ainsi qu’à Londres et à New York, non moins que la<br />
vente de la collection Breton, ont fait apercevoir de façon tout à fait imprévisible de profonds<br />
changements dans la perception globale du « phénomène » surréaliste, dont l’expression<br />
littéraire a permis en France la reconnaissance d’œuvres majeures comme celle de Paul Eluard,<br />
d’Aragon, de Georges Limbour et de tant d’autres.<br />
Il est temps d’élaborer une théorie de cette réception en France – sans négliger quelques<br />
excursions et retours dans le domaine étranger (Walter Benjamin, 1929) et dans le domaine,<br />
devenu majeur, de la peinture - ; il est temps d’évaluer ces fluctuations, qui doivent prendre en<br />
compte le souci singulier, propre au surréalisme, de réévaluer lui-même son parcours à tout<br />
moment, voire de le mettre en scène.<br />
On lira ou relira les grandes étapes de ces lectures et de ces regards, souvent fort<br />
polémiques : on partira de Jules Monnerot, dont le parcours politique était destiné à devenir<br />
chaotique, qui a publié (dès 1945, avant même l’Histoire du surréalisme de Maurice Nadeau)<br />
un ouvrage remarquable sur le plan des idées et d’une grande carence sur le plan de la réflexion<br />
poétique. Maurice Blanchot, quelques mois plus tard, élabore une critique poéticienne destinée à<br />
servir de la pendant une cinquantaine d’années, tandis que l’année 1947 est celle des grands<br />
échauffements (à fondement politique chez Tristan Tzara ou Roger Vailland, philosophique et<br />
esthétique chez Jean-Paul Sartre, qu’irrite l’exposition surréaliste internationale de 1947 chez<br />
Maeght). Julien Gracq, Georges Bataille, Ferdinand Alquié prennent le relais d’un dialogue<br />
fondé sur l’empathie, tandis que l’ouvrage de Gaëtan Picon, Journal du surréalisme, en 1976,<br />
scande fortement cette réception. La période 1976-2003 de cette étude sera l’objet du séminaire<br />
en 2004-2005. Cependant, comme ce sont les enjeux esthétiques et idéologiques d’une réception<br />
cherchant ses repères qui sont visés par ce séminaire, l’actualité ne sera pas éludée.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Sur le surréalisme, les textes majeurs – pour ne citer que quelques écrivains – sont accessibles<br />
dans les éditions de la Pléiade pour l’œuvre d’André Breton (trois tomes parus), d’Aragon (tome 1<br />
pour une partie de l’œuvre surréaliste), Paul Eluard (les deux tomes), Julien Gracq (les deux tomes) ;<br />
dans la collection blanche de Gallimard pour l’œuvre de Georges Bataille et Antonin Artaud ; chez<br />
d’autres éditeurs pour Philippe Soupault.<br />
• Un parcours général, facile d’accès et d’ambition diversifié, est disponible sous le titre Il y aura<br />
une fois, une anthologie du surréalisme éditée et présentée par Jacqueline Chénieux-Gendron,<br />
Gallimard/Folio, 2002, seconde édition revue et corrigée, 2003, 710 pages.<br />
• Les textes étudiés seront fournis au fur et à mesure. Donnons ici quelques jalons :<br />
• Jules Monnerot, La poésie moderne et le sacré, Gallimard, 1945, (épuisé)<br />
• Maurice Blanchot, « Quelques réflexions sur le surréalisme », L’Arche, n°8, août 1945.<br />
• Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, Seuil, 1945, (nombreuses rééditions réactualisées)<br />
• Julien Gracq, André Breton, quelques aspects de l’écrivain, José Corti, 1948<br />
• Ferdinand Alquié, Philosophie du surréalisme, Flammarion, 1955, ainsi que Entretiens sur le<br />
surréalisme, colloque de Cerisy, 1966, Mouton <strong>Paris</strong>/La Haye, 1968.<br />
• Gaëtan Picon, Journal du surréalisme, Skira, Genève, 1976.<br />
• Pour la critique d’art, on évoquera les lectures de Clement Greenberg, Marcellin Pleynet,<br />
William S. Rubin , ainsi que René Passeron, José Vovelle et José Pierre.<br />
17
Pascal <strong>DE</strong>BAILLY et Florence DUMORA<br />
RIRE, PEUR ET AUTRES PASSIONS <strong>DE</strong> L’AGE CLASSIQUE<br />
Après avoir confronté sciences humaines et pensée classique sur le rire à propos du comique et<br />
du ridicule dans les Fables de La Fontaine puis dans certaines comédies de Molière, nous avons<br />
entamé une étude des rapports entre rire et peur. Celle-ci nous a conduits à explorer la place de<br />
la peur dans diverses hypothèses théoriques sur le rire, anciennes et contemporaines, mais aussi<br />
à jeter les bases d’une histoire de la peur elle-même, effet calculé de la représentation théâtrale,<br />
picturale, ou romanesque. La recherche a porté à la fois sur l’œuvre de Molière et sur les<br />
premiers dictionnaires et les traités des passions, ou sur la représentation du poltron, à partir<br />
notamment du personnage de Sosie.<br />
Nous élargirons cette année le domaine d’enquête à d’autres œuvres de l’âge classique pour<br />
constituer la peur sous ses aspects médicaux, moraux, et rhétoriques (le récit qui fait peur, le<br />
discours peureux, les liens entre la peur comique et l’effroi tragique, les grandes peurs<br />
collectives étudiées par Jean Delumeau, la crainte religieuse, etc.), et observer dans ses<br />
manifestations littéraires et philosophiques le passage d’une définition sociale et morale de la<br />
peur à une distinction psychologique dans le long terme entre peur et angoisse.<br />
Une bibliographie sera communiquée lors de la première séance.<br />
18
Daniel FONDANÈCHE<br />
LES PARALITTÉRATURES 5 :<br />
LES PARALITTERATURES ET L’UTILISATION DU TEMPS<br />
Après avoir examiné le temps du géomètre, du philosophe et de l’astrophysicien, nous<br />
verrons quelle utilisation du temps on va faire dans les paralittératures. L’uchronie est un jeu<br />
intellectuel sur le temps qui consiste à manipuler ce paradoxe fondamental : le voyage dans le<br />
temps est impossible, mais si je rencontre un voyageur temporel, c’est que ce type de voyage<br />
existe, or comme il est impossible, je ne peux rencontrer de voyageur temporel et pourtant…<br />
L’uchronie est le monde des univers parallèles. La dystopie va présenter un futur idéalement<br />
parfait, scientifiquement pensé pour être le meilleur possible pour l’homme, mais comme<br />
l’enfer est pavé de bonnes intentions, ce futur est une abomination. Dans la dystopie, l’avenir<br />
est obligatoirement plus beau hier. Quant au roman historique, qu’il emprunte une forme<br />
classique, sentimentale, policière ou rurale, c’est une façon de réécrire l’Histoire sous une forme<br />
plus ou moins fantasmée, dont les auteurs ne conservent que quelques éléments représentatifs,<br />
que quelques personnages « mondialement historiques » pour donner libre cours à la fiction<br />
narrative et reconstruire le temps de l’Histoire.<br />
Au-delà du temps même du récit, qui a son importance, le Temps s’est introduit dans les<br />
formes narratives pour donner naissance à des genres particuliers qui présentent quelques points<br />
communs.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Jacques Attali, Histoire du Temps, <strong>Paris</strong>, Le Livre de Poche, 1989, 318 p. (Biblio-Essais,<br />
n°4011).<br />
• Emile Borel, L’espace et le temps, <strong>Paris</strong>, Félix Alcan, 1939, 253 p.<br />
• Jean-Toussaint Desanti, Réflexions sur le temps : variations philosophiques, <strong>Paris</strong>, Le Livre de<br />
Poche, 1997, 154 p. (Biblio-Essais, n°4245).<br />
• Alban Gonord, Le Temps, <strong>Paris</strong>, Flammarion, 2001, 249 p. (GF-Corpus, n°3006).<br />
• Stephen W. Hawking, Brève histoire du temps, <strong>Paris</strong>, J’ai Lu, 1992, 228 p.<br />
• Louis Lavelle, Du temps et de l’éternité, <strong>Paris</strong>, Aubier-Montaigne, 1945, 572 p.<br />
• Rémy Lestienne, Les Fils du temps : causalité entropie et devenir, <strong>Paris</strong>, Presses du CNRS,<br />
1990,<br />
• 288 p.<br />
• Emmanuel Lévinas, La mort et le temps, <strong>Paris</strong>, Le Livre de Poche, 1992, 155 p. (Biblio-Essais,<br />
• n° 4148).<br />
• Jean Matricon et Julien Roumette, L’invention du temps, <strong>Paris</strong>, Presses Pocket/La Villette, 1991,<br />
• 127 p. (Explora, n° 12).<br />
19
QUELQUES EXEMPLES R OMANESQUES<br />
L’uchronie :<br />
• Stephen Baxter, Les Vaisseaux du temps.<br />
• Philip K. Dick, Le Maître du haut-château.<br />
• Keith Roberts, Pavane.<br />
• Norman Spinrad, Rêve de fer.<br />
La dystopie:<br />
• Ray Bradbury, Fahrenheit 451.<br />
• John Brunner, Tous à Zanzibar.<br />
• George Orwell, 1984.<br />
• Roger Zamiatine, Nous autres.<br />
Le roman historique :<br />
• Honoré de Balzac, Les Chouans.<br />
• Prosper Mérimée, La Chronique du règne de Charles IX.<br />
• Walter Scott, Waverley.<br />
• Alfred de Vigny, Cinq Mars.<br />
20
Claude MURCIA<br />
LITTERATURE ET CINEMA<br />
Ce séminaire se propose d’engager une réflexion sur les rapports de toutes sortes<br />
qu’entretiennent la littérature et le cinéma au cours du XXe siècle. La problématique de<br />
l’adaptation cinématographique – ou de la réécriture – fera l’objet de plusieurs séances (en<br />
collaboration avec des enseignants de littérature).<br />
Seront également interrogées certaines modalités de l’inscription du cinéma dans la littérature<br />
contemporaine (Manuel Puig, Tanguy Viel…).<br />
TEXTES<br />
• Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain, éd. De Minuit, (sous réserve).<br />
• John Lvoff, La salle de bain, (film), (sous réserve).<br />
• Manuel Puig, Le baiser de la femme-araignée, Points Seuil.<br />
• Tanguy Viel, Cinéma, éd. Minuit.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• André Gaudreault, Du littéraire au filmique, Système du récit, Méridiens Klincksieck, 1988.<br />
• Jean-Marie Clerc, Littérature et cinéma, Nathan, 1993.<br />
• Christian Metz, Le signifiant imaginaire, 10/18.<br />
(La bibliographie sera complétée au début des cours)<br />
21
Jacqueline NACACHE<br />
ESTHETIQUE HOLLYWOODIENNE<br />
Objet de passion et de culte à la grande époque de la cinéphilie française, le cinéma<br />
hollywoodien classique est désormais un fertile terrain d’investigation universitaire, traversé par<br />
toutes les tendances de la recherche. Pour aborder le vaste champ que constituent trente ans de<br />
classicisme hollywoodien, ce séminaire se propose de remettre l’esthétique à l’honneur, dans un<br />
faisceau d’approches visant à proposer l’idée d’une théorie hollywoodienne. Théorie implicite,<br />
presque invisible, qui ne s’est pas élaborée pour l’essentiel dans des textes, mais dans des actes,<br />
des pratiques, au fil des films eux-mêmes, le tout dans le cadre du laboratoire grandeur nature<br />
qu’a constitué l’âge d’or du studio system.<br />
Seront abordés, entre autres, les thèmes suivants :<br />
- Le cinéma hollywoodien comme apprentissage : sources savantes et formes populaires<br />
- Technologie et images mentales : Hollywood et la représentation des rêves<br />
- La narrativité en question : l’ellipse et la maîtrise du temps<br />
- Hollywood et le travail de la mémoire : poétique du remake<br />
- L’acteur hollywoodien, une épopée du geste<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Jean-Loup Bourget, Hollywood, la norme et la marge, Nathan-Cinéma, 1998.<br />
• Marc Cerisuelo, Hollywood à l’écran, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000.<br />
• Jean-Pierre Moussaron et Jean-Baptiste Thoret (dir.), Why Not ? Sur le cinéma américain Rouge<br />
Profond, 2002.<br />
• Jacqueline Nacache, Hollywood, l’ellipse et l’infilmé, L’Harmattan, « Champs Visuels », 2001<br />
• Dominique Sipière (dir.), « Cinéma américain et théories françaises : images critiques croisées »<br />
Revue française d’études américaines, n°88, mars 2001<br />
22
Jean VIGNES<br />
LA CITE <strong>DE</strong>S MUSES : ENGAGEMENT ET<br />
MISSIONS DU POETE A LA RENAISSANCE<br />
Au XVIe siècle, presque toutes les pratiques littéraires semblent chercher leur légitimité —<br />
sociale, politique, voire religieuse — dans l’utilité qu’elles revendiquent ou qu’on leur prête.<br />
Les poètes de la Renaissance, soucieux de profiter à la collectivité, de remplir avec civisme une<br />
mission d’instruction et d’édification, considèrent cette contribution à l’ordre de la Cité comme<br />
l’une des justifications les plus nobles de leur vocation. On le montrera d’abord à travers<br />
quelques textes théoriques de l’époque humaniste. Le poète se donne notamment pour mission<br />
la célébration et l’immortalisation de la dynastie, la glorification du destin national à travers la<br />
narration épique, mais aussi la transmission didactique de préceptes religieux, moraux ou<br />
politiques, et notamment la formation d’un prince digne de ses prérogatives. En cas de conflit, il<br />
épouse la cause de son protecteur, et met sa plume au service de ses idéaux : la poésie se fait<br />
alors arme de combat, au risque de frayer avec le pamphlet. Comment cet engagement s’exercet-il<br />
dans les textes poétiques? Quels genres paraissent les plus efficaces? Et peut-on transgresser<br />
l’impératif d’utilité? Les textes de Marot, Du Bellay, Ronsard, Baïf, Du Bartas, d’Aubigné<br />
(pour ne citer qu’eux) proposent des réponses complémentaires et parfois contrastées.<br />
24
Littérature<br />
et<br />
histoire culturelle<br />
•<br />
25
Bernadette BRICOUT<br />
LE QUOTIDIEN MERVEILLEUX<br />
La fréquentation des contes comme celle des petits genres de la littérature orale (devinettes,<br />
proverbes, formulettes et comptines) nous conduit à porter sur notre environnement familier un<br />
regard différent. L’objet le plus humble qui soit se trouve par le prisme du conte investi d’une<br />
densité singulière , d’une dimension poétique qui souvent nous échappe dans la vie quotidienne.<br />
Les contes merveilleux évoquent le langage obscur que les pierres, les plantes et les animaux<br />
parlent mais dont l’homme a perdu la clef. C’est ce langage que nous nous attacherons à<br />
décrypter en interrogeant les textes oraux mais aussi le « tissu de gestes, de coutumes, de<br />
croyances dont le quotidien de la société qui raconte est, selon le mot de Daniel Fabre,<br />
invisiblement tissé ».<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Joan Amades, L’origine des bêtes. GARAE/Hésiode, 1988 ; Des étoiles aux plantes,<br />
GARAE/Hésiode, 1994.<br />
• Nicole Belmont, Les Signes de la naissance, Plon, 1971 ; Mythes et croyances dans l’ancienne<br />
France, Flammarion, 1973 ; Poétique du conte, Gallimard, 1999.<br />
• Bernadette Bricout, Le savoir et la saveur. Henri Pourrat et le Trésor des contes, Gallimard,<br />
coll. « Bibliothèqes des idées, 1992.<br />
• François Flahault, La pensée des contes, Anthropos, coll. « Psychanalyse » 2001 (nouvelle<br />
édition refondue de L’interprétation des contes.)<br />
• Angelo de Gubernatis, Lq Mythologie des plantes, Connaissance et Mémoires européennes, 1996<br />
(reprise de l’édition de 1878<br />
• Jean-Claude Kaufmann, La trame conjugale, L’analyse du couple par son linge, Nathan, 1992,<br />
Pocket, coll. Agora, 1997, Le cœur à l’ouvrage, Théorie de l’action ménagère, Nathan, coll. « Essais<br />
et Recherches », 1997.<br />
• Eloïse Mozzani, Le livre des superstitions, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1995.<br />
• Anne Muxel, Individu et mémoire familiale, Nathan, coll. « Essais et Recherches », 1996<br />
• Jean-Marie Pelt, Les langages secrets de la nature, Fayard, 1997.<br />
• Yvonne Verdier, Façons de dire, Façons de faire, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences<br />
humaines, 1979 ; Coutumes et destin, Thomas Hardy et autres essais, Gallimard, coll. « Bibliothèque<br />
des sciences humaines », 1995<br />
Le séminaire se tiendra au Musée National des Arts et Traditions Populaires dans le Petit<br />
Auditorium, 11 e étage (5, Avenue du Mahatma Gandhi - 75016 <strong>Paris</strong> ; métro : Sablons).<br />
26
Marc BUFFAT<br />
RECHERCHES SUR L'EPISTOLAIRE : LA LETTRE D'AMOUR<br />
Littérature et affect<br />
Se situant à la confluence de l'écriture et du vécu de l'amour, les correspondances amoureuses<br />
offrent deux intérêts majeurs :<br />
— Quant à la réflexion sur l'épistolaire d'abord. A la différence d'autres formes de<br />
"discours personnel" (autobiographie, journal intime), la lettre à la fois constitue et expose une<br />
relation, un lien. On peut donc soutenir sans paradoxe que la correspondance amoureuse<br />
constitue la forme accomplie de l'échange épistolaire et que la lettre d'amour est la lettre par<br />
excellence.<br />
— Plus largement la lettre d'amour pose la question de l'intensité (émotive, affective,<br />
passionnelle) d'un texte. On suggèrera que celle-ci ne réside pas dans son contenu, mais dans<br />
son style : c'est en tant qu'il est "littéraire" qu'un discours véhicule de l'affect.<br />
Nous envisagerons d'abord brièvement les questions suscitées par la lettre d'amour :<br />
(spontanée ou travaillée ? naturelle ou codifiée ? sincère ou nécessairement mensongère ? etc.),<br />
ainsi que les codifications qu'en proposent rhétoriques et poétiques. Puis nous parcourrons<br />
quelques grandes correspondances amoureuses en les regroupant autour de trois textes sur<br />
lesquels nous nous arrêterons plus particulièrement<br />
Denis <strong>Diderot</strong>, Lettres à Sophie Volland (Gallimard, Folio, 1984).<br />
Alfred de Musset – George Sand, Le roman de Venise (Actes Sud, Babel, 1999).<br />
Guillaume Apollinaire, Lettres à Lou (Gallimard, L'imaginaire, 2000).<br />
BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTIVE<br />
Ce séminaire poursuit la réflexion amorcée dans le n°24 de Textuel ("La lettre d'amour", 1992, dir. J. L.<br />
Diaz) auquel les étudiants sont invités à se reporter.<br />
• Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1977.<br />
• Bernard Bray, L'art de la lettre amoureuse. Des manuels aux romans (1550-1700). La Haye-<strong>Paris</strong>,<br />
Mouton, 1967.<br />
• Roger Duchêne, Réalité vécue et art épistolaire. Mme de Sévigné et la lettre d'amour.<br />
• Jean-Louis Flandrin, Le Sexe et l'Occident, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1981.<br />
• Julia Kristeva, Histoires d'amour, <strong>Paris</strong>, Denoël, 1983.<br />
• Denis de Rougemont, L'Amour et l'Occident, <strong>Paris</strong>, coll. 10/18, 1972.<br />
• Les mythes de l'amour, <strong>Paris</strong>, Plon, 1967.<br />
27
Anny DAYAN ROSENMAN<br />
TÉMOIGNAGE, FICTION, VÉRITÉ <strong>DE</strong> LA LITTÉRATURE.<br />
Si Primo Levi fait état de la nostalgie d’un témoignage qui laisserait les choses se raconter<br />
d’elles-mêmes, Robert Antelme, acquiert très vite la conviction que c’est seulement par le choix,<br />
qui implique la décision consciente d’une mise en forme, qu’il lui sera possible de tenter la<br />
transmission de son expérience. Point de vue qui sera repris, analysé, argumenté par Georges<br />
Perec dans un article intitulé Antelme ou la vérité de la littérature.<br />
Dans le cadre du séminaire nous interrogerons la capacité de certaines œuvres de témoignage à<br />
rendre compte des grands désastres du XX°siècle, en une écriture qui se construit dans une<br />
tension constante entre expérience individuelle et destin collectif, entre langage et silence ,<br />
entre ce qui apparaît chez Piotr Rawicz comme haine de la littérature et le recours obligé à une<br />
écriture maîtrisée mais en quête de nouvelles formes.<br />
L’an dernier, nous nous étions essentiellement centrés sur la notion de médiation. Cette année,<br />
nous nous proposons de mettre en rapport cette écriture de témoignage au premier degré , celle<br />
des témoins rescapés, et l’écriture de ceux qui, tels Vercors, Perec, Schwarz-Bart ou Modiano,<br />
sans avoir été présents aux événements, ont choisi d’en témoigner dans des œuvres que l’on<br />
peut parfois aussi bien qualifier de fictions que de témoignages seconds. Nous tenterons de<br />
cerner la force et la complexité de ces enjeux de transmission de même que ce qui s’écrit de<br />
l’intime dans ces reconstructions de l’Histoire.<br />
TEXTES<br />
• Robert Antelme, L’espèce humaine, Gallimard, 1957.<br />
• Elie Wiesel, La nuit, Ed de Minuit, 1959.<br />
• Primo Levi, Si c’est un homme, Julliard, 1987.<br />
• Pierre Gascar, Le temps des morts, Gallimard, 1953.<br />
• Vercors, Le Songe in Le silence de la mer, Ed de Minuit puis Ed de poche.<br />
• André Schwarz-Bart, Le dernier des Justes, Ed du Seuil, 1959.<br />
• Patrick Modiano, Dora Bruder , Gallimard, 1997.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Nicolas Abraham et Maria Törok, L’écorce et le noyau (cf La crypte au sein du moi)<br />
Flammarion, 1987.<br />
• Théodore Adorno, Notes sur la littérature, Flammarion, 1984.<br />
• Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, Gallimard 1980.<br />
• Alain Parreau, Ecrire les camps , Belin 1995.<br />
• Sous la direction de Annette Wieviorka et de Claude Mouchard, La Shoah, témoignages,<br />
savoirs, œuvres, Presses Universitaires de Vincennes, 1998.<br />
• La Shoah dans la littérature française, Revue d’Histoire de la Shoah, n°176, septembre-décembre<br />
2002.<br />
28
Pierre-Marc <strong>DE</strong> BIASI, Irène FENOGLIO<br />
INTRODUCTION A LA GENETIQUE DU TEXTE<br />
Les manuscrits de travail des écrivains permettent de suivre les différentes étapes de<br />
l’élaboration d’une œuvre. À partir de ces archives se développe une approche génétique de la<br />
littérature et du texte en général qui a pour objectif l’analyse des processus d’écriture autant<br />
qu’une relecture de l’œuvre achevée.<br />
Ce séminaire se propose d'étudier les fondements théoriques de cette approche, d’en illustrer la<br />
productivité par des exemples concrets et de fournir des outils pratiques pour la lecture des<br />
manuscrits : constitution du corpus, description de ses pièces, méthodes de classement et de<br />
transcription, axes interprétatifs, édition traditionnelle ou hypertextuelle.<br />
Plusieurs séances seront consacrées à la genèse de l’œuvre de Flaubert et à la genèse des textes<br />
autobiographiques d’Althusser. Seront également étudiés des manuscrits de Balzac, Stendhal,<br />
Zola, Hugo, Sartre, Barthes, Jabès, Chedid, N. Huston, P. Quignard. Deux séances spéciales<br />
organisées, l’une au Département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France et<br />
l’autre à l’IMEC (Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine), permettront de découvrir les<br />
documents originaux.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, PUF, 1994.<br />
• Michel Contat et Daniel Ferrer, Pourquoi la critique génétique ? Méthodes, théories, éd. du CNRS,<br />
1998.<br />
• Pierre-Marc De Biasi, La génétique des textes, Nathan, 2000.<br />
• Irène Fenoglio et Sabine Boucheron-Pétillon, Langages 103, Processus d’écriture et marques<br />
linguistiques. Nouvelles recherches en génétique du texte, 2002.<br />
• Irène Fenoglio, Langage et Société, n° 103<br />
Ecritures en acte et Genèse du texte, <strong>Paris</strong>, MSH, mars 2003.<br />
• Revue Genesis, éd. Jean-Michel Place, 18 numéros.<br />
29
Jean <strong>DE</strong>LABROY<br />
GENEALOGIES DU POUVOIR VI<br />
William Shakespeare ( et J. Fletcher)<br />
Tout est vrai (Henri VIII)<br />
Le terme mis naguère à l’étude des chroniques avait été l’occasion d’ouvrir avec The Tempest le<br />
dossier compliqué des dernières pièces de Shakespeare. Henri VIII offre l’opportunité de croiser<br />
les deux fils, à la fois « history » ultime ou supplémentaire après les deux tétralogies et oeuvre<br />
parente à bien des égards des enjeux des « dark comedies ». Henri VIII propose certes mais<br />
aussi dépasse l’intérêt d’une pièce de circonstance, célébration élizabéthaine à grand spectacle.<br />
L’abréviation des données historiques, coutumière au dramaturge, permet le questionnement des<br />
mutations par lesquelles passe le pouvoir et surtout des différents points de vue à l’invention<br />
desquels ces mutations obligent. Nécessité et liberté, ambition et vertu, engagement et vanité<br />
sont ici ordonnées pour la dernière fois comme s’il s’agissait avec une sorte de festivité grave et<br />
lucide de récapituler la légende du pouvoir politique. Au-delà c’est l’achèvement qui met son<br />
inquiétude au cœur même de la virtuosité dramatique : tentation et mirage de l’œuvre des<br />
hommes, non pas seulement agir mais finir, que quelque chose enfin puisse être dit avoir été<br />
arraché au trouble de nos histoires sublunaires.<br />
Œuvres complètes de William Shakespeare, Histoires II, Robert Laffont, coll.« Bouquins ».<br />
30
Éric MARTY<br />
POLITIQUE <strong>DE</strong> LA POESIE<br />
Ce cours de <strong>DE</strong>A vise à examiner la récurrence des investissements politiques de la poésie ou<br />
des poètes sur une période précise qui va de la Commune de <strong>Paris</strong> jusqu’à la fin de la Seconde<br />
Guerre mondiale, de Rimbaud à René Char, pourrait-on dire. Nous essaierons de comprendre en<br />
quoi les « engagements », les rétractations ou les retraits opérés par les poètes ne sont pas ou<br />
n’ont pas été seulement des attitudes « intellectuelles » mais avant tout des propositions qui ont<br />
impliqué la poésie comme telle et ont concerné l’essence même de la parole poétique.<br />
TEXTES PRINCIPAUX<br />
• Arthur Rimbaud, Poésies, Une saison en enfer, Illuminations. (Cette lecture de Rimbaud sera<br />
accompagnée par la lecture d’un certain nombre de textes de Baudelaire et Mallarmé.) Guillaume<br />
Apollinaire : Œuvres poétiques, Alcools et Calligrammes.<br />
• André Breton : Manifestes du surréalisme (1924-1930). L’œuvre poétique de Breton et des<br />
surréalistes entre 1924 et 1937.<br />
• René Char : Fureur et Mystère.<br />
• D’autres textes seront évidemment cités (Artaud, Aragon, Césaire, Mandelstam.)<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Une bibliographie sera distribuée au début du cours.<br />
31
Pierre PACHET<br />
SOUS LA CO-RESPONSABILITE <strong>DE</strong> PATRICK HOCHART<br />
"CRITIQUE SENTIMENTALE"<br />
Sans considération de méthode et sans privilégier d'autre point de vue que l'intérêt, le goût, la<br />
curiosité ou l'émotion, on s'intéressera à diverses œuvres ou à des auteurs d'époques diverses,<br />
ou à des questions qui mettent en jeu la littérature sans être nécessairement des questions<br />
littéraires. Parmi les sujets envisagés en 2003-2004 : l’œuvre de l’essayiste et poète Benjamin<br />
Fondane, littérature et pensée libertaire (Orwell, Simone Weil, Stig Dagerman), L’Europe de<br />
l’Est littéraire, Le sommeil selon Proust, La représentation du monde des morts, Poésie<br />
française et poésie anglaise, Actualité de la psychologie des philosophes classiques (Descartes,<br />
Spinoza, Hobbes, Malebranche, Maine de Biran, etc.). Le programme sera précisé au cours de<br />
l’été. Vous pourrez en être informé, ainsi que du programme précis de chaque séance, en<br />
communiquant votre adresse e-mail à pierrepachet@noos.fr.<br />
Les séances, mensuelles, dureront 3 heures (et non 2 comme l’an passé) ce qui permettra à des<br />
intervenants extérieurs, amateurs ou spécialistes, de présenter des exposés structurés. La<br />
validation de la participation au séminaire par les étudiants sera assurée par la rédaction d’un<br />
essai touchant à l’une des questions envisagées, après accord d’un des deux enseignants.<br />
32
Anne PAUPERT<br />
LA PAROLE AU FEMININ<br />
DANS LA LITTERATURE FRANÇAISE DU MOYEN AGE :<br />
VOIX DIDACTIQUES ET SATIRIQUES.<br />
Rares sont les voix de femmes dont les manuscrits médiévaux nous ont directement<br />
transmis l’écho : entre Marie de France au XIIe siècle (« Oëz, seignurs, que dit Marie ! ») et<br />
Christine de Pizan au tout début du XVe siècle, se targuant d’avoir composé « choses nouvelles<br />
venues de sentement de femme », on compte quelques femmes poètes (« trobairitz » de langue<br />
d’oc ou femmes trouvères de langue d’oïl), quelques mystiques ou intellectuelles (mais qui,<br />
comme Héloïse, se sont presque toujours exprimées en latin)… Ces œuvres peu nombreuses<br />
sont néanmoins de la plus grande importance dans l’histoire de la littérature française.<br />
Par ailleurs, de nombreuses voix féminines se font entendre dans la littérature en<br />
« langue vulgaire » (c’est-à-dire en français) : voix amoureuses ou malheureuses des héroïnes<br />
des romans courtois, caquets des devisantes des Évangiles des Quenouilles ou sages propos des<br />
matrones… La parole des femmes, qu’elles soient réduites au silence ou coupables de trop<br />
parler, apparaît souvent problématique. C’est souvent autour d’elle que se cristallisent les<br />
interrogations sur la place et le statut de la femme dans la littérature et la culture médiévales.<br />
Ce séminaire est le deuxième volet de l’étude entreprise l’an dernier, où ont été<br />
abordées l’œuvre de Marie de France, des mises en scène romanesques de voix féminines et<br />
diverses voix lyriques au féminin. Nous nous attacherons cette année à deux autres aspects de la<br />
même problématique, dans des œuvres datant pour l’essentiel de la fin du Moyen Âge.1.<br />
Discours au féminin et discours sur les femmes : la voix didactique de Christine de Pizan ; 2. La<br />
parole en excès : le courant satirique.<br />
TEXTES<br />
• Œuvres de Christine de Pizan :<br />
• La Cité des Dames (Stock / Moyen Age, traduction en français moderne par E. Hicks et T.<br />
Moreau)<br />
• Le livre de l’advision Cristine (éd. L. Dulac et C. Reno, Champion ; traduction en français<br />
moderne par A. Paupert, à paraître dans Le Moyen Age et la femme : voix poétiques, utopiques et<br />
amoureuses, Robert Laffont, coll. « Bouquins »).<br />
• Le Livre des Trois Vertus (éd. C. Cannon-Willard, Champion ; traduction en français moderne<br />
par L. Dulac, à paraître dans Le Moyen Age et la Femme…)<br />
• Les Quinze joies de mariage (texte anonyme de la fin du XIVe-début du XVe siècle ; éd. J.<br />
Rychner, Droz, Textes Littéraires français ; traduction en français moderne par M. Santucci,<br />
Stock/Moyen Age).<br />
• Les Evangiles des Quenouilles (éd. Madeleine Jeay, Vrin ; traduction par A. Paupert, à paraître<br />
dans Le Moyen Age et la femme…).<br />
D’autres textes ou extraits seront distribués aux étudiants.<br />
33
Paule PETITIER, Guy ROSA<br />
THEOPHILE GAUTIER<br />
L'approche maintenant la plus fréquente des oeuvres littéraires examine un corpus à<br />
partir d’une forme, d'un thème ou d'un problème. Rompant avec les désuètes études de “ la vie<br />
et de l'œuvre ” d'un auteur, cette façon de procéder met en lumière l'historicité des genres, des<br />
motifs et des sujets (convergence autour de l'un d'eux à une période donnée, réécriture dans la<br />
durée où ils évoluent). La puissance de la littérature apparaît dans la capacité qui lui est ainsi<br />
prêtée de configurer des représentations et de construire des questions. La fécondité de cette<br />
démarche ne dispense pourtant pas de se demander quels sont les aspects de la pratique littéraire<br />
qu'elle laisse de côté. Forcément sélective, elle conduit rarement à s'interroger, par exemple, sur<br />
l'ensemble de la production d'un auteur, sa cohérence ou ses lignes de fracture, sur le trajet d'une<br />
vie-œuvre, sur les choix existentiels dont il procède, sur l'évolution d'une production dans le<br />
contexte historique, idéologique, commercial et esthétique qui la sous-tend, enfin sur la<br />
constitution d'une figure d’auteur et sur son rôle dans la littérature. Théophile Gautier offre un<br />
bon terrain pour tenter l'expérience d’une telle analyse. Son œuvre abondante (romans,<br />
nouvelles, récits de voyage, poésie, critique d'art, histoire de la littérature…) se caractérise par<br />
son inégal intérêt. On y distingue volontiers les productions alimentaires (pour la presse) des<br />
œuvres nobles, saluées par ses contemporains et reconnues comme des jalons de l'histoire<br />
littéraire (Mademoiselle de Maupin, Émaux et camées), tandis qu'une autre partie a longtemps<br />
été déclassée en classiques pour enfants (Le Capitaine Fracasse, Le Roman de la momie).<br />
Penser le caractère disparate de cette œuvre — alors que la plupart des auteurs du XIX e siècle<br />
mettent en avant l'unité, voire l'organicité, de la leur — constitue une première gageure. Une<br />
autre sera de voir comment se combinent, pour ses contemporains et pour nous, la figure du<br />
grand artiste, du "poëte impeccable" et celle de l'amuseur désabusé, qui proclame à mots à peine<br />
couverts la gratuité vaine de l'acte d'écrire. Gautier, icône du romantisme ? image de son échec,<br />
de ses renoncements ? auteur "réaliste" (trop conscient des réalités de la condition de l'écrivain)<br />
? inventeur de la Littérature et de l'Art ? génie (en) creux, qui programme en quelque sorte son<br />
ratage ?<br />
Le séminaire tentera de découvrir des parcours, des axes et des contradictions significatifs à<br />
travers l'exploration aussi large que possible de l'œuvre de cet auteur. Avec un brin d'optimisme<br />
on dirait, à la manière du XIX e siècle, qu'il s'agira de trouver la "formule" de Gautier.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Théophile Gautier, Œuvres, coll. "Bouquins", Robert Laffont.<br />
• Théophile Gautier, Œuvres, "Pléiade", Gallimard.<br />
34
Guiomar HAUTCOEUR, Régis SALADO<br />
« L’INVENTION <strong>DE</strong>S FORMES ROMANESQUES<br />
A L’EPOQUE MO<strong>DE</strong>RNE »(IV) : L’ECRITURE <strong>DE</strong> LA VOIX<br />
L’inscription de la voix dans le roman a une histoire, qui croise celle de l’affirmation de<br />
l’individu et de sa singularité. Dans le roman pastoral et le roman héroïque, le cours de<br />
l’intrigue est interrompu par des récits qui font entendre des voix exprimant une axiologie<br />
amoureuse ou morale spécifique. Face à cette tradition romanesque, le roman picaresque, le<br />
roman épistolaire et le roman-mémoire sont le lieu d’émergence d’une « voix-vision du<br />
monde » par laquelle se constitue la subjectivité dans le roman. Si l’autonomisation de la voix<br />
semble se poursuivre dans certains textes narratifs du XIXème et du XXème siècles, selon un<br />
mouvement qui donne pleinement droit de cité au langage du personnage de fiction, l’écriture<br />
de la voix peut également travailler à dissoudre les fondements mêmes du romanesque. C’est<br />
notamment le cas dans des textes où se donne à lire, et à entendre, une parole que n’encadre<br />
plus aucune instance narrative extérieure à la voix du personnage.<br />
TEXTES <strong>DE</strong> REFERENCES<br />
• Un dossier de textes comprenant des extraits significatifs des œuvres suivantes sera distribué lors<br />
de la première séance du séminaire.<br />
• L’Astrée d’Honoré d’Urfé, Clélie de Mademoiselle de Scudéry, des romans picaresques<br />
espagnols. Histoire de Clarisse Harlowe de Richardson, Histoire d’une grecque moderne de l’abbé<br />
Prévost.<br />
• Carnets du sous-sol, de Dostoïevski, Les lauriers sont coupés d’Édouard Dujardin, monologue<br />
de Molly Bloom dans Ulysses de James Joyce, Amants, heureux amants... de Valery Larbaud,<br />
Tandis que j’agonise de William Faulkner, L’Innommable de Samuel Beckett, L’Inquisitoire de<br />
Robert Pinget.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Mikhaïl Bakhtine: Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978.<br />
• Dorrit COHN : la transparence intérieure, seuil, 1982.<br />
• René Démoris: Le roman à la première personne: du classicisme aux Lumières, <strong>Paris</strong>, Armand<br />
Colin, 1975.<br />
• Vincent Jouve: L’effet-personnage dans le roman, PUF, 1992.<br />
• Jean-Pierre Martin: La Bande sonore, José Corti, 1998.<br />
• Sophie Rabau : Fictions de présence: la narration orale dans le texte romanesque du roman<br />
antique au XXe siècle, <strong>Paris</strong>, Champion, 2000.<br />
• Jean Rousset : Narcisse romancier. Essai sur la première personne dans le roman, <strong>Paris</strong>, José<br />
Corti, 1986.<br />
35
Annie RENONCIAT<br />
LIVRE/IMAGE/EDITION POUR LA JEUNESSE<br />
La création graphique dans l'édition pour la jeunesse a déployé au cours des siècles un<br />
large éventail d'ambitions, depuis la visée pragmatique – didactique, éducative, persuasive ou<br />
distractive – jusqu'à la "pure" expression artistique qui se veut dégagée de toute visée utilitaire.<br />
L'exploration des coulisses de la création fait apparaître que, dans tous les cas, le travail de<br />
l'illustrateur – choix du sujet, de la technique, de la forme, du style – est étroitement lié à ce<br />
destinataire spécifique qu'est l'enfant, ou, plus exactement aux représentations dominantes qu'en<br />
forgent les sociétés. Dans le sillon du colloque sur "L'image pour enfants : pratiques, normes,<br />
discours", qui s'est tenu à <strong>Paris</strong> 7 en décembre 2000, le séminaire continuera d'explorer les<br />
formes, les normes, les usages, le statut pédagogique, artistique, épistémologique des images<br />
dans différents supports éditoriaux pour la jeunesse, depuis l'Ancien Régime jusqu'à l'époque<br />
contemporaine.<br />
Les séances, qui feront intervenir plusieurs spécialistes du domaine, porteront notamment<br />
sur l'illustration des ouvrages de fiction et des ouvrages pédagogiques dans les livres d'Ancien<br />
Régime ; l'image pour les apprentis-lecteurs au XIXe siècle , la pédagogie par l'image au XIXe<br />
siècle ; le concept "d'art pour l'enfant" ; les albums dits "artistiques" au XIXe siècle ; les images<br />
religieuses ; les images pour lanterne magique ; l'album à la croisée des arts du spectacle dans<br />
les années 1920, les livres "de peintres" pour la jeunesse dans l'entre-deux guerres ; les histoires<br />
en images "à la française" ; les supports d'images populaires aux XIXe et XXe siècles ; la<br />
révolution de l'image dans les années 1970 ; l'album contemporain.<br />
BIBLIOGRAPHIE GENERALE<br />
• Ségolène Le Men, Annie Renonciat, Livres d’enfants, livres d’images, 1848-1914, Les dossiers<br />
du Musée d’Orsay, n°35, Réunion des musées nationaux, <strong>Paris</strong>, 1989, 64 p.<br />
• Claude-Anne Parmegiani, Les Petits Français illustrés, 1860-1940, Éditions du Cercle de la<br />
Librairie, 1989, 304 p.<br />
• Jean Perrot, Carnets d'illustrateurs, Electre-Éditions du Cercle de la librairie, 2000.<br />
• Annie Renonciat dir., L’Image pour enfants : pratiques, normes, discours (France et pays<br />
francophones, XVIe-XXe siècles), numéro spécial de La Licorne, Université de Poitiers, 2003 (actes<br />
de colloque).<br />
36
Carine TREVISAN<br />
ECRIRE, FAIRE FACE<br />
On examinera des textes issus de sujets confrontés à des situations<br />
historiques ou sociales extrêmes (emprisonnement, guerre, déportation).<br />
Quelles sont les formes et les fonctions de ces textes, dont les auteurs<br />
ont moins le souci de faire une oe¦uvre littéraire que de témoigner, rendre<br />
hommage aux morts, souvent profanés ou laissés sans sépulture, ou encore<br />
résister aux entreprises de destruction de l'humain ?<br />
L'étude portera essentiellement sur les XIXe et XXe siècles.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
L'essentiel du corpus étant difficilement accessible, des extraits de<br />
textes seront distribués en cours.<br />
On peut néanmoins déjà consulter les textes suivants :<br />
• La dernière lettre. Prisons et condamnés de la Révolution, Olivier Blanc,<br />
• 1985.<br />
• Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, Le Livre de Poche, 1989.<br />
• La Dernière lettre écrite par des soldats français tombés au champ<br />
• d'honneur, Flammarion, 1922.<br />
• Jean Giono, Refus d'obéissance, Gallimard, Pléiade, 1989.<br />
• Dernières lettres de Stalingrad, Buchet-Chastel, 1994.<br />
• Michel Borwicz, Ecrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie, Folio, 1996.<br />
• Henri Calet, Les Murs de Fresnes, 1945, Viviane Hamy, 1993.<br />
Cette bibliographie n'est pas exhaustive.
Jean VIGNES<br />
LA CITE <strong>DE</strong>S MUSES : ENGAGEMENT ET<br />
MISSIONS DU POETE A LA RENAISSANCE<br />
Au XVIe siècle, presque toutes les pratiques littéraires semblent chercher leur légitimité —<br />
sociale, politique, voire religieuse — dans l’utilité qu’elles revendiquent ou qu’on leur prête.<br />
Les poètes de la Renaissance, soucieux de profiter à la collectivité, de remplir avec civisme une<br />
mission d’instruction et d’édification, considèrent cette contribution à l’ordre de la Cité comme<br />
l’une des justifications les plus nobles de leur vocation. On le montrera d’abord à travers<br />
quelques textes théoriques de l’époque humaniste. Le poète se donne notamment pour mission<br />
la célébration et l’immortalisation de la dynastie, la glorification du destin national à travers la<br />
narration épique, mais aussi la transmission didactique de préceptes religieux, moraux ou<br />
politiques, et notamment la formation d’un prince digne de ses prérogatives. En cas de conflit, il<br />
épouse la cause de son protecteur, et met sa plume au service de ses idéaux : la poésie se fait<br />
alors arme de combat, au risque de frayer avec le pamphlet. Comment cet engagement s’exercet-il<br />
dans les textes poétiques? Quels genres paraissent les plus efficaces? Et peut-on transgresser<br />
l’impératif d’utilité? Les textes de Marot, Du Bellay, Ronsard, Baïf, Du Bartas, d’Aubigné<br />
(pour ne citer qu’eux) proposent des réponses complémentaires et parfois contrastées.<br />
Une bibliographie sera proposée au début du séminaire.
Littérature,<br />
théorie littéraire<br />
et sciences humaines
Françoise ATLANI-VOISIN<br />
LINGUISTIQUE ET LITTERATURE<br />
Ce séminaire propose une réflexion linguistique sur la textualité, et tout particulièrement sur le<br />
texte littéraire. Après avoir défini la spécificité énonciative du texte à partir de l’analyse<br />
formelle du dialogue et de l’énonciation orale, on proposera différentes perspectives<br />
linguistiques qui pourraient permettre de construire une spécificité linguistique de l’écriture. En<br />
effet, grâce au travail singulier des variables linguistiques, par des principes énonciatifs<br />
appliqués à l’excès, la prose littéraire révèle des potentialités d’une langue qui, si elle se<br />
distingue dans sa manifestation de l’énonciation ordinaire, est une activité linguistique à part<br />
entière. La réflexion sera menée en prenant appui sur des textes littéraires du XXe siècle qui<br />
seront proposés en cours.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Jean-Michel Adam, Le style dans la langue, Delachaux & Niestlé.<br />
• Françoise Atlani, L’instance de la lettre, in La lettre entre réel et fiction, Sedes.<br />
• Françoise Atlani, Enonciation fictionnelle et constructions référentiele,. Langue française,<br />
décembre 2000.<br />
• Ann Banfield, Phrases sans paroles, Seuil.<br />
• Mikhaïl Bakhtine, Du discours romanesque, Esthétique et théorie du roman, Gallimard.<br />
• Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard/Tel, vol. 1 et 2.<br />
• Olivier Ducrot, Le dire et le dit.<br />
• Laurent Danon-Boileau, Produire le fictif, Klincksieck.<br />
• Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Seuil/Points et Six leçons sur le son et le<br />
sens.<br />
• Roman Jakobson, Questions de poétique, Seuil.<br />
• Revues : Langages, n° 118, Langue Française, n°120 et 128.<br />
40
Emmanuelle CAGNAC, Florence DUPONT<br />
QU’EST-CE QU’UN TEXTE <strong>DE</strong> THEATRE ?<br />
Aujourd’hui on présente souvent au théâtre des textes qui n’ont pas été écrits à destination de la<br />
scène. Pratique inconcevable dans l’antiquité grecque ou romaine. Si à Rome il existe bien des<br />
lectures publiques d’épopées, de discours oratoires, de poésies légères, - recitationes - celles-ci<br />
n’appartiennent pas à l’espace du théâtres (jeux scéniques). C’est du point de vue de l’Antiquité<br />
que nous poserons donc les questions : « Qu’est-ce qu’un texte de théâtre ? Qu’est-ce que la<br />
parole théâtrale ? Pourquoi l’énonciation théâtrale dans une culture donnée exige-t-elle ou non<br />
des énoncés spécifiques ? »<br />
On partira de la conception du decus (latin) - ou prepon (grec) qui préside à l’évaluation<br />
esthétique d’une énonciation poétique, et donc théâtrale, en fonction de son contexte rituel. Puis<br />
on regardera d’autres théâtres rituels (indiens et japonais) pour examiner la définition du texte<br />
dans la même perspective : la ritualité implique-t-elle l’énonciation d’un texte spécifique ? A<br />
l’occasion, on s’interrogera sur la possibilité de « reconnaître un texte de théâtre » à propos de<br />
textes anciens (égyptiens, arabes par exemple) dont on ignore tout ce que pouvait être leur<br />
contexte d’énonciation. Enfin on en viendra au théâtre contemporain : l’absence de ritualité<br />
dans le théâtre contemporain impose-t-elle qu’un texte de théâtre ait un autre but que celui seul<br />
de « faire du théâtre » et que par là il soit aussi un « texte à lire »? Ce qui par retour permettrait<br />
la mise en scène de textes non théâtraux ? Avec cette question finale : pourquoi mettre en scène<br />
des textes non destinés au théâtre ?<br />
LE LATIN ET LE GREC EN MAITRISE<br />
1 Préparation à la version latine d’agrégation.<br />
Les étudiants de maîtrise qui envisagent de passer le concours d’agrégation de lettres modernes<br />
en 2004-2005 doivent dès cette année se préparer à l’épreuve de version latine.<br />
Ils peuvent s’ils ont un bon niveau (licence groupe fort) suivre les cours de version latine pour<br />
l’agrégation et le CAPES (mercredi matin 9h-11h) cours hebdomadaire.<br />
Pour les autres est crée cette année un cours d’entraînement et de remise à niveau, de deux<br />
heures tous les quinze jours (mercredi 13h-15h)<br />
2. Préparation 0 la recherche<br />
les étudiants qui se destinent à la recherche (<strong>DE</strong>A puis thèse), tout spécialement ceux qui<br />
travaillent sur les littératures modernes ( 16 ème , 17 ème , 18 ème ) ou le moyen Age ont tout intérêt à<br />
suivre pour leur formation un cours de latin correspondant à leur niveau et/ou le cours d’histoire<br />
de la littérature latine destiné aux étudiant de CAPES (mercredi matin 11h-12h)<br />
ils peuvent aussi , dans le même esprit, suivre l’initiation au grec , 1 er ou 2d niveau.<br />
41
Évelyne GROSSMAN<br />
LA VÉRITÉ EST-ELLE UNE QUESTION LITTÉRAIRE ?<br />
(Littérature – philosophie)<br />
Hypothèse dont j’aimerais partir : tout un courant de la pensée moderne (où se croisent<br />
littérature, philosophie, psychanalyse) se définit comme une passion de l’interprétation à<br />
mesure même que semble perdue la croyance en la vérité, – une interprétation infinie<br />
s’exerçant à travers la langue et l’écriture.<br />
L’œuvre d’art travaille “là où la vérité manque”, dit Blanchot, dans l’entrelacs du oui et du non,<br />
“le reflux et le reflux de l’ambiguïté essentielle”. Cet “espace littéraire”, comme le nomme<br />
Blanchot, est proche de ceux qu’explorent Jacques Derrida au titre de la “déconstruction” ou<br />
Gilles Deleuze lorsqu’il définit le philosophe moderne comme un inventeur de concepts<br />
(“ pensée est création, non pas volonté de vérité ”).<br />
On sait les reproches qui ont pu être adressés, à tort ou à raison, à tel ou tel de ces discours :<br />
tentation du nihilisme, irresponsabilité politique, discours de l’équivalence généralisée, perte<br />
des “ valeurs ”, retrait mélancolique. Et pourtant, dans ces espaces d’écriture intenables,<br />
attentifs à l’impensé des discours de la vérité, à la fêlure des mots, à l’équivocité du sens, le vrai<br />
est ce qui pourra, peut-être, suggère Blanchot, “ avoir lieu ”, loin de toute pétrification en<br />
dogme, vérité révélée, corps de doctrine...<br />
On tentera d’explorer quelques-uns de ces espaces d’écriture (littéraires et philosophiques,<br />
indistinctement) à travers, entre autres, l’analyse d’extraits de textes de Blanchot et de Derrida<br />
(liste non limitative, au gré des suggestions et des recherches des participants). Des photocopies<br />
de ces extraits seront distribuées.<br />
REPERES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
• Maurice Blanchot, “ La littérature et l’expérience originelle ”, in L’Espace littéraire (1955), rééd.<br />
Folio-essais ; “ Réflexions sur le nihilisme ”, in L’Entretien infini, Gallimard1969 ; Écrits politiques<br />
(1958-1993), éd. Léo Sheer, 2003.<br />
• Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? Les Éditions de Minuit, 1991<br />
• Christian Delacampagne, “ La raison en question ” in Histoire de la philosophie au XXème siècle,<br />
Seuil, 1995.<br />
• Jacques Derrida, Circonfession (in Jacques Derrida par G. Bennington et J. Derrida, Seuil, “ Les<br />
Contemporains, 1991) ; “ Un ver à soie ” in Voiles, Galilée, 1998 ; Voyous, Galilée, 2003.<br />
• Michel Foucault, “ La pensée du dehors ” (1966), Dits et Écrits I, Quarto-Gallimard<br />
• Michel Guérin, La Terreur et la pitié, Actes Sud, 1990 ; Nihilisme et modernité (essai sur la<br />
sensibilité des époques modernes de <strong>Diderot</strong> à Duchamp), éditions Jacqueline Chambon, 2003.<br />
42
Richard LASZLO<br />
ECRITURE ET IMAGINAIRE LINGUISTIQUE<br />
A partir de textes très divers, pris aussi bien hors du champ littéraire (écrits de schizophrènes,<br />
« poésie naturelle », « art brut »…) que dans la littérature, on étudiera l'émergence, l’activité et<br />
les effets d’un imaginaire linguistique (transgressions syntaxiques et discursives, créations<br />
phonétiques, lexicales ou graphiques, langues inventées, glossolalie, verbigération, lipogramme,<br />
etc.) chez quelques auteurs contemporains (René Daumal, Henri Michaux, Jean Tardieu,<br />
Georges Perec).<br />
TEXTES ETUDIES<br />
• R. Daumal, Les Pouvoirs de la parole, Gallimard.<br />
• H. Michaux, L’Espace du dedans, Poésie/Gallimard.<br />
• J. Tardieu, Obscurité du jour, Skiraa.<br />
Le Fleuve caché, Poésie/Gallimard.<br />
L’Accent grave et l’accent aigu, Poésie/Gallimard.<br />
• G. Pérec, La Disparition, les lettres nouvelles.<br />
REPERES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
• G. Deleuze, Logique du sens, Minuit , 10/18.<br />
• A. Ehrenzweig, L’Ordre caché de l’art, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient ».<br />
• R. Gori, Le Corps et le signe dans l’acte de parole, Dunod.<br />
• J. Kristeva, La Révolution du langage poétique, Seuil.<br />
• A. Green, La Folieprivée – psychanalyse des cas-limites, Gallimard.<br />
• J. Oury, Création et schizophrénie.<br />
• M. Pierssens, La Tour de Babil, Minuit.<br />
• M. Yaguello, Les Fous du langage, Seuil.<br />
Alice au pays langage, Seuil.<br />
43
Vincent NYCKEES<br />
LE CHANGEMENT <strong>DE</strong> SENS :<br />
CONTINUITE OU DISCONTINUITE ?<br />
Rétrospectivement, tout changement de sens se signale comme une rupture : des énoncés qui<br />
auraient paru inadéquats à une certaine époque, dans tel type de situation, deviennent adéquats<br />
à une autre époque, dans le même type de situation, et inversement.<br />
L’irruption d’une telle discontinuité constitue en elle-même un paradoxe. Les significations se<br />
présentent en effet comme autant de « normes » intersubjectives, régissant l'emploi des signes –<br />
mots, morphèmes, structures – au sein des groupes linguistiques. Ces normes sont à la fois<br />
relativement efficaces et indéniablement puissantes (soustraites pour l’essentiel à la volonté<br />
individuelle). Comment expliquer dans ces conditions :<br />
- que l’évolution des significations ne paraisse pas compromettre leur (relative) adéquation<br />
fonctionnelle ?<br />
- que les contemporains des évolutions (et leurs promoteurs eux-mêmes...) n’en soient<br />
généralement pas conscients et qu’elles se produisent le plus souvent indépendamment de leur<br />
volonté ?<br />
Etudier le changement de sens, c’est d’abord mettre en oeuvre une méthode pour résoudre ce<br />
paradoxe.<br />
Nous nous proposerons au cours de ce séminaire de comparer et d’évaluer les principales<br />
stratégies mises en oeuvre dans les analyses du changement de sens, ce qui nous conduira à en<br />
présenter une typologie et à réfléchir à la place qu’il convient d’accorder aux différents types<br />
de facteurs invoqués dans la littérature : facteurs historiques, discursifs, cognitifs et<br />
intralinguistiques.<br />
Nous nous interrogerons chemin faisant sur les conditions que devrait satisfaire une théorie<br />
véritablement scientifique de l’évolution sémantique.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Emile Benveniste, 1966, « Problèmes sémantiques de la reconstruction », in Problèmes de<br />
linguistique générale, t.1, 289-307, <strong>Paris</strong>, Gallimard, 1966.<br />
• Michel Bréal, 1982 (1897) : Essai de sémantique, <strong>Paris</strong>, Gérard Montfort.<br />
• Arsène Darmesteter, 1979 (1887), La Vie des mots étudiée dans leurs significations, <strong>Paris</strong>,<br />
Champ Libre<br />
• Jacques François (éd.), 2000, Mémoires de la Société de Linguistique de <strong>Paris</strong> (IX), « Théories<br />
contemporaines du changement sémantique », Leuven, Peeters.<br />
• Christiane Marchello-Nizia, 1995, L’évolution du français, <strong>Paris</strong>, Armand Colin<br />
• Antoine Meillet, 1948 (1906), « Comment les mots changent de sens », in Linguistique<br />
historique et linguistique générale, <strong>Paris</strong>, Champion.<br />
• Vincent Nyckees, 1998, La sémantique, <strong>Paris</strong>, Belin.<br />
• Vincent Nyckees, à paraître, « Rien n’est sans raison : les bases d’une théorie continuiste de<br />
l’évolution sémantique », in D. Candel et F. Gaudin (éd.), Aspects diachroniques du vocabulaire,<br />
Presses Universitaires de Rouen, Dyalang.<br />
• Alain Rey (dir.), 1992, Dictionnaire historique de la langue française, <strong>Paris</strong>, Le Robert.<br />
• Ferdinand de Saussure, 1972, Cours de linguistique générale, <strong>Paris</strong>, Payot.<br />
• Ferdinand de Saussure, 2002, Ecrits de linguistique générale, <strong>Paris</strong>, Gallimard.<br />
• Eve Sweetser, 1990, From Etymology to Pragmatics, Cambridge, Cambridge University Press.<br />
• Stephen Ullmann, 1969, Précis de sémantique française, Berne, A. Francke.<br />
• Walther von Wartburg et Stephen Ullmann, 1969, Problèmes et méthodes de la linguistique,<br />
<strong>Paris</strong>, PUF.<br />
44
NATHALIE PIEGAY-GROS<br />
LE ROMANESQUE : REVER, CRITIQUER, RACONTER.<br />
Le roman, en particulier dans la tradition française, s’est défini contre le romanesque, qui serait<br />
à l’opposé du sens critique comme du souci réaliste. A rebours du roman qui pense et qui<br />
critique, le romanesque représenterait la tentation de la facilité (attachée au populaire, au nonlittéraire,<br />
au féminin…). Pourtant, il n’est pas l’apanage ambigu du seul roman : il investit<br />
d’autres types de discours.<br />
Le désir romanesque est non seulement une propension au merveilleux et au fantasme, mais<br />
aussi une élaboration imaginaire de la relation qu’un sujet entretient avec sa condition sociale. Il<br />
fraye avec l’utopie comme il frôle le poétique. Nous nous interrogerons donc sur la pensée qu’il<br />
élabore, sur les formes qu’il suscite (clichés, intrigue, discours psychologique…) ainsi que sur<br />
les lieux où il se développe (mélodrame, poésie, récit autobiographique ou historique, récit de<br />
cas… ).<br />
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES<br />
• Nous travaillerons sur différents extraits de romans (par exemple :<br />
• Cervantès, Don Quichotte ; Flaubert, Madame Bovary ; Victor Hugo, Les Misérables ; Balzac,<br />
La Cousine Bette, Marcel Proust, A la recherche du temps perdu ; Aragon, Le Paysan de <strong>Paris</strong>, Les<br />
Voyageurs de l’impériale ; Robert Pinget, Quelqu’un ; Michel Butor, La Modification ; Claude<br />
Simon, Les Géorgiques ; Jean, Echenoz, Je m’en vais) ainsi que sur des texte non fictionnels<br />
(Stendhal, Vie de Henri Brulard ; Sigmund Freud, Cinq psychanalyses ; Georges Duby, Le<br />
dimanche de Bouvines ; Aragon, Henri Matisse, roman ).<br />
ORIENTATIONS CRITIQUES<br />
• L’Atelier du roman, n° 6, 1996 ; 8 et 10, 1997.<br />
• Vincent Descombes, Proust, Philosophie du roman, Minuit, 1997.<br />
• René Girard, Mensonge romanesque, vérité romantique, Grasset, rééd. « Pluriel ».<br />
• Marthe Robert, Roman des origines, origines du roman, Gallimard, « Tel ».<br />
• Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, Gallimard, « Folio Essais ».<br />
• Schaeffer, Jean-Marie : “Le Romanesque”, publié le 14 octobre 2002, in Vox Poetica<br />
(www.vox-poetica.org/t/leromanesque.htm).<br />
• André Thibaudet, Essais sur le roman, Gallimard, 1938.<br />
45
Martin RUEFF<br />
LITTERATURE ET PHILOSOPHIE<br />
LA VOIX INTERIEURE COMME TECHNIQUE LITTERAIRE<br />
ET COMME PROBLEME PHILOSOPHIQUE<br />
Après avoir interrogé la relation de la littérature et de la philosophie à partir du destin<br />
littéraire de la phénoménologie, nous proposons d’approcher cette relation par l’examen d’un<br />
problème : la voix intérieure.<br />
La voix intérieure s’impose à l’évidence comme un paradoxe intime : par elle je me<br />
parle à moi- même dans l’immédiateté d’un monologue silencieux, et pourtant elle est bien un<br />
langage. Il faut donc que je l’aie appris et si je l’ai appris, je peux donc le tenir à autrui.<br />
Comment penser, alors, au cœur du sujet, cette forme tranquille et quotidienne d’étrangement ?<br />
Il faut tenter de la décrire et aussi de la voir à l’œuvre.<br />
On interrogera ainsi la notion de voix intérieure comme question de linguistique,<br />
comme problème philosophique, comme technique littéraire mais aussi comme enjeu<br />
existentiel.<br />
On suivra la problématique dans la constitution historique de sa traçabilité (avec Platon,<br />
Aristote et les stoïciens pour la philosophie antique, Augustin et la tradition médiévale jusqu’à<br />
Ockham, Descartes et Malebranche pour la philosophie classique). On accordera pourtant une<br />
attention particulière à la question de la voix intérieure dans la première moitié du XXe siècle.<br />
La technique littéraire du monologue intérieur (Desjardins et Joyce sont nommés pour<br />
l’exemple) et la fin supposée de l’intériorité dans la tradition du symbolisme furent<br />
contemporaines d’élaborations philosophiques de premier plan comme la critique<br />
wittgensteinienne du langage privé ou l’analytique de la voix de la conscience dans Etre et<br />
temps (§§ 56- 60).<br />
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES SOMMAIRES<br />
LITTERATURE SECONDAIRE<br />
• Banfield, A. Phrases sans parole, théorie du récit et du style indirect libre, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1995<br />
• Bouveresse, J., Le mythe de l’intériorité, Expérience, signification et langage privé chez<br />
Wittgenstein, <strong>Paris</strong>, Minuit, 1987<br />
• Chauvier, S., Dire Je, Essai sur la subjectivité, <strong>Paris</strong>, Vrin, 2001<br />
• Jenny, L., La fin de l’intériorité, <strong>Paris</strong>, P.U.F, 2002<br />
• Pannacio, C., Le discours intérieur de Platon à G. d’Ockham, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1999<br />
• Ricoeur, P., Soi même comme un autre, <strong>Paris</strong>, Seuil, 1990<br />
46
Bernard SICHERE<br />
LA JUSTICE<br />
Faire justice, se faire justice.<br />
Qu’en est-il de l’œuvre de justice ? Jusqu’où doit aller l’exigence de justice ?<br />
De la justice au pardon : le temps et la mémoire.<br />
Quel rapport entre l’idée de justice et l’idée de destinée et de vérité ?<br />
Comment se croisent ou peuvent se croiser l’exigence individuelle et<br />
l’exigence collective de justice .<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
• Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phénoménologie de l’esprit. Aubier, 2001.<br />
• Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique. Gallimard, coll.”Tel, 1980.<br />
• Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Gallimard, coll.”Folio Histoire”, 2002.<br />
FILMOGRAPHIE<br />
• Clint Eastwood, Joseph Wales hors la loi (1976).<br />
Unforgiven (1992).<br />
Sudden impact (1983).<br />
47