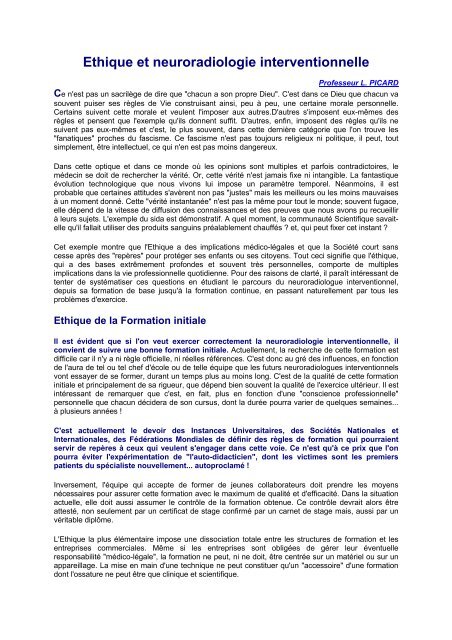Ethique et neuroradiologie interventionnelle
Ethique et neuroradiologie interventionnelle
Ethique et neuroradiologie interventionnelle
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Ethique</strong> <strong>et</strong> <strong>neuroradiologie</strong> <strong>interventionnelle</strong><br />
Professeur L. PICARD<br />
Ce n'est pas un sacrilège de dire que "chacun a son propre Dieu". C'est dans ce Dieu que chacun va<br />
souvent puiser ses règles de Vie construisant ainsi, peu à peu, une certaine morale personnelle.<br />
Certains suivent c<strong>et</strong>te morale <strong>et</strong> veulent l'imposer aux autres.D'autres s'imposent eux-mêmes des<br />
règles <strong>et</strong> pensent que l'exemple qu'ils donnent suffit. D'autres, enfin, imposent des règles qu'ils ne<br />
suivent pas eux-mêmes <strong>et</strong> c'est, le plus souvent, dans c<strong>et</strong>te dernière catégorie que l'on trouve les<br />
"fanatiques" proches du fascisme. Ce fascisme n'est pas toujours religieux ni politique, il peut, tout<br />
simplement, être intellectuel, ce qui n'en est pas moins dangereux.<br />
Dans c<strong>et</strong>te optique <strong>et</strong> dans ce monde où les opinions sont multiples <strong>et</strong> parfois contradictoires, le<br />
médecin se doit de rechercher la vérité. Or, c<strong>et</strong>te vérité n'est jamais fixe ni intangible. La fantastique<br />
évolution technologique que nous vivons lui impose un paramètre temporel. Néanmoins, il est<br />
probable que certaines attitudes s'avèrent non pas "justes" mais les meilleurs ou les moins mauvaises<br />
à un moment donné. C<strong>et</strong>te "vérité instantanée" n'est pas la même pour tout le monde; souvent fugace,<br />
elle dépend de la vitesse de diffusion des connaissances <strong>et</strong> des preuves que nous avons pu recueillir<br />
à leurs suj<strong>et</strong>s. L'exemple du sida est démonstratif. A quel moment, la communauté Scientifique savaitelle<br />
qu'il fallait utiliser des produits sanguins préalablement chauffés ? <strong>et</strong>, qui peut fixer c<strong>et</strong> instant ?<br />
C<strong>et</strong> exemple montre que l'<strong>Ethique</strong> a des implications médico-légales <strong>et</strong> que la Société court sans<br />
cesse après des "repères" pour protéger ses enfants ou ses citoyens. Tout ceci signifie que l'éthique,<br />
qui a des bases extrêmement profondes <strong>et</strong> souvent très personnelles, comporte de multiples<br />
implications dans la vie professionnelle quotidienne. Pour des raisons de clarté, il paraît intéressant de<br />
tenter de systématiser ces questions en étudiant le parcours du neuroradiologue interventionnel,<br />
depuis sa formation de base jusqu'à la formation continue, en passant naturellement par tous les<br />
problèmes d'exercice.<br />
<strong>Ethique</strong> de la Formation initiale<br />
Il est évident que si l'on veut exercer correctement la <strong>neuroradiologie</strong> <strong>interventionnelle</strong>, il<br />
convient de suivre une bonne formation initiale. Actuellement, la recherche de c<strong>et</strong>te formation est<br />
difficile car il n'y a ni règle officielle, ni réelles références. C'est donc au gré des influences, en fonction<br />
de l'aura de tel ou tel chef d'école ou de telle équipe que les futurs neuroradiologues interventionnels<br />
vont essayer de se former, durant un temps plus au moins long. C'est de la qualité de c<strong>et</strong>te formation<br />
initiale <strong>et</strong> principalement de sa rigueur, que dépend bien souvent la qualité de l'exercice ultérieur. Il est<br />
intéressant de remarquer que c'est, en fait, plus en fonction d'une "conscience professionnelle"<br />
personnelle que chacun décidera de son cursus, dont la durée pourra varier de quelques semaines...<br />
à plusieurs années !<br />
C'est actuellement le devoir des Instances Universitaires, des Sociétés Nationales <strong>et</strong><br />
Internationales, des Fédérations Mondiales de définir des règles de formation qui pourraient<br />
servir de repères à ceux qui veulent s'engager dans c<strong>et</strong>te voie. Ce n'est qu'à ce prix que l'on<br />
pourra éviter l'expérimentation de "l'auto-didacticien", dont les victimes sont les premiers<br />
patients du spécialiste nouvellement... autoproclamé !<br />
Inversement, l'équipe qui accepte de former de jeunes collaborateurs doit prendre les moyens<br />
nécessaires pour assurer c<strong>et</strong>te formation avec le maximum de qualité <strong>et</strong> d'efficacité. Dans la situation<br />
actuelle, elle doit aussi assumer le contrôle de la formation obtenue. Ce contrôle devrait alors être<br />
attesté, non seulement par un certificat de stage confirmé par un carn<strong>et</strong> de stage mais, aussi par un<br />
véritable diplôme.<br />
L'<strong>Ethique</strong> la plus élémentaire impose une dissociation totale entre les structures de formation <strong>et</strong> les<br />
entreprises commerciales. Même si les entreprises sont obligées de gérer leur éventuelle<br />
responsabilité "médico-légale", la formation ne peut, ni ne doit, être centrée sur un matériel ou sur un<br />
appareillage. La mise en main d'une technique ne peut constituer qu'un "accessoire" d'une formation<br />
dont l'ossature ne peut être que clinique <strong>et</strong> scientifique.
<strong>Ethique</strong> de l'exercice<br />
Une des bases de l'éthique de l'exercice de la <strong>neuroradiologie</strong> <strong>interventionnelle</strong> étant la<br />
compétence <strong>et</strong>, si celle ci est considérée comme acquise, ce sont ensuite les éléments<br />
relationnels avec les différents partenaires qui moduleront la qualité de c<strong>et</strong> exercice.<br />
En France, l'article 36 du Code de Déontologie demande aux médecins de s'entourer de tous les<br />
moyens nécessaires pour parvenir au diagnostic exact. Ceci nous impose d'utiliser les moyens<br />
nécessaires en hommes <strong>et</strong> en matériel, mais aussi, parfois, de solliciter d'autres avis si le problème<br />
posé est particulièrement complexe. C<strong>et</strong>te demande d'avis d'un spécialiste plus compétent, pratiquée<br />
de longue date, va avoir un développement de en plus important en raison de l'évolution de la<br />
téléradiologie qui pose, elle-même, ses problèmes spécifiques. Losqu'un avis est sollicité puis obtenu,<br />
qui sera responsable si l'avis est erroné <strong>et</strong> si les décisions qui en découlent ont des conséquences<br />
fâcheuses . Le problème n'est, pour le moment, pas résolu sur le plan législatif, mais la réflexion a<br />
déjà débuté; il apparaît en outre évident qu'en cas de problème, le magistrat prendra nécessairement<br />
en compte la démarche du médecin qui a sollicité l'avis d'un spécialiste plus compétent que lui dans<br />
un domaine donné.<br />
Une fois le diagnostic posé, il conviendra alors de discuter l'indication du traitement <strong>et</strong>, là encore, se<br />
posent de nombreux problèmes éthiques. Le choix de l'indication doit être envisagé en fonction des<br />
différentes possibilités thérapeutiques réelles, existantes au moment de l'acte, <strong>et</strong> non pas uniquement<br />
en fonction de la seule technique que sait utiliser le neuroradiologue interventionnel consulté. Ce<br />
choix éthique peut, en eff<strong>et</strong> conduire à confier le patient à d'autres équipes, ce qui implique<br />
naturellement une certaine forme de renoncement personnel.<br />
Mais, de plus en plus, le choix de l'indication n'est pas du ressort d'un seul thérapeute, en<br />
l'occurence le neuroradiologue interventionnel. Le choix est, bien souvent, celui d'une équipe.<br />
Il doit, en fait, être aussi celui du patient, bien sûr guidé par les conseils de l'équipe<br />
thérapeutique. Pour que c<strong>et</strong>te liberté de choix soit réelle, il convient de donner aux patient des<br />
informations préalables précises, indispensables au recueil de son "consentement éclairé". La<br />
qualité des informations fournies est fondamentale. L'expérience montre que c<strong>et</strong>te information est<br />
variable <strong>et</strong> qu'elle n'est pas toujours parfaitement honnête, peut-être de façon inconsciente. Il<br />
convient, en eff<strong>et</strong>, d'expliquer au patient les motivations de l'indication en fonction de ce que nous<br />
savons, ou de ce que nous croyons savoir au suj<strong>et</strong> de l'histoire naturelle de la maladie, comparée aux<br />
risques thérapeutiques réels. Quels sont ces risques ? Sont-ils ceux de la meilleure équipe au Monde,<br />
ou ceux du neuroradiologue interventionnel qui est en face de son patient ? Que faire lorsqu'il s'agit<br />
d'un spécialiste débutant ?<br />
L'entr<strong>et</strong>ien avec le patient doit, préférentiellement, se faire en présence de membres de la famille<br />
<strong>et</strong>/ou d'un témoin. La remise d'un document écrit peut se discuter. De toute manière, il est souhaitable<br />
de demander au patient de signer un document, attestant qu'il a été informé, qu'il a compris ce qui lui<br />
avait été expliqué <strong>et</strong> qu'il donne son accord pour l'intervention proposée. Ce recueil du consentement<br />
éclairé n'est valable que si les informations données ont été "loyales", claires, précises <strong>et</strong> surtout<br />
compréhensibles pour le patient. Ce dernier point est important <strong>et</strong> il convient de s'assurer que le<br />
message a été correctement reçu par le patient <strong>et</strong> sa famille. Pour répondre à c<strong>et</strong>te question,<br />
certaines équipes ont mis au point des "programmes-tests" sur ordinateur, perm<strong>et</strong>tant, après<br />
l'entr<strong>et</strong>ien, de contrôler le message reçu, mais faut-il réellement aller jusque-là ?<br />
<strong>Ethique</strong> de la réalisation de l'acte<br />
L'indication étant posée <strong>et</strong> acceptée, l'acte doit être réalisé dans les conditions prévues. La<br />
personnalisation de l'opérateur peut être mise en cause <strong>et</strong> ceci tout particulièrement dans les Hôpitaux<br />
Universitaires où le neuroradiologue interventionnel est entouré de collaborateurs en cours de<br />
formation.<br />
En France, en dehors du secteur public, où la responsabilité civile est essentiellement administrative,<br />
la prise de contact établie au moment de la consultation vaut "contrat ": c'est donc théoriquement le
médecin initialement consulté qui dont intervenir; dans le cas contraire, il doit en informer le patient qui<br />
doit, théoriquement, garder sa liberté de choix.<br />
La découverte per-opératoire d'éléments nouveaux, jusque là inconnus, peut poser de difficiles<br />
problèmes. Faut-il s'arrêter pour rediscuter avec le patient ou continuer l'intervention en agissant au<br />
mieux ? De même, le patient doit être informé de ce qui a réellement été fait durant l'intervention. Le<br />
patient a le droit de savoir que "rien n'a pu être fait". L'expérience montre que l'information postopératoire<br />
est parfois tronquée afin de ne pas décevoir le patient...! Il faut être très prudent car le<br />
mensonge représente certainement la pire des solutions. Parallèlement, il convient de rappeler que<br />
tous ces actes s'inscrivent dans le contexte de larges équipes multidisciplinaires, au sein desquelles<br />
se situent des problèmes de responsabilité respective qui sortent du cadre de l'éthique.<br />
<strong>Ethique</strong> <strong>et</strong> matériel<br />
L'intrication des problèmes d'éthique <strong>et</strong> de responsabilité se r<strong>et</strong>rouve au niveau du matériel <strong>et</strong><br />
de sa maintenance. Nous vivons une période au cours de laquelle l'évolution technique est<br />
extraordinairement rapide, imposant des investissements de plus en plus lours, de plus en plus<br />
fréquents <strong>et</strong>, par conséquent, quelquefois, impossibles à supporter par la Société. Il convient alors de<br />
faire des choix d'autant plus difficiles que l'opérateur n'est pas souvent le décideur.<br />
La question est donc posée: jusqu'à quelles limites peut-on travailler avec du matériel<br />
dépassé, dont les performances n'assurent, bien évidemment, pas au patient la même sécurité<br />
q'un matériel plus moderne ? Si nous voulons discuter c<strong>et</strong>te question, il faut déterminer des critères<br />
de choix: à partir de quel moment n'est-il plus éthique de travailler avec une scopie de qualité<br />
insuffisante...? Un élément plus sensible <strong>et</strong>, je l'adm<strong>et</strong>s, beaucoup plus discutable, est celui du biplan.<br />
Ayant toujours travaillé en angiographie biplan, j'estime que le biplan apporte indiscutablement des<br />
éléments de sécurité supplémentaire. Emboliser le nidus d'une malformation artérioveineuse en biplan<br />
facilite grandement la compréhension de la progression de l'embole <strong>et</strong> peut perm<strong>et</strong>tre d'éviter des<br />
complications, même si l'on possède d'excellentes connaissances radio-anatomiques. Il n'est pas<br />
dans mon propos de dire qu'il n'est pas éthique d'emboliser en monoplan, j'utilise c<strong>et</strong> exemple<br />
uniquement pour illustrer la difficulté à fixer des limites.<br />
Dans le même ordre d'idées, se situe le problème de la maintenance <strong>et</strong> de l'utilisation des techniques<br />
de prévention des pannes ou incidents. Assurer une maintenance régulière a un coût mais peut<br />
perm<strong>et</strong>tre d'éviter la survenue de pannes inoppinées qui, lorsqu'elles se produisent au cours d'une<br />
injection d'histoacryl, par exemple, peuvent entraîner des complications catastrophiques. Assurer une<br />
maintenance en urgence, 24 heures sur 24, est encore plus onéreux mais, que se passe-t-il<br />
lorsqu'une panne se produit durant un week-end ? En allant plus loin, la prévention d'une panne<br />
d'alimentation électrique peut être obtenue par la mise en place d'onduleurs de forte puissance,<br />
associés à des condensateurs capables d'éviter l'arrêt du générateur de rayons-X à l'occasion d'une<br />
panne de secteur. Les coûts de ces matériels sont alors très élevés, pouvant atteindre plusieurs<br />
millions par salle. Où est la limite de ce qui est éthique <strong>et</strong> de ce qui ne l'est pas, ou plus ?<br />
Tous ces éléments se r<strong>et</strong>rouvent naturellement au niveau du p<strong>et</strong>it matériel, tant en ce qui concerne<br />
ses qualités intrinsèques que ses conditions d'utilisation ou de réutilisation. La réutilisation peropératoire<br />
d'un coil "fatigué" pour des raisons tout à fait compréhensibles d'économie, peut conduire à<br />
une rupture de ce coil <strong>et</strong>, par conséquent, à des graves complications. Où est la limite ? Nous devons<br />
aborder là le problème de l'usage unique, dont on connaît l'extrême variété dans le monde actuel.<br />
Dans les pays considérés comme riches, il n'est plus éthique de réutiliser du matériel de cathétérisme,<br />
alors que dans les pays les plus pauvres, il n'y a pas d'autre solution pour ceux qui veulent pouvoir<br />
continuer à travailler.<br />
<strong>Ethique</strong> <strong>et</strong> formation continue<br />
Jusqu'à maintenant, dans de nombreux pays, la formation continue était laissée à l'initiative de<br />
l'individu-médecin. C<strong>et</strong>te formation continue dépendait donc uniquement du "bon vouloir" du<br />
spécialiste, de ses motivations <strong>et</strong>, finalement, <strong>et</strong> sa conscience professionnelle. Mais nous le savons,<br />
la médecine devient de plus en plus efficace <strong>et</strong>, par conséquent, de plus en plus iatrogène car le<br />
médecin, compétent ou non, a entre ses mains des armes de plus en plus dangereuses. C'est afin
d'assurer une meilleure qualité des soins <strong>et</strong>, surtout, afin de protéger le patient vis-à-vis de ses<br />
médecins que nos Sociétés vont, de plus en plus, imposer une formation continue que la<br />
rapidité de l'évolution technologique rend naturellement indispensable. Assurer la pérennité <strong>et</strong> le<br />
développement de ses connaissances fait donc partie des règles éthiques que la Société impose<br />
puisque cela n'apparaît pas spontanément à tous les médecins "normal <strong>et</strong> indispensable".<br />
<strong>Ethique</strong> de la recherche <strong>et</strong> de l'expérimentation<br />
Il est intéressant de remarquer que dans de nombreux pays, ce sont d'abord les animaux que l'on a<br />
cherché à protéger vis à vis de l'expérimentation médicale. Ce n'est que récemment que les<br />
législateurs se sont intéressés à la protection de l'Être Humain. En France, c'est le 20/12/1988 qu'à<br />
été promulguée la première loi sur "la protection des personnes qui se prêtent à des recherches<br />
biomédicales": c<strong>et</strong>te Loi dite "Loi Huri<strong>et</strong>" a été modifiée par une loi du 23/01/1990 puis précisée par le<br />
Décr<strong>et</strong> du 22/09/1990. C<strong>et</strong>te loi précise "qu'aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur<br />
l'Être Humain :<br />
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques <strong>et</strong> sur une<br />
expérimentation pré-clinique suffisante;<br />
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de<br />
proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de c<strong>et</strong>te recherche;<br />
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'Être Humain <strong>et</strong> les moyens<br />
susceptibles d'améliorer sa condition ;<br />
Toutefois, les recherches sans finalité thérapeutique directe sont admises si les trois conditions<br />
suivantes sont remplies :<br />
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé;<br />
- être utile à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de<br />
handicap ;<br />
- ne pouvoir être réalisée autrement.<br />
Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre,<br />
éclairé <strong>et</strong> exprès de celle-ci doit être recueilli après que l'investigateur ou un médecin qui le représente<br />
lui ait fait connaître :<br />
- l'objectif de la recherche, sa méthodologie <strong>et</strong> sa durée;<br />
- les contraintes <strong>et</strong> les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son<br />
terme;<br />
- l'avis du Comité d'<strong>Ethique</strong> correspondant".<br />
La personne, dont le consentement est sollicité, doit avoir le droit de refuser de participer à<br />
une recherche ou de r<strong>et</strong>irer son consentement à tout moment, sans encourir aucune<br />
responsabilité. Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit, remis à la<br />
personne dont le consentement est sollicité.<br />
Dans chaque région, le Ministre chargé de la Santé, agrée un, ou selon les besoins, plusieurs Comités<br />
Consultatifs de Protection des Personnes dans la recherche bio-médicale. Avant de réaliser une<br />
recherche sur l'Être Humain tout investigateur est tenu d'en soum<strong>et</strong>tre le proj<strong>et</strong> à l'avis d'un Comité<br />
Consultatif de protection des personnes, dans la recherche biomédicale, ayant son siège dans la<br />
région où il exerce son activité...<br />
Bien évidemment une telle Loi est contraignante. Elle impose aux structures de recherche de<br />
contracter des assurances perm<strong>et</strong>tant l'indemnisation du patient en cas d'incident ou d'accident. Elle<br />
apparaît cependant indiscutablement comme un facteur de progrès <strong>et</strong> c'est ce qui explique pourquoi<br />
ce type d'évolution est observé dans de nombreux pays.<br />
A titre d'illustration, dans un rapport du Conseil de l'Europe, date de 1993, il était précisé que "à<br />
l'exception de l'Autriche, de L'Irlande, de l'Islande <strong>et</strong> du Liechtenstein qui affirment n'en avoir aucune,<br />
la grande majorité des pays membres <strong>et</strong> observateurs dispose d'une structure nationale d'<strong>Ethique</strong>...".<br />
Deux tendances prédominent actuellement quant à la constitution de ces structures nationales<br />
d'<strong>Ethique</strong>. Alors que certains pays ont opté pour la mise en place d'un Comité National spécifique<br />
indépendant <strong>et</strong> permanent, d'autres pays ont opté pour la multiplicité des Instances Nationales <strong>et</strong> leur<br />
apparition ad Hoc ou par spécialité... Les dates de création de ces Comités sont récentes puisque leur
avènement s'échelonne de 1983 à 1991, tandis que d'autres sont envisagées mais non encore<br />
instituées.<br />
La soumission des proj<strong>et</strong>s de recherche <strong>et</strong> d'expérimentation à un Comité d'<strong>Ethique</strong> extérieur à<br />
l'équipe de recherche constitue, très certainement, un progrès: elle oblige les chercheurs à<br />
établir des objectifs <strong>et</strong> un protocole extrêmement précis. Elle les oblige, bien évidemment, à<br />
respecter l'Être Humain, ce qui peut paraître évident pour beaucoup mais n'a malheureusement<br />
pas toujours été respecté, comme en témoignent de dramatiques expériences vécues durant<br />
les dernières décennies, à l'occasion de conflits ou sous l'emprise d'états totalitaires.<br />
Il n'en reste pas moins que, même dans de telles structures, des problèmes d'<strong>Ethique</strong> peuvent se<br />
poser. La randomisation est actuellement considérée comme une des seules méthodes perm<strong>et</strong>tant de<br />
résoudre certains problèmes difficiles. L'expérience des anévrysmes que nous vivons actuellement<br />
nous perm<strong>et</strong> d'apprécier la difficulté d'un tel concept: je ne suis pas le seul à ressentir une certaine<br />
réticence vis-à-vis d'une certaine forme de randomisation du traitement des anévrismes destinée à<br />
comparer l'intérêt du traitement endovasculaire par rapport aux équipes, il apparaît tout à fait évident<br />
que le traitement endovasculaire à réduit la mortalité <strong>et</strong> la morbidité des anévrysmes vertébrobasilaires.<br />
Est-il encore nécessaire de vouloir le prouver ?<br />
<strong>Ethique</strong> Scientifique<br />
Lorsque nous réalisons des travaux scientifiques, qu'il s'agisse de véritables<br />
expérimentations, d'études cliniques ou autres, les résultats doivent être diffusés. Or, dans le<br />
monde où nous vivons, la compétition est vive <strong>et</strong> les tentations de tricher sont nombreuses.<br />
La plupart des êtres humains cherchent à se m<strong>et</strong>tre en valeur <strong>et</strong>, par conséquent, à présenter de bons<br />
résultats, principalement si le spécialiste concerné se trouve en situation de rivalité avec d'autres<br />
équipes. Mais, si l'on excepte ce que l'on pourrait considérer comme de simples traits caractériels,<br />
dans certains cas, la situation est beaucoup plus difficile. En eff<strong>et</strong>, dans certains pays totalitaires, le<br />
Scientifique "n'a pas droit à l'erreur": s'il n'est pas très bon, voire excellent, il risque tout simplement de<br />
perdre sa situation. Alors comment résister à la tentation "d'embellir" ses résultats ?...<br />
En dehors de la mise en cause d'une honnêt<strong>et</strong>é de base, de tels comportements ont de redoutables<br />
implications éthiques. Ne pas publier ou cacher les échecs d'une technique, conduit inévitablement<br />
d'autres équipes à essayer c<strong>et</strong>te technique, ce qui peut parfois provoquer de nouvelles complications<br />
chez d'autres patients. Malheureusement, le truquage est de plus en plus facile <strong>et</strong> accessible à tous.<br />
La présentation de nos résultats passant le plus souvent par l'image, quoi de plus facile que d'utiliser<br />
un des fabuleux programmes informatiques existant sur le marché pour embellir les résultats obtenus<br />
? La connaissance de tels risques nous oblige à les prévenir en exerçant des contrôles perm<strong>et</strong>tant de<br />
garantir la véracité des publications scientifiques.<br />
<strong>Ethique</strong> <strong>et</strong> Humanisme<br />
Le problème de l'argent ne peut être éludé. Comme dans toutes les professions, la <strong>neuroradiologie</strong><br />
<strong>interventionnelle</strong> a un coût. Durant de longues années, la neuraradiologie <strong>interventionnelle</strong> est restée<br />
une technique de pointe dont les bienfaits étaient, dans certaines Sociétés, réservés à ceux qui<br />
avaient des moyens suffisamment importants pour y accéder. Qu'en est-il des plus pauvres ?...<br />
Parallèlement, les conceptions évoluent <strong>et</strong> de nouvelles questions se posent. Bien sûr, le patient a<br />
droit à la discrétion <strong>et</strong> le secr<strong>et</strong> médical doit être préservé, ce qui est de plus en plus difficile dans nos<br />
structures informatiques, toutes reliées par réseau. Comment protéger la confidentialité vis-à-vis des<br />
compagnies d'assurance qui cherchent à moduler leurs primes en fonction de risques calculés ?<br />
Une notion plus récente est celle de la propriété de notre image ou de nos images. Jusqu'alors, c<strong>et</strong>te<br />
notion était essentiellement appliquée aux visages des individus car c'est ce qui perm<strong>et</strong> de nous<br />
reconnaître. Actuellement, certains revendiquent la propriété de la totalité de nos images qu'il s'agisse<br />
de l'aspect IRM de notre cerveau ou de tout autre examen.
C'est en raison de ces nouvelles questions que des groupes de réflexion se forment, afin de tenter<br />
d'établir une véritable "Charte du patient" destinée à fixer des limites aux activités médicales. Il<br />
convient donc d'être conscient du poids de nos responsabilités, afin d'exercer notre art dans l'optique<br />
du respect de l'Être Humain, tel que cela apparaît dans la "Déclaration des Droits de l'Homme".<br />
Professeur Luc PICARD<br />
Chef de service<br />
Service de Neuroradiologie diagnostique <strong>et</strong> thérapeutique,<br />
Hôpital Saint-Julien, 54035 Nancy cedex.