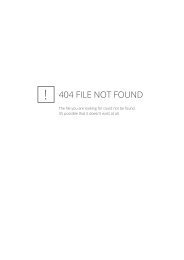La banque de détail en France : De l'intermédiation aux ... - Cerna
La banque de détail en France : De l'intermédiation aux ... - Cerna
La banque de détail en France : De l'intermédiation aux ... - Cerna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CERNA, C<strong>en</strong>tre d’économie industrielle<br />
École Nationale Supérieure <strong>de</strong>s Mines <strong>de</strong> Paris<br />
60, bld St Michel - 75272 Paris ce<strong>de</strong>x 06<br />
Tél. : (33) 01 40 51 91 83<br />
Fax : (33) 01 44 07 10 46<br />
daley@cerna.<strong>en</strong>smp.fr<br />
http://www.cerna.<strong>en</strong>smp.fr<br />
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> :<br />
<strong>De</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Docum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> travail<br />
Février 2001
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Sommaire<br />
Introduction__________________________________________________________________________________ 3<br />
Une industrie au service <strong>de</strong> la politique macroéconomique (1941 - fin <strong>de</strong>s années 70) ___________________ 5<br />
Le circuit du Trésor (1941 - 1966)______________________________________________________5<br />
<strong>La</strong> bancarisation <strong>de</strong> l’économie (1966 - 1984)_____________________________________________6<br />
<strong>La</strong> rupture <strong>de</strong>s années 80 ______________________________________________________________________ 9<br />
<strong>La</strong> libéralisation <strong>de</strong>s années 80_________________________________________________________9<br />
<strong>La</strong> transformation du modèle d’affaires <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s_______________________________________13<br />
<strong>La</strong> baisse t<strong>en</strong>dancielle <strong>de</strong>s marges d’intermédiation _____________________________________13<br />
<strong>La</strong> diversification <strong>de</strong>s sources <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us _____________________________________________14<br />
<strong>La</strong> distribution : le nouvel <strong>en</strong>jeu stratégique _____________________________________________________ 17<br />
<strong>La</strong> chaîne <strong>de</strong> valeur dans la <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong>_____________________________________________17<br />
Internet : vecteur <strong>de</strong> recomposition <strong>de</strong>s services financiers__________________________________19<br />
Conclusion _________________________________________________________________________________ 23<br />
Bibliographie _______________________________________________________________________________ 25<br />
Annexe 1 : Composition du PNB <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit ____________________________ 27<br />
Annexe 2 : <strong>La</strong> désintégration <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> valeur bancaire ______________________________________ 29<br />
<strong>Cerna</strong> 2
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Introduction<br />
<strong>La</strong> numérisation <strong>de</strong>s can<strong>aux</strong> <strong>de</strong> distribution, induite par le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong><br />
l’information (TI), transforme les conditions concurr<strong>en</strong>tielles dans la <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong>. <strong>De</strong><br />
nouvelles firmes émerg<strong>en</strong>t grâce au déploiem<strong>en</strong>t d’Internet : sites comparatifs spécialisés dans<br />
le crédit, <strong>banque</strong>s <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t à distance, brokers <strong>en</strong> ligne, etc. Ces <strong>en</strong>trants développ<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
nouve<strong>aux</strong> modèles origin<strong>aux</strong>, mais qui rest<strong>en</strong>t cep<strong>en</strong>dant expérim<strong>en</strong>t<strong>aux</strong> et <strong>en</strong>core instables.<br />
Aussi une <strong>de</strong>s conditions nécessaire, pour analyser ces modèles et leurs pertin<strong>en</strong>ces, est <strong>de</strong><br />
rev<strong>en</strong>ir sur la dynamique industrielle qui a permis d’édifier les conditions <strong>de</strong> base à la<br />
concurr<strong>en</strong>ce dans ce secteur. L’approche ret<strong>en</strong>ue ici se singularise par l’isolem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
variables clefs : le modèle économique, c’est-à-dire le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s firmes bancaires<br />
(organisation industrielle et moy<strong>en</strong>s développés pour <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drer <strong>de</strong>s profits). <strong>La</strong> secon<strong>de</strong> fait<br />
référ<strong>en</strong>ce à l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s activités mises <strong>en</strong> œuvre pour créer et distribuer les produits et<br />
services d’une <strong>en</strong>treprise : la chaîne <strong>de</strong> valeur [Porter, 1986] 1 . Dans l’industrie bancaire, la<br />
chaîne <strong>de</strong> valeur se compose <strong>de</strong> trois activités principales liées économiquem<strong>en</strong>t : le back office<br />
(traitem<strong>en</strong>t administratif <strong>de</strong>s opérations), la production <strong>de</strong> produits et services et la distribution.<br />
Ces <strong>de</strong>ux concepts, interdép<strong>en</strong>dants, ont considérablem<strong>en</strong>t évolué au cours <strong>de</strong> ces vingt<br />
<strong>de</strong>rnières années.<br />
En effet, les <strong>banque</strong>s sont <strong>de</strong>s intermédiaires qui assur<strong>en</strong>t traditionnellem<strong>en</strong>t 2 quatre types<br />
d’opérations : la collecte <strong>de</strong>s dépôts, la distribution <strong>de</strong>s crédits, les opérations interbancaires et<br />
la gestion <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> paiem<strong>en</strong>ts. Les <strong>de</strong>ux premières fonctions, qui constitu<strong>en</strong>t le cœur <strong>de</strong><br />
l’activité bancaire <strong>de</strong> <strong>détail</strong> et la source principale <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us, se sont profondém<strong>en</strong>t<br />
transformées. <strong>De</strong>ux modèles économiques 3 se sont succédé, délimités par les réformes<br />
réglem<strong>en</strong>taires. Le marché bancaire français s’est progressivem<strong>en</strong>t ouvert introduisant une plus<br />
forte concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>puis le début <strong>de</strong>s années 80. Ces bouleversem<strong>en</strong>ts ont<br />
radicalem<strong>en</strong>t modifié les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> génération <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us. Les commissions se sont<br />
progressivem<strong>en</strong>t substituées <strong>aux</strong> marges d’intermédiation traditionnelles dans le produit net<br />
bancaire.<br />
Ces mutations se sont répercutées sur la chaîne <strong>de</strong> valeur <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s. Ainsi, l’organisation<br />
intégrée <strong>de</strong>s activités semble atteindre, aujourd’hui, ses limites face au nouvel <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
concurr<strong>en</strong>tiel. <strong>La</strong> gestion <strong>de</strong>s risques et la distribution apparaiss<strong>en</strong>t comme <strong>de</strong>s activités clefs,<br />
1 Selon cet auteur, une firme acquiert un avantage concurr<strong>en</strong>tiel lorsqu’elle parvi<strong>en</strong>t à organiser les activités <strong>de</strong> sa<br />
chaîne <strong>de</strong> valeur à un coût inférieur à celui <strong>de</strong> ses concurr<strong>en</strong>ts.<br />
2 Appelée intermédiation classique ou bancaire.<br />
3 On utilisera égalem<strong>en</strong>t le terme <strong>de</strong> modèle d’affaires.<br />
<strong>Cerna</strong> 3
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
elles sont génératrices d’avantages concurr<strong>en</strong>tiels pour les <strong>banque</strong>s. Ce processus concurr<strong>en</strong>tiel<br />
provoque la réorganisation <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> valeur et sa désagrégation. Ce <strong>de</strong>rnier phénomène<br />
risque, par ailleurs, <strong>de</strong> s’accélérer avec le développem<strong>en</strong>t d’Internet dans l’industrie.<br />
L’objectif <strong>de</strong> cet article est d’examiner les aspects réglem<strong>en</strong>taires et économiques <strong>de</strong> l’industrie<br />
bancaire française pour appréh<strong>en</strong><strong>de</strong>r les dynamiques organisationnelle et concurr<strong>en</strong>tielle.<br />
Comm<strong>en</strong>t a évolué le rôle <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s dans l’économie ? Quelles sont les conséqu<strong>en</strong>ces <strong>de</strong>s<br />
réformes sur l’organisation industrielle ? Comm<strong>en</strong>t se sont modifiés les modèles d’affaires <strong>de</strong>s<br />
<strong>banque</strong>s ? Quelles sont les répercussions sur l’organisation <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> valeur ?<br />
L’article est organisé <strong>en</strong> trois parties. <strong>La</strong> première examine l’organisation du secteur bancaire<br />
jusqu’à la fin <strong>de</strong>s années 70, pério<strong>de</strong> marquée par l’interv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s pouvoirs publics. <strong>La</strong><br />
<strong>de</strong>uxième partie analyse les facteurs <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>t et la mutation <strong>de</strong>s bilans bancaires. Enfin, la<br />
<strong>de</strong>rnière partie examine les répercussions du nouveau modèle d’affaires sur la chaîne <strong>de</strong> valeur<br />
<strong>de</strong>s activités bancaires.<br />
<strong>Cerna</strong> 4
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Une industrie au service <strong>de</strong> la politique<br />
macroéconomique (1941 - fin <strong>de</strong>s années 70)<br />
<strong>De</strong>s années d’après guerre jusqu’à la fin <strong>de</strong>s années 70, le secteur bancaire est soumis au dictat<br />
<strong>de</strong>s pouvoirs publics. Durant cette pério<strong>de</strong>, les <strong>banque</strong>s sont l’instrum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la politique<br />
monétaire et doiv<strong>en</strong>t pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’économie française. Les autorités<br />
utilis<strong>en</strong>t les <strong>banque</strong>s pour recycler les fonds publics p<strong>en</strong>dant toute la phase <strong>de</strong> reconstruction : la<br />
moitié <strong>de</strong> leurs emplois est constituée par <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte publique. À la fin <strong>de</strong>s années 60,<br />
les pouvoirs publics assoupliss<strong>en</strong>t le cadre réglem<strong>en</strong>taire et favoris<strong>en</strong>t l’expansion <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s<br />
pour adapter le système bancaire <strong>aux</strong> nouvelles conditions économiques. Cette époque se<br />
caractérise par une croissance ext<strong>en</strong>sive <strong>de</strong>s activités bancaires toujours au service du<br />
financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’économie. Ces interv<strong>en</strong>tions publiques façonn<strong>en</strong>t le modèle d’affaires <strong>de</strong>s<br />
<strong>banque</strong>s qui repose ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur les rev<strong>en</strong>us issus <strong>de</strong>s marges d’intermédiation.<br />
Le circuit du Trésor (1941 - 1966)<br />
L’activité bancaire est une industrie très réglem<strong>en</strong>tée <strong>de</strong>puis le début <strong>de</strong>s années 40. Le t<strong>aux</strong><br />
élevé <strong>de</strong> faillites bancaires, expérim<strong>en</strong>té p<strong>en</strong>dant l’Entre-<strong>de</strong>ux-guerres, et les conditions<br />
économiques d’Après guerre ont conduit les autorités à réglem<strong>en</strong>ter cette industrie. Les <strong>banque</strong>s<br />
sont spécialisées et classées <strong>en</strong> trois catégories : les <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> dépôts, les <strong>banque</strong>s d’affaires et<br />
les <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> crédit à moy<strong>en</strong> et long terme. Cette spécialisation permet <strong>aux</strong> autorités <strong>de</strong><br />
contrôler les activités <strong>de</strong>s établissem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong> limiter les risques systémiques 4 , c’est-à-dire les<br />
risques <strong>de</strong> défaillance <strong>en</strong> casca<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s, reliées <strong>en</strong>tre elles par <strong>de</strong>s opérations<br />
interbancaires 5 . Pour r<strong>en</strong>forcer la tutelle <strong>de</strong> l’Etat, les pouvoirs publics nationalis<strong>en</strong>t la Banque<br />
<strong>de</strong> <strong>France</strong> et les quatre gran<strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> dépôt 6 <strong>en</strong> 1945. Leur objectif est d’ori<strong>en</strong>ter les<br />
financem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> ces établissem<strong>en</strong>ts conformém<strong>en</strong>t <strong>aux</strong> objectifs <strong>de</strong> la politique économique.<br />
L’autorité compét<strong>en</strong>te <strong>de</strong> l’époque (le Conseil National du Crédit), créée <strong>en</strong> 1945, réglem<strong>en</strong>te<br />
les ouvertures d’ag<strong>en</strong>ces, les modifications <strong>de</strong> capital, le changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> statuts et les fusions<br />
acquisitions. Les restrictions <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> guichets, soumis à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation,<br />
4 En effet, les Etats-Unis ont utilisé le principe <strong>de</strong> spécialisation <strong>en</strong> 1933 (« Glass Steagall Act ») <strong>en</strong> réponse à la crise<br />
<strong>de</strong> 1929 p<strong>en</strong>dant laquelle <strong>de</strong> nombreuses <strong>banque</strong>s commerciales ont fait faillite après s’être <strong>en</strong>gagées dans <strong>de</strong>s<br />
placem<strong>en</strong>ts mobiliers.<br />
5 Pour une explication approfondie du rôle <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s au sein <strong>de</strong> l’économie et <strong>de</strong>s termes relatifs <strong>aux</strong> activités<br />
bancaires, le lecteur se référera à l’ouvrage suivant : X. Freixas & J.C. Rochet (1999), « Microeconomics of<br />
banking », The MIT Press, 4 ème édition.<br />
6 Le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la Banque nationale pour le commerce et l’industrie et le Comptoir<br />
national d’escompte <strong>de</strong> Paris. <strong>La</strong> fusion <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières <strong>banque</strong>s donne naissance à l’actuelle BNP.<br />
<strong>Cerna</strong> 5
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
favoris<strong>en</strong>t le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> monopoles loc<strong>aux</strong>. <strong>La</strong> réglem<strong>en</strong>tation <strong>en</strong> matière d’ouverture<br />
d’ag<strong>en</strong>ces limite les stratégies <strong>de</strong> couverture territoriale <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s. Celles-ci ne peuv<strong>en</strong>t<br />
s’implanter systématiquem<strong>en</strong>t à proximité <strong>de</strong> leurs concurr<strong>en</strong>tes ce qui confère, à<br />
l’établissem<strong>en</strong>t qui a reçu l’autorisation d’ouvrir un guichet dans une zone, un pouvoir <strong>de</strong><br />
monopole sur sa cli<strong>en</strong>tèle. Ces limites modèr<strong>en</strong>t ou même interdis<strong>en</strong>t le fonctionnem<strong>en</strong>t efficace<br />
<strong>de</strong> la concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre <strong>banque</strong>s. <strong>La</strong> proximité géographique <strong>de</strong>s ag<strong>en</strong>ts est une variable<br />
concurr<strong>en</strong>tielle primordiale.<br />
Durant cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconstruction <strong>de</strong> l’économie française, les financem<strong>en</strong>ts publics jou<strong>en</strong>t<br />
un rôle prépondérant. Les titres <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte publique représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t la moitié <strong>de</strong>s emplois bancaires<br />
<strong>en</strong> 1946. Les rev<strong>en</strong>us <strong>de</strong>s portefeuilles <strong>de</strong> titres contribu<strong>en</strong>t à près <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong>s rev<strong>en</strong>us <strong>de</strong>s<br />
<strong>banque</strong>s. Le circuit du Trésor 7 joue un rôle important dans la reconstruction <strong>de</strong> l’économie<br />
française. Il permet <strong>de</strong> collecter d’importantes liquidités <strong>en</strong> contrepartie <strong>de</strong> l’émission <strong>de</strong> titres<br />
publics. <strong>La</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> reconstruction achevée, son poids se réduit progressivem<strong>en</strong>t au profit <strong>de</strong>s<br />
crédits bancaires. Ces <strong>de</strong>rniers représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t 90 % <strong>de</strong>s emplois <strong>en</strong> 1965. <strong>La</strong> marge<br />
d’intermédiation, représ<strong>en</strong>tée par la différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre le r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s crédits et le coût <strong>de</strong>s<br />
dépôts, <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t la principale source <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s et contribue à 80 % du produit net<br />
bancaire à la fin <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>.<br />
<strong>La</strong> bancarisation <strong>de</strong> l’économie (1966 - 1984)<br />
<strong>La</strong> fin <strong>de</strong>s années 60 marque une première phase <strong>de</strong> changem<strong>en</strong>ts, les contraintes réglem<strong>en</strong>taires<br />
qui pès<strong>en</strong>t sur les <strong>banque</strong>s sont relâchées. L’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t économique s’est profondém<strong>en</strong>t<br />
modifié, la <strong>France</strong> connaît <strong>de</strong>puis le début <strong>de</strong>s années 60 une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> forte croissance. Les<br />
pouvoirs publics déci<strong>de</strong>nt d’assouplir le cadre réglem<strong>en</strong>taire, d’une part, pour favoriser<br />
l’expansion <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s <strong>en</strong> réponse à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> croissante <strong>de</strong> crédits <strong>de</strong>s ag<strong>en</strong>ts et d’autre<br />
part, influ<strong>en</strong>cer les stratégies bancaires au gré <strong>de</strong>s ori<strong>en</strong>tations <strong>de</strong> la politique monétaire. Ainsi,<br />
<strong>en</strong> 1966, l’ouverture <strong>de</strong>s guichets <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t libre. Les <strong>banque</strong>s s’<strong>en</strong>gag<strong>en</strong>t alors dans une course à<br />
la création d’ag<strong>en</strong>ces, par obligation concurr<strong>en</strong>tielle, pour acquérir une taille optimale et<br />
conquérir <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong> marché. Cette croissance ext<strong>en</strong>sive est liée au modèle <strong>de</strong> réseau intégré<br />
<strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s. Le circuit <strong>de</strong> distribution, constitué par le réseau d’ag<strong>en</strong>ces, <strong>de</strong> chaque<br />
établissem<strong>en</strong>t est exclusif, la variable distribution constitue le moteur <strong>de</strong> toute l’activité bancaire<br />
qui dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> la collecte <strong>de</strong>s dépôts. Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s repose sur une<br />
logique d’accumulation : la croissance du nombre <strong>de</strong> cli<strong>en</strong>ts et donc les objectifs <strong>de</strong> production<br />
vont <strong>de</strong> pair avec l’ext<strong>en</strong>sion du nombre d’ag<strong>en</strong>ces. Le graphique 1 illustre la corrélation<br />
7 Le circuit du Trésor regroupe le groupe Caisse <strong>de</strong>s dépôts et consignations et les caisses d’épargne, la Poste et le<br />
Trésor Public.<br />
<strong>Cerna</strong> 6
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
positive, jusqu’<strong>en</strong> 1975, <strong>en</strong>tre l’augm<strong>en</strong>tation du nombre d’ag<strong>en</strong>ces et la progression du produit<br />
net bancaire (PNB) composé principalem<strong>en</strong>t par les rev<strong>en</strong>us issus <strong>de</strong>s activités d’intermédiation<br />
traditionnelles. En effet, la société <strong>de</strong> consommation se développe et le contexte inflationniste<br />
provoque un <strong>en</strong>gouem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s ag<strong>en</strong>ts économiques pour le crédit.<br />
<strong>La</strong> même année, la distinction <strong>en</strong>tre <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> dépôts et <strong>banque</strong>s d’affaires est abolie,<br />
favorisant l’essor <strong>de</strong> la <strong>banque</strong> universelle. Ce modèle permet <strong>aux</strong> institutions d’offrir une<br />
gamme très large, voire complète, <strong>de</strong> services financiers allant <strong>de</strong>s activités d’intermédiation<br />
classique <strong>aux</strong> opérations sur les marchés financiers ; y compris les placem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> titres et les<br />
prises <strong>de</strong> participation dans le capital <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises. Cep<strong>en</strong>dant, les <strong>banque</strong>s peuv<strong>en</strong>t être<br />
considérées comme <strong>de</strong>s firmes mono produit vivant exclusivem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la v<strong>en</strong>te <strong>de</strong> crédit jusqu’à<br />
la fin <strong>de</strong>s années 70. Cette sous-pério<strong>de</strong> (1966-1975) correspond à une bancarisation int<strong>en</strong>se <strong>de</strong><br />
l’économie et à l’essor <strong>de</strong> l’économie d’<strong>en</strong><strong>de</strong>ttem<strong>en</strong>t, c’est-à-dire <strong>de</strong> la finance intermédiée.<br />
Graphique 1 : Evolution du nombre <strong>de</strong> guichets et du produit net bancaire (Banques AFB)<br />
Source : Plihon (1995)<br />
En 1967, les t<strong>aux</strong> débiteurs <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t libres (plafonnés) ce qui permet pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>aux</strong><br />
<strong>banque</strong>s <strong>de</strong> se livrer à une concurr<strong>en</strong>ce par les prix. Cep<strong>en</strong>dant, ces libéralisations ne sont pas<br />
synonymes <strong>de</strong> retrait <strong>de</strong>s autorités. L’instauration <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t du crédit, <strong>en</strong> 1972, bloque la<br />
concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> volume. L’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t consiste à conting<strong>en</strong>ter, par voie réglem<strong>en</strong>taire, le t<strong>aux</strong><br />
<strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s <strong>en</strong>cours <strong>de</strong> crédits distribués par les <strong>banque</strong>s. <strong>De</strong>ux raisons justifi<strong>en</strong>t alors son<br />
utilisation. P<strong>en</strong>dant les années 70, le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’économie s’effectue pour l’ess<strong>en</strong>tiel par<br />
le crédit bancaire, tandis que le contrôle <strong>de</strong>s changes 8 r<strong>en</strong>force la nécessité <strong>de</strong> surveiller le<br />
volume <strong>de</strong>s crédits. Les normes <strong>de</strong> progression <strong>de</strong>s crédits sont fixées par les autorités<br />
monétaires <strong>en</strong> fonction du t<strong>aux</strong> <strong>de</strong> croissance souhaité <strong>de</strong> la masse monétaire et <strong>de</strong> l’exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong><br />
certains crédits à l’économie non <strong>en</strong>cadrés. En cas <strong>de</strong> dépassem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la norme, les <strong>banque</strong>s<br />
8 Le contrôle <strong>de</strong>s changes est une politique qui limite la convertibilité <strong>de</strong> la monnaie nationale <strong>en</strong> <strong>de</strong>vises ainsi que les<br />
sorties <strong>de</strong> monnaie du territoire. Elle vise à maint<strong>en</strong>ir un contrôle effectif <strong>de</strong> la masse monétaire.<br />
<strong>Cerna</strong> 7
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
sont sanctionnées par une augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> leur dépôt <strong>de</strong> réserves obligatoires non rémunérées<br />
auprès <strong>de</strong> la <strong>banque</strong> c<strong>en</strong>trale. Cette disposition interdit toute concurr<strong>en</strong>ce interbancaire dans<br />
l’octroi <strong>de</strong> crédits malgré la libéralisation <strong>de</strong>s t<strong>aux</strong> débiteurs. Elle peut être assimilée à une<br />
prime concédée <strong>aux</strong> <strong>banque</strong>s les moins dynamiques. L’exemple ci-après permet <strong>de</strong> mieux<br />
compr<strong>en</strong>dre l’effet <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t du crédit sur les <strong>banque</strong>s. On considère trois <strong>banque</strong>s ayant<br />
<strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> croissance différ<strong>en</strong>tes. <strong>La</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> crédit adressée à la première <strong>banque</strong><br />
stagne (0 % <strong>de</strong> croissance), celles qui sont adressées à la <strong>de</strong>uxième et à la troisième progress<strong>en</strong>t<br />
respectivem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 5 % et 10 %. Les autorités fix<strong>en</strong>t un t<strong>aux</strong> <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s crédit plafonné à<br />
5 % par an à chaque <strong>banque</strong>. <strong>La</strong> troisième <strong>banque</strong>, la plus dynamique, se retrouve donc bloquée<br />
dans son développem<strong>en</strong>t, elle ne peut répondre qu’<strong>aux</strong> 5 % <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s supplém<strong>en</strong>taires. Les<br />
5 % restants, qui ne trouv<strong>en</strong>t pas <strong>de</strong> crédit, rest<strong>en</strong>t soit insatisfaits soit ils sont récupérés par la<br />
<strong>banque</strong> la moins active. Les autorités organis<strong>en</strong>t ainsi la concurr<strong>en</strong>ce et sont à l’origine <strong>de</strong><br />
phénomènes <strong>de</strong> quasi-r<strong>en</strong>tes. Les <strong>banque</strong>s sont <strong>en</strong> monopole sur une ressource rare : le crédit.<br />
L’interv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> l’Etat, dans l’industrie, est égalem<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>forcée <strong>en</strong> février 1982. Les autorités<br />
déci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> nationaliser 39 <strong>banque</strong>s françaises soit 90,5 % <strong>de</strong>s guichets et 85 % <strong>de</strong>s dépôts. Ces<br />
nationalisations apparaiss<strong>en</strong>t comme la condition d’une meilleure gestion <strong>de</strong>s ressources<br />
financières existantes sous le contrôle <strong>de</strong> l’Etat. Les restructurations, issues <strong>de</strong> ces<br />
nationalisations, réduis<strong>en</strong>t le nombre <strong>de</strong> <strong>banque</strong>s qui, d’<strong>en</strong>viron 225 <strong>en</strong> 1981, ne sont plus que<br />
200 au début <strong>de</strong> l’année 1984. <strong>La</strong> logique <strong>de</strong>s autorités publiques correspond à l’idéologie du<br />
« Too big to fall ». <strong>La</strong> création <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s semble être la solution la plus appropriée<br />
pour assurer la stabilité du système bancaire et limiter les risques <strong>de</strong> défaillance <strong>de</strong>s<br />
intermédiaires financiers. L’association d’une forte conc<strong>en</strong>tration du marché bancaire au<br />
manque <strong>de</strong> concurr<strong>en</strong>ce permet <strong>aux</strong> <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> dégager <strong>de</strong>s marges d’intermédiation élevées.<br />
<strong>De</strong>s années 60 au début <strong>de</strong>s années 80, l’activité bancaire est donc <strong>en</strong> majeure partie contrôlée<br />
par les pouvoirs publics, la concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit est faible et organisée.<br />
Elle repose exclusivem<strong>en</strong>t sur l’ouverture d’ag<strong>en</strong>ces, c’est-à-dire sur les activités <strong>de</strong><br />
distribution, instrum<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s dépôts. Les <strong>banque</strong>s ont donc assuré une véritable<br />
fonction <strong>de</strong> service public modulée au gré <strong>de</strong>s priorités économiques définies par les pouvoirs<br />
publics. Les conditions chang<strong>en</strong>t radicalem<strong>en</strong>t au cours <strong>de</strong>s années 80. Le contrôle <strong>de</strong> l’Etat<br />
s’affaiblit progressivem<strong>en</strong>t face à la globalisation <strong>de</strong>s marchés. Les autorités, à l’origine d’une<br />
série <strong>de</strong> mesures visant à mo<strong>de</strong>rniser les activités bancaires et à libéraliser les marchés<br />
financiers, jou<strong>en</strong>t un rôle majeur dans cette transition vers l’économie <strong>de</strong> marché <strong>de</strong>s capit<strong>aux</strong>.<br />
<strong>Cerna</strong> 8
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
<strong>La</strong> rupture <strong>de</strong>s années 80<br />
L’activité <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s s’est profondém<strong>en</strong>t transformée durant ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières déc<strong>en</strong>nies.<br />
L’intermédiation bancaire, sur laquelle avait reposée le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s jusqu’au<br />
début <strong>de</strong>s années 80, a progressivem<strong>en</strong>t diminué au sein <strong>de</strong> leurs bilans. Ces changem<strong>en</strong>ts sont,<br />
<strong>en</strong> gran<strong>de</strong> partie, le résultat <strong>de</strong>s réformes financières et monétaires impulsées par les pouvoirs<br />
publics à partir <strong>de</strong> 1984. Le système financier français a basculé d’une logique d’économie<br />
d’<strong>en</strong><strong>de</strong>ttem<strong>en</strong>t, où les ag<strong>en</strong>ts à capacités <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t plac<strong>en</strong>t leur arg<strong>en</strong>t auprès <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s<br />
qui couvr<strong>en</strong>t, avec <strong>de</strong>s crédits, les besoins <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t, à une logique d’économie <strong>de</strong> marché<br />
<strong>de</strong>s capit<strong>aux</strong> 9 .<br />
<strong>La</strong> libéralisation <strong>de</strong>s années 80<br />
Ces transformations sont amorcées avec la loi bancaire du 24 janvier 1984. L’objectif <strong>de</strong>s<br />
autorités à travers cette loi est <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rniser le cadre législatif et la profession bancaire. Elle<br />
édicte un cadre juridique unique relatif à l’exercice <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s activités bancaires. Elle<br />
repose sur une notion homogène d’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> crédit et reconnaît explicitem<strong>en</strong>t la vocation<br />
universelle <strong>de</strong> ces établissem<strong>en</strong>ts. <strong>La</strong> standardisation <strong>de</strong>s activités constitue, ainsi, le premier pas<br />
vers le décloisonnem<strong>en</strong>t et la banalisation <strong>de</strong>s produits et services bancaires. Cette loi a <strong>de</strong>ux<br />
principales conséqu<strong>en</strong>ces sur la structure <strong>de</strong> l’industrie.<br />
D’une part, le principe <strong>de</strong> la « <strong>banque</strong> à tout faire » 10 crée un biais concurr<strong>en</strong>tiel important <strong>en</strong><br />
faveur <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s mutualistes et <strong>de</strong>s caisses d’épargne. Elle leur permet <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s services<br />
qu’elles n’étai<strong>en</strong>t pas, auparavant, <strong>en</strong> mesure d’offrir tout <strong>en</strong> maint<strong>en</strong>ant leurs privilèges (le<br />
livret A 11 par exemple). Le livret A <strong>de</strong>s caisses d’épargne représ<strong>en</strong>te 45 millions <strong>de</strong> comptes ce<br />
qui leur fournit une large base <strong>de</strong> consommateurs pour la v<strong>en</strong>te d’autres produits. Il peut être<br />
assimilé à un produit d’appel financé par l’Etat permettant à ces établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à<br />
<strong>de</strong>s v<strong>en</strong>tes croisées <strong>de</strong> produits. Ce biais, associé à une structure <strong>de</strong> gouvernance moins<br />
contraignante 12 , accroît la pression concurr<strong>en</strong>tielle supportée par les <strong>banque</strong>s commerciales et<br />
9 Les ag<strong>en</strong>ts sont <strong>en</strong> relation directe grâce <strong>aux</strong> marchés <strong>de</strong>s capit<strong>aux</strong> (finance directe). L’emprunt se fait directem<strong>en</strong>t<br />
via les marchés <strong>de</strong> titres.<br />
10 Ou <strong>banque</strong> universelle, un établissem<strong>en</strong>t peut effectuer tous les types d’opérations.<br />
11<br />
Les caisses d’épargne et la Poste sont <strong>en</strong> situation <strong>de</strong> monopole sur la distribution du livret A. Le t<strong>aux</strong> <strong>de</strong> cette<br />
épargne réglem<strong>en</strong>tée est fixé par le gouvernem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> ses objectifs <strong>de</strong> politique monétaire. Le Crédit<br />
Mutuel dispose égalem<strong>en</strong>t d’un monopole sur le livret bleu, épargne rémunérée au même t<strong>aux</strong> que celui du livret A.<br />
Ces <strong>de</strong>ux produits sont exonérés d’impôts ce qui confère un avantage comparatif à ces institutions pour acquérir <strong>de</strong><br />
nouve<strong>aux</strong> cli<strong>en</strong>ts.<br />
12 <strong>La</strong> structure <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong> ces institutions est considérée comme un avantage compétitif par rapport <strong>aux</strong> <strong>banque</strong>s<br />
commerciales : les contraintes <strong>de</strong> r<strong>en</strong>tabilité sont plus faibles, les caisses d’épargne sont <strong>de</strong>s organisations à but non<br />
lucratif et le montant <strong>de</strong>s divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s versés par les <strong>banque</strong>s mutualistes est plafonné. Ces <strong>banque</strong>s ne sont pas cotées<br />
<strong>en</strong> bourse et donc ne subiss<strong>en</strong>t pas les sanctions du marché.<br />
<strong>Cerna</strong> 9
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
impose une plus faible r<strong>en</strong>tabilité à ces <strong>de</strong>rnières. D’autre part, la consolidation <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong><br />
réseau <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s mutualistes et <strong>de</strong>s caisses d’épargne 13 <strong>en</strong>traîne une forte conc<strong>en</strong>tration dans<br />
l’industrie.<br />
Encadré 1 : la loi bancaire <strong>de</strong> 1984<br />
L’article 1 <strong>de</strong> la loi dispose :<br />
« Les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit sont <strong>de</strong>s personnes morales qui effectu<strong>en</strong>t à titre <strong>de</strong> profession habituelle<br />
<strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> <strong>banque</strong>. Les opérations <strong>de</strong> <strong>banque</strong> compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t la réception <strong>de</strong> fonds du public, les<br />
opérations <strong>de</strong> crédit, ainsi que la mise à disposition <strong>de</strong> la cli<strong>en</strong>tèle ou la gestion <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong><br />
paiem<strong>en</strong>t. » Ainsi les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit sont définis par les opérations qu’ils effectu<strong>en</strong>t, appelées<br />
« opérations <strong>de</strong> <strong>banque</strong> » qui sont <strong>de</strong> trois ordres : collecter <strong>de</strong>s fonds auprès du public, faire <strong>de</strong>s crédits à<br />
l’économie et gérer les moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> paiem<strong>en</strong>t. Pour ces opérations, l’article 10 donne un monopole <strong>aux</strong><br />
établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> crédit d’effectuer<br />
<strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> <strong>banque</strong> à titre habituel. »<br />
Le champ d’activité <strong>de</strong>s établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit n’est pas limité <strong>aux</strong> opérations <strong>de</strong> <strong>banque</strong> m<strong>en</strong>tionnées<br />
par l’article 1. Il peut s’ét<strong>en</strong>dre à d’autres opérations « connexes » à l’activité principale énumérées par<br />
l’article 5 :<br />
- Les opérations <strong>de</strong> change,<br />
- Les opérations sur or, mét<strong>aux</strong> précieux et pièces,<br />
- Le placem<strong>en</strong>t, la souscription, l’achat, la gestion, la gar<strong>de</strong> et la v<strong>en</strong>te <strong>de</strong> valeurs mobilières et <strong>de</strong> tout<br />
produit financier,<br />
- Le conseil et l’assistance <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> gestion du patrimoine,<br />
- Le conseil et l’assistance <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> gestion financière, l’ingénierie financière et d’une manière<br />
générale tous les services <strong>de</strong>stinés à faciliter la création et le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises, sous<br />
réserve <strong>de</strong>s dispositions législatives relatives à l’exercice illégal <strong>de</strong> certaines professions,<br />
- Les opérations <strong>de</strong> location simple <strong>de</strong> bi<strong>en</strong>s mobiliers et immobiliers, pour les établissem<strong>en</strong>ts habilités<br />
à effectuer <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> crédit-bail.<br />
Ces opérations n’<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t pas dans le monopole. Les <strong>banque</strong>s ont le droit <strong>de</strong> les effectuer, sans limitation,<br />
mais elles s’y trouv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>ce avec d’autres professions qui les pratiqu<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t (sociétés <strong>de</strong><br />
bourse, cabinets - conseils, etc). Par ailleurs, les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit sont habilités à pr<strong>en</strong>dre <strong>de</strong>s<br />
participations, comme d’autres sociétés, dans <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises industrielles et commerciales (article 6).<br />
<strong>La</strong> loi bancaire distingue (article 18) six catégories d’établissem<strong>en</strong>ts qui se différ<strong>en</strong>ci<strong>en</strong>t à la fois par leurs<br />
statuts juridiques et par l’ét<strong>en</strong>due <strong>de</strong> leurs prérogatives : les <strong>banque</strong>s AFB, les <strong>banque</strong>s mutualistes ou<br />
coopératives, les caisses d’épargne et <strong>de</strong> prévoyance, les caisses <strong>de</strong> crédit municipal, les sociétés<br />
financières (y compris les maisons <strong>de</strong> titre <strong>de</strong>puis 1992) et les institutions financières spécialisées.<br />
Source : Plihon (1999), pp. 9-10.<br />
Cette réforme est suivie d’un retrait progressif <strong>de</strong> l’Etat. <strong>La</strong> logique concurr<strong>en</strong>tielle l’emporte<br />
sur le contrôle public, les autorités procè<strong>de</strong>nt à une première vague <strong>de</strong> privatisation <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s<br />
<strong>en</strong> 1986. Néanmoins, ce processus n’est pas neutre, les autorités émett<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s conditions qui ont<br />
<strong>de</strong>s répercussions directes sur la structure <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s et qui r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t les<br />
inégalités introduites par la loi <strong>de</strong> 1984. En effet, d’une part, l’Etat conserve certains droits <strong>de</strong><br />
propriété dans ces établissem<strong>en</strong>ts (« gol<strong>de</strong>n share »). D’autre part, une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s parts<br />
est cédée à <strong>de</strong>s groupes d’actionnaires stables (groupe d’actionnaires part<strong>en</strong>aires) dont la tête <strong>de</strong><br />
pont est généralem<strong>en</strong>t un grand groupe français. L’<strong>en</strong>jeu, pour les autorités, était <strong>de</strong> prév<strong>en</strong>ir<br />
13 En référ<strong>en</strong>ce à la loi <strong>de</strong> 1988 qui a permis <strong>aux</strong> caisses d’épargne, organisées sur une base déc<strong>en</strong>tralisée, <strong>de</strong> se<br />
restructurer.<br />
<strong>Cerna</strong> 10
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
ainsi tout risque d’offre publique d’achat ou <strong>de</strong> rachat par <strong>de</strong>s groupes étrangers.<br />
<strong>La</strong> dim<strong>en</strong>sion sociale a égalem<strong>en</strong>t joué un grand rôle dans la sélection <strong>de</strong>s actionnaires. Ces<br />
<strong>de</strong>rniers <strong>de</strong>vai<strong>en</strong>t inclure, dans leur plan <strong>de</strong> reprise, un volet social assurant à l’Etat la<br />
préservation <strong>de</strong>s emplois. Au regard <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier critère, la structure <strong>de</strong> gouvernance <strong>de</strong>s<br />
caisses d’épargne et <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s mutualistes a constitué un avantage comparatif par rapport <strong>aux</strong><br />
<strong>banque</strong>s commerciales. Elles étai<strong>en</strong>t davantage <strong>en</strong> mesure <strong>de</strong> garantir la stabilité <strong>de</strong>s emplois au<br />
contraire <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s commerciales qui répon<strong>de</strong>nt à une logique <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s coûts et <strong>de</strong><br />
synergie <strong>de</strong>s activités. Les acquisitions, issues <strong>de</strong>s privatisations, ont permis <strong>aux</strong> caisses<br />
d’épargne et <strong>banque</strong>s mutualistes d’ét<strong>en</strong>dre leurs parts <strong>de</strong> marché et <strong>de</strong> diversifier leurs sources<br />
<strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us 14 .<br />
Conjointem<strong>en</strong>t au processus <strong>de</strong> privatisation, un nouveau système financier est instauré. Ces<br />
transformations sont dictées par la globalisation financière à l’échelon mondial et par la<br />
perspective <strong>de</strong> création du marché unique europé<strong>en</strong>. Les autorités mo<strong>de</strong>rnis<strong>en</strong>t les cadres<br />
bancaire et financier afin <strong>de</strong> pouvoir transposer les directives europé<strong>en</strong>nes <strong>en</strong> <strong>France</strong>. Ainsi, le<br />
rationnem<strong>en</strong>t du crédit est levé <strong>en</strong> 1987. Les principales raisons qui conduis<strong>en</strong>t la <strong>France</strong> à<br />
abandonner cet instrum<strong>en</strong>t sont symétriques à celles qui l’avai<strong>en</strong>t justifié. Le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s<br />
marchés s’est réalisé au détrim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’intermédiation bancaire : <strong>en</strong> 1985, le crédit bancaire<br />
n’assure plus que 50 % du financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s sociétés non financières. Le rationnem<strong>en</strong>t du crédit<br />
bancaire ne permet donc plus d’assurer pleinem<strong>en</strong>t le contrôle du financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’économie.<br />
L’abandon du contrôle <strong>de</strong>s changes <strong>en</strong> 1989, condition nécessaire à la création d’un marché<br />
europé<strong>en</strong> <strong>de</strong>s capit<strong>aux</strong> unifié, r<strong>en</strong>force l’obsolesc<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> cette mesure. Par ailleurs, le contrôle<br />
par les t<strong>aux</strong> apparaît plus crédible. L’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t a fait l’objet <strong>de</strong> nombreuses critiques 15<br />
d’autant plus que l’appareil financier et le marché monétaire ont été mo<strong>de</strong>rnisés.<br />
En effet, à partir <strong>de</strong> 1986, tous les ag<strong>en</strong>ts ont accès au marché monétaire et <strong>de</strong> nouve<strong>aux</strong><br />
instrum<strong>en</strong>ts 16 sont créés sous l’impulsion directe <strong>de</strong>s pouvoirs publics. L’objectif principal est<br />
<strong>de</strong> créer un marché unifié <strong>de</strong> capit<strong>aux</strong> ouvert à l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s acteurs économiques. Ces<br />
réformes sont suivies par un développem<strong>en</strong>t important <strong>de</strong>s marchés financier et monétaire. Cet<br />
essor traduit un changem<strong>en</strong>t dans les préfér<strong>en</strong>ces <strong>de</strong>s ag<strong>en</strong>ts non financiers. Il est lié à<br />
l’<strong>en</strong>gouem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers pour le marché <strong>de</strong>s titres, les t<strong>aux</strong> étant particulièrem<strong>en</strong>t attractifs<br />
à partir <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> moitié <strong>de</strong>s années 80. Ces mo<strong>de</strong>rnisations ont <strong>de</strong>ux principales<br />
conséqu<strong>en</strong>ces sur les établissem<strong>en</strong>ts bancaires. Face à la concurr<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s marchés, les <strong>banque</strong>s<br />
s’<strong>en</strong>gag<strong>en</strong>t dans une phase int<strong>en</strong>se d’innovation <strong>de</strong> produits. Les activités <strong>de</strong> production<br />
14 Par exemple, le Crédit Agricole a racheté la <strong>banque</strong> Indosuez (<strong>banque</strong> d’affaires).<br />
15 Lour<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> gestion administrative, réduction <strong>de</strong> la concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les <strong>banque</strong>s qui avai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> outre t<strong>en</strong>dance à<br />
privilégier les cli<strong>en</strong>ts sûrs au détrim<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s investissem<strong>en</strong>ts plus risqués.<br />
16 Les certificats <strong>de</strong> dépôts négociables émis par les <strong>banque</strong>s, les billets <strong>de</strong> trésorerie émis par les ag<strong>en</strong>ts non<br />
<strong>Cerna</strong> 11
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
<strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t un <strong>en</strong>jeu stratégique majeur car elles détermin<strong>en</strong>t les capacités <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s à ret<strong>en</strong>ir<br />
leur cli<strong>en</strong>tèle d’<strong>en</strong>treprises.<br />
Parallèlem<strong>en</strong>t, dans le patrimoine <strong>de</strong>s ménages, les portefeuilles <strong>de</strong> titres pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t une<br />
importance croissante ce qui <strong>en</strong>traîne un changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la structure du bilan <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s. <strong>La</strong><br />
part <strong>de</strong>s dépôts à vue (ressources non rémunérées 17 ) ne cesse <strong>de</strong> diminuer comme le montre le<br />
graphique 2. Les produits rémunérés <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t plus attrayants pour les consommateurs car les<br />
t<strong>aux</strong> d’intérêt à court terme sont élevés et l’inflation a largem<strong>en</strong>t reculé. L’augm<strong>en</strong>tation du coût<br />
<strong>de</strong>s ressources pèse sur les marges d’intermédiation <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s dès la fin <strong>de</strong>s années 80. Cette<br />
t<strong>en</strong>dance se r<strong>en</strong>force durant la déc<strong>en</strong>nie suivante résultant, non seulem<strong>en</strong>t, du comportem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s<br />
ménages, mais aussi <strong>de</strong> la pression concurr<strong>en</strong>tielle interne à l’industrie. Les <strong>banque</strong>s sont<br />
incitées à diversifier leurs activités pour comp<strong>en</strong>ser la baisse <strong>de</strong>s rev<strong>en</strong>us issus <strong>de</strong>s marges<br />
d’intermédiation et trouver <strong>de</strong> nouvelles sources <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us.<br />
Graphique 2 : Evolution <strong>de</strong> la composition <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s AFB<br />
(<strong>en</strong> % <strong>de</strong>s ressources cli<strong>en</strong>tèle)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1950 1960 1970 1980 1990 1993 1997 1999<br />
Ressources non rémunérées<br />
Ressources à t<strong>aux</strong> réglem<strong>en</strong>tés<br />
Ressources à t<strong>aux</strong> <strong>de</strong> marché<br />
Autres ressources rémunérées<br />
Source : Plihon (1995 et 1999), données Commission bancaire 18<br />
financiers et les bons du Trésor négociables.<br />
17 <strong>De</strong>puis 1937, les <strong>banque</strong>s ont l’interdiction <strong>de</strong> rémunérer les dépôts à vue. En contrepartie, elles ne doiv<strong>en</strong>t pas<br />
facturer les chèques à leurs cli<strong>en</strong>ts.<br />
18 Les ressources non rémunérées sont les dépôts à vue, les ressources à t<strong>aux</strong> réglem<strong>en</strong>tés compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t, notamm<strong>en</strong>t,<br />
les livrets A, les plans d’épargne logem<strong>en</strong>t et les comptes à terme. Leurs t<strong>aux</strong> sont déterminés par les pouvoirs<br />
publics.<br />
<strong>Cerna</strong> 12
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
<strong>La</strong> transformation du modèle d’affaires <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s<br />
<strong>La</strong> baisse t<strong>en</strong>dancielle <strong>de</strong>s marges d’intermédiation<br />
Les années 90 marqu<strong>en</strong>t l’essor <strong>de</strong> l’intermédiation financière pour les <strong>banque</strong>s. <strong>La</strong> marge<br />
d’intermédiation traditionnelle chute dès la déc<strong>en</strong>nie 80 et atteint son niveau le plus bas <strong>en</strong><br />
1993. Cette évolution est due à la conjonction <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ts facteurs. <strong>La</strong> structure du bilan <strong>de</strong>s<br />
<strong>banque</strong>s commerciales s’est déformée. <strong>La</strong> part <strong>de</strong>s dépôts à vue non rémunérés, au passif <strong>de</strong>s<br />
<strong>banque</strong>s, passe <strong>de</strong> 55,1 % <strong>en</strong> 1980 à 15,7 % <strong>en</strong> 1999. En contrepartie, les ressources rémunérées<br />
ont progressé : comptes épargne, comptes à terme, obligations et titres négociables. À l’actif <strong>de</strong>s<br />
bilans bancaires, la part <strong>de</strong>s crédits bancaires diminue égalem<strong>en</strong>t. Ce <strong>de</strong>rnier phénomène est la<br />
conséqu<strong>en</strong>ce directe <strong>de</strong> l’accroissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la pression concurr<strong>en</strong>tielle suite au mouvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
libéralisation <strong>de</strong>s marchés. Le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s marchés et <strong>de</strong>s innovations financières<br />
procure <strong>aux</strong> <strong>en</strong>treprises, part importante <strong>de</strong> la cli<strong>en</strong>tèle <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s commerciales, un pouvoir<br />
<strong>de</strong> négociation plus élevé auprès <strong>de</strong> leur <strong>banque</strong>. Elles peuv<strong>en</strong>t se financer via le crédit bancaire<br />
ou bi<strong>en</strong> directem<strong>en</strong>t sur les marchés <strong>de</strong>s capit<strong>aux</strong>. Par ailleurs, les conditions économiques au<br />
début <strong>de</strong>s années 90 les pouss<strong>en</strong>t à se dés<strong>en</strong><strong>de</strong>tter et à privilégier l’autofinancem<strong>en</strong>t. <strong>La</strong><br />
conjoncture est défavorable à l’investissem<strong>en</strong>t et les t<strong>aux</strong> d’intérêt sont élevés ce qui ral<strong>en</strong>tit<br />
fortem<strong>en</strong>t la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> crédit <strong>de</strong>s firmes. Ces <strong>de</strong>rnières préfèr<strong>en</strong>t donc recourir directem<strong>en</strong>t au<br />
marché pour se financer <strong>en</strong> émettant <strong>de</strong>s billets <strong>de</strong> trésorerie 19 .<br />
Graphique 3 : Evolution <strong>de</strong> la marge partielle d’intermédiation 20 <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s AFB (%)<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
1972 1978 1983 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999<br />
Marge partielle d'intermédiation<br />
Source : <strong>Cerna</strong> (données Commission Bancaire)<br />
19 Les billets <strong>de</strong> trésorerie sont <strong>de</strong>s titres émis par les établissem<strong>en</strong>ts non financiers sur le marché monétaire. Leur<br />
échéance peut varier <strong>de</strong> 10 jours à un an.<br />
20 <strong>La</strong> marge partielle d’intermédiation représ<strong>en</strong>te la différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre le r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s crédits et le coût <strong>de</strong>s dépôts.<br />
<strong>Cerna</strong> 13
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Cette t<strong>en</strong>dance est moins marquée dans le cas <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s mutualistes et <strong>de</strong>s caisses d’épargne.<br />
<strong>La</strong> structure <strong>de</strong> leur cli<strong>en</strong>tèle diffère <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s commerciales. <strong>La</strong> part <strong>de</strong>s particuliers<br />
est beaucoup plus importante. Or, la compétition sur ce segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cli<strong>en</strong>tèle est moins forte que<br />
sur celui <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises. L’exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> sortie 21 [P. Kemplerer 1995], couplée à un<br />
pouvoir <strong>de</strong> négociation faible 22 , réduit la concurr<strong>en</strong>ce et permet <strong>aux</strong> <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> dégager <strong>de</strong>s<br />
marges plus élevées. Les consommateurs <strong>en</strong>cour<strong>en</strong>t d’importants coûts <strong>de</strong> transaction et<br />
d’information lorsqu’ils chang<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>banque</strong> : recherche et comparaison <strong>de</strong>s offres concurr<strong>en</strong>tes,<br />
frais <strong>de</strong> clôture et d’ouverture <strong>de</strong> comptes, etc. Ils support<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> portage,<br />
c’est-à-dire <strong>de</strong>s coûts liés au transfert d’information. Le cli<strong>en</strong>t doit révéler <strong>de</strong> l’information à<br />
son nouveau fournisseur <strong>de</strong> produits bancaires. Ces coûts sont irrécupérables, l’information ne<br />
peut se transmettre automatiquem<strong>en</strong>t d’une <strong>banque</strong> à l’autre. Ils sont dissuasifs et conduis<strong>en</strong>t à<br />
l’inertie. Les cli<strong>en</strong>ts sont captifs, les <strong>banque</strong>s peuv<strong>en</strong>t donc extraire une r<strong>en</strong>te plus élevée sur ce<br />
segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cli<strong>en</strong>tèle.<br />
Graphique 4 : Evolution <strong>de</strong> la composition du PNB <strong>en</strong> % (<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s)<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997<br />
Marge d'intermédiation<br />
Produits divers (commissions)<br />
Source : <strong>Cerna</strong> (données OCDE)<br />
<strong>La</strong> diversification <strong>de</strong>s sources <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us<br />
<strong>La</strong> baisse <strong>de</strong>s marges d’intermédiation est comp<strong>en</strong>sée par la diversification <strong>de</strong>s sources <strong>de</strong><br />
rev<strong>en</strong>us, les opérations hors intermédiation sont croissantes. Les commissions 23 ont ainsi acquis<br />
un poids prépondérant dans les rev<strong>en</strong>us bancaires. Leur contribution au PNB <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s<br />
établissem<strong>en</strong>ts bancaires passe <strong>de</strong> 19,25 % <strong>en</strong> 1988 à 53 % <strong>en</strong> 1997. Dans le cas <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s<br />
commerciales, les commissions sont <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues la principale source <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us et contribu<strong>en</strong>t à<br />
plus <strong>de</strong> 60 % du PNB <strong>en</strong> 1997. Cette évolution est <strong>en</strong> gran<strong>de</strong> partie le résultat direct du biais<br />
21 Les coûts <strong>de</strong> sortie sont les coûts que les consommateurs associ<strong>en</strong>t au changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> fournisseur <strong>de</strong> produits ou <strong>de</strong><br />
services.<br />
22 Les particuliers ne peuv<strong>en</strong>t se financer directem<strong>en</strong>t sur les marchés financiers.<br />
23 Par exemple les commissions liées à la gestion <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> paiem<strong>en</strong>t (carte <strong>de</strong> crédit), celles qui rémunèr<strong>en</strong>t les<br />
risques liés à l’intermédiation classique et les commissions sur opérations <strong>de</strong> bourse (achat- v<strong>en</strong>te <strong>de</strong> titres) etc.<br />
<strong>Cerna</strong> 14
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
concurr<strong>en</strong>tiel, <strong>en</strong>tre <strong>banque</strong>s commerciales, <strong>banque</strong>s mutualistes et caisses d’épargne, évoqué<br />
précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> la marchéisation 24<br />
<strong>de</strong>s bilans bancaires. Face à l’accroissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la<br />
concurr<strong>en</strong>ce sur le segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises, ces établissem<strong>en</strong>ts ont pratiqué <strong>de</strong>s prix d’appels<br />
(tarification <strong>en</strong> <strong>de</strong>ssous du coût marginal) sur certains produits 25 pour attirer et acquérir la<br />
cli<strong>en</strong>tèle <strong>de</strong> particuliers. Pour limiter les risques systémiques liés à cette guerre <strong>de</strong>s prix, la<br />
circulaire Trichet paraît <strong>en</strong> 1995. Celle-ci recomman<strong>de</strong> <strong>aux</strong> <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> ne pas allouer <strong>de</strong> crédit à<br />
un t<strong>aux</strong> débiteur inférieur au t<strong>aux</strong> sans risque et fixe un t<strong>aux</strong> plancher minimal. Cette mesure<br />
vise à ce que les ag<strong>en</strong>ts ne se financ<strong>en</strong>t pas à un t<strong>aux</strong> inférieur à celui que paie l’Etat, sa qualité<br />
<strong>de</strong> signature étant supérieure. Cep<strong>en</strong>dant, l’application <strong>de</strong> cette mesure reste limitée car ce n’est<br />
pas une loi et la concurr<strong>en</strong>ce sur ce segm<strong>en</strong>t d’activité <strong>de</strong>meure élevée <strong>en</strong> raison <strong>de</strong>s stratégies<br />
<strong>de</strong> v<strong>en</strong>tes croisées adoptées par les <strong>banque</strong>s. En effet, l’objectif <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s à travers ces<br />
produits d’appels est d’attirer les consommateurs et <strong>de</strong> leur proposer <strong>en</strong>suite <strong>de</strong>s services<br />
complém<strong>en</strong>taires qui génèr<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s commissions. Dans cette optique est né le concept <strong>de</strong><br />
« bancassurance ». Les <strong>banque</strong>s ont développé <strong>de</strong>s services autour <strong>de</strong> leurs produits <strong>de</strong> base :<br />
elles associ<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s produits à faible r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t (crédit) à <strong>de</strong>s services complém<strong>en</strong>taires<br />
(assurances) fortem<strong>en</strong>t rémunérateurs.<br />
Encadré 2 : <strong>La</strong> bancassurance<br />
Les années 90 marqu<strong>en</strong>t le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la « bancassurance ». Les <strong>banque</strong>s ont une expéri<strong>en</strong>ce <strong>de</strong><br />
longue date <strong>en</strong> matière d’assurances à travers l’association systématique <strong>aux</strong> contrats <strong>de</strong> crédit <strong>de</strong><br />
systèmes <strong>de</strong> couverture contre l’invalidité ou le décès et à travers l’assurance <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> paiem<strong>en</strong>t.<br />
Cette diversification « naturelle » permet <strong>aux</strong> <strong>banque</strong>s d’étaler leurs coûts <strong>de</strong> distribution sur un plus<br />
grand nombre <strong>de</strong> produits. Elles bénéfici<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t d’économies <strong>de</strong> gamme liées à l’exploitation <strong>de</strong><br />
leurs fichiers cli<strong>en</strong>ts. Par ailleurs, les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit se positionn<strong>en</strong>t comme une alternative <strong>aux</strong><br />
assureurs traditionnels grâce à la capillarité <strong>de</strong> leur réseau <strong>de</strong> distribution. Dans un premier temps, les<br />
<strong>banque</strong>s ont proposé à leurs cli<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>s contrats d’assurance vie. Ces produits d’épargne simples<br />
permett<strong>en</strong>t d’attirer la cli<strong>en</strong>tèle grâce <strong>aux</strong> incitations fiscales qui leur sont associées. Elles ont ét<strong>en</strong>du, par<br />
la suite, leur gamme d’assurances dans le cadre d’offres groupées : association d’un crédit immobilier et<br />
d’une assurance multirisque habitation ou <strong>en</strong>core d’un crédit automobile et d’une assurance dommage.<br />
Les moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> paiem<strong>en</strong>t (hormis les chèques) génèr<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t une part très importante <strong>de</strong>s<br />
commissions. Les cartes <strong>de</strong> retrait nationales ou internationales sont <strong>de</strong>s produits peu coûteux<br />
pour les <strong>banque</strong>s, mais la facturation <strong>de</strong> ce service au cli<strong>en</strong>t est élevée. Les services tels les<br />
transferts d’arg<strong>en</strong>t d’un établissem<strong>en</strong>t à un autre ou <strong>en</strong>core les transferts vers l’étranger sont<br />
égalem<strong>en</strong>t d’importantes sources <strong>de</strong> profit.<br />
Les <strong>banque</strong>s mutualistes ont connu une évolution similaire et ont adopté <strong>de</strong>s stratégies<br />
analogues à celles <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s commerciales. Cep<strong>en</strong>dant si les commissions particip<strong>en</strong>t à<br />
hauteur <strong>de</strong> 44 % <strong>de</strong> leur PNB <strong>en</strong> 1997, les rev<strong>en</strong>us issus <strong>de</strong> la marge d’intermédiation <strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t<br />
la principale source <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>us (56 % <strong>de</strong>s rev<strong>en</strong>us). Cette différ<strong>en</strong>ce est liée à l’importance<br />
24 Le concept <strong>de</strong> marchéisation fait référ<strong>en</strong>ce à la place croissante <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> marché, aussi bi<strong>en</strong> à l’actif qu’au<br />
passif, dans les bilans <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s.<br />
<strong>Cerna</strong> 15
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
relative du segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s particuliers au sein <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> la cli<strong>en</strong>tèle. <strong>La</strong> pression sur les<br />
marges d’intermédiation perçues sur ce segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cli<strong>en</strong>tèle est plus faible que sur celui <strong>de</strong>s<br />
<strong>en</strong>treprises.<br />
Par comparaison, la contribution <strong>de</strong>s commissions au PNB <strong>de</strong>s caisses d’épargne est plus faible<br />
bi<strong>en</strong> qu’<strong>en</strong> augm<strong>en</strong>tation 26 . Elles représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t 28 % du PNB <strong>de</strong> ces établissem<strong>en</strong>ts. Les activités<br />
liées <strong>aux</strong> commissions sont historiquem<strong>en</strong>t moins développées au sein <strong>de</strong> ces institutions dont la<br />
vocation première est <strong>de</strong> collecter <strong>de</strong> l’épargne liqui<strong>de</strong> pour financer le logem<strong>en</strong>t social à <strong>de</strong>s<br />
t<strong>aux</strong> privilégiés. L’exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> la structure <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong>s caisses d’épargne permet d’expliquer la<br />
singularité <strong>de</strong> ces établissem<strong>en</strong>ts. En 1999, les ressources à t<strong>aux</strong> réglem<strong>en</strong>tés (PEL, CEL etc)<br />
représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t plus <strong>de</strong> 70 % <strong>de</strong>s ressources totales. Parmi celles-ci, le livret A constitue un cas<br />
particulier. Les caisses d’épargne jou<strong>en</strong>t un rôle <strong>de</strong> prestataire <strong>de</strong> services auprès <strong>de</strong> la Caisse<br />
<strong>de</strong>s dépôts et consignations (CDC). Le produit <strong>de</strong> la collecte du livret A est c<strong>en</strong>tralisé <strong>en</strong> totalité<br />
à la CDC qui <strong>en</strong> assure la gestion. Celle-ci réalise la transformation <strong>de</strong> ces fonds <strong>en</strong> prêts <strong>de</strong><br />
longue durée et à t<strong>aux</strong> privilégiés qui bénéfici<strong>en</strong>t <strong>aux</strong> secteurs prioritaires désignés par l’Etat.<br />
Les caisses d’épargne perçoiv<strong>en</strong>t une rémunération égale à 1,2 % <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>cours collecté <strong>en</strong><br />
contrepartie <strong>de</strong> leur prestation. En 1997, cette <strong>de</strong>rnière s’élève à 4,9 milliards <strong>de</strong> francs, soit<br />
17 % du PNB net du réseau. Ce chiffre révèle l’ampleur du biais concurr<strong>en</strong>tiel <strong>en</strong>tre les<br />
différ<strong>en</strong>ts établissem<strong>en</strong>ts. Néanmoins, le marché unique <strong>de</strong>vrait pousser les caisses d’épargne à<br />
s’aligner sur le modèle d’affaires actuel, fondé sur les commissions, <strong>de</strong>s autres <strong>banque</strong>s pour<br />
faire face à la concurr<strong>en</strong>ce pot<strong>en</strong>tielle <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s europé<strong>en</strong>nes.<br />
Ainsi, les <strong>banque</strong>s, qui assurai<strong>en</strong>t une fonction <strong>de</strong> service public et dont le modèle d’affaires<br />
reposait sur les rev<strong>en</strong>us issus <strong>de</strong> l’intermédiation, se sont radicalem<strong>en</strong>t métamorphosées ces<br />
vingt <strong>de</strong>rnières années. Aujourd’hui, leurs bénéfices dans les activités <strong>de</strong> <strong>détail</strong> dép<strong>en</strong><strong>de</strong>nt<br />
exclusivem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leur aptitu<strong>de</strong> à générer <strong>de</strong>s commissions issues <strong>de</strong>s services. <strong>La</strong> banalisation<br />
d’un certain nombre <strong>de</strong> produits bancaires (les crédits par exemple), a déplacé la compétition<br />
<strong>en</strong>tre <strong>banque</strong>s <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> production <strong>aux</strong> activités <strong>de</strong> distribution. Après une phase <strong>de</strong><br />
diversification, l’<strong>en</strong>jeu n’est plus <strong>de</strong> multiplier le nombre <strong>de</strong> produits mais <strong>de</strong> disposer d’un<br />
système <strong>de</strong> distribution performant répondant <strong>aux</strong> att<strong>en</strong>tes <strong>de</strong>s consommateurs. Ces nouvelles<br />
formes <strong>de</strong> la concurr<strong>en</strong>ce, reposant sur la distribution et les services, suggèr<strong>en</strong>t donc que la<br />
chaîne <strong>de</strong> valeur <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> <strong>détail</strong> ait égalem<strong>en</strong>t été bouleversée.<br />
25 Par exemple, les étudiants bénéfici<strong>en</strong>t <strong>de</strong> réduction sur les cartes <strong>de</strong> crédit, ou <strong>en</strong>core <strong>de</strong> services gratuits.<br />
26 Confère graphiques <strong>de</strong> l’annexe 1.<br />
<strong>Cerna</strong> 16
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
<strong>La</strong> distribution : le nouvel <strong>en</strong>jeu stratégique<br />
<strong>De</strong>ux phénomènes apparaiss<strong>en</strong>t dans ce nouveau contexte. D’une part, la concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les<br />
<strong>banque</strong>s s’est accrue et d’autre part la déréglem<strong>en</strong>tation a attiré <strong>de</strong> nouve<strong>aux</strong> acteurs non<br />
financiers (<strong>La</strong> Redoute ou les Galeries <strong>La</strong>fayette par exemple) dans le secteur bancaire, dont les<br />
<strong>en</strong>treprises <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> distribution. Ces <strong>de</strong>rnières se sont <strong>en</strong>gagées sur <strong>de</strong>s niches 27 , bénéficiant<br />
d’une large base établie <strong>de</strong> consommateurs et <strong>de</strong> la capillarité <strong>de</strong> leur réseau <strong>de</strong> distribution. Le<br />
développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s TI a égalem<strong>en</strong>t incité <strong>de</strong> nouvelles firmes à créer <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t à<br />
distance ou <strong>de</strong>s sites dédiés à la comparaison <strong>de</strong>s offres bancaires. L’accroissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la<br />
compétition interne et externe dans l’industrie modifie les variables concurr<strong>en</strong>tielles <strong>en</strong>tre les<br />
firmes du secteur. Ces bouleversem<strong>en</strong>ts incit<strong>en</strong>t les <strong>banque</strong>s à m<strong>en</strong>er une réflexion sur leur<br />
chaîne <strong>de</strong> valeur, autrem<strong>en</strong>t dit, sur l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s activités qu’elles exerc<strong>en</strong>t.<br />
<strong>La</strong> chaîne <strong>de</strong> valeur dans la <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong><br />
<strong>La</strong> chaîne <strong>de</strong> valeur <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> <strong>détail</strong> est traditionnellem<strong>en</strong>t organisée autour <strong>de</strong> plusieurs<br />
activités qui sont restées intégrées jusque dans les années 90 28 . <strong>De</strong>ux types d’activités peuv<strong>en</strong>t<br />
être distinguées : les activités primaires et les activités <strong>de</strong> souti<strong>en</strong> [E. <strong>La</strong>marque 1999]. Les<br />
premières compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t :<br />
- Le back office : la gestion <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> paiem<strong>en</strong>t, le traitem<strong>en</strong>t administratif <strong>de</strong>s<br />
opérations bancaires.<br />
- <strong>La</strong> conception <strong>de</strong>s produits et <strong>de</strong>s services : une distinction est faite <strong>en</strong>tre les produits<br />
directem<strong>en</strong>t liés ou non à la collecte. Les crédits relèv<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la première catégorie alors que<br />
les assurances font partie <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> catégorie.<br />
- Le marketing et la v<strong>en</strong>te : la politique <strong>de</strong> communication et le choix du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
distribution.<br />
<strong>La</strong> principale activité <strong>de</strong> souti<strong>en</strong> dans la <strong>banque</strong> est la gestion <strong>de</strong>s risques : risque <strong>de</strong> nonremboursem<strong>en</strong>t<br />
lors <strong>de</strong> la v<strong>en</strong>te <strong>de</strong> produits financiers mais aussi risques associés à la phase <strong>de</strong><br />
conception <strong>de</strong>s produits, au suivi <strong>de</strong> la relation ou <strong>en</strong>core <strong>aux</strong> traitem<strong>en</strong>ts administratifs <strong>de</strong>s<br />
dossiers cli<strong>en</strong>ts.<br />
27 Cartes privatives <strong>de</strong>stinées à fidéliser la cli<strong>en</strong>tèle ou crédits à la consommation par exemple.<br />
28 Confère annexe 2.<br />
<strong>Cerna</strong> 17
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Le poids <strong>de</strong> ces différ<strong>en</strong>tes activités varie suivant les firmes bancaires qui dispos<strong>en</strong>t <strong>de</strong> savoirfaire<br />
distincts. Cep<strong>en</strong>dant, la gestion <strong>de</strong>s risques et la distribution apparaiss<strong>en</strong>t comme <strong>de</strong>s<br />
activités clefs <strong>de</strong> leur chaîne <strong>de</strong> valeur par rapport <strong>aux</strong> autres activités. En effet, la conception <strong>de</strong><br />
produits est une fonction qui a progressivem<strong>en</strong>t perdu <strong>de</strong> son importance car les <strong>banque</strong>s<br />
peuv<strong>en</strong>t difficilem<strong>en</strong>t construire <strong>de</strong>s avantages concurr<strong>en</strong>tiels sur cette activité. L’innovation<br />
produit a constitué un <strong>en</strong>jeu <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importance jusqu’au début <strong>de</strong>s années 90. L’<strong>en</strong>semble<br />
<strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s a dû faire face à la concurr<strong>en</strong>ce croissante <strong>de</strong>s marchés financiers et développer <strong>de</strong><br />
nouve<strong>aux</strong> produits pour conserver leurs cli<strong>en</strong>ts. Cep<strong>en</strong>dant, l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> protection, par <strong>de</strong>s<br />
brevets, <strong>de</strong>s produits financiers, ne procure pas <strong>aux</strong> établissem<strong>en</strong>ts d’avantage concurr<strong>en</strong>tiel.<br />
L’innovation est rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t imitée par les concurr<strong>en</strong>ts 29 . Les activités <strong>de</strong> back office<br />
représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t un c<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> coûts pour les <strong>banque</strong>s. Ces <strong>de</strong>rnières cherch<strong>en</strong>t à réduire le poids <strong>de</strong>s<br />
frais génér<strong>aux</strong> liés à ces opérations. Lorsqu’une <strong>banque</strong> ne parvi<strong>en</strong>t pas à atteindre un niveau<br />
d’économies d’échelle satisfaisant (réduction <strong>de</strong>s coûts), il est préférable <strong>de</strong> sous-traiter ces<br />
fonctions administratives auprès d’autres établissem<strong>en</strong>ts. À titre d’exemple, la <strong>banque</strong> Natexis –<br />
Banques populaires s’est spécialisée dans ces activités et traite les opérations d’autres<br />
établissem<strong>en</strong>ts comme la BNP. Ce choix reflète la nécessité, pour un établissem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> dét<strong>en</strong>ir<br />
un savoir-faire particulier pour bénéficier d’économies d’échelle. Lorsque cette activité n’est<br />
pas optimisée au sein d’une <strong>banque</strong>, elle est externalisée dans une logique d’allégem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s<br />
coûts.<br />
Il n’<strong>en</strong> est pas <strong>de</strong> même pour les activités <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong> distribution. <strong>La</strong> gestion<br />
<strong>de</strong>s risques, c’est-à-dire les techniques <strong>de</strong> sélection <strong>de</strong>s cli<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong>s opérations, conditionne la<br />
r<strong>en</strong>tabilité <strong>de</strong>s établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit. Cette fonction stratégique ne peut pas être légitimem<strong>en</strong>t<br />
sous-traitée lorsque la distribution est intégrée <strong>aux</strong> activités <strong>de</strong> production. Or, la distribution<br />
constitue une source d’avantage concurr<strong>en</strong>tiel pour les <strong>banque</strong>s. Si les pratiques <strong>de</strong> course à<br />
l’ouverture <strong>de</strong> guichets, maint<strong>en</strong>ant dépassées, ont révélé leurs limites dès que la saturation du<br />
marché a été atteinte (problèmes <strong>de</strong> r<strong>en</strong>tabilité et <strong>de</strong> productivité), les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> distribution<br />
revêt<strong>en</strong>t, aujourd’hui, une dim<strong>en</strong>sion stratégique <strong>de</strong> premier plan. Le système <strong>de</strong> distribution<br />
recouvre <strong>de</strong>ux dim<strong>en</strong>sions : la gestion du support physique <strong>de</strong> l’offre bancaire et la gestion du<br />
contact cli<strong>en</strong>t. <strong>La</strong> mise <strong>en</strong> place <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ts can<strong>aux</strong> <strong>de</strong> distribution augm<strong>en</strong>te la valeur produite<br />
par une <strong>banque</strong> pour elle-même et ses cli<strong>en</strong>ts. L’utilisation <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ts can<strong>aux</strong> (ag<strong>en</strong>ce,<br />
automate bancaire, c<strong>en</strong>tre d’appel, Internet) permet d’optimiser la répartition <strong>de</strong>s coûts et <strong>de</strong>s<br />
rev<strong>en</strong>us associés à chaque produit ou service et <strong>de</strong> répondre à l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s préfér<strong>en</strong>ces <strong>de</strong>s<br />
consommateurs. Or, sur ces <strong>de</strong>ux activités <strong>de</strong> nouve<strong>aux</strong> acteurs concurr<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t les firmes<br />
traditionnelles. <strong>De</strong>s sociétés <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t spécialisées dans la gestion <strong>de</strong>s risques (Cofinoga<br />
par exemple) ont pénétré le marché bancaire, mais aussi <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> distribution<br />
29 Cep<strong>en</strong>dant, l’innovation est une source perpétuelle <strong>de</strong> nouve<strong>aux</strong> rev<strong>en</strong>us.<br />
<strong>Cerna</strong> 18
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
(Carrefour, Auchan, Leclerc…).<br />
Face à ces nouve<strong>aux</strong> concurr<strong>en</strong>ts, les <strong>banque</strong>s mèn<strong>en</strong>t une réflexion sur leur chaîne <strong>de</strong> valeur<br />
afin d’isoler les fonctions les moins r<strong>en</strong>tables et d’i<strong>de</strong>ntifier leurs compét<strong>en</strong>ces clés pour se<br />
redéployer sur les activités où leur savoir faire est le plus important. Les <strong>banque</strong>s adopt<strong>en</strong>t<br />
progressivem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong> spécialisation ou <strong>de</strong> multi-spécialisation, certaines activités<br />
pouvant être autonomes et avoir une logique propre <strong>de</strong> création <strong>de</strong> valeur. <strong>La</strong> spécialisation <strong>de</strong>s<br />
<strong>banque</strong>s est un moy<strong>en</strong> <strong>de</strong> se différ<strong>en</strong>cier par la singularité <strong>de</strong>s activités et <strong>de</strong> créer <strong>de</strong> la valeur<br />
ajoutée. <strong>La</strong> conc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong>s compét<strong>en</strong>ces sur <strong>de</strong>s fonctions limitées peut pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t être<br />
générateur d’économies d’échelle, mais elle induit égalem<strong>en</strong>t un éclatem<strong>en</strong>t du modèle <strong>de</strong><br />
<strong>banque</strong> intégré. <strong>La</strong> désagrégation <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> valeur peut conduire les <strong>banque</strong>s à s’<strong>en</strong>gager<br />
dans les stratégies suivantes : la <strong>banque</strong> productrice, la <strong>banque</strong> distributeur et la <strong>banque</strong><br />
prestataire <strong>de</strong> services.<br />
Encadré 3 : Les stratégies <strong>de</strong> spécialisation<br />
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> productrice : la firme se spécialise sur un petit nombre <strong>de</strong> produits avec peu <strong>de</strong> variantes. Elle<br />
tire son avantage concurr<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong>s économies d’échelle et <strong>de</strong> son <strong>de</strong>gré d’expertise. Cette stratégie a été<br />
mise <strong>en</strong> place par les <strong>banque</strong>s étrangères pour réduire leurs coûts d’installation sur le marché français.<br />
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> distributeur : elle accepte <strong>de</strong> distribuer <strong>de</strong>s produits conçus par d’autres acteurs du secteur.<br />
Cette stratégie revêt <strong>de</strong>ux aspects : celui « d’Op<strong>en</strong> Finance », une <strong>banque</strong> traditionnelle accepte <strong>de</strong><br />
distribuer les produits <strong>de</strong> ces concurr<strong>en</strong>ts et celui <strong>de</strong> supermarché financier à l’instar <strong>de</strong> ZeBank <strong>en</strong> <strong>France</strong><br />
qui distribue les produits <strong>de</strong> diverses <strong>banque</strong>s sous marque blanche 30 .<br />
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> prestataire <strong>de</strong> services : elle propose <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> back office (impression <strong>de</strong> relevés <strong>de</strong><br />
comptes, comp<strong>en</strong>sation <strong>de</strong>s chèques par exemple), <strong>de</strong>s infrastructures et <strong>de</strong>s rése<strong>aux</strong> <strong>de</strong> communication<br />
interbancaire <strong>aux</strong> autres établissem<strong>en</strong>ts financiers. C’est le cas <strong>de</strong> Natexis - Banque Populaires <strong>en</strong> <strong>France</strong><br />
Les possibilités <strong>de</strong> réorganiser la chaîne <strong>de</strong> valeur dans la <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> sont donc multiples<br />
et vont évoluer durant les dix prochaines années particulièrem<strong>en</strong>t avec le développem<strong>en</strong>t<br />
d’Internet.<br />
Internet : vecteur <strong>de</strong> recomposition <strong>de</strong>s services financiers<br />
Le développem<strong>en</strong>t d’Internet et l’apparition <strong>de</strong> nouvelles firmes issues du développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s TI<br />
risqu<strong>en</strong>t d’accélérer le mouvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> désagrégation <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> valeur. En matière <strong>de</strong><br />
distribution trois principales options se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>aux</strong> <strong>banque</strong>s. <strong>La</strong> première consiste à intégrer<br />
Internet comme un canal <strong>de</strong> distribution complém<strong>en</strong>taire au sein du dispositif déjà <strong>en</strong> place pour<br />
consoli<strong>de</strong>r le modèle <strong>de</strong> distribution multicanal. Cette stratégie a été jusqu’ici privilégiée par les<br />
<strong>banque</strong>s françaises qui actuellem<strong>en</strong>t dispos<strong>en</strong>t toutes d’un canal Internet. Au sein <strong>de</strong> ce modèle<br />
multicanal, les ag<strong>en</strong>ces rest<strong>en</strong>t le pivot <strong>de</strong> la relation commerciale. Les can<strong>aux</strong> à distance<br />
30 <strong>La</strong> firme distribue les produits <strong>de</strong> ses part<strong>en</strong>aires sous sa propre marque.<br />
<strong>Cerna</strong> 19
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
serv<strong>en</strong>t à traiter les tâches administratives et à dés<strong>en</strong>gorger les guichets. <strong>La</strong> logique <strong>de</strong> ce<br />
modèle est <strong>de</strong> répartir la valeur ajoutée <strong>de</strong>s opérations suivant le coût <strong>de</strong>s can<strong>aux</strong> <strong>de</strong> distribution.<br />
Une <strong>de</strong>uxième possibilité rési<strong>de</strong> dans le développem<strong>en</strong>t d’une nouvelle <strong>en</strong>tité autonome<br />
<strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t à distance sous une autre marque. Cette stratégie a été mise <strong>en</strong> œuvre <strong>aux</strong> Etats-<br />
Unis. Certaines <strong>banque</strong>s américaines se sont risquées dans cette voie (Wingsbank par exemple<br />
développée par Bank One) qui a rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t atteint ses limites. Ce modèle implique<br />
d’importances dép<strong>en</strong>ses publicitaires pour établir la marque et donc <strong>de</strong>s coûts d’acquisition<br />
cli<strong>en</strong>t élevés. Ces coûts ont <strong>de</strong>ux dim<strong>en</strong>sions : les dép<strong>en</strong>ses marketing d’une part et la mise <strong>en</strong><br />
place d’offres compétitives compr<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s produits d’appels qui sont privilégiés par la cli<strong>en</strong>tèle<br />
dans un premier temps. Le modèle <strong>de</strong> ces nouvelles <strong>banque</strong>s repose <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t sur la<br />
conversion <strong>de</strong>s cli<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> consommateurs r<strong>en</strong>tables <strong>de</strong> produits et services bancaires. Or, ces<br />
<strong>de</strong>rniers ont une confiance très limitée dans ces nouvelles institutions et restreign<strong>en</strong>t leur<br />
volume d’achats <strong>de</strong> services bancaires auprès d’elles. L’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ce physique (<strong>en</strong><br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s distributeurs automatiques) représ<strong>en</strong>te égalem<strong>en</strong>t un frein même si ces <strong>banque</strong>s sont<br />
affiliées à <strong>de</strong>s établissem<strong>en</strong>ts traditionnels.<br />
Enfin, la <strong>de</strong>rnière option, adoptée <strong>en</strong> Gran<strong>de</strong>-Bretagne, consiste à adopter un modèle <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>struction créatrice 31 [J. Schumpeter 1942]. <strong>La</strong> <strong>banque</strong> déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> privilégier les can<strong>aux</strong> à<br />
distance (Internet et c<strong>en</strong>tre d’appel <strong>en</strong> particulier) et <strong>de</strong> fermer les ag<strong>en</strong>ces les moins r<strong>en</strong>tables<br />
<strong>de</strong> son réseau « brique & mortier ». <strong>De</strong> telles stratégies sont mises <strong>en</strong> œuvre par <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s<br />
anglaises comme Barclays. Cette <strong>banque</strong> a fermé 200 ag<strong>en</strong>ces et lic<strong>en</strong>cié 6000 employés pour<br />
rec<strong>en</strong>trer son offre sur les can<strong>aux</strong> à distance. Ainsi, les c<strong>en</strong>tres d’appel sont considérés <strong>en</strong> tant<br />
que can<strong>aux</strong> commerci<strong>aux</strong> à part <strong>en</strong>tière et non pas uniquem<strong>en</strong>t comme <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>tres <strong>de</strong> coûts<br />
administratifs (cas français). Ces stratégies ne sont pas antinomiques et peuv<strong>en</strong>t être combinées.<br />
Ainsi, une <strong>banque</strong> peut à la fois créer une filiale autonome sous une nouvelle marque et<br />
pratiquer une stratégie <strong>de</strong> distribution multicanal. Suivant les modèles organisationnels adoptés,<br />
<strong>de</strong>ux principales logiques se dégag<strong>en</strong>t pour l’élaboration d’une stratégie <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t : la<br />
continuité <strong>de</strong>s services et la distribution multiservices.<br />
<strong>La</strong> première stratégie s’inscrit dans la continuité historique <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>détail</strong> et consiste à sécuriser le cœur <strong>de</strong> l’activité bancaire : la distribution <strong>en</strong> pratiquant <strong>de</strong>s<br />
stratégies d’agrégation <strong>de</strong> services financiers connexes. L’objectif <strong>de</strong> la <strong>banque</strong> est <strong>de</strong> couvrir<br />
l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> ses cli<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> multipliant les offres <strong>de</strong> services. L’ext<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> la<br />
gamme <strong>de</strong> produits répond à la logique suivante : la diversité <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans le temps.<br />
Cette diversité est reflétée par le cycle <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s consommateurs. Leurs besoins <strong>de</strong> services<br />
financiers évolu<strong>en</strong>t suivant leur âge, leur situation familiale ou <strong>en</strong>core leur profession.<br />
<strong>Cerna</strong> 20
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
L’évolution <strong>de</strong>s besoins incite, <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce, les <strong>banque</strong>s à diversifier et ét<strong>en</strong>dre leur gamme<br />
<strong>de</strong> produits pour répondre à ces changem<strong>en</strong>ts temporels. Elles recherch<strong>en</strong>t à pratiquer une<br />
différ<strong>en</strong>ciation horizontale 32 [Hotelling, 1929] qui passe par l’ext<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> la gamme <strong>de</strong><br />
services. Elles combin<strong>en</strong>t divers produits et services qui répon<strong>de</strong>nt <strong>aux</strong> préfér<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> chaque<br />
segm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cli<strong>en</strong>tèle : forfait compr<strong>en</strong>ant différ<strong>en</strong>ts moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> paiem<strong>en</strong>t (cartes <strong>de</strong> crédit et<br />
chéquier) <strong>de</strong>s conditions privilégiées sur les découverts, <strong>de</strong>s lettres d’information, <strong>de</strong>s<br />
assurances voyage ou assistance médicale, garanties sur les achats, par exemple, autant <strong>de</strong><br />
combinaisons qui permett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> générer <strong>de</strong>s commissions.<br />
Cep<strong>en</strong>dant, ce modèle, c<strong>en</strong>tré sur les services financiers, correspond à une stratégie déf<strong>en</strong>sive<br />
car il vise <strong>en</strong> premier lieu à stabiliser la cli<strong>en</strong>tèle établie. Ce choix se heurte au développem<strong>en</strong>t<br />
<strong>de</strong> nouve<strong>aux</strong> acteurs (tra<strong>de</strong>rs <strong>en</strong> ligne, courtiers, assureurs par exemple), issus <strong>de</strong>s TI et d’autres<br />
secteurs. Parmi ces nouve<strong>aux</strong> acteurs l’exemple <strong>de</strong> Paypal <strong>aux</strong> Etats-Unis qui est un système <strong>de</strong><br />
monnaie électronique permettant le paiem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre particuliers via le règlem<strong>en</strong>t par carte <strong>de</strong><br />
crédit sur le compte du créancier ou <strong>en</strong>core <strong>de</strong> ZeBank <strong>en</strong> <strong>France</strong> qui se positionne comme un<br />
supermarché financier. Ces firmes ne sont pas soumises <strong>aux</strong> rigidités historiques du secteur<br />
bancaire traditionnel, elles n’ont pas à supporter les inconvéni<strong>en</strong>ts liés au réseau d’ag<strong>en</strong>ces<br />
« Brique & Mortier ». Elles peuv<strong>en</strong>t ainsi développer <strong>de</strong>s offres <strong>de</strong> produits et services<br />
innovantes et compétitives.<br />
<strong>La</strong> secon<strong>de</strong> stratégie s’appuie sur la mise <strong>en</strong> place <strong>de</strong> multiples part<strong>en</strong>ariats. <strong>La</strong> distribution<br />
multiservices signifie que l’établissem<strong>en</strong>t n’offre pas uniquem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s produits et services<br />
financiers, mais aussi <strong>de</strong>s services d’autres industries. Une converg<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les différ<strong>en</strong>tes<br />
industries <strong>de</strong> services est déjà <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong>puis quelques années : <strong>de</strong>s offres <strong>de</strong> services<br />
complém<strong>en</strong>taires sont associées comme c’est le cas dans la bancassurance. Ce regroupem<strong>en</strong>t se<br />
fait égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre les fournisseurs <strong>de</strong> services et les fournisseurs d’accès <strong>aux</strong> consommateurs<br />
à l’instar <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats qui ont été développés avec les <strong>en</strong>treprises <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> distribution<br />
(Auchan distribue les produits du CCF ainsi que Carrefour ceux <strong>de</strong> Cetelem). Cette stratégie<br />
recouvre <strong>de</strong>ux aspects : l’ext<strong>en</strong>sion du réseau <strong>de</strong> distribution et l’<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s cont<strong>en</strong>us<br />
offerts <strong>aux</strong> consommateurs. <strong>La</strong> <strong>banque</strong> peut ainsi accroître son réseau <strong>de</strong> distribution grâce à<br />
ceux <strong>de</strong> ses part<strong>en</strong>aires. Elle n’est pas <strong>en</strong> relation directe avec ses cli<strong>en</strong>ts, mais cette stratégie lui<br />
permet <strong>de</strong> toucher une plus gran<strong>de</strong> audi<strong>en</strong>ce, <strong>de</strong> valoriser sa marque par la maximisation <strong>de</strong> sa<br />
diffusion et <strong>de</strong> capturer pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> nouve<strong>aux</strong> cli<strong>en</strong>ts. Elle <strong>en</strong>richit égalem<strong>en</strong>t son offre<br />
grâce <strong>aux</strong> produits et services <strong>de</strong> ses part<strong>en</strong>aires et procure ainsi une plus gran<strong>de</strong> valeur ajoutée<br />
31 <strong>La</strong> <strong>de</strong>struction créatrice est, selon cet auteur, le processus <strong>de</strong> l’innovation dans le capitalisme.<br />
32 <strong>La</strong> différ<strong>en</strong>ciation horizontale repose sur l’hétérogénéité <strong>de</strong>s goûts <strong>de</strong>s consommateurs qui ont <strong>de</strong>s nive<strong>aux</strong> <strong>de</strong><br />
rev<strong>en</strong>us i<strong>de</strong>ntiques. Par exemple, la <strong>banque</strong> offre un nombre plus ou moins important <strong>de</strong> services rattachés à un<br />
compte courant suivant les préfér<strong>en</strong>ces.<br />
<strong>Cerna</strong> 21
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
à ses cli<strong>en</strong>ts : une <strong>banque</strong> peut associer son offre <strong>de</strong> crédits à un site d’immobilier ou <strong>en</strong>core à<br />
producteur <strong>de</strong> bi<strong>en</strong>s <strong>de</strong> consommation (d’ordinateurs par exemple). Grâce à cette stratégie, les<br />
<strong>banque</strong>s sont <strong>en</strong> position <strong>de</strong> conquête <strong>de</strong> nouve<strong>aux</strong> cli<strong>en</strong>ts, mais elles peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t<br />
augm<strong>en</strong>ter le panier moy<strong>en</strong> <strong>de</strong> leur base actuelle <strong>de</strong> cli<strong>en</strong>tèle <strong>en</strong> leur proposant les services <strong>de</strong><br />
leurs part<strong>en</strong>aires donc une plus gran<strong>de</strong> valeur ajoutée.<br />
Cep<strong>en</strong>dant, ces part<strong>en</strong>ariats ne sont pas sans risque pour les <strong>banque</strong>s qui pourrai<strong>en</strong>t perdre le<br />
contrôle <strong>de</strong> la relation cli<strong>en</strong>t. Ils nécessit<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t le partage <strong>de</strong> la valeur créée <strong>en</strong>tre les<br />
acteurs. Cette association a une dim<strong>en</strong>sion à la fois coopérative et compétitive. Le terme <strong>de</strong><br />
coopétition traduit cette situation, les risques <strong>de</strong> désintermédiation, c’est-à-dire <strong>de</strong> perte <strong>de</strong><br />
contrôle, sont élevés.<br />
<strong>Cerna</strong> 22
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Conclusion<br />
Les mutations <strong>de</strong>s conditions d’exercice <strong>de</strong>s activités bancaires ont <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dré une baisse <strong>de</strong> la<br />
contribution <strong>de</strong>s marges d’intermédiation au profit <strong>de</strong>s commissions liées <strong>aux</strong> services. <strong>La</strong><br />
libéralisation a r<strong>en</strong>du possible la séparation <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> distribution et a<br />
permis à <strong>de</strong> nouvelles firmes <strong>de</strong> pénétrer le marché. <strong>La</strong> diffusion <strong>de</strong>s TI dans l’économie<br />
r<strong>en</strong>force ce phénomène. Les coûts d’accès, <strong>de</strong>s nouve<strong>aux</strong> <strong>en</strong>trants, au marché bancaire<br />
diminu<strong>en</strong>t. Le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la <strong>banque</strong> à distance, via Internet ou les c<strong>en</strong>tres d’appel,<br />
<strong>en</strong>traîne une baisse <strong>de</strong>s coûts fixes d’installation. Ainsi, le coût <strong>de</strong> création d’une <strong>banque</strong><br />
virtuelle équivaut à celui d’une seule ag<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> réseau. Par ailleurs, au sein <strong>de</strong> ces nouve<strong>aux</strong><br />
can<strong>aux</strong> <strong>de</strong> distribution, les coûts <strong>de</strong> transaction sont inférieurs : le coût <strong>de</strong> transaction via une<br />
<strong>banque</strong> virtuelle représ<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre 1 et 25 % du coût <strong>en</strong> ag<strong>en</strong>ce et <strong>en</strong>tre 40 et 70 % <strong>de</strong> celui-ci<br />
lorsque la transaction est traitée par un c<strong>en</strong>tre d’appel. Dans ce nouveau contexte, la maîtrise <strong>de</strong><br />
la relation cli<strong>en</strong>t va constituer un <strong>en</strong>jeu concurr<strong>en</strong>tiel majeur <strong>en</strong>tre les différ<strong>en</strong>ts acteurs.<br />
Différ<strong>en</strong>tes questions se pos<strong>en</strong>t :<br />
- L’<strong>en</strong>trée <strong>de</strong> nouve<strong>aux</strong> acteurs peut-elle conduire une proportion croissante <strong>de</strong>s<br />
consommateurs à la multi-bancarisation ?<br />
- Quels serai<strong>en</strong>t les effets <strong>de</strong> ce phénomène sur la r<strong>en</strong>tabilité <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s acteurs ?<br />
- Si les firmes non bancaires (gran<strong>de</strong> distribution, <strong>en</strong>treprises technologiques, acteurs Internet,<br />
etc.) parvi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à maîtriser la relation cli<strong>en</strong>t, les <strong>banque</strong>s vont-elles <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> simples<br />
producteurs <strong>de</strong> commodités ?<br />
- Quelles seront, dans ce cas, leurs sources d’avantages comparatifs ?<br />
- Comm<strong>en</strong>t la valeur ajoutée va-t-elle être redistribuer <strong>en</strong>tre ces différ<strong>en</strong>ts interv<strong>en</strong>ants ?<br />
Une <strong>de</strong>s possibilités pour répondre à ces questions est <strong>de</strong> m<strong>en</strong>er une analyse sur les coûts <strong>de</strong><br />
sortie <strong>de</strong>s consommateurs. Ils sont un élém<strong>en</strong>t ess<strong>en</strong>tiel d’analyse <strong>de</strong> l’évolution du paysage<br />
bancaire car ils permett<strong>en</strong>t d’examiner la viabilité <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts acteurs.<br />
L’analyse <strong>de</strong>s questions suivantes est donc primordiale pour compr<strong>en</strong>dre l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s<br />
nouvelles firmes sur les <strong>banque</strong>s <strong>en</strong> place.<br />
- Quelle est l’ampleur <strong>de</strong> ces coûts <strong>de</strong> sortie et comm<strong>en</strong>t évolu<strong>en</strong>t-ils ?<br />
- Existe-t-il une corrélation <strong>en</strong>tre les coûts <strong>de</strong> sortie et la r<strong>en</strong>tabilité <strong>de</strong>s consommateurs ?<br />
<strong>Cerna</strong> 23
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
- Les coûts <strong>de</strong> sortie sont-ils différ<strong>en</strong>ts suivant les produits et services bancaires ?<br />
- Existe-t-il <strong>de</strong>s avantages informationnels suivant les can<strong>aux</strong> <strong>de</strong> distribution et comm<strong>en</strong>t les<br />
nouve<strong>aux</strong> <strong>en</strong>trants peuv<strong>en</strong>t-ils <strong>en</strong> jouer ?<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> sortie et surtout leur mesure dans l’industrie bancaire constituera le<br />
prolongem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cette recherche. Elle permettra <strong>de</strong> mieux i<strong>de</strong>ntifier les risques qui pès<strong>en</strong>t sur<br />
les <strong>banque</strong>s <strong>de</strong> <strong>détail</strong> face au développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s TI et d’analyser le caractère pér<strong>en</strong>ne <strong>de</strong>s<br />
activités <strong>de</strong> ces nouvelles <strong>en</strong>treprises issues d’Internet.<br />
<strong>Cerna</strong> 24
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Bibliographie<br />
Akerlof G. (1970), The market for lemons : quality uncertainty and the market mechanism, The<br />
Quaterly Journal of Economics, vol. 84, pp. 488-500.<br />
Augory C. et Pansard F. (2000), L’intermédiation financière <strong>en</strong> Europe, Revue semestrielle <strong>de</strong> la<br />
CDC, n°6, février.<br />
Avouyi-Dovi S et Boutillier M (1995), L’évolution <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s françaises <strong>de</strong>puis le début <strong>de</strong>s<br />
années quatre-vingt, Problèmes économiques, n°2.448, 29 novembre.<br />
Boujnah S. (1996), « Elém<strong>en</strong>ts d'économie industrielle appliqués à la <strong>banque</strong> :<br />
Déréglem<strong>en</strong>tation et évolution <strong>de</strong> l'activité bancaire », Mémoire <strong>de</strong> DEA, Université <strong>de</strong><br />
Lilles 1.<br />
Boutillier M. et Quéron A. (2000), Les commissions perçues par les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit <strong>en</strong><br />
Europe, Revue semestrielle <strong>de</strong> la CDC, n°6, février.<br />
Boutitie E., Burnand R et Marcellier C. (1998), Banques : taille critique, quelle taille critique ?,<br />
Conjoncture, Paribas, février.<br />
Caisse <strong>de</strong>s Dépôts et Consignations (1999), Concurr<strong>en</strong>ce et innovation technologique dans le<br />
marché bancaire europé<strong>en</strong>, Recherche épargne n°4, Service <strong>de</strong>s Etu<strong>de</strong>s Economiques et<br />
Financières.<br />
Commission Bancaire (2000), Rapport 1999.<br />
<strong>De</strong> Boissieu C et <strong>De</strong> Pontbriand G (1993), « Les stratégies bancaires dans les années 1990 »,<br />
Revue d’Economie financière, n°27, hiver.<br />
<strong>De</strong> Coussergues S. (1996), « <strong>La</strong> <strong>banque</strong> : structures, marchés, gestion », <strong>De</strong>uxième édition,<br />
Editions Dalloz.<br />
Dietsch M. (1990), « Economie d’échelle, économie d’<strong>en</strong>vergure et structure <strong>de</strong>s coûts dans les<br />
<strong>banque</strong>s françaises <strong>de</strong> dépôts », Conseil National <strong>de</strong> Crédit et Association <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s<br />
françaises.<br />
Fonds Monétaire International (1999), <strong>France</strong> : Selected Issues, IMF Staff Country Report, No.<br />
99/139, décembre.<br />
Freixas X. et Rochet J.C. (1999), « Microeconomics of banking », The MIT press, 4 ème édition.<br />
Hotelling H. (1929),Stability in competition, Economic Journal, 39, pp. 41-57.<br />
Klemperer P. (1995), Competition wh<strong>en</strong> consumers have switching costs : an overview with<br />
applications to industrial organization, macroeconomics, and international tra<strong>de</strong>, Review<br />
of Economic Studies, 62.<br />
<strong>La</strong>marque E. (1999), Les activités clés <strong>de</strong>s métiers bancaires : une analyse par la chaîne <strong>de</strong><br />
valeur, Finance Contrôle Stratégie, volume 2, n°2, juin.<br />
Muldur U. et Sass<strong>en</strong>ou M. (1989), Economies of scale and scope in the fr<strong>en</strong>ch banking and<br />
<strong>Cerna</strong> 25
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
saving institutions, Working Paper prés<strong>en</strong>té au 3 ème séminaire Franco-Américain.<br />
Muldur U. (1993), Les barrières à l’<strong>en</strong>trée dans le marché bancaire français, Revue d’Economie<br />
financière, n° 27, hiver.<br />
OCDE (1999), « R<strong>en</strong>tabilité <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s : comptes <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s ».<br />
Plihon D. (1995), L’évolution <strong>de</strong> l’intermédiation bancaire (1950-1993), Bulletin <strong>de</strong> la Banque<br />
<strong>de</strong> <strong>France</strong>, n°21, septembre.<br />
Plihon D. (1999), « Les <strong>banque</strong>s, nouve<strong>aux</strong> <strong>en</strong>jeux, nouvelles stratégies », Editions <strong>La</strong><br />
Docum<strong>en</strong>tation Française, Paris.<br />
Porter M. (1986), « L’avantage concurr<strong>en</strong>tiel », InterEditions, Paris.<br />
Rajan R. G. (1994), An investigation into the economics of ext<strong>en</strong>ding bank powers, mimeo,<br />
Université <strong>de</strong> Chicago.<br />
Schumpeter J. (1980), « Capitalisme, socialisme et démocratie », Editions Payot, Paris.<br />
Shepherd W. G. (1990), « The Economics of Industrial Organization », Troisième édition,<br />
Pr<strong>en</strong>tice Hall International Editions.<br />
Zollinger M. et <strong>La</strong>marque E. (1999), « Marketing et stratégie <strong>de</strong> la <strong>banque</strong> », Troisième édition,<br />
Editions Dunod, Paris.<br />
<strong>Cerna</strong> 26
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Annexe 1 : Composition du PNB <strong>de</strong>s<br />
différ<strong>en</strong>ts établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit<br />
Évolution <strong>de</strong> la contribution <strong>de</strong> la marge d’intermédiation et <strong>de</strong>s commissions<br />
au PNB <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s commerciales (%)<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997<br />
Marge d'intermédiation<br />
Produits divers (commissions)<br />
Source : <strong>Cerna</strong> (données OCDE)<br />
Évolution <strong>de</strong> la contribution <strong>de</strong> la marge d’intermédiation et <strong>de</strong>s commissions<br />
au PNB <strong>de</strong>s caisses d’épargne (%)<br />
100,00<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997<br />
Marge d'intermédiation<br />
Produits divers (commissions)<br />
Source : <strong>Cerna</strong> (données OCDE)<br />
<strong>Cerna</strong> 27
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Évolution <strong>de</strong> la contribution <strong>de</strong> la marge d’intermédiation et <strong>de</strong>s commissions<br />
au PNB <strong>de</strong>s <strong>banque</strong>s mutualistes (%)<br />
100,00<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997<br />
Marge d'intermédiation<br />
Produits divers (commissions)<br />
Source : <strong>Cerna</strong> (données OCDE)<br />
Évolution <strong>de</strong> la contribution <strong>de</strong> la marge d’intermédiation et <strong>de</strong>s commissions au PNB : autres <strong>banque</strong>s (%)<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997<br />
Marge d'intermédiation<br />
Produits divers (commissions)<br />
Source : <strong>Cerna</strong> (données OCDE)<br />
<strong>Cerna</strong> 28
<strong>La</strong> <strong>banque</strong> <strong>de</strong> <strong>détail</strong> <strong>en</strong> <strong>France</strong> : <strong>de</strong> l’intermédiation <strong>aux</strong> services<br />
Nathalie Daley<br />
Annexe 2 : <strong>La</strong> désintégration <strong>de</strong> la chaîne<br />
<strong>de</strong> valeur bancaire<br />
Activités <strong>de</strong> back office<br />
Le modèle intégré<br />
Middle office<br />
Distribution<br />
Cli<strong>en</strong>ts<br />
Au sein du modèle <strong>de</strong> <strong>banque</strong> intégrée, qui a prévalu dans le secteur jusque dans les années 90,<br />
un seul acteur pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> charge l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s opérations. Ainsi, le réseau physique sert à<br />
collecter <strong>de</strong>s fonds, transformés <strong>en</strong> produits et services par le départem<strong>en</strong>t « middle office ».<br />
Ces produits sont <strong>en</strong>suite distribués par le réseau <strong>de</strong> distribution propriétaire. Les opérations<br />
induites par la v<strong>en</strong>te <strong>de</strong> produits sont traitées par le back office <strong>de</strong> la <strong>banque</strong> (comp<strong>en</strong>sation <strong>de</strong>s<br />
paiem<strong>en</strong>ts par exemple). Les interactions <strong>en</strong>tre <strong>banque</strong>s se limit<strong>en</strong>t <strong>aux</strong> opérations<br />
interbancaires. Ces fonctions sont interdép<strong>en</strong>dantes. Le réseau <strong>de</strong> distribution et la force <strong>de</strong><br />
v<strong>en</strong>te sont <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> collecte d’information sur les besoins <strong>de</strong>s cli<strong>en</strong>ts. Ces informations sont<br />
utilisées lors <strong>de</strong> la phase <strong>de</strong> conception <strong>de</strong>s produits. Enfin, la tarification <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers<br />
dép<strong>en</strong>d, pour partie, du poids <strong>de</strong>s frais génér<strong>aux</strong> du back office.<br />
Banque spécialisée<br />
back office<br />
Banque<br />
producteur<br />
<strong>La</strong> désagrégation <strong>de</strong>s activités<br />
Banque intégrée<br />
multicanal<br />
Cli<strong>en</strong>ts<br />
Nouve<strong>aux</strong> acteurs spécialisés sur<br />
<strong>de</strong>s segm<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> marché, distribution<br />
Avec l’accroissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la pression concurr<strong>en</strong>tielle, les <strong>banque</strong>s se sépar<strong>en</strong>t <strong>de</strong> certaines <strong>de</strong><br />
leurs activités <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> leurs avantages compétitifs. Ainsi certaines <strong>banque</strong>s se spécialis<strong>en</strong>t<br />
dans les opérations <strong>de</strong> back office et pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong> charge, <strong>en</strong> échange d’une rémunération, les<br />
opérations d’autres <strong>banque</strong>s. <strong>De</strong> multiples interactions apparaiss<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre <strong>banque</strong>s et non<br />
<strong>banque</strong>s : les produits sont distribués par <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>aires. Les flux administratifs issus <strong>de</strong> ces<br />
v<strong>en</strong>tes sont traités par la <strong>banque</strong>. D’autres établissem<strong>en</strong>ts se spécialis<strong>en</strong>t dans la production <strong>de</strong><br />
produits et services distribués par leurs part<strong>en</strong>aires financiers ou non financiers.<br />
<strong>Cerna</strong> 29