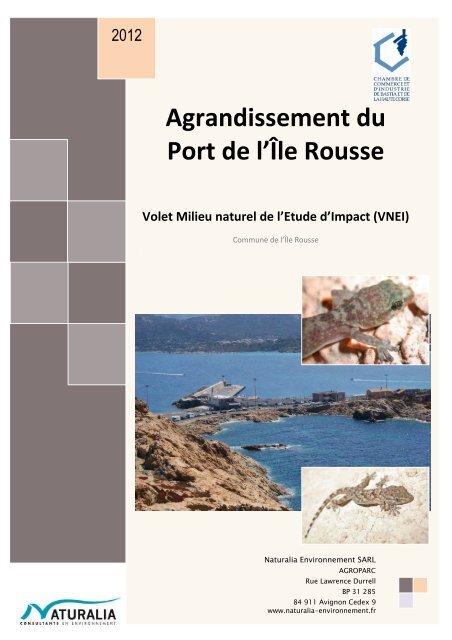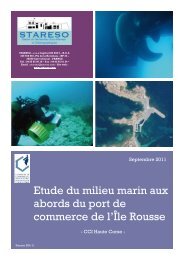Etude du milieu naturel terrestre
Etude du milieu naturel terrestre
Etude du milieu naturel terrestre
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2012<br />
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Agrandissement <strong>du</strong><br />
Port de l’Île Rousse<br />
Volet Milieu <strong>naturel</strong> de l’<strong>Etude</strong> d’Impact (VNEI)<br />
)<br />
Commune de l’Île Rousse<br />
Naturalia Environnement SARL<br />
AGROPARC<br />
Rue Lawrence Durrell<br />
BP 31 285<br />
84 911 Avignon Cedex 9<br />
www.naturalia-environnement.fr<br />
0Intro<strong>du</strong>ction<br />
1
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Rapport remis le :<br />
30 novembre 2011<br />
Mis à jour le 14 juin 2012<br />
Pétitionnaire :<br />
Chambre de Commerce et d’In<strong>du</strong>strie Bastia Haute-Corse<br />
Hôtel Consulaire<br />
Nouveau Port<br />
20293 BASTIA Cedex<br />
: 04.95.54.44.44<br />
<strong>Etude</strong> réalisée par :<br />
NATURALIA environnement sarl<br />
Rue Lawrence Durrell<br />
Site AGROPARC – BP 31 285<br />
84911 AVIGNON cedex 9<br />
: 04 90 84 17 95<br />
contact@naturalia-environnement.fr<br />
www.naturalia-environnement.fr<br />
Coordination et validation :<br />
Olivier PEYRE<br />
Rédaction :<br />
Cécile BLOT<br />
Eric DURAND<br />
Cartographie :<br />
Olivier MAILLARD<br />
Relecture :<br />
Aude BUFFIER<br />
Expertise faunistique :<br />
Eric DURAND<br />
Mathieu FAURE<br />
Guy DURAND<br />
Expertise floristique :<br />
Marion ANQUEZ<br />
2
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
SOMMAIRE<br />
INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 6<br />
I. METHODOLOGIE ...................................................................................................................................... 7<br />
I.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE / ZONE PROSPECTEE .......................................................................................... 7<br />
I.2. LES PHASES D’ETUDE ................................................................................................................................... 7<br />
I.2.1. Recueil bibliographique / Consultation des personnes ressources .................................................... 7<br />
I.2.2. Stratégie / Méthodes d’inventaires des espèces ciblées ................................................................... 8<br />
I.2.2.1. Choix des groupes taxonomiques étudiés ................................................................................................ 8<br />
I.2.2.2. Calendrier des prospections / Effort d’échantillonnage ........................................................................... 8<br />
I.2.2.3. Méthodes d’inventaires employées ......................................................................................................... 9<br />
I.2.2.4. Critères d’évaluation .............................................................................................................................. 12<br />
I.3. ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITION DE MESURES ....................................................................................... 15<br />
II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET .......................................................................................... 17<br />
II.1. DESCRIPTION DU PROJET ............................................................................................................................ 17<br />
III. CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE ........................................................................................................... 20<br />
III.1. LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE D’ETUDE ............................................................................................. 20<br />
III.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE ............................................................................................................................... 20<br />
IV. BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE ......................................................................... 21<br />
IV.1.1. Les périmètres d’inventaire ......................................................................................................... 21<br />
IV.1.1.1. les ZNIEFF ............................................................................................................................................... 21<br />
IV.1.1.2. les ZICO ................................................................................................................................................... 25<br />
IV.1.2. Les périmètres de protection réglementaire et contractuelle ..................................................... 25<br />
IV.1.2.1. Le Réseau Natura 2000 ........................................................................................................................... 25<br />
IV.1.2.2. L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ....................................................................................... 27<br />
IV.1.2.3. Les Parcs Naturels Nationaux / Naturels Régionaux ............................................................................... 27<br />
IV.1.2.4. Les Réserves Naturelles Nationales / Régionales ................................................................................... 28<br />
IV.1.2.5. Les réserves de biosphère ...................................................................................................................... 28<br />
IV.1.3. Bilan des périmètres d’inventaire et de protection règlementaire et contractuelle ................... 29<br />
V. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE ...................................................................................... 30<br />
V.1. LES HABITATS NATURELS ............................................................................................................................ 30<br />
V.1.1. Généralités sur les habitats <strong>naturel</strong>s ........................................................................................... 30<br />
V.1.2. Les habitats d’intérêt patrimonial et règlementaire ................................................................... 33<br />
V.1.3. Bilan des enjeux des habitats <strong>naturel</strong>s ........................................................................................ 33<br />
V.2. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES............................................................................................... 36<br />
V.2.1. Généralités sur les cortèges et les grands types d’habitats ........................................................ 36<br />
3
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
V.2.2. Les espèces d’intérêt règlementaire ou patrimoniale ................................................................. 36<br />
V.3. CONCLUSION ........................................................................................................................................... 39<br />
V.4. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES .............................................................................................. 40<br />
V.4.1. Les invertébrés protégés ............................................................................................................. 40<br />
V.4.1.1. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce ........................................................................... 40<br />
V.4.1.2. Les espèces DE portee règlementaire .................................................................................................... 40<br />
V.4.2. Les amphibiens ............................................................................................................................ 40<br />
V.4.3. Les reptiles .................................................................................................................................. 40<br />
V.4.3.1. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce ........................................................................... 40<br />
V.4.3.2. Les espèces d’intérêt patrimonial et règlementaire ............................................................................... 42<br />
V.4.4. Les oiseaux .................................................................................................................................. 47<br />
V.4.5. Les mammifères <strong>terrestre</strong>s.......................................................................................................... 47<br />
V.4.6. Les chiroptères ............................................................................................................................ 47<br />
V.4.6.1. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce ........................................................................... 47<br />
VI. BILAN DES ENJEUX FAUNISTIQUES ..................................................................................................... 48<br />
VII. EVALUATION DES IMPACTS ............................................................................................................... 49<br />
VII.1. NATURE DES IMPACTS ................................................................................................................................ 49<br />
VII.1.1. Types d’impact ............................................................................................................................ 49<br />
VII.1.1.1. Les impacts directs ................................................................................................................................. 49<br />
VII.1.1.2. Les impacts indirects : ............................................................................................................................ 49<br />
VII.1.2. Durée des impacts ....................................................................................................................... 50<br />
VII.1.2.1. Les impacts temporaires :....................................................................................................................... 50<br />
VII.1.2.2. Les impacts permanents :....................................................................................................................... 50<br />
VII.2. EVALUATION DES IMPACTS SUR LES HABITATS ................................................................................................. 50<br />
VII.3. IMPACTS SUR LES ESPECES VEGETALES ........................................................................................................... 52<br />
VII.4. IMPACTS SUR LES ESPECES ANIMALES ............................................................................................................ 54<br />
VIII. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION D’ATTEINTES ................................. 56<br />
VIII.1. TYPOLOGIE DES MESURES ....................................................................................................................... 56<br />
VIII.2. PROPOSITIONS DE MESURES DE REDUCTION / SUPPRESSION .......................................................................... 57<br />
VIII.3. EVALUATION DES IMPACTS APRES MESURES ............................................................................................... 60<br />
VIII.4. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES ........................................................................................... 61<br />
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 62<br />
4
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
TABLE DES ILLUSTRATIONS<br />
Figure 1 : Travaux de modernisation <strong>du</strong> port de commerce de l’Île Rousse (Source : CCI Haute Corse) ............. 18<br />
Figure 2 : Travaux de modernisation <strong>du</strong> port de commerce de l'Île Rousse envisagés en tranche conditionnelle<br />
(Source : CCI Haute Corse) .................................................................................................................................. 19<br />
Figure 3 : Localisation des périmètres d’inventaire à proximité <strong>du</strong> projet .............................................................. 24<br />
Figure 4 : Localisation des sites Natura 2000 à proximité <strong>du</strong> projet ...................................................................... 26<br />
Figure 5: Groupement à criste marine et à limonium articulé. Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA ............. 30<br />
Figure 6: Groupement à ficoïde à fleurs nodales. Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA................................ 31<br />
Figure 7: Groupement à passerine hirsute, à immortelle d'italie et à limonium articulé. Photo sur site : M.<br />
Anquez / NATURALIA ........................................................................................................................................... 31<br />
Figure 8 : Fourré halonitrophile au nord <strong>du</strong> parking. Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA ............................ 32<br />
Figure 9: Tapis de griffe de sorcières. Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA ................................................. 33<br />
Figure 10 : Répartition des habitats <strong>naturel</strong>s sur la zone d'étude .......................................................................... 35<br />
Figure 11: Limonium articulé (Limonium articulatum L.). Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA ..................... 36<br />
Figure 12 : Le ficoïde à fleurs nodales (Mesembryanthemum nodiflorum L.). Photo sur site : M.Anquez/Naturalia<br />
.............................................................................................................................................................................. 37<br />
Figure 13 : localisation des espèces patrimoniales sur la zone d'étude ................................................................ 38<br />
Figure 14 - Hémidactyle verruqueux Hemidactylus turcicus. Photo sur site : E. Durand ....................................... 42<br />
Figure 15 : Localisation des points de contact de l’herpétofaune dans la zone de relevés de terrain ................... 46<br />
Tableau 1 : Calendrier des prospections 2011 et 2012 ........................................................................................... 8<br />
Tableau 2 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection à proximité (moins de 3km) de l’aire<br />
d’étude ................................................................................................................................................................... 29<br />
Tableau 3 : Habitats identifiés sur l'aire d'étude .................................................................................................... 34<br />
Tableau 4 : Bilan hiérarchisé des enjeux faunistiques réglementaires notables au sein de la zone d’étude ......... 48<br />
Tableau 5: Evaluation des impacts sur les fourrés halonitrophiles ........................................................................ 50<br />
Tableau 6 : Evaluation des impacts sur les falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium<br />
spp. endémiques ................................................................................................................................................... 51<br />
Tableau 7 : Evaluation des atteintes sur le limonium articulé ................................................................................ 52<br />
Tableau 8 : Evaluation des atteintes sur le ficoïde à fleurs nodales ...................................................................... 53<br />
Tableau 10: Evaluation des atteintes sur l’Hémidactyle verruqueux ..................................................................... 54<br />
Tableau 11: Evaluation des atteintes sur la Tarente de Maurétanie...................................................................... 55<br />
Tableau 12: Evaluation des atteintes sur le Lézard tyrrhénéen ............................................................................. 55<br />
Tableau 13 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces et atteintes rési<strong>du</strong>elles............................. 60<br />
5
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
INTRODUCTION<br />
La Chambre de Commerce et d’In<strong>du</strong>strie de Bastia et de la Haute Corse, en qualité de concessionnaire<br />
exploitant, souhaite mettre en œuvre le plan de développement portuaire de l’Ile Rousse sur la commune de l’Île<br />
Rousse (département de la Corse <strong>du</strong> Nord). Dans le cadre de ce projet, NATURALIA s’est vue confier la<br />
réalisation <strong>du</strong> Volet Naturel de l’<strong>Etude</strong> d’Impact (VNEI).<br />
En application <strong>du</strong> titre II° <strong>du</strong> livre I <strong>du</strong> Code de l’Environnement, une étude d’impact est systématiquement exigée<br />
lors de la réalisation d’un projet d’extension et de réhabilitation portuaire. La prise en compte <strong>du</strong> <strong>milieu</strong> <strong>naturel</strong> est<br />
aujourd’hui une partie importante de toute étude d’impact.<br />
L’article L 110-1 <strong>du</strong> Code de l’Environnement précise que « la protection des espaces, ressources et <strong>milieu</strong>x<br />
<strong>naturel</strong>s, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres<br />
biologiques auxquels ils participent, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion, sont<br />
d’intérêt général ».<br />
L’article L 122-1 de ce même Code précise les objectifs des études à réaliser : «Les projets de travaux,<br />
d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont<br />
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude<br />
d'impact permettant d’en apprécier les conséquences».<br />
Le but de l’expertise faune-flore est de choisir la solution qui concilie le mieux l’opportunité <strong>du</strong> projet avec la<br />
préservation de l’environnement. Conformément à la circulaire d’application n° 93-73 <strong>du</strong> 27 septembre 1993, elle<br />
se base sur l’analyse de l’état initial comprenant des investigations de terrain intégrant les <strong>milieu</strong>x <strong>naturel</strong>s, la<br />
faune et la flore, en plus de la consultation de données bibliographiques.<br />
Cette étude doit également apprécier les potentialités d’accueil <strong>du</strong> site vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe<br />
biologique particulier et établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au projet.<br />
Le présent rapport vise à mettre en évidence les impacts prévisibles <strong>du</strong> projet d’extension et de réhabilitation <strong>du</strong><br />
port de l’Île Rousse. Cette étude réglementaire correspond donc à l’expertise des <strong>milieu</strong>x <strong>naturel</strong>s, de la faune et<br />
de la flore dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement afin de déterminer les modalités de réalisation<br />
de ces projets dans le souci <strong>du</strong> moindre impact environnemental. Cette prestation est régie par le Code de<br />
l’Environnement (R122-1 à R122-16).<br />
0Intro<strong>du</strong>ction<br />
6
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
I. MÉTHODOLOGIE<br />
I.1. DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE / ZONE PROSPECTÉE<br />
Pour la flore, l’aire d’étude est constituée de l’aire d’emprise définie par le porteur de projet.<br />
Pour la faune, l’aire d’étude inclue l’aire projetée et la périphérie immédiate. Cette démarche permet d’aborder<br />
avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les liens<br />
fonctionnels qu’il peut exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de leur cycle<br />
biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions et les<br />
axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de quelques<br />
centaines de mètres autour <strong>du</strong> site.<br />
L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion :<br />
- la zone d’étude première qui correspond à la surface couverte par les aménagements prévus<br />
dans le cadre <strong>du</strong> plan de développement portuaire ;<br />
- l’aire d’influence élargie qui inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements… applicables à<br />
des espèces à large rayon d’action (Oiseaux, Chiroptères,…) soit quelques dizaines de mètres<br />
autour de l’aire d’implantation potentielle.<br />
I.2. LES PHASES D’ÉTUDE<br />
I.2.1. RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DES PERSONNES<br />
RESSOURCES<br />
L’analyse de l’état initial <strong>du</strong> site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique auprès des sources de<br />
données de l’Etat, des associations locales, des institutions et bibliothèques universitaires afin de regrouper<br />
toutes les informations pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ..), inventaires, études<br />
antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... Cette phase de recherche bibliographique est<br />
indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant par la<br />
suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées<br />
dans la bibliographie de ce rapport.<br />
A titre indicatif, les personnes et/ou organismes suivants ont été sollicités :<br />
- Conservatoire Botanique National de Corse;<br />
- Monsieur Paradis, botaniste local<br />
- Mairie de l’Ile Rousse<br />
- Parc Naturel Régional de la Corse<br />
IMéthodologie<br />
7
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
I.2.2. STRATÉGIE / MÉTHODES D’INVENTAIRES DES ESPÈCES CIBLÉES<br />
I.2.2.1.<br />
CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS :<br />
CHOIX DES GROUPES TAXONOMIQUES ÉTUDIÉS<br />
L’ensemble de la flore et de la végétation a été étudiée sur l’aire d’étude.<br />
CONCERNANT LA FAUNE :<br />
L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (avec une attention toute pour les reptiles et amphibiens)<br />
ainsi que les invertébrés protégés parmi les orthoptères et les lépidoptères.<br />
I.2.2.2. CALENDRIER DES PROSPECTIONS / EFFORT<br />
D’ÉCHANTILLONNAGE<br />
Les sessions de prospections se sont essentiellement déroulées fin août et début septembre, une période qui au<br />
regard de la Faune apparait suffisante pour cerner les enjeux en présence. En effet, la conjonction de différents<br />
facteurs (position supra-littorale de la zone d’étude, activités humaines importantes dans et aux abords de la<br />
zone d’origine à l’origine de l’altération des habitats et vectrices de dérangements importants et réguliers dans et<br />
aux abords de la zone d’étude) justifie de potentialités de présence limitée à des espèces ubiquistes ou à des<br />
espèces à cycle d’activités essentiellement nocturnes. Enfin, deux nuits d’inventaires complémentaires ont été<br />
réalisées en mai 2012. Ces dernières ont concerné le compartiment herpétologique et tout particulièrement le<br />
Phyllodactyle d’Europe (espèce dont la présence est avérée dans les îlots attenants à la presqu’ile de la Pietra)<br />
Concernant la Flore, les inventaires s’appuient sur un large recueil bibliographique auprès des structures<br />
compétentes (conservatoire botanique, naturaliste spécialisée dans la botanique corse,…). Ce recueil<br />
bibliographique a permis d’appréhender les potentialités de présence d’espèces à floraison vernale et printanière.<br />
Groupes Intervenants Dates de prospection<br />
Flore et Habitats Marion ANQUEZ 31/08/2011<br />
Entomofaune Guillaume AUBIN 01/09/2011<br />
Ornithologie Eric DURAND 02/09/2011<br />
Herpétofaune<br />
Herpétofaune<br />
Eric DURAND<br />
Guy DURAND<br />
02/09/2011<br />
03/09/2011<br />
05/05/2012<br />
06/05/2012<br />
05/05/2012<br />
06/05/2012<br />
Mammifères Mathieu FAURE 31/08/2011<br />
Tableau 1 : Calendrier des prospections 2011 et 2012<br />
IMéthodologie<br />
8
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
I.2.2.3.<br />
MÉTHODES D’INVENTAIRES EMPLOYÉES<br />
Pour la flore patrimoniale<br />
Une fois le recueil des données établi et les potentialités régionales identifiées, comme pour les habitats, une<br />
analyse cartographique est réalisée à partir d’un repérage par BD Ortho® (photos aériennes), des fonds<br />
Scan25® et des cartes géologiques afin de repérer les habitats potentiels d’espèces patrimoniales. En effet, la<br />
répartition des espèces est liée à des conditions stationnelles précises en termes de type de végétation (Forêts,<br />
<strong>milieu</strong>x aquatiques, rochers) ou de caractéristiques édaphiques (pH, granulométrie, bilan hydrique des sols).<br />
Des inventaires de terrain complémentaires à cette synthèse bibliographique sont par ailleurs définis selon le<br />
calendrier phénologique des espèces (sur l’ensemble <strong>du</strong> cycle biologique). Afin d’affiner les principaux enjeux et<br />
la richesse relative <strong>du</strong> site, ces relevés permettent d’établir la composition et la répartition en espèces<br />
patrimoniales au sein de la zone d’étude. Les taxons à statuts sont systématiquement géolocalisés et<br />
accompagnés si nécessaire de relevés de végétation afin de préciser le cortège floristique qu’ils fréquentent. Ces<br />
prospections servent alors à définir leur dynamique (nombre d’indivi<strong>du</strong>s présents, densité, éten<strong>du</strong>e des<br />
populations) et leurs exigences écologiques (associations, nature <strong>du</strong> sol) mais aussi à étudier leur état de<br />
conservation, ainsi qu’à examiner les facteurs pouvant influencer l’évolution et la pérennité des populations.<br />
Ces inventaires floristiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont<br />
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :<br />
- Les conventions internationales : Annexe I de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage<br />
et <strong>du</strong> <strong>milieu</strong> <strong>naturel</strong> de l'Europe, 19/09/1979, Berne ;<br />
- Les textes communautaires : Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, Directive 92/43/CEE<br />
<strong>du</strong> 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats <strong>naturel</strong>s<br />
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;<br />
- La législation nationale : Article 1 et 2 des espèces végétales protégées sur l'ensemble <strong>du</strong> territoire,<br />
Arrêté modifié <strong>du</strong> 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble <strong>du</strong><br />
territoire ;<br />
- La législation régionale et/ou départementale. Dans la région concernée : Arrêté <strong>du</strong> 24 juin 1986 relatif à<br />
la liste des espèces végétales protégées en région Corse.<br />
Ils pourront être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes<br />
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons<br />
endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe.<br />
Pour les habitats <strong>naturel</strong>s :<br />
Un premier travail de photo-interprétation à partir des photos aériennes orthonormées (BD Ortho®), superposées<br />
au fond Scan25® IGN 1/25 000, permet d’apprécier l’hétérogénéité des biotopes donc des habitats <strong>du</strong> site.<br />
Les grands ensembles définis selon la nomenclature CORINE Biotope peuvent ainsi être identifiés :<br />
- 1. Les habitats littoraux et halophiles ;<br />
- 2. Les <strong>milieu</strong>x aquatiques non marins (Eaux douces stagnantes, eaux courantes…) ;<br />
- 3. Les landes, fructicées et prairies (Fructicées sclérophylles, prairies mésophiles…) ;<br />
- 4. Les forêts (Forêts ca<strong>du</strong>cifoliées, forêts de conifères…) ;<br />
- 5. Les tourbières et marais (Végétation de ceinture des bords des eaux…) ;<br />
- 6. Les rochers continentaux, éboulis et sables (Eboulis, grottes…) ;<br />
IMéthodologie<br />
9
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
- 7. Les terres agricoles et paysages artificiels (Cultures, terrains en friche et terrains vagues…).<br />
A l’issue de ce pré-inventaire, des prospections de terrain permettent d’infirmer et de préciser les habitats<br />
<strong>naturel</strong>s présents et pressentis sur le site d’étude, notamment ceux listés à l’Annexe I de la Directive Habitats<br />
(directive 92/43/CEE <strong>du</strong> 12 mai 1992).<br />
Afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats <strong>naturel</strong>s, des inventaires<br />
phytosociologiques exhaustifs peuvent être effectués. Le nombre de relevés stratifiés (de 2 ) à réaliser pour<br />
chaque type de formations est défini selon la surface couverte par l’habitat. Ils permettent ainsi d’avoir un<br />
échantillonnage représentatif des communautés végétales rencontrées et d’apprécier leur diversité.<br />
Ces relevés sont établis selon la méthode de coefficient d’abondance-dominance définie par Braun-Blanquet<br />
(1928), elle sert à estimer la fréquence de chaque plante dans le relevé et sont accompagnés d’observations<br />
écologiques (nature <strong>du</strong> sol, pente, etc.). En effet, les habitats et leur représentativité sont définis par des espèces<br />
indicatrices mises en évidence dans les relevés, elles permettent, en partie la détermination de l’état de<br />
conservation des habitats. D’autre part, lorsque cela est nécessaire, une aire minimale conçue comme l’aire sur<br />
laquelle la quasi-totalité des espèces de la communauté végétale est représentée peut être définie.<br />
Le prodrome des végétations de France (Bardat & al., 2004) est utilisé lors de l’étude afin d’établir la<br />
nomenclature phytosociologique, notamment l’appartenance à l’alliance. La typologie est par ailleurs définie à<br />
l’aide des Cahiers habitats édités par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Collectif, 2001-2005) et des<br />
publications spécifiques à chaque type d’habitat ou à la région étudiée. Les correspondances sont établis selon le<br />
manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR 27 (CE, 2007) et le référentiel CORINE<br />
biotopes (Bissardon & al., 1997).<br />
Enfin, les différents types d’habitats sont cartographiés à l’échelle <strong>du</strong> 1/5.000ième. La cartographie est élaborée<br />
et restituée sous le logiciel de SIG MapInfo 8.5 (couche polygones + données attributaires associées). Le<br />
système de projection utilisé est le Lambert II cartographique éten<strong>du</strong> métrique.<br />
Pour la faune<br />
Ces inventaires faunistiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont<br />
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :<br />
- Les conventions internationales : Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie<br />
sauvage et <strong>du</strong> <strong>milieu</strong> <strong>naturel</strong> de l'Europe, 19/09/1979, Berne ;<br />
- Les textes communautaires :<br />
o Annexe I de la Directive Oiseaux, Directive 79/409/CEE <strong>du</strong> 2 avril 1979 et ses directives<br />
modificatives concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats de<br />
repro<strong>du</strong>ction ;<br />
o Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, Directive 92/43/CEE <strong>du</strong> 21 mai 1992<br />
modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats <strong>naturel</strong>s ainsi que<br />
de la faune et de la flore sauvages ;<br />
- La législation nationale :<br />
o Arrêté <strong>du</strong> 17 avril 1981 relatif à la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble <strong>du</strong> territoire<br />
(dernière modification en date <strong>du</strong> 29 octobre 2009) ;<br />
o Arrêté <strong>du</strong> 22 juillet 1993 <strong>du</strong> relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble <strong>du</strong> territoire<br />
(dernière modification en date <strong>du</strong> 23 avril 2007) ;<br />
o Arrêté <strong>du</strong> 12 février 1982 relatif à la liste des poissons protégés sur l’ensemble <strong>du</strong> territoire<br />
(dernière modification en date <strong>du</strong> 8 décembre 1988) ;<br />
IMéthodologie<br />
10
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
o Arrêté <strong>du</strong> 22 juillet 1993 relatif à la liste des reptiles et amphibiens protégés sur l’ensemble <strong>du</strong><br />
territoire (dernière modification en date <strong>du</strong> 19 novembre 2007) ;<br />
o Arrêté <strong>du</strong> 17 avril 1981 relatif à la liste des mammifères protégés sur l’ensemble <strong>du</strong> territoire<br />
(dernière modification en date <strong>du</strong> 23 avril 2007).<br />
Ils pourront être complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes<br />
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons<br />
endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe.<br />
o<br />
Invertébrés protégés<br />
En raison d’une diversité spécifique trop importante, les inventaires n’ont concerné que les espèces<br />
d’orthoptères, lépidoptères, odonates et coléoptères qui sont inscrites sur les listes de la Directive Habitats, de la<br />
Convention de Berne, protégées par la législation française, ainsi que les taxons endémiques, en limite d’aire ou<br />
menacés. L’inventaire de terrain a été programmé en fin d’été 2011, à une époque considérée comme optimale<br />
pour l’apparition des a<strong>du</strong>ltes des principaux groupes d’insectes. Elles ont été complétées par des recherches<br />
bibliographiques, ceci afin de disposer de données qui couvrent une période plus large que la seule fenêtre<br />
d’observation de la présente étude.<br />
A l’aide d’un filet à papillons, les prospections se sont déroulées aux heures les plus favorables à l’observation<br />
des lépidoptères et autres invertébrés (odonates et coléoptères notamment), à savoir de la fin de matinée aux<br />
heures chaudes de l’après midi. Alliée à une recherche des chenilles sur les plantes hôtes et à l’identification aux<br />
jumelles des a<strong>du</strong>ltes volants, cette technique permet d’identifier les indivi<strong>du</strong>s susceptibles de fréquenter la zone.<br />
Les pierres ont été soulevées pour repérer les coléoptères et les différents arthropodes endogés.<br />
o<br />
Amphibiens<br />
Au regard de la position biogéographique de la zone d’étude, les potentialités de présence de la batrachofaune<br />
ont été jugées nulles. Si l’espèce d’amphibiens la plus ubiquiste de l’île, la Rainette sarde Hylas sarda, est<br />
connue dans le secteur de l’île Rousse, ces habitats de prédilection ne correspondent pas à ceux rencontrés au<br />
sein de l’aire d’étude. Aucun habitat de repro<strong>du</strong>ction favorable n’a été identifié au sein de l’aire d’étude. Lors des<br />
prospections nocturnes menées pour l’herpétofaune, aucun amphibien n’a été observé dans l’aire d’étude.<br />
o<br />
Reptiles<br />
La méthodologie d’inventaires a consisté en :<br />
-Analyse préliminaire des micro-habitats potentiellement favorables à l’accueil des espèces visées (de<br />
jour)<br />
-Prospections nocturnes, par conditions météorologiques favorables (température > 20°C ; pas de lune<br />
pleine ;…) des micro-habitats jugés attractifs. 4 heures de prospections à raison de minimum 4<br />
passages au niveau des micro-habitats et prospections en linéaire aléatoire.<br />
-Positionnement sur un support orthophotographique des différents points d’observations de la faune<br />
identifiée.<br />
o<br />
Oiseaux<br />
Concernant l’avifaune, la position (bio)géographique <strong>du</strong> site, la nature des habitats rencontrés ainsi que<br />
l’importante fréquentation humaine justifie d’un intérêt avifaunistique limitée. Bien que Les phases de terrain aient<br />
été menées en période tardive, cette tendance a été confirmée.<br />
IMéthodologie<br />
11
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
o<br />
Mammifères (hors chiroptères)<br />
Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type<br />
d’habitat ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées<br />
(traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage…).<br />
Des horaires de prospection adaptés à leur rythme d’activité bimodale, avec une recherche active tôt le matin et<br />
en début de nuit ont été mis en œuvre pour cette étude.<br />
o<br />
Chiroptères<br />
Pour ce groupe taxonomique, l’essentiel des données proviendra de la bibliographie. Aucune prospection<br />
spécifique ne sera engagée pour ce compartiment en raison de la localisation <strong>du</strong> projet (absence de gîtes<br />
favorables au sein de la zone d’emprise).<br />
I.2.2.4.<br />
CRITÈRES D’ÉVALUATION<br />
Pour la flore, l’évaluation est à dire d’expert. De façon à rendre cette évaluation la plus objective possible,<br />
plusieurs critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille de comparaison des niveaux d’enjeu. Les<br />
critères sélectionnés sont fréquemment utilisés dans la majorité des études d’évaluation des impacts et des<br />
incidences, ils sont dépendants des connaissances scientifiques actuelles et sont susceptibles d’évoluer avec le<br />
temps :<br />
- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une<br />
répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte).<br />
- La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même espèce<br />
aura un poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite<br />
d’aire de répartition ou un isolat.<br />
- L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie<br />
localement d’autres stations pour son maintien.<br />
- L’état de conservation des stations impactées : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation<br />
intrinsèque de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site.<br />
- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le<br />
niveau de l’impact sur l’espèce au niveau local voir national. Cette taille de population doit être<br />
ramenée à la démographie de chaque espèce.<br />
- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante,<br />
certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutation génétique les<br />
favorisant. A l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et<br />
sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier<br />
fortement les enjeux identifiés.<br />
- La résilience de l’espèce : en fonction de l’écologie de chaque espèce, le degré de tolérance<br />
aux perturbations est différente.<br />
Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en prenant des<br />
unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des connaissances est beaucoup<br />
plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc pas être appréciés.<br />
IMéthodologie<br />
12
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui prennent en compte<br />
aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire.<br />
- les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ;<br />
- les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou régionales et<br />
autres documents d’alerte ;<br />
- les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle <strong>du</strong> département de la Haute-Corse;<br />
- les espèces en limite d’aire de répartition ;<br />
- certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui<br />
sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation.<br />
L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux con<strong>du</strong>it à déterminer plusieurs niveaux d’enjeux pour les espèces<br />
et les habitats. Cette évaluation concerne les espèces à un moment de leur cycle biologique. Il n’y a pas de<br />
hiérarchisation des espèces au sein des différentes classes d’enjeux :<br />
Espèces ou habitats à enjeu « Majeur » :<br />
Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrites sur les<br />
documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle<br />
européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Cela se tra<strong>du</strong>it essentiellement par de forts<br />
effectifs, une distribution très limitée, au regard des populations régionales et nationales. Cette responsabilité<br />
s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques sont<br />
concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de conservation.<br />
Espèces ou habitats à enjeu « Fort » :<br />
Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrites sur les<br />
documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou méditerranéenne relativement<br />
vaste mais qui, pour certaines d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce<br />
contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment <strong>du</strong> cycle<br />
biologique, y compris comme sites d’alimentation d’espèces se repro<strong>du</strong>isant à l’extérieur de l’aire d’étude.<br />
Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des <strong>milieu</strong>x originaux au sein de<br />
l’aire biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette aire<br />
biogéographique.<br />
Espèces/habitats à enjeu « Moyen » :<br />
Espèces protégées dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale.<br />
L’aire biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des<br />
populations nationales ou régionale. Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement<br />
indicatrices de <strong>milieu</strong>x en bon état de conservation.<br />
IMéthodologie<br />
13
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Espèces/habitats à enjeu « Faible » :<br />
Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, ni régionale, ni au niveau local.<br />
Ces espèces sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de<br />
leur environnement.<br />
Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ». La nature « ordinaire » regroupe des espèces communes sans enjeu de<br />
conservation au niveau local. Ces espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions menées sur les<br />
habitats des espèces de plus grand enjeu.<br />
Le niveau d’enjeu des espèces résultera donc des statuts réglementaires et patrimoniaux mais également de<br />
critères liés au projet et à sa zone d’emprise. Ils concerneront par exemple :<br />
- la capacité de réaction de l’espèce face aux perturbations,<br />
- la faculté de reconquête des sites perturbés<br />
- la taille des populations touchées,<br />
Ces informations seront précisées pour chacune des espèces patrimoniales dans deux rubriques différenciées<br />
qui s’intituleront « niveau d’enjeu » et « sensibilités au projet ».<br />
Note sur le statut d’espèces protégées en France :<br />
Le statut d’espèce protégée n’est pas homogène suivant les groupes faunistiques et floristiques. Différentes logiques successives ont<br />
con<strong>du</strong>it l’élaboration des listes d’espèces protégées au fil <strong>du</strong> temps. Au-delà de l’aspect conservation des espèces, d’autres critères ont<br />
été pris en compte. La « pression sociale » a également son empreinte sur les listes actuelles. Il est possible de distinguer les logiques de<br />
protections :<br />
- relevant de la non « chassabilité » des espèces, c’est le cas des oiseaux par exemple, les espèces « non chassables » sont<br />
protégées ;<br />
- relevant de la non dangerosité des espèces : pour les reptiles et les amphibiens, toutes les espèces non dangereuses pour<br />
l’homme sont protégées ;<br />
- relevant d’un aspect conservation des espèces à plusieurs échelles (au niveau européen avec la Directive Habitats) ou au<br />
niveau régional avec les listes d’espèces végétales protégées au niveau régional) ;<br />
- relevant d’une logique intégrative de l’espèce au sein de son environnement, avec par exemple l’habitat protégé de certaines<br />
espèces pris en compte depuis quelques années (mammifères, reptiles, amphibiens…).<br />
Cette superposition de logiques de protection amène parfois des ambigüités pour certaines espèces dans une étude règlementaire de type<br />
étude d’impact : l’enjeu de conservation d’une espèce (fonction de sa rareté, de sa vulnérabilité, de son état de conservation…) n’est pas<br />
forcément en adéquation avec l’enjeu règlementaire de l’espèce.<br />
IMéthodologie<br />
14
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
I.3. ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITION DE MESURES<br />
Les impacts sont hiérarchisés en fonction d’éléments juridiques (protection …), de conservation de l’espèce, de<br />
sa sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui sont définis précédemment. Ils sont évalués selon les<br />
méthodes exposées dans les documents suivants :<br />
- Association Française des ingénieurs écologues, 1996 – Les méthodes d’évaluation des<br />
impacts sur les <strong>milieu</strong>x, 117 p.<br />
- DIREN MIDI-PYRÉNÉES & BIOTOPE, 2002 – Guide de la prise en compte des <strong>milieu</strong>x <strong>naturel</strong>s<br />
dans les études d’impact, 76 p.<br />
- DIREN PACA, 2009. Les mesures compensatoires pour la biodiversité, Principes et projet de<br />
mise en œuvre en Région PACA, 55P.<br />
Pour chaque espèce et habitat d’intérêt patrimonial et réglementaire contacté dans l’aire d’étude et susceptible<br />
d’être impacté par le projet d’extension et de réhabilitation portuaire, un tableau d’analyse des impacts<br />
synthétise :<br />
- l’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat ;<br />
- la fréquentation et l’usage <strong>du</strong> périmètre étudié par l’espèce ;<br />
- le niveau d’enjeu écologique (critères patrimoniaux et biogéographiques) ;<br />
- la résilience de l’espèce ou de l’habitat à une perturbation (en fonction de retour d’expérience, de<br />
publications spécialisées et <strong>du</strong> dire d’expert) ;<br />
- la nature de l’impact :<br />
o<br />
o<br />
- le type d’impact :<br />
o<br />
o<br />
les impacts retenus sont de plusieurs ordres ; par exemple : la destruction d’indivi<strong>du</strong>s,<br />
la destruction ou la dégradation d’habitats d’espèces, la perturbation de l’espèce ;<br />
l’analyse des impacts est éclairée par un 4 ème niveau d’analyse qui correspond aux<br />
fonctionnalités écologiques atteintes. L’évaluation de la dégradation des<br />
fonctionnalités écologiques se base sur les niveaux de détérioration de l’habitat,<br />
enrichi des données sur la répartition spatio-temporelle des espèces et de leur<br />
comportement face à une modification de l’environnement. Parmi les impacts aux<br />
fonctionnalités écologiques on peut notamment citer l’altération des corridors<br />
écologiques, l’altération d’habitat refuge, la modification des conditions édaphiques et<br />
la modification des attributs des espèces écologiques.<br />
les impacts directs sont essentiellement liées aux travaux touchant directement les<br />
habitats, espèces ou habitats d’espèces;<br />
les impacts indirects ne résultent pas directement des travaux mais ont des<br />
conséquences sur les habitats, espèces ou habitats d’espèces et peuvent apparaitre<br />
dans un délai plus ou moins long.<br />
IMéthodologie<br />
15
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
- la <strong>du</strong>rée de l’impact :<br />
o<br />
o<br />
impacts permanents liées à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement <strong>du</strong><br />
programme d’aménagement dont les effets sont irréversibles ;<br />
impacts temporaires : il s’agit généralement d’atteintes liées aux travaux ou à la<br />
phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient réversibles (bruit,<br />
poussières, installations provisoires, …). Passage d’engins ou des ouvriers, création<br />
de piste d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaire de matériaux.<br />
Des propositions de mesures d’atténuation, visant à supprimer ou ré<strong>du</strong>ire les impacts <strong>du</strong> projet sont formulées.<br />
La persistance d’impacts rési<strong>du</strong>els estimés, après mise en œuvre des mesures d’atténuation, con<strong>du</strong>it à l’étude de<br />
mesures compensatoires.<br />
Le travail sur les mesures d’atténuation (suppression et ré<strong>du</strong>ction) et de compensation est effectué en fonction<br />
des impacts identifiés. Un chiffrage des mesures proposées est également estimé.<br />
IMéthodologie<br />
16
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET<br />
II.1.<br />
DESCRIPTION DU PROJET<br />
En tant que concessionnaire exploitant, la CCI de Bastia et de Haute Corse a développé un plan de<br />
développement <strong>du</strong> port de commerce de l’Île Rousse. Celui vise à étendre et réhabiliter les infrastructures<br />
existantes. Le port de commerce couvre une superficie totale de 113 200 m² et les travaux envisagés sont au<br />
nombre de six :<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Extension des terre-pleins<br />
Renforcement de la digue <strong>du</strong> large<br />
Renforcement et extension <strong>du</strong> double tenon<br />
Confortement et défense <strong>du</strong> musoir de la jetée<br />
Dragage et déroctage <strong>du</strong> bassin<br />
Travaux de protection cathodique de l’ensemble des ouvrages<br />
De plus, la CCI étudie la possibilité de créer un nouveau terre-plein à l’ouest de la route actuelle de desserte de<br />
la presqu’île de la Pietra ainsi que l’éventuel prolongement de la digue <strong>du</strong> large. Compte tenu <strong>du</strong> faible état<br />
d’avancement de ces projets, ceux-ci ne constituent qu’une tranche conditionnelle.<br />
IIDescription et justification <strong>du</strong> projet<br />
17
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Figure 1 : Travaux de modernisation <strong>du</strong> port de commerce de l’Île Rousse (Source : CCI Haute Corse)<br />
IIDescription et justification <strong>du</strong> projet<br />
18
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Figure 2 : Travaux de modernisation <strong>du</strong> port de commerce de l'Île Rousse envisagés en tranche conditionnelle (Source : CCI Haute Corse)<br />
IIDescription et justification <strong>du</strong> projet<br />
19
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
III. CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE<br />
III.1.<br />
LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE D’ÉTUDE<br />
Le port de commerce de l’Île Rousse est situé sur la commune <strong>du</strong> même nom au nord ouest de la Corse.<br />
Localisé en Balagne, le site d’étude est adossé à la presqu’île de la Pietra constitué de granit ocre rouge sur<br />
laquelle ont été édifiés une tour génoise et un sémaphore.<br />
Le port de commerce s’étend sur 113 200m² répartis de la manière suivante :<br />
Plan d’eau : 78 400 m²<br />
Terre-plein : 34 800 m²<br />
Pré-embarquement : 5700 m²<br />
Embarquement : 8 300 m²<br />
Jetée : 2 700 m²<br />
Terre-plein arrière jetée : 3 200 m²<br />
Gare maritime et bâtiments techniques : 7 100 m²<br />
Terre-plein ouest RD.81 : 7 800 m²<br />
Le port dispose également de deux postes à quai. L’ensemble de ces infrastructures est intégré dans l’aire<br />
d’étude.<br />
III.2.<br />
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE<br />
L’étude a consisté en l’élaboration <strong>du</strong> volet <strong>naturel</strong> de l’étude d’impact (VNEI). Pour cela, dans un premier temps,<br />
un état initial faunistique et floristique a été réalisé.<br />
Dans ce diagnostic biologique, sont caractérisés :<br />
<br />
<br />
<br />
les habitats <strong>naturel</strong>s,<br />
les cortèges et les enjeux floristiques,<br />
les cortèges et les enjeux faunistiques.<br />
IIIContexte général de l’étude<br />
20
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
IV. BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE<br />
IV.1.1. LES PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRE<br />
Les zones d’inventaires n’intro<strong>du</strong>isent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles identifient les<br />
territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la justification sont<br />
officiellement portées à la connaissance <strong>du</strong> public, afin qu’il en soit tenu compte dans tout projet pouvant porter<br />
atteintes aux <strong>milieu</strong>x et aux espèces qu’ils abritent.<br />
IV.1.1.1.<br />
LES ZNIEFF<br />
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à l’échelle<br />
régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional <strong>du</strong> Patrimoine Naturel<br />
(CSRPN) nommé par le préfet de région. Cet inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle <strong>du</strong> Ministère<br />
chargé de l'Environnement constitue un outil de connaissance <strong>du</strong> patrimoine <strong>naturel</strong> de la France. Les données<br />
sont enfin transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour évaluation et intégration au fichier national<br />
informatisé.<br />
Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique,<br />
participant au maintien des grands équilibres <strong>naturel</strong>s ou constituant le <strong>milieu</strong> de vie d’espèces animales et<br />
végétales rares, caractéristiques <strong>du</strong> patrimoine <strong>naturel</strong> régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une<br />
mesure de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents<br />
d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la présence d’habitats <strong>naturel</strong>s et identifient<br />
les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF :<br />
● Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces,<br />
d’association d’espèces ou de <strong>milieu</strong>x rares, remarquables ou caractéristiques <strong>du</strong> patrimoine <strong>naturel</strong> national ou<br />
régional.<br />
● Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles <strong>naturel</strong>s riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui offrent<br />
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.<br />
D’après le porter à connaissances de l’Observatoire de l’Environnement de Corse, le projet est situé à proximité<br />
(3 km) de 3 ZNIEFF : 1 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II. Celles-ci sont décrites succinctement cidessous.<br />
ZNIEFF de type I : « Dunes et pointes rocheuses de Botre et Giunchetu » (940 030 023) :<br />
Ce site de 35ha, localisé à environ 2km à l’ouest de l’Ile Rousse dans le département de la Haute Corse, se<br />
compose d’une partie de la pointe <strong>du</strong> sémaphore et de deux petites plages : Botre et Giunchetu. Séparées par un<br />
petit monticule granitique portant des <strong>du</strong>nes anciennes, plaquées sur le substratum rocheux, ces plages<br />
proposent la même couverture végétale organisée de la mer vers les terres de la manière suivante :<br />
- Formations herbacées des <strong>du</strong>nes ;<br />
- Ourlets chaméphytiques ponctuels a Ephedra distachya et/ou Hélichrysum italicum ;<br />
- Un fourré littoral à genévriers à gros fruits (Junisperus macrocarpa) et à lentisques (Pistacia<br />
lentiscus) ;<br />
- Des prairies plus ou moins à l’abandon à Inule visqueuse (Dittrichia viscosa L. Greuter) et<br />
Asphodèles.<br />
Fortement fréquentée et partiellement anthropisée (bar-restaurant, parking…) cette zone souffre des<br />
dégradations engendrées par les activités humaines auxquelles s’ajoute un phénomène d’érosion important.<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
21
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Milieux (code) Espèces végétales Espèces animales<br />
Aucun<br />
1 conifère, 3 dicotylédones et 1<br />
gymnosperme déterminants<br />
Aucune<br />
Aucun Aucune Aucune<br />
Distance<br />
minimale<br />
de la<br />
ZNIEFF au<br />
projet (m)<br />
1800<br />
ZNIEFF de type II : « Oliveraies et boisements des collines de Balagne » (940004142) :<br />
Ce site de collines se compose de plusieurs entités réparties dans les principales vallées de la Balagne : au sud<br />
la vallée <strong>du</strong> Fiume Seccu, à l’ouest le bassin d’Aregno, au nord et à l’est la vallée de Regino. Il couvre ainsi une<br />
superficie totale de 2016ha dans le département de la Haute Corse. Vestige de l’ancien paysage arboré de la<br />
Balagne, cette zone est couverte d’anciennes oliveraies, de chênaies pubescentes sur les anciennes terrasses et<br />
de bosquets et taillis de chênes verts sur les adrets et côtes rocheuses. Dans les vallons humides quelques<br />
châtaigneraies se développent tandis qu’en amont <strong>du</strong> barrage de Codole une remarquable suberaie, unique en<br />
Balagne, se maintient. Cette diversité d’habitats, dont la répartition est fortement influencée par les incendies,<br />
abrite un cortège faunistique riche notamment pour ce qui est de l’avifaune.<br />
Milieux (code) Espèces végétales Espèces animales<br />
Distance<br />
minimale de la<br />
ZNIEFF au<br />
projet (m)<br />
Aucun Aucune 1 oiseau déterminant<br />
1 remarquable<br />
(45-1)<br />
13 monocotylédones et 38 dicotylédones<br />
remarquables<br />
3 batraciens, 10 mammifères, 35<br />
oiseaux et 5 reptiles<br />
remarquables<br />
2800<br />
ZNIEFF de type II : « Vallée de Regino » (940030247)<br />
Ce site, localisé au sein de la vallée de Regino, s’organise autour <strong>du</strong> cours d’eau <strong>du</strong> même nom. Il s’étend ainsi<br />
sur 4214 ha dans le département de la Haute Corse et présente un intérêt écologique majeur. En effet, sa<br />
diversité d’habitats (zone de gravières, cultures, plan d’eau, espaces ouverts et <strong>milieu</strong>x forestiers) rend la zone<br />
très favorable au développement d’un cortège faunistique riche. L’avifaune est particulièrement bien représentée<br />
avec pas moins de 54 espèces identifiées aussi bien nicheuses que migratrices ou hivernantes. Le barrage de<br />
Codole constitue un secteur stratégique aussi bien pour les oiseaux que la Cistude d’Europe qui peuple ses<br />
berges. Les abords <strong>du</strong> Regino abritent quant à eux un intéressant cortège batracologique et herpétologique<br />
tandis que les mines de Lozari sont reconnues pour leur remarquable intérêt chiroptérologique. La ZNIEFF<br />
coïncide d’ailleurs toute ou partie avec deux sites Natura 2000 et un arrêté préfectoral de protection de biotope.<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
22
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Milieux (code) Espèces végétales Espèces animales<br />
Distance<br />
minimale<br />
de la<br />
ZNIEFF au<br />
projet (m)<br />
Aucun<br />
Aucun<br />
Aucune<br />
Aucune<br />
1 amphibien, 3 mammifères, 47<br />
oiseaux et 1 reptile déterminants<br />
2 amphibiens, 2 mammifères, 7<br />
oiseaux et 3 reptiles remarquables<br />
3100<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
23
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Figure 3 : Localisation des périmètres d’inventaire à proximité <strong>du</strong> projet<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
24
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
IV.1.1.2.<br />
LES ZICO<br />
Une ZICO est un inventaire scientifique dressé en application d'un programme international de Birdlife<br />
International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages.<br />
D’après le porter à connaissances de l’Observatoire de l’Environnement de Corse, il n’y a pas de ZICO à<br />
proximité (moins de 3km) de l’aire d’étude.<br />
IV.1.2. LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RÉGLEMENTAIRE ET<br />
CONTRACTUELLE<br />
IV.1.2.1. LE RÉSEAU NATURA 2000<br />
La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive<br />
Oiseaux (<strong>du</strong> 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (<strong>du</strong> 21 mai 1992), transposées en droit français.<br />
Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats <strong>naturel</strong>s et<br />
des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.<br />
Zones de Protection Spéciale<br />
La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée<br />
prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des<br />
Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur<br />
desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de<br />
leurs populations: les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats<br />
permettent d'assurer la survie et la repro<strong>du</strong>ction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à<br />
certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares.<br />
La protection des aires de repro<strong>du</strong>ction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble<br />
des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des <strong>milieu</strong>x <strong>terrestre</strong>s que marins.<br />
Zones Spéciales de Conservation / Sites d’Importance Communautaire<br />
La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en<br />
compte non seulement d’espèces mais également de <strong>milieu</strong>x <strong>naturel</strong>s (les « habitats <strong>naturel</strong>s », les éléments de<br />
paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la<br />
distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la<br />
Directive. Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E.,<br />
elle con<strong>du</strong>it à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de<br />
Zones Spéciales de Conservation (ZSC).<br />
D’après le porter à connaissances de l’Observatoire de l’Environnement de Corse, il n’y a pas de sites Natura<br />
2000 à proximité (moins de 3 km) <strong>du</strong> projet. Il n’est donc pas nécessaire de les prendre en compte dans le cadre<br />
<strong>du</strong> VNEI. Néanmoins, 5 sites peuvent être signalés dont 3 feront l’objet d’une évaluation simplifiées des<br />
incidences Natura 2000 présentée dans un dossier distinct : les 3 SIC « Agriates », « Plateau <strong>du</strong> Cap Corse » et<br />
« Cap Rossu, Scandola, Pointe de la Reveletta, Canyon de Calvi ».<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
25
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Figure 4 : Localisation des sites Natura 2000 à proximité <strong>du</strong> projet<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
26
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
IV.1.2.2.<br />
L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE<br />
Pris par les préfets de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) se basent sur<br />
l’avis de la commission départementale des sites. Ils ont pour objectif, la protection des biotopes nécessaires à<br />
l’alimentation, la repro<strong>du</strong>ction, le repos ou la survie des espèces animales ou végétales protégées pas la loi.<br />
Réglementé par le décret (n 77-1295) <strong>du</strong> 25 novembre 1977, pris pour l’application des mesures liées à la<br />
protection des espèces prévues par la loi <strong>du</strong> 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : ces dispositions<br />
sont codifiées aux articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 415-1 <strong>du</strong> code de l’environnement. Il existe en outre une<br />
circulaire n 90-95 <strong>du</strong> 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les<br />
<strong>milieu</strong>x aquatiques.<br />
Les APPB ne comportent pas de mesures de gestion mais consistent essentiellement en une interdiction<br />
d'actions ou d'activités pouvant nuire à l'objectif de conservation <strong>du</strong> ou des biotope(s), et qui sont susceptibles<br />
d’être contrôlés par l’ensemble des services de police de l’Etat. Ils représentent donc des outils de protection<br />
forte, pouvant de plus être mobilisés rapidement (la procé<strong>du</strong>re de création peut être courte <strong>du</strong>rée s’il n’y a pas<br />
d’opposition manifeste).<br />
D’après le porter à connaissances de l’Observatoire de l’Environnement de Corse, le projet n’est situé à proximité<br />
(moins de 3 km) d’aucun APPB.<br />
IV.1.2.3.<br />
LES PARCS NATURELS NATIONAUX / NATURELS RÉGIONAUX<br />
Réglementés par le Code de l’Environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 <strong>du</strong> 14 avril 2006 relative aux<br />
parcs nationaux, aux parcs <strong>naturel</strong>s marins et aux parcs <strong>naturel</strong>s régionaux.<br />
Placés sous la tutelle <strong>du</strong> ministre chargé de la protection de la nature, les Parcs Naturels Nationaux français<br />
sont au nombre de 9. Classé par décret, un parc <strong>naturel</strong> national est généralement choisi lorsque « la<br />
conservation de la faune, de la flore, <strong>du</strong> sol, <strong>du</strong> sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, d’un <strong>milieu</strong><br />
<strong>naturel</strong> présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce <strong>milieu</strong> contre tout effet de dégradation <strong>naturel</strong>le<br />
et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer la diversité, la composition, l'aspect et<br />
l'évolution. » (Chap. Ier, Article L331-1 <strong>du</strong> Code de l’Environnement). Tous les parcs nationaux assurent une<br />
mission de protection des espèces, des habitats et des ressources <strong>naturel</strong>les, une mission de connaissance, une<br />
mission de sensibilisation et d'é<strong>du</strong>cation à l'environnement. Enfin, ils participent au développement local et au<br />
développement <strong>du</strong>rable.<br />
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine <strong>naturel</strong> et culturel remarquable<br />
d’espaces ruraux de qualité mais fragiles (Chap. III, Article L333-1 <strong>du</strong> Code de l’Environnement) Leur politique<br />
s’appuie sur la protection de l'environnement, l'aménagement <strong>du</strong> territoire et son développement économique et<br />
social. La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales<br />
concernées et adoptée par décret portant classement en PNR pour une <strong>du</strong>rée maximale de dix ans. La révision<br />
de la charte est assurée par l'organisme de gestion <strong>du</strong> PNR.<br />
D’après le porter à connaissances de l’Observatoire de l’Environnement de Corse, il n’y a pas de parc <strong>naturel</strong> à<br />
proximité (moins de 3km) <strong>du</strong> projet.<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
27
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
IV.1.2.4.<br />
LES RÉSERVES NATURELLES NATIONALES / RÉGIONALES<br />
Réglementés par le titre III <strong>du</strong> livre III « Espaces <strong>naturel</strong>s » <strong>du</strong> Code de l’Environnement relatif aux parcs et<br />
réserves, et modifié notamment par la Loi dite « Grenelle II » <strong>du</strong> 12 juillet 2010. Les réserves sont des outils<br />
réglementaires, de protection forte, correspondant à des zones de superficie limitée créées afin « d’assurer la<br />
conservation d’éléments <strong>du</strong> <strong>milieu</strong> <strong>naturel</strong> d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation<br />
communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale » (Art L332-2 <strong>du</strong> Code de<br />
l’Environnement).<br />
Les Réserves Naturelles Nationales sont classées par décision <strong>du</strong> Ministre chargé de l’écologie et <strong>du</strong><br />
développement <strong>du</strong>rable. Elles sont créées par un décret (simple ou en Conseil d’Etat) qui précise les limites de la<br />
réserve, les actions, activités, travaux, constructions et modes d’occupation <strong>du</strong> sol qui y sont réglementés. Pour<br />
chaque réserve la réglementation est définie au cas par cas afin d’avoir des mesures de protection appropriées<br />
aux objectifs de conservation recherchés ainsi qu’aux activités humaines existantes sur chaque site.<br />
En application de l’article L332-11 <strong>du</strong> Code de l’Environnement (modifié par Loi n°2002-276 <strong>du</strong> 27 février 2002 -<br />
art. 109 JORF 28 février 2002), les anciennes réserves <strong>naturel</strong>les volontaires sont devenues des Réserves<br />
Naturelles Régionales. Elles peuvent être créées à l’initiative des propriétaires des terrains eux-mêmes ou des<br />
conseils régionaux afin de protéger les espaces « présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine<br />
géologique ou paléontologique ou d’une manière générale pour la protection des <strong>milieu</strong>x <strong>naturel</strong>s » (art L332-2<br />
<strong>du</strong> Code de l’Environnement). Le conseil régional fixe alors les limites de la réserve, les règles applicables, la<br />
<strong>du</strong>rée <strong>du</strong> classement (recon<strong>du</strong>ctible tacitement) et désigne ensuite un gestionnaire avec lequel il passe une<br />
convention.<br />
D’après le porter à connaissances de l’Observatoire de l’Environnement de Corse, aucune réserve <strong>naturel</strong>le n’est<br />
située à proximité (moins de 3 km) <strong>du</strong> projet.<br />
IV.1.2.5.<br />
LES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE<br />
Les Réserves de biosphère sont le fruit <strong>du</strong> programme « Man and Biosphère » (MAB) initié par l’UNESCO en<br />
1971 qui vise à instaurer des périmètres, à l’échelle mondiale, au sein desquels sont mises en place une<br />
conservation et une utilisation rationnelle de la biosphère.<br />
Les réserves de biosphère, désignées par les gouvernements nationaux, sont pensées comme étant des<br />
territoires d’application <strong>du</strong> programme MAB, qui consiste à « promouvoir un mode de développement<br />
économique et social, basé sur la conservation et la valorisation des ressources locales ainsi que sur la<br />
participation citoyenne». La France compte un réseau de 10 réserves de biosphère, animé par le Comité MAB<br />
France, mais dont chacune reste placée sous la juridiction de l’Etat.<br />
Les objectifs généraux de ces réserves sont triples : conserver la biodiversité (écosystèmes, espèces, gènes…),<br />
assurer un développement pour un avenir <strong>du</strong>rable et mettre en place un réseau mondial de recherche et de<br />
surveillance continue de la biosphère.<br />
Pour cela chacune d’elle est divisée en 3 secteurs : l’aire centrale dont la fonction est de protéger<br />
règlementairement la biodiversité locale, la zone tampon consacrée à l’application d’un mode de développement<br />
<strong>du</strong>rable, et la zone de transition où les restrictions sont moindres.<br />
D’après le porter à connaissances de l’Observatoire de l’Environnement de Corse il n’y a pas de réserve de<br />
biosphère à proximité (moins de 3km) <strong>du</strong> projet.<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
28
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
IV.1.3. BILAN DES PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION<br />
RÈGLEMENTAIRE ET CONTRACTUELLE<br />
Le Tableau 2 ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et à portée réglementaire à proximité (moins de<br />
3km) de l’aire d’étude.<br />
Statut <strong>du</strong> périmètre Dénomination Superficie (ha) Code<br />
ZNIEFF <strong>terrestre</strong>s de type I<br />
ZNIEFF <strong>terrestre</strong>s de type II<br />
« Dunes et pointes<br />
rocheuses de Botre et<br />
Giunchetu »<br />
« Oliveraies et boisements<br />
des collines de Balagne »<br />
35 940030023<br />
2016 940004142<br />
« Vallée de Regino » 4214 940030247<br />
Tableau 2 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection à proximité (moins de 3km) de l’aire d’étude<br />
IVBilan des protections et documents d’alerte<br />
29
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
V. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE<br />
V.1.<br />
LES HABITATS NATURELS<br />
V.1.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES HABITATS NATURELS<br />
Le site d’étude s’inscrit dans la trame paysagère de la Balagne et se localise sur la presqu’île siliceuse de l’Ile<br />
Rousse. Cet endroit très réputé pour la particularité de la couleur de sa roche est avant tout aménagé afin<br />
d’accueillir les navires ainsi que les touristes. Ainsi, ce <strong>milieu</strong> est très anthropisé et remanié, cependant des<br />
habitats <strong>naturel</strong>s liés aux rochers maritimes sont présents sur la zone à aménager. Sur le site d’étude est présent<br />
des groupements caractéristiques des falaises méditerranéennes ainsi que des garrigues côtières à Helichrysum<br />
correspondant à des habitats d’intérêt communautaire. La rudéralisation et la fréquentation ont favorisé le<br />
développement de plusieurs espèces invasives, la griffe de sorcière (Carpobrotus e<strong>du</strong>lis (L.) N.E.Br.) recouvrant<br />
les rochers.<br />
En fonction des espèces dominantes et en adoptant la classification « CORINE Biotopes », on peut observer :<br />
Groupement des falaises méditerranéennes (Code CORINE Biotopes:18.22)<br />
Cet habitat relève de la Directive 92/43/CEE en tant qu’habitat d’intérêt communautaire « 1240- Falaises avec<br />
végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques ». Cet habitat est caractéristique des<br />
falaises méditerranéennes et représenté sur le site d’étude par trois groupements constitués d’une végétation<br />
halophile et semi-halophile. Le plus représentatif correspond à l’association <strong>du</strong> Crithmo-Limonieta et à la sousassociation<br />
Crithmo-limonietum frankenietosum qui est constituée par la criste marine (Crithmum maritimum L.),<br />
le limonium articulé (Limonium articulatum (Loisel.) Kuntze), et par la bruyère marine (Frankenia laevis L.). Cette<br />
formation est caractéristique des replats rocheux. Sur le site d’étude, cet habitat est très disséminé et représente<br />
de très faible superficie. Il présente un mauvais état de conservation dû aux piétinements.<br />
Figure 5: Groupement à criste marine et à limonium articulé. Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA<br />
Le deuxième faciès est à relier à l’association <strong>du</strong> Pegano-Salsoletea correspondant au groupement à<br />
Mesembryanthemum nodiflorum. Cette formation est caractéristique des groupements halophile ou semihalophile<br />
occupant des secteurs où des éléments sableux se déposent dû à l’érosion des roches par les vents et<br />
les embruns salés. Sur le site d’étude, ce faciès est représenté au sud <strong>du</strong> parking en haut <strong>du</strong> talus.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
30
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Figure 6: Groupement à ficoïde à fleurs nodales. Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA<br />
Un troisième faciès correspondant à des <strong>milieu</strong>x plus terreux ou rocailleux est à relier à l’association Thymelaeohelichrysetum<br />
italici,Crithmo-limonietea. On peut noter la présence de l’immortelle d’Italie (Helichrysum italicum<br />
(Roth) G.Don), de la carotte d’Espagne (Daucus carota subsp. hispanicus (Gouan) Thell), <strong>du</strong> lotier faux-cytise<br />
(Lotus cytisoides L.), de la passerine hirsute (Thymelaea hirsuta (L.) Endl.) et de la cousteline (Reichardia<br />
picroides (L.) Roth.). Ce faciès se situe au sud de la zone d’étude et présente un meilleur d’état de conservation<br />
car il est moins piétiné.<br />
Figure 7: Groupement à passerine hirsute, à immortelle d'italie et à limonium articulé.<br />
Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
31
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Fourré halonitrophile (code CORINE Biotopes : 15.72)<br />
Cet habitat relève de la Directive 92/43/CEE en tant qu’habitat d’intérêt communautaire « 1430- Fourrés halonitrophiles<br />
(Pegano-Salsoletea) »<br />
Cet habitat correspond aux végétations pérennes arbustives littorales méditerranéennes halo-nitrophiles qui se<br />
développent sur substrat graveleux drainé. Sur le site d’étude, cet habitat est caractérisé par la présence de la<br />
mauve royale (Lavatera arborea L.), la giroflée des jardins (Matthiola incana (L.) R.Br.) , de la carotte d’Espagne<br />
(Daucus carota subsp. hispanicus (Gouan) Thell), <strong>du</strong> lotier faux-cytise (Lotus cytisoides L.). Ces formations sont<br />
classiquement liées aux zones nitrophiles des espaces insulaires où les oiseaux marins jouent un rôle primordial,<br />
mais aussi aux sols soumis au remaniement des lapins. Les formations en présence trouvent un niveau de<br />
parenté dans la nature des substrats (remaniés et relativement eutrophes) et la composition des cortèges<br />
associés. Cette entité peut être apparentée aux zones rudérales et friches qui sont généralement le résultat de la<br />
profonde altération des <strong>milieu</strong>x <strong>naturel</strong>s et semi-<strong>naturel</strong>s, suite à la détérioration anthropique des sols. Elles sont<br />
colonisées dans une première phase par de nombreuses plantes pionnières intro<strong>du</strong>ites ou nitrophiles à stratégie<br />
opportuniste et à faible valeur patrimoniale, avec la présence quasi systématique d’espèces invasives. En<br />
contexte insulaire ce type d’espace présente des caractéristiques particulières au littoral qui impliquent une prise<br />
en considération.<br />
Figure 8 : Fourré halonitrophile au nord <strong>du</strong> parking. Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
32
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Groupement à griffes de sorcière<br />
Cet habitat monospécifique est constitué de deux espèces végétales représentées par les griffes de sorcière<br />
(Carpobrotus e<strong>du</strong>lis (L.) N.E.Br. et Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus) formant des tapis recouvrant les<br />
rochers. Ces espèces sont invasives et peu d’espèces accompagnent celles-ci. Cette formation est disséminée<br />
sur l’ensemble <strong>du</strong> site.<br />
Figure 9: Tapis de griffe de sorcières. Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA<br />
V.1.2. LES HABITATS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET RÈGLEMENTAIRE<br />
Les différentes phases de prospections ont mis en évidence la présence de deux habitats <strong>naturel</strong>s d’intérêt<br />
communautaire relevant de la Directive 92/43/CEE :<br />
• 1240- Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques incluant<br />
deux habitas élémentaires : « Végétation des fissures des falaises cristallines (1240-2) » et les<br />
« Garrigues littorales primaires (1240-3) »<br />
• 1430-« Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea) » incluant l'habitat élémentaire « Fourrés halonitrophiles<br />
<strong>du</strong> littoral de la Corse et de la Provence (1430-1) »<br />
V.1.3. BILAN DES ENJEUX DES HABITATS NATURELS<br />
Le site d'étude n'est pas inclus au sein d'un périmètre Natura 2000, n'in<strong>du</strong>isant ainsi pas de contraintes<br />
réglementaires spécifiques aux habitats <strong>naturel</strong>s. Toutefois, par leurs valeurs patrimoniales, les habitats 1240, et<br />
1430 représentent un enjeu modéré sur le périmètre étudié. Ils constituent des formations assez communes en<br />
Corse mais sont particulièrement rares et menacées à l'échelle nationale. Au niveau floristique, les cortèges sont<br />
peu diversifiés mais ils abritent plusieurs espèces végétales patrimoniales. D'autre part, ces formations sont<br />
vulnérables sur le site d’étude car elles sont sensibles au piétinement dû à la fréquentation touristique, aux<br />
aménagements portuaires, à l’envahissement et à la concurrence par les griffes de sorcière.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
33
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Code<br />
Corine<br />
Intitulé Corine biotopes<br />
Code<br />
prodrome<br />
Alliance<br />
Code<br />
Natura<br />
2000<br />
Intitulé Natura 2000<br />
Statut<br />
de<br />
l'habitat<br />
Niveau<br />
d’enjeu<br />
Habitats littoraux et halophile<br />
15.72 Fourrés halonitrophiles - Salsolo-Peganion Br.-Bl &O. de Bolos 1954 1430<br />
Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-<br />
Salsoletea)<br />
IC<br />
Modéré<br />
18.1 Falaises maritimes nues - - - - NC Faible<br />
18.22<br />
Groupement des falaises<br />
méditerranéennes<br />
21.0.1.0.3<br />
Erodion corsici (Gamisans & Muracciole 1984) Géhu & Biondi<br />
1994<br />
1240<br />
Falaises avec végétation des côtes<br />
méditerranéennes avec Limonium<br />
spp. endémiques.<br />
IC<br />
Modéré<br />
19 Ilots, bancs rocheux, récifs - - - - NC Faible<br />
- Tapis de griffes de sorcières - - - - NC Faible<br />
Terres agricoles et paysages artificiels<br />
85.31 Jardins ornementaux - - - - NC Faible<br />
86.1 Habitations - - - - NC Faible<br />
87.2 Zones rudérales - - - - NC Faible<br />
89.11 Port maritime - - - - NC Faible<br />
Tableau 3 : Habitats identifiés sur l'aire d'étude<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
34
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Figure 10 : Répartition des habitats <strong>naturel</strong>s sur la zone d'étude<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
35
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
V.2.<br />
DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES<br />
V.2.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES CORTÈGES ET LES GRANDS TYPES<br />
D’HABITATS<br />
Un examen minutieux des publications existantes, des études de références traitant de sites comparables ou<br />
d’une aire géographique proche, est une étape essentielle afin d’identifier les espèces potentielles sur le site<br />
d’étude. Pour cela ont été utilisées, la végétation de la Corse (Gamisans J., 1999) et Flora Corsica (Jeanmonod<br />
D. & Gamisans J.,2007). La consultation <strong>du</strong> Conservatoire Botanique National Corse, ainsi que la base ZNIEFF<br />
de la DREAL Corse nous permettent de localiser les espèces présentes dans l’aire d’étude ou à proximité<br />
immédiate. Une espèce à statut a été identifiée sur la commune de l’Ile Rousse, précisément sur la presqu’île.<br />
Trois autres espèces d’intérêt patrimonial sont présentes.<br />
V.2.2. LES ESPÈCES D’INTÉRÊT RÈGLEMENTAIRE OU PATRIMONIALE<br />
Aucune espèce protégée n’a été identifiée lors de cette journée de prospection. Cependant, deux espèces<br />
dites patrimoniales, c’est-à-dire que soient leurs aires de répartition sont très restreintes en Corse soient elles<br />
sont endémiques, ont été observées :<br />
Limonium articulé – Limonium articulatum (Loisel.) Kuntze<br />
(Espèce endémique cyrno-sarde, Livre Rouge de la flore menacée de France, tome 2, version provisoire)<br />
Description générale : Espèce de la famille des<br />
Plombaginacées, cette chaméphyte mesure de 5 à 40<br />
centimètres. Cet arbrisseau nain hémisphérique, lâche<br />
à dense à tiges ligneuses de 2 à 10 cm est constitué<br />
d’un feuillage inséré en spirale dont les feuilles sont<br />
généralement toutes flétries à la floraison. Les<br />
branches sont densément pourvues de verrues en<br />
forme de cratère dans la moitié supérieure et sont<br />
densément ramifiées à disposition dichotomique. Les<br />
fleurs d’un bleu-violet s’épanouissent de juin à octobre.<br />
(Flora Corsica, 2007)<br />
Figure 11: Limonium articulé (Limonium articulatum L.). Photo sur site : M. Anquez / NATURALIA<br />
Répartition : Cette espèce d’origine sténoméditerranéenne est une endémique cyrno-sarde.<br />
Ecologie et fonctionnalité : Cette espèce affectionne tout particulièrement les rochers littoraux et les sables.<br />
Dynamique et vulnérabilité de l’espèce : Le limonium articulé est une espèce commune sur le littoral corse. Ces<br />
stations sont menacées par les aménagements littoraux et la fréquentation touristique.<br />
Localisation sur le site d’étude : Cette espèce occupe essentiellement le sud <strong>du</strong> site d’étude sur les rochers<br />
littoraux.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
36
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Statut Effectifs Dynamique Distribution Niveau d’enjeu<br />
Aucune protection,<br />
endémique,<br />
Livre Rouge de la<br />
flore menacée de<br />
France, tome 2<br />
version provisoire<br />
5 stations<br />
environ 10<br />
pieds<br />
Elle est abondante dans les<br />
zones ouvertes et rocailleuses.<br />
Elle est présente au bord <strong>du</strong><br />
sentier dans les rochers.<br />
Faible, espèce<br />
commune.<br />
Ficoïde à fleurs nodales – Mesembryanthemum nodiflorum L.<br />
(Espèce endémique cyrno-sarde, Livre Rouge de la flore menacée de France, tome 2, version provisoire)<br />
Description générale : Espèce de la famille des Aizoacées, cette<br />
thérophyte mesure de 5 à 25 centimètres. Cette plante au port<br />
postré à redressé est ramifiée dès la base. Les feuilles inférieures<br />
sont opposées, les supérieures sont alternes, sessiles et<br />
crassulescentes linéaires et obtuses. Les fleurs sont axillaires et<br />
subsessiles blanchâtres à rosées. La floraison se déroule entre le<br />
mois d’avril à juin. (Flora Corsica, 2007)<br />
Figure 12 : Le ficoïde à fleurs nodales (Mesembryanthemum nodiflorum L.). Photo sur site : M.Anquez/Naturalia<br />
Répartition : Cette espèce d’origine sténoméditerranéenne est présente en Europe méditerranéenne, en Asie<br />
occidentale et en Afrique septentrionale. En France, elle se situe dans les départements des Bouches-<strong>du</strong>-Rhône,<br />
<strong>du</strong> Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse.<br />
Ecologie et fonctionnalité : Cette espèce affectionne tout particulièrement les sables et les rochers littoraux.<br />
Dynamique et vulnérabilité de l’espèce : Le ficoïde à fleurs nodales est une espèce intro<strong>du</strong>ite et rare sur le littoral<br />
corse. Ces stations sont menacées par les aménagements littoraux et la fréquentation touristique.<br />
Localisation sur le site d’étude : Cette espèce occupe essentiellement le nord <strong>du</strong> site d’étude en contrebas <strong>du</strong><br />
parking.<br />
Statut Effectifs Dynamique Distribution Niveau d’enjeu<br />
Aucune protection,<br />
rare<br />
Environ<br />
100 pieds<br />
Elle est abondante dans<br />
les zones sablonneuses<br />
Elle est présente sur le talus<br />
sablonneux en contrebas <strong>du</strong> parking<br />
Faible, espèce<br />
intro<strong>du</strong>ite.<br />
Au regard <strong>du</strong> recueil bibliographique et des audits de personnes ressources, plusieurs espèces sont confirmées à<br />
proximité <strong>du</strong> projet. Il s’agit notamment de la doradille marine (Asplenium marinum L.), espèce protégée<br />
régionalement qui est située au nord de la presqu’île, hors de la zone d’étude (Mlle Piazza, Conservatoire<br />
Botanique National de Corse). De plus, la frankénie pulvérulente (Frankenia pulverulenta L. subsp pulverulenta),<br />
espèce rare en Corse, a été observée en dehors de la zone d’étude, en bas de la tour génoise (M. Paradis<br />
comm. pers). Cependant, ces espèces ne peuvent être présentes sur la zone d’étude car les conditions<br />
écologiques et ne sont pas propices à l’installation de la Doradille marine. De plus, la fréquentation touristique<br />
provoque un piétinement intensif ce qui ne permet pas le développement d’espèces à statut.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
37
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Figure 13 : localisation des espèces patrimoniales sur la zone d'étude<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
38
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
V.3.<br />
CONCLUSION<br />
Deux habitats d’intérêt communautaire relèvent de la Directive Habitats Faune-Flore. Ils se localisent sur<br />
l’emprise même <strong>du</strong> projet et en limite. Toutefois, ils présentent un état de conservation médiocre et constituent<br />
par là même des enjeux écologiques modérés.<br />
Les prospections effectuées tardivement n’ont pas pris en compte tous les taxons. Cependant, deux espèces<br />
patrimoniales ont été observées sur le site d’étude : le limonium articulé et le ficoïde à fleurs nodales qui ne<br />
constituent qu’un enjeu faible. Malgré des inventaires floristiques tardifs, la potentialité de présence d’espèces à<br />
statut est faible au regard de l’état de détérioration <strong>du</strong> site et de sa bonne connaissance par les botanistes<br />
locaux. Cependant, une attention sera nécessaire quant au risque inhérent à la dispersion des deux espèces<br />
invasives que sont les griffes de sorcière (Carpobrotus e<strong>du</strong>lis (L.) N.E.Br.) et Carpobrotus acinaciformis (L.) L.<br />
Bolus) en phase de travaux.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
39
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
V.4.<br />
DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES<br />
V.4.1. LES INVERTÉBRÉS PROTÉGÉS<br />
V.4.1.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS<br />
D’ESPÈCE<br />
Les habitats de l’aire d’étude présentent des conditions drastiques limitant les cortèges entomologiques, de plus<br />
la zone est largement remaniée. Toutefois plusieurs espèces généralement communes peuvent s’y développer.<br />
Les communautés de coléoptères des zones sableuses et rocheuses <strong>du</strong> littoral méditerranéen sont<br />
essentiellement composées de scarabeidae, carabidae et tenebrionidae. Cette famille est représentée par de<br />
nombreuses espèces bien adaptées aux conditions de sécheresse et sont souvent actives de nuit.<br />
Plusieurs espèces de lépidoptères ubiquistes peuvent venir s’alimenter sur la végétation littorale comme Papilio<br />
machaon, Polyommatus icarus, Lycaena phlaeas, Aricia agestis, Pieris spp., etc.<br />
Concernant les orthoptères, seules des espèces communes de <strong>milieu</strong>x ouverts vont pouvoir se développer sur le<br />
site d’étude. Il s’agit notamment de Calliptamus barbarus, Oedipoda caerulescens, Sphingonotus corsicus,<br />
Ailopus thalassinus, Acrotylus patruelis, Decticus albifrons, Euchortippus elegantulus, etc.<br />
V.4.1.2.<br />
LES ESPÈCES DE PORTEE RÈGLEMENTAIRE<br />
Au regard des <strong>milieu</strong>x présents sur l’aire d’étude, aucune espèce à valeur règlementaire n’est présente.<br />
V.4.2. LES AMPHIBIENS<br />
Aucune espèce à portée réglementaire n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude. Le caractère halophile de la<br />
plupart des habitats <strong>naturel</strong>s, l’absence de points d’eau douce à légèrement saumâtre (temporaire ou permanent)<br />
justifient de la non représentativité de ce compartiment.<br />
V.4.3. LES REPTILES<br />
V.4.3.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS<br />
D’ESPÈCE<br />
Le peuplement herpétologique local est peu diversifié au regard de la relative homogénéité des habitats<br />
rencontrés dans l’aire d’étude. Il se compose en deux grands cortèges dont les assemblages spécifiques pour un<br />
certain nombre d’espèces :<br />
Espèces à large valence écologique (capacité à occuper une large gamme d’habitats) ;<br />
Deux espèces recensées dans l’aire d’étude peuvent être affiliées à ce compartiment. Il s’agit <strong>du</strong> Lézard<br />
tyrrhénéen Podarcis tilliguerta et de la Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica<br />
Ce lézard fait partie <strong>du</strong> cortège de fonds de l’herpétofaune insulaire corse. Cette espèce occupe la quasi-totalité<br />
de l’île depuis le bord de mer jusqu’à près de 1800 mètres d’altitude. Espèce ubiquiste, elle affectionne toutefois<br />
les substrats d’origine <strong>naturel</strong>le comme artificielle. En situation littorale, elle s’accommode également des<br />
formations sableuses bien qu’elle rentre en compétition avec une autre espèce de lézard allochtone : le Lézard<br />
sicilien Podarcis sicula.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
40
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Bien qu’endémique insulaire corso-sarde, la valeur patrimoniale <strong>du</strong> Lézard tyrrhénéen reste faible au<br />
regard de sa représentativité, de son état de conservation à différentes échelles et de ses<br />
caractéristiques écologiques.<br />
La Tarente de Maurétanie est une espèce que l’on peut qualifier de plastique (large valence écologique) et<br />
affiliée au substrat rocheux. Cette espèce est particulièrement bien représentée en Corse <strong>du</strong> nord et notamment<br />
en Balagne à la faveur des formations rocheuses et des espaces anthropisés (bâti). L’indigénat insulaire de<br />
l’espèce est encore discuté à l’instar de bon nombre de stations <strong>du</strong> bassin méditerranéen occidental.<br />
La valeur patrimoniale de cette espèce reste très modeste au regard de sa représentativité, de son état<br />
de conservation à différentes échelles et de ses caractéristiques écologiques.<br />
Espèces affiliées à l’origine aux formations rocheuses :<br />
L’Hémidactyle verruqueux est une espèce caractéristique des formations rocheuses de l’étage méditerranéen<br />
inférieur avec une concentration particulière des stations au niveau de la frange littorale. Cette espèce est par<br />
nature moins encline à fréquenter les <strong>milieu</strong>x humanisés, préférant les substrats rocheux <strong>naturel</strong>s. La<br />
compétition (voire la prédation ?) avec la tarente de Maurétanie pourrait limiter la distribution de l’espèce.<br />
La valeur patrimoniale de l’Hémidactyle verruqueux est notable au regard de sa relative rareté<br />
sur l’île de Corse, de son état de conservation à différentes échelles et de ses caractéristiques<br />
écologiques.<br />
Le Phyllodactyle d’Europe Euleptes europaeus est une espèce de gecko ouest méditerranéenne à distribution<br />
essentiellement insulaire. En Corse, l’espèce est affiliée aux formations rocheuses <strong>naturel</strong>les le plus souvent. Sa<br />
distribution insulaire comprend la frange littorale mais également l’intérieur des terres à la faveur des grandes<br />
vallées.<br />
La valeur patrimoniale <strong>du</strong> Phyllodactyle d’Europe est forte au regard de sa relative rareté sur l’île<br />
de Corse comme sur l’ensemble de son aire de répartition, de son état de conservation à<br />
différentes échelles et de ses caractéristiques écologiques.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
41
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
V.4.3.2.<br />
LES ESPÈCES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET RÈGLEMENTAIRE<br />
Hémidactyle verruqueux Hemidactylus turcicus<br />
Annexe III de la Convention de Berne<br />
Statut européen : « menacé » d’après la Société Herpétologique<br />
Européenne<br />
Espèce de reptile protégée sur le territoire français (art 1 er )<br />
Description de l’espèce :<br />
Espèce discrète, principalement crépusculaire et nocturne, l’hémidactyle ne sort que rarement en journée pour<br />
profiter <strong>du</strong> soleil. Sédentaire, il est actif une large part de l’année <strong>du</strong> fait <strong>du</strong> caractère tempéré des zones côtières<br />
qu’il affectionne. Avril marque le début de la période de repro<strong>du</strong>ction. Les mâles se font plus territoriaux et les<br />
émissions vocales variées jouent à ce moment un rôle très important pour les délimitations <strong>du</strong> territoire ou<br />
l’attraction des partenaires.<br />
Figure 14 - Hémidactyle verruqueux Hemidactylus turcicus. Photos sur site : E. Durand<br />
Ecologie de l’espèce<br />
Inféodé aux zones côtières chaudes, on le trouve dans une gamme variée d’habitats dont le point commun est le<br />
substrat rocheux. Ainsi, il se rencontre aussi bien sur des systèmes <strong>naturel</strong>s de type blocs rocheux nus que dans<br />
des <strong>milieu</strong>x artificiels tels que les carrières ou les zones urbaines. Dans ce dernier habitat, une compétition<br />
interspécifique avec la Tarente de Mauritanie a déjà pu être démontrée en France continentale, avec l’exclusion<br />
de ces deux espèces en <strong>milieu</strong> urbain, chacune occupant des quartiers différents d’une même ville (Geniez,<br />
1989).<br />
Dans les situations de sympatrie, l’hémidactyle fréquente plutôt le bas des murs et des falaises. Affilié aux zones<br />
côtières, sa répartition altitudinale dépasse rarement les 300 mètres et ne concerne que des zones aux<br />
caractéristiques climatiques très tempérées.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
42
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Distribution<br />
Son aire de répartition <strong>naturel</strong>le couvre le pourtour méditerranéen (sud de<br />
l'Europe, Afrique <strong>du</strong> Nord et<br />
Proche-Orient), la plupart des<br />
îles méditerranéennes, le nordest<br />
de l'Afrique jusqu'au Kenya,<br />
la péninsule arabique et le<br />
Moyen-Orient jusqu'à atteindre<br />
l'Inde. Intro<strong>du</strong>it dans de<br />
nombreux pays, il a ainsi pu<br />
coloniser l’Amérique <strong>du</strong> Nord et<br />
centrale. En France, l'espèce<br />
est actuellement assez rare,<br />
distribuée sporadiquement le<br />
long <strong>du</strong> littoral méditerranéen<br />
continental où il est présent par<br />
noyaux depuis les Pyrénées<br />
orientales jusqu’à la frontière<br />
italienne en passant par les<br />
Calanques de Marseille, les<br />
îles d’Hyères, l’Estérel, la<br />
Riviera et la Corse. Cette<br />
répartition fragmentée pourrait<br />
indiquer une fragilité de<br />
l’espèce mais des prospections<br />
récentes démontrent que<br />
l’espèce se porte bien et aurait<br />
même tendance à coloniser de<br />
nouveaux sites.<br />
En Corse, l'Hémidactyle verruqueux est peu régulier sur une large part de la frange littorale à la faveur des zones<br />
urbaines et périurbaines. Il semble que les populations continentales soient principalement cantonnées aux<br />
secteurs anthropisés (habitations, carrières) <strong>du</strong> littoral. Ses densités de populations sont très faibles à l’exception<br />
de l’extrême sud de l’île (région de Bonifacio) (Delaugerre & Cheylan 1992).<br />
Statut dans l’aire d’étude<br />
Statut Effectifs Distribution Niveau d’enjeu<br />
Présence - Repro<strong>du</strong>ction<br />
Effectif<br />
modeste<br />
Dans la zone, l’espèce se rencontre dans une<br />
large gamme d’habitats (falaises <strong>naturel</strong>s, murets<br />
de pierres, blocs rocheux, façades de bâti,…)<br />
Modéré<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
43
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Phyllodactyle d’Europe Euleptes europaeus<br />
Espèce de reptile protégée en France (art 1 er )<br />
Annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore »<br />
Annexe II de la Convention de Berne<br />
Statut national : « à surveiller » d’après les critères UICN<br />
Statut mondial : « vulnérable » d’après les critères UICN<br />
Statut européen : « menacé » d’après la Société herpétologique<br />
Européenne<br />
Ecologie de l’espèce<br />
Le phyllodactyle est une espèce globalement discrète principalement nocturne. Son affinité pour le substrat<br />
rocheux lui permet ainsi de bénéficier de la chaleur accumulée de jour par les roches régulant de la sorte sa<br />
température sans modifier son cycle circadien. Le début de la phase d’activité se situe deux heures après le<br />
coucher <strong>du</strong> soleil avec pour comportement principal la chasse, et se poursuit jusqu’à l’aube avec un pic entre<br />
02h30 et 04h30. Peu enclin aux déplacements, sa recherche alimentaire ne s’étend que sur un rayon d’action<br />
limité à quelques mètres et ce n’est que lors de dispersions estivales qu’il peut s’éloigner nettement (Delaugerre.<br />
2003)<br />
Poïkilotherme, l’activité comme la <strong>du</strong>rée de l’hibernation de ce gecko est largement dépendante des conditions<br />
thermiques ambiantes. Ainsi les populations corses ou sardes vivant en altitude (maximum 1500 mètres)<br />
rencontrent des conditions plus sévères ré<strong>du</strong>isant leur cycle annuel d’activité à environ 6 mois et par<br />
conséquence leur taux de fécondité. A contrario, les populations littorales dont la phase d’hibernation est<br />
discontinue et inférieure à 3 mois (ce qui implique des conditions meilleures) ont un meilleur taux de fécondité.<br />
De mœurs grégaires, des densités de 30 à 40 indivi<strong>du</strong>s par mètre carré peuvent être notées ce qui laisse peu de<br />
place à l’hypothèse de comportements territoriaux des mâles. Sur les îles Lavezzi en Corse <strong>du</strong> sud, les densités<br />
peuvent atteindre 200 indivi<strong>du</strong>s au mètre carré sous les croûtes d’altération des chaos granitiques (Delaugerre &<br />
Cheylan 1992).<br />
Lié à des microhabitats rupestres à développement végétatif faible à nul, il affectionne les portions exposées au<br />
soleil qui fournissent abri et joue le rôle de régulateur thermique. Exploitant en majorité les formations rocheuses<br />
<strong>naturel</strong>les constituées de failles étroites et profondes, il retrouve également ces caractéristiques sur des<br />
formations non <strong>naturel</strong>les (muret, terrasses,…) et plus rarement sous les souches ou les écorces d’arbres morts.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
44
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Distribution<br />
Endémique méditerranéen, le phyllodactyle<br />
montre une distribution relictuelle et dispersée<br />
dans le bassin occidental avec près de 200<br />
isolats géographiques. Ainsi, il se rencontre<br />
dans un grand nombre d’îles et îlots comme<br />
les Iles Tyrrhéniennes, les différents îlots <strong>du</strong><br />
nord de la Tunisie (archipel de la Galite et île<br />
Cani), devant les côtes ligure et toscane en<br />
Italie (Capocaccia 1956; Vanni & Lanza 1978;<br />
Bruno 1980; Delaugerre 1981b) mais aussi sur<br />
les différents archipels de Provence et de<br />
Corse (Müller & Schneider 1971; Knoepffler<br />
1973; Vanni & Lanza 1978, Delaugerre 1997).<br />
Outre les <strong>milieu</strong>x insulaires, quelques<br />
populations continentales côtières ont été<br />
découvertes notamment sur une frange <strong>du</strong><br />
littoral toscan mais aussi plus ponctuellement<br />
sur les hauteurs de Gênes.<br />
En France, le cœur de la population se situe<br />
en Corse. En effet, l’espèce y occupe aussi<br />
bien les îlots satellitaires (70 environ<br />
dénombrées) que les régions littorales<br />
rocheuses ou les vallées de moyenne<br />
montagne.<br />
L’espèce n’est pas mentionnée par Delaugerre et Cheylan (1992) dans le secteur de l’île Rousse. Toutefois,<br />
Delaugerre en 1997 l’a découverte sur les îlots situés devant d'Ile Rousse. Selon ces mêmes auteurs, bien qu’ils<br />
n’aient pas réalisé de prospections spécifiques sur l’île de la Pietra, les biotopes sont jugés tout à fait<br />
convenables et une présence de l’espèce pouvait être considérée.<br />
Statut dans l’aire d’étude<br />
A l’issue des prospections menées entre août et octobre 2011 et en mai 2012, aucun indivi<strong>du</strong> de cette espèce<br />
n’a été contacté dans l’aire d’emprise projet comme dans l’ensemble de l’aire d’étude. Une attention<br />
particulière a été portée sur cette espèce (recherche dans les habitats jugés optimums pour l’espèce dans des<br />
conditions météorologiques favorables) lors des prospections printanières. Il est probable que l’absence de<br />
l’espèce s’explique par certains facteurs dont :<br />
- Abondance de prédateurs notamment de Rat surmulot, Chat domestique<br />
- Compétition au sein des habitats favorables avec la Tarente de Maurétanie notamment<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
45
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Figure 15 : Localisation des points de contact de l’herpétofaune<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
46
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
V.4.4. LES OISEAUX<br />
La nature des biotopes rencontrés dans l’aire et la proximité <strong>du</strong> tissu urbain et des activités anthropiques qui en<br />
découlent limitent fortement la richesse spécifique locale ainsi que l’état de conservation des habitats d’espèces.<br />
Au niveau de la zone d’emprise comme de son espace d’influence, le peuplement avifaunistique peut être<br />
regroupé en deux catégories :<br />
- les espèces à large valence écologique et souvent liées aux aménagements anthropiques existants.<br />
Ce cortège est très largement le plus représenté. Il se compose d’espèces communes, largement distribuées à<br />
différentes échelles et dont les sites de repro<strong>du</strong>ction se situent hors de la zone d’étude (jardins privés, bâti,<br />
espaces verts,…). La zone d’étude est essentiellement exploitée lors des phases d’alimentation. Les espèces les<br />
plus représentées sont l’Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris, le Moineau domestique et cisalpin Passer<br />
domesticus et italiae, le Choucas des tours Corvus mone<strong>du</strong>la, la Tourterelle turque Streptopelia turtur, la<br />
Bergeronnette grise Motacilla alba, et le Rouge-queue noir Phoenicurus ochuros.<br />
- les espèces strictement affiliées à la frange littorale.<br />
Le Cormoran de Méditerranée Phalacrocorax aristotelis desmaresti s’alimente occasionnellement dans la baie de<br />
l’île Rousse. Il exploite la plupart des criques à la recherche de poissons. Plus au large, divers oiseaux<br />
pélagiques (Puffin cendré, Puffin yelkouan,…) transitent sans pour autant être liés aux habitats rencontrés dans<br />
l’aire d’étude.<br />
V.4.5. LES MAMMIFÈRES TERRESTRES<br />
Concernant les micromammifères, nous n’avons pas mis en place un inventaire spécifique au regard de<br />
l’incompatibilité des habitats avec la présence de micro-mammifères protégés et/ou à valeur patrimoniale.<br />
Les espèces potentielles sont :<br />
- Le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus : relativement abondant en Corse entre 0 et 500 m<br />
d’altitude. Le site ne présente pas d’habitats favorables à l’espèce. En revanche, sa présence est jugée<br />
potentielle dans le centre urbain de l’île Rousse à la faveur des jardins privatifs.<br />
- Le Rat noir Rattus rattus et la Souris domestique Mus musculus : ces deux espèces très répan<strong>du</strong>es et<br />
courantes en Corse ont été contactées lors des prospections nocturnes.<br />
V.4.6. LES CHIROPTÈRES<br />
V.4.6.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS<br />
D’ESPÈCE<br />
La zone d’étude englobe des habitats que l’on peut qualifier de défavorables à l’accueil des chiroptères<br />
remarquables en gîte. Seules des espèces anthropophiles et communes peuvent se maintenir dans le patrimoine<br />
bâti existant. La tour génoise située hors zone d’emprise n’a pas pu faire l’objet de prospections<br />
chiroptérologiques et pourrait abriter des chauves-souris en gîte.<br />
Les espaces visés par l’aménagement ne correspondent pas à des habitats de chasse particulièrement<br />
importants pour la chiroptérofaune. Seules des espèces à large valence écologique comme les Pipistrelles sp, la<br />
Sérotine commune Eptesicus serotinus, l’Oreillard gris Plecotus austriacus, le Vespère de Savi Hypsugo savi<br />
peuvent survoler la zone, probablement attirées par la concentration d’insectes provoquée par les éclairages<br />
publics existants.<br />
VEtat Initial Ecologique de l’Aire d’<strong>Etude</strong><br />
47
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
VI. BILAN DES ENJEUX FAUNISTIQUES<br />
Espèces<br />
Protection<br />
Liste rouge<br />
nationale<br />
Statut sur la zone d'emprise<br />
VIBilan des enjeux Faunistiques<br />
Niveau<br />
National<br />
Niveau<br />
européen<br />
Hémidactyle verruqueux Menacé Présence<br />
Lézard tyrrhénéen x A surveiller Présence<br />
Tarente de Maurétanie x A surveiller Présence<br />
Tableau 4 : Bilan hiérarchisé des enjeux faunistiques réglementaires notables au sein de la zone d’étude<br />
Négligeable Modéré Très fort<br />
48
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
VII. EVALUATION DES IMPACTS<br />
VII.1.<br />
NATURE DES IMPACTS<br />
L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats <strong>naturel</strong>s, les<br />
espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent.<br />
VII.1.1.<br />
TYPES D’IMPACT<br />
VII.1.1.1.<br />
LES IMPACTS DIRECTS<br />
Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou <strong>du</strong> fonctionnement de l’aménagement sur<br />
les <strong>milieu</strong>x <strong>naturel</strong>s. Pour identifier les impacts directs, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais<br />
aussi de l’ensemble des modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt,<br />
les pistes d’accès, les places de retournement des engins,...).<br />
Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières :<br />
Destruction de l’habitat d’espèces :<br />
L’implantation d’un aménagement dans le <strong>milieu</strong> <strong>naturel</strong> ou semi <strong>naturel</strong> a nécessairement des conséquences<br />
sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux de<br />
terrassement préliminaires à l’implantation peuvent notamment con<strong>du</strong>ire à la diminution de l’espace vital des<br />
espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation.<br />
Les emprises des travaux associées aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les<br />
voies d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives pour des<br />
espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur <strong>milieu</strong> de prédilection, à savoir leur territoire de repro<strong>du</strong>ction ou<br />
encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire<br />
avec les difficultés que cela représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra<br />
spécifique, disponibilité alimentaire, substrat convenable…).<br />
Destruction d’indivi<strong>du</strong>s :<br />
Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune présente et causeront la perte d’indivi<strong>du</strong>s.<br />
Des travaux en période de repro<strong>du</strong>ction auront un impact plus fort sur la faune parce qu’ils toucheront aussi les<br />
oiseaux (destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des<br />
espèces dont la conservation est menacée.<br />
VII.1.1.2. LES IMPACTS INDIRECTS :<br />
Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des<br />
conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts <strong>du</strong>s à la phase <strong>du</strong> chantier que des impacts persistant<br />
pendant la phase d’exploitation.<br />
Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :<br />
Dérangement :<br />
Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation <strong>du</strong> site lors de la phase<br />
d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se tra<strong>du</strong>it éventuellement par une gêne voire une répulsion pour les<br />
espèces les plus farouches.<br />
L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures,…)<br />
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à déserter le site.<br />
VIIEvaluation des Impacts<br />
49
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Cela peut se pro<strong>du</strong>ire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine tranquillité et<br />
d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines.<br />
Altération des fonctionnalités :<br />
La réalisation d’un projet au sein <strong>du</strong> <strong>milieu</strong> <strong>naturel</strong> peut modifier l’utilisation <strong>du</strong> site par les espèces. En particulier<br />
pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile à appréhender mais<br />
est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie <strong>du</strong> paysage peut aider à évaluer cet impact.<br />
VII.1.2.<br />
DURÉE DES IMPACTS<br />
VII.1.2.1. LES IMPACTS TEMPORAIRES :<br />
Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient<br />
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements<br />
d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou<br />
de zones de dépôt temporaires de matériaux…<br />
VII.1.2.2. LES IMPACTS PERMANENTS :<br />
Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont per<strong>du</strong>rer le temps de l’exploitation.<br />
La qualité de l’habitat en sera altérée.<br />
VII.2.<br />
EVALUATION DES IMPACTS SUR LES HABITATS<br />
Seuls les habitats présentant un enjeu écologique avéré sur la zone considérée font l’objet d’une évaluation des<br />
impacts.<br />
Habitat concerné<br />
Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)<br />
Niveau d'enjeu<br />
écologique sur la zone<br />
Modéré (fortement dégradés sur la zone d’emprise)<br />
Rareté relative<br />
Forte<br />
Degré de menace<br />
Fort<br />
Résilience de l’habitat à<br />
une perturbation<br />
Faible<br />
Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2<br />
Nature de l'impact<br />
Description de l'impact<br />
Destruction de l’habitat<br />
Destruction directe de l’habitat lors de la<br />
phase chantier<br />
Emprise située sur la station de l’habitat<br />
considéré<br />
Dégradation des fonctionnalités<br />
écologiques<br />
Intro<strong>du</strong>ction d’espèces invasives<br />
Fragmentation de l’habitat<br />
Type d’impact Directe Indirecte<br />
Durée de l’impact Permanente Permanente<br />
Effets cumulatifs<br />
Non<br />
Evaluation de l’impact<br />
global<br />
Faible (habitat rudéralisé et en limite de la zone d’emprise)<br />
Nécessité de mesures<br />
Oui<br />
Tableau 5: Evaluation des impacts sur les fourrés halonitrophiles<br />
VIIEvaluation des Impacts<br />
50
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Habitat concerné<br />
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp.<br />
endémiques<br />
Niveau d'enjeu<br />
écologique sur la zone<br />
Modéré (fortement dégradés sur la zone d’emprise)<br />
Rareté relative<br />
Faible<br />
Degré de menace<br />
Modéré<br />
Résilience de l’habitat à<br />
une perturbation<br />
Faible<br />
Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2<br />
Nature de l'impact<br />
Destruction de l’habitat<br />
Dégradation des fonctionnalités<br />
écologiques<br />
Description de l'impact<br />
Destruction directe de l’habitat lors de la<br />
phase chantier<br />
Emprise située sur la station de l’habitat<br />
considéré<br />
Intro<strong>du</strong>ction d’espèces invasives<br />
Fragmentation de l’habitat<br />
Type d’impact Directe Indirecte<br />
Durée de l’impact Permanente Permanente<br />
Effets cumulatifs<br />
Evaluation de l’impact<br />
global<br />
Nécessité de mesures<br />
Non<br />
Faible (commun sur le littoral méditerranéen)<br />
Oui<br />
Tableau 6 : Evaluation des impacts sur les falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium<br />
spp. endémiques<br />
VIIEvaluation des Impacts<br />
51
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
VII.3.<br />
IMPACTS SUR LES ESPÈCES VÉGÉTALES<br />
Seules les espèces présentant un enjeu écologique avéré sur la zone considérée font l’objet d’une évaluation des<br />
impacts. Aucune espèce à portée réglementaire n’a été mise en évidence au sein de l’aire d’étude.<br />
Espèce concernée<br />
Niveau d'enjeu écologique sur la zone<br />
Rareté relative<br />
Degré de menace<br />
Statut biologique et quantité<br />
Résilience à la perturbation<br />
Limonium articulé – Limonium articulatum (Loisel.)<br />
Kuntze<br />
Faible<br />
Faible<br />
Modéré<br />
Environ dix indivi<strong>du</strong>s<br />
Faible<br />
Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2<br />
Nature de l’atteinte Destruction d'indivi<strong>du</strong>s Destruction d'habitat<br />
Type d’atteinte<br />
Durée de l’atteinte<br />
Portée de l'atteinte<br />
Directe<br />
Permanente<br />
Locale<br />
Evaluation de l’atteinte globale<br />
Nécessité de mesures<br />
Faible<br />
Oui<br />
Tableau 7 : Evaluation des atteintes sur le limonium articulé<br />
VIIEvaluation des Impacts<br />
52
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Espèce concernée<br />
Niveau d'enjeu écologique sur la zone<br />
Rareté relative<br />
Degré de menace<br />
Statut biologique et quantité<br />
Résilience à la perturbation<br />
Ficoïde à fleurs nodales– Mesembryanthemum<br />
nodiflorum L.<br />
Faible<br />
Forte<br />
Modéré<br />
Environ 100 pieds<br />
Faible<br />
Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2<br />
Nature de l’atteinte Destruction d'indivi<strong>du</strong>s Destruction d'habitat<br />
Type d’atteinte<br />
Durée de l’atteinte<br />
Portée de l'atteinte<br />
Evaluation de l’atteinte globale<br />
Nécessité de mesures<br />
Directe<br />
Permanente<br />
Locale<br />
Faible (en limite de la zone d’emprise)<br />
Oui<br />
Tableau 8 : Evaluation des atteintes sur le ficoïde à fleurs nodales<br />
VIIEvaluation des Impacts<br />
53
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
VII.4.<br />
IMPACTS SUR LES ESPÈCES ANIMALES<br />
Seules les espèces présentant un enjeu écologique avéré sur la zone considérée font l’objet d’une évaluation des<br />
impacts.<br />
Espèce concernée<br />
Hémidactyle verruqueux<br />
Niveau d'enjeu<br />
écologique sur la zone<br />
Modéré<br />
Rareté relative<br />
Espèce peu représentée en Corse<br />
Degré de menace<br />
Non évalué<br />
Statut<br />
Présence – Repro<strong>du</strong>ction<br />
Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2<br />
Nature de l'impact Destruction d’indivi<strong>du</strong>s Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce<br />
Description de l'impact<br />
Les emprises <strong>du</strong> projet d’extension <strong>du</strong> port<br />
concernent une partie de l’aire de présence<br />
avérée de l’hémidactyle<br />
L’espèce est présente au niveau de l’actuel<br />
parking ainsi que sur divers murets<br />
Type d’impact Directe Directe<br />
Durée de l’impact Permanente Permanente<br />
Portée de l'impact<br />
Locale<br />
Evaluation de l’impact<br />
global<br />
Nécessité de mesures<br />
Faible<br />
Oui<br />
Tableau 9: Evaluation des atteintes sur l’Hémidactyle verruqueux<br />
VIIEvaluation des Impacts<br />
54
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
Espèce concernée<br />
Tarente de Maurétanie<br />
Niveau d'enjeu<br />
écologique sur la zone<br />
Faible<br />
Rareté relative<br />
Espèce largement représentée en Corse et à faible valeur patrimoniale en France<br />
Degré de menace Non menacée. Espèce opportuniste qui s’accommode volontiers des situations anthropiques<br />
Statut<br />
Présence - Repro<strong>du</strong>ction<br />
Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2<br />
Nature de l'impact Destruction d’indivi<strong>du</strong>s Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce<br />
Description de l'impact<br />
Des indivi<strong>du</strong>s ont été contactés dans la<br />
plupart des secteurs<br />
<strong>terrestre</strong>s visés par les travaux.<br />
Les habitats de l’espèce au niveau de la zone<br />
d’emprise correspondent aux formations<br />
rocheuses <strong>naturel</strong>les, aux espaces anthropisés<br />
(bâti, parking, enrochement, espaces<br />
jardinés,…).<br />
Type d’impact Directe Directe<br />
Durée de l’impact Permanente Permanente<br />
Portée de l'impact<br />
Locale<br />
Evaluation de l’impact<br />
global<br />
Nécessité de mesures<br />
Non significatif<br />
Non. L’espèce bénéficiera des aménagements consécutifs au projet d’extension <strong>du</strong> port.<br />
Tableau 10: Evaluation des atteintes sur la Tarente de Maurétanie<br />
Espèce concernée<br />
Lézard tyrrhénéen<br />
Niveau d'enjeu<br />
écologique sur la zone<br />
Faible<br />
Rareté relative<br />
Espèce très largement représentée en Corse<br />
Degré de menace<br />
Non menacé à l’exception très localement de la compétition avec le lézard sicilien (espèce<br />
allochtone)<br />
Statut<br />
Présence - Repro<strong>du</strong>ction<br />
Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2<br />
Nature de l'impact Destruction d’indivi<strong>du</strong>s Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce<br />
Description de l'impact<br />
Des indivi<strong>du</strong>s ont été contactés<br />
essentiellement au niveau <strong>du</strong> parking ainsi<br />
qu’aux abords de l’hôtel Pietra.<br />
Les habitats de l’espèce au niveau de la zone<br />
d’emprise correspondent essentiellement aux<br />
formations artificialisées (abords de l’hôtel<br />
Pietra, parking)<br />
Type d’impact Directe Directe<br />
Durée de l’impact Permanente Permanente<br />
Portée de l'impact<br />
Locale<br />
Evaluation de l’impact<br />
global<br />
Nécessité de mesures<br />
Faible<br />
Non. L’espèce est bien représentée sur cette portion de trait de côte.<br />
Tableau 11: Evaluation des atteintes sur le Lézard tyrrhénéen<br />
VIIEvaluation des Impacts<br />
55
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
VIII. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE<br />
REDUCTION D’ATTEINTES<br />
L’article L 122-1 <strong>du</strong> Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter,<br />
ré<strong>du</strong>ire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables <strong>du</strong> projet sur l’environnement… ».<br />
Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de ré<strong>du</strong>ction des<br />
impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant<br />
compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts rési<strong>du</strong>els examinés. Si ces derniers sont<br />
finalement vecteurs d’atteintes majeures, des mesures compensatoires seront évoquées.<br />
VIII.1.<br />
TYPOLOGIE DES MESURES<br />
Les mesures de suppression<br />
La suppression d’un impact implique parfois la modification <strong>du</strong> projet initial telle qu’un changement de site<br />
d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, le<br />
choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux.<br />
Les mesures de ré<strong>du</strong>ction<br />
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus<br />
possible la ré<strong>du</strong>ction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux<br />
(limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration <strong>du</strong> <strong>milieu</strong> ou de<br />
certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à faune…).<br />
Les mesures d’accompagnement<br />
Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par<br />
exemple <strong>du</strong> contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement.<br />
VIIIProposition de Mesures de suppression et de re<strong>du</strong>ction d’atteintes<br />
56
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
VIII.2. PROPOSITIONS DE MESURES DE RÉDUCTION /<br />
SUPPRESSION<br />
L’évaluation des atteintes <strong>du</strong> projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux<br />
d’atteinte non nuls mais globalement assez modestes. Les mesures proposées ici permettront de ré<strong>du</strong>ire les<br />
effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part sur les espèces nicheuses ou potentiellement<br />
nicheuses, ainsi que sur les espèces fréquentant la zone d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse.<br />
Les mesures d’atténuation suivantes sont préconisées :<br />
Code mesure : R1<br />
Limitation des espèces végétales invasives<br />
Modalité technique<br />
de la mesure<br />
Localisation<br />
présumée de la<br />
mesure<br />
Eléments<br />
écologiques<br />
bénéficiant par la<br />
mesure<br />
Période optimale<br />
de réalisation<br />
Coût (estimatif)<br />
Il est préconisé d’apporter une vigilance particulière sur la zone d’emprise à ce sujet. Les<br />
travaux peuvent en effet constituer une nouvelle niche écologique de choix pour la<br />
prolifération des espèces végétales invasives. Certains végétaux exogènes ont une<br />
capacité de repro<strong>du</strong>ction élevée, de résistance aux maladies, une croissance rapide et une<br />
forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant<br />
les écosystèmes <strong>naturel</strong>s. Les invasions biologiques sont à ce propos la deuxième cause<br />
de perte de biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 1997).<br />
Les principales espèces exotiques invasives de la presqu’île de l’île Rousse sont :<br />
• Carpobrotus e<strong>du</strong>lis (fréquent)<br />
• Carpobrotus acinaciformis (localisé)<br />
- autres<br />
Lors de la phase chantier, il convient d’identifier les espèces invasives déjà présentes sur le<br />
site et, par la suite, il est nécessaire de veiller à ne pas les disséminer (semence et<br />
bouture) avec les engins de travaux. Un nettoyage des engins de travaux sera nécessaire<br />
régulièrement et particulièrement après la phase d’exposition aux espèces invasives. Les<br />
zones de présence d’espèces végétales invasives et d’entretien des engins de travaux<br />
doivent être définies avec l’aide d’un expert-écologue.<br />
Ensemble de la zone d’emprise <strong>du</strong> projet et des voies de circulation.<br />
La limitation de la prolifération des espèces invasives est compatible avec le plus grand<br />
nombre d’espèces patrimoniales. En effet, celles-ci sont particulièrement sensibles à la<br />
concurrence avec les taxons exogènes.<br />
Pendant toute la <strong>du</strong>rée des travaux<br />
Non évaluable en l’état<br />
VIIIProposition de Mesures de suppression et de re<strong>du</strong>ction d’atteintes<br />
57
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Limitation de l’emprise <strong>du</strong> projet<br />
Code mesure : R2<br />
Modalité technique de<br />
la mesure<br />
Localisation présumée<br />
de la mesure<br />
Eléments écologiques<br />
bénéficiant par la<br />
mesure<br />
Période optimale de<br />
réalisation<br />
Coût<br />
Limitation de l’emprise <strong>du</strong> projet sur les secteurs à forte sensibilité<br />
Cette mesure s’applique sur les secteurs où les enjeux écologiques sont à proximité<br />
immédiate de la zone de travaux et qui vont être impactés par le chantier.<br />
Un balisage léger à l’aide de rubalise peut être réalisé sur les zones « éloignées »<br />
<strong>du</strong> chantier. Pour les secteurs à enjeux à proximité <strong>du</strong> chantier, un balisage plus<br />
serré et en <strong>du</strong>r peut être réalisé afin de cantonner l’emprise des travaux au<br />
maximum.<br />
Ce balisage devra être mis en œuvre sur les marges <strong>du</strong> parti d’aménagement afin<br />
de garantir les éventuels débordements de chantier<br />
Le schéma de circulation devra faire l’objet de concertation et de validation par une<br />
Assistance environnementale (structure externe)<br />
Ce type de mesure est applicable à l’ensemble des secteurs à enjeu herpétologique.<br />
Toutes les espèces animales à portée réglementaire potentiellement visées.<br />
Cette opération devra obligatoirement être réalisée avant le début <strong>du</strong> chantier et<br />
préférentiellement quelques jours avant le lancement des travaux afin de garantir la<br />
pérennité des emplacements des balisages.<br />
Le coût de cette mesure sera variable en fonction de la longueur <strong>du</strong> balisage à<br />
implanter et de la nature <strong>du</strong> balisage réalisé. Environ 2 500.00 euros ht.<br />
VIIIProposition de Mesures de suppression et de re<strong>du</strong>ction d’atteintes<br />
58
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
Dispositifs d’éclairage<br />
Code mesure : R3<br />
Modalité technique de<br />
la mesure<br />
Localisation présumée<br />
de la mesure<br />
Eléments écologiques<br />
bénéficiant par la<br />
mesure<br />
Période optimale de<br />
réalisation<br />
Dispositifs d’éclairage<br />
Cette mesure s’applique sur les espaces soumis à projet aux stades chantier et<br />
exploitation :<br />
- Phase chantier : s’il s’avère nécessaire de travailler de nuit, la mise en<br />
place de dispositifs d’éclairage devra intégrer la dimension <strong>milieu</strong> <strong>naturel</strong><br />
<strong>terrestre</strong>. En effet, en raison de la présence proche d’espèces à mœurs<br />
nocturnes à enjeu (Hémidactyle verruqueux et Tarente de Maurétanie), il<br />
est important de ne pas orienter les faisceaux lumineux vers les aires de<br />
présence de ces espèces (notamment secteur nord parking).<br />
- Phase exploitation : les éclairages mis en place devront intégrer les<br />
contraintes environnementales connexes au projet. L’orientation des<br />
dispositifs devra veiller à être en conformité avec le maintien des espèces à<br />
mœurs nocturnes actuellement en présence.<br />
Ce type de mesure est applicable à l’ensemble <strong>du</strong> parti d’aménagement avec une<br />
attention particulière pour les secteurs ouest (parking non bitumé et crique sud).<br />
Toutes les espèces animales à portée réglementaire potentiellement visées.<br />
Phases chantier (potentiellement) et exploitation<br />
Coût<br />
Pas de surcoût lié à la mise en place de cette mesure qui relève de la simple<br />
organisation <strong>du</strong> chantier et de l’intégration dans l’aménagement paysager de<br />
l’espace.<br />
VIIIProposition de Mesures de suppression et de re<strong>du</strong>ction d’atteintes<br />
59
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
VIII.3. EVALUATION DES IMPACTS APRÈS MESURES<br />
Le Tableau 1212 présente les mesures préconisées et les atteintes rési<strong>du</strong>elles après mesures pour chaque<br />
espèce d’intérêt patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle.<br />
Espèces<br />
Nature <strong>du</strong> ou des<br />
atteintes<br />
Niveau global<br />
d’atteinte avant<br />
mesure<br />
Mesures<br />
préconisées<br />
Atteintes<br />
rési<strong>du</strong>elles<br />
après<br />
mesures<br />
Limonium articulé<br />
Ficoïde à fleurs<br />
nodales<br />
Phyllodactyle d’Europe<br />
Destruction d’indivi<strong>du</strong>s<br />
Destruction d’indivi<strong>du</strong>s<br />
Destruction d’indivi<strong>du</strong>s<br />
Destruction d’habitats<br />
d’espèce<br />
Faible<br />
Faible<br />
Limitation des emprises<br />
Limitation des espèces<br />
végétales invasives<br />
Limitation des emprises<br />
Limitation des espèces<br />
végétales invasives<br />
Non<br />
significatives<br />
Non<br />
significatives<br />
Nul - Nul<br />
Hémidactyle<br />
verruqueux<br />
Destruction d’indivi<strong>du</strong>s<br />
Destruction d’habitats<br />
d’espèce<br />
Faible<br />
Limitation des emprises<br />
Dispositif d’éclairage<br />
Non<br />
significatives<br />
Lézard tyrrhénéen<br />
Tarente de Maurétanie<br />
Destruction d’indivi<strong>du</strong>s<br />
Destruction d’habitats<br />
d’espèce<br />
Destruction d’indivi<strong>du</strong>s<br />
Destruction d’habitats<br />
d’espèce<br />
Faible<br />
Non significatif<br />
Limitation des emprises<br />
Pas de mesures<br />
spécifiques<br />
Tableau 12 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces et atteintes rési<strong>du</strong>elles<br />
Non<br />
significatives<br />
Non<br />
significatives<br />
Si les mesures de suppression et de ré<strong>du</strong>ction des atteintes telles que proposées dans le présent document sont<br />
mises en œuvre et si le contrôle de leur application est assuré <strong>du</strong>rant tout le déroulement <strong>du</strong> chantier, les<br />
atteintes rési<strong>du</strong>elles sur le compartiment <strong>naturel</strong> <strong>terrestre</strong> <strong>du</strong> projet d’agrandissement <strong>du</strong> port de l’ïle Rousse<br />
seront jugées non significatives.<br />
VIIIProposition de Mesures de suppression et de re<strong>du</strong>ction d’atteintes<br />
60
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
VIII.4.<br />
PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES<br />
Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de protection de la<br />
nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le code de<br />
l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3.<br />
La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes sont<br />
réunies :<br />
- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ;<br />
- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. »<br />
Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une<br />
compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets<br />
dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles <strong>du</strong> site.<br />
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de ré<strong>du</strong>ction<br />
proposées, le niveau d'atteintes rési<strong>du</strong>elles est estimé négligeable.<br />
Pour cette raison, et moyennant le respect des mesures d'insertion préconisées, la définition de mesures<br />
compensatoires n'apparaît pas nécessaire au titre <strong>du</strong> patrimoine <strong>naturel</strong> <strong>terrestre</strong> local.<br />
VIIIProposition de Mesures de suppression et de re<strong>du</strong>ction d’atteintes<br />
61
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.-C., 1997 – CORINE Biotopes – Version originale – Types d’habitats<br />
français ; Ecole nationale <strong>du</strong> génie rural et des eaux et forêts, Laboratoire de recherches en sciences forestières,<br />
Nancy (France), 339 p.<br />
DANTON. P, BAFFRAY. M., 1995. – Inventaire des plantes protégées en France. Nathan 294 p.<br />
DIREN PACA, 2007 – Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte <strong>du</strong> paysage et <strong>du</strong> <strong>milieu</strong> <strong>naturel</strong><br />
dans les études d’impact de carrières.<br />
I.E.G.B. (M.N.H.N.), 1994 – Livre rouge de la flore menacée en France. Tome 1 : espèces prioritaires – Mus. Nat.<br />
Hist. Nat., Cons. Bot. Nat. De Porquerolles, Ministère de l’Environnement. Paris, 485 p.<br />
JEANMONOD D., GAMISANS J., 2007. Flora Corsica. Edisud. 921p.<br />
GAMISANS J., 1999. Végétation de la Corse. Edisud. 391p.<br />
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 1986 – Arrêté <strong>du</strong> 24/06/86 relatif à la liste des espèces végétales<br />
protégées en région Corse complétant la liste nationale. Journal Officiel de la République Française.<br />
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 1998 – Arrêté <strong>du</strong> 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales<br />
protégées sur l’ensemble <strong>du</strong> territoire national, Journal Officiel de la République Française.14p.<br />
BIRDLFE International (2004) – Birds in Europe : population estimates, trends and conservation status.<br />
Cambridge, UK : BirdLife International (BirdLife Conservation Séries No. 12)<br />
DUBOIS P.J, Le MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2000) – Inventaire des oiseaux de France.<br />
Nathan, Paris. 400 P.<br />
DUQUET M. (1992) - Inventaire de la faune de France. Nathan, Paris. 416p.<br />
ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France.<br />
SEOF/LPO, Paris, 600p.<br />
THIOLLAY J.M. et BRETAGNOLLE V. (coord.), 2004, Rapaces nicheurs de France, Distribution, effectifs et<br />
conservation, Delachaux et Niestlé, Paris.<br />
YEATMAN-BERTHELOT JARRY G. (1994) – Atlas des oiseaux nicheurs de France. SOF, Paris. 776p<br />
CHEYLAN M. (1998). Evolution of the distribution of the European pond turtle in the French Mediterranean area<br />
since the post-glacial. EMYS Symposium Dresden 96.<br />
DELAUGERRE M., CHEYLAN M. (1993). Atlas de répartition des batraciens et reptiles de Corse. PNR Corse –<br />
EPHE-CNRS. 129p<br />
BARATAUD, M. (1992). Reconnaissance des espèces de Chiroptères français à l’aide d’un détecteur d’ultrason : le<br />
point sur les possibilités actuelles. In M.d.h. <strong>naturel</strong>le, (Ed.) Proceedings : Actes <strong>du</strong> XVIème colloque<br />
francophone de mammalogie SFEPM, 1992, Grenoble, SFEPM, 58-68.<br />
BISCARDI, S., RUSSO, D., CASCIANI, V., CESARINI, D., MEI, M. et BOITANI, L. (2007). Foraging requirements of the<br />
endangered long-fingered bat : the influence of micro-habitat structure, water quality and prey type. Journal of<br />
Zoology London: 1-10.<br />
FUKUI, D., MURAKAMI, M., NAKANO, S. et AOI, T. (2006). Effect of emergent aquatic insect on bat foraging in a<br />
riparian forest. Journal of Animal Ecology, (75): 1252-1258.<br />
0Bibliographie<br />
62
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2012<br />
MESCHEDE, A. & K.-G. HELLER. (2003). Ecologie et protection des chauves-souris en <strong>milieu</strong> forestier. Le<br />
Rhinolophe n°16 pp. 1-248<br />
RAINHO, A. (2007). Summer foraging habitats of bats in a Mediterranean region of the Iberian Peninsula. Acta<br />
Chiropterologica, 9 (1): 171-181.<br />
ROUE S.Y. & BARATAUD M. (1999). Habitats et activité nocturne des chiroptères menacés en Europe : synthèse<br />
des connaissances en vue d'une gestion conservatrice. Le Rhinolophe, Spéc. 2 : 47-<br />
0Bibliographie<br />
63
Agrandissement <strong>du</strong> Port de l’Île Rousse 2011<br />
0Bibliographie<br />
64