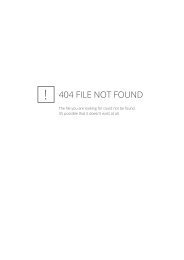La définition, les outils d'évaluation et de financement du ... - Cerna
La définition, les outils d'évaluation et de financement du ... - Cerna
La définition, les outils d'évaluation et de financement du ... - Cerna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CERNA, Centre d’économie in<strong>du</strong>strielle<br />
Ecole Nationale Supérieure <strong>de</strong>s Mines <strong>de</strong> Paris<br />
60, bld St Michel - 75272 Paris ce<strong>de</strong>x 06<br />
Tél.: (33) 01 40 51 90 91 / 90 71<br />
Fax: (33) 01 44 07 10 46<br />
E-mail: cerna@cc.ensmp.fr<br />
http://www.ensmp.fr/Fr/CERNA/CERNA<br />
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public<br />
en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Rapport final pour :<br />
Direction <strong>de</strong>s Etu<strong>de</strong>s, Stratégies <strong>et</strong> Investissement <strong>de</strong> la SNCF<br />
Contrat n° 821009.60253<br />
Juill<strong>et</strong> 1997.
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Table <strong>de</strong>s matières<br />
1. Réglementation <strong>de</strong>s biens collectifs <strong>et</strong> <strong>de</strong>s services publics<br />
Synthèse................................................................................................................2<br />
1. <strong>La</strong> réglementation <strong>de</strong>s biens collectifs.................................................................................4<br />
1.1. <strong>La</strong> main invisible tenue en échec par <strong>les</strong> biens non-excludab<strong>les</strong>.........................................5<br />
1.2. L’inefficacité <strong>du</strong> marché en présence <strong>de</strong> biens non-rivaux..................................................9<br />
1.3. Les différents types <strong>de</strong> biens.......................................................................................11<br />
1.4. L’offre privée <strong>de</strong> biens collectifs..................................................................................16<br />
2. <strong>La</strong> réglementation <strong>de</strong>s biens collectifs appliquée aux services publics.......................................21<br />
2.1. Service public <strong>et</strong> bien collectif....................................................................................22<br />
2.2. <strong>La</strong> notion <strong>et</strong> la doctrine juridiques <strong>du</strong> service public.......................................................26<br />
2.3. Déréglementation <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau <strong>et</strong> service public..............................................30<br />
2. Services publics : notes <strong>de</strong> repérage................................................................34<br />
Avant propos terminologique...............................................................................................36<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service public dans le droit français.....................................................................36<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service public en droit communautaire.................................................................39<br />
De premières différences entre <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> service public selon le droit français <strong>et</strong> le droit<br />
communautaire..................................................................................................................40<br />
<strong>La</strong> double nature <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> service public à caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial.......................41<br />
Quelques lignes <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>s doctrines <strong>du</strong> service public........................................................42<br />
Les doctrines exclusives <strong>de</strong> l'efficacité <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'équité..................................................................42<br />
Les conséquences <strong>de</strong> l'ouverture à la concurrence sur <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service public.....................44<br />
Bibliographie....................................................................................................................46<br />
3. Les conséquences <strong>de</strong> l'ouverture à la concurrence<br />
sur <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service public...........................................................46<br />
4. <strong>La</strong> réforme <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public :<br />
le cas <strong>de</strong>s télécommunications.....................................................................50<br />
5. <strong>La</strong> réforme <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public :<br />
le cas <strong>du</strong> secteur postal..................................................................................78<br />
6. Déréglementation <strong>et</strong> Service public................................................................104<br />
CERNA 2
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1. Réglementation <strong>de</strong>s biens collectifs<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong>s services publics<br />
Synthèse<br />
François Lévêque<br />
CERNA 3
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1. <strong>La</strong> réglementation <strong>de</strong>s biens collectifs<br />
<strong>La</strong> nature collective d'un bien est un défaut <strong>de</strong> marché, qui est souvent mal compris. Son<br />
explication fait appel en eff<strong>et</strong> à <strong>de</strong>s catégories analytiques qui s’entremêlent <strong>et</strong> se recoupent.<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> bien collectif, ou bien public, combine plusieurs dimensions intuitivement<br />
diffici<strong>les</strong> à distinguer. D'autre part, ce défaut <strong>de</strong> marché présente <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> parenté avec<br />
ceux déjà étudiés mais <strong>les</strong> correspondances entre bien collectif <strong>et</strong> externalité, <strong>et</strong> entre bien<br />
collectif <strong>et</strong> monopole naturel ne sont ni simp<strong>les</strong> ni directes. <strong>La</strong> nature collective <strong>de</strong> certains<br />
pro<strong>du</strong>its ou services est un argument central mis en avant par l’économie publique pour<br />
justifier une intervention <strong>de</strong> l’Etat pour pro<strong>du</strong>ire, ou faire pro<strong>du</strong>ire, ces biens. Elle implique<br />
que <strong>les</strong> biens collectifs <strong>de</strong>vraient être financés par l'impôt <strong>et</strong> non par marché <strong>et</strong> qu'ils<br />
<strong>de</strong>vraient être offerts à tous. Le concept <strong>de</strong> bien collectif se rattache ainsi à la question <strong>du</strong><br />
Service Public. En France, son avenir fait l'obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> nombreux débats. Les obligations <strong>de</strong><br />
services publics <strong>de</strong>s entreprises <strong>du</strong> transport, <strong>de</strong> l'énergie, <strong>du</strong> courrier <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />
télécommunications sont en train d'être redéfinies. C<strong>et</strong>te évolution sera étudiée dans la<br />
partie suivante.<br />
Avant d'exposer <strong>les</strong> analyses théoriques <strong>de</strong>s biens collectifs, un avant-propos sur <strong>les</strong> termes<br />
utilisés est nécessaire. Nous emploierons systématiquement par la suite le terme <strong>de</strong> bien<br />
collectif, <strong>et</strong> non celui <strong>de</strong> bien public. Ce <strong>de</strong>rnier suggère la présence <strong>de</strong> la puissance publique<br />
en particulier au titre <strong>de</strong> fournisseur ou propriétaire <strong>du</strong> bien. Nous verrons que dans certaines<br />
conditions <strong>les</strong> biens collectifs peuvent parfaitement être financés <strong>et</strong> pro<strong>du</strong>its sans<br />
implication <strong>de</strong> la puissance publique. Le terme <strong>de</strong> bien collectif présente l'avantage d'être<br />
neutre. Il ne se réfère à l’initiative d'aucun acteur en particulier : une association <strong>de</strong><br />
consommateurs, un groupe d'entreprises, une municipalité, un gouvernement central, <strong>et</strong>c.<br />
Afin <strong>de</strong> distinguer le concept économique <strong>et</strong> <strong>les</strong> réalités qu'il recouvre nous avons réservé le<br />
terme <strong>de</strong> bien collectif à la <strong>définition</strong> théorique, <strong>et</strong> le terme <strong>de</strong> service collectif aux formes<br />
empiriques. Cel<strong>les</strong>-ci peuvent alors être spécifiées selon leur dimension géographique<br />
(ex. : un service collectif local), leur forme <strong>de</strong> contrôle (ex. : un service collectif public) <strong>et</strong><br />
le statut <strong>du</strong> fournisseur (ex. : un service collectif en régie). Indiquons enfin, dans la<br />
perspective <strong>de</strong> la partie suivante que nous réserverons le terme <strong>de</strong> service public au concept<br />
juridique. Une entreprise qui sert <strong>de</strong>s obligations léga<strong>les</strong> <strong>de</strong> service public est appelée une<br />
entreprise <strong>de</strong> service public. C<strong>et</strong>te dénomination réunie aussi bien <strong>les</strong> entreprises publiques <strong>de</strong><br />
service public (GDF, SNCF) que <strong>les</strong> entreprises privées <strong>de</strong> service public (British Gas,<br />
Railtrack, ou <strong>les</strong> filia<strong>les</strong> loca<strong>les</strong> <strong>de</strong> la Générale <strong>de</strong>s eaux).<br />
Un bien collectif est un bien dont la consommation est collective : il est accessible à tous <strong>et</strong><br />
sa consommation par un indivi<strong>du</strong> n’entraîne pas une moindre disponibilité pour <strong>les</strong> autres<br />
CERNA 4
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
[Samuelson, 1954]. Les <strong>de</strong>ux exemp<strong>les</strong> canoniques sont ceux <strong>de</strong> la défense nationale <strong>et</strong> <strong>du</strong><br />
phare. En France, tous <strong>les</strong> citoyens bénéficient <strong>de</strong> la protection nucléaire. De même, tous <strong>les</strong><br />
bateaux qui passent au voisinage <strong>de</strong> l'Ile <strong>de</strong> Ré peuvent utiliser pour se gui<strong>de</strong>r <strong>les</strong> éclairs <strong>du</strong><br />
phare <strong>de</strong>s Baleines. Un bien collectif s'oppose au bien privé pour lequel, au contraire, la<br />
consommation totale se divise entre <strong>les</strong> différents usagers <strong>et</strong> la consommation d'un indivi<strong>du</strong><br />
prive un autre indivi<strong>du</strong> d'utiliser le même bien. Si je mange c<strong>et</strong>te pomme, tu ne la<br />
consommeras pas. Si je m<strong>et</strong>s c<strong>et</strong>te paire <strong>de</strong> chaussure, tu ne pourras pas l'utiliser.<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> bien collectif associe en fait <strong>de</strong>ux propriétés : la non-excludabilité <strong>et</strong> la nonrivalité<br />
<strong>de</strong> l'usage. Il convient <strong>de</strong> bien <strong>les</strong> séparer car chacune renvoie à une source<br />
d’inefficacité <strong>du</strong> marché différente : l'absence d'incitation à pro<strong>du</strong>ire liée au comportement<br />
<strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin <strong>et</strong> le rationnement sous-optimal <strong>de</strong>s consommateurs en présence <strong>de</strong><br />
coût <strong>de</strong> congestion nul.<br />
1.1. <strong>La</strong> main invisible tenue en échec par <strong>les</strong> biens non-excludab<strong>les</strong><br />
<strong>La</strong> non-excludabilité désigne l'impossibilité d'exclure <strong>de</strong> l'usage quelconque utilisateur, y<br />
compris ceux qui ne contribuent pas au <strong>financement</strong> <strong>du</strong> bien. A l'exemple <strong>de</strong> la dissuasion<br />
nucléaire ou <strong>du</strong> phare, une fois <strong>les</strong> investissements réalisés, chacun peut en profiter. Bien sûr,<br />
on peut imaginer un dispositif technique qui ren<strong>de</strong> inobservable <strong>les</strong> signaux <strong>de</strong>s balises aux<br />
marins non équipés ; le bien collectif <strong>de</strong>vient alors excludable. C'est le cas <strong>de</strong> figure<br />
rencontré dans la télévision avec l'invention <strong>de</strong>s déco<strong>de</strong>urs. Ils perm<strong>et</strong>tent d’empêcher <strong>les</strong><br />
non-abonnés <strong>de</strong>s chaînes cryptées d'avoir accès gratuitement aux programmes. Dans le cas<br />
<strong>de</strong> la dissuasion nucléaire, non seulement personne ne peut être exclu <strong>de</strong> son usage, mais sa<br />
consommation s'impose à tous, même à ceux qui dénoncent une telle orientation<br />
stratégique. Pour s'en échapper, <strong>les</strong> pacifistes n'ont que la possibilité d'émigrer. Il est<br />
essentiel <strong>de</strong> noter que la notion d'excludabilité se rapporte toujours à un territoire ou à une<br />
communauté d'une juridiction donnée. <strong>La</strong> défense nationale <strong>de</strong> la France est un bien<br />
considéré comme non-excludable même si, bien enten<strong>du</strong>, elle ne profite pas à l'ensemble <strong>de</strong>s<br />
habitants <strong>de</strong> la planète. De façon similaire, un banc <strong>de</strong> dora<strong>de</strong>s qui se déplace d'une zone <strong>de</strong><br />
pêche à l'autre est un bien non-excludable même si seuls <strong>les</strong> pêcheurs <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux zones ont<br />
le droit <strong>de</strong> <strong>les</strong> capturer.<br />
Un problème d’incitation à pro<strong>du</strong>ire<br />
Le problème pratique que posent <strong>de</strong> tels biens est celui <strong>du</strong> manque d'incitation <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs à <strong>les</strong> pro<strong>du</strong>ire. Ils savent à l'avance qu'ils auront <strong>du</strong> mal à se faire payer. En<br />
eff<strong>et</strong>, ils n'ont aucun moyen <strong>de</strong> priver d'utilisation <strong>les</strong> agents qui ne rémunèrent pas leur<br />
service. Les consommateurs sont peu enclins à payer puisque rien ne <strong>les</strong> y oblige. <strong>La</strong><br />
CERNA 5
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
conséquence est que le marché ne pro<strong>du</strong>ira pas <strong>les</strong> biens non-excludab<strong>les</strong> en quantité<br />
suffisante. D'un point <strong>de</strong> vue normatif, il est donc pris en défaut d'inefficacité. <strong>La</strong> cause <strong>de</strong><br />
c<strong>et</strong>te défaillance <strong>du</strong> marché rési<strong>de</strong> dans le comportement <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin.<br />
Dans sa version simple, le problème <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin peut être représenté ainsi :<br />
Décision <strong>de</strong>s autres joueurs<br />
ils contribuent ils ne contribuent pas<br />
Décision il contribue 2-1=1 -1<br />
<strong>de</strong> A il ne contribue pas 2 0<br />
Un utilisateur potentiel A <strong>du</strong> bien non-excludable a le choix entre <strong>de</strong>ux stratégies :<br />
contribuer ou ne pas contribuer à la rémunération <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>cteur. Deux options sont<br />
possib<strong>les</strong> quant au reste <strong>de</strong>s joueurs : <strong>les</strong> autres utilisateurs potentiels contribuent ; <strong>les</strong> autres<br />
utilisateurs potentiels ne contribuent pas. Si le bien est pro<strong>du</strong>it, A r<strong>et</strong>ire un gain <strong>de</strong> 2 qui<br />
correspond à l'accroissement <strong>de</strong> la satisfaction <strong>de</strong> ses besoins. Disons que sa contribution<br />
s'élève à 1 s'il déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> rémunérer le pro<strong>du</strong>cteur. Si alors <strong>les</strong> autres ne contribuent pas, il subi<br />
une perte n<strong>et</strong>te <strong>de</strong> -1, <strong>et</strong> il bénéficie d'un gain n<strong>et</strong> <strong>de</strong> 1 (son accroissement d'utilité moins sa<br />
contribution) dans le cas contraire. Si en revanche, A déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> ne pas contribuer, soit il<br />
gagne 2 car <strong>les</strong> autres ont contribué <strong>et</strong> lui ne paye rien ; soit sa situation ne change pas, car il<br />
n'a enregistré ni gain ni perte supplémentaires. On voit ainsi que quelle que soit l'option<br />
suivie par <strong>les</strong> autres utilisateurs potentiels, A a toujours intérêt à ne pas contribuer car c'est<br />
la stratégie qui maximise son gain minimum. Ce raisonnement vaut bien enten<strong>du</strong> pour tous<br />
<strong>les</strong> autres utilisateurs potentiels. Personne ne contribuera, <strong>et</strong> par conséquent le bien ne sera<br />
pas pro<strong>du</strong>it. Nous sommes dans une situation qui m<strong>et</strong> en échec la main invisible puisque le<br />
comportement rationnel d'agents uniquement préoccupés <strong>de</strong> leurs intérêts ne parvient pas à<br />
un équilibre qui maximise le bien-être social. Dans la matrice <strong>du</strong> jeu <strong>de</strong> l'encadré 1, où pour<br />
simplifier on a considéré seulement <strong>de</strong>ux utilisateurs, la perte <strong>du</strong> surplus social s'élève à 8.<br />
Encadré 1 : Passager clan<strong>de</strong>stin <strong>et</strong> dilemme <strong>du</strong> prisonnier<br />
Le jeu repose sur le mécanisme suivant. Chaque joueur doit déci<strong>de</strong>r s'il contribue pour une unité <strong>de</strong><br />
bien non-excludable ou non, <strong>et</strong> ceci sans connaître la décision <strong>de</strong> l'autre participant. Chaque contribution<br />
à une unité <strong>de</strong> bien apporte un gain <strong>de</strong> 5 à chacun (qu'il soit contributeur ou non contributeur) <strong>et</strong> coûte 6.<br />
Si <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux agents contribuent alors chacun reçoit un gain <strong>de</strong> 2x5, dépense 6, <strong>et</strong> finalement perçoit un<br />
bénéfice n<strong>et</strong> <strong>de</strong> 4. Lorsqu'un seul participant contribue pour une unité <strong>de</strong> bien, il essuie une perte n<strong>et</strong>te <strong>de</strong><br />
1 (le gain <strong>de</strong> 5 soustrait <strong>de</strong> sa dépense <strong>de</strong> 6), alors que l'autre obtient un bénéfice n<strong>et</strong> <strong>de</strong> 5 puisqu'il accè<strong>de</strong><br />
à l'unité <strong>de</strong> bien collectif sans avoir rien dépensé. Si enfin, <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux participants choisissent <strong>de</strong> ne pas<br />
contribuer, leur bénéfice est nul. Le comportement <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin bloque <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux joueurs dans le<br />
cadran sud-est bien que la contribution collective au <strong>financement</strong> <strong>du</strong> bien qui mène au cadran nord-ouest<br />
soit mutuellement avantageuse. Le lecteur familier <strong>de</strong> la théorie <strong>de</strong>s jeux aura reconnu dans le tableau ci<strong>de</strong>ssous<br />
une matrice <strong>de</strong> dilemme <strong>du</strong> prisonnier où chaque joueur dans l'impossibilité <strong>de</strong> coopérer avec<br />
l'autre est incité à choisir la stratégie dominante, c'est à dire celle qui lui rapporte le plus quel que soit le<br />
choix <strong>de</strong> l'autre, ce qui con<strong>du</strong>it à une situation sous-optimale au sens <strong>de</strong> Paréto.<br />
Agent A<br />
contribue ne contribue pas<br />
Agent B contribue (4,4) (-1,5)<br />
ne contribue pas (5,-1) (0,0)<br />
CERNA 6
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
L’intervention <strong>du</strong> réglementeur<br />
En cas <strong>de</strong> bien non-excludab<strong>les</strong> la prescription <strong>de</strong> l’économie publique est i<strong>de</strong>ntique à celle<br />
déjà vue pour l’externalité <strong>et</strong> le monopole naturel : une autorité publique doit se substituer au<br />
marché pour réaliser l’allocation efficace <strong>de</strong>s ressources. Le moyen pratique recommandé<br />
pour y parvenir consiste à financer la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s biens à partir <strong>de</strong> fonds publics.<br />
C<strong>et</strong>te recommandation est parfois associée à l'idée <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction publique <strong>de</strong>s services<br />
collectifs, c'est à dire offerte par l'administration ou une entreprise contrôlée par l'Etat. Il<br />
s'agit là d'une interprétation abusive. En l'absence <strong>de</strong> toute intervention étatique, la nonexcludabilité<br />
entraine un problème d'incitation à l’offre privée. Mais dès lors que le<br />
problème <strong>de</strong> rémunération <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction est résolu par l'Etat, rien n'empêche ce <strong>de</strong>rnier<br />
<strong>de</strong> déléguer ensuite la pro<strong>du</strong>ction proprement dite. <strong>La</strong> décision <strong>de</strong> faire, ou faire faire, n'est<br />
pas liée au caractère non-excludable <strong>du</strong> bien. Le choix entre un service ministériel, un<br />
établissement public à caractère administratif ou in<strong>du</strong>striel, une concession <strong>de</strong> service public<br />
à une entreprise privée relève <strong>de</strong> considérations organisationnel<strong>les</strong> <strong>et</strong> politiques, <strong>et</strong> non d'une<br />
caractéristique intrinsèque <strong>de</strong>s services à pro<strong>du</strong>ire.<br />
Le recours à l'Etat pour le <strong>financement</strong> <strong>de</strong>s biens non-excludab<strong>les</strong> pose un problème <strong>de</strong><br />
planification. Comment déterminer la quantité optimale <strong>de</strong> bien à pro<strong>du</strong>ire ou faire<br />
pro<strong>du</strong>ire ? Outre <strong>les</strong> coûts, le planificateur a besoin <strong>de</strong> connaître <strong>les</strong> préférences <strong>de</strong>s<br />
consommateurs. Quel est leur consentement à payer pour disposer <strong>du</strong> bien ? Faisons<br />
l'hypothèse ici que le nombre d'utilisateurs est élevé <strong>et</strong> qu'il y a un seul type <strong>de</strong> bien qui peut<br />
être pro<strong>du</strong>it. <strong>La</strong> décision publique se résume alors entre pro<strong>du</strong>ire le bien ou ne pas le<br />
pro<strong>du</strong>ire. Il s'agit par exemple d'un pont pour franchir une rivière <strong>et</strong> pour lequel il n'y a qu'un<br />
coût <strong>et</strong> une capacité possib<strong>les</strong>. Le planificateur peut interroger <strong>les</strong> utilisateurs potentiels<br />
mais il va se heurter à <strong>de</strong>s manipulations stratégiques <strong>de</strong> l'information. Si chaque agent sait<br />
qu'il paiera un impôt ou une re<strong>de</strong>vance en fonction <strong>de</strong> sa réponse, il est incité à annoncer un<br />
chiffre faible, escomptant que c<strong>et</strong>te tricherie n'aura finalement pas d'eff<strong>et</strong> sur la décision <strong>de</strong><br />
construction <strong>du</strong> pont. Chacun suivant le même raisonnement, la décision <strong>de</strong> l'autorité<br />
publique pourra aboutir à ne rien faire alors que <strong>les</strong> bénéfices cachés l'emportent sur le coût.<br />
Inversement, si on garantit à l'agent que sa réponse ne sera pas utilisée pour calculer sa<br />
contribution ultérieure, il aura tendance à déclarer une somme supérieure à la vérité. Chacun<br />
suivant le même raisonnement, la décision publique pourra con<strong>du</strong>ire alors c<strong>et</strong>te fois à<br />
construire le pont alors que son coût excè<strong>de</strong> le bénéfice que la collectivité en r<strong>et</strong>irera.<br />
<strong>La</strong> littérature micro-économique a élaboré <strong>de</strong> nombreux mécanismes <strong>de</strong> révélation <strong>de</strong>s<br />
préférences <strong>de</strong>s agents auxquels le planificateur peut faire appel dans ses décisions en matière<br />
<strong>de</strong> bien collectif. <strong>La</strong> plus connue est le schéma d'incitation <strong>de</strong> Clarke-Groves. Son principe<br />
CERNA 7
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
général est qu'il fait <strong>de</strong> la déclaration honnête <strong>de</strong>s préférences une stratégie dominante pour<br />
tous <strong>les</strong> agents (cf. encadré 2).<br />
Encadré 2 : Enchère <strong>de</strong> Vickrey <strong>et</strong> mécanisme <strong>de</strong> révélation <strong>de</strong> Clarke-Groves [d'après Campbell,<br />
1995]<br />
Le mécanisme <strong>de</strong> révélation <strong>de</strong>s préférences pour un bien collectif imaginé par Clarke [1971] <strong>et</strong> Groves<br />
[1973] repose sur l'idée <strong>de</strong> faire payer à chaque agent une taxe qui correspond à la différence d'utilité que<br />
r<strong>et</strong>ire la collectivité <strong>du</strong> bien (non compris l'utilité <strong>de</strong> A) quand il est financé avec la participation <strong>de</strong> A <strong>et</strong><br />
quand il est financé sans la participation <strong>de</strong> A. Un exemple numérique est donné plus bas dans le cas <strong>de</strong><br />
trois participants. Pour comprendre ce principe général, il est utile <strong>de</strong> rappeler le mécanisme d'enchère <strong>de</strong><br />
Vickrey, dont le schéma <strong>de</strong> Clarke-Groves s'inspire.<br />
Une peinture ancienne est mis aux enchères par un commissaire-priseur soucieux d'encourager chaque<br />
acquéreur potentiel à déclarer honnêtement sa préférence. Il souhaite qu'il soit attribué à celui qui en<br />
r<strong>et</strong>irera la plus gran<strong>de</strong> satisfaction sans toutefois que ce <strong>de</strong>rnier l'obtienne à un prix bradé, c'est à dire en<br />
<strong>de</strong>çà <strong>de</strong> la valeur que l'amateur lui accor<strong>de</strong>. <strong>La</strong> solution consiste à organiser <strong>de</strong>s enchères sous pli cach<strong>et</strong>é<br />
<strong>et</strong> à attribuer l'obj<strong>et</strong> convoité au plus offrant mais à un prix correspondant à l'offre <strong>de</strong> second rang. C<strong>et</strong>te<br />
règle incite chaque participant à déclarer strictement sa préférence. Voyons pourquoi à travers un exemple.<br />
Imaginons qu'il y a plusieurs acquéreurs potentiels dont A qui est prêt à débourser au plus 50 MF pour<br />
obtenir l'obj<strong>et</strong> ; en d'autres termes sa préférence est <strong>de</strong> 50. S'il déclare une somme supérieure, disons 75,<br />
<strong>et</strong> que l'offre immédiatement inférieure d'un autre participant est <strong>de</strong> 70, A emporte l'obj<strong>et</strong> mais subi une<br />
perte n<strong>et</strong>te <strong>de</strong> 20 puisqu'il a payé un obj<strong>et</strong> 70 MF qui ne lui rapporte qu'un gain <strong>de</strong> 50 MF. Surévaluer sa<br />
préférence est donc une stratégie qui peut se sol<strong>de</strong>r par une perte. C'est aussi une stratégie qui ne procure<br />
jamais d'avantage. A ne r<strong>et</strong>ire un bénéfice n<strong>et</strong> que s'il paie moins <strong>de</strong> 50 MF, ce qui implique que toutes<br />
<strong>les</strong> autres offres sont inférieures. Dans ce cas, A l'aurait aussi emporté en faisant une offre juste égale à sa<br />
préférence. Gonfler son offre ne change donc rien. Examinons maintenant le cas où A déclare une offre<br />
inférieure à son consentement à payer. S'il déclare par exemple 30 MF alors que l'offre la plus élevée est<br />
<strong>de</strong> 40 MF, il subi un manque à gagner <strong>de</strong> 10. En eff<strong>et</strong>, il aurait obtenu l'obj<strong>et</strong> pour 40 MF en déclarant sa<br />
véritable préférence <strong>de</strong> 50, alors qu'en déclarant 30 il n'obtient pas l'obj<strong>et</strong> <strong>et</strong> son utilité ne varie donc pas.<br />
C<strong>et</strong>te stratégie ne procure également jamais d'avantage. Si A l'emporte en sous-évaluant sa préférence, il<br />
l'aurait aussi emporté en déclarant honnêtement sa préférence. Déclarer la vérité est donc ici une stratégie<br />
dominante.<br />
En outre, c<strong>et</strong>te règle d'enchère satisfait l'intérêt général. Comme il s'agit d'une peinture ancienne, on<br />
n'a pas à se préoccuper ici <strong>de</strong> son coût <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction. En revanche, il faut tenir compte d'un coût<br />
d'opportunité pour la collectivité. En attribuant la peinture à un participant, le commissaire-priseur prive<br />
<strong>les</strong> autres acquéreurs intéressés <strong>de</strong> leur satisfaction à consommer le bien. Si la peinture est attribuée au<br />
plus offrant, le coût d'opportunité pour la collectivité est égale à l'offre <strong>de</strong> second rang, c'est à dire la<br />
<strong>de</strong>uxième préférence la plus élevée (<strong>et</strong> non à la somme <strong>de</strong>s préférences, car dans tous <strong>les</strong> cas <strong>de</strong> figure, la<br />
peinture étant unique elle ne peut être attribuée qu'à un seul amateur). C'est le cas qui correspond à<br />
l'arrangement alternatif qui maximise l'utilité. Si la peinture est attribuée à un autre acquéreur, le coût<br />
d'opportunité pour la collectivité s'élève c<strong>et</strong>te fois, au prix <strong>de</strong> r<strong>et</strong>rait <strong>du</strong> plus offrant. Ce <strong>de</strong>rnier<br />
arrangement est inefficace car il ne minimise pas le coût collectif.<br />
En résumé, dans le système d'enchère <strong>de</strong> Vickrey, l'agent paye une re<strong>de</strong>vance qui est égale au coût que<br />
sa participation impose au reste <strong>du</strong> groupe (dans le cas considéré plus haut, c<strong>et</strong>te re<strong>de</strong>vance est égale à la<br />
préférence <strong>du</strong> second offreur, si l'agent emporte le bien <strong>et</strong> est égale à 0 si l'agent n'obtient pas le bien).<br />
C'est le même principe que suit le mécanisme <strong>de</strong> Clarke and Groves dans le cas <strong>de</strong>s biens collectifs.<br />
Voyons ce mécanisme à travers un exemple numérique, car le modèle général est très technique. Dans<br />
la matrice ci-<strong>de</strong>ssous, on a considéré trois agents A, B, C <strong>et</strong> <strong>de</strong>ux proj<strong>et</strong>s publics I <strong>et</strong> II, par exemple un<br />
chemin goudronné ou en terre qui réuni <strong>les</strong> propriétés <strong>de</strong>s agents.<br />
A B C<br />
Proj<strong>et</strong> I route en terre 10 19 30<br />
Proj<strong>et</strong> II route goudronnée 15 10 40<br />
Re<strong>de</strong>vance additionnelle 0 0 4<br />
Les <strong>de</strong>ux premières lignes indiquent <strong>les</strong> préférences <strong>de</strong> chaque agent pour <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux biens. Si chaque<br />
propriétaire déclare honnêtement sa préférence, la route goudronnée sera choisie car elle génère un<br />
accroissement <strong>de</strong> bien-être total <strong>de</strong> 65 au lieu <strong>de</strong> 59. <strong>La</strong> troisième ligne indique la re<strong>de</strong>vance exigée. Bien<br />
que A préfère la route goudronnée, il ne paie pas <strong>de</strong> charge car même sans sa participation, c<strong>et</strong>te option<br />
l'emporte. L’accroissement <strong>de</strong> bien être est supérieur <strong>de</strong> (10+40) - (19+30), soit 1, en faveur <strong>de</strong> la route<br />
goudronnée. B ne paye pas non plus <strong>de</strong> re<strong>de</strong>vance car ce n'est pas le proj<strong>et</strong> qu'il préfère qui est choisi. C<br />
CERNA 8
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
paye, en revanche une charge <strong>de</strong> 4, car sans sa participation l'accroissement <strong>de</strong> bien-être pour la<br />
collectivité constituée <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux autres participants est <strong>de</strong> 29 pour le proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> route en terre contre 25 pour<br />
la route goudronnée. Il est facile au lecteur <strong>de</strong> vérifier qu'aucun <strong>de</strong>s trois propriétaires n'a intérêt à déclarer<br />
une préférence différente <strong>de</strong> la sienne. Par exemple, A n'a pas intérêt à mentir puisque l'option choisie est<br />
celle qu'il préfère <strong>et</strong> ne lui coûte pas <strong>de</strong> taxe additionnelle.<br />
<strong>La</strong> dissimulation <strong>de</strong>s préférences pour <strong>les</strong> biens collectifs se rattache au problème plus<br />
général <strong>de</strong> l’asymétrie d'information entre réglementeur <strong>et</strong> réglementé ; <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res<br />
perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> la corriger font partie <strong>de</strong>s mécanismes d'incitation à révéler l'information<br />
cachée. Si le planificateur ne connaît pas <strong>les</strong> préférences <strong>de</strong>s agents, son intervention pour<br />
financer <strong>les</strong> biens collectifs ne peut atteindre qu'un optimum <strong>de</strong> second rang. Il est obligé <strong>de</strong><br />
laisser à l'agent supérieurement informé une rente d'information.<br />
1.2. L’inefficacité <strong>du</strong> marché en présence <strong>de</strong> biens non-rivaux<br />
<strong>La</strong> non-rivalité est la propriété qu'un bien puisse être consommé simultanément par<br />
plusieurs personnes sans que la quantité consommée par l'une diminue <strong>les</strong> quantités<br />
disponib<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> autres. Les biens déjà cités <strong>du</strong> phare, <strong>de</strong> la défense nationale, ou <strong>du</strong><br />
programme <strong>de</strong> télévision remplissent c<strong>et</strong>te propriété. En regardant une émission sur tel<br />
canal, je ne prive pas un autre téléspectateur <strong>de</strong> la consommation <strong>du</strong> même programme. Ce<br />
n'est pas en revanche, le cas <strong>du</strong> banc <strong>de</strong> poisson déjà cité aussi au titre <strong>de</strong>s biens nonexcludab<strong>les</strong>.<br />
<strong>La</strong> capture <strong>de</strong>s dora<strong>de</strong>s ne bénéficie qu'à celui qui la réussi ; c'est autant <strong>de</strong><br />
poissons qu'un autre chalutier ne pourra attraper. <strong>La</strong> non-rivalité peut se décliner <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
autres manières en disant que chaque utilisateur consomme la même unité <strong>de</strong> bien, ou en<br />
disant qu'un consommateur additionnel <strong>du</strong> bien n’entraîne pas <strong>de</strong> nuisances <strong>de</strong> congestion.<br />
Quelle que soit la formulation r<strong>et</strong>enue, la conséquence <strong>de</strong> la non-rivalité en termes<br />
économiques est la même : le coût marginal pour servir un utilisateur supplémentaire est nul.<br />
C'est c<strong>et</strong>te propriété économique qui est à l'origine d'une autre défaillance <strong>du</strong> marché en<br />
présence d'un bien collectif : le rationnement sous-optimal. Elle est illustrée par le cas <strong>du</strong><br />
péage d'un pont représenté par la figure 1.<br />
CERNA 9
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Montant <strong>du</strong> péage<br />
Figure 1<br />
P<br />
Capacité<br />
<strong>du</strong> pont<br />
R<br />
m<br />
p<br />
A<br />
0 q° q∗ T<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
passagers<br />
<strong>La</strong> courbe Rm est la fonction <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour la traversée <strong>du</strong> pont au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la rivière qui<br />
perm<strong>et</strong> par exemple d'éviter un long détour. Elle indique l'utilité <strong>de</strong> ce bien pour ses<br />
utilisateurs potentiels <strong>et</strong> <strong>les</strong> sommes qu'ils sont disposés à payer en conséquence. Rm est<br />
égale à la rec<strong>et</strong>te moyenne <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>cteur. On suppose que le coût marginal pour servir un<br />
passager supplémentaire est nul : <strong>les</strong> travaux d’entr<strong>et</strong>ien ne varient pas avec le nombre<br />
d'utilisateurs <strong>et</strong> la capacité <strong>de</strong> l’ouvrage d'art est supérieure au nombre <strong>de</strong> clients potentiels<br />
(T>q*). Supposons que le péage que doit fixer un entrepreneur pour juste couvrir ses coûts<br />
d'investissements <strong>et</strong> <strong>de</strong> maintenance soit égal au montant p. Le nombre <strong>de</strong> traversées est<br />
alors <strong>de</strong> q° ; <strong>les</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>cteur s'élèvent à l'aire Oq°Ap ; puisque son surplus est nul, le<br />
surplus social se ré<strong>du</strong>it au surplus consommateur, soit l'aire pAP. Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l'intérêt<br />
général, c<strong>et</strong>te situation est sous-optimale car le surplus est inférieur au surplus dégagé en<br />
l'absence <strong>de</strong> péage. En eff<strong>et</strong>, en l'absence <strong>de</strong> péage, le surplus est plus grand <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong><br />
l'aire <strong>du</strong> triangle q°q*A. Décomposons-le pour le vérifier. Le surplus pro<strong>du</strong>cteur est négatif<br />
(moins l'aire Oq°Ap) puisqu'aucune rec<strong>et</strong>te <strong>de</strong> péage n'est perçue. Le surplus consommateur<br />
est quant à lui égal à la totalité <strong>de</strong> la surface <strong>du</strong> triangle Oq*P. Le surplus total vaut donc<br />
Oq*P moins Oq°Ap. Ainsi si le déficit <strong>de</strong> l'entrepreneur n'est pas financé par <strong>de</strong>s ressources<br />
publiques, le pont sera sous-utilisé <strong>et</strong> entraînera une ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> bien-être.<br />
<strong>La</strong> propriété <strong>de</strong> non-rivalité con<strong>du</strong>it ainsi à une tarification <strong>de</strong> la fourniture privée <strong>de</strong>s biens<br />
qui entraîne un rationnement sous-optimal <strong>de</strong>s consommateurs. <strong>La</strong> recommandation<br />
normative est qu'il revient à la puissance publique <strong>de</strong> financer <strong>les</strong> biens non-rivaux à partir le<br />
l'impôt. C<strong>et</strong>te rec<strong>et</strong>te sera affectée à l'administration qui pro<strong>du</strong>ira le service, ou à une<br />
entreprise privée à qui sera confiée la pro<strong>du</strong>ction <strong>et</strong> la gestion <strong>du</strong> bien. Le lecteur aura<br />
remarqué que le problème <strong>de</strong> la non-rivalité, <strong>de</strong> même que sa solution est très similaire à<br />
celui posé par le monopole naturel. <strong>La</strong> différence est que pour ce <strong>de</strong>rnier le coût marginal est<br />
CERNA 10
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
non nul.<br />
1.3. Les différents types <strong>de</strong> biens<br />
Les propriétés <strong>de</strong> non-excludabilité <strong>et</strong> <strong>de</strong> non-rivalité, dont nous venons <strong>de</strong> voir qu’el<strong>les</strong><br />
soulèvent chacune un problème d’inefficacité différent, sont indépendantes. Il existe en<br />
eff<strong>et</strong> <strong>de</strong>s biens non-excludab<strong>les</strong> mais rivaux <strong>et</strong> <strong>de</strong>s biens excludab<strong>les</strong> mais non-rivaux. C'est<br />
ainsi qu'un banc <strong>de</strong> poisson est une ressource qui ne bénéficie qu'à celui qui la capture mais<br />
avant sa pêche aucun chalutier qui navigue dans <strong>les</strong> parages ne peut-être exclu <strong>de</strong> tenter sa<br />
chance. A l'inverse, un programme crypté <strong>de</strong> télévision ne peut-être regardé que par <strong>les</strong><br />
ménages disposant d'un déco<strong>de</strong>ur mais la consommation indivi<strong>du</strong>elle d'un abonné n'empêche<br />
pas celle d'un autre abonné.<br />
Les différentes combinaisons <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux propriétés font donc apparaitre quatre catégories <strong>de</strong><br />
biens.<br />
Non-rival<br />
Rival<br />
Les biens collectifs<br />
Non-excludable<br />
Biens collectifs<br />
(ex. phare, défense<br />
nationale)<br />
Biens en commun<br />
(ex. banc <strong>de</strong> poissons)<br />
Excludable<br />
Biens <strong>de</strong> club<br />
(ex. programme <strong>de</strong><br />
télévision crypté)<br />
Biens privés<br />
(ex. pomme, paire <strong>de</strong><br />
chaussures)<br />
Le cadran supérieur gauche <strong>du</strong> tableau regroupe <strong>les</strong> biens collectifs définis par Samuelson<br />
[1954] par opposition aux biens privés. Ces <strong>de</strong>rniers sont consommés par un indivi<strong>du</strong> <strong>et</strong> un<br />
seul, tandis que <strong>les</strong> biens collectifs sont accessib<strong>les</strong> à l’ensemble <strong>de</strong> la communauté, chacun<br />
disposant <strong>de</strong> la même quantité. <strong>La</strong> fonction d’utilité <strong>de</strong>s agents prend une nouvelle<br />
expression qui comprend à la fois <strong>de</strong>s biens privés <strong>et</strong> <strong>de</strong>s biens collectifs (cf. tableau 1).<br />
CERNA 11
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Tableau 1<br />
(1)Fonction traditionnelle d' utilité d' un indivi<strong>du</strong> i pour <strong>de</strong>s biens x<br />
U 1 = U 1 (X 1<br />
i , X2<br />
i , ..., X n<br />
i )<br />
avec la quantité <strong>de</strong> biens X j = Σ S X j<br />
i i = 1<br />
(2) Fonction d' utilité <strong>de</strong> Samuelson<br />
U i = U i i i<br />
(X i i i<br />
1, X 2,..., X n,X n+1 ,...,X n+m )<br />
i<br />
avec la quantité <strong>de</strong> bien collectif Xn+j = X n+ j<br />
(3) Fonction d' utilité <strong>de</strong> Buchanan<br />
[ ]<br />
U i = U i i i i i i<br />
(X 1 , N1 ), (X 2 , N2 ),...,(X n+m ,Nn+m<br />
i )<br />
où Nj est le nombre <strong>de</strong> personnes qui utilise conjointement le bien Xj<br />
<strong>La</strong> recommandation <strong>de</strong> l’économie publique est <strong>de</strong> financer la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s biens collectifs<br />
à partir <strong>de</strong> fonds publics. Remarquons que c<strong>et</strong>te prescription est justifiée par <strong>de</strong>ux fois<br />
puisqu’elle découle <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux propriétés prises isolément qui caractérisent <strong>les</strong> biens<br />
collectifs : l’intervention publique est requise au titre <strong>du</strong> caractère <strong>de</strong> non-excludabilité <strong>et</strong><br />
également au titre <strong>du</strong> caractère <strong>de</strong> non-rivalité.<br />
Les biens <strong>de</strong> club<br />
Les biens excludab<strong>les</strong> non-rivaux (ex. une chaine <strong>de</strong> télévision à abonnement, un club <strong>de</strong><br />
tennis, une piscine, un réseau <strong>de</strong> communication d’information, un parking <strong>de</strong> marché, <strong>et</strong>c.)<br />
sont qualifiés <strong>de</strong> biens <strong>de</strong> club. Chez Samuelson c<strong>et</strong>te catégorie ne fait pas l’obj<strong>et</strong> d’un<br />
traitement analytique particulier. Car il la regroupe en fait avec <strong>les</strong> biens collectifs.<br />
Samuelson recomman<strong>de</strong> en eff<strong>et</strong> que <strong>les</strong> biens non-rivaux soient gratuitement mis à<br />
disposition <strong>de</strong> tous leurs utilisateurs potentiels. S’il existe un dispositif perm<strong>et</strong>tant d’assurer<br />
l’excludabilité <strong>du</strong> bien (ex. une barrière à l’entrée d’un pont ou d’une route), il ne doit pas<br />
être utilisé. En d’autres termes, Samuelson propose <strong>de</strong> rendre non-excludab<strong>les</strong> tous <strong>les</strong> biens<br />
non rivaux.<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> bien <strong>de</strong> club a été formalisée par Buchanan [1967]. C<strong>et</strong> économiste <strong>de</strong> l’Ecole<br />
<strong>du</strong> choix public intro<strong>du</strong>it le nombre <strong>de</strong> membres <strong>de</strong>s communautés d'intérêt comme variable<br />
clef <strong>de</strong>s biens consommés. Il formule une fonction d'utilité qui attache à chaque bien le<br />
nombre d'indivi<strong>du</strong>s qui en partagent la consommation. Apparait ainsi toute une catégorie <strong>de</strong><br />
biens intermédiaires entre <strong>les</strong> biens privés <strong>de</strong> consommation indivi<strong>du</strong>elle <strong>et</strong> <strong>les</strong> biens<br />
collectifs utilisés en commun par la totalité <strong>de</strong> la population.<br />
Le problème soulevé par ce type <strong>de</strong> biens est celui <strong>de</strong> la taille optimale <strong>du</strong> club. Il s’agit <strong>de</strong><br />
déterminer à la fois le nombre d’adhérents <strong>et</strong> la taille <strong>de</strong>s équipements qu’ils veulent utiliser.<br />
CERNA 12
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
D’un côté, il est souhaitable que l’effectif <strong>du</strong> club soit le plus élevé possible. Le coût<br />
indivi<strong>du</strong>el <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>et</strong> d'entr<strong>et</strong>ien <strong>du</strong> bien (y compris le coût <strong>du</strong> dispositif d’exclusion qui<br />
perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> réserver le bien aux membres) diminue avec la taille <strong>du</strong> club quand un plus grand<br />
nombre <strong>de</strong> membres participent aux dépenses. Ceci pousse à accepter <strong>de</strong> nouveaux membres.<br />
D’un autre côté, le phénomène <strong>de</strong> congestion qui s'amplifie avec la taille contrarie<br />
l’expansion <strong>du</strong> club. L'arrivée <strong>de</strong> nouveaux membres perm<strong>et</strong>tra <strong>de</strong> baisser la cotisation<br />
annuelle d'une association <strong>de</strong> tennis mais va diminuer le bénéfice que chacun r<strong>et</strong>ire <strong>de</strong>s<br />
installations car il sera plus difficile d'obtenir un court. Comme l'indique la figure 2, pour un<br />
niveau d'output donné (ex. : une piscine olympique), il y a un effectif optimal <strong>du</strong> club.<br />
Inversement, pour un nombre <strong>de</strong> membres donné, il y une quantité optimale <strong>du</strong> bien à<br />
pro<strong>du</strong>ire (ex. la construction <strong>de</strong> 8 courts <strong>de</strong> tennis). C<strong>et</strong>te secon<strong>de</strong> relation est illustrée par la<br />
figure 3. Pour le cas où le club n'a qu'un seul membre, il peut très bien se faire que la quantité<br />
optimale soit nulle ; ceci est illustré par <strong>les</strong> courbes C1 <strong>et</strong> B1 où le coût total par personne<br />
croît plus vite que le bénéfice total. Pour un seul adhérent, il est inutile <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong><br />
plusieurs courts <strong>de</strong> tennis, ou même d'un seul... Comme l'objectif <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction dépend <strong>du</strong><br />
nombre <strong>de</strong> membres <strong>et</strong> réciproquement, la particularité <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> club est qu'il est<br />
nécessaire <strong>de</strong> déterminer simultanément l'effectif <strong>et</strong> la quantité optimale. <strong>La</strong> taille optimale<br />
<strong>du</strong> club correspond au nombre optimal <strong>de</strong> membres pour une capacité optimale <strong>du</strong> bien<br />
pro<strong>du</strong>it (cf. figure 4).<br />
Figure 2 : Effectif optimal pour une quantité <strong>de</strong> biens fixée<br />
(ex. : une piscine <strong>de</strong> taille olympique)<br />
Y1<br />
E1<br />
Bh<br />
Ch<br />
0<br />
N=1 S1 Sh<br />
B1<br />
C1<br />
Personnes<br />
CERNA 13
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Figure 3 : Quantité <strong>de</strong> bien optimale pour différents effectifs<br />
(ex. : taille <strong>de</strong> la piscine à construire)<br />
C1<br />
N=1<br />
N=1<br />
B1<br />
N=k<br />
Bk<br />
Ck<br />
N=k<br />
0<br />
Qk<br />
Quantité <strong>de</strong> biens<br />
Figure 4 : Taille optimale <strong>du</strong> club<br />
Effectif optimal<br />
Quantité optimale<br />
Quantité <strong>de</strong> biens<br />
0<br />
Nombre <strong>de</strong> personnes<br />
Dans le cas <strong>de</strong>s biens collectifs, seule la question <strong>de</strong> la quantité optimale s’était posé puisque<br />
l'effectif est fixe ; c'est le total <strong>de</strong> la population. Une autre différence entre <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong><br />
bien est que le bien <strong>de</strong> club correspond à une adhésion volontaire [Cornes <strong>et</strong> Sandler, 1986].<br />
Les indivi<strong>du</strong>s ne contribuent au <strong>financement</strong> <strong>du</strong> bien <strong>de</strong> club que s'ils en r<strong>et</strong>irent un bénéfice<br />
n<strong>et</strong>. Dans le cas <strong>du</strong> bien collectif, la participation n'a pas forcément un caractère volontaire<br />
car le bien peut nuire à certains. C'est l'exemple <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> défense nationale pour<br />
un pacifiste, ou <strong>de</strong> l'eau <strong>du</strong> robin<strong>et</strong> fluorée pour ceux qui s'opposent à l'emploi <strong>de</strong> c<strong>et</strong> additif.<br />
CERNA 14
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Les biens en commun<br />
<strong>La</strong> propriété <strong>de</strong> rivalité associée à celle <strong>de</strong> non-excludabilité défini <strong>les</strong> biens en commun. Le<br />
problème posé est celui <strong>de</strong> gérer <strong>de</strong>s dotations communes en évitant <strong>les</strong> eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> congestion.<br />
Ici, <strong>les</strong> biens sont déjà pro<strong>du</strong>its <strong>et</strong> le comportement <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin entraine leur surconsommation.<br />
Appliqué aux ressources naturel<strong>les</strong> le problème est connu sous le nom <strong>de</strong><br />
tragédie <strong>de</strong>s communaux [Hardin, 1968]. Il stipule qu’en l’absence d’une privatisation<br />
aboutissant à la propriété indivi<strong>du</strong>elle ou d’une intervention publique contraignant <strong>les</strong><br />
conditions d’usage collectif <strong>de</strong> la ressource, le bien en commun est nécessairement appelé à<br />
être sur-exploité. Par exemple s’il n’y a pas <strong>de</strong> quota, le comportement indivi<strong>du</strong>el <strong>de</strong>s<br />
pêcheurs <strong>les</strong> con<strong>du</strong>it à épuiser <strong>les</strong> ressources halieutiques. Lorsqu'un pêcheur capture <strong>de</strong>s<br />
jeunes en âge <strong>de</strong> se repro<strong>du</strong>ire, il contribue à ré<strong>du</strong>ire le stock <strong>de</strong> poissons futur ; c<strong>et</strong>te action<br />
pénalise l'ensemble <strong>de</strong>s pêcheurs, y compris son auteur. Mais à la différence <strong>de</strong>s autres<br />
pêcheurs, celui qui agit ainsi voit sa nuisance compensée par un gain qu’il est le seul à<br />
s’approprier, une prise supplémentaire ; sa situation n<strong>et</strong>te peut ainsi s'améliorer. Chaque<br />
pêcheur est tenté <strong>de</strong> suivre ce comportement <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin, ce qui aboutit à<br />
l’épuisement <strong>de</strong> la ressource naturelle.<br />
L’exemple <strong>de</strong> la pêche montre que le problème <strong>de</strong>s biens non-excludab<strong>les</strong> rivaux peut être<br />
formulé en terme d’externalité publique <strong>et</strong> réciproque : publique puisque le comportement <strong>du</strong><br />
pêcheur entraine une nuisance qui est la même pour tous ; réciproque parce qu’il est à la fois<br />
la source <strong>et</strong> l’un <strong>de</strong>s récepteurs <strong>de</strong> l’eff<strong>et</strong> externe.<br />
On aurait pu illustrer aussi c<strong>et</strong>te équivalence entre bien commun <strong>et</strong> externalité publique<br />
réciproque en prenant l’exemple <strong>de</strong>s embouteillages sur une route. En rejoignant une voie <strong>de</strong><br />
circulation à gran<strong>de</strong> vitesse mais où le trafic est <strong>de</strong>nse, l’automobiliste contribue à ralentir le<br />
flot <strong>de</strong> véhicu<strong>les</strong>. Mais la congestion additionnelle qu’il occasionne - mais aussi qu’il subi -<br />
est négligeable en comparaison <strong>de</strong> son gain (éviter d’emprunter une p<strong>et</strong>ite route où la<br />
vitesse <strong>de</strong> circulation est limitée). Pour la même raison, <strong>les</strong> autres automobilistes entrent<br />
également sur l’autoroute qui <strong>de</strong>vient alors complètement embouteillée.<br />
Biens partiellement excludab<strong>les</strong> <strong>et</strong> partiellement rivaux<br />
Dans la classification <strong>de</strong>s biens en quatre types nous avons considéré que la non-excludabilité<br />
<strong>et</strong> la non-rivalité étaient <strong>de</strong>s fonctions discrètes prenant la valeur 0 ou 1 selon la nature<br />
intrinsèque <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>et</strong> <strong>de</strong>s services concernés.<br />
Pourtant l’excludabilité varie gra<strong>du</strong>ellement selon l'état <strong>de</strong> la technique <strong>et</strong> <strong>du</strong> droit. Un<br />
programme <strong>de</strong> télévision est non-excludable seulement si <strong>les</strong> brouilleurs <strong>et</strong> déco<strong>de</strong>urs <strong>du</strong><br />
signal n'ont pas été mis au point. Les coins à champignon <strong>de</strong> la forêt communale ne sont<br />
CERNA 15
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
pas excludab<strong>les</strong> tant que la municipalité n'a pas pris un arrêt (<strong>et</strong> su le faire respecter)<br />
interdisant le ramassage <strong>de</strong>s cèpes <strong>et</strong> girol<strong>les</strong> aux touristes <strong>de</strong> passage. Il ne s'agit plus <strong>de</strong><br />
savoir si l'accès d'un bien peut-être limité par un dispositif physique ou juridique mais quel est<br />
le coût <strong>de</strong> mise au point <strong>et</strong> <strong>de</strong> mise en oeuvre d'un tel dispositif. Les biens peuvent alors se<br />
ranger selon un coût d'excludabilité qui prend différentes valeurs, <strong>et</strong> non être classés dans <strong>les</strong><br />
<strong>de</strong>ux uniques catégories <strong>de</strong>s biens purement excludab<strong>les</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong>s biens purement nonexcludab<strong>les</strong>.<br />
De même la rivalité est gra<strong>du</strong>elle en fonction <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>s techniques <strong>et</strong> <strong>du</strong> nombre<br />
d’utilisateurs. Plutôt que d’envisager seulement <strong>de</strong>ux situations contrastées celle <strong>de</strong> la<br />
congestion <strong>et</strong> celle <strong>de</strong> la non-congestion, on peut mesurer le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> rivalité d’un bien par<br />
le coût total marginal <strong>de</strong> congestion, c’est à dire la somme <strong>de</strong>s pertes d’utilité <strong>de</strong>s membres<br />
<strong>du</strong> club liée à l’entrée d’un nouveau venu.<br />
Relativiser ainsi <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux propriétés <strong>de</strong>s biens collectifs perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> gagner en réalisme. Mais<br />
cela ne doit pas aboutir à rem<strong>et</strong>tre en cause la classification <strong>de</strong>s biens obtenue en combinant<br />
<strong>les</strong> <strong>de</strong>ux propriétés. Les trois catégories <strong>de</strong> biens autres que <strong>les</strong> biens privés auquels l’analyse<br />
économique à l’habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> se référer correspon<strong>de</strong>nt en eff<strong>et</strong> chacune à un type particulier<br />
<strong>de</strong> problème pratique d’action collective. Les biens collectifs soulèvent la question <strong>de</strong> la<br />
pro<strong>du</strong>ction économique <strong>de</strong> services publics comme la défense nationale, la sécurité intérieure<br />
ou l’administration <strong>de</strong> la justice. Les biens <strong>de</strong> club correspon<strong>de</strong>nt au problème <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s<br />
associations regroupant <strong>de</strong>s usagers se partageant le même bien ou service, à l’exemple bien<br />
sûr <strong>de</strong>s clubs sportifs <strong>et</strong> <strong>de</strong> loisir, mais aussi <strong>de</strong>s services communs d’immeub<strong>les</strong>, <strong>de</strong>s groupes<br />
d’intérêts professionnels, <strong>de</strong>s syndicats, <strong>et</strong>c. Enfin, <strong>les</strong> biens en commun posent le problème<br />
<strong>de</strong>s mesures collectives à prendre pour éviter <strong>les</strong> méfaits <strong>de</strong> la congestion que ce soit sous la<br />
forme <strong>de</strong> la sur-exploitation d’une pro<strong>du</strong>ction naturelle comme l’eau <strong>de</strong>s nappes aquifères ou<br />
la sur-consommation d’une pro<strong>du</strong>ction humaine comme <strong>les</strong> infrastructures <strong>de</strong> transport, ou<br />
<strong>les</strong> espaces verts urbains.<br />
1.4. L’offre privée <strong>de</strong> biens collectifs<br />
Jusqu'ici, le lecteur aura sans doute été convaincu par l'argumentation théorique <strong>de</strong><br />
l’économie publique justifiant l'intervention <strong>de</strong> l'Etat pour financer <strong>et</strong> offrir la gratuité<br />
d’accès <strong>de</strong>s biens collectifs ; plus encore sans doute que par l'argumentation avancée pour <strong>les</strong><br />
cas d'externalité <strong>et</strong> <strong>de</strong> monopole naturel puisqu'il y a ici non une raison d’échec <strong>du</strong> marché<br />
mais <strong>de</strong>ux : le problème <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin <strong>et</strong> le rationnement sous-optimal. D'autre<br />
part, <strong>les</strong> exemp<strong>les</strong> cités semblent aller <strong>de</strong> soi. Le phare en particulier est une illustration très<br />
convaincante ; c'est pourquoi elle est si abondamment citée <strong>de</strong>puis John Stuart Mill. Il s'agit<br />
pourtant d'un pur exemple académique. Il faut attendre l'année 1974 pour disposer d'une<br />
CERNA 16
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
première étu<strong>de</strong> économique empirique, l'analyse historique <strong>de</strong> R. Coase sur l'évolution <strong>du</strong><br />
système britannique <strong>de</strong>s phares <strong>et</strong> balises qui montre que dès le milieu <strong>du</strong> dix-septième siècle :<br />
« Contrairement à la croyance <strong>de</strong> nombreux économistes, le service <strong>de</strong>s phares est fourni<br />
par l'entreprise privée (...) Les phares ont été construits, gérés, financés, possédés par <strong>de</strong>s<br />
personnes privées (...) Le rôle <strong>du</strong> gouvernement était limité à l'établissement <strong>et</strong> l'application<br />
<strong>du</strong> droit <strong>de</strong> propriété sur <strong>les</strong> phares. » Comment prétendre alors que le phare est le type<br />
même <strong>de</strong> bien qui ne peut être fourni qu'à l’initiative <strong>de</strong> l'action publique ? Où est l'erreur <strong>du</strong><br />
raisonnement théorique exposé précé<strong>de</strong>mment sur <strong>les</strong> défauts <strong>du</strong> marché en présence <strong>de</strong><br />
biens collectifs ?<br />
L’offre privée optimale <strong>de</strong> biens non-rivaux<br />
Réexaminons l’hypothèse <strong>de</strong> la nécessité d’une intervention publique pour assurer l’accès<br />
gratuit <strong>de</strong>s biens non-rivaux. Ne peut-on pas envisager d’autres solutions que le <strong>financement</strong><br />
public qui seraient capab<strong>les</strong> <strong>de</strong> parvenir à un équilibre <strong>de</strong> Paréto ?<br />
Montrons tout d’abord que l’argument théorique <strong>de</strong> l'inefficacité <strong>du</strong> marché en présence <strong>de</strong><br />
biens non-rivaux n'est pas fondé dans un mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> transaction nuls. On peut en<br />
eff<strong>et</strong> appliquer le théorème <strong>de</strong> Coase <strong>et</strong> concevoir une négociation entre <strong>les</strong> parties<br />
intéressées qui con<strong>du</strong>it à maximiser le bien-être collectif. C<strong>et</strong>te solution est appliquée au cas<br />
<strong>du</strong> pont dans l'encadré 3.<br />
Une autre solution d’offre privée efficace, proposée par Dems<strong>et</strong>z [1970], consiste à<br />
discriminer <strong>les</strong> tarifs selon <strong>les</strong> consentements à payer <strong>de</strong>s utilisateurs. Les coûts<br />
d’élaboration <strong>et</strong> <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong> la discrimination sont supposés nuls. Un fournisseur <strong>de</strong><br />
bien non-rival est donc capable sans que cela occasionne <strong>de</strong> dépenses : (i) <strong>de</strong> proposer à<br />
chaque utilisateur un contrat indivi<strong>du</strong>el qui <strong>les</strong> engage à souscrire une re<strong>de</strong>vance égale à leur<br />
consentement à payer, (ii) <strong>de</strong> faire respecter ces contrats. Rappelons qu’une telle<br />
discrimination est efficace en reprenant l’exemple <strong>du</strong> pont. Si l’entreprise <strong>de</strong> travaux publics<br />
est en mesure <strong>de</strong> fixer pour chaque passager un péage égal à sa disposition à payer, le<br />
passager marginal (c'est à dire celui qui a le plus faible consentement à payer) est servi, sans<br />
que cela ne détériore la situation <strong>de</strong>s autres passagers. On abouti bien à un optimum <strong>de</strong><br />
Paréto. En maximisant son profit, l'entreprise maximise aussi le surplus social puisque la<br />
discrimination lui perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> s'en approprier la totalité. L'allocation à laquelle on parvient<br />
ainsi est très inégalitaire mais elle efficace.<br />
CERNA 17
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Encadré 3 : <strong>La</strong> négociation entre fournisseurs <strong>et</strong> utilisateurs <strong>de</strong> bien non-rival<br />
Supposons un tarif égal à p aux utilisateurs dont le consentement à payer pour l'usage <strong>du</strong> pont est égal<br />
ou supérieur à ce montant <strong>et</strong> qui rémunère <strong>les</strong> dépenses d'investissement <strong>et</strong> <strong>de</strong> maintenance <strong>de</strong> l'entreprise<br />
<strong>de</strong> travaux publics. Dans un mon<strong>de</strong> sans coût <strong>de</strong> transaction, c<strong>et</strong>te situation non optimale va s'orienter<br />
spontanément vers un équilibre <strong>de</strong> Paréto. Il va en eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> l'intérêt <strong>de</strong> l'entreprise <strong>et</strong> <strong>de</strong>s utilisateurs déjà<br />
servis <strong>de</strong> former une coalition <strong>et</strong> <strong>de</strong> proposer aux utilisateurs exclus par le péage <strong>de</strong> payer une contribution<br />
d'usage inférieure à p dès lors que ces <strong>de</strong>rniers acceptent <strong>de</strong> partager avec la coalition une partie <strong>de</strong> leur<br />
accroissement <strong>de</strong> bien-être. Le montant <strong>de</strong> ce transfert pour une variation Dp = (p - p') est borné par <strong>les</strong><br />
aires p'CAp <strong>et</strong> p'BAp. Un transfert à la coalition <strong>de</strong> p'CAp ne modifie pas sa situation tandis qu'elle<br />
améliore <strong>de</strong> CAB, celle <strong>de</strong>s utilisateurs auparavant exclus. Un transfert à la coalition <strong>de</strong> p'BAp améliore<br />
sa situation <strong>de</strong> CAB mais ni n'améliore ni ne dégra<strong>de</strong> la situation <strong>de</strong>s utilisateurs dorénavant servis. Entre<br />
ces <strong>de</strong>ux valeurs <strong>de</strong> transferts, toute <strong>les</strong> répartitions sont possib<strong>les</strong>. En l'absence <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> négociation<br />
entre <strong>les</strong> parties, le marchandage se déroule jusqu’au moment où la taille <strong>du</strong> gâteau (l'aire <strong>du</strong> triangle<br />
ABC) à partager est maximale, c'est à dire avec la participation <strong>de</strong> l'usager marginal. Il n'y a plus <strong>de</strong> gain<br />
à l'échange à réaliser.<br />
Montant <strong>du</strong> péage<br />
p<br />
A<br />
p’<br />
C<br />
B<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
passagers<br />
Si l’on se place maintenant dans l’hypothèse <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> transaction positifs, <strong>les</strong> différentes<br />
solutions, l’offre publique sans péage, la négociation <strong>et</strong> la discrimination ont <strong>de</strong>s coûts<br />
d’élaboration <strong>et</strong> <strong>de</strong> mise en oeuvre qui leurs sont propres. Une argumentation à propos <strong>de</strong>s<br />
différentes solutions <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s externalités <strong>de</strong> pollution a montré qu’il n’y a pas <strong>de</strong><br />
solution qui soit systématiquement meilleure (i.e., moins coûteuse) qu’une autre <strong>et</strong> que seule<br />
l’étu<strong>de</strong> au cas pas perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> trancher. Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas intéressante à citer car elle est à<br />
l’origine d’une controverse avec Samuelson [1958] est celle menée par Minasian [1964] sur<br />
le choix entre un programme <strong>de</strong> télévision financé par la publicité <strong>et</strong> dont l’accès est libre <strong>et</strong><br />
un programme exclusivement réservé à <strong>de</strong>s abonnés.<br />
Un <strong>de</strong>s points clefs <strong>de</strong> l’examen <strong>de</strong> l’efficacité relative <strong>de</strong>s différentes solutions d’offre <strong>de</strong><br />
biens non-rivaux porte sur la comparaison entre <strong>les</strong> pertes respectives <strong>de</strong> l’accès gratuit <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> l’accès payant. En optant pour un <strong>financement</strong> par l’impôt, l’autorité publique se prive<br />
d’une source d'information sur la satisfaction <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s utilisateurs. C<strong>et</strong>te source est le<br />
signal-prix qu'apporte une re<strong>de</strong>vance assise sur l'usage. Le prix communique <strong>de</strong>s informations<br />
sur l’opportunité d'améliorer la qualité <strong>du</strong> service offert (par exemple la propr<strong>et</strong>é <strong>de</strong>s<br />
vestiaires d'une piscine en embauchant un employé supplémentaire) ou d'augmenter la<br />
capacité <strong>de</strong>s infrastructures (par exemple construire un pont d’une plus gran<strong>de</strong> capacité à la<br />
place <strong>de</strong> l'ancien). De son côté, l’accès payant, dans le cadre d’une tarification qui est<br />
nécessairement imparfaite, <strong>du</strong> fait <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> transaction positifs (prix unique ou<br />
CERNA 18
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
discrimination imparfaite) prive <strong>de</strong> façon non-optimale certains usagers <strong>de</strong> la<br />
consommation <strong>du</strong> bien.<br />
Dès lors que l’offre privée <strong>de</strong> bien non-rivaux est optimale dans un mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong><br />
transaction nuls <strong>et</strong> qu’elle n’est pas nécessairement moins efficace que l’offre publique dans<br />
un mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> transaction positifs, la recommandation <strong>de</strong> Samuelson est ca<strong>du</strong>que : il<br />
n’est pas nécessaire <strong>de</strong> rendre non-excludab<strong>les</strong> tous <strong>les</strong> biens non-rivaux, <strong>de</strong> <strong>les</strong> m<strong>et</strong>tre à la<br />
disposition gratuite <strong>de</strong>s utilisateurs.<br />
L’incapacité privée à offrir <strong>de</strong>s biens non-excludab<strong>les</strong><br />
Il est utile pour la clarté <strong>de</strong> l’exposé <strong>de</strong> distinguer ici trois questions qui seront<br />
successivement discutées : celle <strong>de</strong> l’incapacité <strong>de</strong> l’initiative privée (indivi<strong>du</strong>elle ou<br />
coopérative) à offrir <strong>de</strong>s biens non-excludab<strong>les</strong> ; celle <strong>de</strong> la non-optimalité parétienne <strong>de</strong><br />
l’offre privée <strong>de</strong> ces biens ; celle, enfin, <strong>de</strong> l’efficacité relative <strong>de</strong> l’offre privée par rapport<br />
à l’offre publique.<br />
Le comportement <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin <strong>et</strong> sa tra<strong>du</strong>ction en dilemme <strong>du</strong> prisonnier sont<br />
avancés par l’économie publique pour expliquer que la fourniture privée d'un bien nonexcludable<br />
est impossible. Mais, comme son nom le suggère, le dilemme <strong>du</strong> prisonnier m<strong>et</strong><br />
en scène <strong>de</strong>s joueurs qui sont dans l'impossibilité <strong>de</strong> communiquer. En conséquence, ils ne<br />
peuvent pas m<strong>et</strong>tre au point un accord sur le coup qu'ils vont jouer, ni m<strong>et</strong>tre au point un<br />
système <strong>de</strong> rétorsion, si l'accord n'est pas respecté. Dans le cas d’un bien non-excludable<br />
comme un phare, telle n'est pas la situation. Rien n'empêche un entrepreneur <strong>de</strong> travaux<br />
publics <strong>de</strong> passer un contrat avec <strong>les</strong> armateurs souhaitant la construction d’un phare qui<br />
assurerait une meilleure sécurité à leurs navires. Le contrat peut s’accompagner d'un prépaiement<br />
calculé <strong>de</strong> telle sorte qu'il diminue l'intérêt <strong>de</strong> la défection quand l'investissement<br />
est réalisé ; le risque <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin est ré<strong>du</strong>it <strong>et</strong> l’offreur peut alors trouver son<br />
compte à l'opération. En d'autres termes, un entrepreneur privé peut négocier la pro<strong>du</strong>ction<br />
<strong>du</strong> bien non-excludable avec ses utilisateurs potentiels.<br />
Dans quel<strong>les</strong> circonstances c<strong>et</strong>te négociation peut aboutir à la fourniture <strong>du</strong> bien ? Un<br />
élément <strong>de</strong> réponse évi<strong>de</strong>nt est que <strong>les</strong> bénéfices atten<strong>du</strong>s par <strong>les</strong> utilisateurs soient supérieurs<br />
aux coûts <strong>de</strong>s fournisseurs. Un second élément est que le respect <strong>du</strong> contrat soit assuré. Celui<br />
qui ne paye pas la contribution prévue au contrat qu’il a signé alors qu’il profite <strong>du</strong> bien doit<br />
encourir un risque <strong>de</strong> sanction qui le dissua<strong>de</strong> d’agir <strong>de</strong> la sorte. Il faut donc prévoir que le<br />
coût <strong>du</strong> contrat (<strong>de</strong> son élaboration, mais aussi <strong>du</strong> système <strong>de</strong> surveillance <strong>et</strong> d’amen<strong>de</strong> qui lui<br />
est attaché) soit inférieur aux bénéfices liés à l'utilisation <strong>du</strong> bien. Troisième élément, il est<br />
bien enten<strong>du</strong> nécessaire que <strong>les</strong> droits <strong>de</strong> propriété soient garantis par l’Etat. Il faut que ceux<br />
qui n’ont pas signé le contrat en espérant ultérieurement disposer gratuitement <strong>du</strong> bien<br />
CERNA 19
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
puissent être condamnés pour c<strong>et</strong> abus, ce qui signifie pour l’entrepreneur privé <strong>de</strong>s coûts<br />
supplémentaires en actions <strong>de</strong> surveillance <strong>et</strong> <strong>de</strong> recours en justice.<br />
L’incapacité <strong>de</strong> l’initiative privée à offrir <strong>de</strong>s biens non-excludab<strong>les</strong> peut également être<br />
levé par un effort d’innovation <strong>de</strong>s fournisseurs potentiels aboutissant à la mise au point<br />
d’un dispositif technique d’exclusion. A condition que le coût d’invention <strong>et</strong> <strong>de</strong> maintenance<br />
<strong>de</strong> ce dispositif soit inférieur à la disposition à payer <strong>de</strong>s usagers pour le bien ainsi ren<strong>du</strong><br />
excludable.<br />
En résumé, pour observer la fourniture privée il faut que <strong>les</strong> bénéfices que vont r<strong>et</strong>irer <strong>les</strong><br />
utilisateurs soient supérieurs aux coûts <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> bien <strong>et</strong> <strong>du</strong> dispositif d'excludabilité<br />
qu'il soit juridique ou technique. <strong>La</strong> pro<strong>du</strong>ction d’un bien non-excludable n'est donc pas en<br />
théorie nécessairement hors <strong>de</strong> portée <strong>de</strong> l'initiative privée, cela dépend <strong>de</strong>s dépenses<br />
contractuel<strong>les</strong> ou d'innovation technique que <strong>les</strong> entrepreneurs doivent consacrer pour<br />
rendre le bien excludable.<br />
Mais c<strong>et</strong>te offre privée peut-elle aboutir à un équilibre <strong>de</strong> Paréto ? Montrons tout d'abord<br />
que la fourniture privée est efficace au sens <strong>de</strong> Paréto si <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> transaction sont nuls.<br />
Dans un mon<strong>de</strong> sans coût <strong>de</strong> transaction, le coût <strong>du</strong> marchandage est nul ; il en est <strong>de</strong> même<br />
pour le coût <strong>de</strong> la rédaction <strong>et</strong> <strong>du</strong> respect <strong>de</strong>s contrats. Il en découle que <strong>les</strong> fournisseurs<br />
privés peuvent toujours assurer l'exclusion <strong>de</strong> leurs services par un contrat auprès <strong>de</strong>s<br />
utilisateurs potentiels. Il n'y a pas d’inefficacité liée au coût d'exclusion puisque ce <strong>de</strong>rnier<br />
est nul. Dit d'une autre manière, dans un mon<strong>de</strong> sans coût <strong>de</strong> transaction, tous <strong>les</strong> biens sont<br />
excludab<strong>les</strong> : la propriété <strong>de</strong> non-excludabilité <strong>de</strong>s biens ne peut ni apparaître, ni persister.<br />
Pour départager la fourniture publique <strong>et</strong> privée <strong>de</strong> biens collectifs - notre troisième<br />
question - il faut donc prendre pour référence un mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> transaction positifs. Les<br />
coûts <strong>de</strong> transactions sont-ils en défaveur <strong>de</strong> la fourniture privée, <strong>et</strong>, a contrario, en faveur<br />
<strong>de</strong> la fourniture publique ? Encore une fois, il n'y a pas <strong>de</strong> réponse générale à c<strong>et</strong>te question.<br />
Ce n'est qu'en examinant l'ensemble <strong>de</strong>s coûts, en particulier ceux supportés par <strong>les</strong><br />
entrepreneurs pour décourager le comportement <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin <strong>et</strong> négocier <strong>et</strong><br />
contracter avec <strong>les</strong> utilisateurs, <strong>et</strong> <strong>de</strong>s variab<strong>les</strong> liées au contexte, comme le nombre <strong>de</strong><br />
parties concernées, la réputation <strong>et</strong> le pouvoir <strong>de</strong> coercition <strong>de</strong> l'autorité publique par<br />
rapport à l'organisation privée, que la supériorité d'un mo<strong>de</strong> sur l'autre peut-être avancée.<br />
Voyons comment à travers <strong>de</strong>ux dimensions, l’incitation à révéler ses préférences <strong>et</strong> le<br />
nombre d’usagers potentiels, comment l’efficacité relative <strong>de</strong> l’offre publique sur l’offre<br />
privée relève <strong>du</strong> cas par cas.<br />
Partons <strong>du</strong> cas <strong>du</strong> comportement <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin selon la formulation plus réaliste <strong>et</strong><br />
plus subtile <strong>du</strong> problème donnée aujourd’hui par la théorie mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> l'économie publique.<br />
CERNA 20
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
C<strong>et</strong>te formulation est qu'adopter un comportement <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin, revient non pas à<br />
refuser <strong>de</strong> contribuer pour l'usage <strong>du</strong> bien mais consiste à déclarer avoir un intérêt inférieur à<br />
son consentement à payer. Le fournisseur privé <strong>et</strong> le fournisseur public sont tous <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux<br />
confrontés à ce problème <strong>de</strong> révélation <strong>de</strong>s préférences. Un enquêteur public en charge<br />
d'évaluer l'intérêt <strong>de</strong>s pêcheurs pour l'installation d'un nouveau phare ou un entrepreneur<br />
privé croyant entrevoir là un proj<strong>et</strong> rentable se heurteront semblablement à <strong>de</strong>s indivi<strong>du</strong>s qui<br />
ont intérêt à sous-évaluer leurs préférences. Il est tout à fait concevable que <strong>les</strong> répondants<br />
biaisent moins leurs déclarations quand il s'agit d'un proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> la puissance publique. Il suffit<br />
d'invoquer que dans ce cas leur sens civique <strong>et</strong> leur altruisme sont plus prononcés. Mais il<br />
s'agit là d'une raison purement <strong>de</strong> circonstance. Dans un pays où la puissance publique est<br />
synonyme <strong>de</strong> bureaucratie, voire <strong>de</strong> corruption, <strong>et</strong> l'entreprise privée parée <strong>de</strong> toutes <strong>les</strong><br />
vertus, la situation s'inversera.<br />
Les coûts <strong>de</strong> transaction relatifs <strong>de</strong> l’offre privée <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’offre publique dépen<strong>de</strong>nt aussi <strong>du</strong><br />
nombre d'utilisateurs. S'ils sont en p<strong>et</strong>it nombre, comme <strong>les</strong> pêcheurs utilisant le service <strong>de</strong>s<br />
phares <strong>et</strong> balises en comparaison <strong>de</strong>s habitants d'un pays bénéficiant <strong>de</strong> sa défense nationale,<br />
ils seront probablement inférieurs. En eff<strong>et</strong>, <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> négociation augmentent rapi<strong>de</strong>ment<br />
avec la taille <strong>de</strong>s coalitions, ce qui pénalise la solution privée. Il en est <strong>de</strong> même pour <strong>les</strong><br />
coûts <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>et</strong> <strong>de</strong> respect <strong>de</strong>s contrats. Plus la taille <strong>de</strong> la coalition est gran<strong>de</strong>,<br />
plus le nombre <strong>de</strong> contrats à passer est élevé, <strong>et</strong> surtout plus la défection d'un indivi<strong>du</strong> à<br />
tendance à passer inaperçue. Le respect <strong>du</strong> contrat présuppose un coût <strong>de</strong> surveillance <strong>et</strong> un<br />
pouvoir <strong>de</strong> coercition élevés. Il est traditionnellement considéré que cela donne un avantage<br />
à l’offre publique car l'Etat pour appliquer le droit bénéficie souvent d'économies d'échelle,<br />
<strong>et</strong>, disposant <strong>du</strong> monopole <strong>de</strong> l'exercice <strong>de</strong> la violence, est doté d'un pouvoir <strong>de</strong> coercition<br />
supérieur à celui <strong>de</strong>s organisations privées. Il s'agit d'une explication liée à un contexte<br />
particulier. Pendant longtemps, le droit <strong>de</strong>s communautés privées a largement été associé à<br />
<strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong> sanction très coercitifs. Il suffit d'évoquer <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> religieuses ou le co<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> l'honneur attaché au <strong>du</strong>el.<br />
2. <strong>La</strong> réglementation <strong>de</strong>s biens collectifs appliquée aux<br />
services publics<br />
<strong>La</strong> réforme <strong>de</strong> réglementation <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau amène à reconsidérer la<br />
transformation <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> services publics qu’el<strong>les</strong> sont traditionnellement chargées<br />
d’assurer. Après avoir présenté <strong>les</strong> liens qui rapprochent <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> bien collectif <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
service public, <strong>et</strong> la doctrine juridique <strong>et</strong> politique française en la matière, nous examinerons<br />
comment l’ouverture à la concurrence amène à redéfinir <strong>les</strong> missions <strong>de</strong> service public <strong>et</strong><br />
leur <strong>financement</strong>.<br />
CERNA 21
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
C<strong>et</strong>te partie donne l’occasion <strong>de</strong> traiter <strong>les</strong> aspects redistributifs associés à la<br />
réglementation. En France, la réglementation <strong>de</strong> service public appliquée aux in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong><br />
réseau vise à ré<strong>du</strong>ire certaines inégalités entre différents territoires <strong>et</strong> entre différents<br />
ménages plutôt qu’à corriger <strong>de</strong>s inefficacités <strong>du</strong> marché.<br />
2.1. Service public <strong>et</strong> bien collectif<br />
Les activités <strong>de</strong> services publics regroupent un ensemble très vaste <strong>et</strong> hétérogène <strong>de</strong> services<br />
collectifs réglementés par l’Etat : <strong>de</strong>s services administratifs comme la délivrance <strong>de</strong>s<br />
passeports ou l’enregistrement <strong>de</strong> l’état civil, <strong>de</strong>s services sociaux comme ceux offerts par<br />
<strong>les</strong> hôpitaux, <strong>de</strong>s services in<strong>du</strong>striels <strong>et</strong> commerciaux comme ceux fournis par EDF <strong>et</strong> la<br />
SNCF ; <strong>de</strong>s services qui sont aussi bien assurés par <strong>de</strong>s administrations centra<strong>les</strong>, <strong>de</strong>s<br />
établissements publics, <strong>de</strong>s régies municipa<strong>les</strong>, que par <strong>de</strong>s entreprises publiques ou privées ;<br />
<strong>de</strong>s services éten<strong>du</strong>s à l’ensemble <strong>du</strong> territoire comme la télévision publique nationale, ou <strong>de</strong>s<br />
services collectifs locaux comme <strong>les</strong> pompes funèbres <strong>et</strong> la distribution d’eau ; enfin, on<br />
trouve aussi bien <strong>de</strong>s services payants que <strong>de</strong>s services gratuits. Le caractère <strong>de</strong> service public<br />
<strong>de</strong> ces diverses activités est le résultat <strong>de</strong> décisions politiques <strong>et</strong> juridiques prises par le<br />
pouvoir législatif <strong>et</strong> le juge administratif (au premier rang <strong>de</strong>squels le Conseil d'Etat). Quel<br />
éclairage l'analyse économique <strong>de</strong>s biens collectifs perm<strong>et</strong>-il <strong>de</strong> porter sur la séparation ainsi<br />
faite entre <strong>de</strong>s services qui sont publics <strong>et</strong> <strong>de</strong>s services dits ordinaires qui ne le sont pas ?<br />
<strong>La</strong> caractérisation économique <strong>de</strong>s services publics<br />
Le tableau ci-<strong>de</strong>ssous dresse une classification économique <strong>de</strong>s services publics. C<strong>et</strong>te<br />
classification fait appel à différentes catégories d’analyse qui ont été présentées dans la<br />
partie précé<strong>de</strong>nte sur <strong>les</strong> biens collectifs.<br />
Biens <strong>de</strong> club<br />
Accès payant<br />
Service public<br />
marchand<br />
Financement par<br />
<strong>les</strong> rec<strong>et</strong>tes<br />
perçues auprès<br />
<strong>de</strong>s usagers<br />
Consommation<br />
facultative<br />
Electricité<br />
Téléphone<br />
Accès gratuit<br />
Service public<br />
non marchand<br />
Financement<br />
mixte<br />
Financement par<br />
l’impôt<br />
Transports<br />
collectifs parisiens<br />
Cantines scolaires<br />
Piscines<br />
municipa<strong>les</strong><br />
Minitel<br />
Musées<br />
Eco<strong>les</strong><br />
Vaccinations<br />
Biens collectifs<br />
Consommation<br />
forcée<br />
Défense nationale<br />
Eclairage <strong>de</strong>s rues<br />
Signalisation<br />
routière<br />
Le tableau fait apparaître que, contrairement à une idée souvent répan<strong>du</strong>e, il n’existe pas<br />
une correspondance stricte entre service public <strong>et</strong> bien collectif. Les services publics<br />
CERNA 22
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
s’éten<strong>de</strong>nt bien au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s services qui possè<strong>de</strong>nt la double propriété <strong>de</strong> non-excludabilité <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> non-rivalité. Ils concernent également <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> club, c’est à dire <strong>de</strong>s biens dont la<br />
consommation collective peut-être fermée à certains usagers.<br />
Le haut <strong>et</strong> le bas <strong>du</strong> tableau regroupent <strong>de</strong>ux types simp<strong>les</strong> <strong>de</strong> services publics. Ils présentent<br />
chacun <strong>de</strong>s caractéristiques opposées. Côté bas, on trouve <strong>de</strong>s services non-marchands<br />
correspondant à <strong>de</strong>s biens collectifs. Leur accès est gratuit. Leur pro<strong>du</strong>ction est financée par<br />
<strong>de</strong>s fonds publics alimentés par l’impôt. Autre caractéristique, leur usage s’impose à tous.<br />
Les coûts d’évitement pour <strong>les</strong> indivi<strong>du</strong>s réfractaires à leur consommation sont en eff<strong>et</strong> très<br />
élevés. Ceux qui ne veulent pas bénéficier <strong>de</strong> ces services n’ont souvent pas d’autres choix<br />
que <strong>de</strong> quitter la commune ou le pays où ils rési<strong>de</strong>nt. <strong>La</strong> défense nationale d’un territoire,<br />
l’éclairage <strong>de</strong>s rues d’une cité <strong>et</strong> la signalisation routière sont donnés en exemple. C<strong>et</strong>te<br />
catégorie <strong>de</strong> services publics comprend <strong>les</strong> services offerts <strong>et</strong> imposés par la puissance<br />
publique à chaque citoyen <strong>de</strong> la nation (ou à chaque habitant <strong>de</strong> la collectivité locale dans le<br />
cas <strong>de</strong>s services publics locaux). Côté haut, on trouve <strong>les</strong> services publics marchands. C<strong>et</strong>te<br />
fois il s’agit <strong>de</strong> bien <strong>de</strong> club : leur consommation est donc facultative <strong>et</strong> <strong>les</strong> droits d’entrée<br />
doivent couvrir la totalité <strong>du</strong> coût <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong>s services. En France, <strong>les</strong> réseaux <strong>de</strong><br />
distribution d’électricité <strong>et</strong> <strong>de</strong> communication téléphonique vocale se rangent parmi c<strong>et</strong>te<br />
catégorie.<br />
Au milieu <strong>du</strong> tableau se concentrent plusieurs types intermédiaires <strong>de</strong> services publics. Ils<br />
sont délimités par trois frontières que l’Etat a le pouvoir <strong>de</strong> déplacer. L’Etat peut déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
rendre gratuit l’accès à certains biens <strong>de</strong> club. Ce peut être, par exemple, l’entrée à l’école,<br />
dans un musée ou sur un autoroute. Ces biens sont souvent offerts gratuitement alors qu’il<br />
est facile (i.e., peu coûteux) d’en réserver l’accès à ceux qui payent. Si l’école est gratuite <strong>et</strong><br />
ainsi ouverte à tous <strong>les</strong> enfants d’âge scolaire, ou si un musée national est d’entrée libre le<br />
dimanche ce n’est pas faute d’un dispositif technique visant à exclure d’éventuels passagers<br />
clan<strong>de</strong>stins. Ici, la non-excludabilité est le résultat <strong>de</strong> l’action publique plutôt que la cause.<br />
D’autre part, l’Etat peut déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> subventionner en partie <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> club d’accès payant.<br />
C’est le cas <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> transport collectif parisiens. Les rec<strong>et</strong>tes <strong>de</strong> bill<strong>et</strong>terie ne<br />
couvrent qu’une partie <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong> l’infrastructure. De même, <strong>les</strong> cantines<br />
scolaires ou <strong>les</strong> piscines municipa<strong>les</strong> sont subventionnées en partie par <strong>les</strong> collectivités<br />
loca<strong>les</strong>. Enfin, l’Etat peut utiliser son pouvoir <strong>de</strong> coercition pour imposer la consommation<br />
<strong>de</strong> certains biens <strong>de</strong> club. C’est le cas déjà cité <strong>de</strong> l’école qui est en France obligatoire jusqu’à<br />
l’âge <strong>de</strong> seize ans.<br />
CERNA 23
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
<strong>La</strong> justification économique <strong>de</strong>s services publics<br />
L’économie publique <strong>de</strong> la réglementation perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> légitimer un domaine très éten<strong>du</strong> <strong>de</strong><br />
services collectifs réglementés par l’Etat.<br />
L’économie publique range naturellement l’ensemble <strong>de</strong>s biens collectifs dans la catégorie<br />
<strong>de</strong>s services publics. L’intervention <strong>de</strong> l’Etat est pour ces biens doublement justifiée.<br />
L’économie publique défend également le principe <strong>de</strong> rendre gratuit l’accès aux biens <strong>de</strong> club.<br />
En agissant ainsi la puissance publique évite un rationnement sous-optimal. Le lecteur<br />
reconnaît la prescription normative <strong>de</strong> Samuelson quand <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> congestion <strong>de</strong>s biens<br />
excludab<strong>les</strong> sont nuls. Une secon<strong>de</strong> raison avancée pour défendre le principe <strong>de</strong> la gratuité<br />
<strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> club est quand leur consommation est à l’origine d’externalités positives<br />
publiques. C’est l’argumentation proposée par exemple pour justifier la distribution gratuite<br />
<strong>de</strong> terminaux <strong>de</strong> Minitel au cours <strong>de</strong> la phase <strong>de</strong> lancement <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te technologie. En eff<strong>et</strong>,<br />
plus l’effectif en ménages équipés s’élargit, plus <strong>les</strong> entreprises sont nombreuses à proposer<br />
<strong>de</strong> nouveaux serveurs, plus l’éventail <strong>de</strong> services s’étend pour le consommateur, plus il est<br />
utile <strong>de</strong> disposer d’un Minitel chez soi, ce qui, in fine, amène <strong>de</strong> nouveaux ménages à déci<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> s’équiper. Mais ce phénomène <strong>de</strong> boule <strong>de</strong> neige se déclenche difficilement spontanément<br />
s’il faut ach<strong>et</strong>er un appareil. Chacun à intérêt à r<strong>et</strong>ar<strong>de</strong>r son achat, à attendre que <strong>les</strong> autres<br />
fassent d’abord le premier pas car c’est celui le plus coûteux. <strong>La</strong> présence d’externalités<br />
positives peut aller jusqu’à prescrire d’imposer la consommation <strong>du</strong> bien à tous <strong>les</strong> citoyens<br />
au lieu <strong>de</strong> la laisser facultative comme dans le cas <strong>du</strong> Minitel. L’exemple communément<br />
avancé est celui <strong>de</strong> la vaccination obligatoire. Si chacun fait ce qu’il entend <strong>et</strong> se soucie<br />
uniquement <strong>de</strong> son propre intérêt, il va attendre que le reste <strong>de</strong> la population agisse, ce qui<br />
lui évitera d’agir lui-même <strong>et</strong> <strong>de</strong> supporter d’éventuels eff<strong>et</strong>s secondaires ou simplement<br />
l’inconfort d’une piqûre (le lecteur reconnaît encore une fois le problème <strong>du</strong> passager<br />
clan<strong>de</strong>stin). Ce raisonnement est parfois appliqué aux services d’é<strong>du</strong>cation <strong>et</strong> <strong>de</strong> formation<br />
qui bénéficient à ceux qui apprennent, mais aussi à l’ensemble <strong>du</strong> pays <strong>du</strong> fait <strong>de</strong> la<br />
corrélation observée entre la richesse d’une nation <strong>et</strong> le niveau d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ses habitants.<br />
Le concept d’externalité positive publique sert aussi <strong>de</strong> référence pour justifier la subvention<br />
partielle <strong>de</strong> l’Etat en faveur <strong>de</strong> certains biens <strong>de</strong> club. Le cas <strong>de</strong> figure typique est, en France,<br />
celui <strong>de</strong>s services en réseau dans <strong>les</strong> secteurs <strong>du</strong> transport, <strong>de</strong> l’énergie <strong>et</strong> <strong>de</strong> la<br />
télécommunication. Leur présence dans <strong>les</strong> régions à faible <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> population contribue<br />
au maintien d’activités économiques hors <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s agglomérations congestionnées. Ils<br />
participent ainsi à rendre l’aménagement <strong>du</strong> territoire plus efficace [Henry, 1997]. On peut<br />
toutefois s’interroger sur la visée d’efficacité d’une telle action dès lors qu’elle ne<br />
s’accompagne pas d’une politique symétrique d’internalisation <strong>de</strong>s eff<strong>et</strong>s externes négatifs<br />
CERNA 24
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
dans <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s métropo<strong>les</strong> où l’usage <strong>de</strong> la voirie pour la circulation <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’atmosphère<br />
pour déverser <strong>de</strong>s émissions polluantes reste gratuit.<br />
L’économie in<strong>du</strong>strielle <strong>de</strong> la réglementation prend le contre-pied <strong>de</strong>s recommandations<br />
précé<strong>de</strong>ntes. Reprenant à son compte <strong>les</strong> prescriptions <strong>de</strong> la théorie <strong>du</strong> choix public, elle<br />
défend l’idée que le service public doit être exclusivement limité au fonctions régaliennes <strong>de</strong><br />
l’Etat, c’est à dire aux services <strong>de</strong> la sécurité intérieure, <strong>de</strong> la défense nationale <strong>et</strong> <strong>de</strong> la<br />
justice. Ce sont <strong>les</strong> seuls services collectifs qui doivent être offerts gratuitement à l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s citoyens <strong>et</strong> financés à partir <strong>de</strong> l’impôt. Les autres doivent être payés par <strong>les</strong><br />
consommateurs.<br />
Il est suggéré par exemple que <strong>les</strong> biens collectifs locaux comme l’éclairage urbain ou la<br />
voirie soient financés directement par <strong>les</strong> propriétaires d’habitation <strong>et</strong> <strong>de</strong> commerce<br />
(syndicat <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nts, promoteurs, <strong>et</strong>c.) à l’exemple <strong>de</strong> ce qui se passe dans certaines vil<strong>les</strong><br />
américaines comme Saint Louis ou Ar<strong>de</strong>n [Foldvary, 1994]. Les biens collectifs locaux sont<br />
considérés comme <strong>de</strong>s biens territoriaux dont le valeur est capitalisée dans <strong>les</strong> actifs<br />
immobiliers. Lorsqu’ils sont financés par le gouvernement à partir d’impôts sur la<br />
pro<strong>du</strong>ction, <strong>les</strong> propriétaires fonciers occupent <strong>de</strong> fait une position <strong>de</strong> passager clan<strong>de</strong>stin.<br />
L’idée est en eff<strong>et</strong> que <strong>les</strong> propriétaires bénéficient <strong>de</strong>s infrastructures urbaines à travers le<br />
niveau <strong>de</strong> la rente foncière. Une augmentation <strong>de</strong> la quantité ou <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s biens<br />
collectifs locaux se tra<strong>du</strong>it par une augmentation <strong>de</strong>s prix <strong>du</strong> terrain <strong>et</strong> <strong>de</strong>s loyers que sont<br />
prêts à payer <strong>les</strong> utilisateurs. Pour <strong>les</strong> économistes <strong>du</strong> choix public, <strong>les</strong> propriétaires sont<br />
alors <strong>les</strong> mieux à même <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r la taille <strong>et</strong> le contenu <strong>de</strong>s services publics locaux qui<br />
doivent être fournis. Les élus ne disposent pas d’une information aussi précise que <strong>les</strong><br />
propriétaires, <strong>et</strong> ils sont suspectés <strong>de</strong> manipuler la taxation locale à <strong>de</strong>s fins redistributives<br />
auprès <strong>de</strong> clientè<strong>les</strong> à fort pouvoir électoral plutôt que d’agir en cherchant <strong>les</strong> solutions <strong>de</strong><br />
moindre coût.<br />
Le <strong>financement</strong> public <strong>de</strong>s biens collectifs locaux n'est envisagé par ces économistes que<br />
dans un cas <strong>de</strong> figure théorique : celui d'une concurrence pure <strong>et</strong> parfaite entre municipalités.<br />
Il s'agit <strong>du</strong> résultat d'un modèle développé par Tiebout [1956], où le niveau <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction<br />
optimal <strong>de</strong>s biens collectifs locaux est atteint par le mécanisme <strong>du</strong> vote par <strong>les</strong> pieds. Dotés<br />
d'une information <strong>et</strong> d'une mobilité parfaites (connaissance <strong>de</strong> toutes <strong>les</strong> offres <strong>et</strong><br />
déplacements à coût nul), <strong>les</strong> citoyens choisissent la municipalité qui propose le panier <strong>de</strong><br />
services collectifs qui leur convient le mieux. <strong>La</strong> consommation <strong>de</strong> service public est donc<br />
ici volontaire. Le vote par <strong>les</strong> pieds apparaît comme un mécanisme <strong>de</strong> marché décentralisé<br />
qui résout le problème d’absence <strong>de</strong> signal prix quand <strong>les</strong> biens sont ren<strong>du</strong>s gratuits à cause<br />
<strong>de</strong>s subventions publiques.<br />
Pour désigner <strong>les</strong> activités collectives qui appellent une réglementation publique, <strong>les</strong> analyses<br />
CERNA 25
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
économiques <strong>de</strong>s biens collectifs élaborées par l’économie publique <strong>et</strong> l’économie in<strong>du</strong>strielle<br />
aboutissent donc à <strong>de</strong>s prescriptions opposées. El<strong>les</strong> partagent toutefois un point commun :<br />
chacune formule ses recommandations normatives au nom <strong>de</strong> l’efficacité. L’économie<br />
publique se prononce pour un large service public au nom <strong>de</strong> l’efficacité allocative <strong>de</strong>s<br />
ressources tandis que l’économie in<strong>du</strong>strielle condamne l’extension <strong>de</strong>s services publics au<br />
nom <strong>de</strong> l’efficacité supérieure <strong>du</strong> marché en terme <strong>de</strong> performances en coût <strong>et</strong> en qualité. <strong>La</strong><br />
norme économique qu’elle soit libérale ou étatique ignore ainsi largement la dimension <strong>de</strong><br />
l’équité, dimension très présente en revanche dans la norme juridique <strong>du</strong> service public.<br />
2.2. <strong>La</strong> notion <strong>et</strong> la doctrine juridiques <strong>du</strong> service public<br />
Selon Léon Duguit [1928] relève <strong>du</strong> service public « toute activité dont l'accomplissement<br />
doit être assuré, réglé <strong>et</strong> contrôlé par <strong>les</strong> gouvernants, parce que l'accomplissement <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te<br />
activité est indispensable à la réalisation <strong>et</strong> au développement <strong>de</strong> l'interdépendance sociale<br />
(on parlerait aujourd'hui <strong>de</strong> cohésion sociale), <strong>et</strong> qu'elle est <strong>de</strong> telle nature qu'elle ne peut être<br />
réalisée complètement que par l'intervention <strong>de</strong> la force gouvernante ». <strong>La</strong> doctrine<br />
élaborée par ce juriste reste en France la doctrine <strong>de</strong> référence. Elle accor<strong>de</strong> une place<br />
centrale à l'Etat. C'est en eff<strong>et</strong> aux pouvoirs publics nationaux <strong>et</strong> locaux qu'il revient <strong>de</strong><br />
déci<strong>de</strong>r si une activité présente le caractère <strong>de</strong> service public, d'en dicter <strong>les</strong> conditions <strong>de</strong><br />
mise en oeuvre <strong>et</strong> d'en contrôler l'exécution [Denoix <strong>de</strong> Saint Marc, 1996]. C<strong>et</strong>te décision<br />
<strong>de</strong>s pouvoirs publics <strong>et</strong> sa mise en oeuvre doivent se conformer à un certains nombres <strong>de</strong><br />
principes juridiques définis par le droit administratif. Les plus importants sont la recherche<br />
<strong>de</strong> l’intérêt général <strong>et</strong> l’égalité.<br />
L’intérêt général<br />
Pour qu’un service collectif puisse être rangé parmi <strong>les</strong> services publics, il faut qu’il répon<strong>de</strong><br />
à un besoin d’intérêt général. C<strong>et</strong>te notion ne doit pas être confon<strong>du</strong>e avec la <strong>définition</strong><br />
économique utilitariste qui somme <strong>les</strong> bien-être indivi<strong>du</strong>els. L’intérêt général a en France<br />
une connotation différente. Il transcen<strong>de</strong> <strong>les</strong> intérêts particuliers ; il fon<strong>de</strong> l’intérêt commun<br />
<strong>de</strong>s citoyens plutôt qu’il ne se dé<strong>du</strong>it <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s intérêts indivi<strong>du</strong>els qui seraient<br />
partagés par tous.<br />
Le droit public ne donne pas <strong>de</strong> <strong>définition</strong> précise <strong>de</strong> l’intérêt général. Il énonce<br />
principalement que l’intérêt général est l’obj<strong>et</strong> même <strong>de</strong> l’action <strong>de</strong> l’Etat <strong>et</strong> qu’il revient au<br />
législateur <strong>de</strong> le définir. <strong>La</strong> notion d’intérêt général fait donc l’obj<strong>et</strong> d’un usage varié <strong>et</strong><br />
changeant selon <strong>les</strong> époques. Par exemple, l’intérêt général a pu être associé aux<br />
représentations <strong>du</strong> théâtre public, a pu être invoqué pour justifier une politique <strong>de</strong> relance<br />
dans le secteur <strong>du</strong> bâtiment, ou encore a pu être mis en avant pour lutter contre<br />
CERNA 26
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
l’abstentionnisme lors d’une consultation électorale. Limitée pendant la pério<strong>de</strong> libérale <strong>de</strong><br />
l’entre-<strong>de</strong>ux guerres aux fonctions régaliennes, la qualification d’activité d’intérêt général a<br />
été admise pour un grand nombre <strong>de</strong> services économiques <strong>et</strong> in<strong>du</strong>striels à la Libération.<br />
L’imprécision juridique <strong>de</strong> la notion d’intérêt général présente ainsi l’avantage que le droit<br />
peut facilement s’adapter à l’évolution <strong>de</strong>s techniques <strong>et</strong> <strong>de</strong>s besoins. Mais elle présente aussi<br />
un grave inconvénient. Elle con<strong>du</strong>it à une situation où l’Etat se légitime par <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong><br />
service public dont lui seul détermine la <strong>définition</strong>. Comme le souligne C. Henry [1997] «<br />
[l’] Etat organise ses services publics dans le cadre d’un droit taillé sur mesure ».<br />
Le fait <strong>de</strong> répondre à un besoin d’intérêt général soum<strong>et</strong> <strong>les</strong> activités reconnues comme<br />
services publics à <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> gestion particuliers dont <strong>les</strong> plus importants sont ceux <strong>de</strong><br />
continuité, d'adaptabilité <strong>et</strong> d'égalité. Une implication pratique <strong>du</strong> principe <strong>de</strong> continuité est<br />
le service minimum en cas <strong>de</strong> grève. Il est assuré par exemple dans la navigation aérienne <strong>et</strong><br />
l'audiovisuel. Le second principe perm<strong>et</strong> d'adapter le contenu <strong>du</strong> service public à l'évolution<br />
<strong>du</strong> progrès technique <strong>et</strong> <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s usagers. Il perm<strong>et</strong> d'abandonner <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong><br />
services publics <strong>et</strong> d'en intro<strong>du</strong>ire <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong>. Le troisième principe appelle un plus long<br />
commentaire.<br />
L’égalité <strong>de</strong>vant le service public<br />
Le principe d’égalité qui s’applique au service public est un principe général <strong>de</strong> nondiscrimination.<br />
Il oblige à traiter <strong>les</strong> usagers <strong>de</strong> façon i<strong>de</strong>ntique. Il perm<strong>et</strong> en particulier <strong>de</strong><br />
condamner <strong>de</strong>s mesures qui intro<strong>du</strong>iraient une différence dans <strong>les</strong> prestations offertes aux<br />
indivi<strong>du</strong>s selon leur communauté d’origine <strong>et</strong> leurs croyances. En matière <strong>de</strong> services publics<br />
aussi, chaque citoyen doit disposer <strong>de</strong>s mêmes droits comme le prescrivent <strong>les</strong> premiers<br />
artic<strong>les</strong> <strong>de</strong> la déclaration <strong>de</strong> 1789 <strong>et</strong> <strong>de</strong> la constitution <strong>de</strong> 1958.<br />
Le principe d’égalité <strong>de</strong>vant le service public est donc un principe d’égalité <strong>de</strong> traitement. Il<br />
n’est absolument pas synonyme <strong>de</strong> gratuité d’accès. En témoignent bien évi<strong>de</strong>mment <strong>les</strong><br />
nombreux services publics marchands. Leur accès payant exclut <strong>de</strong> facto une frange <strong>de</strong> la<br />
population, celle dont l’insuffisance <strong>de</strong> revenus ne perm<strong>et</strong> pas <strong>de</strong> consommer <strong>les</strong> biens en<br />
question. L’Etat peut déci<strong>de</strong>r pour limiter ce phénomène d’exclusion <strong>de</strong> subventionner, pour<br />
partie ou pour totalité, le service public considéré. C<strong>et</strong>te décision n’est aucunement<br />
contrainte par le droit. Il s’agit simplement d’un choix politique, celui d’opérer une<br />
redistribution en faveur <strong>de</strong> certaines catégories <strong>de</strong> population pour compenser <strong>de</strong>s handicaps<br />
physiques, <strong>de</strong>s inégalités <strong>de</strong> revenus ou <strong>de</strong>s disparités régiona<strong>les</strong> ; ou, celui plus fondamental,<br />
d’inscrire la contribution d’un service au rang <strong>de</strong>s nécessités <strong>de</strong> l’unité <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité<br />
nationa<strong>les</strong> en rendant l’accès gratuit à tous.<br />
CERNA 27
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Le principe d’égalité n’empêche pas non plus <strong>de</strong> pratiquer <strong>de</strong>s prix <strong>et</strong> d’offrir <strong>de</strong>s qualités <strong>de</strong><br />
service différenciés. Le cas <strong>de</strong>s services publics en réseaux en fourni une illustration<br />
évi<strong>de</strong>nte. <strong>La</strong> SNCF propose plusieurs classes <strong>de</strong> confort <strong>et</strong> <strong>les</strong> prix <strong>du</strong> TGV sont mo<strong>du</strong>lés<br />
selon <strong>les</strong> heures <strong>de</strong> pointe. D’un point <strong>de</strong> vue juridique, rien n’oblige non plus EDF à<br />
appliquer aux ménages un tarif uniforme <strong>du</strong> kilowattheure <strong>de</strong> base. Depuis longtemps, le<br />
droit administratif <strong>du</strong> service public perm<strong>et</strong> d’appliquer <strong>de</strong>s règ<strong>les</strong> différentes lorsque <strong>les</strong><br />
situations <strong>de</strong>s usagers sont différentes. Selon une célèbre formule « Le principe d’égalité ne<br />
joue que toutes choses éga<strong>les</strong> par ailleurs » [G. Ve<strong>de</strong>l, 1969]. Relèvent par exemple <strong>de</strong> la<br />
différence <strong>de</strong> situation : être propriétaire d’une rési<strong>de</strong>nce principale plutôt que d’une<br />
rési<strong>de</strong>nce secondaire dans l’île <strong>de</strong> Ré pour prétendre à un tarif préférentiel <strong>de</strong> la traversée <strong>du</strong><br />
pont qui la relie à <strong>La</strong> Rochelle ; percevoir <strong>de</strong> faib<strong>les</strong> revenus pour payer moins cher la<br />
cantine scolaire <strong>de</strong> ses enfants ; voyager sur un vol <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux heures par rapport à<br />
voyager sur un vol <strong>de</strong> moindre <strong>du</strong>rée pour avoir droit à un espace fumeur. Ces exemp<strong>les</strong> sont<br />
tirés <strong>de</strong> décisions <strong>du</strong> Conseil d’Etat. <strong>La</strong> différenciation entre catégories d'usagers est en eff<strong>et</strong><br />
opposable au juge administratif. En <strong>de</strong>rnier ressort, c'est au Conseil d'Etat <strong>de</strong> se prononcer<br />
sur son bien fondé.<br />
Malgré une possibilité éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> différenciation grâce à la prise en compte <strong>de</strong> situations<br />
différentes, <strong>les</strong> entreprises <strong>de</strong> service public n’ont donc pas tout à fait la même liberté <strong>de</strong><br />
tarification <strong>et</strong> <strong>de</strong> choix <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> leurs prestations que <strong>de</strong>s entreprises ordinaires. Le<br />
recours au tribunal administratif marque la différence rési<strong>du</strong>elle entre une entreprise soumise<br />
pleinement à l’économie <strong>de</strong> marché <strong>et</strong> une entreprise <strong>de</strong> service public à caractère in<strong>du</strong>striel<br />
<strong>et</strong> commercial (à condition bien sûr que ces <strong>de</strong>rnières ne soient pas par ailleurs <strong>et</strong> pour<br />
d’autres raisons - monopole naturel, actionnariat public, <strong>et</strong>c. - soumises à <strong>de</strong>s contraintes <strong>de</strong><br />
réglementation <strong>de</strong> prix ou <strong>de</strong> qualité). L’encadré 4 fournit une illustration <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te<br />
spécificité dans le cas <strong>de</strong> la SNCF.<br />
Le principe d’égalité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>vant <strong>les</strong> services publics ne con<strong>du</strong>it donc pas à<br />
uniformiser systématiquement <strong>les</strong> prix <strong>et</strong> <strong>les</strong> qualités <strong>de</strong>s prestations offertes. Une échelle<br />
pour représenter différents <strong>de</strong>grés <strong>du</strong> principe d'égalité peut être construite comme suit. Au<br />
plus haut <strong>de</strong> l'égalité <strong>de</strong> traitement, se trouvent <strong>les</strong> services publics pour <strong>les</strong>quels la<br />
population d'usagers est formée indistinctement par l'ensemble <strong>de</strong>s citoyens, l'accès est<br />
gratuit pour tous, <strong>et</strong> la qualité <strong>de</strong> service unique. Un exemple est celui <strong>de</strong> la justice ou <strong>de</strong><br />
l'école républicaine. Inversement, au plus bas <strong>de</strong> l'échelle <strong>de</strong> l'égalité <strong>de</strong> traitement, se<br />
placent <strong>les</strong> services publics pour <strong>les</strong>quels la population d'usagers est partitionnée (par<br />
exemple selon l'âge), l'accès est payant, <strong>et</strong> plusieurs qualités sont proposées (ex. : classe<br />
affaire ou classe tourisme). <strong>La</strong> plupart <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> service public <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau<br />
se situent aujourd'hui à ce <strong>de</strong>rnier niveau. Au milieu <strong>de</strong> l’échelle, une gradation est obtenue<br />
en faisant varier le nombre <strong>de</strong> tarifs <strong>et</strong> <strong>de</strong> qualités <strong>de</strong> service. En montant vers une plus<br />
CERNA 28
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
gran<strong>de</strong> égalité on franchit <strong>les</strong> barreaux suivants : plusieurs tarifs <strong>et</strong> plusieurs qualités<br />
accessib<strong>les</strong> à tous, c'est à dire sans différence liée par exemple à l'âge ou au nombre<br />
d'enfants ; plusieurs tarifs mais une seule qualité, comme dans le cas d'une cantine scolaire qui<br />
propose un prix <strong>du</strong> repas plus faible pour <strong>les</strong> famil<strong>les</strong> à bas revenus ; un tarif unique <strong>et</strong> une<br />
seule qualité comme dans le cas <strong>de</strong> l'eau pour <strong>les</strong> habitants d'une même commune.<br />
Encadré 4 : Les contraintes <strong>de</strong> tarification exercées par le Conseil d’Etat sur la SNCF [repris <strong>de</strong> :<br />
Rapport public 1996 <strong>du</strong> Conseil d’Etat - collection Etu<strong>de</strong>s <strong>et</strong> Documents - Editions <strong>La</strong><br />
Documentation Française]<br />
L’application d’un nouveau tarif voyageurs sur <strong>les</strong> lignes <strong>du</strong> TGV Nord-Europe a con<strong>du</strong>it le<br />
gouvernement à solliciter l’avis <strong>du</strong> Conseil d’Etat*. Aux termes <strong>de</strong> c<strong>et</strong> avis, le Conseil d’Etat a<br />
considéré que l’objectif d’assurer une meilleure rentabilité <strong>de</strong> la SNCF, l’équilibre financier <strong>de</strong> c<strong>et</strong><br />
établissement public <strong>et</strong> sa capacité à faire face à la concurrence d’autres moyens <strong>de</strong> transports, constituent<br />
<strong>de</strong>s nécessités d’intérêt général justifiant une diversification <strong>de</strong> sa politique tarifaire. Mais le Conseil<br />
d’Etat a assorti c<strong>et</strong>te lecture <strong>du</strong> principe d’égalité <strong>de</strong> précisions qui sont autant <strong>de</strong> précautions visant à<br />
préserver l’égal accès <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> usagers au service public :<br />
• la mo<strong>du</strong>lation <strong>du</strong> tarif <strong>de</strong> base applicable à l’ensemble <strong>de</strong>s lignes SNCF est soumise aux conditions<br />
d’être justifiée par <strong>de</strong>s éléments objectifs, d’être limitée à l’intérieur d’un écart maximum entre tarifs <strong>de</strong><br />
base particuliers <strong>et</strong> tarifs <strong>de</strong> base général, <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong>s coûts correspondants afin <strong>de</strong> ne pas donner<br />
lieu à une guerre tarifaire avec la concurrence, susceptible <strong>de</strong> comprom<strong>et</strong>tre l’équilibre général <strong>de</strong><br />
l’exploitation, <strong>de</strong> respecter l’obligation d’information <strong>du</strong> public ;<br />
• la mo<strong>du</strong>lation temporelle <strong>du</strong> tarif <strong>de</strong> base qui perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> fixer celui-ci en fonction <strong>de</strong> la date <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’heure<br />
choisies est elle-même soumise à la condition que le nombre <strong>et</strong> <strong>les</strong> horaires <strong>de</strong>s trains aux tarifs <strong>les</strong> plus<br />
bas soient tels que, sur aucune liaison, l’égal accès au service public ne se trouve compromis.<br />
*CE Assemblée générale, avis n°353605 <strong>du</strong> 24 juin 1993, Rapport public 1993, p. 338.<br />
En conclusion, la doctrine juridique française <strong>du</strong> service public est souple en ceci qu’elle<br />
s’adapte à <strong>de</strong>s situations très variées. C’est ce qui perm<strong>et</strong> d’avancer qu’elle est parfaitement<br />
compatible avec la construction <strong>de</strong> l’Union européenne <strong>et</strong> la législation communautaire,<br />
même si c<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière procè<strong>de</strong> d’une inspiration juridique différente en particulier par la<br />
place qu’elle accor<strong>de</strong> aux aspects économiques (cf. encadré 5).<br />
Encadré 5 : <strong>La</strong> conception communautaire <strong>du</strong> service public<br />
Le terme <strong>de</strong> service public n'est pratiquement pas employé dans <strong>les</strong> textes européens. Il faut se reporter<br />
aux notions <strong>de</strong> service d'intérêt économique général <strong>et</strong> <strong>de</strong> service universel pour cerner la conception<br />
communautaire.<br />
<strong>La</strong> première formule apparaît dans la législation <strong>de</strong> la concurrence. Selon l'article 90 §2 <strong>du</strong> traité <strong>de</strong><br />
Rome, « <strong>les</strong> entreprises chargées <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> services d'intérêt économique général [...] sont<br />
soumises [...] aux règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> la concurrence, dans <strong>les</strong> limites où l'application <strong>de</strong> ces règ<strong>les</strong> ne fait pas échec<br />
à l'accomplissement [...] <strong>de</strong> la mission particulière qui leur a été impartie ». <strong>La</strong> notion d'intérêt<br />
économique général n'est cependant pas définie dans le traité. Son contour prend la forme d'une liste<br />
d'activités (services portuaires, <strong>de</strong> radiodiffusion, <strong>de</strong> distribution d'électricité, <strong>et</strong>c.) qui évolue au gré <strong>de</strong><br />
décisions <strong>de</strong> la Commission <strong>et</strong> <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> Justice européenne [Stoffaës, 1995]. Il ressort également à la<br />
lecture <strong>de</strong> diverses initiatives. Citons le Conseil européen <strong>de</strong> Juin 1995 qui souligne la compatibilité <strong>de</strong><br />
la réalisation <strong>du</strong> marché intérieur « avec <strong>les</strong> missions d'intérêt économique général qui s'imposent en<br />
Europe, concernant notamment l'aménagement équilibré <strong>du</strong> territoire, l'égalité <strong>de</strong> traitement entre <strong>les</strong><br />
citoyens [...] la qualité <strong>et</strong> la permanence <strong>du</strong> service ren<strong>du</strong> au consommateur [...]. » De son côté la<br />
Commission a proposé dans une communication [COM (96) 443] que la promotion <strong>de</strong>s services d'intérêt<br />
général soit inscrit à l'article 3 <strong>du</strong> traité comme un <strong>de</strong>s objectifs fondamentaux que doit poursuivre<br />
l'Union européenne. C<strong>et</strong>te proposition a été acceptée au somm<strong>et</strong> d’Amsterdam en juin 1997. Contribuer à<br />
la promotion <strong>de</strong>s services d’intérêt général est donc dorénavant l’un <strong>de</strong>s 21 objectifs <strong>de</strong> l’action<br />
communautaire.<br />
<strong>La</strong> formule <strong>de</strong> service universel est d’apparition plus récente. Elle apparaît dans <strong>les</strong> réglementations <strong>du</strong><br />
secteur <strong>de</strong>s communications [livre vert sur <strong>les</strong> télécommunications <strong>et</strong> sur <strong>les</strong> services postaux, proposition<br />
<strong>de</strong> directive (COM(95) 3479 relative à l'interconnexion dans <strong>les</strong> télécommunications actualiser].<br />
Empruntée au droit américain, c<strong>et</strong>te notion regroupe <strong>les</strong> services <strong>de</strong> base pour <strong>les</strong>quels un droit d'accès<br />
pour tous <strong>les</strong> citoyens est jugé indispensable. Elle correspond à une tarification à un prix abordable <strong>de</strong><br />
prestations essentiel<strong>les</strong> dont le contenu est révisable périodiquement afin <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> l'évolution<br />
CERNA 29
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
sociale <strong>et</strong> <strong>du</strong> progrès technique. D'un point <strong>de</strong> vue comptable, le service universel entraîne un manque à<br />
gagner pour <strong>les</strong> fournisseurs. Il est donc nécessaire <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s instruments qui assurent son<br />
<strong>financement</strong> (subventions croisées, fonds <strong>de</strong> <strong>financement</strong> spécial alimenté par une re<strong>de</strong>vance <strong>de</strong>s usagers,<br />
ou abondé par le budg<strong>et</strong> <strong>de</strong> l'Etat).<br />
Par contraste avec la conception juridique française, la conception communautaire <strong>de</strong>s services publics<br />
accor<strong>de</strong> une large place aux considérations économiques. <strong>La</strong> notion d’intérêt général dans <strong>les</strong> textes<br />
européens s’est longtemps uniquement référée à l’intérêt économique général. D’autre part, <strong>les</strong> notions <strong>de</strong><br />
service public <strong>et</strong> d’égalité sont centrées sur l’entreprise. <strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service universel ne concerne que le<br />
secteur marchand alors que la notion française <strong>de</strong> service public englobe <strong>les</strong> services administratifs <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
fonctions régaliennes <strong>de</strong> l’Etat. Enfin, le service d’intérêt général est dans la conception européenne une<br />
notion associée au droit <strong>de</strong> la concurrence <strong>et</strong> le souci <strong>de</strong> la Commission <strong>du</strong> fait <strong>de</strong>s responsabilités dont<br />
elle est investi par le traité <strong>de</strong> Rome se préoccupe plus <strong>de</strong> l’égalité <strong>de</strong> traitement entre <strong>les</strong> entreprises que<br />
<strong>de</strong> l’égalité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s citoyens européens.<br />
2.3. Déréglementation <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau <strong>et</strong> service public<br />
<strong>La</strong> réforme <strong>de</strong> la réglementation qui affecte <strong>les</strong> in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau a <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces<br />
sur le service public en France. Les monopo<strong>les</strong> SNCF, EDF, France Télécom ou <strong>La</strong> Poste<br />
sont <strong>de</strong>s services publics à caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial. A leur mission d'efficacité<br />
s'ajoute une fonction sociale <strong>de</strong> redistribution. Ils doivent respecter <strong>de</strong>s contraintes <strong>de</strong><br />
couverture <strong>du</strong> territoire national (ex. : <strong>de</strong>sserte <strong>du</strong> territoire en cabine téléphonique,<br />
maintien <strong>de</strong> lignes ferroviaires déficitaires) <strong>et</strong> <strong>de</strong> fourniture auprès <strong>de</strong> certaines catégories<br />
d'usagers (ex. : équipements téléphoniques spéciaux pour malentendants, ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> prix <strong>du</strong><br />
transport urbain offertes aux famil<strong>les</strong> nombreuses <strong>et</strong> aux personnes âgées). Il en est <strong>de</strong> même<br />
pour <strong>les</strong> monopo<strong>les</strong> locaux <strong>de</strong>s services d’environnement. Les entreprises concernées,<br />
filia<strong>les</strong> le plus souvent <strong>de</strong> la Générale <strong>de</strong>s eaux ou <strong>de</strong> la Lyonnaise <strong>de</strong>s eaux, sont tenues <strong>de</strong><br />
fournir leurs prestations sur l’ensemble <strong>du</strong> territoire <strong>de</strong> la commune qui leur a délégué le<br />
service public.<br />
Historiquement, <strong>les</strong> monopo<strong>les</strong> <strong>de</strong> réseau jouent en France un grand rôle dans la ré<strong>du</strong>ction<br />
d'inégalités liés à <strong>de</strong>s conditions géographiques, à l'insuffisance <strong>de</strong> revenus, ou à <strong>de</strong>s handicaps<br />
indivi<strong>du</strong>els [Stoffaes, 1994]. Le moyen traditionnel utilisé consiste à appliquer un tarif<br />
commun à plusieurs catégories d’usagers indépendamment <strong>de</strong>s écarts <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> revient qui<br />
peuvent exister pour <strong>les</strong> servir. Par exemple, le tarif <strong>de</strong> base <strong>de</strong> l’électricité en Guyane <strong>et</strong> en<br />
Martinique est i<strong>de</strong>ntique à celui pratiquée en métropole alors qu’il est beaucoup plus cher à<br />
pro<strong>du</strong>ire <strong>et</strong> à distribuer. De même en France, l’affranchissement d’une carte postale ne<br />
dépend pas <strong>de</strong> la boite à l<strong>et</strong>tre dans laquelle elle est déposée ni <strong>de</strong> l’adresse <strong>du</strong> <strong>de</strong>stinataire s’il<br />
rési<strong>de</strong> dans l’Union européenne. I<strong>de</strong>m, pour le ramassage <strong>de</strong>s or<strong>du</strong>res ménagères pour lequel<br />
la contribution <strong>de</strong>mandée aux habitants ne varie pas selon que la rési<strong>de</strong>nce est plus ou moins<br />
excentrée par rapport au circuit <strong>de</strong> collecte <strong>et</strong> à la localisation <strong>de</strong> la décharge. Certains<br />
segments <strong>de</strong> marché sont ainsi déficitaires tandis que d’autres sont bénéficiaires ; le profit<br />
<strong>de</strong>s uns compensant la perte <strong>de</strong>s autres. Le montant <strong>de</strong>s transferts qui s’opèrent entre<br />
différentes catégories d’usagers peut atteindre <strong>de</strong>s sommes très élevées. <strong>La</strong> <strong>de</strong>rnière<br />
statistique publique <strong>de</strong>s transferts entre abonnés <strong>du</strong> téléphone date <strong>de</strong> 1984. Les subventions<br />
CERNA 30
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
croisées géographiques entre zones rura<strong>les</strong> <strong>et</strong> urbaines s'élèvent à 6.8 milliards <strong>de</strong> francs, au<br />
bénéfice <strong>de</strong>s premières. Les subventions croisées entre raccor<strong>de</strong>ment <strong>et</strong> trafic qui ont pour<br />
eff<strong>et</strong> d'avantager <strong>les</strong> ménages faib<strong>les</strong> consommateurs (ce qui réunit aussi bien <strong>les</strong> famil<strong>les</strong> à<br />
faib<strong>les</strong> revenus que <strong>les</strong> propriétaires <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nces secondaires) représentent 26 milliards.<br />
C<strong>et</strong>te redistribution exercée par <strong>les</strong> in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau ne concerne pas seulement <strong>les</strong><br />
ménages entre eux <strong>et</strong> en particulier <strong>les</strong> ménages urbains au bénéfice <strong>de</strong>s ménages ruraux.<br />
D’après la même source citée pour <strong>les</strong> télécommunications, <strong>les</strong> entreprises financent à<br />
hauteur <strong>de</strong> 7,8 milliards <strong>de</strong> francs la consommation téléphonique <strong>de</strong>s ménages. De même, la<br />
tarification <strong>de</strong> l’électricité favorise <strong>les</strong> ménages au détriment <strong>de</strong>s PME-PMI [Henry, 1997].<br />
A l’inverse, certaines catégories d’entreprises comme <strong>les</strong> entreprises <strong>de</strong> presse en ce qui<br />
concerne le service postal peuvent être <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong>s subventions croisées. <strong>La</strong> Poste<br />
est soumise à une obligation <strong>de</strong> service public visant à défendre le pluralisme <strong>de</strong>s journaux<br />
d’opinion qui la con<strong>du</strong>it à distribuer <strong>les</strong> journaux <strong>et</strong> périodiques à perte.<br />
<strong>La</strong> réforme en cours <strong>de</strong> réglementation <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau est en train d’imposer <strong>de</strong>s<br />
aménagements à l’exercice <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te fonction <strong>de</strong> redistribution. <strong>La</strong> déréglementation impose<br />
en eff<strong>et</strong> une double nécessité : une re<strong>définition</strong> <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> service public dans le cadre<br />
d’une négociation ouverte à un plus grand nombre <strong>de</strong> parties <strong>et</strong> un <strong>financement</strong> plus<br />
transparent <strong>de</strong> leurs coûts.<br />
<strong>La</strong> re<strong>définition</strong> <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> service public<br />
Le régime <strong>de</strong> l'entreprise en monopole s'accommo<strong>de</strong> <strong>de</strong> missions <strong>de</strong> service public qui ne<br />
sont pas spécifiées dans le détail. L'entreprise bénéficie alors d'un pouvoir discrétionnaire<br />
dans leur interprétation <strong>et</strong> dans leur mise en oeuvre. Le périmètre <strong>de</strong>s zones déficitaires à<br />
servir, le contour <strong>de</strong>s catégories d'usagers à favoriser, le choix <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> base<br />
relèvent pour partie <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong> l'entreprise <strong>de</strong> service public <strong>et</strong> dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> sa<br />
politique d'investissement <strong>et</strong> <strong>de</strong> gestion <strong>du</strong> personnel. EDF, par exemple, a surinvestit dans<br />
<strong>les</strong> réseaux <strong>de</strong> distribution ruraux en s’appuyant sur sa mission <strong>de</strong> service public<br />
d’aménagement <strong>du</strong> territoire afin <strong>de</strong> développer une nouvelle consommation d’électricité<br />
pour le chauffage. Autre cas : celui <strong>de</strong> GDF qui assure une continuité <strong>du</strong> service à un coût très<br />
élevé en favorisant le stockage souterrain pour <strong>de</strong>s raisons qui lui sont propres <strong>de</strong> gestion<br />
d’une partie <strong>de</strong> son personnel.<br />
L’ouverture à la concurrence exige désormais une <strong>définition</strong> précise <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> service<br />
public. C<strong>et</strong>te <strong>définition</strong> fait l'obj<strong>et</strong> d'une discussion ouverte à l'ensemble <strong>de</strong>s parties prenantes<br />
<strong>et</strong> non plus d'un tête à tête à l'abri <strong>de</strong>s regards extérieurs entre le monopole <strong>et</strong> sa tutelle.<br />
L'ouverture à la concurrence dans <strong>les</strong> télécommunications illustre c<strong>et</strong>te nouvelle donne. En<br />
1996, le gouvernement <strong>et</strong> le parlement ont été amenés dans le cadre <strong>de</strong> la loi sur <strong>les</strong><br />
CERNA 31
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
télécommunications à redéfinir <strong>les</strong> missions <strong>de</strong> service public <strong>de</strong> ce secteur. El<strong>les</strong> ont été<br />
réparties en trois composantes. <strong>La</strong> première concerne le service universel. Elle comprend :<br />
la mise à disposition <strong>du</strong> service <strong>de</strong> téléphonie vocale, la fourniture d'un service <strong>de</strong><br />
renseignement <strong>et</strong> d'un annuaire d'abonnés, la gratuité <strong>de</strong>s appels d'urgence. <strong>La</strong> secon<strong>de</strong><br />
composante, celle <strong>de</strong>s services obligatoires, recouvre <strong>de</strong>s prestations moins courantes (mais<br />
que l'opérateur doit aussi offrir sur l'ensemble <strong>du</strong> territoire) comme l'accès au réseau<br />
numérique, <strong>les</strong> liaisons louées, <strong>les</strong> transmissions <strong>de</strong> données ou le télex. <strong>La</strong> <strong>de</strong>rnière<br />
composante correspond à <strong>de</strong>s missions d’intérêt général en matière <strong>de</strong> défense <strong>et</strong> <strong>de</strong> sécurité,<br />
<strong>de</strong> recherche publique <strong>et</strong> d’enseignement supérieur. Le choix <strong>de</strong> classement d'un service<br />
particulier en services universel ou en service obligatoire a été âprement discuté. Un service<br />
rangé dans la première composante <strong>de</strong>vra être offert à un tarif très bas qui sera contrôlé par<br />
l’agence <strong>de</strong> réglementation ; tandis que s'il appartient à la secon<strong>de</strong> catégorie, l'opérateur sera<br />
libre <strong>de</strong> fixer son prix. Le texte final <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> réglementation <strong>de</strong>s télécommunications qui<br />
fixe c<strong>et</strong>te nouvelle <strong>définition</strong> <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> service public est résulté <strong>de</strong> longues<br />
négociations <strong>et</strong> tractations avec l'opérateur historique mais aussi <strong>les</strong> nouveaux entrants. Il a<br />
été aussi influencé par <strong>les</strong> discussions européennes portant sur le service universel. C<strong>et</strong>te<br />
implication <strong>de</strong> l'échelon communautaire renforce le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> transparence <strong>et</strong> d'ouverture <strong>de</strong>s<br />
négociations auxquel<strong>les</strong> donnent lieu dorénavant le rôle redistributif <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau.<br />
Le <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public<br />
<strong>La</strong> réforme <strong>de</strong> la réglementation <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau m<strong>et</strong> fin à l’usage généralisée <strong>de</strong>s<br />
subventions croisées comme moyen <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public.<br />
Désormais, l’Etat ou <strong>les</strong> collectivités loca<strong>les</strong> doivent subventionner directement, c’est à dire<br />
à partir <strong>de</strong> rec<strong>et</strong>tes fisca<strong>les</strong>, <strong>les</strong> prestations non-rentab<strong>les</strong> <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> réseaux. En<br />
d’autres termes, <strong>les</strong> pouvoirs publics doivent payer aux prestataires <strong>de</strong> service <strong>les</strong> actions<br />
qu’ils leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt d’entreprendre au titre <strong>de</strong> la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s inégalités géographiques, <strong>de</strong><br />
revenus ou <strong>de</strong>s chances. Il ne suffit donc pas que <strong>les</strong> missions <strong>de</strong> service public soient<br />
précisément définies dans leur contenu, il est également nécessaire <strong>de</strong> déterminer leur coût.<br />
Le <strong>financement</strong> <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public par le mécanisme <strong>de</strong> subvention croisée est<br />
d'une gran<strong>de</strong> simplicité <strong>de</strong> mise en oeuvre mais il présente l'inconvénient d'être opaque. Il y<br />
a encore peu <strong>de</strong> temps, le voyageur d'Air Inter entre Paris <strong>et</strong> Toulouse subventionnait - sans<br />
connaître le montant <strong>de</strong> sa contribution <strong>et</strong> même le plus souvent sans le savoir -, <strong>les</strong><br />
déplacements <strong>de</strong>s usagers sur la ligne Paris-Bézier. Le plus souvent l'entreprise ne connaît<br />
pas <strong>les</strong> transferts qu'elle opère pour répondre aux obligations auxquel<strong>les</strong> elle est soumise. Dès<br />
lors qu'elle est protégée par le monopole, elle est à l'abri d'un écrémage <strong>de</strong>s segments <strong>les</strong> plus<br />
rentab<strong>les</strong> <strong>du</strong> marché <strong>et</strong> n'a donc pas besoin <strong>de</strong> chiffrer sa participation à la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s<br />
inégalités entre territoire <strong>et</strong> entre certaines catégories d'usagers. Quels type <strong>et</strong> montant <strong>de</strong><br />
CERNA 32
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
transferts entraîne le service public était il y a peu <strong>de</strong> temps une question saugrenue. En<br />
régime <strong>de</strong> concurrence, le recours aux subventions croisées est contre-indiqué : <strong>les</strong> nouveaux<br />
entrants vont s'emparer <strong>de</strong>s segments <strong>les</strong> plus rentab<strong>les</strong> <strong>et</strong> l'ancien monopole n’occupera<br />
plus qu’une position dominante sur <strong>les</strong> segments à pertes.<br />
<strong>La</strong> révélation <strong>de</strong>s transferts a un eff<strong>et</strong> déterminant sur l'évolution <strong>de</strong>s prestations qui seront<br />
offertes à tous <strong>les</strong> citoyens car elle fait apparaître <strong>les</strong> gains <strong>et</strong> <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong> bénéficiaires <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
contributeurs qui auparavant ignoraient leur participation. Elle facilite alors l'organisation <strong>de</strong><br />
nouveaux groupes d'intérêts qui vont chercher à influencer le choix public dans un sens qui<br />
leur est favorable. Dans ces circonstances, <strong>les</strong> métho<strong>de</strong>s <strong>et</strong> résultats <strong>d'évaluation</strong> <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong><br />
service public présentent un caractère stratégique. Pour l'opérateur historique <strong>de</strong>s<br />
télécommunications qui souvent bénéficie encore <strong>du</strong> monopole <strong>de</strong> la fourniture <strong>du</strong> service<br />
universel, il s'agit d'en surestimer le coût pour obtenir une compensation financière plus<br />
élevée. En Australie, l'évaluation <strong>du</strong> coût <strong>de</strong> service universel passe <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 1 à l'ordre 4<br />
entre l'estimation proposée par la compagnie dominante Telstra à partir <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
coûts totalement distribués <strong>et</strong> celle d'Austel, l'agence <strong>de</strong> réglementation, fondée sur <strong>les</strong> coûts<br />
incrémentaux. Au Royaume Uni, le cabin<strong>et</strong> d’étu<strong>de</strong> Analysis a estimé le déficit dû aux<br />
d'abonnés non-rentab<strong>les</strong> selon <strong>de</strong>ux variantes <strong>de</strong> calcul : l’une aboutit au chiffre <strong>de</strong> 58<br />
millions <strong>de</strong> livres, l’autre à 89 millions <strong>de</strong> livres.<br />
Le choix <strong>du</strong> nouveau mécanisme <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> service public fait<br />
également l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> vifs débats entre <strong>les</strong> différentes parties prenantes. Il y a <strong>de</strong>ux<br />
principa<strong>les</strong> options : celle d'un fonds spécial qui est abondé par l'ensemble <strong>de</strong>s opérateurs,<br />
ancien monopole comme nouveaux entrants, <strong>et</strong> celle d'un complément aux charges <strong>de</strong> péage<br />
que payent <strong>les</strong> exploitants <strong>de</strong> réseau aux gestionnaire d’infrastructures. Le première moyen<br />
<strong>de</strong> <strong>financement</strong> a l'avantage <strong>de</strong> pouvoir faire jouer plus facilement la concurrence sur <strong>les</strong><br />
obligations <strong>de</strong> service public <strong>et</strong> d'inciter ainsi <strong>les</strong> entreprises à être plus efficaces pour <strong>les</strong><br />
offrir. C’est la solution adoptée dans le transport aérien en France. Un fonds <strong>de</strong> péréquation<br />
financé par une taxe doit perm<strong>et</strong>tre d’équilibrer l’exploitation d’une quarantaine <strong>de</strong> lignes<br />
intérieurs dont le maintien a été jugé nécessaire à l’aménagement <strong>du</strong> territoire par <strong>les</strong><br />
pouvoirs publics. L’exploitation exclusive <strong>de</strong> ces lignes est mise en enchère <strong>et</strong> attribué à la<br />
compagnie qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> la subvention la plus faible. Le second instrument <strong>de</strong> <strong>financement</strong><br />
laisse plutôt un avantage à l'ancien monopole. Il peut manipuler plus facilement le niveau <strong>de</strong><br />
qualité ou <strong>de</strong> prix <strong>du</strong> service, <strong>et</strong> il reçoit <strong>de</strong> l'argent au lieu d'en verser. C’est la solution<br />
r<strong>et</strong>enue par la loi <strong>de</strong> réglementation <strong>de</strong>s télécommunications. France Télécom est l’unique<br />
opérateur <strong>du</strong> service universel. Ses concurrents lui versent un complément à la charge<br />
d’interconnexion <strong>de</strong> la boucle locale.<br />
Le service public <strong>de</strong>vient ainsi l'obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> comportements stratégiques <strong>de</strong> multip<strong>les</strong> firmes : <strong>les</strong><br />
décisions politiques <strong>et</strong> administratives d'inclure telle obligation ou non au cahier <strong>de</strong>s charges<br />
CERNA 33
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
<strong>de</strong>s opérateurs, d'évaluer son coût selon telle ou telle métho<strong>de</strong>, <strong>et</strong> d'en réserver l'exclusivité<br />
<strong>de</strong> fourniture à l'ancien monopole, sont autant d'occasions pour <strong>les</strong> entreprises d'obtenir <strong>de</strong>s<br />
avantages sur leurs rivaux. L'arène <strong>de</strong> la discussion <strong>de</strong>s prestations qui doivent être offertes à<br />
tous <strong>les</strong> citoyens est ainsi élargie, <strong>et</strong> elle est dorénavant éclairée par <strong>de</strong>s informations<br />
comptab<strong>les</strong>. Cela modifie le contenu <strong>de</strong>s prestations <strong>et</strong> le contour <strong>de</strong>s catégories d'usagers <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong>s zones géographiques qui en bénéficient.<br />
Mais pour savoir dans quel sens précisément ces modifications porteront il faut étudier <strong>les</strong><br />
déréglementations au cas par cas. Les groupes <strong>de</strong> pressions, <strong>les</strong> intérêts en jeux, <strong>les</strong> objectifs<br />
politiques sont différents pour le courrier postal, le transport aérien, la distribution<br />
d'électricité ou <strong>les</strong> télécommunications. En tendance cependant, il est probable que l'on<br />
s'achemine vers une contraction <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> service public. <strong>La</strong> mission sociale <strong>de</strong>s<br />
in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau est en eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> plus en plus contestée à mesure que progresse la doctrine<br />
économique libérale. Celle-ci recomman<strong>de</strong> que la redistribution prenne la voie directe <strong>de</strong><br />
l'impôt <strong>et</strong> n'interfère pas avec le marché. Si un gouvernement juge que telle portion <strong>du</strong><br />
territoire est défavorisée, il doit soutenir financièrement directement <strong>les</strong> régions concernées<br />
<strong>et</strong> non entraver le marché en manipulant la vérité <strong>de</strong>s prix <strong>du</strong> raccor<strong>de</strong>ment téléphonique,<br />
<strong>du</strong> transport ferroviaire ou <strong>du</strong> timbre poste. De même, la doctrine libérale recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
fournir une ai<strong>de</strong> directe aux personnes démunies pour qu’elle s’équipent d’un poste <strong>de</strong><br />
téléphone si l’accès à ce service est jugée primordial. Ainsi <strong>de</strong> la double dimension <strong>de</strong><br />
monopole naturel <strong>et</strong> <strong>de</strong> service public qui caractérise aujourd'hui <strong>les</strong> in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseau, la<br />
secon<strong>de</strong> est à notre avis amenée à perdre <strong>de</strong> l'importance dans <strong>les</strong> années futures. Ce qui<br />
amènera ces in<strong>du</strong>stries très particulières à perdre une partie <strong>de</strong> leur spécificité.<br />
CERNA 34
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
2. Services publics :<br />
notes <strong>de</strong> repérage<br />
François Lévêque<br />
CERNA 35
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
<strong>La</strong> question <strong>du</strong> service public dans le cas <strong>de</strong>s entreprises en monopole <strong>et</strong> dans la perspective<br />
<strong>de</strong> leur mise en concurrence est confuse. Le service public désigne aussi bien l'école que le<br />
téléphone, <strong>les</strong> obligations auprès <strong>de</strong>s usagers que <strong>les</strong> entreprises qui <strong>les</strong> servent, un droit<br />
égalitaire qu'une économie particulière à l'origine <strong>de</strong> très fortes externalités. Pour certains<br />
(Borotra, 1995), la déréglementation européenne menace l'avenir <strong>du</strong> service public en<br />
France, tandis que pour d'autres (Stoffaës, 1995), elle offre l'occasion <strong>de</strong> sa nécessaire<br />
mo<strong>de</strong>rnisation.<br />
<strong>La</strong> finalité <strong>de</strong> ce texte <strong>de</strong> travail est <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> repères sur ce qui différencie<br />
<strong>les</strong> conceptions françaises <strong>et</strong> communautaires <strong>de</strong> service public. On s'interroge, en<br />
conclusion, sur <strong>les</strong> conséquences <strong>de</strong> l'ouverture à la concurrence sur <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service<br />
public.<br />
Avant propos terminologique<br />
On ne s'intéresse ici qu'au service public marchand, c'est à dire en droit français qu'au service<br />
public à caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial. D'autre part, on distingue <strong>les</strong> obligations (ou<br />
missions) <strong>de</strong> service public <strong>de</strong>s entreprises qu'el<strong>les</strong> contraignent. Ces <strong>de</strong>rnières sont appelées<br />
entreprises <strong>de</strong> service public. Ce terme réuni aussi bien <strong>les</strong> entreprises publiques <strong>de</strong> service<br />
public (EDF, France Télécom) que <strong>les</strong> entreprises privées <strong>de</strong> service public (British Gas,<br />
Générale <strong>de</strong>s Eaux).<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service public dans le droit français 1<br />
Selon Léon Duguit (1981), relève <strong>du</strong> service public "toute activité dont l'accomplissement<br />
doit être assuré, réglé <strong>et</strong> contrôlé par <strong>les</strong> gouvernants, parce que l'accomplissement <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te<br />
activité est indispensable à la réalisation <strong>et</strong> au développement <strong>de</strong> l'interdépendance sociale,<br />
<strong>et</strong> qu'elle est <strong>de</strong> telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention<br />
<strong>de</strong> la force gouvernante".<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service public est une catégorie juridique qui caractérise l'ensemble <strong>de</strong>s<br />
interventions <strong>de</strong> l'Etat. Elle n'intro<strong>du</strong>it pas <strong>de</strong> séparation entre <strong>de</strong>s services aussi variés que<br />
l'éclairage <strong>de</strong>s rues, l'é<strong>du</strong>cation, la défense nationale ou l'entr<strong>et</strong>ien <strong>de</strong>s routes<br />
départementa<strong>les</strong> 2 .<br />
1 On se référera utilement aux artic<strong>les</strong> suivants : B Stirn (1994), J.F. <strong>La</strong>chaume (1994).<br />
2 Pour éclairer la portée très générale <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> service public, il est utile <strong>de</strong> l'associer au concept<br />
économique <strong>de</strong> bien public. On sait qu'un bien public se caractérise par <strong>de</strong>ux propriétés : la non <strong>de</strong>struction par<br />
l'usage <strong>et</strong> la non-exclusion. Les archétypes <strong>de</strong> biens publics sont le phare <strong>et</strong> la dissuasion nucléaire. Ils sont<br />
CERNA 36
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Trois principes <strong>de</strong> gestion sont associés à la notion <strong>de</strong> service public. <strong>La</strong> continuité implique<br />
qu'il n'y ait pas <strong>de</strong> rupture dans la fourniture <strong>du</strong> service. L'égalité recomman<strong>de</strong> que <strong>les</strong> usagers<br />
doivent être traités <strong>de</strong> façon i<strong>de</strong>ntique. <strong>La</strong> mutabilité rappelle que le service public doit<br />
s'adapter aux changements techniques <strong>et</strong> à l'évolution <strong>de</strong>s besoins<br />
Le premier principe n'appelle pas <strong>de</strong> commentaire. Le débat se focalise sur la question <strong>du</strong><br />
service minimum en cas <strong>de</strong> grève.<br />
Le droit <strong>de</strong>s services publics reconnaît une acception <strong>de</strong> l'égalité qui peut laisser songeur un<br />
non spécialiste. Le principe d'égalité implique en eff<strong>et</strong> "qu'il soit fait application <strong>de</strong> règ<strong>les</strong><br />
semblab<strong>les</strong> à <strong>de</strong>s situations semblab<strong>les</strong>, mais n'interdit pas qu'il soit fait application <strong>de</strong> règ<strong>les</strong><br />
différentes à <strong>de</strong>s situations différentes". Pour l'éclairer, voyons comment ce principe se<br />
tra<strong>du</strong>it dans le cas <strong>de</strong> la tarification.<br />
Première remarque, l'égalité n'implique pas que l'accès au service public soit gratuit. Il s'agit<br />
d'un droit à l'i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> traitement. C<strong>et</strong>te remarque vaut aussi bien pour <strong>les</strong> services publics<br />
administratifs <strong>et</strong> sociaux (frais d'inscription à une école <strong>de</strong> musique, participation au frais <strong>de</strong><br />
cantine scolaire) que pour <strong>les</strong> services publics à caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial pour<br />
<strong>les</strong>quels il y a obligation d'équilibrer <strong>les</strong> dépenses par <strong>les</strong> rec<strong>et</strong>tes liées aux prestations.<br />
Secon<strong>de</strong> remarque, le caractère uniforme <strong>du</strong> traitement est mo<strong>du</strong>lé par la prise en compte <strong>de</strong><br />
situations différentes. D'un point <strong>de</strong> vue juridique, rien n'oblige la SNCF <strong>et</strong> EDF à appliquer<br />
un tarif uniforme <strong>du</strong> kilomètre parcouru <strong>et</strong> <strong>du</strong> kilowattheure. <strong>La</strong> différenciation est autorisée<br />
au titre <strong>de</strong> la différence <strong>de</strong> service (comme la classe affaire ou la classe tourisme). Elle est<br />
aussi autorisée s'il y a une différence <strong>de</strong> situation "pertinente <strong>et</strong> significative" entre usagers.<br />
<strong>La</strong> différenciation entre catégories d'usagers est opposable au juge administratif. C'est en<br />
<strong>de</strong>rnier ressort, au Conseil d'Etat <strong>de</strong> se prononcer sur son bien fondé. Citons quelques cas<br />
célèbres. Le cas <strong>du</strong> bac <strong>de</strong> l'île <strong>de</strong> Ré pour lequel un tarif préférentiel pour <strong>les</strong> Rétais rési<strong>de</strong>nts<br />
a été accepté alors qu'il a été refusé pour <strong>les</strong> rési<strong>de</strong>nts secondaires <strong>et</strong> <strong>les</strong> non-îliens <strong>du</strong><br />
département. Le cas <strong>de</strong> l'école <strong>de</strong> musique <strong>de</strong> Tarbes, où une décision municipale qui<br />
discriminait <strong>les</strong> frais d'inscription selon le revenu <strong>de</strong>s famil<strong>les</strong> a été annulée. Parmi <strong>les</strong><br />
principaux critères r<strong>et</strong>enus pour accepter ou refuser une différenciation entre usagers <strong>de</strong><br />
services publics sont : le caractère à finalité sociale avérée <strong>du</strong> service (qui autorise par<br />
exemple une crèche à différencier ses tarifs selon le revenu <strong>de</strong>s parents), <strong>les</strong> conditions<br />
d'exploitation <strong>du</strong> service (gestion <strong>de</strong>s heures creuses <strong>de</strong> consommation), la part <strong>de</strong><br />
responsabilité <strong>de</strong> l'usager dans la situation dans laquelle il se trouve (un agriculteur éloigné <strong>de</strong><br />
toujours cités en référence car ils respectent <strong>de</strong> façon stricte <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux propriétés. Le plus souvent, cependant, <strong>les</strong><br />
biens publics ne s'observent pas dans une forme pure. Elargi aux formes impures, le concept recouvre alors un<br />
ensemble très disparate.<br />
CERNA 37
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
centre <strong>de</strong> la commune ne doit pas payer <strong>les</strong> surcoûts <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> son exploitation) 3 .<br />
En matière <strong>de</strong> service public à caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial, la tradition juridique<br />
adopte un sens faible <strong>de</strong> l'égalité d'accès : un principe <strong>de</strong> non discrimination plus qu'un souci<br />
d'égalitarisme. Explicitons différents <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> l'égalité d'accès. L'égalité au sens fort<br />
correspond à un accès gratuit <strong>et</strong> une qualité <strong>de</strong> service unique (ex. : l'école républicaine, ou la<br />
dissuasion nucléaire). L'égalité au sens faible correspond à l'égalité <strong>de</strong> traitement définie<br />
comme le même tarif pour une même qualité <strong>de</strong> service <strong>et</strong> pour une même catégorie<br />
d'usagers. Entre <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux, une gradation peut être obtenue en faisant varier le nombre <strong>de</strong><br />
tarifs <strong>et</strong> <strong>de</strong> qualités <strong>de</strong> service (un tarif unique <strong>et</strong> une seule qualité comme dans le cas <strong>de</strong> l'eau<br />
pour tous <strong>les</strong> habitants d'une même commune ; plusieurs tarifs mais une seule qualité, comme<br />
dans le cas d'une cantine scolaire qui propose un prix <strong>du</strong> repas plus faible pour <strong>les</strong> famil<strong>les</strong> à<br />
bas revenus ; plusieurs tarifs <strong>et</strong> plusieurs qualités accessib<strong>les</strong> à tous, c'est à dire sans<br />
discrimination liée à l'âge, au sexe, ou au nombre d'enfants contrairement aux tarifs <strong>de</strong><br />
transports ferroviaire réservés à certaines catégories <strong>de</strong> population). Un tel schéma pourrait<br />
servir à m<strong>et</strong>tre en évi<strong>de</strong>nce d'éventuels décalages entre ce que le droit impose (un sens faible<br />
<strong>de</strong> l'égalité d'accès), la différenciation pratiquée par <strong>les</strong> entreprises <strong>de</strong> service public<br />
(relativement faible jusqu'à une pério<strong>de</strong> récente comme en témoignent la tarification<br />
électrique <strong>et</strong> ferroviaire 4 ), <strong>et</strong> <strong>de</strong>s aspirations égalitaires qui assimilent le droit au téléphone<br />
au droit à l'é<strong>du</strong>cation ou à la santé. Il suggère également que le caractère uniforme <strong>de</strong> la<br />
qualité <strong>du</strong> service est une dimension centrale <strong>de</strong> l'égalité en matière <strong>de</strong> service public (voir <strong>les</strong><br />
slogans contre la santé, l'é<strong>du</strong>cation, ou même le transport ferroviaire à <strong>de</strong>ux vitesses) 5 .<br />
Le principe <strong>de</strong> mutabilité perm<strong>et</strong> d'adapter le contenu <strong>du</strong> service public à l'évolution <strong>de</strong> la<br />
société. Il a une autre conséquence <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> portée soulignée par le rapport <strong>du</strong><br />
Commissariat <strong>du</strong> Plan (1995). Il rend nécessaire <strong>de</strong> disposer d'une autorité légitime <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
règ<strong>les</strong> qui perm<strong>et</strong>tent d'attribuer la caractéristique d'intérêt général (i.e., la réalisation <strong>et</strong> le<br />
développement <strong>de</strong> l'interdépendance sociale selon <strong>les</strong> termes <strong>de</strong> Léon Duguit) à une activité.<br />
Or, aujourd'hui, ni <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> ni <strong>les</strong> autorités publiques responsab<strong>les</strong> ne sont clairement<br />
i<strong>de</strong>ntifiab<strong>les</strong> 6 .<br />
3 Pour une analyse <strong>du</strong> principe d'égalité appliqué à la tarification selon la jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s décisions <strong>du</strong><br />
Conseil d'Etat se reporter à l'article <strong>de</strong> M. Long (1995).<br />
4 On sait que le prix <strong>du</strong> kilowattheure est le même pour un habitant <strong>de</strong> Cayenne, <strong>de</strong> Calvi <strong>et</strong> <strong>de</strong> Limoges alors<br />
qu'EDF n'est pas tenue à une telle uniformité <strong>de</strong> sa tarification. Longtemps la SNCF a pratiqué un tarif<br />
kilométrique uniforme pour chaque classe sur l'ensemble <strong>du</strong> territoire <strong>et</strong> indépendamment - sauf la classe - <strong>de</strong> la<br />
qualité <strong>du</strong> service offert (vitesse, horaire, <strong>et</strong>c.). Les tarifs sont aujourd'hui très différenciés. Étudier l'arrêt <strong>du</strong><br />
Conseil d'Etat pour voir toutefois <strong>les</strong> limites à la différenciation tarifaire imposée sur la ligne <strong>de</strong> T.G.V. Paris<br />
Lille.<br />
5 On remarquera inci<strong>de</strong>mment que l'économie <strong>de</strong>s monopo<strong>les</strong> publics ne traite que <strong>du</strong> prix alors que<br />
l'intervention publique agit également sur la qualité, en particulier la variété offerte aux usagers.<br />
6 Ce qui fait dire aux auteurs <strong>du</strong> rapport <strong>du</strong> Plan que "l'Etat se légitime alors par <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> service public<br />
dont lui seul détermine la <strong>définition</strong> [<strong>et</strong> que cela] va <strong>de</strong> pair avec une vision proprement française <strong>de</strong> l'intérêt<br />
général : celle d'un intérêt public transcendant <strong>les</strong> intérêts privés, plutôt qu'un intérêt commun immanent aux<br />
CERNA 38
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
On r<strong>et</strong>iendra <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te brève présentation l'absence <strong>de</strong> référence économique <strong>et</strong> le caractère<br />
générique <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> service public dans le droit français. Elle s'étend indifféremment<br />
aux services gratuits (l'école), payants mais subventionnés (musées), <strong>et</strong> in<strong>du</strong>striels <strong>et</strong><br />
commerciaux (électricité). Ces <strong>de</strong>rniers se distinguant <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>du</strong> droit par<br />
l'obligation <strong>de</strong> rentabilité (i.e., <strong>les</strong> rec<strong>et</strong>tes perçues auprès <strong>de</strong>s usagers doivent équilibrer <strong>les</strong><br />
dépenses).<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service public en droit communautaire 7<br />
Le droit communautaire est jurispru<strong>de</strong>ntiel (i.e., interprétatif <strong>et</strong> évolutif) <strong>et</strong> hybri<strong>de</strong> (entre la<br />
tradition anglo-saxonne <strong>et</strong> romaine). Il a progressé <strong>de</strong>puis le traité <strong>de</strong> Rome vers la vision<br />
anglo-saxonne <strong>du</strong> Common <strong>La</strong>w, où droit privé <strong>et</strong> public ne sont pas dissociés.<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service public occupe une faible place dans le droit communautaire <strong>et</strong> elle n'est<br />
abordée qu'indirectement (i.e., <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> la concurrence). Le traité <strong>de</strong><br />
Rome ne mentionne le terme <strong>de</strong> service public que dans un seul article, l'article 77 consacré<br />
à la politique commune <strong>de</strong> transport 8 . Deux notions voisines sont présentes dans <strong>les</strong> textes<br />
communautaires <strong>et</strong> font l'obj<strong>et</strong> d'une <strong>définition</strong> progressive : celle <strong>de</strong> service d'intérêt<br />
économique général <strong>et</strong> celle <strong>de</strong> service universel.<br />
L'article 90 §2 autorise dans certaines limites une dérogation aux règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> la concurrence<br />
pour "<strong>les</strong> entreprises chargées <strong>de</strong> la gestion d'un service d’intérêt économique général". C<strong>et</strong>te<br />
notion n'est cependant pas définie dans <strong>les</strong> traités. Elle ne se dégage qu'à la lumière d'une<br />
suite <strong>de</strong> décisions <strong>de</strong> la Commission <strong>et</strong> d'arrêts <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> Justice sur l'autorisation <strong>de</strong><br />
monopole concernant diverses activités, comme certains services : portuaires, <strong>de</strong><br />
radiodiffusion, d'annonce d'emploi <strong>de</strong> cadre, postaux, <strong>de</strong> distribution d'électricité, <strong>et</strong>c. Les<br />
<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers cas sont très commentés par <strong>les</strong> juristes français car ils marqueraient un<br />
infléchissement <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce européenne dans un sens plus favorable à la prise en<br />
compte d'impératifs d'intérêt général dans <strong>les</strong> décisions d'exemption <strong>de</strong> la concurrence. Ils<br />
reconnaissent également explicitement l'intérêt <strong>de</strong>s subventions croisées. Il s'agit <strong>de</strong> l'affaire<br />
Corbeau (1993) <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'affaire Almelo (1994). Dans la première la Cour a jugé, a propos <strong>de</strong>s<br />
activités <strong>de</strong> la poste Belge : "il ne saurait être contesté que la régie <strong>de</strong>s Postes est chargée<br />
d'un service d'intérêt économique général consistant dans l'obligation d'assurer la collecte, le<br />
intérêts particuliers".<br />
7 Il existe désormais une littérature abondante qui analyse l'approche communautaire en matière <strong>de</strong> service<br />
public : pour une vision d'ensemble <strong>de</strong>stinée au non-spécialiste voir Cohen Tanugi (1994) ; voir R. Le Mestre<br />
(1995) <strong>et</strong> J.L. Dewost (1994) pour une analyse d'ensemble juridique ; voir F. Hamon (1993 <strong>et</strong> 1994) pour une<br />
analyse juridique <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong>s affaires Corbeau <strong>et</strong> Almelo.<br />
8 C<strong>et</strong> article prévoit la compatibilité <strong>de</strong>s "ai<strong>de</strong>s qui répon<strong>de</strong>nt aux besoins <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong>s transports ou<br />
correspon<strong>de</strong>nt au remboursement <strong>de</strong> certaines servitu<strong>de</strong>s inhérentes à la notion <strong>de</strong> service public". Nulle part<br />
CERNA 39
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
transport <strong>et</strong> la distribution <strong>du</strong> courrier, sur l'ensemble <strong>du</strong> territoire <strong>de</strong> l'Etat membre<br />
concerné, à <strong>de</strong>s tarifs uniformes <strong>et</strong> à <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> qualité similaires, sans égard aux<br />
situations particulières <strong>et</strong> au <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> rentabilité économique <strong>de</strong> chaque opération<br />
indivi<strong>du</strong>elle". Dans l'affaire commune d'Almelo, elle a jugé que l'entreprise IJM à laquelle<br />
avait été concédé un service <strong>de</strong> fourniture d'énergie électrique était chargée d'un service<br />
d'intérêt économique général. Elle s'est fondée sur le constat suivant : "l'entreprise doit<br />
assurer la fourniture ininterrompue d'énergie électrique, sur l'intégralité <strong>du</strong> territoire concédé,<br />
à tous <strong>les</strong> consommateurs, distributeurs locaux ou utilisateurs finals, dans <strong>les</strong> quantités<br />
<strong>de</strong>mandées à tout moment, à <strong>de</strong>s tarifs uniformes <strong>et</strong> à <strong>de</strong>s conditions qui ne peuvent varier<br />
que selon <strong>de</strong>s critères objectifs applicab<strong>les</strong> à tous <strong>les</strong> clients".<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service universel est plus récente. Elle apparaît dans <strong>les</strong> réglementations <strong>du</strong><br />
secteur <strong>de</strong>s communications (livres vert sur <strong>les</strong> télécommunications <strong>et</strong> sur <strong>les</strong> services<br />
postaux, proposition <strong>de</strong> directive (COM(95) 3479) relative à l'interconnexion dans <strong>les</strong><br />
télécommunications). Elle est empruntée à la législation américaine. Le service universel est<br />
un service ouvert à tous dans <strong>de</strong>s conditions d'accès <strong>et</strong> <strong>de</strong> prix raisonnab<strong>les</strong> 9 . Il est<br />
fréquemment avancé que le service universel est une notion plus étroite que celle <strong>de</strong> service<br />
public. Le rapport Borotra parle <strong>de</strong> service public restreint <strong>et</strong> <strong>de</strong> dérive minimaliste à son<br />
propos. Car le service public est définit par défaut (un service à perte pour l'exploitant qu'il<br />
est pourtant légalement tenu d'assurer 10 ) <strong>et</strong> ne concerne pas forcément tous <strong>les</strong> usagers.<br />
Aujourd'hui, la notion <strong>de</strong> service universel n'est pas <strong>du</strong> tout figée dans le droit européen. Elle<br />
sera analysée dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas sur <strong>les</strong> télécommunications.<br />
De premières différences entre <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> service public<br />
selon le droit français <strong>et</strong> le droit communautaire<br />
Deux différences principa<strong>les</strong> sont à r<strong>et</strong>enir. <strong>La</strong> première porte sur la référence à l'économie.<br />
<strong>La</strong> notion <strong>de</strong> service public en France est déliée <strong>de</strong> toute référence à l'économie tandis que<br />
<strong>les</strong> références à l'économie sont omniprésentes dans <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> service public<br />
communautaire :<br />
• mention <strong>de</strong> l'intérêt économique général, <strong>et</strong> non <strong>de</strong> l'intérêt général tout court,<br />
n'est cependant définie c<strong>et</strong>te notion.<br />
9 Selon le livre vert sur la poste le service universel est un "service <strong>de</strong> base ouvert à tous, dans l'ensemble <strong>de</strong> la<br />
communauté, à <strong>de</strong>s conditions abordab<strong>les</strong> <strong>et</strong> avec un niveau <strong>de</strong> qualité standard".<br />
10 <strong>La</strong> proposition <strong>de</strong> directive (COM(95)) parle <strong>de</strong> services "qui ne peuvent être fournis qu'à perte ou dans <strong>de</strong>s<br />
conditions ne correspondant pas aux normes commercia<strong>les</strong> classiques. Les téléphones publics payants ou<br />
certains services pour <strong>les</strong> handicapés relèvent par exemple <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te catégorie".<br />
CERNA 40
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
• notion <strong>de</strong> service public centrée sur l'entreprise 11 ,<br />
• notion associée au droit <strong>de</strong> la concurrence.<br />
<strong>La</strong> secon<strong>de</strong> concerne le caractère générique ou spécifique <strong>de</strong>s notions. Le service public à<br />
caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial n'est qu'une division <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> service public tandis<br />
que dans le droit communautaire <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> service universel <strong>et</strong> <strong>de</strong> service d'intérêt<br />
économique général s'appliquent à <strong>de</strong>s situations particulières <strong>et</strong> ne sont subsumées par<br />
aucune autre catégorie plus générale.<br />
Ces oppositions sont-el<strong>les</strong> irré<strong>du</strong>ctib<strong>les</strong> ? Une vision pragmatique con<strong>du</strong>it à dire que le<br />
compromis est aisé puisqu'une conception part <strong>de</strong> la référence étatique pour se rapprocher<br />
<strong>de</strong> la référence au marché (élaboration <strong>de</strong> la catégorie <strong>de</strong> service public à caractère in<strong>du</strong>striel<br />
<strong>et</strong> commercial) tandis que l'autre procè<strong>de</strong> <strong>de</strong> la référence exclusive au marché <strong>et</strong> se dirige<br />
vers la prise en compte <strong>de</strong> l'objectif <strong>de</strong> cohésion sociale (service universel définit en<br />
référence à l'article 90§2 <strong>et</strong> à l'article 130 A). El<strong>les</strong> finiront donc par se rejoindre ! <strong>La</strong><br />
question se limite alors à la position finale médiane précise <strong>du</strong> curseur selon <strong>les</strong> différents<br />
secteurs (transports ferroviaires, poste, électricité, <strong>et</strong>c.). C'est la position <strong>de</strong> C. Henry <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
C. Stoffaës. Remarquons qu'une telle vision revient à considérer que l'Etat <strong>et</strong> le marché sont<br />
<strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> coordination substituab<strong>les</strong>. Leurs différences rési<strong>de</strong>nt simplement dans leurs<br />
performances relatives ; performances variant selon <strong>les</strong> circonstances historiques, <strong>les</strong><br />
contextes techniques <strong>et</strong> <strong>de</strong> consommation. Les doctrines sont alors balayées <strong>et</strong> mises au<br />
rebut. Mais plutôt que <strong>les</strong> passer sous le tapis, essayons <strong>de</strong> <strong>les</strong> clarifier.<br />
<strong>La</strong> double nature <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> service public à caractère<br />
in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial<br />
Les entreprises <strong>de</strong> service public se prêtent à <strong>de</strong>ux discours : l'un m<strong>et</strong> en avant leur<br />
dimension économique, l'autre souligne leur contribution à la cohésion nationale.<br />
Posons alors que <strong>les</strong> entreprises <strong>de</strong> service public se caractérisent par :<br />
1. la nature économique particulière <strong>de</strong> leurs activités : el<strong>les</strong> combinent caractéristiques <strong>de</strong><br />
ren<strong>de</strong>ments croissants <strong>et</strong> source d'externalités positives ;<br />
2. la contribution <strong>de</strong> leurs activités à assurer une certaine égalité entre citoyens : un principe<br />
<strong>de</strong> justice distributive leur est associé.<br />
11 Ainsi d'ailleurs que la notion d'égalité : la politique <strong>de</strong> la concurrence qui encadre <strong>les</strong> développements sur<br />
<strong>les</strong> services publics vise à assurer l'égalité entre <strong>les</strong> entreprises.<br />
CERNA 41
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
<strong>La</strong> première dimension, celle <strong>de</strong> l’efficacité, est celle qu'étudient exclusivement <strong>les</strong><br />
économistes <strong>de</strong>s réseaux. L'unique préoccupation est celle <strong>de</strong> la maximisation <strong>du</strong> surplus. On<br />
connaît le raisonnement : en situation <strong>de</strong> monopole naturel <strong>et</strong> d'eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> club, le marché est<br />
pris en défaut <strong>et</strong> l'allocation inefficace doit être corrigée par l'intervention publique. <strong>La</strong><br />
dimension redistributive est ignorée car on raisonne en équilibre partiel - <strong>les</strong> compensations<br />
se réalisent quelque part ailleurs dans l'économie.<br />
<strong>La</strong> secon<strong>de</strong> dimension, celle <strong>de</strong> l’équité, est traditionnellement laissée au soin <strong>de</strong>s spécialistes<br />
<strong>du</strong> droit ou <strong>de</strong>s sciences politiques.<br />
Ces <strong>de</strong>ux dimensions sont-el<strong>les</strong> séparées ou liées, <strong>et</strong> dans ce <strong>de</strong>rnier cas comment ?<br />
Quelques lignes <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>s doctrines <strong>du</strong> service public<br />
Une première opposition porte sur le principe d'égalité. Nous avons vu que le droit<br />
administratif s’accommo<strong>de</strong> d'un principe d'égalité au sens faible. Il n'y a pas pour autant<br />
consensus. Certains soutiennent que le principe d'égalité au sens fort <strong>de</strong>vrait s'appliquer à la<br />
gestion <strong>de</strong> services publics comme le train, l'électricité ou la poste. Les conséquences en<br />
terme <strong>de</strong> redistribution sont importantes. Dans le cas <strong>de</strong> l'égalité au sens faible, la<br />
redistribution ne doit s'opérer qu'entre catégories d'usagers. Les transferts à travers <strong>de</strong>s<br />
subventions publiques sont exclus. En revanche, dans le cas <strong>de</strong> l'égalité forte, la rentabilité ne<br />
doit pas être une contrainte qui détermine la qualité <strong>du</strong> service ren<strong>du</strong> ; l'activité <strong>de</strong> service<br />
public n'est possible que grâce à une redistribution entre payeurs d'impôts <strong>et</strong> usagers 12 .<br />
<strong>La</strong> secon<strong>de</strong> opposition concerne le lien entre la nature économique <strong>et</strong> la nature <strong>de</strong> justice<br />
distributive <strong>du</strong> service public à caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial, entre efficacité <strong>et</strong> équité.<br />
Les positions divergent sur l'absence ou la présence d'une relation, <strong>et</strong> sa nature.<br />
Les doctrines exclusives <strong>de</strong> l'efficacité <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'équité<br />
<strong>La</strong> première se préoccupe uniquement d'efficacité. C<strong>et</strong>te doctrine <strong>du</strong> service public<br />
condamne l'intervention publique sur un marché à <strong>de</strong>s fins redistributives. <strong>La</strong> redistribution<br />
n'est pas frappée d'interdit, mais elle doit emprunter la voie <strong>de</strong> la fiscalité <strong>et</strong> non la voie<br />
tarifaire. <strong>La</strong> seule intervention légitime est la correction <strong>de</strong>s défauts <strong>de</strong> marché pour rétablir,<br />
ou se rapprocher, d'une allocation Paréto-optimale. Les notions d'intérêt économique<br />
12 Dès lors que l'on pose que <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service public répon<strong>de</strong>nt à un objectif <strong>de</strong> redistribution, une<br />
<strong>de</strong>s questions à traiter est pourquoi c<strong>et</strong>te redistribution n'est pas assurée par l'impôt. Quel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong> sources<br />
d’inefficacité <strong>de</strong> l'impôt ? Quels sont <strong>les</strong> avantages <strong>et</strong> <strong>les</strong> inconvénients respectifs <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
redistribution que sont la redistribution fiscale <strong>et</strong> la redistribution tarifaire ? Il conviendra <strong>de</strong> rechercher <strong>les</strong><br />
CERNA 42
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
général <strong>et</strong> <strong>de</strong> service public à caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial se confon<strong>de</strong>nt alors avec la<br />
correction <strong>de</strong>s externalités, <strong>de</strong>s eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> club ou <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments croissants.<br />
C<strong>et</strong>te doctrine s'appuie sur la nouvelle économie <strong>du</strong> bien-être 13 . Il est important <strong>de</strong> souligner<br />
qu'il ne s'agit pas d'une doctrine libérale. En la matière, la doctrine libérale consisterait à<br />
supprimer l'intervention publique <strong>de</strong> réglementation <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> réseaux. En eff<strong>et</strong>, la<br />
vision libérale <strong>de</strong> la réglementation nie que l'autorité publique puisse agir dans le sens <strong>de</strong><br />
l'efficacité. <strong>La</strong> réglementation est un jeu <strong>de</strong> pure redistribution entre groupes d'intérêts <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
défauts <strong>de</strong> marché ne sont qu'un prétexte, qu'un écran <strong>de</strong> fumée dressé par l'économie<br />
publique.<br />
<strong>La</strong> doctrine exclusive <strong>de</strong> l'équité ne se fon<strong>de</strong> que sur <strong>de</strong>s considérations <strong>de</strong> redistribution. Elle<br />
est assortie d'un sens fort <strong>de</strong> l'égalité. Elle revient par exemple à accor<strong>de</strong>r à l'ensemble <strong>de</strong> la<br />
population d'un pays, ou d'une commune, le droit d'accé<strong>de</strong>r gratuitement au téléphone, à<br />
l'électricité, ou au ramassage <strong>de</strong>s déch<strong>et</strong>s. On reconnaît la doctrine <strong>de</strong>s plus ar<strong>de</strong>nts<br />
défenseurs <strong>du</strong> service public à la française. Elle n'intro<strong>du</strong>it aucune distinction <strong>de</strong> nature entre<br />
service public à caractère in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial <strong>et</strong> service public administratif, entre par<br />
exemple le service <strong>de</strong> la police nationale <strong>et</strong> le service postal. Pour ses tenants, il n'est pas<br />
question <strong>de</strong> composer avec <strong>de</strong>s considérations économiques, en particulier <strong>de</strong> différencier <strong>les</strong><br />
services selon <strong>les</strong> revenus.<br />
Plus intéressantes, car plus réalistes, sont <strong>les</strong> doctrines <strong>de</strong> compromis entre efficacité <strong>et</strong><br />
redistribution. Pour filer la métaphore pâtissière, on dira que ces doctrines adm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong>s<br />
relations entre la taille <strong>du</strong> gâteau <strong>et</strong> <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> son partage (e.g., certaines règ<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
répartition peuvent con<strong>du</strong>ire à saper <strong>les</strong> efforts d'accroissement <strong>de</strong> la richesse ; il n'y a alors<br />
que <strong>de</strong>s parts minuscu<strong>les</strong> à se partager).<br />
Deux doctrines <strong>du</strong> service public peuvent être opposées : celle qui accor<strong>de</strong> un primat à<br />
l'efficacité sur la redistribution, <strong>et</strong> celle qui accor<strong>de</strong> un primat <strong>de</strong> la redistribution sur<br />
l'efficacité. C'est sans doute là que se situe l'opposition principale <strong>de</strong> doctrine entre la<br />
conception défen<strong>du</strong>e par la France <strong>et</strong> la conception défen<strong>du</strong>e par la Commission. <strong>La</strong><br />
première n'ignore pas l'impératif d'efficacité, <strong>et</strong> la secon<strong>de</strong> reconnaît l'impératif <strong>de</strong><br />
principa<strong>les</strong> réponses déjà apportées dans la littérature économique.<br />
13 Rappelons qu'il s'agit <strong>de</strong> maximiser le niveau moyen <strong>de</strong> bien-être indivi<strong>du</strong>el. <strong>La</strong> limite <strong>de</strong> l’économie <strong>du</strong><br />
bien-être est <strong>de</strong> ne pas trancher entre <strong>de</strong>ux solutions optima<strong>les</strong> correspondant à <strong>de</strong>s répartitions très différentes<br />
entre indivi<strong>du</strong>s. Plus encore, si le niveau moyen <strong>de</strong> bien-être augmente marginalement mais au prix d'un<br />
accroissement considérable <strong>de</strong>s inégalités, c<strong>et</strong>te solution est jugée préférable. L'utilitarisme ordinal n'accor<strong>de</strong><br />
aucune place au principe d'égalité (minimisation <strong>de</strong> la dispersion <strong>de</strong> bien-être indivi<strong>du</strong>el). L'économiste laisse<br />
alors le soin au politique (i.e., le vote) <strong>de</strong> choisir entre <strong>les</strong> différents états Paréto-optimaux. Mais surgit avec ce<br />
passage au critère <strong>de</strong> la majorité, la possibilité d'irrationalité collective inhérente à toute procé<strong>du</strong>re<br />
d’agrégation purement ordinale <strong>de</strong>s préférences indivi<strong>du</strong>el<strong>les</strong> qui s'écarte <strong>du</strong> principe <strong>de</strong> Paréto pour en rompre<br />
l'indétermination (paradoxe <strong>de</strong> Condorc<strong>et</strong> <strong>et</strong> théorème d'impossibilité d'Arrow). Le bien-être <strong>de</strong>s indivi<strong>du</strong>s<br />
cesse alors d'être la seule information pertinente pour gui<strong>de</strong>r <strong>les</strong> choix collectifs.<br />
CERNA 43
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
redistribution (sous le terme <strong>de</strong> cohésion sociale <strong>et</strong> en référence à l'article 130) en ce qui<br />
concerne <strong>les</strong> activités <strong>de</strong> réseaux.<br />
Selon la conception <strong>de</strong> la Commission, il s'agit <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> modalités <strong>de</strong> mise en<br />
oeuvre d'obligations <strong>de</strong> service universel compatib<strong>les</strong> avec l'ouverture à la concurrence<br />
(ouverture qui est la condition <strong>de</strong> l'efficacité, i.e., qui accroît la richesse globale).<br />
Dans la conception française, <strong>les</strong> objectifs <strong>de</strong> performances économiques doivent<br />
s’accommo<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s impératifs <strong>de</strong> redistribution. C'est ainsi que le maintien <strong>de</strong> certaines lignes<br />
ferroviaires est défen<strong>du</strong> alors qu'il renchérit le coût moyen <strong>de</strong> la SNCF, <strong>et</strong> qu'il serait plus<br />
économique pour la collectivité <strong>de</strong> payer le taxi à ceux qui <strong>les</strong> empruntent. En ce qui<br />
concerne le droit <strong>de</strong> la concurrence, il s'agit d'en aménager <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> rendre<br />
compatib<strong>les</strong> avec <strong>les</strong> objectifs <strong>de</strong> redistribution.<br />
D'un point <strong>de</strong> vue théorique la doctrine <strong>de</strong> compromis qui privilégie l'efficacité peut être<br />
utilement rapprochée <strong>de</strong>s travaux sur la justice redistributive, en particulier ceux <strong>de</strong> Rawls 14 .<br />
Les conséquences <strong>de</strong> l'ouverture à la concurrence sur <strong>les</strong><br />
obligations <strong>de</strong> service public<br />
El<strong>les</strong> diffèrent selon que leurs analyse sépare ou relie <strong>les</strong> questions d'efficacité <strong>et</strong> d'équité.<br />
L'approche micro-économique avance la neutralité <strong>de</strong> la libéralisation en matière <strong>de</strong> choix<br />
<strong>de</strong> périmètre <strong>de</strong> service public. Les <strong>de</strong>ux questions sont considérées comme indépendantes<br />
car l'efficacité <strong>et</strong> la redistribution peuvent (<strong>et</strong> doivent) être traitées séparément. Le<br />
périmètre <strong>de</strong> service public a un statut analogue à un objectif environnemental dans une<br />
approche <strong>de</strong> second rang. Il est fixé indépendamment <strong>du</strong> calcul économique <strong>et</strong> <strong>de</strong> façon<br />
exogène. Sa variation est dictée par <strong>de</strong>s considérations politiques, hors <strong>du</strong> champ <strong>de</strong> l'analyse<br />
économique. Indépendamment <strong>de</strong> l'ouverture à la concurrence, il peut s'étendre ou se<br />
contracter. Il s'agit <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux phénomènes disjoints.<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public, l'ouverture à la concurrence ne soulève<br />
14 Les théories <strong>de</strong> la justice redistributive sont issues <strong>de</strong> la philosophie analytique anglo-saxonne (dont la<br />
démarche est fondamentalement a-historique <strong>et</strong> fondée sur l'indivi<strong>du</strong>alisme méthodologique). <strong>La</strong> question<br />
générale qu'el<strong>les</strong> abor<strong>de</strong>nt est celle <strong>de</strong> la répartition la plus juste <strong>de</strong>s ressources entre <strong>les</strong> indivi<strong>du</strong>s. El<strong>les</strong><br />
recourent fréquemment aux robinsonna<strong>de</strong>s : soient une île où poussent <strong>les</strong> carottes sauvages <strong>et</strong> la patate douce,<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong>s habitants au goûts différents : quelle répartition initiale assurer ? Le principe Rawlsien <strong>du</strong> maximin : la<br />
maximisation <strong>du</strong> bien-être minimal. Avec Rawls, on quitte définitivement une économie pure <strong>de</strong> redistribution<br />
(i.e., pas <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction, ou encore un mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> jeux à somme nulle). En d'autres termes, le gâteau à partager doit<br />
préalablement être préparé <strong>et</strong> sa taille dépend <strong>de</strong>s règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> partage. En particulier, il y a <strong>de</strong>s inégalités efficaces :<br />
cel<strong>les</strong> qui améliorent le bien-être moyen. Mais seu<strong>les</strong> sont légitimes <strong>les</strong> inégalités qui con<strong>du</strong>isent à<br />
l'amélioration <strong>du</strong> sort <strong>de</strong>s plus défavorisés (notion <strong>de</strong> biens sociaux premiers).<br />
CERNA 44
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
alors que <strong>de</strong>s problèmes économiques d'ordre technique : comment évaluer le coût <strong>du</strong> service<br />
public <strong>et</strong> comment le financer ?<br />
Il ne s'agit pas <strong>de</strong> questions trivia<strong>les</strong>. Les monopo<strong>les</strong> <strong>de</strong> service public ne disposent pas <strong>de</strong>s<br />
informations comptab<strong>les</strong> nécessaires à l'estimation <strong>de</strong>s transferts. Ils n'en avaient pas besoin<br />
jusqu'à maintenant. Les premières évaluations <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> service public <strong>et</strong> <strong>de</strong>s subventions<br />
croisées ont débuté chez France Télécom <strong>et</strong> Air Inter avec l'ouverture à la concurrence. Ces<br />
entreprises subventionnent <strong>les</strong> télécommunications <strong>de</strong>s ménages au détriment <strong>de</strong>s<br />
entreprises, <strong>et</strong> <strong>les</strong> voyageurs <strong>de</strong> lignes secondaires au détriment <strong>de</strong>s voyageurs <strong>de</strong> lignes<br />
principa<strong>les</strong>, cependant, en l'absence <strong>de</strong> concurrents <strong>et</strong> <strong>de</strong> risque d'écrémage, <strong>les</strong> montants <strong>de</strong>s<br />
transferts n'ont pas besoin d'être connus.<br />
<strong>La</strong> question <strong>de</strong>s instruments <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>du</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public est<br />
éminemment stratégique. Les instruments choisis, nécessairement imparfaits <strong>du</strong> fait <strong>de</strong>s<br />
asymétries d'information, peuvent avantager l'ancien monopole ou <strong>les</strong> nouveaux entrants, le<br />
détenteur <strong>de</strong>s infrastructures ou <strong>les</strong> opérateurs <strong>de</strong> service, l'in<strong>du</strong>strie ou <strong>les</strong> consommateurs,<br />
<strong>et</strong>c.<br />
Selon une thèse opposée, l'ouverture à la concurrence modifie nécessairement <strong>les</strong> obligations<br />
<strong>de</strong> service public. A ma connaissance, l'argumentation <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te thèse n’est pas développée.<br />
On peut toutefois proposer trois éléments qui iraient dans son sens :<br />
• Une critique <strong>de</strong> la thèse micro-économique. <strong>La</strong> thèse <strong>de</strong> la neutralité n'est juste que si<br />
l'ont fait abstraction <strong>de</strong>s institutions. L'approche micro-économique fait l'hypothèse que<br />
<strong>les</strong> institutions sont légitimes <strong>et</strong> vertueuses.<br />
• <strong>La</strong> libéralisation modifie <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> <strong>du</strong> jeu en matière <strong>de</strong> <strong>définition</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> contrôle <strong>du</strong><br />
service public, <strong>et</strong> <strong>les</strong> espaces ouverts aux différents groupes d'intérêt. L'ouverture à la<br />
concurrence rend nécessaire d'i<strong>de</strong>ntifier une autorité publique en charge <strong>de</strong> définir <strong>et</strong> faire<br />
respecter <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service public. Elle oblige aussi à compter ; ce qui fait<br />
apparaître <strong>les</strong> gains <strong>et</strong> <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>et</strong> <strong>de</strong>s contributeurs ; ce qui facilite<br />
l'organisation en groupes d'intérêt. On passe ainsi d'une configuration où <strong>les</strong> obligations<br />
<strong>de</strong> service public sont fixées par le monopole public (salariés <strong>et</strong> dirigeants) <strong>et</strong> ses<br />
interlocuteurs gouvernementaux à une configuration où el<strong>les</strong> doivent être définies par une<br />
autorité <strong>de</strong> réglementation négociant avec <strong>de</strong> multip<strong>les</strong> groupes d'intérêts 15 .<br />
• En situation <strong>de</strong> concurrence, la qualité offerte est fixée par le marché. Il n'y a pas d'autres<br />
obstac<strong>les</strong> à la variété <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>et</strong> services que <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> différenciation <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
15 Le cas <strong>du</strong> CSA <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’ouverture à la concurrence dans la télévision est sans doute un exemple plein<br />
d’enseignements.<br />
CERNA 45
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
préférences <strong>de</strong>s consommateurs pour la diversité. En situation <strong>de</strong> concurrence ouverte,<br />
l'obligation <strong>de</strong> service public ne peut porter que sur la <strong>définition</strong> <strong>de</strong> la qualité minimale<br />
(i.e., le service <strong>de</strong> base).<br />
Bibliographie<br />
Stirn, B. (1994): "L'évolution juridique <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> service public in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial" in<br />
Stoffaës, C. "L'Europe à l'épreuve <strong>de</strong> l'intérêt général", Collection I.S.U.P.E., Editions ASPE<br />
Europe.<br />
Borotra, F. (1995) : "Faut-il défendre le service public ?", Rapport d'Information n° 2260, Les documents<br />
d'Information <strong>de</strong> l'Assemblée Nationale.<br />
Cohen Tanugi, F. (1994) "Vers un droit européen <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> réseau" in Stoffaës, C. "L'Europe à<br />
l'épreuve <strong>de</strong> l'intérêt général", Collection I.S.U.P.E., Editions ASPE Europe.<br />
Commission <strong>de</strong>s Communautés Européennes (1987) : Livre vert sur le développement <strong>du</strong> marché<br />
commun <strong>de</strong>s services <strong>et</strong> équipements <strong>de</strong> télécommunications, Commission Européenne, Bruxel<strong>les</strong>.<br />
Commission <strong>de</strong>s Communautés Européennes (1992) : Livre vert sur le développement <strong>du</strong> marché<br />
commun <strong>de</strong>s services postaux, Commission Européenne, Bruxel<strong>les</strong>.<br />
Duguit, L. (1981) : "Libertés publiques", Collection Traité <strong>de</strong> Droit Constitutionnel, Editions CUJAS.<br />
Hamon, F. (1993) : "Communautés Européennes - Litiges relatifs au versement d'ai<strong>de</strong>s communutaires",<br />
L'actualité Juridique - Droit Administratif, 20 Décembre 1993, pp. 865-869.<br />
Hamon, F. (1994) : "Communautés Européennes - Concurrence - Libre circulation <strong>de</strong>s marchandises",<br />
L'actualité Juridique - Droit Administratif, 20 Septembre 1994, pp. 637-643.<br />
Dewost, J.L. (1994) : "Service public <strong>et</strong> droit communautaire" in Stoffaës, C. "L'Europe à l'épreuve <strong>de</strong><br />
l'intérêt général", Collection I.S.U.P.E., Editions ASPE Europe.<br />
<strong>La</strong>chaume, J-F. (1994) : "L'usager <strong>du</strong> service public in<strong>du</strong>striel <strong>et</strong> commercial géré par l'entreprise<br />
publique", C.J.E.G, 30 Juin 1994, pp. 317-334.<br />
Le Mestre, R. (1995) : "Le régime juridique <strong>du</strong> service public en droit communautaire", Les P<strong>et</strong>ites<br />
Affiches, 2 Août 1995, N° 92<br />
Long, M. (1995) : "Principe d'égalité <strong>et</strong> tarification <strong>de</strong>s services publics locaux", Les P<strong>et</strong>ites Affiches, 15<br />
Mai 1995, N° 58.<br />
Rawls, J. (1971) : "A theory of justice", Oxford, Oxford University Press. (Tra<strong>du</strong>ction française :<br />
"Théorie <strong>de</strong> la Justice", 1987, Editions <strong>du</strong> seuil.)<br />
Stoffaës, C. (1994) : "L'Europe à l'épreuve <strong>de</strong> l'intérêt général", Collection I.S.U.P.E., Editions ASPE<br />
Europe.<br />
Stoffaës, C. (1995) : "Services publics, question d'avenir", Rapport au Commissariat Général <strong>du</strong> Plan,<br />
Editions Odile Jacob - <strong>La</strong> Documentation Française.<br />
CERNA 46
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
3. Les conséquences <strong>de</strong> l'ouverture<br />
à la concurrence<br />
sur <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service public<br />
François Lévêque<br />
CERNA 47
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
L'ouverture à la concurrence <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> réseaux (France Télécom, SNCF, Air Inter,<br />
<strong>et</strong>c.) ne rem<strong>et</strong> pas en cause <strong>les</strong> principes <strong>du</strong> service public français ; mais elle entraîne une<br />
réforme <strong>de</strong> leur mise en oeuvre qui se tra<strong>du</strong>ira forcément par <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>s modifications <strong>de</strong>s<br />
prestations offertes à tous <strong>les</strong> citoyens.<br />
En terme juridique le service public français se définit par <strong>de</strong>s grands principes dont celui<br />
d'égalité. Appliqué aux in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong> réseaux comme <strong>les</strong> télécommunications ou l'énergie, ce<br />
<strong>de</strong>rnier implique l'i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s usagers pour le raccor<strong>de</strong>ment au téléphone ou à<br />
l'électricité. Concrètement, il se tra<strong>du</strong>it par <strong>de</strong>ux types d'obligations pour <strong>les</strong> entreprises :<br />
servir <strong>les</strong> usagers indépendamment <strong>de</strong> leur lieu d'habitation <strong>et</strong> <strong>de</strong> la faib<strong>les</strong>se <strong>de</strong> leurs revenus,<br />
<strong>et</strong> proposer <strong>de</strong>s prestations particulières à certaines catégories <strong>de</strong> citoyens (e.g., équipements<br />
téléphoniques spéciaux pour malentendants, ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> tarif aux famil<strong>les</strong> nombreuses ou<br />
aux personnes âgées). En terme économique, le service public correspond donc à une<br />
redistribution <strong>de</strong> richesse.<br />
Il est enten<strong>du</strong> aujourd'hui que l'ouverture à la concurrence ne rem<strong>et</strong> pas en cause <strong>les</strong> principes<br />
<strong>du</strong> service public français. Le partage <strong>de</strong>s infrastructures ferroviaires, <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> téléphone,<br />
ou <strong>de</strong>s con<strong>du</strong>ites <strong>de</strong> gaz entre plusieurs opérateurs <strong>de</strong> service, au lieu d'une firme unique qui<br />
gère le réseau <strong>et</strong> sert <strong>les</strong> clients finals, n'aboutit pas à supprimer <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service<br />
public. En témoignent <strong>de</strong> nombreuses expériences étrangères dans <strong>les</strong> pays anglo-saxons<br />
comme le Royaume-Uni ou l'Australie, mais aussi dans <strong>de</strong>s pays comme la Suè<strong>de</strong> <strong>et</strong> le Japon.<br />
Sur le plan conceptuel, la disjonction entre ouverture à la concurrence <strong>et</strong> avenir <strong>de</strong>s<br />
obligations <strong>de</strong> service public est également bien établie. D'un côté, il y a la question <strong>de</strong><br />
l'efficacité, c'est à dire <strong>du</strong> choix <strong>de</strong> l'organisation in<strong>du</strong>strielle la plus performante face aux<br />
nouvel<strong>les</strong> conditions techniques <strong>et</strong> aux nouvel<strong>les</strong> aspirations <strong>de</strong>s consommateurs ; d'un autre,<br />
il y a la question <strong>de</strong> la redistribution, c'est à dire <strong>de</strong> l'objectif politique <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s<br />
inégalités d'accès aux réseaux liés à <strong>de</strong>s conditions géographiques, à l'insuffisance <strong>de</strong> revenus,<br />
ou à <strong>de</strong>s handicaps indivi<strong>du</strong>els. Les <strong>de</strong>ux problèmes sont (<strong>et</strong> doivent être) séparés. Il n'y a<br />
aucune conséquence mécanique à attendre entre la démonopolisation <strong>de</strong> France Télécom, <strong>de</strong><br />
la SNCF ou d'Air Inter <strong>et</strong> la contraction (ou l'extension) <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public.<br />
Indirectement cependant, l'ouverture à la concurrence va contribuer à remo<strong>de</strong>ler<br />
profondément le contenu <strong>de</strong> ces obligations. Comment ? A travers trois mesures <strong>de</strong> nouvelle<br />
réglementation qui accompagnent la libéralisation : la <strong>définition</strong>, l'évaluation <strong>du</strong> coût, <strong>et</strong> le<br />
choix <strong>du</strong> mécanisme <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public. Ces mesures<br />
s'imposent car l'ouverture à la concurrence exige <strong>de</strong> n'avantager ni l'ancien monopole, ni <strong>les</strong><br />
nouveaux entrants. C'est l'égalité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s opérateurs qu'impose toute politique <strong>de</strong><br />
concurrence qui influence alors l'égalité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s usagers. Détaillons chacune <strong>de</strong>s<br />
mesures <strong>et</strong> ses eff<strong>et</strong>s.<br />
CERNA 48
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Le régime <strong>de</strong> l'entreprise publique en monopole s'accommo<strong>de</strong> d'obligations qui ne sont pas<br />
spécifiées dans le détail. L'entreprise bénéficie alors d'un pouvoir discrétionnaire pour leur<br />
interprétation <strong>et</strong> leur mise en oeuvre. Le périmètre <strong>de</strong>s zones déficitaires à servir, le contour<br />
<strong>de</strong>s catégories d'usagers à favoriser, le choix <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> base relèvent pour partie <strong>de</strong><br />
ses décisions, ou résulte indirectement <strong>de</strong> sa politique d'investissement <strong>et</strong> <strong>de</strong> gestion <strong>du</strong><br />
personnel. Il est fréquent <strong>de</strong> citer l'exemple d'EDF qui offre le même prix <strong>du</strong> kilowattheure<br />
aux habitants <strong>de</strong> Cayenne <strong>et</strong> <strong>de</strong> la région parisienne, alors que nul règlement ne lui enjoint <strong>de</strong><br />
pratiquer une péréquation tarifaire si égalitaire <strong>et</strong> si éloignée <strong>de</strong> ses coûts. Le passage au<br />
régime ouvert à la concurrence entraîne une regumise à plat <strong>et</strong> un <strong>de</strong>ssin précis <strong>du</strong> contour<br />
<strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public. Un dépoussiérage s'avère alors souvent nécessaire <strong>et</strong> surtout<br />
<strong>de</strong> nouveaux choix doivent être tranchés. L'ouverture à la concurrence dans <strong>les</strong><br />
télécommunications amène par exemple aujourd'hui le gouvernement <strong>et</strong> le parlement à se<br />
prononcer sur le contenu concr<strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux catégories <strong>de</strong> service. <strong>La</strong> première concerne le<br />
service universel. Il comprend dans le proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> loi la mise à disposition <strong>du</strong> service <strong>de</strong><br />
téléphonie vocale, la fourniture d'un service <strong>de</strong> renseignement <strong>et</strong> d'un annuaire d'abonnés, la<br />
gratuité <strong>de</strong>s appels d'urgence, <strong>et</strong> la <strong>de</strong>sserte <strong>du</strong> territoire nationale en cabines publiques. <strong>La</strong><br />
secon<strong>de</strong> catégorie recouvre <strong>de</strong>s prestations moins courantes (mais que l'opérateur doit aussi<br />
offrir sur l'ensemble <strong>du</strong> territoire) comme l'accès au réseau numérique, <strong>les</strong> liaisons louées, <strong>les</strong><br />
transmissions <strong>de</strong> données ou le télex. Le choix politique <strong>de</strong> classement d'un service<br />
particulier dans une catégorie ou dans l'autre détermine le contenu <strong>du</strong> service public pour <strong>les</strong><br />
cinq prochaines années. En eff<strong>et</strong>, si le service est rangé dans la première catégorie, il <strong>de</strong>vra<br />
être offert à un prix abordable, c'est à dire en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> son coût, ce qui élargira son usage ;<br />
tandis que s'il appartient à la secon<strong>de</strong>, l'opérateur restera libre <strong>de</strong> la tarification.<br />
L'évaluation <strong>du</strong> coût <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public est un bouleversement qu'apporte<br />
l'ouverture à la concurrence. Dans le régime <strong>de</strong> l'entreprise publique en monopole, <strong>les</strong><br />
transferts <strong>de</strong> revenus liés aux obligations <strong>de</strong> service public entre zones géographiques <strong>et</strong><br />
catégories d'usagers s'opèrent à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> subventions croisées. Ce mécanisme <strong>de</strong> <strong>financement</strong><br />
est d'une gran<strong>de</strong> simplicité <strong>de</strong> mise en oeuvre. Mais il présente l'inconvénient d'être opaque.<br />
Il y a encore peu <strong>de</strong> temps, le voyageur régulier d'Air Inter entre Paris <strong>et</strong> Toulouse<br />
subventionnait - sans connaître le montant <strong>de</strong> sa contribution <strong>et</strong> même le plus souvent sans<br />
le savoir -, <strong>les</strong> déplacements <strong>de</strong>s usagers sur <strong>les</strong> lignes déficitaires. Dans ces circonstances,<br />
l'entreprise ne connaît pas elle-même le coût total <strong>de</strong>s obligations auxquel<strong>les</strong> elle est<br />
soumise. C'est une donnée que sa comptabilité ne saisit pas car le besoin n'existe pas.<br />
Combien coûte le service public était il y a peu <strong>de</strong> temps une question saugrenue. En régime<br />
<strong>de</strong> concurrence, le recours aux subventions croisées est contre-indiqué : <strong>les</strong> nouveaux<br />
entrants vont écrémer <strong>les</strong> segments rentab<strong>les</strong> <strong>du</strong> marché <strong>et</strong> l'ancien monopole se r<strong>et</strong>rouvera<br />
en position dominante uniquement là où il n'y a rien à gagner. Il faut donc prévoir un autre<br />
mécanisme <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public <strong>et</strong> par voie <strong>de</strong> conséquence<br />
CERNA 49
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
évaluer leurs coûts. <strong>La</strong> révélation <strong>de</strong>s coûts a un eff<strong>et</strong> déterminant sur l'évolution <strong>de</strong>s<br />
prestations qui seront offertes à tous <strong>les</strong> citoyens car elle fait apparaître <strong>les</strong> gains <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
pertes <strong>de</strong> bénéficiaires <strong>et</strong> <strong>de</strong> contributeurs qui auparavant s'ignoraient. Elle facilite alors<br />
l'organisation <strong>de</strong> nouveaux groupes d'intérêts qui vont chercher à influencer le choix<br />
politique dans un sens qui leur est favorable.<br />
Enfin, le choix <strong>du</strong> mécanisme <strong>de</strong> <strong>financement</strong> n'est pas non plus sans inci<strong>de</strong>nce sur <strong>les</strong><br />
obligations <strong>de</strong> service public. Il y a <strong>de</strong>ux principa<strong>les</strong> options : celle d'un fonds spécial qui est<br />
abondé par l'ensemble <strong>de</strong>s entreprises, ancien monopole comme nouveaux entrants, <strong>et</strong> celle<br />
d'un complément à la charge d'accès aux infrastructures que payent <strong>les</strong> opérateurs <strong>de</strong> service.<br />
<strong>La</strong> première a l'avantage <strong>de</strong> pouvoir faire jouer la concurrence sur <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service<br />
public <strong>et</strong> d'inciter ainsi <strong>les</strong> entreprises à être efficaces pour le fournir. C<strong>et</strong>te diminution <strong>du</strong><br />
coût peut ensuite entraîner un relèvement <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong>s prestations offertes à tous. D'un<br />
autre côté, la crainte est toujours forte en France que <strong>les</strong> fonds spéciaux soient<br />
progressivement détournés pour alimenter le budg<strong>et</strong> général <strong>de</strong> l'Etat. Les prestations se<br />
ré<strong>du</strong>iraient alors comme peau <strong>de</strong> chagrin. <strong>La</strong> secon<strong>de</strong> option laisse plutôt un avantage à<br />
l'ancien monopole. Elle l'encourage à poursuivre la fourniture d'obligations <strong>de</strong> service public<br />
<strong>de</strong> qualité, quitte à ce que leurs coûts soit trop élevées. Le service public <strong>de</strong>vient l'obj<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
comportements stratégiques <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s firmes. C<strong>et</strong>te observation vaut pour l'ensemble<br />
<strong>de</strong>s mesures qui accompagnent l'ouverture à la concurrence : inclure telle obligation ou non<br />
au cahier <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong>s opérateurs, évaluer son coût selon telle ou telle métho<strong>de</strong>, en<br />
réserver l'exclusivité <strong>de</strong> fourniture à l'ancien monopole, sont autant d'occasions d'obtenir <strong>de</strong>s<br />
avantages sur <strong>les</strong> rivaux.<br />
En obligeant à faire <strong>de</strong>s choix politiques, en révélant que le service public à un coût, <strong>et</strong> en<br />
rendant sa fourniture l'obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> comportements stratégiques <strong>de</strong> nouveaux pro<strong>du</strong>cteurs,<br />
l'ouverture à la concurrence est aussi une ouverture à l'entrée <strong>de</strong> nouveaux groupes d'intérêt.<br />
L'arène <strong>de</strong> la discussion <strong>de</strong>s prestations qui doivent être offertes à tous <strong>les</strong> citoyens s’élargit.<br />
Elle dépasse le cadre ancien <strong>de</strong>s négociations limitées aux dirigeants <strong>et</strong> salariés <strong>de</strong> l'entreprise<br />
publique <strong>et</strong> aux autorités <strong>de</strong> l'Etat. Cela va modifier le contenu <strong>de</strong>s prestations <strong>et</strong> le contour<br />
<strong>de</strong>s catégories d'usagers <strong>et</strong> <strong>de</strong>s zones géographiques qui en bénéficient. Globalement, cela<br />
con<strong>du</strong>ira à un nouveau niveau <strong>de</strong> redistribution <strong>et</strong> d'égalité d'accès aux réseaux. Mais rien ne<br />
dit qu'il sera plus faible ou plus élevé qu'aujourd'hui. Il n'y a pas <strong>de</strong> lien <strong>de</strong> causalité direct<br />
entre démonopolisation <strong>et</strong> contraction (ou extension) <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service public. Les<br />
<strong>de</strong>ux issues sont parfaitement envisageab<strong>les</strong>.<br />
CERNA 50
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
4. <strong>La</strong> réforme <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong><br />
service public : le cas <strong>de</strong>s télécommunications<br />
François Lévêque<br />
Document <strong>de</strong> la présentation <strong>du</strong> 17 avril 1996<br />
CERNA 51
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1. Définition <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service universel.<br />
2. Métho<strong>de</strong>s <strong>d'évaluation</strong> <strong>du</strong> coût <strong>du</strong> service<br />
universel.<br />
3. Mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service universel.<br />
CERNA 52
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
DEFINITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL<br />
• Exemp<strong>les</strong>.<br />
• Définition juridique.<br />
• Définition économique.<br />
CERNA 53
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
EN FRANCE AUJOURD'HUI (LOI DE 1990)<br />
• l'accès au service <strong>du</strong> téléphone à toute personne qui en fait<br />
la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>,<br />
• le raccor<strong>de</strong>ment doit être effectué dans <strong>les</strong> meilleurs délais<br />
<strong>et</strong> la qualité <strong>du</strong> service maintenu en toutes circonstances,<br />
plus la location-entr<strong>et</strong>ien d'un équipement terminal <strong>de</strong> base,<br />
• dans le principe d'égalité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s usagers,<br />
• mais aussi <strong>de</strong>s prestations diverses : mise à disposition <strong>de</strong><br />
cabines publiques ; service gratuit <strong>de</strong>s numéros 15, 17<br />
<strong>et</strong> 18 ; prise en charge <strong>du</strong> CNET ; liaisons nécessaires aux<br />
déplacement <strong>du</strong> Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République, <strong>et</strong>c.<br />
Dans le cas <strong>du</strong> réseau SFR : calendrier <strong>de</strong> couverture <strong>du</strong><br />
territoire ; contribution à la R&D ; service continu ; <strong>et</strong>c.<br />
CERNA 54
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
EN FRANCE DEMAIN (PROJET DE LOI)<br />
• le service universel <strong>du</strong> téléphone,<br />
• <strong>les</strong> services obligatoires,<br />
• <strong>les</strong> missions d’intérêt général.<br />
CERNA 55
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
LE SERVICE UNIVERSEL DU TELEPHONE<br />
<strong>La</strong> mise à disposition <strong>du</strong> service <strong>du</strong> téléphone sur tout le<br />
territoire <strong>et</strong> à un prix abordable, comprenant :<br />
• l’acheminement <strong>de</strong>s télécommunications entre abonnés,<br />
• la <strong>de</strong>sserte <strong>du</strong> territoire en cabines téléphoniques,<br />
• un annuaire, imprimé <strong>et</strong> électronique, <strong>et</strong> un service <strong>de</strong><br />
renseignements,<br />
• l’acheminement gratuit <strong>de</strong>s appels d’urgence,<br />
• <strong>de</strong>s obligations tarifaires contrôlées par le Gouvernement<br />
afin <strong>de</strong> garantir l’accès à tous <strong>et</strong> la péréquation<br />
géographique,<br />
• <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> qualité.<br />
CERNA 56
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
LES SERVICES OBLIGATOIRES<br />
fournis sur tout le territoire <strong>et</strong> dont <strong>les</strong> tarifs sont<br />
libres dans le respect <strong>de</strong>s principes<br />
<strong>du</strong> service public :<br />
• accès au réseau numérique (RNIS),<br />
• liaisons louées,<br />
• transmission <strong>de</strong> données,<br />
• services avancés <strong>de</strong> téléphonie vocal,<br />
• télex.<br />
CERNA 57
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
LES MISSIONS D’INTERET GENERAL DANS LE<br />
DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS<br />
assurées par ou pour le compte <strong>de</strong> l’Etat <strong>et</strong> prises en<br />
charge par l’Etat :<br />
• la défense <strong>et</strong> la sécurité,<br />
• l’enseignement supérieur,<br />
• la recherche publique.<br />
CERNA 58
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
AU ROYAUME-UNI<br />
Le service téléphonique <strong>de</strong> base doit être disponible à <strong>de</strong>s<br />
conditions raisonnab<strong>les</strong> pour ceux qui ont <strong>de</strong>s difficultés à<br />
payer le prix ordinaire.<br />
• Service universel <strong>de</strong> base<br />
Accès indivi<strong>du</strong>el aux réseaux <strong>de</strong> télécommunications par<br />
l'intermédiaire <strong>de</strong> commutateurs capab<strong>les</strong> d'offrir :<br />
• la téléphonie vocale,<br />
• <strong>de</strong>s services gratuits : facturation détaillée, renonciation à<br />
l’appel <strong>de</strong> numéros déterminés,<br />
• un service minimal excluant <strong>les</strong> appels départs à la place<br />
<strong>de</strong> la déconnexion,<br />
• une possibilité raisonnable d'accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s cabines<br />
téléphoniques (en particulier dans <strong>les</strong> zones urbaines<br />
pauvres <strong>et</strong> <strong>les</strong> régions rura<strong>les</strong> éloignées).<br />
• Des mesures raisonnab<strong>les</strong> doivent être prises pour<br />
perm<strong>et</strong>tre l'accès <strong>de</strong>s usagers ayant <strong>de</strong>s besoins<br />
particuliers, ou un handicap, aux services élémentaires.<br />
• En cours <strong>de</strong> discussion : une extension <strong>du</strong> service<br />
universel pour un niveau plus élevé <strong>de</strong> service à certains<br />
groupes d'usagers (e.g., liaison à haut débit pour <strong>les</strong><br />
éco<strong>les</strong>). Différents niveaux <strong>de</strong> service universel peuvent<br />
alors correspondre à différents groupes d'usagers.<br />
CERNA 59
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
DÉFINITION JURIDIQUE<br />
Deux types d'obligations : l'obligation <strong>de</strong> service universel à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong><br />
couverture <strong>du</strong> territoire <strong>et</strong> d'accès au plus grand nombre, <strong>et</strong> <strong>de</strong>s obligations<br />
ciblées sur certains services <strong>et</strong> catégories <strong>de</strong> population.<br />
Le second type est moins coûteux <strong>et</strong> pose moins <strong>de</strong> problème <strong>d'évaluation</strong><br />
<strong>de</strong> coût.<br />
"To make available so far as possible, to all people in the United States, a<br />
rapid, efficient, nationwi<strong>de</strong>, and worlwi<strong>de</strong> wire and radio communications<br />
service with a<strong>de</strong>quate facilities at reasonable cost".<br />
"Accès indivi<strong>du</strong>el à la téléphonie vocale, ou à un service équivalent, pour tous<br />
ceux qui en font raisonnablement la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, à un prix abordable,<br />
indépendamment <strong>de</strong> l'endroit où ils vivent" (OFTEL, 1995).<br />
"Le service universel <strong>de</strong> télécommunications fournit à tous un service<br />
téléphonique <strong>de</strong> qualité à un prix abordable" (Proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> loi française, version<br />
<strong>du</strong> 3 avril 1996).<br />
"Les principes d'universalité, d'égalité, <strong>de</strong> continuité sont à la base <strong>du</strong> service<br />
universel pour perm<strong>et</strong>tre l'accès à un ensemble minimal <strong>de</strong> services définis<br />
d'une qualité donnée, ainsi que la fourniture <strong>de</strong> ces services à tous <strong>les</strong><br />
utilisateurs, indépendamment <strong>de</strong> leur localisation <strong>et</strong>, à la lumière <strong>de</strong><br />
conditions spécifiques nationa<strong>les</strong>, à un prix abordable" (Résolution <strong>du</strong><br />
Conseil 94/C48/01).<br />
CERNA 60
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
DEFINITION ECONOMIQUE<br />
Par rapport à l'opérateur (Cave)<br />
Les services universels sont <strong>les</strong> services qu'un opérateur est<br />
obligé d'offrir <strong>et</strong> qui lui font subir une perte, même s'il est<br />
efficace.<br />
Par rapport à l'ensemble <strong>de</strong> la collectivité (Curien)<br />
<strong>La</strong> différence entre le surplus total avec <strong>et</strong> sans service<br />
public. Comprend quatre termes :<br />
• déficit d'accès lié au raccor<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> groupe d'abonnés<br />
non rentab<strong>les</strong>,<br />
• surplus associé au trafic reçu par ces nouveaux abonnés<br />
(externalité <strong>de</strong> réseau),<br />
• surplus associé au trafic émis par <strong>les</strong> abonnés non<br />
rentab<strong>les</strong>,<br />
• eff<strong>et</strong> externe dit <strong>de</strong> cohésion <strong>et</strong> d'intégration sociale.<br />
CERNA 61
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
L'EVALUATION DU COUT DU SERVICE<br />
UNIVERSEL<br />
• Position <strong>du</strong> problème.<br />
• Métho<strong>de</strong>s.<br />
• Exemp<strong>les</strong>.<br />
CERNA 62
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
POSITION DU PROBLEME<br />
L'abonné rentable <strong>et</strong> l'abonné non rentable : l'égalité rec<strong>et</strong>te<br />
moins coûts, mais quels coûts <strong>et</strong> quel<strong>les</strong> rec<strong>et</strong>tes ?<br />
Ordres <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur :<br />
• au Royaume-Uni, le nombre d'usagers non rentab<strong>les</strong> servis<br />
est estimé à 2,5 millions (environ 12% <strong>du</strong> total <strong>de</strong>s<br />
abonnés). On compte 25 000 déconnexions par mois pour<br />
impayés.<br />
• en France <strong>de</strong> 2 à 6 milliards <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> service universel<br />
(pour 140 Mds <strong>de</strong> CA <strong>et</strong> 9 Mds <strong>de</strong> résultats n<strong>et</strong>s). Au<br />
Royaume-Uni, <strong>de</strong> 0,8 à 1,3 Mds <strong>de</strong> francs soit 0,3 à 0,7 %<br />
<strong>du</strong> CA <strong>de</strong> B.T., en Australie <strong>de</strong> 4,5 à 14 % <strong>du</strong> CA <strong>de</strong><br />
Telstra.<br />
Le déséquilibre : tarif d'accès (raccor<strong>de</strong>ment <strong>et</strong><br />
abonnement)/tarif <strong>de</strong> communication.<br />
Les rec<strong>et</strong>tes per<strong>du</strong>es <strong>de</strong>s abonnés non rentab<strong>les</strong>.<br />
L'allocation <strong>de</strong>s coûts communs dans le cas <strong>de</strong> firmes multipro<strong>du</strong>its<br />
CERNA 63
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
coût <strong>de</strong> l’interurbain<br />
prix <strong>de</strong> l’interurbain<br />
coût <strong>de</strong> la boucle locale<br />
prix <strong>de</strong> la boucle locale<br />
Abonné non rentable<br />
Les communications interurbaines ne compensent pas le déficit d’accès.<br />
coût <strong>de</strong> l’interurbain<br />
prix <strong>de</strong> l’interurbain<br />
coût <strong>de</strong> la boucle locale<br />
prix <strong>de</strong> la boucle locale<br />
Abonné rentable<br />
Les communications interurbaines compensent le déficit d’accès.<br />
CERNA 64
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Subventions croisées géographiques (1984)<br />
lieu zones rura<strong>les</strong> zones urbaines gran<strong>de</strong>s<br />
agglomérations<br />
transfert<br />
(milliards <strong>de</strong><br />
francs)<br />
Source : France Télécom<br />
-6,8 1,2 5,6<br />
Subventions croisées entre raccor<strong>de</strong>ment <strong>et</strong><br />
trafic (1984)<br />
pro<strong>du</strong>it raccor<strong>de</strong>ment trafic local trafic<br />
interurbain<br />
transfert<br />
(milliards <strong>de</strong><br />
francs)<br />
Source : France Télécom<br />
-26 19,5 6,5<br />
Rééquilibrage entre <strong>les</strong> communications loca<strong>les</strong> <strong>et</strong><br />
interurbaines (1984)<br />
communications interurbaines loca<strong>les</strong><br />
multiplication<br />
<strong>de</strong>s tarifs<br />
Source : France Télécom<br />
par 2/3 par 2<br />
Rééquilibrage entre <strong>les</strong> communications <strong>et</strong> le<br />
raccor<strong>de</strong>ment (1984)<br />
pro<strong>du</strong>it<br />
multiplication<br />
<strong>de</strong>s tarifs<br />
Source : France Télécom<br />
communication<br />
s interurbaines<br />
communications<br />
loca<strong>les</strong><br />
raccor<strong>de</strong>ment<br />
par 1/3 par 1,2 par 3,3<br />
CERNA 65
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
LES DEUX PRINCIPALES METHODES<br />
• Coûts totalement distribués.<br />
• Coûts évitab<strong>les</strong>.<br />
CERNA 66
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
CALCUL PAR LA METHODE DES COUTS<br />
EVITABLES DE LA CONTRIBUTION NETTE D’UN<br />
ABONNE AU SU<br />
Facture <strong>de</strong> l’abonné<br />
CTD <strong>de</strong> l’abonné<br />
Ajouter si nécessaire <strong>les</strong><br />
appels reçus<br />
Revenu dû à l’abonné<br />
Soustraction <strong>de</strong>s coûts<br />
joints<br />
Appels remplacés<br />
Revenu équitable dû à<br />
l’abonné<br />
Coût évitable <strong>de</strong><br />
l’abonné<br />
Coût n<strong>et</strong> <strong>du</strong> service<br />
universel<br />
CERNA 67
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
COUTS TOTALEMENT DISTRIBUES : LA<br />
METHODE COMPTABLE TRADITIONNELLE<br />
Tous <strong>les</strong> coûts sont répartis sur <strong>les</strong> différents services. Les<br />
coûts non directement attribuab<strong>les</strong> sont ventilés grâce à une<br />
clef <strong>de</strong> répartition au prorata d'une variable d'usage aisément<br />
observable (coûts directs, chiffre d'affaires).<br />
Inconvénients :<br />
• plus la firme génère <strong>de</strong> charges indirectes, plus l'allocation<br />
<strong>de</strong>s coûts repose sur le choix <strong>de</strong> la clef <strong>de</strong> répartition <strong>et</strong><br />
plus la métho<strong>de</strong> est arbitraire,<br />
• ne tient pas compte <strong>de</strong>s inefficacités éventuel<strong>les</strong> <strong>du</strong><br />
fournisseur <strong>de</strong> service universel.<br />
Avantages :<br />
• garanti l'équilibre financier <strong>de</strong> l'opérateur historique,<br />
• faible coût en collecte d’information.<br />
CERNA 68
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
LA METHODE DU COUT EVITABLE<br />
C'est la métho<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne, préconisée par la Commission.<br />
Elle consiste à calculer <strong>les</strong> dépenses économisées par la<br />
déconnexion <strong>de</strong>s abonnés non rentab<strong>les</strong>. Elle suit une<br />
procé<strong>du</strong>re itérative. L'abonné est au bas <strong>de</strong> l'échelle, puis on<br />
considère <strong>de</strong>s groupes d'abonnés, <strong>de</strong>s commutateurs, <strong>de</strong>s<br />
commutateurs <strong>de</strong> transit <strong>et</strong> finalement <strong>les</strong> districts. A chaque<br />
fois, le montant <strong>de</strong>s coûts évitab<strong>les</strong> augmente. Ainsi dans un<br />
premier temps, seuls <strong>les</strong> frais <strong>de</strong> maintenance <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
fonctionnement entrent dans c<strong>et</strong>te catégorie. Puis il faut<br />
ajouter le génie civil, <strong>les</strong> infrastructures dépendant <strong>du</strong><br />
commutateur, une partie <strong>de</strong>s frais d'administration... Au<br />
niveau national, l'ensemble <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong>vient évitable puisqu'il<br />
s'agit <strong>de</strong>s coûts évitab<strong>les</strong> <strong>de</strong> long terme.<br />
Avantage :<br />
• plus proches <strong>de</strong>s coûts réellement subis<br />
Inconvénient :<br />
• réclame <strong>de</strong>s informations très coûteuses à collecter<br />
CERNA 69
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
a<br />
CALL REPLACEMENT<br />
b<br />
U<br />
P<br />
c<br />
U = “Unprofitable” customers<br />
P = “Profitable” customers<br />
There will be different replacement rates for flows “a”, “b” and “c”.<br />
CERNA 70
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
AVOIDABLE AND JOINT COSTS AT DIFFERENT<br />
ANALYTIC LEVELS<br />
Decision<br />
level<br />
Examp<strong>les</strong> of cost items and categorisation<br />
Electricity Wear &<br />
Tear of switches<br />
Customer<br />
connection to<br />
exchange<br />
Terminal<br />
exchange cost<br />
N<strong>et</strong>work District<br />
office<br />
PSTN<br />
Central<br />
office<br />
Output Avoidable Joint<br />
Customer Avoidable Joint<br />
Exchange Avoidable Joint<br />
District Avoidable Joint<br />
Telephon<br />
e n<strong>et</strong>work<br />
All components of telephony costs are avoidable<br />
Telecom<br />
All Telecom costs are avoidable<br />
CERNA 71
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
TABLEAU COMPARATIF DE L’ALLOCATION DES<br />
Allocation <strong>de</strong>s revenus<br />
Appels ‘sortants’<br />
Locaux<br />
Nationaux<br />
Appels reçus<br />
Locaux<br />
Nationaux<br />
Divers<br />
COUTS ET DES REVENUS (INDICES)<br />
Opérateur<br />
40<br />
40<br />
BTCE<br />
20<br />
30<br />
20<br />
20<br />
TOTAL 100 150<br />
Allocation <strong>de</strong>s coûts<br />
Boucle locale<br />
Administration locale<br />
Administration <strong>de</strong> district<br />
Coût <strong>de</strong>s appels reçus<br />
22<br />
10<br />
20<br />
22<br />
7<br />
8<br />
13<br />
Charges indirectes<br />
98<br />
TOTAL 150 50<br />
40<br />
40<br />
CERNA 72
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
ANALYSIS estime le coût <strong>du</strong> service universel à :<br />
(en millions <strong>de</strong> £) Scénario <strong>de</strong> base Variante<br />
Coût financier (BT) : total,<br />
dont<br />
zones non rentab<strong>les</strong><br />
usagers non rentab<strong>les</strong> <strong>de</strong>s<br />
autres zones<br />
Avantages non financiers<br />
(BT)<br />
zones non rentab<strong>les</strong><br />
usagers non rentab<strong>les</strong> <strong>de</strong>s<br />
autres zones<br />
89<br />
21<br />
68<br />
49 à 80<br />
12<br />
37 à 68<br />
58<br />
9<br />
49<br />
33 à 54<br />
5<br />
28 à 49<br />
COUT NET DU SERVICE<br />
UNIVERSEL (BT)<br />
9 à 40* 4 à 25**<br />
Coût financier (KC) 0,4 0,4<br />
* 70 à 300 millions <strong>de</strong> francs environ (au 12 octobre 1995, 1£ = 7,84 FF)<br />
** 30 à 200 millions <strong>de</strong> francs<br />
CERNA 73
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
LES MODES DE FINANCEMENT<br />
Deux principaux mo<strong>de</strong>s : à travers <strong>les</strong> charges<br />
d'accès ou par un fonds spécial.<br />
• Royaume-Uni : charge d'accès mais passage vers<br />
le fonds <strong>de</strong> service universel en 1997.<br />
• Australie : fonds spécial.<br />
• France : charges d'accès pour <strong>les</strong> obligations dont<br />
France Télécom est l'opérateur unique, <strong>et</strong> fonds<br />
pour <strong>les</strong> autres obligations (e.g., services auprès<br />
<strong>de</strong>s malentendants, annuaire d'abonnés). A terme,<br />
le <strong>financement</strong> via <strong>les</strong> charges d'accès serait<br />
supprimé.<br />
CERNA 74
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
LES CHARGES D'ACCES OU TARIF<br />
D'INTERCONNEXION<br />
Deux approches : la règle <strong>de</strong> Baumol <strong>et</strong> Willig <strong>du</strong> coût<br />
d'opportunité (Efficient Component Pricing Rule), <strong>et</strong> la<br />
tarification <strong>de</strong> second rang selon la formule <strong>de</strong> Ramsey<br />
Boiteux<br />
• ECPR : Le coût d'accès inclue le coût direct in<strong>du</strong>it par<br />
l'accès <strong>et</strong> le coût d'opportunité pour l'opérateur dominant<br />
d'autoriser l'entrée d'un concurrent sur le marché final. Le<br />
coût d'opportunité se réfère au fait que l'opérateur en offrant<br />
l'accès perd une partie <strong>de</strong> sa rec<strong>et</strong>te aval.<br />
L'idée est que l'opérateur dominant est efficace <strong>et</strong> qu'il faut<br />
trouver un tarif d'interconnexion qui barre la route à <strong>de</strong>s<br />
entrants inefficaces.<br />
• Ramsey-Boiteux : la charge d'interconnexion est égale au<br />
coût marginal <strong>du</strong> segment local plus une marge<br />
inversement proportionnelle à l'élasticité prix <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
CERNA 75
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
CHARGES D'ACCES OU FONDS ?<br />
Le <strong>financement</strong> via la charge d'interconnexion est décriée car<br />
laisse un monopole à la fourniture <strong>de</strong> service universel. Mieux<br />
vaut également séparer <strong>les</strong> négociations <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux problèmes<br />
distincts (l'interconnexion qui rémunère <strong>les</strong> frais d'entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s infrastructures <strong>et</strong> le service universel<br />
qui concerne <strong>de</strong>s subventions d'accès à certains usagers).<br />
<strong>La</strong> formule <strong>de</strong> remplacement proposée est un fonds qui<br />
présente <strong>de</strong>ux avantages :<br />
• faire jouer le ‘play or pay’,<br />
• autoriser la mise aux enchères (franchises sur <strong>de</strong>s<br />
segments <strong>du</strong> service universel).<br />
CERNA 76
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Périmètre <strong>du</strong> SU<br />
Politique <strong>de</strong> la<br />
concurrence<br />
Obligation <strong>de</strong> SU pour<br />
<strong>les</strong> opérateurs<br />
Etat <strong>de</strong><br />
développement<br />
<strong>du</strong> réseau<br />
Coût <strong>du</strong> SU pour<br />
chaque opérateur<br />
Principes d’allocation<br />
Fixation <strong>de</strong>s contributions <strong>de</strong> chaque opérateur<br />
CERNA 77
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
CAVE Martin, MILNE Claire, SCANLAN Mark - Me<strong>et</strong>ing universal service obligations in a<br />
comp<strong>et</strong>itive telecommunications sector - Report to DG IV - CEC - Mars 1994.<br />
CURIEN Nicolas, DOGNIN Elisab<strong>et</strong>h - Le service universel : quelle valeur, quel coût ? quel<br />
<strong>financement</strong> ? - Anna<strong>les</strong> <strong>de</strong>s Télécommunications, 50, n°2, pp. 337-347 - 1995.<br />
LEVASSEUR Lionel, LE VU Gaelle, TURPIN Etienne - Les enjeux économiques <strong>de</strong><br />
l’interconnexion <strong>de</strong>s réseaux - Anna<strong>les</strong> <strong>de</strong>s Télécommunications, 50, n°2, pp. 325-336 -<br />
1995.<br />
OFTEL - Effective comp<strong>et</strong>ition : Framework for action - A statement on the future of<br />
interconnection, comp<strong>et</strong>ition and related issues - Juill<strong>et</strong> 1995.<br />
OFTEL - The Costs, benefits and funding of universal service in the UK - Octobre 1995.<br />
OFTEL - Universal Telecommunications Services - Décembre 1995.<br />
YOMTOV Jérôme - Le service universel <strong>de</strong>s télécommunications <strong>et</strong> son <strong>financement</strong> -<br />
Mémoire <strong>de</strong> DEA - Université Paris-Dauphine - Septembre 1995.<br />
COSTASEQUE Anne, PROTHAIS François - Public service and universal service, how<br />
costly ? - France Télécom - Ronéo.<br />
Proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> loi n° MIPX9600022L relative à la réglementation <strong>de</strong>s télécommunications -<br />
Exposé <strong>de</strong>s motifs - 3 avril 1996.<br />
Proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> loi n° MIPX9600022L relative à la réglementation <strong>de</strong>s télécommunications -<br />
3 avril 1996.<br />
TREGOUET René - Préparer la libéralisation <strong>de</strong>s télécommunications en Europe -<br />
Collection Les Rapports <strong>du</strong> Sénat, n° 90 - 1995-1996.<br />
LARCHER Gérard - L’avenir <strong>de</strong> France Télécom : un défi national - Collection Les<br />
Rapports <strong>du</strong> Sénat, n° 260 - 1995-1996.<br />
COUSSAIN Yves - Le nouveau cadre <strong>de</strong>s télécommunications en Europe - Les<br />
Documents d’information <strong>de</strong> l’Assemblée Nationale - Rapport d’information n°2646 -<br />
1996.<br />
CERNA 78
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
5. <strong>La</strong> réforme <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service<br />
public :<br />
le cas <strong>du</strong> secteur postal<br />
Elise ALOY<br />
Document <strong>de</strong> la présentation <strong>du</strong> 6 Novembre 1996<br />
CERNA 79
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1. Les marchés <strong>du</strong> secteur postal<br />
2. Royaume Uni, Allemagne <strong>et</strong> Suè<strong>de</strong> : <strong>de</strong>s cheminements différents vers<br />
l’ouverture<br />
3. Le processus réglementaire<br />
4. <strong>La</strong> <strong>définition</strong> <strong>du</strong> périmètre <strong>du</strong> service universel<br />
5. L’évaluation <strong>du</strong> coût <strong>du</strong> service universel<br />
6. Le <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service universel<br />
CERNA 80
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1. LES MARCHÉS DU SECTEUR POSTAL<br />
Quelques chiffres globaux :<br />
En 1994, le secteur postal générait à l’échelle <strong>de</strong>s 12 pays européens 1,5 %<br />
<strong>du</strong> PIB <strong>et</strong> employait plus <strong>de</strong> un million sept cent mille personnes, dont un<br />
million trois cent mille dans <strong>les</strong> postes proprement dites.<br />
Le trafic postal représente environ 80 milliards d’obj<strong>et</strong>s par an, dont<br />
environ 3 milliards pour <strong>les</strong> échanges entre Etats <strong>de</strong> la Communauté.<br />
1.1. Le courrier<br />
1.2. <strong>La</strong> messagerie<br />
1.3. L’express<br />
1.4. L’international<br />
1.5. Des opérateurs nationaux concurrencés<br />
CERNA 81
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1.1. LE COURRIER<br />
• Les correspondances<br />
Activité traditionnelle <strong>du</strong> secteur postal : transmission d’informations<br />
écrites.<br />
4 segments distincts, soumis chacun à la concurrence d’autres mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
communication (fax, téléphone; EDI <strong>et</strong>c.)<br />
Segment <strong>de</strong> clientèle Répartition <strong>de</strong>s<br />
Remarques<br />
flux <strong>de</strong><br />
correspondances<br />
pour la Poste<br />
1994)<br />
particulier à particulier 7 % En déclin<br />
particulier à organisation 8 % Segment en très faible croissance.<br />
Flux <strong>de</strong> réponses à <strong>de</strong>s offres <strong>de</strong> vente, <strong>de</strong>s<br />
enquêtes, <strong>de</strong>s jeux cocours <strong>et</strong>c.<br />
organisation à particulier 45 % Taux <strong>de</strong> croissance annuelle à <strong>de</strong>ux chiffres.<br />
Volume <strong>de</strong> publicité adressée a triplé en 10 ans.<br />
organisation à organisation 40 % Concurrence directe <strong>du</strong> fax, téléphone, EDI ou<br />
échange <strong>de</strong> documents<br />
40 grands comptes assurent 20 % <strong>du</strong> chiffre d’affaires <strong>de</strong> la Poste.<br />
Le seul segment en croissance est le courrier d’organisation à particulier.<br />
Envois en nombre <strong>de</strong> factures, d’extraits <strong>de</strong> compte ou <strong>de</strong> publicité postale<br />
CERNA 82
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1.1. LE COURRIER (suite)<br />
Deux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> publicité postale, <strong>de</strong>ux <strong>outils</strong> <strong>du</strong> mark<strong>et</strong>ing direct<br />
• publipostage ou publicité adressée : 1984 : 11 % <strong>du</strong> trafic total <strong>de</strong> la<br />
Poste, 1994 : 17 %<br />
Filiale <strong>de</strong> la Poste : Postimpact.<br />
Dans quasiment tous <strong>les</strong> pays <strong>de</strong> l’EU, ce segment relève <strong>du</strong> monopole<br />
postal.<br />
• publicité non adressée : distribution <strong>du</strong> même prospectus à toutes <strong>les</strong><br />
adresses d’une zone déterminée.<br />
Filiale <strong>de</strong> la Poste : Postcontact, qui détiendrait 45 % <strong>de</strong> ce secteur soumis<br />
à concurrence<br />
Moins chère que pub. adressée, elle bénéficie <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> la<br />
connaissance <strong>de</strong>s secteurs socio-géographiques.<br />
• <strong>La</strong> Presse<br />
<strong>La</strong> Poste est tenue d’assurer le service public <strong>du</strong> transport <strong>et</strong> <strong>de</strong> la<br />
distribution <strong>de</strong> la presse en tout point <strong>du</strong> territoire, au nom <strong>du</strong> bon<br />
fonctionnement <strong>de</strong> la démocratie. En 1994, la Poste a distribué + <strong>de</strong> 2<br />
milliards <strong>de</strong> journeaux, pour un coût estimé à 6 milliards <strong>de</strong> francs. Les<br />
charges relatives à c<strong>et</strong>te obligation sont réparties entre la presse (2 milliards<br />
<strong>de</strong> FF), l’Etat (1,9 prévus dans le contrat <strong>de</strong> plan 1995-1997) <strong>et</strong> la Poste.<br />
CERNA 83
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1.2. LA MESSAGERIE<br />
Secteur difficile à définir : transport <strong>de</strong> colis dont on n’a pas précisé a<br />
priori le poids, la rapidité <strong>du</strong> service <strong>et</strong> la nature <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s transportés.<br />
Peut être segmenté entre le pli international, le colis <strong>de</strong> particulier à<br />
particulier, la VPC...<br />
Les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> marché existantes concernent le transport <strong>de</strong> colis <strong>de</strong> 0 à<br />
300 kg.<br />
Messagerie classique : <strong>les</strong> opérateurs nationaux se r<strong>et</strong>rouvent avec <strong>les</strong><br />
secteurs <strong>les</strong> moins rentab<strong>les</strong>. ecrémage <strong>du</strong> marché. Ainsi, Exapaq propose<br />
<strong>de</strong>s tarifs inférieurs <strong>de</strong> 15 à 20 % à ceux <strong>de</strong> la poste sur le segment<br />
organisation à organisation. Sur le segment entreprise à particulier, <strong>les</strong><br />
entreprises <strong>de</strong> VPC m<strong>et</strong>tent en place <strong>de</strong>s points relais clients.<br />
CERNA 84
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1.3. L’EXPRESS<br />
Express : transport <strong>de</strong> plis/documents <strong>et</strong> colis/marchandises dans <strong>de</strong>s<br />
délais courts. Fiabilité <strong>du</strong> système intéresse <strong>les</strong> clients.<br />
Marché très convoité, caractérisé par <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> croissance à <strong>de</strong>ux<br />
chiffres, aussi bien pour le national que l’international. <strong>La</strong> Poste partage 65<br />
% <strong>du</strong> marché au départ <strong>de</strong> la France avec DHL alors que UPS, TNT, <strong>et</strong><br />
Fe<strong>de</strong>x ne représentent que 17,5 % .<br />
Grand nombre d’opérateurs <strong>de</strong> toutes natures :<br />
• intégrateurs, avec ambition mondiale : DHL, Fe<strong>de</strong>ral Express, UPS,<br />
TNT-GDEW. Maîtrise <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> transport.<br />
• opérateurs spécialisés sur le domestique : J<strong>et</strong> Services, Colirail. Ou,<br />
propres à la France, la Poste <strong>et</strong> la SNCF ont créé <strong>de</strong>s départements<br />
spécialisés ou <strong>de</strong>s filia<strong>les</strong> (Chronopost, Sernam, Calberson) pour contrer<br />
<strong>les</strong> intégrateurs.<br />
Mouvements <strong>de</strong> concentration, <strong>de</strong> prise <strong>de</strong> participations croisées :<br />
• Fe<strong>de</strong>ral Express s’est r<strong>et</strong>iré <strong>du</strong> marché intra-EU en 1992 sous la<br />
pression <strong>de</strong> ses actionnaires <strong>et</strong> s’est s’implanté à Roissy pour se<br />
concentrer sur l’intercontinental.<br />
• DHL a ouvert son capital à Lufthansa <strong>et</strong> Japan Airlines.<br />
• TNT s’est associé à 5 postes (France, Allemagne, Pays Bas, Suè<strong>de</strong> <strong>et</strong><br />
Canada) pour créer une JV : GD Express Worldwi<strong>de</strong> : <strong>les</strong> adversaires<br />
d’hier sont maintenant associés.<br />
• UPS a rach<strong>et</strong>é 16 entreprises en France, dont Prost.<br />
CERNA 85
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1.4. L’INTERNATIONAL<br />
Courrier transfrontalier entrant en proportion <strong>du</strong> courrier total 1991<br />
Pays<br />
Communauté Internationa Total<br />
Européenne l<br />
Belgique 5 1 6<br />
Danmark 2 2 4<br />
Germany 2 2 4<br />
Greece 5 4 9<br />
Spain 1 1 2<br />
France 1 1 2<br />
Ireland 17 2 19<br />
Italy 3 2 5<br />
Luxembourg 12 2 14<br />
N<strong>et</strong>herlands 2 1 3<br />
Portugal 3 2 5<br />
United<br />
1 2 3<br />
Kingdom<br />
Total 2 1 3<br />
Source : adaptation <strong>du</strong> Livre Vert, Commission Européenne.<br />
Enjeu important pour tous <strong>les</strong> opérateurs européens. Les envois <strong>de</strong>s<br />
entreprises représentent 80 %.<br />
• Express : cf supra<br />
• Traditionnel : problème <strong>du</strong> repostage, ou détournement <strong>du</strong> trafic postal,<br />
impliquant <strong>de</strong>s “reposteurs” privés (TNT Mailfast, DHL) ou <strong>de</strong>s<br />
opérateurs nationaux (hollan<strong>de</strong>, royaume uni) s’appuyant au besoin sur<br />
<strong>de</strong>s intermédiaires (routeurs, “consolidateurs”).<br />
Le repostage exploite le niveau trop bas <strong>de</strong> la rémunération (<strong>les</strong> “frais<br />
terminaux”) que la poste expéditrice verse à la <strong>de</strong>stinataire pour compenser<br />
le coût <strong>de</strong> la distribution dans le pays d’arrivée.<br />
CERNA 86
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1.4. L’INTERNATIONAL (suite)<br />
Exemple : tarif d’une l<strong>et</strong>tre en France : 3 F, frais terminaux : 1,40 F<br />
<strong>La</strong> poste néerlandaise peut proposer à un “gros” expéditeur français un<br />
tarif <strong>de</strong> 2,50 F, décomposé comme suit : 1,40f, <strong>de</strong> frais terminaux payés à<br />
la Poste, 0,30 F tranport Frabce vers Pays Bas, 0,60 frais <strong>de</strong> tri <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
transport vers la France <strong>et</strong> 0,20 <strong>de</strong> marge. Le courrier est collecté en A,<br />
acheminé vers B, où il est affranchi <strong>et</strong> réinjecté dans le circuit postal<br />
normal vers le pays <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination C (ABC).<br />
Deux formes <strong>de</strong> repostage : ABA <strong>et</strong> ABC. L’établissement d’un nouveau<br />
système <strong>de</strong> frais terminaux est en cours : système REIMS (remuneration<br />
of exchanges of international mail)<br />
CERNA 87
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1.5. ESQUISSE DE L’ORGANISATION INDUSTRIELLE DU<br />
SECTEUR POSTAL<br />
Le secteur postal européen est organisé <strong>de</strong> la façon suivante<br />
• un domaine réservé, pour lequel l’opérateur national dispose d’un<br />
monopole<br />
Pays<br />
Opérateur<br />
national<br />
Périmètre <strong>du</strong> secteur réservé<br />
Royaume Uni Post Office L<strong>et</strong>tres <strong>de</strong> tarif inférieur à 1 £. Inclut le publipostage. Le<br />
gouvernement peut délivrer <strong>de</strong>s licences pour <strong>de</strong>s services<br />
particuliers : Christmas Cards charities<br />
Irlan<strong>de</strong> An Post Collecte <strong>et</strong> livraison <strong>de</strong> “postal pack<strong>et</strong>s”. <strong>La</strong> concurrence est<br />
tolérée sur l’express. Ministre ou An Post peuvent délivrer <strong>de</strong>s<br />
licences<br />
France <strong>La</strong> Poste Monopole sur <strong>les</strong> l<strong>et</strong>tres <strong>et</strong> paqu<strong>et</strong>s jusqu’à 1 KG <strong>et</strong> obligations<br />
<strong>de</strong> service universel pour <strong>les</strong> obj<strong>et</strong>s jusqu’à 7 kg.<br />
Espagne Correos Marché domestique le plus libéralisé : marché inter-urbain <strong>et</strong><br />
publipostage sont libéralisés. Privés : 30 % <strong>du</strong> trafic total.<br />
Pays Bas KPN Monopole sur <strong>les</strong> l<strong>et</strong>tres personnalisées jusqu’à 500g : une partie<br />
<strong>du</strong> publipostage est libéralisée. Obligations <strong>de</strong> service public :<br />
pour <strong>les</strong> obj<strong>et</strong>s jusqu’à 10 kg.<br />
Allemagne<br />
Deutsche<br />
Bun<strong>de</strong>spost<br />
Postdienst<br />
Monopole sur <strong>les</strong> obj<strong>et</strong>s jusqu’à 1 kg. Lobby intense <strong>de</strong> la VPC<br />
(Quelle) pour ouvrir le publipostage à la concurrence. Licences<br />
attribuées gra<strong>du</strong>ellement. (supérieur à 250 g, puis à 100g).<br />
CERNA 88
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
1.5. ESQUISSE DE L’ORGANISATION INDUSTRIELLE DU<br />
SECTEUR POSTAL (SUITE)<br />
• un domaine ouvert à la concurrence, qui peut être divisé <strong>de</strong> la façon<br />
suivante,<br />
• un secteur pour lequel l’opérateur national est soumis à <strong>de</strong>s obligations<br />
<strong>de</strong> service public (presse, messagerie),<br />
• un secteur sans obligations <strong>de</strong> service public.<br />
Répartition <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> la Poste en 1994<br />
Secteur<br />
% <strong>du</strong> chiffre<br />
d’affaire<br />
Secteur libre<br />
29 %<br />
Express, Publicité non adressée, Services financiers<br />
Service public non réservé<br />
13 %<br />
Messagerie, Presse<br />
Secteur réservé<br />
58 %<br />
Correspondances, publicité adressée<br />
CERNA 89
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
2. ROYAUME-UNI, ALLEMAGNE ET SUÈDE : DES CHEMINEMENTS<br />
DIFFÉRENTS VERS L’OUVERTURE<br />
2.1. Les évolutions en Europe<br />
2.2. Le Royaume Uni : <strong>de</strong>s pércurseurs qui cherchent leur route<br />
2.3. <strong>La</strong> Suè<strong>de</strong> : l’abolition <strong>du</strong> monopole<br />
2.4. L’Allemagne : la pression <strong>de</strong>s clients<br />
CERNA 90
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
2.1. LES ÉVOLUTIONS EN EUROPE<br />
• Changements institutionnels<br />
- Evolution <strong>de</strong>s statuts <strong>de</strong>s opérateurs<br />
Modèle dominant : “administration centrale”, puis en 1994, “établissement<br />
public”, <strong>et</strong> plusieurs pays vont <strong>les</strong> transformer en société <strong>de</strong> droit privé<br />
Evolution <strong>du</strong> statut <strong>de</strong>s 15 opérateurs postaux <strong>de</strong> la Communauté<br />
1990 1994 1996<br />
Société Anonyme 3 6 9<br />
Etablissement public 5 7 6<br />
Administration 7 2 0<br />
- Mise en place d’un réglementeur indépendant, dans la logique <strong>de</strong><br />
séparation entre l’opérateur <strong>et</strong> le réglementeur.<br />
• Changements in<strong>du</strong>striels<br />
Apparition <strong>de</strong> nouveaux acteurs <strong>et</strong> recherche <strong>de</strong> gains <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ctivité chez<br />
opérateurs nationaux<br />
CERNA 91
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
2.1. LES ÉVOLUTIONS EN EUROPE (SUITE)<br />
statut <strong>de</strong>s<br />
opérateurs postaux<br />
Société anonyme<br />
“Entreprise”,<br />
“établissement” ou<br />
“office” public<br />
Les différents processus <strong>de</strong> changement<strong>de</strong> statut <strong>de</strong>s opérateurs postaux<br />
relation Etats<br />
Remarques<br />
financières avec<br />
l’Etat<br />
Actionnariat<br />
public<br />
Autonomie<br />
Financière<br />
Pays bas Intro. parielle en Bourse (nov. 1994)<br />
Irlan<strong>de</strong><br />
Nouvelle-Zélan<strong>de</strong><br />
Portugal<br />
Suè<strong>de</strong><br />
Allemagne Fin <strong>du</strong> monopole (93)<br />
Fonctionnaires (50 %). Passage en<br />
SA le 1/01/95 <strong>et</strong> ouverture partielle<br />
<strong>du</strong> publipostage<br />
Belgique<br />
Espagne<br />
Grèce<br />
Italie<br />
Royaume Uni<br />
Luxembourg<br />
Danemark<br />
Administration Etats Unis Organisme fédéral<br />
Fonctionnaires (90 %)<br />
Fonctionnaires (70 %), courrier local<br />
libéralisé<br />
salariés droit privé<br />
SA au plus tard en 1996<br />
Echec <strong>du</strong> proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> privatisation<br />
partielle, salariés droit privé.<br />
Fonctionnaires<br />
Transformée en entreprise publique<br />
en 1995, fonctionnaires (50 %)<br />
CERNA 92
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
2.2. LE ROYAUME UNI : DES PÉRCURSEURS QUI CHERCHENT<br />
LEUR ROUTE<br />
1981 : British Post Office, qui avait <strong>de</strong>puis 1969 un statut d’entreprise<br />
publique, est scindée en 2 établissements publics : Post Office <strong>et</strong> British<br />
Telecom<br />
• Restriction <strong>du</strong> monopole au courrier affranchi <strong>de</strong> moins d’une livre <strong>et</strong><br />
licences accordées pour échange <strong>de</strong> courrier entre boîte aux l<strong>et</strong>tres<br />
(Britdoc, 1% <strong>du</strong> trafic <strong>de</strong> Royal Mail)<br />
• Segmentation <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> Post Office : counters, Royal Mail,<br />
Parcelforce <strong>et</strong> Girobank, ven<strong>du</strong> en 1990 à une société <strong>de</strong> crédit.<br />
• Organisation décentralisée en centres <strong>de</strong> profit<br />
• Relations financières avec l’Etat ont été formalisées.<br />
1994, proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> privatisation pour perm<strong>et</strong>tre à Royal Mail <strong>et</strong> Parcelforce <strong>de</strong><br />
disposer <strong>de</strong> la “liberté pour réagir avec soup<strong>les</strong>se <strong>et</strong> efficacité”. Proj<strong>et</strong><br />
repoussé par le Parlement.<br />
Pas <strong>de</strong> possibilité <strong>de</strong> se développer à l’international ou diversifier vers<br />
l’électronique. Parcelforce est déficitaire.<br />
CERNA 93
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
2.3. LA SUÈDE : L’ABOLITION DU MONOPOLE<br />
1993, abolition <strong>du</strong> monopole postal. 1er Mars 1994, la poste est <strong>de</strong>venue<br />
une société <strong>de</strong> droit privé détenue par l’Etat à 100 %.<br />
• <strong>La</strong> fin <strong>du</strong> monopole n’a pas signifié la fin <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong> service<br />
public : distribution quotidienne 5 jours par semaine à un prix<br />
raisonnable, mais c<strong>et</strong>te fois <strong>les</strong> “surcoûts” sont payés par l’Etat (swe<strong>de</strong>n<br />
Post a évalué à 1,3 milliards <strong>de</strong> couronnes suédoises pour 1994-96 (CA :<br />
14,6).<br />
• Organisation décentralisée (courrier national, international, messagerie<br />
<strong>et</strong>c.).<br />
• <strong>La</strong>ncement <strong>de</strong> ePost, concurrent direct <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong><br />
communication électronique.<br />
• Diminution <strong>de</strong>s effectifs : 58 000 à 46 000 <strong>de</strong> 1990 à 1994, <strong>et</strong> un tiers<br />
<strong>de</strong>s guich<strong>et</strong>s a été franchisé.<br />
CityMail, concurrent existant avant l’abolition, détient 5 % <strong>du</strong> marché <strong>du</strong><br />
courrier. Présent sur le marché local <strong>du</strong> courrier non urgent à Stockholm.<br />
Problème pour le calcul <strong>du</strong> coût <strong>du</strong> service universel.<br />
CERNA 94
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
2.4. ALLEMAGNE : LA PRESSION DES CLIENTS<br />
1989 : 1ère réforme postale qui a vu la création <strong>de</strong> 3 entreprises publiques :<br />
DBP Postdienst, DBP Postbank <strong>et</strong> DBP Telekom. Le parlement a voté en<br />
1994 leur transformation en sociétés par actions avec ouverture <strong>de</strong> leur<br />
capital à terme. Deutsche Post, Deutsche Postbank <strong>et</strong> Deutsche Telekom<br />
ont une holding publique commune.<br />
• Statut <strong>du</strong> personnel : 50 % <strong>de</strong>s salariés sont fonctionnaires.<br />
Conservation <strong>de</strong>s avantages sociaux acquis. Pas <strong>de</strong> recrutement <strong>de</strong><br />
nouveaux fonctionnaires<br />
• Propriété <strong>du</strong> capital : l’Etat conserve la majorité jusqu’en 1999.<br />
• Modification <strong>du</strong> périmètre <strong>du</strong> monopole <strong>et</strong> accord <strong>de</strong> licences par un<br />
conseil <strong>de</strong> Régulation, constitué paritairement par <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux chambres.<br />
Lobby <strong>de</strong> la VPC pour intro<strong>du</strong>ire la concurrence dans le publipostage.<br />
CERNA 95
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
3. LE PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE<br />
• 1989 : évocation <strong>de</strong> l’opportunité d’une politique communautaire, sur<br />
une initiative <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nce française.<br />
• Juin 1992 : Publication d’un Livre Vert sur “Le développement <strong>du</strong><br />
marché Unique <strong>de</strong>s services postaux”.<br />
• 2 Juin 1993 : la Commission a communiqué au Conseil <strong>et</strong> au Parlement<br />
<strong>les</strong> résultats <strong>et</strong> orientations dégagées <strong>de</strong> la consultation. Pas <strong>de</strong> valeur<br />
normative.<br />
• 7 février 1994, le Conseil adopte une résolution qui i<strong>de</strong>ntifie <strong>les</strong> objectifs<br />
d’une politique ommunautaire <strong>et</strong> invite la Commission à préparer <strong>les</strong><br />
mesures nécessaires à leur réalisation.<br />
• 28 Juill<strong>et</strong> 1995 : Proposition <strong>de</strong> directive <strong>de</strong> la Commission concernant<br />
<strong>les</strong> “règ<strong>les</strong> communes pour le développement <strong>de</strong>s services postaux<br />
communautaires <strong>et</strong> l’amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>du</strong> service”. Définition <strong>du</strong><br />
périmètre <strong>du</strong> service universel, <strong>et</strong> <strong>du</strong> secteur réservé.<br />
• 31 Juill<strong>et</strong> 1996 : Proposition <strong>de</strong> directive <strong>du</strong> Parlement <strong>et</strong> <strong>du</strong> Conseil : la<br />
prési<strong>de</strong>nce Irlandaise est plus radicale que la Commission car elle<br />
propose <strong>de</strong> libéraliser totalement à partir <strong>de</strong> 2001 le publipostage <strong>et</strong> le<br />
courrier transfrontalier.<br />
• 27 septembre 1996 : Conseil <strong>de</strong>s Ministres. <strong>La</strong> France, la Belgique, le<br />
Luxembourg, la Grèce <strong>et</strong> le Portugal rej<strong>et</strong>tent c<strong>et</strong>te proposition. Prochain<br />
conseil en Décembre. 1er semestre 1997, prési<strong>de</strong>nce hollandaise.<br />
CERNA 96
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
3. LE PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE (SUITE)<br />
Ce qui est proposé :<br />
• Définition <strong>du</strong> périmètre <strong>du</strong> service universel.<br />
• Les obligations <strong>de</strong> service universel vont être supportées par un seul<br />
opérateur, l’opérateur national.<br />
• En échange, <strong>de</strong>s droits exclusifs lui sont accordés : monopole “<strong>de</strong> jure”.<br />
Le domaine réservé est un moyen <strong>de</strong> financer le service public.<br />
• Système <strong>de</strong> subventions croisées : l’éten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> domaine réservé perm<strong>et</strong>elle<br />
<strong>de</strong> couvrir financièrement <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service universel.<br />
Le dossier postal européen est actuellement bloqué : aucune décision n’est<br />
prise.<br />
Les négociations portent sur le périmètre <strong>du</strong> service réservé. Deux<br />
éléments sont en discussion : le publipostage <strong>et</strong> le courrier transfrontalier<br />
entrant.<br />
CERNA 97
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
4. LA DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DU SERVICE UNIVERSEL<br />
A fait l’obj<strong>et</strong> d’un consensus<br />
Logique :<br />
1) cohésion sociale <strong>et</strong> aménagement <strong>du</strong> territoire<br />
2) échanges économiques<br />
Relevage, transport <strong>et</strong> distribution <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> correspondance au moins<br />
5 jours par semaine, avec levée <strong>et</strong> distribution quotidienne.<br />
Plis inférieurs à 2 kg, <strong>et</strong> <strong>les</strong> colis à 20kg <strong>et</strong> ce pour <strong>les</strong> services<br />
domestiques <strong>et</strong> transfrontaliers.<br />
Objectif est <strong>de</strong> promouvoir l’offre <strong>de</strong> services postaux <strong>de</strong> qualité, fournis<br />
<strong>de</strong> manière permanente en tout point <strong>du</strong> territoire à <strong>de</strong>s prix abordab<strong>les</strong>,<br />
quelque soit l’utilisateur.<br />
Satisfaire aux principes :<br />
• égalité<br />
• neutralité<br />
• universalité<br />
• confi<strong>de</strong>ntialité<br />
• continuité<br />
• adaptabilité<br />
CERNA 98
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
5. LE COÛT DU SERVICE UNIVERSEL<br />
Aucune évaluation précise n’a été faite en Europe, sauf en Suè<strong>de</strong> au<br />
moment <strong>de</strong> l’abolition <strong>du</strong> monopole postal : il s’est alors agi <strong>de</strong> clarifier <strong>les</strong><br />
transferts financiers <strong>de</strong> l’Etat.<br />
Ceci s’explique par l’organisation in<strong>du</strong>strielle existante :<br />
En échange <strong>de</strong> la fourniture d’un certain nombre d’obligations <strong>de</strong> service<br />
universel, l’opérateur national jouit d’un monopole. Les transferts <strong>de</strong><br />
revenu entre zones géographiques <strong>et</strong> catégories d’usagers constituent <strong>les</strong><br />
subventions croisées. Pas <strong>de</strong> connaissance <strong>de</strong> ces flux faute d’une<br />
coptabilité analytique appropriée.<br />
<strong>La</strong> proposition <strong>de</strong> réglementation euroépenne ne rem<strong>et</strong> pas en cause c<strong>et</strong>te<br />
organisation.<br />
DG 4 recomman<strong>de</strong> d’utiliser la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s coûts évitab<strong>les</strong> <strong>de</strong> long terme,<br />
avec toutefois <strong>de</strong>s différences dans le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul par rapport aux<br />
telecoms : pas <strong>de</strong> sunk cost dans la poste.<br />
CERNA 99
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
5. LE COÛT DU SERVICE UNIVERSEL (SUITE)<br />
Australian In<strong>du</strong>stry Commission (1992) : i) tarif postal uniforme est<br />
maintenu <strong>et</strong> ii) l’Etat paye pour <strong>les</strong> “higher cost services”. Le coût <strong>de</strong>s<br />
obligations <strong>de</strong> service universel est calculé selon la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s coûts<br />
évitab<strong>les</strong>.<br />
Rappel : coût évitable = coût <strong>de</strong> fourniture incrémental, affecté aux conso.<br />
non profitab<strong>les</strong>.<br />
stand alone cost = coût <strong>de</strong> fourniture séparé, affecté aux consommateurs<br />
profitab<strong>les</strong><br />
coût <strong>du</strong> service universel = revenu évitable moins coût évitable<br />
Revenu évitable : estimer le nombre d’envois qui ne seraient pas effectués<br />
si certains points ne sont plus <strong>de</strong>sservis.<br />
Coût évitable : pas <strong>de</strong> sunk cost dans le secteur postal : la pério<strong>de</strong><br />
temporelle <strong>du</strong> calcul est moins importante.<br />
Autralian Post : avec le réseau existant, <strong>les</strong> normes <strong>de</strong> qualités <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
niveaux <strong>de</strong> trafic existants, a i<strong>de</strong>ntifié <strong>les</strong> services non offerts par AP si elle<br />
agit sur <strong>de</strong>s bases commercia<strong>les</strong>.<br />
Coût <strong>du</strong> service universel : $60 millions en 1990/91<br />
Peut être ventilé par type <strong>de</strong> service : le <strong>de</strong>ficit à l’international est <strong>de</strong> 15<br />
millions, sur <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s l<strong>et</strong>tres domestiques <strong>de</strong> 12 million <strong>et</strong> sur <strong>les</strong> p<strong>et</strong>ites<br />
<strong>de</strong> 33.<br />
par type <strong>de</strong> trafic : urbain/urbain : $26, urbain/rural $14, rural/urbain : $14<br />
<strong>et</strong> rural/rural $6.<br />
CERNA 100
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
6. LE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL<br />
Quel périmètre pour le domaine réservé ?<br />
Transport, tri <strong>et</strong> distribution <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> correspondance domestique, <strong>de</strong><br />
poids inférieur à 350 g, <strong>et</strong> <strong>de</strong> prix inférieur à 5 fois le tarif <strong>de</strong> base.<br />
Inclut la distribution <strong>de</strong> courrier transfrontalier entrant <strong>et</strong> le publipostage<br />
<strong>La</strong> Commission déci<strong>de</strong>ra au plus tard le 30 Juin 1996 la possibilité <strong>de</strong><br />
réserver ces services au <strong>de</strong>là <strong>du</strong> 31 Décembre 2000. Le courrier<br />
transfrontalier sortant est libéralisé dès l’entrée en vigueur <strong>de</strong> la directive.<br />
CERNA 101
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
6. LE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL (SUITE)<br />
Le publipostage<br />
Importance commerciale <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te activité : en moyenne en Europe, 17 %<br />
<strong>du</strong> volume <strong>et</strong> 12 % <strong>de</strong>s rec<strong>et</strong>tes courrier <strong>de</strong>s postes !! Rapellons que 40<br />
grands comptes asurent 20 % <strong>du</strong> chiffres d’affaire courrier <strong>de</strong> la Poste.<br />
Crainte <strong>de</strong>s adversaires à l’ouverture à la concurrence : la nature <strong>du</strong><br />
courrier transporté est difficilement i<strong>de</strong>ntifiable <strong>et</strong> donc <strong>les</strong> opérateurs<br />
privés peuvent, via le publipostage, impiéter sur l’activité <strong>de</strong> courrier<br />
traditionnel, qui appartient au domaine réservé.<br />
CERNA 102
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
6. LE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL (SUITE)<br />
Le courrier transfrontalier entrant<br />
Crainte <strong>de</strong>s adversaires à l’ouverture à la concurrence : 1) <strong>les</strong> opérateurs<br />
privés vont accepter <strong>du</strong> courrier domestique, ce qui viole le domaine<br />
réservé, <strong>et</strong> vont se concentrer sur <strong>les</strong> segments <strong>les</strong> plus rentab<strong>les</strong> <strong>et</strong> 2) le<br />
courrier domestique sera converti en courrier transfrontalier via un tranfert<br />
électronique <strong>de</strong>s informations hors <strong>du</strong> pays.<br />
Ces <strong>de</strong>ux arguments posent la question <strong>de</strong> l’éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> l’écrémage <strong>du</strong><br />
marché.<br />
D’après le DG 4, le courrier qui pourrait être détourné “électroniquement”<br />
est le publipostage. Or <strong>les</strong> <strong>de</strong>stinataires sont <strong>les</strong> particuliers, ce qui ne<br />
correspond pas au segment attractif qui est le courrier <strong>de</strong> ville à ville.<br />
En raison <strong>de</strong> la structure <strong>de</strong>s coûts (livraison est le poste le plus élevé) <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> l’existence d’économies <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité pour la livraison, un opérateur <strong>du</strong><br />
courrier entrant est tenté d’accepter <strong>du</strong> courrier domestique. Le risque<br />
existe, il faut donc contrôler <strong>les</strong> entrées <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre en place <strong>de</strong>s procé<strong>du</strong>res<br />
<strong>de</strong> contrôle. Comment faire si il n’exsite pas <strong>de</strong> tutelle ?<br />
Remarque : pour que le transfrontalier entrant soit ouvert à la concurrence,<br />
le problème <strong>de</strong>s frais terminaux doît être résolu.<br />
CERNA 103
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE<br />
DELBECQ André - Les entrepreneurs postaux <strong>et</strong> l’économie postale à<br />
l’échelle européenne - Cahiers <strong>de</strong> l’IREPP, pp. 153-161 - Juin 1996.<br />
DELFAU Gérard - Construire l’Europe postale dans le respect <strong>du</strong> service<br />
public - Collection <strong>les</strong> Rapports <strong>du</strong> Sénat, n° 135 - 14 décembre 1995.<br />
Di MAGGIO Antoine - <strong>La</strong> Poste <strong>et</strong> le secteur <strong>de</strong> la messagerie - Réalités<br />
In<strong>du</strong>striel<strong>les</strong>, Anna<strong>les</strong> <strong>de</strong>s Mines - Janvier 1995.<br />
HENRY Clau<strong>de</strong> - Concurrence <strong>et</strong> services publics dans l’Union<br />
Européenne : <strong>les</strong> services postaux - Cahiers <strong>du</strong> laboratoire d’économétrie,<br />
Ecole Polytechnique, n° 438, Mai 1996.<br />
LABORDE François - Le marché <strong>du</strong> courrier international - Réalités<br />
In<strong>du</strong>striel<strong>les</strong>, Anna<strong>les</strong> <strong>de</strong>s Mines - Janvier 1995.<br />
LEJEUNE Michel - A la recherche d’une réglementation européenne -<br />
Réalités In<strong>du</strong>striel<strong>les</strong>, Anna<strong>les</strong> <strong>de</strong>s Mines - Janvier 1995.<br />
Communication <strong>de</strong> la Commission au Conseil <strong>et</strong> au Parlement Européen -<br />
Lignes directrices pour le développement <strong>de</strong>s services postaux<br />
communautaires - COM (93) 247, 2 juin 1993.<br />
CERNA 104
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
6. Déréglementation <strong>et</strong> Service public<br />
François Lévêque<br />
Document <strong>de</strong> la présentation <strong>du</strong> 29 mai 1997<br />
CERNA 105
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
• (O 1 ) <strong>La</strong> doctrine économique exerce<br />
une influence croissante sur la<br />
conception <strong>du</strong> service public.<br />
• (O 2 ) <strong>La</strong> déréglementation entraîne<br />
une nouvelle réglementation.<br />
• (O 3 ) L’évaluation <strong>du</strong> coût <strong>et</strong> le<br />
<strong>financement</strong> par l’Etat <strong>de</strong>s<br />
obligations <strong>de</strong> service public<br />
élargissent la participation <strong>de</strong>s<br />
groupes d’intérêt.<br />
CERNA 106
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
(O1) <strong>La</strong> doctrine économique<br />
exerce une influence<br />
croissante sur la conception<br />
<strong>du</strong> service public.<br />
• Conception juridique <strong>et</strong> conception<br />
économique.<br />
• Les 5 principes normatifs <strong>de</strong> la<br />
déréglementation.<br />
• <strong>La</strong> tra<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s normes en faits.<br />
• Deux illustrations.<br />
CERNA 107
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
Les principes directeurs <strong>de</strong> la<br />
doctrine :<br />
• (P1) Assurer l’efficacité d’abord, se<br />
préoccuper <strong>de</strong> la répartition ensuite.<br />
• (P2) Découper le monopole en entités<br />
indépendantes.<br />
• (P3) Séparer la fonction <strong>de</strong><br />
réglementation <strong>et</strong> le pouvoir exécutif.<br />
• (P4) Réglementer le péage pour<br />
l’utilisation <strong>de</strong> l’infrastructure<br />
séparément <strong>du</strong> service universel.<br />
• (P5) M<strong>et</strong>tre fin aux subventions<br />
croisées.<br />
CERNA 108
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
(P1) Assurer l’efficacité<br />
d’abord, se préoccuper <strong>de</strong> la<br />
répartition ensuite.<br />
• Le rôle historique <strong>de</strong>s in<strong>du</strong>stries <strong>de</strong><br />
réseaux dans la ré<strong>du</strong>ction<br />
d’inégalités.<br />
• Redistribution par <strong>les</strong> réseaux ou par<br />
l’impôt.<br />
• Taille <strong>du</strong> gateau <strong>et</strong> règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> partage.<br />
• Rendre compatible <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong><br />
service public avec la concurrence <strong>et</strong><br />
non aménager <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
concurrence pour <strong>les</strong> rendre<br />
compatib<strong>les</strong> avec l’objectif <strong>de</strong><br />
redistribution.<br />
CERNA 109
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
(P2) Découper le monopole<br />
historique<br />
en entités indépendantes.<br />
• Comment intro<strong>du</strong>ire la concurrence<br />
(pour ré<strong>du</strong>ire <strong>les</strong> coûts <strong>et</strong> améliorer la<br />
qualité <strong>de</strong>s prestations) ?<br />
• Ouvrir le réseau aux nouveaux<br />
opérateurs avec ou sans déintégration<br />
verticale <strong>du</strong> monopole<br />
historique.<br />
• Mieux vaut découper en un trop grand<br />
nombre <strong>de</strong> parties qu’en un trop p<strong>et</strong>it<br />
nombre (<strong>les</strong> exemp<strong>les</strong> <strong>de</strong> British Gas<br />
<strong>et</strong> British Rail).<br />
CERNA 110
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
(O2) <strong>La</strong> déréglementation<br />
entraîne<br />
une nouvelle réglementation.<br />
• De nouvel<strong>les</strong> réglementations : le<br />
péage d’accès <strong>et</strong> <strong>les</strong> obligations <strong>de</strong><br />
service public.<br />
• Un nouveau cadre réglementaire : <strong>les</strong><br />
agences sectoriel<strong>les</strong>.<br />
• (P3) Séparer la fonction <strong>de</strong><br />
réglementation <strong>et</strong> le pouvoir exécutif.<br />
• Un exemple d’analyse économique<br />
institutionnelle :<br />
(P 4<br />
) (péage<br />
administré+agence)<br />
versus<br />
(péage négocié + autorité <strong>de</strong><br />
la concurrence)<br />
CERNA 111
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
(O3) L’évaluation <strong>du</strong> coût <strong>et</strong> le<br />
<strong>financement</strong> par l’Etat <strong>de</strong>s<br />
obligations <strong>de</strong> service public<br />
élargit la participation <strong>de</strong>s<br />
groupes d’intérêt.<br />
• (P5) M<strong>et</strong>tre fin aux subventions<br />
croisées.<br />
• <strong>La</strong> nécessité <strong>de</strong> définir précisément<br />
<strong>les</strong> obligations <strong>de</strong> service public, d’en<br />
évaluer le coût, <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>les</strong> financer<br />
directement.<br />
• L’exemple <strong>de</strong>s télécommunications.<br />
• L’exemple <strong>de</strong> la poste.<br />
CERNA 112
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
L’exemple <strong>de</strong>s<br />
télécommunications.<br />
• Une <strong>définition</strong> précise <strong>de</strong>s obligations<br />
à l’origine d’une rivalité entre <strong>les</strong><br />
opérateurs.<br />
• Une évaluation <strong>du</strong> coût <strong>du</strong> service<br />
universel qui varie selon <strong>les</strong> métho<strong>de</strong>s<br />
<strong>et</strong> <strong>les</strong> intérêts <strong>de</strong>s parties.<br />
• Un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> à travers <strong>les</strong><br />
charges d’accès ou un fonds spécial.<br />
CERNA 113
<strong>La</strong> <strong>définition</strong>, <strong>les</strong> <strong>outils</strong> <strong>d'évaluation</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>financement</strong> <strong>du</strong> service public en situation <strong>de</strong> concurrence ouverte<br />
Elise Aloy & François Lévêque<br />
L’exemple <strong>de</strong> la poste.<br />
• Une directive qui conserve le principe<br />
<strong>du</strong> <strong>financement</strong> <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong><br />
service public par subventions<br />
croisées : <strong>les</strong> services réservés.<br />
• L’équilibre champ <strong>du</strong> service<br />
universel / périmètre <strong>de</strong>s services<br />
réservés : inclure ou exclure le<br />
publipostage <strong>et</strong> le courrier<br />
transfrontière.<br />
• Vers une évaluation <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong><br />
service universel.<br />
CERNA 114