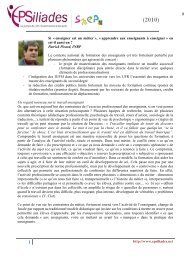- 1 - Table ronde Eps, sport et Handicap : quelles ... - Le SNEP
- 1 - Table ronde Eps, sport et Handicap : quelles ... - Le SNEP
- 1 - Table ronde Eps, sport et Handicap : quelles ... - Le SNEP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Forum international de l’Education Physique <strong>et</strong> du Sport - 4-5-6 novembre 2005 - Cité Internationale Paris<br />
En eff<strong>et</strong>, la pratique régulière d’activités physiques <strong>et</strong> <strong>sport</strong>ives adaptées aux besoins de chacune des<br />
personnes en situation de handicap favorise la prévention des eff<strong>et</strong>s délétères de la sédentarité <strong>et</strong><br />
l’amélioration de la qualité de vie <strong>et</strong> à ce titre peut donc s’inscrire dans une démarche de santé<br />
publique.<br />
C’est dans ce but que j’appelle votre attention sur l’intérêt que représente pour vos résidents la<br />
pratique de c<strong>et</strong>te activité qui pourrait être intégrée dans leurs proj<strong>et</strong>s de vie mais aussi constituer un<br />
objectif de votre proj<strong>et</strong> d’établissement… ».<br />
En espérant que ce courrier facilite en Midi-Pyrénées <strong>et</strong> ailleurs un meilleur accès des personnes en<br />
situation de handicap à la pratique d’activités physiques <strong>et</strong> <strong>sport</strong>ives, ʺraisonnée, régulière <strong>et</strong><br />
raisonnableʺ (comme le préconise le professeur Daniel Rivière, président de la société Midi-Pyrénées<br />
de médecine du <strong>sport</strong>), dans l’objectif notamment d’une meilleure santé.<br />
* disponible en téléchargement sur le site de la DRDJS Midi-Pyrénées (www.drdjs-midipyrenees.jeunesse-<strong>sport</strong>s.gouv.fr/pdf/c-aps/<strong>et</strong>ude_handicap_apsa_qdv_mp_2004.pdf)<br />
.<br />
Pour le développement des pratiques <strong>sport</strong>ives mixtes : une application du principe<br />
de discrimination positive ?<br />
Anne Marcellini, MCU-HDR, Responsable pédagogique de l’accueil des étudiants en<br />
situation de handicap, Laboratoire « Génie des Procédés Symboliques, en Santé <strong>et</strong> en Sport »,<br />
JE 2416, Université Montpellier 1<br />
Production <strong>et</strong> réduction des situations de handicap : la place de l’environnement<br />
30 ans après la loi de 1975, « pour l’intégration des personnes handicapées », à l’heure de la loi de<br />
2005, « pour l’égalité des droits <strong>et</strong> des chances, la participation <strong>et</strong> la citoyenn<strong>et</strong>é des personnes<br />
handicapées », notre pays s’est doté d’un cadre législatif qui constitue en obligation nationale l’accueil<br />
des personnes dites handicapées dans les milieux de vie ordinaire.<br />
On peut s’en féliciter, reste à généraliser, voire à banaliser c<strong>et</strong> accueil. Reste également à le penser,<br />
l’organiser, car on peut accueillir plus ou moins bien la différence. Dans les espaces de pratique<br />
physique <strong>et</strong> <strong>sport</strong>ive, que ce soit en EPS, en club <strong>sport</strong>if, ou dans les pratiques physiques « sauvages »,<br />
que peut signifier « bien accueillir » des personnes en situations de handicap ?<br />
Si l’on se réfère au modèle social du handicap, <strong>et</strong> au processus de production des handicaps (P.<br />
Fougeyrollas, 2000), l’environnement matériel <strong>et</strong> humain est un élément déterminant des situations de<br />
handicaps : de l’organisation de celui-ci dépend donc l’augmentation ou la réduction des situations de<br />
désavantage social que vivent les personnes qui présentent des déficiences <strong>et</strong> des incapacités.<br />
Bien accueillir des personnes en situation de handicap dans les pratiques corporelles signifie donc la<br />
mise en place d’aménagements particuliers de l’environnement matériel <strong>et</strong> humain, prenant en<br />
compte les différences. Et prendre en compte les différences signifie nécessairement une identification,<br />
une reconnaissance <strong>et</strong> une évaluation de celles-ci.<br />
Discriminer pour reconnaître <strong>et</strong> adapter ?<br />
Reconnaître une différence, c’est donc discriminer, au sens de distinguer. En tant qu’enseignants, nous<br />
sommes méfiants à l’égard de l’idée de discriminer certains de nos élèves des autres. Notre<br />
préoccupation égalitaire s’oppose, à première vue, à ce processus de repérage, de catégorisation, voire<br />
d’étiqu<strong>et</strong>age des individus perçu dans ses eff<strong>et</strong>s potentiels négatifs de séparation, voire de ségrégation<br />
- 6 -