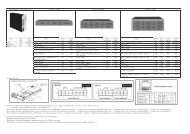LE RESEAU TELEPHONIQUE COMMUTE ... - UV UTBM J. Millet
LE RESEAU TELEPHONIQUE COMMUTE ... - UV UTBM J. Millet
LE RESEAU TELEPHONIQUE COMMUTE ... - UV UTBM J. Millet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>LE</strong> <strong>RESEAU</strong> TE<strong>LE</strong>PHONIQUE <strong>COMMUTE</strong>: R.T.C.<br />
Relier chacun des abonnés français à tous les autres nécessiterait des milliers de milliards de liaisons<br />
=> éléments d’aiguillage, les commutateurs ( centraux téléphoniques ).<br />
Les réseaux téléphoniques sont hiérarchisés et fortement maillés à routage fixe. C’est en particulier le cas du RTC ( réseau<br />
téléphonique commuté ).<br />
I) Architecture générale du RTC<br />
On distingue 2 catégories de commutateurs:<br />
Commutateurs<br />
d’abonnés<br />
( les lignes d’abonnés<br />
sont directement<br />
rattachés )<br />
Commutateurs de<br />
transit<br />
COMMUTATEURS LOCAUX: CL ( appelés CLASSE 4 )<br />
Il n’a qu’un faisceau le reliant au commutateur hiérarchiquement supérieur.<br />
COMMUTATEURS A AUTONOMIE D’ACHEMINEMENT: CAA ( appelés CLASSE 3 )<br />
Il peut analyser les numéros et choisir parmi plusieurs faisceaux pour acheminer l’appel<br />
COMMUTATEURS DE TRANSIT SECONDAIRE: CTS ( appelés CLASSE 2 )<br />
Au dessus des CAA. Il assure le transit du trafic de tous les CAA qui lui sont rattachés.<br />
COMMUTATEURS DE TRANSIT PRINCIPAUX: CTP ( appelés CLASSE 1 )<br />
Le CTP est au sommet de la hiérarchie nationale. Tous les CTP sont reliés 2 à 2 entre eux.<br />
COMMUTATEURS DE TRANSIT INTERNATIONAUX: CTI<br />
Il assure le transit du trafic international.<br />
=> découpage géographique: CL: local, CAA: urbain, CTS: régional, CTP: national, CTI: international.<br />
CTI<br />
CTP<br />
CTP<br />
CTP<br />
CTS<br />
CTS<br />
CAA CAA CAA CAA<br />
CL<br />
USAGER<br />
CL<br />
USAGER USAGER USAGER<br />
Pour le réseau français, il y a plus de 5000 CL , environ 1500 CAA, 50 CTS et une dizaine de CTP.<br />
Pour la région, le CTP est à Nancy, le CTS à Besançon. Il y a des CAA à Belfort et Montbéliard.<br />
J. <strong>Millet</strong> 1<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
a) Acheminement des appels<br />
L’acheminement se fait selon une table de routage statique.<br />
=> Solutions de secours si un acheminement est impossible du fait de l’occupation ou panne.<br />
On distingue 2 possibilités d’acheminement:<br />
Via un faisceau transversal: Entre commutateurs de même niveau = Prioritaire<br />
Via un faisceau hiérarchique: Liaison entre un commutateur et son supérieur hiérarchique = Si nécessaire.<br />
b) Lien avec la numérotation<br />
On retrouve l’architecture du réseau dans le numéro de poste fixe: 10 chiffres: EZ AB PQ MCDU.<br />
E: Indicatif de l’exploitant ( opérateur ).<br />
Z: Indicatif de zone (ZTP)<br />
AB: Indicatif interurbain ( ZTS)<br />
PQ: Indicatif du commutateur de rattachement.<br />
MCDU: Indicatif de l’abonné.<br />
II) Aspect technique<br />
Ce réseau a longtemps été l’unique réseau téléphonique => Transmissions analogiques, terminal = poste simple.<br />
Même si le numérique est arrivé, on ne peut changer simultanément tous les postes français chez les usagers<br />
=> Coeur de réseau numérique depuis 1995.<br />
=> On garde des postes analogiques avec une bande de fréquences 300 Hz - 3400 Hz .<br />
Commutation de circuits,<br />
Signalisation réseau sémaphore CCITT7,<br />
Artères internes de transmissions en fibre optique.<br />
Abonnés de type analogique : 2 fils, 48V continu, paire torsadée, 300-3400 Hz<br />
Signalisation usager : à impulsions ou à fréquences vocales.<br />
.<br />
Autocommutateurs de grande capacité<br />
Les principaux systèmes de commutation de grande capacité sont les suivants:<br />
Fabricant Système Capacité<br />
ALCATEL<br />
E10B3<br />
MT20/25<br />
200 000<br />
65 000<br />
MET ( MATRA ERICSSON ) AXE10 200 000<br />
SIEMENS EWSD 100 000<br />
NORTHERN TE<strong>LE</strong>COM DMS10 (rural )<br />
DMS100 ( urbain )<br />
10 000<br />
100 000<br />
ATT ESS5 100 000<br />
Les commutateurs actuels sont tous numériques à commutation temporelle de circuit.<br />
Sur le réseau France Télécom, on utilise des MT25, E10B3 et des AXE10.<br />
Architecture générale d’un commutateur public<br />
L’organisation de commutateurs de marque différente n’est pas la même. Toutefois on retrouve des éléments communs:<br />
+ Le cœur de chaine : CDC<br />
Il est constitué du réseau de connexion, de l’unité de commande et des unités de<br />
raccordement des circuits ou des multiplex.<br />
J. <strong>Millet</strong> 2<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
+ Les unités de raccordement d’abonnés : URA<br />
Les URA peuvent être locales ( URAL ) ou distantes ( URAD ).<br />
-> URAL + CDC = CAA.<br />
-> URAD éloignée du coeur de chaîne = CL<br />
URA est un terme générique qui englobe des techniques très différentes dans la conception et le fonctionnement des<br />
équipements.<br />
Pour l’E10B3, l’URA est un CSN ( centre satellite numérique ).<br />
Pour l’AXE10, l’URAL est un SSS ( Subscriber Subsystem : Sous système d’abonné ).<br />
l’URAD est un RSS ( Remote Subsystem : Sous système Distant ).<br />
L’un des 2 commutateurs utilisés est l’E10B3, c’est pourquoi le paragraphe suivant lui est consacré.<br />
Exemple de raccordement avec E10B3<br />
Le CSN est fait de 2 sous-ensembles:<br />
Le CN : Concentrateur numérique.<br />
L’UCN : Unité de Commande Numérique.<br />
Le CN réalise l'électronique de base ( conversion analogique/numérique, 1er niveau de concentration,… )<br />
Il peut être + CNL = Local = situé dans la baie du CSN.<br />
+ CNE = Eloigné = situé à distance du CSN, relié à celui-ci par des liaisons MIC.<br />
Il est fait de 1 à 16 cartes d’abonné ou UT ( unité terminale ) = première connexion de l’abonné au réseau.<br />
L’UCN est la partie centrale du CSN. Elle est raccordée à la partie centrale de l’E10B3 par des liaisons MIC.<br />
L'UCN fait + le deuxième niveau de concentration ( 42 multiplex MIC vers 16 multiplex à 2,048 Mbit/s ).<br />
+ le deuxième niveau de connexion et commande avec:<br />
- Affectation des voies temporelles aux communications.<br />
- Traitement des appels ( présélection, libération ).<br />
- Observation de trafic, essais des lignes.<br />
J. <strong>Millet</strong> 3<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
III) Raccordement des abonnés<br />
D’après les remarques précédentes ( nature analogique ou numérique ), le réseau RTC se divise en fait en 2 parties:<br />
Le réseau de distribution ou réseau local. Sa structure est étoilée.<br />
Le réseau de transmission ou réseau national. Sa structure est surtout maillée.<br />
Le réseau local se décompose de la façon suivante:<br />
Point de<br />
Entrée<br />
Répartiteur Sous-répartiteur concentration de poste<br />
CAA<br />
ou CL<br />
Transport Distribution Branchement Installation<br />
intérieure<br />
Ligne d’abonné<br />
ou boucle locale<br />
Du fait de sa densité, c’est la partie du réseau la plus compliquée à gérer même si c’est la plus simple techniquement.<br />
Remarque: Evolution du câblage de la boucle locale<br />
Dans la cas du téléphone ( basses fréquences ), la longueur de ligne modifie peu l'atténuation.<br />
Dans la cas xDSL où l'on veut utiliser des fréquences plus élevées, la longueur de ligne est très importante.<br />
=> On a fait évoluer la boucle locale à certains endroits en remplaçant les sous-répartiteurs passifs par des éléments<br />
actifs. C'est le NRA-ZO = Noeud de Raccordement d'Abonné – Zone d'Ombre ( on a parlé parfois de NRA-HD noeud de<br />
raccordement haut débit ).<br />
source: http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr<br />
J. <strong>Millet</strong> 4<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
Boucle locale cuivre: Liaison téléphonique<br />
IV) Réseaux de collecte et de transport<br />
On a vu la partie Réseau d'accès = Lien abonnés avec premier commutateur du réseau.<br />
Ensuite il y a le réseau de collecte = niveau régional.<br />
Puis il y a le réseau de transport = niveau national.<br />
On utilise souvent SDH ( Synchronous Digital Hierarchy ) en STM16 au niveau collecte = 2,5 Gbit/s<br />
J. <strong>Millet</strong> 5<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
J. <strong>Millet</strong> 6<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
<strong>LE</strong> <strong>RESEAU</strong> NUMERIQUE A INTEGRATION DE SERVICES: R.N.I.S.<br />
Le RTC est fait pour le raccordement d’un terminal par ligne et donne peu de possibilité de gérer une communication<br />
en cours. Son caractère analogique n’est pas adapté à la transmission de données.<br />
La solution est la numérisation de la liaison d’abonné. On arrive ainsi à un lien tout numérique: Le RNIS.<br />
I) Permettre la gestion de communication = Services<br />
Pour permettre de communiquer en même temps la voix ( commutation de circuit ) et les données de gestion de<br />
communication ( commutation de paquets ) on multiplexe 2 types d’informations :<br />
CANAL B<br />
CANAL D<br />
Canal de données en commutation de circuit d’une capacité de 64 kbit/s.<br />
( transfert de données ou de la voix numérisée ).<br />
Canal de données en commutation de paquets dont la capacité dépend du nombre<br />
de canaux B associés.<br />
Il est dédié à la signalisation d’où son type de commutation.<br />
Il est aussi utilisé pour des transferts de données en mode paquet ( X25 ).<br />
Remarque: Le canal B est bipoint ( lien entre 2 usagers, commutation de circuits ) alors que le canal D est multipoints (<br />
partageable par plusieurs utilisateurs ).<br />
Un accès au RNIS est fait d’un ensemble de canaux B et d’un canal D. On trouve actuellement<br />
Accès de base : T0/S0 = 2B + D16<br />
On a 2 canaux B à 64 kbit/s plus un canal D à 16 kbit/s. On arrive ainsi à un débit utile de 144 kbit/s.<br />
A cela s’ajoute différents bits de gestion de trames d’où un débit total de 192 kbit/s<br />
( trames de 48 bits en 250 µs ).<br />
Accès primaire : T2 = 30B + D64<br />
On a 30 canaux B à 64 kbit/s plus un canal D à 64 kbit/s. On arrive à un débit utile de 1984 kbit/s.<br />
A cela s’ajoute des bits de gestion de trames d’où un débit total de 2048 kbit/s.<br />
( 32 IT ou intervalles de temps dans une trame de 125 µs ).<br />
Remarque:<br />
Aux USA ou au Japon, on utilise des accès T1/S1 dont les débits sont différents.<br />
Un accès T2 s’appelle E1 dans ces pays.<br />
Remarque: Les opérateurs propose aussi des groupements d’accès de base. On trouve aussi l’association d’un accès de base et<br />
de 2 lignes analogiques ( Numéris ITOO chez France télécom qui remplace Numéris DUO ).<br />
J. <strong>Millet</strong> 7<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
Les principaux nouveaux services sont:<br />
IDENTIFICATION D’APPEL L’abonné demandé connaitra l’identité de l’abonné demandeur ( numéro principal + sous adresse )<br />
PRESENTATION D’APPEL Un abonné en communication est prévenu qu’un troisième l’appelle. Il peut prendre cette<br />
communication en mettant en garde la première et basculer ainsi de l’une à l’autre.<br />
SOUS-ADRESSE Un abonné RNIS peut connecter plusieurs terminaux sur une même ligne. Pour les différencier, il peut<br />
leur associer une sous-adresse ( 1 à 4 chiffres ). Le réseau transporte l’information mais ne la traite pas.<br />
Cette fonction n’est applicable qu’entre 2 abonnés RNIS.<br />
PORTABILITE Un abonné peut interrompre une communication pour la reprendre d’ici à 3 minutes<br />
+ sur le même terminal non déplacé.<br />
+ sur le même terminal déplacé dans son installation ( même bus ).<br />
+ sur un autre terminal de la même installation.<br />
MINIMESSAGE Echange d’au maximum 32 caractères lors de l’établissement ou de la libération des communications.<br />
Pour la communication voix, on a un message avant de prendre l’appel, en données cela peut être un mot<br />
de passe<br />
SDA: SE<strong>LE</strong>CTION DIRECTE A Une installation peut avoir plusieurs numéros du plan de numérotation national ( 4 derniers chiffres<br />
L’ARRIVEE<br />
différents)<br />
SPECIALISATION DES On réserve un certain nombre de canaux pour une application.<br />
CANAUX<br />
SERVICE RESTREINT Un abonné n’aura pas le droit d’appeler un usager selon son type de numéro, selon la tarification pour<br />
l’atteindre.<br />
INDICATION DU COUT Le coût de la communication est indiqué en temps réel<br />
COUT TOTAL Le coût de la communication est indiqué en fin de communication<br />
TRANSFERT D’APPEL Un abonné fait réacheminer ses communications vers un autre numéro<br />
RENVOI DU TERMINAL Un terminal peut refuser un appel en demandant son renvoi au commutateur d’abonné en précisant<br />
l’adresse de renvoi dans un message de refus.<br />
DOUB<strong>LE</strong> APPEL Un abonné en communication avec un autre peut en appeler un troisième, le deuxième étant mis en<br />
garde<br />
VA ET VIENT Un abonné en communication avec 2 autres peut passer de l’un à l’autre<br />
FACTURATION DETAIL<strong>LE</strong>E Facturation détaillée comme pour le RTC mais avec en plus la séparation selon le service ( voix,<br />
données )<br />
NON IDENTIFICATION Le numéro de l’usager demandeur n’est pas indiqué à l’abonné demandé<br />
D’APPEL<br />
Il existe différentes versions du RNIS.<br />
France télécom les identifie par VNx où x est le numéro de la version.<br />
Dans les autres pays on a d’autres versions où les services sont différents.<br />
La norme Euro-ISDN ( integrated services digital network ) définit des éléments communs.<br />
II ) Connecter plusieurs terminaux : Bus RNIS<br />
Le caractère numérique des informations permet d’utiliser un bus. En raccordement analogique, on doit disposer<br />
d’autant d’accès au réseau que de terminaux que l’on veut utiliser indépendamment.<br />
En raccordement RNIS, on peut raccorder tous les terminaux sur le même support, un bus S. On pourra faire autant<br />
de communication que de canaux B sur un seul accès.<br />
Gestion du bus usager : Exemple d’un accès de base S0<br />
Dans le cas d’une connexion analogique, lorsque l’usager ne veut pas téléphoner, la ligne est ouverte, il ne se passe<br />
rien. En revanche, en RNIS, la gestion est définie par les 3 couches basses du modèle OSI. Avec un accès de base, le<br />
gestionnaire du bus est une TNR ( terminaison numérique de réseau ).<br />
NIVEAU 1: Couche physique<br />
+ Trames échangées:<br />
TNR vers TE<br />
F L B1 E D A F A N B2 E D M B1 E D S B2 E D L<br />
TE vers TNR<br />
F L B1 L D L F A L B2 L D L B1 L D L B2 L D L<br />
2 bits<br />
J. <strong>Millet</strong> 8<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
Chaque canal B est fait de 8 bits. On arrive au total à 48 bits en 250µs. En plus des bits des canaux B et D, on ajoute différents<br />
bits à la trame. On a donc ajouté 12 bits. Ces bits sont:<br />
-Le bit F: Fanion. Ce premier bit de la trame est un 0 logique systématiquement.<br />
-Les bits L d’équilibrage: Il sert à annuler le composante continue du signal. Un bit F est toujours<br />
suivi d’un bit L. Dans le sens TE -> TNR, chaque canal B est suivi d’un bit<br />
L. Dans le sens TNR -> TE, les problèmes posés par la composante continue<br />
étant moins graves, il n’y a qu’un bit de compensation qui termine la trame.<br />
-Le bit F A : Bits de verrouillage de trame auxiliaire: Toujours à 0.<br />
-Les bits E d’écho: Uniquement dans le sens TNR -> TE. Il est aussi utilisé pour l’accès au canal D.<br />
-Les bits A: Bits d’activation: La liaison est inactive hors communication pour diminuer la<br />
consommation d’énergie.<br />
NIVEAU 2: Couche liaison<br />
( Norme I440 ): LAP-D<br />
Le protocole de niveau 2 du RNIS est le LAP-D. C’est un dérivé du LAP-B et donc de HDLC. Il gère la transmission<br />
grâce aux bits D de la trame. Ainsi une fois les terminaux synchronisés, le système sait où sont les bits D dans les trames, il les<br />
en extrait pour les stocker et les analyser:<br />
trame N Trame N+1<br />
trame T0 D j D j+1 D j+2 D j+3 D j+4 D j+5 D j+6 D j+7 D j+8<br />
trame LAP-D = Regroupement D j D j+1 D j+2 D j+3 D j+4 D j+5 D j+6 D j+7 D j+8<br />
des bits D<br />
On reconstitue donc une trame de bits D. Cette trame est au format LAP-D:<br />
Trame LAP-D<br />
( niveau 2 )<br />
Fanion<br />
1 octet<br />
Adresse<br />
2 octets<br />
Contrôle<br />
1 ou 2 octets<br />
Information canal D<br />
FCS<br />
2 octets<br />
Fanion<br />
1 octet<br />
SAPI C/R EA<br />
= 0<br />
TEI<br />
EA<br />
= 1<br />
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
Remarque: Si EA du premier octet est à 1, alors l’adresse n’est que sur un octet.<br />
J. <strong>Millet</strong> 9<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
Le type de trame est défini par le champ contrôle<br />
Fanion Adresse Contrôle Information FCS Fanion<br />
bit 8 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1<br />
N(R) P/F N(S) 0 Trame INFORMATION: I<br />
N(R) P/F S S 0 1 Trame SUPERVISION: S<br />
U U U P/F U U 1 1 Trame NON SEQUENCEE: U<br />
N(S) donne le numéro de la trame d’information émise concernée ( Send )<br />
N(R) donne le numéro de la trame d’information que la station est prête à recevoir ( Received )<br />
S bits définissant les fonctions de supervision<br />
U bits définissant les fonctions complémentaires<br />
P/F P ( poll ): Demande de réponse explicite, émise par une station primaire.<br />
F ( final ): Indication de réponse explicite, émise par une station secondaire suite à une demande ( voir P ).<br />
Trames d’information:<br />
Elles transportent les données utilisateur: Ce sont les seules dont le champ information n’est pas vide.<br />
Elles servent aussi d’acquittement pour les trames reçues grâce à N(R).<br />
N(S) et N(R) sont définis modulo 8 ( de 0 à 7 ) ou modulo 128 avec le contrôle étendu.<br />
Trames de supervision:<br />
On utilise ce type de trame pour acquitter ou rejeter des trames, pour indiquer la disponibilité de la station. Elles sont utilisées par une station primaire ou<br />
secondaire. Elles acquittent les trames jusqu’à N(R)-1.<br />
S 4S 3 = 00: RR ( Receiver ready )<br />
Le Récepteur est prêt à recevoir de nouvelles trames d’informations => Acquittement grâce à N(R).<br />
S 4S 3 = 10: REJ ( Reject )<br />
Le récepteur demande la retransmission de toutes les trames à partir de la trame numérotée N(R).<br />
S 4S 3 = 01: RNR ( Receiver not ready )<br />
Le récepteur est temporairement incapable de recevoir de nouvelles trames d’informations.<br />
S 4S 3 = 11: SREJ ( Selective reject )<br />
Le récepteur demande la retransmission de la trame numéro N(R).<br />
Trames non séquencées ( ou non numérotées):<br />
Elles n’ont ni champ d’information ( il est vide sauf pour un cas ), ni numéro de trame. Elles ont donc un usage général. Elles permettent le contrôle de la<br />
liaison ( initialisation, libération, signalisation d’erreurs,... ).<br />
bit 8 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 Signification<br />
0 0 0 P 1 1 1 1 SARM Set Asynchronous Response Mode<br />
0 0 1 P 1 1 1 1 SABM Set Asynchronous Balanced Mode<br />
0 1 1 P 1 1 1 1 SABME SABM en mode étendu<br />
0 1 0 P 0 0 1 1 DISC Disconnect<br />
0 1 1 F 0 0 1 1 UA Unnumbered Acknowledgment<br />
1 0 0 F 0 1 1 1 CMDR / FRMR Command Reject / Frame Reject<br />
0 0 0 F 1 1 1 1 DM Disconnect Mode<br />
Les trames CMDR/FRMR contiennent un champ d’informations de 4 octets précisant les raisons du rejet.<br />
L’évolution majeure par rapport au LAP-B est l’ajout d’un champ adresse. Le LAP-D remplit les fonctions de HDLC:<br />
+ Synchronisation de ses trames par le fanion,<br />
+ Transport des informations de manière transparente,<br />
+ Le multiplexage de plusieurs liaisons de données,<br />
+ Le maintien en séquence des trames lorsqu’elles sont numérotées ( information et supervision ),<br />
+ La détection d’erreur de transmission ( FCS, format de la trame avec les fanions, numérotation des trames ),<br />
+ La récupération d’informations reçues fausses par retransmission,<br />
+ La régulation de flux par le principe d’acquittement et de fenêtre d’anticipation.<br />
En plus de ces fonctions, LAP-D dispose d’autres éléments de gestion de la liaison:<br />
+ La supervision de l’état de la liaison,<br />
+ La génération et l’analyse du type d’information portée par la trame;<br />
Signalisation,<br />
Information de gestion,<br />
Information de communication en mode paquet.<br />
+ La génération et l’analyse du numéro de terminal ( identifié par le TEI ).<br />
J. <strong>Millet</strong> 10<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
Le champ adresse contient le TEI et le SAPI:<br />
Le SAPI ( Service Access Point Identifier ) peut prendre les valeurs suivantes:<br />
0: Signalisation des canaux B. La trame, appelée trame S est envoyée au réseau sémaphore CCITT n°7.<br />
16: La trame appelée P transporte des données paquets X25 sur canal D.<br />
63: Trame de type M transportant des informations de gestion de l’identité des terminaux: TEI<br />
…<br />
Le TEI ( terminal end point identifier ) permet d’identifier le terminal. Chaque terminal a son TEI.<br />
0: Réservé au cas d’un terminal unique sur le bus.<br />
1 -> 63: Numéro affecté manuellement par l’usager ou le fabricant.<br />
64 -> 126: Numéro attribué automatiquement par le gestionnaire du bus.<br />
127: Venant du réseau : Adresse de diffusion du gestionnaire de bus aux usagers.<br />
Venant d’un terminal : Demande d’attribution de TEI.<br />
Remarque : Utilisation du mode étendu => Trame d’information et de supervision sur 2 octets ce qui permet une numérotation des trames sur un nombre de bits plus<br />
important. Les trames non séquencées sont les mêmes.<br />
8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1<br />
Information I N(S) 0 N(R) P<br />
Supervision RR 0 0 0 0 0 0 0 1 N(R) P/F<br />
Supervision RNR 0 0 0 0 0 1 0 1 N(R) P/F<br />
Supervision REJ 0 0 0 0 1 0 0 1 N(R) P/F<br />
Remarque : Gestion d’accès au canal D de terminaux ayant déjà leur TEI:<br />
Un terminal qui veut se connecter commence par écouter le canal D. Il attend au moins 8 bit à 1. Comme le canal D utilise le LAP-D, un dérivé de HDLC,<br />
on sait que s’il y a plus de 6 bits à 1 c’est que le canal est inactif ( en cas d’activité avec une message à plus de 6 bits à 1, on a insertion automatique de 0 ).<br />
Ensuite, il émet le SAPI = 0 et son TEI.<br />
Au fur et à mesure, il analyse les bits d’écho ( image du canal D ) qui reviennent dans l’autre sens de transmission. Ainsi si plusieurs terminaux demandent<br />
un accès simultané au canal D, le gestionnaire de bus en choisit un. Les terminaux émettent jusqu’à s’apercevoir que le canal écho ne correspond pas à ce qu’il ont émis<br />
sur le canal D, ils cessent alors leur transmission.<br />
Du fait du ET logique réalisé physiquement, l’accès au bus est plus facile pour les terminaux de TEI faible (commençant par des bits 0). Afin de permettre<br />
une probabilité d’accès équitable, on utilise un dispositif de gestion de priorité d’accès. Ce dispositif repose sur la notion de classe de priorité.<br />
Chaque terminal dispose d’un nombre X qu’il fait évoluer selon sa réussite à accéder au canal D. Pour accéder au canal D donc à la connexion, il devra<br />
compter X bits à 1 sur le canal D pour le considérer libre et donc tenter d’y accéder ( X = 8 ou 9 classe de priorité haute, X = 10 ou 11 classe de priorité basse ).<br />
En outre, un message de signalisation aura un accès prioritaire (X=8) par rapport à un message de transmission de données d’une liaison en mode paquet.<br />
NIVEAU 3: Couche réseau<br />
( Norme I450, I451 et I452 ) : protocole D.<br />
La fonction principale du niveau 3 est d’établir, commander, contrôler et gérer les connexions des canaux de<br />
transmissions ( Le LAP-D, de niveau 2 gère la liaison du canal D ). Il doit gérer de nombreux services et compléments de<br />
services.<br />
Les messages de niveau 3 se trouvent dans le champ information de la trame LAP-D. Le SAPI du champ d’adresse du<br />
LAP-D indique quel service réseau est demandé ( SAPI = 0 => Signalisation des canaux B ).<br />
J. <strong>Millet</strong> 11<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
Trame LAP-D<br />
( niveau 2 )<br />
Fanion<br />
1 octet<br />
Adresse<br />
2 octets<br />
Contrôle<br />
1 ou 2 octets<br />
Information signalisation<br />
FCS<br />
2 octets<br />
Fanion<br />
1 octet<br />
niveau 3<br />
Discriminateur de<br />
protocole<br />
Longueur de la<br />
référence d’appel<br />
référence<br />
d’appel<br />
Type de<br />
message<br />
Elément<br />
d’information<br />
Elément<br />
d’information<br />
. . .<br />
1 octet<br />
1 octet avec les<br />
4 premiers bits à<br />
0<br />
1 bit F puis<br />
la valeur sur<br />
7 bits en T0<br />
15 bits en T2<br />
1 octet<br />
m octets<br />
n octets<br />
Elément d’information à octet<br />
unique ( 1 octet )<br />
ou Elément d’information de<br />
longueur variable<br />
1 Identificateur<br />
(3 bits ou 7)<br />
0 Identificateur<br />
(7 bits)<br />
Contenu éventuel<br />
(4 bits ou 0)<br />
Longueur du Contenu<br />
en octets (1 octet)<br />
ou<br />
Contenu<br />
Télécom:<br />
« Discriminateur de protocole » identifie le type de réseau: RNIS = 0000 1000.<br />
« Référence d’appel » permet de repérer un appel de l’établissement de la connexion à la libération.<br />
« Type de message » indique la nature des opérations à effectuer. Les messages suivants correspondent à la version VN6 utilisée pour Numéris de France<br />
Phase d’appel Type de messages Commentaire Code<br />
Alerte L’abonné destinataire est alerté ( sonnerie ) 000 00001<br />
Appel en cours<br />
L’appel est en cours d’établissement, aucune nouvelle 000 00010<br />
information d’établissement ne sera acceptée<br />
Etablissement Appel acheminé Allocation d’un canal B = établissement de la connexion 000 00011<br />
d ’appel Connexion Acceptation de connexion par l’abonné destinataire 000 00111<br />
Accusé de réception de connexion Confirmation de connexion vers l’abonné appelant, 000 01111<br />
ordre de connexion à l’abonné demandé<br />
Etablissement Demande d’établissement d’appel: Initialisation 000 00101<br />
Accusé de réception d’établissement L’établissement d’appel a été déclenché,<br />
on attend la suite de numérotation ( par chevauchement )<br />
( sinon on a appel en cours pour la numérotation par bloc )<br />
000 01101<br />
Déconnexion Invitation à libérer la communication 010 00101<br />
Libération d’appel Libération Confirme que la demande de libération est en cours 010 01101<br />
Fin de libération Confirme la libération, le canal peut être à nouveau utilisé 010 11010<br />
Reprise Demande de reprise d’une communication suspendue 001 00110<br />
Accusé de réception de reprise Confirme la reprise 001 01110<br />
Transfert Refus de reprise Rejet de la demande de reprise 001 00010<br />
d’information Suspension Demande la suspension d’une communication 001 00101<br />
Accusé de réception de suspension Confirme la réalisation de la suspension 001 01101<br />
Refus de suspension Rejet de la demande de suspension 001 00001<br />
Information d’usager Message de signalisation d’usager à usager 001 00000<br />
Information<br />
Informations pour l’établissement de la communication 011 11011<br />
( numérotation par chevauchement )<br />
Facilité Demande d’accès à un service supplémentaire 011 00010<br />
Messages Acceptation de facilité Autorise l’accès au service supplémentaire 011 01010<br />
divers Refus de facilité Rejet de la demande de facilité 011 10010<br />
( facilités ) Enregistrement Enregistrement de données de facilités 011 00100<br />
Acceptation d’enregistrement Autorise l’enregistrement de données de facilités 011 01100<br />
Refus d’enregistrement Rejet de la demande d’enregistrement 011 10100<br />
Etat Indication d’erreur 011 11101<br />
« Elément d’information » contient les informations liées au type de message.<br />
J. <strong>Millet</strong> 12<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
III) Faciliter l’interconnexion : Organisation du RNIS<br />
Modèle de référence<br />
Usagers, serveurs<br />
Usagers, serveurs<br />
RTC<br />
Réseau à commutation<br />
de paquets<br />
RNIS<br />
Commutation de circuits<br />
Commutation de paquets<br />
Signalisation sémaphore<br />
Exploitation, maintenance<br />
V<br />
TNL<br />
Terminaison numérique de ligne<br />
U<br />
Limite du réseau<br />
public<br />
TNR ( pour accès de base )<br />
Terminaison numérique de réseau<br />
ou TNL<br />
pour accès primaire<br />
TNA<br />
Terminaison numérique d’abonné<br />
T<br />
Réalisation matérielle de ce réseau<br />
Partie commutation ( coeur du réseau jusqu’à<br />
l’interface V ): commutateurs numériques<br />
TNL: Carte placée dans un CSN.<br />
S<br />
Terminal<br />
RNIS<br />
ou<br />
S<br />
AT<br />
Adaptateur de terminal<br />
R<br />
Terminal non RNIS<br />
= Terminal adapté<br />
Interface U: Liaison 2 fils entre le CSN et l’abonné.<br />
On utilise les mêmes que pour l’analogique.<br />
Installation chez l’usager:<br />
L’opérateur installe une TNR chez l’usager qui veut un accès<br />
de base S0, ou une TNL pour un accès primaire S2.<br />
Interface T/S: Un PABX peut être esclave côté T<br />
et maître côté S<br />
J. <strong>Millet</strong> 13<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
LIAISONS LOUEES : L.L.<br />
( ex Liaisons Spécialisées : L.S. )<br />
L’opérateur fournit un lien entre deux sites client ( liaison point à point ).<br />
Le service est permanent, au débit choisi. La structure de trame est conforme à la Recommandation G.704.<br />
On utilise une interface 4 fils à paires symétriques conforme au paragraphe 6 de la norme G.703 de l'UIT-T.<br />
Les ETCD sont fournis, installés et entretenus par l’opérateur. ( le type d’interface peut changer ).<br />
L’opérateur garantit le fonctionnement de la liaison ( permanence de la liaison et BER garanti ). En cas de non fonctionnement<br />
de la liaison, l’opérateur devra payer des pénalités.<br />
Exemple : Service Transfix de France Télécom<br />
IT de la trame G704 utilisées:<br />
Débit Option 1 – Avec IT16 Option 2 – Sans IT16<br />
256 kbit/s IT 1 à 3 + IT 16 IT 1 à 4<br />
384 kbit/s IT 1 à 5 + IT 16 IT 1à 6<br />
512 kbit/s IT 1 à 7 + IT 16 IT 1 à 8<br />
768 kbit/s IT 1 à 11 + IT 16 IT 1 à 12<br />
1024 kbit/s IT 1 à 16 sans objet<br />
1920 kbit/s IT 1 à 30 sans objet<br />
1984 kbit/s IT 1 à 31 sans objet<br />
La facturation est forfaitaire. Le coût est calculé selon une formule intégrant distance à vol d’oiseau et débit<br />
exemple :<br />
pour une LL 128 kbit/s : 250,61+12,99 D euros HT/mois avec D < 10 km<br />
342,1 + 3,84 D euros HT/mois avec 10 km < D < 50 km<br />
491,13 + 0,86 D euros HT/mois avec 50 km < D < 300 km<br />
600,95 + 0,49 D euros HT/mois avec 300 km < D<br />
pour une LL 256 kbit/s : 1023,31 + 1,79 D euros HT/mois avec 50 km < D < 300 km<br />
pour une LL 2048 kbit/s : 1494 + 8,99 D euros HT/mois avec 50 km < D < 300 km )<br />
voir le site http://www.lesprix.francetelecom.com/Catalogue<br />
J. <strong>Millet</strong> 14<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
INSTALLATION PRIVEE : PABX<br />
On a vu les réseaux publics RTC et RNIS. En RTC, on a un terminal par ligne réseau. En RNIS, on a au maximum une dizaine<br />
de terminaux pour une ligne réseau.<br />
Si on applique ces liaisons à une entreprise qui possède plusieurs postes téléphoniques<br />
réseau<br />
public<br />
abonnements<br />
entreprise<br />
Dans cette hypothèse<br />
=> N téléphones supposent de payer N abonnements<br />
=> Une communication avec le bureau voisin dans l’entreprise sera facturée par l’opérateur<br />
C’est trop cher avec cette solution, donc l'entreprise a intérêt à acheter un commutateur téléphonique.<br />
=> Communication privées internes à l’entreprise gratuites<br />
=> Abonnements vers le réseau public à l’extérieur en nombre limité ( tout le monde ne téléphone pas en même temps ).<br />
Ce commutateur téléphonique privé est un PABX ( Private Automatix Branch eXchange )<br />
ou autocommutateur privé ( autocom ).<br />
I) Situation d’un PABX ( autocommutateur privé ) par rapport au réseau public et local<br />
réseau<br />
public<br />
Public: Lignes<br />
Accès<br />
abonnements<br />
Privé: Abonné<br />
Poste<br />
Terminal<br />
entreprise<br />
Côté public<br />
LIGNES EXTERIEURES<br />
Numérotation publique 10 chiffres<br />
Côté privé interne à l’entreprise<br />
TERMINAUX LOCAUX<br />
Numérotation privée à 2, 3 ou 4 chiffres<br />
L’autocommutateur privé se situe entre le réseau public et le réseau local. Il fait le lien entre 2 types de numérotation<br />
Appel privé -> public = Ajout de préfixe avant n°<br />
Appel public -> privé = SDA ( Sélection Directe à l'Arrivée = Programmation du PABX pour associer le n° public appelé avec un n° privé )<br />
Le PABX est fait d’une carte mère ( µP + mémoires pour supervision, traitement d'appel, commutation )<br />
de cartes filles qui font les interfaces réseaux et usagers<br />
=> Architecture modulaire répondant à la diversité des réseaux et terminaux.<br />
J. <strong>Millet</strong> 15<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
II) Les différents connexions côté privé: terminaux connectables<br />
Terminal avec interface analogique Z ( en anglais FXS = Subscriber ) => 2 fils, sans configuration<br />
+ Poste analogique ou poste simple.<br />
+ Modem: On transmet des données numériques d’un PC sur accès analogique.<br />
+ Fax catégorie III ( télécopie ): C’est un cas particulier de la transmission précédente.<br />
Terminal avec interface propriétaire UA (Alcatel), I (Matra), … => 2 fils, sans configuration<br />
+ Poste dédié ou numérique: Il fournit de nombreux services (standard).<br />
Terminal avec interface RNIS => 4 fils, avec configuration<br />
+ Adaptateur V24/S, X25/S, Z/S, ...<br />
+ PC avec carte RNIS interne.<br />
+ Poste téléphonique RNIS (interface S) ou visiophone.<br />
+ Fax catégorie IV.<br />
Remarque: Sans PABX, les interfaces S et T du RNIS sont confondues. En revanche il faut les distinguer dès que l’on a un<br />
PABX. Ainsi du point de vue du PABX le T0 est une entrée, le S0 une sortie.<br />
« Terminal » pour CTI<br />
Le CTI, couplage téléphonie informatique, permet d’intégrer téléphonie et informatique<br />
( couplage téléphonie informatique ou computer telephony integration )<br />
Cette intégration permet de fournir des services plus importants:<br />
Il n’y a pas de norme dominante en CTI pour les connexions entre ordinateur et autocommutateur. Chaque<br />
constructeur utilise sa solution ( TAPI pour Microsoft et Intel, TsAPI pour ATT et Novell ).<br />
Exemple: Centre d'appel<br />
Une personne appelant est aussi identifiée par son numéro de téléphone ce qui permet à l’ordinateur de fournir ses<br />
caractéristiques à partir d’une base de données = remontée de fiche.<br />
Exemple: Serveur vocaux interactif ( SVI )<br />
Le client d'une banque peut connaître et modifier ses comptes ( base de données ) via le téléphone.<br />
Exemple: Voitures équipées avec un GSM couplé à un GPS.<br />
Le calculateur de la voiture sait où elle se situe avec le GPS. Il est programmé pour couper l’allumage électronique,<br />
bloquer la voiture si elle sort d’un périmètre prédéfini et signaler sa situation par GSM.<br />
Exemple: ACR acheminement à coût réduit = LCR least cost routing.<br />
Selon le numéro appelé, un PABX choisit l’opérateurs et modifie le numéro en conséquence.<br />
III) Les différentes connexions côté public<br />
Ligne analogique vers RTC: LR ( ligne réseau ) ( en anglais FXO = Office )<br />
2 fils, 1 circuit, 48 V continu.<br />
Remarque: Ne pas confondre une interface FXS qui permet de brancher un poste analogique<br />
avec FXO qui permet de brancher le RTC ( accès analogique ou LR ligne réseau ).<br />
Ligne RNIS ( T0, T2 )<br />
+ T0 accès de base ( BRI Basic Rate Interface ): 2 canaux B.<br />
+ T2 accès primaire ( PRI Primary Rate Interface ): 30 canaux B.<br />
On peut aussi avoir des combinaisons: Moitié de T2, des T2 spécialisés en entrée, en sortie,...<br />
Ligne IP<br />
Voir chapitre ToIP.<br />
Remarque: Pour le RNIS ( ISDN en anglais ), une carte de PABX peut être<br />
- en S0 = maitre = NT mode ( Network Terminator ): La carte S0 gère le bus = donne les ordres,<br />
On branche dessus un terminal via le bus.<br />
- en TO = esclave = TE mode ( Terminal Equipement ): La carte T0 se branche au réseau public RNIS,<br />
elle reçoit des ordres.<br />
J. <strong>Millet</strong> 16<br />
RTC, RNIS, LL, PABX
carte T0 de PABX =<br />
en TE mode ( slave )<br />
carte S0 de PABX =<br />
en NT mode ( master )<br />
J. <strong>Millet</strong> 17<br />
RTC, RNIS, LL, PABX