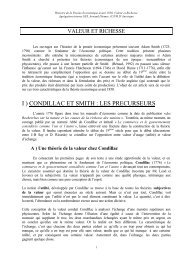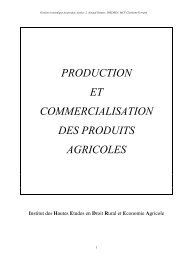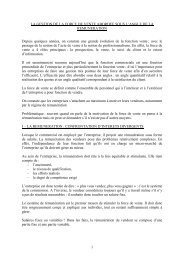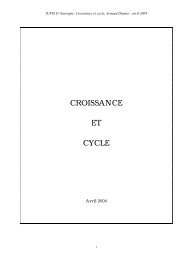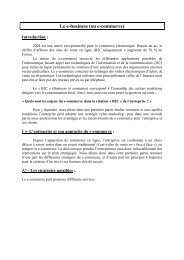Les répartitions possibles entre les acteurs de la ... - Oeconomia.net
Les répartitions possibles entre les acteurs de la ... - Oeconomia.net
Les répartitions possibles entre les acteurs de la ... - Oeconomia.net
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Les</strong> répartitions <strong>possib<strong>les</strong></strong> <strong>entre</strong> <strong>les</strong><br />
<strong>acteurs</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière agro-alimentaire <strong>de</strong>s<br />
gains éventuels tirés <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes<br />
transgéniques en France<br />
Stéphane Lemarié<br />
Marion Desquilbet<br />
Arnaud Diemer<br />
Stéphan Marette<br />
Fabrice Levert<br />
Myriam Carrère<br />
David Bullock (col<strong>la</strong>b.)<br />
Juillet 2001<br />
Etu<strong>de</strong> financée par le Commissariat Général du P<strong>la</strong>n<br />
(convention d'étu<strong>de</strong> numéro 01/2001)
Liste <strong>de</strong>s auteurs et affiliations<br />
Myriam Carrère<br />
Ingénieur d'Etu<strong>de</strong><br />
INRA-ESR, équipe SERD<br />
INRA Université Pierre Mendès France<br />
BP 47<br />
38040 Grenoble Ce<strong>de</strong>x 9<br />
carrere@grenoble.inra.fr<br />
http://www.grenoble.inra.fr<br />
Arnaud Diemer<br />
Maître <strong>de</strong> Conférence<br />
IUFM d'Auvergne<br />
IHEDREA Paris<br />
Département d’Economie<br />
36-38 avenue Jean-Jaurès<br />
63400 Chamalières<br />
adiemer@auvergne.iufm.fr<br />
Fabrice Levert<br />
Assistant Ingénieur<br />
INRA-ESR<br />
équipe Politique Agricole et Modélisation<br />
rue Adolphe Bobierre<br />
CS 61103, 35011 Rennes ce<strong>de</strong>x<br />
Fabrice.Levert@roazhon.inra.fr<br />
http://www.rennes.inra.fr/economie<br />
Marion Desquilbet<br />
Chargée <strong>de</strong> Recherche<br />
INRA-ESR<br />
équipe Politique Agricole et Modélisation<br />
rue Adolphe Bobierre<br />
CS 61103, 35011 Rennes ce<strong>de</strong>x<br />
Marion.Desquilbet@roazhon.inra.fr<br />
http://www.rennes.inra.fr/economie<br />
Stéphane Lemarié<br />
Chargé <strong>de</strong> Recherche<br />
INRA-ESR, équipe SERD<br />
INRA Université Pierre Mendès France<br />
BP 47<br />
38040 Grenoble Ce<strong>de</strong>x 9<br />
lemarie@grenoble.inra.fr<br />
http://www.grenoble.inra.fr<br />
Stéphan Marette<br />
Chargé <strong>de</strong> Recherche<br />
UMR Economie Publique INRA-INAPG<br />
16 rue C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Bernard<br />
75231 Paris ce<strong>de</strong>x 05<br />
marette@inapg.inra.fr<br />
Le chapitre 3 <strong>de</strong> ce rapport a été réalisé en col<strong>la</strong>boration avec David Bullock:<br />
David S. Bullock<br />
Associate Professor<br />
Department of Agricultural and Consumer Economics<br />
University of Illinois<br />
305 Mumford Hall<br />
1301 W. Gregory Drive<br />
Urbana, IL 61801<br />
Etats-Unis<br />
dsbulloc@uiuc.edu<br />
http://www.ace.uiuc.edu/faculty/bullockd.html
Remerciements<br />
Ce rapport présente un bi<strong>la</strong>n d'un peu plus <strong>de</strong> 6 mois <strong>de</strong> recherche. Pour conduire ces travaux, nous<br />
avons bénéficié <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> plusieurs personnes que nous souhaitons remercier.<br />
Le <strong>de</strong>uxième chapitre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> n'aurait pas pu être conduit sans l'accès à différentes données<br />
qui nous ont été fournies par l'AGPM, le CETIOM, l'ITB et <strong>la</strong> Protection <strong>de</strong>s Végétaux. Nous tenons à<br />
remercier <strong>les</strong> personnes <strong>de</strong> ces institutions avec qui nous avons été en contact, non seulement pour<br />
l'accès aux données, mais également pour leurs suggestions et réponses à nos questions.<br />
L'analyse présentée ici s'appuie en partie sur une quinzaine d'<strong>entre</strong>tiens réalisés auprès <strong>de</strong><br />
responsab<strong>les</strong> d'<strong>entre</strong>prises ou d'organismes que nous tenons à remercier pour leur accueil et le temps<br />
passé à répondre à nos interrogations.<br />
A mi-parcours, nous avons eu l'occasion <strong>de</strong> discuter <strong>de</strong> résultats intermédiaires avec Hacina<br />
Benhamed, Pierre-Benoît Joly, Antoine Messéan et Egizio Valsceschini que nous remercions pour<br />
leurs observations.<br />
<strong>Les</strong> résultats présentés ici n'engagent bien sûr que <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong>s auteurs.
Sommaire<br />
Résumé<br />
Une évolution <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>de</strong>ux métiers <strong>de</strong> l'amont: <strong>les</strong> semences et <strong>les</strong> produits phytosanitaires i<br />
La diffusion et l'impact potentiel <strong>de</strong>s OGM en France: quelques résultats concernant <strong>la</strong> betterave, le<br />
colza et le maïs_____________________________________________________________________ ii<br />
Evaluation <strong>de</strong>s coûts potentiels en cas <strong>de</strong> coexistence OGM / non OGM en France pour le colza et le<br />
maïs _____________________________________________________________________________ v<br />
Introduction 1<br />
Chapitre 1. Le développement <strong>de</strong>s OGM et l'évolution <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong><br />
<strong>les</strong> métiers <strong>de</strong> l'amont <strong>de</strong> l'agriculture<br />
Introduction________________________________________________________________________ 6<br />
1. <strong>Les</strong> déterminants <strong>de</strong>s ventes et <strong>de</strong>s profits tirés <strong>de</strong>s innovations dans <strong>les</strong> industries amonts _______ 7<br />
1.1. <strong>Les</strong> semences conventionnel<strong>les</strong>_____________________________________________________ 8<br />
- Le cadre réglementaire ___________________________________________________________ 8<br />
- <strong>Les</strong> déterminants <strong>de</strong> l'appropriabilité_________________________________________________ 8<br />
- La segmentation et <strong>les</strong> pratiques <strong>de</strong>s agriculteurs ______________________________________ 11<br />
1.2. Produits phytosanitaires ________________________________________________________ 13<br />
- <strong>Les</strong> caractéristiques <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s produits et le contexte réglementaire _______________________ 13<br />
- La segmentation _______________________________________________________________ 15<br />
- <strong>Les</strong> pratiques <strong>de</strong>s agriculteurs _____________________________________________________ 15<br />
- <strong>Les</strong> volumes <strong>de</strong> ventes et leurs distributions __________________________________________ 16<br />
1.3. Vers le développement <strong>de</strong> variétés présentant <strong>de</strong>s composantes <strong>de</strong> l'offre en protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes 17<br />
- Le traitement <strong>de</strong> semences _______________________________________________________ 17<br />
- <strong>Les</strong> variétés non-OGM résistantes à <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s _____________________________________ 18<br />
- <strong>Les</strong> variétés OGM ______________________________________________________________ 18<br />
2. <strong>Les</strong> <strong>acteurs</strong> et <strong>les</strong> structures industriel<strong>les</strong> ______________________________________________ 19<br />
2.1. Evolution générale dans l'industrie <strong>de</strong>s semences ______________________________________ 19<br />
2.2. Evolution générale dans l'industrie <strong>de</strong>s phytosanitaires _________________________________ 21<br />
2.3. Evolution générale sur <strong>les</strong> biotechnologies agrico<strong>les</strong> ___________________________________ 24<br />
- Du côté <strong>de</strong>s firmes détentrices <strong>de</strong>s OGM _____________________________________________ 24
- Du côté <strong>de</strong>s semenciers __________________________________________________________ 26<br />
3. Un modèle <strong>de</strong> compétition sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes __________________________________ 27<br />
3.1. Le modèle ___________________________________________________________________ 27<br />
3.2. <strong>Les</strong> fonctions <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> _______________________________________________________ 29<br />
3.3. L'équilibre initial avec une seule solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes ________________________ 30<br />
3.4. Analyse <strong>de</strong> l'impact <strong>de</strong> l'introduction d'une solution OGM _______________________________ 32<br />
- Analyse dans le cas IR __________________________________________________________ 32<br />
- Analyse dans le cas HT__________________________________________________________ 33<br />
Conclusion ________________________________________________________________________ 34<br />
Références ________________________________________________________________________ 35<br />
Annexe A. Solution analytique du modèle <strong>de</strong> concurrence __________________________________ 36<br />
- Le cas IR_______________________________________________________________________ 36<br />
- Le cas HT______________________________________________________________________ 36<br />
Chapitre 2. La diffusion potentielle <strong>de</strong>s OGM en France et son impact sur<br />
le revenu <strong>de</strong>s agriculteurs et <strong>de</strong>s firmes situées en amont<br />
Introduction_______________________________________________________________________ 39<br />
1. <strong>Les</strong> hypothèses <strong>de</strong> travail et <strong>la</strong> démarche ______________________________________________ 40<br />
1.1. Hypothèses généra<strong>les</strong>___________________________________________________________ 40<br />
1.2. La démarche retenue pour réaliser <strong>les</strong> estimations dans ce chapitre________________________ 41<br />
2. Analyse dans le cas HT (Colza et Betterave)____________________________________________ 44<br />
2.1. Formu<strong>la</strong>tion analytique _________________________________________________________ 44<br />
2.2. Application au cas du Colza HT ___________________________________________________ 49<br />
- <strong>Les</strong> données <strong>de</strong> départ __________________________________________________________ 49<br />
- L'adoption <strong>de</strong> programme OGM ___________________________________________________ 51<br />
- <strong>Les</strong> gains <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> et <strong>la</strong> stratégie optimale sur <strong>les</strong> OGM ________________________________ 52<br />
- L'impact sur l'utilisation <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels __________________________________ 56<br />
- Analyse <strong>de</strong> sensibilité ___________________________________________________________ 57
2.3. Application au cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave HT ______________________________________________ 65<br />
- <strong>Les</strong> hypothèses et données <strong>de</strong> base _________________________________________________ 65<br />
- L'adoption <strong>de</strong> programme OGM ___________________________________________________ 67<br />
- <strong>Les</strong> gains <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> et <strong>la</strong> stratégie optimale sur <strong>les</strong> OGM ________________________________ 69<br />
L'impact sur l'utilisation <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels ___________________________________ 72<br />
- Analyse <strong>de</strong> sensibilité ___________________________________________________________ 73<br />
3. Analyse dans le cas du maïs Bt ______________________________________________________ 76<br />
3.1. Formu<strong>la</strong>tion analytique _________________________________________________________ 77<br />
- <strong>Les</strong> indices et variab<strong>les</strong> __________________________________________________________ 77<br />
- Le profit et l'utilité <strong>de</strong> l'agriculteur _________________________________________________ 78<br />
- Définition <strong>de</strong>s seuils d'adoption ___________________________________________________ 79<br />
3.2. Analyse <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> valeurs <strong>de</strong> paramètres pour l'adoption <strong>de</strong>s technologies ________________ 80<br />
- Effet du prix du maïs Bt (w g )______________________________________________________ 80<br />
- Effet du niveau d'aversion au risque (b)______________________________________________ 82<br />
3.3. Projection sur <strong>la</strong> France ________________________________________________________ 84<br />
- Formu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour chaque technologie et le profit <strong>de</strong>s firmes situées en amont _____ 84<br />
- <strong>Les</strong> données <strong>de</strong> départ __________________________________________________________ 84<br />
- Analyse <strong>de</strong> l'effet <strong>de</strong> l'introduction du maïs Bt dans le cas <strong>de</strong> base__________________________ 87<br />
Conclusion ________________________________________________________________________ 92<br />
- Rappel <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> _____________________________________________________________ 92<br />
- Rappel <strong>de</strong>s résultats ______________________________________________________________ 92<br />
- Limites et extensions <strong>possib<strong>les</strong></strong> ______________________________________________________ 93<br />
Références ________________________________________________________________________ 95<br />
Annexe A. Informations sur <strong>les</strong> données brutes utilisées pour <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions sur le Colza HT______ 96<br />
A.1. Nettoyage <strong>de</strong> <strong>la</strong> base : __________________________________________________________ 96<br />
A.2. Problème du prix <strong>de</strong>s produits :___________________________________________________ 96<br />
A.3. Pondération <strong>de</strong> l’échantillon : ____________________________________________________ 98<br />
Annexe B - <strong>Les</strong> données utilisées _____________________________________________________ 100
Chapitre 3. Evaluation ex ante <strong>de</strong>s coûts potentiels en cas <strong>de</strong><br />
coexistence OGM / non OGM en France<br />
Introduction______________________________________________________________________ 104<br />
1. Analyse ex ante <strong>de</strong>s coûts potentiels liés à <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM en France _________ 104<br />
1.1. La réglementation actuelle <strong>de</strong> l'Union Européenne et <strong>de</strong> <strong>la</strong> France sur <strong>les</strong> OGM et le non OGM__ 105<br />
a. <strong>Les</strong> autorisations sur le maïs et le colza OGM dans l'Union Européenne et en France__________ 105<br />
b. La réglementation sur le non OGM dans l'Union Européenne ___________________________ 106<br />
1.2. <strong>Les</strong> coûts potentiels liés à <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM, <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences à <strong>la</strong><br />
transformation _____________________________________________________________________ 108<br />
a. <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences _______ 109<br />
b. <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM / non OGM sur l'exploitation agricole _________________ 115<br />
c. <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM / non OGM au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte et du stockage ________ 117<br />
d. <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM / non OGM au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation ______________ 122<br />
1.3. Conclusion partielle___________________________________________________________ 123<br />
2. Répartition potentielle <strong>de</strong>s coûts liés à <strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong>: un<br />
modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion _________________________________________________________________ 125<br />
2.1. Introduction : structure du modèle et hypothèses principa<strong>les</strong> ____________________________ 126<br />
2.2. Cadre analytique _____________________________________________________________ 130<br />
a. Agriculteurs <strong>de</strong> l'UE __________________________________________________________ 130<br />
b. Stockeurs/transformateurs <strong>de</strong> l'UE________________________________________________ 132<br />
c. Consommateurs <strong>de</strong> l'UE________________________________________________________ 135<br />
d. Deman<strong>de</strong> excé<strong>de</strong>ntaire du reste du mon<strong>de</strong> __________________________________________ 137<br />
e. Conditions d'équilibre _________________________________________________________ 137<br />
2.3. Simu<strong>la</strong>tions _________________________________________________________________ 138<br />
a. Présentation du modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion _____________________________________________ 138<br />
b. Simu<strong>la</strong>tion 1 ________________________________________________________________ 140<br />
c. Simu<strong>la</strong>tion 2 ________________________________________________________________ 144<br />
d. Simu<strong>la</strong>tion 3 ________________________________________________________________ 145<br />
2.4. Conclusion partielle___________________________________________________________ 146<br />
Conclusion _______________________________________________________________________ 148<br />
Références _______________________________________________________________________ 148<br />
Annexes _________________________________________________________________________ 151
Annexe 1. <strong>Les</strong> étapes <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> colza _______________________ 151<br />
A1.1. La création variétale (semences <strong>de</strong> pré-base)_______________________________________ 151<br />
A1.2. La multiplication <strong>de</strong>s parents (semences <strong>de</strong> base) et <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semence commerciale chez <strong>les</strong><br />
agriculteurs _______________________________________________________________________ 152<br />
A1.3. <strong>Les</strong> îlots <strong>de</strong> production pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semence <strong>de</strong> base et <strong>de</strong> semence commerciale ____ 153<br />
A1.4. Livraison et conditionnement <strong>de</strong> semence commerciale _______________________________ 153<br />
Annexe 2. Le circuit logistique <strong>de</strong> <strong>la</strong> graine chez l'organisme stockeur________________________ 154<br />
Annexe 3. <strong>Les</strong> marchés du maïs et du colza en France et dans l'Union Européenne______________ 155<br />
A3.1. Développement <strong>de</strong>s cultures OGM en maïs et colza dans le mon<strong>de</strong>_______________________ 155<br />
A3.2. <strong>Les</strong> importations <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> colza (semence, graines, produits transformés) en France et dans<br />
l'Union Européenne _________________________________________________________________ 156<br />
- <strong>Les</strong> importations <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs et colza _______________________________________ 156<br />
- <strong>Les</strong> importations <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> colza au sta<strong>de</strong> agricole et au sta<strong>de</strong> transformé ________________ 157<br />
A3.3. <strong>Les</strong> utilisations intérieures du maïs et du colza______________________________________ 158<br />
Annexe 4. Calibrage du modèle ______________________________________________________ 160<br />
A4.1. Calibrage <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s agriculteurs __________________________________ 161<br />
- coûts <strong>de</strong> production par tonne du colza non OGM sans i<strong>de</strong>ntité préservée ___________________ 161<br />
- coûts <strong>de</strong> production par tonne du colza OGM ________________________________________ 162<br />
- coûts <strong>de</strong> production par tonne du colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée _____________________ 163<br />
A4.2. Calibrage <strong>de</strong>s paramètres <strong>de</strong>s transformateurs______________________________________ 163<br />
- Calibrage <strong>de</strong> c rh _______________________________________________________________ 163<br />
- Calibrage <strong>de</strong> c ih _______________________________________________________________ 163<br />
- Calibrage <strong>de</strong> k________________________________________________________________ 164<br />
A4.3. Calibrage <strong>de</strong>s paramètres <strong>de</strong>s consommateurs ______________________________________ 164<br />
- Calibrage <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> finale lorsque tous <strong>les</strong> consommateurs sont indifférents <strong>entre</strong> le colza non IP<br />
et le colza IP_____________________________________________________________________ 164<br />
- Calibrage <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> finale lorsqu'un consommateur sur <strong>de</strong>ux refuse le colza non IP ________ 166<br />
A4.4. Calibrage du reste du mon<strong>de</strong> ___________________________________________________ 166
Liste <strong>de</strong>s tableaux<br />
Chapitre 1.<br />
Tableau 1. Type <strong>de</strong> fécondation et types <strong>de</strong> variétés pour <strong>les</strong> principa<strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s cultures.............................10<br />
Tableau 2. <strong>Les</strong> déterminants <strong>de</strong> l'appropriabilité sur <strong>les</strong> innovations semencières............................................10<br />
Tableau 3. Poids <strong>de</strong>s différentes espèces végéta<strong>les</strong> dans l'activité semencière en France..................................11<br />
Tableau 4. Segmentation <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> semences sur <strong>la</strong> betterave, le colza et le maïs...................................12<br />
Tableau 5. Chiffre d'affaires en produits phytosanitaires <strong>de</strong> principaux pays d'Europe <strong>de</strong> l'Ouest............16<br />
Tableau 6. Chiffre d’affaires du marché phytosanitaire français (en millions <strong>de</strong> F)..........................................16<br />
Tableau 7. Spécialisation <strong>de</strong>s semenciers sur <strong>les</strong> différents marchés par espèce .................................................20<br />
Tableau 8. <strong>Les</strong> principa<strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises <strong>de</strong> phytosanitaires en France.....................................................................24<br />
Tableau 9. Participation <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> l'agrochimie dans <strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises semencières ..................................26<br />
Tableau 10. Valeurs <strong>de</strong> paramètres retenues pour <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions..........................................................................29<br />
Tableau 11. Résultat <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux premières simu<strong>la</strong>tions avec uniquement <strong>la</strong> solution 1 .........................................32<br />
Tableau 12. Impact <strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution 2 dans le cas IR......................................................................32<br />
Tableau 13. Impact <strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution 2 dans le cas HT....................................................................33<br />
Chapitre 2.<br />
Tableau 1. Remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s programmes conventionnels par <strong>les</strong> programmes OGM..................................50<br />
Tableau 2. Bi<strong>la</strong>n global <strong>de</strong>s gains liés à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM (en MF) .................................................................56<br />
Tableau 3. L'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels ............................57<br />
Tableau 4. Bi<strong>la</strong>n global avec différentes valeurs <strong>de</strong> D .................................................................................................59<br />
Tableau 5. Bi<strong>la</strong>n global avec un taux <strong>de</strong> marge plus faible sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels..........................59<br />
Tableau 6. Bi<strong>la</strong>n global avec une baisse <strong>de</strong> prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels....................................................61<br />
Tableau 7. Bi<strong>la</strong>n global sans prise en compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> passage (en MF) ........................................................62<br />
Tableau 8. Synthèse <strong>de</strong>s effets observés avec l'analyse <strong>de</strong> sensibilité ......................................................................64<br />
Tableau 9. Remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s programmes OGM par <strong>les</strong> programmes conventionnels .................................66<br />
Tableau 10. Bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s pertes et gains pour <strong>les</strong> différents types d'<strong>acteurs</strong> (MF) ...................................................72<br />
Tableau 11. L'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong>s principaux herbici<strong>de</strong>s conventionnels...72<br />
Tableau 12. Bi<strong>la</strong>n global avec différentes valeurs <strong>de</strong> D ...............................................................................................74<br />
Tableau 13. L'effet d'une baisse du prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels sur le bi<strong>la</strong>n global ..............................75<br />
Tableau 14. Valeur <strong>de</strong>s paramètres dans le cas <strong>de</strong> base.............................................................................................87<br />
Tableau 15. Bi<strong>la</strong>n global <strong>de</strong>s gains liés à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong> maïs Bt (en MF) .............................................................91<br />
Tableau 16. Détail <strong>de</strong>s données départementa<strong>les</strong> utilisées pour <strong>la</strong> projection <strong>de</strong>s effets du maïs Bt en<br />
France........................................................................................................................................................................... 102
Chapitre 3.<br />
Tableau 1. Prix (F / t) et quantités (M t) dans <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions ............................................................................... 140<br />
Tableau 2. Changement dans <strong>les</strong> profits et <strong>les</strong> utilités <strong>de</strong> différents groupes d'agriculteurs, <strong>de</strong><br />
transformateurs et <strong>de</strong> consommateurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation initiale à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. unité: F / t .............. 143<br />
Tableau 3. Changement dans <strong>les</strong> profits et <strong>les</strong> utilités <strong>de</strong> différents groupes d'agriculteurs, <strong>de</strong><br />
transformateurs et <strong>de</strong> consommateurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation initiale à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 2. unité: F / t .............. 145<br />
Tableau 4. Changement dans <strong>les</strong> profits et <strong>les</strong> utilités <strong>de</strong> différents groupes d'agriculteurs, <strong>de</strong><br />
transformateurs et <strong>de</strong> consommateurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation initiale à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 3. unité: F / t .............. 146<br />
Tableau A1. Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> maïs OGM dans le mon<strong>de</strong> ........................................................... 155<br />
Tableau A2. Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> colza OGM dans le mon<strong>de</strong> .......................................................... 156<br />
Tableau A3. Semences <strong>de</strong> maïs : bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> commercialisation et origine <strong>de</strong>s importations, campagne<br />
1999/2000 .................................................................................................................................................................... 156<br />
Tableau A4. Semences <strong>de</strong> colza : bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> commercialisation, campagne 1999/2000................................. 157<br />
Tableau A5. Bi<strong>la</strong>n d'approvisionnement du maïs, UE à 15 .................................................................................... 157<br />
Tableau A6. Bi<strong>la</strong>n d'approvisionnement du colza, UE à 15 ................................................................................... 158<br />
Tableau A7. Utilisations intérieures du maïs, UE à 15............................................................................................. 158<br />
Tableau A7bis. Utilisations du maïs, France (1999/00)............................................................................................ 159<br />
Tableau A8. Utilisations <strong>de</strong>s tourteaux et hui<strong>les</strong> <strong>de</strong> colza, UE à 15 ...................................................................... 159<br />
Tableau A9. Prix et quantités pour le colza non OGM sans IP dans <strong>la</strong> situation initiale............................... 160<br />
Tableau A.10. Hypothèses sur <strong>les</strong> é<strong>la</strong>sticités prix du colza non OGM sans maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité dans <strong>la</strong><br />
situation initiale......................................................................................................................................................... 160<br />
Tableau A11. Hypothèses sur <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong>s autres paramètres exogènes...................................................... 161
Liste <strong>de</strong>s figures<br />
Chapitre 1.<br />
Figure 1. Evolution <strong>de</strong>s positions <strong>de</strong>s lea<strong>de</strong>rs en phytosanitaires <strong>de</strong>puis 1999.....................................................22<br />
Figure 2. Génop<strong>la</strong>nte et <strong>les</strong> alliances <strong>entre</strong> <strong>les</strong> principaux <strong>acteurs</strong> français dans <strong>les</strong> biotechnologies<br />
agrico<strong>les</strong>..........................................................................................................................................................................27<br />
Figure 3. Représentation <strong>de</strong> l'utilité <strong>de</strong>s agriculteurs et <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> basculements .........................................30<br />
Chapitre 2.<br />
Figure 1. Distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage dans l’échantillon total ................................................................49<br />
Figure 2. Distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage pour <strong>les</strong> programmes 100, 010, 110 et 001 remp<strong>la</strong>cés par un<br />
programme OGM à un passage...............................................................................................................................51<br />
Figure 3. Distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage pour <strong>les</strong> programmes 101, 011, et 111 remp<strong>la</strong>cés par un<br />
programme OGM à <strong>de</strong>ux passages.........................................................................................................................51<br />
Figure 4. Courbe <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM en fonction du supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM...............52<br />
Figure 5. Evolution <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> désherbage pour <strong>les</strong> agriculteurs <strong>de</strong> l’échantillon....................................53<br />
Figure 6. Gains réalisés par l'innovateur avec ou sans prise en compte <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong><br />
l'herbici<strong>de</strong> OGM...........................................................................................................................................................54<br />
Figure 7. <strong>Les</strong> pertes <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels.........................................................................54<br />
Figure 8. Bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s gains et pertes réalisées par l’ensemble <strong>de</strong>s firmes d’amont.................................................55<br />
Figure 9. Sensibilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> diffusion à D .......................................................................................................58<br />
Figure 10. Sensibilité du profit <strong>de</strong> l'innovateur à D .....................................................................................................58<br />
Figure 11. Impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse du prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels sur <strong>la</strong> courbe d’adoption....................60<br />
Figure 12. Impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> passage sur <strong>la</strong> courbe d’adoption..................................62<br />
Figure 13. Distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage dans l’échantillon total ..............................................................65<br />
Figure 14. Courbe d’adoption potentielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave OGM résistant à un herbici<strong>de</strong>................................67<br />
Figure 15. Courbe d’adoption potentielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave OGM par zone géographique*...............................68<br />
Figure 16. Courbe d’adoption potentielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave OGM par type d'exploitation*...............................68<br />
Figure 17. Evolution <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> désherbage Betterave pour <strong>les</strong> agriculteurs ............................................69<br />
Figure 18. Gain <strong>de</strong> l'innovateur.........................................................................................................................................70<br />
Figure 19. Perte <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels................................................................................70<br />
Figure 20. Variation <strong>de</strong>s gains pour l'ensemble <strong>de</strong>s firmes situées en amont.......................................................71<br />
Figure 21. Représentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> comparaison <strong>entre</strong> différentes technologies.......................................................79<br />
Figure 22. Evolution <strong>de</strong>s niveaux d'indifférence avec le prix du maïs Bt (w g )......................................................81<br />
Figure 23. Représentation <strong>de</strong>s zones d'adoption <strong>de</strong>s trois technologies .................................................................82<br />
Figure 24. Evolution <strong>de</strong>s niveaux d'indifférence avec le niveau d'aversion au risque et w g faible..................83<br />
Figure 25. Evolution <strong>de</strong>s niveaux d'indifférence avec le niveau d'aversion au risque et w g élevé ...................83<br />
Figure 26. Distribution <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> Pyrale en France..........................................................................................85<br />
Figure 27. Carte <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> Pyrale en France ..........................................................................86
Figure 28. Courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en maïs Bt.....................................................................................................................88<br />
Figure 29. Courbe <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment moyen du maïs français ........................................................................................89<br />
Figure 30. Dépenses <strong>de</strong>s agriculteurs pour le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pyrale ........................................................................90<br />
Figure 31. Revenu <strong>de</strong>s agriculteurs diminué <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> pyrale...........................................90<br />
Chapitre 3.<br />
Figure 1 : Structure du modèle....................................................................................................................................... 126<br />
Liste <strong>de</strong>s encarts<br />
Chapitre 1.<br />
Encart 1. Quelques rappels sur <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> différenciation et <strong>la</strong> segmentation <strong>de</strong>s marchés ......................11<br />
Encart 2. La gamme <strong>de</strong> produit tiré du Glyphosate par Monsanto.........................................................................13<br />
Chapitre 3.<br />
Encart 1. Autorisations sur <strong>les</strong> OGM en France : le cas du maïs et du colza.................................................... 106<br />
Encart 2. Présence fortuite d'OGM dans <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> variétés non OGM : trois cas d'intervention<br />
gouvernementale en 2000 ....................................................................................................................................... 107<br />
Encart 3. Différents cas <strong>de</strong> figure envisagés pour <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong>s équipements <strong>de</strong>s organismes<br />
stockeurs dans <strong>les</strong> filières OGM et non OGM................................................................................................... 120
Résumé<br />
Ce rapport vise à fournir <strong>de</strong>s éléments d'évaluation ex ante <strong>de</strong>s effets économiques qui résulteraient<br />
d'une diffusion <strong>de</strong>s OGM en France, et notamment <strong>de</strong>s gains ou <strong>de</strong>s pertes pour <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong><br />
et au niveau global. <strong>Les</strong> OGM pris en compte dans cette étu<strong>de</strong> sont ceux qui ont déjà connu une<br />
diffusion importante en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l'Union Européenne, à savoir, ceux qui présentent une amélioration<br />
sur <strong>de</strong>s caractères agronomiques. Plus précisément, il s'agit <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes tolérantes à un herbici<strong>de</strong> total<br />
(HT) et <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes résistantes à un insecte (IR). Dans le cas HT, il est possible d'éliminer <strong>les</strong> adventices<br />
en appliquant l'herbici<strong>de</strong> total sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte à n'importe quel sta<strong>de</strong>. Dans le cas IR, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte est<br />
protégée <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> cet insecte, sans application d'insectici<strong>de</strong>. Cette étu<strong>de</strong> se limite donc à ces<br />
<strong>de</strong>ux cas (HT et IR), et il est important <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r en tête qu'elle ne fournit pas d'indications sur l'impact<br />
potentiel <strong>de</strong>s biotechnologies en général (et <strong>de</strong> <strong>la</strong> génomique en particulier).<br />
L'étu<strong>de</strong> comporte trois chapitres complémentaires. Le premier chapitre présente une analyse <strong>de</strong>s<br />
effets <strong>de</strong>s OGMs sur <strong>les</strong> re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> industries d'amont (semences, pestici<strong>de</strong>s, innovation OGM). Le<br />
second chapitre analyse l'adoption potentielle d'OGM par <strong>les</strong> agriculteurs français, et ses effets sur <strong>les</strong><br />
revenus <strong>de</strong>s industries d'amont et <strong>de</strong>s agriculteurs, dans trois cas : colza résistant à un herbici<strong>de</strong>,<br />
betterave résistante à un herbici<strong>de</strong>, maïs résistant à un insecte. La troisième partie présente <strong>les</strong> coûts<br />
potentiels liés à <strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux filières en France, une filière avec OGM et une filière sans<br />
OGM au <strong>de</strong>là d'un seuil <strong>de</strong> tolérance donné.<br />
L'analyse est basée en partie sur <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>tiens (chapitres 1 et 3) ou un travail en col<strong>la</strong>boration avec<br />
<strong>les</strong> instituts techniques (chapitre 2). Un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion particulier est mis en œuvre dans chacun<br />
<strong>de</strong>s trois chapitres, à partir d'un modèle théorique centré sur <strong>la</strong> question étudiée dans ce chapitre, et en<br />
s'appuyant sur <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>tiens ou <strong>les</strong> données <strong>de</strong>s instituts techniques.<br />
Une évolution <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>de</strong>ux métiers <strong>de</strong> l'amont: <strong>les</strong> semences et <strong>les</strong><br />
produits phytosanitaires<br />
L'expérience américaine a montré que <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s OGM agronomiques conduit à une<br />
évolution très <strong>net</strong>te <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> semenciers et <strong>les</strong> firmes <strong>de</strong> l'agrochimie, avec <strong>de</strong>ux<br />
changements importants. Premièrement, <strong>les</strong> choix <strong>de</strong>s agriculteurs sur <strong>les</strong> semences et <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s<br />
sont <strong>de</strong> moins en moins dissociés, <strong>les</strong> semences incorporant <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
Autrement dit, une fois <strong>la</strong> semence achetée, l'agriculteur choisit ses pestici<strong>de</strong>s dans un éventail plus<br />
restreint <strong>de</strong> produits. Deuxièmement, <strong>les</strong> caractères <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes qui sont intégrés ou<br />
combinés à <strong>la</strong> semence peuvent être protégés indépendamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence. <strong>Les</strong> propriétaires <strong>de</strong> ces<br />
caractères peuvent accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s licences aux semenciers et tirer <strong>de</strong>s bénéfices spécifiquement sur ces<br />
caractères. <strong>Les</strong> variétés OGM sont donc <strong>de</strong>s innovations composites en terme <strong>de</strong> propriété<br />
i
intellectuelle, et <strong>les</strong> propriétaires <strong>de</strong>s différentes parties doivent trouver un accord <strong>entre</strong> eux pour<br />
partager <strong>les</strong> bénéfices <strong>de</strong> cette innovation. Sur ce point, l'expérience américaine montre que le<br />
semencier a un certain poids, d'une part parce qu'un bon caractère ne présentera d'intérêt que dans une<br />
semence à très fort potentiel, et d'autre part parce que c'est le semencier qui intègre le caractère et met<br />
<strong>la</strong> semence sur le marché. L'importance <strong>de</strong> disposer d'un bon accès au marché <strong>de</strong>s semences pour <strong>les</strong><br />
firmes <strong>de</strong> l'agrochimie a conduit ces <strong>de</strong>rnières à investir fortement dans le rachat <strong>de</strong> semenciers.<br />
Pour pouvoir conduire <strong>les</strong> investissements importants dans <strong>les</strong> biotechnologies, <strong>les</strong> firmes <strong>de</strong><br />
l'agrochimie ont développé, dans un premier temps, une stratégie <strong>de</strong> groupes en sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie<br />
basée sur l'exploitation <strong>de</strong>s synergies <strong>entre</strong> <strong>les</strong> recherches sur <strong>les</strong> biotechnologies humaines et<br />
agrico<strong>les</strong>. Cette stratégie a montré ses limites <strong>entre</strong> autres à cause <strong>de</strong>s écarts <strong>de</strong> niveaux <strong>de</strong> rentabilité<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux métiers (santé humaine vs santé <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes). On a donc assisté, dans un second temps, à une<br />
dissociation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux métiers et une série <strong>de</strong> fusions et acquisitions dans <strong>les</strong> métiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection<br />
<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l'analyse générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconfiguration <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> métiers, le chapitre 1<br />
fournit quelques éléments d'analyse complémentaires plus spécifiques à <strong>la</strong> France. Deux points<br />
principaux doivent être soulignés:<br />
• L'industrie <strong>de</strong>s semences en France comprend un nombre important d'<strong>acteurs</strong> indépendants qui sont<br />
détenus soit par <strong>de</strong>s individus, soit par <strong>de</strong>s coopératives. Leurs investissements dans <strong>les</strong><br />
biotechnologies sont <strong>net</strong>tement plus faib<strong>les</strong> que ceux réalisés par <strong>les</strong> firmes lea<strong>de</strong>rs. Ces semenciers<br />
sont alors confrontés au problème <strong>de</strong> l'accès aux innovations dans <strong>de</strong>s conditions convenab<strong>les</strong> vis à<br />
vis <strong>de</strong>s concurrents qui peuvent éventuellement être <strong>de</strong>s filia<strong>les</strong> <strong>de</strong> firmes <strong>de</strong> l'agrochimie engagées<br />
sur <strong>les</strong> biotechnologies. Deux stratégies ont été suivies: (i) certains semenciers ont ouvert leur<br />
capital à <strong>de</strong>s firmes lea<strong>de</strong>rs en biotechnologie dans le but d'avoir un bon accès au travers <strong>de</strong> cet<br />
actionnaire particulier, (ii) d'autres semenciers ont mis en p<strong>la</strong>ce un certain nombre d'alliances (ex:<br />
Biogemma, Biop<strong>la</strong>nte) pour donner un effet <strong>de</strong> levier à leurs investissements et négocier <strong>de</strong> concert<br />
<strong>les</strong> accès.<br />
• Bien que <strong>les</strong> OGM ne soient pas développés pas en France, on voit se développer <strong>de</strong>s produits<br />
présentant <strong>de</strong>s propriétés équivalentes, à savoir <strong>de</strong> limiter, au moment <strong>de</strong> l'achat <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence,<br />
l'éventail <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s qui peuvent être achetés. Ces produits peuvent également faire évoluer <strong>les</strong><br />
re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> le métier <strong>de</strong>s semences et le métier <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
La diffusion et l'impact potentiel <strong>de</strong>s OGM en France: quelques résultats<br />
concernant <strong>la</strong> betterave, le colza et le maïs<br />
Dans le chapitre 2 <strong>de</strong> ce rapport, l'objectif est d'étudier quel gain potentiel pourraient tirer <strong>les</strong><br />
agriculteurs <strong>de</strong> l'utilisation <strong>de</strong>s OGM en France. Un <strong>de</strong>s premiers obstac<strong>les</strong> rencontrés dans ce genre<br />
d'exercice porte sur <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> l'hétérogénéité <strong>de</strong>s gains pour <strong>les</strong> agriculteurs. En effet, <strong>les</strong><br />
produits qui sont étudiés ici présentent <strong>de</strong>s innovations sur <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
ii
Dans ces conditions, le gain pour un agriculteur dépend <strong>de</strong> l'ampleur du problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ntes auquel il est confronté. Par exemple, un maïs résistant à <strong>la</strong> Pyrale peut présenter un <strong>net</strong> progrès<br />
technique et assurer une protection presque totale contre <strong>les</strong> attaques <strong>de</strong> Pyrale, mais il ne présentera<br />
pas beaucoup d'intérêt pour l'agriculteur qui est exposé exceptionnellement à <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> attaques (à<br />
l'inverse il présentera <strong>de</strong> l'intérêt pour l'agriculteur exposé). <strong>Les</strong> résultats présentés dans ce rapport<br />
prennent assez bien cette contrainte en compte car ils se basent sur <strong>de</strong>s données représentatives <strong>de</strong><br />
l'hétérogénéité <strong>de</strong>s situations d'agriculteurs.<br />
Par construction, l'analyse conduite ici est faite ex ante. Ce<strong>la</strong> signifie donc qu'il est nécessaire <strong>de</strong><br />
faire <strong>de</strong>s hypothèses sur <strong>les</strong> comportements <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> (agriculteurs et firmes situées en amont). Du<br />
coté <strong>de</strong>s agriculteurs, <strong>de</strong>ux cas <strong>de</strong> figure se présentent:<br />
• Pour <strong>la</strong> betterave et le colza, nous disposions <strong>de</strong> données d'enquêtes réalisées respectivement par<br />
l'ITB et le CETIOM auprès <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 1000 agriculteurs dans chaque cas. Ces données indiquent<br />
précisément <strong>les</strong> dépenses <strong>de</strong> désherbages réalisées, <strong>les</strong> produits utilisés, le nombre <strong>de</strong> passages <strong>de</strong><br />
traitement et <strong>les</strong> coûts supportés. En accord avec <strong>les</strong> instituts techniques, nous avons supposé que <strong>la</strong><br />
solution OGM apporte un ren<strong>de</strong>ment équivalent à <strong>la</strong> solution conventionnelle, si bien que<br />
l'agriculteur n'adopte que si il réalise une certaine économie sur ces dépenses <strong>de</strong> désherbage (coût<br />
<strong>de</strong> passage et supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM inclus).<br />
• Pour le maïs, nous disposions <strong>de</strong> données sur <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> pyrale en France sur<br />
plusieurs années. Un modèle agronomique permet <strong>de</strong> simuler le ren<strong>de</strong>ment atteint avec différentes<br />
solutions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes, l'agriculteur retenant celle qui lui offre le meilleur profit.<br />
Ces hypothèses permettent <strong>de</strong> définir <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s agriculteurs en semence OGM en fonction du<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle. L'étape suivante<br />
consiste à calculer le profit dégagé par <strong>la</strong> firme qui commercialise l'OGM et en déduire le niveau<br />
optimal <strong>de</strong> tarification <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM.<br />
Deux principa<strong>les</strong> hypothèses restrictives ont été faites: (i) <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s produits agrico<strong>les</strong> sont<br />
maintenus constants, (ii) le coût additionnel lié à une filière non-OGM ne sont pas pris en compte.<br />
Nous reviendrons sur ces hypothèses après avoir résumé <strong>les</strong> résultats.<br />
<strong>Les</strong> résultats qui sont résumés ici correspon<strong>de</strong>nt à une tarification optimale <strong>de</strong> <strong>la</strong> part d'un<br />
innovateur en situation <strong>de</strong> monopole. <strong>Les</strong> simu<strong>la</strong>tions montrent que <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong> diffusion atteints<br />
pour le colza et <strong>la</strong> betterave HT sont <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 70%, alors qu'ils sont <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 40% pour le maïs<br />
Bt. Une telle diffusion conduit à <strong>de</strong>s chutes <strong>de</strong> ventes <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels supérieures à 80%<br />
dans tous <strong>les</strong> cas <strong>de</strong> figure. Enfin, <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM conduit à un gain total sur l'ensemble <strong>de</strong>s<br />
<strong>acteurs</strong> toujours positif. Ces premiers résultats se sont avérés robustes lorsqu'on analyse <strong>la</strong> sensibilité<br />
<strong>de</strong>s résultats à un certain nombre <strong>de</strong> paramètres.<br />
La diffusion <strong>de</strong>s OGM conduit à un gain social annuel <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 240 MF pour le colza HT,<br />
120 MF pour <strong>la</strong> betterave HT et 120 MF pour le maïs Bt (cette estimation n'inclut pas <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong><br />
iii
echerche et développement sur l'innovation OGM). Ce gain social dépend du taux <strong>de</strong> marge réalisé au<br />
départ sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels. Plus ce taux est faible, plus <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong> bénéfices <strong>de</strong>s<br />
fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels sont faib<strong>les</strong> et plus le gain total est élevé. <strong>Les</strong> chiffre<br />
indiqués ici sont basés sur une hypothèse <strong>de</strong> taux <strong>de</strong> marges assez élevé (50%) et peuvent donc être<br />
considérés comme <strong>de</strong>s valeurs p<strong>la</strong>nchers.<br />
Lorsque le partage <strong>de</strong>s gains est analysé, le même résultat qualitatif est observé dans <strong>les</strong> différents<br />
cas <strong>de</strong> figure: <strong>les</strong> agriculteurs et l'innovateur qui propose <strong>la</strong> solution OGM enregistrent un gain positif,<br />
et alors que <strong>les</strong> firmes qui commercialisent <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels subissent <strong>de</strong>s pertes. En<br />
revanche, <strong>les</strong> proportions observées sont variab<strong>les</strong> d'une simu<strong>la</strong>tion à l'autre. Qualitativement, si le<br />
contexte est plus difficile pour <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM, le prix optimal <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM pour<br />
l'innovateur diminue, si bien que le gain <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier diminue et le gain <strong>de</strong>s agriculteurs augmente. Ce<br />
cas <strong>de</strong> figure se produit lorsque le gain minimal pour qu'un agriculteur adopte <strong>les</strong> OGM augmente, ou<br />
lorsque <strong>les</strong> firmes proposant <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels baissent leurs prix. En ordre <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur, le<br />
gain maximum <strong>de</strong>s innovateurs est 20% supérieur au gain total. Ce résultat signifie qu'une <strong>la</strong>rge part<br />
<strong>de</strong> ce gain est réalisé aux dépends <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels. Du côté <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs, le gain minimum est égal à 20%-30% du gain total.<br />
Il est important <strong>de</strong> bien gar<strong>de</strong>r en tête <strong>les</strong> hypothèses <strong>de</strong> travail qui ont été retenue pour réaliser ces<br />
calculs.<br />
• Premièrement, <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s produits agrico<strong>les</strong> sont supposés constants alors que <strong>les</strong> gains <strong>de</strong><br />
productivité attendus <strong>de</strong>vraient conduire une hausse <strong>de</strong> <strong>la</strong> production et donc une baisse <strong>de</strong> prix.<br />
Cette <strong>de</strong>rnière conduirait alors à un transfert <strong>de</strong> surplus <strong>de</strong>puis l'agriculteur vers <strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises<br />
situées en aval. Ce phénomène conduirait également à une diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> adressée aux<br />
industries amont, et donc à une baisse <strong>de</strong> prix optimal <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM pour l'innovateur. Il est<br />
difficile a priori d'estimer l'effet <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux phénomènes sur le surplus <strong>de</strong>s agriculteurs. En<br />
revanche, on peut penser que le gain global sur l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière <strong>de</strong>vrait rester sensiblement,<br />
<strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> prix affectant principalement <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> gains <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents types d'<strong>acteurs</strong>.<br />
• Deuxièmement, <strong>les</strong> estimations réalisées ici ne prennent pas en compte l'accroissement du coût lié à<br />
une ségrégation plus difficile <strong>de</strong>s filières OGM et non-OGM. Nous reviendrons plus loin sur ce<br />
résultat. Néanmoins, il est indéniable que ce phénomène conduit à une baisse du gain total lié à<br />
l'introduction <strong>de</strong>s OGM. En théorie, rien n'empêche même que ce gain total soit négatif. Là encore,<br />
le partage <strong>de</strong>s gains ou pertes <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong> se trouverait affecté. Il est néanmoins<br />
difficile <strong>de</strong> savoir a priori l'acteur qui subirait <strong>les</strong> pertes <strong>les</strong> plus importantes.<br />
iv
Evaluation <strong>de</strong>s coûts potentiels en cas <strong>de</strong> coexistence OGM / non OGM en<br />
France pour le colza et le maïs<br />
Compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> forte opposition <strong>de</strong> l’opinion publique aux OGM en France, il est nécessaire<br />
d’envisager <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGMs dans un contexte <strong>de</strong> filière double, l'une pouvant contenir <strong>de</strong>s<br />
produits OGM et l'autre contenant uniquement <strong>de</strong>s produits non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée (IP) (c'està-dire<br />
<strong>de</strong>s produits sans OGM au <strong>de</strong>là d'un seuil <strong>de</strong> tolérance donné). <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> segmentation<br />
en <strong>de</strong>ux filières au niveau national pourraient réduire <strong>net</strong>tement le gain global lié à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s<br />
OGM, voire conduire à une perte globale. L'objectif du chapitre 3 est <strong>de</strong> présenter une analyse ex ante<br />
<strong>de</strong>s coûts potentiels liés à <strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux filières en France et <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> ces coûts<br />
<strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong>, dans <strong>les</strong> cas du maïs et du colza.<br />
Dans <strong>la</strong> situation actuelle, il n'y a pas <strong>de</strong> culture commerciale d'OGMs en France, et <strong>les</strong> OGMs sont<br />
éliminés <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong>stinés à l'alimentation humaine et <strong>de</strong> certains aliments pour animaux.<br />
Cependant, même en l'absence <strong>de</strong> commercialisation en France, <strong>de</strong>s mé<strong>la</strong>nges d'OGM dans <strong>de</strong>s<br />
produits non OGM sont <strong>possib<strong>les</strong></strong>, en raison <strong>de</strong>s importations réalisées aux différents sta<strong>de</strong>s ou en<br />
raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence d'essais techniques d'OGMs en France. En conséquence, différentes procédures<br />
ont d'ores et déjà été mises en p<strong>la</strong>ce pour assurer une offre non OGM en réponse aux exigences<br />
exprimées en aval par <strong>les</strong> transformateurs et distributeurs. La segmentation en <strong>de</strong>ux filières (avec<br />
OGM ou non OGM) dans un contexte où <strong>les</strong> OGMs seraient diffusés commercialement en France<br />
introduirait <strong>de</strong>s coûts supplémentaires à chaque sta<strong>de</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semence <strong>de</strong> maïs ou <strong>de</strong><br />
colza à <strong>la</strong> production d'un produit transformé contenant un ingrédient à base <strong>de</strong> maïs ou <strong>de</strong> colza.<br />
<strong>Les</strong> coûts qui existent actuellement et <strong>les</strong> coûts qui seraient liés à l'introduction <strong>de</strong> cette double<br />
filière peuvent être séparés en <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s catégories, à savoir <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation et <strong>de</strong>s coûts<br />
<strong>de</strong> garantie.<br />
• <strong>Les</strong> coûts <strong>de</strong> ségrégation seraient encourus pour maintenir à tous <strong>les</strong> sta<strong>de</strong>s une séparation physique<br />
<strong>de</strong>s produits <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières, en garantissant une pureté très élevée pour le non OGM. Ils<br />
comprendraient :<br />
• <strong>de</strong>s coûts pour éviter <strong>la</strong> pollinisation <strong>de</strong> champs non OGM par du pollen OGM, aux sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> semences et <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole. L'exigence d'une pureté élevée dans <strong>la</strong><br />
filière non OGM créerait une incitation à un zonage <strong>de</strong> <strong>la</strong> production, avec <strong>de</strong>s zones sans<br />
culture d'OGMs. Cependant, <strong>les</strong> intérêts <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> au sein d'une même zone géographique<br />
peuvent diverger, et <strong>la</strong> coordination <strong>entre</strong> ces <strong>acteurs</strong> pour aboutir à l'absence <strong>de</strong> cultures OGM<br />
serait très difficile à atteindre, dans un contexte avec <strong>de</strong>s débouchés significatifs pour l'OGM.<br />
En l'absence <strong>de</strong> zonage, certains agriculteurs souhaitant participer à <strong>la</strong> filière non OGM<br />
pourraient en être empêchés si <strong>de</strong>s OGMs étaient cultivés dans <strong>de</strong>s champs voisins.<br />
• <strong>de</strong>s coûts pour stocker, dép<strong>la</strong>cer et transformer séparément <strong>de</strong>s produits qui constituent<br />
actuellement une filière unique, et qui constitueraient alors <strong>de</strong>ux filières, chacune étant <strong>de</strong> plus<br />
v
petite taille. Il s'agirait <strong>de</strong> coûts logistiques dus à <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong> certains équipements<br />
existants dans l'une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières, en raison d'une perte dans <strong>la</strong> flexibilité avec <strong>la</strong>quelle ces<br />
équipements peuvent être utilisés, et <strong>de</strong> coûts d'investissements pour favoriser <strong>la</strong> gestion<br />
simultanée <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières.<br />
• En plus <strong>de</strong> ces coûts <strong>de</strong> ségrégation, il existerait <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> garantie pour assurer un acheteur <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> filière non OGM que le contenu <strong>de</strong> son produit est bien non OGM au seuil <strong>de</strong> tolérance accepté.<br />
Ils comprendraient :<br />
• <strong>de</strong>s coûts pour réaliser <strong>de</strong>s tests <strong>de</strong> contenu non OGM ;<br />
• <strong>de</strong>s coûts pour mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s contrats <strong>entre</strong> acheteurs et ven<strong>de</strong>urs spécifiant <strong>de</strong>s procédures<br />
<strong>de</strong> ségrégation et <strong>de</strong> test, et pour vérifier le respect <strong>de</strong> ces contrats ;<br />
• <strong>de</strong>s coûts internes <strong>de</strong> garantie pour définir <strong>de</strong>s procédures d'assurance qualité chez certains<br />
<strong>acteurs</strong>.<br />
L'étu<strong>de</strong> présente <strong>les</strong> types <strong>de</strong> coûts encourus actuellement et <strong>les</strong> types <strong>de</strong> coûts que l'on peut<br />
anticiper en cas <strong>de</strong> diffusion commerciale <strong>de</strong>s OGMs en France aux différents sta<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> <strong>la</strong> production<br />
<strong>de</strong> semences à <strong>la</strong> transformation. Il n'y a pas <strong>de</strong> tentative pour quantifier ces différents coûts dans le<br />
cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>. En revanche, un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion est développé pour comprendre <strong>les</strong> effets<br />
<strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong>s OGMs et <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières sur <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong>. Ce modèle<br />
utilise <strong>les</strong> enseignements <strong>de</strong> l'analyse qualitative qui précè<strong>de</strong> sur <strong>les</strong> types <strong>de</strong> coûts liés à <strong>la</strong><br />
segmentation, en posant <strong>de</strong>s hypothèses ad hoc sur <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong> ces coûts. Ce modèle est appliqué au<br />
cas du colza au niveau <strong>de</strong> l'Union Européenne en distinguant trois groupes d'<strong>acteurs</strong> : <strong>les</strong> producteurs<br />
agrico<strong>les</strong>, <strong>les</strong> stockeurs/transformateurs (considérés comme un acteur agrégé) et <strong>les</strong> consommateurs.<br />
L'intérêt <strong>de</strong> ce modèle est <strong>de</strong> prendre en compte l'hétérogénéité <strong>de</strong> ces différents groupes: certains<br />
producteurs ont plus d'intérêt que d'autres à adopter <strong>de</strong>s OGMs, <strong>les</strong> coûts pour préserver l'i<strong>de</strong>ntité non<br />
OGM <strong>de</strong>s produits sont différents selon <strong>les</strong> agriculteurs et selon <strong>les</strong> stockeurs/transformateurs, certains<br />
consommateurs refusent <strong>les</strong> OGM tandis que d'autres sont indifférents <strong>entre</strong> OGM et non OGM. <strong>Les</strong><br />
simu<strong>la</strong>tions montrent que <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation <strong>de</strong>s filières avec<br />
OGM et non OGM peuvent être très différents, au sein d'un même groupe, selon <strong>les</strong> individus.<br />
Ainsi, <strong>les</strong> consommateurs qui refusent <strong>les</strong> OGM subissent une perte lorsque <strong>les</strong> OGM sont diffusés.<br />
En effet, ils supportent une partie <strong>de</strong>s coûts liés à <strong>la</strong> création d'un marché segmenté pour le non OGM<br />
à i<strong>de</strong>ntité préservée. Ils paient donc leur produit plus cher que dans une situation sans diffusion<br />
d'OGM. <strong>Les</strong> consommateurs qui sont indifférents <strong>entre</strong> OGM et non OGM supportent certains <strong>de</strong>s<br />
coûts liés à <strong>la</strong> segmentation, en raison <strong>de</strong>s coûts dus à une perte <strong>de</strong> flexibilité dans l'utilisation <strong>de</strong>s<br />
équipements pour <strong>la</strong> filière double. Dans une situation avec OGM et filière double, ces consommateurs<br />
peuvent gagner par rapport à une situation sans OGM, mais ils per<strong>de</strong>nt nécessairement par rapport à<br />
une situation avec OGM sans filière double.<br />
<strong>Les</strong> agriculteurs avec un avantage <strong>de</strong> coût pour <strong>les</strong> OGM gagnent moins qu'ils ne gagneraient dans<br />
une situation avec OGM sans segmentation (selon <strong>les</strong> hypothèses, il peuvent gagner ou perdre par<br />
vi
apport à une situation sans OGM). <strong>Les</strong> stockeurs/transformateurs pour qui il est plus avantageux <strong>de</strong><br />
rester dans <strong>la</strong> filière OGM per<strong>de</strong>nt. Ceux qui ont un avantage pour faire du non OGM gagnent sur ce<br />
marché parce que <strong>la</strong> prime qu'ils acceptent fait plus que payer leur coût pour maintenir l'i<strong>de</strong>ntité non<br />
OGM. De même certains agriculteurs ont <strong>de</strong>s coûts plus faib<strong>les</strong> que d'autres pour participer à <strong>la</strong> filière<br />
non OGM. Ils gagnent à l'apparition <strong>de</strong>s OGMs et <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière non OGM, même si eux-mêmes<br />
n'adoptent pas <strong>la</strong> technologie OGM.<br />
<strong>Les</strong> résultats obtenus à partir <strong>de</strong> ce modèle sont encore préliminaires, en raison <strong>de</strong> l'absence <strong>de</strong><br />
données sur <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation. Il n'est pas possible à ce sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> quantifier l'effet <strong>de</strong>s coûts<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation sur le gain ou <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM. Cependant, l'intérêt du modèle est<br />
<strong>de</strong> souligner qu'au <strong>de</strong>là d'un calcul en termes <strong>de</strong> gain ou <strong>de</strong> perte au niveau global il importe <strong>de</strong><br />
prendre en compte l'effet sur <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong>, certains pouvant perdre et d'autres gagner aux<br />
OGM.<br />
vii
Introduction<br />
Un certain nombre d'Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) présentant <strong>de</strong>s améliorations sur<br />
<strong>de</strong>s caractères agronomiques ont connu une diffusion très rapi<strong>de</strong> en Amérique du Nord. A l'inverse, ils<br />
ont soulevé progressivement une vive controverse dans l’Union Européenne, avec <strong>de</strong>ux conséquences<br />
importantes: <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d'un moratoire (explicite ou implicite) sur <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong> ces<br />
produits, le développement <strong>de</strong> stratégies visant à commercialiser <strong>de</strong>s produits non OGM.<br />
L'objectif <strong>de</strong> ce rapport est d'étudier l'impact économique qu'aurait le développement <strong>de</strong>s OGM en<br />
France. Un certain nombre d'étu<strong>de</strong>s équivalentes ont déjà été réalisés aux Etats-Unis 1 . La plupart <strong>de</strong><br />
ces travaux concluent que l'impact économique <strong>de</strong> ces cultures est positif, à <strong>la</strong> fois au niveau global,<br />
mais également pour <strong>les</strong> innovateurs et <strong>les</strong> agriculteurs qui adoptent ces cultures. Faut-il en conclure<br />
que <strong>la</strong> faible adoption <strong>de</strong>s OGM en France se traduit par un fort manque à gagner sur le p<strong>la</strong>n<br />
économique, pour <strong>les</strong> agriculteurs et <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> <strong>de</strong>s secteurs liés à l'agriculture Sans chercher à être<br />
exhaustif, quelques arguments importants permettent <strong>de</strong> comprendre que <strong>la</strong> transposition directe est<br />
délicate:<br />
• <strong>Les</strong> conditions pédo-climatiques, <strong>les</strong> cultures et <strong>les</strong> problèmes <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes sont<br />
différents sur <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux continents. Par exemple, le maïs et le soja occupent près <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s<br />
surfaces agrico<strong>les</strong> aux Etats-Unis alors que le soja est une culture marginale en France et<br />
l'importance re<strong>la</strong>tive du maïs est plus faible en France.<br />
• <strong>Les</strong> OGM peuvent conduire à une modification <strong>de</strong>s pratiques cultura<strong>les</strong>. Néanmoins, l'effet<br />
économique dépend <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s exploitations agrico<strong>les</strong> et <strong>de</strong>s pratiques cultura<strong>les</strong> en p<strong>la</strong>ce,<br />
qui sont toutes <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux <strong>net</strong>tement différentes en France et en Amérique du Nord.<br />
1 Voir Lemarié (2001) et OCDE (2000) pour une première synthèse <strong>de</strong> ces travaux.<br />
1
• Enfin, si <strong>les</strong> OGM se diffusent en France, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> produits non OGM adressée au secteur<br />
agricole sera sans doute plus importante qu’aux Etats-Unis. Des mesures spécia<strong>les</strong> <strong>de</strong>vront être<br />
prises <strong>de</strong> façon à ce qu'une offre <strong>de</strong> produit non-OGM soit maintenue parallèlement à <strong>la</strong> production<br />
OGM. Cette <strong>de</strong>rnière pourrait bien générer <strong>de</strong>s coûts additionnels.<br />
L'analyse <strong>de</strong>s effets économiques <strong>de</strong>s OGM en France a été déjà abordée à plusieurs reprises. Un<br />
certain nombre <strong>de</strong> rapports (Conseil Economique et Social 1999, Bizet 1999, Le Déault 1998) dressent<br />
<strong>de</strong>s bi<strong>la</strong>ns assez <strong>la</strong>rges sur <strong>les</strong> perspectives <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s biotechnologies (<strong>les</strong> OGM en faisant<br />
partie), et présentent <strong>de</strong> manière qualitative <strong>les</strong> gains et <strong>les</strong> risques liées à ce type <strong>de</strong> produits. <strong>Les</strong><br />
instituts techniques ont également réalisé d'importantes contributions et ont délivré récemment <strong>de</strong>s<br />
rapports <strong>de</strong> synthèses (Vo<strong>la</strong>n 2000, CETIOM 2000) en lien avec <strong>la</strong> fin du moratoire sur <strong>les</strong> OGM. Du<br />
point <strong>de</strong> vue économique, ces travaux donnent <strong>de</strong>s indications sur <strong>les</strong> types d'agriculteurs qui auraient<br />
le plus intérêt à adopter ce type <strong>de</strong> culture. Enfin, il est nécessaire <strong>de</strong> mentionner l'étu<strong>de</strong> conduite par<br />
l'INRA sur <strong>la</strong> "pertinence et <strong>la</strong> faisabilité d'une filière non-OGM" (Valceschini et Ave<strong>la</strong>nge 2001, Le<br />
Bail et al. 2001) au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle a été conduit une analyse <strong>de</strong> l'organisation <strong>de</strong>s filières et <strong>de</strong>s<br />
conditions dans <strong>les</strong>quels une production certifiée sans OGM au <strong>de</strong>là d'un certain seuil pouvait être<br />
réalisée.<br />
L'étu<strong>de</strong> présentée ici est complémentaire <strong>de</strong>s travaux qui viennent d'être rapi<strong>de</strong>ment rappelés.<br />
L'analyse est restreinte ici à un nombre bien limité d'OGM présentant <strong>de</strong>s améliorations sur <strong>de</strong>s<br />
caractères agronomiques. Notre approche se situe dans <strong>la</strong> lignée d'un certain nombre <strong>de</strong> travaux<br />
développés en économie agricole sur <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> l'impact <strong>de</strong>s innovations et le partage <strong>de</strong>s bénéfices<br />
<strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière 2 .<br />
Avant <strong>de</strong> présenter en détail <strong>les</strong> différentes parties <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, il est important <strong>de</strong> rappeler<br />
quelques indications sur l'organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière (Figure 1). Pour simplifier, nous avons p<strong>la</strong>cé sur ce<br />
schéma <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> pour <strong>les</strong>quels <strong>les</strong> OGM pouvait avoir <strong>de</strong>s effets. Typiquement, l'agriculteur qui se<br />
trouve au c<strong>entre</strong> <strong>de</strong> cette filière utilise <strong>de</strong>s semences et <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s qu'il aura achetés auprès d'un<br />
distributeur, celui-ci jouant le rôle d'intermédiaire vis à vis <strong>de</strong>s semenciers et <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong><br />
pestici<strong>de</strong>s. La récolte est ensuite livrée à un organisme stockeur, puis intégrée en aval dans différentes<br />
filières <strong>de</strong> production (alimentation animale, alimentation humaine, utilisations industriel<strong>les</strong> non<br />
alimentaires). <strong>Les</strong> OGM envisagés ici sont soit <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes tolérantes à un herbici<strong>de</strong> total (HT), soit<br />
<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes résistantes à un insecte (IR). Dans le cas HT, il est possible d'éliminer <strong>les</strong> adventices en<br />
appliquant l'herbici<strong>de</strong> total sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte à n'importe quel sta<strong>de</strong>. Dans le cas IR, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte est protégée<br />
<strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> cet insecte, sans application d'insectici<strong>de</strong>. Par rapport au schéma conventionnel, trois<br />
différences apparaissent: (i) <strong>la</strong> variété OGM est produite par le semencier, mais le semencier aura<br />
2 Voir Moschini (2001) pour une synthèse récente.<br />
2
signé un accord <strong>de</strong> licence avec une firme <strong>de</strong> biotechnologie en amont, détentrice <strong>de</strong> ce caractère, (ii)<br />
une interdépendance s'établit <strong>entre</strong> le choix réalisé sur <strong>la</strong> semence et le choix réalisé sur <strong>les</strong> produits<br />
phytosanitaires, (iii) <strong>la</strong> production OGM <strong>de</strong>vra être séparée <strong>de</strong> <strong>la</strong> production non OGM <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> semences aux industries ava<strong>les</strong> si on se p<strong>la</strong>ce dans un scénario où une part <strong>de</strong>s<br />
consommateurs souhaite avoir le choix <strong>de</strong> ne pas acheter <strong>de</strong> produit OGM.<br />
Figure 1. Une représentation schématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière <strong>de</strong> production végétale<br />
Biotechnologie<br />
Semencier<br />
Pestici<strong>de</strong><br />
Distributeur<br />
Agriculture<br />
Organisme Stockeur<br />
Industries ava<strong>les</strong>:<br />
- Alimentation animale<br />
- Première transformation<br />
- Agro-alimentaire<br />
- Usages industriels<br />
Ce rapport comprend trois chapitres complémentaires:<br />
• Le chapitre 1 porte sur l'évolution <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> situés en amont <strong>de</strong> l'agriculture.<br />
L'objectif est d'analyser <strong>les</strong> raisons pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong> OGM conduisent à une modification <strong>de</strong>s<br />
re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents métiers <strong>de</strong> l'amont. Ces f<strong>acteurs</strong> permettent d'expliquer en partie <strong>les</strong><br />
restructurations qui se sont produites dans ces secteurs au cours <strong>de</strong>s dix <strong>de</strong>rnières années.<br />
• Le chapitre 2 est centré sur l'agriculteur. Dans un premier temps, il s'agit d'étudier quel type<br />
d'agriculteur aurait intérêt à adopter une culture OGM, et quel bénéfice il pourrait en tirer. Après<br />
agrégation, cette première étape permet d'aboutir à une fonction <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> semence OGM<br />
en fonction du prix <strong>de</strong> cette semence. Compte tenu <strong>de</strong> cette fonction <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, il est possible<br />
ensuite d'estimer le gain <strong>de</strong> l'innovateur et donner une indication sur <strong>la</strong> tarification qu'il aurait<br />
intérêt à adopter.<br />
3
• Le chapitre 3 porte sur <strong>les</strong> coûts pour séparer <strong>les</strong> produits avec OGM et <strong>les</strong> produits non OGM,<br />
dans le cas d'une diffusion <strong>de</strong>s OGM en France. Une première partie <strong>de</strong> ce chapitre présente <strong>de</strong><br />
manière qualitative <strong>les</strong> coûts actuels liés au non OGM en France et <strong>les</strong> coûts attendus en cas <strong>de</strong><br />
diffusion <strong>de</strong>s OGM. Une secon<strong>de</strong> partie présente un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion utilisé pour indiquer<br />
qualitativement <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> l'introduction simultanée <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation <strong>entre</strong> filières<br />
avec OGM et non OGM sur <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong>.<br />
L'analyse est basée en partie sur <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>tiens (chapitres 1 et 3) ou un travail en col<strong>la</strong>boration avec<br />
<strong>les</strong> instituts techniques (chapitre 2). Un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion particulier est mis en œuvre dans chacun<br />
<strong>de</strong>s trois chapitres, à partir d'un modèle théorique centré sur <strong>la</strong> question étudiée dans ce chapitre, et en<br />
s'appuyant sur <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>tiens ou <strong>les</strong> données <strong>de</strong>s instituts techniques.<br />
Références<br />
CETIOM (2000). Introduction <strong>de</strong> variétés génétiquement modifiées <strong>de</strong> colza tolérantes à<br />
différents herbici<strong>de</strong>s dans le système <strong>de</strong> l'agriculture française: Evaluation <strong>de</strong>s<br />
impacts agro-environnementaux et é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> scénarios <strong>de</strong> gestion. CETIOM,<br />
Thiverval-Grignon.<br />
Conseil Economique et Social (1999). La France face au défit <strong>de</strong>s biotechnologies: quels<br />
enjeux pour l'avenir Conseil Economique et Social, Paris, 298 p.<br />
Le Bail, M., Meynard, J.M., Angevin, F. (2001). Proposition <strong>de</strong> stratégies <strong>de</strong> ségrégation au<br />
champ et en <strong>entre</strong>prise <strong>de</strong> collecte stockage. Programme <strong>de</strong> recherche pertinence<br />
économique et faisabilité d'une filière "sans utilisation d'OGM". Document <strong>de</strong> travail,<br />
mars 2001.<br />
Le Déaut, J.-Y. (1998). Rapport sur l'utilisation <strong>de</strong>s organismes génétiquement modifiés en<br />
agriculture et dans l'alimentation. OPECST, 73 p.<br />
Lemarié, S. (2001). Le développement et l'impact <strong>de</strong>s OGM Agronomiques aux Etats-Unis:<br />
une synthèse <strong>de</strong>s analyses économiques. Dans : S. Lemarié et J.-M. Ditner, Analyse<br />
économique du développement <strong>de</strong>s cultures à base d'organismes génétiquement<br />
modifiés aux Etats-Unis. Grenoble, INRA. 1: 1-50.<br />
Moschini, G. (2001). Biotech - Who wins Economic Benefits and Costs of Biotechnology<br />
Innovations in Agriculture. Estey Center Journal for Law and Economics in<br />
International 2(1): 93-117.<br />
OCDE (2000). Mo<strong>de</strong>rn biotechnology and agricultural markets: a discussion of selected<br />
issues. OECD, Paris, AGR/CA/APM(2000)5.<br />
Valceschini, E. et Ave<strong>la</strong>nge, I. (2001). Analyse économique et réglementaire <strong>de</strong><br />
l'organisation d'une filière "sans OGM". Programme <strong>de</strong> recherche pertinence<br />
économique et faisabilité d'une filière "sans utilisation d'OGM". Document <strong>de</strong> travail,<br />
mars 2001.<br />
Vo<strong>la</strong>n, S. (2000). Introduction <strong>de</strong> variétés <strong>de</strong> Maïs transgéniques : évaluation <strong>de</strong>s impacts<br />
agro-environnementaux et mise en p<strong>la</strong>ce d'un système <strong>de</strong> biovigi<strong>la</strong>nce. AGPM, 140 p.<br />
4
Chapitre 1.<br />
Le développement <strong>de</strong>s OGM et l'évolution<br />
<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> métiers <strong>de</strong> l'amont<br />
<strong>de</strong> l'agriculture<br />
Stéphane Lemarié<br />
Arnaud Diemer<br />
Stephan Marette<br />
5
Introduction<br />
Dans ce rapport il est envisagé le cas <strong>de</strong>s OGM présentant <strong>de</strong>s améliorations sur <strong>de</strong>s caractères<br />
agronomiques. Dans l'industrie amont, <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM se traduit, du point <strong>de</strong> vue économique,<br />
par une évolution <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong> marché et une évolution <strong>de</strong>s structures industriel<strong>les</strong>. Ces <strong>de</strong>ux<br />
évolutions sont liés à <strong>de</strong>ux phénomènes:<br />
1) Ces produits présentent <strong>de</strong>s innovations sur <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. La diffusion<br />
<strong>de</strong>s OGM est <strong>la</strong> résultante d'un remp<strong>la</strong>cement, au niveau <strong>de</strong>s agriculteurs, <strong>de</strong> solutions<br />
conventionnel<strong>les</strong> par <strong>de</strong>s solutions OGM. Le cas du Soja aux Etats-Unis est intéressant <strong>de</strong> ce point <strong>de</strong><br />
vue. En l'espace <strong>de</strong> 3 ans, l'imazetapyr, un <strong>de</strong>s désherbants lea<strong>de</strong>rs sur le Soja a vu sa part <strong>de</strong> marché<br />
passer <strong>de</strong> 45% à 17% malgré une baisse <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> ces produits <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 40%. Bien que <strong>les</strong><br />
chiffres soient spectacu<strong>la</strong>ires dans certains cas, le mécanisme économique sous-jacent est assez<br />
c<strong>la</strong>ssique. Si <strong>la</strong> diffusion a effectivement lieu, <strong>de</strong>ux phénomènes se produisent: (i) chaque nouveau<br />
produit présentant une innovation par rapport aux produits existants sur le marché vient<br />
progressivement prendre <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong> marché au dépend ce ces <strong>de</strong>rniers 1 , (ii) le prix <strong>de</strong>s produits<br />
existant aura tendance à diminuer en réaction à l'entrée <strong>de</strong> nouveaux produits dans le but <strong>de</strong> limiter <strong>la</strong><br />
perte <strong>de</strong> bénéfices. Un phénomène très simi<strong>la</strong>ire se produit à chaque fois qu'une nouvelle matière<br />
active ou une nouvelle variété se diffuse sur son marché.<br />
2) <strong>Les</strong> OGM présentent cependant <strong>de</strong>ux particu<strong>la</strong>rités qui modifient <strong>net</strong>tement <strong>les</strong> re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong><br />
<strong>les</strong> métiers situés en amont <strong>de</strong> l'agriculture:<br />
• La semence est une composante <strong>de</strong> l'offre en matière <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. Quel que soit le<br />
caractère envisagé, le choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> variété <strong>de</strong> semence va avoir une influence déterminante sur le<br />
choix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s réalisé ensuite.<br />
• <strong>Les</strong> variétés OGM sont <strong>de</strong>s innovations composites en terme <strong>de</strong> propriété intellectuelle,<br />
puisqu'el<strong>les</strong> mêlent un germp<strong>la</strong>sm innovant détenu par un semencier à un événement <strong>de</strong><br />
transformation détenu par une firme <strong>de</strong> biotechnologie. Pour que <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> variétés puissent se<br />
développer, il faut donc que ces <strong>de</strong>ux parties trouvent un accord sur <strong>la</strong> façon <strong>de</strong> partager <strong>les</strong><br />
bénéfices issues <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> innovations.<br />
1 La façon <strong>de</strong> voir le remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s anciens produits par <strong>les</strong> nouveau est assez simpliste. L'expérience<br />
montre que <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s nouveaux produits n'est pas aussi déterministe qu'on le <strong>la</strong>isse entendre ici. Certains<br />
produits peuvent présenter un intérêt technique et s'avérer être <strong>de</strong>s échec commerciaux. Le contraste <strong>entre</strong> <strong>la</strong><br />
diffusion très rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s OGM en Amérique du Nord et sa non-diffusion en Europe est une bonne illustration <strong>de</strong>s<br />
multip<strong>les</strong> f<strong>acteurs</strong> qui viennent influencer <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s produits. Retenons ici que nous nous p<strong>la</strong>çons dans un<br />
cas où <strong>la</strong> diffusion se produit effectivement. Dans ce cas, le remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s anciens produits par <strong>les</strong> nouveaux<br />
est assez c<strong>la</strong>ssique.<br />
6
L'objectif <strong>de</strong> ce chapitre est d'analyser l'impact <strong>de</strong>s OGM sur <strong>les</strong> industries d’amont, au travers <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ux phénomènes qui viennent d'être décrits: (i) le remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s produits conventionnel par <strong>les</strong><br />
solutions OGM et (ii) <strong>la</strong> modification <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> métiers <strong>de</strong> l'amont. La présentation est<br />
faite en trois temps. La première section est consacrée à l'analyse <strong>de</strong>s déterminants <strong>de</strong>s ventes d'une<br />
innovation et <strong>de</strong>s bénéfices que l'innovateur pourra en tirer. Dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième section, l'objectif est <strong>de</strong><br />
présenter l'évolution <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> et <strong>de</strong>s structures industriel<strong>les</strong> (en amont <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production végétale) et <strong>de</strong> discuter dans quelle mesure ce<strong>la</strong> est lié à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s OGM. Enfin,<br />
dans <strong>la</strong> troisième section, nous illustrerons certains <strong>de</strong>s phénomènes présentés dans <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux premières<br />
sections à l'ai<strong>de</strong> d'un modèle <strong>de</strong> concurrence dans <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
1. <strong>Les</strong> déterminants <strong>de</strong>s ventes et <strong>de</strong>s profits tirés <strong>de</strong>s innovations<br />
dans <strong>les</strong> industries amonts<br />
Pour <strong>les</strong> industries étudiées dans ce chapitre, <strong>les</strong> ventes et <strong>les</strong> profits sont déterminés par trois<br />
f<strong>acteurs</strong> principaux:<br />
• <strong>Les</strong> f<strong>acteurs</strong> <strong>de</strong> différenciation et <strong>de</strong> segmentation <strong>de</strong>s marchés qui définissent le volume <strong>de</strong><br />
marché sur lequel le produit pourra être commercialisé et l'éventail <strong>de</strong>s produits concurrents qu'il<br />
<strong>de</strong>vra affronter. Ces f<strong>acteurs</strong> sont indispensab<strong>les</strong> à prendre en compte pour analyser <strong>les</strong> ventes<br />
potentiel<strong>les</strong> <strong>de</strong>s nouveaux produits.<br />
• <strong>Les</strong> f<strong>acteurs</strong> d'appropriation <strong>de</strong>s bénéfices par <strong>les</strong> innovateurs. Il s'agit en premier lieu <strong>de</strong>s droits<br />
<strong>de</strong> propriété intellectuelle. Nous verrons cependant que certains dispositifs techniques (par<br />
exemple <strong>les</strong> semences hybri<strong>de</strong>s) ont une influence très <strong>net</strong>te sur l'appropriabilité.<br />
• Le cadre réglementaire qui concerne l'autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché. Ce cadre définit un<br />
certain nombre <strong>de</strong> contraintes sur <strong>les</strong> caractéristiques techniques <strong>de</strong>s produits. Il a également une<br />
influence sur <strong>les</strong> coûts que <strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises doivent supporter pour mettre <strong>les</strong> produits sur le marché.<br />
Ces déterminants seront étudiés successivement dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle, dans le<br />
cas <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels, et enfin dans le cas <strong>de</strong>s OGM que nous associeront au cas du<br />
traitement <strong>de</strong> semence.<br />
7
1.1. <strong>Les</strong> semences conventionnel<strong>les</strong><br />
- Le cadre réglementaire<br />
Le cadre réglementaire en vigueur sur le marché <strong>de</strong>s semences conventionnel<strong>les</strong> présente trois<br />
composantes principa<strong>les</strong>:<br />
• La protection <strong>de</strong>s innovations est basée sur le Certificat d'Obtention Végétal (COV) 2 . Pour qu'une<br />
variété obtienne un COV, il faut qu'elle répon<strong>de</strong> aux trois critères suivant: Distinction,<br />
Homogénéité et Stabilité (DHS). Le critère "distinction" signifie que toute nouvelle variété doit<br />
être distincte <strong>de</strong>s variétés existantes. <strong>Les</strong> critères "homogénéité" et "stabilité" signifient que <strong>la</strong><br />
variété doit être régulière du point <strong>de</strong> vue génétique et reproductible à l'i<strong>de</strong>ntique dans le temps. Le<br />
COV est équivalent au brevet dans le sens où il confère un monopole temporaire à celui qui le<br />
détient. En revanche, le COV diffère du brevet par le fait qu'il comporte <strong>de</strong>ux exemptions -<br />
l'exemption pour <strong>la</strong> recherche et l'exemption du fermier- sur <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> nous reviendrons plus loin.<br />
• Pour qu'une variété puisse être commercialisée en France, il est nécessaire qu'elle soit inscrite au<br />
catalogue officiel <strong>de</strong>s variétés. Cette inscription nécessite que <strong>la</strong> variété répon<strong>de</strong> d'une part au<br />
critère DHS décrit plus haut et d'autre part qu'elle présente un progrès technique par rapport aux<br />
variétés du marché (critère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Valeur Agronomique et Technologique ou VAT).<br />
• Enfin, chaque sac <strong>de</strong> semence commercialisé doit répondre à une certification. Celle-ci se base sur<br />
<strong>de</strong>s contrô<strong>les</strong> au champs et sur <strong>de</strong>s tests réalisés sur <strong>les</strong> lots <strong>de</strong> semence, dans le but <strong>de</strong> vérifier<br />
différents critères (pureté variétale, germination, état sanitaire). La question <strong>de</strong> <strong>la</strong> certification non-<br />
OGM <strong>de</strong>s semences, qui sera traitée en détail dans le chapitre 3, peut être vue comme un<br />
renforcement <strong>de</strong> ce système <strong>de</strong> certification.<br />
- <strong>Les</strong> déterminants <strong>de</strong> l'appropriabilité<br />
Pour bien comprendre <strong>les</strong> choix stratégiques <strong>de</strong>s semenciers, il est nécessaire d'analyser <strong>de</strong> quelle<br />
manière il peut s'approprier <strong>les</strong> bénéfices <strong>de</strong> l'innovation. Revenons d'abord sur <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux exemptions<br />
particulières au COV.<br />
L'exemption pour <strong>la</strong> recherche autorise <strong>les</strong> concurrents semenciers à utiliser <strong>les</strong> variétés du marché<br />
dans leur programme <strong>de</strong> recherche. L'intérêt <strong>de</strong> ce principe est <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser un accès libre au progrès<br />
génétique existant qui est incorporé dans le génotype <strong>de</strong> <strong>la</strong> variété qui vient d'être introduite sur le<br />
2 L'équivalent du COV existe également aux Etats-Unis avec <strong>les</strong> P<strong>la</strong>nt Bree<strong>de</strong>r's Rights. Néanmoins, <strong>les</strong><br />
semenciers ont également <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> protéger leurs variétés <strong>de</strong> semence par <strong>de</strong>s brevets. Voir Heisey et al.<br />
(2000) pour une synthèse <strong>de</strong>s différents régimes <strong>de</strong> propriété intelectuelle dans le mon<strong>de</strong> pour ce qui concerne<br />
<strong>les</strong> obtentions végéta<strong>les</strong>.<br />
8
marché. D'un autre coté, ce principe présente <strong>de</strong>s inconvénients pour <strong>les</strong> semenciers lea<strong>de</strong>rs puisqu'il<br />
<strong>la</strong>isse une p<strong>la</strong>ce pour une certaine imitation et limite donc <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> l'innovateur initial à<br />
s'approprier <strong>les</strong> bénéfices <strong>de</strong> son innovation. Deux contraintes limitent cependant <strong>la</strong> possibilité<br />
d'imiter:<br />
• Premièrement, le critère <strong>de</strong> <strong>la</strong> DHS interdit <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> copies exactes <strong>de</strong>s variétés <strong>de</strong> départ.<br />
Cette mesure a été renforcée avec <strong>la</strong> révision <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention UPOV en 1991 dans <strong>la</strong>quelle le<br />
concept d'essentielle dérivation a été introduit. Sous cette nouvelle convention, <strong>la</strong> distance<br />
génétique <strong>entre</strong> toute nouvelle variété et <strong>les</strong> variétés existantes doit passer un certain seuil.<br />
• Deuxièmement, il existe toujours un dé<strong>la</strong>i pour obtenir une variété assez distincte <strong>de</strong> <strong>la</strong> variété<br />
d'origine. Plus ce dé<strong>la</strong>i est important et mieux <strong>la</strong> variété est protégée (Joly et Docus 1993).<br />
L'exemption <strong>de</strong> l'agriculteur autorise ce <strong>de</strong>rnier à utiliser <strong>les</strong> produits <strong>de</strong> sa récolte précé<strong>de</strong>nte pour<br />
ensemencé son champ, sans avoir donc à acheter sa semence. Dans <strong>la</strong> pratique, l'agriculteur mettra en<br />
œuvre cette exemption si <strong>la</strong> semence est le produit <strong>de</strong> sa récolte et si celle-ci a un niveau <strong>de</strong><br />
performance équivalent à celui qu'il obtiendrait en achetant sa semence à un distributeur. On estime<br />
ainsi qu'en France <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s semences fermières dépasse 50% pour <strong>les</strong> céréa<strong>les</strong> à paille, et est <strong>de</strong><br />
l'ordre <strong>de</strong> 25% pour le colza. L'agriculteur <strong>de</strong>vient alors, d'une certaine manière, un concurrent du<br />
semencier. Le prix <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s semences doit alors s'aligner sur le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence<br />
pour l'agriculteur, <strong>la</strong>issant <strong>de</strong>s marges faib<strong>les</strong>.<br />
Lorsque <strong>les</strong> semences sont hybri<strong>de</strong>s, l'agriculteur n'a généralement pas intérêt à utiliser le produit<br />
<strong>de</strong> sa récolte car <strong>les</strong> semences ainsi obtenues ont un potentiel inférieur à celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> génération<br />
précé<strong>de</strong>nte (c'est à dire <strong>la</strong> génération <strong>de</strong>s semences hybri<strong>de</strong>s, achetées sur le marché). Ainsi, <strong>la</strong><br />
possibilité <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s variétés hybri<strong>de</strong>s est apparue comme un moyen intéressant pour s'approprier<br />
<strong>les</strong> bénéfices <strong>de</strong> l'innovation en éliminant <strong>la</strong> concurrence potentielle <strong>de</strong> l'agriculteur. Au cours <strong>de</strong>s dix<br />
<strong>de</strong>rnières années, <strong>les</strong> semenciers ont tenté <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s semences hybri<strong>de</strong>s sur le colza et le blé et<br />
on se trouve dans une phase <strong>de</strong> coexistence <strong>de</strong> différents types variétaux (Tableau 1). Dans le cas du<br />
colza, <strong>les</strong> hybri<strong>de</strong>s et <strong>les</strong> associations variéta<strong>les</strong> représentent 20% <strong>de</strong>s semences, mais on estime que ce<br />
pourcentage va progressivement augmenter, l'essentiel <strong>de</strong>s recherches <strong>de</strong>s semenciers portant<br />
actuellement sur <strong>de</strong>s hybri<strong>de</strong>s. Dans le cas du blé, le poids <strong>de</strong>s hybri<strong>de</strong>s est <strong>net</strong>tement moindre pour<br />
<strong>de</strong>ux raisons: le différentiel <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment <strong>entre</strong> <strong>les</strong> lignées et <strong>les</strong> hybri<strong>de</strong>s est assez faible, et le coût <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong>s hybri<strong>de</strong>s est élevé (notamment à cause du faible coefficient <strong>de</strong> multiplication).<br />
Aujourd'hui, <strong>la</strong> recherche sur <strong>les</strong> blés hybri<strong>de</strong>s est menée uniquement par certains semenciers, et on<br />
estime que <strong>les</strong> variétés hybri<strong>de</strong>s ne <strong>de</strong>vrait représenter qu'une niche <strong>de</strong> marché dans <strong>la</strong>quelle certaines<br />
caractéristiques <strong>de</strong> rusticité et <strong>de</strong> stabilité pourraient être bien valorisées.<br />
Si jusque là <strong>les</strong> semences fermières représentaient une perte sèche pour <strong>les</strong> obtenteurs, <strong>la</strong> situation<br />
est en train d'évoluer. En effet, le droit Européen sur <strong>les</strong> obtentions végéta<strong>les</strong> <strong>la</strong>isse cependant <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
9
à une "rémunération équitable" <strong>de</strong>s obtenteurs sans pour autant remettre en cause le principe <strong>de</strong><br />
l'exemption du fermier 3 . Une mesure concrète est actuellement é<strong>la</strong>borée en France pour traduire ce<br />
principe. Avec cette mesure, l'agriculteur utilisant une semence fermière <strong>de</strong>vrait reverser l'équivalent<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s royalties versées dans le cas <strong>de</strong> l'achat d'une semence certifiée (soit à peu près 20<br />
F/qtal pour <strong>les</strong> céréa<strong>les</strong> à paille). Cette mesure permettra donc à l'obtenteur <strong>de</strong> s'approprier une part<br />
plus <strong>la</strong>rge <strong>de</strong>s bénéfices sur <strong>de</strong>s obtention végéta<strong>les</strong> <strong>de</strong> type lignée. Néanmoins, elle ne remet pas en<br />
cause fondamentalement <strong>la</strong> concurrence <strong>de</strong> l'agriculteur, si bien que <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>vront encore être<br />
alignés sur le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l'agriculteur, <strong>la</strong>issant <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> marge assez faib<strong>les</strong>.<br />
Tableau 1. Type <strong>de</strong> fécondation et types <strong>de</strong> variétés pour <strong>les</strong> principa<strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s cultures<br />
Espèces<br />
Type <strong>de</strong> variété<br />
Blé<br />
2.5% Hybri<strong>de</strong><br />
97.5% Lignées<br />
Autres céréa<strong>les</strong> à paille (orge, seigle, 100% Lignées<br />
triticale)<br />
Maïs<br />
100% Hybri<strong>de</strong><br />
Tournsesol<br />
100% Hybri<strong>de</strong><br />
Colza<br />
10% Hybri<strong>de</strong><br />
10% Association variéta<strong>les</strong><br />
80% Lignées<br />
Protégineux (pois, féverole)<br />
100% Lignées<br />
Betterave<br />
100% Hybri<strong>de</strong> (monogerme)<br />
Pomme <strong>de</strong> Terre<br />
100% Tubercule<br />
<strong>Les</strong> f<strong>acteurs</strong> influençant l'appropriabilité sur <strong>les</strong> variétés <strong>de</strong> semence sont résumés dans le Tableau<br />
2. Le semencier est face à <strong>de</strong>ux types concurrents: <strong>les</strong> autres semenciers et <strong>les</strong> agriculteurs. Le COV<br />
offre une assez bonne protection face aux semenciers concurrents, mais n'offre pas <strong>de</strong> protection<br />
contre <strong>les</strong> agriculteurs compte tenu <strong>de</strong> l'exemption du fermier. Dans le cas où l'exemption du fermier<br />
pose <strong>de</strong>s problèmes au semencier, le recours à <strong>de</strong>s constructions hybri<strong>de</strong>s permet alors <strong>de</strong> s'affranchir<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence <strong>de</strong>s agriculteurs.<br />
Tableau 2. <strong>Les</strong> déterminants <strong>de</strong> l'appropriabilité sur <strong>les</strong> innovations semencières<br />
Source <strong>de</strong> concurrence Moyen <strong>de</strong> protection<br />
COV<br />
Hybri<strong>de</strong><br />
Semenciers concurrents Assez bon, renforcé par <strong>la</strong> Faible<br />
révision <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention UPOV<br />
Agriculteurs Faible (exemption du fermier) Fort<br />
3 Voir le site <strong>de</strong> <strong>la</strong> SICASOV pour plus <strong>de</strong> détails (www.sicasov.fr)<br />
10
- La segmentation et <strong>les</strong> pratiques <strong>de</strong>s agriculteurs<br />
D'après le GNIS, le marché total <strong>de</strong>s semences en France, incluant <strong>les</strong> ventes en France et <strong>les</strong><br />
exportations, représentait un peu plus <strong>de</strong> 11 milliards <strong>de</strong> francs pour <strong>la</strong> saison 1999/2000, <strong>les</strong><br />
exportations représentant un peu plus d'un quart <strong>de</strong> ce chiffre. Le marché est séparé en plusieurs<br />
marchés par espèces ou groupe d'espèces. On peut d'abord distinguer <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s cultures qui<br />
représentent <strong>les</strong> trois quarts du marché total français, et <strong>les</strong> potagères et flora<strong>les</strong> qui représentent le<br />
quart restant. La venti<strong>la</strong>tion ensuite <strong>de</strong>s différentes espèces au sein <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s cultures (Tableau 3)<br />
met en évi<strong>de</strong>nce l'importance <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> maïs.<br />
Tableau 3. Poids <strong>de</strong>s différentes espèces végéta<strong>les</strong> dans l'activité semencière en France<br />
Espèce ou groupe d'espèce Part dans <strong>les</strong> semences<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> culture*<br />
Maïs et Sorgho 49%<br />
Céréa<strong>les</strong> 18%<br />
Fourragères 11%<br />
Betterave 10%<br />
Pomme <strong>de</strong> Terre 7%<br />
Oléagineux 6%<br />
* Estimations faites à partir <strong>de</strong>s données du GNIS. <strong>Les</strong> pourcentages sont exprimé par rapport à l'activité total<br />
sur <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s cultures, incluant <strong>les</strong> ventes en France et <strong>les</strong> exportation.<br />
Encart 1. Quelques rappels sur <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> différenciation et <strong>la</strong> segmentation <strong>de</strong>s marchés<br />
Sur <strong>de</strong>s marchés, comme ceux <strong>de</strong>s semences ou <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s, où <strong>les</strong> biens présentent <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques différentes, l'analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence <strong>entre</strong> produits s'appuie sur <strong>les</strong> notions <strong>de</strong><br />
différenciation verticale et horizontale <strong>de</strong>s produits.<br />
La différenciation <strong>entre</strong> produit est verticale lorsque tous <strong>les</strong> utilisateurs sont d'accord <strong>entre</strong> eux pour<br />
c<strong>la</strong>sser <strong>les</strong> produits en terme <strong>de</strong> préférence. Autrement dit, si tous <strong>les</strong> produits sont payés au même<br />
prix, tous <strong>les</strong> utilisateurs s'orienteront vers le produit le plus performant ou présentant <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong><br />
qualité. Si <strong>les</strong> choix <strong>de</strong>s utilisateurs sont différents, ce<strong>la</strong> signifie que certains utilisateurs accor<strong>de</strong>nt<br />
moins d'importante ou ne sont pas prêt à payer plus cher pour le produit <strong>de</strong> haute qualité. Par exemple,<br />
certains agriculteurs seront prêts à payer très cher pour disposer d'un produit qui leur permettent <strong>de</strong><br />
contrôler <strong>les</strong> problèmes <strong>de</strong> pyrale sur le maïs parce qu'ils subissent tous <strong>les</strong> ans <strong>de</strong>s attaques sévères <strong>de</strong><br />
pyrale. En revanche, d'autres agriculteurs qui subissent rarement <strong>de</strong> tels attaques ne seront pas prêts à<br />
payer aussi cher.<br />
La différenciation <strong>entre</strong> produits est horizontale lorsque le c<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong>s produits en terme <strong>de</strong><br />
préférence n'est pas le même d'un utilisateur à l'autre. Dans ce cas, <strong>les</strong> choix <strong>de</strong>s utilisateurs sont<br />
différents, même si <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s produits sont i<strong>de</strong>ntiques.<br />
Au sein d'un marché différencié, <strong>les</strong> segments regroupent <strong>de</strong>s ensemb<strong>les</strong> <strong>de</strong> produits assez proches et<br />
facilement substituab<strong>les</strong> l'un à l'autre. En d'autres termes, <strong>la</strong> concurrence est toujours plus forte <strong>entre</strong><br />
produits d'un même segment qu'<strong>entre</strong> produits <strong>de</strong> différents segments. Pour autant, <strong>les</strong> segments <strong>de</strong><br />
marché ne constituent pas <strong>de</strong>s compartiments totalement indépendants. Par exemple, l'introduction<br />
d'un nouveau produit dans un segment <strong>de</strong> marché peut parfois affecter <strong>les</strong> segments <strong>de</strong> marchés<br />
voisins. Compte tenu <strong>de</strong> ces interdépendances <strong>entre</strong> segments voisins, il y a toujours une part<br />
d'arbitraires dans <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>s frontières d'un segment <strong>de</strong> marché, certains produits ou certains<br />
utilisateurs pouvant se trouver à cheval sur <strong>de</strong>ux segments.<br />
11
Au sein <strong>de</strong> chaque marché-espèce, <strong>la</strong> segmentation est basée sur <strong>de</strong>ux f<strong>acteurs</strong> principaux:<br />
l'adaptation aux conditions <strong>de</strong> culture et <strong>les</strong> débouchés. On trouvera dans l'Encart 1 quelques brefs<br />
rappels sur <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> différenciation et <strong>de</strong> segmentation. Le Tableau 4 indique <strong>les</strong> différents<br />
segments <strong>de</strong> marché <strong>de</strong> semence existant pour <strong>les</strong> trois espèces végéta<strong>les</strong> qui sont plus<br />
particulièrement étudiées dans ce rapport.<br />
Tableau 4. Segmentation <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> semences sur <strong>la</strong> betterave, le colza et le maïs<br />
Adaptation aux conditions <strong>de</strong> culture Débouché<br />
Colza<br />
- Niche: Erucique<br />
Maïs Groupes <strong>de</strong> précocité - Spécialisation <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> précocité<br />
sur <strong>les</strong> usages grain ou ensi<strong>la</strong>ge<br />
- Niches: Waxy, B<strong>la</strong>ncn Maïs doux<br />
Betterave Résistance à <strong>la</strong> Rhizomanie Industriel standard<br />
Fourrager<br />
L'adaptation aux conditions <strong>de</strong> culture renvoie dans <strong>la</strong> pratique à <strong>de</strong>s critères différents selon <strong>les</strong><br />
espèces. Dans le cas du maïs, le critère majeur correspond à l'adaptation au climat. La segmentation se<br />
traduit donc par l'existence <strong>de</strong> différents groupes <strong>de</strong> précocité: <strong>les</strong> variétés <strong>les</strong> plus précoces étant<br />
adaptées au Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> France, <strong>les</strong> variétés <strong>les</strong> plus tardives étant adaptées au Sud. Dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Betterave, le critère majeur correspond à <strong>la</strong> résistance à <strong>la</strong> Rhizomanie 4 .<br />
<strong>Les</strong> différents débouchés <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole peuvent conduire à une segmentation du marché<br />
amont, mais ceci n'est pas systématique.<br />
Dans le cas du Colza, <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux débouchés concernent soit <strong>les</strong> usages alimentaires, soit <strong>les</strong> usages<br />
industriels. Cependant <strong>les</strong> variétés utilisées pour ces <strong>de</strong>ux types d'usage sont généralement <strong>les</strong> mêmes.<br />
La principale segmentation qui prévaut actuellement concerne le colza érucique sur<br />
approximativement 10 000 ha. Dans ce cas, <strong>les</strong> débouchés standard et érucique sont incompatib<strong>les</strong><br />
puisque le premier requiert un teneur maximum en aci<strong>de</strong> érucique qui est <strong>net</strong>tement inférieure à <strong>la</strong><br />
teneur minimum requise dans le second cas.<br />
Dans le cas du Maïs, <strong>la</strong> production est utilisée pour produire du maïs grain ou <strong>de</strong> l'ensi<strong>la</strong>ge. Des<br />
critères <strong>de</strong> différenciation <strong>de</strong>s variétés vis à vis <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux usages ont été progressivement mis en<br />
p<strong>la</strong>ce au cours <strong>de</strong>s dix <strong>de</strong>rnières années. Compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> production, il y a<br />
une certaine spécialisation <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> précocité par usage, <strong>les</strong> groupes <strong>les</strong> plus précoces étant<br />
<strong>de</strong>stinés principalement à un usage en ensi<strong>la</strong>ge, <strong>les</strong> groupes <strong>les</strong> plus tardifs étant <strong>de</strong>stinés<br />
principalement à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> maïs grain. La distinction <strong>entre</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> grain ou d'ensi<strong>la</strong>ge<br />
4 La Rhizomanie est une ma<strong>la</strong>die qui conduit à d'importante chute <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment. En 2000, cette ma<strong>la</strong>die<br />
concernaint 170 000 ha, soit plus <strong>de</strong> 40% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> betterave en France.<br />
12
a surtout conduit à une spécialisation <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> sélection sur <strong>les</strong> segments existants, mais pas à<br />
une segmentation accrue du marché. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> cette première spécialisation ensi<strong>la</strong>ge/grain, il existe<br />
une série <strong>de</strong> niches <strong>de</strong> marché qui correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s usages spécifiques du maïs grain: maïs b<strong>la</strong>nc,<br />
maïs waxy et maïs doux. Chacune <strong>de</strong> ces trois niches correspond à un segment <strong>de</strong> marché spécifique<br />
en amont sur <strong>les</strong> semences.<br />
1.2. Produits phytosanitaires<br />
- <strong>Les</strong> caractéristiques <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s produits et le contexte réglementaire<br />
Un produit phytosanitaire est une préparation combinant une ou plusieurs matières actives avec<br />
certains adjuvants. La matière active confère <strong>la</strong> propriété biologique du produit en terme <strong>de</strong> lutte<br />
contre le ravageur ou contre <strong>les</strong> adventices. L'adjuvant permet <strong>de</strong> modifier l'efficacité du produit en<br />
modifiant sa propriété physique. L'Encart 2 donne une illustration, dans le cas du Glyphosate chez<br />
Monsanto, <strong>de</strong> <strong>la</strong> gamme <strong>de</strong> produit qui peut ainsi être générée à partir d'une matière active.<br />
Encart 2. La gamme <strong>de</strong> produit tiré du Glyphosate par Monsanto<br />
Monsanto est le lea<strong>de</strong>r mondial sur le marché <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s non sélectifs avec son produit phare, le<br />
Round up. C’est en 1972, que <strong>les</strong> <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> Monsanto inventent <strong>la</strong> molécule <strong>de</strong> glyphosate et<br />
découvrent ses propriétés herbici<strong>de</strong>s. Cette molécule sera brevetée pendant plus <strong>de</strong> 20 ans à l’INPI<br />
(homologation en 1974, commercialisation en 1975) et <strong>de</strong>viendra <strong>la</strong> matière active du produit<br />
Roundup à raison <strong>de</strong> 360 g/L. Le Roundup est un désherbant qui présente certaines caractéristiques : il<br />
est foliaire (il pénètre dans <strong>les</strong> mauvaises herbes par <strong>les</strong> feuil<strong>les</strong>, <strong>les</strong> parties vertes…), systémique (il<br />
est transporté par <strong>la</strong> sève jusqu’aux racines et autres organes souterrains), complet (il détruit<br />
définitivement <strong>les</strong> mauvaises herbes en bloquant <strong>la</strong> synthèse <strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s aminés aromatiques) et non<br />
persistant dans le sol.<br />
Le Roundup est rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>venu <strong>la</strong> référence sur le marché <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes vivaces qui<br />
étaient jusqu’alors détruites mécaniquement du fait <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> produit efficace (systémique). Puis<br />
le Roundup a investi le marchés <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes annuel<strong>les</strong> suite à l’introduction d’une nouvelle technique,<br />
<strong>la</strong> TAE (Technique d’Application Economique) qui permet <strong>de</strong> diminuer <strong>les</strong> coûts pour <strong>les</strong> agriculteurs.<br />
Cette technique développée dans <strong>les</strong> années 80 consiste à ajouter au glyphosate un surfactant qui a<br />
pour rôle d’agresser <strong>la</strong> cuticule et qui ai<strong>de</strong> ainsi <strong>la</strong> pénétration <strong>de</strong> <strong>la</strong> matière active. On diminue alors<br />
<strong>les</strong> doses <strong>de</strong> glyphosate par <strong>de</strong>ux et donc le coût/hectare. Genamin, le surfactant <strong>de</strong> Monsanto, est<br />
vendu pour être utilisé avec le Roundup c<strong>la</strong>ssique. Depuis <strong>la</strong> date d’expiration du brevet (1991 (1) ), <strong>de</strong><br />
nombreuses sociétés concurrentes sont arrivées sur le marché avec <strong>de</strong>s produits génériques concurrents<br />
à base <strong>de</strong> glyphosate.<br />
Monsanto a adapté son offre (en proposant <strong>de</strong>s prix plus faib<strong>les</strong>, en jouant sur <strong>les</strong> é<strong>la</strong>sticités <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> au prix ) et é<strong>la</strong>rgi son portefeuille produits grâce à <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> formu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> Roundup (2) .<br />
Il s’agit d’une stratégie <strong>de</strong> bas prix associée à une politique <strong>de</strong> marque. Grâce à l’ajout <strong>de</strong> surfactant,<br />
<strong>les</strong> proportions qui étaient <strong>de</strong> 360g/L pour le Roundup ont pu passer à 120 g/L sur <strong>de</strong>ux nouveaux<br />
produits très efficaces sur <strong>les</strong> p<strong>la</strong>ntes annuel<strong>les</strong> (le Sting spécifique aux céréa<strong>les</strong> et l’Azural spécifique<br />
aux vignes).<br />
Dans le même temps, Monsanto a continué à é<strong>la</strong>rgir sa gamme Roundup avec <strong>de</strong>s produits contenant<br />
<strong>de</strong>s bioactivateurs. Ces <strong>de</strong>rniers permettent au glyphosate <strong>de</strong> pénétrer dans <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte sans agresser <strong>la</strong><br />
cuticule et donc sans <strong>la</strong> stresser (contrairement au surfactant). En outre, ils activent <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
sève en augmentant <strong>la</strong> pénétration jusqu’aux racines. Avec cette nouvelle formule brevetée, Monsanto<br />
a <strong>la</strong>ncé 4 nouveaux produits à forte valeur ajoutée: le Roundup Bioforce (le plus connu et le plus<br />
13
vendu, il contient <strong>de</strong>ux bioactivateurs), le Roundup Star (simi<strong>la</strong>ire au Bioforce mais conçu pour <strong>la</strong><br />
distribution), le Roundup Expert (<strong>de</strong>stiné à <strong>la</strong> vigne, il contient trois bioactivateurs) et le Roundup<br />
Géoforce (formule sèche).<br />
(1) Le brevet a expiré en septembre 2000 aux Etats-Unis.<br />
(2) Le Roundup représente aujourd’hui encore 80% du chiffre d’affaires phytosanitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> division agriculture <strong>de</strong><br />
Monsanto France.<br />
<strong>Les</strong> matières actives sont généralement protégées par brevet pour une durée <strong>de</strong> 20 ans (Hartnell<br />
1996). Passé ce dé<strong>la</strong>i, <strong>de</strong>s formes génériques <strong>de</strong> cette matière active apparaissent sur le marché,<br />
conduisant à une baisse du prix <strong>de</strong>s produits qui en sont tirés. En France, ces <strong>les</strong> produits génériques<br />
représentent 10% du marché phytosanitaire global. Cette proportion varie en fonction <strong>de</strong>s innovations<br />
introduites. <strong>Les</strong> ventes <strong>de</strong> génériques sur <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s betteraves et <strong>les</strong> fongici<strong>de</strong>s pommes <strong>de</strong> terre<br />
ont eu tendance à se développer au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années, alors que ventes <strong>de</strong> générique sur <strong>les</strong><br />
fongici<strong>de</strong>s céréa<strong>les</strong>, <strong>les</strong> insectici<strong>de</strong>s maïs, <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s céréa<strong>les</strong> et maïs ont eu tendance à diminuer.<br />
<strong>Les</strong> produits génériques représentent 10% du marché (1 544 MF pour le chiffre d’affaires <strong>de</strong>s<br />
produits génériques en 1999-2000). <strong>Les</strong> évolutions <strong>de</strong> ce marché sont toutefois fonction <strong>de</strong>s segments<br />
<strong>de</strong> marché génériques. Sur <strong>les</strong> marchés génériques en baisse, <strong>les</strong> produits sont souvent moins utilisés<br />
en raison <strong>de</strong> l’arrivée <strong>de</strong> nouveautés plus attrayantes pour l’agriculteur pour leur efficacité et surtout<br />
en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité qu’el<strong>les</strong> offrent à l’utilisateur, à l’environnement et au consommateur.<br />
Le commercialisation <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s est réglementée par <strong>la</strong> directive 91/414 (Tait et Assouline<br />
1998). <strong>Les</strong> autorisations <strong>de</strong> mise sur le marché sont accordées pour une durée <strong>de</strong> 10 ans. Cette<br />
directive a eu <strong>de</strong>ux effets principaux, (i) <strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises ont dû re<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s autorisations <strong>de</strong> vente<br />
sur leurs produits, et ont parfois été contraintes à abandonner <strong>de</strong>s produits, (ii) le coût <strong>de</strong>s<br />
homologations a <strong>net</strong>tement augmenté. On considère aujourd'hui que le coût <strong>de</strong> mise au point d'une<br />
molécule (recherche, développement et homo<strong>la</strong>gation) est <strong>de</strong> 130 Milions <strong>de</strong> US$ (Ollinger et<br />
Fernan<strong>de</strong>z-Cornejo 1998). Nous reviendrons dans <strong>la</strong> section suivante sur <strong>les</strong> implications <strong>de</strong> ces<br />
évolutions sur <strong>les</strong> stratégies <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong>.<br />
En 2000 <strong>la</strong> Taxe Générale sur <strong>les</strong> Activités Polluantes (TGAP) a été appliquée aux produits<br />
phytosanitaires. Il est encore trop tôt pour évaluer <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> cette taxe sur <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong><br />
produits phytosanitaires. Retenons simplement que <strong>la</strong> TGAP distingue différentes c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> produits<br />
selon <strong>les</strong> critères <strong>de</strong> toxicité et d'écotoxicité, le niveau <strong>de</strong> taxe appliqué étant différent selon <strong>les</strong><br />
c<strong>la</strong>sses 5 .<br />
5 Le niveau <strong>de</strong> taxation s’étend <strong>de</strong> 0 F par kilo (c<strong>la</strong>sse 1) pour <strong>les</strong> matières actives exemptées <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement<br />
(tel<strong>les</strong> que le cuivre, le soufre, le glyphosate…) à 11 F par kilo pour <strong>les</strong> molécu<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus toxiques (c<strong>la</strong>sse 7).<br />
%). En France, 300 à 350 molécu<strong>les</strong> sur <strong>les</strong> 700 homologuées sont concernées par <strong>la</strong> TGAP.<br />
14
- La segmentation<br />
<strong>Les</strong> matières actives sont généralement spécifiques <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes et<br />
peuvent être employées avec différentes cultures. A <strong>la</strong> différence <strong>de</strong>s semences où <strong>la</strong> segmentation par<br />
culture est stricte, <strong>la</strong> segmentation pour <strong>les</strong> produits phytosanitaire est essentiellement basée sur <strong>les</strong><br />
cib<strong>les</strong>. Cette segmentation peut être définie comme une segmentation en <strong>de</strong>ux étapes:<br />
• Une venti<strong>la</strong>tion par gran<strong>de</strong>s catégories <strong>de</strong> cible distingue <strong>les</strong> fongici<strong>de</strong>s, <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s, et <strong>les</strong><br />
insectici<strong>de</strong>s. Ces trois gran<strong>de</strong>s catégories représentent plus <strong>de</strong> 90% du marché total. On peut<br />
considérer que ces trois catégories représentent <strong>de</strong>s marchés assez indépendants <strong>les</strong> uns <strong>de</strong>s autres.<br />
• Une venti<strong>la</strong>tion au sein <strong>de</strong> chaque catégorie selon <strong>les</strong> cib<strong>les</strong> plus précises. On distinguera par<br />
exemple <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s totaux <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s sélectifs au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s, avant<br />
<strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s sous-c<strong>la</strong>sse au sein <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s sélectifs (ex: anti-dicotylédone vs antimonocotylédone).<br />
Suivant le découpage adopté, il est possible que <strong>les</strong> segments ne soient pas<br />
totalement indépendants : l'introduction d'une innovation dans un segment pourra, dans certains cas<br />
<strong>de</strong> figure, affecter <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong>s produits du segment voisin.<br />
- <strong>Les</strong> pratiques <strong>de</strong>s agriculteurs<br />
Le choix <strong>de</strong>s produits phytosanitaires est généralement beaucoup plus complexe que le choix<br />
variétal. Dans le cas d'une variété, l'agriculteur choisira généralement une seule variété sur une<br />
parcelle. Dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes, l'éventail <strong>de</strong>s problèmes nécessite <strong>de</strong> réaliser<br />
différents passages pour chaque type <strong>de</strong> problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes: luttes contre <strong>les</strong><br />
mauvaises herbes, lutte contre <strong>les</strong> insectes, etc. De plus, au sein <strong>de</strong> chaque type <strong>de</strong> problèmes, il sera<br />
nécessaire <strong>de</strong> conduire différents passages pour contrôler le problème en question aux différents sta<strong>de</strong>s<br />
du cycle <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture. Enfin, à chaque passage, l'agriculteur sera plus ou moins efficace selon <strong>la</strong><br />
combinaison <strong>de</strong> produit qu'il utilisera et <strong>les</strong> doses auxquels il utilisera <strong>les</strong> produits.<br />
L'emploi <strong>de</strong> produits phytosanitaires n'est pas le seul moyen <strong>de</strong> conduire <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
Dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection contre <strong>les</strong> ravageurs, certains biopestici<strong>de</strong>s peuvent représenter <strong>de</strong>s<br />
alternatives intéressantes. Par exemple, <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> Pyrale sur le maïs peut également être conduit<br />
au moyen <strong>de</strong> trychogramme ou <strong>de</strong> bactérie Bt. Dans le cas du désherbage, certaines pratiques <strong>de</strong><br />
binage plus ou moins mécanisées peuvent aussi être réalisées. D'une façon générale, on peut<br />
considérer que <strong>les</strong> moyens <strong>de</strong> lutte par emploi <strong>de</strong> produits phytosanitaires se sont imposés jusque là car<br />
ils sont efficaces et peu coûteux en terme <strong>de</strong> main d'œuvre. L'emploi <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s alternatives <strong>de</strong>vient<br />
compétitif dès lors que l'agriculteur est capable <strong>de</strong> valoriser <strong>la</strong> production, comme c'est le cas<br />
typiquement avec <strong>les</strong> produits issus <strong>de</strong> l'agriculture biologique.<br />
15
- <strong>Les</strong> volumes <strong>de</strong> ventes et leurs distributions<br />
Tableau 5. Chiffre d'affaires en produits phytosanitaires<br />
<strong>de</strong> principaux pays d'Europe <strong>de</strong> l'Ouest<br />
Pays<br />
CA (M$)<br />
France 2299<br />
Allemagne 1120<br />
Italie 763<br />
Gran<strong>de</strong>-Bretagne 654<br />
Espagne 616<br />
Hol<strong>la</strong>n<strong>de</strong> 281<br />
Grèce 194<br />
Belgique 133<br />
Portugal 130<br />
Danemark 106<br />
Autriche 86<br />
Source: UIPP<br />
La France représente le plus gros marché au sein <strong>de</strong> l'Europe en produits phytosanitaires (Tableau<br />
5). <strong>Les</strong> fongici<strong>de</strong>s et <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s représentent plus <strong>de</strong>s trois quarts du marché <strong>de</strong>s produits<br />
phytosanitaires (respectivement 36% et 40%). La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> TGAP en a précipité <strong>les</strong> ventes,<br />
cel<strong>les</strong> <strong>de</strong> 2000 ayant été anticipées en 1999. En d'autres termes, <strong>les</strong> ventes moyennes sur 1999-2000<br />
sont proches <strong>de</strong>s ventes réalisées en 1998.<br />
Tableau 6. Chiffre d’affaires du marché phytosanitaire français (en millions <strong>de</strong> F)<br />
Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />
Fongici<strong>de</strong>s 4266 4173 4757 5022 5162 4879<br />
Insectici<strong>de</strong>s 1414 1428 1433 1371 1596 1386<br />
Herbici<strong>de</strong>s 4430 5199 5118 5730 5729 4457<br />
Divers 1327 1434 1435 1585 1688 1606<br />
Total 11437 12234 12743 13708 14175 12328<br />
Source: UIPP<br />
Il est très difficile d'obtenir <strong>de</strong>s données sur <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s ventes par culture. Notons que cette<br />
distribution est différente <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s surfaces, l'emploi <strong>de</strong> produits phytosanitaire étant<br />
parfois <strong>net</strong>tement plus important sur certaines cultures que sur d'autres. Ainsi, <strong>les</strong> dépenses en produit<br />
phytosanitaire sur <strong>la</strong> vigne, <strong>les</strong> production maraîchères et fruitières varient <strong>entre</strong> 2000 et 5000 F/ha. En<br />
revanche, pour <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s cultures ces dépenses varient généralement <strong>entre</strong> 500 et 1500 F/ha. Malgré<br />
16
ces écarts importants, le déséquilibre en terme <strong>de</strong> surface est tel que plus <strong>de</strong>s trois quarts du marché<br />
phytosanitaire français est <strong>de</strong>stiné aux gran<strong>de</strong>s cultures 6 .<br />
1.3. Vers le développement <strong>de</strong> variétés présentant <strong>de</strong>s composantes <strong>de</strong> l'offre<br />
en protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes<br />
<strong>Les</strong> <strong>de</strong>ux sous-sections précé<strong>de</strong>ntes ten<strong>de</strong>nt à montrer que <strong>les</strong> choix <strong>de</strong> semences et <strong>de</strong> produits<br />
phytosanitaires sont c<strong>la</strong>ssiquement assez indépendants. Nous présentons à présent une série <strong>de</strong> cas <strong>de</strong><br />
figure dans <strong>les</strong>quels l'agriculteur réduit l'éventail <strong>de</strong> ses choix en matière <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes au<br />
moment où il achète sa semence.<br />
- Le traitement <strong>de</strong> semences<br />
Un traitement <strong>de</strong> semences désigne un produit phytosanitaire qui est directement appliqué sur <strong>la</strong><br />
graine avant le semis. <strong>Les</strong> premiers traitements <strong>de</strong> semences étaient basés sur <strong>de</strong>s fongici<strong>de</strong>s et avaient<br />
pour objectif <strong>de</strong> contrôler <strong>les</strong> parasites transmis par <strong>la</strong> semence. Plus récemment, ont été mis au point<br />
<strong>de</strong>s traitements <strong>de</strong> semence avec <strong>de</strong>s propriétés systémiques. Le pestici<strong>de</strong> diffuse d'abord alentours <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> graine <strong>la</strong> protèges contre <strong>les</strong> parasites. Ensuite le produit est ensuite absorbé par <strong>les</strong> racines puis<br />
véhiculé par <strong>la</strong> sève et se répartit dans <strong>les</strong> feuil<strong>les</strong> au fur et à mesure <strong>de</strong> leur développement.<br />
Le Gaucho (produit Bayer) est aujourd'hui le produit lea<strong>de</strong>r sur le traitement <strong>de</strong> semence 7 . Mis sur<br />
le marché en 1991, ce produit à base d'imidaclopri<strong>de</strong> a une action sur <strong>les</strong> insectes pendant <strong>les</strong><br />
premières semaines du cycle végétatif. En 1998, <strong>les</strong> ventes mondia<strong>les</strong> <strong>de</strong> Gaucho atteignaient 500<br />
millions <strong>de</strong> $. Aujourd'hui <strong>les</strong> firmes se penchent sur <strong>la</strong> possibilité d'associer plusieurs molécu<strong>les</strong> dans<br />
le traitement <strong>de</strong> semence et sur le contrôle <strong>de</strong> certaines ma<strong>la</strong>dies en végétation comme <strong>la</strong> rouille <strong>de</strong>s<br />
céréa<strong>les</strong> sur <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>s essais sont actuellement réalisés.<br />
Le traitement <strong>de</strong> semence peut être vu comme une étape intermédiaire <strong>entre</strong> l’application d’un<br />
pestici<strong>de</strong> indépendamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> variété semencière utilisée l’intégration <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> protection<br />
<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes dans le génotype <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte (cas <strong>de</strong>s OGM). En effet, le traitement <strong>de</strong> semence peut<br />
facilement être appliqué sur n'importe quelle variété au <strong>de</strong>rnier moment sans avoir à modifier <strong>la</strong><br />
variété elle-même. Le développement du traitement <strong>de</strong> semence a néanmoins complexifié <strong>les</strong> gammes<br />
<strong>de</strong> produit <strong>de</strong>s semenciers et augmenté le coût <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s stocks supporté par ces <strong>de</strong>rniers. Par<br />
ailleurs, le développement du produit dépend <strong>de</strong> l'éventail <strong>de</strong> variété sur lequel il est appliqué, éventail<br />
qui peut se trouver contraint par <strong>les</strong> antagonismes <strong>entre</strong> molécu<strong>les</strong> utilisées dans le traitement <strong>de</strong><br />
6 On peut estimer que <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong>stinées à <strong>la</strong> vigne et aux productions maraîchères et fruitières<br />
représente approximativement 15% du marché français <strong>de</strong>s produits phytosanitaires alors que ces cultures<br />
représentent moins <strong>de</strong> 5% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface cultivée en France.<br />
7 Depuis 1999 l'usage du Gaucho sur le Tournesol a été interdit à cause <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> liés aux effets sur <strong>les</strong><br />
abeil<strong>les</strong>.<br />
17
semences. En résumé, le traitement <strong>de</strong> semence et <strong>les</strong> OGM ont en commun le fait que le<br />
développement <strong>de</strong>s produits nécessite une certaine implication <strong>de</strong>s semenciers.<br />
- <strong>Les</strong> variétés non-OGM résistantes à <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
Ces produits présentent <strong>de</strong>s propriétés équivalentes aux semences OGM tolérantes à un herbici<strong>de</strong>,<br />
mais el<strong>les</strong> ne sont pas obtenues par transgénèse. Depuis 2000, <strong>de</strong>ux produits ont été mis sur le marché:<br />
• La tolérance à l’imazamox (famille <strong>de</strong> imidazolinones) développé par Cyanamid Agro avec le<br />
système Clearflield 8 . Ce caractère est protégé par brevet et a été intégré par différents semenciers<br />
qui ont obtenue <strong>de</strong>s licences d'utilisation. Par exemple, Pioneer dispose déjà <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux variétés<br />
tardives <strong>de</strong> maïs, Résista et California, versions résistantes <strong>de</strong> Cécilia et Marista.<br />
• La tolérance à <strong>la</strong> cycloxydime, matière active du Stratos Ultra <strong>de</strong> BASF. Ce caractère a été intégré,<br />
<strong>entre</strong> autres, dans <strong>la</strong> variété DK 312 (variété <strong>de</strong> RAGT, n°3 sur le marché français du maïs grain)<br />
pour donner <strong>la</strong> variété Lexxor dont <strong>la</strong> dose est 25 F plus chère que celle <strong>de</strong> DK 312.<br />
Des produits équivalents ont aussi été mis sur le marché aux Etats-Unis et au Canada. Dans le cas<br />
du Soja, <strong>les</strong> exportations américaines <strong>de</strong> non OGM certifiées sont en partie orchestrées par DuPont<br />
avec l'utilisation comme point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> Soja tolérantes aux sulfonilurés.<br />
- <strong>Les</strong> variétés OGM<br />
<strong>Les</strong> autorisations <strong>de</strong> mises sur le marché sur <strong>les</strong> OGM sont définies par <strong>la</strong> directive 90/220. Deux<br />
types d'autorisations sont accordées 9 :<br />
• <strong>Les</strong> autorisations sur <strong>les</strong> essais aux champs (partie B) sont accordées <strong>de</strong> manière décentralisée par<br />
l'instance compétente dans chaque pays membre. L'information sur <strong>les</strong> essais est transmise aux<br />
autres pays membres qui peuvent faire <strong>de</strong>s observations 10 .<br />
• <strong>Les</strong> autorisations <strong>de</strong> mise sur le marché (partie C) suivent un circuit plus complexe. <strong>Les</strong> dossiers<br />
sont d'abord examinés par un état membre, l'autorisation est ensuite accordée par l'ensemble <strong>de</strong>s<br />
états membres et va<strong>la</strong>ble pour tous <strong>les</strong> pays, enfin <strong>les</strong> variétés contenant <strong>les</strong> événements autorisés<br />
doivent être inscrites dans chaque pays au catalogue officiel <strong>de</strong>s variétés.<br />
8 Le groupe agrochimique avait mis au point un nouvel herbici<strong>de</strong>, l’AC 264, une association d’imazamox et<br />
<strong>de</strong> pendiméthaline, permettant le désherbage <strong>de</strong> variétés résistantes (système Clearfield). Suite au report <strong>de</strong><br />
l’homologation <strong>de</strong> l’AC 264 et au rachat <strong>de</strong> Cyanamid par BASF, le maïs Clearfield n’a pas été commercialisé<br />
en 2000.<br />
9 La directive 90/220 a récemment été amendée, et sera remp<strong>la</strong>cé en 2002 par <strong>la</strong> directive 2001/18. <strong>Les</strong><br />
principa<strong>les</strong> modifications concernent <strong>les</strong> points suivants: (i) une reconnaissance du besoin d'étiquetage, (ii) une<br />
plus gran<strong>de</strong> consultation <strong>de</strong> <strong>la</strong> société civile, notamment dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d'essais.<br />
10 L'information sur <strong>les</strong> essais réalisés en Europe est centralisée au Joint Research Center. Cette information<br />
est disponible publiquement sur le site http://biotech.jrc.it/<br />
18
<strong>Les</strong> produits pour <strong>les</strong>quels <strong>les</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> commercialisation ont été faites présentent <strong>de</strong>s<br />
améliorations sur <strong>de</strong>s caractères agronomiques. Trois caractères sont concernés: <strong>la</strong> tolérance à un<br />
herbici<strong>de</strong> total (HT, sur betterave, colza et maïs), <strong>la</strong> résistance à un insecte (IR ou Bt sur maïs) et <strong>la</strong><br />
possibilité <strong>de</strong> rendre <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes mâle-stéri<strong>les</strong> (sur colza). Plus <strong>de</strong> détails sur <strong>les</strong> événements <strong>de</strong><br />
transformations autorisés en Europe sont donnés dans le chapitre 3 (sous-section 1.1, paragraphe a).<br />
Aujourd'hui plusieurs variétés <strong>de</strong> maïs Bt sont autorisées à <strong>la</strong> vente en France, mais <strong>les</strong> industriels ont<br />
pour le moment suspendu leurs ventes. En Europe, seule l'Espagne présente <strong>de</strong>s surfaces en OGM<br />
assez importantes.<br />
2. <strong>Les</strong> <strong>acteurs</strong> et <strong>les</strong> structures industriel<strong>les</strong><br />
Comme ce<strong>la</strong> a été rappelé dans l'introduction <strong>de</strong> ce rapport, 4 principaux métiers sont en re<strong>la</strong>tion en<br />
amont <strong>de</strong> <strong>la</strong> production végétal: <strong>les</strong> semences, <strong>les</strong> produits phytosanitaire, <strong>la</strong> distribution, et <strong>les</strong><br />
biotechnologies. L'objectif <strong>de</strong> cette section est d'analyse l'évolution générale <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> ces<br />
métiers et d'expliquer en particulier l'effet <strong>de</strong>s OGM sur cette évolution.<br />
Le métier <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution ne sera pas étudié ici pour <strong>de</strong>ux raisons: (i) <strong>les</strong> <strong>entre</strong>tiens ont eu<br />
tendance à confirmer que ce métier a re<strong>la</strong>tivement peu d'influence sur <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM (il a une<br />
influence en général sur <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s produits, mais dans le cas <strong>de</strong>s OGM, cette influence semble<br />
être assea faible, (ii) c'est un métier qui a été re<strong>la</strong>tivement peu étudier (il était donc difficile <strong>de</strong> repartir<br />
d'un acquis).<br />
2.1. Evolution générale dans l'industrie <strong>de</strong>s semences<br />
Par soucis <strong>de</strong> concision, nous nous conc<strong>entre</strong>rons ici uniquement sur le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> France.<br />
Le GNIS recense actuellement une centaine d'établissements obtenteurs en France, certains d'<strong>entre</strong><br />
eux faisant parti d'un même groupe. Deux c<strong>la</strong>ssements complémentaires peuvent être réalisés pour<br />
mieux caractériser cette popu<strong>la</strong>tion: le premier sur le type d'espèce végétal qui est travaillé, le second<br />
sur <strong>la</strong> base du type <strong>de</strong> détention 11 .<br />
L'analyse est basée sur <strong>les</strong> marchés semenciers visés. Pour ne pas <strong>entre</strong>r trop dans le détail <strong>de</strong>s<br />
marchés par espèces, 4 principaux groupes <strong>de</strong> marchés ont été distingués (Tableau 7): <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
cultures, <strong>les</strong> p<strong>la</strong>ntes fourragères, <strong>les</strong> potagères et <strong>les</strong> fleurs. L'analyse du positionnement <strong>de</strong>s<br />
établissements sur chacun <strong>de</strong> ces marchés montre <strong>la</strong> très <strong>net</strong>te séparation <strong>entre</strong> <strong>les</strong> établissements<br />
spécialisés sur <strong>les</strong> potagères et flora<strong>les</strong> et <strong>les</strong> établissements spécialisés sur <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s cultures et <strong>les</strong><br />
fourragères. Cette séparation s'explique sans doute <strong>les</strong> caractéristiques différentes <strong>de</strong>s clients qui sont<br />
visés et <strong>les</strong> réseaux commerciaux concernés: d'un coté <strong>les</strong> semences pour <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s cultures et <strong>les</strong><br />
11 Nous reprenons ici <strong>les</strong> résultats d'une étu<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte (Lemarié et. al 2001).<br />
19
p<strong>la</strong>ntes fourragères sont commercialisés par <strong>les</strong> coopératives ou <strong>les</strong> négocient en agrofourniture, alors<br />
que d'un autre coté <strong>les</strong> potagères et flora<strong>les</strong> sont <strong>de</strong>stinés aux maraîchers ou aux particuliers.<br />
Tableau 7. Spécialisation <strong>de</strong>s semenciers sur <strong>les</strong> différents marchés par espèce<br />
Type <strong>de</strong> marché visé<br />
Nombre d'établissements<br />
Gran<strong>de</strong>s cultures 46<br />
P<strong>la</strong>ntes fourragères 13<br />
Gran<strong>de</strong>s cultures et p<strong>la</strong>ntes fourragères 11<br />
Potagères 11<br />
Flora<strong>les</strong> 2<br />
Potagères et flora<strong>les</strong> 6<br />
4 groupes <strong>de</strong> marché 1<br />
Gran<strong>de</strong>s cultures et potagères 2<br />
Gran<strong>de</strong>s cultures, potagères et flora<strong>les</strong> 2<br />
L'analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> détention du capital fait ressortir 5 types d'<strong>entre</strong>prises:<br />
• <strong>Les</strong> semenciers indépendants détenus par <strong>de</strong>s personnes individuel<strong>les</strong> (15 obtenteurs). Il s'agit en<br />
quelque sorte <strong>de</strong> <strong>la</strong> catégorie <strong>la</strong> plus ancienne <strong>de</strong> semencier, puisque certaines <strong>de</strong> ces <strong>entre</strong>prises<br />
ont été crées il y a plus d'un siècle. Cette catégorie est <strong>de</strong> plus en plus mince sous l'effet <strong>de</strong><br />
différents rachats 12 . Ces <strong>entre</strong>prises sont <strong>de</strong> taille re<strong>la</strong>tivement petite, et <strong>les</strong> semences représentent<br />
généralement leur seule activité. <strong>Les</strong> <strong>de</strong>ux tiers d'<strong>entre</strong> el<strong>les</strong> ont moins <strong>de</strong> 100 employés, <strong>la</strong> plus<br />
gran<strong>de</strong> étant Florimond Desprez avec 235 employés et 300 millions <strong>de</strong> F <strong>de</strong> chiffre d'affaires.<br />
• <strong>Les</strong> filia<strong>les</strong> <strong>de</strong> groupes coopératifs (37 établissements, soit 20 groupes différents après<br />
regroupement). Historiquement, ces coopératives ont été impliquées dans <strong>la</strong> production et <strong>la</strong><br />
distribution <strong>de</strong> semence et el<strong>les</strong> ont progressivement investit l'activité <strong>de</strong> sélection soit en créant<br />
leur propre station <strong>de</strong> sélection, soit en achetant d'autres établissements. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s trois<br />
activités <strong>de</strong> collecte, distribution et <strong>de</strong> semencier, certaines <strong>de</strong> ces coopératives se sont également<br />
diversifiées dans d'autres métiers liés à l'agro-alimentaire. La distribution <strong>de</strong>s chiffres d'affaires sur<br />
l'activité semencières est très étalée : <strong>les</strong> plus petits établissements sont <strong>de</strong> taille comparable à <strong>de</strong>s<br />
semenciers indépendants, mais <strong>les</strong> plus grands groupes se situent dans <strong>les</strong> 10-20 premiers<br />
semenciers mondiaux (l'exemple le plus connu étant Limagrain, 4 ième semencier au mon<strong>de</strong> et<br />
lea<strong>de</strong>r sur <strong>la</strong> sélection du maïs en Europe).<br />
• <strong>Les</strong> filia<strong>les</strong> communes <strong>entre</strong> plusieurs établissements (10 établissements). Typiquement, il s'agit<br />
d'un regroupement <strong>de</strong> l'activité <strong>de</strong> recherche <strong>entre</strong> plusieurs semenciers <strong>de</strong> taille assez mo<strong>de</strong>ste.<br />
L'activité <strong>de</strong> recherche concerne soit <strong>de</strong>s espèces végéta<strong>les</strong> sur <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> il est difficile d'amortir<br />
12 <strong>Les</strong> <strong>de</strong>ux exceptions sont Germicopa et Caussa<strong>de</strong>s qui correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s reprises par <strong>les</strong> employé, suite<br />
au désengagement <strong>de</strong>s groupes dont ils faisaient parti (respectivement Rhône Poulenc et Sanofi).<br />
20
un programme <strong>de</strong> recherche compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille du marché 13 , soit une activité <strong>de</strong><br />
biotechnologie pour <strong>la</strong>quelle il est nécessaire <strong>de</strong> conc<strong>entre</strong>r <strong>les</strong> moyens pour rester compétitif face<br />
aux programmes menées par <strong>les</strong> grand groupes industriels. Nous reviendrons plus loin le rôle <strong>de</strong><br />
ces filia<strong>les</strong> communes.<br />
• <strong>Les</strong> établissement filia<strong>les</strong> <strong>de</strong> semenciers étrangers (25 établissements). Généralement, un<br />
semencier étranger souhaitant s'imp<strong>la</strong>nter en France a <strong>de</strong>ux solutions à sa disposition: (i) déléguer<br />
ses variétés à une <strong>entre</strong>prise française et toucher <strong>de</strong>s royalties en contrepartie, (ii) créer une filiale<br />
en France qui gérera le développement, <strong>la</strong> production et <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong> toute nouvelle<br />
variété. La <strong>de</strong>uxième solution correspond à un engagement plus lourd, mais elle assure un meilleur<br />
contrôle du développement commercial <strong>de</strong>s produits. D'une manière générale, cette <strong>de</strong>uxième<br />
solution est adoptée pour <strong>les</strong> semences à forte valeur ajoutée (ex: maïs) et quand <strong>les</strong> semenciers<br />
ont une position forte dans le pays d'origine. C'est <strong>la</strong> stratégie qui a été adoptée par Pioneer au<br />
cours <strong>de</strong>s années 80, et c'est <strong>la</strong> stratégie qui est actuellement suivie par <strong>de</strong>s semenciers comme<br />
KWS (Allemagne) ou Gol<strong>de</strong>n Harvest (USA).<br />
• <strong>Les</strong> filia<strong>les</strong> <strong>de</strong> groupes industriels (10 établissements). Aujourd'hui <strong>les</strong> 4 groupes concernés sont<br />
tous <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> l'agrochimie (DuPont, Monsanto, Syngenta, et Aventis) l'entrée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
d'<strong>entre</strong> eux étant re<strong>la</strong>tivement récente. La même analyse 10 ans plus tôt aurait montré une plus<br />
gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong>s groupes industriels impliqués avec, <strong>entre</strong> autres, Lafarge Coppée (via<br />
Hybrinova et C<strong>la</strong>es Luck), Shell (via Nickerson), Cargill (via Semences Cargill) ou Beghin Say<br />
(via Agrosem). Comme nous le verrons plus loin, on retrouve parmi <strong>les</strong> établissements concernés<br />
<strong>les</strong> lea<strong>de</strong>rs en France sur <strong>la</strong> betterave (avec Hil<strong>les</strong>hög), le colza (avec DeKalb et Novartis) et le<br />
maïs (avec Pioneer et Dekalb).<br />
2.2. Evolution générale dans l'industrie <strong>de</strong>s phytosanitaires<br />
Comme nous l'avons indiqué plus haut, <strong>les</strong> matières actives à <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s nouveaux produits<br />
phytosanitaires (ou "spécialités") peuvent être protégées par brevet, <strong>de</strong>s formes générique <strong>de</strong> cette<br />
matière active pouvant apparaître une fois <strong>la</strong> durée du brevet écoulée. Il est possible <strong>de</strong> faire une<br />
distinction au sein <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>prises <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s <strong>entre</strong> <strong>les</strong> firmes dont l'essentiel <strong>de</strong> l'activité se base sur<br />
<strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> spécialités et cel<strong>les</strong> dont l'essentiel <strong>de</strong> l'activité se base sur <strong>de</strong>s produits génériques.<br />
Compte tenu <strong>de</strong>s investissements importants nécessaires pour développer <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> spécialités, <strong>les</strong><br />
firmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> première catégorie doivent être imp<strong>la</strong>ntées sur <strong>les</strong> principaux continents et avoir une taille<br />
13 Quelques exemp<strong>les</strong> sont illustratifs:<br />
- Unisigma, filiale <strong>de</strong> recherche commune en céréa<strong>les</strong> à paille <strong>entre</strong> Advanta et <strong>de</strong>s coopératives françaises,<br />
- le GIE REGA filiale commune <strong>entre</strong> 4 semenciers et spécialisée sur <strong>les</strong> gazons (recherche et production),<br />
- Sémunion Verneuil filiale <strong>de</strong> recherche commune <strong>entre</strong> Sémunion et Verneuil semence spécialisée sur <strong>les</strong><br />
p<strong>la</strong>ntes fourragères.<br />
21
critique. Lorsqu'on analyse <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s chiffres d'affaires (au niveau mondial) dans le domaine<br />
<strong>de</strong>s phytosanitaires, <strong>les</strong> firmes produisant <strong>de</strong>s spécialités ont aujourd'hui une taille al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 2 à 6<br />
milliards <strong>de</strong> $, alors que <strong>les</strong> firmes produisant <strong>de</strong>s génériques ont une taille inférieure à 0.8 milliards<br />
<strong>de</strong> $. Le nombre <strong>de</strong> firmes produisant <strong>de</strong>s spécialités est très limité et el<strong>les</strong> conc<strong>entre</strong>nt à el<strong>les</strong> seu<strong>les</strong><br />
80% du chiffre d'affaires mondial.<br />
Aujourd'hui, toutes <strong>les</strong> firmes engagées sur <strong>la</strong> production <strong>de</strong> spécialités réalisent également<br />
d'importants efforts sur <strong>les</strong> biotechnologies. L'image était re<strong>la</strong>tivement différente au milieu <strong>de</strong>s années<br />
90 où Cyanamid, Dow, Bayer et BASF n'avaient pas encore réalisé d'engagements significatifs. <strong>Les</strong><br />
engagements sur <strong>les</strong> biotechnologies ont principalement trois objectifs: (i) utiliser ces nouvel<strong>les</strong><br />
technologies pour accélérer <strong>la</strong> mise au point <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> matières actives, (ii) mettre au point <strong>de</strong><br />
nouveaux caractères génétiques sur <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes dans le but d'être plus<br />
concurrentiel sur ce marché, (iii) développer <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> filières <strong>de</strong> productions par <strong>la</strong> mise au point<br />
<strong>de</strong> nouveaux caractères <strong>de</strong> qualité.<br />
Figure 1. Evolution <strong>de</strong>s positions <strong>de</strong>s lea<strong>de</strong>rs en phytosanitaires <strong>de</strong>puis 1999<br />
rang 1999 2000 2001 (début) 2001 (fin)<br />
1<br />
Novartis<br />
Aventis<br />
Syngenta<br />
Syngenta<br />
2<br />
Monsanto<br />
Novartis<br />
Aventis<br />
Aventis<br />
3<br />
Zeneca<br />
Monsanto<br />
BASF<br />
BASF<br />
4<br />
DuPont<br />
Zeneca<br />
Monsanto<br />
Monsanto<br />
5<br />
AgrEvo<br />
DuPont<br />
DuPont<br />
Dow Agrosciences<br />
6<br />
Bayer<br />
Bayer<br />
Bayer<br />
DuPont<br />
7<br />
Rhône Poulenc<br />
Cyanamid<br />
Dow Agrosciences<br />
Bayer<br />
8<br />
Cyanamid<br />
Dow Agrosciences<br />
9<br />
Dow Agrosciences<br />
BASF<br />
10<br />
BASF<br />
>10<br />
Rohm & Hass agri (#14)<br />
<strong>Les</strong> flèches en trait plein indiquent <strong>les</strong> fusion ou acquisition, alors que <strong>les</strong> flèches en pointillé indique <strong>les</strong><br />
cessions importantes <strong>de</strong> matières actives. Ce schéma ne tient pas compte du rachat possible d'Aventis par Bayer<br />
qui est en négociation.<br />
D'importantes restructurations ont eu lieu dans ce secteur au cours <strong>de</strong>s 3 <strong>de</strong>rnières années. Pour<br />
simplifier le propos, nous nous conc<strong>entre</strong>rons uniquement sur <strong>les</strong> plus importantes, à savoir cel<strong>les</strong> qui<br />
concernent <strong>les</strong> firmes produisant <strong>de</strong>s spécialités. Alors qu'el<strong>les</strong> étaient 10 pendant <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié<br />
<strong>de</strong>s années 90 (Figure 1), ces firmes seront au nombre <strong>de</strong> 6 au début <strong>de</strong> l'année 2002 après le rachat <strong>de</strong><br />
Aventis Crop Science. Cette concentration s'est produit par fusion et acquisition, et s'explique<br />
principalement par 3 arguments 14 :<br />
14 Voir Bijman (2000).<br />
22
• Des bénéfices plus diffici<strong>les</strong> à réaliser, liées à une tendance à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong>s marchés agricole, une<br />
concurrence forte <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s OGM en Amérique du Nord et <strong>de</strong>s investissements croissants pour<br />
développer <strong>de</strong> nouveaux produits.<br />
• Un abandon progressif <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> création <strong>de</strong> groupes en "sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie". L'idée générale<br />
était <strong>de</strong> regrouper au sein d'un même groupes <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> santé humaine et <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ntes dans le but <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> synergies en recherche et pouvoir ainsi amortir plus facilement<br />
<strong>les</strong> investissements sur ce domaine, en particulier dans <strong>les</strong> biotechnologies. <strong>Les</strong> 10 lea<strong>de</strong>rs en 1999<br />
étaient tous présents à <strong>la</strong> fois sur <strong>la</strong> pharmacie et l'agriculture. Après <strong>la</strong> cession d'Aventis Crop<br />
Science, seul Bayer sera encore présent sur <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux domaines. En l'espace <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux ans,<br />
American Home Product a cédé Cyanamid, Novartis et AstraZeneca ont fusionné leurs activités<br />
avant <strong>de</strong> s'en séparer par une introduction en bourse, Pharmacia a également commencé<br />
l'introduction en bourse <strong>de</strong> Monsanto, et enfin DuPont et BASF ont cédé leur activité dans le<br />
domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pharmacie. Plusieurs explications peuvent être apportées pour expliquer cette<br />
séparation pharmacie-agriculture: un écart trop important <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> rentabilité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux activités<br />
qui désavantage ces firmes hybri<strong>de</strong>s par rapport à cel<strong>les</strong> qui sont exclusivement dans le domaine<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pharmacie, une valorisation difficile <strong>de</strong>s investissements en biotechnologie liée <strong>entre</strong> autre<br />
aux controverses sur <strong>les</strong> OGM, et enfin, pour cel<strong>les</strong> qui ont décidé d'abandonner leurs activités<br />
liées à l'agriculture, le besoin <strong>de</strong> rester compétitif dans <strong>la</strong> pharmacie où d'importantes fusions et<br />
acquisitions ont également eu lieu.<br />
• Un effet d'autorenforcement dès lors que <strong>les</strong> concentrations crééent <strong>de</strong>s asymétries trop<br />
importantes sur <strong>les</strong> tail<strong>les</strong> d'<strong>entre</strong>prises. Pendant <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié <strong>de</strong>s années 90, <strong>les</strong> tail<strong>les</strong> <strong>de</strong>s<br />
<strong>entre</strong>prises étaient assez proches <strong>les</strong> une <strong>de</strong>s autres <strong>entre</strong> 2 et 3 milliards <strong>de</strong> $. <strong>Les</strong> premières<br />
fusions et acquisitions ont fait apparaître <strong>de</strong>s firmes beaucoup plus gran<strong>de</strong>s qui peuvent mettre en<br />
difficulté, à terme, cel<strong>les</strong> qui ont conservé leur taille. Cet argument explique en partie le rachat <strong>de</strong><br />
Cyanamid par BASF et celui (annoncé) d'Aventis Crop Science par Bayer. Si ce <strong>de</strong>rnier rachat est<br />
confirmé, DuPont et Dow AgroSciences auront <strong>de</strong>s tail<strong>les</strong> assez <strong>net</strong>tement inférieures par rapport<br />
aux 4 lea<strong>de</strong>rs. Il est donc possible qu'el<strong>les</strong> soient contraintes, <strong>de</strong> ce fait, <strong>de</strong> s'engager à leur tour<br />
dans un mouvement <strong>de</strong> fusion-acquisition.<br />
La distribution <strong>de</strong>s ventes <strong>entre</strong> <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s catégories <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong> montre que ces firmes sont en<br />
général présentes sur <strong>les</strong> trois c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> produits. <strong>Les</strong> firmes d'origine américaines (Monsanto, DuPont<br />
et Dow) dégagent plus <strong>de</strong> ventes sur <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s par rapport aux Européennes, ceci s'expliquant par<br />
le poids plus important que représentent <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s en Amérique du Nord. A l'inverse, le poids <strong>de</strong>s<br />
firmes Européennes est plus fort en Europe. Lorsqu'on compare <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s ventes à l'échelle <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> France (Tableau 8) par rapport à l'échelle mondiale, <strong>les</strong> 7 premières firmes représentent dans <strong>les</strong><br />
<strong>de</strong>ux cas approximativement 80% du marché, mais <strong>la</strong> répartition firmes Européennes/firmes<br />
Américaines est plus équilibrée au niveau mondial (55%/25%) qu'en France (70%/10%). Ainsi, avec<br />
23
scénario <strong>de</strong> rachat d'Aventis CropScience par Bayer, 70% du marché français <strong>de</strong>s produits<br />
phytosanitaires <strong>de</strong>vrait être détenu par trois firmes Européennes, avec <strong>de</strong>s tail<strong>les</strong> re<strong>la</strong>tivement<br />
équivalentes pour chacune <strong>de</strong>s trois. En conséquence, le chiffre d'affaires en France <strong>de</strong>s firmes<br />
américaines est plus proche <strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s plus gros fournisseurs <strong>de</strong> génériques que celui <strong>de</strong>s lea<strong>de</strong>rs<br />
Européens.<br />
Tableau 8. <strong>Les</strong> principa<strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises <strong>de</strong> phytosanitaires en France<br />
CA France Fongici<strong>de</strong> Herbici<strong>de</strong> Insectici<strong>de</strong> RC+TS**<br />
(MF)<br />
Zeneca 1721 52% 34% 9% 5%<br />
Novartis 2500<br />
Aventis<br />
2800 35% 40% 15% 10%<br />
CropScience<br />
BASF 3100 58% 29% 7% 6%<br />
Bayer 1640<br />
DuPont 640 40% 51% 9% 0%<br />
Monsanto 630 0% 100% 0% 0%<br />
Dow<br />
600 8% 81% 7% 4%<br />
AgroSciences<br />
Sipcam-Phyteurop 504 25% 60% 9% 6%<br />
Cerexagri 429 62% 15% 5% 0%<br />
Phi<strong>la</strong>gro 329 49% 43% 8% 0%<br />
Calliope 250 30% 40% 30% 0%<br />
Makheteshim- 298 16% 82% 2% 0%<br />
Agan<br />
CFPI Nufarm 266 0% 97% 0% 3%<br />
Source: Référence Appro (Avril 2001). La catégorie "autre produits" n'est pas mentionnée ici et représente le<br />
complément pour atteindre 100%.<br />
* Régu<strong>la</strong>teur <strong>de</strong> Croissance et Traitement <strong>de</strong> Semence<br />
2.3. Evolution générale sur <strong>les</strong> biotechnologies agrico<strong>les</strong><br />
- Du côté <strong>de</strong>s firmes détentrices <strong>de</strong>s OGM<br />
A <strong>la</strong> différence <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux métiers <strong>de</strong>s semences et <strong>de</strong>s phytosanitaires présentés plus haut, le métier<br />
<strong>de</strong>s biotechnologies agrico<strong>les</strong> est émergent. Pour simplifier le propos, nous ne discuterons ici que <strong>de</strong>s<br />
innovations en biotechnologie sous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> nouveaux caractères qui puissent être intégrés dans <strong>les</strong><br />
semences comme c'est le cas avec <strong>les</strong> OGM. Le fait <strong>de</strong> pouvoir parler <strong>de</strong> métier <strong>de</strong>s biotechnologie<br />
tient à <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> protéger ces innovations et d'en tirer <strong>de</strong>s bénéfices à partir <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong><br />
licences. Cette possibilité est une condition nécessaire pour qu'un métier s'individualise, mais elle n'est<br />
pas une condition suffisante. <strong>Les</strong> 5 <strong>de</strong>rnières années ont en effet montré que <strong>les</strong> firmes ayant basé leur<br />
stratégie sur le développement <strong>de</strong>s biotechnologie sous forme d'OGM ont eu besoin <strong>de</strong> renforcé leurs<br />
actifs (c'est à dire <strong>les</strong> brevets qu'el<strong>les</strong> détenait), principalement dans <strong>de</strong>ux directions:<br />
24
• Premièrement en s'assurant que <strong>les</strong> brevets qu'el<strong>les</strong> détenaient constituaient <strong>de</strong>s portions <strong>de</strong><br />
propriété intellectuelle valorisab<strong>les</strong> et non dépendants d'autres brevets par <strong>de</strong>s concurrents. Or,<br />
comme il s'agissait d'un domaine émergent, l'examen <strong>de</strong>s domaines <strong>de</strong> revendication par <strong>les</strong><br />
examinateurs <strong>de</strong> brevet a été parfois délicat, et certaines brevets avec <strong>de</strong>s domaines <strong>de</strong><br />
revendications très <strong>la</strong>rges ont été acceptés dans un premier temps avant d'être réexaminés lors <strong>de</strong><br />
procès. Ce problème a été rendu plus aigu encore par le fait que <strong>les</strong> domaines <strong>de</strong> recherches <strong>de</strong>s<br />
différentes firmes pouvaient être extrêmement proches, comme ce<strong>la</strong> a été le cas avec <strong>les</strong> recherches<br />
autour <strong>de</strong>s gènes Bt 15 . Pour faire face à ce<strong>la</strong> <strong>les</strong> firmes ont été engagées dans un nombre important<br />
<strong>de</strong> procès ou ont choisi <strong>de</strong> racheter certaines startups <strong>de</strong> biotechnologies 16 .<br />
• Deuxièmement, en s'assurant un accès au marché <strong>de</strong>s semences. Pendant plusieurs années,<br />
certaines firmes comme Monsanto, DuPont ou AgrEvo ont considéré qu'el<strong>les</strong> pourraient valoriser<br />
correctement leurs actifs en biotechnologie par une stratégie <strong>de</strong> fournisseur <strong>de</strong> biotechnologie 17 ,<br />
c'est à dire en accordant <strong>de</strong>s licences non exclusives aux différents semenciers qui souhaiteraient<br />
intégrer <strong>les</strong> caractères développés avec <strong>les</strong> OGM. L'expérience américaine a révélé qu'avec une<br />
telle stratégie ne permettait pas d'intégrer <strong>les</strong> caractères développés dans le meilleur matériel<br />
possible, et rendait <strong>de</strong> ce fait <strong>les</strong> OGM moins intéressants pour <strong>les</strong> agriculteurs. Autrement dit, une<br />
stratégie unique <strong>de</strong> fournisseurs p<strong>la</strong>çait <strong>les</strong> firmes <strong>de</strong> biotechnologies dans une certaine situation <strong>de</strong><br />
dépendance vis à vis <strong>de</strong>s semenciers. A l'inverse, le fait d'avoir une filiale dans le domaine <strong>de</strong>s<br />
semences permet d'assurer une bonne diffusion du caractère par <strong>les</strong> meilleures variétés <strong>de</strong> cette<br />
filiale. Avec une telle configuration, <strong>les</strong> concurrents ne souhaitant pas perdre trop <strong>de</strong> parts <strong>de</strong><br />
marché seront plus enclins à intégrer <strong>de</strong>s événements <strong>de</strong> transformations dans leurs meilleurs<br />
variétés. La firme <strong>de</strong> biotechnologie peut alors choisir d'accor<strong>de</strong>r soit une licence exclusive à sa<br />
filiale semencière et gagner ainsi <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong> marché sur <strong>les</strong> semences soit une licence non<br />
exclusive et assurer ainsi une <strong>la</strong>rge diffusion <strong>de</strong> l'événement <strong>de</strong> transformation. Dans ce <strong>de</strong>uxième<br />
cas, <strong>la</strong> menace <strong>de</strong> ne pas accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong> licence met <strong>la</strong> firme <strong>de</strong> biotechnologie dans une position plus<br />
forte pour négocier <strong>les</strong> tarifs <strong>de</strong> cession <strong>de</strong> licence.<br />
15 Voir Krattiger (1996) pour une analyse détaillée <strong>de</strong>s brevets sur le Bt. Voir également Joly et De Looze<br />
(1996) pour une analyse détaillée <strong>de</strong>s brevets dans <strong>les</strong> biotechnologies.<br />
16 Voir Joly (2000) pour plus <strong>de</strong> détails sur ce <strong>de</strong>rnier point.<br />
17 Voir Joly et Docus (1993) pour une analyse plus détaillée <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> fournisseur <strong>de</strong> biotechnologie.<br />
25
Monsanto<br />
DuPont<br />
Syngenta<br />
Tableau 9. Participation <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> l'agrochimie dans <strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises semencières<br />
Dow AgroSciences<br />
Prise <strong>de</strong> participation majoritaire<br />
DeKalb<br />
Hol<strong>de</strong>n's<br />
Asgrow Agronomics<br />
Cargill international<br />
PBI Cambridge<br />
Hybritech<br />
Pioneer HiBred<br />
Hybrinova<br />
Hil<strong>les</strong>hög<br />
Northup King<br />
Agrosem<br />
Mycogen<br />
Cargill Seeds US<br />
Prise <strong>de</strong> participation minoritaire<br />
Advanta<br />
Maïsadour semences<br />
C.C. Benoist<br />
Secobra<br />
Verneuil Semences<br />
Aventis<br />
KWS<br />
BASF<br />
Svalöf Weibull<br />
Seuls sont rapportés ici <strong>les</strong> prises <strong>de</strong> participations dans <strong>de</strong>s semenciers imp<strong>la</strong>ntés sur <strong>les</strong> marchés <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
cultures situés en Europe ou en Amérique du Nord.<br />
- Du côté <strong>de</strong>s semenciers<br />
Compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille <strong>de</strong>s marchés et du niveau <strong>de</strong> concentration, <strong>les</strong> semenciers (indépendants)<br />
ne peuvent pas engager <strong>de</strong>s investissements en recherche sur <strong>les</strong> biotechnologies qui soient<br />
comparab<strong>les</strong> aux investissements réalisés par <strong>les</strong> plus grands groupes <strong>de</strong> l'agrochimie. Ces semenciers<br />
se p<strong>la</strong>cent donc en situation d'intégration <strong>de</strong>s innovations dans leurs variétés. Le point clef pour ces<br />
<strong>acteurs</strong> est alors <strong>de</strong> pouvoir avoir accès dans <strong>de</strong>s conditions convenab<strong>les</strong> par rapports aux concurrents<br />
semenciers.<br />
Deux stratégies ont été adoptées jusque là par <strong>les</strong> semenciers français:<br />
• Une stratégie <strong>de</strong> regroupement, comme c'est le cas avec Biogemma, BioP<strong>la</strong>nte et Génop<strong>la</strong>nte<br />
(Figure 2). L'objectif est double: (i) fédérer un certain nombre <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> recherche en<br />
biotechnologie dans le but <strong>de</strong> constituer un portefeuille <strong>de</strong> brevets qui permette d'être en position<br />
plus favorable pour négocier l'accès à certaines innovations en biotechnologie détenues par <strong>de</strong>s<br />
firmes <strong>de</strong> biotechnologies concurrentes, (ii) améliorer <strong>les</strong> conditions d'accès à certaines innovations<br />
en biotechnologies en négociant au nom <strong>de</strong> plusieurs semenciers.<br />
• Une stratégie <strong>de</strong> partenariat privilégié avec une firme <strong>de</strong> biotechnologie. Ce<strong>la</strong> se matérialise par<br />
une prise <strong>de</strong> participation minoritaire <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier dans <strong>la</strong> firme <strong>de</strong> semences (<br />
26
Tableau 9). En France, <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> concernés sont Verneuil Semences (Dow), Maïsadour, C.C.<br />
Benoist, et Secobra (Syngenta).<br />
Figure 2. Génop<strong>la</strong>nte et <strong>les</strong> alliances <strong>entre</strong> <strong>les</strong> principaux <strong>acteurs</strong> français<br />
dans <strong>les</strong> biotechnologies agrico<strong>les</strong><br />
Pau Euralis<br />
Unigrains<br />
Sophiprotéol<br />
INRA, CNRS,<br />
CIRAD,IRD<br />
Biogemma<br />
Génop<strong>la</strong>nte<br />
Limagrain<br />
Rhobio<br />
Aventis<br />
Sigma<br />
BioP<strong>la</strong>nte<br />
Florimond Desprez<br />
Acteurs publics ou para-publics<br />
Filia<strong>les</strong> communes <strong>de</strong> recherche<br />
Semenciers<br />
Phytosanitaire et biotech agricole<br />
3. Un modèle <strong>de</strong> compétition sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes 18<br />
3.1. Le modèle<br />
L'analyse s'appuie ici sur un modèle <strong>de</strong> différenciation verticale à <strong>la</strong> Mussa Rosen (1978). <strong>Les</strong><br />
échanges se déroulent sur une seule pério<strong>de</strong> dans un contexte d'information parfaite. <strong>Les</strong> produits<br />
considérés correspon<strong>de</strong>nt à une solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. Potentiellement, une solution repose<br />
sur l'usage d'un pestici<strong>de</strong> particulier et d'une semence particulière. Par simplicité, nous supposons<br />
qu'un seul produit pestici<strong>de</strong> est utilisé pour une solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes et que tous <strong>les</strong><br />
agriculteurs emploient ce produit à <strong>la</strong> même dose.<br />
Le ren<strong>de</strong>ment atteint par l'agriculteur qui utilise <strong>la</strong> solution i est défini par:<br />
( 1−<br />
( − ) θ )<br />
y = y M<br />
a 1<br />
α i<br />
Cette formu<strong>la</strong>tion est i<strong>de</strong>ntique à celle qui sera utilisée dans le chapitre suivant dans le cas du maïs<br />
Bt (voir <strong>la</strong> section 3 du chapitre 2). θ reflète l'ampleur du problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes auquel<br />
18 Le modèle proposé ici est basé une extension d'un premier modèle <strong>de</strong> Lemarié et Marette (2001).<br />
27
l'agriculteur est exposé. Cette variable est différente d'un agriculteur à l'autre et, pour le modèle<br />
théorique envisagé ici, nous supposons que cette variable est distribuée <strong>de</strong> manière uniforme <strong>entre</strong> 0 et<br />
1. y M est le niveau <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment atteint lorsque l'agriculteur ne rencontre aucun problème <strong>de</strong><br />
protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. On peut voir donc qu'au fur et à mesure que le problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ntes s'aggrave, le ren<strong>de</strong>ment décroît <strong>de</strong> façon linéaire. Le paramètre a traduit l'ampleur <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse<br />
<strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment après un certain accroissement du problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. α i indique<br />
l'efficacité technique <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. Ce paramètre est compris <strong>entre</strong> 0 et 1. Si<br />
α i =1 alors <strong>la</strong> solution est parfaitement efficace et le ren<strong>de</strong>ment atteint est égal au ren<strong>de</strong>ment qui aurait<br />
été atteint sans problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
Le profit <strong>de</strong> l'agriculteur qui utilise <strong>la</strong> solution i est définit par:<br />
π<br />
i<br />
= y p − w − ρ<br />
= p y<br />
M<br />
i<br />
i<br />
( 1−<br />
a ( 1−<br />
αi<br />
) θ ) − wi<br />
− ρi<br />
p est le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole. w i est le coût en pestici<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ntes i. ρ i est le coût additionnel en semence <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes i par rapport au<br />
coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle. La surface totale sur <strong>la</strong>quelle <strong>les</strong> choix sont faits est égale à N.<br />
Trois solutions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes sont envisagées:<br />
• La solution 0 correspond au fait <strong>de</strong> n'appliquer aucune protection particulière. Dans ce cas α 0 =0,<br />
w 0 =0 et ρ 0 =0. Autrement dit, π = p y M<br />
( 1−<br />
a θ )<br />
0<br />
• La solution 1 correspond à l'utilisation d'une solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes conventionnelle<br />
basée uniquement sur l'emploi d'un pestici<strong>de</strong>. Dans ce cas, α 1 >0, w 1 >0 et ρ 1 =0.<br />
• Enfin, <strong>la</strong> solution 2 correspond à l'utilisation d'une solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes basée sur<br />
l'utilisation <strong>de</strong> semences OGM. Cette solution est supposée plus efficace du point <strong>de</strong> vue technique<br />
que <strong>la</strong> solution 1 (α 2 >α 1 ). Deux sous-cas doivent être distingués:<br />
• Pour le contrôle <strong>de</strong>s insectes (cas IR), <strong>la</strong> semence seule suffit à assurer <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
On a alors, α 2 >0, w 2 =0 et ρ 2 >0.<br />
• Pour le contrôle <strong>de</strong>s adventices (cas HT), l'agriculteur utilise une semence OGM <strong>de</strong> type HT en<br />
combinaison avec un herbici<strong>de</strong> total. On a alors, α 2 >0, w 2 >0 et ρ 2 >0.<br />
L'agriculteur choisit <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes qui lui offre le meilleur profit. Pour gar<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>s expressions simp<strong>les</strong>, il est équivalent <strong>de</strong> raisonner sur le profit <strong>de</strong> l'agriculteur ou sur le profit<br />
additionnel par rapport au fait d'utiliser <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> type 0. On définit donc l'utilité <strong>de</strong> l'emploi <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
solution <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> type i par:<br />
u<br />
i<br />
= π<br />
i<br />
− π<br />
0<br />
= p y<br />
M<br />
a α<br />
i<br />
θ − w<br />
i<br />
− ρ<br />
i<br />
28
La composante pestici<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution i est proposée par n i firme(s) qui se livrent une concurrence<br />
en quantité (concurrence à <strong>la</strong> Cournot). Le coût marginal <strong>de</strong> production <strong>de</strong> chaque produit est supposé<br />
nul. Dans le cas <strong>de</strong>s solutions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes basées sur l'utilisation <strong>de</strong> semence OGM, ρ i est<br />
fixé par une firme <strong>de</strong> biotech qui est supposée être en position <strong>de</strong> monopole.<br />
Un tel modèle peut être résolu <strong>de</strong> manière analytique. Nous donnerons également une série <strong>de</strong><br />
résultats <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tions en prenant <strong>les</strong> valeurs <strong>de</strong>s paramètres indiquées dans le Tableau 10.<br />
Tableau 10. Valeurs <strong>de</strong> paramètres retenues pour <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions<br />
3.2. <strong>Les</strong> fonctions <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
Paramètre Valeur<br />
a 0.1<br />
p 100<br />
y 100<br />
α 1 0.50<br />
α 2<br />
0.75<br />
N 1<br />
Si toutes <strong>les</strong> solutions étaient gratuites (w i =0 et ρ i =0) alors tous <strong>les</strong> agriculteurs choisirait <strong>la</strong><br />
solution technique <strong>la</strong> plus efficace. En revanche, si on a <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> penser que <strong>les</strong> solutions<br />
techniques <strong>les</strong> plus efficaces seront plus chers, alors <strong>les</strong> choix <strong>de</strong>s agriculteurs ne seront pas toujours<br />
<strong>les</strong> mêmes.<br />
L'utilité <strong>de</strong> chaque produit est croissante avec l'ampleur du problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes<br />
(Figure 3). La courbe est d'autant plus croissante que le produit est efficace. Si <strong>les</strong> solutions <strong>les</strong> plus<br />
efficace sont aussi <strong>les</strong> plus chers, alors il existe toujours un niveau seuil sur θ au <strong>de</strong>là duquel <strong>la</strong><br />
solution <strong>la</strong> plus efficace sur le p<strong>la</strong>n technique est préférée à <strong>la</strong> solution <strong>la</strong> moins efficace. Cette<br />
propriété traduit un fait empirique simple: l'agriculteur sera prêt à payer cher pour <strong>la</strong> solution efficace<br />
uniquement si il est confronté à <strong>de</strong> gros problèmes <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
29
Figure 3. Représentation <strong>de</strong> l'utilité <strong>de</strong>s agriculteurs et <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> basculements<br />
u<br />
u 2<br />
u1<br />
θ 1 θ 12<br />
θ<br />
adoption <strong>de</strong> 0<br />
adoption <strong>de</strong> 1<br />
adoption <strong>de</strong> 2<br />
Il est possible <strong>de</strong> calculer <strong>les</strong> seuils au niveau <strong>de</strong>squels <strong>les</strong> choix <strong>de</strong>s agriculteurs basculent:<br />
• θ 1 est le niveau pour lequel l'agriculteur est indifférent <strong>entre</strong> <strong>les</strong> solutions 0 et 1. Pour θ>θ 1 alors<br />
l'agriculteur préfère <strong>la</strong> solution 1 à <strong>la</strong> solution 0 (et réciproquement).<br />
• θ 12 est le niveau pour lequel l'agriculteur est indifférent <strong>entre</strong> <strong>les</strong> solutions 1 et 2. Pour θ>θ 12 alors<br />
l'agriculteur préfère <strong>la</strong> solution 2 à <strong>la</strong> solution 1 (et réciproquement).<br />
Après résolution <strong>les</strong> valeurs <strong>de</strong> θ 1 et θ 12 sont définies par:<br />
θ<br />
1<br />
=<br />
p<br />
1<br />
y<br />
M<br />
a<br />
w<br />
α<br />
1<br />
1<br />
θ<br />
12<br />
=<br />
p<br />
1<br />
y<br />
M<br />
w<br />
⋅<br />
a α<br />
2<br />
2<br />
− w<br />
− α<br />
1<br />
1<br />
Comme <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s θ est uniforme <strong>entre</strong> 0 et 1, il est possible <strong>de</strong> calculer simplement <strong>les</strong><br />
fonctions <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:<br />
• Avant l'introduction <strong>de</strong>s OGM, seule <strong>la</strong> solution conventionnelle est présente sur le marché. La<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> est D = N ( − )<br />
1<br />
1 θ 1<br />
• Après l'introduction <strong>de</strong>s OGM, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux solutions est = N ( − )<br />
D<br />
( θ − )<br />
1<br />
= N<br />
12<br />
θ1<br />
D<br />
2<br />
1 θ 12<br />
et<br />
3.3. L'équilibre initial avec une seule solution <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes<br />
<strong>Les</strong> détails <strong>de</strong> <strong>la</strong> résolution ne sont pas présentés ici. Nous donnerons ici <strong>la</strong> solution analytique pour<br />
l'équilibre initial car cette solution est re<strong>la</strong>tivement simple et permet <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce certaines<br />
propriétés généra<strong>les</strong>.<br />
30
Lorsque <strong>la</strong> solution 1 est proposée par n 1 firmes i<strong>de</strong>ntiques, <strong>les</strong> prix et <strong>les</strong> quantités à l'équilibre<br />
sont définies par:<br />
w<br />
q<br />
*<br />
1<br />
*<br />
1<br />
= a p y<br />
M<br />
1<br />
= N<br />
1+<br />
n<br />
1<br />
α<br />
1<br />
1+<br />
n<br />
Le profit <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s firmes est:<br />
Π<br />
*<br />
1<br />
= N a p y<br />
M<br />
1<br />
α<br />
1<br />
( 1+<br />
n ) 2<br />
1<br />
Le surplus <strong>de</strong>s agriculteurs adoptant <strong>la</strong> solution 1 est 19 :<br />
W<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1 1<br />
u1dθ<br />
= N a p y<br />
M<br />
θ<br />
2 n<br />
1 1<br />
= ∫<br />
α<br />
n<br />
( 1+<br />
) 2<br />
Ces équilibres présentent <strong>de</strong>ux propriétés importantes qui seront vérifiées dans tous <strong>les</strong> cas <strong>de</strong><br />
figure (voir l'annexe A pour <strong>les</strong> résultats avec <strong>les</strong> autres équilibres):<br />
• Deux termes reviennent régulièrement dans <strong>les</strong> expressions, à savoir N <strong>la</strong> surface totale sur<br />
<strong>la</strong>quelle <strong>les</strong> choix <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes sont réalisés et le produit a p y qui représente le manque<br />
à gagner pour l'agriculteur lié au problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes envisagé ici. Il est intéressant<br />
<strong>de</strong> voir que le manque à gagner pour l'agriculteur augmente si (i) le problème en question a un<br />
impact fort sur le ren<strong>de</strong>ment (paramètre a), (ii) si le ren<strong>de</strong>ment est élevé (paramètre y), ou si (iii) <strong>les</strong><br />
prix agrico<strong>les</strong> sont élevés (paramètre p).<br />
• Le prix à l'équilibre, le profit chaque firme et le surplus <strong>de</strong>s agriculteurs augmentent tous <strong>de</strong><br />
manière proportionnelle avec l'ampleur du manque à gagner <strong>de</strong> l'agriculteur (a p y) et l'efficacité<br />
technique du produit. Il est intéressant en particulier <strong>de</strong> retenir que si le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> production<br />
agricole diminue, alors <strong>les</strong> firmes situées en amont réagissent en baissant leur prix dans <strong>les</strong> mêmes<br />
proportions.<br />
Avec <strong>les</strong> valeurs <strong>de</strong>s paramètres indiquées dans le Tableau 10, <strong>de</strong>ux simu<strong>la</strong>tions ont été faites en<br />
prenant une ou <strong>de</strong>ux <strong>entre</strong>prises. Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion A avec une seule <strong>entre</strong>prise en monopole, <strong>la</strong><br />
solution 1 est adoptée sur 50% du marché, et le monopole parvient à s'accaparer <strong>les</strong> 2/3 du surplus<br />
total (contre 1/3) aux agriculteurs. En passant <strong>de</strong> 1 à 2 <strong>entre</strong>prises (simu<strong>la</strong>tion B), le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution<br />
1 diminue et cette solution est adoptée sur 67% du marché. Cet é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> conduit à<br />
un accroissement du surplus total, mais dans <strong>de</strong>s proportions plus faib<strong>les</strong> que l'augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
19 Pour être précis, le surplus <strong>de</strong>s agriculteurs est définit comme le surplus lié à <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
solution 1, par rapport à <strong>la</strong> situation dans <strong>la</strong>quelle seule <strong>la</strong> solution 0 est disponible.<br />
31
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>, car l'é<strong>la</strong>rgissement concerne <strong>de</strong>s agriculteurs qui ont <strong>de</strong>s propensions à payer plus faib<strong>les</strong> (θ<br />
plus faible). Enfin, cette baisse <strong>de</strong> prix conduit à un ré-équilibrage du partage du surplus au profit <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs dont le surplus est égal à <strong>la</strong> moitié du surplus total.<br />
Tableau 11. Résultat <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux premières simu<strong>la</strong>tions avec uniquement <strong>la</strong> solution 1<br />
Variable Simu<strong>la</strong>tion A Simu<strong>la</strong>tion B<br />
n 1 1 2<br />
w 1 250 166<br />
θ 1<br />
0.5 0.33<br />
q 1 0.5 0.33<br />
Q 1 0.5 0.67<br />
Π 1 125 55.6<br />
W 1 62.5 111.1<br />
W total 187 222<br />
Q i est <strong>la</strong> quantité totale produite par toutes <strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises produisant<br />
le produit i. W total est le surplus total sur l'ensemble <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong><br />
(agriculteurs et <strong>entre</strong>prises amonts).<br />
3.4. Analyse <strong>de</strong> l'impact <strong>de</strong> l'introduction d'une solution OGM<br />
<strong>Les</strong> solutions analytiques correspondant aux nouveaux équilibres sont indiquées dans l'annexe A.<br />
- Analyse dans le cas IR<br />
Deux simu<strong>la</strong>tions ont été réalisées (C et D). El<strong>les</strong> correspon<strong>de</strong>nt respectivement aux simu<strong>la</strong>tions A<br />
et B avec un nouvel acteur proposant seule une semence OGM <strong>de</strong> plus gran<strong>de</strong> efficacité.<br />
Tableau 12. Impact <strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution 2 dans le cas IR<br />
Variable Simu<strong>la</strong>tion A Simu<strong>la</strong>tion C Simu<strong>la</strong>tion B Simu<strong>la</strong>tion D<br />
n 1 1 1 2 2<br />
n 2 0 1 0 1<br />
w 1 250 150 166 107.1<br />
ρ 2 - 300 - 267.9<br />
θ 1<br />
0.5 0.3 0.33 0.214<br />
θ 12 - 0.6 - 0.643<br />
q 1 0.5 0.3 0.33 0.214<br />
Q 1 0.5 0.3 0.67 0.429<br />
Q 2 - 0.4 - 0.357<br />
Π 1 125 45 55.6 22.6<br />
Π 2 - 120 - 95.7<br />
W 1 62.5 22.5 111.1 45.9<br />
W 2 - 120 - 124.4<br />
W total 187 307 222 312<br />
32
Par rapport à <strong>la</strong> situation initiale, le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution 1 diminue <strong>de</strong> 35% à 40% et se situe en<br />
<strong>de</strong>ssous du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution 2. L'introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution 2 conduit à un déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
pour le produit 1. Par exemple en passant <strong>de</strong> <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion A à C, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour le produit 1 qui se<br />
situait initialement pour θ compris <strong>entre</strong> 0.5 et 1 se situe à présent pour θ compris <strong>entre</strong> 0.33 et 0.6. Le<br />
surplus total augmente très <strong>net</strong>tement et se partage à peu près équitablement <strong>entre</strong> <strong>les</strong> agriculteurs et<br />
<strong>les</strong> firmes situées en amont. Une gran<strong>de</strong> partie du gain enregistré par <strong>la</strong> firme proposant <strong>la</strong> solution 2<br />
résulte d'un transfert <strong>de</strong> ventes <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> firme proposant le produit 2 dont le profit diminue très<br />
<strong>net</strong>tement.<br />
Lorsqu'on compare <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions A et C d'un coté et <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions B et D <strong>de</strong> l'autre, on peut<br />
remarquer que toutes <strong>les</strong> variations, qu'el<strong>les</strong> soient positives ou négatives, ont <strong>de</strong>s amplitu<strong>de</strong>s plus<br />
faib<strong>les</strong> quand <strong>la</strong> situation initiale est plus concurrentielle (avec n 1 =2).<br />
- Analyse dans le cas HT<br />
En repartant <strong>de</strong> <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion A, <strong>de</strong>ux nouvel<strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions (E et F) ont été réalisées en<br />
introduisant une solution 2 <strong>de</strong> type HT et en supposant que <strong>la</strong> composante herbici<strong>de</strong> <strong>de</strong> cette solution<br />
est proposée par une ou <strong>de</strong>ux firmes.<br />
Tableau 13. Impact <strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution 2 dans le cas HT<br />
Variable Simu<strong>la</strong>tion A Simu<strong>la</strong>tion E Simu<strong>la</strong>tion F<br />
n 1 1 1 1<br />
n 2 0 1 2<br />
ρ 2 - 250 250<br />
w 1 250 200 178.6<br />
w 2 - 150 107.1<br />
θ 1 0.5 0.4 0.357<br />
θ 12 - 0.8 0.714<br />
q 1 0.5 0.4 0.357<br />
q 2 - 0.8 0.143<br />
Q 1 0.5 0.4 0.357<br />
Q 2 - 0.2 0.286<br />
Π 1 125 80 63.8<br />
Π B - 50 71.4<br />
Π 2 - 30 15.3<br />
W 1 62.5 40 31.9<br />
W 2 - 55 81.6<br />
W total 187 255 279<br />
Deux propriétés i<strong>de</strong>ntiques au cas IR sont observées: (i) le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution 1 diminue, et <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour cette solution est décalée vers <strong>les</strong> agriculteurs ayant <strong>de</strong>s propensions à payer plus<br />
faib<strong>les</strong>, (ii) le surplus total augmente très <strong>net</strong>tement et celui-ci repose en partie sur un transfert <strong>de</strong>puis<br />
<strong>la</strong> firme qui propose le produit 1.<br />
33
Dans le cas HT, <strong>la</strong> solution 2 est commercialisée par <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> firme, <strong>la</strong> première vendant <strong>la</strong><br />
partie semence et <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> <strong>la</strong> partie pestici<strong>de</strong>. Cette configuration est plus complexe que dans le cas<br />
IR où <strong>la</strong> solution 2 est entièrement intégrée dans <strong>la</strong> semence. Cette particu<strong>la</strong>rité conduit à un prix plus<br />
fort par rapport au cas IR, alors que tous <strong>les</strong> autre paramètres sont i<strong>de</strong>ntiques (avec n 1 =1 et n 2 =1, <strong>la</strong><br />
solution 2 revient à 300 F/ha dans <strong>la</strong> configuration IR et 400 F/ha dans <strong>la</strong> configuration HT). Compte<br />
tenu <strong>de</strong> cet effet, toutes <strong>les</strong> variations observée <strong>entre</strong> <strong>la</strong> situation initiale et <strong>la</strong> situation finale ont <strong>de</strong>s<br />
amplitu<strong>de</strong>s plus faib<strong>les</strong>. En particulier, <strong>la</strong> solution 1 subit moins <strong>de</strong> perte et le gain total sont plus<br />
faib<strong>les</strong>. Enfin, comme <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s solutions sont plus élevés, <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s agriculteurs dans le surplus<br />
total est plus faible.<br />
Conclusion<br />
<strong>Les</strong> structures <strong>de</strong>s industries situées en amont <strong>de</strong> <strong>la</strong> production végétale ont connu d'importantes<br />
restructuration au cours <strong>de</strong>s 10 <strong>de</strong>rnières années. Ce phénomène s'explique en partie par le<br />
développement <strong>de</strong>s biotechnologies pour <strong>de</strong>ux raisons: (i) <strong>les</strong> OGM agronomiques modifient <strong>les</strong><br />
re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> semenciers et <strong>les</strong> firmes <strong>de</strong> l'agrochimie, (ii) le développement <strong>de</strong>s biotechnologies<br />
nécessite d'importants investissements en recherche.<br />
Dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> France, <strong>de</strong>ux points principaux doivent être soulignés:<br />
• L'industrie <strong>de</strong>s semences en France comprend un nombre important d'<strong>acteurs</strong> indépendants dont <strong>les</strong><br />
investissements en recherche sur <strong>les</strong> biotechnologies sont <strong>net</strong>tement plus faib<strong>les</strong> que ceux réalisés<br />
par <strong>les</strong> firmes lea<strong>de</strong>rs. Ces semenciers sont alors confrontés au problème <strong>de</strong> l'accès aux innovations<br />
dans <strong>de</strong>s conditions convenab<strong>les</strong> vis à vis <strong>de</strong>s concurrents qui peuvent éventuellement être <strong>de</strong>s<br />
filia<strong>les</strong> <strong>de</strong> firmes <strong>de</strong> l'agrochimie engagées sur <strong>les</strong> biotechnologies. Deux stratégies ont été suivies:<br />
(i) certains semenciers ont ouvert leur capital à <strong>de</strong>s firmes lea<strong>de</strong>rs en biotechnologie dans le but<br />
d'avoir un bon accès au travers <strong>de</strong> cet actionnaire particulier, (ii) d'autres semenciers ont mis en<br />
p<strong>la</strong>ce un certain nombre d'alliances (ex: Biogemma, Biop<strong>la</strong>nte) pour donner un effet <strong>de</strong> levier à<br />
leurs investissements et négocier <strong>de</strong> concert <strong>les</strong> accès.<br />
• Bien que <strong>les</strong> OGM agronomiques ne se soient pas diffusé pas en France, on voit se développer <strong>de</strong>s<br />
produits présentant <strong>de</strong>s propriétés équivalentes, à savoir <strong>de</strong> limiter, au moment <strong>de</strong> l'achat <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
semence, l'éventail <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s qui peuvent être achetés. Ces produits peuvent également faire<br />
évoluer <strong>les</strong> re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> le métier <strong>de</strong>s semences et le métier <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
Pour compléter l'analyse <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> métiers <strong>de</strong> l'amont, <strong>de</strong>ux directions<br />
nous semblent maintenant importantes à développer:<br />
• Il est nécessaire <strong>de</strong> pouvoir analyser <strong>les</strong> pouvoirs <strong>de</strong> marché aux différents maillons <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaîne.<br />
Pour ce qui concerne <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong>s inputs agrico<strong>les</strong>, le modèle présenté dans <strong>la</strong> section<br />
3 est une première tentative. Nous verrons dans le chapitre suivant que certaines données sont<br />
disponib<strong>les</strong> pour pouvoir tester un tel modèle. Néanmoins ce modèle est difficilement applicable<br />
34
directement car <strong>les</strong> choix <strong>de</strong>s agriculteurs en matière <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes sont plus complexes<br />
que ce qui a été supposé ici (utilisation <strong>de</strong> plusieurs produits, à différentes doses avec plusieurs<br />
passages). Par ailleurs, pour ce qui concerne <strong>les</strong> questions d'accès à <strong>la</strong> technologie pour <strong>les</strong><br />
semenciers, <strong>de</strong> nombreux travaux ont été réalisés sur <strong>les</strong> accords <strong>de</strong> licences et mériteraient d'être<br />
appliqués ici.<br />
• Il est nécessaire <strong>de</strong> ne pas se limiter à <strong>la</strong> seule analyse <strong>de</strong>s innovations sur <strong>les</strong> caractères<br />
agronomiques. De nombreux <strong>acteurs</strong> reconnaissent que l'impact <strong>de</strong>s biotechnologies reposera<br />
surtout sur <strong>la</strong> création <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> filières. <strong>Les</strong> mêmes <strong>acteurs</strong> reconnaissent aussi généralement<br />
que <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> filières ne peuvent pas être mises en p<strong>la</strong>ce sans l'implication <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> <strong>de</strong> l'aval très<br />
tôt dans le projet. Là encore, le développement <strong>de</strong>s biotechnologies s'accompagnera sans doute<br />
d'une évolution <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> métiers (ici <strong>les</strong> métiers <strong>de</strong> l'amont et <strong>les</strong> métiers <strong>de</strong> l'aval).<br />
Cette question ne faisait cependant pas partie <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> et nous avons donc décidé<br />
<strong>de</strong> ne pas le traiter.<br />
Références<br />
Bijman, J. (1999). “Life Science Companies: Can they combine seeds, agrochemic als and<br />
pharmaceuticals” Biotechnology and Development Monitor(40): 14-19.<br />
Hartnell, G. (1996). “The innovation of agrochemicals: regu<strong>la</strong>tion and patent protection.”<br />
Research Policy 25(3): 379-395.<br />
Joly, P.-B. (1999). “<strong>Les</strong> biotechnologies végéta<strong>les</strong> pour le "meilleur <strong>de</strong>s mon<strong>de</strong>s" agrico<strong>les</strong> ”<br />
OCL 6(2): 179-187.<br />
Joly, P.-B. et C. Ducos (1993). <strong>Les</strong> artifices du vivant : stratégies d'innovation dans l'industrie<br />
<strong>de</strong>s semences. Paris, INRA Editions, Economica.<br />
Joly, P.-B. et M.-A. <strong>de</strong> Looze (1996). “An analysis of innovation strategies and industrial<br />
differentiation through patent applications: the case of p<strong>la</strong>nt biotechnology.” Research<br />
Policy 25(7): 1027-1046.<br />
Krattiger, A. F. (1996). Insect resistance in crops: a case study of Bacillus thuringiensis (Bt)<br />
and its transfer to <strong>de</strong>veloping counrties. ISAAA, Ithaca, NY, 2, 42 p.<br />
Lemarié, S. et S. Marette (2001). The GM seeds and the pestici<strong>de</strong> market : toward a<br />
theoretical framework. in N. Ka<strong>la</strong>itzandonakes Economic and environmental impacts<br />
of agbiotech: a global perspective, Kluwer-Plenum (Forthcoming)<br />
Lemarié, S., I. Jorge et P.-B. Joly (2001). SMEs in the french agrochemicals, seeds and p<strong>la</strong>nt<br />
biotechnology industries. INRA, Grenoble, 19 p.<br />
Ollinger, M. et J. Fernan<strong>de</strong>z-Cornejo (1998). “Sunk cost and regu<strong>la</strong>tion in the US pestici<strong>de</strong><br />
industry.” International Journal of Industrial Organization 16.<br />
Tait, J. et G. Assouline (1998). Pestici<strong>de</strong>s policies. in J. Bijman and J. Tait European Union<br />
policies on agrochemicals, biotechnology and seeds (PITA project)<br />
35
Annexe A. Solution analytique du modèle <strong>de</strong> concurrence<br />
- Le cas IR<br />
Lorsque <strong>la</strong> solution 1 est proposée par n 1 firmes i<strong>de</strong>ntiques, et <strong>la</strong> solution 2 est proposée par une<br />
firme en monopole, <strong>les</strong> équilibres en prix sont:<br />
⎧<br />
⎪w<br />
⎨<br />
⎪ρ<br />
⎪<br />
⎩<br />
*<br />
1<br />
*<br />
2<br />
= a p y<br />
= a p y<br />
M<br />
M<br />
⋅<br />
2<br />
α<br />
⋅<br />
2<br />
( n1<br />
+ 1)<br />
α<br />
2<br />
− n1<br />
α1<br />
2<br />
(( n1<br />
+ 1)<br />
α<br />
2<br />
−α1<br />
)<br />
( n + 1)<br />
α − n α<br />
1<br />
α<br />
2<br />
α<br />
<strong>Les</strong> quantités à l'équilibre sont:<br />
⎧<br />
⎪q<br />
⎨<br />
⎪q<br />
⎪⎩<br />
*<br />
1<br />
*<br />
2<br />
= N ⋅<br />
2<br />
= N ⋅<br />
2<br />
( n1<br />
+ 1)<br />
α<br />
2<br />
− n1<br />
α<br />
(( n1<br />
+ 1)<br />
α<br />
2<br />
−α1<br />
)<br />
( n + 1)<br />
α − n α<br />
1<br />
α<br />
<strong>Les</strong> profits à l'équilibre sont:<br />
⎧<br />
⎪Π<br />
⎪<br />
⎨<br />
⎪<br />
⎪<br />
Π<br />
⎩<br />
*<br />
1<br />
*<br />
2<br />
= N ⋅ a p y<br />
= a p y<br />
M<br />
⋅<br />
⋅<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
1<br />
M<br />
( 2 ( n1<br />
+ 1)<br />
α<br />
2<br />
− n1<br />
α1<br />
)<br />
2<br />
α<br />
2<br />
(( n1<br />
+ 1)<br />
α<br />
2<br />
−α<br />
1<br />
)<br />
2<br />
( 2 ( n + 1)<br />
α − n α )<br />
1<br />
2<br />
1<br />
1<br />
α<br />
2<br />
2<br />
1<br />
α<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
Enfin, <strong>les</strong> surplus <strong>de</strong>s agriculteurs utilisant <strong>les</strong> solutions 1 et 2 sont respectivement:<br />
⎧<br />
⎪W<br />
⎪<br />
⎨<br />
⎪<br />
⎪<br />
W<br />
⎩<br />
1<br />
2<br />
= N ⋅ a p y<br />
= N ⋅ a p y<br />
M<br />
M<br />
⋅<br />
⋅<br />
2<br />
( 2 ( n1<br />
+ 1)<br />
α<br />
2<br />
− n1<br />
α1<br />
)<br />
2 2 2<br />
α<br />
2<br />
( n1<br />
+ 1)<br />
α<br />
2<br />
− n1α<br />
( 2 ( n + 1)<br />
α − n α )<br />
2<br />
( )<br />
1<br />
n<br />
2<br />
1<br />
α<br />
2<br />
2<br />
α<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
- Le cas HT<br />
Dans le cas HT, <strong>la</strong> résolution est faite en <strong>de</strong>ux temps, en supposant que le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM<br />
(ρ 2 ) est fixé d'abord. En procédant par induction arrière, on calcul d'abord <strong>les</strong> équilibre en Cournot sur<br />
le marché <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s. <strong>Les</strong> solutions d'équilibres dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> ρ 2 . Ensuite, connaissant<br />
<strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> solution 2 qui sera vendu en fonction <strong>de</strong> ρ 2 , <strong>la</strong> firme <strong>de</strong> biotechnologie fixe le prix <strong>de</strong> ρ 2<br />
<strong>de</strong> manière optimale. On ensuite recalculer <strong>les</strong> équilibre sur le marché <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s en avec <strong>la</strong> valeur<br />
optimale <strong>de</strong> ρ 2 . <strong>Les</strong> solutions données ici correspon<strong>de</strong>nt à un optimum pour toutes <strong>les</strong> firmes.<br />
<strong>Les</strong> prix d'équilibres sont:<br />
36
⎧<br />
⎪w<br />
⎪<br />
⎪<br />
⎨w<br />
⎪<br />
⎪<br />
⎪ρ<br />
⎩<br />
*<br />
1<br />
*<br />
2<br />
*<br />
2<br />
= a p y<br />
= a<br />
p y<br />
= a p y<br />
M<br />
M<br />
M<br />
α<br />
α<br />
1<br />
2<br />
α<br />
⋅<br />
⋅<br />
2<br />
⋅<br />
2<br />
<strong>Les</strong> quantités à l'équilibre sont:<br />
⎧<br />
⎪q<br />
⎨<br />
⎪q<br />
⎪<br />
⎩<br />
*<br />
1<br />
*<br />
2<br />
= N ⋅<br />
2<br />
= N ⋅<br />
2<br />
2<br />
+<br />
n2<br />
n1<br />
( α<br />
2<br />
−α1<br />
) + α<br />
2<br />
( 2n1<br />
+ n2<br />
+ 2)<br />
( n1<br />
+ 1) ( n2<br />
n1<br />
( α<br />
2<br />
−α1<br />
) + α<br />
2<br />
( n1<br />
+ n2<br />
+ 1)<br />
)<br />
α ( + 1)<br />
2<br />
n1<br />
−α1<br />
n1<br />
( n2<br />
n1<br />
( α<br />
2<br />
−α1<br />
) + α<br />
2<br />
( n1<br />
+ n2<br />
+ 1)<br />
)<br />
n1<br />
( α<br />
2<br />
−α<br />
1<br />
)<br />
( n + 1)<br />
2<br />
1<br />
n2<br />
n1<br />
( α<br />
2<br />
−α1<br />
) + α<br />
2<br />
( 2n1<br />
+ n2<br />
+ 2)<br />
( n1<br />
+ 1) ( n2<br />
n1<br />
( α<br />
2<br />
−α<br />
1<br />
) + α<br />
2<br />
( n1<br />
+ n2<br />
+ 1)<br />
)<br />
α<br />
2<br />
( n1<br />
+ 1)<br />
−α1<br />
n1<br />
( n n ( α −α<br />
) + α ( n + n + 1)<br />
)<br />
2<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
1<br />
<strong>Les</strong> profits à l'équilibre sont (Π B est le profit tiré <strong>de</strong>s licences sur <strong>la</strong> semence OGM):<br />
⎧<br />
⎪Π<br />
⎪<br />
⎪<br />
⎪<br />
⎨Π<br />
⎪<br />
⎪<br />
⎪Π<br />
⎪<br />
⎩<br />
*<br />
1<br />
*<br />
2<br />
*<br />
B<br />
= N<br />
= N<br />
= N a<br />
a p y<br />
a p y<br />
M<br />
p y<br />
M<br />
M<br />
⎛<br />
α ⋅<br />
⎜<br />
1<br />
⎝ 2<br />
α<br />
2<br />
⋅<br />
4<br />
2<br />
n2<br />
( α<br />
2<br />
−α1<br />
) + α<br />
2<br />
( 2n1<br />
+ n2<br />
+ 2)<br />
( n + 1) ( n n ( α −α<br />
) + α ( n + n + 1)<br />
)<br />
2<br />
⎛ n ( α −α<br />
) + α ⎞<br />
1 2 1 2<br />
⋅<br />
⎜<br />
( ( ) ( ))<br />
⎟<br />
⎝ 2 n2<br />
n1<br />
α<br />
2<br />
−α1<br />
+ α<br />
2<br />
n1<br />
+ n2<br />
+ 1 ⎠<br />
2<br />
( n1<br />
( α<br />
2<br />
−α1<br />
) + α<br />
2<br />
)<br />
( n + 1) ( n n ( α −α<br />
) + α ( n + n + 1)<br />
)<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
2<br />
37
Chapitre 2.<br />
La diffusion potentielle <strong>de</strong>s OGM en<br />
France et son impact sur le revenu <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs et <strong>de</strong>s firmes situées en<br />
amont<br />
Marion Desquilbet<br />
Stéphane Lemarié<br />
Fabrice Levert<br />
Myriam Carrère<br />
38
Introduction<br />
L'objectif <strong>de</strong> ce premier chapitre est d'abor<strong>de</strong>r <strong>les</strong> 3 questions suivantes:<br />
1. Que peut-on dire du niveau <strong>de</strong> diffusion potentiel en France <strong>de</strong>s OGM actuellement disponib<strong>les</strong><br />
Dans quel<strong>les</strong> régions et sur quels types d'exploitation <strong>la</strong> diffusion serait-elle <strong>la</strong> plus importante<br />
2. Le niveau <strong>de</strong> diffusion est sensible au tarif appliqué sur <strong>la</strong> semence OGM. Quel est le niveau<br />
optimal <strong>de</strong> tarification <strong>de</strong> l'OGM pour <strong>les</strong> firmes situées en amont, et quels sont <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong><br />
diffusion correspondants<br />
3. Quel est l'impact <strong>de</strong>s OGM sur <strong>les</strong> gains <strong>de</strong> différents <strong>acteurs</strong>: agriculteurs, fournisseurs <strong>de</strong><br />
pestici<strong>de</strong>s conventionnels, firmes proposant <strong>les</strong> OGM<br />
Ce travail est appliqué à 4 cas, en partenariat avec <strong>les</strong> instituts techniques concernés: le Colza HT<br />
(col<strong>la</strong>b. CETIOM), <strong>la</strong> Betterave HT (col<strong>la</strong>b. ITB), le Maïs HT et le Maïs IR (col<strong>la</strong>b. AGPM). Dans<br />
l'état actuel, <strong>de</strong>s développements assez poussés ont été réalisés sur le Colza HT et <strong>la</strong> Betterave HT.<br />
<strong>Les</strong> développements présentés ici présentent <strong>de</strong>ux principaux intérêts:<br />
• Ils prennent en compte l'hétérogénéité <strong>de</strong>s gains pour <strong>les</strong> agriculteurs. En effet, <strong>les</strong> produits qui sont<br />
étudiés ici présentent <strong>de</strong>s innovations sur <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. Dans ces<br />
conditions, le gain pour un agriculteur dépendra <strong>de</strong> l'ampleur du problème <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes<br />
auquel il est confronté. Par exemple, un Maïs résistant à <strong>la</strong> Pyrale peut présenter un <strong>net</strong> progrès<br />
technique et assurer une protection presque totale contre <strong>les</strong> attaques <strong>de</strong> Pyrale, mais il ne<br />
présentera pas beaucoup d'intérêt pour l'agriculteur qui est exposé exceptionnellement à <strong>de</strong> tel<strong>les</strong><br />
attaques (à l'inverse il présentera <strong>de</strong> l'intérêt pour l'agriculteur exposé). Or pour <strong>les</strong> quatre cas<br />
étudiés ici, <strong>les</strong> problèmes <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes sont suffisamment hétérogènes à l'échelle <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
France pour que l'on soit contraint <strong>de</strong> prendre en compte l'hétérogénéité <strong>de</strong>s gains pour <strong>les</strong><br />
agriculteurs.<br />
• Parmi <strong>les</strong> différentes variab<strong>les</strong> qui <strong>entre</strong>nt dans le calcul <strong>de</strong>s gains pour l'agriculteur, le supplément<br />
<strong>de</strong> prix payé sur <strong>la</strong> semence OGM par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle est l'une <strong>de</strong>s moins<br />
bien connue. Compte tenu <strong>de</strong>s différences <strong>de</strong> contexte par rapport aux Etats-Unis, une transposition<br />
<strong>de</strong>s données américaines au cas français serait assez discutable. En revanche, on peut<br />
raisonnablement penser que l'innovateur qui mettra en p<strong>la</strong>ce le programme OGM aura un<br />
comportement maximisateur du profit dégagé sur l'ensemble du territoire français. L'analyse<br />
proposée ici permet <strong>de</strong> donner une estimation du profit dégagé par cet innovateur avec différents<br />
niveaux <strong>de</strong> supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM. Il est alors possible <strong>de</strong> donner une estimation<br />
du supplément <strong>de</strong> prix qui maximise le profit <strong>de</strong> l'innovateur.<br />
39
1. <strong>Les</strong> hypothèses <strong>de</strong> travail et <strong>la</strong> démarche<br />
1.1. Hypothèses généra<strong>les</strong><br />
Trois hypothèses restrictives sont faites pour réaliser <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions. Une discussion sur l'impact<br />
<strong>de</strong>s ces hypothèses sera réalisée plus en détail dans le rapport final à partir <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s françaises et <strong>de</strong><br />
ce que l'on sait <strong>de</strong> l'expérience nord-américaine.<br />
1) Non prise en compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse possible <strong>de</strong>s prix agrico<strong>les</strong> et <strong>de</strong> <strong>la</strong> ré-allocation <strong>de</strong>s surfaces<br />
agrico<strong>les</strong> <strong>entre</strong> <strong>les</strong> cultures.<br />
De manière générale, selon le cadre retenu dans notre étu<strong>de</strong>, un agriculteur déci<strong>de</strong> d'adopter une<br />
variété OGM sur une culture donnée si l'adoption conduit à <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong> productivité, par diminution<br />
<strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> production et/ou augmentation du ren<strong>de</strong>ment. A prix agrico<strong>les</strong> constants, <strong>la</strong> profitabilité<br />
<strong>de</strong> cette culture augmente pour <strong>les</strong> agriculteurs ayant adopté l'OGM. Ceci peut conduire à une<br />
augmentation du niveau d'offre <strong>de</strong> cette culture, à prix agrico<strong>les</strong> constants, pour <strong>de</strong>ux raisons. <strong>Les</strong><br />
agriculteurs peuvent augmenter <strong>la</strong> surface allouée à <strong>la</strong> culture considérée, au détriment d'autres<br />
cultures, en réponse à l'augmentation <strong>de</strong> sa profitabilité. Cet effet peut être renforcé par une<br />
augmentation du ren<strong>de</strong>ment. L'ajustement vers un nouvel équilibre <strong>entre</strong> offre et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> conduit à<br />
une diminution du prix agricole <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture considérée. L'importance <strong>de</strong>s effets sur <strong>les</strong> surfaces et <strong>les</strong><br />
prix dépend <strong>de</strong> plusieurs f<strong>acteurs</strong>, notamment <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion prix-quantité<br />
offerte suite à l'adoption d'OGM, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion prix-quantité <strong>de</strong>mandée, <strong>les</strong> instruments <strong>de</strong> politique<br />
agricole utilisés sur <strong>la</strong> culture considérée.<br />
En raison <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>, nous examinons l'incitation à adopter pour différents types<br />
d'agriculteurs, selon l'effet anticipé <strong>de</strong> l'OGM sur leurs coûts <strong>de</strong> production et/ou leurs ren<strong>de</strong>ments,<br />
mais nous n'examinons pas l'effet agrégé <strong>de</strong> l'adoption au niveau national sur l'ajustement <strong>de</strong> l'offre et<br />
<strong>de</strong>s prix. Cependant, nous donnerons <strong>de</strong>s éléments d'analyse sur l'ampleur <strong>de</strong>s ajustements d'offre et <strong>de</strong><br />
prix que l'on peut attendre, notamment selon <strong>les</strong> instruments <strong>de</strong> politique agricole (par exemple,<br />
l'ajustement potentiel <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> betterave sera limité par l'existence <strong>de</strong> quotas <strong>de</strong> production à<br />
prix préférentiels), et selon <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> France sur <strong>les</strong> marchés mondiaux pour le produit considéré<br />
et ses substituts proches. Par exemple, l'ajustement <strong>de</strong>s prix du colza sera certainement limité car il est<br />
un substitut proche du soja pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en alimentation animale, or <strong>la</strong> France est un petit pays sur<br />
le marché du soja, c'est-à-dire prenant <strong>les</strong> prix mondiaux du soja comme donnés.<br />
2) Non prise en compte <strong>de</strong>s externalités négatives. <strong>Les</strong> externalités négatives liées aux risques <strong>de</strong><br />
contournement <strong>de</strong> résistance (Maïs Bt), aux risques <strong>de</strong> flux <strong>de</strong> gènes vers <strong>de</strong>s adventices (Colza HT)<br />
ou aux problèmes <strong>de</strong> repousse (Colza HT et Betterave HT) sont exclues du champ <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>.<br />
3) Prise en compte partielle <strong>de</strong>s effets indirects. <strong>Les</strong> simu<strong>la</strong>tions que nous réalisons sur l'adoption<br />
<strong>de</strong>s OGM par <strong>les</strong> agriculteurs sont basées essentiellement sur <strong>les</strong> effets directs <strong>de</strong>s OGM sur le profit<br />
au travers <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment ou <strong>de</strong>s économies d'intrants. Or, on sait que certains agriculteurs<br />
40
peuvent avoir intérêt à adopter parce que <strong>les</strong> OGM ont un effet indirect intéressant (par exemple, une<br />
diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> travail pendant une pério<strong>de</strong> critique). Parmi ces effets indirects nous avons<br />
uniquement pris en compte <strong>la</strong> diminution du nombre <strong>de</strong> passages <strong>de</strong> traitement, en affectant un coût à<br />
chaque passage.<br />
Deux autres hypothèses <strong>de</strong> travail ont été retenues pour <strong>les</strong> développements du volet 1, mais sont<br />
levées dans <strong>les</strong> chapitres suivants.<br />
1) L'effet sur <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s est exogène. Comme nous le montrerons, pour <strong>de</strong>s prix donnés<br />
<strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels, <strong>les</strong> OGM conduisent à une baisse <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s. On peut<br />
s'attendre, en réaction, à ce que le prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels diminue (ce que l'on peut<br />
observer dans le cas américain). En réaction à cette réaction, le prix optimal <strong>de</strong> tarification <strong>de</strong>s OGM<br />
aura aussi tendance à diminuer. Rigoureusement, le travail sur <strong>la</strong> tarification <strong>de</strong>s OGM doit donc<br />
s'appuyer sur l'analyse du dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> l'équilibre <strong>de</strong> marché. Combiner ce travail avec une analyse<br />
détaillée <strong>de</strong>s effets sur <strong>les</strong> agriculteurs est assez délicat, et nous avons choisi pour le moment <strong>de</strong><br />
conduire <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux tâches en parallèle. Plus précisément, ce chapitre s'attache à analyser, dans le détail,<br />
l'effet sur <strong>les</strong> agriculteurs et <strong>les</strong> comportements d'adoption qui en découlent. <strong>Les</strong> calculs sont réalisés<br />
dans ce volet avec plusieurs scénarios <strong>de</strong> baisse <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s. Nous analyserons dans le<br />
chapitre suivant comment l'introduction <strong>de</strong>s OGM conduit à un dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> l'équilibre <strong>de</strong> marché<br />
<strong>entre</strong> <strong>les</strong> produits <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes.<br />
2) Le coût lié à <strong>la</strong> ségrégation <strong>de</strong>s filières OGM et non-OGM. L'impact <strong>de</strong>s OGM, tel qu'il est<br />
estimé ici, suppose que <strong>la</strong> production agricole est vendue sur le marché standard, et que <strong>la</strong> diffusion<br />
<strong>de</strong>s OGM n'affecte pas <strong>la</strong> gestion et le coût <strong>de</strong>s autres productions. Si l'on suppose que <strong>les</strong> OGM se<br />
diffusent en France, le scénario le plus probable est un scénario dans lequel co-existeraient, au moins<br />
pendant un certain temps, une filière OGM et une filière non-OGM. La présence d'une production<br />
OGM conduirait alors à augmenter le coût <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux filières. Ces effets seront étudiés<br />
dans <strong>les</strong> chapitres 5 et 6.<br />
1.2. La démarche retenue pour réaliser <strong>les</strong> estimations dans ce chapitre<br />
Dans <strong>la</strong> démarche qui est proposée ici nous envisageons trois types d'<strong>acteurs</strong>:<br />
• <strong>Les</strong> agriculteurs. Chaque agriculteur réalise un arbitrage <strong>entre</strong> le fait <strong>de</strong> choisir un programme <strong>de</strong><br />
protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> type conventionnel et un programme <strong>de</strong> type OGM. Son choix ira vers le<br />
programme qui lui semblera le plus rentable. Comme le programme <strong>de</strong> type OGM est une<br />
nouveauté, il se peut cependant que l'agriculteur reste sur le programme conventionnel si le gain<br />
apporté par le programme OGM n'est pas suffisamment important.<br />
• <strong>Les</strong> fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels. Ces <strong>acteurs</strong> sont supposés tirer une marge <strong>de</strong>s ventes<br />
<strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels. Compte tenu du manque d'information sur le niveau <strong>de</strong> ces marges,<br />
nous avons été contraints <strong>de</strong> faire l'hypothèse d'un taux <strong>de</strong> marge i<strong>de</strong>ntique sur tous <strong>les</strong> produits.<br />
41
Dans un premier temps, on suppose que ces <strong>acteurs</strong> proposent <strong>les</strong> mêmes produits qu'actuellement<br />
au même prix. Certains prolongements sont néanmoins réalisés ensuite, en supposant qu'ils<br />
réagissent en baissant leurs prix.<br />
• L'innovateur. Cet acteur est celui qui propose l'événement <strong>de</strong> transformation qui permet <strong>de</strong><br />
conduire un programme <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> type OGM. On suppose ici que l'événement <strong>de</strong><br />
transformation est créé et que l'on se situe dans <strong>la</strong> phase où l'innovateur engrange <strong>les</strong> bénéfices <strong>de</strong><br />
ces investissements en recherche. Dans le cas IR, le programme OGM nécessite uniquement<br />
l'utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM. Dans le cas HT, ce programme nécessite l'utilisation conjointe <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> semence OGM et d'un herbici<strong>de</strong> total auquel <strong>la</strong> semence est tolérante (pour simplifier, cet<br />
herbici<strong>de</strong> sera appelé "herbici<strong>de</strong> OGM"). Le profit <strong>de</strong> l'innovateur est <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s profits dégagés<br />
à partir <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong> semences OGM à <strong>la</strong>quelle on ajoute éventuellement <strong>les</strong> profits dégagés à<br />
partir <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> complémentaire (différents cas <strong>de</strong> figures seront envisagés). Le<br />
supplément <strong>de</strong> prix payé sur <strong>la</strong> semence OGM est supposé représenter un profit complet pour<br />
l'innovateur car le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM est approximativement égal au coût <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnel. On considère que l'innovateur maximise son profit en<br />
jouant sur le supplément <strong>de</strong> prix payé sur <strong>la</strong> semence et qu'il n'a pas <strong>de</strong> marge <strong>de</strong> manœuvre pour<br />
fixer le prix <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM dans le cas HT. Enfin, dans <strong>les</strong> traitements qui ont été réalisés<br />
jusque là, nous avons supposé qu'il n'y a qu'un seul innovateur.<br />
Trois types <strong>acteurs</strong> ne sont pas pris en compte ici:<br />
• <strong>Les</strong> semenciers. Dans <strong>la</strong> réalité, <strong>les</strong> semenciers signent un accord <strong>de</strong> licence avec l'innovateur qui<br />
leur permet d'intégrer l'événement <strong>de</strong> transformation dans leurs variétés. Supposer que l'intégralité<br />
du supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence représente un profit pour l'innovateur revient à faire <strong>de</strong>ux<br />
hypothèses: (i) l'accord <strong>de</strong> licence stipule le versement <strong>de</strong> royalties sur chaque sac <strong>de</strong> semence<br />
OGM vendu, (ii) <strong>les</strong> semenciers sont en concurrence parfaite sur <strong>la</strong> fourniture <strong>de</strong> l'événement <strong>de</strong><br />
transformation et sont contraints <strong>de</strong> vendre <strong>la</strong> semence OGM à un prix égal à <strong>la</strong> somme du prix <strong>de</strong><br />
leur semence conventionnelle et <strong>de</strong>s royalties qui sont reversées à l'innovateur. Autrement dit, une<br />
fois décomptées <strong>les</strong> royalties, le semencier réalise <strong>la</strong> même marge par sac <strong>de</strong> semence, qu'elle soit<br />
OGM ou conventionnelle. Cette hypothèse est extrême: on sait d'après l'expérience américaine que<br />
l'innovateur est contraint <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser une marge supplémentaire au semencier, pour que ce <strong>de</strong>rnier<br />
soit prêt à faire <strong>les</strong> investissements pour intégrer l'événement <strong>de</strong> transformation dans ses variétés.<br />
<strong>Les</strong> quelques informations disponib<strong>les</strong> montrent cependant que <strong>la</strong> marge <strong>la</strong>issée au semencier reste<br />
faible (<strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 10 à 20% du supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM).<br />
• <strong>Les</strong> distributeurs distribuent <strong>de</strong>s semences (OGM ou conventionnel<strong>les</strong>) ou <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s. Ces<br />
distributeurs réalisent <strong>de</strong>s marges, mais rien ne <strong>la</strong>isse penser néanmoins qu'ils réalisent une marge<br />
plus importante sur <strong>les</strong> solutions OGM par rapport aux solutions conventionnel<strong>les</strong>.<br />
42
• <strong>Les</strong> <strong>acteurs</strong> en aval <strong>de</strong> l'agriculteur. Comme nous l'avons indiqué plus haut, <strong>les</strong> prix <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production agricole sont supposés constants et il ne se produit donc pas <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong> surplus <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs vers l'aval. Par ailleurs, <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> en aval sont supposés tirer <strong>la</strong> même utilité <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production agricole qu'elle provienne <strong>de</strong> cultures OGM on conventionnelle. Cette <strong>de</strong>rnière<br />
hypothèse sera levée dans <strong>les</strong> chapitres 5 et 6.<br />
En résumé, le schéma réducteur qui a dû être adopté ici pour gar<strong>de</strong>r une démarche assez simple<br />
nécessite <strong>de</strong> bien gar<strong>de</strong>r trois observations à l'esprit:<br />
• Ce qui sera considéré ici comme le profit <strong>de</strong> l'innovateur regroupe dans <strong>la</strong> réalité le profit <strong>de</strong><br />
l'innovateur et celui <strong>de</strong>s semenciers qui créent <strong>de</strong>s variétés OGM, <strong>la</strong> part al<strong>la</strong>nt à ces <strong>de</strong>rniers étant<br />
assez faible.<br />
• Le profit <strong>de</strong> l'innovateur rémunère un certain nombre <strong>de</strong> coûts fixes qu'il a dû supporter pour<br />
amener l'innovation sur le marché, à savoir <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> recherche et le coût <strong>de</strong>s tests nécessaires<br />
pour obtenir l'autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché.<br />
• Le gain <strong>de</strong>s agriculteurs ne prend pas en compte le transfert vers l'aval qui se produira s'il y a baisse<br />
<strong>de</strong> prix. Autrement dit, le gain <strong>de</strong>s agriculteurs <strong>de</strong>vrait plutôt être considéré comme le gain <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs et <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> situés en aval.<br />
Une fois le cadre défini, quelques explications peuvent être données sur <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> d'estimation,<br />
celle-ci étant assez <strong>net</strong>tement différente <strong>entre</strong> <strong>les</strong> cas HT et le cas IR:<br />
• Dans le cas HT, nous partons d'une observation sur le programme conventionnel qui est appliqué<br />
par chaque agriculteur et le coût par hectare qu'il représente. Pour chaque type <strong>de</strong> programme<br />
conventionnel est proposé un programme OGM alternatif qui permet d'atteindre le même<br />
ren<strong>de</strong>ment. Autrement dit, le gain <strong>de</strong> l'agriculteur est supposé reposer uniquement sur une<br />
économie <strong>de</strong> dépenses en désherbage. Suivant l'économie réalisée, l'agriculteur choisit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le<br />
même programme conventionnel ou <strong>de</strong> basculer sur le programme OGM alternatif. Après avoir<br />
agrégé <strong>les</strong> choix <strong>de</strong>s agriculteurs, il est possible <strong>de</strong> tracer <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en semences OGM<br />
en fonction du supplément <strong>de</strong> prix par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle, d'estimer <strong>les</strong> gains <strong>de</strong><br />
l'innovateur et <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels.<br />
• Le seul cas IR envisagé ici est celui du Maïs Bt. Nous ne disposons pas <strong>de</strong> données assez précises<br />
sur <strong>les</strong> utilisations d'insectici<strong>de</strong>s pour lutter contre <strong>la</strong> pyrale. En revanche, l'effet <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong><br />
pyrale sur le ren<strong>de</strong>ment est assez bien connu. En se basant sur une telle formu<strong>la</strong>tion, et en<br />
supposant que l'agriculteur retient <strong>la</strong> solution qui lui offre <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> utilité (en prenant en<br />
compte l'aversion au risque), il est possible <strong>de</strong> calculer <strong>les</strong> seuils <strong>de</strong> basculement d'un programme<br />
vers un autre. Enfin, en utilisant <strong>de</strong>s données sur <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> pyra<strong>les</strong> en France,<br />
nous tentons <strong>de</strong> réaliser une première projection <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion du maïs Bt.<br />
43
Malgré ce cadre simplifié, <strong>les</strong> estimations dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> nombreuses variab<strong>les</strong>, certaines étant<br />
mieux connues que d'autres. Trois cas <strong>de</strong> figure se présentent:<br />
• Certaines variab<strong>les</strong> sont bien connues et ne <strong>de</strong>vraient pas trop changer suite à l'introduction <strong>de</strong>s<br />
OGM. Il s'agit du prix <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM dans le cas IR, <strong>de</strong>s doses d'application <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s, du<br />
coût d'un passage <strong>de</strong> traitement, et <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspondance <strong>entre</strong> programmes conventionnels et<br />
programmes OGM. Ces variab<strong>les</strong> gar<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> même valeur pour toutes <strong>les</strong> estimations.<br />
• Certaines variab<strong>les</strong> sont assez mal connues ou sont susceptib<strong>les</strong> <strong>de</strong> changer suite à l'introduction<br />
<strong>de</strong>s OGM. Il s'agit du taux <strong>de</strong> marge réalisé sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s, du gain minimal que l'agriculteur<br />
doit anticiper pour basculer vers un programme OGM et enfin du prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels qui peuvent diminuer par rapport à <strong>la</strong> situation actuelle après l'introduction <strong>de</strong>s<br />
OGM. Pour chacune <strong>de</strong> ces variab<strong>les</strong>, on réalisera une analyse <strong>de</strong> sensibilité <strong>de</strong>s résultats.<br />
• Certaines variab<strong>les</strong> sont endogènes au modè<strong>les</strong>, dans le sens où ce sont <strong>les</strong> estimations qui sont<br />
faites ici qui vont en déterminer <strong>la</strong> valeur. Il s'agit ici du supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM.<br />
<strong>Les</strong> résultats sont présentés avec un éventail <strong>la</strong>rge <strong>de</strong> valeurs ou à l'optimum <strong>de</strong> l'innovateur (c'est à<br />
dire lorsque le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM permet <strong>de</strong> maximiser le profit <strong>de</strong><br />
l'innovateur).<br />
2. Analyse dans le cas HT (Colza et Betterave)<br />
2.1. Formu<strong>la</strong>tion analytique<br />
<strong>Les</strong> indices :<br />
j : agriculteur<br />
k : <strong>la</strong> culture envisagée. k prend <strong>de</strong>ux valeurs:<br />
c : solution <strong>de</strong> type conventionnelle<br />
g : solution <strong>de</strong> type OGM<br />
i : herbici<strong>de</strong> conventionnel<br />
<strong>Les</strong> variab<strong>les</strong> :<br />
Variab<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> :<br />
p : prix <strong>de</strong> l'output agricole<br />
g<br />
w<br />
s<br />
: supplément <strong>de</strong> prix payé sur <strong>la</strong> semence OGM par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle<br />
c<br />
w<br />
h<br />
: vecteur <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels,<br />
g<br />
w<br />
h<br />
: coût <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM g<br />
c<br />
w<br />
hi<br />
étant le prix <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> conventionnel i<br />
w n : coût d'un passage <strong>de</strong> traitement (main d'œuvre, amortissement du matériel)<br />
∆ : supplément <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> l'agriculteur pour qu'il adopte <strong>la</strong> culture OGM<br />
44
Variab<strong>les</strong> spécifiques à l'agriculteur j :<br />
y j : ren<strong>de</strong>ment obtenu par l'agriculteur j (supposé i<strong>de</strong>ntique pour OGM et conventionnel).<br />
s j : surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture pour l'agriculteur j<br />
c<br />
h ij : dose d'utilisation <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> conventionnel i par l'agriculteur j<br />
g<br />
h j : dose d'utilisation <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM g par l'agriculteur j<br />
k<br />
n j : nombre <strong>de</strong> passages <strong>de</strong> traitement réalisé par l'agriculteur j sur une culture <strong>de</strong> type k.<br />
c j : Ensemble <strong>de</strong>s autres coûts <strong>de</strong> l'agriculteur j indépendant du choix <strong>de</strong> k. Ce<strong>la</strong> inclut le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
semence traditionnelle.<br />
Constante:<br />
S: surface totale allouée à <strong>la</strong> culture considérée. S ∑s j<br />
.<br />
=<br />
j<br />
Le profit <strong>de</strong> l'agriculteur j sur un hectare <strong>de</strong> culture conventionnelle est égal à son revenu (prix<br />
multiplié par ren<strong>de</strong>ment) moins ses coûts (coût <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels utilisés, coût <strong>de</strong>s<br />
passages <strong>de</strong> traitement herbici<strong>de</strong> et ensemble <strong>de</strong>s autres coûts):<br />
π ( p, w , w ) ( w h ) − w n − c<br />
c<br />
j<br />
c<br />
h<br />
n<br />
= p yj<br />
−∑<br />
i<br />
c<br />
hi<br />
c<br />
ij<br />
n<br />
c<br />
j<br />
j<br />
Le profit <strong>de</strong> l'agriculteur j sur un hectare <strong>de</strong> culture OGM est égal à son revenu (prix multiplié par<br />
ren<strong>de</strong>ment) moins ses coûts (coût <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM utilisé, coût <strong>de</strong>s passages <strong>de</strong> traitement<br />
herbici<strong>de</strong>, supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM et ensemble <strong>de</strong>s autres coûts):<br />
π<br />
g<br />
j<br />
( p ,w , w , w ) = p y − w h − w n − w − c<br />
g<br />
h<br />
g<br />
s<br />
n<br />
j<br />
g<br />
h<br />
g<br />
j<br />
n<br />
g<br />
j<br />
g<br />
s<br />
Ces profits sont exprimées en fonction <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s inputs et <strong>de</strong>s outputs. Dans le cas d'un<br />
programme conventionnel, le programme conventionnel initialement conduit par l'agriculteur est<br />
supposé optimal. Plus précisément, <strong>les</strong> quantités d'herbici<strong>de</strong> conventionnel<br />
j<br />
c<br />
h ij et le nombre <strong>de</strong><br />
passages <strong>de</strong> traitement herbici<strong>de</strong><br />
c<br />
n j sont supposés optimaux pour l'agriculteur étant donnés ses<br />
caractéristiques propres et <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s inputs et output.<br />
Dans le cas du programme OGM, on établit une correspondance <strong>entre</strong> <strong>les</strong> caractéristiques du<br />
programme conventionnel initialement conduit et <strong>les</strong> caractéristiques du programme OGM qui<br />
semblerait optimal. Cette correspondance a été établie en lien avec <strong>les</strong> instituts techniques. Elle dépend<br />
dans tous <strong>les</strong> cas du nombre <strong>de</strong> passages d'herbici<strong>de</strong>s conventionnels.<br />
- Condition d'adoption<br />
L'agriculteur adopte si le profit avec le meilleur programme OGM apporte un profit additionnel au<br />
moins égal à ∆ par rapport au profit obtenu avec le meilleur programme conventionnel. De manière<br />
45
équivalente, l'agriculteur adopte le programme OGM si celui-ci lui permet <strong>de</strong> réaliser une économie <strong>de</strong><br />
coût au moins égale à ∆ par rapport au programme conventionnel.<br />
π<br />
g<br />
j<br />
⇔<br />
( p, w , w , w ) − π ( p, w , w ) > ∆<br />
∑<br />
i<br />
g<br />
h<br />
( w<br />
c<br />
hi<br />
g<br />
s<br />
c<br />
ij<br />
n<br />
h ) − w<br />
g<br />
h<br />
h<br />
c<br />
j<br />
g<br />
j<br />
+ w ( n<br />
n<br />
c<br />
h<br />
c<br />
j<br />
n<br />
− n<br />
g<br />
j<br />
) − w<br />
g<br />
s<br />
> ∆<br />
On notera que le raisonnement a pu être ramené à une minimisation du coût pour <strong>de</strong>ux raisons: (i)<br />
<strong>les</strong> <strong>de</strong>ux programmes sont supposés aboutir au même ren<strong>de</strong>ment, (ii) le prix <strong>de</strong> l'output est le même<br />
quel que soit <strong>la</strong> culture envisagée. Ces <strong>de</strong>ux hypothèses seront relâchées dans l'analyse <strong>de</strong> sensibilité<br />
sur le cas du Colza HT.<br />
L'expression précé<strong>de</strong>nte peut également s'écrire :<br />
g g g<br />
c c<br />
π<br />
j<br />
( p, wh<br />
, ws<br />
, wn<br />
) − π<br />
j<br />
( p, w<br />
h<br />
, wn<br />
) > ∆<br />
g<br />
c c g g<br />
c g<br />
⇔ ws<br />
< ∑ ( whi<br />
hij<br />
) − wh<br />
hj<br />
+ w<br />
n( nj<br />
− nj<br />
) − ∆<br />
i<br />
On définit une variable γ j qui est égale à 1 si l'agriculteur j adopte le programme OGM et 0 si<br />
l'agriculteur j reste sur un programme conventionnel:<br />
γ<br />
γ<br />
j<br />
j<br />
= 1 ⇔ w<br />
sg<br />
= 0 ⇔ w<br />
sg<br />
<<br />
><br />
∑<br />
i<br />
∑<br />
i<br />
( w<br />
( w<br />
c<br />
hi<br />
c<br />
hi<br />
c g<br />
h ) − w h<br />
ij<br />
c g<br />
h ) − w h<br />
ij<br />
h<br />
h<br />
g<br />
j<br />
g<br />
j<br />
+ w ( n<br />
n<br />
+ w ( n<br />
n<br />
c<br />
j<br />
c<br />
j<br />
− n<br />
g<br />
j<br />
− n<br />
g<br />
j<br />
) − ∆<br />
) − ∆<br />
Dans ce qui suit, on analyse l'adoption en fonction du supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence,<br />
l'agriculteur j, l'équation précé<strong>de</strong>nte montre que l'adoption sera réalisée uniquement lorsque<br />
passera en <strong>de</strong>ssous d'une valeur seuil, donnée par<br />
g<br />
w<br />
s<br />
. Pour<br />
g<br />
w s<br />
c c g g<br />
∑ − + w (<br />
c g<br />
( whi<br />
hij<br />
) wh<br />
hj<br />
n nj<br />
− nj<br />
) − ∆ . Cette valeur<br />
seuil est différente selon <strong>les</strong> agriculteurs. De plus, elle varie avec <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels,<br />
profit additionnel minimal, ∆.<br />
c<br />
w<br />
h<br />
, le prix <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM,<br />
i<br />
g<br />
w<br />
h<br />
, le coût d'un passage <strong>de</strong> traitement,<br />
w<br />
n<br />
, et le<br />
Par ailleurs, on remarque dans l'équation précé<strong>de</strong>nte que <strong>la</strong> valeur du paramètre<br />
γ j (0 ou 1) ne<br />
dépend pas <strong>de</strong>s variab<strong>les</strong><br />
g<br />
w<br />
s<br />
et ∆ indépendamment, mais dépend <strong>de</strong> <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux variab<strong>les</strong>,<br />
g<br />
( w + ∆ ). Considérons alors l'effet d'une augmentation du paramètre ∆ d'une valeur initiale ∆ 1 à une<br />
s<br />
valeur finale ∆ 2 (c'est à dire d'une augmentation du profit additionnel en OGM nécessaire pour<br />
"convaincre" l'agriculteur d'adopter <strong>la</strong> solution OGM). Toutes choses éga<strong>les</strong> par ailleurs, <strong>la</strong> condition<br />
g<br />
g<br />
d'adoption <strong>de</strong> l'agriculteur j reste inchangée pour: ( w<br />
s1 + ∆<br />
1<br />
= ws<br />
2<br />
+ ∆2<br />
), autrement dit, si le supplément<br />
<strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM diminue d'une valeur initiale<br />
g<br />
g<br />
ws<br />
1<br />
à une valeur finale<br />
2<br />
= g s<br />
ws<br />
1<br />
+ ∆1<br />
− ∆2<br />
w .<br />
- Taux d'adoption (ou niveau <strong>de</strong> diffusion)<br />
46
Lorsqu'un agriculteur adopte le programme OGM, il l'adopte sur l'ensemble <strong>de</strong> sa surface allouée à<br />
<strong>la</strong> culture considérée, s j . Le taux d'adoption <strong>de</strong> l'OGM, ou niveau <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> l'OGM, est défini<br />
comme <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface totale allouée à <strong>la</strong> culture considérée où le programme OGM est adopté:<br />
1<br />
TA =<br />
S<br />
∑<br />
j<br />
γ<br />
j<br />
s j<br />
.<br />
(D'après ce qui précè<strong>de</strong>, on remarque que, toutes choses éga<strong>les</strong> par ailleurs, le taux d'adoption <strong>de</strong><br />
l'OGM reste inchangé lorsque le paramètre ∆ augmente <strong>de</strong> ∆ 1 à ∆ 2 , si le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong><br />
semence OGM diminue <strong>de</strong><br />
g g<br />
ws<br />
1<br />
à<br />
2<br />
= g s<br />
ws<br />
1<br />
+ ∆1<br />
− ∆2<br />
w ).<br />
- La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour <strong>les</strong> différents inputs<br />
La surface totale en OGM est égale à <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong>s agriculteurs qui adoptent le<br />
programme OGM:<br />
S<br />
g<br />
= ∑<br />
j<br />
γ<br />
j<br />
s<br />
j<br />
La quantité vendue pour l'herbici<strong>de</strong> OGM est égale à <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s doses d'utilisation multipliées<br />
par <strong>les</strong> surfaces pour <strong>les</strong> agriculteurs qui adoptent le programme OGM:<br />
Q<br />
g<br />
= ∑<br />
j<br />
γ<br />
j<br />
h<br />
g<br />
j<br />
s<br />
j<br />
La quantité vendue pour chaque herbici<strong>de</strong> conventionnel i est égale à <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s doses<br />
d'utilisation multipliées par <strong>les</strong> surfaces pour <strong>les</strong> agriculteurs qui restent sur un programme<br />
conventionnel:<br />
Q<br />
c<br />
= i<br />
j<br />
∑(<br />
1 − γ<br />
j<br />
) h<br />
c<br />
ij<br />
s<br />
j<br />
- <strong>Les</strong> profits<br />
On fait ici trois hypothèses:<br />
- La firme qui commercialise <strong>les</strong> OGM commercialise intégralement l'herbici<strong>de</strong> OGM;<br />
- Le taux <strong>de</strong> marge sur <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s, noté φ, est i<strong>de</strong>ntique pour tous <strong>les</strong> produits;<br />
- Le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM est égal au coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence<br />
conventionnelle. Autrement dit, <strong>la</strong> marge faite sur <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong> l'OGM est <strong>de</strong> 100%.<br />
Le profit <strong>de</strong> l'innovateur qui commercialise <strong>la</strong> semence OGM est égal à <strong>la</strong> somme du profit réalisé<br />
sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> semences OGM (supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM multiplié par <strong>la</strong> surface<br />
totale en OGM) et du profit réalisé sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM (marge sur l'herbici<strong>de</strong> OGM<br />
multipliée par <strong>la</strong> quantité totale d'herbici<strong>de</strong> OGM vendue):<br />
g g g<br />
Π = ws<br />
S +<br />
g<br />
w φ Q<br />
g<br />
h<br />
47
Le profit réalisé sur <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> conventionnel i est égal à <strong>la</strong> marge sur l'herbici<strong>de</strong><br />
conventionnel i multipliée par <strong>la</strong> quantité totale d'herbici<strong>de</strong> i vendue:<br />
i h<br />
Π = wi<br />
φ<br />
Q<br />
c<br />
i<br />
Le profit total <strong>de</strong>s agriculteurs sur <strong>la</strong> culture considérée est égal à <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s profits <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs qui adoptent le programme OGM et <strong>de</strong>s profits <strong>de</strong>s agriculteurs qui restent sur un<br />
programme conventionnel.<br />
∑<br />
g<br />
c<br />
[ γ π + ( − γ ) π ]<br />
a<br />
Π = s 1<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
Ce profit total peut être décomposé <strong>de</strong> <strong>la</strong> façon suivante :<br />
a a a<br />
Π = Π<br />
0<br />
− CH .<br />
a<br />
• Π<br />
0<br />
est <strong>la</strong> marge totale réalisée par tous <strong>les</strong> agriculteurs sur leurs cultures avant d'avoir décompté<br />
<strong>les</strong> dépenses <strong>de</strong> désherbage (herbici<strong>de</strong>s et coûts <strong>de</strong>s passages):<br />
a<br />
Π = ∑s<br />
( p y − c ) .<br />
0<br />
j<br />
j<br />
Sous <strong>les</strong> hypothèses adoptées ici,<br />
programmes OGM.<br />
j<br />
j<br />
• CH a est <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs:<br />
CH<br />
a<br />
=<br />
∑<br />
j<br />
= w<br />
g<br />
s<br />
s<br />
j<br />
S<br />
⎡<br />
⎢γ<br />
⎣<br />
g<br />
j<br />
( w<br />
+ w<br />
g<br />
h<br />
g<br />
h<br />
h<br />
Q<br />
g<br />
j<br />
g<br />
+ w<br />
+<br />
i<br />
n<br />
∑<br />
n<br />
w<br />
g<br />
j<br />
h<br />
i<br />
Q<br />
i<br />
a<br />
Π<br />
0<br />
est un terme constant indépendant du niveau d'adoption <strong>de</strong>s<br />
) + ( 1−<br />
γ<br />
+<br />
∑<br />
j<br />
γ<br />
j<br />
j<br />
⎛<br />
) ⎜<br />
⎝<br />
w<br />
∑<br />
n<br />
i<br />
n<br />
( w<br />
g<br />
j<br />
s<br />
c<br />
hi<br />
j<br />
+<br />
h ) + w<br />
c<br />
ij<br />
∑<br />
j<br />
n<br />
( 1−γ<br />
La somme <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs est composée <strong>de</strong> quatre termes. Le premier<br />
est égal aux ventes tota<strong>les</strong> d'herbici<strong>de</strong>s OGM par l'innovateur. Le second est égal aux ventes<br />
tota<strong>les</strong> d'herbici<strong>de</strong> conventionnel par <strong>les</strong> firmes d'amont. Le troisième est égal aux dépenses en<br />
passages <strong>de</strong> traitement herbici<strong>de</strong> sur <strong>les</strong> surfaces où le programme OGM est adopté. Le quatrième<br />
est égal aux dépenses en passages <strong>de</strong> traitement herbici<strong>de</strong> sur <strong>les</strong> surfaces qui restent avec un<br />
programme conventionnel.<br />
n<br />
j<br />
c<br />
j<br />
⎞⎤<br />
⎟⎥<br />
⎠⎦<br />
) w<br />
n<br />
n<br />
c<br />
j<br />
s<br />
j<br />
48
2.2. Application au cas du Colza HT<br />
- <strong>Les</strong> données <strong>de</strong> départ<br />
L'analyse a été faite à partir d'une base <strong>de</strong> données fournie par le CETIOM. Cette base <strong>de</strong> données<br />
reprend <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong> l'enquête "charte environnement" conduite en 1999 (récolte 1999). Après<br />
<strong>net</strong>toyage, <strong>la</strong> base traitée ici contient 1238 exploitations couvrant une surface totale en Colza d'un peu<br />
plus <strong>de</strong> 32 000 ha (soit 2.4% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface française). <strong>Les</strong> biais d'échantillonnage ont été corrigés en<br />
attribuant <strong>de</strong>s poids aux exploitations <strong>de</strong> façon à ce que chaque département et chaque c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> taille<br />
d'exploitation ait une représentativité nationale. <strong>Les</strong> résultats présentés ici sont donc <strong>de</strong>s projections<br />
nationa<strong>les</strong> sur 1.369 millions d'hectares <strong>de</strong> Colza. Le détail <strong>de</strong>s opérations réalisées pour <strong>net</strong>toyer <strong>la</strong><br />
base et <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s poids sont indiqués dans l'annexe A.<br />
La distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage sur l'ensemble <strong>de</strong> l'échantillon (Figure 1) montre<br />
l'importante diversité <strong>de</strong>s stratégies conventionnel<strong>les</strong> <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. Globalement <strong>la</strong><br />
dépense en désherbant varie <strong>entre</strong> 0 et 1300 F/ha, avec une moyenne <strong>de</strong> 547 F/ha.<br />
Figure 1. Distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage dans l’échantillon total<br />
%age <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> l'échantillon<br />
18%<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> désherbage (FF/ha)<br />
Le coût indiqué ici ne prend pas en compte le coût <strong>de</strong>s passages <strong>de</strong> traitement.<br />
Le désherbage du colza peut nécessiter jusqu'à trois ou quatre interventions à l'un ou l'autre <strong>de</strong>s<br />
sta<strong>de</strong>s suivants: présemis, prélevée, et post-levée. Chaque type <strong>de</strong> programme a donc été défini par un<br />
co<strong>de</strong> en trois chiffres, chaque chiffre indiquant s'il y a eu intervention (chiffre 1) ou pas d'intervention<br />
(chiffre 0) au sta<strong>de</strong> présemis (premier chiffre), prélevée (<strong>de</strong>uxième chiffre), ou post-levée (troisième<br />
chiffre). Par exemple, un programme "101" correspond à au moins une intervention au sta<strong>de</strong> présemis,<br />
et à au moins une intervention au sta<strong>de</strong> post-levée. Le programme OGM envisagé ici est un<br />
programme combinant l’herbici<strong>de</strong> total Roundup (matière active glyphosate) avec une semence <strong>de</strong><br />
Colza qui lui est résistante (ou semence Roundup-Ready ® ). <strong>Les</strong> stratégies <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cement<br />
conventionnel/OGM (Tableau 1) ont été définies à partir <strong>de</strong>s données du CETIOM (2000). Le coût en<br />
49
herbici<strong>de</strong> du programme OGM varie <strong>entre</strong> 100 et 200F/ha, le prix retenu pour le Roundup (w h g) étant<br />
<strong>de</strong> 50 F/l.<br />
La Figure 2 et <strong>la</strong> Figure 3 donnent une indication <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux souséchantillons<br />
qui seront remp<strong>la</strong>cés respectivement par <strong>de</strong>s programmes OGM à 1 ou 2 passages. La<br />
dépense moyenne en désherbant est <strong>de</strong> 475 F/ha pour <strong>les</strong> programmes <strong>les</strong> plus légers (Figure 2) et <strong>de</strong><br />
609 F/ha pour <strong>les</strong> programmes <strong>les</strong> plus lourds (Figure 3).<br />
Rappelons que nous faisons l'hypothèse que <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> programmes (conventionnel et<br />
OGM) conduisent au même ren<strong>de</strong>ment.<br />
Dans <strong>les</strong> calculs suivant seront intégrés <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> passage <strong>de</strong> traitement. On pose le coût d’un<br />
passage à 45 F/ha, ainsi en adoptant <strong>la</strong> technologie OGM certains agriculteurs peuvent donc aller<br />
jusqu’à faire l’économie <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux traitements.<br />
Dans <strong>les</strong> premières estimations qui sont faites avant l'analyse <strong>de</strong> sensibilité, le prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels est supposé ne pas changer et le taux <strong>de</strong> marge sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels est<br />
supposé égal à 50%.<br />
Tableau 1. Remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s programmes conventionnels par <strong>les</strong> programmes OGM<br />
Co<strong>de</strong><br />
Surface<br />
concern<br />
ée<br />
Coût<br />
moyen<br />
Programme conventionnel<br />
Détail<br />
100* 6% 248 Présemis seul (programme économique)<br />
010* 17% 527 Prélevée seule<br />
110* 24% 508 Présemis – Prélevée<br />
001 2% 538 Post-levée seule<br />
101 16% 450 Présemis – Post-levée<br />
Programme économique avec nécessité <strong>de</strong> faire<br />
face à un problème d’adventice tardive<br />
011 11% 701 Présemis – Post-levée<br />
Programme c<strong>la</strong>ssique ayant échoué partiellement<br />
et nécessitant un rattrapage, ou intégration dans<br />
le programme d’un problème d’adventice<br />
particulière et tardive.<br />
111 24% 674 Présemis - Prélevée - Post-levée<br />
Programme c<strong>la</strong>ssique ayant échoué partiellement<br />
et nécessitant un rattrapage, ou intégration dans<br />
le programme d’un problème d’adventice<br />
particulière et tardive (crucifères, géraniums,<br />
graminées, etc… )<br />
Programme OGM<br />
Un seul passage à 2 l/ha<br />
( h g = 2)<br />
Deux passages à 2 l/ha<br />
chacun ( h g = 4)<br />
* L’absence <strong>de</strong> traitement en post-levée peut être due à l’absence <strong>de</strong> produit efficace. Dans ces cas-là, un second<br />
traitement avec le désherbant total pourrait dans ces situations s’avérer pertinent.<br />
50
Figure 2. Distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage pour <strong>les</strong> programmes<br />
100, 010, 110 et 001 remp<strong>la</strong>cés par un programme OGM à un passage<br />
25%<br />
%age <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> l'échantillon<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> désherbage (FF/ha)<br />
Le coût indiqué ici ne prend pas en compte le coût <strong>de</strong>s passages <strong>de</strong> traitement.<br />
Figure 3. Distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage pour <strong>les</strong> programmes<br />
101, 011, et 111 remp<strong>la</strong>cés par un programme OGM à <strong>de</strong>ux passages<br />
14%<br />
%age <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> l'échantillon<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> désherbage (FF/ha)<br />
Le coût indiqué ici ne prend pas en compte le coût <strong>de</strong>s passages <strong>de</strong> traitement.<br />
- L'adoption <strong>de</strong> programme OGM<br />
La Figure 4 représente <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM en fonction du supplément <strong>de</strong> prix payé sur<br />
<strong>la</strong> semence OGM (w g s). Lorsque <strong>la</strong> semence OGM est au même prix que <strong>la</strong> semence conventionnelle<br />
(w g s=0), le niveau <strong>de</strong> diffusion dépasse 90%. Dans ce cas <strong>de</strong> figure, le coût d'un programme <strong>de</strong><br />
désherbage OGM varie <strong>entre</strong> 100 et 200 F/ha, et on comprend bien au vu <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> distribution<br />
<strong>de</strong>s coûts (Figure 1) qu'une très gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s agriculteurs soit intéressée. A l'inverse, dès que le<br />
51
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence est supérieur à 650 F/ha, <strong>la</strong> diffusion n'excè<strong>de</strong> pas <strong>les</strong> 10%. Là<br />
encore, si l'on se réfère à <strong>la</strong> Figure 1, on voit que très peu d'agriculteurs seront intéressés par un<br />
programme OGM dont le coût serait <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 700 à 800 F/ha. Entre ces <strong>de</strong>ux extrêmes, <strong>la</strong> pente <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> diffusion passe par <strong>de</strong>s niveaux importants (spécialement <strong>entre</strong> 300 F/ha et 500 F/ha) qui<br />
se traduisent par une diminution <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 3500 ha (ou 0.25% <strong>de</strong>s surfaces françaises) par franc<br />
supplémentaire sur <strong>la</strong> semence OGM.<br />
Figure 4. Courbe <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM en fonction du supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
taux d'adoption<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
0 200 400 600 800 1000 1200<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM en FF/ha<br />
Rappelons à titre indicatif que le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle <strong>de</strong> Colza en France varie <strong>entre</strong><br />
270 F/ha (variétés lignées) et 410 F/ha (variétés hybri<strong>de</strong>s) 1 .<br />
- <strong>Les</strong> gains <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> et <strong>la</strong> stratégie optimale sur <strong>les</strong> OGM<br />
- <strong>Les</strong> dépenses <strong>de</strong>s agriculteurs en désherbage<br />
Commençons d'abord par étudier l'évolution <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs avec<br />
différents niveaux <strong>de</strong> supplément <strong>de</strong> prix payé sur <strong>la</strong> semence OGM (c'est à dire différents niveaux <strong>de</strong><br />
diffusion <strong>de</strong>s OGM).<br />
Sur <strong>la</strong> droite <strong>de</strong> <strong>la</strong> Figure 5, le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM est très élevé et dissua<strong>de</strong><br />
tous <strong>les</strong> agriculteurs d'adopter, même ceux dont <strong>les</strong> dépenses actuel<strong>les</strong> en herbici<strong>de</strong> conventionnel sont<br />
importantes. Tous <strong>les</strong> agriculteurs conservent leur coût <strong>de</strong> désherbage conventionnel: c’est <strong>la</strong> situation<br />
<strong>de</strong> référence <strong>de</strong> l’enquête, où <strong>la</strong> dépense totale <strong>de</strong> désherbage est <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 876 MF (748 MF<br />
d’herbici<strong>de</strong>s + 128 MF <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> passage).<br />
1 Prix donnés à titre indicatif d’après le site <strong>de</strong> vente en ligne www.agrifirst.com.<br />
52
En se dép<strong>la</strong>çant vers <strong>la</strong> gauche, le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM diminue et <strong>de</strong>vient<br />
attractif pour certains agriculteurs qui déci<strong>de</strong>nt d’adopter dès lors que le coût du programme OGM<br />
égalise le coût <strong>de</strong> désherbage conventionnel. En adoptant, <strong>les</strong> agriculteurs abandonnent donc<br />
totalement leurs dépenses en traitements (herbici<strong>de</strong> + passage) conventionnels et cel<strong>les</strong>-ci se<br />
répartissent désormais en dépenses en herbici<strong>de</strong> OGM (100 ou 200 F/ha selon <strong>les</strong> cas), en cout <strong>de</strong><br />
passage <strong>de</strong> l’herbici<strong>de</strong> OGM (45 ou 90F/ha) et en dépenses supplémentaires liées au surcoût <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
semence.<br />
Ainsi, le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence diminuant, l'adoption croissante d'OGM se traduit par<br />
une diminution sensible <strong>de</strong>s dépenses tota<strong>les</strong> <strong>de</strong>s agriculteurs en désherbage. Dans le cas <strong>de</strong> figure<br />
envisagé ici, ces dépenses peuvent passer <strong>de</strong> 876 MF à 311 MF lorsque <strong>la</strong> semence OGM est au prix<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
Figure 5. Evolution <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> désherbage pour <strong>les</strong> agriculteurs <strong>de</strong> l’échantillon<br />
1000<br />
million <strong>de</strong> francs<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
cumul <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> désherbage<br />
500<br />
dépenses en herbici<strong>de</strong> conventionnel<br />
dépense en licence OGM<br />
400<br />
dépense en herbici<strong>de</strong> OGM<br />
300<br />
dépense passage conventionnel<br />
200<br />
dépense passage OGM<br />
100<br />
0<br />
0 200 400 600 800 1000 1200 1400<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM en FF/ha<br />
- <strong>Les</strong> gains et pertes <strong>de</strong>s firmes situées en amont<br />
Nous supposons ici que l'innovateur va fixer le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence <strong>de</strong> façon à<br />
maximiser son profit. Il réalise donc un arbitrage <strong>entre</strong> un prix <strong>de</strong> licence faible qui lui permet <strong>de</strong><br />
diffuser <strong>la</strong>rgement le produit mais qui lui <strong>la</strong>isse une marge faible, et un prix <strong>de</strong> licence élevé qui lui<br />
permet <strong>de</strong> dégager une marge importante sur chaque unité mais qui conduit à restreindre <strong>la</strong> diffusion<br />
du produit. La Figure 5 nous fournit une première indication sur cet optimum. Si le profit <strong>de</strong><br />
l'innovateur est uniquement basé sur <strong>les</strong> royalties touchées sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> semences OGM, un<br />
maximum est atteint avec un supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM <strong>de</strong> 364 F/ha. Le profit <strong>de</strong><br />
l'innovateur est <strong>de</strong> 353 MF et <strong>les</strong> variétés OGM sont adoptées sur 71% <strong>de</strong>s surfaces (Figure 4).<br />
Si on suppose que le profit <strong>de</strong> l'innovateur prend également en compte <strong>les</strong> gains sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong><br />
l'herbici<strong>de</strong> OGM complémentaire en supposant que <strong>la</strong> marge sur celui-ci est <strong>de</strong> 50% (Figure 6), alors<br />
53
le niveau optimum <strong>de</strong> supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence est alors <strong>de</strong> 344 F/ha. Le profit <strong>de</strong><br />
l'innovateur est ainsi <strong>de</strong> 428 MF (352 MF sur <strong>la</strong> licence et 76 MF sur <strong>les</strong> ventes d’herbici<strong>de</strong>s OGM).<br />
Figure 6. Gains réalisés par l'innovateur avec ou sans prise en compte<br />
<strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM<br />
million <strong>de</strong> francs<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Gain cumulé <strong>de</strong>s firmes d'amont sur<br />
l'innovation OGM et l'herbici<strong>de</strong> OGM<br />
Gain <strong>de</strong>s firmes d'amont sur l'innovation<br />
OGM<br />
Gain <strong>de</strong>s firmes d'amont sur l'herbici<strong>de</strong><br />
OGM<br />
0<br />
0 200 400 600 800 1 000 1 200<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
P<strong>la</strong>çons nous à présent du côté <strong>de</strong>s concurrents sur <strong>les</strong> perstici<strong>de</strong>s conventionnels. En supposant un<br />
taux <strong>de</strong> marge (φ) <strong>de</strong> 50%, <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong>s firmes amont passent <strong>de</strong> 0 à 371 MF quand le supplément <strong>de</strong><br />
prix sur <strong>la</strong> semence passe <strong>de</strong> 1200 F/ha à 0 F/ha. Lorsque l'innovateur choisit le prix optimal<br />
(w s g=364 F/ha) <strong>les</strong> pertes sont éga<strong>les</strong> à 308 MF soit 82% du profit initial. Dans ces conditions, on peut<br />
s'attendre à ce que <strong>les</strong> fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels réagissent en baissant leur prix. Ce cas<br />
<strong>de</strong> figure sera envisagé plus loin (analyse <strong>de</strong> sensibilité).<br />
Figure 7. <strong>Les</strong> pertes <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
400<br />
350<br />
millions <strong>de</strong> francs<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
pertes <strong>de</strong>s firmes d'amont sur <strong>les</strong><br />
herbici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
0<br />
0 200 400 600 800 1 000 1 200<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
54
La Figure 8 dresse un bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s gains et <strong>de</strong>s pertes réalisés par l'ensemble <strong>de</strong>s firmes situées en<br />
amont. Pour une différence <strong>de</strong> prix <strong>entre</strong> <strong>la</strong> semence OGM et <strong>la</strong> semence conventionnelle inférieure à<br />
225 F/ha, <strong>les</strong> pertes engendrées par <strong>la</strong> chute <strong>de</strong>s ventes d’herbici<strong>de</strong>s conventionnels sont supérieures<br />
aux recettes liées à <strong>la</strong> technologie OGM. L’amont est donc globalement en situation <strong>de</strong> perte par<br />
rapport à <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> référence. A l'inverse, si <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> prix est supérieure à 225 F/ha alors<br />
l’ensemble <strong>de</strong> l’amont dégage un profit supérieur par rapport à <strong>la</strong> situation initiale. Cette situation peut<br />
paraître surprenante car elle signifie que l'amont, comme <strong>les</strong> agriculteurs, enregistrent <strong>de</strong>s gains<br />
positifs par rapport à <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> référence. Ce<strong>la</strong> s'explique par une diminution du coût <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s par <strong>les</strong> industriels dans le cas du programme OGM par rapport au<br />
programme conventionnel. En effet, le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM est i<strong>de</strong>ntique au coût<br />
<strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle. Le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM représente<br />
quant à lui 50 ou 100 F/ha selon <strong>la</strong> stratégie retenue (1 ou 2 passages). En revanche, le coût <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels représente 50% <strong>de</strong>s dépenses en herbici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
<strong>de</strong>s agriculteurs et dépasse donc généralement le niveau <strong>de</strong> 100 F/ha. Notons néanmoins que ces<br />
estimations dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l'hypothèse assez arbitraire retenue ici d'un taux <strong>de</strong> marge i<strong>de</strong>ntique sur tous<br />
<strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s. Ce point sera discuté plus loin avec l'analyse <strong>de</strong> sensibilité.<br />
Figure 8. Bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s gains et pertes réalisées par l’ensemble <strong>de</strong>s firmes d’amont<br />
150<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
100<br />
50<br />
millions <strong>de</strong> francs<br />
0<br />
0<br />
-50<br />
200 400 600 800 1 000 1 200<br />
-100<br />
-150<br />
-200<br />
gain potentiel <strong>de</strong>s firmes d'amont sur l'innovation<br />
OGM et l'herbici<strong>de</strong> OGM moins <strong>les</strong> pertes sur <strong>les</strong><br />
herbici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
-250<br />
-300<br />
Le Tableau 2 présente le bi<strong>la</strong>n complet <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong>s différents <strong>acteurs</strong> en comparant <strong>la</strong> situation <strong>de</strong><br />
référence à <strong>la</strong> situation dans <strong>la</strong>quelle une semence OGM est commercialisée à un prix optimal pour<br />
l'innovateur (364 F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle). La diffusion <strong>de</strong>s programmes<br />
conventionnels conduit à un gain global <strong>de</strong> 266 MF. 56 % <strong>de</strong> ces gains sont transmis à l'agriculteur<br />
alors que le reste représente le gain pour <strong>les</strong> firmes d'amont. En amont, une gran<strong>de</strong> partie du gain <strong>de</strong><br />
l'innovateur est réalisé au détriment <strong>de</strong>s firmes produisant <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels puisque le<br />
profit <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières est diminué <strong>de</strong> 308 MF.<br />
55
Tableau 2. Bi<strong>la</strong>n global <strong>de</strong>s gains liés à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM (en MF)<br />
Référence avec OGM* Variation<br />
Revenu sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM 0 353 +353<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> l’herbici<strong>de</strong> OGM 0 72 +72<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes d’herbici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels<br />
374 66 -308<br />
Coûts <strong>de</strong> passage en traitements -128 -98 +30<br />
Coûts <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs -749 -630 +119<br />
Gain total dans <strong>la</strong> situation avec OGM - - +266<br />
* La semence OGM est commercialisée à 364 F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
- L'impact sur l'utilisation <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
Comme nous l'avons observé, <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong>s OGM à un prix <strong>de</strong> 364 F/ha conduit à une<br />
diminution <strong>de</strong> 82% <strong>de</strong>s ventes tota<strong>les</strong> <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels. Cette baisse n'est cependant pas<br />
homogène sur l'ensemble <strong>de</strong>s produits (Tableau 3). Ainsi, parmi <strong>les</strong> produits <strong>les</strong> plus vendus, le Colzor<br />
et le Novall subissent une baisse plus marquée (≈90 %) que le Tréf<strong>la</strong>n et le Fusi<strong>la</strong><strong>de</strong> (≈70%). Cette<br />
différence s'explique en gran<strong>de</strong> partie par le coût que représentent ces produits dans un programme <strong>de</strong><br />
désherbage. En se basant sur <strong>la</strong> dose moyenne d'utilisation dans <strong>les</strong> programmes conventionnels (avant<br />
introduction <strong>de</strong>s OGM), le Colzor et le Novall représentent un coût supérieur à 450 F/ha, alors qu'à<br />
l'inverse le Tréf<strong>la</strong>n et le Fusi<strong>la</strong><strong>de</strong> représentent un coût inférieur à 150 F/ha. Ainsi, lorsqu'un produit<br />
représente une charge importante, il est utilisé essentiellement dans <strong>de</strong>s programmes conventionnels<br />
dont le coût est élevé et qui seront plus facilement remp<strong>la</strong>cés par <strong>de</strong>s programmes OGM.<br />
56
Tableau 3. L'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
Produit<br />
Prix<br />
(F/l ou<br />
F/kg)<br />
Doses<br />
(l/ha ou<br />
kg/ha)<br />
Part <strong>de</strong><br />
marché<br />
initiale<br />
Ventes<br />
initia<strong>les</strong><br />
Ventes après<br />
diffusion <strong>de</strong>s<br />
OGM*<br />
Perte <strong>de</strong><br />
ventes liée<br />
aux OGM<br />
Colzor 99 5,0 36,45% 272 836 465 23 896 124 -91%<br />
Butisan S 234 1,4 20,03% 149 894 335 32 236 485 -78%<br />
Novall 250 1,8 12,50% 93 593 180 6 308 258 -93%<br />
Tréf<strong>la</strong>n 28 2,4 6,94% 51 925 414 17 820 634 -66%<br />
Devrinol 170 2,0 5,92% 44 301 151 18 724 919 -58%<br />
Fusi<strong>la</strong><strong>de</strong> X2 358 0,4 3,19% 23 900 530 6 512 986 -73%<br />
Targa D+ 610 0,4 2,50% 18 729 312 1 765 982 -91%<br />
Pilot 221 0,7 2,36% 17 691 892 3 611 601 -80%<br />
Eloge 510 0,3 2,11% 15 783 686 4 416 177 -72%<br />
Stratos Ultra 137 1,2 2,01% 15 057 311 4 370 670 -71%<br />
Agil 344 0,4 1,36% 10 216 389 1 990 386 -81%<br />
Brassix 28 2,4 1,30% 9 733 337 2 800 927 -71%<br />
Cent 7 212 0,5 0,71% 5 335 793 2 021 334 -62%<br />
Pradone TS 166 3,0 0,59% 4 404 848 638 906 -85%<br />
Quartz 120 0,5 0,47% 3 526 928 2 341 572 -34%<br />
Lontrel 345 0,8 0,45% 3 401 268 853 394 -75%<br />
Légurame PM 105 2,1 0,37% 2 795 722 943 732 -66%<br />
Chrono 180 1,0 0,24% 1 795 283 201 946 -89%<br />
Colzamid 170 3,8 0,22% 1 661 510 164 036 -90%<br />
Kerb Flo 262 1,0 0,14% 1 073 780 0 -100%<br />
Tichrey 28 2,5 0,06% 440 455 211 300 -52%<br />
Sting ST 31 1,0 0,02% 134 980 49 464 -63%<br />
Isoproturon 41 1,5 0,01% 93 761 93 761 0%<br />
Zodiac TX 186 0,4 0,01% 87 442 40 358 -54%<br />
Cetrelex 28 2,3 0,01% 62 352 0 -100%<br />
Karmex 60 0,3 0,00% 10 953 0 -100%<br />
* La semence OGM est commercialisée à 364F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
- Analyse <strong>de</strong> sensibilité<br />
- Sensibilité au supplément <strong>de</strong> profit à partir duquel l'agriculteur adopte <strong>la</strong><br />
solution OGM (∆)<br />
La Figure 9 donne quelques indications sur <strong>la</strong> sensibilité <strong>de</strong>s résultats au gain minimal que<br />
l'agriculteur doit anticiper pour adopter (variable ∆). Comme ce<strong>la</strong> a été montré <strong>de</strong> manière analytique<br />
dans <strong>la</strong> section 2.1, le taux d'adoption reste i<strong>de</strong>ntique lorsque le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> licence,<br />
g<br />
w<br />
s<br />
, diminue <strong>de</strong> ∆.<br />
Ce<strong>la</strong> conduit à décaler <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> vers <strong>la</strong> gauche (quand ∆ augmente). La perte <strong>de</strong><br />
diffusion estimée lorsque ∆ augmente <strong>de</strong> 100 F/ha varie <strong>entre</strong> 10% et 25% suivant le supplément <strong>de</strong><br />
prix sur <strong>la</strong> semence. De <strong>la</strong> même manière, on pourrait observer que <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong>s dépenses en<br />
traitement conventionnel (Figure 5) est décalée <strong>de</strong> ∆.<br />
57
Figure 9. Sensibilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> diffusion à D<br />
100%<br />
taux d'adoption<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
supplément <strong>de</strong> profit nul<br />
supplément <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> 50 FF/ha<br />
supplément <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> 100 FF/ha<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
0 200 400 600 800 1000 1200<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM en FF/ha<br />
La courbe <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> l'innovateur (Figure 10) diminue car pour un prix <strong>de</strong> licence donné le niveau<br />
<strong>de</strong> diffusion est toujours inférieur. Le maximum <strong>de</strong> ces courbes se dép<strong>la</strong>ce vers <strong>la</strong> gauche quand ∆<br />
augmente: en réaction à l'adoption plus difficile <strong>de</strong>s produits, l'innovateur a intérêt à baisser le<br />
supplément <strong>de</strong> prix payé sur <strong>la</strong> semence <strong>de</strong> ∆.. Comme l'innovateur baisse le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong><br />
semence OGM <strong>de</strong> ∆, le niveau <strong>de</strong> diffusion à l'optimum reste i<strong>de</strong>ntique.<br />
Figure 10. Sensibilité du profit <strong>de</strong> l'innovateur à D<br />
400<br />
supplément <strong>de</strong> profit nul<br />
million <strong>de</strong> francs<br />
350<br />
supplément <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> 50 F/ha<br />
300<br />
250<br />
supplément <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> 100 F/ha<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0 200 400 600 800 1 000 1 200<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
Lorsque l'on examine le bi<strong>la</strong>n global <strong>de</strong>s gains et <strong>de</strong>s pertes <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> (Tableau 4), on remarque<br />
qu'une augmentation <strong>de</strong> ∆ conduit à un transfert <strong>de</strong> gain <strong>de</strong> l'innovateur vers <strong>les</strong> agriculteurs. Ce<br />
transfert est intégral et <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> surplus global est inchangée.<br />
58
Revenu sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence<br />
OGM<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> l’herbici<strong>de</strong><br />
OGM<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes d’herbici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels<br />
Tableau 4. Bi<strong>la</strong>n global avec différentes valeurs <strong>de</strong> D<br />
[A]<br />
Référence<br />
[B]<br />
avec OGM<br />
et ∆=0*<br />
[C]<br />
avec OGM et<br />
∆=100**<br />
Variation<br />
[B-A]<br />
Variation<br />
[C-A]<br />
0 353 256 +353 +256<br />
0 72 72 +72 +72<br />
374 66 66 -308 -308<br />
Coûts <strong>de</strong> passage en traitements -128 -98 -98 +30 +30<br />
Coûts <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs<br />
-749 -630 -533 +119 +216<br />
Gain total (<strong>de</strong> A à B ou <strong>de</strong> A à C) - - +266 +266<br />
* La semence OGM est commercialisée à 364F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
** La semence OGM est commercialisée à 264 F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
- Sensibilité au taux <strong>de</strong> marge sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s (φ)<br />
Le taux <strong>de</strong> marge sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s (conventionnels et OGM) (φ) n'affecte pas <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong><br />
diffusion (Figure 4) et n’a pas d'effet sur <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> l'innovateur (sur l’innovation OGM<br />
seule), si bien que le niveau optimal pour le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence reste inchangé. La<br />
diffusion attendue <strong>de</strong>s OGM est donc inchangée.<br />
L'effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> φ sur le bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> est illustré dans le Tableau 5. Dans<br />
le cas présent, <strong>les</strong> estimations correspondant à <strong>la</strong> référence (avant introduction <strong>de</strong>s OGM) sont aussi<br />
modifiées. Le gain <strong>de</strong>s agriculteurs et le gain <strong>de</strong> l'innovateur lié à <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> semence OGM sont<br />
inchangés. En revanche, comme le taux <strong>de</strong> marge est plus faible, <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> profit <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong><br />
pestici<strong>de</strong>s conventionnels (en valeur absolue) est moindre ainsi que <strong>la</strong> perte sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong><br />
l’herbici<strong>de</strong> OGM. Dans ces conditions le gain <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> situés en amont est encore plus important et<br />
ce<strong>la</strong> affecte directement le gain total. La part du gain <strong>de</strong>s agriculteurs dans le gain total est maintenant<br />
plus faible (39% au lieu <strong>de</strong> 56%).<br />
Tableau 5. Bi<strong>la</strong>n global avec un taux <strong>de</strong> marge plus faible sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
[A]<br />
Référence<br />
φ=25%<br />
[B]<br />
avec OGM<br />
et φ=25%*<br />
Variation<br />
[B-A]<br />
Revenu sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM 0 353 +353<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> l’herbici<strong>de</strong> OGM 0 36 +36<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes d’herbici<strong>de</strong>s conventionnels 187 33 -154<br />
Coûts <strong>de</strong> passage en traitements -128 -98 +30<br />
Coûts <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs -749 -630 +119<br />
Gain total - - +384<br />
59
- Sensibilité au prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s<br />
Comme nous l'avons indiqué plus haut, on peut penser que <strong>les</strong> fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels baisseraient leurs prix en réaction à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> leur activité <strong>de</strong> 82%. On doit ici se<br />
limiter à un cas <strong>de</strong> figure très simple dans lequel <strong>les</strong> agriculteurs qui restent sur <strong>la</strong> solution<br />
conventionnelle choisissent toujours le même programme <strong>de</strong> traitement. Cette hypothèse est respectée<br />
si on suppose que <strong>les</strong> prix <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> produits diminuent <strong>de</strong> manière homothétique. Nous présentons<br />
ici une série <strong>de</strong> résultats dans <strong>les</strong>quels <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels sont supposés diminuer<br />
<strong>de</strong> 40%.<br />
La courbe d'adoption <strong>de</strong>s OGM se trouve ici décalée vers <strong>la</strong> gauche: pour un supplément <strong>de</strong> prix<br />
donné, beaucoup moins d'agriculteurs ten<strong>de</strong>nt à adopter (Figure 11). Ce<strong>la</strong> a un effet direct sur le profit<br />
<strong>de</strong> l'innovateur qui diminue également, conduisant à un dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> l'optimum vers <strong>la</strong> gauche.<br />
Lorsque le prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels diminue <strong>de</strong> 40%, le niveau optimal pour le supplément<br />
<strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM passe <strong>de</strong> 364 F/ha à 159 F/ha. Dans ce cas <strong>de</strong> figure, le fait <strong>de</strong> prendre en<br />
compte ou non <strong>les</strong> gains liés à <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> l'herbici<strong>de</strong> OGM a également un effet sur le supplément <strong>de</strong><br />
prix optimal <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM. Celui-ci passe <strong>de</strong> 159 F/ha à 152 F/ha quand ces ventes sont prises<br />
en compte. Cette baisse du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM compense en gran<strong>de</strong> partie le déca<strong>la</strong>ge sur <strong>la</strong><br />
courbe d'adoption : <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM atteint à présent 72% <strong>de</strong>s surfaces avec un<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM <strong>de</strong> 159 F/ha.<br />
Figure 11. Impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse du prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels sur <strong>la</strong> courbe d’adoption<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
pas <strong>de</strong> baisse du prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
baisse <strong>de</strong> 40 % du prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
taux d'adoption<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
0 200 400 600 800 1000 1200<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM en FF/ha<br />
60
Tableau 6. Bi<strong>la</strong>n global avec une baisse <strong>de</strong> prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
Revenu sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence<br />
OGM<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> l’herbici<strong>de</strong><br />
OGM<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes d’herbici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels<br />
[A]<br />
Référence<br />
[B]<br />
avec OGM<br />
à prix<br />
i<strong>de</strong>ntique*<br />
[C]<br />
avec OGM<br />
et baisse<br />
<strong>de</strong> prix**<br />
Variation<br />
[B-A]<br />
Variation<br />
[C-A]<br />
0 353 158 +353 +158<br />
0 72 72 +72 +72<br />
374 66 38 -308 -336<br />
Coûts <strong>de</strong> passage en traitements -128 -98 -107 +30 +21<br />
Coûts <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs<br />
-749 -630 -378 +119 +371<br />
Gain total (<strong>de</strong> A à B ou <strong>de</strong> A à C) - - +266 +286<br />
* La semence OGM est commercialisée à 364 F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
** La semence OGM est commercialisée à 159 F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
Le Tableau 6 montre l'effet sur le bi<strong>la</strong>n global <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong>s différents <strong>acteurs</strong>. La baisse du prix <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> licence et <strong>la</strong> baisse du prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conduisent à une très <strong>net</strong>te augmentation <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs qui passe <strong>de</strong> +149 MF à +392 MF. Ce chiffre couvre non seulement le gain <strong>de</strong>s adopteurs,<br />
mais également le gain <strong>de</strong>s non-adopteurs. On notera néanmoins que l'essentiel <strong>de</strong> l'augmentation <strong>de</strong><br />
gain <strong>de</strong>s agriculteurs va aux adopteurs qui bénéficient <strong>de</strong> l'importante baisse <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> licence. Le<br />
gain pour <strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises d'amont diminue très <strong>net</strong>tement. Du côté <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels, <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> bénéfice est supérieure à ce qu'elle était avec <strong>de</strong>s prix inchangés. Ce<strong>la</strong> est<br />
dû à <strong>la</strong> très forte baisse du taux <strong>de</strong> marge réalisé qui passe <strong>de</strong> 50% à 20%. Baisser <strong>les</strong> prix <strong>de</strong> 40% ne<br />
permet donc pas <strong>de</strong> "limiter <strong>les</strong> dégâts" pour ces <strong>acteurs</strong>. Il est possible néanmoins qu'une baisse moins<br />
importante permette à ces <strong>acteurs</strong> <strong>de</strong> ne pas subir une perte aussi conséquente. Du côté <strong>de</strong> l'innovateur,<br />
le bénéfice diminue très <strong>net</strong>tement du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM. On notera ici que<br />
le gain <strong>de</strong> l'innovateur ne compense plus <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> bénéfice <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels.<br />
- Sensibilité à <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> passage<br />
Dans ce qui précè<strong>de</strong>, on a affecté un coût <strong>de</strong> 45 F/ha à chaque passage <strong>de</strong> traitement herbici<strong>de</strong>. On<br />
s’intéresse maintenant au cas où le coût <strong>de</strong> passage n’est pas pris en compte. Pour un agriculteur<br />
donné, le niveau <strong>de</strong> supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM pour lequel il adopte reste i<strong>de</strong>ntique si le<br />
nombre <strong>de</strong> passages est le même en OGM et en conventionnel. Il diminue (<strong>de</strong> 45 F/ha par passage en<br />
moins) si <strong>la</strong> technologie OGM permet d’économiser <strong>de</strong>s passages. La courbe d’adoption a alors un<br />
autre aspect et se trouve décalée vers <strong>la</strong> gauche (Figure 12) : pour un supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong><br />
61
semence OGM donné, moins <strong>de</strong> personnes adoptent car el<strong>les</strong> ne considèrent pas l’économie<br />
supplémentaire réalisée en effectuant éventuellement un ou plusieurs passage en moins.<br />
Figure 12. Impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> passage sur <strong>la</strong> courbe d’adoption<br />
100%<br />
90%<br />
avec prise en compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> passage<br />
taux d'adoption<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
sans prise en compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> passage<br />
10%<br />
0%<br />
0 200 400 600 800 1000 1200<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM en FF/ha<br />
L’optimum <strong>de</strong> tarification <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence se situe ainsi plus bas, à 321 F/ha au-<strong>de</strong>ssus du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
semence conventionnelle, et c’est alors 75% <strong>de</strong>s surfaces qui sont concernées par l’adoption. Le profit<br />
sur <strong>la</strong> semence OGM est inférieur au cas <strong>de</strong> référence (Tableau 7) car l’augmentation du taux<br />
d’adoption ne compense pas <strong>la</strong> baisse du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> licence. Cette baisse du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> licence entraîne<br />
également un gain plus important pour <strong>les</strong> agriculteurs. Ce gain <strong>de</strong> 162 MF sans considérer <strong>les</strong> coûts<br />
<strong>de</strong> passage est même supérieur au gain réalisé dans <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> référence en y ajoutant <strong>les</strong> gains sur<br />
<strong>les</strong> économies <strong>de</strong> passage.<br />
Tableau 7. Bi<strong>la</strong>n global sans prise en compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> passage (en MF)<br />
Référence avec OGM* Variation<br />
Revenu sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM 0 329 +329<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> l’herbici<strong>de</strong> OGM 0 76 +76<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes d’herbici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels<br />
374 53 -321<br />
Coûts <strong>de</strong> passage en traitements - - -<br />
Coûts <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs -749 -587 +162<br />
Gain total dans <strong>la</strong> situation avec OGM +245<br />
* La semence OGM est commercialisée à 321F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
62
- Synthèse<br />
On se p<strong>la</strong>ce toujours dans le cas où l'innovateur applique le niveau optimal <strong>de</strong> supplément <strong>de</strong> prix<br />
sur <strong>la</strong> semence OGM. L'analyse <strong>de</strong> sensibilité permet <strong>de</strong> dégager plusieurs (Tableau 8):<br />
• Le niveau <strong>de</strong> diffusion important observé dans le cas <strong>de</strong> base (71%) est confirmé dans à peu<br />
près tous <strong>les</strong> cas. Nous avons pu voir qu'une modification du profit additionnel à partir duquel<br />
<strong>les</strong> agriculteurs adoptent <strong>la</strong> solution OGM (∆) ou du prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
conduisait à un déca<strong>la</strong>ge sensible <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbe d'adoption. Néanmoins, à chaque fois<br />
l'innovateur ajuste son choix en abaissant son prix, <strong>de</strong> telle sorte que le niveau <strong>de</strong> diffusion à<br />
l'optimum change très peu. L'observation sur le niveau <strong>de</strong> diffusion semble donc assez robuste.<br />
• Le gain global estimé change re<strong>la</strong>tivement peu d'un cas <strong>de</strong> figure à l'autre, car <strong>la</strong> modification<br />
<strong>de</strong>s paramètres conduit essentiellement à <strong>de</strong>s transferts <strong>entre</strong> <strong>acteurs</strong>. Il faut noter néanmoins<br />
que l'hypothèse sur le taux <strong>de</strong> marge réalisé sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s aura un effet important sur le gain<br />
total : plus le taux <strong>de</strong> marge est faible, plus <strong>la</strong> perte sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels est faible<br />
et plus le gain total est important.<br />
• Le gain <strong>de</strong>s agriculteurs estimé dans le cas <strong>de</strong> base correspond à un p<strong>la</strong>ncher. Le gain <strong>de</strong>s<br />
adopteurs augmente très <strong>net</strong>tement lorsque <strong>la</strong> modification d'un paramètre conduit l'innovateur<br />
à baisser le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM.<br />
• <strong>Les</strong> pertes <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels sont délicates à estimer car el<strong>les</strong><br />
dépen<strong>de</strong>nt du taux <strong>de</strong> marge sur lequel on ne dispose pas d'information précise. Plus le taux <strong>de</strong><br />
marge est important et plus <strong>les</strong> pertes seront importantes.<br />
• <strong>Les</strong> gains <strong>de</strong> l'innovateur sont sensib<strong>les</strong> aux hypothèses faites sur ∆ et sur <strong>la</strong> réaction <strong>de</strong>s<br />
fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels. <strong>Les</strong> estimations faites dans le cas <strong>de</strong> base<br />
correspon<strong>de</strong>nt plutôt à un p<strong>la</strong>fond.<br />
• <strong>Les</strong> gains <strong>de</strong> l'innovateur sont tantôt supérieurs, tantôt inférieurs aux pertes <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong><br />
pestici<strong>de</strong>s conventionnels. En effets <strong>les</strong> estimations <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>prises amont sont<br />
sensib<strong>les</strong> aux paramètres, si bien que le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux est également sensible.<br />
63
Tableau 8. Synthèse <strong>de</strong>s effets observés avec l'analyse <strong>de</strong> sensibilité<br />
Cas <strong>de</strong> base ∆ ↑ φ ↓ w h c ↓ Pas <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong><br />
passage<br />
Licence<br />
364 F/ha<br />
Baisse<br />
(variation égale à <strong>la</strong><br />
variation <strong>de</strong> ∆)<br />
Inchangé<br />
Baisse plus que<br />
proportionnelle<br />
Diminue<br />
Diffusion 71% Inchangé Inchangé<br />
Augmente<br />
légèrement<br />
Augmente<br />
Perte <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong><br />
pestici<strong>de</strong> conventionnel<br />
- 308 MF Inchangé<br />
Plus faible<br />
(proportionnel avec<br />
φ)<br />
Augmente<br />
Augmente<br />
Gain sur <strong>la</strong> semence<br />
OGM<br />
+353 MF<br />
Diminue (transfert<br />
intégral vers<br />
agriculteur)<br />
Inchangé<br />
Diminue (transfert<br />
vers l'agriculteur)<br />
Diminue<br />
Gain sur l'herbici<strong>de</strong><br />
OGM<br />
+72 MF Inchangé<br />
Plus faible<br />
(proportionnel avec<br />
φ)<br />
Change peu<br />
Augmente<br />
Gain <strong>de</strong> l'agriculteur<br />
(passage + désherbage)<br />
+149 MF Augmente Inchangé Augmente Augmente<br />
Gain total +266 MF Inchangé Augmente<br />
Augmente<br />
légèrement<br />
Diminue<br />
64
2.3. Application au cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave HT<br />
- <strong>Les</strong> hypothèses et données <strong>de</strong> base<br />
L'analyse est faite ici à partir <strong>de</strong> données fournies par l'ITB. Ces données correspon<strong>de</strong>nt à une<br />
enquête menée en 2000 auprès <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> mille agriculteurs 2 couvrant une surface totale en Betterave<br />
d'un peu plus <strong>de</strong> 10 000 ha (soit à peu près 5% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface française en Betterave). <strong>Les</strong> biais<br />
d'échantillonnage sont ici corrigés avec une métho<strong>de</strong> simi<strong>la</strong>ire à celle utilisée dans le cas du Colza. <strong>Les</strong><br />
résultats présentés ici correspon<strong>de</strong>nt à une projection sur 400 000 ha en France.<br />
La distribution <strong>de</strong>s coûts sur l'ensemble <strong>de</strong> l'échantillon (Figure 13) montre également <strong>la</strong> variance<br />
importante. <strong>Les</strong> dépenses moyennes en désherbage s'élèvent à 858 F/ha, avec un écart type <strong>de</strong><br />
295 F/ha. La variance repose en gran<strong>de</strong> partie sur <strong>les</strong> écarts <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong> passages en post-levée qui<br />
varient <strong>entre</strong> 0 et une dizaine.<br />
Figure 13. Distribution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> désherbage dans l’échantillon total<br />
9%<br />
Superficies cultivées en betterave (%)<br />
8%<br />
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
100-149<br />
150-199<br />
200-249<br />
250-299<br />
300-349<br />
350-399<br />
400-449<br />
450-499<br />
500-549<br />
550-599<br />
600-649<br />
650-199<br />
700-749<br />
750-799<br />
800-849<br />
850-899<br />
900-949<br />
950-999<br />
1000-1049<br />
1050-1099<br />
1100-1149<br />
1150-599<br />
1200-1249<br />
1250-1299<br />
1300-1349<br />
1350-1399<br />
1400-1449<br />
1450-1499<br />
1500-1549<br />
1550-1599<br />
1600-1649<br />
1650-1699<br />
1700-1749<br />
1750-1799<br />
1800-1849<br />
>= 1850<br />
C<strong>la</strong>sses <strong>de</strong>s coûts conventionnels <strong>de</strong> désherbage (FF/ha)<br />
Le coût indiqué ici ne prend pas en compte le coût <strong>de</strong>s passages <strong>de</strong> traitement.<br />
<strong>Les</strong> hypothèses concernant le remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s programmes conventionnels par <strong>les</strong> programmes<br />
OGM sont présentées dans le Tableau 9. Le programme OGM envisagé ici est un programme<br />
combinant l'herbici<strong>de</strong> Roundup à une semence <strong>de</strong> Betterave qui lui est résistante. <strong>Les</strong> programmes<br />
OGM retenus varient <strong>entre</strong> 1 et 3 passages <strong>de</strong> Roundup (essentiellement 2 ou 3) appliqués en post-<br />
2 A <strong>la</strong> différence du Colza, <strong>les</strong> données qui nous ont été fournies résultent d'une première agrégation dans<br />
<strong>la</strong>quelle ont été regroupés tous <strong>les</strong> agriculteurs se rapportant à une même c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> traitement<br />
conventionnel (avec un pas <strong>de</strong> 10 F/ha) et toutes <strong>les</strong> stratégies <strong>de</strong> traitement conventionnel<strong>les</strong> (nombre <strong>de</strong><br />
passages en prélevée, nombre <strong>de</strong> passages en post-levée). Dans un premier tableau, nous disposions <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface<br />
totale <strong>de</strong> ces exploitations. Dans un <strong>de</strong>uxième tableau nous disposions <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> chaque produit.<br />
65
levée avec une dose totale <strong>de</strong> 2,5 à 6 litres <strong>de</strong> produits. Le prix du litre <strong>de</strong> Roundup (w h g) est <strong>de</strong> 50 F/l,<br />
comme dans le cas du Colza. Dans certains cas, le programme OGM conduit à réduire très <strong>net</strong>tement<br />
le nombre <strong>de</strong> passages <strong>de</strong> traitement. En se basant sur <strong>les</strong> tarifs d'entrai<strong>de</strong>, nous supposons que le coût<br />
d'un passage <strong>de</strong> traitement (w p ) s'élève comme dans le cas du colza à 45 F/ha. Le désherbage réalisé en<br />
présemis n'a pas été pris en compte ici, car nous supposons que cette opération est conduite<br />
indifféremment avec un programme conventionnel ou un programme OGM 3 . De <strong>la</strong> même manière<br />
nous avons supposé que <strong>les</strong> pratiques <strong>de</strong> binage mécanique seraient reconduites à l'i<strong>de</strong>ntique avec <strong>les</strong><br />
<strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> programmes 4 .<br />
Tableau 9. Remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s programmes OGM par <strong>les</strong> programmes conventionnels<br />
Co<strong>de</strong>*<br />
Programme conventionnel<br />
Surface<br />
concernée<br />
Coût moyen<br />
(avec<br />
passages)<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
passages <strong>de</strong><br />
Roundup<br />
Programme OGM<br />
Dose<br />
appliquée<br />
Coût du<br />
programme<br />
avec passages<br />
0+1 0,35% 272 2 5 340<br />
0+2 2,50% 671 2 5 340<br />
0+3 14,38% 756 2 5 340<br />
0+4 14,09% 906 3 6 435<br />
0+5 3,49% 1160 3 6 435<br />
0+6 0,84% 1320 3 6 435<br />
0+8 0,13% 1380 3 6 435<br />
0+12 0,14% 1890 3 6 435<br />
1+0 0,23% 469 1 2,5 170<br />
1+1 1,12% 699 2 5 340<br />
1+2 16,12% 1015 2 5 340<br />
1+3 27,90% 1120 2 5 340<br />
1+4 15,45% 1248 3 6 435<br />
1+5 2,87% 1362 3 6 435<br />
1+6 0,18% 2034 3 6 435<br />
1+7 0,09% 1540 3 6 435<br />
1+9 0,12% 1720 3 6 435<br />
* Le premier chiffre correspond au nombre <strong>de</strong> passages en prélevée, le <strong>de</strong>uxième chiffre correspond au nombre<br />
<strong>de</strong> passages en post-levée<br />
3 <strong>Les</strong> traitements en présemis sont réalisés principalement avec du Roundup, et visent à contrôler <strong>les</strong> <strong>la</strong>bours<br />
reverdis. Il serait envisageable avec un programme OGM <strong>de</strong> supprimer ce passage, voir même <strong>de</strong> conduire une<br />
culture intermédiaire qui pourrait jouer le rôle <strong>de</strong> piège à nitrate (avec enfouissement <strong>de</strong> cette culture ou semis<br />
sous couvert). Re<strong>la</strong>tivement peu d'essais techniques ont été réalisés jusque là sur ce type <strong>de</strong> programmes, et nous<br />
avons préféré nous limiter à <strong>de</strong>s programmes dont l'efficacité technique est assez bien connue.<br />
4 Le binage est réalisé sur à peu près 10% <strong>de</strong>s surfaces. Il est souvent réalisé en combinaison avec une<br />
application localisée d'herbici<strong>de</strong>. Néanmoins, <strong>la</strong> baisse générale <strong>de</strong>s doses d'application <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s a réduit<br />
<strong>net</strong>tement l'intérêt <strong>de</strong>s applications loca<strong>les</strong>. Par ailleurs, le binage mécanique est aussi appliqué pour l'<strong>entre</strong>tien<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> structure du sol ou pour supprimer certains rangs qui se croiseraient dans <strong>les</strong> fourrières. Autrement dit, <strong>la</strong><br />
maîtrise <strong>de</strong>s problèmes d'adventices n'est pas toujours <strong>la</strong> vocation principale du binage mécanique.<br />
66
- L'adoption <strong>de</strong> programme OGM<br />
Figure 14. Courbe d’adoption potentielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave OGM résistant à un herbici<strong>de</strong><br />
Taux d'adoption<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
0 500 1000 1500<br />
Supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence (FF/ha)<br />
L'évolution du niveau <strong>de</strong> diffusion en fonction du supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (Figure<br />
14) a une forme simi<strong>la</strong>ire à celle qui a été observée dans le cas du Colza. Lorsque <strong>la</strong> semence OGM est<br />
au prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle, plus <strong>de</strong> 99% <strong>de</strong>s agriculteurs adoptent un programme OGM.<br />
En revanche, le niveau d'adoption passe en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>s 10% quand le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong><br />
semence dépasse 1100 F/ha. Par rapport au Colza, on notera une forme beaucoup plus étalée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
courbe qui est liée à <strong>la</strong> variance plus importante <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> traitements. Lorsque le supplément <strong>de</strong><br />
prix sur <strong>la</strong> semence OGM passe <strong>de</strong> 200 à 1100 F/ha, chaque franc supplémentaire sur <strong>la</strong> semence<br />
OGM conduit à une diminution moyenne <strong>de</strong> 0,1% du taux d'adoption (contre 0,25% dans le cas du<br />
Colza) soit à peu près 400 ha. Rappelons à titre indicatif que le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence <strong>de</strong> Betterave pour<br />
l'agriculteur s'élève à 1300 F/ha.<br />
D'assez <strong>net</strong>tes disparités ressortent lorsque <strong>la</strong> diffusion est étudiées région par région (Figure 15): <strong>la</strong><br />
diffusion est moins importante en Champagne-Ar<strong>de</strong>nne (50% avec w s g=500 F/ha) qu'en Picardie et<br />
Nord-Pas <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>is (80% avec w s g=500 F/ha). Cet écart s'explique par <strong>les</strong> écarts très <strong>net</strong>s sur <strong>les</strong> coûts<br />
<strong>de</strong> désherbage: <strong>les</strong> agriculteurs en Champagne-Ar<strong>de</strong>nne réalisent rarement un passage en prélevée car<br />
le semis est plus tardif, ce passage étant en général assez coûteux. L'analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion par type<br />
d'exploitation (Figure 16) tend à montrer que <strong>la</strong> diffusion est plus importante dans <strong>les</strong> exploitations où<br />
<strong>la</strong> sole en Betterave représente plus <strong>de</strong> 50 ha, <strong>les</strong> écarts étant néanmoins assez faib<strong>les</strong>.<br />
67
Figure 15. Courbe d’adoption potentielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave OGM par zone géographique*<br />
Taux d'adoption (surfaces concernées)<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
France<br />
Bourgogne<br />
Champagne-Ar<strong>de</strong>nnes<br />
Nord-Pas <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>is<br />
Normandie<br />
Picardie<br />
Sud-Paris<br />
0%<br />
0 200 400 600 800 1000 1200 1400<br />
Supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
*<strong>Les</strong> courbes Bourgogne et Normandie sont basés sur un nombre réduit d'observations, et moins représentatives<br />
que dans le cas <strong>de</strong>s 4 autres régions.<br />
Figure 16. Courbe d’adoption potentielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave OGM par type d'exploitation*<br />
Taux d'adoption (surfaces concernées)<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
France<br />
moins <strong>de</strong> 10 ha<br />
<strong>de</strong> 10 ha à 49 ha<br />
50 ha et plus<br />
0 200 400 600 800 1000 1200 1400<br />
Supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
*<strong>Les</strong> types d'exploitation sont définies par leur surface en betterave, en distinguant trois c<strong>la</strong>sses: moins <strong>de</strong><br />
10 ha; <strong>de</strong> 10 à 49 ha; 50 ha et plus.<br />
68
- <strong>Les</strong> gains <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> et <strong>la</strong> stratégie optimale sur <strong>les</strong> OGM<br />
- <strong>Les</strong> dépenses <strong>de</strong>s agriculteurs en désherbage<br />
Figure 17. Evolution <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> désherbage Betterave pour <strong>les</strong> agriculteurs<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
Dépenses Herb Conv (en millions <strong>de</strong> francs)<br />
Dépenses Pass Conv (en millions <strong>de</strong> francs)<br />
Dépenses Herb OGM (en millions <strong>de</strong> francs)<br />
Dépenses Pass OGM ( en millions <strong>de</strong> francs)<br />
Dépenses Sup Licence (en millions <strong>de</strong> francs)<br />
Bi<strong>la</strong>n<br />
50<br />
0<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000<br />
La Figure 17 indique l'évolution <strong>de</strong>s dépenses tota<strong>les</strong> en désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs, avec une<br />
décomposition par types <strong>de</strong> dépense. La partie droite du graphique où <strong>la</strong> semence OGM est à un prix<br />
très élevée reflète <strong>la</strong> situation actuelle dans <strong>la</strong>quelle tous <strong>les</strong> agriculteurs applique un traitement<br />
conventionnel. <strong>Les</strong> dépenses tota<strong>les</strong> en produits désherbant sont éga<strong>les</strong> à 343 MF, et le coût <strong>de</strong>s<br />
passages <strong>de</strong> traitement s'élève à 70 MF. En se dép<strong>la</strong>çant ensuite vers <strong>la</strong> gauche, une proportion<br />
croissante d'agriculteurs adopte le programme OGM, et <strong>les</strong> dépenses en désherbage conventionnel sont<br />
progressivement remp<strong>la</strong>cées par <strong>de</strong>s dépenses en désherbage OGM. In fine, lorsque <strong>la</strong> semence OGM<br />
est au prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle, l'adoption <strong>de</strong>s OGM est presque totale et <strong>les</strong> dépenses<br />
tota<strong>les</strong> en désherbage s'élèvent à 150 MF (dont 110 MF pour le Roundup et 40 MF pour <strong>les</strong> passages<br />
<strong>de</strong> traitement).<br />
- <strong>Les</strong> gains et pertes <strong>de</strong>s firmes situées en amont<br />
Dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave, <strong>la</strong> stratégie optimale <strong>de</strong> l'innovateur consiste à fixer un supplément <strong>de</strong><br />
prix sur <strong>la</strong> semence OGM égal à 505 F/ha (soit une augmentation <strong>de</strong> 40% du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence).<br />
Cette valeur est <strong>la</strong> même que l'on prenne en compte ou non <strong>les</strong> marges réalisées sur l'herbici<strong>de</strong> OGM<br />
complémentaire (Figure 18). Une telle tarification conduit alors à une diffusion <strong>de</strong> 72%.<br />
69
Figure 18. Gain <strong>de</strong> l'innovateur<br />
Gains (millions <strong>de</strong> francs)<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Somme Gains firmes OGM<br />
(en millions <strong>de</strong> francs)<br />
Dépenses Sup Licence (en<br />
millions <strong>de</strong> francs)<br />
Total<br />
0<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000<br />
Supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
Si on se p<strong>la</strong>ce à présent du coté <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels (Figure 19), <strong>les</strong><br />
pertes tota<strong>les</strong> <strong>de</strong> profit varient <strong>entre</strong> 0 et 171 MF avec un taux <strong>de</strong> marge (φ) <strong>de</strong> 50%. Lorsque<br />
l'innovateur applique sa tarification optimale, <strong>la</strong> perte s'élève à 139 MF, soit 81% du bénéfice initial.<br />
Figure 19. Perte <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
Pertes (millions <strong>de</strong> francs)<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0 500 1000 1500 2000 2500<br />
Supplément <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
Lorsqu'on considère à présent l'ensemble <strong>de</strong>s firmes situées en amont (Figure 20), on observe une<br />
courbe simi<strong>la</strong>ire à celle du Colza dans <strong>la</strong>quelle <strong>les</strong> faib<strong>les</strong> suppléments <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM<br />
70
conduisent à <strong>de</strong>s pertes pour l'ensemble <strong>de</strong> ces <strong>entre</strong>prises, alors que <strong>de</strong>s gains positifs sont<br />
observab<strong>les</strong> à partir d'un certain seuil (ici 335 F/ha). Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce seuil, le gain <strong>de</strong> l'innovateur est<br />
supérieur aux pertes <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels.<br />
Figure 20. Variation <strong>de</strong>s gains pour l'ensemble <strong>de</strong>s firmes situées en amont<br />
Gains (millions <strong>de</strong> francs)<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
-100<br />
-120<br />
-140<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000<br />
Supplément <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
Lorsqu'on se situe à l'optimum <strong>de</strong> l'innovateur, le bi<strong>la</strong>n global (Tableau 10) amène à faire plusieurs<br />
remarques:<br />
• Le gain total pour l'ensemble <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> est <strong>de</strong> 121,9 MF. Cette estimation est inférieure à celle du<br />
Colza, mais ce<strong>la</strong> s'explique par <strong>la</strong> surface totale <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture qui est trois fois supérieure dans le cas<br />
du Colza par rapport à <strong>la</strong> Betterave. En d'autres termes, ce gain ramené par unité <strong>de</strong> surface <strong>de</strong>vient<br />
plus important dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave, et ceci en gran<strong>de</strong> partie parce que <strong>les</strong> dépenses <strong>de</strong><br />
désherbage conventionnel sont supérieures dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Betterave.<br />
• Le gain <strong>de</strong>s agriculteurs s'élève à 78,5 MF, dont <strong>les</strong> trois quarts portent sur <strong>de</strong>s économies <strong>de</strong><br />
désherbant et le quart restant porte sur une économie <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> passage.<br />
• En proportion, <strong>les</strong> gains ou pertes <strong>de</strong>s différents types d'<strong>acteurs</strong> sont équivalentes à cel<strong>les</strong> qui ont<br />
été observées dans le cas du Colza: le gain <strong>de</strong>s agriculteurs représente à peu près <strong>la</strong> moitié du profit<br />
<strong>de</strong> l'innovateur sur <strong>la</strong> semence OGM; <strong>les</strong> pertes sur <strong>les</strong> ventes d'herbici<strong>de</strong> conventionnel<strong>les</strong> sont<br />
équivalentes au gain <strong>de</strong> l'innovateur sur <strong>la</strong> semence OGM; enfin le gain <strong>de</strong>s agriculteurs représente<br />
<strong>les</strong> <strong>de</strong>ux tiers du gain total, le tiers restant al<strong>la</strong>nt aux firmes amont (ce tiers masquant un important<br />
transfert <strong>de</strong> ventes <strong>de</strong>puis <strong>les</strong> fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels vers l'innovateur).<br />
71
Tableau 10. Bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s pertes et gains pour <strong>les</strong> différents types d'<strong>acteurs</strong> (MF)<br />
Référence avec OGM* Variation<br />
Gain sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM 0 143,7 +143,7<br />
Gain sur <strong>les</strong> ventes d'herbici<strong>de</strong> OGM 0 38,4 +38,4<br />
Gain sur <strong>les</strong> ventes d'herbici<strong>de</strong>s conventionnels 171,5 32,8 -138,7<br />
Coût <strong>de</strong> passage en traitements -70 -48,4 +21,6<br />
Coût en désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs -343 -286,1 +56,9<br />
Gain total - - 121,9<br />
* La semence OGM est commercialisée à 505 F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle<br />
L'impact sur l'utilisation <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
La perte <strong>de</strong> ventes totale sur <strong>les</strong> herbici<strong>de</strong>s conventionnels (81%) masque <strong>de</strong>s pertes variab<strong>les</strong><br />
lorsqu'on se p<strong>la</strong>ce au niveau <strong>de</strong> chaque produit (Tableau 11). Parmi <strong>les</strong> produits <strong>les</strong> plus vendus, ce<br />
sont <strong>les</strong> produits <strong>de</strong> type Betanal Progress, Zepplin, Lontrel ou Safari qui subissent <strong>les</strong> baisses <strong>les</strong> plus<br />
fortes (autour <strong>de</strong> 90%). A l'inverse <strong>de</strong>s pertes plus faib<strong>les</strong> sont observées pour <strong>les</strong> produits <strong>de</strong> type<br />
Betanal ou Tramat.<br />
Tableau 11. L'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong>s principaux herbici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels<br />
Composition<br />
Principaux<br />
produits<br />
commerciaux<br />
Part <strong>de</strong><br />
marché<br />
initiale<br />
Ventes<br />
initia<strong>les</strong>*<br />
Ventes<br />
après<br />
OGM**<br />
Perte <strong>de</strong><br />
ventes<br />
METAMITRONE GOLTIX 34,48% 121,440 25,351 -79%<br />
PHENMEDIPHAME+<br />
ETHOFUMESATE+<br />
DESMEDIPHAME<br />
QUINMERAC+<br />
CHLORIDAZONE<br />
PHENMEDIPHAME<br />
BETANAL PROG. 12,02% 42,341 4,531 -89%<br />
ZEPPLIN<br />
REBELL T<br />
11,16% 39,314 4,397 -89%<br />
BETANAL<br />
FASNET<br />
BETAGRI<br />
7,74% 27,256 9,114 -67%<br />
LENACILE VENZAR 6,15% 21,674 5,589 -74%<br />
CHLORIDAZONE PYRAMINE DF 5,87% 20,677 5,413 -74%<br />
ETHOFUMESATE<br />
TRAMAT<br />
BOXER EC<br />
AGRIJET 200<br />
STEMAT 200<br />
MURENA<br />
5,43% 19,136 6,618 -65%<br />
TRIFLUSULFURON-METHYLE SAFARI 4,96% 17,465 1,229 -93%<br />
CLOPYRALID LONTREL 2,63% 9,274 0,566 -94%<br />
FLUAZIFOP-P-BUTYL FUSILATE 2,17% 7,650 1,268 -83%<br />
CYCLOXYDIME STRATOS ULTRA 1,62% 5,705 0,983 -83%<br />
QUIZALOFOP ETHYL ISOMERE D TARGA D+ 1,21% 4,252 1,023 -76%<br />
L'ensemble <strong>de</strong>s compositions présentées ici représentent 95% <strong>de</strong>s ventes tota<strong>les</strong> en France.<br />
* <strong>Les</strong> ventes sont exprimées en Millions <strong>de</strong> francs.<br />
** <strong>Les</strong> ventes après diffusion <strong>de</strong>s OGM ont été calculées en supposant que le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence<br />
OGM est égal à 505 F/ha.<br />
72
Le c<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong>s produits est modifié. Le Roundup <strong>de</strong>vient le principal herbici<strong>de</strong> avec <strong>de</strong>s ventes<br />
s'élevant à 76,8 MF, équivalentes aux ventes <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels. Au sein <strong>de</strong>s<br />
herbici<strong>de</strong>s conventionnels, <strong>les</strong> produits <strong>de</strong> type Betanal Progress et Zepplin passant <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ces n°2 et<br />
n°3 aux p<strong>la</strong>ces n°7 et n°8, alors qu'à l'inverse <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> type Betanal ou Tramat<br />
<strong>de</strong>viennent plus importants au sein <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels.<br />
- Analyse <strong>de</strong> sensibilité<br />
- Sensibilité à ∆<br />
∆ représente le gain minimal que doit apporter le programme OGM par rapport au programme<br />
conventionnel pour être adopter. En faisant, passer ∆ <strong>de</strong> 0 à 100 F/ha, <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> diffusion se décale<br />
vers <strong>la</strong> gauche. Pour répondre à cette baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, l’optimum passe <strong>de</strong> 505 F/ha à 480 F/ha.<br />
Malgré cette baisse <strong>de</strong> prix, le taux <strong>de</strong> diffusion diminue en passant <strong>de</strong> 72% à 60%. Rappelons que<br />
dans le cas du colza, <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> prix était beaucoup plus forte (équivalente à ∆), ce qui permettait <strong>de</strong><br />
maintenir constant le niveau <strong>de</strong> diffusion.<br />
Le bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s gains et <strong>de</strong>s pertes pour <strong>les</strong> différents types d'<strong>acteurs</strong> (Tableau 12) met en évi<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong>ux phénomènes:<br />
• Un transfert <strong>de</strong> gain <strong>de</strong>puis le fournisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution OGM vers <strong>les</strong> agriculteurs, dans le cas<br />
où <strong>les</strong> agriculteurs adoptent avec <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux niveaux <strong>de</strong> ∆. Ce transfert est lié à <strong>la</strong> légère baisse <strong>de</strong><br />
prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM qui conduit à une diminution <strong>de</strong> gain <strong>de</strong> 32 MF pour ces fournisseurs<br />
(26,7 MF pour <strong>la</strong> semence OGM et 5,5 MF sur l'herbici<strong>de</strong> OGM).<br />
• Un certain nombre d'agriculteurs adoptent avec ∆=0 et n'adoptent plus avec ∆=100 F/ha. Ces<br />
agriculteurs ne bénéficient plus d'économies sur <strong>les</strong> dépenses <strong>de</strong> désherbage avec ∆=100 F/ha.<br />
Ce<strong>la</strong> explique que l'économie sur le coût total <strong>de</strong> désherbage (OGM et conventionnel) soit plus<br />
faible avec ∆=100 F/ha (50,3 MF au lieu <strong>de</strong> 48,4 MF). Ce<strong>la</strong> explique également que <strong>les</strong> pertes<br />
<strong>de</strong>s fournisseurs d'herbici<strong>de</strong>s conventionnels soient plus faib<strong>les</strong> (124 MF au lieu <strong>de</strong> 138,7 MF).<br />
On notera que ce <strong>de</strong>uxième phénomène n'existait pas dans le cas du colza.<br />
Globalement, <strong>les</strong> gains <strong>de</strong>s premiers agriculteurs compensent le manque à gagner <strong>de</strong>s seconds, si<br />
bien que l'économie sur <strong>les</strong> dépenses <strong>de</strong> désherbage augmente (85,7 MF au lieu <strong>de</strong> 78,5 MF, en<br />
incluant <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> passage). Cette augmentation <strong>de</strong>s gains est réalisée au dépend du fournisseur <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> solution OGM, si bien que le gain global pour l'ensemble <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> diminue légèrement (111 MF<br />
au lieu <strong>de</strong> 121 MF soit une baisse <strong>de</strong> 8%).<br />
73
Tableau 12. Bi<strong>la</strong>n global avec différentes valeurs <strong>de</strong> D<br />
[A]<br />
Référence<br />
[B]<br />
avec OGM<br />
et ∆=0*<br />
[C]<br />
avec OGM<br />
et ∆=100**<br />
Variation<br />
[B-A]<br />
Variation<br />
[C-A]<br />
Gain sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> 0,0 143,7 117,0 +143,7 +117,0<br />
semence OGM<br />
Gain sur <strong>les</strong> ventes 0,0 38,4 32,9 +38,4 +32,9<br />
d'herbici<strong>de</strong> OGM<br />
Gain sur <strong>les</strong> ventes 171,5 32,8 47,1 -138,7 -124,4<br />
d'herbici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
Coût <strong>de</strong> passage en 0,0 -30,6 -26,3 -30,6 -26,3<br />
traitements OGM<br />
Coût <strong>de</strong> passage en -70,0 -17,8 -24,0 +52,2 +46,0<br />
traitements conventionnel<br />
Coût en désherbage <strong>de</strong>s -343,0 -286,1 -277,0 +56,9 +66,0<br />
agriculteurs (hors passages)<br />
Gain total - - - 121,9 111,2<br />
* La semence OGM est commercialisée à 505 F/ha en plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
** La semence OGM est commercialisée à 480 F/ha en plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
- Sensibilité à φ<br />
Une nouvelle simu<strong>la</strong>tion a été réalisée en diminuant le taux <strong>de</strong> marge <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> 50% à 25%. Ce changement n'affecte pas <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> diffusion, si bien que l'optimum reste<br />
i<strong>de</strong>ntique. <strong>Les</strong> dépenses <strong>de</strong>s agriculteurs et <strong>les</strong> gains du fournisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution OGM restent<br />
également i<strong>de</strong>ntiques.<br />
Cette modification n'affecte que <strong>les</strong> bénéfices <strong>de</strong>s fournisseurs d'herbici<strong>de</strong>s (OGM et<br />
conventionnels) qui diminuent <strong>de</strong> moitié à <strong>la</strong> fois dans <strong>la</strong> situation initiale et après <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s<br />
OGM. La perte <strong>de</strong>s fournisseurs d'herbici<strong>de</strong>s conventionnels diminue donc <strong>de</strong> moitié (69,4 MF au lieu<br />
138,7 MF). Cette moindre perte dépasse très <strong>net</strong>tement le manque à gagner <strong>de</strong>s fournisseurs<br />
d'herbici<strong>de</strong> OGM, si bien que le gain total augmente très <strong>net</strong>tement en passant <strong>de</strong> 122 MF à 172 MF.<br />
Comme dans le cas du colza, φ est le paramètre auquel le gain total est le plus sensible.<br />
- Sensibilité à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
On considère ici que <strong>les</strong> fournisseurs <strong>de</strong> herbici<strong>de</strong>s conventionnels dont <strong>les</strong> ventes baissent <strong>de</strong> 80%<br />
dans le cas <strong>de</strong> base vont réagir en baissant leurs prix. Une baisse <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> 40% est envisagée ici sur<br />
l'ensemble <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels. Ce changement conduit à un déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong><br />
diffusion vers <strong>la</strong> gauche. En réaction, le prix optimal <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM passe <strong>de</strong> 505 F/ha à<br />
290 F/ha, soit une baisse en proportion à peu près équivalente à celle <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels.<br />
Cette baisse <strong>de</strong> prix ne suffit pas à rattraper le déca<strong>la</strong>ge sur <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> diffusion, si bien que le<br />
nouvel optimum correspond à un niveau <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> 57% (au lieu <strong>de</strong> 72% dans le cas <strong>de</strong> base).<br />
74
L'analyse du bi<strong>la</strong>n global pour l'ensemble <strong>de</strong>s <strong>acteurs</strong> (Tableau 13) met en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s propriétés<br />
équivalentes à ce que nous avions observé dans le cas du colza. Compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> réaction <strong>de</strong>s<br />
fournisseurs <strong>de</strong> l'innovateur, <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> prix ne suffit pas pour enrayer <strong>la</strong> perte <strong>de</strong>s fournisseurs<br />
d'herbici<strong>de</strong>s conventionnels qui reste à peu près i<strong>de</strong>ntique. Du coté <strong>de</strong> l'innovateur, <strong>les</strong> gains diminuent<br />
<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié. Enfin, le gain <strong>de</strong>s agriculteurs est presque triplé et repose à <strong>la</strong> fois sur un gain du<br />
coté <strong>de</strong>s adopteurs (grâce à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM) et un gain du coté <strong>de</strong>s non adopteurs<br />
(grâce à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s conventionnels).<br />
Globalement, le gain total change peu (129 MF au lieu <strong>de</strong> 121 MF), l'essentiel <strong>de</strong> variations <strong>de</strong> gain<br />
au niveau <strong>de</strong> chaque <strong>acteurs</strong> reposant sur <strong>de</strong>s transferts <strong>de</strong>puis ou vers d'autres <strong>acteurs</strong>.<br />
Tableau 13. L'effet d'une baisse du prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s conventionnels sur le bi<strong>la</strong>n global<br />
[A]<br />
Référence<br />
[B]<br />
avec OGM<br />
sans baisse <strong>de</strong><br />
prix*<br />
[C]<br />
avec OGM<br />
avec baisse<br />
<strong>de</strong> prix**<br />
Variation<br />
[B-A]<br />
Variation<br />
[C-A]<br />
Gain sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> 0,0 143,7 65,7 +143,7 +65,7<br />
semence OGM<br />
Gain sur <strong>les</strong> ventes 0,0 38,4 30,6 +38,4 +30,6<br />
d'herbici<strong>de</strong> OGM<br />
Gain sur <strong>les</strong> ventes 171,5 32,8 31,4 -138,7 -140,1<br />
d'herbici<strong>de</strong>s conventionnels<br />
Coût <strong>de</strong> passage en 0,0 -30,6 -24,5 -30,6 -24,5<br />
traitements OGM<br />
Coût <strong>de</strong> passage en -70,0 -17,8 -25,7 +52,2 +44,3<br />
traitements conventionnel<br />
Coût en désherbage <strong>de</strong>s -343,0 -286,1 -189,7 +56,9 +153,3<br />
agriculteurs (hors passages)<br />
Gain total - - - 121,9 +129,3<br />
* La semence OGM est commercialisée à 505 F/ha en plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
** La semence OGM est commercialisée à 290 F/ha en plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
75
3. Analyse dans le cas du maïs Bt<br />
L'analyse sur le maïs Bt repose sur <strong>les</strong> mêmes hypothèses généra<strong>les</strong> que <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux analyses<br />
précé<strong>de</strong>ntes sur <strong>la</strong> betterave et le colza. La formu<strong>la</strong>tion précise diffère cependant d'une part parce que<br />
l'hypothèse <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment i<strong>de</strong>ntique <strong>entre</strong> <strong>la</strong> solution conventionnelle et <strong>la</strong> solution OGM ne peut plus<br />
être retenue, et d'autre part parce que <strong>les</strong> données <strong>de</strong> base dont nous disposons concernent non pas <strong>les</strong><br />
pratiques <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes (<strong>les</strong> traitements herbici<strong>de</strong>s), mais <strong>les</strong> problèmes <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ntes (<strong>les</strong> attaques <strong>de</strong> pyra<strong>les</strong>).<br />
<strong>Les</strong> solutions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes retenues dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> pyrale sont plus<br />
simp<strong>les</strong> que cel<strong>les</strong> retenues plus haut pour le désherbage du colza ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> betterave:<br />
• <strong>Les</strong> traitements conventionnels contre <strong>la</strong> pyrale ne correspon<strong>de</strong>nt qu'à un seul passage<br />
d'insectici<strong>de</strong> à un prix donné, alors que plusieurs passages sont généralement nécessaires pour<br />
conduire un désherbage conventionnel.<br />
• L'utilisation d'une semence résistante à <strong>la</strong> pyrale se substitue directement à l'utilisation d'un<br />
insectici<strong>de</strong> contre <strong>la</strong> pyrale. Lorsque le Maïs Bt est adopté, il n'y a donc aucun traitement<br />
insectici<strong>de</strong> contre <strong>la</strong> pyrale. Dans le cas du désherbage, <strong>la</strong> solution OGM correspondait à<br />
l'utilisation d'un herbici<strong>de</strong> total en complément avec <strong>la</strong> semence résistante à cet herbici<strong>de</strong>, avec<br />
un ou plusieurs passages <strong>de</strong> cet herbici<strong>de</strong> total.<br />
En revanche, <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion proposée ici est plus complexe que celle retenue dans le cas HT sur<br />
<strong>de</strong>ux points:<br />
• L'effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> pyrale sur le ren<strong>de</strong>ment est important, et <strong>les</strong> différents types <strong>de</strong> programmes <strong>de</strong><br />
traitement n'offrent pas le même niveau <strong>de</strong> protection contre <strong>la</strong> pyrale. Il est donc nécessaire <strong>de</strong><br />
définir comment le ren<strong>de</strong>ment varie en fonction <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> pyrale et <strong>de</strong>s types <strong>de</strong><br />
traitement utilisés - à savoir, absence <strong>de</strong> traitement, traitement insectici<strong>de</strong> conventionnel, ou<br />
adoption <strong>de</strong> maïs Bt. Dans le cas du désherbage, nous avions supposé (en accord avec <strong>les</strong><br />
instituts techniques) que le ren<strong>de</strong>ment restait i<strong>de</strong>ntique en passant <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution<br />
conventionnelle à <strong>la</strong> solution OGM, si bien que le raisonnement portait uniquement sur <strong>les</strong><br />
coûts <strong>de</strong> désherbage.<br />
• <strong>Les</strong> attaques <strong>de</strong> pyra<strong>les</strong> sont très variab<strong>les</strong> d'une année sur l'autre et peu prévisib<strong>les</strong> au moment<br />
<strong>de</strong> choisir le moyen <strong>de</strong> lutte. La lutte contre <strong>la</strong> pyrale est donc préventive, qu'il s'agisse d'un<br />
programme conventionnel ou d'un programme OGM 5 . Cette lutte permet d'augmenter le<br />
5 Dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution OGM, il est c<strong>la</strong>ir que l'agriculteur dispose <strong>de</strong> peu d'information sur l'attaque <strong>de</strong> pyrale<br />
au moment <strong>de</strong> choisir sa semence. Le choix d'une variété Bt est donc fait <strong>de</strong> manière préventive. Dans le cas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> solution conventionnelle, on pourrait penser que ce choix soit fait <strong>de</strong> manière plus adaptative. <strong>Les</strong> personnes<br />
<strong>de</strong> l'AGPM et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Protection <strong>de</strong>s Végétaux avec qui nous avons été en contact nous ont indiqué que, dans <strong>la</strong><br />
pratique, <strong>les</strong> traitements étaient le plus souvent préventifs. La Protection <strong>de</strong>s Végétaux travaille d'ailleurs<br />
76
en<strong>de</strong>ment attendu et <strong>de</strong> diminuer le risque pris. Pour prendre en compte ces <strong>de</strong>ux variab<strong>les</strong>, il<br />
faut intégrer un paramètre d'aversion au risque dans le choix <strong>de</strong> l'agriculteur. Dans le cas du<br />
désherbage, <strong>les</strong> choix <strong>de</strong> traitements sont plutôt réalisés en réponse à <strong>de</strong>s niveaux d'infestation<br />
observés si bien que <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> l'aversion au risque est moins importante.<br />
<strong>Les</strong> détails <strong>de</strong> <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion retenue ici sont présentés dans <strong>la</strong> sous-section 3.1. On analyse ensuite<br />
réalisée <strong>les</strong> zones <strong>de</strong> valeurs <strong>de</strong>s paramètres dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong> différentes technologies sont adoptées<br />
(sous-section 3.2.). Enfin, on présente une projection <strong>de</strong> l'adoption potentielle au niveau français<br />
(sous-section 3.3). <strong>Les</strong> résultats <strong>de</strong> cette projection révèlent certaines limites liées aux données<br />
utilisées. Pour cette raison, il nous a semblé préférable <strong>de</strong> ne pas conduire d'analyse <strong>de</strong> sensibilité<br />
comme nous l'avons fait plus haut dans le cas du colza et <strong>de</strong> <strong>la</strong> betterave.<br />
3.1. Formu<strong>la</strong>tion analytique<br />
- <strong>Les</strong> indices et variab<strong>les</strong><br />
- <strong>Les</strong> indices<br />
j : agriculteur<br />
k : type <strong>de</strong> programme utilisé dans <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> pyrale:<br />
- <strong>Les</strong> variab<strong>les</strong><br />
0 : aucun programme<br />
c : traitement insectici<strong>de</strong> conventionnel<br />
g : utilisation <strong>de</strong> maïs Bt<br />
n j : niveau d'attaque <strong>de</strong>s pyra<strong>les</strong> (nombre <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves <strong>de</strong> pyrale par p<strong>la</strong>nte). Il s'agit d'une variable<br />
aléatoire <strong>de</strong> moyenne<br />
n<br />
j<br />
et d'écart type σ.<br />
y jM : ren<strong>de</strong>ment atteint par l'agriculteur j en l'absence d'attaque <strong>de</strong> pyrale.<br />
y jk : ren<strong>de</strong>ment atteint par l'agriculteur j étant donnés une attaque <strong>de</strong> pyrale <strong>de</strong> niveau n j et un<br />
programme <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> pyrale k.<br />
α k : efficacité <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie k, mesuré comme <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves <strong>de</strong> pyra<strong>les</strong> tuées avant<br />
qu'el<strong>les</strong> n'aient un effet néfaste sur le ren<strong>de</strong>ment. Sur ce point, <strong>les</strong> travaux s'accor<strong>de</strong>nt pour dire que α k<br />
est supérieur pour le maïs Bt par rapport au traitement insectici<strong>de</strong> (α 0
a : coefficient d'impact contre <strong>la</strong> pyrale, mesuré comme le pourcentage <strong>de</strong> chute <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment<br />
consécutif à une attaque <strong>de</strong> pyrale d'un niveau équivalent à 1 <strong>la</strong>rve par p<strong>la</strong>nte (cette <strong>la</strong>rve ayant<br />
survécu à <strong>la</strong> technologie k).<br />
s j : surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> maïs grain pour l'agriculteur j<br />
p : prix du maïs grain<br />
w k : coût du programme utilisé pour lutter contre <strong>la</strong> pyrale (k=0, c ou g). Dans le cas du traitement<br />
insectici<strong>de</strong> (k=c), ce coût prend en compte le produit et le coût du passage. Dans le cas du maïs Bt<br />
(k=g), le coût représente le supplément <strong>de</strong> prix payé sur <strong>la</strong> semence <strong>de</strong> maïs Bt par rapport à <strong>la</strong><br />
semence <strong>de</strong> maïs conventionnel.<br />
c j : Ensemble <strong>de</strong>s autres coûts <strong>de</strong> l'agriculteur j indépendant du choix <strong>de</strong> k. Ce<strong>la</strong> prend en compte le<br />
coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence traditionnelle.<br />
∆ : supplément <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> l'agriculteur pour qu'il adopte le maïs Bt en remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s<br />
technologies 0 ou c.<br />
b : coefficient d'aversion au risque <strong>de</strong> l'agriculteur (b=0 lorsque l'agriculteur est neutre au risque).<br />
- Le profit et l'utilité <strong>de</strong> l'agriculteur 6<br />
On suppose que le ren<strong>de</strong>ment atteint par l'agriculteur j après une attaque <strong>de</strong> pyrale décroît<br />
linéairement avec le nombre <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves par p<strong>la</strong>nte ayant survécu à <strong>la</strong> technologie k. Exprimé en fonction<br />
du nombre initial <strong>de</strong> pyrale, le ren<strong>de</strong>ment décroît d'autant moins que <strong>la</strong> technologie permet d'éliminer<br />
un nombre important <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves. La formu<strong>la</strong>tion retenue est <strong>la</strong> suivante:<br />
y<br />
π<br />
jk<br />
jk<br />
jM<br />
( 1−<br />
a ( − α ) n )<br />
= y 1<br />
Le profit observé ex post donc:<br />
= p y<br />
j<br />
= p y<br />
jM<br />
− w<br />
k<br />
− c<br />
j<br />
k<br />
j<br />
( 1−<br />
a ( 1−α<br />
k<br />
) n<br />
j<br />
) − wk<br />
− c<br />
j<br />
L'agriculteur base son choix non pas sur le profit observé ex post, mais sur une utilité qui prend en<br />
compte l'espérance <strong>de</strong> profit attendu et <strong>la</strong> variance <strong>de</strong> profit. La formu<strong>la</strong>tion retenue est <strong>la</strong> suivante 7 :<br />
u<br />
jk<br />
= E<br />
=<br />
p<br />
[ π<br />
jki<br />
] − b var[ π<br />
jki<br />
]<br />
2 2<br />
y<br />
jM<br />
( 1−<br />
a ( 1−α<br />
k<br />
) n<br />
j<br />
) − b p y<br />
jM<br />
a ( 1−α<br />
k<br />
) σ − wk<br />
− c<br />
j<br />
6 La formu<strong>la</strong>tion retenue ici est très proche <strong>de</strong> celle utilisée par Ostlie et al. (1997) Marra et al. (1998) ou<br />
encore Nelson et al. (1999). Hy<strong>de</strong> et al. (1997) utilisent quant à eux une formu<strong>la</strong>tion plus complexe dont le<br />
paramétrage est plus délicat. Nous avons choisi ici <strong>de</strong> commencer l'analyse avec une formu<strong>la</strong>tion re<strong>la</strong>tivement<br />
simple.<br />
7 La forme utilisée ici pour prendre en compte l'aversion au risque est une <strong>de</strong>s formes standard utilisées en<br />
économie. Un autre forme possible consiste à définir l'utilité comme une forme exponentielle du profit.<br />
78
On peut remarquer ici que pour un prix donné, l'utilité augmente avec l'efficacité technique pour<br />
<strong>de</strong>ux raisons: (i) dans le premier terme, l'effet négatif <strong>de</strong> l'attaque <strong>de</strong> pyrale tend à diminuer, ce qui<br />
conduit à une augmentation <strong>de</strong> l'espérance <strong>de</strong> profit, (ii) dans le <strong>de</strong>uxième terme, <strong>la</strong> variance du profit<br />
tend également à diminuer.<br />
- Définition <strong>de</strong>s seuils d'adoption<br />
La Figure 22 donne une illustration du raisonnement qui est fait lorsqu'on compare <strong>les</strong> trois<br />
technologies. Cette figure représente l'utilité <strong>de</strong>s trois technologies en fonction du niveau moyen<br />
d'attaque <strong>de</strong> pyrale, pour <strong>de</strong>s niveaux donnés <strong>de</strong>s autres paramètres (prix du maïs, prix <strong>de</strong>s<br />
technologies c et g). Plus le moyen <strong>de</strong> lutte est efficace et plus <strong>la</strong> pente <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbe est faible. Pour un<br />
niveau d'attaque moyen donné, l'agriculteur choisit <strong>la</strong> technologie qui donne le profit le plus élevé,<br />
donc qui correspond à <strong>la</strong> courbe située le plus en haut. Lorsque <strong>de</strong>ux technologies sont comparées, on<br />
peut remarquer alors qu'il y aura toujours un niveau seuil sur<br />
n<br />
j<br />
au <strong>de</strong>ssus duquel <strong>la</strong> technologie <strong>la</strong><br />
plus performante (avec une courbe <strong>de</strong> pente plus faible) sera préférée à <strong>la</strong> technologie <strong>la</strong> moins<br />
performante. Une fois comparées l'ensemble <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong>ux à <strong>de</strong>ux, il est possible <strong>de</strong> définir,<br />
pour chacune d'el<strong>les</strong>, un segment <strong>de</strong> valeurs sur<br />
n<br />
j<br />
au sein duquel elle sera préférée aux autres.<br />
Figure 21. Représentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> comparaison <strong>entre</strong> différentes technologies<br />
utilité<br />
ujg - ∆<br />
u jc<br />
u j0<br />
E[n j]<br />
adoption <strong>de</strong> 0<br />
adoption <strong>de</strong> c<br />
adoption <strong>de</strong> g<br />
L'agriculteur choisit <strong>la</strong> solution qui offre <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> utilité. Dans le cas du maïs Bt (k=g) l'utilité<br />
doit être supérieure d'au moins ∆ pour que <strong>la</strong> solution soit retenue. Le choix d'adoption est donné par :<br />
• aucun traitement si ( u<br />
j0 ≥ u jc<br />
) et ( u<br />
j0<br />
+ ∆ ≥ u jg<br />
)<br />
• conventionnel si ( u<br />
jc<br />
≥ u j 0)<br />
et ( u<br />
jc<br />
+ ∆ ≥ u jg<br />
)<br />
• OGM si ( u + ∆)<br />
et ( u jg<br />
≥ u + ∆)<br />
jg<br />
≥ u j 0<br />
jc<br />
79
Le seuil d'indifférence <strong>de</strong> l'agriculteur j <strong>entre</strong> <strong>les</strong> technologies k 1 et k 2 est noté n ( k ,k j 1 2<br />
). Le seuil<br />
d'indifférence <strong>entre</strong> le traitement insectici<strong>de</strong> (k=c) et l'absence <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> pyrale (k=0) est défini<br />
par :<br />
n<br />
1 w<br />
c, 0 = ⋅ − b p y<br />
jM<br />
a 2 −α<br />
c<br />
σ<br />
p y a α<br />
c<br />
2<br />
π jc = π j0 ⇔ ( ) ( )<br />
j<br />
jM<br />
c<br />
Le seuil d'indifférence <strong>entre</strong> l'utilisation <strong>de</strong> Maïs Bt (k=g) et l'absence <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> pyrale (k=0)<br />
est défini par :<br />
n<br />
1 wg<br />
+ ∆<br />
g, 0 = ⋅ − b p yM<br />
a 2 −α<br />
g<br />
σ<br />
p y a α<br />
π jg = π j0 + ∆ ⇔ ( ) ( )<br />
2<br />
j<br />
jM<br />
g<br />
Le seuil d'indifférence <strong>entre</strong> l'utilisation <strong>de</strong> Maïs Bt (k=g) et le traitement insectici<strong>de</strong> (k=c) est<br />
défini par :<br />
n<br />
1 wg<br />
+ ∆ − wc<br />
g, c = ⋅<br />
− b p yM<br />
a 2 −α<br />
g<br />
−α<br />
c<br />
σ<br />
p y a α −α<br />
π jg = π jc + ∆ ⇔ ( ) ( )<br />
2<br />
j<br />
jM<br />
g<br />
c<br />
Il est important <strong>de</strong> noter que <strong>les</strong> niveaux seuils peuvent varier d'un agriculteur à l'autre selon le<br />
ren<strong>de</strong>ment y jM atteint en l'absence du pyrale. Deux agriculteurs exposés au même niveau d'attaque<br />
peuvent être conduits à faire <strong>de</strong>s choix différents si leurs ren<strong>de</strong>ments sont différents.<br />
3.2. Analyse <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> valeurs <strong>de</strong> paramètres pour l'adoption <strong>de</strong>s<br />
technologies<br />
L'objectif <strong>de</strong> cette sous-section est <strong>de</strong> montrer d'une part qu'il existe une zone <strong>de</strong> valeurs <strong>de</strong><br />
paramètres dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> l'adoption <strong>de</strong> c est impossible, et d'autre part, que cette zone disparaît<br />
quand l'aversion au risque <strong>de</strong>vient assez importante.<br />
- Effet du prix du maïs Bt (w g )<br />
La Figure 21 donne une indication <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation <strong>de</strong>s trois niveaux d'indifférence avec w g . On peut<br />
voir que <strong>les</strong> trois droites se croisent en un même point. Il s'agit là d'une propriété générale qui<br />
s'observe dans tous <strong>les</strong> cas <strong>de</strong> figure. Le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie g au niveau duquel on est indifférent<br />
<strong>entre</strong> <strong>les</strong> trois technologies est défini par:<br />
wˆ<br />
g<br />
α<br />
=<br />
α<br />
g<br />
c<br />
w<br />
c<br />
− ∆ − b<br />
2 2<br />
( a p y ) σ α ( α −α<br />
)<br />
jM<br />
g<br />
g<br />
c<br />
80
Figure 22. Evolution <strong>de</strong>s niveaux d'indifférence avec le prix du maïs Bt (w g )<br />
Espérance du nombre <strong>de</strong> pyra<strong>les</strong><br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0 100 200 300 400 500<br />
nj(0,c)<br />
nj(0,g)<br />
nj(c,g)<br />
w g<br />
Deux zones peuvent être repérées selon que w g est au <strong>de</strong>ssus ou en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong><br />
23 pour une illustration):<br />
• Lorsque<br />
w<br />
ˆ<br />
g<br />
< wg<br />
alors quand<br />
j<br />
d'indifférence n j<br />
( g,0)<br />
avant <strong>de</strong> rencontrer ( c,0)<br />
ŵ<br />
g<br />
(voir <strong>la</strong> Figure<br />
n augmente en partant <strong>de</strong> 0, il rencontre d'abord <strong>la</strong> courbe<br />
n j<br />
. Ce<strong>la</strong> signifie donc que l'on passe directement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie 0 à <strong>la</strong> technologie g: <strong>la</strong> technologie c ne sera alors jamais adoptée.<br />
• Lorsque<br />
w<br />
ˆ<br />
g<br />
> wg<br />
alors quand<br />
j<br />
n augmente en partant <strong>de</strong> 0, il rencontre d'abord <strong>la</strong> courbe<br />
d'indifférence n j<br />
( c,0)<br />
avant <strong>de</strong> rencontrer n j<br />
( g,0)<br />
puis ( g c)<br />
n j<br />
, . Ce<strong>la</strong> signifie donc que l'on<br />
passe d'abord <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie 0 à <strong>la</strong> technologie c puis <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie c à <strong>la</strong> technologie g.<br />
81
Figure 23. Représentation <strong>de</strong>s zones d'adoption <strong>de</strong>s trois technologies<br />
n<br />
n(c,g )<br />
n(0,g)<br />
Adoption <strong>de</strong> g<br />
Adoption <strong>de</strong> c<br />
n(0,c)<br />
Adoption <strong>de</strong> 0<br />
w g<br />
Le point au niveau duquel <strong>les</strong> trois courbes d'indifférence se croisent a été exprimé ici en fonction<br />
<strong>de</strong> w g parce que nous analysions <strong>la</strong> sensibilité à ce paramètre. On peut observer néanmoins que<br />
l'égalité définissant ŵ<br />
g<br />
peut être reformulée différemment en fonction d'un autre paramètre. Retenons<br />
ici que quel que soit le paramètre étudié, il y aura toujours au point au niveau duquel <strong>les</strong> trois courbes<br />
d'indifférence se croiseront. Suivant <strong>la</strong> position par rapport à ce point, on observera <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong><br />
basculement: soit <strong>de</strong> 0 vers g directement (l'adoption <strong>de</strong> c est alors impossible), soit <strong>de</strong> 0 vers c puis <strong>de</strong><br />
c vers g (l'adoption <strong>de</strong> c est alors possible).<br />
- Effet du niveau d'aversion au risque (b)<br />
Quels que soient <strong>les</strong> coup<strong>les</strong> <strong>de</strong> technologie envisagés, plus l'aversion au risque est élevée et plus<br />
<strong>les</strong> seuils d'indifférence sont faib<strong>les</strong>. Autrement dit, si l'aversion au risque augmente, on basculera plus<br />
facilement vers <strong>la</strong> technologie <strong>la</strong> plus efficace du point <strong>de</strong> vue technique. Deux formes <strong>de</strong> graphes sont<br />
obtenus selon <strong>les</strong> valeurs <strong>de</strong>s paramètres.<br />
Si on se trouve dans un cas où l'adoption <strong>de</strong> c est impossible sans aversion au risque, alors on<br />
obtient un graphe <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> <strong>la</strong> Figure 24. (La Figure 24 correspond au cas particulier w g est égal à<br />
225). On observe alors un point au niveau duquel <strong>les</strong> trois courbes se croisent. A gauche <strong>de</strong> ce point,<br />
on se trouve dans une situation où on passe directement <strong>de</strong> 0 à g alors qu’à droite <strong>de</strong> ce point, on se<br />
trouve dans une situation où on passe d'abord <strong>de</strong> 0 à c, puis <strong>de</strong> c à g. Une propriété intéressante<br />
apparaît: dans <strong>les</strong> cas où l'adoption <strong>de</strong> c est impossible sans aversion au risque, le fait d'introduire une<br />
82
aversion au risque assez gran<strong>de</strong> va faire apparaître une zone dans <strong>la</strong>quelle l'adoption <strong>de</strong> c <strong>de</strong>vient<br />
possible.<br />
Figure 24. Evolution <strong>de</strong>s niveaux d'indifférence avec le niveau d'aversion au risque et w g faible<br />
Espérance du nombre <strong>de</strong> pyra<strong>les</strong><br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14<br />
nj(0,c)<br />
nj(0,g)<br />
nj(c,g)<br />
b<br />
w g =225. Voir le Tableau 14 pour <strong>les</strong> valeurs par défaut <strong>de</strong>s autres paramètres.<br />
Dans le cas contraire où l'adoption <strong>de</strong> c est possible sans aversion au risque, on ne trouve pas <strong>de</strong><br />
valeur <strong>de</strong> b positive pour <strong>la</strong>quelle <strong>les</strong> trois courbes d'indifférence se croisent (Figure 25). On se trouve<br />
alors dans un cas <strong>de</strong> figure qui correspond à <strong>la</strong> partie droite <strong>de</strong> <strong>la</strong> Figure 24.<br />
Figure 25. Evolution <strong>de</strong>s niveaux d'indifférence avec le niveau d'aversion au risque et w g élevé<br />
Espérance du nombre <strong>de</strong> pyra<strong>les</strong><br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14<br />
nj(0,c)<br />
nj(0,g)<br />
nj(c,g)<br />
b<br />
w g =275. Voir le Tableau 14 pour <strong>les</strong> valeurs par défaut <strong>de</strong>s autres paramètres.<br />
83
3.3. Projection sur <strong>la</strong> France<br />
- Formu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour chaque technologie et le profit <strong>de</strong>s firmes situées<br />
en amont<br />
Comme dans le cas HT, <strong>la</strong> variable γ jk indique si <strong>la</strong> technologie k est utilisée (γ jk =1) ou non (γ jk =0)<br />
par l'agriculteur j. La surface totale sur <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> technologie est définie par:<br />
k<br />
S = ∑γ<br />
jk<br />
s<br />
j<br />
j<br />
On ne fait pas <strong>de</strong> distinction <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents insectici<strong>de</strong>s, et on considère ici uniquement <strong>la</strong><br />
somme <strong>de</strong>s profits <strong>de</strong>s fournisseurs d'insectici<strong>de</strong>s. En supposant que le taux <strong>de</strong> marge (φ) est i<strong>de</strong>ntique<br />
pour tous <strong>les</strong> produits, on obtient <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion suivante:<br />
Π<br />
c c<br />
= S φ<br />
w<br />
c<br />
Du côté <strong>de</strong> l'innovateur proposant le maïs Bt, le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM est<br />
supposé égal au coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle. Le profit <strong>de</strong> l'innovateur est donc:<br />
Π<br />
g<br />
= S<br />
g<br />
w<br />
g<br />
- <strong>Les</strong> données <strong>de</strong> départ<br />
Le modèle présenté plus haut est appliqué uniquement au maïs grain, qui représente<br />
approximativement <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface française <strong>de</strong> maïs, l'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> pyrale sur le maïs ensi<strong>la</strong>ge<br />
étant faible.<br />
Pour appliquer le modèle présenté plus haut, il est nécessaire <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> données sur le niveau<br />
moyen d'attaque <strong>de</strong> pyrale, le ren<strong>de</strong>ment et <strong>la</strong> surface en maïs grain pour chaque entité j étudiée. A <strong>la</strong><br />
différence du cas du colza et du cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> betterave étudiés précé<strong>de</strong>mment, pour <strong>les</strong>quels <strong>les</strong><br />
simu<strong>la</strong>tions étaient basés sur <strong>de</strong>s échantillons d'agriculteurs, nous disposions uniquement <strong>de</strong> données<br />
au niveau départemental. <strong>Les</strong> calculs sont réalisés ici en supposant que tous <strong>les</strong> agriculteurs au sein<br />
d'un même département peuvent être regroupés pour former un seul agriculteur-département j. 8<br />
<strong>Les</strong> niveaux d'attaques <strong>de</strong> pyrale sont calculés d'après <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> Protection <strong>de</strong> Végétaux et<br />
<strong>de</strong> l'AGPM. <strong>Les</strong> niveaux d'attaques correspon<strong>de</strong>nt à une moyenne sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1995-1998 et<br />
concernent essentiellement <strong>de</strong>s <strong>la</strong>rves univoltines. <strong>Les</strong> données sur le ren<strong>de</strong>ment 9 et <strong>les</strong> surfaces<br />
8 Plus précisément, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s végétaux dispose <strong>de</strong> données plus fines sur <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s attaques<br />
<strong>de</strong> Pyrale qui ne suivent pas le découpage départemental. Néanmoins, il n'était pas possible <strong>de</strong> coupler ces<br />
données avec <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> surface en maïs.<br />
9 Rigoureusement, le ren<strong>de</strong>ment fourni par le SCEES est le ren<strong>de</strong>ment après attaque <strong>de</strong> Pyrale. Pour<br />
simplifier, nous avons supposé que le ren<strong>de</strong>ment sans attaque <strong>de</strong> Pyrale (y jM ) était égal au ren<strong>de</strong>ment fourni par<br />
le SCEES.<br />
84
départementa<strong>les</strong> ont été tirées <strong>de</strong>s publications du SCEES. Le détail <strong>de</strong> ces sources est donné dans<br />
l'annexe B.<br />
Compte tenu <strong>de</strong>s données manquantes sur <strong>les</strong> attaques <strong>de</strong> pyrale, seulement 61 départements sont<br />
pris en compte dans l'analyse qui est faite ici. Ces départements couvrent près <strong>de</strong> 1,5 millions<br />
d'hectares <strong>de</strong> maïs grain, soit 87,6% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface en maïs grain française, en moyenne annuelle sur <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> 1995-1998. Parmi ces 61 départements, 4 départements (soit 3% <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie totale) n’ont<br />
pas subi d'attaques <strong>de</strong> pyrale sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> envisagée. La distribution <strong>de</strong>s niveaux d'attaque <strong>de</strong> pyrale<br />
est détaillée dans <strong>la</strong> Figure 26 et <strong>la</strong> Figure 27. Le ren<strong>de</strong>ment moyen sur <strong>les</strong> 61 départements est <strong>de</strong><br />
85,4 qtx/ha, valeur très proche <strong>de</strong> <strong>la</strong> moyenne nationale (85,5 qtx/ha).<br />
Figure 26. Distribution <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> Pyrale en France<br />
40%<br />
35%<br />
Surfaces concernées<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
0.00-0.19 0.20-0.39 0.40-0.59 0.60-0.79 0.80-0.99 1.00-1.19 3.08<br />
Nombre moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves <strong>de</strong> pyrale par p<strong>la</strong>nte<br />
85
Figure 27. Carte <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> Pyrale en France<br />
8<br />
62<br />
35<br />
225<br />
222<br />
199<br />
32<br />
261<br />
51<br />
27<br />
35<br />
194<br />
17<br />
36<br />
44<br />
240<br />
296<br />
146<br />
190<br />
127<br />
107<br />
196<br />
359<br />
195 59<br />
87<br />
153<br />
108<br />
65<br />
45<br />
18<br />
18<br />
4<br />
91<br />
27<br />
571<br />
15<br />
677<br />
289<br />
202<br />
373<br />
87<br />
165<br />
215<br />
92<br />
622<br />
380<br />
119<br />
303<br />
1<br />
2<br />
363<br />
589<br />
1 329<br />
797<br />
363<br />
618<br />
281<br />
304<br />
66<br />
13<br />
C<strong>la</strong>sses d'infestation<br />
par <strong>la</strong> pyrale<br />
0.0-0.19 (22)<br />
0.2-0.39 (14)<br />
0.4-0.59 (6)<br />
0.6-0.79 (5)<br />
0.8-0.99 (1)<br />
1.0-1.19 (12)<br />
3.08 (1)<br />
<strong>Les</strong> couleur correspon<strong>de</strong>nt aux c<strong>la</strong>sses d'infestation par <strong>la</strong> pyrale en nombre <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves par p<strong>la</strong>nte. Le chiffre<br />
<strong>entre</strong> parenthèse dans <strong>la</strong> légen<strong>de</strong> est le nombre <strong>de</strong> département dans chaque c<strong>la</strong>sse d'infestation. Le chiffre<br />
indiqué dans chaque département est production annuelle (moyenne 1995-1998 en milliers <strong>de</strong> tonnes <strong>de</strong> maïs<br />
grain). <strong>Les</strong> départements en c<strong>la</strong>ir sans chiffres sont <strong>les</strong> départements pour <strong>les</strong>quels aucune données sur <strong>les</strong><br />
attaques <strong>de</strong> pyrale n'a pu être obtenu.<br />
<strong>Les</strong> valeurs <strong>de</strong> paramètres sont indiquées dans le Tableau 14. Le coût du traitement insectici<strong>de</strong>, w c ,<br />
est tiré <strong>de</strong> Vo<strong>la</strong>n (2000). L'impact d'une attaque d'une pyrale sur le ren<strong>de</strong>ment, a, est issu <strong>de</strong> Nelson et<br />
al. (1999). <strong>Les</strong> paramètres α c et α g , donnant l'efficacité d'un insectici<strong>de</strong> conventionnel et du maïs Bt<br />
pour <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> pyrale, ont été choisis après discussion avec Guy le Hénaff (Protection <strong>de</strong>s<br />
Végétaux, Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture, Nancy) et Denis Bourguet (département santé <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes et<br />
environnement, INRA, Versail<strong>les</strong>-Grignon). La valeur <strong>de</strong> α c retenue ici est plutôt favorable, ce<br />
paramètre étant situé dans une fourchette <strong>de</strong> 50-75 %. Rappelons que <strong>les</strong> calculs sont faits pour le<br />
moment sans aversion au risque.<br />
86
Tableau 14. Valeur <strong>de</strong>s paramètres dans le cas <strong>de</strong> base<br />
Paramètre Description Valeur<br />
p Prix du maïs grain 65 F/qt<br />
w c Coût du traitement insectici<strong>de</strong> 200 F/ha<br />
a Impact d'une attaque d'une pyrale sur le ren<strong>de</strong>ment 5%<br />
α c Efficacité d'un insectici<strong>de</strong> conventionnel (proportion <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves tuées) 75%<br />
α g Efficacité du maïs Bt (proportion <strong>de</strong> <strong>la</strong>rves tuées) 95%<br />
∆ Supplément <strong>de</strong> profit <strong>de</strong> l'agriculteur pour qu'il adopte le Maïs Bt 0 F/ha<br />
φ Taux <strong>de</strong> marge réalisé sur l'insectici<strong>de</strong> conventionnel 50%<br />
- Analyse <strong>de</strong> l'effet <strong>de</strong> l'introduction du maïs Bt dans le cas <strong>de</strong> base<br />
- Analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> référence avant introduction du maïs Bt<br />
Dans <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> référence, avant l'introduction d'OGM, le modèle proposé ici prévoit que <strong>de</strong>s<br />
insectici<strong>de</strong>s sont utilisés sur 545 300 hectares <strong>de</strong> maïs grain pour lutter contre <strong>la</strong> pyrale, tandis que <strong>les</strong><br />
954 300 hectares restants ne sont pas traités. Cette estimation est plus élevée que <strong>la</strong> surface réellement<br />
traitée en France chaque année, qui est autour <strong>de</strong> 450 000 hectares (Vo<strong>la</strong>n, 2000). Cet écart s'explique<br />
en partie par le fait que nous avons été contraints <strong>de</strong> supposer que <strong>les</strong> départements adoptent sur<br />
l'ensemble <strong>de</strong> leur surface en maïs grain dès que le seuil sur le niveau d'attaque minimum (n j (0,c)) est<br />
passé. La distribution géographique <strong>de</strong>s zones traitées est également différente. Avec le modèle<br />
proposé ici, le traitement insectici<strong>de</strong> concerne dix départements, soit quatre départements situés en<br />
Aquitaine (33, 40, 64, 47), quatre départements situés en Midi-Pyrénées (32, 65, 82, 31), le Jura (39)<br />
et l’Allier (03). Or, l'essentiel <strong>de</strong>s surfaces réellement traitées en France se situe dans l'Aquitaine<br />
(traitement contre le complexe Sésamie-Pyrale) et le Sud du bassin parisien (traitement contre <strong>la</strong><br />
Pyrale). Autrement dit, on ne retrouve pas avec le modèle <strong>la</strong> zone <strong>de</strong> traitement dans le Sud du bassin<br />
parisien.<br />
En général, il est recommandé aux agriculteurs <strong>de</strong> traiter lorsque le seuil <strong>de</strong> 0,8 <strong>la</strong>rves par p<strong>la</strong>nte est<br />
dépassé. Dans le cas présent, le seuil moyen d'intervention se situe à 1,02 <strong>la</strong>rves par p<strong>la</strong>nte.<br />
- La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en maïs Bt<br />
La Figure 28 représente l'adoption <strong>de</strong> maïs Bt en fonction du supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence <strong>de</strong><br />
maïs Bt (w g ). Cette courbe peut être divisée en trois parties :<br />
• Lorsque w g est supérieur à 265 F/ha, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en Maïs Bt est très faible. Plus précisément, <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> est nulle lorsque w g est supérieur à 367F, seuil en <strong>de</strong>ssous duquel le département <strong>de</strong><br />
Haute-Garonne commence à adopter. On notera que ce département est atypique car <strong>la</strong> pression<br />
<strong>de</strong> Pyrale (3,08) est plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux fois supérieure à celle <strong>de</strong>s autres départements (cf Figure 26).<br />
Dans cette zone <strong>de</strong> prix, on se trouve dans une situation très semb<strong>la</strong>ble à <strong>la</strong> situation <strong>de</strong><br />
référence avec une absence <strong>de</strong> traitement sur 2/3 <strong>de</strong>s surfaces, un traitement sur 1/3 <strong>de</strong> surface,<br />
et une surface en maïs Bt nulle à très faible.<br />
87
• Dans <strong>la</strong> fourchette très étroite où w g varie <strong>entre</strong> 255 et 265 F/ha, on observe un basculement<br />
très rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s départements qui réalisaient un traitement insectici<strong>de</strong> vers <strong>la</strong><br />
culture du maïs Bt. Dans le bas <strong>de</strong> cette fourchette (w g =255 F/ha), on trouve toujours une<br />
absence <strong>de</strong> traitement sur 2/3 <strong>de</strong>s surfaces, mais un abandon complet du recours au traitement<br />
insectici<strong>de</strong> et une adoption <strong>de</strong> maïs Bt sur 1/3 <strong>de</strong>s surfaces.<br />
• Enfin, lorsque w g passe progressivement <strong>de</strong> 250 à 0 F/ha, <strong>les</strong> départements qui ne réalisaient<br />
aucun traitement dans <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> référence adoptent progressivement le maïs Bt. Notons<br />
que l'augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface en maïs Bt est insignifiante dans <strong>la</strong> zone située <strong>entre</strong> 150 et<br />
250 F/ha et <strong>de</strong>vient significative en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 150 F/ha (chaque diminution <strong>de</strong> 1 F du<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence conduisant alors en moyenne à augmenter <strong>la</strong> surface en maïs<br />
Bt <strong>de</strong> 7000 hectares).<br />
Figure 28. Courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en maïs Bt<br />
Pourcentage <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface en maïs grain<br />
100%<br />
90%<br />
Surface ensemencée en maïs Bt<br />
Surface en semence conventionnele non traitée contre <strong>la</strong> pyrale<br />
80%<br />
Surface en semence conventionnele traitée contre <strong>la</strong> pyrale<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
0 50 100 150 200 250 300 350 400<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
- <strong>Les</strong> gains et <strong>les</strong> dépenses agriculteurs<br />
Le maïs Bt étant plus efficace que le traitement conventionnel ou l'absence <strong>de</strong> traitement, le<br />
ren<strong>de</strong>ment augmente dans <strong>les</strong> départements qui l'adoptent. L'adoption <strong>de</strong> chaque nouveau département<br />
conduit alors à une augmentation du ren<strong>de</strong>ment moyen en France. Ainsi, plus le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence <strong>de</strong><br />
maïs Bt est proche du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnel, plus <strong>la</strong> surface en maïs Bt est importante et<br />
plus le ren<strong>de</strong>ment moyen en production du maïs grain en France est élevé (Figure 29).<br />
Avec uniquement un remp<strong>la</strong>cement du traitement insectici<strong>de</strong> par le maïs Bt, le ren<strong>de</strong>ment<br />
augmente <strong>de</strong> 1 qt/ha dans <strong>les</strong> départements qui adoptent et <strong>de</strong> 0,5 qt/ha en moyenne sur l'ensemble <strong>de</strong><br />
88
<strong>la</strong> France. Si à l'extrême toute <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> maïs française bascule en Bt, le ren<strong>de</strong>ment moyen en<br />
France augmente d'un peu plus <strong>de</strong> 1 qt/ha.<br />
Figure 29. Courbe <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment moyen du maïs français<br />
85.6<br />
85.4<br />
ren<strong>de</strong>ment (qtx/ha)<br />
85.2<br />
85<br />
84.8<br />
84.6<br />
84.4<br />
84.2<br />
84<br />
0 50 100 150 200 250 300 350 400<br />
Supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
<strong>Les</strong> dépenses <strong>de</strong>s agriculteurs pour contrôler <strong>la</strong> Pyrale (Figure 30) correspon<strong>de</strong>nt uniquement à <strong>de</strong>s<br />
dépenses en insectici<strong>de</strong>s lorsque le supplément <strong>de</strong> prix sur le maïs Bt est supérieur à 260 F/ha.<br />
A l'inverse, en <strong>de</strong>ssous du seuil <strong>de</strong> 250 F/ha toutes <strong>les</strong> dépenses pour contrôler <strong>la</strong> Pyrale<br />
correspon<strong>de</strong>nt aux dépenses pour payer le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence <strong>de</strong> maïs Bt. Ces dépenses<br />
sont éga<strong>les</strong> au profit réalisé par l'innovateur, car le coût marginal <strong>de</strong> production du maïs Bt est égal à<br />
celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence conventionnelle. D'après <strong>la</strong> Figure 30, le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM conduisant à<br />
maximiser le profit <strong>de</strong> l'innovateur est égal à 236 F/ha. A ce prix, le profit <strong>de</strong> l'innovateur est égal à<br />
160 millions <strong>de</strong> francs.<br />
89
Figure 30. Dépenses <strong>de</strong>s agriculteurs pour le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pyrale<br />
Dépenses en millions <strong>de</strong> francs<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Dépenses supplémentaire sur<br />
semence OGM<br />
Dépenses en insectici<strong>de</strong>s<br />
conventionnels<br />
0<br />
0 50 100 150 200 250 300 350 400<br />
Supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
La Figure 31 indique le revenu <strong>de</strong>s agriculteurs diminué <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> pyrale. Pour<br />
un supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM supérieur à 250 F/ha cette recette est stable et correspond<br />
approximativement à <strong>la</strong> situation initiale. En <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> ce seuil, <strong>la</strong> recette augmente progressivement<br />
pour <strong>de</strong>ux raisons: (i) <strong>de</strong> nouveaux départements adoptent le maïs Bt parce que celui-ci permet<br />
d'augmenter le profit <strong>de</strong>s agriculteurs, (ii) le profit <strong>de</strong>s agriculteurs qui adoptent déjà le maïs Bt<br />
augmente grâce à <strong>la</strong> baisse du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM.<br />
Figure 31. Revenu <strong>de</strong>s agriculteurs diminué <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> pyrale<br />
9550<br />
recette partielle <strong>de</strong>s agriculteurs (MF)<br />
9500<br />
9450<br />
9400<br />
9350<br />
9300<br />
9250<br />
9200<br />
0 50 100 150 200 250 300 350 400<br />
Supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM (FF/ha)<br />
90
- Le bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s gains et pertes <strong>de</strong>s différents <strong>acteurs</strong><br />
On se p<strong>la</strong>ce ici dans le cas <strong>de</strong> figure où l'innovateur choisit son prix optimal (w g =236 F/ha). A ce<br />
prix, 39% <strong>de</strong>s surfaces sont ensemencées en OGM. Il s’agit <strong>de</strong> <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s surfaces qui recevaient un<br />
traitement conventionnel (36% <strong>de</strong>s surfaces) plus 3% <strong>de</strong> surfaces qui ne recevaient pas <strong>de</strong> traitement.<br />
Dans une telle situation, <strong>la</strong> diffusion du maïs Bt conduit à un gain total <strong>de</strong> 118 MF, qui se répartit<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> manière suivante:<br />
• <strong>Les</strong> agriculteurs bénéficient d'une augmentation <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> 55 MF en gran<strong>de</strong> partie annulée<br />
par une augmentation <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> 35 MF. Leur gain total est égal à (55 - 35) = 20 MF (soit<br />
17% du gain total).<br />
• L'innovateur gagne 160 MF tandis que <strong>les</strong> fournisseurs d'insectici<strong>de</strong>s per<strong>de</strong>nt 62 MF. Le gain<br />
total <strong>de</strong>s firmes situées en amont est égal à (160 - 62) = 98 MF (soit 83 % du gain total). Le<br />
gain <strong>de</strong> l'innovateur est <strong>net</strong>tement supérieur à celui <strong>de</strong>s agriculteurs. Il se base en partie sur un<br />
transfert <strong>de</strong> bénéfices <strong>de</strong>puis <strong>les</strong> fournisseurs d'insectici<strong>de</strong>s.<br />
Tableau 15. Bi<strong>la</strong>n global <strong>de</strong>s gains liés à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong> maïs Bt (en MF)<br />
Référence avec OGM* Variation<br />
Revenu sur <strong>la</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM 0 160 +160<br />
Revenu sur <strong>les</strong> ventes d'insectici<strong>de</strong>s 62 0 -62<br />
Dépenses <strong>de</strong> agriculteurs pour contrôler <strong>la</strong> Pyrale -125 -160 -35<br />
Recettes sur <strong>les</strong> ventes <strong>de</strong> maïs 9 372 9 427 +55<br />
Gain total dans <strong>la</strong> situation avec OGM - - +118<br />
* La semence OGM est commercialisée à 236F/ha en plus par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle.<br />
<strong>Les</strong> proportions observées ici sur <strong>les</strong> gains sont <strong>net</strong>tement différentes <strong>de</strong> cel<strong>les</strong> qui ont été obtenues<br />
avec <strong>la</strong> Betterave et le Colza, le poids <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong>s agriculteurs étant <strong>net</strong>tement plus faible (17% ici au<br />
lieu <strong>de</strong> 30% à 60%plus haut). Cette propriété tient essentiellement à <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s<br />
attaques <strong>de</strong> pyrale en France (Figure 2), avec un creux dans <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s attaques pour <strong>de</strong>s<br />
niveaux situés <strong>entre</strong> 0.39 et 1 <strong>la</strong>rve par p<strong>la</strong>nte. Il en résulte (Figure 28) une zone <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> autour <strong>de</strong> 250 F/ha dans <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est très iné<strong>la</strong>stique, précédée par une zone <strong>entre</strong><br />
150 et 250 F/ha dans <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est au contraire très é<strong>la</strong>stique. Dans <strong>la</strong> zone située autour <strong>de</strong><br />
250 F/ha, le monopole est capable <strong>de</strong> s'accaparer presque <strong>la</strong> totalité du surplus parce qu'il peut<br />
augmenter son prix sans faire diminuer <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qui lui est adressée.<br />
La forme <strong>de</strong> cette courbe tient en gran<strong>de</strong> partie à <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> nos données sur <strong>les</strong> attaques <strong>de</strong><br />
pyrale. Pour compléter <strong>les</strong> données 1995-1998 fournies par <strong>la</strong> Protection <strong>de</strong>s Végétaux, le niveau<br />
d'infestation <strong>de</strong> pyrale a été fixé à 1 pour dix départements qui étaient exclus <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> PV<br />
mais pour <strong>les</strong>quels d'autres sources suggéraient <strong>de</strong>s niveaux d'infestation voisins <strong>de</strong> 1 (voir annexe B).<br />
Ceci explique le pic <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s attaques autour d'une <strong>la</strong>rve par p<strong>la</strong>nte. Cette hypothèse forte<br />
n'est évi<strong>de</strong>mment pas satisfaisante, mais il n'est pas satisfaisant non plus d'exclure <strong>de</strong> l'analyse dix<br />
91
départements pour <strong>les</strong>quels il est connu que l'infestation <strong>de</strong> pyrale est importante. Pour poursuivre ces<br />
travaux, une investigation plus poussée <strong>de</strong>s données existantes <strong>de</strong>vrait être menée. En l'état actuel, il<br />
convient <strong>de</strong> retenir que <strong>la</strong> différence par rapport aux cas du colza et <strong>de</strong> <strong>la</strong> betterave tient en partie aux<br />
données. Compte tenu <strong>de</strong>s limites sur ces données, il nous a semblé préférable <strong>de</strong> conduire l'analyse <strong>de</strong><br />
sensibilité uniquement sur <strong>les</strong> seuils d'adoption, qui ne dépen<strong>de</strong>nt pas <strong>de</strong>s données sur <strong>la</strong> distribution<br />
<strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> pyrale en France dont nous venons <strong>de</strong> voir <strong>les</strong> limites.<br />
Conclusion<br />
- Rappel <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong><br />
Ce chapitre fournit <strong>de</strong>s éléments d'évaluation <strong>de</strong>s gains qui pourraient être tirés <strong>de</strong> l'utilisation <strong>de</strong>s<br />
OGM en France et <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> ces gains <strong>entre</strong> agriculteurs et industries d'amont. Par<br />
construction, l'analyse conduite ici est faite ex ante. Elle est donc basée sur <strong>de</strong>s hypothèses a priori sur<br />
le comportement d'adoption <strong>de</strong>s agriculteurs. On peut rappeler ici brièvement <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> utilisée.<br />
• Pour étudier le cas <strong>de</strong>s variétés HT (colza et betterave), nous avons utilisé <strong>de</strong>s données sur <strong>les</strong><br />
dépenses réel<strong>les</strong> <strong>de</strong> désherbage, qui incluent <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s utilisés et une estimation <strong>de</strong>s<br />
coûts <strong>de</strong> passage <strong>de</strong> traitement. Nous avons supposé que si une variété OGM était introduite, elle<br />
serait adoptée par l'agriculteur s'il réalisait une certaine économie sur ses dépenses <strong>de</strong> désherbage<br />
(en incluant le supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM).<br />
• Pour étudier le cas <strong>de</strong>s variétés IR (maïs), nous avons utilisé <strong>de</strong>s données sur <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s<br />
attaques <strong>de</strong> pyrale en France sur plusieurs années. Nous avons fait <strong>de</strong>s hypothèses sur <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong><br />
ren<strong>de</strong>ment dues à <strong>la</strong> pyrale et sur <strong>la</strong> protection apportée par un traitement insectici<strong>de</strong> ou une<br />
semence OGM apportant une résistance à l'insecte. Nous avons supposé que si une variété OGM<br />
était introduite, l'agriculteur l'adopterait s'il obtenait une certaine augmentation <strong>de</strong> son profit.<br />
Ces hypothèses permettent <strong>de</strong> définir <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s agriculteurs en semence OGM en fonction du<br />
supplément <strong>de</strong> prix sur <strong>la</strong> semence OGM par rapport à <strong>la</strong> semence conventionnelle. L'étape suivante<br />
consiste à calculer le profit dégagé par <strong>la</strong> firme qui commercialise l'OGM et en déduire le niveau<br />
optimal <strong>de</strong> tarification <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM.<br />
Un intérêt <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est <strong>de</strong> se baser sur <strong>de</strong>s données qui reflètent l'hétérogénéité <strong>de</strong>s problèmes<br />
<strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes et <strong>de</strong>s coûts phytosanitaires, donc l'hétérogénéité <strong>de</strong>s gains potentiels liés aux<br />
OGM pour <strong>les</strong> agriculteurs.<br />
- Rappel <strong>de</strong>s résultats<br />
<strong>Les</strong> résultats qui sont rappelés ici correspon<strong>de</strong>nt à une tarification optimale <strong>de</strong> <strong>la</strong> part d'un<br />
innovateur en situation <strong>de</strong> monopole. <strong>Les</strong> simu<strong>la</strong>tions montrent que <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong> diffusion atteints<br />
pour le colza et <strong>la</strong> betterave HT sont <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 70%, alors qu'ils sont <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 40% pour le maïs<br />
92
Bt. Une telle diffusion conduit à <strong>de</strong>s chutes <strong>de</strong> ventes <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels supérieures à 80%<br />
dans tous <strong>les</strong> cas <strong>de</strong> figure. Enfin, <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM conduit à un gain total sur l'ensemble <strong>de</strong>s<br />
<strong>acteurs</strong> toujours positif. Ces premiers résultats se sont avérés robustes lorsqu'on analyse <strong>la</strong> sensibilité<br />
<strong>de</strong>s résultats à un certain nombre <strong>de</strong> paramètres.<br />
La diffusion <strong>de</strong>s OGM conduit à un gain social annuel <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 240 MF pour le colza HT,<br />
120 MF pour <strong>la</strong> betterave HT et 120 MF pour le maïs Bt (cette estimation n'inclut pas <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong><br />
recherche et développement sur l'innovation OGM). Ce gain social dépend du taux <strong>de</strong> marge réalisé au<br />
départ sur <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels. Plus ce taux est faible, plus <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong> bénéfices <strong>de</strong>s<br />
fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels sont faib<strong>les</strong> et plus le gain total est élevé. <strong>Les</strong> chiffre<br />
indiqués ici sont basés sur une hypothèse <strong>de</strong> taux <strong>de</strong> marges assez élevé (50%) et peuvent donc être<br />
considérés comme <strong>de</strong>s valeurs p<strong>la</strong>nchers.<br />
Lorsque le partage <strong>de</strong>s gains est analysé, le même résultat qualitatif est observé dans <strong>les</strong> différents<br />
cas <strong>de</strong> figure: <strong>les</strong> agriculteurs et l'innovateur qui propose <strong>la</strong> solution OGM enregistrent un gain positif,<br />
et alors que <strong>les</strong> firmes qui commercialisent <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels subissent <strong>de</strong>s pertes. En<br />
revanche, <strong>les</strong> proportions observées sont variab<strong>les</strong> d'une simu<strong>la</strong>tion à l'autre. Qualitativement, si le<br />
contexte est plus difficile pour <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM, le prix optimal <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM pour<br />
l'innovateur diminue, si bien que le gain <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier diminue et le gain <strong>de</strong>s agriculteurs augmente. Ce<br />
cas <strong>de</strong> figure se produit lorsque le gain minimal pour qu'un agriculteur adopte <strong>les</strong> OGM augmente, ou<br />
lorsque <strong>les</strong> firmes proposant <strong>les</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels baissent leurs prix. En ordre <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur, le<br />
gain maximum <strong>de</strong>s innovateurs est 20% supérieur au gain total. Ce résultat signifie qu'une <strong>la</strong>rge part<br />
<strong>de</strong> ce gain est réalisé aux dépends <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> pestici<strong>de</strong>s conventionnels. Du côté <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs, le gain minimum est égal à 20%-30% du gain total.<br />
- Limites et extensions <strong>possib<strong>les</strong></strong><br />
Plusieurs directions peuvent être suggérées pour poursuivre l'analyse qui est faite ici.<br />
1) Dans le cas du colza et <strong>de</strong> <strong>la</strong> betterave HT, <strong>les</strong> résultats sont basés sur une année d'enquête sur <strong>les</strong><br />
pratiques <strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s agriculteurs. Il faudrait vérifier <strong>la</strong> robustesse <strong>de</strong> ces résultats étendant<br />
l'étu<strong>de</strong> à d'autres années. Il serait intéressant également <strong>de</strong> réaliser une étu<strong>de</strong> du même type dans le cas<br />
du maïs HT. Dans le cas du maïs Bt, <strong>les</strong> données utilisées sur <strong>les</strong> attaques <strong>de</strong> pyrale portent sur<br />
plusieurs années mais certaines zones ne sont pas couvertes tous <strong>les</strong> ans. De plus, <strong>les</strong> attaques <strong>de</strong><br />
sésamie ne sont pas prises en compte. Il serait important <strong>de</strong> compléter <strong>les</strong> données utilisées dans <strong>la</strong><br />
mesure du possible.<br />
2) <strong>Les</strong> résultats présentés dans ce chapitre correspon<strong>de</strong>nt à une tarification optimale <strong>de</strong> <strong>la</strong> part d'un<br />
innovateur en situation <strong>de</strong> monopole. Il serait intéressant d'étendre l'analyse au cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> tarification<br />
qui serait fixée par plusieurs innovateurs en situation <strong>de</strong> concurrence imparfaite. En effet, plusieurs<br />
événements sont aujourd'hui disponib<strong>les</strong> sur le marché dans tous <strong>les</strong> cas <strong>de</strong> figure (RoundupReady et<br />
LibertyLink dans le cas HT; Bt11, Bt176 et Mon810 dans le cas du maïs Bt).<br />
93
3) <strong>Les</strong> prix <strong>de</strong>s produits agrico<strong>les</strong> sont supposés constants dans ce chapitre. En réalité, <strong>les</strong> gains <strong>de</strong><br />
productivité attendus <strong>de</strong>vraient conduire une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production et donc une baisse <strong>de</strong> prix.<br />
Cette <strong>de</strong>rnière conduirait alors à un transfert <strong>de</strong> surplus <strong>de</strong>puis l'agriculteur vers <strong>les</strong> <strong>entre</strong>prises situées<br />
en aval. Ce phénomène conduirait également à une diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> adressée aux industries<br />
amont, et donc à une baisse <strong>de</strong> prix optimal <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM pour l'innovateur. Rappelons à ce<br />
titre que nous avons pu voir avec le modèle du chapitre 2 (section 3) que <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s inputs à<br />
l'équilibre sont toujours proportionnels au prix <strong>de</strong> l'output agricole. On peut penser que le gain global<br />
sur l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière <strong>de</strong>vrait rester sensiblement le même, <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> prix affectant<br />
principalement <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> gains <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents types d'<strong>acteurs</strong>. Pour étudier cette question<br />
plus en détail, il serait nécessaire d'intégrer <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong> ce chapitre dans un modèle d'équilibre à<br />
plusieurs marchés liés verticalement.<br />
4) <strong>Les</strong> estimations réalisées ici ne prennent pas en compte l'accroissement du coût lié à une<br />
ségrégation <strong>de</strong>s filières OGM et non-OGM, qui conduit à une baisse du gain total lié à l'introduction<br />
<strong>de</strong>s OGM. En théorie, rien n'empêche même que ce gain total soit négatif. Là encore, le partage <strong>de</strong>s<br />
gains ou pertes <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong> se trouverait affecté. Il est néanmoins difficile <strong>de</strong> savoir a<br />
priori l'acteur qui subirait <strong>les</strong> pertes <strong>les</strong> plus importantes.<br />
5) On considère ici trois types <strong>de</strong> gains que <strong>les</strong> agriculteurs peuvent obtenir en adoptant <strong>de</strong>s OGM HT<br />
ou IR : une diminution du prix <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s, une diminution du coût <strong>de</strong>s passages <strong>de</strong> traitements<br />
phytosanitaires, éventuellement une augmentation du ren<strong>de</strong>ment (cas IR). <strong>Les</strong> étu<strong>de</strong>s menées dans <strong>les</strong><br />
pays où <strong>les</strong> OGM agronomiques sont déjà adoptés suggèrent d'autres f<strong>acteurs</strong> <strong>de</strong> gain pour <strong>les</strong><br />
agriculteurs. Ainsi, d'après Phillips (2000), dans le cas du colza HT au Canada, <strong>les</strong> agriculteurs<br />
obtiennent un meilleur prix pour du colza HT parce que <strong>les</strong> récoltes sont plus propres. De plus, ils<br />
peuvent semer le colza plus tôt, donc obtenir un meilleur ren<strong>de</strong>ment, parce qu'il est possible<br />
d'appliquer l'herbici<strong>de</strong> après l'émergence. Dans une étu<strong>de</strong> sur le soja HT aux Etats-Unis, Bullock et<br />
Nitsi (2001) concluent que <strong>les</strong> économies <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> désherbage ne semblent pas suffisantes pour<br />
compenser le surcoût <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM pour tous <strong>les</strong> agriculteurs qui adoptent. Ils concluent que<br />
d'autres f<strong>acteurs</strong> tels que <strong>la</strong> "facilité d'utilisation" et <strong>la</strong> "diminution du risque" conduisent à <strong>de</strong>s<br />
économies <strong>de</strong> coût non négligeab<strong>les</strong> pour beaucoup d'agriculteurs. Il serait intéressant <strong>de</strong> tenter <strong>de</strong><br />
chiffrer <strong>les</strong> gains qui pourraient être apportés par ces différents f<strong>acteurs</strong> dans le cas français, et<br />
d'étudier dans quelle mesure ils modifient <strong>les</strong> résultats obtenus ici ex ante sur le choix d'adoption <strong>de</strong>s<br />
agriculteurs.<br />
94
Références<br />
Bullock, D. S., Nitsi., E. I. (2001). Roundup ready soybean technology and farm production<br />
costs : measuring the incentive to adopt. American Behavioral Scientist 44, 1283-<br />
1301.<br />
CETIOM (2000). Introduction <strong>de</strong> variétés génétiquement modifiées <strong>de</strong> colza tolérantes à<br />
différents herbici<strong>de</strong>s dans le système <strong>de</strong> l'agriculture française: Evaluation <strong>de</strong>s<br />
impacts agro-environnementaux et é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> scénarios <strong>de</strong> gestion. Rapport.<br />
CETIOM, France.<br />
Hy<strong>de</strong>, J., Martin, M. A., Preckel, P. V. and Edwards, C. R. (1999), The economics of Bt corn:<br />
valuing protection from the European Corn Borer. Review of Agricultural Economics,<br />
21(2).<br />
Marra, M., Carlson, G. and Hubbell, B. (1998). Economic impacts of the first crop<br />
biotechnologies.,, North Carolina State University,<br />
http://www.ag-econ.ncsu.edu/faculty/marra/FirstCrop/sld001.htm.<br />
Nelson, G.G., Josling, T., Bullock, D.S., Rosegrant, M., Hill, L. (1999). The economics and<br />
politics of ge<strong>net</strong>ically modified organismes in agriculture : implications for WTO 2000.<br />
Bulletin 809, College of Agricultural, Consumer and Environemental Sicences,<br />
University of Illinois at Urbana-Champaign, 119 p.<br />
http://web.aces.uiuc.edu/wf/GMO/GMO.pdf.<br />
Ostlie, K. R., Hutchison, W. D. and Hellmich, R. L. (1997). Bt Corn and European Corn<br />
Borers: long term success through resistance management. North Central Regional<br />
Extension publication, NCR602, University of Minnesota.<br />
http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/DC7055.html.<br />
Phillips, P.W.B. (2000). The economic impact of herbici<strong>de</strong> tolerant cano<strong>la</strong> in Canada.<br />
Document <strong>de</strong> travail, université <strong>de</strong> Saskatchewan, Canada.<br />
Vo<strong>la</strong>n, S. (2000). Introduction <strong>de</strong> variétés <strong>de</strong> maïs transgéniques : évaluation <strong>de</strong>s impacts<br />
agro-environnementaux; Mise en p<strong>la</strong>ce d'un système <strong>de</strong> bio vigi<strong>la</strong>nce. Synthèse <strong>de</strong>s<br />
données scientifiques et techniques sur le maïs génétiquement modifié. Document<br />
interne AGPM, 134 p.<br />
95
Annexe A. Informations sur <strong>les</strong> données brutes utilisées pour <strong>les</strong><br />
simu<strong>la</strong>tions sur le Colza HT<br />
A l’origine : 2223 fiches d’enquêtes ; 1296 exploitations (927 font du colza alimentaire et<br />
énergétique, 369 font un seul <strong>de</strong>s 2 types)<br />
A.1. Nettoyage <strong>de</strong> <strong>la</strong> base :<br />
• Suppression d’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux enregistrements pour <strong>les</strong> 927 exploitations enregistrées en double, le<br />
ren<strong>de</strong>ment conservé est celui du colza alimentaire (recodage en AE)<br />
• Suppression d’un enregistrements car un seul produit utilisé (CALI) correspondant à un fongici<strong>de</strong><br />
• Suppression <strong>de</strong> 6 enregistrements car le produit 4 (ROUN,GLYP,ACTI, ALTI, KARM,PILA)<br />
n’est pas comptabilisé dans le calcul du coût<br />
• Suppression <strong>de</strong> 13 enregistrements avec surface en colza = 0<br />
• Suppression <strong>de</strong> 29 enregistrements avec coût <strong>de</strong> désherbage non renseigné à cause <strong>de</strong> doses<br />
manquantes<br />
• Suppression <strong>de</strong> 9 enregistrements avec coût <strong>de</strong> désherbage =0<br />
• 7 remp<strong>la</strong>cements du nom <strong>de</strong> produit NAPR par DEVR, 11 remp<strong>la</strong>cements <strong>de</strong> TRIF par TREF, 2<br />
remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> COLD par COZA.<br />
• Modification <strong>de</strong> 2 exploitations avec <strong>de</strong>s surfaces en colza sup. à 800ha. On fixe cette surface à<br />
205ha<br />
• Modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> dose <strong>de</strong> TARGA D+ <strong>de</strong> 2l/ha à <strong>la</strong> dose généralement utilisé <strong>de</strong> 0,5l/ha <strong>de</strong><br />
l’exploitation ayant le coût <strong>de</strong> désherbage traditionnel le plus élevé.<br />
• Changement <strong>de</strong> <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s prix utilisés dans l’enquête qui correspon<strong>de</strong>nt plus à <strong>de</strong>s prix va<strong>la</strong>ble<br />
en 1997. Remp<strong>la</strong>cement par <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s mentionnés dans <strong>la</strong> « brochure colza 99 » du<br />
Cetiom, ou si manquants, par <strong>les</strong> prix inspirés <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>x Teyssier.<br />
58 enregistrements sont donc supprimés en plus <strong>de</strong>s doublons par rapport à <strong>la</strong> base d’origine.<br />
L’échantillon est donc constitué <strong>de</strong> 1238 exploitations.<br />
A.2. Problème du prix <strong>de</strong>s produits :<br />
<strong>Les</strong> prix utilisés à l’origine dans l’enquête correspon<strong>de</strong>nt en fait à <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> 1997. <strong>Les</strong> écarts avec<br />
<strong>les</strong> prix actuels nous semb<strong>la</strong>nt important sur certains produits, nous avons choisi <strong>de</strong> recalculer <strong>les</strong> coûts<br />
<strong>de</strong> désherbage <strong>de</strong>s exploitation avec <strong>les</strong> prix en cours en 1999 à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> « brochure colza 99 » du<br />
Cetiom (cf. Annexe 1). Lorsque ceux-ci ne figuraient pas dans <strong>la</strong> brochure, <strong>les</strong> prix <strong>de</strong> l’enquête ont été<br />
conservé s’ils semb<strong>la</strong>ient cohérent avec <strong>les</strong> prix figurant dans l’in<strong>de</strong>x Teyssier <strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong>s normes<br />
agrico<strong>les</strong>.<br />
96
Tableau A.1. Prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s<br />
Nom commercial Firmes Matière active Prix dans l’enquête<br />
F/l ou kg<br />
Prix brochure<br />
Colza 99<br />
F/l ou kg<br />
Prix Teyssier<br />
97/98-99/00<br />
F HT/l ou kg<br />
Prix utilisé dans nos<br />
traitements<br />
F/l ou kg<br />
Colzor Evolya Tébutame + clomazone 98 98-100 95-94 99<br />
Butisan S BASF Métazachlore 360 232-236 220-247 234<br />
Novall<br />
BASF<br />
Métazachlore +<br />
quinmérac<br />
236 248-252 238-245 250<br />
Tréf<strong>la</strong>n Dow AgroSciences trifluraline 26 24-32 28-28 28<br />
Devrinol Rhône-Poulenc Napropami<strong>de</strong> 170 122-191 160-142 170<br />
Fusi<strong>la</strong><strong>de</strong> X2 Sopra fluazifop-p-butyl 450 350-367* 470-395 358<br />
Pilot Phi<strong>la</strong>gro Quizalofop éthyl D 220 217 230-240 221<br />
Targa D+ Rhône-poulenc Quizalofop éthyl D 540 600-620* 540-512 610<br />
Stratos Ultra BASF Cycloxydime 145 135-140 142-150 137<br />
Eloge Bayer Agro Haloxyfop R 500 500-520 498-505 510<br />
Agil Evolya Propaquizafop 280 337-350 294-275 344<br />
Brassix Sipcam-Phyteurop Trifluraline 26 24-32 -27 28<br />
Cent 7 Dow AgroSciences Isoxaben 200 200-225 232-220 212<br />
Pradone TS Rhône-poulenc<br />
Carbétami<strong>de</strong> +<br />
diméfuron<br />
140 165-167 167-170 166<br />
Lontrel Dow AgroSciences Clopyralid 370 340-350 410-380 345<br />
Quartz<br />
Rhône-poulenc<br />
Diflufénicanil +<br />
isoproturon<br />
120 132-128 120<br />
Légurame PM Rhône-poulenc Carbétami<strong>de</strong> 97 103-107 112-108 105<br />
Chrono Dow AgroSciences Pyridate + piclorame 170 176-184 -195 180<br />
Colzamid RP Leadagro Napronami<strong>de</strong> 155 122-191 - 170<br />
Kerb Flo AgrEvo Propyzami<strong>de</strong> 250 258-267 263-250 262<br />
Tichrey Makhteshim Trifluraline 26 24-32 - 28<br />
Sting ST Monsanto Glyphosate 31 - 31<br />
Cetrelex Sipcam-Phyteurop Trifluraline 26 24-32 - 28<br />
Isoproturon Isoproturon 41 41<br />
Zodiac TX<br />
Diflufénicanil +<br />
isoproturon<br />
186 202-200 186<br />
Karmex DuPont Diuron 60 60-58 60<br />
97
A.3. Pondération <strong>de</strong> l’échantillon :<br />
L’objectif est que notre échantillon soit le plus représentatif possible <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture du<br />
colza en France. On ne s’intéresse pas ici à <strong>la</strong> distinction <strong>entre</strong> colza alimentaire et énergétique car<br />
l’enquête indique que <strong>les</strong> pratiques <strong>de</strong> désherbage sont strictement i<strong>de</strong>ntiques <strong>entre</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong><br />
culture. Nous ne pouvons pas non plus réutiliser directement <strong>les</strong> coefficients pondérateurs utilisés par<br />
le Cétiom du fait <strong>de</strong>s exploitations que nous avons éliminées <strong>de</strong> l’enquête <strong>de</strong> départ.<br />
Nous disposons <strong>de</strong> résultats <strong>de</strong> l’enquête structure du SCEES <strong>de</strong> 1997 qui nous donne <strong>la</strong> répartition<br />
<strong>de</strong>s surfaces en colza par département et par c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> taille ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface totale en colza en<br />
1999 issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique agricole annuelle du SCEES (1 369 000 ha).<br />
Chaque exploitation se voit donc attribuée une nouvelle surface <strong>de</strong> manière à ce que soit respectée<br />
<strong>la</strong> représentativité départementale et par c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> taille <strong>de</strong> l’enquête structure et que <strong>la</strong> nouvelle<br />
surface cumulée <strong>de</strong>s exploitations <strong>de</strong> l’échantillon soit égale à <strong>la</strong> surface totale en colza en 1999.<br />
Ainsi, pour <strong>les</strong> départements ayant suffisamment d’exploitations enquêtées dans chaque c<strong>la</strong>sse,<br />
celle-ci est prise en compte dans <strong>la</strong> pondération. Pour ceux où <strong>la</strong> représentativité est jugée insuffisante,<br />
on ignore ce critère <strong>de</strong> pondération afin <strong>de</strong> ne pas créer <strong>de</strong> biais artificiel. <strong>Les</strong> départements ayant très<br />
peu d’exploitations enquêtées sont regroupés avec un ou plusieurs voisins <strong>de</strong> même spécificité<br />
géographique afin d’avoir une représentation plus juste non pas du département mais <strong>de</strong> l’ensemble<br />
géographique en question. Enfin, 25 départements n’ont aucune exploitation enquêté et ne sont donc<br />
pas pris en compte dans cette étu<strong>de</strong> (cf. Annexe 2). Cependant, afin d’avoir <strong>de</strong>s résultats censés<br />
représenter <strong>la</strong> situation française, <strong>la</strong> surface globale <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> est bien <strong>la</strong> surface totale <strong>de</strong> colza en<br />
France incluant <strong>les</strong> superficies éventuellement ensemencées dans ces départements. <strong>Les</strong> autres<br />
départements sont donc sur-pondérés pour compenser l’absence <strong>de</strong> donnée.<br />
Au final, nous travaillons sur l’échantillon suivant :<br />
Avant pondération<br />
Après pondération<br />
1 238 exploitations<br />
32 737 ha <strong>de</strong> colza 1 369 000 ha <strong>de</strong> colza<br />
18, 2 MF <strong>de</strong> dépenses <strong>de</strong> désherbage 748, 5 MF <strong>de</strong> dépenses <strong>de</strong> désherbage<br />
547 F/ha <strong>de</strong> coût moyen <strong>de</strong> désherbage<br />
En première analyse <strong>de</strong> nos données on peut dire que désormais <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> désherbages<br />
s’échelonnent <strong>de</strong> 56 F/ha à 1 235 F/ha. <strong>Les</strong> 9 principaux programmes <strong>de</strong> désherbage (cf. Annexe 3)<br />
représentent 30% <strong>de</strong>s exploitations en nombre et 24% <strong>de</strong>s surfaces. Ce sont <strong>de</strong>s traitements réalisés<br />
soit à base <strong>de</strong> trifluraline en présemis suivi ou non d’un traitement <strong>de</strong> prélevée (type Butisan, Devrinol<br />
ou Colzor) ou bien <strong>de</strong>s traitements avec seulement le produit Colzor appliqué en prélevée en un seul<br />
passage.<br />
98
Figure A.1. Situation et représentativité <strong>de</strong>s exploitations <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
dpts représentés avec prise en compte <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> taille (32)<br />
dpts représentés sans prise en compte <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> taille (16)<br />
dpts regroupés (23)<br />
dpts non représentés (25)<br />
Départements avec prise en compte <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> taille :<br />
01, 02, 03, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 41, 45, 51, 52, 55, 57, 60, 65, 67, 72, 76, 79, 80,<br />
86, 89<br />
Départements sans prise en compte <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> taille :<br />
07, 08, 24, 26, 39, 47, 49, 53, 54, 58, 61, 63, 68, 69, 71, 81<br />
Départements regroupés :<br />
04, 05 et 38 (partie <strong>de</strong>s Alpes) ; 11, 30 et 34 (partie du Languedoc Roussillon); 35 et 50 (Manche-Ille-et-<br />
Vi<strong>la</strong>ine)) ; 44 et 85 (Loire-At<strong>la</strong>ntique-Vendée); 46 et 82 (Lot et Tarn et Garonne) ; 59 et 62 (Nord-Pas-<strong>de</strong>-<br />
Ca<strong>la</strong>is), 70 et 88 (Haute-Saône-Vosges); 77, 78, 91, 94 et 95 (partie d’Ile <strong>de</strong> france); 83 et 84 (Var-Vaucluse).<br />
Départements non représentés :<br />
06, 12, 15, 19, 2A, 2B, 22, 23, 29, 33, 40, 42, 43, 48, 56, 64, 66, 73, 74, 75, 87, 90, 92, 93<br />
99
Annexe B - <strong>Les</strong> données utilisées<br />
Nous utilisons quatre sources pour construire notre base <strong>de</strong> données sur <strong>les</strong> infestations moyennes<br />
<strong>de</strong> pyra<strong>les</strong> par département :<br />
- <strong>Les</strong> surfaces considérées sont <strong>les</strong> surfaces départementa<strong>les</strong> moyennes <strong>de</strong> maïs grain sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
1995-1998 (source : Statistique Agricole Annuelle du SCEES).<br />
- Guy Le Hénaff, du Service Régional <strong>de</strong> <strong>la</strong> Protection <strong>de</strong>s Végétaux (SRPV, Ministère <strong>de</strong><br />
l'Agriculture), Nancy, nous a fourni <strong>de</strong>s informations sur <strong>les</strong> niveaux moyens d’infestation par<br />
département pour <strong>les</strong> années 1995, 1996, 1997 et 1998. Au total, 50 départements sont informés au<br />
moins sur une <strong>de</strong>s quatre années. Ces 50 départements représentent 945 366 hectares <strong>de</strong> maïs<br />
grain, soit 55 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface nationale <strong>de</strong> maïs grain, en moyenne sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1995-1998. Ces<br />
données sont issues d’enquêtes <strong>de</strong> terrain et <strong>de</strong> comptages sur <strong>de</strong>s parcel<strong>les</strong> réalisées par <strong>la</strong><br />
Protection <strong>de</strong>s Végétaux. Il s’agit <strong>de</strong>s données <strong>les</strong> plus précises qui soient disponib<strong>les</strong>. Cependant,<br />
ces données sont incomplètes. De plus, <strong>les</strong> données disponib<strong>les</strong> n'offrent pas toutes le même<br />
niveau <strong>de</strong> précision, certaines régions pouvant avoir <strong>de</strong> très nombreuses parcel<strong>les</strong> visitées par <strong>de</strong>s<br />
enquêteurs et d’autres aucune. Ainsi, <strong>la</strong> Lorraine est renseignée sur <strong>les</strong> quatre années avec 250 à<br />
300 parcel<strong>les</strong> visitées chaque année, alors qu'il n'y a aucune information sur le Sud Est <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
France et <strong>la</strong> région Rhône-Alpes. Il y a également très peu d’informations sur le sud-Ouest où <strong>les</strong><br />
problèmes <strong>de</strong> pyrale sont plutôt gérés par l’Association Générale <strong>de</strong>s Producteurs <strong>de</strong> Maïs<br />
(AGPM) ou <strong>les</strong> groupements <strong>de</strong> producteurs <strong>de</strong> maïs.<br />
- Ces informations sont complétées par <strong>la</strong> carte d’infestation pyrale du maïs <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne 1999<br />
réalisée par le SRPV. Cette carte présente <strong>de</strong>s infestations <strong>de</strong> pyrale supérieures à une <strong>la</strong>rve par<br />
p<strong>la</strong>nte dans <strong>les</strong> départements du Sud-Ouest. Cette information est corroboré par Guy Le Hénaff<br />
selon qui <strong>les</strong> problèmes liés à <strong>la</strong> pyrale bivoltine sont croissants et sérieux dans le Sud-Ouest<br />
<strong>de</strong>puis 1997. La raison en est imputable à l’usage massif d’insectici<strong>de</strong>s génériques<br />
(pyréthrinoi<strong>de</strong>s) contre le complexe sésamie-pyrale, qui a pour effet pervers <strong>de</strong> réduire <strong>les</strong> espèces<br />
auxiliaires qui sont <strong>les</strong> prédateurs naturels <strong>de</strong> ces insectes. Ainsi on pose un indicateur<br />
d’infestation égal à 1 pour <strong>les</strong> départements concernés et sur <strong>les</strong>quels il n’y a pas d’information<br />
dans <strong>les</strong> données SRPV 1995-1998.<br />
- La <strong>de</strong>rnière source utilisée est le rapport réalisé par Sandrine Vo<strong>la</strong>n pour l'AGPM (2000). Selon ce<br />
rapport, le seuil d’infestation <strong>de</strong> pyrale au <strong>de</strong>là duquel il est utile <strong>de</strong> traiter est <strong>de</strong> 0,8 <strong>la</strong>rves par<br />
p<strong>la</strong>ntes, et 450 000 hectares seraient traités contre <strong>la</strong> pyrale en France. Deux régions sont<br />
distinguées : l’Aquitaine (départements 24, 33, 40, 47 et 64) où l’infestation a été jugée supérieure<br />
à 0,8 chaque année <strong>de</strong> 1995 à 1999 sauf en 1997, et le Sud du bassin parisien (départements 28,<br />
41, 45 et 77) où le seuil d’infestation a été supérieur à 0,8 en 1995 uniquement mais où <strong>les</strong> gens<br />
continuent à traiter. On complète ainsi <strong>les</strong> données en posant une infestation au moins égale à 1<br />
100
pour <strong>les</strong> départements d’Aquitaine et une infestation présente mais inférieure à 0,8 sur le Sud du<br />
bassin parisien.<br />
Finalement, nous obtenons 61 départements renseignés couvrant 1 499 611 hectares, soit 87,6 % <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> surface en maïs grain française, en moyenne annuelle sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1995-1998.<br />
Moyenne France 1995-1998 Moyenne <strong>de</strong>s départements<br />
renseignés 1995-1998<br />
Superficie en maïs grain (ha) 1 712 735 1 499 611<br />
Ren<strong>de</strong>ment moyen (qt/ha) 85,4 85,5<br />
101
Tableau 16. Détail <strong>de</strong>s données départementa<strong>les</strong> utilisées pour <strong>la</strong> projection <strong>de</strong>s effets du maïs Bt<br />
en France<br />
Département<br />
Ren<strong>de</strong>ment<br />
(wt/ha)<br />
Surface en<br />
maïs grain<br />
(ha)<br />
Indice<br />
infestation<br />
nb. données<br />
PV<br />
Département<br />
Ren<strong>de</strong>ment<br />
(wt/ha)<br />
Surface en<br />
maïs grain<br />
(ha)<br />
Indice<br />
infestation<br />
nb données<br />
PV<br />
31 Haute-Garonne 83 36 588 3.08 1 90 T <strong>de</strong> Belfort 78 1 888 0.27 2<br />
39 Jura 84 11 038 1.19 4 86 Vienne 87 43 150 0.27 3<br />
3 Allier 83 20 000 1.08 4 80 Somme 85 4 088 0.25 2<br />
9 Ariège 77 8 600 1.00 * 0 52 Haute-Marne 68 6 625 0.24 1<br />
11 Au<strong>de</strong> 73 1 800 1.00 * 0 55 Meuse 74 8 750 0.23 4<br />
24 Dordogne 71 42 920 1.00 ** 0 8 Ar<strong>de</strong>nnes 85 10 250 0.22 3<br />
32 Gers 89 69 310 1.00 * 0 25 Doubs 83 3 200 0.22 4<br />
33 Giron<strong>de</strong> 90 40 470 1.00 ** 0 51 Marne 83 18 500 0.21 3<br />
40 Lan<strong>de</strong>s 99 134 950 1.00 * 0 88 Vosges 64 575 0.19 4<br />
47 Lot-et-Garonne 86 69 000 1.00 * 0 68 Haut-Rhin 97 59 125 0.19 2<br />
64 Pyrénées-Atl. 86 92 675 1.00 ** 0 85 Vendée 88 33 003 0.19 2<br />
65 Hautes-Pyrénées 90 40 595 1.00 * 0 54 M et Moselle 71 2 500 0.18 4<br />
82 Tarn-et-Garonne 92 30 675 1.00 * 0 57 Moselle 68 2 625 0.16 4<br />
45 Loiret 88 40 750 0.88 2 10 Aube 76 14 375 0.16 2<br />
15 Cantal 100 95 0.69 3 17 Charente Mar 95 65 693 0.15 3<br />
37 Indre-et-Loire 71 26 625 0.64 3 56 Morbihan 67 29 625 0.15 2<br />
49 Maine-et-Loire 69 28 050 0.64 2 50 Manche 86 3 725 0.12 1<br />
27 Eure 79 4 625 0.62 3 36 Indre 79 11 000 0.10 2<br />
71 Saône-et-Loire 78 27 500 0.60 1 67 Bas-Rhin 93 73 150 0.10 2<br />
16 Charente 84 45 540 0.57 3 76 Seine-Maritime 82 2 100 0.07 3<br />
63 Puy <strong>de</strong> dôme 84 14 150 0.52 1 14 Calvados 78 3 525 0.05 1<br />
60 Oise 84 12 750 0.51 3 35 Ille-et-Vi<strong>la</strong>ine 77 34 000 0.03 3<br />
41 Loir-et-Cher 88 16 560 0.45 ** 2 18 Cher 81 23 975 0.03 1<br />
70 Haute-Saône 82 11 163 0.44 4 22 Côtes-d’Armor 80 27 900 0.03 2<br />
61 Orne 73 6 000 0.40 2 43 Haute-Loire 88 175 0.02 2<br />
2 Aisne 83 15 250 0.38 2 58 Nièvre 81 7 250 0.02 1<br />
53 Mayenne 65 5 375 0.38 2 29 Finistère 73 30 750 0.00 1<br />
77 Seine-et-Marne 85 23 250 0.34 ** 0 44 Loire-Atl. 70 7 375 0.00 1<br />
28 Eure-et-Loir 100 24 000 0.34 2 59 Nord 85 7 300 0.00 2<br />
79 Deux-Sèvres 91 22 238 0.30 3 62 Pas-<strong>de</strong>-Ca<strong>la</strong>is 82 1 000 0.00 2<br />
72 Sarthe 74 39 875 0.29 2 Dpt non rens 85 213 124 <br />
Le ren<strong>de</strong>ment et <strong>la</strong> surface correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s moyennes <strong>entre</strong> 1995 et 1998 (source SCEES). La colonne "Nb<br />
données PV" indique le nombre d'années <strong>entre</strong> 1995 et 1998 pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>la</strong> Protection <strong>de</strong>s Végétaux a pu<br />
fournir <strong>de</strong>s données.<br />
* Estimation établie à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> SRPV pour 1999. ** Estimation établie à partir du AGPM (Vo<strong>la</strong>n 2001).<br />
102
Chapitre 3.<br />
Evaluation ex ante <strong>de</strong>s coûts potentiels en<br />
cas <strong>de</strong> coexistence OGM / non OGM en<br />
France<br />
Marion Desquilbet<br />
avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> David S. Bullock<br />
1
Introduction<br />
Ce chapitre est divisé en <strong>de</strong>ux parties. La première partie présente une <strong>de</strong>scription qualitative <strong>de</strong>s<br />
coûts actuels pour le non OGM certifié et <strong>de</strong>s coûts que l'on peut anticiper en cas <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s<br />
OGMs en France avec coexistence <strong>de</strong> filières avec OGM et non OGM. La secon<strong>de</strong> partie présente un<br />
modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion sur l'introduction <strong>de</strong>s OGMs au niveau <strong>de</strong> l'Union Européenne avec <strong>de</strong>ux filières<br />
séparées, avec OGM et non OGM.<br />
1. Analyse ex ante <strong>de</strong>s coûts potentiels liés à <strong>la</strong> coexistence OGM -<br />
non OGM en France<br />
Cette partie présente une analyse <strong>de</strong>s coûts actuels pour le non OGM certifié et <strong>de</strong>s coûts qui<br />
seraient liés à <strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux filières en France, l'une pouvant contenir <strong>de</strong>s produits OGM et<br />
l'autre comportant uniquement <strong>de</strong>s produits non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée (IP) (c'est-à-dire <strong>de</strong>s<br />
produits sans OGM au <strong>de</strong>là d'un seuil <strong>de</strong> tolérance donné). L'analyse présentée ici est uniquement<br />
qualitative.<br />
Actuellement, il n'y a pas <strong>de</strong> culture commerciale d'OGMs en France, <strong>les</strong> semenciers ayant<br />
volontairement suspendu <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong>s quelques variétés OGM autorisées. <strong>Les</strong><br />
distributeurs et <strong>les</strong> transformateurs français ont choisi d'éliminer <strong>les</strong> OGMs <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong>stinés à<br />
l'alimentation humaine. Pour certaines filières (essentiellement <strong>de</strong> vian<strong>de</strong> <strong>de</strong> qualité), <strong>les</strong> OGMs sont<br />
également éliminés <strong>de</strong>s aliments pour animaux. Cependant, même en l'absence <strong>de</strong> commercialisation<br />
en France, <strong>de</strong>s mé<strong>la</strong>nges d'OGM dans <strong>de</strong>s produits non OGM sont <strong>possib<strong>les</strong></strong>, en raison <strong>de</strong>s<br />
importations réalisées aux différents sta<strong>de</strong>s ou en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence d'essais techniques d'OGMs en<br />
France. En conséquence, différentes procédures ont d'ores et déjà été mises en p<strong>la</strong>ce pour assurer une<br />
offre non OGM en réponse aux exigences exprimées en aval par <strong>les</strong> transformateurs et distributeurs.<br />
<strong>Les</strong> difficultés pour offrir du non OGM seraient plus gran<strong>de</strong>s dans un contexte où <strong>les</strong> OGMs seraient<br />
diffusés commercialement en France. L'objectif <strong>de</strong> cette partie est <strong>de</strong> présenter quels types <strong>de</strong> coûts en<br />
découleraient dans le cas du maïs et du colza.<br />
Pour ce<strong>la</strong>, cette partie reprend en partie <strong>la</strong> méthodologie adoptée dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bullock,<br />
Desquilbet et Nitsi (2000), qui examinent <strong>les</strong> coûts liés à l'apparition <strong>de</strong> filières non OGM en vue <strong>de</strong><br />
l'exportation pour le soja et le maïs aux Etats-Unis. Elle s'appuie également sur <strong>les</strong> étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Valceschini et Ave<strong>la</strong>nge (2001) et <strong>de</strong> Le Bail et Choimet (2001), qui concernent le cas français, en<br />
analysant essentiellement <strong>la</strong> situation actuelle <strong>de</strong> faible pression <strong>de</strong>s OGM (avec également certains<br />
développements sur <strong>la</strong> situation en cas <strong>de</strong> forte pression OGM). Enfin, outre d'autres éléments <strong>de</strong><br />
bibliographie, elle utilise <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>tiens réalisés avec quelques <strong>acteurs</strong> à partir <strong>de</strong> questions ouvertes<br />
sur une potentielle coexistence OGM - non OGM en France. <strong>Les</strong> personnes interrogées ont réfléchi a<br />
priori sur <strong>les</strong> contraintes apportées par <strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières et le type <strong>de</strong> coûts engendrés. Il<br />
2
convient d'avancer <strong>de</strong>ux réserves concernant ces <strong>entre</strong>tiens. Tout d'abord, le nombre d'<strong>entre</strong>tiens<br />
réalisé à ce sta<strong>de</strong> est faible. De plus, beaucoup <strong>de</strong>s personnes rencontrées n'avaient pas réfléchi à <strong>la</strong><br />
question <strong>de</strong> <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM avant l'<strong>entre</strong>tien, car cette question n'est pas dans leurs<br />
préoccupations actuel<strong>les</strong>. Cependant, il est possible <strong>de</strong> faire une première analyse à partir <strong>de</strong> ces<br />
<strong>entre</strong>tiens, analyse qu'il conviendrait <strong>de</strong> corriger et d'enrichir par <strong>la</strong> suite.<br />
La première section présente le contexte réglementaire sur <strong>les</strong> OGMs et le non OGM dans l'UE et<br />
en France. La secon<strong>de</strong> section présente <strong>les</strong> coûts encourus dans le contexte actuel <strong>de</strong> non diffusion <strong>de</strong>s<br />
OGMs en France et <strong>les</strong> coûts attendus en cas <strong>de</strong> coexistence OGM - non OGM. <strong>Les</strong> sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> semences, <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole, <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte et du stockage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation<br />
sont examinés successivement. L'objectif est d'exposer <strong>les</strong> types <strong>de</strong> coûts présents ou attendus à<br />
chaque sta<strong>de</strong>, sans évaluation quantitative <strong>de</strong> ces coûts. La troisième section propose une première<br />
synthèse sur ces coûts.<br />
1.1. La réglementation actuelle <strong>de</strong> l'Union Européenne et <strong>de</strong> <strong>la</strong> France sur <strong>les</strong><br />
OGM et le non OGM<br />
a. <strong>Les</strong> autorisations sur le maïs et le colza OGM dans l'Union Européenne et en<br />
France<br />
Le principal instrument d'autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché d'OGMs dans l'Union Européenne<br />
(UE) est <strong>la</strong> directive 1990/220/CEE re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> dissémination volontaire d'organismes génétiquement<br />
modifiés, remp<strong>la</strong>cée par <strong>la</strong> directive 2001/18/CE qui <strong>entre</strong>ra en vigueur en septembre 2002. 1 Depuis<br />
l'entrée en vigueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive 1990/220/CEE en octobre 1991, dix-huit autorisations ont été<br />
octroyées en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion commerciale d'OGMs, dont quatre autorisations pour du colza et<br />
quatre autorisations pour du maïs. Il existe actuellement un moratoire <strong>de</strong> fait dans l'UE sur <strong>les</strong><br />
autorisations d'OGM, aucune nouvelle autorisation n'ayant été accordée <strong>de</strong>puis octobre 1998. De plus,<br />
certains Etats membres ont invoqué une c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive 90/220/CEE pour<br />
interdire provisoirement sur leur territoire <strong>la</strong> mise sur le marché <strong>de</strong> produits à base <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> colza<br />
génétiquement modifiés (Commission Européenne, 2000a). En France, <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong><br />
certaines variétés <strong>de</strong> maïs OGM autorisés dans l'UE et <strong>de</strong> toutes <strong>les</strong> variétés <strong>de</strong> colza autorisées dans<br />
l'UE sont interdites (encart 1 ci-<strong>de</strong>ssous).<br />
1 A <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive 1990/220/CEE, <strong>la</strong> nouvelle directive mentionne explicitement <strong>la</strong> question du<br />
seuil minimal au <strong>de</strong>ssous duquel l'étiquetage n'est pas obligatoire.<br />
3
Encart 1. Autorisations sur <strong>les</strong> OGM en France : le cas du maïs et du colza<br />
Maïs :<br />
- Trois événements <strong>de</strong> transformation sont autorisés pour toute utilisation (importation, culture et<br />
transformation industrielle) : le maïs Bt-176 <strong>de</strong> <strong>la</strong> société Novartis tolérant à <strong>la</strong> pyrale et à un herbici<strong>de</strong><br />
(9 variétés autorisées; 3 variétés suspendues par décision du Conseil d'État) ; le maïs MON 810 <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société Monsanto tolérant à <strong>la</strong> pyrale (6 variétés autorisées) ; le maïs T 25 <strong>de</strong> <strong>la</strong> société AgrEvo<br />
tolérant à un herbici<strong>de</strong>.<br />
- Un événement <strong>de</strong> transformation est autorisé seulement à l'importation en vue <strong>de</strong> sa<br />
transformation industrielle : le maïs BT-11 <strong>de</strong> <strong>la</strong> société Novartis, tolérant à <strong>la</strong> pyrale et à un herbici<strong>de</strong>.<br />
Colza :<br />
La France a décidé un moratoire jusqu’en novembre 2000 qui interdit <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong>s<br />
colzas génétiquement modifiés, afin <strong>de</strong> poursuivre l'évaluation du risque environnemental que peut<br />
entraîner le croisement <strong>de</strong> ces colza OGM avec <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes sauvages, bien que le colza génétiquement<br />
modifié ait fait l'objet <strong>de</strong> 4 décisions favorab<strong>les</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission. La France a affirmé sa volonté <strong>de</strong><br />
maintenir ce moratoire en février 2001. Ce "moratoire colza" est mis en oeuvre <strong>de</strong> 2 façons différentes<br />
:<br />
- <strong>les</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché <strong>de</strong> colzas déposées en France n'ont pas fait<br />
l'objet <strong>de</strong> "consentement écrit" par <strong>les</strong> autorités françaises ; ces colzas sont ainsi également interdits<br />
dans toute l'Union européenne;<br />
- <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong>s colzas autorisés par le Royaume-Uni est suspendue en France pour<br />
l'utilisation décrite dans <strong>les</strong> décisions <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission par arrêtés du 16 novembre 1998 (elle reste<br />
autorisée dans le reste <strong>de</strong> l'Union européenne).<br />
Toutefois, <strong>les</strong> hui<strong>les</strong> obtenues à partir <strong>de</strong> ces colzas sont autorisées <strong>de</strong>puis juin 1997 par <strong>la</strong><br />
procédure <strong>de</strong> notification prévue par le règlement 258/97 re<strong>la</strong>tif aux nouveaux aliments. L'importation<br />
et <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong> ces hui<strong>les</strong> sont donc autorisées, mais leur fabrication ne peut avoir lieu en<br />
France.<br />
Sources : Ministère <strong>de</strong> l'économie, <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong> l'industrie (2000) ; CETIOM (2001).<br />
b. La réglementation sur le non OGM dans l'Union Européenne<br />
La réglementation <strong>de</strong> l'UE impose un étiquetage obligatoire <strong>de</strong>s produits alimentaires contenant <strong>de</strong>s<br />
OGM. En application du règlement 49/2000/CE, <strong>la</strong> mention "produit à partir <strong>de</strong> (maïs/soja)<br />
génétiquement modifié" doit être spécifiée, pour chaque ingrédient du produit alimentaire contenant<br />
<strong>de</strong>s OGM, sauf dans le cas d'une présence acci<strong>de</strong>ntelle d'OGM avec un contenu en OGM inférieur à<br />
un pour cent. Le règlement 50/2000/CE impose l'étiquetage <strong>de</strong>s additifs et arômes contenant <strong>de</strong>s OGM<br />
(Commission Européenne, 2000b). 2 Cependant, il n'existe pas encore <strong>de</strong> normalisation sur <strong>les</strong><br />
procédures d'échantillonnage et <strong>de</strong> test à l'échelle européenne. La Commission Européenne a publié en<br />
juillet 2000 un document <strong>de</strong> travail proposant d'accompagner <strong>la</strong> <strong>la</strong>bellisation par <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d'une<br />
traçabilité <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> OGM, dans l'objectif <strong>de</strong> reprendre le processus d'autorisation <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong><br />
2 Ces <strong>de</strong>ux règlements ne concernent pas l'ensemble <strong>de</strong>s OGM actuellement autorisés dans l'UE, mais concernent<br />
uniquement une autorisation <strong>de</strong> soja OGM et une autorisation <strong>de</strong> maïs OGM. Pour <strong>de</strong>s détails sur <strong>la</strong><br />
réglementation européenne en matière d'étiquetage OGM voir Valceschini et Ave<strong>la</strong>nge (2001).<br />
4
variétés OGM tout en répondant aux craintes <strong>de</strong>s consommateurs (Commission Européenne, 2000c).<br />
Par ailleurs, il n'y a pas à l'heure actuelle <strong>de</strong> légis<strong>la</strong>tion communautaire sur l'étiquetage <strong>de</strong>s aliments<br />
pour animaux contenant <strong>de</strong>s OGM.<br />
Il n'existe pas actuellement <strong>de</strong> réglementation sur <strong>la</strong> présence acci<strong>de</strong>ntelle <strong>de</strong> semences OGM dans<br />
<strong>de</strong>s variétés <strong>de</strong> semences non OGM. En l'état actuel, en France, <strong>la</strong> direction générale <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
concurrence, <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation et <strong>de</strong> <strong>la</strong> répression <strong>de</strong>s frau<strong>de</strong>s (DGCCRF) considère que <strong>la</strong><br />
commercialisation en toute connaissance <strong>de</strong> cause <strong>de</strong> semences contenant <strong>de</strong>s OGM autorisés (même<br />
en quantité infime) constitue une "tromperie sur <strong>la</strong> marchandise", si l'acheteur n'en a pas été informé.<br />
De plus, toute présence d'événements non autorisés est considérée comme illégale (Campariol, 2001).<br />
La France a déjà été confrontée en 2000 à <strong>la</strong> présence fortuite d'OGM en proportions très faib<strong>les</strong>, dans<br />
<strong>de</strong>s lots <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> variétés non OGM importés <strong>de</strong> pays où <strong>de</strong>s OGM sont cultivés à gran<strong>de</strong><br />
échelle (voir encart ci-<strong>de</strong>ssous). 3<br />
Encart 2. Présence fortuite d'OGM dans <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> variétés non OGM : trois cas<br />
d'intervention gouvernementale en 2000<br />
En mai 2000, le gouvernement français a ordonné <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> 600 hectares <strong>de</strong> colza, parce que<br />
leurs semences, d'une variété non OGM, avaient été mé<strong>la</strong>ngées lors <strong>de</strong> leur production avec du colza<br />
génétiquement modifié et résistant à un herbici<strong>de</strong> dans une faible proportion (<strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 1 %)<br />
(Gouvernement français, 2000a). La firme ayant fourni <strong>les</strong> semences a indiqué qu'el<strong>les</strong> avaient été<br />
importées du Canada, où el<strong>les</strong> avaient été contaminées par du pollen <strong>de</strong> champs voisins <strong>de</strong> colza OGM<br />
au cours <strong>de</strong> leur production (Le Mon<strong>de</strong>, 20 mai 2000).<br />
En juillet 2000, le gouvernement a écarté le recours à <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction pour <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> maïs<br />
conventionnel<strong>les</strong> avec <strong>de</strong>s impuretés OGM en très faible proportion (<strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 2 pour mille) dans<br />
<strong>de</strong>s lots correspondant à 4500 hectares <strong>de</strong> production. <strong>Les</strong> résultats faisaient état <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> trois<br />
types d'OGM, dont <strong>de</strong>ux autorisés à <strong>la</strong> culture et à <strong>la</strong> consommation et un non autorisé à <strong>la</strong> culture<br />
mais autorisé à <strong>la</strong> consommation. Le gouvernement s'est engagé à étiqueter <strong>les</strong> récoltes<br />
potentiellement concernées (Gouvernement Français, 2000b).<br />
En août 2000, le gouvernement français a ordonné <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> 46 hectares <strong>de</strong> cultures <strong>de</strong> soja,<br />
pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> une présence d'OGM d'un taux <strong>de</strong> 0,8 % à 1,5 % avait été relevée dans <strong>les</strong> semences.<br />
Ces cultures étaient el<strong>les</strong> même <strong>de</strong>stinées à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences (ministère <strong>de</strong> l'agriculture et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> pêche, 2000). <strong>Les</strong> semences avaient été importées <strong>de</strong>s Etats-Unis (H. Kempf, Le Mon<strong>de</strong>, 28 août<br />
2000).<br />
Ces événements ont sans aucun doute participé à accélérer <strong>la</strong> réflexion sur <strong>la</strong> définition <strong>de</strong> seuils <strong>de</strong><br />
pureté sur <strong>les</strong> semences. Dans un document <strong>de</strong> travail transmis aux Etats membres le 22 janvier 2001,<br />
<strong>la</strong> Commission européenne envisage un seuil <strong>de</strong> présence fortuite <strong>de</strong> 0,3 % pour <strong>les</strong> variétés à<br />
3 Une autre cause possible <strong>de</strong> présence fortuite d'OGMs dans <strong>les</strong> semences serait un mé<strong>la</strong>nge acci<strong>de</strong>ntel au<br />
cours <strong>de</strong> leur production en France, dû à <strong>la</strong> présence d'OGMs (actuellement très faible) dans <strong>les</strong> champs français<br />
(essais techniques, cultures commercia<strong>les</strong>, p<strong>la</strong>ntes issues <strong>de</strong> semences importées avec présence fortuite<br />
d'OGMs). D'après <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> interrogés, cependant, tous <strong>les</strong> cas actuellement avérés <strong>de</strong> présence fortuite d'OGM<br />
dans <strong>de</strong>s semences sont à attribuer à <strong>la</strong> présence d'OGMs dans <strong>de</strong>s semences importées.<br />
5
pollinisation croisée et <strong>de</strong> 0,5 % pour <strong>les</strong> cultures autogames et cel<strong>les</strong> à reproduction végétative. 4 Ce<br />
seuil s'appliquerait aux seuls OGM ayant obtenu une autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché dans l'Union<br />
Européenne. Pour <strong>les</strong> OGM non autorisés, <strong>la</strong> tolérance prévue est <strong>de</strong> 0% (Campariol, 2001). <strong>Les</strong><br />
propositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission ont été transmises au Comité Scientifique <strong>de</strong>s P<strong>la</strong>ntes européen. Selon<br />
l'avis rendu par ce Comité, <strong>les</strong> seuils <strong>de</strong> 0,3 % et 0,5 % proposés par <strong>la</strong> Commission ne pourraient être<br />
obtenus que sous <strong>de</strong>s conditions idéa<strong>les</strong> <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences, et il <strong>de</strong>viendrait <strong>de</strong> plus en plus<br />
difficile d'atteindre ces seuils si <strong>la</strong> production d'OGM en Europe augmentait. De plus, l'opinion du<br />
Comité est qu'il n'est pas possible en pratique d'obtenir un seuil <strong>de</strong> 0% sur <strong>les</strong> événements non<br />
autorisés (Commission Européenne, 2001). La question <strong>de</strong> <strong>la</strong> pureté <strong>de</strong>s semences est examinée dans<br />
<strong>la</strong> section 2.1 ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
1.2. <strong>Les</strong> coûts potentiels liés à <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> semences à <strong>la</strong> transformation<br />
<strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM peuvent être c<strong>la</strong>ssés en <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s catégories :<br />
- <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation OGM - non OGM, pour séparer <strong>les</strong> produits <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières en évitant <strong>la</strong><br />
présence acci<strong>de</strong>ntelle d'OGM au <strong>de</strong>là du seuil <strong>de</strong> tolérance accepté dans <strong>les</strong> produits non OGM. Il<br />
s'agit par exemple <strong>de</strong> coûts pour éviter <strong>la</strong> pollinisation OGM <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes non OGM, dédier certains<br />
équipements à l'une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières pendant une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> temps donnée, investir dans <strong>de</strong>s<br />
nouveaux équipements.<br />
- <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> garantie, pour s'assurer qu'un produit considéré comme non OGM est bien exempt<br />
d'OGM, au seuil <strong>de</strong> tolérance accepté. Il s'agit par exemple <strong>de</strong> coûts pour réaliser <strong>de</strong>s tests <strong>de</strong> contenu<br />
OGM sur <strong>de</strong>s échantillons, mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> coordination <strong>entre</strong> différents <strong>acteurs</strong><br />
(contrats, cahiers <strong>de</strong>s charges) et contrôler leur application, instaurer <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> procédures<br />
d'assurance qualité.<br />
La présentation qui suit détaille ces coûts sta<strong>de</strong> par sta<strong>de</strong>, pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences, <strong>la</strong><br />
production agricole, <strong>la</strong> collecte et le stockage et <strong>la</strong> transformation.<br />
4 La Commission a défini ces seuils en faisant <strong>de</strong>s hypothèses sur <strong>les</strong> taux <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nge OGM <strong>possib<strong>les</strong></strong> aux<br />
sta<strong>de</strong>s ultérieurs à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences, et en calcu<strong>la</strong>nt par différence <strong>les</strong> taux <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nge OGM<br />
acceptab<strong>les</strong> sur <strong>les</strong> semences, pour permettre d'atteindre le seuil <strong>de</strong> 1 % au sta<strong>de</strong> du produit fini. Il en résulte<br />
qu'un seuil plus faible est retenu pour <strong>les</strong> variétés à pollinisation croisée que pour <strong>les</strong> variétés autogames, alors<br />
que <strong>les</strong> mé<strong>la</strong>nges avec <strong>de</strong> l'OGM sont plus probab<strong>les</strong> pour ces variétés (pouvant être fécondées par du pollen<br />
extérieur susceptible <strong>de</strong> provenir d'une p<strong>la</strong>nte OGM) que pour <strong>les</strong> variétés autogames (essentiellement<br />
autofécondées ).<br />
6
a. <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong><br />
semences<br />
- Contexte : taux <strong>de</strong> pureté actuels pour <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> maïs et colza<br />
La ségrégation OGM / non OGM est nécessaire dès le sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences pour<br />
obtenir, en bout <strong>de</strong> chaîne, du non OGM avec une faible présence d'impuretés OGM. Actuellement, il<br />
n'existe pas <strong>de</strong> seuil réglementaire <strong>de</strong> présence fortuite d'OGM dans <strong>les</strong> semences non OGM. La<br />
Commission Européenne a proposé <strong>de</strong>s seuils très faib<strong>les</strong> (0,3 % pour <strong>les</strong> variétés à pollinisation<br />
croisée, 0,5 % pour <strong>les</strong> cultures autogames, et dans <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux cas 0 % sur <strong>les</strong> événements non autorisés).<br />
Selon l'avis rendu par le comité d'experts <strong>de</strong> l'UE chargé d'évaluer cette proposition, ces seuils ne<br />
pourraient être atteints que sous <strong>de</strong>s conditions idéa<strong>les</strong> <strong>de</strong> production (voir section 1). Il est intéressant<br />
<strong>de</strong> rappeler <strong>les</strong> taux <strong>de</strong> pureté actuellement obtenus en production <strong>de</strong> semences en France pour<br />
comprendre le contexte <strong>de</strong> cette question <strong>de</strong>s seuils non OGM sur <strong>les</strong> semences.<br />
La question <strong>de</strong> <strong>la</strong> pureté et <strong>de</strong> <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong>s seuils n'est pas nouvelle pour <strong>les</strong> semenciers en<br />
France. La production <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> l'UE est encadrée par <strong>de</strong>s directives européennes fixant <strong>de</strong>s<br />
obligations <strong>de</strong> moyens ou <strong>de</strong> résultats en matière <strong>de</strong> pureté, directives traduites au niveau français en<br />
un règlement technique homologué par le ministère <strong>de</strong> l'agriculture. 5 En plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> certification<br />
officielle, <strong>les</strong> semenciers développent <strong>de</strong>s efforts pour atteindre une pureté élevée <strong>de</strong> leurs semences<br />
(qui constitue un critère <strong>de</strong> qualité important) via leurs propres systèmes d'assurance qualité.<br />
Autrement dit, <strong>la</strong> définition d'un seuil <strong>de</strong> présence fortuite d'OGM constitue une nouvelle contrainte<br />
sur un problème existant, plutôt qu'un problème entièrement nouveau.<br />
Cependant, il n'y a pas <strong>de</strong> lien univoque <strong>entre</strong> <strong>les</strong> taux d'impureté variétale actuellement obtenus en<br />
production <strong>de</strong> semences, et le taux potentiel <strong>de</strong> pollution OGM en cas <strong>de</strong> coexistence <strong>de</strong> production<br />
commerciale OGM et non OGM en France. La pureté variétale <strong>de</strong>s semences est évaluée à partir <strong>de</strong><br />
critères morphologiques, pour le maïs comme pour le colza. Cette évaluation est réalisée a posteriori,<br />
en semant <strong>de</strong>s échantillons <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence commerciale produite, ainsi que <strong>de</strong>s parents dans le cas<br />
d'une semence hybri<strong>de</strong>. L'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence est réalisée uniquement par une <strong>de</strong>scription <strong>de</strong><br />
ses caractères morphologiques. <strong>Les</strong> critères <strong>de</strong> pureté non OGM actuellement proposés par <strong>la</strong><br />
Commission Européenne, quant à eux, sont basés sur <strong>de</strong>s tests molécu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> détection du contenu<br />
OGM. Ces tests peuvent détecter <strong>de</strong>s impuretés qui ne seraient pas détectées sur <strong>de</strong>s critères<br />
morphologiques. Ils peuvent donc mettre en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s présences d'impuretés plus gran<strong>de</strong>s que<br />
cel<strong>les</strong> qui seraient mises en évi<strong>de</strong>nce par un seul examen <strong>de</strong>s critères morphologiques. Par ailleurs,<br />
5 Il s'agit <strong>de</strong>s directives communautaires 66/402/CEE pour <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> maïs et 69/208/CEE pour <strong>les</strong><br />
semences <strong>de</strong> colza au niveau <strong>de</strong> l'UE, et du règlement technique <strong>de</strong> <strong>la</strong> production, du contrôle et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
certification <strong>de</strong>s semences au niveau français (Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pêche, 1994). Au niveau<br />
international, l'OCDE régit <strong>la</strong> certification <strong>de</strong>s semences en vue du commerce international (OCDE, 2000).<br />
7
même en cas <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> cultures commercia<strong>les</strong> d'OGM, toutes <strong>les</strong> impuretés présentes dans<br />
<strong>les</strong> semences ne seraient pas nécessairement OGM. Certaines impuretés pourraient être dues à une<br />
pollinisation par du pollen <strong>de</strong> variétés non OGM, auquel cas el<strong>les</strong> ne poseraient pas <strong>de</strong> problème pour<br />
l'i<strong>de</strong>ntité non OGM <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence. <strong>Les</strong> taux d'impureté variétale actuellement obtenus ne permettent<br />
donc pas d'anticiper directement quelle serait <strong>la</strong> présence d'impuretés OGM dans <strong>de</strong>s semences non<br />
OGM.<br />
L'expérience acquise jusque là sur <strong>la</strong> pureté <strong>de</strong>s semences montre que <strong>la</strong> pureté absolue est difficile<br />
et coûteuse à atteindre. C'est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>s seuils d'impureté sont acceptés par <strong>la</strong><br />
réglementation. Dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs, <strong>la</strong> réglementation européenne et<br />
française ne définit pas <strong>de</strong> norme <strong>de</strong> pureté variétale minimale, mais définit un ensemble d'obligations<br />
qui concourent au maintien d'une pureté variétale élevée. D'après <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> interrogés, le taux <strong>de</strong><br />
pureté obtenu pour <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> maïs est en général <strong>de</strong> 99 % au moins. Le taux <strong>de</strong> pureté obtenu<br />
peut être plus faible (autour <strong>de</strong> 98 ou 98,5 %) dans <strong>les</strong> zones avec une forte production <strong>de</strong> maïs<br />
consommation, donc une forte masse pollinique (sud-ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> France notamment). Concernant le<br />
colza, il faut distinguer <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> semences, <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> variétés lignées et <strong>les</strong> semences <strong>de</strong><br />
variétés hybri<strong>de</strong>s. La réglementation européenne et française définit un seuil <strong>de</strong> pureté variétale<br />
minimale <strong>de</strong> 99,7 % pour <strong>les</strong> semences certifiées <strong>de</strong> variétés lignées <strong>de</strong> colza, et un seuil <strong>de</strong> pureté<br />
variétale minimale <strong>de</strong> 90 % pour <strong>les</strong> semences certifiées <strong>de</strong> variétés hybri<strong>de</strong>s <strong>de</strong> colza. Actuellement,<br />
au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole commerciale, environ 80 % <strong>de</strong>s surfaces françaises <strong>de</strong> colza sont<br />
semées avec <strong>de</strong>s variétés lignées, environ 10 % sont semées avec <strong>de</strong>s variétés hybri<strong>de</strong>s et environ 10<br />
% sont semées avec <strong>de</strong>s associations variéta<strong>les</strong>. 6<br />
Etant données <strong>les</strong> pratiques <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences, <strong>la</strong> présence d'impuretés OGM dans <strong>de</strong>s<br />
semences non OGM pourrait être un problème si <strong>de</strong>s OGM étaient cultivés à gran<strong>de</strong> échelle en France.<br />
Afin <strong>de</strong> comprendre <strong>les</strong> mesures à mettre en p<strong>la</strong>ce pour améliorer <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong> pureté <strong>de</strong>s semences,<br />
et leurs coûts, il est tout d'abord nécessaire <strong>de</strong> connaître <strong>les</strong> pratiques actuel<strong>les</strong> <strong>de</strong> production <strong>de</strong><br />
semences. <strong>Les</strong> étapes <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> colza sont rappelées dans l'annexe.<br />
<strong>Les</strong> <strong>de</strong>ux sections suivantes présentent <strong>les</strong> mesures prises actuellement pour le non OGM en<br />
production <strong>de</strong> semences, et le type <strong>de</strong> mesures qu'il faudrait envisager dans le cas d'une coexistence<br />
OGM - non OGM en France. Leur contenu est basé sur <strong>les</strong> différents <strong>entre</strong>tiens réalisés.<br />
- Mesures actuel<strong>les</strong> pour le non OGM en production <strong>de</strong> semences<br />
<strong>Les</strong> mesures actuel<strong>les</strong> concernent essentiellement <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> maïs, pour lequel <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
pureté exprimée par <strong>les</strong> opérateurs d'aval a été plus forte. Le cas du maïs est présenté en détail ci<strong>de</strong>ssous,<br />
puis <strong>les</strong> cas du colza et du soja sont évoqués ensuite.<br />
6 <strong>Les</strong> associations variéta<strong>les</strong> sont composées en général <strong>de</strong> 80 % d'une lignée mâle stérile et <strong>de</strong> 20 % d'une<br />
lignée pollinisatrice dans <strong>la</strong> parcelle <strong>de</strong> l'agriculteur.<br />
8
Certains opérateurs d'aval (distributeurs, amidonniers, semouliers notamment) ont exprimé aux<br />
semenciers <strong>de</strong>s exigences d'absence d'OGM dans <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> maïs, suite aux inci<strong>de</strong>nts sur <strong>de</strong>s<br />
pollutions <strong>de</strong> semences en 2000 (voir encart 2). <strong>Les</strong> semenciers ont multiplié <strong>les</strong> audits et ont <strong>entre</strong>pris<br />
d'expliquer qu'il n'était pas possible d'atteindre le zéro absolu. En réaction aux exigences <strong>de</strong>s<br />
opérateurs d'aval, <strong>la</strong> profession semencière a mis en p<strong>la</strong>ce un programme volontaire visant à maîtriser<br />
<strong>la</strong> teneur en impuretés OGM dans <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> maïs. L'objectif <strong>de</strong> ce programme était <strong>de</strong> rassurer<br />
<strong>les</strong> acheteurs, en l'absence <strong>de</strong> réglementation européenne. Ce programme définit <strong>de</strong>s procédures mais<br />
ne définit pas <strong>de</strong> seuil autorisé <strong>de</strong> présence d'OGM. <strong>Les</strong> procédures sont <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux types. Certaines<br />
visent à assurer <strong>la</strong> ségrégation du non OGM, c'est-à-dire à limiter <strong>les</strong> possibilités <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nge OGM /<br />
non OGM (normes plus strictes sur le précé<strong>de</strong>nt cultural, l'isolement <strong>de</strong>s parcel<strong>les</strong>, l'épuration en cours<br />
<strong>de</strong> végétation). D'autres visent à donner <strong>de</strong>s garanties par <strong>la</strong> traçabilité ou par <strong>de</strong>s procédures<br />
d'échantillonnage et <strong>de</strong> tests chimiques <strong>de</strong> contenu non OGM. Ce programme est suivi par tous <strong>les</strong><br />
semenciers français, chacun ayant défini ses propres procédures d'application du programme. <strong>Les</strong><br />
principa<strong>les</strong> mesures prises par <strong>les</strong> semenciers pour le maïs sont détaillées ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
En l'état actuel, en l'absence <strong>de</strong> commercialisation d'OGM en France, <strong>les</strong> impuretés OGM sur <strong>les</strong><br />
semences <strong>de</strong> maïs proviennent essentiellement <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> base importées (c'est-à-dire <strong>de</strong>s<br />
semences issues <strong>de</strong> <strong>la</strong> multiplication <strong>de</strong>s parents <strong>de</strong>s hybri<strong>de</strong>s). 7 Pour <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> base <strong>de</strong> maïs,<br />
souvent au moins un <strong>de</strong>s parents est d'origine américaine. 8 <strong>Les</strong> exigences vis-à-vis <strong>de</strong>s semences<br />
importées <strong>de</strong>s Etats-Unis ont augmenté, et <strong>les</strong> fournisseurs ont répondu par <strong>de</strong>s efforts très<br />
significatifs, y compris dans certains cas en dép<strong>la</strong>çant <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s Etats-<br />
Unis vers <strong>la</strong> France. Il reste cependant <strong>de</strong>s cas problématiques, notamment pour <strong>de</strong>s lignées<br />
développées à petite échelle pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong> efforts n'ont pas été aussi importants.<br />
En plus d'exigences plus strictes sur <strong>les</strong> importations, <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> contrôle ont été mis en p<strong>la</strong>ce<br />
pour tester l'absence d'OGM dans <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> maïs. L'effort <strong>de</strong> contrôle est le plus développé en<br />
7 La pollution peut aussi venir d'essais <strong>de</strong> variétés OGM imp<strong>la</strong>ntés en France. <strong>Les</strong> semences <strong>de</strong> bases sont <strong>les</strong><br />
lignées parenta<strong>les</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence, à partir <strong>de</strong>squel<strong>les</strong> ont réalise <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semence commerciale. Pour<br />
atteindre une pureté élevée <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence commerciale, <strong>les</strong> semenciers adoptent <strong>de</strong>s précautions particulières<br />
pour que <strong>les</strong> semences <strong>de</strong> base soient le plus pures possible.<br />
8 <strong>Les</strong> statistiques disponib<strong>les</strong> sur <strong>les</strong> importations françaises <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> colza sont présentées<br />
dans l'annexe, dans <strong>la</strong> section A.3.2.1. <strong>Les</strong> importations représentent 9 % <strong>de</strong>s ressources françaises en semences<br />
<strong>de</strong> maïs en 1999/2000 (<strong>les</strong> ressources étant <strong>la</strong> somme du stock initial, <strong>de</strong> <strong>la</strong> production et <strong>de</strong>s importations).<br />
Environ un quart <strong>de</strong> ces importations provient <strong>de</strong>s Etats-Unis, où <strong>de</strong>s variétés OGM sont cultivées à gran<strong>de</strong><br />
échelle. Dans le cas du colza, <strong>les</strong> importations représentent seulement 3 % <strong>de</strong>s ressources françaises en<br />
semences. <strong>Les</strong> statistiques ne permettent pas d'évaluer <strong>la</strong> dépendance <strong>de</strong>s importations pour le marché spécifique<br />
<strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> base. <strong>Les</strong> semences <strong>de</strong> base représentent <strong>de</strong>s petits volumes, notamment pour le maïs pour<br />
lequel le taux <strong>de</strong> multiplication est élevé, donc <strong>les</strong> importations tota<strong>les</strong> <strong>de</strong> semences tota<strong>les</strong> ne permettent pas<br />
d'évaluer <strong>la</strong> dépendance <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> base.<br />
9
amont, aux premiers sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> multiplication <strong>de</strong>s semences. <strong>Les</strong> épis issus <strong>de</strong> <strong>la</strong> création variétale<br />
sont analysés par PCR en prenant quelques grains par lignée. 9 Un épi au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> création variétale<br />
produit seulement <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 250 graines, donc le test est nécessairement effectué sur un échantillon<br />
très petit. L'objet du test PCR à ce sta<strong>de</strong> est essentiellement <strong>de</strong> vérifier que l'on n'est pas en présence<br />
d'une p<strong>la</strong>nte entièrement OGM. En revanche, le test ne permet pas <strong>de</strong> déterminer statistiquement <strong>la</strong><br />
probabilité qu'aucun <strong>de</strong>s grains non testés <strong>de</strong> l'épi ne soit OGM suite à une fécondation par du pollen<br />
OGM extérieur. Or, comme <strong>les</strong> grains non testés seront ensuite multipliés <strong>de</strong> nombreuses fois au cours<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences, <strong>les</strong> répercussions d'un grain non détecté au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche<br />
seraient importantes. Des analyses PCR sont également effectuées après multiplication <strong>de</strong>s semences<br />
<strong>de</strong> base, et enfin après production <strong>de</strong>s semences hybri<strong>de</strong>s.<br />
De plus, certains producteurs <strong>de</strong> semences pratiquent une ségrégation <strong>de</strong> lots <strong>de</strong> semences qui sont<br />
issues <strong>de</strong> lots différents <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> base d'une même variété. Autrement dit, ils choisissent <strong>de</strong><br />
considérer <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux lots issus <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> lots différents comme s'il s'agissait <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
variétés différentes. Ceci a pour objectif d'éviter <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nger <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux lots avant <strong>les</strong> résultats<br />
d'analyses <strong>de</strong> contenu OGM sur ces lots, donc d'éviter le risque <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nge éventuel d'un lot non<br />
OGM avec un lot avec présence fortuite d'OGM à un seuil non acceptable. Cette procédure est<br />
re<strong>la</strong>tivement lour<strong>de</strong>, et conduit pour le semencier à <strong>de</strong>s contraintes plus fortes dans <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> ses<br />
équipements.<br />
Dans le cas du colza et du soja, <strong>de</strong>s procédures d'assurance qualité du même ordre ont été mises en<br />
p<strong>la</strong>ce, avec un nombre d'analyses plus faible. Comme le colza et le soja OGM ne sont pas autorisés à<br />
<strong>la</strong> culture en France, il est nécessaire d'obtenir une absence <strong>de</strong> détection <strong>de</strong> traces d'OGM dans <strong>les</strong><br />
semences.<br />
En l'état actuel, <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences non OGM en France a donc engendré un coût malgré<br />
l'absence <strong>de</strong> cultures OGM à gran<strong>de</strong> échelle. Le coût total (que nous n'avons pas tenté <strong>de</strong> chiffrer)<br />
comprend <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> garantie (analyses PCR, éventuellement investissements en équipements <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>boratoire pour réaliser ces analyses, définition <strong>de</strong> procédures d'assurance qualité, définition et<br />
application du cahier <strong>de</strong>s charges non OGM), et <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation (coût pour garantir <strong>la</strong> pureté<br />
non OGM <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> base importées, ou éventuellement relocaliser leur production en France ;<br />
coût <strong>de</strong> ségrégation <strong>entre</strong> lots, coût <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong>s lots).<br />
9 Le test PCR (Polymerase Chain Reaction) est un test <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire utilisé pour détecter l'ADN modifié en<br />
multipliant <strong>de</strong>s sections cib<strong>les</strong> d'une molécule d'ADN.<br />
10
- Comment conserver une pureté non OGM <strong>de</strong>s semences en cas <strong>de</strong> diffusion<br />
commerciale <strong>de</strong> variétés OGM en France<br />
• Contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollinisation croisée<br />
En cas <strong>de</strong> diffusion commerciale <strong>de</strong>s OGM en France, un problème majeur serait <strong>de</strong> limiter <strong>la</strong><br />
présence d'impuretés OGM résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollinisation <strong>de</strong>s semences non OGM par du pollen OGM.<br />
Ainsi, nous avons vu qu'une <strong>de</strong>s mesures actuel<strong>les</strong> est <strong>de</strong> rapatrier <strong>la</strong> production <strong>de</strong> certaines semences<br />
<strong>de</strong> base non OGM vers <strong>la</strong> France, pour assurer un environnement pollinique non OGM. Ceci<br />
<strong>de</strong>viendrait impossible en cas <strong>de</strong> diffusion commerciale <strong>de</strong>s OGM en France, sauf s'il existait <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong>s zones non OGM en France. La possibilité <strong>de</strong> pollinisation OGM existerait également au sta<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semence commerciale. Plusieurs types <strong>de</strong> solutions existent a priori pour limiter <strong>la</strong><br />
pollinisation par du pollen OGM et conserver une pureté non OGM très élevée <strong>de</strong>s semences, en cas<br />
<strong>de</strong> culture d'OGM à gran<strong>de</strong> échelle en France. 10<br />
1) Tout d'abord, plusieurs procédures sont envisageab<strong>les</strong> pour augmenter <strong>la</strong> pureté <strong>de</strong>s semences sans<br />
augmenter significativement le déca<strong>la</strong>ge spatial (zonage) ou le déca<strong>la</strong>ge temporel (déca<strong>la</strong>ge dans <strong>la</strong><br />
floraison) <strong>entre</strong> variétés OGM et non OGM. Il s'agit en fait <strong>de</strong> renforcer <strong>de</strong>s procédures déjà utilisées<br />
pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences (ce qui est d'ailleurs déjà réalisé en partie par <strong>la</strong> profession semencière<br />
dans le cas du maïs) : augmentation du nombre <strong>de</strong> bordures mâ<strong>les</strong>, du nombre <strong>de</strong> rangs mâ<strong>les</strong> alternés<br />
avec <strong>de</strong>s rangs femelle, <strong>de</strong> l'isolement <strong>de</strong>s parcel<strong>les</strong>, <strong>de</strong> l'épuration en cours <strong>de</strong> végétation, du triage<br />
<strong>de</strong>s épis. Ces procédures permettent d'augmenter <strong>la</strong> pureté <strong>de</strong>s semences, mais el<strong>les</strong> ne permettent pas<br />
une absence totale d'impuretés OGM. En effet, l'augmentation <strong>de</strong> l'isolement sans recours à <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
zones non OGM n'empêche pas l'arrivée <strong>de</strong> pollen étranger sur <strong>la</strong> parcelle, car le pollen peut voyager<br />
sur <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s distances. Ces distances sont variab<strong>les</strong> selon <strong>les</strong> espèces, et plus faib<strong>les</strong> pour le maïs<br />
que pour le colza. Si certains <strong>de</strong>s grains d'une p<strong>la</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> variété non OGM souhaitée étaient<br />
pollinisés par du pollen OGM provenant <strong>de</strong> l'extérieur du champ, ces grains n'apparaîtraient pas<br />
comme aberrants et ne seraient donc pas détectés <strong>de</strong> visu. Or, seuls <strong>les</strong> épis aberrants sont éliminés au<br />
cours <strong>de</strong> l'épuration et du triage. Ces procédures qui excluent le zonage ou un déca<strong>la</strong>ge significatif <strong>de</strong>s<br />
dates <strong>de</strong> floraison OGM / non OGM sont donc imparfaites.<br />
2) Une autre possibilité pour limiter <strong>la</strong> pollinisation par du pollen OGM consisterait à définir <strong>de</strong> vastes<br />
territoires sans OGM. Il s'agirait <strong>de</strong> zones entièrement semées avec <strong>de</strong>s variétés non OGM. La zone<br />
située en bordure serait une zone tampon, susceptible <strong>de</strong> recevoir du pollen OGM <strong>de</strong> l'extérieur. Elle<br />
ne serait donc pas nécessairement <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences non OGM. Il y a lors <strong>de</strong>ux<br />
arguments pour définir <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s zones : plus l'exigence <strong>de</strong> pureté est forte, plus <strong>les</strong> zones tampon<br />
doivent être gran<strong>de</strong>s ; et <strong>les</strong> zones tampons seront mieux amorties si el<strong>les</strong> servent à protéger une<br />
surface plus gran<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> production non OGM. Ces zones <strong>de</strong>vraient être très gran<strong>de</strong>s pour que <strong>la</strong><br />
10 Sur <strong>les</strong> questions liées au contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollinisation croisée voir également Angevin et al. (2001).<br />
11
probabilité <strong>de</strong> pollution par du pollen extérieur soit très faible, surtout dans <strong>les</strong> zones avec forte<br />
présence <strong>de</strong> maïs consommation, donc masse pollinique très importante (sud-ouest notamment).<br />
Dans <strong>de</strong> nombreux cas, ceci supposerait d'agrandir considérablement <strong>la</strong> taille <strong>de</strong>s îlots <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong> semences (certains ont actuellement une surface <strong>de</strong> quelques hectares seulement), avec<br />
<strong>de</strong>ux conséquences :<br />
- Dans un îlot <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences, il n'est pas possible <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nger <strong>les</strong> mâ<strong>les</strong>, car il y aurait <strong>de</strong>s<br />
problèmes <strong>de</strong> pureté si un champ <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences était pollinisé par un mâle différent d'un<br />
champ <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences voisin. <strong>Les</strong> petits îlots sont souvent utilisés pour produire <strong>de</strong>s<br />
variétés peu développées. Produire <strong>de</strong>s semences non OGM uniquement dans <strong>de</strong>s grands îlots<br />
compliquerait donc <strong>la</strong> production <strong>de</strong> variétés non OGM à petite échelle.<br />
- La concertation <strong>entre</strong> <strong>les</strong> agriculteurs concernés pour définir l'îlot serait plus difficile<br />
qu'actuellement. A priori, il serait possible <strong>de</strong> s'appuyer sur <strong>la</strong> loi française <strong>de</strong> 1972 qui instaure <strong>la</strong><br />
possibilité <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s zones protégées <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> l'autorité<br />
administrative peut réglementer, limiter ou interdire <strong>la</strong> production <strong>de</strong> certaines espèces (voir annexe<br />
A.1.3), en interdisant au titre <strong>de</strong> cette loi <strong>la</strong> culture commerciale d'OGM dans l'îlot. Mais l'application<br />
<strong>de</strong> cette loi en agrandissant <strong>la</strong> taille <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone protégée pourrait être très difficile en cas <strong>de</strong> désaccord<br />
marqué d'un grand nombre d'agriculteurs <strong>de</strong> cette zone.<br />
3) Enfin, une <strong>de</strong>rnière possibilité pour limiter <strong>la</strong> pollinisation par du pollen OGM consisterait à<br />
s'appuyer sur un déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> floraison <strong>de</strong>s variétés OGM et non OGM (métho<strong>de</strong> déjà<br />
utilisée en partie augmenter <strong>la</strong> pureté <strong>de</strong>s semences). Il semble très difficile d'augmenter <strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> pureté par ce biais. En effet, le semencier n'a pas <strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong>s dates <strong>de</strong> floraison dans <strong>les</strong> parcel<strong>les</strong><br />
voisines <strong>de</strong>s parcel<strong>les</strong> <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences. Garantir une maîtrise <strong>de</strong> <strong>la</strong> pureté non OGM par un<br />
déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> floraison supposerait alors un déca<strong>la</strong>ge significatif par rapport à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> habituelle. Or il<br />
en résulterait une diminution significative du ren<strong>de</strong>ment, et une augmentation significative du risque<br />
<strong>de</strong> production. Le déca<strong>la</strong>ge significatif <strong>de</strong>s dates <strong>de</strong> floraison semble a priori extrêmement difficile à<br />
mettre en p<strong>la</strong>ce (<strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> interrogés le considèrent irréalisable en pratique).<br />
En cas <strong>de</strong> coexistence d'OGM et <strong>de</strong> non OGM sur le territoire français, différentes procédures <strong>de</strong><br />
ségrégation sont donc envisageab<strong>les</strong> a priori pour limiter l'arrivée <strong>de</strong> pollen OGM sur <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes<br />
<strong>de</strong>stinées à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences non OGM, mais certaines sont imparfaites, d'autres sont<br />
diffici<strong>les</strong> à mettre en p<strong>la</strong>ce. L'efficacité d'un ensemble donné <strong>de</strong> procédures varierait selon <strong>les</strong> cas, par<br />
exemple en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>s parcel<strong>les</strong> OGM et non OGM à proximité <strong>de</strong> <strong>la</strong> parcelle <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong> semences, du vent, <strong>de</strong>s barrières naturel<strong>les</strong>. Il est difficile <strong>de</strong> savoir a priori, et <strong>de</strong><br />
manière générale, quel<strong>les</strong> procédures permettraient <strong>de</strong> respecter <strong>les</strong> seuils actuellement envisagés par<br />
<strong>la</strong> Commission Européenne pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences, et à quels coûts. Il est seulement possible,<br />
à ce sta<strong>de</strong>, d'affirmer que <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences non OGM <strong>de</strong>viendrait extrêmement compliquée<br />
12
en cas <strong>de</strong> coexistence en France d'une filière OGM et d'une filière non OGM <strong>de</strong> taille significative, s'il<br />
était nécessaire <strong>de</strong> respecter <strong>les</strong> seuils très faib<strong>les</strong> envisagés actuellement.<br />
• Autres coûts additionnels en cas <strong>de</strong> coexistence OGM - non OGM<br />
En cas <strong>de</strong> coexistence OGM / non OGM en France, en plus <strong>de</strong>s coûts liés aux procédures <strong>de</strong><br />
maîtrise <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollinisation, <strong>les</strong> producteurs <strong>de</strong> semences non OGM <strong>de</strong>vraient également faire face à<br />
<strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation <strong>de</strong>s variétés OGM et non OGM en usine <strong>de</strong> conditionnement. Ces coûts<br />
seraient du même type que <strong>les</strong> coûts présentés plus loin pour <strong>les</strong> organismes stockeurs. De plus, <strong>les</strong><br />
coûts <strong>de</strong> garantie augmenteraient très vraisemb<strong>la</strong>blement par rapport à <strong>la</strong> situation actuelle<br />
(augmentation du nombre <strong>de</strong> tests et/ou alourdissement <strong>de</strong>s procédures d'assurance qualité).<br />
b. <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM / non OGM sur l'exploitation agricole<br />
Pour un agriculteur choisissant <strong>de</strong> cultiver du maïs ou du colza non OGM, une présence fortuite<br />
d'OGM dans <strong>les</strong> semences utilisées conduirait nécessairement à une présence fortuite d'OGM dans <strong>la</strong><br />
récolte. Des mé<strong>la</strong>nges <strong>entre</strong> OGM et non OGM pourraient également se produire sur l'exploitation<br />
agricole au moment du semis, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte, <strong>de</strong> <strong>la</strong> moisson ou du stockage<br />
sur <strong>la</strong> ferme. On peut anticiper que <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> <strong>net</strong>toyage du semoir, <strong>de</strong> <strong>la</strong> moissonneuse, <strong>de</strong>s engins<br />
<strong>de</strong> transport et <strong>de</strong>s équipements <strong>de</strong> stockage sur <strong>la</strong> ferme du matériel seraient faib<strong>les</strong>. 11 La question<br />
principale qui se pose au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'exploitation agricole est <strong>de</strong> savoir s'il serait nécessaire <strong>de</strong> mettre en<br />
œuvre <strong>de</strong>s mesures visant à limiter <strong>la</strong> pollinisation par du pollen OGM.<br />
Pour limiter <strong>la</strong> présence d'impuretés OGM dues à <strong>la</strong> pollinisation, il serait nécessaire <strong>de</strong> suivre <strong>de</strong>s<br />
procédures du même type que cel<strong>les</strong> qui ont été présentées dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences<br />
(récolter à part <strong>les</strong> rangs en bordure <strong>de</strong> champ, veiller à l'isolement <strong>de</strong>s champs, recourir à un zonage<br />
ou à un déca<strong>la</strong>ge dans le temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> floraison OGM / non OGM). Comme pour le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> production<br />
<strong>de</strong> semences, il est difficile <strong>de</strong> connaître <strong>les</strong> procédures qui seraient nécessaires pour atteindre un seuil<br />
faible <strong>de</strong> présence fortuite d'OGM (inférieur à 1%), notamment <strong>de</strong> savoir s'il serait nécessaire ou non<br />
<strong>de</strong> recourir à un zonage <strong>de</strong> <strong>la</strong> production, et quelle serait <strong>la</strong> taille nécessaire pour <strong>les</strong> zones non OGM ;<br />
et l'efficacité d'un ensemble donné <strong>de</strong> procédures varierait selon <strong>les</strong> cas. Le Bail et al. (2001)<br />
présentent <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tions obtenus à partir d'un modèle <strong>de</strong> dissémination du pollen<br />
11 Dans une étu<strong>de</strong> menée sur le cas <strong>de</strong>s Etats-Unis, Bullock, Desquilbet et Nitsi (2000) calculent <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong><br />
différentes options <strong>de</strong> <strong>net</strong>toyage du semoir et <strong>de</strong> <strong>la</strong> moissonneuse dans le cas du soja américain, en se basant sur<br />
<strong>de</strong>s résultats d'étu<strong>de</strong>s expérimenta<strong>les</strong>. Selon leur étu<strong>de</strong>, <strong>les</strong> coûts pour <strong>net</strong>toyer le semoir et <strong>la</strong> moissonneuse <strong>de</strong><br />
manière à obtenir une pureté d'au moins 99,8% sont faib<strong>les</strong>, <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 15 dol<strong>la</strong>rs (un peu plus <strong>de</strong> 100 francs)<br />
pour <strong>net</strong>toyer le semoir, et 10,5 dol<strong>la</strong>rs (environ 75 francs) pour <strong>net</strong>toyer <strong>la</strong> moissonneuse, en incluant une<br />
estimation du coût en travail, soit au total un coût équivalent à environ 0,06 dol<strong>la</strong>rs (environ 50 centimes) par<br />
tonne pour une exploitation typique du Midwest. Il resterait à faire une investigation analogue dans le cas du<br />
maïs et du colza en France.<br />
13
développé par Angevin et al. (2001), permettant <strong>de</strong> simuler <strong>de</strong>s conditions climatiques et<br />
agronomiques réel<strong>les</strong> <strong>de</strong> production <strong>de</strong> maïs. Selon leurs résultats, pour <strong>de</strong>ux parcel<strong>les</strong> contiguës <strong>de</strong><br />
maïs consommation <strong>de</strong> même taille, l'une étant semée avec une variété OGM et l'autre avec une<br />
variété non OGM, il serait possible <strong>de</strong> rester en <strong>de</strong>çà du seuil <strong>de</strong> 1 % soit en respectant une distance <strong>de</strong><br />
100 m <strong>entre</strong> <strong>les</strong> champs, soit en respectant un déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> floraison <strong>de</strong> 50°j équivalent à environ quatre<br />
jours pour <strong>de</strong>s températures moyennes <strong>de</strong> juillet dans le bassin parisien. Il n'existe pas à notre<br />
connaissance <strong>de</strong> résultats analogues dans le cas du colza (<strong>la</strong> distance serait sans doute supérieure car <strong>la</strong><br />
dissémination du pollen <strong>de</strong> colza est plus gran<strong>de</strong>).<br />
Comme en production <strong>de</strong> semences, il semble a priori extrêmement difficile d'organiser un<br />
déca<strong>la</strong>ge significatif <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> floraison OGM et non OGM, en raison <strong>de</strong>s pertes <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment et<br />
<strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> production qui en résulteraient. Concernant le zonage, à <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> <strong>la</strong> production<br />
<strong>de</strong> semences, il n'existe pas <strong>de</strong> cadre réglementaire sur lequel appuyer <strong>la</strong> définition <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s zones<br />
d'isolement sans culture <strong>de</strong> maïs ou <strong>de</strong> colza OGM sur <strong>de</strong>s kilomètres. En l'absence d'un tel cadre<br />
réglementaire, <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce et l'administration <strong>de</strong> ces zones <strong>de</strong>vraient s'appuyer exclusivement sur<br />
une concertation <strong>entre</strong> tous <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone. La structure du parcel<strong>la</strong>ire étant très fragmentée en<br />
France, il faudrait une coordination <strong>entre</strong> un grand nombre d'agriculteurs. Il semble possible d'aboutir<br />
à cette concertation dans le cas d'un maintien du contexte actuel où <strong>les</strong> OGM sont fortement rejetés et<br />
connaissent <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> débouchés. En revanche, si le contexte évoluait vers une coexistence <strong>de</strong><br />
débouchés OGM et non OGM, il serait plus difficile <strong>de</strong> convaincre <strong>de</strong>s agriculteurs ayant un intérêt<br />
économique à adopter <strong>de</strong>s variétés OGM <strong>de</strong> ne pas le faire. La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> cette coordination<br />
peut être aidée par le rôle <strong>de</strong>s organismes stockeurs qui peuvent donner <strong>de</strong>s incitations aux agriculteurs<br />
pour participer à une zone non OGM, via <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> production pour le non OGM incluant <strong>de</strong>s<br />
primes.<br />
Il ressort <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>tiens réalisés que <strong>les</strong> organismes stockeurs n'excluent pas <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong><br />
spécialisation <strong>de</strong> leurs propres points <strong>de</strong> collecte en refusant l'OGM à certains points <strong>de</strong> collecte.<br />
Cependant, <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> interrogés s'accor<strong>de</strong>nt pour juger qu'il serait très difficile <strong>de</strong> parvenir à une<br />
concertation <strong>de</strong>s différents collecteurs d'une zone pour définir cette zone comme non OGM, dans un<br />
contexte avec <strong>de</strong>s débouchés pour <strong>de</strong> l'OGM. A priori, <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> envisagent donc <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> stratégies<br />
<strong>de</strong> zonage uniquement pour leurs propres outils <strong>de</strong> collecte. Dans ce contexte, <strong>les</strong> agriculteurs<br />
souhaitant cultiver <strong>de</strong> l'OGM pourraient passer à <strong>la</strong> concurrence si un collecteur voisin acceptait<br />
l'OGM. <strong>Les</strong> <strong>acteurs</strong> interrogés n'envisagent donc pas <strong>de</strong> refuser l'OGM qui serait cultivé autour d'un<br />
point <strong>de</strong> collecte non OGM, mais plutôt <strong>de</strong> le dévier vers un autre point <strong>de</strong> collecte (selon le mail<strong>la</strong>ge<br />
<strong>entre</strong> <strong>les</strong> points <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> l'organisme stockeur, soit l'agriculteur irait livrer un peu plus loin au<br />
moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte, soit sa récolte serait enlevée par une société ou l'organisme stockeur lui-même).<br />
De plus, <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> interrogés jugent également qu'il serait nécessaire d'accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s primes aux<br />
agriculteurs situés autour <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> collecte non OGM pour qu'ils acceptent <strong>de</strong> renoncer à l'OGM,<br />
si l'OGM présente un avantage au niveau économique.<br />
14
En conclusion, il semble que l'on puisse anticiper que l'essentiel <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation OGM -<br />
non OGM seraient <strong>de</strong>s coûts pour limiter <strong>la</strong> pollinisation <strong>de</strong> variétés non OGM par du pollen OGM. Il<br />
est difficile en l'état actuel <strong>de</strong> savoir quels taux <strong>de</strong> pureté non OGM pourraient être atteints en<br />
l'absence <strong>de</strong> zonage. Comme pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences, il serait possible <strong>de</strong> limiter <strong>la</strong><br />
pollinisation OGM par création <strong>de</strong> zones non OGM. Cependant, <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> zones<br />
exigerait une coordination lour<strong>de</strong> <strong>entre</strong> <strong>acteurs</strong> (contrats <strong>entre</strong> l'organisme stockeur et <strong>les</strong> agriculteurs<br />
avec prime pour <strong>la</strong> production non OGM, accords <strong>entre</strong> organismes stockeurs). <strong>Les</strong> personnes<br />
interrogées étaient généralement très sceptiques sur cette possibilité. 12<br />
c. <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM / non OGM au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte et du<br />
stockage<br />
- Mesures prises actuellement sur le non OGM<br />
Actuellement, dans le cas du maïs, certains clients <strong>de</strong>s organismes stockeurs (amidonniers et<br />
semouliers essentiellement) souhaitent garantir l'absence d'OGM dans leurs produits. En l'absence <strong>de</strong><br />
diffusion commerciale d'OGM en France, l'essentiel <strong>de</strong>s coûts encourus par un organisme stockeur<br />
pour livrer du maïs certifié non OGM consiste en <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> garantie, tandis qu'il n'y a que peu <strong>de</strong><br />
coûts <strong>de</strong> ségrégation.<br />
<strong>Les</strong> coûts <strong>de</strong> garantie comprennent <strong>de</strong>s coûts d'analyses et <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> coordination verticale<br />
(c'est-à-dire <strong>de</strong> coordination <strong>entre</strong> acheteurs et ven<strong>de</strong>urs le long <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaîne). Ainsi, <strong>les</strong> organismes<br />
stockeurs réalisent ou comman<strong>de</strong>nt à un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong>s analyses <strong>de</strong> contenu OGM sur <strong>les</strong> semences<br />
qu'ils fournissent aux agriculteurs via leur branche d'approvisionnement. Au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> livraison,<br />
ils <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt à l'agriculteur <strong>de</strong> fournir un document garantissant que <strong>la</strong> semence a été achetée via leur<br />
branche d'approvisionnement, ou <strong>de</strong> donner le nom <strong>de</strong> leur fournisseur et une preuve d'achat sur <strong>la</strong><br />
semence achetée. Dans certains cas, <strong>de</strong>s échantillons sont prélevés chez <strong>les</strong> agriculteurs qui n'ont pas<br />
acheté <strong>la</strong> semence chez l'organisme stockeur à qui ils livrent leur collecte. Ces échantillons sont<br />
prélevés au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> croissance du maïs, afin <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s analyses <strong>de</strong> contenu OGM<br />
avant le moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte. Le coût correspondant (personnel, analyses) peut être facturé à ces<br />
agriculteurs.<br />
Il y a également pour l'organisme stockeur un coût d'investissement dans <strong>de</strong>s procédures<br />
d'assurance qualité (notamment pour mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>les</strong> procédures à suivre dans le cas où il est<br />
nécessaire <strong>de</strong> traiter à part une parcelle OGM ou une parcelle à risque). Deux cas <strong>de</strong> figure ont été<br />
exposés au cours <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>tiens concernant <strong>les</strong> re<strong>la</strong>tions <strong>entre</strong> organismes stockeurs et transformateurs.<br />
Dans un cas, l'acheteur vient faire une reconnaissance <strong>de</strong> lots au niveau cellule chez l'organisme<br />
12<br />
Il s'agit notamment <strong>de</strong> cinq responsab<strong>les</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte dans <strong>de</strong>s organismes stockeurs, et <strong>de</strong> personnes<br />
spécialistes <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences<br />
15
stockeur et prélève un échantillon sur lequel il fait réaliser une analyse <strong>de</strong> contenu OGM. Si cet<br />
échantillon lui convient, il fait appel spécifiquement à ce lot au moment <strong>de</strong> l'expédition. Dans l'autre<br />
cas, le client s'en remet à l'organisme stockeur pour lui expédier <strong>de</strong>s lots non OGM, après un audit<br />
jugé satisfaisant <strong>de</strong>s procédures d'assurance qualité <strong>de</strong> cet organisme stockeur.<br />
Enfin, même en l'absence <strong>de</strong> diffusion commerciale d'OGM, certains organismes stockeurs<br />
encourent déjà <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation proprement dite. Ainsi, certains organismes stockeurs ont<br />
choisi d'adapter leur logistique pour séparer le maïs non OGM certifié du reste du maïs - pouvant être<br />
non OGM mais n'entrant pas dans un circuit <strong>de</strong> certification (parce que l'agriculteur ne souhaite pas<br />
fournir <strong>de</strong> certificat sur sa semence, ou parce qu'il est localisé à proximité d'un essai OGM par<br />
exemple). Dans ce cas, <strong>les</strong> producteurs qui ne livrent pas du non OGM certifié (qui sont actuellement<br />
<strong>la</strong>rgement minoritaires) reçoivent <strong>de</strong>s consignes particulières pour <strong>la</strong> livraison. Par exemple, <strong>la</strong> récolte<br />
est enlevée chez l'agriculteur par camion puis acheminée vers un séchoir et un silo dédiés, qui ne sont<br />
pas nécessairement <strong>les</strong> équipements <strong>les</strong> plus proches <strong>de</strong> cet agriculteur.<br />
- Coûts potentiels pour <strong>les</strong> organismes stockeurs, en cas <strong>de</strong> coexistence OGM -<br />
non OGM<br />
• Coûts <strong>de</strong> ségrégation<br />
Le coût majeur <strong>de</strong> ségrégation au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong>s organismes stockeurs proviendrait sans doute <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nécessité <strong>de</strong> spécialiser certains équipements pour l'OGM et d'autres pour le non OGM, pour être en<br />
mesure <strong>de</strong> collecter et stocker séparément <strong>de</strong> l'OGM et du non OGM.<br />
La logistique <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte et du stockage <strong>de</strong> <strong>la</strong> graine chez l'organisme stockeur est rappelée dans<br />
l'annexe. <strong>Les</strong> instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> stockage consistent en général en un ou plusieurs circuits al<strong>la</strong>nt<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fosse <strong>de</strong> réception à un élévateur, puis à <strong>de</strong>s tapis rou<strong>la</strong>nts et un séchoir ou <strong>de</strong>s cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
stockage. <strong>Les</strong> graines sont souvent collectées à <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> proximité, où el<strong>les</strong> sont stockées<br />
temporairement avant d'être amenées vers <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> stockage final. En cas <strong>de</strong> coexistence d'OGM et<br />
<strong>de</strong> non OGM, il serait nécessaire <strong>de</strong> dédier certaines cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong> stockage à l'OGM et d'autres au non<br />
OGM. Il faudrait sans doute également spécialiser d'autres équipements (fosses <strong>de</strong> réception,<br />
élévateurs, tapis rou<strong>la</strong>nts, séchoirs) pour l'OGM ou pour le non OGM, pour éviter <strong>de</strong>s présences<br />
acci<strong>de</strong>ntel<strong>les</strong> <strong>de</strong> graines OGM dans <strong>la</strong> filière non OGM. En effet, ces équipements sont conçus pour<br />
rester "raisonnablement" propres, mais ils ne sont pas conçus pour rester sans <strong>la</strong> moindre graine. 13<br />
13 Il faudrait très peu <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nges au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong>s organismes stockeurs pour parvenir au seuil très faible <strong>de</strong> 1 %<br />
<strong>de</strong> présence fortuite d'OGM par ingrédient dans <strong>les</strong> produits <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière non OGM. Le <strong>net</strong>toyage complet <strong>de</strong>s<br />
équipements peut être long et coûteux. Il est en général réalisé seulement une fois par an, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> collecte. Il n'existe a priori pas <strong>de</strong> données expérimenta<strong>les</strong> permettant d'évaluer <strong>les</strong> taux d'impureté qui<br />
pourraient résulter du mé<strong>la</strong>nge avec <strong>de</strong>s graines restées dans <strong>les</strong> équipements. Il semble que <strong>les</strong> mé<strong>la</strong>nges au<br />
niveau du séchoir seraient trop importants pour garantir une pureté très élevée du maïs non OGM, en cas<br />
16
Plusieurs types <strong>de</strong> spécialisation peuvent être envisagés a priori. L'encart ci-<strong>de</strong>ssous présente trois<br />
types <strong>de</strong> spécialisation qui ont été évoqués au cours <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>tiens, en détail<strong>la</strong>nt dans chaque cas <strong>les</strong><br />
contraintes supplémentaires dues à <strong>la</strong> double filière :<br />
- certains équipements spécialisés OGM et d'autres équipements spécialisés non OGM à chaque point<br />
<strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> proximité, pour toute <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> collecte ;<br />
- une spécialisation OGM ou non OGM par points <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> proximité pour toute <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
collecte ;<br />
- une spécialisation OGM ou non OGM pendant une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte uniquement.<br />
La logique est i<strong>de</strong>ntique dans ces trois cas. En général, <strong>les</strong> équipements actuels <strong>de</strong> l'organisme<br />
stockeur ne sont pas adaptés pour stocker, dép<strong>la</strong>cer et sécher <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> maïs ou <strong>de</strong> colza. Or, le<br />
passage <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation actuelle avec uniquement du non OGM en France à une situation avec<br />
coexistence d'une filière avec OGM et d'une filière non OGM exigerait <strong>de</strong> stocker <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> maïs<br />
ou <strong>de</strong> colza séparément. De plus, en raison <strong>de</strong> l'exigence forte sur le niveau <strong>de</strong> pureté du non OGM, il<br />
serait sans doute nécessaire <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cer et sécher ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> maïs ou <strong>de</strong> colza dans <strong>de</strong>s<br />
équipements spécialisés. Deux solutions extrêmes s'offriraient alors à l'organisme stockeur.<br />
- La première serait d'utiliser <strong>les</strong> équipements existants en <strong>les</strong> spécialisant dans l'une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières.<br />
Il en résulterait une perte dans <strong>la</strong> flexibilité avec <strong>la</strong>quelle ces équipements peuvent être utilisés. Cette<br />
perte <strong>de</strong> flexibilité se traduirait par <strong>de</strong>s surcoûts logistiques, avec <strong>de</strong>s coûts additionnels pour chacune<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières. Des exemp<strong>les</strong> <strong>de</strong> tels surcoûts sont donnés dans l'encart ci-<strong>de</strong>ssous. Ainsi, <strong>les</strong><br />
livraisons <strong>de</strong> certains agriculteurs <strong>de</strong>vraient peut-être être transportées plus loin pour trouver un silo<br />
acceptant leurs graines. De plus, certains organismes stockeurs <strong>de</strong>vraient supporter <strong>de</strong>s surcoûts<br />
logistiques pour assurer <strong>la</strong> rotation <strong>de</strong>s camions <strong>entre</strong> leurs silos <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong> proximité et leurs silos<br />
<strong>de</strong> stockage principal. Le même type <strong>de</strong> coût additionnel pourrait être attendu concernant le transport<br />
<strong>de</strong>s graines jusqu'à l'usine <strong>de</strong> transformation.<br />
- La secon<strong>de</strong> solution serait d'acheter <strong>de</strong> nouveaux équipements, avec un coût d'investissement. A<br />
court terme, cependant, il ne faut sans doute pas attendre d'investissement massif avec un changement<br />
radical <strong>de</strong>s infrastructures existantes, en raison du coût élevé <strong>de</strong> certains équipements.<br />
<strong>Les</strong> solutions adoptées seraient sans doute situées <strong>entre</strong> ces <strong>de</strong>ux extrêmes, et varieraient sans doute<br />
selon <strong>les</strong> organismes stockeurs en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> configuration physique <strong>de</strong> leurs équipements<br />
(rapprochement géographique <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents points <strong>de</strong> collecte intermédiaire ; nombre <strong>de</strong> circuits<br />
séparés pour dép<strong>la</strong>cer, sécher et stocker <strong>de</strong>s graines à chaque point <strong>de</strong> collecte). De plus, certains<br />
organismes stockeurs pourraient gérer <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux filières à <strong>de</strong>s coûts plus faib<strong>les</strong> que d'autres.<br />
d'alternance du séchage <strong>de</strong> maïs OGM et non OGM sans précaution particulière. Ainsi, Le Bail et Choimet<br />
(2001) citent un chiffre <strong>de</strong> 2 à 3 % <strong>de</strong> grains pouvant rester dans un séchoir après passage d'un lot et se mêler au<br />
lot suivant.<br />
17
Encart 3. Différents cas <strong>de</strong> figure envisagés pour <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong>s équipements <strong>de</strong>s<br />
organismes stockeurs dans <strong>les</strong> filières OGM et non OGM<br />
1. Equipements spécialisés OGM et équipements spécialisés non OGM à chaque point <strong>de</strong><br />
collecte, sur l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> collecte<br />
Dans ce cas <strong>de</strong> figure, <strong>de</strong>s équipements différents seraient alloués à l'OGM et au non OGM à<br />
chaque point <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> proximité. Il y aurait donc une collecte simultanée d'OGM et <strong>de</strong> non OGM<br />
à chacun <strong>de</strong> ces points <strong>de</strong> collecte. Il en résulterait <strong>de</strong>ux contraintes <strong>de</strong> capacité distinctes pour chaque<br />
culture à chaque point <strong>de</strong> collecte, une pour <strong>la</strong> filière OGM et une pour <strong>la</strong> filière non OGM (au lieu<br />
d'une contrainte <strong>de</strong> capacité totale dans <strong>la</strong> situation actuelle ).<br />
- Selon <strong>la</strong> configuration physique actuelle <strong>de</strong> ces points <strong>de</strong> collecte (en particulier, nombre <strong>de</strong><br />
circuits séparés pour dép<strong>la</strong>cer <strong>les</strong> graines jusqu'aux cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong> stockage, et nombre <strong>de</strong> cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
stockage), il faudrait ou non investir dans <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions supplémentaires (cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong> stockage<br />
supplémentaires, murs <strong>de</strong> béton supplémentaires aux endroits où <strong>la</strong> collecte est en tas) pour permettre<br />
<strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières.<br />
- La séparation physique OGM - non OGM serait plus facile dans le cas du maïs que dans le cas du<br />
colza. En effet, le maïs est <strong>la</strong> seule culture récoltée en octobre - novembre, alors que <strong>la</strong> récolte du colza<br />
chevauche <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte <strong>de</strong> l'orge et le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte du blé. Dans le cas du colza, certaines<br />
cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong> stockage aux points <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> proximité et certains camions assurant le transport <strong>de</strong>s<br />
graines jusqu'aux sites <strong>de</strong> stockage final sont donc occupés par l'orge ou le blé, il y a moins <strong>de</strong> capacité<br />
disponible pour traiter séparément colza OGM et colza non OGM.<br />
Il pourrait en résulter <strong>de</strong>s surcoûts logistiques <strong>de</strong> plusieurs ordres, pour coordonner le transport <strong>de</strong>s<br />
graines <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong> proximité aux sites <strong>de</strong> stockage principal. Ainsi, dans le cas d'un<br />
transport assuré par camion, il y aurait <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> coûts :<br />
- coût pour <strong>net</strong>toyer <strong>les</strong> camions <strong>entre</strong> un chargement OGM et un chargement non OGM, ou assurer<br />
<strong>les</strong> rotations <strong>entre</strong> sites <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong> proximité et sites <strong>de</strong> stockage principal en dédiant certains<br />
camions à l'OGM et d'autres au non OGM ;<br />
- coût pour adapter le rythme <strong>de</strong>s rotations <strong>de</strong> camions au rythme <strong>de</strong> remplissage <strong>de</strong>s cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
stockage <strong>de</strong> proximité pour chacune <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières : en achetant ou en louant <strong>de</strong> nouveaux camions ;<br />
ou en investissant dans <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> stockage supplémentaires pour diminuer <strong>les</strong> contraintes sur <strong>les</strong><br />
rotations <strong>de</strong>s camions.<br />
Selon leur configuration physique, soit <strong>les</strong> sites <strong>de</strong> séchage et <strong>de</strong> stockage principal géreraient<br />
également OGM et non OGM en simultané avec spécialisation <strong>de</strong>s équipements, soit ces sites seraient<br />
dédiés à l'une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières (dans ce cas <strong>les</strong> surcoûts logistiques comprendraient également un<br />
parcours <strong>de</strong> distances supplémentaires par <strong>les</strong> camions <strong>entre</strong> <strong>les</strong> points <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> proximité et <strong>les</strong><br />
sites <strong>de</strong> stockage principal).<br />
2. Certains points <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> proximité spécialisés OGM et d'autres spécialisés non OGM,<br />
sur l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> collecte<br />
Dans ce cas <strong>de</strong> figure, certains sites collecteraient uniquement du non OGM. D'autres sites<br />
collecteraient <strong>de</strong> l'OGM, et éventuellement du non OGM qui serait mé<strong>la</strong>ngé avec l'OGM. La filière<br />
non OGM serait réservée en priorité aux agriculteurs situés autour <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> collecte non OGM.<br />
L'organisme stockeur n'accepterait pas l'OGM à tous ses points <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> proximité. Il courrait<br />
alors le risque qu'un client non satisfait <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> collecte passe à <strong>la</strong> concurrence. Pour gar<strong>de</strong>r<br />
<strong>les</strong> agriculteurs cultivant <strong>de</strong> l'OGM autour <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> collecte non OGM, il y aurait un surcoût<br />
logistique pour dévier leur récolte vers un point <strong>de</strong> collecte OGM. <strong>Les</strong> agriculteurs pourraient aller<br />
livrer eux-mêmes au point <strong>de</strong> collecte OGM s'il était suffisamment proche. Cependant, le mail<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s<br />
points <strong>de</strong> collecte d'un organisme stockeur est souvent assez lâche, avec <strong>de</strong>s distances <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> dix<br />
kilomètres. Or, un trajet plus long <strong>de</strong>s tr<strong>acteurs</strong> jusqu'aux points <strong>de</strong> collecte est problématique au<br />
moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte, s'il est nécessaire d'arrêter <strong>la</strong> récolte dans <strong>les</strong> champs en attendant le retour <strong>de</strong><br />
18
ces tr<strong>acteurs</strong> (l'agriculteur courant alors le risque d'un passage du beau temps au mauvais temps donc<br />
d'un retard encore plus grand dans <strong>la</strong> récolte, d'une perte <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment, d'une mauvaise structure du<br />
sol pour <strong>la</strong> culture suivante). En cas <strong>de</strong> distance trop gran<strong>de</strong> <strong>entre</strong> <strong>les</strong> points <strong>de</strong> collecte, l'organisme<br />
stockeur ou une société pourrait se charger d'enlever <strong>la</strong> récolte OGM chez l'agriculteur pour <strong>la</strong> dévier<br />
vers un point <strong>de</strong> collecte OGM.<br />
Différents critères ont été mis en avant dans <strong>les</strong> <strong>entre</strong>tiens pour le choix <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> collecte non<br />
OGM dans ce cas <strong>de</strong> figure :<br />
- <strong>la</strong> distance avec un autre point <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> l'organisme stockeur ;<br />
- <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s exploitations situées autour du point <strong>de</strong> collecte (avec en priorité <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
exploitations pour diminuer le nombre d'agriculteurs avec <strong>les</strong>quels une coordination est nécessaire, et<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s parcel<strong>les</strong> pour limiter <strong>les</strong> problèmes liés à <strong>la</strong> pollinisation croisée) ;<br />
- <strong>les</strong> re<strong>la</strong>tions commercia<strong>les</strong> avec <strong>les</strong> agriculteurs situés autour du point <strong>de</strong> collecte (le choix se<br />
portera en priorité vers <strong>de</strong>s zones où l'organisme stockeur a <strong>de</strong>s liens rapprochés avec <strong>les</strong> agriculteurs,<br />
notamment où <strong>les</strong> agriculteurs achètent <strong>la</strong> semence à l'organisme stockeur) ;<br />
- l'intensité <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence avec <strong>les</strong> autres organismes stockeurs (dans une zone où <strong>la</strong><br />
concurrence est faible, le risque <strong>de</strong> voir <strong>de</strong>s producteurs changer <strong>de</strong> collecteur parce qu'ils ne sont pas<br />
satisfaits <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> collecte proposées serait faible ).<br />
3. Spécialisation <strong>de</strong>s équipements pendant une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> collecte uniquement<br />
Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, un même équipement serait utilisé successivement pour <strong>de</strong> l'OGM et du non<br />
OGM. Il faudrait alors :<br />
- <strong>net</strong>toyer l'équipement avant utilisation pour le non OGM (mais ce<strong>la</strong> supposerait une pause dans<br />
l'utilisation <strong>de</strong> l'équipement pouvant aller jusqu'à plusieurs jours, ce qui serait très problématique en<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> collecte) ;<br />
- ou "rincer" l'équipement avec du non OGM, c'est-à-dire diriger <strong>les</strong> premiers volumes non OGM,<br />
susceptib<strong>les</strong> d'être mé<strong>la</strong>ngés avec <strong>les</strong> grains OGM restant dans l'équipement, vers <strong>la</strong> filière avec OGM.<br />
Avec cette métho<strong>de</strong>, une partie <strong>de</strong>s volumes non OGM livrés par <strong>les</strong> agriculteurs serait donc<br />
finalement mé<strong>la</strong>ngée avec <strong>de</strong> l'OGM.<br />
Comme nous l'avons déjà évoqué, il est très difficile <strong>de</strong> convaincre <strong>les</strong> agriculteurs livrant à <strong>la</strong><br />
récolte <strong>de</strong> retar<strong>de</strong>r <strong>la</strong> récolte, en raison <strong>de</strong>s risques encourus en cas <strong>de</strong> mauvais temps. En général un<br />
agriculteur a un déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> huit à dix jours au maximum <strong>entre</strong> <strong>la</strong> première et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière parcelle <strong>de</strong><br />
maïs récoltées. Pour le colza, le déca<strong>la</strong>ge est encore plus court. Il semblerait donc extrêmement<br />
difficile <strong>de</strong> convaincre <strong>les</strong> agriculteurs <strong>de</strong> livrer leur culture dans une filière donnée seulement lors<br />
d'une pério<strong>de</strong> donnée.<br />
Une autre solution consisterait à recourir au stockage chez <strong>les</strong> agriculteurs pour une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
filières. Ce cas <strong>de</strong> figure est étudié en détail par Le Bail et Choimet (2001), qui relèvent <strong>de</strong>ux<br />
contraintes : <strong>la</strong> contrainte <strong>de</strong> volume imposée par cette solution (<strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> stockage chez <strong>les</strong><br />
agriculteurs définit le volume maximal <strong>de</strong> l'une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières) et <strong>les</strong> problèmes <strong>de</strong> qualité (<strong>les</strong><br />
pertes <strong>de</strong> qualité peuvent être plus importantes au cours du stockage sur l'exploitation qu'au cours du<br />
stockage chez l'organisme stockeur).<br />
• Coûts <strong>de</strong> garantie<br />
En plus <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation liés à <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cer, sécher et stocker à part l'OGM et le<br />
non OGM, <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM conduirait à une augmentation <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> garantie. En<br />
effet, l'organisme stockeur <strong>de</strong>vrait être certain du contenu non OGM d'une remorque d'un agriculteur<br />
avant <strong>de</strong> <strong>la</strong> décharger dans une cellule <strong>de</strong> stockage dédiée au non OGM. De plus, il serait souhaitable<br />
pour lui d'être en mesure d'estimer <strong>les</strong> volumes respectifs <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières avant le moment <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
19
écolte, pour organiser <strong>la</strong> logistique <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte et <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>s clients pour <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong><br />
produits (non OGM certifié ou avec OGM).<br />
L'organisme stockeur pourrait passer un contrat avec l'agriculteur spécifiant <strong>de</strong>s pratiques <strong>de</strong><br />
production (achat d'une semence non OGM, contrôle <strong>de</strong>s cultures cultivées dans <strong>les</strong> champs voisins,<br />
<strong>net</strong>toyage <strong>de</strong>s engins agrico<strong>les</strong>), et vérifier l'application <strong>de</strong> ce contrat, éventuellement prélever <strong>de</strong>s<br />
échantillons pour réaliser <strong>de</strong>s tests <strong>de</strong> contenu OGM avant <strong>la</strong> récolte. Il y aurait alors un coût <strong>de</strong> mise<br />
en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> ces contrats et <strong>de</strong> vérification du respect <strong>de</strong>s contrats.<br />
Il pourrait également, soit <strong>de</strong> manière alternative, soit en complément, tester le contenu OGM <strong>de</strong><br />
l'échantillon prélevé lors <strong>de</strong> sa livraison par l'agriculteur. Des tests rapi<strong>de</strong>s déjà disponib<strong>les</strong> sur le<br />
marché permettent d'analyser le contenu OGM en dix à quinze minutes pour du soja ou certaines<br />
variétés <strong>de</strong> maïs (Bullock et al., 2000). Il s'agit <strong>de</strong> tests qui requièrent un équipement minimal et<br />
peuvent être réalisés n'importe où. Ce sont <strong>de</strong>s tests qualitatifs, donnant une réponse oui/non (présence<br />
ou absence <strong>de</strong>s OGM ciblés par le test dans l'échantillon). En cas <strong>de</strong> test OGM au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
livraison, il serait nécessaire d'attendre le résultat du test avant <strong>de</strong> décharger <strong>les</strong> graines. Il faudrait<br />
alors augmenter le nombre d'employés présents au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception, pour réaliser <strong>les</strong> tests<br />
OGM au plus vite et éviter une désorganisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception. Si <strong>la</strong> livraison a lieu directement à <strong>la</strong><br />
récolte, une attente plus longue du tracteur au point <strong>de</strong> collecte en raison <strong>de</strong>s tests OGM est<br />
problématique, s'il est nécessaire d'arrêter <strong>la</strong> collecte dans <strong>les</strong> champs en attendant le retour d'un<br />
tracteur. L'agriculteur ou l'organisme stockeur <strong>de</strong>vrait alors peut-être louer ou acheter <strong>de</strong>s tr<strong>acteurs</strong> ou<br />
<strong>de</strong>s camions supplémentaires.<br />
d. <strong>Les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM / non OGM au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation<br />
Le sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation n'a pas fait l'objet d'<strong>entre</strong>tiens spécifiques pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> temps.<br />
Dans <strong>la</strong> situation actuelle, <strong>les</strong> OGM sont exclus <strong>de</strong> l'alimentation humaine et <strong>de</strong> certains débouchés en<br />
alimentation animale dans <strong>de</strong>s filières <strong>de</strong> qualité, tandis qu'il sont acceptés dans le reste <strong>de</strong><br />
l'alimentation animale et dans <strong>les</strong> débouchés industriels. <strong>Les</strong> transformateurs refusant le non OGM ont<br />
déjà mis en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> procédures pour contrôler <strong>les</strong> lots non OGM. <strong>Les</strong> coûts qu'ils subissent sont<br />
essentiellement <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> garantie pour s'assurer <strong>de</strong> l'absence d'OGM. Certains subissent également<br />
<strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation, essentiellement dans le cas du soja en raison <strong>de</strong> l'importance <strong>de</strong>s<br />
importations OGM.<br />
La situation actuelle est donc une segmentation <strong>de</strong>s débouchés OGM - non OGM en fonction <strong>de</strong>s<br />
utilisations, certains utilisateurs acceptant <strong>les</strong> OGM et d'autres non. Cette situation pourrait se<br />
prolonger dans un scénario <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM dans l'UE. Il pourrait également y avoir coexistence<br />
OGM - non OGM dans <strong>de</strong>ux autres scénarios : une segmentation par <strong>de</strong>stination, certains pays <strong>de</strong> l'UE<br />
acceptant <strong>les</strong> OGM et d'autres non ; et un doublement <strong>de</strong> gamme pour certains produits (avec une<br />
gamme avec OGM et une gamme non OGM).<br />
20
Pour déterminer l'importance éventuelle <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> ségrégation, il faudrait tout d'abord réaliser<br />
une analyse détaillée <strong>de</strong>s débouchés <strong>de</strong>s produits et co-produits <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation pour chaque type<br />
d'usine. Ceci permettrait <strong>de</strong> déterminer dans quels scénarios l'usine participerait aux <strong>de</strong>ux filières,<br />
auquel cas il y aurait un coût pour assurer <strong>la</strong> ségrégation dans l'usine, et dans quels scénarios elle<br />
participerait à une seule <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières, auquel cas il n'y aurait pas <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> ségrégation dans<br />
l'usine. Il y aurait alors différents cas <strong>possib<strong>les</strong></strong> dans le cas d'une participation aux <strong>de</strong>ux filières : usine<br />
dédiée (mais le nombre d'usines est faible pour chaque type <strong>de</strong> transformation), <strong>net</strong>toyage <strong>de</strong>s<br />
équipements <strong>entre</strong> OGM et non OGM, ou "rinçage" <strong>de</strong>s équipements en faisant passer du non OGM<br />
après <strong>de</strong> l'OGM. Une connaissance technique <strong>de</strong>s procédés <strong>de</strong> transformation serait nécessaire pour<br />
étudier ces cas.<br />
1.3. Conclusion partielle<br />
La section précé<strong>de</strong>nte a détaillé <strong>les</strong> types <strong>de</strong> coûts liés à <strong>la</strong> coexistence OGM - non OGM, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence à <strong>la</strong> production du produit transformé, en distinguant <strong>les</strong> coûts supportés<br />
actuellement et <strong>les</strong> coûts additionnels que l'on peut anticiper en cas <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM en France.<br />
<strong>Les</strong> coûts qui seraient liés à <strong>la</strong> nouvelle segmentation par diffusion <strong>de</strong>s OGM en France 14 peuvent être<br />
séparés en <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s catégories :<br />
- Des coûts <strong>de</strong> ségrégation, pour maintenir à tous <strong>les</strong> sta<strong>de</strong>s une séparation physique <strong>de</strong>s produits<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières, en garantissant une pureté très élevée pour le non OGM. D'après ce qui précè<strong>de</strong>,<br />
il semble que l'on peut anticiper principalement <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> ségrégation :<br />
- <strong>de</strong>s coûts pour éviter <strong>la</strong> pollinisation <strong>de</strong> cultures non OGM par du pollen OGM, aux sta<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences et <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole<br />
- <strong>de</strong>s coûts liés à une perte <strong>de</strong> flexibilité dans l'utilisation <strong>de</strong> certains équipements, en raison<br />
<strong>de</strong> leur spécialisation dans l'une ou l'autre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières, aux sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte et du<br />
stockage, du transport, éventuellement <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation ; et <strong>de</strong>s coûts d'investissement<br />
dans <strong>de</strong> nouveaux équipements<br />
- Des coûts <strong>de</strong> garantie, pour assurer un acheteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière non OGM que le contenu <strong>de</strong> son<br />
produit est bien non OGM au seuil <strong>de</strong> tolérance accepté :<br />
14 En cas <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM en France, il y aurait une nouvelle segmentation aux sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> production<br />
<strong>de</strong> semences, <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole et <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte et du stockage, avec <strong>de</strong>ux filières (avec OGM et non<br />
OGM) là où actuellement il n'en existe qu'une (non OGM). Comme il est expliqué précé<strong>de</strong>mment, <strong>la</strong> diffusion<br />
<strong>de</strong>s OGM en France pourrait également conduire à une nouvelle segmentation pour certaines industries <strong>de</strong><br />
transformation, mais pas nécessairement,. En effet, il existe déjà une segmentation selon <strong>les</strong> débouchés <strong>entre</strong> une<br />
filière avec OGM importés et une filière non OGM (non OGM pour l'alimentation humaine et certaines filières<br />
<strong>de</strong> qualité en alimentation animale, avec OGM pour le reste <strong>de</strong> l'alimentation animale et <strong>les</strong> débouchés<br />
industriels).<br />
21
- tests <strong>de</strong> contenu non OGM<br />
- mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> contrats spécifiant <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> ségrégation <strong>entre</strong> acheteurs et<br />
ven<strong>de</strong>urs, vérification du respect <strong>de</strong> ces contrats<br />
- coûts internes <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> procédures d'assurance qualité.<br />
Plusieurs questions se posent alors, à savoir, quelle serait l'importance <strong>de</strong> ces coûts, comment ils<br />
varieraient en fonction du taux <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM, et comment ces coûts seraient partagés <strong>entre</strong> <strong>les</strong><br />
différents <strong>acteurs</strong> et <strong>entre</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux filières (avec OGM ou non OGM). Il n'y a pas <strong>de</strong> tentative pour<br />
quantifier ces différents coûts dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>. En revanche, <strong>la</strong> partie suivante présente <strong>de</strong>s<br />
résultats préliminaires obtenus à partir d'un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion sur <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s coûts liés à <strong>la</strong><br />
coexistence <strong>de</strong>s OGM <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong>.<br />
22
2. Répartition potentielle <strong>de</strong>s coûts liés à <strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
filières <strong>entre</strong> <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong>: un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion<br />
Cette partie présente <strong>les</strong> résultats préliminaires d'un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion développé pour<br />
comprendre <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières (avec OGM et non<br />
OGM) sur <strong>les</strong> différents <strong>acteurs</strong>. Ce modèle utilise <strong>les</strong> enseignements <strong>de</strong> l'analyse qualitative qui<br />
précè<strong>de</strong> sur <strong>les</strong> types <strong>de</strong> coûts liés à <strong>la</strong> segmentation, en posant <strong>de</strong>s hypothèses ad hoc sur <strong>les</strong> niveaux<br />
<strong>de</strong> ces coûts.<br />
Ce modèle est appliqué au cas du colza dans l'Union Européenne et le reste du mon<strong>de</strong>. 15 Trois<br />
groupes d'<strong>acteurs</strong> sont distingués : <strong>les</strong> producteurs agrico<strong>les</strong>, <strong>les</strong> stockeurs/transformateurs (considérés<br />
comme un acteur agrégé) et <strong>les</strong> consommateurs. Par mesure <strong>de</strong> simplification, <strong>les</strong> organismes<br />
stockeurs et <strong>les</strong> transformateurs sont agrégés en un unique acteur et le produit <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation du<br />
colza est ramené en équivalent colza sans distinguer <strong>les</strong> différents produits <strong>de</strong> transformation. Le<br />
modèle comprend donc <strong>de</strong>ux marchés liés verticalement, le marché du colza au sta<strong>de</strong> agricole (colza<br />
vendu par <strong>les</strong> agriculteurs et acheté par <strong>les</strong> stockeurs/transformateurs) et le marché du colza transformé<br />
(colza vendu par <strong>les</strong> stockeurs/transformateurs et acheté par <strong>les</strong> consommateurs).<br />
L'intérêt <strong>de</strong> ce modèle est <strong>de</strong> prendre en compte l'hétérogénéité <strong>de</strong> ces différents groupes. Au sta<strong>de</strong><br />
agricole, il est supposé que différents agriculteurs ont <strong>de</strong>s gains différents s'ils adoptent <strong>de</strong>s variétés<br />
OGM, et <strong>de</strong>s coûts différents dans le cas où ils déci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> maintenir l'i<strong>de</strong>ntité non OGM <strong>de</strong> leur colza.<br />
<strong>Les</strong> différents stockeurs/transformateurs ont <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> stockage et transformation différents, et <strong>de</strong>s<br />
coûts <strong>de</strong> maintien d'i<strong>de</strong>ntité non OGM différents. <strong>Les</strong> consommateurs ont <strong>de</strong>s préférences différentes<br />
envers l'OGM et le non OGM. L'objectif <strong>de</strong> ce modèle à <strong>de</strong>ux sta<strong>de</strong>s avec <strong>de</strong>s groupes hétérogènes est<br />
d'examiner <strong>de</strong> manière détaillée qui gagne et qui perd dans chaque groupe pour différents scénarios<br />
d'introduction <strong>de</strong> coexistence OGM / non OGM. <strong>Les</strong> simu<strong>la</strong>tions montrent que <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
diffusion <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation <strong>de</strong>s filières avec OGM et non OGM peuvent être très<br />
différents, au sein d'un même groupe, selon <strong>les</strong> individus.<br />
15 Bien que l'ensemble <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> concerne le cas français, il a été choisi ici <strong>de</strong> raisonner au niveau <strong>de</strong> l'UE. En<br />
effet, on considère ici l'effet <strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong>s filières séparées sur <strong>les</strong> équilibres <strong>de</strong> marché. Il est<br />
alors indispensable <strong>de</strong> modéliser l'UE dans son ensemble, dans <strong>la</strong> mesure où si <strong>les</strong> OGM sont adoptés en France,<br />
ils le seront également dans le reste <strong>de</strong> l'UE. On aurait alors pu choisir <strong>de</strong> distinguer trois zones, France, UE hors<br />
France et reste du mon<strong>de</strong>. Pour simplifier, on a préféré retenir uniquement l'UE dans son ensemble sans<br />
distinguer <strong>la</strong> France.<br />
23
2.1. Introduction : structure du modèle et hypothèses principa<strong>les</strong><br />
- Structure générale du modèle<br />
La structure générale du modèle est résumée dans <strong>la</strong> figure 1 ci-<strong>de</strong>ssous. <strong>Les</strong> agriculteurs ont le<br />
choix <strong>entre</strong> quatre productions : du colza non OGM sans i<strong>de</strong>ntité préservée (c'est-à-dire produit à partir<br />
d'une semence non OGM mais pour lequel aucune procédure n'est mise en œuvre pour empêcher <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>la</strong>nges avec <strong>de</strong> l'OGM), du colza OGM, du colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée (cultivé à partir<br />
d'une semence non OGM et pour lequel <strong>de</strong>s procédures sont prises pour éviter <strong>les</strong> mé<strong>la</strong>nges avec du<br />
colza OGM), et une culture alternative.<br />
Seul le colza à i<strong>de</strong>ntité préservée (IP) au sta<strong>de</strong> agricole peut être transformé en colza à i<strong>de</strong>ntité<br />
préservée et vendu comme tel aux consommateurs finaux. En revanche, le colza non OGM sans<br />
i<strong>de</strong>ntité préservée au sta<strong>de</strong> agricole ne pourra pas être vendu comme non OGM après transformation.<br />
Il est considéré comme du colza appelé "standard" par <strong>les</strong> transformateurs, et mé<strong>la</strong>ngé indifféremment<br />
avec le colza OGM, pour être vendu comme du colza standard aux consommateurs.<br />
Le colza standard est consommé dans l'UE ou exporté vers le reste du mon<strong>de</strong> après transformation,<br />
tandis que le colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée est uniquement consommé dans l'UE. On considère<br />
un bien alternatif, substitut proche du colza, à <strong>la</strong> transformation. Le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture alternative et le<br />
prix du substitut du colza à <strong>la</strong> consommation sont supposés constants (hypothèse d'équilibre partiel).<br />
En revanche, dans <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions, <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> colza aux <strong>de</strong>ux sta<strong>de</strong>s sont<br />
déterminés <strong>de</strong> manière endogène comme <strong>les</strong> prix qui conduisent à l'équilibre offre-<strong>de</strong>man<strong>de</strong> sur<br />
chaque marché.<br />
Figure 1 : Structure du modèle<br />
(RESTE DU MONDE)<br />
UNION EUROPENNE<br />
consommateurs<br />
colza standard<br />
colza non OGM à<br />
i<strong>de</strong>ntité préservée<br />
bien alternatif<br />
(prix constant)<br />
stockeurs/transformateurs<br />
colza standard<br />
colza non OGM à<br />
i<strong>de</strong>ntité préservée<br />
colza non OGM<br />
sans i<strong>de</strong>ntité<br />
préservée<br />
colza OGM<br />
colza non OGM à<br />
i<strong>de</strong>ntité préservée<br />
culture alternative<br />
(prix constant)<br />
Agriculteurs<br />
24
- Hypothèses sur <strong>les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> segmentation<br />
<strong>Les</strong> hypothèses suivantes sont retenues dans le modèle concernant <strong>les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> segmentation<br />
OGM - non OGM, (ces hypothèses sont détaillées dans <strong>les</strong> sections qui suivent).<br />
1) Au sta<strong>de</strong> agricole, on suppose que le coût pour produire du colza non OGM à IP est supérieur au<br />
coût du colza non OGM sans IP pour chaque agriculteur. La différence <strong>entre</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux coûts reflète <strong>les</strong><br />
coûts pour maintenir l'i<strong>de</strong>ntité non OGM du colza : surcoût <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence non OGM à IP ; coût <strong>de</strong><br />
<strong>net</strong>toyage <strong>de</strong>s engins et équipements agrico<strong>les</strong> ; coût lié à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d'un contrat avec un<br />
organisme stockeur ; coût pour livrer à un silo acceptant le non OGM.<br />
Pour simplifier, on suppose ici que <strong>la</strong> différence <strong>entre</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux coûts est constante pour chaque<br />
agriculteur : ainsi, on suppose que le coût additionnel pour maintenir l'i<strong>de</strong>ntité non OGM ne varie pas<br />
selon le taux <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> l'OGM. Cette hypothèse simplificatrice ne serait probablement pas<br />
vérifiée en réalité. Notamment, <strong>les</strong> problèmes liés à <strong>la</strong> pollinisation croisée augmenteraient avec le<br />
taux <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM. A ce sta<strong>de</strong>, <strong>les</strong> mesures qui seraient nécessaires pour éviter cette<br />
pollinisation croisée ne sont pas c<strong>la</strong>ires, notamment il n'est pas c<strong>la</strong>ir qu'il faudrait ou non un zonage<br />
pour respecter <strong>les</strong> seuils actuellement établis ou envisagés, et si oui, comment il serait mis en p<strong>la</strong>ce. La<br />
question du zonage n'est pas prise en compte dans le modèle.<br />
On suppose ici que le coût additionnel <strong>de</strong> maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité non OGM varie selon <strong>les</strong><br />
agriculteurs. Cette hypothèse reflète par exemple <strong>de</strong>s différences dans <strong>les</strong> coûts pour contrôler <strong>la</strong><br />
pollinisation croisée selon <strong>la</strong> taille <strong>de</strong>s parcel<strong>les</strong> et leur situation par rapport aux parcel<strong>les</strong> voisines<br />
(mais, une fois encore, ce coût est constant dans le modèle, donc par exemple ne reflète pas le fait que<br />
<strong>les</strong> voisins cultivent <strong>de</strong> l'OGM ou pas). Elle peut également refléter un coût pour livrer le non OGM à<br />
un point <strong>de</strong> collecte dédié plus ou moins éloigné (avec <strong>la</strong> même limite : le coût constant ne reflète pas<br />
le changement d'affectation possible <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> collecte selon le taux <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> l'OGM).<br />
2) Au sta<strong>de</strong> du stockage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation, on considère <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> coûts liés à <strong>la</strong><br />
segmentation OGM - non OGM :<br />
- un coût <strong>de</strong> maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité non OGM, en excluant le coût d'achat du colza à l'agriculteur et en<br />
excluant <strong>les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong>s équipements. Ce coût est symétrique du coût précé<strong>de</strong>nt<br />
pour <strong>les</strong> agriculteurs. Il est affecté uniquement au colza non OGM IP. Il est constant (il ne varie pas<br />
selon le taux <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM) et il varie d'un stockeur/transformateur à l'autre. Il reflète <strong>les</strong><br />
coûts <strong>de</strong> garantie (tests <strong>de</strong> contenu OGM, mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> contrats avec <strong>les</strong> agriculteurs et <strong>entre</strong><br />
organismes stockeurs et transformateurs), <strong>les</strong> coûts éventuels <strong>de</strong> <strong>net</strong>toyage <strong>de</strong> certains équipements<br />
pour le non OGM.<br />
- un coût lié <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong>s équipements (perte <strong>de</strong> flexibilité due à <strong>la</strong> spécialisation ;<br />
investissements en équipements nouveaux). Pour simplifier, on suppose que ce coût dépend<br />
uniquement <strong>de</strong>s quantités agrégées <strong>de</strong> colza standard et <strong>de</strong> colza non OGM à IP qui sont transformées<br />
25
(mais ne dépend pas <strong>de</strong>s quantités transformées par un transformateur donné). Il est le même pour tous<br />
<strong>les</strong> transformateurs. Il est affecté en partie au colza non OGM à IP et en partie au colza standard. Plus<br />
exactement, on suppose que le coût supporté par un type <strong>de</strong> colza augmente avec <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l'autre type<br />
<strong>de</strong> colza dans l'ensemble du colza transformé.<br />
Ces hypothèses sur <strong>les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> segmentation OGM - non OGM ne reflètent que partiellement<br />
<strong>les</strong> coûts que l'on peut réellement anticiper et qui ont été présentés précé<strong>de</strong>mment. <strong>Les</strong> principa<strong>les</strong><br />
hypothèses simplificatrices sont <strong>les</strong> suivantes :<br />
- Une partie <strong>de</strong> ces coûts ne varie pas selon le taux <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM ;<br />
- Certains coûts varient selon le taux <strong>de</strong> diffusion, mais seulement au sta<strong>de</strong> du stockage et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
transformation ;<br />
- <strong>Les</strong> coûts qui varient en fonction du taux <strong>de</strong> diffusion sont i<strong>de</strong>ntiques d'un stockeur/transformateur à<br />
l'autre.<br />
- Autres hypothèses importantes<br />
Il est important d'insister sur certaines hypothèses généra<strong>les</strong> du modèle :<br />
- Le modèle est un modèle statique. Lorsque l'on introduit un changement (par exemple, adoption du<br />
colza OGM dans l'UE), on se p<strong>la</strong>ce toujours dans une situation d'équilibre <strong>entre</strong> offre agrégée et<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> agrégée sur chaque marché pour examiner <strong>les</strong> conséquences <strong>de</strong> ce changement.<br />
- C'est un modèle non spatial. Notamment, on ne considère pas <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tion bi<strong>la</strong>térale acheteur-ven<strong>de</strong>ur<br />
<strong>entre</strong> un agriculteur et un stockeur/transformateur. Tous <strong>les</strong> agriculteurs obtiennent le même prix pour<br />
un type <strong>de</strong> colza donné. S'il existe une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour du colza à i<strong>de</strong>ntité préservée au niveau UE,<br />
n'importe quel agriculteur peut vendre du colza à i<strong>de</strong>ntité préservée au même prix que <strong>les</strong> autres.<br />
Ainsi, on ne considère pas le cas où un agriculteur est dans l'impossibilité <strong>de</strong> vendre du colza non<br />
OGM à IP parce qu'il n'a pas d'acheteur à proximité.<br />
- C'est un modèle à information parfaite. Pour prendre en compte le fait qu'il est nécessaire <strong>de</strong> mettre<br />
en œuvre <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> test et <strong>de</strong> contrat pour s'assurer que du colza est non OGM, on affecte un<br />
coût supplémentaire pour <strong>la</strong> production du colza à i<strong>de</strong>ntité préservée. On suppose que ce coût est<br />
encouru uniquement pour du colza non OGM à IP. Autrement dit on ne considère pas <strong>la</strong> possibilité<br />
que <strong>de</strong>s lots soient rejetés parce qu'une présence trop forte d'OGM a été mise en évi<strong>de</strong>nce, une fois que<br />
<strong>de</strong>s coûts ont été encourus pour <strong>de</strong> procédures <strong>de</strong> préservation d'i<strong>de</strong>ntité.<br />
- Lien avec <strong>les</strong> modè<strong>les</strong> existants<br />
Il est intéressant <strong>de</strong> recadrer le travail <strong>de</strong> modélisation qui suit dans <strong>la</strong> littérature économique sur<br />
<strong>les</strong> OGM. Ce modèle se situe dans <strong>la</strong> lignée <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s qui examinent <strong>les</strong> effets économiques <strong>de</strong>s<br />
OGM et <strong>de</strong>s politiques menées sur <strong>les</strong> OGM au niveau agrégé. On peut distinguer plusieurs types<br />
d'étu<strong>de</strong>s dans <strong>la</strong> littérature existante :<br />
26
- <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s empiriques <strong>de</strong>s effets économiques <strong>de</strong>s OGM ne prenant pas en compte <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
non OGM : par exemple, Falck-Zepeda, Traxler et Nelson (2000) pour le coton Bt et le soja résistant<br />
au glyphosate, Moschini, Lapan et Sobolevsky (2000) pour le soja résistant au glyphosate. Ces étu<strong>de</strong>s<br />
utilisent le cadre traditionnel <strong>de</strong> l'analyse offre-<strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour estimer <strong>les</strong> effets <strong>de</strong>s OGMs sur <strong>les</strong><br />
revenus <strong>de</strong> différents groupes et <strong>les</strong> revenus globaux. Une difficulté importante à <strong>la</strong>quelle est<br />
confrontée ce type d'étu<strong>de</strong> est <strong>de</strong> <strong>de</strong>voir s'appuyer sur une hypothèse a priori <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
courbe d'offre agrégée <strong>de</strong>s agriculteurs suite à l'adoption <strong>de</strong>s OGM.<br />
- <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s empiriques <strong>de</strong>s effets économiques <strong>de</strong>s OGM prenant en compte <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour du non<br />
OGM : il existe encore peu d'étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ce type. Nielsen et An<strong>de</strong>rson (2000) utilisent un modèle<br />
empirique <strong>de</strong> l'économie globale, le modèle GTAP, pour quantifier <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> différents scénarios où<br />
<strong>de</strong>s pays adoptent <strong>les</strong> OGM hors UE tandis que l'UE interdit ou restreint <strong>les</strong> importations d'OGM, sur<br />
<strong>la</strong> production, le commerce et <strong>les</strong> revenus. La distinction OGM - non OGM est faite uniquement par<br />
pays d'origine. Il n'y a pas <strong>de</strong> modélisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation <strong>entre</strong> offre OGM et offre non OGM<br />
dans un pays donné. Mayer et Furtan (1999) utilisent une analyse graphique au niveau agrégé pour<br />
étudier <strong>les</strong> effets potentiels <strong>de</strong> <strong>la</strong> ségrégation <strong>entre</strong> produits OGM et non OGM sur le marché du colza<br />
au Canada.<br />
- <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s non empiriques sur <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation OGM - non OGM : ces étu<strong>de</strong>s sont peu<br />
nombreuses actuellement. Go<strong>la</strong>n et Kuchler (2000) considèrent <strong>les</strong> effets d'un changement d'une<br />
situation initiale avec seulement du non OGM, à une situation finale avec à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> l'OGM et du non<br />
OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée. Ils argumentent <strong>de</strong> façon intuitive que <strong>les</strong> consommateurs qui préfèrent le<br />
non OGM per<strong>de</strong>nt parce qu'ils doivent payer plus cher pour le non OGM en raison <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong><br />
l'i<strong>de</strong>ntité préservée, tandis que <strong>les</strong> consommateurs indifférents <strong>entre</strong> OGM et non OGM gagnent parce<br />
qu'ils paient un prix plus faible en raison <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> production plus faib<strong>les</strong> <strong>de</strong> l'OGM. L'intérêt <strong>de</strong><br />
cette étu<strong>de</strong> est d'insister sur une réalité politique importante, à savoir, que <strong>les</strong> OGMs ont <strong>de</strong>s effets<br />
différents à l'intérieur d'un même groupe (ici, <strong>les</strong> consommateurs), et que certains individus peuvent<br />
gagner et d'autres perdre à l'intérieur d'un même groupe. Cependant, ces arguments sont purement<br />
intuitifs. De plus, il ne prennent pas en compte l'hétérogénéité <strong>de</strong>s autres groupes que <strong>les</strong><br />
consommateurs, et notamment <strong>les</strong> agriculteurs, <strong>les</strong> organismes stockeurs et <strong>les</strong> transformateurs.<br />
L'une <strong>de</strong>s originalités du modèle qui suit est d'introduire explicitement <strong>la</strong> modélisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
segmentation <strong>de</strong>s filières dans un modèle empirique, en distinguant <strong>de</strong>s coûts affectés uniquement au<br />
non OGM (<strong>les</strong> coûts additionnels pour préserver l'i<strong>de</strong>ntité non OGM au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole<br />
et au sta<strong>de</strong> du stockage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation) et <strong>de</strong>s coûts affectés en partie à <strong>la</strong> filière avec OGM et<br />
en partie à <strong>la</strong> filière non OGM (<strong>les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong><br />
certains équipements au sta<strong>de</strong> du stockage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation). Une autre originalité <strong>de</strong> ce modèle<br />
est <strong>de</strong> chercher à détailler <strong>les</strong> effets sur différents types d'<strong>acteurs</strong> au sein d'un même groupe<br />
(agriculteurs, stockeurs/transformateurs, consommateurs).<br />
27
2.2. Cadre analytique<br />
a. Agriculteurs <strong>de</strong> l'UE<br />
Indices :<br />
j : agriculteur ( j=1,..., J)<br />
k : culture produite. Chaque agriculteur peut choisir <strong>de</strong> produire quatre produits différents :<br />
n : colza non OGM sans i<strong>de</strong>ntité préservée (une semence non OGM est utilisée, mais aucune<br />
procédure n'est prise pour éviter <strong>de</strong>s mé<strong>la</strong>nges avec du colza OGM) ;<br />
g : colza OGM (une semence OGM est utilisée) ;<br />
i : colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée (une semence non OGM est utilisée, et <strong>de</strong>s<br />
procédures sont mises en œuvre pour éviter le mé<strong>la</strong>nge avec du colza OGM) ;<br />
b : une culture alternative.<br />
Constantes :<br />
π b : profit par hectare pour <strong>la</strong> culture alternative. Pour simplifier, on suppose qu'il est le même quel<br />
que soit l'agriculteur.<br />
rdt : ren<strong>de</strong>ment. On suppose qu'il est le même quel que soit l'agriculteur ( j = 1, …, J) et quel que soit<br />
le type <strong>de</strong> culture (k = g, i, n, b).<br />
c kj : coût <strong>de</strong> production par tonne <strong>de</strong> l'agriculteur j pour le colza k (k = g, i, n), supposé constant.<br />
- On suppose : c ij > c nj pour chaque agriculteur j : il est coûteux <strong>de</strong> mettre en œuvre <strong>de</strong>s<br />
procédures pour éviter <strong>les</strong> mé<strong>la</strong>nges OGM - non OGM (le coût <strong>de</strong> production du colza non<br />
OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée est toujours supérieur au coût <strong>de</strong> production du colza non OGM sans<br />
i<strong>de</strong>ntité préservée). 16<br />
- On suppose : c nj > c gj pour certains agriculteurs j, c nj c gj pour d'autres agriculteurs j :<br />
l'adoption d'une variété OGM conduit à une diminution du coût <strong>de</strong> production pour certains<br />
agriculteurs, mais pas nécessairement pour tous <strong>les</strong> agriculteurs.<br />
s : ai<strong>de</strong> directe à l'hectare <strong>de</strong> colza reçue par <strong>les</strong> agriculteurs.<br />
ha : nombre d'hectares par agriculteur (supposé constant et i<strong>de</strong>ntique quel que soit j)<br />
Variable :<br />
w k : prix reçu par <strong>les</strong> agriculteurs pour <strong>la</strong> culture k.<br />
16 Comme il est détaillé dans <strong>la</strong> partie 1, ces procédures peuvent inclure un prix supérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence non<br />
OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée, un coût <strong>de</strong> <strong>net</strong>toyage <strong>de</strong>s engins et équipements (semoir, moissonneuse, remorque,<br />
cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong> stockage à <strong>la</strong> ferme), un coût pour empêcher <strong>la</strong> pollinisation croisée, un coût <strong>de</strong> contractualisation<br />
avec un organisme stockeur.<br />
28
On suppose que le colza n (non OGM sans i<strong>de</strong>ntité préservée) au sta<strong>de</strong> agricole ne peut pas être utilisé<br />
pour produire du colza non OGM à IP au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation. Le colza agricole OGM et le<br />
colza agricole non OGM sans i<strong>de</strong>ntité préservée sont <strong>de</strong>s produits équivalents pour <strong>les</strong> transformateurs<br />
(qu'on appelle du colza standard). A l'équilibre, <strong>les</strong> transformateurs paient donc ces <strong>de</strong>ux produits au<br />
même prix : w n = w g = w r .<br />
Il est important <strong>de</strong> souligner qu'on suppose ici que le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> colza non OGM à<br />
i<strong>de</strong>ntité préservée est constant pour chaque agriculteur. Notamment, un agriculteur donné a le même<br />
coût <strong>de</strong> production du colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée dans une situation avec faible pression<br />
OGM et dans une situation avec forte pression OGM. Cette hypothèse ne permet pas <strong>de</strong> rendre compte<br />
du fait que le coût <strong>de</strong> maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité non OGM peut augmenter avec <strong>la</strong> pression OGM,<br />
notamment le coût <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollinisation croisée.<br />
Le profit <strong>de</strong> l'agriculteur j sur un hectare <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture k est donné par 17 :<br />
π kj = rdt (w k - c kj ) + s<br />
Comme <strong>les</strong> fonctions <strong>de</strong> profit sont linéaires par rapport aux prix, dans notre modèle il est toujours<br />
optimal pour un agriculteur <strong>de</strong> cultiver une seule culture, celle qui conduit au niveau <strong>de</strong> profit le plus<br />
élevé (si ce profit est strictement positif). Chaque agriculteur produit donc une seule culture sur tous<br />
ses hectares ha, celle qui lui donne le profit maximal. 18 Son profit total est donc égal au nombre<br />
d'hectares sur son exploitation, multiplié par le profit maximal par hectare :<br />
Π maxj = ha Max(π b , π n , π g , π i ,0)<br />
La quantité produite par l'agriculteur est égale au nombre d'hectares multiplié par le ren<strong>de</strong>ment,<br />
pour <strong>la</strong> culture pour <strong>la</strong>quelle le profit est maximal 19 :<br />
17 Cette spécification revient à supposer que <strong>la</strong> technologie <strong>de</strong> production est Leontief, le ren<strong>de</strong>ment étant donné<br />
par une fonction f kj (x 1 ,...x m )= Min ( α x ) , où x 1 ,…, x L (L
q s kj = ha rdt si Π maxj = ha π k , q s kj =0 sinon.<br />
Comme <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> production pour chaque type <strong>de</strong> colza varient selon <strong>les</strong> agriculteurs, à<br />
l'équilibre, selon <strong>les</strong> prix, certains peuvent trouver plus profitable <strong>de</strong> cultiver du colza OGM, tandis<br />
que d'autres peuvent trouver plus profitable <strong>de</strong> cultiver du colza non OGM, certains en préservant<br />
l'i<strong>de</strong>ntité non OGM <strong>de</strong> ce colza et d'autres non.<br />
Avec nos hypothèses, comme c ij > c nj , un agriculteur ne cultive jamais <strong>de</strong> colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité<br />
préservée à moins que son prix ne soit supérieur au prix du colza sans i<strong>de</strong>ntité préservée (c'est-à-dire à<br />
moins que w i > w n à l'équilibre).<br />
La fonction d'offre agrégée par <strong>les</strong> agriculteurs pour <strong>la</strong> culture k est notée q sAGGF k , et est définie<br />
comme <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s offres individuel<strong>les</strong> pour cette culture :<br />
J<br />
q k sAGGF =∑<br />
j=<br />
1<br />
s<br />
q kj<br />
Chaque fonction d'offre agrégée dépend <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s produits et <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong><br />
production. Chaque fonction d'offre est croissante en son propre prix, parce que pour <strong>de</strong>s prix donnés<br />
<strong>de</strong>s autres produits, certains agriculteurs trouvent profitable <strong>de</strong> basculer d'une autre culture à cette<br />
culture si son prix augmente. De <strong>la</strong> même manière, chaque fonction d'offre est décroissante dans <strong>les</strong><br />
prix <strong>de</strong>s autres produits (certains agriculteurs trouvent profitable <strong>de</strong> basculer <strong>de</strong> cette culture à une<br />
autre si le prix <strong>de</strong> l'autre culture augmente).<br />
b. Stockeurs/transformateurs <strong>de</strong> l'UE<br />
Indices :<br />
h : stockeur/transformateur (appelé simplement "transformateur" par <strong>la</strong> suite) (h = 1, …, H)<br />
Chaque transformateur achète du colza aux agriculteurs et l'utilise pour produire du colza transformé.<br />
On suppose qu'une tonne <strong>de</strong> colza au sta<strong>de</strong> agricole conduit à <strong>la</strong> production d'une tonne <strong>de</strong> colza<br />
transformé (autrement dit on suppose qu'il n'y a pas <strong>de</strong> pertes lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation du colza).<br />
L'offre <strong>de</strong> colza transformé <strong>de</strong> type k est donc égal à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> colza agricole <strong>de</strong> type k. (Pour<br />
simplifier, on suppose que <strong>la</strong> culture alternative b est consommée sans être transformée).<br />
k : culture produite. Chaque transformateur peut produire <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> colza transformé :<br />
rh : colza transformé “standard”. Il peut être produit indifféremment à partir <strong>de</strong> colza OGM<br />
ou <strong>de</strong> colza non OGM sans i<strong>de</strong>ntité préservée.<br />
ih : colza transformé non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée. Pour le produire, le transformateur doit<br />
acheter du colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée aux agriculteurs.<br />
l'agriculteur cultive seulement une <strong>de</strong>s cultures pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> le profit est maximal. La culture b est supposée<br />
préférée, puis n, puis g, puis i.<br />
30
Constante :<br />
Q : capacité maximale <strong>de</strong> chaque transformateur. On suppose que chaque transformateur peut<br />
transformer du colza jusqu'à sa capacité maximale.<br />
c kh : coût unitaire <strong>de</strong> transformation du colza k par le transformateur h, hors coût d'achat du colza et<br />
hors coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité. On suppose que :<br />
• c rh varie d'un transformateur à l'autre (<strong>les</strong> équipements étant configurés différemment,<br />
certains ont un avantage technologique sur d'autres pour transformer du colza) ;<br />
• c ih > c rh (en <strong>la</strong>issant <strong>de</strong> côté <strong>les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité, il est plus coûteux <strong>de</strong><br />
transformer du colza IP que du colza standard) ;<br />
• <strong>la</strong> différence <strong>entre</strong> c rh et c ih est variable d'un transformateur à l'autre. (Le coût additionnel <strong>de</strong><br />
maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité pour un transformateur dépend <strong>de</strong> <strong>la</strong> configuration <strong>de</strong> son équipement<br />
par exemple).<br />
k : paramètre constant<br />
Variable :<br />
w k : coût d'achat du colza k aux agriculteurs, égal au prix <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s agriculteurs<br />
p k : prix reçu par le transformateur pour du colza transformé k<br />
q sAGGH r : quantité agrégée <strong>de</strong> colza standard transformé dans l'UE<br />
q sAGGH i : quantité agrégée <strong>de</strong> colza à i<strong>de</strong>ntité préservée transformé dans l'UE<br />
part i = q sAGGH i / (q sAGGH r + q sAGGH i ) : part du colza i dans le colza transformé dans l'UE<br />
part r = q sAGGH r / (q sAGGH r + q sAGGH i ) : part du colza r dans le colza transformé dans l'UE<br />
On a vu dans <strong>la</strong> partie 1 <strong>de</strong> ce chapitre qu'en cas <strong>de</strong> coexistence OGM/non OGM en France (ou, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> même manière, dans l'UE), on peut anticiper qu'il y aurait notamment <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong><br />
ségrégation au sta<strong>de</strong> du stockage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation : <strong>de</strong>s surcoûts logistiques dus à <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong><br />
spécialiser certains équipements dans l'OGM et d'autres dans le non OGM (par exemple, louer <strong>de</strong>s<br />
camions supplémentaires pour amener un type <strong>de</strong> colza donné d'un silo <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong> proximité à un<br />
silo <strong>de</strong> stockage principal dédié), et <strong>de</strong>s coûts d'investissement dans <strong>de</strong> nouveaux équipements (par<br />
exemple <strong>de</strong> nouveaux boisseaux d'expédition aux sites <strong>de</strong> stockage intermédiaire). La spécialisation <strong>de</strong><br />
certains équipements dans l'une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières conduirait à une perte <strong>de</strong> flexibilité dans l'utilisation<br />
<strong>de</strong> ces équipements donc un surcoût logistique. Pour rendre compte <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, on suppose ici que chaque<br />
transformateur supporte un coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité au niveau global, coût qui s'écrit : k part i<br />
pour le colza standard, k part r pour le colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée, où k est un paramètre<br />
constant et part k est <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture k dans <strong>la</strong> transformation totale <strong>de</strong> r et i (voir définition<br />
analytique plus haut). Ce terme reflète le surcoût qui résulte d'une perte <strong>de</strong> flexibilité dans le stockage,<br />
le transport et <strong>la</strong> transformation lorsque <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> colza doivent être séparés. Ce terme est<br />
31
endogène et dépend <strong>de</strong>s parts respectives du colza standard et du colza à i<strong>de</strong>ntité préservée dans le<br />
colza transformé.<br />
Le profit d'un transformateur sur une tonne <strong>de</strong> colza standard est alors donné par son prix <strong>de</strong> vente<br />
diminué du prix d'achat du colza agricole, du coût <strong>de</strong> transformation hors coût d'achat du colza et coût<br />
lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité, et du coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité :<br />
π rh = p r - w r - c rh - k part i<br />
Selon notre hypothèse, plus <strong>la</strong> part du colza i est importante dans le système <strong>de</strong> transformation, plus<br />
le coût résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité, k part i , est important. Dans le cas limite où seul du colza<br />
standard est transformé (q sAGGH i = 0), on a : k part i = 0, autrement dit, pas <strong>de</strong> coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong><br />
flexibilité. A l'inverse, le coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité est maximal pour du colza standard lorsque <strong>la</strong><br />
part du colza standard dans <strong>la</strong> transformation tend vers zéro. Ainsi, quand <strong>la</strong> part du colza i dans <strong>la</strong><br />
transformation <strong>de</strong> colza est faible, ce<strong>la</strong> signifie que <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s ressources du système <strong>de</strong><br />
transformation sont utilisées pour le colza standard, donc que <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong> flexibilité pour le colza<br />
standard sont faib<strong>les</strong>.<br />
Pour le colza IP, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière, on a :<br />
π ih = p i - w i - c ih - k part r où part r = q sAGGH r / (q sAGGH r + q sAGGH i )<br />
En raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> linéarité <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> profit dans <strong>les</strong> prix, ici aussi, il est toujours optimal pour<br />
chaque transformateur <strong>de</strong> transformer un seul type <strong>de</strong> colza, celui qui conduit au profit maximal :<br />
Π maxh = Q Max(π rh , π ih ,0)<br />
L'offre du transformateur pour le colza transformé k ∈ {i, r} est alors définie par :<br />
q s kh = Q si Π maxh = Q π kh , q s kh = 0 sinon.<br />
Comme <strong>les</strong> transformateurs ont <strong>de</strong>s valeurs différentes pour <strong>les</strong> paramètres c rh et c ih , à l'équilibre<br />
certains transformateurs pourront trouver plus profitable <strong>de</strong> transformer du colza standard tandis que<br />
d'autres trouveront plus profitable <strong>de</strong> transformer du colza IP. Pour un transformateur donné, son choix<br />
<strong>de</strong> produire du colza standard ou du colza à i<strong>de</strong>ntité préservée dépendra <strong>de</strong> ses paramètres c rh et c ih , <strong>de</strong>s<br />
différences <strong>entre</strong> le prix <strong>de</strong> vente et le prix d'achat du colza sur chaque marché, p r - w r et p i - w i , du<br />
paramètre <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité k, et <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> colza dans <strong>la</strong> transformation au<br />
niveau agrégé.<br />
L'offre agrégée <strong>de</strong> colza transformé <strong>de</strong> type k ∈ {i, r} est notée q sAGGH k . Elle est définie comme <strong>la</strong><br />
somme <strong>de</strong>s offres individuel<strong>les</strong> :<br />
q k sAGGH =∑<br />
H<br />
s<br />
q kh<br />
h=<br />
1<br />
.<br />
32
c. Consommateurs <strong>de</strong> l'UE<br />
Indices :<br />
l : consommateur ( l =1, . . . , L)<br />
k : bien consommé :<br />
r : colza standard<br />
i : colza non OGM IP<br />
a : bien alternatif qui est un substitut proche avec le colza à <strong>la</strong> consommation<br />
z : bien composite qui représente tous <strong>les</strong> biens <strong>de</strong> consommation finale à l'exception du<br />
colza et <strong>de</strong> son substitut proche (le bien a)<br />
Constantes :<br />
Μ : budget d'un consommateur (on suppose que chaque consommateur a le même budget). Le budget<br />
est le montant monétaire dépensé par le consommateur.<br />
σ ral , σ ial , et ρ (paramètres positifs)<br />
Variable : q k (quantité du bien k)<br />
On suppose que l'utilité du consommateur l a <strong>la</strong> forme suivante 20 :<br />
1<br />
ρ ρ<br />
[( q + σ q + σ q ) q ] ρ<br />
l<br />
U ( qa<br />
,qr<br />
,qi<br />
,qz<br />
) = a ral r ial i +<br />
On suppose que le paramètre σ ial est strictement positif : consommer du colza non OGM à IP<br />
augmente nécessairement l'utilité du consommateur. On suppose que le paramètre σ ral peut être positif<br />
pour certains consommateurs mais égal à zéro pour d'autres, qui refusent <strong>de</strong> consommer <strong>de</strong> l'OGM : le<br />
consommateur peut avoir une utilité nulle (mais pas négative) <strong>de</strong> consommer <strong>de</strong> l'OGM 21 . On suppose<br />
également que le colza standard n'est jamais préféré au colza non OGM à IP (mais certains<br />
consommateurs peuvent être indifférents <strong>entre</strong> ces <strong>de</strong>ux biens). D'après ces hypothèses on a :<br />
0 ≤ σ ral ≤ σ ial , et 0 < σ ial pour l = 1, …, L<br />
z<br />
20 L'utilité dépend <strong>de</strong>s quantités q a , q r et q i uniquement <strong>de</strong> manière linéaire. Ce choix dans <strong>la</strong> spécification se<br />
répercute plus loin par le fait que chaque consommateur consomme uniquement un <strong>de</strong>s trois biens, a, r ou i, à<br />
l'équilibre, en fonction <strong>de</strong> ses paramètres <strong>de</strong> préférence (σ ral et σ ial ), et en fonction <strong>de</strong>s prix d'équilibre. De plus,<br />
1<br />
ρ ρ<br />
l'utilité dépend d'un bien numéraire, selon une fonction [ q + ] ρ . Cette spécification a pour intérêt <strong>de</strong><br />
nz<br />
q z<br />
permettre <strong>de</strong> déterminer <strong>de</strong> manière endogène <strong>la</strong> dépense totale <strong>de</strong> l'individu sur le bien a, r ou i.<br />
21 Dans notre modèle un consommateur qui a une utilité nulle <strong>de</strong> consommer <strong>de</strong> l'OGM n'en consommera jamais<br />
à l'équilibre. Cette hypothèse permet donc d'obtenir <strong>de</strong>s résultats simi<strong>la</strong>ires à ceux qu'on obtiendrait en supposant<br />
que certains consommateurs ont une utilité négative à consommer <strong>de</strong> l'OGM.<br />
33
On suppose, <strong>de</strong> manière arbitraire, que pour <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong> prix tels qu'un consommateur est<br />
indifférent <strong>entre</strong> le bien a et le bien r et/ou i, il consomme le bien i, et s'il est indifférent <strong>entre</strong> le bien r<br />
et le bien i, il consomme le bien i. <strong>Les</strong> fonctions <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s biens a, r, et i par le consommateur l<br />
sont données par 22 :<br />
q al d =<br />
p<br />
z<br />
M<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
p<br />
a<br />
1<br />
ρ −1<br />
+ p<br />
a<br />
ρ<br />
ρ−1<br />
si<br />
p<br />
p<br />
r<br />
a<br />
p<br />
i<br />
≥ σ<br />
ral<br />
et σ<br />
ial<br />
pa<br />
≥ ; q al d = 0 sinon.<br />
q rl d =<br />
p<br />
z<br />
M<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
p<br />
r<br />
1<br />
ρ−1<br />
+ p<br />
r<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
si<br />
p<br />
p<br />
r<br />
a<br />
< σ et<br />
ral<br />
p<br />
p<br />
r<br />
i<br />
σ<br />
ral<br />
≤ ; q d rl = 0 sinon.<br />
σ<br />
ial<br />
q il d =<br />
p<br />
z<br />
M<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
p<br />
i<br />
1<br />
ρ−1<br />
+ p<br />
i<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
si<br />
p<br />
p<br />
σ<br />
p<br />
r ral i<br />
> et σ<br />
ial<br />
i σ ial pa<br />
< ; q il d = 0 sinon.<br />
La fonction <strong>de</strong> dépense totale (qui donne <strong>la</strong> dépense nécessaire pour atteindre un niveau d'utilité<br />
égal à U pour <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong> prix p a , p r et p i donnés) est donnée par :<br />
⎡<br />
l<br />
E ( pa<br />
, pr<br />
, pi<br />
,U ) = ⎢ pz<br />
⎢⎣<br />
ρ<br />
ρ−1<br />
+ p<br />
j<br />
ρ<br />
ρ−1<br />
⎤<br />
⎥<br />
⎥⎦<br />
ρ−1<br />
ρ<br />
U ,<br />
La fonction d'utilité indirecte (qui donne le niveau d'utilité maximal pouvant être atteint étant<br />
donnés <strong>les</strong> prix et le budget) est donnée par :<br />
⎡<br />
ρ<br />
l<br />
V ( pa<br />
, pr<br />
, pi<br />
,M ) = ⎢ pz<br />
⎢⎣<br />
ρ<br />
−1<br />
+ p<br />
j<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
Le prix p j ci-<strong>de</strong>ssus est défini comme :<br />
pr<br />
pi<br />
p j = p a si ≥ σ<br />
ral<br />
et ≥ σ<br />
ial<br />
pa<br />
pa<br />
pr<br />
pr<br />
σ<br />
ral<br />
p j = p r si < σ<br />
ral<br />
et ≤<br />
pa<br />
pi<br />
σ ial<br />
pr<br />
σ<br />
ral<br />
pi<br />
p j = p i si > et < σ<br />
ial<br />
p σ p<br />
i<br />
ial<br />
a<br />
⎤<br />
⎥<br />
⎥⎦<br />
1−ρ<br />
ρ<br />
M .<br />
La fonction métrique monétaire d'utilité indirecte du consommateur l est donnée par :<br />
1 1 0<br />
l 1 1 0<br />
µ ( p , p ,M ) = E ( p ,V ( p ,M )) ,<br />
22 La forme <strong>de</strong> ces fonctions <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> découle <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction d'utilité adoptée. Plus précisément,<br />
elle est obtenue en supposant que le consommateur choisit <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong> consommation <strong>de</strong>s biens qui<br />
conduisent à maximiser son utilité, étant donnée <strong>la</strong> contrainte budgétaire à <strong>la</strong>quelle il fait face.<br />
34
où p s s s s s<br />
= ( p , p , p , p ) est le vecteur <strong>de</strong>s prix dans <strong>la</strong> situation s.<br />
a<br />
r<br />
i<br />
z<br />
Cette fonction donne un équivalent monétaire du changement d'utilité du consommateur l lorsqu'il<br />
passe <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation 0 à <strong>la</strong> situation 1 (combien d'argent il faudrait donner à ce consommateur dans <strong>la</strong><br />
situation 1 pour qu'il ait <strong>la</strong> même utilité que dans <strong>la</strong> situation 0 si son budget est M).<br />
Chaque consommateur consomme seulement un <strong>de</strong>s biens a, r, ou i. On considère un ensemble <strong>de</strong><br />
L consommateurs avec <strong>de</strong>s valeurs différentes <strong>de</strong>s paramètres σ ral et σ ial . A l'équilibre, certains peuvent<br />
consommer du colza standard, d'autres du colza non OGM à IP, et d'autres le substitut du colza a. La<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> agrégée <strong>de</strong>s consommateurs pour le bien k ∈ {a, r, i} est notée q dAGGC k et est définie comme<br />
<strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s individuel<strong>les</strong> :<br />
q k dAGGC =∑<br />
L<br />
d<br />
q kl<br />
l=<br />
1<br />
d. Deman<strong>de</strong> excé<strong>de</strong>ntaire du reste du mon<strong>de</strong><br />
On suppose que <strong>les</strong> consommateurs du reste du mon<strong>de</strong> sont indifférents <strong>entre</strong> le colza standard et le<br />
colza non OGM à IP. Comme le prix du colza à IP, p i , est nécessairement supérieur au prix du colza<br />
standard, p r , dans notre modèle, <strong>les</strong> consommateurs du reste du mon<strong>de</strong> consomment seulement du<br />
colza standard. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> excé<strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> colza standard dans le reste du mon<strong>de</strong> est notée q dM r et est<br />
une fonction <strong>de</strong> p r .<br />
e. Conditions d'équilibre<br />
<strong>Les</strong> conditions d'équilibre <strong>de</strong> notre modèle sont <strong>les</strong> suivantes :<br />
- A l'équilibre, <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s offres agrégées <strong>de</strong>s colzas n et g par <strong>les</strong> agriculteurs <strong>de</strong> l'UE est égale à<br />
l'offre agrégée <strong>de</strong> colza standard r par <strong>les</strong> transformateurs <strong>de</strong> l'UE :<br />
q sAGGF g (w r , w i ) + q sAGGF n (w r , w i ) = q sAGGH r (p r - w r , p i - w i )<br />
- A l'équilibre, l'offre agrégée <strong>de</strong> colza i par <strong>les</strong> agriculteurs <strong>de</strong> l'UE est égale à l'offre agrégée <strong>de</strong> colza<br />
i par <strong>les</strong> transformateurs <strong>de</strong> l'UE :<br />
q sAGGF i (w r , w i ) = q sAGGH i (p r - w r , p i - w i )<br />
- A l'équilibre, l'offre agrégée <strong>de</strong> colza r par <strong>les</strong> transformateurs <strong>de</strong> l'UE est égale à <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> agrégée <strong>de</strong> colza r par <strong>les</strong> consommateurs <strong>de</strong> l'UE et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> excé<strong>de</strong>ntaire du reste du<br />
mon<strong>de</strong> :<br />
q sAGGH r (p r - w r , p i - w i ) = q dAGGC r (p r , p i ) + q dM r (p r )<br />
- A l'équilibre, l'offre agrégée <strong>de</strong> colza i par <strong>les</strong> transformateurs <strong>de</strong> l'UE est égale à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> agrégée<br />
<strong>de</strong> colza i par <strong>les</strong> consommateurs <strong>de</strong> l'UE :<br />
q sAGGH i (p r - w r , p i - w i ) = q dAGGC i (p r , p i )<br />
<strong>Les</strong> quatre prix d'équilibre (w i , w r , p i , p r ) sont déterminés <strong>de</strong> manière endogène par <strong>la</strong> résolution <strong>de</strong><br />
ces quatre équations d'équilibre. Une fois ces prix déterminés, on peut déterminer <strong>les</strong> quantités<br />
35
produites ou consommées à l'équilibre pour chaque individu et au niveau agrégé, et <strong>les</strong> revenus pour<br />
chaque individu et au niveau agrégé.<br />
2.3. Simu<strong>la</strong>tions<br />
a. Présentation du modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion<br />
On présente ici <strong>de</strong>s résultats préliminaires obtenus à partir <strong>de</strong> ce modèle, en donnant <strong>de</strong>s valeurs<br />
particulières à l'ensemble <strong>de</strong>s paramètres. <strong>Les</strong> paramètres sont calibrés <strong>de</strong> manière à donner une<br />
représentation stylisée du cas du colza dans l'UE et le reste du mon<strong>de</strong> en 1999/2000. <strong>Les</strong> données et<br />
<strong>les</strong> hypothèses utilisées pour le calibrage du modèle sont détaillées dans l'annexe. Le calibrage est ad<br />
hoc, et notamment <strong>les</strong> hypothèses qui sont posées sur <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong>s coûts liés à <strong>la</strong> segmentation<br />
OGM - non OGM sont ad hoc. Dans ces conditions, <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions qui suivent ne visent pas à<br />
quantifier <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation, mais plutôt à donner <strong>de</strong>s premières indications qualitatives sur<br />
<strong>les</strong> effets <strong>de</strong> cette segmentation.<br />
Le modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion comprend :<br />
- 4620 agriculteurs représentatifs dans l'UE, dont <strong>la</strong> moitié cultive du colza et <strong>la</strong> moitié cultive <strong>la</strong><br />
culture alternative dans l'équilibre initial. Chaque agriculteur produit 5000 t <strong>de</strong> colza s'il cultive du<br />
colza, chaque agriculteur dispose <strong>de</strong> 1515 hectares pour le colza ou <strong>la</strong> culture alternative. - 1500<br />
transformateurs représentatifs dans l'UE, chacun ayant une capacité <strong>de</strong> production <strong>de</strong> 10000 tonnes.<br />
Parmi eux, 1155 transforment le colza dans l'équilibre initial et 345 ne font rien.<br />
- 4220 consommateurs représentatifs, dont 2110 consomment du colza (avec une consommation <strong>de</strong><br />
5000 tonnes chacun) et 2110 consomment son substitut proche a.<br />
Dans toute <strong>la</strong> suite, <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> colza est 5000 t pour un agriculteur ou un consommateur<br />
représentatif et 10000 t pour un transformateur représentatif.<br />
<strong>Les</strong> coûts <strong>de</strong> production par tonne <strong>de</strong>s trois types <strong>de</strong> colza, c kj (k = n, g ou i; j=1,..., 4620) sont<br />
différents pour chaque agriculteur. <strong>Les</strong> coûts <strong>de</strong> transformation par tonne (en excluant le coût du colza<br />
agricole et le coût dû à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité), c kh (k = r ou i; h=1,...,1500) sont differents pour chaque<br />
transformateur. <strong>Les</strong> paramètres <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction d'utilité σ kal (k = r ou i; l = 1, ...,2000) sont differents<br />
pour chaque consommateur.<br />
Dans <strong>la</strong> situation initiale, le colza OGM ne peut être ni produit ni importé dans l'UE. <strong>Les</strong><br />
consommateurs <strong>de</strong> l'UE sont indifférents <strong>entre</strong> le colza standard (r) et le colza à i<strong>de</strong>ntité préservée (i). 23<br />
23 Dans notre modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion, l'UE est un exportateur <strong>net</strong> <strong>de</strong> colza. Par conséquent, dans <strong>la</strong> situation<br />
initiale, même <strong>les</strong> consommateurs qui refusent <strong>de</strong> consommer <strong>de</strong> l'OGM ne per<strong>de</strong>nt pas à consommer du colza<br />
sans IP, étant donné que tout le colza qu'ils consomment est produit dans l'UE, et est non OGM dans <strong>la</strong> situation<br />
initiale. En fait, certains consommateurs pourraient vouloir consommer uniquement du colza IP même en<br />
l'absence <strong>de</strong> production d'OGM dans l'UE : 1) <strong>les</strong> consommateurs pourraient être inquiets que le colza qu'ils<br />
36
<strong>Les</strong> producteurs <strong>de</strong> l'UE produisent uniquement du colza non OGM sans i<strong>de</strong>ntité préservée (n). <strong>Les</strong><br />
transformateurs utilise ce colza pour produire du colza transformé standard (rh), qui est soit consommé<br />
domestiquement, soit exporté vers le reste du mon<strong>de</strong>. <strong>Les</strong> producteurs agrico<strong>les</strong> et <strong>les</strong> transformateurs<br />
<strong>de</strong> l'UE produisent 11.55 Mt (millions <strong>de</strong> tonnes) <strong>de</strong> colza, dont 10.55 Mt sont consommées dans l'UE<br />
et 1 Mt est exportée vers le reste du mon<strong>de</strong>. Le reste du mon<strong>de</strong> produit 31Mt <strong>de</strong> colza et en consomme<br />
32Mt. Le prix d'équilibre sur le marché du colza agricole, wr 0 , est égal à 1000 F / t, et le prix<br />
d'équilibre sur le marché du colza transformé, pr 0 , est égal à 1200 F / t.<br />
On présente <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong> trois simu<strong>la</strong>tions. Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, on analyse <strong>les</strong> conséquences<br />
<strong>de</strong> l'introduction simultanée <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie OGM sur le colza, d'un changement <strong>de</strong>s préférences <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s consommateurs en faveur du colza non OGM à IP (le bien i), et <strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
segmentation <strong>entre</strong> filière avec OGM et filière non OGM dans l'UE. La simu<strong>la</strong>tion 2 est conduite avec<br />
le même ensemble d'hypothèses que <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, sauf que <strong>les</strong> pertes <strong>de</strong> flexibilité au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
transformation sont supposées éga<strong>les</strong> à 0 (le paramètre k est égal à 0). La simu<strong>la</strong>tion 3 représente une<br />
situation où <strong>la</strong> technologie OGM sur le colza <strong>de</strong>vient disponible dans l'UE, avec une distribution <strong>de</strong>s<br />
profits <strong>de</strong>s agriculteurs i<strong>de</strong>ntique aux simu<strong>la</strong>tions 1 et 2, et où <strong>les</strong> consommateurs <strong>de</strong> l'UE sont<br />
indifférents <strong>entre</strong> le colza standard et le colza à IP, si bien qu'il n'y a pas <strong>de</strong> segmentation et pas<br />
d'apparition <strong>de</strong> filière non OGM à IP. <strong>Les</strong> prix et <strong>les</strong> quantités d'équilibre dans <strong>la</strong> situation initiale et<br />
dans <strong>les</strong> trois simu<strong>la</strong>tions sont résumées dans le tableau 1.<br />
consomment ait pu être pollinisé par du colza d'un essai OGM, ou pourraient ne pas être informés <strong>de</strong> l'origine du<br />
colza qu'ils consomment ; 2) l'UE est un exportateur <strong>net</strong> <strong>de</strong> colza et d'huile <strong>de</strong> colza mais un importateur <strong>net</strong> <strong>de</strong><br />
tourteau <strong>de</strong> colza, utilisé principalement en alimentation animale. Certains consommateurs pourraient vouloir<br />
consommer uniquement <strong>de</strong> <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> issue d'animaux nourris sans OGM.<br />
37
Tableau 1. Prix (F / t) et quantités (M t) dans <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions<br />
situation initiale simu<strong>la</strong>tion 1 simu<strong>la</strong>tion 2 simu<strong>la</strong>tion 3<br />
prix<br />
w r 1000,0 951,5 986,2 990,1<br />
p r 1200,0 1193,9 1185,1 1190,6<br />
w i n.d. 972,9 1006,7 n.d.<br />
p i n.d. 1245,3 1223,7 n.d.<br />
quantités<br />
production agricole dans l'UE<br />
sAGGF<br />
q n<br />
sAGGF<br />
q g<br />
sAGGF<br />
q i<br />
production transformée dans l'UE<br />
sAGGH<br />
q r<br />
sAGGH<br />
q i<br />
consommation dans l'UE<br />
dAGGH<br />
q r<br />
dAGGH<br />
q i<br />
exportations vers le reste du mon<strong>de</strong><br />
q r<br />
dM<br />
11,55 0 0 3,99<br />
0 6,46 6,73 7,89<br />
0 5,07 5,17 0<br />
11,55 6,46 6,73 11,88<br />
0 5,07 5,17 0<br />
10,55 5,30 5,34 10,63<br />
0 5,07 5,17 0<br />
1,0 1,16 1,39 1,25<br />
b. Simu<strong>la</strong>tion 1<br />
- Hypothèses sur <strong>les</strong> changements <strong>de</strong>s coûts et <strong>de</strong>s préférences<br />
Trois caractéristiques sont modifiées <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation initiale à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1 :<br />
1) Le colza OGM est diffusé dans l'UE. On suppose que si un agriculteur adopte <strong>la</strong> technologie OGM<br />
son ren<strong>de</strong>ment en colza reste inchangé, et que l'économie <strong>de</strong> coût qui résulte <strong>de</strong> l'adoption du colza<br />
OGM varie selon <strong>les</strong> agriculteurs. D'après le calibrage, <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> production du colza OGM sont<br />
plus faib<strong>les</strong> que <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> production du colza non OGM pour 98% <strong>de</strong>s agriculteurs. L'avantage <strong>de</strong><br />
coût du colza OGM comparé avec le colza non OGM varie <strong>entre</strong> 0 et 320 F / t pour ces agriculteurs,<br />
avec une moyenne <strong>de</strong> 122 F / t.<br />
Lorsque l'on considère <strong>la</strong> diffusion du colza OGM dans l'UE, <strong>la</strong> diminution du coût <strong>de</strong> production due<br />
à l'adoption <strong>de</strong> variétés OGM est calibrée d'après <strong>les</strong> résultats du chapitre 2 en supposant qu'on se<br />
p<strong>la</strong>ce à l'optimum <strong>de</strong> l'innovateur (dans le cas où <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> passage <strong>de</strong> traitement ne sont pas pris en<br />
compte), soit 321 F / ha donc 97 F / t.<br />
2) La moitié <strong>de</strong>s consommateurs <strong>de</strong> l'UE est indifférente <strong>entre</strong> colza standard et colza IP tandis que<br />
l'autre moitié n'a aucune utilité à consommer du colza non IP.<br />
3) Il y a une segmentation <strong>entre</strong> filière avec OGM et filière non OGM. On suppose (<strong>de</strong> manière<br />
arbitraire) que :<br />
38
- le coût additionnel pour maintenir l'i<strong>de</strong>ntité non OGM du colza varie <strong>de</strong> manière linéaire <strong>entre</strong> 1 et 11<br />
F / t selon <strong>les</strong> agriculteurs, avec une moyenne <strong>de</strong> 6 F / t.<br />
- Le coût d'IP pour <strong>les</strong> transformateurs (en excluant le coût dû à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité) varie <strong>entre</strong> 10 et<br />
30 F / t, avec une moyenne <strong>de</strong> 20 F / t.<br />
- Le paramètre k est égal à 100 F / t : le coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité pour le colza standard est égal à<br />
100 F / t fois <strong>la</strong> part du colza IP dans le système <strong>de</strong> transformation (<strong>la</strong> quantité du colza IP transformé<br />
divisée par <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s quantités du colza standard et du colza IP transformés). De <strong>la</strong> même<br />
manière, le coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité pour le colza IP est égal à 100 F / t multiplié par <strong>la</strong> part du<br />
colza standard dans le système <strong>de</strong> transformation.<br />
- Prix et quantités d'équilibre<br />
En comparaison avec <strong>la</strong> situation initiale, le prix d'équilibre du colza standard agricole décroît<br />
d'environ 5% <strong>de</strong> 1000 F / t à 952 F / t, et le prix d'équilibre du colza standard transformé décroît<br />
d'environ 0.5% <strong>de</strong> 1200 F / t à 1194 F / t. Le prix d'équilibre du colza IP agricole est plus faible que le<br />
prix du colza agricole dans <strong>la</strong> situation initiale, à 973 F / t. Le prix d'équilibre du colza IP transformé<br />
est égal à 1245 F / t. Il y a maintenant une différence <strong>de</strong> 272 F / t <strong>entre</strong> le prix du colza IP agricole et le<br />
prix du colza IP transformé, comparée à une différence <strong>de</strong> 200 F / t <strong>entre</strong> <strong>les</strong> prix agricole et<br />
transformé pour le colza standard dans l'équilibre initial. Cette différence plus gran<strong>de</strong> reflète <strong>de</strong>s coûts<br />
plus élevés dus à l'IP et à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité dans le système <strong>de</strong> transformation. Sur le marché du<br />
colza standard, l'offre <strong>de</strong> l'UE aux sta<strong>de</strong>s agricole et transformé est égale à 6,46 Mt. Tout le colza<br />
standard est OGM. La consommation domestique est égale à 5,30 Mt, et <strong>les</strong> exportations vers le reste<br />
du mon<strong>de</strong> sont éga<strong>les</strong> à 1,16 Mt. Sur le marché du colza IP, <strong>la</strong> production agricole et transformée dans<br />
l'UE et <strong>la</strong> consommation domestique sont éga<strong>les</strong> à 5,07 Mt.<br />
- <strong>Les</strong> coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation <strong>de</strong>s filières à l'équilibre<br />
Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, le coût du maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité non OGM pour <strong>les</strong> agriculteurs qui cultivent<br />
du colza non OGM à IP varie <strong>entre</strong> 1 et 11 F / t, et le coût moyen pour <strong>les</strong> agriculteurs qui cultivent du<br />
colza IP à l'équilibre est égal à 5,8 F / t. La part du colza standard dans <strong>la</strong> transformation totale du<br />
colza est 6,46 / (6,46 + 5,07) = 56 %, tandis que <strong>la</strong> part du colza IP dans <strong>la</strong> transformation totale du<br />
colza est égale à 44 %. Le coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité est alors égal à 44 F/t pour le colza standard,<br />
et égal à 56 F / t pour le colza IP. Le coût <strong>de</strong> l'IP (en excluant le coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité) pour<br />
<strong>les</strong> transformateurs qui transforment du colza à IP à l'équilibre varie <strong>entre</strong> 10 et 18 F / t, et le coût<br />
moyen <strong>de</strong> l'IP pour <strong>les</strong> transformateurs qui transforment du colza IP à l'équilibre est égal à 13,7 F / t.<br />
D'après ces chiffres, le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation pour le colza standard est égal à 44 F / t. Le coût<br />
moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation pour le colza à IP est (6 + 56 +13,7) = 75,7 F / t et est plus élevé <strong>de</strong> (75,7 -<br />
44) = 31,7 F / t que le coût pour le colza standard. Le coût le plus élevé <strong>de</strong> l'IP pour <strong>les</strong> agriculteurs<br />
cultivant du colza IP est 11 F / t, le coût le plus élevé <strong>de</strong> l'IP pour <strong>les</strong> transformateurs transformant du<br />
39
colza IP est (56 + 18) = 74 F / t. Le coût le plus élevé pour <strong>les</strong> transformateurs qui transforment du<br />
colza IP est plus élevé <strong>de</strong> (74 - 44) = 30 F / t que le coût <strong>de</strong> l'IP pour <strong>les</strong> transformateurs qui<br />
transforment du colza standard.<br />
- La différence <strong>entre</strong> <strong>les</strong> prix du colza aux sta<strong>de</strong>s agricole et transformé<br />
La différence <strong>entre</strong> <strong>les</strong> prix du colza standard transformé (p r ) et agricole (w r ) est égale à 200 F / t<br />
dans <strong>la</strong> situation initiale, et à (1193,9 - 951,5) = 242,4 F / t dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. Son augmentation (<strong>de</strong><br />
42,4 F / t) est plus faible (<strong>de</strong> 1,6 F / t) que le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation pour le colza standard (44 F / t).<br />
La raison est que pour <strong>les</strong> transformateurs qui transforment du colza standard à l'équilibre, <strong>les</strong> coûts<br />
unitaires pour transformer du colza (autres que <strong>les</strong> coûts pour acheter du colza) varient <strong>entre</strong> 180 et<br />
200 F /t dans <strong>la</strong> situation initiale, alors qu'ils varient <strong>entre</strong> 180 et 198,4 F / t dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. Le<br />
transformateur avec le coût le plus élevé pour transformer du colza, parmi <strong>les</strong> transformateurs qui<br />
transforment du colza standard à l'équilibre initial, est plus faible <strong>de</strong> 1,6 F / t dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1 en<br />
comparaison avec <strong>la</strong> situation initiale.<br />
Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, sur le marché du colza IP, <strong>la</strong> différence <strong>entre</strong> <strong>les</strong> prix du colza au sta<strong>de</strong><br />
agricole et au sta<strong>de</strong> transformé est égale à (1245,3- 972,9) = 272,4 F / t. Cette différence <strong>de</strong> prix est<br />
supérieure <strong>de</strong> (272,4 - 242,4) = 30 F / t à <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> prix équivalente sur le marché du colza<br />
standard. Cette différence <strong>de</strong> prix est égale au coût le plus élevé <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation parmi <strong>les</strong><br />
transformateurs qui transforment effectivement du colza IP, moins le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation parmi<br />
<strong>les</strong> transformateurs qui transforment du colza standard.<br />
- Qui gagne et qui perd<br />
Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, le prix d'équilibre du colza IP transformé (p i1 = 1245 F / t) est supérieur <strong>de</strong> 45<br />
F / t au prix d'équilibre du colza standard transformé dans <strong>la</strong> situation initiale (p r0 = 1200 F /t). <strong>Les</strong><br />
consommateurs qui refusent <strong>de</strong> consommer <strong>de</strong> l'OGM per<strong>de</strong>nt, parce que le prix qu'ils paient pour le<br />
colza IP est plus élevé que le prix qu'ils payaient pour du colza standard (qui était entièrement non<br />
OGM) dans <strong>la</strong> situation initiale. Le tableau 2 montre le changement dans <strong>les</strong> profits et <strong>les</strong> utilités pour<br />
<strong>les</strong> différents groupes d'agriculteurs, <strong>de</strong> transformateurs et <strong>de</strong> consommateurs, <strong>entre</strong> <strong>la</strong> situation initiale<br />
et <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. Parmi <strong>les</strong> 2110 consommateurs qui consommaient initialement du colza, 1015<br />
consommateurs se tournent vers le colza IP, avec une diminution dans leur utilité <strong>de</strong> 45 F / t, et 40<br />
consommateurs se tournent vers le bien substitut a, leur utilité restant inchangée.<br />
40
Tableau 2. Changement dans <strong>les</strong> profits et <strong>les</strong> utilités <strong>de</strong> différents groupes d'agriculteurs, <strong>de</strong><br />
transformateurs et <strong>de</strong> consommateurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation initiale à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. unité: F / t 24<br />
nombre<br />
d'agriculteurs,<br />
transformateurs,<br />
consommateurs<br />
situation initiale simu<strong>la</strong>tion 1 changement moyen dans le<br />
profit (agriculteurs et<br />
transformateur) ou l'utilité en<br />
métrique monétaire<br />
(consommateurs) par tonne<br />
agriculteurs<br />
1015 colza n colza i -32,9<br />
1256 colza n colza g + 14,6<br />
39 colza n culture alternative b - 15,7<br />
36 culture alternative b colza g + 32,8<br />
transformateurs<br />
647 colza r colza r - 1,7<br />
447 colza r colza i + 2,3<br />
60 ne transformant pas colza i + 2,1<br />
<strong>de</strong> colza<br />
61 colza r ne transformant pas <strong>de</strong><br />
colza<br />
-0,9<br />
consommateurs<br />
1055 colza r colza r + 6,1<br />
1015 colza r colza i - 45,3<br />
40 colza r substitut a 0<br />
5 substitut a colza r 0<br />
Le prix d'équilibre du colza agricole IP dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1 (w i1 = 973 F / t) est inférieur <strong>de</strong> 27 F / t<br />
au prix d'équilibre du colza agricole standard dans situation initiale (w r0 = 1000 F / t). 1015<br />
agriculteurs se tournent du colza non OGM sans IP vers le colza IP. En moyenne, le profit <strong>de</strong> ces<br />
agriculteurs diminue <strong>de</strong> 33 F / t. De plus, 39 agriculteurs se tournent du colza non OGM sans IP vers <strong>la</strong><br />
culture alternative, et leur profit diminue <strong>de</strong> 16 F / t en moyenne. 447 transformateurs se tournent du<br />
colza standard vers le colza IP, et leur niveau <strong>de</strong> profit augmente en moyenne <strong>de</strong> 2,3 F / t . 60<br />
transformateurs qui ne transformaient pas <strong>de</strong> colza dans <strong>la</strong> situation initiale commencent à en<br />
transformer. Leur niveau <strong>de</strong> profit augmente en moyenne <strong>de</strong> 2,1 F /t.<br />
24 Note: La colonne 1 indique le nombre d'agriculteurs, <strong>de</strong> transformateurs et <strong>de</strong> consommateurs auxquels le<br />
changement décrit dans <strong>les</strong> colonnes 2 à 4 s'applique. La colonne 2 (respectivement, 3) indique quel bien est<br />
produit ou consommé par ces groupes dans <strong>la</strong> situation initiale (respectivement, <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1). La colonne 4<br />
indique le changement moyen dans le profit ou <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> l'utilité en métrique monétaire pour ce groupe <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
situation initiale à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. Pour obtenir le changement dans l'utilité en métrique monétaire par tonne <strong>de</strong><br />
colza standard, on multiplie le changement dans l'utilité par consommateur par le nombre <strong>de</strong> consommateurs qui<br />
consomment effectivement du colza dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, puis on le divise par <strong>la</strong> quantité totale consommée dans<br />
<strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. On obtient <strong>les</strong> changements d'utilité par tonne <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière pour le colza IP et le bien<br />
substitut.<br />
41
La raison pour <strong>la</strong>quelle <strong>les</strong> profits <strong>de</strong>s transformateurs qui transforment du colza non OGM à IP<br />
augmente est que <strong>les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> segmentation sont hétérogènes <strong>entre</strong> ces transformateurs. La<br />
différence <strong>entre</strong> <strong>les</strong> prix d'équilibre est déterminée par le coût marginal <strong>de</strong> transformation, c'est-à-dire<br />
le coût <strong>de</strong> transformation pour le transformateur qui a le coût le plus élevé, parmi tous ceux qui<br />
transforment du colza IP à l'équilibre. <strong>Les</strong> transformateurs avec un faible coût d'IP gagnent parce qu'ils<br />
font face à une différence <strong>de</strong> prix à l'équilibre qui est supérieure à leur coût <strong>de</strong> transformation.<br />
Le prix d'équilibre pour le colza standard transformé (p r1 = 1194 F /t) diminue <strong>de</strong> 6 F / t par rapport<br />
à <strong>la</strong> situation initiale (p r0 = 1200 F / t). La diminution <strong>de</strong> p r1 est due à <strong>la</strong> diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour<br />
le colza standard, lorsque certains consommateurs se tournent vers du colza IP ou son proche substitut<br />
a. A l'équilibre, <strong>la</strong> consommation domestique totale <strong>de</strong> colza standard diminue <strong>de</strong> (1 - q dAGGH1 r /<br />
dAGGH0<br />
q r =1 - 5,30 / 10,55) = 50 %. La diminution du prix, cependant, est limitée en comparaison avec<br />
le changement dans <strong>la</strong> consommation domestique (1 - p r1 / p r0 = 1 - 1194 / 1200 = 0,5 %), parce que<br />
l'UE fait face à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> excé<strong>de</strong>ntaire é<strong>la</strong>stique du reste du mon<strong>de</strong>. Il en résulte qu'un faible<br />
changement dans le prix se traduit par une forte variation <strong>de</strong>s quantités échangées. Ainsi, <strong>les</strong><br />
exportations du reste du mon<strong>de</strong> augmentent <strong>de</strong> q dM r = 1,0 à q dM r = 1,13 Mt. <strong>Les</strong> consommateurs<br />
domestiques qui sont indifférents <strong>entre</strong> OGM et non OGM gagnent parce qu'ils paient un prix plus<br />
faible que dans <strong>la</strong> situation initiale. Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, 1055 consommateurs continuent à<br />
consommer du colza standard, et leur utilité augmente <strong>de</strong> 6,1 F / t.<br />
Le prix d'équilibre du colza standard agricole dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1 (w r1 = 952 F / t)est plus faible <strong>de</strong><br />
48 F / t par rapport à <strong>la</strong> situation initiale (w r0 = 1000 F / t). La diminution du prix du colza agricole<br />
standard est plus élevée que <strong>la</strong> diminution du prix du colza transformé standard, parce que <strong>la</strong> plupart<br />
<strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> segmentation pour le colza standard sont transmis aux agriculteurs. <strong>Les</strong> transformateurs<br />
supportent également une partie <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation. 647 transformateurs continuent à<br />
transformer du colza standard, et leur profit diminue <strong>de</strong> 1,7 F / t en moyenne. Même si le prix du colza<br />
standard agricole diminue tant, certains agriculteurs gagnent toujours en comparaison avec <strong>la</strong> situation<br />
initiale, parce que leurs économies <strong>de</strong> coût dues à l'adoption du colza OGM sont plus élevées que <strong>la</strong><br />
diminution <strong>de</strong> prix qu'ils subissent. Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, 1256 agriculteurs se tournent du colza non<br />
OGM sans IP vers le colza OGM, et leur profit augmente <strong>de</strong> 15 F / t en moyenne. 36 agriculteurs se<br />
tournent <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture alternative au colza OGM, et leur profit augmente <strong>de</strong> 33 F / t en moyenne.<br />
c. Simu<strong>la</strong>tion 2<br />
Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 2, on suppose qu'il n'y a pas <strong>de</strong> pertes <strong>de</strong> flexibilité dans le système <strong>de</strong><br />
transformation lorsque <strong>la</strong> segmentation est introduite (c'est-à-dire on fixe le paramètre k égal à zéro).<br />
Toutes <strong>les</strong> autres hypothèses sont i<strong>de</strong>ntiques à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. D'après le tableau 1, l'ordre <strong>de</strong>s prix<br />
d'équilibre au sta<strong>de</strong> agricole dans <strong>la</strong> situation initiale, <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1 et <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 2 est donné par :<br />
w r1 < w r2 < w i1 < w r0 < w i2 . De <strong>la</strong> même manière, l'ordre <strong>de</strong>s prix d'équilibre au sta<strong>de</strong> transformé est<br />
donné par : p r2 < p r1 < p r0 < p i2 < p i1 .En comparaison avec <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1, <strong>la</strong> différence <strong>entre</strong> <strong>les</strong> prix<br />
42
transformé et agricole diminue à <strong>la</strong> fois sur le marché du colza standard et sur le marché du colza<br />
transformé, parce qu'il est moins coûteux <strong>de</strong> transformer à <strong>la</strong> fois du colza standard et du colza IP.<br />
Cette plus petite différence <strong>de</strong> prix conduit alors à un prix agricole plus élevé et un prix transformé<br />
plus faible, à <strong>la</strong> fois sur le marché du colza standard et sur le marché du colza IP, en comparaison avec<br />
<strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 1. Cependant, comme il y a toujours un coût <strong>de</strong> segmentation pour <strong>les</strong> agriculteurs et<br />
pour <strong>les</strong> transformateurs, le prix d'équilibre du colza IP transformé est plus élevé que le prix du colza<br />
dans <strong>la</strong> situation initiale. Il en résulte que <strong>les</strong> consommateurs qui refusent <strong>les</strong> OGM per<strong>de</strong>nt par rapport<br />
à <strong>la</strong> situation initiale.<br />
Tableau 3. Changement dans <strong>les</strong> profits et <strong>les</strong> utilités <strong>de</strong> différents groupes d'agriculteurs, <strong>de</strong><br />
transformateurs et <strong>de</strong> consommateurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation initiale à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 2. unité: F / t<br />
nombre<br />
d'agriculteurs,<br />
transformateurs,<br />
consommateurs<br />
situation initiale simu<strong>la</strong>tion 2 changement moyen dans le<br />
profit (agriculteurs et<br />
transformateur) ou l'utilité en<br />
métrique monétaire<br />
(consommateurs) par tonne<br />
agriculteurs<br />
1031 colza n colza i + 0,81<br />
1277 colza n colza g + 48,5<br />
68 culture alternative b colza g + 44,3<br />
4 culture alternative b colza i + 1,8<br />
2 colza n culture alternative b - 0,38<br />
transformateurs<br />
673 colza r colza r - 1,0<br />
449 colza r colza i + 3,0<br />
68 ne transformant pas<br />
<strong>de</strong> colza<br />
colza i + 2,4<br />
consommateurs<br />
1055 colza r colza r + 14,8<br />
1034 colza r colza i - 23,6<br />
21 colza r substitut a 0<br />
13 substitut a colza r - 7,4<br />
Note: voir tableau 2.<br />
d. Simu<strong>la</strong>tion 3<br />
Dans <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 3, on suppose que <strong>la</strong> technologie OGM est introduite dans l'UE et que tous <strong>les</strong><br />
consommateurs sont indifférents <strong>entre</strong> le colza standard et le colza IP. Seul le colza standard est donc<br />
produit à l'équilibre. En comparaison avec <strong>la</strong> situation initiale, le prix d'équilibre du colza standard au<br />
sta<strong>de</strong> agricole diminue <strong>de</strong> w r0 = 1000 à w r3 = 990 F / t, tandis que ce prix au sta<strong>de</strong> transformé diminue<br />
<strong>de</strong> p r0 = 1200 à p r3 = 1191 F / t. 66 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> colza est OGM, et <strong>les</strong> 34 % restants sont non<br />
OGM non IP. 1507 agriculteurs adoptent <strong>la</strong> technologie OGM. <strong>Les</strong> profits moyens <strong>de</strong>s producteurs<br />
d'OGM augmentent <strong>de</strong> 44 F / t en comparaison avec <strong>la</strong> situation initiale. Comme <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong><br />
43
production diminuent en raison <strong>de</strong> l'adoption <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie OGM, cette augmentation a lieu malgré<br />
<strong>la</strong> diminution du prix agricole. Au contraire, <strong>les</strong> profits <strong>de</strong>s agriculteurs qui n'adoptent pas <strong>la</strong><br />
technologie OGM diminuent, parce que le prix plus faible qu'ils reçoivent n'est pas compensé par une<br />
diminution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> production. 767 agriculteurs continuent à cultiver du colza non OGM, et leur<br />
niveau <strong>de</strong> profit décroît <strong>de</strong> 9,9 F / t en moyenne. 6 agriculteurs se tournent du colza à <strong>la</strong> culture<br />
alternative, et leur profit diminue <strong>de</strong> 3,8 F / t en moyenne. L'offre totale <strong>de</strong> colza standard augmente. Il<br />
en résulte que <strong>les</strong> transformateurs avec <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> transformation plus élevés <strong>entre</strong>nt sur le marché<br />
du colza, ce qui conduit à une augmentation du coût marginal <strong>de</strong> transformation du colza standard. Il<br />
en résulte une augmentation du niveau <strong>de</strong> profit <strong>de</strong>s transformateurs qui transformaient déjà du colza<br />
dans <strong>la</strong> situation initiale (égale à 0,56 F / t en moyenne), et pour <strong>les</strong> transformateurs qui <strong>entre</strong>nt sur le<br />
marché du colza standard (égale à 0,29 F / t en moyenne). L'utilité <strong>de</strong>s consommateurs <strong>de</strong> l'UE<br />
augmente, <strong>de</strong> 9,4 F / t, parce qu'ils font face à un prix plus faible pour le colza transformé. En plus <strong>de</strong>s<br />
2110 consommateurs qui consommaient du colza dans <strong>la</strong> situation initiale, et qui continuent à en<br />
consommer, 16 consommateurs se tournent du bien alternatif a au colza standard.<br />
Tableau 4. Changement dans <strong>les</strong> profits et <strong>les</strong> utilités <strong>de</strong> différents groupes d'agriculteurs, <strong>de</strong><br />
transformateurs et <strong>de</strong> consommateurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation initiale à <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion 3. unité: F / t<br />
nombre<br />
d'agriculteurs,<br />
transformateurs,<br />
consommateurs<br />
situation initiale simu<strong>la</strong>tion 3 changement moyen dans le<br />
profit (agriculteurs et<br />
transformateur) ou l'utilité en<br />
métrique monétaire<br />
(consommateurs) par tonne<br />
agriculteurs<br />
1507 colza n colza g + 44,0<br />
797 colza n colza n - 9,9<br />
6 colza n culture alternative b - 3,8<br />
transformateurs<br />
1155 colza r colza r + 0,56<br />
33 ne transformant pas<br />
<strong>de</strong> colza<br />
colza r + 0,29<br />
consommateurs<br />
2110 colza r colza r + 9,4<br />
16 substitut a colza r + 9,4<br />
Note: voir tableau 2.<br />
2.4. Conclusion partielle<br />
<strong>Les</strong> conclusions suivantes se dégagent <strong>de</strong> ces résultats <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tions.<br />
- <strong>Les</strong> consommateurs qui refusent <strong>les</strong> OGM per<strong>de</strong>nt nécessairement <strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong>s OGM.<br />
- <strong>Les</strong> consommateurs qui sont indifférents <strong>entre</strong> OGM et non OGM bénéficient <strong>de</strong> l'introduction <strong>de</strong>s<br />
OGM (notre analyse considère uniquement <strong>les</strong> effets <strong>de</strong> prix. On ne considère pas le fait que <strong>les</strong> OGM<br />
puissent avoir <strong>de</strong>s effets négatifs sur <strong>la</strong> santé ou l'environnement).<br />
44
S'il n'y a pas <strong>de</strong> coûts liés à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité au sta<strong>de</strong> du stockage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation, ces<br />
consommateurs gagnent encore plus lorsque <strong>les</strong> OGM sont diffusés. En effet, comme certains<br />
consommateurs refusent <strong>les</strong> OGM, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour l'OGM diminue, ce qui conduit à une diminution<br />
encore plus gran<strong>de</strong> du prix d'équilibre du colza standard (ce prix diminue déjà en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
diminution <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l'OGM).<br />
En présence <strong>de</strong> coûts liés à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité au sta<strong>de</strong> du stockage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation, ces<br />
consommateurs "indifférents" portent certains <strong>de</strong>s coûts liés à <strong>la</strong> segmentation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières. En ce<br />
sens, ces consommateurs "indifférents" per<strong>de</strong>nt lorsque d'autres consommateurs refusent <strong>les</strong> OGM,<br />
parce que ce<strong>la</strong> augmente <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> stockage et transformation, ce qui conduit à augmenter le prix<br />
payé par <strong>les</strong> consommateurs "indifférents".<br />
- en moyenne, <strong>les</strong> agriculteurs qui ont un avantage <strong>de</strong> coût important pour le colza OGM (par rapport<br />
au colza non OGM) gagnent lorsque <strong>la</strong> technologie OGM est introduite, qu'il y ait segmentation <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ux filières ou pas. Cependant, leur gain moyen est plus faible quand certains consommateurs<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt du non OGM, et encore plus faible lorsqu'ils supportent certains <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
segmentation parce qu'il y a un coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité.<br />
- <strong>Les</strong> transformateurs qui ont un avantage <strong>de</strong> coût pour transformer du colza standard gagnent quand<br />
<strong>les</strong> OGM sont introduits et qu'il n'y a pas <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour du non OGM, parce que <strong>les</strong> quantités<br />
tota<strong>les</strong> transformées augmentent, ce qui conduit à augmenter le coût marginal <strong>de</strong> transformation (c'està-dire<br />
le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière unité transformée) donc à augmenter <strong>les</strong> profits sur <strong>les</strong> unités infra<br />
margina<strong>les</strong>. Mais ils per<strong>de</strong>nt lorsque certains consommateurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt du non OGM.<br />
- <strong>Les</strong> transformateurs qui ont un avantage <strong>de</strong> coût pour transformer du colza non OGM à IP gagnent<br />
lorsqu'il y a une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour du non OGM, parce que <strong>la</strong> prime qu'ils reçoivent fait plus que<br />
compenser leurs coûts. Ainsi, certains <strong>acteurs</strong> gagnent à l'introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation, même si<br />
cette segmentation est coûteuse.<br />
- De même, certains agriculteurs qui ont un faible coût pour maintenir l'i<strong>de</strong>ntité non OGM <strong>de</strong> leurs<br />
cultures gagnent à l'introduction <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation, même si eux même n'adoptent pas <strong>la</strong><br />
technologie OGM.<br />
Ces conclusions sont préliminaires en raison du manque <strong>de</strong> données quantitatives sur <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
segmentation OGM - non OGM. Il conviendrait <strong>de</strong> mettre en œuvre d'autres simu<strong>la</strong>tions pour<br />
confirmer <strong>la</strong> validité <strong>de</strong> ces résultats. En particulier, le calibrage fait ici repose sur <strong>de</strong>s hypothèses<br />
assez faib<strong>les</strong> <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> segmentation. Il est possible qu'il y ait plus d'<strong>acteurs</strong> qui per<strong>de</strong>nt à<br />
l'introduction simultanée <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation OGM - non OGM avec <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong><br />
segmentation plus élevés. La conclusion principale <strong>de</strong> l'analyse préliminaire qui est faite ici est que <strong>les</strong><br />
effets <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation OGM - non OGM sur <strong>les</strong> revenus peuvent être très différents<br />
pour différents agriculteurs, différents organismes stockeurs, différents transformateurs et différents<br />
consommateurs.<br />
45
Conclusion<br />
Ce chapitre présente <strong>de</strong>s éléments d'analyse ex ante <strong>de</strong>s coûts potentiels liés à <strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux filières, l'une avec OGM et l'autre non OGM, en cas <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM en France. Il est<br />
organisé en <strong>de</strong>ux parties. La première partie présente <strong>les</strong> types <strong>de</strong> coûts encourus actuellement et <strong>les</strong><br />
types <strong>de</strong> coûts que l'on peut anticiper en cas <strong>de</strong> diffusion commerciale <strong>de</strong>s OGMs en France. La<br />
secon<strong>de</strong> partie présente un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion développé pour comprendre comment <strong>les</strong> différents<br />
<strong>acteurs</strong> sont affectés par l'introduction <strong>de</strong>s OGMs et <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières. <strong>Les</strong> coûts liés à<br />
<strong>la</strong> segmentation en <strong>de</strong>ux filières au niveau national pourraient réduire <strong>net</strong>tement le gain global lié à <strong>la</strong><br />
diffusion <strong>de</strong>s OGM, voire conduire à une perte globale. L'analyse faite ici est essentiellement<br />
qualitative et donne certains éléments permettant d'anticiper qui gagnerait et qui perdrait dans un<br />
scénario <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM avec segmentation OGM - non OGM. La métho<strong>de</strong> et <strong>les</strong> principaux<br />
résultats sont exposés en introduction et en conclusion <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux parties et ne sont pas repris ici.<br />
<strong>Les</strong> résultats donnés dans ce chapitre sont préliminaires. Pour <strong>les</strong> compléter, il serait important <strong>de</strong><br />
réunir <strong>de</strong>s éléments quantitatifs, dans <strong>la</strong> mesure du possible, pour donner <strong>de</strong>s ordres <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur sur<br />
<strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong>s coûts liés à <strong>la</strong> segmentation. Il faudrait également poursuivre l'analyse qualitative pour<br />
comprendre à quelle filière ces coûts seraient affectés et comment ils évolueraient en fonction du taux<br />
<strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s OGM. Ces éléments pourraient ai<strong>de</strong>r à améliorer <strong>les</strong> hypothèses du modèle <strong>de</strong><br />
simu<strong>la</strong>tion sur <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux filières.<br />
Références<br />
Angevin, F., Klein, E., Choimet, C., Meynard, J.M., <strong>de</strong> Row, A., Sohbi, Y. (2001).<br />
Modélisation <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> culture et du climat sur <strong>les</strong> pollinisations<br />
croisées chez le maïs. Dans : Isolement <strong>de</strong>s collectes et maîtrise <strong>de</strong> disséminations<br />
au champ. Programme <strong>de</strong> recherche pertinence économique et faisabilité d'une filière<br />
"sans utilisation d'OGM". Document <strong>de</strong> travail, mars 2001.<br />
Bullock, D.S., Desquilbet, M., Nitsi, E.I. (2000). The economics of non-GMO segregation and<br />
i<strong>de</strong>ntity preservation. Document <strong>de</strong> travail, 21 octobre 2000.<br />
Campariol, L. (2001). <strong>Les</strong> OGM sèment <strong>la</strong> confusion. Semences et Progrès n° 106, janvierfévrier-mars<br />
2001, pp 9-16.<br />
CETIOM (2001). Dossier OGM. http://www.ogm.cetiom.fr/OGM/OGMSite/in<strong>de</strong>x.html.<br />
Commission Européenne (2000a). Communiqué <strong>de</strong> presse : <strong>les</strong> OGM dans l'UE : <strong>les</strong> faits.<br />
MEMO/00/43. 22 p. 13 juillet.<br />
Commission Européenne (2000b). Règlements CE n° 49/2000 et n°50/2000 <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Commission du 10 janvier 2000, Journal Officiel <strong>de</strong>s Communautés Européennes.<br />
46
Commission Européenne (2000c). Document <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission sur <strong>la</strong><br />
traçabilité et l'étiquetage <strong>de</strong>s OGM et <strong>de</strong>s produits dérivés d'OGM. ENV/620/2000.<br />
18 p.<br />
Commission Européenne (2001). Opinion of the Scientific Committee on P<strong>la</strong>nts concerning<br />
the adventitious presence of GM seeds in conventional seeds. Health and consumer<br />
protection directorate, SCP/GMO-SEED-CONT/002-FINAL, 13 mars 2001.<br />
Commission Européenne, DG VI (2000). Economic impacts of ge<strong>net</strong>ically modified crops on<br />
the agri-food sector : a first review.<br />
Commission Européenne, DG VI (2001). L'agriculture dans l'Union Européenne: informations<br />
statistiques et économiques.<br />
Commission <strong>de</strong>s Communautés Européennes (1966). Directive du Conseil du 14 juin 1966<br />
concernant <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> céréa<strong>les</strong> (66/402/CEE). JO n° L<br />
125 du 11/7/1966 p 2309.<br />
Commission <strong>de</strong>s Communautés Européennes (1969). Directive du Conseil du 30 juin 1969<br />
concernant <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes oléagineuses et à fibres<br />
(69/208/CEE). JO n° L 169 du 11/7/1969 p 3.<br />
Desquilbet, M., Bullock, D. S. (2001). Who pays the costs of non-GMO segregation and<br />
i<strong>de</strong>ntity preservation 5th ICABR conference "Biotechnology, science and mo<strong>de</strong>rn<br />
agriculture: a new industry at the dawn of the century", Ravello, Italie, June 15-18,<br />
2001.<br />
Falck-Zepeda, J. B., Traxler, G., and Nelson, R. G. (2000). Rent creation and distribution<br />
from biotechnology innovations: the case of Bt cotton and herbici<strong>de</strong>-resistant<br />
soybeans in 1997.” Agribusiness 16, 21-32.<br />
Go<strong>la</strong>n, E. and Kuchler, F. (2000). Labeling biotech foods: implications for consumer welfare<br />
and tra<strong>de</strong>. Presented at International Agricultural Tra<strong>de</strong> Research Consortium<br />
Symposium, Montreal, Canada, June 26-27.<br />
GNIS (2000a). Statistique annuelle semences et p<strong>la</strong>nts, 1999/2000.<br />
GNIS (2000b). Rapport d'activité 1999-2000.<br />
Gouvernement français (2000a). "Destruction <strong>de</strong> 600 Hectares <strong>de</strong> Champs <strong>de</strong> Colza<br />
Transgéniques. Communiqué du Gouvernement - 25 mai".<br />
Gouvernement français (2000b). "Présence éventuelle d'OGM : renforcement <strong>de</strong>s contrô<strong>les</strong>.<br />
Communiqué du 14 juillet 2000".<br />
James, C. (2000). Global review of commercialized transgenic crops 2000. ISAAA Briefs<br />
n°21: preview. ISAAA, Ithaca, NY.<br />
Kempf, Hervé (2000). "Arrachage <strong>de</strong> soja contaminé par <strong>les</strong> OGM" . Le Mon<strong>de</strong>, 28 août.<br />
Le Bail, M., Choimet, C. (2001). Diversité <strong>de</strong>s systèmes d'isolement <strong>de</strong>s lots <strong>de</strong> céréa<strong>les</strong> en<br />
<strong>entre</strong>prises <strong>de</strong> collecte-stockage. Dans : Isolement <strong>de</strong>s collectes et maîtrise <strong>de</strong><br />
disséminations au champ. Programme <strong>de</strong> recherche pertinence économique et<br />
faisabilité d'une filière "sans utilisation d'OGM". Document <strong>de</strong> travail, mars 2001.<br />
47
Le Bail, M., Meynard, J.M., Angevin, F. (2001). Proposition <strong>de</strong> stratégies <strong>de</strong> ségrégation au<br />
champ et en <strong>entre</strong>prise <strong>de</strong> collecte stockage. Dans : Isolement <strong>de</strong>s collectes et<br />
maîtrise <strong>de</strong> disséminations au champ. Programme <strong>de</strong> recherche pertinence<br />
économique et faisabilité d'une filière "sans utilisation d'OGM". Document <strong>de</strong> travail,<br />
mars 2001.<br />
Le Mon<strong>de</strong>, 20 Mai 2000. "La ministre <strong>de</strong> l'environnement <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> récoltes<br />
<strong>de</strong> colza transgénique".<br />
Mayer, H., and Furtan, W.H. (1999). Economics of transgenic herbici<strong>de</strong>-tolerant cano<strong>la</strong>: The<br />
case of Western Canada. Food Policy 24: 431-442.<br />
Ministère <strong>de</strong> l'agriculture et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pêche (1994). Arrêté du 4 novembre 1994 re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong><br />
production, au contrôle et à <strong>la</strong> certification <strong>de</strong>s semences. Journal Officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
République Française, 13/11/1994, p 16110.<br />
Ministère <strong>de</strong> l'économie, <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong> l'industrie (2000). Organismes génétiquement<br />
modifiés. http://www.finances.gouv.fr/ogm.<br />
Ministère <strong>de</strong> l'agriculture et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pêche, ministère <strong>de</strong> l'aménagement du territoire et <strong>de</strong><br />
l'environnement, secrétariat d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat et à <strong>la</strong><br />
consommation. "Le gouvernement <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> cultures <strong>de</strong> semences<br />
<strong>de</strong> soja contenant <strong>de</strong>s OGM". Communiqué <strong>de</strong> presse, 5 août 2000.<br />
Moschini, G., Lapan, H., and Sobolevsky, A. (2000). Roundup Ready® soybeans and<br />
welfare effects in the soybean complex. Agribusiness 16: 33-55.<br />
Nielsen, C., and An<strong>de</strong>rson, K. (2000). GMOs, tra<strong>de</strong> policy, and welfare in rich and poor<br />
countries. Paper presented at a World Bank workshop on Standards, Regu<strong>la</strong>tion and<br />
Tra<strong>de</strong>, held in Washington D.C., 27 April 2001.<br />
OCDE (2000). Systèmes <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> l'OCDE, C(2000)146/FINAL, 28 septembre.<br />
ONIC (2001). Marché <strong>de</strong>s céréa<strong>les</strong>, France, Union Européenne, mon<strong>de</strong>, juin 2001.<br />
USDA, Banque <strong>de</strong> Données PS&D View. USDA-Economic Research Service - National<br />
Agricultural Statistics Service.<br />
Valceschini, E. et Ave<strong>la</strong>nge, I. (2001). Analyse économique et réglementaire <strong>de</strong><br />
l'organisation d'une filière "sans OGM". Programme <strong>de</strong> recherche pertinence<br />
économique et faisabilité d'une filière "sans utilisation d'OGM". Document <strong>de</strong> travail,<br />
mars 2001.<br />
48
Annexes<br />
Annexe 1. <strong>Les</strong> étapes <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong><br />
colza<br />
Dans le cas du maïs, chaque p<strong>la</strong>nte a à <strong>la</strong> fois une panicule (mâle) située en haut <strong>de</strong> <strong>la</strong> tige et <strong>de</strong>s<br />
soies (femel<strong>les</strong>) situées plus bas sur <strong>la</strong> tige. La pollinisation se produit lorsque du pollen provenant <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> panicule d'un p<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> maïs est amené par le vent sur une soie du même p<strong>la</strong>nt ou d'un autre p<strong>la</strong>nt <strong>de</strong><br />
maïs. <strong>Les</strong> semences <strong>de</strong> maïs utilisées en France sont <strong>de</strong>s hybri<strong>de</strong>s (essentiellement hybri<strong>de</strong>s simp<strong>les</strong><br />
issus du croisement <strong>entre</strong> <strong>de</strong>ux lignées parenta<strong>les</strong> différentes, hybri<strong>de</strong>s trois voies issus du croisement<br />
<strong>entre</strong> un hybri<strong>de</strong> simple et une lignée fixée, ou hybri<strong>de</strong>s doub<strong>les</strong> issus du croisement <strong>entre</strong> <strong>de</strong>ux<br />
hybri<strong>de</strong>s), l'hybridation permettant <strong>de</strong> créer une p<strong>la</strong>nte ayant une productivité supérieure à cel<strong>les</strong> <strong>de</strong>s<br />
parents. Il est difficile d'obtenir <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong> pureté très élevés parce qu'un p<strong>la</strong>nt producteur <strong>de</strong><br />
semence peut être pollinisé par le pollen d'un p<strong>la</strong>nt d'une variété non désirable, il en résulte alors un<br />
p<strong>la</strong>nt avec <strong>de</strong>s graines (qui seront <strong>de</strong>s semences au sta<strong>de</strong> suivant <strong>de</strong> <strong>la</strong> production) qui ne sont pas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
variété désirée. <strong>Les</strong> impuretés variéta<strong>les</strong> sont obtenues soit lorsque le p<strong>la</strong>nt est fécondé par du pollen<br />
extérieur au champ <strong>de</strong> production <strong>de</strong> maïs, soit lorsqu'il est fécondé par son propre pollen au lieu d'être<br />
fécondé par du pollen du parent mâle (autofécondation).<br />
Dans le cas du colza, chaque fleur possè<strong>de</strong> à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong>s étamines (mâ<strong>les</strong>) et un ovule (femelle). A <strong>la</strong><br />
différence du maïs, <strong>les</strong> parties mâle et femelle ne sont pas séparées sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte. La majorité <strong>de</strong>s<br />
semences <strong>de</strong> colza utilisées actuellement en France sont <strong>de</strong>s variétés lignées, pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> toutes <strong>les</strong><br />
p<strong>la</strong>ntes ont le même patrimoine génétique et peuvent s'auto-fécon<strong>de</strong>r. Une part croissante <strong>de</strong>s<br />
semences <strong>de</strong> colza est constituée <strong>de</strong> semences hybri<strong>de</strong>s. Pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences hybri<strong>de</strong>s,<br />
l'autofécondation est rendue impossible soit par auto-incompatibilité, soit par stérilité mâle génique ou<br />
cytop<strong>la</strong>smique. Des difficultés supplémentaires surviennent dans <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> colza,<br />
par rapport au maïs, notamment le rôle plus <strong>de</strong>s insectes dans <strong>la</strong> dissémination du pollen et <strong>les</strong><br />
possibilités plus importantes <strong>de</strong> repousses qui peuvent polluer <strong>la</strong> parcelle <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences.<br />
A1.1. La création variétale (semences <strong>de</strong> pré-base)<br />
La première étape <strong>de</strong> <strong>la</strong> sélection consiste à réunir <strong>les</strong> caractères <strong>les</strong> plus intéressants <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou<br />
plusieurs p<strong>la</strong>ntes en <strong>les</strong> croisant.<br />
Dans le cas du maïs, le sélectionneur épure et teste <strong>la</strong> valeur agronomique <strong>de</strong>s croisements pendant<br />
environ dix ans. La première année, l'équipe <strong>de</strong> sélection crée un hybri<strong>de</strong> à partir d'un croisement <strong>entre</strong><br />
<strong>de</strong>ux matériels <strong>de</strong> sa collection <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes (constitué <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tions ancestra<strong>les</strong>, <strong>de</strong> géniteurs publics,<br />
d'hybri<strong>de</strong>s commerciaux, <strong>de</strong> lignées développées précé<strong>de</strong>mment). <strong>Les</strong> années suivantes, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte est<br />
ressemée chaque année et auto-fécondée, pour fixer <strong>les</strong> caractères souhaités. Chaque p<strong>la</strong>nte auto-<br />
49
fécondée produit un épi, qui sert à ressemer une ligne l'année suivante. Chaque ligne est jugée, <strong>les</strong><br />
p<strong>la</strong>ntes qui ne remplissent pas <strong>les</strong> critères souhaités sont éliminées. Cette étape est réalisée dans <strong>de</strong>s<br />
champs <strong>de</strong> quelques hectares, sans règle d'isolement, en dirigeant toutes <strong>les</strong> étapes <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondation. A<br />
cet effet, <strong>de</strong>s sacs en p<strong>la</strong>stique sont p<strong>la</strong>cés sur l'épi avant que <strong>les</strong> soies ne sortent (el<strong>les</strong> sortent ainsi<br />
dans le sac en p<strong>la</strong>stique et ne sont pas accessib<strong>les</strong> au pollen extérieur). Le pollen, lui, est recueilli dans<br />
<strong>de</strong>s sacs en papier. La soie à polliniser est choisie, <strong>la</strong> pollinisation est effectuée à <strong>la</strong> main. <strong>Les</strong> risques<br />
<strong>de</strong> fécondation par du pollen extérieur sont faib<strong>les</strong> à cette étape, puisque <strong>les</strong> soies sont protégées et que<br />
<strong>la</strong> fécondation est dirigée. De plus, si <strong>de</strong>s graines étaient tout <strong>de</strong> même malencontreusement pollinisées<br />
par du pollen extérieur à une étape donnée, ces graines, une fois semées à l'étape suivante, donneraient<br />
<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes qui auraient <strong>de</strong>s chances d'être éliminées par le sélectionneur si el<strong>les</strong> n'ont pas le phénotype<br />
souhaité. Il faut souligner cependant qu'une présence acci<strong>de</strong>ntelle d'une graine OGM à ce sta<strong>de</strong> serait<br />
très problématique puisqu'elle se répercuterait ensuite sur toutes <strong>les</strong> semences <strong>de</strong>scendant <strong>de</strong> cette<br />
graine.<br />
A1.2. La multiplication <strong>de</strong>s parents (semences <strong>de</strong> base) et <strong>la</strong> production <strong>de</strong><br />
semence commerciale chez <strong>les</strong> agriculteurs<br />
Une fois <strong>les</strong> lignées obtenues, pour le maïs ou le colza hybri<strong>de</strong>, <strong>les</strong> parents sont multipliés dans <strong>de</strong>s<br />
parcel<strong>les</strong> isolées chez <strong>de</strong>s agriculteurs sous contrat avec <strong>de</strong>s <strong>entre</strong>prises <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences. La<br />
semence issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> multiplication <strong>de</strong>s parents est appelée semence <strong>de</strong> base. Elle est ensuite utilisée<br />
pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semence commerciale (ou semence certifiée), également réalisée dans <strong>de</strong>s<br />
parcel<strong>les</strong> isolées chez <strong>de</strong>s agriculteurs sous contrat.<br />
Pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences hybri<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s rangs dits "mâ<strong>les</strong>" et "femel<strong>les</strong>" sont alternés. Dans<br />
le cas du maïs, le pollen est supprimé dans <strong>les</strong> rangs dits "femel<strong>les</strong>" par <strong>la</strong> castration du maïs. Cette<br />
étape est réalisée soit à <strong>la</strong> main, soit par un passage à <strong>la</strong> machine suivi d'un passage à <strong>la</strong> main, et<br />
consiste à couper l'inflorescence mâle avant qu'elle ait libéré un seul grain <strong>de</strong> pollen. Dans le cas du<br />
colza, l'absence <strong>de</strong> fécondation dans <strong>les</strong> rangs "femelle" par du pollen <strong>de</strong> ces mêmes rangs est obtenu<br />
soit par auto-incompatibilité, soit par stérilité mâle <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> ces rangs.<br />
Au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semence commerciale, différentes procédures permettent d'obtenir<br />
une pureté élevée <strong>de</strong>s semences. Il s'agit <strong>de</strong> procédures tel<strong>les</strong> que le choix du précé<strong>de</strong>nt cultural,<br />
l'isolement <strong>de</strong> <strong>la</strong> parcelle, <strong>la</strong> bordure <strong>de</strong> <strong>la</strong> parcelle par <strong>de</strong>s rangées du parent mâle ensuite récoltées<br />
séparément (afin d'augmenter <strong>la</strong> masse pollinique du parent mâle sur <strong>la</strong> parcelle, donc <strong>de</strong> diminuer <strong>la</strong><br />
probabilité <strong>de</strong> fécondation du p<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semence par du pollen provenant <strong>de</strong> l'extérieur du<br />
champ), l'épuration en cours <strong>de</strong> végétation (consistant à éliminer <strong>les</strong> p<strong>la</strong>nts aberrants au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte), le triage <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>nts après récolte, le <strong>net</strong>toyage correct du semoir, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> moissonneuse et <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> stockage et <strong>de</strong> transport. Pour certaines <strong>de</strong> ces procédures, <strong>de</strong>s<br />
normes minima<strong>les</strong> sont définies <strong>de</strong> manière réglementaire.<br />
50
A1.3. <strong>Les</strong> îlots <strong>de</strong> production pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semence <strong>de</strong> base et <strong>de</strong><br />
semence commerciale<br />
Une <strong>de</strong>s difficultés pour obtenir <strong>de</strong>s semences très pures est <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> contamination par du<br />
pollen extérieur. Dans le cas d'un hybri<strong>de</strong>, <strong>la</strong> parcelle <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences est d'ailleurs<br />
particulièrement concernée par <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nge par du pollen extérieur, en comparaison avec<br />
une parcelle <strong>de</strong> culture commerciale, car <strong>la</strong> masse pollinique y est faible, comme <strong>les</strong> rangs "femel<strong>les</strong>"<br />
ne produisent pas <strong>de</strong> pollen. Afin <strong>de</strong> limiter <strong>les</strong> possibilités <strong>de</strong> fécondation par du pollen extérieur, on<br />
définit en général <strong>de</strong>s îlots <strong>de</strong> production dans <strong>les</strong>quels on utilise un seul mâle pour <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte<br />
concernée, éventuellement commun à plusieurs hybri<strong>de</strong>s, qu'il s'agisse <strong>de</strong> cultures <strong>de</strong>stinées à <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> semences ou <strong>de</strong> cultures <strong>de</strong> consommation.<br />
La définition <strong>de</strong>s îlots <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semence relève pour une gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> concertation<br />
<strong>entre</strong> <strong>les</strong> <strong>acteurs</strong> concernés. En appui <strong>de</strong> cette concertation, <strong>la</strong> loi française 72-1140 du 22/12/72<br />
instaure <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s zones protégées <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong><br />
l'autorité administrative peut réglementer, limiter ou interdire <strong>la</strong> production <strong>de</strong> certaines espèces. Ces<br />
zones sont définies chaque année par arrêté. Cette loi fournit un cadre pour régler <strong>les</strong> conflits<br />
potentiels. En cas <strong>de</strong> litige, elle permet <strong>de</strong> trancher en faveur du producteur <strong>de</strong> semences, quitte à<br />
détruire une production <strong>de</strong> culture <strong>de</strong> consommation à proximité d'une production <strong>de</strong> semences. En<br />
1999/2000, il existait ainsi 199 zones protégées <strong>de</strong> production <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs en France. Ces<br />
zones représentaient 55 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> production nationale <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs. En revanche, il n'existait<br />
pas <strong>de</strong> zones protégées dans le cas du colza (GNIS, 2000b).<br />
Une autre possibilité pour limiter <strong>la</strong> fécondation par du pollen extérieur consiste à décaler <strong>les</strong> dates<br />
<strong>de</strong> floraison <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes, et à faire en sorte que <strong>les</strong> soies du parent femelle soient réceptives au pollen à<br />
un moment où le pollen du parent mâle est libéré en abondance sur <strong>la</strong> parcelle, si possible en déca<strong>la</strong>nt<br />
ce moment par rapport aux possibilités d'arrivée <strong>de</strong> pollen extérieur.<br />
A1.4. Livraison et conditionnement <strong>de</strong> semence commerciale<br />
<strong>Les</strong> semences certifiées produites chez l'agriculteur sont livrées à une usine <strong>de</strong> traitement et<br />
conditionnement. Dans le cas du maïs, <strong>la</strong> semence est livrée à l'usine par benne en épis complets. <strong>Les</strong><br />
épis sont tout d'abord séchés dans <strong>de</strong>s bacs où circule <strong>de</strong> l'air chaud. Ils passent ensuite du sta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
vrac non égréné au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> vrac égréné puis <strong>de</strong> vrac commercial dans un système (tapis rou<strong>la</strong>nts,<br />
etc...). Dans le cas du colza, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière, <strong>les</strong> graines sont pré-<strong>net</strong>toyées pour enlever <strong>les</strong> bouts<br />
<strong>de</strong> tige restants, triées, analysées et conditionnées. <strong>Les</strong> règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> <strong>net</strong>toyage en usine sont strictes, le<br />
risque <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nge à cette étape est donc re<strong>la</strong>tivement faible, en tout cas a priori contrô<strong>la</strong>ble assez<br />
facilement.<br />
51
Annexe 2. Le circuit logistique <strong>de</strong> <strong>la</strong> graine chez l'organisme<br />
stockeur<br />
La récolte du colza a généralement lieu en juillet, elle chevauche <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte <strong>de</strong> l'orge<br />
d'hiver et le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte du blé. La récolte du maïs a lieu en octobre - novembre, le maïs étant <strong>la</strong><br />
seule culture récoltée à cette pério<strong>de</strong>. Après <strong>la</strong> récolte (et parfois le stockage à <strong>la</strong> ferme), l'agriculteur<br />
transporte généralement <strong>la</strong> récolte à un site <strong>de</strong> collecte d'un organisme stockeur voisin avec un<br />
véhicule à remorque. Dans certains cas l'organisme stockeur ou une société réalise ce transport par<br />
camion. A l'arrivée au site <strong>de</strong> collecte d'un organisme stockeur, un échantillon est prélevé et analysé.<br />
<strong>Les</strong> employés <strong>de</strong> l'<strong>entre</strong>prise analysent différentes caractéristiques <strong>de</strong> cet échantillon (par exemple,<br />
humidité et contenu en protéines dans le cas du maïs). <strong>Les</strong> graines sont généralement déchargées une<br />
fois <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong> l'analyse connus. Le maïs est récolté humi<strong>de</strong> dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s cas. Il est alors<br />
nécessaire <strong>de</strong> le sécher dans <strong>les</strong> vingt quatre heures suivant sa livraison. Le colza n'a généralement pas<br />
besoin d'être séché.<br />
L'agriculteur livre soit à un site <strong>de</strong> collecte intermédiaire proche <strong>de</strong> chez lui, d'où le maïs ou le<br />
colza est redirigé par camion vers un site <strong>de</strong> stockage final (et <strong>de</strong> séchage dans le cas du maïs), soit<br />
directement à un site <strong>de</strong> stockage final. A un site <strong>de</strong> collecte intermédiaire, le maïs et le colza sont en<br />
général déchargés dans une fosse, d'où <strong>les</strong> graines sont transportées en hauteur par un élévateur (une<br />
chaîne verticale à go<strong>de</strong>ts insérée dans une structure métallique). <strong>Les</strong> graines sont alors dirigées par <strong>de</strong>s<br />
tapis rou<strong>la</strong>nts au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong> stockage, dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> tombent par gravité. <strong>Les</strong> graines<br />
sont ensuite déchargées par gravité dans un camion, qui <strong>les</strong> amène à un site <strong>de</strong> séchage (pour le maïs)<br />
et <strong>de</strong> stockage final. Il arrive que le maïs soit déchargé au niveau du sol et <strong>la</strong>issé en tas avant d'être<br />
transporté dans un camion (par exemple par un go<strong>de</strong>t), d'où il est amené vers un site <strong>de</strong> stockage final.<br />
A un site <strong>de</strong> séchage (pour le maïs) et <strong>de</strong> stockage final, <strong>les</strong> graines suivent le même type <strong>de</strong> circuit<br />
(fosse, élévateur, tapis rou<strong>la</strong>nt, cellule ). Dans le cas du maïs, el<strong>les</strong> sont ensuite dirigées vers un séchoir<br />
d'où el<strong>les</strong> seront ensuite redirigées vers <strong>de</strong>s cellu<strong>les</strong> <strong>de</strong> stockage. Le séchoir est constitué d'un cylindre<br />
vertical dans lequel circule <strong>de</strong> l'air chaud. Le maïs circule dans le cylindre du haut vers le bas, en flux<br />
continu. Le circuit <strong>entre</strong> l'entrée et <strong>la</strong> sortie du maïs du séchoir dure en général autour <strong>de</strong> trois heures<br />
(<strong>la</strong> durée dépend du type <strong>de</strong> séchoir et du taux d'humidité) ; mais certaines graines restent plus<br />
longtemps dans le séchoir. Le séchoir doit être complètement plein pour fonctionner, il est en général<br />
vidé et <strong>net</strong>toyé seulement une fois par an (le <strong>net</strong>toyage est long, le séchoir comportant tout un<br />
ensemble <strong>de</strong> petites canalisations à gratter séparément).<br />
Après le stockage, <strong>les</strong> graines sont libérées <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong> stockage par gravité, remontées par un<br />
élévateur puis dirigées sur un tapis rou<strong>la</strong>nt qui <strong>les</strong> amène à un boisseau d'expédition (une petite cellule<br />
<strong>de</strong> stockage) ayant un orifice situé au <strong>de</strong>ssus d'un camion, d'un wagon ou d'une péniche (certains silos<br />
<strong>de</strong> stockage étant localisés près <strong>de</strong> lignes <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> fer ou près d'une rivière ou d'un canal).<br />
52
Annexe 3. <strong>Les</strong> marchés du maïs et du colza en France et dans<br />
l'Union Européenne<br />
A3.1. Développement <strong>de</strong>s cultures OGM en maïs et colza dans le mon<strong>de</strong><br />
A l'heure actuelle, il n'y a pas <strong>de</strong> diffusion commerciale d'OGMs en France. En 1999, l'adoption <strong>de</strong><br />
maïs OGM représente 28 % <strong>de</strong>s surfaces mondia<strong>les</strong> en maïs (tableau A1) et 13 % <strong>de</strong>s surfaces<br />
mondia<strong>les</strong> en colza (tableau A2). 25 La culture <strong>de</strong> maïs OGM concerne 36 % <strong>de</strong>s surfaces en maïs aux<br />
Etats-Unis (<strong>les</strong> Etats-Unis représentant neuf dixièmes <strong>de</strong>s surfaces mondia<strong>les</strong> en maïs OGM), 44 % au<br />
Canada et 11 % en Argentine.<br />
Tableau A1. Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> maïs OGM dans le mon<strong>de</strong><br />
Millions d’ha 1996 1997 1998 1999 2000 part du maïs OGM dans<br />
<strong>la</strong> surface nationale /<br />
mondiale (1999)<br />
part du maïs OGM dans<br />
<strong>la</strong> surface mondiale<br />
(2000)<br />
Etats-Unis 0,30 2,27 8,66 10,30 36 %<br />
Canada 0,001 0,27 0,30 0,50 44 %<br />
Argentine 0,07 0,09 0,31 11 %<br />
Afrique du Sud 0,05 0,16 5 %<br />
Espagne 0,01 0,2 %<br />
Portugal 0,001 0,4 %<br />
France 0,002 0,000 0,0%<br />
TOTAL 0,30 2,61 9,11 11,28 10,30 28,0 % 23 %<br />
Sources : années 1996 à 1999 : Commission Européenne, DG VI, 2000 ; année 2000 : James, 2000.<br />
La culture <strong>de</strong> colza concerne 61 % <strong>de</strong>s surfaces en colza au Canada (le Canada représentant <strong>la</strong><br />
quasi-totalité <strong>de</strong>s surfaces mondia<strong>les</strong> en colza OGM) et 15 % <strong>de</strong>s surfaces en colza aux Etats-Unis<br />
(tableau A2).<br />
25 <strong>Les</strong> chiffres pour l'année 2000 présentés dans <strong>les</strong> tableaux 1 et 2 sont issus d'une source différente <strong>de</strong>s<br />
chiffres <strong>de</strong>s années 1996 à 1999 et ne leur sont donc pas directement comparab<strong>les</strong>.<br />
53
Millions<br />
d’hectares<br />
Tableau A2. Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> colza OGM dans le mon<strong>de</strong><br />
1996 1997 1998 1999 2000 part du colza OGM dans<br />
<strong>la</strong> surface nationale /<br />
mondiale (1999)<br />
part du colza OGM dans<br />
<strong>la</strong> surface mondiale<br />
(2000)<br />
Canada 0,1 1,4 2,4 3,4 61 %<br />
Etats-Unis 0,01 0,02 0,03 0,06 15 %<br />
TOTAL 0,11 1,42 2,43 3,46 2.8 13 % 7 %<br />
Sources : années 1996 à 1999 : Commission Européenne, DG VI, 2000 ; année 2000 : James, 2000.<br />
A3.2. <strong>Les</strong> importations <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> colza (semence, graines, produits<br />
transformés) en France et dans l'Union Européenne<br />
En l'état actuel, <strong>les</strong> OGMs ne sont pas commercialisés dans l'Union Européenne. Cependant, dès<br />
lors que <strong>de</strong>s OGMs sont cultivés dans le reste du mon<strong>de</strong>, il est possible d'avoir <strong>de</strong>s OGMs dans l'UE<br />
pour <strong>de</strong>s produits importés. Cette section présente <strong>les</strong> flux d'importation dans le cas du maïs et du<br />
colza.<br />
- <strong>Les</strong> importations <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs et colza<br />
Dans le cas <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> maïs, <strong>les</strong> importations représentent 9 % <strong>de</strong>s ressources françaises en<br />
1999/2000 (<strong>les</strong> ressources étant <strong>la</strong> somme du stock initial, <strong>de</strong> <strong>la</strong> production et <strong>de</strong>s importations).<br />
Environ un quart <strong>de</strong> ces importations provient <strong>de</strong>s Etats-Unis, où <strong>de</strong>s variétés OGM sont cultivées à<br />
gran<strong>de</strong> échelle (tableau A3). Dans le cas <strong>de</strong>s semences <strong>de</strong> colza, <strong>les</strong> importations représentent 3 % <strong>de</strong>s<br />
ressources françaises (tableau A4). La source utilisée ne permet pas <strong>de</strong> distinguer <strong>les</strong> zones<br />
d'importation <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> colza.<br />
Tableau A3. Semences <strong>de</strong> maïs : bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> commercialisation et origine <strong>de</strong>s importations,<br />
campagne 1999/2000<br />
tonnes % tonnes %<br />
total <strong>de</strong>s ressources 279 814 100% total <strong>de</strong>s emplois 279 814 100%<br />
dont : stock initial 112 742 40% dont : ventes en France 88 998 32%<br />
production 140 858 50% exportations 68 157 24%<br />
importations 26 214 9% déc<strong>la</strong>ssements 16 051 6%<br />
stock final 106 609 38%<br />
importations tota<strong>les</strong> 26 214 100%<br />
dont: Hongrie 8 556 33%<br />
Etats-Unis 6 086 23%<br />
Chili 4 940 19%<br />
Canada 2 830 11%<br />
Source : GNIS, statistique annuelle semences et p<strong>la</strong>nts, 1999/2000. <strong>Les</strong> importations en provenance<br />
<strong>de</strong>s quatre pays cités représentent 85 % <strong>de</strong>s importations tota<strong>les</strong> <strong>de</strong> semences <strong>de</strong> maïs.<br />
54
Tableau A4. Semences <strong>de</strong> colza : bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> commercialisation, campagne 1999/2000<br />
tonnes % tonnes %<br />
total <strong>de</strong>s ressources 12 371 100% total <strong>de</strong>s emplois 12 371 100%<br />
dont : stock début 4 633 37% dont : ventes en France 3 893 31%<br />
production 7 350 59% exportations 815 7%<br />
importations 389 3% déc<strong>la</strong>ssements 1 587 13%<br />
stock fin 6 077 49%<br />
Source : GNIS, statistique annuelle semences et p<strong>la</strong>nts, 1999/2000.<br />
- <strong>Les</strong> importations <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> colza au sta<strong>de</strong> agricole et au sta<strong>de</strong> transformé<br />
En 1998/99, <strong>les</strong> importations <strong>de</strong> maïs dans l'UE représentent 9 % <strong>de</strong>s ressources (constituées <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
somme <strong>de</strong> <strong>la</strong> production et <strong>de</strong>s importations) (tableau A5).<br />
Tableau A5. Bi<strong>la</strong>n d'approvisionnement du maïs, UE à 15<br />
1997/98 1998/99<br />
1000 t % 1000 t %<br />
total ressources = total emplois 41 464 100 % 39 693 100 %<br />
production 39 392 95 % 36 053 91 %<br />
importations 2 072 5 % 3 640 9 %<br />
exportations 1 746 4 % 2 094 5 %<br />
variation <strong>de</strong> stocks 1 272 3 % 559 1 %<br />
utilisations intérieures 38 314 93 % 38 011 93 %<br />
Source : Commission Européenne, DG VI, 2001.<br />
En 1999/2000, <strong>les</strong> importations <strong>de</strong> graines <strong>de</strong> colza représentent 7 % <strong>de</strong>s ressources. La dépendance<br />
est plus marquée pour <strong>les</strong> tourteaux <strong>de</strong> colza dont <strong>les</strong> importations représentent 14 % <strong>de</strong>s ressources<br />
(tableau A6).<br />
55
Tableau A6. Bi<strong>la</strong>n d'approvisionnement du colza, UE à 15<br />
1998/99 1999/00<br />
1000 t % 1000 t %<br />
graine <strong>de</strong> colza<br />
total ressources = total emplois 10 476 100 % 12 231 100 %<br />
production 9 584 91 % 11 368 93 %<br />
importations 892 9 % 863 7 %<br />
exportations 798 8 % 2 018 16 %<br />
disponibilités 9 678 92 % 10 212 84 %<br />
tourteau et équivalent tourteau <strong>de</strong> colza<br />
total ressources = total emplois 5 987 100 % 6 654 100 %<br />
production à partir <strong>de</strong> graines communautaires 4 920 82 % 5 236 79 %<br />
production à partir <strong>de</strong> graines importées 500 8 % 483 7 %<br />
importations 567 10 % 935 14 %<br />
exportations 11 0.2 % 14 0.2 %<br />
disponibilités 5 976 99.8 % 6 641 99.8 %<br />
huile et équivalent huile <strong>de</strong> colza<br />
ressources = emplois 3 874 100 % 4 093 100 %<br />
production à partir <strong>de</strong> graines communautaires 3 514 91 % 3 740 92 %<br />
production à partir <strong>de</strong> graines importées 357 9 % 345 8 %<br />
importations 3 0 % 8 0 %<br />
exportations 840 22 % 777 19 %<br />
disponibilités 3 034 78 % 3 316 81 %<br />
Source : Commission Européenne, DG VI, 2001.<br />
A3.3. <strong>Les</strong> utilisations intérieures du maïs et du colza<br />
L'essentiel <strong>de</strong>s utilisations intérieures du maïs (82 %) sont <strong>de</strong>stinées à l'alimentation animale<br />
(tableau A6). 9 % sont <strong>de</strong>stinées à l'alimentation humaine, dont 6 % après transformation. <strong>Les</strong> usages<br />
industriels représentent 8 % <strong>de</strong>s utilisations (tableau A7).<br />
Tableau A7. Utilisations intérieures du maïs, UE à 15<br />
1998/99 1999/00<br />
1000 t % 1000 t %<br />
utilisations intérieures tota<strong>les</strong> 38 314 100 % 38 011 100 %<br />
dont : alimentation animale 30 776 80% 31 068 82%<br />
consommation humaine à l'état transformé 2 182 6% 2 092 6%<br />
consommation humaine à l'état non transformé 3 267 3% 3 155 3%<br />
usages industriels 3 579 9% 3 167 8%<br />
semences 225 1% 208 1%<br />
pertes (marché) 467 1% 413 1%<br />
Source : Commission Européenne, DG VI (2001).<br />
56
Tableau A7bis. Utilisations du maïs, France (1999/00)<br />
utilisations tota<strong>les</strong> 12940 100 %<br />
exportations vers l'UE 8120 63%<br />
fabricants d'aliments du bétail 3058 24%<br />
amidonnerie 580 4%<br />
semoulerie 140 1%<br />
exportations hors UE 250 2%<br />
semences 89 1%<br />
autres utilisations intérieures 500 4%<br />
freintes 203 2%<br />
Source : ONIC (2001)<br />
<strong>Les</strong> triturateurs produisent du tourteau et <strong>de</strong> l'huile <strong>de</strong> colza à partir <strong>de</strong>s graines. <strong>Les</strong> tourteaux sont<br />
quasi-exclusivement utilisés en alimentation animale tandis que <strong>les</strong> hui<strong>les</strong> sont utilisées pour trois<br />
quarts en alimentation humaine et pour un quart en usages industriels dans l'UE (tableau A8).<br />
Tableau A8. Utilisations <strong>de</strong>s tourteaux et hui<strong>les</strong> <strong>de</strong> colza, UE à 15<br />
1998/99 1999/00<br />
1000 t % 1000 t %<br />
tourteau et équivalent tourteau <strong>de</strong> colza<br />
utilisations intérieures 5758 100 % 6441 100 %<br />
dont : alimentation animale 5754 100 % 6437 100 %<br />
usages industriels 4 0 % 4 0 %<br />
huile et équivalent huile <strong>de</strong> colza<br />
utilisations intérieures 2680 100 % 3027 100 %<br />
dont : consommation humaine 2135 80 % 2342 77 %<br />
usages industriels 538 20 % 677 23 %<br />
alimentation animale 7 0 % 8 0 %<br />
Source : USDA, PS&D View, 2001.<br />
57
Annexe 4. Calibrage du modèle<br />
Tableau A9. Prix et quantités pour le colza non OGM sans IP dans <strong>la</strong> situation initiale<br />
variable valeur nom dans le modèle<br />
surface récoltée dans l'UE 3,5 M ha nombre d'agriculteurs cultivant<br />
du colza × ha<br />
ren<strong>de</strong>ment moyen dans l'UE 3,3 t / ha rdt<br />
quantité produite et transformée dans l'UE 11,55 M t q sAGGF sAGGH<br />
n , q r<br />
exportations <strong>de</strong> l'UE vers le reste du mon<strong>de</strong> 1 M t q sAGGH dAGGC<br />
r - q r<br />
consommation <strong>de</strong> colza transformé dans l'UE 11,55 – 1 = 10,55 M t<br />
dAGGC<br />
q r<br />
prix du colza agricole dans l'UE 1000 F / t w r<br />
prix du colza transformé 1200 F / t p r<br />
ai<strong>de</strong> directe à l'hectare dans l'UE 3600 F / ha s<br />
production dans le reste du mon<strong>de</strong> 31 M t n.a.<br />
consommation dans le reste du mon<strong>de</strong> 32 M t n.a.<br />
importations du reste du mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>puis l'UE 1 million tons<br />
dM<br />
q r<br />
(F = Francs, M = million, t = tonne, ha = hectare).<br />
Sources: Surface, ren<strong>de</strong>ment, production, exportations <strong>net</strong>tes <strong>de</strong> colza dans l'UE, production <strong>de</strong> colza<br />
du reste du mon<strong>de</strong>: Oil World Statistics Update, year 1999/2000, March 30, 2001. Un équivalent<br />
exportations <strong>net</strong>tes <strong>de</strong> colza a été calculé en utilisant une moyenne pondérée par <strong>les</strong> prix <strong>de</strong>s<br />
exportations <strong>net</strong>tes <strong>de</strong> graines <strong>de</strong> colza, <strong>de</strong>s exportations <strong>net</strong>tes d'huile <strong>de</strong> colza et <strong>de</strong>s importations<br />
<strong>net</strong>tes <strong>de</strong> tourteau <strong>de</strong> colza. La consommation dans l'UE et le reste du mon<strong>de</strong> sont calculées pour<br />
équilibrer <strong>les</strong> bi<strong>la</strong>ns d'approvisionnement. Prix: prix à <strong>la</strong> production agricole : Agreste conjoncture, le<br />
bulletin, n°5, mai 2001, Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pêche, France. Prix du colza transformé :<br />
prix <strong>de</strong>s graines <strong>de</strong> colza à l'exportation, CETIOM, Colza d'hiver: <strong>les</strong> techniques cultura<strong>les</strong>, le contexte<br />
économique, Mai 2000, France.<br />
Tableau A.10. Hypothèses sur <strong>les</strong> é<strong>la</strong>sticités prix du colza non OGM sans maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité<br />
dans <strong>la</strong> situation initiale<br />
é<strong>la</strong>sticité prix <strong>de</strong> l'offre <strong>de</strong> colza agricole dans l'UE 1<br />
é<strong>la</strong>sticité prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> colza transformé dans l'UE - 1<br />
é<strong>la</strong>sticité prix <strong>de</strong> l'offre <strong>de</strong> colza transformé dans le reste du mon<strong>de</strong> 0,5<br />
é<strong>la</strong>sticité prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> colza transformé dans le reste du mon<strong>de</strong> - 0,5<br />
58
Tableau A11. Hypothèses sur <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong>s autres paramètres exogènes<br />
Symbole Nom du paramètre Valeur<br />
j nombre d'agricuteurs 4620<br />
π b profit/ha pour <strong>la</strong> culture alternative 1723 F / hectare<br />
ha nombre d'hectares par exploitation 5000 / 3,3<br />
h nombre <strong>de</strong> transformateurs 1500<br />
Q capacité par transformateur 5775 tonnes<br />
d nombre <strong>de</strong> consommateurs 4220<br />
M revenu par consommateur 6,6×10 9 F<br />
ρ paramètre <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction d'utilité du consommateur -255<br />
p a prix du substitut proche du colza à <strong>la</strong> consommation 1200 F / unité<br />
p z prix du bien composite 1,36 ×10 6 F/unité<br />
A4.1. Calibrage <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s agriculteurs<br />
- coûts <strong>de</strong> production par tonne du colza non OGM sans i<strong>de</strong>ntité préservée<br />
On ordonne <strong>les</strong> 4620 exploitations agrico<strong>les</strong> selon <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> c n , pour que l'exploitation 1 ait le<br />
coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> n (c n1 ) le plus faible et l'exploitation 4620 ait le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> n (c n4620 )<br />
le plus élevé. Pour calibrer <strong>les</strong> paramètres c n1 à c n4620 , on fait <strong>les</strong> hypothèses suivantes :<br />
- La différence <strong>entre</strong> le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l'exploitation i et le coût <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l'exploitation<br />
i+1 est constante.<br />
- Dans <strong>la</strong> situation initiale, il est plus profitable <strong>de</strong> cultiver du colza n que <strong>la</strong> culture alternative pour<br />
<strong>les</strong> agriculteurs 1 à 2310, et il est plus profitable <strong>de</strong> cultiver <strong>la</strong> culture alternative b plutôt que du colza<br />
n pour <strong>les</strong> agriculteurs 2311 à 4620.<br />
- Le coût <strong>de</strong> production par hectare <strong>de</strong> l'exploitation 1 est égal à un quart du revenu par hectare.<br />
- Le coût <strong>de</strong> production par hectare <strong>de</strong> l'exploitation 1155 (l'exploitation moyenne cultivant du colza<br />
dans <strong>la</strong> situation initiale) est égal à <strong>la</strong> moitié du revenu par hectare (en incluant l'ai<strong>de</strong> directe). 26<br />
D'après <strong>les</strong> valeurs pour rdt, w r et s, le revenu par hectare pour chaque exploitation est égal à<br />
rdt×w r +s=3,3×1000+3600=6900. Pour l'exploitation j, le coût par hectare est rdt×(coût par tonne)=<br />
3,3×c nj . On a alors : c n1 =(6900/3,3)/4=1725/3,3 et c n1155 =(6900/3,3)/2=3450/3,3. On en déduit : c ni+1 -<br />
c ni =((3450-1725)/3,3)/(1155-1)=1725/(3,3×1154).<br />
On a alors : c n2310 =1568.63 F/t, π n2310 =1723.51F/ha, c n2311 =1569.09 F/t, π n2311 =1722.01 F/ha. On<br />
fixe alors : π b =1723 F/ha (dans <strong>la</strong> situation initiale <strong>les</strong> 2310 premières exploitations trouvent plus<br />
profitable <strong>de</strong> cultiver du colza tandis que <strong>les</strong> 2310 <strong>de</strong>rnières exploitations trouvent plus profitable <strong>de</strong><br />
cultiver <strong>la</strong> culture alternative).<br />
26 Cette hypothèse est cohérente avec Agreste, Chiffres et Données Agriculture n° 131, février 2001, Rica<br />
France: Tableaux Standard 1999, Ministère <strong>de</strong> l'Agriculture et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pêche, France.<br />
59
On remarque alors que quand le prix reçu par <strong>les</strong> agriculteurs pour le colza, w r , augmente <strong>de</strong> 1%<br />
par rapport à sa valeur initiale (donc <strong>de</strong> w r0 = 1000 à w r1 = 1010), le nombre d'agriculteurs cultivant du<br />
colza n augmente <strong>de</strong> 2310 à 2332 (donc <strong>de</strong> 22/2310=0,95%). (Ces agriculteurs basculent <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture<br />
alternative b au colza n). L'é<strong>la</strong>sticité d'offre par rapport au prix est donc égale environ à 0,95.<br />
- coûts <strong>de</strong> production par tonne du colza OGM<br />
On utilise ici <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong>s simu<strong>la</strong>tions du chapitre 2 pour calibrer une distribution du paramètre<br />
c g dans <strong>la</strong>quelle on prend <strong>de</strong>s valeurs c g1 , …, c g4620 pour <strong>les</strong> 4620 exploitations du modèle.<br />
a) Distribution <strong>de</strong>s réductions <strong>de</strong> coût d'herbici<strong>de</strong> OGM pour <strong>les</strong> agriculteurs<br />
D'après <strong>les</strong> données du CETIOM sur <strong>les</strong> 1238 exploitations <strong>de</strong> colza en France, en supposant que le<br />
prix <strong>de</strong>s herbici<strong>de</strong>s standards reste constant et que le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> licence est fixé à son optimum <strong>de</strong> 321 F<br />
par hectare, on obtient une réduction <strong>de</strong> coût en herbici<strong>de</strong> <strong>de</strong> 396F/ha en moyenne, avec un écart type<br />
empirique <strong>de</strong> 188. Ici, on divise ces valeurs par le ren<strong>de</strong>ment en colza, 3,3 t/ha, et on approxime <strong>la</strong><br />
distribution empirique <strong>de</strong>s réductions <strong>de</strong> coût en herbici<strong>de</strong> par tonne (<strong>de</strong> colza vendu par l'agriculteur)<br />
par une distribution normale <strong>de</strong> moyenne 120 et d'écart type 57.<br />
Soit CDFN(r; 120, 57) <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> distribution normale cumulée d'une variable aléatoire r <strong>de</strong><br />
moyenne 120 et d'écart type 57. Pour trouver 4620 réductions <strong>de</strong> coût en herbici<strong>de</strong> représentatives à<br />
partir <strong>de</strong> cette distribution, on trouve ensuite 4620 valeurs pour <strong>les</strong> réductions <strong>de</strong> coût par hectare,<br />
qu'on appelle r 1 ,..., r 4620 , où ces points sont définis implicitement par l'équation CDFN(r i ; 120, 57) =<br />
i / 4620 pour i = 1, 2,...,4620.<br />
b) Distribution <strong>de</strong> c gj<br />
Pour éviter d'avoir une corré<strong>la</strong>tion <strong>entre</strong> <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> production par tonne du colza n et <strong>les</strong><br />
réductions du coût en herbici<strong>de</strong> par tonne, on prend une permutation aléatoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste {r 1 , …, r 4620 },<br />
qu'on note {r 1 ', …, r 4620 '}. On définit alors le coût <strong>de</strong> production par tonne <strong>de</strong> colza OGM <strong>de</strong><br />
l'exploitation j, c gj , comme son coût <strong>de</strong> production par tonne <strong>de</strong> colza non OGM, c nj , moins <strong>la</strong><br />
réduction <strong>de</strong> coût en herbici<strong>de</strong>, r j ', plus le coût <strong>de</strong> licence <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence OGM, coûtlicence (c'est à dire<br />
<strong>la</strong> différence <strong>de</strong> prix <strong>entre</strong> <strong>la</strong> semence OGM et <strong>la</strong> semence non OGM, supposée i<strong>de</strong>ntique pour tous <strong>les</strong><br />
agriculteurs):<br />
c gj = c nj - r j ' + coûtlicence, i = 1, 2, … , 4620.<br />
Dans <strong>la</strong> situation initiale, on fixe le prix <strong>de</strong> licence à 3000 F/t. Alors, aucun agriculteur ne cultive<br />
d'OGMs. Dans <strong>les</strong> simu<strong>la</strong>tions où <strong>les</strong> OGMs sont adoptés dans l'UE, on fixe le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> licence à<br />
321/3,3=97 F/t.<br />
60
- coûts <strong>de</strong> production par tonne du colza non OGM à i<strong>de</strong>ntité préservée<br />
On note le coût additionnel <strong>de</strong> maintien d'i<strong>de</strong>ntité au sta<strong>de</strong> agricole par i pfj . On trouve 4620 valeurs<br />
pour <strong>les</strong> coûts additionnels <strong>de</strong> maintien d'i<strong>de</strong>ntité, notés i pf1 , …, i pf4620 , variant <strong>entre</strong> 1 F/t et 11 F/t avec<br />
une moyenne <strong>de</strong> 6 F/t et un écart constant i pfi+1 - i pfi . 27 Pour éviter d'avoir une corré<strong>la</strong>tion <strong>entre</strong> ces coûts<br />
additionnels <strong>de</strong> maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité non OGM et <strong>les</strong> autres coûts au sta<strong>de</strong> agricole, on prend une<br />
permutation aléatoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste {i pf1 , …, i pf4620 }, notée {i pf1 ', …, i pf4620 '}. On définit alors le coût <strong>de</strong><br />
production par tonne <strong>de</strong> colza non OGM IP <strong>de</strong> l'exploitation j, ci j , comme son coût <strong>de</strong> production par<br />
tonne <strong>de</strong> colza non OGM, cn j , plus le coût additionnel <strong>de</strong> maintien d'i<strong>de</strong>ntité, ipf j :<br />
c ij = c nj + i pfj ' , i = 1, 2, … , 4620.<br />
A4.2. Calibrage <strong>de</strong>s paramètres <strong>de</strong>s transformateurs<br />
- Calibrage <strong>de</strong> c rh<br />
Le paramètre c rh est le coût <strong>de</strong> transformation du colza standard, en excluant le coût d'achat du<br />
colza à l'agriculteur et le coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité. On prend <strong>les</strong> coûts c rh d'une distribution<br />
uniforme, <strong>entre</strong> 180 et 206 F/t, sur un échantillon <strong>de</strong> 1500 transformateurs. Le paramètre c rh est<br />
inférieur à 200 F/t pour <strong>les</strong> 1155 premiers transformateurs, qui transforment donc du colza dans <strong>la</strong><br />
situation initiale. Il est supérieur à 200 F / t pour <strong>les</strong> 345 <strong>de</strong>rniers transformateurs, qui ne transforment<br />
donc pas <strong>de</strong> colza dans <strong>la</strong> situation initiale.<br />
- Calibrage <strong>de</strong> c ih<br />
Le paramètre c ih est le coût <strong>de</strong> transformation du colza non OGM à IP, en excluant le coût d'achat<br />
du colza à l'agriculteur et le coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité. D'après nos hypothèses, c ih est supérieur à<br />
c rh , pour chaque transformateur. On appelle c iph <strong>la</strong> différence <strong>entre</strong> c ih et c rh , c'est-à-dire le coût <strong>de</strong><br />
maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité (en excluant le coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité). On suppose que ce coût varie<br />
27 Il y a peu d'information disponible sur <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> préservation d'i<strong>de</strong>ntité au sta<strong>de</strong> agricole. Bullock,<br />
Desquilbet and Nitsi (2000) rapportent que <strong>les</strong> primes aux agriculteurs livrant du soja non OGM sous contrat à<br />
<strong>de</strong>s organismes stockeurs près <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Illinois en 2000 étaient approximativement égaux à 50 F/t. Cette<br />
prime couvrait : <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> <strong>net</strong>toyage du semoir et <strong>de</strong> <strong>la</strong> moissonneuse (approximativement 0,4 F/t), <strong>les</strong> coûts<br />
<strong>de</strong> contractualisation, <strong>les</strong> coûts pour conduire plus loin jusqu'au silo et attendre plus longtemps pour livrer <strong>les</strong><br />
graines non OGM, le profit dû à l'IP et le coût d'opportunité pour ne pas utiliser <strong>de</strong> semence OGM (non<br />
observab<strong>les</strong> et variant par exploitation). Notre ensemble <strong>de</strong> valeurs pour i pfj est choisi arbitrairement étant donnée<br />
cette information.<br />
61
linéairement <strong>entre</strong> 10 et 30 F / t avec une moyenne <strong>de</strong> 20. 28 On prend alors une permutation aléatoire<br />
<strong>de</strong> cette liste, c iph ', et on définit c ih comme:<br />
c ih = c rh + c iph ', h = 1,..., 1500.<br />
- Calibrage <strong>de</strong> k<br />
On assigne une valeur <strong>de</strong> 100 F / t au paramètre k, qui est le paramètre <strong>de</strong> coût lié à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong><br />
flexibilité.<br />
A4.3. Calibrage <strong>de</strong>s paramètres <strong>de</strong>s consommateurs<br />
- Calibrage <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> finale lorsque tous <strong>les</strong> consommateurs sont indifférents<br />
<strong>entre</strong> le colza non IP et le colza IP<br />
La valeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation finale totale <strong>de</strong>s ménages <strong>de</strong> l'UE en 1998 était égale à 28 10 12 F. On<br />
fixe le budget du consommateur l, l = 1,..., 4220, à M=28 × 10 12 / 4220 = 6,6 × 10 9 F. Pour calibrer ,<br />
p z , et une distribution <strong>de</strong> σ ral selon <strong>les</strong> consommateurs, on s'appuie sur <strong>les</strong> trois hypothèses suivantes :<br />
(i) 2110 consommateurs consomment du colza, et 2110 consommateurs consomment le substitut<br />
proche dans <strong>la</strong> situation initiale; (ii) le paramètre σ ral est distribué linéairement <strong>entre</strong> 0 et 2 ; (iii) si le<br />
prix du colza standard augmente <strong>de</strong> 1 %, <strong>la</strong> consommation totale <strong>de</strong> colza standard diminue <strong>de</strong> 1 %.<br />
a) Calibrage <strong>de</strong>s paramètres σ ral , l= 1,..., 4220.<br />
D'après notre modèle, le fait que le consommateur l consomme ou non le bien r est par <strong>la</strong> fonction<br />
indicatrice suivante :<br />
Ind l (p a , p r ) = 1 si le consommateur l consomme du colza standard, i.e. si σ ral > p r / p a<br />
= 0 si le consommateur l consomme le substitut a, i.e. si σ ral p r / p a<br />
Dans <strong>la</strong> situation initiale, p a0 =p r0 =1200 F/t, si bien que p r0 /p a0 =1. On crée une liste <strong>de</strong> 4220 paramètres<br />
ral variant linéairement <strong>de</strong> 0 à 2. On a alors : σ ral > 1 pour l=2111, ...,4220 (<strong>les</strong> consommateurs 2111 à<br />
4220 consomment r dans <strong>la</strong> situation initiale).<br />
28 Tout comme pour <strong>les</strong> agriculteurs, il y a peu d'information sur <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong> maintien <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité non OGM au<br />
sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation. Bullock, Desquilbet and Nitsi (2000) rapportent que <strong>la</strong> prime aux transformateurs<br />
américains livrant du soja non OGM au Japon moins <strong>la</strong> prime aux agriculteurs américains livrant du soja non<br />
OGM sous contrat aux organismes stockeurs près <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Illinois en 2000 étaient approximativement égaux<br />
à 80 F / ton. Cette prime couvrait <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong>s tests, approximativement égaux à 6 F/t, <strong>les</strong> coûts <strong>de</strong><br />
contractualisation, <strong>les</strong> coûts liés à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> flexibilité, le profit dû à <strong>la</strong> ségrégation (non observab<strong>les</strong> ). D'après<br />
ces valeurs on choisit arbitrairement <strong>les</strong> valeurs <strong>de</strong> c iph et <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> k.<br />
62
Lorsque p r augmente <strong>de</strong> 1% <strong>de</strong>puis sa valeur initiale <strong>de</strong> p r0 =1200 à une valeur p r1 =1212, le ratio<br />
<strong>de</strong>vient p r1 /p a0 =1,01. D'après notre définition <strong>de</strong>s paramètres σ ral , on trouve : σ ral > 1,01 pour l=2132,<br />
...,4220. Autrement dit, lorsque le prix <strong>de</strong> r augmente <strong>de</strong> 1%, le nombre <strong>de</strong> consommateurs qui<br />
consomment r diminue <strong>de</strong> (2111-2132)/2110, soit <strong>de</strong> 0,9%.<br />
Cette liste définit également σ ial (<strong>les</strong> consommateurs sont indifférents <strong>entre</strong> du colza standard et du<br />
colza IP dans <strong>la</strong> situation initiale).<br />
b) calibrage <strong>de</strong> ρ et p z<br />
La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> agrégée <strong>de</strong> colza standard est donnée par :<br />
1<br />
ρ −1<br />
(1) q dAGGC p<br />
r = M<br />
ρ<br />
ρ ∑Indl<br />
( p<br />
ρ−1<br />
ρ −1<br />
l<br />
p + p<br />
z<br />
r<br />
a<br />
, pr<br />
)<br />
r<br />
où Ind l (p a , p r ) = 1 si le consommateur l consomme du colza standard, 0 sinon.<br />
D'après cette équation, <strong>la</strong> dépense totale sur le colza est donnée par :<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
(2) p r × q dAGGC p<br />
r = M<br />
ρ<br />
ρ ∑Indl<br />
( p<br />
ρ−1<br />
ρ −1<br />
l<br />
p + p<br />
z<br />
r<br />
a<br />
, pr<br />
)<br />
r<br />
Dans <strong>la</strong> situation initiale, p r × q r dAGGC =1,266×10 10 F, M=6,6×10 9 F, ∑<br />
l<br />
Ind 1200 1200 =2110. En<br />
l ( , )<br />
utilisant ces valeurs dans l'équation précé<strong>de</strong>nte et en simplifiant l'expression, on obtient :<br />
(3)<br />
p z<br />
⎛ 6,<br />
6×<br />
2110 ⎞<br />
= 1200 ⎜ − 1⎟<br />
⎝ 1266 , × 10 ⎠<br />
ρ −1<br />
ρ<br />
= 1200 × 1099<br />
- Afin d'avoir une é<strong>la</strong>sticité prix <strong>de</strong> 1, on souhaite :<br />
q r dAGGC (1200,1212) = 0,99 q r dAGGC (1200,1200).<br />
D'après l'équation (2), en utilisant : ∑<br />
l<br />
équation est équivalente à :<br />
(4) 2089<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
p z<br />
1212<br />
1<br />
ρ −1<br />
+ 1212<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
=2110 × 0,99<br />
ρ−1<br />
ρ<br />
Indl ( 1200 , 1200 ) =2110, ∑ Indl ( 1200 , 1212 ) =2089, cette<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
p z<br />
1200<br />
1<br />
ρ −1<br />
+ 1200<br />
En remp<strong>la</strong>çant p z dans (4) par son expression dans l'équation (3) et en résolvant numériquement <strong>les</strong><br />
équations (3) et (4), on obtient : ρ = -255 et p z = 1,36 10 6 F.<br />
ρ<br />
ρ −1<br />
l<br />
63
- Calibrage <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> finale lorsqu'un consommateur sur <strong>de</strong>ux refuse le colza<br />
non IP<br />
Dans ce cas, σ ial est défini comme précé<strong>de</strong>mment, et σ ral est fixé égal à 0 pour <strong>les</strong> valeurs paires <strong>de</strong><br />
l, et fixé égal à σ ial pour <strong>les</strong> valeurs impaires <strong>de</strong> l.<br />
A4.4. Calibrage du reste du mon<strong>de</strong><br />
On prend <strong>de</strong>s fonctions d'offre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> linéaires dans le reste du mon<strong>de</strong> pour le colza<br />
standard transformé. Dans <strong>la</strong> situation initiale, <strong>les</strong> niveaux <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> consommation dans le<br />
reste du mon<strong>de</strong> sont respectivement égaux à 31 Mt et 32 Mt dans <strong>la</strong> situation initiale. On suppose <strong>de</strong><br />
plus que l'é<strong>la</strong>sticité prix <strong>de</strong> l'offre est égale à 0,5 et l'é<strong>la</strong>sticité prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est égale à - 0,5 dans<br />
<strong>la</strong> situation initiale. On obtient alors :<br />
Courbe d'offre: S = 12916.666 p + 1.55 10 7<br />
Courbe <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: D = -13333.333 p + 4.8 10 7<br />
où <strong>les</strong> quantités sont en tonnes et le prix est en F / t.<br />
64