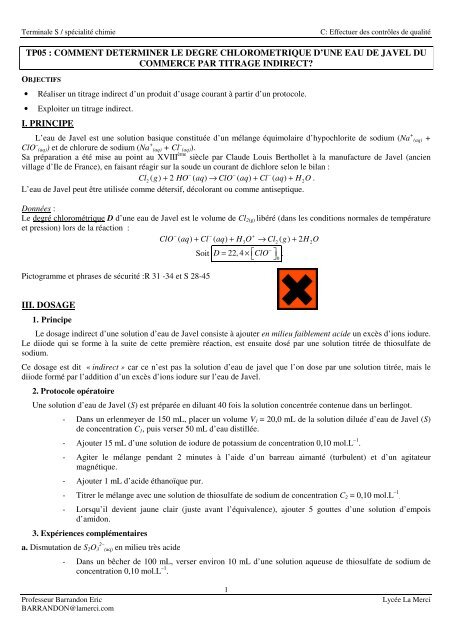TP05 : COMMENT DETERMINER LE DEGRE ... - Laroche
TP05 : COMMENT DETERMINER LE DEGRE ... - Laroche
TP05 : COMMENT DETERMINER LE DEGRE ... - Laroche
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Terminale S / spécialité chimie<br />
C: Effectuer des contrôles de qualité<br />
<strong>TP05</strong> : <strong>COMMENT</strong> <strong>DETERMINER</strong> <strong>LE</strong> <strong>DEGRE</strong> CHLOROMETRIQUE D’UNE EAU DE JAVEL DU<br />
COMMERCE PAR TITRAGE INDIRECT<br />
OBJECTIFS<br />
• Réaliser un titrage indirect d’un produit d’usage courant à partir d’un protocole.<br />
• Exploiter un titrage indirect.<br />
I. PRINCIPE<br />
L’eau de Javel est une solution basique constituée d’un mélange équimolaire d’hypochlorite de sodium (Na + (aq) +<br />
ClO – (aq)) et de chlorure de sodium (Na + (aq) + Cl – (aq)).<br />
Sa préparation a été mise au point au XVIII ème siècle par Claude Louis Berthollet à la manufacture de Javel (ancien<br />
village d’Ile de France), en faisant réagir sur la soude un courant de dichlore selon le bilan :<br />
Cl2 ( g) + 2 HO − ( aq) → ClO − ( aq) + Cl − ( aq)<br />
+ H2O<br />
.<br />
L’eau de Javel peut être utilisée comme détersif, décolorant ou comme antiseptique.<br />
Données :<br />
Le degré chlorométrique D d’une eau de Javel est le volume de Cl 2(g) libéré (dans les conditions normales de température<br />
et pression) lors de la réaction :<br />
ClO − ( aq) + Cl − ( aq) + H O + → Cl ( g) + 2H O<br />
Soit<br />
Pictogramme et phrases de sécurité :R 31 -34 et S 28-45<br />
3 2 2<br />
D = 22, 4 × ⎡ ⎣ ClO − ⎤ ⎦ .<br />
0<br />
III. DOSAGE<br />
1. Principe<br />
Le dosage indirect d’une solution d’eau de Javel consiste à ajouter en milieu faiblement acide un excès d’ions iodure.<br />
Le diiode qui se forme à la suite de cette première réaction, est ensuite dosé par une solution titrée de thiosulfate de<br />
sodium.<br />
Ce dosage est dit « indirect » car ce n’est pas la solution d’eau de javel que l’on dose par une solution titrée, mais le<br />
diiode formé par l’addition d’un excès d’ions iodure sur l’eau de Javel.<br />
2. Protocole opératoire<br />
Une solution d’eau de Javel (S) est préparée en diluant 40 fois la solution concentrée contenue dans un berlingot.<br />
- Dans un erlenmeyer de 150 mL, placer un volume V 1 = 20,0 mL de la solution diluée d’eau de Javel (S)<br />
de concentration C 1 , puis verser 50 mL d’eau distillée.<br />
- Ajouter 15 mL d’une solution de iodure de potassium de concentration 0,10 mol.L –1 .<br />
- Agiter le mélange pendant 2 minutes à l’aide d’un barreau aimanté (turbulent) et d’un agitateur<br />
magnétique.<br />
- Ajouter 1 mL d’acide éthanoïque pur.<br />
- Titrer le mélange avec une solution de thiosulfate de sodium de concentration C 2 = 0,10 mol.L –1 .<br />
- Lorsqu’il devient jaune clair (juste avant l’équivalence), ajouter 5 gouttes d’une solution d’empois<br />
d’amidon.<br />
3. Expériences complémentaires<br />
a. Dismutation de S 2 O 3<br />
2–<br />
(aq) en milieu très acide<br />
- Dans un bêcher de 100 mL, verser environ 10 mL d’une solution aqueuse de thiosulfate de sodium de<br />
concentration 0,10 mol.L –1 .<br />
Professeur Barrandon Eric<br />
BARRANDON@lamerci.com<br />
1<br />
Lycée La Merci
Terminale S / spécialité chimie<br />
C: Effectuer des contrôles de qualité<br />
- Verser 3 mL d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration 2 ,0 mol.L –1 .<br />
b. Dismutation de I 2(aq) en milieu basique<br />
4. Manipulation<br />
- Dans un becher de 100 mL, verser environ 10 mL d’une solution aqueuse de diiode.<br />
- Ajouter 3 mL d’une solution d’hydroxyde de so dium de concentration 2,0 mol.L –1 .<br />
- Verser 3 mL d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration 2 ,0 mol.L –1 .<br />
Réaliser le protocole opératoire en notant les couleurs de la solution aux différentes étapes du dosage.<br />
Réaliser les deux expériences complémentaires.<br />
5. Exploitation<br />
Le dosage indirect des ions hypochlorite se déroule en deux étapes successives :<br />
Etape (1) : Réduction des ions ClO – (aq) par I – (aq)<br />
Etape (2) : Réduction de I 2(aq) par S 2 O 3<br />
2–<br />
(aq)<br />
ClO ( aq) + 2 H O +2 I ( aq) → Cl ( aq) + H O + I ( aq)<br />
(1)<br />
− + − −<br />
3 excès<br />
2 2<br />
I ( aq) + 2 S O ( aq) → 2 I ( aq) + S O ( aq)<br />
(2)<br />
− − 2−<br />
2 2 3 4 6<br />
a. Après avoir analysé les deux expériences complémentaires, expliquer pourquoi il est important de ne pas<br />
travailler en milieu très acide ou en milieu basique <br />
b. Quel est le rôle de l’empois d’amidon <br />
c. Pourquoi l’aj oute-t-on juste avant l’équivalence <br />
d. Compléter le tableau décrivant l’évolution du système au cours de la 1 ère étape (1).<br />
mol<br />
Etat initial x=0<br />
En cours de transformation x<br />
Etat final<br />
x f<br />
ClO ( aq) + 2 H O +2 I ( aq) → Cl ( aq) + H O + I ( aq)<br />
− + − −<br />
3 excès<br />
2 2<br />
e. En déduire la relation entre la quantité de matière initiale d’ions hypochlorite dans l’erlenmeyer et la<br />
quantité de diiode formé.<br />
f. Compléter le tableau décrivant l’évolution du système au cours de la 2 ème étape (2).<br />
mol<br />
− − 2−<br />
I2 ( aq) + 2 S2O3 ( aq) → 2 I ( aq) + S4O6<br />
( aq)<br />
Etat initial x=0<br />
En cours de transformation x<br />
Etat final<br />
x f<br />
g. En déduire la relation entre la quantité de diiode formé au cours de la 1 ère étape et la quantité d’ions<br />
thiosulfate ajoutés à l’équivalence.<br />
h. Calculer le degré chlorométrique de la solution (S) En déduire celui de la solution d’eau de Javel<br />
contenue dans le berlingot.<br />
i. (i) Calculer la valeur moyenne D moy obtenue par tous les binômes.<br />
(ii) Déterminer l’écart -type ó de toutes ces valeurs.<br />
(iii) En admettant que l’incerti tude sur la valeur de D est donnée par cet écart type, exprimez D en<br />
fonction de D moy et de ó.<br />
j. Comparer la valeur trouvée avec celle indiquée par le fabriquant sur l’emballage.<br />
k. Pouvez-vous expliquer cet écart <br />
Professeur Barrandon Eric<br />
BARRANDON@lamerci.com<br />
2<br />
Lycée La Merci