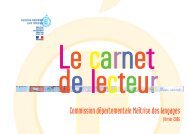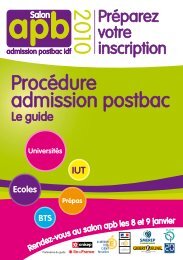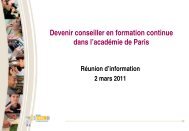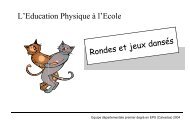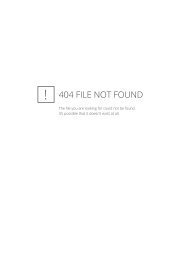Bilinguisme chez les enfants de migrants, mythes et réalités
Bilinguisme chez les enfants de migrants, mythes et réalités
Bilinguisme chez les enfants de migrants, mythes et réalités
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BILINGUISME CHEZ LES ENFANTS<br />
DE MIGRANTS, MYTHES ET RÉALITÉS<br />
Par Dalila REZZOUG 1 , Sylvaine DE PLAËN 2 ,<br />
Malika BENSEKHAR-BENNABI 3 & Marie Rose MORO 4<br />
1 2 3 4<br />
En exerçant dans une consultation <strong>de</strong> pédopsychiatrie qui s’inscrit dans un<br />
environnement marqué par une gran<strong>de</strong> hétérogénéité culturelle <strong>et</strong> linguistique<br />
dans un service <strong>de</strong> psychiatrie <strong>de</strong> l’enfant <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’ado<strong>les</strong>cent en<br />
banlieue parisienne 5 , <strong>et</strong> par conséquent très largement ouverte à la clinique<br />
transculturelle, nous avons pu constater que la question du bilinguisme <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> la langue maternelle <strong>chez</strong> <strong>les</strong> <strong>migrants</strong> <strong>et</strong> leurs <strong>enfants</strong> constitue un<br />
point sensible à plus d’un titre, pour <strong>les</strong> pays d’accueil, en particulier pour<br />
la société française, comme vont le montrer rapi<strong>de</strong>ment <strong>les</strong> faits suivants.<br />
L’actualité <strong>de</strong> l’automne 2006 (lois Sarkozy sur l’immigration <strong>et</strong> l’intégration)<br />
nous a rappelé que parler français pour <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> étrangers<br />
pouvait faciliter l’accès au droit à séjourner en France. De même, le <strong>de</strong>rnier<br />
rapport parlementaire sur la prévention <strong>de</strong> la délinquance (rapport Benisti,<br />
janvier 2005) incitait clairement <strong>les</strong> mères <strong>de</strong> très jeunes <strong>enfants</strong> à utiliser<br />
le français avec eux, même si el<strong>les</strong> ne maitrisaient pas bien c<strong>et</strong>te langue, ce<br />
qui <strong>de</strong> fait dévalorise la langue <strong>de</strong> la famille <strong>et</strong> déprécie le statut <strong>de</strong> ces<br />
<strong>enfants</strong>.<br />
C<strong>et</strong>te situation <strong>et</strong> d’autres semblab<strong>les</strong> nous amènent à questionner <strong>les</strong><br />
représentations collectives construites sur le bilinguisme <strong>et</strong> <strong>les</strong> avatars qui<br />
en résultent. Ces représentations ren<strong>de</strong>nt plus diffici<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>migrants</strong> la construction harmonieuse d’une i<strong>de</strong>ntité métisse qui concilie<br />
<strong>de</strong>ux appartenances culturel<strong>les</strong> ancrées dans une bonne estime <strong>de</strong> soi <strong>et</strong> qui<br />
intègre <strong>de</strong>ux systèmes <strong>de</strong> représentations du mon<strong>de</strong>.<br />
L’école, quant à elle, semble surtout voir dans le bilinguisme <strong>les</strong> troub<strong>les</strong><br />
du langage <strong>et</strong> <strong>de</strong>s apprentissages réputés en résulter, sans parvenir à prendre<br />
en compte <strong>de</strong> manière positive la bilingualité, c’est-à-dire la situation qui<br />
caractérise un suj<strong>et</strong> porteur <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux langues <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux univers culturels<br />
distincts, d’où une situation <strong>de</strong> stigmatisation <strong>et</strong> <strong>de</strong> minoration.<br />
À l’aune <strong>de</strong> ces questions, on essaiera <strong>de</strong> comprendre ce qu’est le bilinguisme,<br />
<strong>de</strong> décrire la diversité <strong>de</strong>s profils bilingues <strong>et</strong> <strong>de</strong> préciser <strong>les</strong> béné-<br />
1. D. Rezzoug, pédopsychiatre, hôpital Avicenne, Bobigny.<br />
2. S. De Plaën, pédopsychiatre, hôpital Sacré Cœur, Montréal.<br />
3. M. Bensekhar-Bennabi, maitre <strong>de</strong> conférences en psychologie interculturelle, université<br />
<strong>de</strong> Picardie Ju<strong>les</strong> Verne, Amiens.<br />
4. M.R. Moro, professeur en pédopsychiatrie, hôpital Avicenne, Bobigny.<br />
5. CHU Avicenne, Bobigny, www.clinique-transculturelle.org
Le Français aujourd’hui n° 158, Enseigner <strong>les</strong> langues d’origine<br />
fices ou <strong>les</strong> problèmes qui en découlent. Ainsi, il sera possible <strong>de</strong> cerner<br />
<strong>les</strong> difficultés spécifiques que rencontrent <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong> notamment<br />
en creusant la notion <strong>de</strong> mutisme extra familial. Ce symptôme peut<br />
être observé <strong>chez</strong> quelques <strong>enfants</strong> allophones qui cessent toute expression<br />
langagière dès lors qu’ils sont immergés dans un milieu linguistique<br />
différent.<br />
Le bilinguisme<br />
On insistera d’abord sur le fait que le bilinguisme est relatif. La difficulté<br />
à préciser le seuil à partir duquel on peut considérer que le bilinguisme est<br />
effectif souligne que, <strong>de</strong> fait, la maitrise <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux langues est inégale. De<br />
multip<strong>les</strong> facteurs propres à l’histoire du suj<strong>et</strong>, à la place <strong>et</strong> aux fonctions<br />
<strong>de</strong>s langues dans son environnement, contribuent à c<strong>et</strong>te inégalité <strong>de</strong><br />
compétence dans <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux langues.<br />
Le bilingue sera finalement le suj<strong>et</strong> qui est placé dans une configuration<br />
familiale ou sociale l’incitant à développer <strong>et</strong> à entr<strong>et</strong>enir <strong>de</strong>s compétences<br />
linguistiques doub<strong>les</strong> jusqu’à possé<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s compétences minima<strong>les</strong> dans <strong>les</strong><br />
<strong>de</strong>ux langues qui lui sont données à apprendre (J.F. Hamers & M. Blanc,<br />
1983 ; H. Bialystok, 1991 ; F. Grosjean, 1982).<br />
Pour J. F. Hamers <strong>et</strong> M. Blanc (Ibid.), il convient <strong>de</strong> distinguer la bilingualité<br />
du bilinguisme. Le bilinguisme inclut la bilingualité. La bilingualité,<br />
elle, réfère à l’individu (c’est un bilinguisme individuel). La<br />
bilingualité est comprise comme « un état psychologique <strong>de</strong> l’individu qui<br />
a accès à plus d’un co<strong>de</strong> linguistique » (J.F. Hamers <strong>et</strong> M. Blanc, Ibid.).<br />
Dans ce cas, le <strong>de</strong>gré d’accès aux co<strong>de</strong>s varie selon un certain nombre <strong>de</strong><br />
dimensions, entre autres d’ordre cognitif, sociologique, culturel <strong>et</strong> linguistique.<br />
Dans la situation idéale, le bilinguisme est équilibré (J.F. Hamers <strong>et</strong><br />
M. Blanc, Ibid.), ce qui recouvre une notion d’équivalence <strong>de</strong> compétence<br />
dans <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux langues. Dans c<strong>et</strong>te situation, la maitrise <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux idiomes<br />
linguistiques est telle qu’elle perm<strong>et</strong> une expression flui<strong>de</strong> <strong>et</strong> en même<br />
temps suffisamment riche dans <strong>les</strong> registres factuel, émotionnel <strong>et</strong> symbolique.<br />
Lorsque le bilinguisme est considéré comme dominant lorsque la<br />
compétence dans une langue est supérieure par rapport à l’autre. La dominance<br />
ne profite pas toujours à la langue maternelle, ce qui est souvent le<br />
cas <strong>chez</strong> <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> issus <strong>de</strong> la migration lorsque l’acculturation <strong>et</strong> la scolarisation<br />
dans le pays d’accueil finissent par restreindre <strong>les</strong> compétences en<br />
langue maternelle, alors même que <strong>les</strong> professionnels persistent à <strong>les</strong> considérer<br />
comme <strong>de</strong>s allophones. Bien entendu, une multiplicité <strong>de</strong> facteurs<br />
comme l’intensification <strong>de</strong>s échanges linguistiques dans une langue secon<strong>de</strong><br />
<strong>et</strong> la régression <strong>de</strong>s stimulations médiatisées par la langue maternelle contribuent<br />
à ce déséquilibre du rapport entre <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux. Notre pratique professionnelle<br />
dans le domaine <strong>de</strong> la santé mentale, dans un contexte d’hétérogénéité<br />
culturelle nous a permis <strong>de</strong> constater qu’ à ces <strong>de</strong>ux facteurs s’ajoute celui <strong>de</strong><br />
la dévalorisation <strong>de</strong>s langues dites « d’origine ». C’est <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te expérience<br />
qu’il s’agit ici.<br />
62
« <strong>Bilinguisme</strong> <strong>chez</strong> <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong>, <strong>mythes</strong> <strong>et</strong> <strong>réalités</strong> »<br />
<strong>Bilinguisme</strong> <strong>et</strong> acquisition : <strong>les</strong> eff<strong>et</strong>s cognitifs positifs du bilinguisme<br />
Dès la vie intra-utérine <strong>les</strong> bébés enten<strong>de</strong>nt bien. Ils disposent d’une<br />
remarquable sensibilité auditive qui leur perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> distinguer tous <strong>les</strong> sons<br />
<strong>de</strong>s langues. On pourrait presque parler d’oreille universelle. Exposés à une<br />
gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong> sons <strong>et</strong> <strong>de</strong> langues à c<strong>et</strong>te époque <strong>de</strong> la vie, ils pourraient<br />
reproduire n’importe quel son. En étudiant l’acquisition <strong>de</strong> la phonologie<br />
<strong>chez</strong> un enfant qui acquiert le langage dans un milieu bilingue, on a pu<br />
m<strong>et</strong>tre en évi<strong>de</strong>nce que la capacité à distinguer à quelle langue appartiennent<br />
<strong>de</strong>s signaux acoustiques différents émerge très tôt. Cela indique que<br />
l’enfant est capable <strong>de</strong> différencier sa langue maternelle d’une autre dans la<br />
pério<strong>de</strong> prélinguistique, c’est à dire avant un an, lorsque <strong>les</strong> phonèmes du<br />
langage commencent à se m<strong>et</strong>tre en place (R. Bijeljac-Babic, 2000).<br />
Ainsi, indiscutablement, plus l’exposition à une langue est précoce, plus son<br />
apprentissage est aisé. Il est donc préférable <strong>de</strong> favoriser la mise en place d’un<br />
système langagier double dans la pério<strong>de</strong> où l’enfant structure son système<br />
langagier. La gran<strong>de</strong> plasticité au plan <strong>de</strong>s apprentissages favorise l’accès aux<br />
langues. De plus, <strong>les</strong> bilingues précoces bénéficient <strong>de</strong> leur condition<br />
d’enfant ; ils sont moins inhibés <strong>et</strong> peu influencés par la crainte <strong>de</strong> se tromper<br />
qui opère davantage à l’ado<strong>les</strong>cence. Il y aurait donc un bénéfice social indéniable<br />
à promouvoir le bilinguisme <strong>et</strong> <strong>les</strong> langues familia<strong>les</strong> <strong>de</strong>s <strong>migrants</strong>, à<br />
partir du moment où on adm<strong>et</strong> que le plurilinguisme est un atout.<br />
Avant <strong>les</strong> années 60, <strong>les</strong> recherches sur le bilinguisme tendaient plutôt à<br />
démontrer <strong>les</strong> désavantages cognitifs du bilinguisme. Ces étu<strong>de</strong>s s’inscrivaient<br />
en particulier aux États-Unis, dans le contexte <strong>de</strong> la migration hispanique<br />
provenant <strong>de</strong> milieux socioculturels très défavorisés (voir dans ce<br />
numéro l’article <strong>de</strong> S. Le Bars sur ce point). Depuis plusieurs années, <strong>les</strong><br />
avantages du bilinguisme sur le plan cognitif ont été n<strong>et</strong>tement soulignés.<br />
Une recherche récente d’E. Bialystok (2004) a montré <strong>les</strong> eff<strong>et</strong>s positifs<br />
du bilinguisme sur le contrôle cognitif <strong>chez</strong> <strong>les</strong> suj<strong>et</strong>s âgés, qui perm<strong>et</strong>trait<br />
d’atténuer <strong>les</strong> eff<strong>et</strong>s négatifs du vieillissement sur <strong>les</strong> fonctions cognitives.<br />
En eff<strong>et</strong>, c’est à partir <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> ces recherches que J. Cummins<br />
(1979) a proposé son hypothèse <strong>de</strong> seuil minimal <strong>de</strong> compétence linguistique.<br />
C<strong>et</strong>te hypothèse stipule qu’un premier seuil <strong>de</strong> compétence doit être<br />
atteint pour perm<strong>et</strong>tre d’éviter le handicap cognitif lié au fait d’un apprentissage<br />
bilingue <strong>et</strong> qu’un <strong>de</strong>uxième niveau <strong>de</strong> compétence langagière doit<br />
être dépassé pour que la bilingualité influence <strong>de</strong> façon positive le développement<br />
cognitif. C<strong>et</strong>te hypothèse, simplifiée, a donné à penser qu’il n’était<br />
pas possible <strong>de</strong> faire l’apprentissage d’une <strong>de</strong>uxième langue avant d’avoir<br />
au préalable un ancrage soli<strong>de</strong> dans la première, donc d’apprendre <strong>de</strong>ux<br />
langues en même temps.<br />
Dans le milieu éducatif, elle a eu pour conséquence <strong>de</strong> conseiller aux<br />
parents <strong>de</strong> ne plus parler leur langue d’origine afin <strong>de</strong> faciliter l’accession<br />
au français, comme si la langue maternelle constituait un frein pour la<br />
bonne acquisition <strong>et</strong> maitrise d’une <strong>de</strong>uxième langue. Dans ce cas précis,<br />
<strong>de</strong>s enseignants bien intentionnés ont quelquefois recommandé aux<br />
parents <strong>de</strong> maintenir la langue d’origine sans s’enquérir <strong>de</strong>s pratiques<br />
linguistiques familia<strong>les</strong>.<br />
63
Le Français aujourd’hui n° 158, Enseigner <strong>les</strong> langues d’origine<br />
En 1962, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> E. Peal <strong>et</strong> W.E. Lambert a été la première à proposer<br />
une méthodologie rigoureuse comparant bilingues <strong>et</strong> monolingues avec un<br />
appariement sur l’âge, le sexe, le niveau socio-économique <strong>et</strong> avec une définition<br />
claire du bilinguisme. Depuis, la plupart <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s ont permis <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre<br />
en évi<strong>de</strong>nce la meilleure flexibilité cognitive liée à l’habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> passer d’un<br />
système <strong>de</strong> symbo<strong>les</strong> à un autre (H. Bialystok <strong>et</strong> al., 2004).<br />
E. Bialystok (1991) a montré que <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> bilingues développaient<br />
davantage <strong>les</strong> processus <strong>de</strong> contrôle cognitif que <strong>les</strong> monolingues. Cela<br />
signifie que <strong>les</strong> tâches impliquant une analyse <strong>de</strong>s informations <strong>et</strong> leur mise<br />
en lien sont mieux traitées par <strong>les</strong> bilingues. Les étu<strong>de</strong>s s’accor<strong>de</strong>nt pour<br />
conclure (J.F. Hamers <strong>et</strong> M. Blanc, 2003 ; E. Bialystok, 1991) que la<br />
coexistence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux systèmes linguistiques génère <strong>de</strong>s connaissances d’un<br />
troisième ordre avec <strong>de</strong> meilleures capacités métalinguistiques, c’est-à-dire<br />
une meilleure conscience phonologique <strong>et</strong> <strong>de</strong> meilleures aptitu<strong>de</strong>s dans <strong>les</strong><br />
jugements <strong>de</strong> grammaticalité ou encore dans <strong>les</strong> tâches <strong>de</strong> catégorisation.<br />
Ces avantages peuvent-ils être transposés aux <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong> qui<br />
nous occupent ici ? En eff<strong>et</strong>, notre pratique clinique porte sur <strong>de</strong>s <strong>enfants</strong><br />
qui ont la particularité d’avoir pour parents <strong>de</strong>s <strong>migrants</strong> issus <strong>de</strong> pays<br />
divers, qui appartiennent pour la plupart aux catégories <strong>les</strong> moins favorisées.<br />
Beaucoup d’entre eux viennent <strong>de</strong> pays qui sont confrontés au multilinguisme.<br />
Dans ce cas, <strong>les</strong> famil<strong>les</strong> que nous rencontrons, lorsqu’el<strong>les</strong> ne sont<br />
pas déjà bilingues, ont au moins une langue à transm<strong>et</strong>tre à leurs <strong>enfants</strong> qui<br />
doivent par ailleurs apprendre le français à partir <strong>de</strong> l’école maternelle.<br />
Le bilinguisme <strong>de</strong>s <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong><br />
Réalité du bilinguisme<br />
Il apparait comme une évi<strong>de</strong>nce que <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> grandissant dans un<br />
contexte bilingue sont bilingues. Ce constat ne rend pas compte, en revanche,<br />
<strong>de</strong> l’existence effective du bilinguisme <strong>et</strong> <strong>de</strong> sa qualité (compréhension,<br />
production, contexte d’utilisation d’une langue ou l’autre : champs<br />
affectif, champs <strong>de</strong>s apprentissages…) De fait, <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> détenant véritablement<br />
une compétence langagière double ne représenteraient que 5 à<br />
15 % <strong>de</strong>s <strong>enfants</strong> perçus comme étant bilingues.<br />
Dans notre pratique clinique auprès d’<strong>enfants</strong> qui se développent dans<br />
<strong>de</strong>s contextes <strong>de</strong> diversité linguistique, nous observons que le groupe<br />
culturel d’appartenance, le rang dans la fratrie, l’histoire familiale <strong>et</strong> migratoire<br />
sont autant <strong>de</strong> paramètres qui font varier non seulement le désir <strong>de</strong>s<br />
parents <strong>de</strong> transm<strong>et</strong>tre leur langue mais aussi la capacité pour <strong>les</strong> <strong>enfants</strong><br />
<strong>de</strong> la recevoir. Il est classique d’observer que l’ainé <strong>de</strong> la fratrie parle mieux<br />
la langue maternelle que <strong>les</strong> puinés, car il y est plus exposé, dans la mesure<br />
où ses parents ne maitrisent pas encore la langue du pays d’accueil. Quant<br />
aux autres <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> la fratrie, ils seront exposés au français plus précocement,<br />
par le biais <strong>de</strong> leur ainé.<br />
L’ancienn<strong>et</strong>é <strong>de</strong> la migration <strong>et</strong> le fait <strong>de</strong> vivre ou non au contact d’une<br />
communauté migratoire ancrée dans sa culture d’origine influencent la<br />
pratique <strong>et</strong> <strong>les</strong> représentations liées à la langue maternelle.<br />
64
« <strong>Bilinguisme</strong> <strong>chez</strong> <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong>, <strong>mythes</strong> <strong>et</strong> <strong>réalités</strong> »<br />
Les représentations culturel<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> <strong>et</strong> cel<strong>les</strong> relatives aux langues<br />
sont liées à l’histoire singulière, familiale <strong>et</strong> collective <strong>de</strong>s <strong>migrants</strong> dans<br />
leur pays d’origine. El<strong>les</strong> sont marquées par d’éventuel<strong>les</strong> ruptures, en<br />
particulier traumatiques survenues avant la migration <strong>et</strong> pouvant être à<br />
l’origine <strong>de</strong> celle-ci. Ces représentations peuvent être aussi l’expression<br />
d’une intériorisation <strong>de</strong>s représentations du pays d’accueil à l’égard <strong>de</strong>s<br />
<strong>migrants</strong> d’ou l’importance <strong>de</strong> l’histoire migratoire <strong>et</strong> <strong>de</strong>s liens entre le pays<br />
d’origine <strong>et</strong> celui qui accueille. Le phénomène d’acculturation qui se m<strong>et</strong><br />
en place progressivement métisse <strong>les</strong> manières <strong>de</strong> faire <strong>et</strong> modifie ce qui<br />
pourrait être considéré par <strong>les</strong> parents comme digne d’une transmission ou<br />
superflu.<br />
<strong>Bilinguisme</strong> actif, passif <strong>et</strong> attrition<br />
Lorsque le bilinguisme est actif, le suj<strong>et</strong> bilingue est capable <strong>de</strong> comprendre<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> langage dans ses <strong>de</strong>ux langues (M. Bensekhar-<br />
Bennabi & G. Serre, 2005).<br />
On observe cependant <strong>chez</strong> certaines famil<strong>les</strong> migrantes <strong>de</strong>s modalités<br />
d’échanges croisés : <strong>les</strong> parents s’expriment avec leurs <strong>enfants</strong> dans leur langue<br />
d’origine, ceux-ci la comprennent, mais ne répon<strong>de</strong>nt qu’en français.<br />
La communication est néanmoins possible, elle se maintient lorsque <strong>les</strong><br />
<strong>de</strong>ux partenaires <strong>de</strong> l’échange ont une compréhension suffisante dans leur<br />
langue secondaire. Chez <strong>les</strong> <strong>enfants</strong>, si la compréhension passive a un<br />
intérêt certain (forme passive <strong>de</strong> bilinguisme), elle n’empêchera pas le<br />
phénomène d’attrition <strong>de</strong> survenir ; c’est-à-dire l’extinction progressive <strong>de</strong><br />
la langue maternelle au profit <strong>de</strong> celle enseignée à l’école.<br />
L’attrition est la réduction ou le tassement <strong>de</strong>s connaissances linguistiques<br />
initialement acquises. Ce phénomène, qui est non seulement soumis à un<br />
eff<strong>et</strong> d’âge mais également à la fréquence <strong>et</strong> à la qualité <strong>de</strong>s sollicitations<br />
verba<strong>les</strong>, peut aller jusqu’à l’extinction d’une langue initialement acquise.<br />
M. Bensekhar <strong>et</strong> G. Serre (Ibid.) considèrent cependant que le maintien<br />
d’une bonne compréhension passive ralentit le processus d’attrition ; celuici<br />
est d’autant plus effectif que l’exposition à la langue maternelle est interrompue<br />
tôt dans la vie <strong>de</strong> l’enfant. Après un certain seuil, qui peut être<br />
situé au moment <strong>de</strong> l’ado<strong>les</strong>cence, on considère que le risque d’attrition est<br />
très faible. Ceci signifie donc que c’est au moment <strong>de</strong> la scolarisation <strong>et</strong><br />
plus encore lors <strong>de</strong> l’entrée dans <strong>les</strong> apprentissages (à partir du cours préparatoire)<br />
que le risque d’attrition est le plus grand si l’on considère en même<br />
temps que c’est à ce moment-là que <strong>les</strong> apprentissages sont <strong>les</strong> plus <strong>de</strong>nses.<br />
En eff<strong>et</strong>, il semble assez naturel <strong>et</strong> d’ailleurs souhaitable qu’au moment <strong>de</strong><br />
la mise en place <strong>de</strong>s apprentissages, avec en particulier le passage à l’écrit,<br />
<strong>les</strong> <strong>enfants</strong> investissent la langue <strong>de</strong> l’école <strong>et</strong> ce qu’elle véhicule en termes<br />
<strong>de</strong> connaissances sur la société dans laquelle ils vivent. De fait, c<strong>et</strong>te étape<br />
constitue une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> fragilité pour la langue maternelle si celle ci n’est<br />
pas représentée <strong>et</strong> portée par <strong>les</strong> parents comme un outil <strong>et</strong> un obj<strong>et</strong><br />
culturel vali<strong>de</strong>, stable <strong>et</strong> précieux à transm<strong>et</strong>tre. C<strong>et</strong> investissement <strong>de</strong>s<br />
parents aura parfois à résister au mouvement <strong>de</strong> l’enfant qui voudra s’en<br />
défaire, s’en démarquer. D’autre part, si <strong>les</strong> parents sont eux-mêmes dans<br />
65
Le Français aujourd’hui n° 158, Enseigner <strong>les</strong> langues d’origine<br />
un processus d’apprentissage <strong>de</strong> la langue française, elle sera surinvestie par<br />
l’ensemble <strong>de</strong> la famille au détriment <strong>de</strong> la langue d’origine.<br />
Le mutisme extrafamilial<br />
Le mutisme extrafamilial ou mutisme sélectif constitue une autre situation<br />
particulière qui reflète la complexité du rapport à la langue <strong>et</strong> au<br />
langage pour <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong>. Il s’agit ici davantage <strong>de</strong> la capacité<br />
pour <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> concernés à utiliser <strong>les</strong> compétences linguistiques développées<br />
antérieurement, dès qu’ils se r<strong>et</strong>rouvent à l’extérieur du milieu<br />
familial ; qu’il s’agisse <strong>de</strong> la langue maternelle ou encore <strong>de</strong> la langue<br />
secon<strong>de</strong>. Typiquement, ces <strong>enfants</strong> parlent sans difficulté quand ils sont à<br />
la maison <strong>et</strong> avec leurs parents, mais ils <strong>de</strong>viennent mu<strong>et</strong>s dès qu’ils sortent<br />
<strong>de</strong> la maison ou qu’ils doivent prendre la parole en présence d’étrangers.<br />
Si le mutisme sélectif se r<strong>et</strong>rouve également dans la population autochtone<br />
(non soumise aux conditions du bilinguisme ou <strong>de</strong> la biculturalité), il<br />
semble que, dans ce cas, il est davantage associé à la présence concomitante<br />
<strong>de</strong> fragilités neuro-développementa<strong>les</strong> (troub<strong>les</strong> primaires du langage ou<br />
encore r<strong>et</strong>ards <strong>de</strong> développement). C<strong>et</strong>te causalité est moins occurrente<br />
<strong>chez</strong> <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong> pour <strong>les</strong>quels la prévalence <strong>de</strong> mutisme est<br />
cependant 3 à 4 fois plus élevée que dans le reste <strong>de</strong> la population. Un<br />
facteur anxieux est souvent r<strong>et</strong>rouvé dans <strong>les</strong> situations <strong>de</strong> mutisme sélectif,<br />
ce qui peut perm<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> proposer l’hypothèse d’un mutisme sélectif qui ne<br />
serait en fait qu’une variante <strong>de</strong> la phobie sociale <strong>chez</strong> <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>migrants</strong> (M. Bensekhar-Bennabi & G. Serre, Ibid.)<br />
Classiquement, c’est dans le passage <strong>de</strong> l’école maternelle à l’école<br />
primaire que le mutisme sélectif est déclaré. Cela coïnci<strong>de</strong> avec l’introduction<br />
dans le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s apprentissages <strong>et</strong> le début <strong>de</strong> l’investissement <strong>de</strong><br />
l’école, lieu par excellence <strong>de</strong> socialisation <strong>et</strong> creus<strong>et</strong> <strong>de</strong> la culture dominante.<br />
Le processus migratoire (S. Akhtar, 1995) peut être associé à une troisième<br />
phase <strong>de</strong> séparation-individuation (la première se situant dans la<br />
toute p<strong>et</strong>ite enfance, <strong>et</strong> la <strong>de</strong>uxième à l’ado<strong>les</strong>cence), c’est-à-dire à une<br />
importante phase <strong>de</strong> réorganisation i<strong>de</strong>ntitaire venant potentiellement<br />
réactiver <strong>les</strong> enjeux <strong>de</strong>s phases antérieures du développement. Dans ce<br />
processus, le migrant doit accepter <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s <strong>de</strong>uils divers, <strong>et</strong> également<br />
accepter d’intégrer <strong>de</strong> nouveaux idéaux, <strong>de</strong> nouveaux modè<strong>les</strong> d’i<strong>de</strong>ntification<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> valeurs. Le résultat en est une i<strong>de</strong>ntité réorganisée,<br />
renouvelée <strong>et</strong> fondamentalement hybri<strong>de</strong>.<br />
J. Mirsky (1991) considère qu’un <strong>de</strong>s enjeux majeurs <strong>de</strong> ce processus <strong>de</strong><br />
séparation-individuation associé à l’immigration concerne l’acquisition<br />
d’une nouvelle langue. Apprendre une nouvelle langue implique notamment<br />
l’acquisition <strong>de</strong> nouveaux obj<strong>et</strong>s internes <strong>et</strong> <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> représentations<br />
<strong>de</strong> soi ; <strong>de</strong> la même façon, la perte <strong>de</strong> la langue maternelle est associée<br />
à un sentiment <strong>de</strong> perte d’une partie importante <strong>de</strong> son i<strong>de</strong>ntité.<br />
La situation <strong>de</strong>s <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong> est à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> particulière à plus d’un<br />
titre. Souvent, ces <strong>enfants</strong> ont une plus gran<strong>de</strong> facilité que leurs parents à<br />
apprendre une nouvelle langue. Comme leur i<strong>de</strong>ntité n’est pas encore<br />
66
« <strong>Bilinguisme</strong> <strong>chez</strong> <strong>les</strong> <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> <strong>migrants</strong>, <strong>mythes</strong> <strong>et</strong> <strong>réalités</strong> »<br />
fixée, ils sont à la fois plus perméab<strong>les</strong> <strong>et</strong> plus ouverts à la possibilité <strong>de</strong><br />
nouvel<strong>les</strong> imitations <strong>et</strong> <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> i<strong>de</strong>ntifications. Ils sont également<br />
animés par un grand désir <strong>de</strong> ressembler aux autres <strong>enfants</strong>. Ce désir<br />
stimule leur processus d’apprentissage <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième langue. Mais <strong>de</strong>s<br />
écueils peuvent survenir dans le processus, notamment lorsque <strong>les</strong> <strong>enfants</strong><br />
ne peuvent recevoir le support émotionnel nécessaire <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> leurs<br />
parents pour investir c<strong>et</strong>te nouvelle langue avec sécurité <strong>et</strong> confiance. Ils<br />
peuvent alors se trouver en conflit avec leur désir d’autonomie <strong>et</strong> d’investissement<br />
du mon<strong>de</strong> extérieur <strong>et</strong> leur besoin parallèle <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r leurs<br />
liens d’attachement <strong>et</strong> <strong>de</strong> sécurité avec leur famille. C<strong>et</strong>te impasse peut<br />
mener soit à une appropriation massive <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième langue <strong>et</strong> <strong>de</strong> ses<br />
repères socioculturels (ce qui risque <strong>de</strong> se faire aux dépens <strong>de</strong> la langue<br />
maternelle), soit à une inhibition importante <strong>de</strong>s processus d’apprentissage<br />
<strong>et</strong> du fonctionnement en milieu scolaire. C<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière situation constitue<br />
un terreau fertile pour le développement <strong>de</strong> troub<strong>les</strong> d’apprentissage ou<br />
encore pour le mutisme sélectif. D’un point <strong>de</strong> vue transculturel, le<br />
mutisme sélectif peut être vu comme une difficulté à gérer le contact entre<br />
le mon<strong>de</strong> du <strong>de</strong>dans (celui <strong>de</strong> la famille) <strong>et</strong> le mon<strong>de</strong> du <strong>de</strong>hors (celui <strong>de</strong><br />
l’école, <strong>de</strong> la société extérieure), difficulté associée à une fragilité <strong>de</strong> la<br />
représentation <strong>de</strong> soi <strong>et</strong> <strong>de</strong> la famille. Des mécanismes <strong>de</strong> clivage entre <strong>les</strong><br />
univers culturels en présence sont alors fortement mis à contribution :<br />
l’inhibition qui porte sur la parole dans le mutisme sélectif vient limiter<br />
symboliquement <strong>les</strong> échanges entre le mon<strong>de</strong> extérieur <strong>et</strong> le mon<strong>de</strong> intérieur,<br />
empêchant une rencontre qui apparait chargée <strong>de</strong> menaces, d’incertitu<strong>de</strong>s<br />
<strong>et</strong> d’angoisse (M.R. Moro, 1994). Dans ce contexte, la prise en<br />
charge implique alors obligatoirement un travail qui prend en compte <strong>les</strong><br />
enjeux culturels <strong>et</strong> i<strong>de</strong>ntitaires en cause (à la fois sur <strong>les</strong> plans individuel,<br />
familial <strong>et</strong> collectif). La reconnaissance <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s difficultés rencontrées<br />
ainsi que le renforcement <strong>de</strong>s repères <strong>et</strong> <strong>de</strong>s liens intrafamiliaux apparaissent<br />
indispensab<strong>les</strong> afin que la rencontre <strong>de</strong>s langues <strong>et</strong> <strong>de</strong>s cultures<br />
<strong>de</strong>vienne non seulement pensable mais aussi possible.<br />
Conclusion<br />
La question du bilinguisme est d’actualité. En eff<strong>et</strong>, <strong>les</strong> représentations<br />
concernant <strong>les</strong> bienfaits <strong>de</strong> la transmission <strong>de</strong> la langue native (langue<br />
d’origine) sont variées. Ces représentations sont du reste au centre du discours<br />
éducatif <strong>et</strong> <strong>de</strong>s pratiques <strong>de</strong> soins en santé mentale dans <strong>les</strong> contextes <strong>de</strong> diversité<br />
culturelle. Or transm<strong>et</strong>tre sa langue ne se justifie pas uniquement sur le<br />
plan linguistique ; cela se justifie également d’un point <strong>de</strong> vue ontologique car<br />
cela revient à transm<strong>et</strong>tre sa culture <strong>et</strong> son histoire personnelle.<br />
Ces transmissions sont nécessairement liées à la construction <strong>de</strong> la parentalité<br />
<strong>et</strong>, du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’enfant, à la structuration <strong>de</strong> sa personnalité<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> ses affiliations.<br />
À la lumière <strong>de</strong> notre expérience, acquise auprès <strong>de</strong> patients <strong>migrants</strong> <strong>et</strong><br />
auprès <strong>de</strong> leurs <strong>enfants</strong>, il nous apparait important d’encourager la transmission<br />
<strong>et</strong> la pratique <strong>de</strong> la langue maternelle. En eff<strong>et</strong>, la bonne maitrise<br />
<strong>de</strong> la langue maternelle <strong>et</strong> la structuration <strong>de</strong> savoirs sur le mon<strong>de</strong> physique<br />
67
Le Français aujourd’hui n° 158, Enseigner <strong>les</strong> langues d’origine<br />
<strong>et</strong> social à travers elle, facilite l’acquisition <strong>de</strong> la langue du pays d’accueil <strong>et</strong><br />
perm<strong>et</strong> ainsi aux <strong>enfants</strong> <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong>s avantages cognitifs inhérents au<br />
bilinguisme.<br />
De même la pratique <strong>de</strong> la langue maternelle renforce l’ancrage <strong>de</strong>s<br />
<strong>enfants</strong> dans leur filiation <strong>et</strong> dans leurs affiliations culturel<strong>les</strong> qui se trouvent<br />
faites <strong>de</strong> diversité. C<strong>et</strong>te pratique a l’avantage <strong>de</strong> promouvoir également<br />
<strong>les</strong> ressources créatives qui fabriquent du métissage.<br />
Bibliographie<br />
Dalila REZZOUG, Sylvaine DE PLAËN,<br />
Malika BENSEKHAR-BENNABI, Marie ROSE MORO<br />
• ABDELILAH-BAER B., ABDELILAH M. (2002), Vous avez dit bilingue ? Le gakie<br />
schot <strong>et</strong> le pinichon… Mé<strong>de</strong>cine <strong>et</strong> Enfance, Paris, Édition <strong>et</strong> communication.<br />
• AKHTAR S. (1995), « A third i<strong>de</strong>ntity individuation : immigration, i<strong>de</strong>ntity, and<br />
the psychoanalytic process », Journal of the American Psychoanalitic Association<br />
(JAPA), n° 43 : 4, pp. 1051-1084.<br />
• BENSEKHAR-BENNABI M. & SERRE G. (2005), « L’univers du bilingue <strong>et</strong> la réalité<br />
<strong>de</strong>s famil<strong>les</strong> bilingues », Entr<strong>et</strong>iens <strong>de</strong> la p<strong>et</strong>ite enfance.<br />
• BIALYSTOK E. (dir.) (1991), Language processing in bilingual children, Cambridge,<br />
Cambrige Uiversity Press.<br />
• BIALYSTOK E, CRAIK F.I.M., KLEIN R. & VISWANATHAN M. (2004), « Bilingualism,<br />
aging, and cognitive control : Evi<strong>de</strong>nce from the Simon task », Psychology<br />
and Aging, vol. 19, pp. 290-303.<br />
• BIJELJAC-BABIC R. (2000), « Acquisition <strong>de</strong> la phonologie <strong>et</strong> bilinguisme<br />
précoce », dans M. Kail & M. Fayol, L’Acquisition du langage, t.1, Paris, PUF.<br />
• GREEN D.W. (1998) « Mental control of the bilingual lexico-semantic system »,<br />
dans Bilingualism : Language and cognition, 1, Cambridge, Cambridge University<br />
Press.<br />
• GROSJEAN F. (1982), Life with two languages. An introduction to bilingualism,<br />
Cambridge MA, Harvard University Press.<br />
• HAMERS J.F. & BLANC M. (1983), Bilingualité <strong>et</strong> bilinguisme, Bruxel<strong>les</strong>, Pierre<br />
Mardaga éditeur.<br />
• MIRSKY J. (1991), « Language and Migration : Separation individuation conflicts<br />
in relation to the mother tongue and the new language », Psychotherapy, n° 28-4,<br />
pp. 618-624.<br />
• MORO M.R. (1994), Parents en exil. Psychopathogie <strong>et</strong> migrations, Paris, PUF.<br />
• MORO M.R. (2007), Aimer ses <strong>enfants</strong> ici <strong>et</strong> ailleurs. Histoires transculturel<strong>les</strong>,<br />
Paris, Odile Jacob.<br />
• PEAL E. & LAMBERT W.E. (1962), « The relation of bilingualism to intelligence »,<br />
Psychological Monographs, pp. 1-23.<br />
68