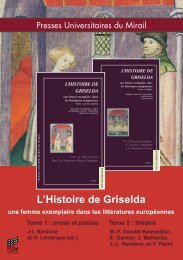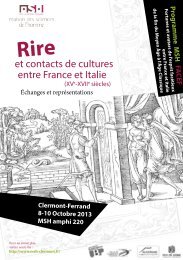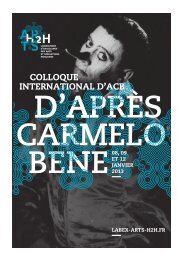de Quasimodo traducteur
de Quasimodo traducteur
de Quasimodo traducteur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 <br />
« Ridurre il diverso al già conosciuto ». L’approximation poétique <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> <br />
<strong>traducteur</strong> <br />
La décision d’adresser mon regard, dans le cadre d’une journée d’étu<strong>de</strong>s consacrée à <br />
l’œuvre poétique <strong>de</strong> Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, à l’activité <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> <strong>traducteur</strong> <br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>, me semble-‐t-‐il, un éclaircissement au seuil <strong>de</strong> mon discours. Eclaircissement <br />
qui remplira finalement une double fonction, parce que mon parti pris <strong>de</strong> donner tout <br />
autant d’attention à la pratique traductive qu’à la création poétique, <strong>de</strong> les faire en <br />
quelque sorte résonner à l’intérieur d’un système d’équivalences ou <strong>de</strong> <br />
correspondances, constitue également la problématique <strong>de</strong> ma réflexion. <br />
Tout un chacun se souviendra <strong>de</strong> cet autre parti pris, bien plus tranchant et célèbre, <br />
opéré par Edoardo Sanguineti vis-‐à-‐vis <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> au sein <strong>de</strong> son anthologie <strong>de</strong> la <br />
« Poesia italiana <strong>de</strong>l Novecento » sortie en 1969, qui avait consisté dans le fait <strong>de</strong> ne <br />
publier que <strong>de</strong>ux poèmes d’Ed è subito sera (« Ora che sale il giorno » et « Già la pioggia è <br />
con noi ») contre treize traductions <strong>de</strong> Sappho, Alcée, Anacréon, Alcman et Ibycos faites <br />
par <strong>Quasimodo</strong>, dont l’œuvre était commentée par le poète <strong>de</strong> Laborintus par un bien <br />
court paragraphe : <br />
Il suo più vero contributo originale alla poesia <strong>de</strong>l nostro secolo non è da riconoscersi nella <br />
produzione creativa, ma nelle traduzioni dai Lirici greci, che sono uno <strong>de</strong>i documenti più <br />
significativi <strong>de</strong>ll’intiera stagione ermetica 1 . <br />
L’équivalence que je propose ne veut pas pencher vers cette direction, qui a été prise <br />
d’ailleurs, certes <strong>de</strong> manière moins abrupte par d’autres critiques majeurs (on peut <br />
penser pour tous au rôle similaire <strong>de</strong>s traductions dans le choix pratiqué par Pier <br />
Vincenzo Mengaldo pour son anthologie <strong>de</strong>s « Poeti italiani » <strong>de</strong> 1978). Et elle ne <br />
prendra non plus le chemin inverse, à savoir <strong>de</strong> considérer la traduction comme une <br />
branche florissante mais secondaire <strong>de</strong> l’œuvre quasimodienne. <br />
Mon choix est justement <strong>de</strong> rester au milieu, <strong>de</strong> s’attar<strong>de</strong>r sur la traduction dans le but <br />
d’une analyse « latérale » sur l’écriture, grâce à la conviction, partagée avec Pierpaolo <br />
Fornaro, que parler <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> <strong>traducteur</strong> « significa parlare anche, e non di <br />
sghembo, <strong>de</strong>lla poesia di <strong>Quasimodo</strong> in sé » 2 . <br />
1 Edoardo Sanguineti, Poesia italiana <strong>de</strong>l Novecento, Einaudi, 1969. <br />
2 Pierpaolo Fornaro, “<strong>Quasimodo</strong> traduttore: il frammento come evento”, Levia Gravia. Qua<strong>de</strong>rno annuale <br />
di Letteratura Italiana, III, 2001, p. 353.
2 <br />
L’importance attribuée aux traductions du poète <strong>de</strong> Modica pourrait se justifier à elle <br />
toute seule par sa taille. <strong>Quasimodo</strong> est un <strong>traducteur</strong> prolifique : sa palette est large et <br />
variée, en allant <strong>de</strong> la poésie lyrique grecque à Homère jusqu’à l’Evangile <strong>de</strong> Jean, <strong>de</strong> <br />
Virgile à Catulle, touchant abondamment le théâtre grec tout comme le théâtre <br />
shakespearien, et encore Ruskin, Molière, Neruda, Eluard. Cette activité l’accompagnera <br />
<strong>de</strong>puis l’époque la plus mûre <strong>de</strong> son hermétisme jusqu’à sa mort. Et il est certain qu’il <br />
s’établit entre ces <strong>de</strong>ux tables <strong>de</strong> travail une correspondance fertile, qui nous permet <strong>de</strong> <br />
parcourir les textes du poète <strong>de</strong> manière inédite et nous introduit dans une énergie <br />
poétique unique mais composée <strong>de</strong> croisements, superpositions, interférences. <br />
Ma réflexion d’aujourd’hui, qui se veut utile à l’optique <strong>de</strong> cette journée d’étu<strong>de</strong>, n’est <br />
pourtant pas celle d’i<strong>de</strong>ntifier les multiples contacts entre les <strong>de</strong>ux écritures, même s’il <br />
m’arrivera <strong>de</strong> passer en revue quelques exemples concrets <strong>de</strong> l’influence réciproque <br />
entre création poétique et traduction. Cette opération soupesant le « dare e avere » a <br />
déjà été admirablement accomplie sur la quasi totalité <strong>de</strong>s traductions <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>, et <br />
je vous invite d’ailleurs à lire ces textes critiques qui ne sont pas nécessairement au <br />
cœur <strong>de</strong> la question <strong>de</strong> concours, mais qui possè<strong>de</strong>nt entre autres le mérite <strong>de</strong> nous <br />
introduire au cœur du laboratoire du poète 3 . <br />
Pour poser le périmètre <strong>de</strong> mon discours, je m’intéresserai moins au mouvement allant <br />
<strong>de</strong>s textes traduits vers l’écriture du poète-‐<strong>traducteur</strong> qu’au mouvement inverse, c’est-‐à-‐<br />
dire à ce que le poète donne <strong>de</strong> son écriture au texte traduit. Tout un chacun se <br />
souviendra <strong>de</strong>s mots <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> lui-‐même à ce sujet, qui semblent aller à l’encontre <br />
<strong>de</strong> l’idée répandue <strong>de</strong> l’influence thématique que constituent ces traductions : <br />
Può sembrare che un avvicinamento a poeti di varia natura, che il passaggio da un lirico <br />
greco a Virgilio, a Omero, a un elegiaco latino, abbia spostato un centro lirico ben <strong>de</strong>finito <br />
verso una periferia « discorsiva ». Può sembrare, ma non è ; perché traducendo i greci o i <br />
latini io non potevo dare loro che la mia sintassi, il mio linguaggio… 4 <br />
Cette trajectoire qui paraît évi<strong>de</strong>nte concernant l’empreinte <strong>de</strong> l’écriture poétique sur la <br />
traduction, est fort bien saisie par Franco Fortini, qui consacre, dans une histoire <strong>de</strong> la <br />
3 Marcello Gigante, L’ultimo <strong>Quasimodo</strong> e la poesia greca, Naples, Guida Editori, 1970 ; Aurélie Gendrat, <br />
« <strong>Quasimodo</strong> e i classici: il filtro <strong>de</strong>ll’antichità », <strong>Quasimodo</strong> e gli altri. Atti <strong>de</strong>l convegno internazionale <br />
Lovanio 27-‐28 aprile 2011, a cura di Franco Musarra, Bart Van <strong>de</strong>n Bossche, Serge Vanvolsem, Louvain, <br />
Leuven University Press/Franco Cesati Editore, 2001, pp. 33-‐43 ; Cristina Marchisio, « <strong>Quasimodo</strong> e <br />
Neruda: il gioco <strong>de</strong>l ‘dare’ e <strong>de</strong>ll’ ‘avere’ », Rivista di Letteratura Italiana, XXI, 1-‐2, 2003, pp. 337-‐345; Maria <br />
Cristina Albonico, « Salvatore <strong>Quasimodo</strong> interprete di Virgilio », Rivista di Letteratura Italiana, 2001, pp. <br />
269-‐273 ; Luigi Fontanella, « <strong>Quasimodo</strong> traduttore di E.E. Cummings », Rivista di Letteratura Italiana, XXI, <br />
1-‐2, 2003, pp. 109-‐116. <br />
4 Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, « Una poetica » [1950], Il poeta e il politico e altri saggi, Milan, Mondadori.
3 <br />
littérature que Laterza publie en 1976, un chapitre à la pratique <strong>de</strong> la traduction telle <br />
qu’elle est menée dans la pério<strong>de</strong> hermétique. Fortini y affirme : <br />
Tradurre, per gli autori <strong>de</strong>l <strong>de</strong>cennio ermetico, significò ridurre il diverso al già posseduto ; e <br />
quindi si trattò soprattutto di tradurre testi di letterature, di età e di autori che distanza di <br />
tempo e di culture ren<strong>de</strong>vano atemporali, oppure di una poesia che poteva essere <br />
consi<strong>de</strong>rata come antece<strong>de</strong>nte remota o prossima <strong>de</strong>lla ten<strong>de</strong>nza nella quale i traduttori si <br />
riconoscevano… 5 <br />
Il s’agirait d’une sorte d’assimilation, celle désignée par Fortini, qui n’est pas <br />
difficilement reconnaissable dans les versions <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>. Il suffit évi<strong>de</strong>mment <strong>de</strong> <br />
penser à l’œuvre par excellence, où fidélité et appropriation se fon<strong>de</strong>nt dans un seul <br />
magnifique élan, et qui ouvre d’ailleurs la longue série d’auscultations, <strong>de</strong> contacts, <strong>de</strong> <br />
découvertes. Il semble indéniable que la « felicissima contaminazione » (c’est toujours <br />
Fortini qui parle) entre le fragment grec et la poétique <strong>de</strong> la parole hermétique <br />
représentée par la traduction <strong>de</strong>s « Lirici Greci », découle d’une coïnci<strong>de</strong>nce parfaite qui <br />
ne se reproduira plus jamais. Si l’on parcourt les comptes rendus <strong>de</strong>s autres traductions <br />
du poète, il est frappant <strong>de</strong> constater combien elles sont instinctivement comparées à la <br />
première sans qu’on y reconnaisse pourtant la même « nécessité ». <br />
Mais aujourd’hui l’analyse <strong>de</strong>s exemples textuels ne tiendra pas en compte l’œuvre <strong>de</strong> <br />
1940. Cette exclusion n’est pas seulement justifiée par l’existence d’une littérature déjà <br />
très riche autour <strong>de</strong>s premières versions du poète, mais tente aussi, et surtout, <strong>de</strong> <br />
détourner le « trop <strong>de</strong> lumière » qui se dégage <strong>de</strong> cette traduction célèbre <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>. <br />
On cherchera d’interroger d’autres textes selon ce mouvement <strong>de</strong> retour à soi i<strong>de</strong>ntifié <br />
par Fortini. Ces prélèvements seront donc effectués sur d’autres ouvrages, proches et <br />
lointains dans le temps <strong>de</strong> la traduction <strong>de</strong> 40, mais qui lui sont reliées comme à une <br />
source primaire. Le lien soli<strong>de</strong> qui tient toutes ces expériences est d’ailleurs mis en avant <br />
très clairement par « Traduzioni dai classici » où <strong>Quasimodo</strong> décrit son parcours <br />
traductif, <strong>de</strong> manière naturellement incomplète (nous sommes en 1945), comme un <br />
chemin ca<strong>de</strong>ncé suivant une forte cohérence. C’est ainsi que la fracture avancée par <br />
Anceschi entre les Lirici et l’épos homérique comme une sorte <strong>de</strong> manifeste hermétique : <br />
Oggi, infine, nel nostro gusto e tempo (nascosto) <strong>de</strong>l cuore al centro <strong>de</strong>lla poetica spiritualità <br />
<strong>de</strong>lla Grecia stanno i grandi lirici e per la loro violenta e rapida musica noi daremmo tutto il <br />
lento romanzo <strong>de</strong>ll’epica 6 . <br />
5 Franco Fortini, « Da Ungaretti agli ermetici », dans Letteratura italiana storia e testi, vol. IX, Il Novecento, <br />
Laterza, 1976, p. 105. <br />
6 Luciano Anceschi, « Introduzione a Lirici Greci », 1944.
4 <br />
est contredite par la logique interne régissant l’ensemble <strong>de</strong>s versions qui accompagne <br />
<strong>Quasimodo</strong> <strong>traducteur</strong> <strong>de</strong> Sappho, vers les latins jusqu’à Homère. <br />
Les premiers exemples viennent d’ailleurs <strong>de</strong> l’œuvre d’Homère, Homère que <br />
<strong>Quasimodo</strong> lit et traduit pendant les années <strong>de</strong> guerre et qu’il reprendra <br />
significativement à la fin <strong>de</strong> sa vie. Les passages traduits <strong>de</strong> l’Ilia<strong>de</strong> seront en effet <br />
donnés à l’impression 12 jours avant sa mort et publiés, <strong>de</strong> manière posthume, alors que <br />
les « millecinquecento versi <strong>de</strong>ll’Odissea » sortiront en 1945. Aujourd’hui nous nous <br />
intéresserons au poème d’Ulysse, figure déterminante pour la poésie <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>, car <br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux poèmes homériques l’Odyssée <strong>de</strong>meure, pour le dire avec Gilberto Finzi, « il <br />
testo più congeniale al poeta siciliano, all’esule nella terra <strong>de</strong>l nord » 7 . Dans le choix <br />
anthologique pratiqué par le poète, nous trouvons le sixième chant et notamment la <br />
prière adressée à Nausicaa par Ulysse, qui fait naufrage dans la terre <strong>de</strong>s Phéaciens et <br />
est réveillé par la belle fille d’Alcinoos jouant à la balle avec ses amies sur la plage où le <br />
héros homérique dort épuisé et nu. Lorsqu’Ulysse apparaît à la vue <strong>de</strong>s jeunes filles, les <br />
servantes s’enfuient terrorisées et seule reste Nausicaa, inspirée par la déesse Athéna, à <br />
écouter les mots que lui adresse le naufragé. L’épiso<strong>de</strong> constitue une pause narrative du <br />
poème mais remplit une fonction cruciale, puisque ce sera bien cette rencontre avec <br />
Nausicaa qui fait basculer le sort d’Ulysse, qui grâce à elle pourra être accueilli au palais <br />
d’Alcinoos, raconter ses aventures et être reconduit à Ithaque. Mais c’est surtout pour <br />
l’importance que dans ce chant prend la parole, à travers laquelle Ulysse doit convaincre <br />
Nausicaa à se faire ai<strong>de</strong>r, qu’il est intéressant <strong>de</strong> se pencher sur la traduction qu’en <br />
donne <strong>Quasimodo</strong>. <br />
Le verbe <strong>de</strong> la supplication qui ouvre la péroraison d’Ulysse est en effet travaillé par <br />
notre poète <strong>de</strong> manière significative. Une fois <strong>de</strong>vant la jeune fille, le naufragé s’adresse <br />
à elle par ces mots : <br />
Αὐτίκα μειλίχιον καὶ κερδαλέον φάτο μῦθον<br />
« Γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· θεός νύ τις, ἦ βροτός ἐσσι; <br />
(vv. 148-‐149, Odyssée, VI) <br />
Subito dolce e astuta parola disse : <br />
« Ti supplico, signora : sei una <strong>de</strong>a o una creatura mortale ? » <br />
7 Gilberto Finzi, « Introduzione » à Lirici greci, Dall’Odissea, Dall’Ilia<strong>de</strong>, traduction <strong>de</strong> Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, <br />
Milan, Mondadori, 1979, p. 23.
5 <br />
que <strong>Quasimodo</strong> traduit ainsi : « E sùbito le disse/ soavi, accorte parole : « Ti supplico, o <br />
potente, in ginocchio. Sei tu forse <strong>de</strong>a o mortale ? », en nous donnant immédiatement à <br />
voir ce que le verbe « gounoumai/gounomai/gounazomai » gar<strong>de</strong>rait dans son <br />
étymologie probable, à savoir le geste <strong>de</strong> supplier en serrant les genoux <strong>de</strong> celui qu’on <br />
implore, et donc en étant nous même à genoux. Mais en explicitant cette action, <br />
<strong>Quasimodo</strong> reprend aussi l’hésitation d’Ulysse à la vue <strong>de</strong> Nausicaa qui traversait les <br />
vers précé<strong>de</strong>nts, partagé entre l’élan instinctif <strong>de</strong> serrer les genoux <strong>de</strong> la fille et la <br />
pu<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> sa nudité qui lui imposait <strong>de</strong> la distance : <br />
ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς,<br />
ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν ἐυώπιδα κούρην<br />
ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι<br />
(vv. 141-‐142, Odyssée, VI) <br />
« e fu incerto Odisseo, <br />
se pregare la vergine avvinto alle sue ginocchia, <br />
o cosi da lontano con dolci parole » <br />
(lissomai :prier ; e gounon : les genoux). On pourrait même indiquer ce verbe <br />
‘gounazomai’ comme signe <strong>de</strong> contact entre les traductions <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>, puisqu’il <br />
figure aussi souvent chez Archiloque, dont notre poète traduit justement un poème <strong>de</strong> <br />
naufrage. Toutefois ne prenons pas ce chemin d’interférences intertextuelles et <br />
intratextuelles certes passionnant, mais qui nous mènerait loin <strong>de</strong> notre analyse. C’est <br />
plutôt le travail lexical mis en acte dans ce passage qui attire notre attention, cette <br />
sollicitation <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> <strong>de</strong> la valeur étymologique <strong>de</strong>s mots, posture éminemment <br />
hermétique s’appliquant habituellement à l’italien, qui est ici en quelque sorte amplifiée, <br />
dédoublée car elle agit au sein du grec lui-‐même. Plusieurs manipulations sémantiques <br />
déterminantes sont à l’œuvre dans la supplication d’Ulysse. Il est vrai, d’un côté, qu’il y a <br />
une persistance significative d’un même et seul mot « cuore », pour <strong>de</strong> multiples termes <br />
grecs : v. 155 : o thumos (qui serait l’esprit, l’animus, ce qui provoque les émotions, siège <br />
<strong>de</strong> la joie, du plaisir, <strong>de</strong> tous les mouvements <strong>de</strong> l’âme) ; v. 158 : to ker (est l’organe du <br />
corps, siège <strong>de</strong>s sentiments et <strong>de</strong>s passions) ; v. 166 : o thumos ; v. 180 : e fren (c’est le <br />
diaphragme qui enveloppe le ker, à l’origine du mot « phrénologie »). Sans vouloir <br />
rentrer dans les distinctions complexes du grec, il serait pour le moins frappant que <br />
<strong>Quasimodo</strong> choisisse une seule solution, si cette solution n’était pas une pierre <strong>de</strong> touche <br />
<strong>de</strong> la grammaire affective <strong>de</strong> sa poésie : en partant du premier vers d’ « Ed è subito <br />
sera » (« Ognuno sta sul cuor <strong>de</strong>lla terra »), dont le « cuore » est immédiatement repris
6 <br />
et décliné dans la syntaxe hermétique <strong>de</strong> « Vento a Tindari » (« oggi m’assali/ e ti chini in <br />
cuore ») ; pour arriver à « Alle fron<strong>de</strong> <strong>de</strong>i salici » (« E come potevamo noi cantare/ con il <br />
pie<strong>de</strong> straniero sopra il cuore ») ; image qui vient d’ailleurs d’une autre source <br />
essentielle <strong>de</strong> la « grecità » <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>, Eschyle, <strong>de</strong>s Choéphores que notre poète <br />
traduira en 1949. Au-‐<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces occurrences très connues, nous trouverons partout ce <br />
mot-‐clé, qui pourrait faire l’objet d’une étu<strong>de</strong> dans ce sens, quel terme grec traduit-‐il à <br />
chaque fois : « il forte buio che sale dalla terra/ abitava il tuo cuore » (« Spiaggia a <br />
Sant’Antioco », Nuove Poesie) ; « La speranza ha il cuore sempre stretto/ e di Clau<strong>de</strong> e <br />
Jacques ne avremo ancora » (« Notizia di Cronaca », La terra impareggiabile) ; « Ed è <br />
morte/ uno spazio nel cuore » (« Fresche di fiumi in sonno », Oboe Sommerso) ; « In te mi <br />
getto : un fresco/ di navate posa nel cuore » (« Alla mia terra », Oboe sommerso) ; « e il <br />
cuore sgrava smemorato » (« Apollion », Erato e Apollion). <br />
De l’autre côté, pourtant, la prière d’Ulysse est parsemée <strong>de</strong> variations et <strong>de</strong> <br />
modifications lexicales, que <strong>Quasimodo</strong> réserve tout particulièrement aux qualificatifs. <br />
Dans le récit du naufrage fait par Ulysse nous avons, par exemple, ce vers : <br />
Χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον <br />
(v. 170, Odyssée, VI) <br />
(Ieri, al ventesimo giorno, scampai al mare colore <strong>de</strong>l vino) <br />
traduction <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> : « Ieri dopo venti giorni, scampai dal livido mare ». <br />
A la place <strong>de</strong> l’adjectif os oinopos (qui veut dire <strong>de</strong> la couleur du vin, o oinos étant le vin), <br />
<strong>Quasimodo</strong> choisit <strong>de</strong> renforcer l’image du naufrage causé par Poséidon par une <br />
association substantif/adjectif assez hardie selon encore une fois <strong>de</strong>s habitu<strong>de</strong>s <br />
stylistiques hermétiques ; ce « livido » qui dans Erato e Apollion figure dans un contexte <br />
oxymorique (« splen<strong>de</strong> la pietra livida », « Salina d’inverno », Erato e Apollion) et qui <br />
revient une seule fois, bien plus tard, mis en valeur par un rejet (« che sgretola la natura <br />
inseparabile, il livido/suono <strong>de</strong>lla solitudine », « Varvàra Alexandrovna », Dare e avere) <br />
et également dans une combinaison inédite. Mais c’est autour <strong>de</strong>s célèbres épithètes <br />
d’Homère que notre poète prend le plus <strong>de</strong> liberté, ces formules figées par lesquelles <br />
sont nommées par exemple les divinités principales ou les héros, essentielles pour <br />
définir le tissu rythmique <strong>de</strong> la poésie homérique. Nous savons que le choix <strong>de</strong> <br />
<strong>Quasimodo</strong>, qui est peut-‐être la raison principale <strong>de</strong> l’heureuse réception <strong>de</strong> ses
7 <br />
traductions du grec, consiste dans l’abandon <strong>de</strong> la métrique classique au profit <strong>de</strong> ce <br />
qu’il indique comme la véritable durée du mot : <br />
Ho eluso il metodo <strong>de</strong>lle equivalenze metriche perché i risultati da esso conseguiti, se pure ci <br />
avvicinarono al battito <strong>de</strong>lle arsi, al silenzio <strong>de</strong>lle tesi, agli spazi <strong>de</strong>lle cesure, alla norma <br />
tecnica, infine astratta, <strong>de</strong>ll’antico testo poetico, non ci resero nel tempo stesso la ca<strong>de</strong>nza <br />
interna <strong>de</strong>lle parole costituite a verso. Parlo <strong>de</strong>lla vera quantità d’ogni parola (nella piega <br />
<strong>de</strong>lla voce che la pronuncia), <strong>de</strong>l suo valore, non di tono, ma di « durata » 8 . <br />
Or, cette intervention va <strong>de</strong> paires avec son traitement <strong>de</strong> l’épithète, que Marcello <br />
Gigante désigne comme métho<strong>de</strong> essentialisante : <br />
<strong>Quasimodo</strong> interprete di Omero ha affrontato e risolto con la stessa acutizzazione <strong>de</strong>lla sua <br />
tecnica ermeneutica e <strong>de</strong>l senso poetico il problema <strong>de</strong>ll’epiteto fisso e <strong>de</strong>l linguaggio <br />
formulare 9 . <br />
Pourquoi problème ? Pour la même raison pour laquelle pouvait l’être la scansion <strong>de</strong>s <br />
vers, ce que les philologues appelle l’épithète formulaire est employé par Homère dans <br />
<strong>de</strong>s conditions métriques figées afin d’i<strong>de</strong>ntifier une idée cruciale, et avait été toujours <br />
traduit par une terminologie classique (que <strong>Quasimodo</strong>, toujours dans son <br />
« Chiarimento » appelle un «linguaggio aromatico ») souvent illisible que le poète veut <br />
mo<strong>de</strong>rniser à tout prix. Et donc Athéna dont l’épithète est « glaukopis » (glaukos signifie <br />
brillant, argenté, d’où la traduction traditionnelle « occhiglauca » ou « glaucopi<strong>de</strong> » /aux <br />
yeux pers sera « dagli occhi lucenti » ; Hector « koruthaiolos » ou « kalkokorustes », sera <br />
« dall’elmo lucente », « dall’elmo di bronzo », au casque brillant, en bronze, qui fait si <br />
peur à son enfant Astyanax (rencontre avec Andromaque, Ilia<strong>de</strong>, VI) ; dans le passage <strong>de</strong> <br />
Nausicaa, elle même est appelée « leukolenos », « dalle braccia splen<strong>de</strong>nti » au lieu <strong>de</strong> <br />
« dalle bianche braccia ». Mais ces formules, parfois mo<strong>de</strong>rnisées, sont surtout <br />
employées contre Homère par <strong>Quasimodo</strong>, qui les casse, les élimine, ne les reprend que <br />
dans le souci d’une mobilité du texte. Le <strong>de</strong>rnier exemple homérique que je propose va <br />
d’ailleurs dans ce sens, puisque dans la réponse bienveillante donnée à Ulysse, celui-‐ci <br />
est désigné par une tournure qui frôle un <strong>de</strong> épithètes les plus fréquents du héros (celui <br />
<strong>de</strong> « polutlas », dai molti affanni, che molto sopporta, qui a souffert beaucoup) : <br />
καί που σοὶ τάδ᾽ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης <br />
(v. 190, Odyssé, VI) <br />
« e a te die<strong>de</strong> questo <strong>de</strong>stino e bisogna che tu lo sopporti comunque », où c’est le verbe <br />
supporter tetlàmen qui évoque polùtlas par sa racine tla-‐). Afin d’exalter cette image <br />
8 Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, « Chiarimento e note alle traduzioni », <strong>Quasimodo</strong> traduce Lirici greci, Milan, <br />
Mondadori, 1944, p. 206. <br />
9 Marcello Gigante, L’ultimo <strong>Quasimodo</strong> e la poesia greca, 1970, Naples, Guida editori, p. 40.
8 <br />
d’Ulysse, <strong>Quasimodo</strong> recourt à <strong>de</strong>ux figures intéressantes: « e a te die<strong>de</strong> questo <strong>de</strong>stino e <br />
bisogna che tu lo sopporti comunque », où l’anadiplose « dolori/dolori » restitue la <br />
gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> souffrances endurées par Ulysse, que par ailleurs l’emploi transitif <strong>de</strong> <br />
« soffrire » semble amplifie plus encore. <br />
Ce souffle anaphorique, véritablement à même <strong>de</strong> rendre la « serena e smemorata aura <br />
di racconto » 10 <strong>de</strong>s poèmes homériques est extrêmement visible chez l’auteur latin qui <br />
est à relier le plus étroitement à Homère dans le chemin du <strong>Quasimodo</strong> <strong>traducteur</strong>. <br />
Passons donc à Virgile, que je commenterai plus rapi<strong>de</strong>ment, dont <strong>Quasimodo</strong> choisit <br />
une sélection <strong>de</strong>s Géorgiques et qu’il voit d’ailleurs, toujours dans son récit <br />
traductologique comme un véritable passeur <strong>de</strong>s fulgurations <strong>de</strong> la poésie lyrique à la <br />
narration <strong>de</strong> l’épos : <br />
I latini, dicono, sono più difficili <strong>de</strong>i greci, quando si tenta una traduzione ; e forse è vero : i <br />
latini sono analitici là dove i greci sono <strong>de</strong>nsi e fulminei ; i primi ragionano dove i secondi <br />
evocano. Ma la lezione di Virgilio mi condusse al discorso, a una misura di oggettivazione, <br />
alla quale forse non sarei arrivato che con la privazione <strong>de</strong>l canto. <br />
Virgile, que notre poète affronte en 1942 avec Il fiore <strong>de</strong>lle Georgiche, donnera sa mesure <br />
d’hexamètre libre <strong>de</strong> césures à Homère, traduit quelques années plus tard. Il est <br />
important <strong>de</strong> souligner la résonance fondamentale entre le choix <strong>de</strong> cet auteur et <strong>de</strong> <br />
cette œuvre (pensons en effet, avec Michele Tondo, à l’enracinement <strong>de</strong>s Géorgiques <br />
dans une Italie dévastée par les guerres) et <br />
Virgile, le temps tragique vécu par <br />
<strong>Quasimodo</strong> et la diffusion dans sa traduction <strong>de</strong> cette « larga sintassi di strofa » 11 qui se <br />
fait par intensification <strong>de</strong> la réitération déjà active chez Virgile. Quelques prélèvements <br />
du premier livre <strong>de</strong>s Géorgiques -‐ œuvre, rappelons-‐le qui sous la forme d’un traité <br />
d’agriculture construit un hymne à la vie champêtre -‐, dans la traduction quasimodienne <br />
indiquent en effet la quête d’une ouverture expressive. Là où le texte latin, par exemple, <br />
égrène d’un ton impératif toute une série <strong>de</strong> gestes et <strong>de</strong> préceptes liés aux saisons : <br />
Núnc facilís rubeá * texátur físcina vírga, <br />
núnc torrét(e) igní * frugés, * nunc frángite sáxo. (vv. 266-‐267) <br />
Ora s’intrecci/intrecciate la comoda fiscella con verghe di rovo, <br />
Ora tostate al fuoco l’orzo, ora pestatelo con la macina. <br />
<strong>Quasimodo</strong>, tout en variant l’anaphore <strong>de</strong>s « nunc » latins, qu’il transformera dans la <br />
répétition habituelle <strong>de</strong> la conjonction « e », dilue énormément l’allure solennelle <strong>de</strong> ces <br />
vers pour les rapprocher d’un ton nettement plus discursif : <br />
10 Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, « Traduzioni dai classici », 1945, Il poeta e il politico e altri saggi, Milan, <br />
Mondadori, 1967, p. 111 et p. 109 pour la citation suivante. <br />
11 Michele Tondo, Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, Milan, Mursia, 1976, 3 e éd., p. 58.
9 <br />
Allora è tempo <br />
d’intrecciare leggeri canestri con verghe di rovo, <br />
e di brunire al fuoco il grano e romperlo con la pietra. <br />
qui continuera aussitôt après, toujours à la place d’une allure plus majestueuse. C’est <br />
d’ailleurs une démarche qu’on retrouve également dans la traduction <strong>de</strong> Catulle, pour <br />
laquelle vaut pour tous l’exemple du célèbre poème 101, dédié au frère, « Multas per <br />
gentes et multa per aequora vectus »/ « Dopo aver traversato terre e mari », qui perd <br />
entièrement chez <strong>Quasimodo</strong> le ton élevé pour se poser sur un hexamètre que Maria <br />
Cristina Albonico désigne <strong>de</strong> « quasi prosastico » 12 , ainsi que l’exemple du poème 87 : <br />
Nulla potest mulier tantum se dicere amatam <br />
Vere, quantum a me Lesbia amata mea es. <br />
Nulla fi<strong>de</strong>s nullo fuit umquam foe<strong>de</strong>re tanta, <br />
Quanta in amore tuo ex parte reperta mea est. <br />
que la version <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> rend extrêmement mobile : <br />
Nessuna può dire che fu amata tanto, <br />
Quanto, mia Lesbia, fosti da me amata. <br />
Mai nessuna fe<strong>de</strong>ltà fu tanta, <br />
Quanto la mia, nel tuo amore. <br />
La correspondance <strong>de</strong> la « fi<strong>de</strong>s », la fidélité, avec le « foedus », le pacte, qui en latin <br />
partagent la même racine, donne à ce poème d’amour <strong>de</strong> Catulle une forme parfaitement <br />
symétrique que <strong>Quasimodo</strong> fait littéralement exploser (jusqu’à en oublier le <strong>de</strong>uxième <br />
terme), selon l’élan fulgurant déjà expérimenté sur les Lirici greci. <br />
Pour revenir à Virgile, les traces <strong>de</strong> ce premier <strong>Quasimodo</strong> restent nombreuses, comme <br />
par exemple la tendance à une personnification découlant directement <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong>s <br />
substantifs absolus, comme dans les vers suivants : <br />
Múlt(a) a<strong>de</strong>ó gelidá * meliús se nócte <strong>de</strong>dére <br />
áut cum sóle novó * terrás inrórat Eóus. (vv. 287-‐288) <br />
(Molte cose si potrebbero meglio soprattutto al fresco <strong>de</strong>lla notte <br />
o, al sole che nasce, quando Lucifero fa umida la terra). <br />
Traduction <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> : In molti lavori ti aiuterà il freddo <strong>de</strong>lla notte <br />
o il primo sole, quando Lucifero fa umida la terra. <br />
Et en concomitance avec ce genre <strong>de</strong> petites illuminations hermétiques, nous assistons à <br />
une diffusion du rythme libre et efficace que Tondo n’hésite pas à attribuer au « ritorno <br />
al canto spiegato » 13 , et dont les vers qui suivent, décrivant l’arrivée du vent, donne un <br />
exemple assez limpi<strong>de</strong> : <br />
12 Cristina Albonico, « Salvatore <strong>Quasimodo</strong> interprete di Virgilio », op. cit., p. 138. <br />
13 Michele Tondo, Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, op. cit., p. 59.
10 <br />
Saép(e) etiám stellás * vent(o) ínpendénte vidébis <br />
praécipités * caeló labí, * noctísque per úmbram <br />
flámmarúm longós * a térg(o) albéscere tráctus; <br />
(Pure spesso, spirando il vento, vedrai stelle <br />
ca<strong>de</strong>re a precipizio dal cielo, e nell’oscurità <strong>de</strong>lla notte <br />
(vedrai) luccicare lunghi strascichi infuocati dietro di esse…) <br />
Traduction <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>=Spesso vedrai stelle quando è imminente il vento, <br />
Ca<strong>de</strong>re dal cielo e lasciare nel buio <strong>de</strong>lla notte <br />
Lunghe strisce di fuoco che biancheggiano. <br />
Si maintenant nous nous déplaçons <strong>de</strong> l’univers classique pour rejoindre la pleine <br />
contemporanéité, cette empreinte à la fois complexe et homogène d’un certain style et <br />
d’une certaine époque, ne disparaît absolument pas. Prenons par exemple l’anthologie <br />
<strong>de</strong> 25 poèmes <strong>de</strong> Pablo Neruda traduit en 1952, qui sera aussi l’occasion d’un contact <br />
direct avec le poète chilien, qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ra à <strong>Quasimodo</strong> d’ajouter un <strong>de</strong>rnier poème en <br />
catastrophe avant la publication, et qui représente une affinité certaine entre les <strong>de</strong>ux <br />
fils <strong>de</strong> cheminots, croyant dans une poésie du réel, chantant leur exil du Sud en termes <br />
très proches : « Più nessuno mi porterà nel Sud » (« Lamento per il Sud », La vita non è <br />
sogno)/ « Océano, traeme/ un dìa <strong>de</strong>l Sur » (« Quiero volver al Sur », Canto general). <br />
En lisant les traductions <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>, il est frappant <strong>de</strong> reconnaître en effet qu’une <br />
certaine allure hermétique <strong>de</strong>meure centrale, irradiant le rythme du chant choral qui se <br />
répand somptueusement <strong>de</strong> l’espagnol vers l’italien. De cette traduction, qui poussera <br />
Fortini à un éloge enthousiaste (« si ha persino l’impressione che, frequentemente, il <br />
traduttore abbia ‘migliorato’ l’originale, ren<strong>de</strong>ndone più robusto e secco il ritmo » 14 ), il <br />
existe plusieurs étu<strong>de</strong>s détaillées et intelligentes, auxquelles je ne peux que renvoyer, et <br />
qui indiquent toutes l’action <strong>de</strong> normalisation menée par <strong>Quasimodo</strong> agissant pourtant <br />
dans une adhésion presque parfaite. Ici on pourra juste toucher quelques passages très <br />
rapi<strong>de</strong>s qui dévoilent cette forte tendance du <strong>traducteur</strong> à raréfier, sublimer la parole <br />
nerudienne. Et cela même à l’intérieur d’une consonance rythmique et thématique plus <br />
qu’évi<strong>de</strong>nte. Si, en effet, la version <strong>de</strong> l’ « O<strong>de</strong> a Fe<strong>de</strong>rico Garcia Lorca » est presque <br />
déroutante tant le souci <strong>de</strong> calquer la ca<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Neruda fait parfois dévier la mélodie <br />
lexicale, la traduction d’ « Arte poetica » associe une auscultation rythmique d’une <br />
gran<strong>de</strong> finesse et une forte tendance à l’abstraction. Si « precipitadamente pálido, <br />
marchito en la frente » donnera tel effort <strong>de</strong> ralentissement « pallido, sempre più pallido, <br />
14 Franco Fortini, « Neruda tradotto da <strong>Quasimodo</strong> », <strong>Quasimodo</strong> e la critica (sous la direction <strong>de</strong> Gilberto <br />
Finzi), Milan, Mondadori, 1969.
11 <br />
col viso spento », ou les vers « y con luto <strong>de</strong> viudo furioso por cada día <strong>de</strong> mi vida,/ay, <br />
para cada agua invisible que bebo soñolientamente » seront repartis autrement : <br />
e in lutto di vedovo furioso <br />
per ogni giorno di vita, ahimè, <br />
per ogni acqua invisibile che bevo sonnolento. <br />
en créant <strong>de</strong> cette manière une nouvelle anaphore qui développe la pulsation <strong>de</strong> Neruda; <br />
il y a d’autant exemples <strong>de</strong> raréfaction dont par exemple : « tengo la misma sed ausente <br />
y la misma fiebre fría »/ « ho sempre assente sete, uguale febbre fredda », <br />
où la <br />
sublimation en sens hermétique est nette, qui reprend quelques habitu<strong>de</strong>s connues du <br />
premier <strong>Quasimodo</strong>, les combinaisons particulières substantif/adjectif (« Uguale raggio <br />
mi chiu<strong>de</strong> », « Spazio », Acque e Terre ; « in fresco oblio disceso », « L’Anapo », Erato e <br />
Apollion), la suppression <strong>de</strong> l’article (« Sera : luce addolorata,/ pigre campane <br />
affondano », « Ver<strong>de</strong> <strong>de</strong>riva », Oboe Sommerso ; « che mi spinse marzo lunare », <br />
« Albero », Acque e Terre), tout en renforçant le tissu rythmique par la série <strong>de</strong> fricatives. <br />
Cette opération <strong>de</strong> réduction du « diverso » qu’on a essayé <strong>de</strong> retrouver en parcourant <br />
auteurs et époques très différents, se révèle chez Neruda comme dénudée, puisque le <br />
temps politique du chilien <strong>de</strong>vient souvent chez <strong>Quasimodo</strong> un temps abstrait. <br />
A vouloir enfin rassembler les impressions <strong>de</strong> cette lecture hétérogène, il semblerait <br />
surgir alors <strong>de</strong> la pratique <strong>de</strong> la traduction une idée <strong>de</strong> poésie atemporelle, qui alimente <br />
un espace, une « terra poetica impareggiabile » au-‐<strong>de</strong>là <strong>de</strong> tout temps, traversée par <strong>de</strong> <br />
multiples modalités d ‘écritures. <br />
Sauf que cette suspension finit presque par <strong>de</strong>venir paradoxale, puisque l’empreinte sur <br />
la texte traduit ne le paralyse pas, au contraire, arrive à le mobiliser, à le mo<strong>de</strong>rniser, à le <br />
transmettre. Si donc c’est un mouvement <strong>de</strong> réduction, il l’est dans le sens d’un retour <br />
actif à la source. On se souviendra <strong>de</strong> cette phrase <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong> : « le parole <strong>de</strong>i cantori <br />
che abitarono le isole di fronte alla mia terra ritornarono lentamente nella mia voce, <br />
come contenuti eterni ». <br />
Il s’agit d’un éternel qui passe à travers une relation dynamique <strong>de</strong> proche et lointain, où <br />
le lointain est traité comme proche et vice versa. Dans une note à sa traduction du <br />
poème <strong>de</strong> Sappho « Vorrei veramente essere morta », pour justifier une <strong>de</strong> ses <br />
interventions libres sur la <strong>de</strong>rnière strophe entièrement fragmentée (<strong>de</strong>s libertés dont <br />
Anceschi parlait comme d’un « sforzare la lingua » et que les philologues lui ont
12 <br />
hautement reprochées) <strong>Quasimodo</strong> écrit : « Ho preferito (…) che la poesia continuasse <br />
l’eco di un ‘suono’ che i secoli avevano interrotto sulle scritture <strong>de</strong>gli amanuensi » 15 . <br />
L’écho que l’écriture s’apprête sans cesse à écouter est bien celui <strong>de</strong> le « stormire <br />
altissimo » <strong>de</strong> l’Anapo (Erato e Apollion), qui à la fois porte et déforme, amplifie et <br />
assourdit ce son <strong>de</strong>s siècles sur lequel <strong>Quasimodo</strong> module sa parole. Puisque ce « già <br />
posseduto » qui se produit dans la traduction, relève d’une nature particulière. Il suffit <br />
en effet d’évoquer le réseau fondateur du lieu natal dans la poésie <strong>de</strong> <strong>Quasimodo</strong>, pour <br />
voir s’ouvrir un temps pour le moins double, surdéterminé par la nostalgie d’une terre <br />
perdue, qui n’existe en même temps que dans sa remémoration mythique, dans la <br />
pulsion d’exil qui rend le poète familier et exclu <strong>de</strong> l’« isola d’Ulisse ». C’est d’ailleurs une <br />
parole primordiale traduite qui permet à <strong>Quasimodo</strong> <strong>de</strong> syllaber la Sicile. <br />
« Non un luogo <strong>de</strong>ll’infanzia/ cerco », on lit dans « Seguendo l’Alfeo », où le rejet est <br />
déterminant pour saisir cette dissonance originaire. <br />
Les termes dans lesquels on peut abor<strong>de</strong>r ce que Bart Van <strong>de</strong>n Bossche a appelé « la <br />
situazione contraddittoria <strong>de</strong>l nostos » 16 chez <strong>Quasimodo</strong> me semblent incroyablement <br />
proches <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> la réflexion sur la traduction affrontée par Martin Hei<strong>de</strong>gger pendant <br />
les mêmes années <strong>de</strong> la traduction <strong>de</strong>s Lirici. En 1941, dans un séminaire autour du seul <br />
fragment conservé d’Anaximandre, un philosophe présocratique presque contemporain <br />
d’Alcée ou <strong>de</strong> Sappho, Hei<strong>de</strong>gger abor<strong>de</strong> la traduction <strong>de</strong> cette parole primordiale (car ce <br />
sont les premiers mots écrits <strong>de</strong> la philosophie occi<strong>de</strong>ntale), par une dialectique entre <br />
proche et dépaysant, familier et étrange. Il pourra paraître pour le moins étrange <strong>de</strong> <br />
citer le philosophe pour lequel la pensée est poème, afin <strong>de</strong> parler d’un poète qui, dans <br />
son Discorso sulla poesia, définissait les philosophes comme les ennemis naturels <strong>de</strong>s <br />
poètes. Pourtant, la question posée à Fribourg sur le « pouvoir illimité <strong>de</strong> dépaysement » <br />
<strong>de</strong> la parole d’Anaximandre, là où, dit toujours Hei<strong>de</strong>gger, « il est un lointain qui <br />
rapproche davantage que toute la familiarité irrespectueuse qui caractérise la science <br />
historique… » 17 , n’est pas étrangère à <strong>Quasimodo</strong>, qui partage cette même méfiance <br />
envers la philologie, et qui rappelle, en parlant <strong>de</strong> traduction, vouloir chercher <br />
15 Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, « Chiarimento e note alle traduzioni », op. cit., p. 211. <br />
16 Bart Van <strong>de</strong>n Bossche, « <strong>Quasimodo</strong> e il mito », <strong>Quasimodo</strong> e gli altri. Atti <strong>de</strong>l convegno internazionale <br />
Lovanio 27-‐28 aprile 2011, a cura di Franco Musarra, Bart Van <strong>de</strong>n Bossche, Serge Vanvolsem, Louvain, <br />
Leuven University Press/Franco Cesati Editore, 2001, p. 31. <br />
17 Martin Hei<strong>de</strong>gger, Das Anfängliche Sagen <strong>de</strong>s Seins im Spruch <strong>de</strong>s Anaximan<strong>de</strong>rs, seconda parte di <br />
Grundbegriffe (Sommersemester 1941), GA Band 51, Klostermann, Frankfurt am Main 1981, p. 96.
13 <br />
« l’approssimazione più specifica d’un testo : quella poetica » 18 . Ne soyons pas <br />
approximatifs en abordant ce terme. Puisqu’ « approssimazione », en italien, n’indique <br />
pas seulement l’approximation mathématique, ce calcul par lequel on approche d’une <br />
gran<strong>de</strong>ur réelle, que <strong>Quasimodo</strong> évoque à maintes reprises, par exemple en parlant <strong>de</strong> l’ <br />
« approssimazione laterale linguistica <strong>de</strong>lla parola » 19 . « Approssimazione » signifie <br />
également ce qu’on dira plus souvent par l’infinitif substantivé « approssimarsi », à <br />
savoir le rapprochement, l’approche, qui dans son acception poétique, <strong>de</strong>vient chez <br />
<strong>Quasimodo</strong>, me semble-‐t-‐il, le mouvement qui va vers le proche analysé par Hei<strong>de</strong>gger. <br />
L’ « approssimazione poetica » pourrait par conséquent régler dans le traduction et dans <br />
l’écriture cette « aventure » (le terme est quasimodien) <strong>de</strong> la parole que notre poète <br />
s’acharne à traverser avec une « fe<strong>de</strong> assoluta nella poesia », selon les célèbres mots <strong>de</strong> <br />
Carlo Bo. Par moments, la « quantità » ou la « <strong>de</strong>nsità » <strong>de</strong> cette parole est atteinte, et le <br />
calcul revient à zéro, comme dans la rencontre « quasi senza residuo » 20 (avait <br />
commenté le latiniste La Penna) avec les poètes grecs, ou encore dans certains poèmes, <br />
dans certains recueils ou zones <strong>de</strong> recueils poétiques, sans penser à la traduction faite <br />
par <strong>Quasimodo</strong> <strong>de</strong> quelques poèmes <strong>de</strong> EE Cummings, poète expérimental on ne peut <br />
plus lointain, pour lequel il trouve <strong>de</strong>s solutions extraordinaires. Par moments, l’ <br />
« approssimazione » tombe dans l’approximatif, dans la dissonance (« non cerco <br />
che/dissonanze », lit-‐on toujours dans Seguendo l’Alfeo). <br />
Que ce soit un terme, un concept, et une manière <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r que la traduction prête à <br />
l’écriture, pour mieux l’éclairer, c’est une hypothèse qui partage cette autre affirmation <br />
<strong>de</strong> Carlo Bo sur <strong>Quasimodo</strong> <strong>traducteur</strong> : <br />
Tradurre non era un mestiere o – al più – è stato un mestiere che <strong>Quasimodo</strong> ha trasformato <br />
in motivo di approfondimento. Tradurre gli dava da vivere e gli dava il senso <strong>de</strong>l diverso, <strong>de</strong>l <br />
più consistente, <strong>de</strong>l vero concreto 21 . <br />
Giorgia Bongiorno, Université <strong>de</strong> Lorraine <br />
18 Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, « Chiarimento », op.cit., p. 206. <br />
19 Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, « Una poetica », op. cit., p. 278. <br />
20 Antonio La Penna, « Il fiore <strong>de</strong>lle Georgiche e Catulli Veronensis Carmina », <strong>Quasimodo</strong> e la critica (sous <br />
la direction <strong>de</strong> Gilberto Finzi), Milan, Mondadori, 1969. <br />
21 Carlo Bo, « Prefazione » à Salvatore <strong>Quasimodo</strong>, Poesie e discorsi sulla poesia, Milan, Mondadori, « I <br />
Meridiani », 1996.