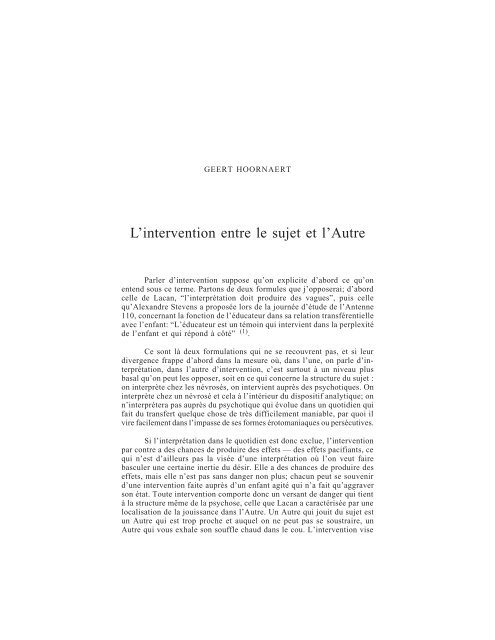L'intervention entre le sujet et l'Autre - Courtil
L'intervention entre le sujet et l'Autre - Courtil
L'intervention entre le sujet et l'Autre - Courtil
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
GEERT HOORNAERT<br />
L’intervention <strong>entre</strong> <strong>le</strong> <strong>suj<strong>et</strong></strong> <strong>et</strong> l’Autre<br />
Par<strong>le</strong>r d’intervention suppose qu’on explicite d’abord ce qu’on<br />
entend sous ce terme. Partons de deux formu<strong>le</strong>s que j’opposerai; d’abord<br />
cel<strong>le</strong> de Lacan, “l’interprétation doit produire des vagues”, puis cel<strong>le</strong><br />
qu’A<strong>le</strong>xandre Stevens a proposée lors de la journée d’étude de l’Antenne<br />
110, concernant la fonction de l’éducateur dans sa relation transférentiel<strong>le</strong><br />
avec l’enfant: “L’éducateur est un témoin qui intervient dans la perp<strong>le</strong>xité<br />
de l’enfant <strong>et</strong> qui répond à côté” (1) .<br />
Ce sont là deux formulations qui ne se recouvrent pas, <strong>et</strong> si <strong>le</strong>ur<br />
divergence frappe d’abord dans la mesure où, dans l’une, on par<strong>le</strong> d’interprétation,<br />
dans l’autre d’intervention, c’est surtout à un niveau plus<br />
basal qu’on peut <strong>le</strong>s opposer, soit en ce qui concerne la structure du <strong>suj<strong>et</strong></strong> :<br />
on interprète chez <strong>le</strong>s névrosés, on intervient auprès des psychotiques. On<br />
interprète chez un névrosé <strong>et</strong> cela à l’intérieur du dispositif analytique; on<br />
n’interprétera pas auprès du psychotique qui évolue dans un quotidien qui<br />
fait du transfert quelque chose de très diffici<strong>le</strong>ment maniab<strong>le</strong>, par quoi il<br />
vire faci<strong>le</strong>ment dans l’impasse de ses formes érotomaniaques ou persécutives.<br />
Si l’interprétation dans <strong>le</strong> quotidien est donc exclue, l’intervention<br />
par contre a des chances de produire des eff<strong>et</strong>s — des eff<strong>et</strong>s pacifiants, ce<br />
qui n’est d’ail<strong>le</strong>urs pas la visée d’une interprétation où l’on veut faire<br />
bascu<strong>le</strong>r une certaine inertie du désir. El<strong>le</strong> a des chances de produire des<br />
eff<strong>et</strong>s, mais el<strong>le</strong> n’est pas sans danger non plus; chacun peut se souvenir<br />
d’une intervention faite auprès d’un enfant agité qui n’a fait qu’aggraver<br />
son état. Toute intervention comporte donc un versant de danger qui tient<br />
à la structure même de la psychose, cel<strong>le</strong> que Lacan a caractérisée par une<br />
localisation de la jouissance dans l’Autre. Un Autre qui jouit du <strong>suj<strong>et</strong></strong> est<br />
un Autre qui est trop proche <strong>et</strong> auquel on ne peut pas se soustraire, un<br />
Autre qui vous exha<strong>le</strong> son souff<strong>le</strong> chaud dans <strong>le</strong> cou. L’intervention vise
2 GEERT HOORNAERT<br />
à barrer c<strong>et</strong> Autre, loin de l’exciter d’avantage, jusqu’à produire des vagues.<br />
Par<strong>le</strong>r de perp<strong>le</strong>xité quand il s’agit du psychotique, c’est dire à quel point<br />
ce <strong>suj<strong>et</strong></strong> est déjà inondé, <strong>et</strong> comment il faut l’aider à se repérer dans c<strong>et</strong>te<br />
étendue béante de par l’absence de signifiants fondamentaux.<br />
L’Autre jouit — l’Autre, c’est avant tout <strong>le</strong> langage, surtout dans la<br />
psychose, où il n’est pas inconscient. Et là on tombe sur un paradoxe; une<br />
intervention produit parfois un eff<strong>et</strong>, alors qu’el<strong>le</strong> aussi relève du langage.<br />
Comment faire alors pour ne pas être inclus dans l’Autre jouisseur ?<br />
Reprenons d’abord la formulation d’A<strong>le</strong>xandre Stevens où l’intervention<br />
est toujours une réponse à côté, une réponse qui ne fait pas front<br />
au <strong>suj<strong>et</strong></strong> comme <strong>le</strong> font <strong>le</strong>s grandes vérités du Maître qui déploie son savoir<br />
en jouissant. El<strong>le</strong> se refuse <strong>le</strong> fameux face-à-face où la puissance scopique<br />
émousse <strong>le</strong>s mots qui se disent en séduction. En déviant du duel, <strong>le</strong> trois<br />
se présentifie.<br />
En fait, <strong>le</strong> terme même d’intervention comporte <strong>le</strong> “répondre à<br />
côté”; intervenir, c’est agir sur une relation à deux qu’on juge néfaste,<br />
malhonnête, exploiteuse. L’Autre exploite <strong>le</strong> <strong>suj<strong>et</strong></strong>, c’est sa modalité principa<strong>le</strong><br />
de jouir. Si l’on intervient là, c’est parce qu’on s’est fait une<br />
certaine idée de l’enfant, cel<strong>le</strong> d’une détresse dans <strong>le</strong> rapport à l’Autre que<br />
<strong>le</strong> <strong>suj<strong>et</strong></strong> ne peut soutenir sans aide extérieure ou à partir de son propre<br />
fantasme. On aidera donc l’enfant en évitant que c<strong>et</strong> Autre ne devienne<br />
parasitaire. Si l’intervention répond à cela, el<strong>le</strong> est automatiquement une<br />
réponse à côté par rapport au <strong>suj<strong>et</strong></strong>.<br />
L’intervention doit donc toujours viser l’Autre du <strong>suj<strong>et</strong></strong> — c’est là,<br />
bien sûr, une position théorique, dont on doit interroger la mise en pratique.<br />
Comment la traduire dans <strong>le</strong> quotidien ? C’est chose peu faci<strong>le</strong>.<br />
Prenons l’exemp<strong>le</strong> de Martin, un enfant qui, sans cesse, frappe du poing<br />
dans <strong>le</strong>s vitres. Ce qui <strong>le</strong> motive, ce qu’il vise, on n’en sait rien, mais “ça”<br />
vise quelque chose : en frappant il nous regarde. Mais il est sûr que lui non<br />
plus n’y “comprend” rien, dans <strong>le</strong> sens d’une finalité quelconque. Ce n’est<br />
donc pas seu<strong>le</strong>ment plus fort que nous, c’est aussi plus fort que lui. Mais<br />
dans <strong>le</strong> quotidien, on a parfois tendance à oublier ce fait, en l’approchant<br />
comme s’il pouvait en rendre compte. Puisqu’une intervention tel<strong>le</strong> que<br />
“Martin, arrête” ou “Martin, qu’est-ce qui se passe” ne fait qu’aggraver la<br />
situation, on ne peut que se demander si l’on fait bien d’adm<strong>et</strong>tre chez lui<br />
la solidarité avec ses actes que ce type d’intervention suppose. Et rappelons-nous<br />
qu’une mauvaise intervention peut “faire <strong>le</strong> désespoir des persécuteurs”,<br />
qui “m<strong>et</strong>tent alors en jeu toute <strong>le</strong>ur magie pour redoub<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s<br />
dou<strong>le</strong>urs” ( 2 ). Mais comment intervenir alors de tel<strong>le</strong> sorte que Martin luimême<br />
ressente qu’on vise c<strong>et</strong> Autre qui l’agite ? Je laisse la question<br />
ouverte, en disant seu<strong>le</strong>ment qu’il ne faut pas trop insister sur <strong>le</strong> nom propre<br />
dans la formulation de l’intervention.<br />
© Les Feuil<strong>le</strong>ts du <strong>Courtil</strong> online, 2003
L’intervention <strong>entre</strong> <strong>le</strong> <strong>suj<strong>et</strong></strong> <strong>et</strong> l’Autre 3<br />
Il n’est donc pas conseillé d’adresser l’intervention directement au<br />
<strong>suj<strong>et</strong></strong> lui-même; en oubliant la dimension de l’Autre, nous prenons <strong>le</strong> risque<br />
de devenir pour l’enfant une sorte de Dieu Schreberien, incapab<strong>le</strong> de comprendre<br />
quoi que ce soit aux vivants. Un exemp<strong>le</strong> d’intervention indirecte<br />
est l’échange des adultes, <strong>entre</strong> eux <strong>et</strong> en présence de l’enfant, de constructions<br />
parmi <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s l’enfant peut choisir pour signifier son impossib<strong>le</strong>à-dire.<br />
C’est une méthode qui se situe à la bonne distance : ni trop proche,<br />
ni trop lointaine. Je veux dire par là qu’on n’intervient pas à partir de<br />
n’importe quel<strong>le</strong> place. On doit toujours être en position tierce, jamais dans<br />
une rivalité duel<strong>le</strong>. Je voudrais illustrer ceci par un exemp<strong>le</strong>.<br />
K., un ado<strong>le</strong>scent paranoïaque, n’allait pas bien. Une soirée, qui allait<br />
se terminer par une hospitalisation en urgence — soirée lourde de signes<br />
qui auguraient de son effondrement — je commençais un jeu de société<br />
avec lui. La compétence de K. en Puissance 4 m’était connue; maintes fois<br />
je me suis incliné devant ses stratégies bien méditées. Ce soir-là, pourtant,<br />
c’était différent. A chaque coup de ma part il répondait de manière irréfléchie<br />
<strong>et</strong> automatique par la contrepartie, de tel<strong>le</strong> manière qu’une ligne médiane<br />
divisait l’écran plastique en deux champs parfaitement réf<strong>le</strong>xifs. Les<br />
suggestions que je lui faisais, d’être bien attentif à ce qui était ma stratégie<br />
— stratégie extrêmement limpide d’ail<strong>le</strong>urs — restaient sans résultat, tant<br />
il était suspendu à l’image d’un autre, par perte, bien sûr, de ses propres<br />
repères. Ma seu<strong>le</strong> “intervention” a été d’interrompre <strong>le</strong> jeu parce que je<br />
sentais la menace de devenir pour lui un persécuteur pur.<br />
Je dirai donc : ne jamais intervenir quand on se trouve dans une<br />
relation duel<strong>le</strong> avec l’enfant, quand on ne se trouve pas à la bonne distance.<br />
La voie roya<strong>le</strong> de l’Autre, Freud nous l’a montré, est cel<strong>le</strong> du signifiant.<br />
Les considérations sur <strong>le</strong> sens dans la formulation de l’intervention<br />
n’ont donc pas la priorité; c’est un <strong>le</strong>urre de penser que <strong>le</strong> sens fonde <strong>le</strong><br />
commun. C’est par <strong>le</strong> signifiant que <strong>le</strong> <strong>suj<strong>et</strong></strong> s’est fait des passerel<strong>le</strong>s vers<br />
l’Autre. Ces signifiants-là ont un statut particulier dans la psychose, en tant<br />
qu’ils témoignent d’une prise de position vis-à-vis de la jouissance. Les<br />
signifiants du <strong>suj<strong>et</strong></strong> (signifiants délirants, signifiants qui relèvent d’une<br />
identification, signifiants imaginaires, ...) font partie d’une structure qui fait<br />
limite à la jouissance, soit sous <strong>le</strong>s formes <strong>le</strong>s plus isolées du signifiant<br />
idéal, soit sous la forme élaborée du délire. C’est de ses signifiants-là qu’il<br />
s’agit de partir dans l’intervention. Si un schizophrène érige des signifiants<br />
imaginaires <strong>et</strong> idéaux en tant qu’opérateurs structurants, on <strong>le</strong>s soutiendra.<br />
Les interventions <strong>le</strong>s plus efficaces seront cel<strong>le</strong>s qui homologuent c<strong>et</strong>te<br />
solution personnel<strong>le</strong> du <strong>suj<strong>et</strong></strong> - cel<strong>le</strong>s qui partent de la structure réparatrice<br />
<strong>et</strong> la prolongent à l’intérieur du langage. La question est différente chez <strong>le</strong>s<br />
paranoïaques, où on essayera de faire bascu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s signifiants de la certitude.<br />
Là, l’intervention n’a pas à solidifier, mais à défixer.
4 GEERT HOORNAERT<br />
J’espère que la tonalité généralisante de ces remarques n’occulte en<br />
rien la singularité de chaque <strong>suj<strong>et</strong></strong>. La moindre expérience nous apprend<br />
que <strong>le</strong> <strong>suj<strong>et</strong></strong> existe dans la psychose, qu’il n’y a donc pas une panacée de<br />
l’intervention-type, absence qui nous perm<strong>et</strong> de réfuter toute identification<br />
de notre travail avec cel<strong>le</strong> d’une équipe policière, qui, el<strong>le</strong>, s’occupe du<br />
contrô<strong>le</strong> des masses.<br />
NOTES<br />
( 1 ) L’Antenne 110 a récemment publié l’ensemb<strong>le</strong> des interventions de c<strong>et</strong>te journée<br />
dans son 3è numéro de Préliminaire.<br />
( 2 ) Berbiguier de Terre-Neuve du Thym, <strong>le</strong>s Farfad<strong>et</strong>s, ou Tous <strong>le</strong>s démons ne sont<br />
pas de l’autre monde (1921), Ed. Jérôme Millon, Grenob<strong>le</strong>, 1990, p. 79. Pour<br />
citer quelqu’un qui sait ce dont il par<strong>le</strong>.<br />
© Les Feuil<strong>le</strong>ts du <strong>Courtil</strong> online, 2003