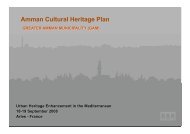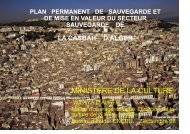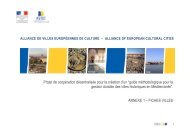Séminaire international ⦠DOSSIER DE PRESSE ⦠- Qualicities
Séminaire international ⦠DOSSIER DE PRESSE ⦠- Qualicities
Séminaire international ⦠DOSSIER DE PRESSE ⦠- Qualicities
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Séminaire <strong>international</strong>« La valorisation du patrimoine urbain en Méditerranée »18 et 19 septembre 2008Arles, Ecole Nationale Supérieure de la Photographie… <strong>DOSSIER</strong> <strong>DE</strong> <strong>PRESSE</strong> …SOMMAIRECommuniqué de presse …………………………………………………………………….………p. 2Séminaire <strong>international</strong> « La valorisation du patrimoine urbain en Méditerranée »….……….p.3- le projet- nos partenaires- le programmeEtudes de cas préparatoires………………………………………………………………………..p.9- Alep (Syrie)- Amman (Jordanie)- Gênes (Italie)- Izmir (Turquie)- La Valette (Malte)- Perpignan (France)- Séville (Espagne)- Split (Croatie)- Tel Aviv (Israël)- Thessalonique (Grèce)-Tlemcen (Algérie)- Tripoli (Liban)Contact presse :Amandine Leopold - Association AVECService patrimoine, Mairie d'Arles BP 193 - 13637 Arles Cedex - FranceE-mail : amandine@avecnet.eu / Tel : + 33 (0)6 78 41 92 37 /Fax : +33 (0)4 90 49 35 30http://patrimoineurbainenmediterrannee.over-blog.com1
Séminaire <strong>international</strong> « La valorisation du patrimoine urbain en Méditerranée »Communiqué de presseLe séminaire <strong>international</strong> « La valorisation du patrimoine urbain enMéditerranée », placé sous le patronage de l’UNESCO, est co-organisé par l’UnionInternationale des Associations et Organismes Techniques (UATI – ONG del’UNESCO), la ville d'Arles, l’Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC), ainsique l'Institut d’urbanisme de la Sorbonne (université Paris IV-Sorbonne).Il se déroulera les 18 et 19 Septembre 2008, à Arles dans l’auditorium de l’EcoleNationale Supérieure de la Photographie.Le séminaire prévoit de réunir des représentants de haut niveau des villes dusud et du nord du bassin méditerranéen. Quinze villes ont été choisies pour présenterles problématiques locales auxquelles elles doivent faire face quotidiennement:- Alep (Syrie),- Alger (Algérie),- Amman (Jordanie),- Arles (France),- Evora (Portugal),- Fez (Maroc),- Gênes (Italie),- Ghardaïa (Algérie),- Perpignan (France),- Pézenas (France),- Séville (Espagne),- Tel-Aviv (Israël),- Tunis (Tunisie),- Ubeda (Espagne),- La Valette (Malte).L‘objectif de ce séminaire est de dresser un catalogue raisonné des questionsopérationnelles et techniques auxquelles sont confrontées les villes à riche patrimoinearchitectural et urbain de la Méditerranée. Ce catalogue doit permettre de définir, àtravers un document de synthèse, des problématiques et des besoins communs auxvilles qui serviront de référence pour les échanges d’expériences et les travauxd’approfondissement ultérieurs à conduire au sein du réseau qui sera ainsi constitué.Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet :http://patrimoineurbainenmediterrannee.over-blog.com2
Séminaire <strong>international</strong> « La valorisation du patrimoine urbain en Méditerranée »Le projetL’UATI est une organisation non gouvernementale (ONG) créée il y a une cinquantaine d’années àl’initiative de l’UNESCO pour mettre en place une activité technique aux côtés des activitéstraditionnelles de formation et de culture.Les membres de l’UATI sont des associations et organisations <strong>international</strong>es ou nationales ayantdes activités <strong>international</strong>es, spécialisées dans divers domaines.En 2003, le conseil d’administration de l’Union Internationale des Associations et OrganismesTechniques a adopté une stratégie plaçant les questions urbaines au cœur de ses priorités etauxquelles se rattachent les manifestations organisées et les travaux conduits ces dernières années :-en 2003, un séminaire méditerranéen sur les risques urbains-en 2004, une conférence <strong>international</strong>e sur la mobilité et la cohésion sociale dans les mégapoles-en 2005, l’étude de faisabilité d’un institut <strong>international</strong> d’ingénierie pour la Méditerranée-en 2006 un séminaire <strong>international</strong> sur l’accès à l’énergie pour tousC’est dans ce cadre que l’UATI travaille, depuis près de trois ans, sur le thème du patrimoine urbain.Les travaux de préparation de ce séminaire ont été lancés en novembre 2006.En début d’année 2008, après une rencontre avec M. Dauge, Sénateur d’Indre et Loire et M.Mourisard, adjoint au Maire d’Arles, délégué au tourisme et au patrimoine et président de l’Alliance deVilles Européennes de Culture (AVEC), l’hypothèse d’organiser le séminaire à Arles s’est imposée, laville d’Arles étant un exemple de villes méditerranéennes auxquelles s’adresse la manifestation et quigère au quotidien un patrimoine très riche (inscrit sur la liste du patrimoine mondial).L’Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC) et L’Institut d’urbanisme de l’Université Paris IV-Sorbonne ont assisté l’UATI dans le développement et l’organisation de ce séminaire.Les dates des 18 et 19 septembre 2008 correspondent à l’ouverture des Journées Européennes duPatrimoine (JEP) à Arles et nous avons décidé de créer un lien entre ces deux manifestations enorganisant une séance publique de présentation des résultats du séminaire ouverte aux participantsdes JEP.M. Yves Dauge, Sénateur d’Indre et Loire, présidera ce séminaire à destination des spécialistes del’urbanisme, techniciens et élus des villes de Méditerranée invitées, universitaires, représentants desministères et institutions partenaires, ambassades de France dans les pays des villes invitées,…venant de France et de toute la région méditerranéenne.3
Nos partenaires- UNESCO - www.unesco.org- Agence Française de Développement - www.afd.fr- Commission Française pour l'UNESCO- www.unesco.fr- Agence nationale de l'habitat - www.anah.fr- Caisse des dépôts et consignations - www.caissedesdepots.fr- Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur - www.regionpaca.fr- Conseil Général des Bouches du Rhône - www.cg13.fr- ICOMOS - www.<strong>international</strong>.icomos.org- Ministère des Affaires étrangères et européennes - www.diplomatie.gouv.fr- Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire -www.developpement-durable.gouv.fr4
Le programmeJeudi 18 septembre9h30 : Ouverture- Bienvenue par M. Hervé SCHIAVETTI, Maire d’Arles- Accueil par M. Jacques ROUSSET, Président d’honneur de l’Union Internationale des Associations etOrganismes Techniques (UATI)- Intervention de M. Michel VAUZELLE, Président du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur- Intervention de Mme Minja YANG, Ambassadrice de l’UNESCO- Intervention de M. Daniel BAILLON, conseiller pour la Culture à la Commission française pour l’UNESCO- Intervention de M. Jean-Michel SEVERINO, Directeur général de l’Agence Française de Développement(AFD)- Intervention de M. Laurent VIGIER, Directeur des affaires européennes et <strong>international</strong>es de la Caisse desDépôts.- Présentation de la manifestation par le Président du séminaire, M. Yves DAUGE, Sénateur d’Indre et Loire11h00 -11h15 : Pause11h15 -12h45 : Communications générales- M. Régis KOETSCHET, Directeur des politiques de développement, Ministère des affaires étrangères eteuropéennes.- M. Jacques FAYE, chef du bureau information & coordination interministérielle, sous-direction de laprévention des risques majeurs au Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et del'aménagement du territoire.- Mme Sofia AVGERINOU KOLONIAS, professeur à l’Université d’Athènes, Vice présidente d’ICOMOSAthènes et présidente du Comité <strong>international</strong> sur le Villes et Villages historiques (CIVVIH) de Méditerranée.- M. Laurent GIROMETTI, Directeur technique et juridique, Agence nationale de l’habitat (Anah).- M. Michel CARMONA, professeur et directeur de l’Institut d’urbanisme – Université Paris IV – Sorbonne- Mme Guillemette PINCENT, ATER, UFR de géographie, Université Paris IV-Sorbonne- M. Tristan MOREL, Etudiant à l'Institut d’urbanisme, Université Paris IV-Sorbonne- M. Christian MOURISARD, Président de l’Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC)13h00 -14h00 : Déjeuner-buffet dans la cour de l’Ecole de la Photographie.14h00 -15h30 : Première session« Urbanisme et Architecture »Président : M. Benjamin MOUTON, architecte en chef des monuments historiques, Président de l’académied’architecture (sous réserve)Rapporteur : M. Daniel DROCOURT, directeur de l’atelier du patrimoine de MarseilleA. Étude de casL’objectif de cette session est de mettre en évidence différents types d’espaces urbains et patrimoniauxvisibles en Méditerranée.=> Ville d’Alep (Syrie): la réhabilitation du centre-ville historique par de multiples acteurs.Intervention de Mme Hélène KILO, Ingénieur, département de protection de la vieille ville à la direction desAntiquités et des Musées d’Alep.=> Ville de Tel Aviv (Israël) : la Ville Blanche, la gestion d’un patrimoine moderne en évolution.5
Intervention de Mme Micha GROSS, architecte designer du Bauhaus Center Tel-Aviv.=> Ville de Gênes (Italie) : la requalification portuaire et urbaine initiée par la municipalité.Intervention de M. le Professeur Giovanni SPALLA, Université de Gênes.B. Questions transversales- Comment hiérarchiser la valeur patrimoniale d’un bien ? Comment hiérarchiser les règles de protection deces biens ?Intervention M. Bernard WAGON, architecte – Paris (France).- Le jeu des acteurs de la protection et de la mise en valeur du patrimoine.Intervention M. Marcelino SANCHEZ, maire d’Ubeda (Espagne).15h30 15h45 Débat15h45 16h00 Pause16h00 17h30 : Deuxième session « Questions sociales »Président : M. Michel POLGE, Pôle interministériel de lutte contre l’habitat indigne (MEEDDAT, France)Rapporteur : Dr. Nuhad ABDALLAH, Professeur d’Architecture et d’urbanisme à l’Université de Tishreen(Syrie).A. Études de casL’objectif de cette session est de mettre en évidence les défis sociaux majeurs que les acteurs locaux tententde relever.=> Ville de Séville (Espagne) : face au vieillissement et à la fuite des habitants, comment attirer la populationlocale dans un centre-ville tertiarisé ?Intervention de D. David BUEZAS MARTINEZ, coordination générale du secteur de l’urbanisme et JustoEmilio GONZALEZ MORMENEO, directeur de la communication et des relations publiques.=> Ville de Fez (Maroc) : comment travailler avec les artisans et les habitants autour de la réhabilitation dupatrimoine urbain ?Intervention de M. Omar HASSOUNI, architecte, géographe, directeur des opérations A<strong>DE</strong>R-Fez, maître deconférences à l’Ecole Nationale d'Architecture à Rabat=> Ville de Ghardaïa (Algérie) : Réhabiliter les Ksours avec les habitantsIntervention de M. Zohair BALLALOU et M. Younes BABANEDJAR, Office de promotion de la vallée du M'zabB. Questions transversalesRéhabilitation de l’habitat et préservation de la mixité sociale : la gentrificationIntervention de M. Damien BERTRAND, géographe, urbaniste, FORS-Recherche Sociale (Paris, France)Intervention de M. Yves <strong>DE</strong> LAGAUSIE, Ingénieur E.C.P., Urbaniste qualifié O.P.Q.U., Programmiste(Montpellier, France)17h30 17h45 Débat18h30 Inauguration des journées du patrimoine et de l’exposition Maurice Frydman (Cloître StTrophime)6
Vendredi 19 septembre9h00 11h00 : Troisième session « Questions opérationnelles et techniques »Président : M. Alexandre METRO, architecte du Patrimoine, ICOMOS France (Paris)Rapporteur : M. Samir ABDULAC, docteur en urbanisme et consultant <strong>international</strong> (Paris).A. Études de casCette troisième session vise à présenter quelques enjeux opérationnels ainsi que des outils originaux mis enœuvre à différentes échelles pour valoriser le patrimoine urbain.=> Ville de Perpignan (France) : les outils nationaux de la réhabilitation.Intervention de Mme Marie TJOYAS, Maire-adjoint délégué au développement durable et Mme MichèleCAP<strong>DE</strong>T, Conseiller Municipal délégué.=> Ville de Tunis (Tunisie) : la rénovation des oukalas : acteurs, principes, projets et réalisations.Intervention de M. Jellal AB<strong>DE</strong>KAFI, architecte paysagiste DPLG, Urbaniste, Tunis.=> Ville d’Amman (Jordanie) : l’élaboration du schéma directeur du grand Amman. Collaboration avec l’AFD etla Ville de Paris.Intervention de M. l’Ingénieur Fawzi MASAD, assistant sous-secrétaire, membre du comité national dupatrimoine et de M. l’Architecte Ibrahim HASHIM, Responsable du patrimoine pour le schéma directeurd’Amman / Technicien conseil et membre du comité national du patrimoine.=> Ville d’Alger (Algérie) : le projet de la Casbah d’Alger.Intervention de M. Abdelouahab ZEKAGH, architecte et enseignant à l’Ecole Polytechnique d’Architecture.B. Questions transversales- Le plan de gestion UNESCO - La réflexion de l’association des biens français inscrits sur la liste del’UNESCO.Intervention de M. Bouzid SABEG, directeur du patrimoine et M. Bernard POUVEREL, directeur du site duPont du Gard.- Les questions de financement, Agence Française de Développement.- L'importance du cadre économique et juridique du patrimoine.Intervention de M. Michel CARMONA, professeur et directeur de l’Institut d’urbanisme de Paris IV – Sorbonne.11H00 11h15 : Débat11h15 11h30 Pause11h30 13h00 : Quatrième session «vulnérabilité du patrimoine et développement durable»Président : Claude LEFROU, ancien Directeur au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (France).Rapporteur : Nadia THEUMA, Professeur à l’Université de Malte (Malte).A. Études de casL’objectif de cette session est de souligner différents types de risques auxquels sont soumises certaines villeshistoriques de Méditerranée. Quels sont ces risques ? Quels outils sont mis en œuvre pour les surmonter ?=> Ville de La Valette (Malte) : les risques liés à la dégradation de l’héritage bâti, le projet de réhabilitation desquais.Intervention de Konrad BUHAGIAR, architecte (Architecture Project - La Valette)=> Ville d’Evora (Portugal): <strong>Qualicities</strong>, une démarche de progrès et un label européen.Intervention de M. José Ernesto D’OLIVEIRA, Maire d’Evora et de M. Raphaël SOUCHIER, Délégué générald’AVEC7
=> Ville de Pézenas (France) : La démarche Med Eco Quartier : Construire des quartiers durables enMéditerranée.Intervention de M. Alain VOGEL-SINGER, maire de Pézenas13h00 14h00 Déjeuner-buffet dans la cour de l’Ecole de la Photographie.14h00 14h45 B. Questions transversales- Le programme du Ministère de l’Ecologie pour la prévention du risque sismique.Intervention de M. Jacques FAYE, chef du bureau information & coordination interministérielle, sous-directionde la prévention des risques majeurs au Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et del'aménagement du territoire.- L’impact des tremblements de terre sur les constructions, les outils de restauration et de prévention.Intervention de M. Norbert AIGOIN, ingénieur.- Patrimoine urbain et développement durable.Intervention de Mme Maria LOPEZ DIAZ, Anah.14h45 15h00 : Débat15h00 16h00 : Réunion publiqueSynthèse des quatre sessions par les rapporteurs.Présentation du programme des Journées européennes du patrimoine par les représentants de la ville d’Arles.16h00 16h30 ConclusionsSéance placée sous la présidence de Monsieur Philippe AUSSOURD, Président de l’UATIAttentes des villes, questions prioritaires et suites à donner, M. Patrick MOROT-SIR, Directeur de l’Ecoled’Avignon(après concertation avec les représentants des villes invitées).16h30 17h00: Débat avec la salle17h00 17h30 : Clôture.La ville d’Arles vous invite à découvrir son patrimoine à travers des visites thématiques, des idées dedécouvertes artistiques, scientifique et ludiques du 18 au 21 septembre à l’occasion des Journéeseuropéennes du Patrimoine.8
Etudes de cas préparatoiresAVANT-PROPOSDes fiches ont été établies par des étudiants et les responsables de l'Institut d'urbanisme de Paris IV -Sorbonne à partir des sources d'information disponibles. Ces sources varient d'une ville à l'autre ce quiexplique que les fiches ne soient homogènes ni dans leur plan, ni dans leur contenu, ni dans leur présentation.Chacune d'elles représente cependant une synthèse des données significatives par rapport au thème del'Atelier.Les fiches réalisées ont été résumées par Tristan MOREL et relues par Guillemette PINCENT. Ces courtstextes sont là pour offrir une lecture rapide et synthétique du paysage urbain étudié.AUTEURS <strong>DE</strong>S FICHES :AN DIEP Thi MaiEKINEL EceGACEM FadilaGUETTOUCHE AtikaGUI<strong>DE</strong>Z EmelyneHENOCQ AntoineLECLERCQ OliviaLECOQ MarieLEVY AnnaMAZEAU SylvainMONTAGNE ClémenceMOREL TristanNESPOLA JulienPASCO MorganePATON ViolainePOPESCU AlexandraPRINCET MylèneROMER JohaneRUIZ LAZARO AngelaTREMEMBERT RozennAUTEUR <strong>DE</strong>S RESUMES <strong>DE</strong> FICHES :MOREL TristanSous la direction de Michel CARMONA et de Guillemette PINCENT.9
Alep (Syrie)Fiche réalisée par Rozenn TREMENBERT et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeAvec 1, 7 millions d’habitants dans la ville et 3,5 millions d’habitants dans l’agglomération, Alep est la deuxième ville laplus peuplée de Syrie après Damas, la capitale. Située au milieu du croissant fertile, Alep est une des plus anciennesvilles du monde, mais c’est à l’époque ottomane que se constitue en partie la trame actuelle de la ville. Aujourd’hui plusmoderne et plus tournée vers l’Occident que Damas, Alep s’impose comme la capitale du nord de la Syrie.Le patrimoine urbainLa Madîna est l’ancien centre de commerce hérité des Ottomans. Elle assure encore cette fonction dans un labyrinthede ruelles et de centaines de boutiques alignées côte à côte, sur 800 m de long. Elle regroupe des activités et desservices présents dans des galeries, des boutiques, des qaïsariyya , des hammams, des cafés, des mosquées et desmadrasa .Les éléments patrimoniaux sont de deux ordres : des monuments spécifiques (par exemple : porte d’Antioche, Grandemosquée, citadelle) et la trame urbaine insérée dans des waqf et constituée de souks, de khan . L’organisation de laville autour du commerce induit une spécialisation des quartiers par les commerces.Cependant, il existe un troisième aspect du centre ancien : les maisons privées, avec leurs intérieurs et leurs cours, quiont souvent un iwan et une qa'a .GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Municipalité et direction de l’ancienne ville (département particulier dépendant de la Municipalité).• État : direction générale des Antiquités et des Musées (Damas).• UNESCO, Fondation Agha Khan.La ville historique est classée et bénéficie d’un cadre juridique spécifique suivant le décret 192 en date du 16/08/1976.Les administrations responsables sont la Direction Générale des Antiquités et des Musées, et la Municipalité. La Loi surles Antiquités est un ensemble de mesures financées par l’Etat pour la protection de l’ensemble de la ville et desmonuments restaurés.Échelle localeLes quartiers historiques de la vieille ville, protégés et en grande partie classés, font l’objet d’une bataille entre lespromoteurs, la Municipalité et la Direction des Antiquités. Dans les quartiers populaires, des pièces sont ajoutées enhauteur ou à l’intérieur des cours. Dans les quartiers où les densités de populations sont les plus faibles vit une petitebourgeoisie mêlée d’immigrants ruraux. L’habitat ancien y est mieux entretenu par ses occupants, souvent propriétaires.Échelle nationaleLa Direction générale des Antiquités et des Musées est responsable de la protection des bâtiments classés.Échelle <strong>international</strong>eLa ville ancienne est inscrite depuis 1986 sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l'UNESCO.EXEMPLE D’OPERATION : UN PROJET <strong>DE</strong> REHABILITATION URBAINEEn 1992, le gouvernement allemand se joint à la République arabe syrienne pour démarrer un projet de réhabilitationdans l’ancienne ville. Les objectifs de ce projet sont de revitaliser le centre ancien en garantissant des ressourcesfinancières durables. Depuis le milieu des années 1990, d’anciennes demeures du quartier chrétien de Jdeidé sontréhabilitées puis transformées en hôtels, restaurants, ou bars de nuit.Sources :Bibliographie• DAVID J-C., <strong>DE</strong>LPAL C., Alep, passage vers l’Orient, Paris, Aedelsa, 2003, 128 p.Internet• Diplomatie.gouv.fr• Ovpm.org/fr/rep_arabe_syrienne/alep10
Amman (Jordanie)Fiche réalisée par Mylène PRINCET et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeAmman se trouve dans une zone vallonnée au nord-ouest de la Jordanie. Sa population est estimée à environ 2,4millions soit 38,8 % de la population du pays. Le début de la Première guerre mondiale a un impact considérable sur larégion, qui devient le point de mire de l’attention des pays occidentaux. Amman reste cependant une petite ville jusqu’àl’arrivée de réfugiés palestiniens qui quittent le nouvel Etat d’Israël en 1948. Une seconde vague de réfugiés a lieu en1967, lors de la guerre des Six Jours. Une troisième, en provenance du Koweït, vient grossir les rangs de la capitale en1991, après la Première guerre du Golfe. En 2003, après l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, un dernier flot d’immigrésarrive à Amman : il y aurait 750 000 réfugiés irakiens en Jordanie. Ces afflux participent directement au « boom » de laconstruction. La majorité des maisons sont construites sans permis, selon les possibilités de chacun. Elles sontrarement édifiées en une seule fois, mais sur plusieurs années.Depuis dix ans, la capitale, centre économique attractif dans une région politiquement instable, connaît une explosion denouvelles constructions au cœur même de la ville et dans ses périphéries (création de 5 villes nouvelles, annexées àAmman en 2007), ce qui s’accompagne d’une forte pression foncière. Cet accroissement rapide et continu met endanger les ressources en eau et nécessite un renforcement des infrastructures (logements, transports). Cedéveloppement urbain n’est pas maîtrisé par la municipalité. L’objectif du Master plan lancé en 2007 par la municipalitéest de remédier à ces dysfonctionnements. Il s’agit :• d’anticiper et d’accompagner la croissance urbaine dans le respect de l’identité d’Amman et de sonenvironnement ;• de donner rapidement un cadre aux investissements immobiliers ;• d’intégrer les nouvelles communes annexées.Une Interim growth strategy a d’abord été adoptée en 2007 pour répondre à la pression foncière et immobilière desinvestisseurs. Trois zones de « densification » en centre ville ou à proximité, ont été identifiées ainsi qu’une dizained’axes routiers, les Intensification corridors.Le patrimoine urbainLes principaux éléments patrimoniaux se trouvent dans les zones de Jebel Amman, Jebel Webdeh et Down Town. Lamunicipalité est en train de mettre en place une stratégie de gestion et de préservation de ces quartiers soumis à lapression immobilière, et donc au risque de destruction. Mais à l’échelle de l’agglomération, les problématiquespatrimoniales ne sont pas prioritaires, contrairement à celles liées à l’habitat insalubre et au coût du logement.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Associations/fondations.• Municipalité : Greater Amman Municipality (GAM).• Etat.• ONG, PNUD etc.Échelle localeAmman dispose d’un Plan de développement 2002-2006, peu à peu remplacé par le master plan qui devrait être adoptéen mai 2008. La Greater Amman Municipality (GAM) a des compétences élevées dans le domaine de l’urbanisme :entretien des routes, des espaces publics, du drainage des eaux pluviales, gestion des terminaux de bus et entretiendes abribus, délivrance des permis de construire, détermination du zonage urbain, collecte des déchets, fourniture desservices culturels. Le territoire de la municipalité est divisé en districts chargés dans la limite de leur zone géographiquede la gestion urbaine. Le partage des compétences entre la mairie centrale et les arrondissements est établi selon unerègle de subsidiarité : ce que les arrondissements ne peuvent pas faire est fait par la municipalité centrale (loi n°29,1955).Échelle nationaleLe gouvernement doit supporter les initiatives de développement national, suivre les plans économiques et de11
développement, se charger de la coopération financière, technique et économique avec les donateurs et lesorganisations <strong>international</strong>es. Une loi de 1971, connue sous le nom de Planning Law of 1971, pose les principes del’investissement du gouvernement dans l’aménagement du territoire, une collaboration entre les ministères et avec lesorganisations travaillant sur le terrain. Un Bureau des directeurs est nommé : il est chargé d’approuver les projets etd’évaluer les programmes nationaux. L’Etat conserve la compétence de l’habitat (organisme HUDC). Une UrbanUpgrading Strategy est prévue pour cinq quartiers informels de la ville. Des fondations créées par les souverains(Association King Abdullah, Queen Rania) soutiennent (voire initient) des projets caritatifs dont l’habitat ne constituequ’une partie.Échelle <strong>international</strong>e• Habitat for Humanity (HFH) est une institution caritative chrétienne américaine qui se donne pour missiond’éliminer l’habitat insalubre dans le monde depuis 1976. En Jordanie, HFH est présente depuis 2001 et travaille surtrois quartiers de la ville.• Depuis 1952, USAID (Agence américaine pour le développement <strong>international</strong>) a versé 4,4 milliards de dollarsdans la région. À Amman, USAID tente d’améliorer les conditions de vie des ‘urbains pauvres’.• L’ONU (Organisation des Nations Unies) est présente à travers l’United Nations Development Program (UNDP)et l’United Nation-Habitat (UNH). Grâce à un traité de coopération signé entre la Jordanie et les Nations Unies, l’ONUfinance des projets locaux de réhabilitation de logements. La question des camps palestiniens reste néanmoins unepriorité.• La Banque mondiale finance le projet du Amman Development Corridor. Les objectifs sont d’améliorer lesinfrastructures de transport et d’apporter un soutien technique au GAM.EXEMPLE D’OPERATION : LE MO<strong>DE</strong>LE D’EAST WAHDATCe programme, bien que commençant à faire date, a servi de modèle à la politique d’amélioration de l’habitat nonseulement à Amman, mais également dans toute la Jordanie. Le projet de East Wahdat devait proposer un typed’habitat adapté à une population défavorisée et devait répondre aux critères suivants :• Coût minimal du projet ;• Abaissement des standards de planification et de construction : les familles peuvent construire une pièce aprèsl’autre selon leurs besoins et leurs moyens ;• Subventions selon le respect des objectifs. Le projet est financé par 21% de fonds privés, 79% de fondspublics, dont 70% de fonds nationaux et 30% d’internationaux ;• Création d’un organisme compétent, l’UDD (Urban Development Department), qui apporte des expertisestechniques et suit le projet ;• Sécurité de la propriété : en encourageant un « squatter » à devenir propriétaire de son terrain, legouvernement l’incite à améliorer son habitat, puisqu’il n’est plus menacé d’expulsion ;• Limitation des démolitions, qui ne doivent servir qu’à la mise en place de VRD ;• Création d’emploi, auto-assistance, création de comités locaux.Sources :Bibliographie• BEL-AIR (de) F., Population, politique et politiques de population en Jordanie 1948-1998, Amman, IFPO, 2006.• DARMAME K., « Qui gère l’eau en Jordanie ? Les enjeux de l’introduction du secteur privé dans la gestion del’eau potable à Amman », Les Cahiers de l’Orient, n°75, 2004.• FUAD K., ABU DAYYEH N., The Condition of Physical Planning in Jordan 1970-1990, Amman, IFPO, Etudescontemporaines n°14, 2004.• Séminaire ACRALENOS, Analyse comparée des relations agricoles en libre-échange Nord-Sud, Montpellier, 19et 20 novembre 2004.Internet• Ammancity.gov.jo• Dos.gov.jo• Euromedheritage.net• Medact.com• Undp-jordan.org• Usaid.gov12
Gênes (Italie)Fiche réalisée par Clémence MONTAGNE et Anna LEVY, et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeGênes est située au nord-ouest des côtes italiennes sur le pourtour méditerranéen, dans la région de Ligurie. Elle est aucarrefour des routes terrestres des sillons alpins est-ouest et des routes maritimes. Bâtie à l’époque romaine, Gênes estune ville de taille moyenne : elle regroupe 660 000 habitants sur une superficie de seulement 250 ha. Elle fait cependantfigure de pôle pour une région économique d'un million d’habitants. Elle est également le premier grand port d’Italie (envolume).Le patrimoine urbainDans toute la ville, nombreuses sont les constructions témoins du passé antique et médiéval de Gênes. Outre unepériurbanisation accrue sur les monts de l’Apennin, on remarque l’étroitesse du cœur historique romain et un centremédiéval tourné vers le port (« Vieux port »). Le centre urbain historique est quasi intact malgré les pressionsdémographiques et urbanistiques, malgré le développement d’un centre-ville contemporain et la création d’un nouveauport industriel et commerçant.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Municipalité.• UNESCO.Échelle localeLa municipalité s’efforce depuis les années 1970 de réhabiliter les friches industrielles pour impulser une nouvelledynamique urbaine. Ces actions sont soutenues par plusieurs architectes de renom <strong>international</strong>, notamment RenzoPiano. La municipalité cherche en fait à se réapproprier les espaces maritimes en les intégrant à l’espace urbain, tout endéveloppant de nouvelles activités portuaires (trafic de conteneurs). Gênes a ainsi réaménagé son front de mer, surtoutcelui de son porto antico (vieux port) et a accompagné plus récemment ces transformations de la réhabilitation du centrehistorique. Les politiques municipales englobent les questions de préservation du patrimoine, de logement, de tourismeet d’infrastructures. Les objectifs sont de :• Relancer une dynamique démographique ;• Réhabiliter le bâti ancien (lutte contre le logement insalubre) ;• Mettre en œuvre une politique du logement.À l’occasion des 500 ans de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1992, le port historique estréaménagé et transformé en pôle culturel. Le port autonome a joué un rôle important dans cette opération, commedivers consortiums publics et privés qui sont intervenus sur le site. Des entrepôts et d’autres équipements portuaires ontété reconvertis en musée, cinéma, université, bibliothèques etc. Par ailleurs, les festivités de 1992 ont été l’occasionpour la ville d’entreprendre un travail de « cosmétique urbaine » dans les centres historiques (par exemple, la créationd’un complexe ludique et nautique pour dynamiser le tissu traditionnel du centro storico).Échelle <strong>international</strong>e• 2001 : le sommet du G8 à Gênes est l’occasion d’améliorer les espaces publics du centre historique.• 2004 : Gênes nommée capitale culturelle de l’Europe.• 13 juillet 2006 : inscription de Gênes sur la liste des sites culturels et naturels protégés par l'UNESCO.EXEMPLE D’OPERATION : UN PROJET <strong>DE</strong> RENOVATION PORTUAIRELe port de Gênes travaille en collaboration avec la municipalité. L’architecte génois, Renzo Piano, a dessiné le masterplan du futur port industriel de Gênes en 1992, à l’occasion des 500 ans de la découverte de l’Amérique. Ce programmede rénovation est réalisé par tranches successives. Pour le financer, une société dont les capitaux sont publics et privés,la Porto Antico Spa, est créée en 1995 par la ville, l’autorité portuaire et la chambre de commerce. Porto Antico Spa ainvesti environ 50 M euros.13
Sources :BibliographieALCAUD D., « La politique culturelle italienne : étude historique et sociologique de l’invention d’une politique publique »,in Patrimonialisation, rapport au patrimoine et question urbaine, Brouillon de recherche, Paris, CJB, 2004.BURE J., « La ville portuaire au XIX ème siècle, étude d’un objet historique méditerranéen. Essai d’analyse comparéesur les formes urbaines à Marseille et à Gênes, entre 1830 et 1900 », in Urbanistica Informazioni, n°67, janvier – février1983.Internet• www.porto.ge.it• www.provincia.genova.it14
Izmir (Turquie)Fiche réalisée par Morgane PASCO et Ece EKINEL, et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeIzmir est la troisième ville la plus peuplée de Turquie et le plus grand port après Istanbul. Située dans le golfe d’Izmir,sur la mer Egée, elle est la capitale de la province d’Izmir, dont elle est le chef-lieu. Selon le recensement de 2004, laville comporte 1 985 300 habitants, son agglomération 2 411 500 et la province d’Izmir 3 400 000. C’est la zone la plusdensément peuplée de Turquie. La mairie métropolitaine d’Izmir est composée de neuf districts métropolitains qui enfont une ville polynucléaire.Le patrimoine urbainIzmir reflète surtout l’image d’une métropole moderne reconstruite après le grand incendie de 1922. Malgré les aléasd’une histoire mouvementée, la permanence du port a maintenu une continuité urbaine et commerciale. La redécouvertedu patrimoine de la ville, qui doit beaucoup à l’action de l’ancien maire Ahmet Piriştina, a conduit à une série derestaurations qui concernent plusieurs sites. Mais la vocation première d’Izmir n’est pas touristique car elle conserve trèspeu de monuments antiques, en dépit de la restauration de son agora. Les vieilles maisons levantines du quartierd’Alsancak et celles du quartier de Konak sont pour la plupart restaurées, mais c’est surtout le vieux bazar qui attire lesvisiteurs.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Municipalité : municipalité du Grand Izmir (IBB : Izmir Büyüksehir Belediyesi) et districts (Konak).• Etat.Échelle localeDepuis 2006, la réhabilitation du patrimoine est annoncée comme une action prioritaire de la municipalité. L’objectif estde développer l’activité touristique et commerciale. De nombreux projets sont prévus. Un seul a été réalisé : il s’agit dela réhabilitation des façades situées dans les rues de Göztepe Kilise et des rues numéro 133-141. Le site étant classéen zone de protection, il a fallu avoir l’accord de la commission de protection. Cette dernière a récemment donné un avispositif pour le projet. Ce programme est financé par l’IBB.Échelle nationaleL’Etat est très actif dans le domaine de la construction de logements (sociaux ou en accession) par le biais du TOKI(Etablissement public de logements collectifs), dont l’intervention est limitée aux projets de plus de 400 logements. Parconséquent, l’Etat ne peut pas intervenir sur les projets de réhabilitation résidentielle de faible ampleur. À Izmir, TOKIest souvent le seul investisseur dans la construction de nouveaux logements. Il agit avec ses fonds propres. Pour lefinancement de projets de construction de moins de 400 logements, l’intervention d’un autre organe étatique, EmlakKonut, peut cependant être envisagée. Enfin, les projets de réhabilitation du patrimoine classé ou inscrit peuventrecevoir des subventions du ministère de la culture et du tourisme.Échelle <strong>international</strong>eLe Centre franco-turc de recherches historiques collabore avec les institutions existantes (IBB, districts, chambre decommerce d’Izmir, ministère des affaires étrangères, Institut français d’études anatoliennes, Institut national d’histoire del’art à Paris) pour apporter des moyens, développer la recherche et diffuser des connaissances historiques sur Izmir.Dans le cadre de la candidature de la ville pour l’exposition <strong>international</strong>e de 2015, le Centre s’efforce de mettre envaleur le patrimoine architectural.EXEMPLE D’OPERATION : LA REHABILITATION <strong>DE</strong> L’AGORALa ville d’Izmir a entrepris un plan de réhabilitation du site historique de l’Agora, actuellement classé en zone deprotection de premier degré : tous les travaux sont soumis à l’autorisation de la commission nationale de protection dupatrimoine. L’objectif est de revitaliser le secteur par la mise en place d’équipements et de nouvelles activités. Un parcarchéologique et historique accueillera des espaces d’expositions et de vente de produits artisanaux. Des bâtimentsclassés et réhabilités seront transformés en bibliothèques ou ateliers. Un bureau d’accueil touristique sera créé.15
Sources :Bibliographie• Mairie Métropolitaine d’Izmir, Rapport stratégique d’Izmir 2006-2007, 2006.• TOKI, Étude d’impact du projet d’Uzundere, 2005.• Université de Bogazici et Ville d’Izmir, Etude du risque sismique et master plan du tremblement de terre, 2000.Internet• www.egekoop.gov.tr : site d’Ege-Koop (association de coopérations de production du logement de masse).• www.izmir.bel.tr : site de la Mairie Métropolitaine d’Izmir.• www.izmir.gov.tr : site de la préfecture de la ville d’Izmir.• www.izmirturizm.gov.tr : site touristique d’Izmir.• www.kultur.gov.tr : site du Ministère de la Culture et du Tourisme Turc.• www.toki.gov.tr : site d’établissement national pour logement de masse.16
La Valette (Malte)Fiche réalisée par Sylvain MAZEAU et Thi Mai An DIEP, et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeLa Valette (6135 habitants en 2005), capitale de la République de Malte, se situe sur la côte orientale de l’île de Malte.La ville entourée de courtines et de bastions est située sur un promontoire et s’étend sur 1,25 km de long depuis laPorte de la ville jusqu’au bout de la péninsule où se situe le fort de Saint Elme. Dans les années 1960, des programmesextensifs de construction de logements sociaux ont été réalisés. Jusqu’à la moitié des années 1980, les espacesurbanisés augmentent de 347 % sur le territoire maltais. Les années 1990 sont marquées par un faible nombre denouvelles constructions réalisées dans la région du Grand Harbour : la forte pression foncière, liée à l’exiguïté du site,rend aujourd’hui difficile la construction dans le cœur de la ville.Le patrimoine urbainLa Valette ressemble encore beaucoup à la Cité des Chevaliers de l’Ordre de Malte, son aspect extérieur n’ayant guèrechangé depuis 1798. À l’intérieur de l’enceinte, la ville se caractérise par un tissu très serré et régulier, à l’exception despetits jardins publics qui ont été aménagés sur les fortifications. 320 édifices religieux et politiques de l’Ordre (XVI, XVIIet XVIII ème siècle) sont classés et groupés sur une surface de 55 hectares. Mais faute de ressources financières et demain d’œuvre qualifiée, de nombreux immeubles sont en mauvais état. De plus, l’obligation de loyers bas ne permet pasaux propriétaires d’avoir des entrées d’argent assez importantes pour maintenir leur immeuble dans un état décent.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Etat maltais et comité de réhabilitation (VRC - Valletta Rehabilitation Committee).• Union européenne.Échelle locale et nationalePar son statut de capitale nationale et de centre historique de premier plan, La Valette bénéficie en priorité desattentions de l’Etat à travers sa politique de rénovation. En 1987, un Comité de réhabilitation (VRC) est créé par RayBondin (ICOMOS Malte) au nom du gouvernement maltais. Cet organisme est responsable de la mise en valeur de laville, gère les projets de rénovation urbaine à travers le Valletta Rehabilitation Project (VRP) et s’occupe des demandesde permis de construire. Cet outil dispose de sa propre organisation administrative, d’un groupe d’architectes etd’employés. Il bénéficie d’un budget annuel de 200 000 Lm (soit 464 560 €) voté par le Parlement. De plus, le ministèredu logement, Housing Authority (1976) met en place des programmes de renouvellement urbain et donne dessubventions pour favoriser l’accès à la propriété. Le budget annuel alloué par le Housing Authority aux opérations deréhabilitation et de rénovation est passé de 700 000 Lm en 1994 à 3 000 000 Lm en 2000. Enfin, le MEPA (MaltaEnvironment and Planning Autority) intervient dans des opérations de rénovation et de requalification du patrimoine bâtià travers un plan mis en place en 1992 : un zonage définit par exemple les espaces de conservation urbaine. En 1992,le MEPA met en œuvre un plan local d’aménagement du Grand Harbour (réhabilitation du tissu industriel). Tous cesorganismes ont rarement d’actions coordonnées, d’où une absence de plan de gestion urbaine à l’échelle de La Valette.Échelle <strong>international</strong>e• Depuis le 5 septembre 1980, la ville figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.• Programme Euromed Heritage II (2002-2005) Ikonos, mené par le Malta Centre for Restoration (1999), financépar l’UE (3 millions d’euros). Un des objectifs est la formation d’experts sur les techniques de restauration.• Programme Interreg III (PAGUS) mené par l’UE, financé à 75% par la FE<strong>DE</strong>R (budget total : 7 millions d’euros),coordonné par le VRP. Les objectifs sont la réhabilitation du centre historique tout en maintenant les populations grâce àune politique de logements et le développement de l’activité commerciale et touristique.EXEMPLE D’OPERATION : PROGRAMME DU CONSORTIUM VISETVISET (consortium privé, bail de 65 ans), en accord avec le gouvernement, va réhabiliter et restaurer les bâtiments dufront de mer le Pinto Stores, Caraffa Stores et l’Old Power Station pour créer un terminal de croisière et renouveler lacôte nord du Grand Harbour. Valletta Waterfront Cruise Liner Terminal est mis en oeuvre dans le cadre du TransitOriented Development Strategy menée par le Ministère maltais pour le Développement urbain et les routes. Le projet estlancé en 2001.17
Sources :Bibliographie• BLONDY A., L’Ordre de Malte au XVIII ème siècle, des dernières splendeurs à la ruine, Paris, ÉditionsBouchène, 2002.• BONDIN R., Les nouvelles de l’OVPM, La Valette, 2000, n°17, août 2000.• Documents UNESCO.• MEPA, Structure Plan for Maltese Islands: Housing topic paper, février 2002.• National Statistics Office of Malta, Census of population and housing, La Valette, 2006.• PAGUS 2D SEMINAR, The Socio-Economic Value of Historic Fortified Cities, discours d’ouverture par NinuZammit, Ministre maltais des ressources et des infrastructures, 4 Novembre 2006 à Malte.• XUEREB M., Making transport in Malta sustainable, The Malta Independent, 30 avril 2007.Internet• Ministère maltais pour le Développement Urbain et les Routes18
Perpignan (France)Fiche réalisée par Julien NESPOLA et Alexandra POPESCU, et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villePerpignan est une commune située dans la région Languedoc-Roussillon, dans le département des Pyrénées-Orientales, à 12 km de la mer Méditerranée et à 27 km de la frontière espagnole. La ville s’étend sur une superficie de68,07 km2 et compte 116 700 habitants en 2004, pour une densité de population de l’ordre de 1544 habitants par km².Perpignan est aussi le centre d’une communauté d’agglomération de 215 550 habitants (2006). Elle concentreaujourd’hui la majorité des habitants du département.Le patrimoine urbainLe centre ancien garde les traces de l’Antiquité romaine avec la présence de monuments civils. Mais c’est le Royaumede Majorque qui est principalement à l’origine des éléments majeurs de son patrimoine, avec des maisons patriciennesdu XIV ème siècle ornées de peintures murales. Le quartier populaire Saint-Jacques est le cœur historique dePerpignan, il abrite la majorité des monuments de la vieille ville. Déserté par la bourgeoisie, il abrite désormais desfamilles plus modestes, notamment une importante communauté gitane, (plus de 40% des habitants sont des gitans) etmaghrébine. Le parc immobilier vétuste ne peut être entretenu par une population en état de précarité. Mais aux margesdu quartier subsistent des immeubles qui n’ont cessé d’être occupés par une population bourgeoise et on constate parailleurs une lente reconquête entreprise par des habitants plus aisés par le biais de rénovations ponctuelles de certainsimmeubles. Une vaste opération de renouvellement urbain centrée sur la mixité sociale est actuellement en cours.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Communauté d’agglomération, mairie de Perpignan.• Organismes HLM.• Etat.Échelle localeEn partenariat avec les acteurs du développement urbain, la Ville de Perpignan a lancé un vaste projet de rénovationurbaine qui concerne 1 200 logements. Il s’agit de mettre en valeur le patrimoine bâti tout en répondant à une fortedemande de logements. Lors de la réhabilitation de l’hyper-centre, des logements dits «tiroirs» sont créés le temps derénover certains îlots (quartier St Jacques) et de reloger ensuite les populations dans des logements décents. Il estégalement possible de jouer sur la vacance assez forte dans ces quartiers (jusqu’à 30% des logements). Les grandsensembles de la périphérie seront également traités, soit en réhabilitation, soit en destruction/reconstruction. Ce plan derénovation urbaine prolonge et amplifie l’Opération de rénovation urbaine (ORU) en cours.De plus, l’un des plus grands secteurs sauvegardés de France (100 hectares) a été créé. Dans le périmètre élaboré parl’Etat, les programmes de rénovation et d’aménagement sont encadrés par un Plan de sauvegarde et de mise en valeur(2003). Ce statut confère des avantages fiscaux aux propriétaires qui entreprennent des opérations de rénovation. Tousles travaux effectués par les résidents doivent faire l’objet d’une demande écrite et d’une autorisation après avis d’unArchitecte des bâtiments de France (ABF).La ville s’est également dotée d’une convention « Villes d’art et d’histoire » pour bénéficier des compétences etressources des services de l’Etat et de différentes collectivités.Échelle nationaleL’Agence Nationale de l’habitat (Anah) apporte son soutien aux propriétaires bailleurs. La Ville de Perpignan s’attacheainsi à délivrer des subventions pour les propriétaires occupants qui investissent pour s’assurer un meilleur cadre de vie.La signature d’une convention entre la ville et l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) permet lefinancement de projets de réhabilitation. Le PNRU est un programme urbain global lancé depuis dix ans dans lesquartiers d’habitat social.19
Séville (Espagne)Fiche réalisée par Angela RUIZ LAZARO et Vilaine PATON, et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeSéville est la capitale de la Communauté autonome d’Andalousie. La ville s’étend sur près de 140 km² et compte 704414 habitants. Elle est le centre d'une agglomération de 1 460 km² qui regroupe 1 182 480 habitants. Le centrehistorique, d’une superficie de 349 ha, compte 56 804 habitants (recensement 2003), soit 7,96 % de la population de laville et moins de 5% de la population de l’aire métropolitaine. Séville est le premier centre économique du sud del’Espagne. Située sur les rives du Guadalquivir, au cœur d’une riche et fertile région agricole, la ville est le principal portfluvial d’Espagne. Le tourisme est une activité essentielle à son économie. En 2006, la ville a reçu près de 2,7 millionsde touristes.Le patrimoine urbainHéritière d’un passé riche et prestigieux, Séville possède un patrimoine historique dont la diversité témoigne desdifférentes étapes de son évolution. C’est surtout l’enjeu touristique qui fait l’attractivité du vieux centre de Séville,encadré par un plan de protection mis au point par la municipalité. Face au vieillissement de la population et à la perted’habitants, la priorité est aujourd’hui de mettre en œuvre une politique de réhabilitation, d’occupation des bâtimentsvacants, de construction de nouveaux logements, en limitant les résidences secondaires et la spéculation. Sévillepossède une gestion avancée de son patrimoine urbain, qui inclut les monuments mais aussi le cadre urbain dans saglobalité. Toutefois, depuis les grands chantiers de l’Exposition universelle (1992), l’absence de grands projets semblesouligner un certain ralentissement des dynamiques urbaines.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Mairie de Séville.• Conseil de Culture de la Junta de Andalucía (gouvernement autonome régional).• Ministère de la culture.• UNESCOÉchelle localeLa mairie de Séville (ayuntamiento) a compétence en matière d’urbanisme et de conservation du patrimoine. Elledispose d’un document cadre, le Plan General Municipal de Ordenación Urbanística (plan général d’aménagementurbain), approuvé en 2006 par le Conseil des travaux publics et transports de la Junta de Andalucía. Ce plan contient unvolet qui traite de la politique patrimoniale. La délimitation actuelle du périmètre de protection, approuvé en 1990 par leConseil de la culture et de l’environnement de la Junta de Andalucía, inclut la ville intra muros, mais aussi la périphériehistorique (arrabales) et les réalisations de l’Exposition ibéro-américaine de 1929, ainsi que les alentours de monumentsisolés. Le document porte sur les « ensembles historiques », les « espaces urbains remarquables » et le « patrimoinearchéologique ». Il privilégie les réhabilitations des bâtiments et la réaffectation du patrimoine bâti inoccupé. Lesdémolitions/reconstructions sont encouragées lorsque des bâtiments qui n’ont pas de valeur intrinsèque sont fortementdégradés ou lorsque la réhabilitation ne permet pas de résoudre des problèmes d’insalubrité.Échelle régionaleLes Communautés autonomes, à travers leurs statuts (Estatutos), ont des compétences en matière de patrimoinehistorique, artistique, archéologique et scientifique. La Junta de Andalucía a rédigé sa propre législation sur la protectiondu patrimoine historique. Le Conseil de Culture (Consejería de Cultura) de la Junta de Andalucía est compétent enmatière de gestion des biens culturels andalous. Les lignes principales d’action sont la protection, la conservation et larestauration, ainsi que la recherche et la diffusion des savoirs. Le Conseil dispose de plusieurs services (direction de laprotection, conservation et travaux, direction de la recherche et de la diffusion du patrimoine historique, direction de laplanification générale des biens culturels, institut andalou du patrimoine historique) qui ont pour mission de conseillerl’action municipale.Échelle nationaleLe ministère de la culture a la charge de la protection du patrimoine espagnol. Deux organismes sont chargés de cette20
protection au sein du Ministère : la sous-direction générale de l’Institut du patrimoine historique espagnol a pour missionl’élaboration de plans pour la conservation et la restauration, la mise au point de techniques modernes de restauration,la recherche documentaire, la diffusion et l’échange avec des organismes internationaux. La sous-direction générale deprotection du patrimoine historique est quant à elle responsable de l’application du régime juridique de protectionpatrimoniale.Échelle <strong>international</strong>eLe principal acteur <strong>international</strong> de la gestion du patrimoine urbain à Séville est l’UNESCO. La Cathédrale, l’Alcazar etl’Archivo de Indias ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en 1987.EXEMPLE D’OPERATION : LA REVITALISATION ARTISANALELe Plan général d’aménagement urbain privilégie l’action sur de petits périmètres, à l’échelle de l’îlot. Un de ses objectifsest d’éviter la disparition de l’activité artisanale du secteur nord-ouest du centre historique, notamment dans l’îlot Mallol,dans lequel se trouve une mixité habitat-industrie artisanale. Il s’agit de conserver cette mixité tout en améliorant lesconditions d’habitation, d’hygiène et de services. Des bâtiments représentatifs de l’architecture industrielle du XIX èmesiècle vont être réhabilités, les autres seront démolis et reconstruits, ce qui permettra de mettre en valeur le couvent deSanta Paula et de construire des parcs de stationnement souterrains.Sources :Bibliographie :• BAIRD D., SYMINGTON M., TSIDALL N., Séville et l’Andalousie, Paris, Hachette, 2003.Internet• Ayuntamiento (Municipalité) de Séville• Junta de Andalucía, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico• Ministerio de Cultura, Área de patrimonio histórico• UNESCO, Centre du patrimoine mondial21
Split (Croatie)Fiche réalisée par Morgane PASCO, et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeFace à la mer Adriatique et à la péninsule italienne, Split est située au fond d’une baie portuaire de la côte dalmate, ausud de la Croatie. Après la Seconde guerre mondiale, elle devient un pôle commercial et culturel, accueillant uneimportante population issue de l’exode rural qui trouve du travail dans les usines nouvellement construites. Pendant lapériode 1945-1990, la population triple et la ville s’étend. Selon le dernier recensement (2001), la région de Dalmatiecompte 4 437 000 personnes : 300 000 sont établies dans l’agglomération de Split et 190 000 habitants dans la villemême. Celle-ci est actuellement la deuxième ville de Croatie en termes de population.Le patrimoine urbainD'une étendue presque comparable (30 000 m² et 20 000 m²), les deux noyaux médiévaux de Split se touchent. Tousdeux sont parcourus de ruelles étroites qui s'articulent autour de places. Sur le site de l'ancien palais de Dioclétien - unrectangle irrégulier - la disposition des rues médiévales respecte le croisement de voies romaines. Le plan du quartiervoisin, pour sa part, reflète une organisation spatiale médiévale plus spontanée.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Municipalité.Échelle localeLes responsables de la protection du complexe historique de la ville de Split sont la municipalité et ses servicestechniques : l’Institut pour la protection de l’héritage culturel de Split, l’Institut d’urbanisme de Dalmatie à Split et l’Institutd’urbanisme de la ville. Le Conseil municipal pour la protection du patrimoine culturel et naturel est l’organe local encharge de la protection patrimoniale de la ville de Split, élaborée en fonction de l’article 111 de la loi sur la protection etla préservation des biens culturels de la République de Croatie (1999). Parmi ses compétences, nous pouvons citer :• Recherche et identification du patrimoine culturel et naturel ;• Mise en place des mesures de protection patrimoniale culturelle et naturelle ;• Attribution des autorisations et permis de construire : en 1999-2000, un "Code des conditions requises àl’acquisition d’un permis pour des travaux de conservation" a été créé. Depuis le Plan général urbanistique (GUP, 2005)de la municipalité, les zones de construction ont diminué de 30% par rapport aux plans précédents ;• Réalisation des mesures de conservation.Une partie des ressources nécessaires au financement de la préservation des biens culturels provient des revenusannuels (à hauteur de 60%) des monuments situés sur le territoire de la municipalité.Échelle nationaleQuelques textes de référence :• Législation sur les Bibliothèques (1997) ;• Législation sur les Musées (1998) ;• Code des conditions requises pour de la recherche archéologique de monuments culturels à l’intérieur duterritoire et des eaux territoriales de la République de Croatie (1998) ;• Code des conditions requises à l’acquisition d’un permis pour des travaux de conservation (1999-2000) ;• Loi de protection et de préservation des biens culturels (1999) ;• Registre des biens culturels de la République de Croatie (2001).Les institutions : Le travail de protection et de préservation du patrimoine culturel est réparti entre plusieurs institutions etorganismes : le ministère de la culture, la direction de la protection du patrimoine culturel, l’Inspection du patrimoineculturel (Division INDOC du Patrimoine culturel. Ces institutions s’attèlent à mettre en œuvre le programme national deprotection et de préservation des biens culturels, financé par le ministère de la culture (Total dédié à la protection dupatrimoine culturel en 2001 : plus de 16 millions d’euros. Source : réseau européen du patrimoine, mai 2007). Lasélection des sites de protection financés par le ministère se fait une fois par an en présence d’une commissiond’experts. Le résultat est ensuite soumis au Conseil croate pour les biens culturels qui finalise le choix à soumettre auministère de la culture : une triple sélection est donc opérée par les principales instances de protection patrimoniale.22
Échelle <strong>international</strong>e• La loi de 1999 s’applique à tous les biens culturels de la République croate, elle est inscrite dans saConstitution et respecte les normes <strong>international</strong>es de protection.• L’UNESCO a inscrit en 1979 le centre historique de Split et le palais de Dioclétien sur la liste du patrimoinemondial de l’humanité.Sources :Bibliographie• Central Bureau of Statistics, Statistical information 2006, Republic of Croatia, Zagreb, Longae Salonae, 2006.• PAVICI J., « Croatie : la côte dalmate au péril du tourisme et de l’urbanisation », Jutarnji List, 20 janvier 2006(propos traduits par Ursula Burger Oesch).• ROSSI A., L’architecture de la ville, Milan, éd. L’équerre, collection « Formes urbaines », 1981.Internet• Bureau central des statistiques de la République de Croatie• Réseau européen du patrimoine23
Tel-Aviv (Israël)Fiche réalisée et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeLa ville de Tel-Aviv-Jaffa est située au centre de la côte méditerranéenne d’Israël. Elle compte environ 384 600habitants (2006), et son agglomération - Gush Dan - entre 2,5 et 3 millions de résidents israéliens. Tel Aviv est lacapitale économique d’Israël. La forme de Tel-Aviv est le résultat de développements urbains successifs. Neve Zedekfut la première installation juive au nord de Jaffa à la fin du XIX ème siècle. Vingt ans plus tard, Achuzat Bayit est fondéeplus au nord. Plusieurs installations de plus en plus structurées sont créées par la suite. La planification puis laconstruction de la Ville Blanche sont issues de ce mouvement. Le premier plan directeur pour une nouvelle implantationurbaine, établi par Sir Patrick Geddes, est adopté en 1925. La réalisation commence au début des années 1930 et sepoursuit jusqu’aux années 1960. Les concepteurs étaient des architectes fraîchement immigrés qui avaient été formésen Europe, notamment à l’école allemande du Bauhaus.Le patrimoine urbainIl fallait loger d’urgence d’importantes populations immigrées. La première flambée de construction, dans les annéestrente et quarante, concrétise l’adaptation des idées modernistes au contexte local, grâce à ce groupe d’architectes quifait appel à des solutions techniques rapides et bon marché (béton armé). Ses activités ont un impact direct sur lespolitiques de planification municipales et Tel-Aviv devient un modèle local du style moderniste. À Tel-Aviv, près de 90 %des 2500 immeubles de style Bauhaus dans la Ville blanche sont des propriétés privées. Or Les droits des propriétaires,y compris les droits d’extension, sont très forts en Israël. Par conséquent, même les constructions protégées récemmentsont susceptibles d’être modifiées par des ajouts illégaux. De plus, l’État est responsable de la préservation des sites dupatrimoine antérieurs au XVIII ème siècle : le patrimoine bâti des périodes ultérieures est donc protégé par d’autrestypes de mesures et d’institutions.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Particuliers ;• Bauhaus Center ;• Municipalité ;• UNESCO.Échelle localeLa municipalité est responsable de la protection des zones urbaines historiques. Le Plan de conservation, en coursd’approbation, sera un instrument juridique qui assurera la protection de la zone historique de Tel-Aviv et des bâtimentsclassés. Il existe cependant d’autres instruments juridiques : les réglementations des plans d’urbanisme historiques(Geddes, 1927/1938), le Plan directeur de Tel-Aviv (1965), l’Ordonnance de Tel-Aviv 2659 b (2001). Lesinvestissements municipaux consacrés aux projets de rénovation sont attribués aujourd’hui à la réhabilitation desinfrastructures et des voies de communication :• Aménagement de pistes cyclables (7 millions de dollars) ;• La rénovation de l’infrastructure de la ville (25 millions de dollars) ;• La réhabilitation prévue de la place Dizengoff (centre de la ville blanche) comprenant l’établissement du projetet les travaux de conservation (27,5 millions de dollars).Faute de financement suffisant, la municipalité doit se tourner vers les investisseurs privés, acteurs fondamentaux de laprotection du patrimoine : grâce à la réglementation municipale des ajouts en toitures, les propriétaires ont déjà réaliséla restauration de 50 immeubles en 2001-2002 (12,5 millions de dollars, dont 15 % d’aide municipale). Au total, 400immeubles ont été rénovés. La municipalité subventionne des prêts à 4 ans au maximum. Des réductions d’impôts sontprévues et la création d’un fonds de préservation de la ville est envisagée.Échelle nationaleAucune entité gouvernementale n’est directement impliquée dans la politique du patrimoine à Tel-Aviv. Mais il existe :• un Plan directeur national TAMA 35 qui comporte une partie intitulée « Plan de conservation urbaine du centrede Tel-Aviv - Jaffa » (1991-1997) ;24
• un Plan directeur régional TMM 5, principal instrument juridique pour la protection de la zone urbaine de Tel-Aviv.Échelle <strong>international</strong>eEn juillet 2003, Tel-Aviv a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, revendiquant le plus grandnombre de bâtiments Bauhaus dans le monde.EXEMPLE D’OPERATION : LA CREATION D’UN PLAN GLOBALActuellement, un plan global pour l’agglomération de Tel-Aviv-Jaffa est en cours d’adoption. Ce « Plan Stratégique pourTel-Aviv Jaffa » rassemble les documents produits depuis 5 ans sur les projets et les études faits sur la ville. Il estsignificatif du travail de réflexion que les équipes municipales et associatives ont lancé sur l’attractivité de la ville.Sources :Bibliographie• ICOMOS, Fiche d’évaluation sur Tel Aviv, Paris, n°1096, mars 2003.• Documents et entretien au Bauhaus Center de Tel Aviv.Internet• www.tel-aviv.gov.il : site de la Mairie de Tel-Aviv (avec leStrategic Plan for Tel-Aviv Yafo, City Profile).• www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=141 : site du Bureau central de statistique d'Israël.25
Thessalonique (Grèce)Fiche réalisée par Olivia Leclercq et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeThessalonique (800 764 habitants en 2001) se situe au nord de la Grèce au fond du golfe de Salonique, dans unerégion exposée au risque sismique. Thessalonique est la deuxième plus grande ville grecque après Athènes, elle est parailleurs la capitale du nome de Thessalonique. En 1890, un premier feu vient détruire le coeur historique, ensuitereconstruit. À la fin du XIX ème siècle, la ville est divisée en deux, avec un quartier européanisé dans le centrehistorique et des quartiers plus populaires à l’habitat vieilli au-delà. Le grand incendie en 1917 détruit une grande partiede la ville qui est alors restructurée et s’étend considérablement après la seconde guerre mondiale et dans les années1960.Le patrimoine urbainL’histoire multiculturelle de Thessalonique s’étend sur 23 siècles et la ville en garde aujourd’hui de nombreuxtémoignages architecturaux. Dans le centre-ville, des structures très anciennes cohabitent avec des constructions desannées 1960, uniformes, en béton. De nombreuses constructions précaires et dégradées jalonnent Thessalonique, plusparticulièrement dans la partie ouest de l’agglomération et au nord du centre-ville historique. Ce dernier n’accueille plusles activités portuaires mais est dédié aux activités commerciales et touristiques. Il se divise entre la partie sud, pluseuropéanisée et commerciale, et la partie nord, où se trouve une majorité de logements souvent dégradés. Lespropriétaires sont nombreux mais souvent modestes.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Sociétés d’économie mixte d’aménagement ;• Entreprise publique de l’urbanisme et du logement (<strong>DE</strong>POS) ;• Municipalité (dème) ;• Département, région ;• Etat : ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics ;• UNESCO ;• Union Européenne.D’une manière générale, la gestion du patrimoine urbain est entre les mains d’institutions éclatées qui deviennentconcurrentes pour acquérir d’importantes subventions de l’Union européenne.Échelle localeCe sont surtout les régions qui doivent exécuter les stratégies publiques en matière d’urbanisme. Il existe ainsi unschéma directeur de la Région de Thessalonique. Les collectivités locales interviennent pour exercer des compétencessurtout consultatives, mais aussi, plus récemment, des compétences décisionnelles (délivrance des permis deconstruire). En termes de financement, la municipalité est largement dépendante de subventions nationales ou<strong>international</strong>es. La rénovation du patrimoine urbain reste un enjeu secondaire des politiques locales, plutôt axées surdes aspects sociaux et environnementaux que culturels et architecturaux. Le patrimoine historique et culturel estlégalement protégé, mais peu d’opérations visent sa réhabilitation.Échelle nationaleLes compétences en matière d’urbanisme sont exercées par le ministère de l’environnement, de l’aménagement duterritoire et des travaux publics, et à titre subsidiaire, par le ministère de l’agriculture, de l’industrie ou de la culture.D’autres instances ont été mises en place pour réaliser des interventions d’urbanisme spécifiques ; elles fonctionnentsous la forme de sociétés d’économie mixte d’aménagement ou d’entreprises publiques, comme l’entreprise publique del’urbanisme et du logement (<strong>DE</strong>POS). L’Etat est seul responsable de la protection du patrimoine historique. Il gère lesmusées et délivre les autorisations nécessaires aux opérations qui touchent au patrimoine historique de la ville. Il existeenfin un système de récompense pour les personnes qui effectuent des recherches archéologiques.Échelle <strong>international</strong>e• Le programme URBAN de l’Union européenne : le secteur ouest de Thessalonique est classé Urban 1. Lesobjectifs visés sont l’amélioration des infrastructures, des équipements et de l’environnement en vue du développementde l’activité économique.26
• Le programme REHABIMED de l’Union européenne : dans le cadre du programme Euromed Heritage, desprojets de réhabilitation sont financés.• De nombreux monuments de Thessalonique ont été classés sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO enseptembre 1988.EXEMPLE D’OPÉRATION : UN PROJET PILOTE (PRD)• La zone d’intervention du PRD (Pilot Project for the Renewal and Development of the Historical andCommercial Centre of Thessaloniki) couvre un périmètre d’environ 500m². Le programme fut initié à partir de juin 1991et réalisé à partir de mars 1996.• Il s’agit de développer un projet intégré, liant des partenaires privés et publics pour mettre en valeur l’héritagehistorique et culturel du centre-ville. Une équipe d’experts coordinatrice est créée.• Le projet cherche à encourager le renouvellement urbain à travers plusieurs opérations : une analyse deséquipements urbains et de leur potentielle nouvelle utilisation, des restaurations de monuments, des rénovationsd’immeubles.• La majeure partie du financement provient de la ville et du ministère de la culture, qui bénéficient d’aideseuropéennes : l’Union européenne finance près de 80% du coût total du projet.• Le projet a réuni la Région, la municipalité, l’université, une banque et deux corps professionnels. L’opérationaméliore les infrastructures touristiques, ce qui ne touche qu’indirectement la population résidente, avec des retombéeséconomiques destinées seulement à ceux qui travaillent dans le tourisme.27
Tlemcen (Algérie)Fiche réalisée par Atika GUETTOUCHE et Fadila GACEM, et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villePeuplée de près de 250 000 habitants, la ville de Tlemcen, chef-lieu de la wilaya du même nom, se situe à plus de 800mètres d’altitude, au nord-ouest de l’Algérie, à 63 kilomètres de la frontière marocaine. Au cœur d’une région de vigneset de culture d’oliviers, Tlemcen est réputée pour ses cuirs, ses tapisseries et son industrie textile.Le patrimoine urbainLa croissance urbaine de Tlemcen s’organise, comme pour la plupart des villes algériennes, à partir de deux modesd’occupation de l’espace, l’un planifié par les documents d’urbanisme, l’autre illicite. À partir de la seconde moitié du XXème siècle, la ville connaît une forte croissance démographique. Aujourd’hui la population subit une crise socialemarquée par le chômage, ce qui a pour corollaire la dégradation des conditions de vie et une précarisation de l’habitatqui n’épargne pas la médina. Comme celle-ci concentre encore des activités commerciales et industrielles intenses, leshabitants de la vieille ville refusent généralement de quitter leurs maisons, même s'ils se savent incapables d'assumerleur restauration et la facture des travaux spécialisés. Les replâtrages ne font que couvrir l’état de dégradation du bâti.Les risques qui pèsent sur les habitants et sur le patrimoine bâti de la médina restent importants.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Associations locale ;• Ministère de l’habitat et de l’urbanisme ;• Ministère de la Culture et commission nationale des biens culturels, présidée par la Ministre de la culture ;• Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques.Échelle localeLes autorités locales ne peuvent pas prendre en charge les lourds chantiers de restauration qui nécessitent de l'argentet un encadrement spécialisé. Par conséquent, l’évolution du tissu urbain s’est poursuivie de manière anarchique, sansque les autorités à l’échelle locale ne réagissent. Les urbanistes et défenseurs du patrimoine insistent cependant sur lanécessité d'une approche globale pour la sauvegarde de la médina. De nombreuses associations ont vu le jour. Ellesoeuvrent pour la sensibilisation de la société civile, pour la protection et la mise en valeur du patrimoine de Tlemcen, parexemple en se portant partie civile lors de procès. Elles peuvent aussi faire partie de la Commission nationale des biensculturels, présidée par la Ministre de la Culture, Mme Khalida Toumi. Les acteurs locaux ont donc une réelle volontéd’œuvrer pour la préservation du patrimoine, qui est cependant freinée par l’absence de synergie avec l’Etat pourfinancer et engager une politique globale.Échelle nationaleLa sensibilisation à la sauvegarde des médinas est très récente et n’a pas encore engendré une politique claire de priseen charge du patrimoine avec des moyens juridiques et financiers adaptés. Dans les années 1960, des lois ont étéadoptées. L’ordonnance de 1967 (n°67 281) relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques etnaturels permet de définir le site historique sur lequel l’Etat peut exercer des procédures de conservation (classement,inscription à l’inventaire supplémentaire). Sont soumis au classement les monuments et sites présentant un intérêtsuffisant ainsi que les immeubles compris dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument. L’initiative duclassement revient tant au propriétaire qu’à l’Etat ; il est prononcé par arrêté ministériel après avis de la commissionnationale des monuments et sites. Les mesures de protection entraînent des servitudes, une surveillance des travauxpar les services compétents et des possibilités d’expropriation pour cause d’utilité publique en cas de non préservationpar des particuliers. Une autre ordonnance en 1983, a permis la protection des sites non classés. Enfin, en 1998, dansle cadre de la loi 98.04, la notion de patrimoine est étendue aux ensembles bâtis (les centres historiques), ce qui conduità l’instauration d’un secteur sauvegardé et à l’établissement d’un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.La reconnaissance explicite de la propriété privée et la création d’un fonds d’aide au patrimoine devaient être lescorollaires de cette loi.Mais jusqu’à ce jour, aucun des textes prévus n’a été réalisé. Le manque de synergie entre le Ministère de l’habitat et del’urbanisme, et le Ministère de la culture, puis entre les différents acteurs privés et associatifs, a souvent constitué unobstacle à la conduite des opérations.28
Le patrimoine historique en cours de conservation est monumental et public. Il ne semble pas pour l’instant que lesautorités considèrent dans sa globalité le patrimoine historique, public et privé, monumental et vernaculaire. Même sices notions ont été définies, il manque un plan général pour l’agglomération prenant en compte toutes cesproblématiques. Mais cela va probablement changer dans les prochaines années : l’Algérie a accueilli début 2008 sonmillionième touriste et modernise ses infrastructures routières.Échelle <strong>international</strong>eTlemcen ne bénéficie à ce jour d’aucun programme <strong>international</strong>. Pour l'instant, la médina n'est pas inscrite sur la listedu patrimoine mondial de l'UNESCO.29
Tripoli (Liban)Fiche réalisée par Marie LECOQ et Antoine HENOCQ, et résumée par Tristan MORELPRESENTATION GENERALELa villeCette ville de 500 000 habitants est située sur une plaine en bordure de la Méditerranée dans la province du Liban-Nord.Elle s’étend sur 22,5 km² et est divisée en deux parties : El-Mina et Tripoli (la ville moderne et l’ancienne). Le tissuurbain est très mélangé et témoigne des époques romaine, fatimide, croisée, mamelouk, ottomane et contemporaine. Lenoyau de la ville est la cité médiévale, entourée d’une ville ottomane, elle-même entourée de quartiers modernes.Le patrimoine urbainAprès la chute de Jérusalem, Tripoli devient Triple, un centre important des Croisés. Des couvents, des écolesreligieuses, de philosophie et de médecine s’ouvrent alors. Le château St Gilles est construit sur le mont Pèlerin, à 3 kmde la côte. Le nouveau quartier latin devient le centre actif de la ville, l’embryon de la ville moderne. Il regroupeaujourd’hui, avec le quartier El-Mina, la quasi-totalité du patrimoine.Tripoli s’est fortement développée au cours de la seconde moitié du XX ème siècle. Le relief l'empêchant de s’accroîtrevers l’est, la cité s'est étendue vers l’ouest, en direction de la mer. La ville et sa banlieue portuaire d’El-Mina forment unemême entité urbaine. Mais la ville-centre qu’est Tripoli ne dispose pas de pouvoirs unis sur son territoire d’influencecapables de régler dans une vision globale les problèmes d’urbanisme, notamment ceux liés au patrimoine privé urbain.GESTION DU PATRIMOINE URBAINLes principaux acteurs• Etat ;• Bureau technique des villes libanaises (BTVL) ;• Réseau des villes historiques et archéologiques (RVHA – Liban, Syrie, Jordanie) ;• AIMF (Association <strong>international</strong>e des maires francophones).Échelle localeLa ville de Tripoli a du mal à gérer son patrimoine : les ressources dont elle dispose sont trop faibles pour assurer unetelle tâche. Un projet municipal est toutefois en cours concernant le patrimoine historique de la vieille ville : élaborationd'une étude sur la vieille ville, recherche de solutions en collaboration avec l'université libanaise (faculté de Génie etfaculté des Beaux Arts). Un département de restauration a été créé à l’institut des Beaux-arts de Tripoli. Un protocole decoopération a été instauré en 1997 entre la municipalité, l’institut des Beaux-arts et l’école de Chaillot à Paris : lamunicipalité fait appel à l’aide <strong>international</strong>e pour pouvoir mener à bien cette entreprise de sauvegarde du patrimoine.Échelle nationale• Le Bureau technique des ville libanaises (BTVL), créé en 2001, financé par les villes libanaises membres duComité des maires, a vocation à assister les villes dans l’élaboration de leurs projets de développement et decoopération. Le BTVL a mis en place le Réseau des villes historiques et archéologiques, qui encourage la création debureaux municipaux de développement local en coopération avec des universités et des réseaux de villes européennes.• L’Etat a compétence en matière d’urbanisme : le Conseil supérieur de l’urbanisme regroupe plusieurs acteursde ministères nationaux (Intérieur, Travaux publics, Tourisme). Il approuve les plans et règlements d’urbanisme établisau préalable par les municipalités. En 2004 est créé le schéma directeur d’aménagement du territoire libanais (SDATL).Il a pour but d’encourager une fiscalité locale, d’imposer un plafond légal de densité, et de contrôler la mise en placed’un plan d’urbanisme. Ce plan d’urbanisme est réalisé par le groupe DAR- IAURIF (Dar Al Handasah, et Institutd’aménagement et d’urbanisme de la région Ile de France).Échelle <strong>international</strong>e• Tripoli est membre du Réseau des villes historiques et archéologiques (RVHA – Liban, Syrie, Jordanie), dont leprincipe est la défense des richesses culturelles.• L’AIMF (Association <strong>international</strong>e des maires francophones) participe à la création d’un organisme municipalcapable de maîtriser les programmes de rénovation, de rechercher les financements et de s'assurer du bon usage desbâtiments. Le coût de cette opération s’élève à 15 000 € financés entièrement par l’AIMF.• Le projet CHUD (Cultural Heritage and Urban Developpement) a pour objectif la défense des richessesculturelles.• Med-réhab fait partie du Réseau Med-Urbs. Son action est d’encourager la réhabilitation et la sauvegarde des30
centres anciens des villes arabes membres.• La coopération décentralisée au Liban entre Marseille et El Mina Tripoli, entre la Région Midi-Pyrénées etTripoli (à partir de 1995), entre Aix-en-Provence et Tripoli.La ville de Tripoli n’est pas inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En septembre 2006, l’Etat libanais afait une demande pour que figure sur cette liste le centre historique de Tripoli-El-Mina.EXEMPLE D’OPERATION : LE PROJET CHUDDes études qui portent sur le tissu urbain, architectural, économique et social ont été mises en œuvre. Elles forment undossier qui comprend plusieurs volets : restauration des souks, consolidation des monuments, construction d’habitationspour 66 familles qui occupent le bâtiment historique de Khan al Askar, aménagement des quartiers riverains du fleuveAbou Ali. Sont également prévus des travaux d’infrastructure dans la vieille ville, l’organisation du trafic routier etpiétonnier, la création de parcs de stationnement et la réhabilitation des espaces publics. Ce projet a pu être mis enœuvre grâce à un prêt accordé par la Banque Mondiale et les gouvernements français et italiens. Ce prêt s’élève à 62millions de dollars et concerne cinq sites historiques du Liban. 19 millions de dollars de cette somme ont été allouéspour la réhabilitation de la vieille ville de Tripoli.Sources :Internet• Aimf.asso.fr• Bureau Technique des villes libanaises• Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire Libanais de 2004• Tripoli.gov.lb• Tripoli-city.org• Unesco.org31