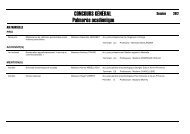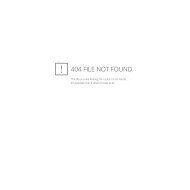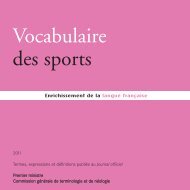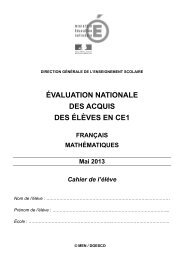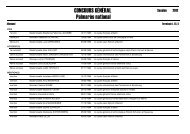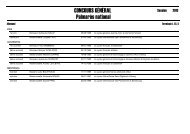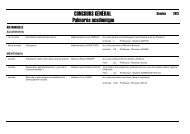Fiche 3.1 : Comment le contrôle social s'exerce-t-il aujourd'hui?
Fiche 3.1 : Comment le contrôle social s'exerce-t-il aujourd'hui?
Fiche 3.1 : Comment le contrôle social s'exerce-t-il aujourd'hui?
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
éduSCOLSciences économiqueset socia<strong>le</strong>s - Première ESSociologie généra<strong>le</strong> et sociologie politique3. Contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> et dévianceRessources pour <strong>le</strong> lycée général et technologique<strong>Fiche</strong> <strong>3.1</strong> : <strong>Comment</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> s’exerce-t-<strong>il</strong> aujourd’hui?INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES : On s’interrogera sur l’évolution des formes du contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> dans <strong>le</strong>ssociétés modernes et sur <strong>le</strong>urs effets. On montrera qu’au fur et à mesure que <strong>le</strong>s relations socia<strong>le</strong>sdeviennent plus impersonnel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> par des instances spécialisées tend à prédominer sur <strong>le</strong>contrô<strong>le</strong> informel exercé par <strong>le</strong>s groupes primaires. On pourra s’interroger éga<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong>s effets produitspar <strong>le</strong> recours à des formes de contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> prenant appui sur <strong>le</strong>s ressources des nouvel<strong>le</strong>s technologies.NOTIONS : Contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> formel/informel, stigmatisation.Savoirs de référence sur <strong>le</strong> thèmeL’évolution des formes du contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong>Le contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> vise à assurer <strong>le</strong> respect des règ<strong>le</strong>s qui régissent la vie en société et à luttercontre <strong>le</strong>s comportements déviants. Au sens large du terme, <strong>il</strong> consiste à édicter des normessocia<strong>le</strong>s et juridiques fondées sur un ensemb<strong>le</strong> de va<strong>le</strong>urs et à <strong>le</strong>s faire respecter. En ce sens, la<strong>social</strong>isation des individus au sein d’un groupe ou d’une société en fait partie et de nombreusesinstitutions en sont <strong>le</strong>s agents (la fam<strong>il</strong><strong>le</strong>, l’éco<strong>le</strong>, la justice…) ; <strong>il</strong> prend alors appui aussi bien surl’éducation, que la religion, <strong>le</strong> droit, ou <strong>le</strong>s usages. Considéré de façon plus restrictive, <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong><strong>social</strong> regroupe <strong>le</strong>s mesures destinées à faire respecter la règ<strong>le</strong> et à sanctionner la déviance. Il seréduit alors à l’ensemb<strong>le</strong> des sanctions encourues par <strong>le</strong>s auteurs de conduites déviantes.S’<strong>il</strong> existe un contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> interne adossé à une obligation auto-consentie, <strong>le</strong>s sanctions de latransgression des normes, qu’el<strong>le</strong>s soient positives ou négatives, relèvent d’un contrô<strong>le</strong> socia<strong>le</strong>xterne qui peut prendre deux formes :• Le contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> formel est celui qui est assuré par des groupes sociaux et desinstitutions spécifiques (ordre des médecins, inspection du trava<strong>il</strong>, justice…). Les sanctionss’énoncent <strong>le</strong> plus souvent sous forme écrite et impersonnel<strong>le</strong> (code de la route, règ<strong>le</strong>mentintérieur d’un lycée) et el<strong>le</strong>s sont de nature variée : sanctions administratives (blâme,avertissement), religieuses (pénitence), sanctions juridiques et péna<strong>le</strong>s (amendes,dommages et intérêts, peines de prison);• Le contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> informel s’exerce au cours des interactions socia<strong>le</strong>s de la vie quotidienneet a un caractère non institutionnel. Il est souvent prédominant dans <strong>le</strong>s groupes primairescomme la fam<strong>il</strong><strong>le</strong> ou <strong>le</strong>s groupes de pairs. Les comportements sociaux sont régulés àtravers et par <strong>le</strong>s interactions socia<strong>le</strong>s. Les sanctions peuvent prendre la formed’approbations (sourire d’acquiescement, félicitations, cadeaux) ou de désapprobations(froncement de sourc<strong>il</strong>s, rires moqueurs, mise en quarantaine…).La frontière séparant ces deux formes de contrô<strong>le</strong> est parfois floue : ainsi, au sein de la fam<strong>il</strong><strong>le</strong>, àl’éco<strong>le</strong> ou sur <strong>le</strong> lieu de trava<strong>il</strong>, contrô<strong>le</strong> formel et contrô<strong>le</strong> informel peuvent coexister.La prédominance du contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> exercé par des instances spécialiséesLe contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> effectué par des instances socia<strong>le</strong>s spécialisées ne concerne pas <strong>le</strong>s seulscrimes et délits, mais s’étend de plus en plus dans <strong>le</strong>s sociétés modernes à d’autres formes dedéviance. En effet, dès lors que certaines infractions tendent à disparaître, on enMinistère de l’éducation nationa<strong>le</strong> (DGESCO) Ju<strong>il</strong><strong>le</strong>t 2013Sciences économiques et socia<strong>le</strong>s – série EShttp://eduscol.education.fr
définit de nouvel<strong>le</strong>s, car paradoxa<strong>le</strong>ment, quand la sécurité s’accroît, on demande davantageencore de protection. Un droit répressif se développe ainsi dans des domaines où autrefois <strong>le</strong>scoutumes et la mora<strong>le</strong> suffisaient à régir <strong>le</strong>s manières de vivre ensemb<strong>le</strong> (interdiction de fumerdans des endroits ouverts au public, loi Hadopi en 2009 pour sanctionner <strong>le</strong> téléchargement <strong>il</strong>légalde musique et/ou de f<strong>il</strong>ms, par exemp<strong>le</strong>). On assiste ainsi à une extension du volume du droit danstous <strong>le</strong>s domaines de la vie quotidienne. De multip<strong>le</strong>s exemp<strong>le</strong>s peuvent en être donnés : droit dela fam<strong>il</strong><strong>le</strong> (pénalisation des vio<strong>le</strong>nces fam<strong>il</strong>ia<strong>le</strong>s), obligation scolaire (sanctions financières pourlutter contre l’absentéisme), lutte contre <strong>le</strong>s risques du tabagisme passif, etc. Le contrô<strong>le</strong> formel vamême jusqu’à protéger l’individu par rapport à lui-même contre des comportements à risques.Le rô<strong>le</strong> des nouvel<strong>le</strong>s technologies dans <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong>La scientifisation du trava<strong>il</strong> de la police, largement mise en va<strong>le</strong>ur dans <strong>le</strong>s séries télévisées, ainsique l’évolution des modalités de contrô<strong>le</strong> de la privation de liberté (télésurve<strong>il</strong>lance, brace<strong>le</strong>tsé<strong>le</strong>ctroniques) constituent l’une des <strong>il</strong>lustrations du rô<strong>le</strong> des nouvel<strong>le</strong>s technologies dans <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong><strong>social</strong>.Dans l’ensemb<strong>le</strong> de la société, <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s technologies sont d’abord mob<strong>il</strong>isées pour prévenir ladélinquance à des niveaux très différents <strong>le</strong>s uns des autres : caméras de surve<strong>il</strong>lance dans <strong>le</strong>smagasins, systèmes anti-vol incorporés aux produits, diffusion de messages subliminaux dans <strong>le</strong>smagasins, régulateurs automatiques de vitesse, analyseurs d‘ha<strong>le</strong>ine anti-démarrage en sontautant d’exemp<strong>le</strong>s. La procédure mise en place dans <strong>le</strong> cadre de la loi Hadopi constitue une autre<strong>il</strong>lustration de cette volonté affichée de prévenir <strong>le</strong>s délits plutôt que de seu<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s sanctionner.Les nouvel<strong>le</strong>s technologies permettent aussi de suivre <strong>le</strong>s individus dans <strong>le</strong> temps et dans l’espaceet de mémoriser ce qui <strong>le</strong>s concerne (fichiers d’ordinateurs, cartes de crédit, connexions internet,téléphone portab<strong>le</strong>). Ainsi chaque individu participe à sa propre surve<strong>il</strong>lance.Cette évolution peut être appréhendée aussi bien positivement que négativement : el<strong>le</strong> contribue àune plus grande sécurisation face aux risques et accroît l’efficacité des dispositifs de protection despersonnes ou des biens. En revanche, certains individus peuvent souffrir de <strong>le</strong>ur appartenance àune catégorie atypique ou jugée à risque ; ce qui peut semb<strong>le</strong>r rationnel au niveau col<strong>le</strong>ctif peuts’avérer dommageab<strong>le</strong> au niveau individuel. La liberté individuel<strong>le</strong> et la capacité d’innovationpeuvent en pâtir et la suspicion, si el<strong>le</strong> est trop poussée, peut saper <strong>le</strong>s bases du lien <strong>social</strong>.Le risque de stigmatisationCertaines sanctions, en particulier négatives, peuvent avoir des effets contreproductifs, et aboutirparadoxa<strong>le</strong>ment à amplifier <strong>le</strong>s comportements déviants en exerçant un effet de stigmatisation quiconduit l’individu ainsi désigné à se définir lui-même comme déviant : (cf. fiche 3.2 : Quels sont <strong>le</strong>sprocessus qui conduisent à la déviance ?). Cet effet a particulièrement été souligné pour <strong>le</strong>s peinesde prison qui mettent <strong>le</strong> délinquant au contact de criminels plus « chevronnés » et qui diminuent àla sortie de prison <strong>le</strong>s possib<strong>il</strong>ités de réinsertion socia<strong>le</strong> et professionnel<strong>le</strong>.Ministère de l’éducation nationa<strong>le</strong> (DGESCO) Page 2 sur 4Sciences économiques et socia<strong>le</strong>s – série EShttp://eduscol.education.fr
Ressources et activités pédagogiques proposéesActivité 1 : Analyse de situations où <strong>le</strong>s comportements des individus sontinfluencés par une opinion dominante ou une autorité considérée commelégitimeFinalité : montrer comment <strong>le</strong>s individus peuvent être conduits dans certaines situations à adopterdes comportements conformistes.Étapes et ressources préconisées :L’expérience conduite par Solomon Asch (1955) peut être reproduite et analysée avec un grouped’élèves pour interroger <strong>le</strong>s comportements d’un individu au sein d’un groupe.• Il s’agit de comparer un segment de droite à trois autres, parmi <strong>le</strong>squels un seul a la mêmelongueur que <strong>le</strong> segment témoin.• Des « complices » (de trois à six) formu<strong>le</strong>nt tous la même réponse inexacte avant que <strong>le</strong>sujet « naïf » soit interrogé.• L’expérience démontre que dans cette situation, une proportion importante des sujets« naïfs » donne une réponse conforme à cel<strong>le</strong> des « complices ».On peut aussi ut<strong>il</strong>iser <strong>le</strong> passage du f<strong>il</strong>m I comme Icare consacré à l’effet M<strong>il</strong>gram, ou bien desextraits de l’ouvrage Soumission à l’autorité, de S. M<strong>il</strong>gram, Calmann-Lévy, 1974) pour étudier <strong>le</strong>smécanismes de la soumission à l’autorité. Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis :• Que cherche à montrer l’auteur de cette expérience?• <strong>Comment</strong> procède-t-<strong>il</strong> ?• Quel constat peut-on dresser ?• <strong>Comment</strong> expliquer <strong>le</strong>s comportements observés ?Activité 2 : mise en évidence, à partir d’exemp<strong>le</strong>s, de l’extrême variété des formesde contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong>Finalité : distinguer <strong>le</strong>s formes de contrô<strong>le</strong> informel<strong>le</strong>s des formes de contrô<strong>le</strong> formel<strong>le</strong>s et analyser<strong>le</strong>ur impact spécifique.Étapes et ressources préconisées :• On pourra ut<strong>il</strong>iser l’artic<strong>le</strong> de Ruwen Ogien, « Sanctions diffuses. Sarcasmes, rires etmépris », Revue française de sociologie, 1990 (pages 591 à 607) accessib<strong>le</strong> gratuitementà partir du site Persée. Prolongeant l’analyse de Durkheim, l’auteur distingue <strong>le</strong>s sanctionsdiffuses, essentiel<strong>le</strong>ment interactives, des sanctions organisées, c'est-à-dire administréespar un corps défini et constitué. Il décline et <strong>il</strong>lustre ensuite <strong>le</strong>s différentes formes quepeuvent prendre des sanctions en croisant deux coup<strong>le</strong>s de caractéristiques : sanctionsdiffuses/organisées, sanctions positives/négatives.Ministère de l’éducation nationa<strong>le</strong> (DGESCO) Page 3 sur 4Sciences économiques et socia<strong>le</strong>s – série EShttp://eduscol.education.fr
BibliographieBibliographie sé<strong>le</strong>ctive et commentée à l’usage du professeurBoudon R. et Bourricaud F., « Le contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> » (pages 111-117) in Dictionnaire critique de lasociologie, PUF, 1982.[Une présentation très claire et très synthétique des différents sens que peut recouvrir l’expression« contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> ».]Cusson M., Le contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> du crime, PUF, 1983. L’ouvrage est accessib<strong>le</strong> gratuitement en ligneau format PDF sur <strong>le</strong> site :http://classiques.uqac.ca/contemporains/cusson_maurice/contro<strong>le</strong>_<strong>social</strong>_du_crime/contro<strong>le</strong>_soc_crime.html[On y trouvera à la fois une discussion critique de l’effet de stigmatisation du contrô<strong>le</strong> <strong>social</strong> et uneprésentation de ses effets dissuasifs.]Gary T., « La société de sécurité maxima<strong>le</strong> », Deviance et société (1988), vol. 12-n°2, (pages 147à 166). L’artic<strong>le</strong> est accessib<strong>le</strong> gratuitement en ligne.[L’auteur met en évidence l’importance des nouvel<strong>le</strong>s technologies et la recherche d’une « sécuritémaxima<strong>le</strong> » dans <strong>le</strong>s sociétés contemporaines qui déploient à cet effet des techniques de plus enplus sophistiquées.]Bibliographie complémentaire :Elias N., La civ<strong>il</strong>isation des mœurs, Calmann-Lévy 2003 (1 ère édition : 1939).Foucault M., Surve<strong>il</strong><strong>le</strong>r et punir, Gallimard, 1975.Marzouki M., Simon P. (dossier coordonné par), Sous contrô<strong>le</strong>. Gouverner par <strong>le</strong>s fichiers,Mouvements, avr<strong>il</strong>-juin 2010, La Découverte.Le Goff T., Fonteneau M., Vidéosurve<strong>il</strong>lance et espaces publics. État des lieux des évaluationsmenées en France et à l’étranger, rapport pour l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Î<strong>le</strong>-de-France, octobre 2008.Ministère de l’éducation nationa<strong>le</strong> (DGESCO) Page 4 sur 4Sciences économiques et socia<strong>le</strong>s – série EShttp://eduscol.education.fr