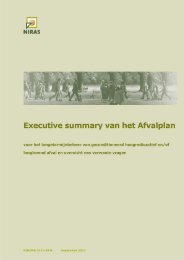Situation actuelle de la gestion des déchets radioactifs en ... - ondraf
Situation actuelle de la gestion des déchets radioactifs en ... - ondraf
Situation actuelle de la gestion des déchets radioactifs en ... - ondraf
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Rapport <strong>de</strong> <strong>gestion</strong><strong>Situation</strong> <strong>actuelle</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> BelgiqueNIROND 2008-02
2/166
Table <strong>de</strong>s matièresPréface..............................................................................................................................6Introduction......................................................................................................................8La radioactivité et les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>...................................................................101. La radioactivité........................................................................................................101.1 Le phénomène <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité.....................................................................101.2 Mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> désintégration et types <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t..........................................111.3 La décroissance radioactive.............................................................................111.4 Les risques liés à <strong>la</strong> radioactivité......................................................................132. Les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>...........................................................................................142.1 Une définition rigoureuse..................................................................................142.2 Leur état physique et le niveau radiologique....................................................152.3 Des origines diverses.......................................................................................173. Quelques cas particuliers........................................................................................223.1 Déchets issus <strong>de</strong>s procédés industriels passés ou actuels .............................223.2 Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> très courte <strong>de</strong>mi-vie.................................................................243.3 Les <strong>déchets</strong> non industriels..............................................................................243.4 Les sources orphelines....................................................................................253.5 Les combustibles irradiés.................................................................................25L'ONDRAF et ses part<strong>en</strong>aires........................................................................................271. L'ONDRAF..............................................................................................................271.1 Le contexte historique <strong>de</strong> sa création...............................................................281.2 Missions et compét<strong>en</strong>ces fixées par <strong>la</strong> loi........................................................291.3 Système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>..........................................................................................311.4 Surveil<strong>la</strong>nce et direction...................................................................................311.5 Financem<strong>en</strong>t.....................................................................................................312. Belgoprocess..........................................................................................................312.1 Activités............................................................................................................323. Autres part<strong>en</strong>aires industriels <strong>de</strong> l'ONDRAF...........................................................324. EURIDICE...............................................................................................................335. Autres part<strong>en</strong>aires sci<strong>en</strong>tifiques <strong>de</strong> l'ONDRAF........................................................336. Autorités fédérales..................................................................................................347. Re<strong>la</strong>tions internationales.........................................................................................34L'ONDRAF dans son rôle d'autorité..............................................................................351. Le cadre international..............................................................................................351.1 Les principes fondam<strong>en</strong>taux.............................................................................351.2 Les conv<strong>en</strong>tions et traités.................................................................................361.3 La légis<strong>la</strong>tion europé<strong>en</strong>ne................................................................................372. Transposition <strong>en</strong> droit belge....................................................................................373. Les Règles générales.............................................................................................384. Les c<strong>la</strong>ssifications...................................................................................................384.1 La c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés................................................394.2 La c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés.......................................................395. Les Critères d'acceptation.......................................................................................416. Les agrém<strong>en</strong>ts........................................................................................................42La prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés.....................................................441. Les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non conditionnés........................................................442. La procédure d’acceptation.....................................................................................453. La prise <strong>en</strong> charge..................................................................................................46Le transport et le traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t............................................................481. Le transport <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.........................................................................................482. Les types <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t...........................................................................................493. Le conditionnem<strong>en</strong>t.................................................................................................514. Les instal<strong>la</strong>tions disponibles....................................................................................514.1 Belgoprocess....................................................................................................514.2 Les c<strong>en</strong>trales <strong>de</strong> Doel et <strong>de</strong> Tihange................................................................55La prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés.............................................................571. Les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés...............................................................573/166
2. L'acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés................................................583. Colis <strong>en</strong>treposés et productions historiques............................................................60Les inv<strong>en</strong>taires techniques prévisionnels...................................................................621. L’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>........................................................................621.1 Méthodologie....................................................................................................631.2 L’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> chiffres................................................642. Déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires..............................................................652.1 Introduction.......................................................................................................652.2 P<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t : objet et modalités <strong>de</strong> constitution.............................662.3 Evaluation <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> matériaux et <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t.....................673. L’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions et sites nucléaires......................................................68La couverture <strong>de</strong>s coûts................................................................................................711. Principes du financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’organisme................................................................712. Les mécanismes <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> courante.........................733. Les mécanismes <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme (FLT).........743.1 Dispositions légales spécifiques.......................................................................743.2 Evaluation <strong>de</strong>s besoins financiers et du montant <strong>de</strong>s contributions ................753.3 Trois idées <strong>de</strong> base assurant <strong>la</strong> viabilité du FLT...............................................763.4 Réservation <strong>de</strong> capacité pour <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s coûts fixes..............................773.5 Paiem<strong>en</strong>ts tarifaires couvrant les coûts fixes et les coûts variables.................783.6 Garantie contr<strong>actuelle</strong> assurant <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts fixes.........................783.7 Gestion du FLT.................................................................................................794. Le Fonds d’insolvabilité...........................................................................................795. Le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission d'inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong> passifs nucléaires............................806. Le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s passifs techniques nucléaires.................................................807. Les financem<strong>en</strong>ts sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> budgets (pluri)annuels........................................828. La fin <strong>de</strong> contrat d’un producteur.............................................................................82L'<strong>en</strong>treposage temporaire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés et du combustible irradié ....841. Introduction.............................................................................................................842. Les bâtim<strong>en</strong>ts pour <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants...................................................862.1 Le bâtim<strong>en</strong>t 150................................................................................................862.2 Le bâtim<strong>en</strong>t 151................................................................................................872.3 Le bâtim<strong>en</strong>t 155................................................................................................893. Le bâtim<strong>en</strong>t 127 pour <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants.........................................904. Les bâtim<strong>en</strong>ts pour <strong>déchets</strong> fortem<strong>en</strong>t irradiants....................................................924.1 Le bâtim<strong>en</strong>t 129................................................................................................924.2 Le bâtim<strong>en</strong>t 136................................................................................................945. Procédure <strong>de</strong> suivi dans le temps <strong>de</strong>s DC acceptés...............................................985.1 Objectif poursuivi et stratégie appliquée...........................................................985.2 Principe <strong>de</strong> radioprotection...............................................................................985.3 P<strong>la</strong>ce du suivi dans le temps dans le processus <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> l’acceptation...995.4 Caractéristiques et propriétés du colis primaire <strong>de</strong> DC qui doiv<strong>en</strong>t être suiviesdans le temps.......................................................................................................1005.5 Déroulem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> suivi dans le temps .....................................1005.6 Établissem<strong>en</strong>t d’un procès-verbal <strong>de</strong> suivi dans le temps (PVST) <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés..........................................................................1016. Inspection visuelle <strong>de</strong>s DC <strong>en</strong>treposés.................................................................101Le projet <strong>de</strong> dépôt définitif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A...........................................1031. Introduction...........................................................................................................1032. Un peu d'histoire...................................................................................................1043. La démarche sociétale – les part<strong>en</strong>ariats..............................................................1064. Le projet intégré <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong> catégorie A..............................................................110Les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C..........................................1131. Introduction et aperçu historique...........................................................................1131.1 Pério<strong>de</strong> 1974-1989 et publication du rapport SAFIR......................................1151.2 Pério<strong>de</strong> 1990-2003 et publication du rapport SAFIR 2...................................1162. Etat du programme B&C à <strong>la</strong> fin 2007...................................................................1172.1 Inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> considérés dans les étu<strong>de</strong>s.......................................1172.2 Méthodologies................................................................................................1182.3 Etat d'avancem<strong>en</strong>t..........................................................................................1213. Principales activités <strong>de</strong> RD&D prévues d’ici 2020.................................................1274/166
3.1 Système <strong>de</strong> dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> Boom.......................................................1273.2 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Argiles Yprési<strong>en</strong>nes.......................................................................1303.3 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> formations schisteuses....................................................................1304. Décisions <strong>en</strong>core à poser......................................................................................131Annexe A : l'arrêté royal du 30 mars 1981..................................................................132Annexe B : structure <strong>de</strong>s Règles générales...............................................................144Annexe C : c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s DNC.............................................................................145Annexe D : c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> DC...........................................................................................147Annexe E : procédures d'agrém<strong>en</strong>t............................................................................149Annexe F : le formu<strong>la</strong>ire S/L........................................................................................155Glossaire.......................................................................................................................1585/166
PréfaceVoilà plus <strong>de</strong> vingt-cinq ans que l’ONDRAF gère, au service <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> <strong>la</strong>popu<strong>la</strong>tion belge, tous les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> prés<strong>en</strong>ts sur le territoire. Cette <strong>gestion</strong><strong>en</strong>globe <strong>de</strong>s tâches qui peuv<strong>en</strong>t être <strong>de</strong> nature et <strong>de</strong> finalité extrêmem<strong>en</strong>t variées : lesactivités qui sont dévolues à l’organisme par <strong>la</strong> volonté du légis<strong>la</strong>teur vont <strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> et matières radioactives prés<strong>en</strong>ts ou à v<strong>en</strong>ir jusqu’à leur mise <strong>en</strong> dépôtdéfinitif, <strong>en</strong> passant par <strong>la</strong> recherche et le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> solutions nouvelles, <strong>la</strong>fourniture aux citoy<strong>en</strong>s ou aux <strong>en</strong>treprises <strong>de</strong> services aussi divers que l’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t, letraitem<strong>en</strong>t, le conditionnem<strong>en</strong>t et l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ou <strong>en</strong>core<strong>de</strong>s prestations à caractère plus normatif comme l’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leurs instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>t, d’<strong>en</strong>treposage et <strong>de</strong> caractérisation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ou à caractèrerégu<strong>la</strong>teur comme l’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> critères d’acceptation ou l’approbation <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong>déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires. On voit ici que le spectre <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong>l’ONDRAF est fort <strong>la</strong>rge, <strong>en</strong> tout cas un <strong>de</strong>s plus <strong>la</strong>rges qui soit pour une ag<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> ceg<strong>en</strong>re, si l’on compare avec ce qui existe à l’étranger. Toutes ces activités ont étéintégrées au coeur d’un système global <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>.Les différ<strong>en</strong>tes étapes <strong>de</strong> cette <strong>gestion</strong> sont m<strong>en</strong>ées par <strong>de</strong>s équipes formées etmotivées, qui agiss<strong>en</strong>t dans le respect <strong>de</strong>s principes fondam<strong>en</strong>taux que sont le principe<strong>de</strong> précaution, celui du développem<strong>en</strong>t durable, et ceux édictés par l’Ag<strong>en</strong>ceInternationale <strong>de</strong> l’Energie Atomique, dans un souci perman<strong>en</strong>t <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> protection<strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Le chemin parcouru par l’organisme <strong>de</strong>puis sacréation <strong>en</strong> 1981 est considérable. D’une petite équipe d’une dizaine <strong>de</strong> personnes audépart, l’ONDRAF a vu son cadre s’é<strong>la</strong>rgir progressivem<strong>en</strong>t jusqu’à compter quatrevingtscol<strong>la</strong>borateurs, ag<strong>en</strong>ts techniques, administratifs, experts, <strong>gestion</strong>naires,sci<strong>en</strong>tifiques chargés aujourd’hui, par leurs moy<strong>en</strong>s propres ou <strong>en</strong> col<strong>la</strong>boration avec <strong>de</strong>s<strong>en</strong>treprises ou part<strong>en</strong>aires extérieurs, <strong>de</strong> « faire tourner » ce système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>, aumieux <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong>s citoy<strong>en</strong>s et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>en</strong> général.Parmi les nombreuses tâches qui lui revi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t légalem<strong>en</strong>t, il <strong>en</strong> est une que l’ONDRAFpartage avec toute <strong>en</strong>treprise ou organisation humaine quelle qu’elle soit : <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification<strong>de</strong> ses activités propres. Pour l’ONDRAF, cette activité <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification a pris, récemm<strong>en</strong>t,une tournure nouvelle avec <strong>la</strong> parution au moniteur belge <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 13 février 2006re<strong>la</strong>tive à l’évaluation <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces <strong>de</strong> certains p<strong>la</strong>ns et programmes surl’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t et à <strong>la</strong> participation du public dans l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns et <strong>de</strong>sprogrammes re<strong>la</strong>tifs à l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. L’article 6, 1° <strong>de</strong> cette loi prévoit <strong>en</strong> effetexplicitem<strong>en</strong>t que ses dispositions s’appliqu<strong>en</strong>t au programme général <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à longterme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Dans le cadre <strong>de</strong> cette nouvelle loi, l’ONDRAF a <strong>la</strong>ncé, <strong>en</strong> 2006, <strong>la</strong> réalisation d’un p<strong>la</strong>n<strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme qu’il <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d, selon le p<strong>la</strong>nning établi, soumettre <strong>en</strong> 2010 à sonautorité <strong>de</strong> tutelle. Ce p<strong>la</strong>n stratégique, appelé P<strong>la</strong>n Déchets 2010, prés<strong>en</strong>tera l’<strong>en</strong>semble<strong>de</strong>s solutions qui sont <strong>en</strong>visageables pour garantir <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> durable <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> et pour lesquelles <strong>de</strong>s décisions stratégiques sont <strong>en</strong>core à pr<strong>en</strong>dre, ainsiqu’une évaluation <strong>de</strong> l’impact que pourrait avoir chacune <strong>de</strong> ces solutions surl’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, si l’on choisissait <strong>de</strong> <strong>la</strong> mettre <strong>en</strong> œuvre. D’une façon générale, l’objectif<strong>de</strong> ce P<strong>la</strong>n Déchets 2010 sera <strong>de</strong> mettre le gouvernem<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dreles décisions qui rest<strong>en</strong>t à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> bonne connaissance <strong>de</strong> cause, ou tout au moinsd’approuver le cal<strong>en</strong>drier <strong>de</strong>s actions préparatoires à cette prise <strong>de</strong> décisions, <strong>de</strong> manièreà permettre à l’ONDRAF <strong>de</strong> « fermer », dès que ce<strong>la</strong> sera possible, son système <strong>de</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et d’offrir ainsi aux citoy<strong>en</strong>s et aux <strong>en</strong>treprises quibénéfici<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ses prestations, un service intégral.Il est dans les fermes int<strong>en</strong>tions <strong>de</strong> l’ONDRAF <strong>de</strong> réaliser ce P<strong>la</strong>n Déchets 2010 <strong>en</strong>dialogue étroit avec le public et les nombreux pr<strong>en</strong>eurs d’<strong>en</strong>jeu dans <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong><strong>la</strong> <strong>gestion</strong> durable <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> car l’on sait désormais que ri<strong>en</strong> dans cedomaine ne se fera sans que les solutions proposées ne reflèt<strong>en</strong>t <strong>la</strong> vision et les att<strong>en</strong>tes<strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Pour que ce dialogue puisse se dérouler sur <strong>de</strong>s bases c<strong>la</strong>ires et porter lesfruits qu’on att<strong>en</strong>d, l’ONDRAF a jugé utile <strong>de</strong> rappeler, dans un ouvrage <strong>de</strong>stiné tant aupublic et aux pr<strong>en</strong>eurs d’<strong>en</strong>jeu qu’aux futurs déci<strong>de</strong>urs, les mécanismes courants dusystème <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> tel qu’il fonctionne <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t. Ce6/166
appel fait l’objet du prés<strong>en</strong>t rapport <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>.7/166
IntroductionLe prés<strong>en</strong>t rapport donne un état complet <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>actuelle</strong> <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> <strong>gestion</strong><strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> Belgique, <strong>en</strong> support du P<strong>la</strong>n Déchets que l'ONDRAF seprépare à remettre au gouvernem<strong>en</strong>t fédéral <strong>en</strong> 2010. Il permet <strong>de</strong> mieux cerner lesdomaines <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> où les activités <strong>de</strong> l’organisme ont pu, avec le temps, sous lecontrôle <strong>de</strong>s autorités compét<strong>en</strong>tes et avec l’ass<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions concernées,accé<strong>de</strong>r à un statut <strong>de</strong> routine maîtrisée, et ceux où <strong>de</strong>s décisions ou <strong>de</strong>s initiativesnouvelles sont <strong>en</strong>core à pr<strong>en</strong>dre.La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> recouvre un grand nombre <strong>de</strong> tâches <strong>de</strong> natures trèsdiversifiées, requérant pour leur mise <strong>en</strong> oeuvre <strong>de</strong>s compét<strong>en</strong>ces et <strong>de</strong>s expertises fortvariées. L'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s activités courantes est mis <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce au sein d'un système<strong>de</strong> <strong>gestion</strong> intégrée dont le fonctionnem<strong>en</strong>t est p<strong>la</strong>cé sous <strong>la</strong> coordination et <strong>la</strong>responsabilité <strong>de</strong> l'ONDRAF. Ce docum<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>te <strong>la</strong> situation <strong>actuelle</strong> au sein <strong>de</strong>sgran<strong>de</strong>s étapes du système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>.Pour donner un aperçu le complet possible, on a opté pour une mise <strong>en</strong> perspectivestructurée <strong>de</strong>s tâches ou activités fondam<strong>en</strong>tales du système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>, dans <strong>la</strong>quellechaque sujet abordé mène, <strong>de</strong> manière aussi naturelle, logique et flui<strong>de</strong> que possible, ausujet suivant. Le docum<strong>en</strong>t est structuré <strong>en</strong> quatre gran<strong>de</strong>s parties :La première partie est subdivisée <strong>en</strong> trois chapitres. Elle décrit le contexte général <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> Belgique : le premier chapitre comm<strong>en</strong>ce par un rappel <strong>de</strong>s aspects principaux re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong>radioactivité et à ses effets. Il donne <strong>en</strong>suite une vue générale sur <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et sur les sources <strong>de</strong> production, le <strong>de</strong>uxième chapitre prés<strong>en</strong>te l'ONDRAF et les principaux interv<strong>en</strong>ants dans lesystème <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, le troisième chapitre précise le cadre normatif qui réglem<strong>en</strong>te le fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cesystème,La <strong>de</strong>uxième partie est composée <strong>de</strong> trois chapitres. Elle est c<strong>en</strong>trée sur les aspectscourants <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> technique et administrative <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, « ce qui sepasse aujourd'hui pour les <strong>déchets</strong> d'aujourd'hui » : le quatrième chapitre décrit le processus <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge par l'ONDRAF d'undéchet radioactif « brut » chez un dét<strong>en</strong>teur qui souhaite s'<strong>en</strong> débarrasser, le cinquième chapitre donne un aperçu <strong>de</strong>s procédés mis <strong>en</strong> oeuvre pour traiter les<strong>déchets</strong> « bruts » prise <strong>en</strong> charge par l'organisme et les conditionner dans une formestable, le sixième chapitre se p<strong>en</strong>che sur les étapes du système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> par l'ONDRAF quifont suite au traitem<strong>en</strong>t et au conditionnem<strong>en</strong>t du déchet radioactif, à savoir <strong>la</strong> prise <strong>en</strong>charge du déchet à l'état conditionné,Avant d'abor<strong>de</strong>r <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à plus long terme, <strong>de</strong>ux chapitresconstituant <strong>la</strong> troisième partie sont consacrés à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> prévisionnelle <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong>, ce que l'on pourrait résumer par « ce qui se passe aujourd'hui pour les<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>main » : le septième chapitre explique comm<strong>en</strong>t sont réalisés les inv<strong>en</strong>taires <strong>de</strong>s quantités ettypes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> à v<strong>en</strong>ir, le huitième chapitre s'ét<strong>en</strong>d sur les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s opérationscourantes et futures,La quatrième et <strong>de</strong>rnière partie se conc<strong>en</strong>tre sur <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à moy<strong>en</strong> et long termes. Elles'ét<strong>en</strong>d sur trois chapitres : le neuvième chapitre expose comm<strong>en</strong>t sont <strong>en</strong>treposés les <strong>déchets</strong> traités etstabilisés, avant leur mise <strong>en</strong> dépôt définitif, que celle-ci ait déjà fait ou non l'objetd'une décision,8/166
le dixième chapitre retrace brièvem<strong>en</strong>t le processus participatif ayant abouti au projet<strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt définitif <strong>de</strong> surface <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible et moy<strong>en</strong>ne activité àcourte durée <strong>de</strong> vie et prés<strong>en</strong>te les lignes directrices du projet <strong>en</strong> cours, le onzième chapitre fait le point sur les recherches <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> dépôt définitif <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t et hautem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong> et/ou à longue durée <strong>de</strong> vie.9/166
Chapitre premierLa radioactivité et les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>Pour tout ouvrage prés<strong>en</strong>tant les activités passées, prés<strong>en</strong>tes ou futures <strong>de</strong> l'ONDRAF,une section rappe<strong>la</strong>nt ce qu'est <strong>la</strong> radioactivité et prés<strong>en</strong>tant les <strong>déchets</strong> qui <strong>la</strong>conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t constitue une introduction aussi nécessaire qu'inévitable. Le prés<strong>en</strong>t rapportne saurait, par conséqu<strong>en</strong>t, déroger à ce principe, et ce premier chapitre nous mène aucoeur du sujet – d'une manière peut-être inhabituelle... .En effet, après un bref exposé <strong>de</strong>s principaux principes et concepts importants <strong>de</strong> <strong>la</strong>radiochimie (<strong>de</strong>mi-vie, activité, types <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t, ...), rappel que le lecteur familierdu sujet pourra se s<strong>en</strong>tir libre <strong>de</strong> survoler, le chapitre sera subdivisé <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux parties.La première traitera, <strong>de</strong> manière synoptique, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qui font l'objet <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> courante et c<strong>en</strong>tralisée <strong>de</strong> l'ONDRAF. Leur origine, tant du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>l'activité génératrice que du point <strong>de</strong> vue historique, leur état physique et leur niveauradiologique serviront <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>s pour l'é<strong>la</strong>boration d'un panorama complet <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>que l'ONDRAF gère à ce jour.La secon<strong>de</strong> partie abor<strong>de</strong>ra l'exist<strong>en</strong>ce d'un certain nombre <strong>de</strong> catégories <strong>de</strong> substancesradioactives dont <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> physique n'est pas <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t du ressort <strong>de</strong> l'ONDRAF,même si celui-ci les pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> compte dans le cadre <strong>de</strong> son système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>prévisionnelle, du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité d'une incorporation future <strong>de</strong> ces substances dansson système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> courante.Dans un premier temps seront abordées les catégories <strong>de</strong> substances dont le caractère<strong>de</strong> déchet est bi<strong>en</strong> établi, mais dont les caractéristiques radioactives sont extrêmem<strong>en</strong>tbasses. Sans anticiper sur le cont<strong>en</strong>u du chapitre, m<strong>en</strong>tionnons certains <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> trèscourte durée <strong>de</strong> vie issus <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, et les <strong>déchets</strong><strong>de</strong> très basse activité, prov<strong>en</strong>ant principalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'industrie chimique, dont les t<strong>en</strong>eurs<strong>en</strong> radio-isotopes naturels sont <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> celles r<strong>en</strong>contrées dans les matièrespremières, ou légèrem<strong>en</strong>t supérieures.Enfin, il y a lieu <strong>de</strong> m<strong>en</strong>tionner les combustibles nucléaires irradiés. Si leur caractèreradioactif est évi<strong>de</strong>nt, leur statut <strong>de</strong> déchet n'est pas, à ce jour, définitivem<strong>en</strong>t tranché,dans <strong>la</strong> mesure où une réutilisation <strong>en</strong> est toujours <strong>en</strong>visageable, par le biais <strong>de</strong> leurretraitem<strong>en</strong>t, <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t soumis à un moratoire.1. La radioactivité1.1 Le phénomène <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivitéLa radioactivité est un phénomène physique naturel qui peut être observé au niveau <strong>de</strong>sélém<strong>en</strong>ts constitutifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> matière, celui <strong>de</strong>s noyaux <strong>de</strong> l'atome. Chaque atome comporteun noyau c<strong>en</strong>tral, composé <strong>de</strong> protons à charge positive et <strong>de</strong> neutrons électriquem<strong>en</strong>tneutres, et <strong>en</strong>touré par un "nuage" ou "voile" d'électrons à charge négative. L'atome peut– très schématiquem<strong>en</strong>t – être représ<strong>en</strong>té comme un système so<strong>la</strong>ire minuscule ayantpour c<strong>en</strong>tre le soleil (le noyau) et autour duquel gravit<strong>en</strong>t les p<strong>la</strong>nètes (les électrons).En règle générale, les noyaux atomiques sont stables. Pour qu'il y ait stabilité, il faut qu'ilexiste un équilibre <strong>en</strong>tre le nombre <strong>de</strong> particules, les protons et les neutrons, prés<strong>en</strong>tesdans le noyau. Dans certains atomes, cet équilibre n'est toutefois pas réalisé. Soit il y atrop <strong>de</strong> protons par rapport au nombre <strong>de</strong> neutrons, soit il y a trop <strong>de</strong> neutrons par rapportau nombre <strong>de</strong> protons, ou <strong>en</strong>core il y <strong>en</strong> a trop <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux. La conséqu<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> cedéséquilibre est un excès d'énergie prés<strong>en</strong>te dans le noyau. Ce noyau est qualifiéd'instable ou <strong>de</strong> radioactif, et les matières qui conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t ce type <strong>de</strong> noyaux sont elles-10/166
mêmes qualifiées <strong>de</strong> radioactives.Ces noyaux atomiques instables doiv<strong>en</strong>t se débarrasser <strong>de</strong> leur énergie excé<strong>de</strong>ntaire.Tôt ou tard, tout noyau atomique instable va subir une modification afin <strong>de</strong> sedébarrasser <strong>de</strong> son excès d'énergie. L'énergie excé<strong>de</strong>ntaire est alors expulsée sous <strong>la</strong>forme <strong>de</strong> particules et/ou d'énergie pure, sous forme d'on<strong>de</strong>s électromagnétiques. C'estce que l'on appelle <strong>la</strong> désintégration radioactive. Cette désintégration est un phénomènespontané et aléatoire.L'énergie est expulsée jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint dans le noyau. Ceci peuts'effectuer <strong>en</strong> une ou plusieures étapes. Ainsi, l'activité d'une matière radioactive diminueprogressivem<strong>en</strong>t jusqu'à ce qu'elle ait pratiquem<strong>en</strong>t disparu. Après une ou plusieursdésintégrations, le noyau instable s'est transformé <strong>en</strong> un noyau stable non radioactif.1.2 Mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> désintégration et types <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>tLa désintégration <strong>de</strong>s noyaux instables peut s'opérer selon <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts, m<strong>en</strong>antà l'émission <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ts types <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t. Toutefois, un même type <strong>de</strong> noyau nedonne lieu, dans l'imm<strong>en</strong>se majorité <strong>de</strong>s cas, qu'à un seul et même mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>désintégration. De manière quelque peu simplifiée, trois cas sont possibles 1 : Dans le cas <strong>de</strong>s noyaux massifs, tel l'uranium, constitués d'un excès simultané <strong>de</strong>protons et <strong>de</strong> neutrons, <strong>la</strong> t<strong>en</strong>dance au retour à <strong>la</strong> stabilité se traduit par l'émission d'unnoyau d'hélium, constitué <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux protons et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux neutrons. Ces noyaux d'héliumconstitu<strong>en</strong>t le rayonnem<strong>en</strong>t alpha. Lourds mais peu pénétrants, les rayons alpha sontrapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t freinés. Une feuille <strong>de</strong> papier ou une couche d'air <strong>de</strong> 3 cm suffis<strong>en</strong>t à lesarrêter. Ces particules sont expulsées du noyau atomique à une vitesse <strong>de</strong> 16 000km/s. Les noyaux plus légers où les neutrons sont excé<strong>de</strong>ntaires par rapport aux protonsvoi<strong>en</strong>t <strong>la</strong> transformation d'un neutron <strong>en</strong> un proton, avec émission simultanée d'unélectron. Ces électrons constitu<strong>en</strong>t le rayonnem<strong>en</strong>t bêta. Les rayons bêta sont <strong>de</strong>sparticules plus légères et sont expulsés du noyau à une vitesse <strong>de</strong> 270 000 km/s. Pourles arrêter, une p<strong>la</strong>que <strong>en</strong> aluminium <strong>de</strong> quelques millimètres ou une couche d'airépaisse <strong>de</strong> 3 mètres s'avèr<strong>en</strong>t nécessaires. Le cas <strong>de</strong>s noyaux où les protons sont <strong>en</strong>surnombre est simi<strong>la</strong>ire, quoique légèrem<strong>en</strong>t plus complexe.Dans ces <strong>de</strong>ux premiers cas, l'émission particu<strong>la</strong>ire ne suffit <strong>en</strong> général pas à évacuer àelle seule l'excès d'énergie prés<strong>en</strong>t dans le noyau. Le reste d'énergie excé<strong>de</strong>ntaire estpar conséqu<strong>en</strong>t émis sous forme <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t électromagnétique, constituant lesrayons gamma. Il s'agit donc d'énergie pure, sans masse, qui, comme toutes les on<strong>de</strong>sélectromagnétiques, se dép<strong>la</strong>c<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> <strong>la</strong> lumière (300 000 km/s). Leur énergieest définie par leur fréqu<strong>en</strong>ce. Les rayons gamma possè<strong>de</strong>nt un grand pouvoir <strong>de</strong>pénétration dans <strong>la</strong> matière <strong>en</strong>vironnante. Ils ne peuv<strong>en</strong>t être arrêtés que par <strong>de</strong>smatières <strong>de</strong>nses comme le fer, le béton, le plomb, etc... . Les épaisseurs nécessairespeuv<strong>en</strong>t aller <strong>de</strong> quelques c<strong>en</strong>timètres à plusieurs mètres, <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> l'int<strong>en</strong>sité durayonnem<strong>en</strong>t. Le rayonnem<strong>en</strong>t gamma peut traverser plusieurs c<strong>en</strong>taines <strong>de</strong> mètres d'airsans affaiblissem<strong>en</strong>t notable. Dans un troisième cas <strong>en</strong>fin, seule l'énergie est <strong>en</strong> excès. Des rayons gamma sontalors émis, et uniquem<strong>en</strong>t eux.1.3 La décroissance radioactiveChaque fois qu'un noyau radioactif émet une particule et/ou <strong>de</strong> l'énergie pour arriver à unmeilleur équilibre <strong>en</strong>tre son nombre <strong>de</strong> protons et <strong>de</strong> neutrons, il se transforme <strong>en</strong> unautre noyau qui peut être lui-même radioactif ou non. Il reste donc une quantité <strong>de</strong> moins<strong>en</strong> moins importante <strong>de</strong> substance radioactive. Cette extinction progressive <strong>de</strong> <strong>la</strong>radioactivité est appelée décroissance radioactive.Le mom<strong>en</strong>t précis où un noyau atomique instable va subir une désintégration ne peut1 Dans ce qui suit, nous omettrons <strong>la</strong> fission spontanée, d'importance marginale, ainsi que le détail <strong>de</strong>sdiffér<strong>en</strong>ts sous-mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> désintégration bêta.11/166
être prédit. Il existe, par contre, une probabilité que cette désintégration se produise surun intervalle <strong>de</strong> temps donné. Cette probabilité 2 s'exprime par <strong>la</strong> constante radioactive λ,qui a <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> l'inverse d'un temps (s -1 ). Egale à zéro pour les noyaux stables,cette constante est, comme son nom l'indique, une propriété immuable et inaltérable <strong>de</strong>chaque espèce <strong>de</strong> noyau radioactif, ou radionucléi<strong>de</strong>.L'activité d'une certaine quantité d'un radionucléi<strong>de</strong> donné est égale au nombre d'atomes<strong>de</strong> ce radionucléi<strong>de</strong> multiplié par cette constante λ. Cette activité a pour unité lebecquerel (symbole : Bq), qui correspond à une désintégration par secon<strong>de</strong>. Le nombred'atomes diminuant au cours du temps, l'activité décroît par conséqu<strong>en</strong>t <strong>de</strong> manièreexpon<strong>en</strong>tielle, selon <strong>la</strong> courbe (expon<strong>en</strong>tielle décroissante) :figure 1: <strong>la</strong> courbe <strong>de</strong> décroissancePlus intuitive que <strong>la</strong> constante radioactive, <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> <strong>de</strong>mi-vie ou pério<strong>de</strong>, c'est-à-dire letemps au terme duquel <strong>la</strong> radioactivité a diminué <strong>de</strong> moitié, est <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t utilisée. Elle estproportionnelle à l'inverse 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> constante λ. Les quantités subsistant après un nombre n<strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s sont donc égales à 1/2 n .Nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s Quantité1 1/22 1/43 1/8... ...9 1/51210 1/1024Table 1.: La décroissance expon<strong>en</strong>tielleComme indiqué dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssus, après dix pério<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong>mi-vies, il ne resteplus qu'un millième <strong>de</strong> <strong>la</strong> matière radioactive initiale.Toutes les matières radioactives ont une <strong>de</strong>mi-vie qui leur est propre. La pério<strong>de</strong> peutaller <strong>de</strong> quelques secon<strong>de</strong>s seulem<strong>en</strong>t pour les unes à <strong>de</strong>s milliers ou <strong>de</strong>s millionsd'années pour d'autres. Vous trouverez ci-<strong>de</strong>ssous quelques exemples <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>sainsi que leur <strong>de</strong>mi-vie.2 Il ne s'agit pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> probabilité au s<strong>en</strong>s mathématique strict du terme, puisque cette valeur peut êtresupérieure à l'unité pour les noyaux très instables et est, par ailleurs, dim<strong>en</strong>sionnelle.3 Selon <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion : t 1/2 = ln(2)/λ12/166
Nucléi<strong>de</strong> Domaine d'utilisation Demi-vieIo<strong>de</strong> 123 mé<strong>de</strong>cine nucléaire : 13 heuresdiagnosticIridium 192 mé<strong>de</strong>cine nucléaire : thérapie 74 joursCobalt 60 mé<strong>de</strong>cine nucléaire : thérapie 5,27 ansCésium 137 mé<strong>de</strong>cine nucléaire : thérapie 30 ansCarbone 14 détermination <strong>de</strong> l'âge <strong>de</strong>s 5.730 ansmatériaux organiquesPlutonium 239 production <strong>de</strong> combustible 24.065 ansnucléaireUranium 235 production <strong>de</strong> combustibl<strong>en</strong>ucléaire704.000.000 ansTable 2.: Exemples <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s1.4 Les risques liés à <strong>la</strong> radioactivitéLes matières radioactives émett<strong>en</strong>t un rayonnem<strong>en</strong>t ionisant qui peut <strong>en</strong>traîner <strong>de</strong>smodifications au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> <strong>la</strong> matière qu'il traverse. En raison <strong>de</strong> leur forteénergie, les rayonnem<strong>en</strong>ts alpha, bêta et gamma peuv<strong>en</strong>t éjecter ou dévier <strong>de</strong>s électronsse trouvant sur leur trajectoire, provoquant <strong>de</strong> ce fait le phénomène d'ionisation. Cephénomène peut <strong>en</strong>dommager, <strong>en</strong>tre autres, les cellules <strong>de</strong>s êtres vivants.Les organismes vivants procè<strong>de</strong>nt normalem<strong>en</strong>t au r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s cellules<strong>en</strong>dommagées. Parfois cep<strong>en</strong>dant, les dommages <strong>en</strong>traînés par le rayonnem<strong>en</strong>t ionisantsont à ce point sérieux qu'ils <strong>en</strong> <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t irréversibles. Dans ce cas, les cellulesatteintes meur<strong>en</strong>t (effets précoces du rayonnem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> type brûlures, lésions internes etma<strong>la</strong>ises <strong>de</strong> natures diverses) ou poursuiv<strong>en</strong>t leur vie sous une forme modifiée aprèsavoir subi une mutation (effets différés du rayonnem<strong>en</strong>t, manifestés par un risque accru<strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> tumeurs cancéreuses ou par un dommage génétique).L'importance <strong>de</strong> l'irradiation d'un tissu est directem<strong>en</strong>t fonction <strong>de</strong> l'énergie que lesrayonnem<strong>en</strong>ts y ont déposée, et <strong>de</strong>s dommages que l'ionisation résultante lui auraoccasionnés. Ce dépôt d'énergie, rapporté à l'unité <strong>de</strong> masse <strong>de</strong> tissu, constitue ce qu'onappelle <strong>la</strong> dose, qui se mesure <strong>en</strong> gray (Gy, correspondant à un joule/kilo) ou <strong>en</strong> sievert(Sv, équival<strong>en</strong>t biologique du gray). Du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitesse limitée <strong>de</strong>s processus naturels<strong>de</strong> r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t ou <strong>de</strong> réparation <strong>de</strong>s tissus vivants, <strong>la</strong> durée d'une exposition auxrayonnem<strong>en</strong>ts joue égalem<strong>en</strong>t un rôle important, et une même dose, absorbée <strong>en</strong> untemps plus court, produit <strong>de</strong>s effets pot<strong>en</strong>tiels plus importants. C'est pourquoi <strong>la</strong> notion <strong>de</strong>débit <strong>de</strong> dose, généralem<strong>en</strong>t exprimée <strong>en</strong> Gy/h ou Sv/h 4 , est fréquemm<strong>en</strong>t utilisée <strong>en</strong>radioprotection. Les effets précoces déjà évoqués sont associés aux doses élevées surune courte pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> temps et leur manifestation t<strong>en</strong>d à être systématique, tandis queles effets différés résult<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s doses plus faibles et/ou cumulées sur <strong>de</strong>s durées pluslongues et leur apparition n'est <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> une certitu<strong>de</strong>.Les rayonnem<strong>en</strong>ts ionisants ne sont pas directem<strong>en</strong>t perceptibles par nos s<strong>en</strong>s. Ilspeuv<strong>en</strong>t toutefois être détectés et mesurés, même à <strong>de</strong>s niveaux extrêmemem<strong>en</strong>t faibles,au moy<strong>en</strong> d'appareils adéquats, comme par exemple le compteur Geiger-Müller.L'importance du risque <strong>en</strong>couru dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> divers facteurs comme <strong>la</strong> durée <strong>de</strong>l'exposition, l'int<strong>en</strong>sité du rayonnem<strong>en</strong>t, le type <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t (alpha, bêta, gamma) etle fait que l'organisme a été exposé <strong>en</strong> totalité ou <strong>en</strong> partie seulem<strong>en</strong>t au rayonnem<strong>en</strong>t.Examinons brièvem<strong>en</strong>t les mo<strong>de</strong>s d'exposition possibles : L'irradiation externe 5 , où <strong>la</strong> source <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>ts n'est pas <strong>en</strong> contact avecl'organisme, mais à distance <strong>de</strong> celui-ci. Vu leur faible pouvoir <strong>de</strong> pénétration dans l'air,les rayons alpha n'<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> ligne <strong>de</strong> compte, et les rayons bêta, uniquem<strong>en</strong>t dans<strong>de</strong>s circonstances très particulières. Ce sont les rayons gamma qui jou<strong>en</strong>t ici un rôlemajeur.4 Le gray et le sievert correspondant à <strong>de</strong>s doses très importantes, on utilise plus fréquemm<strong>en</strong>t leurs sousmultiples,tels leur millième (mGy/h, mSv/h) ou leur millionième (μGy/h, μSv/h).5 L'irradiation interne est le résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> contamination interne, traitée plus bas.13/166
La contamination externe, où <strong>la</strong> matière radioactive est <strong>en</strong> dépôt sur <strong>la</strong> peau. Tous lestypes <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>ts sont susceptibles <strong>de</strong> provoquer <strong>de</strong>s lésions (par exemple, <strong>de</strong>sbrûlures), mais, toujours pour les mêmes raisons, ces lésions ne seront quesuperficielles dans le cas <strong>de</strong>s rayons alpha. Les <strong>de</strong>ux autres types <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>tpeuv<strong>en</strong>t par contre provoquer <strong>de</strong>s lésions <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur. La contamination interne, où <strong>la</strong> matière radioactive a été inhalée ou ingérée. Lesdommages sont occasionnées dans les organes où se dépos<strong>en</strong>t et, év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t, seconc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t les radionucléi<strong>de</strong>s absorbés (selon le radionucléi<strong>de</strong> : le foie, les os, lespoumons, <strong>la</strong> thyroï<strong>de</strong>, etc...) et qu'ils irradi<strong>en</strong>t directem<strong>en</strong>t. Les émetteurs <strong>de</strong>rayonnem<strong>en</strong>t alpha sont ici particulièrem<strong>en</strong>t nocifs, vu les caractéristiques <strong>de</strong> ce type<strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t.Dans tous les cas, <strong>la</strong> réduction du risque est possible moy<strong>en</strong>nant le confinem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>smatières radioactives (diminution du risque <strong>de</strong> contamination), l'interposition <strong>de</strong> blindageset l'éloignem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> source (diminution <strong>de</strong> l'irradiation), et <strong>la</strong> limitation <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong>l'év<strong>en</strong>tuelle exposition au rayonnem<strong>en</strong>t, si celle-ci se produit ou est inévitable.Pour conclure ce bref rappel au sujet <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité, rappelons que celle-ci n'est pasuniquem<strong>en</strong>t un phénomène artificiel dont l'activité humaine, sci<strong>en</strong>tifique ou industrielle,serait <strong>la</strong> seule source. Les minéraux, ainsi que les organismes vivants, conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>ssubstances radioactives naturelles contemporaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Terre – à trèslongue <strong>de</strong>mi-vie donc – ou continuellem<strong>en</strong>t formées dans <strong>la</strong> haute atmosphère sousl'action <strong>de</strong>s rayons cosmiques <strong>de</strong> haute énergie. L'organisme humain est inévitablem<strong>en</strong>tsoumis à une irradiation naturelle continue du fait <strong>de</strong>s substances qui l'<strong>en</strong>vironn<strong>en</strong>t ou<strong>de</strong>s rayons cosmiques, et est lui-même radioactif, puisqu'un corps humain adultereprés<strong>en</strong>te une activité <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 5 000 Bq. Les doses <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t dues à cetteirradiation naturelle sont d'ailleurs généralem<strong>en</strong>t majoritaires par rapport aux expositionsd'origine artificielle, telles que médicales.2. Les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>2.1 Une définition rigoureuseToute problématique se doit d'être circonscrite au moy<strong>en</strong> <strong>de</strong> définitions les plus préciseset les moins équivoques possibles. C'est pourquoi le légis<strong>la</strong>teur 6 définit le déchetradioactif comme étant :“Toute matière pour <strong>la</strong>quelle aucune utilisation n'est prévue et qui conti<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sradionucléi<strong>de</strong>s <strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tration supérieure aux valeurs que les autoritéscompét<strong>en</strong>tes considèr<strong>en</strong>t comme admissibles dans <strong>de</strong>s matériaux propres à uneutilisation ou au rejet sans contrôle.”Si <strong>la</strong> première partie <strong>de</strong> cette définition, qui concerne l'abs<strong>en</strong>ce d'utilisation prévue,n'appelle pas, à ce sta<strong>de</strong>, <strong>de</strong> comm<strong>en</strong>taires particuliers, <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> partie doit par contreret<strong>en</strong>ir notre att<strong>en</strong>tion. Elle précise <strong>en</strong> effet que <strong>la</strong> seule prés<strong>en</strong>ce d'un ou plusieursradionucléi<strong>de</strong>s n'est pas un critère déterminant, mais bi<strong>en</strong> cette prés<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> quantitésupérieure à une limite déterminée. Les raisons <strong>en</strong> sont les suivantes :Tout d'abord, nous l'avons vu précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> radioactivité naturelle est omniprés<strong>en</strong>te.Si toute quantité non nulle <strong>de</strong> radioactivité <strong>de</strong>vait être prise <strong>en</strong> considération, tout déchet,quel qu'il soit – même les <strong>déchets</strong> ménagers ! –, acquerrait <strong>de</strong> facto le statut <strong>de</strong> déchetradioactif.La prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s artificiels (i.e. dûs à l'activité humaine) peut et doit êtreapprochée <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon. En effet, les rayonnem<strong>en</strong>ts qu'ils émett<strong>en</strong>t et les effets queceux-ci sont susceptibles d'induire ne sont <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> différ<strong>en</strong>ts, quant à leur nature, <strong>de</strong> ceuxliés aux radionucléi<strong>de</strong>s d'origine naturelle et il n'y a pas lieu <strong>de</strong> distinguer, <strong>en</strong> tant quephénomène physique, <strong>la</strong> radioactivité artificielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité naturelle. D'autre part,un certain nombre <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s artificiels sont égalem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ts, à l'état <strong>de</strong> tracesgénéralem<strong>en</strong>t infimes, dans l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, principalem<strong>en</strong>t du fait <strong>de</strong>s essais nucléaires6 arrêté royal du 30 mars 1981 définissant les missions <strong>de</strong> l'ONDRAF, Titre 1, Article 1.14/166
<strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> moitié du XX ème siècle et, dans une moindre mesure, <strong>de</strong> l'acci<strong>de</strong>ntnucléaire <strong>de</strong> Tchernobyl.C'est pourquoi le légis<strong>la</strong>teur définit pour chaque radionucléi<strong>de</strong> les niveaux d'activité et <strong>de</strong>conc<strong>en</strong>tration d'activité <strong>en</strong>-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>squels toute substance les cont<strong>en</strong>ant peut êtreexemptée ou libérée 7 dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réglem<strong>en</strong>tation. Ces niveaux sont établis sur <strong>la</strong>base sci<strong>en</strong>tifique <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioprotection et dép<strong>en</strong><strong>de</strong>nt, pour chaque radionucléi<strong>de</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong>nature et <strong>de</strong> l'énergie <strong>de</strong> ses émissions, <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>mi-vie et <strong>de</strong> sa radiotoxicité.Nous retrouverons plus loin dans ce chapitre <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> dont le niveau <strong>de</strong>radioactivité est extrêmem<strong>en</strong>t faible. Dans un premier temps, toutefois, il sera question<strong>de</strong>s substances dont le statut <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> comme le caractère radioactif sont c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>tétablis.2.2 Leur état physique et le niveau radiologique2.2.1 L'état physico-chimiquePhysiquem<strong>en</strong>t et chimiquem<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> très gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> nediffèr<strong>en</strong>t guère <strong>de</strong>s autres <strong>déchets</strong> industriels, ou même ménagers. Qu'il s'agisse d'eauxusées, <strong>de</strong> vêtem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> protection, <strong>de</strong> pièces <strong>de</strong> machines ou d'outils mis au rebut, <strong>de</strong>produits chimiques <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoires d'analyse et <strong>de</strong> recherche, <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> hospitaliers ou<strong>en</strong>core <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> démolition, les matériaux qui les constitu<strong>en</strong>t sont les mêmes queceux que l'on r<strong>en</strong>contre dans les autres domaines <strong>de</strong> l'industrie et <strong>de</strong>s services, et lescauses <strong>de</strong> leur production sont i<strong>de</strong>ntiques : <strong>la</strong> nécessaire mise à l'écart <strong>de</strong> choses<strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues inutiles.Seul un très faible volume <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, celle qui concerne lescombustibles nucléaires eux-mêmes, leur fabrication et les traitem<strong>en</strong>ts qu'ils subiss<strong>en</strong>taprès utilisation pour <strong>la</strong> production d'énergie électrique, possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s caractéristiquesphysico-chimiques qui les différ<strong>en</strong>ci<strong>en</strong>t nettem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s autres <strong>déchets</strong> industriels. Du point<strong>de</strong> vue radiologique, qui fait l'objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> section qui suit, ce sont égalem<strong>en</strong>t ceux quiprés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les niveaux <strong>de</strong> radioactivité les plus élevés.Outre, bi<strong>en</strong> sûr, <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s <strong>en</strong> quantités plus ou moins importantes, <strong>la</strong>plus gran<strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ce que l'on puisse <strong>en</strong> fait relever <strong>en</strong>tre les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et lesautres <strong>déchets</strong> industriels et ménagers, c'est le volume très faible <strong>de</strong>s premiers parrapport aux seconds. Annuellem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> effet, <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> nereprés<strong>en</strong>te que 0,02 % <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> industriels et ménagers produits <strong>en</strong>Belgique.Avant <strong>de</strong> passer, si l'on peut dire, au coeur du problème, c'est-à-dire à leur caractèreradioactif, rev<strong>en</strong>ons brièvem<strong>en</strong>t à l'état physique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.Ils peuv<strong>en</strong>t se prés<strong>en</strong>ter sous forme soli<strong>de</strong> et <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> ce soli<strong>de</strong> déterminera letraitem<strong>en</strong>t qui lui sera ultérieurem<strong>en</strong>t appliqué : Les <strong>déchets</strong> combustibles (papier, tissus, p<strong>la</strong>stiques, ...) peuv<strong>en</strong>t être incinérés, ce quiréduit considérablem<strong>en</strong>t le volume <strong>de</strong>s résidus, Les <strong>déchets</strong> métalliques, ainsi que les autres <strong>déchets</strong> non-combustibles, peuv<strong>en</strong>t êtrecompactés pour autant qu'ils ne soi<strong>en</strong>t pas trop massifs (câbles, outil<strong>la</strong>ge, piècesdiverses, ...), toujours dans le but d'une réduction <strong>de</strong> volume, Les autres <strong>déchets</strong> (béton et autres débris <strong>de</strong> démolition, pièces métalliquesmassives, ...) peuv<strong>en</strong>t être découpés, et, quand ce<strong>la</strong> est possible, radiologiquem<strong>en</strong>tdécontaminés.D'autres <strong>déchets</strong> sont liqui<strong>de</strong>s :7 De manière très simplifiée, l'exemption consiste à considérer le matériau comme non radioactif a priori(“une autorisation n'est pas nécessaire”), tandis que <strong>la</strong> libération n'effectue cette considération qu'aposteriori (“une autorisation n'est plus nécessaire”). La différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre exemption et libération est préciséedans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlem<strong>en</strong>t général <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong>stravailleurs et <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre le danger <strong>de</strong>s rayonnem<strong>en</strong>ts ionisants, Annexes IA et IB.15/166
Certains <strong>de</strong> ceux-ci sont combustibles, puisqu'il s'agit d'huiles usées, <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>sorganiques <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire, ou <strong>en</strong>core, <strong>de</strong> solvants. Dans leur cas, l'incinération estégalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> mise, Les eaux contaminées <strong>en</strong> radionucléi<strong>de</strong>s peuv<strong>en</strong>t être traitées <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>tes façons, <strong>en</strong>fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong> ceux-ci, du volume à traiter et d'autres paramètreschimiques. Selon le cas, elles seront soumises à l'évaporation, <strong>la</strong> filtration, <strong>la</strong>flocu<strong>la</strong>tion-décantation, l'échange d'ions ou tout autre traitem<strong>en</strong>t spécialisé.Les <strong>déchets</strong> gazeux ne sont généralem<strong>en</strong>t pas <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> tant que tels : il s'agit plutôtd'efflu<strong>en</strong>ts gazeux (fumées d'incinération, air <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion, vapeur, ...) pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>tchargés <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s sous forme <strong>de</strong> fines particules. Ces efflu<strong>en</strong>ts sont toujourstraités, le plus souv<strong>en</strong>t par filtration et c'est le filtre qui <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t, in fine, le déchet radioactif.Le seul gaz intrinsèquem<strong>en</strong>t radioactif d'importance significative est le radon ( 222 Rn),d'origine naturelle.Une fois traités, c'est-à-dire stabilisés chimiquem<strong>en</strong>t et/ou ram<strong>en</strong>és à un volume moindre,les <strong>déchets</strong> sont <strong>en</strong>suite p<strong>la</strong>cés dans un fût et immobilisés dans un mortier <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t,parfois le bitume, afin <strong>de</strong> confiner <strong>la</strong> radioactivité et <strong>de</strong> les stabiliser mécaniquem<strong>en</strong>t.Cette opération s'appelle le conditionnem<strong>en</strong>t 8 .Le système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> fait <strong>la</strong> distinction <strong>en</strong>tre les <strong>déchets</strong> nonconditionnés (“les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> départ”) et les <strong>déchets</strong> conditionnés (“les <strong>déchets</strong> traités,immobilisés et emballés”).2.2.2 Le niveau radiologiqueLa caractéristique majeure, fondam<strong>en</strong>tale, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> qui nous occup<strong>en</strong>t ici est d'être<strong>radioactifs</strong>. Il est donc parfaitem<strong>en</strong>t naturel, et même intuitif, <strong>de</strong> les distinguer et <strong>de</strong> lesc<strong>la</strong>sser <strong>en</strong> fonction du niveau <strong>de</strong> radioactivité, ou plutôt, d'irradiation, qu'ils prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t.Tous les pays confrontés à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> tels <strong>déchets</strong> pratiqu<strong>en</strong>t d'ailleurs unec<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> base c<strong>en</strong>trée sur ce critère.Cette première c<strong>la</strong>ssification, simple au <strong>de</strong>meurant, est basée sur le court terme, oumieux, sur l'état radiologique prés<strong>en</strong>t du déchet. On l'a vu dans l'introduction <strong>de</strong> cechapitre, <strong>la</strong> radioactivité évolue au cours du temps. Nous retrouverons donc plus <strong>en</strong>détail, au troisième chapitre <strong>de</strong> ce docum<strong>en</strong>t, une c<strong>la</strong>ssification davantage basée sur <strong>la</strong><strong>gestion</strong> dans les moy<strong>en</strong> et long termes <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, c<strong>la</strong>ssification qui ne <strong>de</strong>vrapas être confondue avec ce qui suit.Pour leur <strong>gestion</strong> à court terme, et notamm<strong>en</strong>t pour leur traitem<strong>en</strong>t et leur <strong>en</strong>treposageprovisoire, opérations qui seront détaillées plus loin (chapitres cinq et neuf), les <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> sont répartis <strong>en</strong> trois gran<strong>de</strong>s catégories selon leur niveau <strong>de</strong> radiation 9 : Les <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants (ou, moins précisém<strong>en</strong>t, “<strong>de</strong> faible activité”) sont les<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> dont le débit <strong>de</strong> dose au contact (dose à <strong>la</strong>quelle un individu estexposé lorsqu'il est <strong>en</strong> contact direct avec le déchet ou son embal<strong>la</strong>ge) est inférieur à 5millisievert/heure. Leur manipu<strong>la</strong>tion, leur <strong>en</strong>treposage provisoire et leur traitem<strong>en</strong>t n<strong>en</strong>écessit<strong>en</strong>t que <strong>de</strong>s mesures minimales <strong>de</strong> protection contre l'irradiation. En effet, dufait du faible niveau d'irradiation pot<strong>en</strong>tielle, seule <strong>la</strong> contamination par dissémination<strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s cont<strong>en</strong>us dans le déchet pourrait prés<strong>en</strong>ter un risque significatif. Les <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants (“<strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité”) sont les <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> dont le débit <strong>de</strong> dose au contact se situe <strong>en</strong>tre 5 millisievert et 2 sievert parheure. Leur traitem<strong>en</strong>t doit se faire dans un espace fermé et blindé et toutes lesmanipu<strong>la</strong>tions se font à l'ai<strong>de</strong> d'appareils commandés à distance. L'irradiation pr<strong>en</strong>d icile pas, du point <strong>de</strong> vue du risque, sur <strong>la</strong> contamination pot<strong>en</strong>tielle, quoique <strong>la</strong>prév<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière reste d'actualité. Les <strong>déchets</strong> fortem<strong>en</strong>t irradiants (“<strong>de</strong> haute activité”) sont les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> dontle débit <strong>de</strong> dose au contact est supérieur à 2 sievert par heure. Ces <strong>déchets</strong> dégag<strong>en</strong>t<strong>en</strong> outre <strong>de</strong>s quantités significatives <strong>de</strong> chaleur. Ils font l'objet <strong>de</strong>s mêmes précautions8 Ceci constitue le cas le plus courant. Dans <strong>de</strong>s cas plus spéciaux, notamm<strong>en</strong>t celui <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> hautem<strong>en</strong>t<strong>radioactifs</strong>, <strong>de</strong>s techniques plus spécifiques sont appliquées, telles <strong>la</strong> vitrification (matrice <strong>de</strong> verre).9 Les limites citées ci-<strong>de</strong>ssous sont celles applicables <strong>en</strong> Belgique pour les <strong>déchets</strong> conditionnés.16/166
que les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité. La seule différ<strong>en</strong>ce est l'épaisseur du blindage,plus importante bi<strong>en</strong> sûr, qui est toujours calculée <strong>de</strong> manière à réduire à un niveauadmissible le rayonnem<strong>en</strong>t subi par les opérateurs.En terme <strong>de</strong> volumes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, <strong>en</strong>viron 80 % <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sont <strong>de</strong> basseactivité et <strong>en</strong>viron 1% sont <strong>de</strong> haute activité. Ceux-ci conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t cep<strong>en</strong>dant à eux seuls95 % <strong>de</strong> l'activité totale <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, toutes catégories confondues. Le restantest constitué <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité.2.3 Des origines diversesA l'heure <strong>actuelle</strong>, ce sont quelque trois quarts du volume <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qui sontdirectem<strong>en</strong>t ou indirectem<strong>en</strong>t relié à <strong>la</strong> production d'électricité via l'utilisation <strong>de</strong> l'énergi<strong>en</strong>ucléaire. Le quart restant provi<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche non reliée à l'énergie,<strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine nucléaire et <strong>de</strong> l'industrie.Il n'<strong>en</strong> a pas toujours été ainsi, et l'histoire nucléaire belge est aussi anci<strong>en</strong>ne quediverse 10 .On distingue schématiquem<strong>en</strong>t trois gran<strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> production :1. L'ère pionnière, caractérisée par une int<strong>en</strong>se activité <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong>développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s technologies du cycle du combustible, <strong>de</strong>s réacteurs et <strong>de</strong>sapplications <strong>de</strong> l'énergie nucléaire, sans production énergétique <strong>de</strong> masse. Lesapplications médicales et industrielles <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité font égalem<strong>en</strong>t l'objet <strong>de</strong>développem<strong>en</strong>ts importants.2. L'ère d'aujourd'hui, héritière <strong>de</strong> <strong>la</strong> précé<strong>de</strong>nte, qui met <strong>en</strong> oeuvre le savoir-faireacquis et où <strong>la</strong> recherche, toujours prés<strong>en</strong>te, cè<strong>de</strong> le pas à <strong>la</strong> production.3. Le futur, qui prévoit <strong>la</strong> mise hors-service <strong>de</strong>s réacteurs nucléaires actuels, suivie<strong>de</strong> leur démantèlem<strong>en</strong>t, ainsi que <strong>la</strong> démolition d'autres instal<strong>la</strong>tions liées aucycle du combustible nucléaire. Les applications médicales et industrielles, parcontre, sembl<strong>en</strong>t <strong>de</strong>voir être poursuivies dans un av<strong>en</strong>ir prévisible.Il est c<strong>la</strong>ir, <strong>en</strong>fin, que <strong>la</strong> transition <strong>en</strong>tre ces phases s'est faite ou se fera <strong>de</strong> manièreprogressive et que les productions <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qui les ont accompagnées (ouaccompagneront), et que nous décrivons ci-après, évolu<strong>en</strong>t avec <strong>la</strong> même progressivité.2.3.1 Les premières activités nucléairesEn Belgique, <strong>la</strong> première industrie mettant spécifiquem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> jeu <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>sremonte à 1922. Cette année-là, <strong>en</strong> effet, l'Union Minière du Haut-Katanga inaugure unatelier <strong>de</strong> production industrielle <strong>de</strong> radium dans son usine d'Ol<strong>en</strong>, radium <strong>de</strong>stiné àcertaines applications médicales <strong>de</strong> l'époque. Cet atelier fonctionnera quelque cinquanteans et produira <strong>en</strong>viron 60 % du radium mondial.L'industrie nucléaire belge voit vraim<strong>en</strong>t le jour <strong>en</strong> 1952, avec <strong>la</strong> création du C<strong>en</strong>tred'Etu<strong>de</strong>s pour les Applications <strong>de</strong> l'Energie Nucléaire (C.E.A.N., S.T.K. <strong>en</strong> néer<strong>la</strong>ndais) àMol <strong>en</strong> Campine anversoise. Il <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> 1957, le C.E.N. (néerl. : S.C.K.), C<strong>en</strong>tred'Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'Energie Nucléaire, aujourd'hui SCK·CEN. Comme l'indique son nom, cec<strong>en</strong>tre est ori<strong>en</strong>té vers tous les domaines concernés par les applications pot<strong>en</strong>tielles <strong>de</strong>ce nouveau type d'énergie : <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong> combustibles, <strong>la</strong> physique <strong>de</strong>s réacteursdont cinq prototypes expérim<strong>en</strong>taux sont construits, <strong>la</strong> production <strong>de</strong> radio-isotopes, leretraitem<strong>en</strong>t chimique <strong>de</strong>s combustibles irradiés, <strong>la</strong> radioprotection, les mesuresradiologiques. Ces activités génèr<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> dont il est à l'époque le plusimportant producteur. Un <strong>de</strong> ses départem<strong>en</strong>ts, le Waste, servira, <strong>de</strong>s années '50 jusqu'à<strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années '80, <strong>de</strong> cellule <strong>de</strong> recherche, mais aussi d'unité <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t industrielet <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.10 De manière générale, le prés<strong>en</strong>t docum<strong>en</strong>t se veut consacré à <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>actuelle</strong> <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Dans certains cas, toutefois, un historique et/ou <strong>de</strong>s perspectives futures sontnécessaires à une compréh<strong>en</strong>sion complète <strong>de</strong> l'état <strong>de</strong> cette <strong>gestion</strong> <strong>actuelle</strong>. Une telle situation seprés<strong>en</strong>te ici, et se représ<strong>en</strong>tera <strong>en</strong>core dans d'autres chapitres.17/166
La dynamique autour du nucléaire que représ<strong>en</strong>te le SCK·CEN ne tar<strong>de</strong> pas à seconcrétiser dans <strong>la</strong> naissance d'autres <strong>en</strong>treprises ou instal<strong>la</strong>tions. Dans <strong>la</strong> même région<strong>de</strong> Mol, et dans <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>nie qui suit, s'imp<strong>la</strong>nt<strong>en</strong>t les usines <strong>de</strong> fabrication <strong>de</strong> combustibl<strong>en</strong>ucléaire BELGONUCLEAIRE et FBFC (Franco-Belge <strong>de</strong> Fabrication <strong>de</strong>s Combustibles),ainsi qu'un projet expérim<strong>en</strong>tal international regroupant treize pays <strong>de</strong> l'OCDE, l'usinepiloteEUROCHEMIC pour l'étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> mise au point <strong>de</strong>s procédés <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>scombustibles nucléaires irradiés. Cette <strong>de</strong>rnière reti<strong>en</strong>t plus particulièrem<strong>en</strong>t notreatt<strong>en</strong>tion, <strong>de</strong> par sa contribution historique à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne ethaute activités.Enfin, dans les années '70, l'Institut <strong>de</strong>s Radio-Elém<strong>en</strong>ts (IRE), issu du SCK·CEN,s'imp<strong>la</strong>nte à Fleurus <strong>en</strong> région wallonne pour assurer <strong>la</strong> production <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s àusage médical et industriel.Le Waste du SCK·CEN c<strong>en</strong>tralise sur cette pério<strong>de</strong> (et jusqu'<strong>en</strong> 1988) le traitem<strong>en</strong>t et leconditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activité du C<strong>en</strong>tre lui-même et <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tionsvoisines. De 1960 à 1982, <strong>la</strong> Belgique procè<strong>de</strong> à l'immersion <strong>en</strong> mer, dans l'At<strong>la</strong>ntiqueNord, d'<strong>en</strong>viron 30.000 tonnes <strong>de</strong> colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activité. Ces immersions,organisées par le Waste, s'effectuai<strong>en</strong>t dans le respect <strong>de</strong>s normes radiologiquesédictées par l'AIEA et sous son contrôle d'abord, sous celui <strong>de</strong> l'Ag<strong>en</strong>ce pour l'EnergieNucléaire <strong>de</strong> l'OCDE <strong>en</strong>suite. Le moratoire (1983), puis l'interdiction (1993), re<strong>la</strong>tifs aurejet <strong>en</strong> mer mir<strong>en</strong>t fin, dès 1983 et dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> Londres, auxcampagnes d'immersion. Des <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>stinés au rejet <strong>en</strong> mer, seuls <strong>en</strong>viron 1 500 m 3restèr<strong>en</strong>t stockés dans les <strong>en</strong>trepôts <strong>de</strong> transit du Waste, du fait <strong>de</strong> l'annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>de</strong>rnière campagne d'immersion.Il n'a jamais été question <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r au rejet <strong>en</strong> mer <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne ou hauteactivité, à aucune époque. Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> ce type sont alors, dans leur imm<strong>en</strong>semajorité, produits par le SCK·CEN et l'EUROCHEMIC.Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne ou haute activité du SCK·CEN sont <strong>de</strong> nature très variée, vu <strong>la</strong>diversité <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> recherche qui les génèr<strong>en</strong>t et sont, <strong>en</strong> gran<strong>de</strong> partie, <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s. Si les <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s peuv<strong>en</strong>t être solidifiés dans le bitume, les <strong>déchets</strong>soli<strong>de</strong>s ne sont, à l'époque, traités et conditionnés que si l'on juge que les techniquesdisponibles sont adéquates. Si tel n'est pas le cas, le déchet est simplem<strong>en</strong>t emballé <strong>en</strong>cont<strong>en</strong>eurs <strong>de</strong> modèles variés et stocké <strong>en</strong> att<strong>en</strong>te sur le site du départem<strong>en</strong>t Waste.C'est ainsi que s'accumul<strong>en</strong>t au cours <strong>de</strong>s années <strong>en</strong>viron 200 m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>sdivers, dits “HRA” et “So<strong>la</strong>rium” (du nom <strong>de</strong> leur instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> stockage temporaire).Vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t s'y ajouter certains <strong>déchets</strong> produits par les autres instal<strong>la</strong>tions citées plus haut,<strong>en</strong> ce compris <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> l'atelier <strong>de</strong> l'Union Minière. Lerec<strong>en</strong>sem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong> et l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>stinée à les traiter s'est effectuédans les années '90. Le conditionnem<strong>en</strong>t définitif <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong> a débuté au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>prés<strong>en</strong>te déc<strong>en</strong>nie.Le retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> combustibles usés consiste à dissoudre ceux-ci pour séparerl'uranium, le plutonium et les produits <strong>de</strong> <strong>la</strong> fission nucléaire. C'est l'activité <strong>de</strong>l'EUROCHEMIC, qui pour cette raison produit surtout <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s. P<strong>en</strong>dant lesannées '70, les <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité sont solidifiés dans une matrice <strong>de</strong>bitume, dans l'instal<strong>la</strong>tion EUROBITUM. Quant aux <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> haute activité, qui, du fait<strong>de</strong> celle-ci, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt une certaine pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> refroidissem<strong>en</strong>t préliminaire, ils sontcoulés <strong>en</strong> blocs <strong>de</strong> verre, dans l'instal<strong>la</strong>tion PAMELA, vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années '80 et ledébut <strong>de</strong>s années '90. Quelques <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s, débris d'anci<strong>en</strong>s combustibles sontégalem<strong>en</strong>t immobilisés dans du cim<strong>en</strong>t vers 1995. Le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>l'EUROCHEMIC est aujourd'hui terminé. L'EUROCHEMIC elle-même a cessé sesactivités <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> 1974.2.3.2 Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> production couranteNous l'avons dit plus haut, <strong>en</strong>viron trois quarts <strong>de</strong> <strong>la</strong> production courante <strong>actuelle</strong> <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sont le fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> production d'électricité par les c<strong>en</strong>trales nucléaires,les industries du cycle du combustible et les institutions <strong>de</strong> recherche et développem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>la</strong> matière. Nous avons déjà r<strong>en</strong>contré BELGONUCLEAIRE et FBFC (fabrication <strong>de</strong>combustibles) et le SCK·CEN (recherche) dans <strong>la</strong> section qui précè<strong>de</strong>, et nous avons18/166
égalem<strong>en</strong>t vu que l'aval du cycle du combustible, le retraitem<strong>en</strong>t avec EUROCHEMIC,avait disparu du paysage nucléaire national. Intéressons-nous d'abord aux réacteursélectronucléaires.Les débuts du parc électronucléaire belge dat<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 1975, avec <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> service <strong>de</strong>sréacteurs DOEL 1 et 2 (puissance : +/- 400 MWe) et TIHANGE 1 (960 MWe). Les suiv<strong>en</strong>t,<strong>en</strong> 1982 et 1983, DOEL 3 (1 000 MWe) et TIHANGE 2 (1 000 MWe). Les <strong>de</strong>rnièresunités, à ce jour, sont DOEL 4 (990 MWe) et TIHANGE 3 (1 020 MWe), raccordées auréseau électrique <strong>en</strong> 1985. Ce sont donc <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t 5 800 MWe <strong>de</strong> puissanceinstallée.Comme toute production industrielle, celle-ci ne va pas sans génération <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>,<strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> l'occurr<strong>en</strong>ce. En suivant toujours <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification selon le niveauradiologique telle qu'exposée ci-avant, un réacteur nucléaire <strong>de</strong> 1 000 MWe – l'unitépréva<strong>la</strong>nte du parc – produit annuellem<strong>en</strong>t : <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activité après traitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t par les soins <strong>de</strong> <strong>la</strong>c<strong>en</strong>trale elle-même ou <strong>de</strong> tiers, d'<strong>en</strong>viron 75 m 3 : vêtem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> protection du personnel prés<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zone contrôlée (“radioactive”), pièces d'équipem<strong>en</strong>t légères, telles qu'outil<strong>la</strong>ge, vannes, manomètres, câb<strong>la</strong>ges ... pièces d'équipem<strong>en</strong>t lour<strong>de</strong>s, par exemple tuyauteries, corps <strong>de</strong> pompe, ... résidus <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s eaux légèrem<strong>en</strong>t contaminées (conc<strong>en</strong>trats et filtres), filtres <strong>de</strong>s circuits <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion, huiles usées <strong>de</strong> lubrification <strong>de</strong>s pompes <strong>de</strong> circu<strong>la</strong>tion. <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité, à raison <strong>de</strong> 5 à 10 m 3 : résines <strong>de</strong> purification <strong>de</strong>s eaux du circuit primaire du réacteur, certains filtres <strong>de</strong> ce même circuit primaire, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> haute activité. Il faut ici distinguer <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s : P<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> première pério<strong>de</strong>, le combustible usé issu <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales est retraité. Cetteopération industrielle, rappelons-le, vise à séparer les produits <strong>de</strong> fission <strong>de</strong> l'uraniumet du plutonium et à recycler ces <strong>de</strong>rniers dans <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong> nouveauxcombustibles. La Belgique opte pour cette solution dès 1975, avant <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r <strong>en</strong>1993 un moratoire sur le retraitem<strong>en</strong>t du combustible usé <strong>de</strong>s réacteurs <strong>de</strong> puissanceet <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cer désormais les <strong>de</strong>ux options pour l'aval du cycle (retraitem<strong>en</strong>t etévacuation directe) sur un pied d'égalité. Le retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s premiers combustiblesbelges est effectué à l'étranger (usine COGEMA, <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t AREVA NC, à <strong>la</strong>Hague, France, cf. chapitre cinq). Pour une année <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t du réacteur <strong>de</strong>1 000 MWe, les <strong>déchets</strong> finaux <strong>de</strong> haute activité résultant du retraitem<strong>en</strong>t ducombustible représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t 4 m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> vitrifiés cont<strong>en</strong>ant les produits <strong>de</strong> fission etactini<strong>de</strong>s mineurs et 4 m 3 d'élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> structure <strong>de</strong>s assemb<strong>la</strong>ges (“coques etembouts”), compactés. Les <strong>déchets</strong> vitrifiés correspondant au retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 670tHM ont été rapatriés <strong>de</strong> France <strong>en</strong> Belgique <strong>en</strong>tre 2000 et 2007 (total 70 m 3 ). Lerapatriem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s coques et embouts compactés est prévu pour l'intervalle2009-2013. Depuis 1993, année du moratoire sur le retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s combustibles <strong>de</strong> c<strong>en</strong>tralesélectronucléaires, le combustible usé issu <strong>de</strong>s réacteurs <strong>de</strong> puissance n'est plusretraité. Les assemb<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> combustible déchargés du réacteur sont aujourd'hui<strong>en</strong>treposés sur le site même <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>en</strong>trale, dans <strong>de</strong>s piscines ou <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>stockage à sec, afin <strong>de</strong> permettre à <strong>la</strong> décroissance d'<strong>en</strong> faire substantiellem<strong>en</strong>tbaisser le niveau d'activité. Dans <strong>la</strong> situation <strong>actuelle</strong>, un réacteur <strong>de</strong> 1 000 MWeproduit un volume annuel d'<strong>en</strong>viron 12 m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> haute activité.Un certain nombre d'instal<strong>la</strong>tions liées au secteur électronucléaire produis<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible, moy<strong>en</strong>ne et haute activité. On a ainsi : <strong>en</strong> faible activité :19/166
les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> production courante <strong>de</strong> <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong>s combustibles(BELGONUCLEAIRE, FBFC), les <strong>déchets</strong> prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s diverses activités <strong>de</strong> recherche ( SCK·CEN et universités), <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne activité : les <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire d'analyse et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> fabrication <strong>de</strong> cesinstal<strong>la</strong>tions, <strong>en</strong> haute activité : les <strong>déchets</strong> cim<strong>en</strong>tés issus du retraitem<strong>en</strong>t, au Royaume-Uni, d'une partie <strong>de</strong>scombustibles du réacteur BR2 d'essais <strong>de</strong> matériaux du SCK·CEN. L'autre partie <strong>de</strong>ces combustibles est retraitée <strong>en</strong> France par les soins d'AREVA NC, les anci<strong>en</strong>s combustibles usés du réacteur BR3, du SCK·CEN.La quote-part du secteur non-nucléaire n'est pas négligeable. Elle représ<strong>en</strong>te <strong>en</strong>viron unquart <strong>en</strong> volume. Ces <strong>déchets</strong> sont <strong>de</strong> nature très variée et ont <strong>en</strong> commun d'êtrepresque tous <strong>de</strong> faible activité. Les seules exceptions notables sont <strong>la</strong> productionannuelle, par l'IRE, <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité générés dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong>production <strong>de</strong> molybdène-99 ( 99 Mo) à usage médical (imagerie et détection <strong>de</strong>s tumeurs)et les sources utilisées <strong>en</strong> radiothérapie ( 60 Co).Pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activité, citons, <strong>de</strong> manière non exhaustive, étant donnée <strong>la</strong>gran<strong>de</strong> variété <strong>de</strong>s productions : les <strong>déchets</strong> hospitaliers (papier et tissus absorbants, seringues, <strong>déchets</strong>biologiques... ), les liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> recherche <strong>en</strong> mé<strong>de</strong>cine nucléaire et pharmacie (traceurs<strong>radioactifs</strong>), les sources et vêtem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s industries <strong>de</strong> stérilisation <strong>de</strong> certainsalim<strong>en</strong>ts et d'instrum<strong>en</strong>ts, notamm<strong>en</strong>t à usage médical, les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire d'analyses et <strong>de</strong> recherches mettant <strong>en</strong> jeu <strong>de</strong>s radioisotopes,tels <strong>la</strong> datation <strong>en</strong> géologie et <strong>en</strong> archéologie, ou les expertises légales, les sources à usage industriel, telles les jauges <strong>de</strong> niveau ou d'épaisseur, ou <strong>en</strong>core lessources pour <strong>la</strong> radiographie <strong>de</strong>s soudures, les <strong>déchets</strong> secondaires <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises procédant à <strong>la</strong> décontamination <strong>de</strong>s lieux oùsont manipulés <strong>de</strong>s substances radioactives,figure 2: <strong>déchets</strong> hospitaliers les paratonnerres et les détecteurs <strong>de</strong> fumée, dont certains modèles – généralem<strong>en</strong>tanci<strong>en</strong>s – conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong> faibles quantités <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s (voir égalem<strong>en</strong>t infra).20/166
Pour terminer ce tour d'horizon <strong>de</strong> <strong>la</strong> production contemporaine, ainsi qu'introduire lesgran<strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> ses perspectives futures, rev<strong>en</strong>ons dans le cadre du secteurélectronucléaire.Les instal<strong>la</strong>tions les plus anci<strong>en</strong>nes, aujourd'hui mises à l'arrêt, sont celles <strong>de</strong> l'usineEUROCHEMIC, le réacteur BR3 du SCK·CEN et certaines unités <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'exdépartem<strong>en</strong>tWaste <strong>de</strong> celui-ci. Après une première pério<strong>de</strong> d'att<strong>en</strong>te, pour préparer lesactivités <strong>de</strong> décontamination, le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t 11 et le démantèlem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tionsa débuté vers le début <strong>de</strong>s années '90 et est toujours <strong>en</strong> cours. Les opérationstechniques mises <strong>en</strong> oeuvre sont principalem<strong>en</strong>t le démontage et/ou le découpage <strong>de</strong>séquipem<strong>en</strong>ts, <strong>la</strong> démolition <strong>de</strong>s structures et <strong>de</strong>s constructions et, le cas échéant, lerac<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s sols contaminés. Dans tous les cas, équipem<strong>en</strong>ts, bâtim<strong>en</strong>ts et sols fontl'objet d'une décontamination préliminaire <strong>la</strong> plus poussée possible, afin <strong>de</strong> réduire autantque faire se peut le volume <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qui résulteront <strong>de</strong>s opérations finales<strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t.Etant donné <strong>la</strong> “matière première” qui constitue les gran<strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires, les<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t sont ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t constitués <strong>de</strong> béton, <strong>de</strong> matériauxmétalliques et <strong>de</strong> terres, par ordre d'importance décroissante. Des <strong>déchets</strong> secondaires,tels que filtres, vêtem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> protection ou eaux contaminées, inhér<strong>en</strong>ts à toute activiténucléaire, sont égalem<strong>en</strong>t générés. A l'exception <strong>de</strong> quelques pièces d'équipem<strong>en</strong>t (cuvedu réacteur BR3, fours <strong>de</strong> vitrification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l'EUROCHEMIC) quidonn<strong>en</strong>t naissance à <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité, les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t secaractéris<strong>en</strong>t par leur faible niveau radioactif.2.3.3 Le futurLes réacteurs électronucléaires arriveront un jour, inéluctablem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> vie et<strong>de</strong>vront être mis à l'arrêt pour être <strong>en</strong>suite démantelés. Même si <strong>la</strong> perspective <strong>en</strong> est<strong>en</strong>core quelque peu éloignée, surtout <strong>en</strong> ce qui concerne le démantèlem<strong>en</strong>t proprem<strong>en</strong>tdit 12 , l'ampleur <strong>de</strong>s opérations concernées comman<strong>de</strong>, dès aujourd'hui, l'att<strong>en</strong>tion. A cetitre, d'ailleurs, <strong>la</strong> troisième partie <strong>de</strong> ce docum<strong>en</strong>t, soit les septième et huitièmechapitres, sera <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t consacrée à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> future <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, et ce, tant dansles domaines technique que financier. Le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et le démantèlem<strong>en</strong>t futurs duparc électronucléaire y ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t une p<strong>la</strong>ce importante. Nous ne ferons ici qu'introduirebrièvem<strong>en</strong>t le sujet, et, comme le veut le thème du prés<strong>en</strong>t chapitre, sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Le réacteur BR3 a été mis à l'arrêt <strong>en</strong> 1987 et son déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t est <strong>en</strong> cours. Comme ils'agit d'un réacteur “à eau pressurisée” du même type – mais à plus petite échelle – queceux <strong>de</strong> DOEL et TIHANGE, son démantèlem<strong>en</strong>t constituera une opération-pilote <strong>en</strong> <strong>la</strong>matière. Qualitativem<strong>en</strong>t donc, les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s c<strong>en</strong>tralesseront très simi<strong>la</strong>ires à ceux prov<strong>en</strong>ant du réacteur BR3 : béton et métaux constituerontles matériaux majoritaires, tandis que les niveaux d'activité seront généralem<strong>en</strong>t faibles.Seules les cuves <strong>de</strong>s réacteurs, fortem<strong>en</strong>t activées par le flux neutronique, ainsi que leurinstrum<strong>en</strong>tation interne, donneront naissance à <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne, ou mêmehaute, activité.Quantitativem<strong>en</strong>t par contre, les volumes seront d'un autre ordre <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur : dans l'étatactuel <strong>de</strong>s connaissances et <strong>de</strong> l'expéri<strong>en</strong>ce technique acquises (qui évolueront <strong>en</strong>coredans le futur), on estime que le démantèlem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s sept réacteurs actuels génèrera<strong>en</strong>viron 35 000 m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> basse activité, soit à peu près le même volume que <strong>la</strong>totalité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> basse activité <strong>de</strong> <strong>la</strong> production courante, toutes prov<strong>en</strong>ancesconfondues. Le volume <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité sera, quant à lui, nettem<strong>en</strong>t plusmo<strong>de</strong>ste par comparaison, puisqu'on estime celui-ci à quelque 850 m 3 .11 Le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t regroupe toutes les opérations qui permett<strong>en</strong>t d'aboutir au retrait d'une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong>liste <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées comme nucléaires, donc soumises à <strong>de</strong>s obligations et contrôlesréglem<strong>en</strong>taires spécifiques, parce qu'elle ne représ<strong>en</strong>te plus aucun risque radiologique.12 Comme pour les instal<strong>la</strong>tions dont le démantèlem<strong>en</strong>t est <strong>en</strong> cours, celui-ci est précédé, après <strong>la</strong> mise àl'arrêt, <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> tout déchet ou autre substance radioactive (dans le cas d'un réacteur, lecombustible), d'une pério<strong>de</strong> d'att<strong>en</strong>te consacrée à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong>s activités industrielles et à <strong>la</strong>décroissance <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s à <strong>de</strong>mi-vie re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t courte, et d'opérations préliminaires <strong>de</strong>décontamination.21/166
Cette ultime production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> s'étalera vraisemb<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t sur plusieursdéc<strong>en</strong>nies, compte t<strong>en</strong>u, d'une part, <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong>s opérations pour chaque unité, et,d'autre part, <strong>de</strong> l'étalem<strong>en</strong>t dans le temps <strong>de</strong> leur mise hors service.Les activités <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t d'aujourd'hui, outre leur effet positif <strong>de</strong> résorption <strong>de</strong>l'héritage du passé, permett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> même temps d'accumuler un précieux savoir-fairetechnique qui trouvera à s'employer dans un futur plus ou moins proche.Notons, à titre <strong>de</strong> conclusion, que l'arrêt et le démantèlem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s réacteurs nucléairesactuels et leur non-remp<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t par <strong>de</strong>s unités <strong>de</strong> production <strong>de</strong> nouvelle générationmettant <strong>en</strong> jeu, au s<strong>en</strong>s <strong>la</strong>rge, l'atome, ne signifieront pas <strong>la</strong> cessation complète <strong>de</strong> <strong>la</strong>production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, sauf à r<strong>en</strong>oncer simultaném<strong>en</strong>t aux utilisationsmédicales et industrielles <strong>de</strong>s radio-isotopes. Les volumes annuels produits seronttoutefois, comme on l'a vu, réduits d'un facteur dix ou plus, et <strong>la</strong> radioactivité, davantage<strong>en</strong>core.3. Quelques cas particuliersLes matières dont il a été question jusqu'à prés<strong>en</strong>t sont celles dont <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification sous<strong>la</strong> définition <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ne fait aucun doute : matières résiduelles et nonréutilisablesissues d'activités mettant spécifiquem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> oeuvre <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s, quece soit ou non dans le but <strong>de</strong> produire <strong>de</strong> l'énergie électrique, leur cont<strong>en</strong>u <strong>en</strong>radioactivité est <strong>de</strong> loin supérieur à celui que l'on r<strong>en</strong>contre dans les <strong>déchets</strong> ménagersou industriels c<strong>la</strong>ssiques. Dans ce qui suit, il sera question <strong>de</strong> matières radioactives pourlesquelles l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition est moins immédiate : généralem<strong>en</strong>t produitesdans <strong>de</strong>s secteurs d'activité n'ayant aucun rapport avec le secteur nucléaire industriel,sci<strong>en</strong>tifique ou médical, leur radioactivité est <strong>de</strong> niveau très faible ou temporaire. Dans unautre cas, c'est le statut <strong>de</strong> déchet qui n'est pas c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t tranché. Leur <strong>gestion</strong> fait, ou<strong>de</strong>vra faire, l'objet d'étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> décisions techniques, politiques et administratives dansun av<strong>en</strong>ir plus ou moins proche.Ces <strong>déchets</strong> sont constitués principalem<strong>en</strong>t par les résidus issus <strong>de</strong>s procédés industrielsactuels ou passés, et <strong>de</strong>s combustibles irradiés <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong>treposés sur lesdomaines <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales nucléaires belges. Il sera égalem<strong>en</strong>t fait m<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> certainstypes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qui, du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> courte <strong>de</strong>mi-vie <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s qu'ils conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t,ne sont que temporairem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong>, <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> d'origine non-industrielle (habitations,<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t) et <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> d'origine non-contrôlée.3.1 Déchets issus <strong>de</strong>s procédés industriels passés ouactuels3.1.1 Les procédés industriels passés – <strong>la</strong> production <strong>de</strong> radiumComme déjà évoqué dans <strong>la</strong> section « les activités historiques », une unité <strong>de</strong> production<strong>de</strong> radium fut démarrée <strong>en</strong> 1922 par <strong>la</strong> firme Union Minière, <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t UMICORE. Leradium était extrait <strong>de</strong>s minerais riches <strong>en</strong> uranium prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> <strong>la</strong> mine <strong>de</strong> Shinkolobwe,au Katanga. Avec le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche nucléaire dans les années 1950,d’autres substances radioactives à <strong>de</strong>mi-vies plus courtes fur<strong>en</strong>t produites quiremp<strong>la</strong>cèr<strong>en</strong>t progressivem<strong>en</strong>t le radium dans l’usage médical, <strong>de</strong> sorte qu’au cours <strong>de</strong>sannées 1970, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> celui-ci s'effondra, l’activité <strong>de</strong> production fut arrêtée et lesinstal<strong>la</strong>tions, démantelées. Il subsiste néanmoins <strong>en</strong>core à Ol<strong>en</strong>, dans l’usine UMICORE,un stock <strong>de</strong> radium pur sous forme d'aiguilles. Les étapes <strong>de</strong> purification du radiumpassées ont donné lieu à une pollution radioactive à l’intérieur et à l’extérieur du siteUMICORE. Trois dossiers d’évaluation radiologique décriv<strong>en</strong>t l’état du site et font le pointcette pollution radioactive résiduelle : le Dossier UMTRAP traite <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion d’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse II construite dansl’<strong>en</strong>ceinte <strong>de</strong> l’usine pour les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> résultant <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> production, le dossier SIM traite <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution résiduelle à l’intérieur du site industriel consécutiveaux activités d'extraction du radium,22/166
le dossier BRAEM (Berging Radioactief Afval Extra Muros) traite <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollutionradioactive dispersée au <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l’usine, particulièrem<strong>en</strong>t dans et autour du ruisseauBankloop et sur un site <strong>de</strong> décharge au Nord du canal Bocholt-Her<strong>en</strong>tals.L'instal<strong>la</strong>tion d'<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse II UMTRAP r<strong>en</strong>ferme les divers <strong>déchets</strong> (terres etmatériaux contaminés, sources et aiguilles médicales, résidus d’extraction) issus <strong>de</strong> <strong>la</strong>fermeture <strong>de</strong> l'unité <strong>de</strong> production <strong>de</strong> radium. Selon leur nature, ils ont été rassemblésdans plusieurs casemates, et immobilisés. L’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s casemates <strong>de</strong> dépôt a <strong>en</strong>suiteété recouvert par un système multi-barrière (béton, feuil<strong>la</strong>rd <strong>de</strong> cuivre, argile, gravier,sable et terreau) <strong>de</strong>stiné à garantir, sans mesures actives <strong>de</strong> prév<strong>en</strong>tion, <strong>la</strong> protectionradiologique et le confinem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’émanation radon générée par <strong>la</strong> décroissance duradium. Ces opérations ont été effectuées conformém<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> règlem<strong>en</strong>tation <strong>en</strong> vigueur.Ces instal<strong>la</strong>tions ne sont pas autorisées <strong>en</strong> tant que dépôt final.Les pollutions radioactives à l’intérieur du domaine d’exploitation d’Umicore à Ol<strong>en</strong> sont<strong>en</strong> faibles conc<strong>en</strong>trations sur une décharge (“décharge I”) et sous forme diffuse surl’<strong>en</strong>semble du domaine d’exploitation.Les pollutions radioactives à l’extérieur du domaine d’exploitation d’Umicore à Ol<strong>en</strong> sontprés<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> faibles conc<strong>en</strong>trations sur une décharge (“décharge D1”) et <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux<strong>en</strong>droits d'une autre décharge (“décharge II”), et <strong>en</strong>fin sous forme diffuse sur trois zonesd’ét<strong>en</strong>due assez réduite, dont <strong>de</strong>ux rues <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune d'Ol<strong>en</strong>. Ces rues, ainsi que leBankloop, ont déjà fait l'objet <strong>de</strong> travaux d'assainissem<strong>en</strong>t.3.1.2 Les procédés industriels actuels - Les <strong>déchets</strong> NORM etTE-NORMLes Déchets NORM (<strong>de</strong> l’ang<strong>la</strong>is Normally Occuring Radioactive Materials) et les <strong>déchets</strong>TE-NORM (Technologically Enhanced Normally Occuring Radioactive Materials) sontindubitablem<strong>en</strong>t à considérer comme <strong>déchets</strong> finaux car aucune utilisation ultérieure n’<strong>en</strong>est prévue. Ils provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s secteurs chimique et parachimiqu<strong>en</strong>on-nucléaires et sont généralem<strong>en</strong>t constitués d'importants volumes <strong>de</strong>matériaux inertes cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s d'origine naturelle, soit l'uranium et/ou lethorium ainsi que leurs <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dants, eux-même <strong>radioactifs</strong>. Leur radioactivité, très faible,est cep<strong>en</strong>dant supérieure au niveau moy<strong>en</strong> général. Cette radioactivité naturelle estcont<strong>en</strong>ue dans les matières premières qui alim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les procédés chimiques mis <strong>en</strong>oeuvre (<strong>déchets</strong> NORM). Certains procédés chimiques ont pour effet <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>trer cetteradioactivité et donn<strong>en</strong>t naissance aux <strong>déchets</strong> TE-NORM.Ces matériaux sont sous <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> leur producteur. C'est l'autorité qui déci<strong>de</strong><strong>de</strong> leur c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t ou non <strong>en</strong> tant que <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> l'impact estimésur l'homme et l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Observons que l’accumu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> volumes importants <strong>de</strong>matériaux très légèrem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong> sur un site particulier pourrait m<strong>en</strong>er dans certainscas à une situation préoccupante et conduire les autorités <strong>de</strong> sûreté à pr<strong>en</strong>dre <strong>de</strong>smesures.Une étu<strong>de</strong> datant <strong>de</strong> 2003 i<strong>de</strong>ntifie <strong>en</strong> Belgique les secteurs industriels toujours <strong>en</strong>activité qui mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> jeu <strong>de</strong>s sources naturelles <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t : l’industrie <strong>de</strong>s phosphates, <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong> composés et d'alliages au thorium, l’industrie du traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s sables au zircon, l’industrie cim<strong>en</strong>tière, l’industrie <strong>de</strong>s non-ferreux, l’industrie sidérurgique, les c<strong>en</strong>trales au charbon, le captage d’eau. l’extraction <strong>de</strong> terres rares,23/166
toute autre activité professionnelle définie par l’autorité et apparaissant sur une listepubliée au Moniteur belge.Seuls les quatre premiers <strong>de</strong> ces secteurs ont fait l’objet d’une étu<strong>de</strong> exhaustive, et sontévoqués ici. L’industrie <strong>de</strong>s phosphates représ<strong>en</strong>te <strong>en</strong> Belgique <strong>la</strong> principale source <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>TE-NORM suite à <strong>de</strong>s traitem<strong>en</strong>ts industriels, dans <strong>la</strong> mesure où le minerai <strong>de</strong>phosphate, importé principalem<strong>en</strong>t du Maroc, sert surtout à <strong>la</strong> production d’<strong>en</strong>graischimiques. On compte <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Belgique plusieurs millions <strong>de</strong> tonnes <strong>de</strong>résidus légèrem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong> produits par l’industrie <strong>de</strong>s phosphates <strong>de</strong>puis le début<strong>de</strong>s années 1920. Le thorium trouve <strong>de</strong>s applications dans un grand nombre <strong>de</strong> produits et procédésmettant <strong>en</strong> jeu <strong>de</strong>s températures élevées : production <strong>de</strong> matériaux céramiques, <strong>de</strong><strong>la</strong>mpes à incan<strong>de</strong>sc<strong>en</strong>ce, <strong>de</strong> revêtem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> l<strong>en</strong>tilles, d’alliages résistants à <strong>la</strong> chaleuret d’électro<strong>de</strong>s <strong>de</strong> soudure <strong>en</strong> sont <strong>de</strong>s exemples. Les sables au zircon sont surtout utilisés comme additifs pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong>matériaux résistants au feu et pour <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong>s moules utilisés dans les fon<strong>de</strong>ries<strong>de</strong> précision. Ces sables prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t fréquemm<strong>en</strong>t une certaine t<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> thorium. L’industrie cim<strong>en</strong>tière utilise à gran<strong>de</strong> échelle <strong>de</strong>s matières premières qui sont <strong>de</strong>srésidus d’autres secteurs industriels, par exemple <strong>de</strong>s <strong>la</strong>itiers <strong>de</strong> l’industriesidérurgique et <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>dres vo<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales au charbon. Ces résidusconti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s naturels (U, Th).3.2 Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> très courte <strong>de</strong>mi-vieLes <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> très courte <strong>de</strong>mi-vie constitu<strong>en</strong>t une catégorie à part. Ils conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>tuniquem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s qui per<strong>de</strong>nt rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t leur activité du fait <strong>de</strong> leur pério<strong>de</strong>très courte, <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> quelques jours ou quelques semaines. Ces <strong>déchets</strong> provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>tdans leur quasi-totalité <strong>de</strong>s hôpitaux et <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> recherche médicale quiutilis<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s substances radioactives à <strong>de</strong>s fins thérapeutiques ou <strong>de</strong> diagnostic.Moy<strong>en</strong>nant les autorisations appropriées, les services internes <strong>de</strong> ces institutions gèr<strong>en</strong>telles-mêmes ces substances et les regroup<strong>en</strong>t au sein <strong>de</strong> locaux dédiés où elles per<strong>de</strong>ntrapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t leur activité. Ces substances ne prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t pratiquem<strong>en</strong>t plus d'activité aprèsquelques semaines ou mois seulem<strong>en</strong>t, et les services <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> hospitalière sont alorsautorisés à les libérer dans le circuit conv<strong>en</strong>tionnel <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non <strong>radioactifs</strong>.3.3 Les <strong>déchets</strong> non industriels De nombreux bâtim<strong>en</strong>ts publics et habitations privées sont <strong>en</strong>core pourvus <strong>de</strong>paratonnerres <strong>radioactifs</strong>, cont<strong>en</strong>ant une petite source radioactive ( 241 Am, 85 Kr ou226Ra) c<strong>en</strong>sée provoquer une légère ionisation <strong>de</strong> l'air capable d'attirer <strong>la</strong> foudre. Cesparatonnerres, une fois localisés, sont démontés par une firme spécialisée agréée puis<strong>en</strong>treposés provisoirem<strong>en</strong>t par elle jusqu’à leur <strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> tant que <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong>. Depuis le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s paratonnerres <strong>radioactifs</strong><strong>la</strong>ncée <strong>en</strong> 2003, plus <strong>de</strong> 1 200 paratonnerres ont été <strong>en</strong>levés. D'anci<strong>en</strong>s modèles <strong>de</strong>détecteurs <strong>de</strong> fumée utilisai<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t ces mêmes isotopes <strong>en</strong> très faible quantité.Plus <strong>de</strong> 100 000 <strong>de</strong> ces détecteurs ont déjà été collectés, notamm<strong>en</strong>t à l'occasion <strong>de</strong> <strong>la</strong>rénovation ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> démolition d'immeubles. Les écoles et les c<strong>en</strong>tres d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t utilis<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s sources radioactives à<strong>de</strong>s fins pédagogiques, tels les cours <strong>de</strong> physique et <strong>de</strong> chimie. Un premier inv<strong>en</strong>tairesystématique <strong>de</strong> ces sources a été initié <strong>en</strong> 2006. Les établissem<strong>en</strong>ts d'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>tdisposant <strong>de</strong> telles sources ont pu, soit <strong>en</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t, soit recevoir lesinformations nécessaires pour pouvoir continuer à <strong>en</strong> faire usage <strong>en</strong> toute conformitéavec <strong>la</strong> règlem<strong>en</strong>tation, si tel n'était pas <strong>en</strong>core le cas. Cette opération est toujours <strong>en</strong>cours.24/166
3.4 Les sources orphelinesComme le suggère le terme « orphelin », il s’agit <strong>de</strong> substances ou <strong>de</strong> contaminationsradioactives détectées dans les flux <strong>de</strong> matériaux prés<strong>en</strong>tés pour traitem<strong>en</strong>t ou recyc<strong>la</strong>gedans le secteur non nucléaire et dont le propriétaire ne peut être i<strong>de</strong>ntifié. Dans ce cas, lematériau radioactif est déc<strong>la</strong>ré « source orpheline ».Les sources orphelines échapp<strong>en</strong>t, par définition, au contrôle réglem<strong>en</strong>taire soit parcequ'elles n'ont jamais fait l'objet d'un tel contrôle, soit parce qu'elles ont été abandonnées,perdues, égarées, volées ou dép<strong>la</strong>cées sans que personne ne le sache. Ces sourcesradioactives peuv<strong>en</strong>t ainsi se retrouver dans le domaine public : <strong>déchets</strong> ménagers,ferrailles, parcs à cont<strong>en</strong>eurs, ... De nombreuses instal<strong>la</strong>tions du secteur non nucléairesont déjà équipées <strong>de</strong> portiques <strong>de</strong> détection <strong>de</strong> matières radioactives.Les sources radioactives <strong>en</strong> question peuv<strong>en</strong>t revêtir <strong>de</strong>s formes très diverses : il peuts'agir notamm<strong>en</strong>t d'objets historiques recouverts d'une couche <strong>de</strong> peinture radioactive, <strong>de</strong>résidus corporels <strong>de</strong> pati<strong>en</strong>ts traités à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> matières radioactives, d’aiguilles <strong>de</strong>montres ou <strong>de</strong> réveils matins ou <strong>en</strong>core <strong>de</strong> minerais ou <strong>de</strong> roches naturellem<strong>en</strong>t<strong>radioactifs</strong> ou <strong>de</strong> sources prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> <strong>la</strong> démolition d'une anci<strong>en</strong>ne usine.La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s sources orphelines est évoquée au chapitre huit.3.5 Les combustibles irradiésPour clore ce chapitre, nous rev<strong>en</strong>ons au secteur électronucléaire et, plusparticulièrem<strong>en</strong>t, à un sous-produit hautem<strong>en</strong>t radioactif issu <strong>de</strong> son activité <strong>de</strong>production d'énergie : le combustible nucléaire irradié.Le combustible nucléaire neuf conti<strong>en</strong>t, avant utilisation, <strong>de</strong> 4 à 5 % <strong>de</strong> 235 U qui constituesa matière fissile. Au cours <strong>de</strong> son séjour dans le réacteur nucléaire, séjour qui dure<strong>en</strong>viron quatre ans, le combustible s'appauvrit <strong>en</strong> sa matière fissile initiale 13 et se chargeprogressivem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> divers produits <strong>de</strong> fission dont certains lui confèr<strong>en</strong>t son caractèrehautem<strong>en</strong>t irradiant. Dev<strong>en</strong>u inapte à produire davantage d'énergie par le phénomène <strong>de</strong>fission nucléaire, il est retiré du réacteur et temporairem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>treposé à <strong>la</strong> c<strong>en</strong>trale mêmeafin <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser décroître cette radioactivité initiale.Deux solutions, que nous avons déjà évoquées dans ce chapitre (voir “les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>production courante”), sont alors possibles : soit le combustible usé est soumis au retraitem<strong>en</strong>t, opération qui sépare chimiquem<strong>en</strong>tles produits <strong>de</strong> fission, ainsi que les actini<strong>de</strong>s mineurs, <strong>de</strong> l'uranium et du plutonium.L'uranium et du plutonium peuv<strong>en</strong>t alors être recyclés dans <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong> nouveauxcombustibles, soit le combustible usé est gardé <strong>en</strong> <strong>en</strong>treposage prolongé jusqu'à ce qu'une décisiondéfinitive soit prise à son sujet.Nous avons égalem<strong>en</strong>t vu que <strong>la</strong> Belgique avait opté pour <strong>la</strong> première <strong>de</strong> ces optionsjusqu'au début <strong>de</strong>s années '90, avant <strong>de</strong> suivre <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> jusqu'à nos jours.Suite au moratoire sur le retraitem<strong>en</strong>t, ces combustibles irradiés sont <strong>en</strong>treposés sur lessites <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales nucléaires <strong>en</strong> att<strong>en</strong>te d'une décision définitive quant à leur usageultérieur. Cette décision relève <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique énergétique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belgique et <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>scombustibles reste du ressort <strong>de</strong> leur propriétaire, <strong>la</strong> société <strong>de</strong> provisionnem<strong>en</strong>tnucléaire SYNATOM.Actuellem<strong>en</strong>t, les assemb<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> combustible usé sont <strong>en</strong>treposés sur les sites <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>trales <strong>de</strong> DOEL et <strong>de</strong> TIHANGE, dans <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions spécialem<strong>en</strong>tconçus pour assurer un <strong>en</strong>treposage sûr et flexible. Le moratoire a eu pour conséqu<strong>en</strong>ceque les capacités d’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s combustibles irradiés sur les c<strong>en</strong>trales ont dû êtreadaptées. Il a été ainsi été décidé <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> nouvelles instal<strong>la</strong>tions sur chacune<strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales, <strong>de</strong> façon à accroître <strong>la</strong> capacité d'accueil <strong>de</strong>s assemb<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> combustibleusé : <strong>en</strong>treposage à sec dans <strong>de</strong>s cont<strong>en</strong>eurs métalliques blindés sur le site <strong>de</strong> DOEL13 Il s'est cep<strong>en</strong>dant égalem<strong>en</strong>t formé, selon un mécanisme complexe, <strong>en</strong>viron 1 % (<strong>en</strong> masse) <strong>de</strong> plutoniumdont une partie est fissile, ainsi que d'autres élém<strong>en</strong>ts <strong>radioactifs</strong> lourds, appelés actini<strong>de</strong>s mineurs.25/166
(mise <strong>en</strong> service : 1995) et <strong>en</strong>treposage <strong>en</strong> piscine sur le site <strong>de</strong> TIHANGE (mise <strong>en</strong>service : 1997).Relevons que le moratoire ne porte que sur le retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s combustibles <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>trales <strong>de</strong> puissance et ne concerne pas celui <strong>de</strong>s combustibles utilisés <strong>en</strong> réacteurs<strong>de</strong> recherche. Il ne porte par ailleurs pas préjudice aux activités <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong>développem<strong>en</strong>t portant sur les questions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à court ou moy<strong>en</strong> terme<strong>de</strong>s combustibles, que ceux-ci soi<strong>en</strong>t retraités ou non. Ces activités se poursuiv<strong>en</strong>taujourd'hui <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant <strong>en</strong> compte les <strong>de</strong>ux options p<strong>la</strong>cées sur un pied d'égalité.26/166
Chapitre <strong>de</strong>uxL'ONDRAF et ses part<strong>en</strong>airesLe premier chapitre nous ayant décrit l'objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>,ce <strong>de</strong>uxième chapitre <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>te, tout naturellem<strong>en</strong>t, les acteurs.L'ONDRAF comm<strong>en</strong>ce par se prés<strong>en</strong>ter lui-même : <strong>de</strong>s actes légis<strong>la</strong>tifs fondateurs à sonorganisation <strong>actuelle</strong>, un bref historique brosse le tableau <strong>de</strong> son évolution. Son statut,ses compét<strong>en</strong>ces et ses missions sont égalem<strong>en</strong>t précisés. L'acc<strong>en</strong>t est mis sur <strong>la</strong> mise<strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce, <strong>en</strong> constante progression, d'une <strong>gestion</strong> intégrée <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.La mise <strong>en</strong> oeuvre d'une telle <strong>gestion</strong> intégrée ne saurait se concevoir sans l'interv<strong>en</strong>tion<strong>de</strong> nombreux part<strong>en</strong>aires. L'ONDRAF se p<strong>la</strong>ce au coeur même d'un réseau ét<strong>en</strong>dud'institutions et sociétés <strong>de</strong>s milieux sci<strong>en</strong>tifique, académique et industriel auxquelles elleconfie missions <strong>de</strong> conseil, d'étu<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong> réalisation technique et sci<strong>en</strong>tifique.Travail<strong>la</strong>nt dans le strict respect <strong>de</strong>s règlem<strong>en</strong>tations <strong>en</strong> vigueur, il r<strong>en</strong>d compte auxautorités <strong>de</strong> tutelle et <strong>de</strong> sûreté, au p<strong>la</strong>n national, et <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s contacts étroits avecles institutions internationales compét<strong>en</strong>tes.Au premier rang <strong>de</strong> ces interv<strong>en</strong>ants vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t ceux dans lesquels l'ONDRAF possè<strong>de</strong><strong>de</strong>s intérêts : BELGOPROCESS, filiale à 100 % et « bras industriel » <strong>de</strong> l'organisme,dont l'important rôle dans <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante est décrit, et le GIE EURIDICE,col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> l'ONDRAF et du SCK·CEN pour <strong>la</strong> recherche <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> dépôtsfinaux <strong>en</strong> couches géologiques ou <strong>en</strong> surface.Les autres part<strong>en</strong>aires industriels (transporteurs, bureaux d'étu<strong>de</strong>s, autres sous-traitants)et sci<strong>en</strong>tifiques (c<strong>en</strong>tres <strong>de</strong> recherche et universités) sont <strong>en</strong>suite évoqués.L'ONDRAF est égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> re<strong>la</strong>tion perman<strong>en</strong>te au p<strong>la</strong>n international avec <strong>de</strong>sorganisations telles que l'OCDE, l'AIEA ou <strong>en</strong>core l'Union europé<strong>en</strong>ne, dont elle pr<strong>en</strong><strong>de</strong>n compte les recommandations et directives, et avec les ag<strong>en</strong>ces-soeurs <strong>de</strong>s paysétrangers.Enfin, bi<strong>en</strong> sûr, l'organisme répond <strong>de</strong> sa <strong>gestion</strong> à sa tutelle et est relié à l'Ag<strong>en</strong>ceFédérale <strong>de</strong> Contrôle Nucléaire. Ces <strong>de</strong>rnières re<strong>la</strong>tions, <strong>de</strong> nature ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>trèglem<strong>en</strong>taire, introduis<strong>en</strong>t par ailleurs le chapitre suivant.1. L'ONDRAFEn créant l'ONDRAF <strong>en</strong> août 1980, le légis<strong>la</strong>teur a voulu que <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> soit confiée à un organisme unique sous contrôle public, afin <strong>de</strong> garantir quel'intérêt général puisse prévaloir, <strong>en</strong> toutes circonstances, dans toutes les décisions àpr<strong>en</strong>dre. Un organisme public est, <strong>en</strong> effet, moins s<strong>en</strong>sible aux aléas <strong>de</strong> <strong>la</strong> vieéconomique et n'est pas soumis aux impératifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité immédiate. L'int<strong>en</strong>tionétait <strong>de</strong> doter <strong>la</strong> Belgique d'une <strong>gestion</strong> c<strong>en</strong>tralisée <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, rationnelle,transpar<strong>en</strong>te et respectueuse <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, aussi bi<strong>en</strong> aujourd'huique dans l’av<strong>en</strong>ir. Dans cette esprit, l'ONDRAF a adopté le Mission statem<strong>en</strong>t suivant :Au service <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité, l’ONDRAF gère tous les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, aujourd’hui et<strong>de</strong>main, par le développem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> solutions respectueuses <strong>de</strong> <strong>la</strong>société et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. A cet effet, l’ONDRAF mainti<strong>en</strong>t un système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> quipropose <strong>de</strong>s solutions intégrales fondées sur l’équilibre nécessaire <strong>en</strong>tre les aspectstechniques, économiques et sociétaux, <strong>de</strong> telle façon que les générations futuresn’ai<strong>en</strong>t pas à supporter <strong>de</strong> charges excessives. En conséqu<strong>en</strong>ce, l’ONDRAF protège <strong>la</strong> société et l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre toutes les27/166
nuisances pot<strong>en</strong>tielles liées aux matières radioactives qui résult<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s activitésnucléaires et non nucléaires. Etant donné que <strong>la</strong> mission <strong>de</strong> l’ONDRAF s’inscrit dans une perspective <strong>de</strong> très longterme, l’organisme <strong>en</strong> ti<strong>en</strong>t compte dans l’exécution <strong>de</strong> ses tâches et fait aussiatt<strong>en</strong>tion à l’évolution du contexte sociétal, technique et économique. L’ONDRAF travaille, à cette fin, <strong>de</strong> façon transpar<strong>en</strong>te et intègre, avec un esprit ouvertet <strong>en</strong> interaction avec <strong>la</strong> société.1.1 Le contexte historique <strong>de</strong> sa créationUn bref rappel historique est utile pour rappeler les conditions qui ont am<strong>en</strong>é à <strong>la</strong> création<strong>de</strong> l'ONDRAF et qui conditionn<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core aujourd'hui l'ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> ses missions. Le toutpremier complexe <strong>de</strong> l’industrie nucléaire belge fut le C<strong>en</strong>tre d’étu<strong>de</strong>s pour l’application<strong>de</strong> l’énergie nucléaire. Dès sa création <strong>en</strong> 1952, cette organisation s’est préoccupée <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qu’elle produisait. À cet effet, elle s'équipa dès qu'elle leput <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nécessaires au traitem<strong>en</strong>t et au conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ses <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong>; l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions a constitué le départem<strong>en</strong>t Waste, comme lepremier chapitre l'a déjà exposé.À partir <strong>de</strong> 1956, le SCK·CEN a comm<strong>en</strong>cé à apporter son ai<strong>de</strong> aux autres producteurs<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qui ne disposai<strong>en</strong>t pas eux-mêmes <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nécessairespour traiter et conditionner leurs propres <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Durant plus <strong>de</strong> vingt ans, leSCK·CEN a ainsi assuré, sur base volontaire, <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> produitssur le territoire. Ce service ne reposait <strong>en</strong> effet sur aucune obligation légale ourèglem<strong>en</strong>taire.Une vingtaine d'années plus tard, l’ext<strong>en</strong>sion rapi<strong>de</strong> du programme électronucléairebelge conduisit progressivem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> saturation <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong>conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions du SCK·CEN. En même temps, apparaissai<strong>en</strong>t <strong>de</strong>nouveaux types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> que le c<strong>en</strong>tre n’était plus techniquem<strong>en</strong>t capable <strong>de</strong> traiter. Il<strong>de</strong>v<strong>en</strong>ait c<strong>la</strong>ir que <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> Belgique <strong>de</strong>vait bénéficier d’unestructure formelle, avec <strong>de</strong>s responsabilités et <strong>de</strong>s missions établies pour les différ<strong>en</strong>tesparties. Le secteur public et les principaux producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> privés créèr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>semble, <strong>en</strong> 1975, le syndicat d’étu<strong>de</strong> BELGOWASTE <strong>en</strong> vue d'examiner <strong>de</strong> quellemanière ils pouvai<strong>en</strong>t structurer <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Les activités <strong>de</strong> cesyndicat conduisir<strong>en</strong>t, cinq ans plus tard, à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’ONDRAF, l’organism<strong>en</strong>ational <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s matières fissiles <strong>en</strong>richies.La fondation, le 8 août 1980 (loi du 8 août 1980, art. 179 § 2), <strong>de</strong> l’ONDRAF fut le premieracte légal confiant <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> à un seul organisme sous tutelle <strong>de</strong>spouvoirs publics 14 .Les compét<strong>en</strong>ces et les missions <strong>de</strong> l’ONDRAF fur<strong>en</strong>t été fixées par l’arrêté royal du 30mars 1981, dont <strong>la</strong> version consolidée figure <strong>en</strong> annexe A. Par cet arrêté, l’ONDRAF étaitc<strong>en</strong>sé repr<strong>en</strong>dre toutes les activités du SCK·CEN qui relevai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> son nouveau domaine<strong>de</strong> compét<strong>en</strong>ce.À partir <strong>de</strong> 1982, l’ONDRAF établit un programme <strong>de</strong>stiné à évaluer <strong>la</strong> situation dont ilhéritait et à définir les gran<strong>de</strong>s lignes d’une politique coordonnée <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> à long terme. Cette politique optait pour <strong>la</strong> continuation <strong>de</strong>s services proposéspar le SCK·CEN aux producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> (le traitem<strong>en</strong>t, le conditionnem<strong>en</strong>t etl’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activité <strong>en</strong> particulier) 15 .En 1984, l’ONDRAF et le SCK·CEN signèr<strong>en</strong>t un accord <strong>de</strong> coopération transitoire. Cetaccord donnait à l’ONDRAF le temps nécessaire pour développer et mettre <strong>en</strong> oeuvre sapropre politique. Parmi les urg<strong>en</strong>ces, il y avait à faire face à <strong>la</strong> situation difficile résultant,14 Avant 1980, l’arrêté royal du 28 février 1963 stipu<strong>la</strong>it que chaque producteur <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>vait assurer une<strong>gestion</strong> sûre <strong>de</strong> ses <strong>déchets</strong>. L’arrêté n’abordait toutefois pas <strong>la</strong> portée <strong>de</strong> cette notion ni <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s àprévoir. Cet arrêté portait exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 29 mars 1958 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>stravailleurs contre les dangers <strong>de</strong>s radiations ionisantes.15 Très rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t, l’ONDRAF a négocié avec les grands producteurs du secteur <strong>de</strong> l’électricité et du secteurdu cycle du combustible à propos <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong>s accords qui <strong>de</strong>vai<strong>en</strong>t couvrir les frais <strong>de</strong>fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’ONDRAF, y compris les programmes d’étu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> recherche et les investissem<strong>en</strong>ts.28/166
l'année précé<strong>de</strong>nte, <strong>de</strong> l’adhésion <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belgique au moratoire sur le rejet <strong>en</strong> mer. Envertu <strong>de</strong> cet accord, l’ONDRAF conclut avec les producteurs <strong>de</strong>s contrats qui fixai<strong>en</strong>t lesconditions d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong>.Dans l’exécution <strong>de</strong> ces contrats, il apparut qu’une plus gran<strong>de</strong> intégration <strong>de</strong>s servicesr<strong>en</strong>dus aux producteurs <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ait, petit à petit, incontournable. L’ONDRAF et le SCK·CENdécidèr<strong>en</strong>t alors, <strong>en</strong> 1986, <strong>de</strong> gérer <strong>en</strong>semble, p<strong>en</strong>dant un an, les instal<strong>la</strong>tions dudépartem<strong>en</strong>t Waste et <strong>de</strong> préparer <strong>la</strong> création d’une nouvelle structure. Cettecol<strong>la</strong>boration aurait pu être <strong>la</strong> base d’une filiale commune. Fin <strong>de</strong> cette même année,toutefois, l’État belge chargea l’ONDRAF <strong>de</strong> repr<strong>en</strong>dre <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociétéBELGOPROCESS, créée <strong>de</strong>ux ans plus tôt <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> remise <strong>en</strong> service év<strong>en</strong>tuelle<strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> l'usine EUROCHEMIC. L’ONDRAF confia très naturellem<strong>en</strong>t à sanouvelle filiale Belgoprocess le soin <strong>de</strong> gérer les instal<strong>la</strong>tions et les <strong>déchets</strong> prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>l’exploitation <strong>de</strong> l’usine <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t EUROCHEMIC et <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>sser les instal<strong>la</strong>tionsmises hors service. Le site <strong>de</strong> EUROCHEMIC <strong>de</strong>vint le site 1 <strong>de</strong> Belgoprocess (BP1).Le 1 er mars 1989, l’État belge céda <strong>la</strong> propriété et l’exploitation du site et <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tionsdu départem<strong>en</strong>t Waste du SCK·CEN à l’ONDRAF. Ce <strong>de</strong>rnier <strong>en</strong> confia égalem<strong>en</strong>tl'exploitation à Belgoprocess. Ce site <strong>de</strong>vint le site 2 <strong>de</strong> Belgoprocess (BP2).Depuis 1989, l’ONDRAF est capable d’exécuter <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t, par ses propres moy<strong>en</strong>s,les missions techniques qui lui sont confiées légalem<strong>en</strong>t. Il le fait <strong>en</strong> étroite col<strong>la</strong>borationavec sa filiale industrielle Belgoprocess 16 .Un quart <strong>de</strong> siècle après sa fondation, l’ONDRAF est un organisme public établi,possédant <strong>de</strong>s compét<strong>en</strong>ces et une expéri<strong>en</strong>ce très diversifiées dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sur l’<strong>en</strong>semble du territoire belge. Il occupe aux <strong>en</strong>virons<strong>de</strong> 75 équival<strong>en</strong>ts temps plein.figure 3.: Les bureaux <strong>de</strong> l'ONDRAF, 14 Av<strong>en</strong>ue <strong>de</strong>s Arts à Bruxelles1.2 Missions et compét<strong>en</strong>ces fixées par <strong>la</strong> loiDiffér<strong>en</strong>tes lois et différ<strong>en</strong>ts arrêtés royaux régiss<strong>en</strong>t aujourd'hui le fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>l’ONDRAF. On ne citera ici que les principaux. Le site internet <strong>de</strong> l’ONDRAF(www.nirond.be) donne accès au cadre légal complet.Comme déjà indiqué auparavant, les compét<strong>en</strong>ces et les missions <strong>de</strong> l’ONDRAF ont étéfixées par l’arrêté royal du 30 mars 1981, lui-même arrêté d’exécution <strong>de</strong> l’article 179 § 2<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 8 août 1980. Cet article fut remp<strong>la</strong>cé par <strong>la</strong> loi du 11 janvier 1991 et l’arrêtéroyal du 30 mars 1981 modifié et complété par l’ arrêté royal du 16 octobre 1991. Cett<strong>en</strong>ouvelle loi précisa certaines compét<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> l’ONDRAF et lui attribua <strong>de</strong> nouvellesmissions, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> matières fissiles <strong>en</strong>richies excé<strong>de</strong>ntaires16 La col<strong>la</strong>boration a été officialisée <strong>en</strong> 1990 par <strong>la</strong> signature <strong>de</strong> conv<strong>en</strong>tions déterminant les missionsd’étu<strong>de</strong>s et les activités industrielles <strong>de</strong> Belgoprocess.29/166
et <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t d'instal<strong>la</strong>tions. Le nom <strong>de</strong> l’ONDRAF <strong>de</strong>vint alors l'organism<strong>en</strong>ational <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s matières fissiles <strong>en</strong>richies.L’article 9 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 12 décembre 1997 chargea plus tard l’ONDRAF d’établir uninv<strong>en</strong>taire quinqu<strong>en</strong>nal <strong>de</strong> toutes les instal<strong>la</strong>tions et <strong>de</strong> tous les sites qui conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>ssubstances radioactives. Cette loi a été complétée par l’A.R. du 31 mai 2000, et celui-ciremp<strong>la</strong>cé par les articles 87 à 94 inclus <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 30 décembre 2001. L’A.R. du 4 avril2003 modifie l’A.R. du 30 mars 1981 pour les aspects qui concerne le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>l’ONDRAF. Dernier <strong>en</strong> date, l'A.R. du 1 er mai 2006 remp<strong>la</strong>ce celui du 4 avril 2003.Les principales compét<strong>en</strong>ces et missions <strong>de</strong> l’ONDRAF, telles que définies dans les loiset arrêtés susm<strong>en</strong>tionnés sont brièvem<strong>en</strong>t synthétisées ci-après: <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sur le territoire belge : L’ONDRAF est compét<strong>en</strong>tpour l'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> chez le producteur qui fait appel à sesservices, pour le transport <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong>, pour leur traitem<strong>en</strong>t et leurconditionnem<strong>en</strong>t. Il est égalem<strong>en</strong>t compét<strong>en</strong>t pour l'<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>conditionnés dans <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts adaptés et <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> solutions pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>à long terme <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong> après <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d’<strong>en</strong>treposage.Plus concrètem<strong>en</strong>t, les missions qui découl<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cet <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> compét<strong>en</strong>cescompr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t : l'établissem<strong>en</strong>t et t<strong>en</strong>ue d’un inv<strong>en</strong>taire quantitatif etqualitatif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés et non conditionnés <strong>en</strong> Belgique, le suivi<strong>de</strong>s prévisions <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s critères d’acceptationpour les <strong>déchets</strong> conditionnés et non conditionnés, l'agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions et <strong>de</strong>sprocédés pour le traitem<strong>en</strong>t et le conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, acceptation<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés et non conditionnés qui répon<strong>de</strong>nt aux critèresd’acceptation, <strong>la</strong> construction <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nécessaires pour le traitem<strong>en</strong>t, leconditionnem<strong>en</strong>t et l’<strong>en</strong>treposage temporaire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qu’il pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong>charge, <strong>la</strong> coordination <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recherche et développem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> matière <strong>de</strong>dépôt définitif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés. <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s quantités excé<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> matières fissiles <strong>en</strong>richies, <strong>de</strong> substancescont<strong>en</strong>ant du plutonium et <strong>de</strong> combustible usé ou non utilisé : L’ONDRAF estcompét<strong>en</strong>t pour le transport <strong>de</strong>s quantités excé<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> matières fissiles <strong>en</strong>richies,<strong>de</strong>s substances cont<strong>en</strong>ant du plutonium et du combustible usé ou non utilisé et pourleur <strong>en</strong>treposage <strong>en</strong> <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> leurs producteurs ou <strong>de</strong> leursdét<strong>en</strong>teurs.Les missions qui découl<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces compét<strong>en</strong>ces recouvr<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t : <strong>la</strong>détermination <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>nnings et modalités <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong> ces substances,l’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s critères d’acceptation pour l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong> ces substances, lecontrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong> ces substances avec les critères d’acceptation, <strong>la</strong> garantie<strong>de</strong> leur <strong>en</strong>treposage, … le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires mises hors service : L’ONDRAF estcompét<strong>en</strong>t pour recueillir et évaluer les données qui sont nécessaires pour établir lesprogrammes <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et pour approuver et exécuterces programmes <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t.À cet effet, il assure, <strong>en</strong>tre autre, le suivi <strong>de</strong>s techniques et méthodologies <strong>de</strong>déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong>s coûts associés <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> l’approbation <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong>déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> leur exécution. l'inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong> toutes les instal<strong>la</strong>tions nucléaires et <strong>de</strong> tous les sites cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>ssubstances radioactives : L’ONDRAF établit un répertoire du lieu et <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>toutes les instal<strong>la</strong>tions nucléaires et <strong>de</strong> tous les sites qui conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s substancesradioactives et évalue les frais d’assainissem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cesinstal<strong>la</strong>tions et sites. Il s’assure, <strong>en</strong> outre, que les provisions pour le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sopérations <strong>en</strong> cours et à v<strong>en</strong>ir sont dûm<strong>en</strong>t constituées et suffisantes. <strong>la</strong> communication sur ses activités propres : L’ONDRAF établit un programme <strong>de</strong>communication et d’information à propos <strong>de</strong> toutes ses activités. <strong>la</strong> recherche et développem<strong>en</strong>t : L’ONDRAF détermine, <strong>en</strong> concertation avec lesexploitants nucléaires, et gère les programmes <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t30/166
nécessaires à <strong>la</strong> bonne exécution <strong>de</strong> ses missions.1.3 Système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>L'aperçu <strong>de</strong>s missions légales <strong>de</strong> l'ONDRAF qui précè<strong>de</strong> montre combi<strong>en</strong> les tâchesconfiées à l'organisme sont variées. L'accomplissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces missions exige <strong>la</strong> mise <strong>en</strong>oeuvre <strong>de</strong> techniques et d'expertises extrêmem<strong>en</strong>t diversifiées. Pour assurer au mieuxson service à <strong>la</strong> collectivité, garantir <strong>la</strong> bonne <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> surl'<strong>en</strong>semble du territoire belge et protéger l'homme et l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre lesnuisances pot<strong>en</strong>tielles liées à leur exist<strong>en</strong>ce, l'ONDRAF a mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce un systèmeé<strong>la</strong>boré <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>. Cette <strong>gestion</strong>, qui se veut intégrée et globale, va <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise <strong>en</strong>charge du déchet chez le producteur jusqu'à sa mise <strong>en</strong> mise <strong>en</strong> dépôt final, <strong>en</strong> passantpar les différ<strong>en</strong>tes étapes d'inv<strong>en</strong>torisation, d'agrém<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> normalisation, <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t,<strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t et d'<strong>en</strong>treposage intérimaire, pour ne citer que les plus courantes.Comme déjà indiqué précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t, le prés<strong>en</strong>t rapport <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> a pour objet principald'exposer, avec un certain niveau <strong>de</strong> détails, les diverses composantes <strong>de</strong> ce système <strong>de</strong><strong>gestion</strong>.1.4 Surveil<strong>la</strong>nce et directionL'autorité <strong>de</strong> tutelle <strong>de</strong> l'organisme est représ<strong>en</strong>tée par les ministres ayant les affaireséconomiques et l’énergie dans leurs attributions. L'ONDRAF remet à intervalles réguliersun rapport <strong>de</strong> ses activités à ses ministres <strong>de</strong> tutelle et rédige chaque année un rapportd’activité <strong>de</strong>stiné au parlem<strong>en</strong>t.L’ONDRAF est dirigé par un conseil d’administration. Les membres <strong>de</strong> ce conseildispos<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> compét<strong>en</strong>ce possible <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> l’ONDRAF. Leconseil sollicite l'avis <strong>de</strong>s experts <strong>de</strong>s milieux sci<strong>en</strong>tifiques, universitaires et industriels.1.5 Financem<strong>en</strong>tL’ONDRAF exécute ses missions selon les règles <strong>de</strong> bonne pratique industrielle,financière et commerciale. Il facture ses services à prix coûtant, <strong>en</strong> appliquant le principedu « pollueur payeur ».L’ONDRAF conclut <strong>de</strong>s contrats avec les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, lesdét<strong>en</strong>teurs <strong>de</strong> matières fissiles <strong>en</strong>richies, <strong>de</strong> substances cont<strong>en</strong>ant du plutonium ou <strong>de</strong>combustible usé ou non utilisé, ainsi qu’avec les exploitants <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions à déc<strong>la</strong>sser.Ces contrats définiss<strong>en</strong>t toutes les modalités qui permett<strong>en</strong>t à l’ONDRAF d’accomplir sesmissions <strong>en</strong> toute sûreté. La loi oblige les contractants à lui fournir les r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>tsdont il a besoin à cet effet.L’ONDRAF peut égalem<strong>en</strong>t compter sur d’autres sources <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t, comme parexemple <strong>la</strong> Commission europé<strong>en</strong>ne pour le cofinancem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> certains <strong>de</strong> sesprogrammes <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>à longue durée <strong>de</strong> vie ou <strong>en</strong>core l’État belge pour le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’assainissem<strong>en</strong>t dupassif nucléaire.Les modalités <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'organisme sont exposées plus <strong>en</strong> détail au chapitrehuit.2. BelgoprocessBelgoprocess est une société anonyme créée <strong>en</strong> 1984 et établie à Dessel. Initialem<strong>en</strong>tfondée pour remettre <strong>en</strong> service les instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> l’usine <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>tEUROCHEMIC, elle est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue <strong>en</strong> 1986, suite à l'abandon du projet belge <strong>de</strong>retraitem<strong>en</strong>t, filiale <strong>de</strong> l’ONDRAF. Véritable bras industriel <strong>de</strong> l'organisme, Belgoprocessassure, pour le compte et sous <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, le traitem<strong>en</strong>t, leconditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ainsi que leur <strong>en</strong>treposage. Elle exécuteégalem<strong>en</strong>t les tâches <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires mises hors service <strong>de</strong>31/166
l'ex-EUROCHEMIC (site BP1) et <strong>de</strong> l'anci<strong>en</strong> départem<strong>en</strong>t Waste du SCK·CEN (site BP2).Son personnel compte <strong>en</strong>viron 240 membres.2.1 ActivitésLes activités <strong>de</strong> Belgoprocess se répartiss<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux grands domaines : les activités <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t, conditionnem<strong>en</strong>t et <strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>; le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions obsolètes.Traitem<strong>en</strong>t, conditionnem<strong>en</strong>t et <strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>Belgoprocess traite les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> soli<strong>de</strong>s et liqui<strong>de</strong>s prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>tralesnucléaires, <strong>de</strong>s hôpitaux, <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires, et d'autres producteurs. Utilisant <strong>de</strong>sprocessus industriels éprouvés, Belgoprocess transforme les <strong>déchets</strong> bruts ethétérogènes <strong>en</strong> un produit fini compact et chimiquem<strong>en</strong>t stable. Pour ce faire, elledispose <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions appropriées et <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s technologiques adaptés auxdiffér<strong>en</strong>ts types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> r<strong>en</strong>contrés. Ainsi, Belgoprocess réduit le volume <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>soli<strong>de</strong>s <strong>en</strong> les incinérant ou <strong>en</strong> les compactant. Les <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s (eaux usées)subiss<strong>en</strong>t un traitem<strong>en</strong>t chimique ou thermique qui les réduit à une boue au volumerestreint. Les résidus <strong>de</strong> ces traitem<strong>en</strong>ts sont immobilisés et confinés dans du cim<strong>en</strong>t oudu bitume et emballé dans <strong>de</strong>s fûts <strong>en</strong> acier.Les <strong>déchets</strong> conditionnés sont <strong>en</strong>treposés <strong>de</strong> façon temporaire dans <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>tsconçus à cet effet, <strong>en</strong> att<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> oeuvre d'une solution à long terme.Belgoprocess se charge égalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> vitrifiés <strong>de</strong> hauteactivité prov<strong>en</strong>ant du retraitem<strong>en</strong>t d’assemb<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> combustibles belges, <strong>en</strong>voyés <strong>en</strong>France dans le cadre d’un contrat conclu <strong>en</strong> 1978 par SYNATOM avec COGEMA, àprés<strong>en</strong>t AREVA NC.Déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t d’instal<strong>la</strong>tions nucléairesfigure 4.: Vue aéri<strong>en</strong>ne du site 1 <strong>de</strong> BelgoprocessActuellem<strong>en</strong>t, Belgoprocess ne s’occupe que du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions miseshors service sur les sites BP1 et BP2. Elle démantèle les anci<strong>en</strong>nes instal<strong>la</strong>tions <strong>en</strong>éliminant les matériaux radiologiquem<strong>en</strong>t contaminés à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> techniques spécifiques :découpage du métal, rac<strong>la</strong>ge du béton, … . Lorsque les bâtim<strong>en</strong>ts sont débarrassés <strong>de</strong>toute radioactivité, ils veill<strong>en</strong>t à leur démolition à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> techniques conv<strong>en</strong>tionnelles.3. Autres part<strong>en</strong>aires industriels <strong>de</strong> l'ONDRAFL'ONDRAF ne transporte pas les <strong>déchets</strong> lui-même mais fait appel pour ce<strong>la</strong> à <strong>de</strong>stransporteurs agréés disposant <strong>de</strong>s autorisations délivrées par l'Ag<strong>en</strong>ce Fédérale <strong>de</strong>32/166
Contrôle Nucléaire. Ces <strong>de</strong>niers transport<strong>en</strong>t les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong>puis lesinstal<strong>la</strong>tions du producteur jusqu'au site <strong>de</strong> Belgoprocess. L'ONDRAF fait <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>tappel à TRANSNUBEL, établi à Dessel, et TRANSRAD, établi à Fleurus.L’ONDRAF travaille aussi très régulièrem<strong>en</strong>t avec <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong>s, notamm<strong>en</strong>t pourles tâches <strong>de</strong> conception et d’ingénierie <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>tet <strong>de</strong> stockage, ainsi que les étu<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong>.L’ONDRAF col<strong>la</strong>bore égalem<strong>en</strong>t avec <strong>de</strong>s organismes <strong>de</strong> contrôle agréés comme Bel-V(anci<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t AVN - Association Vinçotte Nucléaire) et CONTROLATOM.4. EURIDICELe GIE EURIDICE 17 est un groupem<strong>en</strong>t d’intérêt économique créé <strong>en</strong> 1995 conjointem<strong>en</strong>tpar l’ONDRAF et le SCK·CEN, sous le nom originel <strong>de</strong> GIE PRACLAY. Ce groupem<strong>en</strong>teffectue pour l'ess<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong>s travaux sci<strong>en</strong>tifiques et technique portant sur le dépôt final<strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t et hautem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong>.Le GIE EURIDICE gère et exploite, à Mol, dans <strong>la</strong> Campine anversoise, l’infrastructure <strong>de</strong>recherche souterraine HADES 18 . Dans ce <strong>la</strong>boratoire construit à 225 mètres <strong>de</strong>profon<strong>de</strong>ur au coeur du massif d’argile <strong>de</strong> Boom s'effectu<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> troisdéc<strong>en</strong>nies, <strong>de</strong> nombreuses expéri<strong>en</strong>ces visant toutes à répondre à <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoirsi le dépôt final <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur dans l’argile <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> haute activité et/ou à vie longuepeut offrir une solution sûre à long terme. Le chapitre onze détaillera ces étu<strong>de</strong>s.figure 5.: Le <strong>la</strong>boratoire souterrainLe GIE EURIDICE est établi sur le domaine du SCK·CEN, à Mol. Actuellem<strong>en</strong>t,l’ONDRAF et le SCK·CEN mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong>semble <strong>en</strong>viron quinze membres <strong>de</strong> leur personnelrespectif à <strong>la</strong> disposition du GIE EURIDICE.5. Autres part<strong>en</strong>aires sci<strong>en</strong>tifiques <strong>de</strong> l'ONDRAFLes part<strong>en</strong>aires sci<strong>en</strong>tifiques <strong>de</strong> l’ONDRAF sont pour <strong>la</strong> plupart associés aux étu<strong>de</strong>sre<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> sûreté et à <strong>la</strong> phénoménologie <strong>de</strong>s dépôts <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Le principal d'<strong>en</strong>tre eux est le SCK·CEN, C<strong>en</strong>tre d'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'énergie nucléaire, déjàr<strong>en</strong>contré dans les pages qui précè<strong>de</strong>nt. Cet organisme sci<strong>en</strong>tifique d’utilité publiquecompte aujourd'hui plus <strong>de</strong> 600 personnes. Par <strong>la</strong> recherche et le développem<strong>en</strong>t, ilcontribue notamm<strong>en</strong>t aux innovations dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité nucléaire et <strong>de</strong> <strong>la</strong>protection contre le rayonnem<strong>en</strong>t et couvre égalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s aspects sociétaux.L’ONDRAF col<strong>la</strong>bore égalem<strong>en</strong>t avec différ<strong>en</strong>tes universités ou institutions <strong>de</strong> recherchebelges et étrangères.17 EURIDICE est l'acronyme <strong>de</strong> 'European Un<strong>de</strong>rground Research Infrastructure for Disposal of radioactivewaste In a C<strong>la</strong>y Environm<strong>en</strong>t'.18 HADES est l'acronyme <strong>de</strong> 'High-Activity Disposal Experim<strong>en</strong>tal Site'.33/166
6. Autorités fédéralesComme déjà signalé, l’ONDRAF est soumis à <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce du Gouvernem<strong>en</strong>t fédéralpar le biais <strong>de</strong> sa tutelle, les ministres ayant les affaires économiques et l'énergie dansleurs compét<strong>en</strong>ces. Le ministère <strong>de</strong>s affaires économiques, plus particulièrem<strong>en</strong>t, assurele suivi et <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l'exécution technique et financière <strong>de</strong> l'organisme <strong>en</strong> matière<strong>de</strong> passifs nucléaires (cf. chapitre huit).L’Ag<strong>en</strong>ce fédérale <strong>de</strong> contrôle nucléaire (AFCN) fixe le cadre réglem<strong>en</strong>taire pour <strong>la</strong> sûreté<strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaire et pour <strong>la</strong> protection contre les radiations ionisantes, <strong>en</strong>contrôle le respect par les exploitants, délivre les autorisations nucléaires et assure, <strong>en</strong>treautre, le suivi <strong>de</strong> nombreux dossiers internationaux.Elle a parmi ses compét<strong>en</strong>ces le pouvoir <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r du caractère radioactif ou non d'unesubstance. Elle pr<strong>en</strong>d égalem<strong>en</strong>t les décisions <strong>en</strong> cas d'interv<strong>en</strong>tion ou unassainissem<strong>en</strong>t.Dans le cadre d'un protocole d'accord <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration qu'il a conclu avec l'AFCN,l’ONDRAF consulte régulièrem<strong>en</strong>t celle-ci pour tout ce qui concerne les aspects <strong>de</strong>contrôles et d'autorisation.7. Re<strong>la</strong>tions internationalesPlusieurs organisations internationales ai<strong>de</strong>nt leurs États membres à mieux gérer leurs<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, <strong>en</strong> définissant notamm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s normes, <strong>de</strong>s recommandations etautres règles <strong>de</strong> bonne pratique. Elles favoris<strong>en</strong>t les contacts <strong>en</strong>tre spécialistes <strong>de</strong> touspays ainsi que l'échange d'expertise et <strong>de</strong> savoir-faire par le biais <strong>de</strong> programmesinternationaux qu’elles cofinanc<strong>en</strong>t. L’ONDRAF participe activem<strong>en</strong>t à ces échanges etaux programmes issus <strong>de</strong> ces diverses organisations. Parmi elles, on trouve : l’AEN (Ag<strong>en</strong>ce pour l’énergie nucléaire), basée à Paris. Cette ag<strong>en</strong>ce, créée au sein<strong>de</strong> l’OCDE (Organisation <strong>de</strong> coopération et <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t économiques,) souti<strong>en</strong>tses États membres dans le mainti<strong>en</strong> et le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> base sci<strong>en</strong>tifique,technologique, économique et juridique nécessaire pour garantir une utilisation sûre,écologique, efficace et pacifique <strong>de</strong> l’énergie nucléaire. Elle agit comme p<strong>la</strong>te-formed’échange d’informations et <strong>de</strong> connaissances et <strong>en</strong>courage <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borationinternationale. L’AEN travaille <strong>en</strong> étroite col<strong>la</strong>boration avec l’Ag<strong>en</strong>ce internationale <strong>de</strong>l’énergie atomique; l’AIEA (Ag<strong>en</strong>ce internationale <strong>de</strong> l’énergie atomique) à Vi<strong>en</strong>ne. Cette ag<strong>en</strong>ce quidép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> l'organisation <strong>de</strong>s Nations unies émet <strong>de</strong>s recommandations internationalessur <strong>la</strong> protection et <strong>la</strong> sécurité radiologiques, sur <strong>la</strong> technologie et sur les sci<strong>en</strong>cesnucléaires. l’organisation internationale EURATOM (Communauté europé<strong>en</strong>ne pour l’énergieatomique). Cette organisation qui dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> l’Union europé<strong>en</strong>ne a pour but <strong>de</strong>promouvoir les applications pacifiques <strong>de</strong> l’énergie atomique au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong>communauté. La CIPR (Commission internationale <strong>de</strong> protection radiologique). Cette organisationinternationale formule <strong>de</strong>s règles et recommandations sur tous les aspects liés à <strong>la</strong>protection contre les rayonnem<strong>en</strong>ts ionisants.Enfin, l’ONDRAF est régulièrem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> contact avec les ag<strong>en</strong>ces simi<strong>la</strong>ires à l’étranger :ANDRA (France), ENRESA (Espagne), SKB (Suè<strong>de</strong>), NAGRA (Suisse), COVRA (Pays-Bas), NDA (Royaume Uni), DBE (Allemagne), ARAO (Slovénie), ... Les ag<strong>en</strong>ces <strong>de</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> europé<strong>en</strong>nes se réuniss<strong>en</strong>t <strong>de</strong>ux fois par an dans lecadre du Club <strong>de</strong>s Ag<strong>en</strong>ces, organisation informelle parrainée par <strong>la</strong> Commissioneuropé<strong>en</strong>ne, pour échanger <strong>de</strong> l'information sur leur propre fonctionnem<strong>en</strong>t et sur <strong>de</strong>ssujets d'actualité.L'ONDRAF a établi <strong>de</strong>s accords bi<strong>la</strong>téraux <strong>de</strong> coopération avec ANDRA (France),ENRESA (Espagne), NAGRA (Suisse), NDA (UK) et ARAO (Slovénie).34/166
Chapitre troisL'ONDRAF dans son rôle d'autoritéLe <strong>de</strong>uxième chapitre nous a déjà précisé le cadre légal et règlem<strong>en</strong>taire dans lequel agitl'ONDRAF. Ce troisième chapitre approfondit cet aspect <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>, <strong>en</strong> abordant lesélém<strong>en</strong>ts normatifs édictés par l'organisme lui-même. Comme il le sera montré, <strong>la</strong>légitimité <strong>de</strong> ces règles dont l'ONDRAF est à l'origine est garantie par le contrôle auquelelles sont soumises et par l'indisp<strong>en</strong>sable cohér<strong>en</strong>ce qu'elles prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t avec lesrèglem<strong>en</strong>ts, recommandations et pratiques, tant nationaux qu'internationaux. C'est parl'exposé <strong>de</strong> ceux-ci que débute ce chapitre.La base règlem<strong>en</strong>taire sur <strong>la</strong>quelle s'appuie <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge, par l'ONDRAF, <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sont les Règles générales d'acceptation. Elles sont donc les<strong>de</strong>uxièmes à être traitées.La mise <strong>en</strong> oeuvre, pour les différ<strong>en</strong>ts types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, <strong>de</strong> ces Règles générales<strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'abord que ces types soi<strong>en</strong>t c<strong>la</strong>ssés <strong>en</strong> catégories, groupes et c<strong>la</strong>ssesrigoureusem<strong>en</strong>t définis. Les c<strong>la</strong>ssifications, pour <strong>déchets</strong> non-conditionnés d'une part,conditionnés d'autre part, et dont l'ONDRAF fait usage pour structurer et organiser sa<strong>gestion</strong> technique, administrative et financière, sont expliquées.L'intégration <strong>de</strong>s Règles générales et <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>ssifications fon<strong>de</strong> l'é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s Critèresd'acceptation <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts groupes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>.Enfin, les <strong>déchets</strong> ne sont pas seuls à faire l'objet <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> vérification <strong>de</strong>conformité avec un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> règles préétablies. Les méthodologies qui lescaractéris<strong>en</strong>t, <strong>en</strong>tre autres radiologiquem<strong>en</strong>t, les instal<strong>la</strong>tions qui les trait<strong>en</strong>t, lesembal<strong>la</strong>ges qui les conditionn<strong>en</strong>t et les <strong>en</strong>trepôts qui les accueill<strong>en</strong>t une fois conditionnéssont soumis à un agrém<strong>en</strong>t préa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> l'ONDRAF, selon une procédure dont l'exposéclôt le chapitre.De par sa nature, ce troisième chapitre est <strong>de</strong> lecture plus austère, austérité qu'exige <strong>la</strong>nécessité d'une fondation soli<strong>de</strong>, parce que justifiée, <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> oeuvre <strong>de</strong>s <strong>gestion</strong>scourante et à long terme.Nous avons maint<strong>en</strong>ant prés<strong>en</strong>tés, d'un côté, les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> générés, <strong>en</strong>Belgique, par <strong>de</strong> nombreuses activités industrielles, sci<strong>en</strong>tifiques et médicales, et, d'unautre côté, l'ONDRAF investi par <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission <strong>de</strong> les pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge et <strong>de</strong>mettre <strong>en</strong> oeuvre leur <strong>gestion</strong> dans le court, le moy<strong>en</strong> et le long terme.En amont <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion nationale, l'organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>doit égalem<strong>en</strong>t t<strong>en</strong>ir compte d'un certain nombre <strong>de</strong> principes, conv<strong>en</strong>tions et règlem<strong>en</strong>tsénoncés au niveau international et considérés comme fondam<strong>en</strong>taux. Il est donc naturel<strong>de</strong> comm<strong>en</strong>cer par exposer ceux-ci.1. Le cadre international1.1 Les principes fondam<strong>en</strong>tauxAu niveau international, l’AIEA (Ag<strong>en</strong>ce internationale <strong>de</strong> l’énergie atomique) a établi neufprincipes fondam<strong>en</strong>taux auxquels doit répondre <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Cesprincipes sont :Principe n° 1 : les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doiv<strong>en</strong>t être gérés <strong>de</strong> façon à garantir unniveau acceptable <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé humaine.Principe n° 2 : les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doiv<strong>en</strong>t être gérés <strong>de</strong> façon à assurer un niveau35/166
acceptable <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t.Principe n° 3 : les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doiv<strong>en</strong>t être gérés <strong>de</strong> façon à garantir que leseffets pot<strong>en</strong>tiels sur <strong>la</strong> santé humaine et l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s frontièresnationales soi<strong>en</strong>t pris <strong>en</strong> compte.Principe n° 4 : les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doiv<strong>en</strong>t être gérés <strong>de</strong> façon à ce que lesimpacts prévisibles sur <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>s générations futures ne soi<strong>en</strong>t pas supérieursaux niveaux d'impact jugés acceptables aujourd'hui.Principe n° 5 : les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doiv<strong>en</strong>t être gérés <strong>de</strong> façon à ne pas imposer<strong>de</strong> charges injustifiées aux générations futures.Principe n° 6 : les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doiv<strong>en</strong>t être gérés dans un cadre légal nationa<strong>la</strong>pproprié incluant l'attribution c<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>s responsabilités et <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong>mécanismes indép<strong>en</strong>dants <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion.Principe n° 7 : <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doit être maint<strong>en</strong>ue au niveauminimum praticable.Principe n° 8 : les interdép<strong>en</strong>dances <strong>en</strong>tre toutes les étapes <strong>de</strong> production et <strong>de</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doiv<strong>en</strong>t être prises <strong>en</strong> compte <strong>de</strong> manièreappropriée.Principe n° 9 : <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions servant à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> doit être assurée <strong>de</strong> manière appropriée durant toute leur durée <strong>de</strong> vie.En outre, toute pratique mise <strong>en</strong> oeuvre dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> doit répondre à trois principes <strong>de</strong> base établis par l'ICRP (InternationalCommission on Radiological Protection) : principe <strong>de</strong> justification <strong>de</strong>s pratiques : toute pratique impliquant une exposition auxrayonnem<strong>en</strong>ts ionisants doit offrir plus d’avantages que d’inconvéni<strong>en</strong>ts, sans pourautant que ces avantages doiv<strong>en</strong>t nécessairem<strong>en</strong>t bénéficier à ceux qui subiss<strong>en</strong>t lesinconvéni<strong>en</strong>ts. principe d’optimisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection, <strong>en</strong>core appelé principe ALARA (As Low AsReasonably Achievable) : les moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> protection doiv<strong>en</strong>t être choisis <strong>de</strong> manièretelle que les doses individuelles et le nombre <strong>de</strong> personnes exposées soi<strong>en</strong>t maint<strong>en</strong>usà un niveau aussi faible que raisonnablem<strong>en</strong>t possible, compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s facteurséconomiques et sociaux. principe <strong>de</strong> limitation <strong>de</strong>s doses individuelles : <strong>la</strong> dose <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t reçue par lestravailleurs exposés professionnellem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion doit rester inférieure à <strong>de</strong>slimites imposées.1.2 Les conv<strong>en</strong>tions et traitésLa Belgique a adhéré à plusieurs traités et conv<strong>en</strong>tions internationaux re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong><strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et/ou <strong>de</strong>s matières fissiles : La Conv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> Londres sur <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution marine par le rejet <strong>de</strong><strong>déchets</strong> et autres matières, déjà évoquée au chapitre premier. En particulier, le rejet <strong>en</strong>mer <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> quelque nature que ce soit est interdit aux signataires <strong>de</strong><strong>la</strong> Conv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>puis 1994; La Conv<strong>en</strong>tion OSPAR (Oslo - Paris Conv<strong>en</strong>tion for the Protection of the MarineEnvironm<strong>en</strong>t of the North-East At<strong>la</strong>ntic), <strong>en</strong> vigueur <strong>de</strong>puis 1998, qui confirmel'interdiction <strong>de</strong> l'immersion <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> faible et moy<strong>en</strong>ne activité dansl'At<strong>la</strong>ntique Nord-Est; La Conv<strong>en</strong>tion d'Espoo, ratifiée <strong>en</strong> 1999 par <strong>la</strong> Belgique, qui impose aux partiesl'évaluation <strong>de</strong> l'impact <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal <strong>de</strong> certaines pratiques, parmi lesquellesl'<strong>en</strong>treposage et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt définitif <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong> combustiblesirradiés. Cette conv<strong>en</strong>tion impose <strong>en</strong> outre <strong>la</strong> notification <strong>de</strong>s possibles effetstransfontaliers <strong>de</strong> ces pratiques et <strong>la</strong> consultation <strong>de</strong>s autres parties;36/166
La Joint Conv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> l'AIEA <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s combustiblesusés et <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, ratifiée par <strong>la</strong> Belgique <strong>en</strong> 1997. Les obligationsimposées par ce traité sont basées sur les neuf principes fondam<strong>en</strong>taux exposés ci<strong>de</strong>ssus; Le traité international <strong>de</strong> non-prolifération d'armes nucléaires, qui porte sur le contrôleinternational <strong>de</strong>s matières fissiles.1.3 La légis<strong>la</strong>tion europé<strong>en</strong>neL'Union europé<strong>en</strong>ne est égalem<strong>en</strong>t source d'un cadre règlem<strong>en</strong>taire important. Citons : Les règlem<strong>en</strong>ts EURATOM 3227/76 et 2130/93, qui organis<strong>en</strong>t au niveau <strong>de</strong>s Etatsmembres concernés le contrôle <strong>de</strong>s matières fissiles; Les diverses directives europé<strong>en</strong>nes <strong>en</strong> matières <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>ts ionisants, parmilesquelles <strong>la</strong> directive 96/29/Euratom qui fixe les normes <strong>de</strong> base re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong>protection sanitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s travailleurs contre les dangers résultant <strong>de</strong>srayonnem<strong>en</strong>ts ionisants; Les directives portant sur l'évaluation <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces <strong>de</strong> certains projets (directives85/337/CEE et 97/11/CE) et <strong>de</strong> certains p<strong>la</strong>ns et programmes (directive 2001/42/CE).2. Transposition <strong>en</strong> droit belgeAu niveau fédéral, <strong>la</strong> directive europé<strong>en</strong>ne 96/29/Euratom a été transposée <strong>en</strong> légis<strong>la</strong>tionbelge par l’arrêté royal du 20 juillet 2001 (Règlem<strong>en</strong>t général <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong>popu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong>s travailleurs et <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre le danger <strong>de</strong>s rayonnem<strong>en</strong>tsionisants - RGPRI).Le RGPRI définit, <strong>en</strong>tre autres, les normes <strong>de</strong> base <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> radioprotection, lec<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s établissem<strong>en</strong>ts nucléaires et <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisationpour les différ<strong>en</strong>tes c<strong>la</strong>sses d’établissem<strong>en</strong>ts.Les instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sont égalem<strong>en</strong>t soumises àl’évaluation <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (directives europé<strong>en</strong>nes 85/337/CEE et97/11/CE). Les aspects radiologiques <strong>de</strong> cette évaluation ont été incorporés dans leRGPRI. Pour les aspects <strong>de</strong> l’évaluation <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, qui sont duressort <strong>de</strong>s Régions, le RGPRI prévoit l’établissem<strong>en</strong>t d’un accord <strong>de</strong> coopération <strong>en</strong>trel’AFCN et l’autorité régionale compét<strong>en</strong>te. Cet accord est <strong>en</strong> cours <strong>de</strong> préparation (juin2007).*****Afin d'être à même <strong>de</strong> remplir sa mission dans les meilleures conditions et conformém<strong>en</strong>taux principes et textes à caractère normatif exposés ci-<strong>de</strong>ssus, l'ONDRAF a dû lui-mêmeproduire un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> textes normatifs, tels que règles, codifications, spécifications etprocédures. Au sein <strong>de</strong> cet <strong>en</strong>semble normatif re<strong>la</strong>tif aux <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, les Règlesgénérales et les Critères d'acceptation ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> plus importante, parce qu'ilsconcern<strong>en</strong>t les <strong>déchets</strong> eux-mêmes. D'autres textes à caractère règlem<strong>en</strong>taire, lesAgrém<strong>en</strong>ts, que nous r<strong>en</strong>contrerons plus loin, concern<strong>en</strong>t les aspects connexes, tels queles instal<strong>la</strong>tions qui produis<strong>en</strong>t, trait<strong>en</strong>t et stock<strong>en</strong>t les <strong>déchets</strong>, ou <strong>en</strong>core mesur<strong>en</strong>t leurscaractéristiques, au premier rang <strong>de</strong>squelles, bi<strong>en</strong> sûr, les radioactives. Maiscomm<strong>en</strong>çons par les règles et critères :Pour pouvoir assurer une <strong>gestion</strong> sûre à court et à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> quilui sont confiés, l’ONDRAF doit avoir <strong>de</strong>s garanties suffisantes que leurs caractéristiquesintrinsèques ne risqu<strong>en</strong>t <strong>en</strong> principe pas <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> péril <strong>la</strong> sûreté d’une ou <strong>de</strong> plusieurs<strong>de</strong>s étapes <strong>de</strong> leur <strong>gestion</strong>, et il doit pour ce<strong>la</strong> recevoir l’assurance que cescaractéristiques sont conformes à différ<strong>en</strong>ts critères qu’il a préa<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t établis. Il adonc établi les Règles générales <strong>de</strong>vant servir <strong>de</strong> cadre <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour l’é<strong>la</strong>boration<strong>de</strong>s critères auxquels doiv<strong>en</strong>t satisfaire les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> pour qu’il accepte<strong>de</strong> les pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge, avant d’établir les critères d’acceptation proprem<strong>en</strong>t dits. Ces37/166
Règles générales et ces critères d’acceptation peuv<strong>en</strong>t être modifiés <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s recommandations nationales et internationales, ainsique <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t ou <strong>de</strong>s solutions <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> àplus long terme, à l’initiative <strong>de</strong> l'ONDRAF ou <strong>de</strong> l’autorité compét<strong>en</strong>te. Bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du, toutcolis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> accepté par l’ONDRAF doit égalem<strong>en</strong>t satisfaire auxprescriptions légales et règlem<strong>en</strong>taires <strong>en</strong> application, y compris aux dispositions <strong>de</strong>slic<strong>en</strong>ces d’exploitation <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires concernées et son transport doitsatisfaire à <strong>la</strong> règlem<strong>en</strong>tation internationale <strong>de</strong> transport.3. Les Règles généralesNous avons brièvem<strong>en</strong>t évoqué, au chapitre premier, <strong>la</strong> distinction qu'il y avait lieu <strong>de</strong>faire <strong>en</strong>tre les <strong>déchets</strong> dits “non conditionnés” et ceux dits “conditionnés”. Précisons àprés<strong>en</strong>t davantage ces notions, car il existe un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> Règles générales pourchacun <strong>de</strong> ces types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>.1. Les <strong>déchets</strong> non conditionnés sont les <strong>déchets</strong> tels qu'ils se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t chez leurproducteur dans leur état initial. Ils n'ont à ce sta<strong>de</strong> subi aucune opérationphysique ou chimique visant à les stabiliser dans le plus long terme, a fortiorin'ont-ils pas été immobilisés et emballés dans un embal<strong>la</strong>ge à vocation définitive.Tout au plus sont-ils emballés <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> leur <strong>en</strong>treposage et <strong>de</strong> leur transport. Cesont les <strong>déchets</strong> “bruts”.2. Les <strong>déchets</strong> conditionnés sont le résultat du ou <strong>de</strong>s traitem<strong>en</strong>ts physiques et/ouchimiques <strong>de</strong> stabilisation, suivis le plus souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'immobilisation du ou <strong>de</strong>sproduits résultant dans une matrice soli<strong>de</strong> <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong>dissémination <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s (limitation du risque <strong>de</strong> contamination) et ducolisage <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>semble dans un embal<strong>la</strong>ge adéquat et durable, muni ou non d'unblindage supplém<strong>en</strong>taire (limitation du risque d'irradiation). Ce sont les <strong>déchets</strong>“finaux”.Les Règles générales pour l'un et l'autre type <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> ont été approuvées par lettre duministre <strong>de</strong> l'Intérieur <strong>en</strong> date du 10 février 1999 et sont <strong>en</strong>trées <strong>en</strong> vigueur le même jour.Elles constitu<strong>en</strong>t un gui<strong>de</strong> pour l'établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s Critères d'acceptation, soit lesconditions minimales auxquelles doiv<strong>en</strong>t répondre les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> pourêtre pris <strong>en</strong> charge. Leur structure est décrite <strong>en</strong> annexe B.Comme dit plus haut, les Règles générales sont un cadre <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce, ou, si l'onpréfère, une table <strong>de</strong>s matières pour l'é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s Critères d'acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>,conditionnés ou non.4. Les c<strong>la</strong>ssificationsNous avons constaté, au chapitre premier, l'extrême variété <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Considérons d'une part un liqui<strong>de</strong> <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance d'un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> contrôle-qualitéd'une usine <strong>de</strong> fabrication <strong>de</strong> combustible nucléaire, fortem<strong>en</strong>t aci<strong>de</strong> et cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>smatières fissiles et d'autre part <strong>de</strong>s serviettes jetables (<strong>en</strong> papier) prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> <strong>la</strong>poubelle d'une unité <strong>de</strong> radiodiagnostic, très légèrem<strong>en</strong>t contaminées par dutechnetium-99 ( 99 Tc). Ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> déchet pris comme exemples n'ont ri<strong>en</strong> <strong>en</strong>commun : ni leur état physique, ni leurs propriétés chimiques, ni l'embal<strong>la</strong>ge qui lesr<strong>en</strong>ferme, ni, surtout, les radionucléi<strong>de</strong>s qu'ils conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t et l'activité <strong>de</strong> ceux-ci ne sont,même <strong>de</strong> loin, comparables. Un pot <strong>de</strong> peinture au trois-quarts vi<strong>de</strong> prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> travauxd'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> dans <strong>la</strong> zone contrôlée d'une c<strong>en</strong>trale nucléaire est tout aussi différ<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>smêmes points <strong>de</strong> vue, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers exemples. Il s'<strong>en</strong>suit que les opérations <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t qui leur seront appliquées après prise <strong>en</strong> charge seronttout aussi différ<strong>en</strong>tes. Les <strong>déchets</strong> conditionnés qui <strong>en</strong> résulteront diffèrerontradiologiquem<strong>en</strong>t et utiliseront peut-être un modèle <strong>de</strong> fût ou une matrice d'immobilisationdiffér<strong>en</strong>ts. Il s'<strong>en</strong>suit <strong>en</strong>core que le bâtim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> stockage temporaire qui les hébergera<strong>en</strong>suite ne sera pas nécessairem<strong>en</strong>t le même et que <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> dépôt définitif à leurréserver pourrait être, elle aussi, différ<strong>en</strong>te.Il est donc impératif <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sser judicieusem<strong>en</strong>t les différ<strong>en</strong>ts types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> vue <strong>de</strong>38/166
leur assurer le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> le mieux adapté. Il s'agit <strong>de</strong> réduire un grand nombred’élém<strong>en</strong>ts individuels à un nombre plus restreint d’<strong>en</strong>sembles possédant une ouplusieurs caractéristiques propres, communes aux élém<strong>en</strong>ts appart<strong>en</strong>ant à un même<strong>en</strong>semble. Pour les <strong>déchets</strong> non conditionnés, ces <strong>en</strong>sembles sont déterminés par les filières <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t, elles-mêmes fonction <strong>de</strong> l'état physico-chimique du déchetet <strong>de</strong> ses propriétés radiologiques. Pour les <strong>déchets</strong> conditionnés, ces <strong>en</strong>sembles sont déterminés par les mo<strong>de</strong>sd'<strong>en</strong>treposage temporaire et les perspectives <strong>de</strong> dépôt définitif, eux-mêmes fonction<strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> colisage et <strong>de</strong>s propriétés radiologiques.Une fois <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification opérée, <strong>la</strong> transposition <strong>de</strong>s Règles générales <strong>en</strong> critèresquantitatifs pourra s'opérer, sous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> Critères d'acceptation.Comme pour les Règles générales, une distinction est opérée <strong>en</strong>tre <strong>déchets</strong> nonconditionnés et <strong>déchets</strong> conditionnés. Mais tandis que <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>en</strong>sembles<strong>de</strong> Règles générales peut être considérée comme quasim<strong>en</strong>t i<strong>de</strong>ntique, les c<strong>la</strong>ssifications<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés et conditionnés sont, elles, <strong>de</strong> structures très différ<strong>en</strong>tes,parce que répondant à <strong>de</strong>s préoccupations elles aussi différ<strong>en</strong>tes.4.1 La c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnésLa c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés (<strong>en</strong> abrégé : DNC) se fon<strong>de</strong> sur unelogique <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à court terme, plus spécifiquem<strong>en</strong>t les techniques <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong>conditionnem<strong>en</strong>t appliquées aux <strong>déchets</strong> bruts. Ces traitem<strong>en</strong>ts/conditionnem<strong>en</strong>ts sonteux-mêmes déterminés par les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiquesinitiales <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés.Nous avons, au chapitre premier, déjà brièvem<strong>en</strong>t évoqués quelques traitem<strong>en</strong>tsapplicables aux <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s (incinération, compaction, immobilisation directe... ) etliqui<strong>de</strong>s (évaporation, filtration, décantation, flocu<strong>la</strong>tion, incinération... ). L'ONDRAFdispose, via sa filiale Belgoprocess, <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions industrielles permettant lestraitem<strong>en</strong>ts adaptés compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s contraintes pouvant résulter <strong>de</strong> <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce, <strong>en</strong>quantités plus ou moins importantes, <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s. Ces instal<strong>la</strong>tions seront décritesplus <strong>en</strong> détail au chapitre cinq, mais sont m<strong>en</strong>tionnées ici <strong>de</strong> manière générique puisquec'est leur disponibilité qui fon<strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s DNC. En d'autres mots, ce sont lescaractéristiques d'un déchet qui détermin<strong>en</strong>t <strong>la</strong> filière <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t vers <strong>la</strong>quelle il estdirigé et l'affect<strong>en</strong>t à une catégorie bi<strong>en</strong> précise.Ces catégories sont définies par un co<strong>de</strong> à trois caractères, couramm<strong>en</strong>t appelé “co<strong>de</strong>XYZ”. Le détail <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification XYZ <strong>de</strong>s DNC est repris <strong>en</strong> annexe C.4.2 La c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnésLa c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés (<strong>en</strong> abrégé : DC) se base sur une toute autrelogique, celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à moy<strong>en</strong> et long terme. Elle se fon<strong>de</strong>, d'une part, sur lesconditions d'<strong>en</strong>treposage temporaire et, d'autre part, sur <strong>la</strong> solution effective ou présumée<strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt définitif.A cette fin, l'ONDRAF a adopté, <strong>en</strong> 1997 et pour les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés, unec<strong>la</strong>ssification pyramidale <strong>en</strong> quatre niveaux. Cette c<strong>la</strong>ssification est compatible avec lesgran<strong>de</strong>s c<strong>la</strong>ssifications internationales, et peut être adaptée, si nécessaire, aux évolutionsque pourrait connaître <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong>.Cette c<strong>la</strong>ssification se base sur les caractéristiques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leurconditionnem<strong>en</strong>t. Cette précision importante ti<strong>en</strong>t au fait que les caractéristiquesradiologiques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> occup<strong>en</strong>t une p<strong>la</strong>ce c<strong>en</strong>trale dans le processus <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ssification, que ces caractéristiques évolu<strong>en</strong>t au cours du temps du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong>décroissance radioactive et que <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification s'inscrit justem<strong>en</strong>t dans l'optique d'une<strong>gestion</strong> sur <strong>de</strong> longues durées. En termes plus concrets, un déchet conditionnéaujourd'hui fortem<strong>en</strong>t irradiant <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>dra, dans quelques années ou dizaines d'années,moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiant, et, à plus long terme <strong>en</strong>core, faiblem<strong>en</strong>t irradiant. Il importe <strong>de</strong>39/166
donc <strong>de</strong> fixer un mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour le c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t, et ce mom<strong>en</strong>t, asseznaturellem<strong>en</strong>t, est celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> production du colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>.Les <strong>de</strong>ux niveaux fondam<strong>en</strong>taux, soit les moins détaillés, concern<strong>en</strong>t exclusivem<strong>en</strong>t lesscénarios <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt définitif, soit <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long et très long terme. Ce sont ces<strong>de</strong>ux premiers niveaux que nous développerons ici, les troisième et quatrième niveauxfaisant l'objet <strong>de</strong> l'annexe D.Le niveau le plus général est constitué par les groupes, au nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux. Ces groupessont définis <strong>en</strong> fonction du nombre <strong>de</strong>s solutions possibles <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt final pourles <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> question : Le groupe géologique rassemble les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés dont lescaractéristiques radiologiques, c’est-à-dire les conc<strong>en</strong>trations d’activité <strong>de</strong>sradionucléi<strong>de</strong>s qu’ils conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t et leur durée <strong>de</strong> vie, r<strong>en</strong><strong>de</strong>nt impératif leur isolem<strong>en</strong>tperman<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> biosphère sur le très long terme. Cet isolem<strong>en</strong>t perman<strong>en</strong>t est<strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t jugé réalisable via <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt <strong>en</strong> couches géologiques profon<strong>de</strong>s etstables. Le groupe ouvert 19 rassemble les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés dont lescaractéristiques radiologiques ont <strong>de</strong>s valeurs suffisamm<strong>en</strong>t faibles pour permettred’<strong>en</strong>visager <strong>de</strong>s solutions alternatives à l’isolem<strong>en</strong>t géologique, par exemple <strong>la</strong> mise <strong>en</strong>dépôt définitif <strong>de</strong> surface, car leur niveau d’activité atteindra par décroissance naturelleune valeur insignifiante dans un <strong>la</strong>ps <strong>de</strong> temps compatible avec les possibilités <strong>de</strong>contrôle, soit un <strong>la</strong>ps <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> 200 à 300 ans maximum.Le <strong>de</strong>uxième niveau est constitué par les catégories, au nombre <strong>de</strong> trois. Les troiscatégories <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés sont définies sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> leurcaractéristiques radiologiques et <strong>de</strong> leur puissance thermique. La catégorie A apparti<strong>en</strong>tau groupe ouvert et les catégories B et C au groupe géologique. Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A sont ceux dont les radionucléi<strong>de</strong>s qu’ils conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>tprés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s activités spécifiques et <strong>de</strong>s durées <strong>de</strong> vie suffisamm<strong>en</strong>t faibles pourpouvoir être mis <strong>en</strong> dépôt <strong>en</strong> surface. Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie B sont ceux qui ne respect<strong>en</strong>t pas le critère d’appart<strong>en</strong>anceà <strong>la</strong> catégorie A mais génèr<strong>en</strong>t trop peu <strong>de</strong> chaleur pour appart<strong>en</strong>ir à <strong>la</strong> catégorie C. Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie C conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong> (très) gran<strong>de</strong>s quantités d’émetteurs alphaet bêta et génèr<strong>en</strong>t une puissance thermique supérieure à 20 W⋅m –3 , valeur quimarque <strong>la</strong> limite <strong>en</strong>tre les catégories B et C dans le cas d’un dépôt dans l’argile. Ilsdoiv<strong>en</strong>t donc pouvoir se refroidir durant une pério<strong>de</strong> d’<strong>en</strong>treposage et leur puissancethermique résiduelle au seuil <strong>de</strong> leur mise <strong>en</strong> dépôt final impose, soit <strong>de</strong> réduire l<strong>en</strong>ombre <strong>de</strong> colis par mètre courant <strong>de</strong> galerie <strong>de</strong> dépôt, soit d’espacer les galeries (voirégalem<strong>en</strong>t chapitre onze).N.B. : Une confusion est fréquemm<strong>en</strong>t opérée <strong>en</strong>tre les catégories A/B/C et les types“faiblem<strong>en</strong>t/moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t/fortem<strong>en</strong>t irradiants”. Elle consiste à assimiler <strong>de</strong>manière abusive <strong>la</strong> catégorie A aux <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants et <strong>la</strong> catégorie Baux <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants 20 . Ce n'est pas systématiquem<strong>en</strong>t le cas :certains <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants le sont du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>radionucléi<strong>de</strong>s à courte <strong>de</strong>mi-vie (e.g. 58 Co, 60 Co), et leur appart<strong>en</strong>ance à <strong>la</strong>catégorie A et au groupe ouvert n'est pas remise <strong>en</strong> cause, tandis que <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s quantités importantes <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s à longue <strong>de</strong>mi-vie, et donc<strong>de</strong> catégorie B, peuv<strong>en</strong>t s'avérer peu irradiants. Le petit tableau ci-après illustrecette distinction qu'il importe <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r à l'esprit :19 A l'époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> conception <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s DC, aucune décision n'avait <strong>en</strong>core été prise concernantle dépôt définitif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> basse ou moy<strong>en</strong>ne activité à courte durée <strong>de</strong> vie, et <strong>la</strong> question était“ouverte”, d'où l'adjectif qualifiant ce groupe.20 L'association “catégorie C” avec les <strong>déchets</strong> fortem<strong>en</strong>t irradiants est, elle, correcte.40/166
Niveau d'irradiation faible moy<strong>en</strong> élevéCourtes <strong>de</strong>mi-vies A A CLongues <strong>de</strong>mi-vies B B CTable 3 : Association “Types/catégories”5. Les Critères d'acceptationMuni, d'une part, <strong>de</strong>s Règles générales et, d'autre part, <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>ssifications, l'ONDRAF està même <strong>de</strong> transposer les premières <strong>en</strong> critères quantitatifs applicables aux <strong>en</strong>semblesdéfinis dans les secon<strong>de</strong>s. Cette transposition fournit les Critères d'acceptation, plusbrièvem<strong>en</strong>t dénommés ACRIA (Acceptatiecriteria/Critères d'acceptation). Enconséqu<strong>en</strong>ce logique <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong>, il existe <strong>de</strong>s Critères d'acceptation pour <strong>déchets</strong>non conditionnés (ACRIA-DNC) et <strong>de</strong>s Critères d'acceptation pour <strong>déchets</strong> conditionnés(ACRIA-DC).Les ACRIA-DNC sont basés sur les catégories XYZ (cf. Annexe C) <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssificationgénérale <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés. Pour chaque catégorie, au moins un ACRIA-DNC est établi. Des ACRIA-DNC supplém<strong>en</strong>taires peuv<strong>en</strong>t s'y ajouter pour certainessous-catégories spécifiques déterminées, notamm<strong>en</strong>t, par <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> certainsmatériaux, prés<strong>en</strong>ce introduisant <strong>la</strong> nécessité d'adaptations au procédé <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et<strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t..Les ACRIA-DC sont basés sur les c<strong>la</strong>sses “AGA” (cf. Annexe D) <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssificationgénérale <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés. Pour chaque c<strong>la</strong>sse, au moins un ACRIA-DC estétabli. Des ACRIA-DC supplém<strong>en</strong>taires peuv<strong>en</strong>t s'y ajouter pour certaines souscatégoriesspécifiques déterminées, notamm<strong>en</strong>t, par <strong>la</strong> matrice d'immobilisation.Quel que soit le g<strong>en</strong>re <strong>de</strong> déchet, les ACRIA définiss<strong>en</strong>t quantitativem<strong>en</strong>t les exig<strong>en</strong>cestechniques minimales (mécaniques, physiques, chimiques, radiologiques, thermiques et,le cas échéant, biologiques) et détermin<strong>en</strong>t les exig<strong>en</strong>ces administratives auxquelles les<strong>déchets</strong> doiv<strong>en</strong>t satisfaire pour que l'ONDRAF puisse les accepter.En outre et plus spécifiquem<strong>en</strong>t, les ACRIA-DNC pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong> compte les dispositions <strong>de</strong>transport, les exig<strong>en</strong>ces liées à <strong>la</strong> sécurité <strong>en</strong> exploitation, les limitations <strong>de</strong>s procédés etinstal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t, les limites règlem<strong>en</strong>taires re<strong>la</strong>tives à cesprocédés et instal<strong>la</strong>tions, ainsi que les exig<strong>en</strong>ces imposées aux <strong>déchets</strong> conditionnés qui<strong>en</strong> résulteront.Pour les ACRIA-DC, outre les exig<strong>en</strong>ces techniques générales m<strong>en</strong>tionnées plus haut,tout colis doit satisfaire à diverses exig<strong>en</strong>ces liées à sa résistance mécanique, aupourc<strong>en</strong>tage maximum <strong>de</strong> vi<strong>de</strong> qu’il peut cont<strong>en</strong>ir, à sa résistance aux rayonnem<strong>en</strong>ts, àson niveau <strong>de</strong> contamination superficielle et à son cont<strong>en</strong>u <strong>en</strong> matières dangereuses,notamm<strong>en</strong>t à son cont<strong>en</strong>u radiologique, et plus particulièrem<strong>en</strong>t à son cont<strong>en</strong>u <strong>en</strong>radionucléi<strong>de</strong>s critiques. Il ne peut être le siège <strong>de</strong> réactions chimiques qui pourrai<strong>en</strong>tmettre <strong>en</strong> péril <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>. Le déchet conditionné lui-même doit par ailleursformer un tout soli<strong>de</strong> sans liqui<strong>de</strong>s libres, compact, chimiquem<strong>en</strong>t stable, non dispersableet peu susceptible <strong>de</strong> se fissurer, ainsi que satisfaire à différ<strong>en</strong>ts critères qui vari<strong>en</strong>t selonle type <strong>de</strong> matrice qui l’immobilise. Il ne peut r<strong>en</strong>fermer <strong>de</strong> matériaux putrescibles et nepeut cont<strong>en</strong>ir d’ag<strong>en</strong>ts solubilisants <strong>en</strong> quantités telles qu’ils pourrai<strong>en</strong>t avoir un effetdéfavorable significatif sur le comportem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s à proximité du dépôt. Lesdégagem<strong>en</strong>ts gazeux dont il pourrait être le siège ne peuv<strong>en</strong>t risquer <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>dommagerou <strong>de</strong> déformer exagérém<strong>en</strong>t son embal<strong>la</strong>ge. Ce <strong>de</strong>rnier, <strong>en</strong>fin, doit satisfaire à <strong>de</strong>sexig<strong>en</strong>ces re<strong>la</strong>tives à ses caractéristiques géométriques, mécaniques et <strong>de</strong> résistance à<strong>la</strong> corrosion, ainsi plus généralem<strong>en</strong>t qu’au mainti<strong>en</strong> <strong>de</strong> son intégrité.Les ACRIA couvr<strong>en</strong>t <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, conditionnés ou non, produits <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t.Leur <strong>gestion</strong> constitue cep<strong>en</strong>dant une tâche perman<strong>en</strong>te <strong>de</strong> l'ONDRAF, aussi bi<strong>en</strong> pourleur mainti<strong>en</strong> à jour que pour l'établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> nouveaux ACRIA <strong>de</strong>stinés à <strong>de</strong>scatégories ou c<strong>la</strong>sses naissantes et/ou d'occurr<strong>en</strong>ce mineure.Pour terminer, soulignons le fait que les Critères d'acceptation sont égalem<strong>en</strong>t le fruitd'une longue évolution du système <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge établi par l'ONDRAF. Bon nombre41/166
<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ont été produits (et traités/conditionnés) avant que le systèmed'acceptation n'ait pris <strong>la</strong> forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Certains <strong>déchets</strong>,on l'a vu dans le premier chapitre <strong>de</strong> ce docum<strong>en</strong>t, dat<strong>en</strong>t même <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> antérieureà <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l'organisme <strong>en</strong> 1981. Ce <strong>de</strong>rnier cep<strong>en</strong>dant part du principe que lesystème mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce ne doit ni ne peut comporter d'exception quant aux modalités <strong>de</strong>prise <strong>en</strong> charge, et que tout déchet doit être accepté dans le cadre <strong>de</strong> ce système.C'est pourquoi une catégorie particulière d'ACRIA a égalem<strong>en</strong>t été prévue et instaurée.Ces critères, <strong>de</strong>stinés à couvrir les productions antérieures à l'instauration du système,constitu<strong>en</strong>t ce que l'on appelle les HACRIA (historische acceptatiecriteria/Critèresd'acceptation historiques). Leur exist<strong>en</strong>ce est, par ailleurs, explicitem<strong>en</strong>t prévue parl'article 13 <strong>de</strong>s Règles générales :“[...] l’ONDRAF établira pour les colis primaires <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>conditionnés produits avant <strong>la</strong> publication <strong>de</strong>s prés<strong>en</strong>tes Règles générales, <strong>de</strong>scritères d’acceptation spécifiques, fondés sur les prescriptions <strong>en</strong> vigueur aumom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leur production. »La diversité importante <strong>de</strong> ces productions antérieures au système actuel a eu pourconséqu<strong>en</strong>ce que l'établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s HACRIA a constitué, ces <strong>de</strong>rnières années, unepart non négligeable du travail dans cette partie du domaine normatif confié à l'ONDRAF.Voici pour les <strong>déchets</strong> eux-mêmes. Passons maint<strong>en</strong>ant à un domaine règlem<strong>en</strong>taireétroitem<strong>en</strong>t associé aux aspects normatifs exposés jusqu'à prés<strong>en</strong>t. Ce domaineconcerne les modalités <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> (production au s<strong>en</strong>s <strong>la</strong>rge : génération,traitem<strong>en</strong>t, conditionnem<strong>en</strong>t), leur caractérisation, radiologique au premier chef, et leur<strong>en</strong>treposage temporaire : les agrém<strong>en</strong>ts.6. Les agrém<strong>en</strong>tsL’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s, procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> production et <strong>de</strong>caractérisation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, constitue une condition préa<strong>la</strong>ble à l’acceptation<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés (DC) et non conditionnés (DNC) par l’organisme.Ces agrém<strong>en</strong>ts ont pour but <strong>de</strong> s’assurer <strong>de</strong> l’aptitu<strong>de</strong> d’une métho<strong>de</strong>, d’un procédé, d’unéquipem<strong>en</strong>t ou d’une instal<strong>la</strong>tion mis <strong>en</strong> oeuvre par un producteur <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, à produireou caractériser <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, <strong>de</strong> façon à ce que ces <strong>de</strong>rniers répon<strong>de</strong>nt auxcritères d’acceptation qui leur sont applicables.Ces agrém<strong>en</strong>ts établiss<strong>en</strong>t ainsi une présomption <strong>de</strong> conformité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Ils offr<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t l'opportunité <strong>de</strong> fixer <strong>en</strong> concertation avec les producteurs lesmodalités administratives permettant d’étayer, au moy<strong>en</strong> d’une justification appropriée, et<strong>de</strong> montrer, par l’établissem<strong>en</strong>t d’une docum<strong>en</strong>tation adéquate, <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> aux critères d’acceptation applicables. De <strong>la</strong> sorte, les agrém<strong>en</strong>ts prépar<strong>en</strong>t <strong>la</strong>voie m<strong>en</strong>ant à l’acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> par l’ONDRAF.L’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions d’<strong>en</strong>treposage, quant à lui, a pour but <strong>de</strong> s’assurer <strong>de</strong>l’aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s conditions et équipem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s colis DC à répondre auxcritères portant <strong>en</strong> particulier sur l’intégrité et <strong>la</strong> durabilité <strong>de</strong>s colis tout au long <strong>de</strong> leurpério<strong>de</strong> d’<strong>en</strong>treposage.Le champ d’application <strong>de</strong>s agrém<strong>en</strong>ts est fixé par l’arrêté royal du 18 novembre 2002« rég<strong>la</strong>nt l’agrém<strong>en</strong>t d’équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>stinés à l’<strong>en</strong>treposage, au traitem<strong>en</strong>t et auconditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ». Il se décline principalem<strong>en</strong>t comme suit : l’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et équipem<strong>en</strong>ts assurant <strong>la</strong> conformité radiologique etphysico-chimique <strong>de</strong>s DNC; l’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s procédés et instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> (production <strong>de</strong>s colis DC); l’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et équipem<strong>en</strong>ts assurant <strong>la</strong> conformité radiologique <strong>de</strong>s colisDC (incluant <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s affectant <strong>la</strong> caractérisation radiologique<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>); l’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions d’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (bâtim<strong>en</strong>ts42/166
d’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s colis DC).Les différ<strong>en</strong>tes procédures d’agrém<strong>en</strong>t sont développées <strong>en</strong> annexe E. L’acc<strong>en</strong>t est missur l’agrém<strong>en</strong>t par l’ONDRAF <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions mis <strong>en</strong> œuvrepar les producteurs pour produire et caractériser les <strong>déchets</strong> conditionnés.La procédure d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>vant assurer <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> non conditionnés aux critères physico-chimiques et radiologiques applicables, sedécline selon un schéma simi<strong>la</strong>ire. Elle n'y fait donc pas l’objet d’un développem<strong>en</strong>tséparé.Enfin, étant donné son caractère spécifique, <strong>la</strong> procédure d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tionsd’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s colis DC, est égalem<strong>en</strong>t décrite <strong>en</strong> annexe E. Etant donné le caractèreprovisoire <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non conditionnés (et partant l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> critères <strong>de</strong>durabilité), les <strong>en</strong>trepôts pour colis DNC ne sont pas soumis à l’obligation d’agrém<strong>en</strong>t.43/166
Chapitre quatreLa prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnésLes trois premiers chapitres, qui constitu<strong>en</strong>t <strong>la</strong> première partie <strong>de</strong> ce rapport, ont p<strong>la</strong>nté ledécor <strong>de</strong> <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong> leur <strong>gestion</strong>. Il est tempsmaint<strong>en</strong>ant d'<strong>en</strong>trer dans le vif du sujet, <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong>, ou, <strong>en</strong>termes plus directs, « ce qui se passe aujourd'hui pour les <strong>déchets</strong> d'aujourd'hui ». Lestrois chapitres qui suiv<strong>en</strong>t, et form<strong>en</strong>t <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième partie, nous l'expliqu<strong>en</strong>t.Le premier <strong>de</strong> ceux-ci décrit le processus m<strong>en</strong>ant à <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge, par l'ONDRAF,<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> chez leur producteur. Plus précisém<strong>en</strong>t, il sera question <strong>de</strong> <strong>la</strong>prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés, l'imm<strong>en</strong>se majorité <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong><strong>déchets</strong> ne disposant pas <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s techniques et industriels nécessaires autraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ceux-ci. La prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés sera, elle, traitée auchapitre six.Le processus débute par l'établissem<strong>en</strong>t, par le producteur et, le cas échéant, avecl'assistance <strong>de</strong> l'ONDRAF et/ou d'un organisme agréé, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'acceptation etd'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t, dite « Formu<strong>la</strong>ire S/L », qui repr<strong>en</strong>d, dans le détail, <strong>la</strong> <strong>de</strong>scriptiontechnique du lot <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> faisant l'objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.Est <strong>en</strong>suite décrite <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> avec les différ<strong>en</strong>tsaspects normatifs exposés au troisième chapitre. L'adéquation avec les Critèresd'acceptation et les agrém<strong>en</strong>ts applicables est ainsi garantie. La possibilité d'uneinspection physique préa<strong>la</strong>ble est évoquée, ainsi que <strong>la</strong> procédure suivie au cas où le lot<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> ne répond pas, du moins dans un premier temps, à toutes les conditionsnécessaires à sa prise <strong>en</strong> charge immédiate.Une fois satisfaites toutes les vérifications <strong>de</strong> conformité, il est procédé à l'établissem<strong>en</strong>t<strong>de</strong>s procès-verbaux d'acceptation et <strong>de</strong> transfert, qui act<strong>en</strong>t <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge du lot.L'ONDRAF fait alors appel à un transporteur qui procè<strong>de</strong> à l'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> surle site du producteur et les transfère vers le site du sous-traitant pour le traitem<strong>en</strong>tproprem<strong>en</strong>t dit – ce qui fera l'objet du chapitre suivant.1. Les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non conditionnésNous avons abordé au chapitre précé<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> déchet radioactif non conditionné,que nous avons défini comme un déchet “brut”, ni traité, ni immobilisé ni emballé <strong>de</strong>manière perman<strong>en</strong>te et durable. Comme tout déchet, il est le sous-produit d'une activitéexercée par son producteur. Lorsque cette activité met <strong>en</strong> jeu <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s, ceproducteur est obligé, par <strong>la</strong> loi, <strong>de</strong> s'adresser à l'ONDRAF pour le faire pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong>charge.A l'heure <strong>actuelle</strong>, le nombre <strong>de</strong> producteurs belges réguliers <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> estlégèrem<strong>en</strong>t supérieur à trois c<strong>en</strong>ts, effectif resté par ailleurs assez stable au long <strong>de</strong>svingt <strong>de</strong>rnières années. Ces producteurs se rang<strong>en</strong>t – <strong>de</strong> manière quelque peuadministrative – <strong>en</strong> trois grands groupes : les grands producteurs, c’est-à-dire les producteurs qui font très régulièrem<strong>en</strong>tpr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s quantités importantes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> et au rang <strong>de</strong>squels figur<strong>en</strong>tbi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du les c<strong>en</strong>trales électronucléaires et, par assimi<strong>la</strong>tion, l'Etat belge (voir, à cesujet, le début du chapitre huit); les petits producteurs conv<strong>en</strong>tionnés, principalem<strong>en</strong>t les hôpitaux et c<strong>en</strong>tres <strong>de</strong>recherche, producteurs réguliers, mais <strong>de</strong> quantités moins importantes; les petits producteurs non-conv<strong>en</strong>tionnés, à savoir les producteurs occasionnels,44/166
certains ne s'adressant à l'ONDRAF qu'à intervalles <strong>de</strong> plusieurs années.Corol<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t, les quantités faisant l'objet d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge sontpresque toujours très faibles, <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> quelques litres ou kilos.Quel que soit le groupe dans lequel ils se rang<strong>en</strong>t, ils ont presque tous <strong>en</strong> commun <strong>de</strong> nepas disposer <strong>de</strong>s infrastructures nécessaires au traitem<strong>en</strong>t et au conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>leurs <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Les raisons <strong>en</strong> sont autant techniques qu'économiques : <strong>la</strong>technologie, le savoir-faire, les exig<strong>en</strong>ces <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> sûreté et les investissem<strong>en</strong>tsque <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt l'exploitation d'instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> tels<strong>déchets</strong> sont, pour <strong>la</strong> quasi-totalité <strong>de</strong> ces producteurs, hors <strong>de</strong> proportion par rapportaux volumes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qu'ils génèr<strong>en</strong>t individuellem<strong>en</strong>t. La c<strong>en</strong>tralisation <strong>de</strong>sinfrastructures <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t représ<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> cette matière, <strong>la</strong> seulesolution techniquem<strong>en</strong>t et économiquem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>visageable. Comme on l'a vu au <strong>de</strong>uxièmechapitre, ce traitem<strong>en</strong>t c<strong>en</strong>tralisé constitue une <strong>de</strong>s activités majeures <strong>de</strong>BELGOPROCESS, <strong>la</strong> filiale industrielle <strong>de</strong> l'ONDRAF.En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> BELGOPROCESS, seules les c<strong>en</strong>trales <strong>de</strong> DOEL et TIHANGE dispos<strong>en</strong>td'instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Encore les c<strong>en</strong>tralesn'assur<strong>en</strong>t-elles directem<strong>en</strong>t par elles-mêmes que le traitem<strong>en</strong>t d'une partie <strong>de</strong> leurs<strong>déchets</strong> d'exploitation.2. La procédure d’acceptationComme l'impose l’article 13 (cf. Annexe B) <strong>de</strong>s Règles générales, l’ONDRAF doitprocé<strong>de</strong>r, lors <strong>de</strong> l’acceptation <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non conditionnés, à un contrôle <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>proposés. Dans ce cadre, il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> vérifier si les <strong>déchets</strong> sont conformes aux critèresd’acceptation qui lui sont applicables. Lors <strong>de</strong> l’acceptation, l’ONDRAF rédige un procèsverbal,dit d'acceptation, qui confirme officiellem<strong>en</strong>t cette conformité. L’acceptation offre àl’ONDRAF <strong>la</strong> possibilité d’accomplir ses tâches légales re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>et lui fournit les fonds nécessaires pour couvrir les frais <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong>. Enmots moins formels et plus résumés : Un producteur belge <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doit confier ses <strong>déchets</strong> à l'ONDRAF, l'ONDRAF doit les pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge, mais ne peut le faire que s'ils respect<strong>en</strong>t tous les Critères d'acceptation.Afin <strong>de</strong> pouvoir faire accepter et <strong>en</strong>lever ses <strong>déchets</strong> non conditionnés, le producteur doitcompléter un formu<strong>la</strong>ire standard <strong>de</strong> « Deman<strong>de</strong> d’acceptation et d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><strong>déchets</strong> non conditionnés (formu<strong>la</strong>ire S/L) » conformém<strong>en</strong>t aux modalités <strong>de</strong> l’ONDRAFet le transmettre à cet organisme.Ce formu<strong>la</strong>ire S/L 21 est une <strong>de</strong>s plus anci<strong>en</strong>nes “institutions” <strong>de</strong> l'ONDRAF. Depuis sonintroduction dans <strong>la</strong> première moitié <strong>de</strong>s années '80, qui est celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong>l'organisme, jusque 2007, ce sont plus <strong>de</strong> 21 000 “S/L” qui ont été reçus, traités etsoigneusem<strong>en</strong>t conservés. Leur <strong>en</strong>codage informatique a été assuré dès 1987.L'annexe F <strong>en</strong> montre un exemp<strong>la</strong>ire complété, fictif mais réaliste, tel qu'il se prés<strong>en</strong>telors <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception par l'ONDRAF.En outre, avant d’introduire sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le producteur doit vérifier si les <strong>déchets</strong> nonconditionnés ont bi<strong>en</strong> été caractérisés selon une méthodologie agréée par l’ONDRAF. Ladétermination <strong>de</strong>s caractéristiques radiologiques et chimiques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> relève <strong>en</strong> effet<strong>de</strong> sa responsabilité. Les métho<strong>de</strong>s utilisées par le producteur pour <strong>la</strong> caractérisationchimique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> sont décrites dans le dossier d’agrém<strong>en</strong>t du producteur.Les métho<strong>de</strong>s utilisées par le producteur pour <strong>la</strong> caractérisation radiologiquecompr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t un volet théorique et un volet pratique: Le volet théorique compr<strong>en</strong>d le développem<strong>en</strong>t d’une méthodologie <strong>de</strong> caractérisationqui décrit <strong>de</strong> quelle manière l’objectif final, <strong>la</strong> détermination du cont<strong>en</strong>u radiologique,21 La dénomination “S/L” provi<strong>en</strong>t historiquem<strong>en</strong>t du système <strong>de</strong> numérotation <strong>de</strong> ces formu<strong>la</strong>ires, quicomm<strong>en</strong>çait par “S” pour <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s et “L” pour <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s. Une équival<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>néer<strong>la</strong>ndais n'était pas possible, faute <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>tiation <strong>en</strong>tre les initiales <strong>de</strong> Vast et Vloeibaar.45/166
est atteint. Cette méthodologie décrit les calculs et mesures à effectuer. L’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologie, établie par le producteur pour chacun <strong>de</strong> ses types<strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, aboutit au volet pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> caractérisation qui <strong>en</strong>traîne l’i<strong>de</strong>ntification<strong>de</strong>s isotopes prés<strong>en</strong>ts dans les <strong>déchets</strong> et <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong> leur activité respective.L’ONDRAF surveille les métho<strong>de</strong>s utilisées par le producteur pour <strong>la</strong> caractérisation <strong>de</strong>ses <strong>déchets</strong> via le système d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces métho<strong>de</strong>s. De cette manière, il vérifie sile producteur est capable, à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> caractérisation qu’il a établies, <strong>de</strong>caractériser les <strong>déchets</strong> d’une manière concluante.Durant le processus d’acceptation, l’ONDRAF effectue les contrôles administratifs, <strong>de</strong>scontrôles physiques pouvant égalem<strong>en</strong>t être effectués sur p<strong>la</strong>ce sur les <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong>. Les contrôles administratifs consist<strong>en</strong>t à examiner le dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’acceptation et d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t qui a été transmis à l’ONDRAF par le producteur <strong>de</strong><strong>déchets</strong>. Le contrôle physique compr<strong>en</strong>d l’exécution d’une inspection sur p<strong>la</strong>ce, chez leproducteur <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> contrôler <strong>en</strong>tre autres le cont<strong>en</strong>u du ou <strong>de</strong>s colisprimaire(s) <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.La procédure <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge par formu<strong>la</strong>ire S/L est i<strong>de</strong>ntique pour tousles producteurs, et il <strong>en</strong> va <strong>de</strong> même du processus d'acceptation. Il y a toutefois lieu <strong>de</strong>m<strong>en</strong>tionner que, pour certains petits producteurs occasionnels, l'établissem<strong>en</strong>t complet etcorrect du formu<strong>la</strong>ire S/L 22 peut constituer une tâche difficile. C'est pourquoi l'ONDRAFmet systématiquem<strong>en</strong>t ces producteurs <strong>en</strong> contact avec <strong>de</strong>s organismes agréés, telsCONTROLATOM ou TECHNITEST, pour les assister dans leur démarche <strong>de</strong> prise <strong>en</strong>charge. Ces organismes dispos<strong>en</strong>t <strong>en</strong> outre <strong>de</strong> leur propres moy<strong>en</strong>s <strong>en</strong> matière <strong>de</strong>caractérisation radiologique. La prise <strong>en</strong> charge technique peut donc être précédée, si leproducteur le souhaite, d'une assistance administrative.3. La prise <strong>en</strong> chargeEn cas <strong>de</strong> résultat favorable <strong>de</strong>s contrôles décrits ci-avant, l’ONDRAF établit <strong>de</strong>uxprocès-verbaux, un procès-verbal d’acceptation (partie technique) et un procès-verbal <strong>de</strong>transfert (partie financière) et pr<strong>en</strong>d définitivem<strong>en</strong>t les <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> charge. Ces procèsverbauxsont signés par le producteur, puis par l'ONDRAF. En effet, l’acceptation <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> par l'organisme signifie que ce <strong>de</strong>rnier assume <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> ultérieure <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.Dès que les <strong>déchets</strong> ont été acceptés par l’ONDRAF, les données figurant dans ledossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge sont transmises à BELGOPROCESS <strong>en</strong> tant que<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> (formu<strong>la</strong>ire « DO2 ») et auxtransporteurs agréés (TRANSNUBEL ou TRANSRAD – formu<strong>la</strong>ire « DO3 »)) pourp<strong>la</strong>nification du transport, si le producteur (qui reçoit le formu<strong>la</strong>ire « DO1 ») ne l'assurepas par ses propres moy<strong>en</strong>s. L’ONDRAF <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t propriétaire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> au mom<strong>en</strong>t oùles <strong>déchets</strong> quitt<strong>en</strong>t le site du producteur.La procédure ci-<strong>de</strong>ssus s’applique à tous les <strong>déchets</strong> non conditionnés acceptables,étant <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du que :1. les <strong>déchets</strong> non conditionnés sont <strong>de</strong>stinés à être traités et conditionnés selon unprocédé éprouvé dans une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t existante agréée et que lescritères d’acceptation correspondants sont rédigés au préa<strong>la</strong>ble;2. les <strong>déchets</strong> non conditionnés convi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pour être traités et conditionnés selonun procédé éprouvé dans une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t n’existant pas <strong>en</strong>core etque les critères d’acceptation correspondants ont été rédigés;3. le cas 1. peut être atteint moy<strong>en</strong>nant l'application d’opérations élém<strong>en</strong>taires <strong>de</strong>prétraitem<strong>en</strong>t et/ou une adaptation mineure et temporaire au procédé, adaptationelle-même prévue dans le cadre <strong>de</strong>s agrém<strong>en</strong>ts et apportée à l'occasion d'unecampagne spécifique <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t.Lorsque cette <strong>de</strong>rnière action doit être effectuée, on parle <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> spéciaux (<strong>déchets</strong>22 notamm<strong>en</strong>t du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance que celui-ci exige <strong>de</strong>s codifications, Critères d'acceptation,agrém<strong>en</strong>ts et autres élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure.46/166
SPE – formu<strong>la</strong>ire « DO6 »), pour lesquels l’ONDRAF vérifie au cas par cas quelles sousopérationsspécifiques doiv<strong>en</strong>t être effectuées afin que ces <strong>déchets</strong> puiss<strong>en</strong>t finalem<strong>en</strong>têtre traités dans une instal<strong>la</strong>tion produisant <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés qui soi<strong>en</strong>tacceptables – au s<strong>en</strong>s strict <strong>de</strong>s Critères d'acceptation.47/166
Chapitre cinqLe transport et le traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>tCe cinquième chapitre prolonge naturellem<strong>en</strong>t le précé<strong>de</strong>nt et s'ouvre par le transport<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> non conditionnés. Ceux-ci sont à prés<strong>en</strong>t pris <strong>en</strong> charge parl'ONDRAF et transférés, pour traitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t, vers le site <strong>de</strong> sa filialeindustrielle, <strong>la</strong> société Belgoprocess.En tant que telle, celle-ci dispose <strong>de</strong>s infrastructures nécessaires pour traiter, c'est-à-direstabiliser physiquem<strong>en</strong>t et chimiquem<strong>en</strong>t, et conditionner, c'est-à-dire r<strong>en</strong>dre aptes àl'<strong>en</strong>treposage et au dépôt final, les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> que lui achemine l'ONDRAF et les<strong>déchets</strong> secondaires générés par ces opérations <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t.Une <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s principales instal<strong>la</strong>tions est fournie, ces instal<strong>la</strong>tions se différ<strong>en</strong>ciantpar <strong>la</strong> nature physique et le niveau radiologique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> qu'elles sont appelées àtraiter. Il est égalem<strong>en</strong>t fait une distinction <strong>en</strong>tre les filières <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t fonctionnant <strong>en</strong>continu, du fait d'un approvisionnem<strong>en</strong>t régulier <strong>en</strong> <strong>déchets</strong> primaires, et les lignestravail<strong>la</strong>nt par campagnes plus ou moins espacées, leur mise <strong>en</strong> service ne se justifiantqu'à l'issue <strong>de</strong> l'accumu<strong>la</strong>tion d'un volume minimal <strong>de</strong> « matières premières ».Belgoprocess, on le voit, c<strong>en</strong>tralise le traitem<strong>en</strong>t et le conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> pourlesquels leur producteur ne dispose pas <strong>de</strong> tels moy<strong>en</strong>s, cette c<strong>en</strong>tralisation étant gaged'une meilleure efficacité technique et économique. Pour une petite partie <strong>de</strong>sproducteurs toutefois, l'importance <strong>de</strong>s volumes générés, <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> savoir-fairetechnique et l'optimisation économique dict<strong>en</strong>t <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce chez eux <strong>de</strong> leurs propresinstal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t. Il s'agit principalem<strong>en</strong>t, mais nonexclusivem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales électronucléaires, dont le rôle <strong>de</strong> conditionneurs-tiersbelges est <strong>en</strong>suite évoqué.Enfin, au cas où le combustible nucléaire est considéré comme matière susceptible <strong>de</strong>retraitem<strong>en</strong>t (voir chapitre premier), ce retraitem<strong>en</strong>t est confié à l'étranger, <strong>la</strong> Belgique nedisposant plus <strong>de</strong>s infrastructures nécessaires aux opérations industrielles qu'il implique.C'est <strong>la</strong> société française AREVA NC, anci<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t COGEMA, qui <strong>en</strong> était chargée.Quoique l'ONDRAF ne sous-traite pas directem<strong>en</strong>t ces opérations à celle-ci – c'est <strong>la</strong>société belge SYNATOM, propriétaire <strong>de</strong>s combustibles, qui les commandite –, le rôled'AREVA NC et <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge par l'ONDRAF <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés qu'elleretourne à <strong>la</strong> Belgique justifi<strong>en</strong>t amplem<strong>en</strong>t que ce chapitre <strong>en</strong> fasse m<strong>en</strong>tion.1. Le transport <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>En Belgique, tout transport <strong>de</strong> substances radioactives est soumis à une autorisationpréa<strong>la</strong>ble. Cette autorisation, qui est délivrée par l’AFCN, procè<strong>de</strong> d’une règlem<strong>en</strong>tationinternationale stipu<strong>la</strong>nt que tout transport <strong>de</strong> substances radioactives, qu’elles soi<strong>en</strong>t <strong>de</strong>faible, moy<strong>en</strong>ne ou haute activité, doit toujours garantir <strong>la</strong> protection contre lerayonnem<strong>en</strong>t. Cette règlem<strong>en</strong>tation détermine égalem<strong>en</strong>t que les expéditeurs <strong>de</strong> cessubstances doiv<strong>en</strong>t sélectionner <strong>de</strong>s embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> transport qui permett<strong>en</strong>t unconfinem<strong>en</strong>t adéquat <strong>de</strong>s radioélém<strong>en</strong>ts. Ainsi, le transport <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activiténe requiert que quelques mesures <strong>de</strong> précaution spéciale alors que les embal<strong>la</strong>ges<strong>de</strong>stinés au transport <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne et, a fortiori, haute activité doiv<strong>en</strong>trépondre à <strong>de</strong>s critères stricts et précis. Un contrôle <strong>de</strong> contamination externe et <strong>de</strong> débit<strong>de</strong> dose est assuré, au départ, par l’expéditeur et par le transporteur et, à l’arrivée, par le<strong>de</strong>stinataire et à nouveau par le transporteur.48/166
figure 6.: Transport <strong>de</strong> cont<strong>en</strong>eurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> nonconditionnésL’ONDRAF est responsable <strong>de</strong> l’organisation pratique <strong>de</strong>s transports <strong>de</strong> <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> produits <strong>en</strong> Belgique. Le transport proprem<strong>en</strong>t dit est cep<strong>en</strong>dant sous-traité à<strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises spécialisées par le biais d’adjudications publiques. Ces <strong>en</strong>treprisesdispos<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s autorisations et du matériel requis. Les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> quidispos<strong>en</strong>t toutefois eux-mêmes <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong> transport nécessaires, comme parexemple le SCK·CEN, peuv<strong>en</strong>t cep<strong>en</strong>dant se charger du transport <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong> versBelgoprocess, après autorisation <strong>de</strong> l’AFCN.Aujourd'hui, le nombre <strong>de</strong> transports sur base annuelle se situe aux <strong>en</strong>virons <strong>de</strong> 250,dont 180 sont effectués par les soins <strong>de</strong> TRANSNUBEL et TRANSRAD, le sol<strong>de</strong> étantassuré par les producteurs disposant <strong>de</strong> leurs moy<strong>en</strong>s et autorisations propres.2. Les types <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>tLe traitem<strong>en</strong>t et le conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sont <strong>de</strong>s opérations qui ontpour but <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>trer <strong>la</strong> radioactivité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> confiner dans <strong>de</strong>s colis appropriés autransport et à l’<strong>en</strong>treposage. Belgoprocess traite et conditionne principalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible et moy<strong>en</strong>ne activité, sans préjudice <strong>de</strong> sa capacité à traiter <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>de</strong> haute activité. Pour ce faire, elle a amélioré les techniques existantes et <strong>en</strong> aégalem<strong>en</strong>t développé et mis <strong>en</strong> service <strong>de</strong> nouvelles, <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s besoins et <strong>en</strong>t<strong>en</strong>ant compte <strong>de</strong>s exig<strong>en</strong>ces <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> qualité imposées aux <strong>déchets</strong> conditionnés.Avec les procédés actuels et les instal<strong>la</strong>tions nouvelles ou rénovées, il est possibleaujourd’hui <strong>de</strong> traiter <strong>de</strong> façon routinière <strong>la</strong> production courante <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>. Belgoprocesscontinue toutefois à développer <strong>de</strong> nouveaux procédés pour certains lots <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, les<strong>déchets</strong> spéciaux par exemple.Le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> a un double but : d’une part, conc<strong>en</strong>trer autant que possible <strong>la</strong> radioactivité afin <strong>de</strong> limiter le volume <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, d’autre part, am<strong>en</strong>er les <strong>déchets</strong> dans un état physique et chimique adéquats afin <strong>de</strong>pouvoir les conditionner <strong>de</strong> façon sûre et durable.Le type <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t appliqué dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong>s caractéristiques physico-chimiques <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>, qui sont très variables, comme le premier chapitre nous l'a montré. Les <strong>déchets</strong>peuv<strong>en</strong>t être incinérés et réduits <strong>en</strong> c<strong>en</strong>dres, ils peuv<strong>en</strong>t être compactés ou découpés <strong>en</strong>morceaux ou <strong>en</strong>core subir un traitem<strong>en</strong>t séparant les substances radioactives <strong>de</strong>ssubstances non radioactives.Les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> combustibles soli<strong>de</strong>s sont incinérés à une température <strong>de</strong> 900 °Cet réduits <strong>en</strong> c<strong>en</strong>dres dans un incinérateur industriel. Les gaz et fumées résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong>combustion sont filtrés et contrôlés avant d’être rejetés dans l’atmosphère. La réduction<strong>en</strong> volume obt<strong>en</strong>ue est <strong>de</strong> l'ordre d'un facteur 50.Les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> soli<strong>de</strong>s non combustibles qui sont compactables sont recueillisdans <strong>de</strong>s fûts <strong>de</strong> 220 l <strong>en</strong> acier et compactés, sous une pression <strong>de</strong> 2 000 t, <strong>en</strong> galettes49/166
d’<strong>en</strong>viron 25 cm d’épaisseur, ce qui correspond à un facteur <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> volumemoy<strong>en</strong> <strong>de</strong> 3.Les <strong>déchets</strong> non compactables sont découpés <strong>en</strong> morceaux.Les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> liqui<strong>de</strong>s peuv<strong>en</strong>t être traités <strong>de</strong> trois manières :1. Le traitem<strong>en</strong>t physico-chimique <strong>de</strong>s eaux consiste <strong>en</strong> une flocu<strong>la</strong>tion-décantationprovoquant <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> flocons auxquels les substances radioactives sefix<strong>en</strong>t. Ces flocons décant<strong>en</strong>t et form<strong>en</strong>t une couche <strong>de</strong> boue qui est filtrée etséchée, pour être <strong>en</strong>suite traitée comme déchet soli<strong>de</strong>. L’eau purifiée estcontrôlée avant d’être rejetée dans un cours d'eau proche du site <strong>de</strong>Belgoprocess.2. Les petites quantités <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>, notamm<strong>en</strong>t les efflu<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire collectés<strong>en</strong> bouteilles, sont injectées dans <strong>la</strong> chambre <strong>de</strong> post-combustion <strong>de</strong>l’incinérateur à <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s. Cette voie <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t est tout particulièrem<strong>en</strong>td'application pour les liqui<strong>de</strong>s organiques, tels les huiles et solvants.3. Enfin, s'il y a lieu d'appliquer un traitem<strong>en</strong>t thermique, les <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>saqueux sont soumis à l'évaporation, ce qui <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre un résidu sous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong>boue radioactive ainsi qu'un con<strong>de</strong>nsat <strong>de</strong> vapeur d’eau qui peut être rejetéaprès contrôle.Les caractéristiques physico-chimiques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> détermin<strong>en</strong>t donc lesprocédés <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t appliqués. Le niveau d’activité détermine à son tour les moy<strong>en</strong>squi doiv<strong>en</strong>t être appliqués pour limiter l'irradiation et confiner les radioélém<strong>en</strong>ts, ainsi quele type d’équipem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> protection individuelle qui doit être utilisé.Le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants ne requiert <strong>en</strong> général aucun blindageparticulier. Les opérateurs port<strong>en</strong>t toutefois <strong>de</strong>s vêtem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong>s gants <strong>de</strong> protection,équipem<strong>en</strong>ts c<strong>la</strong>ssiques <strong>en</strong> zone contrôlée. S’il existe un risque que les opérateurs soi<strong>en</strong>tmis directem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> contact avec <strong>de</strong>s substances radioactives, ils port<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t unmasque avec filtre. La prév<strong>en</strong>tion du risque <strong>de</strong> contamination est ici prépondérante.Le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants se déroule dans une cellule fermée etblindée. Les opérateurs, qui sont protégés par <strong>de</strong>s murs <strong>en</strong> béton et <strong>de</strong>s f<strong>en</strong>êtres <strong>en</strong>verre au plomb, effectu<strong>en</strong>t toutes les opérations à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> télémanipu<strong>la</strong>teurs etd'appareils commandés à distance. La prév<strong>en</strong>tion du risque d'irradiation se fait ici plusimportante.Le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> hautem<strong>en</strong>t irradiants, <strong>en</strong>fin, requiert le même type <strong>de</strong> mesures<strong>de</strong> précaution que le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants. Les blindagesdoiv<strong>en</strong>t toutefois être adaptés <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce – épaisseurs plus importantes oumatériaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité supérieure.Parmi ces matériaux hautem<strong>en</strong>t irradiants figur<strong>en</strong>t les combustibles nucléaires usés quipeuv<strong>en</strong>t, le cas échéant, faire l'objet d'un retraitem<strong>en</strong>t. Quoique ce retraitem<strong>en</strong>t ne figureplus parmi les activités nucléaires sur le territoire belge <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> l'usineEUROCHEMIC (cf. chapitre premier), et que le retraitem<strong>en</strong>t à l'étranger <strong>de</strong>s combustiblesnationaux soit <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t soumis à un moratoire, nous le décrivons cep<strong>en</strong>dantbrièvem<strong>en</strong>t ici :Ce retraitem<strong>en</strong>t est effectué par AREVA NC 23 (anci<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t COGEMA) dans sesinstal<strong>la</strong>tions du C<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> La Hague (Usine UP3), France. Il intervi<strong>en</strong>t au plus tôt troisannées après le déchargem<strong>en</strong>t du combustible hors du réacteur. Le procédé PUREX mis<strong>en</strong> oeuvre consiste <strong>en</strong> <strong>la</strong> dissolution du combustible par l'aci<strong>de</strong> nitrique, suivie <strong>de</strong> <strong>la</strong>séparation successive, par extraction liqui<strong>de</strong>-liqui<strong>de</strong> au tributylphosphate (TBP), <strong>de</strong>sproduits <strong>de</strong> fission (3 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> masse), du plutonium (1 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> masse) et <strong>de</strong> l'uranium (96% <strong>de</strong> <strong>la</strong> masse). Les solutions cont<strong>en</strong>ant l'uranium et le plutonium font l'objet <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>stinés à recycler ceux-ci dans <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong> nouveaux combustiblesnucléaires. La solution nitrique <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> fission, cont<strong>en</strong>ant égalem<strong>en</strong>t les actini<strong>de</strong>smineurs, est conc<strong>en</strong>trée par évaporation et constitue le principal déchet hautem<strong>en</strong>t23 Plus précisém<strong>en</strong>t, AREVA NC intervi<strong>en</strong>t pour le retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s combustibles belges prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>trales électronucléaires. Le combustible <strong>de</strong> réacteurs <strong>de</strong> recherche, tel le BR2 du SCK·CEN, estégalem<strong>en</strong>t retraité au c<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> DOUNREAY, Royaume-Uni.50/166
irradiant du procédé.3. Le conditionnem<strong>en</strong>tLe conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s résidus du traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doit permettred’obt<strong>en</strong>ir un matériau compact et non dispersable, facilitant les opérations ultérieures <strong>de</strong>transport, <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> <strong>en</strong>treposage, et, plus tard <strong>en</strong>core, <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt définitif. Leconditionnem<strong>en</strong>t se déroule généralem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> immobilisant les <strong>déchets</strong> dans une matricecoulée dans un embal<strong>la</strong>ge métallique cylindrique résistant à <strong>la</strong> corrosion. C'est <strong>la</strong> matriced'immobilisation qui remplit le rôle majeur <strong>de</strong> barrière contre <strong>la</strong> dispersion <strong>de</strong>sradionucléi<strong>de</strong>s. Cette matrice assure par conséqu<strong>en</strong>t le double rôle <strong>de</strong> prév<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong>contamination et <strong>de</strong> l'irradiation.Le déchet conditionné constitue un bloc monolithique stable et inerte, insoluble dansl’eau. Une fois l’embal<strong>la</strong>ge fermé, il reçoit une fiche d’i<strong>de</strong>ntification m<strong>en</strong>tionnant l’origine,le cont<strong>en</strong>u radioactif ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>confinés.Le niveau d’activité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> détermine non seulem<strong>en</strong>t les mesures <strong>de</strong> protection àpr<strong>en</strong>dre, mais influ<strong>en</strong>ce aussi le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t.Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible et moy<strong>en</strong>ne activité ainsi que certains <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s <strong>de</strong> hauteactivité sont cim<strong>en</strong>tés ou bitumés, selon leurs caractéristiques physico-chimiques, dans<strong>de</strong>s fûts <strong>en</strong> acier. Les fûts standard <strong>de</strong> l’ONDRAF, <strong>en</strong> acier galvanisé, ont une capacité <strong>de</strong>400 l, une hauteur <strong>de</strong> 1,07 m et un diamètre <strong>de</strong> 0,77 m. Lorsqu’ils sont remplis, ils pès<strong>en</strong>t<strong>en</strong> général <strong>en</strong>tre 900 et 1 000 kg. On utilise parfois <strong>de</strong>s fûts <strong>de</strong> 220 l.Les <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> haute activité émettant une quantité importante <strong>de</strong> chaleur sontvitrifiés. Ce<strong>la</strong> signifie qu’ils sont mé<strong>la</strong>ngés avec un verre spécial <strong>en</strong> fusion (verre auborosilicate, simi<strong>la</strong>ire au Pyrex ® ) et coulés <strong>en</strong>suite dans un embal<strong>la</strong>ge cylindrique <strong>en</strong> acierinoxydable dans lequel ils se solidifi<strong>en</strong>t. C’est dans <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> ce produit homogèneque les substances radioactives sont immobilisées.Les cont<strong>en</strong>eurs <strong>de</strong>stinés aux <strong>déchets</strong> issus du retraitem<strong>en</strong>t, par les soins d'AREVA NC,<strong>de</strong>s combustibles nucléaires belges usés ont une capacité <strong>de</strong> 180 l, une hauteur <strong>de</strong> 1,34m et un diamètre <strong>de</strong> 0,43 m. Lorsqu’ils sont remplis, ils pès<strong>en</strong>t <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne 450 kg etémett<strong>en</strong>t une quantité <strong>de</strong> chaleur comparable à celle émise par un radiateur électriqued’une puissance d’<strong>en</strong>viron 2 000 watts. Chaque cont<strong>en</strong>eur correspond au retraitem<strong>en</strong>td'<strong>en</strong>viron 1,5 tonne <strong>de</strong> combustible nucléaire usé. Les embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>retraitem<strong>en</strong>t d'EUROCHEMIC qui ont été vitrifiés dans l’instal<strong>la</strong>tion PAMELA ont unecapacité <strong>de</strong> 60 ou 150 l et émett<strong>en</strong>t initialem<strong>en</strong>t une quantité <strong>de</strong> chaleur comparable àcelle d’une ampoule ordinaire.AREVA NC produit égalem<strong>en</strong>t, dans le cadre <strong>de</strong> ses activités <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>scombustibles, <strong>de</strong>s cont<strong>en</strong>eurs du même modèle (et donc <strong>de</strong> mêmes dim<strong>en</strong>sions) quepour les verres nucléaires, et dans lesquels sont compactés les élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> structure<strong>de</strong>s combustibles (« gaines et embouts ») et <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> technologiques.4. Les instal<strong>la</strong>tions disponibles4.1 BelgoprocessBelgoprocess est <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t capable <strong>de</strong> traiter et conditionner <strong>la</strong> majeure partie <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qui exist<strong>en</strong>t et sont produits <strong>en</strong> Belgique. Ce<strong>la</strong> s’applique aussi bi<strong>en</strong>aux <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s que liqui<strong>de</strong>s, et aussi bi<strong>en</strong> à ceux <strong>de</strong> faible que ceux <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne ouhaute activité. Comme dit plus haut, les <strong>déchets</strong> prov<strong>en</strong>ant du retraitem<strong>en</strong>t par AREVANC <strong>de</strong>s combustibles usés déchargés <strong>de</strong>s réacteurs nucléaires belges sont traités etconditionnés dans les instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hague, situées près <strong>de</strong> Cherbourg (France).L’instal<strong>la</strong>tion CILVA, sur le site 1 <strong>de</strong> Belgoprocess, est <strong>la</strong> principale infrastructure <strong>de</strong>stinéeau traitem<strong>en</strong>t et au conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s et liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> faible activité. Laconstruction <strong>de</strong> cette instal<strong>la</strong>tion mo<strong>de</strong>rne a débuté <strong>en</strong> 1992 et compr<strong>en</strong>d cinq unités51/166
principales.Dans l’unité <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong> réception et à l’<strong>en</strong>treposage préa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>bruts, les <strong>déchets</strong> sont pesés et les niveaux <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> contaminationextérieure sont contrôlés. Les <strong>déchets</strong> sont <strong>en</strong>suite <strong>en</strong>treposés p<strong>en</strong>dant <strong>de</strong>ux à troissemaines jusqu’à ce que <strong>la</strong> quantité atteinte soit suffisamm<strong>en</strong>t gran<strong>de</strong> pour <strong>en</strong>tamer unecampagne <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t. Dans l’unité <strong>de</strong>stinée au traitem<strong>en</strong>t préparatoire, les <strong>déchets</strong>sont triés et <strong>en</strong>voyés vers les différ<strong>en</strong>tes instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t.Dans l’unité <strong>de</strong> supercompaction, qui est <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t automatisée, les <strong>déchets</strong>compressibles, p<strong>la</strong>cés dans <strong>de</strong>s fûts <strong>en</strong> acier <strong>de</strong> 220 l, sont compactés, sous unepression <strong>de</strong> 2 000 t, <strong>en</strong> galettes dont l'épaisseur finale dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> <strong>la</strong> compressibilité <strong>de</strong>smatériaux cont<strong>en</strong>us dans les fûts. La moy<strong>en</strong>ne est d’<strong>en</strong>viron 25 cm d’épaisseur. Enfonction <strong>de</strong> leur masse, <strong>de</strong> leur épaisseur et <strong>de</strong> leur niveau <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t, ces galettessont <strong>en</strong>suite empilées dans <strong>de</strong>s fûts standard <strong>de</strong> 400 l. L’unité <strong>de</strong> supercompaction a unecapacité <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 8 000 fûts (<strong>de</strong> 220 l) par an.figure 7.: le supercompacteurDans l’unité d’incinération sont incinérées chaque année <strong>en</strong>viron 250 tonnes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>soli<strong>de</strong>s et 75 m³ <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s aqueux ou organiques. Les gaz <strong>de</strong> combustion sontfiltrés et purifiés par <strong>la</strong>vage, puis rejetés dans l’atmosphère après contrôle. Les c<strong>en</strong>dressont collectées <strong>en</strong> fûts <strong>de</strong> 220 l égalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>stinés à <strong>la</strong> supercompaction. Quant auxefflu<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> <strong>la</strong>vage <strong>de</strong>s gaz, ils sont dirigés vers le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s eaux du site 2 (cf.infra).L'instal<strong>la</strong>tion CILVA dispose égalem<strong>en</strong>t d'une unité <strong>de</strong> découpage pour <strong>déchets</strong> noncompactables.Dans l’unité <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t, les <strong>déchets</strong> traités – principalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s galettes issuesdu supercompacteur – sont p<strong>la</strong>cés dans <strong>de</strong>s fûts standard <strong>de</strong> 400 l et cim<strong>en</strong>tés. Onobti<strong>en</strong>t un ainsi un produit fini compact soli<strong>de</strong> et chimiquem<strong>en</strong>t stable. Cette unité peutproduire jusque 2 000 fûts <strong>de</strong> ce type par an.52/166
figure 8.: coupe d'un fût <strong>de</strong> 400 LL’instal<strong>la</strong>tion PAMELA (G131X), égalem<strong>en</strong>t située sur le site 1, <strong>en</strong> service <strong>de</strong>puis 1985, aservi jusqu’<strong>en</strong> 1991 à <strong>la</strong> vitrification <strong>de</strong> 860 m³ <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong>haute activité prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> l'usine EUROCHEMIC. Par <strong>la</strong> suite, PAMELA a conditionné,<strong>en</strong> matrice <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t, les <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité <strong>de</strong> sa propre exploitationet du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> son unité <strong>de</strong> vitrification, ainsi que <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s <strong>de</strong>moy<strong>en</strong>ne et haute activité prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> <strong>la</strong> rénovation du réacteur BR2 du SCK·CEN et dudéc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t du réacteur BR3. L’instal<strong>la</strong>tion PAMELA a <strong>en</strong>suite été adaptée pour letraitem<strong>en</strong>t et le conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s émetteurs alpha, <strong>de</strong><strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne ou haute activité et d’autres <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s spéciaux,comme les boîtes à gants contaminées par <strong>de</strong>s particules alpha.figure 9.: vue intérieure <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule blindée <strong>de</strong>PAMELAL'unité principale <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> PAMELA est constituée d'une cellule blindée munie <strong>de</strong>télémanipu<strong>la</strong>teurs au moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong>squels s'effectu<strong>en</strong>t toutes les opérations sur les <strong>déchets</strong>.Ces opérations sont le découpage pour les boîtes à gants m<strong>en</strong>tionnées ci-<strong>de</strong>ssus, <strong>la</strong>supercompaction et l'<strong>en</strong>robage dans le cim<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> compactés.Toujours sur le site 1, l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> tri A3X (G110X), <strong>en</strong> service <strong>de</strong>puis mi-2005, est53/166
<strong>de</strong>stinée au tri, selon leur nature physico-chimique, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> contaminés par <strong>de</strong>sparticules alpha, <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> leur traitem<strong>en</strong>t ultérieur dans PAMELA.L’instal<strong>la</strong>tion HRA/So<strong>la</strong>rium (G280X), construite sur le site 2 <strong>de</strong> Belgoprocess et mise <strong>en</strong>service fin 2005, est <strong>de</strong>stinée au traitem<strong>en</strong>t et au conditionnem<strong>en</strong>t, par compaction etcim<strong>en</strong>tation, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> historiques <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité ainsi que certains <strong>déchets</strong>radifères. Ces <strong>déchets</strong> sont pour leur plus gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> anci<strong>en</strong>s stockés sur lesite <strong>de</strong> l'ex-départem<strong>en</strong>t Waste du SCK·CEN (voir au chapitre premier : « les activitéshistoriques »).figure 10: fermeture <strong>de</strong> colis dans l'instal<strong>la</strong>tion HRA/So<strong>la</strong>riumCitons <strong>en</strong>core l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> pyrolyse (site 2), <strong>en</strong> service <strong>de</strong>puis 1999, <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong><strong>de</strong>struction thermique <strong>de</strong>s liqui<strong>de</strong>s organiques contaminés par <strong>de</strong>s émetteurs alphad’Eurochemic. Les résidus soli<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ce traitem<strong>en</strong>t sont <strong>en</strong>suite cim<strong>en</strong>tés.Chacun <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> Belgoprocess dispose d'une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s efflu<strong>en</strong>tsliqui<strong>de</strong>s aqueux :L’instal<strong>la</strong>tion BRE (site 1), <strong>en</strong> service <strong>de</strong>puis 1980, conc<strong>en</strong>tre par évaporation lesefflu<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> basse ou moy<strong>en</strong>ne activité. Les con<strong>de</strong>nsats sont <strong>en</strong>suite traités comme<strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> (très) basse activité. Les conc<strong>en</strong>trats sont, eux, dirigés versEurobitum (ci-<strong>de</strong>ssous).Le site 2 dispose d'une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s eaux par flocu<strong>la</strong>tion/décantation<strong>de</strong>stinée aux efflu<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> basse et très basse activité.Correspondant aux instal<strong>la</strong>tions décrites ci-<strong>de</strong>ssus, il existe <strong>de</strong>ux instal<strong>la</strong>tions qui serv<strong>en</strong>tau traitem<strong>en</strong>t et au conditionnem<strong>en</strong>t dans du bitume <strong>de</strong> boues et conc<strong>en</strong>tratsd’évaporation prov<strong>en</strong>ant du traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s efflu<strong>en</strong>ts contaminés. L’instal<strong>la</strong>tion Mummie(site 2) est <strong>la</strong> plus anci<strong>en</strong>ne puisqu’elle date <strong>de</strong> <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années soixante. Elleconditionne les boues <strong>de</strong> basse activité produites par le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s eaux sur ce site.L’instal<strong>la</strong>tion Eurobitum (site 1) est <strong>en</strong> service <strong>de</strong>puis 1978. Cette instal<strong>la</strong>tion assure letraitem<strong>en</strong>t (précipitation et neutralisation) et le conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s conc<strong>en</strong>trats <strong>de</strong>moy<strong>en</strong>ne activité.54/166
figure 11.: Remplissage et fermeture <strong>de</strong> colis dans EUROBITUMLa baisse perman<strong>en</strong>te du volume <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> produits est sans aucun doutetrès positive pour qui concerne <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Elle n’esttoutefois pas sans conséqu<strong>en</strong>ces pour <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité économique <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t, dont les coûts fixes sont très élevés.4.2 Les c<strong>en</strong>trales <strong>de</strong> Doel et <strong>de</strong> TihangeLes <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> production courante <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales nucléaires d’Electrabeldont le débit <strong>de</strong> dose est supérieur à 2 mSv/h sont traités et conditionnés sur les sitesmême <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales, dans <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions spécialem<strong>en</strong>t conçues à cette fin. Lesprocédés et instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t mis <strong>en</strong>oeuvre, se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t comme suit :C<strong>en</strong>trale nucléaire <strong>de</strong> Tihange : Les efflu<strong>en</strong>ts et autres boues <strong>de</strong> procédés sont collectés dans un évaporateurthermique. Les conc<strong>en</strong>trats qui <strong>en</strong> résult<strong>en</strong>t subiss<strong>en</strong>t un traitem<strong>en</strong>t chimique approprié(neutralisation). Ils sont <strong>en</strong>suite mé<strong>la</strong>ngés <strong>de</strong> façon homogène <strong>en</strong> fût métallique dansune matrice hydraulique à base <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t. A l’issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise, l’<strong>en</strong>robé ainsi constituése prés<strong>en</strong>te sous <strong>la</strong> forme d’un bloc soli<strong>de</strong> et homogène. Les résines échangeuses d’ions sont mé<strong>la</strong>ngées <strong>de</strong> façon homogène <strong>en</strong> fût métalliquedans une matrice polymère. Après refroidissem<strong>en</strong>t, l’<strong>en</strong>robé ainsi constitué se prés<strong>en</strong>tesous <strong>la</strong> forme d’un bloc homogène, soli<strong>de</strong> et compact. Les filtres d’eau et les <strong>déchets</strong> métalliques divers sont bloqués, <strong>en</strong> fût métallique blindé,équipé d’un dispositif <strong>de</strong> c<strong>en</strong>trage ou d’un panier interne perforé, dans un mortier inactifà base <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t. A l’issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise, l’<strong>en</strong>robé ainsi constitué forme un blochétérogène, soli<strong>de</strong> et compact.C<strong>en</strong>trale nucléaire <strong>de</strong> Doel : Les efflu<strong>en</strong>ts et autres boues <strong>de</strong> procédés sont égalem<strong>en</strong>t collectés dans unévaporateur thermique. Les conc<strong>en</strong>trats qui <strong>en</strong> résult<strong>en</strong>t subiss<strong>en</strong>t un traitem<strong>en</strong>tchimique approprié (neutralisation). Ils sont <strong>en</strong>suite mé<strong>la</strong>ngés <strong>de</strong> façon homogène(dans un mé<strong>la</strong>ngeur) dans une matrice hydraulique à base <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t. Le mé<strong>la</strong>nge estversé dans un fût métallique. A l’issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise, l’<strong>en</strong>robé ainsi constitué forme un bloc55/166
homogène, soli<strong>de</strong> et compact. Notons que le fût métallique peut év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>tcont<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s filtres ou <strong>déchets</strong> métalliques divers. Dans ce cas <strong>de</strong> figure, le mé<strong>la</strong>ngehomogène à base <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>trats et <strong>de</strong> béton est versé sur les <strong>déchets</strong> divers. A l’issue<strong>de</strong> <strong>la</strong> prise, l’<strong>en</strong>robé ainsi constitué forme un bloc hétérogène, soli<strong>de</strong> et compact. Les résines échangeuses d’ions sont mé<strong>la</strong>ngées <strong>de</strong> façon homogène (dans unmé<strong>la</strong>ngeur) dans une matrice hydraulique à base <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t. Le mé<strong>la</strong>nge est versédans un fût métallique. A l’issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise, l’<strong>en</strong>robé ainsi constitué se prés<strong>en</strong>te sous <strong>la</strong>forme d’un bloc homogène, soli<strong>de</strong> et compact. Les filtres d’eau et les <strong>déchets</strong> métalliques divers sont bloqués, <strong>en</strong> fût métallique blindé,équipé d’un dispositif <strong>de</strong> c<strong>en</strong>trage ou d’un panier interne perforé, dans un mortier inactifà base <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t hématite. A l’issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise, l’<strong>en</strong>robé ainsi constitué forme un blochétérogène, soli<strong>de</strong> et compact.figure 12.: La c<strong>en</strong>trale nucléaire <strong>de</strong> Doel56/166
Chapitre sixLa prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnésQue les <strong>déchets</strong> ai<strong>en</strong>t été traités par Belgoprocess pour le compte <strong>de</strong> l'ONDRAF, par leurproducteur, directem<strong>en</strong>t, ou <strong>en</strong>core par un tiers, les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>tmaint<strong>en</strong>ant sous forme dite conditionnée, c'est-à-dire aptes à l'<strong>en</strong>treposage et au dépôtfinal. A leur tour, ils doiv<strong>en</strong>t faire l'objet d'une prise <strong>en</strong> charge par l'organisme, à l'issued'une procédure formelle d'acceptation. Ce sixième chapitre décrit cette procédure et, <strong>de</strong>ce fait, prés<strong>en</strong>te <strong>de</strong> nombreuses similitu<strong>de</strong>s avec le chapitre quatre, consacré à <strong>la</strong> prise<strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés.Pour un lot <strong>de</strong> colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, généralem<strong>en</strong>t issu d'une seule et même campagne <strong>de</strong>production, le producteur/conditionneur adresse à l'ONDRAF un dossier dit « <strong>de</strong>conformité » assorti d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge et repr<strong>en</strong>ant, outre lescaractéristiques détaillées <strong>de</strong> chaque colis, tous les paramètres techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong>campagne <strong>de</strong> production.L'ONDRAF confronte l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s informations cont<strong>en</strong>ues dans le dossier <strong>de</strong>conformité avec, d'une part, les Critères d'acceptation ad hoc et, d'autre part, lesagrém<strong>en</strong>ts afférant à l'instal<strong>la</strong>tion et au procédé <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t, aux embal<strong>la</strong>gesutilisés et aux méthodologies <strong>de</strong> caractérisation radiologique et physico-chimique. Labonne fin <strong>de</strong> cet exam<strong>en</strong> débouche <strong>en</strong>suite, comme pour les <strong>déchets</strong> non conditionnés,sur l'établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s procès-verbaux d'acceptation et <strong>de</strong> transfert. De manièresystématique, un contrôle physique <strong>de</strong>s colis chez le producteur est égalem<strong>en</strong>t opérépar un ag<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'ONDRAF, préa<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t à l'établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces procès-verbaux.Ces opérations administratives terminées, un transporteur procè<strong>de</strong> à l'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>scolis conditionnés chez le producteur et opère le transfert vers le site <strong>de</strong> Belgoprocessqui agit ici, toujours pour le compte <strong>de</strong> l'ONDRAF, comme exploitant <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>tsd'<strong>en</strong>treposage temporaire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés. Avant <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> <strong>en</strong>treposageproprem<strong>en</strong>t dite, un nouveau contrôle <strong>de</strong> réception est effectué sur chaque colis.Ceci constitue le modus operandi actuel. L'organisme, toutefois, est confronté àl'exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> productions anci<strong>en</strong>nes, prés<strong>en</strong>tes sur les sites <strong>de</strong> BELGOPROCESS<strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s dates antérieures à, ou contemporaines <strong>de</strong>, sa fondation. Outrel'établissem<strong>en</strong>t a posteriori <strong>de</strong>s dossiers les concernant, ces colis font l'objet d'uncontrôle physique individuel <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> leur réincorporation dans le cycle d'acceptation.La mise <strong>en</strong> évi<strong>de</strong>nce, pour certains d'<strong>en</strong>tre eux, <strong>de</strong> dégradations dues à <strong>de</strong>s causesdiverses, implique <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> oeuvre <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> remédiation.Ceci clôt le cycle actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> et, par là-même, <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxièmepartie <strong>de</strong> ce docum<strong>en</strong>t. Nous retrouverons l'<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés dans<strong>la</strong> quatrième et <strong>de</strong>rnière partie, qui traite <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme, au chapitre neuf.1. Les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnésLa notion <strong>de</strong> déchet conditionné (DC) nous est, à ce sta<strong>de</strong>, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue familière : les<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> départ ont été traités physiquem<strong>en</strong>t et/ou chimiquem<strong>en</strong>t, leurvolume a été, dans toute <strong>la</strong> mesure du possible, réduit, les résidus <strong>de</strong>s traitem<strong>en</strong>ts ontété, <strong>en</strong> même temps que les radionucléi<strong>de</strong>s qui les accompagn<strong>en</strong>t, immobilisés dans unematrice qui empêche leur dispersion, et l'<strong>en</strong>semble, <strong>en</strong>fermé dans un embal<strong>la</strong>ge <strong>en</strong>permettant <strong>la</strong> manut<strong>en</strong>tion <strong>en</strong> vue <strong>de</strong>s opérations ultérieures.Les producteurs <strong>de</strong> DC ou conditionneurs, à l'inverse <strong>de</strong> ce qui préva<strong>la</strong>it dans les cas <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> non conditionnés ou DNC, sont, on l'a vu égalem<strong>en</strong>t, nettem<strong>en</strong>t moins nombreux:57/166
BELGOPROCESS, c<strong>en</strong>tralisatrice du traitem<strong>en</strong>t pour tous les <strong>déchets</strong> que ne peuv<strong>en</strong>ttraiter eux-mêmes ceux qui les produis<strong>en</strong>t, les c<strong>en</strong>trales <strong>de</strong> DOEL et TIHANGE, pour <strong>la</strong> partie <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong> d'exploitationqu'elles trait<strong>en</strong>t et conditionn<strong>en</strong>t, directem<strong>en</strong>t, sur leurs sites respectifs, AREVA NC, pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne et haute activité résultant du retraitem<strong>en</strong>t<strong>de</strong>s combustibles usés <strong>de</strong> ces c<strong>en</strong>trales, avant que ce retraitem<strong>en</strong>t ne fût soumis à unmoratoire, l'EUROCHEMIC, aujourd'hui disparue, pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne et haute activité<strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t « historique » sur le territoire belge, et l'ex-Waste du SCK·CEN pourd'autres <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> basse et moy<strong>en</strong>ne activité, <strong>déchets</strong> dont <strong>la</strong> responsabilitéfinancière a été reprise par l'Etat fédéral. Ce <strong>de</strong>rnier est <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t propriétaire <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> l'EUROCHEMIC, tandis que <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> l'ex-Waste échoità l'ONDRAF, très marginalem<strong>en</strong>t, le C<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> DOUNREAY au Royaume-Uni (retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>certains combustibles du réacteur BR2, les autres combustibles <strong>de</strong> ce réacteur étantretraités par AREVA NC), ainsi que l'armée belge pour certains composants <strong>de</strong>matériel militaire déc<strong>la</strong>ssé.A l'instar <strong>de</strong> ce qui vaut pour les <strong>déchets</strong> non conditionnés, le système <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés se veut homogène et cohér<strong>en</strong>t. Tout colis <strong>de</strong> DC, sansexception, y est soumis.Un grand nombre <strong>de</strong> colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, toutefois, fur<strong>en</strong>t conditionnés dans les annéesprécédant <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce du système d'acceptation actuel. Ce fait, déjà relevé autroisième chapitre (cf. <strong>la</strong> section consacrée aux Critères d'acceptation), impose <strong>de</strong>soumettre a posteriori les productions passées à <strong>la</strong> procédure d'acceptation.La préoccupation principale pour l'ONDRAF est d'absorber progressivem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> lesacceptant selon le système actuel, les productions antérieures à celui-ci afin <strong>de</strong> garantirl'homogénéité qui doit gui<strong>de</strong>r le système.Mais comm<strong>en</strong>çons par l'acceptation <strong>de</strong>s productions courantes.2. L'acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnésConformém<strong>en</strong>t à l’article 13 <strong>de</strong>s Règles générales, l’ONDRAF doit procé<strong>de</strong>r, lors <strong>de</strong>l'acceptation <strong>de</strong>s colis primaires 24 , à un contrôle <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> proposés et doit vérifier si lecolis primaire est bi<strong>en</strong> conforme aux critères d’acceptation applicables au mom<strong>en</strong>t où lecolis a été produit. Lors <strong>de</strong> l’acceptation, l’ONDRAF rédige un procès-verbal qui confirmeofficiellem<strong>en</strong>t cette conformité. Le processus d'acceptation offre à l’ONDRAF <strong>la</strong> possibilitéd’accomplir ses tâches légales <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à moy<strong>en</strong> et long termes <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> et luifournit les fonds nécessaires pour couvrir les frais <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong>.Durant le processus d’acceptation, l’ONDRAF effectue <strong>de</strong>s contrôles <strong>de</strong> conformitéphysiques et administratifs sur les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Les contrôles administratifsconsist<strong>en</strong>t à examiner le dossier <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production rédigé par leproducteur. Les contrôles physiques compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong> divers paramètrestechniques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés. Rappellons que traitem<strong>en</strong>t etconditionnem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t avoir été effectués dans une instal<strong>la</strong>tion préa<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t agrééepar l’ONDRAF.La procédure d’acceptation est décrite ci-<strong>de</strong>ssous :1. Avant toute campagne <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés, le producteur doitvérifier si l’instal<strong>la</strong>tion et le procédé qu’il souhaite utiliser pour le traitem<strong>en</strong>t et leconditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, ainsi que les méthodologies qu’il appliquera pour <strong>la</strong>caractérisation <strong>de</strong> ses <strong>déchets</strong>, sont dûm<strong>en</strong>t agréés par l’ONDRAF. La détermination<strong>de</strong>s caractéristiques radiologiques et chimiques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> relève <strong>en</strong> effet <strong>de</strong> <strong>la</strong>24 La notion <strong>de</strong> colis primaire <strong>de</strong> déchet conditionné est fondam<strong>en</strong>tale pour ce chapitre : il s'agit <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>semblemonolithique formé par les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> stabilisés et <strong>la</strong> matrice (béton, bitume ou verre) qui les<strong>en</strong>robe, ainsi que le fût cont<strong>en</strong>ant ceux-ci, considérés comme un tout.58/166
esponsabilité <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>. Les métho<strong>de</strong>s utilisées par le producteurpour <strong>la</strong> caractérisation chimique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> sont décrites dans le dossier d’agrém<strong>en</strong>t<strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions et <strong>de</strong>s procédés <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t. Les métho<strong>de</strong>sutilisées par le producteur pour <strong>la</strong> caractérisation radiologique compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t un voletthéorique et un volet pratique : Le volet théorique compr<strong>en</strong>d le développem<strong>en</strong>t d’une méthodologie <strong>de</strong> caractérisationqui décrit <strong>de</strong> quelle manière l’objectif final, <strong>la</strong> détermination du cont<strong>en</strong>u radiologique<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, est atteint. Cette méthodologie décrit les calculs et mesures à effectuer. L’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologie, établie par un producteur pour chacun <strong>de</strong> ses types<strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, aboutit au volet pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> caractérisation qui <strong>en</strong>traîne l’i<strong>de</strong>ntification<strong>de</strong>s isotopes prés<strong>en</strong>ts dans les <strong>déchets</strong> et <strong>de</strong> leur activité respective. L’ONDRAFcontrôle les métho<strong>de</strong>s utilisées par le producteur pour <strong>la</strong> caractérisation <strong>de</strong> ses<strong>déchets</strong> via le système d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces métho<strong>de</strong>s. De cette manière, il s'assure quele producteur est effectivem<strong>en</strong>t capable, à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> caractérisation qu’i<strong>la</strong> établies, <strong>de</strong> caractériser les DC d’une manière concluante.2. Une fois les DC produits, le producteur <strong>en</strong>voie à l'ONDRAF une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’acceptation (formu<strong>la</strong>ire C) <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés. Cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> doit notamm<strong>en</strong>tm<strong>en</strong>tionner les caractéristiques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> proposés, comme imposé par l’ONDRAFdans les critères d’acceptation. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’acceptation doit toujours être signéepar un membre habilité du service <strong>de</strong> contrôle physique du producteur. Elle doittoujours être accompagnée du dossier <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne <strong>de</strong>production <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> soumis à l’acceptation. Le dossier <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>production est un dossier cont<strong>en</strong>ant toutes les données utiles re<strong>la</strong>tives aux colis <strong>de</strong><strong>déchets</strong> conditionnés, produits au cours d’une pério<strong>de</strong> déterminée (campagne). Lesdonnées figurant dans un dossier <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation d’une campagne <strong>de</strong> production<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> sont liées aux colis primaires produits durant cette campagne au moy<strong>en</strong><strong>de</strong> leur co<strong>de</strong> d’i<strong>de</strong>ntification.3. L’acceptation a pour but <strong>de</strong> vérifier si les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> proposés sont conformesaux critères d’acceptation applicables. L’acceptation <strong>en</strong> soi compr<strong>en</strong>d tant lescontrôles administratifs que les contrôles physiques effectués par l’ONDRAF sur les<strong>déchets</strong>. Les contrôles administratifs sont effectués sur le dossier <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation<strong>de</strong> production et consist<strong>en</strong>t à vérifier <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s données dans le dossier <strong>de</strong>docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production avec les exig<strong>en</strong>ces imposées dans les critèresd’acceptation applicables. L’ONDRAF effectue donc un contrôle administratif <strong>de</strong> cedossier qui lui permet <strong>de</strong> confirmer <strong>la</strong> qualité docum<strong>en</strong>tée <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> produits dansune instal<strong>la</strong>tion agréée. Les contrôles physiques <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> font égalem<strong>en</strong>t partie <strong>de</strong>l’acceptation et sont effectués <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong> plusieurs valeurs reprisesdans le dossier <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production (par exemple, le co<strong>de</strong> d’i<strong>de</strong>ntificationdu colis primaire, <strong>la</strong> masse, le débit <strong>de</strong> dose, etc...). Dans un premier temps,l’ONDRAF effectue sur le site du producteur un contrôle par échantillonnage sur le lot<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> soumis à l’acceptation. Si <strong>de</strong>s anomalies sont constatées, l’ONDRAFprocè<strong>de</strong> au contrôle complet du lot. Si les contrôles administratifs et physiques sontsatisfaisants pour l’ONDRAF, ils débouch<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> rédaction d’un procès-verbal <strong>de</strong>réception ou d’un rapport d’inspection par l’ONDRAF, signé par celui-ci.4. En cas <strong>de</strong> résultat favorable <strong>de</strong>s contrôles susm<strong>en</strong>tionnés, l’ONDRAF établit unprocès-verbal d’acceptation (partie technique) et un procès-verbal <strong>de</strong> transfert ou uneliste récapitu<strong>la</strong>tive <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> acceptés et <strong>en</strong>levés (partie financière) et pr<strong>en</strong>ddéfinitivem<strong>en</strong>t les <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> charge. Ces docum<strong>en</strong>ts sont signés par le producteur,puis par l’ONDRAF. En effet, l’acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> signifie nonseulem<strong>en</strong>t que l’ONDRAF assume <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> ultérieure <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>, mais garantit égalem<strong>en</strong>t que les fonds nécessaires seront libérés afin <strong>de</strong>couvrir les frais <strong>de</strong> cette <strong>gestion</strong>. À partir <strong>de</strong> ce mom<strong>en</strong>t, l’ONDRAF peut effectuertoutes les opérations qu’il estime souhaitables dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés. La responsabilité juridique et financière <strong>de</strong> celui quia conditionné les <strong>déchets</strong> reste toutefois soumise aux prescriptions légales.5. Dès que les <strong>déchets</strong> ont été acceptés par l’ONDRAF, le transport peut être p<strong>la</strong>nifié.L’ONDRAF <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t propriétaire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> au mom<strong>en</strong>t où les <strong>déchets</strong> quitt<strong>en</strong>t le sitedu producteur. Les <strong>déchets</strong> sont transférés vers les bâtim<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>59/166
l’ONDRAF sur le site <strong>de</strong> Belgoprocess. À leur arrivée sur le site <strong>de</strong> Belgoprocess, lescolis sont réceptionnés individuellem<strong>en</strong>t. La confirmation <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>treposage estconsignée dans un procès-verbal d’<strong>en</strong>treposage signé conjointem<strong>en</strong>t par l’ONDRAFet par Belgoprocess. L’ONDRAF facture <strong>en</strong>suite aux producteurs les provisions pourl’<strong>en</strong>treposage et le dépôt final.Conformém<strong>en</strong>t aux Règles générales, chaque colis primaire accepté par l’ONDRAF doitêtre complètem<strong>en</strong>t docum<strong>en</strong>té et traçable. La traçabilité et l'archivage <strong>de</strong>s donnéesre<strong>la</strong>tives aux colis acceptés par l’ONDRAF s'effectu<strong>en</strong>t matériellem<strong>en</strong>t dans un dossier<strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation ONDRAF, ainsi qu'informatiquem<strong>en</strong>t, dans les bases <strong>de</strong> données <strong>de</strong>l’ONDRAF.Le dossier <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> l’ONDRAF compr<strong>en</strong>d : <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> rédigée par le producteur ainsi que le dossier <strong>de</strong>docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production du producteur; les résultats <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérification par l'ONDRAF <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> avec lescritères d’acceptation; les référ<strong>en</strong>ces ou copies <strong>de</strong>s critères d’acceptation concernés, le dossier d’agrém<strong>en</strong>tapprouvé, les résultats <strong>de</strong>s contrôles administratifs, les rapports d’inspection, lesprocès-verbaux, etc... .Les données (numéro, débit <strong>de</strong> dose, cont<strong>en</strong>u radiologique, masse, etc...) re<strong>la</strong>tives auxcolis primaires <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés sont égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>registrées dans <strong>de</strong>sbases <strong>de</strong> données, et ce, suivant un format déterminé. Elles font l'objet d'archivagesréguliers, i.e. m<strong>en</strong>suels, sous format ASCII indép<strong>en</strong>dant <strong>de</strong> l'outil qui les gère <strong>en</strong> routine,et ce dans un souci <strong>de</strong> pér<strong>en</strong>nité.3. Colis <strong>en</strong>treposés et productions historiquesOutre le suivi dans le temps <strong>de</strong>s colis acceptés, sur lequel on revi<strong>en</strong>dra au chapitre neuf,l’ONDRAF a égalem<strong>en</strong>t prévu le contrôle <strong>de</strong>s colis non <strong>en</strong>core acceptés afin <strong>de</strong> pouvoirs’assurer du bon état physique <strong>de</strong> ceux-ci avant que l’on ne procè<strong>de</strong> à l’acceptationofficielle (et même au contrôle <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation) <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>conditionnés.Suite à plusieurs inspections <strong>de</strong> fûts déjà stockés, il a été décidé <strong>de</strong> ne plus procé<strong>de</strong>r àl’acceptation officielle <strong>de</strong> colis historiques avant l’inspection visuelle d’au moins un colisdu lot à accepter.Les colis qui sont <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t stockés dans les bâtim<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treposage font partie d’un<strong>de</strong>s groupes suivants : colis acceptés colis non <strong>en</strong>core acceptésFont partie du groupe <strong>de</strong> colis acceptés, <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong>s productions historiques (antérieursau 10 février 1999) et <strong>actuelle</strong>s (postérieurs à cette date). Les contrôles <strong>de</strong> ces colis fontprincipalem<strong>en</strong>t partie du suivi dans le temps, développé au chapitre neuf.Les colis non <strong>en</strong>core acceptés peuv<strong>en</strong>t être subdivisés <strong>en</strong> : Colis conformes Colis non conformes Colis intermédiaires60/166
Colis stockésColis acceptésColis non <strong>en</strong>core acceptésColisintermédiairesAcceptationColisconformesColisnon-conformesMesurescorrectivesLe contrôle <strong>de</strong>s colis non <strong>en</strong>core acceptés, principalem<strong>en</strong>t les productions historiques(c'est-à-dire antérieures au 10 février 1999), <strong>en</strong>traîne une répartition <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux statuts :colis conformes et non conformes. Les colis conformes <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t <strong>en</strong> ligne <strong>de</strong> compte pour une acceptation officielle parl’ONDRAF. Pour ces colis, l’ONDRAF peut procé<strong>de</strong>r à l’acceptation officielle, aprèscontrôle du dossier <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>tation et si ce contrôle s'avère satisfaisant. Les colis non conformes doiv<strong>en</strong>t être évalués au cas par cas sous le dénominateur« Mesures correctives » / « Actions correctives ». Les fûts non conformes qui<strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t conformes après une mesure corrective peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>trer <strong>en</strong> ligne<strong>de</strong> compte par <strong>la</strong> suite pour une acceptation officielle par l’ONDRAF.Le statut <strong>de</strong> colis « intermédiaires » produits après le 10 février 1999, prov<strong>en</strong>antprincipalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> BELGOPROCESS, est accordé aux fûts dont les DNC ont étéacceptés par l’ONDRAF et pour lesquels les DC n’ont pas <strong>en</strong>core été acceptés. Étantdonné que, par manque <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce dans les instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t, ces fûts sont p<strong>la</strong>césdans les bâtim<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treposage, plusieurs contrôles physiques et administratifs doiv<strong>en</strong>têtre effectués dans le cadre <strong>de</strong> l’agrém<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> l’acceptation et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>treposage. Lerésultat <strong>de</strong> ces contrôles donne une répartition <strong>en</strong> colis conformes et colis nonconformes.61/166
Chapitre septLes inv<strong>en</strong>taires techniques prévisionnelsGérer les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, c'est égalem<strong>en</strong>t prévoir leur apparition. C'est à cette<strong>gestion</strong> prévisionnelle que sont consacrés les <strong>de</strong>ux chapitres qui suiv<strong>en</strong>t et qui form<strong>en</strong>t <strong>la</strong>troisième partie <strong>de</strong> ce docum<strong>en</strong>t : « ce qui se fait aujourd'hui pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong><strong>de</strong>main ».Le premier <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux chapitres est consacré aux prévisions techniques, soit doncprincipalem<strong>en</strong>t les évaluations re<strong>la</strong>tives aux volumes futurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> que l'organismesera appelé à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge.En premier lieu vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t les prévisions <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés. Sur <strong>la</strong>base d'extrapo<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s prises <strong>en</strong> charge <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non conditionnés, l'ONDRAFétablit les estimations <strong>de</strong> production future <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnésauxquels ils donneront naissance. La notion <strong>de</strong> « flux », i.e. <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques simi<strong>la</strong>ires et homogènes, est icic<strong>en</strong>trale. Les conditionneurs-tiers (chapitre six) effectu<strong>en</strong>t ces estimations pour leurspropres flux et les communiqu<strong>en</strong>t à l'ONDRAF, qui les vérifie et les intègre dans sa base<strong>de</strong> données.La production courante future <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> – celle liée à <strong>la</strong> poursuite d'une activitéimpliquant <strong>de</strong>s matières radioactives – n'est pas, loin s'<strong>en</strong> faut, <strong>la</strong> seule source à pr<strong>en</strong>dre<strong>en</strong> compte. Doit s'y ajouter <strong>la</strong> production liée à <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong> cette activité, du fait dudémantèlem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions. C'est pourquoi les exploitants <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions(c<strong>en</strong>trales électronucléaires, BELGOPROCESS, SCK·CEN, usines <strong>de</strong> fabrication ducombustible, ...) sont astreints à l'é<strong>la</strong>boration d'un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t. Ce p<strong>la</strong>n,év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t é<strong>la</strong>boré avec l'assistance <strong>de</strong> l'ONDRAF, est <strong>en</strong>suite vérifié et approuvépar celui-ci. La compi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> ces p<strong>la</strong>ns et <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> flux fournit uninv<strong>en</strong>taire prévisionnel complet, périodiquem<strong>en</strong>t mis à jour.Outre ces <strong>de</strong>ux volets prospectifs, l'ONDRAF assure égalem<strong>en</strong>t le rec<strong>en</strong>sem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>toutes les instal<strong>la</strong>tions cont<strong>en</strong>ant, manipu<strong>la</strong>nt ou produisant <strong>de</strong>s substances radioactives.Localisations, nature <strong>de</strong> l'activité, type <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s, quantités, etc... form<strong>en</strong>tl'inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires et <strong>de</strong>s sites cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s substancesradioactives. Cet outil est davantage consacré à l'évaluation <strong>de</strong>s risques financiers et à<strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> l'apparition <strong>de</strong> passifs financiers, liés à l'assainissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cesinstal<strong>la</strong>tions, qui tomberai<strong>en</strong>t à charge <strong>de</strong> l'Etat.De nature d'abord technique, cet inv<strong>en</strong>taire a donc égalem<strong>en</strong>t un rôle financier important,ce qui assure <strong>la</strong> transition vers le chapitre qui suit.1. L’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>L’établissem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> t<strong>en</strong>ue d’un inv<strong>en</strong>taire quantitatif et qualitatif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>conditionnés et non conditionnés, <strong>de</strong> même que l’établissem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> t<strong>en</strong>ue à jour <strong>de</strong>sperspectives <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> à court, moy<strong>en</strong> et long terme,constitu<strong>en</strong>t l’une <strong>de</strong>s missions principales confiées par l’arrêté royal du 16 octobre 1991 àl’ONDRAF (art. 2, § 3, 1°, b). L'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s activités nécessaires pour m<strong>en</strong>er à bi<strong>en</strong>cette mission a été rassemblé sous l'intitulé « inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ». Cetinv<strong>en</strong>taire compr<strong>en</strong>d non seulem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>s stocks <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> existants qui setrouv<strong>en</strong>t dans les bâtim<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treposage sur les sites <strong>de</strong> Belgoprocess mais aussil'estimation <strong>de</strong>s quantités futures <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qui apparaîtront d'ici <strong>la</strong> fin duprogramme nucléaire belge. Tant les <strong>déchets</strong> opérationnels produits <strong>en</strong> phased'exploitation <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions existantes que les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t produitsaprès l'arrêt <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions font partie <strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire. L’inv<strong>en</strong>taire ne se conc<strong>en</strong>tre62/166
pas uniquem<strong>en</strong>t sur les quantités et volumes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, mais compr<strong>en</strong>d égalem<strong>en</strong>t leur<strong>de</strong>scription chimique et radiologique.1.1 MéthodologieLa méthodologie d’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> est fondée sur<strong>de</strong>ux élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> base, <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> flux et le questionnaire.Un flux est un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> dotés <strong>de</strong> caractéristiques physiques,chimiques et radiologiques simi<strong>la</strong>ires et homogènes .Les flux constitu<strong>en</strong>t par conséqu<strong>en</strong>t les élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>développée par l’ONDRAF (voir égalem<strong>en</strong>t au chapitre trois : <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>conditionnés).Le questionnaire est l'interface <strong>en</strong>tre le producteur <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et l’ONDRAF.Le producteur est <strong>la</strong> source <strong>de</strong> toutes les données nécessaires pour composerl’inv<strong>en</strong>taire. Afin <strong>de</strong> rassembler ces données d’une manière <strong>la</strong> plus systématique etuniforme possible, l’ONDRAF a développé un questionnaire. La structure <strong>de</strong> cequestionnaire découle <strong>en</strong> fait <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire à établir et se subdivise <strong>en</strong> troisvolets : les informations générales sur chaque flux et les quantités correspondantes <strong>de</strong><strong>déchets</strong>, avec <strong>en</strong>tre autres une <strong>de</strong>scription physique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> et les perspectives <strong>de</strong>production <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong>; <strong>la</strong> composition chimique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, où l’acc<strong>en</strong>t est mis sur <strong>la</strong> composition chimiqueet <strong>la</strong> masse; les propriétés radiologiques, avec l’acc<strong>en</strong>t mis sur l’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s etl’activité volumique correspondante.Chaque producteur est prié <strong>de</strong> compléter un questionnaire par flux. Ces questionnairessont disponibles sous <strong>la</strong> forme d’un fichier <strong>de</strong> type “tableur”.La collecte <strong>de</strong>s données qui seront à <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire requiert une approchesystématique. La métho<strong>de</strong> développée par l’ONDRAF compr<strong>en</strong>d cinq étapes :1. l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s flux par le producteur <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> et l’ONDRAF;2. <strong>la</strong> réponse au questionnaire par les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>;3. l’évaluation <strong>de</strong>s réponses aux questionnaires par l’ONDRAF sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong>l’exhaustivité, <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce et <strong>de</strong> l’exactitu<strong>de</strong>;4. <strong>la</strong> conversion <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> base <strong>en</strong> données adéquates pour établir l’inv<strong>en</strong>taire;5. le transfert <strong>de</strong>s données converties vers une base <strong>de</strong> données c<strong>en</strong>trale auprès <strong>de</strong>l’ONDRAF.L’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> se fait sur <strong>la</strong> base d'un<strong>en</strong>semble d'hypothèses qui constitu<strong>en</strong>t le « scénario <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce ». Ces hypothèsesti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t compte : <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires <strong>actuelle</strong>s ainsi que celles qui seront construites à l’av<strong>en</strong>ir; <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> vie opérationnelle <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> sur <strong>la</strong>quelle<strong>de</strong>vrait s'ét<strong>en</strong>dre leur déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t (une <strong>de</strong>s principales hypothèses est que <strong>la</strong> durée<strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s réacteurs nucléaires est limitée à 40 ans); <strong>de</strong>s paramètres et variables qui ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t compte notamm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s év<strong>en</strong>tuelles évolutionstechniques et stratégiques sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (parexemple un dépôt final <strong>en</strong> surface pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible et moy<strong>en</strong>ne activité àcourte durée <strong>de</strong> vie ou le retraitem<strong>en</strong>t complet du combustible irradié).L’ONDRAF a terminé <strong>en</strong> 1998 un premier inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et a actualiséces données <strong>en</strong> 2003 à l'issue d'un <strong>de</strong>uxième cycle. Le troisième cycle a débuté <strong>en</strong> 2004et se terminera fin 2008. Les résultats repris dans <strong>la</strong> section qui suit provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong>coredu <strong>de</strong>uxième cycle.63/166
1.2 L’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> chiffresCe paragraphe offre un aperçu <strong>de</strong>s résultats les plus importants du <strong>de</strong>uxième cycle <strong>de</strong>l’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (« l’Inv<strong>en</strong>taire 2003 »).En ce qui concerne les quantités <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, les calculs basés sur les hypothèses quisont à l’origine du scénario <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce ont <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dré un volume total <strong>de</strong> 81 500 m³ <strong>de</strong><strong>déchets</strong> conditionnés <strong>de</strong> catégories A, B et C (figure ci-<strong>de</strong>ssous).89002100Catégorie ACatégorie BCatégorie C70500figure 13: Composition du volume <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnésselon l’Inv<strong>en</strong>taire 2003 et <strong>en</strong> supposant que tout le combustible irradiéest retraité et que <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s réacteurs nucléaires est limitée à40 ans (volumes <strong>en</strong> m³).L’inv<strong>en</strong>taire permet d’illustrer <strong>la</strong> composition chimique du volume <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong><strong>déchets</strong>. Pr<strong>en</strong>ons par exemple les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A. La composition chimiquepr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> compte non seulem<strong>en</strong>t les élém<strong>en</strong>ts prés<strong>en</strong>ts dans les <strong>déchets</strong> bruts, maisaussi les composants <strong>de</strong> l’embal<strong>la</strong>ge primaire et <strong>de</strong>s matrices d’immobilisation. Il ressort<strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire chimique que pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A, <strong>en</strong>viron 93 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> massetotale du volume <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A est constitué <strong>de</strong> septcomposants caractéristiques (figure suivante).19.6%12.6%4.8%12.5%Acier carboneAcier inoxCim<strong>en</strong>tSableBétonAutres31.1%19.5%figure 14: Composition chimique du volume <strong>de</strong>référ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés <strong>de</strong> catégorie Aselon l’Inv<strong>en</strong>taire 2003.64/166
Parmi ces constituants, le béton constitue le plus gros <strong>de</strong> <strong>la</strong> masse <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>catégorie A. Ce matériau est <strong>en</strong> effet utilisé abondamm<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> construction <strong>de</strong>sinstal<strong>la</strong>tions nucléaires. Une certaine fraction <strong>de</strong> ce béton, d'une t<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> radionucléi<strong>de</strong>ssupérieure aux critères applicables pour sa libération, se retrouve dans le circuit <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> durant le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s réacteurs nucléaires. Le cim<strong>en</strong>t et lesable, quant à eux, constitu<strong>en</strong>t les ingrédi<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s matrices d’immobilisation lesplus utilisées.L’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s compr<strong>en</strong>d une liste <strong>de</strong>s radio-isotopes prés<strong>en</strong>ts dans les<strong>déchets</strong> et <strong>de</strong> l’activité volumique correspondante, et constitue l’un <strong>de</strong>s principauxélém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>s évaluations <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité que l’ONDRAF effectue ou fait effectuer dans lecadre du dépôt final <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Isotope2001 2070 2370 2001 2070 2370Isotope[Bq] [Bq] [Bq] [Bq] [Bq] [Bq]Am-241 1,2E+11 9,3E+11 6,1E+11 Nb-94 3,9E+11 7,6E+11 7,5E+11Am-243 1,1E+09 2,7E+09 2,6E+09 Ni-59 4,4E+13 1,1E+15 1,1E+15C-14 4,9E+12 2,3E+13 2,2E+13 Ni-63 5,7E+14 1,2E+16 1,5E+15Cl-36 9,4E+10 3,5E+11 3,5E+11 Np-237 1,1E+10 1,4E+10 1,4E+10Cm-244 4,7E+10 3,4E+10 3,6E+05 Pu-238 3,6E+11 3,3E+11 3,1E+10Co-58 7,9E+13 4,4E+11 Pu-239 6,3E+10 1,3E+11 1,3E+11Co-60 2,4E+14 9,5E+13 Pu-240 9,4E+10 1,5E+11 1,4E+11Cs-134 5,7E+13 2,0E+12 Pu-241 1,6E+13 1,5E+12 2,5E+08Cs-135 3,8E+11 6,3E+11 6,3E+11 Pu-242 9,5E+07 1,7E+08 1,7E+08Cs-137 9,5E+13 4,7E+13 4,8E+10 Sr-90 2,4E+12 1,7E+12 1,2E+09Fe-55 1,8E+14 4,9E+11 Tc-99 2,0E+11 4,1E+11 4,1E+11H-3 1,8E+15 5,8E+15 2,6E+08 U-234 5,2E+11 6,7E+11 6,7E+11I-129 3,1E+10 4,0E+10 4,0E+10 U-235 2,0E+10 2,7E+10 2,7E+10Mn-54 5,7E+13 6,5E+11 U-238 9,8E+10 1,3E+11 1,3E+11Table 4: Inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s prés<strong>en</strong>ts dans le volume <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>catégorie A, le 1 er janvier 2001 (mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce du <strong>de</strong>uxième cycle <strong>de</strong> l’inv<strong>en</strong>taire), le1 er janvier 2070 (date <strong>de</strong> fin, selon le scénario <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce, du programme nucléaire belge)et le 1 er janvier 2370 (date <strong>de</strong> fin, selon le scénario <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce, <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase <strong>de</strong> contrôleinstitutionnel <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt final <strong>en</strong> surface).Dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssus, <strong>la</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> se poursuit durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>2001-2070, puis s'arrête (ou <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t marginale). Ceci explique que : l'activité totale <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s à longue ou très longue <strong>de</strong>mi-vie ( 99 Tc, 239 Pu,isotopes <strong>de</strong> l'U) croît par apport <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> durant <strong>la</strong> première phase, puis restepratiquem<strong>en</strong>t constante sur 300 ans; l'activité <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s à courte <strong>de</strong>mi-vie ( 55 Fe, 90 Sr, 137 Cs, isotopes du Co)diminue continum<strong>en</strong>t, même p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> phase où <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> sont <strong>en</strong>core produits, <strong>la</strong>décroissance faisant plus que comp<strong>en</strong>ser l'apport <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>; l'activité <strong>de</strong> quelques radionucléi<strong>de</strong>s à <strong>de</strong>mi-vie intermédiaire 25 ( 63 Ni, 241 Am) augm<strong>en</strong>ted'abord par apport <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, puis diminue par décroissance naturelle.2. Déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires2.1 IntroductionPar <strong>la</strong> loi du 11 janvier 1991 et l’arrêté royal d’exécution du 16 octobre 1991, l’ONDRAFest chargé, <strong>en</strong>tre autres, d’une mission <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tionsnucléaires. Cette mission comporte <strong>la</strong> collecte et l’évaluation <strong>de</strong>s données re<strong>la</strong>tives auxprévisions <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires aux fins d'é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s25 241 Am : 432 ans – 63 Ni : 100 ans65/166
programmes <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qui <strong>en</strong> résulteront, l’approbation <strong>de</strong>sprogrammes <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions, l’établissem<strong>en</strong>t – <strong>en</strong> concertation avecles exploitants – <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t, ainsi que l’exécutionév<strong>en</strong>tuelle <strong>de</strong> ces programmes à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’exploitant ou <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> défail<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>celui-ci.Tout exploitant d’instal<strong>la</strong>tion nucléaire ou toute personne qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> l'autorisationd'exploiter une instal<strong>la</strong>tion nucléaire est t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> fournir à l’ONDRAF, sous saresponsabilité et <strong>en</strong> temps utile, les informations nécessaires à l'établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sprévisions <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions, à <strong>la</strong> nature, aux quantités et aux dates<strong>de</strong> transfert <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> résultant, ainsi qu’aux conditions <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t dudéc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions.Afin <strong>de</strong> mettre à disposition les moy<strong>en</strong>s nécessaires pour le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t d’uneinstal<strong>la</strong>tion nucléaire mise à l’arrêt, les exploitants sont t<strong>en</strong>us <strong>de</strong> constituer <strong>de</strong>s provisionsp<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> vie active <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion. Ces provisions sont calculées <strong>de</strong> telle manière quele montant total, constitué au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise à l’arrêt définitif, puisse couvrirl’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s coûts résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase ultime <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion, c'est-à-dire <strong>la</strong>préparation du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t, les activités <strong>de</strong> décontamination, <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce plus oumoins prolongée <strong>de</strong> l'instal<strong>la</strong>tion, le démantèlem<strong>en</strong>t, ainsi que le traitem<strong>en</strong>t, leconditionnem<strong>en</strong>t, l'<strong>en</strong>treposage et le dépôt final <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> produits p<strong>en</strong>dant cettephase.Le coût du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et, dès lors, les provisions à constituer dép<strong>en</strong><strong>de</strong>nt d’unemultitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> facteurs, souv<strong>en</strong>t peu ou <strong>en</strong>core mal connus p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> phase d’exploitation<strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion. C’est pourquoi il est nécessaire d’examiner certains <strong>de</strong> ces facteurs <strong>de</strong>façon plus att<strong>en</strong>tive, et <strong>de</strong> fixer au plus tôt <strong>de</strong>s hypothèses <strong>de</strong> travail réalistes dans le but<strong>de</strong> constituer <strong>de</strong>s provisions couvrant au mieux le coût du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t ultérieur.C’est à cette fin que l’Ag<strong>en</strong>ce Internationale <strong>de</strong> l’Energie Atomique (AIEA) a établi dans <strong>la</strong>série <strong>de</strong>s « Safety Series » un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> prescriptions guidant l’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t pour toute instal<strong>la</strong>tion nucléaire. Ces prescriptions ai<strong>de</strong>nt chaqueexploitant à estimer les coûts <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et dès lors les provisions à constituer.2.2 P<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t : objet et modalités <strong>de</strong>constitutionLe déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> toute instal<strong>la</strong>tion nucléaire doit être préparé par l’exploitant ou par leresponsable financier bi<strong>en</strong> avant <strong>la</strong> mise à l’arrêt définitif <strong>de</strong> celle-ci, afin <strong>de</strong> faciliter lesopérations <strong>de</strong> décontamination et <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> maint<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>sconditions <strong>de</strong> sûreté optimales, et <strong>de</strong> réaliser le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t au moy<strong>en</strong> <strong>de</strong>s provisionsconstituées à cette fin.L’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t est requis pour les instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse I etles principales instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse II 26 .Les élém<strong>en</strong>ts nécessaires à une préparation optimale du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t sontprincipalem<strong>en</strong>t : <strong>la</strong> collecte <strong>de</strong> toute information technique permettant d'établir un inv<strong>en</strong>taire précis <strong>de</strong>l’état <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts, ainsi que <strong>de</strong> leur niveau <strong>de</strong> contamination etd’activation et <strong>de</strong>s caractéristiques isotopiques; <strong>la</strong> conservation et le mainti<strong>en</strong> <strong>en</strong> état normal <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts et<strong>de</strong>s accessoires ayant servi p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> construction ou l’exploitation et qui sont <strong>de</strong>nature à faciliter les opérations <strong>de</strong> décontamination ou <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t; <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> compte, p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> conception <strong>de</strong> l'instal<strong>la</strong>tion et son exploitation, <strong>de</strong>stechniques susceptibles <strong>de</strong> réaliser le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t dans les meilleures conditions<strong>de</strong>s points <strong>de</strong> vue radioprotection, volume <strong>de</strong> substances radioactives produites,décontaminabilité, démontabilité et accessibilité. Cette prise <strong>en</strong> compte nécessite, pourles nouvelles instal<strong>la</strong>tions, une analyse conceptuelle préliminaire du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>l’instal<strong>la</strong>tion, dès <strong>la</strong> conception <strong>de</strong> celle-ci.26 Pour une définition <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes c<strong>la</strong>sses d'instal<strong>la</strong>tions, voir <strong>la</strong> troisième partie <strong>de</strong> ce chapitre.66/166
Le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t couvre l’historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie nucléaire <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion et repr<strong>en</strong>dl’inv<strong>en</strong>taire complet <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts et équipem<strong>en</strong>ts avec leur état radiologique. Il définitune stratégie d’<strong>en</strong>semble et vérifie <strong>la</strong> faisabilité pratique <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong>décontamination et <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t. Il permet une catégorisation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>démantèlem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>stination finale. Il estime finalem<strong>en</strong>t les coûts dudéc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et évalue les provisions à constituer p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> vie active <strong>de</strong> l'instal<strong>la</strong>tionpour couvrir le coût ultérieur du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t.Le premier p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t est établi lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> exploitation <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion.Ce p<strong>la</strong>n servira à déterminer un mécanisme <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t ultérieur.Les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t sont établis par l’exploitant ou le responsable financier etsoumis à l’ONDRAF pour avis, dans le cas d’un p<strong>la</strong>n initial, et pour accord, dans le casd’un p<strong>la</strong>n final. Cette procédure permet d’assurer <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s hypothèses et <strong>de</strong> <strong>la</strong>méthodologie au niveau national, ainsi que <strong>la</strong> conformité aux prescriptions <strong>en</strong> <strong>la</strong> matière.Le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t initial est révisé au moins tous les cinq ans ou à un intervalleplus court <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> modification importante <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion ou <strong>de</strong> son état radiologique.Ces révisions permett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> suivre l’évolution technique et règlem<strong>en</strong>taire <strong>en</strong> <strong>la</strong> matière,<strong>de</strong> tirer les <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts nécessaires <strong>de</strong> l’expéri<strong>en</strong>ce acquise lors <strong>de</strong>s activitésécoulées et d’adapter, s’il le faut, le montant <strong>de</strong>s provisions ou le rythme <strong>de</strong> constitution<strong>de</strong> ces provisions.Le p<strong>la</strong>n initial évolue vers le p<strong>la</strong>n final pour l’instal<strong>la</strong>tion, ou partie d’instal<strong>la</strong>tion, et pour <strong>la</strong>phase <strong>en</strong>visagée, jusqu'au mom<strong>en</strong>t où <strong>la</strong> mise à l’arrêt définitif est décidée et, saufexception, au moins trois ans avant <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l’arrêt définitif.2.3 Evaluation <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> matériaux et <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong>déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>tL’inv<strong>en</strong>taire physique et radiologique <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires et <strong>de</strong> leur cont<strong>en</strong>u <strong>en</strong>équipem<strong>en</strong>ts et matériaux permet, moy<strong>en</strong>nant hypothèses quant au cal<strong>en</strong>drier d’arrêt <strong>de</strong>sinstal<strong>la</strong>tions les plus importantes et quant aux techniques <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong>décontamination à utiliser, d’évaluer les flux <strong>de</strong> matériaux qui seront issus dudéc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t : <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, matériaux libérables du contrôle nucléaire etmatériaux recyc<strong>la</strong>bles dans <strong>de</strong>s applications nucléaires.Les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sont constitués <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> primaires prov<strong>en</strong>ant dudéc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t proprem<strong>en</strong>t dit <strong>de</strong>s infrastructures et <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts, ainsi que <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> secondaires, à savoir les <strong>déchets</strong> opérationnels produits par le fait même <strong>de</strong>sopérations <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> décontamination. Notons que ces <strong>déchets</strong>secondaires résult<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> contamination <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts et ne correspon<strong>de</strong>nt àaucune radioactivité supplém<strong>en</strong>taire.La plupart <strong>de</strong>s exploitants ou responsables financiers considèr<strong>en</strong>t que l’objectif dudéc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t est celui qui découle <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition légale, à savoir le retrait <strong>de</strong> <strong>la</strong> ou <strong>de</strong>sinstal<strong>la</strong>tions visées <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées. Dans quelques cas toutefois,indiqués dans le texte, le responsable financier pr<strong>en</strong>d l’hypothèse que le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>tira jusqu’à <strong>la</strong> restitution du site à un état non bâti. La démolition conv<strong>en</strong>tionnelle <strong>de</strong>sbâtim<strong>en</strong>ts s’accompagne <strong>de</strong> <strong>la</strong> libération <strong>de</strong> quantités <strong>de</strong> matériaux qui peuv<strong>en</strong>t êtreconsidérables.L’estimation <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’infrastructure et <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts dép<strong>en</strong>ddans une certaine mesure <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>tes hypothèses quant à l’exécution <strong>de</strong>s programmes<strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> particulier du mom<strong>en</strong>t du début du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t. Le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>test qualifié d’« immédiat » quand il débute rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t après l’arrêt définitif <strong>de</strong>l’exploitation. Sinon, il est dit « différé ». La stratégie <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t ret<strong>en</strong>ue parl'ONDRAF pour l’évaluation <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t est celle du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>timmédiat, qui est aussi celle qui a été choisie par <strong>la</strong> presque totalité <strong>de</strong>s exploitants pourles évaluations à effectuer dans le cadre <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> leur(s) p<strong>la</strong>n(s) <strong>de</strong>déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t. C’est <strong>la</strong> stratégie <strong>la</strong> plus conservative du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> constitution<strong>de</strong>s provisions pour le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t, étant donné qu’elle minimise l’impact <strong>de</strong>l’actualisation sur les provisions financières à constituer.67/166
Les données intégrées aux p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t (généralem<strong>en</strong>t annexées) sontvérifiées du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> leur p<strong>la</strong>usibilité et <strong>de</strong> leur complétu<strong>de</strong> avant d’être injectéesdans une base <strong>de</strong> données c<strong>en</strong>tralisée <strong>de</strong> l'ONDRAF, le DecommissioningManagem<strong>en</strong>t System, <strong>en</strong> vue d’assurer leur traçabilité et <strong>de</strong> permettre leur traitem<strong>en</strong>t.Le Decommissioning Managem<strong>en</strong>t System compr<strong>en</strong>d <strong>de</strong>s tables d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sinv<strong>en</strong>taires <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires, <strong>de</strong>s tables auxiliaires cont<strong>en</strong>ant les donnéesnécessaires aux évaluations <strong>de</strong> ces inv<strong>en</strong>taires, ainsi qu’un logiciel d’analyse <strong>de</strong>sprogrammes <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et d’assainissem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> termes <strong>de</strong>s matériaux et <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>s heures d’opérateurs nécessaires à <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>sprogrammes et <strong>de</strong>s coûts y associés.Les données auxiliaires nécessaires aux évaluations sont <strong>en</strong> gran<strong>de</strong> partie basées surl’expéri<strong>en</strong>ce acquise lors <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours sur les sites <strong>de</strong>Belgoprocess ainsi qu’au SCK·CEN (passifs techniques BP et SCK·CEN) et sont affinéespériodiquem<strong>en</strong>t.Toutes les évaluations <strong>de</strong> coûts sont faites dans l’hypothèse d’un déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et/oud’un assainissem<strong>en</strong>t « instantané », c’est-à-dire <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant compte <strong>de</strong>s conditionsrèglem<strong>en</strong>taires, techniques et économiques <strong>en</strong> vigueur au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>l’évaluation : règlem<strong>en</strong>tation <strong>en</strong> matière d’autorisations, <strong>de</strong> libération <strong>de</strong>s matériaux et<strong>de</strong>s sites du contrôle nucléaire, protection <strong>de</strong>s travailleurs et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t,techniques <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> décontamination existantes, tarifs <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>, coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> main d’œuvre, etc... .3. L’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions et sites nucléairesComme tous les pays qui utilis<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s substances radioactives, que ce soit pour produire<strong>de</strong> l’électricité ou à d’autres fins pacifiques, <strong>la</strong> Belgique se trouve face à un importantdéfi : une <strong>gestion</strong> sûre, tant à court qu’à long terme, <strong>de</strong> toutes ces substances. Cette<strong>gestion</strong> a un coût qui, conformém<strong>en</strong>t au principe éthique d’équité intergénérationnelle,doit être principalem<strong>en</strong>t supporté par les générations qui profit<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s activités qui ontproduit ces substances, <strong>en</strong> d’autres termes, par les générations <strong>actuelle</strong>s. Il est toutefoispossible — comme ce<strong>la</strong> a été le cas pour quelques dossiers historiques — qu’une fois lemom<strong>en</strong>t v<strong>en</strong>u, les moy<strong>en</strong>s financiers p<strong>la</strong>nifiés pour couvrir les frais <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t etd’assainissem<strong>en</strong>t se révèl<strong>en</strong>t insuffisants ou indisponibles, voire même tout à faitinexistants : un passif nucléaire est alors créé. Une telle situation peut avoir diversescauses, comme une sous-estimation <strong>de</strong>s frais réels par l’<strong>en</strong>tité qui est financièrem<strong>en</strong>tresponsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s frais, une néglig<strong>en</strong>ce, un transfert <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong>l’instal<strong>la</strong>tion nucléaire ou du site nucléaire sans transfert <strong>de</strong>s provisions correspondantes,une réduction du programme d’exploitation, une faillite ou tout simplem<strong>en</strong>t une ignorance.Parce qu’il souhaite éviter <strong>la</strong> naissance d’un nouveau passif nucléaire, le légis<strong>la</strong>teur achargé, par le biais <strong>de</strong> l’article 9 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi-programme du 12 décembre 1997, l’ONDRAF<strong>de</strong> rassembler tous les élém<strong>en</strong>ts nécessaires pour vérifier si les frais <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t etd’assainissem<strong>en</strong>t seront effectivem<strong>en</strong>t couverts au mom<strong>en</strong>t souhaité. Cette mission estparfois appelée inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s passifs nucléaires <strong>de</strong> manière quelque peu impropre,puisque ces passifs nucléaires ne sont que pot<strong>en</strong>tiels et que l'inv<strong>en</strong>taire a précisém<strong>en</strong>tpour but <strong>de</strong> prév<strong>en</strong>ir l'apparition <strong>de</strong> ceux-ci. Elle implique plus concrètem<strong>en</strong>t : d'établir un répertoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> localisation et <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> toutes les instal<strong>la</strong>tions nucléaireset <strong>de</strong> tous les sites cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s substances radioactives, une substance radioactiveétant définie comme « toute substance cont<strong>en</strong>ant un ou plusieurs radionucléi<strong>de</strong>s dontl’activité ou <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration ne peut pas être négligée pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> protectioncontre le rayonnem<strong>en</strong>t »; d'estimer les frais <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et d’assainissem<strong>en</strong>t, généralem<strong>en</strong>t appelés « fraisnucléaires » par l’ONDRAF; d'évaluer l’exist<strong>en</strong>ce et le montant suffisant <strong>de</strong>s provisions pour le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cesopérations <strong>actuelle</strong>s ou à v<strong>en</strong>ir; <strong>de</strong> mettre à jour cet inv<strong>en</strong>taire tous les cinq ans.68/166
L’article 9 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi-programme du 12 décembre 1997 a pour but <strong>de</strong> fournir un aperçudétaillé sur <strong>la</strong> manière dont les futurs frais nucléaires sont <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t couverts <strong>en</strong>Belgique, afin que les initiatives nécessaires puiss<strong>en</strong>t être prises pour combler les<strong>la</strong>cunes constatées. La mission d’inv<strong>en</strong>taire est donc une mission d’intérêt public, quis’inscrit dans le cadre d’une politique <strong>de</strong> prév<strong>en</strong>tion active basée sur le principe du« pollueur payeur ».La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail appliquée par l’ONDRAF suit les gran<strong>de</strong>s phases <strong>de</strong> <strong>la</strong> missiond’inv<strong>en</strong>taire. Pour chacun <strong>de</strong>s sites m<strong>en</strong>tionnés dans le répertoire – t<strong>en</strong>u à jour <strong>en</strong>perman<strong>en</strong>ce –, l’ONDRAF a reçu <strong>de</strong>s exploitants un inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>,un inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong> l’infrastructure et <strong>de</strong> l’équipem<strong>en</strong>t à déc<strong>la</strong>sser et un inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>smatières nucléaires. Les inv<strong>en</strong>taires <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s matières nucléairesont été convertis <strong>en</strong> frais <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> (principalem<strong>en</strong>t traitem<strong>en</strong>t, conditionnem<strong>en</strong>t,<strong>en</strong>treposage et dépôt final). Des frais <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t ont été reliés à l’infrastructure et àl’équipem<strong>en</strong>t à déc<strong>la</strong>sser. Ils compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t les frais <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> produits lors du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t. Les estimations <strong>de</strong> frais ont été effectuées <strong>de</strong><strong>la</strong> manière <strong>la</strong> plus individuelle possible par l’exploitant et par l’ONDRAF. L’ONDRAF a<strong>en</strong>suite examiné si les responsables financiers <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts sites constitu<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sprovisions pour garantir <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong> leurs frais nucléaires et, si oui, examiné si lesprovisions constituées ou les provisions dont <strong>la</strong> constitution est prévue sont suffisantes.La disponibilité <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s financiers qui sont liés à ces provisions a égalem<strong>en</strong>t étéétudiée. Elle a été évaluée sur <strong>la</strong> base d’une grille d’analyse développée par l’ONDRAFdans le cadre <strong>de</strong> cet exercice.Le « répertoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> localisation et <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> toutes les instal<strong>la</strong>tions nucléaires et <strong>de</strong>tous les lieux qui conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s substances radioactives » a été établi et t<strong>en</strong>u à jour parl’ONDRAF durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1998-2002 et durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2003-2007 sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>sautorisations <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sses I, II et III 27 qui sont octroyées aux exploitants <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tionset sites conformém<strong>en</strong>t aux dispositions du cadre réglem<strong>en</strong>taire et légal applicable,<strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t le RGPRI (cf. chapitre <strong>de</strong>ux : « Transposition <strong>en</strong> doit belge »).Le 30 novembre 2007, le répertoire établi par l’ONDRAF <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires et<strong>de</strong>s sites cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s substances radioactives, cont<strong>en</strong>ait 824 sites au total, à savoir785 sites <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse I, II ou III avec autorisation nucléaire et 39 sites sans autorisationnucléaire, mais cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s substances radioactives. Ces <strong>de</strong>rniers ont fait l’objet d’unedécision <strong>de</strong> principe d’interv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’AFCN.27 La c<strong>la</strong>sse I compr<strong>en</strong>d notamm<strong>en</strong>t les réacteurs nucléaires utilisés pour <strong>la</strong> production d’électricité ou pour<strong>la</strong> recherche sci<strong>en</strong>tifique, toutes les autres instal<strong>la</strong>tions dont les activités s’inscriv<strong>en</strong>t dans le cadre ducycle du combustible nucléaire et les gran<strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions qui produis<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s à gran<strong>de</strong>échelle pour <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine nucléaire ou qui trait<strong>en</strong>t et conditionn<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> nucléaires.La c<strong>la</strong>sse II compr<strong>en</strong>d notamm<strong>en</strong>t les cyclotrons et autres accélérateurs <strong>de</strong> particules ainsi que lesinstal<strong>la</strong>tions utilisées dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine nucléaire et <strong>la</strong> radiographie industrielle.La c<strong>la</strong>sse III compr<strong>en</strong>d le même type d’instal<strong>la</strong>tions que <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse II (à l’exception <strong>de</strong>s accélérateurs <strong>de</strong>particules), mais <strong>la</strong> radiotoxicité et les quantités <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s utilisées y sont plus restreintes quedans les instal<strong>la</strong>tions qui doiv<strong>en</strong>t possè<strong>de</strong>r une autorisation <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse II.69/166
Antwerp<strong>en</strong>G<strong>en</strong>tBrusselLiègeNamurfigure 15: Carte <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse I (<strong>en</strong> rouge), <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse II (<strong>en</strong> jaune) et <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse III (<strong>en</strong> vert)figurant dans le répertoire.L’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s substances radioactives liées aux sites repris dans le répertoire(inv<strong>en</strong>taire à un mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce déterminé) compr<strong>en</strong>d tous les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>existants, mais aussi, plus généralem<strong>en</strong>t, les matières qui seront produites lors dudéc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> l’assainissem<strong>en</strong>t et les matières techniques prés<strong>en</strong>tes sur le territoirebelge. Il compr<strong>en</strong>d : sur les sites avec autorisation :• <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> existants : <strong>en</strong>viron 18 200 m³ <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés, 6 000 m³<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non conditionnés et 9 100 sources <strong>de</strong> faible et <strong>de</strong> haute activité<strong>en</strong>capsulées. À ce<strong>la</strong> s’ajoute <strong>en</strong>core le cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions d’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>c<strong>la</strong>sse II UMTRAP sur le site d’Umicore à Ol<strong>en</strong>;• matériaux <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong> : <strong>en</strong>viron 44 700 m³ <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> nonconditionnés et 2 700 sources <strong>de</strong> faible et <strong>de</strong> haute activité <strong>en</strong>capsulées;• matières fissiles : pour mémoire (diffusion limitée aux titu<strong>la</strong>ires d’une habilitation <strong>de</strong>sécurité). sur les sites sans autorisation qui ont fait l’objet d’une décision <strong>de</strong> principed’interv<strong>en</strong>tion :• sources : 137 sources <strong>de</strong> faible activité sur les sites <strong>de</strong> 38 écoles;• <strong>déchets</strong> chimiques et radifères : <strong>en</strong>viron 200 000 m³ <strong>de</strong> terre et débris, dont unepartie est contaminée par du radium (décharge D1 d’Umicore à Ol<strong>en</strong>).70/166
Chapitre huitLa couverture <strong>de</strong>s coûtsCe chapitre traite d'abord <strong>de</strong> <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong>. La <strong>gestion</strong> courante se fon<strong>de</strong> sur <strong>de</strong>ux principes: Le premier est que <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> l'ONDRAF est supporté par les bénéficiaires<strong>de</strong> ses prestations, les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, selon le principe du« pollueur-payeur ». L'Etat belge est « cli<strong>en</strong>t » <strong>de</strong> l'ONDRAF <strong>en</strong> tant que propriétaire<strong>de</strong> certains <strong>déchets</strong> appart<strong>en</strong>ant aux passifs nucléaires, et uniquem<strong>en</strong>t à ce titre. Le second impose que, comme l'ONDRAF dispose du monopole <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> Belgique, celui-ci travaille à prix coûtant et est astreint àl'équilibre financier. En conséqu<strong>en</strong>ce, l'organisme n'est pas soumis aux aléas <strong>de</strong> <strong>la</strong> vieéconomique et peut travailler <strong>en</strong> toute indép<strong>en</strong>dance.Ce chapitre explique <strong>en</strong>suite comm<strong>en</strong>t, dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> prévisionnelle,l'ONDRAF définit les moy<strong>en</strong>s financiers qui seront nécessaires à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> dans le long terme.Le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> future est basé sur l'approvisionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ts fonds,dont le principe et <strong>la</strong> constitution sont comparables à ceux <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> p<strong>en</strong>sion. La<strong>de</strong>scription et l'alim<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> ces fonds constitu<strong>en</strong>t <strong>la</strong> colonne vertébrale <strong>de</strong> ce huitièmechapitre.Le premier et le plus important <strong>de</strong> ces fonds gérés par l'ONDRAF est le Fonds à LongTerme <strong>de</strong>stiné à couvrir les coûts <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>treposage, dont il sera question au chapitre neuf,du dépôt définitif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A, objet du chapitre dix, et du dépôt définitif<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégorie B et C, objet du chapitre onze.L'organisme gère égalem<strong>en</strong>t d'autres fonds, <strong>de</strong>stinés, par exemple, à couvrir les risquesd'insolvabilité d'un producteur <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, à financer l'assainissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>spassifs nucléaires existants ou à financer le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t futur <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions dont ilest lui-même propriétaire (instal<strong>la</strong>tion CILVA, bâtim<strong>en</strong>ts d'<strong>en</strong>treposage, ...). Ils sont décritsà leur tour, ainsi que leur mo<strong>de</strong> d'approvisionnem<strong>en</strong>t.Enfin, les exploitants d'instal<strong>la</strong>tions nucléaires appelées à être démantelées ou assainies(voir chapitre précé<strong>de</strong>nt) sont t<strong>en</strong>us <strong>de</strong> constituer, <strong>de</strong> leur côté, <strong>de</strong>s provisions <strong>de</strong>stinéesà couvrir les coûts futurs <strong>de</strong> ces opérations. En re<strong>la</strong>tion avec ces exploitants, l'ONDRAFévalue et vérifie régulièrem<strong>en</strong>t l'exist<strong>en</strong>ce, <strong>la</strong> suffisance et <strong>la</strong> disponibilité <strong>de</strong>s fonds ainsiconstitués, ceci dans le cadre <strong>de</strong> l'approbation <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et/ou <strong>de</strong>l'inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s passifs nucléaires.1. Principes du financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’organismeEn application <strong>de</strong> l’arrêté royal du 16 octobre 1991 qui définit ses missions, l’ONDRAFest astreint à respecter sur le p<strong>la</strong>n financier <strong>de</strong>ux principes fondam<strong>en</strong>taux (article 15) : d’une part, les dép<strong>en</strong>ses sont à mettre à charge <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong>s prestations, <strong>en</strong>ce compris les coûts <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> recherche appliquée et <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sprototypes et, d’autre part, les recettes doiv<strong>en</strong>t couvrir les dép<strong>en</strong>ses.Principe du “pollueur payeur”Les coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> pris <strong>en</strong> charge doiv<strong>en</strong>t être couverts par lesproducteurs <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong>, <strong>en</strong> application stricte du principe « pollueur payeur » (PPP).71/166
Il s'agit, pour l'ess<strong>en</strong>tiel, <strong>de</strong>s producteurs d’électricité et <strong>de</strong>s producteurs/utilisateurs <strong>de</strong>substances radioactives. On distingue : les « grands producteurs », c’est-à-dire les producteurs qui font <strong>en</strong>lever trèsrégulièrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s quantités <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> qui peuv<strong>en</strong>t être importantes et quiont conclu à cet effet un contrat d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t avec l’ONDRAF; il s’agit principalem<strong>en</strong>t<strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises <strong>de</strong> l’industrie électronucléaire. les « petits producteurs conv<strong>en</strong>tionnés », principalem<strong>en</strong>t les hôpitaux et c<strong>en</strong>tres <strong>de</strong>recherche. Ces producteurs sont généralem<strong>en</strong>t réguliers mais les quantités qu'ilsproduis<strong>en</strong>t sont plus réduites. Ils ont égalem<strong>en</strong>t conclu <strong>de</strong>s contrats d'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t avecl’ONDRAF; les « petits producteurs non conv<strong>en</strong>tionnés », à savoir les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> qui ne doiv<strong>en</strong>t qu'occasionnellem<strong>en</strong>t faire <strong>en</strong>lever <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>. Ils ne sontpas liés à l'ONDRAF par <strong>de</strong>s contrats. L'ONDRAF leur facture ses prestations à <strong>de</strong>starifs all-in, compr<strong>en</strong>ant le traitem<strong>en</strong>t et le conditionnem<strong>en</strong>t, l’<strong>en</strong>treposage et le dépôtfinal.Un important bénéficiaire <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> l'ONDRAF est l’État belge, qui n'est pasdirectem<strong>en</strong>t producteur <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> mais qui porte <strong>la</strong> responsabilité financière <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong> certains passifs. L'acte <strong>de</strong> création <strong>de</strong> l'anci<strong>en</strong>ne usine <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>tEurochemic prévoyait explicitem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> reprise par l’État belge <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions, à l'issue<strong>de</strong> <strong>la</strong> phase d'exploitation. Il était donc implicitem<strong>en</strong>t prévu que l’État belge aurait un jourà supporter <strong>la</strong> charge du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions. Par ailleurs, <strong>en</strong> tant quepouvoir <strong>de</strong> tutelle d'institutions comme le SCK·CEN à Mol ou l'IRE à Fleurus, l’État belgeassume pareillem<strong>en</strong>t ses responsabilités <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>ces sites <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues obsolètes: il a à cet effet chargé l’ONDRAF <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong>démantèlem<strong>en</strong>t et d’assainissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s « passifs techniques nucléaires» : le « passiftechnique BP1-BP2 » (site <strong>de</strong> l'anci<strong>en</strong>ne usine <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t Eurochemic à Dessel etanci<strong>en</strong> site Waste <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> du SCK·CEN à Mol), le « passif techniqueSCK·CEN » (les anci<strong>en</strong>nes instal<strong>la</strong>tions du SCK·CEN à Mol, notamm<strong>en</strong>t le réacteur <strong>de</strong>puissance pilote BR3, <strong>en</strong> cours <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t) et le « passif technique IRE » (site <strong>de</strong>l’IRE à Fleurus).Dans le système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> financière <strong>de</strong> l'organisme, l’État belge est assimilé à ungrand producteur. Précisons toutefois que l'Etat, <strong>en</strong> tant que pouvoir <strong>de</strong> tutelle,n'intervi<strong>en</strong>t pas directem<strong>en</strong>t dans les frais <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'ONDRAF.Une imposition supplém<strong>en</strong>taire <strong>de</strong> l'arrêté royal (article 3, §2) est que l'ONDRAF couvreles coûts <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> oeuvre <strong>de</strong> son programme <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> par <strong>de</strong>s conv<strong>en</strong>tionsbi<strong>la</strong>térales avec les principaux producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Des conv<strong>en</strong>tions séparées, intitulées « modalités <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> », sont égalem<strong>en</strong>t établiespour ce qui est du financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s passifs techniques, ces <strong>de</strong>rnières impliquant l'État.On notera aussi que l’organisme est autorisé à contracter <strong>de</strong>s emprunts pouvant êtreassortis <strong>de</strong> <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> l’État pour financer ses investissem<strong>en</strong>ts.Services réalisés à prix coûtantIl est par ailleurs <strong>de</strong>mandé que les coûts soi<strong>en</strong>t facturés au prix <strong>de</strong> revi<strong>en</strong>t (« prixcoûtant ») et répartis <strong>en</strong>tre les différ<strong>en</strong>ts bénéficiaires dont question, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>critères objectifs approuvés par le Conseil d’administration. On notera que <strong>la</strong> stricteapplication <strong>de</strong> ces contraintes financières est particulièrem<strong>en</strong>t difficile <strong>de</strong> par <strong>la</strong> naturemême <strong>de</strong>s services r<strong>en</strong>dus et <strong>de</strong> leurs implications sur le très long terme. C’est pourquoile légis<strong>la</strong>teur a quelque peu atténué <strong>la</strong> portée du prix coûtant <strong>en</strong> introduisant <strong>la</strong> notion <strong>de</strong>« charges estimatives » lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> travaux différés à long terme (article 16).Par ailleurs, comme on le reverra plus loin, une réserve <strong>de</strong> 5 % sur le chiffre d’affaires<strong>de</strong>s services prestés est constituée dans un fonds spécial pour faire face aux situations<strong>de</strong> faillite ou d’insolvabilité <strong>de</strong> producteurs ou dét<strong>en</strong>teurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Cetteréserve est alim<strong>en</strong>tée par les producteurs et p<strong>la</strong>fonnée, <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t, à 11.4 M€.72/166
MécanismesLes mécanismes <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'ONDRAF vari<strong>en</strong>t selon le type <strong>de</strong> service presté.Une partie <strong>de</strong>s services offerts par l'ONDRAF aux producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> est facturé auxbénéficiaires sur une base tarifaire. C'est le cas <strong>de</strong>s services qui ont un li<strong>en</strong> direct etimmédiat avec le déchet pris <strong>en</strong> charge. On distingue : les services liés à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante qui compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t, pour l'ess<strong>en</strong>tiel, l'acceptation,<strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge, le transport, le traitem<strong>en</strong>t et le conditionnem<strong>en</strong>t parBELGOPROCESS <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> (voir section 2); les missions <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme, qui compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t l'<strong>en</strong>treposage intérimaire, lesuivi <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> dans le temps et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt final (voir section 3).On verra que les mécanismes <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante diffèr<strong>en</strong>t <strong>de</strong>smécanismes <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme. Ces <strong>de</strong>ux mécanismes necouvr<strong>en</strong>t pas l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s missions ou tâches <strong>de</strong> l'organisme. Un certain nombre <strong>de</strong>ses missions ou tâches courantes fait l'objet <strong>de</strong> mécanismes <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t spécifiques.C'est le cas : <strong>de</strong> l'alim<strong>en</strong>tation du Fonds d’insolvabilité (section 4); <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission d'inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s passifs nucléaires (section 5); <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s passifs techniques nucléaires (section 6); <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong> types variés réalisées sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> budgets (pluri)annuels(section 7).Enfin, on abor<strong>de</strong>ra (section 8) le problème du financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s missions à long termedans le cas particulier où un exploitant d'une instal<strong>la</strong>tion nucléaire arrivée <strong>en</strong> fin <strong>de</strong> viequitte le système <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t conv<strong>en</strong>tionnel.2. Les mécanismes <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s services <strong>de</strong><strong>gestion</strong> couranteL'ONDRAF doit pouvoir garantir, <strong>en</strong> toutes circonstances, le financem<strong>en</strong>t correct <strong>de</strong>l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> ses frais <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> courante. Les contrats d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t conclus avec lesproducteurs détermin<strong>en</strong>t les modalités <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante, <strong>en</strong>particulier <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t c<strong>en</strong>tralisé <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> parBELGOPROCESS. La facturation se fait sur une base tarifaire, <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> quantité<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>en</strong>levés. Les tarifs d'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t sont repris par catégories <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> dansles annexes aux contrats d'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t. Chaque tarif se décompose <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux parties: <strong>la</strong>partie <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s frais proportionnels et <strong>la</strong> partie <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong>couverture <strong>de</strong>s frais fixes.Les frais fixes constitu<strong>en</strong>t <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s frais qui est indép<strong>en</strong>dante <strong>de</strong>s quantités <strong>de</strong> <strong>déchets</strong><strong>en</strong>levés. En d'autres mots, ces frais exist<strong>en</strong>t que l'ONDRAF <strong>en</strong>lève <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> ou non.Le principe appliqué pour garantir <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong> ces frais fixes est celui <strong>de</strong> <strong>la</strong>réservation <strong>de</strong> capacité <strong>de</strong>s frais fixes. La réservation <strong>de</strong> capacité est déterminée commesuit : les charges financières et les frais d’exploitation fixes sont répartis sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>critères objectifs <strong>en</strong>tre tous les producteurs via une clé <strong>de</strong> répartition; <strong>la</strong> réservation <strong>de</strong> capacité représ<strong>en</strong>te l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s charges et frais d’exploitationfixes dont le producteur s’<strong>en</strong>gage à assumer le financem<strong>en</strong>t selon cette clé <strong>de</strong>répartition. Les charges fixes (hors exploitation) compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t les amortissem<strong>en</strong>tsfinanciers, les charges <strong>de</strong>s investissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions et les coûts <strong>de</strong> stand-byopérationnel (OSB) pour le traitem<strong>en</strong>t et le conditionnem<strong>en</strong>t. Ces chargescompr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t les provisions pour le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t futur <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions.Comm<strong>en</strong>t se calcule <strong>la</strong> clé <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s frais fixes ? La clé <strong>de</strong> répartition pour letraitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t est va<strong>la</strong>ble pour cinq ans. Elle est basée sur une moy<strong>en</strong>ne73/166
<strong>de</strong>s quantités <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non conditionnés, c<strong>la</strong>ssés par catégorie, réellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>levéesau cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années et <strong>de</strong>s quantités contr<strong>actuelle</strong>s annoncées par leproducteur pour les cinq années à v<strong>en</strong>ir. C’est l’approche <strong>la</strong> plus objective vu qu’elle ti<strong>en</strong>tcompte à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong>s quantités <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> annoncées par les producteurs et <strong>de</strong>squantités réellem<strong>en</strong>t traitées dans les <strong>de</strong>rnières années. Si <strong>la</strong> production effective <strong>de</strong><strong>déchets</strong> diffère s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s prévisions pour une pério<strong>de</strong> quinqu<strong>en</strong>nale déterminée,<strong>la</strong> situation est rectifiée dans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> suivante, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s quantités réellem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>levées et <strong>de</strong>s nouvelles estimations pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> suivante.Pour ce qui est <strong>de</strong>s petits producteurs, les frais fixes <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong> leur <strong>déchets</strong>ont bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du inclus dans les tarifs all-in. Mais comm<strong>en</strong>t estime-t-on <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s petitsproducteurs dans <strong>la</strong> clé <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s frais fixes, compte t<strong>en</strong>u du caractère trèsoccasionnel <strong>de</strong> ces <strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>ts ? Ce<strong>la</strong> se fait simplem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> utilisant les donnéesstatistiques <strong>de</strong>s cinq années écoulées. Il est donc possible qu’il y ait, à certainespério<strong>de</strong>s, un manque à gagner parce que les quantités <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> livrées par les petitsproducteurs sont inférieures aux prévisions; ce manque à gagner ne peut pas êtrecomp<strong>en</strong>sé par ces mêmes petits producteurs puisque leur re<strong>la</strong>tion avec l'ONDRAF estsouv<strong>en</strong>t unique. Le manque à gagner év<strong>en</strong>tuel pour <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong>s petits producteursà <strong>la</strong> réservation <strong>de</strong> capacité est alors redistribué sur les différ<strong>en</strong>ts gros producteurs, via <strong>la</strong>clé <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong> <strong>la</strong> réservation <strong>de</strong> capacité.Qu'<strong>en</strong> est-il <strong>de</strong> <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s frais proportionnels ? Les charges et frais d’exploitationvariables chez BELGOPROCESS sont facturées sur <strong>la</strong> base d’un tarif proportionnel parcatégorie <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non conditionnés qui couvre l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses variables <strong>de</strong><strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante.Les tarifs proportionnels sont révisés périodiquem<strong>en</strong>t. La réservation <strong>de</strong> capacité et lestarifs proportionnels sont in<strong>de</strong>xés annuellem<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’indice Agoria.3. Les mécanismes <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong><strong>gestion</strong> à long terme (FLT)3.1 Dispositions légales spécifiquesLa couverture <strong>de</strong>s missions à long terme fait l'objet d'un mécanisme particulier. L’article16 <strong>de</strong> l’arrêté royal du 16 octobre 1991 autorise l’ONDRAF à constituer un fondspermettant d’assurer <strong>la</strong> disponibilité <strong>de</strong>s ressources financières nécessaires pour couvrirle coût <strong>de</strong> ses missions à long terme.Des conv<strong>en</strong>tions, ou accords, conclus <strong>en</strong>tre l’ONDRAF et les producteurs définiss<strong>en</strong>t lesdispositions selon lesquelles ce fonds doit fonctionner. Il est précisé dans cet article que : L’organisme pourra, moy<strong>en</strong>nant l’accord du Ministre <strong>de</strong>s affaires économiques,constituer un fonds <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s missions à long terme, le Fonds à Long Terme(FLT); ce fonds est appelé à couvrir le coût <strong>de</strong>s activités nécessaires à l'<strong>en</strong>treposage età l’évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, notamm<strong>en</strong>t leur dépôt év<strong>en</strong>tuel <strong>en</strong> couchesgéologiques; Ce fonds couvrira égalem<strong>en</strong>t, le cas échéant, les coûts surv<strong>en</strong>ant après <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>50 ans qui serai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drés par <strong>de</strong>s défauts <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés pris <strong>en</strong>charge par l’organisme et non prévisibles au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leur réception; Ce fonds sera alim<strong>en</strong>té par <strong>de</strong>s contributions prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>calculées <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s charges estimatives imputables à leurs propres <strong>déchets</strong>; Le Conseil d’administration soumettra à l’approbation du Ministre <strong>de</strong>s affaireséconomiques les règles permettant d’établir le montant <strong>de</strong>s contributions et fixant lesconditions <strong>de</strong> l’utilisation du fonds.L’article 16 bis <strong>de</strong> ce même arrêté indique que: Le fonds est géré conformém<strong>en</strong>t aux dispositions <strong>de</strong>s conv<strong>en</strong>tions conclues <strong>en</strong>trel’ONDRAF et les producteurs concernés;74/166
Les contributions à ce fonds sont établies sur <strong>la</strong> base d’un programme <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ceé<strong>la</strong>boré avec les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> et susceptible d’être revu. Ces contributionssont calculées <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s charges estimatives imputables aux <strong>déchets</strong> produits; L’ONDRAF est t<strong>en</strong>u d’établir et <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ter annuellem<strong>en</strong>t un rapport sur <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>technique et financière du programme d’évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés.3.2 Evaluation <strong>de</strong>s besoins financiers et du montant <strong>de</strong>scontributionsLe Fonds à Long Terme (FLT) est alim<strong>en</strong>té, comme pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> courante, par <strong>de</strong>spaiem<strong>en</strong>ts tarifaires. Ces contributions sont dues par l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s producteursprincipaux ou occasionnels et par les fonds <strong>de</strong>s passifs nucléaires (sous <strong>la</strong> responsabilité<strong>de</strong> l’Etat), à chaque fois que l’ONDRAF accepte <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre un déchet <strong>en</strong> charge.L'ONDRAF détermine les tarifs par type d’opération (<strong>en</strong>treposage, mise <strong>en</strong> dépôt final) etpar type <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> distinguant <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s coûts. Ici égalem<strong>en</strong>t, l’ONDRAF a misau point un mécanisme qui lui garantit <strong>en</strong> toutes circonstances: <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong> ses coûts fixes (<strong>en</strong>tre autres : coût <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> projet, <strong>de</strong>l’aménagem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s infrastructures d’<strong>en</strong>treposage et <strong>de</strong> dépôt final, <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong>service, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fermeture et <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s dépôts final) et <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong> ses coûts variables (principalem<strong>en</strong>t coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>et <strong>de</strong>s manut<strong>en</strong>tions nécessitées par leur <strong>en</strong>treposage provisoire ou leur mise <strong>en</strong>dépôt final)au fur et à mesure qu’ils apparaiss<strong>en</strong>t.Pour remplir ses missions et, <strong>en</strong> particulier, évaluer ces coûts, l’ONDRAF doitnaturellem<strong>en</strong>t connaître les types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qu’il aura à gérer et leurs quantitésrespectives. La typologie <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> et les modalités <strong>de</strong> vérifications techniques etadministratives auxquelles seront soumis les <strong>déchets</strong> avant acceptation, ont été définies.Quant aux prévisions <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> livraison <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, elles sont au cœur <strong>de</strong>sconv<strong>en</strong>tions conclues avec les producteurs pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> et l’approvisionnem<strong>en</strong>t duFLT.Les conv<strong>en</strong>tions conclues avec les producteurs concili<strong>en</strong>t les besoins <strong>de</strong> l’ONDRAF,autrem<strong>en</strong>t dit, <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong>s fonds nécessaires pour remplir ses missions àlong terme <strong>en</strong> toute sûreté quel que soit le volume <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qu’il aurait à gérer, avectrois souhaits légitimes <strong>de</strong>s principaux producteurs : <strong>la</strong> transpar<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’ONDRAF dans l’estimation du coût <strong>de</strong> ses missions à long termeet l'équité dans <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong> ceux-ci <strong>en</strong>tre les producteurs; <strong>la</strong> stabilité <strong>de</strong>s tarifs durant <strong>de</strong> longues pério<strong>de</strong>s (autant que faire se peut); <strong>la</strong> possibilité pour chaque producteur <strong>de</strong> se retirer du Fonds à Long Terme dans <strong>de</strong>sconditions financières acceptables au cas où il cesserait ses activités et n’aurait plus<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> à livrer.Ces conv<strong>en</strong>tions stipul<strong>en</strong>t les conditions techniques et financières auxquelles l’ONDRAFaccepte <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s producteurs sous sa responsabilité à certainesconditions, notamm<strong>en</strong>t le respect <strong>de</strong>s Critères d'acceptation (cf. chapitre trois), et à untarif fixé pour une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 10 ans pour <strong>de</strong>s prévisions <strong>de</strong> livraison <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>contr<strong>actuelle</strong>s (avec prise <strong>en</strong> compte d’un taux d’actualisation et <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>tion),év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t révisable après une première pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 5 ans.Deux facteurs <strong>de</strong> pondération intervi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s tarifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Le premier facteur <strong>de</strong> pondération correspond à <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> prévoir une marge pourimprévus. Cette marge doit couvrir, indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t du volume <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> acceptés, lesincertitu<strong>de</strong>s sur les coûts qui sont importantes <strong>en</strong> raison du caractère « pionnier » <strong>de</strong>sopérations à financer. Des calculs sont donc effectués sur <strong>la</strong> base d’une métho<strong>de</strong> diteEPRI, développée par l’organisme du même nom (Electricity Power Research Institute,75/166
Etats-Unis) et utilisée pour le calcul économique <strong>de</strong> projets nucléaires. Cette métho<strong>de</strong>peut conduire au doublem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> certains coûts bruts estimés par les experts <strong>en</strong> conceptsd’évacuation.Le second facteur <strong>de</strong> pondération <strong>de</strong>s tarifs correspond à <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> compte du fait quele p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s provisions du FLT p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> qui s’écoulera <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> perception<strong>de</strong>s sommes et leur dép<strong>en</strong>se effective, soit plusieurs dizaines d’années dans certainscas, génèrera <strong>de</strong>s intérêts que l’ONDRAF estime <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t à 2 % hors inf<strong>la</strong>tion. Lacapitalisation <strong>de</strong> ces intérêts, c'est-à-dire leur p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t, est égalem<strong>en</strong>t prise <strong>en</strong> compte.En termes financiers, l’opération considérée ici est celle d’actualisation <strong>de</strong>s coûts, sur <strong>la</strong>base d’un taux net d’actualisation estimé à 2 %. Ce taux d'actualisation fait <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>tl'objet d'un réexam<strong>en</strong> pour vérifier notamm<strong>en</strong>t s'il reste compatible avec l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong>conjoncture économique.A titre d’illustration, <strong>la</strong> figure ci-<strong>de</strong>ssous montre une simu<strong>la</strong>tion d’évolution <strong>de</strong>s sommesdisponibles sur le FLT pour l’évacuation (cumul <strong>de</strong>s recettes et retrait <strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses). A <strong>la</strong>fin <strong>de</strong> l'exploitation, seuls subsisteront les moy<strong>en</strong>s nécessaires pour financer l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et<strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s dépôts après leur fermeture.Avai<strong>la</strong>ble funds for disposal - base case14012010080M€604020Cash outCash inFLT0-20200820112014201720202023202620292032203520382041204420472050205320562059-40-60figure 16: Simu<strong>la</strong>tion d’un scénario d’évolution du montant disponible pour le FLT pour <strong>la</strong>mise <strong>en</strong> dépôt final. Le montant résiduel à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> fermeture du site <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong>vraitpermettre <strong>de</strong> générer <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t suffisantes pour <strong>en</strong>core couvrir les fraisd’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce, spécialem<strong>en</strong>t ceux re<strong>la</strong>tifs au dépôt <strong>en</strong> surface, qui <strong>de</strong>vra êtresurveillé p<strong>en</strong>dant 200 à 300 ans.3.3 Trois idées <strong>de</strong> base assurant <strong>la</strong> viabilité du FLTIl est impératif pour garantir une <strong>gestion</strong> responsable <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, quel'ONDRAF dispose <strong>en</strong> tous temps <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s nécessaires à l'exécution <strong>de</strong> sesnombreuses missions, même sur le très long terme. Afin d'être certain que le FLT luipermettra <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong>s montants nécessaires pour couvrir le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à longterme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, l’ONDRAF a mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce un mécanisme qui lui garantit <strong>en</strong>toutes circonstances <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong> ses coûts fixes et qui lui assure <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>ses coûts variables au fur et à mesure qu’ils apparaiss<strong>en</strong>t, mécanisme qui repose sur lestrois idées fondam<strong>en</strong>tales développées plus bas, qui sont les suivantes:76/166
<strong>la</strong> réservation <strong>de</strong> capacité, ou notification contr<strong>actuelle</strong>, par chaque producteurprincipal, <strong>de</strong> son programme complet <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, afin <strong>de</strong> permettre àl’ONDRAF <strong>de</strong> dim<strong>en</strong>sionner ses instal<strong>la</strong>tions, d’<strong>en</strong> estimer les coûts fixes et <strong>de</strong> répartir<strong>en</strong>suite équitablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre les producteurs principaux <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s coûts fixes qui leurrevi<strong>en</strong>t; le paiem<strong>en</strong>t tarifaire, ou approvisionnem<strong>en</strong>t du FLT par l’application d’un tarif unitairechaque fois que l’ONDRAF accepte <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> sous sa responsabilité, afin <strong>de</strong> couvrirà <strong>la</strong> fois les coûts fixes et les coûts variables imputables à ces <strong>déchets</strong>; <strong>la</strong> garantie contr<strong>actuelle</strong> <strong>de</strong> chaque producteur principal, d’un montant à tout mom<strong>en</strong>tégal à <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre le montant total <strong>de</strong>s coûts fixes imputables à <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong><strong>déchets</strong> annoncée par ce producteur et <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s coûts fixes qu’il a déjà payée viases contributions tarifaires.En réalité, le mécanisme d’approvisionnem<strong>en</strong>t du FLT ne s’applique tel quel qu’auxproducteurs principaux. Pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s passifs et <strong>de</strong>s producteurs occasionnels, <strong>en</strong>effet, c’est l’ONDRAF qui estime les capacités d’<strong>en</strong>treposage et d’<strong>en</strong>fouissem<strong>en</strong>trequises, sur <strong>la</strong> base respectivem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> son programme d’assainissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s passifs, et<strong>de</strong> ses propres projections quant à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> par les producteursoccasionnels. Ces <strong>de</strong>rniers ne se voi<strong>en</strong>t par ailleurs pas imposer <strong>de</strong> garantiecontr<strong>actuelle</strong>.3.4 Réservation <strong>de</strong> capacité pour <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s coûtsfixesPour pouvoir répartir équitablem<strong>en</strong>t ses coûts fixes <strong>en</strong>tre les principaux producteurs,l’ONDRAF doit, d’une part, pouvoir estimer les coûts <strong>en</strong> question et, d’autre part, disposer<strong>de</strong> clés <strong>de</strong> répartition objectives. Pour pouvoir estimer les coûts fixes, il doit choisir <strong>de</strong>shypothèses réalistes quant aux solutions possibles <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt final <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> et aux cal<strong>en</strong>driers <strong>de</strong> construction et d’exploitation <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tionscorrespondantes. Les bases <strong>de</strong> travail ret<strong>en</strong>ues pour les accords <strong>en</strong> cours avec lesproducteurs sont le dépôt <strong>en</strong> surface pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A, tel qu'il a étédécidé par le conseil <strong>de</strong>s ministres du 23 juin 2006, et l'hypothèse du dépôt <strong>en</strong>profon<strong>de</strong>ur pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C. Pour pouvoir <strong>en</strong>suite établir <strong>de</strong>s clés<strong>de</strong> répartition objectives pour ces coûts, l’ONDRAF doit avoir une bonne idée <strong>de</strong>squantités totales <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qu'il aura à gérer. Il doit donc connaîtreles programmes globaux <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s principaux producteurs, qui sontt<strong>en</strong>us <strong>de</strong> les lui annoncer par voie contr<strong>actuelle</strong>. Actuellemnt, ces programmes se bas<strong>en</strong>tsur <strong>de</strong>ux autres hypothèses importantes, à savoir d'une part que <strong>la</strong> durée d’exploitation<strong>de</strong>s réacteurs nucléaires commerciaux belges <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong> service est <strong>de</strong> par <strong>la</strong> loilimitée à 40 ans (le <strong>de</strong>rnier étant donc arrêté <strong>en</strong> 2025 <strong>en</strong>viron) et d'autre part que <strong>la</strong>totalité <strong>de</strong>s combustibles usés qui ont été ou seront déchargés <strong>de</strong> ces réacteurs est<strong>de</strong>stinée à être retraitée.Les hypothèses <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’ONDRAF et les quantités contr<strong>actuelle</strong>s annoncées par lesproducteurs sont révisables tous les dix ans, ou avant ce terme <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> forcemajeure 28 . Il est <strong>en</strong>fin <strong>en</strong>visageable que certains producteurs ai<strong>en</strong>t fortem<strong>en</strong>t sur- ousous-estimé les quantités <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qu'ils remettront à l'ONDRAF. Dans <strong>de</strong> tels cas,l’ONDRAF pourrait être am<strong>en</strong>é à revoir ses tarifs ou à modifier les clés <strong>de</strong> répartition<strong>en</strong>tre producteurs.L’annonce <strong>de</strong> quantités contr<strong>actuelle</strong>s par les principaux producteurs signifie <strong>en</strong> réalitéqu'ils <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt à l’ONDRAF <strong>de</strong> prévoir dans ses instal<strong>la</strong>tions d’<strong>en</strong>treposage provisoireet <strong>de</strong> dépôt final <strong>la</strong> capacité nécessaire pour abriter leurs <strong>déchets</strong> : c’est <strong>la</strong> réservation <strong>de</strong>capacité, que l’ONDRAF utilise pour dim<strong>en</strong>sionner ses instal<strong>la</strong>tions ainsi que pour répartir<strong>en</strong>tre ces producteurs <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s coûts fixes qui leur revi<strong>en</strong>t, au prorata <strong>de</strong>s quantités et<strong>de</strong>s types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qu'ils ont annoncés.28 Il se pourrait par exemple que les autorités déci<strong>de</strong>nt finalem<strong>en</strong>t que certains <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie Asoi<strong>en</strong>t pour diverses raisons dirigés vers l’évacuation géologique. Il est égalem<strong>en</strong>t possible qu'il soitdéfinitivem<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>oncé au retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s combustibles usés.77/166
3.5 Paiem<strong>en</strong>ts tarifaires couvrant les coûts fixes et lescoûts variablesLe FLT est alim<strong>en</strong>té par les paiem<strong>en</strong>ts tarifaires <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s producteurs,principaux et occasionnels, ainsi que par les fonds <strong>de</strong>s passifs nucléaires, à chaque foisque l'ONDRAF accepte <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> sous sa responsabilité. Révisables tous les dix ans,mais aussi év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t après <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s intermédiaires <strong>de</strong> cinq ans, à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong>contrôles périodiques <strong>de</strong> l’équilibre financier, ces tarifs sont exprimés <strong>en</strong> euros courantspar m 3 .Ils sont établis <strong>de</strong> façon telle que l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s contributions au FLT pour un type donné<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> soit exactem<strong>en</strong>t égal à <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s coûts, fixes et variables, qui leur sontimputables.Les révisions périodiques <strong>de</strong>s tarifs permet <strong>de</strong> les adapter à l’évolution <strong>de</strong>s donnéestechniques, réglem<strong>en</strong>taires, économiques et financières, et donc, <strong>en</strong> partant <strong>de</strong> chargesestimées <strong>de</strong> façon <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus précise, <strong>de</strong> converger par étapes vers les coûtsunitaires réels.Si <strong>la</strong> production totale <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> d'un producteur principal dépasse le volume <strong>de</strong><strong>déchets</strong> qu'il a annoncé, il paie donc le tarif unitaire pour l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> ses <strong>déchets</strong>,quitte à bénéficier d'une ristourne lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> révision <strong>de</strong> l'accord. Par contre, tant qu'il n'apas atteint sa réservation <strong>de</strong> capacité, le mécanisme <strong>de</strong>s garanties contr<strong>actuelle</strong>s peut<strong>en</strong>trer <strong>en</strong> jeu au terme <strong>de</strong> chaque accord déc<strong>en</strong>nal.3.6 Garantie contr<strong>actuelle</strong> assurant <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>scoûts fixesQuoique le risque <strong>de</strong> défail<strong>la</strong>nce du FLT puisse être comp<strong>en</strong>sé au moins partiellem<strong>en</strong>tpar une politique <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts rigoureuse, l’ONDRAF n’a pas <strong>la</strong> certitu<strong>de</strong> a priori queles paiem<strong>en</strong>ts tarifaires effectués pour les <strong>déchets</strong> qu'il accepte sous sa responsabilitésuffiront à eux seuls à couvrir ses coûts fixes à long terme. En effet, certains producteurspourrai<strong>en</strong>t lui confier moins <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> que prévu. Pour parer à ce risque, l’ONDRAF ainstauré le mécanisme <strong>de</strong>s garanties contr<strong>actuelle</strong>s, qui est intimem<strong>en</strong>t lié aux quantitéscontr<strong>actuelle</strong>s.Chaque producteur principal, et l’ONDRAF pour le compte <strong>de</strong>s passifs techniquesnucléaires, est am<strong>en</strong>é à couvrir <strong>la</strong> quote-part <strong>de</strong>s coûts fixes qui lui est attribué par <strong>la</strong>réservation <strong>de</strong> capacité. La part <strong>de</strong> <strong>la</strong> réservation <strong>de</strong> capacité qui reste à honorer aprèspaiem<strong>en</strong>t du tarif fixe au cours <strong>de</strong>s transferts constitue <strong>la</strong> garantie contr<strong>actuelle</strong> et estactée dans les comptes du producteur comme un sol<strong>de</strong> à financer. Ce montant évolutifreste un <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t ferme et irrévocable. Il sera payé <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> cessation <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tionconv<strong>en</strong>tionnelle avec l'ONDRAF.Le mécanisme <strong>de</strong>s garanties contr<strong>actuelle</strong>s prévoit donc que chaque producteur principals’<strong>en</strong>gage à verser au FLT au minimum le montant <strong>de</strong>s coûts fixes re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> réservation<strong>de</strong> capacité qu’il a effectuée. Il assure donc à l'ONDRAF que le montant nécessaire pourcouvrir les coûts fixes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> annoncéscontr<strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t a effectivem<strong>en</strong>t été constitué via le FLT pour les <strong>déchets</strong> dont il a déjàaccepté <strong>la</strong> responsabilité, et sous forme d’une garantie, pour les <strong>déchets</strong> qui ne lui ontpas <strong>en</strong>core été confiés.La garantie contr<strong>actuelle</strong> <strong>de</strong> chaque producteur est calculée <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière que lescoûts fixes et son montant équivaut à tout mom<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>scoûts fixes imputables à <strong>la</strong> quantité totale <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> annoncée par ce producteur et lescoûts fixes qu'il a déjà couverts par le biais <strong>de</strong> ses paiem<strong>en</strong>ts tarifaires au FLT. Cettegarantie n’est toutefois exigible qu’<strong>en</strong> cas <strong>de</strong> non r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t, par le producteur, <strong>de</strong>l’accord qui le lie à l’ONDRAF, et doit alors être intégralem<strong>en</strong>t honorée avant l'expiration<strong>de</strong> celui-ci. En cas <strong>de</strong> r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'accord par contre, <strong>la</strong> garantie continuesimplem<strong>en</strong>t à courir.Le principe <strong>de</strong>s garanties contr<strong>actuelle</strong>s a donc un caractère parfaitem<strong>en</strong>t éthique car illibère les générations futures <strong>de</strong>s charges financières liées à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s78/166
<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> que leur lègueront les générations <strong>actuelle</strong>s, <strong>en</strong> faisant <strong>en</strong> sorte quel'ONDRAF puisse <strong>en</strong> toutes circonstances couvrir ses coûts fixes, même s'il doit gérermoins <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> que prévu.3.7 Gestion du FLTDes mécanismes permett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> donner aux producteurs et au public toutes lesassurances que le FLT est bi<strong>en</strong> géré, et qu'il n'est pas utilisé à <strong>de</strong>s fins autres que cellesauxquelles il est <strong>de</strong>stiné, autrem<strong>en</strong>t dit que l'arg<strong>en</strong>t nécessaire pour financer l'<strong>en</strong>semble<strong>de</strong>s opérations techniques requises sera effectivem<strong>en</strong>t disponible le mom<strong>en</strong>t v<strong>en</strong>u. Entreautres, un comité d’avis et d’audit a été constitué. Composé notamm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tants<strong>de</strong>s producteurs, il a un droit <strong>de</strong> regard perman<strong>en</strong>t sur les comptes du FLT, dont il vérifie<strong>la</strong> conformité aux programmes <strong>de</strong> l’ONDRAF.Largem<strong>en</strong>t inspiré <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> p<strong>en</strong>sion, l’outil financier que constitue le FLT les dépassetoutefois <strong>en</strong> complexité, puisqu'il a trait à <strong>de</strong>s activités et surtout à <strong>de</strong>s durées sansprécé<strong>de</strong>nt et que le risque <strong>de</strong> sous-estimation involontaire <strong>de</strong>s coûts réels n'est pas nul,malgré toutes les précautions prises lors du calcul <strong>de</strong>s marges d’incertitu<strong>de</strong>.Comme dans le cas <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> p<strong>en</strong>sion, l’idée du FLT est <strong>de</strong> comp<strong>en</strong>ser au moins <strong>en</strong>partie ce risque grâce à une stratégie adéquate <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts permettant <strong>de</strong> générer<strong>de</strong>s recettes supérieures à celles utilisées dans les calculs, qui correspon<strong>de</strong>nt à unr<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t net <strong>de</strong> capitalisation faible estimé <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t à 2 % par l’ONDRAF. Lacapitalisation peut donc être considérée comme un <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> du risque.Toutefois, l’arrêté royal du 4 avril 2003 a imposé à l’ONDRAF <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cer ses avoirsfinanciers <strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>ts financiers <strong>de</strong> l’Etat fédéral, ce qui bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du réduit lespossibilités <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts plus fructueux, mais égalem<strong>en</strong>t les choix <strong>de</strong> stratégie et lesr<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts pot<strong>en</strong>tiels. Cet arrêté royal a été remp<strong>la</strong>cé par l'arrêté royal du 1 er mai 2006qui introduit un peu plus <strong>de</strong> souplesse au niveau <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> l'organisme.Le Comité d’avis et d’audit, qui a été créé <strong>en</strong> réponse à l’article 16 bis <strong>de</strong> l’arrêté royal <strong>de</strong>1991, a un droit <strong>de</strong> regard sur <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> du FLT. Il est composé <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tants <strong>de</strong>l’ONDRAF, <strong>de</strong> l’Etat belge, ainsi que <strong>de</strong> Synatom et d'Electrabel, qui sont les <strong>de</strong>ux plusgrands producteurs. Tous peuv<strong>en</strong>t s’y faire assister d’un ou <strong>de</strong> plusieurs experts <strong>de</strong> leurchoix. Il a pour mission <strong>de</strong> suivre et <strong>de</strong> vérifier <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> financière du FLT, tâche qu’ilpeut confier à un bureau d’audit financier, et se réunit au moins une fois par an, àl’initiative <strong>de</strong> l’ONDRAF ou <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong>s producteurs. Il donne <strong>de</strong>s avis sur <strong>la</strong> stratégieglobale <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> et peut <strong>en</strong> particulier se prononcer sur les stratégies <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t. Ilvérifie égalem<strong>en</strong>t que les montants prélevés dans le FLT sont exclusivem<strong>en</strong>t affectés aufinancem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses liées aux missions à long terme <strong>de</strong> l’ONDRAF.Il dispose pour ce<strong>la</strong> <strong>de</strong>s prévisions <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> recettes et <strong>de</strong> dép<strong>en</strong>ses pour lesdépôts finaux, ainsi que <strong>de</strong>s prévisions re<strong>la</strong>tives aux év<strong>en</strong>tuels coûts complém<strong>en</strong>taires.4. Le Fonds d’insolvabilitéConformém<strong>en</strong>t aux dispositions <strong>de</strong> l’arrêté royal du 30 mars 1981, modifié notamm<strong>en</strong>tpar les arrêtés royaux du 16 octobre 1991, du 2 juin 2006 et du 13 juin 2007, l’ONDRAF amis <strong>en</strong> œuvre un Fonds d’insolvabilité.Ce Fonds a exclusivem<strong>en</strong>t pour but <strong>de</strong> financer les prestations pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t d’instal<strong>la</strong>tions nucléaires non couvertes suite àune faillite ou à l’insolvabilité <strong>de</strong> certains responsables financiers, qui sont implicitem<strong>en</strong>ti<strong>de</strong>ntifiés comme étant les responsables financiers <strong>de</strong>s établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sses II etIII 29 .Il couvre aussi le coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s sources déc<strong>la</strong>rées comme orphelines (cf.chapitre premier) et comme <strong>déchets</strong> par l’AFCN et transmises par l’AFCN à l'ONDRAFafin qu’il <strong>en</strong> assure <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> :Lorsqu'une source radioactive est découverte, l'AFCN t<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> application du principe ‘le29 cf. <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses d'instal<strong>la</strong>tion au chapitre sept.79/166
pollueur paye’, d'i<strong>de</strong>ntifier ce pollueur et <strong>de</strong> le poursuivre. Si le pollueur n'est pas i<strong>de</strong>ntifiéou si les efforts fournis pour l'i<strong>de</strong>ntifier ne sont pas proportionnels aux coûtscorrespondants, <strong>la</strong> source sera déc<strong>la</strong>rée ‘orpheline’ et les coûts financiers <strong>de</strong> sa prise <strong>en</strong>charge par l’ONDRAF seront supportés par le fonds d'insolvabilité <strong>de</strong> l'ONDRAF. Ainsil'AFCN et l'ONDRAF ont mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce, <strong>en</strong>semble, un système financier qui garantit quetoute source orpheline sera gérée et traitée avec les mêmes exig<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong>qualité que les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> pris <strong>en</strong> charge dans le système normal. Avant <strong>la</strong> mise<strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> cette initiative commune, c’est le découvreur <strong>de</strong> <strong>la</strong> source orpheline qui<strong>de</strong>vait supporter les coûts parfois élevés <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> source. Cettesituation n’<strong>en</strong>courageait guère <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ou les opérateurs industriels à faire preuved’esprit civique et constituait une fragilisation dans le système général <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>l’homme et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre les dangers <strong>de</strong>s radiations ionisantes. Jusqu'àprés<strong>en</strong>t, ces coûts étai<strong>en</strong>t à charge <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s fédérations non nucléairesconcernées.L'AFCN, l'ONDRAF et les fédérations professionnelles ont signé, le 19 octobre 2007, uneconv<strong>en</strong>tion commune. Cette conv<strong>en</strong>tion offre désormais, aux signataires qui contribu<strong>en</strong>t àune détection et à une élimination responsables <strong>de</strong> ces matières radioactives, unesolution financière structurelle. Il <strong>en</strong> résulte une col<strong>la</strong>boration unique <strong>en</strong>tre l’ONDRAF,l’AFCN et les différ<strong>en</strong>tes fédérations et secteurs professionnels concernés qui ont prisl’<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> résoudre, <strong>de</strong> manière proactive, <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong>s sourcesorphelines sur l'<strong>en</strong>semble du territoire belge <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong>s travailleurset <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.Les arrêtés royaux du 2 juin 2006 et du 13 juin 2007 organis<strong>en</strong>t le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sdispositions re<strong>la</strong>tives aux sources orphelines <strong>de</strong> l’arrêté royal du 23 mai 2006, quitranspose <strong>la</strong> directive europé<strong>en</strong>ne 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003re<strong>la</strong>tive au contrôle <strong>de</strong>s sources radioactives scellées <strong>de</strong> haute activité et <strong>de</strong>s sourcesorphelines.L'alim<strong>en</strong>tation du Fonds est assurée par l'application d'un taux additionnel <strong>de</strong> 5 % sur letarif <strong>de</strong>s services prestés par l'organisme. Le montant du Fonds est p<strong>la</strong>fonné à unmontant <strong>de</strong> 11.4 millions d'euros.5. Le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission d'inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>passifs nucléairesLes modalités <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission d'inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s passifs nucléaires (voirchapitre précé<strong>de</strong>nt) sont particulières 30 : c'est l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s dét<strong>en</strong>teurs d'uneautorisation nucléaire et les exploitants ou propriétaires <strong>de</strong> site contaminés ou possédant<strong>de</strong>s matières radioactives qui <strong>la</strong> financ<strong>en</strong>t via une re<strong>de</strong>vance annuelle in<strong>de</strong>xable,déterminée selon <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse et <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong> l'instal<strong>la</strong>tion ou du site.La facturation se fait annuellem<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> base du répertoire <strong>de</strong> l'ONDRAF qui rassembletoutes les données re<strong>la</strong>tives aux sites, aux exploitants, aux autorisations et auxinstal<strong>la</strong>tions. L'ONDRAF <strong>en</strong>voie annuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre 500 et 600 factures à cet effet.6. Le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s passifs techniques nucléairesLe financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s passifs techniques nucléaires, <strong>en</strong>core appelés « passifstechniques », couvre les coûts <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions et <strong>la</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> générés par cette opération ainsi que celle <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> déjà<strong>en</strong>treposés sur les sites. Plusieurs conv<strong>en</strong>tions ont été conclues pour assurer lefinancem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces passifs techniques nucléaires.Il y a <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t trois passifs nucléaires reconnus comme tels <strong>en</strong> Belgique : le passifnucléaire regroupant celui <strong>de</strong> l'Eurochemic (<strong>en</strong>core appelé passif BP1) et celui <strong>de</strong> l'anci<strong>en</strong>départem<strong>en</strong>t Waste du SCK·CEN (appelé passif BP2), le passif nucléaire du SCK·CENet, <strong>en</strong>fin, celui <strong>de</strong> l’IRE. Les passifs nucléaires BP1 et BP2 et du SCK·CEN regroup<strong>en</strong>t30 Les modalités <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission d'inv<strong>en</strong>taires sont définies dans les articles 97 à 94 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loiprogrammedu 30 décembre 2001 qui fixe les re<strong>de</strong>vances.80/166
toutes les obligations associées à ces sites (<strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> historiques,déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions, assainissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s sites) qui sont antérieures au 1erjanvier 1989. Le passif nucléaire <strong>de</strong> l’IRE est défini un peu différemm<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s qu’iln’est pas limité dans le temps. La couverture <strong>de</strong>s coûts nucléaires à l’origine <strong>de</strong> ces troispassifs est organisée par l’ État belge, et les montants prévus, versés à l’ONDRAF, lequel<strong>en</strong> assure <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>.Le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’assainissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s passifs nucléaires est réglé par divers texteslégaux.Passif nucléaire <strong>de</strong> BelgoprocessJusqu’<strong>en</strong> 2000, Electrabel et Synatom interv<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t directem<strong>en</strong>t, aux cotés <strong>de</strong> l'état belgedans le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’assainissem<strong>en</strong>t du passif nucléaire BP1 et BP2. L’article 12 <strong>de</strong><strong>la</strong> loi du 29 avril 1999 re<strong>la</strong>tive à l’organisation du marché <strong>de</strong> l’électricité, complété parl’article 432 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi-programme du 24 décembre 2002, a modifié les modalités <strong>de</strong>financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'assainissem<strong>en</strong>t du passif nucléaire BP1 et BP2. Il stipule <strong>en</strong> substancequ' une surcharge, dénommée ‘cotisation fédérale', est désormais prélevée sur les tarifspar <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong> Régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'Electricité et du Gaz (CREG), à charge <strong>de</strong>sutilisateurs du réseau, qui peuv<strong>en</strong>t <strong>la</strong> répercuter sur les cli<strong>en</strong>ts finaux.Le produit <strong>de</strong> cette surcharge est affecté au financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s obligations résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong>dénucléarisation <strong>de</strong>s sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol–Dessel, ainsi que du traitem<strong>en</strong>t,du conditionnem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>treposage et <strong>de</strong> l’évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>accumulés, y compris les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénucléarisation <strong>de</strong>sinstal<strong>la</strong>tions, afférant aux activités nucléaires sur ces sites.L’article 21 <strong>de</strong> <strong>la</strong> même loi, complété par l’article 433 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi-programme, stipule lui que<strong>la</strong> CREG verse les sommes perçues, selon une clé <strong>de</strong> répartition, à l’ONDRAF, qui estchargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> l’assainissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s passifs nucléaires.Passif nucléaire du SCK·CENL’arrêté royal du 16 octobre 1991 « portant les règles re<strong>la</strong>tives au contrôle et au mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>subv<strong>en</strong>tion du C<strong>en</strong>tre d’Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’Energie nucléaire et modifiant les statuts <strong>de</strong> ceC<strong>en</strong>tre » stipule <strong>en</strong> substance que les Ministres ayant les Affaires économiques etl’Energie dans leurs attributions prévoi<strong>en</strong>t chaque année dans leur budget les dotations<strong>de</strong>stinées à couvrir le passif technique du C<strong>en</strong>tre.La dotation annuelle nécessaire pour couvrir le passif technique est versée à un comptespécial <strong>de</strong> l’ONDRAF (article 9), où le passif technique est défini comme étant lesobligations résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénucléarisation <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions, ainsi que du traitem<strong>en</strong>t, duconditionnem<strong>en</strong>t, du stockage et <strong>de</strong> l’évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong>dénucléarisation <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions, afférant aux activités nucléaires du C<strong>en</strong>tre jusqu’au 31décembre 1988 (article 2, 3°).Passif nucléaire <strong>de</strong> l'IREL’arrêté royal du 16 octobre 1991 « fixant les règles re<strong>la</strong>tives au contrôle et au mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>subv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong>s Radioélém<strong>en</strong>ts, et modifiant les statuts <strong>de</strong> cetInstitut » stipule <strong>en</strong> substance que les Ministres ayant les Affaires économiques etl’Energie dans leurs attributions prévoi<strong>en</strong>t chaque année dans leur budget les dotations<strong>de</strong>stinées à couvrir le passif technique <strong>de</strong> l’Institut.La dotation annuelle nécessaire pour couvrir le passif technique est, comme pour lepassif <strong>de</strong> nucléaire du SCK.CEN, versée à un compte spécial <strong>de</strong> l’ONDRAF (article 9), oùle passif technique est, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière, défini comme étant les obligations résultant<strong>de</strong> <strong>la</strong> dénucléarisation <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions, ainsi que du traitem<strong>en</strong>t, du conditionnem<strong>en</strong>t, dustockage et <strong>de</strong> l’évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> accumulés, <strong>en</strong> ce compris les<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> résultant <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénucléarisation <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions, afférant aux activitésnucléaires <strong>de</strong> l’Institut (article 2, 3°).81/166
7. Les financem<strong>en</strong>ts sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> budgets(pluri)annuelsCertaines missions ou tâches courantes <strong>de</strong> l'ONDRAF ne sont pas couvertes par unmécanisme <strong>de</strong> type tarifaire. C'est le cas <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>de</strong> prestations comme l'inv<strong>en</strong>taire<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, l'agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t etd'<strong>en</strong>treposage, <strong>la</strong> communication institutionnelle, l'établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s Critèresd'acceptation, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification, les étu<strong>de</strong>s stratégiques et <strong>la</strong> recherche et développem<strong>en</strong>t.Le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces missions ou tâches est donc assuré par un mécanismeconv<strong>en</strong>tionnel spécifique. L'ONDRAF a, pour ce<strong>la</strong> signé avec les principaux producteurs<strong>de</strong>s conv<strong>en</strong>tions-cadre, appelées «conv<strong>en</strong>tions <strong>de</strong> Pré-étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> R&D ». Diversesannexes contr<strong>actuelle</strong>s, faisant elle-mêmes l'objet <strong>de</strong> nouveaux av<strong>en</strong>ants à date échue,fix<strong>en</strong>t, <strong>en</strong>tre autre, pour une pério<strong>de</strong> déterminée, le programme <strong>de</strong> travail, les budgets,les conditions <strong>de</strong> rapportage, <strong>de</strong> facturation et <strong>de</strong> payem<strong>en</strong>t. L'État belge, qui a signéavec l'ONDRAF <strong>de</strong>s accords globaux pour couvrir <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s passifs nucléaires pourune pério<strong>de</strong> donnée, s'est <strong>en</strong>gagé, par <strong>la</strong> même occasion, à supporter sa part <strong>de</strong>scharges liées aux prestations précitées (inv<strong>en</strong>taire, communication institutionnelle,Critères d'acceptation, ...). Les modalités et conditions reprises dans les av<strong>en</strong>ants auxconv<strong>en</strong>tions-cadres avec les principaux producteurs sont prés<strong>en</strong>tées, discutées etapprouvées par les divers comités <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s passifs nucléaires techniques et seretrouv<strong>en</strong>t dans ces accords globaux. Ces comités <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> sont donc traités sur lemême pied que les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>.Les montants <strong>de</strong>s prestations réelles sont portées <strong>en</strong> compte <strong>de</strong>s producteurs sur <strong>la</strong> base<strong>de</strong> clés <strong>de</strong> répartition objectives. Le financem<strong>en</strong>t se fait le plus souv<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> based'avances trimestrielles avec régu<strong>la</strong>risation, l'année suivante, sur <strong>la</strong> base du réalisé exactétabli au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong>s comptes annuels <strong>de</strong> l'organisme.8. La fin <strong>de</strong> contrat d’un producteurDans le cas <strong>de</strong>s producteurs dont les activités se poursuiv<strong>en</strong>t normalem<strong>en</strong>t, l’<strong>en</strong>semble<strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong> est couvert par différ<strong>en</strong>ts contrats ou conv<strong>en</strong>tions.Le producteur est <strong>en</strong> effet t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> conclure <strong>de</strong> telles conv<strong>en</strong>tions et ces coûts sont donccouverts, soit par les tarifs applicables aux différ<strong>en</strong>tes catégories <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> livrés, soitpar <strong>de</strong>s conv<strong>en</strong>tions spécifiques (R&D par exemple). Tant que le producteur poursuit sesactivités, <strong>la</strong> méthodologie appliquée assure que les coûts sont bi<strong>en</strong> couverts au mom<strong>en</strong>t<strong>de</strong> l'acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> ou le sont par ces conv<strong>en</strong>tions spécifiques.Lorsque le producteur arrête ses activités, ou plus précisém<strong>en</strong>t, lorsqu’il perd <strong>la</strong> qualitéd’exploitant nucléaire et, partant, <strong>de</strong> producteur <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, le système contractuel actuelorganisant <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> par l’ONDRAF cesse d’être opérant. D’unepart, il n’y a plus <strong>de</strong> nouveaux <strong>déchets</strong> pour couvrir les coûts <strong>de</strong> l'ONDRAF repris par lestarifs d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas d'évolution <strong>de</strong> ceux-ci à <strong>la</strong> hausse. D’autre part, <strong>la</strong> répartitionobjective <strong>de</strong>s coûts couverts par <strong>de</strong>s conv<strong>en</strong>tions spécifiques ne peut plus se faire auprorata <strong>de</strong>s quantités annoncées.Toutefois le principe légal <strong>de</strong> <strong>la</strong> couverture intégrale <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> l'ONDRAF rested’application car l’anci<strong>en</strong> producteur reste bénéficiaire <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> l’organisme, etdonc responsable <strong>de</strong>s coûts non couverts ou non suffisamm<strong>en</strong>t couverts attribuables àses <strong>déchets</strong>.Il y a donc lieu dans ce cas <strong>de</strong> définir un cadre conv<strong>en</strong>tionnel permettant d’assurer <strong>la</strong>couverture <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> l'ONDRAF imputables à un producteur qui arrête ses activités.Trois aspects <strong>de</strong> cette problématique reti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t particulièrem<strong>en</strong>t l'att<strong>en</strong>tion : les coûts d’<strong>en</strong>treposage et <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt définitif ont été évalués lors <strong>de</strong>l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s tarifs et facturés au fur et à mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>; toutefois, une dérive hors marge <strong>de</strong> ces coûts ne peut être exclue à priori. Il ya donc lieu <strong>de</strong> maint<strong>en</strong>ir un mécanisme <strong>de</strong> suivi et d’avoir l’<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’exproducteurbénéficiaire <strong>de</strong>s prestations et/ou <strong>de</strong>s producteurs <strong>en</strong>core actifs <strong>de</strong>comp<strong>en</strong>ser un sous-provisionnem<strong>en</strong>t év<strong>en</strong>tuel constaté par l’ONDRAF;82/166
certains coûts, qui étai<strong>en</strong>t couverts p<strong>en</strong>dant les pério<strong>de</strong>s précé<strong>de</strong>ntes par <strong>de</strong>sconv<strong>en</strong>tions spécifiques, rest<strong>en</strong>t à charge du bénéficiaire <strong>de</strong>s prestations avec lequel ilest donc nécessaire que l’ONDRAF conclue une conv<strong>en</strong>tion spécifique. Ces coûtspeuv<strong>en</strong>t être évalués aux conditions <strong>actuelle</strong>s selon un scénario pru<strong>de</strong>nt courantjusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt définitif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>; Enfin, certains coûts supplém<strong>en</strong>taires pourrai<strong>en</strong>t résulter par exemple d’unemodification fondam<strong>en</strong>tale du scénario <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce ou bi<strong>en</strong> <strong>de</strong> modificationsfondam<strong>en</strong>tales du cadre réglem<strong>en</strong>taire et institutionnel spécifique à l’ONDRAF,assimi<strong>la</strong>bles à <strong>de</strong>s « faits du prince ». Ils ne peuv<strong>en</strong>t être prévus et sont trèsdifficilem<strong>en</strong>t évaluables à priori.Un groupe <strong>de</strong> travail où sont représ<strong>en</strong>tés les grands producteurs ainsi que l’ONDRAF aété constitué avec pour objectif d’aboutir à un cons<strong>en</strong>sus sur un texte <strong>de</strong> conv<strong>en</strong>tion dite« <strong>de</strong> fin <strong>de</strong> contrat ».83/166
Chapitre neufL'<strong>en</strong>treposage temporaire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>conditionnés et du combustible irradiéLa quatrième et <strong>de</strong>rnière partie <strong>de</strong> ce docum<strong>en</strong>t, qui s'ouvre maint<strong>en</strong>ant, traite <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> à long terme ou <strong>en</strong>core, <strong>de</strong> <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong> « ce qui se fera <strong>de</strong>main pour les<strong>déchets</strong> d'aujourd'hui » – et égalem<strong>en</strong>t pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>main, puisque lesinv<strong>en</strong>taires prévisionnels expliqués au chapitre sept nous <strong>en</strong> donn<strong>en</strong>t les moy<strong>en</strong>s. Quantaux moy<strong>en</strong>s financiers nécessaires à cette <strong>gestion</strong> à long terme, le chapitre précé<strong>de</strong>ntnous <strong>en</strong> garantit <strong>la</strong> disponibilité.Nous retrouvons ici l'<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés par lequel s'était closle chapitre six. L'<strong>en</strong>treposage, <strong>en</strong> effet, constitue l'activité-charnière <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>courante et <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme.Les bâtim<strong>en</strong>ts d'<strong>en</strong>treposage sont énumérés et brièvem<strong>en</strong>t décrits, par ordre croissant duniveau d'irradiation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés qu'ils conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t. Leur capacité etl'évolution <strong>de</strong> cette capacité font l'objet d'une att<strong>en</strong>tion plus particulière.L'<strong>en</strong>treposage temporaire constitue uniquem<strong>en</strong>t une phase d'att<strong>en</strong>te avant <strong>la</strong> mise <strong>en</strong>service d'un dépôt définitif. Cette phase d'att<strong>en</strong>te est <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t mise à profit pours'assurer que les <strong>déchets</strong> conditionnés rest<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> aptes à leur mise <strong>en</strong> dépôt ultérieure.C'est pourquoi les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> acceptés font l'objet d'un suivi dans le temps,consistant <strong>en</strong> l'inspection périodique <strong>de</strong> colis-témoins <strong>de</strong>stinée à vérifier leur mainti<strong>en</strong> <strong>en</strong>conformité. Ce mécanisme d'inspection constitue par conséqu<strong>en</strong>t un point sail<strong>la</strong>nt dansce chapitre.1. IntroductionDe nouveaux colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> rejoign<strong>en</strong>t, chaque jour, les instal<strong>la</strong>tions c<strong>en</strong>traliséesd’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong> l’ONDRAF, à Dessel. Entre le mom<strong>en</strong>t où un colis est mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>cedans un <strong>en</strong>trepôt et le mom<strong>en</strong>t où il <strong>en</strong> sortira pour gagner sa <strong>de</strong>stination finale, il peut sepasser plusieurs années, voire plusieurs déc<strong>en</strong>nies. Il est ess<strong>en</strong>tiel pour <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong>sopérateurs et pour <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> maint<strong>en</strong>ir les <strong>déchets</strong> conditionnésdans l’état qui a autorisé leur acceptation mais aussi <strong>de</strong> s’assurer, par <strong>de</strong>s inspectionspériodiques, que ces <strong>déchets</strong> rest<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> compatibles avec <strong>la</strong> solution prise commeréfér<strong>en</strong>ce pour leur <strong>gestion</strong> à long terme. La conservation <strong>de</strong>s qualités initiales <strong>de</strong> chaquecolis par, notamm<strong>en</strong>t, le mainti<strong>en</strong> <strong>de</strong> conditions adéquates d’<strong>en</strong>treposage et par unesurveil<strong>la</strong>nce régulière <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> stock constitue donc un défi importantpour un organisme comme l’ONDRAF.L'<strong>en</strong>treposage fait explicitem<strong>en</strong>t partie <strong>de</strong>s missions confiées à l'ONDRAF par lelégis<strong>la</strong>teur qui lui a confié <strong>la</strong> charge:« [L’ONDRAF a pour mission] ... d’<strong>en</strong>treposer les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> hors <strong>de</strong>sinstal<strong>la</strong>tions du producteur, d’établir et <strong>de</strong> t<strong>en</strong>ir à jour l’inv<strong>en</strong>taire quantitatif et qualitatif<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés et d’établir et <strong>de</strong> t<strong>en</strong>ir à jour un programme général <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>à long terme pour assurer <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. » 31Le suivi dans le temps <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> stock est prescrit par l’article 17 <strong>de</strong>s Règlesgénérales (voir <strong>la</strong> première partie du chapitre trois) :« Les critères d’acceptation détermin<strong>en</strong>t les procédures administratives et techniquespermettant d’assurer le suivi dans le temps <strong>de</strong>s caractéristiques et propriétés <strong>de</strong>s colis31 article 2, § 2, 1. c) et § 3, 1. b) et c) <strong>de</strong> l’arrêté royal du 30 mars 1981 modifié par l’arrêté royal du 16octobre 199184/166
primaires <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés. Le but <strong>de</strong> ces procédures est double : contrôler si les colis primaires rest<strong>en</strong>t conformes aux critères d’acceptation qui étai<strong>en</strong>tapplicables au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’établissem<strong>en</strong>t du procès-verbal [dont il est question dans l’art.13], contrôler si les colis primaires <strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t compatibles avec leur <strong>de</strong>stination finale <strong>de</strong>référ<strong>en</strong>ce […].La fréqu<strong>en</strong>ce minimale <strong>de</strong> ce suivi est déterminée comme suit : le premier contrôle trois ans après l’acceptation du colis primaire conformém<strong>en</strong>t auxdispositions <strong>de</strong> l’art. 13, puis tous les dix ans p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d’<strong>en</strong>treposage. […] »L’ONDRAF a choisi <strong>de</strong> c<strong>en</strong>traliser l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés surun seul site, celui <strong>de</strong> sa filiale BELGOPROCESS à Dessel. Les nouvelles instal<strong>la</strong>tionsd’<strong>en</strong>treposage, réalisées à l’initiative <strong>de</strong> l’ONDRAF, y côtoi<strong>en</strong>t les anci<strong>en</strong>nes, construites,dans les années 1970-1980, pour les besoins <strong>de</strong> l’anci<strong>en</strong>ne usine pilote <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>tEUROCHEMIC. Les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés sont <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t conservés danssix <strong>en</strong>trepôts, tous situés sur le site 1 <strong>de</strong> BELGOPROCESS : trois <strong>de</strong> ceux-ci, les bâtim<strong>en</strong>ts 150, 151 et 155, sont <strong>de</strong>stinés aux <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>tirradiants, dont le débit <strong>de</strong> dose au contact est inférieur à 5 mSv/h (10 mSv/h pour lebâtim<strong>en</strong>t 150). Le bâtim<strong>en</strong>t 151 peut cep<strong>en</strong>dant accepter <strong>de</strong>s colis avec un débit <strong>de</strong>dose au contact supérieur à 5 mSv/h, à <strong>la</strong> condition toutefois que leur débit <strong>de</strong> dose àun mètre soit inférieur à 0,5 mSv/h; un quatrième <strong>en</strong>trepôt, le bâtim<strong>en</strong>t 127, héberge les <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants,au débit <strong>de</strong> dose au contact compris <strong>en</strong>tre 5 mSv/h et 2 Sv/h; les bâtim<strong>en</strong>ts 129 et 136, <strong>en</strong>fin, accueille les <strong>déchets</strong> fortem<strong>en</strong>t irradiants et, <strong>de</strong>surcroît, générateurs <strong>de</strong> chaleur.Pour que <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>tation soit complète, il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> citer <strong>en</strong>core l'exist<strong>en</strong>ce : sur le site 1 <strong>de</strong> BELGOPROCESS, d’une instal<strong>la</strong>tion particulière <strong>de</strong>stinée àl’<strong>en</strong>treposage, <strong>en</strong> cont<strong>en</strong>eurs métalliques <strong>de</strong> type CASTOR, <strong>de</strong> combustible nucléaireusé <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance du réacteur BR3 du SCK·CEN confiés provisoirem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>l'ONDRAF; sur le site 2 <strong>de</strong> BELGOPROCESS, <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux hangars métalliques où sont aujourd'huistockés quelques 773 colis <strong>de</strong> 200, 400 et 600 l cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> naturesdiverses conditionnés sur le site, pour <strong>la</strong> plupart non conformes aux Critèresd'acceptation qui leurs sont applicables. Ces hangars servai<strong>en</strong>t autrefois àl'<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> transit <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux campagnes <strong>de</strong> rejet <strong>en</strong> mer. Les<strong>déchets</strong> y <strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t sous contrôle <strong>en</strong> att<strong>en</strong>dant l'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> <strong>la</strong> solution <strong>de</strong>remédiation qui permettra leur transfert verts les instal<strong>la</strong>tions d'<strong>en</strong>treposage c<strong>en</strong>tralisédu site 1.Pour ce qui concerne l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés, l’objectif <strong>de</strong>sûreté principal est <strong>de</strong> s’assurer qu’<strong>en</strong> toute circonstance, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s opérateurs,du public et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t soit garantie et ce, <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce su premiercolis <strong>en</strong> <strong>en</strong>trepôt, jusqu’au départ du <strong>de</strong>rnier. Les contraintes <strong>de</strong> sûreté imposées à cesinstal<strong>la</strong>tions vari<strong>en</strong>t selon <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> et matières <strong>en</strong>treposés : ce<strong>la</strong> va <strong>de</strong>simples mesures <strong>de</strong> blindages anti-radiations jusqu’à <strong>de</strong>s mesures poussées mettant <strong>en</strong>œuvre <strong>de</strong>s épaisseurs <strong>de</strong> parois considérables, <strong>en</strong> passant par <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>systèmes <strong>de</strong> manipu<strong>la</strong>tion à distance, <strong>de</strong> contrôles radiologiques r<strong>en</strong>forcés, <strong>de</strong> dispositifs<strong>de</strong> refroidissem<strong>en</strong>t perman<strong>en</strong>ts (bâtim<strong>en</strong>ts 129 et 136) jusqu’à, si nécessaire <strong>la</strong>réalisation <strong>de</strong> cellules résistantes à l'impact direct d'un avion (bâtim<strong>en</strong>t 136).Il faut rappeler, comme indiqué à <strong>la</strong> fin du troisième chapitre, que les instal<strong>la</strong>tionsd'<strong>en</strong>treposage sont, <strong>de</strong>puis 2002, elles aussi, soumises à l’agrém<strong>en</strong>t.Les différ<strong>en</strong>ts bâtim<strong>en</strong>ts d'<strong>en</strong>treposage sont, dans ce qui suit, prés<strong>en</strong>tés selon lesniveaux croissants d'irradiation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés qu’ils accueill<strong>en</strong>t. On seréfèrera utilem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés exposée au chapitre trois,et plus particulièrem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sses.85/166
2. Les bâtim<strong>en</strong>ts pour <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants2.1 Le bâtim<strong>en</strong>t 150Le bâtim<strong>en</strong>t 150 est le tout premier <strong>en</strong>trepôt pour <strong>déchets</strong> conditionnés construit parl'ONDRAF. Sa construction remonte à l'époque <strong>de</strong> l’interdiction du rejet <strong>en</strong> mer <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants. Suite à cette interdiction, les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> avai<strong>en</strong>tcomm<strong>en</strong>cé à s’accumuler dans les <strong>en</strong>trepôts <strong>de</strong> transit du départem<strong>en</strong>t Waste duSCK·CEN, sans possibilité d’être évacués. Pareille situation ne pouvait naturellem<strong>en</strong>ts’éterniser. On décida donc <strong>de</strong> doter l’ONDRAF, dans les meilleurs dé<strong>la</strong>is possibles,d’une instal<strong>la</strong>tion d’<strong>en</strong>treposage provisoire capable d’abriter, dans <strong>de</strong> meilleuresconditions <strong>de</strong> sûreté, le volume toujours croissant <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. C’est là l’originedu bâtim<strong>en</strong>t 150. En service <strong>de</strong>puis 1986, l’instal<strong>la</strong>tion est aujourd'hui <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>tremplie <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés appart<strong>en</strong>ant ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t aux c<strong>la</strong>sses LAGA etLAGAT. On y <strong>en</strong>trepose égalem<strong>en</strong>t une certaine quantité <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> LAGAL. On yaccepte <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> avec un débit <strong>de</strong> dose maximum au contact <strong>de</strong> 10 mSv/h.Ses dim<strong>en</strong>sions extérieures sont les suivantes : longueur = 60,5 m, <strong>la</strong>rgeur = 19,7 m, hauteur = 7,9 m.Il s’agit d’une construction très simple, réalisée, vu l’urg<strong>en</strong>ce, <strong>en</strong> béton armé préfabriqué.L’épaisseur <strong>de</strong> ses murs (25 cm) et <strong>de</strong> sa toiture (15 cm) suffit à garantir, avec un mo<strong>de</strong>d’empilem<strong>en</strong>t judicieux, un débit <strong>de</strong> dose inférieur à 25 μSv/h (microsievert/heure) aucontact <strong>de</strong>s parois extérieures du bâtim<strong>en</strong>t. La finition du sol et <strong>de</strong>s murs intérieurs estréalisée <strong>en</strong> béton lissé. Il n’y a pas <strong>de</strong> f<strong>en</strong>êtres dans les murs et <strong>de</strong>s murets <strong>en</strong> bétonarmé assur<strong>en</strong>t <strong>la</strong> radioprotection au niveau <strong>de</strong>s sorties <strong>de</strong> secours.Le déchargem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s colis, transportés par camion, se fait à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux chariotsélévateursdans <strong>la</strong> partie médiante <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>trepôt. Deux gran<strong>de</strong>s portes levantespermett<strong>en</strong>t l’accès <strong>de</strong>s véhicules <strong>de</strong> transport. Les <strong>de</strong>ux chariots-élévateurs ont servi à <strong>la</strong>mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s colis dans les espaces dédiés à l’<strong>en</strong>treposage. Les colis y sontempilés <strong>en</strong> position verticale, ouverture vers le haut, <strong>de</strong> manière à ce que chaque colisrepose sur <strong>de</strong>ux colis <strong>de</strong> <strong>la</strong> couche inférieure. Les différ<strong>en</strong>ts colis sont empilés <strong>de</strong> <strong>la</strong>manière indiquée dans le tableau suivant :Colis Nombre <strong>de</strong>couchesHauteur totale(m)220 l 5 4,40400 l 4 4,40600 l 3 3,751000 l 2 2,501500 l 3 3,901600 l 3 3,902200 l 2 2,73Table 5: Mo<strong>de</strong>s d'empilem<strong>en</strong>t selon le type <strong>de</strong> colisUn couloir <strong>de</strong> passage est prévu autour <strong>de</strong>s empilem<strong>en</strong>ts. Ce passage est suffisamm<strong>en</strong>t<strong>la</strong>rge pour permettre un contrôle et une inspection <strong>de</strong>s fûts disposés à <strong>la</strong> périphérie. Lesempilem<strong>en</strong>ts sont réalisés <strong>de</strong> manière à ce que les colis dont le débit <strong>de</strong> dose estproportionnellem<strong>en</strong>t le plus faible soi<strong>en</strong>t p<strong>la</strong>cés à l’extérieur <strong>de</strong> l’empilem<strong>en</strong>t et les plusirradiants au c<strong>en</strong>tre. Ceci permet <strong>de</strong> favoriser l’auto-blindage, un principe qui permet <strong>de</strong>réduire <strong>en</strong>core et à peu <strong>de</strong> frais, l’impact radiologique global – certes déjà faible - <strong>de</strong>l’instal<strong>la</strong>tion sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Des ouvertures gril<strong>la</strong>gées pratiquées dans les portesd’accès suffis<strong>en</strong>t à garantir un r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t d’air suffisant à l’intérieur du bâtim<strong>en</strong>t.Le volume total <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>en</strong>treposés au 31 décembre 2007 s’élève à 1 914 m³ (3 317colis)..86/166
figure 17: Vue extérieure du bâtim<strong>en</strong>t 1502.2 Le bâtim<strong>en</strong>t 151figure 18: Vue interne du bâtim<strong>en</strong>t 150La photo ci-<strong>de</strong>ssous montre, sur <strong>la</strong> gauche, le bâtim<strong>en</strong>t 151, et, sur <strong>la</strong> droite, le bâtim<strong>en</strong>t150 déjà décrit.figure 19.: Les bâtim<strong>en</strong>ts 150 et 151La principale instal<strong>la</strong>tion d’<strong>en</strong>treposage c<strong>en</strong>tralisé pour <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants estle bâtim<strong>en</strong>t 151. Ce grand <strong>en</strong>trepôt, <strong>de</strong> plus d’un <strong>de</strong>mi hectare <strong>de</strong> superficie au sol,accueille les <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants conditionnés <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses LAGA et LAGAT <strong>de</strong><strong>la</strong> production courante. On peut y stocker égalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés LAGAL.87/166
Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>stinés au bâtim<strong>en</strong>t 151 provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t c<strong>en</strong>tralisé CILVA toute proche (cf. chapitre cinq), <strong>de</strong>s unités<strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s c<strong>en</strong>trales nucléaires <strong>de</strong> Doel et Tihange et dutraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s passifs BP1 et BP2.figure 20.: Vue intérieure du bâtim<strong>en</strong>t 151Le bâtim<strong>en</strong>t 151 a été construit <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux phases distinctes. La première phase <strong>de</strong>construction (partie 1) a été mise <strong>en</strong> service <strong>en</strong> 1988, <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième phase (partie 2) <strong>en</strong>1994. La partie 1, longue <strong>de</strong> 72.5 m, se compose <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux halls parallèles (A et B)séparés par un mur continu. Le hall A, d’une <strong>la</strong>rgeur <strong>de</strong> 17.2 m, est principalem<strong>en</strong>t utilisépour l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s colis non standard <strong>de</strong> <strong>la</strong> production historique. Le hall B, d’une<strong>la</strong>rgeur <strong>de</strong> 21.2 m est consacré, <strong>en</strong> priorité, à l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s fûts standards <strong>de</strong> 400 l.Située dans le prolongem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie 1, <strong>la</strong> partie 2 lui est tout à fait i<strong>de</strong>ntique <strong>en</strong>élévation mais sa longueur est <strong>de</strong> 84.5 m. Elle se compose, comme <strong>la</strong> première, <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxhalls parallèles (C, dans le prolongem<strong>en</strong>t du A et D, dans le prolongem<strong>en</strong>t du B) séparéspar un mur continu. La partie 2 accueille, pour l’ess<strong>en</strong>tiel, <strong>de</strong>s fûts standards <strong>de</strong> 400 l.Les parties 1 et 2 sont c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t discernables sur <strong>la</strong> vue extérieure du bâtim<strong>en</strong>t.La zone médiante séparant les <strong>de</strong>ux paires <strong>de</strong> halls d’<strong>en</strong>treposage sert aux opérations <strong>de</strong>déchargem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> contrôle. Les accès à cette zone sont fermés par <strong>de</strong>s portes levantesmétalliques dont <strong>la</strong> hauteur permet le passage <strong>de</strong> camions. Pour protéger les opérateurs,les chauffeurs <strong>de</strong> camion et toute personne circu<strong>la</strong>nt dans cette zone contre lesradiations <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance <strong>de</strong>s empilem<strong>en</strong>ts, une chicane <strong>en</strong> béton armé a été p<strong>la</strong>cée àl’<strong>en</strong>trée <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s halls d’<strong>en</strong>treposage est disposée <strong>de</strong>stinée à. La hauteur <strong>de</strong>smurs <strong>de</strong> cette chicane est limitée à 5 m, ce qui permet le passage <strong>de</strong>s ponts rou<strong>la</strong>ntsservant à <strong>la</strong> manut<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>. Leur <strong>en</strong>tre distance est prévue pourpermettre le passage aisé <strong>de</strong>s chariots élévateurs égalem<strong>en</strong>t utilisés pour les opérations<strong>de</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce.L’épaisseur <strong>de</strong>s murs (25 cm) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> toiture (15 cm) suffit, comme pour le bâtim<strong>en</strong>t 150,à garantir, avec un mo<strong>de</strong> d’empilem<strong>en</strong>t judicieux, un débit <strong>de</strong> dose inférieur à 25 μSv/h(microsievert/heure) au contact <strong>de</strong>s parois extérieures du bâtim<strong>en</strong>t. La finition du sol et<strong>de</strong>s murs intérieurs est égalem<strong>en</strong>t réalisée <strong>en</strong> béton lissé. Il n’y a aucune f<strong>en</strong>être dans lesmurs et <strong>de</strong>s murets <strong>en</strong> béton armé assur<strong>en</strong>t <strong>la</strong> radioprotection au niveau <strong>de</strong>s sorties <strong>de</strong>secours.De simples ouvertures dans les longs murs, protégées par <strong>de</strong>s chicanes <strong>en</strong> béton,assur<strong>en</strong>t le r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’air à l’intérieur du bâtim<strong>en</strong>t. Les parois extérieures sontpourvues d’une iso<strong>la</strong>tion thermique. Des appareils déshumidificateurs mobiles installésdans les halls d’<strong>en</strong>treposage contrôl<strong>en</strong>t l’humidité <strong>de</strong> l’air ambiant. Ces précautions trèssimples contribu<strong>en</strong>t à maint<strong>en</strong>ir les conditions d’<strong>en</strong>treposage nécessaires à <strong>la</strong> bonneconservation <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> <strong>en</strong>trepôt.Les halls A et C sont équipés d’un pont rou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 10 t à comman<strong>de</strong> manuelle mais les88/166
colis peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t y être mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce ou repris à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux chariotsélévateurs. Les halls B et D sont eux équipés d’un pont rou<strong>la</strong>nt semi-automatique pourvud’un grappin d’une capacité <strong>de</strong> 1,5 t pour <strong>la</strong> manut<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s fûts standard <strong>de</strong> 400 l. Pourfaciliter les opérations d’inspection et <strong>de</strong> suivi dans le temps <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> stockés dansles halls A et C, il a été jugé utile d’y installer, <strong>en</strong> 2005, un pont rou<strong>la</strong>nt semi-automatique<strong>de</strong> 3 t. Les <strong>de</strong>ux ponts rou<strong>la</strong>nts <strong>de</strong> 1,5 t et 3 t, <strong>de</strong> conception simi<strong>la</strong>ire, sont commandés àdistance à partir d’une salle contrôle adjac<strong>en</strong>te au hall A.Les colis <strong>de</strong> <strong>la</strong> production historique ont <strong>de</strong>s formes et <strong>de</strong>s dim<strong>en</strong>sions très variées. Ilssont, comme dans le bâtim<strong>en</strong>t 150, empilés par type, <strong>en</strong> position verticale, ouverture versle haut, <strong>de</strong> manière à ce que chaque colis repose sur <strong>de</strong>ux colis <strong>de</strong> <strong>la</strong> couche inférieure.Les fûts <strong>de</strong> 400 l sont égalem<strong>en</strong>t empilés sur six couches, <strong>en</strong> position verticale, ouverturevers le haut mais cette fois, selon une maille triangu<strong>la</strong>ire, chaque fût reposant sur troisfûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> couche inférieure. Un couloir <strong>de</strong> passage est prévu autour <strong>de</strong>s empilem<strong>en</strong>ts. Cepassage est suffisamm<strong>en</strong>t <strong>la</strong>rge pour permettre un contrôle et une inspection <strong>de</strong>s fûtsdisposés à <strong>la</strong> périphérie.La capacité nominale du bâtim<strong>en</strong>t est <strong>de</strong> 14 700 m³. Au 31 décembre 2007, l'inv<strong>en</strong>taire<strong>de</strong>s colis <strong>en</strong>treposés se dressait comme suit : Hall A : 1 558 m 3 (3 361 colis); Hall B : 3 595 m 3 (8 984 colis); Hall C : 1 328 m 3 (4 100 colis); Hall D : 5 211 m 3 (13 028 colis);Selon les prévisions <strong>actuelle</strong>s, le bâtim<strong>en</strong>t 151 arrivera à saturation dans le courant <strong>de</strong>l’année 2016.2.3 Le bâtim<strong>en</strong>t 155Le bâtim<strong>en</strong>t 155, mis <strong>en</strong> service <strong>en</strong> 2006, est assez proche du 151 dans sa conceptiongénérale. L’ONDRAF le <strong>de</strong>stine principalem<strong>en</strong>t à l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> longuedurée <strong>de</strong> vie, ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse LAGAL ainsi que les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>c<strong>la</strong>sse RAGAL. L'int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> l'ONDRAF est d'y transférer tous les <strong>déchets</strong> LAGAL <strong>de</strong> <strong>la</strong>production anci<strong>en</strong>ne qui sont <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong>treposés dans les bâtim<strong>en</strong>ts 150 et 151.L’instal<strong>la</strong>tion est égalem<strong>en</strong>t autorisée pour l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non standard, telsque, par exemple, <strong>de</strong>s barres <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> réacteur.Construit <strong>en</strong> béton armé, le bâtim<strong>en</strong>t 155 se compose <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux halls d’<strong>en</strong>treposageséparés par un mur continu. Le premier <strong>de</strong> ces halls est <strong>de</strong>stiné aux <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sseLAGAL, le second aux <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse RAGAL. L’épaisseur <strong>de</strong>s murs est <strong>de</strong> 45 cm, cequi permet <strong>de</strong> garantir un débit <strong>de</strong> dose au contact <strong>de</strong>s parois extérieures inférieur à 10µSv/h.Les dim<strong>en</strong>sions <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux halls sont pareilles : longueur = 67 m, <strong>la</strong>rgeur = 19 m, hauteur = 12 m.La capacité du hall LAGAL est d’<strong>en</strong>viron 2 000 m³. Celle du hall RAGAL s’élève à <strong>en</strong>viron2 450 m³.Les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés sont déchargés du véhicule <strong>de</strong> transport dans unezone située à l’extrémité <strong>de</strong>s halls d’<strong>en</strong>treposage. Le déchargem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s colis standards’opère à l’ai<strong>de</strong> d’un pont télécommandé <strong>de</strong> 3 t. Pour les colis non standard, on utilise unchariot élévateur électrique. Les colis déchargés sont déposés sur un chariot qui lesconduit à l’<strong>en</strong>trée du hall d’<strong>en</strong>treposage. Un sas isole chaque hall <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone <strong>de</strong>déchargem<strong>en</strong>t.89/166
figure 21: le bâtim<strong>en</strong>t 155figure 22: Vue interne du bâtim<strong>en</strong>t 155Un pont rou<strong>la</strong>nt télécommandé <strong>de</strong> 3 t, muni d’un grappin motorisé manut<strong>en</strong>tionne lescolis à l’intérieur <strong>de</strong> chaque hall. Les fûts y sont empilés, par type, selon un mail<strong>la</strong>getriangu<strong>la</strong>ire, <strong>en</strong> position verticale, ouverture vers le haut, chaque fût reposant sur trois fûts<strong>de</strong> <strong>la</strong> couche, afin <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> meilleure stabilité possible. Le nombre <strong>de</strong> niveauxd’empilem<strong>en</strong>t est limité à : 4 pour les colis <strong>de</strong> 400 l 4 pour les colis <strong>de</strong> 200 l 3 pour les colis <strong>de</strong> 600 l 1 pour tous les colis non standard.Un couloir <strong>de</strong> passage est prévu autour <strong>de</strong>s empilem<strong>en</strong>ts. Ce passage est suffisamm<strong>en</strong>t<strong>la</strong>rge pour permettre un contrôle et une inspection <strong>de</strong>s fûts disposés à <strong>la</strong> périphérie.La v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion est assurée par <strong>de</strong>ux circuits <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion séparés, un pourle hall RAGAL et l’autre pour le hall LAGAL. L’air est rejeté, après filtration év<strong>en</strong>tuelle,dans une cheminée commune. L’air, <strong>en</strong> conditions d’exploitation normales, n’est filtré quedurant les opérations <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>. Il est possible d’accroître <strong>la</strong> capacitéd’extraction d’air du hall RAGAL, ce qui pourrait s’avérer nécessaire <strong>en</strong> casd’accroissem<strong>en</strong>t du taux <strong>de</strong> production <strong>de</strong> gaz radon <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance <strong>de</strong>s colis cont<strong>en</strong>ant<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> radifères.Au 31 décembre 2007, 659 colis (264 m 3 ) étai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>treposés dans <strong>la</strong> zone RAGAL et 189colis (76 m 3 ) dans <strong>la</strong> zone LAGAL.3. Le bâtim<strong>en</strong>t 127 pour <strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>tirradiantsLe bâtim<strong>en</strong>t 127, <strong>en</strong>core appelé EUROSTORAGE, a été mis <strong>en</strong> service <strong>en</strong> 1976, pour lesbesoins <strong>de</strong> l’usine pilote <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t EUROCHEMIC. Il ne comportait, à l'origine, que<strong>de</strong>ux halls d’<strong>en</strong>treposage (halls 1 et 2) dans lesquels EUROCHEMIC stocka les fûts <strong>de</strong>200 l cont<strong>en</strong>ant les <strong>déchets</strong> bituminés issus du conditionnem<strong>en</strong>t, dans l’instal<strong>la</strong>tionEUROBITUM voisine, <strong>de</strong>s efflu<strong>en</strong>ts liqui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne activité <strong>de</strong> l'usine (c<strong>la</strong>sseMAGALE). Ces <strong>de</strong>ux premiers halls étant arrivés à saturation vers 1983, EUROCHEMICdécida <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux nouveaux halls (halls 3 et 4), parallèles aux premiers, <strong>de</strong>même disposition et <strong>de</strong> mêmes dim<strong>en</strong>sions. Lorsqu’ EUROCHEMIC mis fin à sesactivités, seule une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité du hall 3 était exploitée, le hall 4 étant <strong>de</strong>meurévi<strong>de</strong>.L’ONDRAF décida d’utiliser ces intéressantes capacités résiduelles pour ses besoinspropres. C’est ainsi que le hall 3 accueille <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> bituminés <strong>en</strong> fûts <strong>de</strong>220 l, prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> l'instal<strong>la</strong>tion EUROBITUM mais aussi <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> cim<strong>en</strong>tés dansPAMELA (c<strong>la</strong>sse MAGAL). Le hall 4, lui, a été adapté pour accueillir les colis standard(400 l) <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés principalem<strong>en</strong>t par les c<strong>en</strong>trales <strong>de</strong> Doel et <strong>de</strong> Tihange et90/166
dont le débit <strong>de</strong> dose au contact est supérieur à <strong>la</strong> limite d’admission dans le bâtim<strong>en</strong>t151. Ces colis apparti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t aux c<strong>la</strong>sses MAGA, MAGAT et MAGAL.figure 23.: Vue extérieure du bâtim<strong>en</strong>t 127Chaque hall a les dim<strong>en</strong>sions suivantes : longueur = 64 m, <strong>la</strong>rgeur = 12 m, hauteur = 8,2 m.Les murs, réalisés <strong>en</strong> béton armé, ont une épaisseur <strong>de</strong> 80 cm et leur toit <strong>de</strong> 75 cm, cequi garantit un débit <strong>de</strong> dose au contact <strong>de</strong>s parois extérieures du bâtim<strong>en</strong>t inférieur à 25μSv/h.Les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> bitumage EUROBITUM adjac<strong>en</strong>tesont directem<strong>en</strong>t am<strong>en</strong>és par un chariot vers une position d’arrêt située <strong>en</strong> face du hal<strong>la</strong>uquel on les <strong>de</strong>stine. Un pont rou<strong>la</strong>nt télécommandé d’une capacité <strong>de</strong> 2 t les y pr<strong>en</strong><strong>de</strong>n charge, à l’ai<strong>de</strong> d’un grappin motorisé, pour les mettre <strong>en</strong>suite <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce dans le halld’<strong>en</strong>treposage.Les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> ayant une origine externe au complexe EUROSTORAGE-EUROBITUM arriv<strong>en</strong>t par camion, via un sas d’<strong>en</strong>trée. C’est dans ce sas que lescouvercles <strong>de</strong>s blindages <strong>de</strong> transport sont <strong>en</strong>levés et que les fûts à <strong>en</strong>treposer sont pris<strong>en</strong> charge par un pont rou<strong>la</strong>nt télécommandé et transbordés sur le chariot qui les mène àl’<strong>en</strong>trée du hall auquel on les <strong>de</strong>stine.Les fûts <strong>de</strong> 200 l sont empilés sur quatre niveaux. Ce<strong>la</strong> donne une capacité <strong>de</strong> 5 000 fûts<strong>de</strong> 220 l pour chacun <strong>de</strong>s trois premiers halls. Le hall 4 peut accueillir 3 370 fûts <strong>de</strong> 400 l,égalem<strong>en</strong>t empilés sur quatre niveaux. Tous les colis sont <strong>en</strong>treposés <strong>en</strong> positionverticale, ouverture vers le haut, chaque fût reposant sur quatre fûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> coucheinférieure. Lorsqu’un hall est rempli, le pont rou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion est dép<strong>la</strong>cé vers lehall suivant. Une fois rempli, l’<strong>en</strong>trée du hall est obturée à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s caissons remplis <strong>de</strong>sable et <strong>de</strong> blocs <strong>en</strong> béton. Une petite ouverture est <strong>la</strong>issée pour l’<strong>en</strong>trée d’air pour <strong>la</strong>v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion. L’air <strong>de</strong>s halls d’<strong>en</strong>treposage est rejeté, après filtration, via <strong>la</strong> cheminée dubâtim<strong>en</strong>t EUROBITUME.Au 31 décembre 2007, le hall 3 était rempli à 75 % (3 775 colis) et le quatrième, à 79 %(2 666 colis).91/166
figure 24: Vue intérieure du bâtim<strong>en</strong>t 1274. Les bâtim<strong>en</strong>ts pour <strong>déchets</strong> fortem<strong>en</strong>t irradiants4.1 Le bâtim<strong>en</strong>t 129figure 25: Le bâtim<strong>en</strong>t 129Le bâtim<strong>en</strong>t 129 est utilisé, <strong>de</strong>puis 1985, pour l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> haute activité<strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses HAGALP1, HAGALP2 et HAGALP3 <strong>en</strong> prov<strong>en</strong>ance <strong>de</strong> l'ex-EUROCHEMIC etvitrifiés dans l'instal<strong>la</strong>tion PAMELA voisine. La zone d’<strong>en</strong>treposage se compose <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxmodules juxtaposés : l’intérieur <strong>de</strong> chaque module est équipé <strong>de</strong> tubes cylindriquesverticaux (puits) <strong>de</strong>stinés à l’empilem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> vitrifiés. Ces colis,couramm<strong>en</strong>t appelés canisters, sont <strong>de</strong>s récipi<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> acier inoxydable qui conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>tles produits <strong>de</strong> haute activité immobilisés dans une matrice <strong>de</strong> verre.À l’origine, le bâtim<strong>en</strong>t ne compr<strong>en</strong>ait qu’un seul module <strong>de</strong>stiné à accueillir <strong>de</strong>s canistersPAMELA <strong>de</strong> 60 litres <strong>de</strong> volume intérieur. Un <strong>de</strong>uxième module a été construit puis mis<strong>en</strong> service ultérieurem<strong>en</strong>t pour accueillir <strong>de</strong>s canisters PAMELA <strong>de</strong> 150 litres.Les murs <strong>de</strong>s modules, construits <strong>en</strong> béton armé, ont une épaisseur <strong>de</strong> 120 cm, ce quigarantit un débit <strong>de</strong> dose au contact <strong>de</strong>s parois extérieures inférieur à 25 μSv/h.Au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s modules d’<strong>en</strong>treposage se trouve un local <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion appelé hall <strong>de</strong>92/166
chargem<strong>en</strong>t.Les dim<strong>en</strong>sions <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux modules sont les mêmes: longueur = 18 m, <strong>la</strong>rgeur = 12,2 m,Leur hauteur est <strong>de</strong> 20 m, hall <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>t inclus.Le module 1 conti<strong>en</strong>t 252 puits. Dans chaque puits, six canisters <strong>de</strong> 60 l peuv<strong>en</strong>t trouverp<strong>la</strong>ce, ce qui donne une capacité totale <strong>de</strong> 1 512 canisters pour le module 1. Le module 1est pratiquem<strong>en</strong>t saturé puisque 1 501 canisters <strong>de</strong> 60 litres y sont <strong>en</strong>treposés. Lemodule 2 conti<strong>en</strong>t 20 puits pouvant accueillir 5 canisters <strong>de</strong> 150 l et 160 puits pouvantaccueillir 6 canisters <strong>de</strong> 150 l, soit un total <strong>de</strong> 1 060 canisters. 834 canisters <strong>de</strong> 150 litresy ont trouvé p<strong>la</strong>ce à l'heure <strong>actuelle</strong>.Après refroidissem<strong>en</strong>t, les canisters <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> vitrifiés dans l’instal<strong>la</strong>tion PAMELA ontété transférés vers le bâtim<strong>en</strong>t 129, sur wagonnet, à l’intérieur d’un blindage <strong>de</strong> transporttemporaire. Le wagonnet pénètre dans le sas d’<strong>en</strong>trée du bâtim<strong>en</strong>t 129. Un pont rou<strong>la</strong>nt,à comman<strong>de</strong> manuelle, d’une capacité <strong>de</strong> levage <strong>de</strong> 40 t, dépose sur le blindage <strong>de</strong>transport, une hotte blindée équipée d’un système <strong>de</strong> levage. Le grappin mécanique <strong>de</strong>ce système <strong>de</strong> levage agrippe le canister et le tire dans <strong>la</strong> hotte. Le pont rou<strong>la</strong>nt lève<strong>en</strong>suite <strong>la</strong> hotte blindée cont<strong>en</strong>ant le canister et <strong>la</strong> dép<strong>la</strong>ce dans le hall <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>tsitué au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s modules d’<strong>en</strong>treposage. L’épaisse dalle <strong>de</strong> sol du hall <strong>de</strong>chargem<strong>en</strong>t est pourvue d’ouvertures donnant accès aux puits <strong>de</strong>s modulesd’<strong>en</strong>treposage. Ces ouvertures sont obturées par <strong>de</strong>s bouchons <strong>en</strong> béton amovibles<strong>de</strong>stinés à assurer <strong>la</strong> protection radiologique <strong>de</strong>s opérateurs circu<strong>la</strong>nt dans le hall <strong>de</strong>chargem<strong>en</strong>t. Avant d’ôter le bouchon du puits à <strong>de</strong>sservir, on pr<strong>en</strong>d soin <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong>p<strong>la</strong>ce une vanne <strong>de</strong> blindage mobile. La hotte blindée est p<strong>la</strong>cée au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> cettevanne mobile. Après ouverture <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière, le canister est <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>du dans le puitsjusqu’à sa position <strong>de</strong> stockage. Lorsque l’opération <strong>de</strong> remplissage est terminée, lebouchon est remis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce. Tous ces blindages fixes et mobiles garantiss<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> toutescirconstances, <strong>la</strong> protection du personnel d’exploitation et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre lesradiations émises par les <strong>déchets</strong> manut<strong>en</strong>tionnés ou <strong>en</strong>treposés.Bi<strong>en</strong> que <strong>la</strong> chaleur produite par les <strong>déchets</strong> vitrifiés dans PAMELA soit re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>tfaible, l’instal<strong>la</strong>tion est pourvue d’un système <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion forcée permettant <strong>de</strong> refroidirles canisters. L’air évacué <strong>de</strong>s modules d’<strong>en</strong>treposage passe par un filtre avant rejet dansune cheminée <strong>de</strong> 5 m située au-<strong>de</strong>ssus du bâtim<strong>en</strong>t.figure 26.: Le hall <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>t du bâtim<strong>en</strong>t 129Sur <strong>la</strong> photo ci-<strong>de</strong>ssus, les bouchons fermant les paniers sont visibles sur le sol du hall<strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>t. La hotte <strong>de</strong> transfert se trouve à l'arrière-p<strong>la</strong>n.93/166
4.2 Le bâtim<strong>en</strong>t 136Le bâtim<strong>en</strong>t 136 est principalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>stiné à l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>prov<strong>en</strong>ant du retraitem<strong>en</strong>t par l’usine AREVA NC <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hague <strong>de</strong> combustible belgeirradié dans les c<strong>en</strong>trales nucléaires belges (et, pour une petite part, dans le réacteurBR2). Les contrats <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> vigueur prévoi<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> effet, le rapatriem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>Belgique <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong> ultimes. On i<strong>de</strong>ntifie <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t: les <strong>déchets</strong> hautem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong> vitrifiés CSD-V <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse ZAGALC, cont<strong>en</strong>usdans <strong>de</strong>s canisters <strong>en</strong> acier inoxydable. Les <strong>déchets</strong> hautem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong> sontimmobilisés à l’intérieur <strong>de</strong> ces canisters, dans une matrice <strong>de</strong> verre. Le débit <strong>de</strong> doseest considérable et <strong>la</strong> chaleur émise est loin d’être négligeable. La quantité <strong>de</strong> chaleurémise se situe <strong>en</strong>tre 1 et 2 kW par canister, valeur que l'on peut comparer auxquelques dizaines <strong>de</strong> watts émis par un canister HAGALP <strong>de</strong> PAMELA. Ces canisterssont cep<strong>en</strong>dant physiquem<strong>en</strong>t assez simi<strong>la</strong>ires aux <strong>déchets</strong> vitrifiés dans l’instal<strong>la</strong>tionPAMELA <strong>en</strong>treposés dans le bâtim<strong>en</strong>t 129 voisin; les <strong>déchets</strong> métalliques CSD-C <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse HAGALC2 (parfois appelés « gaines etembouts », prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> <strong>la</strong> supercompaction <strong>de</strong>s gaines et élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> structure <strong>de</strong>sassemb<strong>la</strong>ges <strong>de</strong>s combustibles et disposés dans <strong>de</strong>s canisters i<strong>de</strong>ntiques auxprécé<strong>de</strong>nts.figure 27: Vue extérieure du bâtim<strong>en</strong>t 136 : <strong>en</strong> vert, le hall <strong>de</strong> réception, <strong>en</strong> b<strong>la</strong>nc, le sas, <strong>en</strong> bleufoncé, <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t, le hall <strong>de</strong> transfert et <strong>la</strong> cellule d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong>vitrifiés,<strong>en</strong> bleu c<strong>la</strong>ir le couloir <strong>de</strong> transfert et le hall d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> non vitrifiés.94/166
figure 28.: Le hall <strong>de</strong> transfertfigure 29: Le pont <strong>de</strong> transfertOn prévoit <strong>en</strong>fin d’<strong>en</strong>treposer dans le bâtim<strong>en</strong>t 136 un troisième type <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>conditionnés, les <strong>déchets</strong> cim<strong>en</strong>tés <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse MAGAL, prov<strong>en</strong>ant du retraitem<strong>en</strong>t parl’usine UKAEA <strong>de</strong> Dounreay du combustible usé du réacteur BR2 du SCK·CEN.La première partie du bâtim<strong>en</strong>t 136, qui est <strong>de</strong> conception modu<strong>la</strong>ire, a été mise <strong>en</strong>service <strong>en</strong> 2000. La secon<strong>de</strong> partie est prête mais n’est pas <strong>en</strong>core <strong>en</strong>trée <strong>en</strong>exploitation.De par le haut niveau d'activité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> qui y sont <strong>en</strong>treposés, le bâtim<strong>en</strong>t 136 abrite,à lui seul, plus <strong>de</strong> 95 % <strong>de</strong> l'inv<strong>en</strong>taire radioactif total prés<strong>en</strong>t sur le site 1 <strong>de</strong>Belgoprocess. L’ONDRAF a donc pris <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> sécurité très particulières pourgarantir, p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> durée prévisible <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>treposage (60 ans ou plus), <strong>en</strong> situationnormale comme <strong>en</strong> situation acci<strong>de</strong>ntelle, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’homme et l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tcontre les radiations int<strong>en</strong>ses émises par les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>en</strong>treposés. Le séisme,l’explosion <strong>de</strong> gaz et <strong>la</strong> chute d’avion ont été pris <strong>en</strong> compte dans le dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t dubâtim<strong>en</strong>t 136. Les murs extérieurs <strong>de</strong>s locaux où séjourn<strong>en</strong>t ou transit<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s sourcesradioactives sont très épais et <strong>en</strong> béton fortem<strong>en</strong>t armé. Outre le rôle qu’ils jou<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong>protection radiologique, ils ont été conçus pour résister à l’impact direct d’un avion <strong>de</strong>chasse <strong>de</strong> type F-16 tombant à 540 km/h. La résistance à ces sollicitations extrêmesrequiert <strong>de</strong>s épaisseurs <strong>de</strong> parois considérables, l’utilisation d’un type très spéciald’armatures (aciers à haute limite é<strong>la</strong>stique assemblés par manchons) ainsi qu’une haute<strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> ferrail<strong>la</strong>ge.Hall <strong>de</strong> réceptionLes embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> transport arriv<strong>en</strong>t par route, sur une remorque spéciale tirée par untracteur. Le véhicule pénètre dans le hall <strong>de</strong> réception. Ce <strong>de</strong>rnier est équipé d’un pont <strong>de</strong>130 t qui sert au relèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s lourds embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> transport (jusque 110 t) et à leurmise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce sur un chariot <strong>de</strong> transfert se dép<strong>la</strong>çant sur rail. La superstructure <strong>de</strong> cechariot est facilem<strong>en</strong>t adaptable aux différ<strong>en</strong>ts types et formats d’embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> transportatt<strong>en</strong>dus.SasLe chariot <strong>de</strong> transfert se dép<strong>la</strong>ce vers le sas qui se trouve <strong>en</strong>tre le hall <strong>de</strong> réception et <strong>la</strong>cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t. Ce sas conti<strong>en</strong>t tous les équipem<strong>en</strong>ts nécessaires auxcontrôles réglem<strong>en</strong>taires <strong>de</strong>s colis ou embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> transport, à leur <strong>en</strong>trée comme àleur sortie. On y trouve égalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> quoi effectuer, si nécessaire, une décontaminationd’un embal<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> transport. Le sas est équipé d’un pont d’une capacité <strong>de</strong> 20 t.Cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>tAprès contrôle <strong>de</strong> l’embal<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> transport, le chariot <strong>de</strong> transfert se dép<strong>la</strong>ce vers <strong>la</strong>cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t.Cette cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t est conçue <strong>de</strong> manière à ce que les différ<strong>en</strong>ts typesd’embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>s colis primaires <strong>de</strong>stinés à l’<strong>en</strong>treposage dans le bâtim<strong>en</strong>t95/166
136 puiss<strong>en</strong>t être vidangés <strong>en</strong> toute sécurité. Elle est équipée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ponts rou<strong>la</strong>ntssuperposés commandés à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> salle <strong>de</strong> contrôle. Le pont rou<strong>la</strong>nt supérieur estmuni d’un système <strong>de</strong> levage d’une capacité <strong>de</strong> 20 t ; il sert à <strong>la</strong> manut<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s lourdscouvercles fermant les embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> transport. Le pont rou<strong>la</strong>nt inférieur est équipé, lui,<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux systèmes <strong>de</strong> levage : le premier a une capacité d’1 t qui sert à <strong>la</strong> manut<strong>en</strong>tion<strong>de</strong>s canisters <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> vitrifiés ; le <strong>de</strong>uxième a une capacité <strong>de</strong> 5 t qui sert à <strong>la</strong>manut<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s colis primaires <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non vitrifiés.Les <strong>déchets</strong> sont dispatchés, selon le type, <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t vers <strong>la</strong>zone d’<strong>en</strong>treposage qui leur est spécifiquem<strong>en</strong>t réservée.Les <strong>déchets</strong> vitrifiés ZAGALC, qui nécessit<strong>en</strong>t un refroidissem<strong>en</strong>t perman<strong>en</strong>t, dispos<strong>en</strong>td’une zone d’<strong>en</strong>treposage propre, <strong>la</strong> cellule d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> vitrifiés. Unmonte-charge, commandé à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> salle <strong>de</strong> contrôle, amène les canisters <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>vitrifiés ZAGALC <strong>de</strong>puis le niveau supérieur <strong>de</strong> l’embal<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> transport jusqu’à uneouverture pratiquée dans le p<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t. Cette ouverture estobturée par une vanne <strong>de</strong> blindage télécommandée. C’est à cet <strong>en</strong>droit que les canisterssont pris <strong>en</strong> charge par <strong>la</strong> machine <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>t du hall <strong>de</strong> transfert pour <strong>déchets</strong>vitrifiés.Les <strong>déchets</strong> non vitrifiés, les HAGALC2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hague et les MAGAL <strong>de</strong> Dounreay, sonteux évacués à l’ai<strong>de</strong> d’un chariot <strong>de</strong> transport vers leur zone spécifique d’<strong>en</strong>treposage, lehall d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> non vitrifiés.La cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t est pourvue d’un poste <strong>de</strong> contrôle équipé pour réaliser, <strong>de</strong>svérifications sur les colis primaires (débit <strong>de</strong> dose, température, contamination surfacique,masse, aspect visuel, …). Ce poste <strong>de</strong> contrôle pourra servir pour les opérations <strong>de</strong>contrôle <strong>de</strong>s canisters <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> vitrifiés PAMELA (c<strong>la</strong>sses HAGALP1, HAGALP2 etHAGALP3) <strong>en</strong>treposés dans le bâtim<strong>en</strong>t 129.Cellule d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> vitrifiésLa cellule d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> vitrifiés ZAGALC a une capacité d’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>590 colis primaires. Elle est subdivisée <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux modules séparés l’un <strong>de</strong> l’autre par uneparoi. Chaque module compr<strong>en</strong>d trois rangées <strong>de</strong> dix puits, soit 60 puits au total. Chaquepuits compr<strong>en</strong>d un tube, fixé à une structure métallique, dans lequel sont empilés <strong>de</strong> bas<strong>en</strong> haut : un amortisseur <strong>de</strong> chute, dix colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> vitrifiés et un bouchon d’iso<strong>la</strong>tionthermique <strong>de</strong>stiné à protéger le p<strong>la</strong>fond <strong>de</strong>s modules <strong>de</strong> toute surchauffe ponctuelle. Ceconcept d'<strong>en</strong>treposage, <strong>en</strong> puits métalliques verticaux, est assez simi<strong>la</strong>ire à celui dubâtim<strong>en</strong>t 129.Un <strong>de</strong>s 60 puits est réservé au stockage d’échantillons d’acier, <strong>de</strong> béton, … constitutifs<strong>de</strong> <strong>la</strong> structure interne <strong>de</strong>s modules. Un <strong>de</strong>s soucis <strong>de</strong> l’ONDRAF est <strong>en</strong> effet <strong>de</strong> pouvoirsuivre l’évolution <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion d’<strong>en</strong>treposage pour vérifier si elle reste bi<strong>en</strong> compatibleavec les rôles qu’on lui attribue <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> sûreté. Ces échantillons permettrontnotamm<strong>en</strong>t d’analyser comm<strong>en</strong>t les structures évolu<strong>en</strong>t sous l’effet du champ thermiqueet sous l’effet <strong>de</strong> l’irradiation.Les dim<strong>en</strong>sions intérieures <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux modules sont les suivantes : longueur = 15,1 m, <strong>la</strong>rgeur = 11,2 m, hauteur 15 m.L’épaisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> dalle <strong>de</strong> p<strong>la</strong>fond <strong>de</strong>s modules est <strong>de</strong> 170 cm. L’épaisseur <strong>de</strong>s murs <strong>de</strong><strong>la</strong> cellule est <strong>de</strong> 140 cm. Chaque module comporte, <strong>en</strong> plus, un mur intérieur <strong>de</strong> 40 cmd’épaisseur auquel sont fixées les structures métalliques. Ces épaisseurs <strong>de</strong> murspermett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> garantir un débit <strong>de</strong> dose au contact <strong>de</strong>s murs extérieurs du bâtim<strong>en</strong>tinférieur à 20 µSv/h.Au 31 décembre 2007, 390 canisters <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> vitrifiés sont <strong>en</strong>treposés dans <strong>la</strong> cellulepour <strong>déchets</strong> vitrifiés.96/166
Hall <strong>de</strong> transfert pour les <strong>déchets</strong> vitrifiésLe hall <strong>de</strong> transfert se trouve au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong>s modulesd’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> vitrifiés. Le colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> vitrifiés prés<strong>en</strong>té par le montecharge<strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t est pris <strong>en</strong> charge par un dispositif <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tionappelé machine <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>t. Ce dispositif comporte une hotte blindée accrochée à unpont rou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 65 t qui <strong>de</strong>ssert l’<strong>en</strong>tièreté du hall <strong>de</strong> transfert. L’accès aux puits se faitpar <strong>de</strong>s ouvertures dans <strong>la</strong> dalle <strong>de</strong> sol du hall <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>t. Ces ouvertures sontfermées par <strong>de</strong>s bouchons <strong>en</strong> béton qui garantiss<strong>en</strong>t <strong>la</strong> protection radiologique <strong>de</strong>sopérateurs circu<strong>la</strong>nt dans le hall <strong>de</strong> transfert.Avant d’accé<strong>de</strong>r aux puits, on veille à interposer, comme on le fait dans le bâtim<strong>en</strong>t 129,une vanne mobile blindée qui permet <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> continuité <strong>de</strong> <strong>la</strong> protectionradiologique, même après <strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t du bouchon <strong>en</strong> béton. Le bouchon <strong>de</strong> puits estretiré par <strong>la</strong> machine <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>t et déposé dans sa zone d’att<strong>en</strong>te. La machine <strong>de</strong>chargem<strong>en</strong>t se positionne <strong>en</strong>suite sur l’ouverture située au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong>déchargem<strong>en</strong>t, pr<strong>en</strong>d le canister prés<strong>en</strong>té par le monte-charge et vi<strong>en</strong>t le déposer dans lepuits choisi. Un fois l’opération <strong>de</strong> remplissage terminée, <strong>la</strong> machine <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>tremet le bouchon thermique puis le bouchon radiologique <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce.Ces opérations sont partiellem<strong>en</strong>t automatisées et contrôlées à partir d’un poste <strong>de</strong>comman<strong>de</strong> susp<strong>en</strong>du au pont rou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> machine <strong>de</strong> chargem<strong>en</strong>t. La combinaison <strong>de</strong>blindages radiologiques perman<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong> blindages mobiles ainsi que <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce<strong>de</strong> nombreux systèmes <strong>de</strong> verrouil<strong>la</strong>ge et <strong>de</strong> détection dans le système <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>réduis<strong>en</strong>t considérablem<strong>en</strong>t le risque d’acci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion et garantiss<strong>en</strong>t, <strong>en</strong>toutes circonstances, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> toute personne circu<strong>la</strong>nt dans le hall <strong>de</strong> transfert.Hall d’<strong>en</strong>treposage pour les <strong>déchets</strong> non vitrifiésLe hall d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> non vitrifiés accueillera bi<strong>en</strong>tôt les canisters <strong>de</strong><strong>déchets</strong> HAGALC2 compactés (gaines et embouts) <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hague et les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>cim<strong>en</strong>tés HAGAL <strong>de</strong> Dounreay. Les canisters <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> HAGALC2 serontpréa<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t disposés dans <strong>de</strong>s paniers métalliques (quatre canisters par panier), aprèsleur sortie <strong>de</strong> l’embal<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> transport.Un couloir <strong>de</strong> transfert relie <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t au hall d’<strong>en</strong>treposage pour<strong>déchets</strong> non vitrifiés. Les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> qui lui sont <strong>de</strong>stinés quitt<strong>en</strong>t <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong>déchargem<strong>en</strong>t sur un chariot <strong>de</strong> transport. Ce chariot <strong>de</strong> transfert s’arrête à l’<strong>en</strong>trée duhall d’<strong>en</strong>treposage. Ce hall est normalem<strong>en</strong>t fermé par <strong>de</strong> lour<strong>de</strong>s portes blindées. Unefois les portes ouvertes, un pont rou<strong>la</strong>nt (capacité <strong>de</strong> 10 t) pr<strong>en</strong>d, à l’ai<strong>de</strong> d’un grappinadapté, les <strong>déchets</strong> disposés sur le chariot et va les mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce dans le halld’<strong>en</strong>treposage.Il est prévu d’empiler les paniers cont<strong>en</strong>ant les HAGALC2 sur trois couches. Les coliscim<strong>en</strong>tés (UKAEA) seront <strong>en</strong>treposés <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux couches dans un empilem<strong>en</strong>t distinct dupremier, chaque colis reposant sur <strong>de</strong>ux colis <strong>de</strong> <strong>la</strong> couche inférieur.Les dim<strong>en</strong>sions intérieures du hall d’<strong>en</strong>treposage sont les suivantes : longueur = 60 m, <strong>la</strong>rgeur = 15 m, hauteur = 12 m.L’épaisseur <strong>de</strong> ses murs, <strong>en</strong> béton fortem<strong>en</strong>t armé, s’élève à 170 cm, ce qui garantit undébit <strong>de</strong> dose au contact <strong>de</strong>s murs extérieurs inférieur à 25 µSv/h.Le hall d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> non vitrifiés est <strong>en</strong>core vi<strong>de</strong> à l’heure <strong>actuelle</strong>. Lerapatriem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s premiers <strong>déchets</strong> HAGALC2 est prévu pour l’année 2009.Caractère modu<strong>la</strong>ire du bâtim<strong>en</strong>t 136Le bâtim<strong>en</strong>t 136 est <strong>de</strong> conception modu<strong>la</strong>ire, ce qui permet <strong>de</strong> construire aisém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sext<strong>en</strong>sions aux capacités d’<strong>en</strong>treposage existantes, <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s besoins réels. De97/166
nouvelles capacités pourrai<strong>en</strong>t s’avérer nécessaires dans le cas où <strong>la</strong> Belgique mettraitfin au moratoire sur le retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s combustibles usés. On pourrait aller, s’il le fal<strong>la</strong>it,jusqu’à décupler <strong>la</strong> capacité initiale.V<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tionLe bâtim<strong>en</strong>t 136 est équipé d’un système <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion comportant plusieurs circuitsindép<strong>en</strong>dants. La conception <strong>de</strong> ces circuits, <strong>en</strong> particulier celui <strong>de</strong>stiné aurefroidissem<strong>en</strong>t perman<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> vitrifiés, a fait l’objet d’un soin particulier : <strong>de</strong>sv<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>teurs <strong>de</strong> secours sont prêts à <strong>en</strong>trer <strong>en</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> défail<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>sv<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>teurs normaux. Une alim<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> secours assure le mainti<strong>en</strong> d’une puissanceélectrique suffisante <strong>en</strong> sas <strong>de</strong> rupture <strong>de</strong> l’alim<strong>en</strong>tation normale.L’air évacué est filtré puis rejeté, après contrôle, par <strong>de</strong>ux cheminées : l’une est située àcôté <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> vitrifiés, l’autre est p<strong>la</strong>cée au <strong>de</strong>ssus dulocal <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion situé à l’extrémité du hall d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> non vitrifiés.La première <strong>de</strong>s cheminées a une hauteur <strong>de</strong> 30 m. En cas <strong>de</strong> panne totale du système<strong>de</strong> refroidissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s modules d’<strong>en</strong>treposage pour <strong>déchets</strong> vitrifiés, un simple by-passmanuel <strong>de</strong>s filtres d’<strong>en</strong>trée et <strong>de</strong> sortie permet, grâce à <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> cette hautecheminée, <strong>la</strong> création, <strong>en</strong> ultime secours, d’un courant <strong>de</strong> convection naturelle suffisantpour assurer le refroidissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s canisters, même si les modules sont remplis.Une système <strong>de</strong> récupération <strong>de</strong> chaleur a été installé à l’extraction <strong>de</strong> l’air <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion.5. Procédure <strong>de</strong> suivi dans le temps <strong>de</strong>s DC acceptés5.1 Objectif poursuivi et stratégie appliquéeCe sont, comme le prévoit l’article 17 <strong>de</strong>s Règles générales applicables aux colis <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés, les critères d’acceptation établis par l’ONDRAF quidétermin<strong>en</strong>t les procédures administratives et techniques régissant le suivi dans le temps<strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> mis <strong>en</strong> <strong>en</strong>trepôts. Le but <strong>de</strong> cesprocédures est double :1. contrôler si les colis primaires rest<strong>en</strong>t conformes aux critères d’acceptation quiétai<strong>en</strong>t applicables au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’établissem<strong>en</strong>t du procès-verbal d’acceptation;2. contrôler si les colis primaires <strong>de</strong>meur<strong>en</strong>t compatibles avec leur <strong>de</strong>stination finale<strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce.Cette <strong>de</strong>rnière est aujourd’hui connue pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A : ce sera <strong>la</strong> misedans un dépôt final <strong>en</strong> surface, à Dessel, conformém<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> décision du gouvernem<strong>en</strong>tdu 23 juin 2006.Pour les autres catégories <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, <strong>la</strong> situation est beaucoup moins c<strong>la</strong>irepuisqu’aucune décision n’a été prise pour ce qui concerne leur <strong>de</strong>stination finale. Il fautdonc se cont<strong>en</strong>ter ici d’hypothèses <strong>de</strong> travail. Compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s conclusions<strong>en</strong>courageantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission SAFIR 2 (voir chapitre onze), l’ONDRAF a choisi, àtitre provisoire, <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre comme solution <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégoriesB et C, le dépôt profond dans l’Argile <strong>de</strong> Boom. Tout changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> scénario <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>à long terme conduira vraisemb<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t à une révision <strong>de</strong>s procédures administrativeset techniques.5.2 Principe <strong>de</strong> radioprotectionDans tous les cas <strong>de</strong> figures et malgré les précautions prises pour protéger lesopérateurs chargés <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion, d’inspection et <strong>de</strong> mesureseffectuées dans le cadre du suivi dans le temps, ces opérations <strong>de</strong> suivi contribu<strong>en</strong>tinévitablem<strong>en</strong>t à un accroissem<strong>en</strong>t, aussi faible soit-il, <strong>de</strong>s doses reçues par lesopérateurs. Or on se rappellera que toute décision d’action <strong>en</strong> <strong>la</strong> matière doitimpérativem<strong>en</strong>t être justifiée, <strong>en</strong> application du 1er principe <strong>de</strong> radioprotection mais98/166
égalem<strong>en</strong>t optimisée, <strong>en</strong> application du principe ALARA – As Low As ReasonablyAchievable. Ce<strong>la</strong> signifie que les observations et données acquises dans le cadre <strong>de</strong> cesopérations <strong>de</strong> suivi doiv<strong>en</strong>t obligatoirem<strong>en</strong>t apporter <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts dont <strong>la</strong> valeur ajoutéeest supérieure à celle <strong>de</strong>s informations déjà disponibles comme les données publiéesdans <strong>la</strong> littérature, les connaissances acquises dans le cadre <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>caractérisation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> gérées par l’ONDRAF et/ou les informations reprises dansles dossiers d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s procédés <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t.En particulier, les opérations <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> colis aussi irradiants que les canisters <strong>de</strong><strong>déchets</strong> vitrifiés ZAGALC doiv<strong>en</strong>t être limitées au strict nécessaire. Toute manipu<strong>la</strong>tionsupplém<strong>en</strong>taire accroît <strong>en</strong> effet les risques d'inci<strong>de</strong>nt, nonobstant les mesures drastiques<strong>de</strong> sécurité prises. Toute nouvelle opération doit être préa<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t justifiée et optimiséesur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté, ce qui peut exiger <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s considérablestant d'un point <strong>de</strong> vue technique que financier.5.3 P<strong>la</strong>ce du suivi dans le temps dans le processus <strong>de</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong> l’acceptationLa surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>en</strong>treposés n’est qu’une parmi les nombreuses activitésréalisées par l’ONDRAF, dans le cadre son système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>, pour garantir, dans <strong>la</strong>durée, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s opérateurs, du public et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre les nuisancespot<strong>en</strong>tielles issues <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> pris <strong>en</strong> charge. Elle est complém<strong>en</strong>taire <strong>de</strong> toutes lesactivités <strong>de</strong> contrôle, <strong>de</strong> mesure, d’inspection réalisées tout au long du cycled’acceptation. Le suivi dans le temps ne remp<strong>la</strong>ce pas les év<strong>en</strong>tuels contrôlessupplém<strong>en</strong>taires requis dans le cadre d’une procédure normale d’acceptation maisoccupe, <strong>en</strong> aval, une p<strong>la</strong>ce c<strong>en</strong>trale dans le contexte <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> continue <strong>de</strong>l’acceptation <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés.Le premier contrôle doit interv<strong>en</strong>ir au plus tard trois ans après l’acceptation officielle ducolis primaire, conformém<strong>en</strong>t aux dispositions <strong>de</strong> l’article 13 <strong>de</strong>s Règles générales. Lescontrôles suivants <strong>en</strong> pério<strong>de</strong> sont à réaliser tous les dix ans, p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>d'<strong>en</strong>treposage.Des mesures correctives ou prév<strong>en</strong>tives seront, si elles se justifi<strong>en</strong>t, mises <strong>en</strong> œuvre : dans le cas où, lors d’un exam<strong>en</strong> réalisé dans le cadre du suivi dans le temps, uneévolution anormale d’une caractéristique physique est i<strong>de</strong>ntifiée sur colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>accepté pour autant que cette évolution anormale soit <strong>de</strong> nature à <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drer <strong>de</strong>srisques inacceptables pour l’homme et l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t; dans le cas d’une modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion applicable; dans le cas d’une modification substantielle d’un critère d’acceptation; dans le cas d’un changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge ou <strong>de</strong>scaractéristiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>stination finale <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce.Ces mesures sont déterminées <strong>en</strong> concertation avec toutes les parties concernées, <strong>en</strong>particulier l’exploitant <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion, le producteur ou le propriétaire du colis concerné.Elles peuv<strong>en</strong>t, à titre d’exemple, consister <strong>en</strong> : un exam<strong>en</strong>, une analyse, une caractérisation complém<strong>en</strong>taires; une recherche <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong> cette évolution anormale; une réparation ou un reconditionnem<strong>en</strong>t provisoire ou définitif du ou <strong>de</strong>s colisconcerné(s); une modification <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion d’<strong>en</strong>treposage; une révision <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> fréqu<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s contrôles <strong>de</strong> suivi.99/166
5.4 Caractéristiques et propriétés du colis primaire <strong>de</strong> DCqui doiv<strong>en</strong>t être suivies dans le temps.Le but <strong>de</strong>s contrôles effectués est <strong>de</strong> vérifier si, d’une part, <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>treposag<strong>en</strong>’est pas mise <strong>en</strong> péril par une évolution anormale <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong>s colis et si,d’autre part, les colis peuv<strong>en</strong>t être gérés <strong>en</strong> toute sûreté jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>d’<strong>en</strong>treposage. Les caractéristiques <strong>de</strong>s colis qui ne sont pas susceptibles d’évoluer aucours du temps ou dont l’évolution est déterminée <strong>de</strong> manière uniforme par lescaractéristiques initiales du colis (comme <strong>la</strong> masse), n’<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t donc normalem<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong>ligne <strong>de</strong> compte dans le cadre du suivi dans le temps.Le suivi dans le temps porte <strong>en</strong> priorité sur l’intégrité physique <strong>de</strong> l’embal<strong>la</strong>ge primaireainsi que sur l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> contamination surfacique si un défaut (corrosion, fissuration,déformation, perforation, perte d’étanchéité, …) est constaté sur l’embal<strong>la</strong>ge primaire.Mais d’autres contrôles sont possibles s’ils sont jugés nécessaires. L’atmosphère peutêtre égalem<strong>en</strong>t mesurée à différ<strong>en</strong>ts points dans le bâtim<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>treposage.5.5 Déroulem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> suivi dans le tempsChaque bâtim<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>treposage fait l’objet d’un p<strong>la</strong>n spécifique <strong>de</strong> suivi dans le temps quipr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> compte les conditions techniques <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion comme l’accessibilité <strong>de</strong>scolis, <strong>la</strong> disponibilité d’un <strong>en</strong>treposage tampon disponible, les équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>manut<strong>en</strong>tions disponibles ainsi que les caractéristiques propres <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>conditionnés comme, par exemple, le débit <strong>de</strong> dose. Un ou plusieurs colis sontsélectionnés par nouvelle campagne <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t, pour servir <strong>de</strong> colis témoindans le cadre <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> suivi dans le temps. Ces colis témoins sont <strong>en</strong>treposésdans une zone séparée <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>trepôt pour être aisém<strong>en</strong>t accessibles. Pour ce quiconcerne les colis <strong>de</strong> <strong>la</strong> production historique, les ag<strong>en</strong>ts responsables du suivi dans letemps sélectionn<strong>en</strong>t sur une base aléatoire, les colis qui <strong>de</strong>vront servir à l’av<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>témoins. Ces colis sont alors retirés <strong>de</strong> l’empilem<strong>en</strong>t et <strong>en</strong>treposés dans <strong>la</strong> zone réservéeaux colis témoins.Déchets faiblem<strong>en</strong>t irradiantsLe suivi dans le temps est opérationnel pour les colis <strong>en</strong>treposés dans bâtim<strong>en</strong>ts 151 et155. Le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> suivi dans le temps <strong>de</strong>s colis <strong>en</strong>treposés dans le bâtim<strong>en</strong>t 150 est <strong>en</strong>préparation. Il faut t<strong>en</strong>ir compte, pour cette instal<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong> l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> ponts rou<strong>la</strong>nts quir<strong>en</strong>d <strong>la</strong> récupération sélective <strong>de</strong>s colis plus difficile. L’inspection régulière <strong>de</strong>s colis situés<strong>en</strong> périphérie <strong>de</strong>s empilem<strong>en</strong>ts permet toutefois <strong>de</strong> se faire une idée sur <strong>la</strong> bonne t<strong>en</strong>ued’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s colis <strong>en</strong> <strong>en</strong>treposage.Déchets moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiantsLe suivi dans le temps <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>en</strong>treposés dans le bâtim<strong>en</strong>t 127 ne porte que sur les<strong>déchets</strong> acceptés, soit les <strong>déchets</strong> situés dans le hall 4 et une partie <strong>de</strong> ceux situés dansle hall 3 : pour le hall 4, dans lequel sont principalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>treposés <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> 400 l <strong>de</strong> <strong>la</strong>production courante, les mêmes modalités que pour le bâtim<strong>en</strong>t 151 sont d'application,moy<strong>en</strong>nant <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> radioprotection adéquates, compte t<strong>en</strong>u du niveaud'irradiation plus élevé <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> concernés; pour le hall 3, <strong>la</strong> situation est intermédiaire puisque <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong>s productionsanci<strong>en</strong>nes coexist<strong>en</strong>t avec les colis <strong>de</strong> <strong>la</strong> production courante, ces <strong>de</strong>rniers étanttoutefois moins nombreux. Les contrôles dans les halls 3 et 4 sont plus aisés à réaliserque dans les halls 1 et 2 étant donné que le pont rou<strong>la</strong>nt y a toujours normalem<strong>en</strong>taccès.Pour les halls 1 et 2, qui ne conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t que <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong>s productions anci<strong>en</strong>nes, il n'aété effectué à ce jour que <strong>de</strong>s contrôles visuels à distance, à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> caméras. Cescontrôles, qui se déroul<strong>en</strong>t dans le cadre du programme d'inspection visuelle (voir section100/166
6 du prés<strong>en</strong>t chapitre), ont cep<strong>en</strong>dant permis <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s défauts surcertains colis <strong>en</strong>treposés : corrosions localisées, déformations <strong>de</strong> couvercles,débor<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice bitumineuse d'immobilisation suite à un gonflem<strong>en</strong>t dumatériau. Une étu<strong>de</strong> approfondie portant sur l’origine <strong>de</strong> ces défauts et sur les mesures<strong>de</strong> remédiation possibles a été <strong>la</strong>ncée. Ces défauts ne mett<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> péril <strong>la</strong> sûretéd’exploitation du bâtim<strong>en</strong>t 127 ni <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, les radionucléi<strong>de</strong>s restantpiégés au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice <strong>de</strong> bitume.Déchets fortem<strong>en</strong>t irradiantsLe p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> suivi dans le temps <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> vitrifiés <strong>en</strong>treposés dans le bâtim<strong>en</strong>t 136 estopérationnel. Des canisters témoins, représ<strong>en</strong>tatifs <strong>de</strong> l'année d'acceptation, ont étésélectionnés et disposés dans les puits, au sommet <strong>de</strong>s l’empilem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> façon à êtredirectem<strong>en</strong>t accessible.Le suivi dans le temps repose ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur un exam<strong>en</strong> visuel <strong>de</strong> l'embal<strong>la</strong>geprimaire <strong>de</strong>s canisters témoins ainsi que sur une mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> contamination surfacique.Ces opérations qui vis<strong>en</strong>t à s’assurer du bon état <strong>de</strong> l'embal<strong>la</strong>ge primaire et doncindirectem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'étanchéité du colis primaire sont réalisées au poste <strong>de</strong> contrôle situédans <strong>la</strong> cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t du bâtim<strong>en</strong>t 136.Des échantillons <strong>de</strong> l'acier inoxydable constitutif <strong>de</strong>s embal<strong>la</strong>ges primaires <strong>de</strong>s canisters,voire même un canister vi<strong>de</strong>, sont disposés dans le puits <strong>de</strong> stockage prévu à cet effetafin <strong>de</strong> les mettre dans <strong>de</strong>s conditions d'<strong>en</strong>treposage représ<strong>en</strong>tatives. L'application <strong>de</strong>diverses techniques d'analyse métallographique permettra <strong>de</strong> suivre l’évolution <strong>de</strong> ces<strong>en</strong>veloppes métalliques dont le rôle <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> sûreté est ess<strong>en</strong>tiel.Les modalités <strong>de</strong> suivi dans le temps <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> vitrifiés <strong>de</strong> l'EUROCHEMIC <strong>en</strong>treposésdans le bâtim<strong>en</strong>t 129 sont <strong>en</strong>core à l'étu<strong>de</strong>. Le bâtim<strong>en</strong>t 129 ne possè<strong>de</strong> pas <strong>de</strong> poste <strong>de</strong>contrôle. Il est vraisemb<strong>la</strong>ble que les canisters PAMELA sélectionnés pour servir <strong>de</strong>témoins seront transférés, moy<strong>en</strong>nant <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> sécurité drastiques, vers lebâtim<strong>en</strong>t 136 pour y être inspectés. L’opération s’effectuera au poste <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong>cellule <strong>de</strong> déchargem<strong>en</strong>t selon une procédure simi<strong>la</strong>ire à celle utilisée pour les <strong>déchets</strong>vitrifiés du bâtim<strong>en</strong>t 136.5.6 Établissem<strong>en</strong>t d’un procès-verbal <strong>de</strong> suivi dans letemps (PVST) <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés.Le résultat <strong>de</strong>s contrôles effectués est repris dans un procès-verbal <strong>de</strong> suivi dans letemps (PVST). Ce procès-verbal est établi par l’ONDRAF et contre-signé par leproducteur <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> contrôlés. Une copie <strong>de</strong> ce procès-verbal est <strong>en</strong>voyé à l’Ag<strong>en</strong>cefédérale <strong>de</strong> contrôle nucléaire.6. Inspection visuelle <strong>de</strong>s DC <strong>en</strong>treposésDans une lettre adressée le 14 février 2003, le ministre <strong>de</strong> tutelle a <strong>de</strong>mandé à l'ONDRAF<strong>de</strong> réaliser un inv<strong>en</strong>taire complet <strong>de</strong>s colis <strong>en</strong>treposés à Belgoprocess et un rapportsemestriel sur l’évolution <strong>de</strong>s colis non conformes. L’ONDRAF a établi un vasteprogramme d’inspection individuelle sur près <strong>de</strong> dix ans qui porte sur l'intégrité <strong>de</strong>s colis<strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>en</strong>treposés. Des images numériques <strong>de</strong> chaque colis inspecté sont prises etarchivées <strong>de</strong> même que les procès-verbaux <strong>de</strong>s constats établis. Les informationsrecueillies dans le cadre <strong>de</strong> ce programme particulier sont utilisées dans le cadre <strong>de</strong>l’acceptation courante <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.Durant ce programme d’inspection, il a été relevé que certains colis <strong>en</strong>treposés àBELGOPROCESS ne répondai<strong>en</strong>t pas aux exig<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> l’ONDRAF. Il s’agit<strong>de</strong> colis cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> bitumés ou cim<strong>en</strong>tés. On relève, par exemple, <strong>de</strong>s traces<strong>de</strong> gonflem<strong>en</strong>t du bitume ou <strong>de</strong>s marques <strong>de</strong> corrosion <strong>de</strong> l'embal<strong>la</strong>ge primaire. Sur<strong>en</strong>viron 33 000 colis contrôlés individuellem<strong>en</strong>t, moins <strong>de</strong> 4 % prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s nonconformités.Ils apparti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t le plus souv<strong>en</strong>t à <strong>de</strong>s productions historiques.101/166
Un certain nombre <strong>de</strong> mesures correctives vont être prises: les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> bitumésseront p<strong>la</strong>cés dans un surembal<strong>la</strong>ge. Celui-ci est fermé au moy<strong>en</strong> d’un couvercle munid’un microfiltre. Certains <strong>de</strong> ces colis sont sélectionnés pour servir <strong>de</strong> colis témoins etfont l’objet d’un suivi régulier. Cette pério<strong>de</strong> d’observation et les résultats <strong>de</strong>sobservations sont mis à profit pour déterminer <strong>la</strong> solution à long terme. Les colisprés<strong>en</strong>tant <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> corrosion font eux l’objet d’un suivi régulier, sans autresmesures particulières.Il convi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> souligner que ces colis non conformes ne prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t aucun danger, ni pourles travailleurs <strong>de</strong> Belgoprocess ni pour <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Ils se trouv<strong>en</strong>t dans <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>tssécurisés, fermés et contrôlés et les substances radioactives rest<strong>en</strong>t confinées dans <strong>la</strong>matrice <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t (cim<strong>en</strong>t ou bitume). Il n’y a donc aucun risque <strong>de</strong>contamination ou <strong>de</strong> fuite (libération <strong>de</strong> particules radioactives) et dès lors, aucunproblème <strong>de</strong> sûreté.L'ONDRAF publie sur son site internet le résultat <strong>de</strong>s contrôles effectués.102/166
Chapitre dixLe projet <strong>de</strong> dépôt définitif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>catégorie ALa mise <strong>en</strong> dépôt définitif <strong>de</strong> surface <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A, <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong><strong>en</strong>treposage intermédiaire (voir le chapitre qui précè<strong>de</strong>), constitue, pour ces <strong>déchets</strong>,l'étape <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> ultime.Comme tous ceux qui précè<strong>de</strong>nt, le prés<strong>en</strong>t chapitre est, <strong>de</strong>scriptif <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation<strong>actuelle</strong>. Il faut cep<strong>en</strong>dant mettre <strong>en</strong> évi<strong>de</strong>nce que <strong>la</strong> situation <strong>actuelle</strong> est le fruit d'unprocessus décisionnel très long qui remonte à une vingtaine d'années dans le passé.Jusqu'au début <strong>de</strong>s années quatre-vingt, <strong>en</strong> effet, <strong>la</strong> Belgique, comme certains paysvoisins, procédait, sous le contrôle <strong>de</strong> l'OCDE, au rejet <strong>en</strong> mer <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>conditionnés <strong>de</strong> ce type. Suite au moratoire, puis à l'interdiction définitive <strong>de</strong> cettesolution, <strong>de</strong> nouvelles pistes ont dû être explorées.Elles le fur<strong>en</strong>t, par l'ONDRAF, dès 1985. Afin <strong>de</strong> relier le passé au prés<strong>en</strong>t, l'historique <strong>de</strong>ce long processus décisionnel est retracé. Les premières étu<strong>de</strong>s, les premiers rapports,les premières propositions sont brièvem<strong>en</strong>t rappelés. Les principales décisionsgouvernem<strong>en</strong>tales <strong>en</strong> <strong>la</strong> matière mais aussi le rôle crucial joué par les collectivitéslocales, via <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats, dans l'é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> solutions possibles <strong>de</strong> dépôt sont plusparticulièrem<strong>en</strong>t mis <strong>en</strong> lumière.Aujourd'hui, suite à <strong>la</strong> décision gouvernem<strong>en</strong>tale du 23 juin 2006, l'ONDRAF a <strong>la</strong>ncéconcrètem<strong>en</strong>t le projet <strong>de</strong> dépôt définitif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A, <strong>en</strong> veil<strong>la</strong>nt aumainti<strong>en</strong> du processus participatif qui a présidé aux étu<strong>de</strong>s d'avant-projet. Lastructuration du projet et les moy<strong>en</strong>s mis <strong>en</strong> oeuvre sont décrits. Cette partie du chapitres'attache à mettre <strong>en</strong> valeur <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> projet intégré (intégration du projet <strong>de</strong> dépôtfinal proprem<strong>en</strong>t dit dans un projet plus vaste constituant une plus-value au niveaulocal). Sûreté, santé publique, communication, développem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, ... sontautant <strong>de</strong> thèmes qui, dès le départ, ont vocation à être traitées à un même niveaud'exig<strong>en</strong>ce que <strong>la</strong> réalisation technique du dépôt et ses futures modalités d'exploitation,notamm<strong>en</strong>t le transfert <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> leur <strong>en</strong>trepôt vers le dépôt final, sansoublier l'organisation <strong>de</strong>s contrôles ultimes qui <strong>de</strong>vront donner <strong>la</strong> garantie que chaquecolis mis <strong>en</strong> dépôt est bi<strong>en</strong> conforme aux critères d'admission applicables.Nous conclurons ce chapitre par l'évocation <strong>de</strong>s premières gran<strong>de</strong>s échéances :é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s détaillées, précision <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong>s conditions associées et <strong>de</strong>leur modalités <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t, obt<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts permis (nucléaire,<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, construction, ...) et début <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase d'exécution.1. IntroductionL’étape ultime <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A, à l’issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> phased’<strong>en</strong>treposage intermédiaire décrite au chapitre qui précè<strong>de</strong>, est aujourd'hui connue. Cesera <strong>la</strong> mise <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong> dans un dépôt définitif <strong>de</strong> surface. Le site approuvé par legouvernem<strong>en</strong>t dans sa décision du 23 juin 2006 est situé à Dessel, juste à côté du site 1<strong>de</strong> Belgoprocess.Gérer les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, c’est aussi gérer <strong>la</strong> décroissance. La décroissanceradioactive est ce phénomène naturel spontané par lequel une quantité initiale <strong>de</strong> matièreradioactive voit sa radioactivité décroître plus ou moins rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t avec le temps <strong>en</strong>fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s qu’elle conti<strong>en</strong>t. Comme rappelé auxchapitres un et trois, <strong>la</strong> caractéristique principale <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> dits <strong>de</strong> catégorie A est qu’ilsne conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t que <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s <strong>en</strong> quantité faible ou moy<strong>en</strong>ne et, <strong>de</strong> surcroît, <strong>de</strong>103/166
courte durée <strong>de</strong> vie (moins <strong>de</strong> 30 ans), quelques traces <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s à plus longuepério<strong>de</strong> pouvant toutefois être prés<strong>en</strong>ts. Ce<strong>la</strong> signifie qu’après un nombre limité <strong>de</strong>pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> décroissance, <strong>la</strong> radioactivité initiale <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong> retombe spontaném<strong>en</strong>tà un niveau comparable à celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité naturelle. La durée nécessaire pouratteindre ce niveau est <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux à trois siècles, durée p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong>quelle l'ONDRAF prévoit<strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le site sous surveil<strong>la</strong>nce. Cette pério<strong>de</strong>, qui fait suite à <strong>la</strong> fermeture définitive dudépôt, porte le nom <strong>de</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> contrôle institutionnel.Le défi pour l'ONDRAF est <strong>de</strong> concevoir une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt dont les composantsrésist<strong>en</strong>t assez longtemps pour que les <strong>déchets</strong> évacués rest<strong>en</strong>t isolés <strong>de</strong> <strong>la</strong> biosphèrep<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> durée requise. Il a été démontré que: par <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> barrières multiples, polymorphes et robustes, par l'emploi <strong>de</strong> matériaux chimiquem<strong>en</strong>t stables, par une analyse <strong>de</strong> sûreté <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur pr<strong>en</strong>ant <strong>en</strong> compte l'occurr<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>sollicitations externes importantes, par <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> programmes <strong>de</strong> contrôle strict <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité,cet objectif pouvait être atteint.On peut ainsi passer progressivem<strong>en</strong>t d'une <strong>gestion</strong> active (contrôles et inspectionsfréqu<strong>en</strong>ts, <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>, réparations, protection <strong>de</strong>s accès, ...) à une <strong>gestion</strong> passive (limitéeà <strong>de</strong>s restriction <strong>de</strong> l'usage du sol, au p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> marqueurs pour prév<strong>en</strong>ir lesgénérations lointaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce d'un dépôt). Ce principe du passage progressifd'une phase <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce active à une phase <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce passive est à <strong>la</strong> basemême du concept <strong>de</strong> dépôt pour <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A.Pour bi<strong>en</strong> compr<strong>en</strong>dre <strong>la</strong> situation <strong>actuelle</strong> du projet <strong>de</strong> dépôt final <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>catégorie A, il est nécessaire <strong>de</strong> faire un rappel historique <strong>de</strong>s faits et démarches qui ontm<strong>en</strong>é à <strong>la</strong> décision gouvernem<strong>en</strong>tale du 23 juin 2006. Car cette décision estl'aboutissem<strong>en</strong>t d'un long processus s'éta<strong>la</strong>nt sur plus <strong>de</strong> vingt ans. C'est au long <strong>de</strong> ceprocessus que l'ONDRAF a pu pr<strong>en</strong>dre, pour <strong>la</strong> première fois, <strong>la</strong> pleine mesure <strong>de</strong>l'importance qu'occupe <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sion sociétale dans <strong>la</strong> résolution <strong>de</strong>s problèmes<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux qui interpell<strong>en</strong>t le plus <strong>la</strong> société.2. Un peu d'histoireJusqu'au début <strong>de</strong>s années quatre-vingt, <strong>la</strong> Belgique, comme certains pays voisins,procédait, sous contrôle <strong>de</strong> l'OCDE, au rejet <strong>en</strong> mer <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés <strong>de</strong>ce type. Suite au moratoire <strong>de</strong> 1982, puis à l'interdiction définitive <strong>de</strong> cette solution, <strong>de</strong>nouvelles pistes se <strong>de</strong>vai<strong>en</strong>t d'être explorées dans les meilleurs dé<strong>la</strong>is. Les activités <strong>de</strong>recherche et développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'ONDRAF <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A débutèr<strong>en</strong>t <strong>en</strong> 1985, soit peu <strong>de</strong> temps après <strong>la</strong> création <strong>de</strong>l’organisme. Envisagées initialem<strong>en</strong>t dans une optique exclusivem<strong>en</strong>t sci<strong>en</strong>tifique ettechnique, ces travaux permir<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s progrès incontestables <strong>en</strong> <strong>la</strong> matière. Ils am<strong>en</strong>èr<strong>en</strong>tnotamm<strong>en</strong>t l’ONDRAF à pr<strong>en</strong>dre progressivem<strong>en</strong>t consci<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> nécessitéincontournable d’intégrer <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sion sociétale dans <strong>la</strong> résolution <strong>de</strong> questions aussidélicates que <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Rappelons brièvem<strong>en</strong>t lesgran<strong>de</strong>s étapes du cheminem<strong>en</strong>t accompli <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> décision d’arrêter le rejet <strong>en</strong> mer.Une première étu<strong>de</strong> 32 , publiée <strong>en</strong> 1990, comparait trois options <strong>en</strong>visageables pour <strong>la</strong><strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A : <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt <strong>en</strong> surface, l’utilisationd’anci<strong>en</strong>nes mines <strong>de</strong> charbon ou <strong>de</strong> carrières et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur dansune formation argileuse. Une fois l'option « mines ou carrières » définitivem<strong>en</strong>t écartéepour <strong>de</strong>s raisons techniques, l’ONDRAF décida, <strong>en</strong> accord avec son Ministre <strong>de</strong> tutelle,<strong>de</strong> focaliser ses travaux sur l’étu<strong>de</strong> du dépôt final <strong>en</strong> surface. Les étu<strong>de</strong>s réalisées aucours <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1990–1993 s’attachèr<strong>en</strong>t à évaluer <strong>la</strong> faisabilité technique <strong>de</strong>l’imp<strong>la</strong>ntation d’une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt final <strong>en</strong> surface pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie Asur le territoire belge. Elles visai<strong>en</strong>t à examiner, d’une part, s’il existait <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong>32 ONDRAF, L’évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activité : bi<strong>la</strong>n et perspectives, rapport NIROND 90–01, janvier1990104/166
construction adéquates et, d’autre part, s’il était possible d’i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s zones favorablesou pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t favorables à l’imp<strong>la</strong>ntation d’une telle instal<strong>la</strong>tion. Ces étu<strong>de</strong>saboutir<strong>en</strong>t :1. aux premiers développem<strong>en</strong>ts du concept <strong>de</strong> dépôt final <strong>en</strong> surface,2. à <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong> premiers critères radiologiques <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> pouvoir distinguer les<strong>déchets</strong> qui peuv<strong>en</strong>t être mis <strong>en</strong> dépôt <strong>en</strong> surface <strong>de</strong>s autres et3. à l’i<strong>de</strong>ntification, sur base bibliographique, <strong>de</strong> 98 zones pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t favorables àl’imp<strong>la</strong>ntation d’une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt <strong>en</strong> surface.Publiée <strong>en</strong> 1994, <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s 98 zones i<strong>de</strong>ntifiées 33 , suscita un rejet vigoureux et unanime<strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s communes concernées et du public <strong>en</strong> général. L’approche purem<strong>en</strong>ttechnici<strong>en</strong>ne qui fut utilisée semb<strong>la</strong>it, à l'époque, assez naturelle vu que le docum<strong>en</strong>tvisait à proposer une réponse technique à un problème perçu comme exclusivem<strong>en</strong>ttechnique. Cette approche se heurta à <strong>la</strong> s<strong>en</strong>sibilité <strong>de</strong>s perceptions locales, suscita unelevée générale <strong>de</strong> boucliers et conduisit à un refus total <strong>de</strong>s propositions <strong>de</strong> l'ONDRAF.Cet échec cuisant conduisit l’ONDRAF à <strong>la</strong> conclusion qu’il lui fal<strong>la</strong>it revoir son approchegénérale : les facteurs sociétaux al<strong>la</strong>i<strong>en</strong>t désormais eux aussi être pris <strong>en</strong> compte dans <strong>la</strong>résolution <strong>de</strong>s problèmes posés par <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.Soucieux d’apaiser les remous causés par <strong>la</strong> publication du rapport <strong>de</strong> 1994 et <strong>de</strong> sortirl’ONDRAF <strong>de</strong> l’impasse sociétale dans <strong>la</strong>quelle il se trouvait, le Gouvernem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>manda<strong>en</strong> juin 1995 à l’ONDRAF <strong>de</strong> réaliser une nouvelle étu<strong>de</strong> visant à évaluer les alternativespossibles au dépôt <strong>en</strong> surface <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A. Cette étu<strong>de</strong> porta d’embléesur les trois grands types <strong>de</strong> solutions possibles: une solution non définitive(l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong> longue durée) et <strong>de</strong>ux solutions définitives ou pouvant le <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir (ledépôt final <strong>en</strong> surface et le dépôt final <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur). Ces fur<strong>en</strong>t examinées sousdiffér<strong>en</strong>ts angles : caractère définitif, sûreté radiologique, faisabilité technique,contrô<strong>la</strong>bilité, flexibilité et coûts notamm<strong>en</strong>t. Le rapport final <strong>de</strong> l’ONDRAF 34 , transmis auxautorités fédérales à <strong>la</strong> mi-1997, déconseil<strong>la</strong>it c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t toute solution provisoire etrecommandait au Gouvernem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> baser son choix <strong>en</strong>tre solution non définitive etsolution définitive sur <strong>de</strong>s considérations éthiques.Il convi<strong>en</strong>t, pour que ce rappel historique fût complet, <strong>de</strong> m<strong>en</strong>tionner <strong>en</strong>core <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>qui avait été faite fin 1996 à l’ONDRAF par son Ministre <strong>de</strong> tutelle d’examiner, sur unebase ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t bibliographique, une liste <strong>de</strong> 25 sites militaires <strong>en</strong> voie <strong>de</strong>désaffectation et d’évaluer <strong>la</strong> possibilité d’utiliser l’un ou l’autre d’<strong>en</strong>tre eux dans le cadre<strong>de</strong> ses activités. Cette étu<strong>de</strong> le conduisit, durant l’été 1997, à i<strong>de</strong>ntifier 16 sites militairespot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t favorables. Suite à l’étu<strong>de</strong> préliminaire <strong>de</strong> ces sites militaires, unecommune, celle <strong>de</strong> Beauraing, se porta candidate pour une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité surl’anci<strong>en</strong>ne base militaire <strong>de</strong> Baronville qui figurait parmi les 16 sites militairesprovisoirem<strong>en</strong>t ret<strong>en</strong>us par l’ONDRAF. Alors qu’une campagne <strong>de</strong> reconnaissancegéologique était v<strong>en</strong>ue <strong>en</strong>tre temps confirmer que le site <strong>de</strong> Baronville <strong>en</strong>trait <strong>en</strong> ligne <strong>de</strong>compte pour le développem<strong>en</strong>t d’un avant-projet <strong>de</strong> dépôt final pour <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>catégorie A, une consultation popu<strong>la</strong>ire organisée le 28 juin 1998 par les autoritéscommunales <strong>de</strong> Beauraing révé<strong>la</strong> qu’<strong>en</strong>viron 95 % <strong>de</strong>s habitants étai<strong>en</strong>t opposés à <strong>la</strong>perspective d’un tel projet sur le territoire <strong>de</strong> leur commune. Beauraing retira sacandidature. Cette expéri<strong>en</strong>ce confirma <strong>la</strong> nécessité impérieuse d’appliquer l’approcheparticipative que l’ONDRAF v<strong>en</strong>ait juste <strong>de</strong> comm<strong>en</strong>cer à développer mais qu’il n’avaitpas eu le temps d’appliquer au site <strong>de</strong> Baronville.Rev<strong>en</strong>ons au rapport <strong>de</strong> 1997. Suivant les recommandations que l’ONDRAF y formu<strong>la</strong>it,le Conseil <strong>de</strong>s ministres décida, le 16 janvier 1998, d’opter pour une solution définitive ouà vocation définitive pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A et <strong>de</strong> confier<strong>de</strong> nouvelles missions à l’ONDRAF, tout <strong>en</strong> restreignant le cadre <strong>de</strong> ses investigations.Cette décision fut formulée comme suit 35 .« Pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible et moy<strong>en</strong>ne activité et <strong>de</strong> courte durée <strong>de</strong> vie33 ONDRAF, Le dépôt définitif <strong>en</strong> surface, sur le territoire belge, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> faible activité et <strong>de</strong>courte durée <strong>de</strong> vie : synthèse et recommandations, rapport NIROND 94–04, avril 199434 ONDRAF, Comparaison <strong>de</strong>s diverses options pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> faibleactivité et <strong>de</strong> courte durée <strong>de</strong> vie : aspects sûreté et différ<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> coûts, rapport NIROND 97–04, juin 199735 Lettre du Ministre <strong>de</strong> tutelle <strong>de</strong> l’ONDRAF à l’ONDRAF, Décision du Gouvernem<strong>en</strong>t sur les <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> catégorie A, réf. BL/vd/203-Cab, 26 janvier 1998105/166
(<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A), sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts et étu<strong>de</strong>s disponibles et avec <strong>la</strong>préoccupation d’une <strong>gestion</strong> économique pru<strong>de</strong>nte vis-à-vis <strong>de</strong>s générations futures,dans le souci perman<strong>en</strong>t du meilleur niveau <strong>de</strong> sécurité et d’une <strong>la</strong>rge concertation avecles autorités et popu<strong>la</strong>tions concernées, le Conseil : opte, <strong>en</strong> exécution <strong>de</strong> l’Accord du Gouvernem<strong>en</strong>t, pour une solution définitive ou àvocation définitive, progressive, flexible et réversible; confirme <strong>la</strong> nécessité d’effectuer, dans les meilleurs dé<strong>la</strong>is, un choix technique etéconomique <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt profond ou <strong>de</strong> surface, à conditions <strong>de</strong> sûretécomparables et dans le meilleur respect <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t; charge le Ministre <strong>de</strong> l’Economie <strong>de</strong> donner, à cet effet, pour mission à l’organism<strong>en</strong>ational <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s matières fissiles <strong>en</strong>richies (ONDRAF) : <strong>de</strong> se limiter dans ses actions <strong>de</strong> prospection, y compris les reconnaissancesnécessaires sur le terrain permettant d’aboutir au choix technique, aux zonesnucléaires existantes et aux sites où les autorités locales manifest<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’intérêt; d’approfondir et <strong>de</strong> finaliser, dans les meilleurs dé<strong>la</strong>is, les concepts d’évacuation <strong>de</strong>surface, notamm<strong>en</strong>t du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> réversibilité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrô<strong>la</strong>bilité; d’approfondir et finaliser, dans les meilleurs dé<strong>la</strong>is, les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> faisabilité et <strong>de</strong> coûtd’évacuation géologique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activité; <strong>de</strong> développer les métho<strong>de</strong>s, y compris les structures <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> et <strong>de</strong> concertation,permettant d’intégrer un projet <strong>de</strong> cette nature au niveau local.Dans l’exécution <strong>de</strong> ces missions, l’ONDRAF travaillera <strong>en</strong> col<strong>la</strong>boration étroite avec lesautorités <strong>de</strong> sûreté, notamm<strong>en</strong>t l’Ag<strong>en</strong>ce fédérale <strong>de</strong> contrôle nucléaire, concernant tousles aspects touchant à <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions et à <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. »La lettre du Ministre <strong>de</strong> tutelle <strong>de</strong> l’ONDRAF lui communiquant cette décision précisait <strong>en</strong>outre que « La question <strong>de</strong> première priorité, ainsi que l’indique le <strong>de</strong>uxième [carré] <strong>de</strong> <strong>la</strong>notification, est aujourd’hui d’effectuer le choix <strong>en</strong>tre l’évacuation <strong>en</strong> surface et <strong>en</strong>profon<strong>de</strong>ur, à conditions <strong>de</strong> sûreté comparables, sur une base économique et technique.[…] ».3. La démarche sociétale – les part<strong>en</strong>ariatsSuite à <strong>la</strong> décision du Conseil <strong>de</strong>s ministres du 16 janvier 1998, l’ONDRAF remania <strong>en</strong>profon<strong>de</strong>ur son programme <strong>de</strong> travail afin d’y intégrer au mieux <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong>concertation avec les popu<strong>la</strong>tions souhaitée par le Gouvernem<strong>en</strong>t, ainsi que le fait qu’il<strong>de</strong>vait désormais limiter ses étu<strong>de</strong>s aux zones nucléaires existantes et aux sites où lesautorités locales manifest<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’intérêt. Cette nouvelle démarche <strong>de</strong> concertation avecles popu<strong>la</strong>tions souhaitée par le Gouvernem<strong>en</strong>t déboucha sur <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong>méthodologie <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats locaux 36 . Développée par l’Universitaire InstellingAntwerp<strong>en</strong> 37 <strong>en</strong> col<strong>la</strong>boration avec <strong>la</strong> Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL),cette méthodologie particulièrem<strong>en</strong>t innovatrice – elle suscite toujours un grand intérêt auniveau international 38 – visait à créer les conditions d’un dialogue et d’une col<strong>la</strong>borationouverts mais structurés <strong>en</strong>tre l’ONDRAF et les collectivités locales disposées à s’investirdans <strong>la</strong> recherche d’une solution définitive pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>catégorie A. Elle reposait sur l’hypothèse que <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions locales sont plussusceptibles d’accepter l’imp<strong>la</strong>ntation d’un projet à priori <strong>de</strong> nature à leur apporter <strong>de</strong>sdésagrém<strong>en</strong>ts, voire qui comporte une part <strong>de</strong> risque ou qui est perçu comme tel, si cespopu<strong>la</strong>tions reçoiv<strong>en</strong>t l'opportunité <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borer effectivem<strong>en</strong>t à son développem<strong>en</strong>t et sielles ont été impliquées réellem<strong>en</strong>t dans le processus décisionnel associé.36 ONDRAF, Programme <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’ONDRAF sur <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt final <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faible activité et <strong>de</strong>courte durée <strong>de</strong> vie — Dossier d’information, rapport NIROND 00–01, janvier 200037 Anne Bergmans, Van “<strong>de</strong> burger als beleidssubject” naar “<strong>de</strong> burger als partner”: <strong>de</strong> Belgische queeste naare<strong>en</strong> <strong>la</strong>ngetermijnoplossing voor het beheer van het <strong>la</strong>agradioactief <strong>en</strong> kortlev<strong>en</strong>d afval, UniversiteitAntwerp<strong>en</strong>, Faculteit Politieke <strong>en</strong> Sociale Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, 2005, Thèse <strong>de</strong> doctorat38 Dealing with Interests, Values and Knowledge in Managing Risk, Actes du 4e workshop <strong>de</strong> l’OCDE/AENForum on Stakehol<strong>de</strong>r Confi<strong>de</strong>nce, 18–21 novembre 2003, Bruxelles, NEA No. 5301, OCDE 2004106/166
L’ONDRAF proposa concrètem<strong>en</strong>t aux communes qui le souhaitai<strong>en</strong>t <strong>de</strong> créer avec lui unpart<strong>en</strong>ariat local visant au développem<strong>en</strong>t d’un projet intégré <strong>de</strong> dépôt final, autrem<strong>en</strong>t ditun avant-projet d’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt final intégré dans un projet sociétal plus <strong>la</strong>rge, telque le projet intégré <strong>de</strong> dépôt dans son <strong>en</strong>semble fasse l’objet d’un <strong>la</strong>rge cons<strong>en</strong>sus ausein <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale concernée. Pour que ce cons<strong>en</strong>sus <strong>la</strong>rge soit possible,l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt al<strong>la</strong>it <strong>de</strong>voir être intégrée dans un projet plus <strong>la</strong>rge prés<strong>en</strong>tant unevaleur ajoutée suffisante pour <strong>la</strong> commune et/ou <strong>la</strong> région concernée. La règle était queles communes disposées à col<strong>la</strong>borer avec l’ONDRAF dans le cadre d’un part<strong>en</strong>ariatlocal gar<strong>de</strong>rai<strong>en</strong>t toute <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> <strong>de</strong> mettre fin à tout mom<strong>en</strong>t à cette col<strong>la</strong>boration.L’ONDRAF sonda directem<strong>en</strong>t l’intérêt <strong>de</strong>s communes sur le territoire <strong>de</strong>squelles sontsituées les quatre zones nucléaires existantes. Les communes <strong>de</strong> Bever<strong>en</strong> (zon<strong>en</strong>ucléaire <strong>de</strong> Doel) et <strong>de</strong> Huy (zone nucléaire <strong>de</strong> Tihange) ne souhaitèr<strong>en</strong>t pas s’<strong>en</strong>gagerdans <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration proposée. Celles <strong>de</strong> Mol, <strong>de</strong> Dessel, <strong>de</strong> Fleurus et <strong>de</strong> Farci<strong>en</strong>nes semontrèr<strong>en</strong>t par contre assez rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t intéressées. L’ONDRAF organisa le 16décembre 1998 une journée d’information sur <strong>la</strong> méthodologie <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats locaux, à<strong>la</strong>quelle l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s communes belges fut invité. L’intérêt <strong>de</strong>s communes <strong>de</strong> Mol, <strong>de</strong>Dessel, <strong>de</strong> Fleurus et <strong>de</strong> Farci<strong>en</strong>nes se confirma progressivem<strong>en</strong>t pour aboutir finalem<strong>en</strong>tà <strong>la</strong> création <strong>de</strong> trois part<strong>en</strong>ariats avec l’ONDRAF, qui tous prir<strong>en</strong>t <strong>la</strong> forme d’une ASBL.Le premier part<strong>en</strong>ariat, STOLA-Dessel, fut créé le 30 septembre 1999 <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> commune<strong>de</strong> Dessel et l’ONDRAF. Le <strong>de</strong>uxième part<strong>en</strong>ariat, MONA, fut créé le 9 février 2000 <strong>en</strong>tre<strong>la</strong> commune <strong>de</strong> Mol et l’ONDRAF. Le troisième part<strong>en</strong>ariat, PALOFF, fut créé plus tard, le27 février 2003 <strong>en</strong>tre les communes <strong>de</strong> Fleurus et Farci<strong>en</strong>nes et l’ONDRAF. Les troispart<strong>en</strong>ariats s’organisèr<strong>en</strong>t <strong>de</strong> façon à pouvoir jouer leur rôle <strong>de</strong> p<strong>la</strong>tes-formes locales <strong>de</strong>discussion et <strong>de</strong> travail, représ<strong>en</strong>tatives, transpar<strong>en</strong>tes, ouvertes et indép<strong>en</strong>dantes,confiant le travail <strong>de</strong> réflexion et <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t à <strong>de</strong>s personnes issues <strong>de</strong>scollectivités locales et agissant sur base volontaire et bénévole, à l’exception <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxcol<strong>la</strong>borateurs dans chaque part<strong>en</strong>ariat, <strong>en</strong>gagés à temps plein.Les part<strong>en</strong>ariats avai<strong>en</strong>t une autonomie décisionnelle totale, disposant d’un budgetannuel dont ils assurai<strong>en</strong>t seuls <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>.Chaque part<strong>en</strong>ariat comptait les quatre niveaux organisationnels suivants : une assemblée générale, rassemb<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s représ<strong>en</strong>tants du (<strong>de</strong>s) conseil(s)communal(aux) et <strong>de</strong>s acteurs sociétaux et économiques locaux, ainsi qu’unreprés<strong>en</strong>tant <strong>de</strong> l’ONDRAF; un conseil d’administration, constitué <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tants <strong>de</strong>s acteurs politiques,sociétaux et économiques ainsi que d’un représ<strong>en</strong>tant <strong>de</strong> l’ONDRAF; une cellule <strong>de</strong> coordination comptant <strong>de</strong>ux col<strong>la</strong>borateurs <strong>en</strong>gagés à temps plein; <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> travail, compr<strong>en</strong>ant chacun <strong>de</strong>s représ<strong>en</strong>tants <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>l’assemblée générale ainsi que <strong>de</strong>s particuliers et un expert <strong>de</strong> l’ONDRAF. Ils ont étéaidés sur une base perman<strong>en</strong>te par l’ONDRAF et sur une base quasi-perman<strong>en</strong>te parl'UA (pour STOLA-Dessel et pour MONA) et <strong>la</strong> FUL (pour PALOFF). Ils ont fait appel à<strong>de</strong>s experts indép<strong>en</strong>dants chaque fois qu’ils le désirai<strong>en</strong>t.Outre le développem<strong>en</strong>t d’un projet intégré <strong>de</strong> dépôt final, les part<strong>en</strong>ariats assurèr<strong>en</strong>tégalem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> communication avec <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale et l’information sur les travaux etles étu<strong>de</strong>s effectués, veil<strong>la</strong>nt aux intérêts et aux préoccupations <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité locale, etdialoguant avec elle pour connaître son opinion par rapport aux projets intégrés <strong>de</strong> dépôtfinal qu’ils développai<strong>en</strong>t.Suite à l’exig<strong>en</strong>ce du Gouvernem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> limiter les travaux « aux zones nucléairesexistantes et aux sites où les autorités locales manifest<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’intérêt », l’ONDRAF s’estvu, par <strong>la</strong> force <strong>de</strong>s choses, contraint d’abandonner <strong>la</strong> méthodologie d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>sites favorables qu’il avait jusque-là suivie pour lui substituer une nouvelle approche,systémique. Les sites étant désormais imposés a priori par décision <strong>de</strong> l’autorité, le déficonsistait maint<strong>en</strong>ant à concevoir une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt <strong>en</strong> surface adaptée auxcaractéristiques du terrain et telle que le système <strong>de</strong> dépôt final (l’<strong>en</strong>semble constitué parle site et concept technique) puisse satisfaire aux conditions décou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision duConseil <strong>de</strong>s ministres. Cette approche était assez différ<strong>en</strong>te <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologied’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s sites pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t favorables mais tout aussi va<strong>la</strong>ble. Entre ces107/166
<strong>de</strong>ux démarches, l’écart était, <strong>en</strong> quelque sorte, celui qui sépare le prêt-à-porter du surmesure… .La méthodologie <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats locaux conduisit au développem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> col<strong>la</strong>borationétroite avec les popu<strong>la</strong>tions locales, <strong>de</strong> cinq projets intégrés <strong>de</strong> dépôt final. Chacun <strong>de</strong>ces projets intégrés compr<strong>en</strong>ait un avant-projet d’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt et un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong>conditions associées qui <strong>en</strong> étai<strong>en</strong>t indissociables : un avant-projet d’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt final (surface ou profon<strong>de</strong>ur), développé pour lelieu d’imp<strong>la</strong>ntation choisi par le part<strong>en</strong>ariat; un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> conditions associées, définies par <strong>la</strong> collectivité locale, et couvrant un<strong>la</strong>rge spectre <strong>de</strong> préoccupations et <strong>de</strong> valeurs comme <strong>la</strong> sûreté, <strong>la</strong> santé,l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> plus-value sociale, économique et culturelle.Chaque avant-projet partait d’une première proposition é<strong>la</strong>borée par l’ONDRAF pr<strong>en</strong>ant<strong>en</strong> compte les caractéristiques du terrain et du sous-sol : Compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s bibliographiques et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> terrainpréliminaires effectuées pour <strong>la</strong> zone nucléaire <strong>de</strong> Mol–Dessel et compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> <strong>la</strong>bonne connaissance qu’on avait déjà, grâce au <strong>la</strong>boratoire souterrain HADES (cf.chapitre <strong>de</strong>ux, « EURIDICE »), <strong>de</strong> <strong>la</strong> couche d’Argile <strong>de</strong> Boom prés<strong>en</strong>te dans le soussol<strong>de</strong> <strong>la</strong> région, l’ONDRAF put ainsi proposer, à STOLA-Dessel et à MONA, <strong>de</strong>uxavant-projets <strong>de</strong> dépôt final, un <strong>en</strong> surface et un <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur. Compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s caractéristiques géomécaniques et hydrogéologiques particulières<strong>de</strong> <strong>la</strong> zone nucléaire <strong>de</strong> Fleurus–Farci<strong>en</strong>nes et <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie disponible, l’ONDRAFproposa à PALOFF un avant-projet <strong>de</strong> dépôt final dit « semi-<strong>en</strong>terré » composé <strong>de</strong>trois silos cylindriques possédant chacun une cave d’inspection communiquant avecl’espace annu<strong>la</strong>ire <strong>en</strong>tre le silo et <strong>la</strong> paroi moulée faiblem<strong>en</strong>t perméable <strong>de</strong>stinée àisoler le silo <strong>de</strong> <strong>la</strong> nappe aquifère, une sorte <strong>de</strong> variante au dépôt <strong>en</strong> surface. L’optiondu dépôt <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur ne fut pas étudiée à Fleurus–Farci<strong>en</strong>nes, dans <strong>la</strong> mesure où lesous-sol y est <strong>de</strong> nature schisteuse et moins bi<strong>en</strong> connu, ce qui aurait <strong>en</strong>traîné unprogramme d’étu<strong>de</strong>s spécifique fort lourd.Comme <strong>de</strong>mandé dans <strong>la</strong> décision du Conseil <strong>de</strong>s ministres, l’ONDRAF a, tout au long<strong>de</strong> cette phase d’avant-projet, travaillé <strong>en</strong> très étroite col<strong>la</strong>boration avec l’Ag<strong>en</strong>ceFédérale <strong>de</strong> Contrôle Nucléaire (AFCN) pour tous les aspects touchant à <strong>la</strong> sûreté et àl’impact sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s avant-projets d’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt. L'AFCN d’ailleursn’a pas émis d’observations <strong>de</strong> nature à remettre fondam<strong>en</strong>talem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> question <strong>la</strong>sûreté radiologique <strong>de</strong>s avant-projets <strong>de</strong> STOLA et MONA. D’autres instances ont été, à<strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'AFCN, impliquées dans <strong>la</strong> concertation : pour les aspects <strong>de</strong> sûreté radiologique, l’Association Vinçotte Nucléaire (AVN); pour les aspects d’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, les instances régionales f<strong>la</strong>man<strong>de</strong>s et wallonnescompét<strong>en</strong>tes, à savoir : pour <strong>la</strong> Région f<strong>la</strong>man<strong>de</strong>, l’Administratie Milieu-, Natuur-, Land- <strong>en</strong> Waterbeheer(AMINAL, cellule MER (Milieueffectrapportage)) et l’Op<strong>en</strong>bareAfvalstoff<strong>en</strong>maatschappij voor het V<strong>la</strong>amse Gewest (OVAM); pour <strong>la</strong> Région wallonne, <strong>la</strong> Direction générale <strong>de</strong>s Ressources naturelles et <strong>de</strong>l’Environnem<strong>en</strong>t (DGRNE).Les étu<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> sûreté ont été discutées <strong>en</strong> détail avec l’AFCN et AVN et cellesre<strong>la</strong>tives à l’impact sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t ont été discutées <strong>en</strong> détail avec l’AFCN ainsi queAMINAL et l'OVAM d’une part, ou avec l’AFCN et <strong>la</strong> DGRNE d’autre part. L’OVAM 39 et <strong>la</strong>DGRNE 40 ont chacune transmis à l’ONDRAF un avis préliminaire dans lequel elles neremett<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> question le bi<strong>en</strong>-fondé <strong>de</strong>s avant-projets développés. Plusspécifiquem<strong>en</strong>t, au long <strong>de</strong> ses discussions avec l’ONDRAF, l’AFCN n’a pas formuléd’observations remettant fondam<strong>en</strong>talem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> question <strong>la</strong> sûreté radiologique d’un <strong>de</strong>savant-projets d’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt restants (STOLA-Dessel et MONA).39 Lettre <strong>de</strong> l’OVAM à l’ONDRAF, Programma “Berging van categorie A afval” evaluatie van <strong>de</strong> chemotoxischeimpact, réf. AB/AA/BT/03-347, 2 février 2004, et son annexe40 Lettre <strong>de</strong> <strong>la</strong> DGRNE à l’ONDRAF, réf. DPA/DCPP/2005/086/AB, 21 avril 2005108/166
Les projets intégrés <strong>de</strong> dépôt final fir<strong>en</strong>t d’abord l’objet, <strong>en</strong> 2002, d’un rapportd’avancem<strong>en</strong>t intermédiaire <strong>de</strong> l’ONDRAF à son Ministre <strong>de</strong> tutelle 41 , <strong>en</strong>suite <strong>de</strong> rapportsfinaux établis par chacun <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats <strong>en</strong> toute autonomie et finalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> rapports<strong>de</strong> conformité par lesquels l’ONDRAF émettait un jugem<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> façon dont les avantprojetsproposés répondai<strong>en</strong>t aux conditions imposées par <strong>la</strong> décision gouvernem<strong>en</strong>tale. Le rapport final <strong>de</strong> STOLA-Dessel 42 fut approuvé à l’unanimité et sans modificationspar l’assemblée générale du part<strong>en</strong>ariat et par le conseil communal <strong>de</strong> Dessel. Nil’assemblée générale ni <strong>la</strong> commune n’exprimèr<strong>en</strong>t <strong>de</strong> préfér<strong>en</strong>ce pour l’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>uxoptions techniques proposées. Le rapport final <strong>de</strong> MONA 43 fut approuvé sans modifications par l’assemblée généraledu part<strong>en</strong>ariat (27 voix pour, 1 voix contre, 4 abst<strong>en</strong>tions) et par le conseil communal<strong>de</strong> Mol (unanimité moins 2 abst<strong>en</strong>tions). Ni l’assemblée générale ni <strong>la</strong> commun<strong>en</strong>’exprimèr<strong>en</strong>t <strong>de</strong> préfér<strong>en</strong>ce pour l’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux options techniques proposées. L’assemblée générale <strong>de</strong> PALOFF décida, par 24 voix pour et 4 voix contre, <strong>de</strong>transmettre les rapports finaux <strong>de</strong> PALOFF 44 45 aux conseils communaux <strong>de</strong> Fleurus et<strong>de</strong> Farci<strong>en</strong>nes. Le conseil communal <strong>de</strong> Fleurus décida cep<strong>en</strong>dant l’arrêt <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>spar 23 voix contre 3. Compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> cette décision, le conseil communal <strong>de</strong>Farci<strong>en</strong>nes s’abstint à l’unanimité <strong>de</strong> se prononcer sur le dossier.Les rapports <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats fur<strong>en</strong>t transmis à l’ONDRAF, ainsi que les décisions <strong>de</strong>sconseils communaux, afin qu’il les remette à son Ministre <strong>de</strong> tutelle, accompagnés durapport <strong>de</strong> conformité établi par l’ONDRAF 46 47 48 49 , chacun <strong>de</strong> ces rapports <strong>de</strong> conformitéattestant que les différ<strong>en</strong>tes conditions imposées par <strong>la</strong> décision du gouvernem<strong>en</strong>t du 16janvier 1998 avai<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> été r<strong>en</strong>contrées par les différ<strong>en</strong>ts projets intégrés <strong>de</strong> dépôt finalproposés, y compris par celui développé par PALOFF.En mai 2006, l’ONDRAF transmit au gouvernem<strong>en</strong>t son rapport <strong>de</strong> synthèse 50 sur lestravaux accomplis <strong>en</strong> exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision gouvernem<strong>en</strong>tale du 16 janvier 1998,clôturant ainsi <strong>la</strong> phase d’avant-projet.C’est sur cette base que le Conseil <strong>de</strong>s Ministres du 23 juin 2006 a pris une importantedécision 51 , celle <strong>de</strong> mettre les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> Catégorie A dans un dépôt <strong>de</strong> surface installésur <strong>la</strong> commune <strong>de</strong> Dessel, conforme à l’avant-projet technique développé par lepart<strong>en</strong>ariat STOLA.Le concept <strong>de</strong> dépôt final repose sur les principes multi-barrières et multi-fonctions etcomporte sur les élém<strong>en</strong>ts suivants: p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> (fûts <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés ou <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>41 ONDRAF, Rapport d’avancem<strong>en</strong>t sur les travaux réalisés dans le cadre du dépôt final <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> faibleactivité et <strong>de</strong> courte durée <strong>de</strong> vie — 1998–2001, rapport NIROND 2002–01 f, mars 200242 STOLA-Dessel, Het Belgisch <strong>la</strong>agactief <strong>en</strong> kortlev<strong>en</strong>d afval: thuis in Dessel? E<strong>en</strong> geïntegreerdbergingsproject met e<strong>en</strong> technisch <strong>en</strong> e<strong>en</strong> maatschappelijk luik, novembre 200443 MONA, MONA, e<strong>en</strong> weg naar <strong>de</strong> aanvaardbaarheid van e<strong>en</strong> berging van categorie A-afval in Mol?, janvier200544 PALOFF, Fleurus-Farci<strong>en</strong>nes — Avant-projet <strong>de</strong> dépôt final <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>smesures d’accompagnem<strong>en</strong>t requises, Version synthétique, décembre 200545 PALOFF, Fleurus-Farci<strong>en</strong>nes — Avant-projet <strong>de</strong> dépôt final <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>smesures d’accompagnem<strong>en</strong>t requises, Version détaillée, décembre 200546 ONDRAF, La mise <strong>en</strong> dépôt final, sur le territoire belge, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> faible et moy<strong>en</strong>neactivité et <strong>de</strong> courte durée <strong>de</strong> vie — Rapport préparatoire à <strong>la</strong> remise par l’ONDRAF au Gouvernem<strong>en</strong>tfédéral <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats locaux, rapport NIROND 2005–07 f, mars 200547 ONDRAF, La mise <strong>en</strong> dépôt final, sur le territoire belge, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> faible activité et <strong>de</strong>courte durée <strong>de</strong> vie — Rapport <strong>de</strong> l’ONDRAF re<strong>la</strong>tif au projet intégré <strong>de</strong> dépôt final développé par STOLA-Dessel, rapport NIROND 2005–08 f, avril 200548 ONDRAF, La mise <strong>en</strong> dépôt final, sur le territoire belge, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> faible activité et <strong>de</strong>courte durée <strong>de</strong> vie — Rapport <strong>de</strong> l’ONDRAF re<strong>la</strong>tif au projet intégré <strong>de</strong> dépôt final développé par MONA,rapport NIROND 2005–09 f, juin 200549 ONDRAF, La mise <strong>en</strong> dépôt final, sur le territoire belge, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> faible activité et <strong>de</strong>courte durée <strong>de</strong> vie — Rapport <strong>de</strong> l’ONDRAF re<strong>la</strong>tif au projet intégré <strong>de</strong> dépôt final développé par paloff,rapport NIROND 2006–01 f, mars 200650 ONDRAF, La mise <strong>en</strong> dépôt final, sur le territoire belge, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> faible et moy<strong>en</strong>neactivité et <strong>de</strong> courte durée <strong>de</strong> vie. Rapport <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong> l’ONDRAF re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1985–2006, invitantle Gouvernem<strong>en</strong>t fédéral à déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> suite à donner au programme <strong>de</strong> dépôt, rapport NIROND 2006–02f, mai 200651 Lettre du Ministre <strong>de</strong> tutelle <strong>de</strong> l’ONDRAF à l’ONDRAF, Berging op Belgisch grondgebied van het afval vancategorie A, réf. MV/EDC/BA/cb/2006-007081, 5 juillet 2006109/166
démantèlem<strong>en</strong>t peu contaminés <strong>en</strong> vrac) à l'intérieur d'un caisson <strong>en</strong> bétonpréfabriqué; <strong>en</strong>robage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> dans une matrice à base <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t pour obt<strong>en</strong>ir le colis <strong>de</strong>dépôt final appelé « monolithe »; transport et dépose <strong>de</strong>s monolithes dans <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s structures <strong>en</strong> béton armésappelées « modules » <strong>de</strong> dépôt final; fermeture <strong>de</strong>s modules remplis par betonnage d'une dalle <strong>de</strong> fermeture; lorsqu'une série complète <strong>de</strong> module est remplie et fermée, mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce d'unecouverture <strong>de</strong> terre combinant les fonctions ess<strong>en</strong>tielles <strong>de</strong> confinem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> protection,<strong>de</strong> drainage et d'étanchéité; un espace accessible sous chaque module ainsi que <strong>de</strong>s galeries <strong>de</strong> contrôlepermettant <strong>de</strong> contrôler au plus près, le bon fonctionnem<strong>en</strong>t du dispositif p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong>pério<strong>de</strong> nécessaire.figure 30: Concept <strong>de</strong> tumulus pour dépôt <strong>de</strong> surface (STOLA)4. Le projet intégré <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong> catégorie ACette décision du Conseil <strong>de</strong>s Ministres est fondam<strong>en</strong>tale pour l’ONDRAF car elle luidonne l’autorisation d’<strong>en</strong>tamer concrètem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> phase <strong>de</strong> conception détaillée du projetintégré <strong>de</strong> dépôt final <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A. Elle impose <strong>en</strong>tre autres choses que leprocessus participatif <strong>de</strong>meuré actif tout au long <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase d’avant-projet soit maint<strong>en</strong>u,ce qui signifie que les activités d’étu<strong>de</strong>s détaillées seront à m<strong>en</strong>er <strong>en</strong> col<strong>la</strong>boration étroiteavec les part<strong>en</strong>aires locaux et l’AFCN. En outre, les coûts <strong>de</strong>s conditions associéesinsuffisamm<strong>en</strong>t définis au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision gouvernem<strong>en</strong>tale et leurs modalités <strong>de</strong>financem<strong>en</strong>t (via un fonds spécial <strong>en</strong>core à créer, appelé Fonds à Moy<strong>en</strong> Terme) <strong>de</strong>vrontêtre précisés dans le cadre du processus participatif pour <strong>la</strong> fin 2008.Le processus participatif avec les part<strong>en</strong>aires locaux <strong>de</strong>vra se poursuivre, <strong>en</strong> premier lieuavec <strong>la</strong> commune <strong>de</strong> Dessel choisie pour l’imp<strong>la</strong>ntation et premier part<strong>en</strong>aire dans lesnégociations mais égalem<strong>en</strong>t avec <strong>la</strong> commune <strong>de</strong> Mol et ce, sur <strong>de</strong>s bases révisées,afin <strong>de</strong> permettre aux part<strong>en</strong>aires locaux <strong>de</strong> préciser, là où ce<strong>la</strong> est nécessaire, lecont<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s diverses composantes du projet intégré, <strong>de</strong> contribuer activem<strong>en</strong>t audéroulem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase <strong>de</strong> conception détaillée, <strong>de</strong> vérifier que les résultats <strong>de</strong>s110/166
différ<strong>en</strong>tes actions et prestations <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase <strong>de</strong> conception détaillée sont bi<strong>en</strong> conformesà leurs exig<strong>en</strong>ces et à leurs att<strong>en</strong>tes spécifiques et, si nécessaire, <strong>de</strong> corriger le tir.Pour m<strong>en</strong>er à bi<strong>en</strong> ce projet intégré, l’ONDRAF a mis sur pied une équipe <strong>de</strong> projetmultidisciplinaire qu’il a choisi d’installer à Dessel, au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité locale et àproximité du futur site d’imp<strong>la</strong>ntation.Beslissing16/01/1998Beslissing ministerraad23/06/2006 Opperv<strong>la</strong>kteberging in Dessel E<strong>en</strong> geïntegreerd project Participatief procesLouter technischeb<strong>en</strong>a<strong>de</strong>ringGeïntegreer<strong>de</strong> b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>ring1982Verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong><strong>de</strong>studies1998Voorontwerp20062008Ontwerp +vergunning<strong>en</strong>2011Bouw <strong>en</strong>uitvoering2016ExploitatieMasterp<strong>la</strong>nverga<strong>de</strong>ring produc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van 5 september 2008Un groupe <strong>de</strong> pilotage du projet intégré a été créé <strong>en</strong> septembre 2007. Il compr<strong>en</strong>d <strong>de</strong>sreprés<strong>en</strong>tants du part<strong>en</strong>ariat <strong>de</strong> Dessel (qui a changé son nom <strong>en</strong> STORA), <strong>de</strong> Mol(MONA) et <strong>de</strong> l'ONDRAF. Divers groupes <strong>de</strong> travail composés <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tants locauxbénévoles et <strong>de</strong> spécialistes <strong>de</strong> l'ONDRAF suiv<strong>en</strong>t et ori<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sd'étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> détail.L'objectif concret est <strong>de</strong> produire, fin 2008, <strong>en</strong> étroite col<strong>la</strong>boration avec les popu<strong>la</strong>tionslocales, un “P<strong>la</strong>n gui<strong>de</strong>” (Masterp<strong>la</strong>n) qui donnera un aperçu complet du projet intégré,avec une <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s sous-projets individuels, une évaluation <strong>de</strong>s coûts globaux et unp<strong>la</strong>nning pour <strong>la</strong> suite <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s.Les étu<strong>de</strong>s détaillées <strong>en</strong> cours couvr<strong>en</strong>t les domaines suivants: l'instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt final, l'instal<strong>la</strong>tion pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong> monolithes, le tumulus d'essai, <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong>s caissons, le c<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> communication, le développem<strong>en</strong>t local lié au projet (emploi, mainti<strong>en</strong> du know-how nucléaire, p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong>reconversion, ...) l'aménagem<strong>en</strong>t du territoire (quai le long du canal Bocholt-Her<strong>en</strong>tals, accessibilité ausite, dés<strong>en</strong>c<strong>la</strong>vem<strong>en</strong>t du zoning industriel, création <strong>de</strong> nouveaux zoning industriels, ...) <strong>la</strong> création d'un fonds <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t local pour Dessel et Mol.Les aspects liés à <strong>la</strong> sûreté radiologique et conv<strong>en</strong>tionnelle (sûreté d'exploitation, sûretéà long terme, impact <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal, programme <strong>de</strong> monitoring, suivi <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>sriverains, p<strong>la</strong>n d'urg<strong>en</strong>ce, transports, ...) font l'objet d'un soin particulier.L'ONDRAF examine <strong>en</strong> parallèle les modalités <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t possibles pour le volet111/166
<strong>de</strong>s conditions associés, ainsi que les adaptations év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t nécessaires au cadrelégal pour r<strong>en</strong>dre possible et légitime ce financem<strong>en</strong>t. L'idée est <strong>de</strong> constituer un fondsspécial, appelé fonds à moy<strong>en</strong> terme (FMT), pour le distinguer du fonds à long terme<strong>de</strong>stiné au financem<strong>en</strong>t du seul projet technique.On estime que <strong>la</strong> phase <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> conception détaillée du Projet durera <strong>en</strong>viron cinqans <strong>de</strong> 2007 à 2011. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation nucléaire d’établissem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’autorisation <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tale (MER) <strong>de</strong>vrai<strong>en</strong>t être introduites mi-2010. L’objectif visépour fin 2011 est double : obt<strong>en</strong>ir <strong>la</strong> signature d’une conv<strong>en</strong>tion fixant <strong>de</strong> façon ferme et irrévocable les droits et<strong>de</strong>voirs <strong>de</strong>s parties pr<strong>en</strong>antes dans le cadre du projet intégré (tutelle, communesconcernées, part<strong>en</strong>ariats, producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, ONDRAF); obt<strong>en</strong>ir l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s autorisations (nucléaire d’établissem<strong>en</strong>t, permisd’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, permis <strong>de</strong> bâtir) nécessaire pour passer à <strong>la</strong> phase d’exécution duprojet intégré.On estime aujourd’hui que <strong>la</strong> phase d’exécution, <strong>en</strong> ce compris <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> service <strong>de</strong>l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt final, durera <strong>en</strong>viron quatre ans, pério<strong>de</strong> p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong>quelle lesdiffér<strong>en</strong>tes composantes du projet intégré m<strong>en</strong>tionnées ci-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>vront être réaliséesdans leur diversité et leur spécificité, à <strong>la</strong> satisfaction <strong>de</strong>s parties concernées. Dans <strong>la</strong>phase d’exécution sont donc inclues l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s tâches visant à <strong>la</strong> réalisationconcrète <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts sous-projets, avec comme objectif <strong>de</strong> disposer d’une instal<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> dépôt final opérationnelle <strong>en</strong> 2016.figure 31: Vue aéri<strong>en</strong>ne du futur site <strong>de</strong> dépôt durant sa phase d'exploitation. Lesmodules <strong>de</strong> dépôt (<strong>en</strong> bleu c<strong>la</strong>ir) sont visibles sur <strong>la</strong> gauche du site 1 <strong>de</strong> Belgoprocess. Al'avant-p<strong>la</strong>n, le SCK·CEN et le site 2 (<strong>en</strong> bas, à droite).112/166
Chapitre onzeLes étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories Bet CAvec ce douzième et <strong>de</strong>rnier chapitre, nous voici arrivés au terme <strong>de</strong> ce docum<strong>en</strong>t.L’expression « <strong>gestion</strong> à long terme » pr<strong>en</strong>d ici tout son s<strong>en</strong>s : <strong>de</strong> toutes les activités <strong>de</strong>l’ONDRAF, les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> B et C sont celles qui s’inscriv<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong>perspective <strong>de</strong> temps <strong>la</strong> plus <strong>la</strong>rge. L’initiative du programme, par ailleurs, remonte àplus <strong>de</strong> tr<strong>en</strong>te ans, avant même <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’ONDRAF donc, puisque c’est leSCK•CEN qui, <strong>en</strong> 1974, comm<strong>en</strong>ça les premières étu<strong>de</strong>s <strong>en</strong> <strong>la</strong> matière.C’est par un rappel <strong>de</strong>s principales hypothèses <strong>de</strong> travail du programme B&C, et par unhistorique succinct <strong>de</strong> ses gran<strong>de</strong>s étapes <strong>de</strong>puis les années septante jusqu’à nos jours,que débute ce chapitre. Les rapports SAFIR et SAFIR 2 y ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t une p<strong>la</strong>ce importante.Le corps du chapitre est consacré à l’exposé <strong>de</strong> l’état actuel du programme. Lesquantités et types <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> sont rappelés, les méthodologies mises <strong>en</strong> œuvre –argum<strong>en</strong>taires sci<strong>en</strong>tifiques et techniques, stratégie <strong>de</strong> sûreté et <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>sconnaissances – sont exposées.Le concept <strong>de</strong> dépôt géologique tel qu’<strong>en</strong>visagé aujourd’hui est <strong>en</strong>suite décrit. Sontpassées <strong>en</strong> revue <strong>la</strong> formation-hôte et l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt proprem<strong>en</strong>t dite, dont, <strong>en</strong>particulier, les barrières ouvragées, qui sont <strong>de</strong>stinées à faciliter l’exploitation et àconfiner les radionucléi<strong>de</strong>s après <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt.Les principaux acquis sci<strong>en</strong>tifiques et techniques <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> recherche m<strong>en</strong>és<strong>en</strong> col<strong>la</strong>boration avec le SCK•CEN vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t compléter l’exposé <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>actuelle</strong><strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s visant à confirmer <strong>la</strong> sûreté et <strong>la</strong> faisabilité du dépôt géologique dans l’Argile<strong>de</strong> Boom.Ce programme d’étu<strong>de</strong>s est <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>te évolution. Le tableau <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation 2007 neserait pas complet sans qu’y soi<strong>en</strong>t abordées les principales activités prévues dans lefutur proche, au nombre <strong>de</strong>squelles les expéri<strong>en</strong>ces PRACLAY.Enfin, les hypothèses et questions ouvertes conditionnant <strong>la</strong> poursuite, dans le plus longterme, du programme d’étu<strong>de</strong>s et <strong>la</strong> réalisation du dépôt sont abordées. Dans le cadre<strong>de</strong> ce docum<strong>en</strong>t, ces hypothèses et questions ne sont que brièvem<strong>en</strong>t posées. Ce serale rôle d’un autre docum<strong>en</strong>t, le P<strong>la</strong>n Déchets déjà évoqué, d’approfondir l’év<strong>en</strong>tail <strong>de</strong>sréponses qui pourront et <strong>de</strong>vront y être apportées.1. Introduction et aperçu historiqueLa mise <strong>en</strong> dépôt au sein d’une formation géologique stable est <strong>la</strong> solution <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>trecommandée au niveau international (AIEA, AEN, etc...) afin <strong>de</strong> protéger l’homme etl’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s risques que prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C 52,53 . Cettesolution, qui repose sur une stratégie <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>tration et <strong>de</strong> confinem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sradionucléi<strong>de</strong>s cont<strong>en</strong>us dans les <strong>déchets</strong>, implique l’interposition <strong>en</strong>tre ces <strong>de</strong>rniers etl’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t d’une série <strong>de</strong> barrières artificielles et naturelles complém<strong>en</strong>taires. Elledoit assurer <strong>la</strong> sûreté à long terme, autrem<strong>en</strong>t dit après <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>dépôt, et ce <strong>de</strong> façon passive, c’est-à-dire sans nécessiter d’interv<strong>en</strong>tions humaines. Lamise <strong>en</strong> dépôt géologique est une solution <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> définitive et, <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s, elle clôt <strong>la</strong>filière <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C.52 AIEA (1995), Principes <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, Collection Sûreté N° 111-F53 Loi du 2 août 2002 portant ass<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> Conv<strong>en</strong>tion commune sur <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> ducombustible usé et sur <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, faite à Vi<strong>en</strong>ne le 5 septembre 1997(1), Moniteur belge du 25.12.2002113/166
Compte t<strong>en</strong>u du choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belgique <strong>de</strong> recourir à l’énergie d’origine nucléaire pourassurer une partie <strong>de</strong> ses besoins <strong>en</strong> électricité, et consci<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> trouverune solution pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> haute activité et <strong>de</strong> longuedurée <strong>de</strong> vie issus du retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s combustibles nucléaires usés, le SCK•CEN a, dès1974, <strong>en</strong>trepris un programme d’étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt géologique. Sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>sinformations disponibles et <strong>de</strong> l’expéri<strong>en</strong>ce internationale <strong>en</strong> <strong>la</strong> matière, le SCK•CEN et leService Géologique <strong>de</strong> Belgique focalisèr<strong>en</strong>t très rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t leur att<strong>en</strong>tion sur lescouches d’argiles peu indurées, autrem<strong>en</strong>t dit faiblem<strong>en</strong>t consolidées, situées à moy<strong>en</strong>neprofon<strong>de</strong>ur dans le sous-sol <strong>de</strong> <strong>la</strong> Campine, et <strong>en</strong> particulier sur l’Argile <strong>de</strong> Boomprés<strong>en</strong>te sous <strong>la</strong> zone nucléaire <strong>de</strong> Mol–Dessel. Le bi<strong>en</strong>-fondé <strong>de</strong> l’intérêt sci<strong>en</strong>tifiqueporté à l’Argile <strong>de</strong> Boom avait du reste été confirmé par un catalogue europé<strong>en</strong> <strong>de</strong>sformations favorables à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt, établi <strong>en</strong>tre 1976 et 1979 sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>Commission europé<strong>en</strong>ne sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s informations bibliographiques existantes 54,55 .Le programme <strong>de</strong> RD&D (recherche, développem<strong>en</strong>t et démonstration) re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C <strong>en</strong> cours <strong>de</strong>puis lors, dont <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> aprogressivem<strong>en</strong>t été reprise par l’ONDRAF au début <strong>de</strong>s années quatre-vingt, a connu<strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s phases jusqu’ici : <strong>la</strong> phase 1974–1989 et <strong>la</strong> phase 1990–2003. Au fil dutemps, <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt géologique, qui s’inscrit dans les possibilités prévues par lecadre légal qui régit les missions <strong>de</strong> l’ONDRAF 56 , et plus particulièrem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> mise <strong>en</strong>dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> Boom, s’est progressivem<strong>en</strong>t imposée <strong>de</strong> fait, implicitem<strong>en</strong>t,comme solution <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories Bet C.Tous les développem<strong>en</strong>ts sci<strong>en</strong>tifiques et techniques du programme B&C, qui est <strong>en</strong>coreau sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> RD&D méthodologique, ont toujours été et sont toujours réalisés et auditésdans le cadre <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borations internationales multi<strong>la</strong>térales ou bi<strong>la</strong>térales. La mise <strong>en</strong>dépôt géologique a <strong>en</strong> effet été choisie par plusieurs pays comme politique <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> àlong terme <strong>de</strong> tout ou partie <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Ainsi, par exemple, <strong>la</strong> France a décidé <strong>en</strong> juin 2006 <strong>de</strong> poursuivre ses travaux actuels sur <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôtgéologique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> haute activité et/ou <strong>de</strong> longue durée <strong>de</strong> vie au sein d’uneformation argileuse indurée, dans l’int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’autorisation <strong>de</strong> constructiond’ici 2015 et <strong>de</strong> comm<strong>en</strong>cer l’exploitation industrielle <strong>de</strong> son dépôt <strong>en</strong> 2025; <strong>la</strong> Suisse a fait <strong>en</strong> 2005 le choix du dépôt géologique; l’argile indurée y a <strong>la</strong> préfér<strong>en</strong>ce; <strong>en</strong> Suè<strong>de</strong>, SKB (<strong>la</strong> société chargée <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>scombustibles usés) projette d’introduire <strong>en</strong> 2009 une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation pour <strong>la</strong>construction d’un dépôt pour les combustibles nucléaires usés au sein d’une formationcristalline; <strong>la</strong> Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong> a choisi <strong>en</strong> 2001 le dépôt géologique au sein d’une formation cristallinecomme solution pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong> ses combustibles usés, dansl’int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’autorisation <strong>de</strong> construction d’ici 2012 et <strong>de</strong> comm<strong>en</strong>cerl’exploitation industrielle <strong>de</strong> son dépôt <strong>en</strong> 2020; dans cette optique, <strong>la</strong> Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong>construit <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> caractérisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> roche choisie; <strong>en</strong> Allemagne, l’autorisation <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> non chauffants (<strong>déchets</strong> <strong>de</strong>catégorie B) à Konrad, une anci<strong>en</strong>ne mine située sous une couverture argileuse, vi<strong>en</strong>td’être donnée; le Royaume-Uni a récemm<strong>en</strong>t fait le choix du dépôt géologique pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à longterme <strong>de</strong> ses <strong>déchets</strong> B et C, sans exprimer <strong>de</strong> préfér<strong>en</strong>ce pour une formation hôte54 CE (1980), Confinem<strong>en</strong>t géologique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> dans <strong>la</strong> Communauté Europé<strong>en</strong>ne. Catalogueeuropé<strong>en</strong> <strong>de</strong>s formations géologiques prés<strong>en</strong>tant <strong>de</strong>s caractéristiques favorables à l’évacuation <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> solidifiés <strong>de</strong> haute activité et/ou <strong>de</strong> longue vie. EUR 6891 FR55 CE (1979), Catalogue europé<strong>en</strong> <strong>de</strong>s formations géologiques prés<strong>en</strong>tant <strong>de</strong>s caractéristiques favorables àl’évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> solidifiés <strong>de</strong> haute activité et/ou <strong>de</strong> longue vie. 2 — Belgique, Etat au01.01.197856 Le littera d) du 1° du §2 <strong>de</strong> l’article 2 <strong>de</strong> l’arrêté royal du 30 mars 1981 stipule que « La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong> compr<strong>en</strong>d […] l’évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés. » où l’évacuation est définie àl’article 1 er comme étant le « rejet ou dépôt <strong>de</strong> tels <strong>déchets</strong> sans int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> récupération. Ceci compr<strong>en</strong>dnotamm<strong>en</strong>t le dépôt év<strong>en</strong>tuel <strong>en</strong> surface ou <strong>en</strong> couches géologiques […] ».Le littera a) du 1° du §3 <strong>de</strong> l’article 2 fixe comme une <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> l’ONDRAF « dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> » d’« exécuter les opérations décou<strong>la</strong>nt du §2, 1°, du prés<strong>en</strong>t article ».114/166
particulière; les Etats-Unis exploit<strong>en</strong>t <strong>de</strong>puis 1999 l’instal<strong>la</strong>tion WIPP (Waste Iso<strong>la</strong>tion Pilot P<strong>la</strong>nt),construite dans une couche <strong>de</strong> sel, pour le dépôt <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> militaires transurani<strong>en</strong>s(<strong>déchets</strong> non chauffants). Cette instal<strong>la</strong>tion est <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t le seul dépôt géologique<strong>en</strong> exploitation dans le mon<strong>de</strong>.Légalem<strong>en</strong>t et contr<strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> RD&D est financée au prix coûtant par lesproducteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et définie <strong>en</strong> concertation avec eux, selon lesmodalités exposées au chapitre huit.1.1 Pério<strong>de</strong> 1974-1989 et publication du rapport SAFIREtant donné l’abs<strong>en</strong>ce d’expéri<strong>en</strong>ce, tant au niveau national qu’au niveau international,<strong>en</strong> matière <strong>de</strong> creusem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> construction d’instal<strong>la</strong>tions dans une argile peu indurée,à <strong>en</strong>viron 200 mètres <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur, un <strong>de</strong>s objectifs principaux du programme <strong>de</strong> RD&Dinitial du SCK•CEN fut d’évaluer et <strong>de</strong> démontrer <strong>la</strong> faisabilité <strong>de</strong> telles opérations. C’est<strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> construction du <strong>la</strong>boratoire souterrain <strong>de</strong> recherche HADES(High-Activity Disposal Experim<strong>en</strong>tal Site), un outil <strong>de</strong> recherche unique au mon<strong>de</strong>, fut<strong>en</strong>tamée très tôt dans le programme belge (figure ci-<strong>de</strong>ssous).figure 32: Historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction du <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> recherche souterrain HADES. HADESpermet (1) <strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> recherche fondam<strong>en</strong>tale in situ, (2) <strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces <strong>de</strong>confirmation à long terme et (3) <strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> démonstration semi-industrielle ouindustrielle. C’est aussi un outil <strong>de</strong> communication du programme B&C.Soucieux <strong>de</strong> r<strong>en</strong>tabiliser l’expéri<strong>en</strong>ce et les résultats prometteurs déjà obt<strong>en</strong>us par leSCK•CEN <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C,l’ONDRAF décida, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> reprise progressive <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s travaux du SCK•CEN,d’approfondir les étu<strong>de</strong>s <strong>en</strong> cours, faisant du SCK•CEN son part<strong>en</strong>aire privilégié pourtous les aspects <strong>de</strong> RD&D qui supporterai<strong>en</strong>t son programme <strong>de</strong> travail dans cedomaine. Il souhaitait avant tout établir s’il était possible, à partir <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s réaliséesdans le <strong>la</strong>boratoire souterrain, considéré comme site <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce, <strong>de</strong> concevoir uneinstal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt géologique dans l’Argile <strong>de</strong> Boom pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories Bet C qui soit sûre et faisable (y compris <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> coûts).Suivant <strong>en</strong> ce<strong>la</strong> une recommandation émise par <strong>la</strong> Commission d’évaluation <strong>en</strong> matièred’énergie nucléaire (Commission <strong>de</strong>s Sages) dans son rapport <strong>de</strong> 1976 57 , l’ONDRAFdécida <strong>en</strong> 1984 <strong>de</strong> préparer un docum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s travaux re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong>dépôt géologique m<strong>en</strong>és <strong>de</strong> 1974 à 1989 <strong>en</strong> Belgique. Ce rapport (Safety Assessm<strong>en</strong>tand Feasibility Interim Report ou SAFIR), publié <strong>en</strong> 1989 58 , <strong>de</strong>vait permettre à sonautorité <strong>de</strong> tutelle d’émettre un premier avis sur les qualités <strong>de</strong> <strong>la</strong> couche d’Argile <strong>de</strong>Boom à l’aplomb <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone nucléaire <strong>de</strong> Mol–Dessel.57 Commission d’Evaluation <strong>en</strong> matière d’Energie nucléaire (1976), Rapport final, Ministère <strong>de</strong>s Affaireséconomiques58 ONDRAF (1989), Safety Assessm<strong>en</strong>t and Feasibility Interim Report (SAFIR), ONDRAF/NIRAS115/166
La commission d’experts belges et étrangers établie par l’autorité <strong>de</strong> tutelle <strong>de</strong> l’ONDRAFpour évaluer le SAFIR <strong>en</strong> confirma les conclusions 59 , à savoir que les argiles peuindurées, et <strong>en</strong> particulier l’Argile <strong>de</strong> Boom sous <strong>la</strong> zone nucléaire <strong>de</strong> Mol-Dessel,peuv<strong>en</strong>t être <strong>en</strong>visagées pour <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C.L’Argile <strong>de</strong> Boom se révé<strong>la</strong>it <strong>en</strong> effet être une roche très peu perméable et possédant uneforte capacité <strong>de</strong> fixation <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s, et donc une bonne aptitu<strong>de</strong> à retar<strong>de</strong>r leurmigration vers l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. La Commission d’évaluation SAFIR recommanda <strong>de</strong>poursuivre les efforts <strong>de</strong> RD&D ainsi que d’inclure d’autres formations-hôtes etlocalisations dans le programme <strong>de</strong> recherche, et notamm<strong>en</strong>t d’étudier les ArgilesYprési<strong>en</strong>nes à l’aplomb <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone nucléaire <strong>de</strong> Doel comme formation alternative.1.2 Pério<strong>de</strong> 1990-2003 et publication du rapport SAFIR 2L’ONDRAF réévalua <strong>en</strong> 1990 son programme <strong>de</strong> RD&D méthodologique afin <strong>de</strong> l’alignersur les recommandations <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission d’évaluation SAFIR. En particulier, il yincorpora une caractérisation préliminaire <strong>de</strong>s Argiles Yprési<strong>en</strong>nes à l’aplomb <strong>de</strong> <strong>la</strong> zon<strong>en</strong>ucléaire <strong>de</strong> Doel. Par ailleurs, conformém<strong>en</strong>t à une résolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chambre adoptée le22 décembre 1993 60 , confirmée par le Conseil <strong>de</strong>s ministres <strong>la</strong> même année etreconfirmée <strong>en</strong> 1998, l’ONDRAF p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>puis lors sur pied d’égalité l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong>dépôt géologique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t et celle <strong>de</strong>s combustibles usés nonretraités.Le SAFIR 2, qui a clôturé <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième phase du programme <strong>de</strong> RD&D méthodologique(1990–2000) et a été publié <strong>en</strong> 2001 61,62 , synthétise les avancées <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> dépôtdans l’Argile <strong>de</strong> Boom, évaluant <strong>la</strong> confiance <strong>en</strong> <strong>la</strong> sûreté et <strong>la</strong> faisabilité du système <strong>de</strong>dépôt étudié, et abor<strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Argiles Yprési<strong>en</strong>nes. Il a fait l’objet d’une évaluationpar un comité d’experts académiques belges créé à l’initiative du Conseil d’administration<strong>de</strong> l’ONDRAF 63 , puis d’un audit international, <strong>de</strong>mandé par le gouvernem<strong>en</strong>t fédéral etréalisé sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’AEN. Les résultats <strong>de</strong> cet audit ont été publiés <strong>en</strong> 2003 64 .Le SAFIR 2 et ses audits ont indiqué que <strong>la</strong> solution proposée <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôt dansl’Argile <strong>de</strong> Boom est prometteuse : l’Argile <strong>de</strong> Boom apparaissait exempte <strong>de</strong> vicesrédhibitoires <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> sûreté et <strong>de</strong> faisabilité pour les <strong>déchets</strong> sur lesquels les étu<strong>de</strong>ss’étai<strong>en</strong>t focalisées jusque-là, à savoir les <strong>déchets</strong> vitrifiés <strong>de</strong> haute activité issus duretraitem<strong>en</strong>t et, dans une moindre mesure, les combustibles usés. Les conclusions <strong>de</strong>l’audit <strong>de</strong> l’AEN indiqu<strong>en</strong>t <strong>en</strong> particulier que le niveau <strong>de</strong> connaissances et l’expéri<strong>en</strong>ceaccumulée autoris<strong>en</strong>t le passage au processus <strong>de</strong> choix d’un site <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong>solution <strong>de</strong> dépôt tout <strong>en</strong> poursuivant <strong>la</strong> RD&D afin <strong>de</strong> réduire les incertitu<strong>de</strong>s restantes.Elles précis<strong>en</strong>t toutefois, tout comme le fait l’ONDRAF dans le docum<strong>en</strong>t contextuel 65 quiaccompagne le SAFIR 2, que les conditions <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvre d’une telle solution nesont pas réunies : d’une part, <strong>la</strong> solution <strong>de</strong>vrait bénéficier d’un support sociétal et sondéveloppem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>vrait s’inscrire dans un processus décisionnel partagé par les pr<strong>en</strong>eursd’<strong>en</strong>jeux, d’autre part, le cadre légal et règlem<strong>en</strong>taire applicable à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt<strong>de</strong>vrait être précisé et complété.Le SAFIR 2 ne se prononce pas quant au pot<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong>s Argiles Yprési<strong>en</strong>nes <strong>en</strong> tant queformation-hôte alternative dans <strong>la</strong> mesure où l’interprétation <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>sreconnaissances préliminaires géologiques et hydrogéologiques était toujours <strong>en</strong> coursau mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> sa rédaction.59 Commission d’évaluation SAFIR (1990), Rapport final, Secrétariat d’Etat à l’Energie60 Chambre <strong>de</strong>s représ<strong>en</strong>tants <strong>de</strong> Belgique, Résolution 541/6 – 91/92 re<strong>la</strong>tive à l’utilisation <strong>de</strong> combustiblescont<strong>en</strong>ant du plutonium et <strong>de</strong> l’uranium dans les c<strong>en</strong>trales nucléaires belges, ainsi qu’à l’opportunité duretraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s barres <strong>de</strong> combustible, Session ordinaire du 16 décembre 199361 ONDRAF (2001), SAFIR 2—Safety Assessm<strong>en</strong>t and Feasibility Interim Report 2, NIROND 2001-06 E,ONDRAF/NIRAS62 ONDRAF (2001), Apercu technique du rapport SAFIR 2 — Safety Assessm<strong>en</strong>t and Feasibility InterimReport 2, NIROND 2001-05 F, ONDRAF63 Comité <strong>de</strong> lecture sci<strong>en</strong>tifique consultatif du rapport SAFIR 2 (2001), Avis final, Annexe 5 <strong>de</strong> l’Apercutechnique du rapport SAFIR 2 (NIROND 2001-05 F)64 NEA/AEN (2003), SAFIR 2: Belgian R&D Programme on the Deep Disposal of High-level and Long-livedRadioactive Waste—An International Peer Review, ISBN 92-64-18499-6, OECD/NEA65 ONDRAF (2001), Vers une <strong>gestion</strong> durable <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> — Contexte du rapport SAFIR 2,NIROND 01-07 F, ONDRAF116/166
2. Etat du programme B&C à <strong>la</strong> fin 2007Malgré une reconnaissance internationale <strong>de</strong> sa pertin<strong>en</strong>ce et <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> sesfon<strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts sci<strong>en</strong>tifiques et techniques, <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce n’a jamais été soumiseau test <strong>de</strong> l’acceptabilité sociétale et n’a jamais été formellem<strong>en</strong>t confirmée au niveaufédéral <strong>en</strong> tant que choix <strong>de</strong> principe pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>scatégories B et C. Elle repose donc sur <strong>de</strong>s hypothèses <strong>de</strong> travail (voir ci-<strong>de</strong>ssous),dépourvues <strong>de</strong> légitimité formelle. A fortiori, aucune décision n’a jamais été priseconcernant un site pot<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvre. Ces faiblesses ont été soulignées parl’ONDRAF, à l’occasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication du SAFIR 2 65 , ainsi que par les experts <strong>de</strong>l’AEN 64 .Suite à cette constatation, le Ministre <strong>de</strong> tutelle <strong>de</strong> l’ONDRAF a donné <strong>en</strong> 2004 pourmission à l’ONDRAF <strong>de</strong> préparer et d’<strong>en</strong>gager le dialogue sociétal à tous les niveaux tout<strong>en</strong> poursuivant les activités <strong>de</strong> RD&D <strong>en</strong> cours. Il confirmait par là même l’approbation,par le Conseil d’administration <strong>de</strong> l’ONDRAF, <strong>de</strong> <strong>la</strong> double décision proposée dans ledocum<strong>en</strong>t contextuel du SAFIR 2.Principales hypothèses <strong>de</strong> travail du programme B&C1. Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C doiv<strong>en</strong>t être gérés à long terme sur le territoir<strong>en</strong>ational.2. La solution <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B etC est <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt au sein d’une formation géologique profon<strong>de</strong> (dépôtgéologique).3. Les formations-hôtes pot<strong>en</strong>tielles pour un dépôt géologique se limit<strong>en</strong>t aux formationsargileuses.4. Les formations argileuses susceptibles d’abriter un dépôt sont les argiles peuindurées.5. La formation-hôte <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour les formations argileuses peu indurées estl’Argile <strong>de</strong> Boom.6. La solution <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme sera mise <strong>en</strong> œuvre dès que possible afind’assurer au plus vite <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> sûreté passive <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, conformém<strong>en</strong>t auximplications du principe d’équité intergénérationnelle, ceci compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s facteurssci<strong>en</strong>tifiques, techniques et sociétaux pertin<strong>en</strong>ts ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> disponibilité <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>.Compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> <strong>la</strong> difficulté pratique, économique, sci<strong>en</strong>tifique et légale <strong>de</strong> susp<strong>en</strong>dre lestravaux <strong>de</strong> RD&D <strong>en</strong> att<strong>en</strong>dant le <strong>la</strong>ncem<strong>en</strong>t effectif d’un dialogue sociétal au sujet duprogramme B&C, l’ONDRAF a mis à profit les <strong>de</strong>rnières années pour adapter sonprogramme B&C et l’aligner sur les recommandations <strong>de</strong> l’AEN, ce<strong>la</strong> <strong>en</strong> supposant queses principales hypothèses <strong>de</strong> travail serai<strong>en</strong>t progressivem<strong>en</strong>t confirmées.La suite <strong>de</strong> cette section : rappelle l’inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> considérés dans les étu<strong>de</strong>s; décrit succinctem<strong>en</strong>t les principales nouvelles approches méthodologiques mises <strong>en</strong>p<strong>la</strong>ce; décrit l’état d’avancem<strong>en</strong>t du programme, y compris <strong>en</strong> matière d’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong>sûreté et <strong>de</strong> <strong>la</strong> faisabilité du système <strong>de</strong> dépôt géologique dans l’Argile <strong>de</strong> Boom.2.1 Inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> considérés dans les étu<strong>de</strong>sSelon les estimations les plus réc<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> l’ONDRAF, les volumes <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>conditionnés <strong>de</strong>s catégories B et C à gérer d’ici 2070, autrem<strong>en</strong>t dit d’ici <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>sactivités <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> toutes les instal<strong>la</strong>tions nucléaires existantes et prévues,sont les suivants :1. <strong>en</strong> cas d’abandon du retraitem<strong>en</strong>t : 4 500 m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie C (à postconditionner<strong>en</strong> supercont<strong>en</strong>eurs – cf. infra) et plus <strong>de</strong> 9 200 m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>117/166
catégorie B (à post-conditionner <strong>en</strong> monolithes – cf. infra);2. <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> reprise du retraitem<strong>en</strong>t : 550 m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie C (à postconditionner<strong>en</strong> supercont<strong>en</strong>eurs), 1 550 m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie C (moinsgénérateurs <strong>de</strong> chaleur, à post-conditionner <strong>en</strong> monolithes) et près <strong>de</strong> 8 900 m 3 <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie B (à post-conditionner <strong>en</strong> monolithes).Cette estimation pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> compte <strong>la</strong> loi du 31 janvier 2003 sur <strong>la</strong> sortie progressive <strong>de</strong>l’énergie nucléaire : elle suppose que les sept réacteurs nucléaires <strong>de</strong> puissance actuelsseront exploités durant 40 ans chacun.Ceci dit, il est probable qu’une partie <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t jugés compatibles avecune mise <strong>en</strong> dépôt <strong>en</strong> surface, et qui apparti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t donc à <strong>la</strong> catégorie A, ne pourra êtremise <strong>en</strong> dépôt <strong>en</strong> surface et <strong>de</strong>vra donc être mise <strong>en</strong> dépôt géologiques 66 .Les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t à eux seuls plus <strong>de</strong> 99 % <strong>de</strong> <strong>la</strong>radioactivité totale <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories A, B et C qui seront produitsd’ici 2070.2.2 MéthodologiesSuite au rapport SAFIR 2, l’ONDRAF a développé et met <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> nouvellesapproches méthodologiques, <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> r<strong>en</strong>forcer l’effici<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> et <strong>de</strong>l’intégration <strong>de</strong>s aspects sci<strong>en</strong>tifiques et techniques <strong>de</strong> son programme B&C : il conçoit les supports docum<strong>en</strong>taires, et <strong>la</strong> RD&D qui les sous-t<strong>en</strong>d, <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>sdécisions visées (argum<strong>en</strong>taires sci<strong>en</strong>tifiques et techniques), il suit une stratégie <strong>de</strong> sûreté, il utilise un système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s connaissances.La méthodologie d’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté, déjà mise <strong>en</strong> œuvre dans le cadre <strong>de</strong>l’exercice SAFIR 2, fait l’objet <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>ts considérables au niveau international ;son application dans le contexte belge doit <strong>en</strong>core être affinée. Elle combine les résultats<strong>de</strong> calculs <strong>de</strong> dose radiologique, <strong>de</strong>s argum<strong>en</strong>ts sci<strong>en</strong>tifiques et techniques ainsi que les<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts qui peuv<strong>en</strong>t être tirés <strong>de</strong> l’observation d’analogues naturels. Laméthodologie d’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> faisabilité doit quant à elle <strong>en</strong>core être développée.2.2.1 Argum<strong>en</strong>taires sci<strong>en</strong>tifiques et techniquesL’ONDRAF <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d désormais <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aux autorités compét<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre lesdécisions nécessaires à l’avancem<strong>en</strong>t formel du programme B&C sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>docum<strong>en</strong>ts ou <strong>de</strong> dossiers <strong>de</strong> type « argum<strong>en</strong>taire ». Bi<strong>en</strong> que les supportsdocum<strong>en</strong>taires <strong>de</strong> type SAFIR ai<strong>en</strong>t une utilité intrinsèque, dans <strong>la</strong> mesure où ilspermett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> faire le point sur l’état <strong>de</strong>s connaissances sci<strong>en</strong>tifiques et techniques et surles incertitu<strong>de</strong>s restantes à un mom<strong>en</strong>t donné, le besoin d’obt<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong> <strong>la</strong> part<strong>de</strong>s autorités compét<strong>en</strong>tes suggère <strong>de</strong> structurer ces connaissances <strong>de</strong> manière àfaciliter <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> décision. Il s’agit donc <strong>de</strong> hiérarchiser et d’articuler <strong>de</strong>s argum<strong>en</strong>tsplutôt que d’énumérer <strong>de</strong>s résultats. Une telle approche ne préjuge toutefois pas <strong>de</strong>sdécisions qui seront effectivem<strong>en</strong>t prises par les autorités compét<strong>en</strong>tes.Compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> l’hypothèse que les autorités compét<strong>en</strong>tes confirmeront <strong>la</strong> solution dudépôt géologique dans une argile peu indurée, le volet sci<strong>en</strong>tifique et technique duprogramme B&C est <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t organisé <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> permettre l’établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>de</strong>uxdossiers — les Safety and Feasibility Cases ou SFCs — sur lesquels l’ONDRAF comptes’appuyer pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aux autorités compét<strong>en</strong>tes d’autoriser le passage à <strong>de</strong>s phasesultérieures du programme : Le SFC 1 sera consacré à évaluer <strong>la</strong> sûreté et <strong>la</strong> faisabilité d’une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt,d’une part, au sein d’une ou plusieurs zones délimitées dans l’Argile <strong>de</strong> Boom(SFC 1 AB) et, d’autre part, au sein d’une ou plusieurs zones délimitées dans les ArgilesYprési<strong>en</strong>nes (SFC 1 AY). La partie consacrée aux Argiles Yprési<strong>en</strong>nes sera toutefois66 Quelques milliers <strong>de</strong> m 3 <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A pourrait être concernés.118/166
nettem<strong>en</strong>t moins détaillée que celle consacrée à l’Argile <strong>de</strong> Boom.Le SFC 1 <strong>de</strong>vrait permettre aux autorités compét<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> donner leur feu vert au<strong>la</strong>ncem<strong>en</strong>t du processus d’i<strong>de</strong>ntification d’un ou <strong>de</strong> plusieurs sites d’imp<strong>la</strong>ntationpot<strong>en</strong>tiels pour le dépôt, dans une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux formations-hôtes étudiées ou dans les<strong>de</strong>ux. Sa finalisation est <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t prévue pour 2013, ce qui doit permettre d’yincorporer les résultats du transitoire du test <strong>de</strong> chauffe PRACLAY. (Cette échéancesuit aussi <strong>la</strong> date <strong>de</strong> publication du SAFIR 2 d’une dizaine d’années). Une telledécision <strong>de</strong> type « go for siting » marquerait le passage vers <strong>la</strong> phase d’avant-projet. Si le SFC 1 conduit à une décision <strong>de</strong> type « go for siting », l’ONDRAF préparera unSFC 2 visant à fournir aux autorités compét<strong>en</strong>tes tous les élém<strong>en</strong>ts sci<strong>en</strong>tifiques ettechniques nécessaires pour leur permettre <strong>de</strong> choisir <strong>en</strong> connaissance <strong>de</strong> cause le sited’imp<strong>la</strong>ntation du dépôt final ainsi qu’un avant-projet intégré <strong>de</strong> dépôt comportant <strong>de</strong>sconditions socio-économiques locales et adapté à ce site. Une telle décision seraitanalogue à <strong>la</strong> décision du gouvernem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 2006 pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie A.Cette décision <strong>de</strong> type « go for lic<strong>en</strong>sing » donnerait le feu vert à <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong>sdossiers <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation et marquerait donc le passage vers <strong>la</strong> phase <strong>de</strong>projet. Si le siting se limite à l’Argile <strong>de</strong> Boom, le SFC 2 pourrait être finalisé à l’horizon2020.Aux décisions <strong>de</strong> type « go for siting » et « go for lic<strong>en</strong>sing » <strong>de</strong>vra s’ajouter <strong>la</strong> décision<strong>de</strong> développer un ou plusieurs avant-projets intégrés <strong>de</strong> dépôt avec une ou <strong>de</strong>scommunes intéressées, dans l’esprit <strong>de</strong> ce qui a été fait au sein <strong>de</strong>s part<strong>en</strong>ariats locauxcréés dans le cadre du programme catégorie A. Cette décision <strong>de</strong>vra être prise plusieursannées avant <strong>la</strong> date escomptée <strong>de</strong> finalisation du SFC 2.2.2.2 Stratégie <strong>de</strong> sûretéL’ONDRAF a développé une stratégie <strong>de</strong> sûreté pour <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> dépôt <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>scatégories B et C 67 qui décrit le processus <strong>de</strong>stiné à développer un concept et un <strong>de</strong>signpour le dépôt géologique <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong> et à développer les preuves et argum<strong>en</strong>tsnécessaires pour montrer que ceux-ci sont sûrs et peuv<strong>en</strong>t être implém<strong>en</strong>tés selon lesmodalités prévues.La stratégie <strong>de</strong> sûreté a été développée <strong>de</strong> manière à t<strong>en</strong>ir compte <strong>de</strong> l’approche itérativeet progressive que suit le développem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre d’un dépôt : elle estsusceptible d’être appliquée <strong>de</strong> façon répétée à <strong>de</strong>s étapes successives du programme.Cep<strong>en</strong>dant, ses résultats évolueront au fur et à mesure <strong>de</strong> l’avancem<strong>en</strong>t du programme,<strong>de</strong> <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> décisions, <strong>de</strong> l’acquisition <strong>de</strong> connaissances et <strong>de</strong> l’affinem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> based’évaluation. Le produit <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> sûreté <strong>de</strong>vrait être un conceptet un <strong>de</strong>sign <strong>de</strong> dépôt ainsi que <strong>de</strong>s argum<strong>en</strong>taires <strong>de</strong> type SFC susceptibles <strong>de</strong>supporter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> décisions nécessaires.La stratégie <strong>de</strong> sûreté part d’un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> conditions limites, liées au contexte duprogramme, qui inclu<strong>en</strong>t par exemple les élém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> guidance internationale, le cadrelégal et règlem<strong>en</strong>taire belge, l’hypothèse <strong>de</strong> travail que l’Argile <strong>de</strong> Boom sera <strong>la</strong> formationgéologique hôte pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C ou <strong>en</strong>core les décisions <strong>de</strong>politique institutionnelle (figure ci-<strong>de</strong>ssous). Le développem<strong>en</strong>t du système est alorsguidé par un certain nombre <strong>de</strong> choix stratégiques faits par l’ONDRAF (compatibles avecles conditions limites), qui sont <strong>en</strong>suite traduits <strong>en</strong> un <strong>en</strong>semble d’exig<strong>en</strong>ces re<strong>la</strong>tives ausystème dans son <strong>en</strong>semble, à <strong>de</strong>s sous-systèmes ou à <strong>de</strong>s composants individuels dusystème <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> r<strong>en</strong>contrer les objectifs généraux <strong>de</strong> sûreté et <strong>de</strong> faisabilité.67 ONDRAF/NIRAS (2007), The ONDRAF/NIRAS Long-Term Safety Strategy for the Disposal of High-LevelWaste, first full draft, NIROND-TR 2006-04 E, ONDRAF/NIRAS119/166
figure 33: Principaux élém<strong>en</strong>ts du processus défini par <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> sûreté 67 . Les « conditionslimites » et <strong>la</strong> base d’évaluation fourniss<strong>en</strong>t un input à <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> sûreté mais n’<strong>en</strong> font paselles-mêmes partie.Le développem<strong>en</strong>t même du système se fait à <strong>de</strong>ux niveaux. Le niveau supérieur estcelui du développem<strong>en</strong>t d’un concept <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce général. Le niveau inférieur, plusdétaillé, porte sur le développem<strong>en</strong>t (ou <strong>la</strong> ré-évaluation) <strong>de</strong> choix plus spécifiquesconcernant le <strong>de</strong>sign et l’implém<strong>en</strong>tation du dépôt. Le concept <strong>de</strong> dépôt, qui porte sur lesgrands composants du dépôt et sur leurs fonctions, est supposé être robuste par rapportà tous les changem<strong>en</strong>ts raisonnablem<strong>en</strong>t prévisibles re<strong>la</strong>tifs aux connaissances et auxconditions limites. Le <strong>de</strong>sign détaillé, lui, peut être modifié au fur et à mesure <strong>de</strong>l’évolution du programme afin d’assurer une meilleure adéquation aux exig<strong>en</strong>ces, <strong>de</strong> tirerprofit <strong>de</strong>s progrès réalisés aux niveaux sci<strong>en</strong>tifique et technique et <strong>de</strong> permettre <strong>de</strong> mieuxétayer les arboresc<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> safety statem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong> feasibility statem<strong>en</strong>ts 68 quiconstitueront <strong>la</strong> colonne vertébrale <strong>de</strong>s futurs SFC.Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> sûreté, les choix stratégiquessuivants ont été effectués : Etant donné l’hypothèse <strong>de</strong> travail que l’Argile <strong>de</strong> Boom sera <strong>la</strong> formation-hôte pour undépôt pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C, le dépôt sera construit au cœur <strong>de</strong> cetteformation, les formations sédim<strong>en</strong>taires <strong>en</strong> surplomb faisant office <strong>de</strong> couverturegéologique. Les matériaux et les procédures <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvre ne perturberont pas les fonctions<strong>de</strong> sûreté <strong>de</strong> l’Argile <strong>de</strong> Boom 69 <strong>de</strong> façon inacceptable, ni aucun autre composant dusystème important pour <strong>la</strong> sûreté. Dans le cas <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> chauffants, les barrières ouvragées seront conçues pourassurer un confinem<strong>en</strong>t complet <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> au moins durant toute <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> où ledégagem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> chaleur est important (pas d’exig<strong>en</strong>ce simi<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> confinem<strong>en</strong>t pourles autres <strong>déchets</strong>) pour éviter <strong>de</strong> <strong>de</strong>voir modéliser le transport <strong>de</strong>s contaminantsdurant cette phase thermique. Les <strong>déchets</strong> seront divisés <strong>en</strong> groupes et mis <strong>en</strong> dépôt dans <strong>de</strong>s portions distinctes dudépôt. La construction du dépôt et son exploitation se feront dès que possible, compte t<strong>en</strong>u<strong>de</strong>s considérations sci<strong>en</strong>tifiques, technologiques, sociétales et économiques. Les différ<strong>en</strong>tes portions du dépôt et le dépôt dans son <strong>en</strong>semble seront fermés(remb<strong>la</strong>yage <strong>de</strong>s voies d’accès et scellem<strong>en</strong>t) dès que possible après <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>. Il y a une préfér<strong>en</strong>ce pour un blindage perman<strong>en</strong>t et pour une minimisation <strong>de</strong>sopérations <strong>en</strong> sous-sol.68 Assertions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> sûreté ou à <strong>la</strong> faisabilité d’un système <strong>de</strong> dépôt, utilisées pour établir un SFC. Lessafety statem<strong>en</strong>ts et les feasibility statem<strong>en</strong>ts sont dérivés <strong>de</strong>s exig<strong>en</strong>ces et sont organisés <strong>en</strong> <strong>en</strong>semblesstructurés.69 L’Argile <strong>de</strong> Boom est <strong>la</strong> principale barrière au transport <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s et à leur relâchem<strong>en</strong>t par lesystème <strong>de</strong> dépôt. La sûreté ne <strong>de</strong>vrait pas dép<strong>en</strong>dre <strong>de</strong> façon critique du système <strong>de</strong> barrières ouvragéespour autant que les propriétés <strong>de</strong> l’Argile <strong>de</strong> Boom qui sont importantes pour <strong>la</strong> sûreté ne soi<strong>en</strong>t pasperturbées <strong>de</strong> façon significative par <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> ou par les barrières ouvragées elles-mêmes.120/166
Il y a une préfér<strong>en</strong>ce pour <strong>de</strong>s matériaux et <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvre pourlesquels exist<strong>en</strong>t déjà une <strong>la</strong>rge expéri<strong>en</strong>ce et <strong>de</strong> vastes connaissances. Le développem<strong>en</strong>t du dépôt se base sur l’hypothèse que <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce post-fermetureet le monitoring seront maint<strong>en</strong>us aussi longtemps que raisonnablem<strong>en</strong>t possible, afin<strong>de</strong> limiter les risques d’intrusion humaine délibérée (non autorisée) ou acci<strong>de</strong>ntelle,ceci compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s ressources nécessaires.Ces choix sont susceptibles <strong>de</strong> changer au cours du développem<strong>en</strong>t du programme. Ilsfourniss<strong>en</strong>t toutefois un cadre pour le développem<strong>en</strong>t du concept et du <strong>de</strong>sign <strong>de</strong> dépôt,certains d’<strong>en</strong>tre eux se traduisant directem<strong>en</strong>t par <strong>de</strong>s exig<strong>en</strong>ces sur le concept ou le<strong>de</strong>sign.2.2.3 Gestion <strong>de</strong>s connaissances : knowledge managem<strong>en</strong>tsystemCompte t<strong>en</strong>u du volume considérable <strong>de</strong> connaissances (données, résultats,interprétations, etc...) déjà acquises et qui le seront <strong>en</strong>core dans le cadre du programme<strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme, et compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> docum<strong>en</strong>ter les décisions etchoix effectués, il s’est avéré indisp<strong>en</strong>sable d’adjoindre au programme <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à longterme un système <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s connaissances (Knowledge Managem<strong>en</strong>t System ouKMS). Ce système, <strong>en</strong>core <strong>en</strong> cours <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t, est, d’une part, un outild’intégration et <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s connaissances au quotidi<strong>en</strong> et, d’autre part, unoutil <strong>de</strong> traçabilité et d’archivage, <strong>de</strong>stiné notamm<strong>en</strong>t à permettre <strong>de</strong> relier les actions<strong>en</strong>tamées aux décisions qui les sous-t<strong>en</strong><strong>de</strong>nt, et vice-versa, ainsi qu’à permettre <strong>la</strong>reproduction d’expéri<strong>en</strong>ces ou d’évaluations <strong>de</strong> sûreté.Le KMS, qui est utilisé à <strong>la</strong> fois par l’ONDRAF et par ses part<strong>en</strong>aires, est conçu <strong>de</strong> façontelle qu’il implém<strong>en</strong>te les procédures d’assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’ONDRAF <strong>en</strong> matière<strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> RD&D.2.3 Etat d'avancem<strong>en</strong>tActuellem<strong>en</strong>t, le programme <strong>de</strong> RD&D se focalise très <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t sur le développem<strong>en</strong>td’un système <strong>de</strong> dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> Boom, les Argiles Yprési<strong>en</strong>nes n’ayant jusqu’àprés<strong>en</strong>t fait l’objet que <strong>de</strong> reconnaissances préliminaires. Afin <strong>de</strong> ne pas alourdirinutilem<strong>en</strong>t le texte, les référ<strong>en</strong>ces bibliographiques n’ont int<strong>en</strong>tionnellem<strong>en</strong>t pas étém<strong>en</strong>tionnées.2.3.1 Système <strong>de</strong> dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> BoomLe développem<strong>en</strong>t d’une solution <strong>de</strong> dépôt géologique pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> procè<strong>de</strong> d’une approche systémique. Une telle approche considèrel’<strong>en</strong>semble « formation-hôte + barrières ouvragées + <strong>déchets</strong> » comme un tout — lesystème <strong>de</strong> dépôt —, lequel doit satisfaire aux exig<strong>en</strong>ces fondam<strong>en</strong>tales <strong>de</strong> sûretéopérationnelle, <strong>de</strong> sûreté à long terme et <strong>de</strong> faisabilité.Le système actuel <strong>de</strong> dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> Boom est, dans l’état actuel <strong>de</strong>sconnaissances et <strong>de</strong>s évaluations, jugé sûr et faisable.DescriptionLe système <strong>de</strong> dépôt pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C est constitué <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> dépôt proprem<strong>en</strong>t dite et <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation-hôte <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle cette instal<strong>la</strong>tiona été développée. A l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt proprem<strong>en</strong>t dite sont associées <strong>de</strong>sinstal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> surface pour le post-conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.Formation-hôteLa formation argileuse <strong>de</strong> Boom est prés<strong>en</strong>te dans le nord-est <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belgique. Sous <strong>la</strong>121/166
zone nucléaire <strong>de</strong> Mol-Dessel, elle se prés<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre ~ 190 et ~ 290 mètres <strong>de</strong>profon<strong>de</strong>ur (carte ci-<strong>de</strong>ssous). C’est une roche peu indurée et très peu perméable. Sesperformances comme barrière à <strong>la</strong> migration <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s ont été établiesexpérim<strong>en</strong>talem<strong>en</strong>t, notamm<strong>en</strong>t son homogénéité, sa capacité <strong>de</strong> scellem<strong>en</strong>t (projeteuropé<strong>en</strong> SELFRAC), qui réduit l’impact <strong>de</strong>s perturbations induites par le dépôt, ainsiqu’une très bonne aptitu<strong>de</strong> à retar<strong>de</strong>r <strong>la</strong> migration <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s versl’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Ce retard est dû, d’une part, aux très faibles mouvem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> l’eauinterstitielle (transport diffusif) et, d’autre part, à une capacité importante <strong>de</strong> fixation(piégeage) <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s dans l’argile.Les formations situées <strong>de</strong> part et d’autre <strong>de</strong> l’Argile <strong>de</strong> Boom sont sableuses et aquifères.Les sables qui repos<strong>en</strong>t sur l’Argile <strong>de</strong> Boom constitu<strong>en</strong>t le second aquifère <strong>en</strong>importance pour le captage d’eau potable <strong>en</strong> Belgique et le principal pour le nord-est dupays. L’aquifère situé sous l’Argile <strong>de</strong> Boom est peu productif.figure 34: Profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> <strong>la</strong> base, et épaisseur, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Formation <strong>de</strong> Boom.Instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôtL’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt géologique <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong>visagée consiste <strong>en</strong> un réseau <strong>de</strong>galeries horizontales construit dans l’Argile <strong>de</strong> Boom (figure ci-<strong>de</strong>ssous). Trois puitsdonn<strong>en</strong>t accès à une galerie principale, qui <strong>de</strong>ssert les galeries <strong>de</strong> dépôt, <strong>de</strong> diamètreplus petit. Celles-ci sont réparties <strong>en</strong> trois sections, <strong>de</strong>stinées à recevoir d’une part les<strong>déchets</strong> chauffants (<strong>déchets</strong> vitrifiés ainsi que, le cas échéant, combustibles usés) etd’autre part les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie B, ces <strong>de</strong>rniers étant globalem<strong>en</strong>t répartis <strong>en</strong> ungroupe « passifs » et un groupe « démantèlem<strong>en</strong>t ».122/166
figure 35: L’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt géologique <strong>en</strong>visagée pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C.Le système <strong>de</strong> barrières ouvragées <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong>visagé pour les <strong>déchets</strong> chauffantsest basé sur l’utilisation <strong>de</strong> supercont<strong>en</strong>eurs (première figure ci-<strong>de</strong>ssous). Unsupercont<strong>en</strong>eur est l’unité formée par un surembal<strong>la</strong>ge <strong>en</strong> acier au carbone cont<strong>en</strong>ant les<strong>déchets</strong> vitrifiés ou les combustibles usés et une couche <strong>de</strong> protection massive <strong>en</strong> béton,appelée buffer. Le supercont<strong>en</strong>eur a une double fonction : assurer le confinem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sradionucléi<strong>de</strong>s tant que le gradi<strong>en</strong>t thermique à travers les barrières ouvragées est élevé(phase thermique <strong>de</strong> quelques c<strong>en</strong>taines à quelques milliers d’années) et assurer unblindage radiologique perman<strong>en</strong>t pour les travailleurs, lequel facilite <strong>en</strong> outre lep<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t dans les galeries <strong>de</strong> dépôt. Tous les espaces vi<strong>de</strong>s dans les galeries <strong>de</strong> dépôtsont comblés par <strong>de</strong>s matériaux choisis pour leur aptitu<strong>de</strong> à contribuer à <strong>la</strong> sûreté globaledu système.Le <strong>de</strong>sign <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie B est basé sur l’utilisation <strong>de</strong>monolithes (secon<strong>de</strong> figure), où chaque monolithe se prés<strong>en</strong>te comme un bloc <strong>de</strong> bétondans <strong>la</strong> masse duquel ont été immobilisés plusieurs colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>. Ce monolithe sertprincipalem<strong>en</strong>t à assurer un blindage radiologique pour les travailleurs et à faciliter lesmanut<strong>en</strong>tions <strong>en</strong> sous-sol. Son <strong>de</strong>sign est fortem<strong>en</strong>t inspiré <strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s monolithes <strong>en</strong>cours <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t dans le cadre du programme catégorie A.123/166
figure 36: Le <strong>de</strong>sign du supercont<strong>en</strong>eur, pour les <strong>déchets</strong> vitrifiés (ou pour combustibles usés).figure 37: Le <strong>de</strong>sign du monolithe,pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie B.124/166
Evaluation <strong>de</strong>s performancesBarrières ouvragées : les conditions géochimiques imposées par le matériau cim<strong>en</strong>tairemassif du buffer du supercont<strong>en</strong>eur sont favorables à une durabilité importante dusurembal<strong>la</strong>ge <strong>en</strong> acier au carbone (taux <strong>de</strong> corrosion généralisée inférieur à 0,1 µm/a).Ceci <strong>de</strong>vrait permettre d’assurer le confinem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> phase thermique.Matrices <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> : <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> sûreté n’impose pas <strong>de</strong> durabilité minimale auxmatrices <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>. Cep<strong>en</strong>dant, <strong>en</strong> milieu argileux, <strong>la</strong> faible lixiviation <strong>de</strong>s verres et <strong>de</strong> <strong>la</strong>matrice UO 2 <strong>de</strong>s combustibles contribuera à <strong>la</strong> sûreté du système <strong>de</strong> dépôt.Perturbations induites par les <strong>déchets</strong> : le gonflem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> bitumésEurochemic et les surpressions qui <strong>en</strong> découl<strong>en</strong>t sont importants et susceptibles d’induireune perturbation mécanique <strong>de</strong> l’argile et d’ainsi réduire ses performances. Des tests insitu à petite échelle indiqu<strong>en</strong>t que les <strong>déchets</strong> chauffants ne <strong>de</strong>vrai<strong>en</strong>t pas induire <strong>de</strong>perturbations thermiques inacceptables pour l’Argile <strong>de</strong> Boom. Ceci <strong>de</strong>vrait être démontréà plus gran<strong>de</strong> échelle grâce au test <strong>de</strong> chauffe PRACLAY.Evaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté à long termeLes principaux acquis <strong>en</strong> matière d’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté à long terme peuv<strong>en</strong>t, pour lescénario d'évolution normale, se résumer comme suit : c’est l’Argile <strong>de</strong> Boom qui contribue le plus à <strong>la</strong> sûreté à long terme; le rôle <strong>de</strong>s matrices <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> et <strong>de</strong>s barrières ouvragées est marginal; <strong>la</strong> dose maximale <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drée par le dépôt est inférieure d’au moins un ordre <strong>de</strong>gran<strong>de</strong>ur à <strong>la</strong> contrainte <strong>de</strong> dose réglem<strong>en</strong>taire et est 300 à 400 fois inférieure à <strong>la</strong>dose moy<strong>en</strong>ne induite par <strong>la</strong> radioactivité naturelle <strong>en</strong> F<strong>la</strong>ndre : les principaux contributeurs à <strong>la</strong> dose sont les produits <strong>de</strong> fission non piégés parl’Argile <strong>de</strong> Boom ( 129 I, 36 Cl, 14 C, ...), les actini<strong>de</strong>s (U, Pu, …) ne contribu<strong>en</strong>t que très faiblem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> dose. les produits <strong>de</strong> fission et d’activation quitt<strong>en</strong>t l’Argile <strong>de</strong> Boom après <strong>de</strong>s durées <strong>de</strong>l’ordre <strong>de</strong> quelques dizaines <strong>de</strong> milliers d’années; les actini<strong>de</strong>s quitt<strong>en</strong>t l’Argile <strong>de</strong>Boom après plusieurs c<strong>en</strong>taines <strong>de</strong> milliers d’années. Dans les <strong>de</strong>ux cas, les quantitéssont minimes.L’ONDRAF a par ailleurs formalisé sa stratégie <strong>de</strong> sûreté sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s fonctions quedoiv<strong>en</strong>t assurer les différ<strong>en</strong>ts composants du système <strong>de</strong> dépôt. Cette stratégie permettra<strong>de</strong> sout<strong>en</strong>ir l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s choix <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> conception du dépôt et <strong>de</strong> priorité <strong>de</strong>RD&D.Evaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> faisabilitéLa faisabilité désigne <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> construire, d’exploiter et <strong>de</strong> fermer une instal<strong>la</strong>tion<strong>de</strong> dépôt <strong>en</strong> conformité avec les spécifications établies, compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s contraintesd’ingénierie, <strong>de</strong>s impératifs <strong>de</strong> sûreté opérationnelle et <strong>de</strong>s coûts financiers. Lesprincipaux acquis <strong>en</strong> matière d’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> faisabilité sont les suivants : démonstration <strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong> manière industrielle <strong>de</strong>s puits et <strong>de</strong>sgaleries au sein <strong>de</strong> l’Argile <strong>de</strong> Boom à plus <strong>de</strong> 200 mètres <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur (creusem<strong>en</strong>tdu second puits d’accès au <strong>la</strong>boratoire souterrain HADES et <strong>de</strong> <strong>la</strong> galerie <strong>de</strong> liaison)ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> réaliser le croisem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux galeries (creusem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><strong>la</strong> galerie PRACLAY), tout <strong>en</strong> limitant les perturbations géomécaniques <strong>de</strong> l’argile; possibilités <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s supercont<strong>en</strong>eurs ou <strong>de</strong>s monolithes <strong>en</strong> puits et <strong>en</strong>galerie selon <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s industrielles connues (par exemple au moy<strong>en</strong> <strong>de</strong> coussinsd’air); démonstration <strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> réaliser un scellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> qualité pour un puitsd’accès (test RESEAL); démonstration <strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> combler les espaces vi<strong>de</strong>s <strong>en</strong>tre le revêtem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s125/166
galeries <strong>de</strong> dépôt et les supercont<strong>en</strong>eurs ou les monolithes par un coulis <strong>de</strong> cim<strong>en</strong>t(test ESDRED).Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> conceptualisation <strong>de</strong>s composants du système <strong>de</strong> dépôt, <strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong>s coûtsimplique le choix <strong>de</strong> solutions robustes et industriellem<strong>en</strong>t éprouvées ainsi que <strong>de</strong>s tests<strong>de</strong> pré-optimisation (par exemple pour le revêtem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s galeries).figure 38: Vue générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> galerie <strong>de</strong> liaison, construite <strong>en</strong> 2001–2002, qui relie le <strong>la</strong>boratoiresouterrain existant HADES au second puits d’accès.figure 39: Vue du croisem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> galerie <strong>de</strong> liaison et <strong>de</strong> <strong>la</strong> galerie dédiée au test PRACLAYdans le <strong>la</strong>boratoire souterrain HADES.126/166
2.3.2 Argiles Yprési<strong>en</strong>nes comme formation-hôteLes Argiles Yprési<strong>en</strong>nes ne sont que très peu connues <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur <strong>en</strong> Belgique, dans<strong>la</strong> mesure où elles n’ont fait l’objet que d’un seul forage <strong>de</strong> reconnaissance, réalisé àl’initiative <strong>de</strong> l’ONDRAF. Elles prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t, dans le nord-ouest du pays (Doel, Zelzate,Knokke), <strong>de</strong>s caractéristiques géologiques qui sont proches <strong>de</strong> celles <strong>de</strong> l’Argile <strong>de</strong>Boom. Elles ne constitu<strong>en</strong>t donc pas à proprem<strong>en</strong>t parler une alternative à l’Argile <strong>de</strong>Boom <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s que s’il apparaît un vice rédhibitoire pour le dépôt dans l’Argile <strong>de</strong>Boom qui soit lié à <strong>la</strong> formation même, il y a <strong>de</strong> fortes chances que ce vice soit égalem<strong>en</strong>tprés<strong>en</strong>t dans le cas <strong>de</strong>s Argiles Yprési<strong>en</strong>nes. Par contre, il est probable que ledéveloppem<strong>en</strong>t d’un système <strong>de</strong> dépôt dans les Argiles Yprési<strong>en</strong>nes puisse bénéficier<strong>de</strong>s connaissances acquises jusqu’ici pour l’Argile <strong>de</strong> Boom.Les Argiles Yprési<strong>en</strong>nes prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t plusieurs avantages pot<strong>en</strong>tiels <strong>en</strong> tant que formationhôtepar rapport à l’Argile <strong>de</strong> Boom : elles sont prés<strong>en</strong>tes à plus gran<strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur quel’Argile <strong>de</strong> Boom, elles sont très riches <strong>en</strong> minéraux argileux à l’origine du piégeage <strong>de</strong>sradionucléi<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> scellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation, elles sont <strong>en</strong>touréesd’aquifères peu productifs et salés et elles sont surmontées par d’autres formationsargileuses qui constitu<strong>en</strong>t un <strong>en</strong>semble multibarrière naturel. Certains avantages <strong>de</strong>sArgiles Yprési<strong>en</strong>nes constitu<strong>en</strong>t toutefois <strong>de</strong>s difficultés pot<strong>en</strong>tielles, qui ne sembl<strong>en</strong>t pasinsurmontables mais doiv<strong>en</strong>t être analysées plus <strong>en</strong> détail : ainsi, <strong>la</strong> constructiond’instal<strong>la</strong>tions souterraines dans une argile très gonf<strong>la</strong>nte et à <strong>de</strong>s profon<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> l’ordre<strong>de</strong> 300 à 400 mètres pose question et <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce d’eau salée impose <strong>de</strong>s conditionsgéochimiques différ<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> celles dans l’Argile <strong>de</strong> Boom, ce qui pourrait avoir un impactsur <strong>la</strong> corrosion <strong>de</strong>s barrières ouvragées métalliques et <strong>la</strong> migration <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s.Enfin, les Argiles Yprési<strong>en</strong>nes et leur <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t géologique montr<strong>en</strong>t <strong>de</strong>scaractéristiques propres qui mérit<strong>en</strong>t une att<strong>en</strong>tion sout<strong>en</strong>ue comme <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>failles au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation ou le risque <strong>de</strong> court-circuit hydrogéologique.3. Principales activités <strong>de</strong> RD&D prévues d’ici 2020Les principales activités <strong>de</strong> RD&D <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t prévues d’ici 2020 concern<strong>en</strong>t <strong>la</strong> solution<strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce, soit le dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> Boom. Les activités re<strong>la</strong>tives aux ArgilesYprési<strong>en</strong>nes se limit<strong>en</strong>t pour l’ess<strong>en</strong>tiel à <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> « transférabilité ». D’une manièregénérale, le programme <strong>de</strong> RD&D est <strong>de</strong>stiné à r<strong>en</strong>forcer <strong>la</strong> confiance dans <strong>la</strong> solutiondont l’ONDRAF suppose qu’elle sera confirmée par les autorités compét<strong>en</strong>tes, à savoir <strong>la</strong>mise <strong>en</strong> dépôt géologique dans une argile peu indurée, et à établir <strong>de</strong>s argum<strong>en</strong>tairessupportant les différ<strong>en</strong>tes décisions <strong>de</strong>vant autoriser le passage à <strong>de</strong>s phases ultérieuresdu programme. Les niveaux <strong>de</strong> détail <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tives à l’Argile <strong>de</strong> Boom et auxArgiles Yprési<strong>en</strong>nes sont et resteront différ<strong>en</strong>ts. Le cas échéant, le programme <strong>de</strong> RD&Dsera é<strong>la</strong>rgi à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> formations schisteuses.Etant donné que le développem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre d’une solution <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>s’inscriv<strong>en</strong>t dans une perspective <strong>de</strong> très long terme, le programme <strong>de</strong> RD&D futur sedoit d’être flexible et d’évoluer <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> l’évolution du contexte sociétal, sci<strong>en</strong>tifique,technique et économique.3.1 Système <strong>de</strong> dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> Boom3.1.1 Approfondissem<strong>en</strong>t et confirmation <strong>de</strong> <strong>la</strong> phénoménologieL’approfondissem<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> confirmation <strong>de</strong>s connaissances re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> phénoménologie<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, <strong>de</strong>s composants ouvragés, <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation-hôte et <strong>de</strong> son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, ycompris l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s méthodologies, modèles, co<strong>de</strong>s et données, porteraess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur les grands thèmes suivants : Argile <strong>de</strong> Boom : intégration et consolidation <strong>de</strong>s connaissances re<strong>la</strong>tives à l’Argile <strong>de</strong>Boom, à <strong>la</strong> migration <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s <strong>en</strong> son sein et aux risques <strong>de</strong> dégradation <strong>de</strong>ses performances; une compréh<strong>en</strong>sion fine <strong>de</strong>s phénomènes est <strong>en</strong>visagée pour2020;127/166
problématique <strong>de</strong>s gaz : étu<strong>de</strong> systémique <strong>de</strong> <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> gazau sein d’un dépôt <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie B (cinétique <strong>de</strong> production, migration autravers <strong>de</strong> l’argile et conséqu<strong>en</strong>ces sur le transport <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s, t<strong>en</strong>ue <strong>de</strong>sbarrières ouvragées aux surpressions induites, contamination, …); <strong>déchets</strong> vitrifiés et combustibles usés : évaluation du comportem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> <strong>la</strong> durabilité <strong>de</strong>s matrices <strong>de</strong> verre et d’UO2 <strong>en</strong>milieu cim<strong>en</strong>taire <strong>en</strong> raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> modification réc<strong>en</strong>te du <strong>de</strong>sign <strong>de</strong>s barrièresouvragées pour les <strong>déchets</strong> C (supercont<strong>en</strong>eur) ; une première évaluation <strong>de</strong>vrait êtredisponible d’ici au SFC 1; amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition du terme source <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> combustibles usés <strong>en</strong>t<strong>en</strong>ant compte <strong>de</strong> l’évolution intrinsèque durant l’<strong>en</strong>treposage nécessaire aurefroidissem<strong>en</strong>t (fluage, fragilisation, …); prise <strong>en</strong> compte <strong>de</strong> cette évolution dans lecadre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> post-conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces <strong>déchets</strong>;analyse <strong>de</strong> l’augm<strong>en</strong>tation <strong>actuelle</strong> <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> burn-up et <strong>de</strong> ses conséqu<strong>en</strong>ces; compatibilité <strong>de</strong>s matrices bitumes avec le milieu <strong>de</strong> dépôt : poursuite <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s surle gonflem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s matrices <strong>en</strong> milieu confiné et <strong>de</strong> l’impact <strong>de</strong> ce gonflem<strong>en</strong>t sur lesmonolithes et l’argile; une indication c<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> compatibilité (ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> noncompatibilité) <strong>de</strong>s bitumes Eurochemic avec leur <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>vrait être disponiblepour le SFC 1; corrosion du surembal<strong>la</strong>ge métallique : vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> résistance à <strong>la</strong> corrosion dusurembal<strong>la</strong>ge métallique <strong>en</strong> conditions représ<strong>en</strong>tatives du supercont<strong>en</strong>eur et <strong>de</strong> son<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (milieu cim<strong>en</strong>taire alcalin, sous irradiation, <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce d’espècesagressives, …); <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase thermique dans le cas <strong>de</strong>s combustibles usés(quelques milliers d’années) r<strong>en</strong>d l’extrapo<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s données obt<strong>en</strong>ues sur le courtterme plus délicate et nécessitera une compréh<strong>en</strong>sion plus fine <strong>de</strong>s mécanismes <strong>en</strong>jeu; barrières ouvragées et zone perturbée <strong>de</strong> l’argile : détermination <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>sconditions géochimiques (et du rôle <strong>de</strong>s micro-organismes dans cette évolution);évaluation qualitative/semi-quantitative, <strong>en</strong> synergie avec le programme catégorie A,<strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> dégradation <strong>de</strong>s barrières ouvragées (béton dégradé,produits <strong>de</strong> corrosion métalliques) à retar<strong>de</strong>r les radionucléi<strong>de</strong>s.3.1.2 Faisabilité d’un dépôt et <strong>de</strong> ses composants ouvragésLa conception <strong>de</strong> tous les composants ouvragés <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt serapoursuivie, puis leur viabilité et faisabilité seront démontrées progressivem<strong>en</strong>t,directem<strong>en</strong>t ou indirectem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> ce compris le post-conditionnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> surface ainsique l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion nécessaires à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>. Les niveaux <strong>de</strong> démonstration seront établis <strong>de</strong> manière ad hoc (<strong>de</strong>puis unecomparaison avec <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions ou techniques existantes jusqu’à <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>prototypes), <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant compte <strong>de</strong>s souhaits <strong>de</strong>s pr<strong>en</strong>eurs d’<strong>en</strong>jeux.D’ici au SFC 1, <strong>la</strong> RD&D se focalisera ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> viabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> conception dusupercont<strong>en</strong>eur : mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce et comportem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s composants ess<strong>en</strong>tiels souschargem<strong>en</strong>t thermique, étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> t<strong>en</strong>ue à <strong>la</strong> chute, prototype(s) à échellereprés<strong>en</strong>tative. Les spécificités liées à <strong>la</strong> longueur (6 mètres) et à <strong>la</strong> masse (60 tonnes)<strong>de</strong>s supercont<strong>en</strong>eurs dédiés aux combustibles usés seront égalem<strong>en</strong>t examinées.Les autres étu<strong>de</strong>s et tests prévus sont notamm<strong>en</strong>t les suivants : conception préliminaire, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces existantes, du bâtim<strong>en</strong>t <strong>de</strong> postconditionnem<strong>en</strong>t; développem<strong>en</strong>t du monolithe <strong>en</strong> synergie avec le projet « catégorie A »; manut<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s supercont<strong>en</strong>eurs et <strong>de</strong>s monolithes <strong>en</strong> puits (et étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sconséqu<strong>en</strong>ces sur le dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s puits); affinem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> scellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s puits et galeries via l’évaluation <strong>de</strong>spossibilités pratiques <strong>de</strong> scellem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone perturbée <strong>de</strong> l’argile au moy<strong>en</strong> d’un128/166
ouchon <strong>en</strong> matériau gonf<strong>la</strong>nt (test <strong>de</strong> scellem<strong>en</strong>t PRACLAY); modalités pratiques imposées par <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions; stratégie et possibilités pratiques <strong>de</strong> monitoring du dépôt <strong>en</strong> phase opérationnelle, lors<strong>de</strong> sa fermeture progressive et, év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t, après fermeture.3.1.3 Evaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté du système <strong>de</strong> dépôtL’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté opérationnelle, <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté radiologique à long terme et <strong>de</strong>simpacts sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t du système <strong>de</strong> dépôt implique tant <strong>de</strong>s analyses complètes(par exemple <strong>de</strong>s calculs <strong>de</strong> doses) que <strong>de</strong>s calculs d’ori<strong>en</strong>tation qui permett<strong>en</strong>tnotamm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> fixer les exig<strong>en</strong>ces fonctionnelles à imposer aux différ<strong>en</strong>ts composants dusystème <strong>de</strong> dépôt.D’ici 2013, les efforts viseront ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t à mettre au point les méthodologiesnécessaires aux évaluations <strong>de</strong> sûreté (scénarios, <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s, indicateurs<strong>de</strong> sûreté, safety statem<strong>en</strong>ts, etc...).Le SFC 1 se limitera à une première application <strong>de</strong>s méthodologies développées.L’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s évaluations nécessaires <strong>de</strong>vra avoir été effectué pour le SFC 2, afin qu’ilsoit possible <strong>de</strong> passer <strong>en</strong>suite <strong>en</strong> phase <strong>de</strong> projet.La concertation <strong>en</strong> cours avec l’autorité <strong>de</strong> sûreté se focalise sur l’acceptabilité <strong>de</strong>principe <strong>de</strong>s approches et méthodologies suivies dans le cadre <strong>de</strong>s évaluations <strong>de</strong>sûreté.3.1.4 Préparation et réalisation <strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces PRACLAYLes expéri<strong>en</strong>ces PRACLAY in situ vis<strong>en</strong>t principalem<strong>en</strong>t à confirmer <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong>l’Argile <strong>de</strong> Boom et <strong>de</strong>s revêtem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>s galeries à supporter <strong>la</strong> charge thermiqueimposée par les <strong>déchets</strong> chauffants, cette charge étant un <strong>de</strong>s transitoires les plusimportants qu’auront à subir l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt et <strong>la</strong> formation-hôte. A ce titre,PRACLAY <strong>de</strong>vrait conforter les résultats obt<strong>en</strong>us par les travaux <strong>de</strong> RD&D <strong>en</strong> permettantd’étayer une légitime confiance dans les modèles, leurs hypothèses <strong>de</strong> base et leursprédictions. Les résultats finaux serviront donc à resserrer les p<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t<strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ts composants du système <strong>de</strong> dépôt et apporteront <strong>de</strong> précieuses informationsdans le cadre <strong>de</strong>s exercices ultérieurs d’affinem<strong>en</strong>t et d’optimisation. Les principauxobjectifs <strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces PRACLAY sont les suivants. Le test <strong>de</strong> chauffe PRACLAY vise à confirmer <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> l’Argile <strong>de</strong> Boom àmaint<strong>en</strong>ir ses propriétés thermo-hydro-mécaniques (et, dans une moindre mesure,chimiques), favorables pour <strong>la</strong> sûreté à long terme du dépôt, malgré l’impact thermique<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> chauffants et ce, pour <strong>de</strong>s échelles spatiales et temporellesreprés<strong>en</strong>tatives <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> dépôt. Ce test in situ, d’échelle décamétrique etd’une durée <strong>de</strong> dix ans, a été conçu pour être indép<strong>en</strong>dant du <strong>de</strong>sign <strong>de</strong>s barrièresouvragées ainsi que du type <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>. Il est <strong>en</strong> cours <strong>de</strong> préparation et d’instal<strong>la</strong>tionau sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> galerie dédiée qui vi<strong>en</strong>t d’être excavée dans le <strong>la</strong>boratoire souterrain.L’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s résultats sera donc disponible pour le SFC 2 (2020). Cep<strong>en</strong>dant, lesrésultats les plus importants, car re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> phase initiale <strong>de</strong> chauffe, durant <strong>la</strong>quellele gradi<strong>en</strong>t thermique est le plus important, seront déjà disponibles pour le SFC 1(2013). Afin <strong>de</strong> garantir <strong>de</strong>s conditions pénalisantes, le test <strong>de</strong> chauffe nécessite <strong>la</strong> mise <strong>en</strong>œuvre d’un scellem<strong>en</strong>t hydraulique, dont le p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t et les performances serontriches d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts pour <strong>la</strong> faisabilité d’ouvrages <strong>de</strong> scellem<strong>en</strong>t dans un système<strong>de</strong> dépôt (test <strong>de</strong> scellem<strong>en</strong>t PRACLAY). Le test <strong>de</strong> chauffe vise aussi à acquérir <strong>de</strong>s informations re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> nécessitéd’inclure <strong>de</strong>s matériaux compressibles dans le revêtem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s galeries <strong>de</strong> dépôt afin<strong>de</strong> repr<strong>en</strong>dre les charges mécaniques prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> <strong>la</strong> converg<strong>en</strong>ce du massif et <strong>de</strong> <strong>la</strong>di<strong>la</strong>tation thermique <strong>de</strong>s voussoirs. Le test <strong>de</strong> chauffe vise <strong>en</strong>fin à tirer une série d’informations utiles quant aux129/166
possibilités réelles <strong>de</strong> monitoring d’un dépôt (réponse et t<strong>en</strong>ue <strong>de</strong>s s<strong>en</strong>seurs in situsous <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> pression et <strong>de</strong> température représ<strong>en</strong>tatives).3.2 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Argiles Yprési<strong>en</strong>nesLe programme <strong>de</strong> RD&D actuel <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> dépôt dans les Argiles Yprési<strong>en</strong>nes porteprincipalem<strong>en</strong>t, du moins jusqu’à <strong>la</strong> remise du SFC 1 <strong>en</strong> 2013, sur l’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong>« transférabilité » <strong>de</strong>s acquis re<strong>la</strong>tifs à l’Argile <strong>de</strong> Boom à l’aplomb <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone nucléaire<strong>de</strong> Mol–Dessel vers les Argiles Yprési<strong>en</strong>nes à l’aplomb <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone nucléaire <strong>de</strong> Doel, oùl’ONDRAF a déjà réalisé un forage exploratoire et est <strong>en</strong> passe d’<strong>en</strong> réaliser un second.Cette analyse portera <strong>en</strong> particulier sur <strong>la</strong> possibilité d’utiliser les acquis <strong>en</strong> matière <strong>de</strong>creusem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> stratégie <strong>de</strong> sûreté et d’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté à long terme, ainsi que <strong>de</strong><strong>de</strong>sign <strong>de</strong>s barrières ouvragées. Elle sera complétée par une évaluation préliminaire <strong>de</strong>sûreté (principalem<strong>en</strong>t qualitative).Si l’option <strong>de</strong>s Argiles Yprési<strong>en</strong>nes n’est pas écartée par <strong>la</strong> décision qui sera prise sur <strong>la</strong>base du SFC 1, <strong>de</strong>s forages <strong>de</strong> reconnaissance détaillée (à Doel ou ailleurs), focalisés <strong>en</strong>particulier sur les aspects <strong>de</strong> creusem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>vront être réalisés. L’établissem<strong>en</strong>t d’un<strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> recherche souterrain méthodologique ex nihilo ne sera par contre sansdoute pas nécessaire étant donné les possibilités <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong>s acquis.La confirmation <strong>de</strong>s caractéristiques géologiques d’un site pot<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> dépôtnécessitera, elle, une instal<strong>la</strong>tion spécifique. Une telle instal<strong>la</strong>tion pourrait, comme c’est<strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t le cas <strong>en</strong> Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong>, combiner <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> confirmation et <strong>de</strong>démonstration tout <strong>en</strong> étant dim<strong>en</strong>sionnée <strong>de</strong> manière à constituer l’amorce <strong>de</strong> <strong>la</strong> futureinstal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt. Ceci impliquerait le choix d’un site pot<strong>en</strong>tiel <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvre tôtdans le développem<strong>en</strong>t du programme.3.3 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> formations schisteusesLes schistes, qui sont <strong>de</strong>s argiles ayant subi d’importantes modifications minéralogiqueset structurales suite à <strong>de</strong>s augm<strong>en</strong>tations <strong>de</strong> température et <strong>de</strong> pression, sont très peuconnus <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur. Ils sont prés<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> <strong>de</strong> nombreux <strong>en</strong>droits dans le sud et le nor<strong>de</strong>st<strong>de</strong> <strong>la</strong> Belgique, et ce sur <strong>de</strong> très fortes épaisseurs. Leurs caractéristiques géologiquessont très différ<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> celles <strong>de</strong> l’Argile <strong>de</strong> Boom. Ce sont <strong>de</strong>s milieux indurés etfracturés, dans lesquels les eaux circul<strong>en</strong>t via les fractures, et qui ont notamm<strong>en</strong>t unecapacité limitée <strong>de</strong> piégeage <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s. Ils ont par contre une très hautecapacité à résister à <strong>la</strong> charge thermique induite par les <strong>déchets</strong>.La prise <strong>en</strong> compte <strong>de</strong> l’option « schiste » dans le programme B&C impliquerait <strong>la</strong> misesur pied d’un programme <strong>de</strong> RD&D <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t nouveau, démarrant « <strong>de</strong> zéro » auniveau belge et incluant notamm<strong>en</strong>t : La conduite d’un programme <strong>de</strong> reconnaissance géologique <strong>la</strong>rge étant donné, d’unepart, <strong>la</strong> diversité <strong>de</strong>s formations <strong>en</strong>visageables et leur variabilité et, d’autre part,l’abs<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> Belgique <strong>de</strong> zone nucléaire surplombant <strong>de</strong>s schistes dotés <strong>de</strong>caractéristiques favorables et sur <strong>la</strong>quelle il serait dès lors assez naturel <strong>de</strong> focaliserles reconnaissances; La construction d’un <strong>la</strong>boratoire souterrain <strong>de</strong> reconnaissance dédié avec <strong>la</strong> mise aupoint <strong>de</strong> protocoles expérim<strong>en</strong>taux spécifiques (<strong>de</strong>s synergies sont sans doutepossibles avec les acquis <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires souterrains installés dans <strong>de</strong>s formationscristallines); dans ce cadre, les informations existantes re<strong>la</strong>tives au creusem<strong>en</strong>td’ouvrages souterrains (mines et tunnels) dans les schistes <strong>de</strong>vront être analysées; La révision complète <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> sûreté et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conception <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>dépôt dans <strong>la</strong> mesure où, contrairem<strong>en</strong>t aux argiles peu indurées, les formationsschisteuses n’aurai<strong>en</strong>t pas le rôle <strong>de</strong> barrière principale, lequel <strong>de</strong>vrait donc êtreassuré par les barrières ouvragées; La conduite d’un programme <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> barrières ouvragées assurant leconfinem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s sur <strong>de</strong> très longues durées.130/166
4. Décisions <strong>en</strong>core à poserIl n’existe pas, <strong>en</strong> Belgique, <strong>de</strong> politique institutionnelle re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>de</strong> haute activité (<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie C) et <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> longue durée <strong>de</strong> vie(<strong>déchets</strong> <strong>de</strong> catégorie B) sur le long terme et, a fortiori, aucune solution <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> n’est<strong>en</strong>core opérationnelle. La filière <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong>s catégories B et Cn’est, <strong>en</strong> d’autres termes, pas <strong>en</strong>core fermée. En effet, bi<strong>en</strong> que les étu<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong>mise <strong>en</strong> dépôt géologique au sein d’une formation argileuse ai<strong>en</strong>t été initiées il y a plus<strong>de</strong> 30 ans, cette solution n’a pas <strong>en</strong>core été confirmée au niveau institutionnel <strong>en</strong> tantque politique nationale <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme pour les <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C.Malgré ses acquis techniques et sci<strong>en</strong>tifiques, le programme B&C prés<strong>en</strong>te plusieursfaiblesses : La solution <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B etC, c’est-à-dire le dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> Boom, repose sur une série d’hypothèses <strong>de</strong>travail (cf. début du chapitre) dépourvues <strong>de</strong> légitimité formelle. Malgré unereconnaissance internationale <strong>de</strong> leur pertin<strong>en</strong>ce et <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> leurs fon<strong>de</strong>m<strong>en</strong>tssci<strong>en</strong>tifiques et techniques, ces hypothèses n’ont <strong>en</strong> effet jamais été soumises au test<strong>de</strong> l’acceptabilité sociétale et n’ont jamais été formellem<strong>en</strong>t confirmées au niveaufédéral <strong>en</strong> tant que choix <strong>de</strong> principe pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> B et C. Les év<strong>en</strong>tuelles alternatives géologiques au dépôt dans l’Argile <strong>de</strong> Boom n’ont pas étéétudiées avec le même <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> détail parce qu'elles se heurtai<strong>en</strong>t rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t à <strong>de</strong>scaractéristiques physiques (taux <strong>de</strong> fracturation élevé) ou chimiques (salinité) quijetai<strong>en</strong>t le doute sur leur acceptabilité <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> sûreté à long terme. Unrelevé et une <strong>de</strong>scription sommaire <strong>de</strong> ces alternatives seront cep<strong>en</strong>dant souhaitablesdans le cadre d’un processus <strong>de</strong> légitimation sociétale et politique. Il n’existe pas <strong>de</strong> cadre décisionnel partagé pour le programme B&C, dans <strong>la</strong> mesureoù il n’y a pas eu <strong>de</strong> réflexion réunissant l'ONDRAF et les autres pr<strong>en</strong>eurs d’<strong>en</strong>jeu(société civile, autorité <strong>de</strong> tutelle, producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>, autorité <strong>de</strong> sûreté, …) afin<strong>de</strong> développer un processus décisionnel, c’est-à-dire un processus précisant quidéci<strong>de</strong>ra quoi, quand et sur quelles bases, qui soit susceptible <strong>de</strong> contribuer à faireconverger le programme vers <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre d’une solution <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme.Sans un tel processus qui fixe <strong>de</strong>s « points <strong>de</strong> r<strong>en</strong>contre » avec les autorités et lesacteurs sociétaux, l'ONDRAF ne peut optimiser ni <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> son programme <strong>de</strong>RD&D ni l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> participation sociétale.Par ailleurs, tant que <strong>la</strong> <strong>de</strong>stination finale <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C n’est pasconnue, l'ONDRAF n’est pas <strong>en</strong> mesure <strong>de</strong> fixer précisém<strong>en</strong>t certains élém<strong>en</strong>ts quiintervi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong> amont dans <strong>la</strong> filière <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, comme les critèresd’acceptation pour le dépôt <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, les filières <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>tou <strong>en</strong>core les provisions financières à constituer.Le P<strong>la</strong>n <strong>déchets</strong>, accompagné d’un dialogue sociétal avec les différ<strong>en</strong>ts pr<strong>en</strong>eursd’<strong>en</strong>jeux ainsi que du rapport sur les inci<strong>de</strong>nces <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns etprogrammes, <strong>de</strong>vrait permettre <strong>de</strong> légitimer une politique <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> B et C et <strong>de</strong> confirmer les hypothèses <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’ONDRAF. Le rapportd’évaluation <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s solutions proposées dans le P<strong>la</strong>n<strong>déchets</strong>, tel que prévu par <strong>la</strong> loi du 13 février 2006, inclura notamm<strong>en</strong>t une analyse <strong>de</strong>s« solutions <strong>de</strong> substitution raisonnables » à <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à longterme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C. Ainsi le P<strong>la</strong>n <strong>déchets</strong> comportera les données<strong>de</strong>vant permettre au gouvernem<strong>en</strong>t :• <strong>de</strong> faire un choix re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> solution à é<strong>la</strong>borer pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> à long terme<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>de</strong>s catégories B et C,• <strong>de</strong> définir un processus décisionnel, y compris les repères et un cal<strong>en</strong>drier, àmettre <strong>en</strong> œuvre pour réaliser l’option <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> choisie,• <strong>de</strong> définir <strong>la</strong> manière dont le support nécessaire pour mettre <strong>en</strong> œuvre <strong>la</strong>décision doit être réalisé.131/166
Annexe A : l'arrêté royal du 30 mars 198130 MARS 1981. - Arrêté royal déterminant les missions et fixant lesmodalités <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'organisme public <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s matières fissiles.TITRE Ier. Missions <strong>de</strong> l'Organisme.Article 1. Définitions.Pour l'application du prés<strong>en</strong>t arrêté, il faut <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dre par :- Déchets <strong>radioactifs</strong> : toute matière pour <strong>la</strong>quelle aucune utilisation n'est prévue et quiconti<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s <strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tration supérieure aux valeurs que les autoritéscompét<strong>en</strong>tes considèr<strong>en</strong>t comme admissibles dans <strong>de</strong>s matériaux propres à uneutilisation ou au rejet sans contrôle;- Déchets <strong>radioactifs</strong> d'origine étrangère : <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ayant obt<strong>en</strong>u leurscaractéristiques <strong>de</strong> radioactivité <strong>en</strong>-<strong>de</strong>hors <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belgique, sauf si cette radioactivitéprovi<strong>en</strong>t d'équipem<strong>en</strong>ts et/ou <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> d'origine belge traités à l'étranger;- Matières fissiles <strong>en</strong>richies : toutes matières cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s isotopes fissiles d'uranium<strong>en</strong> t<strong>en</strong>eur supérieure à celle <strong>de</strong> l'uranium naturel, et se trouvant sous une forme autreque celle <strong>de</strong> combustible neuf ou irradié;- Matières plutonifères : toutes matières cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s isotopes fissiles <strong>de</strong> plutonium, etse trouvant sous une forme autre que celle <strong>de</strong> combustible neuf ou irradié;- Combustible neuf : matières fissiles ou plutonifères cont<strong>en</strong>ues dans une structurepermettant leur utilisation dans un réacteur, avant leur chargem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> réacteur;- Combustible irradié : matières fissiles ou plutonifères cont<strong>en</strong>ues dans une structurepermettant leur utilisation dans un réacteur, après leur déchargem<strong>en</strong>t définitif du réacteur;- Quantités excé<strong>de</strong>ntaires : quantités <strong>de</strong> matières fissiles <strong>en</strong>richies , <strong>de</strong> matièresplutonifères ou <strong>de</strong> combustible neuf ou irradié pour lesquelles aucune utilisation outransformation ultérieure n'est prévue par le producteur ou l'exploitant;- Transport : transport <strong>en</strong>-<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong>s producteurs et exploitants;- Prise <strong>en</strong> charge : <strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s opérations techniques et administratives nécessairespour assurer l'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> ou <strong>de</strong>s quantités excé<strong>de</strong>ntaires du site<strong>de</strong>s producteurs et leur transfert dans les instal<strong>la</strong>tions gérées par l'Organisme;- Réception : opération réalisée lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> ou <strong>de</strong>s quantitésexcé<strong>de</strong>ntaires et <strong>de</strong>stinée à vérifier <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong> ceux-ci avec les spécifications <strong>en</strong>vigueur, <strong>en</strong> vue du transfert <strong>de</strong> responsabilité;- Instal<strong>la</strong>tions nucléaires : tous sites, équipem<strong>en</strong>ts, usines ou c<strong>en</strong>trales mettant <strong>en</strong>oeuvre <strong>de</strong>s matières radioactives;- Entreposage <strong>de</strong> matières plutonifères et <strong>de</strong> combustible neuf : stockage temporaire <strong>de</strong>ces matières dans l'att<strong>en</strong>te d'une utilisation ultérieure év<strong>en</strong>tuelle ou <strong>de</strong> leur c<strong>la</strong>ssificationcomme <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>;- Entreposage <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> : stockage temporaire <strong>de</strong> tels <strong>déchets</strong> dansl'int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>, et <strong>de</strong> manière à pouvoir les repr<strong>en</strong>dre ultérieurem<strong>en</strong>t;- Entreposage <strong>de</strong> combustible irradié : stockage temporaire <strong>de</strong> ces matières dansl'att<strong>en</strong>te du retraitem<strong>en</strong>t ou <strong>de</strong> leur c<strong>la</strong>ssification comme <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>;- Evacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> : rejet ou dépôt <strong>de</strong> tels <strong>déchets</strong> sans int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>récupération. Ceci compr<strong>en</strong>d notamm<strong>en</strong>t le dépôt év<strong>en</strong>tuel <strong>en</strong> surface ou <strong>en</strong> couchesgéologiques ainsi que l'immersion dans les limites autorisées par les conv<strong>en</strong>tionsinternationales;132/166
- Traitem<strong>en</strong>t et conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> : suite d'opérationsmécaniques, chimiques, physiques et autres <strong>de</strong>stinées à assurer <strong>la</strong> conversion <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> colis répondant aux exig<strong>en</strong>ces opérationnelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> manut<strong>en</strong>tion,du transport, <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>treposage ou <strong>de</strong> l'évacuation;- Déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t : <strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s opérations administratives et techniques qui permett<strong>en</strong>t<strong>de</strong> retirer une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées, aux termes <strong>de</strong>sdispositions <strong>de</strong> l'arrêté royal du 28 février 1963, portant règlem<strong>en</strong>t général <strong>de</strong> <strong>la</strong>protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s travailleurs contre le danger <strong>de</strong>s radiations ionisantes;- L'Organisme : l'Organisme national <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s matières fissiles<strong>en</strong>richies (ONDRAF);Autorisations compét<strong>en</strong>tes : les autorités compét<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> matière d'autorisation et <strong>de</strong>contrôle nucléaire, désignées <strong>en</strong> vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 4 août 1955 concernant <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong>l'Etat dans le domaine <strong>de</strong> l'énergie nucléaire et ses arrêtés d'exécution, et <strong>en</strong> vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong>loi du 29 mars 1958 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion contre les dangers résultant<strong>de</strong>s radiations ionisantes et ses arrêtés d'exécution;- Autorité <strong>de</strong> tutelle <strong>de</strong> l'Organisme : les Ministres ayant les Affaires économiques etl'Energie dans leurs attributions;- Producteurs ou exploitants : sociétés, organismes, institutions ou personnes physiquesau bénéfice <strong>de</strong>squels l'Organisme exerce ses compét<strong>en</strong>ces.(- faillite : état dans lequel se trouve un commerçant qui a cessé ses paiem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé et qui a été déc<strong>la</strong>ré dans un telétat par le tribunal <strong>de</strong> commerce conformém<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> loi du 8 août 1997 sur les faillites;- insolvabilité : état <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne physique ou morale qui ne peut payer ses <strong>de</strong>ttes, parinsuffisance d'actifs.) Art. 2. Compét<strong>en</strong>ces et missions <strong>de</strong> l'Organisme.§ 1. L'Organisme excerce sa mission dans le respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> réglem<strong>en</strong>tation <strong>en</strong> vigueur etest notamm<strong>en</strong>t soumis au contrôle et à <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s autorités compét<strong>en</strong>tes.) § 2. Les tâches <strong>de</strong> l'Organisme, sur tout le territoire belge, concernant , <strong>en</strong>tre autre, lesdomaines suivants :1. La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> tous les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> prés<strong>en</strong>ts sur le territoire belge quelles qu'<strong>en</strong>soi<strong>en</strong>t l'origine et <strong>la</strong> prov<strong>en</strong>ance. La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> d'origine est soumise à l'accordpréa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> l'Autorité <strong>de</strong> tutelle <strong>de</strong> l'Organisme. La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>compr<strong>en</strong>d :a) Le transport <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés ou non conditionnés ;b) Le traitem<strong>en</strong>t et le conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> pour le compte <strong>de</strong>sproducteurs qui ne dispos<strong>en</strong>t pas d'équipem<strong>en</strong>ts agréés à cette fin par l'Organisme, ainsique <strong>la</strong> qualification et le suivi <strong>de</strong>s opérations nécessaires au conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> chez les producteurs qui dispos<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces équipem<strong>en</strong>ts; lesconditions <strong>de</strong> qualification <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts imposées par l'Organisme <strong>en</strong> application duprés<strong>en</strong>t arrêté, ainsi que les modalités <strong>de</strong> recours seront déterminées par le Roi;c) L'<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> hors <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions du producteur;d) L'évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés.2. Les aspects suivants <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s matières fissiles <strong>en</strong>richies, <strong>de</strong>s matièresplutionifères et du combustible neuf ou irradié :a) Le transport <strong>de</strong>s matières fissiles <strong>en</strong>richies et <strong>de</strong>s matières plutonifères, quel'Organisme est appelé à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge, dépassant an quantitiés et <strong>en</strong> tauxd'<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t les limites suivantes :- uranium 235 <strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong> 20% ou plus dans l'uranium <strong>en</strong>richi : 5 kg ou plus;133/166
- uranium 233 : 2 kg ou plus;- plutonium : 2 kg ou plus.b) Le transport <strong>de</strong>s quantités excé<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> combustible neuf ou irradié quel'Organisme est appelé à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge;c) L'<strong>en</strong>treposage <strong>en</strong>-<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s producteurs ou exploitants, <strong>de</strong>squantités excé<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> matières plutonifères et <strong>de</strong>s quantités excé<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong>combustible neuf ou irradié.3. Les aspects suivants du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires désaffectées- <strong>la</strong> collecte et l'évaluation <strong>de</strong> toutes les informations permettant à l'Organisme d'établir<strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> re<strong>la</strong>tifs aux <strong>déchets</strong> qui <strong>en</strong> résulteront;- l'accord sur le programme <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions contaminées;- l'exécution du programme <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'exploitant ou <strong>en</strong> cas <strong>de</strong>défail<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> celui-ci.) § 3. Les missions <strong>de</strong> l'Organisme, dans les domaines visés au § 1er, sont :1. dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> :a) exécuter les opérations décou<strong>la</strong>nt du § 2, 1., du prés<strong>en</strong>t article;b) établir et t<strong>en</strong>ir à jour l'inv<strong>en</strong>taire quantitatif et qualitatif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés ounon, ainsi qu'établir et t<strong>en</strong>ir à jour les prévisions <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> à court, moy<strong>en</strong>et long termes;c) établir et t<strong>en</strong>ir à jour un programme général <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> à long terme qui compr<strong>en</strong>dune <strong>de</strong>scription technico-économique <strong>de</strong>s actions <strong>en</strong>visagées par l'Organisme pourassurer <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>;d) établir, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s règles générales proposées aux autorités compét<strong>en</strong>tes etapprouvées par elles, les critères d'acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés et nonconditionnés à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge dans le cadre <strong>de</strong> sa mission;e) établir , sur base <strong>de</strong>s règles générales proposées aux autorités compét<strong>en</strong>tes etapprouvées par elles, les spécifications détaillées et pratiques <strong>en</strong> matière d'exemption <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>;f) définir - <strong>en</strong> concertaition avec les producteurs - les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong>conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> non-conditionnés;g) qualifier, aux conditions déterminées par les ministres ayant les Affaires économiqueset l'Energie dans leurs attributions, les équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>stinés au traitem<strong>en</strong>t et auconditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>;h) s'assurer <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés ou non,aux critères d'acceptation visés au littera d) ci-<strong>de</strong>ssus et assurer leur réception définitive.2. Dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s quantités excé<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> matières fissiles<strong>en</strong>richies, <strong>de</strong> matière plutonifères et <strong>de</strong> combustible neuf ou irradié :a) exécuter les opérations décou<strong>la</strong>nt du § 2, 2. du prés<strong>en</strong>t article;b) collecter périodiquem<strong>en</strong>t auprès <strong>de</strong>s producteurs ou exploitants les informationsnécessaires à l'Organisme pour lui permettre d'évaluer le mom<strong>en</strong>t où, et les modalitéssuivants lesquelles il pourrait être am<strong>en</strong>é à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge ces quantités;c) établir, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s règles générales proposées aux autorités compét<strong>en</strong>tes etapprouvées par elles, les critères d'acceptation <strong>de</strong> ces quantités à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge <strong>en</strong>vue <strong>de</strong> leur <strong>en</strong>treposage <strong>en</strong> application du § 2, 2., littera c) du prés<strong>en</strong>t article;d) s'assurer <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> ces quantités aux critèresd'acceptation visés au littera c) ci-<strong>de</strong>ssus et assurer leur réception pour <strong>en</strong>treposage.3. Dans le domaine du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t :a) exécuter les opérations décou<strong>la</strong>nt du § 2, 3.;134/166
) suivre l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologie et <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> démantèlem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong>scoûts associés, <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> l'approbation <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et l'exécutionév<strong>en</strong>tuelle du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t comme prévu au § 2, 3. <strong>de</strong> cet article.4. Dans un contexte général :a) établir et exécuter un programme d'information et <strong>de</strong> communication couvrantl'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> ses activités;b) définir <strong>en</strong> col<strong>la</strong>boration avec les exploitants les programmes <strong>de</strong> recherche appliquéeet <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t nécessaires à l'accomplissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ses missions.) § 4. L'Organisme peut effectuer ses missions par ses propres moy<strong>en</strong>s, les sous-traiter,ou <strong>en</strong> <strong>la</strong>isser l'exécution à <strong>de</strong>s tiers dans le cadre <strong>de</strong> conv<strong>en</strong>tions spécifiant les règles àobserver. Les missions confiées à <strong>de</strong>s tiers par l'Organisme sont exécutées sous saresponsabilité et sous sa surveil<strong>la</strong>nce, sous le contrôle perman<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s autoritéscompét<strong>en</strong>tes.) § 5. En vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> sa mission l'Organisme peut pr<strong>en</strong>dre tous intérêts dans<strong>de</strong>s associations, syndicats et sociétés et faire toutes opérations financières, mobilièreset immobilières, <strong>en</strong>gager toutes <strong>en</strong>treprises et faire toutes opérations se rapportantdirectem<strong>en</strong>t ou indirectem<strong>en</strong>t à cet objet ou <strong>de</strong> nature à <strong>en</strong> favoriser <strong>la</strong> réalisation. Il peutnotamm<strong>en</strong>t acheter, v<strong>en</strong>dre, louer et gérer tous bi<strong>en</strong>s immobiliers et mobiliers etconcevoir, construire, transformer ou aménager toutes instal<strong>la</strong>tions utiles à son activité.§ 6. Les dispositions du prés<strong>en</strong>t article ne port<strong>en</strong>t <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> préjudice à l'application <strong>de</strong>sdispositions légales et réglem<strong>en</strong>taires re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion contre lesdangers résultant <strong>de</strong>s rayonnem<strong>en</strong>ts ionisants.) Art. 3. Re<strong>la</strong>tions avec lesproducteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>.§ 1. Toute personne qui déti<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, qui exploite <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tionsproduisant <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, ou qui a l'int<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> construire pareilles instal<strong>la</strong>tions,est t<strong>en</strong>ue <strong>de</strong> fournir à l'Organisme toute information nécessaire à l'exercice <strong>de</strong> sesmissions.§ 2. L'Organisme établit avec chacun <strong>de</strong>s exploitants d'instal<strong>la</strong>tions nucléairesproduisant régulièrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s quantitiés <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> jugées significatives parl'Organisme, une conv<strong>en</strong>tion re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> oeuvre du programme général <strong>de</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> visé a l'article 2, § 3, 1. c) Cette conv<strong>en</strong>tion définit lesdroits et obligations respectifs <strong>de</strong>s parties re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> oeuvre du programme.En outre, cette conv<strong>en</strong>tion définit les moy<strong>en</strong>s d'action permettant à l'Organisme <strong>de</strong> :- t<strong>en</strong>ir à jour et vérifier les inv<strong>en</strong>taires perman<strong>en</strong>ts re<strong>la</strong>tifs aux <strong>déchets</strong> <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drés parl'exploitation et le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires;- s'assurer que les équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> utilisés ou <strong>en</strong>visagéspar les exploitants et les procédés mis <strong>en</strong> oeuvre sont compatibles avec le programmegénéral <strong>de</strong> l'Organisme;- p<strong>la</strong>nifier ses investissem<strong>en</strong>ts propres;- s'assurer que les dispositions <strong>de</strong> contrôle-qualité et d'assurance-qualité mises <strong>en</strong> p<strong>la</strong>cepar l'exploitant sont appropriées pour produire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> satisfaisants aux critèresd'acceptation <strong>de</strong> l'Organisme;- contrôler l'application par les exploitants <strong>de</strong> ces dispositions;- préciser les responsabilités à court, moy<strong>en</strong> et long terme;- disposer d'un financem<strong>en</strong>t approprié pour réaliser son programme.§ 3. La prise <strong>en</strong> charge par l'Organisme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> leurtransport, <strong>de</strong> leur conditionnem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> leur <strong>en</strong>treposage et/ou <strong>de</strong> leur évacuation fait135/166
l'objet <strong>de</strong> conv<strong>en</strong>tions <strong>en</strong>tre les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> et l'Organisme. Ces conv<strong>en</strong>tionsdéfiniss<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t les modalités du transfert <strong>de</strong> responsabilité et les conditionsfinancières et techniques. Le conseil d'administration arrête chaque année les conditionscommerciales applicables à certaines catégories <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> dont <strong>la</strong> prise <strong>en</strong>charge n'est pas couverte par une conv<strong>en</strong>tion.L'Organisme notifie au producteur <strong>la</strong> décharge <strong>de</strong> responsabilité lorsqu'il a réceptionnéles <strong>déchets</strong>.Les conv<strong>en</strong>tions comport<strong>en</strong>t une c<strong>la</strong>use <strong>en</strong> vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle celui qui a conditionné les<strong>déchets</strong> reste t<strong>en</strong>u, p<strong>en</strong>dant une pério<strong>de</strong> qui ne dépasse pas cinquante ans, d'in<strong>de</strong>mniserl'Organisme <strong>de</strong>s frais additionnels que ce <strong>de</strong>rnier aura à supporter p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>d'<strong>en</strong>treposage ou au cours <strong>de</strong>s opérations d'évacuation <strong>en</strong> raison d'un vice <strong>de</strong> <strong>la</strong> chos<strong>en</strong>on détectable au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leur réception par l'Organisme , à condition que celui-cipuisse prouver ces élém<strong>en</strong>ts.§ 4. Les disponibilités à moy<strong>en</strong> et long terme <strong>de</strong> l'organisme ou gérées par l'organismeet <strong>de</strong>stinées à l'exécution <strong>de</strong>s tâches et missions opérationnelles confiées à l'organismepar le prés<strong>en</strong>t arrêté doiv<strong>en</strong>t être investies <strong>en</strong> titres <strong>de</strong> créances exprimés <strong>en</strong> Euros émisou garantis par un Etat membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté europé<strong>en</strong>ne, par ses collectivitéspubliques territoriales ou par <strong>de</strong>s organismes internationaux à caractère public dont un ouplusieurs Etats membres font partie.Les disponibilités à moy<strong>en</strong> et long terme <strong>de</strong> l'organisme ou gérées par l'organisme, quisont <strong>de</strong>stinées à l'exécution <strong>de</strong>s tâches et missions opérationnelles confiées àl'organisme par le prés<strong>en</strong>t arrêté et qui ont été investies dans <strong>de</strong>s instrum<strong>en</strong>ts financiersautres que ceux autorisés conformém<strong>en</strong>t au prés<strong>en</strong>t arrêté, sont libérées et p<strong>la</strong>céesconformém<strong>en</strong>t au prés<strong>en</strong>t arrêté, dès que ces p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts ont regagné leur valeur initiale,majorée d'un intérêt composé égal à l'inf<strong>la</strong>tion augm<strong>en</strong>tée <strong>de</strong> 2 % par an <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> dated'acquisition.) Art. 4. Re<strong>la</strong>tions avec lesdét<strong>en</strong>teurs <strong>de</strong> matières fissiles <strong>en</strong>richies, <strong>de</strong> matières plutonifères ou <strong>de</strong>combustible neuf ou irradié.§ 1. Toute personne qui déti<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s matières fissiles <strong>en</strong>richies, <strong>de</strong>s matières plutonifèresou du combustible neuf ou irradié tombant sous l'application <strong>de</strong> l'article 2, § 2, 2. estt<strong>en</strong>ue <strong>de</strong> fournir à l'Organisme toute information nécessaire à l'exercice <strong>de</strong> ses missions.§ 2. L'Organisme conclut avec ces dét<strong>en</strong>teurs un accord définissant <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> cetteinformation.§ 3. La prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong> ces matières par l'Organisme <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> leur transport et <strong>de</strong>leur <strong>en</strong>treposage conformém<strong>en</strong>t à l'article 2, § 2, 2. du prés<strong>en</strong>t arrêté fait l'objet d'uneconv<strong>en</strong>tion <strong>en</strong>tre celui qui déti<strong>en</strong>t ces matières et l'Organisme. Cette conv<strong>en</strong>tion définitnotamm<strong>en</strong>t les modalités du transfert <strong>de</strong> responsabilité et les conditions financières ettechniques.Art. 5. Re<strong>la</strong>tions avec lesexploitants d'instal<strong>la</strong>tions à déc<strong>la</strong>sser.§ 1. Toute personne qui exploite ou <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à exploiter <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires doitfournir à l'Organisme , <strong>en</strong> temps utile et au plus tard trois ans avant l'arrêt définitif <strong>de</strong>celles-ci, toute information re<strong>la</strong>tive aux prévisions <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ces instal<strong>la</strong>tions ettoute information re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> nature, aux quantités et aux dates <strong>de</strong> transfert àl'Organisme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> qui <strong>en</strong> résulteront ainsi que les informations requises dans lecadre <strong>de</strong> l'application <strong>de</strong> l'article 16.§ 2. L'Organisme établira dans l'année qui suivra l'<strong>en</strong>trée <strong>en</strong> vigueur du prés<strong>en</strong>t arrêté,un accord définissant , avec chacun <strong>de</strong> ces exploitants , <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> cette information.§ 3. La prise <strong>en</strong> charge par l'Organisme <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> résultant dudéc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t se fera conformém<strong>en</strong>t aux dispositions <strong>de</strong>s articles 2, § 3, et 3, § 3.136/166
§ 4. Au cas où l'exploitant ou <strong>la</strong> personne responsable financièrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions àdéc<strong>la</strong>sser souhaite se décharger <strong>de</strong> l'exécution <strong>de</strong> ces opérations, l'Organisme et cetexploitant établiss<strong>en</strong>t une conv<strong>en</strong>tion définissant les modalités d'exécution technicofinancièresdu déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions concernées.Art. 6. Statut <strong>de</strong> l'Organisme.L'Organisme jouit <strong>de</strong> <strong>la</strong> personnalité civile et disposera <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> conclure <strong>de</strong>sconv<strong>en</strong>tions d'arbitrage.(Il portera <strong>la</strong> dénomination d'Organisme national <strong>de</strong>s Déchets <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s Matièresfissiles <strong>en</strong>richies, <strong>en</strong> abrégé : ONDRAF. Son siège social est situé dans l'arrondissem<strong>en</strong>tadministratif <strong>de</strong> Bruxelles-Capitale.) L'Organisme est p<strong>la</strong>cé sous <strong>la</strong> tutelle du Ministère <strong>de</strong>s Affaires économique.Les compét<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> l'Organisme ainsi que ses modalités <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong>financem<strong>en</strong>t sont déterminées par le prés<strong>en</strong>t arrêté.L'Organisme ne pourra être dissout que par une loi qui réglera le mo<strong>de</strong> et les conditions<strong>de</strong> cette dissolution.Section II. Administration.Art. 7. Composition duconseil d'administration.L'Organisme est administré par un conseil d'administration composé d'un prési<strong>de</strong>nt, <strong>de</strong><strong>de</strong>ux vice-prési<strong>de</strong>nts et d'un maximum <strong>de</strong> onze autres membres choisis <strong>en</strong> raison <strong>de</strong>leurs compét<strong>en</strong>ces sci<strong>en</strong>tifiques ou professionnelles particulières dans les domainesd'activité <strong>de</strong> l'Organisme et dans <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> ceux-ci. Il doit être constitué <strong>de</strong> manièrelinguistiquem<strong>en</strong>t paritaire et comporter un repés<strong>en</strong>tant <strong>de</strong> chaque Exécutif régional.Sur proposition <strong>de</strong>s Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leursattributions, le Roi nomme après délibération du Conseil <strong>de</strong>s Ministres, le prési<strong>de</strong>nt et lesvice-prési<strong>de</strong>nts.Il est pourvu à toute autre vacance par les Ministres ayant les Affaires économiques etl'Energie dans leurs attributions après délibération du Conseil <strong>de</strong>s Ministres.En cas <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>s voix au sein du conseil, le prési<strong>de</strong>nt a voix prépondérante.Le prési<strong>de</strong>nt, les vice-prési<strong>de</strong>nts et les membres du conseil ne peuv<strong>en</strong>t être au service<strong>de</strong> sociétés ou d'organismes tiers qui ont régulièrem<strong>en</strong>t recours aux services <strong>de</strong>l'Organsime ou qui lui fourniss<strong>en</strong>t régulièrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s bi<strong>en</strong>s ou <strong>de</strong>s services.Ne peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> outre remplir les fonctions <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt, <strong>de</strong> vice-prési<strong>de</strong>nts ou <strong>de</strong>membre du conseil d'administration ceux qui , au mom<strong>en</strong>t où elles leur sont confiées,sont membres au Parlem<strong>en</strong>t europé<strong>en</strong>, <strong>de</strong>s Chambres légis<strong>la</strong>tives ou d'assemblée ayantun pouvoir légiférant équival<strong>en</strong>t , comme les Conseils <strong>de</strong>s Communautés et <strong>de</strong>s Régions.Ne peuv<strong>en</strong>t non plus remplir ces fonctions les personnes qui ont <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> Ministre, <strong>de</strong>Secrétaire d'Etat ou <strong>de</strong> membre d'un Exécutif communautaire ou régional, <strong>de</strong> Gouverneurd'une province, <strong>de</strong> Député perman<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> Bourgmestre, d'Echevin ou <strong>de</strong> Prési<strong>de</strong>nt d'unc<strong>en</strong>tre public d'ai<strong>de</strong> sociale d'une commune <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 30 000 habitants. Cetteinterdiction subsiste p<strong>en</strong>dant l'année qui suit l'expiration <strong>de</strong>s fonctions ou mandats <strong>de</strong>sinteressés.Art. 8. Fonctions.§ 1. Le Prési<strong>de</strong>nt, (les Vice-Prési<strong>de</strong>nts) et les membres du Conseil sont investis <strong>de</strong> leursfonctions pour un terme <strong>de</strong> six ans r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>ble. 137/166
A l'expiration <strong>de</strong> ce terme, ils continueront toutefois à exercer leur mandat jusqu'à ceque <strong>de</strong> nouveaux membres ai<strong>en</strong>t été désignés.§ 2. (Les fonctions <strong>de</strong>s prési<strong>de</strong>nt, vice-prési<strong>de</strong>nts et administrateurs pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t , parailleurs, fin pour décès, démission, incapacité civile ou lorsque les intéressés atteign<strong>en</strong>tl'âge <strong>de</strong> 65 ans.) Lorsqu'un administrateur quitte <strong>la</strong> fonction ou perd <strong>la</strong> qualité <strong>en</strong> raison <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle il aété désigné, il cesse <strong>de</strong> plein droit <strong>de</strong> faire partie du Conseil.(Le Roi peut, sur proposition du conseil d'administration, nommer le prési<strong>de</strong>nt sortantprési<strong>de</strong>nt honoraire. Cette nomination n'est que protoco<strong>la</strong>ire et ne donne pas droit <strong>de</strong>vote, ni droit à aucune rémunération) § 3. Il est pourvu sans dé<strong>la</strong>i à toute vacance, selon <strong>la</strong> procédure visée à l'article 7.Si une vacance se produit <strong>en</strong> cours <strong>de</strong> mandat, le membre nouveau désigné achève lemandat <strong>de</strong> celui qu'il remp<strong>la</strong>ce.§ 4. Le mandat <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s membres du premier conseil d'administration désignéconformém<strong>en</strong>t aux dispositions du paragraphe 1er pr<strong>en</strong>d fin trois ans après <strong>la</strong> dated'<strong>en</strong>trée <strong>en</strong> vigueur <strong>de</strong> l'arrêté <strong>de</strong> nomination. L'arrêté <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong> ces membresm<strong>en</strong>tionne cette particu<strong>la</strong>rité. Le mandat <strong>de</strong>s autres membres pr<strong>en</strong>d fin six ans après <strong>la</strong>même date.) Art. 9. Pouvoirs.§ 1. Le Conseil d'Administration est investi <strong>de</strong>s pouvoirs les plus ét<strong>en</strong>dus pour faire tousles actes d'administration et <strong>de</strong> disposition qui intéress<strong>en</strong>t l'Organisme.§ 2. Il représ<strong>en</strong>te l'Organisme dans les actes judiciaires, poursuite et dilig<strong>en</strong>ce duPrési<strong>de</strong>nt ou <strong>de</strong> l'administrateur désigné à cet effet.§ 3. Le Prési<strong>de</strong>nt et le Directeur général représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t conjointem<strong>en</strong>t l'Organisme dansles actes publics ou sous seing privé.§ 4. Il approuve, par décision motivée avant le premier mai <strong>de</strong> chaque année, leprogramme d'activité <strong>de</strong> l'année suivante et le budget qui y correspond.§ 5. Il arrête le statut du personnel et <strong>en</strong> fixe le cadre organique. Il nomme le personnel<strong>de</strong> direction.§ 6. Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie <strong>de</strong> sespouvoirs notamm<strong>en</strong>t à un bureau. Ces délégations <strong>de</strong> pouvoirs ne peuv<strong>en</strong>t être donnéesqu'<strong>en</strong> vertu <strong>de</strong> délibérations spéciales du Conseil d'Administration, lequel déterminel'objet et l'ét<strong>en</strong>due <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s pouvoirs ainsi octroyés.(Le conseil d'administration détermine parmi les conv<strong>en</strong>tions auxquelles l'Organismesouscrit <strong>en</strong> exécution <strong>de</strong> ses missions, celles qui doiv<strong>en</strong>t faire l'objet d'une décisionformelle <strong>de</strong> sa part.) § 7. Le conseil d'administration se réunit sur <strong>la</strong> convocation du prési<strong>de</strong>nt chaque foisque l'intérêt <strong>de</strong> l'Organisme l'exige et au moins trois fois par an. Il se réunit égalem<strong>en</strong>t à<strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'au moins quatre <strong>de</strong> ses membres.) Art. 10. Du bureau.Le Conseil d'Administration peut constituer <strong>en</strong> son sein un bureau dont fontnécessairem<strong>en</strong>t partie le Prési<strong>de</strong>nt, qui le prési<strong>de</strong>, et le Vice-Prési<strong>de</strong>nt.Art. 11. Fonctionnem<strong>en</strong>t du Conseil.Le Conseil d'Administration arrêté son règlem<strong>en</strong>t d'ordre intérieur.138/166
Section III. Gestion.Art. 12. De <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>.L'Organisme est géré selon les règles <strong>de</strong> bonne <strong>gestion</strong>, industrielle, financière etcommerciale.Sa (<strong>gestion</strong> journalière) est confiée à un Directeur général; celui-ci exerce ses fonctionsdans les conditions fixées par le Conseil d'Administration, qui le nomme et auquel il r<strong>en</strong>dcompte <strong>de</strong> l'accomplissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> sa mission. Le Directeur général assiste aux délibérations du Conseil d'Administration, avec voixconsultative. Il est chargé d'exécuter ses décisions.Dans les actes publics et sous seing privé l'Organisme est représ<strong>en</strong>té par le Prési<strong>de</strong>ntet le Directeur général agissant conjointem<strong>en</strong>t ou par les personnes auxquelles ils ontdélégué tout ou partie <strong>de</strong> leurs pouvoirs.(L'exercice d'une autre activité professionnelle par les membres du personnel <strong>de</strong>l'Organisme est soumise à l'autorisation préa<strong>la</strong>ble du conseil d'administration.) Section IV. Consultation <strong>de</strong>s milieux sci<strong>en</strong>tifiques et industrielsintéresses.Art. 13. § 1. Le Conseil d'Administration s'<strong>en</strong>toure <strong>de</strong>s avis émanant <strong>de</strong>s milieuxsci<strong>en</strong>tifiques et industriels compét<strong>en</strong>ts qui sont <strong>de</strong> nature à l'éc<strong>la</strong>irer dansl'exercice <strong>de</strong> sa mission.§ 2. Il crée, à cet effet, les comités consultatifs nécessaires composés <strong>de</strong> personnalitéschoisies dans les milieux sci<strong>en</strong>tifiques, <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche et <strong>de</strong>smilieux industriels.§ 3. A <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du Conseil d'Administration ou du bureau, ces comités fourniront leuravis, sur les matières relevant <strong>de</strong> leur compét<strong>en</strong>ce particulière, sci<strong>en</strong>tifique ou technique.§ 4. (Le conseil d'administration constitue un Comité technique perman<strong>en</strong>t composé <strong>de</strong>représ<strong>en</strong>tants <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>. Il consulte un Comité sur lesquestions re<strong>la</strong>tives à sa mission et <strong>en</strong> tous cas sur celles concernant :- l'infrastructure;- les programmes <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>;- les propositions <strong>de</strong> critères d'acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés et nonconditionnés ainsi que <strong>de</strong>s combustibles irradiés qu'il est appelé à <strong>en</strong>treposer;- les propositions <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t à appliquer par les dét<strong>en</strong>teurs <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>;- les propositions <strong>de</strong> technique d'<strong>en</strong>treposage et d'évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés,y compris ceux résultant du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires;- les propositions <strong>de</strong>s thèmes <strong>de</strong> recherches et <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> matière <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>;- le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> l'Organisme et, notamm<strong>en</strong>t, les contributions aux fondsdont question dans le prés<strong>en</strong>t arrêté;- <strong>la</strong> comptabilité analytique et l'é<strong>la</strong>boration du prix <strong>de</strong> revi<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes opérationseffectuées par l'Organisme;- les critères objectifs <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s coûts <strong>en</strong>tre les bénéficiaires <strong>de</strong>s prestations.)139/166
§ 5. L'Organisme met à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>s Comités toutes les informations nécessaires.Les avis <strong>de</strong> ces Comités ne li<strong>en</strong>t pas le conseil d'administration.) TITRE III. Des ressources, du budget et <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong>l'Organisme.Art. 14. Ressources <strong>de</strong>l'Organisme.L'Organisme a pour ressources :1° les crédits à charge du Ministère <strong>de</strong>s Affaires économiques qui sont versés àl'Organisme à titre <strong>de</strong> dotation et qui lui rest<strong>en</strong>t acquis afin <strong>de</strong> contribuer à <strong>la</strong> constitution<strong>de</strong> son fonds <strong>de</strong> roulem<strong>en</strong>t;2° les legs et donations <strong>en</strong> sa faveur;3° les subsi<strong>de</strong>s et rev<strong>en</strong>us occasionnels;4° toutes autres recettes légales et réglem<strong>en</strong>taires liées à son action et les in<strong>de</strong>mnitéspour prestations.Art. 15. Moy<strong>en</strong>sfinanciers.§ 1. L'Organisme est astreint à l'équilibre financier, c'est-à-dire que ses recettes doiv<strong>en</strong>tcouvrir tous les coûts tels que définis ci-<strong>de</strong>ssous. L'Organisme est, <strong>en</strong>tre autres, autoriséà contracter <strong>de</strong>s emprunts pour financier ses investissem<strong>en</strong>t. Ces emprunts pourront êtreassortis <strong>de</strong> <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> l'Etat, moy<strong>en</strong>nant l'autorisation préa<strong>la</strong>ble du Ministre <strong>de</strong>sFinances.§ 2. L'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s coûts liés aux activités <strong>de</strong> l'Organisme sont mis à charge <strong>de</strong>sbénéficiaires <strong>de</strong> ses prestations <strong>en</strong> ce compris les coûts <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> rechercheappliquée et <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> prototypes.§ 3. Ces coûts, évalués à prix <strong>de</strong> revi<strong>en</strong>t, sont répartis <strong>en</strong>tre les bénéficiaires <strong>de</strong>sprestations, proportionnellem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> critères objectifs déterminés par leconseil d'administration.§ 4. Le conseil d'administration fixe, après avis du Comité technique perman<strong>en</strong>t, lesélém<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> coût qui doiv<strong>en</strong>t être pris <strong>en</strong> considération pour le calcul du montant <strong>de</strong>sre<strong>de</strong>vances que l'Organisme doit mettre à charge <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong> prestations pourcouvrir ses frais, conformém<strong>en</strong>t au § 2 du prés<strong>en</strong>t article, ainsi que les modalités selonlesquelles les bénéficiaires non conv<strong>en</strong>tionnés sont t<strong>en</strong>us <strong>de</strong> contribuer à ces dép<strong>en</strong>ses.En tout état <strong>de</strong> cause, doiv<strong>en</strong>t être pris <strong>en</strong> compte les frais d'exploitation, <strong>en</strong> ce comprisles frais d'étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> stratégie, les frais liés à <strong>la</strong> politique d'information, les chargesfinancières, les amortissem<strong>en</strong>ts fiscaux et une provision pour le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sinstal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> l'Organisme. (Les <strong>de</strong>uxième, troisième, quatrième et cinquième phrasessont supprimées par )§ 5. L'ONDRAF constitue un fonds d'insolvabilité, qui est géré comme le fonds pour lefinancem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s missions à long terme défini à l'article 16. Le fonds d'insolvabilité aexclusivem<strong>en</strong>t pour but <strong>de</strong> financer les prestations pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>et le déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t d'instal<strong>la</strong>tions nucléaires non couvertes suite à une faillite ou àl'insolvabilité <strong>de</strong> producteurs/propriétaires et/ou dét<strong>en</strong>teurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> etexploitants/propriétaires d'instal<strong>la</strong>tions nucléaires autorisées selon <strong>la</strong> loi du 15 avril 1994re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre les dangers résultant<strong>de</strong>s rayonnem<strong>en</strong>ts ionisants et re<strong>la</strong>tive à l'Ag<strong>en</strong>ce fédérale <strong>de</strong> Contrôle nucléaire etl'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlem<strong>en</strong>t général <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong>popu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong>s travailleurs et <strong>de</strong> l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre le danger <strong>de</strong>s rayonnem<strong>en</strong>tsionisants. Ne sont pas financés par le fonds les prestations faisant suite à <strong>la</strong> faillite ou140/166
l'insolvabilité <strong>de</strong>s producteurs, exploitants, propriétaires et dét<strong>en</strong>teurs qui ont effectué <strong>de</strong>sactivités industrielles re<strong>la</strong>tives au raffinage <strong>de</strong> radium, dont <strong>la</strong> conversion etl'<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t d'uranium effectués dans ce cadre, et à l'utilisation <strong>de</strong> sources naturelles<strong>de</strong> radioactivité.Toute source scellée, au s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l'arrêté royal précité du 20 juillet 2001, déc<strong>la</strong>réecomme orpheline et <strong>déchets</strong> et transmise à titre <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> par l'Ag<strong>en</strong>ce fédérale <strong>de</strong>Contrôle nucléaire à l'ONDRAF est prise <strong>en</strong> charge par le fonds d'insolvabilité. Tant quel'Ag<strong>en</strong>ce n'a pas statué sur le caractère orphelin <strong>de</strong> <strong>la</strong> source, elle est géree parl'ONDRAF qui répercute les coûts <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> soit sur le propriétaire soit sur le fondsd'insolvabilité.En vue <strong>de</strong> récupérer les montants correspondant à ces charges, l'ONDRAF épuise tousles moy<strong>en</strong>s qui lui sont ouverts conformém<strong>en</strong>t aux compét<strong>en</strong>ces qu'il déti<strong>en</strong>t <strong>de</strong> par leslois et arrêtés royaux le régissant contre les producteurs, exploitants, propriétaires oudét<strong>en</strong>teurs <strong>en</strong> cause, y compris les transactions et les recours judiciaires.L'alim<strong>en</strong>tation et l'utilisation du fonds d'insolvabilité sont soumises aux règles suivantes :1° sans préjudice <strong>de</strong>s dispositions ci-après, une réserve <strong>de</strong> 5 % <strong>de</strong>stinée au fondsd'insolvabilité est comprise dans les re<strong>de</strong>vances annuelles dues à l'ONDRAF. Cetteréserve est due <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s qui sont disponibles dans le fonds;2° hormis le cas prévu au 3°, l'inclusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> réserve <strong>de</strong> 5 % dans les re<strong>de</strong>vances estsusp<strong>en</strong>due pour chaque année qui suit une année pour <strong>la</strong>quelle les moy<strong>en</strong>s disponiblesau fonds d'insolvabilité sont égaux ou supérieurs au montant défini ci-après. Le montantà partir duquel cette susp<strong>en</strong>sion <strong>en</strong>tre <strong>en</strong> vigueur, est égal au montant maxima<strong>la</strong>pplicable <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> faillite ou d'insolvabilité qui doit être couvert pour les établissem<strong>en</strong>ts<strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses II et III, tels que définis dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001. Ce montant estfixé par l'ONDRAF tous les cinq ans dans le cadre <strong>de</strong> l'inv<strong>en</strong>taire <strong>de</strong> toutes lesinstal<strong>la</strong>tions nucléaires et <strong>de</strong> tous les sites cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s substances radioactives quel'ONDRAF doit établir et mettre à jour <strong>en</strong> vertu <strong>de</strong>s points 1° et 7° <strong>de</strong> l'article 179, § 2, <strong>de</strong><strong>la</strong> loi du 8 août 1980 re<strong>la</strong>tive aux propositions budgétaires 1979-1980;3° chaque année et au plus tard <strong>en</strong> juin, l'ONDRAF évalue pour l'année suivante lesmoy<strong>en</strong>s qui seront disponibles au fonds d'insolvabilité, <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant compte <strong>de</strong>s intérêts et<strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses prévisibles sur base <strong>de</strong>s données dont dispose l'ONDRAF à ce mom<strong>en</strong>t-là.Si au cours d'une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> susp<strong>en</strong>sion du paiem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> réserve <strong>de</strong> 5 %, il estconstaté qu'il existe un risque que les moy<strong>en</strong>s disponibles dans le fonds d'insolvabilitén'atteign<strong>en</strong>t pas, l'année suivante, <strong>la</strong> limite inférieure ci-après, <strong>la</strong> susp<strong>en</strong>sion est levéedès l'année suivante. Cette limite inférieure est égale au montant défini au 2° diminué <strong>de</strong>l'intérêt annuel prévisible sur ce montant. Cet intérêt est déterminé sur base d'un tauxd'intéret <strong>de</strong> 2 % augm<strong>en</strong>té <strong>de</strong> l'inf<strong>la</strong>tion. La fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> susp<strong>en</strong>sion estcommuniquée aux producteurs, exploitants, propriétaires ou dét<strong>en</strong>teurs concernésmoy<strong>en</strong>nant un préavis <strong>de</strong> six mois au moins par le Comite technique perman<strong>en</strong>t défini àl'article 13, § 4;4° <strong>en</strong> conditions normales, c'est-à-dire à l'exclusion <strong>de</strong>s cas d'urg<strong>en</strong>ce imposant <strong>de</strong>ssorties importantes et rapi<strong>de</strong>s du fonds et <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> surv<strong>en</strong>ance <strong>de</strong> plusieurs faillites ouinsolvabilités importantes dans un <strong>la</strong>ps <strong>de</strong> temps court, les prélèvem<strong>en</strong>ts annuels dans lefonds d'insolvabilité ne peuv<strong>en</strong>t pas dépasser les recettes annuelles, constituées par lesre<strong>de</strong>vances compr<strong>en</strong>ant <strong>la</strong> réserve <strong>de</strong> 5 % et les produits d'intérêts;5° dans les <strong>de</strong>ux cas d'exclusions visés <strong>en</strong> 4°, les moy<strong>en</strong>s disponibles au fondsd'insolvabilité ne peuv<strong>en</strong>t pas <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir inférieurs au 50 % du montant défini au 2°;Chaque année, que <strong>la</strong> réserve <strong>de</strong> 5 % soit comprise ou non dans les re<strong>de</strong>vances, lesinterêts sur les moy<strong>en</strong>s disponibles dans le fonds sont versés dans ce fonds.) Art. 16. Fonds pour le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s missions à long terme.L'Organisme, pourra, moy<strong>en</strong>nant l'accord du Ministre <strong>de</strong>s Affaires économiques,constituer un Fonds <strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s missions à long terme.141/166
Ce Fonds est appelé a couvrir le coût <strong>de</strong>s activités nécessaires à l'évacuation <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, notamm<strong>en</strong>t leur dépôt év<strong>en</strong>tuel <strong>en</strong> couches géologiques.Il couvrira égalem<strong>en</strong>t, le cas échéant, les coûts surv<strong>en</strong>ant après <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 50 ansprévue à l'article 3, qui sont <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drés par <strong>de</strong>s défauts <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés pris <strong>en</strong>charge par l'Organisme et non prévisibles au mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> leur réception.Ce Fonds sera alim<strong>en</strong>té par <strong>de</strong>s contributions prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>calculées <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s charges estimatives imputables à leurs propres <strong>déchets</strong>.Le Conseil d'Administration soumettra à l'approbation du Ministre <strong>de</strong>s Affaireséconomiques les règles permettant d'établir le montant <strong>de</strong>s contributions et fixant lesconditions <strong>de</strong> l'utilisation du Fonds.Art. 16bis. Lefonds visé à l'article 16 est géré conformém<strong>en</strong>t aux dispositions <strong>de</strong>s conv<strong>en</strong>tionsconclues <strong>en</strong>tre l'Organisme et les producteurs concernés.Les contributions à ce fonds sont établies sur <strong>la</strong> base d'un programme <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ceétabli avec les producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> et susceptible d'être revu. Ces contributions sontcalculées <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s charges estimatives imputables aux <strong>déchets</strong> <strong>de</strong> chaqueproducteur.L'Organisme est t<strong>en</strong>u d'établir et <strong>de</strong> prés<strong>en</strong>ter annuellem<strong>en</strong>t un rapport sur <strong>la</strong> <strong>gestion</strong>technique et financière du programme d'évacuation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés.Art. 16ter. Provisions pour le financem<strong>en</strong>t du programme <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t et pour <strong>la</strong> <strong>gestion</strong><strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> résultant.§ 1. L'Organisme établira, <strong>en</strong> concertation avec les exploitants concernés, les conditions<strong>de</strong> financem<strong>en</strong>t du déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions nucléaires désaffectées et <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>en</strong> résultant.§ 2. Les producteurs ayant conclu avec l'Etat, le 9 octobre 1985, une conv<strong>en</strong>tion re<strong>la</strong>tiveau même objet sont disp<strong>en</strong>sés <strong>de</strong> l'application du prés<strong>en</strong>t article <strong>en</strong> ce qui concerne lesinstal<strong>la</strong>tions visées par cette conv<strong>en</strong>tion. Toutefois, l'Organisme aura accès auxinformations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ses missions commeprévu à l'article 5.Art. 17. Du budget, <strong>de</strong>s comptes et <strong>de</strong> <strong>la</strong> comptabilité.§ 1. Chaque année, avant (le 15 décembre), le Conseil d'Administration arrête le budget<strong>de</strong> l'exercice suivant et le communique au Ministre <strong>de</strong>s Affaires économiques, ainsi qu'auMinistre <strong>de</strong>s Finances. § 2. Chaque année, avant (le premier juillet), le Conseil d'Administration approuve lescomptes <strong>de</strong> l'exercice écoulé et les communique au Ministre <strong>de</strong>s Affaires économiques etau Ministre <strong>de</strong>s Finances, avec un rapport sur l'activité et <strong>la</strong> situation financière <strong>de</strong>l'Organisme. Le budget et les comptes sont, dans les <strong>de</strong>ux mois <strong>de</strong> leur établissem<strong>en</strong>t, publiés auxannexes du Moniteur belge.§ 3. La comptabilité sera t<strong>en</strong>ue selon les règles fixées par <strong>la</strong> loi du 17 juillet 1975re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> comptabilité et aux comptes annuels <strong>de</strong>s <strong>en</strong>treprises et par les arrêtésd'exécution <strong>de</strong> cette loi.L'Organisme ti<strong>en</strong>dra <strong>en</strong> outre une comptabilité analytique <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> déterminer le prix<strong>de</strong> revi<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes activités et opérations effectuées par l'Organisme.142/166
TITRE IV. De <strong>la</strong> tutelle.Art. 18. (Commissaires du gouvernem<strong>en</strong>t. Les Ministres ayant dans leursattributions les Affaires économiques et l'Energie d'une part, ceux qui ont dansleurs attributions l'Environnem<strong>en</strong>t et l'Emploi et le Travail d'autre part, nomm<strong>en</strong>tchacun un Commissaire du gouvernem<strong>en</strong>t auprès <strong>de</strong> l'Organisme, qui tous <strong>de</strong>uxassist<strong>en</strong>t aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du Bureauavec voix consultative.) La parité linguistique est respectée au niveau <strong>de</strong>s commissaires du gouvernem<strong>en</strong>t.Ils exerc<strong>en</strong>t leur mission conformém<strong>en</strong>t aux articles 9 et 10 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 16 mars 1954re<strong>la</strong>tive au contrôle <strong>de</strong> certains organismes d'intérêt public et dispos<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s pouvoirsprévus par cette loi à cet effet.Art. 19. Approbationministérielle.L'Organisme soumet à l'approbation du Ministre <strong>de</strong>s Affaires économiques:- le budget et les comptes annuels;- le statut et le cadre organique du personnel;- <strong>la</strong> désignation du directeur général et du directeur général adjoint;- le règlem<strong>en</strong>t d'ordre intérieur du conseil d'administration;- les conv<strong>en</strong>tions visées à l'article 2, § 4;- les actes visés à l'article 2, § 5, à l'exception <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> courante.A défaut <strong>de</strong> notification d'une décision contraire par l'autorité <strong>de</strong> tutelle dans les vingtjours, les décisions prises par le conseil d'administration sont considérées commedéfinitivem<strong>en</strong>t approuvées.Art. 20. Lorsque l'intérêt général et le respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi ou <strong>de</strong>s règlem<strong>en</strong>ts lerequièr<strong>en</strong>t, le gouvernem<strong>en</strong>t peut imposer au Conseil d'Administration <strong>de</strong>l'Organisme <strong>de</strong> délibérer sur un point et il peut pr<strong>en</strong>dre une décision sous formed'arrêté royal délibéré <strong>en</strong> Conseil <strong>de</strong>s Ministres qui annule et remp<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> décision<strong>de</strong> ce Conseil d'Administration.(Toutefois, une telle décision ne pourrait avoir pour objet <strong>de</strong> donner aux disponibilités <strong>de</strong>l'Organisme une <strong>de</strong>stination autre que celle pour <strong>la</strong>quelle elles ont été prévues.) Art. 21. Contrôle <strong>de</strong>s comptes.Le Ministre <strong>de</strong>s Affaires économiques et le Ministre <strong>de</strong>s Finances désign<strong>en</strong>t uncommissaire-réviseur chargé <strong>de</strong> contrôler <strong>la</strong> comptabilité <strong>de</strong> l'Organisme.Art. 22. Le Ministre <strong>de</strong>s Affaires économiques est chargé <strong>de</strong> l'exécution duprés<strong>en</strong>t arrêté.Art. 23. Le prés<strong>en</strong>t arrêté <strong>en</strong>tre <strong>en</strong> vigueur le jour <strong>de</strong> sa publication au Moniteurbelge.143/166
Annexe B : structure <strong>de</strong>s Règles généralesLe premier chapitre <strong>de</strong>s Règles générales traite <strong>de</strong>s généralités :Chapitre 1 : GénéralitésArticle 1 er – Dispositions généralesArt. 2 – DéfinitionsArt. 3 – Domaine d’applicationLe <strong>de</strong>uxième chapitre énumère toutes les conditions <strong>de</strong> nature technique auxquelles estsoumise l'acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>. Les caractéristiques mécaniques, physiques,chimiques, radiologiques et biologiques <strong>de</strong>s colis y ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t logiquem<strong>en</strong>t une p<strong>la</strong>ceimportante. Les technologies applicables, l'assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité et <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tationcomplèt<strong>en</strong>t ce volet technique :Chapitre 2 : Dispositions techniquesArt. 4 – Propriétés mécaniques du colis primaire <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (non) conditionnésArt. 5 – Caractéristiques physiques du colis primaire <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (non)conditionnés 70Art. 6 – Caractéristiques chimiques du colis primaire <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (non)conditionnésArt. 7 – Caractéristiques biologiques du colis primaire <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (non)conditionnésArt. 8 – CriticitéArt. 9 – Technologies acceptablesArt. 10 – Acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ceArt. 11 – Assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualitéArt. 12 – Docum<strong>en</strong>tation et i<strong>de</strong>ntification du colis primaire <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (non)conditionnésSont <strong>en</strong>fin précisées, dans le troisième chapitre, différ<strong>en</strong>tes exig<strong>en</strong>ces administratives :Chapitre 3 : Dispositions administrativesArt. 13 – Conditions pour l’acceptation <strong>de</strong>s colis primaires <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> (non)conditionnésArt. 14 – Traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s non-conformitésArt. 15 – Dérogations aux critères d’acceptationArt. 16 – Révision <strong>de</strong>s critères d’acceptationArt. 17 – Suivi dans le temps <strong>de</strong>s colis primaires <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés 71Art. 18 – Entrée <strong>en</strong> vigueur <strong>de</strong>s prés<strong>en</strong>tes Règles générales70 Cet article est unique dans le cas <strong>de</strong>s Règles générales pour l'acceptation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés, etconcerne aussi bi<strong>en</strong> les caractéristiques radiologiques que les caractéristiques physiques macroscopiques(telles <strong>la</strong> masse ou les dim<strong>en</strong>sions). Dans le cas <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> non conditionnés, l'article est dédoublé pourcerner séparém<strong>en</strong>t ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> caractéristiques.71 Cet article ne s'applique pas aux <strong>déchets</strong> non conditionnés et est par conséqu<strong>en</strong>t abs<strong>en</strong>t dans les Règlesgénérales les concernant.144/166
Annexe C : c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s DNCDéchets non-conditionnés soli<strong>de</strong>s1. Le premier caractère (le X) est <strong>la</strong> lettre A, réservée aux <strong>déchets</strong> qui sont à l'étatsoli<strong>de</strong>.2. Le <strong>de</strong>uxième caractère (l'Y) est un chiffre déterminé par l'int<strong>en</strong>sité durayonnem<strong>en</strong>t d'une part, et <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s émetteurs (alpha et/ou bêta) d'autrepart. Le tableau suivant s'applique :Co<strong>de</strong> YA1* Déchet bêta/gamma faiblem<strong>en</strong>t actifA2* Déchet bêta/gamma et légèrem<strong>en</strong>t contaminé alphaA3* Déchet alpha faiblem<strong>en</strong>t actifA4* Déchet bêta/gamma moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t actifA5* Déchet alpha moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t actifA6* Déchet bêta/gamma hautem<strong>en</strong>t actifA7* Déchet alpha hautem<strong>en</strong>t actifA8* Déchet très fortem<strong>en</strong>t actif (combustible irradié)Table 6.: C<strong>la</strong>ssification selon les caractéristiques radiologiques3. Le troisième caractère (le Z) est un chiffre déterminé par le type <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>tapplicable au déchet soli<strong>de</strong>, selon le tableau suivant :Schéma <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>tIncinération +supercompaction <strong>de</strong>s fûts <strong>de</strong>c<strong>en</strong>dresCompression +supercompactionCompression +supercompactionCo<strong>de</strong> ZA*1 Déchet incinérableDescription du co<strong>de</strong> ZA*2 Déchet compressible (<strong>en</strong> petitembal<strong>la</strong>ge)A*3 Filtres compressiblesSupercompaction A*4 Déchet non compressible (application <strong>de</strong>supercompaction avec réduction limitée<strong>en</strong> volume)Supercompaction A*5 Filtres non compressiblesDécoupage + embal<strong>la</strong>ge +(super)compaction A*6 Déchet réductible (e.a. boîtes à gants)Supercompaction A*7 Déchet supercompactableDéchargem<strong>en</strong>t + cim<strong>en</strong>tationdirecteA*8 Déchet directem<strong>en</strong>t cim<strong>en</strong>tableDiffér<strong>en</strong>ts schémas possibles A*9 Déchet traitable spécifiquem<strong>en</strong>t (e.a.paratonnerres, sources scellées,détecteurs <strong>de</strong> fumées, etc& )Table 7.: C<strong>la</strong>ssification selon les traitem<strong>en</strong>ts applicableUn déchet “A27”, par exemple, est constitué <strong>de</strong> matériaux incombustibles et pouvantalim<strong>en</strong>ter directem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> presse <strong>de</strong> supercompaction <strong>de</strong>stinée à <strong>en</strong> réduire le volume.D'un point <strong>de</strong> vue radiologique, ils sont faiblem<strong>en</strong>t irradiants, contaminés par <strong>de</strong>s145/166
émetteurs bêta et <strong>de</strong>s traces d'émetteurs alpha.Il convi<strong>en</strong>t <strong>en</strong>fin <strong>de</strong> noter que, si, <strong>en</strong> théorie, toutes les combinaisons <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s Y et Zsont possibles, celles-ci sont, dans <strong>la</strong> pratique, limitées : les filtres compressibles (Z = 3),qui ne se r<strong>en</strong>contr<strong>en</strong>t que dans les catégories A13 et A23, et les <strong>déchets</strong> bêta/gammamoy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants (Y = 4), limités aux catégories A41, A47 et A48, <strong>en</strong> sont <strong>de</strong>uxexemples.Déchets non conditionnés liqui<strong>de</strong>sLeur c<strong>la</strong>ssification utilise aussi un co<strong>de</strong> XYZ, mais qui répond à une systématiquequelque peu différ<strong>en</strong>te. En effet, vu <strong>la</strong> diversité limitée d’efflu<strong>en</strong>ts liqui<strong>de</strong>s qui doiv<strong>en</strong>t êtretraités par l’ONDRAF, <strong>la</strong> distinction <strong>en</strong>tre faiblem<strong>en</strong>t actifs, moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t actifs etc… estplutôt opérée au niveau du co<strong>de</strong> Z. Le co<strong>de</strong> X spécifiant un déchet liqui<strong>de</strong> est <strong>la</strong> lettre B.L’ONDRAF distingue aussi les solutions homogènes (co<strong>de</strong> Y = 0) <strong>de</strong>s solutionshétérogènes (boues et susp<strong>en</strong>sions) (co<strong>de</strong> Y = 1).Les <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s B0* sont catégorisés comme suit :Schéma <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t Co<strong>de</strong> XYZ DescriptionTraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s eaux +bituminisation <strong>de</strong>sbouesIncinération +supercompaction <strong>de</strong>sfûts <strong>de</strong> c<strong>en</strong>dresPrétraitem<strong>en</strong>t +bituminisationB01B02B05B06B03B04B07B08B09Con<strong>de</strong>nsat faiblem<strong>en</strong>t actifEfflu<strong>en</strong>t faiblem<strong>en</strong>t actif “froid” 72Efflu<strong>en</strong>t faiblem<strong>en</strong>t actif “tiè<strong>de</strong>”Efflu<strong>en</strong>t faiblem<strong>en</strong>t actif “chaud”Liqui<strong>de</strong> organique faiblem<strong>en</strong>t actif <strong>en</strong>récipi<strong>en</strong>tLiqui<strong>de</strong> aqueux faiblem<strong>en</strong>t actif <strong>en</strong>récipi<strong>en</strong>tDéchet r<strong>en</strong>fermant <strong>de</strong>s émetteurs alphaet/ou chimiquem<strong>en</strong>t chargéDéchet moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t actifDéchet hautem<strong>en</strong>t actifTable 8.: C<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> liqui<strong>de</strong>s homogènesLes boues et susp<strong>en</strong>sions (B1*) subiss<strong>en</strong>t un prétraitem<strong>en</strong>t consistant <strong>en</strong> une séparation<strong>de</strong> <strong>la</strong> phase liqui<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase soli<strong>de</strong>. La phase liqui<strong>de</strong> est <strong>en</strong>suite traitée comme déchetB0* <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> composition radiologique et chimique, et <strong>la</strong> phase soli<strong>de</strong> obt<strong>en</strong>ueest traitée comme déchet radioactif soli<strong>de</strong> non conditionné, comme décrit précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t.72 Les qualifications “froid”, tiè<strong>de</strong>” et “chaud” correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s niveaux croissants <strong>de</strong> conc<strong>en</strong>trationd'activité, celle-ci restant toutefois dans le domaine <strong>de</strong>s faibles valeurs.146/166
Annexe D : c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> DCLe troisième niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> conditionnés est constitué par lesc<strong>la</strong>sses. De <strong>la</strong> même manière que les catégories sont une subdivision <strong>de</strong>s groupes, lesc<strong>la</strong>sses sont une subdivision <strong>de</strong>s catégories. Cette subdivision est, dans leur cas,fonction du type <strong>de</strong> bâtim<strong>en</strong>t d'<strong>en</strong>treposage temporaire dans lesquels sont stockés lescolis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés, et est donc associée à leur <strong>gestion</strong> dans le moy<strong>en</strong> terme.Les types <strong>de</strong> bâtim<strong>en</strong>t, décrits au chapitre neuf, sont : Entrepôts <strong>de</strong> construction c<strong>la</strong>ssique pour <strong>déchets</strong> faiblem<strong>en</strong>t irradiants, Entrepôt à structure r<strong>en</strong>forcée (épaisseur <strong>de</strong>s murs faisant office <strong>de</strong> blindage) pour<strong>déchets</strong> moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t irradiants, Entrepôts “bunkerisés”, avec murs <strong>de</strong> blindage <strong>de</strong> dim<strong>en</strong>sions supérieures au typeprécé<strong>de</strong>nt et système <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ti<strong>la</strong>tion forcée <strong>de</strong> refroidissem<strong>en</strong>t, pour <strong>déchets</strong>hautem<strong>en</strong>t et très hautem<strong>en</strong>t irradiants.Outre le type d'<strong>en</strong>trepôt, les c<strong>la</strong>sses sont égalem<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>ciées, le cas échéant, par letype <strong>de</strong> colisage <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> et/ou leur prov<strong>en</strong>ance.Les co<strong>de</strong>s affectés aux c<strong>la</strong>sses sont <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s alphanumériques à quatre caractères ouplus : Le premier caractère (lettre) r<strong>en</strong>d compte du type d’<strong>en</strong>treposage. Autant que possible,<strong>la</strong> lettre reflète le niveau d'irradiation et ceci, <strong>en</strong> ang<strong>la</strong>is, néer<strong>la</strong>ndais et français : L(low, <strong>la</strong>ag, légèrem<strong>en</strong>t), M (medium, mid<strong>de</strong>l, moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t), H (high, hoog,hautem<strong>en</strong>t), Z (zeer hoog, <strong>de</strong>rnière lettre <strong>de</strong> l’alphabet), R (radium). Les trois caractères suivants sont les lettres AGA (Actief Geconditionneerd Afval),communes à toutes les c<strong>la</strong>sses. Elles n’ont donc pas <strong>de</strong> fonction discriminante. D’unepart, leur rôle est phonétique, d’autre part, elles mainti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t une certaineressemb<strong>la</strong>nce avec d’anci<strong>en</strong>s co<strong>de</strong>s, utilisés antérieurem<strong>en</strong>t à l'adoption <strong>de</strong> <strong>la</strong>prés<strong>en</strong>te c<strong>la</strong>ssification. Le cinquième caractère donne le type <strong>de</strong> dépôt. Son abs<strong>en</strong>ce ou <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong>lettre T (temporary, tij<strong>de</strong>lijk, temporaire) indiqu<strong>en</strong>t une c<strong>la</strong>sse “(dépôt <strong>de</strong>) surface”. Le L(long-lived, <strong>la</strong>nglev<strong>en</strong>d, longue <strong>de</strong>mi-vie) indique une c<strong>la</strong>sse à <strong>de</strong>stination géologique. Si prés<strong>en</strong>t(s), le ou les caractère(s) suivant(s) indique une prov<strong>en</strong>ance ou une variante<strong>de</strong> colisage.147/166
Les c<strong>la</strong>sses sont, à l'heure <strong>actuelle</strong>, au nombre <strong>de</strong> seize. En voici le tableau :C<strong>la</strong>sse Description CategorieZAGALC Verre <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t (AREVA) CZAGALS Combustible irradié conditionné CHAGA 73 Haute activité, courte <strong>de</strong>mi-vie BHAGAL Haute activité, longue <strong>de</strong>mi-vie CHAGALC2 Déchet <strong>de</strong> structure <strong>de</strong> combustible (AREVA) CHAGALP1 Verre <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t (EUROCHEMIC) CHAGALP2 Verre <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t (EUROCHEMIC) CHAGALP3 Débris <strong>de</strong> combustibles (EUROCHEMIC) CMAGA Moy<strong>en</strong>ne activité, courte <strong>de</strong>mi-vie AMAGAT Moy<strong>en</strong>ne activité, courte <strong>de</strong>mi-vie AMAGAL Moy<strong>en</strong>ne activité, longue <strong>de</strong>mi-vie BMAGALE Déchet bituminé (EUROCHEMIC) BLAGA Faible activité, courte <strong>de</strong>mi-vie ALAGAT Faible activité, courte <strong>de</strong>mi-vie ALAGAL Faible activité, longue <strong>de</strong>mi-vie BRAGAL Déchet contaminé Ra (Site BP2) BTable 9: C<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnésAu sein d'une même c<strong>la</strong>sse, les colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnés sont <strong>en</strong>fin répartis <strong>en</strong> flux,ou <strong>en</strong>sembles <strong>de</strong> colis <strong>de</strong> caractéristiques physiques, chimiques et radiologiqueshomogènes, issus du conditionnem<strong>en</strong>t, par un procédé déterminé, <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> bruts <strong>de</strong>même nature. Les flux sont principalem<strong>en</strong>t utilisés dans le cadre <strong>de</strong>s inv<strong>en</strong>taires et <strong>de</strong>sprévisions <strong>de</strong> production. Le niveau <strong>de</strong> différ<strong>en</strong>ciation technique et sci<strong>en</strong>tifique <strong>de</strong> cettec<strong>la</strong>ssification étant élevé – on dénombre plus <strong>de</strong> c<strong>en</strong>t flux –, elle ne sera pas détaillée ici.73 Cette c<strong>la</strong>sse un peu particulière est prévue pour accueillir les sources <strong>de</strong> radiothérapie et <strong>de</strong> radiographieindustrielle. Cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s quantités importantes <strong>de</strong> radionucléi<strong>de</strong>s à courte <strong>de</strong>mi-vie ( 60 Co), etmassivem<strong>en</strong>t blindées, elles sont <strong>de</strong> haute activité, mais faiblem<strong>en</strong>t irradiantes.148/166
Annexe E : procédures d'agrém<strong>en</strong>tProcédure <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong> l’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts etinstal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> caractérisation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>conditionnésLa procédure d’agrém<strong>en</strong>t s’articule principalem<strong>en</strong>t autour <strong>de</strong> l’analyse critique itérative etconcertée d’une docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>scriptive et justificative du procédé, <strong>de</strong> l’équipem<strong>en</strong>t et<strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion à agréer. Cette docum<strong>en</strong>tation est établie par le producteur <strong>en</strong>concertation avec l’ONDRAF. Elle respecte toutefois un canevas et cont<strong>en</strong>u-type fixés parl’ONDRAF <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s sujets traités. Cette docum<strong>en</strong>tation se composeprincipalem<strong>en</strong>t comme suit : dossiers d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s procédés et instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t etd’<strong>en</strong>treposage (chez l’exploitant) <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s embal<strong>la</strong>ges primairescorrespondants; dossiers d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> DC et <strong>de</strong>sméthodologies <strong>de</strong> caractérisation radiologique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> (incluant les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong>détermination <strong>de</strong>s vecteurs isotopiques et le calcul <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s); dossiers d'agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s méthodologies <strong>de</strong> caractérisation chimique <strong>de</strong>s colis <strong>de</strong> DC.Agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s procédés et instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t etconditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> et <strong>de</strong>s embal<strong>la</strong>gesprimaires pour colis DCLa procédure d’agrém<strong>en</strong>t comporte les trois étapes majeures suivantes : Exam<strong>en</strong> <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t établis par le producteurLa docum<strong>en</strong>tation d’agrém<strong>en</strong>t fait l’objet d’un exam<strong>en</strong> approfondi <strong>de</strong> manière à s’assurer<strong>de</strong> son caractère complet, cohér<strong>en</strong>t et convaincant. Cet exam<strong>en</strong> porte <strong>en</strong> particulier surles points suivants : Description <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, <strong>de</strong>s procédés, <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts (incluant les embal<strong>la</strong>gesprimaires et <strong>en</strong>trepôts) et <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>; Description <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions; Justification étayant l’aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions à produire<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> conditionnés conformes aux critères d’acceptationapplicables; Argum<strong>en</strong>taire étayant <strong>la</strong> présomption <strong>de</strong> conformité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> avecchacun <strong>de</strong>s critères d’acceptation applicables; I<strong>de</strong>ntification et justification <strong>de</strong>s paramètres critiques 74 <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts etinstal<strong>la</strong>tions; Description du cont<strong>en</strong>u-type et <strong>de</strong> l’architecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production; Description <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> Contrôle et d’Assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Qualité appliqués auxprocédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions soumis à l’agrém<strong>en</strong>t; Description du système <strong>de</strong> Qualité <strong>en</strong> rapport avec <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.L’exam<strong>en</strong> critique <strong>de</strong>s dossiers se déroule selon un processus itératif. Il aboutit àl’approbation formelle <strong>de</strong>s dossiers par l’ONDRAF.74 Paramètres critiques : paramètres d’un procédé ou d’une instal<strong>la</strong>tion ayant une influ<strong>en</strong>ce démontrée sur <strong>la</strong>qualité finale du colis DC. Ces paramètres et leurs domaines <strong>de</strong> variation autorisés sont i<strong>de</strong>ntifiés, justifiéset quantifiés.149/166
Audits (inspections) techniquesL’ONDRAF réalise <strong>de</strong>s audits techniques (inspections) dans les instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>production <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, <strong>de</strong> manière à vérifier <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre effective<strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions décrits et justifiés dans les dossiersd’agrém<strong>en</strong>t. Ces vérifications port<strong>en</strong>t <strong>en</strong> particulier sur les points suivants : Cohér<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions mis <strong>en</strong> œuvre, et lecont<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t correspondants; Application effective <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> Contrôle et d’Assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Qualité; Conformité <strong>de</strong>s paramètres critiques <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions auxdonnées <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t correspondants; Conformité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> produits aux critères d’acceptation applicables; Conformité <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation produite au cont<strong>en</strong>u-type décrit dans les dossiersd’agrém<strong>en</strong>t.Ces audits sont conduits à partir <strong>de</strong> manuels d’inspection établis par l’ONDRAF sur <strong>la</strong>base du cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t. Ils font l’objet <strong>de</strong> rapports officiels établis parl’ONDRAF et communiqués aux producteurs. Ces audits peuv<strong>en</strong>t conduire à l’adaptation<strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t et/ou <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions à agréer. Exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production du premier lot <strong>de</strong> colis DCLa docum<strong>en</strong>tation couvrant <strong>la</strong> première campagne <strong>de</strong> production <strong>de</strong> colis DC selon lesprocédés et dans les instal<strong>la</strong>tions soumis à l’agrém<strong>en</strong>t, fait l’objet d’un exam<strong>en</strong>administratif approfondi. Cet exam<strong>en</strong> porte <strong>en</strong> particulier sur les points suivants : Conformité <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation à l’organisation et au cont<strong>en</strong>u-type décrits dans lesdossiers d’agrém<strong>en</strong>t; Conformité <strong>de</strong>s paramètres critiques <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions auxdonnées <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t; Conformité <strong>de</strong>s colis DC produits aux critères d’acceptation applicables.L’exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> cette docum<strong>en</strong>tation peut conduire à <strong>la</strong> révision <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>tet/ou <strong>de</strong>s procédés, équipem<strong>en</strong>ts et instal<strong>la</strong>tions, et/ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>production.L’approbation <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production, jointe àl’obt<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> résultats d’audits satisfaisants, conduit à <strong>la</strong> délivrance <strong>de</strong>s agrém<strong>en</strong>tsrequis.Agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure d’activité et <strong>de</strong>sméthodologies <strong>de</strong> caractérisation radiologique <strong>de</strong>s colis DC(incluant <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s marges d’incertitu<strong>de</strong>s)Les producteurs sont t<strong>en</strong>us d’établir, <strong>de</strong> proposer et <strong>de</strong> justifier <strong>de</strong>s méthodologies <strong>de</strong>détermination <strong>de</strong>s caractéristiques radiologiques <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong>. Ces méthodologiesdoiv<strong>en</strong>t permettre <strong>de</strong> caractériser les <strong>déchets</strong> conformém<strong>en</strong>t aux prescriptions édictéespar l’ONDRAF. Elles doiv<strong>en</strong>t être approuvées par le Service <strong>de</strong> Contrôle Physique duproducteur (ou par l’organisme agréé qui <strong>en</strong> ti<strong>en</strong>t lieu). A <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s producteurs,ces méthodologies peuv<strong>en</strong>t év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t être établies par un tiers (par exemple unbureau d’étu<strong>de</strong> spécialisé), toutefois sous <strong>la</strong> responsabilité du producteur <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>.Plusieurs approches sont possibles <strong>en</strong> matière <strong>de</strong> caractérisation radiologique <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>.Les méthodologies peuv<strong>en</strong>t se baser sur <strong>de</strong>s mesures directes <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>(spectrométries) associées à l’application <strong>de</strong> vecteurs isotopiques permettant <strong>de</strong> calculersur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> ces mesures l’activité <strong>de</strong>s isotopes difficilem<strong>en</strong>t mesurables (émetteursbêta purs, alpha ou gamma <strong>de</strong> faibles énergies). Les vecteurs isotopiques fourniss<strong>en</strong>t<strong>de</strong>s facteurs permettant <strong>de</strong> corréler l’activité <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s isotopes non mesurables àl’activité mesurée d’isotopes <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce. Ces vecteurs isotopiques sont établis sur <strong>la</strong>150/166
ase <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, <strong>de</strong> leur origine, <strong>de</strong> l’historique <strong>de</strong> contamination, ou ducont<strong>en</strong>u radiologique <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> simi<strong>la</strong>ires. Ils s’appui<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t sur <strong>de</strong>s rapportsd’activité bêta/alpha, sur <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> contamination surfacique, ou <strong>en</strong>core sur <strong>de</strong>srésultats <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong>structives réalisées <strong>en</strong> <strong>la</strong>boratoire (par ex. par le SCK·CEN). Ladétermination <strong>de</strong>s vecteurs isotopiques fait l’objet <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>ts dûm<strong>en</strong>targum<strong>en</strong>tés par les producteurs, et d’une évaluation critique par l’ONDRAF.D’autres méthodologies conduis<strong>en</strong>t à une estimation calculée <strong>de</strong>s activités isotopiquesrecherchées. Cette approche sommaire, plus «<strong>en</strong>veloppe», peut toutefois se justifier parles faibles niveaux d’activité att<strong>en</strong>dus, par <strong>de</strong>s spectres isotopiques réduits (voireuniques) ou par le faible impact radiologique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> considérés.Enfin, <strong>de</strong>s méthodologies se basant sur <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> débit <strong>de</strong> dose ou <strong>de</strong> <strong>la</strong>contamination surfacique transférable <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>, peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t s’appliquer.Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul et <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> compte <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s affectant les activitésdéterminées selon <strong>de</strong>s méthodologies agréées, fait <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t l’objet d’étu<strong>de</strong>s m<strong>en</strong>éespar l’ONDRAF. Ces étu<strong>de</strong>s conduiront à l’établissem<strong>en</strong>t d’une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul et <strong>de</strong>prise <strong>en</strong> compte <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s, ainsi que sur <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>s données radiologiquesrequises auprès <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> afin <strong>de</strong> répondre à cet objectif.Dans tous les cas <strong>de</strong> figure, les évaluations conduites par les experts <strong>de</strong> l’ONDRAFgarantiss<strong>en</strong>t l’adéquation <strong>de</strong>s méthodologies proposées avec <strong>la</strong> caractérisation requise.La procédure d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> mesure d’activité et <strong>de</strong>s méthodologies <strong>de</strong>caractérisation <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> comporte <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t les <strong>de</strong>ux étapes majeures suivantes : Expertise <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong>s méthodologies <strong>de</strong> caractérisationradiologiqueLes dossiers d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong>s méthodologies font l’objet d’uneexpertise approfondie.Cette expertise porte <strong>en</strong> particulier sur les points suivants : Principe <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure et <strong>de</strong>s méthodologies proposés; Adéquation <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong>s méthodologies par rapport à l’objectif; Description <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure; Description <strong>de</strong>s conditions opératoires <strong>de</strong> <strong>la</strong> mesure; Etalonnage <strong>de</strong>s chaînes <strong>de</strong> mesure; Calcul <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> détection; Mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong>s isotopes non mesurables; Calcul <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s; Campagnes d’intercomparaison <strong>de</strong> mesures; Mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s activités par colis DC; Programmes <strong>de</strong> Contrôle <strong>de</strong> Qualité <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure; Système <strong>de</strong> qualité appliqué aux équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure; Exemple d’application <strong>de</strong>s méthodologies proposées.L’expertise critique <strong>de</strong>s dossiers et méthodologies se déroule selon un processusitératif. Il aboutit à l’approbation formelle <strong>de</strong>s dossiers et méthodologies parl’ONDRAF. Exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production du premier lot <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>La première docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production formalisant <strong>la</strong> caractérisation radiologique <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> obt<strong>en</strong>ue par <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure et <strong>de</strong>sméthodologies approuvés par l’ONDRAF, fait l’objet d’un exam<strong>en</strong> approfondi. Cetexam<strong>en</strong> porte <strong>en</strong> particulier sur les points suivants : Vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les activités déc<strong>la</strong>rées et le domaine applicable <strong>de</strong>s151/166
équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure et <strong>de</strong>s méthodologies; Vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> bonne application <strong>de</strong>s méthodologies; Vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> aux critères d’acceptationradiologiques applicables.L’exam<strong>en</strong> du volet radiologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> première docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production peutconduire à <strong>la</strong> révision <strong>de</strong>s méthodologies et/ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong>mesure et/ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production.L’approbation <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> mesure, <strong>de</strong>s méthodologiesradiologiques et du volet radiologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production, conduit à <strong>la</strong>délivrance <strong>de</strong>s agrém<strong>en</strong>ts « radiologiques » requis.Agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s méthodologies <strong>de</strong> caractérisation chimique <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong>La caractérisation chimique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> doit se conformer aux prescriptionsdéfinies par l’ONDRAF dans les critères d’acceptation applicables. En pratique, cesprescriptions se déclin<strong>en</strong>t <strong>en</strong> critères d’acceptation spécifiques (par ex. exclusion oulimitation quantitative <strong>de</strong> matériaux ou élém<strong>en</strong>ts dûm<strong>en</strong>t i<strong>de</strong>ntifiés) ou génériques(exclusion ou limitation <strong>de</strong>s matériaux – non spécifiés – susceptibles <strong>de</strong> porter préjudice àl’intégrité <strong>de</strong>s colis DC).Pour répondre aux critères spécifiques, les producteurs sont t<strong>en</strong>us d’établir, <strong>de</strong> justifier et<strong>de</strong> proposer, <strong>de</strong>s méthodologies garantissant <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>aux critères quantitatifs applicables.Pour répondre aux critères génériques, les producteurs sont t<strong>en</strong>us d’établir, <strong>de</strong> justifier et<strong>de</strong> proposer à <strong>la</strong> fois l’ét<strong>en</strong>due <strong>de</strong> <strong>la</strong> caractérisation chimique <strong>de</strong> leurs <strong>déchets</strong>, ainsi queles mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong>s conc<strong>en</strong>trations <strong>en</strong> matériaux ou élém<strong>en</strong>ts qui <strong>en</strong> fontpartie.Les évaluations pratiquées par les experts <strong>de</strong> l’ONDRAF garantiss<strong>en</strong>t l’adéquation <strong>de</strong>sméthodologies proposées avec <strong>la</strong> caractérisation requise (critères spécifiques), etassur<strong>en</strong>t <strong>la</strong> compatibilité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> avec les composants <strong>de</strong>s colis DC (critèresgénériques).La procédure d’agrém<strong>en</strong>t comporte les <strong>de</strong>ux étapes majeures suivantes : Exam<strong>en</strong> <strong>de</strong>s méthodologiesLes méthodologies font l’objet d’une analyse approfondie conduite. Cette analyse porte<strong>en</strong> particulier sur les points suivants : Principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologie proposée; Adéquation <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologie proposée par rapport à l’objectif; Mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong>s caractéristiques chimiques par colis; Exemple d’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologie proposée.L’analyse critique <strong>de</strong>s méthodologies se déroule selon un processus itératif. Il aboutit àl’approbation formelle <strong>de</strong>s méthodologies par l’ONDRAF. Exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production du premier lot <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>La première docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production formalisant <strong>la</strong> caractérisation chimique <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> fait l’objet d’un exam<strong>en</strong> approfondi. Cet exam<strong>en</strong> porte <strong>en</strong> particuliersur les points suivants : Vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> caractérisation docum<strong>en</strong>tée et le domaineapplicable <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologie; Vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> bonne application <strong>de</strong> <strong>la</strong> méthodologie; Vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> aux critères d’acceptationapplicables.152/166
L’exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> première docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production peut conduire à <strong>la</strong> révision <strong>de</strong> <strong>la</strong>méthodologie et/ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production.L’approbation <strong>de</strong>s méthodologies et <strong>de</strong> <strong>la</strong> docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> production, conduit à <strong>la</strong>délivrance <strong>de</strong> l’agrém<strong>en</strong>t requis (généralem<strong>en</strong>t inclus dans l’agrém<strong>en</strong>t du procédé <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>).La quantification <strong>de</strong>s méthodologies <strong>de</strong> caractérisation chimique <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> est inclusedans celle <strong>de</strong>s procédés et instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t/conditionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong>.Procédure <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong> l’agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions d’<strong>en</strong>treposage<strong>de</strong> colis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> conditionnésLa procédure d’agrém<strong>en</strong>t comporte les <strong>de</strong>ux étapes majeures suivantes : Exam<strong>en</strong> du dossier d’agrém<strong>en</strong>t établi par l’exploitantLa procédure d’agrém<strong>en</strong>t s’articule principalem<strong>en</strong>t autour <strong>de</strong> l’analyse critique itérativeet concertée d’une docum<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>scriptive et justificative <strong>de</strong>s conditions etéquipem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treposage permettant d’assurer l’intégrité et <strong>la</strong> durabilité <strong>de</strong>s colis DC<strong>en</strong>treposés <strong>en</strong> att<strong>en</strong>te d’une évacuation finale. Cette docum<strong>en</strong>tation (dossierd’agrém<strong>en</strong>t) est établie par l’exploitant <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>en</strong> concertation avec l’ONDRAF.Elle respecte toutefois un canevas et cont<strong>en</strong>u-type fixés par l’ONDRAF. Le cont<strong>en</strong>u dudossier d’agrém<strong>en</strong>t se compose principalem<strong>en</strong>t comme suit : Description <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion et m<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s docum<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce (dossiers <strong>de</strong>sûreté et d’impact sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, autorisation d’exploitation du bâtim<strong>en</strong>t); I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s critères spécifiques applicables à l’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s colis DC; Description <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong>s conditions et équipem<strong>en</strong>ts assurant le respect<strong>de</strong>s critères applicables; Justification étayant l’aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s conditions et équipem<strong>en</strong>ts à garantir l’intégrité et <strong>la</strong>durabilité <strong>de</strong>s colis DC <strong>en</strong>treposés; Argum<strong>en</strong>taire étayant l’aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s conditions et équipem<strong>en</strong>ts mis <strong>en</strong> œuvre pourrépondre à chacun <strong>de</strong>s critères applicables; I<strong>de</strong>ntification et justification <strong>de</strong>s paramètres critiques <strong>de</strong>s conditions et équipem<strong>en</strong>tsd’<strong>en</strong>treposage; Liste <strong>de</strong>s instructions <strong>de</strong> conduite <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> rapport avec le respect <strong>de</strong>scritères applicables; Description <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> Contrôle et d’Assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Qualité appliqués àl’instal<strong>la</strong>tion soumise à l’agrém<strong>en</strong>t.L’exam<strong>en</strong> critique <strong>de</strong>s dossiers se déroule selon un processus itératif. Il aboutit àl’approbation formelle <strong>de</strong>s dossiers par l’ONDRAF. Audits (inspections) techniquesL’ONDRAF réalise <strong>de</strong>s audits techniques (inspections) dans les instal<strong>la</strong>tionsd’<strong>en</strong>treposage <strong>de</strong>s colis DC <strong>de</strong> manière à vérifier <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre effective <strong>de</strong>sconditions et équipem<strong>en</strong>ts décrits et justifiés dans les dossiers d’agrém<strong>en</strong>t. Cesvérifications port<strong>en</strong>t <strong>en</strong> particulier sur les points suivants : Cohér<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les conditions et équipem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treposage, et le cont<strong>en</strong>u dudossier d’agrém<strong>en</strong>t correspondant; Application effective <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> Contrôle et d’Assurance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Qualité; Conformité <strong>de</strong>s paramètres critiques <strong>de</strong>s conditions et équipem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treposageaux données du dossier d’agrém<strong>en</strong>t correspondant; Consultation <strong>de</strong>s instructions <strong>de</strong> conduite <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> rapport avec lemainti<strong>en</strong> <strong>de</strong> l’intégrité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> durabilité <strong>de</strong>s colis DC <strong>en</strong>treposés.153/166
Ces audits sont conduits à partir <strong>de</strong> manuels d’inspection établis par l’ONDRAF sur <strong>la</strong>base du cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s dossiers d’agrém<strong>en</strong>t. Ils font l’objet <strong>de</strong> rapports officiels établis parl’ONDRAF et communiqués à l’exploitant. Ces audits peuv<strong>en</strong>t conduire à l’adaptation <strong>de</strong>sdossiers d’agrém<strong>en</strong>t et/ou <strong>de</strong>s instructions <strong>de</strong> conduites et/ou <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions à agréer.L’approbation du dossier d’agrém<strong>en</strong>t, jointe à l’obt<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> résultats d’auditssatisfaisants, conduit à <strong>la</strong> délivrance <strong>de</strong>s agrém<strong>en</strong>ts requis.Délivrance et reconduction <strong>de</strong>s agrém<strong>en</strong>tsConformém<strong>en</strong>t à l’arrêté royal d’application, les agrém<strong>en</strong>ts sont délivrés pour une pério<strong>de</strong>maximale <strong>de</strong> cinq ans. Ils sont assujettis à <strong>de</strong>s limites et conditions <strong>de</strong> validité que lesproducteurs sont t<strong>en</strong>us <strong>de</strong> respecter. Des audits techniques occasionnels peuv<strong>en</strong>t êtreréalisés <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> vérifier, au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s agrém<strong>en</strong>ts, le respect<strong>de</strong>s limites et conditions imposées.Les agrém<strong>en</strong>ts arrivés au terme <strong>de</strong> leur pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> validité, peuv<strong>en</strong>t être prolongés auterme d’une procédure <strong>de</strong> reconduction. Cette procédure comporte les étapes principalessuivantes (synthèse) : Réexam<strong>en</strong>, le cas échéant, <strong>de</strong> <strong>la</strong> (nouvelle) docum<strong>en</strong>tation d’agrém<strong>en</strong>t transmise parle producteur; Réalisation d’audits techniques dans les instal<strong>la</strong>tions à réagréer; Vérification par voie docum<strong>en</strong>taire (dossiers d’agrém<strong>en</strong>t) et pratique (audits) durespect <strong>de</strong>s limites et conditions <strong>de</strong> validité au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>l’agrém<strong>en</strong>t arrivé à échéance; Vérification par voie docum<strong>en</strong>taire (dossiers <strong>de</strong> production) <strong>de</strong> l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> nonconformités récurr<strong>en</strong>tes affectant les <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> produits au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> validité écoulée; Vérification par voie docum<strong>en</strong>taire (dossiers d’agrém<strong>en</strong>t) et pratique (audits) <strong>de</strong> <strong>la</strong>prise <strong>en</strong> compte effective <strong>de</strong>s actions correctives év<strong>en</strong>tuelles conditionnant leréagrém<strong>en</strong>t; Reconduction <strong>de</strong> l’agrém<strong>en</strong>t toutefois assujetti à <strong>de</strong> nouvelles limites et conditions <strong>de</strong>validité.154/166
Annexe F : le formu<strong>la</strong>ire S/LDEMANDE D'ACCEPTATION ET D'ENLEVEMENT DE DECHETS RADIOACTIFS NON CONDITIONNESFormu<strong>la</strong>ire S/L1. Numéro S/L : 600111 2. Nom du producteur : Fictif International SAAdresse : Rue Michiels, 24Date : 28/11/2007 Localité : 1180 UccleNombre d'annexes : 0 Téléphone : 02 212 10 11 Fax : 02 / 218 51 653. Unité interne <strong>de</strong> production : LaboLieu d'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t : Labo ONDRAFAv<strong>en</strong>ue <strong>de</strong>s Arts, 144. I<strong>de</strong>ntifications générales 1210 BruxellesNuméro du fluxFII-011-NCatégorie du déchet XYZ : A17 5. Aspects quantitatifsDescription déchet AO : M0 Nombre OE : 1Embal<strong>la</strong>ge primaire PV : 11 Volume (m³) : 0,200Unité d'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t OE : 26 Masse nette/brute (kg) : 180,06. Caractéristiques radiologiquesACTIVITE TOTALE (Bq)Bèta/Gamma : 2,15E+08 Type <strong>de</strong> détermination : ME / RA / BRAlpha : 5,17E+04 Type <strong>de</strong> détermination : ME / RA / BRDate <strong>de</strong> détermination : 12/12/2007CONTAMINATION SURFACIQUE TRANSFERABLE Service <strong>de</strong> contrôle physiqueBèta/Gamma < 0.4 Bq/cm² et Alpha < 0.04 Bq/cm² X Oui Non du producteur ou Organisme AgrééSi non, spécifiez : Bèta/Gamma: (Bq/cm²)Alpha :(Bq/cm²)DEBIT DE DOSE A LA SURFACE (mSv/h)Colis primaire et unit é d'<strong>en</strong>lèv. < 2 mSv/h ? X Oui NonValeur max. <strong>de</strong>s unités d'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t : 6,0000E-02 Date, nom et s ignatureDate <strong>de</strong> mesure du débit <strong>de</strong> dose : 12/12/2007Réf. rapportIsotopes à déc<strong>la</strong>rer – activité (Bq)Isotopes complém.H-3 : 0,00E+00 Ni-63 : 1,42E+07 I-129 : 7,74E+01 U-234 : 4,43E+00 Pu-238 : 2,03E+04 Isot. : ActiviteitC-14 : 1,58E+05 Sr-90 : 3,69E+05 I-131 : 0 U-235 : 1,21E-01 Pu-239 : 1,72E+03 Mn-54 2,66E+07CI-36 : 0,00E+00 Nb-94: 5,86E+04 Cs-137: 2,40E+07 U-238 : 1,09E+00 Pu-240 : 3,07E+03 Cm-244 2,38E+04Co-60: 4,08E+07 Tc-99 : 9,23E+03 Ra-226: 0 Np-237 : 9,21E-01 Pu-241 : 7,48E+05 Co-58 3,57E+07Ni-59 : 1,81E+05 I-125 : 0,00E+00 Th-232: 0 Am-241 : 2,98E+03 Pu-242 : 1,27E+01 Fe-55 4,50E+077. Caractéristiques spécifiques 8. Transport et bon <strong>de</strong> transfertContamination biologique ? X Non Oui Transport par moy<strong>en</strong>s propres ? X Non OuiMatières toxiques/dangereuses ? X Non Oui Déc<strong>la</strong>ration matières fissiles ? X Non OuiRéf. <strong>de</strong> l'autorisation <strong>de</strong> transport :9. RemarquesRéf. du bon <strong>de</strong> transfert :Réf. méthodologie caractérisation radiologiqueLe soussigné déc<strong>la</strong>re que les <strong>déchets</strong> sont conforme aux critères d'acceptation <strong>en</strong> vigueur.Date, nom et signature du responsible du producteurExpliquons <strong>la</strong> structure du formu<strong>la</strong>ire et son cont<strong>en</strong>u par le détail :Rubrique 1 Le numéro, unique, du formu<strong>la</strong>ire S/L, préimprimé, sauf si le producteur dispose <strong>de</strong> sapropre numérotation préa<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t conv<strong>en</strong>ue avec l'ONDRAF.155/166
La date d’établissem<strong>en</strong>t du formu<strong>la</strong>ire par le producteur. Le nombre d’annexes jointes à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Ces annexes sont le plus souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sfiches repr<strong>en</strong>ant les données propres à chaque embal<strong>la</strong>ge individuel <strong>de</strong> <strong>déchets</strong>composant le lot (voir aussi rubrique 5), mais aussi <strong>de</strong>s r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts ou remarquescomplém<strong>en</strong>taires re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t dans son <strong>en</strong>semble, ou <strong>de</strong>sphotos.Rubrique 2 Le nom, l’adresse, le numéro <strong>de</strong> téléphone et év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t le numéro <strong>de</strong> fax duproducteur.Rubrique 3 Le lieu <strong>de</strong> production interne ou l’unité interne (par exemple, <strong>la</strong>bo “x”, bâtim<strong>en</strong>t “y”,instal<strong>la</strong>tion “z”, …) d’où provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t les <strong>déchets</strong>. Le lieu d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t, qui doit être complété dans le cas où le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur ne transportepas les <strong>déchets</strong> par ses propres moy<strong>en</strong>s, ce qui est souv<strong>en</strong>t le cas.Rubrique 4 N° flux <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> : i<strong>de</strong>ntificateur utilisé pour les producteurs réguliers (“gros” et “petitsconv<strong>en</strong>tionnés”), permettant <strong>de</strong> simplifier certaines étapes <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure. Ce numéro<strong>de</strong> flux constitue <strong>en</strong> effet référ<strong>en</strong>ce au dossier correspondant d'agrém<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>set équipem<strong>en</strong>ts assurant <strong>la</strong> conformité radiologique et physico-chimique <strong>de</strong>s DNCappart<strong>en</strong>ant à ce flux. Quatre co<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tifs aux catégorie, type <strong>de</strong> matériau et embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>. Onretrouve <strong>en</strong> tête <strong>de</strong> liste le co<strong>de</strong> XYZ r<strong>en</strong>contré au chapitre trois et détaillé à l'annexe C.Rubrique 5 Le nombre d’unités d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t (OE), c'est-à-dire <strong>de</strong> colis individuels constituant lelot. Toutes les unités d'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t doiv<strong>en</strong>t impérativem<strong>en</strong>t cont<strong>en</strong>ir le même type XYZ<strong>de</strong> déchet. Le volume total, <strong>en</strong> m³, <strong>de</strong> toutes les unités d’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t prises <strong>en</strong>semble. La masse, <strong>en</strong> kg, <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> (selon <strong>la</strong> catégorie : masse nette ou brute).Rubrique 6La partie consacrée aux données radiologiques, et <strong>la</strong> plus importante : Les activités totales par type d'émetteur, ainsi que <strong>la</strong> date et le type <strong>de</strong> détermination. Le signalem<strong>en</strong>t d'une prés<strong>en</strong>ce év<strong>en</strong>tuelle <strong>de</strong> contamination radiologique à <strong>la</strong> surface<strong>de</strong>s embal<strong>la</strong>ges, ess<strong>en</strong>tiel pour <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion du risque <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong> contaminationlors <strong>de</strong> <strong>la</strong> manut<strong>en</strong>tion et du transport <strong>de</strong>s colis. Le débit <strong>de</strong> dose et sa date <strong>de</strong> mesure, ess<strong>en</strong>tiel pour <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion du risqued'irradiation lors <strong>de</strong> ces mêmes opérations <strong>de</strong> manut<strong>en</strong>tion et <strong>de</strong> <strong>la</strong> suite du traitem<strong>en</strong>t. Les activités pour chacun <strong>de</strong>s 25 radionucléi<strong>de</strong>s dits « critiques » appart<strong>en</strong>ant à uneliste pré-établie. Une p<strong>la</strong>ce est égalem<strong>en</strong>t libre pour <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>ssupplém<strong>en</strong>taires, dont <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration peut aussi faire l'objet d'annexes. Un cadre pour les signature et cachet du service <strong>de</strong> contrôle physique, c'est-à-dire <strong>en</strong>charge <strong>de</strong>s mesures radiologiques, du producteur ou d'un organisme agréé si leproducteur ne dispose par <strong>de</strong> son propre service <strong>de</strong> contrôle physique (cas <strong>de</strong>s petitsproducteurs).156/166
Lorsque le lot faisant l'objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est constitué <strong>de</strong> plusieurs unitésd'<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t, ces données sont détaillées, par unité, dans les annexes jointes.Rubrique 7 Contamination biologique, substances toxiques et dangereuses : m<strong>en</strong>tion év<strong>en</strong>tuelle <strong>de</strong><strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce d'un risque non relié au caractère radioactif <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.Rubrique 8 Transport : indique si le transport est assuré par le producteur par ses propres moy<strong>en</strong>sou non. Si tel est le cas, <strong>la</strong> référ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’autorisation <strong>de</strong> transport est m<strong>en</strong>tionnée. M<strong>en</strong>tion matières fissiles : indique si les <strong>déchets</strong> conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s matières fissilessoumises à <strong>de</strong>s règlem<strong>en</strong>tations particulières. Si tel est le cas, <strong>la</strong> référ<strong>en</strong>ce dudocum<strong>en</strong>t ad hoc est m<strong>en</strong>tionnée.Rubrique 9 Les remarques év<strong>en</strong>tuelles du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur, si leur brièveté ne justifie pas une annexeséparée.Rubrique 10 Date et signature par <strong>la</strong> personne qui intervi<strong>en</strong>t comme responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s<strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> du producteur.157/166
ActivationGlossairePhénomène t<strong>en</strong>dant à r<strong>en</strong>dre <strong>radioactifs</strong> certains nucléi<strong>de</strong>s, <strong>en</strong> particulier au sein <strong>de</strong>smatériaux <strong>de</strong> structure <strong>de</strong>s réacteurs nucléaires, par bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t par <strong>de</strong>s neutrons oud'autres particules.ActivitéLe nombre <strong>de</strong> désintégrations spontanées <strong>de</strong> l'atome dans une quantité <strong>de</strong> matièreradioactive par unité <strong>de</strong> temps. Elle est mesurée <strong>en</strong> unités becquerel, <strong>en</strong> abrégé Bq.L'unité utilisée antérieurem<strong>en</strong>t était le curie, <strong>en</strong> abrégé Ci.AENAg<strong>en</strong>ce pour l'Energie Nucléaire <strong>de</strong> l'Organisation <strong>de</strong> Coopération et <strong>de</strong> Développem<strong>en</strong>tEconomiques (OCDE), Paris, France.AFCNAg<strong>en</strong>ce Fédérale <strong>de</strong> Contrôle Nucléaire, Bruxelles.AIEAAg<strong>en</strong>ce Internationale <strong>de</strong> l'Energie Atomique: ag<strong>en</strong>ce faisant partie <strong>de</strong>s Nations Unies etqui a son siège à Vi<strong>en</strong>ne, <strong>en</strong> Autriche.AquifèreUnité géologique perméable et poreuse qui conti<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s quantités d'eau exploitable, parexemple par pompage.AREVA NCAnci<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t « COGEMA », Compagnie générale <strong>de</strong>s matières nucléaires : <strong>en</strong>treprisefrançaise qui exploite notamm<strong>en</strong>t une usine <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> combustible nucléaire usé(ou irradié) à La Hague (Normandie).ArgileRoche t<strong>en</strong>dre ou légèrem<strong>en</strong>t solidifiée qui est constituée principalem<strong>en</strong>t par <strong>de</strong> trèspetites particules (inférieures à 2 microns) d'alumino-silicates. L'argile possè<strong>de</strong> le pouvoir<strong>de</strong> ral<strong>en</strong>tir le dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s et est très peu perméable à l'eau. En outre,l'argile est une roche plus ou moins p<strong>la</strong>stique dont le pouvoir réparateur est important :les ouvertures créées dans l'argile (fissures, cassures) ont t<strong>en</strong>dance à se refermerspontaném<strong>en</strong>t.BarrièreToute protection naturelle ou artificielle contre <strong>la</strong> dissémination <strong>de</strong>s matières radioactiveset contre le rayonnem<strong>en</strong>t ionisant.Becquerel (Bq)Unité utilisée pour <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité. 1 Bq correspond à une désintégrationsubie par un radionucléi<strong>de</strong> par secon<strong>de</strong>. Cette unité remp<strong>la</strong>ce le curie.BelgoprocessEntreprise-filiale <strong>de</strong> l'ONDRAF située à Dessel et assurant le traitem<strong>en</strong>t, leconditionnem<strong>en</strong>t et l'<strong>en</strong>treposage provisoire <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> belges. Belgoprocessintervi<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t dans le cadre du démantèlem<strong>en</strong>t d'instal<strong>la</strong>tions nucléaires mises àl'arrêt.BiosphèrePartie <strong>de</strong> l'écorce terrestre, <strong>de</strong>s océans et <strong>de</strong> l'atmosphère où les organismes vivants sedévelopp<strong>en</strong>t et viv<strong>en</strong>t.158/166
BitumageInclusion dans du bitume (goudron, asphalte). Métho<strong>de</strong> utilisée pour confiner certainstypes définis <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> soli<strong>de</strong>s, liqui<strong>de</strong>s voire même <strong>de</strong>s boues prov<strong>en</strong>ant dutraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>s <strong>radioactifs</strong>.BlindageDispositif utilisé pour assurer une protection contre une source radioactive ou diminuerson int<strong>en</strong>sité.BouclierBlindage assurant <strong>la</strong> protection biologique ou thermique autour d'un réacteur nucléaire.BR1Belgian Reactor 1 : premier réacteur nucléaire belge, mis <strong>en</strong> service par le SCK·CEN <strong>en</strong>1956.BR2Belgian Reactor 2 : réacteur d'essai du SCK·CEN, à haut flux <strong>de</strong> neutrons, utilisé pourl'irradiation <strong>de</strong> matériaux. Il a été mis <strong>en</strong> service par le SCK·CEN <strong>en</strong> 1963.BR3Belgian Reactor 3 : premier réacteur <strong>de</strong> recherche europé<strong>en</strong> à eau pressurisée, mis <strong>en</strong>service par le SCK·CEN <strong>en</strong> 1962 et <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t.C<strong>en</strong>trale nucléaireInstal<strong>la</strong>tion productrice d'électricité dans <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> chaleur est produite par fissionnucléaire dans un réacteur nucléaire.Champ lointain (ou géosphère) d'une instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôtEnsemble formé <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation-hôte et <strong>de</strong>s aquifères qui <strong>en</strong>tour<strong>en</strong>t ce dépôt.Champ procheEnsemble formé par les composants <strong>de</strong> l'instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt, y compris les <strong>déchets</strong><strong>radioactifs</strong>, et <strong>la</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation-hôte perturbée par l'excavation.CILVAAcronyme formé par l'expression "C<strong>en</strong>trale Infrastructuur voor Laagactief Vast Afval",autrem<strong>en</strong>t dit une infrastructure c<strong>en</strong>trale pour le traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> soli<strong>de</strong>s <strong>de</strong> faibleactivité sur le site <strong>de</strong> Belgoprocess.Cim<strong>en</strong>tationInclusion dans du cim<strong>en</strong>t ou du béton. Métho<strong>de</strong> utilisée pour confiner certains types <strong>de</strong><strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>, soit soli<strong>de</strong>s (cim<strong>en</strong>tation hétérogène), soit liqui<strong>de</strong>s (cim<strong>en</strong>tationhomogène).CIPRCommission Internationale <strong>de</strong> Protection Radiologique.Combustible nucléaireMatière fissile, c'est-à-dire une matière qui produit <strong>de</strong> l'énergie par <strong>la</strong> fission du noyaudans un réacteur nucléaire par l'intermédiaire d'une réaction <strong>en</strong> chaîne contrôlée.L'énergie qui est <strong>en</strong>fermée dans les noyaux est libérée sous forme <strong>de</strong> chaleur. Commeexemples <strong>de</strong> matières fissiles, on peut m<strong>en</strong>tionner l'uranium 235 et le plutonium 239.Combustible nucléaire <strong>en</strong>richiCombustible nucléaire cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> l'uranium qui a été <strong>en</strong>richi <strong>en</strong> un ou plusieurs <strong>de</strong> sesisotopes fissiles ou auquel ont été ajoutées <strong>de</strong>s nucléi<strong>de</strong>s fissiles chimiquem<strong>en</strong>tdiffér<strong>en</strong>ts.159/166
Combustible nucléaire irradié (ou usé ou épuisé)Pastilles <strong>de</strong> combustible nucléaire dont le niveau d'irradiation atteint les limites dans unréacteur déterminé et qui sont <strong>en</strong>levées du réacteur après utilisation parce qu'elles nepeuv<strong>en</strong>t plus sout<strong>en</strong>ir <strong>la</strong> production d'énergie sans avoir subi un traitem<strong>en</strong>t approprié.Compaction (ou supercompaction)Technique industrielle qui consiste à écraser à l'ai<strong>de</strong> d'une presse les matériaux <strong>de</strong>manière à réduire, à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés divers, leur volume.Compteur Geiger-MüllerInstrum<strong>en</strong>t pour <strong>la</strong> détection et <strong>la</strong> mesure du rayonnem<strong>en</strong>t. Est constitué d'un tube rempli<strong>de</strong> gaz dans lequel une décharge électrique a lieu <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> pénétration d'unrayonnem<strong>en</strong>t ionisant. Les décharges sont comptées et constitu<strong>en</strong>t une mesure <strong>de</strong>l'int<strong>en</strong>sité du rayonnem<strong>en</strong>t.Confinem<strong>en</strong>tEnsemble <strong>de</strong> mesures et <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s pour protéger l'homme et l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t contre <strong>la</strong>dissémination <strong>de</strong>s radionucléi<strong>de</strong>s dans <strong>la</strong> biosphère.Contamination (radioactive)Prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> matières radioactives dans un matériau, à <strong>la</strong> surface d'objets ou à tout<strong>en</strong>droit où cette prés<strong>en</strong>ce est indésirable ou peut avoir <strong>de</strong>s conséqu<strong>en</strong>ces nocives. Pourl'homme, on opère une distinction <strong>en</strong>tre contamination externe ou interne. Dans le casd'une contamination interne, les particules radioactives sont prés<strong>en</strong>tes dans le corps, parexemple par inha<strong>la</strong>tion ou par in<strong>gestion</strong> <strong>de</strong> soli<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong> gaz contaminés par<strong>de</strong>s matières radioactives. Dans le cas d'une contamination externe, les substancesradioactives sont <strong>en</strong> contact avec <strong>la</strong> peau ou les parties externes <strong>de</strong> l'organisme.Curie (Ci)Anci<strong>en</strong>ne unité utilisée pour <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité. Officiellem<strong>en</strong>t remp<strong>la</strong>cée <strong>en</strong>1985 par le becquerel (Bq). Un curie correspond à l'activité d'un 1 g <strong>de</strong> radium et vaut 37milliards <strong>de</strong> becquerel.Cycle du combustible nucléaireLes étapes nécessaires pour pouvoir utiliser l'uranium comme combustible nucléaire pour<strong>la</strong> production d'électricité. Ces étapes compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t l'extraction et <strong>la</strong> préparation duminerai d'uranium, l'<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l'uranium, <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong> pastilles <strong>de</strong> matièrefissile et d'élém<strong>en</strong>ts combustibles et leur utilisation dans un réacteur, le retraitem<strong>en</strong>tchimique év<strong>en</strong>tuel <strong>de</strong>stiné à récupérer l'uranium qui subsiste dans le combustible irradiéainsi que le plutonium obt<strong>en</strong>u, <strong>de</strong> même que <strong>la</strong> refabrication év<strong>en</strong>tuelle <strong>de</strong> nouveauxélém<strong>en</strong>ts combustibles.Déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>tEnsemble <strong>de</strong>s opérations administratives et techniques qui permett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> supprimer uneinstal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste d’instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées, conformém<strong>en</strong>t aux dispositions durèglem<strong>en</strong>t général <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong>s travailleurs et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tcontre les dangers <strong>de</strong>s radiations ionisantes (RGPTRI).DécontaminationElimination ou diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> contamination radioactive dans ou à <strong>la</strong> surface <strong>de</strong>bâtim<strong>en</strong>ts, terrains, objets ou organismes vivants. Cette décontamination peut êtreeffectuée par <strong>de</strong>s procédés <strong>de</strong> nature mécanique, chimique ou électrochimique.Décroissance radioactiveDécroissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité avec le temps par l'émission <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>ts, quirésulte <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation progressive d'élém<strong>en</strong>ts <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> élém<strong>en</strong>ts stables.Demi-vieVoir pério<strong>de</strong> radioactive.160/166
Désintégration nucléaireTransformation d'un noyau comportant <strong>la</strong> scission <strong>en</strong> plusieurs noyaux ou l'émission <strong>de</strong>particules. Cette transformation peut être spontanée ou provoquée par un noyau ou uneparticule.Désintégration radioactiveTransformation nucléaire spontanée d'un noyau due à sa radioactivité. Ce phénomèneprovoque une décroissance radioactive.Dose absorbéeQuantité d'énergie transférée par le rayonnem<strong>en</strong>t ionisant à une matière par unité <strong>de</strong>masse <strong>de</strong> cette matière. L'unité pour <strong>la</strong> dose absorbée est le gray (Gy). 1 graycorrespond à 1 joule par kilo.Dose efficace (effective)Certains tissus et organes sont plus s<strong>en</strong>sibles aux rayonnem<strong>en</strong>ts que d'autres. Pour t<strong>en</strong>ircompte <strong>de</strong> cette caractéristique, <strong>la</strong> dose équival<strong>en</strong>te est pondérée par un facteur <strong>de</strong>risque spécifique pour chaque tissu ou organe <strong>de</strong> manière à donner <strong>la</strong> dose efficace, quiest <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s doses équival<strong>en</strong>tes pondérées délivrées aux différ<strong>en</strong>ts tissus ouorganes. L'unité utilisée ici est le sievert.Dose équival<strong>en</strong>teProduit <strong>de</strong> <strong>la</strong> dose absorbée et d'un coeffici<strong>en</strong>t qui dép<strong>en</strong>d <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature du rayonnem<strong>en</strong>t.L'unité pour <strong>la</strong> dose équival<strong>en</strong>te est le sievert (Sv).DosimètrePetit instrum<strong>en</strong>t portatif pour <strong>la</strong> mesure et l'<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> dose absorbéepersonnelle totale.ElectronParticule élém<strong>en</strong>taire à charge négative (sauf spécification contraire) qui <strong>en</strong>toure l<strong>en</strong>oyau à charge positive. Les électrons détermin<strong>en</strong>t les propriétés chimiques <strong>de</strong> l'atome.Elém<strong>en</strong>t chimiqueSubstance composée <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t d'atomes <strong>de</strong> même numéro atomique et qui ne peutplus être décomposée par voie chimique. On connaît <strong>actuelle</strong>m<strong>en</strong>t 112 élém<strong>en</strong>ts, dont 92sont naturels et 20 artificiels. Chaque élém<strong>en</strong>t possè<strong>de</strong> un nombre spécifique <strong>de</strong> protons,que l'on appelle nombre atomique Z, dans son noyau. Parmi les exemples, on peut citerl'hydrogène (Z = 1), le carbone (Z = 6), l'or (Z = 79), le plomb (Z = 82) et l'uranium (Z =92).Embal<strong>la</strong>ge primairePremière <strong>en</strong>veloppe du déchet, y compris le blindage interne év<strong>en</strong>tuel.Energie nucléaireEnergie <strong>de</strong>s noyaux. L'énergie <strong>en</strong>fermée dans les noyaux peut être libérée <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxmanières, selon <strong>la</strong> célèbre formule E = mc² d'Einstein : par désintégration radioactive oupar fission du noyau. Par énergie nucléaire, on <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d généralem<strong>en</strong>t l'énergie produitepar un réacteur nucléaire lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> fission.Enrichissem<strong>en</strong>tProcessus par lequel est accrue <strong>la</strong> t<strong>en</strong>eur d'un élém<strong>en</strong>t chimique <strong>en</strong> un <strong>de</strong> ses isotopes.Dans le cas <strong>de</strong> l'uranium, il permet d'augm<strong>en</strong>ter par divers procédés (diffusion gazeuse,ultrac<strong>en</strong>trifugation, excitation sélective par <strong>la</strong>ser) <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong> l'isotope 235 parrapport à l'isotope 238 prédominant dans l'uranium naturel.(GIE) EURIDICE"European Un<strong>de</strong>rground Research Infrastructure for Disposal of nuclear waste in C<strong>la</strong>yEnvironm<strong>en</strong>t". Le GIE EURIDICE est le Groupem<strong>en</strong>t d'Intérêt Economique (GIE) <strong>en</strong>trel'ONDRAF et le SCK·CEN, le C<strong>en</strong>tre d'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'Energie Nucléaire. LE GIE EURIDICE a161/166
vu le jour à Mol <strong>en</strong> décembre 2000. Il existait cep<strong>en</strong>dant déjà <strong>de</strong>puis 1995 sous le nomGIE PRACLAY.EUROCHEMICUsine-pilote <strong>de</strong> retraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> combustible nucléaire usé, sur le site 1 <strong>de</strong> Belgoprocess.FBFC InternationalFranco-belge <strong>de</strong> fabrication <strong>de</strong> combustibles International : fabricant <strong>de</strong> combustiblesnucléaires à Dessel.Fissile (matière)Qui peut subir <strong>la</strong> fission par absorption <strong>de</strong> neutrons.Fission nucléaireDivision d'un noyau <strong>en</strong> au moins <strong>de</strong>ux autres noyaux et libération d'une quantitére<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t importante d'énergie. Deux ou trois neutrons sont généralem<strong>en</strong>t libérés aucours <strong>de</strong> cette transformation et peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>traîner d'autres réactions <strong>de</strong> fission dansd'autres noyaux, suscitant ainsi une réaction <strong>en</strong> chaîne. Elle s'accompagne aussi <strong>de</strong>l'émission <strong>de</strong> photons gamma.Fond <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t naturelRadiations ionisantes d'origine naturelle, dont les rayonnem<strong>en</strong>ts cosmiques et lesradiations naturelles prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong>s matériaux <strong>radioactifs</strong>.Gray (Gy)Unité pour <strong>la</strong> dose absorbée. Exprime <strong>la</strong> quantité d'énergie transmise par le rayonnem<strong>en</strong>tionisant à une matière par unité <strong>de</strong> masse <strong>de</strong> cette matière. 1 gray correspond à 1joule/kilo.HADES"High-Activity Disposal Experim<strong>en</strong>tal Site". Laboratoire <strong>de</strong> recherche souterrain installédans une couche d'argile profon<strong>de</strong>, l'Argile <strong>de</strong> Boom, sous le site du SCK·CEN à Mol. Ilest géré et exploité par le GIE EURIDICE. HADES apporte sa contribution aux étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>faisabilité du dépôt final <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> dans <strong>de</strong>s couches profon<strong>de</strong>s d'argile.Instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dépôt finalConstruction <strong>de</strong>stinée à recevoir <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> dans une optique <strong>de</strong> <strong>gestion</strong>passive à long terme.Instal<strong>la</strong>tion nucléaireEnsemble d'objets, d'appareils, <strong>de</strong> dispositifs ou <strong>de</strong> bâtim<strong>en</strong>ts constituant à l'intérieur d'unétablissem<strong>en</strong>t une unité technique où sont exercées une ou <strong>de</strong>s pratiques ou activitésprofessionnelles faisant appel aux rayonnem<strong>en</strong>ts ionisants ou aux substancesradioactives.IonAtome, fragm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> molécule, molécule ou groupe <strong>de</strong> molécules portant une chargeélectrique totale non nulle.IonisationProcessus qui consiste à ajouter ou à <strong>en</strong>lever un ou plusieurs électrons à <strong>de</strong>s atomes ou<strong>de</strong>s molécules, ce qui <strong>en</strong>traîne <strong>la</strong> création d'ions. Des températures élevées, <strong>de</strong>sdécharges électriques ou le rayonnem<strong>en</strong>t nucléaire peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>traîner un phénomèned'ionisation. L'ionisation est aussi <strong>la</strong> formation d'ions par fractionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> molécules.IREInstitut National <strong>de</strong>s Radio-élém<strong>en</strong>ts à Fleurus, <strong>en</strong> Belgique.IrradiationExposition d'un organisme vivant ou d'une matière à un rayonnem<strong>en</strong>t ionisant.162/166
IsotopesAtomes d'un élém<strong>en</strong>t chimique comportant le même nombre <strong>de</strong> protons et d'électrons,mais dont le nombre <strong>de</strong> neutrons est différ<strong>en</strong>t. Ils ont donc le même numéro atomique(Z), mais <strong>de</strong>s nombres <strong>de</strong> masse (A) différ<strong>en</strong>ts. On parle <strong>de</strong>s isotopes d'un élém<strong>en</strong>t.Ainsi, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 sont <strong>de</strong>s isotopes <strong>de</strong> l'élém<strong>en</strong>tcarbone. Les isotopes d'un même élém<strong>en</strong>t ont les mêmes propriétés chimiques, maisleurs propriétés physiques peuv<strong>en</strong>t être différ<strong>en</strong>tes. Le carbone 12 et le carbone 13, parexemple, sont stables alors que le carbone 14 est radioactif.Matière fissile <strong>en</strong>richieCombustible nucléaire cont<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> l'uranium dont un ou plusieurs isotopes fissilessont/ont été <strong>en</strong>richis ou auquel différ<strong>en</strong>ts nucléi<strong>de</strong>s chimiques fissiles ont été ajoutés.Matrice (<strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t ou d'immobilisation)Matière dans <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> sont <strong>en</strong>fermés pour empêcher que lesmatières radioactives ne se dissémin<strong>en</strong>t dans l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Par exemple mortier <strong>de</strong>cim<strong>en</strong>t, verre, bitume, polymère.MoléculeGroupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou <strong>de</strong> plusieurs atomes dont <strong>la</strong> cohésion est assurée par <strong>de</strong>s liaisonsfortes (par exemple électriques). Une molécule est <strong>la</strong> plus petite unité d'un <strong>en</strong>sembleautonome conservant toutes ses propriétés chimiques. C'est ainsi que l'eau estconstituée <strong>de</strong> molécules <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène.NeutronParticule fondam<strong>en</strong>tale électriquem<strong>en</strong>t neutre qui <strong>en</strong>tre, avec les protons, dans <strong>la</strong>composition du noyau <strong>de</strong> l'atome. C'est le neutron qui provoque <strong>la</strong> réaction <strong>de</strong> fission <strong>de</strong>snoyaux fissiles dont l'énergie est utilisée dans les réacteurs nucléaires.Nombre <strong>de</strong> masseNombre total <strong>de</strong> protons et <strong>de</strong> neutrons dans le noyau <strong>de</strong> l'atome d'un nucléi<strong>de</strong> (symboleA).NoyauRégion c<strong>en</strong>trale, à charge positive, d'un atome. A l'exception du noyau <strong>de</strong> l'hydrogèneordinaire, qui possè<strong>de</strong> un proton unique, tous les noyaux atomiques conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> fois<strong>de</strong>s protons à charge positive et <strong>de</strong>s neutrons neutres.Nucléi<strong>de</strong>Terme générique désignant un quelconque isotope X, stable (279) ou instable (près <strong>de</strong>5 000), <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts chimiques, caractérisé par son nombre <strong>de</strong> masse A, son numéroatomique Z.Numéro atomiqueNuméro attribué à chaque élém<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification périodique <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts. Il estégal au nombre <strong>de</strong> charge, qui est le nombre <strong>de</strong> protons cont<strong>en</strong>us dans le noyau d'unatome (symbole Z).OxydationRéaction dans <strong>la</strong>quelle un atome ou un ion perd <strong>de</strong>s électrons.PAMELAInstal<strong>la</strong>tion-pilote (sur le site <strong>de</strong> Belgoprocess) <strong>de</strong> vitrification du combustible nucléaireusé retraité à EUROCHEMIC.Particule alphaParticule à charge positive émise par certaines matières radioactives lors <strong>de</strong> leurdésintégration nucléaire. Une particule alpha est constituée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux neutrons et <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxprotons et est i<strong>de</strong>ntique au noyau d'un atome d'hélium. Le rayonnem<strong>en</strong>t alpha est moinspénétrant que le rayonnem<strong>en</strong>t bêta et que le rayonnem<strong>en</strong>t gamma. Une feuille <strong>de</strong> papier163/166
ou les couches superficielles <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau suffis<strong>en</strong>t déjà à l'absorber. Le rayonnem<strong>en</strong>talpha est donc fortem<strong>en</strong>t ionisant, c'est-à-dire qu'il arrache facilem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s électrons auxatomes du matériau traversé, car ses particules cè<strong>de</strong>nt toute leur énergie sur un faibleparcours.Particule bêtaParticule émise à partir d'un noyau pour un type défini <strong>de</strong> désintégration radioactive. Uneparticule bêta à charge négative est i<strong>de</strong>ntique à un électron. Une particule bêta à chargepositive est appelée positron. Les particules bêta peuv<strong>en</strong>t être arrêtées, par exemple, aumoy<strong>en</strong> d'un écran d'aluminium <strong>de</strong> quelques millimètres d'épaisseur ou par une couche <strong>de</strong>3 mètres d'air. Une particule bêta peut aussi résulter <strong>de</strong> <strong>la</strong> désintégration d'un neutron oud'une particule instable.Pério<strong>de</strong> radioactive (<strong>de</strong>mi-vie)Dans le cas d'un processus unique <strong>de</strong> décroissance radioactive, il s'agit du temps moy<strong>en</strong>nécessaire pour que l'activité d'une source radioactive diminue jusqu'à <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> savaleur initiale.Plutonium (Pu)Elém<strong>en</strong>t métallique lourd artificiel et radioactif. Son isotope le plus important est leplutonium 239 fissile, produit par l'irradiation <strong>de</strong> l'uranium 238 par <strong>de</strong>s neutrons dans unréacteur nucléaire.Positron (ou positon)Particule fondam<strong>en</strong>tale, anti-particule <strong>de</strong> l'électron, <strong>de</strong> même masse et <strong>de</strong> chargeopposée.PRACLAY"Preliminary Demonstration Test for C<strong>la</strong>y Disposal": essai <strong>de</strong> démonstration préparatoiredans l'optique du dépôt final <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>de</strong> haute activité dans l'argile.Programme <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> l'ONDRAF et du SCK·CEN.Principe ALARA'As Low As Reasonably Achievable'. Principe selon lequel l'exposition <strong>de</strong> l'homme et <strong>de</strong>l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t au rayonnem<strong>en</strong>t ionisant doit être 'aussi faible que raisonnablem<strong>en</strong>tpossible'. On ti<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t compte ici <strong>de</strong>s facteurs économiques et sociaux. L'un <strong>de</strong>sprincipes <strong>de</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection contre le rayonnem<strong>en</strong>t. Principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> CommissionInternationale <strong>de</strong> Protection Radiologique (CIPR).Produits <strong>de</strong> fissionNucléi<strong>de</strong>s produits par fission, ou <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dants <strong>de</strong> ces nucléi<strong>de</strong>s.ProtonParticule nucléaire élém<strong>en</strong>taire stable à charge électrique positive. Chaque élém<strong>en</strong>tchimique possè<strong>de</strong> un nombre différ<strong>en</strong>t <strong>de</strong> protons dans le noyau; ce nombre est appelénuméro atomique.RadUnité obsolète <strong>de</strong> dose <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t absorbée; officiellem<strong>en</strong>t remp<strong>la</strong>cée par le gray<strong>en</strong> 1985. 100 rad équival<strong>en</strong>t à 1 gray.RadioactivitéPhénomène physique caractérisé par <strong>la</strong> désintégration, c'est-à-dire <strong>la</strong> réorganisation, <strong>de</strong>noyaux atomiques instables. Cette désintégration s'accompagne <strong>de</strong> l'émission d'unrayonnem<strong>en</strong>t ionisant. Après une ou plusieurs désintégrations, le noyau instable esttransformé <strong>en</strong> un noyau stable qui n'est plus radioactif.Radionucléi<strong>de</strong>Nucléi<strong>de</strong> radioactif, <strong>en</strong> d'autres termes, isotope radioactif d'un élém<strong>en</strong>t chimique. Il s'agitdonc d'un élém<strong>en</strong>t au noyau instable qui se désintègre spontaném<strong>en</strong>t et émet, ce faisant,164/166
un rayonnem<strong>en</strong>t ionisant. On connaît <strong>en</strong>viron 2 500 nucléi<strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts distribués <strong>en</strong>tre112 élém<strong>en</strong>ts chimiques. Sur ce nombre, plus <strong>de</strong> 2 200 sont <strong>radioactifs</strong>.Rayonnem<strong>en</strong>t alphaRayonnem<strong>en</strong>t constitué <strong>de</strong> particules alpha.Rayonnem<strong>en</strong>t bétaRayonnem<strong>en</strong>t constitué <strong>de</strong> particules bêta.Rayonnem<strong>en</strong>t cosmiqueRayonnem<strong>en</strong>t ionisant v<strong>en</strong>u du cosmos compr<strong>en</strong>ant les particules primaires <strong>de</strong> très hauteénergie (d'origine extra-terrestre) et les particules secondaires <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drées parl'interaction <strong>de</strong>s particules primaires avec les hautes couches <strong>de</strong> l'atmosphère.Rayonnem<strong>en</strong>t gammaRayonnem<strong>en</strong>t électromagnétique composé <strong>de</strong> photons émis au cours d'un processus <strong>de</strong>transition nucléaire ou d'annihi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> particules. Rayonnem<strong>en</strong>t électromagnétique àhaute énergie <strong>de</strong> longueur d'on<strong>de</strong> très réduite et sans masse qui est émis par <strong>de</strong>nombreux types <strong>de</strong> noyaux. Le rayonnem<strong>en</strong>t gamma est <strong>de</strong> même nature que <strong>la</strong> lumièreou les rayons X, mais possè<strong>de</strong> beaucoup plus d'énergie. Le rayonnem<strong>en</strong>t gammapossè<strong>de</strong> un pouvoir <strong>de</strong> pénétration très élevé et ne peut être absorbé efficacem<strong>en</strong>t quepar <strong>de</strong>s matériaux <strong>de</strong>nses comme le fer, le béton ou le plomb ou une épaisseur suffisanted'eau. L'épaisseur nécessaire pour assurer une protection contre le rayonnem<strong>en</strong>t gammapeut aller <strong>de</strong> quelques c<strong>en</strong>timètres à plusieurs mètres <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> l'énergie et <strong>de</strong>l'int<strong>en</strong>sité du rayonnem<strong>en</strong>t.Rayonnem<strong>en</strong>t ionisantRayonnem<strong>en</strong>t doté <strong>de</strong> suffisamm<strong>en</strong>t d'énergie pour <strong>en</strong>traîner une ionisation dans <strong>la</strong>matière. Comme exemples on peut citer les rayonnem<strong>en</strong>ts alpha, béta et gamma, ainsique les rayons X.Rayonnem<strong>en</strong>t ionisant naturelRayonnem<strong>en</strong>t ionisant existant dans <strong>la</strong> nature <strong>en</strong> l'abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> toute instal<strong>la</strong>tion nucléaireou <strong>de</strong> toute source radioactive artificielle. Il est dû au rayonnem<strong>en</strong>t cosmique et auxradio-isotopes naturellem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ts dans <strong>la</strong> croûte terrestre et dans l'air.Réaction <strong>en</strong> chaîneSuite <strong>de</strong> fissions nucléaires au cours <strong>de</strong>squelles les neutrons libérés provoqu<strong>en</strong>t <strong>de</strong>nouvelles fissions, à leur tour génératrices <strong>de</strong> nouveaux neutrons provoquant <strong>de</strong>nouvelles fissions et ainsi <strong>de</strong> suite.RécupérabilitéPossibilité, p<strong>en</strong>dant une pério<strong>de</strong> donnée, <strong>de</strong> récupérer <strong>de</strong> façon sûre les <strong>déchets</strong> mis <strong>en</strong>dépôt avec <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s i<strong>de</strong>ntiques ou comparables à ceux qui ont été utilisés pour leurmise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce. La récupérabilité est donc une <strong>de</strong>s conséqu<strong>en</strong>ces possibles <strong>de</strong> <strong>la</strong>flexibilité.RemUnité obsolète pour l'équival<strong>en</strong>t <strong>de</strong> dose, officiellem<strong>en</strong>t remp<strong>la</strong>cée par le sievert <strong>en</strong> 1985.100 rems équival<strong>en</strong>t à 1 sievert.Retraitem<strong>en</strong>tTraitem<strong>en</strong>t du combustible irradié épuisé issu d'un réacteur <strong>de</strong> manière à restaurer lesmatières fissiles ou fertiles et <strong>de</strong> séparer les produits <strong>de</strong> fission. Le produit fissile est traitéultérieurem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> manière à obt<strong>en</strong>ir un nouveau combustible, les produits <strong>de</strong> fission étant<strong>de</strong>s <strong>déchets</strong>.SAFIR"Safety Assessm<strong>en</strong>t and Feasibility Interim Report", rapport provisoire sur <strong>la</strong> sécurité et <strong>la</strong>faisabilité du dépôt final <strong>en</strong> profon<strong>de</strong>ur. Le rapport SAFIR 1 fait le bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s travaux165/166
exécutés <strong>en</strong>tre 1974 et 1988 sur le p<strong>la</strong>n du dépôt final év<strong>en</strong>tuel <strong>de</strong>s <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong>dans <strong>la</strong> couche d'argile <strong>de</strong> Boom. Le rapport SAFIR 2 prés<strong>en</strong>te lui l'état <strong>de</strong>s rechercheseffectuées durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1990-2000.SCK·CENC<strong>en</strong>tre d'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'énergie nucléaire à Mol, <strong>en</strong> Belgique.Sievert (Sv)Unité utilisée <strong>en</strong> radioprotection pour déterminer selon le cas <strong>la</strong> dose équival<strong>en</strong>te ou <strong>la</strong>dose efficace. Elle est égale à 1 joule/kilo et donne une mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> nocivité d'unequantité d'énergie <strong>de</strong> rayonnem<strong>en</strong>t absorbée ou <strong>de</strong> l'effet biologique du rayonnem<strong>en</strong>t surun être vivant.SvVoir sievert.SYNATOMSociété Belge <strong>de</strong>s Combustibles Nucléaires.Transformation nucléaireTransformation d'un radionucléi<strong>de</strong> <strong>en</strong> un autre, par exemple une désintégration alpha ouune désintégration béta.TransNuBelSociété <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> Belgique, Dessel.TRANSRADSociété <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> <strong>déchets</strong> <strong>radioactifs</strong> <strong>en</strong> Belgique, Fleurus.UraniumElém<strong>en</strong>t radioactif naturel dont le numéro atomique est égal à 92 (nombre <strong>de</strong> protons).Ses principaux isotopes naturels sont l'uranium 235 (0,72 % d'uranium naturel) qui estfissile, l'uranium 238 fertile (99,3 % d'uranium naturel) et l'uranium 234 (0,0056 %). Toustrois sont <strong>de</strong>s émetteurs alpha.Uranium appauvriUranium dont <strong>la</strong> t<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> isotope 235, le seul fissile, est inférieure à son niveau naturel(0,72% <strong>en</strong> masse). Il est principalem<strong>en</strong>t obt<strong>en</strong>u, d'une part <strong>en</strong> tant que co-produit d'uneopération d'<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t (autour <strong>de</strong> 0,3% <strong>de</strong> l'uranium 235), d'autre part <strong>en</strong> tant quesous-produit (1% <strong>de</strong> l'uranium 235) d'un traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> combustible usé après passage <strong>en</strong>réacteur.Uranium <strong>en</strong>richiUranium dont <strong>la</strong> t<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> isotope 235, le seul fissile, a été portée <strong>de</strong> son faible niveaunaturel (0,72% <strong>en</strong> masse) à, par exemple, 3,5% pour un combustible <strong>de</strong>stiné à unréacteur nucléaire à eau sous pression.166/166