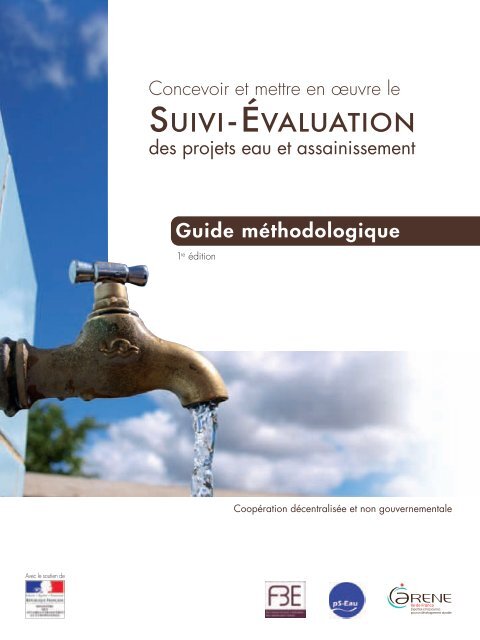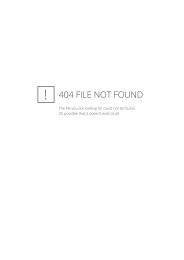Concevoir et mettre en Åuvre le suivi-évaluation des
Concevoir et mettre en Åuvre le suivi-évaluation des
Concevoir et mettre en Åuvre le suivi-évaluation des
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Concevoir</strong> <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong>SUIVI-ÉVALUATION<strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s eau <strong>et</strong> assainissem<strong>en</strong>tGuide méthodologique1 re éditionCoopération déc<strong>en</strong>tralisée <strong>et</strong> non gouvernem<strong>en</strong>ta<strong>le</strong>Avec <strong>le</strong> souti<strong>en</strong> de
<strong>Concevoir</strong> <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong><strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s eau <strong>et</strong> assainissem<strong>en</strong>tGuide méthodologiqueCe guide a été rédigé parD<strong>en</strong>is Désil<strong>le</strong>, pS-EauVinc<strong>en</strong>t Dussaux, pS-EauBruno de Reviers, F3E
Céci<strong>le</strong> Gallian, Ag<strong>en</strong>ce de l’Eau Artois-PicardieAurélie Radde, Ag<strong>en</strong>ce de l’Eau Seine-NormandiePierre Tessier, Mairie de Juvisy-sur-OrgeD<strong>en</strong>is Schultz, Institut Régional de Coopération-Développem<strong>en</strong>tJérôme Bouqu<strong>et</strong>, Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA)Anne-Laure Barrès, Mairie d’Ivry-sur-SeineAngela Lanteri, Grand LyonNicolas Martin, Coopération AtlantiqueAntoine Long<strong>et</strong>, Nantes Métropo<strong>le</strong>Mouhamed Sylla, Association Ardèche Drôme Ouro-Sogui Sénégal (ADOS)Nicolas Moreau, Initiative Développem<strong>en</strong>tIrène Sérot-Alméras, Fondation Ensemb<strong>le</strong>Bruno de Reviers, F3ED<strong>en</strong>is Dangaix, Ar<strong>en</strong>e IdFVinc<strong>en</strong>t Dussaux, pS-EauD<strong>en</strong>is Désil<strong>le</strong>, pS-EauTab<strong>le</strong> <strong>des</strong> matièresPréambu<strong>le</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Le <strong>suivi</strong>-évaluation : de quoi s’agit-il <strong>et</strong> à quoi cela sert-il ? 9Qu’est-ce que <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Pourquoi faire du <strong>suivi</strong>-évaluation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Des dispositifs à adapter aux spécificités de chaque proj<strong>et</strong>. . . . . . . . . . . . . . . 12Le <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> <strong>le</strong>s autres modalités de gestion d’un proj<strong>et</strong> . . . . . . . . . 13Le <strong>suivi</strong>-évaluation pour répondre à <strong>des</strong> <strong>en</strong>jeux ess<strong>en</strong>tiels . . . . . . . . . . . . . . . . 14Résumé de la méthode 17Liste <strong>des</strong> acronymesAEP Approvisionnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Eau Potab<strong>le</strong>AEPA Approvisionnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Eau Potab<strong>le</strong> <strong>et</strong> Assainissem<strong>en</strong>tARENE Ag<strong>en</strong>ce Régiona<strong>le</strong> de l'Environnem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> <strong>des</strong> Nouvel<strong>le</strong>s ÉnergiesCT Col<strong>le</strong>ctivité Territoria<strong>le</strong>DRH Direction Régiona<strong>le</strong> de l’Hydraulique (au Mali)F3E Fonds pour la promotion <strong>des</strong> Etu<strong>des</strong> préalab<strong>le</strong>s,<strong>des</strong> Étu<strong>des</strong> transversa<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>des</strong> EvaluationsMOA Maître d’Ouvrage ou Maîtrise d’OuvrageOMD Objectifs du Millénaire pour <strong>le</strong> Développem<strong>en</strong>tOSC Organisation de la Société Civi<strong>le</strong>pS-Eau Programme Solidarité-EauRMO R<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de la Maîtrise d’OuvrageSE Suivi- ÉvaluationSG Secrétaire GénéralMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation 21Un préalab<strong>le</strong> : rev<strong>en</strong>ir sur la formulation du proj<strong>et</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<strong>Concevoir</strong> un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Étape 1 : Id<strong>en</strong>tifier précisém<strong>en</strong>t ce qui doit faire l’obj<strong>et</strong>d’un <strong>suivi</strong>-évaluation, <strong>et</strong> à qui cela doit servir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Étape 2 : Définir <strong>le</strong>s indicateurs de mesure du <strong>suivi</strong>-évaluation . . . . . . . . . . . . . . 33Étape 3 : Déterminer <strong>le</strong>s activités complém<strong>en</strong>taires pot<strong>en</strong>tiel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t nécessaires . . 39Étape 4 : Organiser <strong>le</strong> dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39M<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Recueillir <strong>le</strong>s données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Analyser <strong>le</strong>s données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Utiliser <strong>le</strong>s résultats du <strong>suivi</strong>-évaluation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Annexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>t 49Réalisation d’infrastructures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Mobilisation socia<strong>le</strong> (usagers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Gestion du service public eau/assainissem<strong>en</strong>t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Impact <strong>et</strong> eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Préambu<strong>le</strong>e F3E, <strong>le</strong> pS-Eau <strong>et</strong> l’ARENE Î<strong>le</strong>-de-France, avec <strong>le</strong> souti<strong>en</strong> duministère <strong>des</strong> Affaires étrangères <strong>et</strong> europé<strong>en</strong>nes, ont animé <strong>en</strong>2009-2010 un groupe de travail composé de col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s,d’ag<strong>en</strong>ces de l’eau, d’ONG <strong>et</strong> d’une fondation, sur <strong>le</strong> thème du <strong>suivi</strong>évaluation<strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s dans <strong>le</strong> secteur de l’eau <strong>et</strong> de l’assainissem<strong>en</strong>t.Le prés<strong>en</strong>t docum<strong>en</strong>t est <strong>le</strong> fruit de ces travaux. Il constitue un outil pourcontribuer à généraliser la pratique du <strong>suivi</strong>-évaluation au sein <strong>des</strong>acteurs de la coopération déc<strong>en</strong>tralisée <strong>et</strong> non gouvernem<strong>en</strong>ta<strong>le</strong>. C<strong>et</strong>outil se veut évolutif <strong>et</strong> sera <strong>en</strong>richi au fur <strong>et</strong> à mesure <strong>des</strong> r<strong>et</strong>oursd’expéri<strong>en</strong>ces <strong>des</strong> acteurs l’ayant mis <strong>en</strong> pratique.La rédaction de ce guide a été animée par la volonté de m<strong>et</strong>tre <strong>le</strong><strong>suivi</strong>-évaluation – suj<strong>et</strong> comp<strong>le</strong>xe – à la portée de non-spécialistes,dans une optique de vulgarisation. Ainsi, il résulte de plusieursversions successives du même docum<strong>en</strong>t, toujours plus simplifiées.Le groupe de travail aura été très exigeant <strong>en</strong> la matière.Certains estimeront peut-être que c<strong>et</strong> effort de simplification reste<strong>en</strong>core insuffisant, tandis que d’autres déploreront une certaineforme de simplisme.Nous espérons toutefois avoir trouvé un compromis raisonnab<strong>le</strong>.4Pourquoi ce guide ?Pour répondre à <strong>des</strong> besoins…Les échanges m<strong>en</strong>és au sein du groupe de travail ont montré que si lapratique du <strong>suivi</strong>-évaluation existe chez <strong>le</strong>s acteurs français de lasolidarité internationa<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> cadre <strong>des</strong> activités liées à la mise <strong>en</strong>œuvre d’un proj<strong>et</strong>, el<strong>le</strong> n’est que rarem<strong>en</strong>t p<strong>en</strong>sée <strong>et</strong> élaborée demanière globa<strong>le</strong> <strong>et</strong> stratégique. De plus, <strong>le</strong>s dispositifs de <strong>suivi</strong>-évaluationsont <strong>en</strong>core souv<strong>en</strong>t conçus de sorte que <strong>le</strong>ur mise <strong>en</strong> œuvre est vécuepar <strong>le</strong>s porteurs de proj<strong>et</strong>s comme une contrainte imposée par <strong>le</strong>sbail<strong>le</strong>urs de fonds, plutôt qu’un réel outil d’aide au pilotage.5
Préambu<strong>le</strong>Préambu<strong>le</strong>… <strong>et</strong> aussi à <strong>des</strong> deman<strong>des</strong>Les membres du groupe de travail ont confirmé qu’il existe une att<strong>en</strong>teforte, au sein <strong>des</strong> acteurs non gouvernem<strong>en</strong>taux, pour disposer d’unréfér<strong>en</strong>tiel méthodologique aidant à la conception de dispositifs de<strong>suivi</strong>-évaluation adaptés à <strong>le</strong>urs moy<strong>en</strong>s <strong>et</strong> répondant à <strong>le</strong>urs att<strong>en</strong>tesspécifiques. Ces att<strong>en</strong>tes port<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t sur :– un dispositif qui soit peu contraignant <strong>en</strong> termes de mise <strong>en</strong> œuvre,<strong>et</strong> soit réel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t ori<strong>en</strong>té vers l’aide au pilotage du proj<strong>et</strong> ;– un dispositif qui perm<strong>et</strong>te de suivre l’atteinte <strong>des</strong> objectifs finaux <strong>en</strong>termes de création ou de r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de services publics d’eau <strong>et</strong>d’assainissem<strong>en</strong>t durab<strong>le</strong>s <strong>et</strong> équitab<strong>le</strong>s ;– un dispositif qui soit uti<strong>le</strong> <strong>et</strong> partagé par l’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> <strong>des</strong> acteursinterv<strong>en</strong>ant sur un proj<strong>et</strong>, participant à une compréh<strong>en</strong>sion communedu proj<strong>et</strong> ;– un dispositif qui perm<strong>et</strong>te de partager <strong>des</strong> informations objectives<strong>en</strong>tre l’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> <strong>des</strong> parties pr<strong>en</strong>antes d’un proj<strong>et</strong> ;– un dispositif qui produise <strong>des</strong> informations servant de base pourla communication auprès <strong>des</strong> contribuab<strong>le</strong>s, la capitalisation deproj<strong>et</strong>s, pour se forger une culture de la coopération, <strong>et</strong>c. ;– <strong>des</strong> dispositifs qui soi<strong>en</strong>t harmonisés au niveau macroscopique (parexemp<strong>le</strong> pour un <strong>en</strong>semb<strong>le</strong> de proj<strong>et</strong>s financés par une ag<strong>en</strong>ce del’eau).À qui s’adresse-t-il ?C<strong>et</strong> ouvrage s’adresse <strong>en</strong> premier lieu à tous <strong>le</strong>s acteurs de la coopérationdéc<strong>en</strong>tralisée <strong>et</strong> non gouvernem<strong>en</strong>ta<strong>le</strong> impliqués dans <strong>des</strong>actions visant à améliorer l’accès à l’eau <strong>et</strong> l’assainissem<strong>en</strong>t dans <strong>le</strong>spays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t : col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s, ONG, ag<strong>en</strong>ces del’eau, fondations, <strong>et</strong>c.Il vise un public peu familiarisé avec <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> la gestionde proj<strong>et</strong> <strong>en</strong> général. Aussi, de nombreux concepts ont été volontairem<strong>en</strong>tsimplifiés.Pour quels types de proj<strong>et</strong>s ?La démarche méthodologique proposée dans c<strong>et</strong> ouvrage peuts’appliquer à tout proj<strong>et</strong> de coopération déc<strong>en</strong>tralisée ou non gouvernem<strong>en</strong>ta<strong>le</strong>.Cep<strong>en</strong>dant, ce guide cib<strong>le</strong> particulièrem<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s proj<strong>et</strong>sd’adduction <strong>en</strong> eau potab<strong>le</strong> <strong>et</strong> d’assainissem<strong>en</strong>t (eaux usées oupluvia<strong>le</strong>s) <strong>en</strong> milieu rural ou urbain ; avec une gestion loca<strong>le</strong> ou parun opérateur national ; l’assainissem<strong>en</strong>t individuel, semi-col<strong>le</strong>ctif oucol<strong>le</strong>ctif. Il propose <strong>le</strong>s contours d’un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluationspécifique pour un proj<strong>et</strong> eau <strong>et</strong> assainissem<strong>en</strong>t classique : formulationd’un proj<strong>et</strong> classique ; exemp<strong>le</strong>s de questions de <strong>suivi</strong> évaluationpour un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>t…61 Le guide se conc<strong>en</strong>tre <strong>en</strong> eff<strong>et</strong> sur un <strong>suivi</strong>évaluationde proj<strong>et</strong>, <strong>et</strong> pas de processus(ex. : <strong>suivi</strong>-évaluation d’un processus der<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> capacités de maîtrised’ouvrage impliquant plusieurs proj<strong>et</strong>ssuccessifs). Même lorsque <strong>le</strong> r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t<strong>des</strong> capacités de maîtrise d’ouvrage estabordé, c’est sous un ang<strong>le</strong> de proj<strong>et</strong> (bi<strong>en</strong>que ce r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t soit un processus).Quel est l’obj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong> ouvrage ?C<strong>et</strong>te publication a été réalisée <strong>en</strong> visant un doub<strong>le</strong> objectif :1. expliquer l’intérêt <strong>et</strong> ce qu’est <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation ;2. fournir un support méthodologique pour construire pas à pas un dispositifde <strong>suivi</strong>-évaluation « sur mesure » dans <strong>le</strong> cadre d’un proj<strong>et</strong> 1 .Partant du constat que <strong>le</strong> meil<strong>le</strong>ur dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation est celuique l’on conçoit soi-même pour répondre aux préoccupations propresd’un proj<strong>et</strong> spécifique, c<strong>et</strong> ouvrage propose <strong>des</strong> « lignes directrices »plutôt que <strong>des</strong> dispositifs « clé <strong>en</strong> main », <strong>en</strong> s’appuyant sur <strong>des</strong>exemp<strong>le</strong>s.En revanche, c<strong>et</strong> ouvrage ne couvre pas l’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> <strong>des</strong> concepts liésà la gestion de proj<strong>et</strong>, dont <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation ne constitue qu’unélém<strong>en</strong>t. Il ne disp<strong>en</strong>se donc pas de la <strong>le</strong>cture d’autres référ<strong>en</strong>ces,notamm<strong>en</strong>t sur l’id<strong>en</strong>tification <strong>et</strong> la conception d’un proj<strong>et</strong> (avec <strong>le</strong>snotions d’étude de faisabilité, d’analyse structurée du contexte <strong>et</strong> dela demande, de cadre logique,…).7
Le <strong>suivi</strong>-évaluation :de quoi s’agit-il <strong>et</strong> à quoi cela sert-il ? 89
Le <strong>suivi</strong>-évaluation : de quoi s’agit-il <strong>et</strong> à quoi cela sert-il ?Le <strong>suivi</strong>-évaluation : de quoi s’agit-il <strong>et</strong> à quoi cela sert-il ?Un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation Recueillir<strong>des</strong> donnéesQu’est-ce que <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation ?Les analyserLe <strong>suivi</strong>-évaluation consiste à recueillir <strong>des</strong> données sur l’état d’avancem<strong>en</strong>tdu proj<strong>et</strong>, puis à <strong>le</strong>s analyser régulièrem<strong>en</strong>t afin d’<strong>en</strong> tirer <strong>des</strong> conclusions<strong>en</strong> termes de pilotage du proj<strong>et</strong> : dans quel<strong>le</strong> mesure est-on <strong>en</strong> capacitéd’atteindre <strong>le</strong>s objectifs assignés au proj<strong>et</strong> ? Y a-t-il lieu de modifier certainesactivités ? Év<strong>en</strong>tuel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t, faut-il réori<strong>en</strong>ter certains aspects du proj<strong>et</strong> ? Etc.SESESE SE SEEn tirer <strong>des</strong> conclusions pour<strong>le</strong> pilotage du proj<strong>et</strong>Conçu durant la phase de planification,<strong>en</strong> même temps que la conceptiondu proj<strong>et</strong>, <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation estutilisé de manière continue duranttoute la phase de mise <strong>en</strong> œuvre duproj<strong>et</strong>.Dans un certain nombre de cas, <strong>le</strong>s informationsissues <strong>des</strong> indicateurs ne suffis<strong>en</strong>t paspour guider <strong>le</strong> pilotage du proj<strong>et</strong>. Il est nécessairede m<strong>en</strong>er <strong>des</strong> activités complém<strong>en</strong>taires(évaluation à mi-parcours, <strong>en</strong>quêtes <strong>des</strong>atisfaction, missions de terrain, réunionsd’échanges…).L’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> de ces dispositions est géré parune organisation à m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> place (qui faitquoi ? quand ? <strong>et</strong>c.)Ainsi, un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation est la combinaison d’indicateurs,d’outils <strong>et</strong> d’étu<strong>des</strong> complém<strong>en</strong>taires, dans <strong>le</strong> cadre d’une organisationgloba<strong>le</strong> liée au pilotage du proj<strong>et</strong>.Pourquoi faire du <strong>suivi</strong>-évaluation ?Un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation perm<strong>et</strong> de vérifier si <strong>le</strong>s objectifs d’un proj<strong>et</strong>seront atteints, <strong>et</strong> de pr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> mesures correctives si nécessaire.Il facilite la prise de décisions multi-acteurs (ex : comité de pilotage) sur <strong>des</strong>bases objectives.Le <strong>suivi</strong>-évaluation oblige à se p<strong>en</strong>cher sur ce qu’il y a derrière <strong>le</strong>s mots parfoisconv<strong>en</strong>us d’un proj<strong>et</strong> (trop souv<strong>en</strong>t rédigé de façon solitaire <strong>et</strong> dans la hâted’une réponse à un appel à proj<strong>et</strong>), <strong>et</strong> à <strong>le</strong> concrétiser via <strong>le</strong>s activités du proj<strong>et</strong>.Il amène <strong>le</strong>s parties pr<strong>en</strong>antes du dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation à par<strong>le</strong>r <strong>le</strong>même langage, tant sur <strong>le</strong>s objectifs visés par <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> que sur ce à quoi ilaboutit réel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t. Réussites <strong>et</strong> échecs sont partagés <strong>et</strong> analysés de concert.10Le <strong>suivi</strong>-évaluation d’un proj<strong>et</strong> s’appuie notamm<strong>en</strong>t sur <strong>des</strong> indicateurs àr<strong>en</strong>seigner tout au long du proj<strong>et</strong>, à la fois qualitatifs <strong>et</strong> quantitatifs. En fonctionde la comp<strong>le</strong>xité du proj<strong>et</strong>, mais aussi de ce que l’on souhaite mesurer, l<strong>en</strong>ombre <strong>et</strong> la nature de ces indicateurs peuv<strong>en</strong>t être très variab<strong>le</strong>s.Ces indicateurs sont valorisés par <strong>le</strong> biais d’outils de col<strong>le</strong>cte (tab<strong>le</strong>aux pourc<strong>en</strong>traliser <strong>le</strong>s données recueillies) <strong>et</strong> d’aide à la décision (tab<strong>le</strong>aux de bord<strong>et</strong> notes de synthèse donnant une vision analytique <strong>des</strong> données recueillies).Le <strong>suivi</strong>-évaluation perm<strong>et</strong> de communiquer auprès <strong>des</strong> part<strong>en</strong>aires <strong>et</strong> der<strong>en</strong>dre compte de façon objective de l’état d’avancem<strong>en</strong>t du proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong>résultats obt<strong>en</strong>us.Cela peut concerner par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong>s autorités loca<strong>le</strong>s <strong>et</strong> l’administration dupays concerné (au Sud), <strong>le</strong>s bail<strong>le</strong>urs de fonds, mais aussi l’assemblée délibérantede la col<strong>le</strong>ctivité du Nord, l’assemblée généra<strong>le</strong> d’une ONG, <strong>des</strong>citoy<strong>en</strong>s, <strong>des</strong> donateurs privés, <strong>et</strong>c. 11
Le <strong>suivi</strong>-évaluation : de quoi s’agit-il <strong>et</strong> à quoi cela sert-il ?Le <strong>suivi</strong>-évaluation : de quoi s’agit-il <strong>et</strong> à quoi cela sert-il ?Le <strong>suivi</strong>-évaluation perm<strong>et</strong> de tirer <strong>des</strong> <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts, à la fois <strong>en</strong> termes degestion de proj<strong>et</strong> (ex. : il peut perm<strong>et</strong>tre ultérieurem<strong>en</strong>t de dim<strong>en</strong>sionner unproj<strong>et</strong> de façon plus réaliste) <strong>et</strong> de connaissance sur <strong>le</strong> secteur de l’eau <strong>et</strong> del’assainissem<strong>en</strong>t (ex. : mieux connaître un portefeuil<strong>le</strong> de proj<strong>et</strong>s ; agréger<strong>des</strong> données,…).Le <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> <strong>le</strong>s autres modalités de gestion d’un proj<strong>et</strong> Classiquem<strong>en</strong>t, un proj<strong>et</strong> comm<strong>en</strong>ce par une phase d’id<strong>en</strong>tification : élaborerune première idée de proj<strong>et</strong> <strong>en</strong>tre part<strong>en</strong>aires, <strong>en</strong> apprécier la pertin<strong>en</strong>ce <strong>et</strong>la faisabilité, <strong>et</strong>c.2 Il s’agit ici d’un cyc<strong>le</strong> de proj<strong>et</strong>simplifié, adapté aux acteurs nongouvernem<strong>en</strong>taux.Pour unecompréh<strong>en</strong>sionpartagée du proj<strong>et</strong>Pour améliorerpilotage <strong>et</strong>efficacitéPourquoi faire du<strong>suivi</strong>–évaluation ?Pour r<strong>en</strong>drecompte <strong>et</strong>communiquerPuis il s’agit de monter <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> proprem<strong>en</strong>t dit : c’est la planification. C<strong>et</strong>tephase consiste à programmer, dans <strong>le</strong> temps, <strong>le</strong>s activités à m<strong>en</strong>er <strong>et</strong> <strong>le</strong>smoy<strong>en</strong>s à rassemb<strong>le</strong>r pour atteindre <strong>le</strong>s objectifs du proj<strong>et</strong>.C’est éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>le</strong> mom<strong>en</strong>t de définir <strong>le</strong> schéma institu -tionnel (répartition <strong>des</strong> rô<strong>le</strong>s <strong>et</strong> responsabilités <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s différ<strong>en</strong>tsacteurs) <strong>et</strong> de rechercher <strong>le</strong>s financem<strong>en</strong>ts manquants.Le dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation doit être conçu au terme dec<strong>et</strong>te phase de planification. Puis il est mis <strong>en</strong> œuvre toutau long de la mise <strong>en</strong> œuvre du proj<strong>et</strong>.Pour capitaliser<strong>et</strong> appr<strong>en</strong>dreLa dernière étape classique d’un proj<strong>et</strong> consiste dans uneévaluation fina<strong>le</strong>, laquel<strong>le</strong> pourra év<strong>en</strong>tuel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t perm<strong>et</strong>tred’<strong>en</strong>cl<strong>en</strong>cher un nouveau proj<strong>et</strong>.Des dispositifs à adapter aux spécificités de chaque proj<strong>et</strong>12Le dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation d’un proj<strong>et</strong> de grande <strong>en</strong>vergure sera généra<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tplus comp<strong>le</strong>xe que celui d’un microproj<strong>et</strong>.On peut très bi<strong>en</strong> concevoir un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation très léger, avec<strong>des</strong> coûts financiers quasim<strong>en</strong>t indolores <strong>en</strong> termes de trésorerie. En revanche,cela nécessite forcém<strong>en</strong>t du temps de travail (une autre forme de coût), ycompris dans la phase de conception.Un dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t réaliste du dispositif est donc indisp<strong>en</strong>sab<strong>le</strong> : <strong>le</strong> principalreproche fait aux dispositifs existants réside dans <strong>le</strong>ur lourdeur…Chaque proj<strong>et</strong> est unique ! Ne serait-ce qu’au regard <strong>des</strong> spécificités <strong>et</strong>besoins locaux, chaque proj<strong>et</strong> nécessite une réf<strong>le</strong>xion <strong>et</strong> une définition qui luisont propres. Parce que <strong>le</strong>s acteurs impliqués, <strong>le</strong>s objectifs visés <strong>et</strong> <strong>le</strong>s activitésà m<strong>en</strong>er sont singuliers, <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation qui sera mis <strong>en</strong> place sera lui aussisingulier.Ce guide essaie de faciliter au maximum <strong>le</strong> travail <strong>des</strong> acteurs. Il ne constituepas pour autant un outil clé <strong>en</strong> main à appliquer <strong>le</strong>s yeux fermés. À chacunde se l’approprier <strong>et</strong> de l’ajuster à son cas particulier.La quasi-totalité <strong>des</strong> acteurs font déjà un <strong>suivi</strong> technique <strong>et</strong> financier <strong>des</strong>activités de <strong>le</strong>urs proj<strong>et</strong>s. Ce <strong>suivi</strong> technique <strong>et</strong> financier se conc<strong>en</strong>tre souv<strong>en</strong>tsur la bonne utilisation <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s <strong>et</strong> ressources. Le guide aborde un <strong>suivi</strong>évaluationqui porte davantage sur <strong>le</strong>s réalisations <strong>et</strong> <strong>le</strong>s résultats obt<strong>en</strong>us,voire <strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong>. Il a donc une dim<strong>en</strong>sion plus stratégique. Mais <strong>le</strong>sdeux sont tout à fait complém<strong>en</strong>taires. Ainsi, <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation ne s’adressepas qu’aux « chefs de proj<strong>et</strong> » : il perm<strong>et</strong> éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t d’animer <strong>des</strong> instancesde décision col<strong>le</strong>ctive type comité de pilotage.Une évaluation fina<strong>le</strong> (ou intermédiaire) est un exercice ponctuel 3 . À la findu proj<strong>et</strong> (ou à un instant donné, pour une évaluation intermédiaire : parexemp<strong>le</strong> à mi-parcours), on regarde derrière soi pour effectuer un bilan <strong>des</strong>actions réalisées <strong>et</strong> apprécier <strong>le</strong>s résultats obt<strong>en</strong>us sur la base d’une gril<strong>le</strong> objective; on <strong>en</strong> tire <strong>des</strong> conclusions ; puis on se proj<strong>et</strong>te dans l’av<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> faisant<strong>des</strong> recommandations pour améliorer <strong>des</strong> actions futures.Le <strong>suivi</strong>-évaluation participe de la même logique que l’évaluation fina<strong>le</strong>, maisil <strong>en</strong> diffère n<strong>et</strong>tem<strong>en</strong>t : ses modalités de mise <strong>en</strong> œuvre sont différ<strong>en</strong>tes, demême que ce qu’on peut <strong>en</strong> att<strong>en</strong>dre. Ainsi, pour aider à clarifier <strong>le</strong>s notions,voici quelques élém<strong>en</strong>ts de distinction :3 Ponctuel, dans la mesure où el<strong>le</strong>est m<strong>en</strong>ée p<strong>en</strong>dant une périodedéterminée (même si el<strong>le</strong> doit êtreprévue dès <strong>le</strong> début du proj<strong>et</strong>).13
Le <strong>suivi</strong>-évaluation : de quoi s’agit-il <strong>et</strong> à quoi cela sert-il ?Le <strong>suivi</strong>-évaluation : de quoi s’agit-il <strong>et</strong> à quoi cela sert-il ?Suivi-évaluation Évaluation NB : lorsqu’il n’existe pas de <strong>suivi</strong>-évaluation sur <strong>le</strong>quel s’appuyer, l’évaluationdoit souv<strong>en</strong>t restreindre ses ambitions, car el<strong>le</strong> doit alors repr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong>élém<strong>en</strong>ts qui aurai<strong>en</strong>t dû être du ressort du <strong>suivi</strong>-évaluation.mise <strong>en</strong> place de services publics de l’eau ou de l’assainissem<strong>en</strong>t. C<strong>et</strong>teperspective implique d’accorder une att<strong>en</strong>tion toute particulière à la maîtrised’ouvrage <strong>des</strong> col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s dont c’est la compét<strong>en</strong>ce. Le dispositifde <strong>suivi</strong>-évaluation doit donner aux col<strong>le</strong>ctivités du Sud un rô<strong>le</strong> approprié à<strong>le</strong>urs responsabilités de maître d’ouvrage du service : élaboration techniqued’outils d’aide à la décision, arbitrage politique, prise de décisions <strong>et</strong> <strong>suivi</strong>…En ce s<strong>en</strong>s, <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation peut, <strong>en</strong> soi-même, constituer une modalitéd’appr<strong>en</strong>tissage <strong>et</strong> de r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de la maîtrise d’ouvrage <strong>des</strong> col<strong>le</strong>ctivitésterritoria<strong>le</strong>s du Sud <strong>et</strong> de la gouvernance loca<strong>le</strong>Cela dit, <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> évaluations font appel aux mêmes ressorts <strong>et</strong> d<strong>en</strong>ombreuses passerel<strong>le</strong>s exist<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s deux exercices. D’ail<strong>le</strong>urs, il s’agitde ne surtout pas <strong>le</strong>s opposer : <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> évaluation sont étroitem<strong>en</strong>tcomplém<strong>en</strong>taires. Ils s’<strong>en</strong>richiss<strong>en</strong>t mutuel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>et</strong> doiv<strong>en</strong>t être programmés<strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce.4 Efficacité de l’aide : www.oecd.org/cadEfficacité du développem<strong>en</strong>t : www.cso-effectiv<strong>en</strong>ess.org14Le <strong>suivi</strong>-évaluation pour répondre à <strong>des</strong> <strong>en</strong>jeux ess<strong>en</strong>tielsEn soi, <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation n’est donc pas révolutionnaire. La plupart <strong>des</strong>acteurs non gouvernem<strong>en</strong>taux ont déjà <strong>le</strong>s bases d’un dispositif : ils font <strong>des</strong>missions de <strong>suivi</strong>, organis<strong>en</strong>t <strong>des</strong> comités de pilotage, <strong>et</strong>c.L’idée est donc avant de tout de structurer <strong>le</strong> dispositif <strong>et</strong> de <strong>le</strong> compléter.Cela dit, <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation véhicu<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>en</strong>jeux forts :■ Depuis l’adoption de la loi Oudin-Santini, <strong>le</strong> nombre de proj<strong>et</strong>s sur l’eau <strong>et</strong>l’assainissem<strong>en</strong>t croît de façon importante, avec <strong>des</strong> acteurs qui n’ont pastoujours une grande expéri<strong>en</strong>ce de la coopération internationa<strong>le</strong>. Il importedonc de <strong>le</strong>s outil<strong>le</strong>r. En particulier, pour <strong>des</strong> acteurs non gouvernem<strong>en</strong>tauxaux moy<strong>en</strong>s limités, <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation peut constituer une voie pour institutionnaliserla fonction évaluative <strong>en</strong> interne.■ Plus globa<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t, la promotion du <strong>suivi</strong>-évaluation est à replacer dans <strong>le</strong>cadre <strong>des</strong> <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts de la communauté internationa<strong>le</strong> sur l’efficacité del’aide (initiés par <strong>le</strong>s États <strong>et</strong> ag<strong>en</strong>ces d’aide bilatéra<strong>le</strong> <strong>et</strong> multilatéra<strong>le</strong>) <strong>et</strong>l’« efficacité du développem<strong>en</strong>t » (processus parallè<strong>le</strong> <strong>des</strong> organisations dela société civi<strong>le</strong>) 4 .■ Enfin, la démarche proposée dans ce guide amène <strong>le</strong>s acteurs à <strong>en</strong>visager<strong>le</strong>s proj<strong>et</strong>s eau/assainissem<strong>en</strong>t dans une optique d’accompagnem<strong>en</strong>t à la15
Résumé de la méthode1617
Résumé de la méthodeRésumé de la méthode1. A. Un préalab<strong>le</strong> : rev<strong>en</strong>ir sur la formulation du proj<strong>et</strong>Avant de se lancer dans la conception du dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation d’unproj<strong>et</strong>, il convi<strong>en</strong>t de rev<strong>en</strong>ir sur la formulation de ce même proj<strong>et</strong>. L’idée estd’être sûr que ses objectifs <strong>et</strong> résultats att<strong>en</strong>dus, tels qu’ils sont formulés,perm<strong>et</strong>t<strong>en</strong>t de guider <strong>le</strong> pilotage.Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong> dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation doit s’intégrer dans <strong>le</strong> dispositifde pilotage du proj<strong>et</strong>. Il importe donc d’être au clair sur la gouvernance duproj<strong>et</strong> : qui fait quoi ?Att<strong>en</strong>tion : à c<strong>et</strong>te étape, il convi<strong>en</strong>t de préciser qui doit être impliqué dansla conception du dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation. En eff<strong>et</strong>, un tel dispositif estvoué à l’échec s’il n’est pas conçu <strong>en</strong> impliquant : <strong>le</strong>s acteurs clé de sa mise<strong>en</strong> œuvre future, <strong>et</strong> ceux qui l’utiliseront.2. 3. 4. Pour chaque résultat « intermédiaire », formu<strong>le</strong>r un ou plusieurs indicateurs.Vérifier si la liste ainsi obt<strong>en</strong>ue est réaliste (aura-t-on <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s de r<strong>en</strong>seignerchacun de ces indicateurs ?). Le cas échéant, revoir ses ambitions àla baisse.Préciser <strong>le</strong>s caractéristiques de chaque indicateur r<strong>et</strong><strong>en</strong>u (définition précise<strong>et</strong> modalités de mesure).( Évaluation à mi-parcours, <strong>en</strong>quête, étude de cas, réunions de réf<strong>le</strong>xioncol<strong>le</strong>ctive,…)M<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce <strong>le</strong> dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> <strong>le</strong> dispositif de pilotagedu proj<strong>et</strong>. Donc :préciser <strong>le</strong> cal<strong>en</strong>drier ;id<strong>en</strong>tifier <strong>le</strong>s personnes à responsabiliser ;estimer <strong>le</strong> coût du dispositif <strong>et</strong> sa faisabilité.Résultatsatt<strong>en</strong>dusR1 : Réalisationd’infrastructuresDes infrastructuresadéquates sont réaliséesLa réalisation <strong>des</strong>infrastructures sefait-el<strong>le</strong> tel<strong>le</strong> qu’on<strong>le</strong> souhaitait ?Le niveau de serviceest-il amélioré ?Tous <strong>le</strong>s ouvrages prévus sont réalisés (<strong>et</strong> <strong>le</strong>sécarts par rapport au prévisionnel sont justifiés)Les ouvrages sont exécutés dans <strong>le</strong> respect<strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s de l’artLes ouvrages réalisés assur<strong>en</strong>t un accès àl’eau potab<strong>le</strong> aux villages qui n’atteignai<strong>en</strong>t pas<strong>le</strong>s normes nationa<strong>le</strong>s <strong>en</strong> 2010B. <strong>Concevoir</strong> un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluationIndicat. n°1Indicat. n°2Indicat. n°3Indicat. n°4Préciser <strong>le</strong>s att<strong>en</strong>tes <strong>des</strong> différ<strong>en</strong>ts acteurs impliqués dans <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> : à qui<strong>le</strong> dispositif doit-il servir <strong>en</strong> priorité ?Préciser sur quoi doit porter <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation, <strong>et</strong> à quoi il doit servir :– à partir de la logique du proj<strong>et</strong>, déterminer quels sont <strong>le</strong>s résultats <strong>et</strong>objectifs à suivre ;– formu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s questions auxquel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation devra apporter <strong>des</strong>réponses ;– hiérarchiser <strong>le</strong>s questions.C. M<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationÉlaborer un outil pour c<strong>en</strong>traliser <strong>le</strong>s données recueillies. D’un point de vueinformatique, il s’agira <strong>le</strong> plus souv<strong>en</strong>t d’un tab<strong>le</strong>au réalisé avec un tab<strong>le</strong>ur.interpréter <strong>le</strong>s données recueillies. Prévoir év<strong>en</strong>tuel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t l’organisation <strong>des</strong>éances de réf<strong>le</strong>xion col<strong>le</strong>ctive ;élaborer <strong>des</strong> outils d’aide à la décision (tab<strong>le</strong>aux de bord), <strong>des</strong>tinés à prés<strong>en</strong>ter<strong>le</strong>s résultats de l’analyse aux décideurs.L’utilisation va dép<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> finalités assignées <strong>en</strong> priorité au dispositif.Faire <strong>des</strong> restitutions <strong>des</strong> résultats obt<strong>en</strong>us auprès <strong>des</strong> acteurs du dispositif.18Définir avec précision ce sur quoi il faudra définir <strong>des</strong> indicateurs. Pour cefaire, décliner <strong>le</strong>s questions <strong>en</strong> « résultats intermédiaires », <strong>le</strong>squels pourront<strong>en</strong>suite être caractérisés par <strong>des</strong> indicateurs.19
Méthodepour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre<strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation Étape 1 : Id<strong>en</strong>tifier précisém<strong>en</strong>t ce qui doit faire l’obj<strong>et</strong>d’un <strong>suivi</strong>-évaluation, <strong>et</strong> à qui cela doit servir 25Étape 2 : Définir <strong>le</strong>s indicateurs de mesuredu <strong>suivi</strong>-évaluation 33Étape 3 : Déterminer <strong>le</strong>s activités complém<strong>en</strong>tairespot<strong>en</strong>tiel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t nécessaires 39Étape 4 : Organiser <strong>le</strong> dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation 39 Recueillir <strong>le</strong>s données 42Analyser <strong>le</strong>s données 43Utiliser <strong>le</strong>s résultats du <strong>suivi</strong>-évaluation 462021
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationUn préalab<strong>le</strong> :rev<strong>en</strong>ir sur la formulation du proj<strong>et</strong>Le <strong>suivi</strong>-évaluation doit s’appuyer sur une logique de proj<strong>et</strong> formulée dansune optique de pilotage…À c<strong>et</strong>te étape, il convi<strong>en</strong>t de préciser qui doit être impliqué dansla conception du dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation. En eff<strong>et</strong>, un teldispositif est voué à l’échec s’il n’est pas conçu <strong>en</strong> impliquant :■ <strong>le</strong>s acteurs clé de sa mise <strong>en</strong> œuvre future ;■ <strong>et</strong> ceux qui l’utiliseront.Un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation doit servir de bousso<strong>le</strong> à un proj<strong>et</strong>. Mais pourque c<strong>et</strong>te bousso<strong>le</strong> soit uti<strong>le</strong>, il faut être au clair sur <strong>le</strong> but que l’on souhaite atteindre.Ainsi, avant de se lancer dans la conception du dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluationd’un proj<strong>et</strong>, il convi<strong>en</strong>t de rev<strong>en</strong>ir sur la formulation de ce même proj<strong>et</strong>. L’idéeest d’être sûr que ses objectifs <strong>et</strong> résultats att<strong>en</strong>dus, tels qu’ils sont formulés,perm<strong>et</strong>t<strong>en</strong>t de guider <strong>le</strong> pilotage (concrètem<strong>en</strong>t, vers quoi voulons-nous vraim<strong>en</strong>tal<strong>le</strong>r ?) – ce qui n’est pas toujours <strong>le</strong> cas.Rev<strong>en</strong>ir sur la formulation du proj<strong>et</strong>, dans <strong>le</strong> cadre d’une réf<strong>le</strong>xion de groupe,est aussi une façon de s’assurer que tous <strong>le</strong>s acteurs ont une compréh<strong>en</strong>sioncommune du proj<strong>et</strong> – ce qui, là <strong>en</strong>core, n’est pas toujours <strong>le</strong> cas : bi<strong>en</strong> <strong>des</strong>proj<strong>et</strong>s sont rédigés de façon solitaire.Prés<strong>en</strong>tation du cas pratique illustrant <strong>le</strong> guideNB : <strong>le</strong> dispositif prés<strong>en</strong>té ici est inspiré de la coopération <strong>en</strong>tre la vil<strong>le</strong> d’Ivry-sur-Seine <strong>et</strong> lacommune rura<strong>le</strong> de Dianguirdé (Mali). L’exemp<strong>le</strong> prés<strong>en</strong>té ci-<strong>des</strong>sous s’appuie sur <strong>le</strong> vol<strong>et</strong>AEPA du programme de coopération 2010-2012. Toutefois, il s’agit d’un dispositif fictif,établi pour <strong>le</strong>s besoins du guide. À l’heure où nous écrivons ces lignes, <strong>le</strong> dispositif réel est<strong>en</strong> cours de conception <strong>et</strong> de discussion <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s différ<strong>en</strong>ts part<strong>en</strong>aires. Et naturel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t, <strong>le</strong>sva<strong>le</strong>urs indiquées ici sont éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t fictives (nous ne pouvons présager <strong>des</strong> résultats quiseront atteints) <strong>et</strong> à vocation purem<strong>en</strong>t pédagogique.L’utilisation d’outils tels que <strong>le</strong> cadre logique – même simplifié – aid<strong>en</strong>t àformu<strong>le</strong>r clairem<strong>en</strong>t la logique d’un proj<strong>et</strong>.Bref aperçu de la coopération225 Voir par exemp<strong>le</strong> sur :www.f3e.asso.fr(rubriques « ressources »).NB : nous partons ici de la réalité de nombre d’acteurs non gouvernem<strong>en</strong>tauxqui élabor<strong>en</strong>t <strong>le</strong>urs proj<strong>et</strong>s assez rapidem<strong>en</strong>t, sans pr<strong>en</strong>dre <strong>le</strong> temps d’uneid<strong>en</strong>tification approfondie <strong>et</strong> d’une planification participative structurée. Maisil est bi<strong>en</strong> évid<strong>en</strong>t qu’un proj<strong>et</strong> doit être conçu dans <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de l’art. D<strong>en</strong>ombreux gui<strong>des</strong> développ<strong>en</strong>t c<strong>et</strong>te méthodologie 5 .… <strong>et</strong> sur une répartition <strong>des</strong> rô<strong>le</strong>s de chaque acteur clairem<strong>en</strong>t définie.Le dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation doit s’intégrer dans <strong>le</strong> dispositif de pilotagedu proj<strong>et</strong>. Il importe donc d’être au clair sur la gouvernance du proj<strong>et</strong> : quifait quoi ?C’est sur c<strong>et</strong>te base qu’on pourra <strong>en</strong>suite préciser :■ l’organisation du dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation : qui est <strong>le</strong> plus indiqué pourrecueillir <strong>le</strong>s données ? pour <strong>le</strong>s traiter ? <strong>et</strong>c.■ <strong>et</strong> sa cib<strong>le</strong> <strong>en</strong> termes d’aide au pilotage : quels sont <strong>le</strong>s différ<strong>en</strong>ts niveauxde décisions (ex. : chef de proj<strong>et</strong>, comité de pilotage,…) ? comm<strong>en</strong>t <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>évaluationdoit-il <strong>le</strong>s alim<strong>en</strong>ter ?Dianguirdé est une commune rura<strong>le</strong> créée <strong>en</strong> 1999, située au nord ouest du Mali, dansla région de Kayes (cerc<strong>le</strong> de Diéma). El<strong>le</strong> regroupe 14 villages très éloignés <strong>le</strong>s uns<strong>des</strong> autres pour une population d’<strong>en</strong>viron 12 000 habitants (Bambaras, Soninkés,Peuhls, Maures, <strong>et</strong>c.). Ivry-sur-Seine (59 600 hab.) est une commune située aux portesde Paris (banlieue sud).La coopération <strong>en</strong>tre Ivry <strong>et</strong> Dianguirdé <strong>et</strong> née dans <strong>le</strong>s années 1990, <strong>des</strong> li<strong>en</strong>s <strong>en</strong>tre<strong>le</strong> comité de jumelage <strong>et</strong> <strong>le</strong>s ressortissants de Dianguirdé vivant à Ivry. C<strong>et</strong>te coopérationa été officialisée <strong>en</strong> 2005 par la signature d’un protoco<strong>le</strong> d’accord <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s deuxcol<strong>le</strong>ctivités part<strong>en</strong>aires.En 2007, un programme de coopération tri<strong>en</strong>nal a été élaboré. L’accès à l’eau potab<strong>le</strong><strong>en</strong> était <strong>le</strong> premier <strong>et</strong> principal vol<strong>et</strong>. Ainsi, 10 forages à pompe manuel<strong>le</strong> ont étéréalisés, répartis dans <strong>le</strong>s différ<strong>en</strong>ts villages.En 2010, un nouveau programme tri<strong>en</strong>nal est élaboré dans la continuité du précéd<strong>en</strong>t,pour r<strong>en</strong>forcer <strong>le</strong> service public de l’eau à Dianguirdé. Un vol<strong>et</strong> assainissem<strong>en</strong>t est parail<strong>le</strong>urs initié. 9 forages supplém<strong>en</strong>taires sont prévus, ainsi que 4 latrines publiques. Leprogramme est cofinancé par <strong>le</strong> ministère <strong>des</strong> Affaires étrangères <strong>et</strong> europé<strong>en</strong>nes(MAEE) <strong>et</strong> une ag<strong>en</strong>ce de l’eau. >>> 23
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation>>>La logique du programmeEn comm<strong>en</strong>çant à réfléchir à ce sur quoi devait porter <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation, il est apparunécessaire de rev<strong>en</strong>ir sur la logique d’interv<strong>en</strong>tion du programme tri<strong>en</strong>nal de lacoopération Ivry-Dianguirdé. C<strong>et</strong>te logique a alors été reformulée <strong>et</strong> reprécisée, pouraboutir à la prés<strong>en</strong>tation suivante :<strong>Concevoir</strong>un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluationÉtape 1 : Id<strong>en</strong>tifier précisém<strong>en</strong>t ce qui doit faire l’obj<strong>et</strong>d’un <strong>suivi</strong>-évaluation, <strong>et</strong> à qui cela doit servirLe chapitre précéd<strong>en</strong>t invitait à rev<strong>en</strong>ir sur <strong>le</strong> proj<strong>et</strong>, notamm<strong>en</strong>t afin deformu<strong>le</strong>r <strong>des</strong> objectifs <strong>et</strong> résultats att<strong>en</strong>dus qui puiss<strong>en</strong>t servir au pilotage dela mise <strong>en</strong> œuvre du proj<strong>et</strong>.Il s’agit désormais de préciser : d’une part <strong>le</strong>s personnes à qui est <strong>des</strong>tiné <strong>le</strong><strong>suivi</strong>-évaluation, d’autre part <strong>le</strong>s informations que ces personnes veul<strong>en</strong>tobt<strong>en</strong>ir du <strong>suivi</strong>-évaluation – <strong>et</strong> donc sur quoi doit porter ce dernier. Deux questions à se poser :■ À qui doit servir <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation ? De quel(s) acteur(s) doit-il alim<strong>en</strong>terla réf<strong>le</strong>xion ?Et si plusieurs acteurs sont ciblés, à qui doit-il servir <strong>en</strong> priorité ?------------------■ De façon généra<strong>le</strong>, qu’est-ce que <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation doit pouvoir lui (<strong>le</strong>ur)apporter <strong>en</strong> priorité ?Pour répondre à ces questions, il convi<strong>en</strong>t de :■ repartir de la liste <strong>des</strong> acteurs du proj<strong>et</strong>. Élaborer un schéma pour visualiserces acteurs <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs interrelations peut alors être d’une grande aide.■ se reporter aux gran<strong>des</strong> finalités d’un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation (pilotage ;compréh<strong>en</strong>sion partagée ; communication <strong>et</strong> redevabilité ; appr<strong>en</strong>tissage).24De façon généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s acteurs impliqués dans un proj<strong>et</strong> peuv<strong>en</strong>t être répartisselon cinq catégories, avec <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes spécifiques :– mandant du proj<strong>et</strong> (financeur <strong>et</strong>/ou élus) ;– concepteur du proj<strong>et</strong> ;– exécuteur du proj<strong>et</strong> ;– maître d’ouvrage du service eau/assainissem<strong>en</strong>t (commune) ;– <strong>le</strong>s usagers (bénéficiaires du proj<strong>et</strong>). 25
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationÀ titre indicatif, <strong>le</strong>urs att<strong>en</strong>tes peuv<strong>en</strong>t être <strong>le</strong>s suivantes : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Exemp<strong>le</strong>Pour <strong>le</strong> vol<strong>et</strong> eau de la coopération Ivry/Dianguirdé, <strong>le</strong> dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluationest <strong>des</strong>tiné à alim<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> priorité la réf<strong>le</strong>xion du comité de pilotage Nord/Sud de lacoopération.NB : Les principaux acteurs de c<strong>et</strong>te coopération sont : <strong>le</strong>s deux col<strong>le</strong>ctivités (Ivry <strong>et</strong>Dianguirdé), un comité de jumelage français, l’association <strong>des</strong> ressortissants de Dianguirdé<strong>en</strong> Î<strong>le</strong>-de-France, <strong>et</strong> l’AMSCID (association mali<strong>en</strong>ne de solidarité <strong>et</strong> de coopération internationa<strong>le</strong>pour <strong>le</strong> développem<strong>en</strong>t, ONG mali<strong>en</strong>ne qui représ<strong>en</strong>te Ivry sur <strong>le</strong> terrain dans <strong>le</strong>cadre de la coopération). Ces cinq acteurs constitu<strong>en</strong>t <strong>le</strong> comité de pilotage du proj<strong>et</strong>. LaDirection régiona<strong>le</strong> de l’hydraulique (DRH) apporte éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t un appui technique. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6 C’est-à-dire qui r<strong>en</strong>voie à l’efficacitéde l’aide (sans se limiter àl’efficacité <strong>en</strong> tant que critèred’évaluation).2627
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationObjectifsglobauxIl convi<strong>en</strong>t de se reporter à la formulation de la logique du proj<strong>et</strong>, qui préciseses objectifs <strong>et</strong> résultats att<strong>en</strong>dus.Le cadre logique simplifié d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>t ressemb<strong>le</strong>ra généra<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tà ceci :Eff<strong>et</strong>s au SudEff<strong>et</strong>s au NordExemp<strong>le</strong>Les résultats <strong>et</strong> objectifs à suivre dans <strong>le</strong> cas d’Ivry-DianguirdéLe schéma illustrant la logique du programme faisait apparaître 4 résultats att<strong>en</strong>dus.Seuls <strong>le</strong>s trois premiers résultats att<strong>en</strong>dus sont développés ici :« Des infrastructures adéquates sont réalisées »« La gestion du service d’eau est améliorée (exploitation <strong>et</strong> maîtrise d’ouvrage) »« Les usagers adopt<strong>en</strong>t <strong>des</strong> pratiques adaptées au service de l’eau »En termes d’objectifs globaux, seuls <strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s du programme sur la santé <strong>des</strong> habitantsde Dianguirdé ont été r<strong>et</strong><strong>en</strong>us pour <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation.ObjectifspécifiqueLa population ciblée disposed’un service d’eau <strong>et</strong> d’assainissem<strong>en</strong>t pér<strong>en</strong>neDeuxième chose : formu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s questions auxquel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationdevra apporter <strong>des</strong> réponsesRésultatsatt<strong>en</strong>dusR1 : Réalisationd’infrastructuresR2 : Gestion du service(exploitation <strong>et</strong>maîtrise d’ouvrage)R3 : Mobilisationsocia<strong>le</strong>R4 : Éducation audéveloppem<strong>en</strong>tDerrière <strong>le</strong>s résultats à suivre (voire <strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s év<strong>en</strong>tuel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t r<strong>et</strong><strong>en</strong>us) : queveut-on savoir ? Concrètem<strong>en</strong>t, quel<strong>le</strong>s questions se pose-t-on <strong>en</strong> termes depilotage ? C’est à ces questions que <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation devra apporter <strong>des</strong>réponses.ActivitésÀ chaque proj<strong>et</strong> de définir ces questions. El<strong>le</strong>s dép<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t de ses <strong>en</strong>jeuxspécifiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes <strong>des</strong> acteurs.Avant tout, il est nécessaire d’organiser une consultation <strong>des</strong> acteurs clé duproj<strong>et</strong> afin de recueillir <strong>le</strong>urs att<strong>en</strong>tes, <strong>et</strong> proposer une priorisation <strong>en</strong> termesd’objectifs du <strong>suivi</strong>-évaluation, <strong>et</strong> d’acteurs <strong>des</strong>tinataires. Même s’il ne répondpas à l’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes de chaque acteur, il reste important que <strong>le</strong>dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation r<strong>et</strong><strong>en</strong>u soit cons<strong>en</strong>suel.Toutefois, pour faciliter c<strong>et</strong>te réf<strong>le</strong>xion, un certain nombre de questions typessont proposées (voir tab<strong>le</strong>au page suivante). Chacun pourra se <strong>le</strong>s approprier<strong>en</strong> <strong>le</strong>s adaptant.28Première chose : déterminer quels sont <strong>le</strong>s résultats <strong>et</strong> objectifs à suivreLes résultats se rapportant aux trois premiers résultats du cadre logique simplifié(R1, R2 <strong>et</strong> R3) sont incontournab<strong>le</strong>s. Un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluationne peut pas <strong>le</strong>s éluder.En revanche, il ne serait pas réaliste de vouloir systématiser <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation<strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s ; il dép<strong>en</strong>d <strong>des</strong> ambitions <strong>et</strong> <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s du proj<strong>et</strong> car il est n<strong>et</strong>tem<strong>en</strong>tplus comp<strong>le</strong>xe (il r<strong>en</strong>voie aux difficultés de l’appréciation de l’impact).Il <strong>en</strong> est de même pour <strong>le</strong> quatrième résultat lié à l’éducation au développem<strong>en</strong>t(R4), que bon nombre de proj<strong>et</strong>s inclu<strong>en</strong>t.29
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationréalisation niveau de service compét<strong>en</strong>ces exploité compét<strong>en</strong>ces politique AEPA garant reconnu s'appropri<strong>en</strong>t-ils comportem<strong>en</strong>ts économique socio-politique sanitaire <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal législatifcitoy<strong>en</strong>n<strong>et</strong>é r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t<strong>des</strong> acteurs dynamismedu territoire développem<strong>en</strong>téconomique Au-delà, on pourra éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t se reporter à l’annexe.Exemp<strong>le</strong>Les questions associées au résultats <strong>et</strong> objectifsà suivre dans <strong>le</strong> cas d’Ivry-DianguirdéObjectif 1 : Quels changem<strong>en</strong>ts significatifs <strong>le</strong>proj<strong>et</strong> produit-il sur <strong>le</strong> contexte sanitaire local au Sud ?Résultat 1 : La réalisation <strong>des</strong> infrastructures sefait-el<strong>le</strong> tel<strong>le</strong> qu’on <strong>le</strong> souhaitait ?Résultat 2 : L’exploitation technique <strong>et</strong> financièredu service public est-el<strong>le</strong> satisfaisante ?Résultat 2 : – Le maître d’ouvrage supervise-t-il la mise <strong>en</strong> place duservice public ? (pour qu’il soit conforme aux prévisions)– Le maître d’ouvrage est-il <strong>le</strong> garant d’un service publicde qualité ?NB : L’objectif 2 (Contribuer au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de la maîtrised’ouvrage de Dianguirdé) n’a pas été r<strong>et</strong><strong>en</strong>u car trop comp<strong>le</strong>xe,mais est partiel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t abordé par <strong>le</strong>s deux questions correspondantau résultat 2 / dim<strong>en</strong>sion maîtrise d’ouvrage.Résultat 3 : Les usagers s’appropri<strong>en</strong>t-ils <strong>le</strong> service ?Au-delà <strong>des</strong> personnesà qui sont <strong>des</strong>tinés <strong>le</strong>srésultats du dispositif,il convi<strong>en</strong>t de ne pasoublier d’associer aussià c<strong>et</strong>te réf<strong>le</strong>xion <strong>le</strong>spersonnes <strong>en</strong> charge durecueil <strong>des</strong> données.En eff<strong>et</strong>, cel<strong>le</strong>-ci ne ferontpas – ou mal – ce recueilsi el<strong>le</strong>s ne compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>tpas à quoi cela vaservir <strong>et</strong> <strong>en</strong> quoi cela<strong>le</strong>ur sera uti<strong>le</strong>…Troisième chose : hiérarchiser <strong>le</strong>s questions30Hiérarchiser <strong>le</strong>s questions ainsi id<strong>en</strong>tifiées. En eff<strong>et</strong>, certaines d’<strong>en</strong>tre el<strong>le</strong>sdevront peut-être être abandonnées pour <strong>des</strong> questions de réalisme. Ce choixpourra être opéré une fois <strong>le</strong>s indicateurs définis. 31
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationExemp<strong>le</strong>Une étape supplém<strong>en</strong>taire est généra<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t nécessaire pour faire <strong>le</strong> li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre<strong>le</strong>s questions de <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> <strong>des</strong> indicateurs.Ainsi, chaque question peut être déclinée <strong>en</strong> résultats « intermédiaires »qu’il faudrait atteindre au cours de la mise <strong>en</strong> œuvre du proj<strong>et</strong>. Si tous cesrésultats « intermédiaires » étai<strong>en</strong>t atteints, alors <strong>le</strong>s grands résultats att<strong>en</strong>dusdu proj<strong>et</strong> (R1, R2, R3, R4) devrai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> principe être atteints éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t.Ce sont ces résultats « intermédiaires » qui pourront être caractérisés, à l’étapesuivante, par <strong>des</strong> indicateurs relativem<strong>en</strong>t simp<strong>le</strong>s.Déclinaison <strong>en</strong> résultats intermédiaires d’un résultat à suivre1. Résultatsatt<strong>en</strong>dusR1 : Réalisationd’infrastructuresDes infrastructuresadéquates sont réalisées2. La réalisation <strong>des</strong>infrastructures sefait-el<strong>le</strong> tel<strong>le</strong> qu’on<strong>le</strong> souhaitait ?Le niveau de serviceest-il amélioré ?3. Tous <strong>le</strong>s ouvrages prévus sont réalisés (<strong>et</strong> <strong>le</strong>sécarts par rapport au prévisionnel sont justifiés)Les ouvrages sont exécutés dans <strong>le</strong> respect<strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s de l’artLes ouvrages réalisés assur<strong>en</strong>t un accès àl’eau potab<strong>le</strong> aux villages qui n’atteignai<strong>en</strong>t pas<strong>le</strong>s normes nationa<strong>le</strong>s <strong>en</strong> 20104. Indicat. n°1Indicat. n°2Indicat. n°3Indicat. n°4Étape 2 : Définir <strong>le</strong>s indicateurs de mesure du <strong>suivi</strong>-évaluationQu’est-ce qu’un indicateur ? Un indicateur est une information caractérisantla « performance » d’une action 7 . En d’autres termes, un indicateur donneune va<strong>le</strong>ur (qualitative ou quantitative) perm<strong>et</strong>tant d’apprécier la « performance» <strong>en</strong> fonction d’un critère de jugem<strong>en</strong>t 8 .Un indicateur de <strong>suivi</strong>-évaluation r<strong>en</strong>verra fréquemm<strong>en</strong>t à <strong>des</strong> échel<strong>le</strong>s de progression9 , perm<strong>et</strong>tant d’apprécier la performance tout au long de la mise <strong>en</strong>œuvre du proj<strong>et</strong>. Il peut aussi s’agir d’une va<strong>le</strong>ur unique, valab<strong>le</strong> à unmom<strong>en</strong>t donné 10 . Dans certains cas, il pourra jouer un rô<strong>le</strong> d’a<strong>le</strong>rte(ex. : quand la qualité de l’eau passe au-<strong>des</strong>sous d’un seuil critique).Enfin, un indicateur peut être quantitatif (c’est-à-dire chiffré : un nombre, unpourc<strong>en</strong>tage) ou qualitatif (c’est alors une appréciation du type : oui/non,un peu/beaucoup/pas du tout, <strong>et</strong>c.).En fonction de l’obj<strong>et</strong> du <strong>suivi</strong>-évaluation précédemm<strong>en</strong>tdéfini, un indicateur peut r<strong>en</strong>seigner sur :l’utilisation <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s <strong>et</strong> la mise <strong>en</strong> œuvre d’activités(« comm<strong>en</strong>t cela se dérou<strong>le</strong>-t-il ? ») ; on par<strong>le</strong> alorsd’indicateur de moy<strong>en</strong>s (<strong>le</strong>squels ne perm<strong>et</strong>t<strong>en</strong>t pas<strong>en</strong> tant que tels de savoir si l’on atteindra ou pas <strong>le</strong>résultat) ;l’atteinte de résultats intermédiaires (« concrètem<strong>en</strong>t,que réalise-t-on ? ») ; on par<strong>le</strong> alors d’indicateurs deréalisation ;l’atteinte de résultats finaux (« à quoi aboutit-on infine ? ») ; on par<strong>le</strong> alors d’indicateurs de résultat ;la contribution à certains eff<strong>et</strong>s (<strong>le</strong>squels r<strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t àl’idée d’impact : « à quels grands changem<strong>en</strong>ts contribue-t-on? ») ; on par<strong>le</strong> alors d’indicateurs d’eff<strong>et</strong>s.Le choix <strong>en</strong>tre ces différ<strong>en</strong>ts types d’indicateurs dép<strong>en</strong>dde l’obj<strong>et</strong> du <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> de ses ambitions (voirétape 1).{{{{Moy<strong>en</strong>sActivitésRéalisationsRésultatsEff<strong>et</strong>s7 L’OCDE (DAC) définit un indicateurde la façon suivante : « Facteurou variab<strong>le</strong>, de naturequantitatif ou qualitatif, qui constitueun moy<strong>en</strong> simp<strong>le</strong> <strong>et</strong> fiab<strong>le</strong> demesurer <strong>et</strong> d’informer <strong>des</strong> changem<strong>en</strong>tsliés à l’interv<strong>en</strong>tion ou d’aiderà apprécier la performanced’un acteur du développem<strong>en</strong>t. »NB : Un indicateur peut aussicaractériser <strong>des</strong> élém<strong>en</strong>ts d’uncontexte donné, afin de voir dansquel<strong>le</strong> mesure ces élém<strong>en</strong>ts évolu<strong>en</strong>tau fur <strong>et</strong> à mesure de l’avancéedu proj<strong>et</strong>.8 Les critères sont <strong>le</strong>s ang<strong>le</strong>s de vuer<strong>et</strong><strong>en</strong>us pour apprécier une action.Si nous regardons une personne,un ang<strong>le</strong> de vue peut-être la tail<strong>le</strong>qui va s’apprécier avec un indicateur« quantité de c<strong>en</strong>timètres », unautre ang<strong>le</strong> de vue peut-être <strong>le</strong>poids qui peut s’apprécier par « l<strong>en</strong>ombre de kilos ». (Source : L’évaluation,un outil au service de l’action,Iram, guide méthodologiqueF3E, 1996)9 Ex. : <strong>le</strong> taux de couverture du serviced’eau potab<strong>le</strong> sera d’aumoins 35 % de la population lapremière année ; 60 % ladeuxième année <strong>et</strong> 95 % à la finde la troisième année.10 Ex. : l’ouvrage réalisé a-t-il étéréceptionné par <strong>le</strong>s services techniquesde la commune ? (oui/non)3233
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation11 Voir : Le <strong>suivi</strong> d’un proj<strong>et</strong> de développem<strong>en</strong>t.Europact, guideméthodologique F3E, 2002.12 Voir : L’évaluation, un outil auservice de l’action, Iram, guideméthodologique F3E, 1996.Les résultats « intermédiaires » définis à l’étape précéd<strong>en</strong>te sont <strong>en</strong> principesuffisamm<strong>en</strong>t simp<strong>le</strong>s pour que la définition d’indicateurs ne soit pas tropcomp<strong>le</strong>xe.Quelques repères peuv<strong>en</strong>t toutefois aider à définir ces indicateurs :Dans la mesure du possib<strong>le</strong>, un indicateur quantitatif doit perm<strong>et</strong>tre derépondre à plusieurs questions : quantité : combi<strong>en</strong> ? qualité : quoi ? groupe cib<strong>le</strong> : qui ? localisation : où ? période : à partir de quand <strong>et</strong> <strong>en</strong> combi<strong>en</strong> de temps ? 11Un indicateur qualitatif doit donner <strong>des</strong> échel<strong>le</strong>s de va<strong>le</strong>ur aussi objectivesque possib<strong>le</strong>. Ceci implique de caractériser <strong>le</strong>s différ<strong>en</strong>tes réponses possib<strong>le</strong>s.Par exemp<strong>le</strong>, pour mesurer la capacité de gestion du comité de gestion d’unforage : « bonnes capacités de gestion » sortie d’un compte d’exploitation ; « capacités de gestion moy<strong>en</strong>nes » t<strong>en</strong>ue d’un cahier de caisse, maisri<strong>en</strong> de plus ; « capacités de gestion insuffisantes » pas de cahier du tout. 12La t<strong>en</strong>tation récurr<strong>en</strong>te est de définir un grand nombre d’indicateurs, avecl’espoir de tout maîtriser. Cela n’est pas réaliste : on n’aura pas <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>sde <strong>le</strong>s suivre tous (p<strong>en</strong>ser au recueil de données, puis à <strong>le</strong>ur traitem<strong>en</strong>t…).Il faut savoir se cont<strong>en</strong>ter d’un nombre limité d’indicateurs, portant sur <strong>le</strong>spoints qu’il semb<strong>le</strong> ess<strong>en</strong>tiel de suivre, auxquels on attache un <strong>en</strong>jeu fort.Tout dép<strong>en</strong>d <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de chaque proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> du type d’indicateurs, maisdans bi<strong>en</strong> <strong>des</strong> cas, une douzaine d’indicateurs constituera un maximum à nepas dépasser.Le cas échéant, il convi<strong>en</strong>t de revoir ses ambitions à la baisse <strong>en</strong> réduisant<strong>le</strong> nombre de questions de <strong>suivi</strong>-évaluation précédemm<strong>en</strong>t définies.Exemp<strong>le</strong>Définition <strong>des</strong> indicateurs du dispositif Ivry-DianguirdéAu départ, <strong>le</strong>s indicateurs étai<strong>en</strong>t très nombreux : plus d’une vingtaine. Ivry <strong>et</strong> ses part<strong>en</strong>airesont rapidem<strong>en</strong>t conclu que <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s dont ils disposai<strong>en</strong>t ne <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>trai<strong>en</strong>tpas de r<strong>en</strong>seigner tous ces indicateurs. Aussi, un nouveau travail de réf<strong>le</strong>xion a été<strong>en</strong>trepris <strong>en</strong> vue d’id<strong>en</strong>tifier <strong>le</strong>s indicateurs incontournab<strong>le</strong>s. Les autres ont été abandonnés,malgré l’intérêt de nombre d’<strong>en</strong>tre eux. Entre autres, un indicateur sur la quantitéd’eau consommée quotidi<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t par habitant avait été défini. Il a été abandonnécar pour <strong>le</strong> r<strong>en</strong>seigner, une <strong>en</strong>quête aurait été nécessaire, laquel<strong>le</strong> a été jugée troponéreuse.Au final, ils sont arrivés à une liste de 13 indicateurs, associés à quelques pointsd’att<strong>en</strong>tion (voir tab<strong>le</strong>au page suivante). Ces points d’att<strong>en</strong>tion sont ponctuels <strong>et</strong>ne nécessit<strong>en</strong>t pas de mesure <strong>en</strong> tant que tel<strong>le</strong>, mais sont néanmoins importants àm<strong>en</strong>tionner.NB : Dans la colonne « indicateurs » du tab<strong>le</strong>au page suivante, <strong>le</strong>s points d’att<strong>en</strong>tion sontrepérés par <strong>des</strong> l<strong>et</strong>tres, tandis que <strong>le</strong>s indicateurs sont numérotés avec <strong>des</strong> chiffres.À noter que sur ces 13 indicateurs, 4 d’<strong>en</strong>tre eux (<strong>le</strong>s premiers) sont ponctuels <strong>et</strong> limitésà la phase de construction <strong>des</strong> ouvrages.3435
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationCas pratiqueDes résultats du proj<strong>et</strong> aux indicateurs de <strong>suivi</strong>-évaluationObjectifs <strong>et</strong> résultats att<strong>en</strong>dus Questions <strong>et</strong> résultats « intermédiaires »R 1 : Réalisation d’infrastructures La réalisation <strong>des</strong> infrastructures se fait-el<strong>le</strong> tel<strong>le</strong> qu’on <strong>le</strong> souhaitait ?➞ R 2 : Gestion du service➞ exploitationR 2 : Gestion du service➞ maîtrise d’ouvrageR 3 : Mobilisation socia<strong>le</strong>➞ Eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong>➞ Le niveau de service est-il amélioré ?IndicateursL’exploitation technique <strong>et</strong> financière du service public est-el<strong>le</strong> satisfaisante ?Le maître d’ouvrage supervise-t-il la mise <strong>en</strong> place du service public ?(pour qu’il soit conforme aux prévisions)Le maître d’ouvrage est-il <strong>le</strong> garant d’un service public de qualité ?Les usagers s’appropri<strong>en</strong>t-ils <strong>le</strong> service ?Quels changem<strong>en</strong>ts significatifs <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> produit-il sur <strong>le</strong> contexte local au Sud ?3637
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation38Exemp<strong>le</strong>Chaque indicateur doit <strong>en</strong>suite faire l’obj<strong>et</strong> d’un travail pour <strong>en</strong> préciser <strong>le</strong>scaractéristiques : définition précise, va<strong>le</strong>urs ciblées, modalités de mesure,<strong>et</strong>c.Un tab<strong>le</strong>au peut y aider.Caractéristiques de quelques indicateurs du dispositif Ivry-Dianguirdé NB : la fréqu<strong>en</strong>ce de col<strong>le</strong>cte peut être différ<strong>en</strong>te d’un indicateur àl’autre (ici : semestriel<strong>le</strong> <strong>et</strong> annuel<strong>le</strong>). Pour certains indicateurs, il n’estpas réaliste de prévoir <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs cib<strong>le</strong>s (ex : taux de préval<strong>en</strong>ce<strong>des</strong> maladies diarrhéiques).Étape 3 : Déterminer <strong>le</strong>s activités complém<strong>en</strong>tairespot<strong>en</strong>tiel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t nécessairesLes indicateurs r<strong>et</strong><strong>en</strong>us sont-ils suffisants pour perm<strong>et</strong>tre de guider <strong>le</strong> pilotagedu proj<strong>et</strong> ? N’y a-t-il pas lieu de compléter <strong>le</strong>s informations fournies par cesindicateurs ?Dans un certain nombre de cas, on sera am<strong>en</strong>é à prévoir <strong>des</strong> activitéscomplém<strong>en</strong>taires, pour affiner l’analyse. Il pourra s’agir d’une évaluation àmi-parcours (évaluation externe, a priori), d’une <strong>en</strong>quête de satisfaction(ex. : pour apprécier la satisfaction <strong>des</strong> usagers d’un service à l’échel<strong>le</strong> d’unquartier à un instant donné 13 ), d’une étude de cas sur un suj<strong>et</strong> spécifique(ex. : pour docum<strong>en</strong>ter <strong>et</strong> aider à mieux compr<strong>en</strong>dre <strong>le</strong>s t<strong>en</strong>ants <strong>et</strong> aboutissantsliés au foncier dans un village), de réunions de réf<strong>le</strong>xion col<strong>le</strong>ctive (type« focus group »),…Là <strong>en</strong>core, il convi<strong>en</strong>t d’être réaliste quant aux moy<strong>en</strong>s nécessaires pour m<strong>en</strong>erces activités, <strong>et</strong> d’opérer un arbitrage <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>ur intérêt (vis-à-vis <strong>des</strong> objectifsdu dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> de ceux du proj<strong>et</strong>) <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur coût : <strong>le</strong> jeu <strong>en</strong>vaut-il la chandel<strong>le</strong> ?Étape 4 : Organiser <strong>le</strong> dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluationIl s’agit ici d’organiser <strong>le</strong> cal<strong>en</strong>drier <strong>et</strong> <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s humains <strong>et</strong> financiers (év<strong>en</strong>tuel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tmatériels) nécessaires au <strong>suivi</strong>-évaluation. L’idée est de m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong>cohér<strong>en</strong>ce <strong>le</strong> dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>et</strong> <strong>le</strong> dispositif de pilotage du proj<strong>et</strong>.Le dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation doit aider à la prise de décision, dans <strong>le</strong>cadre du pilotage du proj<strong>et</strong>.Aussi, il convi<strong>en</strong>t de faire coïncider <strong>le</strong> cal<strong>en</strong>drier du <strong>suivi</strong>-évaluation avec celuidu pilotage du proj<strong>et</strong>. Par exemp<strong>le</strong>, si <strong>le</strong> pilotage d’un programme de coopérationdéc<strong>en</strong>tralisée est organisé autour d’un comité de pilotage Nord/Sudannuel, il faut que <strong>le</strong>s données issues du <strong>suivi</strong>-évaluation soi<strong>en</strong>t disponib<strong>le</strong>s àtemps pour ce comité de pilotage.Pour ce faire, quand faut-il recueillir <strong>le</strong>s données <strong>et</strong> quand faut-il <strong>le</strong>s analyser ?Pour répondre à c<strong>et</strong>te question, un cal<strong>en</strong>drier doit être réalisé. Le plus simp<strong>le</strong>est de raisonner de façon rétrospective (« rétro-planning »), <strong>en</strong> partant de ladate à laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s données analysées seront utilisées.13 Dans <strong>le</strong> cas où cela ne fait pasl’obj<strong>et</strong> d’un indicateur.Parfois, il pourra être uti<strong>le</strong> de réaliser un chronogramme <strong>des</strong> activités de <strong>suivi</strong>évaluation.Ce pourra notamm<strong>en</strong>t être <strong>le</strong> cas lorsque <strong>le</strong> dispositif inclut autrechose que <strong>des</strong> indicateurs (<strong>en</strong>quêtes, évaluation à mi-parcours,…), ou lorsque<strong>le</strong> recueil de données lié à certains indicateurs exige du temps. Ceci perm<strong>et</strong>alors de mieux visualiser <strong>le</strong> chevauchem<strong>en</strong>t d’activités à m<strong>en</strong>er <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur éta<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tdans <strong>le</strong> temps. 39
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationIl importe de bi<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tifier <strong>le</strong>s personnes qui seront <strong>en</strong> charge de recueillir<strong>le</strong>s données, cel<strong>le</strong>s qui seront responsabilisées pour analyser <strong>le</strong>s donnéesrecueillies, puis cel<strong>le</strong>s qui <strong>le</strong>s transm<strong>et</strong>tront aux décideurs.En principe, on a déjà précisé à l’étape 1 qui utilisera <strong>le</strong>s données (ex. : uncomité de pilotage, un élu spécifique, <strong>et</strong>c.). Ces personnes seront chargéesde pr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> décisions sur la base de ces analyses, <strong>et</strong> c’est à el<strong>le</strong>s qu’ilfaudra transm<strong>et</strong>tre <strong>le</strong>s données analysées.Dans <strong>le</strong> cas où <strong>des</strong> activités complém<strong>en</strong>taires ont été prévues (évaluations àmi-parcours, <strong>en</strong>quêtes,…) : qui élaborera <strong>le</strong>s termes de référ<strong>en</strong>ce, qui piloteral’activité ? <strong>et</strong>c. ?C<strong>et</strong>te question est récurr<strong>en</strong>te. Bi<strong>en</strong> <strong>des</strong> dispositifs de <strong>suivi</strong>-évaluation ontéchoué car ils étai<strong>en</strong>t trop coûteux, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> temps de travail. Il convi<strong>en</strong>tdonc d’estimer <strong>le</strong> coût que représ<strong>en</strong>tera la mise <strong>en</strong> œuvre du dispositif, <strong>en</strong>particulier <strong>le</strong> recueil <strong>des</strong> données, mais aussi <strong>le</strong>ur analyse.À noter que la conception même du dispositif, nécessite un investissem<strong>en</strong>thumain à ne pas négliger.Exemp<strong>le</strong>Organisation du dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation d’Ivry-DianguirdéLe dispositif de c<strong>et</strong>te coopération est relativem<strong>en</strong>t simp<strong>le</strong>. Un échéancier n’est doncpas uti<strong>le</strong> à ce stade. Il convi<strong>en</strong>t <strong>en</strong> revanche de préciser qu’une analyse globa<strong>le</strong> <strong>des</strong>données issues du dispositif sera prés<strong>en</strong>tée à chaque comité de pilotage annuel. À c<strong>et</strong>eff<strong>et</strong>, <strong>le</strong> rapport sera <strong>en</strong>voyé à chaque membre du comité de pilotage deux semainesavant la réunion.La col<strong>le</strong>cte <strong>des</strong> données auprès <strong>des</strong> usagers <strong>et</strong> sur <strong>le</strong> territoire est assurée par l'AMSCID.Cel<strong>le</strong>s relatives à la commune par <strong>le</strong> secrétaire général.L’établissem<strong>en</strong>t du rapport annuel de <strong>suivi</strong>-évaluation est confié à l’AMSCID, sous lasupervision du secrétaire général.L’AMSCID est chargée de faire parv<strong>en</strong>ir à ce dernier une première version du rapport,au moins trois semaines avant la réunion annuel<strong>le</strong> du comité de pilotage.Le principal utilisateur <strong>des</strong> résultats du dispositif est <strong>le</strong> comité de pilotage de la coopération.C’est lui sera chargé de pr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> décisions au vu <strong>des</strong> analyses qui lui serontprés<strong>en</strong>tées. Cela dit, <strong>le</strong> secrétaire général de la commune de Dianguirdé, <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avecses élus <strong>et</strong> ses part<strong>en</strong>aires (Vil<strong>le</strong> d’Ivry, comité de jumelage, migrants), peut pr<strong>en</strong>dre toutau long de l’année <strong>le</strong>s décisions qui s’impos<strong>en</strong>t – dans <strong>le</strong>s limites de ses attributions.L’AMSCID <strong>et</strong> <strong>le</strong>SG échang<strong>en</strong>t<strong>le</strong>s donnéesL’AMSCID transm<strong>et</strong>une versionprovisoire au SGL’AMSCID établit<strong>le</strong> rapport annuelL’AMSCID <strong>en</strong>voie<strong>le</strong> rapport au comitéde pilotageFinalisationdu rapportRéunion du comitéde pilotage.Prise de décisionsT – 1 mois T – 3 semaines T – 2 semaines T40La mise <strong>en</strong> œuvre du dispositif ne génère pas de coûts financiers spécifiques, hormisceux déjà prévus dans <strong>le</strong> programme pour <strong>le</strong>s missions de l’AMSCID. (NB : <strong>le</strong>s indicateurscoûteux ont été éliminés du dispositif)En revanche, un investissem<strong>en</strong>t humain relativem<strong>en</strong>t important est nécessaire pour laconception du dispositif d’une part (3 à 4 jours de travail conjoint <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s représ<strong>en</strong>tants<strong>des</strong> deux col<strong>le</strong>ctivités part<strong>en</strong>aires <strong>et</strong> l’AMSCID), pour l’élaboration de chaquerapport d’analyse annuel d’autre part (2 journées, à chaque fois).41
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation42M<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre<strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationExemp<strong>le</strong>Recueillir <strong>le</strong>s donnéesCeci concerne avant tout <strong>le</strong>s indicateurs.L’idée est d’avoir un tab<strong>le</strong>au perm<strong>et</strong>tant d’archiver <strong>le</strong>s données recueillies, <strong>et</strong><strong>le</strong>ur évolution dans <strong>le</strong> temps. La forme du tab<strong>le</strong>au sera liée au type d’indicateur(qualitatif, quantitatif), à la fréqu<strong>en</strong>ce du recueil de données (m<strong>en</strong>suel,trimestriel, annuel).Extrait du tab<strong>le</strong>au de c<strong>en</strong>tralisation <strong>des</strong> données du dispositif Ivry-DianguirdéIndicateurVa<strong>le</strong>urinitia<strong>le</strong>sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 Cumul Le reste <strong>des</strong> données illustrant <strong>le</strong> cas pratique est disponib<strong>le</strong>dans la version é<strong>le</strong>ctronique du guide.D’un point de vue informatique, il s’agira <strong>le</strong> plus souv<strong>en</strong>t d’un tab<strong>le</strong>au réaliséavec un tab<strong>le</strong>ur (ex. : avec Excel). Dans <strong>le</strong>s cas plus rares où <strong>le</strong> volume dedonnées <strong>le</strong> justifierait, une base de données pourrait être créée (ex. : avecAccess). Veil<strong>le</strong>r toutefois à choisir un logiciel qui soit faci<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t utilisab<strong>le</strong>par tous <strong>le</strong>s acteurs concernés par <strong>le</strong> recueil <strong>et</strong> l’analyse <strong>des</strong> données.Analyser <strong>le</strong>s donnéesLes données recueillies doiv<strong>en</strong>t être analysées pour <strong>en</strong> tirer <strong>des</strong> <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>tsuti<strong>le</strong>s au pilotage du proj<strong>et</strong>. Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires.(Ex. : comm<strong>en</strong>t interpréter une baisse <strong>des</strong> cotisations recueillies : par <strong>des</strong> raisonsponctuel<strong>le</strong>s liées à une mauvaise récolte, ou par <strong>des</strong> raisons plus structurel<strong>le</strong>sliées à une insatisfaction quant au service fourni ?)Dans un certain nombre de cas, il peut être uti<strong>le</strong> de prévoir l’organisation <strong>des</strong>éances d’échange <strong>et</strong> de réf<strong>le</strong>xion rassemblant <strong>le</strong>s acteurs concernés, afind’aboutir à une analyse plus fine <strong>des</strong> données recueillies. Il convi<strong>en</strong>t alors de<strong>le</strong>s préparer avec soin :qui inviter ?quel<strong>le</strong> préparation <strong>en</strong> amont pour plus d’efficacité <strong>le</strong> mom<strong>en</strong>t v<strong>en</strong>u ? Il peutparfois y avoir un premier niveau d’analyse préparatoire à faire, au préalab<strong>le</strong>,pour faire gagner du temps au groupe ;bi<strong>en</strong> clarifier <strong>le</strong>s objectifs de ce travail d’analyse <strong>et</strong> ce qu’on <strong>en</strong> att<strong>en</strong>d aufinal, tant sur la forme que sur <strong>le</strong> fond.Ces outils sont <strong>des</strong>tinés à prés<strong>en</strong>ter <strong>le</strong>s résultats de l’analyse aux décideurs.Le type d’outils à élaborer dép<strong>en</strong>d de l’utilisation qu’on veut <strong>en</strong> faire <strong>et</strong> <strong>des</strong>personnes à qui ils sont <strong>des</strong>tinés. S’il s’agit d’aider <strong>des</strong> élus à pr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong>décisions, il faut un support concis, donnant une vision synthétique <strong>et</strong> analytique<strong>des</strong> données recueillies. Au contraire, s’il s’agit de technici<strong>en</strong>s, onpourra parfois avoir besoin de données plus exhaustives.Un ou plusieurs tab<strong>le</strong>aux de bord peuv<strong>en</strong>t ainsi être élaborés. Ils doiv<strong>en</strong>tfournir :une vision synthétique de ce sur quoi <strong>des</strong> décisions devront être prises, outout au moins <strong>des</strong> informations à maîtriser pour pr<strong>en</strong>dre <strong>des</strong> décisions (combinaisonde tab<strong>le</strong>aux, graphiques, chiffres clé, <strong>et</strong>c. sur une ou plusieurs pages)…… assortie de clés de <strong>le</strong>cture (élém<strong>en</strong>ts d’analyse synthétique, concise :comm<strong>en</strong>taires à côté <strong>des</strong> données prés<strong>en</strong>tées <strong>et</strong>/ou note d’analyse).L’important est de transm<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> informations appropriées :éviter <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux illisib<strong>le</strong>s car surchargés ou trop comp<strong>le</strong>xes ; privilégierquelques informations claires <strong>et</strong> ciblées sur <strong>le</strong>s décisions à pr<strong>en</strong>dre (l’exhaustivitén’est pas forcém<strong>en</strong>t uti<strong>le</strong>) ;un graphique est souv<strong>en</strong>t plus parlant qu’un tab<strong>le</strong>au, pour illustrer l’évolutiondans <strong>le</strong> temps d’un indicateur ;t<strong>en</strong>ir compte du profil <strong>des</strong> personnes à qui l’information doit être transmise(élu ou technici<strong>en</strong> ? alphabétisé <strong>en</strong> français ou pas ? <strong>et</strong>c.). 43
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationExemp<strong>le</strong>>>>Analyse <strong>des</strong> données du dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation d’Ivry-DianguirdéUn comité de pilotage a lieu au milieu de la troisième année du proj<strong>et</strong> (fin du semestre 5),avec <strong>le</strong>s élus <strong>des</strong> deux col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s part<strong>en</strong>aires. Un point à l’ordre du jourporte sur <strong>le</strong> <strong>suivi</strong> de la qualité de l’exploitation <strong>des</strong> forages.Ainsi, à partir de l’exploitation <strong>des</strong> données recueillies (indicateur n°5 : nombrede pannes par point d’eau <strong>et</strong> durée de la rupture d’alim<strong>en</strong>tation ; <strong>et</strong> indicateur n°6 :montant cumulé <strong>des</strong> cotisations recueillies, par comité de gestion) l’AMSCID réalise <strong>le</strong>docum<strong>en</strong>t suivant, sous la supervision du secrétaire général de la commune :Suivant <strong>le</strong>s comités de gestion, l’<strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong> <strong>des</strong> ouvrages est plus ou moins régulierDans l’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s comités de gestion effectu<strong>en</strong>t un <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong> régulier (une fois tous<strong>le</strong>s 15 jours, comme prévu), même si certains laiss<strong>en</strong>t parfois passer un <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>. Enrevanche, c<strong>et</strong>te t<strong>en</strong>dance généra<strong>le</strong> masque un problème lié à deux comités qui font<strong>des</strong> <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>s très irréguliers. Ces mêmes comités ont <strong>des</strong> résultats assez faib<strong>le</strong>s <strong>en</strong>termes de recouvrem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> cotisations (voir point suivant).L’AMSCID a r<strong>en</strong>contré ces deux comités, <strong>le</strong>squels réclam<strong>en</strong>t une rétribution supplém<strong>en</strong>tairepour réaliser davantage d’<strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>s.Une décision devrait être prise quant à ces deux comités de gestion : r<strong>en</strong>contre pourune mise à plat, sanctions, …44Les pompes à main suj<strong>et</strong>tes à quelques pannes, mais rapidem<strong>en</strong>t réparéesAu cours <strong>des</strong> deux derniers semestres, on a constaté que chaque pompe installée aucours <strong>des</strong> trois premiers semestres avait eu <strong>en</strong>tre une <strong>et</strong> deux pannes. Les pannespeuv<strong>en</strong>t être liées à la qualité de la maint<strong>en</strong>ance assurée par <strong>le</strong> comité de gestion maisaussi à l’int<strong>en</strong>sité de l’utilisation de la pompe. Les forages 2 <strong>et</strong> 5 r<strong>en</strong>contr<strong>en</strong>t un nombrede pannes plus é<strong>le</strong>vé que <strong>le</strong>s autres, ce qui pourrait s’expliquer par une utilisation plusint<strong>en</strong>se dans <strong>le</strong> cas du forage n°2, situé dans une zone d<strong>en</strong>sém<strong>en</strong>t peuplée, <strong>et</strong> par undéficit d’<strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong> pour <strong>le</strong> forage n°5 (voir plus loin).Le nombre moy<strong>en</strong> de panne par point d’eau asignificativem<strong>en</strong>t augm<strong>en</strong>té à partir du 4 esemestre (1,4 panne/point d’eau), ess<strong>en</strong>tiel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t<strong>en</strong> raison du nombre é<strong>le</strong>vé de pannesr<strong>en</strong>contrées sur <strong>le</strong> forage n°5.Au cours du semestre, sur l’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> <strong>des</strong>forages, on constate que <strong>le</strong>s ruptures d’alim<strong>en</strong>tationdu service liées à une panne dur<strong>en</strong>tgénéra<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t autour de 5 jours (même duréeque <strong>le</strong> semestre précéd<strong>en</strong>t).Ces durées d’interruption de service sont plutôtfaib<strong>le</strong>s <strong>en</strong> comparaison de cas similaires dansla région de Kayes. Cep<strong>en</strong>dant, suivant <strong>le</strong>spoints d’eau, cela peut varier assez fortem<strong>en</strong>t,de 0 à 22 jours au cours du dernier semestre.Les pannes nécessit<strong>en</strong>t généra<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t l’achat de pièces par <strong>le</strong>s artisans réparateursà la vil<strong>le</strong> de Diéma, ce qui ne semb<strong>le</strong> pas poser de problème. La rapidité de remise <strong>en</strong>service <strong>des</strong> pompes ti<strong>en</strong>t aussi à la bonne capacité <strong>des</strong> comités de gestion à réunir <strong>le</strong>ssommes nécessaires à l’achat <strong>des</strong> pièces de rechange.>>>Un recueil <strong>des</strong> cotisations qui évolue de façon assez <strong>en</strong>courageante,sauf pour deux exceptionsÀ la fin de l’année 3 du proj<strong>et</strong>, <strong>et</strong> surl’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> <strong>des</strong> forages, <strong>le</strong>s cotisationsannuel<strong>le</strong>s étai<strong>en</strong>t recueillies à hauteur de75 % (alors que nous tablions sur 70 %seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t). Là <strong>en</strong>core, c<strong>et</strong>te va<strong>le</strong>ur globa<strong>le</strong>masque <strong>des</strong> disparités relativem<strong>en</strong>timportantes.Ainsi, deux comités ont réussi à recueillir la totalité <strong>des</strong> cotisations annuel<strong>le</strong>s.En revanche, deux comités, ont <strong>des</strong> résultats n<strong>et</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>-<strong>des</strong>sous de ceux <strong>des</strong> autres.Il s’agit <strong>des</strong> mêmes qui n’<strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas régulièrem<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s ouvrages.L’AMSCID, lors de sa mission, a fait état d’usagers mécont<strong>en</strong>ts du service, <strong>et</strong> donc peu<strong>en</strong>clins à payer. Il ne s’agirait donc pas tant d’un mauvais travail de recueil par <strong>le</strong>s comités,que d’une conséqu<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> pannes <strong>des</strong> pompes à main. Mais l’irrégularité <strong>des</strong> <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>sréalisés par <strong>le</strong>s comités de gestion n’est probab<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t pas étrangère à ces pannes.À la fin du semestre 5, <strong>le</strong> recueil <strong>des</strong> cotisations semb<strong>le</strong> globa<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>en</strong> avance surl’année précéd<strong>en</strong>te (semestre 3).45
Méthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationMéthode pour concevoir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluationpilotage compréh<strong>en</strong>sion partagée Utiliser <strong>le</strong>s résultats du <strong>suivi</strong>-évaluationLe <strong>suivi</strong>-évaluation d’un proj<strong>et</strong> a quatre gran<strong>des</strong> finalités :Exemp<strong>le</strong>Prise de décision du comité de pilotage Ivry-DianguirdéLors de sa réunion, <strong>le</strong> comité de pilotage a pris plusieurs décisions liées à l’exploitation du service :faire un diagnostic du fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> deux forages suj<strong>et</strong>s aux pannes fréqu<strong>en</strong>tes ;apprécier la qualité <strong>des</strong> <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>s réalisés par <strong>le</strong>s deux comités de gestion correspondant.r<strong>en</strong>contrer <strong>le</strong>s deux comités de gestion récalcitrants <strong>et</strong> trouver <strong>des</strong> solutions avec eux ;r<strong>en</strong>contrer <strong>le</strong>s chefs <strong>des</strong> deux villages concernés pour faire un bilan avec eux.Rappel : <strong>le</strong>s données de ce cas sont tota<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t fictives.communiquerCapitaliser appr<strong>en</strong>dre46La qualité d’un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation se mesure <strong>en</strong> particulier àl’utilisation effective de ses résultats par <strong>le</strong> dispositif de pilotage du proj<strong>et</strong>.S’il n’est pas (ou peu) utilisé, c’est qu’il ne répond pas véritab<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t aux att<strong>en</strong>tes<strong>des</strong> instances de pilotage <strong>et</strong> il convi<strong>en</strong>t de <strong>le</strong> revoir <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s.S’il est très utilisé, il convi<strong>en</strong>t de restituer c<strong>et</strong>te utilisation aux acteurs dudispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation (personnes <strong>en</strong> charge du recueil <strong>et</strong> de l’analyse<strong>des</strong> données). Sinon, ces d<strong>en</strong>iers risqu<strong>en</strong>t de se démotiver avec <strong>le</strong> temps <strong>et</strong><strong>le</strong> dispositif pourrait alors se gripper.47
Annexe : Gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>ctured’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tRéalisation d’infrastructures 51Mobilisation socia<strong>le</strong> (usagers) 52Gestion du service public eau/assainissem<strong>en</strong>t 53Exploitation du service public 53Maîtrise d’ouvrage du service public 54Impact <strong>et</strong> eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong> 56Au Sud 56Au Nord 584849
Annexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tAnnexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>t14 Par exemp<strong>le</strong>, dans <strong>le</strong> cas d’unproj<strong>et</strong> pilote, il peut appuyer laréf<strong>le</strong>xion ou induire une actionsur <strong>des</strong> évolutions rég<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tairesnationa<strong>le</strong>s (<strong>en</strong> matière de déc<strong>en</strong>tralisationde la gestion de l’eau).Le <strong>suivi</strong>-évaluation d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>t peut porter sur plusieursdim<strong>en</strong>sions de l’action :la mise <strong>en</strong> place ou <strong>le</strong> r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t du service public eau/assainissem<strong>en</strong>t: <strong>le</strong> service d’adduction d’eau potab<strong>le</strong> <strong>et</strong>/ou d’assainissem<strong>en</strong>t (non seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t<strong>le</strong>s infrastructures, mais aussi toute l’organisation qui tourne autour) quiest mis <strong>en</strong> place ou r<strong>en</strong>forcé dans <strong>le</strong> cadre du proj<strong>et</strong> de coopération, <strong>et</strong> quia vocation à être pér<strong>en</strong>ne ; <strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong> : <strong>le</strong>s changem<strong>en</strong>ts apportés par <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> sur <strong>le</strong> contexte(de façon directe ou indirecte, qu’ils soi<strong>en</strong>t positifs ou négatifs), au-delà <strong>des</strong>résultats att<strong>en</strong>dus strictem<strong>en</strong>t du proj<strong>et</strong>, que ce soit au Sud ou au Nord 14 ;Pour chacune de ces dim<strong>en</strong>sions, <strong>des</strong> questions à se poser sont suggéréesdans <strong>le</strong>s pages qui suiv<strong>en</strong>t. Ceci r<strong>en</strong>voie à l’étape 1 de la méthode proposéedans ce guide.Fidè<strong>le</strong> à l’idée de ne pas proposer de dispositifs de <strong>suivi</strong>-évaluation « prêt-àporter», c<strong>et</strong>te gril<strong>le</strong> ne va pas jusqu’à la définition d’indicateurs. El<strong>le</strong> propose<strong>des</strong> questions de <strong>suivi</strong>-évaluation appropriées à un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tclassique. Ces questions sont déclinées <strong>en</strong> résultats « intermédiaires », <strong>le</strong>squelsdoiv<strong>en</strong>t faciliter la définition ultérieure <strong>des</strong> indicateurs.Réalisationd’infrastructuresIl s’agit là de la réalisation <strong>des</strong> infrastructures physiques, y compris <strong>le</strong>s étu<strong>des</strong>techniques. Une autre façon de par<strong>le</strong>r aurait pu conduire à évoquerl’« ingénierie technique ».La réalisation <strong>des</strong> infrastructures se fait-el<strong>le</strong> tel<strong>le</strong> qu'on <strong>le</strong> souhaitait ?1. Les ouvrages sont dim<strong>en</strong>sionnésdans <strong>le</strong> respect <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s de l'art<strong>et</strong> de manière réaliste2. Les contrats de marchés sontpassés dans <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de l'art3. Les ouvrages sont exécutésdans <strong>le</strong> respect <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s de l'art(technique, <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal,social)Les principes de dim<strong>en</strong>sionnem<strong>en</strong>t sont <strong>en</strong> adéquation avec <strong>le</strong>sréalités loca<strong>le</strong>sLes normes nationa<strong>le</strong>s sont respectées<strong>le</strong> code <strong>des</strong> marchés publics est respectéLe marché ti<strong>en</strong>t compte <strong>des</strong> aspects <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux <strong>et</strong> sociauxL'exécution <strong>des</strong> travaux est contrôléeLes normes nationa<strong>le</strong>s sont respectéesLes artisans maçons ont <strong>le</strong>s compét<strong>en</strong>ces nécessaires pour laréalisation <strong>des</strong> ouvragesLes prestataires d'assistance technique à la maîtrised'ouvrage sont compét<strong>en</strong>tsLa ressource <strong>en</strong> eau est préservée au niveau de la qualitéLa ressource <strong>en</strong> eau est préservée au niveau de la quantité4. Les choix techniques pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong>compte <strong>le</strong>s nécessités demaint<strong>en</strong>ance <strong>des</strong> ouvrages <strong>et</strong>d'exploitation du serviceL'expertise nécessaire à la maint<strong>en</strong>ance est disponib<strong>le</strong>Les pièces détachées, réactifs, <strong>et</strong>c. seront disponib<strong>le</strong>sLes infrastructures <strong>et</strong> accessoires nécessaires à l'exploitationdu service sont disponib<strong>le</strong>s (ex.: vannes, compteurs,…)Le niveau de service est il amélioré ?5. Les ouvrages réalisés assur<strong>en</strong>tun accès à l'<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> de lapopulationLes standards édictés par <strong>le</strong>s autorités nationa<strong>le</strong>s sont atteints6. Les ouvrages réalisés <strong>et</strong>/ouéquipem<strong>en</strong>ts installés amélior<strong>en</strong>t laqualité de l'eauLa qualité de l'eau répond aux normes (dans <strong>le</strong> temps)5051
Annexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tAnnexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tMobilisation socia<strong>le</strong>(Usagers)Gestion du service publiceau/assainissem<strong>en</strong>tIl s’agit de l’<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> <strong>des</strong> mesures de s<strong>en</strong>sibilisation, d’information <strong>et</strong> de formationconduites dans <strong>le</strong> cadre du proj<strong>et</strong> <strong>en</strong> direction <strong>des</strong> usagers.Les usagers s'appropri<strong>en</strong>t-ils <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> <strong>et</strong>, au-delà, <strong>le</strong> futur service public ?Exploitation du service publicL’exploitation du service public est placée sous la supervision du maître d’ouvrage.El<strong>le</strong> concerne <strong>des</strong> structures <strong>et</strong> dispositifs locaux assurant la gestion <strong>des</strong> infrastructurespubliques ainsi que <strong>le</strong> recouvrem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> coûts, dans une perspective de long terme.Les compét<strong>en</strong>ces loca<strong>le</strong>s nécessaires à l'exploitation du service public sont el<strong>le</strong>s - suffisantes ?1. Les infrastructures réaliséesrépond<strong>en</strong>t à la demande <strong>des</strong>usagers2. La solution technique adoptéeest supportab<strong>le</strong> financièrem<strong>en</strong>t par<strong>le</strong>s usagersL'<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> <strong>des</strong> usagers est associé <strong>et</strong> exprime ses att<strong>en</strong>tesdans <strong>le</strong> cadre du proj<strong>et</strong>une att<strong>en</strong>tion particulière est accordée aux groupes vulnérab<strong>le</strong>sLe coût de possession de l’ouvrage est supportab<strong>le</strong>1. Les besoins de r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de compét<strong>en</strong>cessont id<strong>en</strong>tifiés2. L'association d'usagers est formée à sesprérogatives3. Les exploitants <strong>des</strong> services (commune <strong>en</strong>direct, société, comité de gestion,…) sontcompét<strong>en</strong>ts pour la gestion technique <strong>et</strong> la gestionfinancièreFormation du bureau de l'association d'usagers à la gestiondu service de l'eau : gestion <strong>des</strong> associations, recrutem<strong>en</strong>t<strong>et</strong> gestion du personnel, appréciation de la qualitédu service,…Un service technique professionnel est mis <strong>en</strong> placeDes comités de gestion sont mis <strong>en</strong> place parallè<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tà la conduite <strong>des</strong> travauxComm<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s comportem<strong>en</strong>ts <strong>des</strong> usagers évolu<strong>en</strong>t-ils ?4. Les exploitants <strong>des</strong> services sont compét<strong>en</strong>tspour la gestion <strong>des</strong> relations usagers <strong>et</strong> <strong>le</strong>srelations contractuel<strong>le</strong>s3. Les usagers compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>le</strong>sproblématiques reliées à l'AEPALes usagers sont s<strong>en</strong>sibilisés au cyc<strong>le</strong> de l'eau <strong>et</strong> ses <strong>en</strong>jeuxLes usagers sont s<strong>en</strong>sibilisés aux eff<strong>et</strong>s de l'AEPA(<strong>en</strong> santé, <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t,…)Les usagers sont s<strong>en</strong>sibilisés aux <strong>en</strong>jeux liés au g<strong>en</strong>re dans <strong>le</strong> cadrede l'AEPA (gouvernance, spécificités liées au rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> femmes, <strong>et</strong>c.)5. Les prestataires de services <strong>des</strong> futurs services(<strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>, maint<strong>en</strong>ance, approvisionnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>pièces détachées) sont id<strong>en</strong>tifiés <strong>et</strong> compét<strong>en</strong>tsLe service public est-il exploité de façon satisfaisante ?4. Les usagers adopt<strong>en</strong>t <strong>des</strong>comportem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> adéquation avec<strong>le</strong>s nouveaux ouvragesLes usagers utilis<strong>en</strong>t <strong>le</strong> serviceLes usagers sont s<strong>en</strong>sibilisés à la nécessité de payer <strong>le</strong> serviceLes usagers pai<strong>en</strong>t <strong>le</strong> serviceLes règ<strong>le</strong>s d'utilisation du service ont été définies <strong>et</strong> expliquées auxusagersPas de gaspillage à la borne-fontainePas de surfacturation <strong>en</strong> cas de rev<strong>en</strong>te de voisinageBon usage <strong>des</strong> ouvrages d'assainissem<strong>en</strong>t6. L'exploitation technique duservice est performantePeu de fuites sur <strong>le</strong> réseauLe service est continu [<strong>le</strong>s problèmes d'approvisionnem<strong>en</strong>t (eau) oud'évacuation (assainis.) sont réglés rapidem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> de façon efficace]L'eau consommée respecte (ou approche) <strong>le</strong>s normes de base (OMS<strong>et</strong>/ou nationa<strong>le</strong>s) (soit par <strong>le</strong> type d'ouvrage, soit par un traitem<strong>en</strong>t àdomici<strong>le</strong>)Les efflu<strong>en</strong>ts sont traités avant <strong>le</strong>ur rej<strong>et</strong> dans l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (col<strong>le</strong>cte <strong>et</strong>traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> boues de vidanges,…)5. Les usagers adopt<strong>en</strong>t <strong>des</strong>comportem<strong>en</strong>ts hygiéniquesLavage <strong>des</strong> mains avec du savonLes usagers transport<strong>en</strong>t l'eau dans <strong>des</strong> conditions hygiéniquessatisfaisantesLes usagers stock<strong>en</strong>t l'eau dans <strong>des</strong> conditions hygiéniquessatisfaisantesConsommation d'eau potab<strong>le</strong>7. L'exploitation financière duservice est performante8. Le service est équitab<strong>le</strong> pourtousLe compte d'exploitation est équilibréLe recouvrem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> coûts est satisfaisantDes provisions pour r<strong>en</strong>ouvel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t sont alim<strong>en</strong>téesIl y a équité dans <strong>le</strong> tarif : <strong>le</strong> prix est proportionnel au niveau de servicer<strong>en</strong>duIl y a équité dans l'accès aux services5253
Annexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tAnnexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tGestion du service publiceau/assainissem<strong>en</strong>tMaîtrise d’ouvrage du service publicLe maître d’ouvrage du service eau/assainissem<strong>en</strong>t est <strong>le</strong> plus souv<strong>en</strong>t la commune sur<strong>le</strong> territoire de laquel<strong>le</strong> est implanté <strong>le</strong> service (ou une intercommunalité, quand el<strong>le</strong>sexist<strong>en</strong>t ou sont promues dans <strong>le</strong> cadre du proj<strong>et</strong>).Le maître d’ouvrage a notamm<strong>en</strong>t la charge de définir la politiqueeau/assainissem<strong>en</strong>t dans laquel<strong>le</strong> s’inscrit <strong>le</strong> service, d’organiser <strong>le</strong> montageinstitutionnel du service, puis d’<strong>en</strong> contrô<strong>le</strong>r la qualité.Le MOA dispose-t-il <strong>des</strong> compét<strong>en</strong>ces nécessaires pour jouer son rô<strong>le</strong> ?1. Les besoins de r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t decompét<strong>en</strong>ces sont id<strong>en</strong>tifiés2. La col<strong>le</strong>ctivité loca<strong>le</strong> sait gérer<strong>des</strong> marchés de travaux3. La col<strong>le</strong>ctivité loca<strong>le</strong> sait déléguerla gestion <strong>des</strong> services publics4. La col<strong>le</strong>ctivité loca<strong>le</strong> saitcontrô<strong>le</strong>r la qualité du serviceLes appels d'offres sont lancés <strong>et</strong> dépouillés par la col<strong>le</strong>ctivitéLes travaux sont réceptionnés par la col<strong>le</strong>ctivitéLes contrats signés sécuris<strong>en</strong>t <strong>le</strong> service public de l'eauLa col<strong>le</strong>ctivité loca<strong>le</strong> a été formée à la compréh<strong>en</strong>sion <strong>des</strong>indicateurs de performance d'un réseau d'eau potab<strong>le</strong>(gestion technique, gestion financière)Le MOA est-il <strong>le</strong> garant d'un service public de qualité <strong>et</strong> transpar<strong>en</strong>t ?11. Un dispositif clair <strong>et</strong> exhaustif estétabli pour la gestion du service. Ilfonctionne de façon performante12. Des exploitants compét<strong>en</strong>ts sontmobilisésLe dispositif repose sur <strong>le</strong>s 3 acteurs clé : MOA, exploitant, usagersLes rô<strong>le</strong>s <strong>et</strong> compét<strong>en</strong>ces (montage institutionnel) sont répartisclairem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction <strong>des</strong> responsabilités, capacités <strong>et</strong> risquesLes usagers sont organisés <strong>en</strong> associations représ<strong>en</strong>tatives del'<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> de la populationUn cadre de concertation <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s acteurs est définiCe cadre de concertation joue un véritab<strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de régulationLes compét<strong>en</strong>ces nécessaires pour la gestion <strong>des</strong> nouveaux servicessont connuesLes exploitants possib<strong>le</strong>s sont id<strong>en</strong>tifiésLes futurs exploitants sont sé<strong>le</strong>ctionnésLe MOA a-t-il défini sa politique AEPA ?13. Les règ<strong>le</strong>s d'exploitation <strong>des</strong>services publics sont définies par <strong>le</strong>MOAUn contrat de gestion du service définit <strong>le</strong>s obligations<strong>en</strong> contraintes <strong>des</strong> différ<strong>en</strong>tes parties (MOA, Exploitant, usagers)Les modalités de gestion <strong>des</strong> provisions pour r<strong>en</strong>ouvel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tsont définies5. Le MOA peut s'appuyer sur unétat <strong>des</strong> lieux / diagnostic de sonterritoire <strong>en</strong> matière AEPALe diagnostic ti<strong>en</strong>t compte <strong>des</strong> att<strong>en</strong>tes <strong>des</strong> usagers, <strong>des</strong>aspects sociaux, <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux, économiques, <strong>et</strong>c.14. La qualité du service estcontrôléeLe MOA est <strong>en</strong> capacité d'apprécier la qualité d'un servicesur la base d'indicateurs objectifsLe MOA a défini <strong>le</strong>s sanctions applicab<strong>le</strong>s <strong>en</strong> cas de défaillance6. LE MOA a défini <strong>le</strong>s objectifsAEPA dans <strong>le</strong> cadre de son proj<strong>et</strong>de développem<strong>en</strong>t territorialLes objectifs ont été définis <strong>en</strong> concertation avec toutes <strong>le</strong>s parties pr<strong>en</strong>antesLa politique AEPA est définie dans <strong>le</strong> cadre d'une gestion intégrée<strong>des</strong> ressources <strong>en</strong> eauL'<strong>en</strong>semb<strong>le</strong> de la filière a été prise <strong>en</strong> compte )(aspects techniques, institutionnelsDes objectifs de service ont été définis (par zone / quartier,catégorie d'usagers..)15. La transpar<strong>en</strong>ce du service estgarantieLe MOA r<strong>en</strong>d compte auprès <strong>des</strong> usagers de la performancede <strong>le</strong>urs servicesLe MOA r<strong>en</strong>d compte auprès <strong>des</strong> usagers <strong>des</strong> circuits financiersL’utilisation <strong>des</strong> fonds est contrôlée7. Le MOA s'est fixé un plan d'actionspour atteindre ses objectifsUn cal<strong>en</strong>drier d'amélioration du service a été définiLes actions à m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> œuvre ont été chiffrées8. Le MOA a défini une stratégie depér<strong>en</strong>nisation <strong>des</strong> ressources9. La politique AEPA s'inscrit dans<strong>le</strong> cadre juridique <strong>et</strong> institutionnel10. Le MOA dispose d'un dispositifde <strong>suivi</strong> évaluation de sa politiqueSi un poste de responsab<strong>le</strong> AEPA est créé au sein de la commune,alors <strong>le</strong>s modalités de financem<strong>en</strong>t de ce poste sont prévuesau terme du proj<strong>et</strong>Les modalités de r<strong>en</strong>ouvel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t du matériel sont prévuesLes deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> usagers sont prises <strong>en</strong> compte par <strong>le</strong> MOALa col<strong>le</strong>ctivité est à l'écoute de l'évolution de la demande <strong>des</strong> usagersLe MOA est-il reconnu ?16. Le MOA compét<strong>en</strong>t est reconnu dansses prérogatives <strong>et</strong> <strong>le</strong>s tiers rempliss<strong>en</strong>t<strong>le</strong>urs <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts à son <strong>en</strong>contreLe MOA local est légitimé auprès <strong>des</strong> instances nationa<strong>le</strong>sLe MOA local est légitimé auprès <strong>des</strong> usagers / de la société civi<strong>le</strong>5455
Annexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tAnnexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tImpact <strong>et</strong>eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong>NB : Apprécier l’impact est un travail très ambitieux. Dans <strong>le</strong> cadre d’une démarche de <strong>suivi</strong>évaluation,<strong>le</strong> défi est <strong>en</strong>core plus important. Un préalab<strong>le</strong> doit donc être posé immédiatem<strong>en</strong>t :un dispositif de <strong>suivi</strong>-évaluation ne saurait al<strong>le</strong>r très loin <strong>en</strong> la matière (sauf à déployer <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>simportants) ; seuls quelques eff<strong>et</strong>s pourront être <strong>suivi</strong>s, sans aucune prét<strong>en</strong>tion à l’exhaustivité. Demême, la question de l’attribution <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s (à qui <strong>et</strong> dans quel<strong>le</strong> mesure peut-on imputer la paternitéde tel eff<strong>et</strong> à un proj<strong>et</strong> <strong>en</strong> particulier ?) aura du mal à être traitée sérieusem<strong>en</strong>t par un acteur nongouvernem<strong>en</strong>tal aux moy<strong>en</strong>s limités.Eff<strong>et</strong>s au SudLes eff<strong>et</strong>s générés par un proj<strong>et</strong> eau / assainissem<strong>en</strong>t dépass<strong>en</strong>t largem<strong>en</strong>t l’accès auxservices de base. Ces eff<strong>et</strong>s peuv<strong>en</strong>t concerner <strong>le</strong>s aspects sociaux, économiques,<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux, politiques, <strong>et</strong>c.Quels changem<strong>en</strong>ts « significatifs » <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> produit-il sur <strong>le</strong> contexte local, au Sud ?(changem<strong>en</strong>ts positifs ou négatifs, prévus ou inatt<strong>en</strong>dus, directs ou indirects)Eff<strong>et</strong>s économiquesEff<strong>et</strong>s socio-politiques4. Le proj<strong>et</strong> contribue à l'émancipation<strong>des</strong> groupes vulnérab<strong>le</strong>s(att<strong>en</strong>tion particulière sur <strong>le</strong> g<strong>en</strong>re)5. Le proj<strong>et</strong> ne perturbe pasnégativem<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s équilibres socioéconomiquesou politiques6. Le proj<strong>et</strong> contribue à l'émerg<strong>en</strong>ced'une société civi<strong>le</strong> interlocutrice<strong>des</strong> décideurs locaux7. Le proj<strong>et</strong> contribue à r<strong>en</strong>forcer lacitoy<strong>en</strong>n<strong>et</strong>é chez <strong>le</strong>s habitantsEff<strong>et</strong>s institutionnels8. Le proj<strong>et</strong> contribue au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>tde la maîtrise d’ouvrage de lacol<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong> part<strong>en</strong>aire9. Le proj<strong>et</strong> contribue à l’améliorationde la législation <strong>en</strong> matière d’eau <strong>et</strong>d’assainissem<strong>en</strong>tDavantage de fil<strong>le</strong>s peuv<strong>en</strong>t al<strong>le</strong>r à l'éco<strong>le</strong>Les femmes particip<strong>en</strong>t davantage aux espaces de gouvernance locauxL'équipe proj<strong>et</strong> loca<strong>le</strong> intègre <strong>des</strong> femmes à <strong>des</strong> postes de responsabilitéLe proj<strong>et</strong> n'introduit pas de conflits <strong>en</strong>tre é<strong>le</strong>veurs <strong>et</strong> cultivateurs.Le proj<strong>et</strong> n'amène pas de déplacem<strong>en</strong>ts de populationLe proj<strong>et</strong> ne suscite pas (ou ne r<strong>en</strong>force pas) de népotismeDes proj<strong>et</strong>s d'intérêt général émerg<strong>en</strong>t autour <strong>des</strong> actions AEP,qui sont portés par <strong>des</strong> OSC <strong>en</strong> concertation avec la col<strong>le</strong>ctivitéLes usagers du service AEPA pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t consci<strong>en</strong>ce du rô<strong>le</strong> de lacol<strong>le</strong>ctivité <strong>et</strong> de la nécessité de payer une taxeLes ressources de la commune sont <strong>en</strong> hausse (fiscalité loca<strong>le</strong>)Le proj<strong>et</strong> a un eff<strong>et</strong> d'<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t positif qui r<strong>en</strong>force <strong>le</strong>s autres servicespublics de la col<strong>le</strong>ctivité, au-delà du service AEPA (urbanisme, gestion<strong>des</strong> déch<strong>et</strong>s, état civil / foncier,…)Le proj<strong>et</strong> perm<strong>et</strong> de « tester » certaines rég<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tations nationa<strong>le</strong>s <strong>en</strong>matière de déc<strong>en</strong>tralisation de la gestion de l’eau <strong>et</strong> l ’assainissem<strong>en</strong>tLe proj<strong>et</strong> contribue à lancer <strong>le</strong> débat autour de certainesrég<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tations ou de décr<strong>et</strong>s d’applications de loisL’État, associé au proj<strong>et</strong>, est am<strong>en</strong>é à revoir certaines règ<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tations1. Le proj<strong>et</strong> contribue audéveloppem<strong>en</strong>t économique localLes dép<strong>en</strong>ses de santé sont réduitesLa corvée d'eau est réduite (pour <strong>le</strong>s femmes notamm<strong>en</strong>t) <strong>et</strong> l<strong>et</strong>emps passé aux activités génératrices de rev<strong>en</strong>us est accruL'amélioration de l'accès l'eau <strong>et</strong> à l'assainissem<strong>en</strong>t perm<strong>et</strong>l'émerg<strong>en</strong>ce ou <strong>le</strong> développem<strong>en</strong>t de nouvel<strong>le</strong>s activités économiquesDes emplois pér<strong>en</strong>nes sont créés - ou au contraire, <strong>des</strong> emploissont supprimés (ex.: adduction d'eau qui supprime unapprovisionnem<strong>en</strong>t par camion citerne)Eff<strong>et</strong>s sanitaires10. La santé <strong>des</strong> usagers estaméliorée (cho<strong>le</strong>ra, diarrhées,bilharziose, voire paludisme,…)Eff<strong>et</strong>s <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux2. Le proj<strong>et</strong> r<strong>en</strong>force <strong>le</strong>scompét<strong>en</strong>ces <strong>et</strong> savoir-faire locauxLe proj<strong>et</strong> valorise <strong>et</strong> r<strong>en</strong>force <strong>le</strong>s savoir-faire locauxDe nouvel<strong>le</strong>s compét<strong>en</strong>ces sont créées (ouverture vers d<strong>en</strong>ouveaux métiers ; ex.: recyclage)Les compét<strong>en</strong>ces loca<strong>le</strong>s sont utilisées pour la réalisation<strong>des</strong> équipem<strong>en</strong>ts <strong>et</strong> la gestion du service11. Les eff<strong>et</strong>s négatifs sur <strong>le</strong>changem<strong>en</strong>t climatique sont limités12. Le proj<strong>et</strong> a <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s positifssur <strong>le</strong> changem<strong>en</strong>t climatiqueLe proj<strong>et</strong> perm<strong>et</strong> de lutter contre la désertification (évitersurpâturage, réutilisation <strong>des</strong> eaux usées pour reboisem<strong>en</strong>t,…)3. Le proj<strong>et</strong> pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> compte <strong>le</strong>susages économiques de l'eau(agrico<strong>le</strong>s, industriels…)Le proj<strong>et</strong> ne pénalise pas <strong>le</strong>s autres usages de l'eau (agrico<strong>le</strong> :disponibilité d'eau pour l'irrigation, industriels <strong>et</strong> commerciaux :pêche, <strong>et</strong>c.)13. La qualité <strong>et</strong> la quantité <strong>des</strong>ressources <strong>en</strong> eau ne sont pasdégradées par <strong>le</strong> proj<strong>et</strong>Le proj<strong>et</strong> n'<strong>en</strong>traîne pas une surexploitation <strong>des</strong> aquifèresLe proj<strong>et</strong> contribue à protéger <strong>le</strong>s aquifères de la contaminationpar <strong>des</strong> rej<strong>et</strong>s d'eaux usées5657
Annexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tAnnexe : gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture d’un proj<strong>et</strong> eau/assainissem<strong>en</strong>tImpact <strong>et</strong>eff<strong>et</strong>s du proj<strong>et</strong>Eff<strong>et</strong>s au NordDe façon plus diffuse qu’au Sud, <strong>le</strong>s proj<strong>et</strong>s m<strong>en</strong>és génèr<strong>en</strong>t aussi <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s au Nord.Ces eff<strong>et</strong>s peuv<strong>en</strong>t toucher <strong>des</strong> élus ou <strong>des</strong> services techniques de la col<strong>le</strong>ctivité duNord, ou <strong>en</strong>core <strong>des</strong> citoy<strong>en</strong>s. L’éducation au développem<strong>en</strong>t est souv<strong>en</strong>t ce qui vi<strong>en</strong>timmédiatem<strong>en</strong>t à l’esprit, mais <strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s peuv<strong>en</strong>t être bi<strong>en</strong> plus variés.Les eff<strong>et</strong>s au Nord dép<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t aussi de la volonté de la col<strong>le</strong>ctivité territoria<strong>le</strong> <strong>en</strong> amontde la coopération <strong>et</strong> de sa ligne politique. Certains eff<strong>et</strong>s peuv<strong>en</strong>t être recherchés <strong>et</strong> lacoopération pourra être bâtie <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce (même si ri<strong>en</strong> n’est acquis d ‘avance).Quels changem<strong>en</strong>ts « significatifs » <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> produit-il sur <strong>le</strong> contexte local, au Nord ?Eff<strong>et</strong>s sur <strong>le</strong> r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> acteurs5. Le service public AEPA au Nor<strong>des</strong>t amélioré (r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t <strong>des</strong>capacités opérationnel<strong>le</strong>s)6. Le fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> l'organisationinterne de la CT est amélioré(r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t organisationnel)7. La motivation <strong>et</strong> <strong>le</strong> dynamisme<strong>des</strong> ag<strong>en</strong>ts de la CT sont r<strong>en</strong>forcés8. L'assise institutionnel<strong>le</strong> de la CTest r<strong>en</strong>forcéeLes élus <strong>et</strong> <strong>le</strong>s ag<strong>en</strong>ts requestionn<strong>en</strong>t <strong>le</strong>ur conception du servicepublic AEPA (modalités de financem<strong>en</strong>t, rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> différ<strong>en</strong>tsacteurs,…) <strong>et</strong> la font évoluer grâce à la coopérationDe nouvel<strong>le</strong>s pratiques <strong>en</strong> matière d'AEPA sont introduites(ex.: métho<strong>des</strong> <strong>et</strong> outils d'intermédiation socia<strong>le</strong>) <strong>et</strong>/ou <strong>le</strong>s pratiquesactuel<strong>le</strong>s sont améliorées, grâce aux <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts tirés de lacoopérationLes services de la CT ont appris à travail<strong>le</strong>r davantag <strong>en</strong>semb<strong>le</strong>(décloisonnem<strong>en</strong>t) grâce à la coopérationL'esprit d'équipe est amélioré au sein du personnel de la CT (via <strong>le</strong>urimplication dans <strong>le</strong> proj<strong>et</strong>)Des ag<strong>en</strong>ts de la CT redonn<strong>en</strong>t du s<strong>en</strong>s à <strong>le</strong>ur travail quotidi<strong>en</strong> (ex.:s'occuper d'un réseau d'eau) grâce à ce que la coopération <strong>le</strong>ur a faitvivreLa notoriété de la CT est r<strong>en</strong>forcée, ses atouts sont valorisés,tant sur <strong>le</strong> territoire - qu'au delà (échel<strong>le</strong> nationa<strong>le</strong>, voire internationa<strong>le</strong>)Eff<strong>et</strong>s sur <strong>le</strong> dynamisme du territoire (dim<strong>en</strong>sion « col<strong>le</strong>ctive », impliquant <strong>des</strong> acteurs)Eff<strong>et</strong>s sur la citoy<strong>en</strong>n<strong>et</strong>é (dim<strong>en</strong>sion plutôt individuel<strong>le</strong>)1. Les citoy<strong>en</strong>s du Nordappréh<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t mieux <strong>le</strong>s <strong>en</strong>jeux Nord /Sud, <strong>et</strong> agiss<strong>en</strong>t <strong>en</strong> faveur de lasolidarité internationa<strong>le</strong>2. Du li<strong>en</strong> social est créé <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>shabitants du territoire, <strong>et</strong> <strong>le</strong>spréjugés <strong>des</strong> uns <strong>en</strong>vers <strong>le</strong>s autresse réduis<strong>en</strong>tLa mobilisation politique <strong>et</strong> financière du Nord <strong>en</strong> faveur du Sud estaccrue (grâce au proj<strong>et</strong>) : <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t d'élus, plaidoyerd'associations, dons privés, budg<strong>et</strong> public consacré à la coopération,…Les citoy<strong>en</strong>s du Nord (y compris <strong>le</strong>s jeunes de 2 e générationissus de la migration) sont davantage s<strong>en</strong>sibilisés aux <strong>en</strong>jeuxde la solidarité internationa<strong>le</strong> (grâce au proj<strong>et</strong>)Le personnel <strong>et</strong> <strong>le</strong>s élus de la CT sont davantage s<strong>en</strong>sibilisés aux<strong>en</strong>jeux de la solidarité internationa<strong>le</strong> (grâce au proj<strong>et</strong>)Les citoy<strong>en</strong>s du Nord appr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à mieux connaître <strong>le</strong>urs concitoy<strong>en</strong>sissus de la migration <strong>et</strong> <strong>le</strong>s préjugés tomb<strong>en</strong>t de part <strong>et</strong> d'autreLa coopération perm<strong>et</strong> de créer <strong>des</strong> li<strong>en</strong>s sociaux <strong>en</strong>tre <strong>des</strong> habitantsqui ne se serai<strong>en</strong>t pas r<strong>en</strong>contrés sans cela9. Un réseau d'acteur est crééou r<strong>en</strong>forcé sur <strong>le</strong> territoire10. De nouvel<strong>le</strong>s initiatives sontlancées (grâce à la coopération)11. L'id<strong>en</strong>tité <strong>et</strong> la cohésion duterritoire se r<strong>en</strong>forceDe nouvel<strong>le</strong>s compét<strong>en</strong>ces (personnes, ressources, structures) sontid<strong>en</strong>tifiées sur <strong>le</strong> territoire grâce à la coopération, compét<strong>en</strong>ces quipeuv<strong>en</strong>t être uti<strong>le</strong>s au développem<strong>en</strong>t local (tissu social, culturel,économique <strong>et</strong> politique)Des acteurs du territoire sont mis <strong>en</strong> réseau grâce au proj<strong>et</strong> (associations,socioculturels, professionnels, acteurs économiques, établissem<strong>en</strong>tsacteurs publics, autres CT, autres services de la CT), ce qui peut débouchersur <strong>des</strong> alliances ou <strong>des</strong> initiatives communes au NordLes acteurs migrants acteurssont davantage impliqués dans la vie loca<strong>le</strong>(initiatives culturel<strong>le</strong>s, socia<strong>le</strong>s, implication dans la vie citoy<strong>en</strong>ne,…)Des services publics locaux (jeunesse, politique de la vil<strong>le</strong>,…)peuv<strong>en</strong>t, grâce à la coopération, lancer de nouvel<strong>le</strong>s actions, innoverDes manifestations d'<strong>en</strong>vergure sont organisées sur <strong>le</strong> territoire grâceau proj<strong>et</strong> (manif. culturel<strong>le</strong>s, sportives, citoy<strong>en</strong>nes,…)Grâce aux actions <strong>en</strong>treprises col<strong>le</strong>ctivem<strong>en</strong>t, <strong>le</strong>s acteurs <strong>et</strong> <strong>le</strong>s personness'id<strong>en</strong>tifi<strong>en</strong>t davantage à <strong>le</strong>ur territoire, se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t plus solidaires<strong>le</strong>s uns <strong>des</strong> autres3. Les citoy<strong>en</strong>s connaiss<strong>en</strong>t mieux<strong>le</strong>s acteurs <strong>et</strong> services publicsLes citoy<strong>en</strong>s du Nord perçoiv<strong>en</strong>t mieux l'importance d'un service publicAEPA <strong>et</strong> <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> d'une CTEff<strong>et</strong>s sur <strong>le</strong> développem<strong>en</strong>t économique du territoire584. Les citoy<strong>en</strong>s appréh<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tmieux <strong>le</strong>s <strong>en</strong>jeux liés à certainsbi<strong>en</strong>s publics mondiauxLes citoy<strong>en</strong>s du Nord sont mieux s<strong>en</strong>sibilisés à l'importance dela protection de l'eau, à ses <strong>en</strong>jeux <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux <strong>et</strong> politique12. Le développem<strong>en</strong>t économiquedu territoire Nord est r<strong>en</strong>forcéDes relations <strong>en</strong>tre acteurs économiques Nord <strong>et</strong> Sud sont crééesDe nouveaux débouchés économiques sont créésLe territoire <strong>et</strong> ses atouts sont promus à l'internationalDes emplois sont créés au Nord grâce à la coopération59
NOTES6061
NOTESPhotographies :Guillaume Aubourg, Vinc<strong>en</strong>t Dussaux,Céline Noblot (pS-Eau)Conception graphique<strong>et</strong> mise <strong>en</strong> page06 78 68 27 28Imprimé sur papier 100 % recycléImpression25000 BESANÇON62Dépôt légal : Février 2011
www.f3e.asso.frFonds pour la promotion <strong>des</strong> Étu<strong>des</strong> préalab<strong>le</strong>s,<strong>des</strong> Étu<strong>des</strong> transversa<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>des</strong> ÉvaluationsCréé <strong>en</strong> 1994, <strong>le</strong> F3E est un réseau d’ONG, decol<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s <strong>et</strong> d’hôpitaux français<strong>en</strong>gagés dans <strong>des</strong> actions de coopé ration internationa<strong>le</strong>au service du développem<strong>en</strong>t.Il <strong>le</strong>s accompagne dans l’amélioration de laqualité <strong>et</strong> de l’efficacité de <strong>le</strong>urs pratiques : appuià la mise <strong>en</strong> œuvre d’étu<strong>des</strong>, production degui<strong>des</strong> <strong>et</strong> d’outils, organisation d’échanges <strong>et</strong> deformations.www.pseau.orgprogramme Solidarité EauCréé <strong>en</strong> 1984, <strong>le</strong> pS-Eau est un réseau d'organismesfrançais <strong>et</strong> étrangers interv<strong>en</strong>ant pourl’accès à l'eau potab<strong>le</strong> <strong>et</strong> à l'assainissem<strong>en</strong>t dans<strong>le</strong>s pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t.Il propose appui <strong>et</strong> conseil aux acteurs de la coopérationdéc<strong>en</strong>tralisée <strong>et</strong> non gouvernem<strong>en</strong>ta<strong>le</strong>,anime <strong>des</strong> espaces d’échange <strong>et</strong> de concertation,<strong>et</strong> mène <strong>des</strong> programmes de recherche-actions.www.ar<strong>en</strong>eidf.orgAg<strong>en</strong>ce régiona<strong>le</strong> de l’Environnem<strong>en</strong>t <strong>et</strong><strong>des</strong> Nouvel<strong>le</strong>s énergies d’Î<strong>le</strong>-de-FranceCréée <strong>en</strong> 1994, l’ARENE, organisme « associé »au Conseil régional d’Î<strong>le</strong>-de-France, participe àla mise <strong>en</strong> œuvre du développem<strong>en</strong>t durab<strong>le</strong>.El<strong>le</strong> accompagne <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s <strong>et</strong><strong>le</strong>s acteurs régionaux dans <strong>le</strong>urs démarches :prospection, valorisation d’innovations, infor -mation, s<strong>en</strong>sibilisation, ateliers <strong>et</strong> forums…
Le F3E, <strong>le</strong> pS-Eau <strong>et</strong> l’ARENE Î<strong>le</strong>-de-France, avec <strong>le</strong> souti<strong>en</strong> duMinistère <strong>des</strong> Affaires Étrangères <strong>et</strong> Europé<strong>en</strong>nes, ont animé <strong>en</strong>2009-2010 un groupe de travail composé de col<strong>le</strong>ctivitésterritoria<strong>le</strong>s, d’ag<strong>en</strong>ces de l’eau ainsi que d’ONG <strong>et</strong> d’unefondation, sur <strong>le</strong> thème du <strong>suivi</strong>-évaluation <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s dans <strong>le</strong>secteur de l’eau <strong>et</strong> de l’assainissem<strong>en</strong>t. Ce guide est <strong>le</strong> fruit deces travaux col<strong>le</strong>ctifs.Ce guide contribue d’une certaine manière à un certain nombred’<strong>en</strong>jeux forts :• outil<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s acteurs non gouvernem<strong>en</strong>taux pour <strong>le</strong> pilotage de<strong>le</strong>urs proj<strong>et</strong>s sur l’eau <strong>et</strong> l’assainissem<strong>en</strong>t – <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s dont l<strong>en</strong>ombre croît de façon importante depuis l’adoption de la loiOudin-Santini ;• s’inscrire dans <strong>le</strong>s <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts sur l’efficacité de l’aide <strong>et</strong>l’« efficacité du développem<strong>en</strong>t » ;• am<strong>en</strong>er <strong>le</strong>s acteurs à <strong>en</strong>visager <strong>le</strong>s proj<strong>et</strong>s eau/assainissem<strong>en</strong>tdans une optique d’accompagnem<strong>en</strong>t à la mise <strong>en</strong> placed’un service public de l’eau ou de l’assainissem<strong>en</strong>t.Un point important à c<strong>et</strong> égard : <strong>le</strong> <strong>suivi</strong>-évaluation peut, <strong>en</strong>soi-même, constituer une modalité d’appr<strong>en</strong>tissage <strong>et</strong> der<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de la maîtrise d’ouvrage <strong>des</strong> col<strong>le</strong>ctivités territo -ria<strong>le</strong>s du Sud <strong>et</strong> de la gouvernance loca<strong>le</strong>.Ce guide se veut évolutif. Des suites sont <strong>en</strong>visagées <strong>en</strong> termesde formation <strong>et</strong> d’accompagnem<strong>en</strong>t d’acteurs sur la base de cedocum<strong>en</strong>t. Les <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts tirés de c<strong>et</strong>te dynamique à v<strong>en</strong>irdevrai<strong>en</strong>t perm<strong>et</strong>tre de procéder à une 2 ème édition <strong>en</strong>richie duguide.Aussi, toute suggestion pouvant nous perm<strong>et</strong>tre d’améliorer ceguide sera la bi<strong>en</strong>v<strong>en</strong>ue. Contacter à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> :F3Ewww.f3e.asso.fr32, rue Le Pel<strong>et</strong>ier75009 ParisBruno de Reviersb.dereviers@f3e.asso.frpS-Eauwww.pseau.org32, rue Le Pel<strong>et</strong>ier75009 ParisVinc<strong>en</strong>t Dussauxdussaux@pseau.orgD<strong>en</strong>is Désil<strong>le</strong><strong>des</strong>il<strong>le</strong>@pseau.orgAr<strong>en</strong>e IdFwww.ar<strong>en</strong>eidf.org94 bis, av<strong>en</strong>ue de Suffr<strong>en</strong>75015 ParisD<strong>en</strong>is Dangaixd.dangaix@ar<strong>en</strong>eidf.org