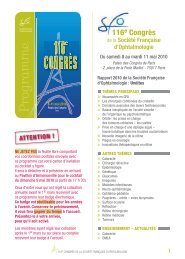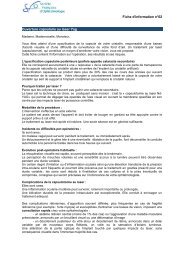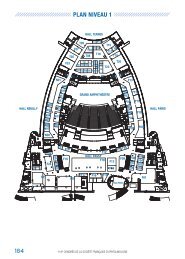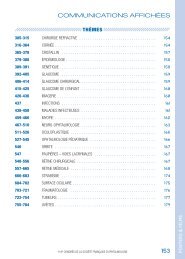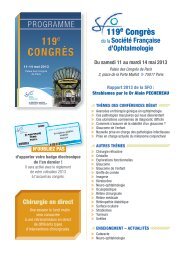COMMUNICATIONS ORALES - Société Française d'Ophtalmologie
COMMUNICATIONS ORALES - Société Française d'Ophtalmologie
COMMUNICATIONS ORALES - Société Française d'Ophtalmologie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1S146<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
JOURNÉE DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET FONDAMENTALE<br />
CICATRISATION CORNÉENNE<br />
10 01<br />
Réépithélialisation du greffon après kératoplastie lamellaire profonde.<br />
Reepithelialization of the graft after Deep lamellar keratoplasty.<br />
GRENARD N*, MURAINE M, TOUBEAU D, BRASSEUR G (Rouen)<br />
But : Comparer de manière prospective la cicatrisation précoce après kératoplastie<br />
lamellaire profonde (KLP) et kératoplastie transfixiante (KT).<br />
Matériel et Méthode : Notre étude porte sur 75 patients opérés par un seul<br />
opérateur : 25 ont bénéficié d’une KLP (âge moyen = 36,3 ans) et 50 patients (âge<br />
moyen = 60,5 ans) d’une KT. Dans chaque cas nous avons étudié la ré-épithélialisation<br />
et l’épaisseur post-opératoire du greffon pendant une période de 1 mois.<br />
Résultats : La durée de ré-épithélialisation cornéenne est significativement plus<br />
longue après kératoplastie lamellaire profonde qu’après kératoplastie<br />
transfixiante : 44 % des patients du groupe KLP sont épithélialisés à J3 contre<br />
74 % dans le groupe KT. A J5, 78 % des greffons sont épithélialisés dans le<br />
groupe KLP contre 94 % dans le groupe KT. La différence de ré-épithélialisation<br />
entre les 2 groupes est corrélée à la présence éventuelle d’un décollement descemétique<br />
et n’est pas reliée dans notre série à l’indication opératoire ni à la durée<br />
de conservation du greffon.<br />
Commentaire et Conclusions : Malgré de nombreux avantages sur la kératoplastie<br />
transfixiante dans la prise en charge des pathologies stromales (absence de rejet,<br />
densité endothéliale élevée à long terme) et une récupération visuelle identique à<br />
long terme, la durée de cicatrisation initiale est apparue plus longue en terme de réépithélialisation<br />
et de récupération d’une épaisseur cornéenne normale.<br />
10 02<br />
Modélisation de l’effet réfractif de la cicatrisation épithéliale cornéenne après<br />
photoablation de surface à visée réfractive (PKR) pour le traitement de la<br />
myopie.<br />
Modelling of the refractive effects of epithelial corneal wound healing after refractive<br />
surgery.<br />
GATINEL D*, MALET J, HOANG-XUAN T (Paris)<br />
But : Étudier l’effet théorique sur la puissance réfractive cornéenne de l’hyperplasie<br />
épithéliale après photokeratectomie à visée réfractive (PKR).<br />
Matériel et Méthode : Les surfaces étudiées (interface air/film lacrymal, membrane<br />
de Bowman), ont été modélisées par des sections coniques et les polynômes de<br />
Zernike de degrés pairs inférieurs ou égaux à 10. En utilisant des données de la<br />
littérature relatives aux variations d’épaisseurs cornéennes stromales et épithéliales<br />
après remodelage cornéen à visée réfractif, l’effet théorique de la cicatrisation cornéenne<br />
épithéliale sur la réfraction a été calculé.<br />
Résultats : L’ablation réalisée en per-opératoire de l’épithélium en PKR induit une<br />
variation importante de la valeur du défocus (Z20), de l’aberration sphérique (Z40)<br />
avant photoablation. Les variations du taux des aberrations de degré supérieur (Z60,<br />
Z80, Z100) sont non significatives. En postopératoire, une hyperplasie épithéliale à<br />
prédominance centrale induit une régression de l’effet réfractif et une modification<br />
importante du taux des aberrations sphériques.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces résultats permettent de quantifier l’effet réfractif<br />
de l’hyperplasie épithéliale après photoablation à visée réfractive et pourraient être<br />
utile pour l’établissement de profils d’ablation personnalisés.<br />
10 03<br />
Évaluation de la surface oculaire du patient diabétique en corrélation avec la<br />
rétinopathie diabétique.<br />
Correlation between retinopathy and dry eye syndrome in diabetic patients.<br />
DENOYER A*, RATEAU J, SULTANIM A, LE LEZ ML, ARSENE S, PISELLA PJ (Tours)<br />
But : Évaluer l’existence d’une corrélation entre la présence d’une rétinopathie diabétique<br />
(RD) et l’atteinte chronique de la surface oculaire des patients diabétiques.<br />
Matériel et Méthode : Cette étude prospective a concerné 40 patients diabétiques<br />
insulinodépendants ou non-insulinodépendants, atteints ou non de RD de sévérité<br />
variable. Nous avons analysé les signes subjectifs de sécheresse oculaire, la sécrétion<br />
lacrymale par le test de Schirmer et le break-up time (BUT), et les signes objectifs<br />
d’inflammation conjonctivale et de kératite. D’autres facteurs comme la durée, le<br />
type de diabète et l’équilibre glycémique ont été étudiés.<br />
Résultats : Il a été mis en évidence une corrélation positive statistiquement significative<br />
entre la sévérité de la rétinopathie diabétique et les critères cliniques d’appré-<br />
ciation de la surface oculaire : diminution de la sécrétion lacrymale et du BUT,<br />
présence d’une inflammation conjonctivale et atteinte cornéenne, avec ou sans signe<br />
fonctionnel. Le type de diabète et l’équilibre glycémique semblaient influer sur ces<br />
résultats.<br />
Commentaire et Conclusions : Les troubles chroniques de la surface oculaire sont<br />
fréquents chez le patient diabétique. La sévérité de la RD semble corrélée à l’atteinte<br />
de la surface oculaire. Cette étude souligne la nécessité d’un examen systématique<br />
de la surface oculaire chez le patient diabétique.<br />
10 04<br />
La transplantation limbo-conjonctivale monobloc autologue : approche<br />
étiopathogénique de la prise en charge chirurgicale du ptérygion.<br />
Limbal-conjunctival autograft transplantation: etiopathogenetic approach for<br />
pterygium surgery.<br />
UZEL JL*, FLAMENT J (Strasbourg)<br />
But : L’étude du ptérygion présente actuellement trois intérêts majeurs : l’augmentation<br />
de sa fréquence en rapport avec celle des flux migratoires, les progrès réalisés<br />
dans la compréhension des méc•anismes physiopathologiques responsables de la<br />
lésion ptérygiale, l’élaboration de prises en charge thérapeutiques plus efficaces<br />
cherchant à en limiter la récidive.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons réalisé une étude prospective dans le but<br />
d’évaluer l’efficacité de la greffe limbo-conjonctivale monobloc autologue dans la<br />
prise en charge de ptérygions évolutifs ou récidivants. Nous avons traité<br />
24 ptérygions, dont 4 récidives, par cette technique chirurgicale qui, après excision<br />
minutieuse de l’ensemble de la lésion ptérygiale, comble le déficit tissulaire<br />
du limbe par un greffon limbo-conjonctival prélevé sur le même œil, au niveau du<br />
cadran temporal supérieur.<br />
Résultats : Une seule récidive a été observée. Elle a été considérée comme relative<br />
en raison du caractère très limité et non évolutif de la prolifération conjonctivale ne<br />
nécessitant aucune reprise chirurgicale et de l’inobservance par le patient du traitement<br />
post-opératoire prescrit. Ce seul cas de récidive (4,1 %) place cette technique<br />
opératoire parmi les plus efficaces.<br />
Commentaire et Conclusions : Les données actuellement admises sur la physiopathologie<br />
du ptérygion ont conduit à le classer dans le nouveau cadre nosologique<br />
des pathologies de la surface oculaire liées à une insuffisance en cellules souches<br />
limbiques, localisée, acquise et d’apparition progressive. Dans ce contexte, la greffe<br />
limbo-conjonctivale monobloc autologue apparaît comme la prise en charge thérapeutique<br />
capable d’apporter la réponse la plus appropriée à ce schéma physiopathologique.<br />
10 05<br />
Prélèvements/repositions limbiques lors d’irradiations de mélanomes annulaires<br />
ciliaires.<br />
Autolologous limbal grafting for ring melanoma treated with proton-beam<br />
therapy.<br />
OTHENIN-GIRARD P* (Suisse), ZOGRAFOS L (Lausanne, Suisse)<br />
But : L’irradiation par faisceau de protons accélérés de mélanomes annulaires iridociliaires<br />
provoque des lésions radiques irréversibles du limbe cornéen. Afin de préserver<br />
une partie des cellules souches, nous avons prélevé deux quadrants conjonctivo-limbiques<br />
la veille de la 1re dose d’irradiation et les avons repositionnés le soir<br />
de la dernière dose.<br />
Matériel et Méthode : L’irradiation par faisceau de protons accélérés s’effectue en<br />
quatre doses journalières avec une dose totale de 60 Gy. La position très antérieure<br />
de ces tumeurs entraîne une irradiation importante du limbe, avec insuffisance limbique<br />
majeure secondaire. Nous avons dans deux cas prélevé un quadrant conjonctivo-limbique<br />
supérieur et un inférieur la veille de la 1 re dose, selon une méthode<br />
classique pour autogreffe limbique. Les greffons ont été placés dans un milieu de<br />
conservation (optisol) à 4 degrés durant 4 jours et remis en place après la dernière<br />
irradiation.<br />
Résultats : En comparaison avec l’évolution habituelle des mélanomes annulaires<br />
irradiés, caractérisée par l’apparition d’ulcérations chroniques cornéennes<br />
répondant mal à tout traitement médical ou chirurgical, l’évolution de ces deux<br />
cas a été favorable sans apparition de signes d’insuffisance limbique à moyen<br />
terme.<br />
Commentaire et Conclusions : Le prélèvement limbique avant irradiation avec<br />
reposition à la fin du cycle de traitement semble être une technique innovatrice de<br />
choix pour éviter les lésions radiques majeures des cellules souches cornéennes.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
JOURNÉE DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET FONDAMENTALE<br />
10 06<br />
Étude de l’expression du système MDR dans les cellules conjonctivales in vitro.<br />
Expression and modulation of multidrug resistance proteins in a human conjunctival<br />
cell line.<br />
DE SAINT JEAN M*, BAUDOUIN C, WARNET JM, BRIGNOLE F (Paris)<br />
But : La résistance pléïotrope (Multiple Drug Resistance, MDR) définit les mécanismes<br />
de défenses non-immunitaires de la cellule contre les agressions par des médicaments<br />
ou des xénobiotiques, en rapport avec une diminution de l’accumulation<br />
intracellulaire de ces substances due à l’action des pompes membranaires<br />
(transporteurs ABC) dont les principales sont la P glycoprotéine (Pgp) et la<br />
protéine MRP1. Le but de notre travail était d’étudier l’expression et la modulation<br />
du système MDR dans les cellules conjonctivales in vitro à l’état basal et sous<br />
influence de la mitomycine C et du 5-fluorouracile (5FU).<br />
Matériel et Méthode : Une lignée continue de cellules épithéliales de la conjonctive<br />
humaine (lignée de Chang) a été traitée avec la mitomycine C à 1, 5 et 10 ng/ml et<br />
avec le 5FU à 1 et 5 ng/ml pendant 24 à 72 h La morphologie cellulaire a été appréciée<br />
en microscopie en contraste de phase et en microscopie confocale après le<br />
marquage du cytosquelette par la phalloidine. L’expression des protéines Pgp et<br />
MRP1 et le cycle cellulaire ont été étudiés en cytofluorimétrie en flux et comparés à<br />
celle des autres lignées cellulaires bien caractérisés pour le système MDR : MCF7<br />
phénotype résistant et sensible, K562 et HL60 phénotypes résistants. De plus, nous<br />
avons mesuré le degré de captage de la calcéine-AM afin d’estimer la fonctionnalité<br />
de la Pgp à l’état basal et sous action des modulateurs (ciclosporine A, vérapamil).<br />
Résultats : Dans les conditions de base, la conjonctive de Chang exprime la Pgp et<br />
MRP1 dans le compartiment intracellulaire, avec une intensité intermédiaire entre les<br />
cellules malignes résistantes et celles de phénotype sensible. La Pgp exprimée dans<br />
les cellules de Chang est fonctionnelle (positivité de test à la calcéine-AM). La mitomycine<br />
C et 5FU ont induit une augmentation d’expression de la Pgp et de la MRP1,<br />
les modifications du cytosquelette, de la taille des cellules et du cycle cellulaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Nos résultats suggèrent que, dans l’œil, la résistance<br />
multi-drogue pourrait être impliquée, entre autres, dans l’échec des traitements<br />
anti-mitotiques appliqués lors de la chirurgie du glaucome et dans<br />
l’élimination des molécules lipophiles (ciclosporine A ou bêtabloquants). Le<br />
système MDR de la conjonctive pourrait, de plus, contribuer à la clairance des traitements<br />
topiques.<br />
10 07<br />
EMMPRIN, l’inducteur de métalloprotéinases, est produit et régulé au niveau de<br />
la cornée.<br />
EMMPRIN, the Matrix Metalloproteinase Inducer, is Present in the Cornea: Regulation<br />
by Tgf-b.<br />
GABISON E*, MOURAH S, HOANG-XUAN T, MAUVIEL A, MENASHI S (Paris)<br />
Purpose: To report the presence of EMMPRIN a metalloproteinase inducer in the<br />
cornea and study its regulation in vitro.<br />
Material and Method: Confocal microscopy, western blot analysis, zymography<br />
and real-time PCR were performed on corneal tissues and cultured cells.<br />
Results: EMMPRIN protein was immunolocalized on the cell surface of epithelial and<br />
stromal cells of perforated human corneas, particularly at the perforated side. The<br />
presence of the protein was confirmed by confoncal microscopy and western-blot<br />
analysis of human keratocytes in culture. EMMPRIN mRNA was detected in human<br />
keratocytes and upregulated by TGF-b. The simultaneous addition of TGF-b and<br />
TNF-a inhibited this induction. Additionally, the induction of EMMPRIN mRNA coincided<br />
with an increased level of MMP-9 in the conditioned medium.<br />
Comment and Conclusions: EMMPRIN may play a role in the induction of Matrix<br />
Metalloproteinases associated with corneal wound healing<br />
10 08<br />
Régulation de l’expression du gêne cornéen de la Kératine 12 par le facteur de<br />
transcription Krüppel-like Factor 6.<br />
Regulation of Corneal Keratin-12 Gene Expression by the Human Krüppel-like<br />
Transcription Factor 6.<br />
CHIAMBARETTA F*, BLANCHON L, DASTUGUE B, RIGAL D, SAPIN V (Clermont-<br />
Ferrand)<br />
But : La kératine 12 (K12) est une protéine essentielle pour l’intégrité de l’épithélium<br />
cornéen. Notre étude a été conduite pour explorer l’implication possible du facteur<br />
nucléaire de transcription Krüppel-like factor 6 (KLF6) dans la régulation de l’expres-<br />
sion du gène de la K12, du fait de la présence d’un site de fixation de KLF6 au niveau<br />
de promoteur de K12 humain et KLF 6 régule l’expression d’autres gènes de la<br />
famille des kératines.<br />
Matériel et Méthode : Des expériences de RT-PCR, Western-blot et d’immunolocalisation<br />
ont étudiées la présence de KLF6 à l’échelle des ARN messagers et protéinique<br />
à partir de 5 cornées humaines totales. Les mêmes expériences ont été<br />
menées sur 20 prélèvements d’épithélium cornéen humains et une lignée cellulaire<br />
humaine d’épithélium cornéen immortalisée (HCE). La capacité de la protéine KLF6<br />
de moduler l’expression de K12 a été explorer par des transfections transitoires d’un<br />
plasmide d’expression de KLF6 et d’un gène rapporteur sous contrôle du promoteur<br />
de K12. Un gel retard a été réalisé pour confirmer l’interaction entre la protéine KLF6<br />
et sa séquence de fixation sur le promoteur de K12.<br />
Résultats : La présence des ARNm et de la protéine KLF6 a été démontré a partir<br />
des extraits cornéens totaux, mais aussi des 20 prélèvements d’épithélium et de la<br />
lignée HCE. Les transfections transitoires montrent une activation significative du<br />
promoteur de K12 par KLF6. Enfin le gel retard confirme l’interaction physique entre<br />
KLF6 et le promoteur de K12.<br />
Commentaire et Conclusions : L’expression de KLF6 au niveau des cellules épithéliales<br />
humaines et son rôle dans la régulation de K12 ont été démontrés.<br />
10 09<br />
Influence des paramètres météorologiques sur la cicatrisation cornéenne après<br />
photoablation réfractive (PRK).<br />
Influence of meteorological parameters on wound healing after photorefractive<br />
keratectomy (PRK).<br />
ROULAND JF*, LABALETTE P, DEDES V, CAILLIAU D (Lille)<br />
But : Étudier l’influence des facteurs météorologiques sur la cicatrisation épithéliale<br />
après PRK.<br />
Matériel et Méthode : L’étude rassemble 453 yeux de 269 patients traités par PRK<br />
dans les même conditions de procédure par laser Excimer Technolas 217, même<br />
thérapeutiques post-opératoires (lentille de contact pansement, antibiotiques et antiinflammatoire<br />
non stéroïdiens locaux). Nous avons analysé la cicatrisation superficielle<br />
à J3 et J4 ainsi que le Haze à 1 et 3 mois. La pression atmosphérique, les<br />
températures minimales et maximales et l’humidité ont été enregistrées pour chaque<br />
patient sur leur lieu de résidence (Nord-Pas de Calais).<br />
Résultats : Une cicatrisation totale a été observée à J3 pour 327 yeux (73,65 %).<br />
Les températures modérées et les pressions atmosphériques hautes sont significativement<br />
corrélées à une cicatrisation rapide (p < 0,001).<br />
Commentaire et Conclusions : Parmi les nombreux facteurs participants à la cicatrisation<br />
épithéliale et donc au résultat final, certains paramètres météorologiques<br />
doivent être connus avant l’intervention par laser Excimer.<br />
10 10<br />
Effet biologique sur la cornée d’une source laser femtoseconde.<br />
Femtoseconde laser and biological corneal damage.<br />
COLLIAC JP*, ALBERT O, DONATE D, TUBELIS P, MOUROU G, LEGEAIS JM<br />
(Paris)<br />
But : Étude des effets de cavitation et des effets thermiques sur le tissu cornéen<br />
d’une nouvelle source laser femtoseconde et évaluation des qualités d’interface des<br />
découpes tissulaires en vue de la réalisation de greffe mécanisée lamellaire ou transfixiante.<br />
Matériel et Méthode : Nous utilisons un laser femtoseconde expérimental délivrant<br />
une énergie de 15 microjoules pour une durée d’impact de 700 femtosecondes. La<br />
fréquence peut être modulée de 1 à 10 000 Hz. Le système expérimental piloté par<br />
informatique et est constitué d’un système de transmission optique focalisé sur une<br />
chambre artificielle. Le système peut se déplacer dans les trois plans de l’espace (xy-z)<br />
avec une précision de 0,1 microns. Les cornées humaines sont exposées à la<br />
source laser et évaluées par microscopie élèctronique à transmission et à balayage.<br />
Les découpes sont comparées à celles obtenues par microkératomes (LSK one,<br />
Moria).<br />
Résultats : On observe au point focal une cavitation intrastromale de 2 à 8 microns.<br />
Quelque soit le taux de répétition du laser utilisé (1 à 10 000 Hz), il n’a pas été<br />
observé d’effet thermique sur le tissu cornéen. Les qualités de découpes intrastromales<br />
sont équivalentes ou supérieures à celles obtenues par microkératome.<br />
Commentaire et Conclusions : Les effets biologiques de notre source laser femtoseconde<br />
sont observés au point de focalisation sans effets biologiques visibles à<br />
distance. Il n’existe en particulier aucun effet thermique intracornéen.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S147
1S148<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
JOURNÉE DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET FONDAMENTALE<br />
10 11<br />
Conservation et évaluation de la viabilité de greffons cornéens endothéliaux.<br />
Conservation in organo-culture of the corneal endothelium carried by the<br />
corneoscleral rim.<br />
MAJO F*, SABATIER P (Paris), KANTELIP B (Besançon), HOANG-XUAN T (Paris)<br />
But : Le but de cette étude est de développer une procédure pour isoler et conserver<br />
l’endothélium cornéen en organoculture.<br />
Matériel et Méthode : Dix-neufs boutons cornéoscléraux humains ont été obtenus<br />
à la banque française des yeux. À l’aide du trépan et de la chambre artificielle de<br />
Hanna 80, 90 % du stroma cornéen a été retiré. Après la dissection lamellaire,<br />
l’endothélium maintenu par son anneau cornéoscléral a été conservé pendant<br />
10 jours dans son milieu de culture. Le comptage endothélial a été réalisé avant et<br />
après dissection du stroma, à J0, J2 et J10. La viabilité des cellules endothéliales a<br />
été évaluée en microscopie optique et électronique.<br />
Résultats : Cette procédure est apparue fiable pour isoler et conserver l’endothélium<br />
cornéen. Deux complications techniques principales ont été rencontrées lors de<br />
la dissection lamellaire : la perte de l’étanchéité de la chambre artificielle (n = 2) et la<br />
trépanation transfixiante du greffon (n = 1). La perte endothéliale moyenne a été évaluée<br />
à 262 cellules/mm 2 entre J0 et J3. À l’examen macroscopique, la couche endothéliale<br />
préservée sans son stroma est apparue plissée. Le contrôle cellulaire en<br />
microscopie optique et électronique de la viabilité endothéliale n’a pas retrouvé de<br />
signes de souffrance cellulaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Ce travail est une première étape dans la conservation<br />
de l’endothélium cornéen maintenu par son anneau cornéoscléral. Notre<br />
objectif est de développer une technique de kératoplastie lamellaire postérieure avec<br />
en préopératoire une procédure d’évaluation du nombre et de la qualité des cellules<br />
endothéliales des greffons lamellaires.<br />
VISION ARTIFICIELLE<br />
10 12<br />
Logiciel de simulation personnalisée des pathologies visuelles.<br />
Software of simulation personalized of visual pathologies.<br />
ZANLONGHI X* (Nantes), SURUT J (Angers), COLINEAU J (Orsay)<br />
But : Il est difficile de comprendre et d’imaginer quelles peuvent être les capacités<br />
discriminatives d’une personne amblyope. En effet, le nombre des pathologies<br />
visuelles est important, de plus, elles n’affectent pas de façon identique les patients.<br />
Il est même fréquent que des patients combinent plusieurs de ces pathologies. Dans<br />
ces conditions, il devient très difficile d’imaginer ce que peut être l’environnement<br />
perçu par un amblyope. Le logiciel que nous développons se propose donc d’être<br />
un outil permettant de simuler ce que serait la vision d’un patient malvoyant.<br />
Matériel et Méthode : Nous intégrons dans un logiciel spécifique des modèles<br />
mathématiques de la vision humaine, des résultats d’examens propres à un patient<br />
déficient visuel et une image source (représentant une scène de la vie quotidienne)<br />
servant de modèle.<br />
Résultats : Ce logiciel de simulation s’articule autour de quatre grands pôles :<br />
– Un pôle pour répertorier des images sources qui serviront pour les simulations.<br />
– Un pôle pour la saisie et la gestion des données relatives aux patients.<br />
– Un pôle pour la création et la maintenance des schémas de simulation. L’utilisateur<br />
disposera d’une interface utilisateur lui permettant de façon intuitive de créer son<br />
schéma.<br />
– Un pôle pour la réalisation des simulations. Il s’agit ici de mettre en relation les<br />
informations répertoriées par les trois pôles précédents. L’utilisateur crée une simulation<br />
en choisissant un patient, une image source et un schéma de simulation.<br />
Commentaire et Conclusions : Cet outil permet de travailler aujourd’hui sur des<br />
images statiques. On peut imaginer un système équivalent en intégrant la stratégie<br />
d’exploration d’une scène visuelle dynamique.<br />
10 13<br />
Un système d’aide à la vision nocturne pour les patients atteints de rétinopathie<br />
pigmentaire.<br />
A night vision helper device for patients with retinitis pigmentosa.<br />
ORSSAUD C*, ROCHE O, DUREAU P, HAKIKI S, DUFIER JL (Paris)<br />
But : Les rétinopathies pigmentaires concernent environ 30 000 patients en France<br />
et 400 000 en Europe. La symptomatologie de ces dégénérescences rétiniennes<br />
varie selon leur mode de transmission. Dans la forme habituelle, les porteurs de cette<br />
affection présentent une gêne visuelle nocturne précoce alors qu’ils conservent longtemps<br />
une vision diurne centrale. Il est donc licite d’assister leur vision nocturne pour<br />
réduire la gêne fonctionnelle. Nous présentons un appareil utilisé en routine par des<br />
patients présentant une rétinopathie pigmentaire.<br />
Matériel et Méthode : Ce système de lunettes de vision nocturne est un appareillage<br />
« main libre », esthétique et léger, constitué de capteurs installés sur une<br />
monture de lunette alimentés par une batterie-ceinture.<br />
Résultats : Ces lunettes de vision nocturne utilisent un système infra-rouge en<br />
ambiance scotopique et agissent en tant que recruteur de photons en vision mésopique.<br />
Elles permettent une vision satisfaisante sur une distance de 12 mètres en<br />
moyenne et un champ visuel de 30°. Leur autonomie est de 4 heures en ambiance<br />
mésopique et 2 heures 30 en ambiance scotopique.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces lunettes de vision nocturne permettent de pallier<br />
à des déficits de vision en ambiance mésopique et scotopique. En raison de<br />
l’atteinte initiale de la vision nocturne chez les patients porteurs de rétinite pigmentaire,<br />
l’utilisation d’un tel système est particulièrement recommandée. L’intérêt du<br />
système présenté ici est sa possibilité d’utilisation « main libre » simplifiée.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
LES INNOVATIONS EN OPHTALMOLOGIE<br />
10 14<br />
Limites et possibilités du système endoscopique « Endognost ».<br />
Limitations and possibilities of “Endognost” endoscopic system.<br />
UHLIG CE*, BUSSE H (Münster, Allemagne)<br />
But : L’histoire du traitement des voies lacrymales commence, autant qu’on sache,<br />
par la loi de Hammurabi de Babylone en l’an 2250 avant J.C.<br />
Matériel et Méthode : La chirurgie macroscopique des voies lacrymales est établie<br />
depuis des dizaines sinon des centaines d’années si on considère également les<br />
essais de traitement plutôt expérimentaux et reposant sur des connaissances moins<br />
élaborées de la physiologie humaine.<br />
Résultats : Aujourd’hui il est possible d’examiner et d’opérer les voies lacrymales<br />
d’une manière peu traumatique, c’est-à-dire avec les mini-endoscopes. Rapport sur<br />
les expériences avec le système « Endognost » de Schwind, Allemagne, qu’on utilise<br />
depuis cinq ans dans notre hôpital.<br />
Commentaire et Conclusions : Les moyens techniques, les limites et les possibilités<br />
des procédures endoscopiques des voies lacrymales seront présentés.<br />
10 15<br />
L’innovation entravée dans le strabisme incomitant.<br />
Delayed innovation in incomitant squints.<br />
ACLIMANDOS W* (London, Uk)<br />
Pupose: Techniques used in squint surgery have not changed much over the last<br />
decades: the two main “innovations” have been the use of adjustable sutures and<br />
posterior fixation sutures (Faden) which were both described over twenty years ago.<br />
Material and Method: Adjustable sutures have proved to be very helpful in adult<br />
squint surgery. Posterior fixation plays a useful role in the correction of some types<br />
of incomitant squints, but is technically difficult and involves significant potential<br />
complications. We have recently used a technique, initially described by Scott for the<br />
treatment of incomitant squints but with very limited uptake of this technique. It involves<br />
the recession and resection of the same muscle, and can be combined with an<br />
adjustable suture. The surgical technique is simple: it can be performed on any rectus<br />
muscle but most of the cases done so far have been on the lateral, inferior and<br />
medial recti. The risks are no higher than in traditional squint surgery.<br />
Comment and Conclusion: The results in the cases we have performed to date are<br />
presented.<br />
10 16<br />
Modulation de la cicatrisation dans la chirurgie du glaucome.<br />
Modulation of wound healing in glaucoma surgery.<br />
GREHN F*, KARASHEVA G, WIMMER I (Berlin, Allemagne)<br />
Purpose: Scarring of the filtering bleb is a hitherto underestimated problem of glaucoma<br />
surgery. About 60% of operated cases are under medical treatment 1 year<br />
after glaucoma surgery, a large proportion already after few weeks. Glaucoma surgery,<br />
however, can only be defined successful if the target pressure is reached<br />
without glaucoma medication.<br />
Material and Method: Therefore, antfibrosis agents are used in glaucoma surgery<br />
in addition to steroid application. The slit lamp morphology of the filtering bleb (vascularity,<br />
cork-screw vessels, encapsulation, microcysts) is a better guide for indication<br />
of antifibrotic agents than intraocular pressure.<br />
Present recommendations: 1. Steroids are given as eye-drops 5 times per day or<br />
hourly tapering off over several weeks. 2. In eyes with previous surgery, mitomycin<br />
C is recommended in a 0,2 mg/ml concentration soaked in a 8x8 mm sponge topically<br />
applied for 3 mn at the time of surgery. 3. 5-Fluorouracil injections (5 mg) are<br />
given postoperatively if excessive wound healing occurs. Needling with subsequent<br />
5-FU injections is indicated in encapsulated blebs. With these measures, the success<br />
rate can be doubled.<br />
Results: Future developments: Because of the side effects of MMC and 5-FU, alternatives<br />
are being developed. 1. Anti-TGFß2 antibodies act against the this cytokine<br />
which plays a major role in wound healing of filtering blebs. A multicenter randomized<br />
prospective European study is underway to test the efficacy of these antibodies<br />
when used in glaucoma surgery. Antisense nucleotides and receptor antagonists are<br />
also candidates for future research. 2. Suramine inhibits various cytokines. 3. Photodynamic<br />
therapy is a promising method which allows selective control of fibroblast<br />
activity.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM FRANCO-ALLEMAND-ANGLAIS<br />
Comment and Conclusion: These developments will probably help to better<br />
control wound healing of glaucoma surgery in the near future.<br />
10 17<br />
Électrotransfert de gène dans l’endothélium de cornées humaines ex vivo.<br />
Ex vivo gene electrotransfer to human corneal endothelial cells.<br />
THURET G*, MANISSOLLE C, DURIEUX AC, FREYSSENET D, CAMPOS L,<br />
MAUGERY J, GAIN P (St-etienne)<br />
But : L’électrotransfert de gène est une stratégie thérapeutique innovante et porteuse<br />
d’espoir pour moduler les fonctions cellulaires grâce à la synthèse de novo de<br />
protéines à effet thérapeutique. Elle apparaît plus sûre et moins immunogène que les<br />
vecteurs viraux et est également réputée plus efficace que la lipofection. Notre but<br />
était de développer et d’optimiser l’électrotransfert de gène ex vivo dans les cellules<br />
endothéliales (CE) de cornées humaines en organoculture.<br />
Matériel et Méthode : Des électrodes stérilisables et non contact ont été spécialement<br />
adaptées à la courbure cornéenne. Le générateur GET 42, original, permettait<br />
de modifier tous les paramètres du courant tels que la durée, le nombre, la fréquence,<br />
la combinaison des pulses, ainsi que l’intensité du courant. L’expression de<br />
la béta-galactosidase a été quantifiée dans les cellules endothéliales de 20 cornées<br />
humaines scientifiques, sous différents types d’impulsion électrique. La toxicité<br />
endothéliale a été évaluée par calcul de la perte cellulaire à l’aide d’un analyseur<br />
automatique de la mosaïque endothéliale développé par notre équipe.<br />
Résultats : Cinq jours après électrotransfert, toutes les cornées transfectées présentaient<br />
des cellules endothéliales exprimant la béta galactosidase en nombre<br />
variable selon les caractéristiques du courant. En l’absence de courant, aucune CE<br />
n’était transfectée. La distribution des cellules transfectées était hétérogène indiquant<br />
soit des susceptibilités cellulaires différentes soit une inhomogénéité de passage<br />
du courant. Une fois optimisé, l’électrotransfert de gène ne déclenchait pas de<br />
surmortalité cellulaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Nous avons démontré pour la première fois la faisabilité<br />
et l’innocuité cellulaire de l’electrotranfert de gène dans les cellules endothéliales<br />
de cornées conservées en organoculture. Des études ultérieures sont en cours<br />
afin de déterminer la durée d’expression du transgène.<br />
10 18<br />
Système HLA-G et cornée.<br />
Expression of HLA-G protein in cornea.<br />
LEGEAIS JM* (Paris)<br />
Purpose: In order to better understand the mechanisms promoting corneal allograft<br />
survival, we analysed wether HLA-G could be implicated in corneal graft acceptance,<br />
as an immunoregulatory factor.<br />
Material and Method: The study was realised on ten healthy corneas and corneas<br />
affected by inflammatory or by non inflammatory diseases coming from donorpatients<br />
undergoing corneal transplantation. Immunohistochemical analysis was carried<br />
out using monoclonal antibodies specific against the non classical HLA-G<br />
proteins (4H84) on cryopreserved corneas. HLA-G transcripts were analysis by RT-<br />
PCR.<br />
Results: A positivity immunohistochemical staining has been shown for the first time<br />
with monoclonal antibodies antiHLA-G (4H84) on epithelium, keratocytes and endothelium<br />
cells.<br />
Comment and Conclusion: Detection of HLA-G protein in adult corneas lead to the<br />
conclusion this protein may contribute to the maintenance of the immune privileged<br />
status of the cornea and to the success of corneal allotransplantation.<br />
10 19<br />
Dosage des IgE et des protéines dans les conjonctivites allergiques.<br />
Analysis of IgE and tear proteins in allergic conjunctivitis.<br />
HOFFMANN EM*, LANG M (Mainz), LESSER J (Nantes), PFEIFFER N, GRUS FH<br />
(Mainz, Allemagne)<br />
Purpose: A quick and reliable method to determine IgE in tears could lead to more<br />
specific and faster treatment in allergic conjunctivitis. In previous studies we could<br />
demonstrate specific changes in the tear proteins of patients suffering from dry-eye<br />
or diabetes mellitus that could be used for diagnosis or follow-up of the disease. The<br />
aim of this study was to analyze the changes in tear protein of patients suffering from<br />
allergic conjunctivits and compare them to the total IgE in tears.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S149
1S150<br />
Material and Method: 80 patients were examined in this study (2 groups: healthy<br />
controls (CTRL, n = 40), and patients suffering from allergic conjunctivits (AC, n = 40).<br />
Each patient was asked for subjective symptoms like burning, itching and foreign<br />
body sensation and slit-lamp examination was performed. The tear proteins were<br />
separated by SDS PAGE (sodium-dodecyl-sulfate poly-acrylamide gel electrophoresis).<br />
Digital image analysis was performed by BioDocAnalyze ® creating densitometric<br />
data files for each electrophoretic lane. The data was analyzed by multivariate statistical<br />
techniques. The amount of IgE was measured by Lacrytest. Lacrytest is a<br />
simple and rapid immuno-chromatographic test which enables the identification of<br />
allergic conjunctivitis in one single step. Lacrytest uses monoclonal and polyclonal<br />
antibodies to detect total IgE in tears.<br />
Results: The IgE analysis in tears by means of lacrytest was easy to perform. The<br />
results of lacrytest correlate significantly with the allergic symptoms in patients (P<br />
< 0.05). Furthermore, the multivariate analysis of discriminance could reveal specific<br />
changes in the tear film of allergic patients (P < 0.01) that correlate with the lacrytest<br />
results and with the clinical score of patients.<br />
Comment and Conclusion: Both lacrytest and the electrophoretic analysis of tear<br />
proteins could detect changes in tear film of allergic patients. Thus, the electrophoretic<br />
analysis of tear proteins gives more insight in the pathogenesis of allergic eye<br />
diseases and using both methods, the tear film could be used for non-invasive diagnostic<br />
approaches.<br />
10 20<br />
Thérapie génique dans les maladies de la cornée : expérience actuelle et<br />
directions futures.<br />
Gene therapy for corneal disorders: current experience and future directions.<br />
PLEYER U* (Berlin, Allemagne)<br />
Purpose: Gene therapeutic strategies are currently under development for delivering<br />
genes to somatic cells. The eye in general and the cornea in particular may provide<br />
several advantages as a target for gene therapy.<br />
Material and Method: In a series of experiments we investigated the efficiacy and<br />
potential toxicity of nonviral as well as adenoviral vectors to corneal cells. Interestingly,<br />
corneal endothelial cells were most susceptible for gene expression using both<br />
vector systems. However, adenoviral gene transfer was significantly more effective<br />
to deliver the marker genes as well as several cytokine and growth factor genes.<br />
Since immune mediated corneal graft rejection remains a therapeutic challenge, we<br />
have been interested in new strategies to modulate the immune response. As an<br />
approach to prevent allograft rejection modulation of the Th1/Th2 cytokine balance<br />
has been suggested. To investigate the potential effect of ex vivo modified corneal<br />
grafts, we performed adenoviral gene transfer of Th2 cytokines prior to transplantation<br />
in an rat model.<br />
Results: Our results indicate that selection of the appropiate cytokine seems crucial<br />
and significant differences have been observed on corneal graft survival. Since viral<br />
IL-10 has been reported as less immunogenic the immune response directed against<br />
Adr might be an important factor to consider. In the future it is necessary to identifie<br />
more efficient modulatory approaches, but gene therapy may have great potential in<br />
a number of corneal disorders.<br />
Comment and Conclusion: Further investigations are not only directed to modulate<br />
the immune response but also to improve biological properties of corneal transplants<br />
e.g. during organ culture prior to tranplantation.<br />
10 21<br />
Microscopie confocale in vivo, évaluation depuis la papille jusqu’au segment<br />
antérieur.<br />
In vivo confocal microscopy, from optic disc analysis to anterior sergment<br />
evaluation.<br />
GUTHOFF RF*, SOMMER U, STAVE J, SCHRODER P (Rostock, Allemagne)<br />
Purpose: Three-dimensional analysis of the optic nerve head by laser scanning<br />
tomography considerably improves the clinical monitoring of glaucoma patients.<br />
Clinical investigations using automated three-dimensional image analyzers revealed<br />
that the longitudinal monitoring of the optic disc using confocal optical systems is<br />
an essential part in the care of glaucoma patients.<br />
Material and Method: The same confocal imaging technique introduced in clinical<br />
routine for over 10 years can be adapted for anterior segment use.<br />
Results: Isolated and three-dimensionally reconstructed structures of the cornea,<br />
such as epithelium, subepithelial and stromal nerves, keratocytes and their subpopulations<br />
are reproducibly obtainable. Changes of the ocular surface as well as alte-<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM FRANCO-ALLEMAND-ANGLAIS<br />
rations in the composition of the corneal epithelial layer after penetrating<br />
keratoplastics, refractive surgery and infections of the eye can be examined with a<br />
magnification of up to 1,000-fold. Intracellular structures, besides the well defined<br />
nucleus are visible, but not yet identified.<br />
Comment and Conclusion: It is expected that wound-healing processes as well as<br />
interactions between locally applied medications will be new fields of clinical and<br />
experimental ophthalmology.<br />
10 22<br />
Comparaison entre biométrie optique et acoustique de l’œil.<br />
Comparison between optical and acoustic biometry of the eye.<br />
GANTENBEIN C*, RUPRECHT KW (Sarre, Allemagne)<br />
But : Début mars 2002 nous avons reçu l’IOL-Master et nous avons voulu comparer<br />
notre méthode standard à ce nouvel instrument.<br />
Matériel et Méthode : Entre mars et juin 2002 nous avons relevé les mesures biométriques<br />
de 175 yeux consécutifs, d’une part à l’aide de l’IOL-Master et, d’autre<br />
part à l’aide de la biométrie acoustique (AL-1000 Tomey) combinée au kératomètre<br />
selon Javal. Les résultats des mesures ont été comparés. Le choix de l’implant a été<br />
fait en fonction de notre méthode standard. La réfraction finale postopératoire nous<br />
a été communiquée par les ophtalmologistes traitants au plus tôt à la 6e semaine<br />
postopératoire.<br />
Résultats : En comparant les longueurs des yeux obtenues, nous avons trouvé une<br />
bonne correspondance entre les mesures de la biométrie optique et acoustique avec<br />
des longueurs significativement plus courtes (p < 0,001) pour la biométrie acoustique.<br />
Nous avons également trouvé une bonne correspondance entre l’IOL-Master et<br />
le Javal pour les mesures de la puissance cornéenne moyenne, le Javal produisant<br />
des valeurs significativement plus élevées (p < 0,001). Autant pour la mesure de la<br />
longueur de l’œil que pour la kératométrie les analyses en régression ont montré une<br />
bonne cohérence des mesures tout le long de l’échantillon des réfractions de nos<br />
patients. En comparant les résultats réfractionnels obtenus aux réfractions postopératoires<br />
estimées par l’IOL-Master d’une part et l’AL-1000 combiné au Javal d’autre<br />
part nous avons trouvé une certaine équivalence entre les deux méthodes.<br />
Commentaire et Conclusions : Les différences attendues entre l’IOL-Master et la<br />
combinaison biomètre acoustique/Javal ont pu être vérifiées. Après une première<br />
analyse, les avantages de la biométrie optique semblent surtout résider dans le gain<br />
de temps et la délégabilité de l’examen, cependant nous n’avons pas encore fini<br />
d’explorer les nombreuses possibilités de ce nouvel instrument.<br />
10 23<br />
Nouvelles structures pour la formation et l’évaluation des chirurgiens oculaires.<br />
New structure for training and assessment of ophthalmic surgeons.<br />
BENJAMIN L* (London, Uk)<br />
Purpose: Training in basic microsurgical skills is currently mandatory for all residents<br />
entering ophthalmic training programmes in the UK, where ophthalmology – unlike<br />
in many other EU states – is almost exclusively a surgical specialty.<br />
Material and Method: Central to these programmes should be a method for<br />
continuous assessment of surgical skills and aptitudes; however very little formal<br />
assessment is made in this way. Our Department of Health is planning an overhaul<br />
of all initial training programmes including in ophthalmology.<br />
Results: This presentation discusses existing methods of assessment and proposes<br />
a new structure to select, train, assess and accredit Ophthalmic Surgeons including<br />
the use of skills centres.<br />
10 24<br />
Solutions visco-anesthésiques pour la chirurgie de la cataracte et la chirurgie<br />
réfractive.<br />
Viscoanesthetic solutions for cataract and refractive surgery: evaluation of toxicity<br />
in rabbit eyes.<br />
WERNER L*, PANDEY S, IZAK A (Salt Lake City, Etats Unis), MACKY T, TRIVEDI R,<br />
APPLE D (Charleston, Etats Unis)<br />
Purpose: Evaluation of the toxicity of a new solution combining 1.5% sodium hyaluronate<br />
with lidocaine.<br />
Material and Method: Toxicity to the cornea was tested in vitro by exposing<br />
excised rabbit corneas to viscoanesthetic solutions containing 3 different concentrations<br />
of lidocaine, and staining with trypan blue/alizarin red. Twenty-nine rabbits<br />
underwent phacoemulsification; 0,3 ml of one of the solutions was injected into the<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
capsular bag, or the vitreous cavity. The solutions were also injected into the anterior<br />
chamber of rabbit eyes, without previous phacoemulsification.<br />
Results: Vital staining of the corneas and histopathological analyses of the enucleated<br />
eyes did not demonstrated toxicity to intraocular structures with lidocaine<br />
concentrations up to 1.65%.<br />
Comment and Conclusion: Viscoanesthesia was not found to be toxic in rabbit<br />
eyes and may prolong the anesthetic effect of lidocaine.<br />
10 25<br />
Microkératome cornéen femto-laser : optimisation expérimentale.<br />
Corneal femto-laser blade: experimental optimisation.<br />
TOUBOUL D*, COLIN J, SALIN F (Bordeaux)<br />
But : Le but de notre expérimentation était l’évaluation et l’optimisation des conditions<br />
de découpe de la cornée par le laser femtoseconde.<br />
Matériel et Méthode : Nous utilisions un modèle de cornée porcine conditionné ex<br />
vivo et introduit dans une chambre antérieure artificielle. Nous avions élaboré un prototype<br />
de laser femtoseconde capable de réaliser des découpes intrastromales par<br />
formation de plasmas. Chaque plasma était à l’origine d’une bulle de dissection<br />
intra-stromale de quelques micromètres de diamètre. Nous utilisions une source<br />
Titane : Saphir produisant des impulsions de 180 femtoseconde à une longueur<br />
d’onde de 800 nm. Notre système optique fournissait une fluence comprise entre 0,1<br />
et 50 J/cm 2 au point de focalisation, à une cadence de 1 000 Hz. Le profil de dissection<br />
du microkératome femto-laser était un plan discoïde construit par organisation<br />
de nombreux cercles de plasmas concentriques focalisés à 200 µm sous la surface<br />
antérieure du stroma. Un cylindre périphérique de plasmas complétait la découpe et<br />
permettait le détachement d’un capot de cornée. L’effet photo-disruptif était observé<br />
à l’aide d’un microscope confocal à balayage et d’une caméra fixée sur le montage<br />
optique. Les capots étaient observés en histologie conventionnelle et en microscopie<br />
électronique à balayage.<br />
Résultats : Les meilleures découpes étaient obtenues avec les bulles intrastromales<br />
les plus sphériques et les plus petites possibles. Elles devaient être disposées entre<br />
elles à la limite de leur confluence. Ces conditions demandaient un système optique<br />
et un laser très performants dont nous discuterons les dimensions.<br />
Commentaire et Conclusions : Nous concluons que, pour certaines conditions<br />
d’optimisation, le microkératome femto-laser pourrait offrir au chirurgien réfractif un<br />
des meilleurs outils pour découper et étudier le stroma cornéen antérieur.<br />
10 26<br />
Ablation personnalisée basée sur le WaveScan 3.0 couplé à l’Excimer VISX VSS<br />
STAR S4 pour la correction de la myopie.<br />
Custom ablation with Excimer Laser VSS STAR S4 guided by WaveScan 3.0 for<br />
correction of myopia.<br />
COCHENER B*, LE BAILLIF S, TANGUY C (Brest)<br />
But : Étude prospective, non randomisée et non masquée pour déterminer l’efficacité<br />
et la sécurité du laser Excimer VISX (STAR S4) relié à l’aberromètre WaveScan<br />
accédant à des ablations personnalisées pour le traitement Lasik des myopies faibles<br />
et modérées.<br />
Matériel et Méthode : L’option par balayage en spot variable (VSS) propre au Star<br />
VISX permet de dessiner une mosaïque d’ablations capable de corriger les erreurs<br />
Wavefront à partir d’un logiciel d’ablation calculant nombre, taille et localisation du<br />
faisceau grâce à la plateforme S4. Les critères d’inclusions respectèrent les recommandations<br />
VISX. L’évaluation a inclus une analyse de la vision quantitative et qualitative.<br />
Résultats : Des traitements personnalisés furent pratiqués chez 20 patients sur<br />
6 mois de suivi. La prédictibilité et l’efficacité du concept sur les résultats réfractifs<br />
et visuels sont comparables à ceux de la photoablation conventionnelle. Aucune<br />
complication n’est rapportée. La meilleure acuité visuelle corrigée est préservée ou<br />
améliorée dans tous les cas. Les sensibilités aux contrastes et à l’éblouissement<br />
sont normalisées à 1 mois postopératoire.<br />
Commentaire et Conclusions : La correction des aberrations wavefront d’ordres<br />
élevés semble surtout améliorer la qualité de vision. La sélection des candidats à<br />
l’ablation personnalisée sera discutée. Un intérêt particulier du concept VISX est<br />
l’application du traitement sur une lentille « PreVue » en préalable de la chirurgie, afin<br />
de confirmer les mesures wavefront, de simuler les résultats de la procédure et ainsi<br />
d’en augmenter la sécurité.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM FRANCO-ALLEMAND-ANGLAIS<br />
10 27<br />
Applications cliniques de la topographie d’élévation et de l’aberrométrie.<br />
Clinical applications of elevation topography and wavefront aberrometry.<br />
ASSOULINE M* (Paris)<br />
But : Présenter les nouvelles applications de la topographie d’élévation et de l’aberrométrie<br />
du front d’onde.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective de 40 patients traités par lasik myopique<br />
guidé par l’aberrométrie. Étude rétrospective de 25 cas de lasik presbyopique. Étude<br />
rétrospective du diagnostic du kératocône, de la cornea plana, de la maladie de Terrien,<br />
de l’ulcère de Morren, de la rosacée cornéenne par topographie d’élévation<br />
Orbscan et aberrométrie Zywave.<br />
Résultats : La topographie d’élévation permet de documenter plus précisemment<br />
la forme cornéenne antérieure et postérieure que la vidéokératoscopie conventionelle<br />
de courbure. Une détection plus précoce du kératocône est possible. L’aberrométrie<br />
du front d’onde permet l’analyse objective de l’optique de l’œil et de son<br />
impact sur la qualité de vision et la réfraction en fonction du diamètre pupillaire<br />
notamment en cas d’asphéricité induite ou de multifocalité.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces nouvelles méthodes d’investigation objective<br />
de l’optique de l’œil pathologique ou opéré devraient prendre une place croissante<br />
dans l’arsenal diagnostic en ophtalmologie.<br />
L’un des auteurs est employé d’une <strong>Société</strong> proposant l’équipement, le procédé ou<br />
le produit présenté.<br />
10 28<br />
Mesure continuelle de l’épaisseur cornéenne pendant le Lasik.<br />
Continuous measurement of corneal thickness during Lasik procedure.<br />
WIRBELAUER C*, HABERLE H, PHAM DT (Berlin, Allemagne)<br />
But : Pour la chirurgie réfractive de la cornée le Laser in situ keratomileusis (LASIK)<br />
est une procedure établie. Pourtant la coupe du lenticule par microkératome et la<br />
profondeur de l’ablation ne sont pas prévisibles. La méthode de la pachimétrie optique<br />
nous permet pour la première fois de mesurer continuellement les changements<br />
de l’épaisseur cornéenne pendant le traitement.<br />
Matériel et Méthode : La pachymétrie optique utilise le principe de la tomographie<br />
en cohérence optique (OCT) utilisant une diode superluminescente (=1 310 nm).<br />
Pour la mesure continuelle des changements de l’épaisseur cornéenne centrale cette<br />
méthode a été intégrée a un laser Excimer. 17 patients avec des amétropies initiales<br />
entre –2,5 et –17 dioptries (équivalent sphérique) ont été ainsi examinés pendant le<br />
LASIK.<br />
Résultats : La pachymétrie optique par OCT permet une mesure continuelle des<br />
changements de l’épaisseur cornéenne pendant le traitement. Les paramètres de<br />
l’épaisseur du lenticule après la coupe, la profondeur intrastromale de l’ablation et<br />
l’épaisseur restante de la cornée à la conclusion de l’ablation peuvent être représentés<br />
avec une haute résolution. Les valeurs moyennes intra-opératoires du lenticule<br />
étaient de 113,31 µm, la profondeur optique de l’ablation de 115,30 µm et l’épaisseur<br />
cornéenne restante de 277,49 µm.<br />
Commentaire et Conclusions : La mesure continuelle des changements de<br />
l’épaisseur cornéenne pendant LASIK apporte une aide considérable pendant le traitement<br />
refractif. La pachymétrie optique par OCT peut ainsi assurer le traitement et<br />
la stabilité cornéenne.<br />
10 29<br />
Une nouvelle lentille intraoculaire en chambre postérieure (PRL) dans la<br />
chirurgie réfractive.<br />
A new posterior chamber intra-ocular lens (PRL) for refractive surgery.<br />
LECHNER S*, LIEKFELD A, SCHELLENBECK M, HARTMANN C (Berlin, Allemagne)<br />
But : Les méthodes de la chirurgie réfractive cornéenne sont limitées par la myopie<br />
forte, la hyperopie et par une cornée très mince. Dans ce cas les lentilles phakes<br />
intraoculaires en chambre postérieure sont indiquées. Nous présentons nos résultas<br />
avec une nouvelle lentille, dans le cadre d’une investigation multicentrique.<br />
Matériel et Méthode : La lentille PRL est une lentille très mince, pliante, en silicone.<br />
Jusqu’à maintenant nous avons implanté cette lentille dans les yeux des personnes,<br />
yeux avec une myopie très forte. La réfraction préopératoire était entre –8,5 et –20,5<br />
(Equivalent sphérique). L’Acuité visuelle pré-opératoire était entre 0,3 à 1,0. Le temps<br />
d’observation remonte à 1,5 ans.<br />
Résultats : La réfraction post-opératoire était entre 0 et –1,0 D, sans changement<br />
d’astigmatisme. L’acuité visuelle post-opératoire sans correction était entre 0,4 et<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S151
1S152<br />
1,25, l’acuité avec correction était entre 0,6 à 1,25. Nous n’avons pas vu de complication<br />
ni per ni post-opératoires, surtout pas d’opacification cristallinienne.<br />
Commentaire et Conclusions : La lentille PRLL est une technique prometteuse<br />
pour traiter la myopie forte et la hyperopie dans la chirurgie réfractive.<br />
10 30<br />
Biopsie du ganglion sentinelle dans les tumeurs péri-oculaires hautement<br />
malignes.<br />
Sentinel node biopsy in highly malignant periocular tumours.<br />
HARDY TG*, LEE V, HEALY C, COLLIN JRO (London, Uk)<br />
Purpose: To describe the visual results and complications of a consecutive series<br />
of patients treated by vitrectomy and radial optic neurotomy for ischaemic central<br />
retinal vein occlusion (CRVO).<br />
Material and Method: An uncontrolled, prospective pilot study of 5 patients will be<br />
presented. All patients have 3-6 months of follow up. Refraction is performed preoperatively<br />
and at 6 months post-operatively. Colour photos, fluorescein angiography<br />
(FA) and Optical Coherence Tomography (OCT) images were obtained at each<br />
clinic visit.<br />
Results: Pre-operative risk factors for systemic vascular disease were present in 3<br />
out of 5 patients. Visible reperfusion was observed in 4 out of 5 patients at the time<br />
surgery. Visual acuity improved in 4 out of 5 patients and deteriorated by one line in<br />
one patient. Colour images and FA demonstrated marked improvement in vascular<br />
congestion, however post-operative OCT scans confirmed persistent macular<br />
oedema. Complications included 2 limited haemorrhages at the time of surgery (one<br />
choroidal and one intra vitreal) and one post-operative visual field defect.<br />
Comment and Conclusion: Vitrectomy and radial optic neurotomy may improve<br />
the clinical outcome of patients with CRVO. The procedure is safe and has a short<br />
operative time.<br />
10 31<br />
Brachythérapie interstitielle adjuvante pour le traitement des tumeurs orbitaires<br />
malignes.<br />
Adjuvant interstitial brachytherapy for treatment of malignant orbital tumors.<br />
KAMPIK D*, PFREUNDNER L, LIEB WE (Wurzburg, Allemagne)<br />
Purpose: The complex anatomical situation in the orbit does not always allow radical<br />
resection of malignant orbital tumors, indicating adjuvant radiation or chemotherapy.<br />
Adjuvant interstitial brachytherapy using afterloading technique allows local high<br />
dose radiation of a specific region of interest while sparing healthy tissue.<br />
Material and Method: Interstitial brachytherapy combined with external beam<br />
radiation was applied in 5 patients after surgical resection of unilateral malignant<br />
orbital tumors between 1996 and 2001. Afterloading tubes were placed into the<br />
tumor bed to apply the radionuclid Iridium 192 using a computer-controlled, automatic<br />
afterloading machine. Patients received a total dose of 12-14 Gy in several<br />
fractions (high dose tare brachytherapy, HDR). Treatment was planned using CT<br />
scans and 3-D reconstruction.<br />
Results: In 3 patients, orbital hemangiopericytomas (including 1 recurrence) and in<br />
2 patients, squamous cell carcinomas were removed conserving the globe. Brachytherapy<br />
was applied during the same stay at hospital and was well tolerated by all<br />
patients. During the follow up period (1/2 to 4 years) all patients remained free of<br />
tumor recurrence. 1 patient died.<br />
Comment and Conclusion: Additional interstitial brachytherapy using afterloading<br />
technique reduces the dose of external beam radiation while achieving a high dose<br />
radiation in the affected tissue. This justifies the additional operative trauma necessary<br />
for the im-/explantation of the probes. For infiltration tumors with a high recurrence<br />
rate where a complete in sano resection is impossible, adjuvant brachytherapy<br />
offers an effective, well-tolerated supplement to external beam radiation.<br />
10 32<br />
Vitrectomie et neurotomie optique radiaire dans l’occlusion de la veine centrale<br />
de la rétine.<br />
Vitrectomy and radial optic neurotomy for central retinal vein occlusion.<br />
ZAMBARAKJI HJ*, CHARTERIS DG, HYKIN PG (London, Uk)<br />
Purpose: To describe the visual results and complications of a consecutive series<br />
of patients treated by vitrectomy and radial optic neurotomy for ischaemic central<br />
retinal vein occlusion (CRVO).<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM FRANCO-ALLEMAND-ANGLAIS<br />
Material and Method: An uncontrolled, prospective pilot study of 5 patients will be<br />
presented. All patients have 3-6 months of follow up. Refraction is performed preoperatively<br />
and at 6 months post-operatively. Colour photos, fluorescein angiography<br />
(FA) and Optical Coherence Tomography (OCT) images were obtained at each<br />
clinic visit.<br />
Results: Pre-operative risk factors for systemic vascular disease were present in 3<br />
out of 5 patients. Visible reperfusion was observed in 4 out of 5 patients at the time<br />
surgery. Visual acuity improved in 4 out of 5 patients and deteriorated by one line in<br />
one patient. Colour images and FA demonstrated marked improvement in vascular<br />
congestion, however post-operative OCT scans confirmed persistent macular<br />
oedema. Complications included 2 limited haemorrhages at the time of surgery (one<br />
choroidal and one intra vitreal) and one post-operative visual field defect.<br />
Comment and Conclusion: Vitrectomy and radial optic neurotomy may improve<br />
the clinical outcome of patients with CRVO. The procedure is safe and has a short<br />
operative time.<br />
10 33<br />
Neurotomie optique pour occlusion de la veine centrale de la rétine : étude pilote.<br />
Radial optic neurotomy for central retinal vein occlusion: a pilot study.<br />
CHAUVAUD D*, AZAN F, ASSARAF E, PIERRE-KAHN V (Paris)<br />
But : Les formes graves d’occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR) ne connaissent<br />
actuellement pas de traitement efficace. Récemment, la neurotomie optique radiaire<br />
(NOR) a été proposée par Opremcak et coll. avec des résultats intéressants.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective. Critères d’inclusion : tableau clinique<br />
d’OVCR datant de moins de 3 mois, acuité visuelle (AV) inférieure à 20/200, âge<br />
supérieur à 50 ans, accord écrit du patient. La technique chirurgicale était celle<br />
décrite par Opremcak : vitrectomie centrale, NOR sur le bord nasal de la papille à la<br />
pique 20 Gauges. Les paramètres étudiés étaient le champ visuel (CV) de Goldmann,<br />
l’AV ETDRS, l’angiographie à la fluorescéine avant, puis après l’intervention (1, 2, et<br />
4 mois).<br />
Résultats : 12 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 68 ans. La durée<br />
moyenne d’évolution pré-opératoire de l’OVCR était de 68 jours. Le CV montrait un<br />
scotome central dans tous les cas, englobant la tache aveugle dans 7 cas. Aucune<br />
complication per-opératoire n’a été notée. Un scotome fasciculaire temporale est<br />
apparu au CV correspondant au site de la NOR dans tous les cas. Au cours du suivi<br />
le scotome central a persisté mais sa surface a été divisée par 3. À 4 mois, le nombre<br />
de lettres lues a augmenté pour tous les patients, en moyenne de 17 lettres et 8<br />
patients ont atteint une AV supérieure ou égale à 20/200. Trois anastomoses veineuses<br />
ont été observées dont une dans la cicatrice de NOR. La photocoagulation rétinienne<br />
a été nécessaire dans 1 seul cas pour persistance d’une ischémie<br />
périphérique.<br />
Commentaire et Conclusions : Une étude prospective comparative à plus grande<br />
échelle est nécessaire pour confirmer ces résultats encourageants.<br />
10 34<br />
Thérapie de l’occlusion de branche veineuse rétinienne par vitrectomie, pelage<br />
de la limitante interne et adventicectomie.<br />
Treatment of retinal branch vein occlusion by vitrectomy, peeling of inner limitant<br />
membrane and adventicectomy.<br />
RAUBER M, DILLINGER P, MESTER U (Sulzbach, Allemagne),<br />
But : Un croisement artério-veineux pathologique est la cause principale de l’occlusion<br />
de branche veineuse rétinienne. Depuis 1988 la vitrectomie avec l’aventicectomie<br />
et le pelage de la limitante interne permet une therapie à la fois causale et<br />
symptomatique.<br />
Matériel et Méthode : Entre 1999 et 2002 nous avons opéré 102 patients atteints<br />
de l’occlusion de branche veineuse retinienne récente (< 3 mois). Tous les patients<br />
ont bénéficié d’une vitrectomie, d’une aventicectomie et le plus souvent d’un pelage<br />
de la limitante interne au niveau de l’occlusion et de la zone maculaire. Les patients<br />
dont l’occlusion était de date plus récente (
visuelle. La complication la plus redoutable a été la survenue d’un décollement de la<br />
rétine chez 5 patients, qui a été traité avec succès dans tous les cas.<br />
Commentaire et Conclusions : La vitrectomie avec pelage de la limitante interne<br />
et aventicectomie nous semble être la thérapie de choix de l’occlusion de branche<br />
veineuse quand il y a menace de baisse d’acuité visuelle importante. Une étude multicentrique<br />
est en cours afin de mieux pouvoir évaluer la place de cette nouvelle thérapie<br />
en ce qui concerne la pathologie de l’occlusion de branche veineuse rétinienne.<br />
10 35<br />
Le vert d’indocyanine dans la chirurgie maculaire : pourquoi y a-t-il problème ?<br />
Indocyanine-green in macular surgery: why is it a problem?<br />
HARITOGLOU C*, GANDORFER A, GASS CA, KAMPIK A (Würzburg, Allemagne)<br />
Purpose: To report on functional results after surgery for macular pucker macular<br />
hole with indocyanine-green staining of the internal limiting membrane (ILM), to evaluate<br />
the ultrastructure of the tissue removed and to describe a toxic or photodynamic<br />
effect as a possible pathomechanism.<br />
Material and Method: Functional outcome (visual acuity, Goldmann perimetry) of<br />
patients with macular hole and macular pucker after standard pars plana vitrectomy<br />
with intraoperative use of indocyanine-green (ICG, 0.05%, 275 mOsm) was retrospectively<br />
analyzed. Epiretinal tissue and the ILM was harvested and prepared for<br />
ultrastructural analysis using light and electron microscopy. In an experimental setting,<br />
the posterior pole of human donor eyes was illuminated using wavelengths of<br />
380-760 nm, 380-620 nm and 620-760 nm. The irradiance of the light source and the<br />
absorption properties of different ICG solutions (BSS, BSS plus, glucose 5%) were<br />
measured.<br />
Results: Patients after ICG-assisted macular surgery presented with less favorable<br />
functional outcome and a high incidence of visual field defects. Histological analysis<br />
revealed clear differences between the stained and unstained specimens concerning<br />
the amount of cellular elements adjacent to the retinal surface of the ILM. Exposure<br />
of the ICG stained ILM to wavelengths beyond 620 nm resulted in a severe damage<br />
of the inner retinal layers. The absorption properties of ICG varied depending on the<br />
solvent agent.<br />
Comment and Conclusion: The histological findings suggest an alteration of the<br />
cleavage plane from the ILM to the innermost retinal layers after ICG staining. The<br />
spectral absorption properties of ICG might account for a photodynamic effect at the<br />
vitreoretinal interface. This might explain less favorable outcome after ICG-assited<br />
macular surgery.<br />
10 36<br />
ERG et PEV multifocal : utilité en clinique.<br />
Multifocal ERG and VEP: clinical usefulness.<br />
HACHE JC*, BASSET D, HONORE J, BOUACHA I (Lille)<br />
But : Les méthodes d’électrophysiologie multifocale se sont développées à la suite<br />
des travaux de Sutter sur les séquences m. Nous avons voulu évaluer l’intérêt clinique<br />
de ces méthodes dans les différentes circonstances cliniques et comparer les<br />
résultats obtenus avec le Moniteur ophtalmologique à ceux obtenus par d’autres<br />
équipes.<br />
Matériel et Méthode : Cent examens consécutifs réalisés avec le Moniteur ophtalmologique<br />
ont été dépouillés Il s’agit de 85 electrorétinogrammes (mERG) et de<br />
15 PEV (mVEP).<br />
Résultats : Les mERG ont tous été réalisés pour rechercher ou préciser une maculopathie.<br />
L’indication principale a été le bilan d’une rétinopathie chloroquinique. Dans<br />
deux cas seulement, les examens ont été impossibles en raison de problème d’instabilité<br />
des électrodes par clignements intempestifs. L’absence de fixation stable en<br />
raison de l’existence d’un scotome central important (taille et profondeur) s’est avéré<br />
être la cause principale de résultats ininterprétables car non conformes aux constatations<br />
cliniques. Lorsque les examens ont été considérés comme fiables (55 cas),<br />
ils ont permis de confirmer les constatations cliniques notamment de la périmétrie<br />
centrale (scotome localisé ou scotome périfovéolaire). Les mVEP ont été réalisés<br />
dans des cas d’affection démyélinisante (10 cas/15) et dans les cas de scotome<br />
hémianopsique paracentral (5/15). La prééminence du pic central a été constatée<br />
dans tous les cas où l’acuité était préservée. Par contre, il a été impossible de mettre<br />
en évidence des scotomes paracentraux en périmétrie.<br />
Commentaire et Conclusions : Le Moniteur ophtalmologique permet d’obtenir<br />
des résultats interprétables dans la grande majorité des cas étudiés. C’est<br />
l’électrorétinogramme multifocal qui s’est avérée la technique la plus intéressante<br />
dans les cas de maculopathie d’origine diverse. Ceci est particulièrement<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM FRANCO-ALLEMAND-ANGLAIS<br />
vrai pour la recherche de la maculopathie chloroquinique où le mERG pourrait<br />
devenir l’examen de référence.<br />
10 37<br />
Exploration du segment postérieur par échographie de haute fréquence.<br />
High frequency ultrasound imaging of posterior pole.<br />
PUECH M* (Paris)<br />
But : L’échographie de diagnostic est habituellement pratiquée avec des sondes de<br />
10 MHz. L’UBM avec sa sonde de 50 MHz est limité à l’exploration du segment antérieur.<br />
Le but de cette présentation est de montrer l’intérêt des sondes de 20 et<br />
50 MHz dans l’exploration du segment postérieur.<br />
Matériel et Méthode : Une étude in vitro sur globes prélevés a montré qu’il est<br />
possible d’utiliser des sondes de 50 MHz focalisées à 25 mm pour obtenir des images<br />
du pôle postérieur. L’arrivée de sondes de 20 MHz focalisées à 25 mm permet<br />
de progresser vers une meilleure exploration du segment postérieur. En deux ans<br />
1 456 patients ont été explorés par échographie de 10 et 20 MHz. Les patients ont<br />
été adressés pour pathologies vitréorériniennes, tumeurs oculaires, exploration<br />
papillaire ou orbitaire…<br />
Résultats : La visualisation du pôle postérieur est possible avec des sondes de<br />
50 MHz avec une très nette majoration de résolution. Les images obtenues in vivo<br />
avec les sondes de 20 MHz permettent dès à présent de visualiser les détails de<br />
toutes les pathologies du pôle postérieur avec une résolution accrue dans l’analyse<br />
des rapports rétinovitréens, de l’échostructure de la papille, du nerf optique et des<br />
tumeurs oculaires.<br />
Commentaire et Conclusions : L’imagerie par échographie de haute fréquence du<br />
pôle postérieur permet une très nette majoration de la résolution d’analyse par rapport<br />
à l’échographie classique de 10 MHz sans être limitée par les troubles des<br />
milieux oculaires.<br />
10 38<br />
Corrélation de l’image en autofluorescence et de la mutation génétique dans la<br />
DMLA.<br />
Correlation of Autofluorescence Image and Genetic Mutation in Age-Related Macular<br />
Degeration (AMD).<br />
KEILHAUER CN*, WOLFGANG F, SCHRADER MD, BERNHARD HF, WEBER PHD<br />
(Wuerzburg, Allemagne)<br />
Purpose: Formation and accumulation of lipofuscin-like material within the retinal<br />
pigment epithelium (RPE) is suspected to be a key event in the pathogenesis of AMD.<br />
Here, we characterize and define patterns of lipofuscin-like depositions in a large<br />
cohort of AMD patients in an effort to refine existing phenotype classifications.<br />
Material and Method: To record the pattern of retinal autofluorescence,<br />
400 patients with well-definable early AMD-stages were included in the study and<br />
were analysed with a scanning laser ophthalmoscope (Heidelberg Retina Angiograph,<br />
Heidelberg Engineering, Germany: excitation 488nm, emission > 500nm).<br />
Funduscopic changes ranged from severe pigment epithelial alterations, geographic<br />
atrophies to confluent soft drusen without leakage in angiography in at least one eye.<br />
Results: The maculopathies, observed in our patient cohort included different kinds<br />
of drusen, pigment epithelial alterations, geographic atrophies or healthy fellow eyes<br />
of exsudative AMD. They were classified with regard to macular AF patterns (granular/smooth/GA<br />
with or without high AF margins) and background AF patterns (regular/granular/reticular)<br />
and macular pigment density distribution into 4 distinct groups<br />
with further subgroups.<br />
Comment and Conclusion: Topography and distinct patterns of lipofuscin-dependent<br />
autofluorescence may directly or indirectly be influenced by genetic factors.<br />
Hence, the suggested grouping of AMD phenotypes may ultimately facilitate the<br />
identification of genes with expression in the RPE or the adjacent retina.<br />
10 39<br />
Étude de la biodisponibilité comparative avec un nouveau support pour les<br />
médications.<br />
Comparative bioavailability studies with a new drug delivery device.<br />
LUX A*, STEINFELD A, SUVERKRUP R, DIESTELHORST M (Köln, Allemagne)<br />
Purpose: To study the ocular bioavailability of different doses of Sodium Fluorescein<br />
to the anterior segment of healthy volunteers from a novel drug delivery system.<br />
Material and Method: Fluorescein methocel was deposited on sterilized flexible<br />
hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) carrier strips and freeze-dried under<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S153
1S154<br />
aseptic conditions. The doses of the lyophilisate were 204 g corresponding to three<br />
conventional, preservative-free eye drops of 40 l Fluorescein SE 0.17% (Alcon). In<br />
a randomised, open-label study 22 healthy volunteers applied the lyophilisate to one<br />
eye (+1 mn) and three consecutive eye drops (+1, +16, +31 mn) of the fluorescein<br />
ophthalmic solution to the fellow eye. Identical doses were reached at +45 minutes.<br />
Fluorophotometry was performed (Fluorotron Master II Ocumetrics, USA) before<br />
and +15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 minutes after application. The fluorescein<br />
concentrations of cornea (C) and mid anterior chamber (AC) were analysed<br />
by paired t-test (SPSS).<br />
Results: Mean cornea and AC values (ng/ml) were significantly higher (p < 0.001) in<br />
the lyophilisate group for up to 7 hours after application with the exception of<br />
+45 minutes. The mean corneal bioavailability of the lyophilisate was up to 11 times<br />
higher compared with three conventional eye drops.<br />
Comment and Conclusion: A triple dose can be delivered to the human eye with<br />
a single lyophilisate and results in significantly better bioavailability for up to 7 hours.<br />
Our data underline that lyophilisates are a favourable alternative to conventional eye<br />
drops. Advantages: significantly better bioavailability, no preservatives, no pHadjustment,<br />
easy handling. The new device should improve the medical treatment<br />
infections, inflammation, glaucoma, dry eye syndrome.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM FRANCO-ALLEMAND-ANGLAIS<br />
10 40<br />
Traitement de la maladie de Graves par des injections orbitaires de<br />
triamcinolone.<br />
Orbital injections of triamcinolone in Graves ophthalmopathy.<br />
EBNER R*, DEVOTO M, WEIL D, BORDABERRY M, MIR C, MARTINEZ H,<br />
BONELLI L, NIEPOMNICSZSE H (Buenos Aires, Argentine)<br />
Purpose: To evaluate the efficacy of periocular triamcinolone for the treatment of<br />
thyroid associated ophthalmopathy (TAO), and the presence of ocular or systemic<br />
adverse effects.<br />
Material and Method: We performed a multicenter prospective pilot study with<br />
patients diagnosed with Graves ophthalmopathy less than 6 months before entry to<br />
the study. Patients were admitted into the study and were randomized into two<br />
groups: treatment and control. The treatment group received 4 doses of 20 mg of<br />
triamcinolone acetate 40 mg/ml in a peribulbar injection to the inferolateral orbital<br />
quadrant. Both groups were evaluated by measuring the area of binocular vision<br />
without diplopia in a Goldmann perimeter and the size of the extraocular muscles on<br />
CT scans. Opthalmological and systemic examinations were done to rule out ocular<br />
and systemic adverse effects. Follow-up was 6 months for both groups.<br />
Results: Fifty patients were eligible for the study. Forty one patients completed the<br />
study. There was an increase in the area of binocular vision without diplopia in the<br />
treatment group (initial: mean±SD, 231.1 ± 99.9 and final absolute change,<br />
mean±SD, of 107.1 ± 129.0) compared to the control group (initial: mean±SD,<br />
350.7 ± 86.5 and final absolute change, mean±SD of –4.5 ± 67.6). The sizes of the<br />
extraocular muscles were reduced in the treatment group (mean±inferior rectus initial<br />
values-IV: 1.3±0.7, final percentage change-FPC: –13.2±25.7, medial rectus IV:<br />
1.2±0.6, FPG: –8.2±20.7, superior rectus-levator palpebrae IV: 1.2±0.6, FPC: –<br />
9.5±29.1, lateral rectus IV: 1.0±0.4, FPC: –11.5±20.6) compared to the control group<br />
(inferior rectus IV: 0.9±0.3, FPC: –4.0±21.5, medial rectus IV: 0.9±0.3, FPC: 0.6±22.4,<br />
superior rectus-levator palpebrae IV: 0.9±0.3, FPC: 12.5±37.5, lateral rectus IV:<br />
0.9±0.4, FPC: –0.5±31.6). Both measurements (degree of diplopia and muscle thickness)<br />
were statistically significant between groups (initial-final). No systemic or ocular<br />
adverse effects were found.<br />
Comment and Conclusion: Triamcinolone acetonide administered as a periocular<br />
injection is effective in reducing diplopia and the sizes of extraocular muscles in TAO<br />
ophthalmopathy of recent onset. This form of treatment is not associated with systemic<br />
or ocular side effects.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
JOURNÉE DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET FONDAMENTALE<br />
OCCLUSIONS VASCULAIRES<br />
10 41<br />
Évaluation en IRM fonctionnelle de l’activité bilatérale des pôles occipitaux dans<br />
un cas d’hémianopsie.<br />
A case of homonymous hemianopia demonstrating bilateral occipital pole activation<br />
with functional magnetic resonance imaging.<br />
YOSHIDA M*, IDA M (Tokyo, Japon), NGUYEN TH, STIEVENART JL, IBA-ZIZEN MT,<br />
BELLINGER L (Paris), NAGAO T, KIKUCHI S, HARA T, KUBO H, SHIBA T,<br />
KANDATSU A, KITAHARA K (Tokyo, Japon), CABANIS EA (Paris)<br />
But : L’atteinte du cortex visuel primaire induit une hémianopsie. L’hémianopsie par<br />
lésion extra-striée (aires visuelles en dehors du cortex visuel primaire) est précisément<br />
rapportée par Hoyton et Hoyt en 1991. Mais l’activité de l’aire striée (cortex<br />
visuel primaire) en cas d’hémianopsie n’est pas bien connu. Nous avons exploré<br />
cette activité corticale chez un patient présentant une hémianopsie en IRM fonctionelle<br />
(IRMf).<br />
Matériel et Méthode : Exploration d’une patiente âgée de 78 ans, présentant une<br />
ischémie du cortex occipital du côté droit, traitée par anti coagulant, et ayant donné son<br />
consentement écrit. Une imagerie fonctionnelle et l’évaluation du champ visuel sont réalisées.<br />
L’imagerie fonctionnelle est effectuée en IRM 1.5T (séquences Echo-planar). Sur<br />
présentation de damier, trois types de stimulation sont réalisés : 1. le point de fixation 2.<br />
le damier présenté du côté gauche (côté affecté) avec le point de fixation 3. le damier<br />
présenté au centre de champ visuel avec le point de fixation. Les données sont analysées<br />
par le logiciel SPM 99 (Statistical Parametric Mapping 99).<br />
Résultats : Le champ visuel statique montre l’hémianopsie du côté gauche. Les<br />
pôles occipitaux sont apparemment intègres en séquence FLAIR. L’activité de pôle<br />
occipital du côté atteint est confirmée avec la stimulation du damier présenté du côté<br />
gauche et au centre de champ visuel.<br />
Commentaire et Conclusions : L’activité de pôle occipital de côté atteint correspondant<br />
à l’aire visuelle primaire est confirmée en IRMf. Ces résultats supportent les observations<br />
concernant l’hémianopsie d’origine extra-striée rapportées par Hoyton et Hoyt.<br />
10 42<br />
Occlusion de l’artère centrale de la rétine au décours d’une intervention sur le rachis.<br />
Central retinal artery occlusion following spinal surgery.<br />
LEGRIS A*, LEVESQUE C, MALLET JF, MIOCQUE S, BILLOTTE C (Caen)<br />
But : L’installation en décubitus ventral du patient nécessité par certaines interventions<br />
chirurgicales orthopédiques peut présenter un risque de compression oculaire,<br />
à l’origine d’un accident vasculaire rétinien.<br />
Matériel et Méthode : Un garçon de 13 ans atteint de spina bifida et de syringomyélie<br />
subit une arthrodèse postérieure du rachis dorso-lombaire pour éviter l’aggravation<br />
d’une scoliose grave. L’enfant est installé en décubitus ventral, la tête<br />
reposant sur une têtière en raison de la rigidité de son rachis cervical. Au réveil de<br />
cette longue intervention, l’enfant se plaint d’une cécité unilatérale. L’examen ophtalmologique<br />
montre une absence de perception lumineuse avec une pupille en<br />
mydriase, et au fond d’œil une occlusion de l’artère centrale de la rétine avec un<br />
œdème rétinien et une macula rouge cerise, ainsi qu’un rétrécissement du calibre de<br />
l’ensemble du réseau artériel. La cécité unilatérale sera définitive.<br />
Commentaire et Conclusions : Les occlusions de l’artère centrale de la rétine sont<br />
secondaires à une embolie, une thrombose, un spasme ou à une diminution du débit<br />
vasculaire rétinien. Dans ce cas, un mécanisme de compression du globe par une<br />
branche de la têtière pendant la durée de l’intervention est probablement impliqué.<br />
Cette compression peut être à l’origine d’un collapsus prolongé irréversible de<br />
l’artère centrale de la rétine. Malgré la surveillance attentive des points d’appui du<br />
visage sur la têtière, dans le souci permanent d’éviter une compression peropératoire<br />
du globe oculaire, un accident ischémique rétinien peut survenir.<br />
10 43<br />
La défaillance de la barrière hémato-rétinienne cortico-induite.<br />
Corticosteroid induced breakdown of the outer blood retinal barrier.<br />
ARNDT C* (Montpellier), PLOESSER M (Berlin, Allemagne), SCHNEIDER C,<br />
ARNAUD B (Montpellier), MATRAN R (Lille)<br />
But : L’épithéliopathie rétinienne diffuse est probablement liée à une atteinte de la<br />
choriocapillaire. Toutefois, l’origine de la diffusion trans-épithéliale responsable de<br />
l’accumulation de liquide sous-rétinien reste mal élucidée. Un effet délétère des corticostéroïdes<br />
a été évoqué.<br />
Matériel et Méthode : L’effet des corticoïdes sur le passage trans-épithélial de<br />
fluorescéine a été évalué in vitro par des techniques de fluorométrie sur des préparations<br />
épithélium pigmentaire rétinien de bœuf. La vitalité des préparations a été<br />
vérifiée par l’enregistrement continu des paramètres électrophysiologiques.<br />
Résultats : Dans les conditions électrophysiologiques de base (circuit ouvert), en<br />
présence d’hydrocortisone en apical (coté rétine), il existe un passage de la fluorescéïne<br />
de basolatéral (coté choriocapillaire) en apical. Cet effet n’existe pas en<br />
l’absence d’hydrocortisone. Dans des conditions de court circuit, le transport trans<br />
épithélial de fluorescéïne du coté apical vers le coté basolatéral est inhibé en présence<br />
d’hydrocortisone.<br />
Commentaire et Conclusions : Les corticoïdes pourraient inhiber l’absorption<br />
active de liquide sous-rétinien et être responsable du soulèvement du neuro-épithélium<br />
observé chez des patients atteints d’épithéliopathie rétinienne diffuse.<br />
10 44<br />
Modifications de la pO2 de la tête du nerf optique après hémodilution<br />
isovolémique.<br />
Effect of isovolemic hemodilution on oxygen delivery to the optic nerve head.<br />
CHAMOT S*, PETRIG B (Sion, Suisse), POURNARAS C (Genève, Suisse), RIVA C<br />
(Sion, Suisse)<br />
Purpose: The purpose of our study was to investigate the effect of isovolemic hemodilution<br />
on the tissue oxygenation of the optic nerve head.<br />
Material and Method: In 9 male miniature pigs (6-12 kg), hemodilution was performed<br />
by replacing 100-140 ml of blood by an equivalent volume of 6% hydroxy-ethyl<br />
starch in saline. Blood flow parameters in the optic nerve head microcirculation,<br />
namely velocity, volume and flow, were measured by laser Doppler flowmetry.<br />
Microelectrodes placed at ~ 50 micro-m from the disc surface and the phosphorescence<br />
quenching technique were used to measure pO 2 in the vitreous (pO 2 , vitr) and<br />
in the optic nerve head capillary blood (pO 2 , blood), respectively. Arterial blood pressure,<br />
hematocrit and gas content were documented.<br />
Results: In all animals, hemodilution reduced the hematocrit by 30 ± 6%. Blood flow<br />
parameters increased markedly. Simultaneously, pO 2 , blood (baseline: 31 ± 13<br />
mmHg) dropped to ~ 75% of its initial value, while pO 2 , vitr (baseline: 26 ± 8 mmHg)<br />
increased by 15 ± 8%.<br />
Comment and Conclusion: Hemodilution leads to an increase of pO 2 , which indicates<br />
a similar raise of the optic nerve head tissue pO 2 . This effect results from an<br />
enhanced blood perfusion of the optic nerve head, which over-compensates the<br />
decrease of the blood O 2 content.<br />
10 45<br />
Ischémie périveinulaire à la phase précoce des occlusions de la veine centrale<br />
de la rétine.<br />
Perivenular ischemia as an early feature of central retinal vein occlusion.<br />
GENEVOIS O* (Rouen), PAQUES M, GAUDRIC A (Paris)<br />
But : Rapporter une présentation clinique particulière des occlusions de la veine<br />
centrale de la rétine (OVCR) associant un œdème ischémique périveinulaire à une<br />
baisse du débit sanguin rétinien sans occlusion capillaire.<br />
Matériel et Méthode : Les dossiers de 5 patients ayant une OVCR récente (symptômes<br />
visuels depuis moins de 4 jours) ont été revus.<br />
Résultats : Les patients présentaient tous un œdème ischémique situé dans le<br />
raphé median temporo-maculaire, s’étendant plus ou moins vers les vaisseaux temporaux.<br />
Cet œdème était à disposition périveineuse, épargnant la rétine autour des<br />
artérioles, lui donnant ainsi un aspect en fougère. Cet aspect était mieux mis en évidence<br />
par les clichés bleus. Il n’y avait pas de non perfusion ni de rupture de la<br />
barrière hématorétinienne. L’angiographie dynamique effectuée dans 3 cas a montré<br />
un ralentissement circulatoire prononcé. Cet aspect était associé à une chute sévère<br />
de l’acuité visuelle dans 4 des 5 cas, avec une récupération spontanée anatomique<br />
et fonctionnelle dans tous les cas.<br />
Commentaire et Conclusions : Nous avons identifié un tableau clinique particulier<br />
de la phase aiguë des OVCR, l’ischémie périveinulaire, qui est mis en évidence sur<br />
les clichés bleus par la présence d’une opacification en feuille de fougère de la rétine<br />
interne temporomaculaire. Ce tableau, du à la chute initiale de débit sanguin rétinien,<br />
peut être associé à une chute sévère de la vision mais n’empêche pas une récupération<br />
visuelle satisfaisante.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S155
1S156<br />
10 46<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
JOURNÉE DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET FONDAMENTALE<br />
Traitement des occlusions sévères de la veine centrale de la rétine par<br />
neurotomie optique radiaire.<br />
Radial optic neurotomy for severe central retinal vein occlusion.<br />
LE ROUIC JF*, BECQUET F, ZANLONGHI X, PERONNET P, POUSSET C,<br />
HERMOUET E, DUCOURNAU D (Nantes)<br />
But : Cette étude a pour but d’évaluer les résultats de la neurotomie optique radiaire<br />
dans le traitement des occlusions sévères de la veine centrale de la rétine.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective sur 10 yeux de 10 patients souffrant<br />
d’une occlusion de la veine centrale de la rétine et dont l’acuité visuelle ne dépassait<br />
pas 0,1. Ils ont bénéficié en pré-opératoire, au 3 ème et au 6 ème mois post-opératoire<br />
d’une angiographie à la fluorescéine, d’une périmétrie automatisée et d’une tomographie<br />
par cohérence optique.<br />
Résultats : L’acuité visuelle moyenne est passée de 30 points ETDRS en préopératoire<br />
à 42 points au troisième mois postopératoire (P = 0,03). L’épaisseur maculaire<br />
moyenne a diminué de 580 µm à 361 µm (P = 0,03). L’aspect du fond d’œil et le<br />
champ visuel se sont améliorés dans tous les cas. L’acuité visuelle moyenne des<br />
5 patients examinés au sixième mois était de 52,8 points. Aucun cas de perte<br />
visuelle ou de néovascularisation n’a été observé.<br />
Commentaire et Conclusions : À court terme, les résultats obtenus par la neurotomie<br />
optique radiaire sont encourageants en comparaison avec l’évolution naturelle<br />
des occlusions de la veine centrale avec une mauvaise vision initiale. Une étude randomisée<br />
serait souhaitable afin d’évaluer la place de cette technique dans le traitement<br />
des occlusions de la veine centrale de la rétine.<br />
10 47<br />
Occlusion expérimentale d’une branche veineuse rétinienne : effet de<br />
l’acétazolamide et de l’inhalation de carbogène (95 % CO2 , 5 % O2 ) sur la PO2 prérétinienne des territoires ischémiques.<br />
Experimental branch retinal vein occlusion: effect of acetazolamide and carbogen<br />
breathing (95% CO2, 5% O2) on preretinal PO2 in ischemic areas.<br />
PETROPOULOS J*, POURNARAS JA, POITRY S, MUNOZ JL, POURNARAS C<br />
(Genève, Suisse)<br />
But : Évaluer les variations de la PO 2 prérétinienne dans des territoires normaux et<br />
ischémiques après occlusion expérimentale d’une branche veineuse rétinienne<br />
(OBVR) dans des conditions de normoxie, d’hyperoxie (100 % O 2 ), d’inhalation de<br />
carbogène (95 % CO 2 , 5 % O 2 ), et après administration intraveineuse d’acétazolamide.<br />
Matériel et Méthode : Les mesures de la PO 2 prérétinienne ont été obtenues dans<br />
des zones intervasculaires de porcs miniatures (n : 14) à l’aide de microélectrodes<br />
sensibles à l’oxygène introduites dans la cavité vitréenne par un micromanipulateur.<br />
La pointe des électrodes était placée à 50 mm de l’interface vitréo-rétinienne. La PO 2<br />
a été mesurée de façon continue durant 10 minutes sous normoxie, hyperoxie ou<br />
carbogène. Après une OBVR induite au laser argon, les mesures ont été répétées<br />
dans les trois conditions précitées, avant et après administration d’acetazolamide<br />
(bolus intraveineux de 500 mg).<br />
Résultats : En hyperoxie, la PO 2 prérétinienne reste relativement constante dans un<br />
territoire normal (DPO 2 = 1,33 ± 3,39 mmHg) ou ischémique (DPO 2 = 3,73 ± 2,84<br />
mmHg), malgré l’augmentation significative de la PaO 2 systémique. Sous carbogène,<br />
la PaO 2 et la PaCO 2 systémiques augmentent significativement, ainsi que la PO 2 prérétinienne<br />
dans le territoire normal (DPO 2 = 23,05 ± 17,06 mmHg) ou ischémique<br />
(DPO 2 = 22,54 ± 5,96 mmHg). L’injection d’acétazolamide entraîne une augmentation<br />
transitoire et faible de la PO 2 prérétinienne lors d’une hyperoxie (DPO 2<br />
= 6,96 mmHg ± 4,49), alors que l’inhalation concomitante de carbogène améliore la<br />
PO 2 prérétinienne (DPO 2 = 15,15 mmHg ± 9,15) dans des territoires ischémiques<br />
après OBVR. La PO 2 prérétinienne demeure élevée même 20 minutes après l’interruption<br />
du carbogène (DPO 2 = 3,75 mmHg ± 4,42).<br />
Commentaire et Conclusions : L’hyperoxie systémique n’augmente pas significativement<br />
la PO 2 prérétinienne dans un territoire normal ou ischémique après<br />
OBVR. L’élévation significative de la PO 2 prérétinienne induite par l’inhalation de<br />
carbogène est probablement due à un effet vasodilatateur entraîné par l’augmentation<br />
de la PCO 2 intravasculaire. L’utilisation concomitante d’acétazolamide et de<br />
carbogène permettrait de maintenir la PO 2 prérétinienne à un niveau adéquat malgré<br />
une OBVR.<br />
10 48<br />
Remodelage microvasculaire après occlusion veineuse rétinienne<br />
expérimentale.<br />
Vascular remodeling after experimental retinal vein occlusion.<br />
GENEVOIS O* (Rouen), PAQUES M, GAUDRIC A, VICAUT E (Paris)<br />
But : Le but de cette étude est d´étudier les modifications de l´angio-architecture<br />
rétinienne après occlusion veineuse chez le rat.<br />
Matériel et Méthode : Une occlusion de branche veineuse rétinienne expérimentale<br />
a été effectuée chez des rats pigmentés. A J1, J3, J8 et J30 après l´occlusion, une<br />
injection intraveineuse de FITC-dextran est réalisée puis l´animal sacrifié. La rétine<br />
mise à plat est examinée en microscopie confocale et la densite microvasculaire de<br />
chaque niveau capillaire est analysée par microscopie confocale.<br />
Résultats : Le protocole de photocoagulation entraîne une occlusion veineuse transitoire<br />
durant 48 heures. Après occlusion veineuse il existe une diminution progressive<br />
de la densité microvasculaire touchant le réseau intermédaire et profond de J1<br />
à J8 et se stabilisant de J8 à J30. Le réseau superficiel semble épargné.<br />
Commentaire et Conclusions : Nos résultats montrent l´existence d´un remodelage<br />
microvasculaire évolutif, touchant les différentes couches, apparaissant dès<br />
l´occlusion et s´aggravant malgré la reperfusion de la veine photocoagulée. Un mécanisme<br />
d´ischémie-reperfusion veineuse pourrait expliquer ces phénomènes.<br />
10 49<br />
Œdème maculaire des occlusions veineuses rétiniennes : mesure par<br />
tomographie en cohérence optique après photocoagulation en grille maculaire<br />
et vitrectomie.<br />
Macular edema in retinal vein occlusion: OCT measurement after grid laser<br />
photocoagulation and after vitrectomy.<br />
NYOUMA MOUNE E* (Douala, Cameroun), GLACET-BERNARD A, ZOURDANI A,<br />
COSCAS G, SOUBRANE G (Creteil)<br />
But : La persistance d’un œdème maculaire (OM) joue un rôle déterminant dans la<br />
récupération visuelle après une occlusion veineuse rétinienne (OVR). Le but de cette<br />
étude est d’évaluer, à l’aide de la tomographie en cohérence optique (OCT),<br />
l’influence d’un traitement laser « en grille » maculaire (GM) et de la vitrectomie sur<br />
l’OM des OVR.<br />
Matériel et Méthode : Deux groupes de patients présentant une OVR (veine centrale<br />
ou branche) ont été analysés. Le 1 er groupe était constitué de 10 yeux traités<br />
par GM. Les 9 yeux du 2 ème groupe avaient bénéficié d’une vitrectomie pour OVR en<br />
cours d’aggravation survenue malgré une prise en charge optimale. Une angiographie<br />
à la fluorescéine et un OCT avec retinal map étaient effectués avant et après<br />
traitement. La vitrectomie comprenait décollement du vitré et pelage de la limitante<br />
interne, complété par une adventicectomie pour les OBV.<br />
Résultats : Dix-neuf patients âgés de 58 à 71 ans ont été traités. L’épaisseur maculaire<br />
était importante avant GM (579 µm) et vitrectomie (694 µm), et était corrélée à<br />
une acuité visuelle initiale basse et une longue durée d’évolution. L’épaisseur maculaire<br />
était considérablement réduite après vitrectomie (-330 µm) comparativement à<br />
la grille (-50 µm, p = 0,004). Un gain moyen d’acuité visuelle de 3 lignes était<br />
constaté après vitrectomie et une perte moyenne d’une ligne après GM. Aucune<br />
complication n’a été observée.<br />
Commentaire et Conclusion : La vitrectomie semble plus efficace que la grille<br />
maculaire dans la régression de l’OM et la récupération visuelle. Une étude randomisée<br />
et plus large semble nécessaire pour confirmer ces conclusions.<br />
10 50<br />
Traitement des œdèmes maculaires post occlusion veineuse rétinienne par<br />
injection intravitréenne de triamcinolone : étude pilote prospective ouverte.<br />
Intravitreal triamcinolone acetonide for macular edema due to retinal vein occlusion:<br />
a prospective pilot study.<br />
ROUX C* (Marseille), PAQUES M, HAOUCHINE B, GAUDRIC A (Paris)<br />
But : L’œdème maculaire chronique est la principale cause de baisse d’acuité<br />
visuelle après occlusion veineuse rétinienne. Hormis la photocoagulation de certaines<br />
occlusions de branche, aucun traitement n’a fait la preuve de son efficacité.<br />
Nous présentons les résultats d’une étude pilote prospective de l’efficacité de la<br />
triamcinolone intravitréenne dans cette indication.<br />
Matériel et Méthode : 15 patients (16 yeux) ont été inclus. Une injection intravitréenne<br />
de triamcinolone a été réalisée. Les critères d’évaluation étaient l’acuité<br />
visuelle et la mesure de l’épaisseur maculaire. Le suivi est d’au moins 3 mois.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
JOURNÉE DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET FONDAMENTALE<br />
Résultats : À 3 mois, 8 yeux ont eu une amélioration significative de leur acuité<br />
visuelle. Aucun patient n’a eu de baisse significative d’acuité visuelle. 15 patients ont<br />
eu une diminution significative de leur épaisseur maculaire et normalisée dans 4 cas.<br />
4 patients ont présentés une hypertonie oculaire, dans 3 cas contrôlée par traitement<br />
local. Un patient a été trabeculectomisé. À 6 mois, 2 patients sur les 6 suivis avaient<br />
une diminution de leur épaisseur maculaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Une injection intravitréenne unique de triamcinolone<br />
est efficace dans le traitement des œdèmes maculaires secondaires aux occlusions<br />
veineuses rétiniennes. Une surveillance post-traitement régulière est<br />
nécessaire en raison du risque d’hypertonie oculaire. La durée d’efficacité moyenne<br />
se situe entre 3 et 6 mois. Une étude versus contrôle est nécessaire avant de<br />
conclure quant au rapport bénéfice sur risque de ce traitement.<br />
10 51<br />
Efficacité du traitement chirurgical de l’œdème maculaire chronique secondaire<br />
à une occlusion de branche veineuse rétinienne.<br />
Surgical treatment efficiency in chronic macular edema after branch vein occlusion.<br />
BECQUET F*, LE ROUIC JF, DUCOURNAU D (Nantes)<br />
But : Récemment, des études pilotes ont montré l’efficacité du pelage de la limitante<br />
interne au pôle postérieur dans la maculopathie oedémateuse diabétique, même en<br />
l’absence de traction vitréomaculaire. Ce travail a été conduit pour évaluer les résultats<br />
du traitement chirurgical de l’œdème maculaire lié à l’occlusion de branche veineuse<br />
rétinienne.<br />
Matériel et Méthode : Une étude prospective non randomisée a été conduite entre<br />
mars 2001 et avril 2002 chez 12 yeux de 12 patients vus consécutivement et présentant<br />
une baisse d’acuité visuelle inférieure à 5/10è secondaire à une occlusion de<br />
branche veineuse avec œdème maculaire. 6 patients ont bénéficié d’une adventicectomie<br />
avec ablation de la limitante interne, 6 autres d’une ablation de limitante<br />
interne simple. En préopératoire, au 3è et 6è mois postopératoire, une mesure de<br />
l’acuité visuelle ETDRS, une angiographie à la fluorescéine, une périmétrie automatisée,<br />
et un OCT a été réalisée pour chaque patient.<br />
Résultats : L’acuité visuelle post-opératoire s’est améliorée chez tous les patients<br />
à 6 mois (moyenne = 5/10è). Le gain moyen d’acuité visuelle est de 3 lignes (ou<br />
14 points ETDRS) (p = 0,002). Au fond d’œil et à l’angiographie, une amélioration a<br />
été constatée chez tous les patients à 6 mois. Au champ visuel automatisé, le déficit<br />
corrigé moyen pré-opératoire (3,4 ± 0,9 dB) s’est amélioré dès le 3è mois post-opératoire<br />
(2,3 ± 0,9 dB) (p = 0,008) pour rester stable au 6è mois. En OCT, l’épaisseur<br />
maculaire moyenne préopératoire (419 ± 57 microns) diminue à 233 ± 10 microns au<br />
6è mois post-opératoire (p = 0,02).<br />
Commentaire et Conclusions : L’ablation de la limitante interne semble efficace<br />
dans le traitement de l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche. En<br />
revanche, l’adventicectomie n’ajoute pas de bénéfice fonctionnel pour le patient.<br />
10 52<br />
Traitement chirurgical des occlusions de branche veineuse rétinienne par<br />
adventicectomie. Étude sur 12 cas.<br />
Surgical treatment of branch retinal vein occlusion: vitrectomy and adventitial<br />
sheathotomy. A prospective review of 12 cases.<br />
CHARBONNEL J* (Le Mans), GLACET-BERNARD A (Creteil), KOROBELNIK JF<br />
(Bordeaux), NYOUMA-MOUNE E (Cameroun), POURNARAS C, SOUBRANE G<br />
(Créteil), COLIN J (Bordeaux)<br />
But : Les occlusions de branches veineuses rétiniennes sont des maladies fréquentes<br />
en ophtalmologie. La prise en charge thérapeutique ne permet pas toujours<br />
d’éviter des séquelles visuelles importantes. L’hypothèse pathogénique la plus communément<br />
admise suppose que le mécanisme primitif est la compression de la veine<br />
par l’artère athérosclérosée qui s’est dilatée et rigidifiée.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons pratiqué une adventicectomie (section de la<br />
gaine commune qui unit artère et veine au niveau des croisements) sur 12 patients<br />
porteurs d’occlusion de branche veineuse. Nous avons pratiqué un test de Student<br />
pour évaluer l’influence des variables quantitatives sur l’amélioration de l’acuité<br />
visuelle, un test bivarié de Pearson pour évaluer l’influence des variables quantitatives<br />
sur le gain d’acuité visuelle et un test exact de Fischer pour évaluer l’influence<br />
des variables qualitatives sur l’amélioration de l’acuité visuelle. Nous avons pratiqué<br />
une OCT lorsque cela était possible (6 cas sur 12).<br />
Résultats : Le gain est meilleur lorsque le vitré préopératoire du patient n’est pas<br />
décollé, lorsque l’acuité visuelle initiale est moins bonne, lorsque l’occlusion est<br />
située sur l’arcade temporale supérieure, dans les formes ischémiques, pour les<br />
patients les plus jeunes.<br />
Commentaire et Conclusions : Le résultat le plus intéressant car jamais publié<br />
dans les études sur les adventicectomies est l’influence de l’état du vitré sur le gain.<br />
Il semblerait que la vitrectomie soit plus bénéfique que l’adventicectomie pour<br />
l’acuité visuelle finale. Cette donnée est à rapprocher des bénéfices retrouvés dans<br />
les études réalisées sur les vitrectomies effectuées pour les œdèmes maculaires des<br />
diabétiques, des occlusions de branche veineuse rétinienne et de la veine centrale.<br />
Une étude sur un plus grand nombre de cas, avec un groupe contrôle est utile pour<br />
confirmer ces résultats.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S157
1S158<br />
ORBITE<br />
10 53<br />
Enucléation et implantation secondaires à la suite de panophtalmie.<br />
Secondary enucleation and implantation following panophthalmia.<br />
GAILLARD MC*, GIANOLI F, SPAHN B (Lausanne, Suisse)<br />
But : La technique d’eviscération primaire suivie d’énucléation et implantation<br />
secondaires permet de récupérer la sclère d’un patient présentant un problème<br />
infectieux (panophtalmie). Cette sclère sera utilisée lors de l’implantation secondaire.<br />
Matériel et Méthode : Trois cas de panophtalmie avec perforation oculaire dont<br />
2 infections bactériennes et une infection mycotique ont été éviscérés dans un premier<br />
temps puis 4 à 6 semaines plus tard énucléés. Lors de l’énucléation secondaire,<br />
la sclère récupérée sert à envelopper l’implant (alumine de 20 et 22 mm de diamètre).<br />
Entre les 2 opérations, seul un traitement antibiotique ou antimycotique par voie<br />
générale et locale a été administré.<br />
Résultats : Aucune complication n’a été constatée aussi bien lors de la première<br />
que lors de la seconde intervention. La sclère énuclée au cours de la seconde intervention<br />
était dans les 3 cas rétractée et déformée. Un étalement de celle-ci a permis<br />
d’enrober les implants. Une prothèse oculaire a été posée 4 à 5 semaines après la<br />
seconde intervention. Aucune complication n’a été constatée à ce jour (suivi de 6 à<br />
18 mois).<br />
Commentaire et Conclusions : L’implantation primaire après un processus infectieux<br />
n’est pas réalisable. L’utilisation de sclère pour enrober une bille diminue nettement<br />
les risques d’extériorisation en particulier si la conjonctive et la Tenon ont<br />
déjà été fragilisées par d’autres chirurgies ou une infection. La technique d’eviscération<br />
primaire avec mise en place d’un conformateur suivie d’une énucléation et<br />
implantation secondaires semble être la solution idéale car elle permet l’utilisation de<br />
la sclère du patient.<br />
10 54<br />
Le type d’implant intraorbitaire post-énucléation influence-t-il la radiothérapie ?<br />
Does the type of intra-orbital implant affect radiotherapy effects?<br />
HENCHOZ L* (Lausanne, Suisse)<br />
But : Connaître la dose d’irradiation à appliquer dans la région orbitaire chez un<br />
patient énucléé ayant un implant intraoculaire de polyethylène poreux, d’hydroxapatite<br />
ou d’alumine.<br />
Matériel et Méthode : Un champ d’irradiation de 4x4 cm 2 a été utilisé pour 3 types<br />
de billes différentes (polyéthylène poreux, hydroxyapatite, alumine) ayant toutes un<br />
diamètre de18 mm. Des mesures d’absorption des 3 différentes billes ont été effectuées<br />
avec des énergies de rayonnement de 6 et 18 MV.<br />
Résultats : Les doses d’irradiation calculées derrière les implants divergent selon<br />
leur matériau de fabrication. Les billes de polyéthylène et d’alumine produisent une<br />
augmentation de la dose de 3 % à 6 MV et de 2 % à 18 MV, par rapport à une irradiation<br />
sans implant. En revanche celle d’hydroxyapatite diminue la dose de 2 % à<br />
6 MV et 1 % à 18 MV.<br />
Commentaire et Conclusions : La dose délivrée avec la présence d’un implant<br />
n’est pas le même selon le matériau. Il est donc impératif de connaître la structure<br />
de l’implant avant une irradiation afin d’adapter le schéma thérapeutique.<br />
STRABISMES<br />
10 55<br />
Ptose palpébrale et troubles oculomoteurs associés au cours du syndrome de<br />
Marcus Gunn.<br />
Associated ptosis and oculomotor disorders in the Marcus Gunn syndrome.<br />
MORAX S*, BOK C (Paris), CATTINI G (Milan), PALLADINO D (Rome)<br />
But : À travers quelques cas cliniques, les auteurs exposent leur expérience de prise<br />
en charge des ptosis associés à des troubles oculomoteurs dans le syndrome de<br />
Marcus Gunn.<br />
Matériel et Méthodes : Nous rapportons les cas de six patients présentant un ptosis<br />
unilatéral avec syncinésie de Marcus Gunn (rétraction rapide de la paupière ptosée<br />
lors de l’ouverture buccale ou de la diduction mandibulaire) associé à des<br />
troubles oculomoteurs homolatéraux à type de paralysie de l’élévation plus ou moins<br />
hypotropie. Le traitement a comporté plusieurs temps : traitement de l’amblyopie<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
ORBITE – STRABISMES<br />
fréquemment existante, puis chirurgie oculomotrice, puis chirurgie palpébrale. Le<br />
traitement oculomoteur a été fait sur l’œil atteint plus ou moins un deuxième temps<br />
sur l’œil controlatéral, la chirurgie palpébrale a comporté une dénervation du muscle<br />
releveur de la paupière supérieure (RPS) atteint, une section et recul du RPS sain et<br />
une suspension bilatérale au muscle frontal.<br />
Résultats : Nous avons obtenu des résultats satisfaisants d’un point de vue sensoriel<br />
et esthétique. Une pénalisation de l’œil dominant a été nécessaire pour maintenir<br />
la fixation de l’œil atteint.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette pathologie associe des phénomènes sensoriels,<br />
moteurs, et innervationnels complexes. La fixation préférentielle par l’œil pathologique<br />
corrige en partie le ptosis. La ptôse résiduelle et la syncinésie motivent la<br />
chirurgie palpébrale. L’unilatéralité du syndrome rend difficile l’obtention d’un résultat<br />
symétrique. Celui est au mieux obtenu par une chirurgie palpébrale bilatérale. À<br />
long terme, il est indispensable que l’œil anciennement amblyope soit fixateur. La<br />
bonne connaissance pathogénique de ce syndrome complexe est nécessaire pour<br />
définir un protocole de prise en charge orthoptique, médical et chirurgical permettant<br />
d’optimiser le résultat fonctionnel et esthétique.<br />
10 56<br />
Apport de la chirurgie ajustable sous anesthésie topique potentialisée dans le<br />
traitement des troubles oculomoteurs des orbitopathies dysthyroïdiennes.<br />
Ajustable surgery under potentialised topic anesthesia for oculomotor disorders<br />
treatment in dysthyroïd orbitopathy.<br />
BOK C*, MORAX S (Paris)<br />
But : Nous rapportons une série de patients ayant eu une chirurgie oculomotrice<br />
réglable, sous anesthésie topique potentialisée, dans le cadre d’orbitopathie dysthyroïdienne.<br />
Matériel et Méthode : La série porte sur des patients opérés depuis mars 2002.<br />
Ces patients étaient porteurs de diplopie invalidante, stable. Tous avaient une maladie<br />
de Basedow équilibrée. La chirurgie oculomotrice a été pratiquée après le geste<br />
osseux, avant le geste palpébral. Les indications à la chirurgie réglable ont été portées<br />
quand la fibrose musculaire restait modérée ou en cas de contre-indication à<br />
l’anesthésie générale. Il s’agissait d’une chirurgie de première intention sur le (ou<br />
parfois les) muscle(s) concerné(s). Le protocole anesthésique comprend l’instillation<br />
d’un collyre anesthésique et l’administration intraveineuse d’un antalgique et d’un<br />
neuroleptique. Le réglage se fait en per-opératoire.<br />
Résultats : Tous nos patients ont eu un bon résultat, stable à au moins six mois<br />
post-opératoires.<br />
Commentaire et Conclusions : La chirurgie réglable trouve sa place sur des muscles<br />
peu fibreux où le résultat est difficilement prédictible par un protocole conventionnel.<br />
Elle permet d’obtenir un résultat immédiat. L’adjonction d’un neuroleptique<br />
intraveineux rend l’intervention plus confortable pour le patient et le chirurgien. La<br />
chirurgie réglable sous anesthésie topique potentialisée nous a donné satisfaction<br />
ainsi qu’à nos patients. Nos résultats nous encouragent à continuer et à lui donner<br />
sa place dans la stratégie de prise en charge des diplopies dysthyroïdiennes.<br />
10 57<br />
Le test de Guyton dans les paralysies de l’oblique supérieur.<br />
Guyton’s test in superior oblique palsies.<br />
PECHEREAU A* (Nantes), LAHBIL D (Casablanca, Maroc), LASSALLE D (Nantes)<br />
But : Pour évaluer les forces passives dans les troubles oculomoteurs, les opérateurs<br />
utilisent le test de duction forcée. Une méthode d’évaluation de la torsion passive<br />
(Guyton) peut être utilisée pour mesurer la torsion passive. Elle consiste à<br />
provoquer une intorsion et une extorsion passive par deux pinces situées au limbe<br />
sur le méridien horizontal et à provoquer un mouvement d’intorsion puis d’extorsion<br />
jusqu’à la butée mécanique. La quantité de chacun de ces mouvements peut être<br />
évaluée.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude prospective portant sur trois<br />
populations : sujets normaux, sujets strabiques et paralysie de l’oblique supérieur.<br />
Le test est réalisé sous anesthésie générale en préopératoire. Une photographie de<br />
la position de départ, des positions d’intorsion et d’extorsion forcées est réalisée.<br />
L’angle de rotation par rapport à l’horizontal est mesuré par le logiciel NIH 1.62.<br />
Résultats : Les trois populations seront comparées quand à la quantité de torsion<br />
forcée. La population de paralysie de l’oblique supérieur sera divisée en deux sousgroupes<br />
en fonction ou non d’une atrophie de l’oblique supérieur à l’IRM. Les résultats<br />
seront présentés en séance.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
Commentaire et Conclusions : L’évolution de la chirurgie oculomotrice montre<br />
l’importance des tests per-opératoires. Ceux-ci sont réalisés de façon systématique<br />
en chirurgie des muscles droits. Pour les muscles obliques, aucun protocole<br />
n’a été proposé pour l’instant en dehors de l’évaluation directe. Ce test<br />
peut être un outil supplémentaire pour le chirurgien dans le processus de décision<br />
chirurgical.<br />
10 58<br />
Résultats chirurgicaux des exotropies primitives concomitantes à grand angle<br />
chez les enfants.<br />
Surgical results in childhood primary comitant large-angle exotropia.<br />
ASLANIS D*, FOLLIDI V, CONSTANTOPOULOS I, SPYROPOULOS G, PAIKOS P<br />
(Athènes, Grèce)<br />
But : Le but de cette étude était d’évaluer les résultats chirurgicaux des exotropies<br />
primitives concomitantes à grand angle (>30) après un seul temps chirurgical chez<br />
les enfants.<br />
Matériel et Méthode : On a effectué une étude rétrospective des tous les enfants<br />
présentant une exotropie primitive concomitante à angle supérieure de 30∆, qui ont<br />
été opérés dans notre service de janvier 1996 à décembre 2000 par divers opérateurs<br />
de grande expérience. On a exclu de notre étude les enfants avec un syndrome<br />
alphabétique important, les syndromes de rétraction et les nystagmus. Les résultats<br />
postopératoires ont été classés en trois catégories : exotropie résiduelle de plus que<br />
10∆, bon résultat post-opératoire (ésotropie < 10∆, orthotropie ou exotropie > 10∆)<br />
et esotropie consécutive de plus que 10∆.<br />
Résultats : 97 enfants accomplissaient les critères de l’étude. 40 (41,2 %)<br />
étaient garçons et 57 (58,8 %) filles. L’age moyen le jour de l’opération était<br />
6,5 ans (SD 3,1). 40,2 % (39 sur 97) avaient une exotropie intermittente qui s’est<br />
ensuite décompensée. 26 (26,8 %) ont bénéficié d’un recul de deux droits externes,<br />
67 (69,1 %) d’une opération unilatérale, recul du droit externe/résection du<br />
droit interne et 4 (4,1 %) d’une opération sur trois muscles. 58,8 % des enfants<br />
opérées ont eu un bon résultat postopératoire, sans nécessité de deuxième<br />
intervention.<br />
Commentaire et Conclusions : Les exotropies primitives concomitantes à angle<br />
importante chez les enfants, peuvent être corrigés avec une seule intervention chirurgicale,<br />
unilatérale ou bilatérale, avec un succès qui, dans notre étude, a atteint le<br />
58,8 %.<br />
10 59<br />
Étude de la réfraction sous cyclopentolate à 0,5 % chez l’enfant emmétrope : 2<br />
gouttes versus 3 gouttes.<br />
Study of refraction with cyclopentolate 0.5% in emetropic children: 2 drops versus 3<br />
drops.<br />
MADERN F*, SANTALLIER M, SELLAMI L, CUSSENOT B, BERTRAND P,<br />
PISELLA PJ, ARSENE S (Tours)<br />
But : Chez l’enfant, la cycloplégie est réalisée par l’instillation d’une goutte de cyclopentolate<br />
à 0,5 %, à 3 reprises à 5 minutes d’intervalle, avec mesure de la réfraction<br />
45 minutes après la première goutte. Le but de l’étude est de savoir si la réfraction<br />
chez les enfants de 4 à 13 ans sans trouble visuel et oculo-moteur est différente<br />
selon que l’on instille 2 ou 3 gouttes.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude prospective randomisée, sur enfant<br />
mineur avec bénéfice individuel direct, chez 36 enfants emmétropes, âgés de 4<br />
à 13 ans, réalisée dans le service d’ophtalmologie du C.H.U de Tours. Chaque<br />
enfant a reçu successivement 2 ou 3 gouttes de cyclopentolate à 0,5 % dans<br />
chaque œil simultanément à deux reprises à 4 semaines d’intervalle. La mesure<br />
de la réfraction a été réalisée de façon automatisée par autokératoréfractomètre<br />
pendant une heure et demi après le début de l’instillation à raison d’une mesure<br />
toute les 15 minutes.<br />
Résultats : Les valeurs du cylindre et de son axe étaient équivalentes à chaque<br />
temps. La variation de la sphère était équivalente dans les deux protocoles et augmentait<br />
de façon significative de 1 +/– 0,60 dioptrie entre t0’ et t45’.<br />
Commentaire et Conclusions : Chez l’enfant emmétrope, la cycloplégie sous<br />
2 gouttes de cyclopentolate à 0,5 % permet l’obtention d’une réfraction aussi fiable<br />
qu’après instillation de 3 gouttes. Le gain en tolérance la fait préférer à cette dernière.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
ORBITE – STRABISMES<br />
10 60<br />
Facteurs de risque de l’ésotropie précoce.<br />
Risk factors in early esotropia.<br />
DENIS D*, WARY P, FEDERICI L, HADJADJ E (Marseille)<br />
But : L’ésotropie précoce survient lors des 6 premiers mois de vie, période où le<br />
système oculomoteur est en plein développement. Il se définit par un ensemble de<br />
signes oculaires moteurs et sensoriels caractéristiques qui établissent le diagnostic.<br />
Le but de cette étude est de quantifier l’incidence des facteurs de risque dans ce<br />
type de strabisme.<br />
Matériel et Méthode : À l’aide d’un questionnaire et d’une consultation, les facteurs<br />
sont répertoriés chez 50 enfants présentant une ésotropie précoce. Ont été exclus<br />
les enfants qui présentaient des lésions systémiques et/ou du système nerveux central.<br />
Résultats : Le facteur héréditaire est présent dans 30 %, la prématurité 15 %<br />
(£ 37 SA) (avec une prématurité relative (
1S160<br />
10 61<br />
Comparaison de quatre critères d’analyse du retentissement de la<br />
choriorétinopathie de type birdshot.<br />
Comparaison of four analysis criteria of birdshot retinochoroidopathy.<br />
DUBERNARD G* (Poissy), MONNET D, MAZEAU V, GRENIER C, HAOUCHINE B,<br />
PARC C, BREZIN A (Paris)<br />
But : Analyser quatre critères du retentissement de la choriorétinopathie de type<br />
birdshot, l’acuité visuelle, le champ visuel automatisé, l’angiographie en fluorescéine<br />
et la tomographie en cohérence optique. Les éléments objectifs permettant le suivi<br />
de la maladie, la décision thérapeutique et le contrôle de son efficacité ont été analysés.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective monocentrique portant sur 42 patients<br />
atteints de choriorétinopathie de type birdshot. L’acuité visuelle (étude portant sur<br />
42 patients), l’œdème maculaire en angiographie en fluorescéine (42 patients), la<br />
déviation moyenne sur le champ visuel automatisé (30 patients) et l’épaisseur<br />
moyenne en tomographie en cohérence optique (24 patients) ont été comparés.<br />
Résultats : Une corrélation statistiquement significative a été démontrée entre<br />
l’acuité visuelle et la déviation moyenne sur le champ visuel automatisé ; entre<br />
l’acuité visuelle et l’œdème maculaire sur l’angiographie en fluorescéine ; entre la<br />
déviation moyenne et l’œdème maculaire angiographique. Il n’existait pas de corrélation<br />
significative entre la tomographie en cohérence optique et les autres examens.<br />
Commentaire et Conclusions : La baisse de l’acuité visuelle dans la choriorétinopathie<br />
de type birdshot peut être rapportée à une augmentation (œdème) ou une<br />
diminution (atrophie) de l’épaisseur maculaire. Cette distinction a des répercussions<br />
thérapeutiques majeures. Bien que n’étant pas corrélée, la tomographie en cohérence<br />
optique est un indicateur fin de l’anatomie maculaire qui conditionne le pronostic<br />
visuel et donc la prise en charge thérapeutique. La tomographie en cohérence<br />
optique paraît un élément susceptible de grand intérêt pour prédire la réponse thérapeutique<br />
à attendre dans les cas nécessitant un traitement.<br />
10 62<br />
Différentes prises en charge thérapeutiques de la choriorétinopathie de Birdshot.<br />
Various therapeutic coverages of Birdshot’s chorioretinopathy.<br />
CAPRANI L*, LAURANS P, LEROY C, MILAZZO S, TURUT P (Amiens)<br />
But : La choriorétinopathie de Birdshot est une uvéite bilatérale chronique rare, individualisée<br />
en 1980 par Ryan et Maumenee, dont les prises en charges thérapeutiques<br />
sont variées.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons étudié les 10 cas de maladie de Birdshot suivis<br />
depuis 8 ans dans le service et comparé les différentes caractéristiques des patients<br />
entre eux mais surtout leur prise en charge thérapeutique et leur récupération<br />
visuelle.<br />
Résultats : Notre série comporte une majorité d’hommes, d’âge supérieur à 50 ans<br />
avec une forte prédominance du groupe HLA A 29, ce qui est en accord avec les<br />
données de la littérature. La prise en charge thérapeutique a été variée associant ou<br />
non corticothérapie, perfusion d’immunoglobulines polyvalentes et, en dernier lieu,<br />
la chirurgie.<br />
Commentaire et Conclusions : La choriorétinopathie de Birdshot est une uvéite<br />
postérieure d’évolution chronique dont le pronostic visuel a été décevant dans notre<br />
série. L’utilisation de thérapeutiques lournes n’a pas évité la survenue de<br />
complications : œdème maculaire cystoïde, membrane épirétinienne chez certains<br />
de nos patients.<br />
10 63<br />
Différentiation de l’atteinte rétinienne et choroïdienne dans la rétinochoroïdite<br />
de Birdshot, étude longitudinale sur leurs évolutions et leurs réponses<br />
respectives au traitement.<br />
Differential involvement, evolution and progression of retinal and choroidal<br />
inflammation in birdshot retinochoroidopathy: a longitudinal study.<br />
HERBORT CP* (Lausanne, Suisse), PROBST K (Utrecht, Pays Bas), CIMINO L<br />
(Reggio Emilia, Italie), TRAN V. T (Lausanne, Suisse)<br />
But : La rétinochoroïdite de Birdshot est un cas particulier parmi les uvéites parce<br />
que la rétine et la choroïde sont des cibles indépendantes de l’inflammation. L’angiographie<br />
au vert d’indocyanine permet maintenant de suivre l’évolution inflammatoire<br />
choroïdienne de façon tout aussi précise que l’atteinte rétinienne. Le but ici fut de<br />
comparer les atteintes inflammatoires rétinienne et choroïdienne et leur réponse respective<br />
au traitement.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
UVÉITES (1)<br />
Matériel et Méthode : Les patients avec rétinochoroïdite de Birdshot suivis à la<br />
consultation des uvéites du Centre Ophtalmologique de La Source à Lausanne,<br />
Suisse de 1995 à 2002 (n = 15/742 = 2 %) furent répartis dans 3 groupes. Groupe 1 :<br />
patients nouvellement diagnostiqués dont l’évolution de la maladie (symptômes)<br />
n’excédait pas 1 an (n = 6), Groupe 2 : patients sous traitement immunosuppresseur<br />
dont l’évolution de la maladie était d’un an mais n’excédait pas 7 ans (n = 5).<br />
Groupe 3 : patients traités dont l’évolution était de plus de 7 ans (n = 4). Les paramètres<br />
suivant furent analysés pour les trois groupes : champ visuel automatisé,<br />
score angiographique fluorescéinique (0-4), score angiographique ICG (0-4) et<br />
atteinte du fond d’œil (lésions dépigmentées, 0-4). Ces scores furent établis par un<br />
examinateur externe (K.P.) ne connaissant pas les données du patient à l’aide de<br />
photos types représentant les graduations de 1-4 des différents scores. Ces scores<br />
furent comparés dans les trois groupes afin de juger de leur évolution au cours des<br />
différents stades d’évolution de la maladie.<br />
Résultats : Dans la phase précoce de la maladie l’atteinte choroïdienne est plus<br />
prononcée (score 30.8) que l’atteinte rétinienne (score 2.11.2) avec très peu de<br />
dépigmentation (score 10.27). L’atteinte choroïdienne répond bien au traitement<br />
immunosuppresseur avec réduction du score à 1.2 et 0.75 dans les groupes 2 et 3,<br />
alors que l’atteinte rétinienne a tendance à progresser (scores de 2.8 et 3 pour les<br />
groupes 2 et 3) malgré le traitement. Les zones dépigmentées (scores de 2.8 et 3<br />
pour les groupes 2 et 3) progressent malgré la bonne réponse choroïdienne au traitement.<br />
L’atteinte du champ visuel suit l’évolution rétinienne avec une amélioration<br />
à l’introduction du traitement puis dégradation très lente.<br />
Commentaire et Conclusions : L’atteinte rétinienne et choroïdienne dans le Birdshot<br />
ont une évolution diverse avec bonne réponse de l’inflammation choroïdienne au<br />
traitement et relative résistance de l’inflammation rétinienne. L’augmentation des<br />
zones dépigmentées malgré un bon contrôle de l’inflammation choroïdienne s’explique<br />
par une dépigmentation choroïdienne résiduelle après résolution des granuLomés,<br />
hypothèse confirmée récemment par un cas d’autopsie de Birdshot.<br />
10 64<br />
Manifestations choriorétiniennes des rickettsioses.<br />
Chorioretinal manifestations of rickettsiosis.<br />
LADJIMI A*, KHAIRALLAH M, BEN YAHIA S, ZAOUALI S, MESSAOUD R, JELLITI B,<br />
SGHAIER S (Monastir, Tunisie)<br />
But : Rapporter les manifestations choriorétiniennes de la fièvre boutonneuse méditerranéenne<br />
(FBM), une maladie infectieuse due à Rickettsia conorii.<br />
Matériel et Méthode : Trente patients atteints de FBM ont été examinés à la phase<br />
aiguë de la maladie. Un examen ophtalmologique complet, incluant une angiographie<br />
à la fluorescéine, ont été pratiqués chez tous les patients.<br />
Résultats : Vingt-cinq des 30 patients (83,3 %) avaient une atteinte uni (5 patients)<br />
ou bilatérale (20 patients) du segment postérieur. Seize des 25 patients (64 %)<br />
n’avaient aucun symptôme oculaire et 9 patients (36 %) avaient une altération brutale<br />
de la vision. Les lésions observées se présentaient comme suit : Hyalite modérée<br />
(45 yeux, 100 %), rétinite focale ou multifocale (16 yeux, 35,6 %), engainement<br />
vasculaire (4 yeux, 8,7 %), plaques artérielles multiples (1 œil, 2,2 %), hémorragies<br />
intrarétiniennes (14 yeux, 31,1 %) hémorragies à centre blanc (2 yeux, 4,4 %),<br />
hémorragies sous-rétiniennes (2 yeux, 4,4 %), décollement séreux rétinien (3 yeux,<br />
6,7 %), étoile maculaire (2 yeux, 4,4 %), œdème maculaire cystoïde (1 œil, 2,2 %),<br />
œdème papillaire (1 œil, 2,2 %), occlusion de branche artérielle (1 œil, 2,2 %), nodules<br />
cotonneux (2 yeux, 4,4 %), hyperfluorescence papillaire (30 yeux, 66,7 %), diffusions<br />
vasculaires (27 yeux, 60 %), retard de remplissage d’une branche veineuse<br />
(1 œil, 2,2 %), taches hypofluorescentes choroïdiennes multiples (10 yeux, 22,2 %),<br />
hyperfluorescence papillaire (30 yeux, 66,7 %) et une néovascularisation rétinienne<br />
(1 œil, 2,2 %) notée après 6 mois d’évolution. Toutes les atteintes du segment postérieur<br />
observées à la phase aiguë se sont résolues au bout de 3 à 10 semaines,<br />
avec une acuité visuelle finale de 10/10 dans 41 des 45 yeux (91,1 %). Des altérations<br />
de l’épithélium pigmentaire de la rétine ont été observées après résolution des<br />
foyers de rétinite dense.<br />
Commentaire et Conclusions : Une atteinte du segment postérieur, le plus souvent<br />
asymptomatique, est très fréquente au cours de la FBM. L’apport de l’angiographie<br />
rétinienne à la fluorescéine est déterminant pour le diagnostic des atteintes<br />
infracliniques particulièrement la vascularite rétinienne. La présence des atteintes<br />
sus-citées chez un patient ayant une fièvre et/ou un exanthème, séjournant ou<br />
retournant d’un voyage dans une zone endémique surtout au printemps ou en été,<br />
doit fortement faire suspecter le diagnostic de FBM.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
10 65<br />
La toxocarose oculaire dans le nord de la France : aspects diagnostiques et<br />
épidémiologiques.<br />
Diagnosis and epidemiology of ocular toxocarosis in the north of France.<br />
LABALETTE P*, JAUMAIN-SPRIMONT AS, CROS C, MALBREL F, DUTOIT E,<br />
CAMUS D (Lille)<br />
But : Décrire une importante série consécutive de patients présentant une toxocarose<br />
oculaire et analyser les résultats obtenus sur les plans épidémiologique, clinique<br />
et biologique.<br />
Matériel et Méthode : Vingt sujets présentant une toxocarose oculaire et examinés<br />
dans le Service d’Ophtalmologie du C.H.R.U. de Lille entre 1992 et 2002 ont été<br />
inclus. Le diagnostic de toxocarose était retenu (1) devant un aspect clinique typique,<br />
quel que soit le statut sérologique au moment du diagnostic, ou (2) sur la combinaison<br />
d’arguments cliniques et biologiques lorsque l’aspect de l’uvéite était<br />
simplement évocateur ou compatible avec cette étiologie. La comparaison des différents<br />
résultats concernant les critères cliniques a été effectuée avec le test T de<br />
Student lorsqu’il s’agissait de facteurs quantitatifs et avec le test exact de Fisher<br />
lorsqu’il s’agissait de facteurs qualitatifs.<br />
Résultats : Notre série comporte onze adultes et neuf enfants, soit respectivement<br />
55 % et 45 % des sujets, ce qui diffère des affirmations communément<br />
admises pour cette affection. Sur le plan fonctionnel, l’affection s’avère nettement<br />
plus grave pour la population pédiatrique que pour les sujets plus âgés : le pronostic<br />
visuel s’avère catastrophique en dessous de 8 ans, puisqu’aucun des<br />
patients de cette catégorie n’a d’acuité visuelle utile dans notre série. Les formes<br />
périphériques sont les plus fréquentes (80 %), alors que les lésions postérieures<br />
sont plus graves. L’enquête sérologique permet de confirmer le diagnostic dans<br />
tous les cas évolutifs.<br />
Commentaire et Conclusions : Ce travail nous a permis de : a) mieux connaître les<br />
populations cibles et les résultats fonctionnels de cette infection oculaire peu fréquente,<br />
b) d’identifier certains facteurs pronostiques et enfin c) de proposer un arbre<br />
diagnostique décisionnel devant une suspicion de toxocarose oculaire.<br />
10 66<br />
Manifestations ophtalmologiques de la maladie de Wegener : différences entre<br />
les formes localisées et les formes généralisées de la maladie : étude de 44 cas.<br />
Ophthalmic manifestations of Wegener desease: Differences between localized and<br />
systemic forms of the desease. Review of 44 cases.<br />
DELAIR BRIFFOD E, FAJNKUCHEN F, BLIGNY D, MAHR A, GUILLEVIN L,<br />
CHAINE G (Saint-mandé),<br />
But : Décrire la présentation clinique et le pronostic des manifestations ophtalmologiques<br />
de la maladie de Wegener en séparant les formes localisées et les formes<br />
généralisées de la maladie.<br />
Matériel et Méthodes : Étude rétrospective de 101 cas de maladie de Wegener<br />
entre 1986 et 2000. Les patients atteints de manifestations ophtalmologiques ont été<br />
séparés en 2 groupes en fonction de la présence ou non d’une atteinte rénale (respectivement<br />
forme généralisée et localisée de la maladie). Les aspects cliniques<br />
ophtalmologiques et extra-ophtalmologiques, les traitements utilisés, et le pronostic<br />
visuel ont été évalués dans ces 2 groupes.<br />
Résultats : 44 cas de maladie de Wegener avec atteinte ophtalmologique ont été<br />
analysés. 18 patients (41 %) présentaient la forme localisée de la maladie, et 26<br />
(59 %), la forme généralisée. L’épisclérite était la manifestation ophtalmologique la<br />
plus fréquemment retrouvée (40,9 %), suivie de la conjonctivite (22,7 %), la sclérite<br />
(18,2 %), le syndrome sec (18,2 %), l’inflammation orbitaire (13,7 %), la kératite ulcérante<br />
périphérique (13,7 %), l’uvéite antérieure (11,3 %), et d’autres moins fréquentes.<br />
Une différence significative était retrouvée entre ces 2 groupes uniquement pour<br />
l’uvéite antérieure, associée dans tous les cas à la forme généralisée de la maladie,<br />
et pour l’inflammation orbitaire, associée à la forme localisée. Parmi 10 patients<br />
(22,7 %) ayant développé une baisse d’acuité visuelle, 7 présentaient une forme<br />
localisée. La plupart de ces atteintes ophtalmologiques sévères ont été traitées par<br />
bolus de cyclophosphamide et de prednisone.<br />
Commentaire et Conclusion : Il existe des variations dans la présentation clinique<br />
de l’atteinte ophtalmologique en fonction du caractère localisé ou généralisé de la<br />
maladie de Wegener. Une baisse d’acuité visuelle est plus fréquente en cas de forme<br />
localisée, mais le pronostic visuel final est identique dans les 2 formes.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
UVÉITES (1)<br />
10 67<br />
Lymphome oculaire de type MALT simulant une sclérite ou une uvéite postérieure.<br />
B-cell lymphoma of MALT type masquerading as scleritis or posterior uveitis.<br />
GAUCHER D*, BODAGHI B, CHARLOTTE F, CASSOUX N (Paris), SCHNEIDER C<br />
(Montpellier), LEMAITRE C (Paris), RAO N (Los Angeles, Usa), LE HOANG P (Paris)<br />
But : Prise en charge diagnostique et thérapeutique des pseudo-uvéites associées<br />
au lymphome de type MALT.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons les cas de trois patients adressés pour une<br />
baisse visuelle profonde évoluant sur un mode aigu ou chronique. Tous présentaient<br />
une uvéite ou une sclérite corticorésistante. Il s’agissait respectivement d’une uvéite<br />
postérieure associée à une infiltration rétinochoroïdienne, d’une sclérite antérieure<br />
associée à un syndrome d’effusion uvéale et d’une panuvéite bilatérale associée à des<br />
décollements séreux rétiniens. Deux des patients avaient un antécédent de pathologie<br />
maligne systémique. Les trois patients ont bénéficié d’un bilan étiologique complet. La<br />
recherche des étiologies infectieuses, auto-immunes ou malignes était infructueuse<br />
mais l’imagerie orbitaire mettait en évidence un épaississement scléral postérieur.<br />
Résultats : Le diagnostic de lymphome oculaire de type MALT a été posé dans les trois<br />
cas après biopsie des lésions sclérales. Les analyses immunohistochimiques ont mis en<br />
évidence un infiltrat lymphocytaire scléral CD20 + et CD5-. Les trois patients ont bénéficié<br />
de cures de chimiothérapie associées à une radiothérapie dans un cas. Les lésions<br />
ont été stabilisées dans le premier cas alors qu’une amélioration de l’acuité visuelle a<br />
été observée dans le second et une guérison totale a été obtenue dans le troisième.<br />
Commentaire et Conclusions : Les manifestations cliniques de cette atteinte oculaire<br />
semblent être très variées, mimant différents types d’uvéite postérieure. Dans ces<br />
trois cas nous n’avons pas mis en évidence d’atteinte muqueuse digestive associée.<br />
Le diagnostic repose entièrement sur l’examen anatomopathologique. La récupération<br />
visuelle rapide dans deux cas démontre l’importance d’un diagnostic précoce et d’un<br />
traitement spécifique. Toute uvéite postérieure totale, chronique et corticorésistante<br />
impose une imagerie spécialisée suivie le cas échéant, d’une biopsie orbitaire étagée.<br />
10 68<br />
Rétinoblastome avec atteinte vitréenne prédominante : le rétinoblastome<br />
infiltrant diffus.<br />
Retinoblastoma with predominant vitreous seeding: diffuse infiltrating retinoblastoma.<br />
LEVY GABRIEL C*, LUMBROSO L, DOZ F, BRISSE H, SASTRE X, DESJARDINS L<br />
(Paris)<br />
But : Le rétinoblastome est la tumeur intra-oculaire la plus fréquente de l’enfant. La<br />
présentation clinique est classique dans la majorité des cas, avec au fond de l’œil<br />
une ou plusieurs masses tumorales rétiniennes souvent calcifiées d’aspect typique<br />
en échographie, au scanner ou en IRM. Le rétinoblastome infiltrant diffus est une<br />
forme de présentation beaucoup plus rare et trompeuse, simulant une uvéite ou un<br />
décollement de rétine parfois associé à une rubéose irienne, sans masse tumorale<br />
individualisable. Les examens complémentaires : échographie, scanner et IRM<br />
apportent alors peu d’éléments, les calcifications classiques font défaut.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons 4 observations cliniques de rétinoblastome<br />
infiltrant diffus traités à l’Institut Curie. Il s’agissait de 4 enfants âgés de 2 ans, 3 ans<br />
(2cas) et 8 ans qui présentaient pour 3 d’entre eux un décollement de rétine (associé<br />
à une uvéite dans 2 cas), une uvéite totale pour le quatrième. Dans tous les cas, le<br />
scanner et l’IRM étaient négatifs, sans calcification caractéristique. Dans 3 cas sur<br />
4, l’énucléation a été réalisée pour œil non-voyant et douloureux en rapport avec un<br />
glaucome néovasculaire ; le rétinoblastome n’a été affirmé qu’après analyse de la<br />
pièce, mettant en évidence un rétinoblastome peu différencié ou indifférencié.<br />
Commentaire et Conclusions : Une uvéite ou un décollement de rétine inexpliqué<br />
chez un enfant doivent faire évoquer le diagnostic de rétinoblastome et adresser le<br />
patient pour un avis en milieu spécialisé onco-ophtalmologique. Un scanner ou une<br />
IRM non évocateur ne permettent pas d’éliminer formellement ce diagnostic.<br />
10 69<br />
Uvéites postérieures et néovaisseaux sous-rétiniens (10 cas).<br />
Posterior uveitis and choroïdal new-vessels (10 cases).<br />
CHEKIR N*, MELLOULI T, KACEM S, GHORBEL M, EL MABROUK S, MAHJOUB H,<br />
KRIFA F, BEN HADJ HAMIDA F (Sousse, Tunisie)<br />
But : Les foyers chorio-rétiniens uniques ou multiples dans le cadre des uvéites postérieures<br />
peuvent se compliquer de néovaissaux sous-rétiniens (NVSR). Ceux-ci sont<br />
considérés comme une cause importante de perte de la vision centrale au décours<br />
de ces affections.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S161
1S162<br />
Matériel et Méthode : Les auteurs ont revu dix cas d’uvéite postérieure compliquées<br />
de NVSR. Ils ont étudié leur profil clinique, les aspects angiographiques des<br />
foyers néovascularisés ainsi que leur profil évolutif et les résultats des cas traités.<br />
Résultats : Les NVSR étaient de découverte fortuite à l’angiographie dans 3 cas et<br />
à l’occasion d’une baisse de la vision dans 7 cas. Il s’agissait de NVSR développés<br />
sur un foyer de choroïdite serpigineuse (5 cas), de toxoplasmose (1 cas), de pseudo<br />
histoplasmose (1 cas), de choroïdite hémorragique du sujet jeune (1 cas), d’épithéliopathie<br />
en plaques (1 cas) et de Birdshott-choriorétinopathie (1 cas). Le siège des<br />
NVSR était maculaire sur foyer cicatriciel dans tous les cas et contemporain d’un<br />
foyer inflammatoire dans un cas. Dans les 5 cas traités au Laser, comme dans les<br />
5 cas non traités, les auteurs ont noté une baisse de l’acuité visuelle dans 2 cas sur<br />
5 et une stabilisation dans 3 cas sur 5.<br />
Commentaire et Conclusions : La néovascularisation sous-rétinienne au cours des<br />
uvéites postérieures est souvent constatée lorsque l’inflammation a été chronique, à<br />
rechute avec une altération de la membrane de Bruch et l’épithélium pigmenté. Sa<br />
survenue à la phase aiguë est exceptionnelle. Son diagnostic repose sur l’analyse<br />
attentive de l’angiographie car elle peut être interprétée à tort comme une récidive<br />
du processus inflammatoire. Son traitement par photocoagulation au Laser est efficace<br />
s’il est institué précocement.<br />
10 70<br />
Caractéristiques cliniques des nécroses rétiniennes aiguës liées à HSV-2.<br />
Clinical characteristics of HSV-2 acute retinal necrosis.<br />
TRAN LY THC*, STANESCU D (Belgique), CASPER-VELU L (Belgique),<br />
ROZENBERG F, LIESNARD C (Belgique), CASSOUX N, BODAGHI B, LE HOANG P<br />
(Paris)<br />
But : Étudier les particularités cliniques et le pronostic visuel de 11 cas de nécrose<br />
rétinienne aiguë (ARN) à HSV-2.<br />
Matériel et Méthode : Nous analysons rétrospectivement les dossiers des<br />
11 patients (12 yeux) atteints de ARN à HSV-2. Le génome de HSV-2 a été détecté<br />
par la réaction en chaîne à la polymérase à partir du liquide intraoculaire (humeur<br />
aqueuse +/– vitré). Les données de l’examen initial, l’évolution clinique sous traitement<br />
antiviral, les complications et l’acuité visuelle finale ont été évaluées.<br />
Résultats : L’âge moyen lors de l’atteinte du premier œil était de 36 ans (10 à<br />
57 ans). Tous les patients étaient immunocompétents. Les événements remarquables<br />
dans l’histoire de maladie étaient : l’herpès néonatal (n = 1), l’ARN du premier<br />
œil (n = 3), le traumatisme périoculaire (n = 1) et la corticothérapie systémique avant<br />
l’apparition de ARN. Les cicatrices choriorétiniennes préexistantes ont été retrouvées<br />
dans 3 cas. Deux patients ont présenté un tableau d’uvéite postérieure sans<br />
rétinopathie nécrosante avant l’apparion de ARN. Les patients ont été traités par aciclovir<br />
ou foscarnet par voie intraveineuse +/– injections intravitéennes de ganciclovir<br />
+/– interféron. Le suivi moyen était de 14,5 mois (5 à 22 mois). À l’examen final,<br />
5 yeux (41,7 %) ont présenté une amélioration de deux lignes d’acuité visuelle ou<br />
plus. L’acuité visuelle finale était supérieure ou égale à 1/20 dans 8 yeux (66,7 %) et<br />
moins de 1/20 dans 4 yeux (33,3 %).<br />
Commentaire et Conclusions : Les antécédents d’herpès néonatal, les facteurs<br />
déclenchants tels que la neurochirurgie, le traumatisme périoculaire, la corticothérapie<br />
systémique ainsi que la présence des cicatrices choriorétiniennes préexistantes<br />
retrouvées dans cette étude et dans la littérature suggèrent que l’ARN à HSV-2 est<br />
secondaire à une réactivation d’une infection à HSV-2. HSV-2 peut être responsable<br />
de tableaux cliniques variés allant d’une uvéite sans rétinopathie nécrosante à un<br />
ARN sévère.<br />
10 71<br />
Uvéites granulomateuses associées à des lésions d’épithéliopathie en plaques :<br />
à propos d’un cas.<br />
Granulomatous uveitis with acute posterior multifocal placoid pigment<br />
epitheliopathy: a case report.<br />
DANAN A*, MONNET D, GUENOUN JM, ABAD S, PARC C, BREZIN A (Paris)<br />
But : L’épithéliopathie en plaques initialement décrite par GASS serait associée dans<br />
un tiers des cas à des manifestations systémiques. Une réaction inflammatoire de<br />
chambre antérieure importante serait exceptionnelle.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons le cas d’une patiente de 22 ans qui, trois<br />
semaines après un épisode de gastro-entérite, a développé un érythème noueux,<br />
des polyarthralgies et une uvéite antérieure bilatérale granulomateuse. L’examen du<br />
fond d’œil et l’angiographie objectivaient des lésions typiques d’épithéliopathie en<br />
plaques.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
UVÉITES (1)<br />
Résultats : Les examens complémentaires ont révélé un syndrome inflammatoire,<br />
une anergie tuberculinique, une réaction méningée, des adénopathies hilaires bilatérales,<br />
qui, associés au tableau clinique étaient fortement évocateurs de sarcoïdose<br />
(syndrome de Löfgren). La guérison fut spontanée sans récidive après un suivi de<br />
8 mois.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette observation est l’occasion de rapporter les<br />
cas précédemment décrits dans la littérature d’épithéliopathie en plaques associée<br />
à des maladies systémiques. L’association à une uvéite antérieure granulomateuse<br />
est peu rapportée. Cette observation et les données des cas similaires de la littérature<br />
incitent à rechercher par des tests spécifiques une maladie systémique sousjacente<br />
lors du diagnostic d’épithéliopathie en plaques.<br />
10 72<br />
Épithéliopathies en plaques, choroïdites serpigineuses et multifocales : analyse<br />
étiologique et prise en charge thérapeutique.<br />
Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy, serpiginous and<br />
multifocal choroiditis: etiological and therapeutic management.<br />
TEYSSOT N*, BODAGHI B, CASSOUX N, ULLERN M, FARDEAU C, LE HOANG P<br />
(Paris)<br />
But : Il s’agit d’affections classiquement considérées comme idiopathiques, isolées<br />
ou associées à diverses pathologies systémiques. Une enquête étiologique détaillée<br />
pourrait permettre de proposer une thérapeutique spécifique dans les formes chroniques<br />
et sévères.<br />
Matériel et Méthode : Cette étude a porté sur une période de deux ans<br />
(janvier 2000 à janvier 2002). Les patients adressés pour une choroïdite ou une épithéliopathie<br />
en plaques ont bénéficié d’un examen ophtalmologique complet, d’une<br />
angiographie à la fluorescéine et au vert d’indocyanine. Une recherche étiologique<br />
infectieuse extensive a été réalisée, le cas échéant, afin de mettre en évidence une<br />
atteinte bactérienne, virale ou parasitaire.<br />
Résultats : Quatorze patients ont été inclus, ce qui représente 1 % de l’ensemble<br />
des inflammations intraoculaires prises en charge pour la première fois durant cette<br />
période. L’âge moyen était de 37,4 ans et le sexe-ratio (F/H) de 9/5. Il s’agissait de<br />
6 cas de choroïdite serpigineuse, 4 cas de choroïdite multifocale et 4 cas d’épithéliopathie<br />
en plaques. La notion de contage ou de primo-infection tuberculeuse a été<br />
mise en évidence dans 6 cas (42,8 %). Le diagnostic de toxoplasmose rétinochoroïdienne<br />
a été confirmé après ponction de chambre antérieure dans un cas. Parmi les<br />
serpigineuses, deux patientes ont bénéficié d’un traitement antituberculeux permettant<br />
de contrôler leur affection, dont une était résistante aux immunosuppresseurs.<br />
Une épithéliopathie en plaques a été contrôlée par antibiothérapie.<br />
Commentaire et Conclusions : Un agent infectieux, quel qu’il soit, pourrait être à<br />
l’origine de ce type d’atteinte. Toute inflammation résistant à une corticothérapie<br />
bien conduite ou aux immunosuppresseurs conventionnels doit bénéficier d’un bilan<br />
infectieux avant intensification thérapeutique. Malgré le faible recul de cette série, un<br />
traitement étiologique spécifique nous a cependant permis de contrôler l’évolution<br />
de l’inflammation oculaire dans tous les cas.<br />
10 73<br />
Le syndrome de Vogt Koyanagi Harada. Problèmes diagnostiques et<br />
thérapeutiques.<br />
Vogt Koyanagi Harada syndrom. Diagnostic and therapeutic problems.<br />
MELLOULI T*, FAFANI BEN HADJ H, NARJESS C, GHORBEL M, HACHMI M<br />
(Tunisie), KRIFA F (Sousse, Tunisie)<br />
But : Le syndrome de Vogt Koyanagi Harada est une affection systémique, touchant<br />
les yeux, les oreilles, les téguments et les méninges. Le diagnostic positif du syndrome<br />
de Vogt Koyanagi Harada est basé sur un faisceau d’arguments cliniques et<br />
para cliniques où l’atteinte ophtalmologique occupe une place prépondérante. Le<br />
pronostic a été transformé par l’usage des corticoïdes par voie systémique. Le but<br />
de notre travail est de rapporter les problèmes diagnostiques et thérapeutiques, et<br />
d’évaluer le pronostic visuel dans le syndrome de Vogt Koyanagi Harada.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude a porté sur les 24 yeux des 12 patients présentant<br />
un syndrome de Vogt Koyanagi Harada, qui se répartissent en 10 femmes et<br />
hommes, âgés en moyenne de 32 ans. Le bilan a comporté un examen ophtalmologique<br />
avec une échographie en mode B et une angiographie à la fluorescéine, un<br />
examen O.R.L. avec audiogramme, un examen neurologique avec ponction lombaire,<br />
une analyse du L.C.R. et un examen dermatologique. Nos patients ont été suivi<br />
sur une période allant de 6 mois à 54 mois avec une moyenne de 30 mois.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
Résultats : L’examen initial a montré une panuvéite dans 15 yeux, une uvéite antérieure<br />
dans 3 yeux et une uvéite postérieure dans 4 yeux. Tous les malades ont été<br />
mis sous prednisone à la dose de 1 mg/kg/j. La comparaison de l’acuité visuelle initiale<br />
et finale de chaque œil a montré que celle-ci s’est amélioré dans 14 yeux,<br />
qu’elle est resté stable dans 6 yeux et qu’elle a diminué dans 2 yeux. Le recours aux<br />
immunosuppresseurs a été indiqué chez 4 patients, dont 3 cas de cortico-dépendance<br />
et 1 cas de cortico-résistance.<br />
Commentaire et Conclusions : Le syndrome de Vogt Koyanagi Harada est une<br />
affection systémique relativement rare, dans laquelle l’atteinte oculaire est déterminante<br />
sur le plan diagnostique et surtout sur le plan pronostique. Nous discutons les<br />
différents problèmes rencontrés dans la prise en charge des uvéites dans le cadre<br />
du syndrome de Vogt Koyanagi Harada, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique.<br />
10 74<br />
Prise en charge diagnostique et thérapeutique du syndrome de Vogt-Koyanagi-<br />
Harada.<br />
Diagnostic and therapeutic management of Vogt-Koyanagi-Harada syndrome.<br />
TOUITOU V*, ESCANDE C, BODAGHI B, CASSOUX N, LEMAITRE C, TRAN T,<br />
FARDEAU C, LE HOANG P (Paris)<br />
But : Évaluation de l’incidence et de la présentation clinique des patients atteints<br />
d’uvéoméningite dans le cadre d’un syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH).<br />
Matériel et Méthode : Les dossiers des 7 patients adressés pour une première<br />
consultation entre janvier et décembre 2001 avec une suspicion de VKH ont été<br />
rétrospectivement analysés. Un bilan incluant principalement une angiographie rétinienne,<br />
une imagerie cérébrale et une ponction lombaire a permis d’évaluer l’atteinte<br />
oculaire et méningée. Les patients ont bénéficié d’une corticothérapie en bolus avec<br />
relais per os plus ou moins prolongé en cas d’atteinte inflammatoire évolutive. L’utilisation<br />
des immunosuppresseurs a été réservée à l’échec du traitement conventionnel.<br />
Résultats : Sept patients ont été inclus dans cette étude (0,9 %). L’âge moyen lors<br />
du diagnostic était de 34,2 ans (8 à 50 ans) et le sexe-ratio (F/H) était de 6/1. Les<br />
signes fonctionnels neurologiques et cutanés étaient présents respectivement dans<br />
4 cas (57,1 %) et 2 cas (28,6 %). Un décollement séreux rétinien bilatéral responsable<br />
d’une baisse visuelle majeure a été noté dans 6 cas (85,7 %). La ponction lombaire<br />
a mis en évidence une méningite dans 4 cas (57,1 %). La corticothérapie<br />
intensive a permis de contrôler la poussée inflammatoire initiale mais l’indication des<br />
immunosuppresseurs conventionnels et de l’IFN-alpha a été posée devant un seuil<br />
élevé de corticodépendance dans 2 cas. L’inflammation a pu être finalement contrôlée<br />
dans tous les cas et une récupération visuelle a été obtenue dans 6 cas (85,7 %)<br />
avec un suivi minimal de 12 mois.<br />
Commentaire et Conclusions : Malgré sa faible incidence, le syndrome de VKH<br />
doit être systématiquement recherché devant une uvéite postérieure bilatérale avec<br />
décollement séreux rétinien mais également devant une uvéite antérieure granulomateuse.<br />
L’utilisation des immunomodulateurs semble une alternative séduisante en<br />
cas de corticodépendance mais des études complémentaires sont nécessaires<br />
avant toute conclusion.<br />
10 75<br />
Syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada : analyse de 17 cas consécutifs.<br />
Analysis of 17 cases with Vogt-Koyanagi-Harada disease.<br />
GUENOUN JM*, DHOTE R, PARC C, DANAN A, MONNET D, BREZIN A (Paris)<br />
But : Le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada est connu pour toucher principalement<br />
les populations pigmentées et notamment japonaises. Nous avons étudié 17 cas<br />
consécutifs de syndrome de VKH entre 1997 et 2002, touchant une population caucasienne<br />
et africaine, afin d’en déterminer le profil clinique.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective descriptive<br />
de 17 nouveaux cas consécutifs de syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada.<br />
Résultats : Le ratio des sexes était de 11 femmes (65 %) pour 6 hommes (35 %).<br />
L’âge moyen était de 39 +/– 9,4 ans. La série comportait 8 patients d’Afrique du nord<br />
(47 %), 7 caucasiens (41 %) et 2 d’Afrique noire (12 %). Onze patients ont été vus<br />
initialement à la phase aiguë, tandis que 6 patients ont été vus secondairement. La<br />
panuvéite avec décollement séreux rétiniens était la présentation la plus fréquente<br />
(88 %). Tous les patients présentaient une atteinte bilatérale. Les signes extraoculaires<br />
étaient retrouvés chez 86 % des patients avec le plus fréquemment une méningite<br />
(64 %). Un vitilego était présent chez 1 patient (6 %), une alopécie fut retrouvée<br />
chez 1 patient (6 %). Il existait une uvéite antérieure chez 15 patients (88 %), de type<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
UVÉITES (1)<br />
granulomateux dans 52 % des cas. La complication la plus fréquente était la cataracte<br />
(40 %). Sept patients (46 %) ont présenté des récidives, dont 6 (86 %) uniquement<br />
sous forme d’uvéites antérieures. L’acuité visuelle moyenne initiale était de<br />
0,29 +/– 0,35 et l’acuité visuelle finale était de 0,75 +/– 0,34. Deux patients (12 %),<br />
pris en charge tardivement n’ont pas présenté d’amélioration de leur acuité visuelle.<br />
90 % des patients vus à la phase aiguë ont été traités pas corticothérapie générale.<br />
Parmi la série complète un traitement immunosuppresseur a été nécessaire dans<br />
56 % des cas.<br />
Commentaire et Conclusions : Le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, dans une<br />
population caucasienne et africaine, a une présentation ophtalmologique et<br />
extraophtalmologique proche de celle de la population japonaise. En revanche les<br />
signes cutanés sont beaucoup plus rares et leur absence ne doit pas exclure le diagnostic.<br />
Le pronostic visuel est globalement favorable. Un traitement par corticoïdes<br />
peut être suffisant mais dans la moitié des cas un recours aux immunosuppresseurs<br />
peut s’avérer nécessaire.<br />
10 76<br />
Cataracte et uvéites : à propos de 48 cas.<br />
Cataract associated with uveitis: about 48 cases.<br />
D’KHISSY M*, AIT MOULAY L, RACHID R, LAOUISSI N, ZAGHLOUL K, AMRAOUI A<br />
(Casablanca, Maroc)<br />
But : La cataracte reste une complication fréquente des uvéites chroniques et/ou<br />
récidivantes. Son traitement chirurgical pose plusieurs problèmes. Le but de notre<br />
travail est d’étudier les particularités et les difficultés de cette chirurgie.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 48 patients<br />
opérés pour cataracte sur uvéite. La moyenne d’age est de 38 ans. La durée<br />
moyenne d’évolution de l’uvéite est de 5 ans. Les étiologies sont dominées par la<br />
maladie de Behcet retrouvées dans 55 % des cas. Tous les patients ont bénéficié<br />
d’une phacoexérèse simple ou associée à une implantation selon les possibilités chirurgicales,<br />
associée à une corticothérapie pré et post-opératoire.<br />
Résultats : Les suites ont été marquées par une réaction inflammatoire chez 20 %<br />
des patients avec amélioration de l’acuité visuelle chez les patients implantés après<br />
un recul moyen de 2 ans.<br />
Commentaire et Conclusions : La chirurgie de la cataracte compliquant une uvéite<br />
reste difficile et doit répondre à trois objectifs : choix de la date d’intervention,<br />
nécessité on non d’instaurer un traitement médical pendant la période périopératoire<br />
et enfin le choix de la technique opératoire la plus adéquate.<br />
10 77<br />
Uvéite fibrineuse post chirurgicale pseudophakogénique.<br />
Toxic lens syndrom.<br />
RANNEN R*, LEILA L, FEDRA K, KAIS K, GABSI S (Tunis, Tunisie)<br />
But : L’uvéite fibrineuse après chirurgie de la cataracte avec implantation oculaire<br />
est une complication inflammatoire redoutable et imprévisible.<br />
Matériel et Méthode : Les auteurs rapportent le cas d’un homme âgé de 56 ans<br />
opéré d’une cataracte sénile de l’œil gauche par phakofragmentation manuelle avec<br />
implantation dans la chambre postérieure sans incident per opératoire.<br />
Résultats : Les suites immédiates étaient marquées par une réaction inflammatoire<br />
intense non jugulée par une antibiothérapie et une corticothérapie par voie locale et<br />
générale. Reprise du patient au cinquième jour pour explantation. Culture bactériologique<br />
négative.<br />
Commentaire et Conclusions : L’uvéite fibrineuse après implantation et l’expression<br />
type de la biocompatibilité imparfaite. Le diagnostic est difficile et jamais sûr.<br />
L’évolution après explantation étant le meilleur argument diagnostic. Le pronostic<br />
dépend de la rapidité d’installation du traitement.<br />
10 78<br />
Effusion uvéale non traumatique.<br />
Non traumatic choroidal effusion.<br />
LAMIREL C*, JALLET G, BRIEND B, EBRAN JM, COCHEREAU I (Angers)<br />
But : L’effusion uvéale non traumatique, rare et mal connue, est déroutante par sa<br />
présentation trompeuse avec aplatissement de la chambre antérieure. Souvent due<br />
à un défaut d’évacuation du liquide suprachoroïdien par la voie uvéosclérale, ses<br />
étiologies sont variées, en particulier, inflammatoires.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S163
1S164<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de cinq cas d’effusion uvéale non traumatique.<br />
Les patients ont bénéficié d’un bilan inflammatoire, d’une échographie B et<br />
dans quatre cas d’une imagerie orbitaire et encéphalique.<br />
Résultats : Cinq patients (4 hommes, 1 femme) d’âge moyen 69 ans [48-91] ont<br />
présenté un décollement choroïdien non traumatique. Les signes les plus fréquents<br />
étaient : une chambre antérieure étroite (4/5), un œil rouge (4/5), 2 myopisations. Le<br />
diagnostic a été fait par le fond d’œil et l’échographie. Les étiologies étaient deux<br />
sclérites, une pseudo-tumeur inflammatoire, une allergie médicamenteuse supposée,<br />
inconnue dans un cas. Tous les patients ont été traités médicalement par atropine<br />
et corticoïdes locaux. Trois ont eu une corticothérapie générale. Le délai de<br />
résorption était variable (3 jours à 6 mois). Le recul moyen après le diagnostic était<br />
de 16,2 mois [1-28].<br />
Commentaire et Conclusions : Il faut savoir penser à l’effusion uvéale devant un<br />
aplatissement de chambre antérieure avec pression intraoculaire peu élevée et dilater<br />
le patient et/ou faire une échographie pour établir le diagnostic. Le traitement<br />
local comprend atropine et souvent corticoïdes locaux. L’indication de la corticothérapie<br />
générale dépend de l’étiologie.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
UVÉITES (1)<br />
CONGRÈS 2004<br />
L’envoi des abrégés des communications se fera<br />
exclusivement sur le site WEB de la SFO : www.sfo.asso.fr<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
20 79<br />
Dosage de l’interleukine 10 dans l’humeur aqueuse et le vitré dans le diagnostic<br />
de lymphome oculaire et cérébral primitif.<br />
Evaluation of interleukine 10 in the aqueous humor and the vitreous for the diagnosis<br />
of primary ocular and cerebral lymphoma.<br />
CASSOUX N*, MERLE H, BODAGHI B, GIRON A, LE HOANG P (Paris)<br />
But : Évaluer l’apport du dosage de l’interleukine 10 (IL-10) dans l’humeur aqueuse<br />
et le vitré dans le diagnostic de lymphome oculaire et cérébral primitif.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective allant de 1997 à 2000 incluant<br />
44 patients atteints de lymphome oculaire et cérébral primitif et 52 patients atteints<br />
d’uvéite avec un diagnostic de certitude. Ces patients ont bénéficié d’une vitrectomie<br />
diagnostique ou thérapeutique au cours de laquelle un dosage de l’IL-10 a été<br />
réalisée dans l’humeur aqueuse et le vitré.<br />
Résultats : Le taux moyen d’IL-10 dans l’humeur aqueuse était de 571,50 pg/ml<br />
pour le groupe lymphome et de 28,79 pg/ml pour le groupe uvéite (p < 0,005). Dans<br />
le vitré le taux moyen d’IL-10 était de 2135,86 pg/ml pour le groupe lymphome et de<br />
31,71 pg/ml pour le groupe uvéite (p < 0,005). Dans l’humeur aqueuse pour un taux<br />
de 100 pg/ml, la sensibilité est de 80,55 % et la spécificité de 94 %, kappa = 5,20.<br />
Dans le vitré, la sensibilité est de 89,47 % et la spécificité de 91,50 %, kappa = 8,74.<br />
Les faux positifs sont essentiellement liés à 3 cas de nécrose rétinienne virale et un<br />
cas de toxoplasmose avec hyalite majeure. Les faux négatifs sont des patients<br />
atteints de lymphome cérébral associé à une hyalite minime.<br />
Commentaire et Conclusions : Le dosage de l’IL-10 dans l’humeur aqueuse et<br />
dans le vitré est un test spécifique avec une meilleure sensibilité dans le vitré. Ce<br />
test appliqué à l’humeur aqueuse, s’il est supérieur à 100 pg/m, permet de suspecter<br />
avec une faible marge d’erreur le diagnostic de lymphome et de guider la biopsie du<br />
vitré.<br />
20 80<br />
Vitrectomie diagnostique dans les uvéites postérieures sévères : résultats de<br />
l’étude rétrospective 2000-2002.<br />
Diagnostic vitrectomy in severe posterior uveitis: results of the retrospective study.<br />
LEMAITRE C*, CASSOUX N, BODAGHI B, FARDEAU C, LE HOANG P (Paris)<br />
But : Afin de préciser les caractéristiques et l’évolution des patients vitrectomisés à<br />
la Pitié-Salpétrière entre janvier 2000 et décembre 2001, une étude rétrospective a<br />
repris les dossiers des 47 patients ayant bénéficié d’une vitrectomie à visée diagnostique<br />
pour uvéite postérieure sévère pendant cette période.<br />
Matériel et Méthode : Le sex ratio était équilibré (49 % de femmes, 51 % d’hommes)<br />
avec une moyenne d’âge de 52 ans. La vitrectomie est revenue positive chez<br />
24 patients (51 %) et chez 35 patients (74 %), un diagnostic de certitude a pu être<br />
établi. La prévalence des lymphomes malins non hodgkiniens (LMNH) reste élevée<br />
(23 %) avec une majorité de femmes (72 %). Parmi les 23 patients présentant une<br />
infection oculaire (48 %), on note, avec une forte prédominance masculine (80 %),<br />
l’explosion des endophtalmies mycotiques à Candida du toxicomane, le plus souvent<br />
par autoinjection du traitement oral substitutif par Subutex. Celles-ci ont été<br />
répertoriées dans l’étude multidisciplinaire Canditox.<br />
Résultats : Les résultats détaillés seront comparés à ceux de l’étude 1989-1999 et<br />
de la littérature et discutés.<br />
Commentaire et Conclusions : Il apparaît que les éléments de contexte et les traitements<br />
antérieurement appliqués restent d’une importance cruciale pour l’orientation<br />
diagnostique et la rentabilité du prélèvement vitréen dans les uvéites<br />
postérieures sévères.<br />
20 81<br />
Identification bactérienne dans les endophtalmies par PCR universelle.<br />
Bacterial identification using universal PCR in endophthalmitis.<br />
CHIQUET C*, CUDRAZ I, BENITO Y, LINA G, VANDENESCH F, BURILLON C,<br />
DENIS P (Lyon)<br />
But : L’objectif de cette étude prospective est l’identification bactérienne par cultures<br />
microbiologiques et analyse du génome bactérien par PCR universelle dans les<br />
endophtalmies.<br />
Matériel et Méthode : Cette étude inclue actuellement dix patients, âgés de 22 à<br />
91 ans (moyenne 67,5 ans), présentant une endophtalmie dans les suites d’une chirurgie<br />
de la cataracte (7 patients), chirurgie filtrante (2 patients). Un patient présentait<br />
une endophtalmie endogène. Chaque patient a bénéficié en urgence d’une ponction<br />
de chambre antérieure dont 100 microL étaient destinés à la culture microbiologique<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
PATHOLOGIE DU VITRÉ (1)<br />
et 150 microL destinés à la PCR. Dans trois cas, une vitrectomie permettait l’analyse<br />
de vitré selon les mêmes méthodes.<br />
Résultats : Le diagnostic microbiologique a été réalisé dans 50 % à l’aide des<br />
cultures bactériologiques (2 Staphylococcus aureus, 1 Enterococcus faecalis, 1 Staphylococcus<br />
epidermidis, 1 Streptococcus pneumoniae) et dans 70 % à l’aide de la<br />
PCR (1 Moraxella, 1 E. faecalis, 2 S. epidermidis, 1 S. sanguis, 1 S. deficiens, 1 S.<br />
pneumonaie). Dans 2 cas, la PCR était négative alors que les cultures étaient positives<br />
(2 S. aureus). Dans 3 cas, la PCR permettait d’identifier le germe non retrouvé<br />
à l’aide des cultures (1 Moraxella, 1 S. deficiens, 1 S. epidermidis). Pour les prélèvements<br />
vitréens, les PCR et les cultures étaient positives dans 2 cas (S. sanguis,<br />
S. epidermidis), la PCR uniquement positive dans 1 cas (S. epidermidis). En couplant<br />
PCR et cultures, 90 % des germes en cause étaient identifiés.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces résultats préliminaires montrent que l’utilisation<br />
de la culture bactériologique et de la PCRu permet une identification efficace et<br />
rapide des germes en cause et un ciblage de l’antibiothérapie intravitréenne et générale.<br />
20 82<br />
Comparaison de l’échographie à 10, 20 MHz et de la tomographie en cohérence<br />
optique dans l’évaluation des trous maculaires.<br />
Evaluation of the macular hole with 10 MHz, 20 MHz ultrasonography and optical<br />
coherence tomography.<br />
SI AHMED K* (Rouen), BERGES O (Paris), BRASSEUR G (Rouen)<br />
But : Évaluer et comparer les données fournies par l’échographie à 10 MHz, 20 MHz<br />
et de la tomographie en cohérence optique (OCT) pour l’étude des trous maculaires.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons inclus dans notre étude entre septembre 2001<br />
à Décembre 2002, 60 cas de trous maculaires à différents stades. Tous les patients<br />
ont bénéficié de façon systématique d’un examen échographique à 1O Mhz, 20 MHz<br />
avec un appareil quantel médical cinescan et d’un examen OCT.<br />
Résultats : Des travaux ont montré qu’il était possible d’utiliser des sondes de fréquences<br />
supérieures à 10 MHz pour l’étude du pôle postérieur, au prix cependant<br />
d’une cellule d’exploration plus réduite que celle habituellement utilisée avec la<br />
sonde de 10 MHz et d’une réflectivité plus faible des interfaces rencontrées. On est<br />
en effet très rapidement limité par le bruit si on augmente le gain.<br />
Commentaire et Conclusions : L’échographie à 10 MHz est très utile pour l’appréciation<br />
du corps vitré. L’écho à 20 MHz doit être systématique car elle apporte des<br />
renseignements plus utiles par une meilleure analyse de l’interface vitréo-maculaire.<br />
La tomographie en cohérence optique reste encore cependant supérieure pour<br />
l’étude morphologique fine sauf s’il existe des troubles des milieux.<br />
20 83<br />
Échographie de 20 MHz dans les pathologies vitréo-rétiniennes.<br />
Use of 20 MHz ultrasound imaging in case of vitreo-retinal diseases.<br />
PUECH M* (Paris)<br />
But : Le but de cette étude est de présenter les avantages de l’échographie de haute<br />
fréquence dans l’exploration des pathologies vitréo-rétiniennes.<br />
Matériel et Méthode : L’exploration vitréo-rétinienne est habituellement réalisée<br />
avec des sondes de 10 MHz. Nous avons utilisé une sonde prototype de 20 MHz<br />
focalisée à 25 mm de façon à atteindre le pôle postérieur. Une immersion plus ou<br />
moins importante est nécessaire afin de positionner la zone focale de la sonde sur<br />
la région d’intérêt. Cette immersion variable est facilement réalisée à l’aide de doigtiers<br />
plus ou moins remplis de sérum. En deux ans 980 patients ont été explorés<br />
avec la sonde de 10 MHz et 20 MHz pour des pathologies vitréo-rétiniennes.<br />
Résultats : Toutes les pathologies vitréo-rétiniennes ont pu être explorées par les<br />
deux types de sondes avec une majoration de la résolution des images lorsque l’on<br />
utilise la sonde de 20 MHz. Les rapports vitréo-rétiniens sont mieux analysés avec<br />
la sonde de 20 MHz qui permet d’observer la réaction rétinienne de façon plus précise.<br />
Commentaire et Conclusions : Les mécanismes de traction par bride vitréenne<br />
peuvent être facilement visualisés par exemple dans les cas de déchirures de rétine,<br />
décollements de rétine, de membranes épimaculaires, de trous maculaires, de rétinopathie<br />
diabétique… L’application de l’échographie de haute fréquence au segment<br />
postérieur représente un important gain de résolution pour l’exploration des<br />
pathologies rétinovitréennes.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S165
1S166<br />
20 84<br />
Apport de l’OCT pré-opératoire pour l’estimation du pronostic visuel des<br />
décollements de rétine à macula décollée.<br />
Preoperative OCT in prediction of visual outcome after macula-off retinal<br />
detachments.<br />
COLLET A*, MURAINE M, SIAHMED K, CABOT A, QUINTYN JC, RETOUT A,<br />
BRASSEUR G (Rouen)<br />
But : La récupération visuelle après chirurgie des décollements de rétine à macula<br />
soulevée, principalement liée à l’intensité de la souffrance maculaire induite par le<br />
décollement, est relativement peu prévisible. Nous avons cherché à analyser au<br />
moyen de l’Optical Coherence Tomography (OCT) les modifications pathologiques<br />
de la rétine maculaire en pré et post-opératoire, dans le but de mettre en évidence<br />
les aspects OCT influençant l’acuité visuelle post-opératoire.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective sur 20 malades (20 yeux) opérés de<br />
décollement de rétine rhegmatogène à macula décollée avec succès anatomique.<br />
Des coupes OCT passant par le centre de la fovéa en pré-opératoire, et à<br />
1 mois, 3 mois et 6 mois post-opératoire ont été réalisées. Nous avons étudié<br />
sur les coupes OCT l’aspect rétinien, la hauteur du décollement de rétine au<br />
centre de la fovéa, l’épaisseur rétinienne temporale et maximale en pré-opératoire<br />
ainsi que l’épaisseur rétinienne fovéolaire et l’épaisseur rétinienne temporale<br />
en post-opératoire. La meilleure acuité visuelle corrigée a été évaluée de<br />
façon concomitante.<br />
Résultats : Il n’a pas été mis en évidence de relation significative entre l’aspect rétinien<br />
(classé en 3 catégories), l’épaisseur rétinienne temporale et maximale pré-opératoires<br />
et l’acuité visuelle post-opératoire. En revanche, la hauteur du décollement<br />
de rétine au centre de la fovéa est inversement corrélée, de façon significative, avec<br />
l’acuité visuelle post-opératoire.<br />
Commentaire et Conclusions : La mesure par OCT de la hauteur du décollement<br />
rétinien au centre de la fovéa en pré-opératoire est une donnée supplémentaire pour<br />
l’estimation du pronostic visuel des décollements de rétine réappliqués. L’OCT semble<br />
être un outil intéressant pour la compréhension des mécanismes à l’origine de la<br />
souffrance maculaire dans les décollements de rétine.<br />
20 85<br />
Décollement périfovéolaire du vitré normal et pathologique en OCT.<br />
OCT of normal and pathological perifoveolar vitreous detachment.<br />
HAOUCHINE B*, ERGINAY A, MASSIN P, PAQUES M, TADAYONI R, GAUDRIC A<br />
(Paris)<br />
But : Récemment l’OCT a montré que le décollement postérieur du vitré (DPV) commençait<br />
autour de la macula chez le sujet normal, confirmant ainsi l’existence d’une<br />
adhérence plus forte de la hyaloïde à la fovéola. Ce DPV périfovéolaire est impliqué<br />
dans de nombreuses situations pathologiques tel que les menaces de trou maculaire,<br />
le syndrome de traction vitréo-maculaire, l’œdème maculaire tractionnel du diabétique<br />
ou du syndrome d’Irvine Gass. Le but de cette est de comparer l’aspect de<br />
la hyaloïde du sujet normal et dans ces différentes pathologies.<br />
Matériel et Méthode : 7 500 patients ont été examinés en OCT1 depuis<br />
octobre 1996 et environ 600 patients en OCT3 depuis juin 2002. Parmi ces patients,<br />
1 172 étaient diabétiques, 1 023 présentaient un trou maculaire, 1 327 une membrane<br />
épimaculaire et 36 un syndrome de traction vitréo-maculaire. L’examen comportait<br />
des coupes maculaires linéaires de 3 à 6 mm centrées sur la macula et des<br />
coupes extra-maculaires nasales et temporales en cas de traction vitréomaculaire.<br />
Résultats : L’aspect de décollement périfovéolaire de la hyaloïde avec une attache<br />
uniquement maculaire est commun au sujet normal ainsi qu’aux menaces de trou<br />
maculaire et aux œdèmes non tractionnels, par contre il existe profil particulier de la<br />
jonction vitréomaculaire dans le syndrome de traction vitréomaculaire et les œdèmes<br />
tractionnels. Dans ces cas il existe aussi parfois des tractions extra-maculaires qui<br />
peuvent être multiples. Le DPV périfovéolaire peut exceptionnellement se produire<br />
de façon “ rhegmatogène “, la hyaloïde périmaculaire se décollant en laissant en<br />
place la hyaloïde prémaculaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Le décollement périfovéolaire du vitré associant<br />
une attache maculaire avec persistance d’une attache papillaire est un aspect<br />
retrouvé aussi bien chez le sujet normal que chez le sujet présentant une menace de<br />
trou maculaire ou un œdème non tractionnel. Le syndrome de traction vitréomaculaire<br />
et l’œdème maculaire tractionnel présentent un profil spécifique.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
PATHOLOGIE DU VITRÉ (1)<br />
20 86<br />
Intérêt de la microscopie confocale in vitro dans l’étude des membranes<br />
épirétiniennes.<br />
Interest of confocal microscopy in the analysis of epiretinal membranes.<br />
DUBREUIL F* (Paris), RODRIGUES-GRILLON S (Villeneuve-St-Georges), LOZATO P,<br />
ULLERN M, BAUDOUIN C (Paris)<br />
But : Déterminer l’aspect en microscopie confocale des prélèvements effectués au<br />
cours de la chirurgie des membranes épirétiniennes et des trous maculaires.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective incluant 49 patients opérés de membrane<br />
épirétinienne (40 patients) ou de trou maculaire idiopathique (9 patients). Le<br />
vert d’infracyanine a été utilisé dans 42 cas. Toutes les pièces opératoires, membranes<br />
épimaculaires et membranes limitantes internes, ont pu être analysées en<br />
microscopie confocale après immunomarquage par les anticorps anti-Glial Fibrillary<br />
Acidic Protein (GFAP) et anti-vimentine, marquant les cellules gliales.<br />
Résultats : L’analyse des prélèvements en microscopie confocale a permis de distinguer<br />
trois tissus différents : 17 membranes épirétiniennes, épaisses, pluricellulaires,<br />
26 membranes limitantes internes, fines, plissées, paucicellulaires, et 6 tissus<br />
mixtes. Des cellules marquées par les anticorps anti-GFAP ont été mise en évidence<br />
aussi bien dans les membranes épirétiniennes que dans les limitantes internes.<br />
Commentaire et Conclusions : La microscopie confocale permet une analyse<br />
rapide, reproductible, tridimensionnelle des membranes épirétiniennes. Son association<br />
à un immunomarquage permet d’identifier les cellules impliquées dans la genèse<br />
des membranes. Les cellules de Müller, adhérentes à la membrane limitante interne,<br />
pourraient participer au développement des membranes épirétiniennes en initiant la<br />
gliose.<br />
20 87<br />
Particularités du vitré dans la maladie de Stickler.<br />
Caracteristics of vitreous gel in Stickler Disease.<br />
VALLAT M* (Limoges)<br />
But : Le vitré de la maladie de Stickler présente une spécificité de constitution permettant<br />
d’individualiser cette affection parmi les autres maladies dégénératives<br />
rétino-vitréennes associées à la myopie. Cette étude vise à porter, rapidement et<br />
précisément, un diagnostic clinique, lourd de conséquences à long terme.<br />
Matériel et Méthode : Trente patients, appartenant à 11 familles, ont été suivis<br />
régulièrement de 1974 à 2002 et étudiés rétrospectivement depuis la date du premier<br />
examen. L’âge au moment du diagnostic, les antécédents familiaux, la topographie<br />
initiale des lésions, les traitements mis en œuvre, l’évolution, l’acuité visuelle finale<br />
ont été notés.<br />
Résultats : L’évaluation des résultats montre que les signes cliniques peuvent être<br />
classés en quatre phases concomitantes de la croissance : présence d’altérations<br />
décelables à la naissance, constitution de lésions de la rétine et du vitré dont l’aspect<br />
du vitré « fenêtré » est pathognomonique, phase de décollement partiel du vitré et<br />
risque de décollement de la rétine, phase de stabilisation rétino-vitréenne et constitution<br />
d’une cataracte.<br />
Commentaire et Conclusions : Les particularités étiologiques, le retard au diagnostic<br />
et la gravité du décollement déclaré sont responsables de la perte définitive<br />
de l’acuité visuelle chez des sujets jeunes. Cet état contraste avec le bon pronostic<br />
à long terme des patients qui ont pu passer le cap du décollement postérieur du<br />
vitré. La maladie de Stickler est une affection pluridisciplinaire héréditaire dont le diagnostic<br />
revient le plus souvent à l’ophtalmologiste. Le pronostic pourrait être amélioré<br />
par une prise en charge précoce de l’enfant et de la fratrie, associée à une aide<br />
à la famille dans la gestion des soins généraux et du conseil génétique.<br />
20 88<br />
Dégénérescence vitréo-rétinienne de Wagner : clinique et génétique.<br />
Wagner vitreo-retinal degeneration.<br />
ZECH JC*, MORLE L, LEYNAUD JL, GODET J, TREPSAT C, PLANCHU H (Lyon)<br />
But : Décrire l’hérédo-dégénérescence vitréo-rétinienne de Wagner sur le plan clinique<br />
et génétique à partir d’une large famille française.<br />
Matériel et Méthode : Les patients décrits dans cette série appartiennent tous à<br />
une seule et grande famille (37 membres).<br />
Résultats : Sur les 32 membres examinés, 20 (62 %) présentent la maladie de<br />
Wagner avec une dégénérescence vitréorétinienne bilatérale sans anomalie extraoculaire.<br />
Chez les patients jeunes, l’acuité visuelle est le plus souvent normale après<br />
correction d’une myopie moyenne. Une cataracte présénile évolue à partir de 30 ans<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
et nécessite souvent son ablation. L’anomalie primaire est représentée par l’anomalie<br />
vitréenne. Quelques bandes vitréennes vasculaires représentent souvent la seule<br />
caractéristique optique de la cavité vitréenne. La condensation vitréenne pré-rétinienne<br />
périphérique circonférentielle signe aussi la maladie. Elle présente souvent<br />
des adhérences avec la rétine. Plus rarement, sont parfois rencontrés un décollement<br />
de la rétine, des anomalies pigmentaires rétiniennes, une atrophie progressive<br />
de l’épithélium pigmentaire simulant une choroïdienne, une dégénérescence pallissadique.<br />
L’analyse génétique révèle une liaison significative (lod score > 5,0) entre la<br />
maladie et 10 marqueurs dans la région du chromosome 5q13-q14. Deux recombinaisons<br />
nous ont permis de situer le gène sur une région de 20 cM entre les marqueurs<br />
D5S650 et D5S618.<br />
Commentaire et Conclusions : Les aspects ophtalmologiques de la maladie de<br />
Wagner semblent progresser avec l’âge. L’examen ophtalmologique régulier est<br />
important pour détecter des anomalies vitréo-rétiniennes. Le gène impliqué dans la<br />
maladie de Wagner est situé sur un intervalle de 20-cM sur le chromosome 5q13q14.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
PATHOLOGIE DU VITRÉ (1)<br />
20 89<br />
Amylose vitréenne au cours d’Amylose familiale de « type Portugaise ». À propos<br />
de 5 cas.<br />
Familial amyloidosis with polyneuropathy. Presentation of 5 cases.<br />
PROENCA PINA J*, FRAU E, RUMEN F, LABETOULLE M, LAUTIER FRAU M,<br />
KIRSCH O, OFFRET H (Bicêtre)<br />
But : L’amylose familiale « portugaise » est une entité rare, secondaire à une mutation<br />
de la transthyrétine, qui associe une polyneuropathie prédominant aux membres<br />
inférieurs, et une atteinte oculaire. Nous rapportons notre expérience, dans un centre<br />
associant une prise en charge neurologique, un service hautement spécialisé dans<br />
la greffe hépatique et un service d’ophtalmologie.<br />
Matériel et Méthode : Cinq patients, 4 femmes et un homme, âgés de 40 à 56 ans,<br />
ont été examinés dans le service d’ophtalmologie du CHU de Bicêtre. Tous les<br />
patients avaient été adressés par le service de neurologie avec le diagnostic de polyneuropathie<br />
amyloïde familiale type « portugaise ».<br />
Résultats : Parmi les cinq patients, quatre avaient reçu une greffe hépatique et un<br />
était en attente de greffe. Les cinq patients présentaient une infiltration amyloïde du<br />
vitré, mais seulement deux patients avaient une opacification du vitré gênant la<br />
visualisation du fond d’œil. L’infiltration vitréenne continuait à progresser malgré la<br />
greffe hépatique. Une vitrectomie a été pratiquée chez ces deux patients. L’infiltration<br />
vitréenne n’a pas récidivé chez ces patients. Les cinq patients présentaient un<br />
glaucome sévère limitant l’acuité visuelle chez 3 patients. Tous les patients avaient<br />
une infiltration irienne avec déformation pupillaire.<br />
Commentaire et Conclusions : L’atteinte ophtalmologique au cours de l’amylose<br />
familiale de type portugaise est dominée par l’opacification du vitré et le glaucome,<br />
cette dernière manifestation domine le pronostic visuel.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S167
1S168<br />
UVÉITES (1)<br />
20 90<br />
Analyse épidémiologique des inflammations intra-oculaires au cours de<br />
l’année 2001.<br />
Epidemiological analysis of intra ocular inflammation during 2001.<br />
BODAGHI B*, MIYARA M, CASSOUX N, WECHSLER B, FARDEAU C, LE THI<br />
HUONG D, LEMAITRE C, DUHAUT P, TRAN TFC, COSTEDOAT N, AMOURA Z,<br />
PIETTE JC, LE HOANG P (Paris)<br />
But : Nous avions précédemment analysé l’épidémiologie des uvéites sévères prises<br />
en charge dans un centre de référence tertiaire. Il était important d’évaluer les caractéristiques<br />
des patients atteints d’inflammation oculaire durant une période précise<br />
indépendamment de la sévérité de l’atteinte.<br />
Matériel et Méthode : Les observations médicales des patients adressés, entre le<br />
1 er janvier et le 31 décembre 2001, pour la prise en charge diagnostique ou thérapeutique<br />
d’une inflammation intra-oculaire ont été analysées. Un bilan minimal ou<br />
exhaustif mais orienté a été pratiqué selon la sévérité de l’atteinte et la présentation<br />
clinique. Une conduite thérapeutique adaptée a été proposée puis modifiée en fonction<br />
de l’analyse étiologique.<br />
Résultats : L’étude a porté sur 835 patients dont l’âge moyen était de 42,3 ans et<br />
le sexe-ratio F/H de 1,54. Il s’agissait d’une uvéite unilatérale dans 50,3 % des cas<br />
et bilatérale dans 49,7 % des cas. Les uvéites postérieures étaient les plus fréquentes<br />
(29,5 %) suivies des atteintes antérieures (26,4 %), totales (24,5 %) et intermédiaires<br />
(11 %). Une sclérite et une épisclérite ont été notées dans 7,3 % des cas. Le<br />
bilan a mis en évidence une orientation étiologique dans 69,4 % des cas. Il s’agissait<br />
d’une uvéite de type B27 ou d’une uvéite virale dans la plupart des atteintes antérieures<br />
et d’une toxoplasmose rétinochoroïdienne, d’une maladie de Behçet ou<br />
d’une granulomatose dans la majorité des atteintes postérieures.<br />
Commentaire et Conclusions : La prise en charge des inflammations oculaires<br />
nécessite une coopération étroite entre l’ophtalmologiste et l’interniste. L’étiologie<br />
des uvéites intermédiaires reste encore fréquemment indéterminée. Le rendement<br />
du bilan étiologique a été amélioré grâce à l’apport des techniques moléculaires<br />
appliquées aux liquides intra-oculaires. La mise en évidence de nouvelles étiologies<br />
infectieuses permettrait une approche thérapeutique plus spécifique.<br />
20 91<br />
Profil épidémiologique et étiologique des uvéites dans le service d’ophtalmologie<br />
de Monastir.<br />
Epidemiological characteristics and etiology of uveitis in the department of<br />
ophthalmology of Monastir.<br />
BEN YAHIA S*, LADJIMI A, ZAOUALI S, MESSAOUD R, ABOUCHAHADA M,<br />
KHAIRALLAH M (Monastir, Tunisie)<br />
But : Les uvéites constituent un groupe hétérogène d’affections. Leur épidémiologie<br />
dépend de plusieurs facteurs (géographique, ethnique, génétique). Le but de notre<br />
étude était d’analyser le profil épidémiologique et étiologique des uvéites dans le<br />
service d’ophtalmologie de Monastir (Tunisie).<br />
Matériel et Méthode : Ont été inclus dans l’étude 384 patients présentant une<br />
uvéite et examinés dans le service d’ophtalmologie de Monastir entre Janvier 1990<br />
et Août 2002. Tous les patients ont bénéficié d’un examen ophtalmologique complet.<br />
Nous avons adopté la classification de l’International Uveites Study Group pour classer<br />
nos patients. Des critères diagnostiques standards ont été utilisés pour déterminer<br />
l’étiologie de l’uvéite.<br />
Résultats : L’âge des patients variait de 4 à 80 ans (moyenne 34 ans). L’atteinte<br />
était unilatérale dans 62,5 % des cas et bilatérale dans 37,5 % des cas. L’acuité<br />
visuelle était inférieure à 1/10 dans 11,2 % des yeux atteints. L’uvéite était non granulomateuse<br />
dans 88 % des cas, chronique dans 65,1 % des cas et hypertensive<br />
dans 15,9 %. L’uvéite antérieure était la forme anatomoclinique la plus fréquente<br />
représentant 36 % de l’ensemble des cas, suivie par l’uvéite postérieure (28 %), la<br />
pan uvéite (19 %) et l’uvéite intermédiaire (17 %). Une étiologie à l’uvéite était retrouvée<br />
dans 256 cas (66,7 %). L’uvéite herpétique représentait l’étiologie la plus fréquente<br />
des uvéites antérieures, la toxoplasmose celle des uvéites postérieures et la<br />
maladie de Behçet celle des pan uvéites. L’uvéite intermédiaire était idiopathique<br />
dans 86.2 % des cas. Les complications les plus fréquentes étaient l’œdème maculaire<br />
cystoïde (21,8 %) et la cataracte (15,3 %).<br />
Commentaire et Conclusions : Notre étude montre que l’uvéite antérieure était la<br />
forme anatomo-clinique la plus fréquente des uvéites. L’infection herpétique, la toxoplasmose<br />
et la maladie de Behçet étaient les étiologies les plus fréquemment rencontrées.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS DU MAGHREB<br />
20 92<br />
Approche diagnostique et thérapeutique des uvéites : résultats d’une étude<br />
prospective.<br />
Diagnostic and therapeutic approach of uveitis: results of a prospective study.<br />
KALOGEROPOULOS C*, ASPROUDIS I, KOSTOULA A, PSYLLA M, TRAKOS NS,<br />
LEVIDIOTOU S, PSILAS K (Ioannina, Grèce)<br />
But : Évaluer les méthodes diagnostiques et le succès du traitement, à travers une<br />
série de patients présentant une uvéite de diagnostic différentiel difficile.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons colligé, sur une période de 4 ans (1999-2002),<br />
110 patients atteints d’uvéite et inclus dans une étude prospective selon un protocole<br />
concernant une approche diagnostique et therapeutique algorithmique. Les instructions<br />
de la <strong>Société</strong> Internationale pour les Inflammations Oculaires (IOIS) ont été<br />
considérées dans notre étude. La contribution de l’historique, de l’interprétation de<br />
la sémiologie clinique et des méthodes en ce qui concerne l’exploration diagnostique<br />
ont été évaluées. Les stratégies et les résultats du traitement (traitement immunosuppresseur,<br />
traitement des uvéites d’origine infectieuse, chirurgie des complications<br />
des uvéites) ont été aussi évalués.<br />
Résultats : Nos résultats, sur un total de 110 patients, sont représentés par : une<br />
uvéite d’étiologie détectée dans 80 % et une uvéite idiopathique dans 20 % ; l’uvéite<br />
a été d’origine infectieuse dans 51 %. Un traitement supplémentaire immunosuppresseur<br />
par voie systémique a été ajouté, dans certain cas, au cours des uvéites<br />
d’origine infectieuse pour le contrôle de l’inflammation. Chez 20 % des patients une<br />
opération a été faite pour le traitement des complications de l’uvéite (cataracte, glaucome,<br />
opacités du vitré etc.). Nous avons observé une amélioration ou un contrôle<br />
de l’inflammation dans 91 % des cas.<br />
Commentaire et Conclusions : L’utilisation d’un plan diagnostique et thérapeutique<br />
pour le traitement des uvéites est essentielle. La contribution du laboratoire, en<br />
ce qui concerne le diagnostic a été importante pour les patients manifestant surtout<br />
une uvéite d’origine infectieuse ou en cas de sarcoïdose. Le traitement médical a été<br />
efficace dans la plupart des cas et la contribution du traitement immunosuppresseur<br />
essentielle à l’amélioration des stratégies thérapeutiques.<br />
20 93<br />
Atteinte oculo-orbitaire d’origine sarcoïdosique.<br />
Oculo-orbitar manifestations during sarcoidosis.<br />
BENCHEKROUN W*, HAJJI I, SBAI IDRISSI D (Casablanca, Maroc)<br />
But : Le but de notre travail est d’insister sur les manifestations ophtalmologiques<br />
de la sarcoïdose qui peuvent être révélatrices de la maladie.<br />
Matériel et Méthode : Les auteurs rapportent le cas d’une patiente de 40 ans ayant<br />
un antécédent d’œil rouge à répétition et qui consulte pour une hypertrophie douloureuse<br />
des glandes lacrymales. L’examen clinique retrouve par ailleurs un syndrome<br />
sec et une uvéite antérieure de l’œil droit non granulomateuse avec une acuité<br />
visuelle réduite aux mouvements de la main. L’examen général retrouve une patiente<br />
en bon état général avec hypertrophie des glandes parotides et des adénopathies<br />
cervicales.<br />
Résultats : La biopsie d’une adénopathie cervicale a conclu à une sarcoïdose. La<br />
patiente est mise sous corticoïdes par voie générale. L’évolution est bonne avec<br />
régression de l’hypertrophie des glandes lacrymales et parotides ainsi que des<br />
signes d’uvéite. L’acuité visuelle a remonté à 9/10.<br />
Commentaire et Conclusions : À travers cette étude, nous insistons sur l’intérêt<br />
du diagnostic étiologique précoce pour pouvoir instaurer rapidement le traitement<br />
adéquat seul garant d’un bon résultat.<br />
20 94<br />
Utilisation du tyndallomètre laser dans la prise en charge et la surveillance de<br />
l’uvéite associée a l’arthrite juvénile idiopathique.<br />
Use of laser flare photometry in the management of uveitis related to juvenile<br />
idiopathic arthritis.<br />
TUIL A* (Marseille), BODAGHI B (Paris), TAO TRAN V (Lausanne, Suisse),<br />
PRIEUR AM, CASSOUX N, LE HOANG P (Paris), HERBORT CP (Lausanne, Suisse)<br />
But : La morbidité des uvéites associées à l’arthrite juvénile idiopathique (AJI)<br />
demeure importante avec un taux de cécité compris entre 5 et 10 %. Les complications<br />
sont liées à un retard ou une insuffisance thérapeutique et plus rarement à un<br />
surdosage en corticoïdes. L’extrême sensibilité du tyndallomètre laser (TL) pour<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
détecter les variations infracliniques de l’inflammation oculaire a été bien démontrée.<br />
Le but de cette étude est d’évaluer l’intérêt du TL dans la surveillance quantitative<br />
de l’inflammation de l’uvéite associée a l’AJI.<br />
Matériel et Méthode : Les patients adressés pour la prise en charge d’une uvéite<br />
rhumatismale sévère entre 1995 et 2001 ont été inclus dans cette étude rétrospective<br />
et bicentrique. Les données démographiques et cliniques ainsi que l’analyse du<br />
tyndall de chambre antérieure par photométrie automatisée ont été répertoriées lors<br />
de la présentation initiale et tout au long du suivi. Nous avons utilisé un tyndallomètre<br />
Kowa-FM-500 ou FC-1000 et corrélé les résultats à l’évolution clinique et la réponse<br />
thérapeutique. Un test de Student a été utilisé pour la comparaison des valeurs<br />
moyennes du tyndall. Les patients ont été inclus dans 2 groupes selon la sévérité de<br />
l’atteinte, l’importance des complications et l’acuité visuelle finale. Groupe 1 : AV<br />
finale inférieure ou égale à 0,2 ; Groupe 2 : AV finale supérieure à 0,3.<br />
Résultats : Quarante patients (15 cas sévères et 25 cas bénins) ont été étudiés. Le<br />
suivi moyen était de 6,5 ans. Le tyndall moyen était initialement de 185 ph/ms dans<br />
le groupe 1 et de 69,8 ph/ms dans le groupe 2 (p < 0,001). La réduction du tyndall<br />
était spectaculaire dans le groupe 2 (24,9 ph/ms) mais beaucoup moins importante<br />
dans le groupe 1 (p < 0,001).<br />
Commentaire et Conclusions : La bonne restauration de la barrière hématoaqueuse<br />
après traitement anti-inflammatoire est parfaitement évaluée par le TL et<br />
représente un des principaux facteurs de bon pronostic. De plus, la photométrie<br />
automatisée du tyndall permet une adaptation précise du traitement en fonction de<br />
l’inflammation résiduelle au cours des uvéites rhumatismales de l’enfant.<br />
20 95<br />
Uvéite antérieure bilatérale révélatrice d’une syphillis secondaire.<br />
Bilateral anterior uveitis as first manifestation of secondary syphillis.<br />
KONAN-TOURE ML*, GBE K, BONI S (Abidjan, Côte d’Ivoire)<br />
But : Les manifestations ophtalmologiques de la syphillis sont polymorphes et souvent<br />
rencontrées dans le deuxième stade de la maladie. Nous rapportons ici un cas<br />
d’uvéite antérieure, particulier par ses manifestations, par son étiologie syphillitique<br />
et parce que révélateur de la maladie générale.<br />
Matériel et Méthode : Le patient est un sujet de sexe masculin de 22 ans, vu pour<br />
rougeur et douleurs oculaires. L’examen ophtalmologique note un tableau semblable<br />
aux deux yeux avec une majoration droite. Il objective la baisse d’acuité visuelle qui<br />
est réduite à la perception lumineuse. La biomicroscopie note une sclérite, une uvéite<br />
antérieure à hypopion et des nodule en taches de bougie sur l’iris. La pression intraoculaire<br />
est à 12 mmHg. le vitré et le fond d’œil ne sont pas accessibles. le bilan biologique<br />
note une sérologie VIH négative. La sérologie de la syphillis note un TPHA<br />
positif au 1/1024, témoignant d’une infection évolutive. la cytobactériologie et la chimie<br />
du liquide céphalo rachidien sont en faveur d’une méningite lymphocytaire. Un<br />
traitement par Benzylpénicilline benzathine est institué.<br />
Résultats : L’amélioration clinique a été rapide. Cinq jours après le début du traitement,<br />
l’acuité visuelle est de 01/10 à droite et 02/10 à gauche. À six semaine l’acuité<br />
visuelle est de 02/10-P4 et de 07/10-P3. À deux mois l’examen du segment antérieur<br />
est normal, l’acuité visuelle est de 07/10-P3 et 09/10-P2. La biologie est normalisée.<br />
Commentaire et Conclusions : Les origines des uvéites sont très variées et quelquefois<br />
difficiles à identifier. L’établissement précoce de la relation entre l’uvéite et<br />
la syphillis malgré nos moyens d’investigation limités a permis un traitement efficace<br />
et la récupération fonctionnelle.<br />
20 96<br />
L’atteinte oculaire dans la maladie de Behçet : étude épidémiologique à propos<br />
728 cas.<br />
Ocular involvement in Behçet disease: epidemiologic study about 728 cases.<br />
AMRAOUI A*, RAKKAA A, BENAMOUR S, MOUTAOUAKIL A, ZAGHLOUL K<br />
(Casablanca, Maroc)<br />
But : La maladie de Behçet est une vascularite systèmique d’étiologie inconnue. Elle<br />
atteint l’adulte jeune, son évolution est marquée par l’alternance de poussées et de rémissions.<br />
Le but de ce travail est de dégager le profil épidémiologique de cette affection.<br />
Matériel et Méthode : Nous vous proposons à travers cette étude rétrospective de<br />
728 cas, colligés au Centre Hospitalier IBN ROCHD de 1981 à 2001, de tracer son<br />
profil épidémiologique. C’est le résultat d’une consultation spécialisée ouverte dans<br />
ce sens.<br />
Résultats : Le diagnostic de la maladie de Behçet a été retenu selon les critères du<br />
groupe international d’étude sur la maladie de Behçet 1990. L’atteinte oculaire a été<br />
retrouvée chez 64 % de nos patients. Il s’agit de 605 hommes (83 %) et 123 femmes<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS DU MAGHREB<br />
(17 %). L’âge moyen des patients était 30 ans. Cette atteinte ophtalmologique a été<br />
inaugurale dans 49 % des cas et bilatérale dans 60 % des cas. Le rythme de poussées<br />
a été de 2 à 3 fois par an chez 5 % des patients et la cécité irréversible a été<br />
notée dans 24,4 % des cas. Ces atteintes ont été dominées par la panuveïte notée<br />
dans 37 % des cas, suivie de l’uveïte anterieure présente dans 16,3 % des cas et<br />
des lésions vasculaires rétiniennes dans 37,2 % des cas. La neurobehçet était évaluée<br />
à 18 % des cas, l’atteinte maculaire est retrouvée chez 18,5 % des cas. L’aphtose<br />
buccale a été retrouvée chez tous les patients. Les autres atteintes de la<br />
maladie de Behçet seront évoquées dans ce travail.<br />
Commentaire et Conclusions : La maladie de Behçet est fréquente au Maroc estimée<br />
à 24 % de toutes les uveïtes et 34 % des uveïtes graves. L’atteinte oculaire est sévére,<br />
nécessitant un diagnostic précoce et une surveillance réguliére et un traitement (corticoïdes<br />
– immunosuppresseurs) s’il est efficace sur l’imflammation, ne fait que retarder<br />
l’échéance de la cécité ou de la malvoyance, principale complication de cette maladie.<br />
20 97<br />
Aspects cliniques de l’uvéite dans la maladie de Behçet.<br />
Clinical features in uveitis of Behçet’s disease.<br />
EL MATRI L*, MILI-BOUSSEN I, CHARFI O, BAKLOUTI K, OUERTANI A (Tunis,<br />
Tunisie)<br />
But : L’uvéite est la localisation oculaire la plus fréquente au cours de la maladie de<br />
Behçet (MB). Le but notre travail est d’étudier la prévalence de ses différentes formes<br />
anatomo-cliniques ainsi que celles des lésions associées.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une rétrospective portant sur 223 patients atteints<br />
(critères de l’International Study Group for Behçet Disease) avec atteinte oculaire.<br />
Chaque patient a bénéficié d’un bilan ophtalmologique complet. Les autres manifestations<br />
de la MB ont été notées.<br />
Résultats : L’âge moyen des patients était de 29 ans et le sex-ratio à 2,62 ; l’uvéite<br />
était de type iridocyclite récidivante, isolée dans 20 % des cas, fibrineuse sans ou<br />
avec hypopion (4 %), évoluant vers des complications à type de secclusion pupillaire<br />
(60 %), cataracte (40 %), hypertonie oculaire (2 %). L’uvéite postérieure était de loin<br />
plus fréquente, avec hyalite (70,2 %), vascularite (40 %), uvéo-papillite (25 %), foyers<br />
de chorio-rétinite (0,5 %) ; les complications de la vascularite occlusive conditionnent<br />
le pronostic visuel, avec un aspect terminal de « fond de l’œil sans vaisseaux »<br />
(20 %). D’autres manifestations ont été associées à l’uvéite : aphtose conjonctivale<br />
(1 cas), sclérite (3 cas), paralysie oculomotrice (2 cas).<br />
Commentaire et Conclusions : L’uvéite au cours de la maladie de Behçet est fréquente<br />
et habituellement sévère. Son pronostic dépend du type de l’atteinte, de la<br />
précocité et de la réponse au traitement ; dans tous les cas, il reste redoutable.<br />
20 98<br />
Facteurs évolutifs et pronostiques de l’uvéite dans la maladie de Behçet.<br />
Evolution and prognosis factors in Behçet’s uveitis.<br />
OUERTANI MEDDEB A* (Tunis, Tunisie)<br />
But : Déterminer des scores pour évaluer l’évolutivité et la sévérité de l’uvéite dans<br />
la maladie de Behçet.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude prospective a porté sur 51 patients porteurs<br />
d’une uvéite liée à la maladie de Behçet (critères de l’International Study Group for<br />
Behcet Disease). Des paramètres chiffrés ont été établis pour quantifier l’évolutivité<br />
de l’uvéite (de 0 à 4) et/ou sa sévérité (de 0 à 10). Ces scores ont été calculés à<br />
chaque examen ophtalmologiqe selon la réponse au traitement.<br />
Résultats : Le score inital moyen d’évolutivité était de 17 +/-7,4 et celui de sévérité à 20.<br />
Ce score semble étroitement corrélé à la gravité du pronostic visuel de l’uvéite (p = 0,034).<br />
Commentaire et Conclusions : Les scores utilisés se sont avérés reproductibles,<br />
fiables et simples à utiliser. Une étude à plus large échelle permettrait une meilleure<br />
discrimination des facteurs pronostiques utilisés.<br />
20 99<br />
Résultats thérapeutiques à long terme des immunosuppresseurs dans le Behçet<br />
oculaire.<br />
Long term therapeutic results of immunosuppressant drugs in ocular Behcet.<br />
BENCHEKROUN N*, REFASS L, BELMEKKI M, HAJJI Z, BERRAHO A (Rabat,<br />
Maroc)<br />
But : Le Behçet est une étiologie fréquente d’uvéites au Maroc. Cette étude vise à<br />
comparer les résultats thérapeutiques obtenus avec le cyclophosphamide d’une part<br />
et le chlorambucil d’autre part sur une période de 18 ans (1984-2002).<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S169
1S170<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 226 patients<br />
(345 yeux), le sexe ratio est de 6.4, l’âge moyen de 31. 3 ans. Le diagnostic de<br />
Behçet est posé conformément aux critères du groupe international d’étude sur la<br />
maladie. Tous nos patients ont bénéficié d’un examen ophtalmologique complet<br />
avec angiofluographie rétinienne. Tous avaient une uvéite sévère. Groupe1 : 126<br />
yeux traités par chlorambucil : 1 mg/Kg/j pendant 4 semaines, puis traitement<br />
d’entretien à 0.5mg/10 kg/j, avec une fenêtre thérapeutique de 1 à 6 mois, traitement<br />
de 18 mois en moyenne. Goupe2 : 209 yeux traités par cyclophosphamide : 10 mg/<br />
m 2 sc et par cure ; cures mensuelles au nombre de 6 par an en moyenne. Parallèlement<br />
au traitement immunosuppresseur, un bolus de méthylprédnisolone (1 mg/Kg/<br />
j pendant 3 jours) a été préconisé lors des poussées inflammatoires aiguës.<br />
Résultats : Avec un recul moyen de 6 ans, l’analyse des résultats a montré chez le<br />
groupe1 une stabilisation dans 59 % des cas (groupe 2 : 68 %), une rechute à l’arrêt du<br />
traitement dans 29 % des cas (groupe 2 : 25 %) et sous traitement dans 12 % des cas<br />
(groupe 2 : 7 %). Les résultats fonctionnels, anatomiques et évolutifs sont meilleurs sous<br />
cyclophosphamide. Ainsi, le nombre de poussées et les intervalles les séparant sont plus<br />
réduits sous cette même molécule. Ajoutons que des complications iatrogènes ont été<br />
notées dans le groupe1 : 12 cas d’infection, 6 leuconeutropénies, 3 azoospermies.<br />
Aucune complication iatrogène n’a été notée sous cyclophosphamide. Cette molécule<br />
permet aussi une meilleure maniabilité et observance que le chlorambucil.<br />
Commentaire et Conclusions : Le Behçet oculaire pose un problème d’ordre thérapeutique<br />
et pronostic. Notre travail suggère que le cyclophosphamide serait préfèrable<br />
au chlorambucil dans le traitement des uvéites du Behçet.<br />
21 00<br />
Intérêt des « Bolus » d’Endoxan® dans le traitement des manifestations<br />
oculaires de la maladie de Behçet.<br />
Interest of Endoxan®“bolus” in the treatment of ocular manifestations in<br />
Behçet’disease.<br />
KRIFA F*, GHORBEL M, YACOUBI S, GHOUL A, TOUZANI F, MAHJOUB H, BEN<br />
HADJ HAMIDA F (Sousse, Tunisie)<br />
But : La maladie de Behçet est une vascularite qui touche préférentiellement<br />
l’homme jeune. L’atteinte oculaire est fréquente et le pronostic reste assez reservé<br />
malgré la diversité des moyens thérapeutiques actuellement disponibles. Nous rapportons<br />
notre expérience à propos de l’usage des bolus d’Endoxan.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude porte sur 15 malades suivis dans le service<br />
d’Ophtalmologie Farhat Hached de Sousse. Le diagnostic de la maladie de Behçet<br />
a été retenu selon les critères internationaux de l’« Institut Study Group Behçet<br />
Disease ». Tous les patients ont bénéficié de bolus d’Endoxan, mensuels, à la dose<br />
de 1 g pendant 16 mois.<br />
Les principales indications étaient :<br />
– la sévérité de l’inflammation oculaire ;<br />
– la corticorésistance ;<br />
– les effets indésirables de la corticothérapie.<br />
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 30 ans. Le sexe ratio était de 3/1.<br />
Sur le plan fonctionnel, nous avons noté : une récupération de 2 lignes selon l’echelle<br />
de Snellen chez 60 % des malades et une régression de l’inflammation intra-oculaire<br />
chez 73 % des patients.<br />
Commentaire et Conclusions : L’action du bolus d’Endoxan au cours des manifestations<br />
oculaires de la maladie de Behçet a été proposée par plusieurs auteurs. Le THI<br />
HUONG DU et ses collaborateurs ont rapporté leurs résultats à propos de 17 cas. Les<br />
bolus ont été administrés à un rythme moyen de 4 semaines, à la dose moyenne de<br />
922 mg. Le nombre moyen de bolus reçus par malade est de 10. La disparition des<br />
signes inflammatoires était la règle. Alors que l’acuité visuelle ne s’est améliorée que<br />
dans 12 yeux. Ce traitement a permis de réduire les doses de corticoïdes. Sa tolérance<br />
est bonne ; et il a l’avantage d’améliorer l’observance et la qualité du suivi.<br />
21 01<br />
Uvéite antérieure réfractaire liée au cytomégalovirus chez 2 patients<br />
immunocompétents.<br />
Refractory anterior uveitis associated with cytomegalovirus infection in two<br />
immunocompetent patients.<br />
DE SCHRYVER I* (Gand, Belgique), BODAGHI B, ROZENBERG F, CASSOUX N, LE<br />
HOANG P (Paris)<br />
But : Nous rapportons deux cas d’uvéite antérieure unilatérale chronique sans<br />
atteinte rétinienne associée.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS DU MAGHREB<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit de deux hommes âgés de 78 et 69 ans, pris en<br />
charge pour une uvéite antérieure granulomateuse, hypertensive, sans atrophie<br />
irienne et évoluait depuis plusieurs mois. L’inflammation résistait à l’association<br />
d’aciclovir per os et de corticoïdes locaux. Il n’y avait aucun facteur de risque en<br />
faveur d’une immunodépression sous-jacente. Une ponction de chambre antérieure<br />
a été réalisée dans les deux cas avec recherche du génome des virus herpès par<br />
PCR et évaluation de la synthèse locale d’anticorps antiviraux. Des tests de prolifération<br />
lymphocytaire in vitro ont été réalisés en présence de différents antigènes, en<br />
particulier herpétiques.<br />
Résultats : Le génome du cytomégalovirus a été mis en évidence dans les deux cas<br />
avec production intra-oculaire d’anticorps. Les deux patients ont bénéficié d’un traitement<br />
antiviral par foscarnet à doses d’attaque pendant 3 semaines relayé par le<br />
valganciclovir per os. L’hypertonie oculaire a été corrigée dans les deux cas permettant<br />
l’arrêt du traitement antihypertenseur médical. Le valganciclovir a été interrompu<br />
chez un patient pour anémie avec rechute rapide de l’uvéite. Le ganciclovir topique<br />
a alors permis de stabiliser l’inflammation.<br />
Commentaire et Conclusions : L’uvéite à cytomégalovirus est une affection rare.<br />
La résistance à l’aciclovir n’exclut pas une atteinte virale herpétique et impose la<br />
réalisation d’une analyse moléculaire à partir de l’humeur aqueuse. Seul un traitement<br />
antiviral spécifique permet de contrôler l’uvéite.<br />
21 02<br />
Retard de diagnostic des uvéites de Fuchs et ses conséquences néfastes.<br />
Delay in the diagnosis of Fuchs’ uveitis and its deleterious consequences.<br />
SEKKAT L* (Lausanne, Suisse), BRANCALEONI A (Ferrara, Italie), BOUCHENAKI N<br />
(Genève, Suisse), HERBORT CP (Lausanne, Suisse)<br />
But : Le retard de diagnostic de l’uvéite de Fuchs peut être à l’origine de conséquences<br />
délétères tel qu’un traitement inadéquat avec ses conséquences. Le but de cette<br />
étude est d’analyser la proportion des cas de Fuchs non diagnostiqués vus dans un<br />
centre de référence secondaire et les conséquences de ce retard.<br />
Matériel et Méthode : Les données des patients avec uvéite de Fuchs vus à la<br />
Consultation des Uvéites du Centre Ophtalmologique de La Source (COS) à Lausanne<br />
ont été analysées. La proportion des cas avec retard de diagnostic, la<br />
moyenne de ce retard, les diagnostics originaux erronés, les caractéristiques de la<br />
maladie et les effets délétères ont été enregistrés.<br />
Résultats : Entre 1995 et 2002, le diagnostic d’uvéite de Fuchs fut posé chez 62<br />
des 742 patients vus à la consultation des uvéites du COS. Dans 49/62 cas (79 %),<br />
le diagnostic a été retardé en moyenne de 3,67±4,34 ans. Le diagnostic de départ<br />
était : uvéite intermédiaire dans 27/49 cas (55 %), uvéite postérieure ou panuvéite<br />
dans 11 cas (22 %) et uvéite granulomateuse dans 5 cas (10 %). L’uvéite de Fuchs<br />
était bilatérale dans 6/62 cas (12 %). Le signe le plus fréquent était une vitrite dans<br />
66/68 yeux (97 %), des précipités kératiques stellaires dans 64 (94 %), un voile sous<br />
capsulaire postérieur ou cataracte dans 41 (60 %), une hétérochromie dans 23<br />
(42,6 %) et des nodules de Koeppe dans 9 yeux (13 %). Dix-huit furent traités avec<br />
des stéroïdes systémiques avec addition de traitements immunosuppresseurs dans<br />
5 cas. Dans un cas, la thérapie fut presque fatale puisqu’une primoinfection toxoplasmique<br />
fut attribuée à la récidive de l’uvéite « autoimmune » et traitée par une<br />
immunosuppression massive.<br />
Commentaire et Conclusions : L’uvéite de Fuchs est souvent manquée probablement<br />
parce que l’atteinte prédominante du vitré est méconnue. Cette situation doit<br />
être portée à l’attention des ophtalmologues pour éviter les effets néfastes d’un traitement<br />
inapproprié par collyre stéroïdien voir par stéroïdes systémiques ou même<br />
par thérapie immunosuppressive.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
NÉO-VAISSEAUX – DMLA – DÉCOLLEMENT DE RÉTINE – NEURO-OPHTALMOLOGIE<br />
NÉO-VAISSEAUX<br />
21 03<br />
Traitement par laser milipulsé d’un pédicule nourricier de néo-vaisseaux choroïdiens<br />
rétrofovéaux occultes compliquant une dégénérescence maculaire liée à l’âge.<br />
Feeder vessels treatment of subfoveal occult choroidal new vessels in AMD.<br />
COSCAS F*, SAYAG D, PAPP M, COSCAS G, SOUBRANE G (Créteil)<br />
But : Diminuer la perfusion des néo-vaisseaux choroïdiens occultes (NVO) rétrofovéaux<br />
par laser millipulsé sur le vaisseau nourricier (VN) extrafovéal.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective de 50 yeux atteints de DMLA, présentant<br />
des NVO rétrofovéaux en phase de décompensation, sur une période de 6 à 9 mois.<br />
Le diagnostic de NVO est porté sur l’angiographie à la fluorescéine (AF) et l’angiographie<br />
au vert d’infracyanine (ICG) par laser à balayage (HRA-Heidelberg –<br />
Allemagne). La détection des VN est obtenue par l’angiographie à haute vitesse (HS-<br />
ICG). Après diagnostic et repérage des VN artériels, une photocoagulation localisée<br />
par laser diode millipulsé est appliquée. Un contrôle immédiat en HS-ICG est effectué.<br />
Un bilan associant fond d’œil, acuité visuelle (AV), AF et HS-ICG est effectué<br />
avant et puis à 1,3 et 6 mois.<br />
Résultats : Trente-neuf VN artériels ont été détectés sur les 50 yeux : 28 VN sur les<br />
39 étaient extrafovéaux accessibles au laser. Sur les 10 cas de VN multiples, 9 avaient<br />
2 VN dont 3 étaient hors de la fovéa. L’efficacité du traitement a été : obtenue sur<br />
l’occlusion du VN dans 15 cas sur 28 dès le premier laser. 6 cas ont bénéficié d’un<br />
retraitement immédiat. À 6 mois, 4 reperméabilisations sur les 21 VN occlus se sont<br />
produites. Tous les VN perméables ont étés retraités à 6 mois. À 9 mois, 13 cas étaient<br />
occlus, 12 avaient un calibre diminué. Dans 27 cas sur les 28 traités, l’AV est stable.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette technique de photocoagulation permet un<br />
bon résultat anatomique avec cicatrices minimes, extra fovéales et le plus souvent<br />
conservation de la vision centrale.<br />
21 04<br />
Traitement des néovaisseaux occultes choroïdiens rétrofovéolaires par la<br />
thermothérapie transpupillaire : résultats à un an.<br />
Transpupillary thermotherapy of occult choroidal neovascularisation: one-year results.<br />
FRANCOIS L*, RENAUD-ROUGIER MB, FOURMAUX E, ISBER-SOYER R,<br />
KOROBELNIK JF (Bordeaux)<br />
But : Évaluer l’efficacité de la thermothérapie transpupillaire (TTT) dans le traitement<br />
des néovaisseaux occultes rétrofovéolaires (NVO-RF).<br />
Matériel et Méthode : Les auteurs rapportent les résultats à un an de suivi d’une<br />
étude rétrospective, non randomisée, non comparative du traitement par TTT des<br />
NVO-RF. Les résultats à 3 mois ont été publiés. Une angiographie à la fluorescéine<br />
et au vert d’indocyanine a été réalisée à l’inclusion et à un an. L’acuité visuelle, comprise<br />
entre 20/200 et 20/40, a été mesurée sur l’échelle ETDRS. Une variation de<br />
plus de 3 lignes était considérée comme significative. Le traitement a consisté en<br />
l’application d’un seul impact de laser (diode 810nm) d’une minute, avec un spot de<br />
taille variable (2 500 – 4 000nm), de puissance variable (450-800 mW). Aucun blanchiment<br />
de la rétine n’a été observé en fin de traitement. À un an le résultat du traitement<br />
est évalué par l’acuité visuelle, l’examen du fond d’œil et la lecture des<br />
angiographies par deux examinateurs indépendants.<br />
Résultats : Soixante-six patients ont été traités. 9 patients ont été éliminés pour non<br />
respect des critères d’inclusion. Sur les 57 patients évaluables, 10 % a conservé son<br />
acuité visuelle, et 22 patients ont présenté des complications graves (3 brûlures rétiniennes,<br />
19 apparitions de néovaisseaux visibles).<br />
Commentaire et Conclusions : Le nombre important de complications sévères<br />
nous incite à ne plus proposer ce traitement selon les critères que nous avons utilisés.<br />
Cependant, cette approche thérapeutique mérite d’être réévaluée, en redéfinissant<br />
les paramètres de traitement (puissance, taille du spot) en fonction notamment<br />
de la pigmentation du fond d’œil et de l’opacité cristallinienne.<br />
21 05<br />
Sensibilité rétinienne centrale après traitement avec thermothérapie transpupillaire.<br />
Central retinal threshold sensitivity after transpupillary thermotherapy.<br />
GIO M* (Zingonia-Bergamo, Italie), SIRIANNI P (Aosta, Italie), FUMAGALLI G,<br />
GIACOMOTTI E, GOTTARDI V (Zingonia-Bergamo, Italie)<br />
But : Les auteurs ont réalisé une étude sur 70 patients atteints des formes sévères de<br />
dégénérescence maculaire liée à l’âge et myopique, présentant une acuité visuelle<br />
égale ou inférieure à 1/10, qui ont été traités par thermothérapie transpupillaire.<br />
Matériel et Méthode : L’examen de la sensibilité rétinique a été réalisé par Frequency<br />
Doubling Technology, avec un programme en seuil central de 20°, avant chaque<br />
traitement et à 1, 3 et 6 mois. La thermothérapie transpupillaire a été pratiquée<br />
avec Iris Oculight SLx. La population recrutée pour cette étude clinique a été de<br />
70 patients âgés en moyenne de 65 ans, avec un suivi de minimum 3 mois. Une<br />
angiographie dynamique (HRA) à la fluorescéine et au vert d’Indocyanine a été réalisée<br />
avant chaque traitement et à 1, 3 et 6 mois. Les patients ont tous bénéficié<br />
d’une seule séance de thermothérapie transpupillaire.<br />
Résultats : Les auteurs rapportent les résultats des variations de la sensibilité rétinienne<br />
centrale d’une part et, d’autre part, l’acuité visuelle, l’évolution des métamorphopsies<br />
et l’impression subjective des patients à pathologie maculaire stabilisée.<br />
Les critères objectifs étaient basés sur l’aspect de la lésion au fond d’œil et en angiographie<br />
à la fluorescéine et au vert d’Indocyanine.<br />
Commentaire et Conclusions : L’analyse des résultats porte à considérer que<br />
l’amélioration de l’aspect anatomo-fonctionnel, après cette thérapeutique, ne correspond<br />
pas toujours à un effet positif sur les paramètres subjectifs du patient. L’amélioration<br />
des paramètres angiographiques de l’œdème maculaire a été confirmé par<br />
l’augmentation de la sensibilité rétinique centrale à l’examen Frequency Doubling<br />
Technology.<br />
21 06<br />
La translocation nasale : variante de la translocation maculaire sans rétinotomie.<br />
Nasal translocation: a variant from limited macular translocation.<br />
GLACET-BERNARD A* (Créteil), COSCAS G (Paris), SOUBRANE G (Créteil)<br />
But : La translocation (TL) maculaire a pour but de déplacer la rétine neurosensorielle<br />
maculaire par rapport aux plans sous-jacents (EP – membrane de Bruch). En<br />
cas de néovascularisation rétrofovéale compliquant la myopie dégénérative ou la<br />
DMLA, cette technique a montré des résultats très encourageants en déplaçant la<br />
fovéa en regard d’une zone saine. Le but de cette étude est d’évaluer la faisabilité<br />
d’une variante de la TL sans rétinotomie, permettant d’obtenir un déplacement non<br />
pas inférieur mais nasal.<br />
Matériel et Méthode : Cinq yeux présentant une membrane néovasculaire s’étendant<br />
en temporal du point de fixation ont été opérés selon une variante de la TL :<br />
raccourcissement scléral temporal par 4 sutures non résorbables, création d’un<br />
décollement de rétine par injection sous la rétine de BSS à l’aide d’une canule rigide<br />
de 39 G, plusieurs échanges fluide-air, positionnement du patient en décubitus latéral<br />
pendant 36 heures.<br />
Résultats : L’âge moyen des patients était de 41 ans, 3 étaient myopes forts, 1 présentait<br />
une rupture traumatique de la membrane de Bruch et 1 une choroïdite multifocale.<br />
Le déplacement en nasal de la fovéa a été obtenu dans tous les cas<br />
(moyenne * DP), situant les néovaisseaux en position extrafovéale dans 4 cas et<br />
juxta-fovéale dans 1 cas. Tous les yeux ont bénéficié d’un traitement par photocoagulation<br />
au laser des néovaisseaux. Quatre yeux sur 5 ont récupéré une acuité<br />
visuelle de 5/10 ou plus.<br />
Commentaire et Conclusions : Le déplacement semble plus régulièrement prédictible<br />
avec cette technique, peut-être du au positionnement plus facile à observer. La<br />
TL nasale semble efficace pour déplacer la fovéa à distance des néovaisseaux, et<br />
permet d’élargir les indications actuelles de la TL.<br />
21 07<br />
Apparition de néovaisseaux choroïdiens après ablation chirurgicale d’une<br />
membrane épirétinienne.<br />
Choroïdal new-vessels ingrowth after surgical removal of an epiretinal membrane.<br />
ROCHE O*, ORSSAUD C, HAKIKI S, DUFIER JL (Paris)<br />
But : Parmi les complications de la chirurgie des membranes rétiniennes l’apparition<br />
de néovaisseaux choroidiens est exceptionnelle. Les auteurs rapportent l’observation<br />
d’un patient ayant développé des néovaisseaux à distance d’un pelage rétinien<br />
non compliqué.<br />
Matériel et Méthode : Un homme victime d’un traumatisme oculaire perforant<br />
limité au segment antérieur a été pris en charge initialement dans de bonnes conditions.<br />
L’apparition progressive d’une cataracte a nécessité une ablation intra capsulaire<br />
du cristallin 2 ans après avec implantation de chambre antérieure. Le patient a<br />
été suivi régulièrement pendant 12 ans avec une dégradation progressive de son<br />
acuité visuelle liée au développement d’une membrane épirétinienne. Une chirurgie<br />
d’exérèse à permis d’améliorer l’acuité visuelle et de réduire les signes fonctionnels.<br />
Environ 10 mois après l’intervention, le patient a ressenti une baisse de vision. Des<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S171
1S172<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
NÉO-VAISSEAUX – DMLA – DÉCOLLEMENT DE RÉTINE – NEURO-OPHTALMOLOGIE<br />
signes ophtalmoscopiques indirects font suspecter une membrane néovasculaire<br />
confirmée par une angiographie.<br />
Résultats : Une destruction complète de la membrane a été obtenue en deux étapes<br />
par photocoagulation au laser Argon puis Krypton.<br />
Commentaire et Conclusions : Les auteurs cherchent à comprendre la physiopathologie<br />
de ce phénomène rare. L’hypothèse d’une altération iatrogène de la membrane<br />
de Bruch semble être la plus probable. Même si elle reste rare, une telle<br />
complication doit être redoutée en cas de récidive des signes fonctionnels.<br />
21 08<br />
Étude de l’évolution spontanée des drusen bilatéraux et des drusen du 2e œil.<br />
Bilateral and second eye drusen spontaneous evolution.<br />
ZOURDANI A*, NYOUMA E (Cameroun), COSCAS G, SOUBRANE G (Creteil)<br />
But : Notre étude se propose d’analyser l’évolution spontanée des drusen bilatéraux<br />
et du 2 e œil avec diverses méthodes et surtout de rechercher des corrélations entre<br />
les examens complémentaires (angiographie à la fluorescéine, angiographie en infrarouge,<br />
tomographie en cohérence optique), et le pronostic ou l’apparition de néovaisseaux.<br />
Matériel et Méthode : Quatre-vingt-dix patients dont 51 de sexe féminin, d’âge<br />
moyen de 75 ans, ont été examinés entre mai et juin 2002. Plusieurs facteurs de risque<br />
ont été identifiés dans les antécédents du patient : Hypertension artérielle<br />
(27 %), tabagisme (11 %), hypercholestérolémie (17 %), antécédents familiaux de<br />
DMLA (11 %), antécédents de phakoexérèse (4 %). 86 patients ont été inclus avec<br />
des drusen maculaires du 2 e œil alors que le 1 er œil était atteint de complications<br />
dégénératives (84 néovaisseaux choroïdiens et 2 atrophies géographiques).<br />
4 patients avaient des drusen bilatéraux.<br />
Résultats : Les drusen sont mieux identifiés à l’angiographie en infrarouge qu’à la<br />
fluorescéine (37 % à l’angiographie à la fluorescéine contre 56 % pour l’angiographie<br />
en infrarouge avec l’infracyanine). De même, la survenue de complications était<br />
mieux dépistée par l’angiographie à l’infracyanine (5 décollements de l’épithélium<br />
pigmentaire et 5 néovaisseaux occultes à type de plaque décelés seulement sur<br />
l’angiographie en infracyanine). L’examen en OCT constitue également un bon indicateur<br />
des drusen mettant en évidence de petits soulèvements de l’épithélium pigmentaire<br />
dont on peut estimer l’épaisseur et l’évolution dans le temps.<br />
Commentaire et Conclusions : La détection des néovaisseaux choroïdiens reste<br />
difficile aux stades initiaux et en particulier lorsque le fond d’œil est très remanié par<br />
des drusen et anomalies pigmentaires et de petites plages atrophiques : les examens<br />
complémentaires sont alors indispensables. Cette étude confirme l’importance<br />
et la complémentarité de ces différents examens dans l’analyse et le suivi des drusen,<br />
ainsi que pour la détection et surveillance des complications.<br />
21 09<br />
Anastomoses choroïdo-rétiniennes (ACR) et vasculopathie polypoidale dans la<br />
DMLA. Association ou hasard ? Étude de 4 cas.<br />
Retinal-choroidal anastomoses (RAC) and polypoidal choroidal vasculopathy in AMD.<br />
Chance or association? Report of 4 cases.<br />
PAPP M*, PAWLAK D, HADDAD WM, SOUIED E, COSCAS G, SOUBRANE G<br />
(Créteil)<br />
But : Le but est l’analyse de différentes formes cliniques considérées comme faisant<br />
partie du l’ensemble des tableaux cliniques de la DMLA.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de quatre yeux avec DMLA exsudative<br />
non traitée. L’étude en video-angiographie à haute vitesse au vert d’infracyanine<br />
pour des ACR a mis en évidence la présence simultanée des vasculopathies polypoïdales<br />
associées.<br />
Résultats : Des dilatations choroidiennes polypoidales étaient retrouvées, situées<br />
dans le DEP vascularisé dans un rayon de 1,236 à 3,032 mm par rapport à l’anastomose.<br />
Dans 2 cas, deux autres malformations polypoïdales étaient associées en<br />
péri-papillaire. Les dilatations polypoidales choroidiennes présentaient les caractéristiques<br />
angiographiques typiques. Dans tous les cas, une seule ACR comportait la<br />
participation d’une artère et d’au moins une veine rétinienne. Une membrane occulte<br />
rétrofovéolaire était observée avec, dans tous les cas la présence d’exsudats, et d’un<br />
œdème maculaire cystoïde, associés dans 50 % à des hémorragies intra-rétiniennes.<br />
Commentaire et Conclusions : Aucune autre association de ce type n’a encore<br />
été décrite dans la littérature. L’éventualité d’une pathogénie commune entre ces<br />
deux types de lésions n’est actuellement pas démontrée. L’analyse en vidéo-angio-<br />
graphie au vert d’infracyanine à un stade plus précoce devrait permettre de mettre<br />
en évidence la séquence d’apparition des 2 pathologies.<br />
21 10<br />
Analyse de la dynamique circulatoire dans les anastomoses entre choroïde et<br />
rétine (ACR).<br />
Flow dynamic analysis of anastomoses between choroid and retina (RCA).<br />
PAWLAK D*, PAPP M, HADDAD WM, SAYAG D, SOUIED E, COSCAS G,<br />
SOUBRANE G (Créteil)<br />
But : Analyse du sens circulatoire dans les anastomoses entre choroïde et rétine<br />
d’yeux avec une DMLA compliquée de néovaisseaux occultes.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective non randomisée sur 28 yeux de<br />
26 patients consécutifs présentant une anastomose vasculaire au sein d’un décollement<br />
de l’épithélium pigmentaire (DEP) ou d’une membrane occulte. La vidéo-angiographie<br />
à haute vitesse au vert d’indocyanine permet une analyse précise des temps<br />
circulatoires très précoces. Pour chaque œil, les caractéristiques suivantes furent<br />
recherchées : présence et taille d’un DEP, altérations et anomalies vasculaires rétiniennes<br />
ou choroïdiennes.<br />
Résultats : Dans 21 % des yeux, plusieurs anastomoses furent retrouvées, donnant<br />
un total de 37 anastomoses. Un DEP était associé dans 71 % des cas. Dans 78 %<br />
des cas l’anastomose concernait une artère et une veine rétinienne. Cependant, elle<br />
était artérielle pure dans 13 % des cas et veineuse pure dans 8 %. Le flux circulatoire<br />
était rétino-rétinien sans néovaisseaux occultes interposés dans 16 % des cas, chorio-rétinien<br />
dans 11 % des cas, rétino-choroidien dans 11 % des cas et rétino-choroido-rétinien<br />
dans 62 % des anastomoses.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette analyse pourrait apporter des renseignements<br />
complémentaires sur la localisation en profondeur de ces anastomoses, sur<br />
leur pathogénie et sur leur évolution. Les anastomoses pourraient être une réponse<br />
à différentes altérations, initiales ou secondaires, rétiniennes ou choroïdiennes dont<br />
ferait partie, entre autres, la DMLA.<br />
DMLA<br />
21 11<br />
Hématome dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) : lésions sousjacentes.<br />
Subretinal hemorrhage in age-related macular degeneretion: responsible lesions.<br />
MARTHELOT V*, PAPP M, SAYAG D, PAWLAK D, COSCAS G, SOUBRANE G<br />
(Créteil)<br />
But : Analyse angiographique du type de néovaisseaux (NV) choroïdiens associés à<br />
l’apparition d’un hématome sous rétinien (HSR) dans la DMLA. Analyse des facteurs<br />
pouvant intervenir dans l’apparition et l’évolution de l’HSR.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de 62 yeux de 52 patients examinés de<br />
juin 1996 à novembre 2002. Lors de l’apparition de l’HSR, un examen clinique et<br />
angiographique a été réalisé et confronté aux examens antérieurs et ultérieurs.<br />
Résultats : Dix-neuf hommes et 33 femmes, âgés de 66 à 93 ans présentaient<br />
une hypertension artérielle traitée dans 64,5 % des cas, un traitement anti-agrégant<br />
dans 30,5 % et anticoagulant dans 9 % des cas. Lors de l’apparition de<br />
l’HSR, l’AV était de 1,2/10 (score 19 EDTRS). Les angiographies montrent la présence<br />
de NV occultes dans 49 cas (80,3 %, dont 7 formes mixtes), de NV visibles<br />
dans 3 cas, de 2 cas de décollement de l’épithélium pigmentaire (EP)<br />
vascularisé et d’1 cas d’hémorragie intravitréene dense. L’attitude thérapeutique<br />
a été une photocoagulation pour 21 yeux, une photothérapie dynamique pour<br />
8 yeux, une injection de gaz pour 5 yeux, une injection sous ténonienne d’acétate<br />
d’anécortave dans 1 cas et une surveillance simple pour 23 yeux. L’AV<br />
finale moyenne (suivi de 1 mois à 5 ans) est de 0,9/10 (score 24 EDTRS). L’évolution<br />
se fait vers une lésion fibrovasculaire dans 20 cas, la persistance de NV<br />
occultes dans 12 cas, une déchirure de l’EP dans 9 cas et la persistance ou<br />
l’extension de l’HSR dans 7 cas.<br />
Commentaire et Conclusions : L’apparition d’un HSR dans la DMLA est liée à la<br />
présence de NV occultes dans 49 cas sur 52 cas où l’angiographie est analysable.<br />
Le pronostic visuel reste sévère et il n’existe pas de différence significative entre les<br />
différentes attitudes thérapeutiques.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
NÉO-VAISSEAUX – DMLA – DÉCOLLEMENT DE RÉTINE – NEURO-OPHTALMOLOGIE<br />
21 12<br />
DMLA avec anastomose choroïdo-rétinienne : étude prospective et évolution<br />
spontanée du deuxième œil par angiographies à la fluorescéinine et à<br />
l’infracyanine.<br />
AMD with choroïdo-retinal anastomosis: prospective study and natural history with<br />
fluorescein and ICG angiography.<br />
COSCAS G*, HADDAD WM, COSCAS F, PAPP M, SOUIED E, SOUBRANE G<br />
(Créteil)<br />
But : Analyser les aspects ophtalmoscopiques et angiographiques à l’œil adelphe<br />
de patients avec DMLA exsudative et une anastomose choroïdo rétinienne<br />
(ACR), pour étudier l’évolution spontanée, l’existence initiale d’une prolifération<br />
angiomateuse rétinienne (PAR), les facteurs de risque de néovaisseaux choroïdiens<br />
(NVC) ; rechercher le degré de symétrie de l’atteinte et les indications thérapeutiques.<br />
Matériel et Méthode : L’examen initial comporte la mesure de la meilleure acuité<br />
visuelle (AV), la biomicroscopie du fond d’œil, les angiographies à la fluorescéine (AF)<br />
et au vert d’infracyanine (ICG) utilisant le laser à balayage de Heidelberg (SLO). Ces<br />
examens ont été répétés tous les 3 mois (de 6 mois à 5 ans).<br />
Résultats : Tous les patients de la série présentaient au 2 e œil des précurseurs de<br />
la DMLA (drusen, migrations pigmentaires). L’atteinte néovasculaire était présente à<br />
différents stades, dès l’examen initial dans 15 cas ; 30 %. Les patients présentant<br />
une atteinte néovasculaire initiale sans décollement de l’épithélium pigmentaire<br />
(DEPV) ont été traités sans délai (5 cas ; 10 %). Lorsqu’un DEP V était déjà présent,<br />
toutes les tentatives thérapeutiques ont été décevantes. En l’absence d’atteinte néovasculaire<br />
initiale, à l’examen du 2 e œil, l’apparition de signes fonctionnels liée à la<br />
survenue d’un DEPV pendant le suivi s’est fait vers la survenue de ce DEPV avec<br />
ACR dans 10 % des cas (5 cas). Dans aucun cas de la série n’a été constaté d’anastomoses<br />
rétino rétiniennes ni de PAR isolées avant l’apparition de DEPV. Le suivi<br />
prospectif des patients est en cours.<br />
Commentaire et Conclusions : Le caractère symétrique des lésions semble<br />
confirmé mais retardé dans le temps. L’examen en SLO a permis de guider efficacement<br />
le traitement. Le pronostic des DMLA apparaît particulièrement sévère sauf<br />
en cas de détection très précoce sans DEP ou DEPV minime.<br />
DÉCOLLEMENT DE RÉTINE<br />
21 13<br />
Décollement de rétine du pseudophake : modèle prédictif de récidive.<br />
Pseudophakic retinal detachment: recurrence prognosis model.<br />
BECQUET F*, LE ROUIC JF, DUCOURNAU D (Nantes)<br />
But : Les buts de l’étude étaient d’identifier les facteurs pronostiques chez des<br />
patients phakes ou pseudophakes opérés de décollement de rétine et de proposer,<br />
à l’aide d’un score, un modèle prédictif de récidive.<br />
Matériel et Méthode : Cette étude rétrospective a concerné 3098 patients opérés<br />
consécutivement de décollement de rétine par vitrectomie et/ou indentation épisclérale.<br />
Seuls les patients n’ayant pas été opérés antérieurement d’une pathologie rétinienne<br />
ont été inclus dans cette étude. Dix variables cliniques ont été étudiées en<br />
analyse univariée. Les variables liées à la récidive ont été incluses dans un modèle<br />
de Cox. Un score a été établi à partir du coefficient de régression bêta des variables<br />
statistiquement liées à la récidive en analyse multivariée.<br />
Résultats : Le taux de récidive après le premier traitement chirurgical a été de 8 %<br />
(249 sur 3098) avec un taux d’échec final de 3 % (95 sur 3098). L’étude univariée a<br />
montré que 5 des 10 variables étaient liées à la récidive. Le modèle de Cox a isolé<br />
3 variables indépendantes : la forte myopie (> –6,00) (p = 0,002), la capsulotomie au<br />
laser Yag dans les 6 mois précédant le décollement de rétine (p = 0,02), la pseudophakie<br />
compliquée (p < 0,0001). Les coefficients de régression bêta de ces<br />
3 variables ont permis d’établir un score qui a discriminé les patients en 3 sous-groupes<br />
de pronostic différent. Les risques de récidive de ces 3 sous-groupes ont été<br />
respectivement à 6 mois de 7 %, 15 % et 25 %.<br />
Commentaire et Conclusions : Les yeux pseudophakes restent fragiles en comparaison<br />
des yeux phakes lorsqu’un décollement de rétine survient. Ce modèle<br />
devrait permettre de mieux estimer la probabilité de développer une récidive de<br />
décollement de rétine et d’identifier ces patients à risque.<br />
21 14<br />
Délai de survenue du décollement de rétine chez le pseudophaque de chambre<br />
postérieure.<br />
Retinal detachment onset delay in posterior chamber pseudophakic patient.<br />
LE ROUIC JF*, DUCOURNAU D, BECQUET F (Nantes)<br />
But : La majorité des études ayant cherché à déterminer le risque ou le délai de<br />
survenue du décollement de rétine après pseudophaquie de chambre postérieure<br />
non compliquée ont observé un délai moyen de survenue de l’ordre d’une année<br />
après phakoexérèse, mais avec un recul moyen d’étude court. Le but de cette étude<br />
est de déterminer ce délai moyen de survenue sur une série de grande taille homogène,<br />
mais avec un recul d’examen plus long.<br />
Matériel et Méthode : Analyse rétrospective du délai de survenue du décollement<br />
de rétine sur 706 dossiers de patients pseudophaques de chambre postérieure sans<br />
rupture capsulaire peropératoire opérés de décollement de rétine de première intention<br />
par la suite.<br />
Résultats : Le délai moyen de survenue du décollement après phacoexérèse est<br />
fonction du recul d’étude ; il passe de 2 ans et 7 mois pour la totalité des<br />
706 dossiers (avec une médiane à 2 ans et 19,6 % de DR après 5 ans), à 4 ans et<br />
9 mois pour les malades dont le recul minimum après phacoexérèse est de 10 ans<br />
(avec une médiane à 4 ans et 37 % de DR après 5 ans).<br />
Commentaire et Conclusions : Si le nombre de décollements de rétine survenant<br />
après phakoexérèse sans rupture capsulaire décroît régulièrement au cours du suivi,<br />
cette complication persiste à travers le temps. Les études sur le risque de survenue<br />
du décollement de rétine chez le pseudophaque doivent tenir compte de ce risque<br />
de survenue tardive.<br />
21 15<br />
Étude contrôlée, prospective, randomisée de l’efficacité d’une anesthésie<br />
péribulbaire associée à l’anesthésie générale dans la chirurgie du décollement<br />
de rétine.<br />
Prospective randomised controlled study of combined peribulbar and general<br />
anesthesia during retinal detachment surgery.<br />
TCHAPLYGUINE F*, MOREL J, THURET G, PASCAL J, PERRET D, ROUSSIER M,<br />
AUBOYER C, MAUGERY J, GAIN P (Saint-Etienne)<br />
But : La période post opératoire de la chirurgie du décollement rétinien (DR) est souvent<br />
douloureuse. Le but de notre étude était d’évaluer l’intérêt de l’association analgésie<br />
péribulbaire (APB) anesthésie générale (AG) dans cette indication.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective contrôlée randomisée en double insu.<br />
Soixante deux patients opérés de DR sous AG (propofol-remifentanil) et consentants<br />
ont été randomisés en 2 groupes égaux : groupe APB (ropivacaïne 1 %) et<br />
groupe témoin (sous cutanée de sérum physiologique). La mesure des paramètres<br />
d’évaluation était réalisée à l’aveugle par un médecin indépendant. En peropératoire,<br />
les épisodes de bradycardie par réflexe oculocardiaque (ROC) étaient<br />
notés et le saignement per-opératoire coté par le chirurgien en 0 = saignement<br />
absent ; 1 = saignement non gênant ; 2 = saignement gênant la chirurgie. En<br />
postopératoire, l’analgésie était assurée par paracétamol et pompe de néfopam<br />
contrôlée par le patient lui-même. En cas de douleur supérieure à 4 mesurée par<br />
échelle visuelle analogique (EVA), un antalgique supplémentaire était injecté.<br />
L’EVA, la consommation de néfopam, l’incidence des nausées-vomissements<br />
étaient évaluées pendant 48 heures. Critère principal d’évaluation : consommation<br />
d’analgésique post opératoire. Analyse statistique : Chi-deux et test t de<br />
student.<br />
Résultats : Les groupes étaient comparables pour les données démographiques et<br />
les paramètres chirurgicaux. En per-opératoire, le saignement était moins important<br />
(1 vs 11 patients cotés à 2, p = 0,001), la durée d’intervention plus courte (59 +/-<br />
24 mn vs 76 +/-32 mn, p < 0,05). et le nombre de ROC moins important (6 ROC uniques<br />
vs 8 ROC répétés, p = 0,038) pour le groupe APB que le groupe témoin. En<br />
post-opératoire, l’incidence des nausées-vomissements était comparable dans les 2<br />
groupes mais la consommation de néfopam (p < 0,001) jusqu’à 12 heures et la<br />
demande d’antalgique supplémentaire plus faible dans le groupe APB comparée au<br />
groupe témoin.<br />
Commentaire et Conclusions : L’APB à la ropivacaïne en complément de l’AG<br />
améliore la prise en charge de la douleur per et post-opératoire. Elle semble en outre<br />
de limiter les ROC, le saignement et la durée de la chirurgie.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S173
1S174<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
NÉO-VAISSEAUX – DMLA – DÉCOLLEMENT DE RÉTINE – NEURO-OPHTALMOLOGIE<br />
21 16<br />
Décollement de rétine post-laser excimer. Étude multicentrique rétrospective : à<br />
propos de 15 cas.<br />
Retinal detachment (RD) post Laser excimer. Retrospective multicenter study: a<br />
15 cases report.<br />
FEKI J*, TRIGI A, CHAABOUNI M, BEN SALAH S (Sfax, Tunisie), BOUACIDA B<br />
(Tunis, Tunisie), CHECHIA N, ZAYANI A, NOUIRA F (Sousse, Tunisie), DAGHFOUS F,<br />
AYED S, KAMOUN M (Tunis, Tunisie)<br />
But : La chirurgie réfractive par LASIK ou PKR est destinée généralement pour une<br />
population de myope.<br />
À partir d’une étude multicentrique, les auteurs ont pu recenser un certain nombre<br />
de DR apparu après chirurgie réfractive par laser excimer et ont discuté le rôle joué<br />
par les techniques utilisées dans sa genèse.<br />
Matériel et Méthode : Quatre centres disposant de 8 lasers excimer ont participé<br />
à cette étude, 22 700 yeux ont bénéficié d’une chirurgie réfractive myopique.<br />
Résultats : Le délai moyen de survenue du DR était de 20 mois avec des extrêmes<br />
allant de 2 mois à 7 ans. L’indication opératoire était de mise chez tous les patients<br />
sauf un à cause d’une PVR très avancée. 15 yeux de 13 patients ont développé un<br />
DR rhègmatogène dont 2 étaient bilatéraux la cornée n’a pas empêché une bonne<br />
visualisation du fond d’œil en per ou en post opératoire. La rétine a été réappliquée<br />
dans 12 cas avec 2 échecs et une abstention.<br />
Commentaire et Conclusions : La survenue spontanée de DR rhegmatogène<br />
chez la population de myopes est estimée à 2 %, elle est de l’ordre de 0,1 %<br />
dans une population d’emmétrope. Le laser excimer par son effet thermique<br />
induit par l’onde de choc, le traumatisme subi par l’anneau de succion lors du<br />
lasik pourrait majorer ce risque chez le myope, une revue de la littérature a mis<br />
en doute cette hypothèse. Ce présent travail d’un grand échantillon de myope<br />
(22 700) ayant subi un traitement réfractif par Laser Excimer (Lasik et/ou PKR)<br />
suggère que ce type de chirurgie puisse provoquer des lésions iatrogènes de la<br />
jonction vitréo-rétinienne. L’incidence faible du DR post excimer du myope<br />
retrouvée dans la littérature et également dans notre étude (entre 0,06 et 0,09 %<br />
contre 2 % pour ceux qui n’en ont pas eu) serait expliquée par la pratique d’un<br />
examen systématique de la périphérie du fond d’œil et par le traitement préventif<br />
des lésions dégénératives. La manipulation de la cornée au cours de la chirurgie<br />
du DR doit être minutieuse car le volet pratiqué lors du lasik peut se décoller<br />
comme ça été décrit dans la littérature. La chirurgie réfractive par Lasik ou PKR<br />
destiné pour les myopes forts majorerait le risque d’apparition de décollement<br />
de rétine, l’examen systématique de la périphérie du fond d’œil et la photocoagulation<br />
préventive en diminuent l’incidence.<br />
21 17<br />
Tomographie en cohérence optique dans le décollement de rétine<br />
rhegmatogène.<br />
Optical coherence tomography in rhegmatogenous retinal detachment.<br />
AZAN F*, HOLLARD P, BREZIN A, CHAUVAUD D (Paris)<br />
But : Les modalités de récupération visuelle après chirurgie de décollement de rétine<br />
sont incomplètement comprises. Le but de cette étude est de confronter la récupération<br />
visuelle avec la réapplication du neuroépithélium objectivé par la tomographie<br />
en cohérence optique (OCT).<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de 20 patients, âge moyen 56 ans, ayant<br />
présentés un décollement de rétine rhègmatogène avec soulèvement maculaire<br />
traité chirurgicalement par voie ab-externo. Tous les patients avaient en post-opératoire<br />
une rétine réappliquée au biomicoscope. Les paramètres étudiés étaient : la<br />
fonction visuelle (EDTRS, réfraction et vision des couleurs) ainsi que l’aspect biomicroscopique.<br />
Tous les patients ont eu un examen OCT entre 1 et 12 mois post-opératoire.<br />
Résultats : L’analyse de l’acuité visuelle post-opératoire mettait en évidence une<br />
récupération visuelle incomplète et/ou retardée. L’étude de l’OCT a permis une analyse<br />
morphologique du neuroépithélium. Il existe une corrélation entre la mauvaise<br />
récupération visuelle et la persistance de liquide sous fovéolaire en post-opératoire.<br />
Dans un certain nombre de cas malgré un aspect OCT satisfaisant on notait une<br />
mauvaise récupération visuelle.<br />
Commentaire et Conclusions : L’OCT permet de mieux comprendre la récupération<br />
visuelle après chirurgie de décollement de rétine.<br />
NEURO-OPHTALMOLOGIE<br />
21 18<br />
Prise en charge de la neuropathie optique de l’orbitopathie dysthyroïdienne.<br />
Treatment of the optic neuropathy in dysthyroïd orbitopathy.<br />
OBERIC A* (Nantes), VIGNAL-CLERMONT C, HAMEDANI M, BAK C, BEN AYED H<br />
(Paris), COCHEREAU I (Angers), MORAX S (Paris)<br />
But : Étudier les caractéristiques de la neuropathie optique de l’orbitopathie dysthyroïdienne<br />
chez 15 patients et évaluer les résultats fonctionnels après traitement<br />
médicochirurgical.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de 15 patients (10 femmes et 5 hommes,<br />
55,4 ans en moyenne) pris en charge entre 1988 et 2002 pour neuropathie optique<br />
compliquant une orbitopathie dysthyroïdienne. Le suivi moyen était de 21,9 mois.<br />
Résultats : Au moment du diagnostic, l’atteinte était bilatérale dans 86 % des cas.<br />
Ces patients présentaient une baisse de l’acuité visuelle dans 93 % des cas, une<br />
altération de la vision des couleurs précédent la baisse visuelle dans 13 % des cas,<br />
une pupille de Günn dans 20 % des cas, une anomalie au fond d’œil dans 60 % des<br />
cas, une hypertonie oculaire dans 100 % des cas, des troubles oculo-moteurs dans<br />
100 % des cas et des anomalies campimétriques dans 90 % des cas. Le traitement<br />
comportait une corticothérapie et une décompression orbitaire chirurgicale. L’acuité<br />
visuelle est passée de 2,5/10 au moment du diagnotic à 6/10 en post-opératoire. Le<br />
champ visuel a été amélioré dans 93 % des cas.<br />
Commentaire et Conclusions : La gravité de cette pathologie implique qu’elle soit<br />
traitée en urgence. Les facteurs de mauvais pronostic sont : délais de prise en<br />
charge longs, patient âgé, site de décompression chirurgicale trop antérieur, mécanisme<br />
vasculaire de la neuropathie optique.<br />
21 19<br />
Hypertension intracrânienne bénigne : aspects cliniques et facteurs<br />
pronostiques chez 46 patients.<br />
Benign intracranial hypertension: clinical profile and prognostic factors in 46 patients.<br />
PITAULT G*, LAPLACE O, VOEGTLE R, BENRABAH R, DI NOLFO M, BOURCIER T,<br />
ASSARAF M, POISSON F, NORDMANN JP (Paris)<br />
But : L’hypertension intracrânienne bénigne est définie par une élévation de la pression<br />
du liquide cérébro-rachidien en l’absence d’un processus expansif intracrânien ou d’une<br />
hydrocéphalie. Le pronostic visuel, habituellement favorable, peut être menacé au<br />
décours de cette pathologie. Le but de ce travail est de préciser le profil clinique des<br />
patients atteints d’hypertension intracrânienne bénigne, d’évaluer l’évolution de leur fonction<br />
visuelle et de mettre en évidence les facteurs de mauvais pronostic visuel.<br />
Matériel et Méthode : Cette étude rétrospective a inclus 46 patients, suivis entre<br />
1992 et 2002, atteints d’hypertension intracrânienne bénigne selon les critères de<br />
Dandy. L’évolution de l’acuité visuelle et des champs visuels ainsi que les changements<br />
du fond d’œil ont été particulièrement étudiés. Une exploration neuro-radiologique<br />
a été systématiquement réalisée.<br />
Résultats : Les 46 patients, 39 femmes et 7 hommes, ont été suivis sur une période<br />
moyenne de 21,6 mois. L’âge moyen au diagnostic était de 30,7 ans et 34 patients<br />
(73,9 %) étaient obèses. Les céphalées, retrouvées chez 80,4 % des patients, étaient le<br />
signe d’appel le plus fréquent. Des troubles visuels ont été ressentis dans plus de 80 %<br />
des cas. Un déficit visuel modéré à sévère est survenu chez 5 patients (10,9 %), associé<br />
de façon significative avec un long délai diagnostique (p < 0,001) et un âge élevé (p < 0,01).<br />
Commentaire et Conclusions : Le pronostic visuel est bon pour la majorité des<br />
patients atteints d’hypertension intracrânienne bénigne, cependant notre étude a mis en<br />
évidence dans plus de 10 % des cas un déficit visuel important. Du fait du caractère insidieux<br />
et imprévisible des altérations du champ visuel, un suivi régulier est impératif.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
NÉO-VAISSEAUX – DMLA – DÉCOLLEMENT DE RÉTINE – NEURO-OPHTALMOLOGIE<br />
21 20<br />
Influence de l’astigmatisme réglé sur l’activation du cortex visuel : évaluation en<br />
IRM fonctionnelle.<br />
Influence of regular astigmatism on activation of visual cortex: an fMRI study.<br />
SHIBA T*, NGUYEN TH, IBA-ZIZEN MT, STIEVENART JL, LEROUX-LES-JARDINS S<br />
(Paris), YOSHIDA M, IDA M, KIKUCHI S, HARA T, KUBO H (Tokyo, Japon),<br />
CABANIS EA (Paris), KITAHARA KENJI (Tokyo, Japon)<br />
But : Déterminer l’influence de l’astigmatisme réglé (conforme à la règle ou inverse)<br />
sur l’activation du cortex visuel en IRM fonctionnelle.<br />
Matériel et Méthode : Un témoin volontaire, adulte présumé sain, est examiné sur<br />
IRM 1,5 T, en séquences d’imagerie Echo-planar. Trois types de stimulation sont<br />
réalisés ; 1° : Fixation d’un point au centre d’une grille verticale ou horizontale fixe.<br />
2° et 3° : Activations par grille verticale (2°) et par grille horizontale (3°), les grilles<br />
scintillant à la fréquence temporelle de 4 Hz avec la fréquence spatiale de 15’. Chaque<br />
stimulation est présentée selon trois conditions (A° : Interposition d’une lentille<br />
rigide, correspondant à l’emmétropie sans astigmatisme. B° : Lentille rigide avec<br />
objectif cylindrique de +6,00D@0°, imitant l’astigmatisme inverse. C° : Lentille rigide<br />
avec objectif cylindrique de +6,00D@90°, imitant l’astigmatisme conforme à la règle).<br />
Les données sont transformées (logiciel interne Image-calculator) puis analysées par<br />
le logiciel SPM’ 99 (Statistical Parametric Mapping).<br />
Résultats : La stimulation par grille verticale (2°) en conditions A° et B° et par grille<br />
horizontale (3°) en conditions A° et C°, montrent une activation significative dans les<br />
cortex visuels. La stimulation en grille verticale en condition C° (astigmatisme<br />
conforme à la règle avec la grille verticale), et la stimulation en grille horizontale en<br />
condition B° (astigmatisme inverse avec la grille horizontale), donnent une moindre<br />
activation dans les cortex visuels.<br />
Commentaire et Conclusions : L’IRMf a précisément détecté l’influence de l’astigmatisme<br />
réglé sur le cortex visuel. Nos résultats suggèrent que l’IRMf est une technique<br />
efficace pour l’évaluation objective de la réfraction.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S175
1S176<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
CATARACTE – CHIRURGIE RÉFRACTIVE – KÉRATOCÔNE<br />
CATARACTE<br />
21 21<br />
Valeur prédictive de l’ectopie cristallinienne dans le diagnostic de la maladie de<br />
Marfan.<br />
Predictiv value of ectopic lens in Marfan syndrome.<br />
DE SAINT JEAN M*, BOGOTEAN D, BOILEAU C, CHEVALIER B, JONDEAU G, LE<br />
PARC JM, MOURA B, MUTI C, BAUDOUIN C (Asnières)<br />
But : Le syndrome de Marfan est une maladie héréditaire à transmission autosomique<br />
dominante qui touche essentiellement le système cardio-vasculaire, le<br />
squelette et l’œil. Le signe majeur de l’atteinte oculaire est l’ectopie du cristallin<br />
et sa détection est souvent décisive pour poser avec certitude le diagnostic de<br />
la maladie. Le but de ce travail a été de déterminer la valeur diagnostique de la<br />
présence de l’ectopie du cristallin dans une population caractérisée génétiquement.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons analysé les données de 198 patients (parmi<br />
1 250 vus en consultation multidisciplinaire du syndrome de Marfan) qui ont été<br />
génétiquement caractérisés selon la présence ou non de l’allèle muté du gène de<br />
fibrilline-1 responsable de la maladie, ce qui a été établi de manière indirecte par<br />
l’étude de liaison génétique au sein d’une famille atteinte. La position du cristallin<br />
a été qualifiée selon 4 types : position normale (absence d’ectopie), visibilité des<br />
zonules inférieures et du bord cristallinien inférieur (ectopie débutante < 1 mm),<br />
déplacement du cristallin d’environ 1 mm par rapport au limbe (ectopie modérée<br />
= 1 mm) et ectopie > 1 mm (ectopie franche). Les pourcentages de ces différents<br />
types ont été calculés pour chaque sous-groupe de patients (porteurs n = 126 et<br />
non-porteurs n = 72).<br />
Résultats : L’absence d’ectopie cristallinienne a été observée chez 94 % des<br />
patients sains et chez 42 % des patients atteints, porteurs de la mutation. La visibilité<br />
des zonules inférieures et du bord cristallinien inférieur a été détectée chez<br />
3 % des non-porteurs et chez 18 % des porteurs de la maladie (p < 0,001). L’ectopie<br />
de 1 mm a été absente chez les non-porteurs et existait chez 9 % des patients<br />
atteints. L’ectopie franche (>1 mm) existait chez 3 % des non-porteurs et chez<br />
32 % des porteurs du gène muté. Ainsi, le signe d’ectopie modérée ou franche<br />
(égale ou supérieure à 1 mm) présentait le meilleur rapport entre la spécificité et<br />
la sensibilité du test diagnostique (Sp = 0,98 ; Se = 0,4) avec une valeur prédictive<br />
positive de 97 %. L’ectopie < 1 mm, considérée jusqu’à maintenant comme une<br />
variante du phénotype normal, constitue, en fait, un signe de la maladie de forte<br />
spécificité (Sp = 0,97) mais de faible sensibilité (Se = 0,18), et avec une valeur prédictive<br />
positive de 87 %.<br />
Commentaire et Conclusions : La présence d’une visibilité des zonules inférieures<br />
et du bord cristallinien inférieur est plus fréquente chez des patients atteints de la<br />
maladie de Marfan, et peut donc être considérée comme un signe en faveur de la<br />
maladie de Marfan chez les patients examinés en consultation multidisciplinaire.<br />
21 22<br />
Instillations ou insert dans la chirurgie de la cataracte : une approche<br />
cardiovasculaire.<br />
Eyedrops or insert in cataract surgery: a cardiovascular approach.<br />
SOUQUET-GUIGON B*, BAZIN S, MACAREZ R, DE LA MARNIERRE E (Metz)<br />
But : Le but de l’étude est de vérifier les répercussions cardiovasculaires liées au<br />
passage systémique de la néosynéphrine et du tropicamide délivré sous deux formes<br />
différentes, l’une sous forme d’instillation et l’autre sous forme d’insert.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons pris un échantillon de 50 patients venant se faire<br />
opérer de cataracte sénile sans complications préalables : un groupe reçoit la néosynéphrine<br />
et le tropicamide sous forme d’instillation, l’autre sous forme d’insert. Les<br />
instillations sont réparties à raison d’une goutte de chaque à 5 minutes d’intervalle,<br />
3 fois, l’insert est simplement déposé dans le cul de sac conjonctival. Les patients<br />
bénéficient d’une analyse électrocardiographique continue et de prise tensionnelle<br />
régulière, avant et après l’instillation pendant une durée de 3 heures.<br />
Résultats : Il existe une différence significative entre les deux groupes du point de<br />
vue tensionnel et cardiovasculaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Les auteurs pensent que la diffusion d’une moindre<br />
quantité de tropicamide et de néosynéphrine délivrée en continu pour l’insert est à<br />
l’origine de cette différence.<br />
21 23<br />
Apport de l’anesthésie intracamérulaire dans la chirurgie de la cataracte.<br />
Intracamerular anesthesia in cataract surgery.<br />
BOULET F*, RANGUIN M, ISNARD C, MERCIER C, PISELLA PJ (Tours)<br />
But : Comparer l’efficacité analgésique de l’anesthésie péribulbaire et de l’anesthésie<br />
intracamérulaire avec ou sans sédation intraveineuse dans la chirurgie de la cataracte<br />
de l’adulte opéré par phakoémulsification.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective réalisée sur 45 patients randomisés en<br />
trois groupes. Un groupe représentant les patients opérés sous anesthésie péribulbaire,<br />
un autre sous anesthésie intracamérulaire et un sous anesthésie intracamérulaire<br />
avec sédation intraveineuse. Le score de douleur a été recueilli, avec une<br />
échelle verbale analogique cotée de 0 à 10 (0 correspondant à l’absence de douleur,<br />
10 à une douleur insupportable). Un examen de l’endothélium cornéen a été réalisé<br />
en pré-opératoire puis à un mois post-opératoire.<br />
Résultats : Le score de douleur liée à l’acte anesthésique était de 1,97 (± 2,34), celui<br />
liée à l’intervention était de 1,09 (± 1,27). Les douleurs étaient statistiquement plus<br />
élevées dans le groupe anesthésie péribulbaire comparé aux deux autres groupes (p<br />
< 0,05). Il n’existait pas de différence significative pour les paramètres endothéliaux<br />
entre les trois groupes à un mois.<br />
Commentaire et Conclusions : L’anesthésie intracamérulaire procure une analgésie<br />
de qualité pour la chirurgie de la cataracte comparée à l’anesthésie péribulbaire,<br />
sans toxicité endothéliale. La sédation intraveineuse n’apporte pas de véritable<br />
bénéfice au patient.<br />
21 24<br />
Anneaux capsulaires : pourquoi et comment les poser ?<br />
Capsular tension ring: why and how to put it in the bag?<br />
HEHN F* (Vandœuvre)<br />
But : Après un bref rappel de l’historique et de l’intérêt croissant de l’anneau décrits<br />
dans la littérature, notamment dans la prévention de l’opacification de la capsule<br />
postérieure.<br />
Matériel et Méthode : L’auteur présente les différentes techniques d’insertion d’un<br />
anneau dans le sac capsulaire, à l’injecteur ou à la pince.<br />
Résultats : L’exposé s’attache en particulier à montrer les astuces opératoires pour<br />
passer le 1 er œillet sous le rhexis antérieur, éviter de léser la capsule, résoudre et<br />
prévenir l’anneau « in out ».<br />
Commentaire et Conclusions : La pose d’un anneau intra capsulaire s’avère utile,<br />
facile, rapide et non traumatique.<br />
21 25<br />
Évaluation de l’efficacité à six ans du capsulorhexis postérieur dans la<br />
prévention de la cataracte secondaire chez l’adulte.<br />
Evaluation of the interest of posterior capsulorhexis against posterior capsular<br />
opacification in adult at six years follow-up.<br />
SALSOU E*, CONAN L, RUIZ S, BILLOTTE C (Caen)<br />
But : En 1991 Gimbel a décrit la technique du capsulorhexis postérieur. Certains ont<br />
proposé le capsulorhexis postérieur dans la prévention de la cataracte secondaire.<br />
Matériel et Méthode : Trente-neuf yeux (sur 59) ayant bénéficié d’un capsulorhexis<br />
postérieur sans vitrectomie antérieure ont pu être suivis avec un recul moyen de<br />
6,28 ans. Toutes les interventions étaient des phakoémulsifications avec capsulorhexis<br />
antérieur et postérieur, et mise en place d’un implant en PMMA à optique à<br />
bord arrondi. L’âge moyen des patients est de 54,9 ans. Le taux de cataracte secondaire<br />
a été évalué.<br />
Résultats : 17/38 yeux ont présenté une cataracte secondaire par fermeture complète<br />
de l’aire du capsulorhexis postérieur par une couche épaisse de cellules épithéliales,<br />
nécessitant un traitement par laser YAG, soit une proportion de 43,6 %. Le<br />
délai moyen du traitement par YAG est de 3,04 ans. Deux décollement de rétine ont<br />
été observés.<br />
Commentaire et Conclusions : L’absence de capsule postérieure n’est pas une<br />
condition suffisante pour éviter la prolifération et la migration des cellules épithéliales,<br />
qui peuvent pousser sur la hyaloïde antérieure. Le taux de cataracte secondaire<br />
n’est pas différent de celui qui est observé en l’absence de capsulorhexis postérieur.<br />
La réalisation d’un capsulorhexis postérieur ne conduit pas à une diminution du taux<br />
de cataracte secondaire chez l’adulte. Le rapport benéfice/risque ne semble par en<br />
faveur de cette technique en routine dans la chirurgie de la cataracte.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
21 26<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
CATARACTE – CHIRURGIE RÉFRACTIVE – KÉRATOCÔNE<br />
Intérêt de l’anneau de Cionni à fixation sclérale dans les désinsertions zonulaires<br />
traumatiques étendues.<br />
Interest of the Cionni modified capsular tension ring with scleral fixation in profound<br />
traumatic zonular dialysis.<br />
ROUSSEL B*, POUCHOT A, PERGOLA A, HANSEN C, BILLOTTE C (Caen)<br />
But : Les désinsertions zonulaires traumatiques très étendues (supérieures à 140°)<br />
présentent des difficultés chirurgicales importantes.<br />
Matériel et Méthode : Deux cas de désinsertions étendues avec hernie du vitré<br />
dans la chambre antérieure, hypertonie importante, cataracte avec subluxation du<br />
cristallin, sont présentées. Le traitement chirurgical a consisté en l’ablation du cristallin<br />
par phacoémulsification après capsulorhexis antérieur, la mise en place d’un<br />
anneau de tension capsulaire classique, puis d’un deuxième anneau de Cionni,<br />
suturé à la sclère en regard du milieu de la zone de désinsertion zonulaire. L’implant<br />
a été mis dans le sac et une vitrectomie antérieure a été associée.<br />
Résultats : Les deux patients ont un implant centré dans un sac stabilisé. L’acuité<br />
visuelle postopératoire est excellente, avec une hypertonie maîtrisée.<br />
Commentaire et Conclusions : Les anneaux de tension capsulaire classiques ne<br />
permettent pas de traiter efficacement des désinsertions zonulaires très étendues<br />
avec déplacement du cristallin. Les anneaux de Cionni stabilisent et recentrent le<br />
sac, permettent de conserver un plan capsulaire, et d’implanter dans le sac. Les<br />
auteurs décrivent la technique de mise en place de ce type d’anneau. Les anneaux<br />
de Cionni paraissent être une bonne solution chirurgicale aux désinsertions traumatiques<br />
étendues avec subluxation du cristallin. La technique de mise en place de<br />
l’anneau est malgré tout de réalisation difficile.<br />
CHIRURGIE RÉFRACTIVE<br />
21 27<br />
Traitement de l’hypermétropie et de l’astigmatisme hypermétropique par<br />
kératoplastie conductive.<br />
Conductive keratoplasty as a treatment of hypermetropic and astigmatic eye defect.<br />
PICCO RJ*, ALLENDE JP (Santa Fe, Argentine)<br />
Purpose: Describe and show our experience with conductive keratoplasty in the<br />
treatment of 131 eyes treated between august 2000 and November 2001.<br />
Material and Method: Modification of original nomograms. The importance of<br />
variables such as intraocular pressure, cornal diameter, age, pachymetry and corneal<br />
curvature.<br />
Results: The treated group with more of than 1 year of follow up, will be described.<br />
The efficacy of the procedure in the treatment of low hyperopia (1 – 3 D) and astigmatic<br />
defects, was improved compared with the original method.<br />
Comment and Conclusion:<br />
– the modifications of refraction defects are stable;<br />
– the method is very simple;<br />
– allows to improve the VA;<br />
– satisfaction of the patient is high.<br />
21 28<br />
Laser Sub-Epithélial Keratomileusis (LASEK). Une nouvelle option en chirurgie<br />
réfractive.<br />
Laser Sub-Epithélial Keratomileusis (LASEK) – A new alternative in refractive<br />
surgery.<br />
ACOSTA J* (Buenos Aires, Argentine)<br />
But : Nous présentons notre expérience du LASEK dans des cas de myopie, hypermétropie<br />
et d’astigmatisme, pour évaluer son efficacité, sécurité et stabilité comme<br />
technique de chirurgie réfractive.<br />
Matériel et Méthode : L’étude rétrospective non-comparative d’une série de<br />
53 yeux de 32 patients consécutifs traités en Lasek, par un même chirurgien, suivant<br />
la technique de M. Camellin. Le rang du vice de réfraction sphérique était entre –7 à<br />
–2 dioptries (D) pour les myopes, +1 à +5 D parmi les hypermétropes et entre –5 à<br />
+ 4,5 D pour les astigmatismes. Le laser Excimer utilisé est un Schwind Esiris. Le<br />
suivi post-opératoire comprend 2 mois dans tous les cas et jusqu’à 13 mois dans les<br />
premières. Contrôles quotidiens jusqu’au quatrième jour, deux et huit semaines suivantes,<br />
tout en continuant tous les deux jusqu’aux huit mois.<br />
Résultats : Il n’y a pas des différence significative entre les yeux au cours du temps<br />
de la cicatrisation. Les douleurs post-opératoires son très limitées. À 2 mois postopératoire<br />
la réfraction est +/-0.50 D dans 45 yeux (84 %) et +/-1D en huit yeux<br />
(16 %). L’incidence de Haze n’est pas significative, voire nulle après le 2°mois postopératoire.<br />
Il n’y a pas de perte de la MAVC.<br />
Commentaire et Conclusions : Le Lasek est une alternative sûre et efficace, avec<br />
une forte réduction de la douleur post-opératoire, par rapport à la Photokératectomie<br />
Réfractive (PKR). L’incidence de Haze n’est pas significative. Elle peut éviter les<br />
complications ayant un rapport avec le volet et l’interphase cornéen du Lasik. Ses<br />
résultats doivent être évalués à long terme.<br />
21 29<br />
Traitement des erreurs réfractives chez des pseudophaques par le LASIK.<br />
LASIK for the treatment of pseudophakic refractive errors.<br />
TUNC Z*, BAHCECIOGLU H, UNAL M (Istanbul, Turquie)<br />
But : Nous avons analysé les résultats du LASIK pour l’amétropie ou l’anisomètropie<br />
chez des patients pseudophaques avec intolérance de lentille de contact ou des verres<br />
correcteurs.<br />
Matériel et Méthode : Nous présentons une étude rétrospective avec une série de<br />
7 yeux de 5 patients atteints d’une amétropie ou d’une anisométropie après avoir<br />
subi l’intervention de la cataracte dans notre service ou ailleurs. L’âge des patients<br />
varie de 64 à 76 ans. L’erreur réfractive est due au calcul de l’implant ou à la situation<br />
de l’implant dans la chambre postérieure.<br />
Résultats : Les patients ont été opérés par le LASIK 5 à 12 mois après l’intervention<br />
de la cataracte. 5 yeux ont été opérés par la technique de la phacoémulsification<br />
avec ICP et 2 yeux par extraction extracapsulaire avec ICP. 3 patients se plaignaient<br />
d’anisométropie car ils étaient phaques d’un œil. 2 patients opérés de 2 yeux qui<br />
souffraient de myopie et d’astigmatisme. Nous avons envisagé soit l’emmétropie soit<br />
une petite myopie en fonction du choix des patients. Nous avons obtenu une diminution<br />
de la myopie entre –1,8 et –6,2 dioptries. Nous n’avons pas eu de complication<br />
du capot cornéen ni au niveau de l’incision de la cataracte.<br />
Commentaire et Conclusions : Le LASIK dans le traitement des erreurs réfractives<br />
chez des pseudophaques apparaît comme une technique fiable et reproductible.<br />
21 30<br />
Résultats du Lasik chez les patients de plus de 45 ans avec la vision combinée<br />
(monovision).<br />
Results of combined vision with Lasik overs 45 years old.<br />
FALCON C*, ORTIZ F* (Valencia, Espagne), SOLER F (Gandia, Espagne)<br />
But : La presbytie est une condition qui peut rendre un peu moins satisfaisants les<br />
résultats du LASIK. La diminution du pouvoir d’accommodation du cristallin rend<br />
plus difficile l’adaptation post-opératoire. On a nommé « Vision Combinée » l’association<br />
d’un œil emmétrope et de l’autre œil avec une dioptrie de myopie. De cette<br />
façon, on peut atteindre une bonne vision de loin et une vision assez bonne pour<br />
certaines activités de près. Il nous a semblé intéressant de connaître les résultats<br />
obtenus avec le LASIK chez les patients de plus de 45 ans avec la « Vision<br />
Combinée » (monovision).<br />
Matériel et Méthode : On a étudié rétrospectivement 66 patients de plus de 45 ans<br />
(entre 45 et 72 ans) atteints de myopie, astigmatisme ou hypermétropie ayant bénéficiés<br />
du LASIK. Le Laser a été programmé pour l’emmétropie d’un œil et une dioptrie<br />
de myopie de l’autre œil. Les patients devaient avoir une vision semblable sur<br />
les deux yeux pour bénéficier de la « vision combinée » (0,2 ou moins de différence).<br />
Pour choisir l’œil sélectionné pour la myopie on demandait l’option que le patient<br />
préférait en posant une lentille de +1,00 dioptrie devant chaque œil. On a expliqué<br />
soigneusement que la “ vision combinée “ peut donner une vision assez bonne pour<br />
quelques activités de près, mais pas une vision parfaite de près.<br />
Résultats : 92,4 % des patients ont une vision de près de 0,6 (directoire téléphonique<br />
avec lumière) ou plus dans la première semaine après le LASIK, qui s’améliore<br />
plus en qualité qu’en quantité pendant le premier mois. Parmi ces patients-là, 95 %<br />
ont une vision confortable pour toutes les activités de loin et pour la majorité des<br />
activités de près, dans le premier mois après le LASIK. 85 % des patients avait entre<br />
–0,5 et –1,5 dioptries d’équivalent sphérique sur l’œil myope dans le premier mois.<br />
Il y a eu trois cas (4,5 %) qui ont eu la vision souhaitée, cependant ils ont préféré<br />
avoir une bonne vision de loin avec les deux yeux et ont bénéficié d’une reprise de<br />
LASIK sur l’œil myope. Il y a eu deux cas de sur-correction chez deux patients hypermétropes<br />
ayant entraîné une bonne vision de près, mais pas très bonne de loin.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S177
1S178<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
CATARACTE – CHIRURGIE RÉFRACTIVE – KÉRATOCÔNE<br />
Commentaire et Conclusions : La programmation de la « vision combinée »<br />
chez les patients de plus de 45 ans candidats pour le LASIK est une excellente<br />
option pour obtenir une bonne vision de loin et une assez bonne vision de près.<br />
Cependant, cette option n’est qu’une aide pour mieux voir de près et jamais la<br />
solution de la presbytie. La satisfaction des patients dépend de l’information<br />
pré-opératoire.<br />
21 31<br />
Critères de sélection des patients à une photoablation cornéenne assistée par<br />
aberrométrie (système Bausch et Lomb* ZYOPTIX* sur laser excimer<br />
Keracor 217z) dans le traitement de la myopie par LASIK.<br />
Selection of the patients for the wavefront customized ablation with the Bausch and<br />
Lomb ZYOPTIX* system in myopic laser in situ keratomileusis.<br />
TOROSSIAN T*, LAPLACE O, NORDMANN JP (Paris)<br />
But : Cette étude a pour but de vérifier et d’évaluer sur des critères objectifs et subjectifs<br />
l’apport de la personnalisation du traitement LASIK chez des patients myopes<br />
présentant des critères préopératoires d’aberrations optiques significatives.<br />
Matériel et Méthode : Quarante yeux myopes ont été opérés par LASIK personnalisé<br />
à l’aide du laser excimer Keracor 217z selon le système Zyoptix*, après analyse<br />
préopératoire comprenant un bilan visuel complet associé à une mesure des aberrations<br />
optiques. Les critères d’inclusion à cette étude sont : le diamètre pupillaire<br />
élevé en ambiance mésopique, la relative mauvaise acuité visuelle après correction,<br />
les limites chirurgicales imposées par une cornée trop fine, l’existence d’une franche<br />
augmentation des aberrations optiques après dilatation active de la pupille (élévation<br />
du PPR) confirmant l’impression des patients d’une aggravation franche de leur<br />
vision nocturne, importance de la diffraction d’un point lumineux projeté sur la rétine<br />
(élargissement du PSF), taux global des aberrations d’ordre élevé (HORMS). Le recul<br />
minimum est de 3 mois après intervention.<br />
Résultats : Cette étude mesure les facteurs de l’amélioration des aberrations visuelles<br />
après intervenion : diminution de la gêne visuelle subjective nocturne, évolution<br />
du PSF, stabilisation du PPR après dilatation, diminution des HORMS. L’aberrométrie<br />
préopératoire permet de mieux définir le défaut visuel préopératoire et de corriger<br />
au besoin la réfration subjective retenue pour l’intervention. Elle représente un moyen<br />
efficace de sélection des patients.<br />
Commentaire et Conclusions : L’apport de l’aberrométrie, technique non invasive,<br />
dans le choix de la photoablation personnalisée, représente une avancée décisive<br />
dans le domaine de la chirurgie réfractive. Elle permet de convertir, grâce à de nouveaux<br />
facteurs de mesure, les anomalies visuelles subjectives en critères d’évaluation<br />
objective. Ces critères pourraient être amenés à devenir, dans un proche avenir,<br />
des éléments du dossier médical aussi fondamentaux que la pachymétrie cornéenne.<br />
21 32<br />
Résultats de la photoablation personnalisée avec le logiciel Zyoptix ® dans le<br />
traitement de la myopie par Lasik.<br />
Results of Customised Ablation with Zyoptix ® in Lasik for myopia.<br />
ANCEL JM* (Neuilly Sur Seine)<br />
But : Analyse rétrospective des résultats réfractifs mais aussi aberrométriques de la<br />
photoablation personnalisée avec le système Zyoptix ® .<br />
Matériel et Méthode : L’analyse rétrospective porte sur 30 yeux myopes et/ou<br />
astigmates opérés selon la technique du Lasik avec un microkératome Hansatome ®<br />
et le logiciel Zyoptix ® du laser 217 Z. Les patients traités respectaient tous les critères<br />
d’inclusion du fabricant (en terme de myopie, astigmatisme, écart de réfraction<br />
entre subjective et celle mesurée par aberrométrie et enfin aberrations optiques<br />
d’ordre élevé). Les patients ont été revus à J1, J7, 1 mois, 3 mois, 6 mois.<br />
Résultats : Les résultats présentés sont ceux de la réfraction subjective avec acuité<br />
visuelle sans et avec correction, ainsi que les valeurs des abérrations optiques<br />
d’ordre élevé. Les resultats réfractifs montrent, à trois mois, une AVSC > 8/10 dans<br />
85 % des yeux et un ES moyen de +0,35D. La valeur moyenne des HORMS passe<br />
de 0,48 µ en pré-op à 0,78 µ en post-op.<br />
Commentaire et Conclusions : La photoablation personnalisée ne permets pas<br />
d’obtenir une supériorité des résultats réfractifs en terme d’acuité visuelle mais il<br />
semblerait qu’il induise moins d’aberrations optiques post-opératoire que le traitement<br />
standard.<br />
21 33<br />
Apport de l’aberrométrie pour le choix des lentilles multifocales.<br />
Aberrometry for multifocal contact lens selection.<br />
MALET F*, AGUSSAN J, COLIN J (Bordeaux)<br />
But : Les lentilles de contact représentent une option intéressante, simple, modulable<br />
pour la compensation optique de la presbytie. L’aberrométrie, par l’analyse du<br />
front d’ondes, permet une analyse innovante de la qualité de la vision.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons évalué par aberrométrie (Zywave et Ladarwave)<br />
les aberrations d’ordre supérieur induites par le port de lentilles de contact multifocales.<br />
Différents modèles de lentilles, de concepts optiques variables, ont été étudiées<br />
chez une série de patients presbytes ; pour une meilleure comparaison, les<br />
patients ont été équipés individuellement par des lentilles différentes.<br />
Résultats : Les résultats obtenus montrent une qualité de vision différente selon les<br />
différentes lentilles utilisées : il est particulièrement intéressant de noter que certains<br />
modèles entraînent de façon reproductive des abérrations d’ordre supérieur moins<br />
importantes.<br />
Commentaire et Conclusions : Les différences obtenues avec les différents modèles<br />
de lentilles multifocales permettent d’expliquer la variabilité de leur tolérance<br />
chez les patients. L’aberrométrie constitue une approche diagnostique nouvelle pour<br />
l’adaptation des lentilles multifocales : elle permet en particulier de prévoir la qualité<br />
de vision chez les patients.<br />
21 34<br />
Implantation multifocale versus lentilles de contact multifocales : comparaison<br />
des fonctions visuelles.<br />
Visual functions of multifocal intraocular lens and multifocal contact lens.<br />
ALBOU GANEM C* (Paris)<br />
But : Évaluation de l’acuité visuelle, de la sensibilité aux contrastes et de la satisfaction<br />
des patients implantés en multifocal ou porteurs de lentilles de contact multifocales.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective portant sur 10 patients implantés en<br />
bilatéral d’un implant multifocal « SA 40 » dans le cadre d’un Prelex ou du traitement<br />
d’une cataracte avec un recul allant de 2 ans à 1 mois et sur 10 patients équipés de<br />
lentilles multifocales « Acuvue Bifocales » dont le principe est équivalent au<br />
« SA 40 ».<br />
Résultats : Cette étude analyse l’acuité visuelle dans des conditions identique de<br />
luminosité, la sensibilité aux contrastes avec une planche test Galinettes, et les réponses<br />
à un questionnaire portant sur le degré de satisfaction et le degré d’indépendance<br />
des patients. Les résultats sont en cours d’analyse et seront exposés ultérieurement.<br />
Commentaire et Conclusions : Malgré quelques aléas, les patients implantés avec<br />
un « SA 40 » sont satisfaits des résultats et bénéficient d’une bonne indépendance<br />
vis à vis des verres correcteurs.<br />
21 35<br />
Qualité de la vision après chirurgie réfractive avec l’implant multifocal AMO<br />
Array.<br />
Quality of life and vision after refractive lens exchange with the Array multifocal<br />
intraocular lens.<br />
GANEM S*, FEBBRARO JL, BERBACHE S (Paris)<br />
But : Étudier la qualité de la vision, le degré de satisfaction de patients amétropes<br />
et/ou presbytes corrigés avec l’implant multifocal AMO Array.<br />
Matériel et Méthode : Cinquante patients traités au moins 6 mois auparavant ont<br />
rempli un questionnaire concernant leur confort visuel, l’évolution de l’acuité, leur<br />
besoin de correction pour conduire, regarder l’écran de télévision ou ordinateur, coudre,<br />
cuisiner… Des questions spécifiques sur les halos, l’éblouissement, la conduite<br />
nocturne sont posées. Le degré de satisfaction générale a été évalué.<br />
Résultats : Tous les patients – sauf un – ont confirmé l’amélioration du confort<br />
visuel. Dans tous les cas, on rapporte une amélioration de l’acuité de loin et de près<br />
sans correction. Si 93 % des patients ne portent jamais de lunettes pour conduire,<br />
87 % des patients n’ont jamais ou rarement besoin de lunettes pour lire. Cependant,<br />
40 % signalent des difficultés d’adaptation à l’obscurité, et 78 % des halos la nuit.<br />
Les auteurs rapportent les résultats visuels de 3 patients déçus.<br />
Commentaire et Conclusions : La chirurgie réfractive avec l’implant multifocal<br />
AMO Array est un traitement efficace de l’amétropie et/ou de la presbytie, avec un<br />
degré de satisfaction élevé des patients. Cependant, la vision nocturne et les halos<br />
restent, dans certains cas, le reproche majeur. Les patients doivent donc en être<br />
informés au préalable.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
CATARACTE – CHIRURGIE RÉFRACTIVE – KÉRATOCÔNE<br />
21 36<br />
Implants phakes pliables de chambre antérieure pour la correction des myopies<br />
modérées et forte (GBR-Vivarte) et de la presbytie (Newlife).<br />
Anterior Chamber Foldable Phakic IOL for correction of low and moderate Myopia<br />
(GBR-Vivarte) and of Presbyopia (Newlife).<br />
COCHENER B*, TANGUY C (Brest)<br />
But : Efficacité, prédictibilité et sécurité de l’implant pliable de chambre antérieure à<br />
appuis angulaires GBR–Vivarte pour le traitement de la myopie et du récent bifocal<br />
Newlife pour la correction de la presbytie.<br />
Matériel et Méthode : trente yeux reçurent cette lentille réfractive pour le traitement<br />
d’amétropies (de –8 à –21 D). 6 patients presbytes emmétropes, petits myopes ou<br />
hypermétropes furent implantés avec une lentille Newlife. Acuité visuelle, réfraction,<br />
biomicroscopie et qualité de la vision ont été évaluées sur 12 mois. Les complications<br />
potentielles exigent des mesures de la densité endothéliale, de la mobilité<br />
pupillaire et de la pression oculaire.<br />
Résultats : Aucune complication sévère n’a requis d’ablation d’implant. Nous reportons<br />
la survenue de 2 blocs pupillaires et d’un décentrement. Les implants semblent stables<br />
dans leur position et résultats réfractifs. Les pupilles larges devraient être évitées et<br />
la réalisation d’une procédure combinée à la photoablation reste d’intérêt en cas de<br />
cylindre associé. L’analyse du groupe presbyte montre une amélioration satisfaisante de<br />
la vision de loin et de près ainsi qu’un haut niveau de satisfaction des patients.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude préliminaire est prometteuse et devrait être<br />
comparée aux résultats issus des autres implants phakes. Un suivi prolongé s’impose pour<br />
le dépistage des complications tardives. Un développement des systèmes d’imagerie<br />
intraoculaires est nécessaire à l’affinement du dessin et de la taille des implants phakes.<br />
21 37<br />
Développement et sécurité du traitement par la lentille ICL.<br />
Development and security of the treatment with ICL.<br />
PAJIC B*, PALLAS G (Olten, Suisse)<br />
But : Le développement de la lentille phaque postérieur ICL avec optique plus fins,<br />
plus grand flexibilité, déploiement contrôlable, meilleure biocompatibilité et meilleur<br />
comportement de centrage a permis de les implanter de façon chirurgicale-réfractive<br />
dans l’œil myope avec une grande précision et sécurité. Non seulement le matériel<br />
utilisé mais aussi le design de la lentille IOL sont déterminant et permettant d’obtenir<br />
ces résultats après plusieurs étapes de développement.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons examiné 41 lentilles ICL consécutives. L’âge moyen<br />
des patients est de 36 ans. La lentille ICL a été implantée dans les cas où le défaut de vision<br />
pour des raisons biomorphologique ne pouvait être corrigé par Laser Excimer. L’équivalent<br />
sphérique moyen pré-opératoire se situe pour les yeux myopes à –10,55±5,00 dioptrie (-<br />
23,13 à –2,5) et pour les yeux hypermétropes à +6,56±1,97 dioptrie (3,5 à 9,25).<br />
Résultats : En postopératoire l’équivalent sphérique est de –0,29±0,93 dioptrie pour<br />
les yeux myopes et de –0,10±0,32 dioptrie pour les yeux hypermétropes. L’astigmatisme<br />
a pu être corrigé de 1,5 dioptrie en moyenne par un abord « clear corneal »,<br />
ceci indépendamment du rayon cornéen préopératoire (p = 0,42). 92 % resp. 100 %<br />
de tous les yeux ont atteint la correction visée à +/– 1 resp. 1,5 dioptrie. Nous avons<br />
eu 3 cas de complications à savoir une augmentation passagère de la pression<br />
intraoculaire et jusqu’à ce jour aucun cas de cataracte.<br />
Commentaire et Conclusions : À l’aide de la lentille ICL, nous pouvons atteindre<br />
une grande précision de réfraction. Le taux de complication reste controversé dans<br />
la littérature. Pour l’obtention d’une taux bas de complications sont déterminant<br />
d’une part la géométrie de la lentille et d’autre part la détermination exacte de la<br />
distance « blanc à blanc » afin d’éviter un contact fixe de la lentille. Nous avons<br />
constaté que la lentille ICL n’est pas adaptée pour des corrections de plus de –17<br />
dioptrie et nous privilégions dans ces cas la lentille Iris-claw IOL. L’implantation de<br />
l’ICL est une méthode chirurgicale sûre avec un taux de dispersion calculable.<br />
21 38<br />
Keratoplastie Lamellaire avec Laser (Pachy Link).<br />
Pachy link and laser lamellar keratoplasty.<br />
IBANEZ M*, CARRIAZO C (Barranquilla, Colombie)<br />
Purpose: A new system, “PACHY LINK”, and a new technique, “LASER LAMELLAR<br />
KERATOPLASTY” are introduced.<br />
Material and Method: “PACHY LINK” consists of a laser-assisted keratectomy performed<br />
on the receptor eye, linking the pachymetric data to the excimer laser in order<br />
to perform a successful Laser Refractive Lamellar Keratoplasty.<br />
The LLK method includes several steps:<br />
The mapping of the anterior and posterior surfaces of the patient’s cornea.<br />
The patient’s corneal pachymetry is used to identify the corneal thickness; and once<br />
this is established, to guide the surgical laser in the ablation of a layer in the anterior<br />
surface of the patient’s cornea in order to obtain the desired corneal bed. A corneal<br />
disk is retrieved from the anterior surface of the donor cornea.<br />
The donor corneal disk is immediately placed on the previously created corneal bed<br />
of the receptor patient’s cornea.<br />
Results: In 15 eyes, we achieved a smooth stromal bed with a thickness average of<br />
130 microns. In one case, which presented an anterior chamber perforation (Post-<br />
Radial-Keratotomy), we had to stop the laser ablation, since aqueous humor began<br />
to come out. In all the cases treated, we were able to improve the patient’s spectacle-corrected<br />
visual acuity after surgery.<br />
Comment and Conclusion: The “PACHY – LINK” system allows the performance<br />
of the Laser Refractive Lamellar Keratoplasty with an extremely high degree of transparency<br />
of the donor-receptor contact surfaces; it also provides excellent refractive<br />
results, and a low surgical risk.<br />
L’un des auteurs a un intérêt financier dans l’équipement, le procédé ou le produit<br />
présenté.<br />
KÉRATOCÔNE<br />
21 39<br />
Étude vidéophotokératoscopique du kératocône familial.<br />
Videokeratoscopic study of familial keratoconus.<br />
LEVY D*, MALECAZE F (Toulouse), ROULAND JF (Lille), HUTCHINGS H, ARNE JL,<br />
APTEL I (Toulouse)<br />
But : Détection de kératocônes infracliniques parmi les apparentés apparemment<br />
sains de forme familiale de keratocône afin de préciser les caractères vidéophotokératoscopiques<br />
des kératocônes frustes.<br />
Matériel et Méthode : Étude multicentrique de prévalence portant sur 23 familles<br />
comprenant 55 kératocônes cliniques, 89 apparentés de premier degré, 43 autres<br />
apparentés et un groupe témoin de 130 personnes. L’analyse vidéophotokératoscopique<br />
a été qualitative (classification de Bogan et coll. modifiée) en utilisant un incrément<br />
coloré de 0,5 Dioptrie et quantitative (K, AST, I-S, Srax, Kisa %). Des<br />
comparaisons statistiques ont été effecuées entre les cornées des différents groupes.<br />
Résultats : Deux formes de cornées sont statistiquement plus représentées<br />
parmi les apparentés de kératocône familial que parmi les témoins ; la forme J<br />
et la forme Jinv (une nouvelle image). Les résultats de l’analyse quantitative<br />
montrent que seules les valeurs de Srax, I-S et Kisa % sont élevées dans ces<br />
groupes suspects.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude réalisée sur un terrain clairement génétique<br />
de kératocône apporte de nouveaux éléments permettant la détection de kératocône<br />
d’expressivité faible. On pourrait appliquer avec prudence ces résultats à la<br />
population générale, notamment dans le cadre de la détection de contre-indications<br />
à la chirurgie réfractive. Cette étude constitue aussi la première étape d’un travail de<br />
génétique moléculaire.<br />
21 40<br />
Kératoplastie pour kératocône sur patients de moins de 18 ans.<br />
Keratoplasty for keratoconus in patients under 18 y. age.<br />
DEDES V*, BONNE M, JOURDEL D, CAILLIAU D, MALBREL F, LABALETTE P,<br />
ROULAND JF (Lille)<br />
But : Le but de cette étude est d’étudier les résultats des greffes de cornées chez<br />
des patients mineurs présentant un kératocône évolué.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons répertorié 11 patients mineurs greffés pour kératocône<br />
à partir de la base de données informatisée du service sur ces 5 dernières<br />
années. La moyenne d’âge était de 15,8 ans (de 12 à 17 ans). L’acuité visuelle<br />
moyenne pré-opératoire était inférieure à 1/10 (de perception des mouvements de la<br />
main à 2/10). 7 patients présentaient un kératocône stade IV et 4 patients présentaient<br />
un kératocône stade III. Ils ont tous bénéficié d’une kératoplastie transfixiante<br />
suturée par surjet et 8 points séparés. Le suivi moyen était de 2,5 années.<br />
Résultats : Tous les greffons étaient clairs avec une acuité visuelle supérieure à 5/<br />
10 dès le sixième mois post-opératoire. L’acuité visuelle moyenne à 12 mois était de<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S179
1S180<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
CATARACTE – CHIRURGIE RÉFRACTIVE – KÉRATOCÔNE<br />
8,2/10 avec correction optique (de 6/10 à 10/10). Le seul incident a été un surjet<br />
desserré de façon précoce à 4 mois. Aucun rejet n’a été observé.<br />
Commentaire et Conclusions : Les résultats fonctionnels ont été rapidement<br />
excellents avec une faible proportion de complication chez ces jeunes patients avec<br />
une acuité visuelle pré-opératoire basse.<br />
21 41<br />
Kératoplastie lamellaire profonde et kératocône : étude préliminaire.<br />
Deep lamellar keratoplasty in keratoconus: preliminary study.<br />
FOURNIE P*, ARNE JL (Toulouse)<br />
But : Le but de ce travail est d’étudier la kératoplastie lamellaire profonde dans le<br />
traitement chirurgical du kératocône comme une alternative à la kératoplastie transfixiante.<br />
Matériel et Méthode : Douze patients porteurs de kératocône ont été opérés par<br />
kératoplastie lamellaire profonde dans le cadre d’une étude prospective monocentrique<br />
non comparative. La dissection stromale profonde prédescemétique a été réalisée<br />
par injection intrastromale d’air et de substance viscoélastique. Un greffon<br />
allogénique débarrassé de son endothélium par simple frottement mécanique était<br />
ensuite suturé dans le lit du receveur. 3 microperforations de la membrane de Descemet<br />
du receveur ont nécessité une conversion en kératoplastie transfixiante. Les<br />
paramètres suivants ont été évalués : acuité visuelle, astigmatisme kératométrique,<br />
pression intra-oculaire, densité cellulaire endothéliale et nombre de rejets.<br />
Résultats : L’acuité visuelle moyenne pré-opératoire était de 0,13. À 3 mois, la<br />
meilleure acuité visuelle corrigée était de 0,22. L’astigmatisme moyen était de<br />
2,35 dioptries. Le comptage cellulaire endothélial ne retrouvait pas de diminution<br />
statistiquement significative par rapport au comptage pré-opératoire. Aucun cas de<br />
rejet n’a été observé.<br />
Commentaire et Conclusions : La kératoplastie lamellaire profonde est peu utilisée<br />
du fait de sa relative difficulté d’exécution. L’injection intrastromale d’air et de produit<br />
viscoélastique semble faciliter sa réalisation technique et améliorer la régularité de<br />
l’interface entre le donneur et le receveur. Ses avantages par rapport à la kératoplastie<br />
transfixiante sont d’être une chirurgie extraoculaire et de préserver l’endothélium<br />
cornéen du receveur. Les résultats fonctionnels en terme d’acuité visuelle, d’astigmatisme<br />
et de densité cellulaire endothéliale sont encourageants à court terme et<br />
font de la kératoplastie lamellaire profonde une alternative intéressante à la kératoplastie<br />
transfixiante dans le kératocône.<br />
21 42<br />
Résultats réfractifs après kératoplastie transfixiante dans le kératocône. Étude<br />
comparative entre deux techniques de trépanation du donneur.<br />
Refractive outcome in penetrating keratoplasty for keratoconus. Comparative study<br />
of two techniques donor eyes trephination.<br />
VILLEROY F*, MURAINE M, VASSENEIX C, BRASSEUR G (Rouen)<br />
But : Évaluer et comparer de façon rétrospective l’amétropie sphérique, l’astigmatisme<br />
et la récupération visuelle de deux cohortes de patients opérés de kératoplastie<br />
transfixiante pour kératocône avec deux procédures de trépanation du donneur.<br />
Matériel et Méthode : L’étude clinique porte sur deux cohortes de 20 patients opérés<br />
selon deux procédures de trépanation chirurgicale du greffon au CHU de Rouen,<br />
à savoir l’utilisation de la chambre antérieure artificielle de Hanna dans le groupe A<br />
et l’utilisation du trépan de type punch de Hanna dans le groupe B. La trépanation<br />
du receveur était effectuée par le trépan guidé de Hanna dans tous les cas.<br />
Résultats : La récupération visuelle est aussi bonne dans le groupe A que dans le<br />
groupe B (respectivement 0,70 +/-0,13DS et 0,66 +/-0,14DS ; p = 0,491). Aucune différence<br />
significative d’astigmatisme n’a été retrouvée avant (A = 2,04 +/-1,10 versus<br />
B = 3,08 +/-1,29) ni après ablation des fils (A = 2,15 +/-0,78 versus B = 3,60 +/-1,21).<br />
En revanche, 3 patients du groupe A ont bénéficié d’une chirurgie incisionnelle pour<br />
astigmatisme élevé contre aucun du groupe B. Avant ablation des fils, il existe dans<br />
le groupe B, une myopisation moins importante que dans le groupe A (A =-3,14 +/-<br />
3,36 dioptries ; B = +0,56 +/-4,48 avec p = 0,0077). Cette différence diminue et<br />
devient non significative après ablation des fils (Equivalent sphérique A =-2,46 +/-<br />
2,77D ; B =-1 +/-3,37D).<br />
Commentaire et Conclusions : La chambre antérieure artificielle de Hanna ne présente<br />
pas d’avantage significativement évident en terme d’astigmatisme. Elle diminue<br />
en revanche la myopisation post-opératoire, essentiellement avant ablation des<br />
fils.<br />
21 43<br />
Suivi à long terme des kératoplasties transfixiantes.<br />
Long term follow-up of penetrating keratoplasties.<br />
CHAZE PA*, BOURGES JL, RENARD G (Paris)<br />
But : Le but de cette étude est d’évaluer les résultats à long terme des kératoplasties<br />
transfixiantes et de rechercher des facteurs pronostiques.<br />
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant des patients suivis<br />
au moins 5 ans après kératoplastie transfixiante dans le service d’ophtalmologie<br />
de l’Hôtel-Dieu de Paris. Les données disponibles concernant cette intervention ont<br />
été relevées. L’évaluation du suivi post-opératoire reposait sur l’acuité visuelle,<br />
l’astigmatisme, la fréquence des rejets et autres complications, le taux de survie des<br />
greffons (Kaplan-Meier), les causes d’échec et la densité endothéliale. Une étude<br />
statistique a recherché des facteurs de risque d’échec, de rejet, ou modifiant l’astigmatisme.<br />
Résultats : Cent greffes réalisées de 1971 à 1997 avec un suivi moyen de 11 ans<br />
ont été analysées. Les principales indications étaient : le kératocône (50 %), la dystrophie<br />
de Fuchs (14 %), l’échec d’une précédente greffe (14 %), l’herpès (9 %) et<br />
l’œdème du pseudophaque (5 %). L’acuité visuelle atteignait au moins 5/10 dans<br />
64 % des cas et 28,5 % en cas de regreffe (p = 0,004). L’astigmatisme moyen était<br />
de 4.26 dioptries. Le rejet (20 %), l’hypertonie (11 %) et la décompensation endothéliale<br />
(3 %) étaient responsables de 93 % des échecs. À 5 et 10 ans, 87 % et 86 %<br />
des greffons étaient clairs, 98 % pour les kératocônes, 92 % pour les dystrophies<br />
de Fuchs, 88,9 % pour l’herpès, 80 % pour les œdèmes du pseudophaque et 50 %<br />
pour les regreffes. Le risque d’échec était accru en cas de néovascularisation préopératoire<br />
(p = 0,0008) et d’hypertonie post-opératoire (p = 0,0001). La densité<br />
endothéliale moyenne était de 720 cellules/mm 2 après 15.6 ans de suivi moyen.<br />
Commentaire et Conclusions : La kératoplastie transfixiante présente un très bon<br />
pronostic sur un très long terme, sauf en cas de regreffe, de néovascularisation préopératoire<br />
et d’hypertonie post-opératoire. Les échecs sont peu fréquents après<br />
5 ans et rares après 10 ans.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
21 44<br />
Intérêt diagnostique du bleu de toluedine au cours de l’examen clinique : étude<br />
préliminaire.<br />
Diagnostic purpose of toluedin blue during clinic exam: provious study.<br />
SIMON P* (Orsay)<br />
But : Parmi les colorants vitaux déjà utilisés, dans le domaine médico-chirurgical, le<br />
bleu de toluédine en application topique, est une alternative aux colorants habituellements<br />
utilisés en ophtalmologie. Il présente une bonne sensibilité par rapport aux<br />
principales pathologies cornéo-conjonctivales, avec une spécificité identique au vert<br />
de lissamine concernant le mucus.<br />
Matériel et Méthode : Le collyre utilisé est une préparation à 0,1 % réalisée à partir<br />
d’une solution injectable de bleu de toluédine et d’un excipient isotonique aux larmes<br />
(pH 7,2). L’étude a inclus 40 patients, examinés en lampe à fente avec système<br />
vidéo. On analyse, une minute après instillation, le film lacrymal, la conjonctive et la<br />
cornée. Deux groupes de patients ont été examinés avec ce colorant : un groupe<br />
témoin sain et un groupe présentant un syndrome sec confirmé par les autres tests<br />
validés.<br />
Résultats : Nous avons recueillis les résultats cliniques par interrogatoire et examen<br />
clinique des 2 groupes de patients étudiés. La bonne tolérance clinique et la réversibilité<br />
du colorant est identique au vert de lissamine. L’analyse des pathologies<br />
associées aux syndromes secs montre une bonne sensibilité du colorant par rapport<br />
aux colorants type fluorescéine ou rose bengale.<br />
Commentaire et Conclusions : En Europe, le bleu de toluédine a déjà été utilisé<br />
en ophtalmologie pour colorer des empreintes conjonctivales et mettre en évidence<br />
les anomalies du mucus. En Amérique du sud, il est utilisé en pratique courante, pour<br />
diagnostiquer les érosions cornéennes, les lésions conjonctivales, les kérato-conjonctivites<br />
et les anomalies du film lacrymal. Les résultats de notre étude préliminaire<br />
montre que le bleu de toluédine est d’usage fiable et non toxique pour le dépistage<br />
des anomalies courantes de la conjonctive et de la cornée. Il est cependant nécessaire<br />
de réaliser une étude plus approfondie en comparant la spécificité du bleu de<br />
toluédine par rapport au vert de lissamine. Le bleu de toluédine, déjà utilisé en ophtalmologie<br />
sur empreinte conjonctivale s’avère pouvoir être un colorant vital d’usage<br />
fréquent en pratique clinique. Il présente les critères d’inoccuité des colorants déjà<br />
utilisés, et présente une bonne spécificité à la coloration du mucus.<br />
21 45<br />
Obstruction lacrymale congénitale chez le nourrisson et chez l’enfant.<br />
Congenital nasolacrimal system obstruction.<br />
EL BELHADJI M*, BOURHALEB L, BOURHALEB Z, ALLALI B, RACHID R,<br />
ZAGHLOUL KAMRAOUI A (Casablanca, Maroc),<br />
But : L’obstruction lacrymale congénitale, pathologie fréqente chez le nourrisson,<br />
peut être soit résolutive spontanément soit compliquée nécessitant une prise en<br />
charge adéquate, sujette encore à de multiples questions. À travers ce travail et une<br />
revue de la littérature, les auteurs se proposent de déterminer l’attitude thérapeutique<br />
la plus appropriée.<br />
Matériel et Méthode : Les auteurs rapportent une étude rétrospective réalisée<br />
entre 1997 et 2002 concernant 231 cas (316 yeux) d’obstruction congénitale des<br />
voies lacrymales. La moyenne d’âge est de 3 ans et 6 mois sans prédominance de<br />
sexe. Le larmoiement chronique était présent dans 71,5 % avant l’âge d’un an. Il<br />
était permanent dans 61 % et mucopurulent dans 78 % des yeux.<br />
Résultats : L’obstruction siégeait au niveau de la portion verticale des voies<br />
lacrymales dans 75,5 % des yeux. Le lavage des voies lacrymales à partir de 3 mois<br />
a permis de lever l’obstacle dans 19,5 % et le sondage dans 74,6 % des yeux dont<br />
la principale complication était le saignement dans 8 % des yeux. Pour les autres<br />
cas nous avons traité l’obstruction avec succès par une intubation bicanaliculonasale<br />
sous contrôle visuel dans 1 % et par une dacryo-cystorhinostomie dans 94,2 %<br />
des yeux.<br />
Commentaire et Conclusions : L’attitude thérapeutique est variable selon les écoles.<br />
Certains partisans d’un traitement conservateur attendent la résolution spontanée<br />
de cette affection, d’autres plus interventionnistes préconisent le sondage<br />
précoce. Il nous semble que l’attitude thérapeutique doit tenir compte de l’âge de<br />
l’enfant, de son état général ainsi que du tableau clinique.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
VOIES LACRYMALES<br />
21 46<br />
Expérience personnelle de traitement de l’ectropion lacrymal : à propos de 27 cas.<br />
Personal experience of lacrymal ectropion treatments: about 27 cases.<br />
CAMEZIND P*, ROBERT PY, ADENIS JP (Limoges)<br />
But : L’ectropion du point lacrymal est une pathologie fréquemment retrouvée chez<br />
le sujet âgé à l’origine de larmoiement à voie lacrymale perméable. Différents procédés<br />
chirurgicaux ont été proposés pour repositionner correctement les méats<br />
lacrymaux. Nous décrivons notre technique personnelle dite « du colimaçon » et la<br />
comparons aux autres techniques.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 27 patients,<br />
19 hommes et 8 femmes, d’un âge moyen de 72,3 années, tous porteurs d’un ectropion<br />
du point lacrymal inférieur. 21 patients ont été opérés selon la technique du<br />
colimaçon pure, et 6 patients ont bénéficié d’un geste associé (tarsal strip ou plicature<br />
du tendon canthal interne). La chirurgie a été unilatérale dans 20 cas, bilatérale<br />
dans 7 cas (dans le même temps ou décalée). L’indication était un larmoiement à<br />
voie lacrymale perméable dans 23 cas et une réhabilitation esthétique dans 4 cas.<br />
La technique décrite dans cette étude consiste sous anesthésie locale en une retension<br />
du muscle de Horner par voie conjonctivale avec suture à la peau.<br />
Résultats : Le repositionnement du point lacrymal est satisfaisant dans 100 % des<br />
cas avec un recul moyen de 13 mois. Sur le plan fonctionnel, le résultat est satisfaisant<br />
chez 16 patients (76 % des cas). 2 patients sont perdus de vue. Aucune complication<br />
n’a été observée.<br />
Commentaire et Conclusions : Le traitement de l’ectropion du point lacrymal selon<br />
la technique du colimaçon est un procédé simple et très séduisant de repositionnement<br />
des méats lacrymaux. Les échecs de cette technique posent le problème délicat<br />
des larmoiements à voies lacrymales perméables.<br />
21 47<br />
Traitement des dacryocystites aiguës par dacryocystorhinostomie endonasale<br />
de première intention.<br />
Treatment of the lacrimal sac abcess by endonasal dacryocystorhinostomy as a first<br />
procedure.<br />
PIATON JM* (Domont), KELLER P (Paris)<br />
But : Le traitement classique des dacryocystites aiguës non résolutives sous antibiothérapie<br />
est, à la phase d’abcédation, l’incision du sac accompagnée d’un<br />
méchage. Dans un second temps est réalisée à distance une dacryocystorhinostomie<br />
à froid. Cette étude analyse les résultats des dacryocystorhinostomies endonasales<br />
pratiquées en première intention, à la place de l’incision du sac.<br />
Matériel et Méthode : Trente-quatre patients ont été opérés de dacryocystorhinostomie<br />
endonasale en phase d’abcédation du sac. Pour 15 patients il s’agissait du<br />
premier épisode de dacryocystite aiguë ; pour les 19 autres, la dacryocystite avait<br />
été précédée de 1 et 5 épisodes identiques traités médicalement ou chirurgicalement<br />
(5 incisions du sac et 1 dacryocystorhinostomie externe). Tous les patients ont<br />
été opérés par les mêmes chirurgiens avec la même technique chirurgicale. Vingtsept<br />
patients ont été opérés sous anesthésie locale, 7 sous anesthésie générale.<br />
Résultats : Pour les 34 patients la dacryocystorhinostomie a permis la résolution<br />
des signes inflammatoires et infectieux. Une dacryolithe a été retrouvée à l’ouverture<br />
du sac dans un cas. En post-opératoire tardif (> 6 mois) 31 patients ont gardé un<br />
ostium patent avec résolution de l’épiphora ; 1 patient a présenté une récidive de<br />
l’épiphora par fermeture de l’ostium par repousse de la muqueuse nasale ; 2 patients<br />
ont été perdus de vue.<br />
Commentaire et Conclusions : La dacryocystorhinostomie endonasale doit être préférée<br />
à l’incision du sac dans les dacryocystites aiguës non résolutives sous traitement<br />
médical car elle traite l’abcédation et l’obstruction du canal lacrymo-nasal dans le même<br />
temps ; elle évite donc les récidives et soulage le patient de son larmoiement avec un<br />
taux de succès aussi bon que pour les dacryocystorhinostomies réalisées à froid.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S181
1S182<br />
21 48<br />
Mise en évidence d’une corrélation positive entre les résultats du test lacrymal<br />
au fil imprégné de rouge phénol et ceux du test de Schirmer I chez les patients<br />
présentant des signes fonctionnels d’œil sec.<br />
Assessment of the presumed correlation between phenol red impregnated thread<br />
test results and Schirmer I test results among patients complaining of dry eye<br />
symptoms.<br />
RONCIN S* (Rennes)<br />
Purpose: The phenol red thread test (PRTT) is useful to assess tear volume, wich is<br />
related to tear secretory rate. Thus it seems to be an interesting new tool to diagnose<br />
aqueous-deficient dry eye disease. The test uses a cotton thread that has been<br />
treated with phenol red, a pH sensitive substance that changes from yellow to red<br />
on contact with the tears. The mean qualities of this test are the non traumatic insertion<br />
of the thread and the short time it needs (15 seconds).<br />
Material and Method: In this study, we try to find a positive significant correlation<br />
between the Schimer I test (ST) values and the PRTT values among patients complaining<br />
of dry eye symptoms. ST and PRTT were performed in each 44 patients<br />
(43 females), beginning either with the ST or the PRTT at random.<br />
Results: If we consider all the results of all the patients, we find a positive significant<br />
(p < 0.01) correlation between PRTT results and ST results. However if we only compare<br />
the PRTT values inferior or equal to 20 mm at 15 seconds to the ST values of<br />
the same patients, we fail to find any statistical significant correlation. Similarly we<br />
do not find any correlation between ST values inferior or equal to 10 mm at 5 minutes<br />
and corresponding PRTT values.<br />
Comment and Conclusion: There is no universal agreement about the PRTT reliability<br />
compared to the one of the ST, and it seems effectively very difficult to establish<br />
any correspondence between the results of these two tests. This fact is<br />
probably due to the great differences in the protocol of these tests. The sensitivity<br />
and the specificity of the PRTT are discussed at the light of the cut-off values usually<br />
admitted.<br />
21 49<br />
Syndrome oculaire sec dans le syndrome de Sjögren primaire : étude<br />
rétrospective sur la corrélation entre l’évaluation clinique et les caractéristiques<br />
autoimmunitaires sériques.<br />
Dry eye syndrome in primary Sjögren syndrome: retrospective study on correlation<br />
between clinical assesment and serological autoimmunitary findings.<br />
ANDRIANTAFIKA M*, ZANEN A, STEINFELD S, LIBERT J (Bruxelles, Belgique)<br />
But : Étudier le profil auto-immunitaire des patients atteints d’un syndrome de Sjogren<br />
primaire et rechercher des corrélations avec la sévérité du syndrome oculaire<br />
sec.<br />
Matériel et Méthode : Une cohorte de 53 patients (âge moyen 54,2 ans, sex ratio<br />
F : M 12:1, follow-up moyen 23,0 mois) atteints du syndrome de Sjogren primaire<br />
selon les critères européens modifiés, est réalisée. Les titres en anticorps antinucléaires<br />
et facteur rhumatoïdes sont confrontés au test de Schirmer I, au tear break<br />
up time et à la coloration au vert de Lissamine évaluée par le score de Van Bijterveld.<br />
Résultats : L’évolution moyenne du titre en autoanticorps antinucléaires est de<br />
0,90 dilution/mois pour toute la cohorte. Le titre en anticorps antinucléaires est significativement<br />
corrélé au Schirmer I (rs =-0,52, p < 0,05) et au score de Van Bijsterveld<br />
(rs = 0,58, p < 0,05). La concentration en facteur rhumatoïde dosée par la méthode<br />
au latex est significativement corrélée au break up time (rp =-0,42, p < 0,05) et score<br />
de Van Bijterveld (rp = 0,52, p < 0,05). Tous les autres tests statistiques ne sont pas<br />
significatifs.<br />
Commentaire et Conclusions : L’évolution du titre en autoanticorps antinucléaires<br />
est lente dans le syndrome de Sjogren primaire. Les titres en anticorps antinucléaires<br />
et facteur rhumatoide sont de bons marqueurs du syndrome oculaire sec. Les résultats<br />
laissent supposer une certaine spécificité des anticorps antinucléaires comme<br />
marqueur négatif de la sécrétion lacrymale basale évalué par le test de Schirmer I,<br />
et du facteur rhumatoïde pour l’altération du film lacrymal évaluée par le break up<br />
time. Chacun d’entre eux contribue alors à une souffrance épithéliale évaluée par le<br />
score de Van Bijterveld. L’étude des sécretions lacrymales à la recherche d’anomalies<br />
de composition, d’autoanticorps et autoantigènes spécifiques pourrait aider à<br />
une meilleure compréhension de la physiopathologie oculaire dans le syndrome de<br />
Sjogren primaire.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
VOIES LACRYMALES<br />
21 50<br />
La caroncule. Un reste archaïque de troisième paupière ne servant à rien ? Rien<br />
de nouveau ?<br />
Caroncule: a remnant of the third lid, without fonction nor utility? Nothing new?<br />
SCHAPIRO D*, BERNARD JA, AMELINE V, MORAX S (Paris)<br />
But : À l’angle interne de l’œil, la caroncule est une incomprise depuis longtemps,<br />
et pourtant son rôle reste tout à fait d’actualité : par sa présence, elle<br />
supprime la « profondeur » du lac lacrymal, le limitant à 2 dimensions, hauteur<br />
par largeur. Elle empêche ainsi l’engorgement rétrograde des rivières lacrymales.<br />
Dans la chirurgie substitutive des voies lacrymales (laco-rhinostomies) son<br />
ablation permet précisément de reconstituer un vrai lac, petit réservoir néoformé<br />
à l’angle interne, dont le contenu sera régulièrement aspiré par le tube de<br />
« laco ». Par ailleurs, si les causes les plus fréquentes de larmoiement sont<br />
représentées par les anomalies des voies lacrymales ou les malpositions palpébrales,<br />
il existe également des pathologies de la caroncule qui peuvent provoquer<br />
un larmoiement par compression des voies lacrymales ou surtout<br />
obstruction des méats. Ces pathologies, peu fréquentes et volontiers discrètes,<br />
restent à l’heure actuelle méconnues, ce qui explique qu’elles peuvent passer<br />
inaperçues et aboutir, puisque non dépistées, à des erreurs diagnostiques et<br />
thérapeutiques.<br />
Matériel et Méthode : S’appuyant sur une courte série de patients traités dans le<br />
service du Dr Morax à la Fondation Rothschild, les auteurs décrivent rapidement<br />
les résultats de la laco-rhinostomie par voie transconjonctivale pure, puis les différentes<br />
pathologies de la caroncule et les traitements adaptés (anti-inflammatoires,<br />
chirurgie) qui souvent soulagent le patient, à la condition bien entendu que<br />
d’autres causes éventuelles associées de larmoiement soient également dépistées<br />
et traitées.<br />
Résultats : La caroncule, régulièrement taxée de « vieux reste de paupière », garde<br />
cependant toute son actualité. Elle ne doit pas être régulièrement l’oubliée et la mal<br />
aimée de la pathologie du larmoiement. Son ablation est logique dans le compromis<br />
thérapeutique que représente la laco-rhinostomie. En cas d’anomalie, sa résection,<br />
complète ou partielle, geste très simple et léger sous anesthésie locale pure, peut<br />
permettre de régler un larmoiement jusque là incompris.<br />
Commentaire et Conclusions : Il est donc logique, souhaitable et toujours actuel<br />
que l’analyse de la caroncule, notamment à la lampe à fente, soit systématiquement<br />
faite, pour ne pas méconnaître son rôle et les conséquences thérapeutiques de sa<br />
physiopathologie.<br />
21 51<br />
Dacryocystorhinostomie par voie endonasale : une technique simple.<br />
Endonasal dacryocystorhinostomy: an easy technic.<br />
DUCASSE A*, MEROL JC, SCHOLTES F, POITEVIN J, GOTZAMANIS A,<br />
BRUGNIART C (Reims)<br />
But : Les auteurs rapportent leur technique de dacrocystorhinostomie par voie<br />
endonasale ne comportant pas d’unciformectomie systématique. La technique est<br />
assez simple et consiste à aborder la bosse lacrymale sous contrôle endoscopique,<br />
guidé par un éclairage transcanaliculaire.<br />
Matériel et Méthode : La muqueuse nasale est incisée puis réclinée. L’os est fraisé,<br />
puis la muqueuse lacrymale est incisée et ouverte. Une sonde bicanaliculonasale est<br />
mise en place. Il n’y a dans cette technique ni unciformectomie ni geste sur les cornets.<br />
Résultats : Les résultats obtenus avec un recul supérieur à trois mois sont satisfaisants.<br />
Les complications limitées en particulier il y a peu d’hémorragies per et postopératoires.<br />
Commentaire et Conclusions : La DCR par voie endonasale permet par une technique<br />
simple d’obtenir un résultat équivalent à celui obtenu par voie externe. Ses<br />
avantages sont la rapidité et l’absence de cicatrice ; ses désavantages tiennent au<br />
coût du matériel, à la nécessité d’un apprentissage, à l’impossibilité d’un bon<br />
contrôle endosacculaire et à la nécessité d’une intubation. C’est une très bonne<br />
technique en première intention chez le sujet jeune et en seconde intention après<br />
échec d’une DCR par voie externe.<br />
21 52<br />
ANNULÉ<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
21 53<br />
Traitement des sténoses lacrymales par voie endoscopique transpuctale et<br />
transcanaliculaire (technique de Pifaretti).<br />
Treatment of lacrymal stenosis by transpunctal and transcanalicular endoscopy<br />
(Pifaretti’s technique).<br />
BIJON JC*, ELAHI C (Strasbourg)<br />
But : Évaluer l’efficacité du traitement des sténoses lacrymales par la voie endoscopique<br />
transpunctale et transcanaliculaire décrite par JM Piffaretti en 1999.<br />
Matériel et Méthode : 184 procédures furent réalisées entre mars 2000 et<br />
mai 2002. 120 patients (77 femmes et 41 hommes) âgés de 2 à 95 ans (moyenne<br />
78 ans). Tous présentaient un larmoiement chronique depuis plus de six mois rebelle<br />
aux traitements standards. Une analyse sémiologique précise du larmoiement fut<br />
faite : aspect des paupières et des points lacrymaux, étude endoscopique des voies<br />
lacrymales. Après prise en charge ambulatoire sous anesthésie locale, le traitement<br />
fut programmé en fonction de l’analyse sémiologique : correction des troubles palpébraux,<br />
trépanation des lésions sténosées dans les voies lacrymales.<br />
Résultats : Avec un recul de 6 mois 90.7 % des patients se disent guéris ou améliorés.<br />
Nous analysons les différents facteurs qui peuvent influer sur le résultat.<br />
Commentaire et Conclusions : Il s’agit certainement d’une technique intéressante<br />
par son efficacité et sa fiabilité. De plus la légèreté de la prise en charge apporte un<br />
confort indiscutable au patients qui sont souvent âgés.<br />
21 54<br />
Apport de l’endoscopie transcanaliculaire et nasale dans les obstructions<br />
congénitales de voies lacrymales.<br />
Interest of transcanalicular and nasal endoscopy in congenital obstruction of<br />
lacrymal ducts.<br />
BREMOND GIGNAC D*, DEPLUS S, COULOIGNIER V, TIXIER J, LAROCHE L (Paris)<br />
But : L’obstruction congénitale du canal lacrymonasal est une pathologie fréquente<br />
qui touche jusqu’à 60 % des nouveaux-nés avec une obstruction anatomique et<br />
jusqu’à 10 % des nourrissons avec un épipohora clinique pathologique. Les anomalies<br />
embryologiques du canal lacrymonasal sont de l’ordre de 8 variations anatomiques<br />
au niveau de la partie inférieure du canal.<br />
Matériel et Méthode : Nous présentons une série de 220 yeux avec interventions<br />
de désobstruction du canal lacrymonasal et mise en place d’une intubation mono ou<br />
bicanaliculo-nasale. Nous avons eu recours à l’endoscopie nasale pour certains cas<br />
difficiles et pour contrôler la position de la sonde. Par ailleurs, certains cas d’interventions<br />
ont été réalisés avec un endoscope trans-canaliculaire rigide de 0,8 mm de<br />
diamètre pour examiner l’obstruction anatomique.<br />
Résultats : Dans des cas l’intubation bicanaliculo-nasale a été réalisée sous<br />
contrôle endoscopique. L’endoscopie nasale a révélé un cas de concha bullosa du<br />
cornet inférieur. L’endoscopie trans-canaliculaire a permis de visualiser le niveau de<br />
l’obstruction des voies lacrymales et en particulier certains obstacles canaliculaires.<br />
Commentaire et Conclusions : L’endoscopie des voies lacrymales par voie<br />
trans-canaliculaire a été décrite en 1990 pour la première fois avec une visée diagnostique.<br />
Ensuite des systèmes type laser ou foret ont été développés pour traiter<br />
l’obstruction. Notre étude a observé les obstructions congénitales pour<br />
apprécier les différents types d’obstructions et envisager le traitement chirurgical<br />
le plus adapté selon chaque type d’anomalie. Le développement de sonde<br />
d’endoscopie de plus en plus fine permet la visualisation directe des obstructions<br />
congénitales des voies lacrymales de l’enfant. Une meilleure connaissance anatomique<br />
des obstructions congénitales des voies lacrymales doit permettre un traitement<br />
plus adapté en particulier dans les cas où le sondage et la mise en place<br />
de la sonde semble difficile.<br />
21 55<br />
La canthoplastie latérale dans le larmoiement à voies lacrymales perméables.<br />
Lateral canthoplasty in case of tearing with patent lacrymal pathways.<br />
MOURIAUX F*, JOFFRE J, DEMAILLY FX (Carency)<br />
But : La pathologie palpébrale représente plus de 50 % des causes de larmoiement.<br />
Parmi ces causes, il existe l’hyperlaxité involutionnelle de la paupière inférieure.<br />
L’épiphora peut alors s’associer à une hyperhémie conjonctivale, la sensation de<br />
corps étranger, des conjonctivites chroniques ou encore à une blépharite. Cependant,<br />
l’hyperlaxité involutionnelle de la paupière inférieure s’accompagne parfois<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
VOIES LACRYMALES<br />
d’un rétrécissement des voies lacrymales d’excrétion. Le but de ce travail est d’étudier<br />
l’intérêt de la canthoplastie latérale dans les larmoiements à voies lacrymales<br />
perméables.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons étudié 20 patients (33 paupières). L’âge moyen<br />
était de 74 ans. Le sondage diagnostiqie de la partie horizontale des voies lacrymales<br />
montrait la présence d’un rétrécissement sur 7 paupières. Dans tous les cas, le<br />
lavage des voies lacrymales était perméable avec ou sans reflux. L’intervention s’est<br />
déroulée sous anesthésie locale et a consisté en une canthoplastie latérale seule.<br />
Les patients ont été revus ou contacté pour cette étude 6 mois au moins après<br />
l’intervention.<br />
Résultats : Vingt-cinq paupières ne présentaient plus de larmoiement après l’intervention.<br />
Il existait un larmoiement modéré et peu gênant sur 3 paupières. Les 5 dernières<br />
paupières n’ont pas été améliorées par la chirurgie. Il s’agissait de deux<br />
patientes exophtalmes.<br />
Commentaire et Conclusions : Une hyperlaxité palpébrale involutionnelle doit être<br />
recherchée devant tout larmoiement. Une canthoplastie peut être proposée même<br />
en présence d’un rétrécissement des voies lacrymales excrétrices.<br />
21 56<br />
Larmoiement à voies lacrymales perméables et dacryolithiase : une cause<br />
fréquente depuis le dacryoscan rx.<br />
Dacryolithiasis in tearings without lacrymal obstruction: a current finding in CT<br />
evaluations.<br />
NGUYEN TH* (Paris), LOPEZ A (Romorentin), PIATON JM, KELLER P, IBA<br />
ZIZEN MT, CABANIS EA (Paris)<br />
But : Évaluer l’acuité de l’examen dacryoscan rx dans le diagnostic de la dacryolithiase,<br />
notion jusqu’alors peu relevée en dacryographie lipiodolée des larmoiements<br />
à voies lacrymales perméables.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de 210 examens dacryoscan rx réalisés<br />
de 2000 à 2002 dans le service de Neuro-Imagerie du C.H.N.O. des XV-XX, pour<br />
larmoiements à voies lacrymales perméables. Les patients, 122 femmes et<br />
88 hommes âgés de 22 à 83 ans, présentent des larmoiements unilatéraux (62 %,<br />
d’égale latéralité) ou bilatéraux (38 %). Après cathétérisme des voies lacrymales, rinçage<br />
au sérum physiologique puis injection lente et contrôlée de contraste iodé<br />
hydrosoluble. Acquisitions scan rx en coupes axiales millimétriques jointives, suivies<br />
de reconstructions coronales, sagittales, 3D et endoscopie virtuelle.<br />
Résultats : Quarante-six des 220 dacryoscans rx (22 %) objectivent la dacryolithiase,<br />
sous forme d’images de soustraction endoluminales, partiellement ou complètement<br />
circonscrites par le contraste dans le plan axial. Le pourcentage est<br />
comparable pour les atteintes unilatérales et bilatérales (23,2 et 21,5 %). La localisation<br />
la plus fréquente est canalaire (71 %), impliquant la jonction sac-canal ou le tiers<br />
canalaire inférieur. Les localisations sacculaires voire intranasales sont plus rares<br />
(24 % et 5 %). Dans 15 cas, l’extrémité inférieure de la dacryolithiase reste non délimitée<br />
par le contraste.<br />
Commentaire et Conclusions : Ce diagnostic de 22 % de dacryolithiase est élevée<br />
par rapport aux résultats obtenus en dacryographie, où la faible résolution en densité<br />
du contraste iodé, et l’impossibilité de visualisation tridimensionnelle empêchent une<br />
séméiologie radiologique spécifique de la dacryolithiase. L’exploration chirurgicale a<br />
confirmé le diagnostic dans 27 cas sur 35 interventions. La dacryolithiase, conséquence<br />
aggravante de la stagnation lacrymale, peut être aisément diagnostiquée en<br />
scan rx. Les possibilités de délimitation et reconstructions tridimensionnelles permettent<br />
ainsi une visualisation pré-thérapeutique de l’obstacle, avant une exérèse<br />
par voie anatomique efficace et peu invasive.<br />
21 57<br />
Aspects histopathologiques des muqueuses lacrymale et nasale au cours de la<br />
dacryocystorhinostomie par voie externe.<br />
Histopathological aspects of nasal and lacrimal mucosas during external<br />
dacryocystorhinostomies.<br />
POITEVIN J*, DUCASSE A, GOTZAMANIS A, PLUOT M, DIEBOLD MD,<br />
BRUGNIART C, SCHOLTES F (Reims)<br />
But : Les auteurs insistent sur l’intérêt de pratiquer systématiquement un examen<br />
anatomo-pathologique des muqueuses lacrymale et nasale qui sont retirées au<br />
cours de la dacryocystorhinostomie.<br />
Matériel et Méthode : L’ensemble des dacryocystorhinostomies réalisées depuis<br />
1990 et ayant bénéficié d’un examen anatomo-pathologique des muqueuses<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S183
1S184<br />
lacrymale et nasale ont été retenues. Il s’agit d’une étude rétrospective. L’ensemble<br />
de ces muqueuses représente 380 malades.<br />
Résultats : Dans de nombreux cas, il existe une réaction inflammatoire importante<br />
au niveau de la muqueuse lacrymale, voire de la muqueuse nasale. Dans certains<br />
cas, des pathologies générales peuvent être mises en évidence : un cas de maladie<br />
de Wegener, deux cas de lymphome généralisé et deux cas de sarcoïdose. La maladie<br />
de Wegener et les lymphomes étaient des pathologies connues alors que les<br />
sarcoïdoses ne l’étaient pas.<br />
Commentaire et Conclusions : La technique actuelle de dacryo-cysto-rhinostomie<br />
par voie externe telle que nous la pratiquons amène à reséquer les murs postérieurs<br />
à la fois au niveau nasal et au niveau lacrymal. Ces morceaux de muqueuse nasale<br />
et lacrymale peuvent être adressés en anatomopathologie afin de réaliser une étude<br />
systématique. Même si le plus souvent les résultats traduisent simplement l’inflammation<br />
lacrymale ou nasale en rapport avec les phénomènes de dacryocystite chronique<br />
parfois des pathologies bien spécifiques peuvent être mises en évidence<br />
confirmant une pathologie connue comme la granulomatose de Wegener ou un lymphome<br />
ou une sarcoïdose. Les résultats permettent d’expliquer les cas d’échec de<br />
dacryocystorhinostomie sur ces terrains en particulier la sarcoïdose. Il nous paraît<br />
intéressant d’examiner à titre systématique les muqueuses nasale et lacrymale retirées<br />
au cours des dacryocystorhinostomies par voie externe.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
VOIES LACRYMALES<br />
21 58<br />
Echographie en Haute Fréquence et pathologie des canalicules lacrymaux.<br />
High frequency echography and impairment of lacrimal canaliculi.<br />
FAYET B*, PUECH M, RACY E (Paris)<br />
But : Étudier l’aide que peut apporter l’échographie Haute Fréquence (20 mHz) dans<br />
les indications thérapeutiques en pathologie canaliculaire.<br />
Matériel et Méthode : Deux cas de larmoiement chronique liés à une sténose canaliculaire<br />
ont ete étudiés par échographie en Haute Fréquence (20 mHz). Cet examen<br />
devait préciser l’étendue de l’obstacle et rechercher l’existence d’une lumière canaliculaire<br />
résiduelle en aval de la lésion. Dans un cas, il s’agissait d’une sténose des<br />
deux canalicules du même côté, survenue dans les suites d’une kérato-conjonctivite<br />
virale. Dans l’autre, il s’agissait d’une agénésie canaliculaire complète connue depuis<br />
la naissance.<br />
Résultats : Dans ces deux cas, l’échographie en Haute Fréquence (20 mHz) à identifié<br />
une lumière canaliculaire débutant immédiatement après l’obstacle anatomique.<br />
Ces données échographiques ont été confrontées positivement à l’exploration chirurgicale.<br />
Commentaire et Conclusions : Les résultats initiaux de l’échographie en Haute<br />
Fréquence (20 mHz) appliquée à la pathologie des canalicules lacrymaux sont<br />
encourageants.<br />
L’un des auteurs a un intérêt financier dans l’équipement, le procédé ou le produit<br />
présenté.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
UVÉITES (2)<br />
21 59<br />
Les récidives d’uvéite antérieure aiguë : les étiologies à risque.<br />
Anterior uveitis recurrences: etiologies.<br />
SCHOLTES F*, NDJILEKISSA S, FERON A, BRUGNIART C, GOTZAMANIS A,<br />
SEGAL A, DUCASSE A (Reims)<br />
But : À partir des dossiers des patients ayant présenté une uvéite antérieure aiguë<br />
hospitalisés au CHR de Reims, une étude rétrospective a été menée afin de voir si<br />
des étiologies particulières étaient plutôt responsables de récidives que d’autres.<br />
Matériel et Méthode : L’ensemble des patients ayant présenté une uvéite antérieure<br />
aiguë hospitalisés au CHR de Reims entre 1991 et 2000 a été retenu<br />
(470 patients). L’étude rétrospective a porté sur l’ensemble du bilan réalisé afin de<br />
déterminer l’étiologie éventuellement retrouvée. Parmi ces étiologies celles ayant<br />
amené à plusieurs poussées d’uvéite antérieure aiguë chez le même patient ont été<br />
particulièrement étudiées.<br />
Résultats : Il semble que les pathologies rhumatismales à type de pelvispondylite<br />
ankylosante en particulier chez des patients HLA B27 soient plus souvent la cause<br />
de récidives d’uvéite antérieure aiguë de même que l’herpès.<br />
Commentaire et Conclusions : La recherche d’une étiologie et sa mise en évidence<br />
lors d’une première poussée d’uvéite antérieure aiguë permet éventuellement<br />
de craindre des récidives ultérieures liées à cette maladie.<br />
21 60<br />
Uvéites et colites inflammatoires : à propos de 3 cas.<br />
Uveitis and inflammatory colitis: about 3 cases.<br />
CHAOUI Z*, BERNOUSSI A, BOURASSI A, BELMEKKI M, CHEFCHAOUNI M,<br />
BERRAHO A (Rabat, Maroc)<br />
But : Les colites inflammatoires sont représentées essentiellement par la maladie de<br />
Crohn et la réctocolite-ulcéreuse ou ulcéro-hémorragique (RCH), qui associent des<br />
manifestations extra-intestinales, en particulier, articulaire et oculaires. L’uvéite antérieure<br />
constitue la principale manifestation oculaire et reste exclusivement sous la<br />
dépendance de processus inflammatoires en rapport avec des complexes immuns.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons 3 cas d’uvéite antérieure bilatérale et synéchiante<br />
entrant dans le cadre d’une RCH, dans 2 cas, et d’une maladie de Crohn,<br />
dans 1 cas. Dans les 2 premiers cas : l’uvéite est survenue après 8 ans d’évolution<br />
de la maladie qui était stabilisée par sulfasalazopyridine, dans le premier cas, et<br />
6 mois après une colectomie subtotale, dans le deuxième cas. Dans le 3e cas, la<br />
patiente était suivie pour une maladie de Crohn depuis 3 ans avec des poussées<br />
d’uvéite antérieure granulomoteuse concomitantes des poussées intestinales.<br />
Résultats : Dans les deux premiers cas, L’évolution était favorable sous corticothérapie<br />
locale sans récidive. Dans le 3e cas la corticothérapie locale et générale a permis<br />
de juguler l’inflammation oculaire, mais l’évolution a été marquée par une<br />
seclusion pupillaire et installation d’un glaucome inflammatoire.<br />
Commentaire et Conclusions : L’uvéite antérieure constitue la principale manifestation<br />
oculaire dans les colites inflammatoires ; sa fréquence est de 1,9-4,5 % dans<br />
la maladie de crohn et de 1,6 % dans la RCH. Son évolution est synchrone des<br />
poussées évolutives de la maladie et son traitement est basé sur les anti-inflammatoires,<br />
mais dans les formes graves récidivantes, la guérison est obtenue après<br />
résection de la totalité du segment intestinal malade (coloproctectomie). L’atteinte<br />
oculaire des colites inflammatoires est variée dominée par l’atteinte du segment<br />
antérieur dont l’évolution est synchrone des poussées intestinales et dont la guérison<br />
est obtenue après coloproctectomie.<br />
21 61<br />
Uvéite tuberculeuse. Approche diagnostique et thérapeutique : à propos de<br />
5 cas.<br />
Tuberculous uveitis diagnostic and therapeutic approach: 5 cases report.<br />
TACHFOUTI S*, AMAZOUZI A, CHERKAOUI O, KABBAJ A, DAFRALLAH L,<br />
MOHCINE Z (Rabat, Maroc)<br />
But : L’uvéite tuberculeuse connaît une recrudescence actuelle avec l’extension du<br />
SIDA, elle peut accompagner les manifestations générales de la maladie ou être isolée.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons une série de 5 patients traités pour uvéite<br />
tuberculeuse au service d’ophtalmologie A de l’hôpital des spécialités de RABAT entre<br />
juin 2000 et mai 2002. L’âge moyen de nos patients est de 30 ans, l’atteinte oculaire<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS DU MAGHREB<br />
consiste en une vascularite rétinienne dans 2 cas, une uvéite postérieure avec œdème<br />
papillaire et maculaire dans 2 cas et une choriorétinite en foyer dans le cas restant.<br />
Résultats : Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement antibacillaire basé sur<br />
l’association rifampicine, izoniazide, pirazinamide pendant 6 mois associé à une corticothérapie,<br />
avec une amélioration clinique et angiographique.<br />
Commentaire et Conclusions : L’uvéite tuberculeuse regroupe l’uvéite antérieure,<br />
le granulomé choroïdien, l’uvéite postérieure et la vascularite rétinienne. C’est une<br />
atteinte qui peut être secondaire soit à une atteinte directe suite à une transmission<br />
par contiguïté ou par voie sanguine, soit à une atteinte indirecte immunologique. Le<br />
diagnostic de l’uvéite tuberculeuse est difficile à faire notamment en l’absence de<br />
tuberculose systémique. À la lumière de ces observations les auteurs discutent les<br />
difficultés diagnostiques et les particularités thérapeutiques et évolutives de cette<br />
affection.<br />
21 62<br />
Les uvéites tuberculeuses : à propos de 8 cas.<br />
Tuberculosis uveitis: report of 8 cases.<br />
HAJJI Z*, ELGHORFI H, MELLAL Z, OUAZZANI B, BENCHEKROUN N, AGNAOU L,<br />
BERRAHO A (Rabat, Maroc)<br />
But : La tuberculose oculaire est relativement rare par rapport aux autres localisations<br />
tuberculeuses (pulmonaires, ganglionnaires, cérébrales…) ; cependant, l’uvéite<br />
tuberculeuse en est la manifestation ophtalmologique la plus fréquente. Elle est due<br />
à la virulence du germe lui-même ou à un mécanisme immuno-allergique. Il s’agit<br />
d’une uvéite granulomateuse souvent associée à une tuberculose extra-oculaire qui<br />
permet d’orienter le diagnostic.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons une série de huit jeunes patients présentant<br />
une uvéite tuberculeuse. L’âge moyen est de 22 ans avec des extrêmes allant<br />
de 6 à 38 ans.<br />
Résultats : Une tuberculose extra-oculaire concomitante est retrouvée dans 7 cas<br />
dont 3 ganglionnaires, 2 pulmonaires, une intestinale et une méningée. Un enfant<br />
était déjà sous traitement antibacillaire pour tuberculose pulmonaire. Une seule<br />
patiente était séropositive pour le VIH. Dans un cas, il s’agissait d’une uvéite chronique<br />
isolée compliquée d’abcès sous-conjonctival et de fistulisation sclérale.<br />
L’atteinte du nerf optique a été mise en évidence dans 4 cas. Tous nos patients ont<br />
bénéficié d’un traitement antibacillaire associé secondairement à une corticothérapie<br />
dans la moitié des cas. L’évolution s’est faite vers la phtyse dans 2 cas.<br />
Commentaire et Conclusions : À la lumière de ces observations, les particularités<br />
cliniques et angiographiques de l’uvéite tuberculeuse sont discutées de même que<br />
les différents éléments diagnostiques. Dans notre série, l’origine tuberculeuse de<br />
l’uvéite a été retenue sur un faisceau d’arguments cliniques : contage tuberculeux,<br />
intradermo-réaction à la tuberculine positive, localisation extra-oculaire (études histologiques<br />
de biopsie ganglionnaire, étude du liquide céphalo-rachidien, radiographie<br />
pulmonaire). Dans un seul cas, le diagnostic a été basé sur l’étude histologique<br />
de prélèvements oculaires (biopsie conjonctivale et liquide provenant de la fistule<br />
sclérale) qui a révélé un granulomé épithéliogigantocellulaire avec nécrose caséeuse.<br />
Enfin, nous insistons sur la toxicité oculaire de certains antibacillaires utilisés, tels<br />
l’Ethambutol et l’Isoniazide.<br />
21 63<br />
La choroïdite tuberculeuse : à propos de 3 cas.<br />
Choroidit tuberculosis: about 3 cases.<br />
MOUTAOUAKIL A*, EL BELHADJI M, SBAI D, BENCHEKROUN S, ZAGHLOUL K,<br />
AMRAOUI A (Casablanca, Maroc)<br />
But : La tuberculose est une infection qui sévit à l’état endémique dans notre pays,<br />
elle peut être responsable, au niveau oculaire, d’une uvéite granulomateuse, caractérisée<br />
par des nodules choroïdiens ou tubercules de Bouchut. Dans ce travail, on<br />
rapporte les observations de 3 patients présentant une tuberculeuse viscérale associée<br />
à une chroïdite tuberculeuse, avec revue de la littérature.<br />
Matériel et Méthode : Cas n° 1 : il s’agit d’une patient de 24 ans qui présente une<br />
ménigite tuberculeuse confirmée et de multiples tubercules de Bouchut au niveau<br />
oculaire. Cas n° 2 : patiente de 20 ans qui présente une tuberculose pulmonaire, dorsolombaire<br />
et de la main avec confirmation bactériologique et l’examen ophtalmologique<br />
retrouve un tubercule de Bouchut de l’œil droit. Cas n° 3 : c’est le cas d’une<br />
patiente âgé de 22 ans présentant une tuberculose miliaire avec granulomé choroïdien<br />
pseudo tumoral.<br />
Résultats : Le traitement antibacillaire a entraîné la disparition de ces nodules chez<br />
tous les patients.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S185
1S186<br />
Commentaire et Conclusions : Les manifestations de la tuberculose sont rares (1<br />
à 2 % de cas). Elles touchent tous les tissus oculaires sauf le cristallin. Les tubercules<br />
de Bouchut constituent une manifestation choroïdienne rare, généralement multifocale,<br />
d’une miliaire tuberculeuse ; ce sont des follicules composés de cellules<br />
épithéliales et de cellules géantes, avec nécrose caséeuse. L’angiographie à la fluoréscéine<br />
est très utile au diagnostic. Le traitement est celui de la tuberculose miliaire.<br />
La fréquence de la tuberculose dans les pays en voie de développement, sa recrudescence<br />
avec le SIDA, doit inciter les ophtalmologistes à rester vigilant quant à la<br />
recherche de l’atteinte oculaire.<br />
21 64<br />
Choroïdite serpigineuse associée à une rétinochoroïdite toxoplasmique.<br />
Serpiginous choroiditis associated with toxoplasmosis retinitis.<br />
CATIER A*, BAUDET D, CHARLIN JF (Rennes)<br />
Matériel et Méthode : Nous décrivons le cas d’un patient présentant les critères angiographiques<br />
d’une choroïdite serpigineuse associée à une rétinochoroïdite toxoplasmique.<br />
Résultats : En août 1997, un patient de 30 ans s’est plaint d’une baisse d’acuité<br />
visuelle de l’œil gauche. Le fond d’œil retrouvait alors une lésion blanchâtre sous<br />
rétinienne contiguë à une zone atrophique juxtapapillaire. L’analyse des anticorps<br />
antitoxoplasmiques a permis de retrouver un coefficient de Witmer-Desmont significatif<br />
à 68,91. Un traitement antiparasitaire suivi d’une corticothérapie systémique a<br />
été instauré. L’évolution est marquée par la récurrence et la bilatéralisation des<br />
lésions. Devant l’aspect atrophique, la répartition géographique péripapillaire et<br />
l’atteinte bilatérale, le diagnostic de choroïdite serpigineuse est posé. Un nouveau<br />
bilan est réalisé : le coefficient de Witmer-Desmont est évalué à 3,86, la sérologie<br />
concernant les virus du groupe herpès est négative, un typage HLA B7 est retrouvé.<br />
Commentaire et Conclusions : La choroïdite serpigineuse est une pathologie<br />
inflammatoire d’étiologie indéterminée aboutissant à une occlusion de la choriocapillaire.<br />
D’après les études histologiques, il semble exister une réaction immunologique<br />
anormale vis à vis d’un antigène tissulaire ou infectieux. Dans ce cas clinique,<br />
le processus initial est une rétinochoroïdite toxoplasmique confirmée par le coefficient<br />
de Witmer-Desmont. La rétinochoroïdite toxoplasmique, survenant sur un terrain<br />
immunitaire prédisposé, pourrait être à l’origine d’une réponse immunologique<br />
anormale aboutissant au tableau de choroïdite serpigineuse.<br />
21 65<br />
Apport de la ponction de chambre antérieure dans les choriorétinites présumées<br />
toxoplasmiques.<br />
Anterior chamber punction in toxoplasmic chorioretinitis.<br />
NDJILEKISSA N*, DUCASSE A, VILLAIN E, MARX-CHEMLA C, GOTZAMANIS A,<br />
BRUGNIART V, N’GUESSAN MY, SEGAL A, PINON JM (Reims)<br />
But : Les auteurs rapportent les résultats des ponctions de chambre antérieure réalisées<br />
devant toute choriorétinite présumée d’origine toxoplasmique.<br />
Matériel et Méthode : 87 patients ayant présenté une choriorétinite toxoplasmique<br />
ont bénéficié d’une ponction de chambre antérieure permettant de déterminer le<br />
coefficient C de Witmer, considéré comme positif au delà de 4 et également de réaliser<br />
une PCR à la recherche d’ADN toxoplasmique.<br />
Résultats : La ponction de chambre antérieure a permis de confirmer la<br />
toxoplasmose ; par contre, la PCR à la recherche d’ADN toxoplasmique a été très<br />
peu contributive pour le diagnostic.<br />
Commentaire et Conclusions : Devant une choriorétinite, la meilleure façon de<br />
confirmer l’origine toxoplasmique de celle-ci reste la réalisation d’une ponction de<br />
chambre antérieure avec recherche des IgG, des IgM, des IgA et éventuellement des<br />
IgE. La recherche d’ADN toxoplasmique par PCR est par contre relativement peu<br />
productive. Les auteurs insistent sur l’intérêt de la recherche du coefficient de Witmer<br />
dans les uvéites présumées toxoplasmiques.<br />
21 66<br />
Récurrence de la rétinochoroïdite toxoplasmique après traitement par<br />
clindamycine.<br />
Toxoplasmic retinochroiditis recurrence after clindamycin treatment.<br />
BEN ZINA Z*, CHAABOUNI S, HENTATI N, TRIGUI A, CHAABOUNI F, BEN AYED M,<br />
FEKI J (Sfax, Tunisie)<br />
But : La survenue de récidive de la rétinochoroidite toxoplasmique est un des principaux<br />
problèmes dans la prise en charge de la toxoplasmose oculaire. Plusieurs<br />
études ont été menées dans le but de retrouver le meilleur protocole thérapeutique<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS DU MAGHREB<br />
permettant de palier à ce problème. Notre étude a pour objectif de déterminer l’innocuité<br />
et l’efficacité du protocole clindamycine-corticoide et d’évaluer le taux de<br />
récurrence avec ce traitement.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude a porté sur 22 cas présentant une rétinochoroidite<br />
toxoplasmique active recensés dans notre service depuis 1995 jusqu’à 2000. Il<br />
s’agit de 17 hommes et de 15 femmes, d’âge moyen 28 ans. Tous les patients ont<br />
bénéficié du protocole clindamycine en sous conjonctival, associé à une corticothérapie<br />
par voie générale. La surveillance au cours du suivi était essentiellement clinique,<br />
basée sur l’évaluation de l’acuité visuelle et l’examen biomicroscopique du fond<br />
d’œil, complétée par une angiographie rétinienne en cas de besoin.<br />
Résultats : Le suivi moyen était de 44 mois, allant de 24 à 84 mois. Le traitement à<br />
base de clindamycine-corticoide a permis d’obtenir une amélioration subjective de<br />
l’acuité visuelle au cours des quatre premiers jours dans 68,75 % et une cicatrisation<br />
des foyers choriorétiniens dans tous les cas dans un délai moyen de 1.6 mois. Une<br />
récurrence a été observée dans uniquement 2 cas (9 %). Cette récurrence a eu lieu<br />
au cours des dix premiers mois.<br />
Commentaire et Conclusions : Un taux de récurrence de 50 % a été rapporté<br />
aussi bien avec un traitement à base de pyriméthamine-sulfadiazine qu´avec le protocole<br />
pyriméthamine-azithromycine. Dans notre étude, la tolérance du protocole<br />
clindamycine était bonne à part un cas de nécrose conjonctivale et un cas d’érosion<br />
cornéenne et conjonctivale attribués à une erreur de concentration. Le protocole<br />
clindamycine-corticoïde a permit d’obtenir de bons résultats avec une bonne tolérance.<br />
Il a permis en plus de réduire le taux de récurrence de 50 % à 9 %. Il mérite<br />
donc d’être étudié sur de larges études plus randomisées.<br />
21 67<br />
ANNULÉ<br />
21 68<br />
Uvéites et maladies générales.<br />
Uveitis and systemic assessment.<br />
AILEM A* (Alger, Algérie)<br />
Texte non reçu.<br />
21 69<br />
Uvéites et diabète.<br />
Uveitis and diabetes.<br />
MERAD BOUDIA Z* (Alger, Algérie)<br />
Texte non reçu.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
21 70<br />
Les uvéites de l’enfant : à propos de 32 cas.<br />
Children uveitis: about 32 cases.<br />
MOHCINE Z*, DAHERDDINE M, LAGHMARI M, BENHARBIT M, GUERIDA K,<br />
IWRAHIMY W, DAOUDI R (Rabat, Maroc)<br />
But : Les uvéites de l’enfant sont rares, elles représentent 3 à 8 % de l’ensemble<br />
des uvéites. La découverte d’une uvéite chez l’enfant nécessite une démarche diagnostique<br />
et étiologique proche de celle de l’adulte avec les particularités d’un examen<br />
difficile et d’une évolution insidieuse.<br />
Matériel et Méthode : Dans une étude rétrospective de 1995 à 2002, 32 cas<br />
d’uvéite ont été recensés. Ces patients ont bénéficié d’un bilan ophtalmologique et<br />
d’un traitement puis ont été suivis pendant une période allant jusqu’à 7 ans.<br />
Résultats : Trente-deux enfants présentant une uvéite, âgés de 9 à 15 ans, dont le<br />
bilan étiologique révèle 10 cas de maladie de Behçet, 2 cas de syndrome de Vogt<br />
Koyanagi Harada, 1 cas de sarcoïdose, une uvéite associée à une maladie coeliaque,<br />
1 cas de toxoplasmose, 3 ophtalmies sympathiques, 2 uvéites post streptococciques,<br />
1 cas d’arthrite chronique juvénile, 1 cas de toxocarose et 11 cas ou l’étiologie<br />
est indéterminée. Un traitement étiologique est instauré dans le cas de toxoplasmose<br />
et de l’uvéite post streptococcique, les autres cas ont bénéficié d’une corticothérapie<br />
par voie générale à forte dose puis à dose dégressive.<br />
Commentaire et Conclusions : Nous avons relevé l’importance de l’incidence de<br />
la maladie de Behcet dans cette série, une évolution marquée par des récidives fréquentes<br />
pour un cas de Vogt Koyanagi Harada et pour le cas de toxoplasmose, la<br />
fréquence des cataractes compliquées dans l’ensemble. Nous proposons de discuter<br />
les caractéristiques cliniques, l’évaluation diagnostique et la prise en charge thérapeutique<br />
des uvéites chez l’enfant.<br />
21 71<br />
Les uvéites de l’enfant.<br />
Children uveitis.<br />
ZAGHLOUL K*, AMRAOUI A, LAMARI H, HAMDANI M (Casablanca, Maroc)<br />
But : Les uvéites de l’enfant sont relativement rares (2 à 6 % de toutes les uvéites<br />
dans un service d’Ophtalmologie). Le but de ce travail est de traiter les particularités<br />
des uvéites de l’enfant à la lumière de notre série.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons 25 observations d’uvéite chez des patients<br />
de moins de 16 ans<br />
Résultats : L’âge moyen des enfants est de 9 ans (5-16 ans) sans prédominance de<br />
sexe. L’uvéite est antérieure dans 12 cas ; postérieure dans 7 cas ; intermédiaire<br />
dans 3 cas et totale dans 3 cas. Les étiologies sont dominées par l’arthrite chronique<br />
juvénile (7 cas) ; la maladie de Behcet (3 cas) et la sarcoïdose (2 cas). Les complications<br />
sont fréquentes : cataracte (9 cas), glaucome secondaire (4 cas) ; kératite en<br />
bandelette dans 6 cas.<br />
Commentaire et Conclusions : Elles sont graves et menacent le pronostic visuel.<br />
Elles constituent une urgence thérapeutique et imposent un bilan étiologique. Les<br />
étiologies sont dominées par les arthrites chroniques juvéniles et les spondylarthropathies.<br />
Les uvéites de l’enfant sont moins fréquentes que celles de l’adulte mais de<br />
pronostic plus réservé. Elles surviennent entre 6 et 9 ans et touchent les deux sexes.<br />
Les étiologies sont dominées par les arthrites chroniques juvéniles et les spondylarthropathies.<br />
Les complications sont fréquentes dominées par la cataracte (22 à<br />
71 % des cas), le glaucome secondaire (5 à 30 % des cas), la kératite en bandelette<br />
(8 à 66 % des cas) et l’œdème maculaire cystoïde (55 % des cas). Le pronostic fonctionnel<br />
est souvent réservé avec un acuité visuelle finale inférieure à 20/200 dans 16<br />
à 36 % des cas.<br />
21 72<br />
Données nosologiques et types de traitements des uvéites de l’enfant.<br />
Nosological data and kind of treatments in the child-uveitis.<br />
LEININGER L*, UZEL JL, FISCHBACH M, TERZIC J, SPEEG-SCHATZ C<br />
(Strasbourg)<br />
But : La nature du traitement des uvéites de l’enfant est liée à la localisation de<br />
l’uvéite, au nombre d’œil atteint, à l’existence de récidive. Il implique souvent l’utilisation<br />
de la corticothérapie générale, quelquefois en association aux immunosuppresseurs.<br />
Matériel et Méthode : Étude analytique des cas d’uvéites de l’enfant suivis<br />
conjointement dans les services d’ophtalmologie et de pédiatrie des Hôpitaux Uni-<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS DU MAGHREB<br />
versitaires de Strasbourg, de 1997 à 2002. 40 patients ont été traités pour uvéites,<br />
mais seuls 20 patients ont pu être inclus dans l’étude car il y a eu 20 perdus-de-vue.<br />
Résultats : L’âge moyen de survenue est de 6 ans et 3 mois. On a retrouvé 7 cas<br />
d’uvéite antérieure (35 %), 6 cas d’uvéite antérieure avec hyalite (30 %), 7 cas de<br />
pan-uvéite (35 %) dont 5 avec papillite (25 %), et 2 avec foyers choriorétiniens<br />
(10 %). Dans 65 % des cas, il s’agit d’uvéites bilatérales. Une étiologie n’est retrouvée<br />
que dans 45 % des cas. Le traitement local à base de collyres cortisoniques a<br />
été utilisé dans l00 % des cas, complété dans 70 % des cas par la corticothérapie<br />
générale, voire associé à un traitement immunosuppresseur dans 60 % des cas.<br />
L’efficacité de ces traitements est estimée par une amélioration de l’acuité visuelle<br />
de 67 % après traitement et une absence totale de complication dans 45 % des cas.<br />
Les complications les plus fréquemment rencontrées sont : des synéchies postérieures<br />
(73 % dont un quart de séclusions pupillaires), des kératites en bandelette<br />
(27 %), des hypertonies sous corticoïdes locaux (27 %), des cataractes (36 %).<br />
Commentaire et Conclusions : Le recours à une thérapeutique générale (dans<br />
70 % des cas) peut s’expliquer par la fréquente atteinte des deux yeux (65 %) et la<br />
participation postérieure (hyalite, chorio-rétino-papillite) dans 65 %. L’utilisation des<br />
immunosuppresseurs (60 % des cas) conjointement aux corticoïdes a pour objectif<br />
la diminution des doses de cortisone administrées et de lutter contre les phénomènes<br />
de cortico-dépendance. L’utilisation chez l’enfant de la corticothérapie par voie<br />
générale souvent associée aux immunosuppresseurs (IMUREL dans 83 %, et plus<br />
récemment l’EMBREL) permet d’obtenir une bonne récupération visuelle et une nette<br />
diminution des complications secondaires à l’uvéite.<br />
21 73<br />
L’uvéite chez l’enfant : aspects épidémiologiques et cliniques.<br />
Uveitis in children: epidemiological and clinical features.<br />
BELTAIEF O*, BALDOOUTI K, MILI BOUSSEN I, TRABELSI M, KANDIL C,<br />
ZHIOUA R, OUERTANI MA (Tunis, Tunisie)<br />
But : Étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et étiologiques des uvéites de<br />
l’enfant.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude porte sur 34 patients (n = 59 yeux) âgés de<br />
moins de 16 ans, colligés sur 8 ans. Un examen ophtalmologique avec fluoroangiographie<br />
rétinienne était systématique, complété au besoin par une angiographie en<br />
ICG et/ou une échographie B. En première intention, un bilan étiologique était<br />
demandé selon la forme anatomo-clinque de l’uvéite (classification de l’IUSG) et<br />
l’examen pédiatrique initial ; un deuxième bilan complétait le premier orienté selon<br />
les premiers résultats.<br />
Résultats : L’âge moyen était de 12,7 ans (4-16 ans), le sex-ratio à 1. Les panuvéites<br />
(n = 19) et les uvéites antérieures (n = 17) étaient les formes les plus fréquentes.<br />
Les étiologies, non déterminées dans 32,3 % des cas, étaient dominées par l’arthrite<br />
juvénile idiopathique (20 %) et les infections focales (20 %) pour les uvéites antérieures,<br />
la toxoplasmose (40 %) pour les uvéites postérieures et la maladie de Behcet<br />
(50 %) pour les panuvéites. Les complications (47 yeux) étaient dominées par la<br />
cataracte (n = 15) et l’œdème maculaire (n = 11). Avec un recul moyen de 2,5 ans<br />
(6 mois à 8 ans), l’acuité visuelle était inférieure à 1/10 dans 65 % des cas.<br />
Commentaire et Conclusions : Les uvéites de l’enfant ont un pronostic le plus<br />
souvent réservé, du fait des complications fréquentes et des étiologies dominées par<br />
les maladies de système. Une surveillance ophtalmologique régulière s’impose chez<br />
les patients à risque.<br />
21 74<br />
Formes graves d’uvéite de l’enfant.<br />
Severe forms of uveitis in children.<br />
GORBEL M*, KACEM S, MELLOULI T, CHEKIR N, MAHJOUB H, KRIFA F, BEN<br />
HADJ HAMIDA F (Sousse, Tunisie)<br />
But : Les uvéites chez l’enfant sont rares. Elles ne représentent que 5 à 10 % de la<br />
totalité des uvéites. Elles posent des problèmes diagnostiques, étiologiques, thérapeutiques<br />
et surtout pronostiques. Le but de notre étude est de montrer les difficultés<br />
diagnostiques, positif et étiologique et d’insister surtout sur les formes rebelles<br />
au traitement.<br />
Matériel et Méthode : Nous présentons une étude rétrospective de 10 patients,<br />
âgés entre 5 et 15 ans, hospitalisés dans le Service d’Ophtalmologie de Sousse pour<br />
uvéite. Chaque patient a bénéficié d’un examen ophtalmologique complet, d’une<br />
enquête étiologique. Un traitement à base de corticothérapie, à la dose de 1 mg/kg/<br />
j a été préconisé pour tous les patients. Un traitement immunosupresseur à base de<br />
phospahmides a été indiqué dans 3 cas.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S187
1S188<br />
Résultats : L’âge moyen des patients était de 11 ans. Les étiologies étant variées :<br />
maladie de Behçet, maladie de Vogt Koyanagi Harada, maladie dermique juvénile,<br />
sarcoïdose et choriorétinite en foyers. Le traitement a permis la stabilisation de<br />
l’inflammation.<br />
Commentaire et Conclusions : Les uvéites de l’enfant posent plusieurs<br />
problèmes :<br />
– diagnostique ;<br />
– étiologique, le pourcentage d’étiologie retrouvé n’excède pas 35 à 50 % ;<br />
– thérapeutique, puisque souvent ces uvéites nécessitent un traitement lourd pour<br />
l’enfant (corticothérapie par voie générale ou traitement immunosupresseur) ;<br />
– pronostique, puisqu’il s’agit d’affection chronique, émaillée de poussées inflammatoires<br />
souvent dans un contexte de maladie générale.<br />
21 75<br />
Corticothérapie systémique et traitement immunosuppresseur dans l’uvéite de<br />
l’enfant.<br />
Systemic corticosteroids and immunosuppressive treatment in childhood uveitis.<br />
BOUCHENAKI N* (Genève, Suisse), TRAN VAN T, HERBORT CP (Lausanne, Suisse)<br />
But : Évaluer les indications et la contribution du traitement corticoïde et immunosuppresseur<br />
systémique dans l’uvéite de l’enfant.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective d’enfants présentant une uvéite chronique<br />
ou récidivante traités de façon systémique par corticoïde et/ou immunosuppresseur.<br />
Les indications, l’efficacité et les effets secondaires sont analysés.<br />
Résultats : De 1995 à 2002, 78 enfants atteints d’uvéite furent examinés au Centre<br />
Ophtalmologique de la Source à Lausanne. 33 enfants (42 %) reçurent un traitement<br />
systémique. 16 (48,5 %) (7 filles, 9 garçons) ont été traités par corticoïdes systémiques<br />
seuls (pars planite (6), toxoplasmose (2, associé aux antibiotiques), arthrite<br />
juvénile idiopathique (2), maladie de Behcet (1), choriocapillaropathie inflammatoire<br />
(1), diagnostic indéterminé (4). 17 (51,5 %) reçurent un traitement immunosuppresseur<br />
systémique dont 14 (7 filles, 7 garçons) avaient assez de données pour être<br />
analysés. Leurs diagnostics étaient : arthrite juvénile idiopathique (4), pars planite (3),<br />
maladie de Behcet (2), sarcoïdose (1), indéterminé (4). Les indications à l’ajout d’un<br />
autre immunosuppresseur étaient la sévérité de l’inflammation (11) et/ou l’effet<br />
d’épargne corticoïde (6). L’azathioprine (AZT) fut associée dans 10 cas, le méthotrexate<br />
dans 5, la cyclosporine dans 3, l’entanacept dans 1 et la colchicine dans 1.<br />
Après l’introduction du traitement immunosuppresseur l’inflammation fut contrôlée<br />
chez tous les patients avec des données de suivi suffisantes (n = 11). L’AZT fut arrêtée<br />
dans un cas en raison d’une toxicité hépatique.<br />
Commentaire et Conclusions : Une corticothérapie systémique ou un traitement<br />
immunosuppresseur étaient nécessaires chez une relative grande proportion<br />
d’enfants atteints d’uvéite. L’utilisation d’immunosuppresseurs à effet d’épargne<br />
corticoïde dans le traitement de l’uvéite pédiatrique contribue au contrôle de l’inflammation<br />
et permet de diminuer les effets secondaires de la corticothérapie systémique,<br />
en particulier sur la croissance.<br />
21 76<br />
Intérêt de l’interféron alpha dans le traitement des uvéites à HHV-8.<br />
Interferon alpha for the treatment of uveitis associated with HHV-8.<br />
BRASNU E*, BODAGHI B, WECHSLER B (Paris), GAMBARELLI N (Marseille),<br />
BIELEFELD P (Dijon), LE HOANG P (Paris)<br />
But : Nous rapportons les cas de 2 patientes immunocompétentes présentant un<br />
uvéite bilatérale. Cette uvéite est attribuée dans les 2 cas à une infection par le virus<br />
HHV-8, reconnu comme agent responsable du sarcome de Kaposi.<br />
Matériel et Méthode : Le premier cas est celui d’une patiente de 73 ans, adressée<br />
pour prise en charge d’une panuvéite bilatérale synéchiante évoluant depuis un an<br />
sous corticothérapie. Il existait un œdème maculaire gauche. L’examen biomicroscopique<br />
mettait en évidence des lésions nodulaires conjonctivales qui ont été biopsiées.<br />
L’analyse anatomopatholoqique a confirmé le diagnostic de sarcome de<br />
Kaposi, et la PCR a mis en évidence l’ADN d’HHV-8 au niveau conjonctival. Le reste<br />
du bilan étiologique est resté négatif. La patiente a bénéficié d’une association prednisone<br />
et Interféron alpha, avec absence de récidive à 2 ans.<br />
Le seconde observation rapporte le cas d’une patiente de 14 ans adressée pour<br />
prise en charge d’une uvéite bilatérale de type intermédiaire compliquée de vasculites<br />
rétiniennes et évoluant depuis plusieurs mois. Le bilan réalisé est resté négatif<br />
en dehors d’une sérologie HHV-8 positive. Sous prednisone, le tableau a évolué vers<br />
une pars planite typique. Un traitement immunosuppresseur basé sur l’azathioprine<br />
a alors été instauré sans succès. Devant la forte suspicion d’uvéite associée à une<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS DU MAGHREB<br />
infection virale herpétique, la patiente a bénéficié d’injections tri-hebdomadaires<br />
d’alpha interféron. La symptomatologie s’est alors améliorée avec un diminution de<br />
la fréquence et de l’intensité des poussés.<br />
Discussion et Conclusions : Aucune autre étiologie n’a été mise en évidence dans<br />
ces deux cas en dehors d’une infection à HHV-8. Ce diagnostic semble être le plus<br />
probable et aucun cas similaire n’a été décrit précédemment. L’infection par le virus<br />
HHV-8 peut se manifester chez le sujet immunocompétent par une uvéite bilatérale<br />
associée ou non à une atteinte conjonctivale et le cas échéant à un sarcome de<br />
Kaposi systémique. L’interféron alpha pourrait stabiliser l’inflammation et permettre<br />
une diminution du seuil de corticodépendance.<br />
21 77<br />
Efficacité et tolérance de l’interféron alpha dans le traitement des uvéites<br />
chroniques réfractaires.<br />
Efficacy and safety of interferon alpha in severe and refractory uveitis.<br />
GENDRON G*, BODAGHI B, WECHSLER B, CASSOUX N, LE THI HUONG D,<br />
LEMAITRE C, FARDEAU C, PIETTE JC, LE HOANG P (Paris)<br />
But : Évaluation de l’efficacité et de la tolérance de l’interféron alpha-2a (IFN-alpha)<br />
au cours des uvéites chroniques sévères et réfractaires aux corticoïdes et immunosuppresseurs<br />
conventionnels.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective incluant les patients présentant une<br />
uvéite sévère et ayant bénéficié d’une immunomodulation par IFN-alpha. Les<br />
patients présentant une maladie de Behçet étaient analysés dans une série indépendante<br />
présentée précédemment. L’IFN-alpha était injecté en sous-cutanée à une<br />
posologie de 3 à 6 millions d’unités trois fois par semaine, associé à une corticothérapie<br />
systémique. Le suivi était assuré en collaboration entre les services de médecine<br />
interne et d’ophtalmologie.<br />
Résultats : Quatorze patients furent inclus jusqu’à août 2001. L’âge moyen était de<br />
26 ans et la durée moyenne d’évolution de l’uvéite avant mise sous IFN de 52 mois.<br />
En moyenne, les patients avaient présenté 3 rechutes sévères avant l’instauration de<br />
l’immunomodulation. Huit patients ont répondu favorablement au traitement, permettant<br />
la diminution de l’inflammation oculaire, l’augmentation de l’acuité visuelle<br />
et la diminution du seuil de corticodépendance (de 21,7 à 11,9 mg/j en moyenne)<br />
avec un suivi moyen de 19,5 mois. Aucun de ces patients n’a interrompu le traitement<br />
par IFN-alpha au 1/12/2002. Sept des quatorze patients ont présenté une leucopénie<br />
réversible, un seul cas requérant une interruption transitoire du traitement.<br />
Commentaire et Conclusions : Au cours des uvéites chroniques sévères et réfractaires<br />
aux immunosuppresseurs conventionnels, l’interféron représente une alternative<br />
de valeur. Cependant, le taux de succès parait inférieur à celui observé dans une<br />
population de patients présentant une uvéite chronique et réfractaire liée à la maladie<br />
de Behçet, étudiée durant la même période (57,1 % versus 81,8 %). La tolérance doit<br />
aussi être strictement monitorée afin d’éviter la survenue de complications hématologiques,<br />
hépatiques et auto-immunes.<br />
21 78<br />
Efficacité de l’infliximab dans le traitement des uvéites chroniques réfractaires :<br />
à propos de six cas.<br />
Efficacy of infliximab in the treatment of chronic severe and refractory uveitis: a<br />
review of six cases.<br />
ROZENBAUM O*, BUI QUOC E, BODAGHI B, WECHSLER B, CASSOUX N, LE THI<br />
HUONG D, LEMAITRE C, FARDEAU C, PIETTE JC, LE HOANG P (Paris)<br />
But : Les nouvelles approches thérapeutiques de l’inflammation oculaire font appel<br />
à de nouvelles molécules aux cibles beaucoup mieux définies. Les anticorps monoclonaux<br />
apportent des perspectives prometteuses : c’est le cas de l’Infliximab, anticorps<br />
anti-Tumor Necrosis Factor-alpha.<br />
Matériel et Méthode : Le traitement par perfusion d’Infliximab à la dose de 5 mg/<br />
kg, renouvelée à 2 semaines, 6 semaines et toutes les 8 semaines, a été proposé en<br />
cas d’uvéite chronique sévère réfractaire à une corticothérapie conventionnelle et<br />
aux immunosuppresseurs classiques. Nous avons rétrospectivement analysé la<br />
réponse anti-inflammatoire et la tolérance du traitement chez les patients ayant<br />
bénéficié de cette thérapeutique depuis le début de l’année 2001. L’efficacité du traitement<br />
a été évaluée par biomicroscopie, fond d’œil, photométrie automatisée du<br />
tyndall et angiographie à la fluorescéine.<br />
Résultats : Le traitement a été réalisé chez 6 patients d’âge moyen 37 ans (21-<br />
45 ans) et dont l’uvéite évoluait depuis en moyenne 7,6 ans (4-20 ans). Il s’agissait<br />
d’une maladie de Behçet (3 cas), d’une spondylarthropathie (2 cas) et d’une panuvéite<br />
avec vascularite rétinienne nécrosante non infectieuse (1 cas). Le traitement a<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
été efficace sans récurrence après une ou plusieurs perfusions dans tous les cas :<br />
régression des signes inflammatoires à l’examen clinique et à l’angiographie à la<br />
fluorescéine, absence de récurrence avec un suivi moyen de 9 mois (3-15 mois).<br />
Commentaire et Conclusions : Le TNF-alpha est un médiateur majeur de l’inflammation.<br />
L’utilisation d’un inhibiteur spécifique de cette molécule a montré son efficacité<br />
au cours de la polyarthrite rhumatoïde et de la maladie de Crohn. Cette<br />
alternative semble intéressante dans de nombreuses autres indications. C’est le cas<br />
des uvéites chroniques sévères réfractaires. Une évaluation sur un plus grand nombre<br />
de patients sera proposée dans les prochains mois dans le cadre d’une étude<br />
européenne.<br />
21 79<br />
Évaluation de la voie de Ripart pour l’injection sous ténonienne profonde de<br />
corticoïdes retards.<br />
The Ripart’s technique for deep posterior sub-tenon injections of depository<br />
corticosteroids.<br />
DE LA MARNIERRE E*, GUIGON B (Metz), MAGE F (Lyon), MACAREZ R, DJONG<br />
TRAN H, BAZIN S (Metz)<br />
But : Évaluer rétrospectivement la voie d’injection de Ripart, développée dans<br />
l’anesthésie loco-régionale, pour l’administration sous-ténonienne profonde de corticoïdes<br />
retard.<br />
Matériel et Méthode : Soixante-trois injections d’une suspension de 40 mg d’acétonamide<br />
de triamcinolone (1 ml) ont été réalisées pour 12 yeux de 10 patients, dont<br />
7 uvéites chroniques, 3 syndromes d’Irvine-Gass, une neuropathie optique antérieure<br />
aiguë, une dégénérescence maculaire liée à l’âge exsudative, et une prolifération<br />
vitréorétinienne postopératoire.<br />
Résultats : L’acuité visuelle a été augmentée pour 11 yeux. La biomicroscopie a été<br />
qualitativement améliorée pour tous sur un ou plusieurs critères : précipités rétrocornéens,<br />
tyndall de chambre antérieure et vitréen, pars-planitis, œdème maculaire.<br />
Les injections étaient peu douloureuses, et n’ont entraîné aucun dépôt sous-conjonctival,<br />
ni aucune hypertonie.<br />
Commentaire et Conclusions : La technique de Ripart est un mode d’injection<br />
sous-ténonienne profonde originale, développée pour l’anesthésie locorégionale.<br />
Elle s’appuie sur les connections étroites entre le replis semi-lunaire, le fascia orbitaire<br />
et le récessus postérieur de la capsule de Tenon. Ne donnant pas de chémosis,<br />
elle n’est pas susceptible de laisser de dépôts corticoïdes sous-conjonctivaux, ce<br />
qui devrait diminuer le risque d’hypertonie. Elle autorise donc l’utilisation d’acétonamide<br />
de triamcinolone dont la rémanence est d’au moins trois semaines, et pour<br />
lequel nous n’avons observé aucune atrophie tissulaire. Après avoir fait ses preuves<br />
en anesthésie, la voie de Ripart nous semble être une méthode sure et reproductible<br />
pour réaliser des injections sous-ténoniennes profondes de corticoïdes-retard.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS DU MAGHREB<br />
21 80<br />
Sclérectomies profondes avec implant de collagène et mitomycine C comparée<br />
à la trabéculectomie et mitomycine C dans les hypertonies oculaires au cours<br />
des uvéites.<br />
Deep sclerectomy with collagen implant and mitomycine C compared with<br />
trabeculectomy and mitomycine C in ocular hypertention of uveitis.<br />
CEDDAH A*, FARDEAU C, CASSOUX N, BODAHGI B, LE HOANG P (Paris)<br />
But : L’hypertonie oculaire peut compliquer l’évolution d’un uvéite. Les mécanismes<br />
sont multiples : hypersécrétion d’humeur aqueuse, blocage pupillaire par séclusion<br />
pupillaire, trabéculite, goniosynéchies, rubéose irienne (glaucome néovasculaire),<br />
traitement par corticoïdes et processus inflammatoires rétro-iriens effaçant l’ange<br />
irido cornéen.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective longitudinale suivant deux cohortes pendant<br />
quatre à vingt-quatre mois. Dix-huit patients bénéficiant systématiquement<br />
d’une trabéculectomie avec mitomycine C. Dix patients chez qui nous avons systématiquement<br />
réalisé une sclérectomie profonde avec implant de collagène et mitomycine<br />
(0,2 milligramme par millilitre pendant deux minutes). La chirurgie a été<br />
pratiqué à distance d’une poussée évolutive de l’uvéite et chez des patients avec<br />
hypertonie résistante au traitement médical maximal. Les patients présentant un blocage<br />
pupillaire par séclusion pupillaire et ou un effacement de l’angle irido cornéen<br />
par processus inflammatoire rétro irien et ou une rubéose irienne n’ont pas été<br />
inclus.<br />
Résultats : Les paramètres relevés en pré-opératoire et en fin de suivi pour la comparaison<br />
étaient : la pression intra oculaire par applanation, les indices globaux de<br />
périmétrie automatique : déviation individuelle (pattern deviation) et déviation<br />
moyenne (mean deviation). Chez certains patients nous avons pu suivre l’évolution<br />
de l’inflammation de la chambre antérieure par laser flare cell meter en pré et postopératoire.<br />
Commentaire et Conclusions : À court terme les suites opératoires immédiates de<br />
sclérectomies profondes sont plus simples que celles de la trabéculectomie. À<br />
moyen terme il n’existe pas de différence statistiquement significative dans la modification<br />
des paramètres pris en compte. L’absence de différences significatives entre<br />
ces deux méthodes peut être due au manque de puissance de l’étude. Le caractère<br />
de l’uvéite et les mécanismes présumés de l’hypertonie oculaire pourraient être pris<br />
en compte pour optimiser les résultats et orienter le choix du type de chirurgie filtrante.<br />
L’étude est poursuivie en prospectif.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S189
1S190<br />
PAUPIÈRES<br />
31 81<br />
Implant intra palpébral dans les paralysies faciales : quel risque<br />
d’extériorisation à long terme ?<br />
Gold weight implant: long-term risk of extrusion.<br />
ESCALAS P* (Nantes)<br />
But : L’implant intra palpébral permet d’obtenir une réanimation passive de la paupière<br />
grâce à la gravité. Une réticence subsiste dans son usage du fait du risque<br />
d’expulsion. Le but de cet étude est d’évaluer ce risque avec une technique opératoire<br />
toujours identique.<br />
Matériel et Méthode : Trente-deux patients ont été opérés. Le choix du poids de<br />
l’implant est effectué après un test pré-opératoire avec un set d’essai. La limite de<br />
1,6 gramme a été arbitrairement fixée considérant que, au delà, la fibrose du muscle<br />
releveur est telle que le principe de la technique ne peut plus s’appliquer.<br />
Résultats : Avec un recul de 1 à 7 ans et un recul moyen de 48 mois, aucune extériorisation<br />
ou expulsion ne s’est produite.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces résultats sont rassurant, l’intérêt d’un matériau<br />
pour renforcer la couverture de l’implant est discuté ainsi que la sélection des<br />
patients. Cette technique parait une alternative fiable et efficace de la tarsorraphie.<br />
31 82<br />
Utilisation de la membrane amniotique dans la chirurgie de reconstruction<br />
oculo-palpébrale.<br />
Amniotic membrane transplantation for oculo-palpebral and reconstructive surgery.<br />
OBERHANSLI C*, SPAHN B (Lausanne, Suisse)<br />
But : Dans cette étude la membrane amniotique a été employée en chirurgie oculopalpébrale<br />
et reconstructrice en tant qu’alternative à la muqueuse buccale. Les<br />
résultats fonctionnels et cosmétiques se sont avérés satisfaisants.<br />
Matériel et Méthode : Quarante-neuf interventions utilisant de la membrane amniotique<br />
ont été effectuées chez 45 patients. 18 cas : création ou agrandissement d’un<br />
cul-de-sac permettant la mise en place d’une prothèse oculaire. 13 cas : reconstruction<br />
conjonctivale (maladies inflammatoires ou brûlures chimique et thermique).<br />
11 cas : reconstruction palpébrale cutanée et conjonctivale (traumatismes, tumeurs<br />
cutanées). 7 cas : reconstruction conjonctivale (tumeurs conjonctivales).<br />
Résultats : Un cas n’a pas de suivi. Sur 4 cas de réfection de cul-de-sac, 2 ont été<br />
des échecs totaux (dont 1 cavité irradiée) et deux des échecs partiels qui ont nécessité<br />
une seconde intervention pour obtenir un cul-de-sac satisfaisant et stable. 2<br />
autres cas ont dû subir une seconde intervention (maladie inflammatoire). Les 38<br />
autres cas ont tous présentés de bons résultats.<br />
Commentaire et Conclusions : Les résultats fonctionnels et cosmétiques sont<br />
bons sauf pour 4 cas : deux rétractions complètes des culs-de-sac et deux rétractions<br />
partielles ont été observées. La membrane amniotique est un excellent matériau<br />
en tant qu’alternative à la muqueuse buccale dans la chirurgie oculo-palpébrale<br />
et reconstructrice.<br />
31 83<br />
Les formes palpébrales de lèpres.<br />
Palpebral forms of leprosy.<br />
LEMARINEL B*, ROCHE O, HAKIKI S, DUREAU P, DUFIER JL (Paris)<br />
But : La lèpre est, de toutes les maladies infectieuses, celle qui entraîne le plus de<br />
cécité. On recense près de 750 000 à un million d’aveugles pour 10 à 15 millions de<br />
sujets atteints. Parmi les atteintes ophtalmologiques, les lésions palpébrales sont<br />
moins cécitantes mais elles orientent le diagnostic.<br />
Matériel et Méthode : À partir de plusieurs observations, les auteurs présentent un<br />
rappel clinique illustré d’une riche iconographie des différentes atteintes palpébrales<br />
observées au cours de la lèpre.<br />
Résultats : Il existe deux grandes formes cliniques de lèpre, la lèpre tuberculoïde et<br />
la lèpre lépromateuse, chacune ayant des manifestations générales, oculo-palpébrales<br />
différentes et spécifiques. L’existence de formes intermédiaires rend parfois difficile<br />
le diagnostic clinique.<br />
Commentaire et Conclusions : Les flux de population défavorisée sont plus que<br />
jamais d’actualité. Tout médecin quelque soit son lieu d’exercice peut donc être<br />
confronté à ce type de pathologie accessible à la prévention ou au traitement curatif,<br />
dont le diagnostic est rarement évoqué de première intention.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
PAUPIÈRES – DERMATOSES PALPÉBRALES<br />
31 84<br />
Management et traitement des hémangiomes palpébraux : à propos de 46 cas.<br />
Managment and treatment of eyelids hemangiomas: about 46 cases.<br />
LONGUEVILLE E*, VERSAPUECH J, LEAUTE-LABREZE C, GRENIER N, TAIEB A,<br />
COLIN J (Bordeaux)<br />
But : Une thérapeutique efficace doit être proposée lorsqu’un hémangiome menace<br />
la fonction visuelle en obturant l’axe ou en induisant un astigmatisme. Le but de cette<br />
étude était d’analyser les complications des hémangiomes palpébraux d’essayer de<br />
proposer une prise en charge adaptée.<br />
Matériel et Méthode : Une analyse rétrospective de 46 cas d’hémangiomes palpébraux<br />
vus entre 1990 et 2000 a été réalisée avec un suivi moyen de 40 mois.<br />
31 patients ont bénéficié d’une consultation d’ophtalmologie, 18 enfants ont eu une<br />
échodoppler couleur orbitaire, 6 une imagerie de l’orbite. En cas de retentissement<br />
visuel (20 cas), une corticothérapie a été instituée ainsi qu’une amblyothérapie.<br />
Résultats : Après un mois de corticothérapie, ils ont été jugés excellents ou bons<br />
dans 13 cas, mauvais (stabilisation) dans 4 cas et qualifiés d’échec (augmentation)<br />
dans 3 cas. L’efficacité thérapeutique sur les complications ophtalmologiques a été<br />
excellente dans 3 des 8 cas analysables, bons dans un cas, et mauvais dans 4 cas.<br />
Le traitement a été bien toléré. Les autres complications observées sont des ulcérations<br />
et des séquelles esthétiques : télangiectasies, cicatrices chalazodermiques,<br />
cicatrice rétractile.<br />
Commentaires et Conclusions : L’efficacité de la corticothérapie systémique est<br />
comparable à celle des corticoïdes in situ sans risque d’OACR. Tout hémangiome<br />
palpébral doit avoir un bilan ophtalmologique, Une échographie doppler, parfois<br />
complétée d’une IRM à la recherche d’une extension profonde. Le traitement de première<br />
intention est la corticothérapie générale.<br />
DERMATOSES PALPÉBRALES<br />
31 85<br />
Traitement des pemphigoïdes oculaires cicatricielles par la sulfasalazine.<br />
Efficacy of sulfasalazine in ocular cicatricial pemphigoïd.<br />
RASHDAN A*, DOAN S, GABISON E, LEROUIC JF, HOANG-XUAN T (Paris)<br />
But : Étudier l’efficacité de la sulfasalazine dans le traitement des pemphigoïdes<br />
oculaires cicatricielles.<br />
Matériel et Méthode : Les dossiers de vingt patients présentant une pemphigoïde<br />
oculaire cicatricielle prouvée histologiquement et traités par sulfasalazine ont été étudiés<br />
rétrospectivement.<br />
Résultats : La sulfazalazine avait été introduite soit en remplacement de la dapsone<br />
en raison d’effets secondaires dans 16 cas, soit en première intention dans 1 cas,<br />
soit en complément d’un premier traitement insuffisamment efficace dans 3 cas. La<br />
dose orale de sulfasalazine était en moyenne de 2,5 g (de 0,5 à 4 g). Le suivi moyen<br />
était de 35,3 mois (de 5 à 87 mois). La maladie a été contrôlée sous sulfasalazine<br />
chez 13 patients (65 %). Un traitement par cyclophosphamide ou par dapsone a dû<br />
être ajouté dans respectivement 6 cas et 1 cas en raison d’une inflammation persistante.<br />
La sulfasalazine a été interrompue pour effet secondaire dans 4 cas (20 %) :<br />
2 pour hémolyse persistante malgré l’arrêt de la dapsone, un pour neutropénie et un<br />
pour troubles gastriques.<br />
Commentaire et Conclusions : La sulfasalazine est efficace dans le traitement des<br />
pemphigoïdes oculaires cicatricielles. Ce traitement est utile dans les formes peu à<br />
modérément évolutives en remplacement de la dapsone, ou en association dans les<br />
formes plus sévères.<br />
31 86<br />
Manifestations oculaires et palpébrales des ichtyoses.<br />
Ocular and palpebral manifestations of ichtyosis.<br />
DUREAU P*, HAKIKI S, ORSSAUD C, ROCHE O (Paris), UTEZA Y (Montpellier),<br />
DUFIER JL (Paris)<br />
But : Les ichtyoses sont caractérisées par la présence de squames qui couvrent<br />
l’ensemble de l’épiderme. Certaines formes se compliquent d’atteintes palpébrales<br />
ou oculaires. Nous avons étudié plusieurs patients atteints d’ichtyose avec complications<br />
ophtalmologiques afin d’illustrer les différents aspects de ces maladies.<br />
Matériel et Méthode : Douze patients ont été examinés. Pour chacun ont été notés<br />
le type d’ichtyose, les anomalies générales associées, l’acuité visuelle, l’atteinte pal-<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
pébrale, l’état du segment antérieur et de la rétine, les examens complémentaires<br />
pratiqués et le traitement entrepris.<br />
Résultats : Trois patients présentaient une forme congénitale, quatre une forme<br />
d’hérédité récessive, trois une forme avec rétinopathie pigmentaire et deux une<br />
forme avec neuropathie et cataracte. Dans les formes cutanées pures, l’acuité était<br />
peu altérée avec un ectropion et une kératite ponctuée superficielle traités médicalement.<br />
Dans les formes avec rétinopathie, la fonction visuelle et l’électrorétinogramme<br />
étaient progressivement altérés tandis que les deux patients atteints de<br />
maladie de Refsum ont été opérés de cataracte avec succès.<br />
Commentaire et Conclusions : Si l’ichtyose vulgaire ne comporte pas de manifestations<br />
ophtalmologiques, d’autres formes se compliquent d’anomalies oculaires<br />
handicapantes et d’ectropions dont le traitement chirurgical est rendu difficile par<br />
l’absence de site de prélèvement pour une greffe de peau.<br />
Conclusion : Les manifestations ophtalmologiques des ichtyoses doivent être<br />
connues afin de soulager au mieux ces patients déjà lourdement handicapés.<br />
31 87<br />
Amylose palpébrale : à propos de deux cas.<br />
Eylid amylosis: two cases report.<br />
GOTZAMANIS A* (Paris), DUCASSE A, BRUGNIART C, PLUOT M, ARAV E,<br />
POITEVIN J, PENNAFORTE JL (Reims)<br />
But : En rapportant deux cas de localisation palpébrale, les auteurs rappellent les<br />
différentes atteintes oculaires pouvant s’observer dans les diverses formes d’amylose,<br />
ainsi que leur classification actuelle.<br />
L’intérêt et les différentes techniques nécessaires au diagnostic anatomo-pathologique<br />
sont décrites.<br />
Matériel et Méthode : Deux patientes présentant des lésions palpébrales fortement<br />
évocatrices de dépôts amyloïdes ont été opérées au CHU de Reims. L’étude anatomo-pathologique<br />
utilisant à chaque reprise les mêmes techniques de coloration et<br />
d’immunofluorescence ont été utilisées. Un bilan clinique et para-clinique systématiques<br />
à la recherche d’atteintes systémiques associées ont été pratiqués par<br />
ailleurs.<br />
Résultats : Un cas d’amylose palpébrale associé à un myéLomé multiple et un autre<br />
d’amylose primitive associée à une atteinte rénale sont suivis et traités. Plus de six<br />
ans après la confirmation du diagnostic l’état oculo-palpébral et général sont satisfaisants.<br />
Commentaire et Conclusions : L’amylose palpébrale peut être associée à des<br />
atteintes viscérales pouvant mettre en jeu le pronostic vital. La connaissance de la<br />
symptomatologie oculo-palpébrale doit être bien connue afin d’orienter ou de compléter<br />
le bilan clinique.<br />
L’atteinte palpébrale amyloïde est une entité relativement rare. L’examen anatomopathologique<br />
méthodique permet aisément de mettre en évidence des dépôts amyloïdes<br />
caractéristiques.<br />
31 88<br />
Xanthogranulomatose palpébrale : à propos d’un cas.<br />
Palpebral xanthogranuloma: one case report.<br />
BEN AYED H*, MORAX S, HAMEDANI M, BADELON I (Paris)<br />
But : Une revue des aspects cliniques, histologiques et thérapeutiques de la xanthogranulomatose<br />
périorbitaire.<br />
Matériel et Méthode : Les auteurs rapportent le cas d’un patient de 62 ans qui a<br />
présenté une infiltration progressive des quatre paupières par des plaques jaunâtres<br />
et dures occasionnait un préjudice esthétique et fonctionnel. Une biopsie exérèse a<br />
été faite avec une étude anatomopathologique.<br />
Résultats : L’examen histologique a permis de faire le diagnostic de xanthogranulomatose<br />
palpébrale. Un bilan systémique à la recherche d’autres atteintes s’est<br />
révélé négatif. Le patient est surveillé régulièrement.<br />
Commentaire et Conclusions : La xanthogranulomatose périorbitaire est une<br />
entité rare, elle peut être divisée en trois variétés cliniques, la xanthogranulomatose<br />
juvénile, la maladie d’Erdheim Chester et la xanthogranulomatose de l’adulte. Bien<br />
que suspecté cliniquement, le diagnostic de certitude est histologique. L’approche<br />
des patients présentant cette atteinte doit être multidisciplinaire à la recherche<br />
d’anomalies systémiques associées. La prise en charge thérapeutique de l’atteinte<br />
palpébrale est confrontée aux problèmes de l’exérèse mutilante et de la reconstruction<br />
parfois difficile.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
PAUPIÈRES – DERMATOSES PALPÉBRALES<br />
31 89<br />
À propos d’un cas d’ariboflavinose palpébrale.<br />
A case of ariboflavinosis.<br />
GUALINO V*, HAKIKI S, ROCHE O, DUREAU P, ORSSAUD C, DUFIER JL (Paris)<br />
But : Les auteurs rapportent l’observation ancienne d’un patient de 15 ans ayant<br />
présenté une ariboflavinose palpébrale.<br />
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’un enfant atteint d’une maladie de Crohn sévère<br />
sous alimentation parentérale exclusive. Il nous a été adressé pour une atteinte palpébroconjonctivale<br />
bilatérale apparue brutalement.<br />
Résultats : L’absence d’atteintes oculaires associées a permis d’éliminer un lien<br />
avec la maladie de Crohn. Des injections répétées de vitamine B2 ont permis une<br />
régression complète des lésions.<br />
Commentaire et Conclusions : L’association d’une atteinte cutanée et conjonctivale<br />
dans un contexte de nutrition parenterale prolongée, nous a orienté vers une<br />
dermatose carentielle. La prise en charge nutritionnelle actuelle des pathologies<br />
digestives, prend en compte les risques de déficits vitaminiques.<br />
31 90<br />
Rosacée oculaire : étude prospective et intérêt d’une approche bi-disciplinaire.<br />
Ocular rosacea: a prospective study highlights the interest of a bi-disciplinary<br />
approch.<br />
VABRES B*, GERVAIS-LACHAISE S, DRENO B, WEBER M, STADLER JF,<br />
PECHEREAU ALAIN (Nantes)<br />
But : Caractériser de façon bi-disciplinaire (ophtalmologique et dermatologique) les<br />
données épidémiologiques, les signes fonctionnels et d’examen de patients présentant<br />
ou suspects de présenter une rosacée oculaire.<br />
Matériel et Méthode : Analyse d’une série prospective de 24 patients recrutés du<br />
1-IX-2001 au 1-III-2002 en consultation d’ophtalmologie du CHU de Nantes puis<br />
adressés en consultation de dermatologie pour déterminer la présence ou non de<br />
signes de rosacée cutanée.<br />
Résultats : La moitié (12) des patients étaient adressés par leur ophtalmologiste, 4<br />
par leur généraliste, 2 par leur dermatologiste et 8 se présentaient spontanément.<br />
Dans 92 % des cas le diagnostic de rosacée n’était pas connu antérieurement. Le<br />
diagnostic de rosacée oculaire était considéré comme possible chez 7 patients<br />
(29 %), très probable chez 9 patients (38 %), caractéristique avec atteinte cornéenne<br />
chez 8 patients (33 %). À l’issu de la consultation dermatologique, 83 % des patients<br />
présentaient une rosacée cutanée dont 11 (55 %) au stade II (érythro-couperose), 7<br />
(35 %) au stade III (papulo-pustuleuse) et 2 (10 %) au stade IV (rhinophyma).<br />
Commentaire et Conclusions : Le diagnostic de rosacée oculaire est largement<br />
sous estimé par l’ophtalmologiste qui peut cependant reconnaître les signes caractéristiques<br />
de cette affection fréquente aux complications parfois sévères. Ces<br />
signes étant souvent minimes le dermatologiste pourra utilement confirmer un diagnostic<br />
suspecté mais doit également faire documenter l’atteinte oculaire d’une<br />
rosacée cutanée sévère.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S191
1S192<br />
31 91<br />
Prévalence d’une hypertonie oculaire et du glaucome dans une population<br />
française d’âge moyen, non sélectionnée.<br />
Prevalence of intra-ocular hypertension and open angle glaucoma in a non-selected<br />
middle-aged french population.<br />
BRON A (Dijon), BAUDOUIN C, NORDMANN JP (Paris), ROULAND JF (Lille),<br />
THOMAS F, BEAN K, DE CLERCQ B, BENTOS A, COSCAS A (Paris)<br />
But : En France, la prévalence du glaucome, non sélectionnée sur une pathologie<br />
ophtalmologique, est inconnue. Le but de l’étude était d’évaluer la prévalence de<br />
l’hypertonie oculaire et du glaucome dans une population française.<br />
Matériel et Méthode : La population comprenait 2 074 sujets [1 384 hommes (H),<br />
690 femmes (F) ; âge moyen : 50±13 ans] venus pour un bilan de santé au Centre<br />
IPC (février-juin 2002) pour lesquels une mesure dans chaque œil de la pression<br />
intraoculaire (PIO) par tonométrie à flux d’air a été réalisée. Un champ visuel (FDT 5)<br />
et un fond d’œil (Topcon TRC-NW 6S) ont été réalisés chez 395 sujets ayant une<br />
PIO20 mmHg à un des deux yeux et/ou traitement pour PIO élevée ou glaucome, et/<br />
ou PIO élevée et/ou glaucome connu. Quatre investigateurs indépendants ont statué<br />
sur la présence de glaucome.<br />
Résultats : Au total, 14,9 % des hommes et 9,9 % des F ont une PIO 21 mmHg à<br />
l’un des yeux. Après examens complémentaires, la présence d’un glaucome sur un<br />
œil a été conclue chez 31 hommes (2,2 %) et 20 femmes (3 %). Le glaucome<br />
augmente avec l’âge : 0,8 % à 18-39 ans et 5,7 % à plus de 60 ans chez les hommes<br />
et 0,6 % et 4,7 %, respectivement chez les femmes.<br />
Commentaire et Conclusions : La prévalence du glaucome dans une population<br />
française d’âge moyen, est de 2,2 % chez les hommes et 3 % chez les femmes. Elle<br />
augmente avec l’âge, dès 60 ans chez les hommes et 50 ans chez les femmes.<br />
31 92<br />
Diagnostic et traitement des glaucomes : aide de l’informatique.<br />
Diagnostic and treatment in glaucoma: what help from data-processing?<br />
PAYCHA F*, NEPOUX G, ROCHE O, DUREAU P, UTEZA Y, DUFIER JL (Paris)<br />
But : L’accroissement du volume des connaissances qui augmentent les difficultés<br />
et les risques du diagnostic, d’une part, et la convivialité nouvelle de l’informatique,<br />
d’autre part, sont à l’origine de ce travail.<br />
Matériel et Méthode : Les données relatives aux glaucomes consignées dans les<br />
traités comprennent, suivant les auteurs, environ 30 chapitres, chacun comportant<br />
au plus une centaine de tableaux cliniques, soit au total moins de 1 000. L’établissement<br />
du diagnostic est une suite de comparaisons, signe par signe entre l’observation<br />
et les connaissances du praticien aboutissant à une identification ou au moins<br />
à un rapprochement. Il comporte classiquement 3 facteurs : l’observation, les<br />
connaissances du praticien et le raisonnement proprement dit où peuvent se produire<br />
des erreurs par omission, confusion ou fourvoiement.<br />
Comme depuis 1975 aucune nouvelle forme de glaucome n’a été publiée, les<br />
connaissances sur les glaucomes forment un ensemble fini. L’analyse combinatoire<br />
montre qu’avec 80 signes convenablement choisis qui constituent le thésaurus il est<br />
possible de les décrire toutes sans ambiguïté. La programmation sous Visual Basic<br />
met en mémoire avec ces signes un corpus comprenant tous les tableaux cliniques<br />
des glaucomes.<br />
Résultats : Un algorithme booléen y retrouve le cas décrit identique à l’observation.<br />
La fiabilité de l’informatique évite les erreurs. Une analyse des proportions par les<br />
probabilités ajustées calcule la valeur des réponses.<br />
Commentaire et Conclusions : L’approche informatique propose une aide au diagnostic<br />
et, en outre, permet de mieux appréhender nos mécanismes intellectuels.<br />
31 93<br />
Évaluation du glaucome chronique à angle ouvert (GCAO) par un score de graduation.<br />
Glaucoma evaluation with a scoring system.<br />
LACHKAR Y* (Paris)<br />
But : La prise en charge du glaucome chronique à angle ouvert (GCAO) nécessite<br />
l’évaluation de nombreux paramètres et ne repose pas uniquement sur un chiffre de<br />
pression intra oculaire, de l’évaluation du rapport c/d, ou sur l’analyse d’un champ<br />
visuel. Le but de cette étude préliminaire a été d’évaluer le GCAO du sujet adulte par<br />
l’intermédiaire d’un score établi de façon empirique et de voir si celui ci était bien<br />
corrélé à la gravité de la maladie et au traitement entrepris.<br />
Matériel et Méthodes : 90 patients atteints de GCAO ont été évalués suivant un<br />
score qui repose sur 11 paramètres cotés de 0 à 5 (côte). Les antécédents familiaux :<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
GLAUCOME<br />
cécité par glaucome (2), oui (1), non (0) ; l’âge : forme juvénile tardive (4) ; la race :<br />
sujet caucasien (0) sujet asiatique (1) sujet noir (2) ; la myopie : de 0-6 dioptries (1),<br />
de 6 à 12 dioptries (2) supérieur à 12 dioptries (3) ; la présence d’une dispersion<br />
pigmentaire ou d’une pseudoexfoliation capsulaire (1) ; la valeur de la pression intra<br />
oculaire (PIO) sans traitement : > 30 mm Hg (4), de 25 à 30 mm Hg (3) de 20 à 25 mm<br />
Hg (2) ; l’épaisseur cornéenne : < 500 µ (3) > 500 µ (0) ; l’analyse clinique du disque<br />
optique : suspect (1) ou pathologique (4) ; le déficit au champ visuel ; débutant (1)<br />
modéré (3), avancé (5) ; la présence de facteurs vasculaires (1) ; la notion de perte<br />
d’un œil par glaucome (4). La valeur du score s’échelonnait de 2 à 34. Nous avons<br />
comparé ce score au statut thérapeutique du patient : traitement médical ou chirurgical<br />
et nombre de collyres utilisés pour traiter le glaucome afin de savoir si ce score<br />
était bien corrélé à la gravité du glaucome.<br />
Résultats : Les patients ont été répartis en trois groupes ; groupe 1 (36 patients)<br />
score de 0 à 8, groupe 2 (24 patients) score de 9 à 13, groupe 3 (30 patients) score<br />
supérieur à 13. La répartition entre les patients traités médicalement (nombre moyen<br />
de collyres) et les patients opérés était : groupe 1 : traitement médical : 1,63 +/–0,73<br />
collyres ; chirurgie 4/36 ; groupe 2 : traitement médical : 2,00 +/–0,7 collyres, chirurgie<br />
17/24. groupe 3 : traitement médical : 2,12 +/–0,67 collyres, chirurgie 27/30.<br />
88 % des patients n’ont pas été opérés dans le groupe 1 alors que 90 % des<br />
patients du groupe 3 ont bénéficié d’une chirurgie filtrante.<br />
Commentaire et Conclusions : Le score de gradation utilisé semble être un outil<br />
simple et pratique pour évaluer rapidement un GCAO. Il permettrait de mieux poser<br />
les indications thérapeutiques ou de déterminer la PIO cible d’un patient. D’autres<br />
études sont nécessaires afin de le valider. Il ne s’applique cependant qu’au glaucome<br />
chronique à angle ouvert et ne tient donc pas compte des patients présentant<br />
un glaucome ou une hypertonie oculaire lié à un problème de fermeture de l’angle.<br />
31 94<br />
Corrélation entre la tomographie confocale du nerf optique (HRT) et la périmétrie<br />
automatique standard et la périmétrie en double fréquence (FDT). Évaluer son<br />
importance dans le diagnostic précoce du glaucome.<br />
Correlation between optic nerve confocal tomography (HRT) and standard automated<br />
perimetry and double frequency technology (FDT). Their importance in early<br />
diagnosis of glaucoma.<br />
SAMPAOLESI R* (Buenos Aires, Argentine), BRUSINI P (Udine, Italie),<br />
SAMPAOLESI JR (Buenos Aires, Argentine)<br />
But : Mettre en corrélation les quatre stades de la classification des atteintes du Nerf<br />
Optique (NO) d’après la tomographie confocale avec les données du champ visuel<br />
(MD et CLV) avec « Glaucoma Staging System ». Pour cette première corrélation on<br />
a utilisé la périmétrie automatique conventionnelle : SAP « Standard Automated<br />
Perimetry » (Périmètre Octopus 101). Dans un deuxième moment on a essayé de<br />
mettre en corrélation la stadification du nerf optique avec « FDT Staging System ».<br />
Pour cette seconde corrélation on a utilisé des périmètres HUMPHREY ZEISS<br />
WELCH ALLYN qui utilisent la technologie de double fréquence (FDT).<br />
Matériel et Méthode : On a étudié 58 champs visuels appartenant à 58 malades<br />
avec hypertension oculaire chez les uns ou glaucome chez les autres, avec une fourchette<br />
d’âge entre 15 et 65 ans, choisis au hasard. Les champs visuels ont été étudiés<br />
avec les SAP et les FDT, l’examen du nerf optique a été réalisé avec la<br />
tomographie comphocale (Heidelberg Retina Tomograph).<br />
Résultats : Dans 40 % au moins des champs visuels étudiés, qui avec la périmétrie<br />
standart (SAP Octopus 101) se seront révélés normaux, on a trouvé des défauts glaucomateux<br />
avec la technique de double fréquence (FDT). Ces défauts ont correspondu<br />
topographiquement avec la lésion du NO étudiée avec la tomographie confocale.<br />
Commentaire et Conclusions : Les nouvelles techniques périmétriques non<br />
conventionnelles telles la SWAP, flicker périmétrie, et dans ce cas, la FDT, permettent<br />
de mettre en évidence, bien avant les autres techniques, les défauts du champ<br />
visuel correspondant topographiquement aux lésions du NO. Ceci permet d’agir<br />
médicalement ou chirurgicalement beaucoup plus vite.<br />
31 95<br />
Altérations du champ visuel chez les patients porteurs d’un syndrome d’apnées<br />
du sommeil.<br />
Visual field defects in patients referred for sleep-related breathing disorders.<br />
BATISSE JL*, VIX J, SWALDUZ B, RACT MAJOUX G, CHAVE N (Lyon)<br />
But : Rechercher et préciser les atteintes du champ visuel dans le syndrome des<br />
apnées du sommeil.<br />
Matériel et Méthode : Les patients hospitalisés pour polysomnographie dans le<br />
service ORL bénéficient d’une consultation ophtalmologique de dépistage avant<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
l’enregistrement. Les antécédents personnels et familiaux sont recherchés de même<br />
que toute pathologie locale ou générale. Le lendemain est réalisé, chez les patients<br />
sans glaucome connu, une périmétrie bleu-jaune au périmètre de Humphrey. Une<br />
altération suspecte fait pratiquer un examen de la vision des couleurs et un nouveau<br />
contrôle à 3 mois. L’étude statistique cherche une relation entre les indices du<br />
champ visuel, MD, SF, PSD et CPSD et l’index d’apnées (RDI, « Respiratory Disturbance<br />
Index »).<br />
Résultats : Dans une étude préliminaire sur un petit nombre de patients, présentée<br />
lors du dernier congrès, seule la MD avait été trouvée significativement liée à l’index<br />
d’apnées du sommeil, la SF était indépendante, la PSD et la CPSD non significativement<br />
liées mais avec une tendance à l’aggravation parallèle à celle de l’index.<br />
Cette étude a été poursuivie dans les mêmes conditions afin de confirmer ou infirmer<br />
sur un plus grand nombre de patients l’hypothèse d’une altération du champ visuel<br />
de type glaucomateux dans ce syndrome. L’étude est en cours, les résultats seront<br />
présentés lors de la communication.<br />
Commentaire et Conclusions : Plusieurs études publiées mettent en évidence une<br />
fréquence importante des glaucomes à pression normale ou élevée dans le syndrome<br />
d’apnées du sommeil qui atteint essentiellement les hommes avec une surcharge<br />
pondérale et des ronflements nocturnes. La pathogénie pourrait mettre en<br />
jeu l’hypoxie secondaire chronique à laquelle ont été attribués également des troubles<br />
neurologiques ou cardiovasculaires. L’intérêt pour cette pathologie est récent<br />
et les conséquences des apnées nocturnes non encore complètement répertoriées.<br />
Si une telle prédisposition au glaucome pouvait être mise en évidence chez ces<br />
patients, des études multicentriques et un dépistage systématique pourraient être<br />
justifiées.<br />
31 96<br />
Syndrome d’apnées du sommeil et pression intraoculaire. Influence de la<br />
pression positive continue sur le rythme nycthémérale de la pression intraoculaire.<br />
Sleep apnea syndrome and intraocular pressure. Influence of nasal continuous<br />
positive airway pressure therapy on nycthemeral variation of intraocular pressure.<br />
HALLER M* (Grenoble), MELKI L (Valence), PEPIN JL, ROMANET JP (Grenoble)<br />
But : Nous avons étudiés, chez le patient apnéïque non glaucomateux, les variations<br />
nycthémérales de la pression intraoculaire ainsi que leurs modifications sous traitement<br />
par pression positive continue.<br />
Matériel et Méthode : Douze patients, indemnes de toute pathologie ophtalmologique,<br />
atteints de syndrome d’apnées du sommeil ont bénéficié d’un enregistrement<br />
nycthéméral de la pression intraoculaire et d’un enregistrement polysomnographique,<br />
avant et sous traitement par pression positive continue.<br />
Résultats : Avant traitement, 75 % des patients apnéiques non glaucomateux, présentent<br />
un rythme se rapprochant de celui mis en évidence chez le sujet glaucomateux.<br />
Avec traitement, nous avons constaté une modification du rythme de la<br />
pression intraoculaire dans 72 % des cas, une augmentation significative de la pression<br />
intraoculaire moyenne nocturne dans la population totale et une progression<br />
vers un rythme de type sain.<br />
Commentaire et Conclusions : La normalisation du sommeil et en particulier l’augmentation<br />
du sommeil lent profond (période pendant laquelle la pression intraoculaire<br />
est maximale) sous traitement semblent occuper une place prépondérante<br />
dans la progression vers un rythme de type sain.<br />
Ce travail met en évidence l’influence positive du traitement du syndrome d’apnée<br />
du sommeil sur le rythme circadien de la pression intraoculaire. Mais cette évolution<br />
met-elle à l’abris d’un glaucome dont on sait la prévalence élevée dans cette<br />
population ?<br />
31 97<br />
Action de différents collyres antiglaucomateux sans conservateur sur la<br />
prolifération et la viabilité d’une lignée de fibroblastes immortalisés (swiss3T 3)<br />
in vitro.<br />
Study of topical antiglaucomatous drugs on cells cultures: outgrowth and viability.<br />
JANY B*, MILAZZO S, GEKAS J, LAURANS P, CAPRANI L (Amiens)<br />
But : Étude du comportement d’un modèle cellulaire cultivé in vitro en présence de<br />
différents collyres antiglaucomateux sans conservateur.<br />
Matériel et Méthode : Des cellules de la même lignée de fibroblastes de souris<br />
immortalisées (Swiss 3T3) ont été mis en culture. Des boîtes de Pétri de 2,5 cm 2 ,<br />
traitées pour la culture cellulaire ont été utilisées. Au To, 200 000 cellules sont mises<br />
en culture dans chaque boîte dans 1 ml de milieu de culture adapté (DMEM). Nous<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
GLAUCOME<br />
comparons une culture témoin à des cultures en présence de collyres antiglaucomateux<br />
sans conservateurs (le timolol, la brimonidine et le cartéolol). Chaque jour (To,<br />
J1, J2) une numération à la cellule de Mallassez et une étude de la viabilité au bleu<br />
trypan a permis de comparer la cinétique de prolifération et la viabilité cellulaire en<br />
présence de chaque collyre testé par rapport à la culture témoin.<br />
Résultats : L’étude quantitative porte sur le nombre total de cellules (N), le rapport<br />
de multiplication cellulaire (R) et la viabilité (V) à To, J1 et J2. Une étude statistique<br />
de nos résultats a été réalisée par le test de Kruskal-Wallis et a été considérée<br />
comme extrêmement significative (p < 0,0001).<br />
Commentaire et Conclusions : Dans le groupe des collyres antiglaucomateux<br />
sans conservateur, seul le groupe cartéolol altère de façon significative la croissance<br />
cellulaire par rapport au témoin (p < 0,001) et par rapport au timolol et à la brimonidine<br />
(p < 0,001). Nous mettons en évidence une différence significative d’effet sur la<br />
croissance cellulaire, dans notre modèle de culture, entre les antiglaucomateux testés<br />
sans conservateur. Ces données préliminaires, bien qu’obtenues sur un modèle<br />
cellulaire bien connu et aisément utilisable grâce à son fort potentiel prolifératif,<br />
devraient être confirmées sur des lignées humaines. On sait que le traitement prolongé<br />
par ce type de collyres peut engendrer des altérations de la surface oculaire.<br />
Existe-t-il une action sur la formation d’une cataracte secondaire ? Nous voulons<br />
compléter l’étude en testant les antiglaucomateux sur des cultures de cellules épithéliales<br />
de cristallin humain. Et ainsi savoir quel antiglaucomateux prescrire préférentiellement<br />
dans le glaucome du pseudophake en vue de réduire l’incidence de la<br />
cataracte secondaire.<br />
31 98<br />
Analyse par cytofluorimétrie en flux de l’expression des interleukines 6 et 8 par les<br />
cellules épithéliales conjonctivales de patients glaucomateux traités au long cours.<br />
Flow cytometric analysis of interleukine-6 and –8 expression by conjunctival<br />
epithelial cells from patients with prolonged topical treatments for primary open<br />
glaucoma.<br />
BENSOUSSAN L*, BRIGNOLE-BAUDOUIN F, BLONDIN C, HAMARD P (Paris),<br />
CREUZOT-GARCHER C (Dijon), PISELLA PJ (Tours), BAUDOUIN C (Paris)<br />
But : Évaluer l’expression, par les cellules de l’épithélium conjonctival, de trois marqueurs<br />
inflammatoires, HLA-DR, interleukine 6 (IL-6) et interleukine 8 (IL-8), en cytométrie<br />
en flux, afin d’établir une corrélation entre l’expression de ces marqueurs et<br />
le type de traitement suivi par le patient.<br />
Matériel et Méthode : Soixante-quatre empreintes conjonctivales ont été prélevées<br />
sur 54 patients : 39 patients glaucomateux traités au long cours par des collyres<br />
avec ou sans conservateur et 15 yeux normaux. Un marquage membranaire et cytoplasmique<br />
a été réalisé par des techniques d’immunofluorescence directe et indirecte.<br />
La cytométrie en flux a défini dans les différents groupes de patients le<br />
pourcentage de cellules positives ainsi qu’une quantification de l’intensité de fluorescence<br />
émise par les cellules conjonctivales pour chaque marqueur.<br />
Résultats : Une expression significative a été mise en évidence sur des cellules épithéliales<br />
conjonctivales de patients glaucomateux traités par rapport à celles d’un<br />
groupe contrôle pour les marqueurs inflammatoires suivants : HLA-DR (p < 0,007),<br />
IL-6 (p < 0,0001) et IL-8 (p < 0,0003). Cette augmentation d’expression de HLA-DR<br />
et des interleukines 6 et 8 était plus importante chez les patients traités avec un<br />
collyre conservé et ceux sous multithérapie. Des corrélations positives et significatives<br />
ont été mises en évidence entre l’expression de HLA-DR et les expressions d’IL-<br />
6 (p < 0,0001) et d’IL-8 (p = 0,0004). Une corrélation négative a été mise en évidence<br />
entre l’expression d’IL-6 membranaire et celle de HLA-DR membranaire (p = 0,01) et<br />
d’IL-6 cytoplasmique (p = 0,03).<br />
Commentaire et Conclusions : Nous avons mis en évidence, par cytométrie en<br />
flux, la production de cytokines pro-inflammatoires, par l’épithélium conjonctival de<br />
patients glaucomateux traités. Cette technique fiable, reproductible et standardisée,<br />
objective et quantifie l’inflammation à partir d’une méthode de prélèvement conjonctival<br />
peu invasive. Cette méthode a déjà mis en évidence des processus inflammatoires<br />
et/ou apoptotiques dans les syndromes secs et le glaucome. Elle permet<br />
d’envisager une exploration plus large de la surface oculaire, allant des pathologies<br />
inflammatoires et allergiques aux phénomènes iatrogènes et toxiques induits par des<br />
agents médicamenteux ou environnementaux.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S193
1S194<br />
31 99<br />
La trabéculo-rétraction au laser argon (TRLA) dans le traitement du glaucome<br />
primitif à angle ouvert une expérience à propos de 25 cas chez le noir africain à<br />
Abidjan (Côte d’Ivoire).<br />
Laser treatment in primitif glaucoma an experience about 25 cases in black patients<br />
in Abidjan (Ivory Coast).<br />
COULIBALY F*, FANY A, BERETE R, ADJORLOLO C, KONAN-TOURE ML, GBE K,<br />
BONI S, OUATTARA A, DIALLO M (Abidjan, Côte d’Ivoire)<br />
But : L’utilisation du laser dans le traitement du glaucome à angle ouvert est une<br />
étape intermédiaire entre le traitement médical et la chirurgie. L’avènement de nouveaux<br />
moyens médicaux, chirugicaux et particulier la multiplication des lasers a<br />
modifié les protocoles thérapeutiques. Nous avons mené une expérience chez des<br />
patients noirs africains présentant un glaucome primitif à angle ouvert. Cette étude<br />
a pour but de définir les indications et d’évaluer les résultats de la trabéculo-rétraction<br />
au laser Argon (TRLA) chez le noir africain.<br />
Matériel et Méthode : Étude transversale portant sur deux séries de patients présentant<br />
un glaucome primitif à angle ouvert dont l’une traitée par des antiglaucomateux soit<br />
en monothérapie, bithérapie ou trithérapie a subi une TRLA après échec du traitement<br />
médical, l’autre série ayant bénéficié d’une TRLA de première intention. Le protocole a<br />
consisté en deux séances de TRLA à deux semaines d’intervalle sur la moitié inférieure<br />
de l’angle irido-cornéen puis sur la moitié supérieure avec un laser monochromatique vert.<br />
Résultats : Les résultats à moyen terme semblent satisfaisants avec un pourcentage de<br />
baisse de la pression intraoculaire allant de 10 % à 40 % chez la majorité des patients<br />
avec un seul cas d’élévation de la tension oculaire. Le gain moyen de pression intraoculaire<br />
est de 5 mmhg avec un maximum de 9 mmhg et un minimum de 2 mmhg.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces résultats, qui restent à évaluer à long terme,<br />
permettraient d’améliorer la qualité de la prise en charge en reculant le plus possible<br />
la prescription des nouvelles molécules qui constituent, de par leur coût élevé, un<br />
obstacle à l’observance du traitement médical.<br />
32 00<br />
Trabéculoplastie au laser sélectif : résultat clinique d’une étude prospective<br />
avec 4 ans de recul.<br />
Selective laser trabeculoplasty: clinical results. A 4 year prospective study.<br />
BEN SAID A*, LACHKAR Y (Paris)<br />
But : Le but de ce travail est d’évaluer l’inocuité et l’efficacité du nouveau procédé<br />
de trabéculoplastie utilisant le laser neodynium (Nd) : YAG, dit sélectif, dans la réduction<br />
de la pression intra-oculaire (PIO).<br />
Matériel et Méthode : 60 yeux de 39 patients sans antécédents de chirurgie ou de<br />
laser, portant tous un glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) non contrôlé par un traitement<br />
médical, ont été traités avec le laser Coherent Selecta 7 000 (Coherent INC, Palo<br />
Alto, CA), un laser Nd : YAG à fréquence doublée et commutation de Q. Chaque œil à<br />
reçu en une séance, environ 110 impacts d’une énergie variant de 0,8 à 1,2 mJ sur 360°.<br />
La taille du spot et la durée d’exposition sont fixes : 400 m et 3ns. L’efficacité du procédé<br />
a été évalué à 4 ans pour 21 yeux. Le recul moyen était de 33,73 ± 17,12 mois.<br />
Résultats : L’âge moyen des patients est de 64,86 ± 12,1 ans. L’énergie totale<br />
moyenne distribuée est de 85,9 ± 30,6 mJ. La PIO préopératoire moyenne était de<br />
23,44 mmHg ± 3,59 mmHg. La PIO postopératoire moyenne à 3 mois était de<br />
16,29 mmHg ± 2,71 mmHg, soit une réduction de 43,87 %, 16,0 mmHg ± 2,47 mmHg<br />
à 6 mois, 15,96 mmHg ± 2,45 mmHg à 1 an, 16,61 mmHg ± 2,74 mmHg à 2 ans,<br />
15,46 mmHg ± 2,17 mmHg à 3 ans, et de 15,94 mmHg ± 2,62 mmHg à 4 ans soit une<br />
réduction de 46,99 %.<br />
Commentaire et Conclusions : La trabéculoplastie au laser sélectif (TLS) paraît<br />
être une technique sûre et efficace afin d’abaisser la PIO, et pourrait être une alternative<br />
à la trabéculoplastie au laser à l’argon.<br />
32 01<br />
Sclérectomie profonde non perforante au Brésil : étude rétrospective de 3 ans.<br />
Non Penetrating Deep Sclerectomy in Brazil: a retrospective study of 3 years.<br />
PALETTA GUEDES VM*, PALETTA GUEDES R (Juiz De Fora, Brésil)<br />
But : La sclérectomie profonde est apparue comme une bonne alternative pour le traitement<br />
chirurgical du glaucome primaire à angle ouvert. Cette chirurgie est peu connue et<br />
peu acceptée parmi les médecins brésiliens. Le but de cette étude est d’évaluer les résultats<br />
et le taux de succès de cette technique après trois ans d’utilisation au Brésil.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
GLAUCOME<br />
Matériel et Méthode : Les auteurs ont étudié 111 patients atteints de glaucome<br />
primaire à angle ouvert qui ont été opérés de 1999 à 2002. Pour les patients avec<br />
risque d’échec, la Mitomicyne C per-opératoire a été utilisée.<br />
Résultats : L’âge moyen était de 63,72 ans et 42,3 % des patients étaient noirs. Pour<br />
une pression intraoculaire pré-opératoire moyenne de 22,57 +/– 4,92 mmHg, les<br />
auteurs ont trouvé une pression intraoculaire finale moyenne de 14,22 +/– 2,89 mmHg.<br />
Pour 7 patients la chirurgie a été converté en trabéculectomie. Les auteurs ont utilisé<br />
la Mitomicine C chez 80 patients. Le succès absolu (pression < 18 mmHg sans médication)<br />
est de 82,7 % et le succès rélatif (pression < 18 mmHg avec médication) est de<br />
93,3 %.<br />
Commentaire et Conclusions : Malgré cette nouvelle technique chirurgicale qui<br />
est très peu faite au Brésil, nos résultats confirment sa sécurité et son succès pour<br />
les glaucomateux au Brésil. D’autant que la population brésilienne est très mélangéé.<br />
Il faut augmenter la connaissance de la sclérectomie profonde parmi les chirurgiens<br />
brésiliens afin que plus patients bénéficient de cette technique.<br />
32 02<br />
Comparaison des sclérectomies profondes avec trabéculectomie externe<br />
associées ou non à un adjuvant de la filtration.<br />
Comparison of deep sclerectomies with external trabeculectomy performed with or<br />
without filtration adjuvants.<br />
HAMARD P*, OUNNOUGHENE Y, RODALLEC T, BAUDOUIN C (Paris)<br />
But : Les adjuvants chirurgicaux, destinés théoriquement à améliorer le pronostic<br />
fonctionnel des sclérectomies profondes non perforantes (SP), sont d’un intérêt discuté.<br />
Notre étude a comparé de façon rétrospective les résultats des SP associées<br />
ou non à l’utilisation per opératoire d’un antimétabolite – le 5 fluorouracile (5FU) – ou<br />
d’un implant en acide hyaluronique réticulé (SKGEL).<br />
Matériel et Méthode : Soixante-six patients consécutifs, d’âge comparable,<br />
atteints de glaucome chronique à angle ouvert sans facteur de risque d’échec chirurgical<br />
majeur et échappant à un traitement médical, ont été opérés par le même<br />
opérateur de sclérectomie profonde avec trabéculectomie externe selon la même<br />
technique. Une éponge de 5 FU (50 mg/ml, 5 minutes) a été mise au contact de la<br />
chambre de décompression dans 22 cas (groupe SP + 5 FU), un drain SKGEL a été<br />
positionné dans 24 cas (groupe SP + SKGEL) tandis que 20 patients (groupe SP)<br />
n’ont pas eu d’adjuvant chirurgical. Les succès pressionnels et les taux de goniopuncture<br />
ont été évalués rétrospectivement dans chaque groupe au terme du suivi.<br />
Résultats : Les pressions oculaires (PIO) moyennes pré et post opératoires, avec<br />
ou sans traitement d’appoint, étaient de 20,5 ± 3,9 mmHg et 14,2 ± 3,8 mmHg<br />
(groupe SP, suivi 19 ± 11 mois), 23,4 ± 6,9 mmHg et 13,7 ± 2,9 (groupe SP + SKGEL,<br />
suivi 17 ± 14 mois), 22,1 ± 4,1 mmHg et 14,1 ± 3,2 (groupe SP + 5 FU, suivi<br />
14 ± 7 mois). Les succès pressionnels évalués au terme du suivi (baisse de 30 % de<br />
la PIO pré opératoire sans traitement d’appoint) étaient équivalents dans les groupes<br />
SP et SP + 5FU (60 % et 63 % respectivement) tandis qu’ils étaient moindres dans<br />
le groupe SP + SKGEL (46 %). Les taux de goniopuncture se sont avérés moindres<br />
dans le groupe SP + 5FU (32 %) que dans les groupe SP (50 %) et SP + SKGEL<br />
(45 %).<br />
Commentaire et Conclusions : L’application de 5FU dans la chambre de décompression,<br />
en l’absence de facteurs de risque d’échec chirurgical majeur, est un adjuvant<br />
efficace de la sclérectomie profonde avec trabéculectomie externe car il paraît<br />
diminuer l’incidence des goniopunctures.<br />
32 03<br />
Étude de l’évolution de la pression intraoculaire chez le sujet mélanoderme<br />
après phako-exérèse vs phako-exérèse associée à une sclérectomie profonde.<br />
Follow-up study of the intraocular pressure in a black population:<br />
phakoémulsification vs phakoemulsifcation combined with a deep sclerectomy.<br />
JOYAUX JC*, PERICHON JY, DESOUDIN C, BILLIARD P (Fort-de-France)<br />
But : Montrer l’efficacité de la phako-sclérectomie à long terme chez le mélanoderme<br />
et suivre l’évolution de la pression intra-oculaire chez les patients du même<br />
phénotype opérés par phakoémulsification simple.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de deux groupes de sujets mélanodermes<br />
opérés entre 1993 et 1999 : l’un (groupe A) par phako-exérèse simple, l’autre<br />
(groupe B : sujets porteurs d’un glaucome chronique à angle ouvert non contrôlé par<br />
traitement médical maximum tolérable), combinée à une sclérectomie profonde.<br />
Résultats : Groupe A (100 patients) : PIO de départ 15,53 mmHg (14-20 mmHg) –<br />
nombre de traitement : 0,2. PIO après 72 mois 14,67 mmHg (18-12 mmHg) nombre<br />
de traitement : 0,42.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
Groupe B (50 patients) : PIO de départ 21,56 mmHg (14-34 mmHg) nombre de<br />
traitement : 2,38. PIO après 38 mois 14,36 mmHg (20-8 mmHg) nombre de<br />
traitement : 0,72.<br />
Commentaire et Conclusions : L’étude au long terme des courbes de pression<br />
intra-oculaire des deux groupes montre nettement une baisse de la tension intraoculaire<br />
la première année. Cette courbe tend à retrouver son niveau initial dans le<br />
groupe A de phako-émulsification simple, confirmant un effet transitoire sur la baisse<br />
de la PIO au long terme. Par contre la baisse de la PIO dans le groupe B est le témoin<br />
de l’efficacité de la sclérectomie associée à l’exérèse de la cataracte.<br />
32 04<br />
Cyclophotocoagulation au laser diode dans le traitement des glaucomes<br />
réfractaires.<br />
Diode laser cyclophotocoagulation for treatment of refractory glaucoma.<br />
PATTE M*,, CHIAMBARETTA F, DALENS H, BACIN F, RIGAL D (Clermont-Ferrand)<br />
But : Les glaucomes congénitaux, les glaucomes néovasculaires ou secondaires<br />
sont bien souvent réfractaires au traitement médical maximal et/ou à la chirurgie filtrante.<br />
La photocoagulation au laser diode du corps ciliaire permet de diminuer la<br />
pression intraoculaire (PIO) avec peu de complications sévères et peut ainsi constituer<br />
une thérapeutique adaptée.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective<br />
incluant 29 yeux de 26 patients. L’âge moyen est de 64 ans chez l’adulte et de 3,6<br />
ans chez l’enfant. Notre suivi s’étale sur 8 mois. Les glaucomes traités sont pédiatriques<br />
dans 5 cas, néovasculaires dans 12 cas, induits par la silicone dans 4 cas,<br />
des glaucomes chroniques réfractaires dans 3 cas et post-traumatiques pour<br />
2 patients. Tous les enfants avaient déjà bénéficié d’une ou plusieurs chirurgies filtrantes<br />
ainsi que 2 patients atteints d’un glaucome chronique. 18 impacts transcléraux<br />
sont réalisés sur 270° grâce au laser diode Iris Medical Oculight SLX. 14 % des<br />
patients dont 2 sur 5 enfants ont nécessité un deuxième traitement.<br />
Résultats : En terme pressionnel, on note une baisse de la PIO < 22 mmHg et/ou<br />
une diminution de plus de 30 %, dans 75,8 % des cas. La PIO moyenne passe de<br />
36,9 mmHg en pré-opératoire à 19,3 mmHg en post-opératoire. Sur le plan visuel,<br />
17 yeux d’adultes sur 22 sont malvoyants (acuité visuelle inférieure à 1/20) avant le<br />
laser. En post-opératoire, 80 % des patients ont une vision stable ou améliorée. De<br />
plus, on remarque dans 61,5 % des cas une suppression d’au moins 2 molécules<br />
hypotonisantes après cyclophotocoagulation et dans tous les cas, sauf un, les douleurs<br />
oculaires sont réduites ou disparaissent. Les complications sont soit une inefficacité<br />
ou une efficacité courte du laser chez 4 patients, soit une hypotonie sévère<br />
avec décollement choroïdien transitoire.<br />
Commentaire et Conclusions : Les résultats sont encourageants. La cyclophotocoagulation<br />
est une méthode rapide, peu invasive, responsable de moindres<br />
complications par rapport à la chirurgie et paraît efficace à moyen terme surtout<br />
dans les glaucomes réfractaires de l’adulte. Néanmoins chez les enfants, il est fréquent<br />
de renouveler le traitement par laser et les résultats sont plus incertains.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
GLAUCOME<br />
32 05<br />
Stimulation électromagnétique pour le traitement de l’atrophie glaucomateuse<br />
du nerf optique.<br />
Electromagnetic stimulation in treatment of glaucomatous optic nerve atrophy.<br />
ANISIMOV S*, ANISIMOVA S (Moscou, Russie)<br />
Purpose: To determine the effectiveness of the indirect electro- and magnetic stimulation<br />
in complex treatment of optic nerve glaucomatous atrophy.<br />
Material and Method: In this prospective study, 121 patients (296 eyes) with severe<br />
glaucomatous damage of optic nerve underwent course of 10 procedures of electromagnetic<br />
indirect stimulations. All patients have IOP not more 20 mm Hg on medications<br />
or after surgery. Course was repeated every 6 months. Noninvasive stimulation<br />
include magnetic influence (350 mcTl on the working surface with running<br />
magnetic field). Electrostimulation were performed by special device, adapted for the<br />
eye with tension 30v, frequency 50Hz, rectangle impulses, currency 50-100 mka.<br />
Follow-up period include 3-6 years of visual functions control every 6 months.<br />
Results: Analysis of the visual field showed that improvement were in 14.7% of<br />
cases after 1-2 courses of treatment. In 6.7% of cases with far-advanced glaucomatous<br />
process we found out aggravation of visual field during our follow-up period.<br />
Comment and Conclusion: After complex treatment of optic nerve atrophy by indirect<br />
electromagnetic stimulation improvement in visual acuity and stabilisation in visual acuity<br />
and stabilisation of visual field in all patients. Noninvasive course of electro-magnetic<br />
stimulation may be included in complex treatment of glaucomatous optic nerve atrophy.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S195
1S196<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
BOURSES DE LA FRANCOPHONIE – RISQUES INFECTIEUX EN OPHTALMOLOGIE<br />
BOURSES DE LA FRANCOPHONIE<br />
32 06<br />
Les urgences traumatiques de l’enfant à l’Institut d’Ophtalmologie tropicale de<br />
l’Afrique de Bamako au Mali.<br />
Children traumatic emergencies at African Tropical of Ophthalmology Institute in<br />
Bamako, Mali.<br />
KEITA-SYLLA F*, BOITTE JP, TRAORE J (Bamako, Mali)<br />
But : La traumatologie reste encore la principale source des urgences en ophtalmologie.<br />
Les grandes métropoles africaines n’y échappent pas. Elles se singularisent<br />
par la diversité et parfois l’originalité des causes ainsi que par l’âge de survenue des<br />
ces traumatismes, les enfants payant un lourd tribu en termes de handicap visuel et<br />
de retentissement socio-économique.<br />
Matériel et Méthode : Une étude rétrospective de 12 mois réalisée à l’Institut<br />
d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique de Bamako au Mali a recensé les urgences<br />
traumatiques chez les enfants de 0 à 18 ans en étudiant les caractéristiques épidémiologiques<br />
et cliniques des traumatismes oculaires. 162 patients vus aux urgences<br />
présentaient un traumatisme oculaire soit 24 % de l’ensemble de Urgences. Mais<br />
dans la tranche d’âge considérée, ils représentent 90 % des urgences. L’âge moyen<br />
est de 9 ans, le sexe ratio de 1,75 et 2 urgences sur 3 étaient reçues dans les 24<br />
premières heures. Les accidents d’origine ludique et domestique sont au premier<br />
rang des causes de traumatisme. La nature de l’agent causal est essentiellement<br />
végétale (aiguille de tresse en bois) ou métallique. La prise en charge chirurgicale<br />
s’effectue au-delà de la 24 e heure le plus souvent et sous anesthésie générale. Les<br />
plaies de cornées concernent la moitié des traumatismes. Le suivi thérapeutique est<br />
malheureusement aléatoire, seulement régulier chez 1 patient sur 4. Les taies cornéennes<br />
et les atteintes du segment antérieur sont les principales séquelles rencontrées<br />
posant le problème de l’amblyopie résiduelle et celui de la binocularité pour les<br />
jeunes patients en âge scolaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude confirme les effets désastreux des<br />
traumatismes oculaires chez les enfants en milieu tropical. Leur retentissement<br />
social, éducatif et économique contribue aux difficultés rencontrées quotidiennement<br />
par ces enfants. La prise en charge thérapeutique ne leur offre que trop rarement<br />
le maximum de chances en terme de rapidité et d’arsenal thérapeutique<br />
disponible. La création d’un service spécialisé d’ophtalmo-pédiatrie au sein de<br />
l’Institut devrait atténuer l’impact des traumatismes oculaires chez les enfants en<br />
Afrique.<br />
32 07<br />
Morbidité oculaire et cécité chez les personnes âgées en zone rurale du Togo.<br />
Morbidity and blindness among old people in a remote rural area of Togo.<br />
TEOU K*, BALO KP, BANLA M, AGLA K (Lomé, Togo)<br />
But : Étudier chez les populations vivant en zone rurale et ayant une accessibilité<br />
limitée aux soins oculaires les prévalences spécifiques de cécité ainsi que leurs causes<br />
dans les classes d’âges de 50 ans et plus.<br />
Matériel et Méthode : Une enquête de terrain, réalisée dans 13 villages relativement<br />
desservis situés à 80 km de la capitale et portant sur un échantillon de 768<br />
personnes des deux sexes extraites d’une population cible totale de 1 136 personnes<br />
soit une participation de 67,60 %. Ils ont eu un examen ophtalmologique comportant<br />
l’acuité, l’examen à l’aide des loupes de magnification et un fond d’œil.<br />
Résultats : Le groupe était constitué de 445 hommes et 323 femmes soit 58 % et<br />
42 % respectivement ; la tranche 50-54 ans avec 33,7 % était majoritairement<br />
représentée ; la prévalence cécité bilatérale a été de 15.4 %, celle de la cécité unilatérale<br />
était de 6,3 % ; la baisse de vision était prévalente dans 17,7 % des cas ;<br />
les prévalences selon le genre donnent 8,33 % chez les femmes contre 7,03 % de<br />
cécité bilatérale chez les hommes tandis qu on observe 9,37 % de prévalence de<br />
baisse de vision chez les femmes et 8,33 % chez les hommes ; les principales affections<br />
cécitantes sont la cataracte 39,58 %, le glaucome 30,72 %, les traumatismes<br />
oculaires 17,4 % et les opacités cornéennes 2,9 %.<br />
Commentaire et Conclusions : Les prévalences de cécité tant bilatérales qu’unilatérales<br />
et les baisses de vision sont relativement très élevées dans cette zone<br />
rurale enclavée ; les cataractes et les glaucomes prédominent et les femmes semblent<br />
plus exposées que les femmes. La lutte contre la cécité devra donc intégrer<br />
une orientation vers la chirurgie décentralisée.<br />
RISQUES INFECTIEUX EN OPHTALMOLOGIE<br />
32 08<br />
Comparaison entre mesures de la pression intraoculaire (PIO) par le tonomètre<br />
de Goldmann avec ou sans protection ou par une tonométrie à air.<br />
Comparison between evaluations of intra-ocular pressure (IOP) with Goldmann<br />
tonometer with or without Tonoshield ® or with air-tonometry.<br />
LABETOULLE M*, BRANCHE A, RUMEN F, OFFRET H, FRAU E (Le Kremlin Bicêtre)<br />
But : Estimer la pertinence des mesures de la PIO conformes aux règles de prévention<br />
des risques infectieux (pas de contact de matériel réutilisable avec la cornée) en<br />
étudiant la corrélation entre 3 méthodes de mesure : tonométrie à air et tonométrie<br />
de Goldmann avec ou sans protection à usage unique (méthode de référence).<br />
Matériel et Méthode : Des mesures de la PIO ont été réalisées chez 104 patients<br />
répartis en 2 groupes, soit avec un tonomètre à air (NT 2000 ® , Nidek) puis un tonomètre<br />
de Goldmann avec puis sans protection (Tonoshield ® ), soit dans l’ordre inverse.<br />
Résultats : Les méthodes de mesure comparées deux à deux ont montré une très<br />
forte corrélation des estimations de la PIO (R* : 0,8-0,9) quelque soit l’ordre utilisé.<br />
En moyenne, les mesures avec le tonomètre de Goldmann protégé et le tonomètre<br />
à air étaient supérieures de respectivement 1,4-1,8 mmHg et 0,5-1 mmHg par rapport<br />
à celles obtenues au tonomètre de Goldman sans protection. Cette surestimation<br />
était généralement majorée dans les valeurs hautes.<br />
Commentaire et Conclusions : Le tonomètre à air et la protection Tonoshield ® permettent<br />
de respecter les conseils d’hygiène (pas de contact de matériel réutilisable<br />
avec la cornée) tout en obtenant des valeurs très bien corrélées avec celles du tonomètre<br />
de Goldmann nu. Cependant, la surestimation de la PIO surtout dans les<br />
valeurs hautes incite à réserver ces méthodes au dépistage en complétant avec une<br />
tonométrie classique lorsqu’une valeur précise est nécessaire.<br />
32 09<br />
Protocole de décontamination des verres à trois miroirs et des tonomètres dans<br />
le service d’ophtalmologie de Reims : notre bilan depuis 1998.<br />
Decontamination modalities for 3 mirorrs lens and Goldmann tonometers in Reims<br />
department of ophthalmology: our experience since 1998.<br />
BRUGNIART C*, GOTZAMANIS A, DUCASSE A, SAINT MARTIN F, PELLETIER J,<br />
FERON A, POITEVIN J (Reims)<br />
But : L’actualité sur les agents transmissibles non conventionnels (prions) responsables<br />
notamment de la maladie de Creutzfeld Jacob ainsi que la circulaire sur les<br />
procédés d’élimination de ces prions (DGS 100 du 11/12/95) nous a amenés à mettre<br />
en place depuis 1998 un protocole de décontamination des verres à 3 miroirs et des<br />
tonomètres utilisés en consultation et en hospitalisation.<br />
Matériel et Méthode : Nous exposons les modalités de cette décontamination<br />
étape par étape et la nécessité d’augmenter le nombre de verres et de tonomètres.<br />
L’éducation du personnel et l’augmentation de la charge de travail sont évoquées.<br />
Résultats : Nous évaluons également l’incidence de ce protocole sur le matériel<br />
(usure prématurée). La durée devie du matériel, la nécessité de commandes supplémentaires<br />
et le coût global sont estimés.<br />
Commentaire et Conclusions : La procédure de décontamination instaurée est fiable<br />
sur le prion mais entraîne une augmentation de la charge de travail et des coûts (usure<br />
du matériel). Toutefois d’autres équipes ont depuis adhéré à ce système très sécurisant.<br />
32 10<br />
Prise en charge clinique et pronostique des kératites amibiennes. Étude<br />
rétrospective à propos de 25 cas.<br />
Clinical management and prognosis in Acanthamoeba keratitis. A retrospective<br />
study of 25 cases.<br />
CARDINE S* (Aulnay-sous-Bois), BOURCIER T, CHAUMEIL C, ZAMFIR O,<br />
BORDERIE V, LAROCHE L (Paris)<br />
But : Évaluer les facteurs de risque, les caractéristiques cliniques, les éléments du<br />
diagnostic et le devenir des patients atteints de kératites amibiennes.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons revu rétrospectivement les cas de 23 patients<br />
(25 yeux) traités pour kératite amibienne dans notre hôpital entre novembre 1994 et<br />
octobre 2000. Dans tous les cas, les amibes du genre Acanthamoeba avaient été<br />
retrouvées dans l’un et/ou l’autre des prélèvements suivants : cornée, lentilles de<br />
contact, boîtier des lentilles.<br />
Résultats : Un facteur de risque a été retrouvé chez 22 patients sur 23 : la plupart<br />
d’entre eux (20 sur 22) étaient porteurs de lentilles de contact ; 2 patients avaient été<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
BOURSES DE LA FRANCOPHONIE – RISQUES INFECTIEUX EN OPHTALMOLOGIE<br />
victimes d’un récent traumatisme cornéen. 15 patients sur 23 avaient été traités pour<br />
suspicion d’infection herpétique avant notre examen. Le délai moyen entre les premiers<br />
symptômes et le diagnostic positif était de 2 mois. Tous les patients ont été<br />
traités par l’association de 2 ou 3 collyres antiamibiens pendant 2 à 6 mois.<br />
5 patients ont reçu un traitement par voie systémique (kétoconazole ou itraconazole).<br />
Une intervention chirurgicale a été réalisée pour 9 yeux : kératoplastie transfixiante<br />
dans 8 cas, recouvrement conjonctival dans 1 cas, énucléation (secondaire) dans<br />
1 cas. Le pronostic visuel est resté compromis dans 10 cas (acuité visuelle inférieure<br />
à 3/10 e ) en raison du délai diagnostique.<br />
Commentaire et Conclusions : La kératite amibienne est une affection sévère qui<br />
met en jeu le pronostic visuel de l’œil atteint. Un diagnostic et un traitement précoces<br />
sont essentiels pour préserver au mieux la fonction visuelle. Des méthodes de diagnostic<br />
telles que la microscopie confocale et la recherche d’Acanthamoeba par<br />
PCR, permettant un diagnostic plus précoce de l’infection, devraient dans l’avenir,<br />
améliorer la prise en charge.<br />
32 11<br />
Intérêt de la greffe de membrane amniotique dans le traitement des kératites<br />
amibiennes sévères.<br />
Role of amniotic membrane transplantation in the management of Acanthamoeba<br />
keratitis.<br />
RONDEAU N*, BOURCIER T, CHAUMEIL C, BAUDRIMONT M, ZAMFIR O,<br />
THOMAS F, PATTEAU F, BORDERIE V, LAROCHE L (Paris)<br />
But : Les amibes représentent une cause redoutable de kératite infectieuse, provoquant<br />
une sévère inflammation oculaire et des douleurs importantes. Nous rapportons<br />
l’expérience de greffe de membrane amniotique (GMA) à la phase postinfectieuse<br />
de kératites amibiennes sévères.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée dans le service<br />
5 du CHNO des XV-XX de mai 2001 à mai 2002. Sont pris en compte les patients<br />
présentant une kératite amibienne hyperalgique chronique, non calmée par les antalgiques<br />
de classe II ou III. L’étude considère les facteurs de risque, les circonstances<br />
de contamination, les méthodes diagnostiques, les différents traitements et l’évolution.<br />
Résultats : Nous retrouvons trois cas de kératite amibienne hyperalgique chronique.<br />
Deux patients sont porteurs de lentilles, traités initialement pour une kératite d’allure<br />
herpétique ou d’allure bactérienne. Dans le troisième cas, il s’agit d’un ulcère de<br />
cornée provoqué par la projection de produit alcalin souillé de débris telluriques.<br />
Dans tous les cas le traitement initial ne comportait pas d’antiparasitaire. Le diagnostic<br />
de kératite amibienne a été fait dans un délai de 1 à 3 mois, par Polymerase Chain<br />
Reaction (2 cas) ou biopsie cornéenne (1 cas). Le traitement anti-parasitaire comprenait<br />
dans tous les cas : localement du PHMB et de la propamidine associés à des<br />
antibiotiques, et par voie générale du fluconazole. Les corticoïdes en topique ou en<br />
sous-conjonctival ont été débutés 7 à 15 jours après les anti-parasitaires. Une GMA<br />
double couche est proposée devant la persistance des douleurs entre le 6 e et le<br />
9 e mois d’évolution. Dans tous les cas les douleurs se sont rapidement amendées et<br />
l’effet antalgique persiste tant que la membrane est en place. Toutes les cornées se<br />
sont réépithélialisées. Les trois patients ont bénéficié entre le 10 e et le 14 e mois d’une<br />
kératoplastie transfixiante à but optique. Nous retrouvons alors dans toutes les cornées<br />
de nombreux kystes amibiens en anatomopathologie.<br />
Commentaire et Conclusions : La GMA représente une alternative thérapeutique<br />
intéressante dans la prise en charge des kératites amibiennes. Elle permet une réépithélialisation<br />
durable et l’allègement voire la suppression des antalgiques par voie<br />
générale en attente d’une kératoplastie transfixiante.<br />
32 12<br />
Première preuve par étude ultrastructurale et séquençage de la transmission<br />
d’Herpes Simplex Virus de type 1 dans un greffon cornéen conservé en<br />
organoculture.<br />
First demonstration of herpes simplex virus-1 transmission on a cornea stored in<br />
organ culture with electron microscopy and sequencing.<br />
THURET G*, BOURLET T (Saint-Étienne), LABETOULLE M (Paris), DUMOLLARD JM,<br />
ACQUART S, CAMPOS L, MAUGERY J, GAIN P (Saint-Étienne)<br />
But : La transmission d’Herpes Simplex Virus de type 1 (HSV-1) par greffe de cornée<br />
a récemment été formellement démontrée par la caractérisation génétique de la<br />
même souche virale dans la colerette cornéosclérale d’un donneur et chez son receveur.<br />
Ce travail rapporte la première démonstration d’une telle transmission par<br />
microscopie électronique à transmission (MET) et séquençage.<br />
Matériel et Méthode : Une femme de 35 ans, atteinte de kératocone, sans antécédent<br />
d’herpès, a bénéficié d’une kératoplastie perforante réalisée avec un greffon<br />
conservé 9 jours en organoculture. Le donneur n’avait aucun antécédent herpétique<br />
connu. Les examens macro et microscopiques du greffon étaient normaux tout au<br />
long de l’organoculture. Cinq jours après greffe, un important défect épithélial et une<br />
uvéite antérieure étaient constatés, conduisant à l’opacification du greffon. La<br />
patiente a bénéficié d’un changement de greffon 8 mois plus tard. À ce moment,<br />
l’humeur aqueuse, le greffon opaque et la collerette corneosclérale du donneur,<br />
stockée en routine en anatomopathologie au sein de notre laboratoire, ont été analysés<br />
en PCR (lightcycler) pour les virus du groupe Herpès. L’identification des souches<br />
virales par technique des empreintes digitales (fingerprint) et séquençage de<br />
régions hypervariables a également été réalisée. Le greffon opaque et la collerette<br />
cornéosclérale du donneur ont été examinés en MET.<br />
Résultats : L’ADN de HSV-1 a été retrouvé par PCR dans le greffon opaque et la<br />
collerette du premier donneur. Le séquençage confirmait qu’il s’agissait de la même<br />
souche virale. En MET, de nombreuses particules virales étaient présentes dans les<br />
noyaux et cytoplasmes ainsi que des particules virales enveloppées se détachant<br />
des cellules et correspondant à des virus matures.<br />
Commentaire et Conclusions : La MET, la PCR et l’identification génique ont<br />
confirmé l’allo-transmission d’HSV-1 du donneur au receveur par la greffe de cornée.<br />
Nous insistons sur la possibilité d’une réplication virale silencieuse durant l’organoculture<br />
n’affectant pas, en particulier, ni l’épithélium ni l’endothélium. L’archivage<br />
adapté des collerettes cornéosclérales pour la MET et la biologie moléculaire peut<br />
être utile pour l’analyse rétrospective des échecs primaires de greffe de cornée, dont<br />
l’herpès constitue une des principales causes.<br />
32 13<br />
Comparaison de la pénétration dans la chambre antérieure de la lévofloxacine<br />
et de la ciprofloxacine.<br />
Comparison of anterior chamber penetration of levofloxacin and ciprofloxacin.<br />
VELOU SIMONPOLI S*, COLIN J (Bordeaux)<br />
But : Nous avons comparé la pénétration intraoculaire de la levofloxacine (LFX) et<br />
de la ciprofloxacine (CFX) en collyres chez des patients opérés de la cataracte.<br />
Matériel et Méthode : Dans une étude randomisée, prospective, masquée,<br />
60 patients ont reçu 60, 30 et 15 mn avant une chirurgie de la cataracte une goutte de<br />
LFX 0,5 % ou de CFX 0,3 %. Un prélèvement d’humeur aqueuse a été réalisé en début<br />
d’intervention ; la concentration des fluoroquinolones a été mesurée par HPLC.<br />
Résultats : La concentration moyenne de LFX (917,3 ng/ml, SD 656,3) était statistiquement<br />
supérieure à celle de la CFX (118,2 ng/ml, SD 113,4) (p = 0,001).<br />
Commentaire et Conclusions : La CMI 90 pour staphylococcus epidermidis est de<br />
780 ng/ml pour la LFX et de 1 170 ng/ml pour la CFX ; malgré des variations interindividuelles<br />
importantes, la concentration de la LFX dans la chambre antérieure est<br />
supérieure à la CMI 90 de ce micro-organisme, la concentration de la CFX étant, elle,<br />
inférieure à ce taux. La bonne solubilité de la LFX permet d’obtenir une concentration<br />
dans l’humeur aqueuse environ 7 fois supérieure à celle de la CFX ; sa concentration<br />
est supérieure à la CMI90 des germes gram-positifs habituellement rencontrés au<br />
cours des endophtalmies.<br />
32 14<br />
Réinstillation d’anesthésie topique et endophtalmie post-opératoire.<br />
Topical anesthesia and postoperative bacterial endophtalmitis.<br />
SERVANTIE R*, ROBERT PY, ADENIS JP (Limoges)<br />
But : Lors d’une anesthésie topique, un supplément de collyre peut être instillé alors que<br />
le globe oculaire est ouvert. Nous analysons les risques infectieux de cette ré-instillation<br />
à la lumière d’une série d’endophtalmies et d’une étude de contamination in vitro.<br />
Matériel et Méthode : Nous présentons 5 endophtalmies post-opératoires de cataracte<br />
survenues dans le même service sur une période de 4 mois (320 phakoémulsifications).<br />
Dans les 5 cas, une ou plusieurs réinstillations d’oxybuprocaïne ont été<br />
prodiguées en cours d’intervention. Nous présentons également les résultats d’une<br />
étude in vitro de contamination après instillation de collyre dans les conditions pratiquées<br />
au bloc opératoire.<br />
Résultats : Dans les 5 cas, les facteurs de risque d’endophtalmie étaient une rupture<br />
capsulaire, un noyau dur (3 cas), une durée d’intervention supérieure à 45 mn (5 cas).<br />
La responsabilité statistique de l’anesthésie locale n’a pas été prouvée. In vitro, le nombre<br />
de contaminations a diminué après désinfection des unidoses à la Bétadine ® .<br />
Commentaire et Conclusions : Nous ne montrons pas de lien significatif entre la<br />
réinstillation d’anesthésique et le déclenchement d’une endophtalmie post-opératoire.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S197
1S198<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
BOURSES DE LA FRANCOPHONIE – RISQUES INFECTIEUX EN OPHTALMOLOGIE<br />
Néanmoins l’inoculum diminue après désinfection des unidoses. Cette désinfection<br />
peut être généralisée par principe de précaution avant toute instillation de collyre à<br />
globe ouvert.<br />
32 15<br />
Infections nosocomiales oculaires post-opératoires au CHNO des XV-XX.<br />
Nosocomial ocular infection in CHNO des XV-XX.<br />
MOREL C*, GENDRON G, TOSETTI D, AUCLIN F, LAPLACE O, TUIL E,<br />
CHAUMEIL C, SCHEER S, NORDMANN JP, BAUDOUIN C, SAHEL J, LAROCHE L,<br />
WARNET JM (Paris)<br />
But : La prévention des infections nosocomiales est une des priorités de chaque<br />
établissement de santé. En accord avec les recommandations de l’ANAES, le comité<br />
de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) du CHNO des Quinze-Vingt a mis<br />
en place une procédure de signalement de ces infections. Nous rapportons les résultats<br />
de cette démarche.<br />
Matériel et Méthode : La procédure de signalement est coordonnée par le cadre<br />
hygiéniste de l’établissement. Elle est déclenchée dés qu’une demande d’examen<br />
microbiologique est demandée chez un patient déjà opéré ou par signalement du<br />
médecin référent du CLIN de chaque service. Les résultats portent sur la survenue<br />
d’endophtalmie post-opératoire du premier janvier 2000 au 15 novembre 2002, et la<br />
survenue d’infection de matériel d’indentation à partir de 2002. Les prises en charge<br />
thérapeutiques des patients, le pronostic et les mesures préventives prises sont analysés.<br />
Résultats : Les taux d’endophtalmies bactériologiquement prouvés après chirurgie<br />
de la cataracte sont, pour les années 2000, 2001 et les sept premiers mois de 2002,<br />
de 1,6, 0,6 et 1,3 pour mille et de respectivement 3, 2, 2,3 pour mille pour les<br />
endophtalmies présumées. Plus de la moitié des patients conserve une acuité supérieure<br />
à 5/10. Le taux d’infection de matériel d’indentation est de l’ordre de 1 %.<br />
Commentaire et Conclusions : La procédure de signalement des infections nosocomiales<br />
permet la mise en place des mesures de correction et de prévention si<br />
nécessaire et d’évaluer leur efficacité à long terme.<br />
32 16<br />
Endophtalmies aiguës à streptocoques post-chirurgie de la cataracte : une<br />
complication dévastatrice.<br />
Streptococcus endophthalmitis after cataract surgery: a devastating complication.<br />
LE LEZ ML*, LAMOTTE P, DENOYER A, ARSENE S, PISELLA PJ (Tours)<br />
But : Les endophtalmies après chirurgie de la cataracte sont une complication<br />
redoutable, survenant dans 0,07 à 0,13 % des cas. Leur pronostic, fonctionnel et<br />
anatomique, apparaît fortement lié au germe impliqué. Les espèces les plus fréquemment<br />
retrouvées sont les staphylocoques. Les streptocoques sont rares (9 %<br />
des cas).<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur 37 cas<br />
d’endophtalmie aiguë, survenues après une chirurgie de la cataracte, déroulée sans<br />
incident. Tous les patients ont bénéficié d’une ponction de chambre antérieure et/ou<br />
d’humeur aqueuse. Le traitement instauré consistait en une antibiothérapie locale et<br />
générale, associée à une corticothérapie locale.<br />
Résultats : Sur les 37 cas d’endophtalmies suspectées cliniquement, 14 ont été bactériologiquement<br />
prouvées (humeur aqueuse et/ou vitré). La majorité des bactéries était<br />
gram positive (13 cas sur les 14). Les staphylocoques représentaient 5 cas sur 14, les<br />
streptocoques 4 cas, les entérocoques 3 cas. Concernant les endophtalmies à streptocoque<br />
et entérocoques, aucun des patients n’a amélioré son acuité visuelle ; pour les<br />
endophtalmies à staphylocoques, 80 % ont amélioré leur acuité visuelle.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude rétrospective objective la gravité des<br />
endophtalmies à streptocoque et à entérocoque. En l’absence de thérapeutique efficace,<br />
compte tenu de la virulence de ces espèces, nos efforts doivent porter sur la<br />
prévention de ces endophtalmies.<br />
32 17<br />
Place de la vitrectomie dans le traitement des endophtalmies.<br />
Vitrectomy in the treatment of post operative endophthalmitis.<br />
METGE F*, MEGHERBI C, LOUGHZAIL K, DE LAAGE DE MEUX P (Paris)<br />
But : Évaluer les résultats visuels dans 25 cas d’endophtalmie post opératoire, en<br />
fonction des modalités de prise en charge médicale et chirurgicale.<br />
Matériel et Méthode : Vingt-cinq cas d’endophtalmie post opératoire ont été analysés<br />
rétrospectivement avec un suivi moyen de 3 mois. Il s’agissait de 20 endophtalmies<br />
aigues et 5 endophtalmies chroniques. Les relations entre le pronostic visuel<br />
et le type de germe, la rapidité de prise en charge, la nature du geste thérapeutique<br />
et le moment de sa réalisation ont été étudiés. Tous les patients ont bénéficié d’une<br />
injection intra vitréenne d’antibiotiques au moment du diagnostic d’endophtalmie,<br />
associée à une antibiothérapie par voie intra veineuse.<br />
Résultats : Une vitrectomie à trois voies a été nécessaire dans un deuxième temps<br />
dans tous les cas d’endophtalmie chronique. Dans les endophtalmies aigues, elle a<br />
été réalisée chez 11 patients (55 %), dans un délai variable, en l’absence d’amélioration<br />
sous traitement médical, et lorsque l’échographie montrait la persistance d’un<br />
trouble vitréen important. Les patients dont l’acuité visuelle de départ était inférieure<br />
ou égale à « voir bouger la main » obtiennent des résultats visuels meilleurs en cas<br />
de vitrectomie précoce réalisée dans la première semaine après le diagnostic<br />
d’endophtalmie, qu’en cas de traitement médical seul, ou de vitrectomie plus tardive.<br />
Commentaire et Conclusions : La prise en charge des endophtalmies est actuellement<br />
bien codifiée sur le plan médical et repose sur la réalisation d’injections intra<br />
vitréennes d’antibiotiques. Le pronostic de cette pathologie reste cependant grave<br />
dans certains cas, et la réalisation d’une vitrectomie précoce doit sans doute être<br />
plus systématiquement envisagée dans les endophtalmies aiguës, en l’absence<br />
d’amélioration rapide après la première injection intra vitréenne.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
DMLA<br />
42 18<br />
Traitement par photothérapie dynamique des néovaisseaux visibles de la<br />
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Valeur pronostique du niveau d’acuité<br />
visuelle initiale. Étude prospective à propos de 76 observations.<br />
Treatment of classic choroidal neovascularization with photodynamic therapy in age<br />
related macular degeneration. Prognostic value of initial visual acuity. A prospective<br />
study about 76 cases.<br />
ROUILLOT JS* (Nantes), MOUTAOUAKIL A (Casablanca, Maroc), MARIE O,<br />
CAPELLI C, WEBER M (Nantes)<br />
But : Analyser l’influence pronostique du niveau d’acuité visuelle initiale sur l’acuité<br />
visuelle finale chez les patients présentant une néovascularisation rétrofovéolaire<br />
compliquant une DMLA traitée par photothérapie dynamique.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude prospective a porté sur 76 patients traités par<br />
photothérapie dynamique pour néovascularisation sous-rétinienne à prédominance<br />
visible compliquant une DMLA. Le suivi était au minimum de 6 mois, et en moyenne<br />
de 9 mois. Les patients ont été suivis tous les 3 mois selon le protocole de la TAP<br />
STUDY GROUP (Treatment of age related macular degeneration with phototherapy) :<br />
la membrane néovasculaire a été documentée par angiographie à chaque visite et la<br />
mesure de l’acuité visuelle effectuée en utilisant l’échelle ETDRS.<br />
Résultats : L’analyse de nos résultats montre qu’une acuité visuelle initiale inférieure<br />
à 20/200 avant le premier traitement constitue un facteur pronostic défavorable en<br />
ce qui concerne l’acuité visuelle finale. Parmi les patients présentant une acuité<br />
visuelle initiale supérieure à 20/200, les moins bons résultats fonctionnels sont obtenus<br />
pour ceux présentant un âge supérieur à 75 ans et/ou une membranes de<br />
grande surface initiale (≥ 1 000 µ) et/ou diffusion angiographique persistante 3 mois<br />
après le premier traitement.<br />
Commentaire et Conclusions : La valeur prédictive négative d’une basse acuité<br />
visuelle initiale sur l’acuité visuelle nous incite à discuter du bénéfice apporté par la<br />
photothérapie dynamique aux patients présentant une acuité initiale inférieure à un<br />
dixième. Pour les patients présentant une acuité initiale non effondrée (≥ 20/200)<br />
nous avons individualisé certains facteurs pronostics autres que l’acuité visuelle initiale<br />
susceptibles d’influer de manière péjorative sur l’acuité visuelle finale : il s’agit<br />
de l’âge, de la surface initiale de la membrane et de la surface de diffusion angiographique<br />
résiduelle 3 mois après le premier traitement.<br />
42 19<br />
Évaluation de l’efficacité de la thérapie photodynamique par<br />
l’électrorétinogramme multifocal dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge.<br />
Assessment of macular function by multifocal-Electroretinogram in Age-related<br />
Macular Degeneration before and after Photodynamic Therapy.<br />
MOSCHOS M* (Lausanne, Suisse), MOSCHOS M, PANAYOTIDIS D, SYNODINOS E,<br />
GEORGIADOU E, THEODOSIADIS G (Athènes, Grèce)<br />
Purpose: To evaluate the macular function by multifocal-Electroretinogram before<br />
and after Photodynamic Therapy in patients with classic subfoveal choroidal neovascularization<br />
due to Age-related Macular Degeneration.<br />
Material and Method: Twenty eyes of 20 patients (10 male, 10 female) with classic<br />
subfoveal choroidal neovascularization due to Age-related Macular Degeneration<br />
were studied. All patients received Verteporfin therapy. Fluorescein angiography and<br />
multifocal-Electroretinogram were performed in each patient 1 day before and 1<br />
week, 3 and 6 months after Photodynamic Therapy treatment.<br />
Results: Before treatment, the visual acuity and the electrical response densities in<br />
the foveal and parafoveal area were decreased in all patients. The mean visual acuity<br />
before Photodynamic Therapy was 21.35 (SD 15). The mean retinal response density<br />
before Photodynamic Therapy in area 1 was 1.535 nV/deg2 (SD 5.474) and in area<br />
2 1.065 nV/deg2 (SD 2.369). The visual acuity 6 months after Photodynamic Therapy<br />
remained stable in 70% of the patients. However, the mean mean retinal response<br />
density after Photodynamic Therapy in area 1 was 0.262 nV/deg2 (SD 3.7) and in<br />
area 2 0.2 nV/deg2 (SD 2.989).<br />
Comment and Conclusion: Multifocal-electroretinogram evaluates objectively the<br />
macular function of eyes with choroidal neovascularization due to age-related macular<br />
degeneration. In this study, the stability of visual acuity visual acuity coincided<br />
with a clear impairment of electrical activity of the foveal and parafoveal area. This<br />
finding postulates the need of adopting mf-ERG in order to assess objectively the<br />
efficacy of Photodynamic Therapy in the treatment of the disease.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
DMLA – PATHOLOGIE DU VITRÉ (2)<br />
42 20<br />
Caractéristiques angiographiques des néovaisseaux échappant au traitement<br />
par photothérapie dynamique dans la DMLA.<br />
Angiographic characteristics of newvessels with resistance to photodynamic<br />
therapy.<br />
FAVARD C*, FRANCAIS C, MAFTHOUI A, DE LAAGE DE MEUX P, LAROCHE L<br />
(Paris)<br />
But : Selon l’étude TAP, le traitement des néovaisseaux (NVX) rétrofovéolaires à prédominance<br />
visible de la DMLA par photothérapie dynamique (PDT) réduit le risque<br />
de perte supérieure à 3 lignes d’acuité visuelle (AV) à 1 et 2 ans.<br />
Matériel et Méthode : Dans cette étude rétrospective sur 2 ans, nous avons analysé<br />
les cas d’échec précoce du traitement par PDT. La surface et le diamètre des<br />
NVX sur l’angiographie à la fluorescéine et l’acuité visuelle ETDRS ont été étudiés<br />
avant PDT, puis à 4-6 semaines et 3 mois après PDT et à 3 mois après retraitement<br />
PDT.<br />
Résultats : Sur 220 yeux traités, 23 cas d’extension des NVX et de chute d’AV de<br />
plus de 3 lignes à 4-6 semaines puis 3 et 6 mois post PDT ont été observés. Les<br />
caractéristiques angiographiques de ces NVX sont dans 100 % des cas : empiètement<br />
partiel de la zone avasculaire centrale (ZAC), halo hypofluorescent, plus de<br />
75 % de NVX visibles et, dans 75 % des cas drusen miliaires ou absence de drusen<br />
(25 %). Dans tous les cas, au contrôle à 4-6 semaines on observe une chute de l’AV<br />
de plus de 3 lignes et un envahissement de l’ensemble de la ZAC.<br />
Commentaire et Conclusions : L’empiétement partiel de la ZAC par les NVX traités<br />
semble être un facteur majeur de mauvais pronostic. Ces échecs sont-ils liés<br />
à un masquage par le pigment xanthophylle, à la sécrétion de facteurs angiogéniques<br />
particuliers, ou à une anatomie particulière en raquette ? L’empiètement<br />
partiel de la ZAC semblant associé aux échecs du traitement par PDT, il paraît<br />
essentiel d’éviter de traiter les NVX empiétant moins de 50 % de la ZAC. En cas<br />
d’échec initial, un retraitement précoce par PDT ou un traitement antiangiogénique<br />
anti VEGF ou stéroïde retard intravitréen pourraient peut-être améliorer le<br />
pronostic.<br />
PATHOLOGIE DU VITRÉ (2)<br />
42 21<br />
Vitrectomie pour Vitréorétinopathie Exsudative Familiale.<br />
Endocular surgery for Familial Exudative Vitreoretinopathy.<br />
KRIVOSIC V*, MASSIN P, GAUDRIC A (Paris)<br />
But : Étude rétrospective rapportant les résultats de la chirurgie endoculaire chez<br />
des patients atteints de vitréorétinopathie exsudative familiale (VREF).<br />
Matériel et Méthode : Patients : Quatorze yeux de 10 patients atteints de VREF<br />
ont été opérés. L’indication chirurgicale a été un décollement de rétine (DR)<br />
exsudatif et tractionnel dans 7 cas, un DR reghmatogène dans 1 cas, une membrane<br />
épimaculaire (MEM) dans 4 cas, et une hémorragie du vitré (HDV) dans 2<br />
cas.<br />
Méthode : La technique chirurgicale a consisté en une vitrectomie par la pars<br />
plana, associée à une dissection des proliférations fibrogliales prérétiniennes, et<br />
une destruction des néovaisseaux périphériques par endolaser ou cryoapplication.<br />
Une indentation externe a été réalisée dans 2 cas. Pour chaque patient,<br />
l’acuité visuelle et l’aspect anatomique rétinien pré et post opératoire ont été<br />
relevés.<br />
Résultats : L’âge moyen des patients au moment de la chirurgie était de 24,6 ans<br />
(3 à 60 ans). La durée moyenne de suivi a été de 2,9 années (3 mois à 7 ans).<br />
L’acuité visuelle moyenne était de 1/10 (PL à 4/10) en préopératoire, versus 3/10<br />
(PL à 8/10) à la dernière visite post opératoire. Dans 7/14 cas l’acuité visuelle s’est<br />
améliorée de 2 lignes ou plus. Parmi les 8 cas de DR, la rétine a été réappliquée<br />
et la macula était à plat dans 7 cas à la dernière visite post opératoire. L’ablation<br />
de la membrane a été complet dans les 4 cas de MEM. Dans les 2 cas d’HDV, la<br />
chirurgie a permis d’éclaircir les milieux et de traiter les anomalies néovasculaires<br />
causales.<br />
Commentaire et Conclusions : La chirurgie vitréorétinienne permet de préserver<br />
l’acuité visuelle des patients atteints de forme modérée à sévère de VREF, quand<br />
elle est entreprise rapidement après la baisse de vision.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S199
1S200<br />
42 22<br />
Indications de la vitrectomie chez les patients atteints d’une baisse d’acuité<br />
visuelle secondaire à une hyalopathie astéroïde ou à un synchisis étincelant.<br />
Role of Vitrectomy in Patients with Decrease visual Acuity secondary to Asteroid<br />
Hyalosis or Synchisis Scintillans.<br />
BOISSONNOT M*, MANIC H, BALAYRE S, DIGHIERO P (Poitiers)<br />
But : La hyalopathie astéroïde et le synchisis étincelant du vitré sont des dégénérescences<br />
vitréennes lipidiques avec dépôts de calcium et de phosphore en règle<br />
associés à des pathologies cardio-vasculaires ou générales. Elles sont habituellement<br />
asymptomatiques. Le but de cette étude est de déterminer l’intérêt de la vitrectomie<br />
chez les patients atteints porteurs d’une baisse d’acuité visuelle.<br />
Matériel et Méthode : Trois patients ont bénéficié d’une vitrectomie en raison d’une<br />
acuité visuelle inférieure à 1/10 e . L’examen au biomicroscope retrouve les caractéristiques<br />
de la hyalopathie : particules blanchâtres et brillantes, de forme arrondie,<br />
de taille variable siégeant dans le vitré antérieur, mobiles aux mouvements du globe.<br />
Le fond d’œil est mal ou non visible. L’examen en échographie B objective un vitré<br />
très échogène, dense avec décollement postérieur laissant un espace pré rétinien<br />
libre d’échos. La vitrectomie est réalisée sans problème, complétée dans un cas par<br />
l’ablation d’une membrane épirétinienne associée.<br />
Résultats : La récupération visuelle est bonne dans deux cas (6/10 e ou plus), médiocre<br />
dans un cas par maculopathie atrophique.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces résultats sont comparés à ceux de la littérature :<br />
la vitrectomie peut être proposée en cas de baisse importante d’acuité visuelle. Le pronostic<br />
visuel dépend de l’état maculaire sous jacent qui peut être évalué par une angiographie<br />
fluorescéinique pré-opératoire si la densité de la hyaloïdopathie le permet.<br />
42 23<br />
Valeur pronostique de l’envahissement du vitré dans le rétinoblastome : une<br />
étude rétrospective sur 245 patients.<br />
Pronostic value of vitreous seeds in retinoblastoma: a retrospective study of 245 patients.<br />
DESJARDINS L*, LEVY C, LUMBROSO L, DENDALE R, SASTRE X, MICHON J,<br />
DOZ F (Paris)<br />
But : Nous avons réalisé une étude rétrospective pour mettre en évidence l’influence<br />
de l’essaimage vitréen dans le rétinoblastome sur le recours à l’irradiation externe et<br />
la conservation oculaire.<br />
Matériel et Méthode : Depuis 1995 nous avons réalisé un enregistrement systématique<br />
de tous les patients traités à l’institut Curie pour un rétinoblastome. Les données<br />
concernant chaque tumeur et chaque œil ont été notées ainsi que l’existence<br />
ou non d’un essaimage vitréen ou sous rétinien. Les données concernant le ou les<br />
traitements utilisés et le résultat sur la conservation oculaire sont également enregistrées.<br />
Une analyse statistique a été réalisée.<br />
Résultats : Il y a 245 patients (11 unilatéraux et 134 bilatéraux) soit 379 yeux avec un<br />
recul médian de 61 mois. 89 patients (44 unilatéraux et 45 bilatéraux) soit 101 yeux présentaient<br />
un envahissement du vitré. Sur ces 101 yeux 44 ont été conservés dont 26<br />
après irradiation externe et 18 après chimiothérapie et traitements locaux (dont 15 avec<br />
disque d’iode 125 pour envahissement localisé du vitré). Au total 35 yeux ont été irradiés.<br />
57 yeux ont été énucléés dont 41 en première intention, 9 après échec de l’irradiation et<br />
7 après échec de la chimiothérapie associée aux traitements locaux. L’analyse statistique<br />
montre en cas d’envahissement du vitré une augmentation significative du nombre d’yeux<br />
énucléés, du nombre d’yeux irradiés et de l’échec de l’irradiation externe.<br />
Commentaire et Conclusions : Les progrès effectués au cours des dix dernières<br />
années reposent essentiellement sur le bénéfice de la chimiothérapie et la thermothérapie.<br />
En cas d envahissement du vitré la concentration intra vitréenne n’est pas<br />
toujours suffisante pour permettre une efficacité correcte. Par ailleurs les lésions<br />
intravitréennes sont peu accessibles à la thermothérapie.<br />
Malgré les progrès récents dans le traitement du rétinoblastome, l’existence d’un<br />
essaimage vitréen diffus reste un facteur de gravité important.<br />
42 24<br />
Ablation de la limitante interne dans le trou maculaire stade 1.<br />
Internal Limiting Membrane Removal in Stage 1 Macular Hole.<br />
DUCOURNAU D*, BECQUET F, LE ROUIC JF (Nantes)<br />
But : Présenter les résultas d’une étude pilote sur l’ablation de la limitante interne<br />
dans le trou maculaire stade 1.<br />
Matériel et Méthode : Évaluation rétrospective de 93 trous maculaires stade 1<br />
consécutifs, yeux adelphes de trous maculaires de pleine épaisseur, opérés par<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
DMLA – PATHOLOGIE DU VITRÉ (2)<br />
vitrectomie postérieure, ablation de la hyaloïde postérieure et ablation systématique<br />
de la limitante interne. Le recul moyen est de 48 mois. Les acuités visuelles relevées<br />
par un observateur indépendant ont été converties en LogMAR pour leur analyse.<br />
Résultats : Quatre-vingt-dix yeux sur 93 (96,8 %) n’ont pas développé de trous<br />
maculaires constitués. Trois yeux (3,2 %) ont développé un stade 2 et ont été réopérés<br />
avec succès. À noter 2 récidives de stade 1 (2,15 %), 2 décollements de rétine<br />
(2,15 %) et 43 opérations de cataracte sur les 83 yeux phaques (52 %). Le gain<br />
moyen sur les 93 yeux a été de 1,5 lignes de LogMAR. Trois yeux ont perdu 2 lignes<br />
alors que 43 yeux ont gagné 2 lignes ou plus. Dans 6 cas (6,5 %), l’acuité visuelle<br />
est restée inférieure à 4/10.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette série rétrospective non randomisée montre<br />
que l’ablation de la limitante interne peut empêcher l’évolution du trou maculaire<br />
stade 1 vers le trou maculaire de pleine épaisseur dans une proportion plus grande<br />
que son évolution spontanée ou lors de l’ablation de la hyaloïde postérieure. De<br />
même l’acuité visuelle finale des yeux opérés au stade 1 est supérieure à celle des<br />
yeux opérés aux stades ultérieurs. À notre avis le patient devrait être informé de cette<br />
possibilité thérapeutique pour lui permettre une décision éclairée.<br />
42 25<br />
Persistance de la vascularisation fœtale : vers une classification plus clinique.<br />
Persistent fetal vasculature: a new clinical classification.<br />
CAPUTO G*, EDELSON C, METGE F, ARNDT C, MEUNIER I, BERGES O, DE LAAGE<br />
DE MEUX P (Paris)<br />
But : La persistance de la vascularisation fœtale anciennement persistance et hyperplasie<br />
du vitré primitif présente un polymorphisme clinique important. Il semble<br />
nécessaire d’établir une classification plus clinique permettant de guider la prise en<br />
charge thérapeutique.<br />
Matériel et Méthode : Analyse clinique et sémiologique de 35 cas de persistance<br />
de la vascularisation fœtale traités chirurgicalement.<br />
Résultats : En cas d’atteinte vasculaire ciliaire, notamment par persistance de la<br />
tunique postérieure du cristallin la forme est qualifiée d’antérieure complète ou partielle.<br />
Une atteinte rétinienne détermine les formes postérieures. Les formes combinées<br />
peuvent être classées en formes modérées en cas d’atteinte antérieure<br />
partielle, et sévères lorsque l’atteinte antérieure est complète. La prise en charge des<br />
formes antérieures se fait par voie cornéenne. En cas de forme partielle, une implantation<br />
en chambre postérieure est le plus souvent possible. Dans les formes postérieures<br />
une vitrectomie postérieure est nécessaire. Les formes combinées modérées<br />
se traitent comme une forme antérieure, alors que les formes sévères présentent une<br />
atteinte majeure du segment postérieur avec dysplasie rétinienne justifiant le plus<br />
souvent l’abstention.<br />
Commentaire et Conclusions : La persistance de la vascularisation fœtale présente<br />
une hétérogénéité phénotypique marquée. Une classification plus clinique de<br />
ce syndrome permet de comparer les études, et de clarifier la prise en charge thérapeutique,<br />
en donnant des éléments pronostics précis.<br />
42 26<br />
Traitement des déchirures géantes chez le sujet phaque par perfluorocarbone<br />
liquide et tamponnement interne temporaire par huile de silicone, sans ablation<br />
du cristallin ni identation sclérale.<br />
Giant retinal tears in phakic patients: surgical techniques and results using<br />
perfluocarbon liquid and silicone oil tamponade, without lens removal or scleral<br />
buckling.<br />
BENOUAICH X*, DABADIE-SIBILLE B, MAHIEU L (Toulouse), ROQUE I (Béziers),<br />
MATHIS V, MATHIS A (Toulouse)<br />
But : Évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels de la chirurgie du décollement<br />
de la rétine par déchirure géante chez le sujet phaque par vitrectomie, réapplication<br />
rétinienne par perfluorocarbone liquide, et tamponnement interne temporaire<br />
par huile de silicone, sans ablation du cristallin ni indentation sclérale.<br />
Matériel et Méthode : Cinquante-quatre patients phaques présentant une déchirure<br />
géante, sans prolifération vitréorétinienne sévère, ont été opérés par vitrectomie,<br />
repositionnement de la rétine inversée par un perfluorocarbone liquide, endophotocoagulation<br />
et/ou cryoapplication, et tamponnement interne temporaire par huile de<br />
silicone, sans ablation du cristallin ni indentation sclérale.<br />
Résultats : Après un suivi moyen de 4 ans, la rétine est réappliquée dans 100 %<br />
des cas. Deux récidives de décollement de rétine dont un cas avec nouvelle prolifération<br />
vitréorétinienne, et 3 récidives de décollement sur trou maculaire ont été<br />
observées. Une cataracte est survenue dans 49 cas (91 %) et une membrane épiré-<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
tinienne maculaire dans 9 cas (17 %). À la fin du suivi, l’acuité visuelle était supérieure<br />
ou égale à 1/20 dans 89 % des yeux, supérieure ou égale à 2/10 dans 65 %<br />
et supérieure ou égale à 5/10 dans 44 %.<br />
Commentaire et Conclusions : L’apport des perfluorocarbones liquides a simplifié<br />
le traitement des décollements de rétine par déchirure géante. Chez le sujet phaque,<br />
la vitrectomie associée à un tamponnement interne temporaire par huile de silicone<br />
sans ablation du cristallin ni indentation sclérale permet d’obtenir de bons résultats<br />
anatomiques et fonctionnels. L’ablation précoce de l’huile de silicone semble diminuer<br />
les complications du segment antérieur, notamment cornéennes.<br />
42 27<br />
Pronostic chirurgical respectif du syndrome de traction vitréo-maculaire et de la<br />
membrane épimaculaire idiopathiques.<br />
Surgical prognosis in idiopathic vitreomacular syndrome and epimacular membrane,<br />
respectively.<br />
GRIBOMONT AC* (Bruxelles, Belgique)<br />
But : Non traitée, la membrane épimaculaire progresse moins que le syndrome de<br />
traction vitréo-maculaire. Nous testons l’hypothèse que le pronostic chirurgical, dans<br />
les formes idiopathiques, est également meilleur pour la membrane épimaculaire.<br />
Matériel et Méthode : L’étude rétrospective comporte une série consécutive de 63<br />
membranes épimaculaires (groupe I) et 25 syndromes de traction vitréo-maculaire<br />
(groupe II) opérés avec un suivi d’au moins 6 mois. Sont exclus les yeux avec antécédent<br />
chirurgical ou lésions rétiniennes postérieures ou périphériques. Si les 2 yeux<br />
sont opérés, seul le premier est étudié. Les paramètres analysés sont l’acuité visuelle<br />
de loin et près, préopératoire et à 6 mois en tenant compte du cristallin, l’incidence<br />
des déchirures et décollements de rétine, et des récidives de membrane épimaculaire.<br />
Résultats : À 6 mois, si le cristallin est stable ou opéré, l’acuité visuelle augmente<br />
d’au moins 2 lignes de loin et près dans 100 % des cas (12/12) pour le groupe I, et<br />
60 % des cas (3/5) pour le groupe II. L’incidence du décollement de rétine et des<br />
déchirures est respectivement de 1,5 % (1) et 1,5 % (1) dans le groupe I et 8 % (2)<br />
et 4 % (1) dans le groupe II. Celle des récidives de membrane épimaculaire est de<br />
6 % (4) dans le groupe I et 8 % (2) dans le groupe II.<br />
Commentaire et Conclusions : Dans les cas idiopathiques, l’absence d’adhérence<br />
vitréo-maculaire préopératoire semble déterminer un meilleur pronostic chirurgical<br />
pour la membrane épimaculaire que pour le syndrome de traction vitréo-maculaire.<br />
42 28<br />
Résultats de la chirurgie vitréo-rétinienne dans le syndrome de traction vitréomaculaire<br />
: à propos de 42 cas.<br />
Results of vitreoretinal surgery for vitreomacular traction syndrome: a review of<br />
42 cases.<br />
PETROPOULOS J*, STANGOS AA, BROZOU C, KAPETANIOS A, POURNARAS C<br />
(Genève, Suisse)<br />
But : Le syndrome de traction vitréo-maculaire est caractérisé par un décollement<br />
postérieur du vitré avec persistance d’adhérences maculaires de la hyaloïde postérieure,<br />
entraînant des modifications tractionnelles anatomiques et fonctionnelles. Le<br />
but de notre étude est d’évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels de la<br />
vitrectomie pour le syndrome de traction vitréo-maculaire symptomatique.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons revu de façon rétrospective 42 yeux consécutifs<br />
de 40 patients (âge 72 ans en moyenne) qui ont subi une vitrectomie par la pars<br />
plana pour syndrome de traction vitréo-maculaire symptomatique. La vitrectomie a<br />
été combinée avec un pelage d’une membrane épirétinienne dans 36 yeux et de la<br />
membane limitante interne dans 18 yeux.<br />
Résultats : Le suivi postopératoire s’élève à 23 mois en moyenne. L’œdème maculaire<br />
kystoïde, identifié en préopératoire par l’examen biomicroscopique et sur des<br />
clichés d’angiographie fluorescéinique dans 33 cas, a disparu dans 92 % des cas.<br />
L’acuité visuelle s’est améliorée dans 29 yeux (69 %), d’au moins 4 lignes dans<br />
14 yeux (33 %). L’acuité visuelle moyenne à la fin du suivi (0,38 ± 0,07 logMAR) était<br />
significativement supérieure à celle en préopératoire (0,58 ± 0,08 logMAR) (p<br />
= 0,0002). Les complications peropératoires étaient des pétéchies (32 %) et des<br />
déchirures rétiniennes (8 %). Les complications postopératoires comprenaient la<br />
cataracte (83 %), les remaniements de l’épithélium pigmentaire (26 %) et le décollement<br />
de rétine (8 %). Deux récidives de membrane épirétinienne ont été observées.<br />
Commentaire et Conclusions : La vitrectomie pour syndrome de traction vitréomaculaire<br />
est efficace pour le relâchement de la traction vitréo-maculaire, le rétablis-<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
DMLA – PATHOLOGIE DU VITRÉ (2)<br />
sement de l’anatomie rétinienne et la régression de l’œdème maculaire cystoïde.<br />
L’acuité visuelle s’améliore significativement dans la majorité des cas.<br />
42 29<br />
Chirurgie du trou maculaire avec pelage de la limitante interne sans coloration.<br />
Internal limiting membrane peeling without staining in macular hole surgery.<br />
BADET JC*, BERROD JP, HUBERT I, NAOUN K, RASPILLER A (Nancy)<br />
But : Évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels de la chirurgie du trou maculaire<br />
avec pelage de la limitante interne (LI).<br />
Matériel et Méthode : Étude d’une série de 230 cas consécutifs de trou maculaire<br />
idiopathiques opérés entre 1996 et 2002. L’âge moyen est de 67 ans et 10 % des<br />
patients sont pseudophaques. Tous ont bénéficié d’une vitrectomie à trois voies<br />
avec pelage systématique de la limitante interne sans coloration, un tamponnement<br />
interne par gaz non expansif et un positionnement de 4 à 7 jours. Le suivi postopératoire<br />
minimum est de 6 mois.<br />
Résultats : Après une intervention 97,8 % des trous sont fermés avec pour 84 %<br />
des patients une amélioration de l’acuité visuelle supérieure ou égale à deux lignes<br />
équivalent Snellen. Au cours du suivi, aucune récidive n’a été constatée et 76 phacoémulsifications<br />
ont été réalisées avec une amélioration de l’acuité visuelle de<br />
1,5 ligne en moyenne. Le taux de décollement de rétine postopératoire est de 5,2 %<br />
sans réouverture du trou, tous réappliqués après une nouvelle procédure endoculaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Le pelage de la limitante interne améliore les résultats<br />
anatomiques et fonctionnels de la chirurgie du trou maculaire idiopathique et<br />
prévient les récidives.<br />
42 30<br />
Chirurgie du trou maculaire avec et sans utilisation du vert d’infracyanine.<br />
Macular hole surgery with or without use of intra-operative indocyanine green dye.<br />
ULLERN M*, DUBREUIL F, BAUDOUIN C (Paris)<br />
But : L’utilisation du vert d’infracyanine intra vitréen facilite l’ablation de la limitante<br />
interne dans la chirurgie du trou maculaire. Mais son innocuité est discutée. C’est<br />
pourquoi nous présentons rétrospectivement les résultats de 2 groupes de patients<br />
opérés avec et sans cet adjuvant.<br />
Matériel et Méthode : Quatorze trous maculaires successifs ont été opérés avec<br />
utilisation du vert d’infracyanine, pelage systématique de la limitante interne,<br />
mélange non expansif air ? C3F8, positionnement 8 à 10 jours. Ils sont comparés<br />
aux 14 cas précédents traités avec plasma autologue et ablation facultative de la<br />
limitante interne. Le reste de la procédure est identique. Le recul minimum est de<br />
6 mois.<br />
Résultats : Le taux de succès anatomique en une intervention est de 92 % avec<br />
ICG et ablation de la limitante interne et de 78 % sans ICG. L’acuité visuelle<br />
moyenne préopératoire est de 1/10 dans les 2 séries. En post opératoire elle est de<br />
2,5/10 dans les 2 groupes (gain de 4 lignes Snellen). Un aspect compatible avec un<br />
phototraumatisme est noté dans le groupe sans ICG.<br />
Commentaire et Conclusions : Les résultats anatomiques et fonctionnels sont<br />
comparables avec et sans ICG et aussi avec et sans ablation systématique de la<br />
limitante interne. Cette étude n’a pas retrouvé les effets délétères du vert d’indocyanine<br />
cités par les auteurs anglo saxons sur l’aspect angiographique et les résultats<br />
visuels ; l’utilisation d’un produit différent sans iode en est peut-être la raison. Elle<br />
n’a pas non plus démontré de bénifice visuel lié à l’ablation de la limitante interne.<br />
42 31<br />
Membranes épirétiniennes maculaires. Résultats à un an.<br />
Epiretinal membrane peeling. One year post operative results.<br />
AFFORTIT A*, FRAU E (Bicêtre), LAUTIER FRAU M (Paris), LABETOULLE M,<br />
RUMEN F, KIRSCH O, OFFRET H (Bicêtre)<br />
But : Les membranes épirétiniennes maculaires sont le plus fréquemment idiopathiques,<br />
surviennent après 50 ans et sont associées dans 90 % des cas à un décollement<br />
postérieur du vitré. Leur évolution spontanée se fait vers une rétraction qui<br />
entraîne une souffrance rétinienne et un œdème maculaire cystoïde. Le traitement<br />
repose sur la vitrectomie et le pelage de la membrane. Les auteurs rapportent leur<br />
expérience sur une série de 89 patients opérés avec la même technique.<br />
Matériel et Méthode : Les dossiers de 89 patients traités au CHU de Bicêtre pour<br />
membrane épirétinienne ont été revus rétrospectivement. Il s’agissait de 49 femmes<br />
et 40 hommes (âge moyen 70,15 ans) opérés entre mai 1998 et décembre 2001.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S201
1S202<br />
Tous les patients ont été opérés par le même chirurgien, une vitrectomie 3 voies,<br />
centrale et périphérique, a été effectuée, puis la membrane était enlevée à la pince<br />
sans utiliser d’autre instrument. L’acuité visuelle de près et de loin, une angiographie<br />
à la fluorescéine ont été pratiquées avant l’intervention, 3 mois et un an après l’intervention.<br />
Le recul minimum était de 1 an.<br />
Résultats : Parmi les 89 patients, 72 présentaient une membrane idiopathique, 17<br />
avaient une membrane secondaire à une uvéite, dans 6 cas un décollement de rétine<br />
avait été traité avant la survenue de la membrane, 3 patients avaient une rétinopathie<br />
diabétique traitée par panphotocoagulation, 3 patients avaient dans leurs antécédents<br />
un mélanome de la choroïde traité par protonthérapie. Une amélioration de<br />
l’acuité visuelle d’au moins deux lignes a pu être obtenue chez 70 % des patients.<br />
Un décollement de rétine est survenu chez un patient dans le mois qui suivait l’intervention,<br />
une chirurgie externe a permis la réapplication de la rétine. Une endophtalmie<br />
est survenue chez une autre patiente.<br />
Commentaire et Conclusions : L’ablation des membranes épirétiniennes en utilisant<br />
un seul instrument est une technique efficace et reproductible.<br />
42 32<br />
Intervention combinée vitrectomie pour membrane épimaculaire et<br />
phacoémulsification de cristallin : résultats préliminaires.<br />
Pars plana vitrectomy for epiretinal membrane removal combined with<br />
phacoemulsification: preliminary results.<br />
BERROD JP*, NAOUN K, HUBERT I, BADET JC, RASPILLER A (Nancy)<br />
But : Évaluer l’efficacité et rechercher les complications de la chirurgie simultanée<br />
des membranes épimaculaires et de la cataracte.<br />
Matériel et Méthode : Vingt-cinq yeux de 25 patients consécutifs sont opérés au<br />
cours de la même scéance de vitrectomie avec pelage de membrane épimaculaire<br />
et de limitante interne puis de phacoémulsification avec implantation souple dans le<br />
sac capsulaire. Les 12 premiers patients sont opérés dans un premier temps de la<br />
cataracte alors que les cas suivants on réalise d’abord la vitrectomie. Tous les yeux<br />
sont évalués pré-opératoirement et au 3 e mois post-opératoire par OCT.<br />
Résultats : Dans tous les cas l’intervention combinée s’est déroulée sans complication<br />
per- opératoire et la membrane a pu être retirée en totalité. L’acuité visuelle<br />
moyenne au 3 e mois est passée de 2,5/10 à 5,5/10 avec régression des métamorphopsies.<br />
L’épaisseur rétinienne mesurée sur l’OCT passe de 475 microns à<br />
350 microns dans les 1 000 microns centraux.<br />
Commentaire et Conclusions : L’intervention combinée pelage de membrane et<br />
phaco-éxérèse est efficace sur la récupération fonctionnelle. La phaco-éxérese réalisée<br />
dans le même temps ne semble pas aggraver le pronostic anatomique maculaire<br />
évalué par l’OCT.<br />
42 33<br />
Décollement de rétine du myope fort et vitrectomie de 1ère intention sans<br />
indentation épisclérale.<br />
Primary vitrectomy without scleral buckling for rhegmatogenous retinal detachment<br />
in high myopia.<br />
NAOUN K*, HUBERT I, BADET JC, SABLON JC, BERROD JP (Nancy)<br />
But : Rapporter les résultats de la vitrectomie sans indentation dans le traitement du<br />
décollement de rétine des yeux ayant une longueur axiale supérieure à 26 mm.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective de 116 patients consécutifs, présentant<br />
un décollement de rétine opéré en 1re intention par vitrectomie, dissection du cortex<br />
vitréen échange fluide-gaz, rétinopexie par cryoapplication ou laser et tamponnement<br />
interne par mélange gazeux faiblement expansif de SF6 ou C2F6.<br />
Résultats : La longueur moyenne des globes oculaires est de 29,2 mm, 33 % des<br />
yeux sont pseudophaques, l’étendue moyenne du décollement est 2,9 quadrants,<br />
avec 79 % des maculae décollées. Une prolifération vitréorétinienne supérieure ou<br />
égale à B est présente chez 37,5 % des yeux. Après une seule intervention, 82 %<br />
des rétines sont recollées, 91 % avec 2 opérations et 96 % avec 3 opérations.<br />
L’acuité visuelle moyenne passe de 0,7/10 à 3,5/10. Il n’y a pas de déficit oculomoteur.<br />
Les causes d’échec sont 11 cas de PVR, 7 nouvelles déhiscences dont 3 géantes<br />
et un trou maculaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude confirme l’efficacité de la vitrectomie<br />
sans indentation réalisée en première intention pour traiter les décollements de rétine<br />
du myope fort.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
DMLA – PATHOLOGIE DU VITRÉ (2)<br />
42 34<br />
Vitrectomie de première intention, sans indentation, dans le traitement des<br />
décollements de rétine avec déhiscence inférieure.<br />
Primary vitrectomy without scleral buckling for retinal detachment with inferior<br />
retinal break.<br />
HUBERT I*, NAOUN K, BADET JC, BERROD JP, RASPILLER A (Nancy)<br />
But : Déterminer l’efficacité de la vitrectomie sans indentation avec positionnement<br />
limité à 24 heures dans le traitement des décollements de rétine avec déhiscence<br />
inférieure.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective de 130 cas consécutifs de décollements<br />
de rétine présentant au moins une déhiscence en dessous des méridiens horizontaux.<br />
Ont été exclus de cette étude, les patients diabétiques, déjà opérés de DR, les<br />
déchirures géantes, les décollements post-traumatiques. La technique consiste en<br />
une vitrectomie, échange fluide-air, rétinopexie par cryo ou laser, tamponnement<br />
interne par gaz expansif. Le suivi post-opératoire minimum est de 6 mois.<br />
Résultats : 50 % des patients étaient pseudophaques, 28 % avaient une longueur<br />
axiale supérieure à 26 mm. La macula était décollée chez 76 % des patients. Une<br />
déchirure en position rétro-équatoriale était retrouvée chez 36 % des patients. Une<br />
prolifération vitreo-rétinienne de grade B ou plus était retrouvée chez 62 % des<br />
patients. La rétine était recollée en une intervention chez 116 patients (89 %). Parmi<br />
les 14 échecs, 5 étaient dus à une nouvelle déchirure ou une déchirure insuffisamment<br />
traitée et 9 étaient secondaire à la PVR. L’acuité visuelle pré-opératoire était<br />
de 1,6/10 (1,6 LogMar) et l’acuité post-opératoire moyenne était de 4,5/10<br />
(0,44 LogMar).<br />
Commentaire et Conclusions : La vitrectomie sans indentation est une technique<br />
sûre et efficace pour traiter les décollements par déhiscence inférieure Le positionnement<br />
prolongé n’est pas indispensable.<br />
42 35<br />
Vitrectomie avec injection d’infracyanine prémaculaire pour œdème maculaire<br />
diabétique cystoïde : résultats à moyen terme (à propos de 42 globes).<br />
Vitrectomy with premacular infracyanine injection for diabetic cystoid macular<br />
edema: mean term results (a review of 42 eyes).<br />
GRANGE JD*, JANKOWSKI O, ROUBEROL F (Lyon)<br />
But : Démontrer l’intêret et l’inocuité de l’injection peropératoire prémaculaire<br />
d’infracyanine, durant la vitrectomie pour œdème maculaire diabétique.<br />
Matériel et Méthode : 42 globes porteurs d’un œdème maculaire cystoïde appartenant<br />
à 35 patients diabétiques ont bénéficié d’une vitrectomie avec délamination<br />
de la limitante interne prémaculaire après injection d’infracyanine en regard de cette<br />
structure. 29/35 patients sont non insulinodépendants, mais insulino-requérants<br />
dans 19 cas. 17/35 patients ont une hypertension artérielle. L’œdème maculaire cystoïde<br />
était isolé dans 6 globes/42.<br />
Résultats : Sur le plan anatomique, l’œdème maculaire cystoïde a disparu immédiatement<br />
après chirurgie dans 64 % des cas. Dans 26 % des cas la régression est<br />
présente mais retardée. Aucune régression n’est notée dans 10 % des cas. Sur le<br />
plan fonctionnel, l’acuité visuelle de loin est augmentée dans 40 % des cas, stable<br />
dans 23 %, abaissée dans 14 % des cas. Le recul est insuffisant dans les autres cas.<br />
Commentaire et Conclusions : Bien que le recul moyen d’observation soit de<br />
6,5 mois (médiane 5 mois), la concordance entre la rapidité de l’amélioration anatomique<br />
dans la majorité des cas et par ailleurs la stabilité des résultats fonctionnels<br />
eux-mêmes caractérisés par un taux élevé d’amélioration-stabilisation, est à noter.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
42 36<br />
Implant de chambre postérieure à fixation sclérale, une alternative à la prise en<br />
charge des patients victimes de la luxation du cristallin cataracte par les<br />
tradipraticiens : à propos de cinq cas.<br />
Posterior chamber intraocular lenses with sclerotic fixation, an alternative to the<br />
treatment of the patients victims of luxation of the lens cataract caused by the<br />
traditional medecine: about five cases.<br />
BONI S*, FANY A, KONAN-TOURE ML, ADJORLOLO C, GBE K, COULIBALY F,<br />
BERETE R, OUATTARA A, DIALLO M (Abidjan, Côte d’Ivoire)<br />
But : Notre objectif est de proposer une solution à l’aphakie provoquée par l’abaissement<br />
du cristallin cataracté par les tradipraticiens.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude porte sur cinq cas d’abaissement traditionnel<br />
du cristallin dans le vitré. Les patients ont bénéficié d’un examen ophtalmologique<br />
avec évaluation de l’acuité visuelle et correction par verres aphaques. L’examen du<br />
segment postérieur constate la présence du cristallin dans le vitré sans complications<br />
inflamatoires ni vitréorétiniennes. L’examen est complété par une biométrie<br />
oculaire pour mésurer la puissance de l’implant à proposer. Les patients sous anesthésie<br />
locale ont bénéficié d’une extraction du cristallin luxé à l’anse après incision<br />
cornéenne, vitrectomie et injection de perfluorocarbone liquide dans la cavité<br />
vitréenne. une implantation en chambre postérieure avec implant à fixation sclérale<br />
a été réalisée.<br />
Résultats : Le suivi post opératoire immédiat met en évidence de légers œdèmes<br />
cornéens dans deux cas qui régressent rapidement, et la présence de perfluorocarbone<br />
liquide en chambre antérieure dans un cas. L’acuité visuelle à J60 était de 01/<br />
10 dans un cas ; de 02/10 dans un cas ; de 05/10 P4 dans un cas ; de 07/10 P3<br />
dans un cas et de 08/10 P3 dans un cas.<br />
Commentaire et Conclusions : La présence du cristallin dans le vitré constitue une<br />
menace permanente pour l’œil avec les risques d’inflammations, d’hypertonie oculaire<br />
et de décollement de la rétine. La mise en place d’un implant à fixation sclérale<br />
offre l’avantage de restituer la fonction visuelle et de prévenir les complications.<br />
L’utilisation de perfluorocarbone liquide réduit les complications peropératoires.<br />
L’implantation de chambre postérieure avec un implant à fixation sclérale est une<br />
alternative intéressante à la prise en charge des patients victimes de l’abaissement<br />
du cristallin par les tradipraticiens.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
DMLA – PATHOLOGIE DU VITRÉ (2)<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S203
1S204<br />
52 37<br />
Suivi à long terme des implants de cristallin artificiel en chambre postérieure en<br />
milieu africain.<br />
Long term follow up of posterior chamber intra ocular lens in Africa.<br />
LAM A* (Dakar, Sénégal), ELHIF S, GUEYE N, SECK CM, MVEMENGOME E<br />
(Libreville, Gabon)<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
ÉVOLUTION DES IMPLANTS CRISTALLINIENS<br />
But : Étudier l’évolution à long terme des implants de cristallin artificiel de chambre<br />
postérieure dans un service hospitalier dakarois.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit dune étude rétrospective des patients opérés dans<br />
le service d’ophtalmologie de Hôpital Principal de Dakar entre 1988 et 1992. Les<br />
critères d’inclusion sont : implantation de chambre postérieure en première<br />
intension ; absence de complications per-opératoires ; suivi minimum de 10 ans. Les<br />
paramètres étudiés sont : l’acuité visuelle et les complications post-opératoires.<br />
Résultats : Sur 400 yeux implantés, 60 soit 15 % ont été revus pendant au moins<br />
10 ans. Seulement 58 yeux ont rempli les critères d’inclusion. Vingt et un, soit 36 %<br />
des cas, ont présenté une anomalie post opératoire : cinq nouveaux glaucomes<br />
apparus après 5 ans chez des patients ages de plus de 55 ans ; huit déformations<br />
pupillaires ; neuf cataractes secondaires ; quatre maculopathies et cinq déplacements<br />
de l’implant dont deux luxations, spontanée et post-traumatique dans le vitre.<br />
Trois décollement de la retire ont été notes dont un compliquant une luxation postérieure.<br />
Acuité post opératoire moyenne est respectivement de 7/10 ; 8/10 et 5/10<br />
a 3 mois, un an et 10 ans. Sept patients ont perdu la vue.<br />
Commentaire et Conclusions : Les complications opératoires sont fréquentes<br />
dans cette étude Cependant seuls six cas, 23 % sont entièrement imputables à la<br />
présence de l’implant.<br />
Ces résultats attestent de la bonne tolérance des implants chez le noir africain malgré<br />
le faible taux de suivi. Mais la constatation de complications graves doit inciter<br />
à la vigilance et à un suivi régulier et prolonge des patients.<br />
52 38<br />
Perte cellulaire endothéliale après phakoémulsification et mise en place d’un<br />
implant cristallinien intrasaculaire.<br />
Endothelial cell loss after phacoemulsification with posterior lens.<br />
MEYER F*, WARY P, VITTE S, ROUX L, BOUAT C (Marseille)<br />
But : Une étude prospective se propose d’évaluer le pourcentage de perte de cellules<br />
endothéliales cornéennes après chirurgie de la cataracte par phakoémulsification<br />
et mise en place d’un implant cristallinien dans le sac capsulaire.<br />
Matériel et Méthode : L’échantillon est composé de 34 yeux de patients agés de<br />
50 à 85 ans. Sont exclus les patients porteurs de maladies chroniques, de cornea<br />
guttata ou de complications per-opératoires. La méthode de phakoémulsification est<br />
standardisée : chirurgiens séniors, anesthésie loco-régionale, voie cornéene, viscoprotection,<br />
divide and conquer, implant cristallinien pliable dans le sac. Le comptage<br />
cellulaire endothélial est effectué par microscopie spéculaire optique, non-contact<br />
par le SP2000P. Les mesures sont effectués dans les 15 jours qui précédent l’intervention<br />
puis à 1 mois post-opératoire. Le comptage cellulaire est corrigé en mode<br />
manuel évitant les faux positifs du comptage automatique.<br />
Résultats : La perte cellulaire globale moyenne est de 8,4 % à 1 mois. Cette valeur<br />
cache de grande disparité et l’étude de différents sous-groupes est plus intéressante.<br />
Dans un cas « standard » la perte moyenne est de 4,81 %. Par contre les pertes<br />
sont plus élevées si la cataracte est de type nucléaire dense : 15,55 % perte et<br />
en cas de faible capital endothélial de départ avec perte moyenne de 18 %. Certaines<br />
pertes majeures ne trouvent pas d’explication avec probablement une prédisposition<br />
particulière à l’apoptose.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude confirme que même la chirurgie moderne<br />
de la cataracte représente un « coût » pour l’endothélium cornéen et que la perte<br />
moyenne se situe à 5 % à 1 mois. Mais elle montre aussi qu’il existe des facteurs de<br />
risques qui combinés peuvent conduire à des situations critiques. D’où l’importance<br />
d’une meilleure protection de l’endothélium cornéen et du dépistage des sujets à risque.<br />
52 39<br />
Rétraction du capsulorhexis après phakoémulsification et implantation dans le sac.<br />
Capsulorhexis retraction after phacoemulsification and in the bag implantation.<br />
FEYS J*, BENDEDDOUCHE K, GRILLON S (Villeneuve-St-Georges)<br />
But : La rétraction du capsulorhexis, complication peu fréquente de la phacoémulsification<br />
avec implantation dans le sac, doit être reconnue pour être correctement<br />
traitée à temps.<br />
Matériel et Méthode : Quatorze patients opérés par phacoémulsification avec pose<br />
d’un implant dans le sac, ayant nécessité dans les suites opératoires l’ouverture du<br />
capsulorhexis rétracté.<br />
Résultats : Douze patients ont été traités par une capsulotomie antérieure radiaire<br />
au laser Yag, qui a permis de dégager l’aire pupillaire. Deux patients ont subi une<br />
explantation chirurgicale avec ablation du sac, du fait de la subluxation de l’implant<br />
secondaire à la rétraction du sac.<br />
Commentaire et Conclusions : Les différents facteurs de risque de rétraction du<br />
rhexis retrouvés dans cette série sont comparés à ceux habituellement rapportés,<br />
diabète, myopie, rétinopathie pigmentaire, âge avancé, pseudoexfoliation capsulaire<br />
et fragilité zonulaire, et discutés. Le biomatériau de l’implant paraît être également<br />
un élément important dans la survenue de cette complication. Les indication thérapeutiques<br />
sont discutées, en tenant compte de l’existence ou non d’un déplacement<br />
de l’implant. Complication peu fréquente, de traitement aisé sous condition d’être<br />
reconnue à un stade précoce. Sa prévention repose sur la réalisation d’un capsulorhexis<br />
de taille suffisante, et le choix d’un implant adapté notamment en présence<br />
de facteurs de risque.<br />
52 40<br />
Effet de bord et effet de jonction sur les implants cristalliniens et cataracte<br />
secondaire.<br />
Edge effect and junction effect with intra ocular lenses and posterior capsular<br />
opacification prevention.<br />
BILLOTTE C* (Caen)<br />
But : L’importance de l’effet de bord des optiques des implants cristalliniens dans<br />
la prévention de la cataracte secondaire a été mise en évidence par les travaux de<br />
Nishi, et est confirmée par de nombreuses études cliniques. La jonction entre optique<br />
et haptique peut constituer une zone de faiblesse dans l’effet de bord.<br />
Matériel et Méthodes : Les aspects cliniques de la prolifération et de la migration<br />
des cellules épithéliales ont été étudiés par des photographies, en particulier la voie<br />
empruntée par les cellules épithéliales pour passer sous l’optique, avec différents<br />
types d’implants PMMA ou pliables, trois pièces ou monobloc.<br />
Résultats : L’effet de barrière contre la cataracte secondaire est augmenté avec les<br />
optiques à bord carré ou tronqué, et quand la taille du capsulorhexis est inférieure<br />
au diamètre de l’optique. En regard du raccordement entre l’haptique et l’optique il<br />
existe un effet de jonction qui réduit ou supprime l’effet de bord à ce niveau, en<br />
particulier avec les implants monoblocs.<br />
Commentaire et Conclusions : La forme géométrique du bord de l’optique est<br />
reconnue comme étant un des facteurs influençant la prévention de la cataracte<br />
secondaire (effet de bord). L’effet de jonction agit en sens inverse de l’effet de bord.<br />
L’importance de l’effet de bord est reconnu. Il convient de minimiser le plus possible<br />
l’effet de jonction au niveau du raccordement haptique-optique pour ne pas compromettre<br />
l’effet de bord comme facteur de diminution du taux de cataracte secondaire.<br />
52 41<br />
Comparaison de deux implants multifocaux pliables en silicone.<br />
Comparative study of two multifocal silicone IOL´s.<br />
RIECK P*, LIEKFELD A, HARTMANN C (Berlin, Allemagne), KLEMEN U (St. Poelten,<br />
Allemagne), RENTSCH R (Karlsruhe, Allemagne)<br />
But : Le principe optique diffractif de certains implants multifocaux a fait ses preuves<br />
en pratique, mais il n´existait qu´un modèle non-pliable en PMMA. Depuis tout<br />
récemment, un implant souple en silicone avec une distribution asymmétrique de la<br />
lumière est disponible. Notre étude multicentrique a pour objectif d´évaluer l´acuité<br />
visuelle et la sensibilité au contrastes après phakoémulsification et mis un place d´un<br />
implant multifocal diffractif comparé à un modèle réfractif.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude porte sur 108 yeux de 54 patients avec un recul<br />
jusqu´à un an. La moitié est porteur bilatéral d´une lentille intraoculaire en silicone<br />
multifocale diffractive, l´autre moitié est porteur bilatéral d´un modèle réfractif en silicone.<br />
Nous avons évalué l´acuité visuelle (AV) de loin et de près sans et avec correction,<br />
la sensibilité au contrastes (SC, Pelly-Robson-Charts) ainsi que des rapports<br />
subjectifs des patients.<br />
Résultats : L´AV de loin n´ a pas montré de différence significative entre les deux<br />
groupes (sc 0,72/cc 0,86 pour l´implant diffractif, 0,74/0,95 pour l´implant réfractif ;<br />
échelle décimale). L´AV moyenne de près sans correction a été significativement<br />
meilleure pour le modèle diffractif (0,92) comparé avec l´implant de type réfractif<br />
(0,59). Il y n´avait pas de différence significative pour les SC entre les deux implants.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
Commentaire et Conclusions : La nouvelle lentille intracoculaire multifocale diffractive<br />
représente une combinaison d´un principe optique perfectionné avec l´avantage<br />
des implants pliables.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
ÉVOLUTION DES IMPLANTS CRISTALLINIENS<br />
52 42<br />
Chirurgie de la cataracte avec implant multifocal SA40 : résultats à 3 ans.<br />
Cataract extraction and implantation of AMO Array multifocal lens: 3 years follow up.<br />
ZOUARI N*, GHOUL A, CHAOUCH K, PAPAEFTHYMIOU I, BURGAT C,<br />
BERBACHE S, GANEM S (Paris)<br />
But : Notre étude a pour objectif d’évaluer les résultats réfractifs, visuels et les aberrations<br />
optiques après phako-émulsification et mise en place de l’implant multifocal<br />
SA40 souple en silicone à 5 zones optiques concentriques alternant les visions de<br />
près et de loin.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude rétrospective porte sur 50 yeux de 42 patients<br />
âgés de 46 à 90 ans (moyenne 71 ans), avec un recul de 3 ans. Le calcul de la puissance<br />
de l’implant a été effectué avec la formule SRK II. Aucune complication per et post-opératoire<br />
n’a été rapportée. Tous les implants ont été placés dans le sac capsulaire à l’aide<br />
d’un injecteur. Nous avons évalué l’acuité visuelle de loin sans et avec correction,<br />
l’acuité visuelle de près sans et avec correction, et l’acuité visuelle de près avec la correction<br />
de loin afin d’évaluer la capacité de pseudo-accomodation de l’implant.<br />
Résultats : L’équivalent sphérique post-opératoire est de –0,5 +/–0,5d. L’acuité<br />
visuelle moyenne de loin sans correction est de 6,7 +/–0,73 (échelle décimale).<br />
L’acuité visuelle de loin avec correction est de 7,8 +/–0,85. L’acuité visuelle moyenne<br />
de près sans correction est de P2,9 +/– 0,3. L’acuité visuelle de prés avec correction<br />
est de P2. Une pseudo-accomodation a été notée dans tous les cas. Nous n’avons<br />
observé aucun décentrement de l’implant malgré une fibrose de la capsule postérieure<br />
notée dans 8 cas (16 %). La récupération visuelle a été totale après capsulotomie<br />
au laser YAG.<br />
Commentaire et Conclusions : Si cet implant multifocal semble privilégier la vision<br />
de loin, les acuités visuelles de près n’en demeurent pas moins très satisfaisantes.<br />
La présence de halos lumineux est rarement évoquée spontanément et le degré de<br />
satisfaction est élevé.<br />
52 43<br />
Implantation secondaire par implant pliable.<br />
Secondary foldable intraocular lens implantation.<br />
ADAM PA*, MURAINE M, SIHAMED K, BRASSEUR G (Rouen)<br />
But : Évaluer l’utilisation d’un implant pliable dans la correction chirurgicale de<br />
l’aphakie.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons implanté secondairement 42 yeux de 29 patients<br />
avec l’implant acrysof. L’aphakie était secondaire à une cataracte congénitale dans<br />
26 cas et une cataracte traumatique dans 16 cas. L’âge moyen est de 28 ans.<br />
L’implant est positionné dans le sulcus au travers d’une incision temporale de 3,2 mm<br />
non suturée. Dans 4 cas, il est solidarisé à l’iris par 2 points de McCannel modifiés.<br />
Résultats : En préopératoire, l’acuité visuelle est de 0,46, l’équivalent sphérique de<br />
+13,16 D et l’astigmatisme de 1,4D. La puissance de l’implant était de 21,5 D (10 –<br />
30D). En postopératoire, la réfraction et l’astigmatisme sont stables dès 15 jours.<br />
L’acuité visuelle passe à 0,57, l’équivalent sphérique à –1,3 D et l’astigmatisme reste<br />
stable à 1,47D. L’astigmatisme induit moyen est de 0,03 D +/– 1,15. Dans 2 cas,<br />
l’implant s’est déplacé quelques semaines plus tard en raison d’un support capsulaire<br />
insuffisant. L’implant a pu être repositionné et les haptiques suturées à l’iris pour<br />
plus de stabilité.<br />
Commentaire et Conclusions : L’implantation secondaire à l’aide d’un implant pliable<br />
permet une récupération visuelle particulièrement rapide et garantit un astigmatisme<br />
faible. Les haptiques doivent être rigides afin de permettre une fixation irienne<br />
dans certains cas. En raison du positionnement plus antérieur de l’implant, il est nécessaire<br />
de retirer une dioptrie par rapport aux mesures échographiques classiques.<br />
52 44<br />
Implants suturés à la sclère.<br />
Transcleral sutured posterior chamber intraocular lenses.<br />
CHARPENTIER D*, ABOU-AHMED A, PARRAT E, FOULQUIER S, TOUAMER S,<br />
ESTRIPLET R (Pointe-à-Pitre, Guadeloupe)<br />
But : Analyse retrospective des résultats fonctionnels et des complications de<br />
11 patients ayant bénéficié d’un implant suturé à la sclère pour correction<br />
d’aphaquie.<br />
Matériel et Méthode : Huit patients présentaient une luxation ou subluxation traumatique<br />
du cristallin, deux une luxation d’un implant de chambre postérieure sur<br />
phakoexérèse compliquée et un dernier une aphaquie sur traumatisme perforant.<br />
Huit ont eu une suture sclèrale ab externo de l’implant et trois une technique ab<br />
interno de fixation ciliaire de l’implant.<br />
Résultats : 82 % des yeux en post-opératoire ont 5/10 ou plus de meilleure acuité<br />
corrigée et aucun n’a de perte de meilleure acuité visuelle pré-opératoire. Un décentrement,<br />
un œdème maculaire, deux érosions sur fils et un décollement de rétine<br />
limité tardif sur palissade trouée ont été observés.<br />
Commentaire et Conclusions : Nos résultats fonctionnels et le taux de complications<br />
de cette étude sont comparables à ceux des séries publiées. Le décollement<br />
de rétine et l’œdème maculaire sont les deux responsables de perte d’acuité visuelle<br />
à côté des très rares cas d’endophtalmies.<br />
L’implant à fixation ciliaire n’a pas plus de complications postérieures que l’implant<br />
de chambre antérieure. Il garde actuellement des indications spécifiques lors des<br />
délabrements iriens et/ou de synéchies angulaires importants.<br />
52 45<br />
Une nouvelle lentille intraoculaire souple à fixation sclérale.<br />
A new foldable scleral-fixation intraocular lens.<br />
BRUSINI P*, MIGLIORATI G (Udine, Italie)<br />
But : Les auteurs illustrent l’utilisation d’une nouvelle lentille à fixation sclérale en<br />
matériel souple acrylique, qui trouve son soutien dans le sulcus ciliaire.<br />
Matériel et Méthode : La lentille a un diamètre total de 13 mm et un diamètre de<br />
l’optique de 6,5 mm ; sa forme est ronde avec quatre trous pour la suturer à la sclère.<br />
La forme et les dimensions lui assurent une très bonne stabilité, sans possibilité de<br />
tilting, tandis que la souplesse du matériel permet de l’introduire par une incision de<br />
4 mm de longueur qui ne nécessite donc pas de suture. De plus la géométrie de la<br />
lentille permet souvent de la fixer au sulcus sans être obligé de la suturer à la sclère,<br />
car il faut seulement quelque résidu de la capsule pour la soutenir. Dans les mêmes<br />
conditions une lentille à fixation sclérale « classique » doit toujours être suturée.<br />
Résultats : Les auteurs ont traité 12 cas qui nécessitaient l’introduction d’une lentille<br />
à fixation sclérale dans le sulcus. Les auteurs montrent les avantages de cette<br />
lentille en cas de : absence du cristallin, greffe cornéenne, traumatismes, dislocation<br />
du cristallin ou d’une lentille intraoculaire dans le vitré, en chirurgie vitrorétinienne et<br />
en cas de nécessité d’une lentille dans le sulcus avec ou sans fixation sclérale. Les<br />
résultats optiques ont été très encourageants.<br />
Commentaire et Conclusions : Les auteurs considèrent que la lentille à fixation<br />
sclérale présentée est une innovation dans la chirurgie ophtalmologique pour ses<br />
caractéristiques tant physique que de dessin.<br />
L’un des auteurs a un intérêt financier dans l’équipement, le procédé ou le produit<br />
présenté.<br />
52 46<br />
Les prothèses d’iris et du cristallin, recul de deux ans.<br />
Iris and lens prosthesis, two years follow-up.<br />
MARTINEZ-COSTA PEREZ R*, DESCO C, MENEZO JL (Valencia, Espagne)<br />
But : Étudier la sécurité, les complications et l’amélioration des yeux atteints d’aniridie<br />
après l’implantation d’une prothèse d’iris.<br />
Matériel et Méthode : Huit yeux de sept patients souffrant d’aniridie (dont trois<br />
congénitales et quatre traumatiques), ont été opérés pour les implanter un iris artificiel.<br />
Les modèles des prothèses ont été différents : 1) deux prothèses avec un trou<br />
de 3 millimètres comme pupille, suturés au sulcus devant une lentille intraoculaire.<br />
2) Cinq lentilles intraoculaires avec un diaphragme au milieu de la zone optique.<br />
3) Deux anneaux fenêtrés au lieu du diaphragme devant une lentille intraoculaire<br />
dans un cas. Dans deux cas, l’opération a été combinée à une chirurgie antiglaucomateuse<br />
et dans un autre à une greffe de cornée. Un cas a eu une autokeratoplastie<br />
rotatoire dans un second temps.<br />
Résultats : Tous les yeux montrent une amélioration de l’acuité visuelle après chirurgie<br />
avec disparition de l’éblouissement. Trois yeux présentent une hypertension<br />
intraoculaire. Un cas présente un retard de l’épithélisation cornéenne.<br />
Commentaire et Conclusions : Malgré les différences de chacun, le dénominateur<br />
commun est une grande incision, étant donné le diamètre des implants ; cette particularité<br />
est responsable d’une longue période de récupération visuelle. Les cas<br />
nécessitant de suturer l’implant sont plus complexes. Les cicatrices cornéennes<br />
dues aux traumatismes et à des malformations de l’œil selon les cas, ont aussi une<br />
influence dans l’acuité visuelle finale. Il faut aussi envisager plusieurs opérations<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S205
1S206<br />
complémentaires (chirurgie filtrante, des kératoplasties), qui puissent être réalisées<br />
en différents gestes. Les implants d’iris artificiels, améliorent fortement l’acuité<br />
visuelle et diminuent les troubles des malades atteints d’aniridie congénitale ou<br />
acquise.<br />
52 47<br />
Implantation d’une lentille acrylic monobloc Natural ® .<br />
Natural ® Acrylic monobloc lens implantation.<br />
BUMBACHER M*, ROTH A, TABATABAY C (Genève, Suisse)<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
ÉVOLUTION DES IMPLANTS CRISTALLINIENS<br />
But : Évaluer la vision des couleurs et la perception des contrastes chez les patients<br />
opérés de la cataracte et recevant un implant monobloc Acrylic Natutal ® , contenant<br />
un filtre bleu absorbant le rayonnement lumineux entre 400 et 500 nanomètres.<br />
Matériel et Méthode : Cent cas de phacoémulsification de la cataracte avec<br />
implantation d’une lentille SN60 ALCON ont été effectués. La lentille est placée dans<br />
le sac capsulaire. 20 patients ont été examinés rétrospectivement à la lampe-à-fente,<br />
dont 1 œil avait été implanté avec une lentille en acrylic de type SA60 et l’autre œil<br />
avec un implant de type acrylic avec un filtre bleu SN60. Nous avons comparé les<br />
résultats de la perception des couleurs et des contrastes dans le suivi post-opératoire<br />
pour les 2 types de lentilles.<br />
Résultats : Les 100 cas d’implants consécutifs de SN60 n’ont posé aucun problème<br />
particulier par rapport à l’implantation d’une lentille acrylic habituelle. Dans les cas<br />
des 20 patients dont 1 œil avait été implanté avec une lentille SA60 et l’autre œil avec<br />
une SN60, la vision des contrastes ne montrait pas de différence, et nous présentons<br />
les résultats individuels des tests de la vision des couleurs.<br />
Commentaire et Conclusions : L’implant monobloc Acrylic Natural ® se comporte<br />
comme les autres implants de sa catégorie. Il se distingue par l’adjonction d’un filtre<br />
à lumière bleue qui aurait un rôle préventif dans la dégénérescence maculaire liée à<br />
l’âge. Subjectivement, les patients ne remarquaient pas de différence.<br />
52 48<br />
Cataracte et dégénérescence maculaire liée à l’âge : une étude rétrospective.<br />
Cataract and age-related maculopathy: a retrospective study.<br />
ABITBOL O* (Paris), NGHIEM-BUFFET MH (Bobigny), FAJNKUCHEN F, BADELON I,<br />
CHAINE G (Bobigny)<br />
But : Étudier l’évolution de l’acuité visuelle et des lésions du fond d’œil après opération<br />
de la cataracte chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à<br />
l’âge.<br />
Matériel et Méthode : Quarante yeux de 27 patients atteints de dégénérescence<br />
maculaire liée à l’âge et opérés de cataracte ont été inclus dans l’étude. Ils ont été<br />
répartis en deux groupes en fonction du stade de dégénérescence maculaire liée à<br />
l’âge. Dans le premier groupe, on regroupait les drusen et altérations de l’épithélium<br />
pigmentaire, dans le second, les formes sévères avec lésions atrophiques et néovasculaires.<br />
Résultats : Dans le groupe 1 (15 yeux), on notait une augmentation de l’acuité<br />
visuelle de 3,9 lignes en moyenne à 1 an. De nouvelles lésions néovasculaires sont<br />
apparues dans 1 œil (8,3 %), et les lésions étaient stable dans 92,8 % des cas à an.<br />
Dans le groupe 2 (25 yeux), les lésions étaient atrophiques dans 72 % des cas et<br />
néovasculaires dans 28 % des cas. On retrouvait une amélioration de l’acuité<br />
visuelle dans 78 % des yeux ayant des lésions atrophiques et dans 57 % des yeux<br />
ayant des lésions néovasculaires.<br />
Commentaire et Conclusions : Dans notre étude, l’opération de la cataracte chez<br />
les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge apporte un bénéfice<br />
visuel sans augmenter le risque d’évolution vers les formes sévères.<br />
52 49<br />
Implants de protection maculaire. Suivi sur 9 années.<br />
Macular protection intraocular Lens. 9 years follow-up.<br />
MALBREL C* (Reims)<br />
But : L’évolution de la dégénérescence maculaire subit une accélération après la<br />
chirurgie de la cataracte surtout si le patient est emmétropisé et qu’il s’expose à la<br />
lumière solaire en raison de la focalisation de l’énergie lumineuse dans l’aire fovéolaire.<br />
Les courtes longueurs d’onde du visible étant les plus énergétiques, il nous a<br />
paru intéressant d’introduire une coupure allant au-delà des 380nm des implants<br />
intraoculaires classiques jusqu’à 450nm afin d’observer si l’on obtenait un ralentissement<br />
dans l’évolution de la maladie sur une longue période d’observation.<br />
Matériel et Méthode : Deux groupes de 39 yeux furent opérés par le même chirurgien<br />
avec la même technique chirurgicale. Il a été mis en place le même implant de<br />
7 mm de diamètre en PMMA dont une série était standard et dont l’autre avait un<br />
matériau modifié par l’adjonction d’un colorant entraînant une coupure jusqu’à<br />
450 nm. Les patients étaient tous porteurs de drusen et l’attribution d’une série ou<br />
d’une autre était aléatoire. Leur suivi s’est étalé pour 9 années et comprenait à intervalles<br />
réguliers un examen ophtalmologique avec exploration du sens chromatique,<br />
de la sensibilité maculaire et si nécessaire une angiographie. À 9 ans, seulement<br />
25 % des sujets à implant standard et 35 % des sujets à implant modifié sont encore<br />
l’objet d’un suivi régulier notamment en raison d’une grande fréquence des décès<br />
entre 5 et 7 ans du suivi.<br />
Résultats : L’acuité visuelle est significativement en faveur des implants modifiés à<br />
partir du 24 e mois après l’implantation avec un écart qui se stabilise autour de 1/10<br />
en moyenne. Les diminutions significatives de la vision ont été en rapport avec<br />
l’apparition d’une dégénérescence maculaire exsudative dans 5 yeux porteurs de<br />
l’implant modifié avec un délai d’apparition de 4 ans alors que pour les implants<br />
standard la degenerescence est apparue 8 fois dans un délai moyen de 3 ans et<br />
demi.<br />
Commentaire et Conclusions : Il semblerait donc que dans une population à risques<br />
(porteurs de drusen), la simple adjonction d’une protection permanente de la<br />
fonction maculaire vis-à-vis des courtes longueurs d’onde du visible soit susceptible<br />
de retarder l’apparition de la dégénérescence maculaire exsudative ou d’en diminuer<br />
les effets.<br />
L’un des auteurs a un intérêt financier dans l’équipement, le procédé ou le produit<br />
présenté.<br />
52 50<br />
Implant prismatique pour la DMLA.<br />
Prismatic IOL for age related macular degeneration.<br />
COLIN J* (Bordeaux), BERNARD P (La Rochelle), AGUSSAN J (Bordeaux)<br />
But : Malgré les progrès récents médicaux et chirurgicaux réalisés dans le domaine<br />
de la DMLA, celle-ci représente encore une cause fréquence de basse vision, dont<br />
la rééducation visuelle est très difficile.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons réalisé une étude prospective, dans le cadre de<br />
la loi Huriet, pour évaluer l’efficacité et la sécurité de l’implantation d’un cristallin<br />
artificiel prismatique dans la DMLA. Les critères d’inclusion étaient une atteinte bilatérale,<br />
avec une maculopathie stable, anatomiquement peu étendue. Le bilan préopératoire<br />
comprend une analyse par SLO pour mesurer l’acuité visuelle périmaculaire<br />
résiduelle, et pour déterminer l’axe d’orientation du prisme. Le prisme est implanté<br />
dans le sulcus en piggy-back en avant d’un implant de chambre postérieure, et est<br />
inséré soit au moment de la chirurgie de la cataracte, soit secondairement si l’œil est<br />
déjà pseudophake. Le sommet du prisme a été tronqué pour diminuer son épaisseur.<br />
Résultats : Les résultats montrent une augmentation de l’acuité visuelle de près ; il<br />
n’a pas été observé de diplopie postopératoire.<br />
Commentaire et Conclusions : Par une analyse préopératoire sélective, l’implant<br />
prismatique permet d’améliorer la qualité visuelle de patients porteurs de DMLA en<br />
état de cécité légale. Le prisme est actuellement en PMMA, et son épaisseur est<br />
encore un écueil pour la chirurgie. Une nouvelle approche technologique permettra<br />
de réaliser un prisme plus mince, avec une implantation plus aisée. L’implantation<br />
d’un cristallin artificiel prismatique en piggy-back permet d’amèliorer la qualité de<br />
visison de patients porteurs de maculopathies bilatérales.<br />
L’un des auteurs est employé d’une <strong>Société</strong> proposant l’équipement, le procédé ou<br />
le produit présenté.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
52 51<br />
Implantation intra oculaire dans la première année de vie.<br />
IOL implantation in the first year of life.<br />
EDELSON C*, CAPUTO G (Paris), ARNDT C (Montpellier), METGE F, IOSSIFOV D,<br />
DE LAAGE DE MEUX P (Paris)<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
ÉVOLUTION DES IMPLANTS CRISTALLINIENS<br />
But : Évaluation des résultats réfractifs et des résultats visuels préliminaires chez les<br />
patients pédiatriques opérés de cataracte avec implantation primaire au cours de la<br />
première année de la vie.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective portant sur 72 yeux de 48 patients opérés<br />
de 1997 à 2002. La procédure chirurgicale, standardisée, comprend la réalisation<br />
d’un capsulorhexis antérieur, d’un capsulorhexis postérieur et d’une vitrectomie centrale<br />
dans tous les cas. L’implantation se fait dans le sac ou dans le sulcus (avant le<br />
troisième mois). La puissance de l’implant est calculée d’après les données de la<br />
biométrie et minorée afin d’obtenir une emmétropisation à l’âge de 5 ans.<br />
Résultats : La réfraction post-opératoire moyenne est de +3,55 dioptries à 3 mois,<br />
+2,92 dioptries à 6 mois, +1,28 dioptries à 1 an, +1,28 dioptries à 2 ans et –3,15<br />
dioptries à 3 ans. Les principales complications observées sont : une reprolifération<br />
cellulaire dans l’axe visuel nécessitant une vitrectomie secondaire (15 yeux) ; une<br />
libération de synéchies entre l’iris et l’incision cornéenne (11 yeux). Un glaucome<br />
secondaire a été diagnostiqué chez 2 enfants de cette série.<br />
Commentaire et Conclusions : L’aspiration du cristallin avec implantation permet<br />
d’obtenir un résultat anatomique très satisfaisant avec peu de complications. Il existe<br />
une myopisation progressive des yeux opérés. Les résultats visuels sont difficiles à<br />
analyser en raison du jeune âge des patients et du nombre important de perdus de<br />
vue. Cependant une rééducation agressive de l’amblyopie avec une occlusion bien<br />
conduite et prolongée permet d’obtenir les résultats visuels les plus satisfaisants.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S207
1S208<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST<br />
OPHTALMOLOGIE TROPICALE<br />
52 52<br />
Développement sous conjonctival d’une larve d’oestrus ovis : à propos d’un cas.<br />
Sub conjunctival growth of an oestrus ovis larva.<br />
BOUHAMIDA K*, GICQUEL JJ, CURUTCHET L, BERTHONNEAU J, DIGHIERO P<br />
(Poitiers)<br />
But : Rapporter un cas de développement sous conjonctival d’oestrus ovis.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons le cas d’une femme de 42 ans qui consulte<br />
pour une rougeur conjonctivale de l’œil droit sans baisse d’acuité visuelle Elle n’a pas<br />
d’antécédent particulier. À l’interrogatoire on retrouve la notion d’un voyage en Corse du<br />
sud 6 semaines avant la consultation. La patiente relate qu’alors qu’elle était en promenade<br />
une mouche lui avait piqué l’œil droit. L’examen en lampe à fente retrouve un corps<br />
étranger sous conjonctival entouré d’une zone inflammatoire de l’angle externe.<br />
Résultats : L’examen parasitologique mettra en évidence une larve d’oestrus ovis Il<br />
s’agit d’une mouche vivant en Corse et en Afrique du nord pondant ses œufs dans<br />
les narines des ovins et caprins.<br />
52 53<br />
Morbidité oculaire et cécité chez les personnes âgées en zone rurale du Togo.<br />
Ocular morbidity and blindness among old persons in rural areas of Togo.<br />
AGLA K*, BALO KP, TEOU K, BANLA M (Lomé, Togo)<br />
But : Le but de ce travail est d’étudier chez les populations vivant en zone rurale et<br />
ayant une accessibilité limitée aux soins oculaires les prévalences spécifiques de<br />
cécité ainsi que leurs causes dans les classes d’âges de 50 ans et plus.<br />
Matériel et Méthode : Une enquête de terrain, réalisée dans 13 villages relativement<br />
desservis situés à 80 km de la capitale et portant sur un échantillon de<br />
768 personnes des deux sexes extraites d’une population cible totale de<br />
1136 personnes, soit une participation de 67,60 %.<br />
Résultats : Le groupe était constitué de 445 hommes et 323 femmes soit 58 % et<br />
42 % respectivementT ; la tranche 50-54 ans avec 33,7 % était majoritairement<br />
représentée ; la prévalence cécité bilatérale a été de 15,4 %, celle de la cécité unilatérale<br />
était de 6,3 % ; la baisse de vision était prévalente dans 17,7 % des cas ;<br />
les prévalences selon le genre donnent 8,33 % chez les femmes contre 7,03 % de<br />
cécité bilatérale chez les hommes tandis qu on observe 9,37 % de prévalence de<br />
baisse de vision chez les femmes et 8,33 % chez les hommes. Les principales affections<br />
cécitantes sont la cataracte 39,58 %, le glaucome 30,72 %, les traumatismes<br />
oculaires 17,4 % et les opacités cornéennes 2,9 %.<br />
Commentaire et Conclusions : Les prévalences de cécité tant bilatérales qu’unilatérales<br />
et les baisses de vision sont relativement très élevées dans cette zone<br />
rurale enclavée ; les cataractes et les glaucomes prédominent et les femmes semblent<br />
plus exposées que les hommes. La lutte contre la cécité devra donc intégrer<br />
une orientation vers la chirurgie décentralisée.<br />
52 54<br />
Epidémiologie des traumatismes oculaires en Afrique.<br />
Epidemiological aspect of the african ocular traumatism.<br />
LAM A* (Dakar, Sénégal), MVEMENGOME E (Libreville, Gabon), PERNOD L (Toulon),<br />
MEYER F (Marseille), SCHAUER P, FILLIARD G (Toulon), GUEYE N (Sénégal),<br />
SECK C (Dakar, Sénégal), DAUBAS P (Toulon)<br />
But : Étudier les aspects épidémiologiques des traumatismes oculaires en Afrique,<br />
cerner leurs caractéristiques et enseignements, pour une meilleure prévention.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude bibliographique, de la traumatologie<br />
oculaire en Afrique au cours de ces trente dernières années analysant : les caractéristiques<br />
régionales, l’âge, le sexe, l’agent causal, les circonstances de survenue et<br />
la prise en charge.<br />
Résultats : Les travaux sont peu nombreux, la méthodologie et les recueils de données<br />
inhomogènes. Les traumatismes constituent la première cause de cécité unilatérale<br />
(5,6 à 12,2 4 %). Ils concernent des sujets très jeunes : les tranches de 0 à<br />
9 ans et de 20 à 29 ans sont plus touchées. Les femmes sont fréquemment concernées.<br />
Le sex-ratio est en moyenne 2,5/1. Ils semblent plus fréquents en milieu urbain<br />
qu’en milieu rural. Les causes et circonstances sont variables suivant l’âge et le sexe.<br />
Les coups et piqûres constituent les premières étiologies. Les retards de prise en<br />
charge sont constants et les facteurs aggravant très nombreux.<br />
Commentaire et Conclusions : Les traumatismes oculaires sont fréquents en Afrique<br />
mais encore mal connus. La revue de la littérature montre néanmoins qu’ils<br />
constituent l’un des domaines de l’ophtalmologie où l’Afrique se singularise par une<br />
épidémiologie assez spécifique. La difficulté de la prise en charge des lésions très<br />
polymorphes, répond encore dans de nombreuses régions à la loi du tout ou rien et<br />
le pronostic très réservé appel à une mobilisation pour une bonne prévention.<br />
52 55<br />
Tradipraticiens et soins oculaires au Togo.<br />
Traditional healers and ocular treatment in Togo.<br />
BALO KP*, YOVOGAN K, BANLA M, AGLA K, KOFFI GUE KB, KONDI G (Lomé,<br />
Togo)<br />
But : Cette étude a été entreprise auprès de certains tradipraticiens du Togo dans<br />
le but de recueillir les informations sur la nature de leur traitement, leur niveau d’instruction<br />
et leur motivation pour une formation pouvant les amener à mieux prendre<br />
en charge leurs patients.<br />
Matériel et Méthode : Une enquête par questionnaire et interview a été conduite<br />
auprès de 50 tradipraticiens ayant consenti à participer au travail. L’étude a eu lieu<br />
à Lomé et dans sa région géographique proche.<br />
Résultats : L’âge moyen des tradipraticiens est de 45,8 ans, le groupe est majoritairement<br />
constitué d’hommes avec 86,3 % contre 13,7 % de femmes ; 17,6 % sont<br />
analphabètes, 17 % ont un niveau primaire, 47,1 % un niveau secondaire et 27,5 %<br />
un niveau universitaire ; les pratiques utilisées sont variées : on trouve des préparations<br />
de plantes, feuilles ou écorces soit à l’état frais, en infusions et en macération.<br />
Les voies d’administration sont locales sur le globe oculaire, les paupières ou générale<br />
per os. Toutes ces formes d’utilisation sont soit précédées ou suivies de prières.<br />
On note que 43,1 % des tradipraticiens de cette étude ont exprimé leur désir de se<br />
soigner dans les hôpitaux s’il leur arrivait de souffrir des yeux, 52,9 % pensent se<br />
soigner avec leurs propres produits. Les actes ne sont pas gratuits et les coûts<br />
paraissent parfois supérieurs à ce qui est perçu dans les hôpitaux ou cabinets privés.<br />
Commentaire et Conclusions : Plusieurs raisons peuvent expliquer le regain de<br />
popularité de la fréquentation des tradipraticiens. Cette étude montre que l’argument<br />
du coût prohibitif des soins dits conventionnels n’est probablement pas suffisant. Il<br />
est heureux de constater l’ouverture de ces thérapeutes pour une formation ce qui<br />
améliorera leurs diagnostics et les « soins » prodigués aux patients.<br />
52 56<br />
Atteintes oculaires au cours de l’infection à VIH à l’IOTA.<br />
Ocular involvments in VIH infection at the IOTA/Institut Oculaire Tropical Africain.<br />
TRAORE J*, TRAORE L, THERA J (Bamako, Mali)<br />
But : Il s’agit d’une étude prospective s’étendant sur une année afin de décrire les<br />
atteintes oculaires au cours de l’infection à VIH et de rechercher les atteintes oculaires<br />
chez les patients soumis à la trithérapie.<br />
Matériel et Méthode : Trente-huit patients ont été inclus dans l’étude. La moyenne<br />
d’âge était de 35 ans et le sexe ratio de 1,2. Six patients étaient sous trithérapie. 31<br />
(81,6 %) patients présentaient une pathologie oculaire. Le zona ophtalmique était la<br />
manifestation oculaire la plus fréquente (26,3 %) et nous a permis dans bon nombre<br />
de cas de diagnostiquer la maladie. Les nodules cotonneux et les hémorragies rétiniennes<br />
étaient aussi fréquentes 23,7 % et 13,2 %. 23,7 % des patients présentaient<br />
une choriorétinite toxoplasmique. Trois patients (7,9 %) présentaient une atrophie<br />
optique parmi lesquels 1 cas était une atrophie bilatérale avec cécité totale. Nous<br />
n’avons trouvé qu’un seul cas de rétinite à CMV et 1 cas de paralysie oculomotrice.<br />
Résultats : Dans notre étude les atteintes oculaires étaient de loin moins fréquentes<br />
chez les patients soumis à la trithérapie, en dehors de l’atrophie optique qui fut<br />
observée exclusivement chez les patients soumis à la trithéraphie.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces résultats ne peuvent pas être généralisés à la<br />
population malienne, eu égard à la taille de l’échantillon relativement petite, mais elle<br />
permet d’avoir un aperçu sur les atteintes oculaires liées à l’infection à VIH Sida dans<br />
notre pays.<br />
52 57<br />
Chirurgie mutilante du globe oculaire.<br />
Mutilating surgery of eye ball.<br />
GUEYE N*, MVEMENGOME E (Gabon), SECK C, ELHIF S, LAM A (Dakar, Sénégal)<br />
But : Étudier les aspects épidémiologiques de la chirurgie mutilante du globe oculaire<br />
à l’Hôpital Principal de Dakar.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective et prospective de Novembre 1991 à<br />
Novembre 2002. Elle inclue tous les patients qui ont subi une chirurgie mutilante du<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST<br />
globe. Les paramètres étudiés sont : le sexe, l’âge, la pathologie en cause et le type<br />
de chirurgie pratiquée.<br />
Résultats : Cent soixante yeux ont été opérés durant cette période. L’âge varie de<br />
5 mois à 80 ans avec une moyenne de 24 ans. Il s’agit de 98 hommes (62 %) et<br />
62 femmes (38 %). Les causes principales sont : infectieuse 28 % des cas (abcès<br />
perforé, panophtalmie, endophtalmie), remaniement et ectasie du segment antérieur<br />
24 % (dystrophique, post traumatique, inflammatoire), atrophie du globe 21,5 %<br />
(post traumatique, Inflammatoire), tumorale 21 % (rétinoblastome, mélanome uvéale,<br />
sarcome), éclatement du globe 4 %. Dans 70 % des cas une éviscération a été pratiquée,<br />
une énucléation dans 16 %, une exentération 10 % et une segmentectomie<br />
antérieure (sculpture) 4 % des cas.<br />
Commentaire et Conclusions : La chirurgie mutilante du globe oculaire est pratiquée<br />
à l’Hôpital Principal de Dakar le plus souvent chez le sujet jeune de sexe masculin.<br />
Elle est généralement motivée par des causes infectieuses et post<br />
traumatiques caractérisées par leur sévérité et leur retard diagnostic. Les tumeurs<br />
sont dominées par le rétinoblastome, restent l’apanage des enfants.<br />
52 58<br />
La trabéculecto-rétraction au laser Argon dans le traitement du glaucome<br />
primitif à angle ouvert : une expérience à propos de 25 cas chez le noir africain<br />
à Abidjan.<br />
Argon Laser trabeculoplasty as a treatment for primitiv open angle glaucoma: our<br />
experience in 25 black africans in Abidjan city.<br />
COULIBALY F, BERETE R, ADJORLOLO C, TOURE KML, GBE K, BONI S,<br />
OUATTARA A, DIALLO M (Abidjan, Côte d’Ivoire),<br />
But : L’utilisation du laser dans le traitement du glaucome à angle ouvert est une<br />
étape intermédiaire entre le traitement médical et la chirurgie. L’avènement de nouveaux<br />
moyens médicaux, chirurgicaux et en particulier la multiplication des lasers a<br />
modifié les protocoles thérapeutiques. Nous avons mené une expérience chez des<br />
patients noirs africains présentant un glaucome primitif à angle ouvert. Cette étude<br />
a pour but de définir les indications et d’évaluer les résultats de la trabéculo-rétraction<br />
au laser Argon (TRLA) chez le noir africain.<br />
Matériel et Méthode : Étude transversale portant sur deux séries de patients présentant<br />
un glaucome primitif à angle ouvert dont l’une traitée par des antiglaucomateux<br />
soit en monothérapie, bithérapie ou trithérapie a subi une TRLA après échec du<br />
traitement médical, l’autre série ayant bénéficié d’une TRLA de première intention.<br />
Le protocole a consisté en deux séances de TRLA à deux semaines d’intervalle sur<br />
la moitié inférieure de l’angle irido-cornéen puis sur la moitié supérieure avec un laser<br />
monochromatique vert.<br />
Résultats : Les résultats à moyen terme semblent satisfaisants avec un pourcentage<br />
de baisse de la pression intraoculaire allant de 10 % à 40 % chez la majorité<br />
des patients avec un seul cas d’élévation de la tension oculaire. Le gain moyen de<br />
pression intraoculaire est de 05 mmhg avec un maximum 09 mmHg et un minimum<br />
de 02 mmHg.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces résultats qui restent à évaluer à leur terme,<br />
permettraient d’améliorer la qualité de la prise en charge en reculant le plus possible<br />
la prescription des nouvelles molécules qui constituent de par leur coût élevé un<br />
obstacle à l’observance du traitement médical.<br />
52 59<br />
Pourquoi un traitement médical du glaucomateux est problématique en Afrique<br />
Noire ?<br />
Why is it problematic to undertake and follow a medical treatment for glaucoma in<br />
Sub Saharian Africa?<br />
BALO KP*, AGLA K, BANLA M (Lomé, Togo)<br />
But : Une enquête de coûts du traitement médical a été réalisée afin de mettre en<br />
perspective ces coûts avec le PNB et d’évaluer leur capacité de financement du traitement<br />
antiglaucomateux.<br />
Matériel et Méthodes : Un questionnaire a été adressé auprès des prescripteurs<br />
médécins, techniciens pour rechercher leurs pratiques dans la prise en charge du<br />
glaucomateux (nombre de consultations moyennes, types de bilan, prescriptions)<br />
ainsi que les coûts y afférents.<br />
Résultats : Les pratiques varient dans la fourchette suivante : maximum de<br />
2 consultations et champs visuels par an et des traitements comportant les options :<br />
béta bloquants seuls ou bithérapies bétabloquants avec soit myotiques, ou dorzolamide,<br />
ou prostaglandines ou brimonidine. Selon ces options les coûts annuels<br />
minima sont 82 320 cfa, 128 240, 249 600, 303 080, 234 980 cfa. Ces coûts corres-<br />
pondent à 123 Usd, 192, 374, 454, 352 Usd respectivement. Comparé au PNb, les<br />
ratios du traitement annuel du glaucome par PBN annuel sont de 0.41 % ; 0,64 % ;<br />
1,24 % ; 1,54 % et 1 ; 17 %. Seules deux options coûtent moins cher que le PNB<br />
per capita.<br />
Commentaire et Conclusions : Tenant compte du niveau de vie de la population,<br />
du PNB per capita de 300 USD et de l’absence d’assurance maladie, on en déduit<br />
que ces coûts sont prohibitifs pour le glaucomateux togolais et pourraient expliquer<br />
les difficultés d’observance thérapeutique ainsi que les dégradations observées dans<br />
l’évolution de la maladie lors du traitement médical.<br />
52 60<br />
Caractéristiques de l’excavation papillaire dans une population générale de<br />
685 personnes au Togo.<br />
Caracteristics of disc cupping in a general population of 685 people in Togo.<br />
BANLA M*, BALO KP, ANIKA A, KOFFI GUE KB, AGLA K (Lomé, Togo)<br />
But : Plusieurs rapports et études ont montré le fort taux de cécité glaucomateuse<br />
dans notre population. Le but visé par ce travail est de recueillir les données sur les<br />
excavations papillaires dans la population rurale de plus de 40 ans au sud Togo.<br />
Matériel et Méthode : Un échantillon de 685 personnes âgées de 40 ans et plus<br />
qui se sont présentées ont été examinées au dispensaire local ou l’infirmerie de leur<br />
village. L’examen ophtalmologique comportait notamment la mesure de l’acuité<br />
visuelle, l’examen du segment antérieur, le fond d’œil, la prise du tonus.<br />
Résultats : L’âge moyen était de 49, 70 ans (extrêmes 40-99 ans) ; on avait 61, 8 %<br />
d’hommes et 38,2 % de femmes. Les valeurs moyennes des excavations étaient de<br />
0,38 à droite et 0,37 à gauche. Les excavations supérieures à 0,5 représentaient<br />
29,3 % et 29,8 % respectivement à droite et à gauche. Dans 92 % des cas l’excavation<br />
était ronde, elle était ovalaire dans 7,6 %. La position de l’excavation a été<br />
notée comme centrale dans 75 % des cas, temporale dans 22 % et nasale dans<br />
2,4 %.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude de terrain montre la grande variété des<br />
papilles dans nos milieux, cependant la moyenne d’excavation trouvée ici semble<br />
être identique à celle d’autres études similaires. Il peut être considéré comme pathologique<br />
les valeurs supérieures à 0,5.<br />
52 61<br />
Complications oculaires des produits éclaircissants utilisés par les femmes<br />
noires : à propos de 8 cas répertoriés à Abidjan (Côte d’Ivoire).<br />
Ophthalmic complications of skin bleaching creams used by african women: eight<br />
cases studied in Abidjan (Ivory Coast).<br />
SANGARE Y*, AMOUSSOU YA, COULIBALY F, BONI S, ADJORLOLO C,<br />
TOURE KML, GBE K, BERETE R (Abidjan, Côte d’Ivoire)<br />
But : Les complications oculaires et en particulier la cataracte liées à l’usage des<br />
corticoïdes par voie générale sont fréquemment décrites dans la littérature. Cependant<br />
la place des dermocorticoïdes apparaît de plus en plus importantes dans ces<br />
complications oculaires graves. L’objectif de l’étude est d’attirer l’attention des praticiens<br />
et des utilisateurs des dermocorticoïdes sur les risques en particulier oculaires<br />
afin de contribuer aux campagnes de sensibilisation pour remédier à ces<br />
pratiques.<br />
Matériel et Méthode : Huit patientes, de races noires, âgées de 27 ans à 48 ans,<br />
de toutes professions confondues (ménagère, employée de bureau, cadre), ayant<br />
utilisé les dermocorticoïdes pendant des périodes variables allant de 5 à 8 ans et<br />
ayant présenté par la suite une cataracte uni ou bilatérale ont servi d’échantillon pour<br />
notre étude. Sont exclus à l’étude, les patients présentant une cataracte d’autres<br />
étiologies (traumatique, métabolique, inflammatoire etc..) ainsi que celle exerçant<br />
une profession à risque cataractogène.<br />
Résultats : Les cas rapportés dans cette étude sont comparables à ceux décrits<br />
dans la littérature en ce qui concerne les cataractes après corticothérapie par voie<br />
générale à savoir :<br />
– au plan ophtalmologique, une longue période d’utilisation du corticoïde variant<br />
entre 5 et 10 ans ;<br />
– au plan clinique, la cataracte sous-capsulaire postérieure, uni ou bilatérale.<br />
Commentaire et Conclusions : Les cas de cataracte due aux dermocorticoïdes<br />
sont rarement rencontrés dans la littérature. Le mécanisme physiopathologique<br />
pourrait être la résorption cutanée excessive liée à l’application répétée sur une surface<br />
étendue qui entraînerait à la longue une altération de la barrière épidermique. Il<br />
y a donc une impérieuse nécessité d’informer les praticiens et de sensibiliser les<br />
patients.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S209
1S210<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST<br />
52 62<br />
Intérêt de l’extraction extra-capsulaire de la cataracte avec implantation de<br />
cristallin artificiel.<br />
Interest of extra-capsular cataract extraction with implantation of an intra-ocular<br />
lens.<br />
MEDA N*, DJIGUIMDE WP, NAGALO Y, OUEDRAOGO PA, RAMDE B<br />
(Ouagadougou, Burkina Faso)<br />
But : Les auteurs rapportent les résultats de l’extraction extracapsulaire de la cataracte<br />
avec implantation de cristallin artificiel.<br />
Matériel et Méthode : L’ensemble des patients opérés de cataracte entre janvier 1998<br />
et décembre 2001 ont fait l’objet d’une analyse rétrospective. 40 % des cas ont bénéficié<br />
d’une extraction extra capsulaire du cristallin et d’un suivi supérieur à six mois.<br />
Résultats : L’échantillon comprenait 150 hommes et 110 femmes avaient un âge<br />
moyen de 57,31 ans. La majorité des cas présentaient une cataracte était totale avec<br />
acuité visuelle réduite à la perception lumineuse. Les complications de l’opération<br />
ont été dominées par l’issue de vitré (15 %) et l’œdème cornéen (30 %). L’acuité<br />
visuelle après traitement a été supérieure à 0,3 dans 67,7 % des cas.<br />
Commentaire et Conclusions : La technique d’extraction extracapsulaire avec<br />
implantation de cristallin artificiel a permet à la majorité des patients, aveugles avant<br />
l’opération de reprendre une activité normale sans lunettes. Les complications que<br />
nous avons rencontrées sont dues surtout au manque de matériel adéquat, à la<br />
vétusté des instruments et à l’absence de consommables. L’extraction extra-capsulaire<br />
de la cataracte avec implantation constitue la méthode idéale de prise en<br />
charge de la cécité par cataracte. Elle demande cependant une amélioration des<br />
plateaux techniques et une formation complémentaires des opérateurs encore attachés<br />
à la technique d’extraction intracapsulaire.<br />
52 63<br />
Extraction Extra Capsulaire manuelle sans suture.<br />
Sutureless extracapsular cataract extraction technique.<br />
RUIT S* (Kathmandu, Népal)<br />
But : Dans notre pratique quotidienne nous sommes confrontés le plus souvent à<br />
des cataractes blanches totales, se prêtant peu à la réalisation d’une phacoémulsification.<br />
Ainsi nous avons été amenés à développer une technique de phacoexérèse<br />
par extraction extra capsulaire totalement manuelle et sans suture.<br />
Matériel et Méthode : Devant des cataractes blanches totales et à noyau dur nous<br />
proposons une technique d’extraction extracapsulaire manuelle par relative petite<br />
incision (6 mm) autoétanche et ne nécessitant pas de suture. Pour cela nous procédons<br />
à une incision sclérocornéenne tunnélisée trapézoïdale dont l’ouverte sclérale<br />
mesure 6 mm puis, après avoir réalisé un capsulorhexis antérieur et la luxation du<br />
noyau en chambre antérieure, nous l’enlevons in toto en utilisant une canule de<br />
Simco. L’implantation est ensuite exécutée sous air dans le sac capsulaire.<br />
Résultats : Nous avons opéré plusieurs centaines d’individus avec cette technique<br />
opératoire. Aucune complication liée à la taille de l’incision et à sa non fermeture par<br />
des sutures n’a jamais été observée. L’astigmatisme par une voie supérieure classique<br />
est en moyenne de 1,5 dioptries contre 0,75 par voie temporale. Le temps opératoire<br />
moyen est de 5 minutes.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette procédure chirurgicale sans suture permet<br />
de traiter tout type de cataracte, de surseoir à l’utilisation de viscoélastique, de<br />
réduire considérablement le temps opératoire, tout en obtenant d’excellent résultat<br />
anatomique et fonctionnel, raisons pour lesquelles nous en avons fait la techniques<br />
de première intention dans notre centre chirurgical. Grâce à cette technique reposant<br />
sur une incision sclérocornéenne trapézoïdale et l’utilisation d’une canule de Simco,<br />
la réalisation d’une phacoexérèse par EEC sans suture devient possible, et ceci quelque<br />
soit le type de cataracte, en toute sécurité et en un temps minime.<br />
52 64<br />
Formation à l’EEC sans suture en milieu tropical.<br />
Teaching sutureless EEC in a tropical setting.<br />
ANDRE JM*, FORZANO O (Marseille), ANDRIANAIVOARIVOLA T (Mahajunga,<br />
Madagascar), ROBSON A, ANDRIANTSOA V, RAMANITRARIVO LV (Tananarive,<br />
Madagascar), CONRATH J, PROUST H, RIDINGS B (Marseille)<br />
But : L’objectif de cette étude est l’évaluation prospective de la formation à la technique<br />
de phacoéxérèse par l’extraction extracapsulaire (EEC) par voie sclérale tunnélisée<br />
sans suture d’un ophtalmologiste malgache maîtrisant déjà l’EEC et la<br />
phacosection.<br />
Matériel et Méthode : Dans le cadre du programme Sight First de lutte contre la<br />
cécité à Madagascar, l’ophtalmologiste de Majunga a recruté des cataractes blanches<br />
totales. Ces dernières ont été opérées par EEC sans suture avec tunnel sclérocornéen<br />
trapézoïdal en utilisant le matériel habituel de l’hôpital local, auquel étaient<br />
ajoutés : un couteau creshent et une canule de Simco. L’anesthésie était une péribulbaire<br />
avec oculo-pression. Les contrôles post opératoires (acuité visuelle et état<br />
cornéen) étaient effectués à J1, J5 et J30.<br />
Résultats : Cinquante cataractes ont été opérées ; les dix premières, par le formateur<br />
aidé par le stagiaire et les quarante suivantes par le stagiaire aidé par le formateur.<br />
Nous avons noté cinq complications per-opératoires : cinq ruptures capsulaires<br />
postérieures (dont une au cours de l’implantation). En post opératoire, nous retrouvons<br />
peu d’astigmatisme induit (£ 1,5 dioptries), une bonne récupération visuelle et<br />
toutes les cornées limpides dès J5.<br />
Commentaire et Conclusions : Les résultats, pour cette période d’apprentissage,<br />
sont excellent avec : une réhabilitation visuelle en moins de cinq jours et seulement<br />
cinq complications (dont une non liée à la technique opératoire). Cette procédure<br />
chirurgicale sans suture a permis d’une part de réduire l’astigmatisme induit, et<br />
d’autre part, de traiter sans risque des cataractes blanches totales. La réalisation<br />
d’une phacoexérèse par EEC sans suture, grâce au tunnel scléro-cornéen trapézoïdal,<br />
est donc possible pour les cataractes difficiles en milieu tropical avec un coût<br />
additionnel très faible et en toute sécurité. De plus, la formation d’un chirurgien maîtrisant<br />
déjà l’EEC classique est rapide et sans risque pour les patients.<br />
52 65<br />
Chirurgie du ptérygion par autogreffe limbo-conjonctivale avec ancrage scléral<br />
postérieur.<br />
Limbo-conjunctival auto-graft with posterior scleral sutures for pterygium surgery.<br />
LOUGHZAIL K*, MERDASSI A, ASSOULINE M, DE LAAGE DE MEUX P (Paris)<br />
But : La chirurgie du ptérygion a pour principaux objectifs l’exérèse de la lésion, la<br />
correction de l’astigmatisme, la reconstruction du site opératoire, la réhabilitation de<br />
la transparence et de la régularité de la surface cornéenne et surtout la prévention<br />
des récurrences.<br />
Matériel et Méthode : Nous présentons l’étude rétrospective de 120 cas de pterygion<br />
consécutifs opérés par un même chirurgien de 1997 à 2002. Dans les 60 premiers<br />
cas, la prévention des récurrences a été réalisée par autogreffe limboconjonctivale.<br />
Dans les 60 cas suivants, cette procédure a été modifiée pour réaliser<br />
un ancrage scléral postérieur de la berge réceptrice et de la berge périphérique du<br />
greffon conjonctival.<br />
Résultats : Le suivi a été de 1 à 48 mois. Un seul cas de récurrence significative<br />
(envahissement cornéen de plus de 2 mm par une pterygoide avec aspect de traction<br />
sous conjonctivale) a été observé dans le premier groupe. Aucun cas de récurrence<br />
n’a été observé dans le second groupe. Une rétraction inesthétique du greffon<br />
a été observée dans 12 cas du premier groupe et dans seulement 2 cas du second<br />
groupe, en relation avec un lachage prématuré des sutures postérieure.<br />
Commentaire et Conclusions : L’ancrage postérieur du greffon limbo-conjonctival<br />
permet de s’opposer à la contraction cicatricielle de la berge réceptrice pathologique<br />
et de la face profonde (fibroblastique) du greffon. Cet ancrage nous semble potentialiser<br />
l’effet préventif de la greffe limbique (apport de cellules souches indemne de<br />
dégénérescence actinique, prélevée au dépens du limbe supérieur sous palpébral)<br />
et améliorer l’aspect esthétique du greffon à moyen et long terme.<br />
52 66<br />
Problématique du rétinoblastome en Afrique noire : à propos de 12 cas<br />
répertoriés au CHU de Treichville.<br />
Problems of retinoblastomas in black Africa: about 12 cases listed in Treichville<br />
University Hospital.<br />
BERETE R, COULIBALY F, ADJORLOLO AC, KONAN-TOURE ML, BONI<br />
SOUATTARA A, DIALLO M (Abidjan, Côte d’Ivoire),<br />
But : Le rétinoblastome, tumeur maligne de la rétine n’est pas un diagnostic exceptionnel<br />
en Afrique noire. Cependant plus que la nature cancéreuse, c’est son diagnostic<br />
encore tardif qui constitue le problème et gène le pronostic vital de la plupart<br />
des enfants atteints. Par ailleurs la chirurgie mutilante, notamment l’énucléation précoce<br />
reste la thérapeutique de référence dans nos pays. Pour rappeler la gravité du<br />
pronostic et par conséquent la nécessité d’un diagnostic précoce, nous rapportons<br />
une série de 12 cas dont un seul bilatéral.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective sur 6 ans (1995-2001)<br />
devant lesquelles 11 patients ont été traités. Un patient avait une tumeur bilatérale.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST<br />
Résultats : Les enfants dont l’âge varie entre 10 mois et 5 ans avec une moyenne<br />
de 33 mois ont été amenés pour leucocorrie (1 cas), exophtalmie (7 cas), tuméfaction<br />
du globe oculaire (3 cas). Le diagnostic clinique a été confirmé par l’échographie<br />
voire le scanner dans certains cas et après énucléation par l’anatomie pathologique.<br />
La chimiothérapie post opératoire a été nécessaire dans 5 cas lorsque la tumeur<br />
avait dépassé le seul cadre orbitaire. 1 patient est décédé dans les suites opératoires<br />
immédiates, 4 sont perdus de vue lors de la chimiothérapie. Le cas bilatéral a été<br />
énucléé de l’œil le plus atteint et évacué pour chimiothérapie en France pour l’autre.<br />
Commentaire et Conclusions : Le rétinoblastome reste toujours un problème préoccupant<br />
notamment lorsqu’on sait que son diagnostic est encore posé tardivement.<br />
L’énucléation reste la seule sanction thérapeutique tant que la radiothérapie et autre<br />
proton thérapie ne sont pas encore disponibles. Il est donc indispensable de sensibiliser<br />
afin que le diagnostic précoce permette d’éviter l’hypothèque du pronostic<br />
vital.<br />
52 67<br />
Les béta-thalasso drépanocytoses pourvoyeuses de rétinopathies ischémiques<br />
graves : à propos de 5 cas observés à Abidjan.<br />
Betathalasso sickle cell disease cause of serious ischemic retinopathy: 5 cases in<br />
Abidjan.<br />
FANY A*, COULIBALY F, GBE K, ADJORLOLO C, KONAN-TOURE ML, BERETE R,<br />
BONI S, OUATTARA A, DIALLO M (Abidjan, Côte d’Ivoire)<br />
But : Les rétinopathies drépanocytaires sont connues et parfaitement codifiées dans<br />
de nombreuses formes d’hémoglobines. Aussi les formes hétérozygotes SS et doubles<br />
hétérozygotes SC sont connues pour les risques d’hémorragie et de décollement<br />
de la rétine qu’elles peuvent provoquer, la SAFA2 (bétathalasso<br />
drépanocytose) apparaissait comme sans risques majeurs. Par cette étude nous<br />
voulons démontrer que les bétathalasso drépanocytaires méritent la même rigueur<br />
de surveillance que les formes SS et SC, compte tenu des risques d’ischémie rétinienne<br />
et de son corolaire, la néovascularisation.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons répertorié 5 patients au cours de l’examen<br />
angiographique systématique présentant des tableaux d’ischémie rétinienne avec<br />
arcades anastomotiques vasculaires.<br />
Résultats : Sur cette série de patients chez qui dans le cadre des bilans d’hémoglobinopathie,<br />
une angiographie a été prescrite, nous avons détecté une rétinopathie<br />
drépanocytaire. Les lésions observées étaient superposables à celles décrites dans<br />
les formes SC avec zone de non perfusion en périphérie par ischémie rétinienne et<br />
arcades anastomotiques vasculaires.<br />
Commentaire et Conclusions : L’observation de ces lésions fait peser un risque<br />
potentiel de néovascularisation et de son corollaire, l’hémorragie vitréorétinienne<br />
chez le sujet porteur de bétathalasso drépanocytose. Ces lésions sont rarement<br />
décrites dans la littérature. La bétathalasso drépanocytose mérite une surveillance<br />
aussi rigoureuse que les doubles hétérozygotes SC, un dépistage systématique par<br />
examen du fond d’œil et angiographie rétinienne mérite d’être prescrits à ces<br />
patients qui risquent une hémorragie par néovascularisation et un décollement de<br />
rétine.<br />
52 68<br />
Aspects angiofluorographiques des lésions rétiniennes chez le drépanocytaire<br />
sénégalais.<br />
Angiofluorographical retinal lesions of the sickle-cell patient.<br />
WANE AM*, SANCHEZ SA, NDIAYE PA, DE MEDEIROS ME, BA EL HADJ A,<br />
NDOYE PA, NDIAYE MR, WADE A (Dakar, Sénégal)<br />
But : Nous avons évalué dans cette étude prospective réalisée sur un an, les aspects<br />
angiofluorographiques des lésions rétiniennes secondaires à la drépanocytose.<br />
Matériel et Méthode : Cinquante-quatre patients ont été concernés. Chacun avait<br />
bénéficié d’une électrophorèse de l’hémoglobine, d’un examen clinique ophtalmologique<br />
et d’une angiographie rétinienne à la fluorosceine. Le logiciel épi info et le texte<br />
statistique student ont été utilisés pour la corrélation.<br />
Résultats : On comptait 63 % de femmes, 13 drépanocytaires hétérozygotes<br />
(AS), 28 homozygotes (SS) et 12 double hétérozygotes (SC). L’âge moyen des<br />
patients était de 21,74 ans. Sur les 104 yeux examinés, 74,1 % présentaient des<br />
anomalies vasculaires, 53,33 % une forme proliférante et 15,55 % une rétinopathie<br />
non proliférante. Ces derniers avaient un taux d’hémoglobine fœtale plus<br />
élevé. La tranche d’âge de 20 – 29 ans est double hétérozygote était les plus<br />
atteints.<br />
Commentaire et Conclusions : La drépanocytose est en Afrique un véritable problème<br />
de santé publique. La prise en charge des lésions rétiniennes souvent incidieuses<br />
nécessite une éducation et une surveillance ophtalmoscopique et<br />
angiographique. Le traitement par photocoagulation au laser à argon a amélioré le<br />
pronostic de cette affection.<br />
52 69<br />
Dermatoses faciales, palpébrales et exophtalmie associées à une sclérodermie<br />
généralisée à Brazzaville : à propos de deux cas.<br />
Facial, palpébral dermatosis and exophtalmia associated with a systemic<br />
sclerodermia at Brazzaville: a report of two cases.<br />
KAYA G*, LENGA LI, PEKO JF, MAKITA BC (Brazzaville, Congo)<br />
But : Souligner la place de l’imagerie et des examens de laboratoire dans le diagnostic<br />
des inflammations spécifiques et de la sclérodermie.<br />
Matériel et Méthode : Les auteurs rapportent les observations sur la survenue<br />
inhabituelle des manifestations orbitaires et cutanées de la face et des paupières<br />
associées à une sclérodermie chez deux patients : une femme de 35 ans présentant<br />
une infiltration cutanée palpébrale et de la face avec des lésions de dépigmentation,<br />
une hémi-atrophie faciale, une exophtalmie et une neuropathie optique associées à<br />
une sclérodermie et un homme avec une infiltration bilatérale des deux paupières,<br />
une sclérodermie généralisée associée à une silicose et une sarcoïdose pulmonaire.<br />
Des corticoïdes ont été admi-nistrés pendant 12 mois.<br />
Résultats : Le diagnostic a été fait sur la base des arguments cliniques et para cliniques.<br />
L’utilisation des corticoïdes a permis de stabiliser les lésions dans un cas et<br />
une récidive a été observée dans l’autre cas à l’arrêt du traitement.<br />
Commentaire et Conclusions : À la lumière des ces observations les auteurs discutent<br />
les caractéristiques cliniques générales et oculaires et la pathogénie de la<br />
sclérodermie. L’imagerie, les dosages des anti-corps anti-acides nucléiques, antimuscles<br />
lisses des facteurs rhumatoïdes et les biopsies s’avèrent indispensables au<br />
diagnostic des infections spécifiques. La meilleure connaissance épidémiologique<br />
des inflammations spécifiques oculo-palpébrales en Afrique ne sera obtenue<br />
qu’avec la disponibilité des moyens d’investigation.<br />
52 70<br />
La maladie de Destombes, Rosai et Dorfman : entité clinique à manifestations<br />
oculaires rares : à propos d’un cas.<br />
Destombes, Rosai and Dorfman disease: clinical entity with rare ophthalmological<br />
appearance: a case report.<br />
FANY A*, KONAN-TOURE ML, GBE K, ADJORLOLO C, COULIBALY F, BERETE R,<br />
BONI S, OUATTARA A, DIALLO M (Abidjan, Côte d’Ivoire)<br />
But : Mieux faire connaître aux ophtalmologistes la maladie de Destombes, Rosai et<br />
Dorfan, entité clinique rare, aux manifestations ophtalmologiques exceptionnelles.<br />
Elle se définie comme une lymphadénopathie cervicofaciale massive par histiocytose<br />
sinusale. Nous rapportons ici un cas d’envahissement massif de la cavité orbitaire<br />
ayant provoqué la cécité par compression du nerf optique.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’un jeune de 20 ans que nous suivons en collaboration<br />
avec le Service de Stomatologie depuis l’âge de 6 ans. En 1988, le patient<br />
présentait : au plan ophtalmologique, une importante exophtalmie bilatérale, au plan<br />
cervicofacial, on notait de volumineuses adénopathies tout le long du cou et de la<br />
région sous maxillaire. La tomodentométrie montre un envahissement de toute la<br />
cavité orbitaire par un processus expansif de type tumoral. Plusieurs interventions<br />
chirurgicales en équipe avec les stomatologues ont permis un curage des adénopathies<br />
cervicofaciales et orbitaires. L’étude histologique a conclu à un processus granulomateux<br />
inflammatoire complexe sclérolipomateux.<br />
Résultats : L’évolution est émaillée d’importantes récidives aboutissant aujourdíhui<br />
à un comblement total de la cavité orbitaire, expulsant les globes totalement hors du<br />
cadre orbitaire avec une cornéomalacie totale et la cécité. Une énucléation de propreté<br />
est envisagée.<br />
Commentaire et Conclusions : La maladie de Destombes est rencontrée le plus<br />
souvent chez le sujet de race noire. Le cas de notre malade au-delà de la rareté<br />
de l’affection a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Bien que décrite<br />
depuis près de 4 décennies, les manifestations oculaires de la maladie de Destombes<br />
sont mal connues. Leur évolution peut pourtant provoquer des complications<br />
oculaires graves voire la cécité et la perte des globes oculaires comme<br />
le cas de notre patient.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S211
1S212<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM DES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST<br />
52 71<br />
Tuberculose orbitaire pseudo-tumorale.<br />
Pseudo tumoral orbital tuberculosis.<br />
BANLA M*, BALO KP, BANLA AK, OURO DJERI S, KOFFI GUE KB (Togo, Mali)<br />
But : Présenter un cas d’exophtalmie pseudotumorale de cause rare.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’un cas clinique portant sur un garçon de 20 ans<br />
reçu pour exophtalmie droite d’évolution progressive. Nous avons procédé à l’interrogatoire,<br />
à l’examen ophtalmologique, aux examens radiologiques orbitaires, lombaires<br />
et pulmonaires, puis à l’examen bactériologique des produits du tubage<br />
gastrique, et au test de dépistage du VIH (ELISA) enfin au traitement classique<br />
d’épreuve de la pseudo tumeur inflammatoire. Le traitement par les anti tuberculeux<br />
a été introduit à la suite des résultats des examens complémentaires.<br />
Résultats : L’acuité visuelle est réduite à la perception lumineuse. l’exophtalmie est<br />
axile irréductible, avec une motilité oculaire réduite. le fond de l’œil présente un<br />
œdème papillaire et des hémorragies rétinopapillaires. Les radiographies ont montré<br />
une opacité endo orbitaire diffuse, un mal de Pott lombaire, et une miliaire pulmonaire.<br />
L’examen microscopique directe des produits du tubage gastrique a révélé<br />
des bacilles acido-alcoolo-résistants, et la recherche de l’infection au VIH est négative.<br />
Commentaire et Conclusions : Seul le traitement anti tuberculeux a permis la<br />
régression de l’exophtalmie.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
RÉTINE<br />
52 72<br />
Premiers résultats du dépistage systématique de la rétinopathie du prématuré<br />
au CHU de Tours.<br />
Screening for retinopathy of prematurity: first results in Tours.<br />
LALA E*, MAJZOUB S, ARSENE S, DELPLACE MP, PISELLA PJ (Tours)<br />
But : Malgré une meilleure prise en charge préventive, diagnostique et thérapeutique,<br />
la rétinopathie du prématuré (RP) reste une des causes majeures de basse<br />
vision de l’enfant.<br />
Matériel et Méthode : Tous les nouveaux-nés de moins de 32 semaines d’aménorrhée<br />
(SA) ou de 1 500 g, hospitalisés au CHU de Tours, ont eu un fond d’œil entre<br />
4 et 6 semaines de vie, à l’aide d’un verre contact de Layden par ophtalmoscopie<br />
directe après dilatation pupillaire. Les principaux facteurs de risques ont été relevés<br />
pour chaque patient (âge gestationnel, poids de naissance (PN), gémellité, détresse<br />
respiratoire transitoire, maladie des membranes hyalines, bronchodysplasie, persistance<br />
du canal artériel, transfusion, hémorragie inter-ventriculaire).<br />
Résultats : À 6 mois, 10 cas de RP (3 stades 1, 5 stades 2 et 2 stades 3 selon<br />
la classification internationale chez 5 filles et 5 garçons d’âge moyen de 28 SA,<br />
de PN moyen de 803 g) ont été dépistés parmi les 38 patients examinés (23 filles<br />
et 15 garçons, âge moyen de 29 SA + 2 jours, PN moyen de 1127 g). Tous les<br />
facteurs de risque étaient plus souvent présents chez les patients atteints. Deux<br />
patients ont été traités par photocoagulation laser, l’évolution a été favorable<br />
dans tous les cas.<br />
Commentaire et Conclusions : La RP n’est pas rare. Il faut s’appliquer à la rechercher<br />
afin d’éviter une évolution au-delà de tout recours thérapeutique. Le risque augmenté<br />
de strabisme, de myopie et de complications tardives (décollement de rétine,<br />
glaucome, cataracte) justifie un suivi rapproché et prolongé, en entière collaboration<br />
avec les parents.<br />
52 73<br />
Rétinopathie du prématuré. Résultats de l’examen du fond d’œil chez 94 enfants<br />
à risque.<br />
Retinopathy of prematurity. Results of fundus examination performed in 94 preterm<br />
infants.<br />
DENIS P*, BEBY F, BURILLON C (Lyon)<br />
But : Dépister la présence de lésions rétiniennes chez des enfants nés avant la<br />
32e semaine de gestation ou pesant moins de 1 500 grammes à la naissance.<br />
Matériel et Méthode : Entre janvier et octobre 2002, un fond d’œil a été réalisé à<br />
5 semaines de vie chez des enfants nés avant 32 semaines de gestation ou de poids<br />
de naissance inférieur à 1 500 grammes. Le matériel d’examen utilisé pour le dépistage<br />
était l’ophtalmoscopie binoculaire indirecte avec lentille asphérique de<br />
20 dioptries. La dilatation pupillaire était obtenue par 3 instillations de tropicamide<br />
réalisées à 15 minutes d’intervalle. Les lésions furent classées selon la classification<br />
internationale de Calgary.<br />
Résultats : 94 prématurés ont été examinés dont 49 garçons et 45 filles. L’âge gestationnel<br />
et le poids de naissance moyens étaient respectivement de 29 semaines et<br />
1 240 grammes. Une rétinopathie a été dépistée chez 18 enfants soit 19 % des prématurés<br />
examinés. Le détail des stades évolutifs des lésions rencontrées était le<br />
suivant : une rétinopathie de stade 3, cinq rétinopathies de stade 2, douze rétinopathies<br />
de stade 1. Les durées moyennes de cicatrisation des lésions en fonction du<br />
stade évolutif étaient les suivantes : 3 semaines pour les rétinopathies de stade 1,<br />
5 semaines pour les rétinopathies de stade 2, 12 semaines pour la rétinopathie de<br />
stade 3. Aucun décollement de rétine n’a été constaté. Si la fréquence de la rétinopathie<br />
s’est montrée particulièrement élevée chez les enfants ayant bénéficié d’une<br />
supplémentation en oxygène (33 %) en comparaison aux enfants non suroxygénés<br />
(9,7 %), la fréquence de la maladie s’est avérée également importante chez les<br />
enfants présentant une pathologie cardiaque et chez les enfants transfusés en culots<br />
globulaires.<br />
Commentaire et Conclusions : La majorité des lésions dépistées étaient peu<br />
sévères et transitoires. Aucune rétinopathie n’a nécessité de prise en charge<br />
chirurgicale. Outre les critères habituels de dépistage, il semble nécessaire de<br />
proposer un fond d’œil systématique à tout prématuré transfusé ou atteint de<br />
cardiopathie.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
RÉTINE – OCT/PDT<br />
52 74<br />
Une choriorétinite à cryptoccoque : à propos d’un cas.<br />
Cryptococcal chorioretinitis: a report on a case.<br />
KHALDI L*, RAICHON G, SOYEUX A, BACHENE A, BOUILLOT-GOUTORBE M<br />
(Nevers)<br />
But : L’atteinte oculaire dans la cryptococcose se manifeste fréquemment par<br />
une atteinte du nerf optique ou paralysie oculo-motrice ; la choriorétinite est<br />
plus rare.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’un patient âgé de 55 ans, admis dans le service<br />
des urgences pour un syndrome méningé modéré, ne présentant aucun antécédent<br />
médical. Il a décrit un trouble visuel au niveau de l’œil gauche qui a nécessité un<br />
fond d’œil pratiqué à son lit, révélant un léger trouble vitréen, un foyer choriorétinien<br />
d’aspect blanc crémeux proche de la macula associé à quelques hémorragies rétiniennes<br />
et nodules cotonneux.<br />
Résultats : Devant une lymphocytose et une hypoglycorachie découvertes après la<br />
ponction lombaire, le patient est mis sous traitement antituberculeux, sans confirmation<br />
bactériologique : celui-ci a été arrêté 4 jours après. Le test HIV s’est révélé positif<br />
à 2 reprises. La 2e ponction lombaire a mis en évidence la présence de<br />
Cryptococce Neoformans avec une sérologie à 200U ; la sérologie de toxoplasmose,<br />
CMV, hépatite B et C s’est révélée négative ; le scanner cérébral était normal. Le<br />
diagnostic de méningite cryptococcique a été retenu : un traitement a été instauré<br />
au 6ème jour. Un 2e fond d’œil pratiqué 3 semaines après a montré la disparition<br />
totale des nodules cotonneux, une nette diminution du foyer choriorétinien, ainsi<br />
qu’une quasi disparition des hémorragies rétiniennes ; la paralysie oculomotrice a<br />
partiellement récupéré. Une insuffisance rénale sévère secondaire a nécessité l’arrêt<br />
du traitement ; depuis l’état général s’est aggravé, un kaposi s’est généralisé : le<br />
patient a sombré dans un coma pendant quelques jours. Le patient est décédé 6<br />
semaines après son entrée à l’hôpital.<br />
Commentaire et Conclusions : Dans notre cas, la cryptococcose s’est manifestée<br />
par des lésions choriorétiniennes unilatérales et une paralysie oculo-motrice ayant<br />
bien répondu au traitement en 3 semaines, malgré son arrêt précoce lié aux effets<br />
indésirables. La cryptococcose reste une infection la plus fréquente lors du SIDA ;<br />
dans notre observation, elle en était révélatrice ; le décès reste élevé au stade de<br />
méningite ou méningoencéphalite.<br />
52 75<br />
Étude rétrospective sur la prise en charge de 34 cas d’occlusions d’artère<br />
centrale de la rétine.<br />
Retrospectiv study about 34 central retinal artery occlusion.<br />
SELLAMI L*, LE LEZ ML, JACOMET PV, PISELLA PJ, ARSENE S (Tours)<br />
But : L’occlusion d’artère centrale de la rétine est une cause brutale et souvent irréversible<br />
de perte de la vision. Elle touche le plus souvent des patients de plus de<br />
50 ans. Le mécanisme physiopathologique n’est pas élucidé.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur<br />
34 patients atteints d’occlusion artérielle rétinienne afin de déterminer les particularités<br />
étiologiques, cliniques et évolutives de cette affection.<br />
Résultats : La moyenne d’âge était de 67 ans avec une prédominance masculine<br />
sans atteinte oculaire préférentielle. Un facteur de risque cardiovasculaire est<br />
retrouvé dès l’interrogatoire dans plus de 50 % des cas. Le bilan étiologique était à<br />
la fois biologique (recherche de trouble de la crase sanguine, bilan lipidique et inflammatoire)<br />
et cardiovasculaire. Il s’est révèle contributif chez les sujets jeunes avec une<br />
prédominance d’étiologies cardiaques. Chez les sujets âgés, dans 3 cas une maladie<br />
de Horton a été décelée au cours du bilan. L’évolution, le plus souvent défavorable,<br />
était fonction du traitement et du délai de prise en charge. Dans 7 cas, on a constaté<br />
une récupération fonctionnelle plus ou moins complète lors d’une prise en charge<br />
inférieure à 24 heures. Des complications sont apparues dans 5 % des cas, essentiellement<br />
marquées par le glaucome néo-vasculaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude souligne l’importance d’un bilan<br />
approfondi et d’une prise en charge précoce dans les occlusions artérielles.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S213
1S214<br />
52 76<br />
Syndrome des antiphospholipides et occlusion vasculaire rétinienne : à propos<br />
de sept cas.<br />
Antiphospholipid syndrome and retinal vascular occlusion: about seven cases.<br />
MANIC H*, PACCALIN M, MERCIE M, DIGHIERO P, ROBLOT P, BECQ-<br />
GIRAUDON B (Poitiers)<br />
But : Les thromboses rétiniennes sont une pathologie du sujet âgé, favorisée par<br />
l’athérosclérose, l’hypertension artérielle ou le diabète. Une étude prospective a<br />
récemment souligné l’implication du syndrome des antiphospholipides (SAPL) dans<br />
cette pathologie avec une prévalence estimée à 24 %.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons 7 observations de patients hospitalisés<br />
pour baisse d’acuité visuelle avec mise en évidence d’une occlusion vasculaire<br />
rétinienne. Quatre patients présentaient une occlusion de la veine centrale de la<br />
rétine et 3 une occlusion de l’artère centrale. L’échographie-doppler carotidienne,<br />
l’échographie cardiaque et l’ECG étaient normaux. Un patient avait un<br />
antécédent de thrombose veineuse des membres inférieurs. Le bilan de thrombophilie<br />
révélait l’existence d’un SAPL, contrôlé à 2 reprises. Les taux d’anticorps<br />
anticardiolipine étaient significatifs chez 5 patients et les taux d’anticorps<br />
anti-b2GPI étaient positifs dans 3 cas. Trois patients avaient un taux de facteurs<br />
anti-nucléaires positif, avec dans un cas un diagnostic de syndrome de Gougerot-Sjögren.<br />
Résultats : Dans 5 cas un traitement anticoagulant au long cours a été instauré.<br />
Deux patients ont été traités par aspirine seule. Aucun patient n’a présenté d’amélioration<br />
visuelle. Aucune récidive thrombotique n’a été notée.<br />
Commentaire et Conclusions : Plusieurs manifestations ophtalmologiques sont<br />
décrites au cours du SAPL : amaurose, cécité, diplopie, neuropathie ischémique,<br />
occlusions vasculaires. La recherche systématique d’un tel syndrome nous<br />
apparaît opportune, d’autant plus que l’examen ne révèle pas d’autre facteur de<br />
risque cardiovasculaire.<br />
52 77<br />
ANNULÉ<br />
52 78<br />
Prévalence de l’Helicobacter pylori dans la choriorétinopathie séreuse centrale<br />
et l’épithéliopathie rétinienne diffuse : étude complémentaire.<br />
Prevalence of Helicobacter pylori in Central Serous Chorioretinopathy and Diffuse<br />
Retinal Epitheliopathy: a complementary study.<br />
AHNOUX ZABSONRE A* (Abidjan, Côte d’Ivoire), QUARANTA M, MAUGET<br />
FAYSSE M (Lyon)<br />
But : En 2001, nous avions trouvé sur 16 patients atteints de formes actives de choriorétinopathie<br />
séreuse centrale (CRSC) et d’épithéliopathie rétinienne diffuse (ERD)<br />
une prévalence d’infection par Helicobacter pylori (Hp) de 56,3 %. Cette prévalence<br />
était le double par rapport à celle de la population française. Cette étude complémentaire<br />
vise à vérifier ces résultats.<br />
Matériel et Méthode : Entre 1996 et 2002, 78 patients présentant une CRSC/ERD<br />
active étaient inclus. Le diagnostic était confirmé par l’examen du FO, une angiographie<br />
à la fluorescéine et au vert d’indocyanine et des coupes rétiniennes effectuées<br />
avec l’OCT (à partir de 2000). Ces patients avaient tous bénéficié d’une recherche<br />
de Hp par le test respiratoire à l’urée. L’analyse des résultats a été réalisée avec les<br />
tests de Chi2.<br />
Résultats : Sur 78 patients, 60 hommes (76,9 %) et 18 femmes (23,1 %)<br />
(moyenne d’âge 53 ans : min 29-max 80), 27 avaient une CRSC (34,6 %) et 51<br />
une ERD (65,4 %). La recherche d’Hp était positive chez 31 (39,7 %) patients et<br />
négative chez 47 (60,3 %). 48,3 % des hommes avaient une recherche positive,<br />
contre seulement 27,8 % des femmes. La différence de prévalence de l’Hp dans<br />
le groupe CRSC/ERD (39,7 %) et celle dans la population générale (25,4 % des<br />
58 419 710 français en 1999) était statistiquement hautement significative (p<br />
= 0,0036).<br />
Commentaire et Conclusions : La CRSC/ERD se retrouve fréquemment associée<br />
à une infection à Hp. Ces résultats complémentaires confirment les premiers résultats<br />
de notre étude préliminaire de 2001 en montrant cette prévalence particulièrement<br />
significative pour les patients de sexe masculin.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
RÉTINE – OCT/PDT<br />
52 79<br />
Syndrome para-néoplasique et rétinopathie.<br />
Para neoplasic syndrome associated retinopathy.<br />
CLEMENT B*, CREISSON G, SALAME N, LEBRETON O, MONTARD M (Besançon)<br />
But : Cas clinique d’une rétinopathie induite par un cancer bronchique à petites cellules.<br />
Matériel et Méthode : Il s’agit d’un patient âgé de 55 ans sans antécédent notable,<br />
hormis un tabagisme important, présentant depuis un mois des métamorphopsies, des<br />
phosphènes et une héméralopie avec une baisse d’acuité visuelle (5/10 œil droit, et 8/<br />
10 œil gauche). Les examens clinico-biologiques et radiologiques, en particulier TDM<br />
orbito-cérébral, fluorographie et radio pulmonaire sont sans particularité. Le champ<br />
visuel retrouve un rétrecissement concentrique des isoptères des deux côtés. Les<br />
potentiels évoqués visuels objectivent un effondrement bilatéral de l’amplitude de<br />
l’onde P100. L’électro-rétinogramme montre une négativité marquée du tracé.<br />
L’absence d’ondes B et E traduit l’atteinte des couches internes de la rétine. Une rétinopathie<br />
paranéoplasique est confirmée quelques jours plus tard par la survenue d’une<br />
pleurésie séro-hémorragique révélatrice d’un carcinome bronchique à petites cellules.<br />
Résultats : Les rétinopathies associées aux cancers systémiques sont liées à la présence<br />
d’anticorps dirigés vers des protéines tumorales présentant malheureusement<br />
des homologies avec les protéines spécifiques de la rétine dont la recoverine, protéine<br />
photoréceptrice de 23 K-Daltons. La tumeur la plus fréquemment impliquée<br />
dans la genèse de cette pathologie est le carcinome bronchique à petites cellules.<br />
Commentaire et Conclusions : Les cas rapportés dans la littérature sont rares, et<br />
cette association trompeuse, au pronostic sombre, est dans 50 % des cas la première<br />
manifestation du cancer sous-jacent.<br />
52 80<br />
Traitement par antipaludéens de synthèse : étude rétrospective du suivi des<br />
patients.<br />
Synthetic antimalarial treatment: retrospective study.<br />
CREPY P*, MAILLE M (Clamart)<br />
But : Tout patient qui doit bénéficier d’un traitement par antipaludéens de synthèse<br />
nécessite un bilan ophtalmologique clinique et fonctionnel avant sa mise en route<br />
puis ensuite régulièrement afin de dépister les premiers signes d’intoxication, réversibles,<br />
qui permettront d’adapter ou d’arrêter le traitement.<br />
Matériel et Méthode : Dans le cadre de l’étude sur la surveillance ophtalmologique<br />
des antipaludéens de synthèse pour laquelle le service a été sollicité, les auteurs<br />
réalisent une étude rétrospective à partir des dossiers des patients examinés depuis<br />
quatre ans. Le protocole comprend un interrogatoire permettant, entre autre, de<br />
quantifier la dose cumulée depuis le début, un examen clinique, des explorations<br />
fonctionnelles dont un test de vision des couleurs (Farnsworth 100 hue), un champ<br />
visuel central, une périmétrie statique méridienne sur 0-180° et un électrorétinogramme.<br />
Résultats : La surveillance habituelle est semestrielle, mais peut être plus rapprochée<br />
selon la dose prescrite et l’état maculaire, la sensibilité individuelle étant très<br />
variable.<br />
Commentaire et Conclusions : La coopération avec l’interniste est un élément clé<br />
du suivi de ces thérapeutiques à risque, mais néanmoins indispensables au patient,<br />
afin de préserver la fonction visuelle.<br />
52 81<br />
L’hypertrophie congénitale de l’épithélium pigmentaire rétinien : un marqueur de<br />
la polypose adénomateuse familiale exploré chez l’enfant.<br />
Congenital hypertrophy of retinal pigment epithelium: a childhood marker in familial<br />
adenomatous polyposis.<br />
SZWARCBERG J*, LIMACHER JM, FRIKER JP, FLAMENT J (Strasbourg)<br />
But : La polypose adénomateuse familiale (PAF) est une maladie digestive à hérédité<br />
autosomique dominante dont la transformation maligne est inéluctable. Cette étude<br />
concerne la valeur de l’hypertrophie congénitale de l’épithélium pigmentaire (HCEPR)<br />
comme marqueur de la PAF chez l’enfant.<br />
Matériel et Méthode : L’étude est fondée sur une enquête portant sur 21 sujets<br />
âgés de moins de 18 ans appartenant à 12 familles atteintes de PAF.<br />
Résultats : Les caractéristiques de l’HCEPR sont détaillées, les relations entre<br />
génotype et phénotype et celles reliant l’HCEPR au degré de sévérité de la PAF sont<br />
précisées. Les particularités à l’examen du fond d’œil chez l’enfant et l’adolescent,<br />
à la révélation de son résultat à la famille et à leurs multiples implications sont évo-<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
quées. L’examen du fond d’œil apparaît être le reflet du degré de sévérité de la maladie<br />
digestive et il oriente vers une localisation approximative de la mutation sur la<br />
séquence codante du gène APC conduisant à une analyse génétique plus rapide. Il<br />
permet également de préciser la date de réalisation du premier examen endoscopique<br />
et d’en préciser la fréquence.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude confirme les données de la littérature<br />
démontrant la valeur de marqueur de dépistage de l’HCEPR dans la PAF. L’existence ou<br />
non d’une HCEPR permet de cerner la position de l’anomalie génétique, d’évaluer la<br />
sévérité potentielle de la PAF au niveau colique, d’orienter l’analyse génétique sur une<br />
séquence codante limitée et d’obtenir un gain de temps appréciable pour préciser la prise<br />
en charge thérapeutique. L’étude du fond d’œil, examen non invasif, peu onéreux, reproductible<br />
et de réalisation aisée, doit être effectué très précocement chez tout membre<br />
d’une famille vectrice de PAF en raison de sa valeur statistiquement démontrée de marqueur<br />
de cette maladie avant même le développement de tout polype. Cet examen et<br />
l’expression de son résultat aux parents, qui déterminent en grande partie la qualité de la<br />
prise en charge médicale et chirurgicale, doivent être réalisés dans un climat de confiance<br />
entre les soignants et la famille. Des explications simples et claires portant sur le pronostic<br />
vital, les chances de survie, la qualité de vie, l’obligation de surveillance et le recours au<br />
conseil génétique doivent être délivrées de manière adaptée à la personnalité de chacun<br />
des membres de la famille.<br />
52 82<br />
Maculopathie aux antirétroviraux.<br />
Antiretroviral maculopathy.<br />
BENYELLES N*, BEGO B, BODARD-RICKELMAN E (Montfermeil)<br />
But : Nous rapportons le cas d’un patient au stade SIDA qui a présenté une maculopathie<br />
seize mois après l’introduction d’un traitement anti rétroviral.<br />
Matériel et Méthode : Un homme de 31 ans au stade SIDA est suivi depuis 1994<br />
pour rétinite à CMV de l’œil gauche ayant entraîné la perte fonctionnelle de cet œil.<br />
En janvier 1996, est introduit un traitement par Zidovudine, remplacé en mars 1996<br />
par Didanosine et Ritonavir, secondairement associé au Lamivudine en<br />
septembre 1996. En août 1997, on découvre au cours d’un examen systématique<br />
une maculopathie de l’œil droit avec dépôts jaunâtres péri-maculaires coexistant<br />
avec des plages d’atrophie de l’épithélium pigmentaire. L’évolution se fait vers la<br />
disparition spontanée des dépôts mais persistance de l’atrophie.<br />
Résultats : Cinq ans plus tard, l’acuité visuelle est stable à 10/10 P2.<br />
Commentaire et Conclusions : À notre connaissance, il s’agit du premier cas de<br />
maculopathie acquise compliquant les antirétroviraux. Les autres étiologies de<br />
maculopathies acquises et héréditaires sont discutées.<br />
52 83<br />
Fluorescence de la Papille et de la Macula en infrarouge après vitrectomie et emploi<br />
du vert d’indocyanine pour faciliter le pelage de la limitante interne de la rétine.<br />
Infrared fluorescence of the optic nerve and the macula after staining with<br />
indocyanine green for internal limiting membrane peeling in macular diseases.<br />
KOROBELNIK JF*, FRANCOIS L, ISBER SOYEUR R, COLIN J, RENAUD-<br />
ROUGIER MB (Bordeaux)<br />
But : Le traitement de certaines maculopathies associe la vitrectomie et le pelage de la<br />
limitante interne. La coloration par le vert d’indocyanine (ICG) de la limitante interne facilite<br />
le pelage. Mais une possible toxicité de l’ICG a été évoquée par certains auteurs.<br />
Matériel et Méthode : Nous présentons une étude rétrospective de 19 yeux opérés<br />
consécutivement. La chirurgie a consisté à réaliser une vitrectomie, avec décollement<br />
du cortex vitréen postérieur éventuellement non décollé en préopératoire, et<br />
avec dans tous les cas un pelage de la limitante interne après coloration de la limitante<br />
interne avec l’ICG (Infracyanine ® ) injecté dans la cavité vitréenne. Il s’agissait<br />
de 14 trous maculaires, 3 occlusions de branche veineuse, 1 œdème maculaire diabétique<br />
et 1 membrane épirétinienne.<br />
Résultats : Le suivi moyen est de 10,6 mois (2,6 – 18,4 mois). Nous avons observé<br />
une fluorescence en infrarouge au niveau de la macula dans 14 yeux, au niveau de<br />
la papille dans 17 yeux. Huit yeux sur les 10 suivis plus de 12 mois présentent encore<br />
une hyperfluorescence, papillaire dans tous les cas, maculaire et papillaire dans<br />
6 yeux. Le résultat fonctionnel ne peut pas être interprété sur cette série limitée.<br />
Commentaire et Conclusions : L’emploi de l’ICG dans la chirurgie associant<br />
vitrectomie et pelage de la limitante interne entraîne une fluorescence persistante en<br />
infrarouge, dont l’inocuité doit être démontrée par des études complémentaires.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
RÉTINE – OCT/PDT<br />
OCT/PDT<br />
52 84<br />
Intérêt de l’OCT pour analyser les taches flavimaculées de la maladie de<br />
Stargardt.<br />
Contribution of Optical Coherence Tomography (OCT) for analysing the whiteyellowish<br />
flecks in Stargardt’disease.<br />
SAYAG D*, SOUIED E, PAWLAK D, COSCAS G, SOUBRANE G (Créteil)<br />
But : Évaluer l’apport de l’OCT pour l’étude de la localisation des taches périmaculaires<br />
de Fundus flavimaculatus.<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons le cas clinique d’un patient de 48 ans présentant<br />
une maladie de Stargardt d’apparition tardive avec des taches jaunes flavimaculées<br />
géantes. Ce patient est suivi régulièrement depuis 4 ans avec mesure de<br />
l’acuité visuelle, examen du fond d’œil, vision des couleurs, électrorétinogramme,<br />
angiographie rétinienne à la fluorescéine et au vert d’indocyanine ainsi que des coupes<br />
d’OCT passant par les zones des taches les plus volumineuses.<br />
Résultats : Les coupes d’OCT passant par les taches objectivent une zone hyperéflective<br />
située dans la couche des photorécepteurs, en avant de l’hyperéflectivité du<br />
complexe épithelium pigmentaire-membrane de Bruch.<br />
Commentaire et Conclusions : Les rares études anatomopathologiques ont localisé<br />
du matériel du fundus flavimaculatus au niveau de la partie apicale des cellules<br />
de l’épithelium pigmentaire. L’OCT a permis in vivo de localiser avec précision la<br />
topographie des taches de FFM dans l’épaisseur rétinienne. Celles-ci se situent dans<br />
la couche des photorécepteurs, en avant et à distance du plan de l’épithélium pigmentaire.<br />
52 85<br />
Indication de retraitement par photothérapie dynamique et néovaisseaux<br />
choroïdiens rétrofovéaux du myope fort : une place pour l’OCT ?<br />
Retreatment with photodynamic therapy for subfoveal choroidal neovascularization<br />
in pathologic myopia: the role of optical coherence tomography.<br />
HADDAD W*, RAZAVI S, PITAULT G, COSCAS F, RAMAHEFASOLO C, MIMOUN G,<br />
SOUIED E, COSCAS G, SOUBRANE G (Créteil)<br />
But : Déterminer la contribution éventuelle de la tomographie en cohérence optique<br />
(OCT) dans les indications de retraitement des néovaisseaux choroïdiens (NVC)<br />
rétrofovéaux du myope fort traités par photothérapie dynamique (PDT) à la vertéporfine.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective d’une série de patients myopes forts traités<br />
par PDT à la vertéporfine. Une OCT a été réalisée lors de chaque contrôle trimestriel<br />
suivant la PDT, parallèlement à l’angiographie à la fluorescéine (AF). L’AF a<br />
été analysée sur la base de la présence ou non de diffusion, critère de référence pour<br />
l’indication d’un retraitement par PDT. L’OCT a été analysée de manière indépendante,<br />
d’une part selon un critère qualitatif, la présence de liquide sous-rétinien, et<br />
d’autre part selon un critère quantitatif, la mesure de l’épaisseur rétinienne au niveau<br />
des NVC.<br />
Résultats : Quarante-neuf yeux consécutifs (49 patients) ont été inclus dans cette<br />
étude. L’OCT a été considérée comme ininterprétable dans 6 yeux (12 %), exclus de<br />
l’analyse ultérieure. La présence ou non de liquide sous-rétinien en OCT lors de 93<br />
contrôles trimestriels des 43 yeux restants était corrélée à celle d’une diffusion en<br />
AF (concordance dans 78 sur 93 examens, soit 84 %, r = 0,68). La sensibilité et la<br />
spécificité de la présence de liquide sous-rétinien en OCT par rapport à la présence<br />
de diffusion en AF étaient respectivement de 0,95 et 0,75. Les données quantitatives<br />
concernant les variations d’épaisseur rétinienne sont en cours d’analyse.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces résultats suggèrent que l’OCT pourrait apporter<br />
une aide pour préciser les indications de retraitement par PDT des NVC du myope fort.<br />
52 86<br />
Apport de la tomographie en cohérence optique (OCT) dans la dystrophie<br />
maculaire de Best.<br />
OCT features in Vitelliform Macular Dystrophy.<br />
SOUIED E*, BENHAMOU N, OUBRAHAM H, COSCAS G, SOUBRANE G (Créteil)<br />
But : Évaluer l’apport de l’OCT dans la dystrophie maculaire de Best.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons réalisé un examen ophtalmologique complet<br />
avec clichés anérythres et un examen en OCT à tous les patients atteints de maculopathie<br />
de Best consultant consécutivement entre janvier 1997 et novembre 2002.<br />
Un total de 57 examens en OCT (6 coupes par examen, 342 coupes) ont été réalisés<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S215
1S216<br />
et comparés à l’aspect en biomicroscopie, à différents stades d’évolution de la maladie<br />
(21 patients ; 37 yeux).<br />
Résultats : Au stade vitelliforme, l’examen en OCT montre constamment une lésion<br />
hyporéflective surélevée au dessous du plan de l’épithélium pigmentaire (EP) avec<br />
un respect de l’intégrité des couches rétiniennes. Au stade de pseudo-hypopion, il<br />
existe constamment une hyporéflectivité dans la partie supérieure et un aspect hypereflectif<br />
dans la partie inférieure de la lésion, sur le plan de l’EP. Au stade de remaniement<br />
on observe une hyporeflectivité de l’ensemble de la lésion avec quelques<br />
amas hyperréflectifs superposables aux amas de matériel disséminés. Au stade de<br />
fibrose, il existe une masse hyperréflective volumineuse partant du plan de l’EP vers<br />
les couches superficielles rétiniennes, amincies et déstructurées.<br />
Commentaire et Conclusions : L’OCT représente une technique simple, non invasive<br />
et applicable chez l’enfant pour établir des corrélations entre l’aspect biomicroscopique<br />
et l’aspect en OCT, à chacun des stades évolutifs de la maladie.<br />
52 87<br />
PDT et néovaisseaux choroïdiens maculaires compliquant la choroïdite<br />
multifocale.<br />
Photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization associated with<br />
multifocal choroiditis.<br />
MIMOUN G* (Paris), DONATI A (Melun), HADDAD W (Créteil), COSCAS F,<br />
COSCAS G (Paris), SOUBRANE G (Créteil)<br />
But : Étudier les effets de la photothérapie dynamique (PDT) dans le traitement des<br />
patients présentant des néovaisseaux choroïdiens rétrofovéolaires visibles (NVC)<br />
compliquant une choroïdite multifocale.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de 4 yeux de 4 patients présentant des<br />
NVC visibles compliquant un foyer cicatriciel de choroidite multifocale traités par<br />
PDT. L’analyse de l’acuité visuelle EDTRS, de l’examen biomicroscopique, de<br />
l’angiographie à la fluorescéine et au vert d’infracyanine, et de l’OCT avant et après<br />
traitement a été réalisée.<br />
Résultats : L’âge moyen des patientes (toutes de sexe féminin) était de 36,5 ans et<br />
le nombre moyen de traitement a été de 1,75 cures. 2 des patientes avait été traitées<br />
au préalable par corticothérapie avant la PDT en l’absence de reprise inflammatoire.<br />
L’amélioration moyenne de l’acuité visuelle a été de 0,5 lignes. Le suivi allait de 6 à<br />
15 mois. 2 yeux présentant une amélioration de 1 ligne, 1 œil restait stable et 1 œil<br />
s’aggravait de 1 ligne.<br />
Commentaire et Conclusions : Dans cette affection où aucun traitement n’a<br />
démontré son efficacité, bien que le nombre des patients soit peu élevé et le suivi<br />
court ; les résultats initiaux de stabilisation de l’acuité visuelle après traitement par<br />
PDT semblent prometteurs et demandent à être confirmés par une étude ultérieure.<br />
52 88<br />
Influence de l’âge sur les résultats de la photothérapie dynamique des<br />
néovaisseaux choroïdiens du myope fort.<br />
Age influence on the results of Photodynamic therapy of subfoveal choroidal<br />
neovascularization in pathologic myopia.<br />
RAZAVI S* (Tours), HADDAD W, GLACET-BERNARD A, COSCAS G, SOUBRANE G<br />
(Créteil)<br />
But : Déterminer s’il existe une différence dans le pronostic et les résultats de la<br />
photothérapie dynamique des néovaisseaux choroïdiens de la myopie dégénérative<br />
en fonction de l’âge des patients.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective d’août 2000 à mars 2002. Critères<br />
d’inclusion : néovaisseaux choroïdiens secondaires à la myopie pathologique, localisation<br />
rétrofovéolaire de la membrane néovasculaire, AV 20/100 – 20/40. Les<br />
patients ont été divisés en deux groupes : moins de 50 ans, plus de 65 ans. Les<br />
patients ont été traités par photothérapie dynamique à la visudyne selon les critères<br />
de l’étude VIP.<br />
Résultats : Trente et un yeux de 31 patients ont été inclus dans cette étude. L’âge<br />
moyen des patients est de 51 ans (38-76 ans). La myopie moyenne est de – 11 dioptries.<br />
Le suivi moyen des patients a été de 14 mois. En moyenne, les patients de<br />
moins de 50 ans ont, à 1 an, gagné 2 lignes d’acuité visuelle alors que ceux de plus<br />
de 65 ans ont perdu 1 ligne. Le nombre de séance de photothérapie a été de 2.1<br />
pour les patients de moins de 50 ans et de 3.1 pour ceux de plus de 65 ans.<br />
Commentaire et Conclusions : Cette étude met en évidence une différence de<br />
résultat et de pronostic en fonction de l’âge des patients à 1 an. Les patients de<br />
moins de 50 ans ayant des néovaisseaux choroïdiens dus à la myopie semblent<br />
bénéficier le plus du traitement par la photothérapie dynamique à la visudyne.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
RÉTINE – OCT/PDT<br />
52 89<br />
Étude comparative des profils maculaires en OCT1 et OCT3 sur yeux normaux et<br />
sur œdèmes maculaires diabétiques.<br />
OCT 3 versus OCT 1 for the analysis of the macula in normal eyes and in diabetic<br />
macular edema.<br />
PIERRE KAHN V*, TADAYONI R, MASSIN P, GUYOMARD JL, GAUCHER D,<br />
HAOUCHINE B, GAUDRIC A (Paris)<br />
But : Comparaison OCT 3 versus OCT1 dans l’analyse morphologique de la macula<br />
d’yeux normaux et d’yeux présentant un œdème maculaire diabétique.<br />
Matériel et Méthode : Six volontaires sains (7 yeux) et 10 diabétiques avec œdème<br />
maculaire (19 yeux) ont été examinés le même jour en Tomographie en Cohérence<br />
Optique (OCT) modèle 1 et modèle 3. Six coupes radiaires de 6 mm centrées sur la<br />
fovéola ont été réalisées sur chaque œil. L’épaisseur rétinienne moyenne a été calculée<br />
dans chacun des 9 aires de l’ETDRS ainsi qu’au niveau fovéolaire. Une comparaison<br />
appariée des mesures obtenues en OCT 1 et OCT 3 a été réalisée. Une<br />
analyse qualitative des images ainsi qu’une évaluation du taux d’artéfact pour chacun<br />
des deux appareils ont aussi été réalisées.<br />
Résultats : Les mesures enregistrées en OCT 1 et OCT 3 sont fortement corrélés (r<br />
= 0,983, p < 0,0001) sans être identiques. L’écart moyen des mesures est de<br />
21,4 ± 43,6 microns. La courbe de régression montre une sur-estimation des épaisseurs<br />
rétiniennes mesurées en OCT 3 pour des épaisseurs inférieures à 400 microns<br />
et une sous-estimation pour des épaisseurs supérieures. (r = –0,44 p < 0,001).<br />
L’essentiel des sous-estimations est lié à des artéfacts majoritairement présentes en<br />
OCT 3. Après élimination des valeurs artéfactées l’écart moyen des mesures est de<br />
25,4±15,5 microns avec une sur-estimation par l’OCT 3 dans 97 % des cas quelque<br />
soit l’épaisseur. Qualitativement la résolution des images est bien meilleure en OCT<br />
3 qu’en OCT1 (7 vs 15 microns). Le taux d’artéfact est plus élevé en OCT 3.<br />
Commentaire et Conclusions : L’OCT 1 est reconnu reproductible dans ses mesures<br />
d’épaisseur rétinienne en particulier en cas d’œdème maculaire diabétique. De<br />
plus haute résolution, l’OCT 3 apporte un bénéfice certain quant à l’analyse des coupes.<br />
Cette étude montre une différence dans l’estimation de l’épaisseur rétinienne<br />
avec une tendance à la surestimation en OCT3. Les mesures d’épaisseur rétiniennes<br />
obtenues avec l’OCT 1 ne peuvent donc être transposées à l’OCT 3.<br />
52 90<br />
Analyse en Tomographie en Cohérence Optique des relations vitréo-maculaires<br />
chez les patients diabétiques avec et sans œdème maculaire.<br />
Vitreoretinal relationship in diabetic patients with and without macular edema.<br />
TADAYONI R*, GAUCHER D, MASSIN P, ERGINAY A, BENOSMAN R,<br />
HAOUCHINE B, GAUDRIC A (Paris)<br />
But : Analyser, à l’aide de la Tomographie en Cohérence Optique (OCT), la jonction<br />
vitréomaculaire, chez les patients diabétiques atteints d’œdème maculaire et comparaison<br />
avec une série appariée de patients diabétiques sans œdème maculaire.<br />
Matériel et Méthode : Étude comparative de 74 yeux recrutés prospectivement<br />
(37 yeux de 25 patients diabétiques ayant un œdème maculaire et 37 yeux de<br />
25 patients sans œdème, appariés pour l’age, le sexe et le type de diabète). Tous<br />
les patients ont eu une mesure d’acuité ETDRS, une biomicroscopie du fond d’œil<br />
avec recherche de décollement du vitré, un OCT avec cartographie et analyse de la<br />
jonction vitréomaculaire. Les yeux ont été classés en fonction de l’aspect de l’attache<br />
vitréorétinienne en OCT. Les profils OCT ont aussi était analysés qualitativement.<br />
Résultats : L’age moyen des patients était de 61 ans dans les 2 groupes. Parmi les<br />
37 yeux avec œdème, 37,8 % (14) n’avaient pas de décollement de vitré, 54,1 % (20)<br />
avaient un décollement périfovéolaire et 8,1 % (3) un vitré détaché de la macula.<br />
L’épaisseur centrale en cartographie était de 456,40±109 microns. Dans les yeux<br />
sans œdème, ces chiffres étaient respectivement de 56,8 % (21), 35,1 % (13), 8,1 %<br />
(3) et 196,80±28,70. La différence de distribution de l’état du vitré entre les 2 groupes<br />
n’est pas statistiquement significative (p = 0,23).<br />
Commentaire et Conclusions : Le rôle du vitré dans la genèse de l’œdème maculaire<br />
diabétique a été évoqué, en particulier devant la possibilité d’amélioration de<br />
certains œdèmes après vitrectomie. L’OCT permet d’analyser avec une grande précision<br />
la jonction vitréomaculaire. Nous avons comparé l’aspect de la jonction vitréomaculaire<br />
entre des yeux ayant un œdème maculaire, et des yeux sans œdème<br />
maculaire, et n’avons pas observé de différence de distribution de l’état du vitré<br />
entre les 2 groupes. Dans les yeux avec œdème maculaire, l’analyse qualitative des<br />
images montre cependant une épaisseur rétinienne plus importante dans les zones<br />
de vitré attaché par rapport aux zones sans attache. Ces résultats suggèrent un rôle<br />
accessoire du vitré dans la genèse de l’œdème maculaire diabétique.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
52 91<br />
Dépistage de la rétinopathie diabétique par photographies du fond d’œil et<br />
télétransmission : résultats d’un an d’expérience.<br />
Screening for diabetic retinopathy using digital retinal photography and<br />
telemedecine.<br />
BENOSMAN R*, MASSIN P, ERGINAY A, BENMEHIDI A, VICTOR Z, HOANG-<br />
XUAN T, MARRE , GAUDRIC A (Paris)<br />
But : La rétinopathie diabétique (RD) reste une cause importante de malvoyance. Le<br />
dépistage annuel de la RD est en effet insuffisamment pratiqué. La photographie<br />
numérisée du fond d’œil, télétransmise vers un centre de lecture pourrait contribuer<br />
à améliorer le dépistage de la RD. Nous rapportons les résultats d’un an de fonctionnement<br />
d’une expérience pilote menée entre les services de diabétologie de<br />
l’hôpital Bichat et d’ophtalmologie de l’hôpital Lariboisière.<br />
Matériel et Méthode : Un site de dépistage de la RD équipé d’un rétinographe nonmydriatiqueTopcon<br />
TRC-NW6 a été installé dans le service de diabétologie de l’hôpital<br />
Bichat. Le protocole de dépistage comprend une mesure d’acuité visuelle et la<br />
prise, sans dilatation pupillaire, par une infirmière de 5 photographies par œil. Les<br />
photographies sont télétransmises, sous format JPEG vers le service d’ophtalmologie<br />
de Lariboisière et un compte-rendu est adressé aux diabétologues.<br />
Résultats : Entre le 1/10/2001 et le 30/09/2002, 500 diabétiques (20 % type 1, 80 %<br />
type 2, âge moyen : 52 ans) ont bénéficié de photographies du fond d’œil. Seuls 7 %<br />
des patients ont eu des clichés non interprétables. Une RD a été diagnostiquée chez<br />
200 patients (40 %). 108 patients (21 %) avaient une RD non proliférante minime, 25<br />
(5 %) une forme modérée, 22 une forme sévère (4 %). 9 (1,8 %) patients avaient une<br />
rétinopathie proliférante ou un œdème maculaire. Une consultation d’ophtalmologie<br />
a été demandée.<br />
Commentaire et Conclusions : Le dépistage de la RD par photographies du fond<br />
d’œil est une méthode faisable et valide qui devrait permettre d’accroître le nombre<br />
de sujets diabétiques dépistés et d’optimiser le recours à la consultation d’ophtalmologie.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
RÉTINE – OCT/PDT<br />
52 92<br />
Dépistage de la rétinopathie diabétique par la caméra non mydriatique Topcon<br />
CRW6 : faut-il réaliser 2, 3 ou 4 photos ?<br />
Comparison of two, three and four 45-degree image fields with the Topcon CRW6<br />
non-mydriatic camera for the screening of diabetic retinopathy.<br />
ANGIOI-DUPREZ K* (Nancy), OLIVIER S (Montréal, Canada), MAALOUF J (Nancy),<br />
GRESSET J, BOUCHER MC (Montréal, Canada)<br />
But : Évaluer combien de photographies il faut réaliser pour dépister la rétinopathie<br />
diabétique (RD) par la caméra non mydriatique Topcon CRW6.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective transversale de 98 patients diabétiques<br />
comparant la réalisation de 2, 3 ou 4 photos à la caméra non mydriatique aux photographies<br />
stéréoscopiques des 7 champs de l’ETDRS pour dépister la RD. Les 2<br />
premières photos sont centrées une sur la macula et l’autre sur la papille. La 3e est<br />
celle située en temporal de la macula et la 4e en temporal supérieur de la macula.<br />
Résultats : La sensibilité et la spécificité de la caméra pour dépister la présence<br />
d’une RD (stade ETDRS ≥ 10) est pour les 2 champs de 95,7 % et 78,1 %, pour les<br />
3 champs, 97,6 % et 71,9 % et pour les 4 champs 97,6 % et 65,6 %. Le coefficient<br />
Kappa pour les 2, 3 et 4 champs est respectivement de 0,76, 0,71 et 0,65. De plus,<br />
l’utilisation de 3 ou 4 champs entraîne une augmentation de 6,2 % du taux de photos<br />
ininterprétables du fait de leur mauvaise qualité. La sensibilité et la spécificité de la<br />
caméra pour dépister une RD significative (stade ETDRS ≥ 35) est pour les 2 champs<br />
de 87,5 % et 92,3 %, pour les 3 champs, 88,9 % et 94,6 % et pour les 4 champs<br />
88,8 % et 91,9 %. Le coefficient Kappa pour les 2, 3 et 4 champs est respectivement<br />
de 0,80, 0,83 et 0,81.<br />
Commentaire et Conclusions : L’addition de champs supplémentaires aux deux<br />
champs centraux n’apporte pas de gain pour dépister la rétinopathie diabétique. La<br />
prise des deux photos centrales semble être une bonne stratégie.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S217
1S218<br />
ŒIL ET DIABÈTE<br />
52 93<br />
Épidémiologie de la rétinopathie diabétique au Liban.<br />
Epidemiology of diabetic retinopathy in Lebanon.<br />
WAKED N* (Beyrouth, Liban)<br />
But : Pour déterminer la prévalence de la rétinopathie diabétique, évaluer ses facteurs<br />
de risque et évaluer la prévalence du diabète connu dans la population libanaise.<br />
Matériel et Méthode : L’étude de la population a été conduite dans trois régions<br />
libanaises. Le groupe d’étude était formé de 112 diabétiques connus qui ont été<br />
identifiés auparavant parmi 4 063 personnes choisies de façon randomisée. Tous<br />
ces diabétiques connus ont subi un interrogatoire, un examen physique et un examen<br />
minutieux de la rétine à la recherche du moindre signe de rétinopathie diabétique.<br />
Plusieurs facteurs de risque ont été ensuite évalués afin de trouver ceux liés à<br />
la survenue de la rétinopathie diabétique.<br />
Résultats : La prévalence du diabète connu est de 2.95 %. 112 des 120 diabétiques<br />
connus ont accepté d’être examinés. Le rapport homme/femme est de 1,43, l’âge<br />
moyen des diabétiques est de 60.98 ans, l’âge moyen à la découverte du diabète<br />
est de 51,75 ans, et l’ancienneté moyenne du diabète connu est de 9.19 ans. Une<br />
rétinopathie diabétique a été retrouvée chez 19 patients (16.96 %). L’ancienneté du<br />
diabète, le type et la fréquence de la surveillance fundoscopique, et la baisse de<br />
l’acuité visuelle se sont avérés être associés de façon significative avec la survenue<br />
de la rétinopathie diabétique.<br />
Commentaire et Conclusions : Dans notre étude, la rétinopathie diabétique est<br />
détectée chez 16.96 % des diabétiques connus, ce qui est moins fréquent que dans<br />
beaucoup d’autres pays. La majorité de ces patients diabétiques (84,82 %) sait que<br />
le diabète entraîne des pathologies oculaires, mais une minorité seulement (17,85 %)<br />
suit une surveillance fundoscopique régulière.<br />
52 94<br />
Atrophie optique et diabète : le syndrome de Wolfram au Liban.<br />
Optic atrophy and diabetes: the Wolfram syndrome in Lebanon.<br />
BAZ P (Beyrouth, Liban)<br />
Purpose: To report 31 cases of Wolfram syndrome in a type I diabetic lebanese<br />
population and describe the systemic manifestations of the disease.<br />
Material and Method: 589 type I diabetic patients were prospectively examined at<br />
the Chronic Care Center in Lebanon. 31 patients had optic atrophy which, associated<br />
with diabetes mellitus, is called Wolfram syndrome. Almost all these patients<br />
underwent extensive investigation as following: neurologic examination, MRI of eyes<br />
and brain, audiogram, cardiac examination and echocardiography, cystomanometry,<br />
water retriction followed by AVP administration, pituitary function tests, Cpeptide<br />
levels, antiGAD and islet cell antibodies. Blood samples from patients and their families<br />
was taken for DNA sequencing, mtDNA screening for mutation and linkage analysis<br />
on 4p16 1 locus.<br />
Results: These 31 patients (18 males and 13 females) belonged to 17 families.<br />
Consanguinity was found in 100% of cases. The mean age was 20.76, the mean<br />
duration of diabetes was 10.9 years and the age of diagnosis of optic atrophy was<br />
13.9. We found diabetes insipidus in 87%, deafness in 64.5%, abnormal urodynamics<br />
in 73.7%, abnormal pituitar function in 75% and neurological abnormalities<br />
in 70%. Our patients had also cardiac abnormalities, psychiatric disorders and<br />
gastroparesis. We identified 2 putative WFS mutation in 3/17 families, no mtDNA<br />
mutation and 5 families with linkage to the WFS locus.<br />
Comment and Conclusion: This study is one of the largest in the literature. The<br />
prevalence of this disease is high in Lebanon thus we must be aware of this multisystemic<br />
degeneration and we recommand a yearly eye exam for early diagnosis and<br />
prevention of some complications.<br />
52 95<br />
Maculopatie diabétique. Aspects angiographiques. Essais thérapeutiques.<br />
Diabetic maculopathy, angiography and treatment.<br />
ABI RACHED J*, ESTA A (Beyrouth, Liban)<br />
But : Savoir reconnaître une maculopathie diabétique et la traiter en pratique quotidienne.<br />
Matériel et Méthode : Revue critique des grandes études internationales. Étude de<br />
la classification de la maculopathie diabétique. Revue des principaux aspects angiographiques.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM FRANCO-LIBANAIS<br />
Résultats : Résultats d’une petite série personnelle.<br />
Commentaire et Conclusions : Principes thérapeutique en insistant sur la corticothérapie<br />
à forte dose suivie d’une photocoagulation focale.<br />
52 96<br />
Efficacité d’un traitement laser préventif chez des sujets diabétiques soumis à<br />
intervention de cataracte : résultats préliminaires.<br />
Efficacy of a preventive laser therapy in diabetic patients who undergo cataract<br />
surgery: preliminary results.<br />
SCOROLLI L* (Italie), VISMARA S (Italie), MORARA M (Italie), CORAZZA D (Italie),<br />
MEDURI RA (Bologne, Italie)<br />
But : Nous avons évalué si et combien une thérapie au laser préventive et préopératoire<br />
puisse influencer l’apparition et la progression de la rétinopathie diabétique<br />
et le développement d’un œdème maculaire cystoïde après intervention de cataracte<br />
chez des sujets diabétiques.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons sélectionné 26 yeux atteints de diabète type II<br />
et de cataracte au 3 ou 4 stade selon Chylack. Les patients, soumis à angiographie<br />
à la fluorescéine avant l’intervention de cataracte, présentaient :<br />
– aucune atteinte rétinienne dans 14 yeux : groupe A ;<br />
– 12 yeux atteints de rétinopathie diabétique non proliférante minime selon ETDRS :<br />
groupe B.<br />
Les patients des groupes A et B ont effectué une photocoagulation au laser Argon<br />
trois mois avant l’intervention de cataracte (grille maculaire dans le groupe A et grille<br />
maculaire + photocoagulation focale dans le groupe B). 19 patients diabétiques de<br />
contrôle, soumis à extraction de cataracte sans thérapie laser prophylactique :<br />
– 11 yeux sans atteinte rétinienne : groupe C ;<br />
– 8 yeux atteints de rétinopathie diabétique non proliférante minime selon ETDRS :<br />
groupe D.<br />
Les paramètres évalués étaient : acuité visuelle, biomicroscopie, fond d’œil et angiographie<br />
à la fluorescéine. Le suivi moyen a été de 6±2.3 mois.<br />
Résultats : Groupe A : après 1 mois, 0/14 cas (0 %) d’œdème maculaire cystoïde<br />
(OMC) ; après 6 mois, 1/14 cas d’OMC (7.1 %). Groupe C, après 1 mois : 7/11 cas<br />
d’OMC (63,6 %) avec réduction ultérieure de l’acuité visuelle préopératoire ; après<br />
6 mois, 4/11 cas d’OMC (36,5 %) avec réduction permanente de l’acuité visuelle.<br />
Groupe B, après 1 mois : 0/12 cas d’OMC ; après 6 mois 2/12 cas (16,7 %). Groupe<br />
D, après 1 mois : 6/8 cas d’OMC (75 %) ; après 6 mois : 3/8 cas (37,5 %).<br />
Commentaire et Conclusions : D’après les données préliminaires obtenues, nous<br />
avons pu mettre en évidence l’efficacité d’une thérapie laser préopératoire pour prévenir<br />
l’apparition d’OMC chez des patients diabétiques soumis à extraction de cataracte.<br />
52 97<br />
Le traitement de l’œdème maculaire diabétique par le laser jaune.<br />
The treatment of diabetic macular edema by yellow dye laser.<br />
SCHAKAL A* (Beyrouth, Liban)<br />
But : L’œdème maculaire est une cause majeure de baisse de la vision chez les diabétiques.<br />
Le traitement par laser est unanimement reconnu pour son efficacité. Nous<br />
rapportons notre expérience clinique dans le traitement de cet œdème par le laserjaune,<br />
et comparons les résultats à ceux de la littérature.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons étudié l’acuité visuelle, le fond d’œil et l’image<br />
angiographique avant et après traitement focal ou grid chez tous les patients diabétiques<br />
traités depuis 5 ans dans notre centre, par le même ophtalmologiste avec le<br />
même laser à longueur d’onde jaune (580nm). Les résultats ont été évalués et comparés<br />
notamment à ceux publiés sur le laser argon-vert.<br />
Résultats : Il n’y a pas de différence significative entre notre groupe de patients<br />
traités par le laser jaune et ceux publies traites par le laser argon-vert, sur le plan de<br />
l’acuité visuelle et la réduction de l’œdème maculaire. Mais, le laser jaune permet<br />
d’utiliser des niveaux d’énergie plus bas, des tailles d’impact plus petites, et des<br />
temps d’exposition plus courts. Les cicatrices de photocoagulation paraissent<br />
s’étendre moins qu’avec le laser argon-vert traditionnel.<br />
Commentaire et Conclusions : Le laser jaune nous parait une bonne alternative au<br />
laser argon vert pour le traitement des œdèmes maculaires diabétiques. Tout en<br />
donnant les mêmes résultats fonctionnels, il est plus sûr, utilise moins d’énergie,<br />
altère moins l’épithélium pigmentaire, traverse plus facilement des cristallins sclérosés<br />
et n’est pas absorbé par le pigment xanthophylle.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
52 98<br />
Échec de la photocoagulation au cours des œdèmes maculaires sévères.<br />
Failure of laser therapy in servere diabetic macular edemas.<br />
GUYOT-ARGENTON C* (Paris)<br />
But : Tenter d’identifier, grâce aux données de la tomographie en cohérence optique<br />
(OCT), les facteurs susceptibles d’expliquer l’échec de la photocoagulation au cours<br />
des maculopathies diabétiques sévères.<br />
Matériel et Méthode : Étude rétrospective de 40 yeux consécutifs (25 patients)<br />
présentant un œdème maculaire sévère défini par un épaississement rétinien<br />
central (objectivé en biomicroscopie et > 450 µ sur l’OCT) associé à un œdème<br />
diffus (cystoïde dans 75 % des cas) et/ou à des exsudats denses para-fovéolaires,<br />
ainsi qu’à une baisse récente de l’acuité visuelle (AV) > 3 lignes. Ont été<br />
exclues les maculopathies tractionnelles liées à une prolifération fibro-vasculaire,<br />
une membrane épi-rétinienne ou une condensation de la hyaloïde postérieure.<br />
Tous les yeux (n = 40) ont bénéficié d’une photocoagulation en grille<br />
infralaminaire. Durée moyenne du suivi : 17 mois (9 à 24). Les facteurs systémiques<br />
ont été évalués.<br />
Résultats : La photocoagulation a été efficace dans 45 % des cas (17 yeux) et s’est<br />
soldée par un échec dans 55 % des cas (23 yeux). Parmi ces 23 yeux réfractaires à<br />
la photocoagulation, l’OCT a mis en évidence 4 œdèmes tractionnels (17 %) et 15<br />
décollements séreux rétiniens (DSR) fovéolaires (60 %) non objectivés par la biomicroscopie.<br />
6 yeux avec DSR ont présenté, au cours du suivi, une perte irréversible<br />
de l’AV (
1S220<br />
53 02<br />
Rétinopathie diabétique floride : résultats du traitement chirurgical.<br />
Florid diabetic retinopathy: results of the surgery.<br />
GUYOMARD JL*, MASSIN P, TADAYONI R, BENHAMOU N, ERGINAY A,<br />
BENOSMAN R, VICTOR Z, GAUDRIC A (Paris)<br />
But : La rétinopathie diabétique (RD) floride est une forme rare mais grave de<br />
RD, à haut risque de cécité. Elle survient chez les diabétiques de type 1 jeunes<br />
et est caractérisée par une évolution rapide vers la néovascularisation et ses<br />
complications. Le but de cette étude est d’évaluer les résultats du traitement<br />
chirurgical obtenus sur une série consécutive de 26 patients atteints de RD floride.<br />
Matériel et Méthode : Trente-huit yeux de 26 patients diabétiques de type 1 (8<br />
hommes, 18 femmes, âge moyen 30 ans) atteints de RD floride. 5 patients étaient<br />
monophtalmes, 12 ont subi une chirurgie bilatérale. La durée moyenne du diabète<br />
était de 18 ans (11-25). Une néphropathie était présente dans 42 % des cas et une<br />
hypertension artérielle dans 35 %. L’indication opératoire était : décollement de<br />
rétine tractionnel avec prolifération fibrovasculaire (PFV) rétro-équatoriale (stade 1 :<br />
18 yeux), PFV s’étendant au-delà de l’équateur (stade 2 : 5 yeux), PFV antérieure ou<br />
rubéose (stade 3 : 11 yeux), glaucome néovasculaire (stade 4 : 4 yeux). Le suivi<br />
moyen était de 24 mois.<br />
Résultats : L’acuité visuelle médiane préopératoire était de 1/50 (PL à 4/10) et postopératoire<br />
de 1/20 (absence de PL à 6/10).13 des 17 patients monophtalmes ou<br />
ayant une atteinte bilatérale ont récupéré une acuité visuelle ambulatoire. Une réapplication<br />
rétinienne a été obtenue dans 26 yeux (68 %) après un nombre moyen de<br />
1.86 intervention par œil (1 à 5). Une acuité visuelle > ou = à 1/10 a été obtenue dans<br />
72 % des yeux stade 1 versus 15 % des yeux ayant un stade supérieur.<br />
Commentaire et Conclusions : Le pronostic chirurgical des rétinopathies diabétiques<br />
florides est conditionné par la précocité de l’indication opératoire au stade de<br />
PFV échappant au laser.<br />
53 03<br />
Résultats de la vitrectomie dans la rétinopathie diabétique compliquée, jamais<br />
traitée.<br />
Results of vitrectomy in complicated diabetic retinopathy, never treated.<br />
KAMMOUN M*, EL MATRI L, MGHAIETH F, LIMAIEM R, CHARFI O, BOUACHA M<br />
(Tunis, Tunisie)<br />
But : Rapporter les résultats de la vitrectomie chez des patients, présentant une rétinopathie<br />
diabétique proliférante compliquée d’hémorragie intravitréenne et/ou de<br />
décollement de rétine, jamais traités auparavant.<br />
Matériel et Méthode : Nous proposons une étude rétrospective portant sur 38 yeux<br />
de 38 patients diabétiques opérés dans notre service entre le 1 er janvier 2000 et le<br />
31 mars 2002. Tous nos patients ont consulté pour une baisse de l’acuité visuelle.<br />
L’interrogatoire a révélé qu’aucun traitement ophtalmologique n’a été instauré auparavant.<br />
Le traitement chirurgical a consisté en une vitrectomie.<br />
Résultats : La vitrectomie était associée à un pelage de membranes dans 28 cas<br />
(73,6 %), à l’endolaser dans 17 cas (44,7 %) et à un tamponnement interne dans<br />
27 cas (71 %). Ce dernier consistait à l’injection d’huile de silicone dans 14 cas de<br />
C3F8 dans 7 cas et de SF6 dans 6 cas. L’acuité visuelle était améliorée dans 15 cas<br />
(39,5 %), stabe dans 17 cas (44,5 %) et détériorée dans 6 cas (16 %). Le succès<br />
anatomique (rétine à plat avec ablation complète du voile fibrovasculaire) était notée<br />
dans 17 cas (44,5 %). L’hémorragie dans la cavité vitréenne post-opératoire des premiers<br />
jours était retrouvée dans 18 cas (47,3 %). Son incidence était, statistiquement<br />
significative, diminuée par la réalisation d’un pelage de membranes complet (p<br />
= 0,0016) et par le tamponnement interne par l’huile de silicone (p = 0,0003) et augmentée<br />
par la découverte peropératoire d’une rétine ischémique avec un vitré adhérant<br />
(p = 0,006).<br />
Commentaire et Conclusions : La vitrectomie associée à un pelage de membranes<br />
complet et à un tamponnement interne par l’huile de silicone constituent des<br />
facteurs de bon pronostic fonctionnel et anatomique dans la rétinopathie diabétique<br />
proliférante compliquée même jamais traitée. Par ailleurs, nos résultats<br />
confirment les données de la littérature sur les facteurs de risque de l’hémorragie<br />
postopératoire (absence de pelage de membranes ou pelage incomplet, absence<br />
de tamponnement interne par l’huile de silicone et présence de rétine ischémique<br />
en peropératoire).<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
SYMPOSIUM FRANCO-LIBANAIS<br />
53 04<br />
Le traitement chirurgical du décollement rétinien tractionnel secondaire à la<br />
rétinopathie diabétique : expérience libanaise.<br />
Surgical management of traction retinal detachment related to diabetic retinopathy:<br />
lebanese experience.<br />
CHERFAN G (Beyrouth, Liban)<br />
But : Pour présenter l’expérience libanaise dans le traitement chirurgical du décollement<br />
rétinien secondaire à la rétinopathie diabétique, et en discuter la technique,<br />
les résultats et les complications.<br />
Matériel et Méthode : 312 dossiers de diabétiques porteurs de décollement rétinien<br />
tractionnel, et opérés de vitrectomie avec endophotocoagulation rétinienne au<br />
laser, avec un recul supérieur à 6 mois, ont été revus.<br />
Résultats : L’acuité visuelle s’est améliorée chez 191 patients (61,22 %), s’est stabilisée<br />
chez 74 (23,72 %), et s’est détériorée chez 47 (15,06 %). Les complications<br />
rencontrées comprenaient une rubéose irienne (51 %), un décollement rétinien (7 %),<br />
une hémorragie vitréenne persistante (5 %), et une hémorragie vitréenne transitoire<br />
(42 %).<br />
Commentaire et Conclusions : Le décollement rétinien tractionnel représente une<br />
sérieuse complication de la rétinopathie diabétique, pouvant entraîner la cécité. La<br />
vitrectomie par la pars plana peut arrêter la progression des complications et altérer<br />
l’évolution de la maladie.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
TUMEURS<br />
53 05<br />
Epidémiologie des lésions tumorales oculaires et orbitaires : à propos de<br />
1 257 cas consécutifs.<br />
Ocular and orbital tumors: about 1 257 cases.<br />
LEVECQ L*, GUAGNINI AP, DE POTTER P (Bruxelles, Belgique)<br />
But : Analyser les caractéristiques épidémiologiques des lésions tumorales que présentent<br />
les patients adressés à un centre national d’oncologie oculaire.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective de 1 257 nouveaux patients chez qui une<br />
lésion tumorale oculaire ou orbitaire a été diagnostiquée entre le 1/11/1997 et le 1/<br />
11/2002.<br />
Résultats : 638 femmes et 614 hommes sont concernés. L’âge moyen est de<br />
52 ans (écart 0 à 94 ans). Les patients de plus de 60 ans représentent 46 % de la<br />
population étudiée. Les lésions se répartissent en lésions intraoculaires (69 %),<br />
lésions de la surface oculaire (18 %), lésions des annexes (7 %) et lésions orbitaires<br />
(6 %). L’uvée postérieure est la localisation la plus représentée (44 %). Le rétinoblastome<br />
chez les moins de 20 ans, le naevus conjonctival chez les sujets âgés de 20 à<br />
40 ans, le mélanome de l’uvée postérieure chez les sujets âgés de 40 à 60 ans et le<br />
naevus de l’uvée postérieure chez les plus de 60 ans, sont les lésions tumorales les<br />
plus souvent retrouvées.<br />
Commentaire et Conclusions : Ces données épidémiologiques concernent des<br />
patients présentant une lésion tumorale oculaire ou orbitaire dont le diagnostic, le<br />
traitement ou le suivi nécessite une prise en charge dans un centre spécialisé<br />
d’oncologie oculaire.<br />
53 06<br />
Lésions mélaniques des paupières et de la conjonctive. À propos de 20 cas.<br />
Pigmented lesions of lids and conjonctiva. A 20 case revue.<br />
TAZARTES M* (Paris)<br />
But : Nous rapportons notre expérience concernant 20 patients – 3 enfants et 17<br />
adultes – présentant des lésions mélaniques de la paupière et/ou de la conjonctive.<br />
Matériel et Méthode : L’âge moyen est de 45 ans (7 ans-65 ans). Parmi celles-ci<br />
trois étaient des mélanomes, un mélanome cornéo-conjonctival apparu de novo, un<br />
récidive de mélanome orbitaire plus de 20 ans après son exérèse et 2 mélanomes –<br />
conjonctival et palpébral – apparus au sein d’une mélanose acquise de Reese. Les<br />
autres 17 cas présentaient une lésion mélanique de la paupière ou de la conjonctive.<br />
Le traitement a été chirurgical dans la plupart des cas. Quand il existait un doute sur<br />
la bénignité de la lésion mélanique, celle-ci était retirée en bloc avec une zone de<br />
sécurité large de plusieurs millimètres pour respecter les règles carcinologiques liées<br />
à ce type de lésion. Autrement un traitement conservateur était proposé pour éviter<br />
de réaliser une chirurgie mutilante d’emblée.<br />
Résultats : L’accent est mis sur les traitements complémentaires comme la cryothérapie,<br />
en général associée dans le même temps devant une lésion bénigne ou<br />
maligne au niveau de la zone d’exérèse et sur tout le pourtour tissulaire sain au<br />
contact de la lésion pigmentée. Un traitement par collyre à la mitomycine est parfois<br />
associé pour les mélanomes de la conjonctive après la chirurgie. Certaines lésions<br />
mélaniques cutanées bénignes ont également été traitées par laser Erbium. L’évolution<br />
post-opératoire a été favorable dans la plupart des cas.<br />
Commentaire et Conclusions : La discussion porte sur la nécessité ou non de réaliser<br />
une chirurgie large ou non devant une lésion mélanique. En conclusion le traitement<br />
des lésions mélaniques des paupières et de la conjonctive est maintenant<br />
bien codifié en particulier pour les mélanomes qui restent cependant de pronostic<br />
sombre. Plusieurs cas sont présentés avec un recul maximum de 8 ans.<br />
53 07<br />
À propos d’un cas de sarcome secondaire à une radiothérapie d’un mélanome<br />
de la conjonctive.<br />
Radio-induced sarcoma after conjunctiva’s melanoma radiotherapy.<br />
RAPP P*, MOM T, KEMENY JL, CURE H, BACIN F (Clermont-Ferrand)<br />
But : Il s’agit d’une patiente de 64 ans qui, en 2001, est adressée en otorhinolaryngologie<br />
pour une induration douloureuse sous-orbitaire gauche. Comme antécédents,<br />
on retient essentiellement un œil gauche éviscéré dans l’enfance pour une<br />
plaie du globe oculaire et la découverte, en 1992, d’une tache pigmentée du cul de<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
TUMEURS - CORNÉE<br />
sac conjonctival supérieur dans la cavité d’éviscération : la biopsie et l’exérèse large<br />
retrouvent un mélanome de la conjonctive. Celles-ci sont suivies d’une radiothérapie<br />
externe d’une dose totale biologique de 70 Grays.<br />
Matériel et Méthode : En 2001, le scanner sans et avec injection montre une<br />
tumeur lysant l’os de la région sous orbitaire et para-nasale gauche. L’anatomopathologie<br />
de la pièce de résection évoque un sarcome. La comparaison anatomopathologique<br />
et immunohistochimique des lames du mélanome initial et celles du<br />
sarcome élimine un cas de métastase.<br />
Résultats : On évoque alors l’hypothèse de sarcome radio-induit. Le traitement a<br />
comporté plusieurs chirurgies avec radiothérapie et chimiothérapie et malgré un traitement<br />
agressif, le sarcome a continué sa progression.<br />
Commentaire et Conclusions : L’intérêt de cette observation est la rareté de<br />
l’association mélanome de la conjonctive et sarcome radio-induit, il ne faut pas<br />
oublier que la radiothérapie peut avoir des effets secondaires à long terme : en<br />
moyenne 10 ans. On trouve ici l’intérêt d’une réduction des doses et d’une diminution<br />
de la largeur des champs d’irradiation. Nous avons pu aussi, malheureusement,<br />
apprécier l’agressivité des sarcomes radio-induits.<br />
53 08<br />
Tumeurs de la conjonctive bulbaire de l’enfant : résultats de l’examen<br />
histopathologique. Étude rétrospective de 42 lésions.<br />
Tumors of bulbar conjonctiva in children: histopathology results. Retrospective study<br />
about 42 cases.<br />
BEBY F*, BURILLON C, DENIS P (Lyon)<br />
But : Étude rétrospective de 42 tumeurs de la conjonctive bulbaire opérées chez des<br />
enfants avec étude histologique. Le but de l’étude est de renseigner sur la nature<br />
histologique des tumeurs conjonctivales bulbaires de l’enfant.<br />
Matériel et Méthode : Entre janvier 1990 et décembre 2001, 40 enfants ont bénéficié<br />
de l’ablation d’une (ou plusieurs) lésion(s) de la conjonctive bulbaire. Les lésions<br />
de la conjonctive tarsale ainsi que les lésions du bord libre des paupières n’ont pas<br />
été prises en compte. Après exérèse, les tumeurs ont été fixées dans du formol 10 %<br />
et les coupes histologiques ont été étudiées après coloration hématoxyline-éosinesafran.<br />
Résultats : Au total 42 exérèses ont été pratiquées chez 40 enfants dont 18 garçons<br />
(45 %) et 22 filles (55 %). L’âge moyen des enfants était de 10 ans. Le siège de la<br />
tumeur était limbique dans 57 % des cas, caronculaire dans 7 % des cas et en<br />
dehors de ces deux localisations sur la conjonctive bulbaire dans 36 % des cas. La<br />
résection chirurgicale s’est avérée incomplète pour 19 % des actes chirurgicaux.<br />
L’étude histopathologique dénombre 35 naevi (83,3 %), 2 angiomes (4,7 %),<br />
2 dermolipomes (4,7 %), 1 kyste dermoïde (2,4 %), 1 papillomé (2,4 %) et un carcinome<br />
épidermoïde (2,4 %). Les caractéristiques cliniques et évolutives des tumeurs<br />
rencontrées ainsi que les raisons qui ont conduit à la chirurgie sont détaillées.<br />
Commentaire et Conclusions : La plupart des lésions pigmentées étaient des<br />
naevi de la conjonctive. La seule tumeur maligne observée fut un carcinome<br />
conjonctival venant compliquer un xéroderma pigmentosum. Cette étude confirme<br />
le caractère exceptionnellement malin des lésions de la conjonctive bulbaire de<br />
l’enfant.<br />
53 09<br />
Les lymphomes malins non hodgkiniens conjonctivo-orbitaires (étude<br />
rétrospective sur 22 cas).<br />
Orbitar non hodgkin’s lymphoma (retrospectiv study about 22 cases).<br />
BENABID L*, DESABLENS B, MALTHIEU D, TURUT P (Amiens)<br />
But : Le but de notre étude est d’analyser les cas de lymphomes malins non hodgkiniens<br />
à localisation conjonctivo-orbitaire dans le service d’ophtalmologie du CHU<br />
d’AMIENS au cours de ces 20 dernières années.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons répertorié, pour chacun des patients, le mode<br />
de survenue de cette pathologie, sa description clinique, radiologique, les résultats<br />
anatomo-pathologiques, son mode de diagnostic et le type de traitement réalisé. Les<br />
éléments cliniques et radiologiques de ces lésions sont ceux répertoriés dans la littérature<br />
depuis ces 20 dernières années. Les explorations morphologiques ne<br />
contribuent pas au diagnostic positif de lymphome mais permettent seulement de<br />
l’étayer. Seule la biopsie orbitaire pourra affirmer de manière formelle le diagnostic<br />
de lymphome malin non hodgkinien et éliminer son principal diagnostic différentiel :<br />
la pseudo-tumeur inflammatoire. Cependant, ce geste doit être réalisé de manière<br />
précise au bloc opératoire. La lésion prélevée doit être de taille suffisante pour permettre<br />
un examen anatomo-pathologique précis et complet.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S221
1S222<br />
Résultats : La majorité des lymphomes malins non hodgkiniens rencontrés dans<br />
l’orbite sont tous de phénotype B dans notre étude, de bas grade de malignité et de<br />
forme indolente. Il est impératif de faire pratiquer un bilan d’extension par des hématologistes.<br />
La conduite thérapeutique qu’ils adopteront alors dépendra des différents<br />
facteurs pronostiques et de ce bilan d’extension réalisé de manière systématique et<br />
rigoureuse.<br />
Commentaire et Conclusions : Un suivi régulier et prolongé, ophtalmologique et<br />
hématologique, devra être assuré chez ces patients sachant qu’une récidive à 5 ans<br />
du traitement est toujours possible soit sur un mode de faible grade d’agressivité<br />
soit sur un mode de haut grade d’agressivité.<br />
53 10<br />
Le kyste hydatique orbitaire : 22 cas.<br />
Orbital hydatic cyst: 22 cases.<br />
BENHADDOU M*, LAKHDAR A, BENHADDOU M, SAMI A, NAJA A, ACHOURI M,<br />
OUBOUKHLIK A, EL KAMAR A, ZAGHLOUL K, AMRAOUI A, EL AZHARI A<br />
(Casablanca, Maroc)<br />
But : Le kyste hydatique orbitaire (KHO) est une affection rare, elle représente 1 %<br />
de toutes les localisations hydatiques. Notre travail est une étude rétrospective de<br />
22 cas de KHO pris en charge au Service de Neurochirurgie du CHU Ibn Rochd<br />
durant une période de 17 ans, allant de 1985 à 2001.<br />
Matériel et Méthode : La moyenne d’âge des patients est de 23,3 ans, avec une<br />
prédominance masculine. L’origine rurale est retrouvée dans 77,27 % des cas.<br />
L’exophtalmie unilatérale est le maître symptôme, retrouvée chez tous nos malades.<br />
Une baisse de l’acuité visuelle est retrouvée dans 54,5 % des cas. L’atteinte de<br />
l’oculomotricité est notée dans 91 % des cas. La sérologie hydatique, réalisée chez<br />
15 patients, a été positive dans 4 cas. L’échographie oculaire, pratiquée dans 8 cas,<br />
a confirmé la nature liquidienne de la lésion. La TDM crânio-orbitaire a été réalisée<br />
chez tous nos patients, elle a objectivé un processus hypodense, bien limité, ne prenant<br />
pas le contraste. Le siège intra-conique est noté dans 50 % des cas. Le bilan<br />
d’extension a retrouvé une hydatidose pulmonaire dans un seul cas et hépatique<br />
dans un autre cas. Le volet fronto-orbitaire a été réalisé dans 19 cas et l’abord temporal<br />
dans 2 cas.<br />
Résultats : Les suites postopératoires ont été simples. À moyen et à long terme,<br />
nous avons noté 3 cas de récidive et un cas de mucocèle frontale.<br />
Commentaire et Conclusions : Le KHO est rare, il représente 3 à 20 % des exophtalmies<br />
unilatérales. Le tableau clinique est dominé par l’exophtalmie unilatérale<br />
d’allure tumorale. La TDM est l’examen clé, qui met en évidence le caractère kystique<br />
de la lésion, précise son siège et ses rapports permettant ainsi de guider la voie<br />
d’abord chirurgicale. Le traitement est en premier chirurgical. Le pronostic fonctionnel<br />
dépend de la précocité de prise en charge.<br />
53 11<br />
Résultats du traitement du mélanome de l’uvée par faisceau de protons avec un<br />
recul de 10 ans sur une série de 167 patients.<br />
Results of the treatment of uveal melanoma with a minimum follow up of ten years<br />
in a serie of 167 patients.<br />
HAMROUNI Z*, LEVY C, LUMBROSO L, D’HERMIES F, MEYER A, FRAU E,<br />
MAZAL A, DELACROIX S, NAURAYE C, DENDALE R, SCHLIENGER P,<br />
DESJARDINS L (Paris)<br />
But : Nous avons étudié les résultats à long terme du traitement par faisceau de<br />
protons du mélanome de l’uvée sur une série de patients ayant un recul minimum<br />
de 10 ans.<br />
Matériel et Méthode : Les patients ont tous eu un bilan initial comprenant acuité<br />
visuelle, fond d’œil, échographie et biométrie de l’œil, photographies du fond d’œil<br />
et angiographie ainsi qu’un bilan général comprenant une radiographie pulmonaire<br />
et une échographie hépatique. Une pose de clips a été réalisée avant la protonthérapie.<br />
Nous avons délivré une dose de 60 grays équivalent cobalt en 4 fractions sur<br />
4 jours au centre de protonthérapie d’Orsay. Nous avons enregistré les données<br />
concernant le bilan initial, l’évolution annuelle (survie, métastase, énucléation secondaire)<br />
ainsi qu’un bilan fonctionnel oculaire à 1,2,3,5 et 10 ans. Une analyse statistique<br />
a été réalisée.<br />
Résultats : Il y a 167 patients. Le suivi médian est de 116 mois. L’âge médian est<br />
de 59 ans. Il y a 13 tumeurs antérieures à l’équateur, 76 à cheval sur l’équateur et<br />
78 en arrière de l’équateur. Un décollement de rétine initial est noté dans 41 cas ; la<br />
papille est envahie dans 10 cas. Le diamètre tumoral médian est de 12 mm et<br />
l’épaisseur tumorale médiane de 5,8 mm. L’acuité visuelle initiale médiane est de 4/<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
TUMEURS - CORNÉE<br />
10. La survie globale à 10 ans est de 62,93 %. Les facteurs influençant la survie de<br />
manière statistiquement significative en analyse multivariée sont le diamètre tumoral<br />
(p 0,0004) et l’âge > 60 ans (p 0,0001). Le taux de métastases à 10 ans est de 31 %.<br />
Les facteurs de risque significatifs pour l’apparition de métastase sont le siège de la<br />
tumeur, sa taille et l’existence d’un décollement de rétine initial ; le taux d’énucléation<br />
secondaire à 10 ans est de 13,23 % et le taux de récidive locale à 6 %. L’acuité<br />
visuelle moyenne à 10 ans est de 1,9/10.<br />
Commentaire et Conclusions : Le taux de survie et le pourcentage de métastases<br />
sont comparables aux résultats de la littérature. Le taux de conservation oculaire est<br />
satisfaisant. Les facteurs de risque d’apparition de complications oculaires sont discutés.<br />
La taille de la tumeur est un facteur de risque majeur pour la survenue de<br />
métastases et de complications oculaires.<br />
53 12<br />
Protonthérapie des mélanomes choroïdiens résultats après 10 ans de<br />
fonctionnement.<br />
Protontherapy of uveals melanomas results after 10 years of operation.<br />
CAUJOLLE JP*, ZUR C, SANIIAN F, CHAUVEL P, GASTAUD P (Nice)<br />
But : Nous étudions les résultats de la protonthérapie sur les patients porteurs de<br />
mélanomes choroïdiens au CHU de Nice depuis 10 ans. Nous présentons la survie<br />
actuelle, les résultats anatomiques et fonctionnels.<br />
Matériel et Méthode : L’étude porte sur 438 patients présentant des mélanomes<br />
choroïdiens irradiés par un faisceau de protons de 60 CGE. Les mélanomes avaient<br />
une épaisseur moyenne de 5,76 mm ; un diamètre moyen de 12,36 mm. Ils étaient<br />
ciliaires dans 13,6 % des cas atteignaient le pôle postérieur dans 50 % des cas.<br />
Résultats : Le recul moyen est de 6,7 ans. On dénombre 48 décès la plupart présentaient<br />
des métastases en majorité hépatiques. Une reprise évolutive est apparue<br />
dans 3,2 % des cas traités par une nouvelle irradiation ou une énucléation. L’acuité<br />
visuelle est stable dans 38 % des cas. 27 énucléations ont été pratiquées toutes<br />
causes confondues.<br />
Commentaire et Conclusions : La protonthérapie des mélanomes choroïdiens<br />
même en cas de tumeurs volumineuses permet dans une majorité des cas de<br />
conserver l’œil voire une acuité visuelle utile sans aggraver les chances de survie du<br />
patient.<br />
53 13<br />
Le pronostic de la métastase intravitréenne et intracamérulaire de<br />
rétinoblastome.<br />
Prognosis of intra-vitreal and intra-camerular metastasis of retinoblastoma.<br />
CHAMS H*, VOSSOUGH P, KARKHANEH R, ASSADI-AMOLI P (Téhéran, Iran)<br />
But : Des métastases intravitréennes et intracamérulaires ne sont pas rares. Quelle<br />
est l’importance et quelle conduite faut il tenir devant une telle situation ?<br />
Matériel et Méthode : De 1986 à 1995, pendant 10 ans, tous les malades avec le<br />
rétinoblastome unilatéral énucléés à l’hôpital Farabi, dans notre service et ayant subi<br />
des épreuves anatomopathologiques ont été investigués. Tous les malades avec une<br />
exophthalmie apparente et des métastases extraoculaires (sauf à la moëlle osseuse)<br />
sont exclus.<br />
Résultats : 144 malades sont inclus dans notre étude. 15 malades (10,42 %) présentaient<br />
des métastases intraoculaires (10 cas intravitréennes, 5 cas intracamérulaires)<br />
(group I). Nous comparons ces malades avec 129 malades, sans métastase<br />
intraoculaire (group II). Dans le group I : l’âge moyen des malades était de<br />
45,67±27,1 mois (dans le group II = 35,09±22,5 mois). La durée de symptomatologie,<br />
avant d’être opéré était de 5,13±4,64 mois (dans group II = 3,79±4,8 mois). Dans<br />
93,3 % des cas toute la surface de la rétine était prise par la tumeur (dans le group II<br />
= 95,35 %). Dans 20 % des cas le nerf optique était pris microscopiquement par la<br />
tumeur (dans group II = 22,48 %). Dans 13,33 % des cas la moelle osseuse était<br />
atteinte par le néoplasme (dans group II = 10,07 %). Tous les malades étaient énucléés.<br />
44 malades (30,44 %) étaient sousmis à la chimiothérapie, soit à cause de<br />
l’atteinte microscopique du nerf optique, ou de la moelle osseuse et dans deux cas<br />
pour des métastases intracamérulaires isolées. Parmi les 15 malades avec des<br />
métastases intraoculaires 7 malades ont reçu la chimiothérapie (3 malades pour<br />
l’atteinte du nerf optique, deux pour l’atteinte de la moelle osseuse et deux pour des<br />
métastases intracamérulaires isolées). 8 malades avec des métastases intraoculaires<br />
(six intravitréennes et 2 intracamérulaires) étaient simplement énuclées sans traitement<br />
complémentaire.<br />
Commentaire et Conclusions : Tous les 15 malades avec des métastases intraoculaires,<br />
avec ou sans chimiothérapie ont survécu et l’âge, la durée de la maladie,<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
l’extension intra ou extraoculaire de la tumeur n’étaient statistiquement pas influençables<br />
sur l’apparition des métastases intravitréennes ou intracamérulaires.<br />
53 14<br />
Métastases oculaires : à propos de 3 cas atypiques avec erreur diagnostique.<br />
Choroidal metastasis: About 3 unusual cases.<br />
MEUNIER I*, FAVARD C, MERDASSI A, IOSSIFOV D, CAPUTO G, DE LAAGE DE<br />
MEUX P (Paris)<br />
But : Trois cas de présentations atypiques de métastases choroïdiennes ayant<br />
conduit à une erreur de diagnostic de l’atteinte oculaire et à un retard de recherche<br />
de la néoplasie primitive.<br />
Matériel et Méthode : Ces trois cas ont été documentés par une angiographie à la<br />
fluorescéine initiale trompeuse, avec une évolution des données angiographiques<br />
permettant de porter le diagnostic de métastases choroïdiennes.<br />
Résultats : Dans un premier cas, le diagnostic de Horton a été évoqué devant une<br />
ischémie choroïdienne. Dans un deuxième cas, une toxoplasmose oculaire a été<br />
retenue de par l’existence d’un décollement séreux maculaire et d’une lésion blanchâtre.<br />
Dans le troisième cas, le patient a été adressé pour un décollement séreux<br />
inflammatoire.<br />
Commentaire et Conclusions : Les métastases oculaires peuvent avoir un mode<br />
de présentation inhabituelle où les phénomènes exsudatifs ou ischémiques sont prédominants.<br />
CORNÉE<br />
53 15<br />
Mise au point sur la stratégie thérapeutique d’une kératite amibienne : à propos<br />
d’un cas.<br />
Approaches to medical management of acanthamoeba keratitis: a case report.<br />
LEWIN JM*, FLORENT X (Bordeaux)<br />
But : Nous rapportons l’observation d’une patiente de 30 ans, adressée pour kératite<br />
pseudo-dendritique sous lentille souple, sans amélioration sous antiviraux et<br />
s’aggravant depuis 3 semaines.<br />
Matériel et Méthode : Patiente adressée pour kératite sous lentille évoluant vers<br />
l’abcèdation sous antiviraux et antibiotiques. Après prélèvement, en raison de l’histoire<br />
clinique (abcès sous lentille), de l’aspect clinique (abcès profond avec anneau<br />
de Wessley), il a été instauré un traitement anti-amibien et anti-fongique.<br />
Résultats : Les prélèvements réalisés ont révélé la présence de kystes amibiens<br />
sans association fongique. L’évolution s’est montrée satisfaisante sous l’association<br />
d’une bithérapie antiamibienne (désomédine, brolène) et du voriconazole, nouvel<br />
antifongique.<br />
Commentaire et Conclusions : En raison de cas décrits dans la littérature sur<br />
l’association kératite amibienne et fungique et sur l’amélioration de certains abcès<br />
amibiens grâce au traitement antiseptique avec un antifongique, il se peut que le<br />
voriconazole ait été efficace et soit en partie responsable de l’évolution favorable<br />
chez cette patiente. Un abcès sous lentille est, en l’absence de preuve contraire,<br />
amibien et doit être traité en conséquence. La bithérapie antiseptique et antifongique<br />
semble être intéressante dans le traitement de cette pathologie.<br />
53 16<br />
Ulcère de Mooren sur keratoplastie transfixiante : à propos de 2 cas.<br />
Mooren ulcer on penetrating keratoplasty: about 2 cases.<br />
MERDASSI A*, LOUGHZAIL K, ASSOULINE M, DE LAAGE DE MEUX P (Paris)<br />
But : L’ulcère de Mooren est une ulcération inflammatoire d’origine auto-immune de<br />
la cornée périphérique. L’UM est primitif ou secondaire (traumatisme, chirurgie,<br />
infection). Nous rapportons l’iconographie évolutive de deux patients ayant présenté<br />
un ulcère de Mooren dans une l’évolution post-opératoire d’une greffe de cornée.<br />
Matériel et Méthode : Cas clinique n° 1 : Greffe de cornée réalisée chez un sujet<br />
masculin de 19 ans, malgache, à la suite d’une perforation d’abcès bactérien.<br />
L’ulcère apparru à 3 mois est devenu rapidement circonférentiel (300°) et préperforant<br />
malgré l’institution d’un traitement anti-inflammatoire local adapté. Un polyparasitisme<br />
a été mis en évidence et traité. Une résection/récession conjonctivale<br />
associée à l’application de colle Histo-Acryl et d’une lentille hydrophile a permis<br />
d’obtenir un comblement de l’ulcère avec vascularisation et opacification du greffon.<br />
Cas clinique n° 2 : Greffe de cornée pratiquée pour une dystrophie endothéliale de<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
TUMEURS - CORNÉE<br />
Fuchs. L’ulcère est apparu un mois et a régressé de façon complète sur 3 mois sous<br />
traitement topique stéroïde intensif associé à un traitement systémique de la rosacée,<br />
un traitement lubrifiant de l’effet dellen et à un traitement symptomatique d’un<br />
floppy eyelid syndrome sévère.<br />
Commentaire et Conclusions : Nous discuterons les principaux diagnostics différentiels<br />
ainsi que la conduite à tenir. L’étiopathogénie de l’UM sur greffe de cornée<br />
demeure peu claire. Néanmoins de multiples facteurs peuvent s’intriquer pour aggraver<br />
un conflit inflammatoire local. L’ethnie et la polyparasitose ont été incriminées<br />
dans le 1 er cas. Plusieurs hypothèses ont été évoquées dans le 2 e cas (rosacée,<br />
floppy eyelid syndrome, effet dellen, compression par le surjet). L’UM est donc un<br />
diagnostic d’élimination après un bilan étiologique exhaustif. Le traitement par résection<br />
conjonctivale, débridement pithélial et application de colle cyanoacrylate a permis<br />
une cicatrisation.<br />
53 17<br />
Insuffisance limbique bilatérale associées à un syndrome K.I.D. À propos d’un<br />
cas.<br />
Bilateral limbal cell deficiency associated with K.I.D. syndrome.<br />
GICQUEL JJ*, CURUTCHET L, BALAYRE S, MERCIE M, DIGHIERO P (Poitiers)<br />
But : Faire une mise au point sur l’insuffisance limbique dans le syndrome KID (Keratitis-Ichthiosis-Deafness).<br />
Matériel et Méthode : Nous rapportons le cas d’une femme de 30 ans porteuse<br />
d’un syndrome KID consultant pour avis thérapeutique du fait d’une importante néovascularisation<br />
cornéenne.<br />
Résultats : Elle a déjà subi deux kératoplasties transfixiantes infructueuses de l’œil<br />
gauche. L’acuité visuelle est limitée à une simple perception lumineuse du fait de<br />
l’opacification et de la néovascularisation du greffon.<br />
Commentaire et Conclusions : À la lumière de ce cas d’insuffisance limbique,<br />
nous discuterons des manifestations ophtalmologiques du syndrome K.I.D. ; de<br />
ses caractéristiques cliniques, de sa physiopathologie et de son mode de transmission.<br />
53 18<br />
Efficacité de la ciclosporine en collyre dans le traitement de la rosacée de<br />
l’enfant avec inflammation cornéenne sévère.<br />
Efficacy of cyclosporine eyedrops for the treatment of childhood ocular rosacea<br />
associated with severe corneal inflammation.<br />
DOAN S*, ELBIM C, REN L, BELAYACHI N, HOANG-XUAN T (Paris)<br />
But : Étudier l’efficacité de la ciclosporine A en collyre dans le traitement de la rosacée<br />
de l’enfant avec inflammation cornéenne sévère corticodépendante.<br />
Matériel et Méthode : Étude prospective non comparative de 11 enfants d’âge<br />
moyen 9 ± 5 ans. Tous les patients avaient été traités sans succès par antibiotiques<br />
systémiques et corticoïdes locaux. La ciclosporine a été administrée en collyre à 2 %<br />
4 fois par jour, associée à de la dexaméthasone collyre la première semaine.<br />
Résultats : L’inflammation a été contrôlée dans tous les cas en moins de<br />
2 semaines. Il n’y a pas eu de récidive inflammatoire sous ciclosporine en monothérapie<br />
durant le suivi qui était en moyenne de 11 ± 6 mois (de 5 à 27 mois). Le traitement<br />
a été bien toléré dans 10 cas. Une allergie cutanée généralisée a imposé l’arrêt<br />
du traitement au cinquième mois dans un cas.<br />
Commentaire et Conclusions : La ciclosporine topique est efficace dans le traitement<br />
de la rosacée de l’enfant avec inflammation cornéenne sévère. Elle constitue<br />
une alternative intéressante à la corticothérapie.<br />
53 19<br />
Analyse de la réparation cornéenne après greffe amniotique en multicouches.<br />
Corneal wound healing following multilayer amniotic membrane transplantation.<br />
GUEUDRY J*, MURAINE M, SIHAMED K, TOUBEAU D, GROSS H, BRASSEUR G<br />
(Rouen)<br />
But : Rapporter le succès des greffes amniotiques en multicouches dans la prise en<br />
charge des ulcères trophiques perforants ou préperforants et analyser la récupération<br />
de l’épaisseur stromale.<br />
Matériel et Méthode : Notre étude porte sur 30 patients ayant bénéficié d’une<br />
greffe amniotique pour une préperforation (19 cas) ou une perforation cornéenne<br />
avérée (11 cas). Une greffe amniotique en multicouches a été réalisée dans 16 cas<br />
et en simple couche dans 14 cas. L’âge moyen des patients est de 73 ans, le recul<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S223
1S224<br />
est de 22 mois. Nous avons analysé la récupération de l’épaisseur cornéenne par<br />
pachymétrie, UBM, Orbscan et OCT3.<br />
Résultats : L’intervention a permis la cicatrisation cornéenne dans 29 cas/30. Les<br />
différentes techniques d’imagerie sont comparées et mettent en évidence la récupération<br />
de l’épaisseur cornéenne après greffe amniotique en multicouches. L’intervention<br />
a permis de récupérer une épaisseur moyenne de 397,4 microns (197 à<br />
570 microns) à l’endroit le plus mince.<br />
Commentaire et Conclusions : La greffe de membrane amniotique en multicouches<br />
permet de restaurer une épaisseur cornéenne importante lors des perforations<br />
trophiques de la cornée. Elle permet d’éviter la réalisation d’une greffe de cornée à<br />
chaud dont le pronostic est plus que réservé.<br />
53 20<br />
La greffe de membrane amniotique en ophtalmologie. Expérience au CHU de<br />
Toulouse.<br />
Amniotic membrane transplantation in ophthalmology. Experience in Toulouse.<br />
MOALIC S*, ARNE JL, CEDRIC G (Toulouse)<br />
But : Déterminer l’efficacité de la greffe de membrane amniotique (MAH) dans les<br />
indications les plus fréquentes.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons fait une étude rétrospective sans témoin portant<br />
sur 35 patients ayant bénéficié d’une greffe de MAH entre mars 2000 et<br />
février 2002. Cette série comprenait 65,7 % d’hommes pour 34,3 % de femmes<br />
avec une moyenne d’âge de 57,7 ans (2-91). Le suivi moyen était de 8.9 mois<br />
avec des extrêmes allant de 4 mois (8 cas) à 12 mois et plus (21 cas). Ces<br />
patients ont été répartis en 7 groupes : ulcères chroniques, perforations cornéennes,<br />
brûlures par bases, œdèmes du pseudophaque, pathologies générales,<br />
ptérygions et complications des kératoplasties transfixiantes. Les critères<br />
d’évaluations comprenaient l’acuité visuelle et l’aspect anatomique pré et postopératoires,<br />
l’évolution des signes fonctionnels, en particulier des douleurs, le<br />
délai de cicatrisation après la greffe ainsi que la réalisation d’une kératoplastie<br />
transfixiante ou d’une autre chirurgie ophtalmologique dans les mois suivant la<br />
greffe de MAH.<br />
Résultats : Toutes pathologies confondues le délai de cicatrisation était de<br />
1.5 mois. Quatre échecs ont été recensés. Si la greffe de MAH n’influe pas ou<br />
peu sur l’acuité visuelle et l’aspect anatomique, en revanche elle a une action<br />
pratiquement constante sur les douleurs liées aux pathologies de la surface oculaire.<br />
Les meilleures indications restent les ulcères chroniques et les perforations<br />
de petites tailles. Cependant on peut obtenir des résultats étonnants sur<br />
d’autres pathologies comme les brûlures oculaires et leurs séquelles ou les<br />
œdèmes du pseudophaque. Une étude de la littérature sur le sujet confirme nos<br />
résultats.<br />
Commentaire et Conclusions : La simplicité des techniques chirurgicales, le faible<br />
coût et la facilité d’obtention des MAH font de la greffe amniotique un traitement à<br />
tenter dans de nombreuses pathologies de la surface oculaire.<br />
53 21<br />
Greffe de membrane amniotique. 186 cas.<br />
Amniotique membrane. 186 cases.<br />
LEGEAIS JM* (Paris)<br />
But : Étude prospective de 186 cas consécutifs de membranes amniotiques.<br />
Matériel et Méthode : 186 yeux ont été traités de novembre 1999 à novembre 2002<br />
par le même chirurgien. 66 ulcères cornéens, 47 œdèmes du pseudophake et de<br />
l’aphake, 42 brulures par caustique ou par acide évoluant depuis plus de 1 mois,<br />
17 ptérygions récidivants, 14 divers.<br />
Résultats : La cicatrisation définitive a été obtenue dans le groupe ulcère dans<br />
49 cas (71 %), un effet antalgique dans le groupe œdème du pseudophake a été<br />
observé définitivement dans 31 cas (75,2 %) ; dans le groupe brûlure seule les<br />
brulures grades 1 et 2 ont été améliorées 19/32 (59 %) mais aucun dans les<br />
grades 3. Dans le groupe ptérygion, absence de récidive dans 9/17 cas (42 %) ;<br />
dans le groupe divers aucune amélioration n’a été observée dont trois complications<br />
(perforations).<br />
Commentaire et Conclusions : Les meilleures indications de la membrane amniotique<br />
sont les ulcères chroniques cornéens, l’œdème du pseudophake et de l’aphake<br />
et le ptérygion récidivant. L’efficacité sur les brûlures n’est pratiquement jamais<br />
observée sur une brûlure grade 3.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
TUMEURS - CORNÉE<br />
53 22<br />
Kétatoplastie transfixiante après conservation du greffon en organo-culture à<br />
+31°C : résultats à 4 ans.<br />
Penetrating keratoplasty using organ-cultured donor tissue: 4 year results.<br />
BORDERIE V*, TOUZEAU O, BOURCIER T, ALLOUCH C, SCHEER S, LAROCHE L<br />
(Paris)<br />
But : Évaluer les résultats cliniques des greffes de cornées réalisées à partir d’un<br />
greffon conservé à +31°C.<br />
Matériel et Méthode : Nous avons étudié de manière prospective<br />
769 kératoplasties transfixiantes consécutives réalisées entre décembre 1992 et<br />
décembre 1999 à partir de greffons conservés à moyen terme (2 à 5 semaines) en<br />
organo-culture à +31 °C. Le suivi moyen est de 45 mois. La greffe était à haut risque<br />
de rejet dans 26 % des cas et 21 % des yeux avaient une hypertonie préopératoire.<br />
Le greffon était ABO-compatible dans 68 % des cas, Rh-compatible dans 91 % des<br />
cas et HY-compatible dans 74 % des cas.<br />
Résultats : Au terme du suivi, le taux de succès des greffes est de 79 %. Le rejet<br />
est à l’origine de l’échec de la greffe dans 15 % des cas. Le taux de succès est de<br />
99 % pour les kératocônes, 96 % pour les dystrophies de Fuchs, 71 % pour les<br />
séquelles de kératite infectieuse, 66 % pour les kératopathies bulleuses de l’aphake<br />
et du pseudophake et 47 % pour les échecs de greffe. Il est de 60 % pour les<br />
patients à haut risque de rejet et 81 % pour les autres patients. Ce taux de succès<br />
est de 67 % en cas d’hypertonie oculaire préopératoire et de 78 % en l’absence<br />
d’hypertonie oculaire.<br />
Commentaire et Conclusions : L’indication opératoire et la néovascularisation de<br />
la cornée réceptrice sont les deux facteurs pronostiques les plus importants de la<br />
survie du greffon après greffe de cornée. La conservation en organo-culture associée<br />
au contrôle de qualité de l’endothélium du greffon fait disparaître l’influence des facteurs<br />
liés au greffon sur l’évolution de la greffe.<br />
53 23<br />
Est-il encore légitime de faire les comptages endothéliaux à la main dans les<br />
banques de cornées françaises ?<br />
Is manual counting of endothelial cell density in cornea bank still legitimate? The<br />
french experience.<br />
GAIN P*, THURET G (Saint-Étienne), DELBOSC B (Besançon), BORDERIE V (Paris),<br />
ACQUART S, LE PETIT JC, MAUGERY J (Saint-Étienne)<br />
But : L’étude des registres 1999 à 2001 des banques de cornées françaises montre<br />
une étonnante variabilité inter banque à la fois des densités cellulaires endothéliales<br />
(DCE) à cession (de près de 30 %) et des taux d’élimination des cornées malgré une<br />
similitude relative dans les paramètres des donneurs et de la conservation. Le but<br />
de notre travail était d’étudier les facteurs susceptibles d’influencer cette variabilité<br />
dans la mesure de la DCE, paramètre principal de la délivrance des greffons.<br />
Matériel et Méthode : Étude 1 : enquête observationnelle auprès des 22 banques<br />
de cornées françaises. Un questionnaire explorait : caractéristiques techniques des<br />
microscopes et de l’étalonnage, expérience et nombre de techniciens, méthode de<br />
comptage (zone d’observation, mode de détermination de la DCE, nombre de cellules<br />
prises en compte). Étude 2 : quatre lames étalon comportant une mosaïque<br />
humaine fixée et dont la DCE était connue à la cellule près ont été expédiées aux<br />
22 banques françaises et comptées par chaque technicien.<br />
Résultats : Étude 1 : soixante deux techniciens, d’expérience très variable, participaient<br />
au comptage. Parmi les 7 banques qui n’avaient pas calibré leur microscope,<br />
5 avaient les DCE les plus élevées. Parmi les 15 autres, six appliquaient un facteur<br />
de calibration et obtenaient des DCE les plus basses. En général, moins de<br />
100 cellules dans 1 à 5 zones distinctes de la cornée étaient prises en compte.<br />
Étude 2 : il existait une variabilité majeure à la fois entre techniciens d’une même<br />
banque et entre les banques, avec des sur ou des sous estimations graves allant<br />
souvent jusqu’à 20-25 % par rapport à la DCE réelle. Certaines banques sous estimaient<br />
constamment les DCE, d’autres les surestimaient.<br />
Commentaire et Conclusions : Un défaut de calibration des microscopes apparaît<br />
comme le principal facteur de la variabilité des comptages. La stratégie de comptage<br />
elle même, la prise en compte d’un nombre insuffisant de cellules, le facteur technicien<br />
peuvent également expliquer cette variabilité. La mesure manuelle de la DCE,<br />
principal paramètre du contrôle de qualité et de la distribution ou non des cornées,<br />
doit être profondément remise en cause au profit d’analyseurs automatiques qui<br />
seuls garantiront des résultats reproductibles et standardisés d’une banque à l’autre.<br />
109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie J. Fr. Ophtalmol.
53 24<br />
Bilan de la liste nationale d’attente de greffe de cornée française créée en 1999 :<br />
taux d’inscription, flux, indications et caractéristiques des malades.<br />
The french national waiting list for keratoplasty created in 1999: rates of<br />
registration, indications, characteristics and flow of patients registered.<br />
TUPPIN P*, POINARD C, LOTY B, DELBOSC B (Paris)<br />
But : Évaluer l’exhaustivité des déclarations de greffes dans la liste d’attente, et<br />
comparer les taux d’inscription, de greffe et de prélèvement selon les régions ainsi<br />
que les flux inter-régionaux de malades inscrits et leurs caractéristiques cliniques.<br />
Matériel et Méthode : En France, chaque malade en attente de greffe de cornée<br />
doit être inscrit sur la liste nationale avec ses caractéristiques démographiques et<br />
cliniques. Ceux inscrits en 2000 et 2001 ont été inclus. Les résultats obtenus en<br />
terme d’activité ont été comparés à ceux obtenus par un questionnaire annuel diffusé<br />
auprès des équipes.<br />
Résultats : En 2000 et en 2001, 6 093 et 5 505 malades ont été inscrits. Cependant,<br />
3 984 et 3 457 greffes ont été déclarées pendant ces mêmes années alors que<br />
l’enquête par questionnaire rapportait 4 514 greffes en 2000 et 4 388 en 2001. Le<br />
taux national d’inscription est de 96 par million d’habitants (pmh). Il varie de 53 pmh<br />
pour les malades domiciliés en Picardie à 143 pmh pour ceux domiciliés aux Antilles.<br />
Il existe une corrélation significative entre le taux de greffe et celui de prélèvement<br />
entre les régions (r = 0,75, p = 0,001), ce qui n’est pas le cas pour les taux d’inscription<br />
et de prélèvement et les taux d’inscription et de greffe (r = 0,27). Le taux national<br />
d’inscription est de 27 pmh pour les décompensations endothéliales du pseudophaque<br />
(12 pmh dans le Nord-Pas-de-Calais à 64 pmh aux Antilles), et de 24 pmh pour<br />
les kératocônes (11 pmh en Picardie à 36 pmh à la Réunion et 37 pmh en Rhône-<br />
Alpes). Il existe d’important déplacements de malades entre les régions. Parmi les<br />
11 598 malades inscrits, les principales indications sont les décompensations endothéliales<br />
du pseudophaque (27,7 %), le kératocône (25,3 %), et la dystrophie de<br />
Fuchs (9,1 %). Parmi eux, 14,1 % avaient déjà eu une kératoplastie pour le même<br />
œil (7,8 % pour les kératocônes et 14,3 % pour les décompensations endothéliales<br />
sur pseudophaque).<br />
Commentaire et Conclusions : La mise en place d’une gestion des inscriptions<br />
directement par les ophtalmologistes doit permettre d’améliorer la qualité des sorties<br />
de liste et de poursuivre la connaissance épidémiologique de la greffe de cornée en<br />
France.<br />
53 25<br />
Disjonction traumatique des cicatrices de greffe de cornée.<br />
Traumatic wound dehiscence after keratoplasty.<br />
BONNE M*, DEDES V, MALBREL F, JOURDEL D, CAILLIAU D, SALLE M,<br />
LABALETTE P, ROULAND JF (Lille)<br />
But : Le but de cette étude est de décrire les caractéristiques, les causes, la prise<br />
en charge et l’évolution des disjonctions traumatiques des greffons cornéens afin de<br />
développer une prévention efficace de ces accidents.<br />
Matériel et Méthode : Entre 1997 et 2002, 14 patients ont été pris en charge au<br />
CHU de LILLE pour disjonction traumatique de leur greffon cornéen. Les patients ont<br />
tous bénéficié d’une chirurgie oculaire en urgence éventuellement complétée par une<br />
seconde ou une troisième intervention. Le suivi moyen a été de 30 mois (6 mois à<br />
5 ans).<br />
Résultats : L’âge moyen des patients était de 39 ± 20 ans, le délais moyen entre la<br />
greffe et le traumatisme était de 2,8 ans (1 mois à 15 ans), 50 % des patients avait<br />
été greffés pour un kératocône. Au jour du traumatisme 50 % des patients étaient<br />
porteurs de leur surjet. En plus de l’ouverture de leur cicatrice de greffe de cornée,<br />
11 patients présentaient une expulsion du cristallin et 7 une hémorragie intravitréenne<br />
avec dans 2 cas un décollement de rétine associé. Au terme de l’évolution<br />
11 greffons sont restés transparents. Sur les 14 patients, 7 présentaient une acuité<br />
visuelle supérieure à 1/10 e au terme du suivi.<br />
Commentaire et Conclusions : Les traumatismes oculaires sur greffes de cornées<br />
imposent une prévention à 3 niveaux : la sélection des patients, l’information du<br />
patient, la protection oculaire dans les suites de la greffe et la prise en charge<br />
urgente devant tous traumatisme oculaire chez un patient porteur d’une greffe de<br />
cornée.<br />
<strong>COMMUNICATIONS</strong> <strong>ORALES</strong><br />
TUMEURS - CORNÉE<br />
PUBLICATION DES <strong>COMMUNICATIONS</strong><br />
Nous vous remercions de remettre avant la fin du Congrès<br />
le texte intégral des communications destiné à la publication<br />
dans le Journal Français d’Ophtalmologie (en double<br />
exemplaire) au Secrétariat de Rédaction de la SFO.<br />
Vol. 26, Hors Série 1, 2003 109 e Congrès de la <strong>Société</strong> <strong>Française</strong> d’Ophtalmologie<br />
1S225