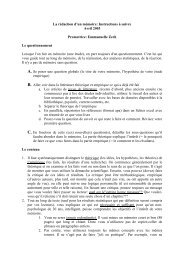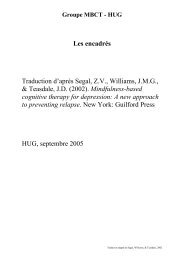La verbalisation des expériences émotionnelles: Effets sur la ... - Dial
La verbalisation des expériences émotionnelles: Effets sur la ... - Dial
La verbalisation des expériences émotionnelles: Effets sur la ... - Dial
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3que les variables examinées jusqu’à présent concernaient uniquement <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de santéphysique (visites chez le médecin, fonctionnement immunitaire), de bien-être (humeurs) et defonctionnement général (e.g., résultats sco<strong>la</strong>ires). Ainsi, bien que le sens commun suggéraitque parler ou écrire au sujet <strong>des</strong> émotions sou<strong>la</strong>ge le poids ou l’impact émotionnel d’unévénement, cette hypothèse n’avait pas encore été examinée. En d’autres termes, les effets del’expression émotionnelle <strong>sur</strong> <strong>la</strong> récupération émotionnelle d’expériences n'avaient pas ététestés. <strong>La</strong> récupération émotionnelle est l'évolution temporelle de l'impact émotionnel suscitépar l'événement lors de son rappel (Rimé, Finkenauer, Luminet, Zech, & Philippot, 1998). Parexemple, on peut me<strong>sur</strong>er <strong>la</strong> récupération émotionnelle d'un événement en évaluantl'évolution de l'intensité du bouleversement, <strong>des</strong> émotions ou <strong>des</strong> sensations physiquesressenties lors du rappel de l'événement.Les effets du partage social <strong>des</strong> émotions <strong>sur</strong> <strong>la</strong> récupération émotionnelleAu cours du temps, l’intensité émotionnelle du souvenir d’un événement diminue. Lerôle médiateur du partage social <strong>des</strong> émotions ou de <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> <strong>des</strong> émotions signifie quece processus devrait permettre d’accélérer <strong>la</strong> pente de l'évolution naturelle. En d’autrestermes, les personnes qui verbalisent leurs émotions devraient récupérer émotionnellementplus rapidement que celles qui ne verbalisent pas leurs émotions. Nous avons entrepris detester cette hypothèse dans quatre étu<strong>des</strong> expérimentales randomisées. Chacune de ces étu<strong>des</strong>a impliqué le rappel d’un épisode émotionnel négatif spécifique que les participants avaientvécu. Dans certaines conditions, on demandait aux participants de verbaliser les émotionsressenties à propos de cet événement. Dans les conditions contrôles, on demandait auxparticipants de verbaliser d’autres sujets. On évaluait l’impact émotionnel de l’événementcible rappelé à divers moments dans le temps de manière à pouvoir estimer l’évolution de <strong>la</strong>récupération émotionnelle à propos de cet événement. Les résultats de ces étu<strong>des</strong> furent trèsconsistants dans les quatre étu<strong>des</strong> rapportées (Zech, 2000; Zech & Rimé, 2001).Ils ont révélé que l’intensité émotionnelle de l’événement diminuait significativement aprèsl’entretien. Cependant, l’impact émotionnel ne diminuait pas plus dans les conditionsexpérimentales que dans les conditions contrôles. Il semble donc que <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> <strong>des</strong>émotions ne permette pas de récupérer d’un événement émotionnel. Les résultats étaientsimi<strong>la</strong>ires lorsque l’on prenait en compte divers indices d’impact émotionnel, que ce soitl’intensité <strong>des</strong> émotions ressenties, <strong>des</strong> sensations physiques, <strong>des</strong> pensées intrusives ou lesentiment subjectif de récupération émotionnelle. Contrairement au sens commun, cecisignifie donc que nous n’avons pas pu démontrer que <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> <strong>des</strong> émotions induit uneffet bénéfique de récupération émotionnelle.Dans ces étu<strong>des</strong>, les bénéfices perçus provoqués par <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> furent égalementinvestigués. On demandait aux participants d'évaluer dans quelle me<strong>sur</strong>e ils trouvaient que <strong>la</strong><strong>verbalisation</strong> avait été utile et intéressant, dans quelle me<strong>sur</strong>e ce<strong>la</strong> les avait sou<strong>la</strong>gé, dansquelle me<strong>sur</strong>e ce<strong>la</strong> avait influencé leur perception de l’événement émotionnel et dans quelleme<strong>sur</strong>e ils avaient perçu <strong>des</strong> bénéfices <strong>sur</strong> le p<strong>la</strong>n interpersonnel (réconfort). Les participantsdans <strong>des</strong> conditions de <strong>verbalisation</strong> émotionnelle rapportaient plus de bénéfices subjectifsque les participants <strong>des</strong> conditions de <strong>verbalisation</strong> factuelle qui eux-mêmes ont perçu que <strong>la</strong>séance de <strong>verbalisation</strong> était plus bénéfique que les participants <strong>des</strong> conditions contrôles. Cesrésultats montraient que quel que soit l’événement émotionnel verbalisé, les individusperçoivent que ce<strong>la</strong> est utile, que ce<strong>la</strong> les sou<strong>la</strong>ge et qu’ils bénéficient cognitivement de cette<strong>verbalisation</strong>.
4Discussion, conclusions et perspectivesEn conclusion, nous avons donc montré que les individus croient que le partage social<strong>des</strong> émotions augmente <strong>la</strong> récupération émotionnelle. Par contre, nous n’avons pas montréque le partage social <strong>des</strong> émotions accélère <strong>la</strong> récupération émotionnelle. Ces conclusionsplutôt pessimistes sont d’une certaine manière compensées par les résultats qui montrent quele partage social <strong>des</strong> émotions induit <strong>des</strong> bénéfices subjectifs. Après <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> de leursémotions, les participants rapportent <strong>des</strong> bénéfices comme le sou<strong>la</strong>gement, le fait de se sentirmieux, d’avoir reçu du soutien <strong>des</strong> autres et d’avoir c<strong>la</strong>rifié les choses.On peut alors se demander pourquoi les personnes ont besoin de partager leursémotions et rapportent que ce<strong>la</strong> leur est bénéfique alors que les indices de récupération ne sontpas influencés par le partage social. En fait, on ne peut exclure l’idée que les bénéfices perçusproviennent de bénéfices réels autres que ceux qui ont été investigués jusqu'à présent. Nousdisposons à Louvain-<strong>la</strong>-Neuve de données préliminaires permettant de faire au moins troishypothèses. Le premier de ces axes concerne <strong>des</strong> aspects physiologiques, le second concerne<strong>des</strong> aspects sociaux, et le troisième, <strong>des</strong> aspects cognitifs.Jusqu'à présent, nos étu<strong>des</strong> ont abordé les réponses subjectives d'impact émotionnel(par questionnaire). Cette dimension subjective pourrait être considérée comme <strong>la</strong> plusimportante puisque l'on pourrait difficilement rapporter une émotion s'il n'y avait pasd'expérience consciente de celle-ci (Scherer, 1996; Frijda, 1986). Cependant, il n'y aurait pasd'expérience émotionnelle s'il n'y avait pas de réponses physiologiques (Bradley, 2000;Cacioppo, Klein, Berntson, & Hatfield, 1993). Les corré<strong>la</strong>tions entre ces deux types deréponses sont souvent très faibles (<strong>La</strong>ng, 1971, 1985). Il est donc possible que les réactionsphysiologiques automatiques soient diminuées après <strong>verbalisation</strong> (réexposition) émotionnellesans que l'expérience consciente subjective ne soit modifiée. A l'appui de cette hypothèse, <strong>des</strong>participants ont récemment été invités à se souvenir d'un événement émotionnel négatifrécupéré vs. non récupéré (i.e., induisant encore <strong>des</strong> émotions pénibles <strong>sur</strong> le p<strong>la</strong>n subjectif).Immédiatement après, l'impact émotionnel subjectif était évalué. Après une période dere<strong>la</strong>xation, soit les participants étaient réexposés à l'événement émotionnel par imageriementale, soit ils étaient réexposés à un événement trivial (e.g., imagerie <strong>sur</strong> le dernier cours).Les réactions électrodermales <strong>des</strong> participants étaient me<strong>sur</strong>ées avant, pendant et après <strong>la</strong>période d'exposition. Après une période de 48 heures, tous les participants étaient invités à sesouvenir à nouveau de l'événement émotionnel et ils devaient s'y réexposer par imagerie.Leurs réactions physiologiques étaient à nouveau enregistrées. Enfin, ils répondaient auquestionnaire évaluant l'impact émotionnel résiduel de l'épisode. Les résultats de cette étudeont révélé que seuls les individus qui avaient confronté les émotions liées à un événementrécupéré présentaient de meilleurs indices de récupération émotionnelle physiologique lors de<strong>la</strong> deuxième séance. En accord avec les résultats de nos recherches antérieures, les indices derécupération émotionnelle subjective ne se différenciaient pas entre les groupes non récupéréet récupéré. Ceci suggère que <strong>la</strong> récupération émotionnelle subjective est un phénomènedifférent de <strong>la</strong> récupération émotionnelle physiologique. Une étude est prévue qui testeral'impact de <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> <strong>des</strong> émotions <strong>sur</strong> ces deux facettes de <strong>la</strong> récupérationémotionnelle.Deuxièmement, il est possible que le partage social permette de raviver les liensd’attachement et <strong>la</strong> réintégration sociale. A l'appui de cette hypothèse, <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> récentes ontmontré que le partage social induit chez le partenaire <strong>des</strong> réponses d'intérêt, d'empathie et <strong>des</strong>comportements non verbaux de proximité physique (e.g., toucher, embrasser) qui sontproportionnels à l'intensité de l'émotion évoquée (Rimé & Christophe, 1997). L'émetteurrépond lui-même très positivement à ces manifestations. En outre, de nombreuses étu<strong>des</strong> <strong>sur</strong><strong>la</strong> révé<strong>la</strong>tion de soi (self-disclo<strong>sur</strong>e) ont montré que les personnes qui s'engagent dans <strong>des</strong>
5discussions personnelles tendent à être plus appréciées que les personnes qui parlent de sujetsmoins personnels. Elles ont aussi montré que <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> de sujets personnels induisaitchez l'émetteur une tendance à plus apprécier ses partenaires (voir <strong>la</strong> méta-analyse de Collins& Miller, 1994). Les bénéfices subjectifs de <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> pourraient donc être liés à unrenforcement <strong>des</strong> liens affectifs qui résulterait de <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> émotionnelle. Ainsi, parl'intermédiaire <strong>des</strong> liens affectifs renforcés, <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> <strong>des</strong> émotions jouerait un rôleimportant d'intégration sociale. Dans une étude en col<strong>la</strong>boration avec Margaret Stroebe del'Université d'Utrecht, nous sommes en train d'examiner les différences de type de réaction dupartenaire d'un partage social perçu comme satisfaisant vs. insatisfaisant du point de vue dulocuteur. Cette étude nous permettra de voir si <strong>des</strong> prototypes de réactions du partenairesoutenant ou non existent. Elle nous permettra également d'examiner si le sentiment <strong>des</strong>olitude varie en fonction <strong>des</strong> bénéfices perçus de l'interaction de partage social.Enfin, il est possible que les bénéfices subjectifs rapportés après <strong>verbalisation</strong> soientinduit par <strong>la</strong> croyance aux effets bénéfiques de <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> <strong>des</strong> émotions. Des recherches<strong>sur</strong> <strong>la</strong> perception <strong>des</strong> sensations physiologiques après induction émotionnelle ont montré queles individus rapportent <strong>des</strong> patterns différenciés d'activation physiologique pour diversesémotions spécifiques (e.g., Shields, 1984). Cependant, il n'existe pas c<strong>la</strong>irement d'activationphysiologique correspondant aux émotions spécifiques. Les individus ne peuvent donc pas seréférer à leurs propres sensations intéroceptives. Rimé, Philippot et Cisamolo (1990) ontmontré que les personnes ont recours à leur savoir stéréotypique et prototypique (<strong>des</strong> schémassociaux) au sujet <strong>des</strong> réponses émotionnelles pour déterminer et différencier leurs sensationsphysiologiques après induction émotionnelle. Selon <strong>la</strong> même logique, on postule que lesindividus, pour déterminer s'ils perçoivent <strong>des</strong> bénéfices après <strong>verbalisation</strong> émotionnelle, ontrecours davantage aux croyances établies qu'à leurs propres expériences personnelles parceque ce<strong>la</strong> leur demande moins d'effort cognitif. En effet, les individus peuvent avoir facilementrecours au stéréotype provenant du savoir social et à leurs croyances <strong>sur</strong> les effets bénéfiquesde <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> <strong>des</strong> émotions (processus cognitif automatique). Par contre, s'ils se réfèrentà leur expérience subjective, ils doivent utiliser un processus contrôlé d'introspectiondemandant un examen approfondi <strong>des</strong> conséquences de <strong>la</strong> <strong>verbalisation</strong> émotionnelle <strong>sur</strong> lesp<strong>la</strong>ns physiologique, subjectif, cognitif et interpersonnel, informations auxquelles le sujet àdifficilement accès. A l'appui de cette hypothèse, les résultats de plusieurs étu<strong>des</strong> indiquentque les bénéfices perçus après <strong>verbalisation</strong> sont significativement associés aux croyancesenvers les effets bénéfiques du partage social mais sont indépendants <strong>des</strong> indices derécupération après <strong>verbalisation</strong>.RéférencesBradley, M. M. (2000). "Emotion and motivation", in Cacioppo J.D. et alii (Eds.), Handbookof psychophysiology (pp. 602-642, 2 nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.Cacioppo, J. T., Klein, D. J., Berntson, G. G., & Hatfield, E. (1993). "The psychophysiologyof emotion", in Lewis M. et alii (Eds.), Handbook of emotions (pp. 67-83). New York:Guilford.Christophe, V., & Rimé, B. (1997). "Expo<strong>sur</strong>e to the social sharing of emotion: Emotionalimpact, listener responses and the secondary social sharing." European Journal of SocialPsychology, 27, 37-54.Collins, N.L., & Miller, L.C. (1994). "Self-disclo<strong>sur</strong>e and liking: A meta-analytic review."Psychological Bulletin, 116, 457-475.Donnelly, D.A., & Murray, E.J. (1991). "Cognitive and emotional changes in written essaysand therapy interviews." Journal of Social and Clinical Psychology, 10, 334-350.Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Murray, E.J., & Segal, D.L. (1994). "Emotional processing in vocal and written expression offeelings about traumatic experiences." Journal of Traumatic Stress, 7, 391-405.Pennebaker, J.W., & Beall, S.K. (1986). "Confronting a traumatic event: Toward anunderstanding of inhibition and disease." Journal of Abnormal Psychology, 95, 274-281.Rimé, B. (1987). Le partage social <strong>des</strong> émotions [Social sharing of emotions]. Paperpresented at the Symposium on Social Psychology and the Emotions, Maison <strong>des</strong>Sciences de l'Homme, Paris, France.Rimé, B., Finkenauer, C., Luminet, O., Zech, E., & Philippot, P. (1998). "Social sharing ofemotion: New evidence and new questions", in Stroebe W. et alii (Eds.), Europeanreview of social psychology (Vol. 9, pp. 145-189). Chichester, UK: John Wiley & SonsLtd.Rimé, B., Philippot, P., Boca, S., & Mesquita, B. (1992). "Long-<strong>la</strong>sting cognitive and socialconsequences of emotion: Social sharing and rumination", in Stroebe W. et alii (Eds.),European review of social psychology (Vol. 3, pp. 225-258). Chichester, UK: JohnWiley & Sons Ltd.Rimé, B., Philippot, P., & Cisamolo; D. (1990). "Social schemata of peripheral changes inemotion." Journal of Personality and Social Psychology, 59, 38-49.Scherer, K. R. (1996). Emotion, in Hewstone M. et alii (Eds.), Introduction to socialpsychology. A European perspective (pp. 279-315, 2 nd ed.). Oxford, UK: B<strong>la</strong>ckwellPublishers.Shields, S. A. (1984). "Reports of bodily change in anxiety, sadness, and anger." Motivationand Emotion, 8, 1-21.Zech, E. (2000). "The effects of the communication of emotional experiences." Unpublisheddoctoral dissertation, University of Louvain, Faculty of psychology, Belgium.Zech, E. (2001). "<strong>La</strong>ypeople's beliefs about the intra- and interpersonal effects of socialsharing: A preliminary investigation of the belief that "talking helps"?" Manuscriptsubmitted for publication. University of Louvain, Louvain-<strong>la</strong>-Neuve, Belgium.Zech, E. & Rimé, B. (2001). "Verbal expression of emotional experiences: Effects onemotional recovery and perceived benefits." Manuscript submitted for publication.University of Louvain, Louvain-<strong>la</strong>-Neuve, Belgium.6