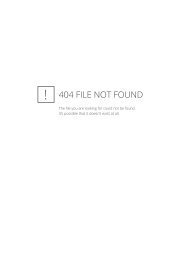Les symbiotes mycorhiziens du peuplier noir (populus nigra L.) : la ...
Les symbiotes mycorhiziens du peuplier noir (populus nigra L.) : la ...
Les symbiotes mycorhiziens du peuplier noir (populus nigra L.) : la ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Les</strong> Actes <strong>du</strong> BRG, 4 (2003) 453-466© BRG, 2003Article original<strong>Les</strong> <strong>symbiotes</strong> <strong>mycorhiziens</strong><strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> (Populus <strong>nigra</strong> L.) :<strong>la</strong> spécificité des assemb<strong>la</strong>ges fongiquesen milieu riverainMonique GARDES * , Emmanuelle BIALET, Estelle BINET,Cécile BROUSSEAU, Frédéric CARRÉ, Jean-Yves CHARCOSSET,Nolwenn FRADET, Patricia GRIFFITH, Hervé GRYTA,Marc LAQUERBE, Carole MARTINEZ, Sophie MILLOTCentre d’écologie des systèmes aquatiques continentaux, UMR CNRS - UniversitéPaul Sabatier, 29 rue Jeanne Marvig, 31055 Toulouse Cedex 4, FranceAbstract - Mycorrhizal fungi associated with b<strong>la</strong>ck pop<strong>la</strong>r (Populus <strong>nigra</strong> L.):specificity of the symbiotic assemb<strong>la</strong>ges on a riparian site. Genetic resourcesof indigenous b<strong>la</strong>ck pop<strong>la</strong>r (Populus <strong>nigra</strong> L.) are threatened because of the risk ofintrogression from cultivated hybrids and anthropic disturbances of the riparianhabitat. We looked for the diversity of mycorrhizal fungi associated with this pioneerp<strong>la</strong>nt species on a riparian ecosystem. Our results showed a complex dynamicsof mycorrhizal types in re<strong>la</strong>tion to stand age and pop<strong>la</strong>r development and/or to thedegree of hydrological disturbance. Arbuscu<strong>la</strong>r mycorrhizae (AM) were detected onroots from young pop<strong>la</strong>rs located on disturbed to highly disturbed habitats, andectomycorrhizae (EM) on roots from older trees on less disturbed habitats. Undercertain ecological conditions, both mycorrhizal types simultaneously colonizedpop<strong>la</strong>r roots. However, strong seasonal variations in colonization patterns were alsoobserved. Molecu<strong>la</strong>r analysis of the ectomycorrhizal community using ITS typing(ITS-RFLP) revealed a predominance of pioneer fungal species with a broad hostrange. Among the dominant taxa, we found many ascomycetes including severalspecies of truffles (Tuber sp.). Finally, two popu<strong>la</strong>tions of two Tricholoma speciesfrom two contrasting habitats were analyzed using RAPD and IGS-RFLP in orderto infer the influence of disturbance on the mode of repro<strong>du</strong>ction. We found numerousand small génets on the riparian site, suggesting that spores are the primarymeans by which these species colonized this disturbed habitat. However, sporemigration from other habitats may be limited as new genotypes appeared to be allclosely re<strong>la</strong>ted to pre-existing local genotypes.mycorrhizal symbiosis / b<strong>la</strong>ck pop<strong>la</strong>r / fungi / riparian habitat / biodiversity* Correspondance et tirés à part : gardes@cict.fr453
M. Gardes et al.Résumé - <strong>Les</strong> popu<strong>la</strong>tions naturelles de <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> (Populus <strong>nigra</strong> L.) sont menacéespar une pollution génétique liée aux nombreux cultivars et par les perturbations anthropiquesde l’habitat riverain. Nous avons examiné <strong>la</strong> diversité des champignons<strong>mycorhiziens</strong> associés à cette essence pionnière des ripisylves. Nous avons mis enévidence l'existence d'une dynamique complexe des types <strong>mycorhiziens</strong> liée au stadede développement <strong>du</strong> peuplement et/ou au niveau de perturbation <strong>du</strong> milieu. Il y aune prédominance des endomycorhizes à vésicules et arbuscules dans les jeunes peuplementssur des sols fortement à moyennement perturbés, et des ectomycorhizesdans les peuplements plus âgés sur les sols les moins perturbés. <strong>Les</strong> <strong>peuplier</strong>s sontdoublement mycorhizés sous certaines conditions mais il existe des variations saisonnièresmarquées. L'analyse des communautés ectomycorhiziennes par typage molécu<strong>la</strong>ire(ITS-RFLP) fait apparaître une prédominance de <strong>la</strong> mycoflore ectomycorhiziennepionnière à mutualisme généraliste. Parmi les espèces dominantes, on trouve de nombreuxascomycètes, des truffes (Tuber sp.) en particulier. Finalement, sur <strong>la</strong> base dedifférents marqueurs génétiques (RAPD, IGS-RFLP), nous avons révélé chez deuxespèces de tricholomes associées au <strong>peuplier</strong>, <strong>la</strong> présence de nombreux génets depetite taille suggérant une colonisation de l’habitat riverain par l’intermédiaire desspores méiotiques. Mais le renouvellement des popu<strong>la</strong>tions est probablement limité enmilieu riverain puisqu'il semble s'effectuer à partir des génotypes locaux, sans ou avecpeu d’apport extérieur au site.symbiose mycorhizienne / <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> / champignons / ripisylve / biodiversité1. INTRODUCTIONL'association mycorhizienne résulte de l'interaction entre <strong>la</strong> racine d'unep<strong>la</strong>nte-hôte avec le mycélium d'un champignon. Probablement apparue au siluro-dévonien(il y a 350 à 460 millions d'années), cette symbiose se serait développéeà plusieurs reprises dans l'histoire des p<strong>la</strong>ntes et des champignons. Elleconcerne <strong>la</strong> plupart de nos espèces végétales et plus de 6 000 espèces de champignons,et rassemble en fait une très grande diversité d'associations possiblesentre des p<strong>la</strong>ntes et des champignons. Ce processus, à bénéfices réciproquespour les deux partenaires, est un des mécanismes majeurs de l'évolution et del'écologie des organismes [15], [17], [19]. La symbiose accélère l'innovation évolutiveet favorise l'expansion et <strong>la</strong> diversification des espèces. Elle joue égalementun rôle moteur dans <strong>la</strong> richesse, <strong>la</strong> stabilité et <strong>la</strong> complexité des écosystèmespar ses effets régu<strong>la</strong>teurs sur les popu<strong>la</strong>tions et les communautés d'organismesqui lui sont directement ou indirectement associées. Dans le cadre denotre projet, nous avons cherché à comprendre comment les communautés etpopu<strong>la</strong>tions de champignons <strong>mycorhiziens</strong> associés au <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> (Populus gr.<strong>nigra</strong>) se mettent en p<strong>la</strong>ce à des échelles locales et régionales, et quels sont lesfacteurs écologiques et génétiques qui orientent leur dynamique. Notre objectifdans ces approches comparatives était de révéler l'éten<strong>du</strong>e de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>sticité de <strong>la</strong>symbiose mycorhizienne vis-à-vis des contraintes environnementales chez le454
<strong>Les</strong> champignons <strong>mycorhiziens</strong> <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong><strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong>. En effet, les associations p<strong>la</strong>ntes-champignons optimisent potentiellementleur ajustement au milieu en jouant : i) sur les différents types de mycorhizeset leur proportion, mais également, ii) sur <strong>la</strong> richesse et <strong>la</strong> distributiondes espèces et des indivi<strong>du</strong>s et <strong>la</strong> diversité de leurs capacités nutritionnelles et iii)sur le degré de généralisation ou de spécialisation des partenaires. Soulignonségalement que le système racinaire d'une p<strong>la</strong>nte peut héberger plusieurs espècesde champignons, voire plusieurs indivi<strong>du</strong>s de chaque espèce. Parmi ces assemb<strong>la</strong>ges,on trouve des espèces fongiques avec des gammes d'hôtes <strong>la</strong>rges : ellessont qualifiées de généralistes ; d'autres, au contraire, manifestent une préférencevoire une spécificité étroite vis-à-vis de certains taxa : ce sont les espèces qualifiéesde spécialistes [12]. Dans notre projet, nous avons entrepris une étude <strong>du</strong>polymorphisme génétique dans des popu<strong>la</strong>tions naturelles de deux espèces detricholomes avec des spectres d'hôtes très contrastés. L'une, Tricholoma populinum,est inféodée aux <strong>peuplier</strong>s tandis que l'autre, Tricholoma scalpturatum, s'associe àune panoplie d'angiospermes et de gymnospermes ligneux (par exemple <strong>peuplier</strong>,saule, chêne, pin).Le <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> est une essence ligneuse à vocation pionnière, souventdominante dans les stades précoces d'évolution des ripisylves. Il sert de basegénétique pour l'obtention de nombreux hybrides euraméricains (par exemple,P. deltoides x P. <strong>nigra</strong>) cultivés dans les p<strong>la</strong>ntations françaises. Malheureusement,<strong>la</strong> populiculture et d'autres activités humaines, par exemple, certains aménagementsfluviaux, ont appauvri le potentiel génétique <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> et ré<strong>du</strong>itson habitat [1], [9]. Au-delà de ces considérations économiques, le <strong>peuplier</strong><strong>noir</strong> est un modèle végétal intéressant pour <strong>la</strong> compréhension de <strong>la</strong> symbiosemycorhizienne puisqu'il est une des rares espèces végétales à pouvoirhéberger simultanément deux types de mycorhizes : des endomycorhizes àvésicules et arbuscules et des ectomycorhizes. <strong>Les</strong> premières concernent desespèces de champignons microscopiques appartenant à <strong>la</strong> division des zygomycètes.Dans cette symbiose, le champignon pénètre à l'intérieur des cellules<strong>du</strong> parenchyme cortical sans engendrer de déformation de <strong>la</strong> racine. <strong>Les</strong> secondesconcernent près de 6 000 espèces décrites de champignons macroscopiquesappartenant aux divisions ascomycètes et basidiomycètes. Le champignonforme un manchon d'hyphes autour des racines courtes et un réseau demycélium entre les cellules corticales. Quel que soit le type mycorhizien, lesmycorhizes (endo- et ecto-) sont des sites privilégiés d'échanges entre <strong>la</strong> racineet le sol. <strong>Les</strong> associés fongiques améliorent <strong>la</strong> nutrition minérale des p<strong>la</strong>ntes,contribuent à une meilleure alimentation hydrique, interfèrent avec le métabolismehormonal de l'hôte végétal et assurent un rôle de protection phytosanitaire[17]. Selon certains auteurs, <strong>la</strong> double colonisation permettrait d'accroîtrel'amplitude écologique de l'hôte végétal en améliorant son alimentation minérale: les symbiontes endo<strong>mycorhiziens</strong> faciliteraient <strong>la</strong> nutrition phosphatéede <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte, les ecto<strong>mycorhiziens</strong> <strong>la</strong> nutrition azotée [17]. Des rôles autres quenutritionnels sont également à envisager.455
M. Gardes et al.Dans cet article, nous présentons les résultats issus des travaux sur lescommunautés et les popu<strong>la</strong>tions de champignons, réalisés pour l'essentieldans le cadre <strong>du</strong> projet et une synthèse des travaux antérieurs effectués dansnotre <strong>la</strong>boratoire sur <strong>la</strong> mycorhization <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong>. Quels sont les déterminantsde <strong>la</strong> distribution de <strong>la</strong> diversité fongique ? Quelles peuvent êtreles conséquences des modifications de l'habitat riverain et de <strong>la</strong> disparitiondes peuplements naturels <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> sur cette diversité ? Des conditionsenvironnementales imprévisibles favorisent-elles un mutualisme généralisteou un mutualisme étroit ? Comment <strong>la</strong> diversité génétique est-ellemaintenue dans des environnements soumis à de fortes contraintes abiotiques? Afin d'apporter des éléments de réponse à ces questions sur <strong>la</strong> dynamiquede <strong>la</strong> mycorhization, nous avons réalisé une prospection de <strong>la</strong> diversitédes symbiontes fongiques à différentes échelles spatio-temporelles etniveaux d'organisation (types <strong>mycorhiziens</strong>, communautés, popu<strong>la</strong>tions).2. MATÉRIEL ET MÉTHODES2.1. <strong>Les</strong> sites d'échantillonnage pour le suivi des types <strong>mycorhiziens</strong>et des communautés fongiquesNous avons effectué nos prélèvements dans deux peuplements naturelsde <strong>peuplier</strong>s <strong>noir</strong>s en bor<strong>du</strong>re de Garonne. Le site principal se trouve dans ledépartement <strong>du</strong> Tarn-et-Garonne, sur <strong>la</strong> commune de Monbéqui, à unecinquantaine de kilomètres en aval de Toulouse. À l'intérieur d'un périmètred'environ 3,5 hectares, les <strong>peuplier</strong>s se répartissent principalement sur unbanc de galets qui s'étend sur environ 900 mètres de <strong>la</strong> berge Sud vers <strong>la</strong>berge Nord et, à un degré moindre, sur une zone périphérique, qualifiée deberge, située entre le banc de galets et des peupleraies cultivées. Nous avonsanalysé <strong>la</strong> mycorhization <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> le long d'une chronoséquence, <strong>du</strong> stadep<strong>la</strong>ntule le long de <strong>la</strong> rivière jusqu'au stade sénescent sur <strong>la</strong> berge. Nousavons réalisé notre échantillonnage dans 4 zones (A, B, C et D) représentativesdes différents stades de succession en nous basant sur l'âge des différentescohortes, celles-ci étant distribuées selon un gradient de perturbationshydrologiques (tableau I). Le deuxième site se trouve sur <strong>la</strong> commune dePortet-sur-Garonne à une dizaine de kilomètres en amont de Toulouse. Nosprélèvements ont été réalisés sur des <strong>peuplier</strong>s juvéniles (2 à 10 ans selonnos estimations) localisés sur un banc de galets près de <strong>la</strong> rivière, et sur desarbres sénescents situés sur <strong>la</strong> berge.456
<strong>Les</strong> champignons <strong>mycorhiziens</strong> <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong>Tableau I : Principales caractéristiques des zones d'échantillonnage sur le site deMonbéqui à proximité de <strong>la</strong> Garonne.ZonesType de milieuFréquence des crues aucours d'un cycle annuelÂge approximatif des<strong>peuplier</strong>s (en 1997)A banc de galets très élevée < 1 anB banc de galets élevée 2 à 4 ansC banc de galets moyennement élevée 10 à 15 ansD berge rare 25 ans à 50 ans ?2.2. <strong>Les</strong> sites d'échantillonnage pour le suivi des popu<strong>la</strong>tionsNous avons récolté et cartographié 74 carpophores de T. scalpturatum (61en 1998, 13 en 1999) et 24 de T. populinum en 1998 sur <strong>la</strong> zone C de Monbéqui,c'est-à-dire sous une cohorte de <strong>peuplier</strong>s d'une dizaine d'années ; l'aireéchantillonnée est d'environ 200 m 2 . À titre de comparaison, en 2000, nousavons également récolté et cartographié 296 carpophores de T. scalpturatum et95 de T. populinum sur un deuxième site de <strong>la</strong> proche banlieue toulousaine, àMontaudran. L'aire d'échantillonnage définie sur ce site est de 250 m 2 ; il s’agitd’une pelouse herbeuse bordée sur deux côtés par une haie artificielle de <strong>peuplier</strong>s<strong>noir</strong>s d'une trentaine d'années. Cet habitat n'est donc pas soumis auxfortes fluctuations hydrologiques caractéristiques <strong>du</strong> site de Monbéqui.2.3. Détermination <strong>du</strong> statut mycorhizien et quantification de <strong>la</strong>colonisationNous avons recensé <strong>la</strong> présence (+) ou l’absence (-) d’endo- et d’ectomycorhizessur des échantillons de racines prélevées au hasard dans les 4zones de Monbéqui, au cours de 3 années successives. Pour quantifier <strong>la</strong>colonisation des endomycorhizes à arbuscules (AM), nous avons utilisé <strong>la</strong>méthode c<strong>la</strong>ssique de Kormanick et MacGraw [8] après coloration des racinesau bleu trypan [14]. Nous avons également dénombré toutes les structuresfongiques (hyphes, vésicules, arbuscules et spores intraracinaires) présentesdans 50 cm de racines d’un diamètre inférieur à 1 mm. Pour les ectomycorhizes,<strong>la</strong> quantification a été effectuée selon <strong>la</strong> méthode de Giovannetti etMosse [5] sur des échantillons de racines de diamètre inférieur à 1,5 mm,pour une longueur racinaire totale de 2,5 à 3,5 m. Sous <strong>la</strong> loupe binocu<strong>la</strong>ire,nous avons noté <strong>la</strong> présence ou l'absence d'ectomycorhizes à chaque intersectiond'une racine avec le quadril<strong>la</strong>ge d'une boîte de Pétri.2.4. Échantillonnage des ectomycorhizes et identificationtaxonomique des espèces fongiques par typage de l'ITSNous avons prélevé au hasard des racines provenant de 3 à 10 arbres, aucours de 3 années successives à Monbéqui et lors <strong>du</strong> printemps 1999 à Portet457
M. Gardes et al.(tableau II). Une centaine de mycorhizes étaient récoltées pour chaque arbre ;un sous-échantillon de 20 à 100 soumises à l'amplification PCR. <strong>Les</strong> donnéesgénétiques recueillies pour l'ensemble des arbres et années sont de 937 mycorhizesà Monbéqui et de 114 à Portet-sur-Garonne. Pour l'identification destaxa, nous avons amplifié par PCR <strong>la</strong> région intergénique transcrite de l'unitéribosomale nucléaire <strong>du</strong> symbionte fongique à l'aide d'amorces « spécifiques »des champignons [4]. L'analyse <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it amplifié a été réalisée en deux étapes.La première consistait à examiner le polymorphisme dans <strong>la</strong> longueur desfragments de restriction pour 2 à 4 enzymes et à regrouper les symbiontes<strong>mycorhiziens</strong> présentant des profils simi<strong>la</strong>ires. Cette analyse, ITS-RFLP, permetune séparation rapide et re<strong>la</strong>tivement fiable des espèces de champignonsecto<strong>mycorhiziens</strong> [3],[4]. En effet, de nombreux travaux ont mis en évidenceune conservation des séquences à l'intérieur des espèces taxonomiques définiesselon des critères c<strong>la</strong>ssiques et, parallèlement, une forte divergence entreles espèces [7]. Dans une deuxième étape, nous avons séquençé l'ITS desprincipaux groupes RFLP afin de préciser l'appartenance taxonomique <strong>du</strong>symbionte par comparaison avec des bases de données existantes (« B<strong>la</strong>stsearch »).Tableau II : Diversité des communautés ectomycorhiziennes <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> en fonction<strong>du</strong> site, de l'habitat et des années. Chaque taxa correspond à un groupe électrophorétiquedéfini par les profils de restriction de <strong>la</strong> région ribosomale nucléaire(ITS-RFLP) pour 2 à 4 enzymes. Sur le site de Monbéqui, les mycorhizes analyséesproviennent de : i) 13 arbres pour <strong>la</strong> zone B et <strong>la</strong> zone C et ii) 9 arbres pour <strong>la</strong> zoneB, toutes années confon<strong>du</strong>es. Sur le site de Portet-sur-Garonne, <strong>la</strong> diversité dessymbiontes a été analysée sur 6 arbres, dont 3 localisés sur un banc de galets près de<strong>la</strong> rivière et 3 sur <strong>la</strong> berge.Nb. total de taxa Nb. moyen de taxa par arbre1998 1999 2000 1998 1999 2000MonbéquiGalet zone B - - 20 - - 2,2Galet zone C 37 19 42 3,7 6,3 7Berge zone D 41 15 17 4,1 5,0 4,3Portet-sur-GaronneGalets - 14 - - 4,7 -Berge - 13 - - 4,3 -2.5. Caractérisation génétique des indivi<strong>du</strong>s de tricholomes etanalyse des donnéesUne caractérisation génétique des iso<strong>la</strong>ts a été réalisée à l'aide de marqueursRAPD. Vingt-deux amorces ont initialement été testées sur un souséchantillonde carpophores (tableau III). Celles qui ont fourni des fragments458
<strong>Les</strong> champignons <strong>mycorhiziens</strong> <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong>bien définis et polymorphes ont été retenues pour <strong>la</strong> suite de l'analyse : 6pour T. populinum et 7 pour T. scalpturatum. <strong>Les</strong> profils RAPD ont été établisen terme de présence-absence des fragments amplifiés. Seuls les fragmentsrepro<strong>du</strong>ctibles (plusieurs amplifications PCR d’un même extrait d’ADN surplusieurs gels) ont été retenus. Une matrice de comparaison deux à deux desiso<strong>la</strong>ts de chaque espèce a été établie en calcu<strong>la</strong>nt pour chaque paire d'iso<strong>la</strong>tsl'indice de simi<strong>la</strong>rité c<strong>la</strong>ssiquement utilisé de Nei et Li [13] : SI = 2Nxy/(Nx+ Ny) (1) où Nxy correspond au nombre de fragments communs à x et y et,Nx et Ny le nombre de fragments présents respectivement chez x et chez y.<strong>Les</strong> carpophores présentant les mêmes profils RAPD ont été traités commeappartenant à un même génet. Une estimation de <strong>la</strong> diversité génique a étéeffectuée pour chaque popu<strong>la</strong>tion par le calcul de l'indice de Shannon [16]sur les fréquences alléliques estimées à chaque locus de chaque génet. Uneanalyse PCR/RFLP de <strong>la</strong> portion IGS2 de l'espaceur intergénique de l'ADNribosomique nucléaire a également été réalisée sur <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion de T. scalpturatumde Monbéqui.Tableau III : Principales caractéristiques des popu<strong>la</strong>tions de T. populinum etT. scalpturatum : i) sur le site fortement perturbé par les crues de Monbéqui et ii) surle site peu perturbé de Montaudran.MonbéquiMontaudranTricholomaTricholoma TricholomaTricholoma scalpturatumpopulinumpopulinum scalpturatum1998 1998 1999 2000 2000Nb. de carpophoresrécoltés24 61 13 95 296Nb. de carpophoresanalysés24 58 12 44 62Nb. de génets 7 56 10 2 12Nb. de carpophores pargénet1 - 18 1 - 3 1 - 2 13 - 31 1 - 27Nb. moyen de carpophorespar génet3,4 1,1 1,1 22 5,2D. max a 1,8 m 0,35 m 0,06 m 13 m 9,2 ma : Distance maximale entre 2 carpophores appartenant au même génet.3. RÉSULTATS3.1. Dynamique spatio-temporelle des types <strong>mycorhiziens</strong> sur lesite de MonbéquiAu cours des 2 premières années, les <strong>peuplier</strong>s étaient : i) non mycorhizésdans <strong>la</strong> zone A (à l'exception de 2 p<strong>la</strong>ntules (sur dix) récoltées <strong>la</strong> deuxième annéeet qui avaient quelques hyphes et vésicules), ii) endomycorhizés dans <strong>la</strong> zone Bet iii) doublement mycorhizés (endo- et ectomycorhizes sur un même système459
M. Gardes et al.racinaire) dans les zones C et D (figure 1). D'importants changements dans <strong>la</strong>mycorhization ont donc été mis en évidence le long de <strong>la</strong> chronoséquence, de <strong>la</strong>rivière vers <strong>la</strong> berge. D'autre part, les taux de colonisation endomycorhizienneétaient significativement plus faibles dans <strong>la</strong> zone B (fortes perturbations) encomparaison de <strong>la</strong> zone D (faibles perturbations), quelle que soit <strong>la</strong> saison oul'année de prélèvement (figure 1 A). Parallèlement à cette diminution, on a observéune augmentation de <strong>la</strong> colonisation ectomycorhizienne de <strong>la</strong> zone C vers<strong>la</strong> zone D (figure 1 B).Figure 1 : Comparaison des taux moyens de colonisation endomycorhizienne (A) etectomycorhizienne (B) <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> sur le site de Monbéqui. <strong>Les</strong> arbres échantillonnésétaient distribués dans des zones représentatives des différents niveaux deperturbations hydrologiques. Dix arbres par zone ont été échantillonnés en 97 et 98.Finalement, les taux d’endomycorhization étaient les plus forts en automne.Ces résultats s’expliquaient en partie par une forte abondance desvésicules de réserve chez les champignons. De nouvelles modifications dans <strong>la</strong>mycorhization sont apparues au cours de <strong>la</strong> troisième année. Ainsi, des hypheset quelques arbuscules et vésicules ont été observées sur 73 % des p<strong>la</strong>ntulesrécoltées dans <strong>la</strong> zone A, sur un terrain en voie de stabilisation à <strong>la</strong> suite d'unemodification <strong>du</strong> chenal de <strong>la</strong> rivière. Nous avons également observé des ec-460
<strong>Les</strong> champignons <strong>mycorhiziens</strong> <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong>tomycorhizes sur quelques <strong>peuplier</strong>s de <strong>la</strong> zone B ; un sous-échantillon a étésoumis à l'analyse molécu<strong>la</strong>ire. Tous ces résultats mettent en évidence unedynamique rapide de <strong>la</strong> mycorhization <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> en milieu riverain etun fort impact des conditions environnementales sur ce processus.3.2. Dynamique spatio-temporelle des communautés dechampignons ecto<strong>mycorhiziens</strong>Il existe une dynamique complexe des types <strong>mycorhiziens</strong>. Qu’en est-il desespèces ? <strong>Les</strong> résultats de l'analyse molécu<strong>la</strong>ire sur les symbiontes ecto<strong>mycorhiziens</strong>sont présentés dans le tableau II et <strong>la</strong> figure 2.Figure 2 : Distribution et abondance des taxa de champigons ecto<strong>mycorhiziens</strong>dans un peuplement de <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> sur le site de Monbéqui en fonction de <strong>la</strong>localisation des arbres (zone B, C ou D) et de l'âge des cohortes. La séparation destaxa repose sur une analyse des profils de restriction dans <strong>la</strong> région intergéniquetranscrite (ITS-RFLP), et leur identification taxonomique sur <strong>la</strong> simi<strong>la</strong>rité de séquencesITS avec les bases de données existantes («B<strong>la</strong>st search»). <strong>Les</strong> mycorhizesproviennent de 13 arbres différents pour <strong>la</strong> zone C et <strong>la</strong> zone D et de 9 arbres pour<strong>la</strong> zone B. Au total, 974 ectomycorhizes ont été analysées.Ils font apparaître : i) une richesse en taxa <strong>du</strong> même ordre de grandeur surles 2 habitats, banc de galets et berge quel que soit le site ; ii) <strong>la</strong> dominance dequelques espèces et <strong>la</strong> présence de nombreuses espèces rares dans les 2 communautés; iii) <strong>la</strong> forte représentation d'une flore fongique présentant des caractèrespionniers : c'est le cas par exemple des genres Tomentel<strong>la</strong>, Thelephora etHebeloma. Ces basidiomycètes se retrouvent sur 2 sites au moins (Monbéqui et461
M. Gardes et al.Portet) et sont présents aussi bien sur le banc de galets que sur <strong>la</strong> berge ; iv) <strong>la</strong>présence de nombreux ascomycètes à fructification hypogée, par exemple legenre Tuber (truffe). Ces taxa sont particulièrement abondants sur le site deMonbéqui, souvent dans les zones les plus perturbées3.3. Structuration et dynamique spatio-temporelle des popu<strong>la</strong>tionsde deux espèces de tricholomes<strong>Les</strong> tableaux III et IV résument les principaux résultats de l'analyse génétiquedes fructifications de tricholomes récoltées sur 2 sites éloignés géographiquement.L'espèce généraliste, T. scalpturatum, montre une diversité plusgrande que l'espèce spécialisée ; cette tendance se confirme sur les 2 sites, l’unperturbé et l’autre non perturbé par les crues. <strong>Les</strong> génets de T. scalpturatumsont généralement de petite taille. Au contraire, chez T. populinum on note <strong>la</strong>présence de plusieurs génets pérennes, parfois de grande taille (par exempleun génet représenté par 31 carpophores dispersés sur 40 m 2 à Montaudran).Tableau IV : Paramètres génétiques des popu<strong>la</strong>tions de T. populinum et T. scalpturatumsur les sites de Monbéqui et de Montaudran.Simi<strong>la</strong>rité entre lesgénets aT. populinum T. scalpturatumMonbéqui Montaudran Monbéqui Montaudran1998 2000 1998 1999 200077 - 97 % 85 % 51 - 99 % 62 - 99 % 20 - 86 %(1998/1999 : 52 - 99 %)Diversité génique b 0,27 (± 0,29) 0,13 (± 0,25) 0,20 (± 0,25) 0,19 (± 0,26) 0,38 (± 0,24)a : Indice de simi<strong>la</strong>rité de Nei et Li (1979).b : Indice de Shannon (Shannon & Weaver, 1949).Ces résultats soulignent l'importance de <strong>la</strong> repro<strong>du</strong>ction végétative parcroissance mycélienne dans <strong>la</strong> structuration des popu<strong>la</strong>tions de cette espèce.Le suivi temporel réalisé sur <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion de T. scalpturatum à Monbéqui a misen évidence <strong>la</strong> présence de nouveaux génets par le biais de <strong>la</strong> repro<strong>du</strong>ctionsexuée, avec peu ou pas de recrutement extérieur au site (tableau IV). Finalement,les popu<strong>la</strong>tions des 2 espèces sont structurées par les conditions environnementales.En effet, pour les deux espèces, l'absence de perturbationsfortes se tra<strong>du</strong>it par une diminution de <strong>la</strong> colonisation par spores méiotiquesau profit de <strong>la</strong> croissance végétative. <strong>Les</strong> génets des 2 espèces occupent généralementdes surfaces très restreintes sur le site sous fortes contraintes abiotiques(i.e. Monbéqui). Mais de façon générale, ils sont de grande taille sur le sitede Montaudran (i.e. non perturbé par les crues).462
4. DISCUSSION<strong>Les</strong> champignons <strong>mycorhiziens</strong> <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong>Nos résultats ont montré l'existence d'une dynamique complexe des types<strong>mycorhiziens</strong> (endomycorhizes à vésicules et arbuscules et ectomycorhizes)<strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> à une échelle locale dans un milieu soumis à de fortescontraintes abiotiques. Des variations simi<strong>la</strong>ires dans <strong>la</strong> proportion des types<strong>mycorhiziens</strong> ont également été décrites chez d'autres espèces d'arbres ouarbustes [10], [11], [18]. De façon générale, chez le <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong>, les endomycorhizesprédominent dans les jeunes peuplements sur des sols fortementà moyennement perturbés mais leur abondance sur le système racinaire d'unmême arbre diminue rapidement au profit des ectomycorhizes. Ces variationssont à mettre en re<strong>la</strong>tion avec le niveau de perturbation <strong>du</strong> milieuet/ou le stade de développement de leur hôte et <strong>du</strong> peuplement. Des interactionspositives ou négatives entre les types trophiques (endo- ou ecto)sont également à envisager pour expliquer cette dynamique. Une connaissanceplus approfondie de l'évolution spatio-temporelle de ces types <strong>mycorhiziens</strong>par des approches expérimentales et descriptives à des échelles plusfines semble cependant nécessaire afin de comprendre comment ces différentsfacteurs interagissent pour définir ces équilibres. Il conviendrait parailleurs de préciser le rôle respectif de chaque type dans <strong>la</strong> nutrition <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong>afin de quantifier le niveau d'adaptation locale de ces différentes re<strong>la</strong>tionsmutualistes et d'autre part, d'évaluer l'importance de cette diversitédans le fonctionnement et <strong>la</strong> stabilité des ripisylves.L'analyse des communautés a révélé une stabilité de <strong>la</strong> richesse globale, <strong>du</strong>banc de galets vers <strong>la</strong> berge. Elle est comparable à celle observée dans d’autresécosystèmes forestiers [2], [7]. D'autre part, de nombreux taxa ecto<strong>mycorhiziens</strong>dominants ou intermédiaires sont présents dans les deux peuplementsde <strong>peuplier</strong> sur le banc de galets (zone C) et sur <strong>la</strong> berge (zone D) ; les taxaspécifiques à chaque peuplement sont dans <strong>la</strong> plupart des cas des taxa rares àl’échelle <strong>du</strong> site. L’identification taxonomique par séquençage de plusieursespèces dominantes sur le site de Monbéqui a montré qu’elles appartiennenttoutes à des genres à vocation pionnière. Selon les données de <strong>la</strong> littérature, leschampignons « pionniers » auraient plutôt des stratégies écologiques de type ret seraient généralement peu spécifiques envers les espèces de p<strong>la</strong>ntes [6], [17].Il est probable que l'écosystème riverain dans son ensemble soit trop instablepour qu’une mycoflore à vocation tardive puisse s’y établir <strong>du</strong>rablement. Finalement,nous avons mis en évidence une forte représentation de champignonshypogés <strong>du</strong> genre Tuber sur le site de Monbéqui. Ainsi une espèce dominait <strong>la</strong>communauté (en terme de fréquence des mycorhizes) sur les 2 habitats, bancde galets et berge. Elle a envahi rapidement et efficacement les peuplementsjeunes sur des zones soumises à de fortes fluctuations hydrologiques (zones Bet C). L'abondance des champignons hypogés sur ce site et leur propagationrapide suggèrent l'existence de mécanismes adaptatifs particuliers (peut-être463
M. Gardes et al.liés à des possibilités de conservation et de dissémination des organes de fructification)permettant d'accroître les capacités de résistance ou de tolérance deces espèces vis-à-vis des perturbations.Par leur manque de mobilité et leur fixation au sol, les champignons <strong>mycorhiziens</strong>sont étroitement soumis aux conditions environnementales localesdans lesquelles se déroule leur croissance. Sur <strong>la</strong> base de marqueurs RAPDs,<strong>du</strong> polymorphisme dans <strong>la</strong> longueur des fragments de restriction dans l'espaceurintergénique ribosomal (IGS) et d'une approche comparative sur 2 espècesde tricholomes, nous avons révélé une évolution vers <strong>la</strong> propagation clonaleliée au niveau de spécialisation des espèces et à <strong>la</strong> stabilisation <strong>du</strong> milieu.La taille des génets est plus faible pour les deux espèces sur le site fortementperturbé par les crues. Toutefois, bien que le nombre de génets soit plus élevésur ce site, <strong>la</strong> diversité génétique apparaît beaucoup plus faible. <strong>Les</strong> nouveauxgénotypes qui apparaissent par le biais de <strong>la</strong> repro<strong>du</strong>ction sexuée semblenttous issus d'une recombinaison des génotypes locaux, sans apport extérieur.Le renouvellement de <strong>la</strong> diversité dans le milieu riverain apparaît donc limitépour ces 2 espèces de champignons. Finalement, les génotypes pro<strong>du</strong>isant desphénotypes intéressants pour une raison ou une autre sont fixés par propagationclonale chez l'espèce à mutualisme étroit ; cette tendance est particulièrementaccentuée sur le site non perturbé. En conclusion, le milieu changeant(i.e. <strong>la</strong> ripisylve) dans lequel vivent et évoluent les popu<strong>la</strong>tions de ces 2 espècesde champignons a un fort impact sur <strong>la</strong> structuration génétique des popu<strong>la</strong>tions.Cette approche popu<strong>la</strong>tionnelle demande cependant à être développée àdes échelles plus <strong>la</strong>rges et sur d'autres espèces afin de prédire et de gérer lesconséquences écologiques et génétiques, de forts changements écologiquesdes ripisylves et d'érosion de <strong>la</strong> diversité biologique.5. CONCLUSIONLe <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong> est un vecteur de diversité pour les ripisylves : les assemb<strong>la</strong>gesfongiques qui lui sont directement associés sont extrêment diversifiésà différents niveaux d'organisation. Il constitue un réservoir d'inoculumfongique pour toutes les espèces végétales mycotrophes susceptibles dese développer dans ce milieu, des herbacées endomycorhiziennes aux ligneuxplutôt ecto<strong>mycorhiziens</strong> (par exemple le saule, l'aulne, le frêne). Nousavons montré que cette espèce est susceptible de s'ajuster aux variations <strong>du</strong>milieu par l'intermédiaire de ses partenaires fongiques en jouant sur i) <strong>la</strong>diversité des types <strong>mycorhiziens</strong> et ii) les caractéristiques biologiques desnombreuses espèces fongiques qu'il contribue à entretenir. La réponse decette mycoflore mycorhizienne face aux modifications de l'environnementse situe sur des échelles de temps très courtes, tra<strong>du</strong>isant ainsi une p<strong>la</strong>sticitéélevée <strong>du</strong> système symbiotique <strong>peuplier</strong>-champignons dans un habitat sou-464
<strong>Les</strong> champignons <strong>mycorhiziens</strong> <strong>du</strong> <strong>peuplier</strong> <strong>noir</strong>mis à de fortes contraintes abiotiques. En résumé, nous pensons que l'intro<strong>du</strong>ctionde cette essence dans des programmes de conservation et de restaurationdes ripisylves devrait significativement contribuer au maintien de <strong>la</strong>diversité végétale et microbienne dans cet écosystème.REMERCIEMENTSNous remercions Dimitri Barthet, Maxime Ga<strong>la</strong>n et Catherine Lafittepour leur aide technique, les lecteurs pour leurs remarques. Le travail présentédans ce manuscrit a été soutenu financièrement par le Bureau desRessources Génétiques et le Centre National de <strong>la</strong> Recherche Scientifique.RÉFÉRENCES[1] Cagelli L., Lefèvre F., Conservation of Populus <strong>nigra</strong> and gene flow with cultivatedpop<strong>la</strong>rs in Europe, For. Genet. 2 (1995) 135-144.[2] Gardes M., Bruns T.D., Community structure of ectomycorrhizal fungi in aPinus muricata forest: above- and below-ground views, Can. J. Bot. 74 (1996)1572-1583.[3] Gardes M. & Bruns T.D., ITS-RFLP matching for the identification of fungi. in:C<strong>la</strong>pp JP.(éd.), Methods in Molecu<strong>la</strong>r Biology: Species Diagnostics Protocols:PCR and Other Nucleic Acid Methods. Totawa: Humana Press Inc., 1996, pp.177-192.[4] Gardes M., Bruns T.D., ITS primers with enhanced specificity for basidiomycetes-applicationto the identification of mycorrhizae and rusts, Mol. Ecol. 2(1993) 113-118.[5] Giovanetti M., Mosse B., An evaluating of techniques for measuring vesicu<strong>la</strong>rarbuscu<strong>la</strong>rmycorrhizal infection in roots, New Phytol. 84 (1980) 489-500.[6] Guinberteau J, Courtecuisse R., Diversité des champignons (surtout <strong>mycorhiziens</strong>)dans les écosystèmes forestiers actuels, in: Le Tacon F. (éd), Champignonset mycorhizes en forêt, Revue Forestière Française, 1997, pp. 25-39.[7] Horton T.R., Bruns T.D., The molecu<strong>la</strong>r revolution in ectomycorrhizal ecology:peeking into the b<strong>la</strong>ck-box, Mol. Ecol. 10 (2001) 1855-1871.[8] Kormanik P.P. & McGraw A.C., Quantification of vesicu<strong>la</strong>r-arbuscu<strong>la</strong>r mycorrhizaein p<strong>la</strong>nt roots. in Schenck N.C. (éd.), Methods and principles of mycorrhizalresearch, The American Phytopathological Society, St Paul Minnesota,1984, pp. 37-45.[9] Lefèvre F, Legionnet A., Va<strong>la</strong>don A., Vil<strong>la</strong>r M., Programme national de conservationde Populus <strong>nigra</strong>, Commission Technique Nationale de Conservation desRessources Génétiques Forestières, 2 Mai 1996, 10 p.[10] Lodge D.J., Negative associations among VA-mycorrhizal fungi and some ectomycorrhizalfungi inhabiting the same root system, Oikos 57 (1990) 347-356.[11] Lopez Aguillon R., Garbaye J., Some aspects of a double symbiosis with ectomycorrhiza<strong>la</strong>nd VAM fungi, Agricul. Ecosyst. 29 (1990) 263-266.465
M. Gardes et al.[12] Molina R., Massicotte H., Trappe J.M., Specificity phenomena in mycorrhizalsymbioses: Community-Ecological consequences and practical implications, in:Allen M.F., (éd.), Mycorrhizal functionning. An integrative p<strong>la</strong>nt-fungal process,Chapman & Hall. New York, 1992, pp. 357-423.[13] Nei M, Li W.-H., Mathematical model for studying genetic variation in terms ofrestriction endonucleases, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 76 (1979) 5269-5273.[14] Phillips J.M., Hayman D.S., Improved proce<strong>du</strong>res for cleaning roots and stainingparasitic and vesicu<strong>la</strong>r-arbuscu<strong>la</strong>r mycorhizal fungi for rapid assessment ofinfection, Trans. Brit. Mycol. Soc. 55 (1970) 158-161.[15] Selosse M.A., Le Tacon F., The <strong>la</strong>nd flora: a phototroph-fungus partnership?Trends Ecol. Evol. 13 (1998) 15-20.[16] Shannon C. E., Weaver W., The mathematical theory of communication, Universityof Illinois Press, Urbana, 1949.[17] Smith S.E., Read D.J., Mycorrhizal symbiosis, Academic Press, London, 1997,605 p.[18] Van der Heidjen L., Mycorrhizal symbioses of Salix repens. Ph. D. Thesis,Wageningen, 2000, ISBN 90-5808-196-6[19] Van der Heijden M.G.A, Klironomos J.N, Ursic M., Moutoglis P., Streitwolf-Engel R., Boller T., Wienken A., Sanders I.R., Mycorrhizal fungal diversity determinesp<strong>la</strong>nt biodiversity, ecosystem variability and pro<strong>du</strong>ctivity, Nature 396(1998) 69-72.466