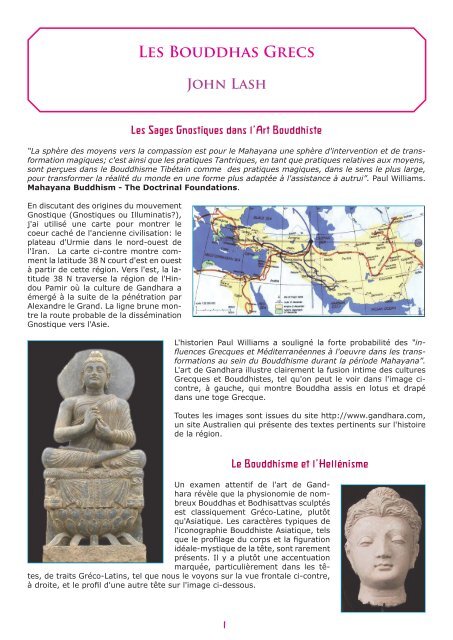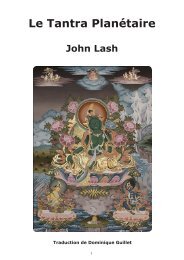Télécharger l'essai en PDF avec les illustrations. - Liberterre
Télécharger l'essai en PDF avec les illustrations. - Liberterre
Télécharger l'essai en PDF avec les illustrations. - Liberterre
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Les Bouddhas GrecsJohn LashLes Sages Gnostiques dans l'Art Bouddhiste“La sphère des moy<strong>en</strong>s vers la compassion est pour le Mahayana une sphère d'interv<strong>en</strong>tion et de transformationmagiques; c'est ainsi que <strong>les</strong> pratiques Tantriques, <strong>en</strong> tant que pratiques relatives aux moy<strong>en</strong>s,sont perçues dans le Bouddhisme Tibétain comme des pratiques magiques, dans le s<strong>en</strong>s le plus large,pour transformer la réalité du monde <strong>en</strong> une forme plus adaptée à l'assistance à autrui”. Paul Williams.Mahayana Buddhism - The Doctrinal Foundations.En discutant des origines du mouvem<strong>en</strong>tGnostique (Gnostiques ou Illuminatis?),j'ai utilisé une carte pour montrer lecoeur caché de l'anci<strong>en</strong>ne civilisation: leplateau d'Urmie dans le nord-ouest del'Iran. La carte ci-contre montre comm<strong>en</strong>tla latitude 38 N court d'est <strong>en</strong> ouestà partir de cette région. Vers l'est, la latitude38 N traverse la région de l'HindouPamir où la culture de Gandhara aémergé à la suite de la pénétration parAlexandre le Grand. La ligne brune montrela route probable de la disséminationGnostique vers l'Asie.L'histori<strong>en</strong> Paul Williams a souligné la forte probabilité des “influ<strong>en</strong>cesGrecques et Méditerrané<strong>en</strong>nes à l'oeuvre dans <strong>les</strong> transformationsau sein du Bouddhisme durant la période Mahayana”.L'art de Gandhara illustre clairem<strong>en</strong>t la fusion intime des culturesGrecques et Bouddhistes, tel qu'on peut le voir dans l'image cicontre,à gauche, qui montre Bouddha assis <strong>en</strong> lotus et drapédans une toge Grecque.Toutes <strong>les</strong> images sont issues du site http://www.gandhara.com,un site Australi<strong>en</strong> qui prés<strong>en</strong>te des textes pertin<strong>en</strong>ts sur l'histoirede la région.Le Bouddhisme et l'HellénismeUn exam<strong>en</strong> att<strong>en</strong>tif de l'art de Gandhararévèle que la physionomie de nombreuxBouddhas et Bodhisattvas sculptésest classiquem<strong>en</strong>t Gréco-Latine, plutôtqu'Asiatique. Les caractères typiques del'iconographie Bouddhiste Asiatique, telsque le profilage du corps et la figurationidéale-mystique de la tête, sont rarem<strong>en</strong>tprés<strong>en</strong>ts. Il y a plutôt une acc<strong>en</strong>tuationmarquée, particulièrem<strong>en</strong>t dans <strong>les</strong> têtes,de traits Gréco-Latins, tel que nous le voyons sur la vue frontale ci-contre,à droite, et le profil d'une autre tête sur l'image ci-dessous.1
Le chignon érigé de cheveux est caractéristique des traditions shamaniquesAsiatiques, tel qu'on le voit souv<strong>en</strong>t dans <strong>les</strong> représ<strong>en</strong>tations de Shiva, lechasseur-shaman de l'Inde Dravidi<strong>en</strong>ne. A ce jour, <strong>les</strong> sadhus errants port<strong>en</strong>tce type de chignon appelé l'ushnisha (pour mon interprétation personnellede l'ushnisha, fondée sur une expéri<strong>en</strong>ce mystique spontanée, voirHoneycomb, Light of the Christos).Vue de profil, la tête ci-contre, égalem<strong>en</strong>t <strong>avec</strong> un chignon, est purem<strong>en</strong>tGréco-Latine et ne prés<strong>en</strong>te aucune trace de physionomie Asiatique. Lasophistication du chignon est unique et reflète des coutumes loca<strong>les</strong> del'Hindou Kush ainsi que des anci<strong>en</strong>nes techniques Grecques de tressage decheveux.Une autre caractéristique des têtes de Gandhara est la moustache, considéréecomme un emprunt aux coutumes des tribus Scythes qui se déplaçai<strong>en</strong>tconstamm<strong>en</strong>t dans la région. La Scythie était une régiondont la culture attint son apogée au 4 ème siècleavant EC, lorsque <strong>les</strong> Mystères étai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core intactset prospères, à savoir 300 ans avant que leur déclinne comm<strong>en</strong>ce. Ses habitants parlai<strong>en</strong>t une diversité dedialectes Irani<strong>en</strong>s. Le Plateau d'Urmie se trouve justeà la frontière <strong>en</strong>tre la Scythie et la Parthie vers le sud,qui compr<strong>en</strong>ait ce qui est maint<strong>en</strong>ant l'Iran moderne.L'ét<strong>en</strong>due de la Scythie vers l'est atteint Gandhara.Il est significatif que la Scythie s'ét<strong>en</strong>dait vers le nordjusqu'aux montagnes de l'Oural, une région associée<strong>avec</strong> le shamanisme <strong>en</strong>théogénique utilisant l'Amanitamuscaria, ou amanite tue-mouche. (Voir Gordon,Soma: Mushroom of Immortality). Les Scythes étai<strong>en</strong>t des chasseurs-shamans nomades et <strong>les</strong> Parthesétai<strong>en</strong>t <strong>les</strong> archers <strong>les</strong> plus experts de l'anci<strong>en</strong> monde. En cohér<strong>en</strong>ce <strong>avec</strong> ce complexe chasseurshaman,certaines sculptures de Gandhara montr<strong>en</strong>t des guerriers Scythes <strong>avec</strong> des moustaches, généralem<strong>en</strong>tdépeintes comme soup<strong>les</strong> et ondulantes. Il est curieux de noter que Padmasambhava, lepersonnage suprême du Bouddhisme Tibétain, qui est réputé avoir vécu au 9 ème siècle EC, est toujoursdépeint <strong>avec</strong> une moustache, bi<strong>en</strong> que ténue et soigneusem<strong>en</strong>t taillée. Ce détail iconique est-il un vestigeatavique des guerriers-shamans Scythes de Gandhara?Il semblerait que cela soit le cas car <strong>les</strong> premières images du Bouddha historiqueapparur<strong>en</strong>t dans l'art de Gandhara et dur<strong>en</strong>t avoir fourni le prototype pourdes versions ultérieures. Cep<strong>en</strong>dant, aucun autre Bouddha ou Bodhisattva neprés<strong>en</strong>te ce trait, à l'exception de Padmasambhava.Dans son ouvrage monum<strong>en</strong>tal, Indo-Tibetan Buddhism, David Snellgrovedit que “<strong>les</strong> premières biographies de Shakyamuni, relatant son histoire, de sanaissance à son nirvana final, fur<strong>en</strong>t rédigées à Gandhara et vraisemblablem<strong>en</strong>tpour des personnes de t<strong>en</strong>dance plus réaliste qui souhaitai<strong>en</strong>t connaîtreplus de choses sur Shakyamuni <strong>en</strong> tant qu'individu”. (Vol I, page 48). Ainsi, cesont non seulem<strong>en</strong>t <strong>les</strong> représ<strong>en</strong>tations sculptura<strong>les</strong> du Bouddha mais aussi<strong>les</strong> premières biographies rédigées, qui procèd<strong>en</strong>t de la même région et durantla même période, à savoir aux <strong>en</strong>virons de 150 EC.Snellgrove affirme “qu'il est très vraisemblable que l'inspiration initiale (pour <strong>les</strong> sculptures et <strong>les</strong> narrations)émana de convertis au Bouddhisme dont la culture était Helléniste” (ibidem). “Si l'inspiration originellede créer une image du Bouddha sous une forme humaine était non-Indi<strong>en</strong>ne, ce qui semble êtrequasim<strong>en</strong>t certain, alors le Bouddha Helléniste doit avoir été le premier” (ibidem). 150 EC était la périodeprécise durant laquelle <strong>les</strong> premiers idéologues de l'Eglise comm<strong>en</strong>cèr<strong>en</strong>t à attaquer <strong>les</strong> Gnostiques et<strong>les</strong> Mystères d'une manière flagrante et viol<strong>en</strong>te. La dissémination du Gnosticisme vers l'Asie avait alorsduré depuis le temps d'Alexandre (330 avant EC), et sans doute même bi<strong>en</strong> avant.2
L'Idéal du BodhisattvaSnellgrove explique <strong>en</strong> détails comm<strong>en</strong>t l'idéal du Bodhisattvaémergea dans le Bouddhisme Mahayana aux<strong>en</strong>virons de 150 EC. Je mainti<strong>en</strong>s que ce concept étaitcompatible <strong>avec</strong> le phoster Gnostique “l'illuminateur”, uninstructeur éclairé - <strong>avec</strong> cette différ<strong>en</strong>ce, cep<strong>en</strong>dant:l'illuminateur Gnostique n'<strong>en</strong>seignait pas seulem<strong>en</strong>t l'illuminationmais développait le pot<strong>en</strong>tiel de création etd'adaptation du génie humain tel qu'il est appréh<strong>en</strong>dé pardes êtres humains éclairés. La t<strong>en</strong>dance du Bouddhismeest, de façon très prédominante, d'<strong>en</strong>seigner la voie del'illumination plutôt que la voie de la co-évolution illuminée.Cette dernière était la finalité ou le telos des Mystères.En sus de l'idéal du Bodhisattva, l'effloresc<strong>en</strong>ce de Gandharaproduisit égalem<strong>en</strong>t une série élaborée de Bouddhasqui apparaiss<strong>en</strong>t dans <strong>les</strong> âges du monde, <strong>avec</strong> une acc<strong>en</strong>tuationsur la Maitreya, “l'Ami Bi<strong>en</strong>veillant” supposéapparaître dans un âge futur. Selon Snellgrove, Maitreyaétait “très populaire à Gandhara”. Je mainti<strong>en</strong>s que lefutur Bouddha était une version du “messie” universel ouinstructeur mondial appelé Chrestos dans <strong>les</strong> cultures dela Méditerranée et du Proche Ori<strong>en</strong>t. Jusqu'au mom<strong>en</strong>t oùle Christos fut investi d'une autorité divine par Constantin<strong>en</strong> 325 EC, le nom alternatif Chrestos, le “Bi<strong>en</strong>veillant”,était utilisé par de nombreuses sectes proto-Chréti<strong>en</strong>nes,tout aussi bi<strong>en</strong> que par d'autres groupes messianiquesqui att<strong>en</strong>dai<strong>en</strong>t la v<strong>en</strong>ue d'un avatar pour l'Age des Poissons.En fait, un inv<strong>en</strong>taire du 19 ème siècle appelé <strong>les</strong> Inscriptions Chréti<strong>en</strong>nes de Blockh conti<strong>en</strong>t 1287<strong>en</strong>trées montrant “qu'il n'existe pas un seul exemple d'une date antérieure au troisième siècle où l<strong>en</strong>om Christ n'est pas écrit Chrest ou Chreist” (Lloyd M. Graham, Deceptions and Myths of the Bible,page 411). De nombreux passages dans <strong>les</strong> Codex de Nag Hammadi utilis<strong>en</strong>t Chrestos pour Christos,montrant que l'avatar divin, ou le messager-messie, att<strong>en</strong>du par de nombreuses personnes durant <strong>les</strong>premiers sièc<strong>les</strong> de l'Ere Commune, était conçu comme un instructeur pleinem<strong>en</strong>t humain, une personnificationde la bonté, un ami éclairé et un modèle d'humanité, à l'image de Maitreya.Magie et EvolutionLe Sutra Avatamsaka est l'écriture Bouddhiste la plus longue et la plus élaborée. Il prés<strong>en</strong>te un panoramavisionnaire d'une myriade de mondes qui s'interpénètr<strong>en</strong>t, rappelant <strong>les</strong> multip<strong>les</strong> Pléromes duGnosticisme. Les trois versions Chinoises qui ont survécu fur<strong>en</strong>t traduites d'un original <strong>en</strong> Sanscrit ou <strong>en</strong>Prâkrit, datant du second siècle EC, le mom<strong>en</strong>t clé dans la culture de Gandhara qui vit la formulation duBouddhisme Mahayana. Le dernier chapitre du Sutra Avatamsaka est appelé le Sutra Gandavyuha,une allusion claire à Gandhara. Il décrit le monde dans lequel nous demeurons comme un <strong>en</strong>droit qui“peut être transformé à volonté par <strong>les</strong> actes m<strong>en</strong>taux des Bouddhas et des Bodhisattvas avancés”. (PaulWilliams, Buddhist Thought, page 208).Les Bouddhas des âges du monde et le Cycle du Révélateur du Gnosticisme constitu<strong>en</strong>t deux exemp<strong>les</strong>d'un scénario d'interv<strong>en</strong>tion: à savoir, ce sont des narrations mythiques, et pseudo-historiques, qui promeuv<strong>en</strong>tl'att<strong>en</strong>te d'être éclairés et géniaux qui vont v<strong>en</strong>ir pour aider l'humanité à découvrir son chemin.Ce ne fut que progressivem<strong>en</strong>t que le Bouddha fut élevé à son niveau surnaturel. Originellem<strong>en</strong>t, dans<strong>les</strong> biographies de Gandhara, il était dépeint comme un être spirituellem<strong>en</strong>t évolué qui se réincarna pourle bénéfice d'autrui mais non pas comme une divinité supramondaine. Le Bouddhisme Mahayana, et leBouddhisme Tantrique ultérieur, explicitèr<strong>en</strong>t très précisém<strong>en</strong>t comm<strong>en</strong>t de tels êtres oeuvrai<strong>en</strong>t dans lemonde ou <strong>en</strong> influant sur le monde.3
Les Tantras Caryas sont une petite catégorie d'écritures dans le Kanjur Tibétain qui conti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t desinstructions spécifiques sur la moralité magique, comme on pourrait l'appeler. Bi<strong>en</strong> que cela ne soit pasun texte Tantrique, le Sutra Gandavyuha traite égalem<strong>en</strong>t de ces pratiques ésotériques, qui sont souv<strong>en</strong>tc<strong>en</strong>trées sur le personnage du shaman de l'éclair, Vairocana:“Pour le Gandavyuha, Vairocana est le Bouddha, demeurant dans unmonde transc<strong>en</strong>dant de luminosité, de fluidité et de métamorphosemagique, tout <strong>en</strong> étant simultaném<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>t à tous <strong>les</strong> niveaux<strong>en</strong> toutes choses. Selon cette perspective, Shakyamuni, le Bouddhahistorique, est une transformation magique produite pour le bénéficedes êtres consci<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> souffrance... L'idée du pratici<strong>en</strong> Tantrique,développant une id<strong>en</strong>tification méditative int<strong>en</strong>se, <strong>avec</strong> une évocationde la divinité, paraît émerger durant la période des textes Carya.Les pratici<strong>en</strong>s s'id<strong>en</strong>tifi<strong>en</strong>t, se visualis<strong>en</strong>t, comme une divinitééveillée occupant un univers lumineux qui peut être magiquem<strong>en</strong>ttransformé, précisém<strong>en</strong>t de la manière dont il peut être transformédans le Sutra Gandavyudha”. (Paul Williams, Buddhist Thought,page 208).Cette citation, ainsi que celle qui se trouve au début de <strong>l'essai</strong>, mett<strong>en</strong>t<strong>en</strong> exergue certains des <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts Bouddhistes Tantriques<strong>les</strong> plus ésotériques et <strong>les</strong> plus séduisants. Il est difficile d'affirmer,cep<strong>en</strong>dant, comm<strong>en</strong>t, ou si, de tel<strong>les</strong> théories sont réellem<strong>en</strong>t mises<strong>en</strong> pratique. Dans Pas <strong>en</strong> Son Image, j'ai suggéré que la theurgia(littéralem<strong>en</strong>t “travail de dieu”) des Mystères pourrait être comparéeà une “imagination active Jungi<strong>en</strong>ne ou, plus pertinemm<strong>en</strong>t, à despratiques avancées de visualisation dans le Tantra et le Dzogch<strong>en</strong>”(page 6). Le yoga de la divinité, tel qu'il est décrit dans le paragrapheci-dessus, apparti<strong>en</strong>t à la phase de développem<strong>en</strong>t du Dzogch<strong>en</strong>mais je suggérerais que la theurgia Gnostique était plus appar<strong>en</strong>téeà la phase de perfection durant laquelle le pratici<strong>en</strong> va au-delà derites d'imitation de visualisation pour atteindre l'hyperception de l'extase pleinem<strong>en</strong>t somatique. Le fluxde super-vitalité au travers des rlun ou des nadis (des canaux subtils dans le corps, supposés être aunombre de 72 000) est caractéristique de l'illumination psychosomatique de la Gnose. Dans <strong>les</strong> Mystères,<strong>les</strong> initiés se t<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t érigés, à l'image de certains Bouddhas de Gandhara (voir images). La tradition <strong>en</strong>vint à favoriser <strong>les</strong> Bouddhas assis <strong>en</strong> position de lotus intégral mais <strong>les</strong> Bouddhas debout, de style Grec,évoqu<strong>en</strong>t des représ<strong>en</strong>tations sculptura<strong>les</strong> tri-dim<strong>en</strong>sionnel<strong>les</strong> des initiés Gnostiques et il semble difficilequ'ils s'<strong>en</strong> rapproch<strong>en</strong>t beaucoup plus.Dans un s<strong>en</strong>s, le Bouddhisme est une Gnose qui est debout sur ses pieds et qui est insérée dans la nature.Les pratiques de théurgie de type Dzogch<strong>en</strong> maîtrisées par Hypatia, et quelques autres Gnostiquesdont <strong>les</strong> noms sont historiquem<strong>en</strong>t connus, n'étai<strong>en</strong>t pas des exercices <strong>en</strong> auto-déification. El<strong>les</strong> étai<strong>en</strong>tplutôt “des pratiques magiques, dans le s<strong>en</strong>s le plus large, pour transformer la réalité du monde <strong>en</strong> uneforme plus adaptée à l'assistance à autrui” (citation d'ouverture). Je suggère que, pour <strong>les</strong> Gnostiques,de tels actes de transformation magique étai<strong>en</strong>t intimem<strong>en</strong>t associés <strong>avec</strong> le fait de ress<strong>en</strong>tir la prés<strong>en</strong>cede la Déesse Sagesse, Sophia, et de communiquer <strong>avec</strong> Elle. En intégrant des connaissances de l'intellig<strong>en</strong>ceplanétaire, <strong>les</strong> te<strong>les</strong>tai des Mystères étai<strong>en</strong>t capab<strong>les</strong> de percevoir aux profondeurs du pot<strong>en</strong>tielhumain dans sa relation <strong>avec</strong> <strong>les</strong> finalités transhumaines de Gaïa. Nous avons assez de témoignages quiprouv<strong>en</strong>t qu'ils étai<strong>en</strong>t des adeptes des arts et des sci<strong>en</strong>ces de la co-évolution. Plutôt que de transformerle monde par des actes magiques, ils mettai<strong>en</strong>t leur confiance dans la possibilité qu'a le génie inné del'espèce humaine d'être tout aussi bon que n'importe quelle magie et, cultivé <strong>avec</strong> amour, dans sa facultéde produire un monde sout<strong>en</strong>able et bi<strong>en</strong>veillant.Tel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong> quelques inspirations que l'on puisse tirer de la fusion Bouddhiste-Gnostique à Gandhara.A ce jour, aucun érudit n'a exploré ces parallè<strong>les</strong> (à l'exception, peut-être, de l'érudit Bouddhiste, J. M.Reynolds, qui a écrit des manuscrits non publiés sur le Bouddhisme et le Gnosticisme. Le principal texteà avoir survécu sur la théurgie est On the Mysteries par Iamblichus. Il conti<strong>en</strong>t de nombreux passagesqui prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une comparaison étroite <strong>avec</strong> l'instruction Dzogch<strong>en</strong> sur le développem<strong>en</strong>t et <strong>les</strong> phasesde perfection de l'Ati Yoga.John Lash. 17 octobre 2006Traduction de Dominique Guillet4