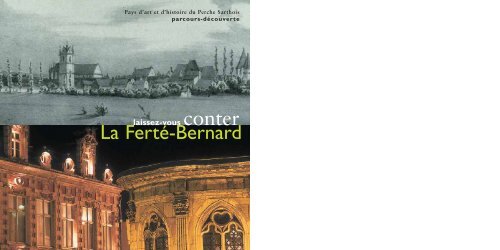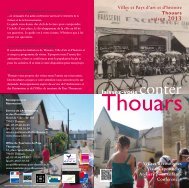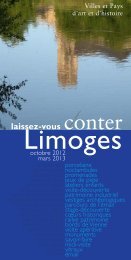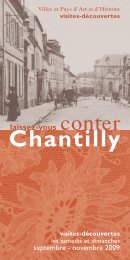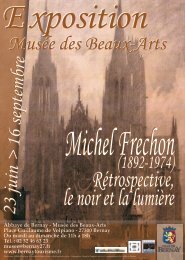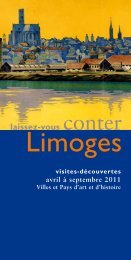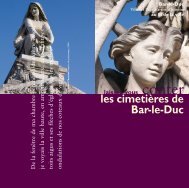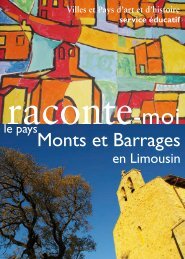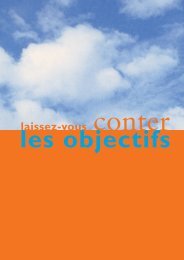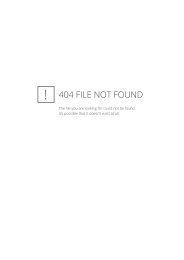Laissez-vous conter La Ferté Bernard - Villes et Pays d'art et d'histoire
Laissez-vous conter La Ferté Bernard - Villes et Pays d'art et d'histoire
Laissez-vous conter La Ferté Bernard - Villes et Pays d'art et d'histoire
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Le moulin à foulon, début XX esiècle, actuellement reconvertien maison de r<strong>et</strong>raite.Eglise Notre-Dame-des-Marais,vitrail de l’Ecce Homo offert parla famille Heullant, détail desdonateurs, bas-côté sud duchoeur, vers 1540 <strong>et</strong> XIX e siècle.Vue hypothétique de la porteSaint-Barthélémy détruite vers1835, estampe.<strong>La</strong> place Saint-Julien audébut du XX e siècle.L’ancien couvent des Filles deNotre-Dame depuis la rue duPré Belard.des ambitions parfaitementlisibles dans l’exceptionnelchantier de l’église Notre-Dame-des-Marais. Les travauxL’adaptation de l’enceintePrimitivement constituée deportes Saint-Barthélémy <strong>et</strong>surtout Saint-Julien, seuleconservée, présentent le mêmesouci d’adaptation au canon.Le développement des faubourgsA l’extérieur de l’enceinte, auxabords des deux portes d’accèsà la ville, deux lieux de marchéConstitué de maisons à pansde-boisincendiées au cours duAux XVII e <strong>et</strong> XVIII esiècles : une ville à l’étroitL’implantation des couventsà la périphérie de la villeravagé en 1624 <strong>et</strong> reconstruiten pierre, ce qui explique la1636 dans le faubourg desGuillotières. Les bâtiments desFilles de Notre-Dame, partiellementconservés, ne sontsont dirigés par des notablestalus de terre <strong>et</strong> de palissades deL’enceinte est renforcée uneexistent dès le XIII e siècle sursiège de 1590, il est agrandiAprès c<strong>et</strong>te période derelative rar<strong>et</strong>é des maisons encependant édifiés qu’à la fin duréunis au sein du conseil debois renforçant la protectiondernière fois en 1589-90 dans ledes places triangulaires. Autourvers le nord avec la création encroissance urbaine, le XVII ecolombage dans la villeXVII e siècle.ville. <strong>La</strong> population vit alorsofferte par la rivière, l’enceintecontexte des Guerres dese développent des faubourgs,1585 de cinq loties séparées parsiècle est surtout marqué par leancienne. <strong>La</strong> bourgeoisieEnfin, après la fin des Guerresprincipalement de laest probablement reconstruiteReligion. <strong>La</strong> ville haute estd’abord spontanément, puis audes canaux. A l’est, le long deconfinement de la ville àconstruit peu, elle préfèrede Religion, l’enceinte est d<strong>et</strong>ransformation <strong>et</strong> de laen pierre dans la seconde moitiéégalement munie d’une enceinteXVI e siècle à l’initiative desla route du Mans, le champ del’intérieur de ses murs.résider dans ses domainesplus en plus perçue commecommercialisation des produitsdu XIV e siècle. Elle conservedont la datation, le tracé <strong>et</strong> laseigneurs locaux ou grandsla Cougère est divisé en six<strong>La</strong> ville est construite essentiel-ruraux des paroisses environ-inutile <strong>et</strong> contraignante. Enagricoles. Plusieurs moulinsson tracé primitif tout enforme restent hypothétiques.propriétaires religieux soucieuxcarrés en 1534, <strong>et</strong> complété enlement en pan-de-bois ; or lanantes ou dans des villes plustransférant sa propriété à lasont installés sur les canaux,incluant le Bourgneuf. Après lesTrois portes y sontde valoriser leurs terres. A1555 avec la création de douzedensification progressive duimportantes comme Le Mansmunicipalité, l’édit royal decomme le moulin à tan utilisantdégradations de la Guerre dementionnées, sur l’axe reliantl’ouest, le faubourg Saint-Julienlots de forme allongée, desservisbâti facilite la propagation desou Paris. Toutefois, des ordres1696 perm<strong>et</strong> enfin à la ville dele tanin pour la transformationCent Ans, une nouvelle recons-Paris au Mans <strong>et</strong> sur la routese forme à proximité de l’hôtel-<strong>et</strong> limités par des alléesincendies. Outre la destructionreligieux, privilégiant unese libérer définitivement de sondes peaux ou le moulin àtruction de la fortification a lieud’Orléans à l’Est.Dieu mentionné dès 1234, ledescendant du pré Belard, <strong>et</strong>des faubourgs Saint-Julien <strong>et</strong>implantation urbaine,carcan défensif médiéval.foulon exploité pour apprêterles étoffes.vers 1450-1490, elle est alorsadaptée à l’artillerie apparue aulong de la chaussée venant deSaint-Antoine-de-Rochefort.formant le faubourg desGuillotières. Ainsi la populationSaint-Barthélemy lors du siègede 1590, le Bourgneuf ests’installent dans les faubourgs,les Recoll<strong>et</strong>s en 1602 à l’est decours du conflit. Les deuxde la ville est portée à 1000la route du Mans, les Filles dehabitants environ.Notre-Dame à l’ouest en 1631-4 5
Vue de l’Huisne <strong>et</strong> du front estde la fortification depuis lepont de la rue DenfertRochereau. A l’arrière-plan, latour Lepell<strong>et</strong>ier <strong>et</strong> les GrandsMoulins.Le P<strong>et</strong>it Mail, premièremoitié du XX e siècle.<strong>La</strong> gare de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>,construite en 1854,aménagement urbain 2006.<strong>La</strong> gare de tramway, avenue de <strong>La</strong>République, dans la première moitiédu XX e siècle. Détruite en 1949, elleest remplacée par un jardin publicdans les années 1950, complétéd’une piscine découverte en 1961.<strong>La</strong> ville sort de ses mursDans ce contexte, l’enceinte estpeu à peu démantelée, les tourssont vendues à des propriétairesqui les utilisent commepavillons de jardin, ou bien lesarasent pour accéder plusfacilement à la rivière.L’enceinte disparaît progressivement,laissant des vestigessouvent très remaniés <strong>et</strong> peulisibles. <strong>La</strong> tour Lepell<strong>et</strong>ier,visible des ponts des ruesDenfert-Rochereau <strong>et</strong>Bourgneuf est l’un des élémentsles mieux conservés. Au XVIII esiècle, à l’ouest, le grand dosd’âne est converti enpromenade publique <strong>et</strong>dépotoir, tandis que de part <strong>et</strong>d’autre du front nord del’église, des mails sont plantésd’arbres.Toutefois, les portes, lieux deperception de l’octroi*, résistentjusqu’à la fin de l’AncienRégime à la pression urbaine.Dans la ville haute, les portesdu Mans <strong>et</strong> de Paris sontdétruites en 1773 lors de lacréation de la route royale <strong>et</strong> decelle en direction d’Orléans vers1822-23. <strong>La</strong> porte Saint-Barthélémy disparaît vers1835-36 pour l’élargissement dela route vers Mamers, <strong>et</strong> ladécision finale de reporter l<strong>et</strong>racé au nord de la ville épargnefinalement la Porte Saint-Julienvouée au même sort.L’amélioration des voies decommunication, favorisée parl’essor démographique, accélèrele développement de la ville auXIX e siècle.Une époque de transitionExtensions <strong>et</strong> annexionsau XIX e siècleAprès l’échec du proj<strong>et</strong> de routede Mamers par l’intérieur de laville, un nouveau tracé entraînedans les années 1860 lacréation de la Rue Denfert-Rochereau, rejoignant lachaussée de Saint-Antoine sur laplace Saint-Julien. Le long dec<strong>et</strong> axe, de nouvelles maisonssont construites autour de laplace de la République créée aunord de l’église au milieu duXIX e siècle.Sur le territoire de la communede Saint-Antoine-de-Rochefort,la création de la gare en 1854sur le tracé de la ligne Paris-Brest entraîne le développementdes échanges avec la ville de <strong>La</strong>Ferté <strong>et</strong> facilite l’industrialisationde la ville. Celle-cicomptera notamment deuxfonderies, une cartonnerie <strong>et</strong>une filature de toile, au débutdu XX e siècle. L’anciennechaussée de Saint-Antoinedevenue insuffisante est alorsdoublée de l’avenue de laRépublique.L’urbanisation croissanteentraîne le rattachement à <strong>La</strong>Ferté-<strong>Bernard</strong> de Saint-Antoine<strong>et</strong> d’une partie de Cherreau <strong>et</strong>Cherré en 1889. C<strong>et</strong>te étape estimportante dans l’essor de laville, sa population augmentede plus de 1500 habitants,passant ainsi à plus de 5000.Mais surtout, la ville se doteainsi d’un territoire agricole quilui faisait défaut jusque là, dansla vallée <strong>et</strong> sur le plateau deBonnétable.L’ère Georges Desnos,politique sociale <strong>et</strong>modernisation de la villeAu début du XX e siècle,l’amélioration des transports sepoursuit par la création delignes de chemin de fer d’intérêtlocal. Aussi, une gare d<strong>et</strong>ramways (à l’emplacement del’actuelle piscine découverte) estconstruite par l’architecte LouisHarel de la Noë en 1898.Elle relie <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> <strong>et</strong> lacampagne environnante : àMamers, au nord-ouest, via <strong>La</strong>Détourbe près de Dehault, <strong>et</strong> àMontmirail, au sud-est, en1916. Non rentable, le trafic dutramway s’arrête dès 1933 versMontmirail <strong>et</strong> en 1947 versMamers.Georges Desnos, maire de 1910à 1941, mène une politiqueglobale visant à moderniser <strong>et</strong> àdévelopper la ville tout enaméliorant les conditions de viedes classes populaires.Constitué de ruelles <strong>et</strong> depassages densément bâtis demaisons anciennes souvent enmauvais état, le centre ville,soumis régulièrement auxinondations, est alors insalubre.Georges Desnos fait créerl’avenue du Nord, qui porteaujourd’hui son nom, pourbarrer la vallée <strong>et</strong> lutter contreles inondations. Ce proj<strong>et</strong> offredu travail aux indigents <strong>et</strong>perm<strong>et</strong> de créer de nouveauxquartiers. Pour ce faire, il fondel’office public d’habitations àbon marché (H.B.M.), àl’origine du lotissement de la6 7
Vue générale de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> depuis la route duMans, au début du XX e siècle.Au premier plan, la ferme de<strong>La</strong> Fontaine désormais inséréedans la ville.Buste de Georges Desnos(1871-1944) par D. Ledoux-Lebard, modèle en plâtrepeint, mairie de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>. Le bronze se trouvedans le jardin public, avenuede <strong>La</strong> République.Entreprise Souriau, bâtimentd’accueil, rue Robert Surmont,début des années 1960.Parc d’activités du Coûtier, 2000.Parc d’activités des Ajeux, crééen 1992, aménagement paysagerPascale Hann<strong>et</strong>el, 1997.rue Robert Surmontnotamment. L’amélioration deséquipements publics estégalement notable par l’électrification,l’arrivée de l’eaupotable, la création desabattoirs <strong>et</strong> d’importantstravaux de voirie. Le centreville est réaménagé au profit derues mieux aérées <strong>et</strong> debâtiments neufs comme lemarché couvert en béton armé,qui remplace “les taudis” de larue Delaborde (qualifié comm<strong>et</strong>els par George Desnos) avantd’être détruit à son tour en2007.<strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> depuis1950, un développementsans précédentLes “trente glorieuses” :de l’économie agricole audéveloppement industriel<strong>La</strong> ville se développe surtoutdans la seconde moitié du XX esiècle grâce à plusieurs facteursconcomitants. En eff<strong>et</strong>, ellebénéficie d’une situationgéographique stratégique entreParis <strong>et</strong> l’Ouest de la France,d’espace <strong>et</strong> d’une main-d’œuvredisponible en raison de l’exoderural ; celle-ci est encore peuqualifiée au sortir de la guerre,mais travailleuse <strong>et</strong> “docile”.Ces conditions, conjuguées auxincitations de l’Etat <strong>et</strong> à unepolitique volontariste de lacommune, concourent à unenouvelle industrialisation de laville à partir des années 1960.Ainsi, l’entreprise deconnectique Souriau s’implanteà <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> dans lecadre de la politique dedécentralisation industrielle en1961. En outre, la traditiond’élevage de la vallée del’Huisne favorise le développementde l’industrieagroalimentaire avec la créationde la Socopa en 1956comprenant un abattoir <strong>et</strong> uneboucherie industrielle.<strong>La</strong> création d’emplois génèredes besoins en matière delogement <strong>et</strong> d’infrastructures d<strong>et</strong>ransport. Les proj<strong>et</strong>s d’équipementscollectifs se multiplient <strong>et</strong>transforment peu à peu laphysionomie de ce paisible cheflieu de canton rural.<strong>La</strong> création de l’autoroute A11entre Paris <strong>et</strong> Le Mans <strong>et</strong>l’ouverture d’un échangeur àproximité de la ville au milieudes années 1970 confortentc<strong>et</strong>te évolution. Néanmoins,dans la seconde moitié du XX esiècle, la ville s’étend principalementdans la vallée,notamment au sud où l’avenuedu Général de Gaulle est percéedans les années 1960 dans lecadre de l’urbanisation du Prédu Château.Parallèlement, la ville évolue aunord-ouest avec la création desH.L.M. du Gaillon, <strong>et</strong> à l’estavec ceux de la rue d’Orléansassociés dans les années 1970aux lotissements de l’avenuePierre Brulé <strong>et</strong> du quartier del’Argenterie.En moins de trente ans, cedéveloppement entraîne ledoublement de la populationqui passe de 5442 habitants en1954 à 9614 en 1982.<strong>La</strong> ville aujourd’huiBien pourvue en équipementsde base, la ville de <strong>La</strong> Ferté selance, au tournant des années1980-90, dans une politique decréation d’équipementsculturels, touristiques <strong>et</strong> sportifsafin de renforcer la qualité deson cadre de vie. Son développementspatial s’oriente vers lesud de la vallée avec laréalisation d’une vaste base deloisirs en 1989 reliée à la villepar des installations sportives <strong>et</strong>le complexe culturel Athéna.Depuis le début des années2000, l’attractivité de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> perm<strong>et</strong> la création delotissements périphériques <strong>et</strong> denouvelles zones industrielles àproximité de la route du Mansdans l’ancienne prairie desAjeux, route de Mamers, <strong>et</strong> à lasortie de l’autoroute où sedéveloppe actuellement laplateforme logistique duCoûtier.L’extension périphérique de <strong>La</strong>Ferté-<strong>Bernard</strong> fait l’obj<strong>et</strong> d’uncontournement progressif del’agglomération dont le premiertronçon reliant la route duMans à la route de Mamers estouvert en 2005. Il devrait seprolonger en 2010 jusqu’à laroute de Saint-Calais (D1) auniveau de l’accès à l’autoroute.Longtemps enfermée dans sesmurs, <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> estdésormais une p<strong>et</strong>ite villeouverte sur l’extérieur. Sondynamisme soutenu par l’Etat,la Région <strong>et</strong> le Départements’inscrit dans une démarcheintercommunale de proj<strong>et</strong>s enlien avec la Communauté deCommunes de l’HuisneSarthoise <strong>et</strong> le <strong>Pays</strong> du PercheSarthois.8 9
Vue de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>depuis le nord-ouest au débutdu XIX e siècle. Lithographiede Saint-Elme-Champ, 1826.<strong>La</strong> chapelle Saint-Lyphard,restaurée dans les années 1980après son rachat par la ville <strong>et</strong> saprotection au titre desMaisons anciennes entre le brasde rivière du Pavillon <strong>et</strong> la rueDelaborde, détruitesprogressivement à partir dePortrait du Duc d’Orléans,fondateur de l’oratoire.Vitrail de la chapelle Saint-Lyphard, 1990. Imaginé par<strong>La</strong> porte Saint-Julien, avant leremplacement du linteau en boisdu passage par un arc en pierredans le troisième quart du XIX eMaison de la famille Paumier-Mauger, construite en 1906,actuellement Espace Jeunesse.Monuments Historiques en 1981.l’entre-deux guerres.Denis Béal<strong>et</strong> <strong>et</strong> réalisé parsiècle, par J. Jacott<strong>et</strong>, lithographieDidier Alliou / Vitrail France.Lemercier.PARCOURS 1Le centre ancien,d’un lieu à l’autrePromenade de 1,5 km / 45 mn environLe site du château <strong>et</strong> lachapelle Saint-Lyphard<strong>La</strong> structure générale ducastellum* fondé au XI e sièclepar Avesgaud est conservée.<strong>La</strong> forteresse qui comprend àl’origine une motte, butte d<strong>et</strong>erre artificielle portant la tourmaîtresse, dite tour du Trésor,est placée au centre d’uneenceinte totalement entouréed’eau, sur laquelle s’appuientles principaux bâtiments. Un<strong>et</strong>our-porche m<strong>et</strong> en communicationpar l’intermédiaire deslices*, dont la place actuelleconserve le nom, le château <strong>et</strong>la ville située dans l’anciennebasse-cour.Partiellement détruit en 1392sur ordre du roi Charles VI,suite à la tentative d’assassinatd’Olivier de Clisson, connétablede France par Pierre de Craon,seigneur de <strong>La</strong> Ferté, le châteauest alors confié à Louis 1 erd’Orléans, frère du roi. Lesreconstructions partielles dulogis <strong>et</strong> de la chapelle Saint-Lyphard lui sont attribuées. <strong>La</strong>fortification est renforcée àcréation de boulevards*d’artillerie le long des canaux <strong>et</strong>sur l’arrière du logis où ilsexistent toujours.<strong>La</strong> tour-porche <strong>et</strong> la tour duTrésor sont détruites lors d<strong>et</strong>ravaux d’urbanisme vers 1830-1850 pour le percement de larue Alfred Marchand. Le logisseigneurial en fond de cour,amputé de son aile en r<strong>et</strong>our,remonte en partie à la fin duXV e siècle; il est agrandi auXVII e siècle, la galerieextérieure en témoigne.Aux XIX e -XX e siècles, l’édificeest amputé de son aile en r<strong>et</strong>ourle long du canal <strong>et</strong> fortementremanié.<strong>La</strong> restauration de la chapelleSaint-Lyphard, dans les années1980 après son rachat par laville, a permis de m<strong>et</strong>tre au jourune ouverture de forme romaneperm<strong>et</strong>tant de faire remonter saconstruction à la fin du XII e ouau début du XIII e siècle, peutêtreaprès l’urbanisation de labasse-cour. Son volume initialest complété à la fin du XIV esiècle d’un p<strong>et</strong>it oratoire* deEn rejoignant la porte Saint-Julien par la rue Florant, àproximité immédiate del’embarcadère, <strong>vous</strong> pourrezvoir les restes de l’enceinteurbaine reconstruite après laguerre de Cent Ans, vers 1450-1480. Les vestiges conservés,peu nombreux, montrent unecourtine* peu élevée, primitivementsurmontée d’un parap<strong>et</strong>crénelé, <strong>et</strong> probablementrenforcée de terre à l’arrière. <strong>La</strong>canonnière* bouchée, visible àl’extrémité du mur, montrel’effort d’adaptation du systèmedéfensif à l’artillerie alors enplein développement. L’enceinteest protégée par un dos d’âne,fort talus de terre dont la rueFlorant emprunte le tracé.<strong>La</strong> vaste maison voisine, destyle néo-régionaliste, est édifiéeen 1906 à l’emplacementapproximatif de la motte. Ellecontraste avec les maisonsalentour par son toit pentu <strong>et</strong>débordant, ses couleurs <strong>et</strong> sondécor aux motifs végétauxcourbes d’inspiration ArtNouveau*, très en vogue audébut du XX e siècle.<strong>La</strong> Porte Saint-JulienMentionnée pour la premièrefois en 1476, c<strong>et</strong>te porte existeprobablement dès l’origine de lafortification. L’édifice actuel estreconstruit, en même temps quel’enceinte vers 1480. Forméed’un corps de bâtiment carrétraversé par deux passagescharr<strong>et</strong>ier <strong>et</strong> piétonnier fermésde ponts-levis, herse* <strong>et</strong> portesdont les ancrages demeurentvisibles, elle est défendue pardeux grosses tours surmontéesd’un chemin de ronde* àcréneaux* <strong>et</strong> mâchicoulis*.partir des années 1470 par lastyle gothique.10 11
<strong>La</strong> porte Saint-Julien depuisla rue d’Huisne, premiertiers du XX e siècle.<strong>La</strong> porte Saint-Julien, détail desmâchicoulis <strong>et</strong> la tour-clocher del’église Note-Dame-des-Marais.Rue d’Huisne, façade de maison,deuxième quart du XVI e siècle(détruite). Cliché Félix Martin-Rue d’Huisne, accès à la cour de<strong>La</strong> Chaussumerie, grotesque.Façade sur rue de l’hôtelCourtin de Torsay avant lacréation des lucarnes dans lesSabon, antérieur à 1897.années 1870, dessin.Plusieurs ouvertures de tirsmarquant l’adaptation de ladéfense à l’artillerie sontL’axe fondateur dela ville : la rue d’Huisne<strong>et</strong> la rue Carnotenduits sont remaniées au fil dutemps ; cependant lestransformations touchentL’hôtel Courtin de Torsay,50 Rue d’HuisneC<strong>et</strong>te vaste demeure est l’un desvisibles.affectation comme hôtel de villebois par une voûte en pierre.En passant sous la porte Saint-l’emprise du parcellaireprincipalement les façades sursubsistent comme celui de larares exemples fertois d’hôtelOuvrage militaire, la Portede 1703 à 1907. Les aménage-Principal vestige de laJulien, <strong>vous</strong> empruntez l’axe demédiéval. Les plus anciennes, derue, aussi les élévationsCour de la Chaussumerieparticulier* de la fin du XVII eSaint-Julien possède aussi unements intérieurs sont modifiésfortification urbaine, la portecommunication le plus ancien.la fin du XV e <strong>et</strong> du début dupostérieures assez biensignalée par un personnagesiècle. Probablement construitfonction ostentatoire <strong>et</strong><strong>et</strong> de nouvelles ouverturesSaint-Julien, protégée au titreDéveloppé au Moyen Age, ilXVI e siècle, adoptent souventconservées sont visibles depuissculpté supposé porter un sacpour la famille Courtin, famillejuridique, comme lieu decréées. Dans les années 1870,des Monuments Historiquesperm<strong>et</strong> la traversée de la villeune formule composée d’unle P<strong>et</strong>it Mail. <strong>La</strong> maison situéede chaux sur l’épaule en guisede magistrat au parlement deperception de l’octroi* : sapour faciliter l’accès à l’étage,depuis 1875, symbolise, plusdepuis les routes de Mamers <strong>et</strong>corps de logis sur rue, desserviau n°31 est caractéristique de ced’enseigne commerciale.Paris, son plan, développé enmonumentalité <strong>et</strong> son décorune tourelle d’escalier estque tout autre monument, laBonnétable par l’intermédiaireà l’arrière par une tourmodèle.Ces espaces sont peu à peulargeur, contraste avec celui desexpriment l’importance que seajoutée par l’architecte Darcy.ville de <strong>La</strong> Ferté auprès desde la chaussée de Saint-Antoine,d’escalier <strong>et</strong> traversé par unMalgré la densité de lareliés par des passerelles àmaisons édifiées sur desdonne alors la cité. Ce rôle seParallèlement, plusieursSarthois. Elle marque aussi lavers la route du Mans par lapassage latéral donnant sur uneconstruction, le bâti n’a pasl’extérieur de la ville, à partir deparcelles étroites. De même, sontrouve renforcé par l’abandoncampagnes de travauxlimite entre le centre historiquerue Bourgneuf <strong>et</strong> la porte Saint-cour où se trouve un secondcolonisé tout l’espace à l’arrièrela création des mails* plantésélévation est beaucoup plusde sa vocation militaire après leextérieurs transforment l’accès<strong>et</strong> les extensions des XIX e <strong>et</strong>Barthélémy. De part <strong>et</strong> d’autrelogis en fond de parcelle reliéde la rue ; quelques passagesd’arbres au XVIII e siècle.régulière que celle des maisonssiège de la ville en 1590 <strong>et</strong> sonà la ville : création d’un pontXX e siècles de la ville.de la Rue d’Huisne <strong>et</strong>, plus loin,au bâtiment précédent par uneantérieures, sa façade sefixe, modification du passagede la Rue Carnot, quelquesgalerie. Ces constructionscompose de grandes ouverturesdont le sol est surélevé <strong>et</strong>maisons étroites révèlentmêlant pans-de-bois <strong>et</strong>alignées <strong>et</strong> soulignées parremplacement du plafond enmaçonneries de moellonsl’emploi d’un appareil mixte en12 13
Hôtel Courtin de Torsay,pièce postérieure droite, détail dela peinture allégorique du plafond,XVII e <strong>et</strong> XIX e siècles.Façade sur rue de l’Hôtel Courtin deTorsay <strong>et</strong> sacristie de l’église Notre-Dame-des-Marais, anciennementchapelle funéraire de Marie de Vabre,Eglise Notre-Dame-des-Marais, élévation sud, parP. Manguin, 1847.Eglise Notre-Dame-des-Marais,voûte du chœur, terminée vers1596.Eglise Notre-Dame-des-Marais,détail du garde-corps del’élévation droite de la chapelleaxiale, vers 1535.construite vers 1616-1624.briques <strong>et</strong> en pierres ; l’ensembleest couvert de deux toits brisésplus facilement aménageablesconstruites postérieurement surL’église Notre-Damedes-Maraispar ceux d’une bourgeoisieachevé en 1596. Si sa structureest de style gothique, son décorévolue au fil de l’avancement deévocations religieuses comme le1624 par la construction d’unechapelle funéraire rapidementconvertie en sacristie, l’égliseen 1840 par Prosper Mérimée.Depuis, elle fait l’obj<strong>et</strong> d<strong>et</strong>ravaux réguliers quique les hautes toitures.l’arrière du bâtiment, une seuleL’érection de la chapelle Notre-montante. Néanmoins, il fautla construction. <strong>La</strong> nef <strong>et</strong> sonRegina Coeli <strong>La</strong><strong>et</strong>are <strong>et</strong> l’AveNotre-Dame-des-Marais estconcourent au XIX e siècle àNéanmoins, la modernité desubsiste aujourd’hui.Dame au rang d’églisepourtant un siècle <strong>et</strong> demi pourportail occidental sontRegina Coelorum sur le garde-représentative du foisonnementrenforcer son caractèrec<strong>et</strong>te maison réside surtout dansDes travaux réalisés entre 1870paroissiale en 1366 entraîneconstruire une église dont lesornementés d’un décorcorps, <strong>et</strong> le répertoireintellectuel à la charnière desgothique comme le révèle lason passage latéral à porte<strong>et</strong> 1877 entraînent lel’ouverture d’un chantier dedimensions sont hors depurement gothique dont laornemental italien associé auxXV e <strong>et</strong> XVI e siècles. En eff<strong>et</strong>, sitransformation du portail sudcochère. Créé au XVII e siècleréaménagement intérieur, tandisreconstruction de l’édifice.proportion avec les besoinssobriété contraste avec lesurprenantes images profanesle plan <strong>et</strong> l’élévation de l’édificeau moment de l’aménagementpour perm<strong>et</strong>tre l’accès desque la modification de la façadeCependant, r<strong>et</strong>ardés par lesd’une population qui n’excèdechœur, conçu à l’image desde Jules César <strong>et</strong> Cléopâtre.restent caractéristiques dede la place Carnot. Depuis lesvoitures à chevaux aux écuriessur rue se limite audifficultés liées à la guerre depas mille habitants.édifices majeurs avec ses troisLe caractère exceptionnel del’architecture gothique, le décorannées 1990, les campagnes desituées à l’origine en fond deremplacement d’anciennesCent Ans, les travaux neLe chantier s’ouvre par laniveaux d’élévation contrebutésl’édifice est lié à l’émulationinspiré par l’Antiquité illustrerestauration ont repris àparcelle, il témoigne du statutarmoiries par des panneauxdébutent véritablement qu’aprèsconstruction de la nef <strong>et</strong> de lad’arcs-boutants. Son décor,entre les donateurs du chantierremarquablement lal’initiative de la mairie ende notable du propriétaire defigurés <strong>et</strong> la création des deuxla fin des troubles, vers 1450.tour dans la seconde moitié duconcentré sur la façade suddont la mémoire est conservéeRenaissance.partenariat avec l’Etat <strong>et</strong> lesc<strong>et</strong>te résidence. Des deux ailesgrandes lucarnes.<strong>La</strong> prospérité économique <strong>et</strong>XV e siècle, <strong>et</strong> il se poursuit autournée vers la ville, est enrichipar leurs armoiries sculptées surLe caractère exceptionnel decollectivités territoriales.Devenue propriété de la ville,l’essor démographiquedébut du XVI e siècle par lad’une ornementation de styleles clefs de voûtes ou associéesl’édifice a suscité son inscriptionc<strong>et</strong>te maison abrite actuellementfavorisent l’afflux de donscréation d’un chœur à troisRenaissance particulièrementà leur représentation en prièresur la première liste desla bibliothèque municipale, <strong>et</strong>royaux <strong>et</strong> seigneuriaux relayéschapelles rayonnantes muniesfoisonnante, mêlant lesdans les quelques trente-cinqMonuments Historiques crééeson passage donne accès à unde voûtes plates entre 1520 <strong>et</strong>vitraux que compte l’édifice.agréable jardin public.1545. L’édifice est finalementDéfinitivement terminée en14 15
Fontaine de la place Carnot <strong>et</strong>église Notre-Dame-des-Maraisaprès la modification du portailsud entre 1843 <strong>et</strong> 1860.Aquarelle, anonyme.Maison n°10, rue Carnot,détail du décor sculpté.Halles Denis Béal<strong>et</strong>, verrièresdu rez-de-chaussée, réaliséespar Didier Alliou,VitrailFrance, 2007.<strong>La</strong> place de la Lice <strong>et</strong> les halles, entre1914 <strong>et</strong> 1918. <strong>La</strong> statue actuelle de SaintLouis ne figure pas dans la niche audessusde la baie centrale.Charpente en chêne des halles,restaurée en 2006-2007.<strong>La</strong> fontaine <strong>et</strong> larue CarnotEn 1477, une pétition m<strong>et</strong> enévidence l’absence dans la villed’un point d’eau publicperm<strong>et</strong>tant l’approvisionnementFerté-<strong>Bernard</strong> qui se dote sousl’impulsion des notables d’équipementspublics.L’édicule actuel, constitué d’und’alignement. Ces maisonsabritent comme jadis descommerces au rez-de-chaussée<strong>et</strong> des logements dans lesétages. Leurs décors sculptésindiquent leur fonctionLes halles, unearchitecture civile desXV e <strong>et</strong> XVI e siècles,refl<strong>et</strong> de prospéritécharpente actuelle donttémoigne un marché passé en1477 <strong>et</strong> la reprise en sousœuvredes maçonneries del’édifice en 1536, à l’initiativede Antoin<strong>et</strong>te de Bourbon,conseil des habitants.L’édifice présente un plansimple <strong>et</strong> une élévationmonumentale. Haute de 20de Saint-Louis, patron desmarchands <strong>et</strong> des hommes dejustice, placée dans une nicheau décor Renaissance dominantde grandes baies. Le pignon estencadré de cross<strong>et</strong>tes1976, le rez-de-chaussée n’estplus utilisé pour le marché,d’où le proj<strong>et</strong> d’y établir unesalle des fêtes en 1899, usageen eau potable ; la seule sourcebassin octogonal <strong>et</strong> d’uncommerciale ancienne. AinsiLes premières mentions desveuve de Charles de Lorraine,mètres, la façade principale, àornementées de deux lionsconservé actuellement.est alors celle de la Cougère,obélisque en granit diamantéaux n°7 <strong>et</strong> 10, la présence dehalles de la Ferté-<strong>Bernard</strong>seigneur de la Ferté.deux niveaux, est structurée enportant autrefois les armoiriesInscrites en tant quesituée à plusieurs centaines ded’Alençon est probablementgrappes de raisin ou deremontent à la fin du XIV eDès la fin du Moyen-Age, lestrois travées coïncidant avec lade la famille de Lorraine. Enfin,“Monument Historique” enmètres hors la ville. C<strong>et</strong>tecréé en 1651 aux frais degrotesques encadrant ausiècle. Leur création devanthalles assurent une doubledivision intérieure en troisl’extrémité du faîtage est1973, les halles ont rouvert aurequête aboutit en 1483 à laRobert Hoyau.premier étage un voyageur <strong>et</strong>l’entrée du château,fonction, commerciale <strong>et</strong>espaces séparés par des pilierscouronnée d’un aigle.public en avril 2008 après unecréation d’une canalisation enDans la rue Carnot, ancien-une sirène évoque l’activité desprobablement à l’initiative desjudiciaire. Le rez-de-chausséeen chêne, soutenant depuis laRestées propriété de la famillerestauration générale deplomb <strong>et</strong> en bois conduisantnement rue des Porches <strong>et</strong> ru<strong>et</strong>avernes. Le n°10 conserve aussiseigneurs, est révélatrice duest dévolu à la vente des toiles,base de l’édifice une impression-Richelieu sous la Révolution,l’édifice pendant trois ans.l’eau de c<strong>et</strong>te source jusqu’auNotre-Dame, se situe l’ensembleau troisième niveau le restedéveloppement de la ville à lades grains <strong>et</strong> des viandes <strong>et</strong>nante charpente visible depuisles halles sont rach<strong>et</strong>ées par la“carrefour” de la ville. Sade maisons en pans-de-bois led’une représentation de lafin du Moyen-Age.l’étage sert de salle d’audiencel’étage. Equipement fonctionnel,commune en 1810. Si l’étagecréation témoigne de lamieux conservé de la ville.lapidation de Saint-Etienne.Le bâtiment actuel résulte depour l’exercice de la justiceles halles ont pour seulssert partiellement à l’exercice deprospérité de la ville de <strong>La</strong>Leurs élévations en encorbel-plusieurs phases de travauxseigneuriale <strong>et</strong> les assemblées duéléments de décor quatrela justice de proximité jusqu’enlement ont été pour la plupartdont les deux principalessculptures agrémentant leépargnées par les planssemblent être l’édification de lapignon. <strong>La</strong> principale est celle16 17
Prairie du Pré du Château,première moitié du XX e siècle.Vue aérienne de la ville, vers 1970.Au premier plan, les immeubles duL’ancienne chapelle de l’hôtel-Dieu, détruite suite à l’inondation<strong>La</strong> place de la République aprèsson réaménagement <strong>et</strong> laLe P<strong>et</strong>it Mail <strong>et</strong> la rue Denfert-Rochereau, première moitié duquartier Saint-<strong>La</strong>urent <strong>et</strong> le lycéedu 21 juin 1889. <strong>La</strong> nouvelle estréouverture du canal, en 2000XX e siècle, avant son ouverture àRobert Garnier construits au sud-construite à l’est du bâtiment,(réalisation Daniel Chevalier /la circulation automobile.ouest de la ville ancienne dans lesvers 1900.AMC <strong>et</strong> Dominique Caire /anées 1960.Feuille à Feuille).PARCOURS 2L’extension de la villeau XIX e <strong>et</strong> XX e sièclesRandonnée urbaine de 8,35 km (1h40 environ)Au-delà du cœur historique dela ville, prenez le temps d’unerandonnée urbaine.Ce parcours de 8,35 km, baliséen jaune, <strong>vous</strong> conduira àl’écart des “sentiers battus”pour découvrir des points devue inattendus sur la ville<strong>et</strong> <strong>vous</strong> perm<strong>et</strong>tre decomprendre son extensionaux XIX e <strong>et</strong> XX e siècles.Départ place du Général deGaulle, face au complexesportif.<strong>La</strong> place du Généralde Gaulle<strong>La</strong> création de la place duGénéral de Gaulle remonte àl’urbanisation du Pré duChâteau au cours des décennies1960-70 sur des terres acquisespar la ville dès les années 1930,dans le but initial de créer unaérodrome qui ne verra jamaisle jour en raison de la guerre.En eff<strong>et</strong>, jusque-là, l’endroit estoccupé par de vastes prairiesinondables dont le principalintérêt historique est à l’originede protéger la ville ancienne, àl’ouest, contre les attaquesextérieures. Ces prairiespement de l’élevage, renforcé auXIX e siècle, notamment parl’essor de l’élevage du chevalpercheron.Le site est urbanisé peu à peudepuis le début des années 1960avec la création de l’avenue duSud appelée désormais avenuedu Général de Gaulle.Prenez l’avenue du 8 mai.C<strong>et</strong> ancien espace agricole estencore occupé, jusqu’à laconstruction d’immeubles delogements collectifs à partir de1962, par d’anciennes bergerieslocaux des services techniquesde la ville avant d’êtreenglobées dans le lycée.Tournez à droite pour rejoindrela place Saint-Julien.L’ancien hôtel-DieuC<strong>et</strong>te place se forme à la fin duMoyen-Age avec la créationd’un faubourg devant la porteSaint-Julien, principale ported’accès à la ville où sedéveloppent des activitésartisanales, principalement liéesà l’utilisation de l’eau de larivière comme les tanneries.A c<strong>et</strong> endroit, un hôtel-Dieu*,converti en 2005 en résidence,établissement de charitéaccueille les plus démunis,enfants trouvés, voyageurs <strong>et</strong>malades. Son emplacement restéinchangé est à la fois prochemais hors de la ville pourpréserver les habitants d’éventuellesmaladies contagieuses.Au cours des XIX e <strong>et</strong> XX esiècles, sa fonction est adaptéeaux besoins croissants liés àl’augmentation démographiquejusqu’à la création du centrehospitalier actuel en 1979.Les bâtiments initialement enpans-de-bois <strong>et</strong> torchis sontEndommagés au cours du siègede la ville en 1590, ils sontréédifiés en 1602, puis en 1707au moment de l’arrivée dessœurs hospitalières deMortagne. Si l’édifice est encoremodifié par la suite, il conserveson allure générale sobre <strong>et</strong>imposante marquée par l’alternancede la brique <strong>et</strong> de lapierre, caractéristique du savoirfairedu maçon fertois PierrePesche.Passez devant la porte Saint-Julien <strong>et</strong> allez tout droit, puistournez à droite pour prendre leP<strong>et</strong>it Mail.Le P<strong>et</strong>it Mail <strong>et</strong> la placede la RépubliqueSur le front nord de la ville, unlieu de promenade <strong>et</strong> dedivertissement pour leshabitants - le mail - est créé dèsle XVIII e siècle. Au milieu duXIX e siècle, les aménagementsse poursuivent, l’anciencim<strong>et</strong>ière situé au pied del’église est définitivementsupprimé pour créer une vasteplace autour de laquelle desmaisons de notables sontconstruites peu à peu.<strong>La</strong> place de la Républiqueperm<strong>et</strong>tent aussi le dévelop-reconverties momentanément enexiste dès le XIII e siècle. C<strong>et</strong>reconstruits à plusieurs reprises.devient le cœur de la ville avec18 19
Faubourg des Guillotières,décor sculpté, réemploi probabledu XVI e siècle.Ruelle desservant les lottiesentre le Pré Belard <strong>et</strong> la rueGamb<strong>et</strong>ta.Site du couvent des Récoll<strong>et</strong>s,Fonderie Fatz, intérieur desbâtiments avec les ouvrierspréparant les moules, premièremoitié du XX e siècle.Centre de Secours, 2000 (AgenceBarré-<strong>La</strong>mbot, Nantes). <strong>La</strong> tour demanœuvre <strong>et</strong> de séchage, <strong>et</strong> laremise à véhicules.Centre de Secours. L’élévationdonnant sur la route de Vibraye ;conçu en béton brut, le bâtimenta été peint peu de temps après saconstruction.désaffectée dans la premièredécennie du XX e siècle. Utiliséecomme garage, elle apparaîtaujourd’hui très dégradée ;toutefois son élévation <strong>et</strong> sesgrandes ouvertures en pleincintre laissent encore deviner safonction primitive.De même, le bâtiment principalreste lisible malgré les divisions.Son élévation soignée présente,comme l’ancien hôtel-Dieu,l’alternance briques <strong>et</strong> pierres,signature de la famille demaçons fertois Pesche, intervenuesur de nombreux bâtimentsà <strong>La</strong> Ferté <strong>et</strong> dans les environs àl’image du prieuré de Tuffé.Empruntez sur une centaine demètres, la rue du Pré Belard,puis prendre une ruelle sur lagauche, ensuite tournez deuxfois à droite.Vous traversez le lotissementcréé à l’ouest de la route duMans en 1555. L’espace estalors divisé en douze lots deforme allongée, desservis <strong>et</strong>limités par des allées descendantdu pré Belard, <strong>et</strong> formant lefaubourg des Guillotières. Si leparcellaire actuel conserve sonaspect d’origine, les maisonsconstruites au fil du temps sontpour la plupart très remaniées.Néanmoins, peu avant dedéboucher sur la rue Gamb<strong>et</strong>taau n° 44, <strong>vous</strong> verrez un basreliefen pierre calcaireréemployé dans le pignon d’unbâtiment annexe ; de même lamaison bordant la route duMans conserve son volume <strong>et</strong>des percements anciens.Traversez la rue Gamb<strong>et</strong>ta parle passage piéton <strong>et</strong> montez larue de la Cougère.<strong>La</strong> rue de la CougèreVous êtes désormais dans lechamp de la Cougère qui formela partie la plus ancienne dufaubourg des Guillotières diviséen six carrés en 1534. C’estégalement le lieu de la source dela Cougère, où les Fertoiss’approvisionnent en eaujusqu’à ce qu’on installe unecanalisation à la fin du XV esiècle pour alimenter la fontainede la place Carnot.En haut de la rue, <strong>vous</strong> pourrezadmirer la vue sur la ville <strong>et</strong>découvrir son emprise actuelledans la vallée de l’Huisne.Le site du Couventdes Recoll<strong>et</strong>sVous <strong>vous</strong> trouvez désormais àla limite de l’extension de <strong>La</strong>Ferté à l’est au cours du XVII esiècle, sur la partie du territoirede Cherré annexée en 1889.Excentré, l’endroit est d’abordchoisi pour établir un nouveaucim<strong>et</strong>ière afin de pallier l’insuffisancede celui jouxtant l’égliseNotre-Dame-des-Marais auXVI e siècle. Puis, le couvent desRecoll<strong>et</strong>s fondé en 1602s’installe au somm<strong>et</strong> de lacolline. Détruit peu de tempsaprès la Révolution, il estremplacé au début du XIX esiècle par une maisonbourgeoise visible à l’extrémitéd’une allée de tilleuls.Tournez à droite pouremprunter la rue Faidherbe <strong>et</strong>rejoindre l’avenue Pierre Brûlé.Vous apercevez alors le rondpointreliant la périphériesud-est de la ville à la route deVibraye (D1).L’ancienne fonderie FatzEn 1919, dans le cadre de ladécentralisation industrielle, levaste site des Recoll<strong>et</strong>s apparaîtpropice à l’implantation d’unefonderie ardennaise. Employanttrois cents ouvriers en 1969 à laproduction de bâtis pourmachines-outils, la fonderieFatz, comme d’autres dans larégion, connaît des difficultésdans les années 1970 avant defermer définitivement ses portesen 1984. De vastes hangarstémoignent encore de c<strong>et</strong>teintense activité industrielle auxlimites de la ville.C<strong>et</strong> espace à vocation agricolejusqu’à la fin du XX e siècle esten cours d’urbanisation pourrépondre aux besoins deservices publics désormaisorganisés non plus à l’échelle dela ville mais à celle d’un bassinde vie d’un peu plus de 26 000habitants. C<strong>et</strong>te transformationdébute, en 2000, par laconstruction des casernes degendarmerie <strong>et</strong> de pompiers.L’implantation du Centre desecours, réalisé par l’agenced’architecture nantaise Barré-<strong>La</strong>mbot, marqueparticulièrement l’espace. <strong>La</strong>sobriété des matériaux, lasimplicité des formes soulignéespar des lignes épuréesperm<strong>et</strong>tent une adaptationparfaite au relief accentué dusite, tout en faisant de sa tourajourée un signal fort à l’entréede la ville. C<strong>et</strong>te architecturecontemporaine qualifieremarquablement c<strong>et</strong> espace d<strong>et</strong>ransition. Elle symbolisel’ouverture de la ville sur lacampagne environnante audébut du XXI e siècle.22 23
Lotissement deL’Argenterie, maisonsde la rue Juliot Curie.L’avenue de Verdun sur l’axe de la RD 323reliant Paris à Nantes, vers 1915. <strong>La</strong> maisondu Closeau, actuellement propriété de laville <strong>et</strong> siège du <strong>Pays</strong> du Perche Sarthois,appartenait à la famille Richard, industrielsdu moulin à tan.Le moulin des Calots, dessin deLéopold Charles (selon DenisBéal<strong>et</strong>), vers 1860. Attesté en1500, il est reconstruit au XIX esiècle <strong>et</strong> transformé encartonnerie de 1932 à 1976.Les jardins familiaux <strong>et</strong> le moulin des Calots.Actuellement, deux cents parcelles sontcultivées par des jardiniers de tous âges <strong>et</strong> d<strong>et</strong>outes conditions sociales.Poursuivez ensuite par lelotissement de l’Argenterie.Pour ce faire, traversez la rueau niveau du rond-point <strong>et</strong>empruntez la rue Pesche avantde tourner à gauche <strong>et</strong> decheminer par la rue Juliot Curiepour rejoindre la rue deChateaudun.Le lotissement del’ArgenterieFavorisé par la loi instituant leslogements économiques <strong>et</strong>familiaux (Logeco) en 1953, celotissement de soixante maisonsest décidé en 1962 dans le butde perm<strong>et</strong>tre l’accès à lapropriété des personnes auxrevenus modestes. Ces maisons,réalisées par une entreprisecoopérative, répondent aubesoin de logements de la villede <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> <strong>et</strong> plusparticulièrement à ceux généréspar l’arrivée d’une maind’œuvreextérieure au sein del’industrie en plein essor. Ellesoffrent alors un niveau deconfort non négligeable àl’époque.Rue de Chateaudun, faitesquelques mètres sur la droitepuis traversez le lotissement desFourneaux par la rue RobertGouin. A proximité des jardinsfamiliaux, tournez à droite pourlonger l’arrière du quartierrésidentiel “d’Orléans” puisl’hôpital.Les jardins familiauxde <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>Les jardins familiaux sedéveloppent à partir de la findu XIX e siècle à l’initiative del’Abbé Lemire dans le nord dela France ; ils ont pour but deperm<strong>et</strong>tre à une populationouvrière le plus souventd’origine agricole de poursuivrele travail de la terre <strong>et</strong> deprocurer à la famille une partiede son alimentation. Ces jardinsoccupent un ensemble deparcelles appartenant souvent àl’origine à des industriels oucomme ici à des communes. Eneff<strong>et</strong>, fondée en 1938, la sectionfertoise de l’association “LeJardinier Sarthois” gère ce sitecomplémentaire à celui desCalots.L’hôpital Paul ChapronLe proj<strong>et</strong> d’un nouvel hôpital,destiné à remplacer celui situédans l’ancien hôtel-Dieu, estenvisagé dès 1963. Cependant,sa construction n’est effectivequ’au début du mandat dePierre Coutable, en 1975, surl’avenue Pierre Brulé récemmentpercée. Du nom de PaulChapron, ancien maire, cenouveau Centre Hospitalierest inauguré le 22 mars 1979.Les résidences du quartierd’Orléans voisin sont achevéesla même année.Poursuivant votre parcours,<strong>vous</strong> franchirez la passerelle surle ruisseau de Saint-Symphorien<strong>et</strong> profiterez d’un cadrechampêtre aux portes de laville. Arrivé avenue de Verdun,tournez à droite pour rejoindreà votre gauche le chemin deBellevue ; arrivé rue de laBarque, remontez la rue <strong>et</strong>rejoignez le moulin puis lesjardins des Calots.L’ancien moulindes Calots<strong>La</strong> ville de <strong>La</strong> Ferté s’étend à lafin du XIX e siècle <strong>et</strong> au débutdu XX e siècle au nord, surl’espace gagné sur le territoirede Cherreau (quartier de laFosse Fondue). Elle gagne ainsides espaces essentiellementdévolus aux activités agricoles,principalement à l’élevagedéveloppé peu à peu au sein deprairies naturelles bordantl’Huisne.<strong>La</strong> rivière a toutefois de longuedate permis d’installer desmoulins, principalement à blécomme celui des Calots,reconverti en cartonnerie de1932 à 1976, avant sa transformationactuelle en résidence.Les jardins familiaux<strong>et</strong> le verger conservatoiredes CalotsSur une île située à laconfluence de l’Huisne <strong>et</strong> de laMême dépendant anciennementde la paroisse de Souvigné-sur-Même, à quelques centaines demètres du cœur historique,s’étend un vaste espace dejardins familiaux.Chassés du site du Gaillon, puisdu Pré du Château, par l’urbanisationdans les années1960-70, les jardins familiauxsont répartis dans différentsendroits à la périphérie de laville avant de s’installerdurablement aux Calots.Sur un espace de plus de8 hectares, trois cents jardinsfamiliaux, conçus par lepaysagiste Jean-Louis <strong>Bernard</strong>,sont ouverts en 1983. Prévuinitialement comme un lieu dejardinage, de rencontre <strong>et</strong> de24 25
Avenue Georges Desnos, crééesuite à l’inondation du 22novembre 1930 qui restera laAvenue de la République,première moitié du XX e siècle.On aperçoit à l’arrière-plan laSaint-Antoine-de-Rochefort,ruelle de <strong>La</strong> Fontaine.Saint-Antoine-de-Rochefort,rue Victor Hugo, premièremoitié du XX e siècle.Saint-Antoine-de-Rochefort,église Saint-Antoine.crue la plus importante du XX esiècle à <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>.gare de tramway.détente, l’aménagement du sitecontexte de crise économique,l’essor des échanges accentuésiège de la ville de <strong>La</strong> Ferté enn’a pas été réalisé en totalité, <strong>et</strong>ce vaste chantier procure dupar la création, en 1854, de la1590 puis au XIX e siècle.son plan quelque peu modifié.tournez à droite jusqu’autravail aux chômeurs de la ville.anciennes du centre ville,gare au sud-ouest du bourg, surscelle le début de la transfor-En eff<strong>et</strong>, une importanteimplantée à mi-chemin entreCependant, ses accès <strong>et</strong> sescroisement de la Rue RobertLes considérations sociales dequalifiées de “taudis”.la ligne Paris-Brest.mation de la chapelle fondée àcampagne de travaux estSaint-Antoine <strong>et</strong> <strong>La</strong> Ferté-circulations en font un lieuSurmont.Georges Desnos l’amènentAu bout de la rue RobertC<strong>et</strong>te large voie au tracél’initiative de Jean Croup<strong>et</strong> versachevée en 1873 ; elle vise la<strong>Bernard</strong>. Sa façade actuelle dateprivilégié entre ville <strong>et</strong>campagne.L’avenue Georges Desnoségalement à créer dans lesannées 1920 la société desSurmont, prenez à droite <strong>et</strong>coupez l’avenue de larectiligne est urbanisée peu àpeu entre la fin du XIX e <strong>et</strong> le1366-1380 au cœur de c<strong>et</strong>tep<strong>et</strong>ite agglomération.réfection extérieure <strong>et</strong> intérieure<strong>et</strong> perm<strong>et</strong> la création de huitdu XVIII e siècle.Prenez la Rue G. Thoreau, puisCe site est désormais complétépar un verger conservatoireen cours de création, enpartenariat entre la ville <strong>et</strong>l’association des Croqueurs dePommes qui a pour but deC<strong>et</strong>te avenue est créée dans lesannées trente à l’initiative deGeorges Desnos, maire radicalsocialistede <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>de 1910 à 1941. Ce proj<strong>et</strong>répond à une double préoccu-H.B.M., qui perm<strong>et</strong> deconstruire des lotissements demaisons ouvrières comme celuide la Rue Robert Surmont,pour offrir aux habitantsmodestes de la ville deRépublique pour prendre laruelle de la Fontaine.L’avenue de la RépubliqueElle est percée au milieu duXIX e siècle pour doublerdébut du XX e siècle,principalement par des maisonsindividuelles <strong>et</strong> par l’anciennecidrerie Legoût sur la Même.<strong>La</strong> ruelle de la Fontaine <strong>vous</strong>entraîne au cœur de l’ancienL’église Saint-Antoinede-Rochefort,Place Victor HugoL’édifice actuel correspond àl’église construite à la fin duverrières archéologiquestémoignant du renouveau del’art du vitrail en Sarthe auXIX e siècle.Empruntez ensuite la rue Victortraversez le quartier Saint-<strong>La</strong>urent jusqu’à l’avenue duGénéral de Gaulle.Le quartier duSaint-<strong>La</strong>urentsauvegarder <strong>et</strong> diffuser lespation. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te avenuemeilleures conditions del’ancienne rue, actuelle rue duvillage de Saint-Antoine-de-XIV e siècle. Néanmoins,Hugo sur quelques dizaines deIl est réalisé à partir des annéesanciennes variétés de fruits.est formée par la création d’unelogement que celles qu’ils4 septembre, reliant la Ferté-Rochefort.l’élévation porte la marquemètres puis tournez à droite à1965 suite à l’acquisition par laEmpruntez la passerelle situéedigue dans le but de lutterconnaissent dans les maisons<strong>Bernard</strong> vers Mamers par leInitialement développé sur led’interventions multiples auproximité d’une imposanteville des terres de l’ancienneau sud-est pour rejoindrecontre les inondations liées auxbourg de Saint-Antoine-de-territoire de Cherré, Saint-XVI e siècle dans le stylemaison du XVI e siècle. Sonferme Saint-<strong>La</strong>urent en 1964.l’avenue Georges Desnos, <strong>et</strong>crues fréquentes de l’Huisne <strong>et</strong>Rochefort. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong> axeAntoine-de-Rochefort est érigégothique tardif, notammentimportance <strong>et</strong> sa porte cochèreIl résulte d’une demandede la Même. De plus, dans leancien devient insuffisant avecen paroisse en 1527. C<strong>et</strong>te datesuite à sa détérioration lors dusignalent une ancienne aubergecroissante de logements à <strong>La</strong>26 27
Quartier du Saint-<strong>La</strong>urent,immeubles créés à partir de 1965<strong>et</strong> rénovés en 2000.Vue aérienne avec au premierplan les immeubles du Pré duChâteau construits vers 1965.Le lycée Robert Garnier <strong>et</strong> lerond-point de l’avenue de Gaulle.Le j<strong>et</strong> d’eau est le trait d’unionentre la ville ancienne marquéepar les canaux <strong>et</strong> le plan d’eau.Complexe culturel Athéna,1994, vue générale depuis laplace de Gaulle (architecteGaëlle Peneau, Nantes).Complexe culturel Athéna,élévation postérieure, détail.A l’arrière-plan, la salleOlympe (architecte DenisKopp, Ermo, 1996).Ferté-<strong>Bernard</strong> en lien avec ledéveloppement de l’entrepriseSouriau. L’architecte Guy Barbéassocié au fertois Gaubertconçoit un proj<strong>et</strong> de 540logements collectifs répartisentre F3, F4 <strong>et</strong> F5 <strong>et</strong> pavillonsindividuels. <strong>La</strong> construction desimmeubles s’échelonne jusqu’en1974, elle concerne desbâtiments comprenant entre4 <strong>et</strong> 10 étages. Ces immeublessont réalisés par l’entrepriseJ.S.R. (Jangot-Sonebec réunis)selon le procédé préfabriquéFoulquier largement utilisé dansles programmes de logementscollectifs de l’époque. Lestravaux se poursuivent jusqu’audébut des années 1980 par laconstruction des maisonssituées au sud de l’avenue.Le quartier Saint-<strong>La</strong>urentprévoit dès l’origine nonseulement un programme delogements mais aussi des accèspiétonniers <strong>et</strong> routiers, desespaces collectifs comme desaires de jeux, des servicespublics <strong>et</strong> des lieux de détente<strong>et</strong> de promenade. Le centresocio-culturel <strong>et</strong> l’espacecommercial envisagés au départne sont pas perçus comme utilescompte tenu de l’intégration duSaint-<strong>La</strong>urent à la ville <strong>et</strong> auxservices existant à Saint-Antoine ou dans le centre ville ;en revanche une écolematernelle est construite en1977. C<strong>et</strong>te conceptiond’ensemble a assuré la réussitede ce quartier dont lesimmeubles collectifs ont étéréhabilités par le cabin<strong>et</strong>d’architecture IDEA <strong>et</strong> lebureau d’études ECTS de 1997à 1999.Suivre à gauche l’avenue duGénéral de Gaulle, franchir laMême <strong>et</strong> rejoindre la place duGénéral de Gaulle. Vous verrezsur votre gauche le lycéeRobert Garnier.Le lycée Robert GarnierDécidé par la ville en 1961, ilest conçu par Guy Barbé,architecte parisien originaire dela Ferté-<strong>Bernard</strong>. C<strong>et</strong> établissementscolaire comprenant unlycée d’enseignement général <strong>et</strong>un lycée technique est terminéen 1967. Il tire son nom dupoète <strong>et</strong> dramaturge de laRenaissance, Robert Garnier, néà <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> en 1545 <strong>et</strong>mort au Mans en 1590. Prévupour 1180 élèves, dans uncontexte de forte croissance dela ville, il en accueille désormais1300 venant du secteur de <strong>La</strong>Ferté-<strong>Bernard</strong> <strong>et</strong> des cantonsvoisins. Son architectureimposante reposant sur unestructure en béton complétée defaçades planes <strong>et</strong> rectilignesaffiche l’ambition de démocratisationscolaire de l’époque.En face, la salle de sportsGérard Dutertre rénovée en2006 par l’agence d’architectureA3dess fait partie du mêmeprogramme ; le bâtiment dumarché-fermier y est accolédepuis 2004.Entre-temps, à l’initiative dePierre Coutable, maire de 1975à 2008, la ville ne cessed’améliorer ses installationssportives <strong>et</strong> culturelles avec laconstruction du COSEC -Centre Maurice Loiseau -comprenant un espace d’hébergement<strong>et</strong> de restaurationassocié à une salle degymnastique <strong>et</strong> un espacepolyvalent en 1978, l’année oùla ville ouvre sa piscinecouverte. A ces équipementsdevenus insuffisants s’ajoutentau début des années 1990 denouvelles infrastructures avec lacréation de la salle de SportsOlympe en 1996 <strong>et</strong> surtout duCentre Culturel Athéna,équipement polyvalent ouverten 1994 comprenantnotamment un théâtre de 424places. Réalisée par l’architectenantaise Gaëlle Peneau, la salleAthéna à l’architecturemonumentale <strong>et</strong> simple assureadmirablement la transitionentre le cœur ancien de la ville<strong>et</strong> les nouveaux espaces auxfonctions diverses.Constituée de bardages clairs <strong>et</strong>de lignes courbes prolongéespar la matérialisation descheminements d’accès, Athénaexprime la volonté de faire dece site un espace d’échange <strong>et</strong>un lieu de rayonnement culturelde la ville.Ce secteur combinant espacesverts <strong>et</strong> bâtiments contemporainsaffirme le caractère XX esiècle de ce quartier <strong>et</strong> témoignedes choix de développement <strong>et</strong>du pari de la modernité engagépar la ville.Terminez au mail de la Liberté,version moderne du mail duXVIII e siècle, témoin del’ouverture de la ville au nord.Celui-ci, créé au début desannées 1990, a ouvert la voieau développement de la villevers le sud <strong>et</strong> aux activités deloisirs par la création du pland’eau en 1985.28 29
BélardRAvenueBellêmeR. d uPercheAvenue PasteurMamersRue Paul BertR. du TertreRue MarceauR.VoltaireRuede RochefortRue Saint AntoineRue Albert CamusRue du GaillonR. du DrImp.P. LotiPlaceVoltaireST-ANTOINE-DE-ROCHEFORTBonnétableGare SNCFRuede <strong>La</strong>uffenCalm<strong>et</strong>t eUsineSouriauQUARTIERDUGAILLONPlaceVictor Hugo15R. de <strong>La</strong>uffenRue Pierre BenoitVictorQUARTIERST-LAURENTR. du Dr. G. RamonR. du Préde CarcéRue RobertSurmontR. A. Malraux16Rue Pierrede CoubertinRue G.ThoreauRueRaspailHugoR. G.ThoreauImpassede l'Orme<strong>La</strong>MêmeAvenueGeorges DesnosQuai du Moulindu BoucherRueduR. Léo DelibesAvenue de la République17Avenue du Général de Gau leStadedu Pré duChâteauNO ESLycée RobertGarnier18194 septembre2021Av. du 8 M ai 1945Site de l'ancienegare de tramwayR. du Moulinà TanPlace duGénéralde GaulleDR. P. RonsardAllée F. Lepage22Base deLoisirsPlan d'eauJardin Public1 2PlaceSt-JulienAvenueRue FlorantMail dela LibertéP<strong>et</strong>it MailRue d'HuisneAvenue JeanPiscined'hiverPiscine d'étéR. GodardRue Vir<strong>et</strong>teR. duChâteauL'HuisneR. DelabordeAllée duChâteauR. R. GarnierR. CarnotL'HuisneRue duCollègeR. TafforeauImp. JeanCourtoisRue Jean CourtoisRue S. CheminGrandRue Vi<strong>et</strong>MailRue A. MarchandRue Bourgneufdu GénéralMon<strong>et</strong>RuePlaceCarnotPRÉ DU CHÂTEAUCollègeGaulleRuePrairieRue deRue du Quai de l'Huisnedu PrélaRue des CalotsCheminDenfert RocherereaudeMailCarnotPlace dela Lice14345R. ThiersAv. du Général Leclerc Rue Gamb<strong>et</strong>taRu i sseaudes CrottesRue de ParisRue desGrand Moulins613Ruede laCougèreCheminRuede la. LenôtredeAvenue de VerdunHocheRue d'OrléansPlaceLedru-RollinPlace duDr. CollièreQUARTIER DESGUILLOTIÈRES7Site de l'anciencouvent desRecoll<strong>et</strong>sLe CloseauR.RueRue des CalotsJules FerryBarqueRueBuffonRue Faidherbe8Avenue Jean Béal<strong>et</strong>Chemin de BellevuePierreBrulée9Avenue de VerdunSaint12Rue duMaineRueR. de la BastilleImp. de la BastilleRueRueQUARTIERD'ORLÉANSHocheJoachim d u BellaySymphorie nd'OrléansChemin des FourneauxRue Juliot CurieRueJ. PescheR. St-Barthélémyde10RueRue du Clos MarocA.ChartresParisChemin du Closde BaifChâteaudunQUARTIER DEL'ARGENTERIECherreauMaroc11Lotissementdes FourneauxRueR. Gouint PARCOURS 2L’EXTENSION DE LA VILLEAU XIX E ET XX E SIÈCLES12345678910111213141516171819202122Hôtel-DieuPorte Saint-JulienMairieTour Lepell<strong>et</strong>ierTour des MoulinsCouvent des Filles de Notre-DameBas-relief, maison N°44Ancienne fonderieCentre de secoursLotissement de l'ArgenterieJardins familiauxHôpitalMoulin des CalotsJardins familiaux des CalotsEglise Saint-AntoineMaison XVI e -XVIII eImmeubles du quartier Saint-<strong>La</strong>urentLycée Robert GarnierSalle Gérard DutertreCentre Maurice LoiseauSalle OlympeComplexe culturel AthénaCentre historiqueLexiqueArt Nouveau : mouvement artistiqueactif à partir de la fin du XIX e siècle enEurope, notamment en architecture.Il utilise des formes parfois complexesinspirées du monde végétal <strong>et</strong> proscrit laligne droite <strong>et</strong> l’angle.Boulevard : fortification extérieureadaptée à l’artillerie, constituée par unterre-plein en avant des remparts.Par extension, large voie, souvent plantéed’arbres, faisant le tour d’une ville.Canonnière : ouverture de tir de formesouvent circulaire perm<strong>et</strong>tant le passaged’une arme à feu, la canonnière apparaîtà la faveur du développement del’artillerie au cours des XV e <strong>et</strong> XVI esiècles.Castellum : terme latin signifiantfortification.Chemin de ronde : chemin decirculation au somm<strong>et</strong> d’un mur fortifié.Courtine : portion de mur d’unefortification comprise entre les tours.Créneau : échancrure rectangulairepratiquée au somm<strong>et</strong> du mur (parap<strong>et</strong>)pour perm<strong>et</strong>tre le tir.Herse : grille de bois ou de fer coulissantdans une rainure, elle sert à renforcer ladéfense de la porte d’un château ou d’uneenceinte urbaine.Hôtel-Dieu : au Moyen-Age, nom donnéà l’hôpital géré par des religieux.Il accueille des malades mais aussi despauvres ou des pèlerins.Hôtel particulier : vaste <strong>et</strong> confortablerésidence urbaine.Lice : espace intermédiaire compris entrel’enceinte du château <strong>et</strong> la basse-cour,utilisé pour les exercices militaires.Mâchicoulis : galerie de pierresurplombant les murs d’une fortification.Partiellement ajourée à sa base, elleperm<strong>et</strong> le j<strong>et</strong> vertical de projectiles sur lesassaillants.Mail : marteau utilisé dans le jeu demaill<strong>et</strong>, en vogue du XVII e au XVIII esiècle. Par extension, allée plantéed’arbres servant de promenade publique<strong>et</strong> de terrain de jeu de maill<strong>et</strong> au momentde leur création.Octroi : lieu de perception des taxessur les marchandises que certaines villesétaient autorisées à percevoir sousl’Ancien Régime.Oratoire : lieu destiné à la prière.Crédits photographiques© Archives Départementales de la Sarthe :p. 2 / 3, n° 1 (PC/133/012, E dév.); p. 12 /13, n° 5 (Fonds d’Elbenne, carn<strong>et</strong>s deRobert Charles, 7 F 79).© Collection André Bouton : p. 2 / 3, n° 2(dans André Pioger, Le Fertois aux XVII e<strong>et</strong> XVIII e siècles. Histoire économique <strong>et</strong>sociale. Le Mans, Imp. Monnoyer, 1973).© B.N.F, Gallica : p. 4 / 5, n°3.© Médiathèque de l’Architecture <strong>et</strong> duPatrimoine : p. 12 /13, n°3 ; p. 14 /15,n°3.© Ville du Mans, Médiathèque LouisAragon : couverture <strong>et</strong> p. 10 / 11, n°1.Lithographie de Saint-Elme-Champ, 1826,publiée avec Charles J. Richel<strong>et</strong>, dansVoyage pittoresque dans le département de<strong>La</strong> Sarthe, Paris, 1829.© Philippe Ruault : p. 22 / 23, n°4-5.© Denis <strong>et</strong> Marc Béal<strong>et</strong> (Mémoire enImages, <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>, Alan Suton,1996) : p. 24 / 25, n° 3.© Maxence Augustin : p. 14 / 15, n°4.© Alain Barbier, architecte dupatrimoine : p. 20 / 21, n°5.© Yves Royer, mairie de <strong>La</strong>Ferté-<strong>Bernard</strong> : couverture, p. 8 / 9, n°5;p. 10 / 11, n°2, 6; p. 12 / 13, n°2, 4 ; p. 14/ 15, n°2 ; p. 18 / 19, n°4.Sauf mention contraire,photographies Perche Sarthois.Cartes postales anciennes,collections privées.Principales sources dedocumentationArchives municipales de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>.Ministère de la Culture, Inventair<strong>et</strong>opographique du canton de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>, Imprimerie nationale, 1983.Denis <strong>et</strong> Marc Béal<strong>et</strong>, Mémoire en Images,<strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>, Alan Suton, 1996.Ouvr. Coll. / Société du <strong>Pays</strong> Fertois, <strong>La</strong>Ferté-<strong>Bernard</strong> d’hier à aujourd’hui, <strong>La</strong>Ferté-<strong>Bernard</strong>, 1999.RemerciementsMme Béal<strong>et</strong>, Nathalie Touboulic,Raymond Cadiou, René Jouanneaux.Document édité par le Syndicat mixte du<strong>Pays</strong> du Perche Sarthois, à 7000exemplaires, sur papier issu de forêtsgérées durablement, certifiées PEFC.RédactionSylvie Lemercier, relecture Julien Hardy.Itinéraire baliséGrégory Pottier, Yves Riou.Conception graphiqueLM communiquer.Réalisation Teatime ~ 06 72 66 49 71Impression <strong>La</strong> FertoiseDépôt légal juin 2009.30Z. A. des AjeuxLe MansCherréD1Vibraye
Avenue de la RépubliqueAncienHôtel-DieuRue Pierre deRonsardL'HuisnePlaceSt-JulienFAUBOURGST-JULIENAnciensabattoirsAllée F. LepageAv. du Général de GaullePARCOURS123Château4Chapelle St-LyphardMaison de stylenéo-régionalisteRueRue FlorantPromenade du P<strong>et</strong>it Mail5d'HuisneL'Huisne7Rue Alfred Marchand6Impasse du PavTour duTrésorAncien moulinà foulonRue Vir<strong>et</strong>teBASSECOUR3COUR1 LE CENTRE ANCIEN567Cour de laChaussumerieillonR. du Château18Hôtel Courtin de TorsayJardin publicPlace de laRépublique9Rue R. GarnierRue DelabordeRue CarnotPlace dela LiceTour Porche2101191011Rue Jean CourtoisRue Sainctot CheminGrand MailCour duSauvageFontaineMaisons à pansde boisHalles Denis Béal<strong>et</strong>Rue Denfert-RochereauRue BourgneufRue Vi<strong>et</strong>BOURGNEUFL'HuisneQuai de l'HuisneMairieTour desMoulins¢Rue duPré BélardRue deTourLepell<strong>et</strong>ierRue ThiersAnc. porteSt-BarthélémyPlacedes GrandsMoulinsl'AbreuvoirFAUBOURG DESGUILLOTIÈRESEnceinte encore visibleEnceinte non conservéeSite de l’ancien marchécouvert des années 1930Rue de ParisRueAnc. portede ParisVILLEHAUTEPlaceLedru-RollinHocheFAUBOURGST-BARTHÉLÉMYNO ESAnc. portedu MansPlace duDr. Collière<strong><strong>La</strong>issez</strong>-<strong>vous</strong> <strong>conter</strong> Le <strong>Pays</strong> du Perche Sarthois,<strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire…Pour enrichir votre découverte, le <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoiredu Perche Sarthois <strong>et</strong> ses guides-conférenciers, en partenariatavec les offices de tourisme <strong>vous</strong> proposent desanimations parmi lesquelles des visites-découvertes de laville de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> <strong>et</strong> des communes du <strong>Pays</strong>, duprintemps à l’automne pour le public individuel <strong>et</strong> toutel’année pour les groupes.Le <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire, c’est également un service éducatifA destination des scolaires, de la maternelle à laterminale. Il propose des parcours, des ateliers, desjournées <strong>et</strong> des classes du patrimoine pour une approchesensible <strong>et</strong> active du patrimoine, de l’architecture, del’urbanisme <strong>et</strong> du paysage.Le <strong>Pays</strong> du Perche Sarthois appartient au réseau nationaldes <strong>Villes</strong> <strong>et</strong> <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoireLe ministère de la Culture <strong>et</strong> de la Communication,direction de l’architecture <strong>et</strong> du patrimoine, attribuel’appellation <strong>Villes</strong> <strong>et</strong> <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire auxcollectivités territoriales qui animent leur patrimoine.Il garantit la compétence des guides-conférenciers <strong>et</strong>des animateurs de l’architecture <strong>et</strong> du patrimoine<strong>et</strong> la qualité des animations proposées.Aujourd’hui un réseau de 140 villes <strong>et</strong> pays <strong>vous</strong> offreson savoir-faire sur toute la France.Sur les 86 communes que comprend le territoire duPerche Sarthois, seulement 62 bénéficient du label VPah.Les communautés de communes du <strong>Pays</strong> Bilurien <strong>et</strong> du<strong>Pays</strong> des Brières <strong>et</strong> du Gesnois, ainsi que la commune deBeaufay, ne sont pas intégrées au <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire ;nous travaillons à ce qu’elles le soient prochainement.RennesLe Mans<strong>La</strong>valAngersNantesToursLilleParisLe Perche SarthoisVendômeA proximité,Le Mans, Le <strong>Pays</strong> Vallée du Loir, Vendôme, <strong>La</strong>val,Le <strong>Pays</strong> Coëvrons-Mayenne, Angers, Tours,Nantes, Guérande, Fontenay-le-Comte, bénéficientde l’appellation <strong>Villes</strong> <strong>et</strong> <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire.Informations pratiques<strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire du Perche Sarthois24 Avenue de Verdun, BP 90100,72 404 <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> cedex02 43 60 72 77perche-sarthois@orange.frwww.perche-sarthois.frOffice de tourisme de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>15 place de <strong>La</strong> Lice,72400 <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>02 43 71 21 21ot.la.ferte-bernard@club-intern<strong>et</strong>.frwww.la-ferte-bernard.com/tourisme.htm4Porte Saint-Julien8Notre-Dame des MaraisLes quartiers <strong>et</strong> faubourgs sont mentionnéssur ce plan dans leur appellation d’origine.
<strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>,parcours de découverte…Ce document est une invitation à lapromenade en ville. Il a pour but de perm<strong>et</strong>trela découverte de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> sous sesmultiples fac<strong>et</strong>tes. Ainsi, que <strong>vous</strong> soyeztouriste ou habitant de longue date, cedocument est fait pour <strong>vous</strong>.Une introduction historique resitue d’abordle contexte de création de la ville avantd’aborder son évolution chronologique <strong>et</strong>spatiale.Puis un premier parcours de 1,5 km, soitenviron 45 mn de marche dans le centrehistorique, <strong>vous</strong> perm<strong>et</strong>tra d’apprécier lesédifices emblématiques de <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong> <strong>et</strong>de comprendre leurs origines.Ensuite, parce que l’intérêt de la ville nes’arrête pas aux monuments les plusprestigieux, une balade de 8,35 km, soitenviron 1h40 mn de marche <strong>vous</strong> invitera àdécouvrir l’urbanisme de la ville jusqu’à nosjours <strong>et</strong> le développement de ses quartiers,entre ville <strong>et</strong> campagne.[Car] je l’ai vue s’éveiller, je l’ai vue recueillir lalumière verte des jardins ouvriersElle est là, translucide, toujours présente.Elle est partout comme un rêve inachevéA LAIN B OUVIER / Seul le cœur, <strong>La</strong> Ferté-<strong>Bernard</strong>, 1999