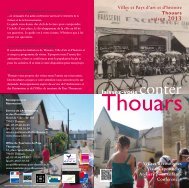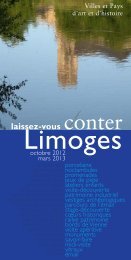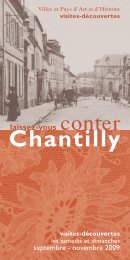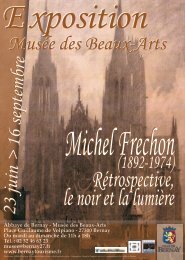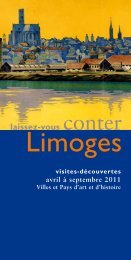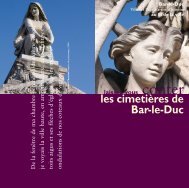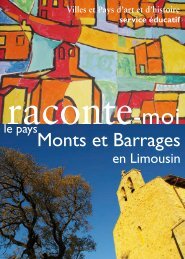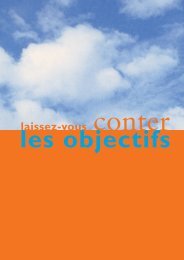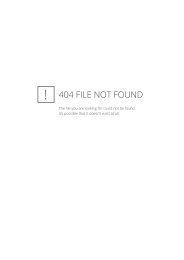La cathédrale Saint-Julien - Villes et Pays d'art et d'histoire
La cathédrale Saint-Julien - Villes et Pays d'art et d'histoire
La cathédrale Saint-Julien - Villes et Pays d'art et d'histoire
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
cathédrale<strong>Saint</strong>-<strong>Julien</strong>Flèche <strong>et</strong> pyramidions détruits au début du XX e siècle,proj<strong>et</strong> de restitution soutenu par la Fondationdu PatrimoinePlan intérieur de la cathédrale <strong>Saint</strong>-<strong>Julien</strong>Le menhir, vieuxde 5 à 7000 ansPanneau du vitrailde “l’Ascension” (XI-XII e siècle)Un livre de pierreUn site sacré ancestralL'histoire de la cathédrale commence,au V e siècle, avec celle de la communautéchrétienne mancelle assemblée autourde ses premiers évêques. Le menhir,adossé à la cathédrale, attestela permanence d'un lieu de culte,à proximité, depuis le Néolithique.L'église est d'abord dédiée à la Vierge<strong>et</strong> aux saints milanais Gervais <strong>et</strong>Protais. Au IX e siècle, elle estconsacrée à saint <strong>Julien</strong>, premierévangélisateur du Mans dont lesreliques sont déposées dans lesanctuaire.<strong>La</strong> cathédrale romaneAu milieu du XI e siècle, le renouveauspirituel insufflé par la Réformegrégorienne se traduit au Manspar l'édification d'une cathédralenouvelle.Sa façade occidentale est aujourd’huiintégralement conservée. Peu decathédrales romanes ont gardé,authentique, une façade de l'an 1100.Le pignon en damier, percé d'unebelle fenêtre aux dimensions inhabituellesau XII e siècle, les bas-reliefshistoriés qui évoquent les motifs destapisseries de Bayeux, font de lafaçade occidentale de <strong>Saint</strong>-<strong>Julien</strong>un exemplaire unique en France.De c<strong>et</strong>te cathédrale romane, élevéepar l'évêque Hoël <strong>et</strong> ses successeurs,subsistent également la partie bassede la tour nord <strong>et</strong> les bas-côtés dela nef, remarquables grâce à leurappareillage de pierres, de calcaire <strong>et</strong>de roussard. C'est dans c<strong>et</strong>te cathédraleencore en construction, que le papeUrbain II invite, en 1093, lesseigneurs manceaux à délivrer l<strong>et</strong>ombeau du Christ à Jérusalem.<strong>La</strong> même année, le moine Jean estappelé de la Trinité de Vendôme pourterminer les travaux.En avril 1120, Hildebert de <strong>La</strong>vardindédicace "la plus belle église del'Ouest", en présence de Foulques,comte du Maine <strong>et</strong> d'Anjou. En 1128,son fils Geoffroy Plantagenêt 1 yépouse Mathilde, p<strong>et</strong>ite fille deGuillaume Le Conquérant <strong>et</strong> héritièredu royaume d'Angl<strong>et</strong>erre. Leursenfants, dont le futur roi d'Angl<strong>et</strong>erre,Henry II, y sont baptisés.Plus tard, plusieurs incendiesimposent une reprise dela nef <strong>et</strong> un couvrement de pierre.Au-dessus du vaisseau central sontédifiées de grandes voûtes bombéessur plan carré. Ces voûtes gothiquesque l'on r<strong>et</strong>rouve dans plusieurs<strong>La</strong> cathédrale <strong>Saint</strong>-<strong>Julien</strong>monuments de l'Ouest de la France,sont caractéristiques du domainePlantagenêt. Elles s'élèvent à24 mètres <strong>et</strong> couvrent la nef, longuede 60 mètres.<strong>La</strong> cathédrale gothiqueÀ la demande de l'évêque <strong>et</strong> deschanoines, Philippe Auguste, roide France, soucieux d'affirmerla conquête politique du comté duMaine, autorise, en 1217, le franchissementde l'enceinte romaine pouragrandir le chœur de la cathédrale. Leplan de l'abside r<strong>et</strong>ient l'attention parson ampleur <strong>et</strong> sa couronne de13 chapelles rayonnantes, séparéesles unes des autres par des fenêtres.L'avènement de Geoffroy de Loudun,en 1234, marque l'histoire architecturalede la cathédrale. Légat du pape, c<strong>et</strong>évêque, bien né <strong>et</strong> fortuné, fait venirau Mans des architectes issus desmilieux normand <strong>et</strong> parisien.Les maîtres de Coutances <strong>et</strong> deBayeux se succèdent à la tête duchantier jusqu'en 1245. Ils élèvent leschapelles <strong>et</strong> le double déambulatoire.Le décor sculpté du triforium illustrebien la qualité du travail accompli.L'ultime étape de la construction du1 L'émail du tombeau de Geoffroy Plantagenêt est visibleau musée de Tessé.chœur est confiée à une équipeparisienne. Les fenêtres mancelles,qui rappellent celles de Notre-Damede Paris, livrent le nom de leurconcepteur : Jean de Chelles. Celui-ci,attentif aux formes préexistantes,déploie tout son génie afin d'assurerla cohérence de l'ensemble, dans lestyle de son temps, le gothiquerayonnant. Les arcs-boutants duchev<strong>et</strong>, en Y renversés, forment unpont vertigineux où s’allient sciencesde l'équilibre <strong>et</strong> de la lumière.Consacré en avril 1254, le nouveauchœur culmine à 34 mètres,10 mètres au-dessus du restede l'édifice.<strong>La</strong> volonté des chanoines derehausser le transept à la hauteur duchœur se concrétise grâce à Charles VIqui voulait remercier saint <strong>Julien</strong> del'avoir sauvé de la démence en août1392. <strong>La</strong> galerie aux fleurs de lyssculptées <strong>et</strong> la grande rosac<strong>et</strong>émoignent des dons royaux.En 1430, la nef romane <strong>et</strong> le chœurgothique s'épousent parfaitement. <strong>La</strong>fin de ces travaux fixe définitivementle visage de la cathédrale mancelle.Porche royal <strong>et</strong>Tour du CavalierUne cathédrale érigée vers les cieuxUne entrée royaleConstruit dans la première moitié duXII e siècle, le portail monumental de<strong>Saint</strong>-<strong>Julien</strong> s'ouvre dans l'axe principalde la ville médiévale, la Grand' Rue, <strong>et</strong>non sur la façade occidentale de l'édificecomme le voudrait l'usage.Appelé "portail de la Pierre au <strong>La</strong>it",parce que les laitières des environsutilisaient comme étal un dolmen situé àproximité jusqu'en 1770, ce portail royalprésente un programme iconographiquecomplexe. Il illustre les trois épisodesfondamentaux de la vie de l’Humanité.En avant du portail, 8 statues-colonnes,personnages de l'Ancien Testament,représentent la vie avant l'arrivée duChrist parmi les hommes. Innovationmajeure, saint Pierre <strong>et</strong> saint Paul,sculptés en bas relief, forment lesmontants de la porte. Les deux apôtres,facilement reconnaissables à leurs piedsnus <strong>et</strong> à leurs nimbes, représentent la viede l'Humanité à partir de la venue duChrist sur terre. Ils invitent à entrer dansl'église 2 . Enfin, au dessus du portail,le tympan représente l'Apocalypse.Le Christ en majesté y est entouré d'unbœuf, d'un aigle, d'un lion ailé, d'unange, symboles des quatre évangélistes,respectivement Luc, Jean, Marc <strong>et</strong>Mathieu.2Le terme "église" désigne ici tant la communautéchrétienne que l'édifice religieux lui-même.Les chapiteaux romansLes vingt chapiteaux du XI e siècle, situésdans les bas-côtés de la nef, offrent uneimagerie fantasmagorique d'oiseaux, demasques humains, de griffons, de lions,de serpents entrelacés… On y lit desthèmes orientaux, identiques à ceux deschapiteaux des églises du Pré <strong>et</strong> de laCouture. Cela prouve qu'il existait auMans une "école de sculpteurs", trèsoriginale, en train de se constituer <strong>et</strong> quiessaima au nord de la Loire. Les chapiteauxdu XII e siècle offrent, quant à eux,une grande diversité dans la compositiondes motifs <strong>et</strong> dans leur traitementplastique. Pour les uns, de belles feuillesd'acanthe typiques de la décorationligérienne, pour d'autres, des jeux depalm<strong>et</strong>tes polychromes qui côtoient desthèmes empruntés au bestiaire roman.Bien plus complexe <strong>et</strong> audacieux qu'àChartres ou à Angers, l'art de sculpter leschapiteaux est, au Mans, à son apogée.Un puits de lumière<strong>La</strong> cathédrale du Mans offre un panoramaexceptionnel de la production verrièredepuis le XI e siècle jusqu'à nos jours.<strong>La</strong> nef présente un très important ensemblede vitraux romans. “L'Ascension” a étéréalisée à la fin du XI e ou au tout débutdu XII e siècle : c’est le plus ancien vitrailconservé dans un édifice religieux. De laverrière originelle subsistent les deuxregistres centraux. On y voit la Vierge <strong>et</strong>les Apôtres assistant à la montée au cieldu Christ, aujourd'hui disparu. Ledépouillement du décor, le mouvementascensionnel des gestes <strong>et</strong> des vêtements,l'éclat des couleurs donnent vie<strong>et</strong> modernisme à c<strong>et</strong>te œuvre majeure.Entre 1230 <strong>et</strong> 1270, les communautésde métiers enrichissent c<strong>et</strong> ensemble.En témoignent les vignerons, les drapiers,les boulangers ou les "changeursd'Allonnes", représentés en activitédans les vitraux du chœur.<strong>La</strong> Grande rosace du transept nord a étécréée pendant la Guerre de Cent-Ans.C<strong>et</strong>te verrière composée d'une rose <strong>et</strong> delanc<strong>et</strong>tes, développe un thème très enfaveur dans l'iconographie du XV e siècle,le Credo 3 .Au début du XVIII e siècle, les artisansverriers manceaux réalisent pour3Credo, du latin "je crois", c<strong>et</strong>te formule exprimeles articles fondamentaux de la foi chrétienne.Chœurs <strong>et</strong> vitrauxdu XIII e sièclela sacristie une verrière en verre incoloreselon la mode de l'époque mais avecune remarquable maîtrise technique.Le XIX e siècle voit se dérouler une vastecampagne de restauration. En 1838,l'architecte Delarue, fait dessiner tousles vitraux anciens de la cathédrale.De nouveaux panneaux sont égalementcréés à la faveur de la redécouvertedu Moyen-Age comme les verrièresnéo-gothiques de la chapelle de la Vierge.Au XX e siècle, <strong>Saint</strong>-<strong>Julien</strong> s'enrichit denouveaux vitraux dont la “Vie de Jeanned'Arc”, placée dans la chapelle du mêmenom, qui manifeste la vitalité <strong>et</strong> le renouveaudes ateliers verriers manceaux dès lesannées 1920. Ainsi, du Moyen-Age jusqu'ànos jours, l'art du vitrail constitue l'undes fleurons du savoir-faire manceau 4 .4Didier Alliou, maître verrier manceau, est le restaurateurdes vitraux de la <strong>Saint</strong>e-Chapelle de Paris. Il est à la têtede la Société Avice, la plus ancienne entreprise du Mans,dont la création remonte à 1756.Chapiteaux du XII e siècle, nef