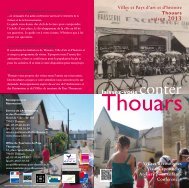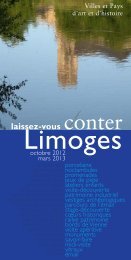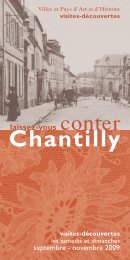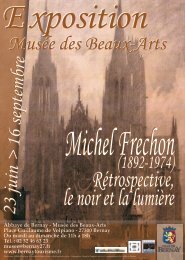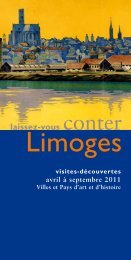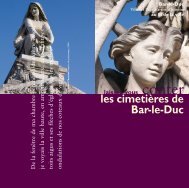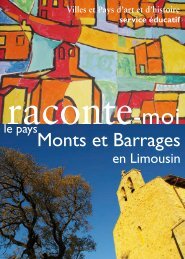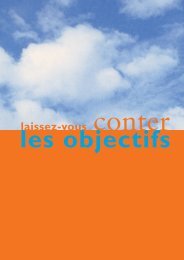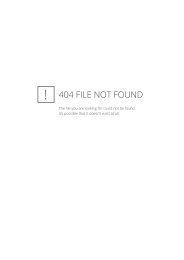Les cÅurs ruraux - Villes et Pays d'art et d'histoire
Les cÅurs ruraux - Villes et Pays d'art et d'histoire
Les cÅurs ruraux - Villes et Pays d'art et d'histoire
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Villes</strong> <strong>et</strong> <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoirede Lens-Liévin2010conterlaissez-vous<strong>Les</strong> cœurs <strong>ruraux</strong>
La Souchez.Le Bois de Mont. En arrière-plan :Vue sur les terrilsNCarte postale ancienne.la tour lanterne <strong>et</strong> la basilique de la nécropole nationalede Notre-Dame de Lor<strong>et</strong>te.de Loos-en-Gohelle depuisle mémorial canadien de Vimy.OELieu historique nationaldu Canada de la crête de Vimy.S<strong>Pays</strong>ages <strong>et</strong> panoramasLe territoire des cœurs <strong>ruraux</strong> se situe sur un seuilgéologique <strong>et</strong> paysager entre le bassin parisien<strong>et</strong> la plaine flamande.<strong>Les</strong> « cœurs <strong>ruraux</strong> »correspondent aux 11communes rurales du suddu territoire du <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong>d’histoire de Lens-Liévin quesont Ablain-Saint-Nazaire,Acheville, Aix-Noul<strong>et</strong>te,Bouvigny-Boyeffles, Carency,Givenchy-en-Gohelle, Gouy-Servins, Servins, Souchez,Villers-au-Bois <strong>et</strong> Vimy.Elles se situent à l’interface dedeux importantes formationssédimentaires dont le contactest marqué par les collinesd’Artois <strong>et</strong> l’escarpement dela crête de Vimy.Au fil du temps, ce seuilgéologique, topographique<strong>et</strong> paysager a été souligné parles activités humaines.L’architecture traditionnelleédifiée à partir de matériauxlocaux, l’aménagementde la plaine de la Gohellepour l’exploitation agricoleou les paysages généréspar l’exploitation minièrecontribuent à sa matérialisation.Lors de la Première Guerremondiale, la valeur stratégiquedes promontoires de Vimy <strong>et</strong>de Notre-Dame de Lor<strong>et</strong>teexplique la fixation du front surce seuil.Cours d’eau <strong>et</strong> vallonsLa réunion des cours d’eaudu Carency <strong>et</strong> du Saint-Nazaireforme la Souchez, qui ellemêmeconstitue le cours amontde la Deûle, voie navigablestructurante de la région. <strong>Les</strong>vallons irrigués par ces rivièressont naturellement favorablesà l’implantation de villages,de moulins à eau ainsi qu’audéveloppement des cultures.<strong>Les</strong> cours d’eau ont égalementinfluencé la forme des villagesqui s’étirent le long des rivescomme à Carency ou Ablain-Saint-Nazaire.Bois <strong>et</strong> forêtLe territoire des cœurs <strong>ruraux</strong>est marqué par la présence denombreuses zones boisées parmilesquelles la forêt domaniale deVimy, les bois de Carieul, de laHaie ou de Mont.La plaine agricolede la GohelleCe paysage rural de champsouverts se dessine pendant laseconde moitié du XIX e siècleavec la contribution de GuislainDecrombecque. Agriculteur <strong>et</strong>maire de Lens, celui-ci assècheles marais autour de Lens <strong>et</strong>améliore le rendement desterres par l’utilisation d’engraisnaturels <strong>et</strong> par des labours plusprofonds.Regards sur le bassin minierDepuis les collines <strong>et</strong> lespromontoires d’Ablain-Saint-Nazaire, Bouvigny-Boyeffles,Souchez <strong>et</strong> Vimy, la vue porte,au-delà des espaces agricoles,sur le bassin minier <strong>et</strong> lecentre urbain du territoire. Lecarreau de fosse 11/19 <strong>et</strong> sesterrils jumeaux (les plus hautsd’Europe) à Loos-en-Gohelle,les chevalements des fosses1bis <strong>et</strong> 3 à Liévin, ou encore l<strong>et</strong>erril de Pinchonvalles à Avionrévèlent le traj<strong>et</strong> de la veine decharbon qui court en sous-sol.Plus loin, <strong>et</strong> en dépit del’altitude modeste de cesbelvédères, le vaste panoramas’étend sur les Monts de Flandre<strong>et</strong> la métropole Lilloise.Guislain Decrombecque(1797 – 1870),est surnommé « le défricheur dela plaine de Lens ». Fils <strong>et</strong> p<strong>et</strong>itfils de maître de postes à Lens,il prend un temps la suite dec<strong>et</strong>te activité puis se consacre deplus en plus à l’agriculture. Sonvaste domaine s’étend sur lescommunes d’Avion, Acheville,Vimy <strong>et</strong> Givenchy-en-Gohelle.A la ferme s’ajoutent plusieursateliers <strong>et</strong> industries annexes :une sucrerie, une distillerie,un moulin à farine, un atelierde maréchal-ferrant, <strong>et</strong>c. Surles immenses terres réputéespeu fertiles de la plaine deLens, Guislain Decrombecquedéploie tout son savoir-faire <strong>et</strong>son ingéniosité. Le rendementde ses terres augmente <strong>et</strong> saréussite a valeur d’exemple lorsdes Expositions Universelles de1855 <strong>et</strong> 1867.23
Silex acheuléen trouvé à Vimy.Statue gallo-romaine deLa tour du château <strong>et</strong> l’église de Carency avantLa Bataille de Lens le 20 août 1648.Le château de Vimy. Détruit en 1833, il seLa distillerie – malterie d’Aix-Noul<strong>et</strong>te.Mercure mise au jour àla Première Guerre mondiale. Carte postale ancienne.Tableau de Hippolyte Lecomte.tenait à l’emplacement de l’actuelle mairie.Carte postale ancienne.Vimy lors du creusementLithographie de Félix Robaut.d’un puits en 1961.Au fi l des sièclesThéâtre de grandes batailles lors de la Première Guerremondiale, le territoire des cœurs <strong>ruraux</strong> est l’héritierd’une longue histoire.Occupations anciennesLa découverte de bifacesacheuléens à Vimy atteste d’uneintense activité de taille de silexau paléolithique. Autrefoisoccupé par le peuple gauloisdes Atrébates dont la capitaleétait Nem<strong>et</strong>acum (Arras),le territoire est longé par lavoie romaine dite « ChausséeBrunehaut » entre Arras <strong>et</strong>Thérouanne. <strong>Les</strong> toponymes <strong>et</strong>les vestiges r<strong>et</strong>rouvés indiquentl’existence d’habitat galloromainà l’emplacement deplusieurs communes.<strong>Les</strong> premiers châteauxAu Moyen Âge, des châteaux,auxquels sont bien souventassociés une chapelle castraleou une église, constituent lesnoyaux à partir desquels sedéveloppent plusieurs villages.Pour d’évidentes raisonsstratégiques, les points hauts,même modestes, sont privilégiéspour implanter ces demeuresseigneuriales. À Aix-Noul<strong>et</strong>te,le vieux quartier s’est structuréautour d’une motte castraledont l’empreinte est toujoursbien visible.Dans le cas de Givenchy-en-Gohelle, deux mottes sontprobablement à l’origine desdeux bourgs de Givenchy<strong>et</strong> Givenchisel qui furentregroupés au XIX e siècle pourformer l’actuelle commune.À Carency, un château <strong>et</strong> uneéglise dominent la vallée jusqu’àleur destruction pendant laPremière Guerre mondiale.<strong>Les</strong> châteaux disparus, cesont bien souvent les églisesqui continuent de marquer cesimplantations originelles. C’estle cas à Bouvigny-Boyeffles oùl’église édifiée à l’emplacementde l’ancien château fort renforcela centralité du hameau par saposition surélevée.1648 : La bataille de LensL’ultime bataille de la guerrede Trente Ans se dérouleaprès la prise de Lens parl’archiduc Léopold-Guillaumede Habsbourg le 17 août 1648.Elle a lieu dans une plaine àl’ouest de Lens, entre Grenay<strong>et</strong> Liévin, le 20 août 1648 <strong>et</strong> sesolde par une victoire françaisesur les troupes espagnoles duComté de Flandre.Une partie des blessés de labataille est soignée au châteaude Vimy, transformé pourl’occasion en hôpital militaire.<strong>Les</strong> frères Duquesnoysous la RévolutionErnest Duquesnoy est né en1749 à Bouvigny-Boyeffles.Lors de la Révolution, ce filsde cultivateur est élu députédu Pas-de-Calais à l’Assembléelégislative, puis à la Convention.Radical <strong>et</strong> autoritaire, il votepour la mort de Louis XVI <strong>et</strong>se montre impitoyable lors desmissions qu’il effectue dans lenord de la France. Accusé d’êtreun des chefs de l’insurrection du20 mai 1795, il est condamné àmort mais se suicide avant sonexécution.Son frère, le général FlorentDuquesnoy (1761 – 1801),s’illustre à plusieurs reprisespar son courage <strong>et</strong> sonintelligence tactique lorsdes guerres révolutionnaires.Dénoncé comme traître suiteà son refus de massacrer descivils lors des soulèvements deVendée, il meurt dans la misèreà Aix-Noul<strong>et</strong>te.<strong>Les</strong> mutationsdu XIX e siècleLe défrichement de la plainede Lens, l’introduction denouvelles cultures, comme cellede la b<strong>et</strong>terave, <strong>et</strong> les prémicesde l’industrialisation illustrentl’ampleur des mutationstechniques, agricoles <strong>et</strong>économiques qui transformentalors la vie des villages.L’émergence du bassin minierconstitue également un véritablebouleversement. <strong>Les</strong> avantagesproposés par les compagniesminières aux employés poussentde nombreux villageois àdélaisser les activités agricolestraditionnelles au profit d’unemploi dans les mines.À Souchez, on compte 56mineurs en 1872, 68 en 1886,113 en 1891 <strong>et</strong> 184 en 1911.A c<strong>et</strong>te date, ils sont déjà plusnombreux que les actifs dusecteur agricole dont le totaln’excède pas 128 personnes.4 5
La Première Guerre mondiale. Entonnoirs sur la crête de Vimy.Evolution de la ligne de front entre décembre 1914 <strong>et</strong> septembre 1915.Affiche du Comité de TourismeAu pied de la nécropole de Notre-Dame de Lor<strong>et</strong>te, le café Albert 1 er , actuel CentreDépart de la course de « La Montagnarde –Carte postale ancienne.C<strong>et</strong>te carte rend compte des difficultés rencontrées pour libérer la positiond’Arras <strong>et</strong> des Champs de BatailleEuropéen de la Paix (à gauche sur la photo), accordait des tarifs spéciaux aux anciensLe doux enfer » en 2009.stratégique du « verrou de Souchez ».de l’Artois, 1919.combattants. Carte postale ancienne.La Première Guerremondiale – <strong>Les</strong> troisbatailles d’ArtoisLa deuxième bataille d’Artoisest disputée entre mai <strong>et</strong>septembre 1915. Entreprisebataille est marquée par laprise héroïque de la crêtede Vimy par les Canadiens.<strong>Les</strong> villages des collinesd’Artois aux lendemainsde la GuerreUn tourisme de mémoireDès la fin du conflit, desmilliers de familles affluentLa Seconde GuerremondialeContrairement au précédentUne nouvelle attractivitéDepuis le milieu des années1970, le territoire estsouchezoise « Il était une foisle Pas-de-Calais libéré », sontl’occasion de rassemblementsLa première bataille d’Artoispar les Alliés pour soulager laOccupée par les Allemands dèsParmi les communes rurales,pour tenter de r<strong>et</strong>rouver leconflit, les villages neconcerné par le phénomèneconviviaux autour de lase déroule entre septembrepression sur le front russe, iloctobre 1914, c<strong>et</strong>te positioncelles situées sur la ligne decorps d’un soldat disparu ousubissent pas de destructionsde rurbanisation qui s’opère ànature, du sport <strong>et</strong> des cultures<strong>et</strong> octobre 1914 lors des’agit de la première offensivestratégique avait été protégéefront ont subi des dommagesconstater de visu l’ampleur desnotables. Le bassin minier,partir des agglomérations delocales. Secteur privilégié pourla « course à la mer ». <strong>Les</strong>française d’importance pourpar un imposant réseau demajeurs. Elles appartiennentdestructions. Progressivement,secteur stratégique, est enLens-Liévin <strong>et</strong> d’Arras. Dansla randonnée, le territoir<strong>et</strong>roupes allemandes occupentpercer le front allemand. Ilsfortifications. <strong>Les</strong> Alliés ontà la « zone rouge » d’uneune forme spécifique derevanche durement touché parce contexte, les cœurs <strong>ruraux</strong>développe aujourd’hui lesle territoire <strong>et</strong> la ville d’Arrass’emparent des villages deperdu plus de 150 000 hommescartographie dressée pourtourisme se structure à partirl’occupation allemande <strong>et</strong> lesoffrent un cadre de vie de plusgîtes d’accueil <strong>et</strong> proposedébut septembre.Souchez <strong>et</strong> de Carency ainsi quelors d’infructueuses tentativesévaluer l’importance desde « pèlerinages », de « guidesbombardements alliés. <strong>Les</strong>en plus apprécié des citadins.des produits du terroir aux<strong>Les</strong> forces françaises reprennentdu promontoire de Notre-Damepour la reprendre. Longuementdestructions aux lendemainsdu souvenir » <strong>et</strong> d’« itinérairesvillages servent alors de refugesLa vitalité des traditionsvisiteurs.rapidement la ville <strong>et</strong> fortifientde Lor<strong>et</strong>te. <strong>Les</strong> armées franco-préparée par le général Byng,du conflit. La plupart se voientdes champs de bataille »<strong>et</strong> de lieux d’approvisionnementfestives compte égalementleur position. La ligne de frontbritanniques ne parviennentl’offensive victorieuse <strong>et</strong>décerner la Croix de guerre. Ilproposés par des professionnels.en nourriture pour lesparmi les attraits des villages.se fixe alors précisément surcependant pas à reprendre ledécisive sur la crête de Vimyfaut n<strong>et</strong>toyer les sols des millierspopulations.Le dynamisme des harmoniesle seuil qu’occupent les cœurscontrôle de la crête de Vimy.coûte la vie à près de 3 600de cadavres qui sont transportés<strong>et</strong> de la pratique des jeux<strong>ruraux</strong>. Courant octobre,La troisième bataille d’Artoissoldats canadiens.dans les cim<strong>et</strong>ières <strong>et</strong> ossuaires.anciens, les manifestations,d’importantes offensivesintervient entre avril <strong>et</strong>Une autre priorité est d’entamertelle que la course pédestreallemandes sont repoussées.mai 1917. Engagée par lesle périlleux travail de désobusagede la Montagnarde à Ablain-<strong>Les</strong> Français finissent cependantBritanniques pour faciliterafin de rendre possible laSaint-Nazaire ou l’animationpar perdre l’emplacementl’offensive du Général Nivellereconstruction <strong>et</strong> la remise enstratégique de la crête de Vimy.au Chemin des Dames, c<strong>et</strong>teculture des terres agricoles.6 7
Le pigeonnier de l’ancienneLa structuration des villages à partirPropriété de Floride Brasme à Aix-Noul<strong>et</strong>te, vers 1900.Soubassement en grès, pignon en épis <strong>et</strong> toiture en tuiles flamandesMur en « rouges-barres ».Rognons de silex dans un moellonferme Dunat à Aix-Noul<strong>et</strong>te.d’une succession de censes, schéma de principe.Carte postale ancienne.vernissées sont parfaitement visibles sur c<strong>et</strong>te ferme d’Aix-Noul<strong>et</strong>te.de pierre blanche.Une architecture rural<strong>et</strong>raditionnellePierre blanche, grès <strong>et</strong> brique : trois ressourceslocales associées avec savoir-faire.<strong>Les</strong> fermes<strong>Les</strong> villages sont généralementstructurés à partir d’unesuccession de fermes.Communément appelées« censes », elles présentent unedisposition typique des fermesartésiennes. <strong>Les</strong> bâtiments sontorganisés autour d’une courfermée <strong>et</strong> protégés de la ruepar un grand porche parfoissurmonté d’un pigeonnier.Dans le cas des ensemblesde plan en L ou en U, le logisest généralement implantéperpendiculairementà la voie.Dans les « censes » de plancarré, qui sont les plus cossues,le logis se tient le plus souventen fond de cour tandis qu’unegrange clôt l’ensemble côté rue.<strong>Les</strong> fermes accolées les unes auxautres définissent un front bâtisur la voie qui est un véritablemarqueur de l’identité urbaine<strong>et</strong> visuelle des villages.Axonométrie d’une cense.Maisons de bourg<strong>et</strong> maisons de maîtresAux côtés des fermesassumant la double fonctiond’exploitation <strong>et</strong> d’habitat,des maisons de bourg sontexclusivement destinées aulogement. Surtout édifiéesà partir du XIX e siècle, leurémergence reflète la partcroissante de populationtravaillant dans d’autressecteurs d’activité quel’agriculture.Des maisons de maîtres, commecelle appartenant à FlorideBrasme, propriétaire d’unebrasserie à Aix-Noul<strong>et</strong>te, furentégalement construites dans cecontexte. Toutefois, la PremièreGuerre mondiale provoque ladestruction de la plupart de cesbelles demeures.<strong>Les</strong> matériaux<strong>Les</strong> constructionstraditionnelles sont édifiéesà partir de matériaux bruts,sans enduits. La pierre calcaireblanche d’Artois domine.D’extraction locale, elle estemployée en moellons dep<strong>et</strong>it appareil <strong>et</strong> associée à labrique pour pallier sa fragilité.Certains murs sont ainsi bâtisen alternant rangs de craie<strong>et</strong> rangs de brique selon latechnique du « rouges-barres ».<strong>Les</strong> pignons sont courammentrenforcés à l’aide de briquesmaçonnées en oblique <strong>et</strong>forment des « pignons en épis ».<strong>Les</strong> soubassements en grès, ouparfois en silex, protègent desremontées d’humidité dans lesmurs. <strong>Les</strong> appareillages mixtesainsi mis en œuvre possèdentd’indéniables qualités, tanttechniques qu’esthétiques.Pour le couvrement, lessources écrites rapportentl’existence passée de toits dechaume comme à Ablain-Saint-Nazaire. La tuile ou « panne »flamande, parfois vernissée,constitue toutefois le matériautraditionnel de couverturele plus couramment utilisé.Le grès d’Artois possède laparticularité de durcir à l’air<strong>et</strong> au fil du temps après sonextraction. Ceci en faisait unmatériau tout indiqué pourle pavage des routes <strong>et</strong> descours de fermes. <strong>Les</strong> différentsmatériaux locaux employésdans le cadre de l’architectur<strong>et</strong>raditionnelle offrent un beléventail de couleurs du grisau rouge, sans oublier lesvariations subtiles de teintesde la craie allant du blanc casséà l’ocre.89
La « Vieille Eglise » d’Ablain-Saint-Nazaire avantL’église-halle d’Aix-Noul<strong>et</strong>te.L’église de ServinsVue ancienne de la croix de grès de Souchez.La chapelle Hannedouche à Servins.La chapelle Jonglez de Ligne à Souchezla Première Guerre mondiale. Carte postale ancienne.<strong>et</strong> sa flèche à croch<strong>et</strong>s.Le socle du XIII e siècle est surmonté de la croixavant sa destruction lors de la Grande Guerre.Carte postale ancienne.restaurée en 1859. Carte postale ancienne.Carte postale ancienne.Patrimoine religieuxUn héritage ancien témoigne de la richesse architecturalequi a précédé les destructions de la Grande Guerre<strong>et</strong> les réalisations de la Reconstruction.Des édifi ces singuliersVers 1500, Jacques le Caron– architecte du beffroi <strong>et</strong> del’hôtel de ville d’Arras – édifiel’église d’Ablain-Saint-Nazaire.Ce fleuron du style gothiqueflamboyant comportait unegrosse tour carrée de 34 m dehauteur flanquée de contrefortsmassifs <strong>et</strong> couronnée par unparap<strong>et</strong> crénelé. Un grandportail richement sculptés’ouvrait en façade sud.Bombardée en 1914, ses ruinessont volontairement conservéespour témoigner de la violencedes combats. Au début duXVI e siècle, Jacques le Caronagrandit également l’égliseSaint-Germain d’Aix-Noul<strong>et</strong>te.La nef romane, remplacée partrois nefs de style gothiqueflamboyant, transforme l’édificeen église-halle. Endommagéelors de la Grande Guerre, elleest reconstruite à l’identiqueaprès le conflit.L’église de Servins date de 1786mais son clocher est antérieur.Edifié à la fin du XVII e siècle,il est surmonté d’une flècheà croch<strong>et</strong>s qui constitue uneforme architecturale récurrenteen Artois. Outre leur valeuresthétique, les croch<strong>et</strong>s avaientsemble-t-il pour fonction defaciliter la mise en place d’unéchafaudage à l’occasion d<strong>et</strong>ravaux.Malgré les destructions de laRévolution française <strong>et</strong> de laPremière Guerre mondiale,l’église de Bouvigny-Boyefflesconserve une partie de sonclocher du XV e siècle.Le presbytère qui lui fait facea été construit par AlexandreGrigny (1815 – 1867), architectedu diocèse d’Arras réputé pourson style fortement empreintd’influences médiévales <strong>et</strong>flamandes.Entre agrandissementssuccessifs <strong>et</strong> épisodes dedestructions-reconstructionsces édifices témoignent desvicissitudes de l’histoire dontils tirent leur singularité.<strong>Les</strong> ruines d’Ablain-Saint-Nazaire <strong>et</strong> l’église Saint-Germain d’Aix-Noul<strong>et</strong>tesont protégées au titre desMonuments historiques.Croix de grèsHaute de 8 m, la croixmonumentale qui s’élevait aucentre de la place de Souchezest détruite lors de la PremièreGuerre mondiale. Celle ducim<strong>et</strong>ière de Servins, datéedu milieu du XVIII e siècle, aconservé d’étonnants bas-reliefsreprésentant des têtes de morts<strong>et</strong> des outils de tailleur depierre. Une autre croix de grèsdu XVII e siècle est conservéecontre le mur extérieur de lasacristie de l’église de Villersau-Bois.Chapelles <strong>et</strong> oratoiresLe long des chemins, au somm<strong>et</strong>des collines, à proximité dessources, aux carrefours ouà la lisière des bois, chapelles<strong>et</strong> oratoires témoignentde la piété des habitants<strong>et</strong> des seigneurs. Nombrede traditions <strong>et</strong> pèlerinagesétaient associés à ces lieuximportants dans la vie desvillages. <strong>Les</strong> chapelles qui noussont parvenues furent édifiéesentre le XVII e <strong>et</strong> le XX e siècle.La chapelle Hannedouche,implantée au cœur d’une vasteplace à Servins, constitue unbel exemple d’architecturebaroque du XVII e siècle.<strong>Les</strong> propriétés de la pierreblanche locale, tendre <strong>et</strong> facileà travailler, ont été exploitéespour la réalisation d’une richemodénature en façade. Laporte cintrée à bossages <strong>et</strong>pilastres est surmontée d’unfronton à volutes. L’intérieurest couvert d’une belle voûted’ogives à liernes <strong>et</strong> tiercerons<strong>et</strong> éclairé par deux occuli.Inscrite au titre des Monumentshistoriques depuis 1989, ellea été restaurée en 1995. Lachapelle Notre-Dame de laDélivrance, située sur la routede Bouvigny-Boyeffles, date de1861. Elle présente l’associationtraditionnelle de la brique <strong>et</strong> de lapierre blanche locale notammentutilisée pour les chaînagesd’angles <strong>et</strong> la façade rehausséed’une frise ornementale.À Souchez, la chapelle de lafamille Jonglez de Ligne, élevéeen 1876 <strong>et</strong> détruite au cours dela Première Guerre mondialeavant d’être reconstruite àl’identique en 1928, est de stylenéo-gothique. Edifiée en1923 à Servins, la chapelleMayeur témoigne del’emploi privilégié de labrique aux lendemainsde la Grande Guerre.C<strong>et</strong>te réalisation illustreégalement les eff<strong>et</strong>s d<strong>et</strong>exture <strong>et</strong> de moulurationobtenus grâce à la posede briques en saillie auniveau du bandeau <strong>et</strong> desencadrements.La croix de grès1011de Servins.
Le « p<strong>et</strong>it moulin » sur la Souchez.Gravure de l’ancien moulin à ventL’ancienne brasserie-malterie à Bouvigny-Exemple de la diversité des établissements industriels qui se développentLa sucrerie d’Ablain-Saint-Nazaire.Carte postale ancienne.de Bouvigny par A. Mayeur en 1913.Boyeffles. Carte postale ancienne.dans les villages : la savonnerie Jules Dreux à Aix-Noul<strong>et</strong>te.Carte postale ancienne.<strong>Les</strong> activités de productionLa vie économique des cœurs <strong>ruraux</strong> a longtempsreposé sur l’agriculture avant que les progrès techniquesn’entraînent l’essor des activités de transformation.<strong>Les</strong> moulinsEntre collines <strong>et</strong> vallées, avec lescours de la Souchez, du Carency<strong>et</strong> du Saint-Nazaire, le territoireoffrait un cadre favorable àl’implantation des moulins,qu’ils soient à vent ou à eau.Aujourd’hui disparus, ils furentle support de diverses activités.A côté des traditionnelsmoulins à farine, on peutmentionner l’existence, attestéenotamment sur la communed’Acheville, de « tordoirs »c’est-à-dire de moulins destinésà la production d’huiles. Ils semultiplient fin XVIII e - courantXIX e siècle alors que la culturedes oléagineux connait unvéritable essor dans la région.À c<strong>et</strong>te époque, l’oeill<strong>et</strong>te offreune huile douce utilisée pourla table <strong>et</strong> dont le résidu sertà alimenter le bétail. L’huilede cameline entre dans lafabrication de la peinture. Celleobtenue à partir du colza sertpour l’éclairage <strong>et</strong> le graissage.Enfin, le lin, dont la fibre estégalement extraite pour lafabrication de tissu, donne unehuile utilisée en pharmacie <strong>et</strong> enpeinture.Brasseries <strong>et</strong> malteriesÀ partir du XIX e siècle,l’émergence de nouvellesénergies <strong>et</strong> technologies(charbon <strong>et</strong> machines à vapeurnotamment) provoque unemutation des productionslocales. De nombreusesbrasseries <strong>et</strong> malteries,telles l’entreprise Brasmed’Aix-Noul<strong>et</strong>te ou Soupl<strong>et</strong> àBouvigny-Boyeffles, s’inscriventdans c<strong>et</strong> essor industriel. Cesétablissements alimentent enbière les nombreux estamin<strong>et</strong>sdes villages <strong>et</strong> du bassin minier.La tradition brassicole seperpétue aujourd’hui encore àAix-Noul<strong>et</strong>te où une brasseries’est récemment établie.D’autres établissementsindustrielsÀ Ablain-Saint-Nazaire lasucrerie construite vers 1857est transformée en distillerie en1870 – 1871. Comme la plupartdes établissements, elle estdétruite lors des combats dela Première Guerre mondiale.L’utilisation massive de labrique lors de la Reconstructionprofite à la briqu<strong>et</strong>erie Mercierde Vimy. C<strong>et</strong> établissementdiffère largement des p<strong>et</strong>itesbriqu<strong>et</strong>eries artisanales quisont créées à la même périodedans plusieurs villages.L’argile extraite localementest transformée en briquesgrâce à un puissant four d<strong>et</strong>ype Hoffman chauffé par unecinquantaine de chaudièresà charbon. Fonctionnant jours<strong>et</strong> nuits, il perm<strong>et</strong> de fournirdes briques de qualité constante<strong>et</strong> en grandes quantités. C<strong>et</strong>tebriqu<strong>et</strong>erie cesse ses activitésvers 1992.Affiche publicitairede la brasserie Brasme.Brasserie -malterieà Aix-Noul<strong>et</strong>teLa premièremention d’une brasserie ence lieu remonte à un acte decession de 1856. Plusieurspropriétaires se succèdentjusqu’à l’achat de l’établissementpar Floride Brasme en 1876.La brasserie est alorsprogressivement agrandie <strong>et</strong>modernisée par le nouveaupropriétaire puis par son filsqui prend la successionà partir de 1907. Quand laguerre éclate, ces aménagementssont à peine terminés.L’usine emploie alors 13 ouvriers,sa production s’élève à 30 000hectolitres <strong>et</strong> elle alimente pasmoins de soixante débits deboissons. Fortementendommagée, la brasseriereprend ses activités à partirde 1918. En 1949, elle estreprise par François Brasmequi s’associe avec la brasseriePelforth de Mons-en-Baroeulà partir de 1972. La productionpasse de 180 000 hectolitresen 1960 à 250 000 hectolitresen 1986, année de la ferm<strong>et</strong>uredu site. La brasserie employaitalors près de 20% de lapopulation active d’Aix-Noul<strong>et</strong>te. <strong>Les</strong> bâtiments sontaujourd’hui détruits.12 13
Souchez en ruines au sortir du conflit.L’église détruite d’Aix-Noul<strong>et</strong>te. En arrière-plan : l’église provisoire.C<strong>et</strong>te « demi-lune » ou « Nissen » abritait une boulangerie à Vimy.Baraques de type « Adrian » à Vimy.Carte postale ancienne.Carte postale ancienne, vers 1919.Carte postale ancienne.Carte postale ancienne.Une architecturede la Reconstruction<strong>Les</strong> reconstructions d’après-guerre composentune nouvelle identité pour les villages entre modernisation,innovation <strong>et</strong> créativité.Sur ce secteur, il convient depréciser que les communes deBouvigny-Boyeffles, Gouy-Servins, Servins <strong>et</strong> Villers-au-Bois sont, de par leur positionen r<strong>et</strong>rait de la ligne de front,relativement épargnées parla guerre <strong>et</strong> conservent unintéressant patrimoine bâtitraditionnel. A l’inverse, lesvillages d’Ablain-Saint-Nazaire,Acheville, Aix-Noul<strong>et</strong>te,Carency, Givenchy-en-Gohelle,Souchez <strong>et</strong> Vimy sortent duconflit à l’état de ruines.« Nous sommes devant Souchez.Le village a disparu. Jamais jen’ai vu une telle disparition devillage. Ablain-Saint-Nazaire<strong>et</strong> Carency gardent encoreune forme de localité, avecleurs maisons défoncées <strong>et</strong>tronquées(…) Ici, dans lecadre des arbres massacrés –qui nous entourent au milieudu brouillard – plus rien n’ade forme : il n’y a même pasun pan de mur, de grille, deportail qui soit dressé, <strong>et</strong> on estétonné de constater qu’à traversl’enchevêtrement de poutres,de pierres <strong>et</strong> de ferrailles, sontdes pavés : c’était ici une rue ».Henri Barbusse, Le Feu,chapitre XII, Le portique.Baraques <strong>et</strong> demi-lunesAux lendemains des combats,il faut reloger dans l’urgence desmilliers de familles. De curieusesconstructions standardisées<strong>et</strong> préfabriquées sont édifiéespour faire office de logementsprovisoires, mais également decommerces, d’écoles, de mairiesou d’églises. Déjà utilisées parles militaires pendant le conflit,les « Adrian » <strong>et</strong> les « Nissen »,du nom de leurs concepteursrespectifs, sont les plusrépandues. <strong>Les</strong> premières sontdes baraques en bois tandis queles secondes, également appelées« demi-lunes », ont une forme endemi-cylindre <strong>et</strong> sont constituéesd’une ossature en bois couvertede papier bitume <strong>et</strong> de tôles.<strong>Les</strong> dommages de guerrePour mener à bien c<strong>et</strong>te tâcheimmense de Reconstruction,des procédures <strong>et</strong> des outilsspécifiques sont mis en place.Une loi dite « charte dessinistrés » instaure dès avril1919 le régime des indemnitésdes dommages de guerre. <strong>Les</strong>inévitables difficultés poséespar l’évaluation des dégâts, laquestion de l’indemnisation<strong>et</strong> les modalités de laReconstruction sont à l’originede nombreuses lois, décr<strong>et</strong>s <strong>et</strong>circulaires. L’administration doittrouver le juste équilibre entrel’impossibilité de tout contrôler,la nécessité de garantir les droitsde chacun <strong>et</strong> l’ambition d’unaménagement planifié pour uneReconstruction rationnelle <strong>et</strong>synonyme de « progrès ».<strong>Les</strong> coopérativesElles constituent l’outiladéquat pour défendre auxmieux les intérêts des sinistrés.Des sociétés de ce type sontrapidement mises en placepour faire des économies,gagner du temps <strong>et</strong> reconstruireavec un souci de qualité.Ces coopératives doiventimpérativement recourir à desprofessionnels agréés pourl’exécution de leurs travaux.C<strong>et</strong>te organisation perm<strong>et</strong>notamment de se prémunirdes nombreuses propositionsémanant d’architectes <strong>et</strong>d’entrepreneurs malhonnêtesou incompétents. Un nombrelimité de professionnels qualifiésse trouve ainsi désigné pourla reconstruction des édificespublics <strong>et</strong> des habitations. Aufinal, les coopératives jouent unrôle déterminant dans le cadredu relèvement des communes.ArthurMayeur(1871-1934)est né àBouvigny-Boyeffles.Il se forme à l’École des Beaux-Arts de Lille <strong>et</strong> obtient lePremier Grand Prix de Romede Gravure en 1896. Son talentpour les estampes <strong>et</strong> la gravureest reconnu: il est régulièrementrécompensé au Salon desArtistes Français, travailleà l’illustration de la Gaz<strong>et</strong>tedes Beaux-Arts <strong>et</strong> de la Revuede l’Art ancien <strong>et</strong> moderne.En 1906, il est nommémembre de la Commission desMonuments historiques. ArthurMayeur s’investit alors dansla valorisation du patrimoinede sa région natale. Après laGrande Guerre, il s’emploienotamment à représenter lesvestiges des édifices touchés parles destructions sur le front del’Artois : beffroi d’Arras, toursdu Mont-Saint-Eloi, chapelleNotre-Dame de Lor<strong>et</strong>teainsi que divers éléments dupatrimoine bâti tels les moulins.14 15
La place, avec les bâtiments de la mairie <strong>et</strong> de l’école, avant <strong>et</strong> après-guerre à Souchez. Cartes postales anciennes.A Ablain-Saint-Nazaire, ce vaste complexe associaitinitialement la mairie <strong>et</strong> les logements des enseignants.Vue d’un estamin<strong>et</strong> reconstruit par l’architecte Paul Decauxà Givenchy-en-Gohelle. Son pignon à la flamande estcaractéristique des influences régionalistes alors en vogue.Réorganiser les villagesregroupés autour d’un vasteArchitecture publiquerepose sur l’eff<strong>et</strong> de symétrieArchitecture privéel’inclusion de briques vernisséesAux lendemains de la Premièreespace public qui devient un<strong>Les</strong> édifices publics sont<strong>et</strong> les principes décoratifs àGlobalement, les maisons <strong>et</strong>pour les encadrements sont lesGuerre mondiale, priorité estvéritable pôle de centralité.des éléments clefs pour lala mode. Ainsi, les ensemblescommerces reconstruits sont deprincipaux eff<strong>et</strong>s décoratifs.donnée au rétablissement desinfrastructures, de l’habitat<strong>et</strong> des équipements civils.C’est le cas à Ablain-Saint-Nazaire, Givenchy-en-Gohelle,Souchez <strong>et</strong> Vimy. A Ablain-concrétisation des préceptesde modernité alors en vogue.Leur reconstruction introduit« mairie-écoles » s’organisentgénéralement en disposantsymétriquement les deux écolesconception simple. La briqueest le matériau privilégié. Sonmoindre coût, la possibilitéD’un point de vue stylistique,les architectes réinvestissentoccasionnellement leursPaul Decaux(1881-1968)Quelques mois plus tard, il estégalement nommé architectePour les communes les plusSaint-Nazaire, la « Vieilled’importantes modifications en(de filles <strong>et</strong> de garçons) ou lesde la produire localement <strong>et</strong>répertoires aux intonationsArchitecte significatif de parordinaire des Monumentstouchées, c<strong>et</strong>te Reconstructionéglise » qui constituait l’ancienmatière de conception, de stylelogements des enseignants desa facilité de mise en œuvreArt déco ou régionalistesle nombre d’édifices qu’il réalisehistoriques. Lors de laest l’occasion d’apporter descentre de la commune est<strong>et</strong> d’écriture. <strong>Les</strong> mairies <strong>et</strong> lespart <strong>et</strong> d’autre de la mairie.– a fortiori dans le cadre dedans la production privée.lors de la Reconstruction,Reconstruction, il travailleaméliorations répondantconservée à l’état de ruinesécoles édifiées avant-guerre<strong>Les</strong> eff<strong>et</strong>s décoratifs sontl’autoconstruction – justifientC<strong>et</strong>te architecture concrétisePaul Decaux l’est égalementsur de nombreux bâtimentsaux principes rationalistes <strong>et</strong>mais la centralité du villageavaient certes déjà adopté desessentiellement basés surpleinement son emploi. <strong>Les</strong>la transition entre desau regard de l’influence Artcommunaux, participe à lahygiénistes énoncés dans la loiest transférée de l’autre côtémodèles de bâti en brique àl’alternance des matériaux.architectes r<strong>et</strong>enus dans le« villages blancs » construitsdéco <strong>et</strong> du recours au bétonrestauration d’églises dévastées,Cornud<strong>et</strong> du 14 mars 1919.de la rivière, à l’emplacementcaractère monumental commeA Vimy, la nouvelle mairiecadre des sociétés coopératives,essentiellement en pierrearmé qui caractérisent sonainsi qu’à celle de la cathédrale<strong>Les</strong> voies étroites <strong>et</strong> tortueusesde l’ancienne mairie.à Ablain-Saint-Nazaire outémoigne des influencestel Paul Decaux ou Henricalcaire <strong>et</strong> des « villagesœuvre. Après des études àdu palais Saint-Vaast <strong>et</strong> dessont élargies <strong>et</strong> redressées, lesUne vaste place y est aménagéeVimy. Avec la Reconstruction,régionalistes <strong>et</strong> balnéairesPhilippe, contribuent aurouges » édifiés quasi-Dieppe, il passe par l’Écoleplaces d’Arras. Avec son associécim<strong>et</strong>ières transférés à l’écartpour accueillir le complexec<strong>et</strong>te architecture s’affirmequi se manifestent lors de larenouvellement de l’architectureexclusivement en brique.des Beaux-Arts de ParisEdouard Crevel, il s’occupedes villages <strong>et</strong> les équipementsmairie-écoles ainsi que laostensiblement au traversReconstruction des grandsdes villages avec ce matériauoù il obtient son diplômeégalement d’un nombrenouvelle église <strong>et</strong> le monumentd’édifices parfois étrangementéquipements publics.qu’ils associent parfois à desd’architecte. En 1909, ilconsidérable de maisonsaux morts.surdimensionnés tels ceuxéléments en béton armé. Ladevient architecte en chef duparticulières. Paul Decauxde Souchez ou de Givenchy-lisibilité de c<strong>et</strong>te combinaisondépartement du Pas-de-Calais.cesse son activité en 1959.en-Gohelle. Leur compositionbrique-béton en façade <strong>et</strong>1617
Cahier des clauses <strong>et</strong>Façade principale de l’église d’Ablain-Saint-Nazaire.Voûte en béton armé de la nefExemple de traitement décoratif basé sur l’alternanceL’église d’Acheville.C<strong>et</strong>te baie de l’église Saint-Martin de Vimyconditions généralesde l’église d’Ablain-Saint-Nazaire.des matériaux. Eglise Saint-Aignan de Carency.illustre les nouvelles possibilités d’expressionde la Société coopérativeoffertes par le béton armé.de reconstruction des églisesdu diocèse d’Arras.Reconstruire les églisesAfin d’édifier rapidement de<strong>Les</strong> célèbres architectesLa production des architectesLe principe d’association duL’église Saint-Martin de VimyAux yeux des autorités,nombreuses églises avec desAuguste <strong>et</strong> Gustave Perr<strong>et</strong>à l’œuvre sur le territoire estbéton armé – utilisé pour laest édifiée sur les plans dequelques années après la loimoyens financiers limités,contribuent à ouvrir la voieemblématique de la volontéstructure porteuse <strong>et</strong> le clocherl’architecte parisien Raoulde séparation des Eglisesle recours aux matériauxde son usage lorsqu’ils édifientd’expérimenter les innovations– à la brique est fréquemmentBrandon à l’emplacement<strong>et</strong> de l’Etat de 1905, lahistoriques, comme la pierre,en quelques mois, <strong>et</strong> avectechniques à disposition.employé. C’est notamment lede l’ancienne église gothique.reconstruction des églises n’estn’est pas envisageable. Unun budg<strong>et</strong> restreint, l’égliseL’église d’Ablain-Saint-Nazairecas pour les églises d’AchevilleOutre la structure en bétonpas une priorité <strong>et</strong> se fera enmatériau moderne - dont l’usageNotre-Dame du Raincy (93)est édifiée entre 1922 <strong>et</strong> 1932<strong>et</strong> de Carency. L’eff<strong>et</strong> décoratifarmé, on peut noter latemps utiles. Pour des raisonss’est diffusé sous l’impulsion deen 1922 – 1923. Dès lors,sur les plans de Paul Decaux.qui résulte de l’agencement desréalisation, sur les façadesreligieuses <strong>et</strong> symboliquesleur réédification est pourtantfortement souhaitée parFrançois Hennebique - apparaîtparticulièrement adapté pourrelever ce défi : le béton armé.l’emploi du béton armé segénéralise pour les réalisationsà caractère monumental.Son architecture mêle diversesinfluences, notamment romane<strong>et</strong> Art déco. Le recours à unematériaux rappelle, en négatif,l’alternance de pierre blanche<strong>et</strong> de brique de l’architecturelatérales, de bas-reliefsrappelant l’éphémère passéminier de la commune.François Hennebique(1842 – 1921)Au début des années 1890,il fonde la première firmeles populations. En 1921,Un temps rej<strong>et</strong>é car jugé indigneIl participe pleinement aucharpente en béton armé <strong>et</strong> latraditionnelle.est né à Neuville-Saint-Vaast,internationale de bétonla création de la Sociétéd’une construction dédiée àrenouvellement stylistique quisymbolique de la nef en formeentre Lens <strong>et</strong> Arras. Maçon puisarmé. Hennebique exploitecoopérative de reconstructionDieu, il est désormais mis às’affirme dans l’architectured’obus en font un bâtimentchef de chantier, c<strong>et</strong> autodidacteparfaitement ses brev<strong>et</strong>s <strong>et</strong>des églises du diocèse d’Arrasl’honneur.sacrée de la Reconstruction.remarquable.se m<strong>et</strong> rapidement à son compteréussit à imposer le nouveauperm<strong>et</strong> d’engager <strong>et</strong> d’accéléreren Belgique.matériau sur le marchéleur relèvement.Il s’intéresse aux qualités dede la construction <strong>et</strong> desl’alliance du ciment <strong>et</strong> du ferouvrages d’art à l’échellepour la résistance aux incendies.internationale.18 19
Vitrail de l’église Saint-GermainVitrail de Francis ChigotVitrail de Francis ChigotEglise Saint-Germain d’Aix Noul<strong>et</strong>te :L’une des stations du chemin de croix de l’égliseMobilier d’inspiration Art décoà Aix-Noul<strong>et</strong>te.dans l’église de Souchez.dans l’église de Carency.statue de Sainte Barbe sculptéed’Aix-Noul<strong>et</strong>te réalisé par le sculpteur Henri Bouchard.de l’église de Carency.par Georges-Laurent Saupique.Vitraux<strong>Les</strong> créations des maîtresSans constituer des référencesdu vitrail Art déco, ces deuxil sera probablement tout àfait possible de transformerÀ Souchez, le compromis avecle curé aboutit à une réalisationFrancis Chigot(1879-1960)Sculpture <strong>et</strong> mobilierSur le même principe,l’Exposition Internationalede 1937. Le second, qui s’estverriers témoignent d’uneréalisations illustrent la quêtenos maqu<strong>et</strong>tes jusqu’à cefigurative caractérisée par laest un verrier <strong>et</strong> peintre demenuisiers, ébénistes <strong>et</strong>vu décerné un prix à l’occasionréelle volonté d’innovationde modernité de l’artiste. Unequ’elles correspondent à votrerichesse <strong>et</strong> la maîtrise dans lavitraux né à Limoges. Il suitsculpteurs expérimentent dede l’Exposition Internationaleinfluencée notamment parl<strong>et</strong>tre adressée à Monsieurmanière de voir tout en restantgamme des couleurs employées.les cours de l’École des Artsnouvelles formes d’expression.des Arts décoratifs de 1925,l’Art déco. Conçus par Louisle curé de Souchez en 1930modernes. »Le drame de la Première GuerreDécoratifs de sa ville <strong>et</strong> s’orienteLa statue du Christ qui ornea notamment participé à laLéglise <strong>et</strong> Henri-Marcel Magne,souligne c<strong>et</strong>te démarche :A Carency, les vitraux adoptentmondiale est une autre sourcevers le vitrail après avoir visitéle service des Monumentsla façade nord de l’église dedécoration du paquebotles vitraux de l’église Saint-« Si j’insiste un peu au suj<strong>et</strong>un graphisme simple à partir ded’inspiration pour les maîtres-l’Exposition Internationale dehistoriques. On fait appelCarency a été réalisée avec du« Normandie ». Dans c<strong>et</strong>teGermain à Aix-Noul<strong>et</strong>te sontde mes propositions […],formes schématisées.verriers. L’un des vitraux de1900 à Paris. Il fonde son atelierà ses talents pour des opérationsbéton coulé sur place, dans unmême église se trouve unà la fois géométriques <strong>et</strong> trèsc’est que je crois qu’à notrela basilique Notre-Dame deà Limoges <strong>et</strong> travaille à la foisde restauration, puis pour lamoule unique. L’église Saint-chemin de croix Art décocolorés. A Carency <strong>et</strong> Souchez,époque, il est rationnel de faireLor<strong>et</strong>te, conçus par Charlespour des demeures privées <strong>et</strong>création de nouveaux vitrauxGermain d’Aix-Noul<strong>et</strong>te abriteréalisé par une autre grandeles vitraux sont l’œuvreun travail qui correspondeLorin d’après des cartonsdes édifices publics. Avec desdestinés aux églises des régionsplusieurs œuvres des sculpteursfigure de la sculpture de lad’un artiste de réputationau sens décoratif actuel : sid’Henri Pinta, s’inscrit dansthèmes empruntés au mondesinistrées. Son atelier acquiertAlexandre Descatoirespremière moitié du XX e siècle :internationale : Francis Chigot.certaines choses vous choquentce mouvement d’évocationvégétal, ses premières œuvresune notoriété internationale(1874 – 1949) <strong>et</strong> Georges-Laurentle dijonnais Henri Bouchard.A la différence d’autres verriers,dans notre conception, nousdu conflit.s’inscrivent dans le mouvement<strong>et</strong> l’on r<strong>et</strong>rouve des vitraux deSaupique (1889 – 1961). LeEn matière de mobilierChigot visitait les églisespourrons toujours en causer ;Art nouveau. Mobilisé en 1914,Chigot dans de nombreux pays.premier, originaire de Douai,liturgique, l’inspiration Artqu’il devait équiper afin d’enil se bat sur l’Yser, avant d’êtreSes œuvres s’inscrivent dansest connu comme étant l’auteurdéco est également parfaitementidentifier les contraintes <strong>et</strong> lesécarté des combats pour raisonles grands courants artistiquesde « la Jeunesse », une desperceptible dans les réalisationspotentialités.de santé. Au sortir du conflit,qui ont marqué le début dustatues en bronze doré du Palaisde l’entreprise Coasne-Delbarreil commence à travailler pourXX e siècle.de Chaillot commandées pourpour l’église de Carency.20 21
La nécropole nationale de Notre-Dame de Lor<strong>et</strong>te.Vitrail de la basilique Notre-DamePortrait de l’architecteMémorial canadien de Vimy, statueLe mémorial canadien de Vimy,Graffiti figurant un canon à Aix-Noul<strong>et</strong>te.de Lor<strong>et</strong>te évoquant le conflit.Louis-Marie Cordonnier.d’un homme endeuillé. Lieu historiquevue d’ensemble. Lieu historique nationalnational du Canada de la crête de Vimy.du Canada de la crête de Vimy.Un patrimoine de mémoireAux côtés des grands sites de Vimy <strong>et</strong> de Notre-Damede Lor<strong>et</strong>te, de nombreux cim<strong>et</strong>ières jalonnent le territoire.La nécropole nationalede Notre-Dame de Lor<strong>et</strong>teDominant le bassin minier,ce site représente un enjeustratégique pendant la PremièreGuerre mondiale. Occupé parles Allemands, il est reconquisen mai 1915 par les troupesfrançaises, au prix de la viede près de 100 000 hommes.En 1921, un cim<strong>et</strong>ière nationalest érigé au somm<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>tecolline où se tenait autrefoisune chapelle. C<strong>et</strong>te nécropolemarque par ses dimensions<strong>et</strong> sa solennité.Plus grand cim<strong>et</strong>ière militairefrançais, il accueille 20000tombes individuelles ainsique les corps de plus de22000 soldats inconnusrassemblés dans 8 ossuaires.Au centre, une basiliqueromano-byzantine <strong>et</strong> une tourlanterne de 52 m de haut sontédifiées entre 1921 <strong>et</strong> 1931Louis-Marie Cordonniernaît à Haubourdin en 1854.Lors de ses études à l’École desBeaux-Arts de Paris, il admireles œuvres d’Eugène Violl<strong>et</strong>le-Duc<strong>et</strong> de Charles Garnier.Il conçoit les hôtels de ville deLoos <strong>et</strong> de Dunkerque ainsique le Palais de la Paix àLa Haye. En 1906, il se voitconfier la réalisation d’unestation balnéaire à Hardelot.par Louis-Marie Cordonnier.La colline de Notre-Dame deLor<strong>et</strong>te est un site classé depuis1929.Après la Grande Guerre,il travaille activement à laReconstruction, notammentà Lille. A Lens, on lui doitles Grands Bureaux dela compagnie des mines.Décédé en 1940, Louis-MarieCordonnier a laissé uneforte empreinte Art déco <strong>et</strong>régionaliste dans le paysagearchitectural de la région.Le mémorial canadiende VimyEn reconnaissance del’intervention victorieuse del’armée canadienne lors de laprise de la crête de Vimy enavril 1917, le gouvernementfrançais concède à perpétuitéun terrain de 91 hectares auCanada. <strong>Les</strong> terres proviennentdes territoires de Givenchy-en-Gohelle, Neuville-Saint-Vaast,Thélus <strong>et</strong> Vimy. La constructiondu mémorial par l’architecteWalter Seymour Allward débuteen 1925 <strong>et</strong> dure 11 années. Surle socle sont gravés les nomsdes 11 285 soldats canadienstués en France <strong>et</strong> sans sépultureconnue.Surplombant la plaine, la statued’une femme drapée représentela nation canadienne pleurantses disparus. Deux colonnesde 35 m de haut symbolisentles sacrifices consentis par laFrance <strong>et</strong> le Canada. A leursomm<strong>et</strong>, les statues de la Paix<strong>et</strong> de la Justice surmontentcelles de la Vérité <strong>et</strong> de laConnaissance, <strong>et</strong> aux pieds desmarches celles de la Vaillance<strong>et</strong> de la Sympathie. A proximitédu Mémorial, le monument auxMorts de la division marocainerend hommage aux soldatsd’élite qui forcèrent pour lapremière fois le front allemandle 9 mai 1915.<strong>Les</strong> cim<strong>et</strong>ièresdu Commonwealth<strong>Les</strong> Britanniques, contrairementaux Français <strong>et</strong> aux Allemands,ont décidé de multiplier leslieux d’inhumation au plusprès des champs de bataille. Cechoix explique la présence denombreux cim<strong>et</strong>ières militairessur le territoire tels le ZouaveValley Cem<strong>et</strong>ery <strong>et</strong> le cim<strong>et</strong>ièredu Cabar<strong>et</strong>-Rouge à Souchezou bien encore le Villers StationCem<strong>et</strong>ery à Villers-au-Bois. <strong>Les</strong>cim<strong>et</strong>ières du Commonwealthont fait l’obj<strong>et</strong> d’une conceptionarchitecturale <strong>et</strong> paysagèreextrêmement soignée.<strong>Les</strong> graffi tis<strong>Les</strong> murs des villages offrentégalement ça <strong>et</strong> là de fragiles<strong>et</strong> touchants témoignages dessoldats engagés dans le conflit.Ils ont bien souvent gravé leurnom, leur affectation ou unedate pour signifier leur passage.Il s’agit parfois de dessins plusélaborés : un canon, l’esquissed’un portrait, le symbole d’uncorps d’armée, d’une nation oud’une appartenance religieuse…Particulièrement tendre, la pierreblanche locale se prêtait aisémentà ces gravures. À Aix-Noul<strong>et</strong>te,la malterie transformée en postede premier secours durant leconflit conserve la trace de c<strong>et</strong>épisode sur sa façade marquéed’une grande croix rouge.22 23
<strong>Les</strong> puits de Vimy en 1913.Plaques de la Compagnie des MinesBas-relief de l’église Saint-Martin de Vimy,La « Société Mécanique de Vimy».Le bus de la Compagnie des Mines de Béthune perm<strong>et</strong>tait aux mineurs, ici à Servins,Carte postale ancienne.de Gouy-Servins toujours visibles surreprésentant une tête de mineur.Carte postale ancienne.de se rendre à leur travail. Carte postale ancienne.une maison de l’ancienne cité minièrede Marqueffles.Le « Tortillard ».Carte postale ancienne.L’activité minièreBien qu’implantés en marge du bassin minier,ces villages représentent des zones d’extractionpotentielles pour les compagnies.Une exploitation minièrede courte duréeLa recherche de charbonconduit à la réalisation desondages prospectifs sur lesecteur. La concession accordéeen 1908 à la Compagnie desMines d’Ablain-Saint-Nazairene fut jamais exploitée. LaCompagnie des Mines de Gouy-Servins, constituée elle aussien 1908, fait foncer deux puitsà Marqueffles, un hameau deBouvigny-Boyeffles, en 1910.<strong>Les</strong> bureaux de la compagniesont installés dans une fermevoisine <strong>et</strong> la fosse est prêteà fonctionner au momentoù la guerre éclate. Elle esttotalement détruite durant leconflit. Après 1918, des travauxde déblaiement sont entrepris.En 1921, 40 maisons d’ouvriersmineurs sont construites.Marqueffles se transformealors en une véritable enclaveminière à la campagne. Troppeu rentables, les puits nefonctionnent cependant quejusqu’en 1934.La concession de Vimy-Fresnoy, est attribuée à laSociété des charbonnagesde Vimy en 1908 – 1910. Laconcession s’étend notammentsur les communes d’Acheville,Givenchy-en-Gohelle, Souchez<strong>et</strong> Vimy. Deux puits jumeaux<strong>et</strong> une cité minière sont établisà Vimy à partir de 1912.Stoppée pendant la guerre,l’exploitation reprend en 1922avant d’être définitivementabandonnée en 1924.Activités associéesLa « Société Mécanique deVimy» illustre le développementde p<strong>et</strong>ites industries suscité parl’activité minière en dehors dubassin minier. C<strong>et</strong>te entreprisede fonderie, chaudronnerie <strong>et</strong>charpente métallique est crééepeu avant 1914 avec le concoursde la Société des Mines de Lens.Située près de la gare de Vimy,c<strong>et</strong>te usine est incendiée en1914 puis transférée à Arrasoù elle existe toujours.À Aix-Noul<strong>et</strong>te la ferme dite« ferme des houillères » estutilisée pour l’alimentation deschevaux de la Compagnie desMines de Lens à partir de 1905.Le TortillardAppartenant à la Société desChemins de Fer Economiquesdu Nord, la ligne Lens-Frévent,d’une longueur de 54 km, estouverte le 8 août 1890. Elleconcrétise le développementde liaisons directes <strong>et</strong> régulièresentre le bassin minier <strong>et</strong> lescommunes rurales. Le traindessert entre autres les garesde Souchez, Carency <strong>et</strong>Villers-au-Bois. Ce p<strong>et</strong>ittrain, surnommé par tous« Le Tortillard », transporte denombreux mineurs issus desvillages vers leur lieu de travail.Il sert également au transportdes marchandises, en particulierdes produits agricoles vers lebassin minier <strong>et</strong> du charbonvers les villages. <strong>Les</strong> gares<strong>et</strong> les voies sont largementdétruites lors de la PremièreGuerre mondiale. Remise enétat au sortir du conflit, laligne du Tortillard reprend sesfonctions. Lors de la SecondeGuerre mondiale, elle perm<strong>et</strong>notamment à la population dese rendre à la campagne pours’approvisionner en nourriture.Après la guerre, la ligne est demoins en moins rentable. LeTortillard effectue son derniervoyage le 31 mai 1948. Unsentier de randonnée reprend enpartie l’ancien tracé ferroviaire<strong>et</strong> perm<strong>et</strong> notamment dedécouvrir les trois anciennesgares toujours visibles.24 25
Agglomération de Lens-Liévin26 27Conception <strong>et</strong> réalisation :Yann Cussey <strong>et</strong> Laurence Pottier( Service <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoirede Lens-Liévin )Remerciements :Béatrice Dancer (Mémoire d’Artois),Aurélie David (Archives municipalesde la Ville de Lens),Jérôme Decoupigny (Communaupolede Lens-Liévin),Col<strong>et</strong>te Dréan (Direction Régionaledes Affaires Culturelles),Christine Drobjak (Communaupolede Lens-Liévin),Philippe Druon (Conseil d’Architecture,d’Urbanisme <strong>et</strong> d’Environnement 62),Bernard Ghienne (Gauhéria),Alain Jacques (Service archéologiqued’Arras),Sébastien Kennitz (Mémoire de Lens),Arlène King (V<strong>et</strong>erans Affairs Canada),Olivier Liard<strong>et</strong> (Direction Régionaledes Affaires Culturelles),Clotilde P<strong>et</strong>itprez (Conseil d’Architecture,d’Urbanisme <strong>et</strong> d’Environnement 62),David Pierru (Communaupolede Lens-Liévin),Martine Tandeau de Marsac,les Bibliothèques municipales ainsi queles membres des comités historiques descommunes concernées pour les informations<strong>et</strong> iconographies sans lesquelles c<strong>et</strong> ouvragen’aurait pu voir le jour.Graphisme : Janine Schlimpert, sur la based’une conception de LM communiquer.Impression : Imprimerie de la Centrale Lens.Illustrations :© Archives départementalesdu Pas-de-Calais (AD 62) p.5 n°2(6 Fi C 179) ; p.7 n°1 (17 Fi B 901) ;p.11 n°1 (5 Fi 801/23) ; p.13 n°1(8 Fi D 1169-1174) ; p.17 n°2 (45 J 565) ;p.18 n°1 (2 O 1338) ; p.25 n°3 (5 Fi 361/48)© Communaupole de Lens-Liévinp.2 ; p.8 n°1 ; p.11 n°4 ; p.19 n°2© Bibliothèque municipale de Lillep.22 n°3 (Fonds Lefebvre 5,33-1 :portrait de Louis-Marie Cordonnier,architecte)© Musée des beaux-arts d’Arrasp.4 n°2 ; p.12 n° 2 ; p.15 n°3© Archives municipales de la Villede Lens p.3 n°4 (3 Fi 1)© CAUE 62 / Mémoire d’Artois(d’après une série de cartes). Evolutionde la ligne de front entre décembre 1914<strong>et</strong> septembre 1915 p.6 n°2© Service archéologique Arras p.4 n°1© Fonds familial Chigot – CSSL p.21 n°4© Jog’Ablain / Christophe Papillaudp.7 n°3© RMN (Château de Versailles) /Gérard Blot p.5 n°1© Interstice pp.26 – 27.© Affiche publicitaire de la BrasserieBrasme D.R. p.13 n°3© Portrait de François Hennebique D.R.p.19 n°4© Axonométrie d’une censeartésienne, dessin extrait de l’ouvrage :« L’architecture rurale française NordPas-de-Calais » ; Ed. La Manufacturep.8 n°4© La structuration des villages à partird’une succession de censes, schéma deprincipe. D.R. p.8 n°2Autres photographies :Office de Tourisme <strong>et</strong> du Patrimoinede Lens-Liévin / Yann CusseyPhoto de couverture :Chêne solitaire non loin du VillersStation Cem<strong>et</strong>ery à Villers-au-Bois.4 e de couverture en haut :Gargouille sur la façade de l’égliseSaint-Germain d’Aix-Noul<strong>et</strong>te.4 e de couverture en bas :Saint-Joseph. Vitrail de Francis Chigot.Chœur de l’église Saint-Nicolas de Souchez.
Direction régionaleLe label <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire est attribué parle Ministère de la Culture <strong>et</strong> de la Communicationaux collectivités engagées dans une politiqueglobale de protection <strong>et</strong> de valorisation dupatrimoine auprès du public.<strong>Les</strong> <strong>Villes</strong> <strong>et</strong> <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire constituentun réseau national qui perm<strong>et</strong> l’échange desexpériences les plus innovantes.A proximité, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Lille,Roubaix <strong>et</strong> Saint-Omer bénéficient de l’appellationVille d’art <strong>et</strong> d’histoire.Pour plus d’informations sur le patrimoine local<strong>et</strong> les activités du <strong>Pays</strong> d’art <strong>et</strong> d’histoire :Maison syndicale des mineurs32 rue Casimir Beugn<strong>et</strong>62300 LENS03 21 67 66 62pole-patrimoine@tourisme-lenslievin.frdes affaires culturellesNord Pas-de-CalaisOffice de Tourisme <strong>et</strong> du Patrimoinede Lens-Liévin26 rue de la Paix62300 LENS03 21 67 66 66info@tourisme-lenslievin.frwww.tourisme-lenslievin.fr