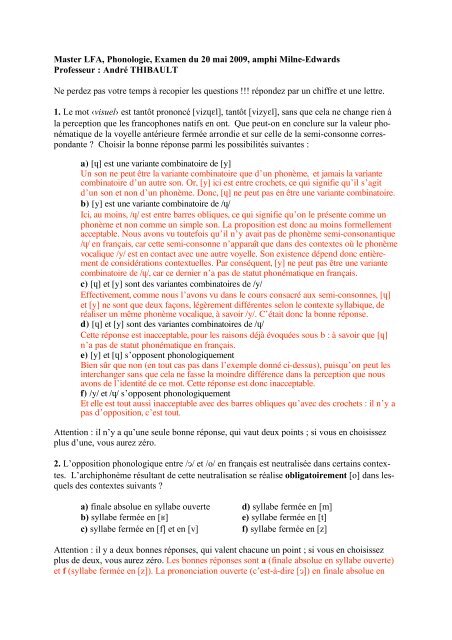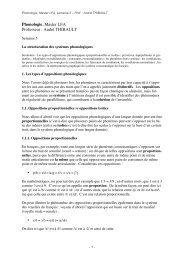Master LFA, Phonologie, Examen du 20 mai 2009 ... - André Thibault
Master LFA, Phonologie, Examen du 20 mai 2009 ... - André Thibault
Master LFA, Phonologie, Examen du 20 mai 2009 ... - André Thibault
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Master</strong> <strong>LFA</strong>, <strong>Phonologie</strong>, <strong>Examen</strong> <strong>du</strong> <strong>20</strong> <strong>mai</strong> <strong>20</strong>09, amphi Milne-EdwardsProfesseur : André THIBAULTNe perdez pas votre temps à recopier les questions !!! répondez par un chiffre et une lettre.1. Le mot ‹visuel› est tantôt prononcé [viz˙El], tantôt [vizyEl], sans que cela ne change rien àla perception que les francophones natifs en ont. Que peut-on en conclure sur la valeur phonématiquede la voyelle antérieure fermée arrondie et sur celle de la semi-consonne correspondante? Choisir la bonne réponse parmi les possibilités suivantes :a) [˙] est une variante combinatoire de [y]Un son ne peut être la variante combinatoire que d’un phonème, et ja<strong>mai</strong>s la variantecombinatoire d’un autre son. Or, [y] ici est entre crochets, ce qui signifie qu’il s’agitd’un son et non d’un phonème. Donc, [˙] ne peut pas en être une variante combinatoire.b) [y] est une variante combinatoire de /˙/Ici, au moins, /˙/ est entre barres obliques, ce qui signifie qu’on le présente comme unphonème et non comme un simple son. La proposition est donc au moins formellementacceptable. Nous avons vu toutefois qu’il n’y avait pas de phonème semi-consonantique/˙/ en français, car cette semi-consonne n’apparaît que dans des contextes où le phonèmevocalique /y/ est en contact avec une autre voyelle. Son existence dépend donc entièrementde considérations contextuelles. Par conséquent, [y] ne peut pas être une variantecombinatoire de /˙/, car ce dernier n’a pas de statut phonématique en français.c) [˙] et [y] sont des variantes combinatoires de /y/Effectivement, comme nous l’avons vu dans le cours consacré aux semi-consonnes, [˙]et [y] ne sont que deux façons, légèrement différentes selon le contexte syllabique, deréaliser un même phonème vocalique, à savoir /y/. C’était donc la bonne réponse.d) [˙] et [y] sont des variantes combinatoires de /˙/Cette réponse est inacceptable, pour les raisons déjà évoquées sous b : à savoir que [˙]n’a pas de statut phonématique en français.e) [y] et [˙] s’opposent phonologiquementBien sûr que non (en tout cas pas dans l’exemple donné ci-dessus), puisqu’on peut lesinterchanger sans que cela ne fasse la moindre différence dans la perception que nousavons de l’identité de ce mot. Cette réponse est donc inacceptable.f) /y/ et /˙/ s’opposent phonologiquementEt elle est tout aussi inacceptable avec des barres obliques qu’avec des crochets : il n’y apas d’opposition, c’est tout.Attention : il n’y a qu’une seule bonne réponse, qui vaut deux points ; si vous en choisissezplus d’une, vous aurez zéro.2. L’opposition phonologique entre /O/ et /o/ en français est neutralisée dans certains contextes.L’archiphonème résultant de cette neutralisation se réalise obligatoirement [o] dans lesquelsdes contextes suivants ?a) finale absolue en syllabe ouverte d) syllabe fermée en [m]b) syllabe fermée en [Â] e) syllabe fermée en [t]c) syllabe fermée en [f] et en [v] f) syllabe fermée en [z]Attention : il y a deux bonnes réponses, qui valent chacune un point ; si vous en choisissezplus de deux, vous aurez zéro. Les bonnes réponses sont a (finale absolue en syllabe ouverte)et f (syllabe fermée en [z]). La prononciation ouverte (c’est-à-dire [O]) en finale absolue en
syllabe ouverte s’entend en français de Suisse et de Belgique dans certains mots, pour desraisons étymologiques, par archaïsme (ex. mot [mO], trop [tÂO], croc [kÂO]), <strong>mai</strong>s en françaiscentral cette possibilité est disparue il y a quelques siècles déjà. Elle s’entend aussi en syllabefermée en [z] dans certains accents <strong>du</strong> sud (rose [ÂOz]), <strong>mai</strong>s cela n’appartient pas non plus aufrançais central (ou standard, ou normé, je vous laisse le choix <strong>du</strong> terme…).Quant à b, dans ce contexte seule la voyelle ouverte est possible.Dans le cas de c, de d et de e, les deux voyelles, l’ouverte et la fermée, sont possibles; elless’opposent d’ailleurs phonologiquement. On ne peut donc pas dire que, dans ces contextes,seule la voyelle fermée est possible; les deux sont possibles.3. L’opposition phonologique entre /ε/ et /e/ en français est difficile à enseigner aux étrangers.Il y a toutefois des indices graphiques (résultant de l’histoire des évolutions phonétiques <strong>du</strong>français) qui permettent d’offrir des repères aux apprenants. Quelles sont, parmi les mots cidessous,ceux qui contiennent des graphies correspondant au phonème /ε/ ?a) ‹poulet› e) ‹entrer›b) ‹armée› f) ‹palais›c) ‹assez› g) ‹karaté›d) ‹partaient› h) ‹prêts›Attention : il y a quatre bonnes réponses, qui valent chacune un point ; si vous en choisissezplus de quatre, vous aurez zéro.Bon, il fallait le savoir par cœur, cette question ne demandait pas beaucoup de réflexion…Les bonnes réponses sont a, d, f et h.4. En français québécois, les occlusives dentales suivies des voyelles (ou semi-voyelles)antérieures fermées subissent un phénomène d’assibilation, par lequel elles se prononcentcomme des affriquées dento-alvéolaires ; ce phénomène n’a toutefois aucune incidencephonologique. Laquelle des séquences de transcriptions suivantes représente fidèlement lasituation ?a) ‹Arthur› [aÂtyÂ] /aÂtyÂ/ d) ‹Arthur› [aÂtyÂ] /aÂèyÂ/b) ‹Arthur› [aÂèyÂ] /aÂèyÂ/ e) ‹Arthur› [aÂèyÂ] /aÂsyÂ/c) ‹Arthur› [aÂèyÂ] /aÂtyÂ/ f) ‹Arthur› [aÂsyÂ] /aÂsyÂ/Il n’y a qu’une seule bonne réponse, qui vaut deux points. Si vous choisissez plus d’uneréponse, vous aurez zéro.La réponse a ne peut pas être la bonne, parce que la transcription phonétique ne rend pasl’assibilation.La réponse b ne peut pas être la bonne, puisque dans l’intitulé de la question il est bienprécisé que le phénomène de l’assibilation n’a aucune incidence phonologique; il est doncerroné de faire apparaître le symbole de la dentale sourde assibilée [è] dans la transcriptionphonologique.La réponse c est la bonne : la dentale sourde assibilée [è] apparaît dans la transcriptionphonétique, <strong>mai</strong>s dans la transcription phonologique figure simplement le phonème /t/(puisqu’on a dit que cette assibilation est purement contextuelle, ce n’est qu’une variantecombinatoire qui dépend <strong>du</strong> contexte, et donc par conséquent en aucune façon un phonème àpart entière, <strong>mai</strong>s simplement une façon de prononcer le phonème /t/ dans un certain contexte(à savoir, devant voyelles ou semi-voyelles antérieures fermées).
La réponse d ne correspond pas à l’intitulé de la question : une assibilée doit apparaître dansla transcription phonétique, <strong>mai</strong>s évidemment pas dans la transcription phonologique.La réponse e ne correspond pas non plus à la question, puisqu’il était bien précisé que l’onparlait des occlusives dentales; or, le /s/ qui apparaît dans la transcription phonologique estune constrictive et non une occlusive.Même chose pour la réponse f.5. Associez les phénomènes diatopiques suivants à la région <strong>du</strong> monde francophone où onpeut les relever (0,5 point par bonne réponse, pour un total de 5 points) :5.1. ‹honte› [hO$t] j) Vosges ; Acadie ; Antilles5.2. ‹pré, prêt› [pÂe] i) Sud de la France ; Alsace5.3. ‹cheveux› [seve] a) Afrique noire5.4. ‹coule› [kUl] ~ ‹cool› [ku:l] g) Québec5.5. ‹emprunt, empreint› [ãpÂE$] f) Paris, Île-de-France5.6. ‹mot› [mO] ~ maux› [mo] d) Belgique ; Suisse5.7. opposition /j/ ~ /λ/ h) Roussillon5.8. ‹pantalon› [pO$talO$] e) Acadie ; Maghreb5.9. ‹théâtre› [tEja:t(Â)] c) Belgique ; Antilles5.10. ‹vite› [vIt] ~ vide [vi:t] b) Belgique6. Pourquoi dit-on en français tailler la haie et non pas tailler l’haie ?a) Parce que la prononciation <strong>du</strong> mot haie a été influencée par la graphie. Non; mêmesi un francophone ignorait totalement la façon dont ce mot s’écrit, il le prononceraittout de même sans liaison et sans élision.b) Parce que le mot haie a pour étymon un mot germanique qui commençait lui-mêmepar une consonne aspirée glottale, ce qui a bloqué l’élision. En effet, c’est la bonneréponse.c) Parce que le mot haie a pour étymon un mot latin qui commençait lui-même par uneconsonne aspirée glottale, ce qui a bloqué l’élision. La consonne aspirée <strong>du</strong> latin acessé de se prononcer déjà vers la fin de l’Antiquité; elle n’a absolument pas survécujusqu’en ancien français, contrairement aux aspirées des mots d’origine germanique.d) Parce que le mot haie est ici en situation d’autonymie. Non; il est dans un contextediscursif et syntagmatique normal.e) Parce que le mot haie est un mot savant. Non, c’est un mot héréditaire.Il n’y a qu’une seule bonne réponse, qui vaut 2,5 points. Si vous donnez plus d’une réponse,vous aurez zéro.7. Supposons que nous avons affaire à un locuteur méridional qui ne distingue pas phonologiquement[e] de [ε]. Comment convient-il de transcrire phonologiquement le mot suivant,dans son usage à lui : ‹Saint-Ger<strong>mai</strong>n-des-Prés› [s„ZEÂm„depÂe].a) /s„ZEÂm„depÂe/ S’il ne distingue pas phonologiquement ces deux sons, cela veutdire qu’ils ne correspondent pas chez lui à deux phonèmes, <strong>mai</strong>s à un seul, qu’on peuttranscrire /e/ dans tous les cas (ou, à la rigueur, /E/ dans tous les cas); ici, latranscription a posé l’existence de deux phonèmes, l’un qui serait /E/ et l’autre qui
serait /e/, ce qui est en contradiction avec le texte de la question, qui postule qu’il n’y ajustement pas d’opposition phonologique entre les deux sons.b) /s„ZeÂm„depÂe/ C’est la bonne réponse; les deux sons ont été ren<strong>du</strong>s par le mêmephénomène, noté /e/. On constate, dans la transcription phonétique donnée dans laquestion, que cet unique phonème est tantôt réalisé [E] (en syllabe fermée), tantôtréalisé [e] (en syllabe ouverte). Ce sont des variantes combinatoires d’un seul et mêmephonème.c) /s„ZEÂm„depÂe/ Les trois dernières transcriptions postulent l’existence d’unarchiphonème /E/. Or, un archiphonème résulte de la neutralisation d’une oppositionqui, quelque part dans la structure syllabique, est valide; <strong>mai</strong>s la question précise bienque chez ce locuteur, l’opposition n’existe pas, car le locuteur ne distingue pasphonologiquement ces deux sons. S’il n’y a pas d’opposition, il ne peut pas y avoir deneutralisation; s’il n’y a pas de neutralisation, il ne peut pas y avoir d’archipbhonème.Les trois dernières transcriptions étaient donc nécessairement erronées.d) /s„ZEÂm„depÂE/e) /s„ZEÂm„depÂE/Une seule réponse est bonne ; elle vaut 2,5 points. Ne choisissez pas plus d’une réponse, vousauriez zéro.Total : <strong>20</strong> points.