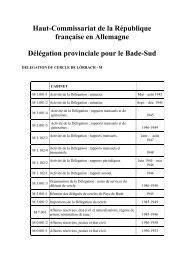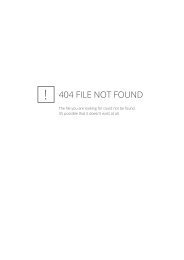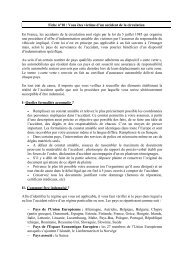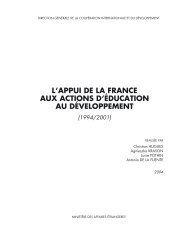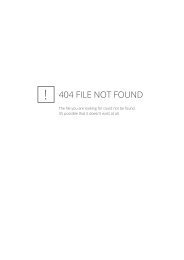Un Bilan de la prospective africaine - Ministère des affaires ...
Un Bilan de la prospective africaine - Ministère des affaires ...
Un Bilan de la prospective africaine - Ministère des affaires ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rapports d’étu<strong>de</strong><br />
DGCID<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong><br />
<strong>africaine</strong><br />
Volume II • Annexes<br />
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
La présente étu<strong>de</strong> a pour objectif <strong>de</strong> réaliser un bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong><br />
menés au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie, <strong>de</strong> leurs métho<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> leurs résultats. Elle présente<br />
également un cadre d’analyse et <strong>de</strong> réflexion permettant d’é<strong>la</strong>borer une recherche<br />
originale à partir <strong>de</strong> quelques principes :<br />
• Les spécificités <strong>africaine</strong>s ne peuvent faire <strong>de</strong> l’Afrique un simple champ d’application <strong>de</strong><br />
métho<strong>de</strong>s universelles.<br />
• Les futurs possibles et souhaitables lointains doivent être liés aux situations passées, présentes<br />
et futures proches. Il s’agit <strong>de</strong> comprendre les cheminements et <strong>de</strong> repérer les<br />
moments <strong>de</strong> rupture ou <strong>de</strong> bifurcations.<br />
• L’analyse <strong>prospective</strong> doit être globale, à <strong>la</strong> fois géopolitique, macro-économique et sectorielle.<br />
Elle suppose <strong>de</strong>s cadres <strong>de</strong> cohérence dont <strong>la</strong> fonction est moins <strong>de</strong> quantifier les<br />
trajectoires futures que <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce les contraintes et les risques <strong>de</strong> rupture.<br />
• La <strong>prospective</strong> globale concernant l’ensemble <strong>de</strong> l’Afrique sub-saharienne doit s’accompagner<br />
<strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s régionales autour <strong>de</strong>s grands pôles tels l’Afrique du Sud, le Nigeria<br />
ou encore <strong>de</strong>s pays présentant <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> désintégration comme <strong>la</strong> République démocratique<br />
du Congo dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong>s Grands <strong>la</strong>cs.<br />
La synthèse (volume I) est établie sur <strong>la</strong> base d'un cadre d'analyse en trois parties :<br />
1. Les objectifs <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s sur l'Afrique<br />
2. Les méthodologies <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s réalisées<br />
3. Les principales étu<strong>de</strong>s publiées avec une bibliographie sélective.<br />
Les annexes (volume II) présentent d'une part les centres d'étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> recherche <strong>prospective</strong>,<br />
publics et privés, et d'autre part <strong>de</strong>s fiches bibliographiques sur les principales étu<strong>de</strong>s<br />
<strong>prospective</strong>s réalisées sur l'Afrique.<br />
Cette collection regroupe <strong>de</strong>s rapports d’étu<strong>de</strong> réalisés à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
du ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères, et <strong>de</strong>stinés à nourrir <strong>la</strong> réflexion<br />
sur <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> coopération internationale et d'ai<strong>de</strong> au développement.<br />
Il s’agit <strong>de</strong> documents <strong>de</strong> travail.<br />
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES<br />
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT<br />
Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> programmation et <strong>de</strong> l’évaluation<br />
244 boulevard St Germain, 75303 Paris 07 SP<br />
http://www.diplomatie.fr<br />
ISBN : 2-11-091308-8
UN BILAN DE LA<br />
PROSPECTIVE AFRICAINE<br />
Volume 2<br />
ANNEXES<br />
Centres <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> production scientifique<br />
Recensement <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s<br />
Étu<strong>de</strong> réalisée par :<br />
Adrien AKANNI-HONVO<br />
Anne ANDROUAIS<br />
Marie-Odile BLANC<br />
Vincent GÉRONIMI<br />
Fabienne KERVAREC<br />
Anne-Catherine LA ROCHEBROCHARD<br />
A<strong>la</strong>in LÉON<br />
Véronique MASSENET<br />
Abel MAYEYENDA<br />
Anne NÉPLAZ<br />
Jean-Pierre NYS<br />
Naïma PAGÈS<br />
Guy POURCET<br />
Frédérique SAME EBOKO<br />
Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> VEREZ<br />
dans le cadre<br />
du CERED/CERNEA<br />
et<br />
sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> :<br />
Philippe HUGON<br />
Olivier SUDRIE<br />
Septembre 1999<br />
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Cette étu<strong>de</strong> est un document interne établi à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du ministère<br />
<strong>de</strong>s Affaires étrangères. Les commentaires et les analyses développées<br />
n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent en aucun cas une position officielle.<br />
Tous droits d’adaptation, <strong>de</strong> traduction et <strong>de</strong> reproduction<br />
par tous procédés, y compris <strong>la</strong> photocopie et le microfilm,<br />
réservés pour tous les pays<br />
© <strong>Ministère</strong> <strong>de</strong>s Affaires étrangères, 2000<br />
ISBN : 2-11-091308-8
SOMMAIRE<br />
2. LES CENTRES DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION SCIENTIFIQUE<br />
2.1 Centres <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> globale ...................................................................................13<br />
2.1.1 Organismes internationaux........................................................................................15<br />
2.1.2 Organismes régionaux...............................................................................................33<br />
2.1.3 Organismes nationaux...............................................................................................45<br />
2.1.4 Organismes privés <strong>de</strong> prévisions et <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s <strong>africaine</strong>s...............................85<br />
2.2 Centres <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> sectorielle.........................................................................91<br />
2.2.1 Agriculture..................................................................................................................93<br />
2.2.2 Démographie............................................................................................................103<br />
2.2.3 Education .................................................................................................................109<br />
2.2.4 Emploi ......................................................................................................................115<br />
2.2.5 Energie.....................................................................................................................117<br />
2.2.6 Santé........................................................................................................................125<br />
2.2.7 Transport..................................................................................................................141<br />
Annexes ...........................................................................................................................143<br />
3. RECENSEMENT DES ETUDES PROSPECTIVES<br />
3.1 Perspectives mondiales ayant <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces sur l’Afrique........................ 155<br />
3.1.1 Impact <strong>de</strong> l’économie mondiale sur l’Afrique...........................................................157<br />
3.1.2 Impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> régionalisation sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> l’Afrique...........................................165<br />
3.1.3 Impact <strong>de</strong>s accords et <strong>de</strong>s arrangements institutionnels sur l’Afrique....................183<br />
3.2 Les <strong>prospective</strong>s générales sur l’Afrique ......................................................... 195<br />
3.3 Les <strong>prospective</strong>s nationales................................................................................. 217<br />
3.4 Les <strong>prospective</strong>s sectorielles............................................................................... 235<br />
3.4.1 L’agriculture..............................................................................................................237<br />
3.4.2 La démographie.......................................................................................................245<br />
3.4.3 L’éducation...............................................................................................................255<br />
3.4.4 L’emploi....................................................................................................................263<br />
3.4.5 Energie, matières premières....................................................................................273<br />
3.4.6 L’environnement.......................................................................................................283<br />
3.4.7 Le financement extérieur .........................................................................................299<br />
3.4.8 La santé....................................................................................................................309<br />
3.4.9 Les transports ..........................................................................................................319<br />
3.4.10 La technologie........................................................................................................325<br />
3.4.11 L’urbanisation.........................................................................................................331<br />
SIGLES UTILISES..............................................................................................................345
INFORMATION<br />
accessible sur Internet<br />
Compte tenu du volume <strong>de</strong>s informations recueillies sur les centres <strong>de</strong> recherche et<br />
<strong>de</strong> production scientifique, ainsi que dans le recensement <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s,<br />
et aussi <strong>de</strong> l’intérêt et <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> ces données, l’édition papier a été limitée à<br />
quelques dizaines d’exemp<strong>la</strong>ires en privilégiant une édition électronique <strong>de</strong>s<br />
annexes (volume 2).<br />
Le lecteur est donc invité à consulter le site web du CERNEA :<br />
www.cernea.org<br />
<strong>Un</strong>e diffusion <strong>de</strong>s annexes est également prévue sous forme <strong>de</strong> CD-ROM.
2.<br />
CENTRES<br />
DE RECHERCHE<br />
ET DE PRODUCTION<br />
SCIENTIFIQUE
Ce volume présente, sous forme <strong>de</strong> fiches, les principaux centres <strong>de</strong> production<br />
<strong>de</strong> travaux prospectifs sur l’Afrique.<br />
Nous avons séparé les centres <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> globale et les centres <strong>de</strong><br />
<strong>prospective</strong> sectorielle et avons différencié les organisations internationales, les<br />
organisations régionales et les centres nationaux.<br />
Nous avons pris le parti d’indiquer <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> production qui font <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>prospective</strong> à titre secondaire ou qui s’intéressent au long terme. Il y a souvent, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong> ces centres, assimi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> et <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévision. Nous avons<br />
également indiqué les grands organismes qui seraient susceptibles d’en faire ou qui<br />
en ont fait sans être spécialisés sur ce domaine.<br />
étoile.<br />
Les rares centres spécialisés en <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> sont marqués d’une<br />
Les références bibliographiques citées faisant l’objet d’une fiche <strong>de</strong> lecture sont<br />
indiquées par une étoile.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 8
SOMMAIRE<br />
2.1. CENTRES DE PROSPECTIVE GLOBALE...................................................................... 13<br />
2.1.1. ORGANISMES INTERNATIONAUX................................................................................... 15<br />
Banque mondiale ............................................................................................................ 16<br />
CAD/OCDE........................................................................................................................ 17<br />
Centre <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l’OCDE.............................................................................. 18<br />
Club du Sahel/OCDE........................................................................................................ 19<br />
CMA.................................................................................................................................. 23<br />
CNUCED............................................................................................................................ 24<br />
Fond Monétaire International.......................................................................................... 25<br />
OCDE................................................................................................................................ 26<br />
OMC ................................................................................................................................. 27<br />
PNUD/Futurs Africains...................................................................................................... 28<br />
PNUD................................................................................................................................ 30<br />
<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies.......................................................................................... 31<br />
WIDER .............................................................................................................................. 32<br />
2.1.2. ORGANISMES REGIONAUX........................................................................................... 33<br />
BAD .................................................................................................................................. 34<br />
CEA .................................................................................................................................. 35<br />
CILSS................................................................................................................................ 36<br />
CODESRIA......................................................................................................................... 37<br />
CREA-AERC...................................................................................................................... 38<br />
DG8/Commission Economique Européenne................................................................... 39<br />
EADI.................................................................................................................................. 40<br />
ECDPM.............................................................................................................................. 42<br />
OUA.................................................................................................................................. 43<br />
Parlement européen........................................................................................................ 44<br />
2.1.3. ORGANISMES NATIONAUX............................................................................................ 45<br />
ACDI.................................................................................................................................. 46<br />
AFD................................................................................................................................... 47<br />
Australian National <strong>Un</strong>iversity......................................................................................... 48<br />
BNETD <strong>de</strong> Côte d’Ivoire.................................................................................................... 49<br />
Centre d’Analyse et <strong>de</strong> Prévision.................................................................................... 50<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche en Développement ...................................................................... 51<br />
CEPII................................................................................................................................. 52<br />
CERED.............................................................................................................................. 53<br />
CERDI ............................................................................................................................... 54<br />
CNAM................................................................................................................................ 55<br />
Commissariat Général du P<strong>la</strong>n....................................................................................... 56<br />
CPB-Central P<strong>la</strong>nning Bureau ......................................................................................... 57<br />
CRDE................................................................................................................................ 58<br />
CRDI ................................................................................................................................. 59<br />
CSIR ................................................................................................................................. 61<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 9
DIAL.................................................................................................................................. 62<br />
DPRU................................................................................................................................ 63<br />
Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prévision ................................................................................................. 64<br />
EPA................................................................................................................................... 65<br />
FGD .................................................................................................................................. 66<br />
GEMDEV ........................................................................................................................... 67<br />
IDE.................................................................................................................................... 69<br />
IFIE ................................................................................................................................... 70<br />
IFR.................................................................................................................................... 71<br />
IFRI................................................................................................................................... 72<br />
ISEAS................................................................................................................................ 73<br />
ISER.................................................................................................................................. 74<br />
ITCS.................................................................................................................................. 75<br />
IUED.................................................................................................................................. 76<br />
<strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n et du Développement industriel - Côte d’Ivoire ................................. 77<br />
<strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n - Sénégal............................................................................................ 78<br />
NIRA ................................................................................................................................. 79<br />
ODI................................................................................................................................... 80<br />
TIPS.................................................................................................................................. 81<br />
UNU-INRA ......................................................................................................................... 82<br />
USAID ............................................................................................................................... 83<br />
2.1.4. ORGANISMES PRIVES DE PREVISIONS ET DE PROSPECTIVES AFRICAINES...................... 85<br />
Liste (non exhaustive) <strong>de</strong> sociétés d’étu<strong>de</strong>s réalisant <strong>de</strong>s analyses <strong>prospective</strong>s<br />
et <strong>de</strong>s prévisions à moyen et long terme en Afrique ...................................................... 87<br />
Etu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s et prévisions globales à long terme<br />
CHOREME .................................................................................................................... 87<br />
DME............................................................................................................................. 87<br />
Economist Intelligence <strong>Un</strong>it........................................................................................ 87<br />
Hudson Institute.......................................................................................................... 88<br />
SFC.............................................................................................................................. 88<br />
Sociétés et Développement....................................................................................... 88<br />
WEFA Group ............................................................................................................... 88<br />
Etu<strong>de</strong>s sectorielles<br />
Pétrole • Pétrostartégies ........................................................................................... 89<br />
Télécommunications • DME....................................................................................... 89<br />
Infrastructures routières • INGEROP........................................................................... 89<br />
Irrigation • STRATYS................................................................................................... 90<br />
Textile • SERES .......................................................................................................... 90<br />
2.2. CENTRES DE PROSPECTIVE SECTORIELLE.............................................................. 91<br />
2.2.1. AGRICULTURE............................................................................................................. 93<br />
Banque mondiale ............................................................................................................ 94<br />
CIRAD ............................................................................................................................... 95<br />
FAO .................................................................................................................................. 97<br />
FAPRI................................................................................................................................ 98<br />
IFPRI................................................................................................................................. 99<br />
SOLAGRAL ...................................................................................................................... 100<br />
USDA/FAS....................................................................................................................... 101<br />
Wageningen Agricultural <strong>Un</strong>iversity.............................................................................. 102<br />
2.2.2. DEMOGRAPHIE .......................................................................................................... 103<br />
CEPED ............................................................................................................................ 104<br />
INED................................................................................................................................ 105<br />
PRB ................................................................................................................................ 106<br />
UNPF .............................................................................................................................. 107<br />
2.2.3. EDUCATION ............................................................................................................... 109<br />
IIPE................................................................................................................................. 110<br />
IREDU ............................................................................................................................. 111<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 10
PNUD.............................................................................................................................. 112<br />
UNESCO.......................................................................................................................... 114<br />
2.2.4. EMPLOI...................................................................................................................... 115<br />
BIT.................................................................................................................................. 116<br />
2.2.5. ENERGIE ................................................................................................................... 117<br />
CERNA............................................................................................................................ 118<br />
EIA.................................................................................................................................. 119<br />
IEPE................................................................................................................................ 120<br />
IIMI/IWMI.......................................................................................................................... 121<br />
US Geological Survey.................................................................................................... 122<br />
WEC ............................................................................................................................... 123<br />
Worldwatch Institute...................................................................................................... 124<br />
2.2.6. SANTE....................................................................................................................... 125<br />
ANRS .............................................................................................................................. 126<br />
BAD ................................................................................................................................ 127<br />
Banque mondiale – Human Development Department................................................ 128<br />
Bur<strong>de</strong>n of Disease <strong>Un</strong>it ................................................................................................. 130<br />
CRIPS ............................................................................................................................. 131<br />
OMS ............................................................................................................................... 133<br />
ONUSIDA......................................................................................................................... 135<br />
ORSTOM/IRD................................................................................................................... 137<br />
<strong>Un</strong>ited Nations – Popu<strong>la</strong>tion Division and Statistics Division....................................... 139<br />
2.2.7. TRANSPORT .............................................................................................................. 141<br />
DBSA .............................................................................................................................. 142<br />
Adresses........................................................................................................................... 143<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 11
2.1.<br />
CENTRES<br />
DE PROSPECTIVE GLOBALE
2.1.1.<br />
ORGANISMES<br />
INTERNATIONAUX
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 1818 H Street NW.<br />
20433 WASHINGTON<br />
États-<strong>Un</strong>is<br />
Tel. : (1 202) 477 1234<br />
Fax : (1 202) 477 6390<br />
Site Internet : http://www.worldbank.org<br />
Statut : Organisation internationale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
BANQUE MONDIALE<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong>, Pays en développement<br />
Sujets : La Banque mondiale est une institution multi<strong>la</strong>térale <strong>de</strong> développement qui a pour mission<br />
d’ai<strong>de</strong>r à promouvoir le progrès économique et social <strong>de</strong> ses membres en développement afin<br />
d’améliorer le niveau et les conditions <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> leurs popu<strong>la</strong>tions.<br />
SPÉCIALISTES<br />
La Banque Mondiale dispose d’un nombre élevé d’économistes et <strong>de</strong> spécialistes <strong>de</strong> l’environnement<br />
faisant <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> long terme. Elle n’a pas à proprement parler <strong>de</strong> spécialistes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong>s<br />
et fait appel à <strong>de</strong>s consultants extérieurs.<br />
RAMGOPAL AGARWALA<br />
URI DADUCH E-mail :udadush@worldbank.org<br />
Directeur du Groupe d’analyse <strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> développement<br />
ALAN GELB E-mail : agelb@worldbank.org Tel. : (1 202) 473 7667<br />
Chef économiste <strong>de</strong> <strong>la</strong> région Afrique<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
*Banque Mondiale (1989), L’Afrique Sub-Saharienne : <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise à une croissance durable. Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>prospective</strong> à long terme, Nov., Washington.<br />
The World Bank (1998/99), « Global Economic Prospects and the Developing Countries », The World<br />
Bank, Washington<br />
*The World Bank (1997), « China 2020 : Development Challenges in the New Century », The World<br />
Bank, Washington<br />
Eduard Bos, My T. Vu, Ernest Massiah, and Rodolfo A. Bu<strong>la</strong>tao (1994), « World Popu<strong>la</strong>tion<br />
Projections 1994-95 : Estimates and Projections with Re<strong>la</strong>ted Demographic Statistics », Washington.<br />
World Bank staff, (1990), « The Long-Term Perspective Study of Sub-Saharan Africa » The World<br />
Bank, Washington.<br />
Vol. 1 : « Countries Perspectives »<br />
Vol. 2 : « Economic and Sectoral Policy Issues »<br />
Vol. 3 : « Institutional and Sociopolitical Issues »<br />
Vol. 4 : « Proceeding of a Workshop on Regional Integration and Cooperation »<br />
Étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s en cours appuyées par <strong>la</strong> Banque Mondiale : Botswana, Nigeria, Gambia,<br />
Ghana.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 16
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 21 rue Pont <strong>de</strong>sHalles<br />
94536 Rungis ce<strong>de</strong>x<br />
Tel : 01 45 24 90 56<br />
Fax : 01 45 24 16 50<br />
E-mail : Brian.Hammond@oecd.org<br />
Site internet : Http://www.oecd.org/dac<br />
CAD/OCDE<br />
Statut : Comité d’Assistance Développement <strong>de</strong> l’OCDE.<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Pays en voie <strong>de</strong> développement<br />
Sujets :<br />
· Politiques économiques.<br />
· Energie.<br />
· Environnement.<br />
· Education.<br />
· Affaires sociales.<br />
· Sciences et technologie.<br />
· Agriculture.<br />
· Commerce.<br />
· Développement.<br />
Publications :<br />
· Shaping the 21 st Century : The contribution of <strong>de</strong>veloppement co-operation.<br />
· Developement Co-operation : Efforts and policies of the Members of the <strong>de</strong>velopment Assistance<br />
Committee. ( rapport annuel).<br />
· Geographical distribution of ressource flows (publication annuelle)<br />
· Financing and external <strong>de</strong>bt of <strong>de</strong>velopping countries (publication annuelle)<br />
· Aid and the environment.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Jean-Louis Grolleau Tel : 01 45 24 90 56<br />
Administrateur Principal<br />
Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Faure<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Le CAD ne réalise pas <strong>de</strong> réelle étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong>. Son activité est centré principalement sur les<br />
statistiques.<br />
*OCDE (1996), Le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération pour le développement à l’aube du XXIe siècle, Paris,<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 17
COORDONNÉES-STATUT<br />
CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L’OCDE<br />
Adresse : 94, rue Chardon-Lagache<br />
75016 Paris<br />
Tel. : 01 45 24 84 81<br />
Fax : 01 45 24 79 43<br />
Site internet : http ://www.oecd.org/<strong>de</strong>v/cen<strong>de</strong>v/<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
· Les crises financières et leurs implications structurelles<br />
· Mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> partenariats pour le développement<br />
· Politiques visant à améliorer <strong>la</strong> gouvernance<br />
· Développement durable<br />
· Mondialisation, cohésion sociale et démographie<br />
SPÉCIALISTES<br />
Le Centre <strong>de</strong> Développement <strong>de</strong> l’OCDE fait <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> prévisions à long terme mais pas <strong>de</strong><br />
réelle <strong>prospective</strong> sur l’Afrique.<br />
Aristomene Varoudakis Tel : 01 45 24 96 35 E-mail : aristomene.varoudakis@oecd.org<br />
Christine Richaud Tel : 01 45 24 96 03 E-mail : christine.richaud@oecd.org<br />
Ludvig So<strong>de</strong>rling Tel : 01 45 24 96 09 E-mail : ludvig.so<strong>de</strong>rling@oecd.org<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE ET LA PREVISION<br />
Bourguignon Fr., Branson W. H et <strong>de</strong> Melo J. (1989), Macroeconomic Adjustment and Income<br />
Distribution a Macro-Micro Simu<strong>la</strong>tion Mo<strong>de</strong>l, OCDE, Paris.<br />
Berthélemy J.-C., Varoudakis A.. (1996), Politiques <strong>de</strong> développement financier et croissance, Série<br />
croissance à long terme, OCDE, Paris.<br />
Morrisson Ch. et Talbi B. (1996), La croissance <strong>de</strong> l’économie tunisienne en longue pério<strong>de</strong>, Série<br />
croissance à long terme, OCDE, Paris.<br />
Berthélémy, J.-C., Ed., (1996), L’Afrique en <strong>de</strong>venir, OCDE, Paris.<br />
Berthélemy J.-C., Seck A. et Vourc’h A.. (1997), La croissance au Sénégal : un pari perdu ?, Série<br />
croissance à long terme, OCDE, Paris.<br />
Étu<strong>de</strong>s en cours :<br />
Programme Afrique Émergente :<br />
Varoudakis, Guil<strong>la</strong>umont, Richaud, « Economic Policy Reform and Growth Prospect in Emerging<br />
African Economies ».<br />
Étu<strong>de</strong>s pays : Côte d’Ivoire, Tanzanie, Mali, Ghana, Ouganda, Burkina Faso, République<br />
Démocratique du Congo.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 18
COORDONNÉES<br />
CLUB DU SAHEL/OCDE*<br />
Adresse : 63 bd Beauséjour, 39, boulevard Suchet<br />
75016 Paris 75016 Paris<br />
Tel. : 01 45 24 82 00 01.45.24.89.86<br />
Fax : 01 45 24 79 43 01.45.24.90.31<br />
Site internet : http ://www.oecd.org/sah/francais2/sahel-fr.htm<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Pays du Sahel, Afrique <strong>de</strong> l’Ouest<br />
SPÉCIALISTES<br />
Jean-Marie Cour Tel : 01 45 24 95 17 E-mail : jean-marie.cour@oecd.org<br />
Jean-Daniel Nau<strong>de</strong>t Tel : 01.53.24.14.50<br />
Benoît Ninnin<br />
Serge Snrech Tél. : 01.44.14.69.13<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Le Club du Sahel réalise, notamment dans le cadre <strong>de</strong> WALTPS, <strong>de</strong> nombreux travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong><br />
sur l’Afrique.<br />
Cour J.-M., Nau<strong>de</strong>t J.-D. (1996) « West Africa in 2020 ». L’observateur <strong>de</strong> l’OCDE, n° 200, Paris<br />
Nau<strong>de</strong>t J.-D. (1995) « L’Émergence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Compétition : Transformation et Déséquilibres dans les<br />
Sociétés Ouest Africaines (1960-2020 ».OCDE. Club du Sahel. Paris<br />
Club du Sahel. (1998). « Pour Préparer l’avenir <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : <strong>Un</strong>e vision à l’horizon 2020 ».<br />
Étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s perspectives à long terme en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. OCDE. Paris<br />
LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS<br />
Synthèse <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> WALTPS SAHID (94) 439<br />
Pour préparer l’avenir <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest: une vision à l’horizon 2020. S. SNRECH, préface<br />
<strong>de</strong> Anne <strong>de</strong> LATTRE.<br />
Décembre 1994. 70 p + annexes. Document épuisé, remp<strong>la</strong>cé par le présent ouvrage, également<br />
disponible en ang<strong>la</strong>is.<br />
Compte rendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> rencontre régionale sur les perspectives à long terme en Afrique <strong>de</strong><br />
l’Ouest, Ouagadougou<br />
26-29 septembre 1994. 37 p. Version ang<strong>la</strong>ise disponible<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 1 SAHID (93) 415<br />
Description du peuplement en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. Commentaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong> données.<br />
B. KALASA. Décembre 1993. 124 p + annexes. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is.<br />
Le document commente <strong>la</strong> base <strong>de</strong> données démographique constituée dans le cadre <strong>de</strong><br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s perspectives à long terme en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : une dynamique démographique sans<br />
précé<strong>de</strong>nt dans l’histoire, une urbanisation rapi<strong>de</strong> mais re<strong>la</strong>tivement équilibrée, une forte<br />
hétérogénéité du peuplement rural, <strong>de</strong>s flux migratoires intenses etc. Le document présente<br />
également <strong>de</strong>s extraits <strong>de</strong> cette base <strong>de</strong> données portant sur les 19 pays étudiés (effectifs totaux,<br />
urbains et ruraux 1930-2020, taux <strong>de</strong> croissance, migrations internes…) ainsi que quelques tableaux<br />
<strong>de</strong> synthèse régionale.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 19
Document <strong>de</strong> travail n° 2 SAHID (93) 410<br />
Analyse démo-économique rétrospective et esquisse d’image démo-économique à long terme<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> région Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.M COUR. Janvier 1994. 80 p + annexes. Disponible en français et<br />
en ang<strong>la</strong>is<br />
Du fait <strong>de</strong> l’insuffisance <strong>de</strong>s statistiques <strong>de</strong> base, les comptes nationaux <strong>de</strong>s pays d’Afrique <strong>de</strong><br />
l’Ouest fournissent une image incomplète et déformée <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité. Ce travail se propose <strong>de</strong> fournir<br />
une <strong>de</strong>uxième image différente et complémentaire, également incomplète et déformée, utilisant le<br />
cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> comptabilité démo-économique. Après un rappel méthodologique sur <strong>la</strong> construction et <strong>la</strong><br />
portée <strong>de</strong>s matrices <strong>de</strong> comptabilité sociale (MCS), l’auteur propose un essai <strong>de</strong> diagnostic<br />
d’ensemble <strong>de</strong>s performances démo-économiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> région entre 1960 et 1990. Cette analyse<br />
démo-économique met en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s éléments porteurs d’avenir qui pourraient déboucher sur une<br />
nouvelle phase <strong>de</strong> croissance économique accélérée et soutenable.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 3 SAHID (93) 411<br />
Eléments <strong>de</strong> vision économique <strong>prospective</strong>, l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest à l’horizon décennal. J.-<br />
D. NAUDET (DIAL). Novembre 1993. 62 p. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />
Fixée sur un horizon décennal, l’étu<strong>de</strong> <strong>la</strong>isse aux dynamiques actuellement engagées un fort<br />
pouvoir d’orientation <strong>de</strong> l’avenir. Quelles sont ces dynamiques ? <strong>Un</strong> développement remarquable du<br />
secteur informel, un secteur mo<strong>de</strong>rne en forte récession, une croissance extensive, sans gain <strong>de</strong><br />
productivité, une économie basée sur l’extérieur, le commerce et les logiques rentières. Au total<br />
cependant, une croissance économique globale qui a néanmoins réussi à suivre <strong>la</strong> croissance<br />
démographique et à s’adapter à <strong>la</strong> structuration du peuplement.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 4 SAHID (94) 433<br />
Géographie économique du milieu ouest-africain ; marchés, peuplement, agriculture, routes ;<br />
éléments <strong>de</strong> modélisation 1960-1990. B. NINNIN. Juin 1994. 107 p + annexes. Disponible en<br />
français et en ang<strong>la</strong>is<br />
Les outils mis à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> géographie quantitative ont singulièrement évolué au cours<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie. Ils offrent désormais <strong>de</strong>s possibilités réelles pour <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
dimension spatiale <strong>de</strong> l’économie, en particulier en milieu rural. L’objet <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> présenter<br />
l’approche par les "tensions <strong>de</strong> marchés" mise au point dans le cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> WALTPS. L’étu<strong>de</strong> se<br />
propose d’établir une mesure <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> structuration spatiale du peuplement et <strong>de</strong><br />
l’agriculture par les marchés et définit les possibilités d’utilisation <strong>de</strong> cette mesure pour <strong>la</strong> construction<br />
d’une image à long terme. Enfin, cette même grille <strong>de</strong> lecture que constituent les tensions <strong>de</strong> marchés<br />
permet <strong>de</strong> proposer une explication (en termes d’ordres <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur) <strong>de</strong> <strong>la</strong> très forte disparité<br />
géographique dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité du réseau d’infrastructures routières.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 5 SAHID (93) 421<br />
Etats, frontières et dynamiques d’aménagement du territoire en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.O. IGUE et<br />
B.G SOULE. Décembre 1993. 74 p + annexes. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />
Comment les cadres territoriaux issus du partage colonial ont-ils été aménagés ? Le document<br />
passe en revue le cadre institutionnel <strong>de</strong>s politiques d’aménagement et dresse le bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s<br />
équipements (communications, éducation, santé, agriculture, industrie…) <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. A<br />
quelques exceptions près, ce diagnostic met en exergue l’inconsistance <strong>de</strong> ces politiques, souvent<br />
mal formulées, dénuées <strong>de</strong> moyens et basées sur <strong>de</strong>s cadres spatiaux inadéquats. Cette<br />
inadéquation du cadre territorial <strong>de</strong>s politiques explique le développement <strong>de</strong> dynamiques<br />
d’aménagement spontanées comme les réseaux <strong>de</strong> marchés ou les espaces frontaliers. La nécessité<br />
<strong>de</strong> repenser l’aménagement du territoire est donc à l’ordre du jour.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 6 SAHID (94) 434<br />
Le financement extérieur du développement en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : analyse <strong>de</strong>s transferts et<br />
réflexion sur l’ai<strong>de</strong> au développement (1960-1990). J.-M. COUR et D. NAUDET (DIAL).<br />
Juillet 1994.124 p. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />
<strong>Un</strong>e étu<strong>de</strong> WALTPS a montré par ailleurs l’intérêt <strong>de</strong> percevoir l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest comme une<br />
région en voie <strong>de</strong> peuplement dans <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l’investissement interne a été<br />
consacré, au cours <strong>de</strong>s trente <strong>de</strong>rnières années, à l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions. Qu’en est-il <strong>de</strong>s<br />
apports financiers extérieurs dans cet endroit du mon<strong>de</strong> généralement perçu comme une région<br />
"portée à bout <strong>de</strong> bras" par <strong>la</strong> communauté internationale ? C’est à cette question que le présent<br />
document tente d’apporter <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> réponse. D’abord par une analyse consolidée <strong>de</strong><br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 20
l’ensemble <strong>de</strong>s financements extérieurs, puis par une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> au développement qui est "un<br />
transfert parmi d’autres mais pas comme les autres". Il s’agit <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux textes complémentaires qui ont<br />
en commun <strong>de</strong> souligner <strong>la</strong> nécessité d’adapter les flux financiers internationaux en direction <strong>de</strong><br />
l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest, aux dynamiques endogènes au premier rang <strong>de</strong>squelles figure l’évolution du<br />
peuplement dans l’espace régional.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 7 SAHID (94) 432<br />
L’éducation en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : situation, enjeux et perspectives. R. PONS. Juin 1994. 47 p.<br />
Disponible en français seulement<br />
Des défis générés par <strong>la</strong> fantastique dynamique démographique <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest,<br />
l’éducation est, sans aucun doute l’un <strong>de</strong>s plus importants. Exercice <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s informations<br />
quantitatives et <strong>de</strong>s analyses les plus récentes, ce document montre l’ampleur <strong>de</strong>s problèmes que <strong>la</strong><br />
région doit et <strong>de</strong>vra affronter en <strong>la</strong> matière : 24 millions d’enfants sco<strong>la</strong>risés dans le primaire en 1990<br />
(60 pour cent <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en âge <strong>de</strong> l’être) et plus <strong>de</strong> 50 millions d’enfants à sco<strong>la</strong>riser en l’an<br />
2020…<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 8 SAHID (93) 412<br />
L’urbanisation en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : mécanismes et logiques. M. ARNAUD. Décembre 1993. 30<br />
pp + annexes.<br />
Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />
L’étu<strong>de</strong> décrit le phénomène d’urbanisation ouest-africain qui, entre 1960 et 80, a été trois fois<br />
plus rapi<strong>de</strong> que celui <strong>de</strong> l’Europe au plus fort <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution industrielle. Cette rapidité explique <strong>la</strong><br />
structure et l’occupation <strong>de</strong> l’espace ainsi que <strong>la</strong> prédominance du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> production informel, "lieu"<br />
d’accueil privilégié <strong>de</strong>s nouveaux migrants. La ville détermine également une structuration sociale<br />
particulière où <strong>la</strong> "proximité du pouvoir" <strong>de</strong>meure le mo<strong>de</strong> majeur d’enrichissement individuel et<br />
collectif. La satisfaction <strong>de</strong>s besoins essentiels, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’espace urbain, l’activité économique et<br />
les changements sociaux, sont abordés à <strong>la</strong> fois dans leurs dynamiques et dans leurs adaptations à <strong>la</strong><br />
crise économique <strong>de</strong>s années 80.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 9 SAHID (94) 444<br />
Evolutions socio-politiques en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : synthèse <strong>de</strong>s réflexions menées dans le<br />
cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> WALTPS. L. BOSSARD, décembre 1994. 30 p. Disponible en français seulement<br />
Dans une première partie, le document retrace l’évolution du pouvoir et <strong>de</strong> l’État dans les<br />
sociétés ouest-<strong>africaine</strong>s, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> pré-coloniale à nos jours. Dans une <strong>de</strong>uxième partie, les<br />
enjeux sociaux et politiques <strong>de</strong> l’avenir sont ébauchés, à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> l’analyse<br />
démo-économique <strong>de</strong> WALTPS : émergence <strong>de</strong> nouvelles c<strong>la</strong>sses d’entrepreneurs ruraux et urbains,<br />
développement <strong>de</strong> l’économie locale et décentralisation, rôle <strong>de</strong> l’Etat, enjeux sociaux liés à<br />
l’urbanisation etc.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 10 SAHID (93) 417<br />
Les conséquences démographiques <strong>de</strong> l’épidémie <strong>de</strong> VIH/SIDA en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.-<br />
J. GABAS, M. POSTEL et B. KALASA. Décembre 1993. 23 p. + annexes. Disponible en français<br />
seulement<br />
Comme dans beaucoup d’autres domaines, les connaissances sur l’étendue <strong>de</strong> l’épidémie <strong>de</strong><br />
SIDA en Afrique sont limitées. Ce que l’on sait en revanche avec certitu<strong>de</strong>, c’est que, contrairement<br />
aux autres régions du mon<strong>de</strong>, le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> transmission en Afrique est majoritairement hétérosexuel. Il<br />
est donc acquis que son impact démographique sera sans doute plus important qu’ailleurs.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 11 SAHID (93) 406<br />
Peuplement et économie en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.-D. NAUDET (DIAL). Novembre 1992. 51 p<br />
+ annexes. Disponible en français seulement<br />
L’objet <strong>de</strong> ce travail est, dans un premier temps, d’essayer d’appréhen<strong>de</strong>r l’économie réelle <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> région par le recoupement <strong>de</strong> différentes bases <strong>de</strong> données internationales et d’informations issues<br />
<strong>de</strong>s pays d’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. Les résultats <strong>de</strong> cette analyse sont ensuite "relus" à travers <strong>de</strong>ux<br />
visions démo-économiques volontairement contrastées (et polémiques) : <strong>la</strong> ville prédatrice, d’un poids<br />
trop important, qui fausse les phénomènes <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion naturelle avec <strong>la</strong> campagne et qui génère<br />
dépendance alimentaire et chômage, et <strong>la</strong> ville structurante qui, même si elle est porteuse <strong>de</strong><br />
déséquilibres, crée une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> solvable et structure son hinter<strong>la</strong>nd.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 21
Document <strong>de</strong> travail n° 12 SAHID (93) 414<br />
Performances du secteur agricole et redistribution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.M<br />
COUR. Décembre 1993. 33 p + annexes. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />
Entre 1930 et 2030, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest aura été multipliée par 10 et <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion urbaine par 100. C’est à travers le prisme <strong>de</strong> cette fantastique dynamique <strong>de</strong> peuplement<br />
que sont analysées les performances agricoles <strong>de</strong> <strong>la</strong> région au cours <strong>de</strong>s trente <strong>de</strong>rnières années. Il<br />
est vrai que globalement, les bi<strong>la</strong>ns alimentaires régionaux se sont progressivement dégradés,<br />
traduisant un déca<strong>la</strong>ge d’adaptation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> trois ans. Mais il<br />
apparaît également que, contrairement à <strong>de</strong>s idées répandues, les habitu<strong>de</strong>s alimentaires urbaines<br />
n’ont pas évolué vers une extraversion croissante et que <strong>la</strong> région est, après le reste <strong>de</strong> l’Afrique subsaharienne,<br />
<strong>la</strong> région du mon<strong>de</strong> où les importations alimentaires par tête sont les plus faibles.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 13 SAHID (93) 405<br />
Modélisation <strong>de</strong>s flux d’échanges extérieurs internationaux 1970-1990 (effets structurels,<br />
inclinaisons spécifiques) et analyse <strong>de</strong>s modèles d’ouverture en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J. D.<br />
NAUDET (DIAL). Février 1993. 33 p. + annexes. Disponible en français seulement<br />
<strong>Un</strong>e étu<strong>de</strong> a pour objet <strong>de</strong> construire et d’analyser un modèle économétrique explicatif <strong>de</strong>s<br />
comportements mondiaux d’échanges extérieurs en fonction <strong>de</strong> paramètres structurels<br />
caractéristiques <strong>de</strong>s pays. Elle tente d’apporter un éc<strong>la</strong>irage sur <strong>de</strong>ux thèmes précis: 1) cerner les<br />
liens entre dimension et/ou popu<strong>la</strong>tion d’un pays et <strong>de</strong>gré d’ouverture aux échanges extérieurs et 2)<br />
définir <strong>de</strong>s niveaux théoriques (ou potentiels) d’échanges entre pays, <strong>de</strong>stinés à servir <strong>de</strong> base<br />
<strong>prospective</strong> ou à appréhen<strong>de</strong>r les échanges extérieurs <strong>de</strong> régions (regroupement ou divisions <strong>de</strong><br />
pays). L’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest fait ensuite l’objet d’un exemple d’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécificité du<br />
comportement d’ouverture d’une région. Cette analyse montre notamment que l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest,<br />
considérée dans son ensemble, ne semble pas présenter <strong>de</strong> caractéristiques spécifiques quant au<br />
niveau <strong>de</strong> ses exportations et <strong>de</strong> ses importations, compte tenu <strong>de</strong> ses paramètres <strong>de</strong> dimension, <strong>de</strong><br />
richesse et <strong>de</strong> prix intérieurs.<br />
Document <strong>de</strong> travail n° 14 SAHID (93) 407<br />
Modélisation démo-économique <strong>de</strong>s pays en voie <strong>de</strong> peuplement. J.-D. NAUDET. Janvier 1993.<br />
33 p. Disponible en français seulement<br />
En Afrique <strong>de</strong> l’ouest, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion est le plus souvent étrangement absente <strong>de</strong> <strong>la</strong> modélisation<br />
et donc <strong>de</strong> <strong>la</strong> réflexion économique. Les modèles <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ignorent l’influence <strong>de</strong>s phénomènes<br />
démographiques. Quant aux modèles d’offre, ils présupposent, le plus souvent à juste titre, que l’offre<br />
<strong>de</strong> travail est illimitée, et désamorcent donc <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion démo-économique. L’étu<strong>de</strong> explore <strong>de</strong>s voies<br />
<strong>de</strong> recherche pour intégrer <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ainsi que l’évolution <strong>de</strong> sa répartition dans<br />
l’espace, dans <strong>de</strong>s modèles économiques <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Elle se base d’une part sur l’idée que <strong>la</strong><br />
distribution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion joue un rôle dans les comportements économiques. Elle part également<br />
<strong>de</strong> l’hypothèse que les mouvements <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion ont principalement pour fonction et déterminant <strong>de</strong><br />
répartir les évolutions <strong>de</strong> revenu entre les différentes composantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Ils ont donc un rôle<br />
régu<strong>la</strong>teur (multiplicateur ou atténuateur) <strong>de</strong>s chocs endogènes et exogènes que subit l’économie.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 22
COORDONNÉES-STATUT<br />
CMA<br />
COALITION MONDIALE POUR L’AFRIQUE<br />
Adresse : 1750 Pensylvania<br />
Avenue NW Suite 1204<br />
Washington DC 2000- USA<br />
Tél. : 1202 458 4338 / 4272 /<br />
Fax : 1202 522 3259<br />
Site internet : www.gcq-cma .org<br />
Statut : Forum Nord-Sud<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Sujets : Réforme économique ; intégration et coopération économiques régionales ; suivi <strong>de</strong>s<br />
tendances du développement et <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong> ressources à l’Afrique ; allégement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte ;<br />
investissement en Afrique ; lutte contre <strong>la</strong> corruption ; convention <strong>de</strong> Lomé et future coopération ACP-<br />
UE ; commerce international.<br />
Activités en 1998 : Conférences <strong>de</strong> Tokyo (TICAD II), Conférence d’Harare ; col<strong>la</strong>boration avec les<br />
ONG ; <strong>la</strong> société civile et le secteur privé.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Ahmedou Ould-Abdal<strong>la</strong>h (secrétaire exécutif) ;<br />
La<strong>la</strong> ben Barka (secrétaire exécutif adjoint)<br />
Ketumile Masire, Frene Ginwa<strong>la</strong> (conférence <strong>de</strong> Tokyo)<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
CMA, (1995), Afrique 1990-95 et au <strong>de</strong>là, Washington<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 23
CNUCED<br />
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE<br />
ET LE DÉVELOPPEMENT<br />
COORDONNEES-STATUT<br />
Adresses : CNUCED<br />
Pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong>s Nations<br />
1211 Genève, Suisse<br />
Tel : +41 22 907 12 34/917 12 34<br />
Fax : +41 22 907 00 43<br />
E-mail : pour les publications et références : Service@unctad.org<br />
Site internet : http ://www.unic.org<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Sujets :<br />
· Mondialisation et structures <strong>de</strong> développement.<br />
· Commerce international <strong>de</strong> biens et services et produits <strong>de</strong> base.<br />
· Investissement, technologie et développement <strong>de</strong>s entreprises.<br />
· Infrastructure <strong>de</strong>s services pour le développement et efficacité commerciale.<br />
· Pays en développement les moins avancés sans littoral ou insu<strong>la</strong>ires.<br />
· Questions intersectorielles.<br />
SPÉCIALISTES<br />
La CNUCED n’a pas <strong>de</strong> spécialistes en <strong>prospective</strong>. Elle a fit <strong>de</strong>s travaux dans une perspective <strong>de</strong><br />
moyen terme.<br />
Lynn Mytelka<br />
Responsable Afrique<br />
Monsieur Kousari Tel : 916 58 00 E mail : kamran.kousari@unctad.org<br />
TRAVAUX BIBLIOGRAPHIQUES<br />
CNUCED, (1998), Rapport sur le commerce et le développement, Genève<br />
*CNUCED, (1998), Libéralisation du commerce international et implications pour <strong>la</strong> diversification en<br />
Afrique, Genève<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 24
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : International Monetary Fund<br />
700 19 th Street, NW<br />
Washington, DC. 20431 USA<br />
Tel. : 1 202 623 74 30<br />
Fax : 1 202 623 72 01<br />
Site internet : http ://www.imf.org<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
FOND MONETAIRE INTERNATIONAL<br />
Zone géographique : L’activité du FMI s’étend à l’ensemble du globe.<br />
Sujets : Le FMI a une mission <strong>de</strong> stabilisation et d’ajustement <strong>de</strong>s économies. Il ai<strong>de</strong> prioritairement<br />
les pays à trouver l’équilibre <strong>de</strong> <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s paiements. Il a une position réactive au sens <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>prospective</strong>.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Département Afrique :<br />
G.E Gondwe E mail : ggondwe@imf.org<br />
Ernesto Hernan<strong>de</strong>z-Cata E mail : ehernan<strong>de</strong>z-cata@imf.org<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Le Fond Monétaire International ne réalise aucune étu<strong>de</strong> à long terme.<br />
Les rapports réalisés sur les pays donnent une vision <strong>de</strong> l’économie à court terme.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 25
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 2, rue André Pascal<br />
75775 Paris Ce<strong>de</strong>x 16<br />
Tel. : 01.45.24.82.00<br />
Fax : 01.45.24.90.31<br />
OCDE<br />
Site internet : http://www.oecd.org/dac/htm/sooncomm.thm<br />
Organisation internationale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Étu<strong>de</strong>s macro-économiques<br />
SPÉCIALISTES<br />
Wolfang MICHALSKI : Directeur unité consultative auprès du secrétaire général<br />
Pete RICHARDSON : Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> division d’analyse macro-économique et gestion <strong>de</strong>s système du<br />
département <strong>de</strong>s Affaires économique <strong>de</strong> l’OCDE<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
OCDE (1997), Globalization and linkages to 2020. Challenges and opportunities for OECD countries,<br />
Paris.<br />
Revue économique <strong>de</strong> l’OCDE, Pete Richardson, ed. (1997), n° 28, Mondialisation et<br />
interdépendance. Défis et opportunités sur le p<strong>la</strong>n macro-structurel, OCDE, Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 26
COORDONNÉES-STATUT<br />
OMC<br />
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE<br />
Adresse : Centre William Rappard,<br />
Rue <strong>de</strong> Lau<br />
CH-1211 Genève, Suisse<br />
Tel. : (022) 739 52 08/53 08<br />
Fax : (022) 739 57 92<br />
Site internet : http ://www.wto.org<br />
Statut : organisation internationale.<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : mon<strong>de</strong><br />
L’OMC ne fait pas <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>. Elle réalise <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s sur l’impact <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong><br />
libéralisation multi<strong>la</strong>térale sur les économies <strong>africaine</strong>s.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Dickson YEBOAH E-mail : Dickson.Yeboah@wto.org<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
OMC (1993) « Intra-African Food Tra<strong>de</strong>: An Empirical Investigation », Journal of The Developing<br />
Economics, volume XXXI, Number 1, Mars, Institute of Developing Economies, Tokyo.<br />
OMC (1993), « Regional Economic Integration and the GATT », World Competition, vol. 17 No. 1,<br />
September., Genève<br />
Yeboah D. (1993), « International Development Policies : Perspectives for Industrial countries », The<br />
Journal of Developing Areas, vol. 27 No. 2 January, Western Illinois <strong>Un</strong>iversity, Urbana<br />
OMC, (1994), « Aid and the Growth of Income in Aid-Favoured Developing Countries : Policy Issues »,<br />
Cambridge Journal of Economics, (jointly with Havelock Brewster). vol. 18 No. 2, April, Cambridge<br />
Yeboah D. (1995), « Structural Adjustment and Rural Labour Markets in Africa », The Journal of<br />
Developing Areas, vol. 30 No. 1, October, Western Illinois <strong>Un</strong>iversity, Urbana<br />
OMC (1996), « The Results of the Uruguay Round of Multi<strong>la</strong>teral Tra<strong>de</strong> Negotiations and African<br />
Countries », May (<strong>Un</strong>published)., Genève<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 27
PNUD/FUTURS AFRICAINS*<br />
Étu<strong>de</strong>s Nationales <strong>de</strong> perspectives à long terme<br />
COORDONNÉES<br />
Adresse : Futurs Africains<br />
01 BP 1747<br />
Abidjan 01, Cote d’Ivoire<br />
Tel. : 225.22 26 69 ou 00 06 70<br />
Fax : 225.22 26 64<br />
E-mail : Ifutures@africanfutures.co.ci<br />
Site PNUD : http ://www.undp.org<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone : Afrique<br />
Futurs Africains<br />
Méthodologie<br />
Étu<strong>de</strong> Nationale sur l’Afrique sub-saharienne<br />
Réflexions sur <strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s régionales (gran<strong>de</strong>s régions <strong>de</strong> l’OUA)<br />
15 pays africains ont fait, font ou feront l’objet d’étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s <strong>de</strong>puis 1991.<br />
Le PNUD/Futurs Africains, dans son appui méthodologique aux autorités nationales, ont sélectionnés<br />
les pays qui ont fait une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et ceux où les conditions d’un travail participatif existent.<br />
L’essentiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> est qualitative. Elle repose sur <strong>de</strong>s enquêtes d’aspiration et <strong>de</strong>s travaux<br />
où sont mobilisés divers acteurs (universitaires, secteur privé, administration, représentants <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société civile).<br />
Les Étu<strong>de</strong>s Nationales <strong>de</strong>s Perspectives à Long Terme sont :<br />
- terminées pour : Côte d’Ivoire, Ile Maurice, Gabon, Guinée-Bissau, Cap Vert, Ma<strong>la</strong>wi, Zimbabwe,<br />
Sao Tome, Madagascar, Swazi<strong>la</strong>nd.<br />
- en cours pour : Zambie, Mali, Ouganda, Seychelles, Tanzanie, Bénin.<br />
- dans leur phase initiale pour : Mozambique et Burkina Faso<br />
- envisagées pour : Guinée, Afrique du Sud, Sénégal, Namibie, Guinée Equatoriale, République du<br />
Congo, Lesotho, et Sierra Leone.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Alioune SALL<br />
Coordinateur régional <strong>de</strong> Futurs Africains<br />
Leopold D.P. MUREITH<br />
Baba TOPE<br />
A<strong>de</strong>sida OLUGBENGA<br />
Joseph OKPAKUR<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Étu<strong>de</strong>s Nationales <strong>de</strong> Perspectives à Long Terme :<br />
Secrétariat d’État à l’Économie et au P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Madagascar (1996), « Madagascar : vision 2020 »,<br />
Antananarivo.<br />
<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, <strong>de</strong> l’environnement et du tourisme du Gabon (1995), « Réflexion<br />
stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase II : construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> »,<br />
Libreville.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 28
<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, <strong>de</strong> l’environnement et du tourisme du Gabon (1996), « Réflexion<br />
stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase III : construction <strong>de</strong>s scénarios »,<br />
Libreville.<br />
<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, <strong>de</strong> l’environnement et du tourisme du Gabon (1996), « Réflexion<br />
stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase IV : construction <strong>de</strong>s scénarios »,<br />
Libreville.<br />
<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, <strong>de</strong> l’environnement et du tourisme du Gabon (1996), « Réflexion<br />
stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport <strong>de</strong> synthèse », Libreville.<br />
Zimbabwe National Economic P<strong>la</strong>nning Commission (1998), « Zimbabwe vision 2020 and long term<br />
<strong>de</strong>velopment strategies », Harare.<br />
Autres publications<br />
Pnud-Futurs Africains (1997), « Futurs Africains, quelques repères, cinq années d’Étu<strong>de</strong>s Nationales<br />
<strong>de</strong>s Perspectives à Long Terme en Afrique », Abidjan.<br />
Pnud-Futurs Africains (1994), Africa in the year 2025 : governance, culture, peace and security,<br />
Abidjan.<br />
Étu<strong>de</strong>s commandées par Futurs Africains :<br />
DIOUF M. (1993), « L’Afrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté économique pan<strong>africaine</strong> en 2025 ».<br />
De JOUVENEL H. (dir) (1994), « De quelques tendances lour<strong>de</strong>s d’évolution à long terme du<br />
contexte international <strong>de</strong> l’Afrique ».<br />
Forum sur <strong>la</strong> compétitivité future <strong>de</strong>s économies <strong>africaine</strong>s, Dakar, 3-5 mars 1999.<br />
Ca<strong>la</strong>bre, S. (1995), Dynamique <strong>de</strong>s marchés mondiaux <strong>de</strong> matières premières et programmes<br />
nationaux, Futurs Africains, Economica., Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 29
PNUD<br />
Programme <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies pour le Développement<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 1 UN P<strong>la</strong>za<br />
New York, NY 10017 — USA<br />
Site : http://www.undp.org<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Pays en développement.<br />
Sujets : Environnement, développement soutenable<br />
Démocratie et Gouvernance<br />
Développement<br />
Pauvreté<br />
Le PNUD effectue <strong>de</strong> nombreux travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> dans <strong>de</strong>s domaines macroéconomiques et<br />
sectoriels. L’essentiel <strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s <strong>africaine</strong>s sont réalisées dans le cadre <strong>de</strong> Futurs Africains.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Roger RIDGELL<br />
BIBLIOGRAPHIE, TRAVAUX<br />
PNUD, (1998), Rapport sur le développement humain, Economica, Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 30
COORDONNÉES-STATUT<br />
UNIVERSITE DES NATIONS UNIES (U.N.U.)<br />
Adresse 5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150<br />
Tél. : 00.81.3.34.99.28.11<br />
Fax : 00.81.3.34.06.73.45<br />
Site Internet : http ://www.unu.edu<br />
Statut organisation internationale ONU<br />
THEMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Afrique<br />
Asie<br />
Océanie<br />
Amérique Latine<br />
Sujet : Économie du développement<br />
Socio-économie<br />
Environnement<br />
Gouvernance<br />
SPECIALISTES<br />
Recteur : Pr J.A. VAN GINKEL<br />
Vice-recteur : Dr A. BESRAT<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Fumio Itoh (ed.) (1997), China in the Twenty-first Century, Politics, Economy and Society, UNU Press,<br />
Tokyo<br />
Faysal Yachir (1988), Mining in Africa Today, Strategies and Prospects, UNU Press, Tokyo<br />
Mihaly Simai, Valentine M. Moghadam, Arvo Kuddo (eds) (1995), Global Employment. An international<br />
Investigation into the Future of Work, UNU Press, Tokyo<br />
Kevin Clements (ed.) (1992), Peace and Security in the Asia Pacific Region, Post-Cold War Problems<br />
and Prospects, UNU Press, Tokyo<br />
George Benneh, William B. Morgan, Juha I. Uitto (eds.) (1996), Sustaining the Future. Economic,<br />
Social and Environmental Change in Sub-Saharan Africa, UNU Press, Tokyo<br />
Fu-chen Lo, Yue-man Yeung (eds) (1998), Globalization and the Urban Future, UNU Press, Tokyo<br />
Chadwick F. Alger (ed.) (1998), The Future of the <strong>Un</strong>ited Nations System. Potential for the Twenty-first<br />
Century, UNU Press, Tokyo<br />
Ro<strong>la</strong>nd J. Fuchs, Ellen Brennan, Joseph Chamie, Fu-chen Lo, Juha I. Uitto (eds) (1994), Mega-city<br />
Growth and the Future, UNU Press, Tokyo<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 31
WIDER<br />
(World Institute for Development Economics Research) UNU<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse Katajanokan<strong>la</strong>ituri 6B<br />
00160 – Helsinki — Fin<strong>la</strong>nd<br />
Tél. : 00.358.9.615.99.11<br />
Fax : 00.358.9.615.99.333<br />
Statut Organisation internationale<br />
THEMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Sub-Saharan Africa<br />
East Europe<br />
Latin America<br />
Asia<br />
Sujets :<br />
1. Poverty, distributrive and institutional issues<br />
2. International financial and economic growth issues<br />
3. Global governance and security issues<br />
4. Transition economics<br />
5. Liberalization and growth in Sub-Saharan Africa<br />
SPECIALISTES<br />
Directeur : Giovanni Andrea CORNIA : Transition strategies<br />
Principal Aca<strong>de</strong>my Officer : Matti POHJOLA :<br />
Senior Research Fellows : Nguyuru H.I. LIPUMBA : Liberalization in SSA<br />
Manuel F. MONTES : Capital flows<br />
Well-being in transitional Asia<br />
Research Fellows : Lu AIGUO : Well-being in transitional Asia<br />
Renato PANICCIA : Transition’s mortality crisis<br />
Cecilia UGAZ : Public goods (<strong>de</strong>centralization)<br />
Visiting Fellows : Grzegorz W. KOLODKO :<br />
Pekka SEPPALA :<br />
Marja-Liisa SWANTZ :<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
WIDER participe à l’étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> du programme UNU/TICAD-II<br />
Les autres projets portent sur :<br />
Studies on market liberalization and <strong>de</strong>velopment prospects in Sub-Saharan Africa<br />
- Impact of liberalization on key markets in Sub-Saharan Africa<br />
- Growth, external sector and role of non-traditional exports in Sub-Saharan Africa<br />
Cornia, G.A., Honkki<strong>la</strong>, J., Paniccia, R., Popov, V. (1996), Long term growth and welfare in transitional<br />
economics : the impact of <strong>de</strong>mographic, investment and social policy changes, WP 122,<br />
<strong>de</strong>cember, Helsinki<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 32
2.1.2.<br />
ORGANISMES<br />
REGIONAUX
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 01 BP 1387<br />
Abidjan 01 Côte d’Ivoire<br />
Tel : (225) 20 44 44<br />
Fax : (225) 20 40 06<br />
Site internet : http ://www.afdb.org/<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique Afrique<br />
SPÉCIALISTES<br />
Mohamed En Nacer BOURENANE<br />
BAD<br />
Banque Africaine <strong>de</strong> Développement<br />
Monsieur OCHIKOYA Tel : (225) 20 41 00<br />
Directeur du département macro-économie<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE<br />
BAD (1997), « Rapport sur le développement en Afrique », BAD, Abidjan.<br />
ADB publications (revue éditée par <strong>la</strong> BAD).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 34
COORDONNÉES-STATUT<br />
CEA<br />
Commission Economique pour l’Afrique<br />
Adresse : P.O.Box 3001 Addis Abeba<br />
Éthiopie<br />
Tel : 251.1.51.58.26<br />
Fax : 251.1.51.03.65<br />
Site internet : http ://www.un.org/Depts/eca/teldir.htm<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique Afrique<br />
Sujets : Questions politiques, sociales, économiques concernant l’Afrique. Perspectives régionales.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Dr K.Y. AMAOKO, directeur Général<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
ECA (1983), ECA and Africa’s Development 1983-2008 : a Preliminary Perspective Study, Addis<br />
Abeba.<br />
A<strong>de</strong><strong>de</strong>ji, A., Shaw, T. (eds) (1985), Economic Crisis in Africa : African Perspectives on Development<br />
Problems and Potentials, Lynne Rienner, Co, Boul<strong>de</strong>r<br />
CEA (1998), Rapport économique sur l’Afrique., Adis Abeba<br />
ECA (1988), Beyond Recovery : ECA Revisited Perspectives on Africa’s Development 1988-2008,<br />
Addis Abeba.<br />
ECA (1989), African Alternatives Frameworks to Structural Adjustment Programs for Socio-ecoomic<br />
Recovery and Transformation, Addis Abeba.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 35
COORDONNÉES-STATUT<br />
CILSS<br />
Adresse secrétariat exécutif : 03 BP 7049, Ouagadougou 03, Burkina Faso<br />
Tel : 00.226.30.67.58/30.67.59<br />
Fax : 00.226.30.67.57<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Ce Comité permanent a été créé après <strong>la</strong> sécheresse <strong>de</strong> 1968-1973 comme cadre <strong>de</strong><br />
coopération régionale et <strong>de</strong> solidarité entre les pays membres et entre ces pays et <strong>la</strong> communauté<br />
internationale pour parer aux défis <strong>de</strong>s sécheresses récurrentes au Sahel.<br />
L’étu<strong>de</strong> "Sahel 21", s’inspirant <strong>de</strong> l’approche WALTPS, a reposé sur une démarche<br />
participative. Elle s’est appuyée sur <strong>de</strong>s notes nationales et <strong>de</strong> nombreuses réunions notamment celle<br />
<strong>de</strong> Banjul (septembre 1997). Le processus Sahel 21 est piloté par le secrétariat exécutif du CILSS<br />
avec l’appui du Club du Sahel/OCDE. Le forum <strong>de</strong> Banjul <strong>de</strong> 1997 avait réuni près <strong>de</strong> 500<br />
représentants.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Ministres coordinateurs du CILSS<br />
Prési<strong>de</strong>nt et directeur du Club<br />
CISSO KHU<br />
J.-P. ELONG MBASSI<br />
M.L. NIGNAN<br />
M. WANKOYE<br />
ÉTUDE PROSPECTIVE<br />
CILSS-Sahel 21. (1988), La vision <strong>de</strong> l’avenir par le Sahéliens et les Sahéliennes. <strong>Bi<strong>la</strong>n</strong> et<br />
perspectives du processus après le Forum <strong>de</strong> Banjul, février, Ouagadougou<br />
Les Sahéliens expriment leur aspiration à un Sahel fédéré, démocratique, pacifique, en bonne<br />
santé physique et morale, productif et compétitif, dans le respect <strong>de</strong> ses valeurs.<br />
Le mandat a été donné au CILSS d’é<strong>la</strong>borer un p<strong>la</strong>n d’action régional servant <strong>de</strong> cadre <strong>de</strong><br />
cohérence global permettant d’atteindre cinq objectifs prioritaires :<br />
- politique volontariste <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong>s ressources humaines<br />
- renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong>s institutions<br />
- développement rapi<strong>de</strong> et durable <strong>de</strong>s productions agricoles<br />
- croissance et diversification <strong>de</strong> l’économie<br />
- espace sahélien plus soudé ouvert sur l’Afrique et sur le Mon<strong>de</strong>.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 36
CODESRIA<br />
Council for the <strong>de</strong>velopment of social science research in Africa<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : Avenue Cheikh<br />
BP 3304<br />
Dakar, Sénégal<br />
Tel. : 00 221 825 98 14<br />
Fax : 00 221 825 12 73<br />
E-mail : CODESRIA@sonatel.senet.net<br />
Site internet : http://wsi.eso.uiuc.edu/CSA/co<strong>de</strong>sria/co<strong>de</strong>sria.htm<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Afrique<br />
Sujets : Les activités <strong>de</strong> Co<strong>de</strong>sria sont variées, mais liées à l’objectif <strong>de</strong> base du<br />
développement <strong>de</strong>s sciences sociales en Afrique.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Mamadou Diouf<br />
Tel : 00 221 8 25 98 22<br />
Fax : 00 221 8 24 12 89<br />
E-mail : Diouf@telecomclus.sn<br />
Achille Mbembe, politiste<br />
Mamadou Koulibaly, économiste<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Le CODESRIA ne produit pas d’étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong>. Il réalise toutefois <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s sur<br />
l’Afrique et est un lieu <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> nombreux experts africains en sciences sociales.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 37
CREA – AERC<br />
AFRICAN ECONOMIC RESEARCH CONSORTIUM<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : P.O.box 62 882 Nairobi Kenya<br />
Tel. : (254-2) 22 80 57<br />
Fax : (254-2) 21 93 08<br />
Site internet : http ://www.kenyaweb.com/aerc/<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Afrique.<br />
Sujets : Pas <strong>de</strong> recherche en <strong>prospective</strong>.<br />
SPÉCIALISTES<br />
M. Ndulu : Former Deputy Director<br />
Dominique Njinkeu E-mail : aerces@form-net.com.<br />
Deputy director of research<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Le CREA n’est pas engagé dans <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong>. Il est un <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong><br />
recherches économiques les plus importants en Afrique et un lieu <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong>s principaux<br />
économistes africains.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 38
DG8/COMMISSION ECONOMIQUE EUROPEENNE<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 200 rue <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />
B-1049 Bruxelles<br />
Belgique<br />
Site internet : http :// www.europa.eu.int/dg08/<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Afrique, Caraïbes, Pacifique<br />
SPÉCIALISTES<br />
Bernard Petit Tel. : 00 322 299 32 55<br />
Chargé <strong>de</strong>s questions macro-économiques<br />
La DGVIII appuie <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> réflexions sur le futur. L’étu<strong>de</strong> <strong>la</strong> plus importante qui a été soutenue<br />
est celle réalisée en 1983 sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Jean-Marie Cour sur une image à long terme <strong>de</strong><br />
l’Afrique.<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
*DG8/CEE, (1977), Livre vert sur les re<strong>la</strong>tions entre l’<strong>Un</strong>ion Européenne et les pays ACP à l’aube du<br />
XXIe siècle. Défis et options vers un nouveau partenariat, Bruxelles, Luxembourg.<br />
COUR, J.-M., (1983), <strong>Un</strong>e image à long terme <strong>de</strong> l’Afrique (2020-2030), Scet International, Se<strong>de</strong>s,<br />
Bruxelles<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 39
COORDONNÉES-STATUT<br />
EADI<br />
European association of <strong>de</strong>velopment,<br />
Research and training studies<br />
Adresse : 10, rue Richemont<br />
PO Box 1211 – Genève 21 – Suisse<br />
Tel : 00.41.22.731.46.48<br />
Fax : 00.41.22.738.57.97<br />
Site internet : http ://www.eadi.org/<br />
RECHERCHES<br />
L’EADI est une association européenne regroupant les principaux centres et instituts <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong>s pays européens. Elle fonctionne à partir <strong>de</strong> différents groupes <strong>de</strong> travail.<br />
Elle organise tous les quatre ans une conférence générale. Elle ne travaille pas sur <strong>la</strong> <strong>prospective</strong><br />
mais constitue un réseau européen <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> chercheurs.<br />
SPÉCIALISTES<br />
C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Auroi : Secrétaire Général<br />
Hélène O’Neill : Prési<strong>de</strong>nte<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Conférence : L’Europe et le Sud à l’aube du XXIe siècle : enjeux et renouvellement <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération,<br />
22-25 septembre 1999., Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 40
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF<br />
Prési<strong>de</strong>nte<br />
Mme Helen O’Neill<br />
Centre for Development Studies<br />
<strong>Un</strong>iversity College Dublin<br />
Library Building. Room 513<br />
Belfield, Dublin 4, Ir<strong>la</strong>n<strong>de</strong><br />
Tél. (353) 1 706 76 03<br />
Fax (353) 1 269 19 63<br />
helen.oneill@ucd.ie<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nts<br />
M. Sergio Alessandrini<br />
Istituto di Economia<br />
<strong>Un</strong>iversità Commerciale<br />
Luigi Bocconi, Via Sarfatti, 25<br />
20 136 Mi<strong>la</strong>n, Italie<br />
Tél. (39) 02 58 36 54 31<br />
Fax (39) 02 58 36 54 39<br />
Sergio.alessandrini@unibocconi.it<br />
Mme Hajna Istvanffy-Lorinc<br />
Budapest <strong>Un</strong>iversity of Economic<br />
Sciences<br />
Dept. Of International Economics<br />
Fövam Tér. 8<br />
1093 Budapest, Hongrie<br />
Tél. (36) 1 217 66 52<br />
Fac (36) 1 218 07 96<br />
Kajnalorinc@eustudce.bke.hu<br />
M. Jean-Luc Maurer<br />
IUED. Institut universitaire<br />
d’étu<strong>de</strong>s du développement<br />
24 rue Rothschild<br />
BP 136, 1211 Genève 21, Suisse<br />
Tél. (41) 22 906 59 46<br />
Fax (41) 22 906 59 47<br />
Jean-Luc.Maurer@iued.unige.ch<br />
M. Arne Tostensen<br />
Chr. Michelsen Institute<br />
P.O. Box 6033<br />
5020 Bergen, Norvège<br />
Tél. (475) 557 40 00<br />
Fax (475) 557 41 66<br />
arnet@ama<strong>de</strong>us.cmi.no<br />
Trésorière<br />
Mme Shei<strong>la</strong> Page<br />
ODI. Overseas Development Institute<br />
27 th Floor, Port<strong>la</strong>nd House, Stag P<strong>la</strong>ce<br />
SW1E 5DP Londres, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
Tél. (44) 171 393 1600<br />
Fax (44) 171 393 16 99<br />
Secrétaire exécutif<br />
M. C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Auroi, EADI<br />
24 rue Rothschild, BP 272<br />
1211 Genève 21, Suisse<br />
Tél. (41) 22 731 46 48<br />
Fax (41) 22 738 57 97<br />
auroi@uni2a.unige.ch<br />
Membres<br />
M. Chris Addison<br />
ECDPM<br />
Onze Lieve Vrouweplein<br />
6211 HE Maastricht, Pays-Bas<br />
Tél. (31) 43 350 29 19<br />
Fax (31) 43 350 29 02<br />
ca@ecdpm.org<br />
M. Lino Briguglio<br />
Foundation for International Studies<br />
<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Malte<br />
St Paul Street, VLT 07 Vallette, Malte<br />
Tél. (356) 248 218<br />
Fax (356) 230 551<br />
lbrigl@um.edu.mt<br />
M. Jerker Carlsson<br />
Nodic Africa Institute<br />
BP 1703, 75147 Uppsa<strong>la</strong>, Suè<strong>de</strong><br />
Tél. (46) 370 30 14 30<br />
Fax (46) 370 49 331<br />
Jerker.carlsson@quest.se<br />
M. Andrea Cornia<br />
WIDER/UNU. World Inst. for<br />
Development Eco. Research<br />
<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies<br />
Katajanokan<strong>la</strong>ituri. 6B<br />
00160 Helsinki, Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong><br />
Tél. (358) 9 615 99 11<br />
Fax (358) 9 615 99 333<br />
Cornia@wi<strong>de</strong>r.unu.edu<br />
M. Michael Cowen<br />
Institute od Development Studies<br />
<strong>Un</strong>iversité d’Helsinki<br />
BP 59, 00014 Helsinki, Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong><br />
Tél. (358) 9 191 24 250<br />
Fax (358) 9 191 24 255<br />
Cowen@valt.helsinki.fi<br />
M. Meine Pieter van Dijk<br />
Economic Faculty, <strong>Un</strong>iversité Erasmus<br />
Room H12-29, BP 1738<br />
3000 DR Rotterdam, Pays-Bas<br />
Tél. (31) 10 408 24 29<br />
Fax (31) 10 408 91 53<br />
Mpvandijk@few.eur.nl<br />
M. Guilio Fossi<br />
48 rue Michel-Ange,<br />
75016 Paris, France<br />
Tél. (33) 1 46 51 49 99<br />
M. Cristobal Kay<br />
ISS. Institute of Social Studies<br />
BP 29776, 2502 LT La Haye, Pays-Bas<br />
M. Kenneth King<br />
Centre of African Studies<br />
<strong>Un</strong>iversité d’Édimbourg<br />
7 Buccleuch P<strong>la</strong>ce<br />
EH8 9LL Edimbourg, Gran<strong>de</strong> Bretagne<br />
Tél. (44) 131 650 38 79<br />
Fax (44) 131 650 65 35<br />
Kenneth.king@ed.ac.uk<br />
M. Bruno Lautier<br />
GEMDEV. Centre Malher<br />
9 rue Malher 75004 Paris, France<br />
Tél. (33) 1 44 78 33 15<br />
Fax (33) 1 44 78 33 88<br />
Gem<strong>de</strong>v@univ-paris1.fr<br />
Mme Irene Norlund<br />
Nordic Institute of Asian Studies<br />
Leifsga<strong>de</strong>. 33<br />
2300 Copenhague S, Danemark<br />
Tél (45) 32 54 88 44<br />
Fax (45) 32 96 25 30<br />
Irene@nias.ku.dk<br />
M. Yilmaz Özkan<br />
Center for Mediterranean Studies<br />
OR-AN 67/8<br />
Cankaya Ankara, Turquie<br />
Tél. (90) 312 212 11 63<br />
Fax (90) 312 212 11 63<br />
amh-e@ada.net.tr<br />
M. Herwig Palme<br />
Inst. For Urban & Regional Studies<br />
Wirtschaftsuniversität<br />
Augasse, 2-6, 1090 Vienne, Autriche<br />
Tél. (43) 1 313 364 779<br />
Fax (43) 1 313 36 705<br />
palme@isis.wuwien.ac.at<br />
M. F. Rodriguez <strong>de</strong> Acuna<br />
Pintor Rosales, 22<br />
28008 Madrid, Espagne<br />
Tél. (34) 91 559 14 42<br />
Fax (34) 91 541 50 19<br />
Fernando@rracuna.com<br />
M. M<strong>la</strong><strong>de</strong>n Stanicic<br />
IMO. Institute for International<br />
Re<strong>la</strong>tions<br />
BP 303, 10000 Zagreb, Croatie<br />
Tél. (385) 1 45 54 522<br />
Fax (385) 1 48 28 361<br />
m<strong>la</strong><strong>de</strong>n@mairmo.irmo.hr<br />
M. Peter Stanovnik<br />
IER. Institute for Economic Research<br />
Kar<strong>de</strong>ljeva Ploscad, 17<br />
61000 Ljubljana, Slovénie<br />
Tél. (386) 61 345 787<br />
Fax (386) 61 342 760<br />
Stanovnik@ier.si<br />
M. Jan V<strong>la</strong>cil<br />
Faculty of General Economics<br />
and Public Administration<br />
W. Churchill sq. 4<br />
13067 Prague, Rép. Tchèque<br />
Tél. (420) 2 691 18 28<br />
Fax (420) 2 691 12 65<br />
v<strong>la</strong>cil@vse.cz<br />
M. Jean-Marie Wautelet<br />
UCL. Institut d’étu<strong>de</strong>s du<br />
développement<br />
P<strong>la</strong>ce Montesquieu, 3<br />
1348 Louvain-<strong>la</strong>-Neuve, Belgique<br />
Tél. (32) 10 47 41 71<br />
Fax (32) 10 47 29 52<br />
wautelet@<strong>de</strong>mo.ucl.ac.be<br />
M. Jürgen Wiemann<br />
DIE. Deutsches Inst. Für<br />
Entwicklungspolitik/GDI<br />
Hallerstrasse 3<br />
10587 Berlin, Allemagne<br />
Tél. (49) 30 390 73 170<br />
Fax (49) 30 390 73 130<br />
jwiemann@t-online.<strong>de</strong><br />
Mme Katarzyna Zukrowska<br />
IRISS. Institute of Development ans<br />
strategie Studies<br />
Ul.Zurawia 4a<br />
00 503 Varsovie, Pologne<br />
tél. (48) 22 693 55 36<br />
Fax (48) 22 625 06 76<br />
zukrowsk@medianet.com.pl<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 41
ECDPM<br />
European Centre for Development Policy Management<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : Onze Lieve Vrouweplein 21<br />
NL-6211 HE MAASTRICHT<br />
PAYS-BAS<br />
Tel. : (31) 43 255121 ; (31) 43 3502914<br />
Fax : (31) 43 253636 ; (31) 43 3502902<br />
E-mail : jvl@ecdpm.org<br />
Site internet : http://www.ecdpm.org/ecdpm<br />
Statut : Institut <strong>de</strong> recherche ; Organisation internationale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Europe ; pays ACP<br />
Sujets : Les activités du centre dans le domaine du renforcement <strong>de</strong>s capacités vise à<br />
améliorer <strong>la</strong> coopération entre l’Europe et les pays d’Afrique, <strong>de</strong>s Caraïbes et du Pacifique.<br />
L’ECDPM ne fait pas <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> mais travaille sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> Lomé dans une<br />
perspective <strong>de</strong> moyen voire <strong>de</strong> long terme.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Jean BOSSUYT E-mail : jb@ecdpm.org<br />
Coordinateur du programme « dialogue sur les politiques <strong>de</strong> développement »<br />
TRAVAUX BIBLIOGRAPHIQUES<br />
ECDPM, (1997) « Entre Lomé et Maastricht : <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> l’ECDPM 1994-1996 », Maastricht.<br />
ECDPM, (1997) « Lomé : Partners in aid and tra<strong>de</strong> », Programme High Lights, Maastricht.<br />
ECDPM, (1998) « Lomé 2000 : au cœur du débat sur l’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération entre l’Europe,<br />
l’Afrique, les Caraïbe et le Pacifique », bulletin, centre européen <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> politique <strong>de</strong><br />
développement, Maastricht.<br />
ECDPM (1993), « Seminar on European <strong>de</strong>velopment policy after the treaty of Maastricht »,<br />
Maastricht.<br />
ECDPM (1994), « Les incertitu<strong>de</strong>s autour <strong>de</strong> Lomé IV », Points clés, Maastricht.<br />
ECDPM (1996), « l’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention baigne dans l’incertitu<strong>de</strong> », points clés, Maastricht.<br />
*ECDPM (1996), « Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> Lomé IV : Pistes <strong>de</strong> réflexion sur l’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération ACP-UE »,<br />
Rapport ECDPM, n° 6, octobre, Maastricht,<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 42
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : P.O. Box 3243 Addis Abeba<br />
Éthiopie<br />
Tel. : 251.1.51.77.00<br />
Fax : 251.1.51.26.22<br />
OUA<br />
E-mail :<br />
Site internet : http ://www.oau-oua.org/oau-info/contact.htm<br />
Statut : organisation internationale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
L’OUA est une organisation internationale qui traite <strong>de</strong>s questions politiques <strong>de</strong> l’Afrique.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Secrétaire général : M. Salim Ahmed SALIM<br />
Secrétaire général adjoint : M. Vijay S. MAKHAN<br />
THÈMES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
OUA, What Kind of Africa by the Year 2000 ?,(1979), Final Report on the Future Development<br />
Prospects of Africa Towards the Year 2000, 12-16 février, Monrovia<br />
OUA, (1980), The Lagos P<strong>la</strong>n of Action for the Economic Development of Africa 1980-2000, Addis<br />
Abeba,<br />
Le p<strong>la</strong>n d’action <strong>de</strong> Lagos date <strong>de</strong> 1980, porte sur une pério<strong>de</strong> à court terme (1980-1985), sur une<br />
pério<strong>de</strong> à moyen terme (1980-1990) et sur une pério<strong>de</strong> à long terme (1980-2000). Il propose un p<strong>la</strong>n<br />
volontariste d’autosuffisance. E<strong>de</strong>m Kodjo était alors le secrétaire général <strong>de</strong> l’OUA.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 43
PARLEMENT EUROPEEN<br />
Commission du Développement et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : Parlement Européen<br />
Rue Wiertz, 8H353<br />
1047 Bruxelles<br />
Belgique<br />
Tel. : 00 322 284 57 85/7785<br />
Fax : 00 3222 284 97 85<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
zone géographique : Europe, Mon<strong>de</strong>.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Michel ROCARD<br />
E-mail : mrocard@europarl.eu.int<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission du Développement et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Nous n’avons pas pu obtenir <strong>de</strong> renseignements sur les travaux prospectifs.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 44
2.1.3.<br />
ORGANISMES<br />
NATIONAUX
ACDI<br />
Agence Canadienne <strong>de</strong> Développement International<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse: Agence Canadienne <strong>de</strong> Développement International<br />
P<strong>la</strong>ce du Centre<br />
200, promena<strong>de</strong> du portage<br />
Hull (Québec) K1A 0G4<br />
Tél.: (819) 953 5023<br />
Fax: (819) 953 6088<br />
Site internet : http://www.acdi-cida.gc.ca ou info@acdi-cida.gc.ca<br />
Statut : Organisme public canadien<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Canada, Afrique, Amérique Latine, Asie et Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : L’Acdi est un organisme public. Son objectif est d’appuyer le développement durable<br />
et <strong>de</strong> favoriser <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté en mettant en oeuvre <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> développement<br />
dans certains pays et dans certaines régions, tout en tenant compte <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s pays en<br />
développement, du but et <strong>de</strong>s priorités du programme d’APD et <strong>de</strong>s intérêts du Canada en matière <strong>de</strong><br />
politique étrangère. L’Acdi ai<strong>de</strong> aussi les pays en développement et coordonne <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s socioéconomiques.<br />
CONTACTS<br />
Émile GAUVEREAU (vice-prési<strong>de</strong>nt : section Afrique et le Moyen-Orient)<br />
Collette DUBOIS E mail : dubois.collette@tbs-sct.gc.ca<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
1. ACDI, (1998), Afrique 21 : une vision <strong>de</strong> l’Afrique pour le XXIe siècle, Document Acdi, juin, Hull<br />
2. ACDI, (1996), Stratégie <strong>de</strong> santé, Direction générale <strong>de</strong>s politiques, novembre, Hull<br />
THÈMES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
1. ACDI, (1996), L’ACDI et l’Afrique du Sud. Document ACDI, Hull<br />
2. ACDI, (1997), L’ACDI et l’Ethiopie. Document ACDI, Hull<br />
3. ACDI, (1996), L’ACDI et <strong>la</strong> Côte d’Ivoire. Document ACDI, Hull<br />
4. ACDI, (1996), L’ACDI et le Ghana. Document ACDI, Hull<br />
5. ACDI, (1997), L’ACDI et le Kenya. Document ACDI, Hull.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 46
COORDONNÉES-STATUT<br />
AFD<br />
Agence Française <strong>de</strong> Développement<br />
Adresse : 5, rue Ro<strong>la</strong>nd Barthes<br />
75598 Paris ce<strong>de</strong>x 12 — France<br />
Tél. : (33) (0) 1 53 44 31 31<br />
Fax : (33) (0) 1 53 44 99 39<br />
Site internet : http://www.afd .fr<br />
E-mail : <br />
Statut : EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial)<br />
IFS (Institution Financière Spécialisée)<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Afrique, zone Caraïbe, zone Océan Indien, zone Pacifique, DOM,<br />
TOM, Cambodge, Laos, Vietnam,<br />
Sujets : L’AFD intervient dans l’ensemble <strong>de</strong> l’Outre-mer français et dans plus <strong>de</strong> quatre-vingts pays<br />
d’Afrique, du Maghreb, du Pacifique, <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule indochinoise, <strong>de</strong>s Caraïbes et <strong>de</strong> l’océan Indien.<br />
Pour son propre compte, l’AFD contribue à <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> projets productifs publics et privés,<br />
créateurs d’emplois, dans différents secteurs.<br />
SPÉCIALISTES EN PREVISION MACRO-ECONOMIQUE<br />
Jean-Pierre BARBIER poste 34.84<br />
Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction Afrique Centrale et Australe<br />
A<strong>la</strong>in CHETAILLE poste 33.35<br />
Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong>s politiques et étu<strong>de</strong>s<br />
Gérald COLLANGE poste 32.91<br />
Division Cameroun et Guinée équatoriale — Direction Afrique Centrale et Australe<br />
François KERHEUL poste 36.42 E-mail : kerheulf@afd.fr<br />
Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> division ajustement et politiques macro-économiques<br />
B<strong>la</strong>ise LEENHARDT poste 33.85<br />
Étu<strong>de</strong> macro-économique et modélisation<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Les économistes <strong>de</strong> l’Agence Française <strong>de</strong> Développement font <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévision à moyen terme<br />
notamment sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s modèles JUMBO et TABLO ou à partir <strong>de</strong> MEGC.<br />
Barbier J.-P. (1988), « Quelques travaux récents <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> : bibliographie commentée », dans<br />
« les Afriques <strong>de</strong> l’an 2000, Perspectives Économiques », sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Philippe Hugon, Afrique<br />
Contemporaine, n° 146, p108-110, Paris.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 47
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY (ANU)<br />
Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS)<br />
Asian Studies Association of Australia, Inc. (ASAA)<br />
Japan Studies Association of Australia (JSAA)<br />
South Asian Studies Association of Australia (SASA)<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse ANU<br />
Canberra ACT 0200<br />
Australie<br />
Tél. : 00.61.2.62.49.51.11<br />
Adresse RSPAS<br />
Directeur : Pr James J. FOX<br />
Tél. : 00.61.2.62.49.22.21<br />
Tél. : 00.61.2.62.49.42.14<br />
Adresse ASAA<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Pr A. REID<br />
E-mail : aser@coombs.anu.edu.au<br />
· JSAA<br />
contact : carolyn STEVENS<br />
Tél. : poste 01.60<br />
· SASA<br />
contact : Kathryn JACQUES<br />
E-mail : Kjacques@netz.une.edu.au<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Chapman, B.J. (1997), Labour market programs, in Changing <strong>la</strong>bour markets : prospects for<br />
productivity growth, Productivity Commission, Melbourne<br />
Gregory, R.G. (1997) Job-creation : comparing Ausqtralia and the <strong>Un</strong>ited States, in James P., Veit,<br />
W.F., Wright, S (eds), Work of the future : global perspectives, Allen & <strong>Un</strong>win, Sydney<br />
Mardi, D., Pitchford, J. (1998), Prospects for output and employment growth with steady inf<strong>la</strong>tion.<br />
Paper presented to the Reserve Bank of Australia/CEPR, ANU Conference : <strong>Un</strong>employment<br />
and the Australian Labour Market, 9-10 june 1998, Canberra<br />
Hull, T.H. (1997), Defining a future for popu<strong>la</strong>tion data, in Jones, G.W., Hull, T.H. (eds), Indonesia<br />
Assessment : popu<strong>la</strong>tion and human resources, RSPAS, ANU and Institute of Southeast Asian<br />
Studies, Singapore<br />
Hull, T.H. (1997) The setting : <strong>de</strong>mographic mosaic of the Asia Pacific Region – Issues <strong>de</strong>fining the<br />
future, Asia Pacific Viewpoint,Canberra<br />
Riaz, H.,(1997) Jamrozik, A., An open door or fortress Australia : policy choice for Australia in the 21 st<br />
century., Canberra<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 48
BNETD DE COTE D’IVOIRE*<br />
Bureau National d’Étu<strong>de</strong>s Techniques et <strong>de</strong> Développement<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : Boulevard Lagunaire 04 BP 945<br />
Abidjan 04<br />
Côte d’Ivoire<br />
Tel. : 00 225 44 02 21<br />
E-mail : bnetd@bnetd.sita.net<br />
Site internet : www.bnetd.sita.net<br />
Statut : Bureau d’Étu<strong>de</strong>s (Ex — Grands Travaux ou DCGTX)<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Côte d’Ivoire et UEMOA<br />
Sujets : Étu<strong>de</strong>s économiques et financières, Urbanisme, Agriculture, Secteurs sociaux, Géographie et<br />
Cartographie, Grands Travaux, Développement territorial, Prospectives économiques…<br />
SPÉCIALISTES<br />
THIAM Tidjane<br />
Ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, Côte d’Ivoire, Directeur du BNETD.<br />
SYLLA Lamine<br />
Directeur du Département <strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s Économiques et Financières, DEEF-BNETD.<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
*Tapinos G.,Vimard P.,Hugon Ph., (1998), Étu<strong>de</strong> re<strong>la</strong>tive aux défis démographiques majeurs et au<br />
développement durable en Côte d’Ivoire, Abidjan<br />
*BNETD, (1998), La Côte d’Ivoire à l’horizon 2010, Abidjan,<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 49
COORDONNÉES-STATUT<br />
CENTRE D’ANALYSE ET DE PREVISIONS<br />
<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong>s Affaires Etrangères<br />
Adresse : Direction <strong>de</strong>s <strong>affaires</strong> économiques<br />
37 quai d’Orsay<br />
PARIS<br />
Tel. : 01 43 17 53 67 (documentation)<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : France, Mon<strong>de</strong>.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Etienne ROLLAND-PIEGUE Tel. : 01 43 17 43 74<br />
Économiste<br />
Patrick ALLARD Tel : 01 43 17 56 69<br />
Économiste<br />
Jean-François BAYARD Tél. : 01.48.04.82.78<br />
Politiste<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Le CAP effectue <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s généralement confi<strong>de</strong>ntielles sur les perspectives politiques à moyen<br />
terme <strong>de</strong> l’Afrique.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 50
CENTRE DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT<br />
<strong>Un</strong>iversité d’Ottawa<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse: 136, rue Jean-Jacques Lussier<br />
Ottawa, Ontario, Canada, K1N 6N5<br />
Tél.: (613) 562 5800 poste 4700<br />
Fax: (613) 562 5167<br />
Site internet : henault@admin.uottawa.ca<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Canada, Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : Georges HENAULT est aussi le coordinateur du Réseau Entrepreneuriat <strong>de</strong><br />
l’Aupelf-Uref. Ce réseau coordonne <strong>de</strong>s nombreuses étu<strong>de</strong>s sur l’Afrique et sur le mon<strong>de</strong>.<br />
CONTACTS<br />
Georges HENAULT<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
A notre connaissance, il n’existe pas d’étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s en cours.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 51
CEPII<br />
Centre d’Etu<strong>de</strong>s Prospectives et d’Informations Internationales<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 9, rue Georges Pitard<br />
75 740 PARIS ce<strong>de</strong>x 15<br />
Tel. : (33) 01 53 68 55 00<br />
Fax : (33) 01 53 68 55 01<br />
Site internet : http://www.cepii.fr<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Les activités d’étu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> recherche du CEPII ont été réorganisées en trois pôles :<br />
1. Pôle « Macro-économie internationale »<br />
2. Pôle « Commerce international »<br />
3. Pôle « Economies émergentes et en transition »<br />
En 1999, le CEPII approfondira l’analyse <strong>de</strong>s enjeux et perspectives <strong>de</strong> l’intégration régionale euroméditerranéenne<br />
et réalisera également une évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> soutenabilité du processus <strong>de</strong><br />
croissance rapi<strong>de</strong> que connaissent plusieurs économies <strong>africaine</strong>s. Il ne fait pas à proprement parler<br />
<strong>de</strong> <strong>prospective</strong>.<br />
SPÉCIALISTES PROSPECTIVE AFRICAINE<br />
Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> BERTHELEMY E-mail : berthelemy@cepii.fr Tel : 01 53 68 55 43<br />
Directeur du CEPII<br />
Agnès CHEVALIER E-mail : a.chevallier@cepii.fr Tel. : 01 53 68 55 60<br />
Économie en développement, Re<strong>la</strong>tions euro-méditérannéennes.<br />
BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREVISION ET LA PROSPECTIVE<br />
Bensidoun I., Chevallier A., (1996), « Europe-méditerranée : le pari <strong>de</strong> l’ouverture », Economica, Paris<br />
Cadiou L., Vil<strong>la</strong> P., (1998), « Mesurer les inégalités entre nations », <strong>la</strong> Lettre du CEPII, n° 164, janvier,<br />
<strong>la</strong> Documentation française, Paris.<br />
Cling J.-P., (1998), « Afrique australe : intégration régionale et « ancrage » à l’<strong>Un</strong>ion européenne »,<br />
Direction <strong>de</strong>s Re<strong>la</strong>tions Économiques extérieures, <strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> l’Économie, Économie internationale,<br />
<strong>la</strong> revue du CEPII, Paris.<br />
Bensidoun I., <strong>Un</strong>al-Kesenci D., (1998), « La concurrence internationale : vingt ans après », <strong>la</strong> Lettre du<br />
CEPII, n° 171, septembre, <strong>la</strong> Documentation française, Paris.<br />
CEPII, (1998), « Compétitivité <strong>de</strong>s nations », rapport du CEPII, Economica, Paris.<br />
Berthélemy J.-C., (1998 ), « Les conséquences <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’Euro pour les états membres <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
francophonie », en col<strong>la</strong>boration avec Sophie Chauvin, décembre, rédigé pour l’Agence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Francophonie, Paris.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 52
CERED<br />
Centre <strong>de</strong> recherches en économie du développement<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : <strong>Un</strong>iversité Paris X-Nanterre, Bâtiment G<br />
200, Avenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
92001 Nanterre Ce<strong>de</strong>x<br />
Tel. : 01.40.97.78.15/78.21<br />
Fax : 01.47.25.74.04<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Centre <strong>de</strong> recherche spécialisé sur l’économie <strong>africaine</strong><br />
SPÉCIALISTES PROSPECTIVE AFRICAINE<br />
Philippe Hugon, directeur du CERED Email : philippe.hugon@u-paris10.fr<br />
Adrien Akanni Honvo<br />
Anne Androuais<br />
Vincent Geronimi<br />
Fabienne Kervarec<br />
Véronique Massenet<br />
Abel Mayeyenda<br />
Guy Pourcet<br />
Olivier Sudrie<br />
Jean C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Verez<br />
BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREVISION ET LA PROSPECTIVE<br />
Ph. Hugon, G. Pourcet, S. Quiers-Valette (1994), L’Afrique <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s, PUF., Paris<br />
Ph. Hugon (ed), Les Afriques <strong>de</strong> l’an 2000, (1988), Afrique Contemporaine, n° 146, Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 53
COORDONNÉES-STATUT<br />
CERDI<br />
CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES<br />
SUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL<br />
Adresse : Centre d’Étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> Recherches sur le Développement International<br />
<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Clermont-Ferrand<br />
65, boulevard François Mitterrand<br />
63033 Clermont-Ferrand<br />
Tél.: 04 73 43 12 08 ou 04 73 43 12 32 ou 04 73 43 12 04<br />
Fax: 04 73 43 12 28<br />
Site internet : http://www.u-clermont1.fr/cerdi/<strong>de</strong>fault.htm<br />
Statut : Laboratoire <strong>de</strong> recherche — CNRS<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Europe, Mon<strong>de</strong><br />
Objectif :Le CERDI est un <strong>la</strong>boratoire universitaire <strong>de</strong> recherche en économie du développement. Ce<br />
centre réalise <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s sur l’Afrique et sur le mon<strong>de</strong>. La recherche du CERDI est<br />
orientée vers :<br />
- les politiques économiques <strong>de</strong>s pays en développement et en transition ;<br />
- l’économie <strong>de</strong> marché ;<br />
- l’analyse comparée <strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong> croissance et <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong> développement ;<br />
- l’analyse <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions économiques entre pays inégalement développés ;<br />
- l’étu<strong>de</strong> du comportement micro-économique <strong>de</strong>s acteurs (ménages agricoles, entreprises)<br />
dans les pays en développement.<br />
Le CERDI travaille en re<strong>la</strong>tion étroite avec les principales institutions françaises et internationales<br />
actives dans le domaine du développement. L’axe <strong>de</strong> recherches du CERDI est orienté vers l’Afrique<br />
du Sud du Sahara et <strong>la</strong> Chine.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Patrick GUILLAUMONT (directeur)<br />
Sylviane GUILLAUMONT-JEANNENEY, Professeur<br />
Gérard CHAMBAS, chargé <strong>de</strong> recherches CNRS<br />
Catherine ARAUJO BONJEAN, Chargée <strong>de</strong> Recherche au CNRS<br />
C<strong>la</strong>udio ARAUJO, Maître <strong>de</strong> Conférences<br />
Jean-Louis ARCAND, Professeur<br />
Stéphane CALIPEL, Maître <strong>de</strong> Conférences<br />
Jean-Louis COMBES, Professeur<br />
Patrick PLANE, Directeur <strong>de</strong> Recherche au CNRS<br />
Mary-Françoise RENARD, Professeur<br />
BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREVISION ET LA PROSPECTIVE<br />
P. GUILLAUMONT, Jeanneney S. GUILLAUMONT, A. VAROUDAKIS (Updating) Politique<br />
économique et perspectives <strong>de</strong> croissance dans les économies émergentes d’Afrique, Document du<br />
CERDI No. 9902, Montpellier.<br />
Le CERDI ne réalise pas d’étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s. Il a, en revanche, participé dans <strong>de</strong> très nombreuses<br />
étu<strong>de</strong>s mettant en perspective les économies <strong>africaine</strong>s. On peut citer l’étu<strong>de</strong> réalisée à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> l’<strong>Un</strong>ion Européenne sur Les Accords <strong>de</strong> Libre Echange entre l’<strong>Un</strong>ion Européenne et l’UEMOA et le<br />
Ghana, Bruxelles 1999, et l’étu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> perspective <strong>de</strong> <strong>la</strong> Côte d’Ivoire.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 54
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 292, rue Saint-Martin<br />
75141 Paris ce<strong>de</strong>x 03<br />
Tel. : 01 40 27 20 00<br />
Site internet : www.cnam.fr<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
CNAM<br />
Conservatoire National <strong>de</strong>s Arts et Métiers<br />
La recherche au CNAM se divise en 7 pôles qui regroupent <strong>de</strong>s équipes et définissent <strong>de</strong>s<br />
programmes. Parmi ces pôles, le pôle « Sciences économiques juridiques et <strong>de</strong> gestion » traite <strong>de</strong><br />
thèmes al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s techniques à l’investigation <strong>prospective</strong>s et stratégiques.<br />
Dans ce pôle, <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> économique est traitée par le Laboratoire d’investigation Prospective et<br />
Stratégique (LIPS), dirigé par Michel GODET.<br />
Le LIPS a réalisé <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s notamment pour les entreprises. Il a développé<br />
une méthodologie en termes <strong>de</strong> scénarios. Il ne travaille pas en revanche sur l’Afrique.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Michel GODET<br />
Tel. : 01 40 27 25 30<br />
E-mail : michel.go<strong>de</strong>t@cnam.fr<br />
Directeur du Lips<br />
Jacques LESOURNE<br />
François ROUBELAT<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
GODET M., en col<strong>la</strong>boration avec MONTI R. et ROUBELAT F. (1997), « Manuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong><br />
stratégique — Tome I, une indiscipline intellectuelle », Dunot éditeur, Paris.<br />
GODET M., en col<strong>la</strong>boration avec MONTI R. et ROUBELAT F. (1997), « Manuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong><br />
stratégique — Tome II, l’art et <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> », Dunod éditeur, Paris.<br />
GODET M. (1991), « L’avenir autrement », Paris, Armand Colin.<br />
GODET M., ROUBELAT F. (1996), « Creating the fututre : the use and misuse of scenarios », Long<br />
Range P<strong>la</strong>nning, vol. 29, n° 2, avril.<br />
Club CRIN <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> scientifique et technologique (1997), « Construire <strong>de</strong>s scénarios<br />
d’environnement global », n° 5, janvier.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 55
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 18 rue <strong>de</strong> Martignac<br />
75 007 Paris<br />
Tel. : 01 45 56 51 00<br />
Fax : 01 45 56 54 75<br />
COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN<br />
Site internet : http : //www.p<strong>la</strong>n.gouv.fr<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Étu<strong>de</strong>s sur l’ensemble <strong>de</strong>s continents.<br />
Sujets : Réalisation d’étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s<br />
SPÉCIALISTES<br />
Bernard CAZES<br />
D. DOUCET<br />
Tel : 01 45 56 51 18<br />
E-mail : ddoucet@p<strong>la</strong>n.gouv.fr<br />
Chargé <strong>de</strong> Mission sur l’Afrique<br />
Documentation<br />
Cécile KARAS<br />
Tel : 01 45 56 53 33<br />
E-mail : ckaras@p<strong>la</strong>n.gouv.fr<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Le Commissariat au P<strong>la</strong>n réalise <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s à long terme et <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s. Parmi les<br />
plus récentes « L’énergie en 2020 ».<br />
En revanche, les travaux consacrés aux <strong>prospective</strong>s sur l’Afrique sont peu nombreux. <strong>Un</strong>e <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>rnières étu<strong>de</strong>s a concerné l’étu<strong>de</strong> dirigée par E.MBOKOLO ou les travaux menés par<br />
Ch.ChAVAGNEUX.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 56
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : P.O. Box 80510<br />
2508 GM Den Haag<br />
The Nether<strong>la</strong>nds<br />
Tel. : (31) 70 33 83 380<br />
Fax : (31) 70 33 83 350<br />
Site internet : http://www.cpb.nl<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong><br />
SPÉCIALISTES PROSPECTIVE<br />
GELAUFF<br />
Tel : (31) 70 33 83 441<br />
De JONG<br />
CPB<br />
CENTRAL PLANNING BUREAU<br />
BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
De JONG A.H.M. et al (1990), « Scanning the future — a long term scenario study of the world<br />
economy », Proceeding of the International Conference.<br />
Van VLIMMEREN J.C.G., Don F.J.H. (1991), « Composition and pattern of the forecast uncertainty<br />
data : further results », ISBN : 90-346-2566-4.<br />
De JONG A.H.M., LINDNER H. (1988), « A long term scenario mo<strong>de</strong>l for the world economy ; some<br />
first results ».<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 57
COORDONNÉES-STATUT<br />
CRDE<br />
Centre <strong>de</strong> recherche et développement<br />
en économique<br />
Adresse : Centre <strong>de</strong> recherche et développement en économique<br />
<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Montréal<br />
Département <strong>de</strong> sciences économiques/C.R.D.E.<br />
3150, rue Jean-Bril<strong>la</strong>nt, bureau C-6050-2<br />
C.P. 6128, Succ. centre-ville<br />
Montréal (PQ) H3C 3J7, CANADA<br />
Tél.: (514) 343 6557<br />
Fax: (514) 343 6583<br />
Site internet : http :// www.cr<strong>de</strong>.umontreal.ca<br />
Statut : Laboratoire universitaire <strong>de</strong> recherche<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Canada, Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : Le CRDE est un <strong>la</strong>boratoire international <strong>de</strong> recherche en économie et en économie<br />
du développement. Ce centre a pour objectif <strong>la</strong> recherche et le développement en économique. le<br />
CRDE concentre ses activités sur trois champs <strong>de</strong> recherche :<br />
- les métho<strong>de</strong>s économétriques ;<br />
- les politiques économiques et allocations <strong>de</strong>s ressources ;<br />
- le développement économique international.<br />
Les <strong>de</strong>ux premiers axes privilégient <strong>de</strong>s recherches à caractère méthodologique ou <strong>de</strong> nature<br />
re<strong>la</strong>tivement fondamentale, tandis que le <strong>de</strong>rnier axe porte sur <strong>de</strong>s recherches <strong>de</strong> nature plus<br />
appliquées.<br />
Le CRDE effectue également <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s en économie du développement et en économie<br />
internationale. Dans cet axe, les recherches portent sur l’analyse formalisée <strong>de</strong>s politiques<br />
économiques <strong>de</strong> développement à l’ai<strong>de</strong>, principalement, <strong>de</strong>s modèles d’équilibre général calcu<strong>la</strong>ble<br />
ainsi que l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s liens existant entre les secteurs informel et formel <strong>de</strong> production dans les pays<br />
en développement.Le CRDE a participé aussi au programme PARADI qui a permis aux économistes<br />
du développement <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s économétriques, <strong>de</strong> politiques économiques et d’allocations<br />
<strong>de</strong>s ressources.<br />
SPÉCIALISTES<br />
André MARTENS Directeur <strong>de</strong> l’axe "Économie internationale et<br />
développement", C.R.D.E.<br />
E-mail: martensa@cr<strong>de</strong>.umontreal.ca<br />
BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREVISION ET LA PROSPECTIVE<br />
Le CRDE ne réalise pas d’étu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong>, mais effectue <strong>de</strong>s modèles servant à<br />
<strong>la</strong> prévision.<br />
B. DECALUWE et A. MARTENS (1996) Le cadre comptable macréoconomique et les pays en<br />
développement, Éditions Hurtubise HMH, Montréal.<br />
N. BOUSSELMI, B. DECALUWE, A. MARTENS et M. MONETTE (1989) Développement socioéconomique<br />
et modèles calcu<strong>la</strong>bles d’équilibre général. Métho<strong>de</strong>s et applications à <strong>la</strong> Tunisie,<br />
Publication conjointe <strong>de</strong> l’I.E.Q. (Tunis) et du C.R.D.E., Montréal.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 58
COORDONNÉES-STATUT<br />
CRDI<br />
Centre <strong>de</strong> recherches pour le Développement<br />
international<br />
Adresse : Centre <strong>de</strong> Recherches pour le Développement International<br />
250, rue Albert<br />
Ottawa, ON, K1P 6M1<br />
Tél.: (613) 236 6163<br />
Fax : (613) 567-7749<br />
Site internet : http://www.idrc.ca<br />
Statut : Organisme public canadien<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Canada, Afrique, Amérique Latine, Asie et Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : Le CRDI est une société d’État canadienne qui ai<strong>de</strong> les pays en développement à<br />
trouver, par <strong>la</strong> recherche, <strong>de</strong>s solutions viables à leurs problèmes sociaux, économiques et<br />
environnementaux. La mission du Centre est <strong>de</strong> <strong>la</strong>ncer, encourager, appuyer et mener <strong>de</strong>s<br />
recherches sur les problèmes <strong>de</strong>s régions du mon<strong>de</strong> en voie <strong>de</strong> développement et sur <strong>la</strong> mise en<br />
oeuvre <strong>de</strong>s connaissances scientifiques, techniques et autres en vue du progrès économique et<br />
social <strong>de</strong> ces régions.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Daniel MORALES-GOMEZ Chargé d’équipe Évaluation <strong>de</strong>s politiques sociales<br />
Tél. : (613) 236-6163 ext. 2308, Fax : (613) 567-7748,<br />
E-mail : dmorales-gomez@idrc.ca<br />
Luc MOUGEOT Chargé d’équipe Agriculture urbaine<br />
Tél. : (613) 236-6163 ext. 2310, Fax : (613) 567-7749,<br />
E-mail : lmougeot@idrc.ca<br />
Stephen TYLER Chargé d’équipe Gestion communautaire <strong>de</strong>s ressources<br />
naturelles — Asie<br />
Tél. : (250) 472-4708, Fax : (250) 721-6359,<br />
E-mail : styler@idrc.ca<br />
Gilles FORGET Chargé d’équipe Écosystèmes et santé<br />
Tél. (613) 236-6163 ext. 2545, Fax : (613) 567-7748,<br />
E-mail : gforget@idrc.ca<br />
Kabiru KINYANJUI Chargé d’équipe Systèmes d’apprentissage — Afrique, Nairobi, Kenya<br />
Tél. (254-2) 713160/1, 713273/4, 713355/6, 713578/9, 713690/1,<br />
713699 Fax : (254-2) 711063 (Nairobi, Kenya),<br />
E-mail : kkinyanjui@idrc.ca<br />
Marie-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> MARTIN Chargé d’équipe Impacts micros <strong>de</strong>s politiques macro-économiques<br />
et d’ajustement — MIMAP, Ottawa, Canada)<br />
Tél. (613) 236-6163 ext. 2331,<br />
Fax : (613) 567-7748, E-mail : mmartin@idrc.ca<br />
Luis NAVARRO Chargé d’équipe Des gens, <strong>de</strong>s terres et <strong>de</strong> l’eau -Afrique,<br />
Nairobi, Kenya<br />
Tél. (254-2) 713160/1, 713273/4, 713355/6, 713578/9, 713690/1,<br />
Fax : (254-2) 711063, E-mail : lnavarro@idrc.ca<br />
Brent HERBERT-COPLEY Chargé d’équipe Petites, moyennes et micro-entreprises :<br />
innovations et technologies Ottawa, Canada,<br />
Tél. (613) 236-6163 ext. 2322,<br />
Fax : (613) 567-7749, E-mail : BHerbert@idrc.ca<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 59
BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREVISION ET LA PROSPECTIVE<br />
CRDI (1998) Intégration et coopération régionales en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest, Ottawa, Éditions Kartha<strong>la</strong>.<br />
CRDI (1998) Interdépendance, déséquilibre et croissance : réflexion <strong>de</strong> l’économie politique <strong>de</strong>s<br />
re<strong>la</strong>tions Nord-Sud au tournant du siècle, Document CRDI, Ottawa.<br />
CRDI (1998) Our continent, our future : African perspectives on structural adjustment, IDRC (voir aussi<br />
CODESRIA), Ottawa.<br />
CRDI (1998) Visions et perspectives <strong>de</strong> l’intégration régionale : CEDEAO. Document CRDI, Ottawa.<br />
John SAMUEL (1997) La popu<strong>la</strong>tion mondiale et le développement : Rétrospective et perspectives,<br />
Document CRDI, Ottawa.<br />
Jill CARR-HARRIS (1997) Coopération Sud-Nord avec l’Asie en ligne <strong>de</strong> mire, Document CRDI,<br />
Ottawa.<br />
Phil HAY (1998) Global Economic Prospects and the Developing Countries 1998/99: Beyond Financial<br />
Crisis, Media Re<strong>la</strong>tions Team, CRDI, Ottawa.<br />
Thomas M. McDEVITT (1999) World Popu<strong>la</strong>tion Profile: 1998, with a Special Chapter Focusing on<br />
HIV/AIDS in the Developing World by Karen A. Stanecki and Peter O. Way, U.S. Census Bureau,<br />
Washington.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 60
CSIR<br />
COUNCIL FOR SCIENCE AND INDUSTRIAL RESEARCH<br />
AFRIQUE DU SUD<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
ADRESSE : P.O.BOX 395<br />
Pretoria 0001<br />
RSA<br />
Site Web : http : //www.csir.co.za<br />
Tél. : (00 27) 12 841 29 11<br />
Fax : (00 27) 12 349 11 53<br />
Statut : Centre <strong>de</strong> recherche national<br />
THEMES DE RECHERCHE<br />
Zone géographique : Afrique du Sud, Afrique Sub-saharienne<br />
Sujet : Centre <strong>de</strong> conseils auprès <strong>de</strong>s départements gouvernementaux, le CSIR propose son<br />
expertise sur les thèmes <strong>de</strong>s sciences techniques et <strong>de</strong> l’industrie. Son unité <strong>de</strong> recherche en<br />
transport et technologie diffuse un état actualisé <strong>de</strong>s infrastructures multimodales dans <strong>la</strong> zone<br />
australe, ainsi que <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s cartographiques.<br />
SPECIALISTES<br />
Nom : Philip HENDRICKS<br />
Tél. : (00 27) 12 841 27 17<br />
Fax: (00 27) 12 841 32 32<br />
E-mail : phendric@csir.co.za<br />
FONCTION : DIRECTEUR DE LA DIVISION TRANSPORT ET TECHNOLOGIE<br />
Nom : Clifford NAUDE<br />
Tél. : (00 27) 12 841 34 94<br />
Fax: (00 27) 12 841 32 32<br />
E-MAIL : CMNAUDE@CSIR.CO.ZA<br />
FONCTION : ECONOMISTE, SPECIALISTE EN ECONOMIE DES TRANSPORTS<br />
TRAVAUX ECONOMIQUES<br />
CSIR (1994), Multi-modal strategic p<strong>la</strong>nning for South Africa as the transport funnel into Africa,<br />
Department of Transport, Rapport RR 93 /197, March, Pretoria.<br />
MAASDORP G. (1991), A strategy for rail and road transportation in Southern Africa in Africa Insight,<br />
No.21, RSA.<br />
SATCC (1988), A scenario mo<strong>de</strong>l for goods transport <strong>de</strong>mand in the SADCC region — the main<br />
results, SADC, September, Gaborone.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 61
DIAL<br />
Centre <strong>de</strong> recherche européen en économie du développement<br />
fondé en 1990 par : ORSTOM, CESD-PARIS, EUROSTAT<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 4, rue d’Enghien<br />
75010 Paris<br />
Tél. : 01.53.24.14.50.<br />
Fax : 01.53.24.14.51<br />
E-mail : dial@compuserve.com<br />
site : http ://www.dial.fr<br />
THEMES DE RECHERCHE<br />
Dial est un Groupement d’intérêt Scientifique qui réalise <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche en macroéconomie<br />
appliquée, sur le développement.<br />
Les recherches s’organisent autour <strong>de</strong> trois axes :<br />
- L’insertion <strong>de</strong>s pays en développement dans l’Économie Mondiale<br />
- Les politiques économiques et leur dimensions sociales<br />
- Prospective économique <strong>de</strong>s Pays en Développement<br />
L’objectif <strong>de</strong> cet axe est <strong>de</strong> fournir un « cadre global <strong>de</strong> compréhension aux analyses <strong>de</strong><br />
macroéconomie appliquée. L’accent est mis sur les « interactions entre les politiques <strong>de</strong><br />
développement et certains processus longs <strong>de</strong> transformation économique et sociale tels que le<br />
peuplement, le développement <strong>de</strong>s ressources humaines ou les évolutions environnementales. »<br />
SPÉCIALISTES<br />
Jacques LOUP<br />
Directeur<br />
Jean COUSSY<br />
Jean-Daniel NAUDET<br />
Duncan JAMES<br />
Denis COGNEAU<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
DIAL (Collectif) (1995), « Développement Social en Afrique Subsaharienne : les changements sociaux<br />
face à <strong>la</strong> crise sont-ils viables à long terme ? », Paris, 34p.<br />
Prospective démo-économique :<br />
NAUDET J.-D. (1993), « Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s perspectives à long terme en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : Éléments <strong>de</strong><br />
vision économique <strong>prospective</strong> <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest à l’horizon décennal », Paris, 66 p.<br />
NAUDET J.-D. (1993) « Peuplement et économie en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : analyse du passé (1960-<br />
1990) et amorce <strong>de</strong> vision <strong>prospective</strong> », Paris, 103 p.<br />
Des travaux récents ont été menés sur <strong>la</strong> Côte d’Ivoire (liens entre <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> et <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification à<br />
moyen terme).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 62
DPRU — DEVELOPMENT POLICY RESEARCH UNIT<br />
AFRIQUE DU SUD<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
ADRESSE : DPRU<br />
UNIVERSITY OF CAPE TOWN<br />
Old Medical School Building<br />
Hidding Campus<br />
Orange Street<br />
Cape Town 8001<br />
RSA<br />
Site Web : http : //www.ucy.ac.za /<strong>de</strong>pts/dpru/htm<br />
E-mail : neethlin@hiddingh.uct.ac.za<br />
Tél. : (00 27) 21 480 71 62<br />
Fax : (00 27) 21 23 25 01<br />
Statut : Centre <strong>de</strong> recherche universitaire<br />
THEMES DE RECHERCHE<br />
Zone géographique : Afrique du Sud<br />
Sujet : Le Development Policy Research <strong>Un</strong>it coordonne les activités <strong>de</strong> recherche en matière <strong>de</strong><br />
politique commerciale, politique industrielle et en sciences et technologies <strong>de</strong>s unités <strong>de</strong> recherche<br />
Industrial Strategy Project et Science and Technology Policy Research Centre . La publication<br />
commune du DPRU et du TIPS, The Tra<strong>de</strong> and Industry Monitor, apporte son expertise aux<br />
départements gouvernementaux sud-africains.<br />
SPECIALISTES<br />
Nom : Dave KAPLAN<br />
Tél. : (00 27) 21 480 71 63<br />
Fax: (00 27) 21 23 25 01<br />
E-MAIL : KAPLAN@HIDDINGH.UCT.AC.ZA<br />
Fonction : Directeur du DPRU<br />
Nom : Dave LEWIS<br />
Tél. : (00 27) 21 480 71 63<br />
Fax: (00 27) ) 21 23 25 01<br />
Fonction : Directeur <strong>de</strong> l’Industrial Strategy Project<br />
TRAVAUX ÉCONOMIQUES<br />
LEWIS D., Dr BLOCH R. (1997), Spatial Development Initiatives : Infrastructure, agglomeration and<br />
region in industrial policy, TIPS, September, Johannesburg.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 63
DIRECTION DE LA PRÉVISION<br />
<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> l’Économie et <strong>de</strong>s Finances et <strong>de</strong> l’Industrie<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 139, rue <strong>de</strong> Bercy<br />
75572 PARIS CEDEX 12<br />
Tel. : 01 40 04 04 04<br />
Site internet : http ://www.finances.gouv.fr/Prevision/orga.htm<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : France, Mon<strong>de</strong><br />
Sujets : Au sein du ministère, <strong>la</strong> fonction centrale <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prévision est d’assurer<br />
les tâches d’analyse et d’évaluation permettant une préparation rationnelle <strong>de</strong>s décisions que doit<br />
prendre le département..<br />
Les <strong>de</strong>ux principales missions <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prévision sont :<br />
• d’établir une prévision <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> l’économie française à un horizon <strong>de</strong> 18 mois à 2<br />
ans.<br />
• Naturellement, <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prévision n’est pas limitée à cet horizon <strong>de</strong> court-moyen terme.<br />
Elle doit s’intéresser à <strong>la</strong> conjoncture immédiate, et elle bénéficie <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> l’INSEE dans<br />
ce domaine.<br />
• <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s analyses économiques, <strong>de</strong>s simu<strong>la</strong>tions, <strong>de</strong>s conseils, <strong>de</strong>s expertises et <strong>de</strong>s<br />
recommandations sur tous les domaines susceptibles d’ai<strong>de</strong>r les déci<strong>de</strong>urs publics.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Ould AOUDIA<br />
Pierre BERTHELIER<br />
Tel : 01 53 18 55 86<br />
Chargé d’Étu<strong>de</strong>s Afrique<br />
Guy <strong>de</strong> MONCHY<br />
Tel : 01 53 18 55 44<br />
Chef <strong>de</strong> service<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Nous n’avons pas pu obtenir <strong>de</strong> renseignements sur les travaux prospectifs. A notre connaissance,<br />
aucune étu<strong>de</strong> ne concerne l’Afrique sub-saharienne.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 64
COORDONNEES-STATUT<br />
Adresse 3-1-1 Kasumigaseki<br />
Chiyoda-Ku<br />
Tokyo 100-8970<br />
Japon<br />
Statut gouvernemental<br />
Email : http ://www.epa.go.jp<br />
THEMES DE RECHERCHES<br />
EPA<br />
ECONOMIC PLANNING AGENCY, Japon<br />
Zone géographique : Japon<br />
Sujet : Économie japonaise<br />
Re<strong>la</strong>tions économiques japonaises avec l’étranger<br />
Technologie du futur<br />
SPECIALITES<br />
Sous-groupe EPA : Asian tehcnology, Information program (ATIP)<br />
T. SAKAIYA : Directeur<br />
E-mail : Kahaner@atip.or.jp<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
EPA (1992), Economic P<strong>la</strong>nning Agency technology forecast to the year 2010, Tokyo.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 65
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : P.O.Box 32571<br />
Braamfontein 2017<br />
Johannesburg<br />
RSA<br />
Site Web : http : //www.fgd.co.za<br />
E-mail : pieter@fgd.co.za<br />
Tél. : (00 27) 11 339 65 85<br />
Fax : (00 27) 11 339 66 16<br />
Statut : O.N.G. <strong>de</strong> recherche<br />
THÈMES DE RECHERCHE<br />
FGD<br />
FOUNDATION FOR GLOBAL DIALOGUE<br />
AFRIQUE DU SUD<br />
Zone géographique : Afrique du Sud, Afrique Sub-saharienne, Europe<br />
Sujet : Centre d’expertise et <strong>de</strong> recherche dans les domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération internationale<br />
et du régionalisme.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Nom : Garth LE PERE<br />
Fonction : Directeur du FGD, politologue<br />
Tél. : (00 27) 11 339 65 85<br />
Fax: (00 27) 11 339 66 16<br />
Nom : Kato LAMBRECHTS<br />
Fonction : Chercheur senior, spécialiste en re<strong>la</strong>tions internationales<br />
Tél. : (00 27) 11 339 65 85<br />
Fax: (00 27) 11 339 66 16<br />
E-mail : kato@fgd.co.za<br />
TRAVAUX ÉCONOMIQUES ET DE PERSPECTIVE<br />
HOUGHTON R. (Ed.) (1997), Trading on Development : South African ‘s re<strong>la</strong>tions with the European<br />
<strong>Un</strong>ion, Foundation for Global Dialogue and the Friedrich Ebert Stiftung, May, Cape Town.<br />
FOURIE P., <strong>de</strong> VILLIERS R. (Ed.) (1998), South Africa and the Non-aligned Movement in an era of<br />
regionalisation and globalisation, Foundation for Global Dialogue and the South African Department of<br />
Foreign Affairs, 29-30 April, Pretoria.<br />
A paraître au premier trimestre 1999: é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> scénarios sur l’évolution politique et économique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> région australe. Publication commune Foundation for Global Dialogue et <strong>la</strong> Fondation Friedrich<br />
Ebert Stiftung.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 66
GEMDEV<br />
GIS Économie mondiale, Tiers-mon<strong>de</strong>, Développement<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : <strong>Un</strong>iversité Paris 1 — Centre Malher<br />
9, rue Malher<br />
75181 Paris ce<strong>de</strong>x 04<br />
Tel. : (33) 01 44 78 33 15<br />
Fax : (33) 01 44 78 33 88<br />
Site web : http://www.univ-paris1.fr/GEMDEV<br />
E-mail : <br />
Statut : groupement d’intérêt scientifique du MENESR GIS<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Tiers mon<strong>de</strong>, re<strong>la</strong>tions Nord-Sud.<br />
Sujet : Le GEMDEV est une fédération volontaire d’équipes <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> formations doctorales<br />
<strong>de</strong>s différentes universités et écoles <strong>de</strong> <strong>la</strong> région parisienne. Créé en 1983, il rassemble aujourd’hui<br />
une cinquantaine d’équipes <strong>de</strong> sciences sociales et humaines, dont 20 rattachées à Paris 1 et à<br />
l’IEDES.<br />
Parmi les thèmes <strong>de</strong> recherche traités par le GEMDEV : crise et développement ; Avenir <strong>de</strong>s Tiers<br />
Mon<strong>de</strong>s (Cheminements et scénarios pour les sociétés <strong>de</strong>s Tiers Mon<strong>de</strong>s ; Popu<strong>la</strong>tion et espaces ;<br />
Emploi, formations, ressources humainesAnalyse du système mon<strong>de</strong>, Mutations sociales et<br />
articu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s espaces urbains et ruraux, Question <strong>de</strong> l’État et <strong>de</strong>s institutions.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Jean-Jacques GABAS<br />
Prési<strong>de</strong>nt<br />
Michel BEAUD<br />
Centre d’étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> recherches sur le capitalisme (CERCA) — <strong>Un</strong>iversité Paris VIII<br />
Isabelle DEBLE<br />
Tel : 01 45 58 18 99<br />
Centre d’étu<strong>de</strong>s comparatives sur le développement (CECOD) — IEDES<br />
Philippe HUGON<br />
Tel. : 01 40 97 78 15<br />
Centre d’Étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> Recherches en Économie du Développement (CERED) — <strong>Un</strong>iversité Paris X<br />
Jean-Pierre RAISON<br />
Tel : 01 40 97 75 54/58 48<br />
Géotropiques, géographie <strong>de</strong>s tropiques (X-GEOTROPIQUES) — <strong>Un</strong>iversité Paris X<br />
Michel VERNIERES<br />
Tel :01 55 43 41 21<br />
Laboratoire d’économie social (LES) — <strong>Un</strong>iversité Paris I<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 67
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Collectif GEMDEV (1998), « La convention <strong>de</strong> Lomé en questions. Les re<strong>la</strong>tions entre les pays<br />
d’Afrique, <strong>de</strong>s Cara (bes et du Pacifique (ACP) et l’<strong>Un</strong>ion européenne après l’an 2000 », Kartha<strong>la</strong>,<br />
Paris.<br />
Collectif GEMDEV (1991), « L’Avenir <strong>de</strong>s Tiers-Mon<strong>de</strong>s », Presse <strong>Un</strong>iversitaire <strong>de</strong> France, IEDES —<br />
Coll. Tiers-Mon<strong>de</strong>, Novembre, Paris.<br />
Cahiers du GEMDEV :<br />
• « L’Avenir <strong>de</strong>s Tiers-Mon<strong>de</strong>s : Afrique », Cahier n° 17, juin 1990.<br />
• « L’Avenir <strong>de</strong>s Tiers-Mon<strong>de</strong>s : Asie », Cahier n° 15, novembre 1989.<br />
• « L’Avenir <strong>de</strong>s Tiers-Mon<strong>de</strong>s : Espaces, Pouvoir, Economies », Cahier n° 8 du GEMDEV,<br />
octobre 1988.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 68
IDE<br />
INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMY (AJIA KEIZAI KENKYUSHO)<br />
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION<br />
COORDONNEES-STATUT<br />
Adresse 42, Ichigaya-Hommura-cho – Shiujuku-ku<br />
Tokyo 162-8442<br />
Japon<br />
Tél. : 00.81.3.33.58.75.10<br />
Fax : 00.81.3.33.54.22.67 / 00.81.3.32.26.84.75<br />
Statut Institution publique (en restructuration)<br />
THEMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Asie ; Océanie<br />
Sujet : Quelques étu<strong>de</strong>s sur les économies <strong>africaine</strong>s<br />
Micro-économie<br />
Agriculture<br />
SPECIALISTES<br />
Pr Ippei YAMAZAWA<br />
Prési<strong>de</strong>nt<br />
Pr Shutaro SHISHIDO Pr Sahuro YAMADA<br />
Pr Shigato KAWANO Pr Hiroichi YAMAGUCHI<br />
Pr Takao FUKUCHI Pr Ippei YAMAZAWA<br />
Pr Reeitsu KOJIMA Pr Takashi NOHARA<br />
Pr Yutaka KOSAI Pr Toshiaki HAYASHI<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
TOIDA M. & HIRATSUKA D. (1997), "Asian Industrializing Region in 2005", Institute of Developing<br />
countries, Ajiken, Tokyo.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 69
IFIE<br />
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS<br />
COORDONNEES-STATUT<br />
Adresse 11 Dupont Circle, NW<br />
Washington DC. 20036-1207<br />
Tél. 1 202 328 90 00<br />
Fax 1 202 328 54 32<br />
E-mail : http ://www.iie.com/ADMINIST/aboutiie.htm<br />
Statut privé<br />
THEMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong><br />
Sujet : Analyse <strong>de</strong>s problèmes économiques internationaux<br />
SPECIALISTES<br />
- Fred BERGSTEN<br />
Directeur<br />
E-mail : alreeves@iie.com<br />
- Dominique N. KHACTU<br />
- Marcus NOLAND<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
NOLAND M. (1991), Pacific Basin Developing Countries : Prospects for the Future, I.I.E. ; New York.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 70
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : PO Box 2010<br />
7535 Belleville<br />
South Africa<br />
Tél. : 00.27.21.918.4144<br />
Fax: 00.27.21.918.4146<br />
IFR<br />
Institute for Futures Research<br />
AFRIQUE DU SUD<br />
Créé en 1974 avec l’appui <strong>de</strong> 10 sociétés sud-<strong>africaine</strong>s et <strong>de</strong>s chercheurs tels Mohdi Elmandjara<br />
(<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Stellenbosch). Il s’agit <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> référence sud-africain pour ce qui concerne les<br />
travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>.<br />
<strong>Un</strong> autre Institut Futuriste avait été créé à l’<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Potchefstroom sous <strong>la</strong> direction du Prof.<br />
Hentie Boshoff.<br />
SPECIALISTES<br />
Nom : Pr. André ROUX<br />
Tél. : 00.27.21.918.4144<br />
Fax: 00.27.21.918.4146<br />
FONCTION : DIRECTEUR<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
ELMANDJARA, M. (1986), Rec<strong>la</strong>iming the Future : A Manuel on Futures Studies for African P<strong>la</strong>nners,<br />
Riverton, N.J., Tycoody Publishing<br />
ELMANDJARA, M. (1992), Rétrospective <strong>de</strong>s futurs, Casab<strong>la</strong>nca, Ouyoun.<br />
GROLBELAAR (1990), Forecasts of the South African Popu<strong>la</strong>tion for the Period 1985-2020.<br />
Rouens <strong>de</strong> LANGE, Den Van SEVENTES SAMSEN (1986), Computers Mo<strong>de</strong>l of the Economy.<br />
Séminaire "The Future : a Special Conference on P<strong>la</strong>nning Scenarios for South Policy Makers"<br />
D’autres contributions en Afrique du Sud à notifier sont les suivantes :<br />
- CSIR, Council for Science and Industrial Research<br />
Adresse : Po Box 395, Pretoria 0001, RSA<br />
Tel : 00 27 12 841 28 82<br />
Fax : 00 27 12 841 20 55<br />
Contact : M.P. HOFMEYR<br />
E-mail : hhofmeyr@csir.co.za<br />
- ESKOM<br />
Adresse : Po Box 1091, 2000 Johannesburg, RSA<br />
Tel : 00 27 11 800 44 40<br />
Fax : 00 27 11 800 59 94<br />
Contact : J.R. VAN DEVENTER<br />
E-mail : jaap.van<strong>de</strong>venter@eskom.co.za<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 71
IFRI<br />
INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 27 rue <strong>de</strong> <strong>la</strong> Procession<br />
75 015 Paris.<br />
Tel : 01 40 61 60 00<br />
Site internet : http ://icip<strong>la</strong>n.com/polet<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : mondiale<br />
Sujets : politique, économie mondiale<br />
L’IFRI ne réalise pas <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s, mais met en <strong>prospective</strong>s <strong>de</strong> l’économie mondiale et les<br />
économies <strong>africaine</strong>s dans ce contexte.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Pierre JACQUET<br />
E-mail : jacquet@ifri.org<br />
Thierry <strong>de</strong> MONTBRIAL<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE<br />
De MONTBRIAL T., JACQUET P. (1999), « Ramses, Synthèse annuelle <strong>de</strong> l’évolution du mon<strong>de</strong> »,<br />
Dunod, Paris.<br />
DAVID D. (1997), « Ramses, Politique : l’éveil <strong>de</strong>s nouveaux mon<strong>de</strong>s », Dunod, Paris.<br />
De MONTBRIAL T. (1994), « Ramses », Paris.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 72
ISEAS<br />
INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES<br />
COORDONNEES-STATUT<br />
Adresse 30 Heng Muikeng Terrace, Pasir Panjang, Singapour 119664<br />
Tél. : 00.65.778.09.55<br />
Fax : 00.65.778.17.35<br />
Internet : http://merlion.iseas.ac.sg<br />
THEMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Asie<br />
Sujet : Regional economic studies<br />
Regional strategic and political studies<br />
Regional, social and cultural studies<br />
Asean transitional economies programme<br />
L’ISEAS est un <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> recherche les plus importants sur l’Asie. Cet Institut a réalisé <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> long terme sur l’Asie qui concernent indirectement l’Afrique.<br />
SPECIALISTES<br />
Dr CHIA SIOW YUE : Directeur<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Yasheug HUANG (1998), FDI in China : an asian perspective, The Chinese <strong>Un</strong>iversity Press,<br />
HongKong.<br />
Seiji Finch NAYA (1995), Asian transnational economies : challenges and prospects for reform and<br />
transformation, ISEAS, Singapour.<br />
Shankar SHARMA (1994), Energy, the environment and the oil market : an Asia-Pacific perspective,<br />
ISEAS, Singapour.<br />
Heal HILL (1992), Indonesia’s textile and garment industries : <strong>de</strong>velopments in an asian perspective,<br />
ISEAS, Singapour.<br />
Nelson R. MANDELA (1997), South and Southern Africa into the next century, ISEAS, Singapour.<br />
Satu LIMAYE (1998), India, Southeast Asia and the <strong>Un</strong>ited States : the new opportunities and<br />
prospects dor co-operation, ISEAS, Singapour.<br />
Shinishi ICHIMURA (1998), Political economy of Japanese and Asian <strong>de</strong>velopement (Debt problems<br />
and Asian perspectives), ISEAS, Singapour.<br />
Mohamed ARIFF (1998), APEC and <strong>de</strong>velopment cooperation, (Offocial <strong>de</strong>velopment assistance : the<br />
Indonesian experience and prospects), ISEAS, Singapour.<br />
Ahmed MUKARRAM (1998), India, Southeast Asia and the <strong>Un</strong>ited States : nex opportunities and<br />
prospects for a co-operation, Asia Society, New York.<br />
Bryce HARLAND (1996), Collision course : America and East Asia in the past and the future, ISEAS<br />
ed., Singapour<br />
Maria SEDA (1993), Environmental management in ASEAN : perspectives on critical regional issues,<br />
ISEAS, Singapour<br />
Richard P. CORNIA (1992), Japan, the <strong>Un</strong>ited States and prospects for the Asia Pacific century : three<br />
scenarios ofr the future, ISEAS, Singapour.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 73
ISER<br />
INSTITUTE FOR SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH<br />
AFRIQUE DU SUD<br />
COORDONNÉES -STATUT<br />
Adresse : <strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Durban-Westville<br />
PRIVATE BAG X54001<br />
Durban 4000<br />
RSA<br />
Tél. : (00 27) 31 204 42 98<br />
Fax : (00 27) 31 204 48 34<br />
E-mail : dhindson@pixie.udw.ac.za<br />
Statut : Centre <strong>de</strong> recherche universitaire<br />
THEMES DE RECHERCHE<br />
Zone géographique : Afrique du Sud, Province du KwaZulu /Natal<br />
Sujet : L’ISER en tant que centre <strong>de</strong> recherche en sciences économiques et sociales promeut <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s à impact local sur les questions <strong>de</strong> gouvernance, d’économie urbaine et <strong>de</strong> dynamiques<br />
territoriales.<br />
SPECIALISTES<br />
Nom : Doug HINDSON<br />
Tél. : (00 27) 31 204 42 95<br />
Fax: (00 27) 31 204 48 34<br />
E-mail : dhindson@pixie.udw.ac.za<br />
Fonction : Professeur et chercheur<br />
TRAVAUX ÉCONOMIQUES<br />
HARRISSON P., TODES A. (1996), The Development corridors route : New Highways or Old-by<br />
ways ?, Indicator SA Vol.13, No.3, RSA.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 74
COORDONNÉES -STATUT<br />
ITCS<br />
Institute for Twenty-first Century Studies<br />
Adresse : Scandinavian Institute of African Studies<br />
Övre Slottsgatan 28 B<br />
S-753<br />
12 UPPSALA — SUEDE<br />
THEMES DE RECHERCHE<br />
Zone géographique : Afrique, plus spécifiquement Afrique australe<br />
Sujets : recherche pluridisciplinaire sur l’Afrique<br />
SPECIALISTES<br />
Martha GARRETT<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
GARRETT M. et al (ed) (1991), Studies for the Twenty-First Century, UA, Arlington.<br />
GARRETT M. (1994), « Exp<strong>la</strong>ning the futures of Africa. Bibliography and gui<strong>de</strong> to information<br />
ressource », Futures, Vol.26, No.9, pp. 912-943, November.<br />
Co-organisatrice avec Olufsemi Bamiro et Godwin Sogolo <strong>de</strong> : Conference UNESCO/PNUD/IDRC<br />
"African Cultures : African Futures", Ibadan.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 75
IUED<br />
Institut <strong>Un</strong>iversitaire d’Étu<strong>de</strong>s du Développement<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 24, rue Rothschild<br />
CP 136<br />
1211 Genève 21<br />
Suisse<br />
Tel. : +41 22 906 5940<br />
Fax : +41 22 906 5947<br />
E-mail : iued@unige.ch<br />
Site internet : http://www.iued.ch/iued<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Tiers-mon<strong>de</strong><br />
SPÉCIALISTES<br />
Jean-Luc MAURER<br />
Directeur<br />
Christian COMELIAU<br />
E-mail : Christian.Comeliau@iued.unige.ch<br />
Tel. : +41 22 90 5965<br />
Politique <strong>de</strong> développement, ajustement structurel, organisations internationales, Afrique <strong>de</strong> l’Ouest,<br />
In<strong>de</strong>, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Zaïre.<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
L’IUED ne fait pas d’étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s. En revanche, Christian COMELIAU a travaillé sur <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nification et <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong>s.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 76
MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL<br />
COTE D’IVOIRE<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : Immeuble CCIA<br />
BPV 65, Abidjan<br />
Côte d’Ivoire<br />
Tél. : 225 21 30 88<br />
Fax : 225 21 30 90<br />
Site Internet: http : //www.refer.org/ivoir_et /vie/adm/accueil.htm<br />
SPECIALISTES<br />
Tidjane THIAM<br />
Ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
- <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n et du développement Industriel (1974), Côte d’Ivoire 2000, Abidjan.<br />
- <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n et du développement Industriel (1985), Côte d’Ivoire 2010, Abidjan.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 77
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification /MEFP<br />
8 rue du Docteur Guilbert<br />
Dakar<br />
SENEGAL<br />
Tél. : (221) 823 88 91<br />
Fax : (221) 823 14 37<br />
E-mail : Ad<strong>la</strong>m@hotmail.com<br />
THEMES DE RECHERCHE<br />
Sujets : p<strong>la</strong>nification et <strong>prospective</strong><br />
MINISTERE DU PLAN<br />
SENEGAL<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Sénégal 2015, Dakar, 1989, avec un rôle <strong>de</strong> conseillers <strong>de</strong> J.GIRI.<br />
Sénégal Prospective 2025, en cours <strong>de</strong> réalisation.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 78
NIRA<br />
NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH ADVANCEMENT<br />
COORDONNEES-STATUT<br />
Adresse Box 5004, Ebisu Gar<strong>de</strong>n P<strong>la</strong>ce Post Office<br />
Shibuya, Tokyo 150-6034<br />
Tél. : 00.81.3.544.817.11<br />
Fax : 00.81.3.544.817.44<br />
E-mail : http ://www.nira.go.jp<br />
Statut gouvernemental<br />
THEMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Asie<br />
Sujet : Économie<br />
SPECIALISTES<br />
S.HASHIMOTO<br />
Prési<strong>de</strong>nt<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Nira Policy Research (1997), China’s prospects after the return of HongKong, 10 (7), Tokyo.<br />
Nira Policy Research (1997), Prospects and issues for Japanese industrial technology : from the<br />
viewpoint of competition and cooperation, 10 (3), Tokyo.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 79
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse: Overseas Development Institute<br />
Port<strong>la</strong>nd House<br />
Stag P<strong>la</strong>ce<br />
London SW1E 5DP - UK<br />
Telephone: +44 (0)171 393 1600<br />
Fax: +44 (0)171 393 1699<br />
Statut: Institut <strong>de</strong> recherche<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique: Tous pays en développement<br />
ODI<br />
Overseas Development Institute<br />
Sujets:<br />
• Ai<strong>de</strong>, Afrique du Sud, Politique <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l’<strong>Un</strong>ion Européenne, et plus généralement,<br />
le fonctionnement du système <strong>de</strong> Bretton Woods dans le développement.<br />
• Sur <strong>la</strong> <strong>prospective</strong>, Plusieurs travaux portant sur les implications à long terme <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s<br />
règles internationales (Lomé, OMC) pour les pays ACP, ou l’ASS (cf. bibliographie).<br />
SPÉCIALISTES<br />
Michael DAVENPORT<br />
Shei<strong>la</strong> PAGE<br />
Roger C. RIDDELL<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
DAVENPORTt M., HEWITT A. and KONING A., (1995) "Europe’s Preferred Partners? The Lomé<br />
Countries in World Tra<strong>de</strong>", ODI, 70 pp, London.<br />
Résumé: Les pays ACP ont bénéficié d’un accès préférentiel au marché européen grâce à <strong>la</strong><br />
convention <strong>de</strong> Lomé, pendant plus <strong>de</strong> 20 ans. Ce rapport évalue l’impact <strong>de</strong> ce traitement préférentiel,<br />
examine en détail leur performance commerciale et analyse les difficultés rencontrées par les<br />
exportateurs ACP. Le rapport analyse aussi les effets potentiels <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong><br />
l’UE vis à vis <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention <strong>de</strong> Lomé ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> libéralisation commerciale résultant <strong>de</strong><br />
l’Uruguay Round sur les performances commerciales <strong>de</strong>s pays ACP.<br />
PAGE Sh. (1997), Prospects for Developing Countries: Tra<strong>de</strong> and Finance for the Least Developed.<br />
Policy Questions for the UK, EU, and Commonwealth", ODI, 52pp, London.<br />
Résumé: Produit dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> conférence 1997 <strong>de</strong> l’ODI sur les perspectives économiques<br />
pour les pays en développement, ce rapport résume les principales prévisions publiées et les étu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>s pays en développement, ainsi que leurs implications <strong>de</strong> politique économique. Il analyse aussi les<br />
propositions existantes pour <strong>la</strong> conception <strong>de</strong> nouvelles politiques.<br />
RIDDELL R.C. (1991), "Manufacturing Africa: Performance and Prospects of Seven Countries in Sub-<br />
Saharan Africa", ODI, 419pp., London.<br />
Résumé: Cette analyse du rôle <strong>de</strong> l’industrie dans le développement <strong>de</strong> l’Afrique regroupe <strong>de</strong>s<br />
chapitres rédigés par <strong>de</strong>s spécialistes sur le cas du Botswana, du Cameroun, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Côte d’Ivoire, du<br />
Zimbabwe, du Nigeria, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zambie et du Kenya. Ces étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cas sont p<strong>la</strong>cées dans le contexte<br />
d’une analyse générale <strong>de</strong>s tendances s’exprimant à travers tous les pays du continent.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 80
TIPS<br />
TRADE AND INDUSTRIAL POLICY SECRETARIAT<br />
AFRIQUE DU SUD<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : Regional office for Southern Africa<br />
P.O.Box 477<br />
WITS 2050<br />
RSA<br />
Site Web : http : //www.tips.org.za<br />
Tél. : (00 27) 11 339 19 11<br />
Fax : (00 27) 11 339 50 50<br />
Statut : Bureau d’étu<strong>de</strong>s international<br />
THEMES DE RECHERCHE<br />
Zone géographique : Afrique du Sud, Afrique australe, Europe<br />
Sujet : Le Tra<strong>de</strong> and Industrial Policy Secretariat, en re<strong>la</strong>tion avec le département du Commerce et <strong>de</strong><br />
l’Industrie sud-africain sert <strong>de</strong> re<strong>la</strong>is entre les instances étatiques, les agents du secteur privés et <strong>la</strong><br />
communauté scientifique dans les secteurs <strong>de</strong> l’industrie et du développement durable. Ses<br />
publications encouragent <strong>la</strong> mise à disposition d’expertises internes et externes .<br />
SPECIALISTES<br />
Nom : Rashad CASSIM<br />
Tél. : (00 27) 11 339 19 11<br />
Fax: (00 27) 11 339 50 50<br />
E-mail : Rcassim@idrc.ca<br />
Fonction : Directeur<br />
Nom : Dr Robin BLOCH<br />
Tél. : (00 27) 11 339 19 11<br />
Fax: (00 27) 11 339 50 50<br />
E-mail : rbloch@idrc.ca<br />
Fonction : Urbaniste-chercheur<br />
TRAVAUX ÉCONOMIQUES<br />
EVANS D. (1998), Options for Regional Integration in Southern Africa, TIPS, Annual Forum, 20-22<br />
Septembre, Johannesburg.<br />
WOOD G. (1998), The problems and prospects of Mozambique three corridors : a case study in<br />
regional integration in Southern Africa, TIPS Working paper No.7, January, Johannesburg.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 81
COORDONNEES -STATUT<br />
UNU-INRA<br />
<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies,<br />
Institute for Natural Resources in Africa<br />
Adresse Acra-Ghana<br />
Lusaka (<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Zambie)<br />
E-mail : mbox@hq.unu.edu<br />
Site internet http ://www.unu.edu<br />
Statut organisation ONU/UNU<br />
THEMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Afrique Sub-Saharienne<br />
Sujet : coopération internationale<br />
dimension socio-économique<br />
décisions en matière <strong>de</strong> développement durable (p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s femmes dans le développement<br />
durable)<br />
conservation et gestion <strong>de</strong>s ressources<br />
rôle <strong>de</strong>s fermiers<br />
éducation<br />
transfert <strong>de</strong> technologies<br />
conservation <strong>de</strong> <strong>la</strong> biodiversité<br />
SPECIALISTES<br />
Dr OKIGBO<br />
Directeur adjoint<br />
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Thème : titre Perspective à moyen terme (1997-2001), Rapport UNU/INRA (1996) Agenda 21,<br />
Tokyo.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 82
COORDONNÉES-STATUT<br />
USAID<br />
U.S. Agency for International Development<br />
Adresse USAID<br />
Ronald Reagan Building<br />
Washington, D.C. 20523-0016<br />
USA<br />
Tel: 202-712-4810<br />
Fax 202-216-3524<br />
Adresse ABIC (Africa Bureau Information Center)<br />
1331 pensylvania Avenue NW Suite 1425 Washington DC 20004-1703 USA.<br />
E-mail : Abic@rrs.cdie.org<br />
Missions en Afrique <strong>de</strong> l’Est, <strong>de</strong> l’Ouest et du Sud (Éthiopie, Mozambique, REDSO/ESA au Kenya,<br />
Afrique Sud) :<br />
• Éthiopie : Riversi<strong>de</strong> Building Off Asmara Road Addis Abeba Ethiopia PO box 1014<br />
Usaid Addis Ababa Department of State Washington DC 20521-2030<br />
Tel : 521-1 510088, fax : 251-1 510043, ai<strong>de</strong>thiopia@usaid.gov<br />
• Kenya (REDSO/ESA) PO Box 30261 Nairobi Kenya ; tel : 254-2-751613 et Fax : 254-2-749393,<br />
www.usia.gov/abtusia/et mmuiruri@usaid.gov.<br />
• Afrique Sud : PO Box 55380 Arcadia 0007 Cnr. Church and Beatrix Street, Sancardia Building, 9 th<br />
flor Petoria, Tel 27-12 323 8869 et Fax : 27-12 323 6443. www.sn.apc.org/usaidsa/<br />
Site internet : www.usaid .gov/regions/afr/puis : abic/10years.htm ou bien : pubs/html<br />
ou bien : fews/htm<br />
Statut : Agence indépendante du gouvernement, spécialisée dans le développement économique et<br />
l’assistance humanitaire, pour faire avancer les intérêts économiques et politiques américains à<br />
l’étranger (créée en 1961 par John F. Kennedy et fonctionnant sur les budgets fédéraux).<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Thèmes : Démocratie et gouvernance ; croissance économique (agriculture, secteur privé,<br />
programmes économiques et réformes politiques) ; éducation ; environnement ; santé et p<strong>la</strong>nification<br />
familiale ; réponses humanitaire.<br />
Programmes :<br />
Programmes agricoles ; développement du secteur privé ; programme <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong>s activités<br />
génératrices <strong>de</strong> revenus. Programmes spécifiques <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance en Afrique : USAID<br />
Economic growth page ; AfricaLink ; Africa Productive Sector Growth and Environment (PSGE) ;<br />
Equity and Growth through Economic Resarch (EAGER) ; Famine Early Warning System (FEWS) ;<br />
Food Security II Cooperative Agreement ; Graeer horn of Africa initiative ; Le<strong>la</strong>nd initiative ; Regional<br />
Telecommunications Restructuring Program ; The Initiative for Southern Africa (ISA) ; Sahel regional<br />
program (SRP) ; Central African Regional program for the Environment (CARPE)<br />
Newsletters <strong>de</strong> l’ABIC : African Voice ; SD Abstracts ; SD Developments.<br />
SPÉCIALISTES<br />
DONALD R. Mackenzie Directeur du Bureau <strong>de</strong> REDSO/ESA (Regional Economic <strong>de</strong>velopment<br />
Sevices Office for East and Southern Africa), Kenya.<br />
HARVEY R. Directeur adjoint du REDSO/ESA (ex directeur <strong>de</strong> Mission Usaid au Cameroun)<br />
IRVIN J., REDSO/ESA Kenya.<br />
RHODES W. Directeur Mission Usaid en Afrique Sud<br />
TAYLOR L. Missionn Usaid Tanzanie.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 83
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
U.S. Development Assistance to Africa Over the Next Deca<strong>de</strong>-- Anticipated Needs and Appropriate<br />
Responses, Report to the Senate Appropriations Committee, May 1997 (Trois chapitres : Assessment<br />
of need ; Achieving the new vision ; Future program directions), insistant sur les défis à relever pour<br />
l’an 2015, en matière d’education, pauvreté, santé, mortalité, sécurité alimentaire, <strong>de</strong> développement<br />
du secteur privé, <strong>de</strong> dévelopement soutenable et régional (rapport en annexe).<br />
Prévisions climatiques in www.sahelusaid.htm<br />
Prévisions in Famine Eearly Warning System<br />
Rapport prévisionnel sur le Sida (/vihusaid.htm)<br />
USAID in Africa : ten year vision (www.info.usaid.gov/regions/afr/10year.html)<br />
USAID-South Africa Strategy 1996-2005 (six objectifs <strong>de</strong> développement sont détaillés)<br />
Conference Report Worldwi<strong>de</strong> Mission Director’s Conference Nov. 1998. Contenu :<br />
Introduction/Backround/USAID’S role in promoting US interests/USAID in a changing global<br />
environment/USAID Reforms/Next Steps/Closing Notes/Annexes/. Dans le chapitre « USAID in a<br />
changing global environment » : référence à une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Allen Hammond (consultant privé,<br />
directeur <strong>de</strong>s analyses stratégiques à World Resources Institute et auteur <strong>de</strong> Which World ?<br />
Scenarios for the 21 st Century ) : trois scénarios sont décrits, à partir <strong>de</strong>squels ont été tracés les 6<br />
objectifs du Rapport.<br />
Estimations économiques (investissement, sécurité, p<strong>la</strong>ns…) in USAID-AfrikaLink et Fews Bulletin.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 84
2.1.4.<br />
ORGANISMES PRIVES<br />
DE PREVISIONS<br />
ET DE PROSPECTIVES AFRICAINES
Le recensement <strong>de</strong>s organismes privés réalisant <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s ou <strong>de</strong>s<br />
exercices <strong>de</strong> prévision à long terme sur les pays africains s’avère beaucoup plus difficile à<br />
réaliser que celui concernant les institutions du secteur public ou parapublic. En effet, <strong>la</strong><br />
plupart <strong>de</strong> ces étu<strong>de</strong>s ne font pas l’objet <strong>de</strong> publications et <strong>de</strong>meurent souvent strictement<br />
confi<strong>de</strong>ntielles.<br />
Les besoins <strong>de</strong> cadrage à long terme s’expriment principalement dans les secteurs à<br />
forte intensité capitalistique, où les temps <strong>de</strong> retour sur investissement sont généralement<br />
longs (et souvent supérieurs à 5/7 ans). Parmi ces secteurs figurent notamment les activités<br />
pétrolières et minières, les activités <strong>de</strong> réseau (transports, télécommunication, électricité,<br />
eau, assainissement…), ou encore certains segments <strong>de</strong> l’industrie chimique dont le cycle <strong>de</strong><br />
vie du produit est allongé en raison <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is liés aux autorisations administratives <strong>de</strong> mise<br />
sur le marché. Ces firmes ont alors besoin <strong>de</strong> compléter les conseils et les cadrages à court-<br />
moyen terme prodigués par les organismes d’assurance (comme <strong>la</strong> COFACE), par leurs<br />
banques conseil ou encore par les sociétés spécialisées dans l’évaluation <strong>de</strong>s risques pays<br />
(comme NSE, Credit-Risk International, Chorême…).<br />
Les besoins d’étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s s’expriment généralement par les firmes<br />
envisageant une imp<strong>la</strong>ntation locale (nécessairement <strong>de</strong> longue durée compte tenu <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques technico-économiques <strong>de</strong> leur production) et attachant une forte importance<br />
à <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong> leurs investissements. Les étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s <strong>de</strong>vront conduire à <strong>de</strong>ssiner<br />
plusieurs scénarios socio-politiques à long terme ; <strong>la</strong> probabilité d’apparition <strong>de</strong>s divers futurs<br />
possibles étant appréciée par <strong>de</strong>s recherches relevant <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> l’intelligence<br />
économique (et repérant notamment les hommes ou les groupes « faiseurs d’histoire »).<br />
Dans le cas où <strong>la</strong> production est <strong>de</strong>stinée au marché intérieur, les analyses<br />
stratégiques doivent être complétées par <strong>de</strong>s prévisions à moyen et long terme. Ces étu<strong>de</strong>s<br />
sont essentiellement sectorielles et visent à apprécier <strong>la</strong> taille du marché (potentiel et effectif)<br />
et ses évolutions à long terme. Elles nécessitent <strong>de</strong>s modélisations spécifiques à chacun <strong>de</strong>s<br />
métiers (modèles <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong> trafic dans le cas <strong>de</strong>s investissements routiers, modèles <strong>de</strong><br />
projection <strong>de</strong> parc et <strong>de</strong> trafic pour les télécoms…). Toutefois, l’alimentation <strong>de</strong> ces modèles<br />
sectoriels nécessite, <strong>la</strong> plupart du temps, <strong>de</strong>s cadrages macro-économiques et financiers à<br />
long terme, associés parfois à <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s spécifiques, portant notamment sur l’évolution <strong>de</strong>s<br />
taux <strong>de</strong> change à long terme si l’investisseur est aussi opérateur.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 86
LISTE (non exhaustive) DE SOCIETES D’ETUDES<br />
REALISANT DES ANALYSES PROSPECTIVES<br />
ET DES PREVISIONS A MOYEN ET LONG TERMES EN AFRIQUE<br />
ETUDES PROSPECTIVES ET PREVISIONS GLOBALES A LONG TERME<br />
CHOREME<br />
Adresse : 95, rue Marignan — F94210 La Varenne Saint Hi<strong>la</strong>ire<br />
Tél. : 01.45.11.29.31 — Fax : 01.45.11.10.68 — E-Mail : Choreme@wanadoo.fr<br />
Contacts : Etienne Picher — Jacques Seguin<br />
Cabinet spécialisé dans l’évaluation <strong>de</strong>s risques-pays. Réalise <strong>de</strong>s cadrages à moyen long terme pour<br />
les pays en développement, notamment africains.<br />
DME<br />
Adresse : 42, rue Pierre Curie — F78670 Médan<br />
Tél. : 01.39.75.36.70 — Fax : 01.39.75.71.91 — E-Mail : scdme@wanadoo.fr<br />
Contacts : Béatrice Bernou — Olivier Sudrie<br />
E<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> modèles <strong>de</strong> prévision à court, moyen et long termes.<br />
Prévisions macro-économiques à long terme pour :<br />
• Algérie<br />
• Côte d’Ivoire<br />
• Sénégal<br />
• Afrique du Sud<br />
• Madagascar<br />
Étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> sur <strong>la</strong> zone Afrique — Moyen Orient- Maghreb<br />
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (GROUPE THE ECONOMIST)<br />
Adresse : www.eiu.com<br />
Contact Afrique : london@eiu.com [co<strong>de</strong> 1ACWLA]<br />
EIU réalise <strong>de</strong>s prévisions à court moyen terme (horizon 2003/2005) pour le Nigéria et l’Afrique du Sud.<br />
EIU é<strong>la</strong>bore <strong>de</strong>s dossiers couvrant l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone « Afrique sub-saharienne ».<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 87
HUDSON INSTITUTE<br />
Adresse : 5395 Emerson Way — Indianapolis — Indiana 46226<br />
Tél. : 317-545-1000 — Fax : 317-545-9639<br />
Web : www.hudson.org<br />
Contacts : Herb London (Directeur)<br />
Anciens responsables : Herman Kahn (ancien directeur)<br />
Duncan James Wiener (ancien prési<strong>de</strong>nt du « Ressouces Management<br />
Council »)<br />
Travaux :<br />
Cet Institut a but non lucratif, créé en 1961 par Herman Kahn et D.J. Wiener, a réalisé <strong>de</strong> très<br />
nombreuses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s dont <strong>la</strong> plus célèbre est : L’an 2000, publié en 1967.<br />
Selon nos informations, Hudson Institute réaliserait actuellement une étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> sur l’Afrique<br />
<strong>de</strong>stinée, notamment, à évaluer le potentiel <strong>de</strong> développement du marché africain.<br />
Étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> <strong>prospective</strong><br />
Giri, J.,(1989), Le Sahel <strong>de</strong>main, Kartha<strong>la</strong>, Paris<br />
Giri, J.,(1989), L’Afrique en panne, Kartha<strong>la</strong>, Paris<br />
Adresse : WEFA SA<br />
25, rue <strong>de</strong> Ponthieu<br />
75008 Paris<br />
Tel. 33.1.53.89.19.10<br />
Fax 33.1.43.63.76.72<br />
S.F.C.<br />
Societe française <strong>de</strong> conseil<br />
(EX-SEDES, GROUPE CEGOS)<br />
Étu<strong>de</strong>s :<br />
« Administrations, Etat et sociétés <strong>africaine</strong>s ».<br />
Pour le compte du <strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération, 1993.<br />
Cette société n’a plus d’activité.<br />
Adresse : 119, Bld Gabriel Péri, 92240 Ma<strong>la</strong>koff<br />
Tel et Fax : 01.49.65.03.03<br />
SOCIETES ET DEVELOPPEMENT<br />
Sociétés et Développement est une association loi <strong>de</strong> 1901 dont l’objet est <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à toute réflexion<br />
et étu<strong>de</strong> ayant trait aux questions <strong>de</strong> développement dans les pays du Sud et aux re<strong>la</strong>tions qui existent<br />
entre le développement et les facteurs sociaux<br />
Responsable : Jacques GIRI<br />
WEFA Group<br />
Wharton Econometrics Forecasting Association Group<br />
Travaux :<br />
Wefa Group (1998), World Economic Outlook, 20 years extension, Paris.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 88
Le Wefa Group fournit <strong>de</strong>s projections <strong>de</strong> croissance utilisées par les principaux modèles<br />
énergétiques. Le Wefa Group est aussi à <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s projections <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale dans <strong>la</strong><br />
revue trimestrielle « Commodity Markets and the Developing Countries »<br />
ETUDES SECTORIELLES<br />
PETROLE<br />
Adresse : 4, rue Boulitte — F75014 Paris<br />
Tél. : 01.40.44.66.67<br />
Fax : 01.40.44.66.72<br />
Contact : Pierre Tierzan<br />
PETROSTRATEGIES<br />
Publication d’une lettre confi<strong>de</strong>ntielle (Pétrostratégies). A publié dans <strong>la</strong> revue Géopolitique (n° 63,<br />
octobre 1998) une étu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> « Nouvelle donne du pétrole Africain ».<br />
TELECOMMUNICATIONS<br />
Adresse : 42, rue Pierre Curie — F78670 Médan<br />
Tél. : 01.39.75.36.70<br />
Fax : 01.39.75.71.91<br />
E-Mail : scdme@wanadoo.fr<br />
Contacts : Béatrice Bernou — Olivier Sudrie<br />
DME<br />
E<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> modèles <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong> parc et <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong> trafic.<br />
Prévisions pour :<br />
- Côte d’Ivoire<br />
- Sénégal<br />
- Afrique du Sud<br />
- Madagascar<br />
INFRASTRUCTURES ROUTIERES<br />
INGEROP<br />
Adresse : 168-170 Bd <strong>de</strong> Verdun — F92413 Courbevoie Ce<strong>de</strong>x<br />
tél. : 01.49.04.59.75 — Fax : 01.49.04.57.01 — E-Mail : michel.titecat@ingerop.com<br />
Contact : Michel Titecat<br />
Ingerop a réalisé <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s sur le développement à long terme <strong>de</strong>s infrastructures <strong>de</strong><br />
communication en Afrique.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 89
IRRIGATION<br />
STRATYS<br />
Adresse : 24, Montée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chaîne, 13016 Marseille<br />
Tél. : 04.91.46.15.91<br />
Contact :J.C.COHEN, Administrateur INSEE<br />
Cabinet spécialisé dans le conseil et <strong>la</strong> formation en stratégie. Stratys a réalisé, en 1999,<br />
«L’étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> irrigation » et « L’étu<strong>de</strong> immigration ouest <strong>africaine</strong> à l’horizon 2020 »pour le<br />
compte du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération.<br />
TEXTILE<br />
SERES<br />
Société Européenne <strong>de</strong> Réalisation, d’Étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> Services<br />
Adresse : 1, chemin <strong>de</strong> l’Abreuvoir. F78860 Saint-Nom <strong>la</strong> Bretèche<br />
Tél. : 01.30.80.02.30. Fax : 01.30.80.02.87. E-Mail : seres@wanadoo.fr<br />
Contact : Jean C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> le Goff<br />
« La compétitivité <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière textile en Afrique subsaharienne ». Étu<strong>de</strong> réalisée en 1995 pour le compte<br />
du <strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération (MEEP) en association avec SOFRECO.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 90
2.2.<br />
CENTRES<br />
DE PROSPECTIVE<br />
SECTORIELLE
2.2.1.<br />
AGRICULTURE
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : The World Bank<br />
1818 H Street, NW.<br />
Washington, DC 20433, USA<br />
Tél. : 202.477-1234<br />
Site internet : http ://www.worldbank.org<br />
E-mail : Info@worldbank.org<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong><br />
Sujets : Macroéconomie<br />
SPÉCIALISTES<br />
Alexan<strong>de</strong>r Mac Cal<strong>la</strong> : agriculture<br />
tél. : 202 458 5028<br />
fax : 202 522 3307<br />
BANQUE MONDIALE<br />
Prospective agricole<br />
Tei Mante (IFC : The International Finance Corporation) : agriculture<br />
tél. : 202 473 0558<br />
fax : 202 974 4336.<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
World Bank (1996), « World and Regional Supplys and Demand Ba<strong>la</strong>nces for Nitrogen Phosphate,<br />
and Potash. 1993-94 — 1999/2000 », World Bank Technical Paper n° 309, Washington<br />
Venkatesan V. and Kampen J. (1998), « Evolution of Agricultural Services in Sub-saharan Africa :<br />
trends and prospects », World Bank discussion paper n° 390, Washington<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 94
CIRAD<br />
CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE<br />
AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 42, rue Scheffer<br />
75116 Paris<br />
Tél. : 01.53.70.20.00<br />
Fax : 01.47.55.15.30<br />
Site internet : www@cirad.fr<br />
Statut : Organisme <strong>de</strong> recherche<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique: Recherche dans 90 pays en Afrique, Amérique <strong>la</strong>tine et dans le Pacifique<br />
Sujets : - Agriculture (<strong>prospective</strong> <strong>de</strong>s filières <strong>de</strong> produit) et alimentation<br />
- Environnement — Développement durable<br />
- Forêt<br />
Participation au club <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> sur les questions alimentaires avec SOLAGRAL (voir fiche<br />
correspondante) et l’INRA<br />
Réflexion sur <strong>la</strong> construction d’un modèle <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> alimentaire<br />
E<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> scénarios techniques, technologiques, institutionnels… pour un développement<br />
durable par écosystème ("révolution doublement verte").<br />
SPÉCIALISTES<br />
Marie <strong>de</strong> Lattre-Gasquet<br />
Observatoire du changement — Direction Scientifique<br />
42, rue Scheffer 75116 Paris<br />
Tél. : 01 53 70 20 00 Fax : 01 47 55 15 30<br />
Michel Griffon<br />
ECOPOL<br />
45 bis av. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belle Gabrielle 94736 Nogent-sur-Marne Ce<strong>de</strong>x<br />
Tél. : 01 43 94 73 28 Fax : 01 43 94 73 11 Email : ecopol@cirad.fr<br />
A<strong>la</strong>in Karsenty<br />
CIRAD-Forêt<br />
45 bis av. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belle Gabrielle 94736 Nogent-sur-Marne Ce<strong>de</strong>x<br />
Tél.: 01 43 94 73 03 (Paris)/ 04 67 59 37 41 (Montpellier)<br />
Fax : 01 43 94 73 08 (Paris)/ 04 67 59 38 27 (Montpellier) Email : a<strong>la</strong>in.karsenty@cirad.fr<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
De Lattre-Gasquet, Despréaux D., Barel M., (1998). Prospective <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière cacao. Document <strong>de</strong><br />
travail, Montpellier<br />
Griffon M. (éd.), (1997) Vers une Révolution doublement verte. Fondation Prospective et Innovation.<br />
CIRAD-GERDAT, Paris.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 95
Griffon M., Marty I., ( 1993) Prospective <strong>de</strong>s déséquilibres environnementaux liés à l’agriculture dans<br />
les pays tropicaux., Paris.<br />
Karsenty A., Debroux L., ( 1997) L’imp<strong>la</strong>ntation <strong>de</strong>s sociétés asiatiques en Afrique centrale —<br />
Rimbunan Hijau au Cameroun, Bois et Forêts <strong>de</strong>s Tropiques, n° 254, Montpellier<br />
Karsenty A., (1997), Les mutations du marché international <strong>de</strong>s bois et ses conséquences pour<br />
l’Afrique, La Lettre <strong>de</strong> l’Association Technique Internationale <strong>de</strong>s Bois Tropicaux, Montpellier<br />
Karsenty A., (1998), La filière bois d’œuvre dans les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone Franc à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise<br />
asiatique, Caisse Française <strong>de</strong> Développement — Trésor Public, Paris<br />
Karsenty A., (1994), Tendances récentes du marché <strong>de</strong>s bois tropicaux et conséquences pour<br />
l’Afrique. <strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération, Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 96
COORDONNÉES-STATUT<br />
FAO<br />
FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION<br />
Adresse : Viale <strong>de</strong>lle Terme di Caracal<strong>la</strong>,<br />
00100 Rome, Italy<br />
Tel.: +39(6) 57051<br />
Fax: +39(6) 57053152<br />
Site internet : www@fao.org<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Sujets : - Agriculture, alimentation<br />
- Environnement, désertificaation, eau, changements climatiques<br />
- Forêt<br />
SPÉCIALISTES<br />
Nikos Alexandratos (agriculture et alimentation)<br />
Wim Sombroek (changements climatiques)<br />
Mafa Chipeta (forêt)<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Alexandratos N. (éd.), (1995), World agriculture : towards 2010, an FAO study. J. Wiley & Sons,<br />
Chichester, and FAO, Rome.<br />
Bazzaz F., Sombroek W. (éd.), (1997). Global Climate Change and agricultural production. Direct and<br />
Indirect Effects of Changing Hydrological Pedological and P<strong>la</strong>nt Physiological Processes., Rome<br />
The State of Food and agriculture (édition annuelle), Rome<br />
The FAO Asia-Pacific Forestry Outlook Study, Rome<br />
(NB : une étu<strong>de</strong> équivalente est <strong>la</strong>ncée pour l’Afrique)<br />
FAO, ( ),Capacités <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pâte et du Papier. Enquête 1997-2002, Rome<br />
FAO, (1990), Forest Resources assessment: global sytnthesis, Rome<br />
FAO, (1995), Forestry Paper n° 124, Rome<br />
FAO, ( ),Future Energy Requirements for Africa’s Agriculture. Findings and Recommendations of an<br />
FAO study, Rome<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 97
FAPRI<br />
FOOD AND AGRICULTURAL POLICY RESEARCH INSTITUTE<br />
Adresse : FAPRI<br />
Iowa State <strong>Un</strong>iversity<br />
Ames, IA 50011-1070<br />
Tél. : (515) 294-1184<br />
Fax : (515) 294 — 6336<br />
Site : http ://www.ag.instate.edu/card/fapri<br />
Programme <strong>de</strong> recherche <strong>la</strong>ncé en 1984, par le congrès américain, et auquel participent : Texas A&M<br />
<strong>Un</strong>iversity, Arizona State <strong>Un</strong>iversity, <strong>Un</strong>iversity of Arkansas, North Dakota State <strong>Un</strong>iversity.<br />
THÈMES<br />
Zone géographique : États <strong>Un</strong>is et Mon<strong>de</strong>.<br />
Sujets : - Agriculture : interre<strong>la</strong>tions économiques entre l’alimentation et les industries agroalimentaires,<br />
- Politiques alimentaires, agricoles et commerciales.<br />
- Facteurs déterminants à court et long terme <strong>de</strong>s évolutions <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> produits agricoles et alimentaires<br />
SPÉCIALISTES<br />
William H.MEYER, Directeur exécutif <strong>de</strong> FAPRI<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
FAPRI, (1998), World Agriculture Outlook, Ames<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 98
IFPRI<br />
INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE<br />
COORDONNÉES<br />
Adresse : 2033 K Street, N.W.<br />
Washington DC 20006-1002, USA<br />
Tel : 202 862-5600<br />
Fax : 202467-4439<br />
E-mail : IFPRI-info@cgiar.org<br />
Site internet : http ://www.cgiar.org/ifpri<br />
L’IFPRI fait partie du CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research).<br />
THÈMES DE RECHERCHE<br />
Zone géographique : mon<strong>de</strong><br />
Sujets :<br />
SPÉCIALISTES<br />
- Économie agricole et agro-alimentaire<br />
- Sécurité alimentaire (Prospective : horizon 2020)<br />
Spécialistes intervenants dans l’étu<strong>de</strong> Horizon 2020 :<br />
- Per PINSTRUP-ANDERSEN : e-mail : P.Pinstrup-A<strong>de</strong>rsen@cgiar.org<br />
- Mark W. ROSEGRANT : e-mail : M.Rosegrant@cgiar.org<br />
- Rajul PANDYA-LORCH.<br />
- Christopher DELGADO<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Ces travaux ont tous été effectués dans le cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> Horizon 2020 (A 2020 Vision for Food,<br />
Agriculture and the Environment)<br />
IFPRI (1995), « International Conference Hears Call for Human Right to Food, Global Action P<strong>la</strong>n for<br />
preventing Hunger while Protecting the Environment to Year 2020 », Washington<br />
Badiane O., Delgado Chr. (1995), « A 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment in<br />
Subsaharan Africa », Washington<br />
IFPRI (1995), « A 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment : the Vision, Challenge, and<br />
Recommen<strong>de</strong>d Action », Washington<br />
Is<strong>la</strong>m Nurul (1995) « Popu<strong>la</strong>tion and Food in the Early Twenty-First Century : Meeting the Future Food<br />
Demand of an Increasing Popu<strong>la</strong>tion », Washington<br />
Pinstrup-An<strong>de</strong>rsen P., Pandya-Lorch R. and Rosegrant M.W. (1995), « The World Food Situation :<br />
Recent Developments, Emerging Issues, and Long Term Prospects »., Washington<br />
Huang J., Rozelle S., Rosegrant M. (1997), « Water Ressources in the Twenty-First Century : supply,<br />
<strong>de</strong>mand, and Tra<strong>de</strong> », Washington<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 99
COORDONNÉES<br />
SOLAGRAL<br />
Solidarités Agricoles et Alimentaires<br />
Adresse : 45 bis av. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Belle Gabrielle<br />
94736 Nogent sur Marne<br />
Tél. : 01.43.94.73.33<br />
Fax : 01.43.94.73.36<br />
Site internet : http ://www.rio.net/so<strong>la</strong>gral<br />
THÈMES<br />
Développement, Environnement, Les défis d’un mon<strong>de</strong> solidaire<br />
Commerce mondial agricole<br />
Environnement<br />
Sécurité alimentaire<br />
Convention <strong>de</strong> Lomé<br />
SPÉCIALISTES<br />
. Pierre CASTELLA<br />
- Yannick JADOT : Organisation Mondiale du Commerce, Re<strong>la</strong>tions UE-ACP, Convention <strong>de</strong> Lomé.<br />
- Benoît VERGRIETTE : Sécurité alimentaire.<br />
- Laurence TUBIANA : Insertion <strong>de</strong> l’Afrique dans le commerce mondial.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
So<strong>la</strong>gral (1996), « Politiques <strong>de</strong> sécurité alimentaire : <strong>prospective</strong>s à long terme », Bruxelles, (<br />
colloque coorganisé par <strong>la</strong> Commission européenne et So<strong>la</strong>gral, avril 1996, Bruxelles.)<br />
So<strong>la</strong>gral, (1997) « Marchés et institutions pour <strong>la</strong> sécurité alimentaire », document préparatoire du<br />
colloque coorganisé par <strong>la</strong> Commission européenne et So<strong>la</strong>gral, décembre 1997, Bruxelles<br />
Jadot Y., Kassa S., Tubiana L. (1997), « Afrique et commerce, les modalités d’insertion dans le<br />
commerce mondial », So<strong>la</strong>gral, Bruxelles<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 100
USDA/FAS<br />
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE/FOREIGN<br />
AGRICULTURE SERVICE<br />
COORDONNÉES<br />
Adresse : USDA/FAS<br />
14 th and In<strong>de</strong>pendance Ave. SW,<br />
Washington, DC 20250<br />
Tél. : (202) 720-2791 (USDA)<br />
E-mail : info@fas.usda.gov (USDA/FAS)<br />
sites : http ://www.usda.gov (USDA)<br />
http ://www.fas.usda.gov (FAS/USDA)<br />
THÈMES<br />
Zone géographique : États <strong>Un</strong>is et Mon<strong>de</strong>.<br />
Sujets : - Agriculture,<br />
- Evolutions <strong>de</strong>s marchés agricoles, insertion <strong>de</strong> l’agriculture américaine dans le<br />
commerce mondial.<br />
SPÉCIALISTES<br />
- Mary REKAS : spécialiste du Foreign Agricultural Service’s Information Division<br />
- Tél. : (202) 720-7939<br />
- Fax : (202) 720 — 3229<br />
- E-mail : rekas@fas.usda.gov<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
FAS/USDA (1996), « Long Term Agricultural Tra<strong>de</strong> Strategy, Global Market Opportunities into the<br />
21 st Century », Washington<br />
Rekas M. (1998), « Sub-saharan Africa : turning to the Future », Washington<br />
Fact Sheets :<br />
FAS/USDA (1998), « Africa Agricultural Issues and Trends, Washington »<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 101
COORDONNÉES-STATUT<br />
WAGENINGEN AGRICULTURAL UNIVERSITY<br />
Adresse : Wageningen Agricultural <strong>Un</strong>iversity — WAU<br />
Postbus 9101<br />
6700 HB Wageningen<br />
The Nether<strong>la</strong>nds<br />
Tél. : 31.317.4.89.111<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong>, mais surtout pays développés.<br />
Sujets : Développement soutenable, environnement, alimentation.<br />
SPÉCIALISTES<br />
J.M.E Pennings : développement durable, ressources renouve<strong>la</strong>bles.<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Pennings J.M.E., Meulenberg M.T.G (1996), « Futures and options risk : with an application to<br />
agricultural commodities », in B. Wierenger et al (eds), PEAAE Seminar Wageningen Agricultural :<br />
Marketing and consumer behavior in a changing world, Wageningen<br />
Bulte E, Pennings J.M.E., Heijman W.J.M. (1996) « Future markets, price stabilisation and efficient<br />
exploitation of exhaustible ressources », Environmental and ressources economics, n°8, Wageningen<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 102
2.2.2.<br />
DEMOGRAPHIE
COORDONNÉES-STATUT<br />
CEPED<br />
CENTRE FRANÇAIS SUR LA POPULATION<br />
ET LE DEVELOPPEMENT<br />
Adresse : 15, rue <strong>de</strong> l’Ecole <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
75270 Paris<br />
Tel. 01.44.41.82.30<br />
Fax 01.44.41.82.31<br />
Site internet : http:/www.ceped.org<br />
Statut : CIS EHESS/INED/INSEE/IRDI/<strong>Un</strong>iversité Paris V<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Tiers Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : Le Ceped réalise <strong>de</strong>s nombreux travaux théoriques et appliqués en<br />
démographie ou en re<strong>la</strong>tion avec les autres disciplines.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Michel LERY, Directeur<br />
Philippe ANTOINE<br />
Jacques VERON<br />
THÈMES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
Garenne M.,(1995), Popu<strong>la</strong>tions <strong>africaine</strong>s et sida. Chronique du CEPED, Paris<br />
Vallin J., Auvert B.m Brouard N., Chieze F., Dozon J. P., Guil<strong>la</strong>ume A.,(1994) : Popu<strong>la</strong>tion <strong>africaine</strong> et<br />
sida. La Découverte, Ceped, Paris<br />
Veron J. (1998), L’horizon 2025 reconsidéré, Popu<strong>la</strong>tions et Sociétés, n° 317, Paris<br />
Coussy J.,Vallin J. (1997), ed, Crises en Afrique : crises économiques, politiques d’ajustement et<br />
dynamiques démographiques. Les étu<strong>de</strong>s du CEPED, Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 104
INED<br />
INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 133, bld Davout<br />
75020 — Paris<br />
Tel. 01.56.06.20.00<br />
Fax 01.56.06.21.99<br />
Site internet : http:/www.ined.org<br />
Statut : organisme public<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : mon<strong>de</strong><br />
Objectif : L’Ined réalise <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherches sur les perspectives démographiques, sur les<br />
déterminants <strong>de</strong> fécondité et <strong>de</strong> mortalité dans le mon<strong>de</strong>. Ce centre réalise <strong>de</strong>s projections<br />
démographiques.<br />
SPÉCIALISTES<br />
François HERAN, Directeur<br />
Jacques VALIN, Démographe<br />
Georges TAPINOS, Économiste<br />
THÈMES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
INED, (1996), Popu<strong>la</strong>tion mondiale : l’horizon 2025 reconsidéré, oct., n° 317, Popu<strong>la</strong>topn et Sociétés,<br />
Paris<br />
INED, (1997), les pays du mone, aoùt, n° 326, Popu<strong>la</strong>tion et Sociétés, Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 105
COORDONNÉES-STATUT<br />
PRB<br />
POPULATION REFERENCE BUREAU<br />
Adresse : 1875 Connecticut Avenue, N.W.<br />
Suite 520<br />
Washington, DC 20009 — 5728, USA<br />
Tél. : (202) 483 — 1100<br />
Fax : (202) 328 — 3937<br />
E-mail : popref@prb.org<br />
THÈMES DE RECHERCHE<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong><br />
Sujet : Démographie et démo-économie<br />
- popu<strong>la</strong>tion et comportements démographiques<br />
- santé et p<strong>la</strong>nning familial<br />
- immigration<br />
- structure familiale<br />
SPÉCIALISTES<br />
Pour contacter les experts et obtenir <strong>de</strong> l’information sur les travaux démographiques, contacter :<br />
Ellen Carnevale<br />
Director of publications<br />
Popu<strong>la</strong>tion Référence Bureau<br />
Suite 520<br />
1875 Connecticut Ave, N.W.<br />
Washington D.C. 20009<br />
Tel : 202/939-5407 Fax : 202/328-3937 E-mail : ecarnevale@prb.org<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
- Périodiques : - lettre mensuelle : Popu<strong>la</strong>tion Today<br />
- Trimestriel : Popu<strong>la</strong>tion Bulletin<br />
- Annuel : World Popu<strong>la</strong>tion Datasheet (statistiques et projections démographiques)<br />
- Publications spécialisées sur les questions démographiques aux États <strong>Un</strong>is et dans le reste du<br />
Mon<strong>de</strong>.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 106
COORDONNÉES-STATUT<br />
UNPF<br />
UNITED NATIONS POPULATION FUND<br />
Adresse : <strong>Un</strong>ited Nations Popu<strong>la</strong>tion Fund<br />
220 East 42 nd Street<br />
New York, NY 10017<br />
USA<br />
Bureau <strong>de</strong> liaison à Genève (FNUAP)<br />
Principal External Re<strong>la</strong>tions Officer<br />
UNFPA Liaison Office/<strong>Un</strong>ited Nations Development Programm<br />
Pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong>s Nations<br />
CH – 1211 Geneva 10, Suisse<br />
Site : http ://www.undp/org<br />
THÈMES<br />
Zone géographique : Pays en Développement<br />
Thèmes : - Développement social et économique : moez.doraid@ods.org<br />
- Développement humain, santé, éducation<br />
- Coopération Internationale pour le développement<br />
- Dialogue inter-générationnel.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Isabelle Gunberg, Office of Development Studies, UNDP :<br />
- Perspectives on financial liberalization.<br />
- Travail, emploi, revenu.<br />
Contact : isabelle.grunberg — fi<strong>la</strong>tov@undp.org<br />
John Langmore, directeur <strong>la</strong> division <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies pour <strong>la</strong> politique sociale et le<br />
développement :<br />
- Travail, emploi, revenu.<br />
Nadis Sadik, directeur exécutif, PNUD et Rosemary Lane, Division <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies pour <strong>la</strong><br />
politique sociale et le développement :<br />
- Démographie et Santé.<br />
CONTACTS en Afrique<br />
- UNFPA Country Support Team (CST) for East and Central Africa<br />
P.O. Box 8714<br />
Addis Abeba, Ethiopia<br />
Directeur : Mme Miriam K. WERE<br />
Politique démographique : Mr le Professeur N. Addo et M. J.R. Herzog<br />
Statistiques démographiques : M. E.A. Colecraft<br />
Travail et emploi : M. D. Popoo<strong>la</strong><br />
Responsables Nationaux : M. Fernan<strong>de</strong>z CASTILLA (Éthiopie) et M. Adrew ARKUTU (Nigeria)<br />
Tél. : 51. 12. 88. Et 51. 31. 34 (Addis Ababa)<br />
Fax : 51.71.33<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 107
- UNFPA CST pour l’Afrique <strong>de</strong> l’ouest et centrale<br />
Boîte Postale 21090<br />
Dakar-Ponty<br />
DAKAR<br />
SÉNÉGAL<br />
- UNFPA CST pour l’Afrique Australe<br />
P.O. Box 4775<br />
HARARE Zimbabwe<br />
e-mail :cst.harare.fpa@undp.org<br />
Tél. : (263) 4-755161<br />
Fax : (263) 4-738792<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
UNPF, (1998), The New Generations, The State of World Popu<strong>la</strong>tion, New-York<br />
UNPF, (1997), The right to choose : reproductive rights and reproductive health, The State of World<br />
Popu<strong>la</strong>tion, New-York<br />
UNPF, (1996), Changing p<strong>la</strong>ces — popu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong>velopment and the urban future The State of World<br />
Popu<strong>la</strong>tion, New-York<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 108
2.2.3.<br />
EDUCATION
IIPE<br />
INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L’EDUCATION<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 7-9, rue Eugène De<strong>la</strong>croix<br />
75116 Paris<br />
France.<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Pays d’ASS.<br />
Sujets : Éducation <strong>de</strong> l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur.<br />
Effectifs <strong>de</strong>s élèves, taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>rité, taux <strong>de</strong> réussite aux examens, effectifs <strong>de</strong>s<br />
enseignants, coûts, déperdition.<br />
Analphabétisme et alphabétisme.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Contacts :<br />
- Serge Peano : spécialiste du Programme, 1 45 03 77 48 (tél.), 1 40 72 83 66 (fax), E-mail :<br />
s.peano@iiep.unesco.org<br />
- Robert Sack : 1 45 03 38 64 (tél.), 1 40 72 83 66 (fax)<br />
- Françoise Caillot : 1 45 03 77 38 (tél.), 1 40 72 83 66 (fax)<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Perspectives <strong>de</strong> l’éducation en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest à l’horizon 2010, lettre d’information, vol. 6, n° 4,<br />
oct-décembre.IIPE, DAE.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 110
IREDU<br />
INSTITUT DE RECHERCHE SUR L’ECONOMIE DE L’EDUCATION<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 9, avenue A<strong>la</strong>in Savary<br />
BP 400<br />
21011 Dijon Ce<strong>de</strong>x<br />
Tel : 03 80 39 54 50<br />
Fax : 03 80 39 54 79<br />
Adresse : <strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Bourgogne<br />
BP 138<br />
21004 Dijon Ce<strong>de</strong>x<br />
Tel : 03 80 39 54 59<br />
Fax : 03 80 39 54 79<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Pays développés (notamment <strong>la</strong> France) et PVD (notamment en ASS).<br />
Sujets : Education <strong>de</strong> l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur.<br />
Formation initiale, formation continue, formation professionnelle.<br />
Analyse coût-efficacité <strong>de</strong>s systèmes éducatifs, <strong>de</strong>s dépenses publiques d’éducation.<br />
Analyse <strong>de</strong> l’adéquation formation-emploi, politiques d’insertion professionnelle.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Contacts :<br />
- François Orivel : directeur<br />
- A<strong>la</strong>in Minguat, J-P. Jarousse.<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Mingrat A. (1998), Vers une diversification <strong>de</strong>s catégories d’enseignants et/ou <strong>de</strong>s structures<br />
d’enseignement dans les pays du Sahel ?, janvier, Notes <strong>de</strong> l’IREDU, Dijon<br />
Orivel E. & Orivel F. (1998), Les comparaisons internationales <strong>de</strong> l’efficience <strong>de</strong>s systèmes éducatifs,<br />
fév., Notes <strong>de</strong> l’IREDU, Dijon<br />
Klimek C. (1996), L’éducation <strong>de</strong> base non formelle hors <strong>de</strong> l’école officielle, contraintes et choix,<br />
Lettre <strong>de</strong> l’Iredu, Dijon<br />
- Les notes <strong>de</strong> l’IREDU, 10 par an (abonnement)<br />
- La lettre <strong>de</strong> l’IREDU, parution mai et novembre<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 111
PNUD<br />
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT<br />
EDUCATION<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse aux Etats-<strong>Un</strong>is :<br />
336 East 45 th Street, Room 401<br />
New York, NY 10017 — USA<br />
Tél. : 1 212 986 0110<br />
Fax : 1 212 986 1237<br />
E-mail : <br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Pays d’ASS.<br />
Sujets : Education <strong>de</strong> l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur.<br />
Effectifs <strong>de</strong>s élèves, taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>rité, taux <strong>de</strong> réussite aux examens, effectifs <strong>de</strong>s<br />
enseignants, coûts, déperdition.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Contact aux Etats-<strong>Un</strong>is :<br />
Jean Le Nay<br />
Département <strong>de</strong>s <strong>affaires</strong> économiques et sociales : 01 212 963 55 52 (tél.)<br />
Contact en France : Jérôme Bindé, unité d’analyse <strong>prospective</strong> : 1 45 68 12 08 (tél.)<br />
Bureau <strong>de</strong> programmation et d’évaluation : 1 45 68 13 19 (tél.) (Mme Rivière)<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Buisine L. & Stankiewicz F.,(1988), Projection <strong>de</strong> flux sco<strong>la</strong>ires et utilisation <strong>de</strong> logiciels informatiques,<br />
le modèle MFS, projet DTCD/PNUD SEN/87/010, DRH, <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération,<br />
Sénégal<br />
Buisine L. & Stankiewicz F., (1989), Logiciel <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion et modèle <strong>de</strong> flux sco<strong>la</strong>ires, projet<br />
DTCD/PNUD NER/85/002, DAEP, <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n, Niger<br />
Buisine L. & Stankiewicz F.,(1990) Le modèle GEAN : masse sa<strong>la</strong>riale et projections <strong>de</strong> l’emploi <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fonction publique, projet DTCD/PNUD NER/88/014, DAEP, <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n, Niger<br />
Buisine L. & Stankiewicz F.,(1990), Le modèle MAS : modèle <strong>de</strong> projection <strong>de</strong> <strong>la</strong> masse sa<strong>la</strong>riale et<br />
<strong>de</strong>s effectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique, projet DTCD/PNUD SEN/87/010, DRH, <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Coopération, Sénégal<br />
Vérez J-C., (1989), L’enseignement primaire au Niger à l’horizon 2010, étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> à partir d’un<br />
modèle <strong>de</strong> flux sco<strong>la</strong>ires, projet DTCD/PNUD NER/85/002, DAEP, <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n, Niger<br />
Vérez J-C.,(1989), L’enseignement primaire au Niger et au Sénégal à l’horizon 2000, étu<strong>de</strong><br />
comparative, projet DTCD/PNUD NER/88/014, DAEP, <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n, Niger<br />
Vérez J-C, (1989), L’enseignement secondaire et l’évolution <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> diplômés au Niger à l’horizon<br />
2010, étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong>, projet DTCD/PNUD NER/88/014, DAEP, <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n, Niger<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 112
Cart B.,(1989), MFS : un modèle <strong>de</strong> flux sco<strong>la</strong>ires, résultats <strong>de</strong>s simu<strong>la</strong>tions, projet DTCD/PNUD<br />
SEN/87/010, DRH, <strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération, Sénégal<br />
Cart B & Vérez J-Ccrises, (1994), Crises <strong>de</strong> l’éducation en Afrique : les cas du Niger et du sénégal,<br />
Afrique Contemporaine, (numéro spécial sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Ph ; Hugon) n° 172, octobre, Paris<br />
Cart B. & Vérez J-C., (1994), La gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique au Niger et au Sénégal à partir <strong>de</strong>s<br />
modèles GEAN et MAS in Outils d’analyse et d’ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> décision dans les PVD, ( sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />
J-C. Vérez, URA CNRS TIERS-MONDES — AFRIQUE 363), Paris.<br />
+ Bourdon J. & Orivel F.,(1992), Stratégie éducation formation emploi, Rép. du Tchad, Pnud, <strong>Un</strong>esco,<br />
Chd/91/001, février, Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 113
UNESCO<br />
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION,<br />
LA SCIENCE ET LA CULTURE<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : 7, p<strong>la</strong>ce Fontenoy<br />
75 352 Paris Ce<strong>de</strong>x 07<br />
France<br />
Tel : 1 45 68 45 64/65/66<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Sujet : Éducation <strong>de</strong> l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur.<br />
Effectifs <strong>de</strong>s élèves, taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>rité, taux <strong>de</strong> réussite aux examens,<br />
effectifs <strong>de</strong>s enseignants, coûts, déperdition.<br />
Analphabétisme et alphabétisme.<br />
Zone géographique :Tous pays.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Contacts en France :<br />
- Mme. Jal<strong>la</strong><strong>de</strong> : 1 45 68 21 02 (tél.)<br />
- Marc Cohen : 1 45 68 21 22 (tél.)<br />
- Isabelle Deblé, commission française sur l’éducation<br />
- Françoise Tandart, statistiques sur l’éducation : 1 45 68 23 93 (tél.)<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Cuenin S. & Rakotoma<strong>la</strong><strong>la</strong> R.,(1996), un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion pour le développement du système<br />
éducatif malien 1996-2008, doc. <strong>Un</strong>esco12/96, Paris<br />
UNESCO, (1992), Éducation et développement : perspectives <strong>africaine</strong>s, revue Perspectives, doc.<br />
<strong>Un</strong>esco vol 27., n° 2, Paris<br />
Chang G-C, (1996), L’éducation dans les PMA : améliorer dans l’adversité, Étu<strong>de</strong>s et documents<br />
d’éducation 64, éd <strong>Un</strong>esco., Paris<br />
Saravanamutto N. & Shaw C.,(1995), Comment utiliser <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte en faveur <strong>de</strong> l’éducation ?,<br />
DAE/<strong>Un</strong>esco, Paris<br />
UNESCO, (1982), Analyse et projection <strong>de</strong>s effectifs sco<strong>la</strong>ires dans les PVD : manuel <strong>de</strong><br />
méthodologie, rapports et étu<strong>de</strong>s statistiques, n° 24, Paris<br />
UNESCO, (1994), Commission internationale sur l’éducation pour le XXI ème siècle, janvier, Paris.<br />
Développement <strong>de</strong> l’éducation en Afrique, (1995), ( 7e conférence <strong>de</strong>s Ministres <strong>de</strong> l’éducation <strong>de</strong>s<br />
États membres africains Durban, Afrique du Sud, 20-24 avril.), Durban<br />
UNESCO, (1995), Compendium <strong>de</strong>s statistiques re<strong>la</strong>tives à l’analphabétisme, édition <strong>de</strong> 1995,<br />
rapports et étu<strong>de</strong>s statistiques, n° 35, par âge et par sexe, 1960-2025 (évaluées en 1993), Division<br />
<strong>de</strong>s statistiques, décembre 1993, Paris<br />
UNESCO, (1993), Tendances et projections <strong>de</strong>s effectifs sco<strong>la</strong>ires par <strong>de</strong>gré d’enseignement, par âge<br />
et par sexe, 1960-2025, (évaluées en 1993), Division <strong>de</strong>s statistiques, déc., Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 114
2.2.4.<br />
EMPLOI
COORDONNÉES-STATUT<br />
BIT<br />
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL<br />
Adresse : 4, route <strong>de</strong>s Morillons<br />
CH-1211 Geneve 22<br />
Suisse<br />
Bureau <strong>de</strong> correspondance Paris<br />
1 rue Miollis 75732 Paris ce<strong>de</strong>x 15<br />
Bureaux en Afrique (Dakar, Abidjan, Cameroun, Kenya, Afrique du Sud.. )<br />
Tél. : (33) (0) 1 45 68 32 50 (Paris)<br />
Fax : (33) (0) 1 45 67 20 04 (Paris)<br />
E-mail : paris@ilo.org<br />
Site internet : www.ilo .org<br />
Statut : Système <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Thèmes par Département : Emploi-formation (EMP-FORM) ; Politiques <strong>de</strong> développement<br />
(POLDEV) ; Conditions <strong>de</strong> travail et environnement (TRAVAIL) ; Re<strong>la</strong>tions industrielles et<br />
travail (RELPROF) ; Sécurité sociale (SECSOC) ; Normes internationales du travail (NORMES) ;<br />
Re<strong>la</strong>tions et conférences (RELCONF) ; Activités Sectorielles (SECTOR) ; Statistiques du travail<br />
(STAT) ; Programmes Afrique (AFRICA) ; questions <strong>de</strong> genre (FEMMES) ; promotion du partenariat<br />
actif et coopération technique (PROPARTEC)…<br />
Plus in site internet : program@hq1.ilo.ch<br />
SPÉCIALISTES<br />
Bureau statistique (dont statistiques <strong>prospective</strong>s), Genève<br />
Marc Copin copin@ilo.org/M. Cornu cornu@ilo.org/B. Dujeu dujeu@ilo.org et stat@ilo.org<br />
Revue Internationale du Travail revue@ilo.org et pubvente@ilo.org<br />
IIES Figueiredo José B. figueiredo@ilo.org<br />
Département Emploi-Formation / POLEMP Rolph van <strong>de</strong>r Hoeven hoeven@ilo.org<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
BIT, (1998), L’avenir <strong>de</strong> l’emploi urbain (en préparation), ILO, BIT, Genève.<br />
BIT, (1996), Labour force <strong>prospective</strong>s 1950-2010. Ouvrage méthodologique, ILO, BIT, Genève.<br />
Base statistique 1950-2010 (popu<strong>la</strong>tion active mesurée par âge, par sexe et par pays/région,<br />
uniquement). <strong>Un</strong> travail <strong>de</strong> synthèse statistiques a été fait pour l’Afrique à partir <strong>de</strong>s ces<br />
données <strong>prospective</strong>s.<br />
Rapport sur l’emploi dans le mon<strong>de</strong> 1998-1999 BIT, Genève.<br />
Revue Internationale du Travail Numéro spécial : Regards croisés sur le travail et son <strong>de</strong>venir vol.<br />
135, n° 6 (cf. Le travail en perspectives d’A. Soupiot, etc..). Thèmes traités autour du <strong>de</strong>venir du<br />
travail dans le mon<strong>de</strong> (pas spécifiquement en Afrique sub-saharienne).<br />
Plus : Bulletin <strong>de</strong>s statistiques du Travail, Annuaire <strong>de</strong>s statistiques du travail et ouvrages <strong>de</strong> l’IIES, du<br />
BIT.<br />
Étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> Afrique 2020<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 116
2.2.5.<br />
ENERGIE
CERNA<br />
CENTRE D’ETUDES SUR LES RESSOURCES NATURELLES<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Centre d’Économie Industrielle<br />
Adresse : 60, boulevard Saint-Michel<br />
75272 Paris Ce<strong>de</strong>x 06<br />
Tél. : 01 40 51 90 71<br />
Fax : 01 44 07 10 46<br />
E-mail: cerna@cc.ensmp.fr<br />
Site internet : http://www.ensmp.fr/Fr/CERNA/CERNA/<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique: France, Pays <strong>de</strong> l’ex-URSS, Chine, Afrique<br />
Sujets : Industrialisation en Afrique<br />
Transformation industriels du post-socialisme en ex-URSS et en Chine<br />
Analyse <strong>de</strong> filière – analyse <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong>s firmes (groupes miniers, industries<br />
forestières…)<br />
Économie <strong>de</strong> l’environnement<br />
SPÉCIALISTES<br />
Pierre-Noël Giraud (Directeur) E-mail : giraud @cerna.ensmp.fr<br />
Compétences : Energie – Politique environnementale<br />
Olivier Bomsel (Directeur adjoint) E-mail : bomsel@cerna.ensmp.fr<br />
Compétences : mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s firmes (stratégies concurrentielles) et sur les politiques<br />
industrielles. Pays <strong>de</strong> l’Est -Matières premières<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Bomsel O.,( 1994.), The future of mining countries : new strategies or the restructuring of the State ?<br />
<strong>Un</strong>ited Nations – UNCTAD/COM/29., New-York<br />
Bomsel O. (1995.), Produire <strong>de</strong>s commodités en l’an 2000 : comment résister à l’instabilité <strong>de</strong>s prix ?<br />
Éditions Eska. Annales <strong>de</strong>s Mines – Réalités industrielles – Oct.-Nov., Paris.<br />
Bomsel O., Carret J.-C., Lazarus S., (1996). La construction d’usine <strong>de</strong> transformation du bois à<br />
Libreville : un début d’industrialisation au Gabon ? <strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération, Paris<br />
Carret J.-C., Bomsel O.,(1996), Industrialisation au Gabon : dynamique et perspectives. Rapport <strong>de</strong><br />
recherche pour <strong>la</strong> Banque Mondiale, PFE, Washington<br />
Carret J.-C., Lazarux S., (1996), Dynamique d’industrialisation dans <strong>la</strong> filière bois en Côte d’Ivoire.<br />
Rapport <strong>de</strong> recherche pour le <strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération, Paris<br />
CERNA, (1994), Transformation <strong>de</strong>s industries minières et métallurgiques au cours <strong>de</strong>s années 1981-<br />
1991. Principales conclusions et Notes <strong>de</strong> synthèses, Paris<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 118
COORDONNÉES-STATUT<br />
EIA<br />
ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION<br />
Adresse: National Energy Information Center<br />
Tél.: 202 586 8800<br />
Fax : 202 586 0727<br />
Statut : Agence <strong>de</strong> statistique et d’analyse indépendante, partie du "US Department of Energy".<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique: Mon<strong>de</strong> et USA<br />
Sujets : Energie, <strong>prospective</strong> énergétique.<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Publications annuelles: « Annual Energy Outlook », « International Energy Outlook », Energy<br />
Information Agency, US Department of Energy, documents format pdf.<br />
Résumé: Rapport annuel basé sur le modèle WEPS (World Energy Projection System), fournissant<br />
<strong>de</strong>s projections jusqu’en 2020, sur les consommations énergétiques et les productions. Les<br />
hypothèses <strong>de</strong> base du modèle (taux <strong>de</strong> croissance économique) proviennent du WEFA group,<br />
notamment du « World Economic Outlook, 20 year extension ». Résumé <strong>de</strong> "Annual Energy Outlook<br />
1999", en format pdf disponible. Faible part consacrée à l’ASS dans les analyses.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 119
IEPE<br />
INSTITUT D’ECONOMIE ET DE POLITIQUE DE L’ENERGIE<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse: IEPE<br />
BP47<br />
38040 GRENOBLE CEDEX 9<br />
France<br />
Tél.: 33 (0)4 76 51 42 40<br />
Fax : 33 (0)4 76 51 45 27<br />
E-mail: iepe@upmf.grenoble.fr<br />
Statut : Centre <strong>de</strong> recherche CNRS et <strong>Un</strong>iversité Pierre Mendès France.<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique: Mon<strong>de</strong><br />
Sujets :<br />
• Libéralisation <strong>de</strong>s industries et globalisation <strong>de</strong>s marchés<br />
• Energie et Développement durable.<br />
• Analyse du comportement <strong>de</strong>s pays producteurs et globalisation économique comme sous-thème<br />
(avec un intérêt spécial vers les pays du Moyen Orient).<br />
SPÉCIALISTES<br />
Contact: Patrick Criqui.<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PERSPECTIVE<br />
Chatelus M., Criqui P., Kourivatis N. (1998), « Marchés énergétiques: <strong>de</strong> l’abondance actuelle à <strong>la</strong><br />
prise en compte <strong>de</strong>s contraintes <strong>de</strong> long terme », Colloque « Dynamique <strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s<br />
matières premières: analyse et prévision », Grenoble, 5 et 6 novembre.<br />
Modèle mondial <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> (POLES), définissant l’évolution <strong>de</strong>s consommations et <strong>de</strong>s<br />
productions <strong>de</strong>s différentes sources d’énergie, à l’horizon 2030. Décomposition du mon<strong>de</strong> en 26<br />
régions, dont ASS.<br />
Méthodologie: modélisation <strong>de</strong>s marchés, offre, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dont l’équilibre produit <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> l’énergie<br />
année par année. Incorporation explicite <strong>de</strong>s technologies. Prix du pétrole fonction <strong>de</strong> l’évolution du<br />
ratio réserves/production, et du taux d’utilisation <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s pays du Golfe.<br />
Construction <strong>de</strong> scénarios alternatifs.<br />
Deux scénarios: ressources abondantes, et référence (par rapport aux hypothèses <strong>de</strong> l’US Geological<br />
Survey cf. fiche correspondante). Retour sur le <strong>de</strong>vant <strong>de</strong> <strong>la</strong> scène <strong>de</strong>s pays du Golfe, dans <strong>la</strong><br />
projection <strong>de</strong> référence, sinon émergence <strong>de</strong>s PVD hors Golfe comme producteurs significatifs.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 120
COORDONNÉES-STATUT<br />
IIMI/IWMI<br />
International Water Management Institute<br />
Adresse: IIMI/IWMI<br />
International Water Management Institute<br />
P.O. Box 2075,<br />
Colombo, SRI LANKA<br />
Tél. : (94-1) 867404<br />
Fax : (94-1) 866854<br />
E-mail : iimi@cgiar.org<br />
Sites : http ://www.cgiar.org/iimi<br />
http ://www.cgiar.org/iwmi<br />
L’International Water Management Institute fait partie du CGIAR (Consultative Group on International<br />
Agricultural Research).<br />
THÈMES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong>. Des programmes <strong>de</strong> recherche sont en cours en particulier au Pakistan,<br />
Sri Lanka, et en projet au Mexique, et en Turquie.<br />
Sujets :<br />
- Environnement,<br />
- Ressources en eau, pollution <strong>de</strong>s eaux.<br />
- Gestion <strong>de</strong>s systèmes iirigués, usages et productivité <strong>de</strong> l’eau.<br />
SPÉCIALISTES<br />
- Doug<strong>la</strong>s J. MERREY, USA : Politique, Institutions, Gestion<br />
e-mail : dmerrey@cgnet.com<br />
- Wilfried Hun<strong>de</strong>rtmark (basé à WARDA), Allemagne : Irrigation, Côte d’Ivoire<br />
e-mail : w.hun<strong>de</strong>rtmark@cgnet.com<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Seckler D. and alii (1998) « Worldwater <strong>de</strong>mand and supply, 1990 to 2025 : scenarios and issues »,<br />
Colombo.<br />
Daerre C. and alii, (à paraître) « Integrated Basin-Scale Water Ressources Management Mo<strong>de</strong>lling :<br />
Review and Future Directions ».<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 121
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse: USGS Minerals Information<br />
983 National Center<br />
Reston VA 20192<br />
USA<br />
Site internet : http://www.usgs.gov<br />
US Geological Survey<br />
Statut : Institut <strong>de</strong> recherche dépendant <strong>de</strong> l’administration publique<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique: Mon<strong>de</strong> et US<br />
Sujets :<br />
USGS World Energy Program<br />
Objectif: rassembler les informations nécessaires pour définir les ressources<br />
énergétiques mondiales.<br />
Définition <strong>de</strong> 8 régions dans le mon<strong>de</strong>, sur une base géologique et politique. L’ASS est <strong>la</strong> 7° région,<br />
dont <strong>de</strong>ux « provinces » sont stratégiques pour l’industrie pétrolière: le <strong>de</strong>lta du Niger et <strong>la</strong> Côte sud<br />
ouest. Le <strong>de</strong>lta du Niger est c<strong>la</strong>ssée 10° par ordre d’importance stratégique, <strong>la</strong> Côte sud ouest est<br />
c<strong>la</strong>ssée 23°, sur 76 provinces enregistrées au niveau mondial. Deux autres « provinces » d’Afrique<br />
sont c<strong>la</strong>ssées sous <strong>la</strong> dénomination « boutiques », exprimant leur intérêt stratégique potentiel (cf.<br />
documents internet). Fournit <strong>de</strong>s estimations <strong>de</strong>s ressources énergétiques <strong>de</strong>s différentes régions du<br />
globe.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Contact/région Afrique: Michele L. Tuttle, E-mail:<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Coakley G.J., Michalski B., Mobbs Ph. M. (1996), « The mineral Industries of Africa and the Middle<br />
East », USGS, document format pdf.<br />
Résumé: Définition <strong>de</strong>s principales ressources minières, et parts dans <strong>la</strong> production mondiale <strong>de</strong>s<br />
différents pays africains. Six minerais dépassent 20 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> production mondiale en 1996: Manganese<br />
(26 %), uranium (20 %), or (28 % ; dont 75 % d’Afrique du sud), diamants (48 %), Cobalt (40 %),<br />
chromite (49 % ; dont 90 % d’Afrique du sud) (cf. rapport).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 122
WEC<br />
World Economic Council<br />
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse: IIASA<br />
A 2362 Laxenburg<br />
Austria<br />
Tél.: 43 2236 807 0<br />
Fax : 43 2236 71313<br />
E-mail: info@iiasa.ac.at<br />
Site internet : http://www.iiasa.ac.at<br />
Statut : Institut <strong>de</strong> recherche appliquée<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique: Mon<strong>de</strong><br />
Sujets :<br />
• Energie et technologie<br />
• Popu<strong>la</strong>tion et société<br />
• Ressources naturelles et environnement<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />
Nakicenovic N. et Jefferson J.-M. (1995), « Global Energy Perspectives to 2050 and Beyond »,<br />
Working Paper n° 95127, décembre, Laxenburg<br />
Résumé: <strong>prospective</strong> sur <strong>la</strong> situation énergétique mondiale à l’horizon 2050 et après.<br />
Méthodologie: Construction <strong>de</strong> six scénarios alternatifs.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 123
COORDONNÉES-STATUT<br />
WORLDWATCH INSTITUTE<br />
Adresse : Worldwatch Institute<br />
1776 Massachussets Ave, NW<br />
Washington, DC 20036-1904, USA<br />
Tél. : (202) 452-1999<br />
Fax : (202) 296-7365<br />
E-mail : worldwatch@worldwatch.org<br />
Site : http ://www.worldwatch.org<br />
Statut : Organisme public <strong>de</strong> recherche à but non lucratif.<br />
THÈMES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong>.<br />
Sujets : - Menaces globales sur l’environnement, écologie, énergie.<br />
- Re<strong>la</strong>tions entre l’économie et l’environnement, développement soutenable, environnement<br />
naturel et générations futures.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Lester R. Brown (Prési<strong>de</strong>nt du Worldwatch Institute) : environnement et popu<strong>la</strong>tion (charge<br />
démographique)<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Brown L.R.. et Ayres E. (ed) (1998) « Worldwatch Rea<strong>de</strong>r on Global Environmental Issues »,<br />
Worldwatch Institute, Washington<br />
Worldwatch Institute (1998 et antérieures), « State of the World, Washington<br />
Hi<strong>la</strong>ry F (1998), « Investing in the Future : Harnessing Private Capital Flows for Environmentally<br />
Sustainable Development », Worldwatch Paper Series 139, Washington<br />
F<strong>la</strong>vin C., Lenssen N. (1994), « Powering the Future : blueprint for a sustainable electricity industry »,<br />
Worldwatch Paper Series 119, Washington<br />
C.P. Shea (1988), « Renewable Energy : today’s contribution, tomorrow’s promise », Worldwatch<br />
Paper Series 81, Washington<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 124
2.2.6.<br />
SANTE
COORDONNÉES-STATUT<br />
ANRS<br />
AGENCE NATIONALE SUR LA RECHERCHE<br />
SUR LE SIDA<br />
Adresse: Agence Nationale sur <strong>la</strong> Recherche sur le Sida<br />
104, rue <strong>de</strong> Tolbiac<br />
75013 Paris<br />
Tél.: 01 53 94 60 00<br />
Fax: 01 53 94 60 01<br />
Site internet : http://igs-server.cnrs-mrs.fr/anrs<br />
Statut : Organisme public<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : France, Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : L’Anrs (Agence Nationale sur <strong>la</strong> Recherche sur le Sida) est un établissement public <strong>de</strong><br />
recherche. Cette agence réalise <strong>de</strong>s nombreux travaux théoriques et appliqués sur le Sida en France<br />
et dans le mon<strong>de</strong>.<br />
CONTACTS<br />
Pr Michel KAZATCHKINE (Directeur)<br />
Recherches cliniques et épidémiologiques<br />
France AGID Chargée <strong>de</strong> mission responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule<br />
Tél.: 01 53 94 60 34, e-mail: fagid@anrs.imaginet.fr<br />
Sciences <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> <strong>la</strong> société<br />
Yves SOUTEYRAND Chargée <strong>de</strong> mission responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule<br />
Tél.: 01 53 94 60 10, e-mail : yshs@anrs.imaginet.fr<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
J. P. COULAND (1997) Initiative Internationale. Rapport. J. P. Cou<strong>la</strong>nd, ANRS, décembre, Paris.<br />
ANRS & ORSTOM (1997) Le sida en Afrique. Collection Sciences Sociales et Sida, avril, Ed.<br />
ANRS/ORSTOM, Paris.<br />
ANRS/ORSTOM (1998) 10 ans <strong>de</strong> recherches sur le sida en France, 1988-1998, Ed.<br />
ANRS/ORSTOM, Paris.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 126
COORDONNÉES-STATUT<br />
BAD<br />
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT<br />
Adresse: The African Development Bank<br />
Rue Joseph Anoma<br />
01 B.P. 1387, Abidjan<br />
Côte d’Ivoire<br />
Tél.: 225-20 44 44<br />
Fax: 225 33 2172<br />
Site internet : http://www.afdb.org/<br />
Statut : Organisation inter-régionale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Afrique<br />
Objectif : La BAD est organisme intergouvernemental. Cet organisme mène <strong>de</strong>s réflexions sur<br />
les perspectives économiques <strong>de</strong> l’Afrique dans le contexte <strong>de</strong> <strong>la</strong> mondialisation et présente <strong>de</strong>s<br />
actions pour améliorer <strong>la</strong> situation économique et sociale sur le continent africain. La Banque <strong>africaine</strong><br />
<strong>de</strong> développement joue un rôle important dans <strong>la</strong> croissance économique, <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté<br />
en Afrique et <strong>la</strong> promotion du commerce et <strong>de</strong> l’investissement. Les prêts non concessionnels sont<br />
financés sur les ressources ordinaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque <strong>africaine</strong> <strong>de</strong> développement (BAD). Les<br />
financements concessionnels sont octroyés sur les ressources du Fonds africain <strong>de</strong> développement<br />
(FAD) et du Fonds spécial du Nigéria (FSN), aux pays à faible revenu qui ne peuvent assurer le<br />
service d’une <strong>de</strong>tte aux conditions du marché.<br />
La Banque mène <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur les axes <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé primaires, <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection maternelle et<br />
infantile, <strong>de</strong> l’éducation <strong>de</strong> base, <strong>de</strong> l’investissement, <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance, <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation professionnelle<br />
orientée vers le travail indépendant, etc.<br />
CONTACTS<br />
O. Kabbaj (Prési<strong>de</strong>nt) Tel. : 225 204444, Fax : 225 217753<br />
J.M. Gharbi (Directeur) Tel. : 225 204042, Fax : 225 217753<br />
G.M. Woldu (Directeur) Département <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification Stratégique & Recherche (FSPR)<br />
Tel. : 225 204064, Fax : 225 204948<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
Germano MWABU (1998) Health Development in Africa, ADB Publication n. 38, Abidjan.<br />
BAD (1998) The African Development Report, Human Capital Development, Abidjan.<br />
T. W. OSHIKOYA (1997) Investing for Long-Term Growth in Africa, ADB Publication n. 27, Abidjan.<br />
O.O. OJO and T. W. OSHIKOYA (1994) Policy Determinants of Long-Term Growth : Some African<br />
Results, ADB Publication n.19, Abidjan.<br />
J. PICKETT (1990) The Low-Income Economies of Sub-Saharan Africa : Problems and Prospects,<br />
ADB Publication n. 12, Abidjan.<br />
Serge SNRECH (1994) Pour préparer l’avenir <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : une vision à l’horizon 2020,<br />
OCDE-BAD-CILSS, Paris.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 127
COORDONNÉES-STATUT<br />
BANQUE MONDIALE<br />
HUMAN DEVELOPMENT DEPARTMENT<br />
Adresse: Human Development Department<br />
The World Bank<br />
The World Bank<br />
1818 H Street N.W.<br />
Washington, DC 20433, USA<br />
Tel (202) 473-2256<br />
Fax (202) 522-3234<br />
Site internet : http:/www.worldbank.org<br />
Statut : Organisation internationale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : La Banque mondiale est organisme intergouvernemental. Par le biais <strong>de</strong> son<br />
Département <strong>de</strong> <strong>la</strong> Popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s Ressources Humaines, elle organise <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> santé.<br />
CONTACTS<br />
S. DEVARAJAN (Research Manager for Public Economics in the Development Research<br />
Group)<br />
Contact Information: E-mail: SDevarajan@WorldBank.org<br />
G. CAPRIO (Research Manager for Finance in the Development Research Group)<br />
Contact Information: E-mail: GCaprio@WorldBank.org<br />
E. JIMENEZ (Research Manager responsible for Poverty and Human Development in the<br />
Development Research Group)<br />
Contact Information: EMail: EJimenez2@WorldBank.org<br />
H. ALDERMAN (Principal Economist in the Poverty and Human Resources unit in the<br />
Development<br />
Research Group)<br />
Contact Information: Email: HAl<strong>de</strong>rman@WorldBank.org<br />
D. VAN DE WALLE (Senior Economist in the Development Research Group)<br />
Contact Information: Email: Dvan<strong>de</strong>walle@WorldBank.org<br />
Prospect Group<br />
Uri DADUSH Email: UDadush@WorldBank.org<br />
Dipak DASGUPTA (Principal Economist in the Development Economics Prospects Group —<br />
DECPG)<br />
Email: DDasgupta@WorldBank.org<br />
William SHAW Email: WShaw@WorldBank.org<br />
THÈMES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
N. BECHU (1996) Les Effets du Sida sur L’Économie Familiale en Côte d’Ivoire : Analyse empirique<br />
<strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong>s ménages touchés en Côte d’Ivoire. World Bank Washington,<br />
D.C.<br />
J. DAYTON (1996) World Bank AIDS Interventions: Ex-ante and Ex-post Evaluation. World Bank<br />
Washington, D.C.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 128
D. FILMER (1997) Socioeconomic Corre<strong>la</strong>tes of Risky Behavior: Results from the Demographic and<br />
Health Surveys. World Bank Washington, D.C.<br />
J. STOVER (1997) The Future Demographic Impact of AIDS: What Do We Know ? World Bank<br />
Washington, D.C.<br />
V. VLIET, C.K. HOLMES, B. SINGER and D. HABBEMA (1997) Effectiveness of HIV Prevention<br />
Strategies un<strong>de</strong>r Alternative Epi<strong>de</strong>miological Scenarios: Evaluation with the STDSIM Mo<strong>de</strong>l. World<br />
Bank Washington, D.C.<br />
M. AINSWORTH and K. GODLIKE (1993) The Impact of Adult Deaths from AIDS and Other Causes<br />
on School Enrollment in Tanzania. Paper presented at the annual meetings of the Popu<strong>la</strong>tion<br />
Association of America. Cincinnati, Ohio. April 1-3.<br />
M. AINSWORTH and O. MEAD (1994a) AIDS and African Development. World Bank Research<br />
Observer 9 (2): 203-40.<br />
WORLD BANK (1998) What Effect will East Asia’s crisis have on <strong>de</strong>veloping countries? Poverty<br />
Reduction and Economic Management (PREM) Notes on Economic Policy Number 1, World Bank,<br />
Washington DC, March.<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES SANTÉ<br />
J. NAJERA (who), B. LIESE (World Bank) and J. S. HAMMER (1990) Ma<strong>la</strong>ria HSPR-25, nov.<br />
Washington.<br />
R. A. BULATAO and P. STEPHENS (1990) Demographic estimates and projections by region : 1970-<br />
2015, HSPR-06, oct. Washington.<br />
B. TONY and P. BLAIKIE (1992) AIDS in Africa: Its Present and Future Impact. New York: Guilford<br />
Press.<br />
C.J.L. MURRAY and A.D. LOPEZ (1996) The Global Bur<strong>de</strong>n of Disease and Injury Series, vol. 1.<br />
WHO, Harvard School of Public Health, World Bank. Cambridge, Mass.: Harvard <strong>Un</strong>iversity Press,<br />
Cambridge.<br />
K.A. STANECKI and P.O. WAY (1997) The Demographic Impacts of AIDS-Perspectives from the<br />
World Popu<strong>la</strong>tion Profile: 1996. IPC Staff Paper 86. International Programs Center, Popu<strong>la</strong>tion<br />
Division, U.S. Bureau of the Census. Washington, D.C.<br />
WORLD BANK (1993c) World Development Report 1993: Investing in Health. New York: Oxford<br />
<strong>Un</strong>iversity Press.<br />
WORLD BANK (1996a) AIDS Prevention and Mitigation in Sub-Saharan Africa: A Strategy for Africa.<br />
Report 15569. World Bank, Africa Region, Technical Department, Human Resources and Poverty<br />
Division, Washington, D.C.<br />
WORLD BANK (1994) Better Health in Africa Experiences and Lessons Learned. World Bank<br />
Washington, D.C.<br />
WORLD BANK (1998) Global Economic Prospects 1997, World Bank, Washington DC.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 129
COORDONNÉES-STATUT<br />
BURDEN OF DISEASE UNIT<br />
Adresse: Bur<strong>de</strong>n of Disease <strong>Un</strong>it<br />
Harvard Center for Popu<strong>la</strong>tion and Development Studies<br />
9 Bow Street<br />
Cambridge, MA 02138, USA<br />
Tél.: 617-495-8498<br />
Fax: 617-496-3227<br />
Site internet : http:// www.hsph.harvard.edu/Register/pop-ctr.html<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : USA, Afrique, Amérique Latine, Asie et Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : L’<strong>Un</strong>ité <strong>de</strong> Charge <strong>de</strong> Ma<strong>la</strong>die fait parti du Centre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s en<br />
Développement <strong>de</strong> l’<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Harvard. Cette unité tente <strong>de</strong> concevoir et <strong>de</strong> tester <strong>de</strong>s nouveaux<br />
instruments méthodologiques pour ai<strong>de</strong>r l’allocation effective dans le domaine <strong>de</strong> santé.<br />
Ce centre concentre ses recherches sur les axes suivants :<br />
- mettre au point <strong>de</strong> théorie et <strong>de</strong>s instruments qui combinent les indicateurs <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mortalité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mobilité et les indicateurs <strong>de</strong> charge <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies ;<br />
- établir une base <strong>de</strong> données <strong>de</strong> coût <strong>de</strong> 200 ma<strong>la</strong>dies dans les pays en développement.<br />
SPÉCIALISTES<br />
C. MURRAY E-mail: cmurray@hsph.harvard.edu<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
C. Murray et A. Lopez (1996) Tome I : Global Bur<strong>de</strong>n of disease, Who, Harvard School of Public<br />
Health and World Bank., Washington<br />
C. Murray et A. Lopez (1996) Tome II : Global Health Statistics of disease, Who, Harvard School of<br />
Public Health and World Bank, Washington<br />
C. Murray (1996) Quantifying the bur<strong>de</strong>n of disease data, methods and results, Harvard School of<br />
Public Health, Cambridge<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 130
COORDONNÉES-STATUT<br />
CRIPS<br />
CENTRE REGIONAL D’INFORMATION<br />
ET DE PREVENTION DU SIDA<br />
Adresse: Centre Régional d’Information et <strong>de</strong> Prévention du Sida<br />
192, rue Lecourbe<br />
75015 Paris<br />
Tél.: 01 53 68 88 88<br />
Fax: 01 5368 88 89<br />
Site internet : http:/www.crips.asso.fr<br />
Statut : Organisme public<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Ile <strong>de</strong> France, France, Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : Le CRIPS (Centre Régional d’Information et <strong>de</strong> Prévention du le Sida) est un réseau national<br />
(Auvergne, Aquitaine, Ile-<strong>de</strong>-France (IDF), Nord-Pas-<strong>de</strong>-Ca<strong>la</strong>is, Pays-<strong>de</strong>-<strong>la</strong>-Loire, Rhône-Alpes,<br />
Provence-Alpes-Côte d’Azur) ayant <strong>de</strong> compétences pour le traitement <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
documentation sur le SIDA. Le but est <strong>de</strong> permettre l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> produits adaptés en matière <strong>de</strong><br />
prévention ainsi que <strong>la</strong> mise en œuvre d’actions.<br />
Les CRIPS, véritables carrefours d’informations, rassemblent les ressources régionales, nationales et<br />
internationales pour faciliter <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> prévention. Chaque centre est une<br />
structure associative autonome. Il convient <strong>de</strong> préciser que le CRIPS apporte son appui aux<br />
questions :<br />
- du traitement <strong>de</strong> l’information, <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentation<br />
- du soutien méthodologique à <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> sensibilisation et <strong>de</strong> communication sur l’infection à<br />
VIH<br />
- <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s professionnels médico-sociaux, <strong>de</strong>s bénévoles et sa<strong>la</strong>riés associatifs<br />
- <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> recherche ou d’évaluation.<br />
CONTACTS<br />
Dr Didier JAYLE (Directeur du CRIPS Région Ile-<strong>de</strong>-France).<br />
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE<br />
Le CRIPS n’est pas un centre d’étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>. Mais au sein du CRIPS-IDF, on peut trouver <strong>de</strong>s<br />
informations, <strong>de</strong>s documents bibliographiques ou <strong>de</strong>s documents sur <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> ou perspective du<br />
SIDA en France et dans le mon<strong>de</strong>. Nous avons recueilli :<br />
L. Lawson (1997) HIV/aids and <strong>de</strong>velopment. Report Interfund, Teaching Screens Productions,<br />
Yeoville, April<br />
H. Jackson, R. Loewenson, A. Whitesi<strong>de</strong> (1997) Social economic issues of HIV/aids in southern<br />
Africa. Safaids.<br />
J. B. Brunet (1996) Les tendances <strong>de</strong> <strong>la</strong> pandémie, Transcriptase.<br />
P. O. Way, K. A. Stanecki (1996) The impact of HIV/AIDS on world popu<strong>la</strong>tion, Report of US<br />
Department of Commerce, Washington.<br />
K. M. De Cock, B. Barrère, M. F. Lafontaine et al. (1991) Mortality trends in Abidjan, Ivory Coast.<br />
AIDS, JAMA ; 5 : 393-8, Abidjan<br />
E. Aka-Danguy, N. Koffi, A. N’Gom (1997) Evolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation épidémiologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose<br />
à Abidjan sous <strong>la</strong> poussée <strong>de</strong> l’infection VIH/SIDA., ( Conference on Global Lung Health and 1997<br />
annual meeting of the International <strong>Un</strong>ion Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris 1-4 october.)<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 131
D. Lévy-Bruhl, A. Soucat, A. Coulibaly et al (1997) Prédictions <strong>de</strong>s tendances futures <strong>de</strong> l’infection<br />
VIH/SIDA en Côte d’Ivoire par une modélisation mathématique. ( Xème conference Internationale sur<br />
le SIDA et les MST en Afrique. Abidjan, Côte d’Ivoire, 7-11, décembre 1997.)<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 132
COORDONNÉES-STATUT<br />
OMS<br />
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE<br />
Adresse: Avenue Appia 20<br />
CH — 1211 Genève 27, Suisse<br />
Tél.: (44 22) 791 21 11<br />
Fax: (41 22) 791 07 46<br />
Site internet : http:/www.who.org<br />
Statut : Organisation internationale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : L’OMS est un organisme intergouvernemental. Sa mission est d’assurer <strong>la</strong> [meilleure] santé<br />
pour tous (cf. Conférence D’Alma-Ata, 1978) à travers le mon<strong>de</strong>. L’OMS réalise et publie <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
internes et externes. Certaines étu<strong>de</strong>s sont mises à <strong>la</strong> disposition du public et les autres sont c<strong>la</strong>ssées<br />
confi<strong>de</strong>ntielles. L’OMS ai<strong>de</strong> et favorise <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s programmes sanitaires <strong>de</strong>s États<br />
membres. Elle apporte son expertise aux États membres dans le secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et l’économie <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> santé.<br />
1. Que signifie <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> en matière <strong>de</strong> santé pour I’OMS et pour le mon<strong>de</strong> ? (S. SAPIRIE)<br />
2. Introduction aux étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s nationales pour les déci<strong>de</strong>urs du secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (M.J.<br />
GARRET)<br />
3. Modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins aux Etats-<strong>Un</strong>is d’Amérique et leur utilisation dans l’é<strong>la</strong>boration<br />
<strong>de</strong>s politiques (H. TRAXLER)<br />
4. Scénarios pour les prestations <strong>de</strong> santé au XXIe siècle aux Etats-<strong>Un</strong>is d’Amérique: changements<br />
en perspective (C. BEZOLD)<br />
5. Avenir et technologie <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé: inci<strong>de</strong>nces d’un système <strong>de</strong> reconnaissance précoce (H.<br />
D. BANTA and A.C. GELIJNS)<br />
6. Simu<strong>la</strong>tion stochastique et analyse <strong>de</strong> sensibilité: estimation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> future <strong>de</strong> ressources<br />
sanitaires en Chine (F. SONG and T. RATHWELL)<br />
7. POHEM — Canevas pour comprendre et modéliser <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions (M.C. WOLFSON)<br />
8. Evaluation <strong>de</strong>s réseaux neuronaux artificiels dans <strong>la</strong> recherche <strong>prospective</strong> en santé (T.<br />
R. FENTON)<br />
CONTACTS<br />
Fabio ZICKER (manager) Task Force on Ma<strong>la</strong>ria Research Capability Strengthening in Africa, Who<br />
Tél. 41 22 791 4854, Fax. 41 22 791 3805, Email : zickerf@who.ch<br />
Stephen SAPIRIE (chief) <strong>Un</strong>it of Monitoring, Evaluation and Projection Methodology (MEP)<br />
Tél. : 44 22 791 23 83, Fax : 41 22 708 00 11, E-mail : Sapiries@who.ch<br />
Doris MA FAT Global Bur<strong>de</strong>n of Disease <strong>Un</strong>it<br />
Tél. : 44 22 791 21 11, Fax : 41 22 791 07 46, E-mail : mafatd@who.ch<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 133
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
OMS (1998) Rapport sur <strong>la</strong> santé dans le Mon<strong>de</strong> : La vie au XXI e siècle, <strong>Un</strong>e perspective pour tous.<br />
Genève.<br />
OMS (1997) Global Health Situation : Analysis and Projection 1950-2025, (Document interne),<br />
Genève<br />
P.I. TRIGG and A.V. KONDRACHINE (1998) La lutte antipaludique dans les années 90. Volume 76,<br />
Number 1, Rétrospective. OMS, Genève.<br />
S.W. LINDSAY and W.J.M. MARTENS (1998) Ma<strong>la</strong>ria in the African high<strong>la</strong>nds: past, present and<br />
future, Volume 76, Number 1, OMS, Genève.<br />
OMS (1997) The World Health Report 1997 : Conquering suffering. Enriching humanity. Genève.<br />
OMS (1981) Global strategy for health for all by the year 2000, (Health for all series n. 3), Genève.<br />
C.J.L. MURRAY, A.D. LOPEZ, and D. JAMISON (1994) The Global Bur<strong>de</strong>n of Disease in 1990:<br />
Summary results, sensitivity analysis and future directions. Bulletin of WHO, vol. 72 (3), Genève<br />
M. J. GARRETT (1997) Health Futures Handbook (in press by WHO for publication I), Genève<br />
WHO (1996) Investing in Health Research and Development, Report of the Ad Hoc Committee on<br />
Health Research Re<strong>la</strong>ting to Future Intervention Options, Genève.<br />
B.N. SORO, G.M. GERSHY-DAMET, A. COULIBALY, K. KONAN, P.A. SATO (1992) The present and<br />
future course of the AIDS epi<strong>de</strong>mic in Côte d’Ivoire. Bull WHO ; 70 : 117-23, Genève<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 134
ONUSIDA<br />
THE JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS<br />
(ou Programme commun <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies sur le VIH/SIDA)<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse: The Joint <strong>Un</strong>ited Nations Programme on HIV/AIDS<br />
(Programme commun <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies sur le VIH/SIDA)<br />
CH — 1211 Genève 27, Suisse<br />
Tél.: (44 22) 791 4650<br />
Fax: (41 22) 791 4191<br />
Site internet : http:/www.onusida.org<br />
Statut : Organisation internationale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : L’Onusida est un programme commun coparrainé par l’UNICEF, l’UNDP, l’UNFPA,<br />
l’UNDCP, l’UNESCO, le WHO et <strong>la</strong> WORLD BANK. Mis en p<strong>la</strong>ce grâce à <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong>s États<br />
membres <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>is, il a pour but <strong>de</strong> lutter contre le sida dans le mon<strong>de</strong>. Sa mission est aussi<br />
d’assurer l’évaluation <strong>de</strong>s programmes nationaux <strong>de</strong> lutte contre le sida.<br />
CONTACTS<br />
O<strong>la</strong>vi ELO Department of Country P<strong>la</strong>nning and Programme Development<br />
Sally COWAL Department of External Re<strong>la</strong>tions<br />
Awa Marie COLL-SECK Department of Policy, Strategy and Research<br />
Bernard FERY Department of Programme Support<br />
Africa and Middle East<br />
Matshidiso MOETI Program Development Officer,<br />
Anne BUCKLEY Geographic Desk Officer — Africa<br />
Africa & Middle East<br />
Roger Sal<strong>la</strong> NTOUNGA Programme Development Officer<br />
Jens Van ROYCE and<br />
Lester CHITSULO Geographic Desk Officer, Programme Development Officers<br />
Consultants :<br />
West Africa Initiative HIV/AIDS<br />
Mamadou-Lamine SAKHO c/o UNDP, BP 1747, Abidjan 01 Côte d’Ivoire<br />
Tel: (225) 24 30 13-14, Fax: (225) 24 31 19<br />
Ethiopia<br />
Emmanuel JESUTHASAN c/o UNDP, PO Box 5580, Addis Ababa<br />
Tel: (251) 1 51 51 17 (8 lines), Fax: (251) 1 51 45 99/ 51 51 47<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
ONUSIDA (1996) Conférence internationale sur le sida en Afrique. Faits et tendances sur le VIH,<br />
Kampa<strong>la</strong>.<br />
The NESDBWorking Group on HIV/AIDS Projection (1994) Projections for HIV/AIDS in Thai<strong>la</strong>nd:<br />
1987-2020. November 1994. Thai<strong>la</strong>nd, Mahidol <strong>Un</strong>iversity.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 135
J. STOVER (1996) The future <strong>de</strong>mographic impact of AIDS: what do we know ? Paper prepared for<br />
AIDS in Development: the Role of Government, Chateau <strong>de</strong> Limelette, 17-19 June.<br />
J.A. CHIN (1994) A beginner’s gui<strong>de</strong> for un<strong>de</strong>rstanding and using EPIMODEL version 2. A computer<br />
programme for estimation and projection of AIDS. Berkeley, <strong>Un</strong>iversity of California.<br />
ONUSIDA (1996) VIH/SIDA: faits et tendances Estimations globales, Programme commun <strong>de</strong>s<br />
Nations <strong>Un</strong>ies sur le VIH/SIDA, Genève, Mars.<br />
AIDSCAP/Family Health International, Harvard School of Public Health, and UNAIDS (1996) The<br />
Status and Trends of the Global HIV/AIDS Pan<strong>de</strong>mic. Final Report of a Satellite Symposium of the<br />
Eleventh International Conference on AIDS, Vancouver, B.C., Canada. July 7-12. Family Health<br />
International.<br />
ONUSIDA (1997) Rapport sur l’épidémie mondiale <strong>de</strong> l’infection VIH/SIDA, Décembre, Genève.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 136
ORSTOM/IRD<br />
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE<br />
POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION<br />
/INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : Institut Français <strong>de</strong> Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération<br />
ou Institut <strong>de</strong> recherche pour le développement)<br />
209, rue La Fayette,<br />
75480 PARIS CEDEX 10<br />
Tel : (33) 1 48 03 77 77<br />
Fax : (33) 1 48 03 08 29<br />
Site internet : http://www.orstom.fr<br />
Statut : Organisation public<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong>, France, Afrique<br />
Objectif : L’Orstom est <strong>de</strong>venu l’IRD (Institut <strong>de</strong> recherche pour le développement). Etablissement<br />
public à caractère scientifique et technologique, il est p<strong>la</strong>cé sous <strong>la</strong> tutelle <strong>de</strong>s ministères chargés <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Recherche et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération. Depuis cinquante ans, il conduit, sur les milieux intertropicaux, <strong>de</strong>s<br />
recherches reconnues sur le p<strong>la</strong>n international. Il propose à ses partenaires du Sud et aux acteurs du<br />
développement <strong>de</strong>s programmes et <strong>de</strong>s résultats sur les milieux tropicaux. I1 met ses capacités <strong>de</strong><br />
diagnostic et d’expertise à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>s organismes publics et privés français, étrangers ou<br />
internationaux. Grâce à ses col<strong>la</strong>borations avec d’autres instituts scientifiques français, européens et<br />
<strong>de</strong>s pays en développement, l’Institut participe à <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> programmes internationaux en zone<br />
intertropicale.<br />
Depuis 10 ans sous l’impulsion <strong>de</strong> J. P. Dozon, il a organisé <strong>de</strong>s nombreuses étu<strong>de</strong>s sur les sciences<br />
sociales et le sida. L’intérêt est <strong>de</strong> présenter les fortes carences du systeme <strong>de</strong> santé en Afrique et<br />
dont proposer <strong>de</strong>s initiatives pour son amélioration. L’ORSTOM – L’IRD abor<strong>de</strong> aussi <strong>la</strong> question du<br />
développement du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche sur l’homme et sur l’organisation <strong>de</strong>s sociétés<br />
humaines. Il réalise cette recherche en trois approches respectivement, "<strong>la</strong> santé", "<strong>la</strong> ville" et "les<br />
conditions contemporaines du développement". L’ORSTOM -IRD est constitué d’une direction qui<br />
combine action scientifique et action administrative. Son fonctionnement est collégial.<br />
CONTACTS<br />
Programmes, responsables et chercheurs :<br />
Bernard PHILIPPON responsable <strong>de</strong> l’UR 7, Santé et politiques <strong>de</strong> développement<br />
E-mail : <strong>la</strong>fitte@paris.orstom.fr<br />
J.-P. OLIVIER <strong>de</strong> SARDAN responsable du Programme 71, Systèmes <strong>de</strong> santé<br />
E-mail : sardan@ehess.cnrs-mrs.fr<br />
Francis DELPEUCH responsable du Programme 72, Conditions d’amélioration <strong>de</strong>s situations<br />
nutritionnelles — E-mail : Francis.Delpeuch@mpl.orstom.fr<br />
Christian BELLEC responsable du Programme 73, Transmission, expression, prévention et<br />
contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies à vecteurs. E-mail : Christian.Bellec@mpl.orstom.fr<br />
Éric DELAPORTE responsable du Programme 74, Sida en milieu tropical<br />
E-mail : Eric.De<strong>la</strong>porte@mpl.orstom.fr<br />
UR 8 – La question urbaine dans les politiques <strong>de</strong> développement (responsable : n.c)<br />
Françoise DUREAU responsable du Projet 1, Mobilités et recompositions urbaines<br />
E-mail : fdureau@regards.cnrs.fr<br />
Benoît LOOTVOET responsable du Projet 2, Gestion économique <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 137
E-mail : lootvoet@bondy.orstom.fr<br />
Marc SOURIS responsable du Projet 3, Gestion environnementale <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville<br />
E-mail : souris@bondy.orstom.fr<br />
A<strong>la</strong>in MOUNIER responsable <strong>de</strong> l’UR 9 Dimensions économiques et sociales du<br />
développement — E-mail : mounier@paris.orstom.fr<br />
Jacques CHARMES responsable du Programme 91, Les politiques économiques et sociales <strong>de</strong>s<br />
pays en développement dans un mon<strong>de</strong> interdépendant<br />
E-mail : charmes@bondy.orstom.fr<br />
Jean-Pierre CHAUVEAU responsable du Programme 92, Privé/Public : opérateurs et<br />
interactions<br />
E.mail : J-Pierre.Chauveau@mpl.orstom.fr<br />
Bernard SCHLEMMER responsable du Programme 93, Formation <strong>de</strong>s compétences et maîtrise<br />
<strong>de</strong>s savoirs. E-mail : schlemm@bondy.bondy.orstom.fr<br />
Marie-José JOLIVET responsable du Programme 94, Enjeux et stratégies i<strong>de</strong>ntitaires<br />
E-mail : jolivet@bondy.orstom.fr<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
ADELF (1997) Compte rendu du 22e Congrès <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong>s épidémiologistes <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
française, 2 et 4 avril, Montpellier (non disponible). Ce Congrès a été organisé par l’Association <strong>de</strong>s<br />
épidémiologistes <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue française (ADELF). L’ORSTOM a porté son soutien et participé à ce<br />
congrès ; une vingtaine <strong>de</strong> ses chercheurs présentent <strong>de</strong>s communications dans les divers thèmes<br />
retenus.<br />
Impact démographique du sida en Afrique sub-saharienne, (travail <strong>de</strong> recherche menée par M.<br />
Garenne au Ceped en 1996).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 138
UNITED NATIONS<br />
POPULATION DIVISION AND STATISTICS DIVISION<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse: Popu<strong>la</strong>tion Division and Statistics Division<br />
<strong>Un</strong>ited Nations<br />
Washington, D. C. 20433<br />
USA<br />
Site internet : http:/www.un.org<br />
Statut : Organisation internationale<br />
THÈMES DE RECHERCHES<br />
Zone géographique : Mon<strong>de</strong><br />
Objectif : L’ONU est organisme intergouvernemental. Par le biais <strong>de</strong> son Département<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Popu<strong>la</strong>tion, elle organise <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> santé.<br />
CONTACTS<br />
Joseph CHAMIE (Director of the Popu<strong>la</strong>tion Division)<br />
Hermann HABERMANN (Director of the Statistical Division)<br />
Zifa KAZEZE (Chief of the Fertility and Mortality Studies Section, Economic<br />
Commission<br />
for Africa — ECA)<br />
Mary-Beth WEINBERGER (Chief of the Popu<strong>la</strong>tion and Development Section)<br />
Ellen BRENNAN (Chief, Popu<strong>la</strong>tion Policy Section)<br />
ÉTUDES PROSPECTIVES<br />
UNITED NATIONS World Popu<strong>la</strong>tion Prospects : The 1996 Revision (<strong>Un</strong>ited Nations Publication,<br />
forthcoming), Washington<br />
UNITED NATIONS (1998) Popu<strong>la</strong>tion and Vital Statistics Report, <strong>Un</strong>ited Nations Publication, jan.<br />
Washington.<br />
UNITED NATIONS (1997) Health and Mortality : A Concise Report, 1999. Demographic Yearbook,<br />
1997, 49th Edition, Washington.<br />
PNUD (1998) Rapport mondial sur le <strong>de</strong>veloppement humain, Washington.<br />
PNUD (1998) Rapport du PNUD Sur <strong>la</strong> pauvreté: Vaincre <strong>la</strong> pauvreté humaine, Washington.<br />
UNITED NATIONS (1997) Rapport sur <strong>la</strong> situation sociale dans le mon<strong>de</strong>, E/1997/15 ST/ESA/252,<br />
Washington.<br />
UNITED NATIONS (1997) La situation économique et sociale dans le mon<strong>de</strong>, E/1997/50 ST/ESA/256,<br />
Washington.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 139
2.2.7.<br />
TRANSPORT
DBSA<br />
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA<br />
COORDONNÉES-STATUT<br />
Adresse : P.O.Box 1234<br />
Halfway House<br />
Midrand 1685<br />
RSA<br />
Tél. : (00 27) 11 313 39 11<br />
Fax : (00 27) 11 313 30 86<br />
Site web : http : //www.dbsa.org<br />
Statut : Banque <strong>de</strong> développement<br />
THÈMES DE RECHERCHE<br />
Zone géographique : SADC (Southern African Development Community)<br />
Sujet : Institution financière sud-<strong>africaine</strong>, <strong>la</strong> DBSA soutient les projets <strong>de</strong> développement<br />
prioritaires dans le secteur <strong>de</strong>s infrastructures, à un niveau institutionnel, économique et social. Il est à<br />
noter qu’elle est dotée <strong>de</strong>puis avril 1997 d’un mandat d’intervention régional.<br />
SPÉCIALISTES<br />
Nom : Peter COPLEY<br />
Fonction : Chercheur, spécialiste <strong>de</strong>s transports<br />
Tél. : (00 27) 11 313 33 36 Fax: (00 27) 11 313 30 86<br />
E-mail : peterc@dbsa.org<br />
Nom : Dr Stephen GELB<br />
Fonction : Économiste, Policy unit<br />
Tél. : (00 27) 11 313 35 54 Fax: (00 27) 11 313 35 33<br />
E-mail : sgelb@dbsa.org<br />
Nom : Jurgens VAN ZYL<br />
Fonction : Spécialiste SDIs (Spatial Development Initiatives)<br />
Tél. : (00 27) 11 313 35 18 Fax: (00 27) 11 313 30 86<br />
E-mail : jurgensv@dbsa.org<br />
Nom : Dr C<strong>la</strong>udia MANNING<br />
Fonction : Spécialiste SDIs (Spatial Development Initiatives)<br />
Tél. : (00 27) 11 313 36 00 Fax: (00 27) 11 313 30 00<br />
E-mail : c<strong>la</strong>udiam@dbsa.org<br />
TRAVAUX ÉCONOMIQUES<br />
DBSA (1997), « Towards strengthening multisectoral linkages in SADC », March, Midrand.<br />
DBSA (1998), « Spatial Development Initiatives : unlocking economic potential », Special issue,<br />
Vol. 15, No. 5, déc., December, Midrand,<br />
Jourdan P., Gordan K., Arkwright D., <strong>de</strong> BEER G. (1996), « Spatial Development Initiatives : Their<br />
potential contribution to investment and employment creation », October, Pretoria<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 142
ADRESSES
ACRDR. Arkleton Centre for Rural<br />
Development Research<br />
Old Aber<strong>de</strong>en, Écosse<br />
http://www.abdn.ac.uk/arkleton<br />
CATAD. Centre for Advenced<br />
Training in Agriculture and Rural<br />
Development<br />
Berlin, Allemagne<br />
http://www.iae.tu-berlin.<strong>de</strong>/-slecatad<br />
CDR. Centre for Development Resarch<br />
Copenhague, Danemark<br />
http://www.crd.dk<br />
CDS. Centre for Development Studies<br />
Leeds, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.leeds.ac.uk/<strong>de</strong>vstud/<br />
CEAN. Centre d’Étu<strong>de</strong>s d’Afrique<br />
Noire<br />
Talence, France<br />
http://www.cean.u-bor<strong>de</strong>aux.fr<br />
CERES. Research School for Resource<br />
Studies for Development<br />
Utrecht, Pays-Bas<br />
http://fswinfo.fsw.ruu.nl/ceres/ceres.<br />
htm<br />
CICAT. Management Centre for<br />
International Cooperation<br />
Delft, Pays-Bas<br />
http://pubwww.tu<strong>de</strong>lft.nl/~frcicat<br />
CICOPS. Centre for the Cooperation<br />
with Developing Countries<br />
Pavie, Italie<br />
http://www.unipv.it<br />
CIDOB Findacio<br />
Barcelona, Espagne<br />
http://www.cidob.es<br />
CIRAD<br />
Paris, France<br />
http://www.cirad.fr<br />
CMI. Chr. Michelsen Institute<br />
Fantoft, Norvège<br />
http://www.cmi.no<br />
CODESRIA<br />
Dakar, Sénégal<br />
http://wsi.cso.uiuc.edu/cas/newco<strong>de</strong>sria<br />
/co<strong>de</strong>sria.htm<br />
DGIDS. Department of Geography<br />
International Development Studies<br />
Roskil<strong>de</strong>, Danemark<br />
http://www.geo.ruc.dk<br />
DPPC. Development and Project<br />
P<strong>la</strong>nning Centre<br />
Bradford, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.brad.ac.uk/contents.html<br />
DPS. Department of Political Sciences<br />
Aarhus, Danemark<br />
http://www.ps.aau.dk<br />
ADRESSES SUR LE WEB<br />
DES PRINCIPAUX CENTRES DE RECHERCHE<br />
DSA. Development Studies<br />
Association<br />
Birmingham, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.bham.ac.uk/dsa<br />
DES. German Foundation for<br />
International Development<br />
Berlin, Allemagne<br />
http://www.dse.<strong>de</strong><br />
DUI. Deutsches Übersee Institut<br />
Hamburg, Allemagne<br />
http://rrz.ini-hamburg.<strong>de</strong>/duei<br />
ECDPM. European Centre for<br />
Development Policy Management<br />
Maastricht, Pays-Bas<br />
http://www.oneworld.org/ecdpm<br />
EADI. European Association for<br />
Development Research and Training<br />
Studies<br />
Genève, Suisse<br />
http://www.eadi.org<br />
Economic Faculty/Erasmus <strong>Un</strong>iversity<br />
Rotterdam, Pays-Bas<br />
http://www..eur.nl/few/seor<br />
EUI. European <strong>Un</strong>iversity Institute<br />
Domenico di Fiesole, Italie<br />
http://www.iue.it<br />
EUT. Eindhoven <strong>Un</strong>iversity of<br />
Technology<br />
Eindhoven, Pays-Bas<br />
http://www.tue.nl<br />
FES. Friedrich Ebert-Stiftung<br />
Bonn, Allemagne<br />
http://www.fes.<strong>de</strong>/ipg<br />
FSDS. Finnish Society for<br />
Development Studies<br />
Helsinki, Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong><br />
http://www.helsinki.fi/jarj/kts<br />
GDI. German Development Institute<br />
Berlin, Allemagne<br />
http://home.t-online.<strong>de</strong>/home/die-berlin<br />
GEMDEV<br />
Paris, France<br />
http://www.univ-paris1.fr/GEMDEV<br />
GTZ. Deutsche Gesellschaft für<br />
Technische Zusammenarbeit<br />
Eschborn, Allemagne<br />
http://www.gtz.<strong>de</strong><br />
IAI. International Africa Institute<br />
Londres, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.oneworld.org/iai/<br />
IBISCUS<br />
Paris, France<br />
http://www.ibiscus.fr<br />
ICE. Istituto Commercio Estero<br />
Rome, Italie<br />
http://www.ice.it<br />
ICU. Istituto par <strong>la</strong> Cooperazione<br />
<strong>Un</strong>iversitaria<br />
Rome, Italie<br />
http://nusso.caspur.it<br />
IDPM. Institute for Development<br />
Policy and Management<br />
Manchester, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.man.ac.uk/idpm<br />
IDS. Institute of Development Studies<br />
Brighton, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.ids.ac.uk/ids/<br />
IDS Helsinki. Institute of Development<br />
Studies<br />
Helsinki, Finfan<strong>de</strong><br />
http://www.valt.helsinki.fi/kmi<br />
IEE. Institut für<br />
Entwicklungsforschung und<br />
Entwicklungspolitik<br />
Bochum, Allemagne<br />
http://www.ruhr-uni-bochum.<strong>de</strong>/iee<br />
IER. Institute for Economie Research<br />
Ljubljana, Slovénie<br />
http://www.ier.si<br />
IES. Institute for Economic Sciences<br />
Belgra<strong>de</strong>, Yougos<strong>la</strong>vie<br />
http://www.ien.bg.ac.yu<br />
IHEM. Institute for Highway and<br />
Maritime Education<br />
Helsinki, Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong><br />
http://www.tieh.fi/ihme<br />
IILS. International Institute for Labour<br />
Studies<br />
Genève, Suisse<br />
http://www.ilo.org<br />
IIPE. Institute of International Politics<br />
ans Economics<br />
Belgra<strong>de</strong>, Yougos<strong>la</strong>vie<br />
http://www.diplomacy.bg.ac.yu/impp/<br />
in<strong>de</strong>x.html<br />
ILRI. International Institute for Land<br />
Rec<strong>la</strong>mation and Improvement<br />
Wageningen, Pays-Bas<br />
http://www.ilri.nl<br />
IMO. Institute for International<br />
Re<strong>la</strong>tions<br />
Zagreb, Croatie<br />
http://www.imo.hr<br />
IRELA<br />
Madrid, Espagne<br />
http://www.ire<strong>la</strong>.org<br />
ISS. Institute of Social Studies<br />
La Haye, Pays-Bas<br />
http://www.iss.nl<br />
ITC. International Institute for<br />
Aerospace Surveys and EarTh Sciences<br />
Ensche<strong>de</strong>, Pays-Bas<br />
http://www.itc.nl<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 144
IUED. Institut <strong>Un</strong>iversitaire d’Étu<strong>de</strong>s<br />
du Développement<br />
Genève, Suisse<br />
http://www.unige.ch/iued<br />
IUHEI. Institut <strong>Un</strong>iversitaire <strong>de</strong>s<br />
Hautes Étu<strong>de</strong>s Internationales<br />
Genève, Suisse<br />
http://hei.unige.ch<br />
IWE. Institute for World Economics<br />
Budapest, Hongrie<br />
http://vki3.vki.hu<br />
KIT. Royal Tropical Institute<br />
Amsterdam, Pays-Bas<br />
http://www.kit.nl<br />
KFPE. Swiss Commission for Research<br />
Partnerships with Developing<br />
Countries<br />
Berne, Suisse<br />
http://www.kfpe.unibe.ch<br />
KUN. Third World<br />
Centre/Development Studies<br />
Nijmegen, Pays-Bas<br />
http://www.socsci.KUN.nl/MAW/<br />
DWC<br />
Mentor Training<br />
Patra, Grèce<br />
http://www.mentor.gr<br />
NAI. Nordic Africa Institute<br />
Uppsa<strong>la</strong>, Suè<strong>de</strong><br />
http://www.nai.uu.se<br />
NUFFIC<br />
La Haye, Pays-Bas<br />
http://www.nufficcs.nl<br />
NUPI. Norwegian Institute of<br />
International Affairs<br />
Oslo, Norvège<br />
http://www.nupi.no<br />
ODG. Overseas Development Group<br />
Norwich, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.uea.ac.uk/menu/acad_<strong>de</strong>pts<br />
/<strong>de</strong>v<br />
ODI. Overseas Development Institute<br />
Londres, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.oneworld.org/odi/<br />
OECD. Development Centre<br />
Paris, France<br />
http://www.oecd.org<br />
OFSE<br />
Vienne, Autriche<br />
http://oefs.ifs.tuwien.ac.at<br />
ORSTOM<br />
Paris, France<br />
http://www.orstom.fr<br />
QEH. Queen Elisabeth House<br />
Oxford, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.qeh.ox.ac.uk<br />
REGARDS (UMR, CNRS, ORSTOM)<br />
Talence, France<br />
http://regards.cnrs.fr<br />
RIPA International<br />
Londres, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.capitagroup.co.uk/training<br />
RUCA. College for Developing<br />
Countries<br />
Anvers, Belgique<br />
http://ua.ac.be<br />
SAI. South Asia Institute<br />
Hei<strong>de</strong>lberg, Allemagne<br />
http://www.sai.uni-hei<strong>de</strong>lberg.<strong>de</strong><br />
SPP. School of Public Policy<br />
Birmingham, Gran<strong>de</strong>-Bretagne<br />
http://www.bham.ac.uk/IntDev/dag.htm<br />
SUM. Centre for Development and<br />
Environment<br />
Oslo, Norvège<br />
http://www.sum.uio.no<br />
STI. Swiss Tropical Institute<br />
Bâle, Suisse<br />
http://www.wb.unibas.ch/sti<br />
TNI. Transnational Institute<br />
Amsterdam, Pays-Bas<br />
http://www.worldcom.nl/tni<br />
UNRISD<br />
Genève, Suisse<br />
http://www.unicc.org/unrisd<br />
WIDER/UNU<br />
Helsinki, Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong><br />
http://www.wi<strong>de</strong>r.unu.edu<br />
WU. Webster <strong>Un</strong>iversity<br />
Bellevue, Suisse<br />
http://www.webster.ch<br />
http://www.webster.ch/<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 145
ALLEMAGNE<br />
ABI. Arnold Bergstraesser Institut<br />
Windausstrasse 16<br />
791110 Freibourg<br />
Tél. +49 761 85 091<br />
Fax +49 761 89 29 67<br />
Email hampel@tuf.uni.freiburg.<strong>de</strong><br />
DES. German Foundation for<br />
International Development<br />
Hans Böckler Strasse 5<br />
53225 Bonn<br />
Tél. +49228 40 01 0<br />
Fax +49 228 40 01 111<br />
Email zed@<strong>de</strong>s.<strong>de</strong><br />
DUI. Deutsches Ubersee-Institut<br />
Neuer Jungfernstieg, 21<br />
20354 Hamburg<br />
Tél. +49 40 35 62 593<br />
Fax +49 40 35 62 547<br />
http://www.rrz.uni-hamburg.<strong>de</strong>/duei<br />
Forschungs & Studienz.Agrar &<br />
Forstwissenschaften<br />
Tropen & Subtrogen<br />
Georg August <strong>Un</strong>iversität Göttingen<br />
AM Vogelsang 6<br />
37075 Göttingen<br />
Tél. +49 551 39 39 09<br />
Fax +49 551 39 45 56<br />
GDI. German Development Institute<br />
Hallerstrasse 3 – 10587 Berlin<br />
Tél. +49 30 390 730<br />
Fax +49 30 390 73 30<br />
Email pwaller@t-online.<strong>de</strong><br />
http://home.t-online.<strong>de</strong>/home/die-berlin<br />
GTZ<br />
P.O. Box 5150 - 65726 Eschborn<br />
Tél. + 49 61 96 79 31 37<br />
Fax +49 61 96 79 11 15<br />
Email postmaster@gtz.<strong>de</strong><br />
http://www.gtz.<strong>de</strong><br />
RUHR<br />
<strong>Un</strong>iversitätstr. 150<br />
44780 Bochum<br />
Tél. +49 234 700 24 18<br />
Fax +49 234 709 42 94<br />
Email wilhem.j.lowenstein@rz.ruhruni-bochum.<strong>de</strong><br />
http://www.ruhr-uni-bochum.<strong>de</strong>/iee<br />
South-Asia Institute<br />
Hei<strong>de</strong>lberg <strong>Un</strong>iversität<br />
Im Neue – 69120 Hei<strong>de</strong>lberg<br />
Tél. +49 221 56 29 24<br />
Fax +49 221 56 49 98<br />
Email 048@ix.urz.uni-hei<strong>de</strong>lberg.<strong>de</strong><br />
http://www.sai.uni-hei<strong>de</strong>lberg.<strong>de</strong><br />
ADRESSES SUR LE WEB<br />
DES PRINCIPAUX CENTRES DE DOCUMENTATION<br />
ESPAGNE<br />
AIETI<br />
C<strong>la</strong>udio Coello, 101 bajo<br />
28006 Madrid<br />
Tél. +34 91 577 06 40<br />
Fax +34 91 576 30 70<br />
Email aieti@lix.intercom.es<br />
CIDOB Foundation Centre<br />
d’Informacio i Documentacio<br />
Internacionals a Barcelona<br />
Elisabets, 12<br />
08001 Barcelone<br />
Tél. +34 93 302 64 95<br />
Fax + 34 93 302 21 18<br />
Email cidob@cidob.org<br />
URL : http://www.cidob.org<br />
EASP. Escue<strong>la</strong> Andaluza <strong>de</strong> salud<br />
Publica<br />
Centro <strong>de</strong> Documentacion para <strong>la</strong><br />
Cooperacion al Desarrollo Sanitorio<br />
Campus <strong>Un</strong>inersitario <strong>de</strong> Cartuja s/n<br />
P.O. Box 2070<br />
18080 Grena<strong>de</strong><br />
Tél. +34 958 16 10 44<br />
Fax +34 958 16 11 42<br />
Email bibcoop@easp.es<br />
http://www.easp.es/cooperacion/<br />
centro_<strong>de</strong>_documentacion/in<strong>de</strong>x.htm<br />
HEOGA. Instituto <strong>de</strong> Estudios sobre el<br />
Desarrollo y <strong>la</strong> Economia Internacional<br />
<strong>Un</strong>iversidad <strong>de</strong>s Païs Vasco<br />
Facultad <strong>de</strong> Ciencias Economicas<br />
Avda. Lehendakari Agirre, 83<br />
48015 Bilbao – Bizkaia<br />
Tél. secrétarait +34 944 47 35 12<br />
Tél. centre doc. +34 944 79 75 56<br />
Fax +34 944 76 26 54<br />
Email hegoa@bs.ehu.es<br />
http://www.ehu.es/hegoa<br />
IRELA. Institute for European-Latin<br />
American Re<strong>la</strong>tions<br />
Pedro <strong>de</strong> Valdivia, 10 E<br />
28006 Madrid<br />
Tél. +34 91 561 72 00<br />
Fax +34 91 562 64 99<br />
Email info@ire<strong>la</strong>.org<br />
http://www.ire<strong>la</strong>.es<br />
EUROPE CENTRALE<br />
ET ORIENTALE<br />
Albanie<br />
QNK. International Centre of Culture<br />
Bulevardi Deshmoret e Kombit<br />
Tirana<br />
Tél. +355 42 28528<br />
Fax +355 42 34193<br />
Bulgarie<br />
Balkanmedia Association<br />
72 Cyril i Metodi Str.<br />
1202 Sofia<br />
Tél. +359 2 83 51 91<br />
Fax +359 2 83 19 70<br />
Croatie<br />
Culturelink – Network of Networks for<br />
Research and Cooperation in Cultural<br />
Development<br />
IMO<br />
j. F. Vukotinovica 2<br />
Zagreb<br />
Tél. + 385 1 4554 522<br />
Fax +385 1 4828 360<br />
Email clink@mairmo.irmo.hr<br />
http://www.culturelink.hr<br />
République Tchèque<br />
ARTAMA. Information Centre for<br />
Culture<br />
Snemovni 7<br />
11822 Prague 1<br />
Tél. +420 2 534 841<br />
Fax +420 2 537 224<br />
ESC. European Studies Centre<br />
Zamek Stirin<br />
25168 Stirin<br />
Tél. +42 2 99 3000<br />
Fax +42 2 99 2727<br />
Hongrie<br />
IEHAS. Institute of Economics<br />
Hungarian Aca<strong>de</strong>my of Sciences<br />
P.O. Box 262<br />
1112 Budapest, XI<br />
Budaorsi ut 45.<br />
1502 Budapest<br />
Tél. +361 185-0777<br />
Fax +361 185-1120<br />
Email<br />
IB18KKTI@HUBPSZ12SZTAKLHU<br />
IWEHAS. Institute for World<br />
Economics of the Hungarian Aca<strong>de</strong>my<br />
of Sciences<br />
Kallo esperes u. 15<br />
1124 Budapest<br />
Tél. +361 319-9383<br />
Fax +361 319-9385<br />
Email vki@vki3.vki.hu<br />
MI. Muvelo<strong>de</strong>skuta to Intezet Cultural<br />
Research Institute<br />
Corvin ter 8 – 1011 Budapest<br />
Tél. +361 201 5782<br />
Fax +361 201 5328<br />
Pologne<br />
CASE. Centrum Analiz Spoleczno-<br />
Ekonomicznych<br />
Bagate<strong>la</strong> 14<br />
00-585 Varsovie<br />
Tél. +48 22 628 09 12<br />
Fax +48 22 628 65 81<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 146
IBGR. Instytut Badan nad Gospodarka<br />
Rynkowa<br />
Do Studzienki 63 – 80-227 Gdansk<br />
Tél. +48 58 41 39 77<br />
Fax + 48 48 41 06 20<br />
ICC. Miedzynarodowe Centrum<br />
Kultury<br />
International Cultural Centre<br />
Rynek Glowny 25<br />
31008 Cracovie<br />
Tél. +48 12 21 86 01<br />
Fax +48 12 21 85 71<br />
Russie<br />
CICAP. Centre of Information for<br />
Culture ans Arts Problems<br />
Kalinina 3 – 101000 Moscou<br />
ICCARS. Informkultura Information<br />
Centre on Culture and Art of the<br />
Russian State Library<br />
3 Vozdvizhenka<br />
101000 Moscou<br />
Tél. +7 095 202 83 12<br />
Fax + 7 095 290 60 62<br />
ISISS. Institute of Scientific<br />
Information on Social Sciences<br />
Nakhimovsky presp. 51/21 – Moscou<br />
Slovaquie<br />
CVT. Centrum pre Vyskum v Kulture<br />
Research Centre for Culture<br />
Nam. Spp 1<br />
81268 Bratis<strong>la</strong>va<br />
Tél. +421 7 531 08<br />
Fax +421 7 595 63<br />
Slovénie<br />
CIR. Center for International Re<strong>la</strong>tions<br />
Faculty for Social Sciences <strong>Un</strong>iversity<br />
of Ljubljana<br />
Kar<strong>de</strong>ljeva pl. 5<br />
10000 Ljubljana<br />
Tél. +386 61 1682 174<br />
Fax +386 61 1682 339<br />
FRANCE<br />
BDPA. Bureau pour le Développement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Production agricole<br />
27 rue Louis Vicat<br />
75738 Paris Ce<strong>de</strong>x 15<br />
Tél. +33 1 46 48 59 42<br />
Fax +33 1 46 44 75 44<br />
Email cdi@bdpa.fr<br />
CEAN (CNRS). Centre d’étu<strong>de</strong><br />
d’Afrique Noire<br />
Domaine universitaire, BP 101<br />
33405 Talence Ce<strong>de</strong>x<br />
Tél. +33 5 56 84 42 82<br />
Fax +33 5 56 84 43 24<br />
Email doceam@rsiep.iep.ubor<strong>de</strong>aux.fr<br />
CEDEP. Centre français sur <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion et le développement<br />
15 rue <strong>de</strong> l’École <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
75006 Paris<br />
Tél. +33 1 44 41 82 55<br />
Fax +33 1 44 41 82 54<br />
Email fgubry@ceped.ined.fr<br />
CFD. Caisse française <strong>de</strong><br />
développement<br />
5 rue Ro<strong>la</strong>nd Barthes<br />
75598 Paris Ce<strong>de</strong>x 12<br />
Tél. +33 1 53 44 35 95<br />
Email cfd-doc@magic.fr<br />
CHEAM. Centre <strong>de</strong>s Hautes Étu<strong>de</strong>s sur<br />
l’Afrique et l’Asie mo<strong>de</strong>rnes<br />
13 rue du Four, 75006 Paris<br />
Tél. +33 1 44 41 38 97<br />
Fax +33 1 40 51 03 58<br />
Email cheam@imaginet.fr<br />
CIDEF. Centre international <strong>de</strong><br />
l’enfance et <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille<br />
Château <strong>de</strong> Longchamp<br />
Bois <strong>de</strong> Boulogne, 75016 Paris<br />
Tél. +33 1 44 30 20 00<br />
Fax +33 1 45 25 73 67<br />
Email ci<strong>de</strong>f@compuserve.com<br />
BIRD (CIDEF)<br />
Bibbliographie references on health,<br />
Women, children<br />
CD-Rom « BIRD »<br />
CIRAD. Centre <strong>de</strong> coopération<br />
internationale en recherche<br />
agronomique pour le développement<br />
Avenue d’Agropolis<br />
BP 5035, 34032 Montpellier<br />
Tél. +33 67 61 58 00<br />
Fax +33 67 61 58 20<br />
Email cidaries@cirad.fr<br />
http://www.cirad.fr<br />
Sésame (CIRAD)<br />
Bibliographie references on agronomy<br />
rural <strong>de</strong>velopment<br />
CD Rom « Sésame »<br />
IBISCUS<br />
1 bis rue du Havre, 75008 Paris<br />
Tél. +33 1 42 94 24 34<br />
Fax +33 1 42 94 25 91<br />
Email cl@ibiscus.fr<br />
http://www.ibiscus.fr<br />
INRA Monpellier. Institut national<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche agronomique<br />
Bibliothèque Pierre Bartoli<br />
Labo. d’économie et <strong>de</strong> sociologie<br />
rurale<br />
2 p<strong>la</strong>ce Via<strong>la</strong>, 34060 Montpellier<br />
Tél. +33 4 99 61 22 00<br />
Fax +33 4 67 63 28 02<br />
Email bedu@ensam.inra.fr<br />
ISTED. Institut <strong>de</strong>s sciences<br />
et <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> l’équipement<br />
et <strong>de</strong> l’environnement pour le<br />
développement<br />
Arche <strong>de</strong> <strong>la</strong> Défense<br />
92055 Paris <strong>la</strong> Défense<br />
Tél. +33 1 40 81 15 74<br />
Fax +33 1 40 81 15 99<br />
Email ved@isted.3ct.com<br />
http://www.isted.3ct.com<br />
Urbamet (ISTED)<br />
Bibliographie references on housing<br />
urbanism, architecture, urban services<br />
CD Rom « Urbadisc »<br />
ISTOM. Institut d’agro développement<br />
international<br />
32 bd du Port, 95094 Cergy Pontoise<br />
Tél. +33 1 30 75 62 03<br />
Fax +33 1 30 75 62 61<br />
Email e.ducoudray@ipsl.tethyssoftware.fr<br />
OIEAU. Office international <strong>de</strong> l’eau<br />
15 rue Édouard Chamber<strong>la</strong>nd<br />
87065 Limoges Ce<strong>de</strong>x<br />
Tél. +33 5 55 11 47 80<br />
Fax +33 5 55 77 72 24<br />
Email doc@oieau.fr<br />
http://www.oieau.fr<br />
EAUDOC (OIEAU)<br />
Bibliographie references on water<br />
CD Rom « Eaudoc »<br />
IRD/ORSTOM. Institut français <strong>de</strong><br />
recherche scientifique pour le<br />
développement en coopération<br />
213 rue La Fayette<br />
75480 Paris<br />
Tél. +33 1 48 03 75 00<br />
Fax +33 1 48 03 08 29<br />
http://www.orstom.fr<br />
Pascal (INIST-CNRS)<br />
Horizon (ORSTOM)<br />
Bibliographic references on geology,<br />
geography, social sciences, agriculture,<br />
health<br />
CD Rom « Horizon »<br />
REGARDS (UMR CNRS ORSTOM).<br />
Recherches en économie, géographie et<br />
anthropologie sur les recompositions et<br />
le développement <strong>de</strong>s Suds<br />
Domaine universitaire, BP 200<br />
33405 Talence<br />
Tél. +33 5 56 84 68 57<br />
Fax +33 5 56 84 68 55<br />
Email dirdoc@regards.cnrs.fr<br />
RITIMO. Réseau <strong>de</strong> centres <strong>de</strong><br />
documentation Tiers-mon<strong>de</strong> Paris<br />
(database management and<br />
dissemination)<br />
21 ter rue Voltaire, 75011 Paris<br />
Tél. +33 1 44 64 74 14<br />
Fax +33 1 44 64 74 14<br />
Email ritimo@globenet.org<br />
Secrétariat d’État à <strong>la</strong> coopération<br />
et à <strong>la</strong> francophonie<br />
57 bd <strong>de</strong>s Invali<strong>de</strong>s, 75007 Paris<br />
Tél. +33 1 53 69 38 79<br />
Fax +33 1 53 69 32 94<br />
Email<br />
bernard.humbaire@cooperation.gouv.fr<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
BLDS. British Library for<br />
Development Studies<br />
Library and Documentation Centre<br />
Institute of Development Studies<br />
<strong>Un</strong>iversity os Sussex<br />
Falmer Brighton BN1 9RE<br />
http://www.ids.ac.uk/ids/<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 147
BLPES. British Library of Political<br />
and Economic Sciences<br />
London School of Economics<br />
10 Portugal St.<br />
Londres WC2A 2HD<br />
CAB International<br />
Bibliothèque<br />
Wallingford<br />
Oxon OX10 8DE<br />
CDS. Centre for Development Studies<br />
Bibliothèque<br />
<strong>Un</strong>iversity College Swansea<br />
Singleton Park<br />
Swansea SA2 8PP<br />
CS. Commonwealth Secretariat<br />
Bibliothèque<br />
10 Carlton House Terrace<br />
Londres SW1Y 5AH<br />
DID. Department for International<br />
Development<br />
Bibliothèque<br />
Abercrombie House<br />
Eaglesham Rd<br />
East Kilbri<strong>de</strong><br />
G<strong>la</strong>sgow G75 8EA<br />
DLIODS. David Livingstone Institute<br />
of Overseas Development Studies<br />
<strong>Un</strong>iversity of Strathcly<strong>de</strong><br />
G<strong>la</strong>sgow G1 1XG<br />
DPPC. Development ans Project<br />
P<strong>la</strong>nning Centre<br />
<strong>Un</strong>iversity of Bradfort<br />
Bradford BD7 1DP<br />
http://www.brad.ac.uk/acad/dppc/<br />
homepage.html<br />
ICS. Institute of Commonwealth<br />
Studies<br />
<strong>Un</strong>iversity of London<br />
27-28 Russel Sq.<br />
Londres WC1B 5DS<br />
IDC. International Development Centre<br />
<strong>Un</strong>iversity of Oxford<br />
Bibliothèque<br />
Queen Elisabeth House<br />
21 St Giles<br />
Oxford OX1 3LA<br />
http://www.qeh.ox.ac.uk<br />
ILAS. Institute of Latin American<br />
Studies<br />
<strong>Un</strong>iversity of London<br />
Bibliothèque<br />
31 Tavistock Sq<br />
Londres WC1H 9HA<br />
NRI. Natural Resources Institute<br />
Central Ave<br />
Chatham<br />
Kent ME4 4TB<br />
Email martin.hebblethwaite@nri.org<br />
Oxfam<br />
274 Banbury Rd<br />
Oxford OX2 7DZ<br />
SCF. Save the Children Fund<br />
Bibliothèque<br />
Mary Datchelor House<br />
17 Grove Lane<br />
Camberwell<br />
London SE5 8RD<br />
SOAS. School of Oriental ans African<br />
Studies<br />
<strong>Un</strong>iversity of London<br />
Thornhaugh St, Russel Sq,<br />
Londres WC1H 0XG<br />
Email intrafrin@clusl.ulcc.ac.uk<br />
UNIC. <strong>Un</strong>ited Nations Information<br />
Centre<br />
Buckingham Gate<br />
Londres SW1E 6LB<br />
PAYS-BAS<br />
ASC. African Studies Centre<br />
Bibliothèque & documentation<br />
Postbus 9555<br />
2300 RB Lei<strong>de</strong>n<br />
Email <strong>de</strong>rijk@rulfsw.lei<strong>de</strong>n<strong>Un</strong>iv.nl<br />
http :www.lei<strong>de</strong>nuniv.nl/ugids/h12/z00<br />
1.btm<br />
CEDLA. Centre for Development<br />
in Latin America<br />
Keizersgracht 395-397<br />
1016 EK Amsterdam<br />
Email ced<strong>la</strong>@sara.nl<br />
http://www.frw.uva.nl/rei/ced<strong>la</strong><br />
CICAT. Management Centre<br />
for International Cooperation<br />
Delft <strong>Un</strong>iversity of Technology<br />
P.O. Box 5048<br />
2600 GA Delft<br />
Email cicatdoc@ct.tu<strong>de</strong>lft.nl<br />
http://www.tu<strong>de</strong>lft.nl/til<strong>de</strong>frcicat<br />
NUFFIC. Nether<strong>la</strong>nds Organization<br />
for International Cooperation in Higher<br />
Education<br />
P.O. Box 29777<br />
2518 TH La Haye<br />
Email nuffic@nuffic.nl<br />
http://www.nuffic.nl<br />
ECDPM. European Centre for<br />
Development Policy Management<br />
Onze lieve Vrouweplein 21<br />
6211 HE Maastricht<br />
Email info@eedpm.org<br />
http://www.oneworld.org/ecdpm<br />
IICD. International Institute for<br />
Communication and Development<br />
Juffrouw Idastraat 11<br />
P.O. Box 11586<br />
2502 AN La Haye<br />
Email information@iicd.org<br />
http://www.iicd.org<br />
ISS. Institute of Social Studies<br />
Bibliothèque & Documentation<br />
P.O. Box 29776<br />
2502 LT La Haye<br />
Email kooijman@iss.nl<br />
http://www.iss.nl/services/intro6.htm<br />
KIT. Royal Tropical Institute<br />
Information. Bibliothèque &<br />
Documentation<br />
Postbox 95001<br />
1090 HA Amsterdam<br />
Email library@kit.nl<br />
http://www.kit.nl/IBD<br />
RC International Water and Sanitation<br />
Centre<br />
Postbox 93190<br />
2509 ADLa Haye<br />
Email general@irc.nl<br />
http://www.oneworld.org/ircwater<br />
<strong>Un</strong>iversity Library and PUDOC<br />
Agricultural <strong>Un</strong>iversity Library<br />
an-Kopshuis, Postbox 9100<br />
6700 HA Wageningen<br />
Email <strong>de</strong>help<strong>de</strong>sk@pd.bib.wau.nl<br />
http://www.bib.wau.nl<br />
VIIO. Association for Information and<br />
International Development<br />
Buitenpepersdreef 166<br />
5231 HJ Den Bosch<br />
Email viio@antenna.nl<br />
http://www.antenna.nl/viio<br />
SCANDINAVIE<br />
Danemark<br />
CAS. Center for Afrikastudier<br />
Kobmagerga<strong>de</strong> 46,4<br />
1150 Copenhague K<br />
Tél. +45 35 32 25 87<br />
Fax + 45 35 32 25 90<br />
Email ahi@teol.ku.dk<br />
http://www.ku.dk/teo/cas.html<br />
CDR. Centre for Development<br />
Researdh<br />
Gammel Kongevej 5<br />
1610 Copenhague V<br />
Tél. +45 33 25 12 00<br />
Fax +45 33 25 81 10<br />
Email library@cdr.dk<br />
http://www.cdr.dk<br />
Danida<br />
Asiatik P<strong>la</strong>ds 2<br />
1448 Copenhague K<br />
Tél. +45 33 92 09 56<br />
Fax +45 33 92 04 93<br />
Email dandamra@inet.uni-c.dk<br />
http://www.um.dk<br />
Danidas Kursuscenter<br />
P.O. 10, Skovvej 7<br />
3100 Hornbaek<br />
Tél. +45 49 70 10 00<br />
Fax +45 49 70 10 73<br />
Email danikurs@inet.uni-c.dk<br />
FNs Informationskontor for <strong>de</strong><br />
Nordiske Lan<strong>de</strong><br />
H.C. An<strong>de</strong>rsen Boulevard 37<br />
1553 Copenhague V<br />
Tél. +45 33 91 21 02<br />
Fax +45 33 14 07 44<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 148
IFU<br />
P.O. 2155, Bremerholm 4<br />
1016 Copenhague K<br />
Tél. + 45 33 63 75 00<br />
Fax+45 33 32 25 24<br />
MS. Mellenfolkeligt Samvirke<br />
Danish Association for International<br />
Cooperation<br />
Borgerga<strong>de</strong> 14 - 1300 Copenhague K<br />
Tél. +45 33 32 62 44<br />
Fax +45 33 14 45 94<br />
NIAS - Norish Institut for Asienstudier<br />
Leifsga<strong>de</strong> 33<br />
2300 Copenhague S<br />
Tél. +45 31 54 88 44<br />
Fax +45 32 96 25 30<br />
Email bib@nias.ku.dk<br />
http://nias.ku.dk<br />
Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong><br />
HEDEK - Healt and Development<br />
Cooperation<br />
P.O. Box 220<br />
Siltasaarenkatu 18 B<br />
00531 Helsinki<br />
Tél. +358 0 39 67 20 39<br />
Fax +358 0 77 32 922<br />
Email irma.kive<strong>la</strong>@stakes.fi<br />
http://www.stakes.fi<br />
KEPA - Servicecentrum för<br />
Bistandssamarbete<br />
Eerinkatu 11 C<br />
00100 Helsinki<br />
Tél. +358 0 58 42 32 20<br />
Fax +358 0 58 42 32 00<br />
Email kepa@katto.kaapeli.fi<br />
http://www.kepa.fi<br />
U-<strong>la</strong>nfsinstitutet<br />
P.O. Box 47<br />
<strong>Un</strong>iversité d’Helsinki<br />
Tavastvägen 153 B<br />
00014 Helsinki<br />
Tél. +358 0 708 47 63<br />
Fax +358 0 708 47 78<br />
Email rsaar@helsinki.fi<br />
Utrikesministeriet, Av<strong>de</strong>lningen för<br />
Utvecklingssamarbete<br />
Skatuddskajen 3<br />
00160 Helsinki<br />
Tél. +358 0 13 41 63 72<br />
Fax +358 0 13 41 63 75<br />
Norvège<br />
CMI - Chr. Michelsen Institute<br />
Fantoftvegen 38<br />
5036 Fantoft<br />
Tél. +47 55 57 41 91<br />
Fax +47 55 54 41 66<br />
Email biblio@ma<strong>de</strong>us.cmi.no<br />
http://www.cmi.no<br />
FN-Samban<strong>de</strong>t i Norge<br />
Srtorgata 33 A<br />
0184 Oslo<br />
Tél. +47 22 20 91 70<br />
Fax +47 22 20 81 42<br />
NORAD<br />
P.O. Box 8034 Dep.<br />
Tollbugt. 31<br />
0030 Oslo<br />
Tél. +47 22 31 44 53<br />
Fax +47 22 31 44 74<br />
NUPI - Norwegian Institute of<br />
International Affairs<br />
P.O. Box 8159 Dep.<br />
0033 Oslo<br />
Tél. +47 22 17 70 50<br />
Fax +47 22 17 70 15<br />
Email tore.gustavsson@nupi.no<br />
http://www.nupi.no<br />
Redd Barna<br />
P.O. Box 6200, Etterstad<br />
Grensesvingen 7, Helsfyr<br />
0602 Oslo<br />
Tél. +47 22 57 00 80<br />
Fax +47 22 67 48 84<br />
Email bibl.rb@normail.no<br />
Senter for Internasjonale Miljo-og<br />
Utviklingsstudier, Noragric<br />
P.O. Box 5001<br />
Tivoli, Norges<br />
Landbrukshogskole i<br />
As 1432 As<br />
Tél. +47 64 94 97 96<br />
Fax +47 64 94 07 60<br />
Suè<strong>de</strong><br />
Dag Hammarskjöldbiblioteket<br />
O. Agatan 27<br />
753 22 Uppsa<strong>la</strong><br />
Tél. +46 18 18 33 50<br />
Fax +46 18 18 39 99<br />
Email gunnel.toren@ub.uu.se<br />
IFLAs ALP-sekretariat<br />
c/o Uppsa<strong>la</strong> <strong>Un</strong>iversitetsbibliotek<br />
P.O. Box 510<br />
Dag Hammarskjöldsväg 111<br />
75 120 Uppsa<strong>la</strong><br />
Tél. +46 18 18 39 89<br />
Fax +46 18 18 39 94<br />
Email if<strong>la</strong>.alp@ub.uu.se<br />
http://www.nlc-bnc.ca/if<strong>la</strong>/vi/1/alp.htm<br />
LAIS - Latinamerika-institutet<br />
<strong>Un</strong>iversitetvägen 10 B<br />
10691 Stockhlom<br />
Tél. +46 8 16 28 87<br />
Fax +46 8 15 65 82<br />
NAI - Nordic Africa Institute<br />
P.O. Box 1703<br />
75147 Uppsa<strong>la</strong><br />
Tél. +46 18 56 22 00<br />
Fax +46 18 12 37 75<br />
Email library@nai.uu.se<br />
SIDA<br />
Sveavägen 20<br />
10525 Stockholm<br />
Tél. +46 8 69 85 00 0<br />
Fax +46 8 69 85 61 5<br />
Email info@sida.se<br />
http://www.sida.se<br />
TVB - Tredje Värl<strong>de</strong>n Biblioteket<br />
Barnängsgatan 23<br />
11641 Stockholm<br />
Tél. +46 8 64 28 72 2<br />
Email tvb@nn.apc.org<br />
SUISSE<br />
AGRECOL Development Information<br />
Schwengistr. 12<br />
4438 Langebruck<br />
Tél. +41 62 390 14 20<br />
Email agrecol@access.ch<br />
Dokumentation <strong>de</strong>r<br />
Arbeitsgemeinschaft Swissaid /<br />
Fastenopfer / Brot für alle / Helvetas /<br />
Caritas<br />
Monbijoustrasse 31<br />
3001 Berne<br />
Tél +41 31 382 12 32<br />
Fax +41 31 382 22 05<br />
Email scoalition@igc.apc.org<br />
BA. Basler Mission<br />
Missionstr. 21<br />
4003 bâle<br />
Tél. +41 61 268 81 11<br />
BAB. Basler Afrika Bibliographien<br />
Klosterberg 21 - 4051 Basel<br />
Tél. +41 61 271 33 45<br />
Fax +41 61 271 31 55<br />
Email bab@bluewin.ch<br />
BE. Bethlehem Mission<br />
Postfach<br />
CH-6405 Immensee<br />
CINFO<br />
Rue Centrale 121<br />
P.O. Box - 2500 Bienne 7<br />
Tél. +41 32-365 80 02<br />
Fax +41 32-365 80 59<br />
Email 100632.2215@compuserve.com<br />
CT. Communauté <strong>de</strong> travail<br />
Documentation<br />
1 av. <strong>de</strong> Cour, P.O. Box 164<br />
1000 Lausanne<br />
Tél. +41 21 612 00 86<br />
Fax +41 22 612 00 99<br />
Email doc@cdt.int.ch<br />
http://www.cdt.int.ch/-doc/<br />
documentation.html<br />
GfEU-GIUB. Dokumentation<br />
Entwicklung und Umwelt<br />
<strong>Un</strong>iversity of Bern<br />
Hallerstr. 12<br />
3012 Berne<br />
Tél. +41 31 631 38 46<br />
HEKS. Hilfswerk <strong>de</strong>n Evangelischen<br />
Kirchen <strong>de</strong>s Schweiz Dokumentation<br />
Stampfenbachstr. 123<br />
P.O. Box 168 - 8035 Zürich<br />
Tél. +41 1 361 66 00<br />
Fax +41 1 361 78 27<br />
Email doku@hekseper.ch<br />
InfoAgrar<br />
Länggasse 85 - 3052 Zollikofen<br />
Tél. +41 31 910 21 91<br />
Fax +41 31 910 21 54<br />
Email info@infoagrar.ch<br />
Doc. Tél. +41 31 910 21 91<br />
Bibliothèque Tél. +41 31 910 21 91<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 149
IC. Intercooperation<br />
Maulbeerstrasse 10<br />
P.O. Box 6724 - 3001 Berne<br />
Tél. +41 31 382 08 61<br />
Email hifback@intercoop.ch<br />
Contact persons : Hilmar Stetter,<br />
Graziel<strong>la</strong> Beuchat, Susanne Zumstein<br />
IUED. Institut <strong>Un</strong>iversitaire d’étu<strong>de</strong>s<br />
du développement<br />
Bibliothèque/Doc. Centre/Périodiques<br />
24 rue Rothschild<br />
P.O. Box 136 - 1211 Genève 21<br />
Tél. +41 22 906 59 20<br />
Fax +41 22 906 59 47<br />
Email Rene.Barbey@iued.unige.ch<br />
http://www.unige.ch/iued<br />
KODIS. Fachstelle für Beruksbildung<br />
in Entwicklungslän<strong>de</strong>rn<br />
Döltschiweg 39<br />
8055 Zurich<br />
Tél. +41 01 454 30 45<br />
Email kodis@bluewin.ch<br />
NADEL<br />
ETH Zentrum<br />
Voltastrasse 24 - 8092 Zürich<br />
Tél. +41 01 632 50 94<br />
Fax +41 01 632 12 07<br />
Email schwickert@na<strong>de</strong>l.ethz.ch<br />
NASA. Nachrichtenstelle<br />
Südliches Afrika<br />
Missionstr. 21 - 4003 Bâle<br />
Tél. +41 61 268 82 33<br />
PSC. Pilgermission St Chrischona<br />
Chrischonarain 200<br />
Tél. +41 61 646 41 11<br />
Fax +41 61 646 45 75<br />
SDC. Swiss Agency for Development<br />
and Cooperation<br />
Eigerstrasse 73 - 3003 Berne<br />
Tél. +41 31 322 34 65<br />
Fax +41 31 324 16 92<br />
Email biblio@sdc.admin.ch<br />
SKAT. Swiss Centre for Development<br />
Cooperation in Technology and<br />
Management<br />
Vadianstrasse 42<br />
9000 ST Gall<br />
Tél. +41 71-228 54 54<br />
Fax +41 71-228 54 55<br />
Email info@skat.ch<br />
http://www.skat.ch<br />
CENTRES DE DOCUMENTATION<br />
DE QUELQUES ORGANISATIONS<br />
INTERNATIONALES<br />
CICR<br />
19 rue <strong>de</strong> <strong>la</strong> Paix<br />
1202 Genève 1l<br />
Tél. + 41 22 734 60 01<br />
Fax +41 22 734 82 80<br />
Email gva@gwn.icrc.org<br />
http://www.icrc.org<br />
OIT<br />
4 route <strong>de</strong>s Morillons<br />
1211 Genève 22<br />
Tél. +41 22 799 61 11<br />
Fax +41 22 798 86 85<br />
Email cabinet@ilo.org<br />
http://www.ilo.org<br />
http://www.ilo.org/public/english/<br />
190bbl/in<strong>de</strong>x.htm<br />
ONU<br />
Pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong>s Nations<br />
1211 Genève 10<br />
Tél. +41 22 917 12 34<br />
Fax +41 22 917 01 23<br />
http://www.unog.ch<br />
HCR<br />
Centre William Rappard<br />
154 rue <strong>de</strong> Lausanne, C.P. 2500<br />
1211 Genève 2 Dépôt<br />
Tél. +41 22 739 81 11<br />
Fax +41 22 731 95 46<br />
Email webmaster@unhcr.ch<br />
http://www.unhcr.ch<br />
OMS<br />
20 Ave Appia<br />
1202 Genève<br />
Tel. +41 22 791 21 11<br />
Banque mondiale<br />
(Programme InfoDev)<br />
Industry and Energy Department<br />
1818 H Street NW<br />
Washington DC 20433 - USA<br />
Tél. + 1 202 477 1234<br />
Fax +1 202 522 3186<br />
Email info<strong>de</strong>v@worldbank.org<br />
http://www.worldbank.org/html/<br />
fdp/info<strong>de</strong>v/info<strong>de</strong>v.html<br />
GreenNet<br />
74-77 White Lion Street<br />
Londres NI 9PF - GB<br />
Tél. +44 171 713 1941<br />
Fax +44 171 837 5551<br />
Email support@gn.apc.org<br />
http://www.gn.apc.org<br />
IDRC. International Development<br />
Research Centre<br />
P.O. Box 8500<br />
Ottawa, ON Canada KIG 3H9<br />
Tél. +1 613 236 6163<br />
Fax +1 613 238 7230<br />
Email info@idrc.ca<br />
http://www.idrc.ca<br />
ITU. International Telecommunications<br />
<strong>Un</strong>ion<br />
P<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s Nations<br />
1211 Genève 20 - Suisse<br />
Tél. +41 22 730 51 11<br />
Fax +41 22 730 6449/730 54 84<br />
Email itumail@itu.int<br />
http://www.itu.ch<br />
ISOC. The Internet Society<br />
International Secretariat<br />
12020 Sunrise Valley Drive,<br />
Suite 210 Reston, VA 22096 - USA<br />
Tél. +1 703 648 98 88<br />
Fax +1 703 648 98 87<br />
Email amr@linus.isoc.org<br />
http://www.isoc.org<br />
http://www.isoc.org/inet98/net.shtml<br />
http://www.isocgva.ch/<strong>de</strong>vsig/<br />
Welcome.html<br />
OneWorld Online<br />
Hedgerley Wood<br />
Red Lane, Chinnor<br />
Oxon, OX9 4BW - GB<br />
Tél. +44 1494 481629<br />
Fax +44 1494 4811751<br />
Email justice@oneworld.org<br />
http://www.oneworld.org<br />
PNUD. Programme <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies<br />
pour le développement<br />
336 East 45th Street. Room 401<br />
New York, NY 10017 - USA<br />
Tél. +1 212 986 0110<br />
Fax +1 212 986 1237<br />
Email hans.dorville@undp.org<br />
http://www.undp.org/undp/comm/<br />
in<strong>de</strong>x.html<br />
WorldTel Ltd<br />
Charles House<br />
5 Regent Street<br />
Londres SW1Y 4LR - GB<br />
Tél. +44 171 389 0500<br />
Fax +44 171 389 0501<br />
Email admin@world-tel.com<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 150
3.<br />
RECENSEMENT<br />
DES ETUDES<br />
PROSPECTIVES<br />
L'incertitu<strong>de</strong> détruit <strong>la</strong> possibilité d'agir<br />
à partir d'une connaissance scientifique, rationnelle du mon<strong>de</strong>
SOMMAIRE<br />
3.1. PERSPECTIVES MONDIALES AYANT DES INCIDENCES SUR L'AFRIQUE ......... 155<br />
3.1.1. Impact <strong>de</strong> l'économie mondiale sur l'Afrique...................................................................157<br />
Scanning the Future : A Long-Term Scenario Study of the World Economy 1990-2015 ...............159<br />
OCDE - Globalization and Linkages to 2020, Challenges and Opportunities for OECD<br />
Countries..........................................................................................................................................163<br />
Les perspectives <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération.................................................................................................164<br />
3.1.2. Impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> régionalisation sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> l'Afrique..................................................165<br />
L'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> régionalisation sur l'Afrique subsaharienne .............................................................167<br />
L'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> régionalisation sur l'Afrique australe et l'océan indien .............................................168<br />
L'impact <strong>de</strong>s économies asiatiques sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> l'Afrique.......................................................171<br />
CHINA 2020 : <strong>de</strong>velopment challenges in the new century/world bank, 1997 ...............................172<br />
Les futures re<strong>la</strong>tions entre le Japon et l'Afrique ..............................................................................176<br />
3.1.3. Impacts <strong>de</strong>s accords et <strong>de</strong>s arrangements institutionnels sur l'Afrique ......................183<br />
L'impact <strong>de</strong> l'OMC sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s économies <strong>africaine</strong>s...........................................................185<br />
Les perspectives <strong>de</strong> l'après Lomé IV...............................................................................................187<br />
Les <strong>de</strong>venirs <strong>de</strong>s régimes monétaires africains et <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l'euro................................191<br />
3.2. LES PROSPECTIVES GENERALES SUR L'AFRIQUE................................................195<br />
<strong>Bi<strong>la</strong>n</strong> rétroprospectif : l'Afrique en <strong>de</strong>venir.......................................................................................197<br />
<strong>Un</strong>e image à long terme <strong>de</strong> l'Afrique (ILTA) au Sud du Sahara (1983) ..........................................201<br />
Les Afriques <strong>de</strong> l'an 2000. Perspectives économiques...................................................................207<br />
L'Afrique subsaharienne : <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise à une croissance durable. Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>prospective</strong><br />
à long terme.....................................................................................................................................214<br />
3.3. LES PROSPECTIVES NATIONALES............................................................................217<br />
Afrique du Sud .................................................................................................................................219<br />
Côte-d'Ivoire 2025............................................................................................................................221<br />
Côte-d'Ivoire horizon 2010 ..............................................................................................................224<br />
Gabon 2025 .....................................................................................................................................226<br />
Madagascar : Vision 2030 ...............................................................................................................228<br />
Maurice : Mauritius. Horizon 2020...................................................................................................231<br />
3.4. LES PROSPECTIVES SECTORIELLES........................................................................235<br />
3.4.1. L'agriculture .........................................................................................................................237<br />
3.4.2. La démographie...................................................................................................................245<br />
Les tendances démographiques <strong>de</strong> l'Afrique : INED, CEPED, PRB...............................................251<br />
3.4.3. L'éducation...........................................................................................................................255<br />
Tendances et projections <strong>de</strong>s effectifs sco<strong>la</strong>ires par <strong>de</strong>gré d'enseignement, par âge<br />
et par sexe, 1960 - 2025 (évaluées en 1993)..................................................................................256<br />
Prospective - Secteur Éducation .....................................................................................................258<br />
3.4.4. L'emploi ................................................................................................................................263<br />
Les dynamiques d'emploi en Afrique subsaharienne, à l'horizon 2025 : les données <strong>prospective</strong>s<br />
du BIT ..............................................................................................................................................264<br />
Prospectives <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion active 1950 – 2010..............................................................................268<br />
Les Dynamiques d'emploi en Afrique subsaharienne en l'An 2010 ................................................270<br />
3.4.5. Énergie - Matières premières .............................................................................................273<br />
Prospectives <strong>de</strong> l'énergie et <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s matières premières ...............................................274<br />
Énergie 2010-2020 ..........................................................................................................................281<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 153
3.4.6. L'environnement..................................................................................................................283<br />
3.4.7. Le financement extérieur....................................................................................................299<br />
Prospective ou perspective <strong>africaine</strong> <strong>de</strong>s transferts extérieurs .....................................................300<br />
3.4.8. La santé ................................................................................................................................309<br />
Ma<strong>la</strong>die, mortalité et santé : Les tendances à l'horizon 2025 en Afrique<br />
au sud du Sahara (ASS) .................................................................................................................310<br />
3.4.9. Les transports .....................................................................................................................319<br />
Perspectives <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> transport à vocation régionale en Afrique australe .........................320<br />
3.4.10. La technologie ..................................................................................................................325<br />
3.4.11. L'urbanisation ...................................................................................................................331<br />
Dynamique <strong>de</strong> l'Urbanisation <strong>de</strong> l'Afrique au Sud du Sahara .........................................................333<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 154
3.1.<br />
PERSPECTIVES MONDIALES<br />
AYANT DES INCIDENCES<br />
SUR L'AFRIQUE
3.1.1.<br />
IMPACT DE<br />
L'ECONOMIE MONDIALE<br />
SUR L'AFRIQUE
Les nombreuses <strong>prospective</strong>s économiques conçues à l'échelle mondiale<br />
traitent l'Afrique <strong>de</strong> manière marginale. La plupart s'accor<strong>de</strong>nt à considérer que les<br />
<strong>de</strong>venirs <strong>de</strong> l'Afrique sont déterminés ou fortement influencés par l'évolution<br />
mondiale.<br />
Nous avons privilégié <strong>de</strong>ux étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s mondiales, celle réalisée par le<br />
Bureau <strong>de</strong> P<strong>la</strong>nification hol<strong>la</strong>ndais et celle réalisée par l'OCDE.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 158
« SCANNING THE FUTURE : A LONG-TERM SCENARIO STUDY<br />
OF THE WORLD ECONOMY 1990-2015 »<br />
OBJECTIFS<br />
André <strong>de</strong> Jong, Gerrit Zalm et al. Dutch,<br />
Central P<strong>la</strong>nning Bureau, La Haye, 1992.<br />
L’objectif initial du Central P<strong>la</strong>nning Bureau (CPB) était <strong>de</strong> disposer d’une <strong>prospective</strong> macroéconomique<br />
pour les Pays-Bas à l’horizon 2015. Or, compte tenu du taux d’ouverture <strong>de</strong> cette<br />
économie, cette étu<strong>de</strong> supposait au préa<strong>la</strong>ble une analyse détaillée <strong>de</strong>s dynamiques <strong>de</strong> l’économie<br />
mondiale.<br />
L’étu<strong>de</strong> du CPB repose sur un découpage du mon<strong>de</strong> en dix gran<strong>de</strong>s régions : Amérique du Nord,<br />
Europe <strong>de</strong> l’Ouest, Japon, Europe Centrale, « <strong>Un</strong>ion soviétique », économies dynamiques d’Asie,<br />
reste <strong>de</strong> l’Asie, Moyen-Orient, Amérique Latine et Afrique sub-saharienne. La région « Afrique »<br />
exclue l’Afrique du Nord (incluse dans le Moyen-Orient) ainsi que l’Afrique du Sud (rattachée, au<br />
même titre que les anciennes possessions britanniques comme l’Australie et <strong>la</strong> Nouvelle-Zé<strong>la</strong>n<strong>de</strong>, à <strong>la</strong><br />
région « Amérique du Nord »).<br />
La projection couvre <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1990 à 2015. Elle s’appuie sur un bi<strong>la</strong>n-diagnostic portant sur <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> 1965-1989.<br />
METHODOLOGIE<br />
L’analyse <strong>de</strong>s <strong>de</strong>venirs possibles <strong>de</strong> l’économie mondiale supposait <strong>de</strong> répondre à trois questions<br />
préa<strong>la</strong>bles :<br />
1. Quels sont les facteurs-clef <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynamique à long terme ?<br />
2. Comment se positionnaient les différentes régions, au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie 90, par rapport<br />
à ces facteurs ?<br />
3. Comment peut-on prévoir l’évolution <strong>de</strong> ces facteurs à l’horizon 2015 dans les différentes<br />
régions ?<br />
Le premier constat réalisé par le CPB est qu’il y a multiplicité <strong>de</strong>s facteurs-clef conditionnant <strong>la</strong><br />
dynamique à long terme <strong>de</strong>s différentes régions mondiales. Le choix <strong>de</strong> ces facteurs est <strong>la</strong>rgement<br />
déterminé par l’approche retenue :<br />
• L’approche en terme d’équilibre général attribue un rôle central au marché pour <strong>la</strong><br />
coordination <strong>de</strong>s agents économiques. Le respect <strong>de</strong>s hypothèses <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence pure et<br />
parfaite conduit à un équilibre général <strong>de</strong>s marchés se doub<strong>la</strong>nt d’un optimum parétien. Les<br />
sources <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance sont à rechercher dans <strong>la</strong> dotation en facteurs <strong>de</strong> production<br />
(ressources naturelles, capital et travail) et dans l’évolution <strong>de</strong> cette dotation. Le rôle <strong>de</strong> l’État<br />
est limité. Il est principalement le gendarme <strong>de</strong>s marchés, le fournisseur <strong>de</strong>s biens publics et<br />
le gestionnaire <strong>de</strong>s externalités.<br />
• La <strong>de</strong>uxième approche, que le CPB rattache à <strong>la</strong> pensée keynésienne, suppose que les<br />
contradictions entre les niveaux micro et macro-économiques peuvent conduire à <strong>de</strong>s<br />
déséquilibres durables. Ceux-ci ne peuvent être résorbés sans intervention <strong>de</strong> l’État. Celui-ci<br />
joue ainsi un rôle actif, non seulement dans le pilotage à court terme <strong>de</strong>s économies, mais<br />
aussi en tant qu’instance <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong>stinée à pallier <strong>la</strong> « myopie <strong>de</strong>s<br />
marchés ».<br />
• L’approche <strong>de</strong> marché se réfère plus ou moins explicitement aux travaux d’Hayek et <strong>de</strong><br />
Schumpeter. L’innovation technologique est le moteur principal d’une croissance sélective où<br />
l’entrepreneur défail<strong>la</strong>nt est exclu du marché. La croissance requiert notamment <strong>de</strong> fortes<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 159
incitations à base <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> propriété, <strong>la</strong> reconnaissance sociale <strong>de</strong>s groupes gagnants<br />
ainsi qu’une faible intervention étatique.<br />
L’analyse menée par le CPB montre que ces facteurs ont tous joué un rôle, évi<strong>de</strong>mment à <strong>de</strong>s<br />
moments différents et avec <strong>de</strong>s intensités variables, dans le développement historique <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
régions mondiales. Ce constat, et l’existence <strong>de</strong> zone <strong>de</strong> recouvrement entre les approches, justifie le<br />
choix du CPB pour une démarche très éclectique dans <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> grille d’analyse <strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong><br />
croissance à long terme emprunte <strong>la</strong>rgement à chacune <strong>de</strong>s écoles (cf. figure 1)<br />
LES SCENARIOS DE L’ECONOMIE MONDIALE<br />
L’impossibilité <strong>de</strong> prévoir avec certitu<strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s facteurs-clef qui conditionneront le<br />
développement à long terme <strong>de</strong> l’économie mondiale, a conduit le CPB à définir 4 scénarios<br />
principaux :<br />
a) Le dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s pôles économiques.<br />
Ce scénario s’inscrit plus spécifiquement dans l’approche du marché où le moteur essentiel <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
croissance est le progrès technique. Le scénario repose sur l’hypothèse d’un transfert d’activité <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
région At<strong>la</strong>ntique vers le bassin Pacifique.<br />
Les entreprises américaines démontrent leur capacité <strong>de</strong> renouvellement face à l’expansion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
zone Pacifique. Le Japon s’ouvre <strong>de</strong> plus en plus à l’économie américaine et aux autres économies<br />
régionales. En revanche, l’Europe ne semble pas en mesure <strong>de</strong> lutter à armes égales avec <strong>la</strong> région<br />
Asie-Pacifique, qui s’avère plus novatrice et plus concurrentielle qu’elle. La propension <strong>de</strong> l’Europe à<br />
privilégier <strong>la</strong> sécurité et <strong>la</strong> stabilité, et son aversion pour le risque prévalent <strong>de</strong> nouveau. Dans ces<br />
conditions, <strong>la</strong> croissance économique européenne est faible ; le chômage s’aggrave et <strong>de</strong>s secteurs<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 160<br />
.
essentiels per<strong>de</strong>nt rapi<strong>de</strong>ment du terrain. L’atonie <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance européenne freine l’é<strong>la</strong>rgissement<br />
<strong>de</strong> l’Europe à l’Est et renforce <strong>la</strong> « tentation protectionniste ».<br />
L’Afrique ne présente aucun avantage lui permettant <strong>de</strong> participer à <strong>la</strong> dynamique évolutive <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone<br />
Asie-Pacifique. Le continent noir conserve <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions privilégiées avec une Europe en déclin re<strong>la</strong>tif<br />
et peu soucieuse <strong>de</strong> son développement économique. Dans ces conditions, les pressions migratoires<br />
s’accentuent et provoquent <strong>de</strong>s tensions fortes en Europe.<br />
b) Renaissance européenne<br />
Ce scénario consacre, comme le précé<strong>de</strong>nt, le rôle moteur du progrès technique dans <strong>la</strong> croissance à<br />
long terme. Toutefois, les besoins <strong>de</strong> financement croissants <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> recherche et<br />
développement conduisent à <strong>de</strong>s alliances stratégiques au niveau mondial. Ces liens, justifiés par les<br />
ren<strong>de</strong>ments d’échelle croissants <strong>de</strong> <strong>la</strong> R&D, passent par <strong>de</strong>s appuis étatiques.<br />
La coordination s’impose aux acteurs. La tradition européenne <strong>de</strong> développement accompagné par<br />
l’État, donne un avantage re<strong>la</strong>tif à l’Europe sur les États-<strong>Un</strong>is. Ceux-ci s’avèrent en effet moins aptes<br />
à gérer <strong>de</strong>s coopérations où les pouvoirs publics renforceraient les externalités. La tentation<br />
protectionniste touche cette fois les États-<strong>Un</strong>is alors que <strong>la</strong> zone Asie-Pacifique est handicapée par <strong>la</strong><br />
politique américaine. Forte <strong>de</strong> ses bonnes performances économiques, l’Europe poursuit sa politique<br />
d’é<strong>la</strong>rgissement à l’Est.<br />
L’Afrique est <strong>la</strong>rgement bénéficiaire <strong>de</strong> cette « renaissance européenne ». L’accroissement <strong>de</strong>s<br />
débouchés pour les produits tropicaux ainsi que le renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération internationale<br />
permettrait une croissance forte (<strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 4% l’an entre 1990 et 2015), <strong>la</strong>rgement supérieure à<br />
l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion (+3,1% par an).<br />
c) Crise mondiale<br />
Les éléments <strong>de</strong> reprise repérables actuellement aux États-<strong>Un</strong>is et en Europe masquent <strong>de</strong> fait un<br />
essoufflement du dynamisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance globale avec <strong>de</strong> très faibles gains <strong>de</strong> productivité. En<br />
dépit <strong>de</strong>s difficultés rencontrées par le Japon (et celles-ci étaient anticipées par le CPB dés le début<br />
<strong>de</strong>s années 90), l’archipel reste structurellement excé<strong>de</strong>ntaire au niveau <strong>de</strong> son commerce extérieur.<br />
L’atonie <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance suscite une montée <strong>de</strong>s tensions entre les blocs régionaux (<strong>Un</strong>ion<br />
Européenne, ALENA, Mercosur...) qui pratiquent <strong>de</strong> multiples formes <strong>de</strong> protectionnisme. Ce repli<br />
re<strong>la</strong>tif retar<strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s technologies.<br />
La fragmentation <strong>de</strong> l’économie mondiale constitue une faiblesse qui pourrait favoriser <strong>la</strong><br />
transformation d’une simple perturbation en un choc systémique dégénérant en une véritable crise<br />
mondiale. L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> CPB montre alors que les coûts induits par cette crise seraient tels, qu’après<br />
quelques année, les gouvernements seraient contraints d’envisager une solution coopérative <strong>de</strong><br />
reprise.<br />
L’Afrique n’échapperait pas à <strong>la</strong> tourmente. Dépendante <strong>de</strong> l’Europe pour ses débouchés et son<br />
financement, l’Afrique <strong>de</strong>vrait enregistrer <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> croissance du PIB inférieurs (+2,3% l’an) à <strong>la</strong><br />
progression démographique.<br />
d) Croissance équilibrée<br />
Ce scénario, même s’il s’avère le plus souhaitable, n’est pas forcément le plus probable. Il suppose <strong>la</strong><br />
réussite <strong>de</strong> divers arbitrages délicats : entre un développement durable et une évolution technologique<br />
dynamique d’une part ; entre <strong>la</strong> liberté donnée à <strong>la</strong> libre entreprise et <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong>s<br />
politiques économiques d’autre part. Ces conditions réunies favoriseraient <strong>la</strong> coopération au niveau<br />
<strong>de</strong>s échanges internationaux avec une diminution sensible <strong>de</strong>s obstacles non tarifaires. L’accélération<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance résulterait essentiellement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation et <strong>de</strong>s économies d’échelle<br />
dynamiques.<br />
Ce contexte mondial est évi<strong>de</strong>mment très favorable à l’Afrique qui enregistrerait une croissance<br />
moyenne <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 5% par an.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 161
APPORTS ET LIMITES DE LA PROSPECTIVE CPB<br />
L’étu<strong>de</strong> du central P<strong>la</strong>nning Bureau constitue probablement <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> économique <strong>la</strong> plus<br />
détaillée <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie. Elle sert <strong>de</strong> référence à <strong>de</strong> nombreux opérateurs et <strong>de</strong> soubassements à <strong>de</strong><br />
multiples analyses sectorielles (notamment dans le domaine <strong>de</strong> l’énergie et <strong>de</strong>s télécommunications).<br />
Bien évi<strong>de</strong>mment, l’Afrique n’était pas au centre <strong>de</strong>s préoccupations du CPB. Elle <strong>de</strong>meure, sinon<br />
ignorée, du moins très marginale. On peut tirer néanmoins <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> du CPB hol<strong>la</strong>ndais 3 conclusions<br />
principales :<br />
1. Le basculement possible <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynamique mondiale <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique vers le Pacifique ignore<br />
totalement l’Afrique alors que le dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s pôles économiques serait déterminant<br />
pour l’Amérique <strong>la</strong>tine.<br />
2. Quelques soient les scénarios, l’Afrique <strong>de</strong>meure marginale mais pas autonome. Comme<br />
le montre le graphique ci-<strong>de</strong>ssous, son <strong>de</strong>venir économique est très fortement lié à celui <strong>de</strong><br />
l’Europe.<br />
Taux <strong>de</strong> croissance du PIB <strong>de</strong> l’Afrique (en %)<br />
5<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
Crise mondiale<br />
1,5 2 2,5 3 3,5<br />
e l’Europe Occi<strong>de</strong>ntale (en %)<br />
Renaissance européenne<br />
Croissance équilibrée<br />
Dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s pôles économiques<br />
Croissance<br />
démographique<br />
3. Les scénarios conduisent à <strong>de</strong>s images <strong>de</strong> l’Afrique à long terme très contrastées. L’écart<br />
entre le PIB par habitant dans le scénario <strong>de</strong> crise et dans celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance équilibrée<br />
est <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 1 à 2. Sur une base 100 en 1965, le PIB par habitant serait, en 2015, à 77<br />
environ dans le premier cas et à 145 dans le second. Le scénario <strong>de</strong> crise mondiale<br />
consacrerait le déclin absolu <strong>de</strong> l’Afrique dont le niveau <strong>de</strong> revenu par tête serait, en 2015,<br />
<strong>de</strong> 30% inférieur à celui <strong>de</strong> 1965 ! A l’inverse, le scénario <strong>de</strong> croissance équilibrée renvoie<br />
l’image assez positive d’une Afrique dont les rythmes <strong>de</strong> croissance flirterait avec les 5%<br />
par an.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 162
OCDE – GLOBALIZATION AND LINKAGES TO 2020<br />
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR OECD COUNTRIES<br />
INTERNATIONAL HIGH-LEVEL EXPERTS MEETINGS<br />
Paris, 1997<br />
Cette étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> ne traite que très marginalement <strong>de</strong> l'Afrique. Elle met en relief <strong>la</strong><br />
globalisation, l'insertion <strong>de</strong> l'Asie <strong>de</strong> l'Est, <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong>s exportations chinoises à haute intensité <strong>de</strong><br />
travail ou les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> libéralisation du commerce et <strong>de</strong>s investissements dans différents continents<br />
tels que l'Amérique Latine et en Afrique. Elle montre <strong>la</strong> forte différenciation entre les continents.<br />
L'irréversibilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> globalisation n'est pas garantie (cas <strong>de</strong> chocs pétroliers, crise <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte).<br />
La globalisation est bénéfique mais elle provoque <strong>de</strong>s ajustements structurels et crée <strong>de</strong>s gagnants et<br />
<strong>de</strong>s perdants.<br />
Le rapport considère qu'il faut avoir une gran<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>stie, <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts peuvent arriver. Il y a<br />
montée <strong>de</strong> guerres locales. Le développement économique ne peut à lui seul définir le futur. Il y a<br />
crise d'i<strong>de</strong>ntification et <strong>de</strong> confiance. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> démocratie transcen<strong>de</strong> toutefois les différences<br />
culturelles. Le XXIe siècle peut ne pas être dominé par l'Ouest. Les évolutions technologiques seront<br />
centrales mais imprévisibles. Les produits à haute intensité <strong>de</strong> savoir auront une p<strong>la</strong>ce croissante<br />
dans les pays <strong>de</strong> l'OCDE.<br />
Le rapport note un découp<strong>la</strong>ge mondial <strong>de</strong>s dynamiques démographiques et économiques. Le<br />
PNB moyen <strong>de</strong>s 44 pays à faible revenu (2 milliards d'hommes) est 80 fois plus faible que celui <strong>de</strong>s 24<br />
pays à revenu élevé (800 millions). Les écarts en parité <strong>de</strong> pouvoir d'achat sont <strong>de</strong> 1 à 20.<br />
L'Afrique n'est pas appréhendée ni au niveau global ni dans les liens qu'elle noue avec le reste<br />
du mon<strong>de</strong>.<br />
Plusieurs facteurs spécifiques <strong>de</strong> l'Afrique sont toutefois indiqués : <strong>de</strong>rnier à amorcer sa<br />
transition démographique, mobilité du peuplement, forte urbanisation par les migrations, faible capital<br />
physique hérité <strong>de</strong> l'histoire, priorité accordée à l'emploi sur <strong>la</strong> productivité, vulnérabilité aux chocs<br />
extérieurs, jeunesse et inexpérience <strong>de</strong>s Etats post coloniaux.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 163
LES PERSPECTIVES DE LA COOPERATION<br />
CAD/OCDE, 1996<br />
De très nombreux documents réalisés par les instances <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> se p<strong>la</strong>cent dans un horizon <strong>de</strong><br />
long terme. Nous avons retenu le document du CAD/OCDE : Le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération pour le<br />
développement à l"aube du XXIème siècle, Paris, Mai 1996.<br />
Les défis et les potentialités sont liés à <strong>la</strong> mondialisation, aux interdépendances entre<br />
économies, à l'augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion mondiale qui passera <strong>de</strong> 1990 à 2015 <strong>de</strong> 5 à 7,5<br />
milliards d'habitants, aux disparités croissantes entre et à l'intérieur <strong>de</strong>s pays. Des pressions<br />
grandissantes s'exercent sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l'eau, <strong>de</strong>s sols et <strong>de</strong> l'air, sur <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> biodiversité,<br />
l'épuisement <strong>de</strong>s ressources halieutiques.<br />
Les leçons du passé montrent d'importants progrès <strong>de</strong>puis 1950 ; l'espérance <strong>de</strong> vie s'est<br />
allongée <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> vingt ans dans les pays en développement (41 à 62 ans), le pourcentage <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion ayant accès à l'eau propre s'est multipliée par <strong>de</strong>ux (<strong>de</strong> 35 à 70 %), le taux<br />
d'alphabétisation <strong>de</strong>s adultes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 50 ans est passé <strong>de</strong> 50 % à plus <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tiers, La<br />
production et <strong>la</strong> consommation alimentaires se sont accrus à un rythme supérieur d'environ 20 % à<br />
celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance démographique.<br />
Le rapport précise certains objectifs à atteindre en 2015:<br />
- dans le domaine du bien être économique : réduire <strong>de</strong> moitié le pourcentage d'habitants<br />
vivant dans l'extrême pauvreté,<br />
- dans le domaine social : assurer une éducation primaire à tous, réduire fortement les<br />
inégalités par sexes, faire chuter <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tiers les taux <strong>de</strong> mortalité juvénile et infantile,<br />
- dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> durabilité et remise en état <strong>de</strong> l'environnement, réaliser un<br />
développement durable...<br />
Le soutien international <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> doit s'appuyer sur le partenariat, assurer une meilleure<br />
coordination en appui aux stratégies locales, une garantie <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohérence entre les politiques d'ai<strong>de</strong>,<br />
augmenter les ressources.<br />
Le rapport souligne que seuls quatre <strong>de</strong>s 21 pays membres du CAD atteignent l'objectif <strong>de</strong><br />
0,7 % du PNB fixé par les Nations <strong>Un</strong>ies en 1970. Or <strong>la</strong> moyenne au sein du CAD est <strong>de</strong> 0,3 %.<br />
Appréciation<br />
Ces documents internationaux définissent <strong>de</strong>s objectifs inaccessibles et ne peuvent, pour <strong>de</strong>s<br />
raisons diplomatiques, traduire ces objectifs en moyens différenciés selon les zones et hiérarchisés.<br />
Compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> l'APD, les objectifs ont peu <strong>de</strong> chance d'être réalisés d'ici l'an 2015.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 164
3.1.2.<br />
IMPACT DE<br />
LA REGIONALISATION<br />
SUR LE DEVENIR DE L'AFRIQUE
La régionalisation accompagne le processus en cours <strong>de</strong> globalisation. On observe<br />
un nouveau régionalisme organisé autour <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tions verticales Nord/Sud. Celui-ci<br />
est plus ou moins institutionnalisé. Ces re<strong>la</strong>tions régionales auront <strong>de</strong>s impacts<br />
importants sur les dynamiques futures <strong>de</strong> l'Afrique. Celle-ci, à <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> l'Asie<br />
<strong>de</strong> l'Est autour du pôle japonais et <strong>de</strong>s réseaux chinois ou <strong>de</strong> l'Amérique <strong>la</strong>tine autour<br />
du pôle nord-américain, est peu entraînée par le pôle européen.<br />
Nous avons sélectionné les travaux consacrés à <strong>la</strong> régionalisation en Afrique<br />
australe et aux effets <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s économies asiatiques sur l'Afrique.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 166
L'IMPACT DE LA REGIONALISATION<br />
SUR L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE<br />
Les travaux sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> <strong>la</strong> régionalisation dans un contexte <strong>de</strong> globalisation sont très<br />
nombreux. Cf. notamment :<br />
- GEMDEV (1999), La mondialisation, les mots et les choses, Paris, Kartha<strong>la</strong>.<br />
- Hugon, Ph. (1997), Economie politique internationale et mondialisation, Paris, Economica<br />
Poche.<br />
- CERED (étu<strong>de</strong> dirigée par Ph. Hugon) (1993), La régionalisation comparée en Afrique Sub-<br />
Saharienne et en Asie <strong>de</strong> l'Est, Tiers Mon<strong>de</strong>, sept.-nov.<br />
Le commerce international se structure autour <strong>de</strong> grands blocs commerciaux régionaux<br />
(ALENA, APEC, ASEAN, MERCOSUR). De nombreux projets <strong>de</strong> libre échange intra américains (Zone<br />
<strong>de</strong> libre échange en 2005), entre l'<strong>Un</strong>ion européenne et le Mercosur, au sein <strong>de</strong> l'ASEAN (AFTA),<br />
entre l'<strong>Un</strong>ion européenne et les pays du mon<strong>de</strong> méditerranéen ou l'Afrique du Sud conduisent à un<br />
démantèlement <strong>de</strong>s protections et à <strong>de</strong>s accords sur <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> réciprocité. L'ancrage aux blocs<br />
commerciaux est stratégique pour les pays africains qui, à défaut, risquent d'être fortement<br />
marginalisés.<br />
Il y aura vraisemb<strong>la</strong>blement:<br />
- concurrence <strong>de</strong>s nouveaux pays émergents d'Asie, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise actuelle, tant sur le<br />
p<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s exportations traditionnelles <strong>de</strong> l'Afrique que <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétitivité <strong>de</strong>s produits<br />
transformés à bas coûts sa<strong>la</strong>riaux, avec néanmoins interrogation sur l'infléchissement<br />
possible <strong>de</strong> ce processus(cf. le krach financier d'août 1997 et <strong>la</strong> crise économique profon<strong>de</strong><br />
qui s'en suit). Les risques <strong>de</strong> dévaluation en chaîne asiatique sont grands pour <strong>de</strong>s<br />
économies <strong>africaine</strong>s rattachées à un euro fort.<br />
- montée en puissance <strong>de</strong> l'économie immatérielle et <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> l'information et<br />
concurrence sur <strong>de</strong>s marchés monopolistiques caractérisés par <strong>de</strong>s différenciations <strong>de</strong><br />
produits et une compétitivité qualité.<br />
- instabilité à court terme et tendance à long terme dépressive <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s matières<br />
premières exportées par l'Afrique. Les quantités <strong>de</strong> matières premières par unité <strong>de</strong> produit<br />
ont baissé en moyenne <strong>de</strong> 1,25 % par an <strong>de</strong>puis 1900.<br />
Les tendances plus incertaines portent sur l'évolution <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s produits alimentaires. D'un<br />
côté, il existe <strong>de</strong>s réserves <strong>de</strong> productivité créant une pression à <strong>la</strong> baisse. De l'autre, <strong>la</strong> libéralisation<br />
<strong>de</strong>s marchés dans le cadre <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> l'OMC doit réduire l'offre. Enfin <strong>de</strong>s pays tels <strong>la</strong> Chine<br />
pèsent considérablement. Les prévisions <strong>de</strong> <strong>la</strong> F.A.O. pour 2010 prévoient pour l'agriculture mondiale<br />
une croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> production suffisante pour répondre à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, un accroissement <strong>de</strong>s<br />
échanges mondiaux et une baisse <strong>de</strong>s prix réels mais plus faible que durant <strong>la</strong> décennie quatre vingt.<br />
L'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise asiatique et <strong>de</strong>s marchés émergents est plus incertain. Elle crée à <strong>la</strong> fois<br />
<strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> contagion et <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> report. Les économies européennes ont bénéficié, dans un<br />
premier temps, d'un report <strong>de</strong>s capitaux sur <strong>de</strong>s marchés à moindre risque qui ont dopé <strong>la</strong> bourse . La<br />
baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> production asiatique a favorisé une forte chute <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s matières premières et<br />
notamment du pétrole qui en 1998 avait un prix réel du niveau <strong>de</strong> 1972. En revanche, les économies<br />
asiatiques ont vu leurs monnaies se dévaluer et leur consommation <strong>de</strong> biens et services se réduire.<br />
Elles n'ont plus porté <strong>la</strong> dynamique <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance mondiale par leurs importations et sont <strong>de</strong>venues<br />
<strong>de</strong>s concurrents au niveau <strong>de</strong>s biens et services.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 167
L'IMPACT DE LA REGIONALISATION<br />
SUR L'AFRIQUE AUSTRALE ET L'OCEAN INDIEN<br />
LES PRINCIPALES ORGANISATIONS REGIONALES<br />
L'IOR (Indian Ocean Rim), les associations économiques<br />
et les réseaux chinois<br />
1. La SADC (Southern African Development Community) créée en 1980 est une organisation<br />
commerciale dont le principal avantage est <strong>de</strong> développer le commerce intra-régional. <strong>Un</strong><br />
certain nombre <strong>de</strong> protocoles ont été signés en matière <strong>de</strong> commerce, d'énergie, <strong>de</strong><br />
transport et <strong>de</strong> communication. La libéralisation du commerce inter-régional, ajoutée à <strong>la</strong><br />
puissance industrielle <strong>de</strong> l'Afrique du Sud, pourrait mettre en péril l'industrie mauricienne.<br />
Les secteurs vulnérables sont : les boissons alcooliques, le tabac et l'industrie chimique.<br />
2. La COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) a été créée en 1981 et a<br />
institué en 1983 le Marché Commun <strong>de</strong> l'Afrique <strong>de</strong> l'Est et <strong>de</strong> l'Afrique Australe. Cette<br />
organisation vise à promouvoir et à développer les échanges entre les 22 pays membres ;<br />
les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> Corne <strong>de</strong> l'Afrique (Djibouti, Erythrée, Éthiopie, Soudan, Somalie), <strong>de</strong><br />
l'Afrique Australe (Ango<strong>la</strong>, Lesotho, Ma<strong>la</strong>wi, Namibie, Swazi<strong>la</strong>nd, Zambie, Zimbabwe), <strong>de</strong><br />
l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest et centrale (Burundi, Kenya, Mozambique, Ouganda, Rwanda,<br />
Tanzanie) et les Iles <strong>de</strong> l'Océan Indien (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles). Ce<br />
vaste marché représente plus <strong>de</strong> 300 millions d'habitants. Il permet <strong>la</strong> création d'une zone<br />
<strong>de</strong> libre-échange, d'un co<strong>de</strong> d'investissement et d'une union douanière. Des taux<br />
préférentiels permettent aux entreprises <strong>de</strong> compenser <strong>la</strong> meilleure compétitivité <strong>de</strong>s<br />
entreprises asiatiques sur les marchés africains. Ces taux auraient dû s'abaisser <strong>de</strong> 70 %<br />
en 1996 pour atteindre 100 % en l'an 2000. Mais seulement 6 pays respectent le calendrier<br />
<strong>de</strong>s abaissements tarifaires qui en fait <strong>la</strong> raison d'être <strong>de</strong> <strong>la</strong> COMESA. En conséquence, le<br />
faible engagement <strong>de</strong>s pays membres dans cette organisation risque <strong>de</strong> leur porter<br />
préjudice et pour l'organisation d'être inopérante, sans pouvoir.<br />
3. La Commission <strong>de</strong> l'Océan Indien (COI) (créée en 1982).<br />
Son objectif principal est <strong>de</strong> favoriser le développement économique, social et culturel <strong>de</strong><br />
manière collective et durable entre les 5 États du Sud-Ouest <strong>de</strong> l'Océan Indien<br />
(Madagascar, Seychelles, Comores, Réunion, Maurice) qui y ont adhéré. C'est une<br />
organisation <strong>de</strong> développement régional et <strong>de</strong> coopération. favorisant les échanges<br />
commerciaux par abaissement tarifaire ; ces échanges sont encore faibles en comparaison<br />
<strong>de</strong>s échanges <strong>de</strong> chaque pays avec le reste du mon<strong>de</strong>. Le principal importateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone<br />
est <strong>la</strong> Réunion, alors que les principaux fournisseurs sont Madagascar et Maurice. Les<br />
re<strong>la</strong>tions entre <strong>la</strong> Réunion et Maurice s'améliorent, plus particulièrement sous l'impulsion <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ux chambres <strong>de</strong> commerce qui viennent <strong>de</strong> passer un accord <strong>de</strong> coopération. Les<br />
économies <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux Iles <strong>de</strong> concurrentes <strong>de</strong>viennent complémentaires.<br />
4. L'IOR-ARC (Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation) est une association<br />
en cour d'é<strong>la</strong>boration dont <strong>la</strong> charte constitutive a été adoptée en mars 1997 par 14 États<br />
membres et qui s'articule autour <strong>de</strong> 3 puissances régionales : l'Australie, l'Afrique du Sud et<br />
l'In<strong>de</strong>. Plusieurs projets sont en œuvre : le commerce, le tourisme et échanges<br />
d'enseignants, diffusion <strong>de</strong> données économiques et promotion d'investissements. Dans ce<br />
contexte, l'Île Maurice constitue un pont commercial et financier entre le Sud-Est <strong>de</strong> l'Asie et<br />
le Sud <strong>de</strong> l'Afrique. Des stratégies <strong>de</strong> partenariat se créent : Afrique du Sud : ressources<br />
minières/valeur ajoutée <strong>de</strong> l'électronique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Thaï<strong>la</strong>n<strong>de</strong> ; le textile <strong>de</strong> Maurice au pétrole<br />
<strong>de</strong>s pays du Golfe/les logiciels <strong>de</strong> l'In<strong>de</strong>. Il sera possible d'investir en Chine et d'organiser<br />
les délocalisations. A côté <strong>de</strong> l'IOR-ARC, s'est juxtaposé l'IORBF (Indian Ocean Rim<br />
Business Forum) et IORAG (Indian Ocean Rim Aca<strong>de</strong>mix Group). Ces associations<br />
tiennent <strong>de</strong>s réunions avec les membres du conseil <strong>de</strong>s ministres.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 168
LES PERSPECTIVES DE COOPERATION DANS L'OCEAN INDIEN<br />
Le processus du développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération dans l'Océan Indien s'opère en plusieurs<br />
étapes :<br />
1. La première étape : Initiative Transfrontalière (ITF)<br />
La Conférence Européenne <strong>de</strong> Maastricht sur le développement en Afrique (1990) a<br />
recommandé une approche pragmatique impliquant une participation du secteur privé. La<br />
Commission Européenne, <strong>la</strong> Banque Africaine <strong>de</strong> Développement, le FMI et <strong>la</strong> Banque<br />
Mondiale coopèrent pour mettre en p<strong>la</strong>ce une initiative qui ne se substitue pas aux<br />
organisations régionales et s'intitule : "Initiative pour réduire les obstacles au commerce, aux<br />
investissements et aux paiements régionaux en Afrique <strong>de</strong> l'Est, Australe et Océan Indien"<br />
ou encore dénommée "l'Initiative transfrontalière ITF". Cette association sert à améliorer les<br />
bases d'une intégration économique régionale en Afrique Australe, Orientale et dans l'Océan<br />
Indien. L'ITF i<strong>de</strong>ntifie les obstacles au commerce, aux investissements et aux paiements<br />
intra-régionaux. Les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> région, <strong>la</strong> COI, <strong>la</strong> COMESA, <strong>la</strong> SADC ont été invitées à<br />
participer à cette initiative. Elle formule <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> politique économique puis les met<br />
en œuvre conjointement avec les organisations <strong>de</strong> leurs États membres dans l'objectif <strong>de</strong> les<br />
ai<strong>de</strong>r à réaliser leurs propres objectifs d'intégration régionale.<br />
2. La <strong>de</strong>uxième étape : "Indian Ocean Rim Initiative" (IORI) (1995) fut organisée par le<br />
gouvernement mauricien, formé <strong>de</strong> 7 pays (M7), appelé groupe exclusif (Australie, In<strong>de</strong>,<br />
Kenya, Maurice, Oman, Singapour et l'Afrique du Sud). Des discussions tripartites<br />
(représentants <strong>de</strong>s gouvernements, secteur privé, universitaires) sont organisées pour :<br />
a) bâtir un consensus autour du concept <strong>de</strong> l'IOR<br />
b) i<strong>de</strong>ntifier les aires <strong>de</strong> coopération<br />
c) mettre sur pied <strong>de</strong>s actions à entreprendre pour <strong>la</strong> formation effective du groupe IOR.<br />
Ce groupe <strong>de</strong> travail se subdivise en sous-groupes :<br />
• Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)<br />
• le groupe académique : Indian Ocean Rim Aca<strong>de</strong>mic Group (IORAG).<br />
Ces groupes <strong>de</strong> travail préparent les réunions <strong>de</strong> l'IOR et présentent <strong>la</strong> candidature <strong>de</strong> 7<br />
autres pays : l'Indonésie, Madagascar, Ma<strong>la</strong>isie, Mozambique, Sri Lanka, Tanzanie et<br />
Yémen.<br />
3. Troisième étape : "Open Economic Association" (OEA). Après <strong>la</strong> tenue en Australie du<br />
"International Indian Ocean Region" (IFIOR) (1995), qui avait pour but d'examiner<br />
l'établissement futur d'un dialogue et <strong>de</strong> coopération dans l'Océan Indien, l'IOR se pose en<br />
pendant au "Pacific Economic Cooperation Council" (PECC), organisé par APEC pour<br />
l'Asie-Pacifique.<br />
RÉSULTATS<br />
1. L'IOR-ARC versus l'OEA<br />
En considérant les modèles alternatifs <strong>de</strong> développement régional <strong>de</strong> coopération économique<br />
pour l'Océan Indien, on est en présence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux modèles historiques. Dans <strong>la</strong> région Asie-Pacifique,<br />
l'intégration économique <strong>de</strong> facto a procédé par le commerce et les investissements à un processus<br />
actif qui maintenant abouti à un début <strong>de</strong> coopération institutionnalisée en <strong>de</strong>sserrant <strong>la</strong> structure<br />
organisationnelle mais en <strong>la</strong> maintenant par <strong>de</strong>s obligations qui a été nommée "Open Economic<br />
Association" (OEA). Par contraste, les processus d'intégration économique <strong>de</strong> l'Europe, ou même <strong>de</strong><br />
l'Amérique du Nord, sont fondés sur une initiative concernée par l'établissement d'une intégration<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 169
institutionnelle fondée par <strong>de</strong>s traités <strong>de</strong> coopération économiques et commerciaux avant l'émergence<br />
d'une réelle intégration. Avant le fonctionnement <strong>de</strong> l'IOR-ARC il pourrait être mis en œuvre un<br />
concept d'OEA afin d'éviter le carcan institutionnel <strong>de</strong> traités non respectés dans un espace<br />
économique et culturel non intégré.<br />
2. Les réseaux <strong>de</strong> l'Océan Indien<br />
Les multiples diasporas <strong>de</strong> l'Océan Indien ont bien servi le secteur intégrateur au commerce,<br />
aux réseaux <strong>de</strong> distribution et aux investissements directs. A partir <strong>de</strong> Madagascar, <strong>la</strong> Réunion,<br />
Maurice, chaque pays avec ses propres réseaux à investi dans son pays d'origine : In<strong>de</strong>, Singapour,<br />
Ma<strong>la</strong>isie, Chine (et Hong Kong). Les diasporas et communautés chinoises sont à l'origine <strong>de</strong>s<br />
"triangles <strong>de</strong> croissance" et continuent en se développant pour accroître l'intégration régionale. Les<br />
solidarités <strong>de</strong>s communautés chinoises sont bien connues sur le p<strong>la</strong>n culturel, économique et<br />
financier. Par exemple, entre Maurice et Hong Kong, un réseau ethnique s'est organisé <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s<br />
décennies et a favorisé l'échange et les investissements dans les <strong>de</strong>ux sens, surtout pour le<br />
commerce du textile et <strong>de</strong> l'habillement. Les alliances avec <strong>de</strong>s entrepreneurs locaux se sont<br />
graduellement mises en p<strong>la</strong>ce en vue d'assurer une sécurité <strong>de</strong> l'investissement et minimiser le risque.<br />
Ouvrages :<br />
Bouteiller, E. (1992), Les chinois <strong>de</strong> <strong>la</strong> diaspora, coll. HEC, Eurasia Institute, Jouy-en-Josas.<br />
De<strong>la</strong>une, F. (1998), <strong>Un</strong> exemple <strong>de</strong> coopération décentralisée : le réseau chinois, Mon<strong>de</strong>s en<br />
développement, tome 26, n° 101.<br />
Dufour, J.F. (1998), Investissements et globalisation dans les NPI asiatiques, Dunod, Paris.<br />
Hugon, Ph. (sous <strong>la</strong> direction) (1998), La régionalisation comparée en Afrique Sub-Saharienne et en<br />
Asie <strong>de</strong> l'Est, Tiers Mon<strong>de</strong>, sept-nov.<br />
Kennes, W., Mansoor, A. (1995), L'Europe face à l'initiative transfrontalière, Mon<strong>de</strong>s en<br />
développement, tome 23, n° 92.<br />
Rakotondrazafy, J. (1999), Investissements directs étrangers et industrialisation dans les pays en<br />
développement, cas <strong>de</strong> Madagascar et Maurice, Thèse <strong>de</strong> doctorat es Sciences Economiques,<br />
Bor<strong>de</strong>aux.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 170
L'IMPACT DES ECONOMIES ASIATIQUES<br />
SUR LE DEVENIR DE L'AFRIQUE<br />
Même si l'Afrique esr re<strong>la</strong>tivement marginalisée <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s dynamiques mondiales et<br />
régionales, le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s économies asiatiques est stratégique quant à leur évolution.<br />
Nous avons sélectionné <strong>de</strong>ux étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s.<br />
TROIS SCENARIOS POUR L'AVENIR DES ECONOMIES ASIATIQUES 1<br />
Il y a, me semble-t-il, trois scénarios pour l'avenir <strong>de</strong>s économies asiatiques. Appelons-les<br />
"Mexique 95", "Mexique 82" et "Fin du mon<strong>de</strong> civilisé".<br />
"Mexique 95" est le scénario que tous espèrent <strong>de</strong>puis le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise : après un choc court<br />
et violent se produit un retournement du marché. Le capital revient massivement et <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
zone rejoint son rythme <strong>de</strong> 8 % l'an.<br />
"Mexique 82" est un scénario plus triste. Les investisseurs, après avoir été tondus, restent<br />
méfiants en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> persistance <strong>de</strong>s problèmes structurels. Ils ne fuient plus, mais ne reviennent<br />
pas non plus en force. Les pays sont entraînés dans une série <strong>de</strong> rééchelonnements <strong>de</strong> leurs <strong>de</strong>ttes,<br />
avec quelques impayés par-ci par-là, et leurs performances <strong>de</strong> croissance restent durablement<br />
médiocres.<br />
Enfin, troisième scénario, celui du désastre : sous le coup <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise, les mouvements <strong>de</strong><br />
protestation popu<strong>la</strong>ire surgissent et échappent à tout contrôle, et un cercle vicieux s'installe, où fuite<br />
<strong>de</strong>s capitaux et violence politique s'entretiennent mutuellement. Les entreprises sont alors dévastées,<br />
et les entrepreneurs <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong>s boat people (…).<br />
S'il fal<strong>la</strong>it faire un choix, je parierais sur le scénario du milieu – ou plutôt sur une version un peu<br />
plus optimiste <strong>de</strong> ce scénario. A mon avis, pendant une pério<strong>de</strong> assez longue, les pays asiatiques<br />
seront contraints <strong>de</strong> négocier <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is avec leurs bailleurs <strong>de</strong> fonds, mais <strong>la</strong> situation va s'améliorer<br />
progressivement. Je ne pense pas que l'Asie soit partie pour une "décennie perdue" <strong>de</strong> croissance<br />
zéro, comme l'Amérique Latine <strong>de</strong>s années 80 (ou le Japon <strong>de</strong>s années 90 !). Ce seront, plus<br />
probablement, <strong>de</strong>ux ou trois années <strong>de</strong> perdues.<br />
1 Extrait <strong>de</strong> Krugman, P. : Retour sur le krack asiatique", in L'expansion, n° 571, 16-29 avril 1998.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 171
OBJECTIFS<br />
CHINA 2020 : <strong>de</strong>velopment challenges<br />
in the new century/World Bank, 1997<br />
« China 2020 Development challenges in the new century » est le premier volume d’un recueil <strong>de</strong> sept<br />
ouvrages traitant <strong>de</strong>s différents problèmes que rencontre <strong>la</strong> Chine actuellement ou qu’elle sera<br />
amenée à rencontrer dans le future.<br />
Ce premier volume est composé <strong>de</strong> différent chapitre représentant les secteurs clés <strong>de</strong> l’économie<br />
chinoise. L’étu<strong>de</strong> débute par un rappel <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation chinoise à l’heure actuelle et se poursuit par<br />
différente projection à horizon 2020 tout en détail<strong>la</strong>nt les défis et les possibilités que sera censé<br />
rencontrer <strong>la</strong> Chine. Ce découpage est repris dans les chapitres suivants pour divers secteurs tel<br />
que : l’agriculture, l ‘environnement, le commerce et <strong>la</strong> finance internationale, <strong>la</strong> force <strong>de</strong> travail…<br />
Ainsi <strong>la</strong> Banque Mondiale dénonce les problèmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> l’économie chinoise et tente d’y<br />
apporter <strong>de</strong>s solutions en proposant les réformes à mettre en œuvre dans chacun <strong>de</strong>s secteurs.<br />
Les auteurs énoncent <strong>de</strong>ux scénarii : les problèmes que rencontrera <strong>la</strong> Chine si les réformes ne sont<br />
pas mises en p<strong>la</strong>ce et les perspectives pour le pays si le gouvernement procè<strong>de</strong> aux changements<br />
nécessaires préconisé par <strong>la</strong> Banque Mondiale .<br />
Enfin l’étu<strong>de</strong> réunit dans trois annexes les métho<strong>de</strong>s employées et les modèles utilisés.<br />
METHODOLOGIE<br />
Le premier modèle<br />
Afin d’expliquer <strong>la</strong> forte croissance chinoise, <strong>la</strong> Banque Mondiale s’appuie sur un modèle<br />
macro-économique du type Solow. Malgré une forte agrégation <strong>de</strong>s éléments, il utilise l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
principaux paramètres <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance. Cependant le facteur résiduel comporte beaucoup<br />
d’inconnus.<br />
Y=F( A, K, H, L)<br />
K= capital<br />
H= capital humain<br />
L= <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active<br />
A= le facteur résiduel<br />
Y= PIB<br />
ainsi l’équation du taux <strong>de</strong> croissance du revenu peut s’écrire:<br />
gY= βKgK +βHgH +βLgL +βAgA<br />
où gK; gH; gL; et gA sont les taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s facteurs et βK; βH; βL;et βA sont les<br />
é<strong>la</strong>sticités revenus <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s facteurs. Autrement dit, lorsque K augmente d’1% β donne l’impact<br />
sur Y. Ils donnent aussi <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance qui peut être expliquée par chacun <strong>de</strong>s facteurs.<br />
Afin <strong>de</strong> définir les déterminants <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance, <strong>la</strong> Banque Mondiale a calculé les différents<br />
taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s différents paramètres calcu<strong>la</strong>bles : PIB, capital, capital humain et <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
active sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1978-1995. Le capital humain a été déterminé par le nombre moyen d’années<br />
d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en âge <strong>de</strong> travailler, déterminé lui même par plusieurs étu<strong>de</strong>s réalisées par<br />
<strong>de</strong> nombreux économistes (Nehru, Dhareshwar, Swanson, Dubey).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 172
Taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s facteurs<br />
1978-1995 en % par an<br />
FACTEURS OFFICIEL RÉEL<br />
PIB 9.4 8.2<br />
CAPITAL 8.8 7.9<br />
CAPITAL HUMAIN 2.7 2.7<br />
POPULATION ACTIVE 2.4 2.4<br />
PART NON EXPLIQUÉE DE LA CROISSANCE<br />
EN % DU PIB<br />
46 43<br />
Source : WORLD BANK. 1997. China 2020, <strong>de</strong>velopment challenges in the new century. The World Bank Washington D.C.<br />
Enfin <strong>la</strong> Banque mondiale nous fournit les é<strong>la</strong>sticités revenus <strong>de</strong>s différents facteurs. Ainsi<br />
nous pouvons connaître l’impact <strong>de</strong> 1% <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong>s facteurs sur le PIB.<br />
E<strong>la</strong>sticités revenus<br />
CAPITAL 0.4<br />
CAPITAL HUMAIN 0.3<br />
POPULATION ACTIVE 0.3<br />
Source : WORLD BANK. 1997. China 2020, <strong>de</strong>velopment challenges in the new century. The World Bank Washington D.C.<br />
Ces résultats ont été trouvés grâce aux travaux empiriques <strong>de</strong> Mankiw, Romer et Weil en<br />
1992 et ont été confirmés par ceux <strong>de</strong> Kim et Lau en 1994-95 ainsi que par Young en 1995.<br />
Grâce aux différentes données, il est possible d’établir que 46% <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance chinoise ou 4,3% <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> croissance par an sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> considérée est expliquée par le facteur résiduel ce qui est hors<br />
norme si l’on regar<strong>de</strong> les facteurs résiduels <strong>de</strong>s autres pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone .<br />
Le second modèle<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce modèle est <strong>de</strong> fournir un cadre simple pour nous éc<strong>la</strong>irer sur les changements <strong>de</strong> rôle<br />
<strong>de</strong>s déterminants <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance en Chine : <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité, l’épargne et les<br />
changements structuraux.<br />
Le modèle présenté est une version multisectorielle du modèle <strong>de</strong> Solow avec une fonction <strong>de</strong><br />
production, <strong>de</strong> consommation et d’accumu<strong>la</strong>tion.<br />
Avec ces 3 équations il est possible <strong>de</strong> décrire <strong>la</strong> trajectoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance du revenu à partir <strong>de</strong><br />
données initiales.<br />
Au lieu d’un seul bien, il y aura N secteurs dans l’économie qui produisent chacun 1 bien.<br />
Chaque bien est produit grâce à différents facteurs : <strong>la</strong> terre, le travail, le capital et <strong>de</strong>s biens<br />
intermédiaires.<br />
Ces biens sont utilisés à leur tour comme <strong>de</strong>s biens intermédiaires dans <strong>la</strong> production <strong>de</strong> d’autres<br />
biens, pour <strong>la</strong> consommation finale et pour l’investissement.<br />
L’économie considérée est composée <strong>de</strong> ménages et d’entreprises.<br />
Les firmes sont <strong>de</strong>man<strong>de</strong>uses <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> production qu’elles utilisent dans <strong>la</strong> fabrication <strong>de</strong> leurs<br />
biens disponibles dans l’économie.<br />
Les ménages fournissent le travail et reçoivent <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires et les profits comme revenus.<br />
<strong>Un</strong>e part exogène du revenu est utilisée pour consommer et pour acheter du capital.<br />
Le troisième modèle<br />
Le troisième modèle tente <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> sur l’évolution <strong>de</strong>s inégalités et <strong>la</strong> pauvreté en<br />
Chine sur 30 provinces.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 173
La constitution du modèle théorique se fait à partir d’équations linéaires.<br />
Le premier calcul consiste à comptabiliser le nombre d’habitant dans chaque province noté : Nj<br />
puis le revenu par habitant noté : yj avec j représentant les différentes provinces (1....30).<br />
Les taux <strong>de</strong> croissance globaux <strong>de</strong>s différents paramètres sont notés gN,gy....<br />
Ainsi on obtient pour les taux <strong>de</strong> croissance dans les provinces :<br />
gNj=gN rNj<br />
gyj= gy ryj<br />
Pour séparer les urbains <strong>de</strong>s ruraux, on note <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s individus vivant dans les villes u*.<br />
ruj =le taux d’urbains <strong>de</strong> <strong>la</strong> province j re<strong>la</strong>tif au taux moyen d’urbains global.<br />
On obtient :<br />
Nuj* = u*ruj Nj<br />
Nrj* = (1-u* ruj) Nj<br />
On note dj* <strong>la</strong> part future re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong> revenu urbains/ruraux dans <strong>la</strong> province j<br />
Les prévisions sur les revenus <strong>de</strong>s urbains yuj* sont donnés par :<br />
yuj*= yj* Nj* /(Nuj + Nrj/dj*)<br />
Pour les ruraux l’équation <strong>de</strong>vient :<br />
yrj*= yj* Nj* /(Nuj dj* + Nrj)<br />
La distribution <strong>de</strong>s revenus dans chaque région est supposée suivre une loi Log Normale et <strong>la</strong> mean<br />
log <strong>de</strong>viation du revenu par habitant est supposé être tij* avec i =u,r et j = 1...30.<br />
Le nombre <strong>de</strong> pauvres s'exprime :<br />
Npoor ij* = Nij* F(P,µij, σij)<br />
où F (P, µ, σ) est une log normale cumu<strong>la</strong>tive avec les parmètres suivants :<br />
σ_ij =2tij*<br />
µij = ln(yij*) - (1/2) σ_ij<br />
Lorsque l’on fait <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s différentes provinces on peut estimer le nombre <strong>de</strong><br />
pauvre c’est à dire le nombre d’individus vivant en <strong>de</strong>ssous d’un certain revenu par habitant fixé par <strong>la</strong><br />
Banque Mondiale.<br />
Pour calculer les inégalités <strong>de</strong> revenu on utilise <strong>la</strong> même métho<strong>de</strong>. L’équation <strong>de</strong>vient :<br />
t = Σ pi ln(y/yi) + ΣΣ pij ln (yi/yij)+ ΣΣ pij tij<br />
où<br />
p est est <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion vivant dans les zones urbaines ou dans les zones rurales.<br />
La résultante nationale <strong>de</strong> <strong>la</strong> log <strong>de</strong>viation du revenu par habitant est trans<strong>la</strong>tée vers un coefficient <strong>de</strong><br />
Gini qui peut être utilisé pour <strong>de</strong>s comparaisons internationales.<br />
On peut calculer au bout <strong>de</strong> combien d’années le taux <strong>de</strong> pauvreté passe en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 5% <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion dans chaque provinces.<br />
Le modèle ne tient pas compte <strong>de</strong>s migrations.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 174
CRITIQUES<br />
Cette <strong>prospective</strong> est stratégique pour l'Afrique en termes <strong>de</strong> compétitivité future. Elle est antérieure à<br />
<strong>la</strong> crise est-asiatique <strong>de</strong> juillet 1997 et n'a pu intégrer les nombreuses incertitu<strong>de</strong>s concernant<br />
notamment le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s flux financiers et le cours du yuan.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Bibliographie du premier modèle<br />
• R.Barro et X Sa<strong>la</strong>-i-Martin. 1995. Economic growth, New York: Mc Graw Hill.<br />
• Burnsi<strong>de</strong>, Craig. 1996. Production Function Regressions, Returns to Scale and Exteral Effects.<br />
Journal of Monetary Economics 3(2) : 177-201.<br />
• Hu, Zuliu, et Moshin Khan. 1996. « Why is China growing so fast? »IMF, Washington.DC.<br />
• Kim Jong-il et Lawrence Lau. 1994. « The Sources of Economic growth of the East Asian Newly<br />
Industrialized Countries. ». Journal of the Japanese and International Economies 8 (3): 235-271.<br />
• Kim Jong-il et Lawrence Lau. 1995. « The Role of the Human Capital in the Economic Growth of<br />
the East Asian Newly Industrialized Countries. ». Asia-Pacific Economic Review 1(3): 3-22.<br />
• A.Kraay. 1996. « A Resilient Residual : Accounting for China Growth Performance in Light of the<br />
Asian Miracle. » World Bank Policy Research Department. Washington.DC.<br />
• A.Maddison. 1995. Monitoring the world Economy. Paris : OECD.<br />
• Mankiw, David Romer et David Weil . 1992. « A Contribution to the Empirics of Economic<br />
Growth. ». Quarterly Journal of Economics 107(2): 407-37.<br />
• V.Nehru Eric Swanson et Ashutosh Dubey .1995. « Anew Database on Human Capital Stock in<br />
Developing and Industrial Countries: Sources, Methodology and Results ». Journal of Development<br />
Economics 46(2): 379- 401.<br />
• World Bank.1996. The Chinese Economy : Fighting Inf<strong>la</strong>tion, Deepening Reforms. Washington.DC.<br />
• Young, Alwyn. 1995. « The Tyranny of Numbers : Confronting the Statistical Realities of the East<br />
Asian Growth Growth Experience ». Quarterly Journal of Economics 100(3): 605-640.<br />
• Young, Alwyn. 1996. The Razor’s Edge: Distortions, Incremental Reform and the Theory of the<br />
Second Best in the People’s Republic of China. Boston : Boston <strong>Un</strong>iversity.<br />
Bibliographie du second modèle<br />
• G.Chow. 1993. « Capital Formationin Economic Growth in China » Quarterly Journal of Economics<br />
108(3) : 809-42.<br />
• V.Nehru Eric Swanson et Ashutosh Dubey .1995. « Anew Database on Human Capital Stock in<br />
Developing and Industrial Countries: Sources, Methodology and Results ». Journal of Development<br />
Economics 46(2): 379- 401.<br />
Bibliographie du troisième modèle<br />
• K.Deininger et L. Squire. 1996. « A New Data Set Measuring Income Inequality ». The World Bank<br />
Economic Review 10(3): 565-91.<br />
• World Bank. 1992. Strategies for Reducing Poverty in the 1990s. Washington DC : World Bank.<br />
• World Bank. 1997. Sharing Rising Incomes: Disparities in China. Washington DC : World Bank.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 175
LES FUTURES RELATIONS ENTRE LE JAPON ET L'AFRIQUE<br />
OBJECTIFS<br />
"Le développement <strong>de</strong> l'Afrique à l'aube du XXIe siècle :<br />
programme <strong>de</strong> Tokyo" TICAD II<br />
Tokyo – 12 au 21 octobre 1998<br />
La première conférence <strong>de</strong> <strong>la</strong> TICAD fut organisée à Tokyo en 1993, afin <strong>de</strong> réunir les<br />
représentants <strong>de</strong>s pays africains, d'insister sur <strong>la</strong> nécessité pour les pays africains d'être les auteurs et<br />
les réalisateurs <strong>de</strong> leur propre stratégie <strong>de</strong> développement ; cette prise <strong>de</strong> conscience fut <strong>la</strong> teneur <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> Tokyo. Les organisateurs étaient : le Gouvernement japonais, <strong>la</strong> CMA (Coalition<br />
Mondiale pour l'Afrique), les Nations <strong>Un</strong>ies (dont l'<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies).<br />
Cette initiative avait aussi pour objectif d'organiser une véritable coopération Asie-Afrique.<br />
Pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième conférence <strong>de</strong> <strong>la</strong> TICAD, les organisateurs mettent l'accent sur "l'Afrique dans<br />
<strong>la</strong> voie du développement économique et social" et formulent <strong>de</strong>s recommandations pour <strong>la</strong> poursuite<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération entre les pays africains et le Japon.<br />
L'ordre du jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> TICAD II a fait l'objet <strong>de</strong> plusieurs réunions en Afrique du comité<br />
préparatoire : Dakar, mars 1998 ; Harare, juin 1998 ; Addis Abeba, septembre 1998 ; ont suivi les<br />
ateliers régionaux organisés par les Ong : Ouagadougou, mai 1998 ; Windhoek, juin 1998 puis juillet<br />
1998 et l'Île Maurice, août 1998.<br />
Afin <strong>de</strong> mettre en œuvre ces objectifs, <strong>de</strong>s questions préa<strong>la</strong>bles sont abordées :<br />
I. QUESTIONS PREALABLES AUX OBJECTIFS FIXES<br />
a. Développement <strong>de</strong> l'Afrique à l'horizon 2015 : développement durable et intégration dans<br />
l'économie mondiale<br />
- Le Programme d'Action pour le Développement <strong>de</strong> l'Afrique met l'accent sur <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pauvreté au moyen d'une croissance économique accélérée, du développement durable et <strong>de</strong><br />
l'intégration <strong>de</strong>s économies <strong>africaine</strong>s dans l'économie mondiale.<br />
A l'horizon 2015, le plus grand défi est <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté (réduction d'au moins 50 %)<br />
pour <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion vivant dans une misère extrême. Pour mettre en œuvre le<br />
développement durable, <strong>la</strong> stabilité sociale ainsi que <strong>la</strong> bonne gouvernance sont essentielles.<br />
- Les efforts <strong>de</strong> développement nécessitent <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté dans une perspective<br />
multi-sectorielle. <strong>Un</strong>e croissance économique, en vue <strong>de</strong> réduire <strong>la</strong> pauvreté, nécessite <strong>la</strong><br />
mise sur pied <strong>de</strong> politiques macro-économiques favorisant <strong>la</strong> stabilité financière,<br />
l'accroissement <strong>de</strong> l'épargne nationale, <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong>s ressources à <strong>de</strong>s fins<br />
d'investissements productifs, <strong>de</strong> créations d'emplois et <strong>la</strong> rationalisation <strong>de</strong>s dépenses<br />
publiques se concentrant sur les domaines prioritaires. Ces stratégies ne peuvent être mises<br />
en œuvre qu'en encourageant le développement <strong>de</strong>s petites, moyennes et micro entreprises<br />
afin <strong>de</strong> revitaliser l'économie rurale et <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> protection<br />
pour les plus démunis. L'expérience tirée du développement <strong>de</strong> l'Asie peut être utile au<br />
développement humain et <strong>la</strong> création <strong>de</strong>s capacités institutionnelles en Afrique.<br />
- La création d'infrastructures <strong>de</strong> bases, d'instruments juridiques et <strong>de</strong> renforcement du capital<br />
humain sont nécessaires à l'instauration <strong>de</strong> réformes <strong>de</strong>s échanges commerciaux et à<br />
l'accroissement <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> capitaux privés. Ceci pourra élever le niveau <strong>de</strong> croissance et<br />
faciliter l'intégration <strong>de</strong>s pays africains dans l'économie mondiale.<br />
- Des niveaux adéquats d'ai<strong>de</strong> publique au développement favoriseront les investissements<br />
extérieurs directs en Afrique en ouvrant les marchés aux exportateurs africains, en<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 176
echerchant <strong>de</strong>s solutions durables au poids <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte extérieure <strong>de</strong>s pays africains et en<br />
facilitant les transferts <strong>de</strong> technologie.<br />
- Le Programme d'Action du Caire pour le Développement Economique et Social <strong>de</strong> l'Afrique<br />
(1995) et les stratégies adoptées en 1996 par le Comité d'Ai<strong>de</strong> au Développement <strong>de</strong> l'OCDE<br />
dans le "Rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération pour le développement à l'aube du 21ème siècle" offrent à <strong>la</strong><br />
TICAD II l'occasion d'engager une réflexion sur <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> cette stratégie en<br />
Afrique par un ensemble d'objectifs précis et quantifiés.<br />
- La notion d'appropriation est définie par <strong>de</strong>s priorités <strong>de</strong> développement ; ces priorités pour<br />
le développement ont été arrêtées par les africains eux-mêmes et celles-ci sont soutenues<br />
par <strong>la</strong> TICAD II. Cette notion d'appropriation est basée sur un dialogue continu <strong>de</strong> façon<br />
générale entre le gouvernement, le secteur privé et <strong>la</strong> société civile.<br />
- Le principe du partenariat mondial pourrait être créé dans un cadre commun <strong>de</strong> coopération<br />
entre tous les acteurs du développement incluant le secteur privé, <strong>la</strong> société civile, les<br />
partenaires du développement <strong>de</strong> l'Afrique ainsi que les pays donateurs, les organisations<br />
régionales et internationales.<br />
b. Thèmes intersectoriels et les nouvelles approches<br />
- Coordination renforcée :<br />
Le renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> coordination entre les partenaires est essentiel à l'efficacité <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
coopération pour le développement et l'utilisation optimale <strong>de</strong>s ressources APD. <strong>Un</strong>e coordination<br />
accrue doit renforcer le partenariat car :<br />
• une meilleure coordination constitue un soutien aux stratégies nationales cohérentes<br />
• une bonne coordination entre les partenaires extérieurs permet d'éliminer les double-emploi<br />
parmi les donateurs et réduire les pressions sur les ressources humaines limitées <strong>de</strong>s pays<br />
africains<br />
• les programmes d'investissements sectoriels nécessitent un perfectionnement <strong>de</strong>s<br />
approches et <strong>de</strong>s mécanismes actuels <strong>de</strong> coordination<br />
• l'intégration régionale et <strong>la</strong> coopération ont été mises en relief par les pays africains <strong>de</strong>puis<br />
le P<strong>la</strong>n d'Action <strong>de</strong> Lagos (1980). Devant <strong>la</strong> mondialisation, les groupements régionaux et/ou<br />
sous-régionaux, les investissements s'accroissent. Le renforcement <strong>de</strong>s institutions paraît<br />
nécessaire pour promouvoir <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong>s groupements<br />
économiques sous-régionaux africains<br />
• <strong>la</strong> coopération Asie-Afrique <strong>de</strong>puis les forum <strong>de</strong> Bandung (1994) et Bangkok (1997) a été<br />
mise en évi<strong>de</strong>nce. Déjà en 1993, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> TICAD I à Tokyo, on a assisté à un accroissement<br />
<strong>de</strong>s flux commerciaux et d'investissements entre les <strong>de</strong>ux régions. De plus, l'établissement<br />
<strong>de</strong> liens inter-institutionnels favorise <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> mécanismes les formes <strong>de</strong><br />
coopération Sud-Sud. Ces <strong>de</strong>rnières années, <strong>la</strong> coopération triangu<strong>la</strong>ire impliquant <strong>de</strong>s pays<br />
développés, <strong>de</strong>s pays en développement et <strong>de</strong>s organisations internationales donne un<br />
nouvel essor à <strong>la</strong> coopération Sud-Sud en établissant <strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong><br />
formation et <strong>de</strong>s chambres <strong>de</strong> commerce<br />
• récemment, les pays africains ont mis au point un projet nommé "Projet pour un Partenariat<br />
Mondial pour le Renforcement <strong>de</strong>s Capacités Africaines (PACT)" qui a pour ambition<br />
l'appropriation <strong>de</strong> leurs stratégies <strong>de</strong> développement et <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r leur capacité<br />
d'analyse, <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification, d'exécution, <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> politique<br />
<strong>de</strong> développement<br />
• <strong>de</strong>vant les aspects sexo-spécifiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance économique et sociale, le rôle <strong>de</strong>s<br />
femmes est essentiel, cependant elles pâtissent d'un refus d'accès aux biens <strong>de</strong> production<br />
et aux services sociaux. <strong>Un</strong> phénomène d'intégration et <strong>de</strong> promotion d'égalité <strong>de</strong>s sexes est<br />
une composante nécessaire pour lutter contre <strong>la</strong> pauvreté et accroître l'efficacité<br />
économique<br />
• un <strong>de</strong>s aspects essentiels du développement durable est <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l'environnement<br />
compte tenu du fait que <strong>la</strong> croissance démographique pèse sur les ressources naturelles <strong>de</strong><br />
l'Afrique. La formu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s politiques, <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns, <strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> décisions en matière <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong> l'Afrique prend en compte les questions écologiques comme <strong>la</strong> menace<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 177
<strong>de</strong> désertification, <strong>la</strong> dégradation <strong>de</strong>s sols, <strong>la</strong> pollution <strong>de</strong> l'eau, <strong>la</strong> déforestation, <strong>la</strong><br />
biodiversité et <strong>la</strong> prévention et l'atténuation <strong>de</strong>s catastrophes naturelles.<br />
Le p<strong>la</strong>n d'action préconisé comprend trois volets :<br />
1. Le développement humain<br />
Le développement humain durable comprenant le développement social et <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pauvreté est l'objectif ultime du développement. De plus, <strong>la</strong> féminisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté est une<br />
question cruciale puisque les <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion pauvre en Afrique sont constitués par <strong>de</strong>s<br />
femmes. En Asie du Sud-Est, <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté a pu être réalisée grâce à une croissance<br />
économique rapi<strong>de</strong> et une distribution équitable <strong>de</strong>s revenus sur une longue pério<strong>de</strong>. Mais <strong>la</strong><br />
réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> misère passe d'abord par les domaines prioritaires <strong>de</strong> l'éducation, <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, <strong>de</strong><br />
l'assistance à <strong>la</strong> pauvreté.<br />
a) L'éducation et <strong>la</strong> formation tiennent une p<strong>la</strong>ce cruciale dans l'ensemble <strong>de</strong>s politiques du<br />
développement en Afrique, le principal problème étant celui <strong>de</strong>s ressources publiques pour<br />
assurer le financement <strong>de</strong> cette éducation. Des métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financement et <strong>de</strong> gestion<br />
sont à l'étu<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s programmes d'éducation par <strong>de</strong>s réformes.<br />
En matière d'éducation, l'objectif à l'horizon 2005 est <strong>de</strong> s'assurer que 80 % <strong>de</strong>s enfants<br />
terminent le cycle primaire (et qu'il <strong>de</strong>vienne universel en 2015). Eliminer l'inégalité entre les sexes<br />
dans l'enseignement primaire et secondaire, renforcer le lien éducation-emploi et les capacités<br />
nationales et régionales dans les domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> science et <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie.<br />
b) La santé et les instal<strong>la</strong>tions sanitaires sont non seulement insuffisants mais en voie <strong>de</strong><br />
dégradation. La réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté nécessite <strong>de</strong> mailleurs services sanitaires <strong>de</strong><br />
base.<br />
La croissance rapi<strong>de</strong> du VIH/SIDA et du paludisme, <strong>de</strong> <strong>la</strong> polio et <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose. Plus <strong>de</strong> 30<br />
millions <strong>de</strong> personnes dans le mon<strong>de</strong> sont infectés par le virus VIH/SIDA dont 21 millions en Afrique et<br />
80 % <strong>de</strong>s femmes atteintes vivent en Afrique, en conséquence l'espérance <strong>de</strong> vie est en baisse et le<br />
taux <strong>de</strong> mortalité infantile en hausse.<br />
En matière <strong>de</strong> santé, les objectifs sont, à l'horizon 2005, <strong>de</strong> réduire <strong>la</strong> mortalité infantile <strong>de</strong><br />
moitié par rapport à 1990, <strong>de</strong> fournir l'accès à l'eau potable et aux équipements sanitaires à au moins<br />
80 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ; à l'horizon 2015, <strong>de</strong> réduire encore <strong>la</strong> mortalité infantile et celle <strong>de</strong>s enfants <strong>de</strong><br />
moins <strong>de</strong> 5 ans, <strong>de</strong> fournir les accès aux services <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> réduire <strong>de</strong> moitié le nombre <strong>de</strong><br />
personnes victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> malnutrition<br />
c) Les autres objectifs <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté<br />
Le principal objectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> TICAD II est <strong>de</strong> réduire <strong>la</strong> pauvreté. A l'horizon 2015 essayer <strong>de</strong> réduire<br />
<strong>la</strong> pauvreté <strong>de</strong>s femmes au 2/3 au moins en créant <strong>de</strong>s emplois et en diversifiant les ressources <strong>de</strong><br />
revenus.<br />
2. Développement économique<br />
Le défi majeur est <strong>de</strong> maintenir ou d'accroître les taux <strong>de</strong> croissance économique, <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s<br />
emplois et d'augmenter les revenus.<br />
a) Le secteur privé<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 178
<strong>Un</strong>e <strong>la</strong>rge gamme d'activités est couverte par les entreprises en Afrique, al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> microentreprise<br />
plus ou moins structurée aux PME dans le secteur manufacturier qui sont un élément du<br />
développement économique et social. L'encouragement <strong>de</strong>s gouvernements est nécessaire pour<br />
encourager les talents créatifs <strong>de</strong>s entrepreneurs africains.<br />
b) Transformations structurelles et industrielles<br />
Des transformations structurelles nécessaires pourraient permettre aux économies <strong>africaine</strong>s<br />
d'augmenter les revenus et les emplois et diversifier les exploitations. Des synergies dynamiques<br />
entre les secteurs industriels et agricoles pourraient être organisées tel que l'a énoncé le programme<br />
<strong>de</strong> l'Alliance pour l'industrialisation <strong>de</strong> l'Afrique (AIA).<br />
c) Agriculture<br />
La réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté passe par le développement <strong>de</strong> l'agriculture, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pêche, <strong>de</strong><br />
l'élevage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sylviculture. A moyen terme, <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> l'Afrique à atteindre une croissance et un<br />
développement durables passe par <strong>la</strong> revitalisation <strong>de</strong> son économie rurale. Le renforcement <strong>de</strong>s liens<br />
entre producteurs ruraux et marchés urbains est un aspect crucial <strong>de</strong> cette stratégie.<br />
d) La <strong>de</strong>tte extérieure<br />
<strong>Un</strong>e série <strong>de</strong> mesures a été mise en œuvre par <strong>la</strong> communauté internationale afin d'alléger et<br />
<strong>de</strong> rééchelonner <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte <strong>de</strong>s pays à faibles revenus. La Banque Mondiale et le FMI ont proposé<br />
diverses initiatives en ce sens aux pays pauvres très en<strong>de</strong>ttés (PPTE) et <strong>de</strong>s niveaux soutenables ont<br />
été présentés par l'accès aux facilités d'ajustement structurel renforcées (FASR) aidé par l'Association<br />
Internationale <strong>de</strong> Développement (AID).<br />
3. Les fon<strong>de</strong>ments du développement<br />
La démocratie et <strong>la</strong> bonne gouvernance tiennent compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécificité <strong>de</strong> chaque pays, <strong>de</strong> sa<br />
culture et <strong>de</strong> son histoire.<br />
a) Démocratie et gouvernance<br />
La démocratie est en progrès ces <strong>de</strong>rnières années, mais elle est liée aux efforts d'autres<br />
progrès dans le domaine social et économique en tenant compte <strong>de</strong>s valeurs culturelles et <strong>de</strong>s<br />
conditions politiques.<br />
b) Progrès en matière <strong>de</strong> prévention et règlement <strong>de</strong>s conflits<br />
Malgré les guerres qui continuent dans certains pays africains, <strong>de</strong>s progrès ont été faits en<br />
matière <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> règlement <strong>de</strong>s conflits régionaux. La création du mécanisme <strong>de</strong><br />
l'Organisation <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>ité Africaine (OUA) a été une étape décisive pour prévenir ou résoudre <strong>de</strong>s<br />
conflits, renforcer <strong>la</strong> réhabilitation, <strong>la</strong> reconstruction <strong>de</strong> pays sortant d'un conflit et assurer <strong>la</strong> sécurité<br />
<strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions réfugiées ou dép<strong>la</strong>cées dans un pays.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 179
METHODOLOGIE<br />
La méthodologie suivie par ce Programme d'Action est fondée sur :<br />
1. le recours aux indicateurs appropriés <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> l'ONU, <strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong> Bretton<br />
Woods et <strong>de</strong> l'OCDE<br />
2. les participants à s'encourager dans <strong>de</strong>s actions spécifiques<br />
3. l'intégration <strong>de</strong> ces actions spécifiques dans les programmes <strong>de</strong> développement nationaux,<br />
régionaux et internationaux<br />
4. le suivi <strong>de</strong> cette intégration <strong>de</strong>s actions par <strong>la</strong> TICAD II<br />
5. l'adoption <strong>de</strong> mesures concrètes<br />
6. <strong>la</strong> coopération Sud-Sud en tant que modalité <strong>de</strong> coopération<br />
7. le développement entre pays d'Asie et d'Afrique en mettant l'accent sur <strong>la</strong> coopération du<br />
secteur privé<br />
8. une série <strong>de</strong> réunions d'examen sera organisée pour assurer l'évaluation du programme<br />
9. un processus <strong>de</strong> partage d'informations sera mis en p<strong>la</strong>ce en créant <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> contacts<br />
TICAD II sur un site Internet afin d'assurer <strong>la</strong> dissémination <strong>de</strong> l'information dans tous les<br />
secteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> société dans les pays africains<br />
10. <strong>la</strong> coordination est ressentie comme une responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s co-organisateurs.<br />
RESULTATS<br />
1. Education<br />
2. Santé<br />
a) Afin d'atteindre les objectifs en matière d'éducation, les pays africains vont <strong>de</strong>voir accroître<br />
<strong>la</strong> part <strong>de</strong>s ressources allouées à l'enseignement <strong>de</strong> base et mobiliser <strong>de</strong>s sources <strong>de</strong><br />
financement non gouvernementales y compris en provenance du secteur privé. Il faudra<br />
mettre au point <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s non conventionnelles comme l'enseignement à distance et <strong>la</strong><br />
gestion communautaire d'établissements d'enseignement financés par les ONG.<br />
b) Fournir une assistance financière et technique en soutien aux priorités <strong>de</strong>s pays africains<br />
pour l'éducation <strong>de</strong> base et soutenir les activités nationales, sous-régionales et régionales<br />
pour l'accès aux technologies et l'information à l'éducation.<br />
a) Améliorer l'infrastructure hospitalière et l'éducation en matière <strong>de</strong> nutrition, créer un<br />
environnement juridique, culturel et un accès volontaire à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification familiale. Il est<br />
nécessaire également <strong>de</strong> pouvoir accé<strong>de</strong>r à l'information médicale et scientifique pour <strong>la</strong><br />
jeunesse, d'accélérer l'accès aux instal<strong>la</strong>tions sanitaires et <strong>de</strong> réduire leurs coûts.<br />
b) Les partenaires du développement pourront fournir une assistance technique et financière<br />
aux efforts entrepris par les pays africains.<br />
3. La pauvreté<br />
a) Les pays africains formuleront <strong>de</strong>s stratégies d'élimination <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté en mettant en<br />
œuvre <strong>de</strong>s programmes ciblés au niveau local, aidés par <strong>de</strong>s ONG du secteur privé pour<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 180
l'organisation <strong>de</strong>s communautés dans <strong>la</strong> création et <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> programmes <strong>de</strong><br />
réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté.<br />
b) Les partenaires du développement encouragent les Institutions Financières Internationales<br />
à prendre davantage en considération l'impact <strong>de</strong>s programmes d'ajustement structurel sur<br />
l'effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté.<br />
4. Le secteur privé<br />
a) Pour assurer l'efficacité du secteur privé, <strong>de</strong>s infrastructures seront mises en p<strong>la</strong>ce grâce à<br />
<strong>de</strong>s réformes, <strong>de</strong>s privatisations et <strong>de</strong> nouveaux investissements (routiers, ferroviaires,<br />
télécommunications, électricité, transports, maritimes et instal<strong>la</strong>tions portuaires).<br />
Les pays africains s'engagent aussi à encourager <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> micro et PMI avec <strong>de</strong>s<br />
supports appriopriés.<br />
b) Les partenaires du développement renforceront <strong>la</strong> coopération Sud-Sud, Asie-Afrique, ce<br />
qui constituera une contribution majeure <strong>de</strong> <strong>la</strong> TICAD II par <strong>de</strong>s échanges d'expériences en<br />
matière <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s <strong>affaires</strong>.<br />
5. Développement industriel<br />
a) Pour harmoniser les activités <strong>de</strong>s organismes gouvernementaux compétents, renforcer les<br />
liens entre les politiques <strong>de</strong> développement industriel et agricole et créer <strong>de</strong> nouvelles<br />
industries dans les secteurs agro-industrie, énergie et ressources minérales où les pays<br />
africains ont un avantage comparatif certain.<br />
b) Les partenaires au développement vont faciliter le partenariat au moyen <strong>de</strong> mécanismes<br />
tels que les conseils conjoints d'entreprises pour un échange d'informations entre les<br />
milieux d'<strong>affaires</strong> asiatiques et africains pour <strong>la</strong> création <strong>de</strong> co-entreprises et<br />
d'arrangements <strong>de</strong> sous-traitance, ce qui encouragera le transfert <strong>de</strong> technologie vers les<br />
pays africains.<br />
6. Le secteur agricole<br />
a) Pour le secteur agricole, secteur-clé du développement africain, <strong>de</strong>s réformes sont<br />
nécessaires dans le domaine <strong>de</strong>s prix à <strong>la</strong> production et à <strong>la</strong> consommation, <strong>de</strong>s marchés, <strong>de</strong>s<br />
facteurs <strong>de</strong> production, <strong>de</strong>s restructuration, <strong>de</strong>s organismes agricoles parapublics et <strong>de</strong> rentabilité <strong>de</strong>s<br />
exploitation.<br />
L'IMPACT SUR L'AFRIQUE<br />
Les perspectives <strong>de</strong> coopération entre le Japon et l'Afrique peuvent peser fortement sur le<br />
<strong>de</strong>venir <strong>de</strong> l'Afrique même si <strong>la</strong> contagion <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance impulsée par l'ai<strong>de</strong>, les investissements et<br />
<strong>la</strong> diffusion du modèle industriel japonais dans l'Asie <strong>de</strong> l'Est a peu <strong>de</strong> chances <strong>de</strong> se reproduire en<br />
Afrique.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 181
3.1.3.<br />
IMPACTS DES ACCORDS<br />
ET DES ARRANGEMENTS<br />
INSTITUTIONNELS SUR L'AFRIQUE
Les accords commerciaux et les arrangements institutionnels en cours, mettant<br />
en p<strong>la</strong>ce une libéralisation multi<strong>la</strong>térale ou régionale, prévoient un démantèlement <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> protection sur <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> réciprocité dans un horizon <strong>de</strong> 10 à 15 ans et <strong>de</strong>s<br />
pério<strong>de</strong>s transitoires pour y parvenir. Les changements <strong>de</strong> règles du jeu international<br />
auront <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces notables sur les économies <strong>africaine</strong>s, bénéficiant<br />
actuellement d'accords <strong>de</strong> non-réciprocité, et dont les recettes budgétaires, les<br />
consommations et les investissements sont <strong>la</strong>rgement liés aux re<strong>la</strong>tions<br />
commerciales extérieures.<br />
Nous présentons les effets <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> l'OMC, <strong>de</strong> l'après Lomé IV et les<br />
accords <strong>de</strong> libre échange <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>ion Européenne et <strong>de</strong>s régimes monétaires africains<br />
notamment dans le nouveau contexte <strong>de</strong> l'euro.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 184
L'IMPACT DE L'OMC SUR LE DEVENIR<br />
DES ECONOMIES AFRICAINES<br />
De très nombreux rapports analysent l'impact prévisible <strong>de</strong>s accords commerciaux multi<strong>la</strong>téraux et<br />
<strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l'OMC sur les économies <strong>africaine</strong>s. Nous en retiendrons quatre :<br />
- Coalition mondiale pour l'Afrique (TUBIANA L, JADOT Y) (1995) Les accords du GATT:<br />
Cadre d'analyse et éléments <strong>de</strong> stratégie pour les pays d'Afrique sub-saharienne.<br />
Washington<br />
- HAROLD P (1998) The Impact of the Uruguay Round on Africa, World bank Discussion<br />
Paper N°311<br />
- CNUCED (1998) Libéralisation du commerce international et implications pour <strong>la</strong><br />
diversification en Afrique, Genève<br />
- Forum mondial sur <strong>la</strong> compétitivité future <strong>de</strong>s économies <strong>africaine</strong>s, PNUD, Dakar, mars<br />
1999.<br />
Les accords <strong>de</strong> l'OMC<br />
Les règles et les pratiques <strong>de</strong> l'OMC sont <strong>de</strong>venues <strong>la</strong>rgement incompatibles avec les systèmes<br />
<strong>de</strong> préférence généralisée et les protections diverses qui ont longtemps caractérisé l'Afrique et qui<br />
continuent <strong>de</strong> caractériser les politiques d'ai<strong>de</strong> (Accords Multi Fibres, soutiens <strong>de</strong>s prix , ai<strong>de</strong> liée,<br />
accords <strong>de</strong> Lomé). Elles visent à:<br />
- généraliser le principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation <strong>la</strong> plus favorisée<br />
- intégrer dans <strong>la</strong> logique <strong>de</strong> l'OMC <strong>de</strong>s secteurs qui y avaient échappé (agriculture, textiles)<br />
ou qui n'avaient jamais fait l'objet <strong>de</strong> négociations(services, propriété intellectuelle)<br />
- réaliser une baisse <strong>de</strong>s tarifs et surtout à s'attaquer aux nouvelles barrières aux échanges<br />
et à toutes les mesures limitant <strong>la</strong> concurrence (subventions, dumping..).<br />
- faire <strong>de</strong> l'OMC un organisme d'arbitrage et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s litiges<br />
Les effets sur les économies <strong>africaine</strong>s<br />
Les corrections <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong> <strong>la</strong> Politique Agricole Commune européenne, <strong>la</strong> libéralisation<br />
<strong>de</strong>s échanges <strong>de</strong> services, le démantèlement <strong>de</strong>s Accords Multi Fibres auront <strong>de</strong>s effets contrastés<br />
sur les pays africains. Ils doivent stimuler les exportations traditionnelles, réduire les marges <strong>de</strong><br />
préférence, accroître les prix alimentaires, améliorer <strong>la</strong> compétitivité grâce à <strong>la</strong> dérégu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s<br />
transports. L'OMC a prévu <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> transition et <strong>de</strong>s dérogations pour les PMA Selon les<br />
projections du modèle Runs, les accords <strong>de</strong> l'OMC et notamment <strong>la</strong> libéralisation agricole <strong>de</strong>vraient<br />
avoir plutôt <strong>de</strong>s effets négatifs sur l'Afrique notamment du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> hausse prévue <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s<br />
produits alimentaires qu'elle importe.<br />
L'Afrique ne pourra plus bénéficier <strong>de</strong>s accès protégés au marché européen. Elle affrontera <strong>la</strong><br />
concurrence <strong>de</strong>s pays émergents. En revanche , elle bénéficiera d'une réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection vis à<br />
vis <strong>de</strong> ses produits sur les marchés mondiaux. Les principaux effets <strong>de</strong>s accords du GATT sur les<br />
pays d'Afrique sub-saharienne sont:<br />
- L'augmentation <strong>de</strong>s exportations <strong>de</strong>s produits traditionnels agricoles et <strong>de</strong>s produits<br />
provenant <strong>de</strong>s ressources naturelles grâce à l'amélioration <strong>de</strong>s accès aux marchés <strong>de</strong>s<br />
pays développés.<br />
- L'érosion <strong>de</strong>s marges préférentielles du SPG et <strong>de</strong>s États ACP du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s<br />
droits NPF<br />
- L'augmentation <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s produits alimentaires du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> réduction du soutien interne<br />
et <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s à l'exportation <strong>de</strong>s pays excé<strong>de</strong>ntaires.<br />
Selon l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> CNUCED (1998), <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s barrières à l'accès aux marchés suite aux<br />
accords <strong>de</strong> l'OMC, a une inci<strong>de</strong>nce positive sur l'expansion du commerce international, mais ses<br />
conséquences sont mitigées en ce qui concerne les pays africains. Ceux-ci sont confrontés à <strong>de</strong>s<br />
barrières tarifaires élevées, à une érosion <strong>de</strong>s préférences et à <strong>de</strong>s barrières non tarifaires.<br />
Les pays ACP bénéficient d'avantages tarifaires mais limités dans leur portée sur les produits<br />
dits sensibles agricoles et textiles. Les pointes tarifaires sont élevées pour les produits alimentaires <strong>de</strong><br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 185
ase. Sur beaucoup <strong>de</strong> marchés développés, notamment ceux <strong>de</strong> l'Amérique du Nord et <strong>de</strong> l'UE, <strong>de</strong><br />
nombreux produits habillement et textile sont soumis à <strong>de</strong>s tarifs élevés.<br />
Selon une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO, <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s exportations agricoles pourrait augmenter <strong>de</strong> 7,1<br />
milliards <strong>de</strong> $ en 1987-89 à 10 milliards en 2000, mais <strong>la</strong> facture <strong>de</strong>s importations augmentait <strong>de</strong> 6<br />
milliards <strong>de</strong> $. Les pays africains affrontent <strong>de</strong>s agricultures bénéficiant <strong>de</strong> 335 milliards <strong>de</strong> $ <strong>de</strong><br />
subvention en 1993.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 186
LES PERSPECTIVES DE I'APRES LOME IV<br />
De nombreuses étu<strong>de</strong>s et travaux ont été consacrés au <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> Lomé<br />
notamment le Livre vert rédigé par <strong>la</strong> CEE, les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> EPDCM, du GEMDEV ou du CERDI.<br />
- Commission européenne Livre vert sur Les re<strong>la</strong>tions entre l'<strong>Un</strong>ion européenne et les pays<br />
ACP à l'aube du XXIe siècle. Défis et options vers un nouveau partenariat, Bruxelles-<br />
Luxembourg 1997.<br />
- EPCDM, "Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> Lomé IV: pistes <strong>de</strong> réflexion sur l'avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération ACP-UE",<br />
Rapport ECPDM, Maastricht, N'6, oct 1996<br />
- GEMDEV, "La convention <strong>de</strong> Lomé en questions, les re<strong>la</strong>tions entre les pays d'Afrique, <strong>de</strong>s<br />
Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'<strong>Un</strong>ion Européenne après l'an 2000", Paris Kartha<strong>la</strong>.1997<br />
- PARLEMENT Européen, rapport sur <strong>la</strong> communication <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission sur les orientations<br />
en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> négociation <strong>de</strong> nouveaux accords <strong>de</strong> coopération avec les pays d'Afrique, <strong>de</strong>s<br />
Caraïbes et du pacifique(ACP) (Rapport Roccard, Mars 1998)<br />
- CERDI, "Les effets <strong>de</strong>s APER sur l'UEMOA et le Ghana", Clermont-Ferrand 1999 (étu<strong>de</strong><br />
réalisée pour <strong>la</strong> DG VIII).<br />
L'originalité <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> Yaoundé et <strong>de</strong> Lomé<br />
Les accords <strong>de</strong> Lomé, entre <strong>la</strong> Communauté européenne et les ACP, se situaient dans le<br />
prolongement <strong>de</strong>s liens coloniaux et dans une perspective régionaliste <strong>de</strong> préférences et <strong>de</strong> non<br />
réciprocité prenant en compte les asymétries internationales. Ils comprenaient plusieurs volets liés, <strong>la</strong><br />
coopération financière et technique, les accords commerciaux et l'appui institutionnel. Ils avaient visé<br />
à insérer les anciennes colonies d'Afrique, <strong>de</strong>s Caraïbes et du Pacifique dans <strong>de</strong>s accords<br />
préférentiels avec leurs anciennes métropole s'intégrant à l'espace européen. Ils ont perdu beaucoup<br />
<strong>de</strong> légitimité et <strong>de</strong> force avec l'é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> l'Europe à <strong>de</strong>s pays sans passé colonial et avec <strong>la</strong><br />
réorientation <strong>de</strong>s intérêts vers l'Europe <strong>de</strong> l'est <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> chute du mur <strong>de</strong> Berlin. Les liens privilégiés<br />
avec l'Afrique sont <strong>la</strong>rgement remis en question notamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l'Allemagne et <strong>de</strong>s pays<br />
scandinaves. Ils le sont <strong>de</strong> manière plus ancienne par <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne fortement intégrée au<br />
mon<strong>de</strong> anglo-saxon.<br />
Des résultats mitigés<br />
Dans leurs principes, les accords CEE/ACP ont répondu à une philosophie moins libérale que<br />
celle du GATT ou <strong>de</strong>s Institutions <strong>de</strong> Bretton Woods. La première convention (1975) paraissait une<br />
innovation dans les re<strong>la</strong>tions Nord/Sud et un pas vers un nouvel ordre économique international:<br />
autonomie dans le contrôle <strong>de</strong>s dépenses, régime <strong>de</strong> l'échange avantageux, prises <strong>de</strong> décisions<br />
concertées, mesures préférentielles, ai<strong>de</strong>s. Les accords entre <strong>la</strong> CEE et les ACP mettaient en avant<br />
<strong>de</strong>s mécanismes stabilisateurs et coopératifs: libéralisation sans réciprocité (systèmes <strong>de</strong> préférences<br />
généralisées), garanties particulières (prix et quantités pour le sucre), mécanismes compensateurs<br />
<strong>de</strong>s instabilités <strong>de</strong> recettes d'exportation (stabex, sysmin), accès aux programmes d'ai<strong>de</strong> du F.E.D.,<br />
principe <strong>de</strong> contractualité, réciprocité...<br />
Les résultats observés <strong>de</strong> Lomé sont mitigés. Le résultat le plus positif concerne quelques rares<br />
pays hors Zone franc. Le protocole sucre et les préférences industrielles ont favorisé l'industrialisation<br />
<strong>de</strong> l'île Maurice grâce à l'affectation productive <strong>de</strong> <strong>la</strong> rente sucrière. Plusieurs étu<strong>de</strong>s montrent que les<br />
préférences <strong>de</strong> Lomé ont servi <strong>de</strong> catalyseur et qu'elles ont conduit à une expansion et à une<br />
diversification dans <strong>de</strong>s pays tels que <strong>la</strong> Jamaïque, le Kenya, Maurice ou le Zimbabwe. L'ai<strong>de</strong>, sous<br />
forme <strong>de</strong> dons, a permis <strong>de</strong> sécuriser <strong>de</strong>s secteurs jugés prioritaires. Elle a conduit à <strong>de</strong>s transferts<br />
nets élevés comparés à ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque mondiale dont les prêts génèrent un service <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte.<br />
Mais ces préférences n'ont pas été une condition suffisante ni même peut être nécessaire.<br />
Malgré les intentions, les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone franc comme les autres ACP ont été impuissants à modifier<br />
et à diversifier leurs spécialisations en produits primaires. Ils n'ont pas été capables <strong>de</strong> maintenir leurs<br />
parts <strong>de</strong> marché alors qu'il y avait accès libre au marché européen pour 95 % <strong>de</strong>s produits agricoles<br />
exportés. Alors que <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l'Europe communautaire dans les exportations <strong>de</strong>s ACP s'est<br />
re<strong>la</strong>tivement maintenue (48% en 1976 et 41 % en 1992), <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s exportations <strong>de</strong>s ACP sur le<br />
marché européen n'a cessé <strong>de</strong> décroître en passant <strong>de</strong> 6,7 % en 1976 <strong>de</strong>s importations extra<br />
communautaires à 2,8 % en 1992 (EPCDM 1996).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 187
Les concessions industrielles, les dispositifs re<strong>la</strong>tifs aux transferts technologiques ou les<br />
promotions aux investissements privés ont eu peu d'effets. Les dotations du Stabex ont été<br />
insuffisantes pour faire face à <strong>de</strong>s prix dépressifs; elles ont plutôt financé les budgets <strong>de</strong>s États que<br />
favorisé une diversification <strong>de</strong>s spécialisations ou une reconstitution <strong>de</strong>s filières exportatrices. Elles<br />
ont alimenté <strong>de</strong>s rentes et au mieux constitué un ballon d'oxygène aux budgets publics. Les accords<br />
avec les ACP n'ont pas permis d'enclencher une diversification <strong>de</strong>s spécialisations ni d'aboutir comme<br />
le prévoyaient les articles 29 et 70 à une industrialisation.<br />
On peut inversement constater que les pratiques <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>ion européenne se sont<br />
progressivement éloignées <strong>de</strong> leurs principes initiaux. Les pratiques communautaires ont fait<br />
également l'objet <strong>de</strong> nombreuses critiques sur <strong>la</strong> lour<strong>de</strong>ur administrative <strong>de</strong>s procédures, le surcoût<br />
financier <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong>, <strong>la</strong> lenteur <strong>de</strong>s décisions. La libéralisation <strong>de</strong>s échanges a tendu à éro<strong>de</strong>r le<br />
système <strong>de</strong> préférences généralisées. Les règles d'origine visant à éviter les détournements <strong>de</strong>s<br />
exportations par les ACP ont été souvent utilisées par l'UE comme <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection. Les<br />
restrictions quantitatives et les mesures antidumping n'ont certes pas touché les ACP mais ils ont créé<br />
<strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> diversion vis-à-vis <strong>de</strong>s investisseurs vou<strong>la</strong>nt changer <strong>de</strong> spécialisation. L'<strong>Un</strong>ion<br />
européenne, a accepté <strong>de</strong>puis Lomé IV le principe <strong>de</strong> l'ajustement. L'ai<strong>de</strong> européenne est <strong>de</strong>venue<br />
davantage macro-économique et à déboursement rapi<strong>de</strong> (fonds stabex, prêts d'ajustement structurel<br />
et fonds <strong>de</strong> contrepartie.). L'ai<strong>de</strong> à l'ajustement a pris un poids croissant par rapport aux ai<strong>de</strong>s projets.<br />
Les fonds stabex ou sysmin et les fonds d'ajustement représentent plus <strong>de</strong> 30 % <strong>de</strong>s fonds du 7ème<br />
et 8ème F.E.D.. Au lieu <strong>de</strong> stabiliser les économies, il s'agit <strong>de</strong> les ajuster au marché mondial; le<br />
partenariat fait p<strong>la</strong>ce à <strong>de</strong>s conditionnalités; les ai<strong>de</strong>s budgétaires ciblées sont insérées dans un cadre<br />
financier <strong>de</strong> cohérence.<br />
L'ajustement a conduit ainsi à fortement rapprocher les doctrines <strong>de</strong>s bailleurs <strong>de</strong> fonds sous le<br />
lea<strong>de</strong>rship <strong>de</strong>s Institutions <strong>de</strong> Bretton Woods. L'éligibilité à l'ai<strong>de</strong> est subordonnée au fait d'être "on<br />
track" dans les négociations avec ces Institutions. Les objectifs <strong>de</strong> sécurisation <strong>de</strong> l'existant l'ont<br />
emporté sur les projets à long terme. L'ai<strong>de</strong> au lieu <strong>de</strong> constituer une transfusion provisoire est<br />
<strong>de</strong>venue une perfusion permanente permettant aux États d'assurer le minimum <strong>de</strong> fonctions<br />
régaliennes .<br />
Les facteurs <strong>de</strong> ruptures<br />
Quatre principaux facteurs conduisent à une remise en cause <strong>de</strong> ces accords :<br />
- Les principes <strong>de</strong> non réciprocité et <strong>de</strong> discrimination entre PVD <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention <strong>de</strong> Lomé<br />
sont en re<strong>la</strong>tive contradiction avec les règles <strong>de</strong> l'OMC.<br />
- De nombreux pays européens voudraient normaliser leurs re<strong>la</strong>tions avec les anciennes<br />
colonies et, au nom <strong>de</strong> cette normalisation, s'orienter vers les nouveaux marchés porteurs<br />
ou privilégier les seuls pays les plus pauvres éventuellement non membres <strong>de</strong>s ACP.<br />
- Les pays ACP se sont différenciés et ont <strong>de</strong>s positions divergentes. Les Caraïbes voudraient<br />
s'intégrer à l'ALENA et ne pas rater le coche <strong>de</strong> son é<strong>la</strong>rgissement. L'Afrique du Sud,<br />
membre à statut restreint <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Lomé, négocie un accord <strong>de</strong> libre échange qui<br />
peut servir <strong>de</strong> modèle.<br />
- La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>ion européenne aura <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces sur les liens avec les ACP et<br />
notamment les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone franc<br />
Les scenarii du livre vert<br />
Quatre options sont envisageables dans le cadre <strong>de</strong> l'après Lomé IV<br />
- Le statu quo avec maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> non réciprocité, du traitement différencié, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
contractualisation et priorité aux conditions d'accès au marché. Ce scénario est peu<br />
probable et en non conformité avec l'OMC. Il supposerait une négociation annuelle rendant<br />
peu prévisibles les politiques commerciales <strong>de</strong>s pays concernés.'<br />
- <strong>Un</strong> accord global complété par <strong>de</strong>s accords bi<strong>la</strong>téraux. <strong>Un</strong>e intégration dans les SPG<br />
conduirait à éliminer le volet commercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention <strong>de</strong> Lomé qui serait réduit à un<br />
système d'ai<strong>de</strong> quitte à accroître les préférences vis à vis <strong>de</strong>s PMA.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 188
- <strong>Un</strong> éc<strong>la</strong>tement <strong>de</strong> Lomé avec mise en p<strong>la</strong>ce d'accords <strong>de</strong> libre échange avec les ACP sur<br />
<strong>de</strong>s bases régionales. La réciprocité pourrait être uniforme après une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> transition<br />
ou différenciée.<br />
- <strong>Un</strong>e réorientation <strong>de</strong>s accords vers les pays les plus pauvres ACP et non ACP<br />
indépendamment <strong>de</strong>s anciens liens coloniaux.<br />
On peut prévoir qu'il y aura combinaison <strong>de</strong> plusieurs modalités. Des accords <strong>de</strong> libre échange<br />
sont possibles avec l'UEMOA ou <strong>la</strong> CEMAC comme ils le sont avec <strong>la</strong> SADC ou le CARICOM. On<br />
peut ainsi considérer que les accords <strong>de</strong> réciprocité seront mis en p<strong>la</strong>ce avec les pays africains. La<br />
question en suspens reste celle <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is pour le démantèlement <strong>de</strong>s barrières tarifaires.<br />
L'impact <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> libre échange <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>ion européenne<br />
avec les pays africains à l'horizon 2015/2020<br />
La plupart <strong>de</strong>s travaux consacrés aux impacts <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> libre échange, avec l'Afrique du<br />
Sud, les pays du bassin méditerranéen ou les pays africains membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Lomé,<br />
conduisent à <strong>de</strong>s résultats simi<strong>la</strong>ires :<br />
- <strong>la</strong> suppression <strong>de</strong> <strong>la</strong> réciprocité bénéficiera principalement à l'<strong>Un</strong>ion Européenne<br />
- les consommateurs <strong>de</strong>s pays africains seront certes gagnants. En revanche, il y aura forte<br />
baisse <strong>de</strong>s recettes fiscales assises sur les re<strong>la</strong>tions extérieures<br />
- il y a risque <strong>de</strong> déséquilibre <strong>de</strong> <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce commerciale.<br />
Les opportunités n'apparaissent qu'à long terme en supposant que l'appareil productif ait <strong>la</strong><br />
flexibilité suffisante pour répondre aux nouvelles donnes. Il faut que les accords <strong>de</strong> libre échange<br />
s'accompagnent d'entrée <strong>de</strong> capitaux publics et privés.<br />
Ainsi l'étu<strong>de</strong> du CERDI, réalisée en 1999 pour le compte <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>ion Européenne, analyse les<br />
effets <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> libre échange entre l'<strong>Un</strong>ion Européenne et l'UEMOA plus le Ghana. La création<br />
<strong>de</strong> l'APER (Accords <strong>de</strong> partenariats économiques régionaux) conduira à une réciprocité <strong>de</strong>s<br />
préférences commerciales. Elle est préférable aux Systèmes <strong>de</strong> préférence généralisée (SPG) mais<br />
aura un coût élevé, du moins à court et moyen terme, par rapport aux préférences actuelles <strong>de</strong> Lomé.<br />
Pour les PMA, <strong>la</strong> négociation d'un APER n'est pas nécessaire pour que s'appliquent les<br />
préférences <strong>de</strong> Lomé. En revanche pour les non PMA, <strong>la</strong> Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal, à<br />
défaut d'APER, il y aura mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> SPG.<br />
L'étu<strong>de</strong> du CERDI simule :<br />
- une baisse <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> protection entre 2005 et 2017<br />
- une exclusion <strong>de</strong> certains produits sensibles<br />
- une substituabilité imparfaite entre les importations européennes et les productions locales<br />
- <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>ion douanière dès 2000 (TEC).<br />
Il en résulterait d'après <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion du modèle :<br />
- une création <strong>de</strong> trafic au profit <strong>de</strong>s produits européens<br />
- un effet <strong>de</strong> baisse <strong>de</strong>s prix favorable aux consommateurs<br />
- une forte chute <strong>de</strong>s recettes fiscales assises sur le commerce extérieur<br />
- une forte vulnérabilité <strong>de</strong>s secteurs protégés.<br />
Les risques sont importants :<br />
- il faudrait réaliser en moins <strong>de</strong> 20 ans une transformation <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiscalité en faveur d'une<br />
taxation interne que 20 ans d'ajustement n'ont pu réaliser. Les taxes assises sur les droits<br />
<strong>de</strong> porte représentent 40 % <strong>de</strong>s recettes fiscales dans l'UEMOA et 20 % au Ghana<br />
- un important appui financier serait nécessaire pour favoriser <strong>la</strong> reconversion du système<br />
productif.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 189
Les effets <strong>de</strong> l'accord <strong>de</strong> libre échange <strong>de</strong> l'Afrique du Sud avec l'<strong>Un</strong>ion européenne<br />
Référence bibliographique : « Southern Africa into the next Millennium », The South African institute of<br />
International Affairs, G. Mills (Ed), July 1998, Johannesburg, RAS.<br />
Les projections économiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> région SADC (Southern African <strong>de</strong>velopment Community) à<br />
l'horizon du 21ème siècle sont stratégiquement dépendantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> redéfinition <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> Lomé<br />
du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> position privilégiée dans cette région <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>ion européenne en termes <strong>de</strong> partenariat<br />
commercial, d'ai<strong>de</strong>s au développement et d'investissements directs d'une part, <strong>de</strong> son nécessaire<br />
ancrage à un pôle régional dominant d'autre part. L'auteur* é<strong>la</strong>bore ici <strong>de</strong>s scénarios contrastés pour<br />
l'Afrique du Sud et l'Afrique australe à partir <strong>de</strong>s renégociations <strong>de</strong> Lomé IV, à son échéance en l'an<br />
2000, et ce, dans un contexte global <strong>de</strong> multi<strong>la</strong>téralisme commercial.<br />
Scénario fort pour <strong>la</strong> SADC<br />
Les États membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> SADC ont adopté en septembre 1997 une ligne politique commune<br />
aux ACP en prévision <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconsidération <strong>de</strong> leurs statuts post-Lomé. Principalement, il faut retenir<br />
<strong>la</strong> poursuite du principe <strong>de</strong> coopération asymétrique et <strong>de</strong> pénétration préférentielle du marché<br />
européen tels que définis dans les accords actuels couplée à une approche différentielle régionale. La<br />
Commission européenne dans son Livre vert recomman<strong>de</strong> ainsi <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> libéralisation <strong>de</strong>s<br />
échanges en accord avec les règles <strong>de</strong> l'Organisation mondiale du travail. Celles-ci concerneraient les<br />
États les plus avancés <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone (I'lle Maurice, le Botswana, et le Zimbabwe) par leur inclusion dans<br />
un Système <strong>de</strong> préférences généralisées (SPG). Les accords <strong>de</strong> partenariat SADC /UE se<br />
positionnent donc sur <strong>la</strong> voie du libre échangisme (Conférence <strong>de</strong> Vienne, novembre 1998) reflétant<br />
<strong>de</strong> façon plus générale <strong>la</strong> marche à suivre pour l'ensemble <strong>de</strong>s ACP. De plus, ils inscrivent les<br />
fon<strong>de</strong>ments d'une « Renaissance <strong>africaine</strong> » basés sur <strong>de</strong>s accords mutuellement avantageux et<br />
équitables nord-sud adaptés aux dé<strong>la</strong>is d'adaptation aux lois du marché et <strong>la</strong> consolidation du tissu<br />
économique intrarégional.<br />
Scénario fort pour l'Afrique du Sud<br />
L'Afrique du Sud bénéficie <strong>de</strong>puis 1997 d'un statut conditionnel dit « qualifié » au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
convention <strong>de</strong> Lomé : adoption <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> cumul d'origine, soumission au Fonds européen <strong>de</strong><br />
développement, ai<strong>de</strong> financière accordée sur quatre ans, extension du SPG et <strong>de</strong> l'accès hors droits<br />
<strong>de</strong> douane pour environ 80% <strong>de</strong>s produits exportés sud-africains . Du fait <strong>de</strong> son rôle moteur dans <strong>la</strong><br />
zone australe et <strong>de</strong> son économie duale, les re<strong>la</strong>tions bi<strong>la</strong>térales AS /UE sont révé<strong>la</strong>trices <strong>de</strong>s enjeux<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d'un accord régional <strong>de</strong> libre-échange et donc <strong>de</strong> réciprocité commerciale dont<br />
l'Afrique du Sud serait le catalyseur. Les avantages attendus côté sud-africain semblent évi<strong>de</strong>nts<br />
(effets d'entraînement, accroissement <strong>de</strong>s investissements directs), bien qu'à l'heure du processus <strong>de</strong><br />
négociation <strong>de</strong> nombreux secteurs <strong>de</strong>meurent sensibles, voire conflictuels (principalement coûts<br />
d'ajustement <strong>de</strong> <strong>la</strong> base industrielle SA, exclusion <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 45% <strong>de</strong> ses produits agricoles les plus<br />
compétitifs). Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s liées à une ouverture symétrique <strong>de</strong> ses marchés avec l'UE,<br />
l'Afrique du Sud s'est engagée parallèlement sur le projet d'une zone <strong>de</strong> libre-échange avec les États<br />
membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> SADC , confortant ainsi le processus <strong>de</strong> consolidation régionale face au global.<br />
*Dr.Elias Links, ambassa<strong>de</strong>ur sud-africain près l'<strong>Un</strong>ion européenne à Bruxelles.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 190
LES DEVENIRS DES REGIMES MONETAIRES AFRICAINS<br />
ET LA MISE EN PLACE DE L'EURO<br />
Plusieurs travaux prospectifs ont traité du <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s régimes monétaires, notamment Ph.<br />
Hugon (1999), La Zone Franc à l'heure <strong>de</strong> l'Euro, Paris Kartha<strong>la</strong>, et J.D. Nau<strong>de</strong>t (1993), Etu<strong>de</strong><br />
WALTPS.<br />
Les blocs monétaires flottants<br />
Il n'existe pas <strong>de</strong> véritable système monétaire international. Celui ci étant défini comme<br />
l'ensemble <strong>de</strong>s mécanismes et <strong>de</strong>s règles qui prési<strong>de</strong>nt à <strong>la</strong> création et à l'utilisation <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong><br />
règlements entre agents appartenant à <strong>de</strong>s nations différentes. Le système monétaire international<br />
actuel est caractérisé par un nombre limité <strong>de</strong> monnaies clés nationales (dol<strong>la</strong>r, yen) ou régionales<br />
(euro) flottant librement entre elles et <strong>de</strong> monnaies nationales ou régionales (CFA), convertibles et<br />
non convertibles, ancrées par une parité fixe ou glissante à une monnaie clé ou à un panier <strong>de</strong><br />
monnaie. Les monnaies vernacu<strong>la</strong>ires se rattachent à <strong>de</strong>s monnaies véhicu<strong>la</strong>ires (Bourguinat) qui<br />
permettent l'acceptabilité, <strong>la</strong> liquidité et <strong>la</strong> stabilité permettant <strong>la</strong> prédictibilité.<br />
Dans un contexte <strong>de</strong> déréglementation, <strong>de</strong> décloisonnement <strong>de</strong>s marchés et <strong>de</strong><br />
désintermédiation, on observe, d'un côté, une unification du marché <strong>de</strong>s fonds prêtables, une<br />
interdépendance <strong>de</strong>s espaces financiers et monétaires internationaux qui débor<strong>de</strong>nt ou transcen<strong>de</strong>nt<br />
les espaces nationaux. Mais <strong>de</strong> l'autre, l'espace réseau financier et les marchés <strong>de</strong>s changes<br />
<strong>de</strong>meurent différenciés avec <strong>de</strong>s pôles monétaires hégémoniques.<br />
Les qualités d'une monnaie internationale, liquidité et liberté financière, dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s effets<br />
d'échelle et d'envergure et ne concernent que quelques <strong>de</strong>vises clés. Elles dépen<strong>de</strong>nt également <strong>de</strong><br />
déterminants politiques, opinion <strong>de</strong>s marchés, convertibilité crédibilité. Le rôle hégémonique du dol<strong>la</strong>r<br />
a progressivement fait p<strong>la</strong>ce à une corresponsabilité systémique avec poids <strong>de</strong> l'euro et du yen<br />
(Aglietta).<br />
Le contexte <strong>de</strong>s valses <strong>de</strong>s monnaies<br />
Dans une "économie mondiale casino voire domino", on observe une valse <strong>de</strong>s monnaies.<br />
Depuis juillet 1997, l'effondrement <strong>de</strong>s monnaies est asiatiques s'est accompagné d'un effondrement<br />
<strong>de</strong>s cours boursiers. Par effet <strong>de</strong> contagion <strong>la</strong> crise a touché les pays <strong>de</strong> l'est notamment <strong>la</strong> Russie et<br />
les pays émergents qui ont vu s'effondrer leurs monnaies et leurs marchés financiers. La Zone euro<br />
est apparue au contraire dopée dans un premier temps par <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> report. La forte chute <strong>de</strong>s<br />
prix <strong>de</strong>s matières premières liée à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation est asiatique a <strong>de</strong> plus accru <strong>la</strong><br />
profitabilité <strong>de</strong>s firmes. La baisse <strong>de</strong>s taux d'intérêt a joué favorablement. En revanche, <strong>la</strong> récession<br />
<strong>de</strong>s pays émergents a eu <strong>de</strong>s répercussions à <strong>la</strong> baisse sur les activités <strong>de</strong>s entreprises européennes.<br />
Les risques <strong>de</strong> d'effets <strong>de</strong> contagion <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise sont grands dans le cas <strong>de</strong> dévaluation du Yuan<br />
chinois<br />
Les pays africains les plus pauvres ont été très peu touchés par cette crise monétaire et<br />
financière. Ils ont toutefois subi les effets <strong>de</strong> baisse <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s matières premières. Les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Zone franc ont bénéficié à court terme du rattachement à une monnaie forte et n'ont pas été affectés<br />
par les turbulences monétaires. En revanche, <strong>la</strong> forte dévaluation <strong>de</strong>s monnaies asiatiques et<br />
notamment du Yuan risqueraient <strong>de</strong> faire baisser fortement leur compétitivité.<br />
Le contexte <strong>de</strong> l'euro<br />
La mise en circu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'euro, monnaie unique européenne, ainsi que l'entrée en vigueur<br />
d'une politique monétaire p<strong>la</strong>cée sous le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque centrale européenne a un impact<br />
symbolique, politique, institutionnel et monétaire essentiel sur l'Afrique et évi<strong>de</strong>mment sur <strong>la</strong> Zone<br />
franc.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 191
A priori, l'Afrique <strong>de</strong>vrait bénéficier d'un euro stable, <strong>de</strong> faibles taux d'inf<strong>la</strong>tion et d'intérêt et <strong>de</strong><br />
liens avec une zone <strong>de</strong> croissance. Trois effets favorables sont attendus : <strong>de</strong> production (croissance),<br />
<strong>de</strong> prix (stabilité) et d'amélioration <strong>de</strong> l'accès aux capitaux. Il <strong>de</strong>vrait y avoir plus gran<strong>de</strong> stabilisation<br />
du taux <strong>de</strong> change effectif nominal. les effets seront d'autant plus positifs que l'euro sera stable par<br />
rapport au $ US et que l'euro remp<strong>la</strong>cera le $ comme unité <strong>de</strong> compte <strong>de</strong>s cours et que <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte<br />
extérieure sera libellée en euros.<br />
En revanche, l'ancrage à l'euro ou <strong>la</strong> fixité du change constitueraient un coût pour <strong>de</strong>s<br />
économies subissant <strong>de</strong>s chocs asymétriques et un euro fort réduira <strong>la</strong> compétitivité change <strong>de</strong>s<br />
économies <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone franc. Il y a eu par contre modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> parité du FCFA vis à vis du dol<strong>la</strong>r.<br />
Dans <strong>la</strong> mesure où l'essentiel <strong>de</strong>s flux commerciaux <strong>de</strong> l'Afrique se fait avec l'Europe, un<br />
rattachement <strong>de</strong>s monnaies <strong>africaine</strong>s à l'euro peut se justifier. L'euro correspondra à un<br />
approfondissement financier <strong>de</strong> l'Europe et à un espace <strong>de</strong> stabilisation monétaire. Toute monnaie<br />
vernacu<strong>la</strong>ire doit s'ancrer sur <strong>de</strong>s monnaies véhicu<strong>la</strong>ires. L'euro sera un <strong>de</strong>s grands pôles<br />
monétaires.(l). Il sera un facteur essentiel d'attraction <strong>de</strong>s capitaux notamment d'Asie en jouant à <strong>la</strong><br />
fois sur <strong>la</strong> confiance, <strong>la</strong> constitution d'un espace intégré. <strong>Un</strong> euro fort se traduirait par <strong>de</strong>s taux<br />
d'intérêt faibles mais par une faible compétitivité commerciale européenne.<br />
La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l'euro aura <strong>de</strong>s effets positifs dont les pays africains pourront être<br />
bénéficiaires. Il y aura élimination <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> transactions liés aux opérations <strong>de</strong> change.<br />
L'instabilité monétaire et l'incertitu<strong>de</strong> qu'elle génère sera réduite. La monnaie forte , liée aux excé<strong>de</strong>nts<br />
extérieurs et aux recompositions <strong>de</strong> portefeuilles <strong>de</strong>s investisseurs non européens, aura un effet<br />
d'attractivité <strong>de</strong>s capitaux.<br />
Les scenarii monétaires<br />
Les autorités monétaires peuvent avoir <strong>de</strong>s actions discrétionnaires en pratiquant une flexibilité<br />
du change( changes flexibles purs). Elles peuvent se soumettre aux règles d'une instance supérieure<br />
ou s'ajuster automatiquement(cas <strong>de</strong> l'étalon or)<br />
Les principes d'action collective sont caractérisés par le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> symétrie et le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> coresponsabilité.<br />
Le premier concerne le partage <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong>s autorités monétaires; ces<br />
<strong>de</strong>rnières sont semb<strong>la</strong>bles lorsqu'il y a symétrie et différentes lorsqu'il y a hiérarchie, un pays à <strong>de</strong>vise<br />
clé fournissant les <strong>de</strong>vises. Le second concerne l'emprise du système sur les décisions <strong>de</strong>s<br />
gouvernants. Il va <strong>de</strong> <strong>la</strong> soumission à <strong>la</strong> co responsabilité.<br />
Plusieurs scenarii sont concevables qui vont d'un maintien voire d'un renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone<br />
Franc jusqu'à son éc<strong>la</strong>tement par recours à <strong>la</strong> souveraineté monétaire <strong>de</strong>s pays africains<br />
a. Le renforcement <strong>de</strong> l'intégration régionale au sein <strong>de</strong>s unions monétaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone franc<br />
b. L'intégration monétaire au sein <strong>de</strong> l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest<br />
On peut supposer qu'à terme se constitue autour du pôle nigérian, avec appui extérieur, une<br />
intégration régionale qui supposerait une intégration monétaire plus ou moins forte. <strong>Un</strong> fonds<br />
monétaire ouest africain pourrait recevoir <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s réserves <strong>de</strong> change. Il émettrait en<br />
contrepartie une unité <strong>de</strong> compte régionale dont le taux flexible serait relié à une monnaie ou à un<br />
panier <strong>de</strong> monnaie. Elle enregistrerait ou participerait à <strong>la</strong> fixation du taux <strong>de</strong> change <strong>de</strong>s monnaies<br />
nationales en fonction <strong>de</strong> cette unité <strong>de</strong> compte. Il y aurait système à <strong>de</strong>ux niveaux avec mise en<br />
œuvre d'une convertibilité régionale.<br />
c. Les souverainetés monétaires<br />
d. Des <strong>Un</strong>ions monétaires indépendantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone franc<br />
e. Des accords monétaires entre les <strong>Un</strong>ions monétaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone et les pays hors Zone<br />
Dans le contexte actuel, et compte tenu <strong>de</strong> l'instabilité <strong>de</strong>s politiques monétaires et cambiaires<br />
<strong>de</strong>s pays hors Zone et notamment du Nigeria, <strong>de</strong> tels accords paraissent utopiques. Ils peuvent<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 192
toutefois, à terme, réduire les instabilités <strong>de</strong> change entre pays africains, favoriser <strong>la</strong> convertibilité <strong>de</strong>s<br />
monnaies et renforcer l'intégration régionale au sein <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s <strong>Un</strong>ions économiques.<br />
Les institutions <strong>de</strong> <strong>la</strong> CEDEAO et <strong>de</strong> <strong>la</strong> CEEAC, ont prévu <strong>de</strong>s possibilités d'accord monétaires<br />
entre les pays membres <strong>de</strong>s <strong>Un</strong>ions Monétaires et les pays à monnaie inconvertible. Dans <strong>la</strong> pratique,<br />
les chambres <strong>de</strong> compensation connaissent d'importants dysfonctionnement du fait <strong>de</strong>s diversités <strong>de</strong>s<br />
régimes <strong>de</strong> change, <strong>de</strong>s pays structurellement déficitaires ou excé<strong>de</strong>ntaires et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ttes et <strong>de</strong>s taux<br />
<strong>de</strong> change irréalistes. Ce sont les marchés parallèles qui permettent pour les pays à monnaie<br />
inconvertible d'accé<strong>de</strong>r à une convertibilité grâce au F CFA. Les <strong>Un</strong>ions monétaires sont plus à même<br />
que les petits pays <strong>de</strong> négocier <strong>de</strong>s accords avec les grands pays tels le Nigeria.<br />
Il serait possible avec un appui <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté financière internationale <strong>de</strong> favoriser accords<br />
monétaires au sein <strong>de</strong>s chambres <strong>de</strong> compensation <strong>de</strong>s ajustements concertés <strong>de</strong> change et <strong>la</strong> mise<br />
en p<strong>la</strong>ce d'un serpent monétaire africain limitant les fluctuations <strong>de</strong> change entre les pays membres<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone et les pays hors Zone....<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 193
3.2.<br />
LES PROSPECTIVES<br />
GENERALES SUR L'AFRIQUE
Nous avons sélectionné quatre étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s concernant l'ensemble <strong>de</strong><br />
l'Afrique sub-saharienne :<br />
• <strong>Un</strong>e ancienne réalisée en 1966 sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> G. Ba<strong>la</strong>ndier permettant<br />
<strong>de</strong> faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> rétro<strong>prospective</strong><br />
• Trois plus récentes réalisées en :<br />
– 1983, ILTA<br />
– 1988, Afrique contemporaine<br />
– 1989, Banque mondiale.<br />
Les <strong>prospective</strong>s WALTPS, concernant l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest, ou <strong>de</strong> Jacques Giri<br />
concernant le Sahel ont été présentées dans le premier volume <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> et ne sont<br />
pas reprises ici.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 196
BILAN RETROPROSPECTIF : L'AFRIQUE EN DEVENIR.<br />
N° spécial Revue Prospective n° 13. Juin 1966<br />
Il s'agit d'un projet collectif commencé en 1963 sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Georges Bal<strong>la</strong>ndier, avec pour<br />
originalité l'intention initiale non <strong>de</strong> produire une vision européenne mais d'ai<strong>de</strong>r les Africains à<br />
construire une vision <strong>africaine</strong> <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>venir. Le projet fut rapi<strong>de</strong>ment abandonné, les Africains ayant,<br />
semble-t-il, bien voulu causer du "souhaitable" mais non du "vraisemb<strong>la</strong>ble" ou du "possible". D'où à<br />
l'arrivée une "tentative pour s’en rapprocher" signée exclusivement par <strong>de</strong>s Français 2 .<br />
- le champ géographique est l'Afrique Noire<br />
- l'horizon temporel: n'est pas précisé<br />
- <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> n'est pas exposée. En fait, il s'agit d'échange <strong>de</strong> vues d'experts sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong><br />
"gran<strong>de</strong>s idées directrices"<br />
L'introduction présente les héritages : colonisation/décolonisation/p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong> pays "en essai <strong>de</strong><br />
développement":<br />
- impossibilité <strong>de</strong> relier <strong>la</strong> colonisation à leur propre passé = <strong>la</strong> tradition orale a perdu sa<br />
fonction d'explication et <strong>de</strong> justification <strong>de</strong> <strong>la</strong> totalité du présent, les dynamiques politiques<br />
antérieures sont bloquées : <strong>la</strong> colonisation ne peut être vue que comme acci<strong>de</strong>nt et non<br />
intégrée à l'histoire<br />
- <strong>de</strong> toutes les décolonisations <strong>de</strong> l'Afrique, celle du Congo belge est <strong>la</strong> seule qui se soit<br />
traduite non par une transition organisée, mais par un effondrement brutal et total <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société coloniale : un avenir tragique s'y prépare.<br />
- dans tous les pays nouvellement indépendants, l'État est venu avant <strong>la</strong> Nation, d'où le<br />
relâchement <strong>de</strong>s disciplines et <strong>la</strong> démobilisation <strong>de</strong>s énergies. La construction nationale<br />
est le préa<strong>la</strong>ble indispensable.<br />
- dans <strong>de</strong>s sociétés plus soucieuses <strong>de</strong> conformité à <strong>la</strong> tradition que <strong>de</strong> domination<br />
conquérante <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature, le développement est une valeur dérivée (condition d'une vie<br />
matérielle meilleure et seule garantie <strong>de</strong> l'indépendance nationale)<br />
- d'où un enthousiasme déclinant pour <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification (rappel du colloque d'Addis Abeba <strong>de</strong><br />
1959 sur <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> créer une mystique du P<strong>la</strong>n pour mobiliser les masses), dont <strong>la</strong><br />
logique initiale est <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> faire appel à l'État du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> faiblesse <strong>de</strong> l'initiative et<br />
<strong>de</strong>s moyens individuels.<br />
- le choix <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> développement a été déterminé par leur coût réduit et leur<br />
forte capacité d'accumu<strong>la</strong>tion anticipée: épargne forcée, monopole d'État du commerce et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution, investissement humain. Mais l'épargne forcée a échoué au Ghana<br />
(fortes tensions sociales), le monopole d'État du commerce extérieur a été inefficace en<br />
Guinée, et partout: désillusions sur les résultats à attendre <strong>de</strong> l'investissement humain.<br />
D'où le recul <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>nifications, mais "leur abandon n'est pas nécessairement un abandon durable";<br />
les auteurs restent convaincus que l'avenir économique <strong>de</strong> l'Afrique repose sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification,.. à<br />
condition entre autres que l'on ne compte pas sur l'ai<strong>de</strong> et les investissements privés étrangers et<br />
qu'on renonce à l'industrialisation. décidée en gran<strong>de</strong> partie parce que les colonisateurs y étaient<br />
opposés.<br />
2 Louis Aujou<strong>la</strong>t (directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération technique au ministère <strong>de</strong>s <strong>affaires</strong> sociales), Jacques De Bourbon Busset<br />
(ambassa<strong>de</strong>ur), Pierre Racine (conseiller d'état), Gabriel d'Arboussier (sous secrétaire ONU). Philippe Decraene (rédacteur Le<br />
Mon<strong>de</strong>) Miche Hoffman (CNRS), Paul Mercier (EHESS) R.P. Jean Merlo (dominicain).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 197
"Des <strong>prospective</strong>s multiples et concurrentes pour l'Afrique noire"<br />
1. Des bases <strong>de</strong> départ différentes<br />
a. <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> doit tenir compte <strong>de</strong>s frontières<br />
- Les disparités nationales à l'origine sont déterminantes (popu<strong>la</strong>tion, taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation,<br />
dotations. <strong>la</strong>ngue..)<br />
- importance <strong>de</strong>s blocs (Casab<strong>la</strong>nca/Monrovia) malgré l'OUA; faible importance <strong>de</strong>s choix<br />
doctrinaux (socialismes/capitalismes d'état)<br />
b. les chances <strong>de</strong> développement sont inégales<br />
(p. 69) : "ceux qui parlent aujourd'hui <strong>de</strong> "l'Afrique utile" emploient une formule qui ne<br />
correspond encore à aucune entité réelle. –Mais déjà le Congo-Léopolville, <strong>la</strong> République Sud<strong>africaine</strong>,<br />
<strong>la</strong> Rhodésie et <strong>la</strong> Zambie qui rassemblent moins. <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'Afrique<br />
noire, sont responsables <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 50 % <strong>de</strong> son PIB et constituent <strong>la</strong> seule zone où<br />
l'agriculture ne soit plus l'activité principale. C'est là que se trouve le centre <strong>de</strong> gravité <strong>de</strong><br />
l'Afrique <strong>de</strong> <strong>de</strong>main. Or <strong>la</strong> difficulté <strong>de</strong> l'analyse <strong>prospective</strong> vient <strong>de</strong> ce que cette "Afrique utile"<br />
est encore dans sa masse à l'heure actuelle une Afrique muette, par indécision ou par<br />
contrainte. Mais lorsque les popu<strong>la</strong>tions noires <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rhodésie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> République Sud<strong>africaine</strong><br />
basculeront du côté <strong>de</strong>s véritables indépendances, les images <strong>africaine</strong>s <strong>de</strong> l'avenir<br />
seront brutalement déformées dans un sens que nos moyens d'information et d'investigation ne<br />
nous permettent guère <strong>de</strong> prévoir, sinon pour imaginer que ces zones <strong>de</strong> décolonisation<br />
différée –auxquelles s'ajoutent les pays <strong>de</strong> colonisation portugaise– porteront une charge<br />
révolutionnaire plus élevée, dans <strong>la</strong> mesure même où les indépendances y résulteront <strong>de</strong> luttes<br />
difficiles… Le poids véritable <strong>de</strong> l'Afrique se trouve donc dans <strong>de</strong>ux zones qui apparaissent<br />
privilégiées : <strong>la</strong> côte <strong>de</strong> l'Afrique occi<strong>de</strong>ntale et l'Afrique méridionale. Si les États les plus<br />
peuplés étaient en même temps les moins pauvres et les plus dynamiques, il serait re<strong>la</strong>tivement<br />
facile <strong>de</strong> déterminer dès à présent ce que sera l'Afrique dans 20 ans. Mais <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>de</strong><br />
l'Afrique ne peut pas être l'assemb<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s <strong>africaine</strong>s nationales juxtaposées. Elle<br />
ne peut être cloisonnée, car le continent tout entier est à <strong>la</strong> fois un champ <strong>de</strong> rivalités et une<br />
caisse <strong>de</strong> résonance".<br />
2. Décol<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s économies<br />
D'après <strong>la</strong> Commission économique pour l'Afrique <strong>de</strong> l'ONU:<br />
- <strong>de</strong>puis 1938, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>la</strong> production agricoles auraient augmenté <strong>de</strong> 50 %; <strong>la</strong><br />
production industrielle a été multipliée par 4.<br />
- pour amener l'Afrique au niveau <strong>de</strong> développement atteint par l'Europe en 1960, il faudrait<br />
en 50 ans multiplier <strong>la</strong> production agricole par 2 (1 à 2 % par an) et <strong>la</strong> production<br />
industrielle par 25 (7 à 8% par an) sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance démographique extrapolée<br />
Ces objectifs peuvent-ils être atteints ?<br />
- perspectives du commerce international peu réjouissantes (dégradation <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong><br />
l'échange); évolution moins nette <strong>de</strong>s produits primaires (peut-être un espoir du côté<br />
minier = Afrique utile); <strong>la</strong> production agricole se tournera plus vers le marché intérieur<br />
(urbanisation) que les marchés extérieurs (saturés, en occi<strong>de</strong>nt) + développement<br />
d'industries alimentaires import-substit.<br />
- insuffisance d'épargne et dualisme financier: ai<strong>de</strong> étrangère insuffisante et inadéquate.<br />
- p<strong>la</strong>nification difficile en l'absence <strong>de</strong> moyens <strong>de</strong> stabiliser les cours,<br />
- rigidités <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> fonctionnement = report <strong>de</strong>s aléas sur les investissements.<br />
- les structures agraires iraient mieux s'il y avait <strong>de</strong> l'emploi dans les villes; mais danger<br />
politique et investissements sociaux = les responsables politiques ne chercheront pas à<br />
bouleverser trop rapi<strong>de</strong>ment les structures du mon<strong>de</strong> rural pour que les données du<br />
problème soient modifiées, il faudrait amener l'industrie à <strong>la</strong> campagne. mais problème <strong>de</strong><br />
communications et peuplement insuffisant<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 198
- les expériences d'unification économique entre régions concurrentes pourraient être<br />
positives et réduire les inégalités. Mais rivalités politiques "l'accentuation <strong>de</strong> disparités<br />
encore peu sensibles, <strong>la</strong> consolidation <strong>de</strong> pôles <strong>de</strong> développement au milieu <strong>de</strong> vastes<br />
espaces défavorisés, l'accroissement du poids re<strong>la</strong>tif <strong>de</strong> certaines régions (côte <strong>de</strong><br />
l'Afrique occi<strong>de</strong>ntale, Afrique centrale et méridionale) transformeront <strong>la</strong> carte <strong>de</strong> l'Afrique<br />
dans un avenir proche" (p. 81). L'unification permettrait <strong>de</strong> diminuer leur caractère<br />
mécanique et aveugle<br />
3. Le dynamisme <strong>de</strong>s groupes sociaux <strong>de</strong>s sociétés "Inédites"<br />
a. les "compétences"<br />
Les c<strong>la</strong>sses dirigeantes: ni possédantes, ni productives; arrivées par <strong>la</strong> politique donc<br />
gérantes bureaucratie technocratique. Les grèves et émeutes, contre cette élite sont le fait<br />
d'ouvriers et d'employés. et visent non <strong>la</strong> catégorie sociale mais les individus..<br />
b. <strong>la</strong> bourgeoisie d'entreprise<br />
commerce, <strong>affaires</strong>, mais aussi p<strong>la</strong>ntations et transports, cette bourgeoisie est généralement<br />
associée aux gestionnaires d'Etat (sauf socialismes type Mali)<br />
c. les sa<strong>la</strong>riés<br />
catégorie privilégiés (par rapport aux paysans) et non prolétaires démunis<br />
syndicats peu revendicatifs, dont les cadres sont souvent (pas toujours, ex agitation Congo-<br />
Brazza et Dahomey) intégrés aux appareils d'État<br />
d. les jeunes<br />
"ils constituent une catégorie qui prend à <strong>la</strong> collectivité plus qu'elle ne lui apporte et qui lui<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> éducation et travail. Il est plus facile <strong>de</strong> satisfaire <strong>la</strong> première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> que <strong>la</strong><br />
secon<strong>de</strong>, car il est moins coûteux <strong>de</strong> créer une p<strong>la</strong>ce dans une école qu'un emploi" (86). La<br />
perspective <strong>de</strong>s sco<strong>la</strong>risés étant le chômage ou le déc<strong>la</strong>ssement professionnel: masse <strong>de</strong><br />
manœuvre <strong>de</strong>s révolutions impossible à désarmer<br />
e. <strong>la</strong> paysannerie<br />
pas homogène, mais sa masse fait force<br />
l'indépendance a surtout amélioré le sort <strong>de</strong>s privilégiés et n'a apporté que peu d'avantages<br />
aux autres. On ne peut préciser <strong>la</strong> forme que prendront les revendications <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers<br />
lorsqu'ils chercheront à combler un écart qui continue <strong>de</strong> s'accroître.<br />
4. <strong>Un</strong>e éducation <strong>africaine</strong><br />
a. rareté <strong>de</strong> l'éducation et coût du savoir<br />
- reprend les chiffres <strong>de</strong> <strong>la</strong> conférence 1961 Addis Abeba<br />
- on a trop favorisé le primaire après l'indépendance au détriment du secondaire (d'où le<br />
manque <strong>de</strong> cadres et le coût trop élevé <strong>de</strong>s enseignants..)<br />
b. nécessité d'une p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong> l'éducation<br />
c. possibilité d'une coopération internationale<br />
5. Construction nationale et stabilisation politique<br />
a. tribalisme et intégration nationale : le déca<strong>la</strong>ge qui existe entre <strong>la</strong> ville et <strong>la</strong> campagne<br />
parait être une menace plus grave pour l'intégration nationale que les manifestations du<br />
tribalisme: les conflits politiques <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières années ont surtout mis face à face <strong>de</strong>s<br />
groupes se recrutant dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 199
. refonte <strong>de</strong>s structures politiques : problèmes du parti unique et <strong>de</strong> l'armée<br />
"quelque extension que prenne l'instabilité politique dans l'avenir, il y a peu <strong>de</strong> chances qu'elle<br />
conduise à une mutation <strong>de</strong>s politiques. Elle peut contribuer à renouveler les dirigeants, plus<br />
en changeant les personnes qu'en modifiant les rapports <strong>de</strong> force entre les groupes<br />
politiques. Ceux qui sortiront vainqueurs <strong>de</strong>s conflits qui surgiront en Afrique hériteront <strong>de</strong> plus<br />
<strong>de</strong> faiblesses que <strong>de</strong> forces. La dépendance <strong>de</strong> l'Afrique vis-à-vis du reste du mon<strong>de</strong> est trop<br />
gran<strong>de</strong> pour qu'elle puisse modifier son cap, il n'y a p<strong>la</strong>ce que pour <strong>de</strong>s ajustements mineurs"<br />
(p. 110).<br />
6. Les chances <strong>de</strong>s socialismes<br />
7. L'Afrique et le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>main<br />
Conclusion<br />
a. dépendance et indépendance<br />
(p. 118). "Peu <strong>de</strong> pays africains sont en mesure d'assurer avec leurs propres moyens le<br />
fonctionnement <strong>de</strong> leur appareil administratif, policier et militaire. Pour certains d'entre eux<br />
l'indépendance n'est guère plus que Ia possibilité <strong>de</strong> choisir entre les dépendances possibles"<br />
b. conflits <strong>de</strong>s solidarités<br />
(p. 119) "La conscience d'appartenir au Tiers Mon<strong>de</strong> s'est formée en Afrique par le biais <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
politique : elle se développera du fait <strong>de</strong>s situations économiques. Pendant longtemps<br />
l'Afrique noire a cru quelle était privilégiée par rapport au reste du tiers mon<strong>de</strong> : elle était à<br />
l'abri <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s famines et ignorait les pressions démographiques. La situation coloniale lui<br />
avait masqué ses vrais problèmes. Aujourd'hui que les zones monétaires se démantèlent et<br />
que les privilèges disparaissent... l'Afrique noire se rend compte que son problème<br />
économique capital, comme celui du reste du Tiers Mon<strong>de</strong>, est le prix <strong>de</strong>s matières<br />
premières"… cependant l'Afrique Noire n'a pas renoncé à une solidarité plus discrète, mais<br />
non moins efficiente, avec les pays développés pour le "ren<strong>de</strong>z-vous du donner et du<br />
recevoir"<br />
c. isolement et engagement<br />
Comme l'Afrique elle-même, cette <strong>prospective</strong> est dépendante<br />
(p. 133) : "La tentation est gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> penser que l'Afrique sera <strong>de</strong>main ce que le mon<strong>de</strong> aura voulu<br />
qu'elle soit et que son histoire à venir ne sera qu'un reflet fidèle <strong>de</strong> l'évolution internationale. Chaque<br />
ensemble politique attache, dans sa stratégie, une importance certaine à l'Afrique et il lui assigne un<br />
rôle : par là il esquisse une image <strong>de</strong> l'Afrique future... Ces images ne se superposent pas. Elles sont<br />
même contradictoires. Mais vouloir déterminer <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong> ces images peut prévaloir sur les autres et<br />
i<strong>de</strong>ntifier à elle l'avenir <strong>de</strong> l'Afrique revient à considérer celle-ci comme un enjeu, presque passif, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
compétition mondiale et à nier le parti que nous avons pris <strong>de</strong> renverser les perspectives<br />
traditionnelles d'analyse et <strong>de</strong> partir <strong>de</strong>s options que l'Afrique elle-même a déjà esquissées.<br />
Dépendance ne signifie pas prédétermination par l'extérieur, mais plutôt non-disposition <strong>de</strong> tous les<br />
éléments <strong>de</strong> base nécessaires à <strong>la</strong> liberté <strong>de</strong>s choix. Ces choix existeront cependant : ils ne seront<br />
pas dictés par <strong>de</strong>s tiers seulement orientés par certaines insuffisances <strong>de</strong> moyens d'action. Cette<br />
distinction n'est pas d'ordre mineur".<br />
Les désillusions:<br />
- peuvent mener à <strong>la</strong> violence (surtout dans les zones frontalières et les zones rurales<br />
isolées : jacqueries, violences inorganisées)<br />
- peuvent mener à <strong>la</strong> patience: les africains, n'ont pas le nombre (comme l'Asie) mais ils ont<br />
le temps…(!)<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 200
Introduction<br />
UNE IMAGE A LONG TERME DE L'AFRIQUE (ILTA)<br />
AU SUD DU SAHARA (1983)<br />
par Jean-Marie COUR<br />
Où et comment vivront le milliard d'habitants que comptera l'Afrique sub-saharienne aux environs <strong>de</strong><br />
l'année 2010 ? Angoissante question si l'on en croit les nombreux ouvrages et rapports traitant <strong>de</strong><br />
l'Afrique, parmi lesquels on citera : René Dumont - L'Afrique noire est mal partie (1962); Nous allons à<br />
<strong>la</strong> famine (1966); L'Afrique étranglée (1982); Pour l'Afrique, j'accuse (1986).<br />
Voici quelques citations extraites <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier ouvragé qui a failli s'appeler « l'Afrique se meurt :<br />
Dakar... un cancer au f<strong>la</strong>nc d'un pays pauvre » : « <strong>la</strong> production alimentaire tombera, en fin <strong>de</strong> siècle,<br />
au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 100 kilos par tête alors que le besoin individuel ne peut <strong>de</strong>scendre au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 145<br />
kilos ».<br />
- UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE: Food problems and prospects in SSA<br />
(1981) : « L'indice <strong>de</strong> <strong>la</strong> production alimentaire par tête <strong>de</strong> l'Afrique au sud du Sahara est passé<br />
<strong>de</strong> 100 en 1961-1965 à 77 en 1978 ».<br />
- INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE (IFPRI) : « La prolongation <strong>de</strong>s<br />
tendances passées (1960-1975) conduirait à un déficit net <strong>de</strong> l'Afrique au sud du Sahara en<br />
céréales <strong>de</strong> 29 à 37 millions <strong>de</strong> tonnes en 1990 selon l'hypothèse retenue <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s<br />
revenus ».<br />
- C<strong>la</strong>ire Brisset (août 1984) : « En 2020 l'Afrique ne pourra nourrir, à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> ses ressources<br />
propres, que moins <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> ses habitants ».<br />
Toutes ces analyses et prévisions sont, à <strong>de</strong>s nuances près, si concordantes que l'on finit par s'y<br />
habituer et ne plus s'en étonner. Pourtant, les Africains eux-mêmes, les premiers intéressés, savent<br />
bien que cette vision d'une Afrique en déroute généralisée, affamée, aux villes peuplées <strong>de</strong> bandits et<br />
<strong>de</strong> moribonds, n'est guère conforme à <strong>la</strong> réalité. Ils savent bien que leurs villes, si sous-équipées<br />
qu'elles soient, offrent d'innombrables opportunités. Même lorsque, dans les réunions internationales<br />
et pour faire comme tout le mon<strong>de</strong>, les responsables africains reprennent à leur compte les prévisions<br />
les plus pessimistes, ils savent bien au fond d'eux-mêmes que l'Afrique <strong>de</strong> l'an 2010 n'a guère <strong>de</strong><br />
chances <strong>de</strong> ressembler à un continent en ruine.<br />
Alors, ne faut-il pas se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si tous ces diagnostics ne sont pas, au moins en partie, le résultat<br />
d'une erreur d'optique et <strong>de</strong> notre incapacité à comprendre les changements qui s'opèrent dans ce<br />
continent en pleine explosion démographique ? Ne faut-il pas remettre en question <strong>la</strong> signification <strong>de</strong>s<br />
agrégats et indicateurs macro-économiques habituels, les indices <strong>de</strong> <strong>la</strong> production alimentaire par<br />
tête, les statistiques <strong>de</strong> l'emploi, du commerce interafricain, etc. ? Si tous ces indicateurs quelque peu<br />
abstraits ne nous permettent pas <strong>de</strong> comprendre pourquoi <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s pays d'Afrique, même le<br />
Zaïre, tiennent encore à peu près <strong>de</strong>bout aujourd'hui et ne meurent pas <strong>de</strong> faim, si nos modèles ne<br />
nous permettent pas <strong>de</strong> comprendre que cette Afrique, même si elle est « mal partie », a fait un bon<br />
bout <strong>de</strong> chemin au cours <strong>de</strong>s trois <strong>de</strong>rnières décennies, ne faut-il pas les remettre en question ? N'y at-il<br />
pas <strong>de</strong> bonnes raisons <strong>de</strong> douter du bien-fondé <strong>de</strong>s stratégies proposées dans les nombreux<br />
rapports panafricains qui passent totalement à côté <strong>de</strong>s problèmes urbain ? (voir le rapport Berg et<br />
ses successeurs, le rapport Strategy for African <strong>de</strong>velopment, etc.).<br />
L'étu<strong>de</strong> ILTA : une approche centrée sur le peuplement<br />
L'étu<strong>de</strong> d'une "image à long terme <strong>de</strong> l'Afrique au sud du Sahara" (ILTA) réalisée en 1983 avec le<br />
concours <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong>s Communautés européennes et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Caisse <strong>de</strong>s dépôts et<br />
consignations, a précisément été conçue pour apporter <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> réponse à ces questions en<br />
adoptant un point <strong>de</strong> vue différent et résolument optimiste. Selon cette étu<strong>de</strong>, <strong>la</strong> croissance<br />
démographique inéluctable ne conduit pas à <strong>la</strong> catastrophe s'il n'est pas fait obstacle, aux p<strong>la</strong>ns<br />
régional, national et local, à <strong>la</strong> mobilité <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong>s activités et si, avec l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
communauté internationale, les infrastructures nécessaires peuvent être réalisées et convenablement<br />
gérées.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 201
Le diagnostic : 1950-1980<br />
ILTA comprend tout d'abord un essai <strong>de</strong> réinterprétation <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance économique et <strong>de</strong>s<br />
changements structurels intervenus dans les 47 pays d'Afrique au sud du Sahara <strong>de</strong>puis 1950. Les<br />
données <strong>de</strong> base sur lesquelles ce diagnostic a été construit sont essentiellement une analyse assez<br />
fine <strong>de</strong> <strong>la</strong> géographie (potentialités et contraintes naturelles) et <strong>de</strong> l'évolution du peuplement<br />
(répartition <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, situation par rapport aux infrastructures et aux marchés). A cette<br />
évolution du peuplement sont associées une estimation <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> l'activité économique et<br />
<strong>de</strong>s échanges et une appréciation <strong>de</strong>s changements structurels correspondants. Quelques exemples<br />
<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions supposées entre peuplement et croissance économique permettront d'illustrer <strong>la</strong><br />
démarche suivie.<br />
Le premier exemple est re<strong>la</strong>tif à l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole. Il est admis<br />
dans ILTA que le facteur principal dont dépend l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> production alimentaire par agriculteur<br />
est le marché représenté par un réseau <strong>de</strong> villes. Plus précisément, <strong>la</strong> productivité <strong>de</strong>s agriculteurs est<br />
fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> urbaine (proportionnelle à <strong>la</strong> taille <strong>de</strong>s villes) et <strong>de</strong>s conditions d'accès à ce<br />
marché (distance, organisation <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> commercialisation, etc.). Ainsi, en rase campagne, loin<br />
<strong>de</strong> tout marché (loin <strong>de</strong> toute ville et <strong>de</strong> toute infrastructure permettant l'accès à ce marché), <strong>la</strong><br />
productivité alimentaire est déterminée par <strong>la</strong> satisfaction <strong>de</strong>s besoins locaux (quelque 800<br />
kilocalories par habitant et par an), et elle n'a guère <strong>de</strong> raison <strong>de</strong> croître au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce niveau si les<br />
re<strong>la</strong>tions avec le marché restent i<strong>de</strong>ntiques. Si, au contraire, le terroir rural considéré est en contact<br />
avec un marché urbain <strong>de</strong> taille croissante, les systèmes <strong>de</strong> production agricole se modifient et se<br />
différencient <strong>de</strong> telle façon que <strong>la</strong> productivité moyenne croîtra en fonction <strong>de</strong>s besoins du marché,<br />
cette évolution étant d'autant plus rapi<strong>de</strong> que <strong>la</strong> connexion avec le marché urbain est mieux assurée.<br />
Globalement, à l'échelle locale comme à l'échelle régionale, c'est donc <strong>la</strong> croissance urbaine re<strong>la</strong>tive<br />
qui apparaît comme le moteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité agricole, <strong>de</strong>s revenus monétaires <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale et <strong>de</strong>s échanges ville-campagne. Les bi<strong>la</strong>ns agricoles et alimentaires locaux et<br />
nationaux reconstitués <strong>de</strong> cette manière (en tenant compte <strong>de</strong>s échanges extérieurs) conduisent à<br />
une image bien différente <strong>de</strong> celle fournie par les statistiques agricoles habituelles reprises dans les<br />
comptes nationaux et les indicateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO.<br />
Le <strong>de</strong>uxième exemple est re<strong>la</strong>tif à l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur ajoutée urbaine. Au secteur mo<strong>de</strong>rne<br />
conçu dans un sens restrictif (l'administration et les activités <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong>s secteurs secondaires<br />
et tertiaires i<strong>de</strong>ntifiables par <strong>la</strong> comptabilité nationale), s'ajoute le secteur « informel » <strong>la</strong>rgement<br />
majoritaire en termes <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine concernée, auquel est associée une production<br />
compatible avec <strong>la</strong> satisfaction <strong>de</strong>s besoins essentiels <strong>de</strong>s ménages dans l'environnement considéré<br />
(capitale, gran<strong>de</strong>s villes, villes secondaires). La productivité moyenne du secteur informel urbain<br />
apparaît ainsi en moyenne <strong>de</strong> l'ordre du double <strong>de</strong> <strong>la</strong> moyenne <strong>de</strong>s zones rurales enc<strong>la</strong>vées.<br />
L'hypothèse faite dans ILTA, selon <strong>la</strong>quelle cette productivité du secteur informel urbain n'a pas décru<br />
<strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux décennies, est bien conforme à l'observation du terrain : le type d'habitat, <strong>la</strong><br />
consommation alimentaire et <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong>s autres biens et services essentiels n'ont guère<br />
changé au sein <strong>de</strong> ce secteur informel. Le PIB urbain recalculé <strong>de</strong> cette manière (et en tenant compte<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance du nombre et <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille <strong>de</strong>s centres urbains qui est presque toujours sous-estimée)<br />
est, dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s pays, sensiblement plus élevé que celui qui résulte <strong>de</strong>s comptes nationaux.<br />
ILTA abor<strong>de</strong> également d'autres composantes <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s économies <strong>africaine</strong>s et s'efforce<br />
en particulier <strong>de</strong> réévaluer les flux d'échanges milieu rural-milieu urbain et le commerce interafricain<br />
dont les statistiques officielles du commerce extérieur ne saisissent qu'une toute petite partie. C'est ce<br />
commerce interafricain, en partie informel, en partie souterrain, qui permet <strong>de</strong> comprendre pourquoi<br />
l'économie <strong>de</strong> certains pays comme le Zaïre résiste mieux qu'on ne pourrait s'y attendre à<br />
l'effondrement du secteur mo<strong>de</strong>rne : les villes du Zaïre (pays vi<strong>de</strong> sauf sur ses frontières) vivent <strong>de</strong> ce<br />
commerce régional, elles périclitent ou se développent en fonction <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong> celui-ci (exemples<br />
respectifs <strong>de</strong> Goma-Bukavu au Centre-Kivu, et <strong>de</strong> Bunia-Butembo au Nord-Kivu).<br />
Globalement, le diagnostic présenté dans ILTA sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1950-1980 est celui d'un continent en<br />
pleine mutation démographique et économique, dont <strong>la</strong> croissance économique, fortement influencée<br />
par l'environnement extérieur, a été marquée par <strong>de</strong>s disparités croissantes. En 30 ans (1950-1980),<br />
le produit intérieur brut <strong>de</strong> <strong>la</strong> région a quadruplé et le produit par habitant a doublé : ce doublement du<br />
PIB moyen par habitant recouvre en fait une légère décroissance du PIB moyen par habitant urbain<br />
(dont l'effectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion a presque sextuplé) et une croissance du PIB moyen par habitant rural<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 202
au rythme dicté par l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille re<strong>la</strong>tive du marché régional <strong>de</strong>s produits alimentaires (qui<br />
représente plus <strong>de</strong> 90 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole totale) : alors qu'en 1950 un agriculteur <strong>de</strong>vait, au<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> son autoconsommation, nourrir 0,18 habitant non agricole (soit un revenu monétaire moyen<br />
correspondant <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 35 dol<strong>la</strong>rs par habitant agricole), ce ratio atteignait en 1980 <strong>la</strong> valeur<br />
moyenne <strong>de</strong> 0,45 (soit un revenu monétaire moyen <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 90 dol<strong>la</strong>rs par habitant agricole),<br />
avec <strong>de</strong>s moyennes nationales s'échelonnant <strong>de</strong> 0,10 au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, à 0,7<br />
en Côte-d'Ivoire, 0,8 au Nigéria et 1,2 en Afrique du Sud.<br />
Contrairement à ce qui est couramment affirmé, le paysannat africain a, dans l'ensemble réussi à<br />
suivre l'accroissement rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> régionale <strong>de</strong>s produits alimentaires les importations <strong>de</strong><br />
produits alimentaires ne croissent pas plus vite que les importations totales; elles représentent moins<br />
<strong>de</strong> 10 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation alimentaire totale et sont compensées par <strong>de</strong>s exportations équivalentes<br />
en valeur nutritive.<br />
L'urbanisation rapi<strong>de</strong> du continent ne s'est pas limitée aux capitales, malgré l'inévitable<br />
concentration d'équipements et d'activités mo<strong>de</strong>rnes dans les villes qui sont le siège du pouvoir<br />
politique. Le nombre total <strong>de</strong> cités <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 100000 habitants est en effet passé <strong>de</strong> 32 à 173, celui<br />
<strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 5000 habitants est passé <strong>de</strong> 670 à 2900. La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s infrastructures<br />
nécessaires à cette redistribution du peuplement a rarement suivi les besoins, <strong>de</strong> nombreux pays<br />
ayant jusqu'à présent vécu sur le stock d'infrastructures légué par l'ère coloniale. L'étu<strong>de</strong> ILTA<br />
considère que cette situation est, au moins en partie, imputable aux partenaires extérieurs : désintérêt<br />
pour <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification et surtout pour <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification régionale et l'aménagement du territoire, priorité<br />
accordée aux secteurs dits productifs dans une approche par projet, désintérêt pour l'administration<br />
du territoire (préfets, gouverneurs, bourgmestres, etc.) dont le rôle clef dans l'animation du<br />
développement régional (bien compris par les anciens colonisateurs) a été perdu <strong>de</strong> vue. Le retard<br />
pris en matière d'infrastructure et d'administration du territoire est beaucoup plus préoccupant pour<br />
l'avenir que le problème <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité alimentaire, dont <strong>la</strong> solution dépend précisément <strong>de</strong>s mesures<br />
propres à faciliter <strong>la</strong> mobilité <strong>de</strong>s personnes (migration), <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s marchandises et le<br />
fonctionnement <strong>de</strong>s marchés.<br />
L'image à long terme : l'horizon 2010<br />
L'image à long terme <strong>de</strong> l'Afrique au sud du Sahara proposée dans l'étu<strong>de</strong> ILTA a tout d'abord pour<br />
objectif <strong>de</strong> montrer que <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> telles images nationales ou régionales est un exercice à <strong>la</strong><br />
portée <strong>de</strong> tous les déci<strong>de</strong>urs (gouvernements <strong>de</strong>s pays d'Afrique au sud du Sahara, organismes<br />
régionaux, bailleurs <strong>de</strong> fonds, etc.), <strong>de</strong> nature à faciliter l'expression d'une stratégie <strong>de</strong> développement<br />
et à améliorer <strong>la</strong> qualité du dialogue entre partenaires.<br />
L'image particulière présentée dans ILTA repose sur l'analyse <strong>de</strong>s tendances passées <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
1950-1980 et notamment sur l'analyse <strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong>s migrations. L'hypothèse fondamentale <strong>de</strong><br />
cette image est que ces migrations au sein du continent seront re<strong>la</strong>tivement libres : les frontières<br />
actuelles sont intangibles mais elles sont perméables aux hommes. Le processus d'urbanisation, en<br />
gran<strong>de</strong> partie lié aux re<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> cette région avec le reste du mon<strong>de</strong>, s'y poursuivra à un rythme<br />
rapi<strong>de</strong>, avec <strong>de</strong>s taux moyens <strong>de</strong> croissance urbaine variant <strong>de</strong> 2 % à 8 % selon les pays.<br />
Selon l'étu<strong>de</strong> ILTA, cette urbanisation continuera sans paupérisation <strong>de</strong>s masses urbaines et sans<br />
déficit alimentaire massif. Du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> concentration <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> liée aux migrations<br />
internationales et à l'urbanisation, <strong>la</strong> productivité <strong>de</strong>s agriculteurs évoluera avec <strong>de</strong>s disparités<br />
fortement croissantes. <strong>Un</strong>e <strong>la</strong>rge fraction du territoire africain restera encore dominée par l'agriculture<br />
<strong>de</strong> subsistance (hors marché), cependant que certaines régions à mail<strong>la</strong>ge urbain très <strong>de</strong>nse seront<br />
caractérisées par une agriculture marchan<strong>de</strong>, spécialisée et à revenus monétaires élevés.<br />
<strong>Un</strong>e autre hypothèse forte <strong>de</strong> cette image ILTA, que les événements récents semblent plutôt<br />
infirmer, est que les besoins considérables en infrastructures (routes, communications, infrastructure<br />
urbaine) seront satisfaits, en partie grâce à <strong>de</strong>s transferts publics croissants. <strong>Un</strong> calcul simple montre<br />
en effet que les besoins d'infrastructure <strong>de</strong> cette région du mon<strong>de</strong>, dont <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale aura<br />
décuplé et <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine aura centuplé en un siècle, sont hors <strong>de</strong> portée <strong>de</strong>s économies<br />
<strong>africaine</strong>s dans leur ensemble.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 203
La mise en œuvre d'un vaste programme régional d'infrastructure, concertée avec les partenaires<br />
extérieurs, milite en faveur d'une nouvelle approche <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification que propose l'étu<strong>de</strong> ILTA : les<br />
p<strong>la</strong>ns indicatifs à long terme (horizon 10 ans), régionalisés par construction et non a posteriori, doivent<br />
former le cadre <strong>de</strong> cohérence <strong>de</strong>s programmes d'action incombant aux divers déci<strong>de</strong>urs<br />
(administration centrale, administration du territoire, collectivités locales, professions).<br />
Conclusion<br />
Cette étu<strong>de</strong> ILTA a soulevé beaucoup <strong>de</strong> critiques. La Commission <strong>de</strong>s Communautés européennes<br />
ne lui a assuré qu'une diffusion restreinte. Il est vrai que le mo<strong>de</strong> d'emploi <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> n'est pas<br />
évi<strong>de</strong>nt, et que le « modèle » économique sous-jacent est quelque peu simpliste.<br />
Il n'en reste pas moins que quelques résultats concrets ont été atteints et qui suffisent à justifier<br />
l'exercice. Tout d'abord, le doute a été jeté quant à <strong>la</strong> validité <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données démographiques<br />
et économiques habituellement utilisées. Il semble qu'on ne soit plus très loin du moment où une<br />
institution internationale prendra <strong>la</strong> décision, difficile, d'une réorganisation en profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> ces bases<br />
<strong>de</strong> données avec une redéfinition <strong>de</strong>s rôles respectifs <strong>de</strong>s diverses organisations spécialisées et <strong>de</strong>s<br />
métho<strong>de</strong>s renouvelées. Ensuite, <strong>la</strong> réflexion sur le rôle <strong>de</strong>s villes dans le développement reprend<br />
quelque actualité, principalement sous <strong>la</strong> forme d'un ensemble d'étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions et <strong>de</strong>s échanges<br />
entre les villes et le milieu rural environnant (urban-rural linkages). C'est grâce à <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ce<br />
genre que <strong>la</strong> nécessité d'une politique active d'urbanisation <strong>de</strong>s pays comme le Burundi n'est<br />
maintenant plus contestée. Ces étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s échanges entre les villes et leur hinter<strong>la</strong>nd débouchent sur<br />
<strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s d'analyse du fonctionnement <strong>de</strong> l'économie locale qui montrent bien l'importance <strong>de</strong>s<br />
villes dans <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s revenus ruraux et permettent <strong>de</strong> comprendre pourquoi et dans quelles<br />
conditions le prélèvement exercé par <strong>la</strong> ville sur son hinter<strong>la</strong>nd profite en fait à <strong>la</strong> fois à l'un et à l'autre.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 204
Carte 1. – Chiffres <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion en 2010 (en millions d’hab.)<br />
Carte 2. – PIB par habitant en 2010
eLES AFRIQUES DE L'AN 2000. PERSPECTIVES 3 ECONOMIQUES<br />
in Afrique Contemporaine, n° 146, 1988<br />
Ce travail, à horizon 2000, comporte six textes principaux (Hugon, Coury, Sudrie, Coussy,<br />
Duruflé, Giri et Sall) plus une bibliographie commentée sur les travaux récents <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> par<br />
Barbier.<br />
I. PRINCIPAUX TRAITS COMMUNS<br />
Presque tous les textes mettent l'accent<br />
- sur les déficiences et inadéquations <strong>de</strong> l'information statistique. Des chercheurs comme<br />
J.M. Cour en tirent l'idée que <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> l'ASS est moins catastrophique que le<br />
suggèrent les indicateurs qu'il essaie <strong>de</strong> corriger en prenant en compte le facteur<br />
"peuplement". D'autres, Sudrie en particulier, insistent sur le fait que ces déficiences<br />
statistiques ne doivent pas conduire à renoncer aux travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>, ceux-ci<br />
pouvant précisément induire à terme, une amélioration <strong>de</strong> l'information. Enfin, Ph. Hugon<br />
analyse les "Mythes et limites <strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s économiques sur l'Afrique" dus en partie<br />
aux carences <strong>de</strong> l'information ;<br />
- sur l'incertitu<strong>de</strong> majeure qui caractérise <strong>la</strong> situation observée (en 1988) et les<br />
cheminements et scénarios possibles. On en retire l'impression (sauf peut-être dans <strong>la</strong><br />
critique faite par Duruflé au texte <strong>de</strong> J.M. Cour) que tout et son contraire peut arriver en<br />
ASS d'ici l'an 2000. Ce trait est particulièrement marqué dans le texte <strong>de</strong> Ph. Hugon<br />
"Quels avenirs économiques pour l'Afrique ?" ;<br />
- l'existence d'un "biais pessimiste" qui corrige quelque peu l'impression précé<strong>de</strong>nte. Là<br />
encore, J.M. Cour fait exception;<br />
- <strong>la</strong> difficulté <strong>de</strong> traiter l'ASS comme un tout, alors qu'elle est marquée par une très forte<br />
hétérogénéité. D'où <strong>de</strong>s propositions <strong>de</strong> découpages <strong>de</strong> l'espace particulièrement in Ph.<br />
Hugon (2ème texte sur les "avenirs").<br />
<strong>Un</strong> autre trait commun à ces textes est l'absence <strong>de</strong> prise en compte <strong>de</strong>s facteurs géopolitiques<br />
et idéologiques bien que le lien entre économie, culturel, social et politique figure dans les<br />
propositions méthodologiques <strong>de</strong> Ph. Hugon (p. 17). Au mieux sont-ils cités, çà et là (Coussy,<br />
Hugon), mais n'ont pas <strong>de</strong> statut défini. Peu <strong>de</strong> choses également sur le problème <strong>de</strong>s flux<br />
migratoires (sauf quelques lignes dans Hugon) et ses liens possibles avec l'évolution <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong><br />
internationale et <strong>de</strong> sa perception par l'opinion publique. En bref, l'étu<strong>de</strong> se veut et est à dominante<br />
économique.<br />
Enfin, on note une re<strong>la</strong>tive déconnexion <strong>de</strong>s textes entre eux, les renvois <strong>de</strong> l'un à l'autre étant<br />
fort rares sauf bien entendu dans le débat qui oppose Cour-Duruflé.<br />
Il. ANALYSE DES TEXTES<br />
L'étu<strong>de</strong> débute et se clôt par <strong>de</strong>ux analyses <strong>de</strong> Ph. Hugon. 1. Propositions d'une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>prospective</strong> ; 2. La mise à l'épreuve.<br />
Texte 1 : Mythes et limites <strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s <strong>africaine</strong>s (pp. 12-20)<br />
Erreurs passées et limites <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s traditionnelles ---><br />
- échec <strong>de</strong>s extrapo<strong>la</strong>tions malthusiennes qui, par construction, débouchent sur <strong>de</strong>s<br />
scénarios catastrophes ;<br />
- échec <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns volontaristes : l'oubli <strong>de</strong>s contraintes financières à court terme permet <strong>de</strong><br />
brosser <strong>de</strong>s "horizons radieux" mais vite démentis (ex. le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Lagos) ;<br />
3 Perspectives et non Prospective.
- surestimation du poids du court terme et du poids du tout-Marché qui conduit à définir <strong>de</strong>s<br />
équilibres financiers irréalistes plutôt que <strong>de</strong>s déséquilibres financiers "acceptables" ;<br />
- échec <strong>de</strong>s schémas évolutionnistes et diffusionnistes où "l'avenir <strong>de</strong> l'Afrique est le passé<br />
<strong>de</strong>s autres", alors qu'on sait que l'histoire ne se répète pas ;<br />
- focalisation excessive sur <strong>la</strong> mondialisation qui renvoie à <strong>la</strong> problématique<br />
centre/périphérie. En réalité, les centres "dominants" impulsent en partie les dynamiques<br />
<strong>de</strong>s économies périphériques, mais le milieu récepteur agit ou rétroagit, transforme,<br />
déforme, contourne, récupère etc... ces impulsions.<br />
D'où cinq propositions alternatives<br />
Préambule - lier un nombre limité d'images contrastées<br />
- l'évolution n'est ni mécanique, ni linéaire, ni déterminée. Les causalités sont<br />
multiples ainsi que les interactions (cf. métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> E. Morin) 4 .<br />
a. Nécessité d'une vision <strong>prospective</strong> intégrée<br />
Ne pas isoler un secteur, ce qui conduit à <strong>de</strong>s perspectives globales incohérentes et irréalistes.<br />
Repérer les interdépendances sectorielles et <strong>la</strong> pluralité <strong>de</strong>s systèmes productifs. D'où prééminence<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> dimension économique, mais reliée au culturel, social et politique.<br />
b. Pluralité <strong>de</strong>s temporalités et <strong>de</strong>s espaces<br />
Définir par analyse taxinomique <strong>de</strong>s ensembles, correspondant à <strong>de</strong>s couples espaces/temps<br />
donnés car:<br />
• les divers espaces (locaux, régionaux, nationaux, internationaux) ont <strong>de</strong>s logiques<br />
différentes ;<br />
• les évolutions se font à <strong>de</strong>s vitesses différentes.<br />
c. Adéquation <strong>de</strong>s systèmes d'information<br />
• les déficiences statistiques renvoient à <strong>la</strong> crise <strong>de</strong> l'État<br />
• inclure les représentations que se font les agents <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>venir<br />
• privilégier, au <strong>de</strong>là <strong>de</strong>s cadres <strong>de</strong> cohérence macro, un processus itératif court/moyen/<br />
long terme. Parallèlement aux cadres, recourir à <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s comme celle <strong>de</strong>s graphes<br />
et <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion.<br />
d. Tirer les leçons <strong>de</strong> <strong>la</strong> rétro<strong>prospective</strong><br />
e. Différencier les <strong>prospective</strong>s selon l'échelle d'analyse : macro ou micro. Distinguer dynamique<br />
externe et dynamique interne ; mais le problème <strong>de</strong> leur pondération reste posé'.<br />
Texte 2 : Quels avenirs pour l'Afrique ? (pp. 85-101)<br />
Préambule :<br />
- privilégier les cheminements via les tendances lour<strong>de</strong>s.<br />
- intégrer le jeu <strong>de</strong>s dynamiques externe et interne<br />
1. Les dynamiques externes : environnement international.<br />
a. Tendances probables<br />
- Matières premières : forte instabilité<br />
- Contraintes financières : pressions catastrophiques pour l'an 2000 où <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte serait <strong>de</strong><br />
550 milliards <strong>de</strong> $. Mais <strong>la</strong> situation "réelle" sera intermédiaire entre l'utopie <strong>de</strong><br />
l'équilibrage financier et un p<strong>la</strong>n Marshall pour l'Afrique<br />
- Évolutions technologiques : 60 % <strong>de</strong>s futurs produits mondiaux ne sont pas<br />
commercialisés aujourd'hui [texte écrit en 1988].<br />
4 Mais on sait que cette métho<strong>de</strong> ne peut porter que sur un objet très restreint.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 208
. Forte incertitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'impact sur l'Afrique<br />
- Firmes transnationales.<br />
- Persistance du risque socio-politique.<br />
- Cantonnement aux firmes primaires.<br />
- Mais distinguer entre PMA et les espaces privilégiés (Zone Franc ou CF-E) et pays à<br />
revenu intermédiaire davantage liés à l'économie mondiale.<br />
Trois grands types <strong>de</strong> pays<br />
- Pays à économie préindustrielle pays CILS, Corne, Afrique orientale. Rôle déterminant <strong>de</strong><br />
l'ai<strong>de</strong> extérieure.<br />
- Pays rentiers avec ressources minières et/ou pétrolières : Liberia, Mauritanie, Niger,<br />
Sierra Leone, Togo, Zaïre, Zambie. Évolution <strong>de</strong>s cours.<br />
- Pays en voie d'industrialisation constituant <strong>de</strong>s pôles d'accumu<strong>la</strong>tion :<br />
• Nigeria et Côte d'Ivoire en Afrique occi<strong>de</strong>ntale,<br />
• Kenya (Afrique orientale),<br />
• Cameroun(Afrique centrale),<br />
• Zimbabwe (Afrique australe).<br />
2. Les dynamiques et tendances lour<strong>de</strong>s internes<br />
- Pression démographique. Pas <strong>de</strong> transition. 670 millions d'habitants en 2000<br />
- explosion urbaine. Taux d'urbanisation ralenti, mais doublement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine<br />
(1 80 à 3 70 millions)<br />
- écosystème. Surexploitation <strong>de</strong>s ressources : 6 millions d'hectares <strong>de</strong> forêt disparaissent<br />
par an<br />
- systèmes productifs<br />
industrie : 1970-85 taux: 4 %<br />
taux prévu : < 4 %<br />
agriculture : réserves <strong>de</strong> productivité mais révolution verte <strong>de</strong> type asiatique est<br />
illusoire. Croissance pas possible sans croissance industrielle<br />
- sociaux : inversion <strong>de</strong>s indicateurs favorables<br />
- services publics collectifs : il faudrait 50 % <strong>de</strong>s recettes publiques pour sco<strong>la</strong>risation<br />
primaire complète et accès à <strong>de</strong>s soins rudimentaires<br />
- pas <strong>de</strong> dualisme réducteur formel/informel, mais quatre filières domestique et marchan<strong>de</strong><br />
liées aux dynamiques endogènes (Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria) étatique et<br />
capitaliste liées à l'environnement international (PMA)<br />
3. Scénarios<br />
Quatre macro-économiques<br />
- Scénario <strong>de</strong> compétitivité extérieure : régu<strong>la</strong>tion par le marché, forte dévaluation <strong>de</strong>s<br />
monnaies, c'est-à-dire, ajustement structurel à coût social élevé<br />
- Scénario d'autosuffisance. Alternative à économie ouverte (Cf P<strong>la</strong>n Lagos). Coût<br />
économique élevé<br />
- Scénario industrialisation et accumu<strong>la</strong>tion dans espaces protégés : Cameroun, Côte<br />
d'Ivoire, Kenya, Nigeria. Coût économique et financier très élevé<br />
- Scénario nationaliste : construction <strong>de</strong> l'État plutôt qu'accumu<strong>la</strong>tion (i.e., comme par le<br />
passé)<br />
Cinq micro décisions et méso-régu<strong>la</strong>tion<br />
Scénarios sur fond <strong>de</strong> conflit <strong>de</strong> générations, affrontements religieux, intégrisme musulman dans<br />
les pays du Sahel.<br />
- Scénario étatiste : construction <strong>de</strong> l'État-nation<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 209
- Scénario organisationnel : stabilisation <strong>de</strong> l'environnement international et interne<br />
- Scénario <strong>de</strong> décentralisation : priorité aux pouvoirs locaux et à <strong>la</strong> société civile<br />
- Scénario tuté<strong>la</strong>ire : pouvoir aux opérateurs étrangers.<br />
Texte 3 / Avenir <strong>de</strong> l'Ass dans l'économie internationale (pp. 21-37) J. Coussy<br />
Long terme : permanence ou aggravation dans <strong>la</strong> hiérarchie internationale d'ici 2008, consensus<br />
pessimiste<br />
Export : resteront agricoles, pétrolières et minières<br />
Import : augmentent sous <strong>la</strong> pression démographique<br />
D'où : s'il y a divergence d'interprétation sur l'inéluctabilité <strong>de</strong>s goulots d'étranglement<br />
internes, il y a accord sur tendance durable :<br />
• déséquilibre <strong>de</strong> paiements extérieurs<br />
• besoin <strong>de</strong> capitaux publics extérieurs, à dominante caritative<br />
Moyen terme : prédominance <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise financière extérieure. Pessimisme aggravé<br />
- Persistance <strong>de</strong>s causes du déséquilibre : chute du prix <strong>de</strong>s minerais et <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> rente<br />
- Crise <strong>de</strong> liquidité, mais aussi <strong>de</strong> solvabilité<br />
- Fragilité <strong>de</strong>s tentatives d'industrialisation<br />
- Faiblesse prononcée <strong>de</strong>s é<strong>la</strong>sticités <strong>de</strong>s exportations.<br />
Les conflits d'interprétation <strong>de</strong>s tendances<br />
entre : dépendantistes/critiques réformistes (ex. ONG) et libéraux (Banque mondiale, Rapport<br />
Berg, 1981) sur :<br />
- La quantitification <strong>de</strong>s déficits extérieurs futurs. Conflits entre théoriciens <strong>de</strong> l'autocentrage<br />
(ex. S. Arnin) et les théoriciens libéraux américains : modèles <strong>de</strong> déficit priceless Chenery qui<br />
minorait <strong>la</strong> flexibilité, majorent les besoins d'ai<strong>de</strong> (Banque Mondiale, 1986 ; Cour, 1984 ; CNUCED).<br />
Ce modèle à <strong>la</strong> faveur <strong>de</strong>s organismes "pro-sud" (CEA, OUA, CNUCF-D) et <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>nificateurs<br />
africains.<br />
Mais dans le même temps, une opposition libérale aux "modèles priceless" a gagné du terrain<br />
(ex. Berg, 1986) : le but assigné à l'ASS est désormais <strong>de</strong> retrouver flexibilité et compétitivité sans<br />
compter sur un financement inconditionnellement renouve<strong>la</strong>ble.<br />
- Les scénarios (Sc.) volontaristes, qui s'opposent au consensus pessimiste sur les scénarios<br />
tendanciels.<br />
- Sc. <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions entre ASS et pays capitalistes (déconnexion) ; Bugnicourt et<br />
P<strong>la</strong>n Lagos, autocentrage ; CNUCED, développement Sud/Sud) ;<br />
· Sc. programmant les re<strong>la</strong>tions commerciales et financières (J.M. Cour et organismes<br />
internationaux) ;<br />
· Sc. libéralisation <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions extérieures (Rapport Berg et son effet "détonateur", Banque<br />
Mondiale, Fmi).<br />
Tendance à <strong>la</strong> radicalisation <strong>de</strong>s oppositions entre ces scénarios, tempérée par quelques<br />
rapprochements pragmatiques. D'où quelques concessions, souvent implicites.<br />
Les dynamiques mal connues<br />
Resserrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrainte <strong>de</strong> compétitivité sous <strong>la</strong> pression notamment <strong>de</strong> l'Asie, alors que<br />
l'ASS oscille entre "économie assistée" ou "économie marginalisée". Après l'espoir d'une<br />
"déconnexion volontaire", crainte d'une "déconnexion subie".<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 210
- Quid <strong>de</strong>s dynamiques socio-politiques créées par l'ajustement structurel. Vo<strong>la</strong>tilité d'une triple<br />
rupture avec l'histoire économique <strong>de</strong> l'ASS<br />
- rompre avec dominante étatique<br />
· rompre avec régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> type colonial<br />
- rompre avec régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s sociétés traditionnelles.<br />
Face à cette volonté, on assistera, compte tenu <strong>de</strong>s "revanches <strong>de</strong>s sociétés <strong>africaine</strong>s"<br />
(Bayart, 1983) au "brico<strong>la</strong>ge" habituel (conflits, résistances cachées, détournement) mais qui prendra<br />
<strong>de</strong>s formes inédites.<br />
Scénarios <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions entre PED, i.e. Quid <strong>de</strong>s conséquences pour ASS <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong>s<br />
exportations asiatiques ?<br />
- Sc. d'entraînement mutuel (CNUCED, FAO, ONU). Mais les prévisions les plus optimistes ne<br />
montrent pas une forte croissance <strong>de</strong>s exportations <strong>de</strong> l'ASS ;<br />
- Sc. <strong>de</strong> compétition entre PED (sur mêmes produits et marchés). Aggravation <strong>de</strong> <strong>la</strong> perte <strong>de</strong><br />
compétitivité <strong>de</strong> l'ASS sur marchés tiers et interne<br />
- Sc. <strong>de</strong> succession entre PED. Sous <strong>la</strong> pression <strong>de</strong> l'élévation <strong>de</strong>s coûts sa<strong>la</strong>riaux dans le<br />
textile, l'Asie cè<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce à l'ASS qui baisse ses coûts unitaires <strong>de</strong> travail par augmentation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité et/ou baisse <strong>de</strong>s rémunérations.<br />
- Sc. d'intégration dans système productif hiérarchisé. Contrôle et impulsion <strong>de</strong> quelques pays<br />
par NPI et pays industriels (ex. Japon).<br />
Imprévisibilité <strong>de</strong> paramètres décisifs pour ASS<br />
- Baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité dans l'agriculture ?<br />
- Création <strong>de</strong> substituts locaux aux intrants importés ? (référence au Nigeria <strong>de</strong> 1988)<br />
- Reprise <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong>s pays industriels ? Même dans ce cas, quid <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
en produits primaires ? (surestimée dans les années 70)<br />
- Reprise (attendre en principe en 2000) du marché pétrolier ?<br />
- Coalition entre producteurs <strong>de</strong> produits primaires et pays en<strong>de</strong>ttés ?<br />
- Modification <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l'espace africain ? Peu probable à moyen terme. Inévitable à<br />
long terme, car signes <strong>de</strong> conflits violents<br />
- Rôle <strong>de</strong>s conflits armés, déjà <strong>de</strong>venus (en 1988) élément majeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynamique <strong>de</strong><br />
l'ASS.<br />
Texte 4 : L'apport <strong>de</strong>s modèles prévisionnels dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s perspectives économiques <strong>de</strong><br />
l'Afrique à horizon 2000 (pp. 38-49) O. Sudrie<br />
Mise au point sur <strong>la</strong> portée et les limites <strong>de</strong>s modèles via une typologie<br />
Distinctions principales<br />
- Équations <strong>de</strong> définition et équations strictement comptables (charpente du modèle. Ex. I = S) et<br />
équations <strong>de</strong> comportement (explication <strong>de</strong>s variations d'un phénomène en (f) <strong>de</strong> variables qualifiées<br />
d'explicatives) ;<br />
- Modèles court terme (CT) et moyen terme (MT)<br />
· CT (6 à 18 mois) pour pilotage <strong>de</strong> l'économie, équilibrage financier. Permet é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong><br />
"budgets économiques" avec distinction, pour l'ASS, entre : le secteur exportateur où l'offre<br />
est limitée par <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> production) le reste <strong>de</strong> l'économie où c'est <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qui<br />
détermine <strong>la</strong> production ;<br />
· MT: explorer les chemins <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance : i.e. expliquer <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong><br />
production (alors que dans les MCT, celles-ci sont prises comme données ou contraintes) ;<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 211
· Modèle Équilibre Général Calcu<strong>la</strong>ble (EGC) et modèles Léontieff (<strong>de</strong>man<strong>de</strong>)<br />
• EGC. Néoc<strong>la</strong>ssique. Modèle fondateur <strong>de</strong>s analyses <strong>de</strong> projets par métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s shadowprices.<br />
But : formaliser séparément les conditions <strong>de</strong> l'offre et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, puis en<br />
étudier les interactions<br />
- Modèle <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> type keynésien qui suppose au contraire, l'existence <strong>de</strong> capacités <strong>de</strong><br />
production oisives.<br />
Esquisse d'un modèle-type idéal<br />
Choix à faire sur nature<br />
structure <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction<br />
usage<br />
Trois interrogations<br />
1. Champ géographique ? Dépend <strong>de</strong> <strong>la</strong> problématique initiale, i.e. : p<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> DIT ou<br />
développement interrégional<br />
2. Nature du modèle ? Là encore dépend <strong>de</strong> l'objet <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>. Rejet d'emblée <strong>de</strong> modèles<br />
procédant à l'optimisation. Préférer modèles opérant par simu<strong>la</strong>tion. A partir <strong>de</strong> scénarios fixant le<br />
niveau <strong>de</strong>s variables exogènes (en particulier environnement économique et financier<br />
international), ces modèles produisent <strong>de</strong>s variantes, assimi<strong>la</strong>bles à <strong>de</strong>s images <strong>de</strong> synthèse<br />
décrivant réactions <strong>de</strong> l'économie nationale aux variations <strong>de</strong>s données exogènes. Contrainte :<br />
pas <strong>de</strong> possibilité d'affecter à chacune <strong>de</strong>s variantes une quelconque probabilité <strong>de</strong> réalisation (cf<br />
modèle Sirène pour le Nigeria 1985, pour 2000).<br />
3. Type <strong>de</strong> modèle Utilisable ? Ce n'est pas nécessairement le terme qui justifie a priori le choix du<br />
modèle<br />
- <strong>la</strong> formalisation pertinente est celle qui dissocie les problèmes du court terme (stabilisation<br />
conjoncturelle) et les problèmes moyen et long terme (ajustement structurel), et qui réalise<br />
leur articu<strong>la</strong>tion<br />
- compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise actuelle, priorité aux variantes <strong>de</strong> passages <strong>de</strong> crise. Pour ce<strong>la</strong>,<br />
modèles CT avec repérage <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s équilibrages financiers.<br />
Double tâche <strong>de</strong>s modèles CT et MT pour projection 2000:<br />
- repérer <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> restauration <strong>de</strong>s équilibres financiers<br />
- décrire les nouvelles structures, économiques et financières, <strong>la</strong>issées par <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
antérieure <strong>de</strong> stabilisation.<br />
Au contraire, pour les formalisations MT et LT, le choix du modèle est <strong>de</strong>s scénarios à explorer :<br />
* insertion dans DIT : modèles EGC qui permet mesure <strong>de</strong>s avantages comparatifs<br />
* développement autocentré : le problème est celui <strong>de</strong> l'évaluation <strong>de</strong> l'épargne disponible<br />
affectable à l'investissement et celui du choix <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> substitution d'importations.<br />
Limites <strong>de</strong>s modèles<br />
Les problèmes <strong>de</strong> réalisation sont :<br />
- ignorance du secteur informel et <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions réciproques avec le secteur mo<strong>de</strong>rne.<br />
Problème <strong>de</strong> <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong>s activités non-marchan<strong>de</strong>s ou c<strong>la</strong>n<strong>de</strong>stines<br />
- défail<strong>la</strong>nce du système d'information statistique<br />
- l'existence d'un "biais conservateur" qui s'amenuise si on dispose <strong>de</strong> séries longues,<br />
lesquelles font précisément défaut pour l'ASS. Le risque est alors <strong>de</strong> tenir pour structurels<br />
<strong>de</strong>s comportements conjoncturels.<br />
Néanmoins, il faut développer <strong>la</strong> Prospective <strong>africaine</strong> qui peut ai<strong>de</strong>r à améliorer l'information<br />
statistique.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 212
Texte 5 (pp. 51-75) : Le débat autour <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> ILTA 5 (1983), i.e. : désaccord entre J.M. Cour et G.<br />
Duruflé.<br />
Thèse <strong>de</strong> JM. Cour<br />
Les piètres performances <strong>de</strong> l'ASS ont été surestimées 6 pour plusieurs raisons<br />
- <strong>la</strong> force <strong>de</strong> l'habitu<strong>de</strong> (biais pessimiste)<br />
- l'inexactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s statistiques<br />
- <strong>la</strong> non-prise en compte <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux variables-clés<br />
i.e. : 1/ le peuplement ; 2/ sa transformation structurelle (i.e. : renforcement du taux<br />
d'urbanisation).<br />
Hyp. L'urbanisation croissante est le facteur d'entraînement qui exerce et exercera <strong>de</strong>s effets<br />
stimu<strong>la</strong>nts sur :<br />
- l'offre agricole alimentaire (augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité)<br />
- l'accumu<strong>la</strong>tion du capital.<br />
CI. Les financements extérieurs doivent s'investir massivement et prioritairement dans les<br />
infrastructures urbaines.<br />
Critique (radicale) <strong>de</strong> celle thèse et <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> par G. Duruflé<br />
1. La croissance <strong>de</strong>s villes est insuffisante pour faire évoluer <strong>la</strong> productivité agricole, <strong>la</strong>quelle,<br />
au mieux, n'a pas augmenté et a peut-être même diminué ;<br />
- les importations alimentaires ont certes diminué, mais uniquement sous <strong>la</strong> contrainte <strong>de</strong><br />
l'ajustement<br />
- le raisonnement <strong>de</strong> J.M. Cour est circu<strong>la</strong>ire [critique fondamentale, semble-t-il]. Pour<br />
défendre <strong>la</strong> thèse du financement <strong>de</strong>s infrastructures urbaines, on suppose connu et résolu<br />
le problème <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions ville-campagne.<br />
2. Les vraies questions sont :<br />
- pourquoi l'échec récurrent <strong>de</strong>s projets d'exportation industrielle ?<br />
- pourquoi le contenu en import du secteur mo<strong>de</strong>rne ne baisse pas ?<br />
- pourquoi <strong>la</strong> production agricole ne suit-elle que partiellement <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> urbaine <strong>de</strong> produits<br />
alimentaires ?<br />
- pourquoi les investissement et grand projets <strong>de</strong>s années 80 ont-ils été à <strong>la</strong> fois coûteux et<br />
inefficaces ?<br />
- pourquoi les couches privilégiées <strong>africaine</strong>s n'investissent-elles pas dans leur propre pays ?<br />
CI. Le seul point d'accord entre les <strong>de</strong>ux chercheurs porte sur l'inadéquation <strong>de</strong> l'information<br />
statistique. Mais J.M. Cour en tire <strong>la</strong> conséquence d'une surestimation <strong>de</strong> <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation en<br />
ASS, alors que G. Duruflé s'étonne <strong>de</strong> ce que les bailleurs <strong>de</strong> fonds s'en accommo<strong>de</strong>nt [question à<br />
<strong>la</strong>quelle fait en partie écho J. Coussy p. 26 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revue Afrique Contemporaine.<br />
Appréciation<br />
1. Mérites <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> : Les "perspectives" à échéance 2000 ne comportement pas d'erreurs<br />
majeures, sauf en ce qui concerne <strong>de</strong>ux points, déterminants il est vrai : - <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion dont les<br />
signes <strong>de</strong> transition n'ont pas été prévus (mais rien ne permet aujourd'hui <strong>de</strong> préjuger <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
portée <strong>de</strong> ces "frémissements") le taux d'urbanisation supposé explosif, alors qu'il s'est ralenti.<br />
2. Limites : Les problèmes <strong>de</strong> faisabilité (i.e. mise en œuvre <strong>de</strong>s hypothèses et une métho<strong>de</strong><br />
préconisées) sont peu abordés (sauf par Sudrie). Aussi bien, l'étu<strong>de</strong> s'intitule-t-elle "perspectives"<br />
économiques.<br />
5 Image à long terme <strong>de</strong> l'Afrique.<br />
6 L'idée sous-jacente est que l'observation <strong>de</strong> terrain incline à plus d'optimisme et que, si les résultats pessimistes étaient<br />
justes, on ne pourrait pas expliquer pourquoi l'ASS "s'en sort" malgré tout.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 213
L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE : DE LA CRISE A UNE CROISSANCE<br />
DURABLE. ETUDE DE PROSPECTIVE A LONG TERME<br />
OBJECTIFS DE L'ETUDE<br />
Banque mondiale, novembre 1989<br />
L'étu<strong>de</strong> réalisée par <strong>la</strong> Banque mondiale débute sur un constat peu f<strong>la</strong>tteur mais bien connu : celui <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> crise, <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années soixante-dix, <strong>de</strong>s économies et <strong>de</strong>s sociétés <strong>africaine</strong>s. L'analyse du<br />
passé, à <strong>la</strong>quelle est consacrée le premier chapitre, conduit à repérer plusieurs facteurs explicatifs <strong>de</strong><br />
ce déclin, à <strong>la</strong> fois externes (baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> mondiale, dégradation <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l'échange...)<br />
mais surtout internes (surcoûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>africaine</strong>, faible rentabilité <strong>de</strong>s investissements,<br />
mauvaise gestion du secteur public, politiques <strong>de</strong> développement inadaptées...). Cependant,<br />
l'originalité du rapport porte moins sur <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s éléments figurant à l'actif ou au passif <strong>de</strong> ce bi<strong>la</strong>n,<br />
que sur le diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise. Selon <strong>la</strong> Banque, l'Afrique ne souffrirait pas simplement <strong>de</strong><br />
déséquilibres macro-économiques et financiers, comme le <strong>la</strong>issaient supposer les premiers<br />
programmes <strong>de</strong> stabilisation et d'ajustement. La crise trouve aussi son origine dans <strong>de</strong>s<br />
dysfonctionnements plus structurels touchant le capital humain, l'accroissement et <strong>la</strong> répartition<br />
spatiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> technologie, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s <strong>affaires</strong> et <strong>de</strong>s institutions.<br />
L'objet du rapport, qui porte sur l'ensemble <strong>de</strong> l'Afrique au sud du Sahara, est donc d'étudier les voies<br />
d'é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> l'ajustement et <strong>de</strong> définir un certains nombres <strong>de</strong> mesures opérationnelles visant à<br />
réduire, à l'horizon 2020, les dysfonctionnements structurels.<br />
METHODOLOGIE DE L'ETUDE<br />
L'appréhension <strong>de</strong>s problèmes évoqués ci-<strong>de</strong>ssus, et qui sortent du cadre c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> l'ajustement<br />
macro-économique et financier, suppose une approche <strong>de</strong> long terme. La démarche <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque<br />
pour réaliser cet exercice s'apparente étroitement à celle utilisée dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> « p<strong>la</strong>nification<br />
indicative ».<br />
La première étape consiste à définir <strong>de</strong>s objectifs généraux à attendre à long terme. Ceux-ci sont au<br />
nombre <strong>de</strong> trois :<br />
1. Transformer les structures <strong>de</strong> production<br />
2. Stopper le déclin <strong>de</strong>s instituions ;<br />
3. Amorcer une croissance durable et soutenable.<br />
La <strong>de</strong>uxième étape à définir une stratégie globale pour atteindre ces objectifs. Cette stratégie <strong>de</strong>vrait :<br />
1. Poursuivre les programme d'ajustement structurel<br />
2. Mettre l'accent sur le développement <strong>de</strong>s capacités locales<br />
3. Créer les conditions propices à l'exercice d'activités productives<br />
4. Enrayer le déclin <strong>de</strong> l'agriculture ;<br />
5. Ralentir <strong>la</strong> progression démographique<br />
6. Stopper <strong>la</strong> dégradation <strong>de</strong> l'environnement;<br />
7. Poursuivre les efforts d'intégration et <strong>de</strong> coopération régionale<br />
8. Forger entre les gouvernements et les donateurs <strong>de</strong>s liens véritables d'association.<br />
La troisième étape conduit à recenser <strong>de</strong>s mesures opérationnelles à mettre en œuvre pour atteindre<br />
les objectifs généraux et satisfaire <strong>la</strong> stratégie d'ensemble définie ci-<strong>de</strong>ssus. Ces mesures, dont<br />
l'inventaire exhaustif ne présente qu'un intérêt limité, s'organisent autour <strong>de</strong> trois thèmes principaux :<br />
<strong>la</strong> libéralisation <strong>de</strong>s économies (qui suppose une réforme <strong>de</strong> l'État et <strong>de</strong>s administrations publiques<br />
ainsi que <strong>la</strong> généralisation <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> marché), <strong>la</strong> valorisation <strong>de</strong>s ressources humaines et <strong>la</strong><br />
maîtrise <strong>de</strong>s pressions démographiques.<br />
Enfin, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière étape consiste à évaluer globalement les besoins financiers nécessaires à <strong>la</strong><br />
réalisation <strong>de</strong>s objectifs généraux.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 214
Principales conclusions<br />
Il s'avère difficile <strong>de</strong> résumer les principales conclusions d'un rapport particulièrement volumineux<br />
(près <strong>de</strong> 350 pages), synthèse lui-même d'étu<strong>de</strong>s diverses et parfois hétérogènes, alternant<br />
généralités et étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cas, micro et macro-économie... Aussi, le relevé <strong>de</strong>s principales conclusions<br />
figurant ci-<strong>de</strong>ssous est-il volontairement limité aux points les plus sail<strong>la</strong>nts.<br />
1. La progression démographique constitue un frein à <strong>la</strong> croissance et au développement<br />
économique. Le maintien <strong>de</strong>s rythmes <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion repérés à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s<br />
années 80 (3,2% par an), conduirait à un doublement <strong>de</strong>s effectifs tous les vingt ans.<br />
Cette pression démographique pose divers problèmes : pression sur les terres et<br />
dégradation <strong>de</strong>s écosystèmes, pression sur le marché du travail, pressions sur les<br />
finances publiques... Selon <strong>la</strong> Banque Mondiale, l'objectif démographique à atteindre<br />
serait une baisse du taux <strong>de</strong> fécondité du même ordre que celle réalisée par d'autres<br />
PVD. Cette transition démographique conduirait à un rythme d'accroissement annuel<br />
moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 2,8% par an entre 1990 (500 millions d'habitants) et<br />
2020 (1,1 milliards). Même dans ces conditions plus favorables, <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion active serait encore <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 3,3% par an. Elle obligerait l'Afrique, si elle<br />
vou<strong>la</strong>it maintenir un taux <strong>de</strong> chômage <strong>de</strong> 10% à l'horizon 2020, à créer prés <strong>de</strong> 380<br />
millions <strong>de</strong> nouveaux emplois sur l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>.<br />
2. L'augmentation du revenu par habitant passe non seulement par une réduction forte <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> progression démographique mais aussi par le retour à une croissance soutenue. Ainsi,<br />
une augmentation <strong>de</strong> 1 à 2% par an du revenu par habitant suppose une croissance<br />
globale du PIB africain <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 5% l'an, c'est à dire un doublement du taux <strong>de</strong><br />
croissance par rapport à ceux enregistrés au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie 80. Cet objectif très<br />
volontariste suppose un relèvement sensible <strong>de</strong>s investissements productifs (et une<br />
amélioration <strong>de</strong> leur efficacité marginale). Les ressources mobilisées pour <strong>la</strong> formation <strong>de</strong><br />
capital fixe <strong>de</strong>vraient atteindre 25% du PIB, soit près <strong>de</strong> 10 points <strong>de</strong> plus que durant <strong>la</strong><br />
décennie 80. La limitation <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> financement extérieurs à <strong>de</strong>s niveaux<br />
acceptables (9% du PIB en 2000 et 5% en 2020) suppose, à son tour, une progression<br />
remarquable <strong>de</strong> l'épargne intérieure : le taux d'effort <strong>de</strong>vant doubler pour passer <strong>de</strong> 11 à<br />
22% du PIB.<br />
3. L'agriculture sera le moteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance à long terme. Le développement <strong>de</strong><br />
l'agriculture est un impératif à <strong>la</strong> fois pour absorber le supplément <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion et<br />
assurer <strong>la</strong> sécurité alimentaire. Cette <strong>de</strong>rnière suppose que <strong>la</strong> consommation alimentaire<br />
par habitant augmente au rythme moyen <strong>de</strong> 1% l'an entre 1990 et 2020. Compte tenu <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> croissance nécessaire <strong>de</strong>s exportations alimentaires, <strong>la</strong> production alimentaire <strong>de</strong>vrait<br />
croître <strong>de</strong> 4% par an. Si, par hypothèse, les gains <strong>de</strong> productivité du travail sont limités à<br />
+1,5% par an, <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole <strong>de</strong>vrait entraîner une augmentation<br />
<strong>de</strong> l'emploi <strong>de</strong> 2,5% par an, ce qui permettrait alors à ce secteur d'absorber <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s<br />
nouveaux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs d'emplois.<br />
4. L'accélération <strong>de</strong>s rythmes <strong>de</strong> croissance suppose une volonté forte <strong>de</strong>s pouvoirs publics<br />
africains <strong>de</strong> libéraliser leur économie. Cette libéralisation passe par un désengagement <strong>de</strong><br />
l'État <strong>de</strong>s activités productives et par son recentrage à <strong>la</strong> fois sur ses fonctions régaliennes<br />
(notamment dans l'éducation) et sur <strong>la</strong> fourniture <strong>de</strong>s externalités positives au<br />
développement (comme les infrastructures).<br />
APPORTS ET LIMITES DE L'ETUDE<br />
Cette étu<strong>de</strong> doit être appréciée en <strong>la</strong> rep<strong>la</strong>çant dans son contexte historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 80.<br />
Partant du constat que le retour à une croissance durable ne repose pas exclusivement sur <strong>de</strong>s<br />
mesures macroéconomiques et financières, ce document marque <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale<br />
d'é<strong>la</strong>rgir le champ <strong>de</strong> l'ajustement structurel à <strong>de</strong>s domaines jusqu'alors <strong>la</strong>rgement exclus <strong>de</strong>s<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 215
programmes d'action (comme <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong>s institutions, <strong>la</strong> gestion du capital humain ou les<br />
conséquences sociales <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> stabilisation).<br />
Les limites <strong>de</strong> l'exercice tiennent plus à <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> qu'aux conclusions <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> (auxquelles il est<br />
difficile <strong>de</strong> ne pas adhérer). L'objectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> produire un programme prioritaire d'action à<br />
long terme à partir <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification indicative conduit à <strong>de</strong>s recommandations<br />
relevant fréquemment du volontarisme naif. En d'autres termes, le rapport n'étudie pas les futurs<br />
possibles mais un futur souhaitable pour l'Afrique. S'il analyse avec précision les conditions qu'il<br />
faudrait réunir pour atteindre les objectifs « p<strong>la</strong>nifiés », il ne dit mot <strong>de</strong>s autres trajectoires. Or, ce sont<br />
bien ces cheminements différents que l'Afrique a empruntés au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie 90...<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 216
3.3.<br />
LES PROSPECTIVES<br />
NATIONALES
pays :<br />
Nous avons sélectionné six étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s nationales concernant cinq<br />
- Afrique du Sud (Institute of Futures et Institute for Social Development)<br />
- Côte d'Ivoire (Futurs Africains, BNETD)<br />
- Gabon (Futurs Africains)<br />
- Madagascar (Futurs Africains)<br />
- Maurice (Futurs Africains).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 218
AFRIQUE DU SUD<br />
De nombreuses <strong>prospective</strong>s ont été réalisées en Afrique du Sud notamment par l'Institute of<br />
Futures et l'Institute for Social Development <strong>de</strong> l'<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong> Western Cape.<br />
Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> Institute of futures<br />
La vision holistique du changement sociétal.<br />
Les futuristes sont <strong>de</strong>s découvreurs, <strong>de</strong>s catalyseurs et <strong>de</strong>s facilitateurs.<br />
Transdisciplinarité. Les référents sont <strong>de</strong> Jouvenel et Achoff.<br />
L'étu<strong>de</strong> reprend <strong>la</strong> typologie <strong>de</strong> Achoff entre <strong>de</strong>s<br />
réactivisme conservatisme<br />
Acteurs inactivisme bureaucratique Politiques<br />
préactivisme idéaliste<br />
interactivisme participatif<br />
Scénarios <strong>de</strong> l'Institute for Social Development – <strong>Un</strong>iversity of Western Cape<br />
Vi<strong>de</strong>o Consulte 1992<br />
Cet institut a réalisé plusieurs <strong>prospective</strong>s dont les scénarios Mont Fleuri. Quatre scénarios<br />
sont différenciés :<br />
- Canard boiteux<br />
- Autruche<br />
- Vol <strong>de</strong> F<strong>la</strong>mands<br />
- Icare<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 219
Le premier suppose :<br />
• une incapacité du gouvernement <strong>de</strong> gérer les coalitions<br />
• l'incertitu<strong>de</strong> conduit au départ <strong>de</strong>s investisseurs<br />
• <strong>la</strong> crise économique et sociale s'aggrave<br />
• les cercles vicieux jouent à <strong>la</strong> baisse<br />
Le <strong>de</strong>uxième suppose :<br />
• une minorité b<strong>la</strong>nche contre le libéralisme<br />
• un cycle répression/violence<br />
• libéralisation <strong>de</strong> l'Afrique du Sud<br />
Le troisième implique :<br />
• une forte participation<br />
• une croissance <strong>de</strong> l'investissement<br />
• un taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> 5 %<br />
Le quatrième suppose :<br />
• "un vol maintenant et un crash après"<br />
• un populisme macro-économique<br />
• <strong>de</strong>s résultats spectacu<strong>la</strong>ires à court terme<br />
• un déficit budgétaire supérieur à 10 % puis un retour à un régime autoritaire.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 220
COTE D’IVOIRE 2025<br />
SITUATION – OBJECTIFS – METHODOLOGIE<br />
<strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n et du Développement Industriel<br />
Commission Nationale <strong>de</strong> Prospective<br />
République <strong>de</strong> Côte d’Ivoire<br />
1997, Abidjan, E. Neter<br />
Le rapport est une synthèse <strong>de</strong> travaux menés par <strong>la</strong> Commission Nationale <strong>de</strong> Prospective,<br />
financés par le PNUD, dans le cadre du projet régional “ Futurs Africains ”. Son objectif est <strong>de</strong><br />
déterminer les orientations stratégiques prioritaires, en tenant compte <strong>de</strong>s aspirations <strong>de</strong>s ivoiriens,<br />
<strong>de</strong>s fores et faiblesses <strong>de</strong> l’économie ivoirienne et en é<strong>la</strong>borant <strong>de</strong>s scénarios.<br />
L’approche méthodologique proposée s’appuie sur les aspirations <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions (enquête sur<br />
un échantillon <strong>de</strong> mille personnes, par métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s quotas et <strong>de</strong>s itinéraires, sur <strong>la</strong> base du<br />
recensement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> 1988), sur cinq étu<strong>de</strong>s rétrospectives (économie, société,<br />
aménagement du territoire, développement régional, démographie), sur lesquelles sont é<strong>la</strong>borés les<br />
diagnostics stratégiques (via les tendances lour<strong>de</strong>s, incertitu<strong>de</strong>s critiques, stratégies passées et<br />
présentes, forces et faiblesses internes, opportunités et menaces externes, germes <strong>de</strong> changement).<br />
La construction <strong>de</strong> scénarios multiples est privilégiée (portant sur les tendances, les<br />
interdépendances, les structures et ruptures possibles). Les stratégies <strong>de</strong> développement qui en sont<br />
issues, passent par l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> questions et d’options stratégiques hiérarchisées (système <strong>de</strong><br />
pondération).<br />
RESUME ET PRINCIPAUX RESULTATS<br />
I/ LES ASPIRATIONS DES IVOIRIENS<br />
Aspirations politiques : à un État <strong>de</strong> droit ; à <strong>la</strong> limitation <strong>de</strong> l’immigration (contrôle <strong>de</strong>s flux,<br />
restrictions a l’emploi, intégration sélective), perçue comme une menace ; net refus <strong>de</strong> <strong>la</strong> citoyenneté<br />
CEDEA (admise à 12%) ; menace <strong>de</strong> l’insécurité forte, mais aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> religion (facteur d’effritement<br />
social).<br />
Aspirations économiques : soutien à l’option libérale ; transformation agro-industrielle et<br />
indépendance alimentaire comme priorités majeures ; intégration économique <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest<br />
souhaitée, avec maintien du Fcfa ; perception <strong>de</strong>s déséquilibres régionaux comme menace <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cohésion nationale.<br />
Aspirations sociales : Insatisfaction générale <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> santé, d’éducation (inefficacité et<br />
coût), <strong>de</strong> l’emploi et <strong>de</strong> l’habitat.<br />
Aspirations culturelles : à l’équité et à <strong>la</strong> moralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> société (sanctions) .<br />
Aspirations technologiques : au développement technologique.<br />
Aspirations re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> femme : à une meilleure intégration (éducation, vie politique).<br />
Aspirations re<strong>la</strong>tives à l’environnement : à l’assainissement public et à <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
écosystèmes (forêts).<br />
II/ DIAGNOSTIC STRATEGIQUE DE LA COTE D’IVOIRE :<br />
FORCES ET FAIBLESSES / OPPORTUNITES ET MENACES<br />
L’économie : (i) atouts : valorisation <strong>de</strong>s ressources humaines, ressources agricoles,<br />
forestières, minérales et minières, diversité agricole favorable à l’industrie, forte <strong>de</strong>man<strong>de</strong> (urbaine) en<br />
produits alimentaires, importance et qualité <strong>de</strong>s infrastructures, perspectives d’intégration régionale.<br />
(ii) faiblesses : faibles épargne et investissement, en<strong>de</strong>ttement massif, économie extravertie,<br />
primarisée, incertitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et instabilité <strong>de</strong>s cours mondiaux ; coûts élevés <strong>de</strong>s facteurs,<br />
inadaptation du système financier et faiblesses <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong> crédit agricole et industriel.<br />
L’aménagement du territoire et le développement régional : (i) forces : amélioration <strong>de</strong><br />
l’infrastructure hydraulique, électrique, routière, <strong>de</strong> communication et richesse énergétique (pétrole,<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 221
gaz). (ii) faiblesses : poids excessif <strong>de</strong> l’agro-exportation au détriment du vivrier et <strong>de</strong> l’industrie,<br />
déséquilibres régionaux.<br />
La société : (i) forces : stabilité et pluripartisme politique et ethnique, infrastructures sociales<br />
importantes et promotion <strong>de</strong>s technologies (ii) faiblesses : fortes disparités, moyens financiers limités<br />
en technologie.<br />
L’environnement et le cadre <strong>de</strong> vie : surexploitation <strong>de</strong>s sols (cultures extensives sans<br />
enrichissement).<br />
III/ Les quatre scénarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Côte d’Ivoire pour l’an 2025<br />
Deux incertitu<strong>de</strong> critiques majeures sont déterminantes :<br />
Contexte international : (i) Évolution favorable si hausse <strong>de</strong>s cours mondiaux, réussite <strong>de</strong><br />
l’UEMOA et renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> CEDEAO, conjoncture favorable en Europe et rôle catalyseur <strong>de</strong>s<br />
institutions ; (ii) Évolution défavorable si baisse <strong>de</strong>s cours, conjoncture défavorable en Europe,<br />
montée du protectionnisme international, hausse <strong>de</strong>s taux d’intérêt, échec <strong>de</strong> <strong>la</strong> régionalisation.<br />
Gouvernance et processus démocratique : (i) Évolution favorable si culture démocratique,<br />
modération syndicale et neutralité <strong>de</strong> l’armée, ingérence extérieure discrète, cohésion sociale<br />
renforcée ; (ii) Évolution défavorable si faible culture démocratique, exclusivisme politique,<br />
exacerbation <strong>de</strong>s tensions i<strong>de</strong>ntitaires.<br />
Scénarios<br />
Évolution du<br />
contexte<br />
international<br />
Évolution du processus<br />
démocratique,<br />
gouvernance<br />
La chauve souris étranglée - -<br />
Le suici<strong>de</strong> du scorpion + -<br />
La ruche <strong>de</strong>s abeilles + +<br />
L’éléphant en marche* - +<br />
+ : evol favorable - : evol. défavorable.<br />
*Scénario <strong>de</strong> l’éléphant en marche : bonne gouvernance, hausse du revenu réel, bonnes<br />
capacités <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l’État, gains <strong>de</strong> productivité et <strong>de</strong> compétitivité agricole,<br />
industrialisation diversifiée, réhabilitation <strong>de</strong>s infrastructures sociales, d’éducation et <strong>de</strong> santé.<br />
IV/ Vision et stratégie pour 2025<br />
Les objectifs fixés sont d’ordre politique, social, humain et culturel, et focalisés sur le libéralisme<br />
et l’ouverture économiques, le plein emploi, <strong>la</strong> sécurité alimentaire, <strong>la</strong> maîtrise démographique.<br />
Les questions majeures re<strong>la</strong>tives au bien être <strong>de</strong>s ivoiriens, au développement durable, à<br />
l’éducation, à l’esprit d’entreprise, au secteur privé, à <strong>la</strong> gouvernance, déterminent les options<br />
stratégiques, hiérarchisées selon <strong>la</strong> difficulté <strong>de</strong> leur réalisation (par ordre croissant), concernant <strong>la</strong><br />
promotion (1) du bien être <strong>de</strong>s ivoiriens, (2) d’un grand pôle régional <strong>de</strong> développement, (3) d’un<br />
système éducatif performant et (4) d’une démocratie renforcée.<br />
L’agrégation <strong>de</strong> ces options conduisent à <strong>de</strong>s orientations stratégiques ou programmes<br />
prioritaires, associant le jeu <strong>de</strong>s acteurs (partenaires) et les facteurs clés <strong>de</strong> succès, <strong>de</strong> telle sorte que<br />
l’ensemble constitue un système.<br />
Les programmes prioritaires sont : (1) le développement d’un capital humain compétitif<br />
(éducation, esprit d’entreprise), (2) <strong>la</strong> promotion <strong>de</strong> <strong>la</strong> bonne gouvernance et d’une démocratie<br />
renforcée, (3) <strong>la</strong> promotion du secteur privé et <strong>la</strong> réorientation du rôle <strong>de</strong> l’État, (4) l’élimination <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pauvreté et l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité globale et du cadre <strong>de</strong> vie, (5) l’édification d’un grand pôle<br />
régional <strong>de</strong> développement.<br />
REMARQUES, CRITIQUES ET EVALUATION<br />
L’originalité du rapport est d’appuyer les recherches <strong>prospective</strong>s sur les aspirations <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion (enquête), en se vou<strong>la</strong>nt représentatif <strong>de</strong> celle-ci (dialogue social…). Néanmoins, l’enquête<br />
auprès <strong>de</strong>s ivoiriens pourrait être é<strong>la</strong>rgie (prise en compte <strong>de</strong>s migrants installés, soit 28% <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion totale du pays). Les aspiraytions révélées sont-elles significatives ?<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 222
L’étu<strong>de</strong> a le mérite <strong>de</strong> mettre en avant les forces et les faiblesses du pays, <strong>de</strong> prendre en<br />
compte les leçons du passé et les tendances lour<strong>de</strong>s, ainsi que les ruptures possibles (germes <strong>de</strong><br />
changement).<br />
Le scénario dit “ réaliste ” doit être analysé avec pru<strong>de</strong>nce : s’il peut y avoir évolution<br />
défavorable internationale, il se peut aussi que <strong>de</strong>s tensions internes apparaissent (nationaux/<br />
étrangers et par là sud/nord). L’optimisme <strong>de</strong> rigueur dans le rapport (le facteur psychologique étant<br />
déterminant dans <strong>la</strong> marche <strong>de</strong> l’éléphant) pourrait être dans ce sens, plus modérée et moins<br />
emphatique.<br />
Il reste que les programmes prioritaires fixés mettent bien en évi<strong>de</strong>nce <strong>la</strong> primauté <strong>de</strong>s<br />
questions <strong>de</strong> développement social, <strong>de</strong> formation, <strong>de</strong> démocratisation, <strong>de</strong>s liens secteur privé/ État,<br />
qui sont posées à <strong>la</strong> Côte d’Ivoire.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 223
CONTEXTE<br />
COTE D'IVOIRE HORIZON 2010 :<br />
ETUDE PROSPECTIVE DU BUREAU NATIONAL D'ETUDES<br />
TECHNIQUES ET DE DEVELOPPEMENT (BNETD)<br />
Abidjan, 1998<br />
La Côte d'Ivoire dispose d'une situation assez favorable dans le cadre du sous ensemble que<br />
constitue l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest, avec une faça<strong>de</strong> maritime re<strong>la</strong>tivement <strong>la</strong>rge sur le Golfe <strong>de</strong> Guinée.<br />
Suffisamment éloignée du géant local que représente le Nigéria, elle exerce sur les pays environnants<br />
principalement francophones, et surtout sur les pays <strong>de</strong> l'intérieur, d'un pouvoir d'attraction qui se<br />
traduit d'ailleurs par <strong>de</strong>s mouvements migratoires important.<br />
Cette situation, à <strong>la</strong>quelle s'ajoutent une stabilité politique liée au long règne prési<strong>de</strong>ntiel <strong>de</strong> Mr<br />
Houphouet Boigny et une forte position dans <strong>la</strong> production <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux produits tropicaux importants que<br />
sont le café et le cacao, ont longtemps donné à ce pays une valeur d'exemple et une certaine avance<br />
économique sur les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> région.<br />
En dépit <strong>de</strong> ces atouts, <strong>la</strong> Côte d'Ivoire occupe une p<strong>la</strong>ce mo<strong>de</strong>ste sur le p<strong>la</strong>n mondial, aussi<br />
sur le p<strong>la</strong>n du PIB par habitant (132ème rang) que sur celui <strong>de</strong> l'indice <strong>de</strong> Développement Humain<br />
(136ème rang). Cette situation est due pour une part importante à <strong>la</strong> faiblesse <strong>de</strong>s cours du café et du<br />
cacao au début <strong>de</strong>s années 90 et à un développement particulièrement rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion par<br />
ailleurs peu sco<strong>la</strong>risée et peu qualifiée, le taux d'analphabétisation dépassant 50%.<br />
Dans ces conditions et malgré un redémarrage <strong>de</strong> l'économie consécutif à <strong>la</strong> dévaluation du<br />
Franc CFA en 1994,<strong>la</strong> situation générale du pays <strong>de</strong>meure fragile, avec une <strong>de</strong>tte extérieure élevée,<br />
un Marché Financier local insuffisant et une faible attraction pour les capitaux étrangers, <strong>la</strong>issant<br />
p<strong>la</strong>ce, pour une <strong>la</strong>rge part, à l'économie informelle.<br />
MÉTHODOLOGIE<br />
L'étu<strong>de</strong> du BNETD a l'avantage d'être récente (octobre 98 ) et s'inspire en partie <strong>de</strong>s<br />
préconisations du PNUD et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s <strong>de</strong> Futurs Africains, en limitant cependant ses<br />
ambitions à l'horizon 2010. Ce qui paraît raisonnable, en effet, compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation actuelle du<br />
Pays qui n'est pas réellement sorti <strong>de</strong> son état <strong>de</strong> sous-développement. L'accent mis respectivement<br />
sur les enjeux politiques, démographiques et sociaux culturels qui font l'objet <strong>de</strong> développements<br />
spéciaux, souligne bien l'importance <strong>de</strong> ces problèmes pour l'avenir du Pays<br />
Bien que <strong>de</strong> nombreux acteurs locaux, appartenant à <strong>de</strong>s secteurs variés <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie locale, dans<br />
<strong>de</strong>s secteurs aussi bien publics que privés économiques, universitaires, voire religieux, aient participé<br />
aux travaux du BNETB, les résultats retenus dans le rapport <strong>de</strong> synthèse donnent plutôt l'impression<br />
d'une mise à p<strong>la</strong>t <strong>de</strong>s problèmes actuels sans que <strong>la</strong> perspective véritablement <strong>prospective</strong> et<br />
volontariste soit suffisamment soulignée.<br />
En d'autres termes les auteurs <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> présentent un catalogue très complet <strong>de</strong><br />
préconisations et <strong>de</strong> mesures à prendre, mais sont restés pour une <strong>la</strong>rge part soit dans l'expression<br />
<strong>de</strong> voeux <strong>de</strong> caractère général (amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gouvernance, diminution du rôle <strong>de</strong> l'État...) soit<br />
dans <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> plusieurs scénarios différents qui souligne leur incertitu<strong>de</strong> sur les perspectives<br />
du Pays.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 224
OBJECTIFS ET MOYENS<br />
Les objectifs retenus sont très ambitieux et sous enten<strong>de</strong>nt un effort important dans tous les<br />
secteurs aussi bien dans le secteur public que dans les domaines culturels ou socio-économiques.<br />
Réduire <strong>la</strong> rapidité du développement démographique, du pour une part importante à<br />
l'immigration (plus <strong>de</strong> 25% d'étrangers).<br />
Réduire le taux particulièrement élevé d'analphabètes et améliorer qualitativement le niveau<br />
d'éducation.<br />
Améliorer le niveau sanitaire du Pays et lutter efficacement contre <strong>de</strong>s pandémies telles que le<br />
SIDA.<br />
Faire face au développement urbain très vigoureux par <strong>de</strong>s équipements adaptés.<br />
Développer le secteur économique privé et réunir à cet effet à <strong>la</strong> fois les capitaux et les<br />
compétences nécessaires.<br />
Assurer <strong>la</strong> bonne Gouvernance indispensable à l'établissement d'un climat <strong>de</strong> confiance aussi<br />
bien local qu'international vis à vis <strong>de</strong> l'Etat et <strong>de</strong> l'Administration.<br />
Ces différents objectifs sont tous hautement prioritaires mais ils sont probablement irréalisables<br />
simultanément faute <strong>de</strong> moyens adaptés.<br />
Aussi bien l'étu<strong>de</strong> du BNETD fait elle apparaître c<strong>la</strong>irement <strong>de</strong>ux aspects fondamentaux <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>prospective</strong> envisagée :<br />
D'une part <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> plusieurs scénarios possibles<br />
- <strong>Un</strong> scénario pessimiste (<strong>la</strong> locomotive en panne)<br />
- <strong>Un</strong> scénario moyen (<strong>la</strong> locomotive en marche)<br />
- <strong>Un</strong> scénario optimiste (<strong>la</strong> Côte d'Ivoire facteur d'entraînement et d'exemple au niveau<br />
régional).<br />
D'autre part un besoin important d'ai<strong>de</strong> extérieure dont le Pays ne peut encore se passer pour<br />
assurer son décol<strong>la</strong>ge économique et social. Le volume <strong>de</strong> cette ai<strong>de</strong> et l'emploi qui en sera fait<br />
concrètement détermineront sans aucun doute, pour une <strong>la</strong>rge part les résultats obtenus à terme. A<br />
cet égard l'évolution <strong>de</strong>s doctrines d'intervention extérieure, tenant compte <strong>de</strong>s résultats médiocres<br />
obtenus dans le passé et <strong>de</strong>s moyens importants consacrés à <strong>de</strong>s projets peu productifs, tend<br />
heureusement à une plus gran<strong>de</strong> souplesse et à une meilleure efficacité.<br />
Il apparaît c<strong>la</strong>irement que <strong>la</strong> tache à accomplir est immense et dépend pour une <strong>la</strong>rge part <strong>de</strong><br />
facteurs extérieurs tels que l'évolution <strong>de</strong> l'économie vers <strong>la</strong> mondialisation ou le niveau <strong>de</strong>s capitaux<br />
internationaux investis dans l'économie locale en particulier dans <strong>de</strong>s secteurs productifs.<br />
Au p<strong>la</strong>n interne, les buts à atteindre dépen<strong>de</strong>nt <strong>la</strong>rgement d'une volonté politique c<strong>la</strong>irement<br />
affirmée. Des résultats ont cependant été obtenus <strong>de</strong>puis quelques années grâce à <strong>la</strong> réussite <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
dévaluation <strong>de</strong> 1994 à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s exportations et au retour <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance économique.<br />
Il s'agit en fait, pour les Responsables locaux politiques et privés <strong>de</strong> faire réellement évoluer le<br />
Pays, sous <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce discrète mais ferme <strong>de</strong>s organismes prêteurs internationaux, c'est à dire<br />
dans le sens :<br />
- Du respect <strong>de</strong>s Institutions et <strong>de</strong>s Hommes<br />
- Du développement et <strong>de</strong> l'encouragement <strong>de</strong> l'initiative privée<br />
- De l'amélioration forcément lente mais progressive et réelle <strong>de</strong>s fondamentaux dans les<br />
domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> Démographie, <strong>de</strong> l'Education et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé.<br />
Le décol<strong>la</strong>ge effectif du Pays dépend pour une très <strong>la</strong>rge part d'une évolution positive <strong>de</strong>s<br />
mentalités locales à tous les niveaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> société ivoirienne.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 225
OBJECTIFS<br />
« GABON 2025 »<br />
Futurs Africains, République Gabonaise, juin 1996.<br />
Définir les futurs possibles du Gabon à l'horizon 2025. Selon les termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> note <strong>de</strong> synthèse:<br />
• Définition d’une vision à long terme du développement du Gabon qui prendrait en compte<br />
les aspirations profon<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions, les potentialités du pays et l’environnement<br />
international;<br />
• É<strong>la</strong>boration d’un gui<strong>de</strong> à <strong>la</strong> décision et à <strong>la</strong> gestion du développement, à court et à moyen ,<br />
à partir d’une vision c<strong>la</strong>ire du futur;<br />
• Renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> réflexion, d’assimi<strong>la</strong>tion et d’adaptation <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nification du développement, face aux incertitu<strong>de</strong>s du futur. »<br />
METHODOLOGIE<br />
Définie par Futurs Africains (cf. note correspondante), elle se déroule en quatre phases:<br />
• I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> <strong>la</strong> problématique: recueil <strong>de</strong>s aspirations nationales, et sélection <strong>de</strong>s<br />
questions et thèmes qui entrent dans le champ <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>.<br />
• Construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> base, recueil <strong>de</strong>s informations nécessaires à <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s<br />
facteurs clefs, à partir d’une analyse rétrospective.<br />
• Construction <strong>de</strong>s scénarios.<br />
• É<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong> développement favorisant <strong>la</strong> réalisation du futur souhaitable.<br />
RESULTATS<br />
Image <strong>de</strong> base: Économie <strong>de</strong> rente, extravertie et lour<strong>de</strong>ment en<strong>de</strong>ttée.<br />
Plusieurs « incertitu<strong>de</strong>s critiques » sont définies dans quatre domaines:<br />
• Économie: le pétrole, les technologies, <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte et <strong>la</strong> zone franc.<br />
• Politique et société: évolution du processus démocratique.<br />
• Démographie: SIDA, flux migratoires, développement <strong>de</strong> nouveaux virus.<br />
• Culture, Éducation, Formation: évolution du système éducatif et évolution <strong>de</strong>s valeurs<br />
culturelles traditionnelles.<br />
• Environnement extérieur: environnement international, évolution <strong>de</strong>s technologies,<br />
intégration sous-régionale.<br />
Quatre scénarios sont dégagés sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s analyses précé<strong>de</strong>ntes:<br />
• Les requins: une dictature militaire à l’horizon 2025, dans un contexte international<br />
favorable (prix du pétrole élevé, APD importante, réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte).<br />
• La panthère: un pays seul contre tous. Dans un contexte international défavorable (bas<br />
prix <strong>de</strong>s matières premières, baisse <strong>de</strong> l’APD, blocage du processus démocratique), le<br />
Gabon met en exploitation <strong>de</strong> nouveaux gisements dans <strong>de</strong>s zones protégées, et se met au<br />
ban <strong>de</strong>s institutions internationales.<br />
• Le chien errant: un pays <strong>de</strong> déso<strong>la</strong>tion à l’horizon 2025. Dans un contexte international<br />
défavorable, et un secteur pétrolier affaibli, le Gabon est abandonné <strong>de</strong> tous, c’est le<br />
syndrome rwandais.<br />
• L’écureuil: un pays industrieux qualifié <strong>de</strong> Suisse <strong>de</strong> l’Afrique. Dans un contexte<br />
international très favorable (hausse <strong>de</strong> l’APD, <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s matières premières, un secteur<br />
pétrolier performant, une démocratisation réussie <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie politique), le Gabon réussit un<br />
développement extraordinaire <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> pointe (télécommunication, informatique,<br />
bureautique, télématique,...), comparable à celui <strong>de</strong>s « dragons » <strong>de</strong> l’Asie du sud-est.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 226
L'orientation du Gabon vers le scénario souhaitable <strong>de</strong> l'écureuil suppose <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong><br />
quatre programmes prioritaires:<br />
• Consoli<strong>de</strong>r le processus démocratique;<br />
• Revaloriser le système éducatif;<br />
• Restructurer l’économie;<br />
• Redéfinir <strong>la</strong> politique diplomatique.<br />
COMMENTAIRE<br />
<strong>Un</strong>e méthodologie bien é<strong>la</strong>borée, qui conduit à insister sur les déterminants extérieurs <strong>de</strong>s<br />
futurs gabonais. Ceux-ci dépen<strong>de</strong>nt pour l’essentiel <strong>de</strong> l’évolution du secteur pétrolier, <strong>de</strong>s marchés<br />
<strong>de</strong>s matières premières, et <strong>de</strong>s flux d’ai<strong>de</strong> en direction du Gabon. Le paramètre interne essentiel<br />
<strong>de</strong>meure celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> démocratisation. Le seul scénario positif, celui <strong>de</strong> l’écureuil, suppose un<br />
développement <strong>de</strong>s nouvelles technologies, ce qui représente une hypothèse forte par rapport à<br />
l’image <strong>de</strong> base définie dans l’analyse rétrospective. Les programmes prioritaires pour orienter le<br />
Gabon vers ce <strong>de</strong>rnier scénario sont qualitatifs et non chiffrés, ils définissent <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s orientations,<br />
sans définition <strong>de</strong>s moyens à mettre en œuvre.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 227
MADAGASCAR: VISION 2030<br />
ETUDES NATIONALES DE PERSPECTIVES A LONG TERME<br />
N.L.T.P.S.<br />
OBJECTIFS, SITUATION<br />
Secrétariat d'État à l'économie<br />
et au p<strong>la</strong>n/Programme <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies pour le développement,<br />
Antananarivo, juillet 1996<br />
L'exercice <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> NLTPS s'efforce, en s'appuyant sur <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> développement<br />
humain durable promue par le PNUD, <strong>de</strong> construire un nouveau regard sur le futur <strong>de</strong> Madagascar qui<br />
se distingue autant <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> l'ajustement structurel que <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> "p<strong>la</strong>nification c<strong>la</strong>ssique" ; pour<br />
autant, il ne se présente pas comme un substitut, ni comme une alternative à ces pratiques. Il se<br />
propose <strong>de</strong> rétablir <strong>la</strong> confiance <strong>de</strong>s acteurs du développement - et en particulier <strong>de</strong> l'État - dans leur<br />
capacité à anticiper les ruptures, à affronter solidairement les défis, à orienter l'avenir du pays.<br />
Ce "forum politiquement neutre" traite <strong>de</strong> problèmes essentiellement politiques : valeurs<br />
nationales, définition d'un projet <strong>de</strong> société et <strong>de</strong>s moyens d'obtenir l'adhésion du peuple et <strong>de</strong>s<br />
institutions à ce projet. A cet effet, il se dote d'un vocabu<strong>la</strong>ire propre à exprimer ses jugements <strong>de</strong><br />
valeur d'une façon consensuelle, et s'inscrit précautionneusement dans le cadre institutionnel local. Le<br />
Ministre du p<strong>la</strong>n prési<strong>de</strong> son comité d'orientation chargé d'informer le gouvernement et <strong>de</strong> prodiguer<br />
un soutien moral et politique au projet. La cellule <strong>de</strong> pilotage, composée <strong>de</strong> quatre ou cinq experts<br />
nationaux est assistée par <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> travail multidisciplinaires aussi composés d'experts<br />
chargés d'exprimer les "aspirations" popu<strong>la</strong>ires et leurs implications pour les visions <strong>prospective</strong>s à 35<br />
ans, les cadrages macroéconomiques à 5 ans et les programmes triennaux d'action <strong>de</strong> l'État.<br />
MÉTHODOLOGIE<br />
La vision NLTPS use d'un vocabu<strong>la</strong>ire inspiré <strong>de</strong> <strong>la</strong> "<strong>prospective</strong> stratégique" (Go<strong>de</strong>t), facilitant<br />
l'expression <strong>de</strong>s volontés face aux contraintes (aspirations, acteurs porteurs <strong>de</strong> projets), <strong>de</strong>s libertés<br />
ou <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s face aux déterminismes (faits porteurs d'avenir, tendances majeures, incertitu<strong>de</strong>s<br />
critiques), <strong>de</strong>s valeurs face aux objets sociaux (forces, faiblesses) ou environnementaux<br />
(opportunités, menaces). Cette "indiscipline intellectuelle" nécessiterait une soli<strong>de</strong> maîtrise du<br />
raisonnement dialectique.<br />
Le processus NLTPS est découpé en cinq phases :<br />
- I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s problèmes, les "aspirations nationales" et les "fonctions que doit remplir<br />
l'État".<br />
- I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s "tendances lour<strong>de</strong>s", "faits porteurs d'avenir", "forces" et "faiblesses",<br />
opportunités" et "menaces", qui caractérisent l'évolution <strong>de</strong>s quarante <strong>de</strong>rnières années et<br />
l'état actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> société malgache et <strong>de</strong> son environnement international.<br />
- Construction <strong>de</strong>s scénarii à partir <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s "incertitu<strong>de</strong>s critiques" et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
formu<strong>la</strong>tion d'hypothèses sur ces <strong>de</strong>rnières.<br />
- É<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> stratégies et <strong>de</strong> lignes politiques générales. Les étapes précé<strong>de</strong>ntes<br />
constituaient le "processus <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification stratégique" ; <strong>la</strong> suivante concerne <strong>la</strong> et gestion<br />
stratégique"<br />
- Programmation, mise en œuvre, suivi, é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns et programmes à court et<br />
moyen terme.<br />
RÉSULTATS<br />
Les auteurs constatent que le produit par tête décroît <strong>de</strong> façon presque continue <strong>de</strong>puis 1960,<br />
que l'environnement naturel subit <strong>de</strong>s dégradations irréversibles, que <strong>la</strong> croissance urbaine n'est pas<br />
maîtrisée, que le pays reste dépendant <strong>de</strong> l'extérieur. Ces "tendances lour<strong>de</strong>s" sont opposées aux<br />
"aspirations nationales", lesquelles reflètent une crise d'i<strong>de</strong>ntité nationale et <strong>de</strong> confiance : Outre<br />
l'aspiration à <strong>la</strong> satisfaction <strong>de</strong>s besoins fondamentaux, définis en termes d'alimentation, <strong>de</strong> logement,<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 228
<strong>de</strong> santé et d'éducation, les experts expriment le vœu d'une restauration <strong>de</strong>s valeurs traditionnelles et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fierté nationale, <strong>de</strong>s aménités <strong>de</strong> l'environnement, d'un régime politique d'équité et <strong>de</strong> liberté<br />
fondé sur <strong>la</strong> démocratie et le libéralisme économique.<br />
Ces "aspirations" coïnci<strong>de</strong>nt opportunément avec les objectifs présumés <strong>de</strong>s bailleurs <strong>de</strong> fonds<br />
que le rapport désigne comme <strong>de</strong>s "opportunités", à l'instar <strong>de</strong> <strong>la</strong> mondialisation et <strong>de</strong>s nouvelles<br />
technologies évoquées abstraitement. Les opportunités peuvent aussi être <strong>de</strong>s menaces: <strong>la</strong><br />
mondialisation, <strong>la</strong> libéralisation <strong>de</strong>s échanges (impliquant <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> Lomé),<br />
l'accélération <strong>de</strong>s progrès technologiques et les politiques d'ouverture non contrôlée peuvent<br />
appauvrir ou marginaliser le pays.<br />
Le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie associative et <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> pression politiques, ainsi que le<br />
libéralisme économique et <strong>la</strong> mobilisation pour <strong>la</strong> reconstruction du pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong> <strong>la</strong> reine sont regardés<br />
comme <strong>de</strong>s faits porteurs d'avenir. Pour aménager l'avenir, les "acteurs" (pouvoirs publics, élus et<br />
partis, investisseurs étrangers et "opérateurs économiques nationaux", bailleurs <strong>de</strong> fonds) pourront<br />
s'appuyer sur les "forces" suivantes : le potentiel humain renforcé par l'existence d'une <strong>la</strong>ngue<br />
nationale et <strong>la</strong> "survivance <strong>de</strong>s valeurs traditionnelles", les ressources naturelles, le dynamisme du<br />
secteur informel et <strong>la</strong> situation géographique <strong>de</strong> l'île. Mais ces forces peuvent aussi <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s<br />
"faiblesses" ; ainsi, <strong>la</strong> dégradation <strong>de</strong>s infrastructures et <strong>de</strong> l'environnement, l'effritement <strong>de</strong>s valeurs<br />
morales, <strong>la</strong> désco<strong>la</strong>risation, l'inefficacité <strong>de</strong> l'administration et les habitu<strong>de</strong>s politiques obèrent l'avenir<br />
<strong>de</strong> Madagascar.<br />
Le rapport i<strong>de</strong>ntifie <strong>de</strong>ux "incertitu<strong>de</strong>s critiques" pour construire trois scénarii. Les incertitu<strong>de</strong>s<br />
critiques portent sur l'évolution du processus démocratique et <strong>de</strong> l'environnement international, et<br />
chacune donne lieu à <strong>de</strong>ux hypothèses, l'une favorable, l'autre défavorable. Sur l'évolution du<br />
processus démocratique, l'hypothèse favorable est celle du consensus national, <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence<br />
administrative et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mobilisation popu<strong>la</strong>ire ; l'hypothèse défavorable implique <strong>la</strong> politisation (zizanie,<br />
corruption, autoritarisme), <strong>la</strong> sclérose administrative et le divorce du peuple et <strong>de</strong>s élites.<br />
L'environnement international peut être stable (hypothèse favorable) ou instable (hypothèse<br />
défavorable). Les trois scénarii sont trois allégories maritimes.<br />
Le scénario du "paquebot <strong>de</strong> croisière" décrit le voyage paisible d'un peuple uni, sur un<br />
bâtiment robuste et sur une mer calme. Les trois étapes <strong>de</strong> ce voyage sont décrites sans conviction :<br />
renaissance <strong>de</strong> l'enthousiasme popu<strong>la</strong>ire et reconstruction institutionnelle attirant les investisseurs<br />
étrangers (1996-2000), puis consolidation <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance (2001-2010), et enfin accession<br />
<strong>de</strong> Madagascar au rang <strong>de</strong> puissance régionale (2010-2030).<br />
Le scénario du "boutre" décrit le sort d'un équipage divisé, sur un bâtiment vétuste, sur une<br />
mer démontée. Entre 1996 et 2001, le pays ne parvient pas à se doter d'institutions démocratiques, le<br />
poids <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>tte l'écrase, <strong>la</strong> "fracture sociale" s'accentue, <strong>la</strong> dégradation <strong>de</strong> l'environnement rural et<br />
urbain, l'explosion du secteur informel et <strong>la</strong> croissance démographique, ruinent le peuple malgache.<br />
Les famines engendrent <strong>de</strong>s troubles sociaux. Ce scénario est décrit avec plus <strong>de</strong> conviction que le<br />
précé<strong>de</strong>nt. <strong>Un</strong> obscur vaisseau fantôme étranger vient finalement prendre le boutre en remorque et<br />
recrée à Madagascar "l'âge <strong>de</strong>s comptoirs commerciaux ; les investisseurs étrangers exploitent les<br />
ressources naturelles ou développent le tourisme sexuel ou narcotique. "Le Malgache a perdu son<br />
i<strong>de</strong>ntité et sa fierté".<br />
Le scénario <strong>de</strong> <strong>la</strong> goélette se construit sur les hypothèses d'une "bonne gouvernance" et d'un<br />
environnement international re<strong>la</strong>tivement perturbé. L'enthousiasme popu<strong>la</strong>ire, le patriotisme <strong>de</strong>s<br />
dirigeants enfin réconciliés et le libéralisme économique compensent le fait que <strong>la</strong> mondialisation<br />
accentue les handicaps du pays. Les réformes nécessaires sont achevées en 2001. Entre 2001 et<br />
2010, <strong>la</strong> moralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie politique, <strong>la</strong> promotion <strong>de</strong>s femmes, <strong>la</strong> réforme du système financier, <strong>la</strong><br />
formation <strong>de</strong>s travailleurs et <strong>la</strong> valorisation du patrimoine culturel et artistique permettent <strong>de</strong><br />
développer le tourisme (<strong>de</strong>venu <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> activité économique du pays), <strong>de</strong> maîtriser <strong>la</strong> croissance<br />
démographique, <strong>de</strong> satisfaire les besoins fondamentaux et <strong>de</strong> "rehausser <strong>la</strong> fierté <strong>de</strong>s malgaches". La<br />
goélette maintient le cap entre 2010 et 2030. Les investissements nationaux permis par le gonflement<br />
<strong>de</strong> l'épargne locale et les investissements étrangers consoli<strong>de</strong>nt les bases d'une croissance moins<br />
forte que dans le scénario du paquebot mais plus autocentrée. "La fierté nationale est retrouvée".<br />
Les exercices précé<strong>de</strong>nts servent à définir les orientations stratégiques du développement<br />
<strong>de</strong> Madagascar : satisfaire les besoins fondamentaux, améliorer <strong>la</strong> gouvernance, renforcer<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 229
l'économie, régénérer et valoriser l'environnement, ainsi que les valeurs culturelles, et reconstruire le<br />
système éducatif La satisfaction <strong>de</strong>s besoins fondamentaux, le "développement humain durable", <strong>la</strong><br />
mobilisation popu<strong>la</strong>ire et <strong>la</strong> croissance économique sont liés dialectiquement, d'une façon un peu<br />
confuse. Pour "construire une économie forte", il convient <strong>de</strong> "mettre en œuvre un programme<br />
d'ajustement structurel qui tienne compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> valoriser les ressources humaines et<br />
d'assurer une exploitation optimale <strong>de</strong> nos potentialités". Grâce à l'appoint <strong>de</strong>s investissements directs<br />
étrangers et à <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong> l'épargne intérieure, le taux d'investissement pourrait passer <strong>de</strong> 11 à<br />
40% du PIB "à l'instar <strong>de</strong> certains pays <strong>de</strong> l'Asie du sud-est". L'économie <strong>de</strong>vrait être plus ouverte sur<br />
l'extérieur, grâce à une "vigoureuse politique d'encouragement à l'exportation" concernant l'agriculture,<br />
l'industrie et l'artisanat ; ainsi pourraient être exploitées les opportunités offertes par les organismes<br />
régionaux comme <strong>la</strong> COI, <strong>la</strong> COMESA ou l'OIR. La promotion <strong>de</strong>s activités scientifiques et<br />
technologiques servirait cet objectif, ainsi que <strong>la</strong> reconstruction du système éducatif. Dans ce <strong>de</strong>rnier<br />
domaine, le rapport suggère, en s'appuyant sur les valeurs culturelles malgaches, <strong>de</strong> faciliter l'accès<br />
<strong>de</strong>s femmes à l'éducation, <strong>de</strong> valoriser <strong>la</strong> fonction enseignante, <strong>de</strong> réhabiliter les infrastructures<br />
éducatives, notamment <strong>de</strong> l'enseignement technique et professionnel, <strong>de</strong> généraliser le bilinguisme et<br />
<strong>de</strong> promouvoir auprès <strong>de</strong>s jeunes l'esprit d'initiative".<br />
Le rapport accor<strong>de</strong> une attention particulière au p<strong>la</strong>n d'action <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase initiale (1996-2001),<br />
au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>vront être installées les bases politiques, économiques, sociales, financières et<br />
sociales d'une croissance économique durable. Il préconise <strong>de</strong> restructurer d'abord <strong>la</strong> confiance entre<br />
les acteurs (l'Etat et <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, l'État et les entrepreneurs nationaux et étrangers), <strong>de</strong> réhabiliter<br />
l'image <strong>de</strong> Madagascar à l'étranger, puis d'assainir l'administration et <strong>la</strong> vie politique en vue <strong>de</strong><br />
stabiliser l'environnement politicoéconomique et d'amorcer le décol<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> l'économie. Ces actions<br />
<strong>de</strong>vront être inspirées par l'idée <strong>de</strong> "<strong>la</strong> prééminence <strong>de</strong> l'être malgache en tant que principal acteur et<br />
bénéficiaire <strong>de</strong> son développement" ; elles <strong>de</strong>vront donc respecter les valeurs culturelles et rechercher<br />
<strong>la</strong> participation <strong>de</strong> tous les Malgaches à <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> l'avenir commun.<br />
REMARQUES CRITIQUES ET EVALUATION<br />
Le rappel <strong>de</strong>s politiques menées <strong>de</strong>puis l'indépendance prouve que les passés sont divers<br />
comme les avenirs.<br />
Le discours nationaliste insu<strong>la</strong>ire est bien celui que tiennent, <strong>de</strong>puis trente ans, les intellectuels<br />
malgaches ; mais <strong>la</strong> convergence <strong>de</strong>s "aspirations nationales" (probablement différentes <strong>de</strong>s<br />
aspirations popu<strong>la</strong>ires) et <strong>de</strong>s thèmes d'action <strong>de</strong>s bailleurs <strong>de</strong> fonds est suspecte. A cet égard, il est<br />
difficile d'apprécier l'effet <strong>de</strong> l'opportunisme <strong>de</strong>s experts nationaux face aux experts étrangers. Ceci n'a<br />
peut-être pas gran<strong>de</strong> importance dans <strong>la</strong> mesure où, en dépit <strong>de</strong> rappels incantatoires <strong>de</strong>s valeurs<br />
nationales, celles-ci ne sont pas précisément mises à contribution dans <strong>la</strong> construction <strong>de</strong>s scénarii,<br />
<strong>de</strong>s orientations et <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 230
MAURICE : MAURITIUS<br />
HORIZON 2020 :<br />
Résumé <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> nationale à long terme établie<br />
par le ministère du Développement économique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération Régionale<br />
Futurs Africains, 1996<br />
CONTEXTE<br />
Isolée dans l'Océan Indien, éloignée <strong>de</strong>s grands centres économiques mondiaux, pauvre en<br />
ressources naturelles et surpeuplée -600 hts/km - l'ILE MAURICE ne paraît pas à priori en situation<br />
favorable à un développement économique exemp<strong>la</strong>ire.<br />
Mais ce petit État <strong>de</strong> 1 million d'habitants, détaché <strong>de</strong> <strong>la</strong> couronne britannique et indépendant<br />
<strong>de</strong>puis 1968, a su faire <strong>de</strong> ses faiblesses <strong>de</strong>s atouts.<br />
Du fait <strong>de</strong> son insu<strong>la</strong>rité et <strong>de</strong> sa taille , elle ne se connaît pas d'ennemi extérieur et sa<br />
popu<strong>la</strong>tion pluriethnique , mais en majorité d'origine indienne vit en bonne harmonie. L'économie<br />
héritée <strong>de</strong> l'époque coloniale et fondée sur <strong>la</strong> production quasi exclusive <strong>de</strong> <strong>la</strong> canne à sucre en 1970<br />
s'est progressivement diversifiée et s'est développée en 25 ans (19701995) au rythme très élevé <strong>de</strong><br />
5.70 % par an permettant <strong>de</strong> quadrupler le PIB et <strong>de</strong> tripler le PIB par hbt qui se situe (à parité <strong>de</strong><br />
pouvoir d'achat) au 31ème rang mondial entre l'Espagne et l'Ir<strong>la</strong>n<strong>de</strong> (Source: État du mon<strong>de</strong> 1996)<br />
<strong>Un</strong> tel développement a été possible grâce à trois facteurs essentiels.<br />
- au p<strong>la</strong>n agricole, utilisation très adroite d'accords internationaux permettant l'exportation<br />
<strong>de</strong> quotas <strong>de</strong> sucre importants vers l'Europe à <strong>de</strong>s prix très intéressants supérieurs aux<br />
prix mondiaux (Convention <strong>de</strong> Lomé)<br />
- au p<strong>la</strong>n industriel, création <strong>de</strong> zones franches à vocation exportatrice utilisant une main<br />
d'œuvre bon marché et <strong>de</strong> qualité, surtout dans le secteur textile.<br />
- au p<strong>la</strong>n tertiaire, développement spectacu<strong>la</strong>ire du tourisme <strong>de</strong> niveau moyen/haut <strong>de</strong><br />
gamme, facilité par <strong>la</strong> beauté <strong>de</strong>s rivages et le caractère accueil<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
Le miracle du développement <strong>de</strong> l'Île Maurice, re<strong>la</strong>tivement peu cité par les grands médias,<br />
s'assimile plutôt aux performances <strong>de</strong>s Dragons Asiatiques qu'à <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>s États Africains<br />
auxquels elle est géographiquement et un peu artificiellement rattachée.<br />
Comme les autres États africains, l'Île Maurice a cependant été appelée à faire une étu<strong>de</strong><br />
<strong>prospective</strong> sur son développement à long terme (à l'horizon 2020) dans le cadre du projet régional du<br />
PNUD<br />
MÉTHODOLOGIE<br />
Plus avancée économiquement et plus stable politiquement que <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s autres États<br />
Africains, l'Île MAURICE a d'ores et déjà menée à bien sa propre étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong>.<br />
Cet ouvrage en <strong>de</strong>ux volumes s'inspire <strong>la</strong>rgement <strong>de</strong>s idées maîtresses exprimées par le PNUD<br />
(cf. Futurs Africains: cinq années d'Étu<strong>de</strong>s nationales <strong>de</strong> perspectives à long terme en Afrique)<br />
Le PNUD préconise, en effet, l'abandon <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> P<strong>la</strong>nification en honneur au moment<br />
<strong>de</strong>s Indépendances et une certaine remise en question <strong>de</strong>s politiques d'ajustement structurel<br />
considérées comme trop rigi<strong>de</strong>s et trop strictes. Il s'agit désormais <strong>de</strong> susciter une réflexion sur les<br />
besoins et les perspectives par pays dans une perspective à <strong>la</strong> fois nationale et régionale. <strong>Un</strong>e telle<br />
étu<strong>de</strong> nécessite une <strong>la</strong>rge participation <strong>de</strong>s différents acteurs économiques et politiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> société<br />
locale et une approche à <strong>la</strong> fois pragmatique et réaliste <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation et <strong>de</strong>s potentialités nationales.<br />
L'Île MAURICE, du fait <strong>de</strong> son niveau <strong>de</strong> développement économique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> stabilité <strong>de</strong> ses<br />
Institutions politiques, s'est aisément adaptée au processus <strong>de</strong> réflexion en 5 phases préconisé par le<br />
PNUD, fondé sur les points suivants :<br />
- i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> <strong>la</strong> problématique et aspirations <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
- bases <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> - diagnostic - forces - changements - menaces - opportunités. scénarios<br />
alternatifs.<br />
- orientations et objectifs concrets à long terme. perspectives <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce<br />
opérationnelle.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 231
Les quatre premiers thèmes sont exposés sur un p<strong>la</strong>n général dans le volume 1 <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>.<br />
Les perspectives <strong>de</strong> réalisations concrètes, étudiées en détail , thème par thème, par <strong>de</strong>s<br />
groupes <strong>de</strong> travail spécifiques, font l'objet <strong>de</strong> <strong>la</strong>rges développements du volume Il.<br />
L'ensemble donne une vue sérieuse, générale et réaliste <strong>de</strong>s possibilités d'évolution du Pays<br />
sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> qui s'étend <strong>de</strong> 1995 à 2020 , sans omettre les difficultés qui peuvent se présenter<br />
OBJECTIFS ET MOYENS<br />
L'Île MAURICE s'est fixée pour objectif un taux <strong>de</strong> développement annuel égal et même<br />
supérieur à celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> antérieure qui était déjà <strong>de</strong> 5,7 % (1970/1995)<br />
La réalisation d'un tel objectif ne dépend pas uniquement <strong>de</strong> facteurs locaux mais aussi pour<br />
une <strong>la</strong>rge part <strong>de</strong> l'évolution géopolitique et économique mondiale. Ces réserves ne sont pas ignorées<br />
par les auteurs <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> qui mettent en avant plusieurs facteurs d'ordre structurel.<br />
- les niveaux d'éducation déjà acquis sont favorables à une évolution vers <strong>de</strong>s activités<br />
tertiaires <strong>de</strong> niveau technologique élevé mais faiblement consommatrices <strong>de</strong> matières<br />
premières et d'énergie (dont le pays est pauvre).<br />
- une évolution mondiale <strong>de</strong>s communications qui tend à réduire les effets <strong>de</strong> l'éloignement<br />
et <strong>de</strong> l'isolement.<br />
- une évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale qui aura pour conséquence une augmentation<br />
modérée <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale (22 % soit 250 000 hts) et un accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> part<br />
re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active améliorant potentiellement le ratio actifs/non actifs.<br />
Toutefois, dans un contexte <strong>de</strong> mondialisation et <strong>de</strong> concurrence accrue les trois secteurs <strong>de</strong><br />
développement antérieurs ne suffiront, selon les rédacteurs <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>, à assurer <strong>la</strong> croissance<br />
espérée.<br />
- au p<strong>la</strong>n agricole, <strong>la</strong> disparition progressive <strong>de</strong>s protections tarifaires notamment sur le<br />
sucre nécessitera d'importants progrès <strong>de</strong> productivité et une légère diminution <strong>de</strong>s<br />
surfaces cultivées en canne à sucre au profit d'autres productions agricoles (légumes<br />
etc.). C'est en mettant l'accent sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> ses produits, liée à une recherche active<br />
que l'Île Maurice espère maintenir ses positions sur le marché mondial du sucre.<br />
- au p<strong>la</strong>n touristique, bien que les capacités d'accueil soient forcément limitées par le<br />
manque d'espace disponible, le nombre annuel <strong>de</strong> touristes pourrait passer <strong>de</strong> 400000<br />
dans les années 90 à 800 000 voire à 1 000 000 dans une vingtaine d'années. Le<br />
développement <strong>de</strong> ce secteur, très important sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> main d'œuvre et sur le p<strong>la</strong>n<br />
monétaire, serait obtenu en mettant l'accent, plus qu'auparavant, sur un tourisme haut <strong>de</strong><br />
gamme.<br />
- au p<strong>la</strong>n industriel, un très gros effort sera nécessaire pour absorber les augmentations <strong>de</strong><br />
main d'œuvre disponible et prendre une part suffisante dans les objectifs globaux <strong>de</strong> type<br />
Asie <strong>de</strong> l'Est. Dans ce domaine, <strong>de</strong>s comportements <strong>de</strong> type Asie <strong>de</strong> l'Est seront<br />
nécessaires : adaptabilité aux conditions du marché, et qualité <strong>de</strong>s produits proposés<br />
dans un environnement mondial supposé plus concurrentiel.. <strong>Un</strong> objectif, très ambitieux,<br />
<strong>de</strong> triplement du secteur <strong>de</strong> l'industrie exportatrice, est souhaité en 25 ans.<br />
Pour relever les défis qu'elle s'est donnée, l'lle MAURICE compte donc sur un développement<br />
important d'un quatrième secteur, encore embryonnaire, dans le domaine <strong>de</strong>s services<br />
essentiellement financiers, estimant possible <strong>de</strong> jouer, au p<strong>la</strong>n régional vis à vis <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> l'Afrique<br />
<strong>de</strong> l'Est, le rôle <strong>de</strong> certaines p<strong>la</strong>ces telles que Singapour pour l'Asie, les Bermu<strong>de</strong>s pour le Continent<br />
Américain etc...<br />
Elle s'estime capable <strong>de</strong> proposer, par <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> sa main d'œuvre, et un haut niveau<br />
d'éducation approprié, <strong>de</strong> développer au rythme <strong>de</strong> 10 à 12 % par an <strong>de</strong>s services off shore <strong>de</strong><br />
qualité, <strong>de</strong>s services informatiques délocalisés, et une recherche technologique <strong>de</strong> bon niveau. <strong>Un</strong>e<br />
telle politique <strong>de</strong> développement, peu consommatrice <strong>de</strong> matières premières et d'énergie, est<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 232
considérée comme très favorable à un Pays <strong>de</strong> petite taille, surpeuplé, et très sensible aux problèmes<br />
d'environnement.<br />
<strong>Un</strong>e exploitation beaucoup <strong>la</strong>rge du très vaste domaine marin <strong>de</strong> l'lle MAURICE soit<br />
1 800 000 km2 environ, rendue possible par les progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche et <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie<br />
(y compris dans les domaines miniers et énergétiques) serait également <strong>de</strong> nature à apporter<br />
une certaine contribution au développement <strong>de</strong> l'lle.<br />
Les Groupes <strong>de</strong> travail sectoriels constitués, dont les travaux sont résumés <strong>de</strong> manière très<br />
sérieuse dans le volume Il <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>, ne <strong>la</strong>issent sous silence aucun <strong>de</strong>s aspects du problème posé:<br />
culture, éducation, développement scientifique et technologique, démographie, ressources naturelles,<br />
environnement, emploi, économie etc.<br />
Les objectifs tendant à une bonne gouvernance, une société harmonieuse, un bon niveau<br />
éducatif et social entrent dans les programmes <strong>de</strong> tous les États intéressés par l'étu<strong>de</strong> du PNUD Ces<br />
objectifs sont d'ores et déjà atteints pour une bonne part par l'lle MAURICE qui figurait, en 1996, au<br />
60ème rang mondial pour l'indice <strong>de</strong> développement humain (0,778)<br />
Malgré ses facultés d'adaptation certaines, malgré les atouts que l'lle MAURICE a su utiliser<br />
et qui <strong>la</strong> p<strong>la</strong>cent très en avance sur les autres pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone Afrique à <strong>la</strong>quelle elle est rattachée,<br />
peut-on raisonnablement penser qu'elle pourra atteindre un nouveau quadruplement <strong>de</strong> son PIB<br />
pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> qui s'étend <strong>de</strong> 1995 à 2020 ? Trop <strong>de</strong> facteurs extérieurs échappent à son emprise<br />
tels que <strong>la</strong> conjoncture mondiale ou l'évolution <strong>de</strong>s pays voisins <strong>de</strong> l'Afrique <strong>de</strong> l'Est et <strong>de</strong> l'Asie du<br />
Sud.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 233
3.4.<br />
LES PROSPECTIVES<br />
SECTORIELLES
3.4.1.<br />
L'AGRICULTURE
Les agricultures <strong>africaine</strong>s participent à l'alimentation <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions, à l'approvisionnement<br />
<strong>de</strong>s industries et à l'équilibre <strong>de</strong>s échanges extérieurs. La plupart <strong>de</strong>s prévisions considèrent<br />
isolément l'une <strong>de</strong> ces fonctions économiques <strong>de</strong> l'agriculture ; un travail <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> doit les<br />
associer dans une explication dynamique. Ce modèle prospectif doit en outre prendre en compte les<br />
ressources foncières, hydrauliques, pédologiques, les risques environnementaux et les dévastations<br />
écologiques, les techniques agraires et <strong>la</strong> consommation d'intrants, les transports et <strong>la</strong><br />
commercialisation, l'évolution <strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong>s revenus.<br />
LES PREVISIONS AGRO-ALIMENTAIRES ET LA PROSPECTIVE AGRICOLE<br />
Les travaux réputés rigoureux se fon<strong>de</strong>nt sur <strong>de</strong>s modèles économétriques qui interprètent <strong>de</strong>s<br />
systèmes agro-alimentaires observés dans le passé, dont les paramètres sont estimés à partir <strong>de</strong><br />
séries chronologiques, et qui permettent <strong>de</strong> projeter <strong>de</strong>s équilibres conventionnellement définis dans<br />
l'avenir. Ils représentent l'avenir le plus vraisemb<strong>la</strong>ble compte tenu <strong>de</strong> leur structure et <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiabilité <strong>de</strong><br />
leurs estimations, en faisant l'hypothèse d'une continuité <strong>de</strong>s processus décrits. Ce sont <strong>de</strong>s modèles<br />
<strong>de</strong> prévision, non <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>.<br />
Les travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> s'inquiètent plutôt <strong>de</strong>s ruptures, ou cherchent à représenter <strong>de</strong>s<br />
évolutions qui peuvent conduire au basculement du comportement du système agroalimentaire. Ils ne<br />
bénéficient pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> réputation <strong>de</strong> rigueur <strong>de</strong>s modèles économétriques (dont ils peuvent cependant<br />
faire usage temporairement) puisque les comportements supposés du système pendant ou après <strong>la</strong><br />
rupture ne peuvent pas être justifiés par <strong>de</strong>s calculs économétriques ; ces basculements ne peuvent<br />
pas être envisagés sans quelque hypothèse normative. Et s'ils prévoient parfois <strong>de</strong>s catastrophes,<br />
c'est à dire <strong>de</strong>s situations critiques qu'aucun choix ne peut dénouer, c'est pour susciter <strong>de</strong>s attitu<strong>de</strong>s<br />
préactives ou <strong>de</strong>s décisions propres à sauvegar<strong>de</strong>r les domaines <strong>de</strong> choix politiques ou <strong>la</strong> variété <strong>de</strong>s<br />
futurs possibles.<br />
Le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévision est <strong>de</strong> réduire l'incertitu<strong>de</strong> du futur, celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> est <strong>de</strong><br />
sauvegar<strong>de</strong>r les domaines <strong>de</strong> choix dans le futur. Ce principe méthodologique nous conduit à<br />
distinguer les modèles <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>, en mettant en évi<strong>de</strong>nce <strong>la</strong><br />
complémentarité <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux métho<strong>de</strong>s.<br />
Quatre modèles économétriques globaux et trois modèles partiels plus prospectifs concernent,<br />
à notre connaissance, <strong>la</strong> situation agro-alimentaire <strong>de</strong> l'Afrique:<br />
Les modèles globaux <strong>de</strong> prévision:<br />
- Le modèle WGM (World Graitis Mo<strong>de</strong>l) <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale permet <strong>de</strong>s projections à<br />
moyen terme du marché mondial <strong>de</strong>s grains pour 21 ensembles géographiques dont le Nigeria et<br />
l'Afrique Sub-Saharienne.<br />
- Le modèle WFM (WorId Food Mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO (Nikos Alexandratos) permet <strong>de</strong> prévoir les<br />
situations alimentaires (offre, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, prix) pour tous les pays et pour quarante produits.<br />
- Les modèles IFPSIM (International Food Policy Simu<strong>la</strong>tion Mo<strong>de</strong>l) et IMPACT (International<br />
Mo<strong>de</strong>l for Policy Analysis of Agricultural Commodities atid Tra<strong>de</strong>) <strong>de</strong> I'IFPRI permettent <strong>de</strong> prévoir <strong>la</strong><br />
situation alimentaire <strong>de</strong> 35 ensembles régionaux pour 17 produits. Le modèle IMPACT met l'accent<br />
sur les popu<strong>la</strong>tions à risque <strong>de</strong> malnutrition.<br />
Les modèles partiels à intention <strong>prospective</strong><br />
- Penning <strong>de</strong> Vries, Van Keuten et Rabbinge proposent un modèle distinguant 15 régions agroclimatiques<br />
(dont l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest, l'Afrique Centrale, l'Afrique <strong>de</strong> l'Est et l'Afrique Australe) qui tient<br />
compte <strong>de</strong>s conditions écologiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole, et notamment <strong>de</strong>s disponibilités en eau.<br />
- M. Monnier C (Terres nourricières, Nourrir les hommes <strong>de</strong>main sans dégra<strong>de</strong>r Ia p<strong>la</strong>nète<br />
1995) insiste sur les migrations que pourrait impliquer <strong>la</strong> croissance démographique et les techniques<br />
agraires.<br />
- M. Yu<strong>de</strong>lman (Demand and Simply of foodstuffs up to 2050 with spécial référence to irrigation<br />
pose le problèmes <strong>de</strong> l'irrigation dans le long terme.<br />
- L. Brown et H. Kane (The worldwatch environmental alert séries reassessing the earth's<br />
popu<strong>la</strong>tion carrying capacity se propose d'i<strong>de</strong>ntifier les problèmes qui résulteraient d'une charge<br />
démographique supérieure à <strong>la</strong> capacité d'accueil <strong>de</strong>s milieux naturels et pose le problème <strong>de</strong><br />
l'insécurité alimentaire.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 238
LES METHODES<br />
Les modèles <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque mondiale, <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO et <strong>de</strong> I'IFPRI peuvent être regardés comme<br />
<strong>de</strong>s variantes d'un schéma d'équilibre <strong>de</strong> marché agro-alimentaire. Pour chaque pays ou groupe <strong>de</strong><br />
pays, ils présentent l'offre et <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'un produit agricole ou d'une collection <strong>de</strong> produits, puis les<br />
importations ou les exportations qui résultent <strong>de</strong> leur inégalité. Les offres d'exportation et les<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'importation sont ensuite confrontées au niveau mondial pour calculer <strong>de</strong>s prix mondiaux,<br />
qui sont enfin transmis à chacun <strong>de</strong>s marchés locaux.<br />
Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s par habitant <strong>de</strong> chaque produit émanent sans doute <strong>de</strong> "consommateurs<br />
rationnels" puisqu'elle est fonction du revenu', du prix du produit et <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s autres produits en<br />
compétition comme dans les fonctions <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> rationnelles. Autrement dit, <strong>la</strong> loi d'Engel permet<br />
<strong>de</strong> déterminer <strong>la</strong> part du revenu réel consacrée à <strong>la</strong> consommation alimentaire, et les prix re<strong>la</strong>tifs<br />
expliquent <strong>la</strong> part du produit dans <strong>la</strong> consommation alimentaire.<br />
1. Définis par leur tendance dans le modèle <strong>de</strong> I'IFPRI : Rt = Rt-1.(I+g), ou g = taux <strong>de</strong><br />
croissance.<br />
<strong>Un</strong> facteur supplémentaire peut être intégré pour représenter l'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique<br />
gouvernementale (WGM). Dans le modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO et dans celui <strong>de</strong> I'IFPRI, <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong><br />
produits végétaux et animaux conduit à distinguer une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> consacrée à <strong>la</strong> consommation<br />
humaine et une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> consacrée à <strong>la</strong> consommation animale. Le modèle <strong>de</strong> I'IFPRI distingue en<br />
outre une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> industrielle, et rendra compte <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions intersectorielles.<br />
Le producteur représentatif implicite <strong>de</strong>s modèles maximise son revenu en réallouant les<br />
parcelles <strong>de</strong> son exploitation aux différentes cultures, suivant les fluctuations <strong>de</strong>s prix. L'offre est<br />
fonction <strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie arable totale ; elle s'i<strong>de</strong>ntifie à <strong>la</strong> production, <strong>la</strong>quelle est<br />
représentée comme le produit <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface par le ren<strong>de</strong>ment (produits végétaux) ou du cheptel par le<br />
taux d'abattage et le ren<strong>de</strong>ment/carcasse (vian<strong>de</strong>s). Les surfaces sont fonction <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s produits<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface totale. Les ren<strong>de</strong>ments dépen<strong>de</strong>nt du prix du produit et <strong>de</strong>s intrants (l'agriculteur<br />
représentatif égalisant sans doute les productivités marginales et les coûts <strong>de</strong>s facteurs), ainsi que<br />
d'un facteur <strong>de</strong> tendance où le modèle WGM fait intervenir <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s semences améliorées.<br />
Dans les modèles <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO et <strong>de</strong> I'IFPRI qui traitent aussi <strong>de</strong>s productions animales, l'effectif du<br />
cheptel dépend logiquement du prix <strong>de</strong>s bêtes ou du <strong>la</strong>it, <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s intrants (aliments du bétail), et<br />
d'un facteur <strong>de</strong> tendance qui intègre le taux d'abattage dans les modèles <strong>de</strong> l'IFPRI (probablement<br />
parce que celui-ci est lié à l'âge <strong>de</strong>s animaux - GP). L'IFPRI lie les taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s productions<br />
agricoles et non agricoles par le moyen <strong>de</strong> multiplicateurs, puisque ses modèles distinguent une<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s secteurs non agricoles.<br />
Les prix mondiaux (ou les prix d'exportation aux USA dans le modèle WGM) sont transmis aux<br />
marchés locaux via les taux <strong>de</strong> change, éventuellement l'indice local <strong>de</strong>s prix à <strong>la</strong> consommation<br />
(WGM), les coûts <strong>de</strong> transport et d'intermédiation, et <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> taxes ou subventions (IFPRI).<br />
L'écart entre les offres et les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s locales est décomposé en variations <strong>de</strong> stocks et<br />
échanges extérieurs. Curieusement, les taux d'intérêt ne sont pris en compte dans aucun <strong>de</strong>s<br />
modèles pour déterminer le stockage. Le stock est lié au prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte (WGM/ BM) ou<br />
déterminé par le stock antérieur, l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation (ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> production) et l'évolution<br />
<strong>de</strong>s prix à l'importation (ou à l'exportation) selon que le pays est importateur net ou exportateur net du<br />
produit (WFM/FAO). Les importations sont affectées par un facteur d'influence politique combiné à<br />
l'état <strong>de</strong>s paiements extérieurs dans le modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale ou modérées par un facteur<br />
d'échelle pour les pays à faibles ressources dans le modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO.<br />
Les offres d'exportation et les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'importation sont agrégées au niveau mondial où doit<br />
se réaliser l'équilibre. Le modèle <strong>de</strong> I'IFPRI minimise <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s échanges nets pour obtenir les<br />
prix internationaux. Avec le modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO, le "clearing" se fait par étapes : Si l'offre et <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
mondiale d'un produit diffèrent, les prix mondiaux changent. Ces prix sont transmis aux marchés<br />
locaux où ils déterminent une variation <strong>de</strong>s offres et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s locales. Les autres marchés étant<br />
affectés par le jeu <strong>de</strong>s é<strong>la</strong>sticités croisées, on procè<strong>de</strong> pareillement pour les autres produits ; le<br />
système <strong>de</strong> prix converge vers l'équilibre.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 239
Les modèles économétriques <strong>de</strong> prévision peuvent toujours être équilibrés, y compris pour <strong>de</strong>s<br />
consommations par tête en <strong>de</strong>çà du minimum vital ou pour <strong>de</strong>s choix culturaux dévastateurs <strong>de</strong><br />
l'environnement, car ils n'intègrent aucune norme physiologique, sociale ou écologique.<br />
Il n'y a pas <strong>de</strong> stocks dans le modèle <strong>de</strong> I'IFPRI.<br />
2. Les travaux suivants intègrent <strong>de</strong> telles normes. Pour fixer <strong>de</strong>s limites aux variations <strong>de</strong>s<br />
gran<strong>de</strong>urs projetées, sans paraître moins scientifique et sans <strong>de</strong>voir entrer dans l'analyse <strong>de</strong><br />
dynamiques locales spécifiques, il faut intégrer les calculs d'autres disciplines telles que <strong>la</strong> physiologie<br />
ou l'écologie dans les prévisions.<br />
Penning <strong>de</strong> Vries, Van Keuten et Rabbinge construisent un modèle écologique <strong>de</strong> l'équilibre<br />
agro-alimentaire. Leurs 15 régions divisées en 15500 unités <strong>de</strong> territoire d'une centaine <strong>de</strong> kilomètres<br />
<strong>de</strong> coté peuvent aussi être regroupées en 700 zones climatiques ou 100 grands bassins versants. La<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> alimentaire (exprimée en éléments nutritionnels) dépend <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion<br />
<strong>de</strong> trois régimes alimentaires distingués selon le niveau calorique et l'importance re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong>s<br />
protéines animales : végétarien, modéré, abondant. Les projections, pour chacun <strong>de</strong>s régimes<br />
alimentaires supposés généralisés, sont faites sur l'horizon <strong>de</strong> l'an 2040. L'offre alimentaire est<br />
composée <strong>de</strong> trois produits <strong>de</strong> synthèse : blé (céréale tempérée), riz (céréale tropicale), pâturages. La<br />
production est calculée en estimant le ren<strong>de</strong>ment biologique <strong>de</strong> base (200 Kg <strong>de</strong> matière sèche par<br />
hectare), puis en <strong>la</strong> multipliant par <strong>de</strong>s coefficients <strong>de</strong> récolte, puis en diminuant <strong>la</strong> production<br />
biologique à l'ai<strong>de</strong> d'un coefficient <strong>de</strong> pertes post-culturales. L'irrigation utilise 50% <strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong>s<br />
rivières en l'an 2040, dont <strong>la</strong> moitié fait retour aux rivières. Il existe <strong>de</strong>ux systèmes <strong>de</strong> production (à<br />
forte et à faible utilisation d'inputs externes à l'agriculture) qui sous-ten<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>ux scénarii.<br />
M. Monnier utilise aussi <strong>de</strong>s coefficients <strong>de</strong> conversion écologiques ou biologiques pour calculer<br />
les besoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et les productions biologiques. A l'horizon <strong>de</strong> l'an 2100, <strong>la</strong> structure par<br />
âges <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion change et réduit les besoins caloriques, le gaspil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s pays industriels a<br />
diminué, le coefficient <strong>de</strong> transformation végétal/animal s'est légèrement élevé, et finalement, si <strong>la</strong><br />
ration alimentaire s'élève <strong>de</strong> 9% en cent ans, les besoins mondiaux triplent en une centaine d'années<br />
pour atteindre 30.1015 calories végétales. Le calcul <strong>de</strong>s productions tient compte <strong>de</strong> l'épuisement <strong>de</strong>s<br />
sols, <strong>de</strong> l'urbanisation, <strong>de</strong> l'extension <strong>de</strong> l'irrigation rendue difficile par <strong>la</strong> concurrence <strong>de</strong>s usages non<br />
agricoles prioritaires. Les ren<strong>de</strong>ments pourraient être multipliés par 2,2, or, il <strong>de</strong>vraient tripler pour<br />
satisfaire les besoins estimés.<br />
Yu<strong>de</strong>lman considère les rations caloriques actuelles (1990), se donne un objectif <strong>de</strong> résorption<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> malnutrition en l'an 2025, et calcule que <strong>la</strong> production agricole <strong>de</strong>vrait croître <strong>de</strong> 4,4% par an. En<br />
Afrique Sub-Saharienne, il faudrait une croissance <strong>de</strong> 6,5% par an. La consommation est aussi<br />
affectée par l'é<strong>la</strong>sticité-revenu <strong>de</strong>s dépenses alimentaires, <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>vrait baisser <strong>de</strong> 3, 1 % en 1990<br />
à 1,6% en 2025. La croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> production dépend <strong>de</strong> l'offre d'eau, <strong>de</strong> terres, et <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments.<br />
Les catégories retenues pour les calculs permettent <strong>de</strong> poser <strong>de</strong>s problèmes écologiques :<br />
compétition entre les usages <strong>de</strong> l'eau, risques <strong>de</strong> salinisation <strong>de</strong>s sols et <strong>de</strong> pollution par les engrais<br />
chimiques.<br />
RESULTATS<br />
Les modèles économétriques <strong>de</strong> projection <strong>de</strong> l'équilibre agro-alimentaire ne décrivent pas les<br />
évolutions <strong>de</strong>s agricultures du mon<strong>de</strong> ; ils l'interprètent en intégrant l'utopie libérale, et cette image<br />
convenue paraît propre à discuter <strong>de</strong>s effets d'un type choisi <strong>de</strong> politiques agraires. Ces<br />
caractéristiques reflètent l'évolution <strong>de</strong>s politiques et <strong>de</strong>s idées sur l'agriculture au cours <strong>de</strong>s vingt<br />
<strong>de</strong>rnières années, évolution qui semble liée à <strong>la</strong> crise <strong>de</strong>s finances publiques dans <strong>de</strong> nombreux pays.<br />
En vingt ans, souvent en faisant écho aux programmes d'ajustement structurel imposés par les<br />
institutions <strong>de</strong> Bretton-Woods, les économistes sont passés d'une conception dirigiste du<br />
développement agraire et <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions intersectorielles à une conception libérale. L'offre agricole,<br />
dont on supposait autrefois qu'elle était rigi<strong>de</strong> pour justifier les taxations, est aujourd'hui supposée<br />
é<strong>la</strong>stique, les marchés que les africanistes supposaient imparfaits et atrophiés sont <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>s<br />
marchés <strong>de</strong> concurrence pure et parfaite ; les prix que les économistes supposaient biaisés par <strong>de</strong>s<br />
transferts <strong>de</strong> valeur liés aux disparités structurelles sont <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>s prix d'équilibre. L'éradication<br />
<strong>de</strong>s visions volontaristes <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions intersectorielles qui, pour subvertir <strong>la</strong> logique <strong>de</strong> l'économie <strong>de</strong><br />
traite ou forcer <strong>la</strong> croissance industrielle, présentaient l'agriculture comme le support <strong>de</strong><br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 240
l'industrialisation, rep<strong>la</strong>ce le secteur agricole à <strong>la</strong> source <strong>de</strong>s exportations primaires. Les nouvelles<br />
politiques <strong>de</strong>vraient donc s'efforcer <strong>de</strong> libérer les initiatives individuelles et <strong>de</strong> restituer aux<br />
entrepreneurs agricoles les surplus <strong>de</strong> leur activité, en réduisant les taxes et en dépréciant les taux <strong>de</strong><br />
change notamment, afin <strong>de</strong> favoriser l'exportation et l'investissement agraire privé. Quelques<br />
inquiétu<strong>de</strong>s subsistent malgré tout quant à <strong>la</strong> réactivité <strong>de</strong> l'offre aux prix, qui poussent les<br />
responsables et certains experts africanistes à rechercher d'autres incitations mais les modèles<br />
économétriques mondiaux n'y font guère écho.<br />
Les résultats <strong>de</strong>s projections valent ce que valent ce renversement <strong>de</strong>s perspectives et les<br />
hypothèses ; le fait que les résultats <strong>de</strong>s scénarii tendanciels soient voisins ne signifie pas qu'ils sont<br />
fiables, mais plutôt que <strong>la</strong> logique <strong>de</strong> construction <strong>de</strong>s modèles et les hypothèses <strong>de</strong> travail sont<br />
semb<strong>la</strong>bles. Nous évoquerons les niveaux <strong>de</strong> l'équilibre alimentaire et les échanges internationaux<br />
<strong>de</strong>s principaux produits, à l'échelle mondiale et a celle <strong>de</strong> l'Afrique Sub-Saharienne, puis les<br />
arguments re<strong>la</strong>tifs aux principales variables.<br />
A l'échelle mondiale, les disponibilités alimentaires par habitant <strong>de</strong>vraient s'accroître d'environ<br />
2500 calories/jour en 1990 à 2700 calories/jour en 2010. Mais cette moyenne cache <strong>de</strong> fortes<br />
disparités. En ASS, <strong>la</strong> ration alimentaire moyenne <strong>de</strong>vrait continuer à diminuer. La sous alimentation<br />
chronique, qui touchait déjà 175 millions d'habitants ou 37% <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en 1990, <strong>de</strong>vrait encore<br />
affecter le tiers <strong>de</strong>s Africains en 2010.<br />
Disponibilités alimentaires en Afrique Sub-Saharienne<br />
(Kg/hab.)<br />
1969 1988 2010<br />
Céréales 115,3 114,3 121<br />
Céréales (tous usages) (140) (133) (140)<br />
Racines, tubercules 209,2 208 197<br />
Légumes secs 11,9 9,6 10<br />
Sucre 7,5 8,2 10<br />
Huiles végétales 7,5 7,8 8<br />
Vian<strong>de</strong>s 10,5 9,5 10<br />
Lait 28,1 27,6 26<br />
Calories/jour 2140 2100 2170<br />
Source : Agriculture mondiale, horizon 2010. FAO 1994.<br />
Les pays en développement <strong>de</strong>vraient <strong>de</strong>venir importateurs nets <strong>de</strong> 160 à 210 millions <strong>de</strong><br />
tonnes <strong>de</strong> céréales en l'an 2010, dont 14 à 32 millions <strong>de</strong> tonnes seraient dirigés vers l'Afrique Sub-<br />
Saharienne. Selon <strong>la</strong> FAO, entre 1990 et 2010 en ASS, <strong>la</strong> production agricole brute <strong>de</strong>vrait diminuer<br />
<strong>de</strong> 0,2% par an alors que <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> intérieure augmentera <strong>de</strong> 3,3% par an. Les agricultures<br />
extensives <strong>de</strong>s USA, du Canada, <strong>de</strong> l'Australie et <strong>de</strong> l'Argentine <strong>de</strong>vraient être les principaux<br />
exportateurs mondiaux, l'<strong>Un</strong>ion Européenne cherchant plutôt à réduire le coût <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s aux<br />
producteurs.<br />
3. En soi, ce résultat n'est pas étonnant ; il est plus étonnant, par contre, que <strong>de</strong>s organismes<br />
internationaux généralement enclins à justifier <strong>de</strong>s politiques libérales <strong>la</strong>issent leurs modèles produire<br />
<strong>de</strong>s projections <strong>de</strong> cette nature sans intervenir lour<strong>de</strong>ment sur les hypothèses <strong>de</strong> travail. L'afropessimisme<br />
global ambiant libère sans doute les économistes <strong>de</strong>s doutes méthodologiques ou<br />
politiques.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 241
Prévision <strong>de</strong>s importations en ASS<br />
(1000 tonnes)<br />
1980 2010<br />
Produit Deman<strong>de</strong> Imports Produit Deman<strong>de</strong> Imports<br />
Céréales 51,5 62,2 10,7 86 118,5 -32,4<br />
Soja 0,25 0,25 0 0,29 0,47 -0,18<br />
Ruminants 2,76 2,87 -0,11 4,25 5,23 -1,28<br />
Non ruminants 1,18 1,37 -0,19 2,15 2,82 -0,66<br />
Œufs 0,67 0,7 -0,03 1,27 1,38 -0,11<br />
Source : IFPRI (Modèle IFPTSIM)<br />
Le coût global <strong>de</strong>s importations alimentaires <strong>de</strong>s pays en développement <strong>de</strong>vrait augmenter<br />
sensiblement, tant en raison <strong>de</strong> l'augmentation <strong>de</strong>s volumes que du fait d'une augmentation <strong>de</strong>s prix<br />
réels.<br />
La nécessité <strong>de</strong> réduire les coûts budgétaires <strong>de</strong>s politiques agraires <strong>de</strong>vrait conduire les pays<br />
en développement à réduire les ai<strong>de</strong>s à l'exportation et à ouvrir leurs marchés aux importations. Les<br />
possibilités d'accroissement <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments étant limitées par le fléchissement <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong><br />
recherche et les coûts <strong>de</strong>s infrastructures <strong>de</strong> colonisation agricole, notamment d'irrigation, le tiers <strong>de</strong><br />
l'accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> production mondiale résultera <strong>de</strong> l'extension <strong>de</strong>s superficies et les <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong><br />
l'accroissement <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments , <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l'accroissement <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments sera probablement plus<br />
faible en ASS.<br />
Le potentiel d'extension <strong>de</strong>s surfaces donne lieu à <strong>de</strong>s estimations fort différentes selon les<br />
sources , par exemple, les superficies cultivées en ASS s'élevant à 186 millions d'hectares en 1974, <strong>la</strong><br />
FAO estime qu'il était encore possible <strong>de</strong> les étendre sur 570 millions d'hectares et le Club <strong>de</strong> Rome<br />
sur 429 millions d'hectares. Les surfaces cultivées <strong>de</strong>vraient continuer à croître, mais leur taux <strong>de</strong><br />
croissance <strong>de</strong>vrait baisser en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> hausse <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments.<br />
Concernant les ren<strong>de</strong>ments, un raisonnement par projection est inapproprié car leur<br />
accroissement résulte toujours <strong>de</strong> nombreux facteurs tels que <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong>s cultures irriguées, <strong>la</strong><br />
recherche agronomique, <strong>la</strong> vulgarisation agricole, les crédits, <strong>la</strong> disponibilité et le prix <strong>de</strong>s intrants et<br />
<strong>de</strong>s équipements, les opinions <strong>de</strong>s agriculteurs sur l'efficacité <strong>de</strong>s techniques ; c'est pourquoi <strong>la</strong><br />
prévision <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments donne lieu à <strong>de</strong>s discussions d'experts, notamment à <strong>la</strong> FAO. Entre 1990 et<br />
2010, <strong>la</strong> consommation totale d'engrais <strong>de</strong>vrait s'élever <strong>de</strong> 36,8 à 79,8 millions <strong>de</strong> tonnes dans<br />
l'ensemble <strong>de</strong>s pays en développement et seulement <strong>de</strong> 1,2 à 3,3 millions <strong>de</strong> tonnes en Afrique Sub-<br />
Saharienne , quant à l'apport d'engrais par hectare récolté, il s'élèverait <strong>de</strong> 62 à 110 Kg dans<br />
l'ensemble <strong>de</strong>s PVD et <strong>de</strong> 11 à 21 Kg en ASS. Les ren<strong>de</strong>ments rizicoles ne <strong>de</strong>vraient guère<br />
augmenter ; pour les autres cultures, l'essentiel <strong>de</strong> l'augmentation serait liée à l'extension <strong>de</strong>s cultures<br />
irriguées.<br />
La part <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active engagée dans l'agriculture tient lieu d'indicateur <strong>de</strong> productivité.<br />
Elle <strong>de</strong>vrait baisser légèrement en ASS, <strong>de</strong> 59,8% en 1990 à 46,9% en 2010. Ces résultats moyens<br />
masquent d'importantes disparités ; par exemple, entre 1990 et 2010, <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s agriculteurs dans <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion active <strong>de</strong>vrait être maintenue aux environs <strong>de</strong> 90% au Burundi, ou baisser <strong>de</strong> 22,8% à<br />
14,3% à Maurice.<br />
Part <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active engagée dans l'agriculture<br />
(popu<strong>la</strong>tion agricole / popu<strong>la</strong>tion active totale)<br />
1990 2010<br />
Mon<strong>de</strong> 37,8<br />
Pays en développement 59,6 46,7<br />
Afrique Sub-Saharienne 59,8 46,9<br />
Burundi 91,3 87,2<br />
Maurice 22,8 14,3<br />
France 5,2 1,9<br />
Source : Agriculture mondiale, horizon 2010, FAO.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 242
APPRECIATIONS ET COMMENTAIRES<br />
Les modèles mondiaux <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong>s équilibres agro-alimentaires manquent <strong>de</strong> précision<br />
lorsqu'ils décrivent l'avenir <strong>de</strong>s agricultures <strong>africaine</strong>s. Le niveau d'agrégation n'est pas en cause<br />
puisque certains fournissent <strong>de</strong>s prévisions par pays et pour une variété considérable <strong>de</strong> produits<br />
végétaux et animaux ; mais ce luxe <strong>de</strong> détails, si utiles aux opérateurs <strong>de</strong>s marchés internationaux,<br />
rend compte <strong>de</strong>s performances <strong>de</strong>s grands producteurs mondiaux bien plus que <strong>de</strong>s enjeux et <strong>de</strong>s<br />
dynamiques spécifiques <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>stes agricultures <strong>africaine</strong>s. Notamment, ces modèles ignorent que<br />
les paysans africains <strong>de</strong>meurent sousintégrés dans les marchés locaux et mondiaux, et ne permettent<br />
pas <strong>de</strong> prévoir les voies et les conséquences <strong>de</strong> cette intégration ; <strong>de</strong> plus, ils ignorent les impacts<br />
environnementaux <strong>de</strong> l'agriculture à jachères longues et ne permettent donc pas <strong>de</strong> prévoir les<br />
dangers <strong>de</strong> ce types <strong>de</strong> croissance agraire. Tenir compte <strong>de</strong> ces spécificités <strong>africaine</strong>s conduit à<br />
changer <strong>de</strong> méthodologie, à passer d'un exercice <strong>de</strong> prévision à un essai <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>.<br />
Nous nous proposons d'esquisser ce changement <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>.<br />
Renonçons à cette idée qui distingue les perspectives, les prévisions et <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> suivant<br />
<strong>la</strong> fiabilité et l'horizon <strong>de</strong>s résultats :<br />
- Les perspectives projetteraient <strong>de</strong>s variables isolées sur un horizon du court terme;<br />
- Les prévisions lieraient ces variables dans un système cohérent d'équations et les<br />
projetteraient sur un horizon du moyen terme en supposant <strong>la</strong> permanence du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
fonctionnement <strong>de</strong> l'économie;<br />
- La <strong>prospective</strong> explorerait les conséquences du changement structurel sur le<br />
comportement <strong>de</strong>s variables dans le long terme.<br />
Sans être tout à fait erronée, cette distinction néglige <strong>la</strong> différence méthodologique principale<br />
qui tient en ce que <strong>la</strong> fiabilité <strong>de</strong>s résultats, qui est l'objectif premier du prévisionniste, n'est qu'un<br />
objectif accessoire du prospectiviste.<br />
Les résultats <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévision sont <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>urs (variables) que l'utilisateur soucieux <strong>de</strong><br />
conjurer l'incertitu<strong>de</strong> du futur espère fiables. La <strong>prospective</strong> n'a pas pour fonction <strong>de</strong> réduire<br />
l'incertitu<strong>de</strong> ; même, il ne serait pas absur<strong>de</strong> <strong>de</strong> prétendre qu'elle est <strong>de</strong>stinée à révéler l'incertitu<strong>de</strong> en<br />
décrivant l'évolution <strong>de</strong>s domaines <strong>de</strong> choix <strong>de</strong>s acteurs pour leur permettre <strong>de</strong> les é<strong>la</strong>rgir. Ces<br />
domaines <strong>de</strong> choix conditionnent le sens <strong>de</strong>s variables économiques, ou désignent les variables<br />
pertinentes dans un contexte futur p<strong>la</strong>usible. Pour le prospectiviste, <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> ces variables<br />
importe moins que leur signification ou <strong>la</strong> manière dont les acteurs futurs les mettront en re<strong>la</strong>tion.<br />
L'objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévision et celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> paraissent donc différents.<br />
Cependant, <strong>prospective</strong> et prévision restent liées ; à chaque domaine <strong>de</strong> choix décrit par une<br />
<strong>prospective</strong> peut correspondre un exercice <strong>de</strong> prévision. Encore faut-il que le domaine <strong>de</strong> choix <strong>de</strong><br />
référence pour <strong>la</strong> prévision ne soit pas défini à priori par quelque utopie, que le prévisionniste se<br />
gar<strong>de</strong> <strong>de</strong> toute espèce <strong>de</strong> schizophrénie.<br />
L'utopie libérale, qui s'inscrit dans les modèles <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale, <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO<br />
ou <strong>de</strong> I'IFPRI, définit un domaine <strong>de</strong> choix particulier : celui <strong>de</strong> l'entrepreneur abstrait dit rationnel<br />
(maximisateur <strong>de</strong> profit) gérant <strong>de</strong>s ressources idéalement divisibles et substituables. Nous ne <strong>de</strong>vons<br />
évi<strong>de</strong>mment pas exclure que le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>vienne un jour conforme à l'utopie libérale, et nous pourrions<br />
même diriger notre <strong>prospective</strong> suivant cette inspiration ; mais tant que le cheminement <strong>de</strong>s domaines<br />
<strong>de</strong> choix réels <strong>de</strong>s paysans, <strong>de</strong>s notables et <strong>de</strong>s responsables gouvernementaux africains vers celui<br />
<strong>de</strong> l'utopie libérale ne sera pas reconnu et probabilisé, tout exercice <strong>de</strong> prévision restera sans<br />
fon<strong>de</strong>ment prospectif. <strong>Un</strong>e prévision n'est fondée par une <strong>prospective</strong> que si son modèle rend compte<br />
<strong>de</strong>s domaines <strong>de</strong> choix <strong>de</strong>s acteurs et <strong>de</strong> leur évolution. Il est possible que ces domaines <strong>de</strong> choix<br />
réels et certaines <strong>de</strong> leurs évolutions conditionnent une croissance agricole plus rapi<strong>de</strong> ou plus lente<br />
que ne le suppose l'utopie libérale.<br />
L'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s domaines <strong>de</strong> choix actuels nécessite que soient pris en compte, au moins,<br />
l'autoconsommation paysanne, les solidarités vil<strong>la</strong>geoises qui conditionnent <strong>la</strong> sécurité alimentaire et<br />
le développement <strong>de</strong>s cultures <strong>de</strong> rente, <strong>la</strong> logique <strong>de</strong>s systèmes agraires combinant <strong>de</strong>s cultures<br />
extensives et intensives, l'instabilité <strong>de</strong>s marchés, les cadres institutionnels d'incitation et les utopies<br />
gouvernementales.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 243
3.4.2.<br />
LA DEMOGRAPHIE
NOTE INTRODUCTIVE<br />
Principales sources <strong>de</strong> statistiques démographiques, les Nations <strong>Un</strong>ies produisent <strong>de</strong>s projections<br />
démographiques, qui sont simultanément:<br />
- utilisées comme base <strong>de</strong> nombreux travaux prospectifs, par les instituts <strong>de</strong> recherche en<br />
démographie,<br />
- critiquées et amendées par ces mêmes centres <strong>de</strong> recherche.<br />
La construction <strong>de</strong>s projections démographiques <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies repose sur <strong>de</strong>s hypothèses fortes,<br />
qui méritent discussion. Toutefois, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s réalisées par divers instituts démographiques (tels que<br />
le Popu<strong>la</strong>tion Reference Bureau, Institut National d'Étu<strong>de</strong>s Démographiques, et le Centre d'Étu<strong>de</strong>s sur<br />
<strong>la</strong> Popu<strong>la</strong>tion et le Développement) affinent les hypothèses sur les évolutions <strong>de</strong>s principaux<br />
déterminants <strong>de</strong> l'évolution démographique (fécondité et mortalité notamment). Ces travaux<br />
permettent <strong>de</strong> discuter et d'apprécier les hypothèses <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies.<br />
Les recherches menées dans le cadre du projet WALTPS (West African Long Term Perspectives)<br />
s'inscrivent dans une optique différente <strong>de</strong>s travaux précé<strong>de</strong>nts ; l'étu<strong>de</strong> se veut démo-économique,<br />
c'est-à-dire qu'elle met l'accent sur les re<strong>la</strong>tions existants entre popu<strong>la</strong>tion et économie.<br />
Nous choisissons donc <strong>de</strong> présenter les travaux prospectifs sur <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>africaine</strong>, en trois<br />
temps :<br />
1. Les projections démographiques <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies ou le chiffrage <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à l'horizon<br />
2020.<br />
2. Les <strong>prospective</strong>s sur les facteurs proches <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance démographique ou l'affinement <strong>de</strong>s<br />
tendances : ces travaux, plus qualitatifs, reprennent parmi leurs sources statistiques les<br />
projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies (Étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l'INED, du CEPED et du Popu<strong>la</strong>tion Reference Bureau).<br />
3. <strong>Un</strong>e approche démo-économique ou le lien entre popu<strong>la</strong>tion et économie : nous traiterons dans ce<br />
volet exclusivement <strong>de</strong> l'analyse démographique <strong>de</strong> WALTPS, une vision plus exhaustive <strong>de</strong><br />
l'étu<strong>de</strong> étant produite à part.<br />
LES PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES<br />
Division <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies<br />
SITUATION - OBJECTIFS<br />
La division <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies fournit les chiffres les plus utilisés par les démographes<br />
concernant l'Afrique dans son ensemble. Elle calcule ses estimations à différents horizons : 2020,<br />
2050, 2100 en particulier. Bien sûr plus l'horizon est lointain, plus les hypothèses paraissent fortes et<br />
les risques d'erreurs importants. Les projections à 30 ans, révisées, sont publiées tous les 2 ans dans<br />
« World Popu<strong>la</strong>tion prospects »(<strong>de</strong>rnières révisions : 1994, 1996 ; révision 1998 à paraître).<br />
MÉTHODOLOGIE<br />
Les projections démographiques réalisées à l'horizon 2025 par les Nations <strong>Un</strong>ies sont conditionnelles<br />
à plusieurs hypothèses :<br />
1) Toutes les popu<strong>la</strong>tions traverseront successivement les différentes phases <strong>de</strong> <strong>la</strong> transition<br />
démographique (Léon Tabah, 1983 ; Nations <strong>Un</strong>ies, World Popu<strong>la</strong>tion prospects, 1994).<br />
L'Afrique sub-Saharienne doit connaître, après <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité, un fléchissement <strong>de</strong> sa<br />
fécondité ; conséquemment, <strong>la</strong> croissance démographique s'accélère puis ralentit.<br />
2) Les indices synthétiques <strong>de</strong> fécondité convergent à moyen ou long terme vers 2.1 enfants par<br />
femme, taux permettant, « selon les normes occi<strong>de</strong>ntales », le remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
Fortes <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux hypothèses fondamentales, les Nations <strong>Un</strong>ies produisent leur projection selon le<br />
schéma (mécanique) suivant:<br />
1) Pour chiffrer l'hypothèse <strong>de</strong> fécondité à l'horizon 2020, <strong>la</strong> division <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion détermine <strong>la</strong><br />
date à <strong>la</strong>quelle le pays atteindra le « taux <strong>de</strong> fécondité <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cement » <strong>de</strong> 2.1 (tableau 1).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 246
Tableau 1 : Fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> transition démographique<br />
Pério<strong>de</strong> prévue <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fin<strong>de</strong> <strong>la</strong> transition<br />
démographique<br />
Pays concernés<br />
1995-2000 Réunion<br />
2000-2015 Tunisie<br />
2015-2020 Algérie, Égypte, Maroc<br />
2020-2030 Zimbabwe, Botswana, Cap Vert<br />
2030-2035 Kenya<br />
2035-2040<br />
Burundi, Comores, Rwanda, Ouganda, Cameroun, Libye, Lesotho,<br />
Namibie, Swazi<strong>la</strong>nd, Gambie, Ghana, Nigeria, Sénégal, Togo<br />
2040-2045 Autres pays d'Afrique Sub-Saharienne<br />
Source : Nations <strong>Un</strong>ies, 1992.<br />
Tableau 2 : Estimations <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion d'Afrique Sub-Saharienne<br />
en milliers<br />
1950 1960 1970 1980 1990 1995<br />
Afrique Sub-Saharienne 179861 226270 292551 384206 500182 588125<br />
Source : Nations <strong>Un</strong>ies, 1992.<br />
2) A partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses points - on connaît <strong>la</strong> situation actuelle (tableau 2) et <strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle<br />
l'indice Synthétique <strong>de</strong> Fécondité atteindra 2.1 -, <strong>la</strong> courbe du taux <strong>de</strong> fécondité est tracée, et<br />
fournit une estimation du taux à l'horizon 2020. Compte tenu <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux hypothèses sur <strong>la</strong><br />
fécondité et <strong>la</strong> mortalité, il suffit alors <strong>de</strong> faire évoluer <strong>la</strong> pyrami<strong>de</strong> <strong>de</strong>s âges selon un schéma<br />
mécanique (on fait « naître et mourir »).<br />
3) A moyen terme, pour chaque pays, les Nations <strong>Un</strong>ies émettent trois hypothèses sur le taux <strong>de</strong><br />
fécondité et une seule sur le taux <strong>de</strong> mortalité. Il en découle trois projections (tableau 3) :<br />
- une haute (fécondité élevée ou convergence tardive),<br />
- une moyenne (« scenario sans surprise », jugé le plus p<strong>la</strong>usible en l'état <strong>de</strong>s<br />
connaissances sur <strong>la</strong> démographie),<br />
- une basse (fécondité faible ou convergence précoce).<br />
<strong>Un</strong> quatrième calcul à fécondité constante, présente davantage un intérêt illustratif que scientifique.<br />
Concernant l'Afrique, il permet, selon l'expression <strong>de</strong> J. Vallin, <strong>de</strong> saisir « l'ampleur <strong>de</strong>s changements<br />
en cours », ou à encourager...<br />
Les projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies ne prennent pas en compte les guerres, famines , ni, normalement,<br />
les nouvelles épidémies. Dès 1992 toutefois, elles intégraient l'impact du Sida pour les 15 pays les<br />
plus touchés (Zambie, Ouganda, Ma<strong>la</strong>wi, Rwanda; Bénin, Burundi, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire,<br />
Kenya, Mozambique, Tanzanie, Congo/ex Zaire, Zimbabwe). Dans <strong>la</strong> révision <strong>de</strong> 1998 <strong>de</strong> « World<br />
Popu<strong>la</strong>tion Prospects », les Nations <strong>Un</strong>ies ont produit une étu<strong>de</strong> spécifique <strong>de</strong> l'impact du Sida sur<br />
l'évolution attendue <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
RÉSULTATS<br />
Les tableaux suivants résument les principaux résultats <strong>de</strong>s projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies (« World<br />
popu<strong>la</strong>tion prospects : the 1996 revision », Nations <strong>Un</strong>ies).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 247
Tableau 3 : Projections <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion d'Afrique sub-Saharienne,<br />
en milliers<br />
Hypothèse 1995 2000 2010 2020 2050<br />
Moyenne 588125 674696 879018 1119306 1789081<br />
Haute 588125 678883 899682 1170181 2096045<br />
Basse 588125 670982 862434 1075748 1523309<br />
Fécondité constante 588125 681480 936229 1314963 4011724<br />
Source : World Popu<strong>la</strong>tion Prospects : the 1996 revision, Nations <strong>Un</strong>ies.<br />
Tableau 4: Projections <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion d'Afrique par région<br />
(hypothèse moyenne, en milliers)<br />
1995 2000 2010 2020 2050<br />
Afrique 719495 819910 1051896 1316839 2046401<br />
Afrique Sub-Saharienne 588125 674696 879018 1119306 1789081<br />
Afrique <strong>de</strong> l'Est 221315 255500 335365 430550 698596<br />
Afrique centrale 83271 95385 126691 166032 284821<br />
Afriqueaustrale 47335 52887 64984 77222 106824<br />
Afrique <strong>de</strong> l'Ouest 209498 241102 315129 401741 638892<br />
Source : World Popu<strong>la</strong>tion Prospects : the 1996 revision, Nations <strong>Un</strong>ies.<br />
Tableau 5: Taux d'urbanisation en Afrique sub-saharienne <strong>de</strong> 1950 à 2025<br />
Taux d'urbanisation<br />
en Afrique Sub-Saharienne<br />
1950 11 %<br />
1975 21 %<br />
1996 32 %<br />
2025 49 %<br />
La révision 1998 (à paraître) conduit à <strong>de</strong> nouvelles projections, prenant mieux en compte <strong>la</strong> baisse<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité et <strong>de</strong> l'impact du Sida. 29 pays d'Afrique sub-saharienne sont spécialement affectés<br />
par l'épidémie (prévalence du virus HIV <strong>de</strong> 2% ou plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion adulte). Les projections en<br />
terme <strong>de</strong> mortalité et d'espérance <strong>de</strong> vie en sont affectées :<br />
Tableau 6: Espérance <strong>de</strong> vie à <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong>s 29 pays africains les plus touchés<br />
avec ou sans Sida, <strong>de</strong> 1985-90 à 2010-2015 (années)<br />
Pério<strong>de</strong> Avec Sida Sans Sida<br />
1985-1990 49.2 50.2<br />
1990-1995 48.5 51.7<br />
1995-2000 47.5 54.1<br />
2000-2005 47.4 56.4<br />
2005-2010 49.4 58.4<br />
2010-2015 52.6 60.4<br />
Au Botswana, pays le plus gravement atteint par l'épidémie, un adulte sur quatre est affecté par le<br />
virus HIV, et l'espérance <strong>de</strong> vie à <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong>vrait s'élever à 41 ans en 2000-2005, soit 29 ans <strong>de</strong><br />
moins qu'en l'absence du Sida. En raison <strong>de</strong> l'impact du Sida sur <strong>la</strong> mortalité, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion projetée en<br />
2015 est <strong>de</strong> 20% moins importante, qu'en l'absence du Sida. Toutefois, compte tenu d'une fécondité<br />
élevée, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion du Botswana <strong>de</strong>vrait quand même doubler entre 1995 et 2050.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 248
REMARQUES, CRITIQUES ET ÉVALUATION<br />
Les hypothèses <strong>de</strong>s projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies suscitent quelques remarques, parmi lesquelles<br />
plusieurs critiques fondamentales.<br />
1) L'hypothèse <strong>de</strong> convergence <strong>de</strong>s modèles démographiques 7<br />
Elle paraît arbitraire et discutable. Le taux <strong>de</strong> fécondité <strong>de</strong> 2.1 enfants par femme correspond au taux<br />
<strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion dans les conditions démographiques (<strong>de</strong> mortalité infantile<br />
notamment) <strong>de</strong>s pays occi<strong>de</strong>ntaux. Si l'Afrique sub-Saharienne connaissait aujourd'hui un tel taux, <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> région baisserait (A. Vinokur). Le taux <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cement dépasse en fait <strong>de</strong> beaucoup<br />
le seuil <strong>de</strong> 2.1. L'hypothèse <strong>de</strong> convergence <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> fécondité dans les projections <strong>de</strong>s Nations<br />
<strong>Un</strong>ies ordonne simultanément une hypothèse <strong>de</strong> convergence <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> mortalité (ou <strong>de</strong><br />
l'espérance <strong>de</strong> vie à <strong>la</strong> naissance).<br />
2) Les déterminants <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité<br />
Les projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies sous-ten<strong>de</strong>nt plusieurs hypothèses <strong>de</strong> fécondité et une seule <strong>de</strong><br />
mortalité pour chaque pays. Or, <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité répond entre autre, selon les constats<br />
empiriques (Zimbabwe, Botswana, mais surtout Kenya), à <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité, et à <strong>la</strong> sco<strong>la</strong>risation<br />
<strong>de</strong>s filles.<br />
Le modèle démographique utilisé par les Nations <strong>Un</strong>ies ne permet pas d'endogénéïser ces<br />
déterminants fondamentaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité, ce qui pose problème dans une étu<strong>de</strong> globale <strong>de</strong><br />
<strong>prospective</strong>.<br />
3) Les migrations<br />
Enfin, les projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies n'intègrent pas ou peu les migrations internationales. Les<br />
sol<strong>de</strong>s migratoires entre pays sont le plus souvent supposés nuls, ce qui a donné lieu à <strong>de</strong>s erreurs<br />
notoires dans le passé (en particulier, l'entrée massive <strong>de</strong> Burkinabés en Côte d'Ivoire fût ignorée <strong>de</strong>s<br />
projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies). Les migrations internes sont elles aussi très mal chiffrées, tant<br />
l'incertitu<strong>de</strong> est gran<strong>de</strong>.<br />
Résumons les critiques fondamentales portant sur les projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies 8<br />
- Mécaniques, les projections ne prennent pas en compte les interactions entre<br />
phénomènes démographiques.<br />
- La pertinence et <strong>la</strong> validité <strong>de</strong>s hypothèses sont discutables - spécialement <strong>la</strong><br />
convergence <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité à 2.1 enfants par femme. Ces hypothèses arbitraires<br />
permettent <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s projections - conditionnelles - mais en aucun cas <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong><br />
réelles prévisions.<br />
Pourtant, l'inertie démographique à moyen terme («les mères <strong>de</strong> <strong>de</strong>main sont déjà nées») et les<br />
compensations d'erreurs permettent une re<strong>la</strong>tive fiabilité <strong>de</strong>s projections concernant l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion d'Afrique sub-Saharienne à l'horizon 2025. La métho<strong>de</strong> appelle bien sûr pour autant à <strong>la</strong><br />
pru<strong>de</strong>nce.<br />
Tableau 7 Confrontation <strong>de</strong>s projections démographiques <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies pour l'Afrique<br />
en milliers, selon l'année <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong><br />
Afrique 1990 1995 2000 2025<br />
Projection 1978 828 1391<br />
Projection 1989 648 872 1581<br />
Projection 1994 728* 1496<br />
Projection 1996 719* 1453<br />
* Estimations<br />
7 La convergence vers un I. S.F. <strong>de</strong> 2. 1 suppose bien sûr en parallèle, <strong>la</strong> remontée <strong>de</strong>s taux observés en Europe...<br />
8 J. Véron, 1996.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 249
BIBLIOGRAPHIE<br />
Popu<strong>la</strong>tion et Sociétés, INED, octobre 1996, n'317, Popu<strong>la</strong>tion mondiale : l'horizon 2025 reconsidéré.<br />
Popu<strong>la</strong>tion et Sociétés, INED, juillet - Août 1997, no326, Tous les pays du mon<strong>de</strong> (1997).<br />
Nations <strong>Un</strong>ies : long Range World Popu<strong>la</strong>tion Projections, two centuries of Popu<strong>la</strong>tion Growth. 1950-<br />
2150, New York, 1992.<br />
Nations <strong>Un</strong>ies, Annuaires démographiques, 1998 et antérieurs.<br />
Nations <strong>Un</strong>ies, World Popu<strong>la</strong>tion prospects : the 1996 Revision (et les Révisions antérieures)<br />
(Révision 1998 à paraître)<br />
G. Mathews : Popu<strong>la</strong>tion mondiale, <strong>de</strong>s projections suspectes, Futuribles, n"190, sept. 94, pp.45-65.<br />
World Urbanization prospects : the 1994 Revision. <strong>Un</strong>ited Nations Popu<strong>la</strong>tion Division, Department for<br />
Economic and Social Information and Policy Analysis.<br />
World Popu<strong>la</strong>tion estimates and projections. Popu<strong>la</strong>tion Division. Department for Economic and social<br />
Information and Policy Analysis. <strong>Un</strong>ited Nations, 1996.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 250
LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES DE L'AFRIQUE :<br />
INED,CEPED,PRB<br />
SITUATION - OBJECTIFS et MÉTHODE<br />
L'INED et le CEPED réalisent <strong>de</strong>s travaux plus qualitatifs visant à mettre en évi<strong>de</strong>nce les<br />
changements et les évolutions récemment observables. Il ne s'agit pas à proprement parler <strong>de</strong><br />
<strong>prospective</strong> ou <strong>de</strong> projections démographiques à l'échelle du continent africain ; toutefois, en<br />
analysant les tendances nouvelles, ces travaux éc<strong>la</strong>irent les projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies. Les<br />
démographes <strong>de</strong> l'INED se sont interrogés sur plusieurs questions sensibles : telles que <strong>la</strong> transition<br />
démographique et <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité, l'înfluence <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise économique sur les comportements<br />
et évolutions démographiques, et enfin l'impact du Sida et l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité.<br />
Les <strong>de</strong>ux enquêtes principales qui permettent <strong>de</strong> définir les tendances démographiques en cours en<br />
Afrique sub-saharienne ont été menées à partir <strong>de</strong>s années 1970 (EMF : Enquête Mondiale <strong>de</strong><br />
Fécondité) et 1980/90 (EDS : Enquêtes Démographiques et <strong>de</strong> Santé). Elles concernent au total 33<br />
pays <strong>de</strong> l'Afrique sub-saharienne (sur 48)<br />
Tableau 8 : Enquêtes Fécondité en Afrique sub-saharienne<br />
Enquête Pério<strong>de</strong> Pays concernés<br />
Enquête mondiale <strong>de</strong> fécondité<br />
Enquête démographique et <strong>de</strong> santé<br />
1973-1984<br />
Bénin Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Lesotho,<br />
Kenya, Nigeria, Sénégal<br />
Première vague 1986-1989<br />
Botswana, Burundi, Ghana, Kenya, Liberia, Mali,<br />
Ouganda, Sénégal, Soudan, Togo, Zimbabwe<br />
Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Madagascar,<br />
Deuxième vague 1990-1992 Ma<strong>la</strong>wi, Namibie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tanzanie,<br />
Zambie<br />
Afrique du Sud, Bénin, République Centr<strong>africaine</strong>,<br />
Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Erythrée, Éthiopie,<br />
Troisième vague 1993-1998 Ghana, Kenya, Madagascar, Ma<strong>la</strong>wi, Mali,<br />
Mozambique, Niger, Ouganda, Sénégal, Tanzanie,<br />
Tchad, Zambie, Zimbabwe<br />
Seuls 14 pays disposent <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux observations au moins ; toutefois, les tendances assez nettes en<br />
matière <strong>de</strong> fécondité permettent aux démographes <strong>de</strong> l'INED (Th. Locoh, J. Vallin, 1998) <strong>de</strong><br />
commenter et affiner les hypothèses <strong>de</strong>s projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies.<br />
Le Popu<strong>la</strong>tion Reference Bureau (PRB) publie chaque année le « World Popu<strong>la</strong>tion Data Sheet », qui<br />
proposent outre les statistiques démographiques <strong>de</strong> l'année en cours, <strong>de</strong>s projections à l'horizon<br />
2025. Ces données sont fournies sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> nombreuses sources telles que <strong>la</strong> Division <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion le Bureau <strong>de</strong>s statistiques <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies, le US Bureau of the Census, les Offices<br />
nationaux <strong>de</strong> statistiques, l'INED...<br />
RÉSULTATS<br />
1 - L'observation <strong>de</strong>s tendances récentes<br />
- l'impact du Sida : En 1994, J. Vallin (INED) mettait en gar<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> validité et <strong>la</strong><br />
représentativité <strong>de</strong>s chiffres circu<strong>la</strong>nt sur <strong>la</strong> prévalence du Sida en Afrique. Rien ne permettait<br />
d'affirmer que le Sida remettrait en cause les projections <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion à l'échelle du continent. En<br />
1996 cependant, le Popu<strong>la</strong>tion Reference Bureau réalise <strong>de</strong>s projections à l'horizon 2025, avec et<br />
sans Sida : il estime que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion d'Afrique sub-saharienne serait <strong>de</strong> 100 millions moins<br />
importante dans le premier cas. De ce point <strong>de</strong> vue, le PRB envisage un impact plus important du<br />
Sida, que les projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies <strong>de</strong> 1996.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 251
- l'impact <strong>de</strong> l'environnement économique (crise, ajustement, dégradation <strong>de</strong>s systèmes<br />
éducatifs et <strong>de</strong> santé) :<br />
La crise et l'ajustement n'ont pas remis en cause <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité (J.Coussy, J. Vallin, 1996).<br />
Le Sida et les violences politiques semblent plus déterminants concernant l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité.<br />
Toutefois, <strong>la</strong> détérioration <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> vie pourrait être une « bombe à retar<strong>de</strong>ment ». En effet,<br />
J. Vallin et J. Coussy s'interrogent: que <strong>de</strong>viendra le savoir-faire en matière <strong>de</strong> santé, comment<br />
évoluera <strong>la</strong> fécondité, si les jeunes générations (spécialement les femmes) fréquentent moins l'école<br />
que leurs aîné(e)s ?<br />
- Le vieillissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
La baisse actuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité provoquera le vieillissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion dans un futur proche<br />
(J. Vallin, 1994). Dans ces conditions, il serait souhaitable <strong>de</strong> mettre à profit <strong>la</strong> « pério<strong>de</strong> faste <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité (... ) non seulement pour assurer le décol<strong>la</strong>ge économique, mais aussi pour<br />
investir dans les moyens <strong>de</strong> répondre <strong>de</strong>main à <strong>la</strong> rapi<strong>de</strong> montée du troisième âge » (J. Vallin, 1994,<br />
p. 20).<br />
- L'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité<br />
<strong>Un</strong> fléchissement significatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité s'observe, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s enquêtes EMF et EDS, pour 12<br />
<strong>de</strong>s 14 pays disposant <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux observations au moins. Les causes <strong>de</strong> cette évolution <strong>de</strong>s<br />
comportements varient selon les pays, mais <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité infantile et l'instruction (surtout<br />
<strong>de</strong>s femmes) semblent déterminants.<br />
La fécondité a fléchi plus brutalement et plus tôt que ne l'avaient prévu les projections <strong>de</strong>s Nations<br />
<strong>Un</strong>ies. Aujourd'hui, l'hypothèse basse apparaît plus vraisemb<strong>la</strong>ble que l'hypothèse moyenne (Th.<br />
Locoh, J. Vallin, 1998).<br />
2 - Les projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies et les données du Popu<strong>la</strong>tion Reference Bureau :<br />
Tableau 9: Comparaison <strong>de</strong>s estimations et projections du PRB et <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies<br />
Afrique Sub-saharienne, en millions d'habitants<br />
Popu<strong>la</strong>tion Reference Bureau* Nations <strong>Un</strong>ies**<br />
Popu<strong>la</strong>tion 1987 Projection 2025 Popu<strong>la</strong>tion 1995 Projection 2020<br />
Afrique orientale 231 384 221 431<br />
Afrique occi<strong>de</strong>ntale 210 429 209 401<br />
Afrique australe 49 56 47 77<br />
Afrique centrale 88 184 83 166<br />
Afrique Sub-Saharienne<br />
* Source : World Popu<strong>la</strong>tion Data Sheet, PRB, 1997<br />
** Source : World Popu<strong>la</strong>tion Prospects : the 1996 Revision, <strong>Un</strong>ited Nations.<br />
Les projections du PRB sont sensiblement plus faible en Afrique orientale et australe,<br />
vraisemb<strong>la</strong>blement en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité, et <strong>de</strong> l'impact du Sida.<br />
Rappelons toutefois que les projections <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies ont été révisées à <strong>la</strong> baisse en 1998.<br />
REMARQUES, CRITIQUES ET ÉVALUATION<br />
Les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s instituts <strong>de</strong> démographie tels que l'INED et le PRB, plus qualitatifs, comblent certaines<br />
<strong>la</strong>cunes <strong>de</strong>s projections trop mécaniques <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies. Elles mettent en évi<strong>de</strong>nce certaines<br />
limites, voire certains échecs <strong>de</strong>s projections démographiques, qui <strong>de</strong>vront inciter tout utilisateur à <strong>la</strong><br />
pru<strong>de</strong>nce. Elles permettent éventuellement <strong>de</strong> réactualiser et <strong>de</strong> réviser les données à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong>s<br />
tendances nouvelles qu'elles soulignent.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 252
Cependant, les Nations <strong>Un</strong>ies restent le seul producteur <strong>de</strong> projections originales à l'échelle du<br />
continent africain ; or, ces données globales sont indispensables pour une <strong>prospective</strong> qui entend<br />
englober l'ensemble <strong>de</strong> l'Afrique Sub-saharienne.<br />
Malgré une re<strong>la</strong>tive inertie <strong>de</strong>s évolutions démographiques qui permet d'accor<strong>de</strong>r une certaine<br />
crédibilité aux projections à l'échelle du continent, <strong>de</strong> nombreuses incertitu<strong>de</strong>s pèsent sur l'avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion <strong>africaine</strong> : alors que le Sida et les violences politiques ren<strong>de</strong>nt incertaine <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité dans certains pays, les comportements en matière <strong>de</strong> fécondité sont<br />
difficilement prévisibles.<br />
La répartition <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion sur le continent, les mouvements migratoires intra et internationaux<br />
sont eux aussi mal connus et difficiles à prévoir. Toutefois, l'étu<strong>de</strong> WALTPS proposent quelques<br />
scénarios concernant l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
INED, Tous les pays du mon<strong>de</strong>, Popu<strong>la</strong>tion et Sociétés, Juillet-Août 1997.<br />
Coussy J. et J. Vallin (dir), Crise et popu<strong>la</strong>tion en Afrique : crises économiques, politiques<br />
d'ajustement et dynamique démographique, Les étu<strong>de</strong>s du Ceped, nol3, Paris-Ceped,<br />
1996,580p.<br />
Locoh Th. et Y. Mak<strong>de</strong>ssi, Politique <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion et baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité en Afrique subsaharienne,<br />
Dossier du Ceped no44, nov. 1 996.<br />
Locoh Th. et J. Vallin, Afrique noire : <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> fécondité, Popu<strong>la</strong>tion et Sociétés, n"338, INED,<br />
septembre 1998.<br />
Popu<strong>la</strong>tion Reference Bureau, World Popu<strong>la</strong>tion Data Sheet, 1998 et années antérieures.<br />
Vallin J., Réflexions sur l'avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion mondiale, Dossier du Ceped, n'26, mai 1994.<br />
Vallin J. et J. Coussy, Crise et Transition démographique en Afrique, Chronique du Ceped, n"23, déc.<br />
1996.<br />
Véron J., L'horizon 2025 reconsidéré, Popu<strong>la</strong>tion et Sociétés, n'317, INED, octobre 1996.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 253
3.4.3.<br />
L'EDUCATION
TENDANCES ET PROJECTIONS DES EFFECTIFS SCOLAIRES PAR<br />
DEGRE D'ENSEIGNEMENT, PAR AGE ET PAR SEXE, 1960 -2025<br />
(EVALUEES EN 1993).<br />
Enquêtes et recherches statistiques, division <strong>de</strong>s statistiques, décembre 1993,<br />
<strong>Un</strong>esco, Paris.<br />
OBJECTIF DE L'ETUDE<br />
L'étu<strong>de</strong> traite <strong>de</strong> l'évolution passée et possible pour l'avenir <strong>de</strong>s effectifs sco<strong>la</strong>ires par <strong>de</strong>gré<br />
d'enseignement. A partir <strong>de</strong>s données re<strong>la</strong>tives aux effectifs par <strong>de</strong>gré d'enseignement, par groupe<br />
d'âge et par sexe, <strong>de</strong> 1960 à l'année <strong>la</strong> plus récente pour <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>s données étaient disponibles à<br />
l'<strong>Un</strong>esco à <strong>la</strong> fin du mois <strong>de</strong> juin 1993, elle étudie les conséquences que les tendances observées<br />
entraîneraient si elles <strong>de</strong>vaient se maintenir.<br />
L'objet principal <strong>de</strong>s projections consiste à examiner comment les effectifs sco<strong>la</strong>ires pourraient<br />
évoluer si les tendances <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation inclus dans le modèle <strong>de</strong> projection<br />
observées <strong>de</strong>puis 1960 <strong>de</strong>vaient se poursuivre dans leurs gran<strong>de</strong>s lignes, jusqu'à 2025, <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière<br />
définie par le modèle. Ces projections sont donc hautement conditionnelles ; quatre facteurs<br />
principaux déterminent les résultats : les données disponibles concernant les tendances passées en<br />
matière d'effectifs sco<strong>la</strong>ires et <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion, les projections <strong>de</strong> l'évolution future <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion d'âge<br />
sco<strong>la</strong>ire utilisées, le modèle <strong>de</strong> projection choisi pour quantifier les conséquences <strong>de</strong> ces tendances et<br />
projections et l'horizon temporel <strong>de</strong>s projections.<br />
MODELE UTILISE<br />
En s'appuyant sur les tendances <strong>de</strong>s effectifs <strong>de</strong>puis 1960, le modèle projette, pays par pays,<br />
les effectifs par <strong>de</strong>gré d'enseignement (enseignement primaire, secondaire et supérieur) et par groupe<br />
d'âge (6-11 ans, 12-17 ans, 18-23 ans), séparément pour les garçons et les filles. Il extrapole ensuite<br />
<strong>la</strong> tendance passée du taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation pour le groupe d'âge 6-11 ans. Pour obtenir le nombre<br />
<strong>de</strong>s inscrits dans l'enseignement primaire, le nombre d'élèves <strong>de</strong> 6-11ans est multiplié par <strong>la</strong><br />
proportion d'inscrits par groupe d'âge et par <strong>de</strong>gré. Pour obtenir les effectifs <strong>de</strong>s autres groupes d'âge<br />
et <strong>de</strong>s autres <strong>de</strong>grés d'enseignement, le modèle utilise <strong>de</strong>s coefficients <strong>de</strong> passage appropriés. Tous<br />
les coefficients du modèle ont été obtenus par projection au moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction logistique. Le calcul<br />
et l'extrapo<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s coefficients <strong>de</strong> passage utilisés dans le modèle ont été opérés par pays et par<br />
sexe.<br />
Il s'agit donc d'un modèle global qui ne peut pas prendre en compte toutes les particu<strong>la</strong>rités<br />
nationales dont certaines rejaillissent sur les flux d'élèves. Les projections <strong>de</strong>s effectifs <strong>de</strong><br />
l'enseignement supérieur en particulier nécessitent beaucoup <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce quant à leur interprétation.<br />
PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS<br />
L'accroissement impressionnant <strong>de</strong>s effectifs sco<strong>la</strong>ires à tous les <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> l'enseignement qui<br />
avait été enregistré au cours <strong>de</strong>s décennies passées ne <strong>de</strong>vrait pas se poursuivre au même rythme<br />
pendant les vingt ou trente prochaines années. Les tendances récentes font apparaître un<br />
ralentissement <strong>de</strong> l'augmentation <strong>de</strong>s effectifs sco<strong>la</strong>ires dans toutes les gran<strong>de</strong>s régions, sauf en Asie<br />
du Sud. Ce phénomène s'explique par <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> natalité, par les difficultés économiques<br />
et par le nombre croissant <strong>de</strong> pays, en particulier en Amérique <strong>la</strong>tine et dans les Caraïbes et en Asie<br />
<strong>de</strong> l'Est, où l'enseignement primaire est quasi généralisé. Entre 1991 et 2025, les effectifs sco<strong>la</strong>ires<br />
aux trois niveaux <strong>de</strong> l'enseignement <strong>de</strong>vraient passer <strong>de</strong> 990 millions à 1295 millions. Concernant les<br />
pays en développement, les effectifs sco<strong>la</strong>ires continueront d'augmenter et cette hausse sera en<br />
gran<strong>de</strong> partie attribuable à <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong>s effectifs en Afrique subsaharienne, dans les États arabes<br />
et en Asie du Sud. Cette augmentation en nombres absolus est essentiellement due à <strong>la</strong> pression<br />
démographique sur l'enseignement primaire dans ces trois régions.<br />
A propos <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation, les pays en développement ont ensemble une capacité<br />
suffisante d'accueillir tous les enfants en âge <strong>de</strong> fréquenter l'école primaire, <strong>de</strong>ux adolescents sur cinq<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 256
sco<strong>la</strong>risables dans le secondaire et un peu moins d'un jeune sur dix dans l'enseignement supérieur.<br />
Par gran<strong>de</strong> région, les contrastes sont nombreux : en ASS, l'accès à l'école primaire, qui avait<br />
sensiblement augmenté entre 1960 et 1980, a <strong>de</strong>puis lors régulièrement baissé. Actuellement, on peut<br />
accueillir dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong>ux enfants d'âge sco<strong>la</strong>ire sur trois dans le primaire. En l'an 2000, 85% <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> région en âge <strong>de</strong> fréquenter l'école primaire vivra dans <strong>de</strong>s pays où l'enseignement<br />
primaire n'aura pas été généralisé. Le nombre d'enfants non sco<strong>la</strong>risés <strong>de</strong>vrait atteindre les 100<br />
millions en 2025. Pour les <strong>de</strong>ux autres niveaux d'enseignement, le taux <strong>de</strong> participation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion sco<strong>la</strong>risable est faible (secondaire) ou minime (supérieur). Selon les projections, les<br />
pourcentages d'adolescents non sco<strong>la</strong>risés ne <strong>de</strong>vraient pas diminuer d'ici 2015.<br />
L'étu<strong>de</strong> souligne ensuite les disparités entre les sexes. Des progrès sensibles ont été réalisés<br />
mais <strong>la</strong> parité entre les effectifs sco<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sexes ne <strong>de</strong>vrait pas être atteinte dans les<br />
premières décennies du siècle prochain à aucun <strong>de</strong>s trois <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> l'enseignement.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 257
PROSPECTIVE - SECTEUR EDUCATION<br />
Comparaison <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong> projection<br />
Les analyses menées par le PNUD, l'UNESCO, <strong>la</strong> Banque Mondiale, l'IREDU, etc. sont<br />
multiples. Il existe <strong>de</strong> nombreux types <strong>de</strong> modèles ou <strong>de</strong> techniques <strong>de</strong> projection <strong>de</strong>s effectifs par<br />
c<strong>la</strong>sse ou par <strong>de</strong>gré du système d'éducation. Ils comprennent <strong>de</strong>s modèles qui projettent directement<br />
les tendances observées <strong>de</strong>s effectifs d'une c<strong>la</strong>sse ou d'un <strong>de</strong>gré. Ces projections ne tiennent pas<br />
compte explicitement <strong>de</strong>s élèves à travers le système, ni du fait que l'effectif d'une année sco<strong>la</strong>ire est<br />
en partie conditionné par l'effectif inscrit dans l'année d'étu<strong>de</strong>s inférieure l'année sco<strong>la</strong>ire précé<strong>de</strong>nte.<br />
Il existe aussi <strong>de</strong>s modèles qui projettent directement les taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation mais ils ne tiennent pas<br />
compte non plus du cheminement <strong>de</strong>s élèves à travers le système sco<strong>la</strong>ire. D'autres modèles<br />
projettent les effectifs sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l'année d'étu<strong>de</strong>s ou du <strong>de</strong>gré immédiatement inférieurs au cours<br />
<strong>de</strong> l'année sco<strong>la</strong>ire précé<strong>de</strong>nte et <strong>de</strong> coefficients décrivant les flux d'élèves d'une année d'étu<strong>de</strong>s ou<br />
d'un <strong>de</strong>gré à l'autre et d'une année sco<strong>la</strong>ire à l'autre. Tel est le principe fondamental <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong><br />
flux. L'UNESCO privilégie cette troisième catégorie <strong>de</strong> modèle dont <strong>la</strong> logique est <strong>de</strong> décrire les<br />
mouvements <strong>de</strong>s élèves à l'entrée, à l'intérieur et à <strong>la</strong> sortie du système d'éducation ou <strong>de</strong> l'une <strong>de</strong><br />
ses parties. Nous re<strong>la</strong>tons, dans un premier temps, <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> projection utilisée par l'IREDU à<br />
propos <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tions re<strong>la</strong>tives aux cas africains (Bourdon, Orivel 1992) puis <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> PNUD et ,<br />
enfin, celle <strong>de</strong> l'UNESCO. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> flux, nous nous pencherons sur <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong><br />
financement du système éducatif dont les variables essentielles reposent sur <strong>de</strong>s caractéristiques<br />
budgétaires (Métho<strong>de</strong> Ph. Hugon, Cered).<br />
* La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'IREDU<br />
La démarche pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire est<br />
semb<strong>la</strong>ble. On calcule une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> début <strong>de</strong> cycle sco<strong>la</strong>ire en appliquant un taux à une<br />
popu<strong>la</strong>tion potentiellement sco<strong>la</strong>risable. On reconstitue ensuite une cohorte en simu<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> transition<br />
<strong>de</strong> cette popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> début <strong>de</strong> cycle sco<strong>la</strong>ire tout au long <strong>de</strong> ce cycle. On procè<strong>de</strong> enfin à <strong>de</strong>s<br />
calculs <strong>de</strong> taux d'encadrement et d'implication financière. On peut donc écrire :<br />
(1) Pt = Pt-1(1 + taux)<br />
(2) taux cp1, t = taux cp1, t-1 + taux cp1, horizon - taux cp1, t0 / T<br />
(3) Ei,t = ri, t-1 x Ei, t-1 + (1 - ri-1, t-1 - ai-1, t-1) x Ei-1, t-1<br />
L'équation (1) permet <strong>de</strong> déterminer l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à partir d'une popu<strong>la</strong>tion totale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse d'âge 6-11 ans et <strong>de</strong> l'effectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> génération <strong>de</strong> 6 ans à l'année origine. Ces <strong>de</strong>ux<br />
popu<strong>la</strong>tions évoluent en fonction d'un taux <strong>de</strong> croissance qui est une variable <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>. Avec<br />
l'équation (2), <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion sco<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> première année du cycle est obtenue en appliquant à <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> 6 ans le taux d'accès en CP1 (taux cp1). Cette <strong>de</strong>rnière variable évolue <strong>de</strong> manière<br />
linéaire entre une donnée origine observée (taux cp1, t0 ) et un objectif retenu pour l'année horizon (T<br />
marque <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> projection). L'indice i fait référence aux divers niveaux d'enseignement du CP au<br />
CM. L'équation dynamique (3) permet <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> niveau en niveau où Ei,t représente l'effectif du<br />
niveau 1 au temps t ; a et r les taux d'abandon et <strong>de</strong> redoublement. La promotion du cours i au cours i<br />
+ 1 est obtenue par le taux <strong>de</strong> promotion p avec p = 1 - r - a.<br />
Enfin, l'effectif du cycle sco<strong>la</strong>ire pour l'année t vient <strong>de</strong> <strong>la</strong> sommation <strong>de</strong>s divers niveaux soit : Et<br />
= ∑ i=cp1 Ei, t<br />
Pour l'enseignement secondaire général, <strong>la</strong> progression <strong>de</strong>s taux et le calcul <strong>de</strong>s cohortes est<br />
totalement i<strong>de</strong>ntique à ce qui vient d'être décrit pour l'enseignement fondamental. Le calcul porte sur<br />
les niveaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> 6e à <strong>la</strong> terminale.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 258
* La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion du PNUD<br />
Nous nous appuyons sur un modèle expérimenté au Niger et au Sénégal et qui repose sur <strong>de</strong>s<br />
variables démographiques et sco<strong>la</strong>ires (Stankiewicz & Buisine 1989, Vérez 1989-1990). Le modèle<br />
SCOFLUX (Niger) et les modèles MFS I et II (Sénégal) sont <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong>s flux<br />
sco<strong>la</strong>ires qui, appliqués à l’enseignement primaire et secondaire, permettent <strong>de</strong> projeter le nombre<br />
d’élèves par c<strong>la</strong>sse année par année et donc le nombre total d’élèves par cycle d’enseignement.<br />
L’enseignement primaire comprend 6 niveaux : CI, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 ; l’enseignement<br />
secondaire du 1er <strong>de</strong>gré comprend 4 niveaux : 6 ème , 5 ème , 4 ème , 3 ème et l’enseignement du 2 nd <strong>de</strong>gré<br />
comprend 3 niveaux : 2 n<strong>de</strong> , I ère , Terminale.<br />
Nous savons qu’à l’issue d’une année sco<strong>la</strong>ire, l’élève peut soit passer en c<strong>la</strong>sse supérieure,<br />
soit redoubler <strong>la</strong> même c<strong>la</strong>sse, soit quitter le système sco<strong>la</strong>ire.<br />
On a donc <strong>la</strong> situation suivante :<br />
- les élèves au CI à l’année n (Cin) sont égaux aux nouveaux élèves du CI à l’année n (NECIn)<br />
auxquels on ajoute les redoub<strong>la</strong>nts en CI <strong>de</strong> l’année n (RCIn) ; ensuite, les élèves <strong>de</strong> CP à l’année n<br />
(Cpn) sont les élèves promus en CP à l’année n (PCPn) auxquels ont ajoute les redoub<strong>la</strong>nts en CP <strong>de</strong><br />
l’année n (RCPn) ; i<strong>de</strong>m pour les c<strong>la</strong>sses suivantes. Ce<strong>la</strong> nous donne les équations :<br />
CIn = NECIn + RCIn<br />
CPn = PCPn + RCPn<br />
- les redoub<strong>la</strong>nts d’une c<strong>la</strong>sse à l’année n sont obtenus à partir du taux <strong>de</strong> redoublement (tr)<br />
appliqué à l’effectif total <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse à l’année n-1 soit, par exemple, pour les redoub<strong>la</strong>nts du CI<br />
l’équation :<br />
RCIn = CIn-1 x trCI<br />
- les promus d’une c<strong>la</strong>sse à l’année n sont obtenus à partir du taux <strong>de</strong> passage (tp) et <strong>de</strong><br />
l’effectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse inférieure à l’année n-1 soit, par exemple, pour les promus du CP l’équation :<br />
PCPn = CIn-1 x tpCI/CP<br />
- les taux d’abandon se déduisent <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> redoublement et <strong>de</strong> passage puisque, par<br />
définition, on a : taux <strong>de</strong> passage + taux <strong>de</strong> redoublement + taux d’abandon = 1<br />
Lorsqu’on connaît le nombre <strong>de</strong> nouveaux élèves en CI et le volume <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion âgée <strong>de</strong><br />
7 ans (POP7n), on peut calculer le taux d’inscription (TIn) :<br />
TIn = NECIn / POP7n x 100<br />
On peut également calculer le taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation (TSCOn) à partir du nombre total d’élèves<br />
dans le cycle d’enseignement (Ntn) et du volume <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en âge <strong>de</strong> fréquenter ce cycle soit,<br />
par exemple, pour l’enseignement primaire :<br />
TSCOn = NTPn / POP7-12n x 100<br />
Il est encore possible <strong>de</strong> calculer les besoins en c<strong>la</strong>sses (CL) et en enseignants (ENS) tout en<br />
tenant compte du système <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses à "double vacation" (ou "double flux") par application <strong>de</strong><br />
ratios nombre d’élèves par c<strong>la</strong>sse (ec), et nombre d’élèves par enseignant (ee). Ces ratios seront bien<br />
entendu différents dans les c<strong>la</strong>sses à double vacation (ecdv et eedv).<br />
CLn = (NTPn - NTPdvn) / cc + NTPdvn / ecdv<br />
ENSn = (NTPn - NTPdvn) / ec + NTPdvn / eedv<br />
avec NTPdvn = nombre total d’élèves du cycle primaire sco<strong>la</strong>risés dans les c<strong>la</strong>sses à « double<br />
vacation ».<br />
Les modèles comprennent trois types principaux <strong>de</strong> variables <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion : les taux <strong>de</strong><br />
passage et <strong>de</strong> redoublement qui traduisent le ren<strong>de</strong>ment interne du système d’enseignement, le taux<br />
d’inscription en CI qui est <strong>la</strong> résultante <strong>de</strong> <strong>la</strong> confrontation entre <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’éducation (issue <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pression démographique) et offre d’éducation, <strong>la</strong> part d’élèves en c<strong>la</strong>sse à « double vacation » qui<br />
mesure le <strong>de</strong>gré d’engagement dans cette politique. Ils permettent donc <strong>de</strong> combiner plusieurs<br />
hypothèses et <strong>de</strong> calculer d’innombrables simu<strong>la</strong>tions. Ils sont donc utiles et performants pour projeter<br />
les flux sco<strong>la</strong>ires, les flux <strong>de</strong> diplômés, les taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation, les besoins en c<strong>la</strong>sses ou en<br />
enseignants à un horizon <strong>de</strong> long voire <strong>de</strong> très long terme.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 259
* La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'UNESCO<br />
On retrouve ici l'essentiel <strong>de</strong>s inputs présentés dans le modèle précé<strong>de</strong>nt. Bien que l'UNESCO<br />
reconnaisse que les modèles <strong>de</strong> flux se prêtent peu à d'autres activités éducatives que l'éducation<br />
formelle (soit, par exemple, l'éducation extra-sco<strong>la</strong>ire : l'enseignement à distance, <strong>la</strong> formation en<br />
cours d'emploi, l'apprentissage informel), ce sont malgré tout les modèles qui "permettent le mieux<br />
l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s types d'éducation organisés en une séquence d'années d'étu<strong>de</strong>s d'égale durée ...et qui<br />
peuvent être utilisés à <strong>de</strong> nombreuses fins" (1982). La présentation analytique du modèle <strong>de</strong>s flux par<br />
année d'étu<strong>de</strong>s peut se résumer aux symboles suivants :<br />
E t<br />
g = effectif <strong>de</strong> l'année d'étu<strong>de</strong>s g, année t (début <strong>de</strong> l'année sco<strong>la</strong>ire t).<br />
E t+1<br />
g,g+1 = nombre d'élèves <strong>de</strong> l'année g, année t qui, l'année sco<strong>la</strong>ire suivante, sont promus à<br />
l'année d'étu<strong>de</strong>s g + 1.<br />
D t<br />
g = nombre d'élèves qui abandonnent au niveau <strong>de</strong> l'année d'étu<strong>de</strong>s g dans l'année sco<strong>la</strong>ire t.<br />
G t<br />
g = nombre d'élèves <strong>de</strong> l'année d'étu<strong>de</strong>s g diplômés à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l'année sco<strong>la</strong>ire t.<br />
N t<br />
1 = nouveaux entrants en 1ère année d'étu<strong>de</strong>s dans l'année sco<strong>la</strong>ire t.<br />
R t+1<br />
g = redoub<strong>la</strong>nts.<br />
et aux re<strong>la</strong>tions "comptables" ci-après :<br />
E t<br />
1 = R t+1<br />
1 + E t+1<br />
1,2 + D t<br />
1<br />
E t<br />
2 = R t+1<br />
2 + E t+1<br />
2,3 + D t<br />
2<br />
E t<br />
3 = R t+1<br />
3 + E t+1<br />
3,4 + D t<br />
3<br />
E t<br />
4 = R t+1<br />
4 + E t+1<br />
4,5 + D t<br />
4<br />
E t<br />
5 = R t+1<br />
5 + E t+1<br />
5,6 + D t<br />
5<br />
E t<br />
6 = R t+1<br />
6 + G t<br />
6 + D t<br />
6<br />
E t+1<br />
1 = N t+1<br />
1 + R t+1<br />
1<br />
E t+1<br />
2 = E t+1<br />
1,2 + R t+1<br />
2<br />
E t+1<br />
3 = E t+1<br />
2,3 + R t+1<br />
3<br />
E t+1<br />
4 = E t+1<br />
3,4 + R t+1<br />
4<br />
E t+1<br />
5 = E t+1<br />
4,5 + R t+1<br />
5<br />
E t+1<br />
6 = E t+1<br />
5,6 + R t+1<br />
6<br />
Les six premières équations (en ligne) et les six autres (en colonne) déterminent les flux entre<br />
les années sco<strong>la</strong>ires t et t + 1 dans l'enseignement primaire. Il convient <strong>de</strong> préciser que toute<br />
hypothèse re<strong>la</strong>tive aux nouveaux entrants en 1ère année conditionne les projections d'effectifs pour<br />
chaque année d'étu<strong>de</strong>s dans les années sco<strong>la</strong>ires suivantes. En complétant <strong>la</strong> présentation du<br />
modèle <strong>de</strong> flux, nous préciserions <strong>la</strong> même remarque à propos du taux <strong>de</strong> promotion lequel<br />
conditionne à son tour les effectifs <strong>de</strong>s niveaux et <strong>de</strong>s années suivantes.<br />
* La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque mondiale<br />
Nous abordons à présent un modèle <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l'éducation et non un<br />
modèle <strong>de</strong> flux sco<strong>la</strong>ires comme précé<strong>de</strong>mment. La démarche est tout autre car elle privilégie <strong>la</strong><br />
variable budgétaire. Sans qu'elle soit exclusive au bailleur <strong>de</strong> fond ici cité, elle témoigne malgré tout<br />
d'une préoccupation différente : ce n’est pas tant l’évolution <strong>de</strong>s effectifs qui importe ou celle du taux<br />
<strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation mais <strong>la</strong> contrainte financière qui, in fine, autorise ou non <strong>de</strong> recruter <strong>de</strong>s enseignants,<br />
<strong>de</strong> construire <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses et, donc, d'accueillir <strong>de</strong> nouveaux élèves. Les modèles précé<strong>de</strong>nts précisent<br />
les taux d'accueil <strong>de</strong>s nouveaux entrants pour accroître le taux d'inscription au CP, précisent encore<br />
quelle doit être l'évolution <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> promotion et <strong>de</strong> redoublement pour élever le taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>rité<br />
mais ne nous informent guère <strong>de</strong>s conditions macroéconomiques et macrofinancières dont il faut tenir<br />
compte.Le modèle dont il s'agit, EDFISIMO, fait du nombre d'étudiants inscrits dans le système un<br />
facteur variable dépendant d'un budget préparé indépendamment, les coûts unitaires dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques du système. En conséquence, l'impact financier <strong>de</strong>s politiques ayant pour objectif <strong>de</strong><br />
modifier le fonctionnement du système reste compatible avec les contraintes budgétaires. Le modèle<br />
permet <strong>de</strong> simuler également les effets obtenus en modifiant différentes composantes du budget ou<br />
en modifiant simultanément un groupe <strong>de</strong> ces composantes et le fonctionnement du système. Le<br />
modèle comprend quatre parties dont le sous-modèle re<strong>la</strong>tif aux élèves, celui re<strong>la</strong>tif aux enseignants<br />
puis aux coûts et au budget. Nous re<strong>la</strong>tons d'abord le sous-modèle re<strong>la</strong>tif aux coûts. Les coûts<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 260
comprennent les coûts <strong>de</strong>s enseignants, les frais administratifs et les coûts du matériel. Les équations<br />
se présentent ainsi :<br />
Tct = CTt + CAt + CMt<br />
CTJt = n Σi=1 TJit WJi<br />
Cat = Σj TJ x CAPT<br />
Cmt = St x CMPP<br />
It = (St - St-1) x CCPS<br />
UCt = Tct / St<br />
TCt, total <strong>de</strong>s coûts<br />
CT, coûts <strong>de</strong>s enseignants<br />
CA, frais administratifs<br />
CM, coûts du matériel<br />
CAPT, frais administratifs par enseignant<br />
CCPS, coûts <strong>de</strong> construction par élève<br />
I, investissement<br />
UC, coût unitaire<br />
Le sous-modèle budgétaire revient à déterminer le budget disponible pour un niveau donné<br />
d'éducation, lui-même fonction du budget total <strong>de</strong> l'État et donc, en partie, du niveau du PIB. La<br />
variable indépendante <strong>de</strong> ce sous-modèle est le taux <strong>de</strong> croissance du budget <strong>de</strong> l'État. Soient les<br />
équations suivantes :<br />
BE kt = BGt α t - ∑ S-1<br />
k=1 BEkt<br />
BG = BG0 (1 + rg) t<br />
αt = αo + at<br />
BEkt = BEko (1 + rk) t<br />
BEk, budget disponible pour le niveau d'éducation k, pour l'enseignement primaire par exemple<br />
BG, budget <strong>de</strong> l'État<br />
S, nombre <strong>de</strong> niveaux et types émargeant au budget <strong>de</strong> l'éducation<br />
rg, taux <strong>de</strong> croissance du budget <strong>de</strong> l'État<br />
α, part <strong>de</strong> l'éducation dans le budget <strong>de</strong> l'État<br />
a, coefficient d'augmentation<br />
rk, taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> BEk<br />
L'une <strong>de</strong>s principales caractéristiques du modèle est sa capacité <strong>de</strong> simuler le coût <strong>de</strong>s<br />
enseignants, avec <strong>de</strong>s résultats parfois contraires aux idées admises. On pense généralement, par<br />
exemple, que les sa<strong>la</strong>ires moyens <strong>de</strong>s enseignants augmentent avec le temps. Ce n'est pas toujours<br />
le cas. L'évolution <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires moyens dépendra également <strong>de</strong> <strong>la</strong> composition par âge du groupe<br />
initial d'enseignants, <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> déperdition <strong>de</strong>s effectifs et <strong>de</strong> mise à <strong>la</strong> retraite et du taux <strong>de</strong><br />
croissance <strong>de</strong> l'ensemble du système éducatif. <strong>Un</strong> tel modèle <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l'éducation paraît<br />
donc utile à l'analyse et, <strong>de</strong> fait, à <strong>la</strong> décision.<br />
Sans négliger l'apport <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> flux sco<strong>la</strong>ires en matière d'analyse et d'ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong><br />
décision, les modèles <strong>de</strong> financement présentent l'intérêt évi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> concilier les objectifs quantitatifs<br />
en terme d'effectifs et les contraintes budgétaires. De fait, ils paraissent incontournables vis à vis <strong>de</strong>s<br />
objectifs <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>. Nous proposons que les variables sur lesquelles reposeront les estimations<br />
<strong>prospective</strong>s soient d’abord d’ordre budgétaire : part <strong>de</strong>s dépenses d’enseignement/PIB, pondération<br />
du sa<strong>la</strong>ire moyen <strong>de</strong> l’enseignant/PIB per capita, rapport entre les dépenses sa<strong>la</strong>riales et les autres<br />
dépenses. La démarche consiste à déterminer, par exemple, le sa<strong>la</strong>ire d’un instituteur par rapport au<br />
poids <strong>de</strong>s dépenses d’enseignement/PIB, par cycle, et par rapport au taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation brut fixé.<br />
De fait, il ne s’agit pas <strong>de</strong> projeter dans l’avenir les effectifs à sco<strong>la</strong>riser et l’évolution du taux <strong>de</strong><br />
sco<strong>la</strong>rité à partir <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong>s nouveaux élèves inscrits au CI ou au CP puis <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> passage en<br />
c<strong>la</strong>sse supérieure, <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> redoublement et <strong>de</strong>s taux d’abandon. Sans que cette métho<strong>de</strong> soit<br />
inutile (cf ci-<strong>de</strong>ssus <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> divers modèles <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion), elle ne permet pas <strong>de</strong> prendre<br />
en considération les contraintes budgétaires telles que les pays en développement (notamment<br />
africains) les connaissent sous ajustement. Les étu<strong>de</strong>s réalisées tant par l’UNESCO, l’IIPE ou le<br />
PNUD relèvent <strong>de</strong> cette métho<strong>de</strong>. Si l’on recherche par conséquent d'autres analyses <strong>prospective</strong>s, il<br />
en existe très peu. C’est moins <strong>de</strong> <strong>la</strong> perspective prévisionnelle à partir d’une situation présente<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 261
projetée que nous cherchons à développer mais davantage un état futur possible. Nous présentons ciaprès<br />
<strong>la</strong> métho<strong>de</strong> é<strong>la</strong>borée par Ph. Hugon et appliquée à <strong>la</strong> Côte d'Ivoire (1998) puis appliquée à<br />
d'autres pays d'ASS (J-C. Vérez, Cered-Forum, document <strong>de</strong> travail, septembre 1998).<br />
* La <strong>prospective</strong> éducative à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> variable budgétaire (Ph. Hugon)<br />
1) La prévision <strong>de</strong>s dépenses publiques d'éducation<br />
L'évolution du budget global <strong>de</strong> l'éducation dépend notamment <strong>de</strong> l'évolution du PIB. Les<br />
effectifs sco<strong>la</strong>risés d'un cycle peuvent se définir comme le rapport entre les dépenses d'enseignement<br />
(E) et le coût année-élève (C) soit : S = E/C. Le taux brut d'inscription sco<strong>la</strong>ire peut se définir comme<br />
le rapport entre les dépenses effectives d'enseignement pour un cycle donné (E) sur les dépenses<br />
qu'il aurait fallu effectuer si l'on avait sco<strong>la</strong>risé l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion sco<strong>la</strong>risable (C. Ps). D'où :<br />
ts = E/(C.Ps). Avec :<br />
ts : le taux d'inscription brut par popu<strong>la</strong>tion sco<strong>la</strong>risable<br />
Y : le PIB<br />
P : <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale<br />
Ps : <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion sco<strong>la</strong>risable, Ps = t.P<br />
t : le taux <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risable ou le rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion d'âge du cycle sco<strong>la</strong>ire sur <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
totale : t = Ps/P<br />
S : le nombre d'élèves inscrits : E/c<br />
C : le coût année-élève : C = m.w (1+h) = mbY/P(1+h)<br />
M: le nombre d'enseignants<br />
E: les dépenses d'enseignement<br />
a: <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s dépenses d'enseignement sur le PIB : a = E/Y<br />
w : le sa<strong>la</strong>ire moyen <strong>de</strong> l'enseignant<br />
b : <strong>la</strong> pondération <strong>de</strong> ce sa<strong>la</strong>ire par rapport au PIB par tête : w = bY/P<br />
m : <strong>la</strong> ratio maître/élève : m = M/S<br />
h : le rapport entre les dépenses autres que sa<strong>la</strong>riales et les dépenses sa<strong>la</strong>riales<br />
i : le cycle sco<strong>la</strong>ire (i = 1,2,3,4 ...)<br />
j : <strong>la</strong> filière (privée, publique, rurale ou urbaine)<br />
Les effectifs inscrits (S) peuvent s'écrire : S = aP / mY(1+h)<br />
Le taux d'inscription brut sco<strong>la</strong>ire s'écrit pour un cycle donné :<br />
Ts = E / (Mi/Si).w.(1+h) (Ps/p) = ai.Y / mi.bi (Y/P) ( 1+hi).t = ai / mi.bi (1+hi).t<br />
2) L'estimation <strong>de</strong>s flux d'élèves sortants par niveau<br />
Les indicateurs <strong>de</strong> sortants doivent intégrer les taux <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment et les dépenses<br />
d'enseignement afférentes à une cohorte d'élèves au cours du processus éducatif. Les taux <strong>de</strong><br />
ren<strong>de</strong>ment correspon<strong>de</strong>nt aux taux <strong>de</strong> promotion, <strong>de</strong> redoublement et d'abandon. Les sortants So<br />
peuvent être déterminés à partir <strong>de</strong>s variables suivantes :<br />
- <strong>la</strong> part du PIB affectée aux dépenses d'enseignement sur une cohorte : d<br />
- <strong>la</strong> pondération du traitement <strong>de</strong> l'enseignant par rapport au PIB : b<br />
- l'indicateur <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment du système qui représente le nombre d'années enseignants par<br />
sortant<br />
- le volume <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion P<br />
- le nombre d'années-maîtres par sortant, n, ce qui correspond au ren<strong>de</strong>ment interne du<br />
système<br />
- C, le coût année élève = m.w (1+h) = mb Y / P(1+h)<br />
Le nombre <strong>de</strong> sortants So s'écrit :<br />
So = E / C = d.Y / R.BY/P(1+h) = d.P / R.b(1+h)<br />
Le nombre <strong>de</strong> sortants par popu<strong>la</strong>tion s'écrit :<br />
So/P = d / R.Y (1+h).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 262
3.4.4.<br />
L'EMPLOI
Les dynamiques d'emploi en Afrique Subsaharienne,<br />
à l'horizon 2025 : les données <strong>prospective</strong>s du BIT<br />
Il s’agit <strong>de</strong> savoir comment évoluera l'emploi (en volume, structure, qualité) d'ici 2025,<br />
corré<strong>la</strong>tivement aux dynamiques démographiques, entrepreneuriales et sectorielles, macroéconomiques.<br />
Comment évolueront le sous-emploi, le chômage et <strong>la</strong> productivité du travail, donc les<br />
revenus issus du travail, face à <strong>de</strong>s contraintes démographiques données, <strong>de</strong>s contraintes dans le<br />
secteur éducation / formation et ressources humaines, <strong>de</strong>s trajectoires macro-économiques,<br />
financières et institutionnelles déterminantes sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail.<br />
1- Comment évoluera l'offre <strong>de</strong> travail (caractéristiques socio-démographiques et<br />
d’éducation/formation) ?<br />
2- Comment évoluera <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail, <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s entreprises mo<strong>de</strong>rnes et<br />
informelles ? Comment évolueront <strong>la</strong> pluriactivité <strong>de</strong> survie, les activités domestiques. Quels seront<br />
les statuts du travail qui domineront (rupture par une reprise <strong>de</strong> <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>risation ou retour aux formes<br />
traditionnelles, mais hétérogènes et inégales <strong>de</strong> mise au travail ; ou reprise du sa<strong>la</strong>riat sans rupture<br />
majeure, avec coexistence <strong>de</strong> formes hétérogènes ?)<br />
3- Comment évoluera <strong>la</strong> productivité <strong>de</strong>s facteurs (notamment du travail) par secteurs, type <strong>de</strong><br />
main d’œuvre ?<br />
4- Comment se fera <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s ressources par secteur ? Quelles seront les logiques<br />
d'accumu<strong>la</strong>tion ? Comment évolueront <strong>la</strong> redistribution <strong>de</strong>s revenus, les inégalités et <strong>la</strong> pauvreté ?<br />
Les sources en <strong>prospective</strong>s sur l'emploi, sont très réduites. Les seules disponibles sont celles<br />
du BIT, mais elles ne tiennent compte que <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active et non <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion employée (<strong>la</strong>bour force <strong>prospective</strong>s 1950-2010). La popu<strong>la</strong>tion active est mesurée par<br />
âge, par sexe et par pays/région, uniquement.<br />
Autrement, nous disposons <strong>de</strong> statistiques standards sur 1970-97 <strong>de</strong> l'emploi du BIT et <strong>de</strong><br />
quelques statistiques fournies par <strong>la</strong> Banque Mondiale, pour une étu<strong>de</strong> rétrospective.<br />
La Banque Mondiale a fait quelques esquisses en <strong>prospective</strong>s sur l’emploi (Rapport <strong>de</strong> 1995 :<br />
Le Mon<strong>de</strong> du travail dans une économie sans frontières et Labor and the growth crisis in sub-saharan<br />
Africa, 1995)<br />
<strong>Un</strong>e étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> sur l'emploi, si elle doit tenir compte <strong>de</strong>s contraintes démographiques<br />
re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong>s actifs (projections <strong>de</strong> l’Offre <strong>de</strong> travail), exige d'être intégrée dans une<br />
analyse plus sectorielle : développement industriel, essor <strong>de</strong> l’entrepreneuriat, développement<br />
agricole, stratégies <strong>de</strong>s acteurs sur le marché du travail, structure du marché <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation,<br />
éducation ; et dans <strong>de</strong>s projections macro-économiques.<br />
Des premières projections peuvent prendre appui sur <strong>de</strong>s schémas simples, tels que :<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 264
1. L'offre <strong>de</strong> travail<br />
Plusieurs tendances <strong>de</strong> l'emploi sont observées sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1960-1997 et projetées sur 2010,<br />
à partir du traitement <strong>de</strong>s données du BIT et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale, en étudiant parallèlement les<br />
traits démographiques dominants :<br />
1.1 La croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active stagne, à un taux <strong>de</strong> 2 à 3% l'an. Elle tendrait à rejoindre<br />
celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, voire à <strong>la</strong> dépasser à long terme. L'offre <strong>de</strong> travail sera donc plus élevée,<br />
re<strong>la</strong>tivement à l'accroissement démographique.<br />
Ce qui implique une baisse <strong>de</strong>s ratios <strong>de</strong> dépendance (nombre <strong>de</strong> dépendants par rapport à <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion en âge <strong>de</strong> travailler), qui jusqu'à présent stagnent, sauf pour l'Afrique du Sud, où ils<br />
baissent (cf. tableau joint).<br />
1.2 La part <strong>de</strong>s actifs diminuerait par rapport à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale dans certains pays (Côte d'Ivoire,<br />
Nigeria). Mais c'est en sous-estimant les actifs ruraux, notamment les femmes, les enfants et les<br />
jeunes en activité. A long terme, <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s actifs <strong>de</strong>vrait croître.<br />
1.3 Les taux d'activité <strong>de</strong>s femmes augmentent et <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s femmes dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active croît,<br />
mais modérément.<br />
1.4 Les migrants ne constituent plus <strong>de</strong>s flux mais <strong>de</strong>s stocks, en milieu urbain. La contrainte<br />
migratoire tend à changer <strong>de</strong> nature, tandis qu'au même moment, le taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong><br />
l'urbanisation diminue, bien que le taux d'urbanisation croisse (cf. tableau joint).<br />
Les mouvements migratoires intra-africains et internes restent cependant importants. Ils<br />
<strong>de</strong>vraient configurer notablement <strong>la</strong> force <strong>de</strong> travail dans certains pays (Côte d'Ivoire, par exemple),<br />
sous différents aspects (instabilité <strong>de</strong> l'offre <strong>de</strong> travail, flexibilité, qualification réduite, transferts <strong>de</strong><br />
revenus, discrimination sur le marché du travail...).<br />
2. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail<br />
L'évolution <strong>de</strong> l'emploi, tant en volume qu'en structure, est marquée par l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
structure productive d'une part et par les stratégies <strong>de</strong> mise au travail et <strong>de</strong> gestion du travail <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs, d'autre part.<br />
2.1 <strong>Un</strong>e structure productive peu créatrice d'emplois sa<strong>la</strong>riés<br />
La part <strong>de</strong>s actifs agricoles <strong>de</strong>meure prépondérante, même si elle diminue légèrement (sauf<br />
pour le Nigeria et l'Afrique du Sud, où <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s actifs agricoles est plus forte). Cette<br />
baisse se fait à l'avantage <strong>de</strong> l'emploi informel et non <strong>de</strong> l'emploi mo<strong>de</strong>rne, sa<strong>la</strong>rié. Et ce notamment<br />
en Côte d'Ivoire et au Ghana. L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'industrialisation permettra <strong>de</strong> mesurer ces évolutions.<br />
Le sa<strong>la</strong>riat, s'il diminue, se concentre dans certaines branches d'activité soulignant d'une part<br />
une faible diversification <strong>de</strong>s activités (activités primaires, d'extraction et agro-alimentaires, avec une<br />
faible part du manufacturier tel que le textile) et d'autre part, le poids <strong>de</strong> l'emploi sa<strong>la</strong>rié administratif<br />
(non productif).<br />
Des ressemb<strong>la</strong>nces régionales fortes sont observables, à l'exception <strong>de</strong> l'Afrique du Sud,<br />
marquée par un sa<strong>la</strong>riat plus important et plus homogène entre branches d'activité.<br />
Les taux <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>risation diminuent surtout par <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> l'emploi mo<strong>de</strong>rne, mais aussi par un<br />
processus <strong>de</strong> désa<strong>la</strong>risation dans le secteur informel et agricole. La structure productive agricole a<br />
favorisé l'accès à <strong>la</strong> propriété privée plutôt que le sa<strong>la</strong>riat agricole et le travail indépendant et familial<br />
domine dans l'informel.<br />
Mais <strong>la</strong> "fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre" et les questions foncières à venir, peuvent développer un sa<strong>la</strong>riat<br />
agricole, dont il s'agira d'évaluer les formes et <strong>la</strong> structure. De même, l'informel peut créer plus <strong>de</strong><br />
sa<strong>la</strong>riés, dans sa partie supérieure (informel "évolutif"), selon les dynamiques accumu<strong>la</strong>tives<br />
dominantes. Il s’agira <strong>de</strong> différencier ces tendances selon les pays (côtiers, sahéliens, du centre,<br />
etc.…).<br />
Or, on observe un processus <strong>de</strong> tertiairisation, notamment au sein du secteur informel, qui<br />
traduit <strong>la</strong> prédominance <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> survie et <strong>de</strong> diversification <strong>de</strong>s sources <strong>de</strong> revenus, par <strong>la</strong><br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 265
multiplication <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> services et <strong>de</strong> commerce (involution ou accumu<strong>la</strong>tion horizontale<br />
préférée à l'accumu<strong>la</strong>tion verticale).<br />
La productivité du travail diminue par secteurs et est re<strong>la</strong>tivement faible, en milieu rural et dans<br />
les activités informelles (tandis que le productivité du travail du secteur mo<strong>de</strong>rne est <strong>la</strong>rgement<br />
déterminée par l'intensité capitalistique qui le caractérise). Ce qui traduit un fort sous-emploi rural et<br />
informel.<br />
<strong>Un</strong>e pénurie <strong>de</strong> main d'œuvre qualifiée (notamment d'encadrement), caractérise le marché du<br />
travail en ASS, due à un système <strong>de</strong> formation professionnelle défail<strong>la</strong>nte et accentuée par <strong>de</strong>s taux<br />
<strong>de</strong> sco<strong>la</strong>risation faibles (qui réduisent d'autant <strong>la</strong> productivité du travail). Ce qui est à l'origine <strong>de</strong> fortes<br />
distorsions sa<strong>la</strong>riales (notables en Côte d'Ivoire, par exemple).<br />
<strong>Un</strong>e distorsion forte <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> l'emploi, découle <strong>de</strong>s différents blocages structurels,<br />
autant dans le secteur mo<strong>de</strong>rne que dans le secteur informel : entre qualifiés et non qualifiés,<br />
permanents et temporaires non protégés, irréguliers et réguliers, indépendants avec capital et sans<br />
capital, etc., et qu'il s'agirait <strong>de</strong> mieux quantifier.<br />
La déformation <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> l'emploi, à l'avantage <strong>de</strong> l'emploi indépendant et familial et au<br />
détriment du sa<strong>la</strong>riat, ainsi que le processus <strong>de</strong> précarisation du travail (observé tant dans l'informel<br />
que dans le mo<strong>de</strong>rne), pose <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> redistribution <strong>de</strong>s revenus et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté (en milieu<br />
urbain notamment).<br />
2.2 <strong>Un</strong>e structure entrepreneuriale hétérogène<br />
Plusieurs ensembles d'entreprises se chevauchent, ayant chacun leur propre logique et<br />
configurant au marché du travail un aspect segmenté :<br />
<strong>Un</strong> entrepreneuriat privé mo<strong>de</strong>rne, très limité ("îlots capitalistes"), qui développe en son sein<br />
<strong>de</strong>s logiques différenciées : les flexibilités interne et externe se conjuguent, rendant <strong>la</strong> structure <strong>de</strong><br />
l'emploi sa<strong>la</strong>rié très hétérogène, accentuant les distorsions <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ires et <strong>de</strong> statut. La flexibilité<br />
externe est plus propre aux PME (à l'inverse <strong>de</strong> <strong>la</strong> flexibilité interne), mais constitue <strong>de</strong> plus en plus un<br />
volet <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> main d'œuvre "banale" au sein <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s entreprises et <strong>de</strong>s firmes<br />
internationales.<br />
<strong>Un</strong>e tendance à <strong>la</strong> baisse du niveau d'emploi moyen s'observe, traduisant une multiplication<br />
<strong>de</strong>s PME au détriment <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s entreprises (même si celles-ci concentrent 80% <strong>de</strong>s emplois).<br />
Cette tendance en faveur <strong>de</strong>s PME pourrait s'inverser dans un contexte <strong>de</strong> croissance, dans<br />
l'hypothèse où le tissu <strong>de</strong>s PME reste fragile et est le résultat d'une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> crise.<br />
L'existence d'un "missing middle", plus ou moins remis en cause actuellement. En Côte d'Ivoire,<br />
un entrepreneuriat intermédiaire existerait, mais fonctionne avec ses logiques propres (forte mobilité,<br />
flexibilité, non visibilité...) et son développement aurait très peu d'effets d'entraînement sur l'emploi<br />
sa<strong>la</strong>rié.<br />
<strong>Un</strong> micro et petit entrepreneuriat très <strong>la</strong>rge, soumis à <strong>de</strong>s logiques différenciées (<strong>de</strong> survie,<br />
redistributive, d'extension et <strong>de</strong> diversification...), marqué par <strong>de</strong>s formes familiales <strong>de</strong> mise au travail<br />
et temporaires.<br />
3. Quels scénarios à venir ?<br />
Plusieurs scénarios sont possibles et différents selon les régions et pays étudiés, à partir <strong>de</strong><br />
l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s spécialisations régionales et internationales :<br />
3.1 <strong>Un</strong>e spécialisation qui reste confinée dans les produits primaires, impliquant <strong>de</strong>s instabilités et<br />
renforçant les stratégies "courtémistes" <strong>de</strong>s acteurs "informels" et <strong>de</strong>s PME, tandis que seules les<br />
firmes et gran<strong>de</strong>s entreprises exploiteraient ces avantages comparatifs.<br />
3.2 <strong>Un</strong>e spécialisation dans <strong>la</strong> sous-traitance et les activités fortement travaillistiques, <strong>de</strong> par les<br />
faibles coûts sa<strong>la</strong>riaux . Des gains <strong>de</strong> compétitivité peuvent être exploités par les faibles coûts du<br />
travail et <strong>la</strong> forte flexibilité du marché du travail, désormais acquise. Cette tendance renforcerait le<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 266
processus <strong>de</strong> flexibilisation du secteur mo<strong>de</strong>rne observée actuellement, mais aussi <strong>de</strong> soustraitance<br />
auprès d'entreprises informelles (encore peu observée à l'heure actuelle). Elle é<strong>la</strong>rgirait<br />
l'entrepreneuriat privé (encore réduit) et pourrait favoriser les investissements étrangers. Il y aurait<br />
donc rupture et possibilité <strong>de</strong> développement sur d'autres avantages comparatifs, si les conditions<br />
préa<strong>la</strong>bles sont requises cf. cas <strong>de</strong> l'Asie).<br />
3.3 <strong>Un</strong>e spécialisation plus portée sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s produits, ce qui exige <strong>de</strong>s dotations fortes en<br />
ressources humaines, une amélioration <strong>de</strong>s productivités du travail et <strong>de</strong>s sauts technologiques<br />
(passage à l'intensif). Il s'agirait ici d'une rupture optimiste.<br />
3.4 <strong>Un</strong>e combinaison <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou <strong>de</strong>s trois scénarios ci-<strong>de</strong>ssus, dans un même pays ou une même<br />
région. L’analyse <strong>de</strong>s effets d’entraînement régionaux serait intéressante.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 267
PROSPECTIVES DE POPULATION ACTIVE 1950-2010, BIT,<br />
SITUATION – OBJECTIFS – METHODOLOGIE<br />
GENEVE, 1998<br />
Il s’agit <strong>de</strong> <strong>la</strong> cinquième édition <strong>de</strong>s évaluations et projections <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active 1950-<br />
2010.<br />
Le modèle vise à produire <strong>de</strong>s estimations annuelles mondiales et régionales sur <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
active, sur l’emploi et le chômage, sur les rapports emploi/popu<strong>la</strong>tion pare sexe et le cas échéant sur<br />
une distinction entre secteur structuré et secteur non structuré.<br />
Les sources : enquêtes auprès <strong>de</strong>s ménages, auprès <strong>de</strong>s établissements et dossiers<br />
administratifs.<br />
Les taux d’activité sont calculés à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion économiquement active âgée <strong>de</strong> 10<br />
ans et plus.<br />
Pour l’Afrique sub-saharienne, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active est mesurée par âge, par sexe et par<br />
pays/région, uniquement. <strong>Un</strong> travail <strong>de</strong> synthèse statistique a été fait à partir <strong>de</strong>s données brutes<br />
recueillies au BIT (cf. tableaux joints).<br />
RESUME ET PRINCIPAUX RESULTATS<br />
Pour les statistiques <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion active en Afrique sub-saharienne, le traitement <strong>de</strong>s données<br />
donnent les résultats suivants :<br />
Plusieurs tendances <strong>de</strong> l'emploi sont observées sur 1950-2010, en étudiant parallèlement les<br />
traits démographiques dominants :<br />
• La croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active stagne, à un taux <strong>de</strong> 2 à 3% l'an. Elle tendrait à<br />
rejoindre <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, voire à <strong>la</strong> dépasser, mais seulement à long terme.<br />
L'offre <strong>de</strong> travail sera donc plus élevée, re<strong>la</strong>tivement à l'accroissement démographique. Ce<br />
qui impliquera une baisse <strong>de</strong>s ratios <strong>de</strong> dépendance (nombre <strong>de</strong> dépendants par rapport à <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion en âge <strong>de</strong> travailler), qui jusqu'à présent stagnent, sauf pour l'Afrique du Sud, où<br />
ils baissent.<br />
• La part <strong>de</strong>s actifs diminue par rapport à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale dans certains pays (Côte<br />
d'Ivoire, Nigeria). Mais c'est en sous-estimant les actifs ruraux, notamment les femmes, les<br />
enfants et les jeunes en activité. A long terme, <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s actifs <strong>de</strong>vrait croître.<br />
• Les taux d'activité <strong>de</strong>s femmes augmenteront et <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s femmes dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
active croîtra, mais modérément. Les taux d’activités <strong>de</strong>s jeunes (15-24 ans) augmentent<br />
aussi.<br />
Globalement, les actifs seront <strong>de</strong> plus en plus nombreux re<strong>la</strong>tivement à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
totale, avec une plus forte participation <strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>s jeunes.<br />
REMARQUES, CRITIQUES ET EVALUATION<br />
La méthodologie s’appuie uniquement sur <strong>de</strong>s projections <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion standards ( a<br />
compléter)<br />
Les statistiques produites sont limitées à l’analyse <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> travail à partir <strong>de</strong>s tendances<br />
démographiques.<br />
Limites <strong>de</strong>s sources (nationales, peu diversifiées.. .) ; sous estimations <strong>de</strong>s taux d’activité <strong>de</strong>s<br />
enfants, <strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>s plus <strong>de</strong> 65 ans (mais biais statistiques difficiles à lever, sans <strong>de</strong>s lour<strong>de</strong>s<br />
enquêtes nationales ; comme par exemple les enquêtes emploi du temps).<br />
<strong>Un</strong>e étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong> sur l'emploi exige d'être intégrée dans une analyse plus globale, tenant<br />
compte en plus <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> travail, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail (<strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s secteurs éducatifs, <strong>de</strong><br />
formation, industriels, agricole, etc.).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 268
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 269
LES DYNAMIQUES D’EMPLOI EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE<br />
EN L’AN 2010,<br />
Banque Mondiale, 1995<br />
SITUATION – OBJECTIFS – MÉTHODOLOGIE<br />
Il n’y a pas d’ouvrage proprement dit sur <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>de</strong> l’emploi édité par <strong>la</strong> Banque Mondiale ;<br />
mais <strong>de</strong>s chapitres sont consacrés à ce thème dans les rapports récents sur l’emploi : Le mon<strong>de</strong> du<br />
travail dans une économie sans frontières Rapport sur le Développement dans le mon<strong>de</strong> 1995 et<br />
Labor and the growth crisis in sub-saharan Africa, Regional perspectives on World Development<br />
Report 1995, Washington DC.<br />
La Banque Mondiale a mis en p<strong>la</strong>ce un modèle d’économie mondiale, qui simule <strong>de</strong>ux scénarios<br />
mondiaux (in “ Quel XXIe siècle pour les travailleurs ? ” Cinquième partie du Rapport <strong>de</strong> 1995), pour<br />
l’an 2010 :<br />
• <strong>Un</strong> scénario <strong>de</strong> divergence (pessimiste ou scénario d’inertie), qui voit les inégalités se<br />
creuser entre régions du mon<strong>de</strong>, avec persistance <strong>de</strong>s tendances passées (en termes<br />
d’investissement, d’éducation, <strong>de</strong> productivité du travail, d’inégalités <strong>de</strong> revenus du travail,<br />
tendance au protectionnisme international).<br />
• <strong>Un</strong> scénario <strong>de</strong> convergence (optimiste), qui voit les pays saisir <strong>de</strong>s opportunités <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mondialisation (meilleure intégration internationale, hausse <strong>de</strong>s taux d’investissement, <strong>de</strong>s taux<br />
d’éducation (quantité et qualité), <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> capitaux, libéralisation commerciale, transfert<br />
technologique…)<br />
Ces scénarios ont pour objectif principal d’indiquer les conséquences <strong>de</strong> certains choix <strong>de</strong> politiques<br />
économiques (marginalisation croissante ou au contraire intégration internationale par une<br />
libéralisation plus poussée). Les chiffres résultants <strong>de</strong> ces scénarios sont <strong>de</strong>s projections fondées sur<br />
un grand nombre d’hypothèses, non détaillées (cf. Lewis, Robinson et Wang et estimations <strong>de</strong>s<br />
services <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiales). Il s’agit surtout <strong>de</strong> tendances futures observables dans les effets<br />
produits <strong>de</strong> politiques économiques, tant à un niveau interne qu’externe.<br />
RÉSUMÉ ET PRINCIPAUX RÉSULTATS<br />
La situation <strong>de</strong>s travailleurs s’améliorent à partir d’une hypothèse <strong>de</strong> base <strong>de</strong> meilleure réallocation<br />
<strong>de</strong>s ressources et <strong>de</strong> certains seuils atteints par l’investissement (équipement, infrastructure,<br />
technologie, instruction), avec comme conditions préa<strong>la</strong>bles une hausse <strong>de</strong> l’épargne, une réduction<br />
<strong>de</strong>s déficits publics budgétaires dans les pays riches, <strong>de</strong>s flux raisonnables <strong>de</strong> capitaux<br />
internationaux. Sont projetés les taux d’investissement, d’éducation, <strong>de</strong> productivité <strong>de</strong>s facteurs, <strong>de</strong><br />
croissance du revenu par tête et <strong>de</strong>s exportations. Les sa<strong>la</strong>ires réels seront alors 50% plus élevés<br />
qu’aujourd’hui, dans le scénario <strong>de</strong> convergence, qui exige <strong>de</strong>s taux élevés d’investissement en<br />
capital humain et physique et en gains <strong>de</strong> productivité globale, ainsi qu’un changement dans <strong>la</strong><br />
division internationale du travail. Ce scénario exige aussi une politique du travail favorable aux actifs<br />
informels et ruraux et réductrice <strong>de</strong>s inégalités sectorielles et <strong>de</strong>s distorsions du marché du travail<br />
(plus gran<strong>de</strong> flexibilité).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 270
Projections <strong>de</strong>s gains sa<strong>la</strong>riaux en Afrique sub-saharienne pour l’an 2010<br />
(pourcentage 1994-2010)<br />
Hypothèses <strong>de</strong> base pour 2010<br />
Part <strong>de</strong> l’Investissement dans le PIB (%)<br />
Moyenne d’années <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>rité<br />
Croissance annuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité totale <strong>de</strong>s facteurs (%)<br />
Croissance économique (%)<br />
Croissance PIB/tête (moyenne annuelle)<br />
Croissance exportations (moyenne annuelle)<br />
Croissance <strong>de</strong>s gains sa<strong>la</strong>riaux (%)<br />
Des travailleurs non qualifiés<br />
Des travailleurs qualifiés<br />
Scénario <strong>de</strong> divergence Scénario <strong>de</strong> convergence<br />
La hausse <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail est favorable au travail non qualifié en Afrique sub-saharienne (en<br />
raison <strong>de</strong> sa spécialisation et d’avantages comparatifs maintenus); les écarts <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire diminueraient<br />
à l’échelle internationale (écart <strong>de</strong> 60 pour 1 en 1994, entre travailleurs qualifiés <strong>de</strong> pays industriels et<br />
paysans d’Afrique à un écart <strong>de</strong> 50 à 1 en 2010) et à l’échelle régionale et nationale.<br />
Le scénario <strong>de</strong> convergence repose sur <strong>de</strong>s hypothèses fortes. La hausse <strong>de</strong> l’investissement doit<br />
être spectacu<strong>la</strong>ire face aux contraintes démographiques que connaît l’Afrique ; les gains <strong>de</strong><br />
productivité doivent fortement croître, notamment dans l’agriculture ; <strong>la</strong> hausse prévue <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s<br />
biens alimentaires mondiaux serait favorable aux paysans, mais seulement dans le cas <strong>de</strong> réformes<br />
agricoles bien structurées.<br />
L’Afrique doit s’assurer les marchés <strong>de</strong>s produits agricoles et miniers et compenser les pertes subie<br />
par les négociations <strong>de</strong> l’Uruguay Round (forte concurrence dans le secteur manufacturier et dans<br />
l’exploitation <strong>de</strong>s ressources naturelles, <strong>de</strong>s pays d’Asie et d’Amérique <strong>la</strong>tine).<br />
Enfin, <strong>la</strong> crédibilité <strong>de</strong>s programmes et <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s est un facteur décisif évoqué en<br />
<strong>de</strong>rnier lieu.<br />
REMARQUES, CRITIQUES ET EVALUATION<br />
Les scénarios sont c<strong>la</strong>ssiques et peu complexifiés (pessimiste/optimiste) ; ils s’appuient sur <strong>de</strong>s<br />
hypothèses c<strong>la</strong>ssiques <strong>de</strong> libéralisation et d’ouverture internationale.<br />
L’intégration internationale <strong>de</strong> l’Afrique (scénario <strong>de</strong> convergence) s’appuie uniquement sur les<br />
avantages en ressources naturelles ; l’Afrique <strong>de</strong>vient exportateur majeur <strong>de</strong> produits agricoles, dans<br />
une perspective mondiale <strong>de</strong>ssinée à travers une échelle technologique : les pays industrialisés suivis<br />
<strong>de</strong>s NPI se spécialisent dans les produits à haute technicité, les pays d’Amérique <strong>la</strong>tine, du Moyen<br />
Orient commencent à maîtriser <strong>de</strong>s produits à moyenne technicité, <strong>la</strong> Chine et l’In<strong>de</strong> sont les plus gros<br />
exportateurs <strong>de</strong>s produits à forts coefficients <strong>de</strong> main d’œuvre. La primarisation <strong>de</strong>s économies<br />
<strong>africaine</strong>s se poursuit dans le scénario optimiste.<br />
Ne sont projetés que les gains sa<strong>la</strong>riaux, en distinguant qualifiés et non qualifiés. Or, il serait intéressant <strong>de</strong><br />
projeter aussi <strong>de</strong>s données sur les revenus non sa<strong>la</strong>riaux, dans <strong>de</strong>s pays à faible sa<strong>la</strong>riat. Des projections <strong>de</strong><br />
données d’emploi (par secteur, type d’emploi, c<strong>la</strong>ssification socioprofessionnelle…) seraient aussi intéressantes<br />
a obtenir.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 271<br />
16<br />
2,6<br />
0,5<br />
-0,3<br />
3,6<br />
6<br />
9<br />
25<br />
2,8<br />
1,4<br />
1,7<br />
6,7<br />
44<br />
49
3.4.5.<br />
ENERGIE<br />
MATIERES PREMIERES
PROSPECTIVES DE L'ENERGIE ET DES MARCHES<br />
DES MATIERES PREMIERES<br />
Dans l'ensemble <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s ou <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s portant sur les marchés<br />
<strong>de</strong>s matières premières, il est frappant <strong>de</strong> constater <strong>la</strong> faible part consacrée à l'ASS. L'importance <strong>de</strong><br />
l'évolution <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s matières premières pour l'évolution à long terme <strong>de</strong> l'ASS est pourtant<br />
incontournable, compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation internationale, et du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> dépendance <strong>de</strong> celle-ci<br />
vis à vis <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> quelques matières premières.<br />
Les <strong>prospective</strong>s sur les différents marchés <strong>de</strong>s matières premières sont en nombre limité, et sont<br />
souvent incluses dans <strong>de</strong>s travaux portant sur les thèmes <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s les plus analysés:<br />
· L'énergie, où le pétrole occupe <strong>la</strong> première p<strong>la</strong>ce,<br />
· La sécurité alimentaire,<br />
Les ressources naturelles.<br />
Les étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s générales sur les marchés <strong>de</strong>s matières premières<br />
Les prévisions à 10 ou 15 ans <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale<br />
Basées (directement ou indirectement) sur <strong>la</strong> projection <strong>de</strong>s tendances antérieures, les analyses <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Banque Mondiale regroupées dans <strong>la</strong> revue "Commodity Markets and the Developing Countries" (cf.<br />
fiche Banque Mondiale) aboutissent au prolongement à moyen long terme <strong>de</strong>s tendances récentes<br />
(cf. annexe n"1). Compte tenu <strong>de</strong>s mauvaises performances <strong>de</strong>s prévisions passées <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque<br />
Mondiale, <strong>la</strong> méthodologie suivie pour ces projections apportent <strong>de</strong>s résultats qui n'ont qu'un intérêt<br />
re<strong>la</strong>tif pour <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> à long terme. Ce constat a été repris par <strong>la</strong> majeure partie <strong>de</strong>s intervenants<br />
du colloque "Dynamique <strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s matières premières: analyse et prévision", tenu<br />
à Grenoble les 5 et 6 novembre 1998, sous l'égi<strong>de</strong> du Gammap (cf. fiche Gammap). Les modèles <strong>de</strong><br />
prévision <strong>de</strong>s prix restent très imparfaits pour définir l'évolution effective <strong>de</strong>s cours, et ne sont que<br />
d'une faible pertinence pour <strong>la</strong> <strong>prospective</strong>. <strong>Un</strong>e dimension fondamentale <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s cours est<br />
celle <strong>de</strong>s ruptures <strong>de</strong> tendance, intégrées dans l'analyse économétrique par <strong>la</strong> définition <strong>de</strong> variables<br />
muettes. Ex post, l'intégration <strong>de</strong> telles variables est indispensable au bon fonctionnement <strong>de</strong>s<br />
modèles; ex ante, toute <strong>la</strong> difficulté rési<strong>de</strong> dans <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>s moments <strong>de</strong> ces ruptures, et <strong>de</strong> leur<br />
signification.<br />
Les analyses qualitatives menées par le GAMMAP<br />
La définition <strong>de</strong> "régimes concurrentiels surréactifs" pour caractériser le fonctionnement <strong>de</strong>s marchés<br />
<strong>de</strong>s matières premières conduit S. Ca<strong>la</strong>bre à anticiper un maintien d'une très forte vo<strong>la</strong>tilité <strong>de</strong>s prix<br />
tant que ce régime persistera. L'hypothèse faite dans un horizon <strong>de</strong> moyen long terme est celui du<br />
maintien <strong>de</strong> ce régime. L'instabilité resterait alors <strong>la</strong> principale caractéristique <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s cours<br />
<strong>de</strong>s matières premières.<br />
Les étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s sectorielles sur les marchés <strong>de</strong>s matières premières<br />
A notre connaissance, seul le CIRAD (cf. fiches agriculture et CIRAD) a tenté <strong>de</strong> délivré une véritable<br />
analyse <strong>prospective</strong> en terme <strong>de</strong> filière sur une matière première agricole: le cacao. Les résultats<br />
présentés en fonction <strong>de</strong> trois scénarios (déclin, stagnation ou hausse), permettent d'i<strong>de</strong>ntifier un<br />
certain nombre <strong>de</strong> ruptures possibles dans l'évolution <strong>de</strong> cette filière. Par contre, aucun effet <strong>de</strong> "feedback"<br />
n'est pris en compte au niveau <strong>de</strong>s marchés mondiaux du cacao, et l'évolution <strong>de</strong>s prix sur ces<br />
marchés n'est pas retenu comme variable pertinente.<br />
Les étu<strong>de</strong>s sur l'énergie<br />
Les étu<strong>de</strong>s disponibles sur l'évolution mondiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation et <strong>de</strong> <strong>la</strong> production énergétiques<br />
au niveau mondial (cf. fiches IEPE et EIA) ne consacrent qu'une faible part à l'ASS. Ceci tient à l'idée<br />
que l'ASS restera marginale aussi bien en terme <strong>de</strong> production qu'en terme <strong>de</strong> consommation<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 274
d'énergie. Au niveau mondial, un certain consensus apparaît dans les différentes analyses en ce qui<br />
concerne :<br />
· Le rôle croissant <strong>de</strong> l'Arabie Saoudite dans l'approvisionnement mondial en pétrole.<br />
· Le rôle toujours marginal joué par l'Afrique.<br />
<strong>Un</strong> prix du baril <strong>de</strong> pétrole compris entre 20 et 30 $ en 2015.<br />
Le cadrage fait par l'USGS<br />
Dans les analyses rassemblées par l'USGS sur son site internet (cf. fiche correspondante), il est<br />
frappant, pourtant, <strong>de</strong> constater l'importance stratégique accordée à certaines régions d'Afrique<br />
subsaharienne, au niveau <strong>de</strong>s ressources pétrolières (<strong>de</strong>lta du Niger), comme au niveau <strong>de</strong> certaines<br />
ressources minières (Afrique du Sud). L'importance stratégique accordé par l'USGS à ces régions ne<br />
transparaît pas dans les analyses <strong>prospective</strong>s disponibles.<br />
"USGS World Energy Program"<br />
Objectif : rassembler les informations nécessaires pour définir les ressources énergétiques mondiales.<br />
Définition <strong>de</strong> 8 régions dans le mon<strong>de</strong>, sur une base géologique et politique. L'ASS est <strong>la</strong> 7' région,<br />
dont <strong>de</strong>ux « provinces » sont stratégiques pour l'industrie pétrolière: le <strong>de</strong>lta du Niger et <strong>la</strong> Côte sud<br />
ouest. Le <strong>de</strong>lta du Niger est c<strong>la</strong>ssée 10' par ordre d'importance stratégique, <strong>la</strong> Côte sud ouest est<br />
c<strong>la</strong>ssée 23', sur 76 provinces enregistrées au niveau mondial. Deux autres « provinces » d'Afrique<br />
sont c<strong>la</strong>ssées sous <strong>la</strong> dénomination « boutiques », exprimant leur intérêt stratégique potentiel (cf.<br />
documents internet). Fournit <strong>de</strong>s estimations <strong>de</strong>s ressources énergétiques <strong>de</strong>s différentes régions du<br />
globe.<br />
Les étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> sécurité alimentaire<br />
Les étu<strong>de</strong>s effectuées au sein <strong>de</strong> I'IFPRI (cf. fiche correspondante) intègrent <strong>de</strong>s éléments prospectifs<br />
sur les marchés alimentaires mondiaux, en analysant les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> libéralisation sur les cours<br />
mondiaux, ainsi que l'évolution <strong>de</strong>s consommations <strong>de</strong>s principaux pays, où <strong>la</strong> Chine apparaît comme<br />
une incertitu<strong>de</strong> majeure.<br />
La conclusion principale <strong>de</strong> ces étu<strong>de</strong>s, du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s marchés mondiaux est celle d'un maintien<br />
d'une très gran<strong>de</strong> instabilité <strong>de</strong>s cours à moyen, long terme, après une phase <strong>de</strong> baisse éventuelle à<br />
court terme. Les conclusions <strong>de</strong>s analyses <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO sont <strong>de</strong> même nature.<br />
Conclusion<br />
Des rares éléments <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> portant sur l'évolution <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s matières premières, il est<br />
possible <strong>de</strong> dégager un certain nombre <strong>de</strong> conclusions:<br />
· Seule <strong>la</strong> Banque Mondiale publie <strong>de</strong>s prévisions quantitatives, pour l'ensemble <strong>de</strong>s matières<br />
premières, à l'horizon 2010. Celles-ci mettent en avant une détérioration continue et limitée <strong>de</strong>s<br />
cours <strong>de</strong>s matières premières dans leur ensemble (cf. annexe 1).<br />
· Dans une perspective mondiale, les marchés <strong>de</strong>s matières premières d'ici à l'horizon 2020 se<br />
caractériseraient par le maintien d'un <strong>de</strong>gré élevé d'instabilité. Soit du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> diminution <strong>de</strong>s<br />
stocks mondiaux (marchés céréaliers), soit du fait du maintien <strong>de</strong> coalitions instables (pétrole),<br />
soit par maintien <strong>de</strong>s régimes « concurrentiels surréactifs » actuels. Cette instabilité rend plus<br />
délicat l'exercice d'une <strong>prospective</strong> quantitative, compte tenu <strong>de</strong>s ruptures probables <strong>de</strong> régimes,<br />
ou <strong>de</strong>s chocs associés à <strong>de</strong>s événements aléatoires qui peuvent survenir sur ces marchés.<br />
· Les exercices <strong>de</strong> rétrospective permettent <strong>de</strong> mettre à jour l'importance <strong>de</strong>s ruptures structurelles<br />
dans l'évolution <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s matières premières sur un horizon <strong>de</strong> 25 ans. Le prolongement<br />
<strong>de</strong>s tendances antérieures pour définir <strong>la</strong> situation future comporte <strong>de</strong>s limites très fortes; un tel<br />
exercice ne permet pas <strong>de</strong> retrouver l'évolution passée <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s matières<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 275
premières. C'est bien une analyse <strong>de</strong>s ruptures possibles à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition <strong>de</strong> variables<br />
critiques qui doit constituer <strong>la</strong> base d'une <strong>prospective</strong> sur les marchés <strong>de</strong>s matières premières.<br />
· Les implications pour l'ASS du maintien <strong>de</strong> cours instables sont extrêmement importantes, et<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt à être encore précisées. L'expérience <strong>de</strong>s années 70 et 80, caractérisées par un forte<br />
instabilité <strong>de</strong>s cours, a mis à jour <strong>la</strong> vulnérabilité <strong>de</strong>s économies d'ASS aux chocs provenant <strong>de</strong>s<br />
marchés mondiaux. Les débats autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition <strong>de</strong> "bonnes" politiques <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />
chocs extérieurs reposent in fine sur <strong>la</strong> nature postulée <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s cours, et les<br />
conclusions <strong>de</strong> ces analyses doivent être prises en compte pour <strong>la</strong> définition du <strong>de</strong>venir à long<br />
terme <strong>de</strong> l'ASS.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 276
ANNEXE N° 1<br />
<strong>Un</strong> aperçu <strong>de</strong>s prévisions effectuées au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque mondiale<br />
Les prévisions sur l'évolution <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s matières premières effectuées par <strong>la</strong> Banque Mondiale<br />
sont publiées régulièrement <strong>de</strong>puis 1993 dans <strong>la</strong> revue trimestrielle «Commodity Markets and the<br />
Developing Countries ». L'évolution <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> 46 produits <strong>de</strong> base sont rassemblées, à un horizon<br />
<strong>de</strong> 1, 2 et 3 ans, et à l'horizon 2005 et 2010 (pour l'année 1997). Ces prévisions servent <strong>de</strong> référence<br />
dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s analyses <strong>prospective</strong>s, au niveau micro-économique (ex: CFD) comme au niveau<br />
global (ex: OMC).<br />
La méthodologie suivie dans l'établissement <strong>de</strong>s prévisions à long terme, celles qui nous intéressent<br />
ici, repose essentiellement sur les perspectives d'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> mondiale en produits<br />
primaires (le taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s pays « développés »). Relier l'évolution <strong>de</strong> l'indice global du<br />
cours matières premières à l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> mondiale donne <strong>de</strong>s résultats plus ou moins<br />
bons selon l'horizon temporel retenu, et surtout selon <strong>la</strong> prise en compte ou non <strong>de</strong> variables muettes<br />
traduisant l'impact <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> régime sur les marchés <strong>de</strong>s matières premières. Sans<br />
introduction <strong>de</strong> variables « structurelles », les prévisions sont <strong>de</strong> qualité réduite. A long terme, c'est<br />
donc bien <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s changements structurels qui peuvent se produire qui est pertinente pour <strong>la</strong><br />
<strong>prospective</strong> 15 .<br />
Les <strong>de</strong>rniers résultats présentés par <strong>la</strong> Banque Mondiale au niveau <strong>de</strong>s indices globaux <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s<br />
matières premières sont rassemblés dans le graphique ci-après.<br />
Indice du prix <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> base hors énergie (33 produits),<br />
dol<strong>la</strong>rs constants, 1948-2005, Banque Mondiale<br />
Source: Commodity Markets and the Developing Countries, Août 1997. Note : Les données à partir <strong>de</strong> 1997 sont <strong>de</strong>s<br />
prévisions. Les indices en Dol<strong>la</strong>rs courants sont déf<strong>la</strong>tés par le G5 MUV In<strong>de</strong>x.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 277
A plus long terme, les prévisions <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale pour 201 0 représentent une poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lente dégradation <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> base, à partir d'un niveau historiquement bas (cf.<br />
graphique ci-après).<br />
" Ainsi, les prévisions effectuées par le FNU ont été améliorées par <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> nouvelles<br />
variables traduisant l'impact <strong>de</strong>s changements d'insertion internationale <strong>de</strong>s pays d'Europe <strong>de</strong> l'Est.<br />
indice du prix <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> base hors énergie, Banque Mondiale,<br />
dol<strong>la</strong>rs constants<br />
Source: Commodity Markets and the Developing Countries, Mars 1994.<br />
Note : Les données à partir <strong>de</strong> 1997 sont <strong>de</strong>s prévisions. Les indices en dol<strong>la</strong>rs courants sont déf<strong>la</strong>tés par le G5 MUV In<strong>de</strong>x.<br />
Les différences d'avec le graphique précé<strong>de</strong>nt sont dues aux changements dans les pondérations <strong>de</strong>s différents produits,<br />
pondérations établies en fonction du poids <strong>de</strong>s exportations <strong>de</strong>s différents produits dans les valeurs <strong>de</strong>s exportations <strong>de</strong>s<br />
économies à revenu intermédiaire ou faible.<br />
Les modèles explicatifs globaux <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> base reposent<br />
essentiellement sur les évolutions <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pays les plus développés. Dans différentes<br />
étu<strong>de</strong>s (Banque Mondiale ou FMI), c'est le principal facteur explicatif, parmi les trois facteurs retenus<br />
comme variables explicatives <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> base à<br />
1. L'indice <strong>de</strong> <strong>la</strong> production industrielle <strong>de</strong>s 7 pays les plus « développés ».<br />
2. L'indice <strong>de</strong> l'évolution du taux <strong>de</strong> change <strong>de</strong> ces mêmes pays vis à vis du dol<strong>la</strong>rs US.<br />
3. L'indice <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> gros.<br />
Dans les différentes analyses économétriques étudiées, les facteurs d'offre sont traités par <strong>de</strong>s<br />
variables muettes choisies ex-post, ce qui n'est pas d'une gran<strong>de</strong> utilité pour <strong>la</strong> <strong>prospective</strong>... On<br />
retrouve cette solution (qui permet d'augmenter <strong>de</strong> façon significative le pouvoir explicatif <strong>de</strong>s<br />
régressions effectuées) dans les travaux étudiant, en série temporelle, l'évolution <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong><br />
l'échange à long terme (cf. Leon et Soto 1996 par exemple). La très gran<strong>de</strong> sensibilité <strong>de</strong>s résultats au<br />
choix <strong>de</strong>s variables muettes conduit à s'interroger sur <strong>la</strong> pertinence <strong>de</strong> tels modèles pour <strong>la</strong><br />
<strong>prospective</strong>. A un horizon <strong>de</strong> long terme, c'est <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> changements éventuels <strong>de</strong><br />
régime, <strong>de</strong> changements structurels qui est essentielle.<br />
En ce qui concerne <strong>la</strong> tendance à long terme <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l'échange, les résultats <strong>de</strong>s nombreuses<br />
étu<strong>de</strong>s effectuées soulignent l'existence d'une tendance négative, très faible selon certains auteurs<br />
(cf. Leon et Soto 1996), plus significatives selon d'autres étu<strong>de</strong>s.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 278
BIBLIOGRAPHIE:<br />
Note : Les étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s sur les marchés <strong>de</strong>s matières premières sont référencées dans les<br />
fiches <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> recherche cités dans le texte.<br />
Akiyama T. et Larson D.F. 1994: The Adding-Up Problem - Strategies for Primary Commodity Exports<br />
in Sub-Saharan Africa " Policy Research Working Paper nol 245, Banque Mondiale, Janvier.<br />
Basu P. et Mc Leod D. 1992: Terms of tra<strong>de</strong> fluctuations and economic growth in <strong>de</strong>veloping<br />
economies ", Journal of Development Economics 37, pp 89-1 1 0.<br />
Bevan D.L., Collier P. et Gunning J.W. 1987 ' Consequences of a Commodity Boom in a Controlled<br />
Economy, World Bank Economic Review 1, pp 489-513.<br />
Chang P.H.K. 1991: Export diversification and international <strong>de</strong>bt un<strong>de</strong>r terms of tra<strong>de</strong> uncertainty - An<br />
intertemporai approach ", Journal of Development Economics 36, pp 259-279.<br />
Choi E.K. et Lapan H.E. 1991: ' Optimal tra<strong>de</strong> policies for a <strong>de</strong>veloping country un<strong>de</strong>r uncertainty,<br />
Journal of Development Economics 35, pp 243-260.<br />
C<strong>la</strong>essens S. et Varangis P. 1994, Commodity Risk Mnagement în Developing Countries, in<br />
Derivative Instruments and Hedging Strategies for Emerging Capital Markets ", Tsetse kos G. et<br />
Papouiannou M. eds, Dow Jones Irwin.<br />
Collier P. et Gunning J.W. 1994: ' Tra<strong>de</strong> Shocks - Consequences and Policy Responses in Developing<br />
Countries ", International Center for Economic Growth Occasional Papers no 5l.<br />
Collier P. et Gunning J.W. 1995: ' Tra<strong>de</strong> Shocks: Theory and Experience ", mimeo, 55 pp.<br />
Cor<strong>de</strong>n M.W. et Neary J. P. 1982 ' Booming Sector and De-industrialization in a Smail Open Economy<br />
"The Economic Journal, décembre.<br />
Cuddington J.T., Liang H. et Lu S. 1995 ' <strong>Un</strong>certainty, Tra<strong>de</strong>, and Capital Flows in Sub-Saharan Africa<br />
" ' Working Paper no6, Georgetown <strong>Un</strong>iversity, Washington DC.<br />
Deaton A.S. 1992: ' Commodity prices, stabilization, and growth in Africa " Discussion Paper nol66,<br />
Princeton <strong>Un</strong>iversity, 35 pp.<br />
Géronimi V. 1992: 'Les économies pétrolières du golfe <strong>de</strong> guinée face aux chocs: apports et limites<br />
<strong>de</strong>s modèles du syndrome hol<strong>la</strong>ndais " thèse Paris X Nanterre, 506 pp.<br />
Géronimi V. et Hugon Ph. 1995: Instabilité <strong>de</strong>s recettes d'exportation, et changements <strong>de</strong> trajectoires<br />
<strong>de</strong>s économies <strong>africaine</strong>s, in L'Afrique <strong>de</strong>s Incertitu<strong>de</strong>s, IEDES Collection Tiers Mon<strong>de</strong> PUF, pp<br />
17-39.<br />
Hugon Ph., Pourcet G. et Quiers-Valette S., L'Afrique <strong>de</strong>s Incertitu<strong>de</strong>s, IEDES Collection Tiers Mon<strong>de</strong>,<br />
PUF, pp 17-39.<br />
Grilli E.M. et Yang M.C. 1988 ' Primary Commodity Prices, Manufactured Goods Prices, and the<br />
Terms of tra<strong>de</strong> of Developîng Countries: What th Long Run Shows " The World Bank Economic<br />
Review Vol. 9, no3.<br />
Gyinah-Brempong K. 1991 'Export lnstability and Economîc Growth in Sub-Saharan Africa Economic<br />
<strong>de</strong>velopment and Cultural change, Chicago.<br />
Love J. 1992 ' Export Instabilité and the Domestic Economy.- Questions of Causatity ", The Journal of<br />
Development Studies vol. 28, no4, Juillet.<br />
Helpman E. et Razin A. 1978 ' <strong>Un</strong>certainty and International Tra<strong>de</strong> in the Presence of Stocks Markets '<br />
Review of Economic Studies 45, pp 239-250.<br />
Knudsen O.K. et Yotopoulos P.A. 1976 'A Transitory lncome Approach to Export lnstability " Food<br />
Research Instituts Studies 15, pp 91-108.<br />
Krugman P. 1987: ' The Narrow Moving Band, The Dutch Disease, and The Competitive<br />
Consequences of Mrs Thatcher ", Journal of Development Economics 27, pp 41-55.<br />
Leon J. et Soto R. 1995 'Structurai Breaks and Long-Run Trends in Commodity Prices " Policy<br />
Research Working Paper n"1406, Banque Mondiale, Janvier.<br />
Ntamatungiro J. 1988: ' Stabilisation <strong>de</strong>s recettes d'exportation: stock régulteur, contrat à terme et<br />
options " Economica, roll. Gestion.<br />
P<strong>la</strong>isance E. 1995: - Le développement <strong>de</strong>s marchés d'options comme forme d'organisation d'un<br />
produit " dans 'Matières premières, marchés mondiaux, déséquilibres, organisation ", sous <strong>la</strong><br />
direction <strong>de</strong> S. Ca<strong>la</strong>bre, Economica.<br />
Ray G.F. 1976 ' Opinion surveys as an instrument of commodité price forecasting " dans ' Primary<br />
commodity prices: analyses and forecasting ", Driehuis W. eds, 1976, Rotterdam <strong>Un</strong>iversity<br />
Press.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 279
Van Wijnbergen S. 1984 ' The Dutch Disease: A Disease After Ait ? ", The Economic Journal 92,<br />
Mars.<br />
Varangis P., Thigpen E. et Satyanarayan S. 1994 ' The Use of New York Cotton Futures Contracts to<br />
Hedge Cotton Price Risk in Developing Countries ", Policy Research Working Paper n'1328,<br />
Banque Mondiale, Juillet.<br />
Varangis P. et Larson D. 1996: 'Dealing with Commodity Price <strong>Un</strong>certainty ", Policy Research Working<br />
Paper n"1667, Banque Mondiale, Octobre.<br />
Yabuki N. et Akiyama T. 1996: Is Commodity-Depen<strong>de</strong>nce Pessîmism Justified ? ", Policy Research<br />
Working Paper nol600, Banque Mondiale, Mai.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 280
ENERGIE 2010-2020<br />
Paris : Commissariat général du P<strong>la</strong>n, 1998<br />
Ce rapport en cinq volumes se compose d'une synthèse <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 500 pages, œuvre d'un<br />
groupe plénier présidé par Pierre Boisson et animé par Nicole Jestin-Fleury (coordinatrice) et Patrick<br />
Criqui (rapporteur général) et <strong>de</strong> quatre autres tomes, représentant les contributions d'autant<br />
d'« ateliers » :<br />
- Le contexte international, sous <strong>la</strong> responsabilité d'Olivier Appert et Nicole Jestin-Fleury,<br />
- Les défis du long terme, sous <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> Benjamin Dessus et Michel Colombier,<br />
- Trois scénarios énergétiques pour <strong>la</strong> France, sous <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> François Moisan et<br />
Olivier Godard,<br />
- Quelle politique pour <strong>la</strong> France ?, sous <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> Jean-Daniel Lévi et Hugo Hanne.<br />
Dès l'avant-propos, le Commissaire au P<strong>la</strong>n, Jean-Michel Charpin, annonce <strong>la</strong> couleur : le<br />
temps <strong>de</strong>s certitu<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s monopoles, <strong>de</strong> l'orgueilleuse politique d'indépendance nationale et<br />
du « tout électrique-tout-nucléaire » est fini. Le reste du rapport, comme les avis <strong>de</strong>s<br />
partenaires sociaux et <strong>de</strong>s organisations professionnelles, confirme <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> conscience<br />
d'une nouvelle donne, quand bien même on décèle, ici et là, <strong>de</strong>s traces <strong>de</strong> nostalgie<br />
colbertiste. Il va falloir diversifier les sources, prendre mieux en compte l'environnement,<br />
écouter le client et les communautés territoriales, sortir du pré hexagonal et batailler pour<br />
rester compétitifs sur <strong>la</strong> scène internationale. L'énergie est aujourd'hui abondante et bon<br />
marché, mais <strong>la</strong> stabilité politique <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s régions productrices suscite <strong>de</strong>s inquiétu<strong>de</strong>s.<br />
Les réserves <strong>de</strong> pétrole ne seront pas éternelles, celles <strong>de</strong> gaz non plus. <strong>Un</strong>e pression<br />
politique croissante réduit <strong>la</strong> liberté <strong>de</strong>s pays à polluer à leur guise l'atmosphère <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nète ou d'exposer leurs voisins aux retombées radioactives. L'<strong>Un</strong>ion européenne impose<br />
l'ouverture progressive du secteur énergétique à <strong>la</strong> concurrence, excluant <strong>la</strong> poursuite<br />
solitaire d'une politique autocentrée. Par son caractère transversal, l'énergie influe <strong>de</strong> façon<br />
décisive sur tout le champ économique et social et aucune démarche internationale, aucune<br />
politique nationale, aucune stratégie industrielle, ne peut plus se concevoir hors d'une<br />
approche globale.<br />
Trois scénarios sont proposés, teintés <strong>de</strong> plus ou moins <strong>de</strong> libéralisme ou <strong>de</strong> colbertisme.<br />
L'horizon retenu, 2010-2020, représente une pério<strong>de</strong> charnière, dans <strong>la</strong> mesure où, en 2010, le<br />
système énergétique sera pour l'essentiel celui qui résulte du capital accumulé et <strong>de</strong> décisions<br />
d'investissement déjà prises, tandis que 2020 verra l'aube d'une nouvelle politique. On saura alors si<br />
l'on remp<strong>la</strong>ce les centrales nucléaires arrivées à fin <strong>de</strong> vie, si l'on bascule vers le gaz et <strong>la</strong><br />
cogénération, si le parc automobile continue <strong>de</strong> croître ou se stabilise, si les effets d'ouverture <strong>de</strong>s<br />
marchés sont mo<strong>de</strong>stes ou importants, si <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong>s pays émergents croît aussi fortement<br />
qu'on peut le supposer, si les engagements internationaux souscrits à Kyoto sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
biosphère sont effectivement respectés.<br />
Quelques enseignements importants émergent <strong>de</strong> ces scénarios :<br />
- le pétrole <strong>de</strong>meure <strong>la</strong> première source d'énergie (autour <strong>de</strong> 40 % <strong>de</strong>s besoins totaux), - le<br />
nucléaire reste le principal producteur d'électricité,<br />
- le gaz et <strong>la</strong> cogénération se développent,<br />
- une utilisation plus sobre et plus rationnelle <strong>de</strong> l'énergie s'impose en tous cas.<br />
Dans les trois scénarios, <strong>la</strong> France dépasse le p<strong>la</strong>fond d'émissions <strong>de</strong> C02 que lui imposent les<br />
engagements pris à Kyoto et <strong>la</strong> situation s'aggraverait si le nucléaire se voyait freiné, comme il l'est<br />
dans d'autres pays. Pour faire mentir les scénarios, il faudrait utiliser beaucoup mieux les ressources<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie, mais aussi changer notre style <strong>de</strong> consommation. Comme l'ouverture <strong>de</strong>s marchés<br />
impose simultanément à l'État <strong>de</strong> redéfinir c<strong>la</strong>irement son rôle et aux opérateurs historiques <strong>de</strong> bien<br />
séparer les différentes composantes <strong>de</strong> leur activité, dont certaines seulement relèvent <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission<br />
<strong>de</strong> service public et <strong>de</strong> <strong>la</strong> souveraineté nationale, l'impression qui se dégage <strong>de</strong> ce rapport est que <strong>la</strong><br />
société française dans son ensemble a besoin d'un bon dépoussiérage. Les partenaires sociaux et les<br />
organisations professionnelles, dans leurs avis, ne s'y sont pas trompés.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 281
Conseil mondial <strong>de</strong> l'énergie<br />
Il existe différents scénarios prospect, comme ceux du Conseil mondial <strong>de</strong> l'énergie. Selon cette<br />
organisation, non politique, regroupant <strong>de</strong>s représentants d'entreprises et d'organisations<br />
professionnelles <strong>de</strong> cent pays, <strong>la</strong> consommation mondiale passera <strong>de</strong> 9 milliards <strong>de</strong> tonnes équivalent<br />
pétrole (TEP) enregistrées au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie à 11 ou 15 milliards <strong>de</strong> TEP en 2020. Les<br />
combustibles fossiles, charbon, gaz et pétrole, resteront dominants, représentant plus <strong>de</strong>s trois quarts<br />
<strong>de</strong> l'approvisionnement, le reste étant réparti entre les énergies renouve<strong>la</strong>bles et le nucléaire.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 282
3.4.6.<br />
L'ENVIRONNEMENT
NOTE INTRODUCTIVE<br />
Les questions <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> portant sur <strong>de</strong>s enjeux environnementaux en Afrique sub-saharienne<br />
sont <strong>de</strong> diverses natures. Parmi les principales questions auxquelles s’attachent les <strong>prospective</strong>s<br />
réalisées, les problématiques suivantes occupent une p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> premier ordre :<br />
- L’enjeu <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation <strong>de</strong>s ressources forestières ;<br />
- L’évolution <strong>de</strong>s ressources naturelles intervenant dans <strong>la</strong> production agricole et <strong>la</strong> question du<br />
développement agricole durable (disponibilité et dégradation <strong>de</strong>s terres arables, limitation <strong>de</strong>s<br />
ressources en eau pour l’irrigation, effets du changement climatique sur <strong>la</strong> production, avancée <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> désertification) ;<br />
- Le problème <strong>de</strong> l’approvisionnement en eau douce (inadéquation <strong>de</strong> l’environnement urbain,<br />
disponibilité en eau pour l’agriculture…)<br />
- L’inci<strong>de</strong>nce du protocole <strong>de</strong> Kyoto sur <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s gaz à effets <strong>de</strong> serre sur les marchés <strong>de</strong>s<br />
produits énergétiques (pétrole, gaz) et sur les droits à polluer.<br />
Nous ne traiterons dans cette sections que <strong>de</strong>s trois premiers aspects, le quatrième étant traité <strong>de</strong><br />
façon spécifique dans <strong>la</strong> fiche sur le pétrole et les marchés énergétiques. Les trois thèmes abordés<br />
sont fortement connectés, <strong>de</strong> par <strong>la</strong> nature systémique <strong>de</strong>s processus naturels, et sont parfois<br />
abordés comme tels.<br />
Ce bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s s’appuie en partie sur le travail <strong>de</strong> synthèse réalisé par le<br />
CIRAD/URPA (1997).<br />
DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE<br />
Le problème du développement soutenable pose <strong>de</strong> façon systémique le problème entre l’évolution <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ressources (ressource foncière, disponibilité en eau…) et <strong>de</strong>s pratiques agricoles (systèmes<br />
agraires, intensification…). Comme les <strong>de</strong>ux points <strong>de</strong> vue sont indissociables et souvent liés dans les<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s, il a été décidé arbitrairement <strong>de</strong> les traité dans <strong>la</strong> rubrique environnement mais il<br />
eût été tout autant justifié <strong>de</strong> le traiter dans le dossier sur l’agriculture.<br />
SITUATION - OBJECTIFS<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conférence <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies sur l’Environnement et le Développement (CNUED, Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, juin 1992), un grand nombre <strong>de</strong>s pays d’Afrique sub-saharienne se sont déc<strong>la</strong>ré souffrir <strong>de</strong><br />
l’érosion <strong>de</strong>s terres et dans certains cas <strong>de</strong> désertification. Si le facteur climatique et notamment<br />
l’insuffisance <strong>de</strong>s précipitations est en cause, il s’y ajoute les activités humaines, notamment <strong>la</strong><br />
surexploitation agricole, le surpâturage et les défrichements inconsidérés.<br />
Les différents objectifs <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s sont les suivants :<br />
- Sécurité alimentaire et développement agricole : dans quelle mesure les contraintes liées aux<br />
ressources et à l’environnement peuvent-elles conditionner les perspectives d’évolution <strong>de</strong>s<br />
disponibilités alimentaires [Alexandratos, 1996], <strong>de</strong>s processus d’intensification ou du changement<br />
<strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> production ?<br />
- Evaluation <strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> dégradations <strong>de</strong>s ressources naturelles pour en trouver les<br />
solutions techniques, institutionnelles et mieux concevoir les politiques d’accompagnement<br />
[Griffon et Marty, 1993]. On notera que, dans le cas <strong>de</strong> Griffon et Marty, l’objectif sous-jacent est<br />
<strong>de</strong> réorienter les axes <strong>de</strong> recherche du CIRAD. Elle débouche sur <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> révolution<br />
doublement verte (révolution verte écologiquement viable et équitable) qui a pour objet <strong>de</strong><br />
proposer <strong>de</strong>s orientations à long terme pour <strong>la</strong> recherche agronomique internationale [voir aussi<br />
Griffon, 1996 et Conway, 1994].<br />
- Lutte contre <strong>la</strong> désertification [Observatoire du Sahara et du Sahel]<br />
- Alerte pour faire pression sur les politiques démographiques [Engelman et Le Roy, 1995].<br />
- Analyse <strong>de</strong> l’impact du changement climatique global sur <strong>la</strong> production agricole [Bazzaz et<br />
Sombroek, 1996] et, plus spécifiquement, sur <strong>la</strong> fertilité <strong>de</strong>s sols [Brinkman et Sombroek, 1996],<br />
sur <strong>la</strong> sécurité alimentaire [Fisher et al., 1996] ou encore sur <strong>la</strong> variabilité climatique avec son<br />
inci<strong>de</strong>nce en terme <strong>de</strong> fluctuation <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ments [Reilly, 1996].<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 284
MÉTHODOLOGIE<br />
On peut regrouper les métho<strong>de</strong>s en trois catégories :<br />
1. Évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> charge maximale et projection à partir d’une <strong>prospective</strong> démographique<br />
Sous sa forme <strong>la</strong> plus simple, l’usage <strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s démographiques pour estimer l’inci<strong>de</strong>nce sur<br />
<strong>la</strong> disponibilité foncière agricole consiste à projeter l‘évolution du nombre d’hectare <strong>de</strong> surface<br />
cultivable par habitant selon différents scénarios <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion [Engelman et Le Roy, 1995 ; horizon<br />
2025].<br />
Les étu<strong>de</strong>s s’appuyant sur <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> charge maximale [Alexandratos, 1996 ; Pearce et Warford,<br />
1993 ; Harrison, 1990 ; Marcoux, 1996] approfondissent l’analyse pédologique en prenant en compte<br />
différentes qualités <strong>de</strong> sols. Par définition, <strong>la</strong> charge maximale est le nombre maximal <strong>de</strong> personnes<br />
qui peut être maintenu sur une terre donné au niveau <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> subsistance. Le but <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>prospective</strong> est alors d’évaluer, à un horizon donné, si cette limites risques d’être atteinte voire<br />
dépassée.<br />
Cette approche procè<strong>de</strong> en trois temps :<br />
• Elle s’appuie sur une typologie <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> dégradation du sol et du type <strong>de</strong> dégradation. C’est<br />
l’objet du projet GLASOD (Global Assessment of Soil Degradation) qui a standardisé les<br />
définitions à l’échelle internationale.<br />
• Elle propose alors une hypothèse sur le rythme <strong>de</strong> dégradation futur. L’étape qui pose alors<br />
problème est d’interpréter ce que ces dégradations impliquent pour <strong>la</strong> productivité agricole car <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>tion entre érosion et perte <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment n’est pas linéaire (fonction <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols, <strong>de</strong> leur<br />
profon<strong>de</strong>ur…).<br />
• A partir d’une <strong>prospective</strong> démographique, on peut alors estimer <strong>la</strong> pression foncière.<br />
2. Prospective <strong>de</strong>s déséquilibres <strong>de</strong> fertilité <strong>de</strong>s terres<br />
Le travail <strong>de</strong> Griffon et Marty consiste à i<strong>de</strong>ntifier les principaux équilibres qui fon<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> durabilité du<br />
développement agricole et à analyser leurs évolutions possibles sous l’effet <strong>de</strong> l’accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion. La démarche procè<strong>de</strong> comme suit.<br />
1) Les principaux agro-écosystèmes sont i<strong>de</strong>ntifiés. Concernant l’Afrique, ils relèvent 6<br />
grands types : les systèmes d’élevage noma<strong>de</strong>, les systèmes traditionnel d’agriculture<br />
pluviale peu ou pas associé à l’élevage, les systèmes d’agro-élevage, les systèmes <strong>de</strong><br />
cultures vivrières et p<strong>la</strong>ntations <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> forêt (avec plusieurs variantes), les systèmes<br />
<strong>de</strong> cultures irriguées, les systèmes péri-urbains ou ceinture vertes.<br />
2) A l’échelle d’une gran<strong>de</strong> région, les principaux « domaines d’équilibre» concernés par une<br />
éventuelle dégradation sont décrits. Les auteurs s’intéressent aux différents facteurs <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong> l’agriculture dont : <strong>la</strong> fertilité <strong>de</strong>s sols, l’eau, et les forêts, qui interagissent<br />
avec <strong>la</strong> fertilité <strong>de</strong>s sols et l’eau.<br />
3) Plus spécifiquement, concernant <strong>la</strong> fertilité <strong>de</strong>s sols, les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> fertilité<br />
dans les différents systèmes <strong>de</strong> production sont décrits ; les conséquences au niveau<br />
régional et national sur les ren<strong>de</strong>ments et les surfaces cultivables sont évaluées.<br />
3. Approche systémique <strong>de</strong>s dynamiques écologiques et sociales et é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> scénarios<br />
d’évolution<br />
Dans son analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> désertification, l’observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) procè<strong>de</strong> en <strong>de</strong>ux<br />
temps :<br />
• Recherche sur les processus qui ont conduit et conduisent à <strong>la</strong> désertification : interactions entre<br />
les causes (climatiques, anthropologiques) et les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> désertification, re<strong>la</strong>tions dynamiques<br />
entre systèmes écologiques et systèmes sociaux.<br />
• É<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> scénarios contrastés d’évolution <strong>de</strong>s conditions environnementales en fonction <strong>de</strong>s<br />
stratégies <strong>de</strong> prévention et simu<strong>la</strong>tion en tenant compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance sur les processus en<br />
jeu.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 285
Pour <strong>la</strong> première étape, l’OSS s’appuie sur un réseau d’observatoires représentatif <strong>de</strong>s principales<br />
situations écologiques et socio-économiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> région (réseau ROSELT). Les données collectées<br />
permettent <strong>la</strong> réalisation d’un Système d’Information Géographique sur l’environnement au niveau<br />
global autour du Sahara.. L’utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> télédétection améliore <strong>la</strong> vision dynamique <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong><br />
en permettant d’i<strong>de</strong>ntifier les différents états <strong>de</strong> dégradation (état dégradé, stable, restauré…) et d’en<br />
analyser l’évolution à partir d’une étu<strong>de</strong> rétrospective.<br />
Cette approche a <strong>de</strong> commun avec <strong>la</strong> précé<strong>de</strong>nte une appréhension systémique bio-socioéconomique<br />
<strong>de</strong>s processus en jeu. Elle se positionne toutefois un peu moins à l’échelle <strong>de</strong>s systèmes<br />
<strong>de</strong> production pour privilégier celle <strong>de</strong>s bassins versants (suivi <strong>de</strong>s grands bassins aquifères) et d’une<br />
éco-région.<br />
4. Modèles <strong>de</strong> changement climatique global<br />
La <strong>prospective</strong> portant sur l’effet du changement climatique global sur <strong>la</strong> productivité agricole<br />
s’exprime parfois en termes qualitatifs [Alexandratos, 1996]. Elle donne aussi lieu à <strong>de</strong>s modélisation<br />
bioclimatiques poussées. Par exemple, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rosenzweig et al. (1995) procè<strong>de</strong> en quatre<br />
étapes :<br />
• Sélection <strong>de</strong>s scénarios <strong>de</strong> changements climatiques à partir <strong>de</strong>s trois principaux modèles<br />
<strong>de</strong> circu<strong>la</strong>tion générale (GISS, GFDL et UKMO ( 9 ))<br />
• Estimation <strong>de</strong>s changements potentiels <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments pour chaque type <strong>de</strong> site<br />
• Agrégation <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes pour estimer les<br />
changements potentiels <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité à l’échelle nationale/régionale (changement<br />
dans les ren<strong>de</strong>ments)<br />
• Simu<strong>la</strong>tion dynamique <strong>de</strong>s modifications <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ments résultant <strong>de</strong>s changements<br />
climatiques sur le système alimentaire mondial.<br />
RÉSULTATS<br />
Engelman et Le Roy (1995) :<br />
• Selon le scénario <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion(faible ou forte croissance), <strong>la</strong> surface cultivable par habitant peut<br />
varier beaucoup. Les stratégies proposées consistent alors à financer <strong>la</strong> recherche, inciter à <strong>la</strong><br />
pratique d’une agriculture plus écologique et à une politique démographique plus adaptée à leur<br />
ressources.<br />
Résultat <strong>de</strong>s projections pour quelques pays Africains<br />
(en nombre d’hectares <strong>de</strong> terre arable par habitant)<br />
Pays 1960/61 1990 2025 scénario faible 2025 Scénario fort<br />
Kenya 0,21 0,10 0,12 0,10<br />
Côte d’Ivoire 0,69 0,31 0,11 0,09<br />
Éthiopie 0,50 0,29 0,12 0,10<br />
Afrique du Sud 0,74 0,36 0,20 0,18<br />
Alexandratos, 1996 : Rareté <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre et dégradation <strong>de</strong>s sols<br />
Situation :<br />
• Il n’y a aucun lien entre <strong>la</strong> surface/habitant et <strong>la</strong> disponibilité alimentaire par habitant. Il reste que<br />
<strong>de</strong> faibles disponibilités <strong>de</strong> terre par habitant obligent à accroître <strong>la</strong> productivité par <strong>de</strong>s techniques<br />
plus intensives.<br />
• Il reste à l’échelle internationale 1,8 mrd d’ha disponibles potentiellement arables. 44% sont en<br />
Afrique sub-saharienne et 48% en Amérique <strong>la</strong>tine. Les 2/3 sont dans peu <strong>de</strong> pays (27% au<br />
Brésil, 9%en RDC, 36% en Ango<strong>la</strong>, Mozambique, Soudan, RCA, Tanzanie, Zambie, Pérou,<br />
Venezue<strong>la</strong>, Mexique, Indonésie. 45% <strong>de</strong>s 1,8MrD sont <strong>de</strong>s forêts soit protégées soit loin <strong>de</strong>s<br />
zones agricoles.<br />
9 GISS : modèle du Goddard Institute for Space Studies (GISS) ; GFDL : modèle du Geophysical Fluid Dynamics Laboratory ;<br />
UKMO : modèle du <strong>Un</strong>ited Kingdom Meteorological Office<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 286
• 9Mha dont 5 en Afrique ont vu leurs fonctions biotiques originelles détruites, leur réhabilitation<br />
n’étant plus rentable.<br />
• 15% <strong>de</strong>s terres mondiales sont dégradées par l’action humaine (résultat du projet GLASOD). Les<br />
pays d’Afrique subsaharienne se répartissent en <strong>de</strong>ux groupes autour <strong>de</strong> cette moyenne : dans<br />
certains, l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation est le double ou le triple <strong>de</strong> <strong>la</strong> moyenne mondiale (Burkina<br />
Faso, Sénégal, Togo…), dans d’autres, elle est très faible [Marcoux, 1996]. Sur les quatre types<br />
<strong>de</strong> dégradation <strong>de</strong>s sols (érosion hydrique, érosion éolienne ; dégradation chimique par perte<br />
d’éléments lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> sols pauvres sans fertilisation suffisante ou par salinisation ; et <strong>la</strong><br />
dégradation physique) c’est <strong>la</strong> dégradation chimique qui occupe <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce prépondérante en<br />
Afrique : il s’agit surtout <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> nutriments due à <strong>la</strong> surexploitation <strong>de</strong>s sols et à l’insuffisance<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fertilisation.<br />
• Les effets sur le ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’érosion sont difficilement mesurable. Les effets ne sont pas<br />
linéaires. La baisse est vraisemb<strong>la</strong>blement peu importante (Crosson, 1992), soit 2 à 4% sur 100<br />
ans sur les terres d’Amérique du Nord. En zone tropicale, les références manquent. La structure<br />
<strong>de</strong>s sols est liée à <strong>la</strong> maintenance <strong>de</strong> leur fertilité, c’est-à-dire à l’apport d’éléments nutritifs et <strong>de</strong><br />
carbone. C’est en Afrique que les risques d’épuisement sont les plus élevés, en particulier en<br />
zone semi-ari<strong>de</strong>.<br />
Entre 1990 et 2010 :<br />
• Dans les zones ari<strong>de</strong>s, les surfaces cultivées <strong>de</strong>vraient s’accroître <strong>de</strong> 6 M ha (ce qui est faible)<br />
mais cette extension concerne <strong>de</strong>s zones fragiles (parcours, terres marginales).<br />
• Les établissements humains utiliseraient 34 Mha dont 20 Mha à vocation agricole (hors Chine), ce<br />
qui n’est pas très important à l’échelle globale.<br />
• La salification s’accroîtrait à un rythme <strong>de</strong> 0,2 à 1,5 M ha par an pour les sols irréversiblement<br />
salés. Elle atteindrait 10 à 15% <strong>de</strong>s terres irriguées.<br />
• 30% <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie <strong>de</strong>s zones cultivées et <strong>de</strong>s parcours sont menacés par <strong>la</strong> désertification.<br />
Mais <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> ce processus peut varier.<br />
Harrisson, 1990 (Banque Mondiale), étu<strong>de</strong> s’appuyant sur les travaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO :<br />
• Disponibilité en terre en Afrique<br />
- L’Afrique détient 806 M ha cultivable dont 200 M cultivés. La moitié <strong>de</strong>s 800 M sont <strong>de</strong>s terres<br />
marginales. Ces <strong>de</strong>rnières années, <strong>la</strong> surface cultivée a augmenté <strong>de</strong> 0.6 à 0.8% par an, ce qui<br />
est moins élevé qu'avant.<br />
- 185 M d'ha <strong>de</strong> terre adaptée (suitable) (soit 93% <strong>de</strong> <strong>la</strong> totalité) est localisée en Afrique centrale et<br />
australe. Ces <strong>de</strong>ux régions ne cultivent qu'un quart <strong>de</strong> leurs ressources. Dans ces régions,<br />
l'expansion <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface cultivée peut donc jouer un rôle majeur dans <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production (peut-être 1.5 à 2% par an), si tant est que les mesures <strong>de</strong> conservation sont mises en<br />
p<strong>la</strong>ce. La principale contrainte sera le déficit <strong>de</strong> main d'œuvre et <strong>de</strong> traction animale dû à <strong>la</strong><br />
trypanomiase. Le facteur clé va donc être technologique : l'amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
main d'œuvre.<br />
- En Afrique <strong>de</strong> l'Est, 59% <strong>de</strong> <strong>la</strong> bonne terre est déjà cultivée, au Sahel, 99% et en Afrique <strong>de</strong><br />
l'Ouest 113% (ce qui signifie que <strong>de</strong>s terres marginales sont mises en culture). Dans ces régions,<br />
on ne peut attendre beaucoup <strong>de</strong> l'expansion <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface cultivée.<br />
- L’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> charge maximale montre qu’à lui seul, le Zaïre pourrait nourrir l'ensemble <strong>de</strong><br />
l'Afrique, avec <strong>de</strong>s niveaux d'utilisation <strong>de</strong>s intrants comparables à ceux <strong>de</strong> l'occi<strong>de</strong>nt. A <strong>de</strong>s<br />
niveaux d'usage d'intrants intermédiaires, l'Afrique centrale pourrait alors nourrir 17 fois sa<br />
popu<strong>la</strong>tion estimée pour 2025, l'Afrique occi<strong>de</strong>ntale humi<strong>de</strong>, et l'Afrique australe, 4 fois. Toutefois,<br />
ces chiffres supposent le défrichement <strong>de</strong> 80% <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt tropicale. Par ailleurs, les pays avec les<br />
plus grands potentiels <strong>de</strong> terres vierges sont les pays les moins <strong>de</strong>nsément peuplés. Se pose<br />
alors un problème <strong>de</strong> main d’œuvre.<br />
- D'un autre côte, le Sahel, les parties montagneuses d'Afrique <strong>de</strong> l'Est, <strong>la</strong> ban<strong>de</strong> séche en Afrique<br />
australe, ont dépassé le niveau <strong>de</strong> carrying capacity, tant que leur niveau d'utilisation d'intrants<br />
reste faible.<br />
- En 2019, 10 pays seront en situation critique. Quatre alternatives s'offrent à eux : Industrie<br />
minière, réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance démographique, migration temporaire ou permanente.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 287
Besoins <strong>de</strong> migration et potentiels<br />
Pays où <strong>de</strong>s migrations internes peuvent être Sénégal, Mali, Burkina, Tchad, Tanzanie,<br />
nécessaires<br />
Madagascar<br />
Pays où l'émigration peut nécessaire Nigeria, Mauritanie, Niger, Éthiopie, Somalie,<br />
Kenya, Rwanda, Burundi; Uganda, Lesotho<br />
Pays capable d'absorber l'immigration vers les Liberia, Tchad, Cameroon, Centre Afrique,<br />
zones rurales<br />
Congo, Gabon, Guinée, Zaïre, Ango<strong>la</strong>, Zambie<br />
Source: FAO, 1986. construit à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> charge maximale<br />
• Perspective <strong>de</strong> révolution verte : les enjeux<br />
Pour permettre une croissance soutenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> production, l'Afrique a besoin d'une révolution verte.<br />
Toutefois, les caractéristiques agro-climatologiques imposent <strong>de</strong>s contraintes :<br />
- Tous les sols présentent <strong>de</strong>s problèmes.<br />
- Le climat est plus imprévisible.<br />
- La main d'œuvre constitue un facteur limitant que ne peut alléger <strong>la</strong> traction animale dans<br />
les zones où sévit <strong>la</strong> mouche tsé-tsé. (soit <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> l'Afrique sub-saharienne : 10 M miles 2 ).<br />
- Nombreux micro-environnement qui requièrent <strong>de</strong>s approches plus locales.<br />
Griffon et Marty (1993) :<br />
L’étu<strong>de</strong> met particulièrement en relief les <strong>de</strong>ux risques environnementaux suivants :<br />
- non-renouvellement <strong>de</strong> <strong>la</strong> fertilité d’un grand nombre d’écosystème agricoles en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
rupture <strong>de</strong>s cycles <strong>de</strong>s nutrients <strong>de</strong>s écosystèmes antérieurs, et <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation<br />
d’engrais ;<br />
- limites dans les ressources en eau par non-renouvellement <strong>de</strong>s capacités d’inflitration et <strong>de</strong><br />
stockage ;<br />
CIRAD/URPA (1997) :<br />
Beaucoup <strong>de</strong> texte vont dans le sens d’une très forte dégradation <strong>de</strong>s sols : forte érosion, perte <strong>de</strong><br />
fertilité, désertification… Cependant, aucun <strong>de</strong> ces processus n’est bien évalué. Ceux qui se sont<br />
penchés <strong>de</strong> façon approfondie sur l’analyse <strong>de</strong>s risques sur les sols concluent qu’il y a souvent<br />
surestimation <strong>de</strong> ceux-ci.<br />
Conway, 1994 :<br />
• Constat : p<strong>la</strong>fonnement <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments en zones anciennes <strong>de</strong> révolution verte<br />
• Il faut plus que doubler <strong>la</strong> production agricole en Afrique et en Asie du Sud d’ici à 2025 pour<br />
répondre aux politiques <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong>s PED et faire jouer à l’agriculture son rôle <strong>de</strong> moteur du<br />
développement.<br />
• Le défi posé à <strong>la</strong> recherche agricole est complexe : elle doit favoriser une révolution plus<br />
productive que <strong>la</strong> première révolution verte et qui soit plus verte en terme <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s<br />
ressources naturelles et <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement (double révolution verte).<br />
Brown, L. 1996<br />
• Disponibilité en terre : plus aucune terre n'est encore disponible<br />
• Impact sur <strong>la</strong> croissance :<br />
- "<strong>la</strong> révolution verte est <strong>de</strong>rrière nous" : les ren<strong>de</strong>ments ont crû moins vite que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion du fait<br />
<strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> <strong>la</strong> science, <strong>de</strong> <strong>la</strong> diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> fertilité <strong>de</strong>s sols, <strong>de</strong> l'indispensable prise <strong>de</strong><br />
mesures se sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'environnement.<br />
- La compétition pour les différents usages du sol est toujours plus vive. Le phénomène<br />
d'urbanisation galopante qui ne fait que s'accélérer confisque en priorité les terres les plus<br />
productives le long <strong>de</strong>s fleuves et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ltas. Les possibilités <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s terres alternatives<br />
sont très limitées et se sont traduites <strong>de</strong> toute façon par <strong>de</strong>s pertes <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ments importantes.<br />
La déforestation (18 Mha annuels dont <strong>la</strong> moitié s'explique par l'agriculture) doit par ailleurs être<br />
maîtrisée compte tenu <strong>de</strong> ses conséquences négatives en terme <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s sols, <strong>de</strong><br />
fixation <strong>de</strong> carbone et <strong>de</strong> climat. Enfin, <strong>la</strong> surexploitation pratiquées au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux décennies<br />
80 et 90 rend une partie <strong>de</strong>s terres impropres à <strong>la</strong> culture. On a constaté, sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
1993/2023 une perte moyenne <strong>de</strong> 0.5% par an <strong>de</strong>s terres disponibles.<br />
- L'eau est <strong>de</strong>venu un facteur limitant dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s zones géographiques. Le phénomène<br />
d'urbanisation ainsi que <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> l'augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production, conduisent à une<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 288
situation <strong>de</strong> plus en plus périlleuse. L'eau étant utilisée en priorité pour les besoins <strong>de</strong>s urbains, sa<br />
disponibilité pour l'agriculture est <strong>de</strong> plus en plus compromise. Il faut en attendre désormais <strong>de</strong>s<br />
pertes <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ments et <strong>de</strong> production particulièrement inquiétants à très court terme.<br />
Brinkman R. et Wombroek, W.G., 1996 : Effet du changement global sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s sols pour <strong>la</strong><br />
production agricole<br />
• Les changements pédologiques majeurs qui <strong>de</strong>vraient résulter <strong>de</strong>s changements climatiques sont<br />
favorables. On anticipe en particulier un accroissement graduel <strong>de</strong> <strong>la</strong> fertilité et <strong>de</strong>s qualités<br />
physiques <strong>de</strong>s sols en zones humi<strong>de</strong>s et sous-humi<strong>de</strong>s, en conséquence <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance du<br />
CO2 atmosphérique.<br />
• Les effets indirects <strong>de</strong>s changements climatiques en raison <strong>de</strong>s augmentations <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong><br />
croissance et <strong>de</strong> l’efficience <strong>de</strong>s utilisation d’eau induites par le taux <strong>de</strong> CO2, en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
montée du niveau <strong>de</strong>s océans, <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance ou réduction du couvert végétal pour <strong>de</strong>s raisons<br />
climatiques, ou du changement <strong>de</strong>s activités agricoles pourraient bien être chacune plus<br />
importantes que l’effet direct sur le sol <strong>de</strong>s températures plus élevées ou d’un plus gran<strong>de</strong><br />
variabilité pluviométrique ou <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong>s niveau pluviométriques moyens.<br />
• Dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s cas, les changements pédologiques par l’action humaine directe <strong>de</strong>vraient<br />
être plus importants que ceux résultant <strong>de</strong>s changements climatiques.<br />
• L’impact <strong>de</strong>s scénarios <strong>de</strong> changements climatiques est plus fort dans les zones tropicales que<br />
dans les <strong>la</strong>titu<strong>de</strong>s moyennes (Rosenzweig et al., 1995).<br />
REMARQUES, CRITIQUES ET ÉVALUATION<br />
Sur le p<strong>la</strong>n méthodologique, on peut faire les observations suivantes :<br />
• Le constat d’Alexandratos selon lequel il n’y a aucun lien entre <strong>la</strong> surface/habitant et <strong>la</strong><br />
disponibilité alimentaire par habitant condamne les projections qui se limitent à une évaluation <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> surface cultivable par habitant [Engelman et Le Roy, 1995].<br />
• L’intérêt <strong>de</strong> l’approche <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO en terme <strong>de</strong> typologie <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sols (GLASOD) et <strong>de</strong> charge<br />
maximale qu’elle permet <strong>de</strong> proposer un scénario quantifié concernant <strong>la</strong> contrainte foncière. Elle<br />
permet également <strong>de</strong> régionaliser les problématiques (zones où <strong>la</strong> terre est abondante et <strong>de</strong><br />
bonne qualité/zones où elle est déjà limitante). Toutefois, il s’agit essentiellement d’une projection,<br />
<strong>la</strong> ressource étant essentiellement considérée <strong>de</strong> façon statique comme un potentiel. Cette<br />
approche ne donne donc pas une vision <strong>de</strong>s processus d’évolution en cours.<br />
• A l’inverse, les approches <strong>de</strong> Griffon et Marty (1993) ou <strong>de</strong> l’OSS se propose d’analyser <strong>de</strong> façon<br />
dynamique les interactions entre les différentes composantes du système. La démarche est plus<br />
lour<strong>de</strong> et n’aboutit pas toujours à une quantification <strong>de</strong>s phénomènes. Toutefois, cette démarche<br />
facilite le repérage <strong>de</strong>s bifurcation (changements <strong>de</strong> trajectoires) et <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> normative,<br />
c’est-à-dire l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s points clé d’intervention pour favoriser le développement<br />
soutenable ou <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> désertification.<br />
• Les approches re<strong>la</strong>tives aux changement climatique global sont très exigeantes en efforts <strong>de</strong><br />
modélisation. Les premières conclusions <strong>prospective</strong>s (l’impact du changement climatique sur les<br />
ren<strong>de</strong>ments est faible comparé à l’évolution <strong>de</strong>s activités humaines) ren<strong>de</strong>nt caduque l’utilité <strong>de</strong><br />
tels modèles lorsque l’on cherche seulement à évaluer l’évolution <strong>de</strong>s ressources foncières<br />
propres à l’agriculture.<br />
Concernant les résultats, on soulignera que les résultats <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s divergent assez<br />
fortement :<br />
• Pour le scénario pessimiste (Brown, 1996), les surfaces cultivées, après avoir atteint leur<br />
extension maximale en 1993, régressent sous l'action <strong>de</strong> l'érosion et <strong>de</strong> <strong>la</strong> déforestation, entre<br />
autres, et surtout les perspectives pour l'avenir sont très sombres. Dans le même temps, l'eau est<br />
<strong>de</strong>venue une <strong>de</strong>nrée rare et donc un facteur limitant. Tout ceci explique une stagnation <strong>de</strong>s<br />
ren<strong>de</strong>ments <strong>de</strong>puis quelques années et annonce même une chute pour le futur.<br />
• Le sénario inspiré d'Alexandratos (1996) envisage <strong>la</strong> même situation; mais avec un répit <strong>de</strong><br />
quelques années : <strong>la</strong> surface agricole utile est stable (elle diminue en Asie mais progresse en<br />
Afrique et en Amérique du Sud), et les tensions sur l'utilisation <strong>de</strong> l'eau sont encore très faibles.<br />
• Enfin, le scénario intégrant le modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution doublement verte se base sur une<br />
augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface cultivée, essentiellement au prix du défrichements <strong>de</strong> nouvelles terres<br />
dont <strong>la</strong> déforestation mettrait en péril <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s sols, celles dont le relief est un obstacle<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 289
à toute mise en culture, et celles dont <strong>la</strong> productivité est extrêmement faible, et nécessiterait<br />
d'énormes apports d'engrais pour être améliorée. Néanmoins, ce scénario prévoit que <strong>de</strong>s<br />
progrès sont réalisés quant à <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s terres. L'augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production est aussi à<br />
long terme. Cette analyse envisage <strong>de</strong>s tensions concernant l'utilisation <strong>de</strong> l'eau, ainsi qu'une<br />
stabilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface cultivée.<br />
PROSPECTIVE CONCERNANT L’ALIMENTATION EN EAU DOUCE<br />
SITUATION - OBJECTIFS<br />
Le constat qui est posé sur les ressources en eau dans certaines régions d’Afrique et du Proche<br />
Orient est sans concession. De tous les grands espaces géopolitiques du mon<strong>de</strong>, l’Afrique et, plus<br />
particulièrement, <strong>la</strong> zone Sahara-Sahel sont les plus démunies en ressources en eau naturelle<br />
renouve<strong>la</strong>ble, en gran<strong>de</strong>ur absolue et par habitant. Les ressources en eau du Proche Orient et<br />
d’Afrique sont presque entièrement exploitées et l’offre <strong>de</strong>vra doubler dans les 20-30 prochaines<br />
années pour maintenir le status quo actuel qui est par ailleurs insatisfaisant. Certains entrevoient<br />
alors <strong>de</strong>s scénarios <strong>de</strong> crise (« Water in crisis », Gleick, 1993 ; Evans, 1996).<br />
Les tensions entre l’offre et <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> suscitent un certain nombre <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s ( 10 ).<br />
Elles sont analysées par rapport à différents objectifs :<br />
- Aménagement urbain : les auteurs s’interrogent sur le problème <strong>de</strong> l’accès à l’eau potable <strong>de</strong><br />
bonne qualité ( 11 ) et sur <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> pollution dans <strong>de</strong>s zones urbaines toujours plus vastes et<br />
<strong>de</strong>nses. Ces étu<strong>de</strong>s sont menées notamment dans le cadre <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong>s aménagements<br />
urbains, <strong>de</strong>s politiques sanitaires et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> rentabilité <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> retraitement à<br />
moyen et long-terme [Chambolle, 1998]. On cherche alors à évaluer les coûts futurs <strong>de</strong> l’accès à<br />
l’eau potable [Benblidia et al., 1998] et le coût public <strong>de</strong>s aménagements [Petit, 1997].<br />
- Ressource en eau et agriculture : <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion entre agriculture est critique dans <strong>la</strong> mesure où<br />
environs 80% <strong>de</strong> l’eau potable est utilisée dans ce secteur et où <strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong> l’eau est<br />
stratégique dans le processus d’intensification agricole. Les questions suivantes sont donc posées<br />
selon le point <strong>de</strong> vue duquel on se p<strong>la</strong>ce : quels sont les potentiels en eau douce pour l’irrigation<br />
[Alexandratos, 1997] ? Quels sont les conséquences <strong>de</strong>s mauvaises pratiques agricoles sur <strong>la</strong><br />
dégradation <strong>de</strong>s ressources en eau potable [Griffon et Marty, 1990] et sur l’accélération <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
désertification [OSS] ? Comment dès lors assurer un développement soutenable vis-à-vis <strong>de</strong> cette<br />
ressources [Griffon, 1996] ?<br />
- Analyse démographique : l’accroissement <strong>de</strong>s disparités dans les réserves en eau est vu comme<br />
l’un <strong>de</strong>s moteurs <strong>de</strong> migrations transrégionales et d’exo<strong>de</strong> rural.<br />
- Géopolitique, les auteurs s’interrogeant sur les conflits d’usage amont/aval, sur les déséquilibres<br />
entre régions et les problèmes <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion, sur les rivalités entre pays que <strong>la</strong><br />
pénurie potentielle en eau potable est susceptible <strong>de</strong> générer.<br />
- La <strong>prospective</strong> sur l’eau intervient aussi comme intrant dans l’analyse sur les changements<br />
climatiques et <strong>de</strong> leurs impacts [Evans, 1996].<br />
MÉTHODOLOGIE<br />
Les principales métho<strong>de</strong>s observées sont les suivantes :<br />
• Approche essentiellement par <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> pression sur les ressources par une<br />
étu<strong>de</strong> démographique (analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>) [Marcoux, 1996] ; analyse en terme <strong>de</strong> capacité<br />
<strong>de</strong> charge [Alexandratos, 1996] ;<br />
• <strong>Bi<strong>la</strong>n</strong> offre-<strong>de</strong>man<strong>de</strong> : Étu<strong>de</strong> associant une <strong>prospective</strong> <strong>la</strong>rge <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
(croissance démographique mais aussi évolution <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> recyc<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> l’eau, <strong>de</strong>s<br />
politiques agricoles) et <strong>de</strong> l’offre (évolution du cycle <strong>de</strong> l’eau, <strong>de</strong> <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong>s ressources<br />
non conventionnelles et <strong>de</strong> l’utilisation et du coût <strong>de</strong> nouvelles techniques d’extraction). Ce type<br />
10 On notera que <strong>la</strong> zone méditerranéenne et le Proche Orient, exclus <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>, font aussi l’objet <strong>de</strong> nombreux travaux, en<br />
particulier au travers du P<strong>la</strong>n Bleu [Benblidia et al., 1998].<br />
11 L’OMS estime que 80% <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies qui affectent les popu<strong>la</strong>tions sont directement liées à l’insuffisance <strong>de</strong> l’évacuation <strong>de</strong>s<br />
matières fécales et <strong>de</strong> l’approvisionnement en eau potable.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 290
d’approche est le fait <strong>de</strong> projets d’aménagements urbains [Department of Water Affairs and<br />
Forestry, 1991] ou <strong>de</strong> grands programmes comme le p<strong>la</strong>n bleu portant sur le bassin<br />
méditerranéen [Benblidia, 1998]. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, l’étu<strong>de</strong> se décompose en plusieurs étapes<br />
itératives :<br />
- Première estimation <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à techniques et institutions<br />
constantes<br />
- Premier calcul <strong>de</strong> l’indice d’exploitation (quantité d’eau prélevée en pourcentage du total<br />
théorique <strong>de</strong>s ressources en eau renouve<strong>la</strong>bles moyennes). <strong>Un</strong> indice d’exploitation égal ou<br />
supérieur à 25% est révé<strong>la</strong>teur <strong>de</strong> tensions locales et conjoncturelles. Au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> 50%, il<br />
annonce <strong>de</strong>s pénuries conjoncturelles plus fréquentes. Aux approches <strong>de</strong> 100%, il indique <strong>de</strong>s<br />
pénuries structurelles généralisées.<br />
- Réévaluation <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> l’offre en incorporant les changements exogènes<br />
(climatiques…) mais aussi en prenant <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong>venues rentables (nouvelles sources<br />
d’approvisionnement nationales mais aussi internationales (commerce)) en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
raréfaction <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource ;<br />
- Réévaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en tenant compte <strong>de</strong>s possibilités d’économies en compte <strong>de</strong><br />
nouvelles techniques (retraitement…).<br />
- Ce travail passe aussi par l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> scénario (offre , <strong>de</strong>man<strong>de</strong>…).<br />
• Approche systémique insistant sur l’évolution <strong>de</strong>s bassins hydrographiques [Observatoire du<br />
Sahara et du Sahel] : comme pour le suivi <strong>de</strong>s ressources foncières (et en liaison avec lui), il s’agit<br />
d’établir un relevé et une modélisation <strong>de</strong>s évolutions hydrologiques à partir d’observatoires sur<br />
les systèmes naturels (eau, sols, végétation) et exploités (cultures irriguées…).<br />
• Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s systèmes agraires et <strong>de</strong>s pratiques agricoles sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s<br />
« gisements » [Griffon et Marty, 1990 ; Griffon, 1996].<br />
• Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’impact du changement climatique global sur <strong>la</strong> disponibilité <strong>de</strong>s ressources en eau<br />
[Evans, 1996]. L’accent est alors mis sur <strong>la</strong> modélisation du cycle <strong>de</strong> l’eau. Celui-ci peut être :<br />
- isolé (programme WHYCOS <strong>de</strong> l’OMM [Rodda et al., 1993]) ;<br />
- intégré à un modèle <strong>de</strong> circu<strong>la</strong>tion général (GCM), c’est-à-dire associant quatre modules :<br />
atmosphère, terre, océan et g<strong>la</strong>ce [Evans, 1996] ;<br />
- associé à un modèle portant sur les activités humaines ou à <strong>de</strong>s hypothèses sur leur évolution<br />
(agriculture, déforestation…).<br />
RÉSULTATS<br />
Alexandratos, 1996 :<br />
• L’eau est utilisée à 70% pour l’agriculture qui <strong>la</strong> paye peu, à 21% pour l’industrie qui <strong>la</strong> paye peu,<br />
à 6% pour les ménages qui vont payer plus cher.<br />
• La compétition pour l’eau <strong>de</strong>vrait aboutir :<br />
- à <strong>de</strong>s prix élevés rendant l’intensification agricole coûteuse<br />
- à <strong>de</strong>s recyc<strong>la</strong>ges<br />
• Dans les zones côtières, <strong>la</strong> surexploitation <strong>de</strong>s nappes posera un problème <strong>de</strong> plus en plus<br />
important car elle entraînera leur salification par intrusion d’eau salée (surtout va<strong>la</strong>ble pour le<br />
Proche Orient et l’Asie).<br />
• La pollution <strong>de</strong> l’eau par les engrais, les pestici<strong>de</strong>s, les effluents organiques augmente mais les<br />
techniques <strong>de</strong> recyc<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> limitation <strong>de</strong>s pollutions progressent.<br />
Harrisson, 1990 : Irrigation et conservation <strong>de</strong> l'eau<br />
• Pour l'heure, 5 M d'ha irrigués. 71% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface irriguée se situe dans trois pays : le Soudan,<br />
Madagascar et le Nigéria.<br />
• Le potentiel d'irrigation total est évalué à 34 M d'ha par <strong>la</strong> FAO et à 27 M par <strong>la</strong> Banque Mondiale.<br />
Sa distribution est peu adéquate : elle est plus faible dans les zones les plus ari<strong>de</strong>s et plus élevé<br />
en zone bien arrosée. Plus <strong>de</strong> 60% se situe dans <strong>de</strong>s pays où l'irrigation est le moins susceptible<br />
d'être profitable : Ango<strong>la</strong>, Mozambique, Zambie, Tanzanie, Zaïre et Centre Afrique. De ce fait, le<br />
potentiel d'irrigation se réduit à 20 M d'ha.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 291
Potentiels d'irrigation<br />
Pays<br />
Tchad<br />
Soudan<br />
Gambie<br />
Madagascar<br />
Botswana<br />
Mali<br />
Burkina Faso<br />
Sénégal<br />
Ma<strong>la</strong>wi<br />
Somalie<br />
Mauritanie<br />
Niger<br />
Uganda<br />
Éthiopie<br />
Kenya<br />
Nigéria<br />
Contribution potentielle<br />
<strong>de</strong> l'irrigation à <strong>la</strong> charge<br />
maximale, 2010 (a)<br />
100<br />
63<br />
50<br />
47<br />
44<br />
28<br />
20<br />
17<br />
15<br />
12<br />
12<br />
9<br />
9<br />
8<br />
8<br />
7<br />
Potentiels<br />
d’irrigation<br />
additionnels (000<br />
ha)<br />
1150<br />
1550<br />
46<br />
240<br />
88<br />
180<br />
350<br />
80<br />
270<br />
7<br />
16<br />
70<br />
398<br />
583<br />
301<br />
1150<br />
Pourcentage<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie irriguée<br />
potentielle non utilisée<br />
en 1982<br />
96<br />
47<br />
64<br />
20<br />
88<br />
53<br />
92<br />
43<br />
93<br />
8<br />
41<br />
70<br />
97<br />
87<br />
86<br />
58<br />
Total<br />
6479<br />
60<br />
(a) Pourcentage <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion qui peut être alimentée à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie potentiellement irrigable, en utilisant un<br />
niveau intermédiaire d'intrants. L'utilisation d'un niveau élevé d'intrants pourrait doubler ces proportions.<br />
Source : FAO<br />
Griffon et Marty, 1993<br />
Les ressources en eau très inégalement réparties en Afrique.<br />
- L’Afrique centrale détient 47% <strong>de</strong>s ressources d’Afrique subsaharienne.<br />
- Les pays <strong>de</strong> climat sahélien, que ce soit dans <strong>la</strong> zone sahélienne ou au sud du désert du Ka<strong>la</strong>hari<br />
ou encore à l’Est <strong>de</strong> <strong>la</strong> corne <strong>de</strong> l’Afrique sont <strong>de</strong>s zones sensibles aux aléas climatiques :<br />
précipitations aléatoires <strong>de</strong> courte durée avec forte évaporation.<br />
- Certains pays d’Afrique puisent déjà dans leurs ressources non renouve<strong>la</strong>bles.<br />
La consommation est globalement très faible : selon les estimations en 1987, 23 pays d’Afrique<br />
avaient une consommation inférieure à 50 m3 par habitant et par an (10 fois moins qu’en France).<br />
Cependant, dans certains contextes, l’eau constitue un facteur limitant. Les facteurs suivant<br />
influencent <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation en eau :<br />
- Croissance démographique et urbanisation : on peut s’attendre à <strong>de</strong>s difficultés du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
concentration urbaine.<br />
- Développement industriel : utilisation d’eau reste minime, sauf Afrique du Sud : 60 m3 par habitant<br />
par an. Le potentiel d’accroissement est important. Toutefois, selon les auteurs, l’industrialisation<br />
rapi<strong>de</strong> et donc une consommation importante <strong>de</strong> l’eau par le secteur industriel, les concurrences<br />
que ce<strong>la</strong> peut entraîner vis à vis <strong>de</strong>s autres secteurs et les pollutions éventuelles ne sont pas à<br />
l’ordre du jour en Afrique.<br />
- Evolution du secteur agricole : principal poste <strong>de</strong> consommation. Dans les zones forestières, l’eau<br />
n’est absolument pas un facteur limitant et le potentiel d’accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation est<br />
très important. Par contre, dans les autres régions, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’eau est essentielle pour les<br />
activités agricoles.<br />
- Système d’élevage ou semi-noma<strong>de</strong> : le potentiel d’accroissement est très limité.<br />
- Système d’agriculture pluviale: pas d’augmentation anticipée <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation en eau<br />
- Système <strong>de</strong> culture irriguée : fortement consommateur d’eau (90% <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation en<br />
eau au Soudan et Mali)<br />
On notera que certains fleuves et rivières menacent <strong>de</strong> s’assécher. Cette perspective pose problème<br />
au regard <strong>de</strong> l’approvisionnement en électricité.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 292
CIRAD/URPA, 1997<br />
• La compétition pour l’eau entre industries, villes et agriculture sera <strong>de</strong> plus en plus forte<br />
aboutissant à une surexploitation sévère <strong>de</strong>s nappes phréatiques. Dans les trois <strong>de</strong>rnières<br />
décennies, l’irrigation a contribué à <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s accroissements <strong>de</strong> production. Or, les coûts<br />
d’irrigation <strong>de</strong>viennent très élevé et les effets écologiques très négatifs (salification, envasement<br />
<strong>de</strong>s barrages…). Il y a donc une forte inflexion possible dans les rythmes <strong>de</strong> mise en valeur par<br />
l’irrigation que les modèles ne traduisent qu’imparfaitement.<br />
Evans Terry E., 1996 : Effet du changement climatique global sur les ressources en eau<br />
• L’effet <strong>de</strong>s changements climatiques sur <strong>la</strong> disponibilité <strong>de</strong>s ressources en eau, quoi que<br />
significative, sera petit comparé à <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> générée par les popu<strong>la</strong>tions,<br />
l’industrialisation, l’urbanisation, les changements dans l’utilisation <strong>de</strong>s sols et l’amélioration du<br />
niveau <strong>de</strong> vie. Dans <strong>de</strong> nombreux pays, les ressources sont déjà pleinement engagées et l’eau va<br />
<strong>de</strong>venir une ressource rare.<br />
• Même si l’agriculture est le principal utilisateur <strong>de</strong>s ressources mondiales en eau, elle est plus<br />
vulnérable à <strong>la</strong> pénurie parce que <strong>la</strong> priorité est donnée à l’eau potable et aux utilisations <strong>de</strong> plus<br />
gran<strong>de</strong> valeur ajoutée.<br />
• Les modèles GCM constituent <strong>la</strong> seule métho<strong>de</strong> p<strong>la</strong>usible pour prévoir les effets du réchauffement<br />
global <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète sur le cycle hydrologique. Malheureusement, les modèles existant ne sont pas<br />
en mesure <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> précipitations suffisamment réalistes pour répondre aux<br />
besoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification. Même le signe <strong>de</strong>s changements dans certaines régions ou continents<br />
ne peut pas être prédite avec confiance.<br />
• <strong>Un</strong>e augmentation du stockage dans les régions où l’eau est à un sta<strong>de</strong> critique est souhaitable<br />
pour le développement <strong>de</strong> l’agriculture et <strong>la</strong> soutenabilité. Les changements climatiques <strong>de</strong>vraient<br />
exacerber les différences entre zones riches et pauvres en eau. Le transfert <strong>de</strong> l’eau prendra donc<br />
une importance croissante et urgente.<br />
• Les cas d’étu<strong>de</strong> sur le <strong>la</strong>c Tchad, le Nil et <strong>la</strong> mer Caspienne montrent que l’hydrologie est très<br />
sensible aux changements climatiques. Dans le cas du <strong>la</strong>c Tchad, <strong>la</strong> sécheresse au Sahel a<br />
entraîné une forte diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille du <strong>la</strong>c et l’a transformé en un <strong>de</strong>lta marécageux avec <strong>de</strong>s<br />
conséquences importantes pour les communautés limitrophes et le système d’irrigation. Cet<br />
exemple montre l’effet d’une baisse <strong>de</strong>s précipitations <strong>de</strong> 25% sur le flux d’une rivière dans une<br />
région semi-ari<strong>de</strong> et les gradients <strong>de</strong> précipitation sont forts et où <strong>de</strong> petits changements dans <strong>la</strong><br />
circu<strong>la</strong>tion atmosphérique peuvent entraîner <strong>de</strong> grands changements dans les précipitations.<br />
OSS (Groud et al.)<br />
• La région <strong>de</strong> l’OSS représente 11% <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface mondiale et 5,3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Ses ressources<br />
en eau naturelle renouve<strong>la</strong>ble ne s’élèvent qu’à 1% <strong>de</strong> <strong>la</strong> quantité mondiale. Ce chiffre est aggravé<br />
par l’irrégu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s pluies et <strong>la</strong> forte évapotranspiration liée au climat (variation saisonnières et<br />
pluriannuelles).<br />
• On considère qu’en <strong>de</strong>ça du seuil <strong>de</strong> 1000 m3/AN/hab, le manque d’eau <strong>de</strong>vient un facteur limitant<br />
au développement. Actuellement, 6 pays (63 M d’habitants, soit 22% <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’OSS)<br />
sont en <strong>de</strong>ça <strong>de</strong> ce seuil. En 2025, on estime à 12 le nombre <strong>de</strong> pays touchés ; 430 millions<br />
d’habitants, soit 67% <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale, manqueront d’eau.<br />
Ressources en eau en m3/an/hab<br />
1990 2025<br />
Maghreb, Afrique du Nord 767 384<br />
Sahel, Afrique <strong>de</strong> l’Ouest 5650 2200<br />
Bassin du Nil, Afrique <strong>de</strong> l’Est 1240 522<br />
Seuil critique à 1000 m3/an/hab<br />
Source : Agroud et al.<br />
• Les zones seront sujettes à différents risques selon le type <strong>de</strong> ressource en eau dont elles<br />
dépen<strong>de</strong>nt (tableau). Ces valeurs ont été chiffrées :<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 293
Caractéristiques<br />
Eau renouve<strong>la</strong>ble<br />
interne<br />
Eau renouve<strong>la</strong>ble<br />
externe<br />
Eau non renouve<strong>la</strong>ble<br />
Forme Ruissellement, Fleuves transfrontaliers, Eau non renouve<strong>la</strong>ble<br />
écoulement superficiel,<br />
eaux souterraines<br />
sources secondaires<br />
Dépendance aux Nulle Modérée, limitée par Nulle<br />
voisins<br />
l’aménageabilité <strong>de</strong>s<br />
fleuves<br />
Risque à long terme Dégradation <strong>de</strong>s Utilisation croissantes Épuisement <strong>de</strong>s<br />
capacités<br />
en aval et en amont, ressources, extraction<br />
d’aménagement, souffre pollutions,<br />
<strong>de</strong> plus en plus<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> déforestation aménagement <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ltas<br />
coûteuse<br />
Exploitabilité Dépend <strong>de</strong>s conditions Partage <strong>de</strong>s droits à Conditions physiques<br />
physiques<br />
l’eau, exigences d’extraction, critères<br />
d’aménagement et <strong>de</strong> qualité , protection du technico-économiques,<br />
maîtrise (retenue<br />
aquifères<br />
débit sortant<br />
stratégies d’exploitation<br />
Régions dominées par Maghreb N, Sahel Égypte, Soudan, Sahara (Égypte, Libye,<br />
ces types <strong>de</strong> ressources (Burkina, Mali S, Tchad Mauritanie, Tchad (+ Maghreb S), Mali N,<br />
S), Afrique <strong>de</strong> l’Est Mali, Sénégal) Niger N, Tchad N,<br />
Source : Agroud et al.<br />
(Éthiopie, Somalie,<br />
Kenya)<br />
Soudan N<br />
• Les conflits autour <strong>de</strong> l’eau sont nombreux dans <strong>la</strong> région et risquent <strong>de</strong> s’aggraver. Ils<br />
s’accentuent fortement en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> sécheresse et diffèrent suivant les types prédominants <strong>de</strong><br />
ressource en eau. Par exemple, dans les pays à ressources fluviales d’origine externe, on risque<br />
<strong>de</strong> voir émerger : <strong>de</strong>s conflits entre mo<strong>de</strong>s traditionnels d’usage <strong>de</strong> l’eau (irrigation…) et <strong>la</strong><br />
nécessité d’économiser l’eau, <strong>de</strong>s conflits d’usage amont/aval, <strong>de</strong>s contraintes géopolitiques et <strong>de</strong>s<br />
rivalités.<br />
REMARQUES, CRITIQUES ET ÉVALUATION<br />
• Remarques méthodologiques :<br />
- On pourra reprendre les remarques précé<strong>de</strong>ntes pour ce qui concerne les métho<strong>de</strong>s en terme <strong>de</strong><br />
charge maximale…<br />
- On soulignera seulement l’impression <strong>de</strong> précision qui se dégage <strong>de</strong>s analyses en terme d’offre et<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et qui incorporent une réflexion sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong>s aménagements les évolutions<br />
technologiques à venir au vue <strong>de</strong> leur coût [Benblidia, 1998].<br />
• Note sur les résultats <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s :<br />
Les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l'eau varient selon les approches : pour le scénario optimiste, l'irrigation est<br />
<strong>de</strong>puis longtemps bien maîtrisée dans presque tous les pays, <strong>de</strong>s économies d'eau sont réalisées, et,<br />
en prenant certaines mesures, on tente <strong>de</strong> ne pas aggraver <strong>la</strong> situation. Pour les autres (Brown,<br />
1996), les politiques <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l'eau sont venues trop tard, alors que <strong>la</strong> ressource était déjà<br />
<strong>la</strong>rgement entamée. Les analyses en terme <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification montrent les contraintes mais aussi les<br />
voies qui permettent <strong>de</strong> limiter ou <strong>de</strong> retar<strong>de</strong>r leur expression.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 294
TENSIONS SUR LES RESSOURCES FORESTIERES<br />
SITUATION - OBJECTIFS<br />
S’appuyant sur les conclusions <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conférence <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies sur l’Environnement et le<br />
Développement (CNUED, Rio <strong>de</strong> Janeiro, juin 1992), certains travaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO présentent <strong>la</strong><br />
dégradation <strong>de</strong>s ressources forestières comme le problème d’environnement dominant en Afrique <strong>de</strong><br />
l’Ouest et Centrale [Marcoux, 1996]. Les principale cause <strong>de</strong> déforestation mentionnée est <strong>la</strong><br />
surexploitation du couvert boisé pour <strong>la</strong> collecte du bois <strong>de</strong> feu ; viennent ensuite les défrichements en<br />
vue <strong>de</strong> l’extension <strong>de</strong>s cultures, le surpâturage, <strong>la</strong> foresterie (bois d’exportation notamment) et les<br />
incendies.<br />
D’une façon générale, on peut regrouper les différents problématiques <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s portant sur les<br />
ressources forestières sous <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> soutenabilité : comment utiliser les arbres et les ressources<br />
forestières pour améliorer à <strong>la</strong> fois l’environnement et le bien-être économique et social <strong>de</strong>s<br />
popu<strong>la</strong>tions, tout en concervant ce patrimoine pour les générations futures (énoncé du programme <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> FAO) ? Toutefois, les analyses insistent <strong>de</strong> façon plus ou moins prononcée sur les objectifs<br />
suivants :<br />
- P<strong>la</strong>nification et politique forestière : certains gouvernement ou organisations internationales<br />
entreprennent <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s <strong>de</strong> marchés pour déterminer leur politique <strong>de</strong> production<br />
forestière [NFAP, 1996 ; FAO ; Karsenty, 1997a, b, 1998].<br />
- Conservation du patrimoine forestier dans un but <strong>de</strong> préservation <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversité biologique où<br />
pour conserver un équilibre climatique général (Bazzaz et Sombroek, 1996).<br />
- Développement agricole et <strong>de</strong>s superficies arables prélevées sur l’espace forestier (Alexandratos,<br />
1996).<br />
MÉTHODOLOGIE<br />
Modèle spatial sur les re<strong>la</strong>tions entre agriculture et forêt<br />
[von Amsberg, 1998]<br />
RÉSULTATS<br />
Alexandratos (1996) :<br />
On soulignera d’abord que les résultats sont mondiaux et <strong>la</strong> spécificité <strong>de</strong> l’Afrique n’est pas toujours<br />
précisée. Entre 1990 et 2010, l’étu<strong>de</strong> envisage les évolutions suivantes :<br />
• Le déboisement pourrait ralentir car :<br />
- les avantages fiscaux au déboisement se réduisent<br />
- l’exploitation forestière est plus contrôlée<br />
- il y a <strong>de</strong> moins en moins <strong>de</strong> terres forestières convenant à l’agriculture<br />
- <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s PED tributaire <strong>de</strong> l’agriculture croît moins vite<br />
- les techniques agricoles facilitent l’intensification<br />
- les financement internationaux tentent <strong>de</strong> limiter le déboisement.<br />
• Il y aurait 90 Mha ( 12 ) <strong>de</strong> forêts déboisés dans les PED (sauf Chine) sur les 1,8 Mrd ha à vocation<br />
agricole inexploitée dont 45% serait en forêt.<br />
• Dans les zones ari<strong>de</strong>s, les surfaces cultivées <strong>de</strong>vraient s’accroître <strong>de</strong> 6 M ha (ce qui est faible)<br />
mais cette extension concerne <strong>de</strong>s zones fragiles (parcours, terres marginales).<br />
• Les établissenemtns humains utiliseraient 34 Mha dont 20 Mha à vocation agricole (hors Chine),<br />
ce qui n’est pas très important à l’échelle globale.<br />
• Les besoins en surfaces nouvelles pour l’agriculture viendront <strong>de</strong> moins en moins du déboisement<br />
(pour 1/4 pour Crosson (1992) à l’horizon 2030 pour 1/3 pour Alexandratos (1996) à l’horizon<br />
2010) et <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> l’accroissement <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments.<br />
12 Mha : millions d’hectares<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 295
Zone<br />
Saharienne<br />
Sahelo-saharienne<br />
Sahélienne<br />
Sahelo-soudanienne<br />
Soudanienne<br />
Soudano-Guinean<br />
Source : Steeds (1985), p.13<br />
Charge maximale dans les zones sahélienne et soudanienne<br />
d'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest<br />
Popu<strong>la</strong>tion soutenable<br />
pour le bois <strong>de</strong> chauffe<br />
-<br />
-<br />
1<br />
10<br />
20<br />
20<br />
LES PERSPECTIVES DU BOIS DE FEU (étu<strong>de</strong> 1993)<br />
Popu<strong>la</strong>tion<br />
rurale effective<br />
0.3<br />
2<br />
7<br />
20<br />
17<br />
9<br />
Popu<strong>la</strong>tion totale<br />
- Ninnin, B. (1993), Towards a geography of woodfulls economics. Application to the case of five<br />
Sahelian countries, Rapport rédigé pour <strong>la</strong> Banque Mondiale Energy <strong>Un</strong>it, Africa Technical<br />
Department, June.<br />
Cette étu<strong>de</strong> utilise <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> WALTPS et notamment celle <strong>de</strong>s tensions <strong>de</strong> marché<br />
développées par B. Ninnin.<br />
La section I définit <strong>de</strong>s scénarios démographiques pour l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest en 2000 en<br />
reprenant les <strong>prospective</strong>s WALTPS et en les comparant avec celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale.<br />
La section II <strong>de</strong>ssine <strong>de</strong>s <strong>de</strong>venirs possibles concernant l'agriculture, les besoins alimentaires,<br />
<strong>la</strong> localisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole, l'évolution <strong>de</strong>s terres utilisées en 2030.<br />
Les sections III et IV font un bi<strong>la</strong>n spécialisé et <strong>de</strong>s perspectives en prenant en compte<br />
différentes hypothèses concernant les coûts <strong>de</strong> transport et <strong>la</strong> distance entre l'offre et <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
Cette étu<strong>de</strong> relie les facteurs économiques et géographiques en privilégiant <strong>la</strong> question urbaine.<br />
Les modèles <strong>de</strong> tensions <strong>de</strong> marché forgés dans <strong>la</strong> cadre <strong>de</strong> WALTPS montrent <strong>de</strong>s <strong>de</strong>venirs<br />
contrastés <strong>de</strong> bois <strong>de</strong> feu.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Agroud N., Cadon B., Desmet A., 1997. Les ressources en eau dans les zones semi-ari<strong>de</strong>s. ESEM,<br />
<strong>Un</strong>iversité d’Orléans.<br />
Alexandratos, 1996. World agriculture : toward 2010, an FAO study. FAO, Roma, 1995.<br />
Bazzaz F., Sombroek W. (éd.), 1997. Global Climate Change and agricultural production. Direct and<br />
Indirect Effects of Changing Hydrological Pedological and P<strong>la</strong>nt Physiological Processes. John<br />
Wiley & Sons, Chichester (UK) et FAO, Rome.<br />
Benblidia M. (Institut Méditerranéen <strong>de</strong> l’Eau), J. Margat (P<strong>la</strong>n Bleu) et D. Vallée (P<strong>la</strong>n Bleu), 1998.<br />
L’eau : une ressource menacée. Pénurie d’eau prochaine en Méditerranée ? Problèmes<br />
Économiques, n° 2.596, 23 Décembre 1998.<br />
Brinkman R., Sombroek W.G., 1996. The Effects of Global Change on Soil Conditions in Re<strong>la</strong>tion to<br />
P<strong>la</strong>nt Growth and Food Production. In F. Bazzaz and W. Sombroek.<br />
Brown L., 1996. State of the World. A worldwatch Institute report on progress toward a sustainable<br />
society. Norton, New-York.<br />
Chambolle T. (Directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suez-Lyonnaise <strong>de</strong>s Eaux), 1998. Perspectives <strong>de</strong> <strong>la</strong> Distribution d’eau<br />
potable dans le mon<strong>de</strong>. Bulletin du Conseil Général du Génie Rural <strong>de</strong>s Eaux et <strong>de</strong>s Forêts,<br />
n°51, août 1998.<br />
CIRAD/URPA, 1997. Analyse <strong>prospective</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation agricole et alimentaire mondiale. Dossier<br />
1997. <strong>de</strong> l’Agriculture, CIRAD <strong>Un</strong>ité <strong>de</strong> Recherche Prospective et Politique Agricole.<br />
Conway G., 1994. <strong>Un</strong>e agriculture durable pour <strong>la</strong> sécurité alimentaire mondiale. Avec H. Carsa<strong>la</strong><strong>de</strong>,<br />
M. Griffon, P. Hazell, J. Hoemberg, U. Lele, J. Peacock, M. Pineiro., CGIAR, CIRAD/URPA.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 296<br />
0.3<br />
2<br />
7<br />
23<br />
21<br />
10
Crosson P., J.R. An<strong>de</strong>rson, 1992. Ressources and global Food Prospects. Supply and Demand for<br />
Cereals to 2030. World Bank Technical Paper 184-1992.<br />
DBSA, 1990. Strategic Development P<strong>la</strong>nning Process for the LHWP (Lesotho High<strong>la</strong>nds Water<br />
Project) (Phase 1A) region and re<strong>la</strong>ted urban <strong>de</strong>velopment p<strong>la</strong>nning process for the Lower<br />
Bokong, Ha Lejone and Buthe Buthe areas, Development Bank of South Africa, March 1990,<br />
Volumes 1 / pages 27.<br />
Department of Water Affairs and Forestry, 1991]. Western Cape System Analysis. Prétoria, Afrique du<br />
Sud.<br />
Engelman R., et P. Le Roy, 1995. Conserving <strong>la</strong>nd : popu<strong>la</strong>tion and sustainable food production,<br />
Popu<strong>la</strong>tion Action International.<br />
Evans Terry E., 1996. The Effects of Changes in the World Hydrological Cycle on Avai<strong>la</strong>bility of Water<br />
Ressources. In F. Bazzaz and W. Sombroek, 1996.<br />
FAO, 1998. The FAO Asia-Pacific Forestry Outlook Study (une étu<strong>de</strong> équivalente est <strong>la</strong>ncée pour<br />
l'Afrique)<br />
Fisher G., Frohberg K., Parry M.L., Rosenzweig C., 1996. The Potential Effects of Climate Change on<br />
Wolrd Food Production adn Security.<br />
Griffon M., I. Marty, 1993. Prospective <strong>de</strong>s déséquilibres environnementaux liés à l'agriculture dans<br />
les pays tropicaux. CIRAD-GERDAT, URPA, Paris.<br />
Griffon M., 1996. De <strong>la</strong> révolution verte à <strong>la</strong> révolution doublement verte, document provisoire. CIRAD-<br />
URPA, Nogent sur Marne.<br />
Harrison Paul, 1991. <strong>Un</strong>e Afrique verte. Kartha<strong>la</strong>, paris.<br />
Harrisson, Paul, 1990. Sustainable growth in Africa. In: World Bank. The long-term pespective study of<br />
Sub-saharan Africa. Volume 2, Economic and sectoral policy issues. Washington D.C.<br />
Karsenty A., Debroux L., 1997a. L'imp<strong>la</strong>ntation <strong>de</strong>s sociétés asiatiques en Afrique centrale -<br />
Rimbunan Hijau au Cameroun, Bois et Forêts <strong>de</strong>s Tropiques, n°254, 1997.<br />
Karsenty A., 1997b. Les mutations du marché international <strong>de</strong>s bois et ses conséquences pour<br />
l'Afrique, La Lettre <strong>de</strong> l'Association Technique Internationale <strong>de</strong>s Bois Tropicaux.<br />
Karsenty A., 1998. La filière bois d'œuvre dans les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone Franc à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise<br />
asiatique, Caisse Française <strong>de</strong> Développement - Trésor Public.<br />
Monchalin G. (responsable su projet français « gestion <strong>de</strong> l’eau » <strong>de</strong> 1993 à 1996) , 1998. Gestion <strong>de</strong><br />
l’eau à l’Île Maurice. Bulletin du Conseil Général du Génie Rural, <strong>de</strong>s Eaux et <strong>de</strong>s Forêts, n°51,<br />
août 1998.<br />
NFAP, 1996. National Forestry Action Programme. Discussion document 1. Introduction to the<br />
National Forestry Action Programme and the Key Issues to be addresses. Department of Water<br />
Affairs and Forestry, Prétoria, Afrique du Sud.<br />
OSS-UNESCO 1995. Les ressources en eau <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> l’OSS : évaluation, utilisation et gestion<br />
(Programme Hydrolique International).<br />
Pearce D. W., Warford J.J., 1993. World without end. Economics, Environment, and Sustainable<br />
Development.Oxford <strong>Un</strong>iversity Press.<br />
Petit J., 1997. L’eau : un vrai défi pour l’Afrique. Marchés tropicaux, pp. 2273-2285, 17 octobre 1997.<br />
Reilly J., 1996 (USDA). Climate Change, Global Agriculture and Regional Vulnerability. In Bazzaz and<br />
Sombroek<br />
Rodda, J.C., Pieyns, S.A., Sehmi, N.S. and Matthews, G., 1993. Toward a world hydrological cycle. J.<br />
Hydrological sciences, 38(5) : 373-378.<br />
Rosenzweig et al., 1995. Climate Change and Agriculture : Analysis of Potential InternationalImpacts.<br />
ASA Special Pub. N°59, American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin.<br />
Toumi M., 1997. Philosopher avec l’eau. Marchés Tropicaux, pp. 2266-2272, 17 octobre 1997.<br />
Von Amsberg, 1998. Problèmes Économiques, n° 2.596, 23 Décembre 1998.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 297
3.4.7.<br />
LE FINANCEMENT<br />
EXTÉRIEUR
PROSPECTIVE OU PERSPECTIVE AFRICAINE<br />
DES TRANSFERTS EXTERIEURS<br />
Les étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s sur le financement extérieur <strong>de</strong>s pays en développement sont rares,<br />
en particulier quand on les compare au foisonnement <strong>de</strong>s travaux réalisés sur l'agriculture, <strong>la</strong><br />
démographie, l'éducation etc. Il est vrai qu'en ce qui concerne l'Afrique Sub-Saharienne, même si les<br />
effets <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>tte sont désastreux pour les pays du continent , ils sont re<strong>la</strong>tivement mineurs pour les<br />
créanciers en regard <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte mondiale. Les quelques informations disponibles sur <strong>la</strong> question sont<br />
souvent noyées dans les modèles économiques mondiaux (dans lesquels le traitement accordé à<br />
l'Afrique est marginal) ou <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s macro-économiques à long terme sur l'Afrique ou sur les PVD.<br />
La plupart <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s traitent plus <strong>de</strong>s perspectives que <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> financière. Ainsi, <strong>de</strong>puis ces<br />
trois <strong>de</strong>rnières années, le FMI et <strong>la</strong> Banque mondiale, dans le cadre <strong>de</strong> l'initiative en faveur <strong>de</strong>s pays<br />
pauvres très en<strong>de</strong>tté (PPTE), ont-ils entrepris <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s à long terme par pays sur le <strong>de</strong>gré<br />
d'en<strong>de</strong>ttement tolérable <strong>de</strong> ces pays.<br />
D'une manière générale dans le cadre <strong>de</strong>s travaux prenant en compte le financement extérieur<br />
<strong>de</strong>s PED on peut distinguer quatre approches : <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> chiffrage <strong>de</strong>s « modèles à déficit », <strong>la</strong><br />
métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong> l'offre et d'allocation internationale <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> publique, les modèles <strong>de</strong><br />
déséquilibre sous contrainte financière et l'approche en terme <strong>de</strong> valeur actuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> soutenabilité <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>tte (modèle DSM).<br />
L'APPROCHE DE CHIFFRAGE DES BESOINS DE FINANCEMENT<br />
L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque mondiale (1989) : « Afrique Sub-Saharienne : <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise à une croissance<br />
durable, étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> à long terme » rentre dans le cadre <strong>de</strong> cette approche.<br />
OBJET DE L'ETUDE<br />
Cette étu<strong>de</strong> a marqué une étape importante dans les travaux sur les stratégies <strong>de</strong> croissance à<br />
long terme notamment en Afrique. Partant <strong>de</strong>s tendances macroé-conomiques antérieures, elle<br />
examine comment modifier les programmes et politiques pour assurer une croissance dans l'équité en<br />
Afrique Sub-Saharienne à l'horizon 2020. Dans ce cadre, l'accent sera mis sur les réformes, le<br />
renforcement <strong>de</strong>s institutions et les infrastructures. Pour ce faire, l'étu<strong>de</strong> suggère un financement<br />
soutenu qui à moyen terme ne peut provenir en gran<strong>de</strong> partie que <strong>de</strong> sources extérieures.<br />
MÉTHODE<br />
Le chiffrage <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> financement s'appuie sur <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s « modèles à déficit ».<br />
<strong>Un</strong>e fois fixé l'objectif <strong>de</strong> croissance « désirée », qui découle <strong>de</strong> l'extrapo<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s tendances macroéconomiques<br />
antérieures, on procè<strong>de</strong> ensuite à différentes projections <strong>de</strong>s déficits intérieurs (écart<br />
entre investissement et épargne) ou déficits extérieurs (écart entre besoins d'importation et capacité<br />
d'exportation) engendrés par l'objectif <strong>de</strong> croissance à atteindre.<br />
LES RÉSULTATS DU CHIFFRAGE<br />
Sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s tendances antérieures le rapport fixe comme objectif <strong>de</strong> croissance du PIB un<br />
taux <strong>de</strong> 4%/an pour <strong>la</strong> décennie 90 puis 5% <strong>de</strong> 2000 à 2020 (le revenu 1 hbt augmente <strong>de</strong> 1 à 2%/an<br />
entre 1990-2020). Les hypothèses macro-économiques utilisées pour analyser les implications <strong>de</strong> cet<br />
objectif sont indiqués dans le tableau 1. Ils suggèrent une lente évolution du taux d'épargne. Pour<br />
réduire <strong>la</strong> dépendance à l'égard du financement extérieur celui-ci <strong>de</strong>vra atteindre un niveau <strong>de</strong> 22%<br />
par rapport au PIB à l'an 2000. De l'année 1989 à cette date l'écart investissement et épargne serait<br />
d'environ 9% du PIB.<br />
En supposant ex post une égalité entre le déficit intérieur et le déficit extérieur, on en déduit que<br />
le transfert net nécessaire pour combler ce <strong>de</strong>rnier serait du même ordre (9% du PIB pour l'an 2000).<br />
Par <strong>la</strong> suite on prévoit <strong>la</strong> baisse du besoin d'épargne en <strong>de</strong>vises (% du PIB) qui va passer à 5% à l'an<br />
2020. Dans <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s flux extérieurs le financement public restera dominant.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 300
Les perspectives <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> Publique au Développement<br />
La stratégie <strong>de</strong> développement future est conçue pour réaliser l'objectif à long terme <strong>de</strong> l'autodépendance<br />
<strong>de</strong> l'Afrique. Comme l'indique les projections du tableau 1 , d'ici l'an 2020 <strong>la</strong> dépendance<br />
<strong>de</strong> l'Afrique vis-à-vis <strong>de</strong>s ressources extérieures nécessaires pour financer son développement et ses<br />
importations alimentaires <strong>de</strong>vrait être moins importante qu'aujourd'hui..<br />
Taux du PIB<br />
Investissement<br />
Epargne intérieure<br />
Coef d’ajustement<br />
Transferts nets<br />
Importations<br />
Exportations<br />
Transferts nets<br />
Ren<strong>de</strong>ment investissement<br />
É<strong>la</strong>sticité importations<br />
Tableau1 : Cadre macroéconomique illustratif<br />
en % du PIB<br />
Résultats<br />
1986-87<br />
0,8<br />
15,1<br />
11,8<br />
-2,9<br />
6,2<br />
25,5<br />
19,3<br />
6,2<br />
5<br />
Projection<br />
1990 2000 2020<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 301<br />
2 ,5<br />
17<br />
12<br />
-3<br />
8<br />
30<br />
22<br />
8<br />
15<br />
Source : Banque mondiale, « Afrique subsaharienne : <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise à une croissance durable, étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s perspectives à long terme », 1989, p 208.<br />
L'étu<strong>de</strong> prévoyait pour les années 90 le maintien du dynamisme <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s années 60, pour<br />
les raisons suivantes :<br />
- poursuite <strong>de</strong>s programmes d'ajustement , avec un nombre <strong>de</strong> plus en plus important <strong>de</strong><br />
pays: après le Nigeria, on s'attend à un allongement <strong>de</strong> <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s pays admis à bénéficier<br />
<strong>de</strong>s crédits <strong>de</strong> l'IDA <strong>de</strong> quelques grands pays (comme l'Ango<strong>la</strong> ). L'admission <strong>de</strong> ces pays<br />
<strong>de</strong>vrait accroître le volume d'APD. Pour le seul Nigeria (0,6 dol<strong>la</strong>rs par habitant en 1986), si<br />
d'ici à l'an 2000, ce pays reçoit le même traitement que d'autres pays africains exportateurs<br />
<strong>de</strong> pétrole, tels que le Cameroun et <strong>la</strong> Côte d'Ivoire, il absorbera environ 2,5 milliards <strong>de</strong><br />
dol<strong>la</strong>rs d'APD par an , ce qui <strong>de</strong>vrait représenter une augmentation <strong>de</strong> 17% par rapport au<br />
volume <strong>de</strong> l'APD estimé pour 1990.<br />
Pour atteindre ces différents objectifs l'APD nécessaire sera fonction <strong>de</strong> variables aléatoires<br />
telles que les programmes d'allégement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte, <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong> capitaux non concessionnels<br />
d'organisme publics et privés, et <strong>de</strong>s besoins en réserves. Mais l'amélioration <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong> fonds<br />
privés, par l'augmentation <strong>de</strong>s envois <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong>s travailleurs émigrés, le ralentissement <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong><br />
capitaux et l'augmentation <strong>de</strong>s IDE, <strong>de</strong>vrait être marginale. La détérioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité<br />
d'en<strong>de</strong>ttement <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong>vrait limiter les emprunts non concessionnels plus que par le<br />
passé. Au total les recettes nettes en provenance <strong>de</strong> ces sources <strong>de</strong>vraient être mo<strong>de</strong>stes, et seront<br />
<strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 6 milliards <strong>de</strong> dol<strong>la</strong>rs par an. Pour les années 90, les besoins en ressources extérieures<br />
<strong>de</strong>vraient être satisfaits si les donateurs respectent <strong>de</strong>ux objectifs :<br />
1) une augmentation <strong>de</strong> l'APD brut <strong>de</strong> 4% par an en termes réels<br />
2) <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s mécanismes d'allégement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte <strong>de</strong>s pays qui <strong>de</strong>vraient permettre<br />
<strong>de</strong> maintenir les paiements au titre du service <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte dans les années 90 à peu près au<br />
même niveau que dans les années 80, soit environ 9 milliards $ par an. A défaut une<br />
augmentation substantielle <strong>de</strong> l'APD serait nécessaire.<br />
Besoins d'une assistance spéciale continue<br />
En accord avec <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> développement proposée les besoins en ai<strong>de</strong> publique au<br />
développement étaient fixés à 22 milliards $ (au prix <strong>de</strong> 1 990) par an en 2000 (Tableau 2).<br />
5<br />
25<br />
18<br />
-2<br />
9<br />
33<br />
24<br />
9<br />
20<br />
1,1<br />
5<br />
25<br />
22<br />
-2<br />
5<br />
33<br />
28<br />
5<br />
20
Tableau 2 : Besoins d’APD <strong>de</strong> l’Afrique Subsaharienne<br />
(milliards $)<br />
Transferts nets<br />
(% PIB)<br />
Service <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte<br />
Autres flux*<br />
APD brute<br />
Moyenne<br />
annuelle ($<br />
courant)<br />
Projection<br />
($ 1990)<br />
1981-85 1986 1990 2000<br />
5<br />
(3)<br />
9<br />
6<br />
8<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 302<br />
8<br />
(5)<br />
9<br />
6<br />
11<br />
12<br />
(8)<br />
9<br />
6<br />
15<br />
19<br />
(9)<br />
9<br />
6<br />
22<br />
Source, Banque mondiale (1989)<br />
Comprennent les emprunts bruts non concessionnels, l’investissement<br />
étranger privé net, les transferts privés nets, les fluctuations <strong>de</strong>s réserves et<br />
les erreurs et omissions.<br />
La réalisation <strong>de</strong> l'objectif l'APD pour 1990 était jugé problématique par <strong>la</strong> Banque mondiale elle<br />
même, compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> réaffectation <strong>de</strong> fonds pris sur l'APD au profit <strong>de</strong>s pays pauvres d'autres<br />
régions.<br />
Dans <strong>la</strong> composition <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong>, conformément à <strong>la</strong> stratégie indiquée, l'APD sera centré sur<br />
l'appui aux dépenses publiques en matière d'infrastructure sociale et matérielle. Le financement <strong>de</strong><br />
l'ajustement structurel restera une composante principale <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> dans les années 90 et au-<strong>de</strong>là,<br />
mais sera plus sélectif. <strong>Un</strong>e restructuration <strong>de</strong>s prêts d'assistance technique « en regard <strong>de</strong><br />
l'accroissement du nombre d'Africains ayant reçus une instruction et une formation et ayant acquis <strong>de</strong><br />
l'expérience <strong>de</strong>puis l'indépendance ». La canalisation <strong>de</strong> l'APD, en particulier vers le développement<br />
par <strong>la</strong> base, va nécessiter un recours aux ONG,<br />
Outre l'ai<strong>de</strong>, le total <strong>de</strong>s besoins estimés <strong>de</strong> ressources extérieures <strong>de</strong>s pays africains<br />
représenteront environ 32 dol<strong>la</strong>rs par habitant en l'an 2000, contre 26 dol<strong>la</strong>rs en 1986.<br />
Le scénario du tableau 1 qui suppose une amélioration <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong> Inefficacité <strong>de</strong>s<br />
investissements par rapport aux années 70 et une augmentation <strong>de</strong> l'épargne intérieure et <strong>de</strong>s<br />
transferts nets dans les années 90 (50% du PIB), est jugé optimiste par <strong>la</strong> Banque mondiale.<br />
Dans l'hypothèse d'une baisse ou une stagnation du ratio transferts/PIB, le taux <strong>de</strong> croissance<br />
du revenu par habitant tomberait à 0,3%. <strong>Un</strong>e stagnation du taux d'épargne impliquerait une<br />
stagnation du revenu par habitant. De même, <strong>la</strong> non amélioration <strong>de</strong> Inefficacité <strong>de</strong>s investissements<br />
entraînerait une baisse du revenu par habitant. Enfin, si l'amélioration <strong>de</strong>s transferts, <strong>de</strong> l'épargne et<br />
<strong>de</strong> l'efficacité <strong>de</strong>s investissements n'est que <strong>de</strong> moitié <strong>de</strong> celle du scénario optimiste, le revenu par<br />
habitant continuera <strong>de</strong> stagner.<br />
METHODE DE PREVISION DE L'OFFRE GLOBALE DE L'AIDE PUBLIQUE<br />
(application au Sahel)<br />
OBJET<br />
Les travaux <strong>de</strong> Nau<strong>de</strong>t (1998) et <strong>de</strong> Van Rooyet C<strong>la</strong>rk (1997) sur les comportements<br />
d'allocation future <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> s'inscrivent dans cette démarche. Dans un contexte <strong>de</strong> baisse <strong>de</strong> l'APD<br />
aux pays en développement, l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Nau<strong>de</strong>t exposée ici tente <strong>de</strong> dégager les tendances probables<br />
<strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> publique aux pays du Sahel à l'horizon 2015. En particulier elle s'interroge sur le risque<br />
possible d'une chute <strong>de</strong>s transferts publics en faveur <strong>de</strong> cette région qui est plus que d'autres<br />
fortement dépendante <strong>de</strong> ces flux.
METHODOLOGIE<br />
Elle repose d'une part sur <strong>la</strong> modélisation <strong>de</strong> l'offre globale <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> et sur <strong>la</strong> modélisation <strong>de</strong>s<br />
comportements d'allocation future <strong>de</strong> cette ai<strong>de</strong>, d'autre part sur les prévisions <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance<br />
mondiale. Les hypothèses d'allocation <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> en 201 5 sont les suivantes:<br />
<strong>Un</strong> pays est donateur à partir d'un revenu par habitant <strong>de</strong> 15000 $. On considère que ce seuil<br />
qui était <strong>de</strong> 9000 $ en 1994, l'année <strong>de</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévision, <strong>de</strong>vrait augmenter grâce à<br />
l'accroissement général du revenu mondial en 2015.<br />
La contribution <strong>de</strong>s pays donateurs est fixée à 0,15% <strong>de</strong> leur PIB. Cette hypothèse<br />
« pessimiste » prend en compte les changements <strong>de</strong> l'environnement international ( avant 1993 ce<br />
taux était <strong>de</strong> 0,33% et il est passé à 0,27% en 1995).<br />
La répartition du montant total d'ai<strong>de</strong> entre les bénéficiaires est fonction du revenu par tête et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> ces pays. Elle est estimée à partir <strong>de</strong> l'équation : APD = k (Pop) 0 (PIB/tête) 0 le dont<br />
les paramètres sont déterminés à partir <strong>de</strong>s données 1993-1995 13 .<br />
L'étu<strong>de</strong> retient quatre scénarios <strong>de</strong> croissance internationale<br />
- <strong>Un</strong> scénario tendanciel où <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> chaque pays, pour les 20 prochaines années,<br />
reste i<strong>de</strong>ntique à celle observée en 1984-94<br />
- Dans un scénario <strong>de</strong> convergence, on admet que plus le niveau <strong>de</strong> vie initial d'un pays est<br />
faible plus sa croissance est forte, Les taux <strong>de</strong> croissance retenus sont :<br />
PIB/tête Croissance 1994-2015<br />
0 - 2000 $<br />
2001 $- 4000 $<br />
4001 $ - 10000 $<br />
plus <strong>de</strong> 10000$<br />
- Convergence avec seuil. Dans ce scénario, l'auteur considère qu'à partir d'un certain seuil,<br />
plus le niveau <strong>de</strong> vie initial est faible plus <strong>la</strong> croissance est forte. En <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> ce seuil <strong>la</strong><br />
croissance est faible.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 303<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
PIB/tête Croissance 1994-2015<br />
0 - 2000 $<br />
2001 $- 4000 $<br />
4001 $ - 10000 $<br />
plus <strong>de</strong> 10000$<br />
- Scénario géographique où les taux <strong>de</strong> croissance sont fonction <strong>de</strong> l'appartenan ce à une<br />
région géographique donnée. Compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynamique actuelle ou prévisible <strong>de</strong>s<br />
différentes zones les taux retenus sont<br />
RESULTATS<br />
Zones croissance<br />
1994-2015<br />
OCDE<br />
1,5%<br />
Asie<br />
4%<br />
Océanie 3%<br />
Amérique Latine 3%<br />
1%<br />
4%<br />
3%<br />
1%<br />
Zones croissance<br />
1994-2015<br />
Europe <strong>de</strong> l'Est + ex-URSS 3%<br />
Afrique Nor<strong>de</strong>t Moyen 0. 2%<br />
Afrique sub-saharienne 1%<br />
En dépit <strong>de</strong>s hypothèses « pessimistes » sur l'offre d'ai<strong>de</strong> publique, seul le scénario (sur les<br />
quatre) qui prévoit une croissance <strong>de</strong> 4% par tête, soit une progression annuelle moyenne <strong>de</strong> 7% pour<br />
le PIB pendant 20 ans, conduit à une baisse (<strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 1 0%) <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> (en valeur constante) en<br />
13 La métho<strong>de</strong> générale utilisée par l'auteur est proche <strong>de</strong> celle utilisée par C<strong>la</strong>rk et Van Rooy. Les scénarios retenus sont<br />
i<strong>de</strong>ntiques. Mais les <strong>de</strong>ux travaux se diffèrent par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> d'allocation <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong>. C<strong>la</strong>rk et Van Rooy ont simulé une répartition<br />
<strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> proportionnelle à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s différents pays receveurs.
faveur du Sahel. Ce résultat optimiste s'explique par l'accroissement du nombre <strong>de</strong> donateurs<br />
provenant notamment <strong>de</strong>s pays du Sud-Est asiatique, par <strong>la</strong> diminution du nombre <strong>de</strong> bénéficiaires<br />
(effet <strong>de</strong> richesse et <strong>la</strong> limite d'allocation <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong>) et par <strong>la</strong> lenteur <strong>de</strong> l'amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation<br />
économique <strong>de</strong> <strong>la</strong> région (par rapport aux autres) qui fait d'elle une zone « privilégiée » en matière<br />
d'ai<strong>de</strong>. L'ensemble <strong>de</strong>s résultats est indiqué dans le tableau ci-après.<br />
Scénarios<br />
Situation<br />
1994<br />
Scénario<br />
tendance<br />
Scénario<br />
converg.<br />
Scénario<br />
converg.<br />
Seuil<br />
Scénario<br />
géograph.<br />
APD totale<br />
(mds $ 94)<br />
Simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> au Sahel en 2020<br />
Nb<br />
donateurs<br />
Nb<br />
bénéficiaire<br />
s<br />
APD Sahel<br />
(mds $ 94)<br />
APD/tête<br />
APD Sahel/<br />
APD total<br />
61,2 25 140 2,7 58 $ 4,4 %<br />
54,9 32 125 3,1 38 $ 5,6 %<br />
40,5 29 115 2,5 30 $ 6,2 %<br />
42,0 32 103 2,7 33 $ 6,4 %<br />
47,7 33 118 3,4 41 $ 7,1 %<br />
Avec <strong>de</strong>s hypothèses d'offre d'ai<strong>de</strong> plus « optimistes », par exemple une contribution <strong>de</strong>s donateurs<br />
<strong>de</strong> 0,3% <strong>de</strong> leur PIB, les résultats sont le double <strong>de</strong> ceux indiqués ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
L'APPROCHE DE LA SOUTENABILITE A LONG TERME DE LA DETTE DES PED<br />
OBJET<br />
Depuis 1996 <strong>la</strong> Banque mondiale et le FMI ont <strong>la</strong>ncé un programme d'« initiative pour résoudre<br />
les problèmes d'en<strong>de</strong>ttement <strong>de</strong>s pays pauvres très en<strong>de</strong>ttés » (PPTE). L'objectif principal est <strong>de</strong><br />
ramener l'en<strong>de</strong>ttement <strong>de</strong>s pays pauvres très en<strong>de</strong>ttés qui poursuivent <strong>de</strong> « saines politiques<br />
économique et fiscale » à un niveau soutenable, pour éviter que le poids élevé <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>tte et <strong>de</strong>s<br />
charges <strong>de</strong> services induites ne compromettent les efforts d'ajustement et <strong>de</strong> réforme entrepris par<br />
ces pays. Sur <strong>la</strong> quarantaine <strong>de</strong> PPTE on compte 31 pays d'Afrique Sub-Saharienne<br />
MÉTHODE<br />
L'initiative PPTE comporte trois phases :<br />
i) <strong>la</strong> condition d'entrée au moment où commencent les programmes d'ajustement ;<br />
ii) le point <strong>de</strong> décision, normalement après trois ans ; et<br />
iii) le point d'achèvement au bout d'une <strong>de</strong>uxième pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> trois ans.<br />
La programmation <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> décision et d'achèvement repose sur <strong>la</strong> détermination du<br />
niveau d'en<strong>de</strong>ttement soutenable (DET). Le modèle <strong>de</strong> référence utilisé par <strong>la</strong> Banque mondiale est le<br />
Modèle + <strong>de</strong> <strong>la</strong> Capacité <strong>de</strong> Soutien <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dette (DSM+) qui permet <strong>de</strong> quantifier les effets <strong>de</strong>s<br />
opérations d'aménagement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte ou <strong>de</strong>s nouveaux emprunts. La démarche adoptée repose sur<br />
une approche (au cas par cas) en terme <strong>de</strong> contrainte <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur actuelle nette (VAN) du ratio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>tte aux exportations (entre 200 et 250%) et du ratio du service <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte aux exportations (entre<br />
20 et 25%). Cette démarche s'inscrit dans un cadre macro-économique à moyen (ou long) terme<br />
portant, notamment sur les données et les projections <strong>de</strong>s exportations et <strong>de</strong> l'en<strong>de</strong>ttement.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 304
INPUT DSM+ MODEL OUTPUT<br />
I<strong>de</strong>ntified need for<br />
restructuring<br />
Figure 1 : Fonctionnement du Mo<strong>de</strong>l DSM+<br />
Source : site Internet Banque mondiale : http ://www.wolrdbank.org<br />
RÉSULTATS<br />
Current state of<br />
borrowing<br />
BOP<br />
Budget<br />
Alternative<br />
restructuring<br />
scenarios<br />
Impact on BOP<br />
and Budget<br />
New borrowing or<br />
new terms<br />
Les perspectives au cas par cas sur <strong>la</strong> progression <strong>de</strong>s PPTE d'Afrique vers chacune <strong>de</strong>s<br />
phases <strong>de</strong> l'initiative à l'horizon 2000 / 2001 indiquent , sur <strong>la</strong> base d'un critère <strong>de</strong> 200% pour le ratio<br />
VAN <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte/exportations, que 1 5 <strong>de</strong>s 26 pays africains étudiés auraient besoin d'une assistance<br />
dans le cadre <strong>de</strong> l'initiative PPTE.<br />
Sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s hypothèses <strong>de</strong> référence (cf. encadré), les estimations <strong>de</strong> coûts globaux <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
programmation <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> décision et d'achèvement qui sont réalisées pour 20 pays en<strong>de</strong>ttés dont<br />
15 pays d'Afrique Sub-Saharienne, indiquent un montant <strong>de</strong> 8,2 milliards <strong>de</strong> dol<strong>la</strong>rs, en valeur actuelle<br />
<strong>de</strong> 1996 (9,4 milliards $ en VAN <strong>de</strong> 1998), en supposant un taux d'actualisation <strong>de</strong> 7%.<br />
Hypothèses utilisées pour les estimations <strong>de</strong>s coûts<br />
Reorganized<br />
borrowing<br />
strategy<br />
New macroeconomic<br />
and<br />
financial<br />
programming<br />
• C<strong>la</strong>use d'extinction : les estimations supposent que les conseils acceptent d'étendre <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
d'admissibilité à bénéficier <strong>de</strong> l'initiative aux pays qui adoptent <strong>de</strong>s programmes appuyés par <strong>la</strong> le<br />
Fonds d'ici à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l'an 2000.<br />
• Cadre macro-économique : les estimations se fon<strong>de</strong>nt sur le cadre macro-économique à moyen<br />
terme établi par les équipes pays, notamment les données et les projections sur les exportations<br />
et l'en<strong>de</strong>ttement. Dans quelques cas, ces données sont sujettes à <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s marges<br />
d'incertitu<strong>de</strong>.<br />
• Programmation <strong>de</strong> l'assistance : il est supposé que tous les pays susceptibles d'être admis à<br />
l'initiative PPTE en font effectivement <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, et que l'assistance est fournie sans retard.<br />
• Critères concernant le <strong>de</strong>gré d'en<strong>de</strong>ttement tolérable : le scénario <strong>de</strong> référence se base sur un<br />
critère <strong>de</strong> 200% concernant le ratio VAN <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte/exportations pour tous les pays, sauf ceux:<br />
i) qui ont déjà atteint le point <strong>de</strong> décision,<br />
ii) qui ont fait l'objet d'examens PPTE préliminaires aux conseils ; ou qui<br />
îii) seront admissibles, d'après les prévisions, en vertu du critère <strong>de</strong> budget/d'ouverture.<br />
• Répartition <strong>de</strong>s charges : pour les pays qui ont déjà reçu un engagement d'assistance, <strong>la</strong><br />
division <strong>de</strong>s coûts par groupe <strong>de</strong> créanciers est faite en fonction <strong>de</strong>s montants indiqués dans<br />
chaque document <strong>de</strong> confirmation du point <strong>de</strong> décision. Pour les cas prospectifs, <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s<br />
charges est censée être faite entièrement sur une base proportionnelle.<br />
Source : Comité du Développement, « Initiative en faveur <strong>de</strong>s pays pauvres très en<strong>de</strong>ttés : examen et<br />
perspectives », DC/98-15<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 305
Outre le Bénin et le Sénégal, on ne dispose pas d'analyses DET à long terme pour les autres<br />
pays. L'analyse, au cas par cas, <strong>de</strong> <strong>la</strong> soutenabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte repose sur <strong>de</strong>ux scénarios: un scénario<br />
optimiste <strong>de</strong> base et un scénario alternatif qui l'est moins. Les horizons d'analyse pour chacun <strong>de</strong>s<br />
pays étaient respectivement 2015 et 2017.<br />
Le scénario économique <strong>de</strong> base suppose <strong>la</strong> réalisation d'une saine politique économique et<br />
fiscale, <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong>s réformes structurelles qui inclus <strong>la</strong> libéralisation <strong>de</strong>s échanges dans le cadre<br />
<strong>de</strong> l'UMOA, et un environnement stable.<br />
Les hypothèses macro-économiques retenues pour le Sénégal sont les suivantes (moyenne par<br />
an en 1997-2006 et 2007-2017) :<br />
- taux <strong>de</strong> croissance du PIB réel : 5,3% et 5,0%<br />
- croissance <strong>de</strong>s exportations en volume : 5,7% et 4,3%<br />
- avec les termes <strong>de</strong> l'échange quasi constants le déficit <strong>de</strong> <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce courante (hors<br />
transferts officiels) <strong>de</strong>vrait passer <strong>de</strong> 7,5 % du PIB en 1997 à 4,9% <strong>la</strong> première pério<strong>de</strong> et<br />
1,7% par <strong>la</strong> suite.<br />
- une amélioration <strong>de</strong>s recettes budgétaires en pourcentage du PIB : 16,2% et 18,5%<br />
- financement extérieur sous forme <strong>de</strong> prêts et <strong>de</strong> dons enregistrera une baisse tendancielle :<br />
6,8% du PIB en 1997 ; 3,9% en 2005 et 1,5% en 2017. La part <strong>de</strong>s dons dans le<br />
financement public est supposée constante. Le relèvement tendanciel <strong>de</strong>s flux nets privés<br />
<strong>de</strong> 1 % du PIB en 2005 et ce niveau sera maintenu par <strong>la</strong> suite.<br />
Dans ces conditions, les allégements <strong>de</strong> <strong>de</strong>tte obtenus <strong>de</strong>s mécanismes en vigueur (réduction<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>tte au Club <strong>de</strong> Paris dans les termes <strong>de</strong> Naples en 1998 et autres traitements comparables hors<br />
Club <strong>de</strong> Paris) suffisent pour permettre à ce pays <strong>de</strong> ramener sa <strong>de</strong>tte à un niveau tolérable. Le ratio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte /exportations en valeur actuelle nette, passe <strong>de</strong> 129% en 1998 à 80% en 2005 et 40 % en<br />
2017. Pour les mêmes années le ratio service <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte/exportations s'établit respectivement à 16 %,<br />
10 % et 4,5 %.<br />
LES MODÈLES DE DÉSÉQUILIBRE SOUS CONTRAINTE FINANCIÈRE<br />
OBJET<br />
Le modèle CEPII pour les économies du Sud, entre dans ce cadre. Il permet <strong>de</strong> montrer<br />
comment <strong>la</strong> contrainte financière <strong>de</strong> ces pays à <strong>la</strong> croissance peut se <strong>de</strong>sserrer ou au contraire se<br />
renforcer selon les évolutions <strong>de</strong> l'environnement international et <strong>de</strong> leurs structures internes. Les<br />
scénarios prospectifs par pays sont effectués sur les années 1992 à 2000 et portent sur un échantillon<br />
diversifié <strong>de</strong> pays à revenu intermédiaire, mais qui ne comporte pas <strong>de</strong> pays d'Afrique Sub-<br />
Saharienne (Mexique, Brésil, Maroc, Thaï<strong>la</strong>n<strong>de</strong> et Ma<strong>la</strong>ysia).<br />
MÉTHODE<br />
Ce modèle qui comporte une centaine d'équations (dont dix <strong>de</strong> comportement) retrace les<br />
évolutions <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur ajoutée en distinguant les postes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> finale :consommation (privée<br />
et publique), l'investissement (privé et public) les exportations et importations <strong>de</strong> biens et service. Il<br />
prend également en compte une décomposition assez fine <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong> capitaux liés à<br />
l'en<strong>de</strong>ttement extérieur. Dans sa logique <strong>de</strong> fonctionnement, qui s'inspire <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong><br />
déséquilibre, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> (externe et interne) détermine l'investissement et <strong>la</strong> croissance « désirée ».<br />
Mais cette <strong>de</strong>rnière peut être contrainte par le financement extérieur.<br />
Compte tenu <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte et <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrainte comptable <strong>de</strong> <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s<br />
paiements, si l'apport <strong>de</strong> capitaux extérieurs est insuffisant, on abouti a un p<strong>la</strong>fonnement du montant<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>vises disponibles pour les importations et donc pour les investissements. De façon générale,<br />
quatre régimes <strong>de</strong> croissance sont traités : un régime keynésien, un régime contraint par l'offre, un<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 306
égime contraint financièrement et un régime à <strong>la</strong> fois contraint par l'offre et les financements<br />
extérieurs.<br />
L'analyse <strong>prospective</strong> part <strong>de</strong>s projections centrales dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong><br />
l'économie mondiale portant sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> mondiale, les prix <strong>de</strong>s échanges, les taux d'intérêt et les<br />
effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> restructuration <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte extérieure. On é<strong>la</strong>bore ensuite <strong>de</strong>s variantes i<strong>de</strong>ntiques (hausse<br />
<strong>de</strong> taux d'intérêt, <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> capitaux et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> mondiale) et <strong>de</strong>s variantes spécifiques pour<br />
chacun <strong>de</strong>s pays en<strong>de</strong>ttés.<br />
RÉSULTATS ET CONCLUSION<br />
Même si l'instrument macro-économique utilisé ne permet pas d'appréhen<strong>de</strong>r les problèmes<br />
spécifiques aux pays à revenu faible, les exercices variantiels effectués mettent en évi<strong>de</strong>nce un point<br />
essentiel qui concerne toutes les catégories <strong>de</strong> pays. « L'amélioration <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l'échange ou<br />
celle <strong>de</strong>s conditions du financement externe sont favorables, à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés divers, à tous les pays du<br />
sud concernés ». Toutefois, ne profitent <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> mondiale que les pays<br />
re<strong>la</strong>tivement intégrés à l'économie mondiale et qui sont aptes à y répondre.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Banque Mondiale (1 989) « Afrique Sub-Saharienne : <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise à une croissance durable, étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>prospective</strong> à long terme » .<br />
Bensidoun 1. et Kessler V. (1 992) « Dynamiques macro-économiques <strong>de</strong>s économies du Sud »<br />
document <strong>de</strong> travail CEPII, no 92-01 mars.<br />
Commission Européenne (1997) « Livre vert sur les re<strong>la</strong>tions entre l'<strong>Un</strong>ion Européenne et les pays<br />
ACP défis et options pour un nouveau partenariat ».<br />
Elliot B. (1 996), Dilemmas in Donor Aid Strategies in Gwin C. and Nelson J., Perspectives on Aid and<br />
Development », ODC Policy Essay, Washington.<br />
Nau<strong>de</strong>t J-D. (1 998), «Trouver <strong>de</strong>s problèmes aux solutions: 20 ans d'ai<strong>de</strong> au Sahel », OCDE, Paris.<br />
O<strong>la</strong>v S.(1996), Foreign Aid towards the Year 2000 : Experiences and Challenges, Franck Cass<br />
London<br />
<strong>la</strong>n S. (1 997), The Overloa<strong>de</strong>d Rickshaw and the future of Aid, Mimeo.<br />
Roger R. (1 996), Aid in the 21st Century, ODS/PNUD.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 307
3.4.8.<br />
LA SANTE
MALADIE, MORTALITE ET SANTE :<br />
LES TENDANCES A L'HORIZON 2025<br />
EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA (ASS)<br />
"La santé est un état <strong>de</strong> complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en<br />
une absence <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die ou d'infirmité (Oms)". Faute <strong>de</strong>s moyens permettant d'évaluer <strong>la</strong> santé, on<br />
utilise <strong>de</strong>s termes sanitaires qui reposent sur <strong>de</strong>s indicateurs c<strong>la</strong>ssiques. Ces indicateurs sont :<br />
l'espérance <strong>de</strong> vie, <strong>la</strong> mortalité et <strong>la</strong> morbidité. Le présent document propose les différentes<br />
estimations tendancielles <strong>de</strong>s experts sur <strong>la</strong> situation sanitaire en Afrique au sud du Sahara à l'horizon<br />
2025. Il s'agit <strong>de</strong> présenter <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s mais aussi <strong>de</strong>s projections à long terme. Ce<br />
travail se répartit <strong>de</strong> manière suivante. En premier, nous présentons les différents modèles. Ensuite,<br />
nous proposons une évaluation globale <strong>de</strong>s travaux.<br />
I. PRESENTATION DES PRINCIPALES PREVISIONS<br />
T.E. MERTENS and D. LOW-BEER (1996). HIV SIDA : Où va l'épidémie ?<br />
OMS, Volume 74, Genève.<br />
Avec plus <strong>de</strong> 12.9 millions d'adultes infectés par le VIH, l'Afrique subsaharienne est <strong>la</strong> région <strong>la</strong><br />
plus durement touchée. La voie hétérosexuelle représente le mo<strong>de</strong> prédominant <strong>de</strong> transmission<br />
<strong>de</strong>puis le début, et actuellement le nombre <strong>de</strong> femmes infectées dépasse celui <strong>de</strong>s hommes.<br />
Dans cet article Mertens et Low-Beer dressent un portrait <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die du SIDA. Ils évoquent<br />
<strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce systématique <strong>de</strong> l'infection à VIH (Virus <strong>de</strong> l'Immuno-déficience<br />
Humaine) et du SIDA mise en p<strong>la</strong>ce dans <strong>de</strong> nombreux pays au cours <strong>de</strong>s dix <strong>de</strong>rnières années.<br />
Il ressort <strong>de</strong> ce travail <strong>de</strong>ux points importants. En 1996, on estimait à plus <strong>de</strong> 20,1 millions le<br />
nombre d'adultes vivants et contaminés par le VIH ou ayant le SIDA. En majorité, ce sont les habitants<br />
<strong>de</strong> l'Afrique orientale, centrale et australe qui sont touchés par <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Mais, <strong>de</strong>puis, l'épidémie a<br />
évolué rapi<strong>de</strong>ment. A titre d'exemple, si en Amérique du Nord et en Europe occi<strong>de</strong>ntale, on constate<br />
un recul <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, elle sévit dans <strong>de</strong> nombreuses autres régions du mon<strong>de</strong>, notamment en<br />
Afrique <strong>de</strong> l'Ouest et du Sud, en In<strong>de</strong>, en Asie du Sud-Est. Ainsi, on estime au total à près <strong>de</strong> 40<br />
millions le nombre d'habitants concernés en l'an 2010. Plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s adultes nouvellement<br />
contaminés sont <strong>de</strong>s femmes. Plus <strong>de</strong> 6 millions <strong>de</strong> femmes en âge <strong>de</strong> procréer sont infectées, et on<br />
pense que non moins <strong>de</strong> 1 million d'enfants ont déjà été contaminés avant ou pendant<br />
l'accouchement, ou par le biais <strong>de</strong> l'al<strong>la</strong>itement au sein.<br />
METHODOLOGIE UTILISEE<br />
Les estimations concernant le virus VIH dans les différentes régions géographiques ont été<br />
réalisées à partir <strong>de</strong>s données empiriques. Elles soulignent les tendances servant à repérer l'évolution<br />
<strong>de</strong>s épidémies régionales. Ces tendances permettent <strong>de</strong> maintenir le lien étroit entre les interventions<br />
et les réalités. Les auteurs signalent aussi le problème <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce et <strong>de</strong> l'évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die. Il faut reconnaître que l'objectif <strong>de</strong> ce travail est maintenant <strong>de</strong> pouvoir i<strong>de</strong>ntifier ce qui fait le<br />
succès et qui pourrait <strong>la</strong>isser entrevoir une lueur d'espoir.<br />
D. KEROUEDAN (1998) Lutter contre le sida en Afrique <strong>de</strong> l'Ouest :<br />
quelles perspectives en cette fin <strong>de</strong> siècle ? Sante Publique, No 10, pp 203 - 218.<br />
La Côte d'Ivoire est un pays <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 15 millions d'habitants. Le taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion annuel moyen est l'un <strong>de</strong>s plus élevés <strong>de</strong> l'Afrique, soit 3,8 %. Dans ce pays, <strong>la</strong> pathologie<br />
est dominée par les ma<strong>la</strong>dies infectieuses. La première cause <strong>de</strong> mortalité <strong>de</strong> l'adulte masculin en<br />
milieu hospitalier est le sida (<strong>de</strong>uxième cause <strong>de</strong> mortalité chez <strong>la</strong> femme). Le pic d'âge <strong>de</strong><br />
contamination se situe entre 15 à 40 ans et le pic <strong>de</strong> mortalité est <strong>de</strong> 5 à 10 ans plus tard après <strong>la</strong><br />
déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 310
En Côte d'Ivoire, il y avait <strong>de</strong>ux cas déc<strong>la</strong>rés en 1985. En 1987, une enquête épidémiologique a<br />
montré que le taux <strong>de</strong> séro-positifs représentait 1 %. En 1989, ce taux passe à 10 %. Selon l'étu<strong>de</strong>, en<br />
raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> pathologie, l'espérance <strong>de</strong> vie en Côte d'Ivoire va connaître une baisse d'environ 20 % en<br />
2010. Le sida est i<strong>de</strong>ntifié comme <strong>la</strong> principale cause <strong>de</strong> mortalité chez les adultes <strong>de</strong> 15 à 44 ans à<br />
Abidjan et chez les 15 à 55 ans en Tanzanie dans les années à venir.<br />
Méthodologie (non publiée)<br />
Sujet n o 3: G. MWABU (1998). Health Development in Africa. , Economic Researche Papers n.<br />
38, ADB, Abidjan.<br />
Dans cet article, Mwabu fait une analyse du rôle joué par les différents facteurs socioéconomiques,<br />
politiques et médicaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé an Afrique. A l'ai<strong>de</strong> d'indicateurs <strong>de</strong> développement<br />
du taux <strong>de</strong> mortalité infantile, <strong>de</strong>s taux bruts <strong>de</strong> mortalité, <strong>de</strong> fécondité et <strong>de</strong> longévité durant les 15<br />
<strong>de</strong>rnières années, l'auteur montre que l'Afrique a connu un gros progrès en termes <strong>de</strong> développement<br />
sanitaire, même si ce développement reste encore faible en comparaison <strong>de</strong>s pays développés.<br />
L'objectif <strong>de</strong> Mwabu est aussi <strong>de</strong> présenter une projection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>africaine</strong> selon les régions.<br />
Méthodologie pour l'évaluation <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> santé<br />
Par rapport aux autres biens et services économiques, <strong>la</strong> santé ne peut être mesurée<br />
directement. Ainsi, l'auteur retient 10 déterminants qui influencent <strong>la</strong> santé (Ex. les variables du niveau<br />
<strong>de</strong> l'individu - éducation, etc.). Dans l'étu<strong>de</strong>, l'auteur utilise <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> niveau national probabilisé<br />
pour représenter l'indicateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et un indicateur actuel <strong>de</strong> santé donné par le taux <strong>de</strong> fertilité<br />
au niveau national (nombre d'enfants nés par rapport aux nombre <strong>de</strong> femmes).Ces indicateurs sont<br />
<strong>de</strong>s proxis. Ainsi le modèle d'étu<strong>de</strong> est un modèle <strong>de</strong> régression. Il permet d'estimer les indicateurs <strong>de</strong><br />
santé : le taux <strong>de</strong> mortalité infantile, le taux brut <strong>de</strong> natalité, le taux brut <strong>de</strong> mortalité, le taux <strong>de</strong> fertilité,<br />
l'espérance <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>s hommes. Pour chaque indicateur, le modèle est <strong>de</strong> type :<br />
Log xt=logft+et<br />
D'après cette équation, si xt est l'indicateur à expliquer (par exemple le taux <strong>de</strong> mortalité), il<br />
dépend <strong>de</strong>s déterminants ft qui influencent <strong>la</strong> santé (par exemple : les variables du niveau <strong>de</strong> l'individu<br />
- éducation, etc.).<br />
RESULTATS<br />
Mwabu a voulu représenter les tendances <strong>de</strong> l'espérance <strong>de</strong> vie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> morbidité et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mortalité par l'indicateur démographique. Ce premier résultat est représenté par le tableau suivant :<br />
Table 4. African popu<strong>la</strong>tion sizes and growth rates, 1960 - 2000<br />
Régions<br />
Popu<strong>la</strong>tions sizes (millions) Popu<strong>la</strong>tion growth rates(%)<br />
1960 1994 2000 1960-1994 1994-2000<br />
Central Africa 32,7<br />
82,2<br />
97,2<br />
2,26<br />
2.99<br />
North Africa 67,9 156,6 177,3 2,67<br />
2.30<br />
West Africa 78,1 199,3 238,9 2,66<br />
2.64<br />
East Africa 56,6 148,9 182,9 2,97<br />
2.40<br />
South Africa 42,7 102,1 108,4 2,72<br />
2.54<br />
Africa 277,7 689,1 804,7 2,65 2.59<br />
Source : Mwabu, 1998.<br />
L'analyse <strong>de</strong> ce tableau montre que <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en Afrique résidait au Nord et à<br />
l'Ouest du continent en 1960. En terme <strong>de</strong> taux <strong>de</strong> croissance, on constate que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à l'Ouest<br />
<strong>de</strong> l'Afrique va connaître une stagnation. Le taux <strong>de</strong> croissance qui est <strong>de</strong> 2,67 % entre 1960 et 1994<br />
va passer à 2,64 %. Au Nord, au Sud et à l'Est, on observe une diminution <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> croissance.<br />
Respectivement, les taux passent <strong>de</strong> 2,67 à 2,30, 2,74 à 2,59 et <strong>de</strong> 2,97 à 2,40. Seule <strong>la</strong> région<br />
Centrale va connaître une augmentation en terme <strong>de</strong> variation du taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 311
OMS (1998) Rapport sur <strong>la</strong> santé dans le mon<strong>de</strong> 1998 : La vie au 21 e siècle. <strong>Un</strong>e perspective<br />
pour tous. OMS, Genève.<br />
Ce rapport dresse un bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s grands problèmes qui ont marqué l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé dans le<br />
mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>puis 1950. Il donne aussi une perspective <strong>de</strong> ce que sera les tendances sanitaires du 21 e<br />
siècle, précisément à l'horizon 2025. Ce rapport est le quatrième document publié par l'OMS qui<br />
permet <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nifier l'action sanitaire au 21 e siècle. Le premier rapport sur <strong>la</strong> santé dans le Mon<strong>de</strong> 1995<br />
- Réduire les écarts avait pour tâche <strong>de</strong> montrer le fossé qui existe entre les pays riches et les pays<br />
pauvres. Dans ce rapport, on présentait <strong>la</strong> pauvreté comme l'une <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> cet écart. Le<br />
<strong>de</strong>uxième rapport sur <strong>la</strong> santé dans le Mon<strong>de</strong> 1996 - Combattre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, promouvoir le<br />
développement présentait trois gran<strong>de</strong>s priorités pour combattre les ma<strong>la</strong>die : (i) achever l'action<br />
entreprise pour éradiquer et éliminer certaines ma<strong>la</strong>dies, (ii) s'attaquer à <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies "anciennes"<br />
(comme <strong>la</strong> tuberculose et le paludisme) et (iii) combattre les ma<strong>la</strong>dies émergentes (comme le sida).<br />
Le troisième rapport sur <strong>la</strong> santé dans le Mon<strong>de</strong> 1997 - Vaincre <strong>la</strong> souffrance, enrichir l'humanité<br />
mettait l'accent sur les ma<strong>la</strong>dies chroniques. Il recommandait les mesures à prendre pour lutter contre<br />
les ma<strong>la</strong>dies : <strong>la</strong> prévention, le diagnostic, le traitement, <strong>la</strong> réadaptation et <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s<br />
professionnels <strong>de</strong> santé. A bien <strong>de</strong>s égards, ce quatrième rapport, dans son ensemble, expose et<br />
projette <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s tendances très optimistes <strong>de</strong> l'état sanitaire du mon<strong>de</strong> jusqu'à l'horizon 2025.<br />
L'explication <strong>de</strong> cette évolution <strong>de</strong> l'état <strong>de</strong> santé dépend <strong>de</strong>s progrès socio-économiques accomplis<br />
par l'humanité durant ce siècle.<br />
RESULTATS<br />
Les résultats <strong>de</strong> l'OMS sont globaux. Dans ce qui suit, nous ne représenterons que les<br />
tendances sanitaires re<strong>la</strong>tives à l'Afrique et concernant les cibles directives qui concernent l'évaluation<br />
<strong>de</strong> l'espérance <strong>de</strong> vie (les tendances démographiques), <strong>la</strong> mortalité et <strong>la</strong> morbidité.<br />
• La démographie mondiale<br />
Selon les estimations <strong>de</strong> l'OMS, <strong>la</strong> composition <strong>de</strong> <strong>la</strong> démographie mondiale serait <strong>la</strong> suivante :<br />
1955 2025<br />
Popu<strong>la</strong>tion mondiale (mlds) 2,8 à 5,8 8<br />
Popu<strong>la</strong>tion mondiale<br />
rurale<br />
68 %<br />
41 %<br />
35 %<br />
59 %<br />
Popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s moins <strong>de</strong> 20 ans 40 % 32 %<br />
Popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s plus <strong>de</strong> 65 ans 390 millions 800 millions<br />
urbaine<br />
• Les causes <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité<br />
Les tendances <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité ont été données dans un cadre plus global <strong>de</strong> famille<br />
ou groupe <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies (voir Rapport sur <strong>la</strong> santé dans le mon<strong>de</strong> 1998). Toutefois, dans le tableau<br />
suivant, on montre que <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s décès sont dus aux ma<strong>la</strong>dies infectieuses et parasitaires. On en<br />
déduit que ces mêmes ma<strong>la</strong>dies seront les premières causes <strong>de</strong> mortalité au 21 e siècle en ASS.<br />
Principaux groupes <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies/affections, Région <strong>de</strong> l'Afrique (ASS)<br />
pour certaines années (liste indicative)<br />
Groupes <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies 1960 1980 1955 2025<br />
Infectieuses et parasitaires 1 1 1 1<br />
Maternelles et périnatales 2 2 2 2<br />
Tumeurs malignes<br />
4 4 5 5<br />
Endocriniennes et nutritionnelles<br />
Troubles mentaux et du comportement<br />
Appareil circu<strong>la</strong>toire 5 5 4 3<br />
Appareil respiratoire 3 3 3 4<br />
Toutes causes extérieures<br />
Source : Rapport OMS 1998, p. 183<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 312
Ces ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>meurent une menace au 21 e siècle, en Afrique au sud du Sahara (ASS). Ce<br />
fléau n’épargne personne. Les autres estimations réalisées par l'Oms montrent également que les<br />
enfants sont et seront confrontés à ces ma<strong>la</strong>dies. Quant au cancer, il est considéré que cette ma<strong>la</strong>die<br />
risque <strong>de</strong> s'étendre à l'ASS. En effet, au fur et à mesure que les économies <strong>africaine</strong>s se développent,<br />
les ma<strong>la</strong>dies non transmissibles vont <strong>de</strong>venir l’une <strong>de</strong>s principales causes <strong>de</strong> mortalité.<br />
• Mortalité chez l'adulte et l'enfant<br />
Selon les estimations <strong>de</strong> l'OMS, on constate une réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité chez l'adulte et<br />
l’enfant.<br />
Taux <strong>de</strong> mortalité : corrigés <strong>de</strong> l'âge, par tranche d'âge<br />
Estimations pour 1955 - 2025 (pour 100 000 habitants)<br />
Tranches d’âge 1955 1975 1995 2025<br />
Corrigé <strong>de</strong> l'âge<br />
2 670 2 013 1 645 936<br />
et du sexe<br />
moins <strong>de</strong> 5 ans 7 243 4 966 3 439 1 431<br />
5 à 19 ans 1 178 821 612 238<br />
20 à 64 ans 1 446 1 099 994 544<br />
64 + 9 299 8 011 7 159 5 717<br />
Source : Rapport OMS 1998, p. 182<br />
Toutefois, les résultats par pays sont très intéressants. Ils donnent une visualisation du futur <strong>de</strong><br />
ce que doit être le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé dans le pays. Les caractéristiques <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die par pays sont données par le tableau suivant :<br />
Espérance <strong>de</strong> vie à <strong>la</strong><br />
(ans)<br />
naissance Taux <strong>de</strong><br />
moins <strong>de</strong><br />
mortalité<br />
5 ans<br />
<strong>de</strong>s Taux <strong>de</strong><br />
infan<br />
mortalité<br />
tile<br />
Taux <strong>de</strong><br />
corrigé <strong>de</strong><br />
du sexe<br />
000<br />
mortalité<br />
l'âge et<br />
(pour 100<br />
hbts)<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 313<br />
Décès au<strong>de</strong><br />
50 ans<br />
total<br />
Deux sexes Rapport<br />
Deux sexes Rapport<br />
f/m<br />
f/m<br />
1997 2025 1997 1997 2025 1997 1997 2025 1997 2025 1997 2025<br />
Pays<br />
Afrique du Sud 65 74 1,10 68 23 0,81 48 20 926 582 47 21<br />
Côte d'Ivoire 51 64 1,04 128 58 0,89 87 44 1658 939 74 53<br />
Éthiopie 50 64 1,06 166 71 0,89 109 51 1737 983 79 63<br />
Ghana 58 69 1,07 107 43 0,87 74 34 1263 755 71 45<br />
Nigeria 52 64 1,06 141 70 0,91 78 42 1563 978 77 58<br />
METHODOLOGIE<br />
Au sein du groupe Prospective <strong>de</strong> l'Oms, on parle plus <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s que d'une métho<strong>de</strong>. En<br />
effet, l'Oms s'appuie sur l'expertise <strong>de</strong>s organismes et centres d'étu<strong>de</strong>s pour faire réaliser ces<br />
évaluations. Les méthodologies qui permettent d'estimer les tendances sanitaires sont contenue dans<br />
le document "Health Futures : Concepts and Methods". Dans ce document, on présente un<br />
ensemble d'étu<strong>de</strong>s et on présente aussi les combinaisons <strong>de</strong>s outils méthodologiques. Pour<br />
l'ensemble <strong>de</strong> ces modèles, le fonctionnement est le suivant : à partir <strong>de</strong>s opinions <strong>de</strong>s experts, on<br />
explore les effets <strong>de</strong>s facteurs socio-économiques pour décrire les tendances longues <strong>de</strong>s indicateurs<br />
<strong>de</strong> santé. Les différents types <strong>de</strong> tendances peuvent se résumer telles que :<br />
• possible - qu'est-ce qui doit arriver ?<br />
• p<strong>la</strong>usible - qu'est-ce qui peut arriver ?<br />
• probable - qu'est-ce qui est probable ?<br />
• préférable - qu'est-ce que nous voulons qui arrive ?<br />
Les actions ou les comportements humains influencent les facteurs socio-économiques. Il est<br />
intéressant <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s normatives - c'est-à-dire construire <strong>de</strong>s scénarios d'une vision du<br />
futur désirable. L'étu<strong>de</strong> doit aussi nécessiter <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> scénarios qui permettent <strong>la</strong> réalisation<br />
<strong>de</strong> certains points et qui sont <strong>de</strong>s tendances préférables. La <strong>prospective</strong> est une créativité<br />
généralisée, <strong>de</strong>s idées et <strong>de</strong>s processus stratégiques. Les stratégiques finales sont alors les produits<br />
<strong>de</strong>s scénarios imaginés et mis en p<strong>la</strong>ce. Cf. le graphique 2.<br />
<strong>de</strong>ssous<br />
en %
Scénarios<br />
vision<br />
Source : Health Futures, OMS, p. 82 (trad.).<br />
Graphique 2<br />
Le rôle <strong>de</strong> vision<br />
Les stratégies et les politiques visent à promouvoir une vision que le spécialiste a sur<br />
l'indicateur. Dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, les stratégies et les politiques visent <strong>la</strong> prévention <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
dans une perspective à long terme. Cet indicateur a un double intérêt : (i) il évalue le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />
développement économique d'un pays et (ii) il décrit en même temps le progrès technologique atteint<br />
par le pays.<br />
Sujet n o 5 : C.J.L. MURRAY and A.D. LOPEZ (1997). Tome I. The Global Bur<strong>de</strong>n of Disease and<br />
Tome II. Global Health Statistics. WHO, Harvard School of Public Health and World Bank.<br />
L'évaluation <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> santé requiert quatre types d'informations : le détail <strong>de</strong>s<br />
conditions épidémiologiques, l'inventaire et les dispositions <strong>de</strong>s ressources, un ensemble d'institutions<br />
et les informations sur les coûts <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong> santé. L'information fiable sur ces questions fait<br />
défaut. L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charge Globale <strong>de</strong>s Ma<strong>la</strong>dies a été conçue pour répondre aux problèmes <strong>de</strong><br />
l'information disponible. Cette série d'ouvrages veut fournir les détails re<strong>la</strong>tifs aux métho<strong>de</strong>s, matériel<br />
et résultats pour chaque ma<strong>la</strong>die et traumatisme. Les objectifs <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> sont quadruples :<br />
• développer <strong>de</strong>s estimations <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité selon l'âge, le sexe et <strong>la</strong> région ;<br />
• développer <strong>de</strong>s estimations <strong>de</strong> l'inci<strong>de</strong>nce, <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévalence et du taux <strong>de</strong> létalité selon l'âge, le<br />
sexe et <strong>la</strong> région ;<br />
• estimer <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> mortalité prématurée et d'invalidité pouvant être attribuée aux facteurs <strong>de</strong><br />
risques choisis, tels que <strong>la</strong> pollution, les rapports sexuels dangereux, etc. ;<br />
• fournir un ensemble <strong>de</strong> projections <strong>de</strong> <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies selon l'âge, le sexe et <strong>la</strong> région à<br />
l'horizon 2020.<br />
RESULTATS<br />
menaces/<br />
opportunités<br />
forces/<br />
faiblesses<br />
position organisationelle<br />
facteurs <strong>de</strong> succès critiquables<br />
directions<br />
stratégiq<br />
position compétitive<br />
stratégies<br />
L'analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charge Globale <strong>de</strong>s Ma<strong>la</strong>dies a été effectuée <strong>de</strong> manière globale. Les résultats<br />
sont présentés suivants les huit régions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale. Ces<br />
différentes régions sont :<br />
• Economies <strong>de</strong> marché bien établies (EMBE) ;<br />
• Anciennes économies socialistes d'Europe (AESE) ;<br />
• Amérique <strong>la</strong>tine et Caraïbe (ALC) ;<br />
• Chine (CHN) ;<br />
• In<strong>de</strong> (IND) ;<br />
• Autres pays d'Asie et Iles (APAI) ;<br />
• Croissant Moyen-Orient - Afrique du Nord, Moyen-Orient, Pakistan et Républiques d'Asie<br />
centrale <strong>de</strong> l'ex-URSS - (CMO) ;<br />
• Afrique subsaharienne (ASS).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 314
Pour les estimations, les auteurs utilisent une structure "ramifiée" <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies et <strong>de</strong>s<br />
traumatismes. Les ma<strong>la</strong>dies sont divisées en trois grands sous-groupes <strong>de</strong> causes :<br />
• Groupe I : les ma<strong>la</strong>dies transmissible, les causes maternelles, les conditions apparaissant<br />
dans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> périnatale et les carences nutritionnelles (tuberculose, MST, VIH,<br />
avortement, malnutrition, etc.) ;<br />
• Groupe II : les ma<strong>la</strong>dies non-transmissibles (cancer, diabètes, ma<strong>la</strong>dies cardio-vascu<strong>la</strong>ires,<br />
etc.) ;<br />
• Groupe III : les traumatismes (acci<strong>de</strong>nts, noya<strong>de</strong>s, violence, guerre, etc.). ;<br />
En utilisant trois métho<strong>de</strong>s, on obtient les résultats globaux :<br />
Les 15 premières causes <strong>de</strong> mortalité dans le mon<strong>de</strong>, 1990 - 2020<br />
1990 2020<br />
(scénario <strong>de</strong> base)<br />
Ma<strong>la</strong>dies et renseignements Ma<strong>la</strong>dies et renseignements<br />
1. Cardiopathie ischémique 1. Cardiopathie ischémique<br />
2. Ma<strong>la</strong>die cérébrovascu<strong>la</strong>ire 2. Ma<strong>la</strong>die cérébrovascu<strong>la</strong>ire<br />
3. Infections <strong>de</strong>s voies respiratoires inférieures 3. Ma<strong>la</strong>die pulmonaire chronique<br />
4. Ma<strong>la</strong>dies diarrhéiques 4. Infections <strong>de</strong>s voies respiratoires<br />
inférieures<br />
5. Affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> périnatale 5. Cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> trachée, <strong>de</strong>s bronches et du<br />
poumon<br />
6. Ma<strong>la</strong>die pulmonaire chronique 6. Acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie publique<br />
7. Tuberculose 7. Tuberculose<br />
8. Rougeole 8. Cancer <strong>de</strong> l'estomac<br />
9. Acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie publique 9. HIV<br />
10. Cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> trachée, bronches et du poumon 10. Traumatismes auto-infligés<br />
11. Paludisme 11. Ma<strong>la</strong>dies diarrhéiques<br />
12. Traumatismes auto-infligés 12. Cirrhose du foie<br />
13. Cirrhose du foie 13. Cancer du foie<br />
14. Cancer d'estomac 14. Violence<br />
15. Diabète sucré 15. Guerre<br />
Les 15 premières causes <strong>de</strong> mortalité AVP dans le mon<strong>de</strong>, 1990 - 2020<br />
1990 2020<br />
(scénario <strong>de</strong> base)<br />
Ma<strong>la</strong>dies et renseignements Ma<strong>la</strong>dies et renseignements<br />
1. Infections <strong>de</strong>s voies respiratoires inférieures 1. Cardiopathie ischémique<br />
2. Ma<strong>la</strong>dies diarrhéiques 2. Acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie publique<br />
3. Affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> périnatale 3. Ma<strong>la</strong>die cérébrovascu<strong>la</strong>ire<br />
4. Cardiopathie ischémique 4. Infections <strong>de</strong>s voies respiratoires<br />
inférieures<br />
5. Rougeole 5. Tuberculose<br />
6. Tuberculose 6. Ma<strong>la</strong>dies diarrhéiques<br />
7. Ma<strong>la</strong>die cérébrovascu<strong>la</strong>ire 7. HIV<br />
8. Paludisme 8. Guerre<br />
9. Acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie publique 9. Affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> périnatale<br />
10. Anomalies congénitales 10. Ma<strong>la</strong>die pulmonaire chronique<br />
11. Tétanos 11. Violence<br />
12. Traumatismes auto-infligés 12. Cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> trachée, <strong>de</strong>s bronches et du<br />
poumon<br />
13. Noya<strong>de</strong> 13. Traumatismes auto-infligées<br />
14. Violence 14. Anomalies congénitales<br />
15. Guerre 15. Rougeole<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 315
Les 15 premières causes <strong>de</strong> mortalité ACVE dans le mon<strong>de</strong>, 1990 - 2020<br />
1990 2020<br />
(scénario <strong>de</strong> base)<br />
Ma<strong>la</strong>dies et renseignements Ma<strong>la</strong>dies et renseignements<br />
1. Infections <strong>de</strong>s voies respiratoires inférieures 1. Cardiopathie ischémique<br />
2. Ma<strong>la</strong>dies diarrhéiques 2. Dépression unipo<strong>la</strong>ire majeure<br />
3. Affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> périnatale 3. Acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie publique<br />
4. Dépression unipo<strong>la</strong>ire majeure 4. Ma<strong>la</strong>die cérébrovascu<strong>la</strong>ire<br />
5. Cardiopathie ischémique 5. Ma<strong>la</strong>die pulmonaire chronique<br />
6. Ma<strong>la</strong>die cérébrovascu<strong>la</strong>ire 6. Infections <strong>de</strong>s voies respiratoires<br />
inférieures<br />
7. Tuberculose 7. Tuberculose<br />
8. Rougeole 8. Guerre<br />
9. Acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie publique 9. Ma<strong>la</strong>dies diarrhéiques<br />
10. Anomalies congénitales 10. HIV<br />
11. Paludisme 11. Affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> périnatale<br />
12. Ma<strong>la</strong>die pulmonaire chronique 12. Violence<br />
13. Chutes 13. Anomalies congénitales<br />
14. Anémie ferriprive 14. Traumatismes auto-infligés<br />
15. Anémie 15. Cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> trachée, <strong>de</strong>s bronches et du<br />
poumon<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 316
METHODOLOGIE<br />
ANNEXES<br />
Les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> projection sont entièrement développées dans The Global Bur<strong>de</strong>n of<br />
Disease. L'approche utilisée est le développement d'un modèle statistique ou économétrique<br />
permettant <strong>de</strong> prédire différents scénarios <strong>de</strong> mortalité selon les causes, à partir d'un petit nombre <strong>de</strong><br />
variables indépendantes. On a retenu quatre variables indépendantes : le revenu par habitant, le<br />
capital humain, l'intensité du tabagisme et le temps.<br />
1. Année <strong>de</strong> vie corrigée du facteur d'invalidité (ACVE)<br />
Elle est une métrique utilisée pour agréger et résumer les données et informations sur <strong>la</strong><br />
mortalité et les issues <strong>de</strong> santé non-fatales :<br />
ACVE = AVP + AVM<br />
AVP = années <strong>de</strong> vie perdues<br />
AVM = années <strong>de</strong> vie avec <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
ra<br />
KCe ( r )( L a) ( r ) a K rL<br />
AVP( r, K)<br />
= [ e [ − ( r + )( L + a) − ] − e [ − ( r + ) a − ] + ( e )<br />
( r + )<br />
r<br />
−<br />
− + + − + 1<br />
−<br />
1 1 1−<br />
2<br />
où r est le taux d'escompte, β un paramètre dépendant <strong>de</strong> l'âge, a l'âge <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité, K un<br />
facteur âge - poids, C une constante et L <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> vie anticipée <strong>de</strong> âge a.<br />
On montre que : AVP[0,0]=L<br />
AVM r K D [ [ ] [ ]<br />
KCe<br />
ra<br />
( r<br />
( , ) =<br />
e<br />
( r + )<br />
)( L a) − ( r +<br />
( r ) a<br />
)( L + a) − − e − ( r +<br />
K rL<br />
) a − + ( e )<br />
r<br />
−<br />
− +<br />
2<br />
+ − +<br />
1<br />
1<br />
−<br />
1 1−<br />
où r est le taux d'escompte, β un paramètre dépendant <strong>de</strong> âge, a âge <strong>de</strong> <strong>la</strong> mortalité, K un<br />
facteur âge - poids, C une constante et L <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> vie anticipée <strong>de</strong> âge a.<br />
2. Cause <strong>de</strong> mortalité<br />
ln Ma,k,i = βa,k,i ln Ma,k,t + Ca,k,i<br />
où Ma,k,i est <strong>la</strong> mortalité du groupe en âge a, <strong>de</strong> sexe k et pour cause <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die du groupe i ;<br />
Ma,k,t <strong>la</strong> mortalité totale du groupe en âge a, <strong>de</strong> sexe k et pour cause <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die du groupe i ; βa,k,i<br />
l'âge du groupe a, <strong>de</strong> sexe k et <strong>de</strong> cause groupe i ; et Ca,k,i <strong>la</strong> constante <strong>de</strong> âge du groupe a, du sexe k<br />
et <strong>de</strong> cause groupe i.<br />
L'équation <strong>de</strong> prédiction du groupe i est donnée par <strong>la</strong> formule :<br />
*<br />
M a, k , i =<br />
M<br />
M a, k , i<br />
+ M + M<br />
M a, k , t<br />
a, k , I a, k , II a, k , III<br />
3. La prévalence et du taux <strong>de</strong> létalie est donnée par :<br />
HLx=Lx(1-∑PjxDjx)<br />
où HLx= est le nombre <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> vie en bonne santé à l'âge x, Lx = le nombre <strong>de</strong>s années<br />
<strong>de</strong> vie en bonne santé à l'âge x <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie <strong>de</strong> <strong>la</strong> table, Pjx = <strong>la</strong> prévalence <strong>de</strong> séquelle <strong>de</strong> morbidité j en<br />
âge x et Djx = <strong>la</strong> morbidité <strong>de</strong> séquelle j en âge x.<br />
Remarque<br />
Pour les EMBE et les AESE, les estimations ont été réalisées à partir <strong>de</strong>s données d'état civil.<br />
En revanche pour les quatre régions <strong>de</strong> l'ALC, APAI, CMO et ASS, les estimations ont été plus difficile<br />
que prévues à effectuer. Il a fallu diviser chaque <strong>de</strong> régions en zone ayant <strong>de</strong>s données d'état civil et<br />
une zone résiduelle. Ceci a permis <strong>de</strong> réaliser le travail en étapes successives.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 317
EVALUATION ET APPRECIATION DES TRAVAUX<br />
Dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Mertens et Low-Beer, il n'est pas fait mention <strong>de</strong> l'impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die sur les<br />
indicateurs économiques. Les informations sur <strong>la</strong> méthodologie paraissent très insuffisantes. Dans <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième étu<strong>de</strong>, le manque <strong>de</strong> méthodologie rend notre travail d'évaluation un peu difficile. Comme<br />
dans les précé<strong>de</strong>ntes étu<strong>de</strong>s, l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Mwabu n'analyse pas aussi l'impact <strong>de</strong>s indicateurs sanitaires<br />
sur les indicateurs socio-économiques. Elle se focalise à donner une perspective à long terme sur <strong>la</strong><br />
démographie que <strong>la</strong> tendance <strong>de</strong>s indicateurs sanitaires. Par ailleurs, les causes <strong>de</strong> baisse ou <strong>de</strong><br />
hausse <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ne sont pas bien mises en évi<strong>de</strong>nce. Dans les différents travaux, on s'aperçoit<br />
que les indicateurs socio-économiques, politiques et médicaux ont un impact direct dans <strong>la</strong> santé.<br />
L'ensemble <strong>de</strong>s travaux présentent <strong>de</strong>s tendances à l'horizon 2025 en Afrique au sud du Sahara très<br />
optimistes. Les perspectives optimistes sont dues :<br />
1. <strong>la</strong> prospérité socio-économique du mon<strong>de</strong> entre 1950 et 1973. Aujourd’hui, le PIB par<br />
habitant est 2 fois et <strong>de</strong>mi plus élevé à celui d’il y a 50 ans ;<br />
2. le taux d’alphabétisation. La proportion <strong>de</strong>s personnes sco<strong>la</strong>risées a beaucoup augmenté ;<br />
3. le progrès technique. Le développement <strong>de</strong>s nouvelles technologies, notamment celles <strong>de</strong>s<br />
télécommunications, a engendré un traitement <strong>de</strong> l’information plus rapi<strong>de</strong>. Ceci fait<br />
apparaître que le mon<strong>de</strong> est <strong>de</strong>venu petit.<br />
A l'issue <strong>de</strong> <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> ces résultats, on peut poser plusieurs questions :<br />
1. Les <strong>prospective</strong>s ne parlent pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> question du traditionnel et du mo<strong>de</strong>rne sur <strong>la</strong> santé.<br />
Tradition et mo<strong>de</strong>rnité <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé : conflit ou complémentarité ? Sur cette question<br />
importante, aucun travail n'a été réalisé.<br />
2. Les coûts sanitaires. Le coût constitue le principal obstacle quant au contrôle <strong>de</strong> certaines<br />
ma<strong>la</strong>dies. A titre d'exemple, pour le sida, le coût est exorbitant. Approximativement, on<br />
estime qu'une bithérapie coûte 2 500 FF par mois, soit 30 000 FF par an (3 000 000 F CFA<br />
représente le sa<strong>la</strong>ire d'un professeur d'université en Afrique). La trithérapie coûte, par<br />
exemple, 5 000 FF par mois, soit 60 000 FF par an. Quelles stratégies vont favoriser les<br />
États Africains pour lutter contre le fléau Sida ? Quelles sont les moyens qui seront mis en<br />
p<strong>la</strong>ce pour combattre le sida ? Comment les États vont-ils mener les campagnes <strong>de</strong><br />
sensibilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die ?<br />
3. Le sida peut avoir un impact néfaste sur les principaux indicateurs macro-économiques. En<br />
effet, dans <strong>la</strong> mesure où <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die affaiblit et donne <strong>la</strong> mort aux mâles en âge <strong>de</strong> travailler,<br />
<strong>la</strong> quantité et <strong>la</strong> qualité du travail peuvent être remises en cause. A <strong>la</strong> longue, on peut<br />
constater une réduction du taux <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> production. Les travaux <strong>de</strong> l'Anrs et<br />
<strong>de</strong> l'Orstom s'inscrivent dans les problématiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévention et dans l'analyse <strong>de</strong>s<br />
paramètres multiples (sociaux, démographiques, politiques, économiques), ainsi que leur<br />
combinaison, pour appréhen<strong>de</strong>r les facteurs <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l'épidémie dans les<br />
sociétés, in Le sida en Afrique, 1997).<br />
CONCLUSION<br />
On a constaté historiquement un développement sanitaire. En revanche, l'instabilité politique et<br />
le ralentissement économique <strong>de</strong> <strong>la</strong> région risquent <strong>de</strong> remettre en cause ces acquis sanitaires. Les<br />
secteurs sociaux, y compris celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, sont touchés par le réduction <strong>de</strong>s dépenses<br />
budgétaires.<br />
<strong>Un</strong>e métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> modélisation régionale permettrait d'apprécier l'étendue et <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
question sanitaire pour améliorer <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> santé. Il<br />
ressort <strong>de</strong> ces analyses que <strong>la</strong> vulnérabilité ou l'exposition <strong>de</strong> l'Afrique face aux épidémies n'est pas<br />
une particu<strong>la</strong>rité <strong>africaine</strong>, mais tout simplement un problème <strong>de</strong> sous-développement.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 318
3.4.9.<br />
LES TRANSPORTS
PERSPECTIVES DES RESEAUX DE TRANSPORT A VOCATION<br />
REGIONALE EN AFRIQUE AUSTRALE<br />
Les économies <strong>de</strong>s pays constituant <strong>la</strong> région australe étant <strong>de</strong> fait fortement dépendantes <strong>de</strong>s<br />
infrastructures portuaires et <strong>de</strong> leurs connexions aux transports terrestres, nous nous intéresserons ici<br />
aux réseaux <strong>de</strong> transport intermodaux rattachés à un pôle <strong>de</strong> développement maritime.<br />
Activités actuelles et historiques <strong>de</strong>s flux maritimes<br />
Table 1 : SADC Ports – Share of SADC Transit Traffic (1995)<br />
PORT Transit Traffic as % % of SADC Transit<br />
of Total Taffic<br />
Traffic<br />
Dar es Sa<strong>la</strong>am 37,76 18,88<br />
Beira 79,17 33,95<br />
Naca<strong>la</strong> 66,75 2,01<br />
Maputo 63,78 24,83<br />
Richards Bay 0,06 0,81<br />
Durban 3,02 13,65<br />
East London 3,33 0,69<br />
Port Elizabeth 0,02 0,02<br />
Cape Town 1,88 2,4<br />
Saldanha Bay 0.00 0.00<br />
Walvis Bay 0.00 0.00<br />
Namibe 0.00 0.00<br />
Lobito 0.00 0.00<br />
Luanda 0.00 0.00<br />
Source : Southern African Development Community, Transport & Communications.<br />
Windhoek, Republic of Namibia, 9-10 February 1997.<br />
Table 2 : South African Port Traffic Performance<br />
1997 compared with 1975/76 (‘000 t)<br />
Richards Durban East London Port Cape Town Saldanha<br />
Bay<br />
Elizabeth<br />
Bay<br />
1997 81,354 52,680 1,801 5,622 9,755 29,998<br />
1995 76,112 43,898 1,203 4,952 7,756 22,961<br />
1970/71 - 12,185 1,092 5,834 5,516 -<br />
Table 3 : Southern African Port Traffic Performance<br />
1995 compared with 1971/74 (‘000 t)<br />
Dar es Sa<strong>la</strong>am Naca<strong>la</strong> Beira Maputo/<br />
Mato<strong>la</strong><br />
Walvis Bay Lobito Luanda<br />
1997 - - 4,700 3,400 2,000 - -<br />
1995 4,236 415 2,488 2,261 1,819 450 1,095<br />
1971/74 - - 3,000 14,900 1,650 2,590 2,320<br />
Key : - Means no tonnage information fund avai<strong>la</strong>ble for the period un<strong>de</strong>r review<br />
Sources : SADC Port Authorities; Southern African Development Community, Transport & Communications, Windhoek,<br />
Republic of Namibia, 9-10 February 1997; Portnet<br />
Ces trois tables offrent une compréhension très explicite <strong>de</strong> l’orientation actuelle <strong>de</strong>s<br />
transits commerciaux par voie maritime dans <strong>la</strong> zone australe.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 320
En 1995, les 15 ports régionaux (incluant Port Louis <strong>de</strong>puis août 1995) manipu<strong>la</strong>ient un tonnage<br />
<strong>de</strong> marchandises <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 155 millions, soit une croissance d’activité <strong>de</strong> 9.4% par rapport à<br />
l’année précé<strong>de</strong>nte.<br />
Ce qu’il est important <strong>de</strong> noter, ce sont les préférences <strong>de</strong>s transporteurs quant aux choix<br />
stratégiques et économiques <strong>de</strong> voies d’évacuation <strong>de</strong> leurs marchandises. Ainsi, 78% soit 122<br />
millions <strong>de</strong> tonnes transitaient en 1995 par <strong>la</strong> faça<strong>de</strong> maritime orientale <strong>de</strong> cette zone, par <strong>la</strong> côte<br />
océan indien. De plus, cette même année, pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> transition en Afrique du Sud, presque 90% <strong>de</strong>s<br />
activités commerciales par voie maritimes utilisaient les facilités portuaires sud-<strong>africaine</strong>s.<br />
Alors que les ports sud-africains bénéficiaient d’un accroissement d’activité <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 9.5%<br />
en 1995, cet indice atteignait 6.3% en moyenne pour les ports maritimes austraux (hors Afrique du<br />
Sud).<br />
Ce regain d’activités ne concerne pas <strong>la</strong> faça<strong>de</strong> maritime <strong>de</strong> l’Ango<strong>la</strong> dont les ports <strong>de</strong> Namibe<br />
et Lobito ont connu un net déclin en tonnages manipulés.<br />
En terme <strong>de</strong> manipu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> trafic international, les ports mozambicains (Beira, Maputo),<br />
tanzaniens (Dar es-Sa<strong>la</strong>am) et sud-africains (Durban et Richards Bay) enregistrent les plus forts<br />
tonnages liés à <strong>de</strong>s considérations historiques, mais aussi infrastructurelles.<br />
Perspectives sur le long terme, à l’ère 2020<br />
Les projections re<strong>la</strong>tives au <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> transport dans <strong>la</strong> région australe<br />
s’é<strong>la</strong>borent autour <strong>de</strong>s évolutions politique et économique <strong>de</strong>s États membres d’une part, <strong>de</strong>s<br />
tendances <strong>de</strong>s flux commerciaux internationaux, d’autre part. Il s’agit donc <strong>de</strong> prendre en<br />
considération les variables suivantes :<br />
- La réalisation <strong>de</strong>s projets d’intégration régionale intra-SADC : multiplication <strong>de</strong>s accords<br />
d’échanges bi<strong>la</strong>téraux sur le commerce notamment et d’accords transfrontaliers. L’adoption<br />
notamment d’un protocole <strong>de</strong> commerce en août 1996 dans le cadre du sommet <strong>de</strong> Maseru<br />
vise l’instauration d’une zone <strong>de</strong> libre-échange sur un horizon <strong>de</strong> huit ans dès sa ratification<br />
par une majorité qualifiée, soit :<br />
- <strong>la</strong> libéralisation généralisée <strong>de</strong>s flux commerciaux intra-régionaux, <strong>de</strong>s biens et <strong>de</strong>s<br />
services sur <strong>la</strong> base d’accords commerciaux équitables et mutuellement avantageux;<br />
- <strong>la</strong> promotion <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversification économique et du développement industriel sur <strong>la</strong> base<br />
<strong>de</strong>s avantages comparatifs <strong>de</strong>s pays membres;<br />
- <strong>la</strong> contribution à un environnement propice aux investissements domestiques,<br />
transfrontaliers et étrangers.<br />
- L’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> marchandises et <strong>de</strong>s matières premières (dépréciation<br />
<strong>de</strong>s cours du charbon par exemple) en tenant compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> forte tendance internationale<br />
pour le trafic conteneurisé ;<br />
- Les politiques nationale et régionale <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s enc<strong>la</strong>ves maritimes et <strong>de</strong> leurs<br />
hinter<strong>la</strong>nds : approche territoriale actuelle po<strong>la</strong>risée encourageant les effets <strong>de</strong> concentration<br />
industrielle et <strong>la</strong> création <strong>de</strong> clusters (cas <strong>de</strong>s Initiatives <strong>de</strong> Développement Spatial).<br />
- La stabilisation politique <strong>de</strong>s États sensibles et <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> l’Organe <strong>de</strong> sécurité SADC à<br />
intervenir dans le cas <strong>de</strong> conflit régional ;<br />
- Les décisions bi et multi<strong>la</strong>térales stratégiques en matière <strong>de</strong> politique extérieure, soit les<br />
options d’une coopération tournée vers l’<strong>Un</strong>ion européenne, les États-<strong>Un</strong>is ou vers l’Asie<br />
(l’ « après-Lomé », concrétisation <strong>de</strong> l’Indian Ocean Rim) ;<br />
- L’impact effectif d’une vision libérale <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fonctionnement du secteur transport,<br />
c’est à dire <strong>la</strong> poursuite soutenue <strong>de</strong>s propositions réformistes en vue d’une plus gran<strong>de</strong><br />
commercialisation et privatisation <strong>de</strong>s infrastructures ( SADC Transport Protocol, août 1996,<br />
et le Transport and Communications Study for Southern Africa, mai 1998).<br />
Il est à noter que l’Afrique du Sud est et reste le pôle décisionnaire incontournable dans un<br />
contexte régional en quête <strong>de</strong> stabilité et <strong>de</strong> représentativité institutionnelle. Toute réflexion sur le<br />
<strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s réseaux d’infrastructures en Afrique australe <strong>de</strong>vrait donc s’articuler autour <strong>de</strong>s<br />
impulsions vers une plus gran<strong>de</strong> insertion dans l’économie mondiale initiées par l’Afrique du Sud et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> capacité <strong>de</strong>s États membres à intégrer <strong>de</strong>s logiques concurrentielles.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 321
Nous expliciterons à présent sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> ces éléments <strong>de</strong> réflexion les grands axes <strong>de</strong><br />
communication qui vraisemb<strong>la</strong>blement structureront l’espace austral sur le moyen et long terme.<br />
• Réhabilitation <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> transit régionales transversales dites stratégiques ou naturelles<br />
suivant le principe <strong>de</strong>s corridors <strong>de</strong> développement ou Initiatives <strong>de</strong> Développement Spatial :<br />
1) Les trois corridors <strong>de</strong> développement mozambicains :<br />
Le corridor <strong>de</strong> Maputo comprenant le port <strong>de</strong> Maputo, le terminal charbonnier <strong>de</strong> Mato<strong>la</strong> et les<br />
trois lignes <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> fer articu<strong>la</strong>nt le port aux pays frontaliers : Goba Line (Maputo-Swazi<strong>la</strong>nd),<br />
Ressano Garcia Line (Maputo-Zimbabwe-RSA), Limpopo Line (Maputo-Zimbabwe) .<br />
Le corridor <strong>de</strong> Beira incluant le port <strong>de</strong> Beira et les voies ferroviaires Machipanda Line et Sena<br />
line le reliant respectivement au Zimbabwe et au Ma<strong>la</strong>wi (actuellement en très mauvais état).<br />
Le corridor <strong>de</strong> Naca<strong>la</strong> comprenant le port <strong>de</strong> Naca<strong>la</strong> dont <strong>la</strong> jonction ferroviaire avec le Ma<strong>la</strong>wi<br />
(B<strong>la</strong>ntyre) est en cours <strong>de</strong> réhabilitation .<br />
2) Le corridor <strong>de</strong> développement tanzanien :<br />
Le corridor <strong>de</strong> Dar es-Sa<strong>la</strong>am <strong>de</strong>sservant <strong>de</strong>puis son port en rénovation <strong>la</strong> Zambie par voie<br />
ferroviaire (Tanzania Zambia Railway) et un vaste réseau routier en liaison avec les pays limitrophes<br />
(région <strong>de</strong>s Grands Lacs).<br />
3) Le corridor <strong>de</strong> développement ango<strong>la</strong>is à dimension régional :<br />
Le corridor <strong>de</strong> Bengue<strong>la</strong> reliant le port <strong>de</strong> Lobito à son hinter<strong>la</strong>nd minier (Zambie et RDC).<br />
• Multiplication <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> communication et /ou <strong>de</strong> développement transfrontaliers :<br />
1) Corridor <strong>de</strong> Walvis Bay (Namibie) dont les <strong>de</strong>ux axes routiers - <strong>la</strong> Trans-Ka<strong>la</strong>hari et <strong>la</strong> Trans-Caprivi<br />
- qui lui sont rattachés offriront une ouverture sur l’océan at<strong>la</strong>ntique déterminante et nécessaire pour <strong>la</strong><br />
région du Gauteng (RSA) et les pays enc<strong>la</strong>vés <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone (Botswana, Zimbabwe).<br />
2) Emergence <strong>de</strong> corridors côtiers longitudinaux tel le corridor <strong>de</strong> Lumbobo reliant <strong>la</strong> province du<br />
KwaZulu-Natal au Swazi<strong>la</strong>nd et à <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Maputo.<br />
• Création <strong>de</strong> corridors ou axes secondaires <strong>de</strong>sservant les pôles d’activités économiques<br />
émergents :<br />
Exemple <strong>de</strong>s corridors <strong>de</strong> Pha<strong>la</strong>borwa, <strong>de</strong> Rustenburg, <strong>la</strong> route P<strong>la</strong>tinum, etc.<br />
En éléments <strong>de</strong> conclusion, à moins que ne soient impulsées <strong>de</strong>s politiques visant à influencer<br />
<strong>la</strong> répartition géographique <strong>de</strong> l’activité industrielle dans <strong>la</strong> région, celle-ci se concentrera dans les<br />
pays disposant déjà d’une base industrielle importante - au détriment <strong>de</strong>s États ou territoires moins<br />
développés (R.Bloch). L’équipement dans le domaine <strong>de</strong>s transports constitue une priorité politique<br />
dans le cadre d’effets <strong>de</strong> désenc<strong>la</strong>vement <strong>de</strong> l’activité industrielle dans <strong>la</strong> région. Le débat autour <strong>de</strong>s<br />
dynamiques induites reste cependant ouvert et les années à venir nous permettront <strong>de</strong> conclure plus<br />
avant sur l’impact <strong>de</strong>s pôles régionaux en Afrique australe, sur <strong>la</strong> mise en opposition <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong><br />
répartition « spatiale équitable» et <strong>de</strong>s stratégies macroéconomiques.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 322
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 323
BIBLIOGRAPHIE PROSPECTIVE<br />
Charlier J., Le système portuaire sud-africain à l’aube du 21ème siècle, Académie Royale <strong>de</strong> Marine<br />
<strong>de</strong> Belgique, janvier 1996.<br />
Department of Transport., A future for roads in South Africa, Pretoria, May 1996.<br />
Department of Transport., Multi-modal strategic p<strong>la</strong>nning for South Africa as the transport funnel into<br />
Africa, March 1994.<br />
Harrison P., To<strong>de</strong>s A., “The new Development Route : New highways or Old By-ways?”, Indicator<br />
South Africa, Vol.13, No.3, 1996.<br />
Jourdan P., Gordhan K., Arkwright D., De Beer G., “Spatial Development Initiatives (Development<br />
Corridors) : Their potential contribution to investment and employment creation”, Working paper,<br />
Development Bank of Southern Africa, Midrand, October, 1996.<br />
African Development Bank, « Economic integration in Southern Arica », Abidjan, pp. 373-437, 1993.<br />
Kennedy T. L., “Transport in Southern Africa”, The South African Institute of International Affairs, in<br />
Southern African issues, November 1988.<br />
Kennedy T. L., Evaluation of Southern African Transport Routes, A regional distribution cost mo<strong>de</strong>l,<br />
Master of Commerce in the Faculty of Economics and Management, <strong>Un</strong>iversity of Natal, Durban<br />
1990.<br />
Kennedy T. L., Southern African transport - An analytical mo<strong>de</strong>l, Africa Institute of South Africa,<br />
Pretoria, 1990.<br />
Khosa M., “Towards a sustainable transport and communication sector in Southern Africa” presented<br />
at the Second ACDESS Conference on South Africa and Africa : Emerging Policy Frameworks,<br />
Johannesburg, 24-27 January 1996.<br />
Kleynhans E., Nau<strong>de</strong> W., Suleman A., “Regional industrialisation in South Africa with special<br />
reference to the P<strong>la</strong>tinum Spatial Development Initiative” presented at the 1998 Tra<strong>de</strong> and<br />
Industrial Policy Secretariat Annual Forum, Johannesburg, 20-22 September 1998.<br />
Lewis D., Bloch R., “Spatial Development Initiatives : Infrastructure, agglomeration and region in<br />
industrial policy” presented at the 1997 Tra<strong>de</strong> and Industrial Policy Secretariat Annual Forum,<br />
Johannesburg, 23 September 1997.<br />
Lipman V., “The role of improved transport linkages and co-operation within South Africa”, Annual<br />
Transport Convention, <strong>Un</strong>iversity of Pretoria, 1995.<br />
Maasdorp G., “A strategy for rail and road transportation in Southern Africa, Africa Insight, Vol.21,<br />
No1, 1991.<br />
Ngwenya (ed) Sindiso, Chipeta H., Nkomo J.C., Banda D.L., The Transport and Communications<br />
Sector in Southern Africa, Sapes Books, Harare, 1993.<br />
Pakes T., “Industrial <strong>de</strong>velopment as an effective local economic <strong>de</strong>velopment strategy : The port<br />
Elizabeth Metropole as a case study” presented at the 1998 Tra<strong>de</strong> and Industrial Policy<br />
Secretariat Annual Forum, Johannesburg, 20-22 September 1998.<br />
Saasa O. S., The effectiveness of regional transport networks in Southern Africa - some Postapartheid<br />
perspectives in Southern Africa after apartheid : regional integration and external<br />
ressources, Ed. Odéon B., Scandinavian Institute of African Studies, 1993.<br />
Southern African Development Community, SADC Transport and Comunications, Windhoek,9-10<br />
February 1997.<br />
Southern Africa Transport and Communications Commission, A scenario mo<strong>de</strong>l for goods transport<br />
<strong>de</strong>mand in the SADCC region – the main results, Stockholm , September 1988.<br />
Wood G., “The problems and prospects of Mozambique’s three corridors : A case study in regional<br />
integration in Southern Africa”, TIPS Working Paper No.7, Johannesburg, January 1998.<br />
World Bank, « Transport and Economic performance :A survey of <strong>de</strong>velopping countries », Rapport<br />
technique No.232, Région Afrique, Washington, 1993, Washington.<br />
World Bank, « Promouvoir les réformes <strong>de</strong> politique pour les services <strong>de</strong> transport efficaces dans les<br />
pays du COMESA », Région Afrique, Findings No.100, juin 1998.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 324
3.4.10.<br />
LA TECHNOLOGIE
L'évolution <strong>de</strong>s technologies est stratégique pour le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s sociétés<br />
<strong>africaine</strong>s. Plusieurs questions doivent être différenciées :<br />
- <strong>la</strong> première concerne l'impact <strong>de</strong>s transformations technologiques<br />
mondiales sur les sociétés <strong>africaine</strong>s ;<br />
- <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> concerne les transferts <strong>de</strong> technologies et leur appropriation<br />
par les sociétés <strong>africaine</strong>s ;<br />
- <strong>la</strong> troisième renvoie aux inventions ou aux innovations technologiques<br />
endogènes, technologies <strong>de</strong> première ligne ou technologies douces.<br />
L'Afrique <strong>de</strong> l'an 2020 gérera un éventail <strong>de</strong> technologies différentes.<br />
Nous retiendrons <strong>de</strong>ux exemples, celui <strong>de</strong> l'impact <strong>de</strong>s nouvelles technologies<br />
<strong>de</strong> l'information et <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication et celui <strong>de</strong>s technologies dans <strong>la</strong> chaîne<br />
agro-alimentaire.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 326
NOUVELLE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION<br />
ET DE LA COMMUNICATION<br />
Les progrès spectacu<strong>la</strong>ires permis par les innovations dans les domaines <strong>de</strong> l'information et <strong>de</strong><br />
l'électronique confèrent aux nouvelles technologies <strong>de</strong> l'information et <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication un impact<br />
primordial dans tous les secteurs d'activité économique, scientifique et culturelle. Dès lors, ces<br />
technologies <strong>de</strong>vront faire l'objet d'une attention particulière <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s autorités nationales, <strong>de</strong>s<br />
opérateurs économiques, <strong>de</strong>s chercheurs et <strong>de</strong> <strong>la</strong> société civile. Ainsi, par exemple, pour accroître les<br />
performances globales <strong>de</strong>s entreprises <strong>africaine</strong>s et garantir leur compétitivité internationale, il importe<br />
que leur management é<strong>la</strong>bore un p<strong>la</strong>n stratégique <strong>de</strong> développement du système informatique.<br />
La révolution dans le domaine du traitement <strong>de</strong> l'information concerne les petites unités<br />
informelles comme les gran<strong>de</strong>s firmes, les secteurs économiques comme les secteurs sociaux<br />
notamment <strong>la</strong> formation.<br />
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES<br />
DANS LA CHAINE AGRO-ALIMENTAIRE<br />
Les principales technologies <strong>de</strong> transformation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées agro-alimentaires sont variables<br />
avec les types <strong>de</strong> produits et portent sur plusieurs opérations parmi lesquelles on note généralement<br />
les suivantes :<br />
- le séchage ou déshydratation, visant à réduire <strong>la</strong> teneur en eau <strong>de</strong>s produits, médium<br />
principal <strong>de</strong>s réactions <strong>de</strong> dégradation parasitaire ou enzymatique ;<br />
- <strong>la</strong> fermentation, basée sur <strong>la</strong> dégradation enzymatique incomplète <strong>de</strong>s matières organiques,<br />
sous l'effet <strong>de</strong> divers micro-organismes ou <strong>de</strong> l'activité métabolique propre aux produits ;<br />
- <strong>la</strong> séparation, plus ou moins complexe, par exemple, le tirage (selon le poids, le volume ou<br />
<strong>la</strong> couleur) ; le décorticage <strong>de</strong>s céréales, l'extraction <strong>de</strong> jus <strong>de</strong> fruits par pression, filtration,<br />
décantation ou contrifugation ; le raffinage <strong>de</strong> l'huile ou du sucre, etc. ;<br />
- <strong>la</strong> concentration, par évaporation, à chaud ou à froid, avec ou sans vi<strong>de</strong> ; par centrifugation ;<br />
par décantation ou par congé<strong>la</strong>tion sélective ;<br />
- le ma<strong>la</strong>xage, visant l'homogénéisation <strong>de</strong>s produits liqui<strong>de</strong>s, pâteux ou farineux ;<br />
- <strong>la</strong> cuisson, selon une combinaison adéquate <strong>de</strong>s facteurs temps, température et pression.<br />
Dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s cas, ces opérations son associées à <strong>de</strong>s traitements thermiques<br />
(appertisation) visant <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction sélective (pasteurisation) ou complète (stérilisation) <strong>de</strong> <strong>la</strong> flore<br />
microbienne avant l'embal<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s produits dans <strong>de</strong>s boîtes métalliques, tétrapak, sachets p<strong>la</strong>stiques,<br />
cartons, etc.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 327
TECHNOLOGIE – XXIe SIECLE<br />
Technologies susceptibles d’accroître <strong>la</strong> compétitivité<br />
<strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> base du secteur agro-alimentaire africain<br />
TYPES DE<br />
TECHNOLOGIE<br />
PRINCIPE AVANTAGES<br />
Télédétection Observation <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface Connaissance précise <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature, <strong>de</strong> <strong>la</strong> quantité<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> terre pour recueillir et <strong>de</strong> <strong>la</strong> localisation <strong>de</strong>s ressources du pays ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> région :<br />
et analyser <strong>de</strong>s<br />
• Évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole (superficies cultivées,<br />
informations et données prévision <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments, évolution <strong>de</strong>s sols et <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasse,<br />
sur les ressources et état <strong>de</strong>s écosystèmes pastoraux…).<br />
l’occupation <strong>de</strong>s sols dans • Évaluation <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> catastrophes naturelles<br />
<strong>de</strong> vastes régions (sécheresse, inondations, érosion…).<br />
• Possibilité <strong>de</strong> prévision et <strong>de</strong> modélisation <strong>de</strong>s changements<br />
futurs.<br />
• Meilleure gestion <strong>de</strong>s forêts, <strong>de</strong>s ressources en eau<br />
(maritime ou <strong>de</strong> surface) et <strong>de</strong>s ressources halieutiques.<br />
• Cartographie <strong>de</strong>s informations géographiques.<br />
• Surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l’environnement.<br />
Biotechnologie Exploitation <strong>de</strong> l’activité • Accroissement <strong>de</strong>s performances <strong>de</strong> l’agriculture<br />
d’agents biologiques et <strong>de</strong> <strong>la</strong> foresterie par <strong>la</strong> production en série <strong>de</strong> semences<br />
(micro-organismes, améliorées (ex. xérotolérance, halotolérance, résistance<br />
cellules, organites ou aux prédateurs et à diverses ma<strong>la</strong>dies), <strong>de</strong> bio-fertilisants,<br />
constituants cellu<strong>la</strong>ires) <strong>de</strong> bio-pestici<strong>de</strong>s et <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s ressources<br />
pour générer <strong>de</strong>s biens ou phytogénétiques.<br />
<strong>de</strong>s services.<br />
• Accroissement <strong>de</strong>s performances <strong>de</strong> l’élevage par<br />
l’amélioration <strong>de</strong>s races, le transfert d’embryons et une meilleure<br />
prophy<strong>la</strong>xie sanitaire du bétail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> vo<strong>la</strong>ille (anticorps<br />
monoclonaux pour le diagnostic rapi<strong>de</strong>, fabrication massive<br />
<strong>de</strong> vaccins et <strong>de</strong> substances pharmaceutiques…).<br />
• Contribution à <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s besoins énergétiques<br />
(production <strong>de</strong> biogaz et <strong>de</strong> divers métabolites combustibles<br />
tels les alcools).<br />
• Protection <strong>de</strong> l’environnement (dépollution, valorisation <strong>de</strong>s<br />
déchets et affluents agricoles, agro-industriels ou ménagers…).<br />
• Continuité dans le temps, indépendance <strong>de</strong>s aléas climatiques,<br />
stabilité et fiabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> <strong>la</strong> production résultant<br />
<strong>de</strong> l’activité biotechnologique.<br />
Chaîne du froid Maintien au froid <strong>de</strong>s • Gran<strong>de</strong> efficacité dans <strong>la</strong> stabilisation et <strong>la</strong> conservation<br />
<strong>de</strong>nrées alimentaires, d’un grand nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>nrées alimentaires (produits horticoles,<br />
en vue <strong>de</strong> ralentir halieutiques, carnés, ovo-produits…).<br />
les processus <strong>de</strong> leur • Possibilité d’être couplée à d’autres technologies<br />
dégradation. Ce froid (ex : irradiation, lyophilisation, atmosphère) intervenant comme<br />
est appliqué à une adjuvants du froid pour accroître les performances<br />
température étudiée, <strong>de</strong> <strong>la</strong> réfrigération ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> congé<strong>la</strong>tion.<br />
pouvant être supérieure • Régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> commercialisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées.<br />
au point <strong>de</strong> congé<strong>la</strong>tion<br />
<strong>de</strong>s produits<br />
(réfrigération) ou<br />
inférieure à ce point<br />
(congé<strong>la</strong>tion).<br />
• Constitution <strong>de</strong> stocks <strong>de</strong> sécurité alimentaire.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 328
Tableau (suite)<br />
Irradiation Exposition <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées à<br />
un rayonnement ionisant<br />
pour détruire les agents<br />
biologiques d’altération<br />
(micro-organismes,<br />
insectes…) et inhiber<br />
divers processus<br />
physiologiques ou<br />
métaboliques impliqués<br />
dans <strong>la</strong> dépréciation <strong>de</strong>s<br />
produits.<br />
Lyophilisation La lyophilisation est une<br />
technique <strong>de</strong><br />
cryo<strong>de</strong>ssiccation (séchage<br />
à froid) reposant sur <strong>la</strong><br />
capacité <strong>de</strong> sublimation <strong>de</strong><br />
l’eau dans certaines<br />
conditions <strong>de</strong> température<br />
et <strong>de</strong> pression. Elle<br />
comporte trois opérations<br />
fondamentales :<br />
• La surgé<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s<br />
produits (congé<strong>la</strong>tion à<br />
très gran<strong>de</strong> vitesse<br />
aboutissant à une fine<br />
cristallisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> g<strong>la</strong>ce).<br />
• L’évaporation sous vi<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s cristaux <strong>de</strong> g<strong>la</strong>ce<br />
permettant <strong>la</strong><br />
déshydratation, d’où<br />
résulte une structure<br />
microporeuse.<br />
• La désorption par<br />
réchauffage progressif,<br />
toujours sous vi<strong>de</strong>, pour<br />
extraire les traces d’eau<br />
résiduelle (eau liée, non<br />
Atmosphère<br />
contrôlée<br />
conge<strong>la</strong>ble).<br />
Entreposage <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées<br />
dans une atmosphère<br />
artificielle,<br />
convenablement<br />
appauvrie en oxygène<br />
et enrichie en gaz<br />
carbonique par rapport<br />
à l’air.<br />
• Accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> conservation et <strong>de</strong> survie<br />
commerciale <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées.<br />
• Possibilité d’utilisation dans <strong>la</strong> sélection variétale appliquée<br />
à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> semences aux performances accrues<br />
(mutations génétiques).<br />
• Réduction <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s risques<br />
<strong>de</strong> contamination chimique <strong>de</strong>s aliments.<br />
• Meilleure rétention <strong>de</strong>s propriétés intrinsèques <strong>de</strong>s produits<br />
(ex : pouvoir germinatif <strong>de</strong>s semences ; propriétés<br />
nutritionnelles, fonctionnelles et organoleptiques <strong>de</strong>s aliments).<br />
• Très longue durée <strong>de</strong> conservation (plusieurs années) à<br />
température ambiante.<br />
• Gran<strong>de</strong> commodité <strong>de</strong> transport et <strong>de</strong> distribution résultant<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> forte réduction du poids <strong>de</strong>s produits.<br />
• Très gran<strong>de</strong> sécurité microbiologique, liée à <strong>la</strong> faible activité<br />
<strong>de</strong> l’eau (Aw) dans les produits traités.<br />
• Reconstitution rapi<strong>de</strong> et facile, par simple réhydratation,<br />
grâce à <strong>la</strong> structure microporeuse résultant du traitement<br />
• Accroissement <strong>de</strong>s performances globales du froid (extension<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées, régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s stocks<br />
<strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> commercialisation).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 329
3.4.11.<br />
L'URBANISATION
Les perspectives concernant l'évolution <strong>de</strong> l'urbanisation <strong>africaine</strong> sont<br />
réalisées par <strong>de</strong> nombreux centres démographiques, d'urbanistes et d'aménagement<br />
du territoire. Cf. plus spécialement : WALTPS, <strong>la</strong> DATAR, les p<strong>la</strong>ns d'urbanisme.<br />
Nous résumons le rapport réalisé par l'ISTED en 1998 pour le compte du<br />
ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération et présentons plusieurs travaux montrant les effets <strong>de</strong><br />
l'urbanisation sur les dynamiques agro-alimentaires.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 332
DYNAMIQUE DE L'URBANISATION<br />
DE L'AFRIQUE AU SUD DU SAHARA<br />
ISTED 1998<br />
Groupe <strong>de</strong> travail : "Mécanismes et logiques <strong>de</strong> l'urbanisation en Afrique au Sud du Sahara", organisé<br />
pour le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coopération par l'ISTED (X. Crépin et M.C. Tabor-Nouval), janvier 1998.<br />
Composition du groupe <strong>de</strong> rédaction sous <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> Michel Arnaud, Ingénieur P.C.,<br />
Architecte DPLG, Urbaniste-conseil<br />
Membres<br />
- Philippe Antoire, Directeur <strong>de</strong> recherches à l'ORSTOM, chercheur au CEPED<br />
- Catherine Coquery-Vidrovitch, Professeur d'histoire à l'<strong>Un</strong>iversité Paris VII, Directeur <strong>de</strong><br />
recherches associée au CNRS, Lab. "Tiers Mon<strong>de</strong>-Afrique"<br />
- Jean-Marie Cour, Ingénieur général <strong>de</strong>s Ponts et Chaussées, économiste, chargé <strong>de</strong> mission à<br />
l'OCDE (Club du Sahel)<br />
- A<strong>la</strong>in Dubresson, Géographe, Maître <strong>de</strong> conférences agrégé à l'<strong>Un</strong>iversité Paris X, docteur ès<br />
lettres, chercheur associé à l'ORSTOM, Dr du Cegan<br />
- Philippe Hugon, Économiste, Professeur <strong>de</strong> sciences économiques à l'<strong>Un</strong>iversité Paris X,<br />
CERED-CERNEA<br />
- Bruno Lautier, Économiste et sociologue, Professeur à l'<strong>Un</strong>iversité Paris I-Sorbonne, IEDES<br />
- Gustave Massiah, Ingénieur, économiste, enseignant à l'<strong>Un</strong>iversité Paris-Saint Charles, consultant<br />
Prdt <strong>de</strong> ACT<br />
- Jean-François Tibillon, Juriste et politologue, enseignant à l'Ecole d'Architecture Paris-La Vilette,<br />
consultant Mbre <strong>de</strong> ACT<br />
Membres associés<br />
- Laurent Bossard, géographe, consultant auprès du Club du Sahel<br />
- Jean-Louis Chaléard, Géographe, professeur à l'<strong>Un</strong>iversité Paris I Panthéon-Sorbonne, IEDES<br />
- Jean Flouriot, Docteur en géographie, consultant<br />
- Sylvy Jaglin, Géographe-urbaniste, maître <strong>de</strong> conférences à l'Institut Français d'Urbanisme-<br />
<strong>Un</strong>iversité Paris VIII<br />
- A<strong>la</strong>in Marie, Sociologue, <strong>Un</strong>iversité Paris I Panthéon-Sorbonne<br />
- François Reynaud, Documentaliste au centre <strong>de</strong> documentation et d'information "Villes en<br />
développement"<br />
Trente ans d'une croissance accélérée, brusquement ralentie par <strong>la</strong> crise<br />
De 1960 à 1990, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> région est passée <strong>de</strong> 17 à 96 millions <strong>de</strong><br />
personnes. La croissance urbaine, particulièrement forte dans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1960-1975 (<strong>de</strong> 6 % à 7 %<br />
l'an) , s'est sensiblement ralentie <strong>de</strong>puis (4,5 %). L'aggravation <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation économique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
région et les mesures d'assainissement mises eu œuvre ont en effet provoqué le ralentissement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
migration rurale. <strong>Un</strong>e fragmentation sociale croissante (différences entre catégories sociales, entre<br />
quartiers…) est à l'origine d'une diversité <strong>de</strong>s situations démographiques dans les villes d'un même<br />
pays. Il y a re<strong>la</strong>tion entre ce ralentissement et les difficultés économiques traversées par les pays <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> région. La reprise économique est trop récente et incertaine pour que <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion inverse puisse être<br />
vérifiée.<br />
Le rapport fait <strong>la</strong> distinction entre l'urbanisation et <strong>la</strong> coissance urbaine. La croissance urbaine<br />
s'alimente à trois sources : <strong>la</strong> croissance démographique naturelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion déjà urbanisée, le<br />
sol<strong>de</strong> migratoire <strong>de</strong>s campagnes vers les villes et l'absorption, le cas échéant, <strong>de</strong> petits centres ruraux<br />
à <strong>la</strong> périphérie <strong>de</strong>s villes. Le terme urbanisation doit être réservé au processus d'élévation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
proportion re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale qui, en première analyse, fait<br />
abstraction <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance naturelle.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 333
Le ralentissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance urbaine en ASS s'est produit indépendamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise,<br />
au fur et à mesure que l'urbanisation progressait. De 1960 à 1975/80, à <strong>la</strong> croissance naturelle en<br />
pleine expansion (2,5 à 3 % l'an) s'ajoutait le fait qu'une émigration <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 1 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
rurale se traduisant alors par un supplément <strong>de</strong> croissance urbaine <strong>de</strong> 4 à 6 %, suivant les proportions<br />
<strong>de</strong> ruraux et <strong>de</strong> citadins <strong>de</strong> l'époque. A l'approche <strong>de</strong> <strong>la</strong> parité numérique citadins/ruraux, <strong>la</strong> même<br />
émigration rurale <strong>de</strong> 1 % n'induit plus qu'un supplément <strong>de</strong> croissance urbaine <strong>de</strong> 1 %.<br />
Par ailleurs, les enquêtes démographiques, notamment sur <strong>la</strong> fécondité, <strong>la</strong>issent entrevoir<br />
qu'une baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> natalité est engagée, en milieu urbain du moins, dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s pays. Mis à<br />
part les effets à terme <strong>de</strong> l'épidémie <strong>de</strong> SIDA – difficiles à apprécier et variables suivant les pays – le<br />
rythme d'accroissement naturel <strong>de</strong>vrait baisser progressivement vers 2 % l'an d'ici 2020. Les taux <strong>de</strong><br />
croissance urbaine records <strong>de</strong> 6 à 7 % l'an, enregistrés dans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 60-75, ne <strong>de</strong>vraient donc plus<br />
se produire, sinon localement et temporairement, sous l'effet d'épiso<strong>de</strong>s climatiques sévères ou <strong>de</strong><br />
troubles socio-politiques graves.<br />
On peut dès lors raisonnablement avancer pour 2020, à quelques années près, une popu<strong>la</strong>tion<br />
totale <strong>de</strong>s 27 pays <strong>de</strong> l'Afrique At<strong>la</strong>ntique voisine <strong>de</strong> 450 millions d'habitants, avec une popu<strong>la</strong>tion<br />
urbaine <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 300 millions <strong>de</strong> personnes, soit le triple <strong>de</strong> l'actuelle et un taux moyen <strong>de</strong><br />
croissance urbaine sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1990-2020 <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 3,7 % l'an.<br />
Des villes productrices <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur ajoutée régionale<br />
L'urbanisation contemporaine <strong>de</strong> l'Afrique au Sud du Sahara doit peu à l'industrialisation, au<br />
sens <strong>de</strong> <strong>la</strong> "Révolution Industrielle". L'économie urbaine <strong>de</strong> l'ASS relève davantage <strong>de</strong> l'industrie au<br />
sens ancien : artisanale et commerciale. Le pacte colonial avait empêché le développement <strong>de</strong>s<br />
transformations <strong>de</strong> produits agricoles et autres matières premières, au profit <strong>de</strong>s industries<br />
métropolitaines. Mais, passée une phase <strong>de</strong> rattrapage au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong>s indépendances, <strong>la</strong> greffe<br />
industrielle n'a pas pris en ASS. La part <strong>de</strong>s exportations <strong>de</strong> matières premières non transformées<br />
reste très élevée et rend les économies <strong>de</strong> <strong>la</strong> région particulièrement sensibles aux fluctuations <strong>de</strong>s<br />
marchés. Les causes <strong>de</strong> cet échec ont été dénoncées : volontarisme étatique, comportement rentier<br />
<strong>de</strong>s élites, rapports excessivement politisés entre pouvoirs centraux et investisseurs privés, entravant<br />
l'émergence d'une véritable bourgeoisie d'entrepreneurs nationaux…<br />
Encore les données officielles sous-estiment-elles l'économie urbaine <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> région.<br />
L'étu<strong>de</strong> WALTPS en partant <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s consommations finales, présente une lecture<br />
complémentaire <strong>de</strong>s "économies réelles" <strong>de</strong> ces pays "en voie <strong>de</strong> peuplement" où une part<br />
substantielle <strong>de</strong> l'activité qui vise à satisfaire les besoins essentiels <strong>de</strong>s ménages, en milieu urbain<br />
comme en milieu rural, échappe <strong>la</strong>rgement à l'appareil statistique. Les résultats ne font que confirmer<br />
les conclusions qui précè<strong>de</strong>nt : <strong>la</strong> productivité urbaine est trois à quatre fois supérieur à celle du milieu<br />
rural. Il en résulte que le milieu urbain "produit" beaucoup plus que proprotionnellement à son poids<br />
démographique. La Banque Mondiale en avait tiré argument pour justifier <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> l'appui au<br />
secteur urbain, pour autant que cet appui viserait l'amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité urbaine.<br />
En trente ans, sur l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> région, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion du secteur informel s'est multipliée par<br />
sept. Le secteur informel a rempli une fonction d'accueil et d'intégration <strong>de</strong>s migrants, en leur<br />
procurant les moyens minimaux d'existence. Le système a été capable <strong>de</strong> se reproduire en<br />
s'é<strong>la</strong>rgissant, à productivité quasi constante. Il s'agit d'une économie marchan<strong>de</strong>, monétarisée, sans<br />
rapport avec l'autosusubsistance ou le troc. Certes, elle fournit <strong>de</strong>s revenus très bas à <strong>la</strong> masse <strong>de</strong><br />
ses sa<strong>la</strong>riés, ai<strong>de</strong>s familiaux ou apprentis, mais elle impose les rapports économiques à une<br />
popu<strong>la</strong>tion considérable. Grâce à elle, l'urbanisation <strong>de</strong> l'ASS répond bien à une logique économique.<br />
Les réponses qu'apporte le secteur informel aux besoins essentiels constituent un moyen <strong>de</strong> résister à<br />
l'immersion dans l'économie-mon<strong>de</strong>. Pour autant, ce ne sont pas <strong>de</strong>s armes pour faire face aux défis<br />
mondiaux.<br />
On peut néanmoins distinguer, dans <strong>la</strong> masse <strong>de</strong>s activités dites informelles, à côté d'un<br />
informel bas <strong>de</strong> gamme très majoritaire, un informel haut <strong>de</strong> gamme, plus proche <strong>de</strong>s PME même s'il<br />
ne satisfait pas à toutes les obligations fiscales ou sociales. La crise économique a introduit une<br />
rupture : <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité dans le haut <strong>de</strong> gamme a été brutalement freinée par<br />
l'affaissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, l'irruption <strong>de</strong>s exclus <strong>de</strong> l'économie formelle et l'exacerbation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
concurrence sur l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. Le bas <strong>de</strong> gamme, qui est également frappé par <strong>la</strong> récession<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 334
économique, en dépit du ralentissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance urbaine, voit gonfler ses effectifs les moins<br />
productifs en même temps que baissent ses revenus. Il ne peut plus jouer son rôle <strong>de</strong> sas dans<br />
l'intégration urbaine <strong>de</strong>s migrants, <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong>s actifs vers d'autres secteurs <strong>de</strong> l'économie.<br />
Le secteur informel, dans son ensemble, ne joue pas un rôle complémentaire <strong>de</strong> celui du<br />
secteur mo<strong>de</strong>rne : il y a imbrication et non réelle intégration économique entre les <strong>de</strong>ux secteurs, au<br />
sens <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssiques <strong>de</strong> sous-traitance ou <strong>de</strong> filière. La dite productivité urbaine n'est ainsi<br />
que <strong>la</strong> moyenne pondérée, artificielle, entre <strong>la</strong> haute productivité d'un secteur mo<strong>de</strong>rne occupant 20 à<br />
35 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine, et celle d'un secteur informel, qui intéresse le plus grand nombre <strong>de</strong>s<br />
citadins et dont <strong>la</strong> productivité est en rapport logique avec <strong>la</strong> productivité rurale.<br />
A l'existence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux systèmes économiques imbriqués correspon<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>ux processus<br />
d'urbanisation superposés. Le premier, d'essence préindustrielle, associe <strong>la</strong> masse <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
en provenance du mon<strong>de</strong> rural et le secteur informel urbain. L'élévation globale du PIB/tête résulte du<br />
transfert d'une part croissante <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active du secteur agricole vers le secteur informel<br />
urbain, <strong>de</strong>ux fois plus productif. Le second, indépendamment du niveau technologique du premier,<br />
prélève sur celui-ci bras et ressources au profit d'îlots d'activités qui associent une minorité nationale à<br />
l'économie-mon<strong>de</strong>, à ses technologies et ses métho<strong>de</strong>s. La production <strong>de</strong>s activités mo<strong>de</strong>rnes,<br />
industrielles ou tertiaires, détermine <strong>la</strong>rgement le niveau du PIB/tête figurant sur les statistiques<br />
internationales. En termes d'emploi, l'urbanisation popu<strong>la</strong>ire et son corol<strong>la</strong>ire, le développement <strong>de</strong><br />
l'activité informelle, constituent par contre le mo<strong>de</strong> majeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation économique interne,<br />
que les politiques urbaines <strong>de</strong>vraient s'efforcer <strong>de</strong> faciliter. Le secteur intermédiaire évoqué plus haut,<br />
pour être important qualitativement, est encore embryonnaire pour influer significativement sur le PIB<br />
ou sur l'emploi.<br />
L'urbanisation accroît <strong>la</strong> productivité du secteur agricole…<br />
De 1960 à 1990, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale <strong>de</strong>s 27 pays <strong>de</strong> l'Afrique At<strong>la</strong>ntique est passée <strong>de</strong> 96 à 161<br />
millions d'individus. Le terme d'exo<strong>de</strong> rural est donc inapproprié pour qualifier l'évolution du<br />
peuplement <strong>de</strong> <strong>la</strong> région : <strong>la</strong> rapidité du mouvement d'urbanisation n'a pas empêché <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
rurale <strong>de</strong> croître, dans tous les pays considérés, beaucoup plus vite qu'elle n'a jamais cru dans les<br />
pays du nord (États-<strong>Un</strong>is mis à part).<br />
Dans un contexte <strong>de</strong> forte croissance démographique et d'urbanisation rapi<strong>de</strong>, le déficit<br />
alimentaire, perceptible au niveau <strong>de</strong>s importations et <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> alimentaire, peut aussi bien être<br />
interprété comme un retard <strong>de</strong> l"offre sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : il n'a jamais dépassé 15 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation<br />
totale, soit 4 ou 5 années d'accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> urbaine, or celle-ci s'est multipliée par 6 en<br />
trente ans. Vivement sollicitée par les excé<strong>de</strong>nts mondiaux, céréaliers notamment, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
urbaine effective <strong>de</strong> produits vivriers locaux ne dépasse guère le niveau <strong>de</strong>s écarts <strong>de</strong> production liés<br />
aux aléas climatiques ; <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s volumes commercialisés reste constituée <strong>de</strong> surplus<br />
d'une agriculture <strong>de</strong> subsistance ; l'étatisation du commerce vivrier a été un échec et <strong>la</strong> variabilité <strong>de</strong>s<br />
prix ne favorise pas l'investissement agricole. Dans un contexte <strong>de</strong> libre échange, un bi<strong>la</strong>n objectif doit<br />
d'ailleurs prendre en compte l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> production agricole, produits d'exportation compris.<br />
<strong>Un</strong> mouvement d'urbanisation modéré mais durable – un différentiel <strong>de</strong> croissance<br />
urbaine/rurale <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 2 % -, développant un marché agricole intérieur, national puis régional, est<br />
<strong>de</strong> nature à induire une croissance du revenu rural plus régulière et moins dépendante <strong>de</strong>s marchés<br />
mondiaux que l'exportation <strong>de</strong>s produits "<strong>de</strong> luxe".<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 335
Rapportée à <strong>la</strong> surface utile <strong>de</strong> <strong>la</strong> région, <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité moyenne du peuplement rural <strong>de</strong> l'Afrique<br />
au Sud du Sahara peut paraître mo<strong>de</strong>ste : <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 30 habitants/Km 2 . Elle est toutefois très<br />
inégalement répartie. Si le processus d'urbanisation était durablement ralenti, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale <strong>de</strong><br />
1997 pourrait être multipliée par 2 d'ici 2025 ; le débouché urbain offert aux agriculteurs ne<br />
s'accroîtrait guère, les privant <strong>de</strong> moyens d'investir ; un accroissement <strong>de</strong>s exportations agricoles au<br />
rythme <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance démographique n'assurerait que le maintien du revenu. <strong>Un</strong>e telle évolution,<br />
déjà amorcée en certaines zones, conduirait à <strong>de</strong>s situations intolérables, voire irréversibles, pour les<br />
ressources naturelles et à <strong>de</strong>s impasses pour le développement. Le déboisement, une <strong>de</strong>s atteintes<br />
les plus visibles à l'environnement autour <strong>de</strong>s villes, n'est pas le fait <strong>de</strong> l'urbanisation : une popu<strong>la</strong>tion<br />
urbanisée consomme plutôt moins <strong>de</strong> bois et <strong>de</strong> charbon que <strong>la</strong> même popu<strong>la</strong>tion restée rurale.<br />
On sait aussi que <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> natalité s'amorce en milieu urbain, avant <strong>de</strong> se diffuser,<br />
lentement, en milieu rural. Le maintien d'une forte proportion <strong>de</strong> ruraux se traduirait donc très<br />
vraisemb<strong>la</strong>blement par une croissance démographique plus forte, et plus durablement forte, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> région.<br />
La croissance urbaine rapi<strong>de</strong> à l'origine <strong>de</strong> situations très difficiles<br />
De 1950 à 1995, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbanisée <strong>de</strong> l'Afrique At<strong>la</strong>ntique est passée <strong>de</strong> 10 à près <strong>de</strong> 100<br />
millions <strong>de</strong> personnes. Les conditions <strong>de</strong> vie du plus grand nombre <strong>de</strong> ces citadins sont<br />
incontestablement médiocres et pour certains dramatiques. L'insuffisance <strong>de</strong>s infrastructures et <strong>de</strong>s<br />
services publics, à l'aune <strong>de</strong>s critères actuels, est manifeste.<br />
Les disparités sont extrêmes. Les revenus vont <strong>de</strong>s rémunérations <strong>de</strong> ressortissants du mon<strong>de</strong><br />
développé, hommes d'<strong>affaires</strong> et représentants officiels résidant sur p<strong>la</strong>ce, et <strong>de</strong> leurs homologues<br />
nationaux jusqu'à l'absence totale <strong>de</strong> revenu <strong>de</strong>s migrants récents. La popu<strong>la</strong>tion urbaine compte près<br />
<strong>de</strong> 50 % <strong>de</strong> jeunes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 15 ans ; les ménages (plus exactement les familles é<strong>la</strong>rgies) sont<br />
constitués <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 5 personnes pour 1,5 actif.<br />
A <strong>la</strong> dualité économique répond en général <strong>la</strong> division <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville en <strong>de</strong>ux espaces, ni disjoints ni<br />
totalement mêlés : d'un côté, centres d'<strong>affaires</strong>, instal<strong>la</strong>tions portuaires et industrielles, quartiers<br />
rési<strong>de</strong>ntiels, équipés aux normes <strong>de</strong>s pays riches ; <strong>de</strong> l'autre, vastes quartiers d'habitat spontané,<br />
sinon précaire, qui accè<strong>de</strong>nt avec beaucoup <strong>de</strong> retard aux services urbains <strong>de</strong> base.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 336
La migration et l'insertion urbaine : un projet collectivement assumé<br />
Les pratiques migratoires s'enracinent dans <strong>de</strong>s traditions qui lient mobilité spatiale et<br />
reproduction sociale. L'instabilité <strong>de</strong>s migrants est très gran<strong>de</strong> : arrivées et départs d'une année sont<br />
souvent plus importants que le sol<strong>de</strong> enregistré. Les itinéraires individuels comportent <strong>de</strong>s étapes<br />
dans <strong>de</strong>s villes petites ou moyennes, <strong>de</strong>s séjours à l'étranger, <strong>de</strong>s retours au milieu d'origine avant un<br />
nouveau départ… et n'aboutissent pas nécessairement à une intégration définitive en ville. La<br />
poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> sco<strong>la</strong>rité en ville est une composante majeure <strong>de</strong> ces flux et souvent le point <strong>de</strong> départ<br />
<strong>de</strong> l'itinéraire qui débouchera pour les uns sur un emploi mo<strong>de</strong>rne et, pour <strong>la</strong> majorité, sur le secteur<br />
informel. Les migrations féminines, d'abord retardées, sauf exception, sont aujourd'hui comparables à<br />
celles <strong>de</strong>s hommes.<br />
La moitié <strong>de</strong>s 100 millions <strong>de</strong> citadins actuels <strong>de</strong> <strong>la</strong> région sont <strong>de</strong>s ruraux venus en ville, ou<br />
leurs enfants. Les rapports ville-campagne se vivent en osmose, caractérisés par l'omniprésence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
référence vil<strong>la</strong>geoise en ville et <strong>la</strong> hantise <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville en milieu vil<strong>la</strong>geois. <strong>Un</strong>e continuité organique<br />
réunit secteurs mo<strong>de</strong>rne et informel urbains et société paysanne, répartissant les risques et les coûts<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> migration-urbanisation.<br />
La majeure partie <strong>de</strong>s immigrants récents est hébergée par <strong>de</strong>s parents, jusqu'à ce qu'un<br />
revenu régulier autorise à <strong>de</strong>venir locataire. La proportion <strong>de</strong>s citadins qui sont propriétaires du<br />
logement qu'ils occupent ne dépasse jamais 50 %. <strong>Un</strong> immigré n'envisage <strong>de</strong> construire en ville que<br />
lorsque sa situation lui paraît stabilisée et souvent après avoir construit au vil<strong>la</strong>ge familial. Il engage<br />
alors un projet patrimonial associant trois préoccupations : afficher sa réussite personnelle, accueillir à<br />
son tour <strong>de</strong>s migrants <strong>de</strong> sa famille et se procurer, par <strong>la</strong> location, <strong>de</strong>s revenus complémentaires.<br />
La masse <strong>de</strong>s migrants désco<strong>la</strong>risés n'a d'autre choix que <strong>de</strong> plonger dans l'activité informelle :<br />
ai<strong>de</strong> familiale <strong>de</strong> celui qui l'héberge, apprenti d'un patron qui l'exploite, sa<strong>la</strong>rié d'un petite entreprise<br />
informelle, parfois d'une unité mo<strong>de</strong>rne… mais visant surtout à s'établir à son compte, se faire ai<strong>de</strong>r et<br />
exploiter à son tour. La communauté d'origine reste encore, le plus souvent, le cadre <strong>de</strong> cette<br />
ascension. Les associations <strong>de</strong> ressortissants d'un même vil<strong>la</strong>ge constituent, avec <strong>la</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
famille en ville, le milieu social <strong>de</strong>s nouveaux citadins. L'appartenance à <strong>de</strong>s associations<br />
professionnelles, sportives ou culturelles signe une intégration urbaine réussie.<br />
L'urbanisation et les dynamiques agro alimentaires<br />
De nombreuses étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s concernent les liens villes/campagnes et plus<br />
spécialement l'impact <strong>de</strong> l'urbanisation sur les dynamiques et sur <strong>la</strong> dépendance agro alimentaire. cf<br />
plus spécialement :<br />
- ALTERSIAL/ CERED/ ORSTOM, Nourrir les villes <strong>africaine</strong>s, Paris L'Harmattan<br />
- ARGENTI O. (ed) 1998, Approvisionnement et distribution alimentaire <strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> l'Afrique<br />
francophone, FAO/ISRA, Dakar, Avril 1997<br />
- COUR JM (et al) (1989), <strong>Un</strong>e image à long terme <strong>de</strong> l'Afrique, Bruxelles, Scet Se<strong>de</strong>s, CEE<br />
- COUR, J.M. (1999), Le financement <strong>de</strong> l'urbanisation et le développement local, OCDE/Club<br />
du Sahel, février.<br />
- FAO, Les systèmes d'approvisionnement et <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong>s aliments Rome., coll.<br />
- HUGON Ph, COUSSY J, SUDRIE O. (1985), Urbanisation et dépendance alimentaire, Paris,<br />
SEDES<br />
- OCDE (1998), Pour préparer l'avenir <strong>de</strong> l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest. <strong>Un</strong>e vision à l'horizon 2020,<br />
Paris, OCDE(WALTPS).<br />
Prévision <strong>de</strong> l'Urbanisation<br />
La baisse du sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s migrants <strong>de</strong> 2 % à 1 % l'an, combinée avec <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance<br />
naturelle <strong>de</strong> 3 % à 2,5 % <strong>la</strong>isse prévoir un ralentissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance urbaine. Celle ci <strong>de</strong> près <strong>de</strong><br />
7% pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1960/1990 passerait entre 3,7 et 4,3 % d'ici 2020. L'essentiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance<br />
urbaine <strong>de</strong>viendrait endogène. Le pourcentage d'urbains serait <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 53 à 63 %. à un taux<br />
annuel <strong>de</strong> 3,5 % d'ici l'an 2020.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 337
Le processus d'urbanisation <strong>africaine</strong> est particulièrement rapi<strong>de</strong>. Si l'ASS reste le souscontinent<br />
le moins urbanisé, le taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions urbaines y est non seulement le<br />
plus rapi<strong>de</strong> du mon<strong>de</strong> mais il a eu tendance à croître (5,3 % en moyenne au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie 60 ;<br />
6 % durant <strong>la</strong> décennie 70) avant <strong>de</strong> s'infléchir durant <strong>la</strong> décennie 80 autour <strong>de</strong> 4,5 % (soit <strong>la</strong><br />
croissance naturelle moyenne plus un point et <strong>de</strong>mi), du fait principalement <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong>s flux<br />
migratoires. Urbanisée à moins <strong>de</strong> 1 0 % il y a trente ans, l'ASS a un taux d'urbanisation moyen<br />
supérieur à 35 % aujourd'hui et plus <strong>de</strong> 40 % <strong>de</strong> sa popu<strong>la</strong>tion sera urbaine en l'an 2000. Même si<br />
l'Afrique occi<strong>de</strong>ntale est <strong>de</strong>ux fois moins urbanisée que l'Afrique centrale (20 % contre 40 %), le même<br />
mouvement <strong>de</strong> croissance démographique interne et d'émigration rurale entraîne le continent.<br />
Alors que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s pays d'ASS a presque triplé entre 1950 et 1990 (164 raillions<br />
d'habitants à 478 millions), les urbains ont plus que décuplé durant cette pério<strong>de</strong> passant <strong>de</strong> 15<br />
millions d'habitants à plus <strong>de</strong> 150 millions (cf. tableau 1).<br />
Popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s 45 pays d'Ass (millions)<br />
Popu<strong>la</strong>tion rurale<br />
Popu<strong>la</strong>tion urbaine<br />
(+ 5000 habitants)<br />
Taux d'urbanisation<br />
Agglomération<br />
> 1 million<br />
> 100 000<br />
Tableau 1<br />
Évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine en A ss<br />
1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000*<br />
130<br />
122<br />
8<br />
6<br />
0<br />
10<br />
164<br />
149<br />
15<br />
12<br />
1<br />
28<br />
* Prévisions CERED<br />
Source : Calculs à partir <strong>de</strong>s statistiques COUR/ILTA, WALTps, p. 7.<br />
On estime (source : WALTPS, 1994) que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine <strong>de</strong> l'Afrique francophone est<br />
passée <strong>de</strong> 8,6 millions en 1960 à 25,1 millions en 1980 et 41,3 millions en 1990, soit <strong>de</strong>s taux<br />
d'urbanisation respectifs <strong>de</strong> 14,3 % à 25,1 % et 31,8 % (cf tableau 3) proches <strong>de</strong> <strong>la</strong> moyenne<br />
<strong>africaine</strong>.<br />
L'explosion urbaine s'accompagne d'un déséquilibre spatial et <strong>de</strong> mégalopoles croissant avec<br />
faible armature urbaine. Il y a prévalence <strong>de</strong>s villes primatiales par rapport à un réseau re<strong>la</strong>tivement<br />
lâche <strong>de</strong> villes secondaires et faible articu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s villes par rapport à leur espace rural.<br />
Dans <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s pays africains, les villes primatiales croissent plus rapi<strong>de</strong>ment que les villes<br />
secondaires : le taux <strong>de</strong> primatialité est passé en vingt ans <strong>de</strong> 35 à 45 % (Hugon, Pourtier, 1993). En<br />
1980, l'Ass comptait 12 villes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 1 millions d'habitants, 160 <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 100 000 et environ<br />
3 000 centres <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 5 000 habitants.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 338<br />
203<br />
176<br />
27<br />
16<br />
265<br />
207<br />
Les déficits comptables : l'urbanisation facteur <strong>de</strong> déficits alimentaires<br />
Par son rythme, sa dimension, les changements <strong>de</strong> structure qu'ils entraînent, les processus<br />
d'urbanisation conduiront à <strong>de</strong>s déficits entre l'offre et <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: <strong>de</strong> logements, d'infrastructures<br />
sanitaires et sco<strong>la</strong>ires, d'alimentation. Selon plusieurs auteurs, il existerait un "biais urbain" et une<br />
dépendance extérieure induite par <strong>de</strong>s urbanisations non maîtrisables. ce processus étant d'autant<br />
plus important que les liens entre les villes et les campagnes se relâchent et qu'un réseau <strong>de</strong> villes<br />
secondaires n'est pas mis en p<strong>la</strong>ce. On observe ainsi apparemment un parallélisme du moins<br />
jusqu'au renversement <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie quatre vingt entre le volume <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine et le<br />
volume <strong>de</strong>s importations alimentaires.<br />
Si l'on suppose une constante <strong>de</strong> <strong>la</strong> productivité agricole (production par agriculteur), toute<br />
baisse du rapport entre agriculteur et non agriculteur aboutit dans un contexte <strong>de</strong> croissance<br />
démographique à un déficit entre production et consommation. Celui-ci conduit soit à un déficit<br />
nutritionnel soit à un déficit <strong>de</strong> <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce extérieure (importations et ai<strong>de</strong> alimentaire). Dans le passé<br />
le taux <strong>de</strong> croissance moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale a été <strong>de</strong> 1,5% par an en Afrique <strong>de</strong> l'ouest et <strong>de</strong><br />
2,7% en Côte d'Ivoire. du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance naturelle et <strong>de</strong> <strong>la</strong> migration. On peut estimer que <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion rurale croîtra <strong>de</strong> 1% par an soit une augmentation <strong>de</strong> 40%.<br />
52<br />
22<br />
360<br />
257<br />
103<br />
30<br />
10<br />
160<br />
478<br />
323<br />
155<br />
33<br />
661<br />
400<br />
260<br />
40
Selon <strong>la</strong> FAO, <strong>la</strong> production est estimée à partir <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tions rurales, <strong>de</strong> surfaces et <strong>de</strong><br />
ren<strong>de</strong>ments mal connues. La production agricole exprimée en calories aurait cru en longue pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
2% (1960/1990) soit une baisse <strong>de</strong> 0,7%. Il y aurait stagnation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production par agriculteur. Les<br />
importations alimentaires auraient cru <strong>de</strong> 5,2% par an pour couvrir 11% <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation finale.<br />
Alors que le sol<strong>de</strong> alimentaire était excé<strong>de</strong>ntaire en 1961/1965, il est <strong>de</strong>venu déficitaire. Dans les<br />
zones où existent <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nsités élevées il faudrait multiplier dans les 25 prochaines années les<br />
ren<strong>de</strong>ments par 2,5 et <strong>la</strong> productivité du travail par 3,1 en moyenne pour faire face à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
L'Afrique est incapable <strong>de</strong> nourrir sa popu<strong>la</strong>tion du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> forte croissance démographique, <strong>de</strong>s<br />
contraintes <strong>de</strong> production et <strong>de</strong>s consommations incompressibles. Celles ci s'explique par <strong>de</strong>s<br />
minimaux nutritionnels et par <strong>de</strong>s rigidités notamment du fait <strong>de</strong> modèles mimétiques..<br />
Les prévisions agricoles <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque mondiale ou <strong>de</strong> l'IFPRI sont pessimistes<br />
pour l'Afrique. D'où <strong>la</strong> nécessité d'une ai<strong>de</strong> alimentaire (Mitchell et Ingco 1993). Selon I'IFPRI(1995),<br />
on aura une augmentation <strong>de</strong> 29 millions à 43 millions <strong>de</strong>s mal nourris en Afrique sub saharienne. La<br />
popu<strong>la</strong>tion en sous alimentation chronique <strong>de</strong> 96 millions(sur 268 millions en 1969-71) serait passée à<br />
204 millions(sur 500 millions en 1990) et pourraient atteindre 300 millions selon <strong>la</strong> FAO en 2010.<br />
Prévisions <strong>de</strong>s déficits alimentaires céréaliers en Afrique sub saharienne<br />
en 2010 (millions tonnes - céréales)<br />
Sélectio<br />
n<br />
1993<br />
FAO Mithell Ingco IFPRI<br />
Offre <strong>de</strong> grains 55 110 83 86<br />
Deman<strong>de</strong> <strong>de</strong> grains 65 129 96 118<br />
Déficit -8 -72 -73 -65<br />
On peut prévoir que <strong>la</strong> connexion au marché se fera par un vivrier commercialisé qui jouera un rôle<br />
croissant dans le PIB marchand. Les incitations à produire augmenteront en fonction <strong>de</strong>s proximités<br />
<strong>de</strong>s villes. Selon WALTPS, le secteur agricole produirait 14% du produit régional brut. 25 millions<br />
d'agriculteurs produiront les quantités nécessaires à l'approvisionnement <strong>de</strong> 40% <strong>de</strong>s consommateurs<br />
soit 100 millions; leur productivité atteindrait cinq fois le niveau <strong>de</strong> subsistance alors que <strong>la</strong><br />
productivité moyenne <strong>de</strong>s 150 millions d'agriculteurs resterait à un niveau proche <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux fois celui<br />
d'autosubsistance. Les échanges intra régionaux joueront un rôle croissant. le commerce régional<br />
contribuerait à 22% <strong>de</strong>s importations contre 9% en 1990.<br />
Il y aura maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> pluralité <strong>de</strong>s circuits d'approvisionnements. L'agriculture intensive sera<br />
davantage localisée en fonction <strong>de</strong>s conditions foncières que <strong>de</strong>s proximités <strong>de</strong> marché.<br />
L'intensification <strong>de</strong> l'agriculture dans les zones éloignées <strong>de</strong>s villes rendra nécessaire une<br />
professionnalisation <strong>de</strong>s taches d'intermédiation. Elle réduira le poids <strong>de</strong>s circuits domestiques et <strong>de</strong>s<br />
circuits à marchands courts. Il y aura par contre développement <strong>de</strong>s circuits marchands longs.<br />
Tout <strong>la</strong>isse à penser que l'Afrique sub-saharienne saura répondre aux défis <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance<br />
urbaine et qu'elle connaîtra une dynamique agro-alimentaire à partir d'une pluralité <strong>de</strong> circuits et <strong>de</strong><br />
filières.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 339
Tableau 2<br />
Parallélisme <strong>de</strong>s déficits alimentaires et <strong>de</strong> l'expansion urbaine <strong>de</strong>s PVD et en Ass<br />
Ba<strong>la</strong>nce céréalière Popu<strong>la</strong>tion nourrie Popu<strong>la</strong>tion urbaine<br />
Millions <strong>de</strong> tonnes Millions<br />
Millions<br />
1 2 3 4 5 6 3/5 4/6<br />
PVD Ass PVD Ass PVD Ass<br />
1934-1938 + 4 – – – 101 9 – –<br />
1948-1952 – 6 – 0,3 30 1,5 189 15 16 10<br />
1958-1962 –15 –1,25 71 5,9 294 38 37 30<br />
1968-1972 –24 –3,15 115 15 457 53 37 30<br />
1973-1977 –40 – 190 – – – – –<br />
1978-1982 –65 –8,8 709 42 706 102 44 40<br />
1982-1984 – 76 – 15 – 71,5 – 115 – 50<br />
1985-1986 – – 8,5 – 40,4 – 127 – 32<br />
1990 –113,3 – 10,5 1 540 50 1 823 150 29 33<br />
a. Argentine et Chine exclues<br />
3 – 4. Selon <strong>la</strong> norme <strong>de</strong> 210 kg par habitant.<br />
Sources : Bairoch, pour les PVD (économie à faible revenu et intermédiaire). Us Department of Agriculture pour l’Ass et Banque mondiale.<br />
Ces prévisions sont à mettre au regard <strong>de</strong>s évolutions passées. Après une aggravation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
dépendance jusqu'au milieu <strong>de</strong>s années soixante dix, il y eu ensuite stagnation voire réduction et donc<br />
réversibilité <strong>de</strong>s tendances. Le taux d'autosuffisance alimentaire <strong>de</strong> l'Afrique <strong>de</strong> 98% en 1960 était<br />
tombé à 90% en 1972. La production agricole a cru entre 1984 et 1995 à un taux estimé à 5%. Le %<br />
<strong>de</strong>s importations alimentaires sur les importations totales était en 1989 du même ordre <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur<br />
qu'en 1965 (17% contre 15%). Les importations alimentaire qui avaient atteint 15 millions <strong>de</strong> tonnes<br />
en 1983/84 contre 5, 1 millions <strong>de</strong> tonnes en 1974 sont retombées autour <strong>de</strong> 10 millions <strong>de</strong> tonnes<br />
durant <strong>la</strong> décennie quatre vingt dix. On peut considérer que les importations alimentaires représentent<br />
pour l'essentiel un déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> trois ans entre <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong><br />
l'offre(Cour).<br />
Les importations croissantes ne concernent que les produits fortement concurrencés<br />
(notamment par les bas prix mondiaux et où <strong>la</strong> substitution <strong>de</strong> produits locaux est faible(vian<strong>de</strong>, blé<br />
riz). On constate en revanche un développement très rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s activités abritées ou semi abritées<br />
suscitées par <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> solvable (maraîchage, petits ruminants, vo<strong>la</strong>illes, canne à sucre) ou d'une<br />
faible concurrence <strong>de</strong>s produits importés (tubercules, légumineuses).<br />
L'urbanisation facteur <strong>de</strong> progrès <strong>de</strong> productivité agricole<br />
L'urbanisation <strong>africaine</strong>, dont les formes sont variées, n'a pas généralement entraîné une<br />
rupture <strong>de</strong>s liens villes/campagnes pour plusieurs raisons. Les agents appartiennent à <strong>de</strong>s réseaux<br />
qui dépassent <strong>la</strong> dichotomie villes/campagnes. Les agglomérations urbaines sont <strong>de</strong>s lieux<br />
d'intensification <strong>de</strong>s échanges. La ville n'est pas seulement un lieu <strong>de</strong> ponction d'un surplus agricole,<br />
elle est surtout un espace <strong>de</strong> création <strong>de</strong> richesse par <strong>la</strong> division du travail et le marché et <strong>de</strong><br />
constitution d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> solvable. Il y a en ville diversité et non-uniformité <strong>de</strong>s régimes<br />
alimentaires, à <strong>la</strong> fois superposition, confrontation et dynamique propre. Les exemples toujours cités<br />
<strong>de</strong> pain ou <strong>de</strong> riz, pour caractériser les modèles mimétiques, doivent être ainsi re<strong>la</strong>tivisés. On note<br />
une re<strong>la</strong>tive ruralisation <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> consommation alimentaire (Requiers-Desjardins, 1989).<br />
En première approximation, le ratio popu<strong>la</strong>tion urbaine sur popu<strong>la</strong>tion rurale est un indicateur <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> production agricole qui doit être commercialisée par <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale afin d'approvisionner les<br />
centres urbains. Bien entendu, dans une analyse plus fine, il importe <strong>de</strong> différencier <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
agricole <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale, d'intégrer <strong>la</strong> composante agricole <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions urbaines et <strong>de</strong> tenir<br />
compte <strong>de</strong>s divers taux d'activité. Le ratio popu<strong>la</strong>tion urbaine/popu<strong>la</strong>tion rurale est passé <strong>de</strong> 0,08 en<br />
1930 à 0,18 en 1950, 0,19 en 1960, 0,28 en 1970 et à 0,41 en 1980 le taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> ce ratio<br />
peut être estimé à 3,2 % en 1950 et à 3,7 % en 1980 (source Cour/ILTA).<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 340
Pour l'ensemble <strong>de</strong> l'Afrique Sub-Saharienne, en 1980 <strong>la</strong> "productivité" était environ six fois<br />
supérieure pour les activités non agricoles que pour les activités agricoles (771 dol<strong>la</strong>rs par tête contre<br />
13 1 dol<strong>la</strong>rs). Par contre, il y a eu au cours du temps réduction <strong>de</strong> cet écart . <strong>la</strong> baisse est <strong>de</strong> 20 %<br />
entre 1970 et 1980 (6,9 à 5,9). On peut estimer qu'en Afrique francophone <strong>la</strong> valeur ajoutée par<br />
habitant rural est <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 340 à 400 dol<strong>la</strong>rs contre une valeur ajoutée par habitant urbain <strong>de</strong><br />
l'ordre <strong>de</strong> 1 1 00 à 1990 dol<strong>la</strong>rs. Les écarts se sont fortement réduits entre 1980 et 1990 mais ils<br />
<strong>de</strong>meurent <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 1 à 3. On peut estimer que le surplus agricole commercialisé en ville par les<br />
paysans africains a augmenté grosso modo comme le rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion non agricole à <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion agricole (cf WALTps, 1994). Selon les pays d'Aftique francophone les divergences sont<br />
gran<strong>de</strong>s ; les écarts entre les rapports <strong>de</strong> productivité varient entre 1,98 au Bénin et 26,5 au Gabon.<br />
Exception faite <strong>de</strong>s pays pétroliers (Congo, Gabon), il y a eu baisse <strong>de</strong> l'écart ce qui <strong>la</strong>isse entendre<br />
un déclin re<strong>la</strong>tif du revenu urbain par tête.<br />
La décennie 80 a été ainsi caractérisée par une forte réduction <strong>de</strong>s écarts <strong>de</strong> valeur ajoutée<br />
entre les villes et les campagnes liée à <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s politiques d'ajustement (Cour, 1985 ;<br />
WALTPS, 1994). Les sa<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s travailleurs non qualifiés du secteur mo<strong>de</strong>rne ont baissé davantage<br />
que <strong>la</strong> moyenne <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires. Le secteur dit informel joue toutefois un rôle mal enregistré<br />
d'amortisseur et <strong>de</strong> maintien re<strong>la</strong>tif <strong>de</strong>s revenus urbains.<br />
Les métho<strong>de</strong>s méso systémiques : les interdépendances entre urbanisation et dynamiques agroalimentaires<br />
Les dynamiques agro-alimentaires doivent prendre en compte <strong>la</strong> pluralité <strong>de</strong>s filières, les<br />
réversibilités <strong>de</strong>s trends, Les analyses en termes <strong>de</strong> filières ou <strong>de</strong> meso systèmes permettent <strong>de</strong><br />
prendre en compte les stratégies d'acteurs., les différents circuits reliant les produits agro-alimentaires<br />
<strong>de</strong> l'amont vers l'aval,.<br />
La filière ou meso système est un lieu intermédiaire pour analyser, au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession<br />
d'opérations techniques d'amont et aval, les dynamiques <strong>de</strong>s sous systèmes à l'intérieur <strong>de</strong>squels<br />
s'exercent <strong>de</strong>s champs <strong>de</strong> force, se nouent <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions marchan<strong>de</strong>s et non marchan<strong>de</strong>s, se réalisent<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s d'organisation et <strong>de</strong>s stratégies d'acteurs. L'adéquation <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> production aux<br />
différents mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> consommation alimentaire se réalise par <strong>de</strong>s opérations prenant en charge les<br />
changements dans <strong>la</strong> matière (transformation) dans l'espace (transports) dans le temps (stockage) et<br />
dans l'attribution (distribution). Les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> produire, d'échanger et <strong>de</strong> consommer se font à partir<br />
<strong>de</strong> technologies plus ou moins capitalistiques et <strong>de</strong> différents mo<strong>de</strong>s d'organisation.<br />
L'impact <strong>de</strong> l'urbanisation sur les dynamiques agro-alimentaires dépend <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>de</strong><br />
l'urbanisation. Il faut différencier les villes parasitaires, rentières, enc<strong>la</strong>ves et entraînantes, pôles <strong>de</strong><br />
développement vis à vis <strong>de</strong> leur hinter<strong>la</strong>nd.<br />
La croissance urbaine exercera <strong>de</strong>s effets multiples sur les dynamiques agro-alimentaires:<br />
- le modèle alimentaire urbain sera pour l'essentiel une combinatoire entre <strong>de</strong>s valeurs<br />
héritées et <strong>de</strong>s valeurs nouvelles<br />
- l'essentiel <strong>de</strong>s circuits d'approvisionnement et <strong>de</strong> distribution (transports, commerce,<br />
stockage, transformation, restauration) seront assurées par les petites activités marchan<strong>de</strong>s<br />
ou "informelles". Le taux <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active dans les filières agro<br />
alimentaires a été voisin <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine dans le passé. Il était <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong><br />
10% <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active en 1995.<br />
- il y aura développement <strong>de</strong> l'agriculture marchan<strong>de</strong> vivrière aux dépens <strong>de</strong> l'auto<br />
consommation.<br />
L'analyse spatiale conduit à différencier les villes parasitaires vis-à-vis du mon<strong>de</strong> rural, les villes<br />
rentières jouant un rôle ou non <strong>de</strong> redistribution vis-à-vis du mon<strong>de</strong> rural, les villes enc<strong>la</strong>ves intégrées<br />
à l'espace international sans liens avec le mon<strong>de</strong> rural ou les villes entraînantes, pôles <strong>de</strong><br />
développement vis-à-vis <strong>de</strong> l'hinter<strong>la</strong>nd. Selon leur morphologie, l'importance <strong>de</strong>s réseaux et les<br />
différents mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> structuration <strong>de</strong> l'espace, les villes ont ainsi <strong>de</strong>s effets divergents sur les filières<br />
d'approvisionnement.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 341
Le découpage <strong>de</strong> l'Afrique en huit gran<strong>de</strong>s régions selon une pluralité <strong>de</strong> facteurs<br />
géographiques, économiques, agronomiques, démographiques et alimentaires montre <strong>de</strong>s résultats<br />
contrastés (cf Hugon, Coussy, Sudrie, 1991).<br />
La ville est un lieu <strong>de</strong> plus gran<strong>de</strong> intégration aux circuits internationaux, <strong>de</strong> constitution d'une<br />
chaîne <strong>de</strong> froid, <strong>de</strong> localisations <strong>de</strong>s filiales étrangères, ou d'accès aux marchandises internationales<br />
(encore faut-il examiner leur localisation géographique). Elles sont toutefois également un lieu à partir<br />
duquel se constituent les différentes opérations d'intermédiation internes. Il y a certes en ville diffusion<br />
<strong>de</strong> modèles <strong>de</strong> consommation importés mais les effets diffèrent selon les villes et selon les régimes<br />
alimentaires ; <strong>la</strong> ville est généralement plus un lieu <strong>de</strong> recomposition <strong>de</strong> nouveaux régimes<br />
alimentaires que <strong>de</strong> rupture avec le mon<strong>de</strong> rural.<br />
Quelles perspectives urbaines ?<br />
La baisse du sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s migrations <strong>de</strong> 2 % à 1 % l'an, combiné avec <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> croissance<br />
naturelle <strong>de</strong> 3 % à 2,5 % l'an, <strong>la</strong>isse prévoir <strong>de</strong>s croissances urbaines passant <strong>de</strong> 5 % à 3,5 % d'ici l'an<br />
2020. Entre 1990 et 2020, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion urbaine croîtra au taux moyen <strong>de</strong> 4,2 % en Afrique <strong>de</strong> l'Ouest<br />
contre un pourcentage <strong>de</strong> 6,3 % entre 1960 et 1990. Les effectifs urbains seront multipliés par 3,5. On<br />
peut estimer que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale croîtra <strong>de</strong> 1 % par an soit une augmentation <strong>de</strong> 40 %. A taux<br />
d'urbanisation constant, le taux <strong>de</strong> croissance moyen <strong>de</strong>s villes serait <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 2,69 % contre<br />
3,35 % pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1960-80. En terme absolu ceci conduit toutefois à faire doubler <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
urbaine en moins <strong>de</strong> 20 ans.<br />
Quelles perspectives agricoles ?<br />
L'agriculture vivrière <strong>de</strong> rapport <strong>de</strong>vra répondre à ces besoins croissants. Il en résultera<br />
vraisemb<strong>la</strong>blement une différenciation croissante au sein <strong>de</strong>s paysanneries.<br />
Selon les prévisions <strong>de</strong> WALTPS, en 2020, le secteur agricole fournira 14 % du Produit<br />
Régional Brut. 25 millions d'agriculteurs (15 % du total) produiront les quantités nécessaires à<br />
l'approvisionnement <strong>de</strong> 40 % <strong>de</strong>s consommateurs soit 100 millions ; leur productivité atteindra cinq<br />
fois le niveau d'autosubsistance alors que <strong>la</strong> productivité moyenne <strong>de</strong>s 150 millions d'agriculteurs<br />
restera à un niveau proche <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux fois celui d'autosubsistance. On peut supposer que les besoins en<br />
calories augmenteront fortement. La croissance est évaluée à 250 % entre 1995 et 2050. L'essentiel<br />
viendra d'énergie d'origine végétale.<br />
Les évolutions passées montrent que, dans l'ensemble, les agricultures vivrières <strong>africaine</strong>s et<br />
les circuits d'approvisionnement auront répondu au défi urbain. Le système agricole commercialisé<br />
par les paysans a augmenté comme le ratio popu<strong>la</strong>tion non agricole sur popu<strong>la</strong>tion agricole. Entre<br />
1930 et 2030, le milieu urbain aura absorbé 70 % du croît démographique.<br />
Il y aura maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> pluralité <strong>de</strong>s circuits d'approvisionnement. L'agriculture intensive sera<br />
davantage localisée en fonction <strong>de</strong>s conditions foncières que <strong>de</strong>s proximités <strong>de</strong> marché.<br />
L'intensification <strong>de</strong> l'agriculture dans <strong>de</strong>s zones éloignées <strong>de</strong>s villes rendra toutefois nécessaire une<br />
professionnalisation accrue <strong>de</strong>s tâches d'intermédiation. Elle réduira le poids <strong>de</strong>s circuits domestiques<br />
et <strong>de</strong>s circuits courts. Si les circuits publics ont peu <strong>de</strong> chance <strong>de</strong> ressurgir, les circuits domestiques<br />
continueront d'exister mais joueront un rôle second par rapport aux circuits marchands. Les grossistes<br />
y joueront un rôle important. Ces circuits marchands s'articuleront avec <strong>de</strong>s organisations<br />
industrielles.<br />
Les disparités spatiales <strong>de</strong>vront être gérées par un aménagement du territoire et par un réseau<br />
<strong>de</strong>nse d'infrastructures. En Afrique <strong>de</strong> l'Ouest francophone, Abidjan et Dakar seront les marchés<br />
moteurs. La <strong>de</strong>nsification <strong>de</strong>s réseaux urbains et d'intensification <strong>de</strong>s approvisionnements supposent<br />
une forte amélioration <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> transport à moyenne distance. L'essentiel <strong>de</strong>s liaisons<br />
concernera l'hinter<strong>la</strong>nd <strong>de</strong>s zones côtières en Afrique <strong>de</strong> l'Ouest.<br />
La complexité <strong>de</strong>s circuits d'approvisionnement suppose un pilotage se situant à <strong>de</strong>s échelles<br />
diverses.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 342
Les popu<strong>la</strong>tions urbaines et les surfaces urbanisées vont tripler au cours <strong>de</strong>s trente prochaines<br />
années et les flux <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong>s biens et services entrant et sortant <strong>de</strong>s villes <strong>de</strong>vront<br />
décupler. La part du milieu urbain dans le produit régional brut <strong>de</strong> l'Ouest passerait <strong>de</strong> 70 % à 85 %<br />
d'ici 2020. Les étu<strong>de</strong>s ECOLOC, portant sur les villes <strong>de</strong> 50000 à 500000 habitants,montrent en quoi<br />
<strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong> l'urbanisation impose <strong>de</strong> recourir à un <strong>la</strong>rge éventail <strong>de</strong> moyens <strong>de</strong> financement.<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 343
SIGLES UTILISES<br />
ACP Afrique Caraïbes Pacifique<br />
AEF Afrique Equatoriale Française<br />
AFD Agence Française <strong>de</strong> Développement (anciennement CFD)<br />
AOF Afrique Occi<strong>de</strong>ntale Française<br />
ALENA Association <strong>de</strong> Libre Echange Nord-Américain<br />
APD Ai<strong>de</strong> Publique au Développement<br />
ASS Afrique Sub-Saharienne<br />
BAD Banque Africaine <strong>de</strong> Développement<br />
BAO Banque <strong>de</strong> l'Afrique Occi<strong>de</strong>ntale<br />
BCEAO Banque Centrale <strong>de</strong>s Etats <strong>de</strong> l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest<br />
BEAC Banque <strong>de</strong>s Etats d'Afrique Centrale<br />
CEAO Communauté Economique <strong>de</strong> l'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest<br />
CEDEAO Communauté Economique <strong>de</strong>s Etats d'Afrique <strong>de</strong> l'Ouest<br />
CEA Commission Economique pour l'Afrique<br />
CEE Communauté Economique Européenne<br />
CFA Colonies Françaises d'Afrique (jusqu'en 1945), Côte Française d'Afrique (dans l'Uemoa<br />
<strong>de</strong>puis 1973), Communauté Financière Africaine (dans <strong>la</strong> Cemac <strong>de</strong>puis 1972)<br />
CFDT Compagnie Française pour le Développement du Textile<br />
CEMAC Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale<br />
CERDI Centre d'Etu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> Recherches sur le Développement International<br />
(Clermont-Ferrand)<br />
CERED Centre d'Etu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> Recherches en Economie du Développement (Paris X-Nanterre)<br />
DOM/TOM Départements d'Outre Mer ; Territoires d'Outre Mer<br />
DTS Droits <strong>de</strong> Tirages Spéciaux<br />
FAB/FOB Franco A Bord ; Free On Board<br />
FAO Food and Agricultural Organization<br />
FIDES Fonds d'Investissement pour le Développement Economique et Social<br />
FMA Fonds Monétaire Africain<br />
FMI Fonds Monétaire International<br />
GATT General Agreement Tariff and Tra<strong>de</strong><br />
MEGC Modèle d'Equilibre Général Calcu<strong>la</strong>ble<br />
OCDE Organisation <strong>de</strong> Coopération et <strong>de</strong> Développement Economique<br />
OMC Organisation Mondiale du Commerce<br />
ONG Organisation Non Gouvernementale<br />
OPEP Organisation <strong>de</strong>s Pays Producteurs <strong>de</strong> Pétrole<br />
PAS Programme d'Ajustement Structurel<br />
PASA Programme d'Ajustement Structurel Agricole<br />
PAZF Pays Africains <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone Franc<br />
PIB Produit Intérieur Brut<br />
PMA Pays les Moins Avancés<br />
PNB Produit National Brut<br />
PPTE Pays Pauvres Très En<strong>de</strong>ttés (HIPC)<br />
PVD Pays en voie <strong>de</strong> développement<br />
SPG Système <strong>de</strong> Préférences Généralisées<br />
STABEX Mécanisme <strong>de</strong> Stabilisation <strong>de</strong>s Recettes d'Exportation<br />
SYSMIN Système <strong>de</strong> Financement pour le Secteur Minier<br />
TCA Taxe sur le Chiffre d'Affaires<br />
TCER Taux <strong>de</strong> Change Effectif Réel<br />
TCR Taux <strong>de</strong> Change Réel<br />
TEC Tarif Extérieur Commun<br />
TOFE Tableau <strong>de</strong>s Opérations Financières <strong>de</strong> l'Etat<br />
UDAO <strong>Un</strong>ion Douanière <strong>de</strong> l'Afrique Occi<strong>de</strong>ntale<br />
UDEAC <strong>Un</strong>ion Douanière et Economique d'Afrique Centrale<br />
UE <strong>Un</strong>ion Européenne<br />
UEMOA <strong>Un</strong>ion Economique et Monétaire Ouest Africaine<br />
UMAC <strong>Un</strong>ion Monétaire d'Afrique Centrale<br />
UMOA <strong>Un</strong>ion Monétaire Ouest Africaine<br />
WALTPS West African Long Term Prospective Studies<br />
ZMO Zone Monétaire Optimale<br />
<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 345
Titres disponibles dans <strong>la</strong> collection<br />
RAPPORTS D’ÉTUDE<br />
• Compétitivité du cacao africain. Analyse du marché mondial et <strong>de</strong>s principaux producteurs. 1990<br />
• La compétitivité <strong>de</strong>s bois d’œuvre africains. 1993<br />
• La compétitivité <strong>de</strong>s cafés africains. 1993<br />
• Les systèmes d’épargne et <strong>de</strong> crédit décentralisés. 1994<br />
• La compétitivité <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière textile en Afrique subsaharienne. 1995<br />
• Le secteur pharmaceutique commercial privé en Afrique. 1996<br />
• Compétitivité <strong>de</strong> <strong>la</strong> pêche maritime en Afrique. 1997<br />
• Le recouvrement <strong>de</strong>s coûts dans le secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé. <strong>Bi<strong>la</strong>n</strong> et perspectives. 1999<br />
• <strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong>. 2000<br />
– Volume 1 : Synthèse (92 p.)<br />
– Volume 2 : Annexes (356 p.)