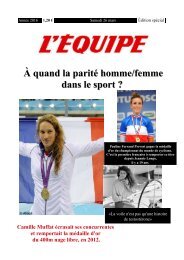You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 Les inégalités Homme/Femme dans le sport<br />
Thème : Les inégalités<br />
Problématique : La Femme a-t-elle sa place dans un<br />
milieu sportif dominé par les Hommes ?<br />
REBELO Fanny<br />
1er ES/L<br />
CASTELLANOS Noémie Année 2015/1016
SOMMAIRE<br />
Introduction<br />
I. La femme et le sport au fil du temps :<br />
a) De l'Antiquité au XIXème siècle<br />
b) De 1800 à nos jours<br />
c)Les Jeux Olympiques<br />
II. Les obstacles au développement du sport féminin<br />
a) Les contraintes liées à la vie privé de la femme<br />
b) Les stéréotypes<br />
c) La sous médiatisation du sport féminin<br />
d)Les inégalités salariales dans le monde du sport<br />
III. Les premiers pas vers une parité Homme/Femme dans le<br />
sport<br />
a) Biographies de sportives qui ont réussis dans le monde du sport<br />
b) L'accès au sport<br />
c) La médiatisation<br />
d) Salaire et instances dirigeantes<br />
Conclusion
Introduction: Le sport est un ensemble d'exercices physiques qui peut se<br />
pratiquer seul ou en équipe et pouvant donner lieu à des compétitions. Dès le<br />
début de l'histoire le sport a défini de nombreuses valeurs comme le respect de<br />
l'adversaire, l'esprit d'équipe ou encore le dépassement de soi. Au début, le sport<br />
comportait un aspect religieux puisque c'était un moyen d'honorer les dieux<br />
ainsi il y avait un ensemble d'épreuves sportives qui se déroulait dans la Rome<br />
antique lors des jeux Olympiques. Au fil du temps, le sport a traversé les<br />
époques et maintenant le sport est avant tout un loisir qui permet de garder la<br />
forme physique ou bien de décompresser. Diverses disciplines sportives sont<br />
proposées pour plaire et être accessible au plus grand nombre. Le sport permet<br />
de réunir toutes les couleurs de peau, peu importe la religion ou encore la classe<br />
sociale. Le sport est un langage universelle car il se pratique dans le monde<br />
entier. En France, c'est la commission nationale qui définit le statut de sportif<br />
de haut niveau. De nombreux critères doivent être pris en compte pour<br />
prétendre à ce statut comme la participation à des compétitions sportives<br />
officielles, les jeux Olympiques, les championnats du monde ou encore les<br />
championnats d'Europe. En revanche le sport de loisir n'a pas cette notion de la<br />
compétition. Le sport est majoritairement pratiqué par les hommes mais depuis<br />
quelques années les femmes s'inscrivent de plus en plus dans des fédérations<br />
sportives. En revanche l'écart est très important dans la pratique d'un sport à<br />
haut niveau puisqu'il y a 2400 femmes contre 4600 hommes. La femme est<br />
quant à elle, considérée, depuis tout temps confondus, comme le « sexe faible<br />
». Cette différence est encrée dans les mœurs, comme si la femme n'était pas<br />
assez compétente, trop fragile, dédiée à des activités déjà programmées ( faire<br />
le ménage, à manger, s'occuper des enfants etc...) et qui donc n'aurait pas sa<br />
place dans un monde monopolisé par le soit disant « sexe fort ». Elles seraient<br />
donc exclues de certaines tâches politiques ou judiciaires, écartées du monde<br />
sportif, mais aussi de certains métiers qualifiés de trop<br />
« difficiles » à gérer ou à exercer. Cependant, une évolution est constatée au fur<br />
et à mesure que les années passent. Il serait judicieux de se demander si la la<br />
femme a sa place dans un milieu dominé par les hommes. Nous allons le voir<br />
dans le cas du monde du sport en abordant en premier temps l'évolution de la<br />
femme dans le sport au fil du temps, puis les obstacles aux développement du<br />
sport enfin les solutions que l'on peut trouver et qui peuvent permettre d'amener<br />
la parité homme/femme dans le sport.<br />
Cette évolution entraîne parallèlement une intégrité de la femme dans le milieu<br />
social, mais aussi toute une disposition aussi bien matérielle que sportive afin<br />
que la femme soit considérée au même titre que celui de l'homme.
I. La femme et le sport au fil du temps :<br />
a) De l'antiquité au XIXème siècle :<br />
Antiquité grecque → Les premières notions sont données par l'Antiquité<br />
grecque. En effet, c'est à Sparte que l'on commence à<br />
constater un début d'évolution. Lycurge (photo cicontre),<br />
encourage l'activité féminine jusqu'à instituer<br />
des concours de vitesse et de forces qui leurs sont<br />
réservés. Ce mythique législateur de Sparte persuadé<br />
que « l'enfant né de père et de mère vigoureux ne peut<br />
être lui-même que vigoureux » vient se placer à<br />
l'encontre des pensées des Romains.<br />
Romains → Du côté des Romains, l'opinion est déjà plus sexiste et plus<br />
nuancée quant au bien fondé de l'exercice physique féminin. Ovide (photo 1),<br />
poète latin reconnue, recommande aux femmes de s’abstenir de<br />
se livrer aux exercices réservés aux hommes, mais ce n'est pas<br />
tout puisque Juvénal (photo 2), autre poète latin mais cette fois<br />
satirique, semble avoir édicté son fameux « mens<br />
sana, in corpore sano » ( un esprit sain dans un<br />
corps sain ) spécialement réservé aux hommes.<br />
Cependant, ces dires relèvent de l'anecdote et ne renseigne pas<br />
vraiment sur la pratique sportive réelle des femmes.<br />
Période de Byzance au XIXème siècle →<br />
* Le christianisme : La culture gréco latine interdisait aux femmes de trop<br />
dévoiler le corps et donc en voilant le corps magnifié (célébré, glorifié ) il<br />
s'opposait aux principes les plus élémentaires de l'activité physique.<br />
Aussi, n'est-il pas étonnant que l'activité corporelle devienne l'objet d'une<br />
certaine réticence ; les jeux publics sont frappés, par exemple, d'interdit par<br />
l’Église et une femme sous l'état de sujétion ne pourrait envisager, à cette<br />
époque, de pratiquer une activité sportive.
* XVème et début XVIIème siècle : L'activité sportive féminine se<br />
concrétise pas à pas et devient certaine. Elle se caractérise par deux courants<br />
distincts.<br />
• D'une part, on distingue les jeux de l'aristocratie dominés par quelques<br />
femmes tels que la chasse, l'équitation avec Catherine de Médicis dont la<br />
réputation est d'être une cavalière émérite et qui va améliorer la monte en<br />
amazone en modifiant la selle et en remplaçant la planchette où l'on<br />
posait les pieds par un étrier en métal , le mail (ancien jeu sportif français<br />
intermédiaire entre le crosse et le criquet et qui se joue sur un terrain<br />
spécialement aménagé à l'aide de maillet de bois, image à gauche ) avec<br />
en chef de file Louise Labbé.<br />
• D'un autre part, on peut distinguer les jeux populaires comme la paume<br />
( image à droite ) et les bains de rivière.<br />
b) De 1800 à nos jours :<br />
XIXème siècle → apparition de doctrine (ensemble de notions qu'on affirme<br />
être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits,<br />
orienter ou diriger l'action) portant sur l'éducation physique. Cette doctrine se<br />
retrouve un peu partout en Europe et est représentée par différentes personnes<br />
importantes ; par Amorosen en France, Pestalozzien en Suisse et Basedowen en<br />
Allemagne. Cependant elle reste fragmentaire et laisse peu de place à l'activité<br />
féminine. C'est en 1839, que Nachtegal ouvre l'une des premières école de<br />
gymnastique féminine et dans les mêmes temps que Jahn, fameux éducateur<br />
allemand et promoteur de la gymnastique, n'entend pas exclure de son<br />
enseignement les femmes ainsi que les jeunes filles. Cependant, une idée de<br />
«féminité» et de «séparation» doit être inclus dans cette éducation, il dit que les<br />
« séances doivent être séparées des hommes, et celles des femmes doivent avoir<br />
de la féminité ».
Malgré ces quelques tentatives d'intégration du sport féminin, le sport pour les<br />
femmes en 1900 reste un fait isolé. Aux yeux d'un grand nombre de personnes<br />
la femme est trop faible, fragile, frêle, ne peut pas s'adonner aux tâches<br />
difficiles et doit donc être protégée. Puis, en ce temps là, les mœurs ne<br />
toléraient pas que la femme s'exhibe en public et se risque donc à avoir des<br />
regards concupiscents (qui attisent le désir sexuel) masculins. Les catholiques<br />
ne sont pas les seuls à déconseiller, entraver, et aller jusqu'à interdire le sport<br />
dans leurs sociétés. Les socialistes ainsi que les communistes pensent et<br />
avancent des arguments de même nature.<br />
À partir des années 1870 → Le cyclisme connaît un grand renouveau<br />
grâce à l’augmentation du diamètre de la roue avant motrice qui va permettre<br />
notamment aux cyclistes de combattre les irrégularités de la route mais aussi<br />
d'atteindre des vitesses plus favorables. Pendant cette apogée, un débat sur la<br />
place qu'a la femme dans la société va être lancé et sera soutenu par la pratique<br />
cycliste féminine.<br />
Dans cette dernière décennie du XIXème, le cyclisme féminin va contribuer à la<br />
libération de la femme ainsi qu'a une instauration de droits jusque-là non<br />
reconnus. Cependant, le combat se fait long puisque la moral établissait des<br />
règles strictes sur le comportement et la tenue vestimentaire à avoir pour une<br />
femme en cette époque. L'émancipation commença donc par exemple par le<br />
vêtement cycliste dit «rationnel» (sorte de culotte de cheval ou de pantalon<br />
resserré à la cheville), ce qui faisait déjà l'éloge de nombreux sujets de<br />
journaux. En effet, une femme qui portait la culotte était inacceptable et<br />
beaucoup critiqué en cette époque. Et, même si la majorité des femmes<br />
portaient encore des robes, avec en dessous des culottes bouffantes, un<br />
changement vestimentaire était à constater; plus esthétique et plus libre. Ainsi,<br />
des changements physiques, notamment au niveau de la masse musculaire,<br />
étaient vu sur des femmes pratiquant le cyclisme. Ces transformations<br />
corporelles attisaient donc les agressions physiques ou encore les insultes de<br />
personnes qui pensaient que cela atteignait aux bonnes mœurs.<br />
En 1911→ l'écrivain Edmond Desbonnet va écrire<br />
Pour devenir belle.. et le rester, et deviendra l'un des<br />
pères fondateurs de la culture française physique.<br />
Dans cette ouvrage il va tenter de montrer qu'il existe<br />
bien un lien entre la beauté et la culture physique<br />
féminine, et donc qu'il ne peut pas y a avoir de beauté<br />
sans santé. Il conseille à celles qui en ont la possibilité<br />
de pratiquer la marche, le cheval, la bicyclette ou bien<br />
de faire des excursions sac au dos, ce qui permettrait
aux femmes pratiquantes de « raffermi[r] les chairs en tonifiant les muscles et<br />
empêche[r] la peau de se rider » autant dire que cette idée de « rester belle »<br />
attirait bon nombre de personnes.<br />
L'importance de la première guerre mondiale → L'émancipation du<br />
sport féminin va aller de pair<br />
avec les conquêtes du<br />
féminisme mais plus<br />
particulièrement avec la guerre<br />
1914-1918 qui donne à la<br />
femme un rôle important,<br />
puisqu'elle est amenée à quitter<br />
son foyer pour aller travailler.<br />
En France, des circulaires<br />
étaient diffusées pour mobiliser<br />
les filles, les sœurs, les<br />
épouses, les fiancées de ces<br />
soldats avec pour mot d'ordre<br />
« Ils donnent leur sang-Donnez<br />
votre travail » ou bien encore<br />
« Quand les hommes s'en vont<br />
en guerre, les femmes partent<br />
au travail ». Des bureaux<br />
d'embauches vont même aller<br />
jusqu'à ouvrir leurs portes en<br />
Province où dans la capital.<br />
Cette main d’œuvre féminine a<br />
pour surnom<br />
«les munitionnettes », elle constitue 15 % de la population active en France<br />
tandis qu'en Allemagne elle représente 35 % .<br />
La notion d'égalité entre les hommes et les femmes est en ce temps là mis en<br />
avant vue l'importance du rôle féminin. Cette idée d'égalité dans le travail va<br />
amener une revendication des droits que devrait avoir la femme. Par exemple<br />
dans la Russie Bolchevique un petit pas va être franchi avec Alexandra<br />
Kollontaï qui sera la première femme à faire partie d'un gouvernement, de<br />
même avec l'obtention du droit de vote qui sera accordé à un grand nombre<br />
d'Européennes. Dans la même année, le tout premier Championnat de France<br />
d'athlétisme féminin va être organisé par «Fémina-Sport », ainsi que l'un des<br />
premiers match de football féminin se déroulant en France et opposant deux<br />
équipes du Fémina Sport-DR d'une longue série le 30 septembre 1917.<br />
Quelques années plus tard, le 2 novembre 1921 se crée la Fédération sportive
féminine internationale à l'aide du symbole de la lutte pour l'accès des femmes<br />
aux grandes compétitions : Alice Milliat (1884-1957). Cette représentante de<br />
profession et sportive de haut niveau (aviron) joue un rôle primordiale dans<br />
cette lutte et se prononcera à ce sujet en disant que le «sport féminin a sa place<br />
dans la vie sociale au même titre que le sport masculin » et qu'elle « savait<br />
[aussi] que beaucoup croy[aient] encore que le sport enlev[ait] aux jeunes filles<br />
une partie de leurs possibilités intellectuelles». À côté de cela, la fédération<br />
connaît tout de même des problèmes puisqu'elle voit le jour malgré la réticence<br />
des fédérations sportives officielles et du Comité International Olympique<br />
(CIO), mais, elle réussit tout de même à publier les premiers règlements<br />
définissant les conditions spécifiques de la pratique sportive féminine.<br />
Malgré cela, les sportives ne sont pas amenées à participer à des compétitions<br />
de type internationales, elles créent donc le 20 avril 1922 les premiers jeux<br />
Mondiaux au stade Pershing.<br />
Cette volonté féminine de gagner sa place dans le sport reste parallèlement un<br />
autre combat pour acquérir les droits que possèdent les hommes. Dans cette<br />
ambiance de combat naît de grandes sportives qui ont marquer l'histoire. On<br />
pensera notamment à une femme socialement reconnue nommée Suzanne<br />
Lenglen dît aussi première «diva» du sport puisqu'elle est glorifiée, admirée<br />
d'être devenue sportive professionnelle et qu'elle attire par dessus tout les<br />
foules.<br />
Nous pouvons voir ici une photo (au dessus) d'un de ces matchs à Cannes (en<br />
une heure, 3000 places sont louées).
Elle suscite avec ces congénères<br />
Maryse Bastié (photo ci-contre), une<br />
aviatrice française détentrice du<br />
records de vitesse et de durée de vol<br />
qui fut la première femme pilote à<br />
traverser l'Atlantique Sud et qui en<br />
plus de cela était la capitaine de<br />
l'Armée de l'air, et Marie Marvingt<br />
(photo en dessous), pionnière de<br />
l'aviation , qui se consacre<br />
pleinement à son sport et qui va<br />
même jusqu'à en trouver une utilité<br />
puisqu’elle va organiser un service<br />
sanitaire aérien afin de ravitailler les<br />
hôpitaux ou même encore pour<br />
pouvoir secourir les blessés par voie<br />
aérienne, des modèles et des sources<br />
de vocations pour d'autres jeunes<br />
femmes dont l'espoir est de se frayer<br />
un chemin dans le domaine sportif.<br />
Ce combat, cette lutte pour l'intégration de la femme dite «sportive»<br />
est reflété dans les Jeux Olympiques. La femme peut tout de même<br />
être fière puisqu'elle faîte bientôt plus de 100 ans de participation à<br />
ces J-O.<br />
c) Les jeux olympiques<br />
Les jeux olympiques modernes ont , au contraire des<br />
jeux antiques, un programme olympique peu stable, on<br />
peut le voir rien que par l'organisation et les décisions<br />
qui sont prises. C'est dans un premier temps les<br />
entrepreneurs de spectacle qui organise les premier<br />
jeux mais au fil du temps c'est le Comité International Olympique, qui avait<br />
déjà auparavant le contrôle de la doctrine, qui devient le seul responsable des<br />
admissions sur l'entrée d'une discipline au programme olympique.<br />
En effet, un lot de nouveautés arrive avec chaque édition des J-O, on voit<br />
apparaître donc de nouvelles disciplines ainsi que de nouvelles catégories.<br />
Si les jeux antiques sont dédiés à une tranche de «personne», ici les Dieux<br />
grecs, les jeux olympiques, dont la première manifestation se fera à Athènes en
1886, vont progressivement ouvrir leurs portes aux femmes.<br />
Alors que Pierre de<br />
Coubertin,<br />
conservateur et<br />
colonialiste,<br />
n'adhère pas du<br />
tout à l'idée que les<br />
jeux olympiques<br />
puisse valoriser le<br />
corps d'une athlète<br />
noire ou d'une<br />
femme tout<br />
simplement, en<br />
allant même jusqu'à<br />
déclarer qu'« une<br />
Olympiade femelle<br />
serait inesthétique,<br />
inintéressante et<br />
incorrecte», une<br />
femme va venir<br />
s'opposer à lui : Alice Millat.<br />
Issue d'une famille de petits<br />
commerçants d'origine<br />
Nantaise, Alice Millat se lance<br />
très jeune, 20 ans environ, dans<br />
la profession d'institutrice. Elle<br />
exerce son métier en<br />
Angleterre au côté de son<br />
marie Joseph Millat et trouve<br />
dans ce pays une certaine maîtrise de l'organisation sportive qu'elle ne trouve<br />
pas en France. Elle va par la suite devenir notamment traductrice, comptable ou<br />
même encore représentante de commerce , et va ensuite va consacrer une partie<br />
de sa vie au sport, et va en pratiquer assidûment. Elle se passionne notamment<br />
pour la natation, un épisode de sa vie mentionne le sauvetage de deux fillettes<br />
en train de se noyer (1923), le football, le hockey, la bicyclette et des articles<br />
vont même jusqu'à lui consacrer quelques pages. Elle devient lors de la course<br />
nautique des Audax, organisée par le journal L'Auto, la première femme à<br />
parcourir en ramant 50 kilomètres en moins de douze heures.<br />
Son caractère d'acier et ses convictions revendiquées lui permette de devenir<br />
une des principales représentantes du combat féminin sportif, elle devient par<br />
ailleurs en 1915 la présidente de Fémina-Sport, puis on lui accordera peu de
temps après, vers 1917, la trésorerie de la Fédération des Sociétés Féminines<br />
Sportives de France ( FSFSF). Elle vu se dérouler les premiers championnats<br />
d'athlétisme féminin (1917), ainsi que le premier cross-country féminin (1918)<br />
et déjà des records enregistrés. D'autres sports comme le football ont tout de<br />
même plus de mal à s'intégrer avec les femmes, ce qui pousse Alice à défendre<br />
cette cause et dire que « quand les joueuses se choquent, elles prennent la peine<br />
de se faire des excuses », un propos véridique qui sera contesté par Pierre de<br />
Coubertin puisque pour lui « les footballeuses ou les boxeuses […] seront<br />
toujours d'imparfaites doublures ». Cependant, selon Alice les femmes ne<br />
trouvaient aucun plaisir à copier le sportif masculin et le départ de son opposant<br />
direct Pierre de Coubertin de la CIO, enleva un frein à l'intégrité de la femme<br />
dans le milieu Olympique.<br />
En 1900, une apparition superficielle des femmes se fait aux Jeux Olympiques<br />
modernes. En effet, 22 participantes féminines sont comptées sur un total de<br />
997 athlètes et sont autorisées à concourir dans cinq sports seulement : le tennis,<br />
le croquet, l'équitation, le golf et la voile. Bémol, seules les compétitions de<br />
tennis et de golf comportent des épreuves uniquement pour les femmes. Ces<br />
compétitions sont reconnues par le CIO, et sont organisées dans un cadre bien<br />
précis celui de l'Exposition universelle de Paris. Suite au vote fait, en juin 1910,<br />
par la CIO durant la session du Luxembourg en faveur de l'admission des<br />
femmes aux Jeux; deux ans plus tard aux Jeux de Stockholm que les jeux voit<br />
apparaître des athlètes féminines de manière plus prononcée. Le CIO autorise<br />
les femmes à participer aux épreuves de natation ainsi que de plongeon où elles<br />
avaient l'obligation de porter<br />
un maillot de bain en laine<br />
accompagné d'une jupe.<br />
Alors, même si cette timide<br />
entrée fait débat les femmes<br />
ne cessent pas le combat et<br />
luttent afin d'obtenir le droit<br />
d'organiser des rencontres<br />
sportives internationales.<br />
Dans l'année 1921, on<br />
assiste à une Olympiade féminine international à Monte Carlo, organisés par<br />
Alice Millat en personne, puis dans l'année qui suit c'est à Paris que se déroule<br />
les Jeux Olympiques féminins. Toutes ces compétitions ne sont que bénéfiques<br />
pour l'athlète féminin puisqu'elles rencontrent un vif succès, et même si<br />
réticence il y a 250 participantes issues de dix huit-pays différents sont<br />
comptées à Londres en 1934. Elles participent aux douze épreuves d'athlétisme<br />
ainsi qu'aux deux sports d'équipes , le hazena ( ancêtre du handball) et le<br />
basketball. Comme le préconisait Alice Millat, les compétitions organisées avec<br />
prudence, sureté et surveillance sont des compétitions où les femmes ont
dignement leur place.<br />
Quelques années plus tard, lors des Jeux olympiques de 1936, la femme ne<br />
trouvait pas sa place puisque, placés sous le signe de la virilité, les Jeux<br />
olympiques féminins sont annulés et sont remplacés par neuf épreuves<br />
féminines à Berlin. Si progression constante il y a, 8% est le chiffre donnée<br />
reflétant la part des femmes sur le nombre total des athlètes à Berlin.<br />
Cependant, le nombre de pays acteurs des Jeux va augmenter en même temps<br />
que le nombre global de participants. La décolonisation, dans les années 1970,<br />
qui amène de nombreux acteurs, est d'une influence moindre sur la participation<br />
des femmes aux Jeux et sur leur présence. Le boycott des pays africains<br />
effectué en 1976 à Montréal montre une augmentation du nombre d'athlète<br />
femme(augmentation de 20 %) et ainsi nous laisse penser que la majorité de ces<br />
femmes proviennent d'Europe ou d'Amérique. Une autre interprétation va être<br />
fourni par les Jeux qui déroule à Moscou, puisque boycot fait sur les pays<br />
occidentaux et surtout sur les Etats-Unis, les 20% sont toujours atteints et donc<br />
montre que les pays du bloc communiste, qui étaient présents à ces Jeux,<br />
contiennent des délégations féminines (RDA, URSS, Roumanie surtout) assez<br />
égalitaires et reflètent donc des sociétés ouvertes et paritaires. Le pourcentage<br />
s'accroient puisque que les 25 % sont atteints à Los Angeles, puis à ceux de<br />
Barcelone c'est 30%, quant à L’Atlanta c'est 35 % avec des épreuves féminines<br />
qui représentent pratiquement plus d'un tiers des épreuves totales qui à Atlanta,<br />
à Sydney c'est 40 % et la barre des 42 % est franchi à Pékin.<br />
Ainsi, une évolution reste tout de même à constater puisque la participation<br />
féminine aux J-O a fortement augmenté. En effet, lors des Jeux Olympiques de<br />
2012 qui se déroulaient à Londres, les femmes atteignent un pourcentage<br />
significatif d'une constante progression participative puisqu'elles représentaient<br />
44% des participants à ces Jeux contre 25% aux Jeux de Los Angeles en 1984,<br />
rappelons-le et à peine 13 % à ceux de Tokyo en 1964. De plus, avec l'ajout de<br />
la boxe féminine au programme Olympique aux Jeux de Londres (2012), ceuxci<br />
devinrent les premiers où les femmes étaient présentes dans chaque discipline<br />
du programme proposé. Et, depuis 1991, si un sport souhaite intégré le<br />
programme olympique il doit obligatoirement comporter des épreuves<br />
féminines.<br />
À côté de cela, le CIO travail afin de pouvoir, avec la coopération des<br />
Fédération Internationales (FI) et les comités d'organisation des J-O, augmenter<br />
le nombre d'épreuves féminines aux Jeux Olympiques et cela depuis bientôt<br />
vingt ans ! De même que la place des femmes au CIO se voit augmenter<br />
crescendo. C'est en 1981, que pour la première fois le CIO compte parmi ses<br />
membres des femmes, enfin plutôt deux femmes il ne<br />
faut pas aller trop vite tout de même! Il s'agit de la Norvégienne<br />
Pirjo Haeggman ainsi que de la Vénézuélienne Flor Isava-Fonseca, qui sera<br />
d'ailleurs élu, en 1990, membre de la commission exécutive, suivi par Anita
L.DeFrantz qui devient quant à elle vice-présidente de 1997 à 2001 et qui<br />
laissera sa place en 2004 à Gunilla Lindberg. Puis, en 2013 quatre femmes sont<br />
nommées membres de la commission exécutive du CIO ( Nawel El<br />
Moutawakel, Claudia Bokel, Anita L.DeFrantz et Gunilla Lindberg). L'année<br />
suivante, les femmes représentant 22,6 % des membres actifs du CIO. En effet,<br />
24 femmes sont rescencées sur un total de 106 membres. Enfin, les femmes se<br />
tiennent à la tête des commissions du CIO notamment pour celles d'évaluations<br />
des Jeux Olympiques de Rio de 2016 par exemple ou ceux de la Jeunesse<br />
d’hiver à Lillehammer 2016, et même encore des Jeux de la Jeunesse d’hiver à<br />
Lausanne 2020, de l’élection des membres ainsi que la commission femme dans<br />
le sport et la commission des athlètes.<br />
II. Les obstacles au développement du sport féminin :<br />
a) Les contraintes liées à la vie privé des femmes<br />
Les femmes sont de plus en plus nombreuses au fil du temps à pratiquer un<br />
sport mais il reste encore une majorité qui abandonne ou ne pratique pas une<br />
activité physique. Ces inégalités de pratique sportive commence dès le plus<br />
jeune âge. D'une manière générale se sont les jeunes qui sont les plus investies<br />
dans des activités sportives ainsi c'est dans ces catégories d'âge que les écarts<br />
entre les sexes sont le plus important. En France, les jeunes filles âgées de 12 à<br />
17 ans sont 14% a déclaré ne jamais avoir fait de sport en dehors des cours<br />
obligatoires à l’école contre 8% de garçons et 26% de filles ont abandonné une<br />
activité physique contre seulement 15% pour les garçons. Les jeunes filles vont<br />
délaisser les activités physiques pour se consacrer pleinement à leurs études<br />
ainsi les garçons pratiquent donc plus fréquemment un sport que les filles. Ces<br />
obstacles à la pratique d'un sport se poursuit à l'âge adulte. En effet, selon le<br />
sondage Eurobaromètre en 2010 environ 43% des hommes déclarent faire un<br />
sport en loisir au moins une fois par semaine mais les chiffres sont plus bas<br />
pour les femmes avec 37%. La première raison avancée par les femmes pour<br />
expliquer ce comportement est le manque de temps pour pratiquer une activité<br />
physique régulière mais c'est un problème qui en cache un autre puisque les<br />
femmes ne s'autorisent pas à prendre du temps pour elles-mêmes. L’intérêt ou le<br />
désintérêt pour une activité physique conditionne en effet le temps accordé à la<br />
pratique sportive. Ainsi, la plupart des femmes qui ne pratiquent pas de sport<br />
n'éprouvent ni l'envie ni le besoin de s'abandonner à une activité physique. En<br />
France 40% des femmes non-pratiquantes déclarent avoir d'autres centres<br />
d’intérêt et 36% disent ne pas aimer le sport. Les femmes qui ne pratiquent pas<br />
d'activités sportives sont généralement très investies dans la sphère familiales<br />
puisqu'elles doivent assurer leurs obligations familiales comme l'entretien de la<br />
maison, s'occuper des enfants ou encore cuisiner ainsi ce sont les activités
privilégiées par les femmes durant leurs temps libre. Et pour celles qui<br />
pratiquent un sport en loisir ou à haut niveau elles ont souvent du mal à<br />
concilier vie familiale, travail et sport. Ces responsabilités familiales sont un<br />
frein majeur surtout pour les femmes issues des catégories populaires.<br />
b) Les stéréotypes<br />
Le sport est certainement<br />
l'un des milieux où les<br />
stéréotypes sont les plus<br />
ancrés. C'est à cause des<br />
stéréotypes que certains<br />
préjugés existent. Le terme de<br />
préjugé désigne des opinions<br />
adoptées en l'absence<br />
d'informations. Parfois<br />
articulés sur des mythes ou<br />
résultant d'une généralisation<br />
hâtive, une idée admise sans démonstration. Le premier vecteur des stéréotypes<br />
dans le monde du sport est le choix des pratiques sportives dès le plus jeune âge<br />
car le sport permet de mettre en place toutes les normes corporelles qui sont<br />
propres aux femmes et aux hommes. De ce fait les filles ne vont pas pratiquer<br />
les mêmes sports que les garçons. Les parents vont orienter et pousser leurs<br />
enfants à pratiquer un sport en fonction du sexes donc dès le plus jeunes âges il<br />
va y avoir une nette séparation entre les deux sexes dans la pratique d'un sport.<br />
En effet, bien rare sont les parents qui présentent sur un pied d'égalité le judo et<br />
la danse à leurs garçons, ou encore le football et la gymnastique à leur filles.<br />
Dans les normes de la société les hommes doivent représenter la puissance, la<br />
force et la résistance à l'effort ainsi ils vont se diriger vers des sports de contact<br />
comme le rugby ou encore le football. On attribue la compétition sportive et<br />
l'exploit sportif surtout aux hommes. Selon la société la pratique d'un sport dit<br />
féminin par un homme est vu comme étrange et même voir une transgression de<br />
la virilité. Les femmes quand à elles doivent être douces, souples et élégantes<br />
par conséquence elles sont plus de trois quarts des licenciées dans les<br />
fédérations de gymnastique, danse et d'équitation alors qu'elles n'occupent que<br />
3% dans les fédérations de football. Les femmes qui pratiquent des sports où les<br />
hommes sont ultra-majoritaires doivent supporter bien des moqueries<br />
concernant leurs capacités physiques et leurs rôles social ainsi elles subissent<br />
des propos sexistes de la part de leurs homologues masculins. Pour ne rien<br />
arranger, il se trouve qu'à la télévision ce sont majoritairement les activités<br />
sportives masculines qui sont mises en avant. Dès lors le sport féminin est
moins diffusé par les médias et il est très souvent présenté de manière différente<br />
et reflète et renforce les stéréotypes sexuels.<br />
Ces stéréotypes se retrouvent aussi dans l'univers du cinéma. En effet, nous<br />
nous sommes penchées sur un film qui évoque les difficultés que peut<br />
rencontrer une athlète lorsqu'elle se lance dans le milieu sportif de haut niveau.<br />
Nous allons à présent passer à l'étude du film que nous avons étudié.<br />
Étude cinématographique : Million Dollar Baby<br />
I. Caractéristiques du film :<br />
● Genre : Drame<br />
→ Le Drame est un genre cinématographique traitant, souvent, de sujet<br />
sérieux tel que la mort, la maladie, la solitude ou même encore la perte de<br />
l'innocence, il est donc plus susceptible d'apporter un sentiment de<br />
tristesse que de rire. Il peut s'inspirer d’histoire avérée, et grave, ou de<br />
l'actualité.<br />
● Date de sortie : Le 23 mars 2005<br />
● Réalisateur : Clint Eastwood<br />
● Acteurs principaux : Morgan Freeman dans le rôle de Eddie Scrap-Iron,<br />
Dupris Hilary Swank dans le rôle de Maggie Fitzgerald, et enfin Clint<br />
Eastwood dans le rôle de Franckie Dunn.<br />
Narrateur : Morgan Freeman (Eddie Scrap)<br />
II. Résumé de l'histoire :<br />
Dans les années 1960, un certain Franckie Dunn est connu pour être le meilleur<br />
soigneur de la ligue de boxe. Pendant cette apogée, il va devenir entraîneur et<br />
gérant de ce sport et va avoir de grands athlètes entre les mains. Cette gloire et<br />
cette reconnaissance et parallèlement à sa vie une vraie réussite. En effet, il est<br />
rejeté depuis longtemps par sa fille ce qui le fait se renfermer sur lui-même et<br />
l'amène à avoir un caractère très dur.<br />
Alors qu'il gère une vedette de la boxe masculine (Willy), une jeune femme de<br />
31 ans nommée Maggie Fitzgerald, pleine d'espoir et d'entrain, va lui demander
de devenir son entraîneur. Pour parvenir à l'acceptation de cette requête elle va<br />
user de détermination et d'un moral d'acier. Elle connaîtra la gloire et trouvera<br />
en Franckie ( et Scrap) une famille qu'elle n'a jamais vraiment eu.<br />
III. Étude de scènes types :<br />
→ Après avoir regardé le match victorieux qu'a disputé le poulain de Franckie,<br />
Maggie tente sa chance et propose à cette entraîneur fard de devenir celui qui la<br />
mènera à la victoire.<br />
→ Malheureusement, la réponse fut négative. Franckie Dunn<br />
« n'entraîne pas les filles ».<br />
→ Malgré le refus de l'entraîneur qu'elle idolâtre, Maggie s'obstine et décide
de s'inscrire dans la salle de boxe qu'il détient et dont il s'occupe depuis un bon<br />
nombres d'années avec Scrap. Issue d'un milieu où tout n'est pas si rose, et où<br />
les problèmes s'accumulent, elle trouve en la boxe une sorte de réconfort.<br />
→ Scrap, ancien boxeur entraîné par Dunn, qui vit dans la salle de boxe<br />
remarque qu'elle s'entraîne le jour ainsi que la nuit. Il va être le premier à croire<br />
en la jeune femme et va même lui donner quelques conseils pour pouvoir<br />
s'améliorer.<br />
→ Grâce aux conseils de Scrap, Maggie devient peu à peu performante, ce qui<br />
n'est pas aux goûts de tout le monde. En effet, Franckie le remarque et n'hésite<br />
pas à lui énoncer tous ses défauts. De plus, il lui fait signaler qu'à « chaque fois<br />
qu'[elle] touche à [sa] poire [il] perd des clients » mais aussi que « les gens<br />
pourraient croire que [c'est] [s]on entraîneur] ».<br />
→ A force d'acharnement et d'entraînement, elle réussit à convaincre<br />
l'entraîneur tant convoité. Le jour de son anniversaire, alors qu'elle s'entraînait
jusqu'à tard le soir, Franckie va finir par accepter de devenir son entraineur,<br />
enfin... sous quelques conditions. Si « [il] devien[t] son entraineur [elle] ne doit<br />
rien [dire] à personne,ne jamais [le] questionner, ne pas demander pourquoi, ne<br />
rien dire à part peut être «oui franckie» ». Il va aussi « essayer d'oublier que<br />
[c'est] une fille ».<br />
c) La sous médiatisation du sport féminin<br />
Le sport est lié aux médias car il joue un rôle important dans la<br />
reconnaissance et le développement d'un sport. Pour qu'un sport soit reconnu, il<br />
faut utiliser tout les moyens de communication disponibles comme la<br />
télévision, les journaux ou encore la radio. Les femmes sont très peu présentes<br />
voir quasiment absentes d'informations sportives dans les médias et quand elles<br />
y sont présentes, c'est de manière stéréotypée. Une conséquence à la faible<br />
présence des sportives de haut niveau dans les média est que les jeunes filles ne<br />
disposent pas de modèles auxquels elles pourraient s'identifier; modèles qui<br />
pourraient les inciter à pratiquer une activité sportive. Contrairement aux jeunes<br />
garçons qui disposent de nombreux héros sportifs. Il existe relativement peu<br />
d’icônes féminines dans le sport d'élite. Pour les chaînes et les journaux il n'y a<br />
aucun intérêt à diffuser des match ou des informations sur le sport féminin<br />
puisque ce n'est suivi que par une minorité de personnes. Ainsi peu de<br />
téléspectateurs signifient une faible audience par conséquence de faibles entrées<br />
d'argent. L'apparition des sportives dans les journaux n'est que de 10% car dans<br />
la profession journalistique on compte environ 90 femmes sur 1800 journalistes<br />
affiliés à l'Union des Journalistes Sportifs Français, soit 5%. Il y a une très forte<br />
disparité entre les hommes et les femmes au niveau de la médiatisation. Le<br />
sport masculin occupe en grande partie du paysage télévisuelle comme le<br />
démontre ces statistiques:<br />
Présence du sport féminin à la télévision<br />
100,00%<br />
80,00%<br />
60,00%<br />
40,00%<br />
20,00%<br />
0,00%<br />
1 2<br />
2012 2013<br />
Rouge part des femmes à la télévision<br />
Bleu part des hommes à la télévision
Pour se frayer un chemin dans les pages de magazines ou sur la télévision, il<br />
faut impérativement que les sportives se fassent remarquer en remportant des<br />
victoires pour accéder à des contrats avec des sponsors et obtenir des fonds.<br />
Dans le paysage télévisuel, l'un des objectifs du sport français est que le sport<br />
féminin ait une plus grande visibilité en effet seulement 7% de sport féminin sur<br />
l'ensemble des retranscriptions sportives à la télévision.<br />
Pourtant de nombreux exemples prouvent que le sport féminin a un certain<br />
succès auprès des téléspectateurs comme un match de football de l'équipe de<br />
France féminine qui a eut plus de 1,7 million de personnes qui ont vibré lors de<br />
la finale de la ligue des champions de football en 2013 ou encore la finale de<br />
l'eurobasket qui a été perdu mais 3,3 million de téléspectateurs ont assistés au<br />
match.<br />
Selon l'ESSEC, environ 24% des français de plus de 18 ans trouvent que le<br />
sport féminin est tout aussi intéressant que le sport masculin et toujours d’après<br />
l'étude 64% en regarderaient davantage s'il était plus régulièrement diffusé à la<br />
télévision.<br />
d) Les inégalités salariales dans l'univers du sport<br />
Dans le sport, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes sont très<br />
révélateurs des inégalités. Les sommes d'argent qui circulent varie aussi<br />
beaucoup selon le sport. Dans la formule1, le football ou le tennis font partie<br />
des sports où l’argent est roi et permet d’avoir les meilleures écuries ou les<br />
meilleures équipes. Les rémunération des sportives de haut niveau se situent<br />
très en dessous de celles que peuvent espérer leurs homologues masculins a par<br />
de très rares exceptions. Pour rester sur le cas du football, c’est sans doute là où<br />
les écarts de salaire et de primes sont les plus flagrantes. Au niveau des salaires,<br />
les joueuses de football les mieux rémunérées en France qui font généralement<br />
parties de l'Olympique lyonnais perçoivent au maximum 10 000 € par mois<br />
mais pour la plupart elles touchent en moyenne 1 000 à 1 500 € pour celles qui<br />
sont considérée comme sportive de haut niveau. Au niveau des primes, le<br />
constat est le même puisque pour la dernière Coupe d’Europe où l’équipe<br />
masculine a atteint les quarts de finale, chaque joueur a toucher 100 000 €. En
evanche, les joueuses française de football qui ont atteint les demie finales de<br />
la Coupe du Monde en 2011,n'ont perçu que 3 500 € par joueuses. Ainsi, il y a<br />
des écarts important entre les salaires perçut par les hommes et ceux par les<br />
femmes. Les hommes ont beaucoup plus souvent le statut de joueurs<br />
professionnels que les femmes et dès que celle-ci accèdent à ce statut les<br />
inégalités de salaire persistent. L'une des contraintes qui fait que la femme est<br />
moins considérer comme sportive professionnel est le manque de temps car les<br />
femmes doivent très souvent cumuler le sport à un autre emploie puisque elles<br />
ne peuvent survenir a leurs besoins si elles font le choix de se consacrer<br />
pleinement a leur sport. Mais selon la joueuse de rugby Manon-André ayant<br />
gagné deux coupes du monde, qui déclare que les contrats semi-professionnel<br />
vont dans le bon sens: «au moins pour pouvoir avoir davantage de temps de<br />
récupération. C'est compliqué, de rentrer de compétition à 4 heures du matin et<br />
d'enchainer le boulot à 8 heures» et «être en semi-pro, ca nous permettrait aussi<br />
de prendre du recul sur notre sport, de garder une certaine aventure. Et puis en<br />
fin de carrière, la reconversion est moins difficile». Les athlètes femmes sont<br />
souvent moins gratifiés alors que les performances entre les hommes et les<br />
femmes sont égales. Ces inégalités peuvent s'expliquer par une plus faible<br />
médiatisation du sport féminin qui brasse beaucoup moins d'argent que le sport<br />
masculin. Les écarts sont très flagrant lorsque l'on compare le salaire de Tiger<br />
Woods qui a perçu en 2006 plus de 74,3 million de dollars alors que la joueuse<br />
de tennis Maria Sharapova a gagnée 19,3 millions de dollars. Dès lors que la<br />
capacité d'une athlète à égaler les revenus des ses homologues masculins,<br />
tiendra plus à sa capacité à vendre son image auprès des marques, qu'à<br />
l'amélioration de ses performances sportives. Quelques solutions permettent de<br />
réduire ces inégalités salariales entre les sexes, comme par exemples aux Jeux<br />
Olympiques où des primes sont versées à l'occasion des victoires des sportifs<br />
quel que soit leur genre: 50 000 euros pour une médaille d'or, 20 000 euros pour<br />
une médaille d'argent et 13 000 euros pour une médaille de bronze. L'état verse<br />
une aide financière aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau,<br />
sur la décision des directeurs techniques nationaux, des présidents de<br />
fédérations et du comité national olympique et sportif français. Ces aides<br />
permettent d'accompagner les sportifs de haut niveau dans leur parcours vers<br />
l'excellence sportive tout en préparant leur carrière professionnelle. Le<br />
ministère développe une politique de suivi social afin que les sportifs de haut<br />
niveau puissent réaliser les performances à la hauteur de leur potentiel, tout en<br />
leur garantissant la poursuite d'une formation et d'une insertion professionnelle<br />
correspondant à leurs capacités et leurs aspirations. Selon les chiffres<br />
communiqués par le ministère des sports, les femmes sont moins nombreuses à<br />
en bénéficier avec 38,14% en 2008 et 36,04% en 2009. Et lorsque l'on compare<br />
le montent moyen de l'aide attribuée respectivement aux sportives et aux<br />
sportifs, il y a des inégalités car les femmes ont perçu 293,28 euros de moins
que les hommes en 2008 et les différences se creusent en 2009 pour atteindre<br />
460,96 euros entre les hommes et les femmes.<br />
III . Les premiers pas vers une parité Homme/Femme dans<br />
le sport :<br />
Si l'émancipation de la femme dans le milieu sportif a connu beaucoup<br />
d'obstacles s'étalant sur des années voir des siècles il n'en est pas moins que<br />
grâce aux combats ( sportif et autres) menés fièrement par les femmes tout au<br />
long de l'histoire; qu'ils soit d'ordres politiques, salariales, ou quotidiens, des<br />
moyens ont pu être mis en place afin de palier au maximum cette inégalité.<br />
a) Biographie de quelques sportives qui ont réussis dans le<br />
monde du sport<br />
Florence Arthaud est née le 28<br />
octobre 1957 à Boulogne-Billancourt,<br />
la passion pour la<br />
navigation va se faire très jeune<br />
au coté de son père où elle<br />
apprend le métier de skipper. A<br />
17 ans, Florence Arthaud va faire<br />
le choix d'une vie de marin et elle<br />
va participer à une traversée de<br />
l'Atlantique avec Jean-Claude<br />
Parisis. Cette expérience conforte le choix de vie de la navigatrice. En 1978,<br />
elle connaît alors un parcours fulgurant grâce notamment à sa première Route<br />
du Rhum où elle finira à la onzième position et gagne le surnom de petite<br />
fiancée de l'Atlantique. L'année 1990 marque le sommet de sa carrière, la<br />
navigatrice pulvérise de près de deux jours le record de la traversée de<br />
l'Atlantique à bord de son trimaran qui est le Pierre premier et remporte la<br />
course en solidaire de la Route du Rhum. Dès lors, la navigatrice va enchaîner<br />
les compétitions prestigieuses aux cotés de grands navigateurs comme Jean Le<br />
Cam ou encore Philippe Poupon. La sportive de haut niveau sera la seule a être<br />
récompensée à deux reprises grâce au prix Monique Berlioux de l'Académie des<br />
sport pour les performances de la navigatrice. En 2003, Florence Arthaud va se<br />
consacrer à de nombreux projets qui lui tient à cœur comme de l'humanitaire<br />
mais sans s'éloigner du milieu maritime. Elle propose à des jeunes en difficulté<br />
d'apprendre à naviguer. La navigatrice va publier en 2009 sa propre<br />
autobiographie «Un vent de liberté». Puis, Florence Arthaud voudra revenir sur
le devant de la scène en participant à l’émission Dropped mais<br />
malheureusement elle perdra la vie dans un accident d'hélicoptère le 9 mars<br />
2015.<br />
Louisa Nécib est est née le 23 janvier 1987 à Marseille. Déjà toute petite<br />
Louisa Nécib portait un intérêt tout particulier au football. Ainsi, il était<br />
fréquent de la voir taper dans un ballon avec des garçons de son quartier. Elle<br />
ne sait pas alors que le football féminin existe et c'est à l'age de 14 ans que<br />
Louisa va s'inscrire en club. La jeune femme possède un certain dons pour le<br />
football, c'est donc après une année passé au Celtec à Marseille en 2003,qu'elle<br />
rejoindra le centre de formation et d’entraînement de Clairefontaine. Durant<br />
cette période,la footballeuse va connaître<br />
les joies de la première division de la<br />
Ligue française de football féminin car<br />
elle sera sélectionné plus de 38 fois avec<br />
9 buts à son actif. La joueuse est une<br />
véritable virtuose du ballon rond car elle a<br />
une technique impressionnante. En 2006,<br />
Louisa Nécib va quittée le centre<br />
d’entraînement en direction du club<br />
Montpelliérain. L'aventure durera une<br />
saison durant laquelle elle inscrit 11 buts<br />
en 21 sélections et remportera avec son<br />
équipe le Challenge de France. C'est avec<br />
l'Olympique lyonnais que la jeune femme<br />
va remporté de nombreux titres tels que la<br />
coupe de France (2012-2013),six titres de championne de France et elle<br />
connaître la consécration avec la Ligue des champions en 2011 et 2012. Avec ce<br />
palmarès prestigieux, on la surnomma la «Zidane de l'Olympique lyonnais».<br />
Elle va passer un cap dans sa carrière en intégrant l'équipe nationale senior avec<br />
laquelle la jeune footballeuse va participé à diverses compétitions comme l'Euro<br />
féminin de football en 2009, la coupe du monde en 2011 et elle représentera les<br />
Bleues lors des jeux olympiques à Londres en 2012.<br />
b) L'accès au sport<br />
➔ Le sport est-il accessible à tout le monde et dans toutes<br />
les disciplines?<br />
Le sport fait partie des choix que l'enfant fait dès son plus jeune âge, ce choix<br />
le conditionnera et deviendra une instance de socialisation durant une partie ou<br />
toute sa vie. Parfois, ce choix se fait suivant la classe social à laquelle appartient<br />
l'enfant. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs le football est le sport le
plus pratiqué au monde, les enfants peuvent jouer au football avec n'importe<br />
quoi, ils n'ont pas besoin de grands moyens; une balle, un ballon, un cailloux,<br />
une boulette de papier et c'est partis pour un match endiablé ! Vous ne verrez<br />
pas un enfant des favelas pratiquer de l'équitation par exemple, car ce sport<br />
suscite un engament financier lourd ou bien au dessus des moyens d'un petit<br />
défavorisé ou appartenant à la classe populaire. Ainsi, les jeunes qui vivent dans<br />
des situations dîtes « précaire » ou dont les parents n'ont pas suivis d'études ont<br />
tendances à ne pas pratiquer d'activité physique, c'est le cas aussi avec des<br />
jeunes filles ou femmes provenant des minorités ou de l'immigration. Le choix<br />
peut-être aussi guidé par les parents, quoi que en nos temps beaucoup moins.<br />
Cependant le choix de pratiquer un sport est beaucoup plus démonstratif chez<br />
les garçons que chez les filles, on le remarque surtout à l'adolescence. Une<br />
étude a déterminé qu'en France en 2002, la taux de garçons pratiquant un sport<br />
ou une activité sportive en dehors du cadre scolaire était de 77% alors que pour<br />
les filles de 12 à 17 ans , le taux était de 60 %. Si les filles n'ont pas à rougir de<br />
ces 60%; l'écart a cependant augmenté en cinq ans seulement, de 14 points, et<br />
encore plus dans les milieux défavorisés, 30 points.<br />
Cet écart ne s'arrête pas à l'adolescence puisque dans des pays comme la<br />
Bulgarie, la Grèce, le Portugal, l'Italie c'est près de 60% des femmes (20 ans et<br />
plus) qui annoncent n'avoir aucune activité sportive, ce qui dépassent donc<br />
largement l'inactivité des hommes dans ces pays. Cette inactivité est aussi<br />
représentait chez les femmes suivant la classe social. Effectivement, les chiffres<br />
sont révélateurs puisque dans les années 2000, l'absence totale de pratique<br />
sportive par les femmes concernait environ 44% des agricultrices, 27% des<br />
ouvrières et seulement 4% pour les femmes qui ont des postes à responsabilité<br />
comme des cadres ou membres des professions intellectuelles supérieures en<br />
France.<br />
Cependant, on trouve des exceptions dans des pays comme le Danemark, la<br />
Suède, ou la Finlande où ce sont les femmes qui devancent les hommes<br />
puisqu'elles sont plus nombreuses à pratiquer un sport. Les pays nordiques aussi<br />
ont semble-t-il une longueur d'avance par rapport aux autres pays sur la<br />
question du sport, mais aussi sur l'inégalité homme/femme dans sa généralité, et<br />
cela depuis plus de 50 ans grâce au mouvement féministe. Des mesures<br />
politiques familiales sont mises en place pour aider et donner envie aux femmes<br />
de reprendre leur travail. Ce qui, dans une outre mesure, conforte la femme<br />
sportive en cas d'échec de carrière à se tourner vers une reconversion dont<br />
l'emploi sera assuré. Selon, Drude Dahlerup, de l'Université de Stocholm, la<br />
culture scandinave a pratiquement, aujourd’hui, résolu la question de l'inégalité<br />
des sexes.
Quelques sports qui s'ouvrent aux femmes<br />
Les femmes vont peu à peu vers des sports qui étaient occuper principalement<br />
par des hommes. Il y a un mouvement d'émancipation des femmes car elles ont<br />
étaient exclues jusqu'en 1942 des fédérations sportives dit «masculines». Ainsi<br />
nous allons voir quelques sport qui évolue avec le temps et qui s'ouvre de plus<br />
en plus aux femmes:<br />
-Le football féminin a était officiellement reconnu depuis 1971. L'équipe de<br />
France féminine a la possibilité de participer à la Coupe du Monde qui se<br />
déroule tous les 4 ans tout comme leur homologue masculin. En revanche, le<br />
nombre de représentants féminins est très faible par rapport aux garçons<br />
beaucoup plus nombreux dans ce sport. En effet, la fédération française de<br />
football compte moins de 3% de femmes qui pratiquent à haut niveau. Bien<br />
qu'elles soient peu nombreuses, les footballeuses sont très performantes<br />
puisqu'elles figurent dans les dix premières du classement mondial féminin de<br />
la FIFA. L'équipe de France féminine a finit quatrième de la Coupe du Monde<br />
en 2011.<br />
-Le rugby fait ici office de sport à part car aucune joueuse de haut niveau n'a le<br />
statut de professionnelle. Malgré cela la fédération française de rugby voit sont<br />
nombre de licenciées augmenter d'années en années. Un tournoi des six nations<br />
et une coupe du monde est organisé pour les équipes féminines de rugby.<br />
-La boxe féminine est très peu connut par le grand public mais elle existe bel et<br />
bien. La boxe est assez impopulaire auprès de la gente féminine qui y voit un<br />
sport avec beaucoup de violence et qui est fait pour les hommes. Grâce au film<br />
Million Dollar Baby et à l'ajout de la boxe féminine aux Jeux Olympiques à<br />
Londres en 2012 qui a permit de révélée ce sport au grand jour. Ainsi la<br />
boxeuse britannique Nicola Adams a était la première femme a remporté la<br />
médaille d'or de boxe féminine aux JO.<br />
-Le handball féminin a joué son premier match international en 1946. Tout<br />
comme l'équipe de France masculine, les femmes ont aussi droit à leurs<br />
compétitions avec les championnats du monde, les Jeux Olympiques ou encore<br />
les Jeux Méditerranéens.<br />
-Le cyclisme féminin s'ouvre très lentement aux jeunes femmes malgré des<br />
performances comme la sportive Jeannie Longo. Il y a un championnat de<br />
France et la Grande Boucle qui sont des courses réservés aux femmes. Mais<br />
souvent ces compétitions féminine sont très peu médiatisé et peu suivis par les<br />
téléspectateurs qui préfèrent le Tour de France. Par conséquents de nombreuses<br />
courses sont annulé faute de moyen économique.
→ Une solution → L'école pourrait, par exemple, offrir un plus grand choix de<br />
sport ce qui permettrait aux filles comme aux garçons de s'adonner à un sport<br />
qu'ils aiment et ainsi de pouvoir s'épanouir pleinement. Encore faut-il que les<br />
mentalités changent et que ces paroles : « le football c'est pour les garçons, la<br />
danse c'est pour les filles » ne deviennent qu'un mauvais souvenir.<br />
c) La médiatisation<br />
➔ Où en est-on avec la médiatisation ?<br />
Si la médiatisation est l'un des principaux freins à l'épanouissement du sport<br />
féminin il n'en est pas moins que des améliorations donnent un espoir quant à<br />
un avenir plus centré sur la médiatisation féminine.<br />
Selon les derniers chiffres du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ( CSA), qui<br />
gère notamment les fréquences destinés à la radio et à la télévision et qui les<br />
attribue, la médiatisation du sport féminin, serait passé de 7% à 15% de la<br />
totalité des diffusions entre septembre 2012 et septembre 2014, un pourcentage<br />
faible mais reflétant une évolution. Mais, ce n'est pas tout puisque l'on remarque<br />
une certaine implication des pouvoirs publics et instances sportives à toutes les<br />
échelles.<br />
À l'échelle national, un budget d'un million d'euros est attribué<br />
aux fédérations par le ministère des sports afin d'assurer la<br />
médiatisation du sport féminin ainsi que du handisport.<br />
À l'échelle européenne, c'est une lutte contre les disparités<br />
médiatique et d'accès aux postes à responsabilités qui est<br />
instaurée par les propositions stratégiques de la Commission européenne,<br />
publiées pour la période 2014-2020, qui vise à établir une égalité du sport.<br />
À l'échelle international, le Comité International Olympique<br />
(CIO) a pour objectif, comme nous le montre la 11ème<br />
recommandation de son agenda olympique 2020 approuvé<br />
fin 2014 à Monaco, d'atteindre une égalité parfaite entre les<br />
athlètes hommes et femmes d'ici les J-O de 2020 qui se<br />
dérouleront à Tokyo au Japon.<br />
Pour se faire diffuser et entendre parler d'elles les<br />
sportives professionnelles doivent impérativement, ou<br />
presque, gagner, posséder une victoire d'un grand événement<br />
comme une finale, une coupe du monde, un championnat. La monté en<br />
puissance des succès à de grands événements sportifs féminin des dernières<br />
années suscite un certain engouement. Par exemple, la coupe du monde<br />
féminine de rugby, se déroulant en France en 2014, n'a pas déçu et bien au<br />
contraire puisque c'est près de 2,2 millions de téléspectateurs qui ont regardé la<br />
retransmission de la demi-finale contre le Canada. On ne s'arrête pas là
puisqu'en 2015 plusieurs matchs du top 8 ont été diffusé, deux d'entre eux ayant<br />
déjà eu leurs heures dans les 24h du sport féminin.<br />
Parallèlement, un pays comme l'Allemagne devance largement un pays comme<br />
la France au niveau de l'égalité médiatique qui peut subsister. Il considère la<br />
médiatisation à son juste titre et pense aux points positifs que celle-ci peut<br />
engendrer. En effet, si la médiatisation a un réel impact, des retransmissions de<br />
matchs ou d'événements féminins pourraient donner envie aux femmes de<br />
pratiquer elles aussi un sport ou même encore de parvenir à un poste de<br />
responsabilité que ce soit administratif ou de gérance ( entraîneurs, arbitres<br />
etc... ).<br />
Une illustration parfaite du choix de médiatisation du sport féminin c'est bien la<br />
chaîne Eurosport qui n'hésite pas à diffuser du sport féminin et à<br />
en être fière.<br />
Les 24 heures du sport féminin<br />
C'est le 1er février 2014 qu'a lieu un événement, important, qui en fera parler<br />
plus d'un. En effet, c'est la première fois que le monde de l'audiovisuel consacre<br />
une de ces journées, d'où le nom de « 24heure », à la visibilité du sport féminin<br />
! À la tête de cette belle initiative,<br />
ayant pour but de mettre en avant les<br />
sportives féminines et ainsi de<br />
combler ce manque de représentation<br />
dans les médias, nous retrouvons<br />
Christine Kelly qui n'est ni plus ni<br />
moins que la Présidente de la mission<br />
Sports au conseil supérieur de<br />
l'audiovisuel(CSA), mais aussi une<br />
journaliste française.<br />
Face à un engouement de taille et un succès qui se fait ressentir, une décision<br />
est prise: celle de réitérer l'événement mais avec encore plus d'ampleur.
C'est donc le samedi 24 janvier 2015, que la 2ème édition est lancée. Mais cette<br />
deuxième édition n'aurait pas pu se faire sans des partenaires de taille. On<br />
retrouve à la tête de tout ceci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel , le<br />
Secrétariat chargé d'État des Droits des Femmes ainsi que celui chargé des<br />
Sports, l'association Femix Sports mais aussi le Comité national olympique et<br />
sportif français (CNOSF).<br />
Elle implique bien évidemment des associations sportives, des entreprises<br />
impliquées dans le milieu du sport, des Fédérations, des ligues et clubs<br />
professionnels, et des sportifs de haut niveau, sans qui il serait difficile de<br />
réaliser ce projet.<br />
D'autant plus que les parrains sont aux nombres de trois et que parmi eux nous<br />
retrouvons le fameux champion du monde de Ju-jitsu Vincent Parisi<br />
(photo en bas à gauche), détenant à son actif 5 titres de champion de France et<br />
au moins 4 titres de champion d'Europe. La représentation d'un homme comme<br />
parrain est un signe fort montrant une volonté masculine d'aider la femme à se<br />
frayer un chemin dans le sport. On retrouve aux côtés du Jujitsuka, Laura<br />
George (première photo ), une footballeuse international française et Sandrine<br />
Gruda (photo en bas à droite ), une baskette française qualifiée comme l'une des<br />
joueuses pilliés de l'équipe de France.<br />
Un mouvement appelé «HeForShe», basé sur la solidarité et l'entre-aide<br />
féminine/masculine, se félicite de voir que les hommes soutiennent les femmes<br />
dans ce genre d'événement, et surtout dans ce combat, et donc dans le fait qu'ils<br />
s'investissent.<br />
Puis, plusieurs chaînes TV célèbres, mais réservées à ses adhérents, se sont<br />
impliquées dans cette journée de sport féminin comme notamment Bein sport,<br />
qui a consacré tout une page spécialement pour donner les résultats des<br />
compétitions sportives féminines, Canal+, qui diffuse des matchs, Eurosport<br />
qui diffuse des coupes du monde ( de ski alpin, de saut à ski), la coupe de<br />
France de football féminin et le championnat dame Volley-Ball. Des chaînes<br />
ouvertes aux grands publics et qui n'exige aucun abonnement sont aussi dans le<br />
projet c'est le cas avec l’Équipe 21, diffuseur d'épreuves de qualifications de<br />
ski cross ainsi qu'une finale de snowboard « Big air » féminine mais aussi<br />
masculine, sur la chaîne M6 on se consacre à «Sort 6» un numéro spécial<br />
relatant le parcours de sportives ainsi qu'une mention spécial pour la sportive<br />
handisport Mari Brochet, France 3 diffuse « Tout le sport », un magasine<br />
proposant des interviews et des reportages sur le sport féminin, France 2 donne<br />
son antenne à William Leymergie (fameux journaliste et animateur) qui<br />
présente « C'est un monde » un reportage sur les sports féminins en Australie,<br />
au Sénégal, en Russie et au Brésil, TF1 propose quant à lui à ses auditeurs un<br />
portrait spécial d'une entraîneuse d'équipe masculine (Clermont-Foot) nommée<br />
Corinne Diacre. Les médias c'est aussi la radio, et elle a voulu elle aussi<br />
participé à cette événement. Europe 1 a lancé très tôt, de 6 heures jusqu'à 9
heures des reportages sur des femmes arbitres à haut niveau (sur matchs<br />
masculins) et a lancé la place aux femmes afin qu'elles commentent quatre<br />
matchs du multiplex de Ligue 1, RTL laisse Glwadys Epangue( championne du<br />
monde de Taekwondo) présenter le «Journal des Sport» puis vers 18 h Philippe<br />
Robuchon reçoit des femmes qui ont réussi, sur un paddleboard, le passage du<br />
Cap Horn, RMC diffuse des débats avec des joueuses telles que Emilie Gomis<br />
(fait parti de l'équipe de France de Basket), Clarisse Agbegnenou (judokate de<br />
-63 kg) ou Assa Koita (XV de France féminin), France Bleu invite notamment<br />
Laura georges à « L'esprit sportive » animée par Nathalie Simon.<br />
La seule note négative que l'on a pu percevoir c'est l'absence de la jeunesse et<br />
des sports, du Secrétaire d’État aux Sports ainsi que le Ministre de la ville lors<br />
de la journée central du samedi des 24 heures du sport féminin.<br />
→ Une solution → La médiatisation des joueuses pourrait être amélioré si l'on<br />
intégrait des matches féminins à la liste des événements sportifs majeurs et<br />
surtout importants. Ceci est d'ailleurs inscrit dans le décret n°2004-1392 datant<br />
du 22 décembre qui avait pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi 86-<br />
1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, au sujet de<br />
la diffusion des événements d'importance majeure.<br />
d) Salaires et instances dirigeantes<br />
Le frein à l'émancipation total de la femme dans le sport est basé sur d'autres<br />
sources telles que le salaire féminin, qui a un écart fulgurant avec le salaire<br />
masculin, ainsi que les instances dirigeantes où l'on retrouve les postes à<br />
responsabilités.<br />
En effet, si l'on regarde les données, elles montrent qu'au seins même des<br />
instances dirigeantes du sport la proportion des femmes occupant une fonction<br />
d'entraîneuse ou de dirigeante en Europe ne dépasse pas les 10% . De même<br />
que 88% des entraîneurs nationaux sont des hommes. En fin 2005, déjà, pour<br />
pallier à ce problème, les FI ( Fédérations internationales), les CNO ( Comité<br />
National Olympique), les fédérations nationales, ainsi que les organismes<br />
sportifs originaires ou adhérents au Mouvement olympique étaient censés<br />
réserver aux femmes au moins 20% des postes qu'ils possédaient dans leurs<br />
structures ayant tout du moins un pouvoir décisionnel (organe exécutif ou<br />
législatif). Ce qu'il faudrait à présent, c'est maintenir ce système tout en agissant<br />
de manière plus impactant et en laissant place à un plus grand nombre de<br />
femmes. Pour cela, les femmes peuvent faire entrer en jeux la législation, plus<br />
précisément la législation européenne qui comporte les législations nationales<br />
(celles du pays, ici la France).<br />
Nous notons tous de même des points positifs et encourageants quant à l'avenir<br />
des femmes dans le sport avec les plans de féminisations que les fédérations
sportives sont dans l'obligation, depuis les conventions d'objectifs 2014-2017<br />
(en lien direct avec l’État), de se munir. Le ministère avait montré sons<br />
engagement et avait poussé, dès 2006, quatre fédérations à s'impliquer dans un<br />
plan de féminisation : le cyclisme, le football, le handball et le basket-ball. Au<br />
cours de l'Olympiade, sous cette impulsion, d'autres fédérations ont suivies les<br />
directives et se sont dotées de plans de féminisations qui ont touché le hockey<br />
sur glace, l'aviron, la boxe, l'escalade, le triathlon mais aussi le tennis. Ces plans<br />
de féminisations touchent, en plus, plusieurs secteurs dans les instances<br />
dirigeantes que ce soit dans la pratique, la formation ou bien dans<br />
l'encadrement, l’arbitrage.<br />
→ Des solutions → Arriver à mettre en place une parité total dans les primes<br />
sportives et sportifs, plus précisément dans le football, lorsque ceux-ci<br />
participent à une compétition de même niveau.<br />
→ Mettre en place une égalité parfaite dans les instances<br />
dirigeants mais aussi dans l'encadrement et surtout dans l'arbitrage grâce à une<br />
représentation systématique dans tous les corps de métiers que ce soit dans le<br />
sport féminin ou masculin.<br />
→ Inscrire, lors des grands événements sportifs de la directive<br />
«Télévision sans frontières », les événements sportifs féminins. Ce qui<br />
entraînerai une avance considérable.<br />
→ Établir des quotas afin de permettre aux femmes d'accéder<br />
plus facilement à des postes à responsabilité, et donc encourager dès le plus<br />
jeune âge les jeunes filles à choisir ce type de responsabilité (poste).<br />
→ Prendre exemple sur d'autres pays en avancent dans<br />
l'intégration de la femme dans le sport comme c'est le cas aux États-Unis. Un<br />
pays dans lequel existe une loi fédéral appelé «Title IX» qui interdit toute forme<br />
de différenciation entre athlètes féminines et athlètes masculins. Cette loi exige<br />
que hommes et femmes soit dotés de même matériel, de même moyen pour<br />
exercer leur sport et ainsi pour pouvoir s'épanouir pleinement. La loi prohibe,<br />
par exemple, le fait qu'une équipe sous prétexte qu'elle soit féminine est un<br />
entraîneur de 17 ans alors qu'une équipe masculine est un entraîneur très<br />
qualifié et expérimenté. De même qu'avec cette loi, un coach qui entraîne une<br />
équipe composait de femmes ne sera pas sous payé.
Conclusion : Ainsi, nous pouvons dire que la réponse est bien évidemment oui!<br />
Oui la femme a sa place dans le milieu sportif, et oui elle peut l'être au même<br />
titre que les hommes. Alors, il est vrai qu'à force de répéter que l'homme et la<br />
femme sont égaux, nous finissons par croire qu'ils sont identiques et ont les<br />
mêmes ressources. Égaux certainement mais la différence est pourtant là, elle<br />
est fondamentale et doit être prise en compte. Homme et femme ont chacun<br />
leurs spécificités, capacités, psychologies et surtout leurs physionomies. Une<br />
femme ne pourra jamais avoir la force d'un homme au même titre qu'un homme<br />
ne pourra pas exercer certaines disciplines où la femme pourra exceller. De<br />
plus, nous pouvons constater que le combat pour l'égalité de la femme dans le<br />
monde sportif a été très long, et il reste encore de nos jours et malgré des<br />
moyens mis en place, un combat inachevé. Le mouvement pour l'égalité des<br />
sexes est un combat mené en grande partie par les femmes. Il ne s'agit<br />
cependant pas d'une lutte féministe mais d'un mouvement de solidarité qui<br />
rassemble une moitié de l'humanité en soutien à l'autre. Il faut savoir que les<br />
discriminations sexistes dans le sport sont à l'encontre des valeurs que la société<br />
nous inculque à savoir la «liberté», «l'égalité», la «fraternité», et ainsi lutter<br />
contre ces discriminations permettraient de formuler le vœu de milliers de<br />
Français de pouvoir se retrouver derrière une équipe féminine, ensemble, autant<br />
que derrière une équipe masculine. De plus, le sport est un milieu qui fait rêver<br />
les plus jeunes, et si une parité homme/femme dans le sport serait atteinte, le<br />
rêve toucherait un plus large public et contribuerait à aider d'autres combats<br />
dans l'émancipation féminine. Il serait à présent envisageable de se demander si<br />
le sport peut aider, parallèlement, la femme à s'émanciper dans sa vie<br />
quotidienne et social.
Bibliographie<br />
livre & journal : Caroline Pavot-Podevin, Le sport au féminin (186 pages)<br />
Sport & Vie, Hors série n°41 ( 82 pages), Edition Faton<br />
sites web :<br />
• http://www.clg-lurcat-sarcelles.ac-versailles.fr/IMG/pdf/L_histoire_de_la_bicyclette-2.pdf<br />
• http://www.ami-hebdo.com/actu/le-front-et-la-forme/<br />
• http://www.femixsports.fr/<br />
• http://blog.lefigaro.fr/sport-business/2015/01/place-aux-femmes-sur-eurosport.html<br />
• http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2015/01/23/les-temps-forts-des-24-heuresdu-sport-feminin_4562657_1655027.html<br />
• http://lerdvsportif.fr/24h-du-sport-feminin/<br />
• https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/les-jeux-olympiques-desenjeux-multiples/les-femmes-aux-jeux-olympiques-la-lente-conquete-de-lolympisme/uneparticipation-feminine-progressive/<br />
photos :<br />
• http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lescasquesdecuir.com<br />
%2Fphotos%2Fhilsz-001.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lescasquesdecuir.com<br />
%2Fcol-341.php&h=228&w=324&tbnid=KSzK3TQLXcuLMM<br />
%3A&docid=XDt9OEjSpM_MHM&ei=Yr_RVteFMIriUYWmkJgP&tbm=isch&iact=rc&u<br />
act=3&dur=779&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0ahUKEwjXvsT0n5jLAhUKcRQKHQ<br />
UTBPMQrQMIMjAH<br />
• http://bmarcore.perso.neuf.fr/tennis/apres14/lenglen1.html<br />
• http://buclermont.hypotheses.org/892<br />
• http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.museedusport.fr%2Fsites<br />
%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Finterne_visuel__710_470_%2Fpublic%2FMILLIAT-<br />
Alice.jpg%253Fitok%253DKy3dPe_a&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.museedusport.fr<br />
%2Ffr%2Factualites_du_musee%2Fportrait-d%25E2%2580%2599alice-milliat-militantedu-sport-f%25C3%25A9minin&h=470&w=760&tbnid=gtDq58eMnXszwM<br />
%3A&docid=UUy8wRDG4pYe3M&ei=9O_RVtroAseGU6rzp8AC&tbm=isch&iact=rc&ua<br />
ct=3&dur=343&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0ahUKEwjaspadzpjLAhVHwxQKHar5C<br />
SgQrQMIITAB<br />
• http://www.museedusport.fr/fr/actualites_du_musee/portrait-d%E2%80%99alice-milliatmilitante-du-sport-f%C3%A9minin<br />
• http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsameoldgame.files.wordpress.com<br />
%2F2013%2F06%2Fhazena-being-played-in-1924.jpg&imgrefurl=http%3A%2F<br />
%2Ffootball-origins.com%2Ftag%2Fhazena<br />
%2F&h=288&w=413&tbnid=KNaJB2bNGivcNM<br />
%3A&docid=561NWpVFZJZaJM&ei=LkHTVrnDDMORUa2NnrAL&tbm=isch&iact=rc&<br />
uact=3&dur=463&page=1&start=0&ndsp=19&ved=0ahUKEwi5ks3qj5vLAhXDSBQKHa2<br />
GB7YQrQMIHjAA<br />
• http://www.aboneobio.com/blog/post/2008/08/12/560-un-bikini-en-laine-ca-vous-dit<br />
• http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstareslike.files.wordpress.com