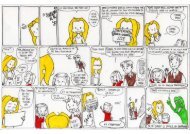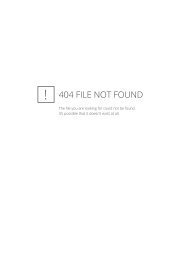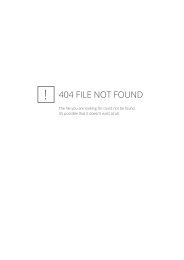lettre_csu_42_pdf
lettre_csu_42_pdf
lettre_csu_42_pdf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>42</strong><br />
Cultures et Sociétés Urbaines - UMR 7217 Cresppa novembre 2016<br />
Du côté des doctorant·e·s<br />
p. 2 Nouveaux, nouvelles<br />
doctorant·e·s et postdoctorante<br />
ÉDITORIAL<br />
p. 3 Soutenance de thèse<br />
p.4 Actualités des doctorant·e·s<br />
À la mi-septembre se sont tenues les Journées<br />
d’étude du CSU, séminaire résidentiel<br />
qui, tous les deux ans et sur deux jours, vise à<br />
rassembler l’ensemble des membres de<br />
l’équipe. Réunissant une quarantaine de<br />
participant·e·s, l’édition 2016 avait plusieurs<br />
objectifs : outre celui de présenter les recherches<br />
des collègues ayant rejoint l’équipe<br />
depuis peu, elle visait à faire dialoguer les<br />
participant·e·s non seulement sur les résultats<br />
mais aussi sur les présupposés et points<br />
d’appui théoriques et les partis pris méthodologiques<br />
de leurs enquêtes.<br />
Déclinées en quatre sessions : « Matérialismes<br />
», « Compter, qualifier, théoriser »,<br />
« Mobilisations dans le domaine de la santé »,<br />
« Classes sociales en action », réunissant<br />
chacune trois communications et une discussion,<br />
ces Journées, denses, ont à la fois<br />
conforté des convergences anciennes et mis<br />
au jour de nouvelles voies dans les recherches<br />
menées au sein de l’équipe.<br />
Sur un plan théorique, si les postures sont<br />
multiples, les membres de l’équipe se retrouvent<br />
sur un refus de l’enfermement<br />
disciplinaire, un intérêt partagé pour le croisement<br />
des approches en sociologie et<br />
science politique, une attention portée à la<br />
socio-genèse des processus et une historicisation<br />
revendiquée. Ils et elles se retrouvent<br />
également dans le souci d’intégrer la réflexion<br />
théorique à l’objet de leurs recherches<br />
en analysant les transformations<br />
des échanges entre les espaces scientifiques<br />
et les mondes sociaux étudiés. Ils partagent,<br />
enfin, dans leurs pratiques de recherche, le<br />
souci de faire varier les échelles d’analyse, à<br />
partir d’approches situées : à l’inverse de ces<br />
sociologies homogénéisantes qui généralisent<br />
le propos par métonymie ou synecdoque,<br />
les recherches des membres du CSU<br />
visent à saturer un terrain, à partir<br />
d’enquêtes monographiques souvent<br />
longues, marquées par l’exigence d’un travail<br />
empirique approfondi.<br />
En termes d'approches, ces Journées<br />
d'étude ont (re)mis au jour l'importance des<br />
approches matérialistes pour l'ensemble des<br />
membres de l'équipe, qu'ils s'inscrivent dans<br />
une sociologie des rapports de domination<br />
de sexe, de classe, de race et / ou de génération.<br />
Ces approches matérialistes au sein de<br />
l'équipe ne font pas l'économie d'une analyse<br />
des schèmes cognitifs et des processus de<br />
formation des représentations mentales des<br />
agents, saisis empiriquement via l’analyse<br />
des pratiques de pensée, des trajectoires et<br />
des ressources que ceux-ci mobilisent. Plus<br />
largement, ces Journées ont montré<br />
l’importance que revêt pour les membres du<br />
CSU l’attention portée aux logiques et processus<br />
de catégorisation. Les rapports de<br />
domination, les logiques de pouvoir, passent<br />
souvent par des catégories, imposées ou<br />
revendiquées, par des luttes de catégorisation,<br />
qui impliquent de ne pas prendre ces<br />
catégories pour « argent comptant », mais<br />
d’en analyser la genèse et les enjeux.<br />
En termes d’objets, ces Journées ont montré<br />
la richesse des approches croisées des processus<br />
et pratiques de politisation, qu’on les<br />
saisisse à l’aune des dispositifs d’action publique<br />
ou dans leurs manifestations « ordinaires<br />
». Elles ont aussi conforté le renforcement<br />
de notre ancrage et de nos apports<br />
en sociologie de la médecine et de la santé, là<br />
Du côté des chercheur·e·s<br />
p. 5 Nouveaux membres<br />
p. 6 Actualités scientifiques<br />
p. 9 Recherches en cours<br />
p. 10 Sélection bibliographique<br />
encore dans des approches croisées, en<br />
l’occurrence ici des mouvements (et des<br />
rapports) sociaux dans le champ de la santé.<br />
Bref, une moisson fructueuse que cette<br />
édition 2016 des « JE du CSU », où l’on mesure<br />
une fois encore toute l’importance qu’il<br />
y a à consacrer du temps à la réflexivité sur<br />
nos pratiques et résultats de recherches, au<br />
sein d’une équipe qui devient ainsi un collectif<br />
de travail.<br />
Cresppa<br />
1
DU COTE DES DOCTORANT·E·S<br />
Nouveaux, nouvelles doctorant·e·s et<br />
post-doctorante<br />
sur les pratiques des professionnels ? Il s’agira de répondre à ces<br />
questions à partir d’une analyse documentaire (revue de presse,<br />
littérature grise, archives, publications scientifiques etc.),<br />
d’entretiens et de questionnaires.<br />
Après un master en sciences sociales à l’ENS Cachan, Quentin Belot<br />
a rejoint l’équipe du CSU pour une thèse provisoirement intitulée<br />
« Une financiarisation précoce dans l’industrie automobile. Analyse<br />
socio-historique de la gestion financière du groupe PSA Peugeot<br />
Citroën à partir des années soixante ». Elle se déroulera sous la direction<br />
de Cédric Lomba et Claude Didry (CMH).<br />
Ce travail vise à nuancer l’idée que la financiarisation serait un phénomène<br />
essentiellement récent provenant de la rupture néolibérale<br />
du début des années quatre-vingt. Les marchés financiers exerceraient<br />
une pression sur les entreprises, aussi forte que diffuse et<br />
insaisissable. Nous examinerons la gestion financière mise en œuvre<br />
par PSA à partir des années soixante, époque pourtant perçue<br />
comme l’âge d’or pré-financier de la production industrielle. Nous<br />
partirons de l’intérieur de cette entreprise fordiste pour étudier à<br />
partir d’entretiens historiques et de documents d’archives (bilans<br />
comptables, rapports d’activité, rapports financiers) le travail de<br />
construction de sa politique financière, les outils comptables qui la<br />
rendent possible et la façon dont ceux-ci ont évolué au fil du temps.<br />
Nous ne postulons pas a priori l’existence d’une rupture radicale au<br />
début des années quatre-vingt. Le capitalisme est un système en<br />
mutation constante dans lequel les grandes entreprises et leurs<br />
propriétaires sont les acteurs principaux, et ont pu en tant que tels<br />
être générateurs de logiques financières dès les années soixante.<br />
Enfin, la gestion concrète, les indicateurs et outils mobilisés par cette<br />
firme laissent entrevoir un continuum entre logiques industrielle et<br />
financière.<br />
Après un master de science politique à l’Université Paris 8, François<br />
Boureau rejoint le CSU dans le cadre d’une thèse financée par l’école<br />
doctorale Sciences sociales de Paris 8, et intitulée « La prise en<br />
charge des “addictions” : de l’émergence d’une catégorie<br />
d’intervention publique à la recomposition d’un espace professionnel<br />
(1999-2016) », sous la direction de Vanessa Codaccioni et de Sylvie<br />
Tissot.<br />
L’émergence, dans les années 1990, d’une approche transversale et<br />
transdisciplinaire des phénomènes de dépendance - appelée « addictologie<br />
» - a marqué, dans le domaine de l’intervention en toxicomanie,<br />
alcoologie, tabacologie, etc., un bouleversement des frontières<br />
entre savoirs, disciplines, institutions, etc. Ce travail vise à saisir le<br />
mouvement d’institutionnalisation de cette discipline.<br />
Plusieurs interrogations guident ce travail : comment et dans quelle<br />
mesure les professionnels travaillant auprès des personnes « addicts<br />
», se sont appropriés ce vocable et cette approche en provenance<br />
d'espaces et de courants du champ médical parfois éloignés ou<br />
concurrents ? Dans quelle mesure la réforme du secteur médicosocial<br />
a transformé les relations entre des institutions et des professionnels<br />
ayant appartenu à des secteurs distincts ? Qui sont les<br />
« addictologues » ? Que recouvre leur formation et quels sont les<br />
effets de la spécialisation sur les représentations des problèmes et<br />
2<br />
Hugo Mulonnière est en deuxième année de doctorat d’histoire et<br />
travaille sous la direction de Raphaëlle Branche (Université de<br />
Rouen) et de Laure Pitti. Après un master d’histoire sur les ouvriers<br />
nord-africains d’une entreprise de métallurgie du Pas-de-Calais<br />
entre 1947 et 1962 (prix Jean Maitron 2012), ses recherches portent<br />
sur les services administratifs « métropolitains » spécialisés dans<br />
l’encadrement du travail et des travailleurs originaires des territoires<br />
nord-africains sous domination française, entre la fin des années<br />
1930 et le milieu des années 1960, période parcourue par de profondes<br />
mutations politiques et sociales qui affectent ces migrants en<br />
métropole. Cette recherche vise à contribuer à l’histoire et à la sociologie<br />
de l’État et de l’administration en contexte impérial en examinant<br />
en quoi la politique de la main-d’œuvre nord-africaine est une<br />
politique d’exception, destinée à une partie de la population dont le<br />
statut, produit de la logique coloniale, évolue dans un espace intermédiaire<br />
entre l’étranger et le national et, en retour, en quoi cette<br />
politique renforçant les logiques de séparation d’avec le droit commun<br />
a contribué à faire de ces travailleurs une catégorie d’exception.<br />
Il s’agit d’étudier la conception de ces services, leurs évolutions structurelles,<br />
leurs personnels, la construction de leur expertise ainsi que<br />
les politiques publiques qu’ils façonnent et mettent en œuvre sur la<br />
période considérée.<br />
Après un master en sciences sociales à l’ENS de Lyon, je commence<br />
une thèse en sociologie à l’Université Paris 8. Cette thèse, réalisée<br />
sous la direction de Dominique Memmi, s’intitule « Parler<br />
d’avortement. L’expression d’un for intérieur féminin entre confidence<br />
et intériorisation des normes procréatives et sexuelles ».<br />
Il sera question d’interroger le rôle que joue la parole (ou la nonparole,<br />
c’est-à-dire le tabou) dans le contrôle social qui s’exerce sur<br />
les femmes ayant recours à l’IVG. Si l’interaction avec les professionnel·le·s<br />
de santé au moment de l’IVG est l’espace incontournable où<br />
s’exerce ce contrôle social par l’échange de parole, famille, pairs,<br />
institutions, mais aussi internet contribuent également à construire<br />
et déconstruire les normes qui encadrent l’IVG.<br />
Cette recherche envisage la parole, et plus précisément la confidence,<br />
comme une ressource « féminine » face à l’IVG : car la parole<br />
échangée autour de l’IVG n’est pas seulement normalisatrice, elle est<br />
également un moment d’expression de soi, et à ce titre peut être<br />
envisagée comme un espace d’autonomie, d’acceptation ou<br />
d’appropriation de sa trajectoire contraceptive et reproductive. En<br />
devenant l’expression d’un « for intérieur » dont il faudra interroger<br />
la dimension genrée, la parole s’individualise et se teinte de psychologie<br />
: or, cette émergence d'une parole « féminine » sur la reproduction<br />
possède une histoire, histoire qu'il faudra retracer pour en montrer<br />
les enjeux sociologiques contemporains.
Après un master à Aix-Marseille Université soutenu en 2014 sur les «<br />
Continuités et réajustements des politiques de sécurité à Marseille »,<br />
Kevin Vacher poursuit un travail doctoral faisant dialoguer les études<br />
de sécurité avec une sociologie des problèmes publics et des mobilisations<br />
sociales. Ce travail est dirigé par Sylvie Tissot et financé par la<br />
région Ile-de-France.<br />
Soutenance de thèse<br />
Sa recherche porte sur les mobilisations pour la sécurité de collectifs<br />
« d’habitants », au sein de territoires populaires. Cette recherche,<br />
menée en comparaison à Marseille et à Naples, s'organise autour<br />
d’un portrait de ce phénomène à l’échelle de la dernière décennie et<br />
d’études de cas d'actions collectives où les acteurs réclament des<br />
mesures de mise en sécurité de leurs territoires.<br />
Prenant à contre-pied les études en science politique mobilisant les<br />
catégories de l'action publique du « sentiment d'insécurité » ou des<br />
« demandes de sécurité », centrées sur le point de vue des pouvoirs<br />
publics confrontés à des acteurs présentés sans propriétés et dépourvus<br />
de capacité d’action, ce travail met en lumière ce qui se révèle<br />
être une demande sociale plurielle, située et contextualisée. il<br />
permet de voir au travers de ces mobilisations collectives comment la<br />
contingence de facteurs sociaux, économiques et urbains et de prescriptions<br />
politiques, d’intéressements militants et d’histoires sociales,<br />
participe à incarner la catégorie des « riverains » dans le champ médiatique<br />
et politique. Cette catégorie faisant elle-même écho à la<br />
figure morale de « l’honnête citoyen », elle nous permet de comprendre<br />
en contraste la construction des figures déviantes contemporaines.<br />
Daniela Vieira dos Santos est postdoctorante<br />
au département de sociologie<br />
à l'Université d'État de Campinas<br />
(Unicamp) au Brésil et boursière de la<br />
Fapesp (Fondation de soutien à la<br />
recherche de l’État de São Paulo).<br />
Depuis son master, elle développe une<br />
analyse sociologique des relations<br />
entre la musique et la société brésilienne.<br />
Dans sa thèse de doctorat intitulée<br />
« As representações de nação nas<br />
canções de Chico Buarque e Caetano Veloso: do nacional-popular à<br />
mundialização » [Les représentations de la nation dans les chansons<br />
de Chico Buarque et Caetano Veloso : du national-populaire à la<br />
mondialisation], elle étudie à travers deux compositeurs emblématiques<br />
brésiliens la relation entre la nation et la chanson au Brésil, des<br />
années 1960 aux années 1990. Elle est notamment l’auteure du livre:<br />
Não vá se perder por aí: a trajetória dos Mutantes [Ne va pas te perdre<br />
là-bas: la trajectoire de Los Mutantes], publié par les éditions de la<br />
Fapesp / Annablume en 2010, au Brésil.<br />
Elle est accueillie au sein du Cresppa-CSU d’octobre 2016 à juin<br />
2017 pour développer une analyse comparative entre le rap français<br />
et le rap brésilien, en collaboration avec Karim Hammou. Le projet,<br />
intitulé « la nouvelle génération du rap et l'industrie de la culture »,<br />
vise à comprendre, à travers le rap, comment les questions de race et<br />
de classes sociales se posent dans ces deux pays.<br />
3<br />
À partir d’une enquête qualitative menée auprès de femmes<br />
ayant avorté dans les dix dernières années en France et au Québec,<br />
cette recherche met en évidence la norme contraceptive<br />
dans ces deux sociétés et révèle l’opposition forte faite par<br />
l’ensemble des femmes – et même celles qui avortent plusieurs<br />
fois – entre les « bonnes » pratiques en matière de contrôle des<br />
naissances (la contraception) et la « mauvaise » pratique<br />
(l’avortement).<br />
Bien qu’il soit une donnée structurelle des trajectoires reproductives<br />
des femmes, une pratique aujourd’hui sans risque pour leur<br />
santé et un acte ordinaire lorsqu’on le défait de la charge morale<br />
qui lui est associé, l’IVG continue d’être l’objet d’un ensemble de<br />
représentations sociales stigmatisantes. L’analyse des expériences<br />
des femmes rend compte des cadres sociaux du contrôle<br />
des naissances, soit des règles socialement édictées quant à<br />
l’usage de l’avortement et de la contraception, tout comme de la<br />
division sexuée du travail que le contrôle des naissances soustend<br />
et sa difficile articulation avec un ensemble de<br />
tâches concurrentes : emploi salarié, travail de santé et maternité.<br />
Elle révèle aussi les cadres sociaux de la parentalité et de son<br />
refus par les femmes. Si la décision d’avorter est une évidence,<br />
lorsqu’elles sont impliquées dans des activités concurrentes<br />
(études, carrière ou élevage et allaitement d’un enfant en bas<br />
âge), elle peut devenir plus difficile lorsqu’elle correspond au refus<br />
de leur partenaire d’investir un projet parental qu’elles portent<br />
seules. Enfin, la mise en perspective des modalités de la prise<br />
en charge, énoncée par les femmes à Paris et à Montréal, révèle<br />
les nombreux obstacles qui peuvent rendre cet épisode plus<br />
compliqué voire douloureux, témoignant des réticences dans ces<br />
deux sociétés à penser cette pratique comme un acte ordinaire<br />
de planification des naissances relevant du champ de la santé.
Actualités des doctorant·e·s<br />
<br />
L’Atelier Balkans réunit des jeunes chercheurs (masterants, doctorants<br />
et jeunes docteurs) ayant comme point commun un intérêt<br />
scientifique pour les Balkans. Lancé en 2014 par Angeliki Drongiti<br />
(doctorante en sociologie, Université Paris 8 – Cresppa-CSU) et<br />
Maria Kokkinou (doctorante en anthropologie, EHESS – IIAC-<br />
LAIOS), il a été inspiré par le double constat d’un manque remarquable<br />
de travaux sur le sujet en France et l'absence de communication<br />
et de lieux d'échanges entre les jeunes chercheurs travaillant sur<br />
les Balkans. L’équipe organisatrice a été renforcée par Dimitris Kosmopoulos<br />
(doctorant en science politique à l’Université Paris Dauphine,<br />
Irisso), Milena Pavlovic (doctorante en anthropologie à<br />
l’Université Paris Nanterre, LESC), Sarah Sajn (doctorante en science<br />
politique au Cherpa, Sciences Po Aix) et Georgia Sarikoudi (postdoctorante<br />
en anthropologie sociale, Université de Macédoine).<br />
La première année a été organisée autour de séances introductives<br />
sur les recherches en cours et la présentation des travaux des participant.e.s.<br />
Ceci a abouti à la participation de l’Atelier Balkans au 11 ème<br />
congrès international de l’Association internationale d’études du<br />
Sud-Est Européen (AISEE) avec une communication collective et<br />
plusieurs communications individuelles. La deuxième année, l’Atelier<br />
s'est concentré sur un travail collectif interne à l'équipe organisatrice,<br />
notamment focalisé sur la publication des articles présentés au<br />
Congrès de l’AISEE pour la revue Études Balkaniques – Cahier Pierre<br />
Belon et les futurs projets.<br />
L’Atelier Balkans reprend ses activités scientifiques pour cette année<br />
universitaire 2016-2017 en proposant un atelier de lecture venant<br />
répondre aux besoins identifiés les années précédentes et notamment<br />
celui de la constitution d'une bibliographie partagée.<br />
Le programme de l’Atelier Balkans est en ligne sur le site du Cresppa-CSU.<br />
http://www.cresppa.cnrs.fr/<strong>csu</strong>/atelier-balkans-2016-2017<br />
<br />
Publications et communications des<br />
doctorant·e·s<br />
A R T I C L E S<br />
Carlotta BENVEGNÙ, « Netturbini nell’era delle privatizzazioni. Ristrutturazioni<br />
del settore della raccolta dei rifiuti a Parigi », Sociologia del<br />
lavoro, n°1<strong>42</strong>, 2016 - p. 49-61.<br />
Maud GELLY et Laure PITTI, « Une médecine de classe ? Inégalités sociales,<br />
système de santé et pratiques de soins », Revue Agone, n°58,<br />
2016 - p. 7-18.<br />
Maud GELLY, « Des inégalités en tous genres face au décès par sida et<br />
de leur ignorance par le système de santé », Revue Agone, n°58,<br />
2016 - p. 135-150.<br />
Maud GELLY et Bibia PAVARD, « De la fabrique des militant·e·s à la fabrique<br />
des patient·e·s », Genèses, n°102, 2016 - p. 47-66.<br />
N O T I C E<br />
Pascal BARBIER, Lucie BARGEL, Amelie BEAUMONT, Muriel DARMON et<br />
Lucile DUMONT, Notice : « Vêtement », in J. Rennes (dir.), Encyclopédie<br />
critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux, La Découverte,<br />
2016 - p. 659-669.<br />
C O M P T E R E N D U<br />
Pierre GILBERT et Camille FRANÇOIS, « Construire et gouverner les<br />
populations par l’espace. À propos de : F. Desage, C. Morel Journel<br />
et V. Sala Pala (dir.) Le peuplement comme politiques, PUR, 2014 »,<br />
Genèses, n°104, 2016 - p. 155-162.<br />
R A P P O R T<br />
Carlotta BENVEGNÙ, Francesco IANNUZZI, Devi SACCHETTO et Francesca<br />
A. VIANELLO, Exploitation and migrant workers’ struggles in the italian<br />
logistics and tourism sectors, University of Padua, 2016.<br />
Organisées par Marie Perrin (Cresppa-CSU) et Alice Romerio (Cresppa-LabToP),<br />
avec le soutien du Cresppa et de l’école doctorale<br />
Sciences sociales de l’Université Paris 8.<br />
Ces deux journées s’articulent en quatre axes : « Les mouvements<br />
féministes à l’épreuve de leur institutionnalisation », avec Marion<br />
Charpenel (CNRS, CMH) et Camille Masclet (Cresppa-CSU), discussion :<br />
A.-M. Devreux (Cresppa-CSU) ; « Ce que l’institutionnalisation fait à la<br />
cause des femmes (1) », avec Mathias Thura (Cessp, DIM-GID), Zoé<br />
Haller (Dysola) et Clémentine Comer (Crape), discussion : Catherine<br />
Achin (Irisso), « Ce que l’institutionnalisation fait à la cause des<br />
femmes (2) », avec Auréline Cardoso (Certop-Sagesse), Virginie<br />
Dutoya (CNRS, CED) et Cécile Talbot (Ceraps), discussion : Alban<br />
Jacquemart (Irisso) et « Les processus d’institutionnalisation », avec<br />
Lison Guignard (ISP), Blandine Lefierdebras (Univ. Rennes 2, association<br />
« Histoire du féminisme ») et Ranime Alsheltawy (Irisso). Discussion<br />
: Ioana Cîrstocea (Cespp-CSE).<br />
Le programme complet est en ligne sur le site du Cresppa.<br />
http://www.cresppa.cnrs.fr/evenements/journees-d-etude-interroger-linstitutionnalisation-de-l-espace-de-la-cause-des<br />
4<br />
C O M M U N I C A T I O N S<br />
Nabila ABBAS, Theorie und Praxis agonistischer Demokratie. Imaginäre<br />
der tunesischen Revolution, Journée d’étude organisée par Regina<br />
Kreide, Universität Gießen, 29 juillet 2016.<br />
Nabila ABBAS, Feministische Imaginäre der tunesischen Revolution,<br />
Colloque : « Gender, Kultur, Transformation: Zur Konstitution einer<br />
deutsch-tunesischen Forschergruppe des DAAD », Universität<br />
Lüneburg, 12 juillet 2016.<br />
Nabila ABBAS, Beyond the ‘Tunisian Exception’ – women rights movements<br />
vs. ‘State feminism’, Colloque : « Living in 2016 - 5 years after<br />
the Arab Spring », University of Oslo, 31 mai 2016.<br />
Nabila ABBAS, Comment on Paula Diehl’s « Symbolism and Democracy<br />
», Colloque : « Beyond renationalization and parliamentarization:<br />
what ways to overcome the EU’s crisis of democratic representation?<br />
», Goethe-Universität Francfort, 23 mai 2016.<br />
Amélie BEAUMONT, Une socialisation par le travail. Le cas des employés<br />
de la loge d’un hôtel de luxe, Colloque « Le travail à l’épreuve des<br />
socialisations », Université de Versailles-Saint-Quentin (UVSQ),<br />
13-14 octobre 2016.<br />
Amélie BEAUMONT, Garder les traditions dans la crise. Les employés de<br />
l’hôtellerie de luxe face aux transformations de leur secteur,<br />
15èmes Journées internationales de sociologie du travail (JIST),<br />
Athènes, 11-13 mai 2016.
Carlotta BENVEGNÙ, Labour transformations in the logistics sector in<br />
France and in Italy, Summer School « Investigating Logistics »,<br />
Humboldt University, Berlin, 19-30 septembre 2016.<br />
Carlotta BENVEGNÙ, Restructuring labour relations and employment in<br />
the European logistics sector: What are unions’ responses?, Workshop<br />
« Reconstructing solidarity: Labour unions, precarious work,<br />
and the politics of institutional change in Europe », Cornell University,<br />
juin 2016.<br />
Carlotta BENVEGNÙ, Migrant workers struggles in the logistics sector in<br />
Italy, Journée d’étude internationale « Migrant workers in China<br />
and Europe », Università degli Studi di Padova (FISPPA), 8 juin<br />
2016.<br />
Carlotta BENVEGNÙ, Fractures ouvrières et contestations dans la crise.<br />
Le cas des travailleurs migrants dans les entrepôts de Padoue,<br />
15èmes Journées internationales de sociologie du travail (JIST),<br />
Athènes, 11-13 mai 2016.<br />
Dimitri COURANT, Le nouvel esprit du tirage au sort. Principes démocratiques<br />
et représentation au sein de dispositifs délibératifs contemporains,<br />
Ecole d’été internationale n°1 « L’esprit de la démocratie<br />
», Sciences Po Bordeaux, 27 juin-1er juillet 2016.<br />
Dimitri COURANT et Colin CROUCH, Thinking sortition. Modes of selection,<br />
deliberative frameworks and democratic principles, Unseld<br />
Summer School on ‘‘Post-democratic challenges’’, Forum Scientiarum,<br />
Univeristy of Tübingen, 22 juin 2016.<br />
Dimitri COURANT, Du klérotèrion à la cryptologie : Le tirage au sort au<br />
XXIe siècle, pratiques et équipements, Quatrièmes journées suisses<br />
d’histoire «Pouvoir(s)», panel « Le pouvoir du hasard : expériences<br />
de tirage au sort en Suisse », Université de Lausanne, 10 juin 2016.<br />
Dimitri COURANT, Le nouvel esprit du tirage au sort. Principes démocratiques<br />
et représentation au sein de dispositifs délibératifs contemporains,<br />
JDoc2 de l’IEPHI, Lausanne, 13 mai 2016.<br />
Christelle DORMOY-RAJRAMANAN, “Mai 68” : fenêtre d’opportunité<br />
pour un haut fonctionnaire au placard. Jacques de Chalendar et la<br />
politique universitaire, Colloque international « Individuals in political<br />
events », Université de Lausanne, 16 septembre 2016.<br />
Christelle DORMOY-RAJRAMANAN, La sociologie à Nanterre autour de<br />
“68” : étude de l’ancrage social et politique de son enseignement, de<br />
1965 aux années 1970, XXe congrès de l’Association internationale<br />
des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, 6 juillet<br />
2016.<br />
Camille FRANÇOIS, Une politique de dépeuplement. Les procédures<br />
d’expulsion locative entre institution préfectorale et pouvoir municipal,<br />
« Biennale de l’Urbain 2016 », Université Toulouse - Le Mirail,<br />
30 septembre 2016.<br />
Camille FRANÇOIS, An indirect debt. Rent debts and the social structure<br />
of low-income families’ indebtedness, 14th Biennial Conference of<br />
the European Association of Social Anthropology (EASA), Milan,<br />
2016 July 22.<br />
Camille FRANÇOIS, Identifier et prévenir les troubles à l’ordre public :<br />
logiques de police dans l’attribution du concours de la force publique<br />
en matière d’expulsions locative, Journée d’étude « Dans la<br />
boîte noire des politiques de sécurité », Université Paris 8, 16-17<br />
juin 2016.<br />
Romain GALLART et Eduarda REINAUX, La Participación Popular y La<br />
Planificación Urbana: que es el papel de la Universidad?, XXII encuentro<br />
de la Red ULAVAV « El hábitat residencial para la creación<br />
de ambientes favorables », Rede Universitaria Latinoamericana de<br />
Cátedra de Vivienda, Xalapa del Estado de Veracruz (México), 24-<br />
26 août 2016.<br />
Romain GALLART et Luis DE LA MORA, A institucionalização do “direito à<br />
cidade”: um conceito inda mobilizador de moradores de bairros populares?,<br />
44ème colloque international du programme Atillio « Le<br />
droit à la ville en France et au Brésil, un nouvel agenda urbain ? »,<br />
Salvador de Bahia, (Brésil), 27-30 Juin 2016 (Actes à paraître).<br />
Silvia HERNÀNDEZ, El Centro Metropolitano de Diseño como actor de la<br />
patrimonialización de Barracas, IIIe Journées d’étude de<br />
l’Amérique Latine et les Caraïbes « América Latina: escenarios en<br />
Disputa », Institut de l’Amérique Latine et les Caraïbes, Université<br />
de Buenos Aires, 28-30 septembre 2016.<br />
Marilena KOURNIATI, Particularités et usages des livres d’architectes<br />
(1945-2000), Journée « Architecture, culture, projet », dans le<br />
cadre des Journées nationales d’architecture, École nationale supérieure<br />
d’architecture Paris Val de Seine, Université Paris Diderot<br />
/ CERILAC, 14 octobre 2016.<br />
Nicolas LARCHET, Les « zones grises » de la « boîte noire » : retour sur<br />
une expérience d’évaluateur de projets de recherche internationaux<br />
pour une fondation abritée, XXe congrès de l’Association internationale<br />
des sociologues de langue française (AISLF), Montréal,<br />
5 juillet 2016.<br />
Maï LE DÛ, Le toucher dans le soin de la mère et de l’enfant : entre<br />
impensable et indispensable, Colloque « Interculturalité et soins,<br />
“Naître... ”», Lyon, 10 novembre 2016.<br />
Maï LE DÛ, Première rencontre…, 6ème colloque de la Société<br />
d’histoire de la naissance « La naissance au risque de la mort, d’hier<br />
à aujourd’hui », Paris, 18 septembre 2016.<br />
Maï LE DÛ, La sage-femme et l’argent, approche sociologique, Colloque<br />
de l’Association nationale des sages-femmes libérales, Grenoble,<br />
19 mars 2016.<br />
Hugo MULONNIERE, Le compte-rendu de la réunion du 12 septembre<br />
1940 sur les rapatriements de Nord-Africains tenue au ministère<br />
de la Production industrielle et du Travail de Vichy, Journées doctorales<br />
« Travaux en cours sur l’Algérie », Université d’Aix-en-<br />
Provence, 1er et 2 juin 2016.<br />
Hugo MULONNIERE, Travail et contraintes : l’exemple des travailleurs<br />
nord-africains en métropole durant la Seconde Guerre mondiale,<br />
Journée d’étude des doctorants de l’Association française pour<br />
l’histoire des mondes du travail « Travail et contraintes », Centre<br />
d’histoire sociale du XXe siècle (CHS), Paris, 12 mars 2016<br />
Ana PORTILLA, La quête de travail sur un marché informel. Catégories<br />
de la pratique chez les ouvriers journaliers aux États-Unis : discussion<br />
de Sylvie Monchatre, 15èmes Journées internationales de sociologie<br />
du travail (JIST), Athènes, 11-13 mai 2016.<br />
Kevin VACHER, Déléguer l’exercice de la contrainte : des « Honnêtes<br />
gens », les Roms et l’État, XXe congrès de l’Association internationale<br />
des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, 5 juillet<br />
2016.<br />
Thomas POSADO, Tommaso GIURIATTI et Kevin VACHER, Une sociologie<br />
politique des doctorant.e.s. Mouvements sociaux, socialisations politiques<br />
et effet de génération chez les doctorant.e.s., Séminaire<br />
« Terrains politiques. Réflexions collectives sur des pratiques de<br />
recherche engagées », Université Paris 8, 10 mai 2016<br />
5
DU COTE DES CHERCHEUR·E·S<br />
Nouveaux membres<br />
Maître de conférences en science politique à l’Université Paris 8<br />
depuis le 1 er septembre 2016, Pierre Gilbert a rejoint le Cresppa-<br />
CSU. Ses travaux portent sur le rôle de l’espace dans la construction<br />
et la transformation des groupes sociaux, sur l’articulation entre les<br />
rapports sociaux de classe, de sexe et de race, et sur la sphère privée.<br />
Il a soutenu en 2014 une thèse de sociologie sur les transformations<br />
des classes populaires dans les quartiers en rénovation urbaine (Les<br />
classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Transformations<br />
sociales et changement social dans une cité HLM). Au croisement de la<br />
sociologie de l’action publique, de la sociologie urbaine et de la sociologie<br />
des classes populaires, cette monographie du quartier des Minguettes<br />
(Vénissieux) combine l’analyse statistique des mobilités et du<br />
peuplement, des entretiens auprès des habitants et des agents de la<br />
politique de rénovation, et des sources documentaires diverses. Elle<br />
montre que ces changements urbains, s’ils ne parviennent pas à modifier<br />
le caractère majoritairement populaire de ces quartiers, ont<br />
pour effet de retenir sur place des ménages appartenant aux fractions<br />
stables des classes populaires. Ils renforcent ce faisant la différenciation<br />
objective entre les positions et les trajectoires des habitants,<br />
mais aussi la perception subjective qu’ils en ont, alimentant<br />
entre les deux fractions des classes populaires qui partagent ce<br />
même espace un sentiment de distance réciproque. Ils affectent<br />
également – de façon différenciée selon les profils et les trajectoires<br />
– les styles de vie en vigueur localement, mettant à l’épreuve les<br />
manières d’habiter et accélérant le processus déjà en cours<br />
d’investissement de la sphère privée et d’affaiblissement des sociabilités<br />
locales.<br />
Depuis 2014, ce questionnement sur la sphère privée a trouvé un<br />
prolongement dans le cadre d’une recherche collective (avec Anaïs<br />
Collet, Marie Cartier, Marie-Hélène Lechien et Sylvie Monchatre)<br />
sur les effets de l’arrivée des enfants sur les inégalités de sexe dans<br />
les couples hétérosexuels. À partir d’entretiens conduits séparément<br />
auprès des conjoints de couples appartenant à diverses classes sociales<br />
et vivant dans des contextes résidentiels contrastés, cette<br />
recherche décrit les manières dont se fabriquent les rapports sociaux<br />
de sexe au moment de l’apprentissage des rôles parentaux, en fonction<br />
des styles de vie et des contraintes professionnelles, locales et<br />
familiales avec lesquelles les couples doivent composer.<br />
Au sein de la revue en ligne Métropolitiques (metropolitiques.eu), en<br />
collaboration avec d’autres disciplines des sciences sociales, il contribue<br />
par ailleurs à la diffusion des savoirs et à l’animation du débat<br />
public sur la ville et les territoires.<br />
Fabien Truong est professeur agrégé au département de sociologie<br />
et d’anthropologie de l’Université Paris 8 et responsable du master<br />
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation en<br />
sciences économiques et sociales (MEEF SES) depuis 2010. Il a auparavant<br />
enseigné les SES pendant six ans dans plusieurs lycées en<br />
Seine-Saint-Denis. Ses travaux s’intéressent principalement à la<br />
marginalité urbaine, à la démocratisation scolaire, à la mobilité sociale,<br />
à la délinquance juvénile, à la gestion du stigmate, aux recompositions<br />
touchant les classes populaires et les familles issues de<br />
l’immigration.<br />
Il a soutenu sa thèse en 2015 à l’EHESS intitulée « À l’école de la<br />
banlieue : la marginalisation urbaine et la démocratisation scolaire à<br />
l’épreuve des trajectoires individuelles ». Elle interroge les conditions<br />
de possibilité de l’ascension sociale et la nécessité des ajustements<br />
que celle-ci implique quand les épreuves les plus déterminantes se<br />
logent dans ce qu’intime la puissance des regards portés sur soi et la<br />
capacité à affronter le stigmate territorial, le mépris de classe,<br />
l’illégitimité culturelle, le racisme et les phobies engendrées par la<br />
pratique de l’islam. Sa thèse montre comment la fragmentation d’un<br />
système inégalitaire où la quête d’un enseignement « approprié »<br />
remodèle la légitimité et la rentabilité du capital culturel, jouant<br />
contre l’intériorisation d’une dignité et d’une singularité acquises par<br />
l’acculturation scolaire - dans une tension entre reproduction et<br />
émancipation incitant à repenser le rapport pédagogique et la performativité<br />
du savoir.<br />
Fabien Truong avait auparavant publié Des capuches et des hommes.<br />
Trajectoires de « jeunes de banlieue » (Buchet-Chastel, 2013), lauréat du<br />
Prix de l’Ecrit Social 2014. Il travaille actuellement sur son prochain<br />
livre qui sera publié sous deux formats différents - Loyautés radicales<br />
(La Découverte, fin 2017) et Radicalized loyalties. Knowing ‘them’ to<br />
understand ‘us’ (Polity Press, début 2018) – et qui proposera notamment<br />
une critique de la notion écran de « radicalisation » à travers<br />
une enquête empirique au long cours, menée sur deux sites.<br />
Fabien Truong mène par ailleurs une enquête ethnographique et<br />
monographique dans une ville de la banlieue sud de Paris avec Gérôme<br />
Truc (CNRS/ISP). Il s’intéresse aussi à la sociologie visuelle et<br />
aux relations entre sociologie et cinéma, et travaille depuis six mois<br />
sur un film documentaire autour du livre issu de sa thèse Jeunesses<br />
françaises. Bac +5 made in banlieue (La Découverte, 2015), avec un<br />
groupe de jeunes étudiants de Saint-Denis et le cinéaste Mathieu<br />
Vadepied.<br />
6
ACTUALITES SCIENTIFIQUES<br />
<br />
Le séminaire collectif du CSU 2016-2017 est coordonné<br />
par Lorenzo Barrault-Stella, Artemisa Flores Espinola, Cédric Hugrée<br />
et Marie Ménoret.<br />
Il vise à mettre en discussion des travaux récents en sociologie et<br />
en science politique. Résolument axé vers les pratiques de recherche,<br />
il constitue un espace de débat scientifique et critique des<br />
membres du CSU et des collègues d’autres institutions invités à<br />
présenter leurs travaux et à les discuter. Un de ses enjeux centraux<br />
est de confronter les approches, les cadres théoriques et les méthodes<br />
(qualitatives comme quantitatives) sur différents objets au<br />
cœur des préoccupations de recherche de l’UMR Cresppa.<br />
Le séminaire est organisé autour de ces thématiques sans exclusive<br />
: la culture, l’action collective et le droit, l’éducation et la mobilité<br />
sociale, l’histoire et l’épistémologie des sciences sociales, le travail,<br />
les rapports sociaux de sexe, la politisation, etc.<br />
<br />
Programme<br />
Le mardi, 14h-16h30, Site Pouchet du CNRS, salle 159.<br />
27 septembre 2016 : Séverine Sofio (Cresppa-CSU), Artistes femmes.<br />
La parenthèse enchantée, XVIIIe-XIXe siècles, Éditions du CNRS,<br />
coll. « Culture et Société », 2016.<br />
Discutant·e·s : Anne-Marie Devreux (Cresppa-CSU) et Sylvain<br />
Antichan (ISP).<br />
18 octobre 2016 : Christelle Avril (IRIS), Les Aides à domicile : un autre<br />
monde populaire, La Dispute, coll. « Corps, Santé, Société », 2014.<br />
Discutant·e·s : Annie Dussuet (CENS) et Camille François (Cresppa-<br />
CSU).<br />
29 novembre 2016 : Romain Pudal (Curapp-ESS), Retour de flammes.<br />
Les pompiers, des héros fatigués, La Découverte, coll. « SH/L’envers<br />
des faits » 2016.<br />
Discutant·e·s : Gabriele Pinna (Cresppa-GTM) et Yasmine Siblot<br />
(Cresppa-CSU)<br />
31 janvier 2017 : Eleonora Elguezabal (Cesaer), Frontières urbaines :<br />
les mondes sociaux des copropriétés fermées, Presses universitaires<br />
de Rennes, 2015.<br />
Discutant·e·s : Colin Giraud (Sophiapol) et Ana Portilla (Cresppa-<br />
CSU).<br />
14 mars 2017 : Geneviève Fraisse (Presage), La Sexuation du monde,<br />
réflexions sur l’émancipation, Presses de Sciences Po, 2016.<br />
Discutant·e·s : Françoise Picq (Irises) et Marie Perrin (Cresppa-<br />
CSU).<br />
16 mai 2017 : Annie Thébaud-Mony, La science asservie. Santé publique<br />
: les collusions mortifères entre industriels et chercheurs, La<br />
Découverte, coll. « Cahiers libres », 2014.<br />
Discutant·e·s : Soraya Boudia (Ifris) et Artemisa Flores Espinola<br />
(Cresppa-CSU).<br />
20 juin 2017 : Hervé Serry (Cresppa-CSU), Aux origines des éditions du<br />
seuil, Éditions du Seuil, 2015.<br />
Discutant·e·s : Pascal Fouché (Imec) et Sébastien Lemerle (Cresppa-<br />
CSU).<br />
<br />
Organisé par Maud Gelly, Audrey Mariette et Laure Pitti (Université<br />
Paris 8, Cresppa-CSU), avec le soutien de l’ARDIS de la région<br />
Ile-de-France.<br />
Depuis une dizaine d’années, la montée en puissance du thème des<br />
inégalités sociales et territoriales de santé est repérable à la fois<br />
dans l’action publique et dans la recherche en sciences sociales.<br />
Paradoxalement, alors même qu’on observe un (relatif) « retour des<br />
classes sociales » dans les sciences éponymes, les inégalités de<br />
santé sont rarement réfléchies en termes de rapports de domination<br />
– et a fortiori dans le croisement avec d’autres rapports de<br />
domination, notamment de race, de sexe ou de génération. Ce<br />
séminaire entend croiser une sociologie des politiques de santé, du<br />
travail médico-social et des classes sociales pour analyser les logiques<br />
de (re)production des inégalités et des discriminations en<br />
matière de santé.<br />
<br />
Programme<br />
Le mercredi, 10h-12h30, site Pouchet du CNRS salle 159.<br />
16 novembre 2016 : Santé, inégalités sociales et rapports de domination<br />
: une introduction, Maud Gelly, Audrey Mariette, Laure Pitti<br />
(Université Paris 8, Cresppa-CSU)<br />
14 décembre 2016 : Ignorance et inaction publique. Ou comment les<br />
savoirs experts contribuent à l’invisibilité des maladies professionnelles,<br />
Emmanuel Henry (Université Paris Dauphine - Irisso)<br />
25 janvier 2017 : Les politiques du handicap entre santé publique et<br />
lutte contre les discriminations, Jérôme Bas (Université Paris 8,<br />
Cresppa-CSU)<br />
22 février 2017 : Médecins généralistes et santé publique : les reconfigurations<br />
paradoxales du gouvernement des conduites, Géraldine<br />
Bloy (Université de Bourgogne – LEDi)<br />
15 mars 2017 : The Black Panther Party and the Fight against Medical<br />
Discriminations, Alondra Nelson (Columbia University)<br />
19 avril 2017 : Racialisation de la précarité et fléchissement du « social<br />
» aux urgences, Dorothée Prud’homme (Université de Bordeaux<br />
– Centre Émile Durkheim)<br />
24 mai 2017 : Étudier les différenciations sociales des pratiques<br />
médicales, d’un médecin à l’autre et d’un patient à l’autre, Anne<br />
Paillet, Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines – Laboratoire<br />
Printemps<br />
14 juin 2017 : Inégalités sociales et territoriales de santé : le cas des<br />
usagères des centres de Protection Maternelle Infantile (PMI),<br />
Odile Henry (Université Paris 8, Cresppa-LabTop), Pascal Martin<br />
(Université Paris 8, Cresppa-LabTop), Claude Thiaudière (Université<br />
de Picardie Jules Verne – Curapp)<br />
7
Ce projet visait à étudier la prise en compte par les protagonistes<br />
sociaux de la diversité linguistique croissante dans les univers de<br />
travail. Il impliquait six équipes de recherche de différents pays<br />
européens : Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Italie, et<br />
Royaume Uni.<br />
<br />
Les recherches ont mis en évidence l’existence de nombreuses<br />
pratiques informelles en matière d’usage des langues dans les<br />
situations de travail, s’inscrivant le plus souvent en décalage avec<br />
les politiques linguistiques affichées par les entreprises. Ces pratiques<br />
informelles visent tout autant à garantir la bonne réalisation<br />
des tâches qu’à préserver un certain confort émotionnel pour les<br />
salarié·e·s. Elles peuvent aussi s’analyser comme l’affirmation d’un<br />
entre soi de certains collectifs de travail cherchant à protéger leur<br />
autonomie.<br />
Il est toutefois apparu que la diversité linguistique ne constituait<br />
que très exceptionnellement un objet de réflexion pour les partenaires<br />
sociaux. De même sa prise en compte dans les accords collectifs<br />
est extrêmement rare. Dans un contexte marqué par une<br />
internationalisation croissante des entreprises et par des mouvements<br />
migratoires de plus en plus importants, la diversité linguistique<br />
au travail constitue pourtant un véritable enjeu démocratique.<br />
Réunissant une quarantaine de personnes, la séance était<br />
l’occasion pour Anne-Marie Devreux, Maud Gelly et Laure Pitti de<br />
présenter ces deux publications collectives, articulées, pour la<br />
première, autour de l’oubli du genre dans les sciences hors SHS,<br />
notamment en médecine et biologie, et, pour la seconde, autour du<br />
rôle du système, des services et des professionnel·le·s de santé<br />
dans la (re)production des inégalités sociales face à la maladie et la<br />
mort. Cinq contributrices ont présenté leurs travaux sur les effets<br />
de la division sociale et sexuelle du travail sur la santé au travail<br />
(Florence Chappert), sur ce que pourrait produire la prise en<br />
compte du sexe et du genre dans les études médicales du stress<br />
(Marie-Pierre Moisan), sur les effets des réformes de la protection<br />
sociale et de l’hôpital en matière de refus de soins aux étranger·e·s<br />
sans-papiers (Caroline Izambert), et sur les logiques médicales<br />
socialement différenciées de prescription contraceptive (Hélène<br />
Bretin et Laurence Kotobi). Dans sa discussion des communications,<br />
Carole Brugeilles a souligné les implications éthiques et<br />
politiques de ces travaux.<br />
Le projet IR-MultiLing a donné lieu à la production de rapports de<br />
recherche nationaux et comparatifs, ainsi qu’à la rédaction de recommandations<br />
destinées aux partenaires sociaux, aux acteurs<br />
politiques et à la commission européenne. Il a également débouché<br />
sur la production d’un outil de formation audiovisuel proposant des<br />
exercices de théâtre forum à destination des représentants syndicaux.<br />
L’ensemble de ce matériel est consultable et téléchargeable sur le<br />
site : http://www.irmultiling.com.<br />
8
RECHERCHES EN COURS<br />
<br />
Nombreux sont les travaux sur la gentrification pointant les changements<br />
remarquables de l’offre commerciale, mais aucun ne s’est<br />
intéressé de près à ces nouveaux acteurs. L’enquête de terrain, conduite<br />
à Paris entre juillet 2014 et août 2015 les révèle comme une<br />
population en reconversion après des études longues et/ou après<br />
avoir occupé des postes de cadre ou assimilé. Comment comprendre<br />
que ce qui représente un déclassement professionnel et social, selon<br />
des critères socio-démographiques classiques, ne soit ici ni vécu ni<br />
regardé comme tel ? Avant d’ouvrir boutique, ces nouveaux commerçants<br />
étaient eux-mêmes des gentrifieurs résidentiels et c’est seulement<br />
parce qu’ils s’implantent dans un quartier gentrifié ou en passe<br />
de l’être que leur changement d’activité ne représente pas un déclassement<br />
social malgré une forte perte de revenus.<br />
Ces commerçants se distinguent nettement de ceux qui se sont installés<br />
après plusieurs années passées comme ouvriers qualifiés de<br />
l’artisanat commercial ou employés de commerce, à la fois dans leur<br />
personnage social et professionnel, et dans leur rapport à leur activité.<br />
Fleuristes, commerces de bouche (fromagers, pâtissiers ou chocolatiers),<br />
commerces de jouets, de vêtements et accessoires, épiceries<br />
fines-traiteurs et cavistes, ou encore commerces de loisirs créatifs,<br />
ces boutiques sont « une modalité particulière d’appropriation de la<br />
ville et un moyen de mettre en scène [des] propriétés sociales et [un]<br />
mode de vie » (article à paraître dans le prochain numéro d’Ethnologie<br />
française). Par exemple les vitrines, de plus en plus transparentes,<br />
sont le moyen de donner à voir la qualité et la mise en scène d’un<br />
assortiment, et donc les qualités professionnelles et sociales qu’il<br />
suppose. Autre exemple, la boutique est autant que possible un lieu<br />
de sociabilité (coin de convivialité, animations, etc.) associant certains<br />
actes de consommation non pas à la satisfaction de besoins élémentaires,<br />
mais à des pratiques liées à un mode de vie de vie particulier,<br />
et donc les qualifiant en retour.<br />
Toutefois, comme dans toute recherche les pistes émergeant des<br />
données d’entretien et d’observation sont bien plus riches que prévues<br />
et ouvrent de nombreuses autres perspectives d’analyse à approfondir.<br />
<br />
Je m’intéresse ainsi depuis deux ans à la « fabrique » de la vulgarisation<br />
des neurosciences dans le contexte de l’édition parisienne de la<br />
Semaine du cerveau (SdC), principal événement national de promotion<br />
des neurosciences, porté par la Société des neurosciences et des<br />
centaines de bénévoles issu.es des centres de recherches sur tout le<br />
territoire. Cette manifestation est d’autant plus intéressante, qu’elle<br />
se déroule dans un cadre relativement autonome par rapport aux<br />
intermédiaires culturels que j’avais pu identifier dans mes précédents<br />
travaux. La SdC permet d’avoir une idée des conditions et contraintes<br />
d’élaboration de la vulgarisation scientifique sans les « interférences<br />
» les plus visibles du champ de production culturelle. Dans ce<br />
cadre, je participe aux réunions de préparation de la SdC, réalise des<br />
entretiens avec ses organisatrices et assiste aux ateliers et conférences.<br />
Mes travaux s’attachent également à la réception des idées neuroscientifiques.<br />
Dans ce but, je réalise en ce moment une étude de cas en<br />
histoire sociale des idées, portant sur la production et la diffusion de<br />
la notion de cerveau reptilien depuis son origine (années 1960)<br />
jusqu’à nos jours. Je mène cette étude en collaboration avec un directeur<br />
de recherches du CNRS, responsable d’équipe à l’Institut des<br />
neurosciences de Paris-Saclay, Philippe Vernier, qui m’apporte son<br />
éclairage de spécialiste sur les enjeux propres au champ des neurosciences<br />
de cette théorie qui, bien qu’obsolète, continue à susciter<br />
l’intérêt dans de nombreux secteurs du monde social (intervention<br />
psychosociale, éducation…).<br />
Les résultats (provisoires) de ces deux chantiers présentent un point<br />
commun : la centralité de dispositifs discursifs reposant sur les métaphores<br />
et les analogies dans la diffusion des idées neuroscientifiques<br />
dans l’espace public. C’est un résultat qu’il me semble nécessaire<br />
d’explorer pour approfondir la portée sociale des idées neuroscientifiques,<br />
en termes de réception et de réappropriations. En découle<br />
mon projet à moyen terme de me consacrer à la question des métaphores<br />
comme « branche » auxiliaire de l’histoire sociale des idées.<br />
9
SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE<br />
O U V R A G E S , D O S S I E R S D E R E V U E S<br />
<br />
<br />
Une même question a été posée à une équipe de chercheurs<br />
spécialisés dans les relations du travail dans les principales économies<br />
post-industrielles de ce début du XXIe siècle : comment a évolué<br />
la régulation sociale dans les entreprises depuis une trentaine<br />
d’années ?<br />
Leurs réponses montrent que les restructurations économiques,<br />
l’européanisation et la mondialisation ont conduit à<br />
d’importants changements, rarement volontaires, dans les relations<br />
entre les « partenaires sociaux » : organisations syndicales et patronales,<br />
sans oublier l’État, qui joue souvent un rôle d’arbitre. Ainsi, les<br />
modèles nationaux hérités du XXe siècle ont été remis en cause. Les<br />
particularismes se sont effacés pour laisser place à des cadres plus<br />
fragiles et plus fluctuants.<br />
Ce livre dresse un état des lieux précis des principaux changements<br />
qui ont affecté les syndicats et le dialogue social dans les entreprises<br />
en Europe et Amérique du Nord. Il permet de dépasser les<br />
idées reçues concernant les modèles anglo-saxon, scandinave, rhénan<br />
et latin.<br />
Soucieuses d’objectivité, les sciences exactes, expérimentales<br />
ou technologiques n’en sont pas moins imprégnées de stéréotypes<br />
sur les différences et hiérarchies entre hommes et femmes, masculin<br />
et féminin ou mâles et femelles. Trop souvent leurs généralisations<br />
découlent d’un point de vue spécifique masculin ignoré comme tel.<br />
Ce livre dévoile d’abord ce point de vue androcentrique à travers<br />
des revues de littératures faites sous l’éclairage du genre, dans<br />
trois grands domaines disciplinaires : biomédecine et santé ; écologie<br />
et environnement ; technologies et ingénierie. Viennent ensuite des<br />
études de cas qui nous font pénétrer au cœur même des protocoles<br />
de recherche. On y voit comment le sexe mâle ou le cas masculin sont<br />
utilisés comme référents neutres aux dépens, parfois jusqu’à l’oubli,<br />
de l’étude des réalités du cas femelle ou de la situation effective des<br />
femmes.<br />
La dernière partie de l’ouvrage donne un aperçu d’initiatives<br />
tendant à favoriser l’inclusion du genre dans la pratique des scientifiques<br />
ou dans l’action d’institutions utilisant les savoirs scientifiques<br />
et en prise sur la société, notamment sur le monde de l’entreprise.<br />
Ces expériences développées en France ou à l’étranger illustrent les<br />
difficultés rencontrées mais aussi les voies d’évolution possibles.<br />
En réunissant des spécialistes de disciplines variées, neuroendocrinologues,<br />
biologistes, historiennes des sciences, ingénieures,<br />
médecins hospitaliers, spécialistes du développement, géographes ou<br />
sociologues, ce livre invite à réfléchir sur l’apport d’un concept issu<br />
des sciences humaines et sociales aux autres sciences.<br />
<br />
À nombre de consultations égal, on est plus ou moins bien soigné<br />
selon sa classe sociale et son origine nationale. Les malades d’un<br />
cancer sont moins bien informés sur leur maladie par leur médecin<br />
quand ils sont pauvres. Au moment de l’apparition d’une douleur<br />
thoracique, premier signe d’un infarctus, les catégories sociales les<br />
plus favorisées font l’objet d’une prise en charge médicale plus approfondie<br />
et plus spécialisée. Les inégalités sociales qui marquent le<br />
suivi de grossesse sont aggravées par les pratiques des soignants qui<br />
informent moins, et moins bien, les femmes des classes populaires, a<br />
fortiori étrangères. Plus largement, les recommandations médicales<br />
nationales sont moins bien appliquées par les médecins pour les<br />
membres des classes populaires.<br />
10
Corps du malade, du mourant, du mort, du pauvre : au cœur de<br />
nos sociétés contemporaines, des agents administrent pour le monde<br />
social et à sa place les marges de la vie biologique et sociale. Comment<br />
les pompiers, les travailleurs sociaux, les employés des pompes<br />
funèbres, les aides-soignantes, les infirmières et médecins se débrouillent-ils<br />
avec le « sale boulot » ? Parmi les émotions dont ils peuvent<br />
être affectés, il en est une, particulièrement archaïque, apparemment<br />
spontanée et difficile à réprimer : le dégoût. Il renvoie aux<br />
sensations du corps, mais recèle aussi une dimension sociale : pas<br />
seulement dégoût du goût des autres, mais peur de devenir comme<br />
eux, surtout s’ils sont jugés socialement inférieurs. Le dégoût traduit<br />
une urgence à se « séparer ». Réaction somatique à la crainte du<br />
rapprochement physique et social, émotion « mixophobe », le dégoût<br />
trace une frontière avec l’Autre, révélant les inavouables sociaux de<br />
nos sociétés. Cet ouvrage interroge ce que le dégoût « fait » aux<br />
interactions. On y découvre l’opposition radicale entre coulisses et<br />
scène, régie par l’autocensure professionnelle, et les mille stratagèmes<br />
permettant d’affronter ce qui révulse. Limitation du toucher,<br />
port de gants, lavage obsessionnel, embellissement du cadavre et<br />
toilettage des mots eux-mêmes, autant de techniques visant à mettre<br />
à distance la vie organique… des autres. Révélatrice d’une souffrance<br />
spécifique au travail, ces stratégies professionnelles avouent une<br />
ambivalence d’autant plus menaçante qu’elle semble de plus en plus<br />
indicible. Car secrété par le processus de civilisation, le dégoût est<br />
pris dans des interdits sociétaux incitant à le taire. Cela en fait un<br />
instrument d’autant plus précieux de lecture du monde social. Cet<br />
ouvrage apporte ainsi une contribution importante à l’histoire, à la<br />
sociologie et à l’anthropologie des sensibilités.<br />
T R A D U C T I O N<br />
Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet, and Yasmine Siblot<br />
The France of the Little-Middles : A Suburban Housing Development in<br />
Greater Paris, trad. Juliette Rogers, Berghanh Books, coll. « Anthropology<br />
of Europe », 2016 - 224 p.<br />
Traduction de : La France des « petits-moyens ». Enquête sur la banlieue<br />
pavillonnaire, Paris : La Découverte, 2008 - 324 p.<br />
11
A R T I C L E S<br />
Lorenzo BARRAULT-STELLA, « Produire un retrait de l’État acceptable.<br />
Les politiques de fermetures scolaires dans les mondes ruraux contemporains<br />
», Gouvernement et action publique, n°3, 2016 - p. 33–58.<br />
Lorenzo BARRAULT-STELLA, Clémentine BERJAUD et Kevin GEAY, « Distances<br />
à la politique : des banlieues populaires aux beaux quartiers<br />
», Savoir/Agir, n°36, 2016 - p. 83-98.<br />
Lorenzo BARRAULT-STELLA, Sandrine GARCIA et Anne-Élise VÉLU, « Faire<br />
preuve de sa spécificité pour se maintenir. Le travail d’entretien du<br />
territoire professionnel des rééducateurs de l’Éducation nationale<br />
(2007-2015) », Sociologie du Travail, vol.58, n°3, 2016 - p. 296-317.<br />
Lorenzo BARRAULT-STELLA et Nazli NOZARIAN, « La mobilisation<br />
d’étudiants dans une enquête autour de bureaux de vote », Pôle<br />
Sud, n°44, 2016 - p. 21-34.<br />
Baptiste COULMONT, « Des prénoms qui ont du chien. Le partage des<br />
prénoms entre hommes et chiens », Annales de démographie historique,<br />
n°131, 2016 - p. 151–170.<br />
Pierre FOURNIER, Cédric LOMBA et Séverin MULLER, « Enquêter en<br />
milieu rétif. L’industrie pharmaceutique sous observation collective<br />
», ethnographiques.org, n°32, 2016 - en ligne :<br />
http://www.ethnographiques.org/2016/Fournier,Lomba,Muller.<br />
Maud GELLY et Laure PITTI, « Une médecine de classe ? Inégalités sociales,<br />
système de santé et pratiques de soins », Revue Agone, n°58,<br />
2016 - p. 7-18.<br />
Karim HAMMOU, « Mainstreaming French rap music. Commodification<br />
and artistic legitimation of othered cultural goods », Poetics, juin<br />
2016 - en ligne :<br />
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304<strong>42</strong>2X16301188 .<br />
Cédric HUGRÉE, « Les sciences sociales face à la mobilité sociale », Politix,<br />
n°114, 2016 - p. 47-72.<br />
Audrey MARIETTE et Laure PITTI, « Médecin de première ligne dans un<br />
quartier populaire », Revue Agone, n°58, 2016 - p. 51-72.<br />
Léa MORABITO et Camille PEUGNY, « Entre pauvreté et exclusion : des<br />
trajectoires de précaires », Cahiers Français, n°390, 2016 - p. 26-32.<br />
Bernard PUDAL, « Les envoyés de Staline. À propos de : B. Studer, The<br />
Transnational World of Cominternians, Palgrave Macmillan, 2015,<br />
227 p. », La vie des idées, 25 octobre 2016 - en ligne :<br />
http://www.laviedesidees.fr/Les-envoyes-de-Staline.html.<br />
Bernard PUDAL, Gérard MAUGER et Louis PINTO, « Communisme »,<br />
Savoir/Agir, n°37, 2016 - p. 71-82 (Grand entretien avec Bernard<br />
Pudal, réalisé par Gérard Mauger et Louis Pinto).<br />
Yves SINTOMER, « L’ère de la post-démocratie », La revue du Crieur, n°4,<br />
2016 - p. 20-35.<br />
C H A P I T R E S D ' O U V R A G E S<br />
Daniel BIZEUL, « Front national : parti fascisant ou parti banal ? De la<br />
difficulté de se faire un jugement sur une organisation hétérodoxe<br />
», in N. Guillet et N. Afiouni (dirs.) Les tentatives de banalisation<br />
de l’extrême droite en Europe, Éditions de l’université de Bruxelles,<br />
2016 - p. 55-72.<br />
Anne-Marie DEVREUX, « L’androcentrisme des sciences. Des biais de<br />
genre très ’durs’», Introduction de A-M Devreux (dir.), Les sciences<br />
et le genre. Déjouer l’androcentrisme, Presses universitaires de<br />
Rennes, coll. « Essais », 2016 - p. 9-43.<br />
Cédric HUGRÉE, Etienne PENISSAT et Alexis SPIRE, « Salariés du public,<br />
salariés du privé : quelles différences en Europe ? », in M. Méron, M.<br />
Amar, C. Babet (dirs.), ESeG = European Socio economic Groups - Nomenclature<br />
socio-économique européenne, INSEE, coll. « Document<br />
de travail », 2016 - p. 99-110.<br />
Sébastien LEMERLE, « La science en culture », in C. Charles, L. Jeanpierre<br />
(dirs.), La vie intellectuelle en France, vol.2, Paris : Éditions du Seuil,<br />
2016 - p. 125-130.<br />
Sébastien LEMERLE, « Tout est dans la tête. Les sciences du cerveau,<br />
nouveaux savoirs légitimes », in C. Charles, L. Jeanpierre (dirs.), La<br />
vie intellectuelle en France, vol.2, Paris : Éditions du Seuil, 2016 -<br />
p. 551-556.<br />
Delphine NAUDIER, « Les intellectuelles depuis les années 1960 », in C.<br />
Charles, L. Jeanpierre (dirs.), La vie intellectuelle en France, vol.2, Paris<br />
: Éditions du Seuil, 2016 - p. 461-469.<br />
Fabien TRUONG, « La foudre et le tonnerre : discrimination ou stigmatisation<br />
territoriale ? » in C. Hancock, C. Lelévrier, F. Ripoll et S. Weber<br />
(dir.), Discriminations territoriales. Entre interpellation politique et<br />
sentiment d’injustice des habitants, L’Œil d’or, 2016 - p 195-211.<br />
Yves SINTOMER, « Les futurs de la démocratie au XXIe siècle », Raison<br />
publique, n°20, 2016 - p. 175-191.<br />
Yves SINTOMER, « Sorteggio e democrazia deliberativa. Una proposta<br />
per rinnovare la politica del XXI secolo », Nomos. Le attualità del diritto,<br />
n°2, 2016 – 7 p.<br />
C r e s p p a<br />
12