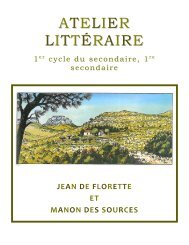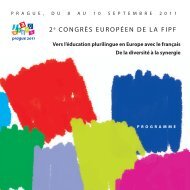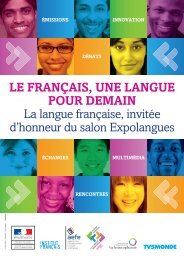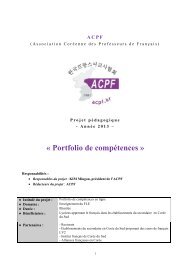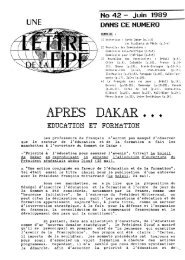- Page 1 and 2: FIPF, au CIEP 1 avenue Léon Journa
- Page 3 and 4: FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFE
- Page 5 and 6: Actes du Xiie co n g r è s m o n d
- Page 7 and 8: Actes du Xiie co n g r è s m o n d
- Page 9 and 10: Actes du Xiie co n g r è s m o n d
- Page 11 and 12: Actes du Xiie co n g r è s m o n d
- Page 13 and 14: Actes du Xiie co n g r è s m o n d
- Page 15 and 16: Actes du Xiie co n g r è s m o n d
- Page 18 and 19: Un Congrès rassemblant 2000 cherch
- Page 20 and 21: Sylvie Boucher Secrétaire parlemen
- Page 22: Allocution de madame Sylvie Boucher
- Page 25 and 26: Je tiens à souligner l’apport tr
- Page 27 and 28: Mais je veux aller plus loin encore
- Page 29 and 30: plus équitable auquel nous aspiron
- Page 31 and 32: Il est des jours comme celui-ci, o
- Page 33 and 34: Sa démarche respecte quelques prin
- Page 35 and 36: considère qu’en promouvant encor
- Page 38 and 39: Pour gérer les langues et les cult
- Page 40 and 41: Márcia Arbex Université Fédéral
- Page 42 and 43: Enjeux sociopolitiques de déséqui
- Page 46 and 47: « Chocolat » Film réalisé par C
- Page 48 and 49: Les deux lectures sont complexes :
- Page 50 and 51: je donc fait ? Simplement donné li
- Page 52 and 53: - La maman Enjeux sociopolitiques U
- Page 54: 6- Expressions écrite et orale Apr
- Page 57 and 58: Il y a dans la poésie québécoise
- Page 59 and 60: epère un élève qui n’apprend p
- Page 61 and 62: - La non-valorisation des apprentis
- Page 63 and 64: maîtrise de la langue à l’écol
- Page 65 and 66: nationale, selon plusieurs niveaux,
- Page 67 and 68: d’une ville, donc pour partie peu
- Page 69 and 70: Analyse du niveau communicationnel
- Page 71 and 72: Pour la préparation aux production
- Page 73 and 74: A supposer qu’un manuel ne propos
- Page 75 and 76: Références bibliographiques Baran
- Page 77 and 78: Taišlová,J. - Bartoš, J. - Hora
- Page 80 and 81: Cristina Boselli Avocate, Professeu
- Page 82 and 83: la Guyane, colonisées par les fran
- Page 84 and 85: Enjeux sociopolitiques à son poids
- Page 86 and 87: Il faudrait se demander également
- Page 88 and 89: Paule Buors, François Lentz Canada
- Page 90 and 91: Enjeux sociopolitiques en français
- Page 92 and 93: Enjeux sociopolitiques autres, du b
- Page 94 and 95:
Enjeux sociopolitiques il y a peut-
- Page 96 and 97:
tel projet, outre qu’il constitue
- Page 98:
Buors, P. et Lentz, F. (à paraîtr
- Page 101 and 102:
par des spécialistes reconnus déc
- Page 103 and 104:
I- De quelques constats sociopoliti
- Page 105 and 106:
maintien. On peut perdre sa langue
- Page 107 and 108:
2.2. La conscientisation aux facteu
- Page 110 and 111:
Bernard Cerquiglini Professeur à l
- Page 112 and 113:
Enjeux sociopolitiques que la langu
- Page 114:
contradiction est dès lors éviden
- Page 117 and 118:
enseignants déjà en fonction. Ni
- Page 119 and 120:
Avant d’aller plus loin dans la r
- Page 121 and 122:
Mais comment entraîner le futur pr
- Page 123 and 124:
spontanément à ce qu’il fait, m
- Page 125 and 126:
qui aient du doigté. En effet, du
- Page 128 and 129:
Apprendre le français dans le mond
- Page 130 and 131:
mot francophonie n’est cité mais
- Page 132 and 133:
3.1. Les images de la langue franç
- Page 134 and 135:
Enjeux sociopolitiques celle-ci est
- Page 136 and 137:
se trouvaient être cantonnées pre
- Page 138 and 139:
La langue française en Algérie, a
- Page 140 and 141:
Enjeux sociopolitiques C’est assu
- Page 142 and 143:
se sentiraient engagés par ce qu
- Page 144 and 145:
Jean-Louis Chiss Université Paris
- Page 146 and 147:
Enjeux sociopolitiques Balkans), el
- Page 148 and 149:
Enjeux sociopolitiques De ce point
- Page 150 and 151:
Fatima Chnane-Davin MCF, Aix-Marsei
- Page 152 and 153:
Les nouveaux arrivants peuvent rele
- Page 154 and 155:
Enjeux sociopolitiques et du citoye
- Page 156 and 157:
Enjeux sociopolitiques de l’insti
- Page 158:
Bibliographie Charaudeau P. (2006)
- Page 161 and 162:
au printemps 2008 et à qui la Fran
- Page 163 and 164:
seuls Français. De même la langue
- Page 165 and 166:
le vieux Bélonie, « vieillard ép
- Page 167 and 168:
Dans cette indécidabilité nationa
- Page 169 and 170:
L’idée de « littérature-monde
- Page 171 and 172:
Soit que l’on ne puisse plus sép
- Page 173 and 174:
Finalement, les manifestants prêch
- Page 175 and 176:
sa vieille maison : dès qu’elle
- Page 177 and 178:
Notes 1 LEBRIS et alt., « Pour une
- Page 179 and 180:
Langues Etrangères (à Kaohsiung)
- Page 181 and 182:
Français eux, sont considérés co
- Page 183 and 184:
hommes et d’un article extrait du
- Page 185 and 186:
Il s’agit ici, d’amener l’app
- Page 188 and 189:
Introduction Mamadou Coulibaly Pré
- Page 190:
Il s’agit enfin d’engager tous
- Page 193 and 194:
un espace de silence et d’enferme
- Page 195 and 196:
à l’intérieur desquelles j’é
- Page 197 and 198:
toutes les langues qui les habitent
- Page 199 and 200:
et ressentis comme incompatibles en
- Page 201 and 202:
Bibliographie Archibald, J. & Chiss
- Page 203 and 204:
1- La communauté de structure coll
- Page 205 and 206:
la stagnation de son propre savoir
- Page 207 and 208:
Les études d’E. Lazega révèlen
- Page 210 and 211:
Alcinéia Emmerick De Almeida Unive
- Page 212 and 213:
Enjeux sociopolitiques classes, cer
- Page 214 and 215:
Enjeux sociopolitiques auxquelles d
- Page 216:
CORACINI, M. J. (org.). Identidade
- Page 219 and 220:
connexes, le recours à Internet pe
- Page 221 and 222:
En quelle année la Société des a
- Page 223 and 224:
Vous méritez maintenant un repos!
- Page 225 and 226:
Annexe A Corrigé du parcours péda
- Page 227 and 228:
Après avoir décrit de façon succ
- Page 229 and 230:
On remarquera que le tutoiement ent
- Page 231 and 232:
fauteuil roulant n’a à aucune oc
- Page 233 and 234:
les « pratiques d’affiliation »
- Page 235 and 236:
Nous avons choisi, pour notre étud
- Page 237 and 238:
jusqu’à la dernière année du s
- Page 239 and 240:
- les 3 cas de figures du processus
- Page 241 and 242:
l’ouverture du monde et de ses fr
- Page 244 and 245:
L’apprentissage du français sort
- Page 246 and 247:
25 lycées de 8 pays d’Europe, on
- Page 248 and 249:
Camilia Faïzova Goulbaram Sadykova
- Page 250 and 251:
des comportements (interprétation
- Page 252 and 253:
compétences à l’écrit ne sont
- Page 254 and 255:
Enjeux sociopolitiques Le présent
- Page 256 and 257:
Valentin Feussi FLSH - Université
- Page 258 and 259:
Cette polyvalence s’inscrit dans
- Page 260 and 261:
traditionnelles, elle favorise « l
- Page 262 and 263:
alors indispensable pour que la com
- Page 264 and 265:
Nous allons voir que la notion de p
- Page 266 and 267:
Etant donné que le discours ne peu
- Page 268 and 269:
Enjeux culturels et littéraires de
- Page 270 and 271:
ois consiste en l’utilisation des
- Page 272 and 273:
3.3 Le stéréotype du porte-parole
- Page 274 and 275:
Le porte-parole comme représentant
- Page 276 and 277:
Certes nous avons été, nous somme
- Page 278 and 279:
c) la substantivité (appelée parf
- Page 280 and 281:
Enjeux culturels et littéraires se
- Page 282 and 283:
temps et la possibilité, qui ne se
- Page 284 and 285:
Discours N°4 Enjeux culturels et l
- Page 286 and 287:
Hamon, P., 1991, La Description Lit
- Page 288 and 289:
Vanessa Gonzaga Nunes Etudiante en
- Page 290 and 291:
Nous exposerons les premiers résul
- Page 292 and 293:
étudiants et à l’institution; c
- Page 294:
apprentissage que le professeur; qu
- Page 297 and 298:
Le CAI est inscrit, depuis la loi d
- Page 299 and 300:
- Parler pour atténuer la souffran
- Page 302 and 303:
Pierre Janin Chargé de mission pou
- Page 304 and 305:
Enjeux pédagogiques et didactiques
- Page 306 and 307:
en lui démontrant une (relative, m
- Page 308:
Escudé, Pierre, 2007a : « Program
- Page 311 and 312:
était question de faire une compar
- Page 313 and 314:
les cultures orientales c’est l
- Page 315 and 316:
de 1971, intitulé La rupture insta
- Page 317 and 318:
Marie-Anne Macé, Le roman au tourn
- Page 319 and 320:
2. Contenus La question d’importa
- Page 322 and 323:
Olga Kassatkina Maître de confére
- Page 324:
L'équipe de la Médiathèque lingu
- Page 327 and 328:
aucunement choisi. Ces dernières r
- Page 329 and 330:
et également parce que son enseign
- Page 331 and 332:
couture/style/fashion/clothes/lovel
- Page 333 and 334:
en classe. Ce double aspect de l’
- Page 336 and 337:
Julien Kilanga Musinde Chef de la d
- Page 338 and 339:
Enjeux sociauxpolitiques vingt univ
- Page 340 and 341:
La réunion des ministres de la Cul
- Page 342 and 343:
L’Océan indien nécessite un eff
- Page 344 and 345:
l’enseignement du français et de
- Page 346 and 347:
aux pays du monde arabe d’obtenir
- Page 348 and 349:
Enjeux sociauxpolitiques donnée ob
- Page 350 and 351:
de référence et la réalisation d
- Page 352:
Notes Enjeux sociauxpolitiques 1 J.
- Page 355 and 356:
américaine des professeurs de fran
- Page 357 and 358:
elles portaient principalement sur
- Page 359 and 360:
La dernière enquête du Centre nat
- Page 361 and 362:
Notes 1 Je voudrais remercier le pr
- Page 363 and 364:
universitaires françaises) véhicu
- Page 365 and 366:
- Sociétés dans toute leur divers
- Page 367 and 368:
Anglicisme Domaine d’emploi Equiv
- Page 370 and 371:
Introduction Je souhaite faire pass
- Page 372 and 373:
Enjeux sociopolitiques raffiné. Le
- Page 374:
Références Cadre européen commun
- Page 377 and 378:
Les recherches toujours plus nombre
- Page 379 and 380:
▪ Des aspects linguistiques : - I
- Page 381 and 382:
leur enseigne leur langue maternell
- Page 383 and 384:
Options didactiques et éducation b
- Page 385 and 386:
Komarek, K. (2004), L’enseignemen
- Page 387 and 388:
Le Ministère de l’Education a d
- Page 389 and 390:
- les programmes ne sont pas vraime
- Page 391 and 392:
Mots-clés : Plurilinguisme, Franco
- Page 393 and 394:
3. Les résultats Comme nous l’av
- Page 395 and 396:
francophone, ce que leur inspire le
- Page 397 and 398:
NUTA : moi aujourd’hui ici E : ou
- Page 399 and 400:
la qualité du français comme l’
- Page 401 and 402:
maintien et le rayonnement du fran
- Page 404 and 405:
Denise Lussier, Ph.D. Université M
- Page 406 and 407:
Les immigrants adultes qui apprenne
- Page 408 and 409:
Enjeux sociopolitiques auxquelles q
- Page 410 and 411:
la compétence interculturelle ne f
- Page 412 and 413:
ne suffit pas d’aligner des prati
- Page 414 and 415:
Il ne faut pas oublier qu’avec la
- Page 416 and 417:
Lucille Mandin Canada Fa i r e v i
- Page 418 and 419:
un pays bilingue et ils en sont fie
- Page 420 and 421:
francophonie. Tel que proposé dans
- Page 422 and 423:
Dra. Mónica Martínez de Arrieta U
- Page 424 and 425:
Enjeux sociopolitiques quand il pen
- Page 426 and 427:
Enjeux sociopolitiques La matière
- Page 428 and 429:
Les décisions des instances - Buca
- Page 430 and 431:
- Les contributions rassemblées da
- Page 432 and 433:
Robert Massart Secrétaire de la CF
- Page 434 and 435:
Enjeux sociopolitiques La visibilit
- Page 436 and 437:
Enjeux sociopolitiques Or les natio
- Page 438 and 439:
croate en passant par le turc, le l
- Page 440 and 441:
En République Démocratique du Con
- Page 442 and 443:
« (…) Sans préjudice des langue
- Page 444 and 445:
l’adaptation des programmes au ni
- Page 446 and 447:
surtout Anglophones, le goût de l
- Page 448 and 449:
du français bascule en ce sens que
- Page 450 and 451:
Alexis Matangila Ibwa Professeur de
- Page 452 and 453:
« Fermez vos yeux charnels, ouvrez
- Page 454:
83 enquêtés (dont 12 D.U, 15 étu
- Page 457 and 458:
Ainsi, le sujet traité se place au
- Page 459 and 460:
poursuite des actions de formation
- Page 461 and 462:
présence de parents ou d’adultes
- Page 463 and 464:
cours, les enseignants utilisent un
- Page 465 and 466:
on se trouve devant des conceptions
- Page 467 and 468:
Par sa nature, il nous parait que c
- Page 469 and 470:
Quand tu vas apprendre une langue,
- Page 471 and 472:
j’aime beaucoup apprendre le fran
- Page 474 and 475:
Appliqué au contexte du Cameroun a
- Page 476 and 477:
l’avenir du français dépend lar
- Page 478 and 479:
gestion linguistique partagée est
- Page 480 and 481:
La mise en place de la politique de
- Page 482 and 483:
et partant, sur les menaces qui pè
- Page 484 and 485:
Enjeux sociopolitiques nature à mo
- Page 486 and 487:
Nguyen Van Hoang Professeur de fran
- Page 488 and 489:
À ce programme, se rajoute l’ens
- Page 490 and 491:
Sur le plan de la gestion, il exist
- Page 492 and 493:
Niyomugabo Cyprien Enseignant de li
- Page 494 and 495:
« votre langue est très compliqu
- Page 496 and 497:
les semi-lettrés (10% et 15% respe
- Page 498:
10. Langues des riches et de la bou
- Page 501 and 502:
Avant de pouvoir commencer le cours
- Page 503 and 504:
d’information permettent de mettr
- Page 506 and 507:
Le malentendu interculturel est dû
- Page 508 and 509:
malentendus, surtout du fait des co
- Page 510 and 511:
Il s’agit ici d’une divergence
- Page 512:
Samovar, L. A., Porter, R.E. Jain,
- Page 515 and 516:
monde, de ce que l’on fait tout n
- Page 517 and 518:
se trouver menacé de disparition i
- Page 519 and 520:
surtout à partir de certaines prat
- Page 522 and 523:
La présente communication rend com
- Page 524 and 525:
3- Méthodologie Dans ce contexte p
- Page 526 and 527:
KO : « Mais on ne se réfère pas
- Page 528 and 529:
Grèce, notamment via Internet, TV5
- Page 530 and 531:
Carole Salmon, Sylvie Dubois Univer
- Page 532 and 533:
Enjeux sociopolitiques En français
- Page 534 and 535:
produisent des traits standards tel
- Page 536 and 537:
leurs niveaux stylistiques sont ré
- Page 538 and 539:
Elena Savélieva Professeur de fran
- Page 540 and 541:
Enjeux sociopolitiques «Est-ce que
- Page 542 and 543:
Une heure après, je rapportais pou
- Page 544:
Aveugle (m), aveuglant, aveugler, a
- Page 547 and 548:
d’apprentissage. Mais en leur lai
- Page 549 and 550:
homophones. Ils lisent donc «parad
- Page 551 and 552:
subordonnée. Nos observations mont
- Page 553 and 554:
langue maternelle domine la langue
- Page 555 and 556:
Выготский Л.С. 1956. И
- Page 557 and 558:
Cette courte période suffit à com
- Page 559 and 560:
« Методика обучени
- Page 561 and 562:
Conclusion L’analyse statistique
- Page 563 and 564:
4 Ce constat concerne toute la dida
- Page 565 and 566:
un processus qui aura à affronter
- Page 567 and 568:
problématiques constituent de sér
- Page 569 and 570:
estiment que derrière la barrière
- Page 572 and 573:
Ilda Thomas School of Language, Med
- Page 574 and 575:
« une discipline intégrant de nou
- Page 576 and 577:
- l’écriture des articles basés
- Page 578:
Bourguignon, C. 2007 «Apprendre et
- Page 581 and 582:
Monde, que la littérature présent
- Page 583 and 584:
a aimé sans chercher à tout prend
- Page 585 and 586:
Se peut-il qu’un des plus grands
- Page 588 and 589:
XIE Yong Université des Etudes ét
- Page 590 and 591:
voir et montrer aux étudiants que
- Page 592 and 593:
L’arrivée en territoire étrange
- Page 594 and 595:
n’est donc pas un livre ouvert qu
- Page 596:
manque de compétence interculturel
- Page 599 and 600:
Les émotions dans l’intercultura
- Page 601 and 602:
l’autre langue et qui les aident
- Page 603 and 604:
qui, selon nous, rend le mieux l’
- Page 605 and 606:
- Repérez dans le la texte le voca
- Page 607:
Fenner A-B., Newby D., (2002), Réf