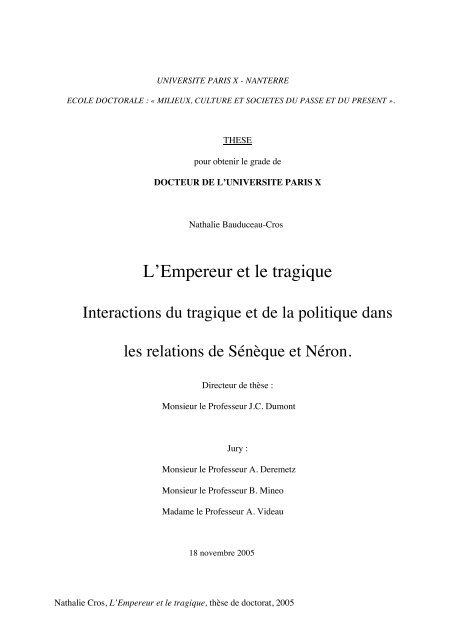manuscrit version 9 - Taberna Latina
manuscrit version 9 - Taberna Latina
manuscrit version 9 - Taberna Latina
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSITE PARIS X - NANTERRE<br />
ECOLE DOCTORALE : « MILIEUX, CULTURE ET SOCIETES DU PASSE ET DU PRESENT ».<br />
THESE<br />
pour obtenir le grade de<br />
DOCTEUR DE L’UNIVERSITE PARIS X<br />
Nathalie Bauduceau-Cros<br />
L’Empereur et le tragique<br />
Interactions du tragique et de la politique dans<br />
les relations de Sénèque et Néron.<br />
Directeur de thèse :<br />
Monsieur le Professeur J.C. Dumont<br />
Jury :<br />
Monsieur le Professeur A. Deremetz<br />
Monsieur le Professeur B. Mineo<br />
Madame le Professeur A. Videau<br />
18 novembre 2005<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005
L’Empereur et le tragique<br />
Interactions du tragique et de la politique dans<br />
les relations de Sénèque et Néron<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005
Résumé<br />
L’empereur et le tragique : interactions du tragique et de la politique dans les relations<br />
de Sénèque et Néron.<br />
Alors qu’il est au cœur de l’analyse et de la condamnation des dérives tyranniques du règne<br />
de Néron, le théâtre est souvent considéré comme marginal par rapport à l’activité politique et<br />
au rôle historique de Sénèque. On se propose dans cette étude d’examiner en quoi la relation<br />
de Sénèque et de Néron est exemplaire des interactions entre tragique et politique. La<br />
première partie envisage la constitution et l’évolution du lien entre l’empereur et le<br />
philosophe, et comment s’affirme, par-delà les divergences, une sensibilité commune pour le<br />
théâtre et la tragédie. La deuxième partie interroge la catégorie du prince tragique, par<br />
laquelle Néron semble pouvoir être défini, et l’apport des tragédies de son ministre, qui<br />
renouvellent et enrichissent une tradition de théâtre politique héritée de la République. Enfin,<br />
la troisième partie étudie ce que le théâtre de Sénèque apporte à la réflexion sur le règne de<br />
Néron, et sur la part d’ombre que recèle le pouvoir absolu.<br />
Mots-clés : Sénèque – Néron – tragédie – principat – politique spectaculaire – tyrannie –<br />
personnage.<br />
Abstract<br />
The Emperor and the Tragic : Tragical and Political Connections in the Relations<br />
between Seneca and Nero.<br />
Although drama is regarded as essential in the analysis and condemnation of Nero’s<br />
tyrannical acts, it is often considered as having little influence on Seneca’s political activity<br />
and historical role. This study examines to what extent the relations between Seneca and Nero<br />
exemplify the close connection between tragedy and politics. The first part deals with the<br />
origin and evolution of the bond between the emperor and the philosopher : beyond their<br />
increasing divergences, Seneca and Nero definitely share a strong liking for drama, and<br />
especially tragedy. The second part investigates the category of tragic prince, in which Nero<br />
may seem to be defined, and the contribution of senecan tragedies, which renew and enrich a<br />
tradition of political drama inherited from the Republic. Finally, the third part studies what<br />
Seneca’s tragedies provide to the reflection about the reign of Nero, and the dark side of<br />
absolute power.<br />
Keywords : Seneca – Nero –tragedy – principate – spectacle policy – tyranny – character.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 1
I/ Présentation du sujet.<br />
INTRODUCTION GENERALE<br />
Le dernier des Julio-Claudiens : la périphrase désigne Néron de manière si habituelle<br />
qu’on en oublie de s’interroger sur son sens. Et pourtant, il est frappant de voir à quel point<br />
l’image de Néron est liée à une certaine idée de la fin, de la chute 1 . Avec lui une dynastie<br />
s’éteint dans le sang et la guerre civile, celle qui avait permis de fonder l’Empire avec<br />
Auguste, sur les traces de Jules César. C’est aussi la fin d’un monde, d’une certaine idée de<br />
Rome, à un moment où le christianisme et ses valeurs annoncent une nouvelle ère. Tels sont<br />
du moins les stéréotypes que lui attache la littérature latine chrétienne, qui fait de lui le<br />
symbole du paganisme, en même temps que celui de la tyrannie 2 . La légende qui entoure ce<br />
prince a en outre une dimension eschatologique, développée par les différentes traditions qui<br />
lui sont hostiles : Néron est associé à la fin du monde, avec l’image cataclysmique de<br />
l’incendie dont on lui a attribué la responsabilité, à tort vraisemblablement. L’éruption du<br />
Vésuve fut, dit-on, précédée de l’apparition d’un faux Néron, annonciatrice de la catastrophe 3 .<br />
1 Le titre de l’ouvrage de M. T. Griffin est révélateur : Nero. The End of a Dynasty, New Haven, 1984.<br />
2 Neronia V. Néron : histoire et légende. Actes du V e Colloque international de la SIEN (Clermont-<br />
Ferrand et Saint-Étienne, 2 - 6 novembre 1994) édités par Jean-Michel Croisille, René Martin et Yves<br />
Perrin. Bruxelles, 1999 : ce volume est consacré à la formation et à l’évolution de l’image de Néron,<br />
depuis l’Antiquité, et présente un état des recherches sur la question.<br />
3 J.-M. Poinsotte, « Un Nero rediuiuus chez un poète apocalyptique du III e siècle (Commodien) »,<br />
Neronia V, 1999, p. 201-213.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 2
Son chiffre, 666, fait de lui l’Antéchrist 1 , figure de l’Apocalypse. Le règne de Néron apparaît<br />
alors comme l’une des premières convulsions de cet empire qui va se dissoudre et s’éteindre<br />
plusieurs siècles plus tard.<br />
Mais à cette figure historique riche de symboles se superpose, en s’en détachant<br />
parfois beaucoup, une figure anhistorique et légendaire qui, elle, s’inscrit dans une série de<br />
commencements : Néron inspire le premier opéra à sujet historique, Le Couronnement de<br />
Poppée de Monteverdi 2 ; le premier film « à l’antique », Néron essayant du poison sur des<br />
esclaves, réalisé un an après l’invention des frères Lumière, par l’Italien A. Promio, en 1896 ;<br />
l’un des premiers longs métrages, Quo vadis ? de E. Guazzoni en 1912 3 . Entre la destruction<br />
et la naissance, la création et l’anéantissement, Néron, dans l’imaginaire collectif, occupe<br />
donc une place charnière, et sa force destructrice se prête à la création artistique et au<br />
spectacle. Racine n’entend-il pas montrer, dans son Britannicus, la naissance d’un monstre ?<br />
Certes l’image de Néron est déplorable dans la tradition, que des études récentes ont<br />
largement contribué à nuancer sans aller toutefois jusqu’à la réhabilitation. Condamnation<br />
radicale ou apologie n’auraient guère de sens du point de vue historique, et les études<br />
modernes montrent la complexité d’un personnage marqué par la chute, et d’un monarque qui<br />
a pourtant voulu être à l’origine d’un monde nouveau, d’un nouvel âge d’or.<br />
Entre naissance impossible et chute irrémédiable, le règne de Néron a une dimension tragique,<br />
que les historiens de l’Antiquité ont mise en valeur, que l’on songe à la structure narrative des<br />
1 L’association de Néron à l’Antéchrist se développe particulièrement au temps de l’Empire tardif et<br />
pendant le Haut Moyen Âge : J. Rougé, 1978, p. 73-87 ; L. Bessone, 1988, p. 51-61. Cette idée ne fait<br />
pourtant pas l’unanimité, combattue notamment par Saint Augustin, Ciuit. Dei, XX, 19.<br />
2 A. Fiaschi, « Néron préside à la naissance de l’opéra : Le Couronnement de Poppée de Cl.<br />
Monteverdi (1642) », Neronia V, 1999, p. 443-456.<br />
3 Telle est la remarque d’Y. Perrin dans son article de synthèse : « En guise de conclusion : l’image de<br />
Néron de sa mort à nos jours. Histoire et mémoire collective », Neronia V, 1999, p. 480.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 3
Annales de Tacite 1 , ou au commentaire de Dion Cassius à la mort du prince, considérée<br />
comme le dernier acte de sa propre tragédie 2 . De fait, du jeune prince, adoré du peuple et<br />
portant tous les espoirs de l’Empire après les dérives du règne de Claude, entraîné au pouvoir<br />
par les intrigues d’une mère qu’il lui faudra supprimer, au tyran que sa propre folie conduit à<br />
l’abandon et à la mort, on peut voir dans le destin de Néron une illustration exemplaire de la<br />
dynamique tragique. Or, c’est précisément son trait de caractère principal qui cause sa perte,<br />
cet amour de l’art et du spectacle qui fait toute l’originalité de la politique néronienne. Poète,<br />
acteur tragique et citharède, Néron vit ce qu’il contribue à représenter, en un dédoublement<br />
vertigineux qui peut faire penser à l’esthétique baroque. L’empereur et le tragique pourraient<br />
alors constituer ses deux facettes.<br />
Dans Le retour du tragique, Jean-Marie Domenach cite cette phrase de Maeterlinck :<br />
« le tragique naît chaque fois qu’un sage ne s’est pas trouvé là» 3 . On peut en effet se<br />
demander si ce fut le cas au cours du règne de Néron : un sage s’est-il trouvé là ? Quels furent<br />
la place et le rôle de Sénèque, et comment concilier l’invasion du tragique avec la présence de<br />
celui que l’hagiographie stoïcienne présente comme un sage, martyr du tyran ? Certes,<br />
l’éloignement de Sénèque correspond à un durcissement du régime, sa mort à un basculement<br />
dans la tyrannie, tandis que les premières années du principat de Néron font souvent l’objet<br />
d’une analyse favorable, compte tenu de l’influence du précepteur du jeune empereur.<br />
Sénèque était un rempart contre la tyrannie, et il l’a payé de sa vie. Cette lecture semble<br />
acceptable si l’on prend comme référence le programme du De clementia, et les prises de<br />
position courageuses du De beneficiis et de certaines lettres à Lucilius. Les passions, et tout<br />
spécialement celles qui, comme la colère, mènent à des conséquences politiques désastreuses,<br />
1 A. Foucher, 2000, p. 773-801 ; F. Galtier, 1999, p. 66-74.<br />
2 63, 28.<br />
3 J.-M. Domenach, Le Retour du tragique, Seuil Point Essais, Paris, 1998, p. 62<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 4
constituent le point critique de la relation entre sagesse et pouvoir. Malgré l’enseignement et<br />
les conseils de Sénèque, Néron s’est laissé emporter par ses passions, qu’il a notamment<br />
exprimées dans sa pratique artistique, et le résultat en est la tyrannie et la mort.<br />
Les tragédies rendent la question plus complexe. Bien entendu, le cas d’un homme<br />
d’Etat ou d’un philosophe auteur tragique n’est pas unique dans l’histoire de Rome, mais<br />
l’œuvre dramatique de Sénèque donne tout de même lieu à des interrogations : comment un<br />
philosophe stoïcien, qui prône la clémence et la maîtrise des passions, et entoure de ses<br />
conseils et de ses avis le personnage le plus puissant du monde connu, peut-il être aussi<br />
l’auteur d’une dizaine de tragédies, témoignage le plus étendu du théâtre tragique romain de<br />
surcroît, dans lesquelles les passions les plus destructrices se déchaînent dans un débordement<br />
de violence et une atmosphère de fin du monde et de destruction totale ? Comment le pouvoir<br />
absolu, qui est autant celui du prince que celui des rois de son théâtre, peut-il donner lieu à<br />
des représentations aussi opposées et incompatibles ?<br />
Il paraît bien difficile d’éluder la question en arguant que, comme dans la Phèdre de<br />
Racine, « les passions n’y sont présentées aux yeux que pour montrer tout le désordre dont<br />
elles sont cause », alors que la tragédie fournit dès l’Antiquité une grille de lecture pour le<br />
règne de Néron. Les interactions entre le tragique et la politique ne naissent pas au premier<br />
siècle (la tragédie est dès l’origine un genre politique), mais pour la période qui nous<br />
concerne, elles paraissent particulièrement riches de sens : la relation de Sénèque et Néron,<br />
souvent réduite aux échanges éducatifs et politiques, doit être envisagée sous cet angle, car<br />
elle met en présence, non seulement un empereur et un philosophe, mais aussi un empereur et<br />
un tragique.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 5
II/ Etat de la question<br />
La vie de Sénèque, qui connut le règne de quatre empereurs, s’est bien souvent<br />
confondue avec l’histoire. Sa carrière politique exceptionnelle pour un homme issu de l’ordre<br />
équestre ne suffit cependant pas à le définir : homme d’Etat, il fut pendant un moment une<br />
personnalité politique de premier plan, mais il était aussi un brillant orateur (encouragé dans<br />
cette voie par son père), un redoutable homme d’affaire, un philosophe de profession (c’est en<br />
tant que tel qu’il adresse à Marcia sa Consolation), et l’un des plus grands littérateurs de son<br />
temps. Ses œuvres en prose sont autant philosophiques que littéraires. Il s’adonna en outre à<br />
la poésie dramatique, et composa des tragédies. Sa longue correspondance avec Lucilius, un<br />
poème satirique, l’Apocoloquintose, des Questions naturelles et d’autres ouvrages perdus<br />
constituent, au côté des dialogues et des tragédies, une œuvre aussi riche que diversifiée. On<br />
comprend dès lors qu’une étude globale d’un personnage qui a marqué à ce point l’histoire<br />
politique, philosophique et littéraire du premier siècle soit pour le moins malaisée. Les études<br />
portent le plus souvent sur un aspect de sa personnalité pour examiner une partie de son<br />
œuvre : les écrits philosophiques, par exemple, sont envisagés d’un point de vue théorique,<br />
pour dégager les principes d’une pensée qui se réclame du stoïcisme 1 , ou dans une perspective<br />
politique, pour éclairer son action auprès de Néron notamment 2 . En ce qui concerne<br />
l’Apocoloquintose, poème satirique qui ridiculise violemment l’apothéose de Claude, la<br />
nécessaire prise en compte du contexte biographique s’impose naturellement.<br />
1 Telle est, par exemple, la démarche de J. Fillion-Lahille, 1984.<br />
2 Ainsi, F. R. Chaumartin, 1985 et 1989.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 6
A/ Les sources.<br />
Philosophe et poète, Sénèque est également un personnage historique impliqué dans<br />
les affaires politiques majeures de son temps, de par ses fonctions auprès de Néron, et ses<br />
écrits. Les historiens anciens mentionnent donc ce personnage, avec plus ou moins de détails,<br />
et en dressent un portrait souvent contrasté. Tacite donne de lui une image relativement<br />
positive dans l’ensemble 1 . Fabius Rusticus, l’une de ses sources, est en effet favorable à<br />
Sénèque 2 . Ainsi, l’historien, qui qualifie l’accusation d’immoralité d’iniuria 3 , souligne<br />
l’intelligence de Sénèque à gouverner, et a des paroles de louanges pour l’équipe qu’il forme<br />
avec Burrus. D’après lui, Néron est devenu un monstre malgré Sénèque, et non à cause de lui.<br />
Tacite le présente comme un brillant écrivain 4 , tout en soulignant au passage sa vanité 5 . Pour<br />
lui, la politique de compromis de Sénèque à l’égard des penchants dissipateurs de Néron n’est<br />
pas indéfendable 6 , même s’il en constate les limites 7 .<br />
Suétone nous livre peu d’indications sur Sénèque. Il apparaît pour la première fois<br />
sous le règne de Caligula, victime de la jalousie du prince qui critiquait le style d’un Sénèque<br />
déjà très en vogue 8 . Deux autres passages évoquent ses fonctions de précepteur auprès de<br />
Néron, et notamment un songe de Sénèque, lui faisant voir qu’il était en charge de l’éducation<br />
de Caligula 9 . Ce songe apparaît sous la plume de Suétone comme une prémonition de la<br />
1 S. L. Dyson, 1970 ; R. Fabbri, 1978-79 ; D. Flach, 1973 ; D. Henry & B. Walker, 1963.<br />
2 Ann. XIII, 20.<br />
3 Ann. XII, 8.<br />
4 Ann. XII, 8 ; XIII, 3.<br />
5 Ann. XIII, 11, 2 ; XV, 63. Il est à noter que le même soupçon de vanité pèse sur Thrasea Paetus.<br />
6 Ann. XIII, 2.<br />
7 Ann. XIV, 14.<br />
8 Cal. 53.<br />
9 Ner. 7.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 7
monstruosité du prince, telle qu’elle devait se révéler par la suite. A la fin du livre consacré à<br />
Néron, Suétone affirme que le philosophe avait détourné le prince de l’étude des auteurs<br />
classiques afin de conserver plus d’ascendant sur son esprit 1 . Enfin, le suicide de Sénèque est<br />
rapidement mentionné, ainsi que son désir préalable de se retirer 2 . Suétone ne donne pas à<br />
Sénèque une place centrale dans sa biographie de Néron, et n’en fait qu’un élément parmi<br />
d’autres de l’histoire de l’évolution désastreuse du prince.<br />
Dion Cassius, dans l’ensemble, se montre plutôt hostile à Sénèque 3 . Certaines<br />
mentions favorables soulignent pourtant la sagesse du philosophe ainsi que son éloquence 4 , et<br />
dénoncent l’injustice du bannissement de Sénèque, faussement accusé par Messaline 5 .<br />
Lorsqu’il occupe des fonctions de ministre, Dion Cassius reconnaît son aptitude à gouverner,<br />
et sa capacité à lutter contre l’influence d’Agrippine 6 . Le principal reproche qu’il fait à<br />
Sénèque n’est cependant pas anodin : c’est son laxisme à l’égard de Néron, qui a conduit à la<br />
catastrophe 7 , son incapacité à le contrôler et à maîtriser ses mauvais penchants. D’ailleurs,<br />
Burrus partage la responsabilité de cet échec. Enfin, le suicide de Sénèque ne lui fait guère<br />
honneur dans la <strong>version</strong> qu’en donne Dion Cassius 8 .<br />
Enfin, les œuvres de Sénèque contiennent des éléments autobiographiques, propres à<br />
enrichir la connaissance de sa vie, et des conditions dans lesquelles s’élabore tel ou tel de ses<br />
1 Ner. 52.<br />
2 Ner. 35.<br />
3 Sur les raisons de cette hostilité, M. T. Griffin, 1976, p. 431 ; I. Munoz Valle, 1975, examine les<br />
charges contre Sénèque, depuis l’Antiquité. Dion Cassius transmet les mêmes accusations que le<br />
premier de ses accusateurs, Suillius, dont Tacite donne par ailleurs une image très négative (Ann. XIII,<br />
42).<br />
4 59, 19, 7.<br />
5 60, 8, 5.<br />
6 61, 4, 1-2.<br />
7 61, 4.<br />
8 62, 25.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 8
écrits, soit qu’il parle en son nom propre pour évoquer tel épisode de sa vie 1 , soit que ses<br />
écrits fassent écho à sa situation particulière 2 .<br />
B/ Etat des études récentes sur Sénèque.<br />
La vie et les écrits de Sénèque sont à la source d’une immense bibliographie 3 . De<br />
nombreux ouvrages, comme celui de J. Fillion-Lahille, mettent l’accent sur l’action politique<br />
de Sénèque, et sur ses liens avec le stoïcisme 4 . I. Hadot insiste sur la dimension pédagogique<br />
des écrits et des actions de Sénèque 5 . Contrairement à I. Lana 6 , selon qui on ne trouve pas<br />
chez Sénèque de doctrine politique cohérente, F. Giancotti 7 et M. T. Griffin 8 consacrent leur<br />
réflexion à l’action politique de Sénèque et à ses fondements idéologiques 9 . Dans cette<br />
1 Par exemple, certains passages des Lettres à Lucilius (dans la lettre 108, 13-23, il évoque des<br />
souvenirs de jeunesse et sa formation philosophique), et bien sûr les Consolations à Helvia et à<br />
Polybe, qui font écho à son exil en Corse.<br />
2 Ainsi, dans le De uita beata, il se défend de certaines accusations (17, sur la richesse du philosophe,<br />
dont le train de vie est celui de Sénèque : il développe un thème certes traditionnel, mais qui le<br />
concerne au premier chef ; 21, 1 sur les contradictions entre les principes du philosophe et sa vie, avec<br />
une allusion particulière à l’exil).<br />
3 Anna Lydia Motto, John R. Clark, Seneca, a Critical Bibliography, 1900-1980 : Scholarship on his<br />
Life, Thought, Prose, and Influence, Amsterdam, 1989 ; B. Seidensticker, D. Armstrong, « Seneca<br />
tragicus 1878-1978 », ANRW II, 32, 2, p. 916-968 ; A.Borgo, « Per una rassegna senecana (1988-<br />
1998), Bolletino di Studi Latini, 1999, 29, p. 159-186 ; F. R. Chaumartin, « Quarante ans de<br />
recherches sur les œuvres philosophiques de Sénèque (1945-1985), ANRW II, 36, 3, p. 1545-1605.<br />
4 J. Fillion-Lahille, 1984.<br />
5 I. Hadot, 1969.<br />
6 I. Lana, 1955, p. 217.<br />
7 F. Giancotti, 1953b, 1953c, 1953d, 1954a et 1954b.<br />
8 M. T. Griffin, 1976.<br />
9 De même, R. Waltz, 1909, et F. Prieto, 1977.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 9
perspective, M. T. Griffin met volontairement de côté les tragédies. Elle met en rapport les<br />
écrits philosophiques de Sénèque et ce que l’on peut connaître de son action politique, afin de<br />
rechercher l’influence du stoïcien sur l’homme d’Etat. Elle a ainsi voulu saisir le personnage<br />
dans son ensemble, pour définir sa cohérence. Mais dans son introduction 1 , elle souligne la<br />
difficulté qu’il y a à relier les activités politiques et littéraires de Sénèque. Tenir compte de la<br />
production dramatique risquerait, selon elle, de compliquer l’étude et d’égarer le lecteur. W.<br />
Calder lui reproche précisément ce parti pris 2 : pour lui, en effet, il est illusoire de prétendre<br />
donner une idée globale d’un personnage comme Sénèque tout en ignorant cette part de son<br />
œuvre.<br />
E. Cizek 3 et P. Grimal 4 , en revanche, consacrent une part de leur étude aux tragédies.<br />
P. Grimal, il est vrai, dans un chapitre séparé, et à la fin de son ouvrage. E. Cizek, car il<br />
accorde une grande importance aux cercles politiques et littéraires qui se développent autour<br />
de personnages influents tels que Sénèque. M. Fuhrmann 5 , envisage également la production<br />
dramatique de Sénèque dans un ouvrage paru récemment, mais qui malgré un titre prometteur<br />
n’apporte pas un éclairage nouveau sur le personnage.<br />
Enfin, Sénèque est souvent considéré comme un opposant à Néron, dans les ouvrages<br />
de G. Boissier 6 , ou de V. Sorensen 7 notamment. Ce n’est pas le moindre paradoxe d’un<br />
homme qui a passé auprès de l’empereur de nombreuses années, qui a contribué à sa<br />
formation et participé à son gouvernement avant de se retirer de la cour. Sénèque apparaît<br />
donc comme un personnage de contrastes et de contradictions : richissime contempteur des<br />
1 p. 28.<br />
2 W. Calder, 1983, et en particulier la note 6, p. 184.<br />
3 E. Cizek, 1972.<br />
4 P. Grimal, 1991a.<br />
5 M. Fuhrmann, 1997.<br />
6 G. Boissier, 1905.<br />
7 W. Sorensen, 1984.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 10
iens matériels, stoïcien et auteur de tragédies dans lesquelles se déchaînent les passions les<br />
plus destructrices, éducateur d’un prince dont la postérité retient avant tout les excès<br />
tyranniques, il conserve sa part d’ombre. Cette complexité est sans doute irréductible, mais<br />
c’est elle qui fait de Sénèque un personnage incontournable pour qui veut étudier le règne de<br />
Néron.<br />
C/ Les tragédies.<br />
Les tragédies constituent une source exceptionnelle sur le théâtre romain, car il s’agit<br />
largement du corpus le plus important qui nous soit parvenu. Le texte en est transmis par deux<br />
traditions, dont la plus fiable est constituée à partir du Codex Etruscus du XI e siècle 1 , et qui<br />
comporte neuf tragédies dont l’une, Les Phéniciennes, est inachevée ou lacunaire. Dans la<br />
tradition A, une tragédie prétexte, apocryphe selon toute vraisemblance, Octavie, fait<br />
apparaître un Sénèque impuissant et sage face au tyran Néron. Le corpus fournit donc un sujet<br />
d’étude de première importance dans le domaine de l’histoire littéraire, qu’on mette en<br />
rapport la production dramatique de Sénèque avec des modèles grecs ou avec ce que l’on peut<br />
supposer de ses prédécesseurs latins 2 . Une telle recherche a pu être complétée par l’étude de la<br />
postérité de l’œuvre de Sénèque et de son influence sur le théâtre élizabéthain et espagnol, sur<br />
celui de la Renaissance française et italienne, ou encore sur la tragédie classique et le théâtre<br />
moderne 3 . Cette influence suffirait à montrer la qualité des tragédies, auxquelles on a<br />
1 O. Zwierlein, 1966.<br />
2 R. J. Tarrant, 1978 ; J. Dangel, 1990 ; P. Grimal, 1963.<br />
3 P. Bacquet, 1960/61 ; K. A. Blüher, 1969 ; E. Paratore, 1975 ; M. Gorrichon, 1991 ; E. Lefèvre (éd.),<br />
1978 ; On trouvera une synthèse de cette question de la postérité du théâtre de Sénèque dans l’ouvrage<br />
de J. C. Dumont et M.-H. François-Garelli, 1998, p. 199-204.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 11
longtemps refusé les qualités poétiques et dramatiques qui ont pourtant assuré sa postérité 1 .<br />
Cette production longtemps dénigrée a fait l’objet d’un intérêt nouveau à partir de la<br />
deuxième moitié du XX e siècle, comme en témoigne l’abondance des études poétiques et<br />
dramatiques qui ont été menées 2 , et qui manifestent un intérêt certain pour le style de<br />
Sénèque, assimilé parfois à une forme de maniérisme et au baroque 3 , mais dont la force et<br />
l’originalité sont désormais bien reconnues 4 .<br />
La prise en compte de l’ensemble de l’œuvre de Sénèque a naturellement amené les<br />
érudits à s’interroger sur les traces de la philosophie, et tout particulièrement du stoïcisme,<br />
dans les tragédies 5 . La vision assez réductrice de ce théâtre comme illustration de la pensée de<br />
Sénèque, comme des exempla qui constitueraient le pendant dramatique des dialogues et des<br />
Lettres 6 a été corrigée et nuancée. En particulier, l’intention parénétique, manifeste dans la<br />
correspondance ou les dialogues de Sénèque, ne suffit pas à expliquer l’intérêt des tragédies 7 ,<br />
qui ne présentent pas une situation d’énonciation suffisamment claire pour que l’on puisse<br />
parler de direction d’âme. Il est malgré tout évident que la pensée de Sénèque imprègne son<br />
théâtre, même si les tragédies révèlent plus de complexité et d’ambiguïté, d’autant plus que la<br />
seule interprétation philosophique, si elle est parfois légitime, ne se révèle pas suffisante,<br />
1 Sur l’évolution de la critique à partir du XIV e siècle, on peut consulter B. Seidensticker & D.<br />
Armstrong, « Seneca tragicus 1878-1978 », ANRW II, 32, 2, p. 916-920, et p. 921 et 924 à propos de<br />
la critique esthétique et dramatique des tragédies. W. M. Calder, 1976b, rappelle cette tradition de<br />
dépréciation, et cite notamment P. J. Enk, « Roman Tragedy », Neophilologus 41, 1957, p. 282-307.<br />
2 D. F. Sutton, 1986 ; M.-H. Garelli-François, 1998b, p. 15-32 ; P. Grimal, 1983. De nombreux articles<br />
du No 49 de la revue Pallas (1998) sont consacrés à l’art dramatique de Sénèque.<br />
3 J. A. Shelton, 1979 ; C. Segal, 1984.<br />
4 « Senecan visionary Drama », dans A. L. Motto, 2001, p. 193-201.<br />
5 C. Auvray-Assayas, 1987. E. Lefèvre, 1969 ; N. T. Pratt, 1948 ; R. G. Tanner, 1984 ; J.-P. Aygon,<br />
1998.<br />
6 F. Egermann, 1940.<br />
7 B. M. Marti, 1945.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 12
comme l’a montré par exemple M. Armisen-Marchetti 1 . Il n’en demeure pas moins que la<br />
cosmologie du cataclysme, la représentation des passions telles que l’ira d’Atrée ou les<br />
développements du chœur sur la royauté du sage renvoient au système philosophique de<br />
Sénèque.<br />
C’est justement l’un des thèmes privilégiés de ce système qui amène à un troisième<br />
type d’approche des tragédies, d’ordre politique cette fois. Il s’agit de la question de<br />
l’exercice du pouvoir absolu, et plus spécialement de ses dérives. Le tyran, figure haute en<br />
couleurs et récurrente des traités philosophiques de Sénèque, est, pourrait-on dire, le<br />
personnage principal de son œuvre dramatique. Dans ses tragédies, Sénèque lui donne la<br />
parole et le montre en action, mettant en application des principes qui s’opposent<br />
diamétralement aux préceptes du De clementia ou du De ira. Dès lors, il a paru intéressant<br />
de faire des tragédies une lecture politique, qui exige la prise en compte de leur contexte de<br />
rédaction, défini au sens large 2 . La crise tragique, qui porte sur l’exercice ou la conservation<br />
du pouvoir, trouve des échos dans la situation du principat et plus spécialement de Néron,<br />
ancien élève et ami de Sénèque 3 . L’interprétation a priori la plus satisfaisante, et qui<br />
confirmait la cohérence de l’ensemble de l’œuvre du ministre et philosophe, consiste à voir<br />
dans les tragédies des œuvres d’opposition 4 , mais plusieurs études ont montré la complexité et<br />
l’ambiguïté des enjeux, et confirmé comme dans le cas de la lecture philosophique, l’absence<br />
d’univocité 5 : le théâtre de Sénèque ne saurait donc être réduit à un ensemble de leçons,<br />
qu’elles soient philosophiques ou politiques.<br />
1 M. Armisen-Marchetti, 1992.<br />
2 E. Lefèvre, 1985.<br />
3 M.-H. Garelli-François, 1994 ; W. M. Calder, 1976 et 1983 ; D. & E. Henry, 1983 et 1985 ; P.<br />
Grimal, 1979 ; A. La Penna, 1980.<br />
4 J. D. Bishop, 1978.<br />
5 W. M. Calder, 1983.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 13
Le théâtre de Sénèque se prête à des lectures plurielles, dont chacune demeure<br />
partielle. Mais l’approche politique des tragédies semble offrir la possibilité d’une unité et<br />
d’une cohérence de ces différentes approches, en les rassemblant et en les dépassant. En effet,<br />
les enjeux politiques permettent de faire le lien entre les différents écrits de Sénèque et sa<br />
carrière : la théorie du pouvoir qu’il développe dans ses traités est à confronter avec<br />
l’enseignement qu’il a dispensé au jeune Domitius, et avec les conseils dont il a entouré le<br />
prince Néron. Les tragédies sont politiques à plusieurs titres : elles exploitent des situations de<br />
crise dans la sphère étroite du pouvoir absolu, et répondent au goût prononcé que Néron avait<br />
pour les spectacles en général, et la tragédie en particulier. Philosophiques, elles reflètent la<br />
pensée de Sénèque et proposent une forme d’incarnation de la réflexion théorique dans des<br />
situations précises. Enfin, elles comportent un enjeu esthétique, dans la mesure où elles<br />
dessinent une image du pouvoir, mais aussi parce que l’art est un aspect important du règne<br />
de Néron. Ainsi, alors que le théâtre de Sénèque est souvent considéré comme périphérique à<br />
son activité politique et à son rôle historique, il pourrait offrir, au contraire, une clef<br />
essentielle à ce personnage et à son œuvre, dont l’unité n’exclut ni la complexité, ni<br />
l’ambiguïté.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 14
III/ Enjeux et limites de l’étude : problématique.<br />
Il est courant de considérer que la relation de Néron et Sénèque doit être pensée selon<br />
la catégorie du prince et du philosophe, ou mieux encore du sage et du tyran. Les traditions<br />
stoïcienne et chrétienne ont entretenu cette opposition, qui tend à faire de Sénèque un martyr<br />
ou un saint, victime de la monstruosité du despote. Si cette vision schématique de la situation<br />
a été depuis largement corrigée et nuancée, la prise en compte des tragédies demeure<br />
marginale et pour ainsi dire, anecdotique. La question de l’empereur et du tragique invite à<br />
une réflexion de plusieurs ordres selon la double relation de Sénèque et de Néron d’une part,<br />
du tragique et de la politique d’autre part. Pour cela, on envisagera la notion de tragique selon<br />
ses différentes acceptions, en privilégiant toutefois dans un premier temps le sens esthétique<br />
et dramatique de l’adjectif, qui placera le spectacle et l’art en position centrale 1 . On se<br />
propose donc dans cette étude de montrer comment la relation de Sénèque et de Néron est<br />
exemplaire des relations entre tragique et politique, et de voir ce que la complexité de ces<br />
interactions apporte à la réflexion sur Sénèque et sur le règne de Néron.<br />
IV/ Organisation d’ensemble.<br />
La relation, complexe et parfois contradictoire, de Sénèque et de Néron doit être, dans<br />
un premier temps, envisagée d’un point de vue historique. En effet, entre le moment où le<br />
philosophe se vit confier par Agrippine l’éducation du jeune Domitius, alors âgé de douze<br />
1 Sur la question de la notion de tragique à Rome, on peut lire l’article synthétique de M.-H. Garelli-<br />
François, « Rome et le tragique, questions », Pallas 49, 1998, p. 9-19.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 15
ans, et la disgrâce du ministre et proche conseiller du prince, impliqué par la suite dans une<br />
conspiration qui provoqua sa perte, les rapports de ces deux personnages ont évolué et révélé<br />
autant leurs points communs que leurs désaccords. Dans cette perspective, le rôle de Sénèque<br />
dans l’éducation de Néron apporte un éclairage essentiel, car les enjeux de cet enseignement<br />
et la place de la formation artistique permettent de répondre partiellement à la question de<br />
l’attitude de Sénèque face au goût de Néron pour le spectacle. De fait, le point critique est<br />
celui de l’art, c’est pourquoi il faudra se demander comment les aspirations artistiques du<br />
prince se sont imposées, avec quelles impulsions et quelles résistances, notamment de la part<br />
de Sénèque. L’affirmation de la politique néronienne en matière de spectacles, dont le centre<br />
absolu est le prince-artifex, ne trouve pas dans l’échec supposé du philosophe une réponse<br />
satisfaisante car, comme on tentera de le démontrer, la rupture entre Néron et Sénèque n’a<br />
justement pas cette prétendue contradiction pour cause. Au contraire, la particularité de cette<br />
rencontre du prince et du philosophe ne réside-t-elle pas dans une pratique privilégiée de la<br />
tragédie ?<br />
L’étude des interactions du tragique et de la politique, particulières au règne de Néron,<br />
dans l’exercice du pouvoir, nécessite une mise au point sur le type d’activité artistique qu’il<br />
pratique et leurs implications politiques. La notion de « prince tragique » doit en effet être<br />
précisée par la prise en compte de disciplines telles que la citharédie et la tragoedia cantata,<br />
qui empruntent leur répertoire à la tragédie tout en permettant une activité de soliste et de<br />
virtuose propre à satisfaire les ambitions de Néron. Il reste le maître de Rome et du monde, en<br />
même temps qu’il s’affirme comme artifex, menant une véritable carrière, et comme héros de<br />
tragédie puisqu’il se plaît à souligner la parenté de sa vie et des mythes qui inspirent ses<br />
chants. Dès lors, la contradiction est en outre interne au prince, puisque les fonctions<br />
artistique et impériale sont traditionnellement présentées comme incompatibles. Et pourtant,<br />
les interactions entre tragédie et politique sont nombreuses et fondamentales pour un régime<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 16
tel que le principat, qui y trouve une forme d’expression. Les tragédies de Sénèque, qui<br />
s’inscrivent dans une tradition de théâtre politique particulièrement adaptée au type de<br />
pouvoir exercé par Néron, peuvent être lues dans cette perspective.<br />
Enfin, on se posera la question de la lecture politique que l’on peut proposer du théâtre<br />
de Sénèque, lecture à laquelle les deux premières parties engagent, et dont la pertinence est<br />
confirmée par l’ancrage des pièces de Sénèque dans la réalité de son temps, qui invite à mettre<br />
en regard entre le mythe et l’actualité, les réalités romaines et les problématiques impériales.<br />
La tentation de voir dans les tragédies des allusions à Néron ne peut réduire la complexité et<br />
la richesse de ces œuvres, qui ne se prêtent guère à une interprétation univoque. En effet,<br />
Néron, figure de référence hors-scène, artiste et prince à la fois, apparaît à bien des égards<br />
comme le destinataire privilégié des tragédies, qui contribuent à créer les conditions d’un<br />
passage entre mythe et réalité, dont on cherchera une confirmation dans l’étude de l’Octavie<br />
du Pseudo-Sénèque.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 17
PREMIERE PARTIE<br />
LA RENCONTRE DU PRINCE ET DU PHILOSOPHE<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 18
Introduction<br />
Qu’un philosophe se mette au service d’un prince ou d’un roi semble une promesse de<br />
bon gouvernement, d’un pouvoir exercé selon les principes de la justice et de la sagesse.<br />
Sénèque peut se prévaloir d’une longue période d’influence sur Néron, dont il devint le<br />
précepteur, puis le ministre et proche conseiller. Pourtant tout semble opposer, ces deux<br />
personnages : le philosophe, adepte du stoïcisme, prônait la maîtrise des passions, la pratique<br />
de la clémence, et le détachement face aux désirs et aux frayeurs qui d’ordinaire brident les<br />
hommes. Son souverain et disciple, non content de s’éloigner des préceptes enseignés par<br />
Sénèque, a laissé le souvenir d’un tyran cruel, asservi par les passions les plus ravageuses, et<br />
sa fin lamentable est comme la conclusion de son évolution désastreuse. Alors, comme Platon<br />
face à Denys, Sénèque aurait échoué, dans son projet d’expérience politique et philosophique,<br />
à faire du souverain un gouvernant lui-même dirigé par la raison, une image humaine du<br />
principe ordonnateur qui régit l’univers. Deux figures archétypales s’opposeraient dès lors,<br />
celles du despote et du sage, et l’on pourrait s’écrier avec Diderot : Sancte Seneca ! 1<br />
Une telle présentation est soumise à une lecture politique, mais aussi à un jugement :<br />
la philosophie en effet peut être l’adjuvant du pouvoir, comme dans le cas de la théorie du<br />
despotisme éclairé, mais dans les faits il y a souvent contradiction qui revient à l’opposition<br />
entre théorie et pratique. Penser la relation de Sénèque et Néron selon la catégorie de la<br />
1 Diderot, Essai sur les règnes de Claude et Néron, in Œuvres, t. 1, Robert Laffont, « Bouquins »,<br />
1993, 40, p. 1163.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 19
encontre du pouvoir et de la philosophie, c’est prendre l’image à la fois la moins précise et<br />
la plus répandue, dans le cadre d’une vision sans doute simplificatrice, mais qui offre<br />
toutefois un angle d’approche. Cette présentation sonne en effet comme un idéal (associer le<br />
pouvoir et la sagesse), mais elle appelle un jugement. Le philosophe a-t-il réussi à réaliser cet<br />
idéal ? A priori la réponse est non, dans le cas de Sénèque : l’évolution du règne de Néron et<br />
la mort de Sénèque témoignent de divergences inconciliables, et, finalement, de l’échec de<br />
l’un comme de l’autre. Cependant, si la formule de la « rencontre du prince et du philosophe »<br />
relève à certains égards d’une image figée, elle permet d’examiner en quoi la relation<br />
effective de Sénèque et de Néron s’éloigne du cliché, et dépasse les catégories sur lesquelles<br />
elle s’appuie tout d’abord.<br />
C’est pourquoi il convient, dans un premier temps, de poser la question de la<br />
contradiction apparente : l’examen de la carrière et de la vie de Sénèque auprès de Néron<br />
explique et expose une grande familiarité entre ces deux personnages. Si l’on peut définir un<br />
programme politique philosophique, l’originalité et la force de leur relation repose sur une<br />
sensibilité commune pour le théâtre, qui perdure au-delà des divergences, qui apparaissent<br />
très tôt, et tournent ensuite à l’affrontement. En réalité, cet éloignement progressif, politique<br />
et idéologique, finit par révéler une proximité permanente. La contradiction ne serait-elle pas<br />
plutôt significative de la complexité et de la particularité de cette rencontre ?<br />
Ensuite, on pourra se demander d’où vient le goût de Néron pour le théâtre, qui<br />
constitue le point d’intimité constant entre le prince et celui qui fut son précepteur. Cette<br />
proximité ne prend-elle pas sa source dans la formation, dans laquelle Sénèque a une grande<br />
part ? C’est la question de l’échec qui se pose alors, après celle de la contradiction.<br />
Enfin, on envisagera la dimension politique de la question, sous l’angle d’une autre<br />
contradiction, centrée cette fois davantage sur Néron, et qui met en relation l’art et la<br />
politique. A chacune des étapes de la réflexion sur les origines et les manifestations de ce qui<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 20
constitue l’aspect le plus spectaculaire, et, à bien des égards, l’un des plus significatifs, du<br />
règne de Néron, la présence de Sénèque nous amènera donc à nous interroger sur son rôle<br />
effectif.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005. 21
Chapitre 1. Un philosophe stoïcien au service d’un empereur<br />
histrion : contradiction ou constat d’échec ?<br />
La tyrannie de Néron se manifeste, d’après la tradition, par sa passion pour le chant, et<br />
ses aspirations artistiques constituent un élément essentiel de la condamnation dont il a fait<br />
l’objet. Bien plus, c’est la politique artistique de Néron qui fait l’originalité de son règne. On<br />
peut, dès lors, se demander ce qui a rendu possible une telle évolution, et quelle place a pu<br />
prendre la poésie dans l’enseignement de Sénèque, qui était aussi un auteur tragique. C’est<br />
pourquoi il convient, dans un premier temps, d’examiner la biographie du philosophe, telle<br />
que le témoignage des sources et de ses propres écrits nous permet de la retracer, et tout<br />
particulièrement la naissance et l’évolution de ses relations avec Néron, dont il fut le<br />
précepteur, puis le principal conseiller avant de tomber en disgrâce et de devoir se donner la<br />
mort. Sénèque a connu une carrière exceptionnelle, dont l’apogée correspond à la période<br />
d’influence qu’il exerça en tant que ministre du prince et membre éminent du consilium<br />
principis. Son déclin, signe de l’éloignement de son élève, sa disgrâce et son suicide, ne<br />
suffisent pas à annuler la grande proximité qui l’unit à Néron, et dont l’origine doit être<br />
recherchée dans l’enseignement de Sénèque.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
22
I/ Un brillant parcours : l’ascension de Sénèque et l’accession de Néron au<br />
pouvoir.<br />
A/ Sénèque avant sa rencontre avec Néron.<br />
Cordoue, constate Martial, peut s’enorgueillir d’avoir vu naître les deux Sénèque et le<br />
poète Lucain 1 . Lucius, cadet des trois fils du rhéteur Marcus Annaeus Seneca, qui appartenait<br />
à l’ordre équestre et possédait une fortune considérable, est né sous le règne d’Auguste,<br />
probablement en 1 av. J.-C 2 . La formation du jeune Sénèque, venu très tôt à Rome, est celle<br />
d’un jeune homme de bonne famille promis à un brillant avenir. Adolescent, il reçoit les<br />
leçons d’un pythagoricien, Sotion, dont il épouse avec enthousiasme la doctrine et les<br />
préceptes, avant d’en être découragé par son père, qui craignait la répression mise en place par<br />
Tibère à l’encontre des sectateurs de certains cultes, notamment égyptiens et juifs, qui<br />
préconisaient les mêmes interdits alimentaires 3 . Dans ses lettres, Sénèque cite également<br />
Attale, philosophe stoïcien dont il a suivi l’enseignement 4 . Il fut vraisemblablement pour lui<br />
un maître influent, dont la pensée l’a profondément influencé. Mais la philosophie de Sénèque<br />
n’est pas réductible à une école. Il admire ainsi l’indépendance de Demetrius le Cynique 5 , il<br />
1 Martial, I, 61, 7-8.<br />
2 P. Grimal, 1991a, p. 56-58, admet la date proposée par F. Préchac, 1934, p. 360 et suiv., car elle ne<br />
pose aucun problème de vraisemblance, et se voit confirmée par les étapes du cursus honorum de<br />
Sénèque.<br />
3 Ep. 108, 22.<br />
4 Ep. 9, 6 ; 108, 13.<br />
5 Vit. 18, 3 ; Ep. 66, 14 ; 91, 19 ; 20, 9-10.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
23
cite souvent Epicure 1 , dont il souligne l’austérité de la doctrine, contre ses prétendus disciples<br />
qui déforment sa pensée pour justifier leur recherche du plaisir. Cette grande liberté<br />
intellectuelle est due en partie au fait que Sénèque se soucie plus d’efficacité pratique que de<br />
développements théoriques : (philosophia) non in uerbis, sed in rebus est 2 . Plus que le<br />
membre docile d’une école, le philosophe est pour lui le pédagogue du genre humain , un<br />
homme engagé dans les choses du monde.<br />
La santé fragile de Sénèque, et la présence dans la province de son oncle C. Galerius,<br />
qui y occupe les fonctions de préfet, sont sans doute à l’origine du voyage en Egypte, où il<br />
séjourne six ans : il visite le pays, s’intéresse à sa culture et se lie avec Chaérémon 3 , qui<br />
participe par la suite à la formation du jeune Néron. De retour à Rome il est nommé questeur<br />
grâce au crédit et aux sollicitations de sa tante, sœur d’Helvia et femme de C. Galerius 4 .<br />
Sénèque se mêle alors à la vie mondaine, où il brille par son éloquence et son esprit 5 , et<br />
remporte des succès oratoires au Sénat, qui lui valent la haine de Caligula 6 . Sénèque fréquente<br />
alors la meilleure société de Rome, il est notamment lié avec les princesses, sœurs de<br />
Caligula, que séduisaient l’agrément de sa conversation et la profondeur de sa pensée 7 . C’est à<br />
cette époque qu’il gagne la confiance d’Agrippine, qui se souviendra de lui lorsqu’elle<br />
songera à former son fils Néron pour le pouvoir.<br />
1 Const. 15, 4 et 16, 2, par exemple. Dans ces passages, Sénèque montre la proximité des pensées<br />
stoïcienne et épicurienne, au sujet de l’attitude du sage à l’égard des richesses et des injures.<br />
2 Ep. 16, 3.<br />
3 Ep. 42, 1 ; 51, 3-13 ; 38, 4 ; Nat. 3, 12, 2 ; 4, 25 ; 7, 3, 2.<br />
4 Helu. 19, 2.<br />
5 Tacite, Ann. XII, 8 et XIII, 3.<br />
6 Dion Cassius, 59, 19, 7 : par jalousie, Caligula envisage de le mettre à mort, mais il l’épargne en<br />
comptant sur sa mauvaise santé.<br />
7 R. Syme, 1963, p. 536.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
24
La première année du règne de Claude 1 , Sénèque est impliqué dans une intrigue de<br />
palais et accusé par Messaline d’adultère avec Julia Livilla, fille de Germanicus 2 . La nouvelle<br />
impératrice a triomphé de ses rivales, et elle règle ses comptes. Au passage, elle se débarrasse<br />
de Sénèque qui pouvait apparaître comme une figure dangereuse de l’opposition sénatoriale 3 .<br />
La peine de mort est cependant adoucie, et Sénèque est relégué en Corse 4 sans espoir de<br />
retour. Il passe huit ans dans cette île sauvage, entre amertume et désespoir. Il rappelle<br />
cependant son existence par la Consolation à Helvia et donne de lui-même une image élevée,<br />
inaccessible aux tourments de l’exil 5 . Il tente cependant de fléchir l’empereur, et d’obtenir son<br />
rappel dans la Consolation à Polybe, mais en vain.<br />
B/ Le retour d’exil et le préceptorat de Néron.<br />
La chute de Messaline et sa mort à la fin de l’été 48 créent les conditions favorables au<br />
retour en grâce de Sénèque : Agrippine l’emporte sur les autres prétendantes, et épouse<br />
quelques mois plus tard son oncle à la faveur d’un décret du Sénat 6 , qui lave officiellement<br />
cette union de sa charge incestueuse. La nouvelle impératrice, mue comme le dit Tacite par<br />
1 P. Grimal (1978, p. 469-78) étudie la portée historique et politique des trois traités écrits pendant le<br />
règne de Claude, De ira, la Consolation à Polybe et le De breuitate uitae.<br />
2 Dion Cassius, 60, 8, 5.<br />
3 P. Grimal, 1991a, p. 90-95. Le précédent de la conjuration de M. Aemilius Lepidus et Cornulius<br />
Lentulus Gaetulicus, soutenus par Agrippine et Julia Livilla, pouvait faire craindre de semblables<br />
menées contre Claude. Réduire à néant de tels opposants renforçait le régime : Tacite, Ann. VI, 30.<br />
4 F. Giancotti, 1953b, examine quelques unes des charges contre Sénèque : l’accusation d’adultère, ses<br />
flatteries à Polybe, après la noble posture de la Consolation à Helvia sur l’exil, et les contradiction<br />
entre ses flatteries à Claude dans la Consolation à Polybe et les violentes attaques de<br />
l’Apocoloquintose.<br />
5 J. Fillion-Lahille, 1989 ; Helu. 13, 8 et 20, 1.<br />
6 Tacite, Ann. XII, 6.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
25
l’ambition, spes dominationis 1 , doit affermir son autorité et étendre son influence, face aux<br />
amici de Claude qui ne lui sont guère favorables. Elle fait éliminer une ancienne rivale, Lollia,<br />
en recourant à des accusations que leur variété aurait pu rendre suspectes 2 . Elle renforce sa<br />
puissance en intriguant pour que Burrus devienne seul préfet du prétoire, comptant sur la<br />
gratitude de ce dernier et sur la fidélité qui en résulterait 3 .<br />
Aussi, la fille de Germanicus ne nourrit pas de petits projets politiques. C’est Néron, le<br />
fils qu’elle a eu avec Domitius Ahenobarbus, qui porte tous ses espoirs : elle le fait adopter<br />
par Claude 4 , fiancer à Octavie 5 , et lui fait revêtir la toge virile avant l’âge, au cours de<br />
festivités qui donnent au jeune homme tout le lustre et l’apparence de l’héritier légitime du<br />
pouvoir 6 . Agrippine multiplie les intrigues pour affirmer sa domination et préparer les<br />
conditions de l’avènement de Néron. Ses entreprises prennent toutes les directions, elle va<br />
jusqu’à faire fonder une colonie de vétérans, afin, dit Tacite, de manifester aux yeux des<br />
nations alliées son pouvoir 7 . Son influence apparaît en toute chose, mais l’impression<br />
d’éparpillement que donne son activité ne lui fait pourtant pas perdre de vue le but unique<br />
qu’elle s’est fixé : conquérir le pouvoir pour son fils, et l’exercer à travers lui 8 .<br />
Le rappel d’exil de Sénèque est une des pièces de cet édifice 9 . Le choix du philosophe,<br />
exilé et vieilli, s’explique de plusieurs manières : Agrippine se souvient de l’éloquence du<br />
philosophe, et sait que c’est une qualité pour un empereur, une manière pour lui de conquérir<br />
les cœurs et de s’attacher ses troupes, en particulier les prétoriens dont le rôle dans la<br />
1 Tacite, Ann. XII, 8.<br />
2 Tacite, Ann. XII, 22.<br />
3 Tacite, Ann. XII, 42.<br />
4 Tacite, Ann. XII, 25.<br />
5 Tacite, Ann. XII, 9.<br />
6 Tacite, Ann. XII, 41.<br />
7 Tacite, Ann. XII, 27. H. Schmitz, 1955.<br />
8 L. W. Rutland, 1978-79.<br />
9 60, 32, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
26
proclamation de l’empereur est essentiel. Elle compte donc donner à son fils, en cette matière,<br />
la meilleure formation qui soit. Une autre explication tient davantage de ce que nous<br />
appellerions la communication : Sénèque est populaire, il est apprécié par l’aristocratie et le<br />
Sénat, il va aider Agrippine à grossir les rangs de ses partisans, tout en lui offrant une caution<br />
morale. Qu’elle se soit attaché Sénèque en lui prodiguant ses faveurs est une possibilité 1 ,<br />
Agrippine ayant eu d’autres fois recours à cette manœuvre 2 .<br />
Sénèque se voit donc chargé de l’éducation de Néron 3 , et se fait le complice de la constitution<br />
de son pouvoir. Il est nommé préteur, et se trouve engagé dans les luttes politiques<br />
contemporaines 4 .<br />
C/ La période d’influence de Sénèque.<br />
Sénèque poursuit naturellement son influence auprès du prince lors de son accession<br />
au pouvoir et pendant les premières années de son règne 5 . Il contribue à installer le prince<br />
dans ses nouvelles fonctions, et à affermir son autorité en composant le discours funéraire de<br />
Claude 6 . Il rédige aussi le discours aux Prétoriens et au Sénat 7 . L’Apocoloquintose et De<br />
11 En l’absence d’autres témoignages, F. Giancotti, 1953a, admet ce que dit Dion Cassius : si Sénèque<br />
et Agrippine ont eu une liaison, sa date probable est pendant les cinq années suivant le retour d’exil de<br />
Sénèque en 49.<br />
2 Tacite évoque ses relations avec Pallas : Ann. XII, 25 ; Tigellin, aux dires de Dion Cassius, avait été<br />
exilé en 39 sur l’accusation d’adultère avec Agrippine (59, 23, 9).<br />
3 La question du préceptorat de Néron est étudiée par F. Giancotti, 1953c.<br />
4 M.T. Griffin, 1976, p420-421. Sur l’éducation de Néron, voir le chapitre 2 : « l’éducation de Néron et<br />
la place des activités artistiques ».<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 52 ; P. Grimal, 1976.<br />
6 Tacite, Ann. XIII, 3 ; Quintilien, I. O. VIII, 5, 18.<br />
7 Dion, 61, 3, 1 ; W. T. Avery, 1959.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
27
clementia 1 , rédigés dans les premières années du règne 2 , marquent la rupture entre le<br />
principat de Claude et les promesses de l’avènement de Néron, en proposant une conciliation<br />
entre les valeurs romaines et une théocratie solaire héritière de la doctrine antonienne.<br />
Sénèque se fait ainsi le théoricien du nouveau régime. Selon P. Grimal, le premier livre du De<br />
clementia 3 , seul complet, a pour origine un discours peut-être prononcé par Sénèque le 1 er<br />
janvier 56, lors de la uotorum nuncupatio, au Capitole 4 .<br />
Les premières années du règne de Néron sont aussi le théâtre d’une lutte de Sénèque<br />
contre l’influence d’Agrippine 5 , en collaboration avec Burrus 6 . La stratégie mise en place par<br />
la « meilleure des mères 7 » devait faire des deux hommes des créatures dociles, propres à<br />
relayer auprès du nouvel empereur l’influence maternelle. Elle n’avait sans doute pas prévu,<br />
ou peut-être avait-elle sous-estimé, une telle résistance, renforcée par une communauté de<br />
vues. Tacite présente clairement les deux factions, l’une menée par Sénèque et Burrus, qui<br />
réalisent l’exploit de s’accorder dans le partage du pouvoir 8 , l’autre par Pallas et Agrippine.<br />
Celle-ci a pu venir à bout de Domitia Lepida, dont l’influence sur Néron, exercée par la<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 11.<br />
2 Respectivement en 54 et 56.<br />
3 Sur la portée politique du De clementia et ses fondements philosophiques, M.T. Griffin, 1976, p 133-<br />
171 ; F. Giancotti, 1954a, propose la date de 56.<br />
4 P. Grimal, 1976, p. 171.<br />
5 F. Giancotti, 1953d.<br />
6 E. Cizek, 1972, p. 76. M. T. Griffin, 1976, p. 421-423 ; D. Gillis, 1963, p. 5-22, propose une analyse<br />
critique des portraits de Burrus et Sénèque, dont l’intérêt qu’ils prennent aux affaires de l’Etat est<br />
présenté sous un jour favorable, contrairement à ce qu’affirme B. Walker (Annals of Tacitus, 2 e éd.<br />
1960).<br />
7 Suétone, Ner. 9, 3 ; Tacite, Ann. XII, 2, 3 ; les monnaies émises à cette époque témoignent par<br />
ailleurs de cette déférence pour Agrippine : E. M. Smallwood, 1967, p. 106-107.<br />
8 Tacite, Ann. XIII, 2, 1. Tacite note ailleurs (XIII, 17, 1), dans une formule célèbre, que le pouvoir ne<br />
se laisse pas partager : insociabile regnum.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
28
douceur, lui portait ombrage 1 , mais elle a trouvé dans l’entourage de son fils des adversaires<br />
bien plus redoutables. Les honneurs inhabituels et excessifs reçus par Agrippine après la mort<br />
de Claude ont pu provoquer la méfiance et l’hostilité de Sénèque et de Burrus, comme signe<br />
d’une volonté de domination : elle avait déjà reçu le titre d’Augusta, à la suite de l’adoption<br />
de Néron, et comme son fils se voit honorée d’un nouveau cognomen 2 . Tacite montre que<br />
cette accumulation de distinctions n’est qu’une manœuvre, comme d’ailleurs les<br />
manifestations de piété à l’égard de Claude, tristitiae imitamenta 3 . Agrippine est comblée<br />
d’honneurs et de privilèges 4 , mais le pouvoir lui échappe, et elle a tôt fait de le remarquer.<br />
Chez Dion Cassius, la prise de contrôle de Burrus et Sénèque commence après l’incident de<br />
l’ambassade arménienne 5 , et que Tacite date de l’année 54 6 : sur les conseils de Sénèque,<br />
Néron arrête la tentative de sa mère de siéger à ses côtés pour recevoir les ambassadeurs<br />
d’Arménie, par un geste qui pouvait passer pour une manifestation de respect filial. Le type<br />
de manœuvre adopté, l’apparence de pietas destinée à sauver les apparences et à confiner<br />
Agrippine dans son rôle de mère pour lui dénier toute influence véritablement politique,<br />
montre une continuité certaine avec les débuts du règne. Sénèque et Burrus tentent d’éviter<br />
une crise ouverte qui ébranlerait un pouvoir encore mal assuré.<br />
Les incidents que provoquent la liaison de Néron avec Acté 7 , l’année suivante,<br />
confirment et accentuent l’éloignement d’Agrippine. Sénèque favorise ces amours, tandis<br />
qu’elle s’y oppose. Acté comble le prince sans que les conséquences s’en fassent sentir, et son<br />
1 Tacite, Ann. XII, 64.<br />
2 Tacite, Ann. XII, 26.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 4, 1.<br />
4 Elle avait, par exemple, conservé la garde militaire qui lui était échue comme épouse de Claude, et<br />
Néron lui avait ajouté des soldats germains comme garde du corps : Tacite, Ann. XIII, 18, 3.<br />
5 61, 3, 3- 4.<br />
6 Ann. XIII, 5, 2.<br />
7 Dion Cassius, 61, 7, 1 ; Tacite Ann. XIII, 12.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
29
influence en fait une alliée précieuse pour ses ministres. Pour Agrippine, Acté est au contraire<br />
une rivale, et elle sent bien que son fils échappe de cette manière à son contrôle, ce qu’elle ne<br />
peut supporter, car elle voit son pouvoir encore diminué. Les accusations d’inceste, quoique<br />
invérifiables, sont de toute manière le signe qu’Agrippine ne s’est pas rendue si facilement, et<br />
qu’elle a pu tenter l’impossible pour reconquérir le crédit qu’elle avait perdu auprès de son<br />
fils. Cet épisode marque donc la fin de l’influence d’Agrippine sur la vie personnelle du<br />
prince, après sa déroute politique.<br />
La riposte de la mère du prince est politique, et ses menaces placent de nouveau<br />
Britannicus sur le devant de la scène 1 . Le fils légitime de Claude pouvait apparaître comme<br />
l’héritier naturel du pouvoir, bien que la succession dynastique ne soit pas établie en droit. Il<br />
ne manquait pas de partisans, ce qui rendait le risque de troubles intérieurs tout à fait sérieux.<br />
La mort du jeune prince met un terme à ces menaces 2 , mais pas aux menées d’Agrippine 1 .<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 14.<br />
2 La mort brutale de Britannicus a été assez généralement mise au nombre des assassinats politiques et<br />
des crimes familiaux ordonnés par Néron. Pourtant, et bien que la tentation soit grande de parfaire<br />
l’image de meurtrier attachée au prince, ce décès demeure pour le moins mystérieux. La question du<br />
poison utilisé a déjà été posée : on ne connaît pas, a priori de substance, disponible à cette époque,<br />
susceptible de provoquer, par ingestion, une mort subite sans autre symptôme, digestif en particulier.<br />
D’ailleurs, les récits qui font intervenir Locuste, reconstitutions dramatiques et effrayantes, sont loin<br />
d’être convaincants par leur outrance même. En outre, le danger que représentait le jeune Britannicus<br />
n’était peut-être pas à ce point imminent que l’on prenne le risque de l’éliminer de manière,<br />
finalement, aussi voyante : il y a en effet une certaine contradiction, semble-t-il, entre le choix d’un<br />
poison discret, et celui de circonstances spectaculaires, un banquet, et en présence de Néron… Enfin,<br />
la mort subite du jeune a fait l’objet d’études médicales récentes, et sans entrer dans le détail, il<br />
apparaît que l’une des causes les plus fréquentes de ce type de décès soit d’origine cardiaque, un<br />
trouble du rythme ventriculaire pouvant provoquer une mort foudroyante, telle que les sources<br />
rapportent que fut celle de Britannicus. Les crises précédentes, que Néron rappelle en les attribuant à<br />
l’épilepsie du jeune homme, en sont peut-être les signes avant-coureurs, les troubles cardiaques dont il<br />
est question pouvant donner lieu à des syncopes, parfois accompagnées de convulsions, et que l’on<br />
peut prendre pour des manifestations d’épilepsie. Il n’est donc pas absurde de penser que la mort de<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
30
Accusée de conspiration et interrogée par Burrus et Sénèque, elle se justifie avec hauteur 2 . La<br />
situation ne semble guère offrir d’issue, et Néron, sous l’influence de Poppée dont il est entre<br />
temps tombé éperdument amoureux, envisage de faire assassiner sa mère. Cette « tragédie »,<br />
comme l’appelle Dion Cassius 3 , est fort célèbre. Sénèque a-t-il une part de responsabilité dans<br />
la tentative avortée de Néron d’éliminer sa mère, comme dit Dion Cassius 4 ? Quoi qu’il en<br />
soit, cette première tentative, qui risquait de provoquer une sédition et une guerre civile, a au<br />
moins amené Sénèque et Burrus à approuver l’élimination d’Agrippine 5 .<br />
Cette exécution constitue le terme de ce que l’on appelle le quinquennium Neronis 6 .<br />
Cette tradition place le tournant du règne en 59, après la mort d’Agrippine. Les premières<br />
années sont pleines de promesses, puisque le prince place sa politique sous le signe de la<br />
clémence, et s’en remet à de sages conseillers. Cependant, Tacite fait plutôt de l’année 62 une<br />
date décisive : c’est à cette époque que se situent les premiers procès en majesté, la mort de<br />
Burrus, la fin de l’influence de Sénèque et le renforcement de celle de Tigellin 7 . Suétone voit<br />
le règne comme la révélation graduelle des vices innés de Néron, les premières indications<br />
étant des événements que Tacite date de 56 8 . Pour Dion Cassius, la mort de Britannicus 1 et<br />
Britannicus ait une cause naturelle, même si sa brutalité la rend suspecte, et même si, finalement,<br />
Néron s’en est fort bien accommodé.<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 18.<br />
2 Tacite, Ann. XIII, 21.<br />
3 61, 12.<br />
4 M. Seita, 1979, analyse et compare les deux <strong>version</strong>s du matricide (Tacite, XIV, 7 et Dion 61, 12, 1).<br />
Chez Tacite il n’y a aucune indication que Sénèque et Burrus aient été informés du projet de Néron de<br />
commettre ce crime, ce qui est hautement improbable. Cf L. Braccesi et A. Coppola, 1997.<br />
5 F.-R. Chaumartin, 1985, p. 163.<br />
6 Un texte d’Aurélius Victor est à l’origine de cette tradition, qui distingue dans le règne de Néron une<br />
période de cinq années au cours de laquelle il se serait montré supportable : Liber de Caesaribus, 51,<br />
4 ; O. Murray, 1965 ; M. T. Griffin, 1984, p. 37-38 et 83-84.<br />
7 Ann. XIV, 57, 1.<br />
8 Ner. 26-7, Tacite, Ann. XIII, 25.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
31
d’Agrippine 2 marque l’accélération des manifestations de la sauvagerie criminelle du prince,<br />
mais il ne fait pas de l’année 62, date du retrait de Sénèque, le tournant du règne. En posant<br />
la crise de 62 comme un événement décisif dans l’évolution de Néron et de sa politique,<br />
Tacite donne à Sénèque une place centrale, et à son influence une importance capitale 3 . Loin<br />
d’être un serviteur docile complice de la tyrannie, Sénèque apparaît alors comme le seul<br />
rempart véritablement solide, propre à contenir les penchants tyranniques de Néron, et à le<br />
guider sur la voie d’une politique raisonnable. Pour Dion Cassius, Sénèque, comme Burrus, a<br />
échoué dans sa tentative de maintenir Néron sur la bonne voie.<br />
II/ Sénèque conseiller et « ami » du prince : une proximité artistique et<br />
politique.<br />
A/ Le rôle politique de Sénèque.<br />
Comment définir le rôle politique de Sénèque auprès de Néron ? Lors de l’accession<br />
de Néron au trône, sa position n’était pas officielle. Ancien précepteur du prince, il devient<br />
naturellement son conseiller le plus proche, ses avis se substituant à ses préceptes. Il participe<br />
aux délibérations au sein du consilium principis, et peut se servir de son influence sur l’esprit<br />
du jeune empereur pour faire triompher ses vues. D’après P. Grimal, l’activité politique de<br />
Sénèque est inspirée par les principes du stoïcisme 4 : il n’est pas étranger à l’esprit du<br />
1 61, 7, 5.<br />
2 61, 11, 1.<br />
3 M. T. Griffin, 1976, p. 423-427 : la date de 62 est politiquement plus satisfaisante.<br />
4 P. Grimal, 1976, p. 173-177.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
32
Portique que le sage se fasse le conseiller des rois et des princes, et c’est même ainsi que ses<br />
principes prennent toute leur dimension. Avant même de se voir chargé de l’éducation de<br />
Néron, Sénèque montre un intérêt particulier pour les princes et leur mode de gouvernement.<br />
Ainsi, dans la Consolation à Polybe, il examine l’attitude de Caligula après la mort de sa sœur<br />
bien aimée, Drusilla, et remarque qu’il est bien loin de se comporter en prince 1 . Cette attitude<br />
n’est nullement en contradiction avec le point de vue stoïcien : c’est par lui que ce grand<br />
corps qu’est l’Etat pourra être régi par le logos, et son engagement dans la vie publique se fait<br />
plus impérieux encore, quand le pouvoir exercé par le prince n’a d’autre limite que la vertu de<br />
son détenteur.<br />
1/ Le rôle d’amicus principis.<br />
Il est malaisé de définir précisément l’action politique de Sénèque. On peut toutefois<br />
observer qu’elle prend plusieurs directions. D’abord, Sénèque peut user de son influence et<br />
profiter de la confiance que lui accorde le prince pour le conseiller sur son comportement en<br />
public, par exemple, lors de la crise de l’ambassade d’Arménie. Sans qu’il y ait besoin d’une<br />
longue délibération, Néron adopte l’attitude qui semble convenir à son amicus, masquant<br />
l’éviction de son indiscrète mère sous l’artifice du respect filial. Le conseiller sert donc<br />
d’intermédiaire avisé entre le prince et l’opinion du peuple, des nations étrangères ou des<br />
classes dirigeantes, et en particulier du Sénat. Il remplit cette fonction lorsqu’il rédige les<br />
premiers discours de Néron. Le De clementia, écrit après la mort de Britannicus, a entre autres<br />
buts celui de rassurer l’opinion par rapport à l’évolution du régime 2 , et pose une affirmation<br />
des principes que le prince, par le fait, s’engage à suivre dans son gouvernement. Sénèque<br />
1 Polyb. 12, 4.<br />
2 M.T. Griffin, 1976, p. 138.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
33
intervient ainsi dans des moments cruciaux, où la stabilité du régime est en jeu ; C’est le cas,<br />
bien sûr, de la mise en place de l’autorité de Néron, mais aussi de la crise provoquée par les<br />
menées d’Agrippine et par sa mort 1 .<br />
Sénèque fait partie des intimes du prince. Il s’autorise donc une certaine franchise,<br />
même quand son influence est déclinante : c’est ainsi qu’il fait remarquer à Néron, prêt à<br />
multiplier les assassinats politiques par crainte d’un coup d’état, que tous ces massacres ne lui<br />
permettront pourtant pas de se débarrasser de son successeur 2 . Dans le De beneficiis, Sénèque<br />
souligne la nécessité pour un prince d’avoir des conseillers francs 3 : cette remarque est sans<br />
doute le fruit de son expérience auprès de Néron. Son âge, l’intimité qu’il a gagnée auprès du<br />
prince pendant ses années de formation, lui donnent une plus grande liberté pour le conseiller<br />
et, parfois, l’écarter de certains projets. Cette situation privilégiée lui permet même<br />
d’intervenir dans les affaires privées de Néron, si les conséquences peuvent en être<br />
politiques : c’est pour cette raison qu’il favorise la liaison de Néron et d’Acté 4 , car cette<br />
passion fait diminuer l’influence d’Agrippine 5 .<br />
2/ La fonction sénatoriale.<br />
Sénèque est également sénateur et en tant que tel, il peut influer sur cette assemblée,<br />
en usant de son prestige et de son éloquence. Les mesures dont l’adoption peut lui être<br />
attribuée ont souvent pour objectif de limiter l’emprise de l’argent sur la vie publique. C’est<br />
1 M.T. Griffin, op. cit., p. 79. Burrus provoque un mouvement de sympathie à l’égard du prince dans<br />
l’armée, accréditant ainsi la thèse du complot déjoué de justesse : Tacite, Ann. XIV, 10, 2.<br />
2 Dion Cassius, 62, 18, 3.<br />
3 Ben. VI, 30, 3.<br />
4 Tacite, Ann. XIII, 12<br />
5 M.T. Griffin, 1976, p. 67.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
34
ainsi que la loi Cincia de 204, reprise par un sénatus-consulte en 58, a pu être rétablie à<br />
l’initiative de Sénèque 1 . Cette décision qui, nous dit Tacite, a été prise pour réprimer les abus<br />
de Suillius en particulier, provoque de violentes réactions de ce dernier, qui s’en prend<br />
précisément à Sénèque, lui reprochant justement sa très grande richesse 2 : une fortune déjà<br />
considérable, qui a été augmentée par les dépouilles de Britannicus. Tacite l’accuse en effet<br />
sans le nommer parmi les uiri grauitatem asseuerantes 3 , qui ont reçu des cadeaux destinés à<br />
faire taire leur conscience. La fortune de Sénèque est ainsi directement reliée à son activité<br />
politique, ce qui met à mal son crédit et fait porter le soupçon sur ses démarches.<br />
Sénèque est alors à l’apogée de sa faveur, et ces attaques contre sa fortune vite acquise<br />
et les concessions qu’il a pu faire se multiplient dans une véritable campagne, dont l’hostilité<br />
amène le philosophe à réagir et à se justifier 4 . Il publie donc le De uita beata, dont le ton<br />
polémique est parfois violent 5 . Dans ce texte, il emploie une expression qui définit sa fonction<br />
politique, telle qu’il souhaite l’exercer : patriae... bonus tutor aut uindex 6 . Il garantit au Sénat<br />
et à la patrie la clémence de Néron et la réalisation des promesses faites au début du règne. Il<br />
sert ainsi aux sénateurs à la fois d’intermédiaire et de caution, et se fait ainsi le protecteur de<br />
la patrie. Il a pu remplir ce rôle jusqu’alors, et s’imposer comme une figure centrale de la vie<br />
politique de son temps.<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 42-43.<br />
2 M.T. Griffin, 1976, p. 75 ; A. L. Motto, 1966.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 17, 3 : ces « hommes qui faisaient étalage de leur austérité », s’étaient partagé des<br />
richesses « comme un butin ».<br />
4 M.T. Griffin, 1976, p. 18-20 et 306-309.<br />
5 Par exemple, 23, 1-2 ; sur les circonstances et la date de ce traité : Sénèque, De uita beata, édition,<br />
traduction et commentaire de P. Grimal, Paris, 1969, p. 17-21.<br />
6 Vit. 15, 4 : « un bon gardien ou défenseur de la patrie ». Sur cette expression, Sénèque, De uita beata,<br />
édition, traduction et commentaire de P. Grimal, Paris, 1969, p. 20.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
35
3/ La politique étrangère.<br />
On peut également voir l’influence de Sénèque en matière de politique étrangère ; en<br />
effet, tant qu’il resta assez proche de Néron pour orienter ses décisions, le principe stoïcien<br />
selon lequel on ne doit entreprendre de guerre que pour garantir la paix semble généralement<br />
appliqué. C’est ainsi que le problème arménien, hérité du règne de Claude, trouve une<br />
solution provisoire dont la modération est sans doute à mettre au compte de l’application de<br />
ce principe : l’établissement d’un roi-client cautionné par Rome 1 . La crise arménienne, qui se<br />
déclenche au début du règne de Néron 2 , aurait pu fortement déstabiliser le pouvoir, l’appui et<br />
les conseils d’hommes d’expérience tels que Sénèque et Burrus se sont donc rapidement<br />
révélés très précieux 3 . En Germanie 4 , la diplomatie fait également valoir ses droits, et l’on<br />
peut voir là encore l’influence de Sénèque 5 . Mais encore une fois, l’action de Sénèque<br />
n’emporte pas tous les suffrages : Dion Cassius accuse Sénèque d’avoir consenti des prêts<br />
usuraires et de partager la responsabilité de la révolte en Bretagne avec le procurateur Catus<br />
dont il dénonce les exactions 6 . Ce n’est pas ici le lieu d’accabler Sénèque ni de le laver de<br />
toute accusation. Remarquons simplement qu’il apparaît comme un personnage influent sur le<br />
1 M.T. Griffin, 1976, p. 236.<br />
2 Tacite, Ann. XIII, 6.<br />
3 A. Oltramare, 1938, cherche à démontrer les qualités politiques et diplomatiques de Sénèque, en<br />
particulier lors de la résolution du problème arménien.<br />
4 Tacite, Ann. XIII, 53-57.<br />
5 P. Grimal, 1976, p. 173-174.<br />
6 62, 1-12. La critique des activités « bancaires » de Sénèque fait écho aux accusations de Suillius<br />
(Tacite, Ann. XIII, 42, 4), qui lui reproche d’épuiser l’Italie et les provinces. Sur la richesse de<br />
Sénèque et sa manière de la faire fructifier, P. Veyne, dans son introduction à l’édition des œuvres en<br />
prose de Sénèque, précise un certain nombre de points d’histoire économique qui contribuent à<br />
éclairer le rapport du philosophe à l’argent.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
36
plan international, et que les conseils qu’il a pu donner à Néron dans le domaine de la<br />
politique étrangère ont pu souvent être suivi d’effets.<br />
On le voit, l’influence de Sénèque auprès de Néron s’étend largement sur différents<br />
domaines, dans les premières années du règne. En politique intérieure ou étrangère, dans les<br />
affaires privées du prince lorsqu’elles ont trait au gouvernement, l’ancien précepteur joue un<br />
rôle important. C’est un homme de pouvoir, et il est décrit comme tel 1 . Cependant, Sénèque<br />
n’est pas tout puissant à la cour, et le contrôle qu’il exerce n’est pas absolu. Les questions que<br />
nous avons examinées relèvent de problèmes qui se posent à tout empereur : affirmation du<br />
pouvoir, règlement des conflits dans les provinces, réformes fiscales, relations avec le Sénat,<br />
etc. Il reste maintenant à s’interroger sur l’attitude de Sénèque à l’égard de ce qui fait la<br />
particularité la plus marquante de la période néronienne : la politique spectaculaire et les<br />
activités artistiques du prince 2 .<br />
B/ Sénèque et la politique artistique de Néron.<br />
1/ Une stratégie de compromis ?<br />
Pendant le préceptorat, et dans les premiers temps du règne, Sénèque n’a pas contré<br />
tous les goûts de Néron, Tacite le confirme dans le rapide portrait qu’il dresse des deux<br />
tuteurs du jeune prince :<br />
1 M.-H. Garelli-François, 1994, p. 88.<br />
2 A.Guaglione, 1977, p. 91-134.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
37
Hi, rectores imperatoriae iuuentutae et, rarum in societate potentiae, concordes,<br />
diuersa arte ex aequo pollebant, Burrus militaribus curis et seueritate morum, Seneca<br />
praeceptis eloquentiae et comitate honesta, iuuantes inuicem, quo facilius lubricam<br />
principis aetatem, si uirtutem aspernaretur, uoluptatibus concessis retinerent. 1<br />
L’indulgence des deux hommes s’oppose, dans ce passage, à la violente intransigeance<br />
d’Agrippine, qui ne souhaitait pas que son fils fût initié à la philosophie, discipline à ses yeux<br />
peu convenable pour un empereur. A plus forte raison, que Néron exerce son art en public<br />
était pour elle impensable, et il est à noter que les premières exhibitions publiques de Néron<br />
sont postérieures à sa mort. L’autorité de sa mère constitue en effet un frein à<br />
l’assouvissement de ses passions :<br />
Hinc superbus ac publici seruitii uictor, Capitolium adiit, grates exsoluit, seque in<br />
omnes libidines effudit, quas, male coercitas, qualiscumque matris reuerentia<br />
tardauerat. 2<br />
Sénèque adopte à l’égard de Néron une attitude plus indulgente, et recourt au compromis,<br />
dans le but d’éviter les débordements d’une passion par trop bridée. En cela, il agit de concert<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 2, 1 : « Ces deux hommes, qui dirigeaient la jeunesse de l’empereur avec un accord<br />
exceptionnel dans le partage du pouvoir, jouissaient d’un crédit égal à des titres différents, Burrus par<br />
ses connaissances militaires et l’austérité de ses mœurs, Sénèque par ses leçons d’éloquence et sa<br />
bienveillance vertueuse. Ils se prêtaient un soutien réciproque, pour contenir plus facilement la<br />
jeunesse turbulente du prince, s’il se détournait de la vertu, en lui accordant quelques plaisirs. »<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 13, 2 : « Alors, plein d’orgueil et vainqueur de la servilité publique, il monta au<br />
Capitole, remercia les dieux, et donna libre cours à toutes ses passions, mal réprimées jusqu’alors,<br />
mais que la crainte respectueuse de sa mère, quelle qu’elle fût, avait contenues. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
38
avec Burrus, et choisit de laisser le prince organiser des courses dans l’enceinte fermée des<br />
jardins impériaux, lui cédant sur un point, ne utraque peruinceret 1 .<br />
Cette politique de compromis n’a guère de succès puisque, comme on l’a vu<br />
précédemment, Néron procède étape par étape pour finalement imposer ses volontés à son<br />
entourage. Ce qui devait constituer un frein, un palliatif aux prétentions de Néron, n’est en fait<br />
que la première étape d’un processus qui vise à imposer aux yeux de tous l’image d’un<br />
empereur artifex. A cet égard, Dion Cassius se montre bien plus sévère à l’endroit de<br />
Sénèque, à qui il reproche au contraire son laxisme qui n’a fait selon lui qu’encourager les<br />
débordements de Néron, avec pour conséquence de favoriser la dérive tyrannique du règne.<br />
Ainsi, alors que Tacite présente un Burrus maerens ac laudans, assistant malgré lui à la<br />
prestation de Néron lors des juvénales de 59, Dion Cassius nous présente en Sénèque un<br />
complice de cette exhibition, qui va jusqu’à faire la claque pour l’artiste impérial :<br />
Kai ; aujtw~~/ kai ; oJ Bou~~rroı kai ; oJ Senevkaı, kaqavper tine ;ı didavskaloi,<br />
uJpobavllontevı ti pareisthvkesan, kai ; aujtoi ; tavı te cei~~raı kai ; ta ; iJmavtia,<br />
oJpovte fqegxaito v ti, ajnevseion, kai ; tou ;ı a [llouı prosepespw~nto. 2<br />
La comparaison kaqavper tine ;ı didavskaloi rappelle les fonctions de pédagogue de Sénèque,<br />
et souligne sa responsabilité et celle de Burrus. En effet, le terme didavskaloı désigne d’abord<br />
le maître, le précepteur, et c’est son acception la plus fréquente, et celle qui correspond le<br />
mieux à ce que nous connaissons des fonctions de Sénèque auprès de Néron. Ce terme<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 14, 2 : « pour éviter qu’il ne l’emporte des deux côtés ». Tacite fait ici allusion au<br />
chant, discipline dans laquelle Néron ne se produit que plus tard.<br />
2 Dion Cassius, 61, 20, 3 : « A ses côtés se tenaient Burrus et Sénèque, comme des metteurs en scène,<br />
qui lui soufflaient ; et ils accompagnaient chacune de ses paroles de mouvements de leurs mains ou de<br />
leur toge, et engageaient les autres à faire de même. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
39
s’entendrait donc davantage pour qualifier Sénèque, son emploi au pluriel à propos de Burrus<br />
peut donc surprendre. De plus, dans un contexte théâtral, qui est celui de notre passage, il peut<br />
également désigner le poète dramatique, chargé de diriger les répétitions, et qui remplit ainsi<br />
les fonctions de metteur en scène 1 . Le verbe didavskein peut également prendre le sens<br />
théâtral de « faire représenter une pièce », et par extension, la mettre en scène 2 . Par l’emploi<br />
de ce terme, Dion Cassius souligne donc la responsabilité de Sénèque et Burrus, qui semblent<br />
un peu ridicules de se tenir là, à souffler et à faire la claque au prince. Cette fonction peu<br />
honorable est un autre exemple de la dérive du rôle que Sénèque joue auprès de Néron : de<br />
précepteur, il devient metteur en scène, comme il est devenu turannodidavskaloı, maître de<br />
despotisme 3 . Un tel jugement dévoile toute la relativité de la notion de compromis, que l’on<br />
serait tenté d’invoquer en faveur de Sénèque, car sa présence et son implication effective à ce<br />
moment, conjugués à ses fonctions officielles et réelles, en font une caution morale et<br />
politique aux projets de Néron.<br />
2/ Une implication relative dans la politique artistique du prince.<br />
Sénèque a-t-il subi cette évolution, en essayant toutefois de contenir les manifestations<br />
de la passion artistique de Néron, comme le laisse entendre Tacite, ou a-t-il encouragé ces<br />
penchants du prince, comme l’en accuse Dion Cassius ? Le développement de la politique<br />
spectaculaire du prince est-il le signe du déclin de l’influence du philosophe, ou la<br />
conséquence fâcheuse d’une indulgence mal calculée, ou pire, d’un laxisme coupable ? En 59,<br />
lors des événements qui nous préoccupent, la mort d’Agrippine a délié les mains de Néron, et<br />
1 Aristophane, Ach. 628.<br />
2 Platon, Prot. 327 d.<br />
3 Dion Cassius, 61, 10, 2. Ce terme est également employé par Platon, Theag. 125 a.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
40
éliminé un obstacle majeur à l’assouvissement de ses passions. Pourtant, Sénèque est encore<br />
relativement libre dans ses propos, et il reste influent. C’est ainsi qu’il détourne son ancien<br />
élève de ses projets d’assassinats politiques, en lui faisant remarquer qu’il lui est impossible<br />
de tuer son successeur 1 . Une certaine audace lui est donc toujours permise, qui ne cadre pas<br />
bien avec la servilité de l’attitude décrite lors des Juvénales.<br />
a/ Les Juvénales et les jeux néroniens.<br />
Au cours de ces jeux que Dion Cassius juge avec tant de sévérité, c’est Gallion, frère<br />
de Sénèque, qui occupe la fonction de héraut et a pour mission d’annoncer les performances<br />
du prince 2 , ce qui constitue un autre indice de l’implication de Sénèque et de ses proches dans<br />
la politique spectaculaire du prince. En effet, le clientélisme joue un rôle important dans les<br />
milieux proches du pouvoir 3 , et il est probable que Sénèque usa de son influence pour placer<br />
ses amis à des postes cruciaux, ou pour les maintenir en place comme ce fut le cas de Burrus 4 .<br />
Or, deux membres de la famille de Sénèque sont impliqués, plus ou moins directement, dans<br />
les projets artistiques de Néron ; Gallion, héraut occasionnel, et Lucain, qui révèle son talent à<br />
Néron en participant aux jeux néroniens, au cours desquels il chante un poème à la louange du<br />
prince 5 . La participation de ces deux personnages aux entreprises poétiques et musicales du<br />
prince semble donc relever davantage d’une implication consciente de Sénèque dans ce projet,<br />
plutôt que d’une concession faite à contrecœur.<br />
1 Dion Cassius, 61, 18, 3.<br />
2 Dion Cassius, 61, 20, 1.<br />
3 M. T. Griffin, 1976, p. 84.<br />
4 Tacite, Ann. XIII, 20, 2.<br />
5 M. Morford, 1985, p. 2014 et 2022.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
41
Les Juvénales suscitent un engouement pour le théâtre parmi les membres des classes<br />
dirigeantes, chevaliers et sénateurs. Cette évolution des mentalités, l’affirmation publique<br />
d’un goût souvent décrié auparavant, doit dans l’esprit du prince servir de base à ses réformes<br />
politiques et esthétiques. Quelle était l’opinion de Sénèque sur ces fêtes ? Les sources donnent<br />
peu d’indications sur son action politique dans ce domaine précis. Il semble que la course de<br />
char dans les jardins de la vallée du Vatican reste sa dernière tentative pour modérer Néron 1 ,<br />
et elle consiste avant tout à éviter qu’il ne se produise en public.<br />
L’année suivante voit l’instauration des jeux quinquennaux appelés « néroniens ».<br />
Tacite rapporte les débats liés à la polémique qu’ils ont suscitée 2 . On peut se demander si<br />
Sénèque prit part à ces discussions, et quelle était sa position. Pourtant, sa présence aux<br />
Juvénales fait de lui une sorte de caution vis à vis du Sénat, et sa participation à ces<br />
manifestations mène à s’interroger sur les éventuels points de rencontre entre les aspirations<br />
de Sénèque et les projets de son ancien élève. En effet, les Juvénales, au cours desquelles<br />
Néron est salué comme le nouvel Apollon 3 , répondent sur le mode festif à une partie du<br />
programme du De clementia.<br />
b/ L’idéologie du De clementia et l’influence orientale.<br />
Le traité propose, dans son préambule, une image de Néron divinement choisi pour<br />
régner sur l’univers : Sénèque place dans la bouche du jeune prince un monologue sans<br />
équivoque.<br />
1 M. Fuhrmann, 1997, p. 262-263.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 20-21<br />
3 voir infra, p. 108.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
42
Egone ex omnibus mortalibus placui electusque sum, qui in terris deorum uice<br />
fungerer? Ego uitae necisque gentibus arbiter 1 .<br />
Comme le fait remarquer J. R. Frears, le complément d’agent du verbe electus sum n’est pas<br />
exprimé, et le complément d’objet indirect du verbe placui non plus. Cependant, il n’est pas<br />
douteux que les dieux soient à l’origine de ce choix 2 . L’importance de l’imagerie solaire dans<br />
le De clementia, comme dans l’Apocoloquintose 3 , a donné lieu à de nombreux commentaires 4 .<br />
Néron apparaît comme un astre : prodire te putas, oreris 5 . Le Soleil fait référence au dieu<br />
romain Apollon, divinité tutélaire d’Auguste, et à l’idéologie antonienne d’inspiration<br />
égyptienne. Sénèque, dans ce traité qui apparaît comme un ”manifeste du nouveau régime ” 6 ,<br />
réalise ainsi la synthèse entre l’idéologie augustéenne et les aspirations antoniennes,<br />
auxquelles son élève était très sensible, lui que sa grand-mère Antonia avait entretenu dans le<br />
culte d’Antoine.<br />
Les prodiges qui entourèrent la naissance de Néron, et que rapportent Suétone et Dion<br />
Cassius, confirment l’importance de l’Egypte dans l’image impériale 7 . Les rayons du soleil<br />
auraient touché Néron avant d’atteindre le sol 8 . Cet événement fait référence à un rite<br />
pharaonique, et désigne clairement Néron comme le futur souverain de l’Egypte, donc de<br />
l’Empire romain tout entier. Or, le voyage de Sénèque en Egypte l’a profondément marqué, et<br />
1 Sénèque, Clem. I, 2 : "C'est moi qui, parmi tous les mortels, ai été choisi et désigné pour tenir sur<br />
terre le rôle des dieux? C'est moi qui ai le droit de vie et de mort sur les peuples."<br />
2 J. R. Frears, 1977, p 136-137.<br />
3 Sénèque, Apoc. 4, 1, 22-24 ; 4, 1, 25-31 ; Clem. 3, 6, 4.<br />
4 P. Grimal, 1991a, p 128.<br />
5 Sénèque, Clem. I, 8, 4.<br />
6 P. Grimal, 1991a, p 126<br />
7 M. P. Cesaretti, 1984, recense l'iconographie pharaonique de Néron.<br />
8 Suétone, Ner. 6.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
43
donne sans doute lieu à des points communs entre les deux hommes 1 . Pendant son séjour,<br />
Sénèque a pu être influencé par les différents courants de la pensée orientale, et “ n’est pas<br />
resté étranger au grand mouvement d’idées qui agitait alors les penseurs, à Alexandrie, et<br />
tendait à unifier, en un puissant syncrétisme, les divers courants de la pensée qui se<br />
partageaient le monde oriental ” 2 .<br />
Sénèque, dans l’Apocoloquintose, assimile Néron à Apollon pour la beauté et pour les<br />
chants, en mettant ces paroles dans la bouche de Phébus :<br />
ille mihi similis uultu similisque decore,<br />
nec cantu nec uoce minor... 3<br />
Néron quant à lui se représente comme Apollon ou Hercule, dans des exhibitions destinées à<br />
manifester son identification à ces divinités 4 . A Rome, Néron semble avoir surtout recherché<br />
les honneurs artistiques, et avoir cultivé sa ressemblance avec Apollon pour des raisons<br />
esthétiques. Dans le reste de l’empire, aucun empereur, excepté Caligula, n’avait autant été<br />
assimilé à un dieu 5 . Ainsi, les dérives de la politique néronienne apparaissent, à bien des<br />
égards, comme un infléchissement et une radicalisation de l’idéologie élaborée par Sénèque<br />
au début du règne.<br />
1 P. Grimal, 1971.<br />
2 P. Grimal, 1991a, p. 161.<br />
3 Sénèque, Apoc. IV, 1, 20- 24 : « Il est mon semblable pour le visage, mon semblable pour la beauté,<br />
et il ne m’est inférieur ni par son chant ni par sa voix. »<br />
4 Suétone, Ner. 53, 3.<br />
5 A. Burnett, 1984, étudie des monnaies sur lesquelles Néron est représenté sous les traits d'Apollon.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
44
III/ De la retraite à la disgrâce : l’affirmation des divergences et la<br />
confirmation d’une sensibilité commune.<br />
A/ Le déclin politique de Sénèque.<br />
D’après les témoignages formels de Suétone 1 et Dion Cassius 2 , Néron a pris Caligula<br />
pour modèle quand il a commencé à se détacher de l’influence de Sénèque et de Burrus. Il<br />
confirme ainsi la validité du rêve de Sénèque, qui s’était vu en songe chargé de l’éducation de<br />
Caligula 3 . L’éloignement de Néron constitue pour Sénèque un échec de sa pédagogie et de<br />
son activité de conseiller du prince. Plus celui-ci lui échappe, plus il s’éloigne des principes<br />
de son ancien précepteur, et plus sa politique se rapproche de dérives tyranniques que le<br />
philosophe voulait tant éviter.<br />
1/ Un événement décisif : la mort d’Agrippine.<br />
L’éloignement de Néron par rapport aux avis de Sénèque commence à partir des<br />
années 58 ou 59 : cette période est notamment marquée par le début de sa liaison avec<br />
Poppée 4 , dont l’influence vient concurrencer celles des amici modérés du prince, et qui se<br />
révèle pour Agrippine une rivale bien plus redoutable que ne pouvait l’être auparavant Acté.<br />
1 Ner. 30.<br />
2 61, 5, 1 : pro ;ı to ;n Gavion e[teinen.<br />
3 Suétone, Ner. 7.<br />
4 F.-R. Chaumartin, 1985, p. 164-165.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
45
Sénécion et Othon 1 , complices des débauches impériales, contribuent à affermir la résistance<br />
de Néron aux avis de ses ministres. La mort d’Agrippine, décidée par le prince pour éliminer<br />
la menace qu’elle faisait peser sur son pouvoir, et dans la justification de laquelle Sénèque se<br />
voit contraint de jouer un rôle central, vient également rompre un équilibre : Sénèque et<br />
Burrus, en effet, s’accordaient pour combattre ses ambitions et pour contrecarrer son<br />
intransigeance tyrannique. Sa disparition constitue en fait, pour les deux hommes, la perte<br />
d’un précieux ennemi, qui garantissait leur crédit auprès du prince, en les rendant<br />
indispensables.<br />
La déception de Sénèque, et son découragement face à cette situation que rien ne<br />
semble désormais pouvoir infléchir apparaissent dans le De beneficiis 2 . Ce traité, rédigé sans<br />
doute après la mort d’Agrippine 3 , peut être lu comme une tentative pour arrêter Néron sur la<br />
pente des meurtres, et le ramener à un gouvernement raisonnable. F. R. Chaumartin, qui a<br />
consacré une étude à la portée politique du De beneficiis, a montré que l’écart entre l’attitude<br />
de Sénèque dans le De clementia et le De beneficiis se manifeste par exemple dans les<br />
références à Auguste, que l’on trouve dans l’un et l’autre traité. Dans le premier, la<br />
comparaison est explicite, et tourne à l’avantage de Néron. Le règne de celui-ci s’ouvre en<br />
effet sur une parole sublime, une parole de clémence 4 , alors qu’Auguste avait obtenu et<br />
installé son pouvoir en faisant couler le sang 5 . Dans le De beneficiis, au contraire, la<br />
comparaison est implicite le plus souvent, et toujours favorable à Auguste 6 . Sénèque<br />
1 Dion Cassius, 61, 11, 2 ; Tacite, Ann. XIII, 45 ; XV, 71 ; Suétone, Ner. 35.<br />
2 F. R. Chaumartin, 1989 ; Sur la datation du De beneficiis : F. R. Chaumartin, 1985, p. 195-197.<br />
3 F. R. Chaumartin, 1985, p. 160.<br />
4 Clem. II, 1, 2 ; cf Suétone, Ner. 10.<br />
5 Clem. I, 11, 1.<br />
6 F. R. Chaumartin, 1985, p. 173 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
46
comprend son échec 1 , et constate l’impasse à laquelle sa tentative de former un rex iustus a<br />
abouti.<br />
Parallèlement, un mouvement d’opposition se développe dans les milieux stoïciens 2 à<br />
partir de 60, préparant les conditions de la conjuration de Pison, dans laquelle Sénèque sera<br />
impliqué. La rupture qui s’amorce entre Néron et Sénèque a donc très rapidement des<br />
conséquences dans les milieux politiques, et en particulier au Sénat. La figure de cette<br />
opposition et de cet esprit de résistance qui peut aller jusqu’à la bravade est Thrasea Paetus,<br />
auquel Sénèque était lié. Il quitte le Sénat dont les décisions montrent la servilité, et marque<br />
ainsi son désaccord au sujet de la mort d’Agrippine, en refusant de cautionner le matricide 3 .<br />
2/ L’influence croissante de Tigellin : un anti-Sénèque ?<br />
Des changements dans l’entourage du prince confirment la tendance amorcée depuis la<br />
mort d’Agrippine, et les premiers signes du déclin de l’influence de Sénèque. La mort de<br />
Burrus, et son remplacement par Tigellin, officier de carrière récente 4 , accentuent l’isolement<br />
de Sénèque en le privant d’un collègue et allié précieux. De naissance obscure, présenté<br />
comme un impudique et un débauché, il participe aux débauches de Néron avant de<br />
l’abandonner et de le trahir 5 . C’est justement à son infamie qu’il doit sa place de favori et sa<br />
1 F. R. Chaumartin, 1985, p. 149.<br />
2 T. Adam, 1970, p. 70.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 12, 1.<br />
4 E. Cizek, 1972, p. 141-145.<br />
5 Tacite, Hist. I, 72, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
47
carrière. Nommé préfet du prétoire à la suite de Burrus, avec Faenius Rufus, il réduit<br />
l’influence de son collègue et encourage les assassinats politiques 1 .<br />
Pour illustrer le changement survenu après la mort de Burrus, qui pour Tacite, marque<br />
la fin de l’influence de Sénèque sur le prince 2 , Tigellin a été présenté comme un anti-Sénèque,<br />
un professeur de tyrannie qui aurait succédé au philosophe 3 . Il peut paraître surprenant, au<br />
premier abord, que le contraste ainsi marqué oppose, non pas Burrus à son successeur, mais<br />
Sénèque au nouveau préfet du prétoire. La prise de fonction de celui-ci coïncide avec la<br />
radicalisation de la politique spectaculaire de Néron, que Sénèque et Burrus avaient tenté de<br />
modérer 4 . On trouve dans les textes une série d’oppositions qui invitent bel et bien à comparer<br />
Tigellin et Sénèque. On le voit fréquemment associé aux intimes débauches du prince 5 , par<br />
exemple lors du « mariage » de celui-ci avec le jeune Sporus : c’est Tigellin qui accompagne<br />
la « mariée » au moment de la cérémonie 6 . Ainsi, tandis que Sénèque jouait un rôle<br />
modérateur auprès du prince, Tigellin le pousse au contraire à ne pas réfréner ses passions. Le<br />
philosophe est donc remplacé par un débauché, que stigmatise la répartie célèbre d’une<br />
servante d’Octavie, qui refusait de calomnier sa maîtresse 7 . En outre, après l’effacement de<br />
Sénèque, la publicité des amusements de Néron contraste avec la clandestinité initiale dont ils<br />
étaient couverts : les escapades nocturnes de Néron deviennent officielles et publiques 8 . Le<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 57.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 52, 1 : Mors Burri infregit Senecae potentiam.<br />
3 Plutarque, Galb. 20.<br />
4 Dion Cassius, 62, 6, 4 et 62, 15, 3.<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 51 ; Dion Cassius, 62, 13, 3-4.<br />
6 Dion Cassius, 63, 13, 1.<br />
7 Tacite, Ann. XIV, 60 ; Dion Cassius, 62, 13, 4.<br />
8 A. M. Gowing, 1997.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
48
crédit du nouveau préfet du prétoire est avant tout basé sur les plaisirs qu’il organise pour son<br />
maître, à tel point que l’influence de Pétrone en ce domaine provoqua sa jalousie 1 .<br />
Ensuite, Tigellin encourage la cruauté de Néron, alors que Sénèque l’exhortait à la<br />
clémence. La répression féroce qui a suivi la découverte de la conjuration de Pison, si elle<br />
s’explique sur le plan politique par la crainte de voir le pouvoir ébranlé, demeure assez<br />
significative de l’infléchissement de l’attitude du dirigeant vers une sévérité impitoyable. Au<br />
contraire, Sénèque exhortait Néron à la clémence, et faisait de cette vertu la pierre angulaire<br />
du programme politique qu’il se proposait de réaliser. Dans le De clementia, cette vertu<br />
véritablement royale est illustrée par l’exemple d’Auguste qui sut pardonner à Cinna qui<br />
complotait contre lui, et dénoua de la sorte une crise majeure 2 . Néron, en l’occurrence, se<br />
comporte davantage comme le jeune Auguste, qui, emporté par la colère, commit plusieurs<br />
crimes et fit couler le sang romain. La conjuration de Pison est donc réprimée avec la dernière<br />
rigueur, et les témoignages ne manquent pas, qui font état des interrogatoires cruels des<br />
conjurés par Néron et Tigellin 3 .<br />
Face à cette cruauté, provoquée comme le souligne Tacite par l’effroi de Néron,<br />
pauido Nerone 4 , se dresse une figure héroïque, digne de figurer comme exemple dans les<br />
traités de Sénèque, à côté de Caton ou de Regulus : c’est Epicharis 5 , qui bien que femme et<br />
affranchie, s’élève au-dessus de sa condition en résistant aux tortures que Tigellin lui fait<br />
infliger 6 , et trouve dans le suicide une issue à une situation intolérable 7 . Epicharis, sans le<br />
savoir, s’applique à elle-même les leçons de Sénèque sur le suicide, et fait par là preuve de<br />
1 Tacite, Ann. XVI, 18, 3.<br />
2 Clem. I, 9.<br />
3 Tacite, Ann. XV, 58.<br />
4 Tacite, Ann. XV, 58, 1.<br />
5 Tacite, Ann. XV, 57.<br />
6 Dion Cassius, 62, 27, 3<br />
7 Sénèque, Ep. 70, 6 ; Prou. VI, 8-9.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
49
sagesse. La mort la délivre de la torture et de la tyrannie, et lui restitue sa liberté, tout en lui<br />
évitant de trahir ses complices 1 . Ainsi, Tigellin participe à la dérive tyrannique de Néron. Il<br />
n’en est pas l’instigateur, car il reste un exécutant et ne semble pas avoir sur le prince un<br />
ascendant très important, mais sa présence représente assez bien l’évolution du règne. R.<br />
Waltz 2 a montré que le renouvellement de l’entourage du prince a des conséquences dans le<br />
domaine de la politique intérieure et extérieure, et cite notamment l’exil de Cornelius Sulla 3 .<br />
Nous avons cependant peu de renseignements sur Tigellin, et tous les témoignages qui<br />
nous sont parvenus lui sont résolument hostiles. La noirceur du personnage, qui l’oppose à<br />
Sénèque, constitue également bien souvent une clef d’explication de l’évolution du règne de<br />
Néron. Sénèque et Burrus, par leur accord et leur action, sont les figures marquantes de la<br />
première partie du règne, tandis que Tigellin serait l’icône de la dérive du régime vers le<br />
despotisme et la folie. Les choses ne sont pourtant pas aussi nettement tranchées. Tigellin est<br />
en effet bien loin de détenir sur Néron l’ascendant d’un Sénèque, et les changements de la<br />
politique néronienne semblent davantage succéder à une émancipation de Néron qu’à un<br />
glissement d’une influence à l’autre. Contrairement à Sénèque, imposé au départ par<br />
Agrippine, Tigellin est choisi par le prince qui en fait l’instrument d’un pouvoir qu’il entend<br />
désormais contrôler entièrement. Sénèque est peu à peu écarté, mais il n’est pas remplacé. Par<br />
ailleurs, J. K. Roper 4 a émis l’hypothèse que Sénèque et Tigellin appartenaient à une même<br />
faction anti-claudienne, et que le second a dû bénéficier de l’appui, ou au moins de<br />
l’approbation du premier pour sa carrière. Tigellin exilé en 39, sur l’accusation d’adultère<br />
1 Les obligations envers la patrie, ainsi que le risque de mal agir figurent parmi les situations qui<br />
justifient le suicide : M. T. Griffin, 1976, p. 378-379. Cf Diogène Laërce, VII, 130.<br />
2 R. Waltz, 1909, p. 356.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 47.<br />
4 J. K. Roper, 1979.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
50
avec Agrippine 1 , devait être lui aussi proche des sœurs de Caligula, et peut-être impliqué dans<br />
le complot qui se joua autour de M. Aemilius Lepidus, avec l’appui de Cornelius Lentulus<br />
Gaetulicus 2 . Tigellin apparaît donc, non pas comme un anti-Sénèque, mais comme une image<br />
dégradée des anciens conseillers de Néron.<br />
3/ L’affirmation de l’indépendance de Néron.<br />
La radicalisation de la politique de Néron s’est manifestée avec plus de force au fur et<br />
à mesure que l’influence de Sénèque déclinait. L’éloignement de Sénèque s’accompagne ainsi<br />
d’une prise de distance croissante d’avec ses principes. L’édification de la Domus aurea, dans<br />
laquelle G.-Ch. Picard voit le signe de l’avènement de l’âge d’or, voulu par Néron 3 , symbolise<br />
de façon grandiose la voie décidée par le prince. Construite en 64, après l’incendie de Rome,<br />
elle témoigne par son symbolisme religieux des visées théocratiques de Néron, qui se sont<br />
accentuées dans les dernières années de son règne. Ce palais est conçu comme une résidence<br />
sacrée, le digne sanctuaire d’un prince solaire 4 . L’imagerie solaire qui prédomine reprend, en<br />
l’infléchissant, celle à laquelle Sénèque avait eu recours dans le De clementia pour mettre en<br />
place sa théorie stoïcienne de la monarchie 5 . La remarque qu’il fait alors, en manière de<br />
plaisanterie provocatrice, foule aux pieds toutes les leçons de son vieux maître sur le luxe et<br />
les richesses :<br />
1 Dion Cassius, 59, 23, 9.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 2.<br />
3 G.-Ch. Picard, 1962, p. 173.<br />
4 E. Cizek, 1982, p 129 ; Suétone, Ner. 31, 4 ; Tacite, Ann. XV, 52, 2.<br />
5 F. Préchac, 1914, p. 231-242 : dans cet article, F. Préchac défend l’idée que les lettres 90 et 115 à<br />
Lucilius, toutes deux composées en 64, réfèrent à la Domus Aurea. P. Grimal, 1991a, p. 130-131.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
51
Eius modi domum cum absolutam dedicaret, ut se diceret quasi hominem tandem<br />
habitare coepisse. 1<br />
Pour montrer l’éloignement que de telles paroles créent entre le prince et son ministre, au-delà<br />
des conceptions idéologiques qui les sous-tendent, il n’est que de citer ce passage de la lettre<br />
60 à Lucilius, qui fustige les adeptes du luxe :<br />
Hos itaque, ut ait Sallustius, 'uentri oboedientes' animalium loco numeremus, non<br />
hominum, quosdam uero ne animalium quidem, sed mortuorum. 2<br />
L’attitude de Néron montre un réel renversement de situation : Sénèque avait, dans la période<br />
où son influence était la plus importante, utilisé les penchants du prince pour l’amener à<br />
adopter une ligne de conduite conforme à ses préceptes et à la théorie du pouvoir qu’il avait<br />
élaborée. Désormais, Néron semble obéir à une logique transgressive, qui lui fait reprendre les<br />
principes de son ancien précepteur pour les infléchir à sa guise, ou pour les appliquer à<br />
l’inverse de leur destination originale. C’est ainsi que l’on peut comprendre un mot du prince,<br />
rapporté par Suétone, et qui conclut une liste de crimes, dont le dernier fait du prince un ogre<br />
par procuration : une rumeur suppose à Néron le projet de faire dévorer ses ennemis par un<br />
Egyptien anthropophage… Ce passage, qui donne de l’empereur une image monstrueuse, et<br />
contribue à la légende noire qui s’est formée autour de lui, se termine par ces paroles :<br />
1 Suétone, Ner. 31 : « Lorsque le palais que je viens de décrire fut achevé, Néron se contenta de dire en<br />
guise d’éloge qu’il allait enfin commencer à être logé comme un homme. »<br />
2 Sénèque, Ep. 60, 4 : « Ces ‘esclaves de leur ventre’, comme les appelle Salluste, il nous faut donc les<br />
compter parmi les animaux, non parmi les hommes, et pour certains, pas même parmi les animaux,<br />
mais parmi les morts. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
52
negauit quemquam principum scisse quid sibi liceret. 1<br />
Cette affirmation de sa toute puissance constitue une <strong>version</strong> tyrannique du De clementia,<br />
dans lequel Sénèque le plaçait au-dessus des lois 2 :<br />
Ego uitae necisque gentibus arbiter ; qualem quisque sortem statumque habeat, in<br />
mea manu positum est; quid cuique mortalium Fortuna datum uelit, meo ore<br />
pronuntiat. 3<br />
En invitant le prince à la clémence, Sénèque avait tenté de mettre en place un politique de<br />
conciliation avec le Sénat. Loin des purges qui avaient ensanglanté les régimes précédents, le<br />
nouveau régime devait garantir la paix civile et la stabilité en laissant aux sénateurs leurs<br />
prérogatives. Or, dans le passage de Suétone précédemment cité, ces paroles de Néron sont<br />
immédiatement suivies par des allusions menaçantes à l’égard de cette assemblée. La rupture<br />
avec les débuts modérés du règne est donc bel et bien consommée.<br />
B/ L’aspiration à la retraite.<br />
Après la mort de Burrus, Sénèque voyant son crédit décliner 1 , et les accusations contre<br />
lui se multiplier, songe à se retirer de la vie politique et fait part de ce projet à Néron. Au<br />
1 « Il déclara qu’aucun empereur avant lui n’avait connu l’étendue de son pouvoir. »<br />
2 J.-P. Néraudau, 1982, p. 106-107.<br />
3 Clem. I, 2 : « J’ai le droit de vie et de mort sur les nations ; le sort et la situation de tous est entre mes<br />
mains ; ce que la Fortune décide d’accorder à chacun des mortels, elle le proclame par ma bouche. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
53
cours d’une entrevue que Tacite a rendue célèbre, il demande au prince de le relever de ses<br />
fonctions, et de reprendre les richesses qu’il lui a accordées. Le refus qu’il essuie alors<br />
s’explique par des raisons politiques, que Tacite évoque avec vraisemblance :<br />
Non tua moderatio, si reddideris pecuniam, nec quies, si reliqueris principem, sed mea<br />
auaritia, meae crudelitatis metus in ore omnium uersabitur. 2<br />
La retraite de Sénèque mettrait au grand jour une rupture qui risquerait de rassembler les<br />
mécontents, et de radicaliser l’opposition. Sa présence dans l’entourage de Néron maintient<br />
donc la fiction de la continuité. Comme le doit un amicus impérial, il suit le prince dans ses<br />
déplacements, et sans doute à Naples, cadre de la première exhibition publique de Néron 3 . Lui<br />
qui avait tenté d’éviter ce genre de manifestations, en organisant notamment une course de<br />
chars dans une enceinte fermée, se voit contraint d’assister à ce spectacle. Il aspire cependant<br />
à une condition plus obscure, et paraît désormais plus rarement au palais, alléguant son état de<br />
santé ou ses loisirs studieux. Il se consacre à nouveau à la philosophie, et rédige ses Lettres à<br />
Lucilius. On trouve dans cette correspondance de nombreuses mentions de son état d’esprit :<br />
Demus itaque operam, abstineamus offensis. Interdum populus est quem timere<br />
debeamus ; interdum, si ea ciuitatis disciplina est ut plurima per senatum<br />
transigantur, gratiosi in eo uiri ; interdum singuli quibus potestas populi et in<br />
populum data est. Hos omnes amicos habere operosum est, satis est inimicos non<br />
1 B. Baldwin, 1970, p. 187-89, admet que le pouvoir de Sénèque a été affaibli par la mort de Burrus,<br />
mais conteste le jugement de Tacite (Ann. XIV, 52, 1). Selon lui, c’est la faible personnalité de<br />
Faenius Rufus qui a permis à Tigellin de l’emporter.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 56, 2 : « Ce n’est pas ta modération, si tu me rends ces richesses, ni ta retraite, si tu<br />
quittes ton prince, c’est ma cupidité et la crainte de ma cruauté qui seront dans toutes les bouches. »<br />
3 M. T. Griffin, 1976, p. 359 : les lettres de Sénèque sont datées de Naples à cette époque.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
54
habere. Itaque sapiens numquam potentium iras prouocabit, immo declinabit, non<br />
aliter quam in nauigando procellam. 1<br />
Sénèque est en accord avec la philosophie stoïcienne lorsqu’il décide de se retirer : le sage<br />
abandonne l’action lorsque les obstacles sont insurmontables 2 . L’engagement dans les affaires<br />
se justifie, tout comme le refus d’y participer, en fonction des circonstances. En ce sens,<br />
l’attitude de Sénèque est en parfaite cohérence avec la doctrine du Portique 3 . Ses ennemis,<br />
regroupés autour de Poppée, sont alors plus puissants que jamais, et paralysent son action 4 . Il<br />
passe cependant pour le plus notable des opposants à Néron, et sa retraite apparaît comme une<br />
manifestation de son hostilité au régime. On pourrait donc envisager l’évolution de la relation<br />
du prince et de son ancien précepteur selon une logique d’éloignement progressif, jusqu’au<br />
déchirement ultime que constitue la mise à mort du philosophe. Et pourtant, à la veille de sa<br />
disgrâce, on lui reproche d’avoir intensifié sa production poétique pour complaire à<br />
l’empereur. Pourtant, l’exécution qui devrait consacrer la point ultime de la rupture, affirme<br />
encore l’intimité des deux hommes et leur sensibilité commune pour la représentation<br />
tragique.<br />
1 Sénèque, Ep. 14, 7 : « Efforçons-nous donc d’éviter les offenses. Parfois, c’est le peuple que nous<br />
avons à craindre ; parfois, si la forme du gouvernement est telle que l’autorité principale est le fait du<br />
Sénat, ce sont les hommes en crédit dans cette assemblée ; parfois, ce sont les monarques, à qui est<br />
confié le pouvoir du peuple pour qu’ils l’exercent sur le peuple. Il est difficile d’avoir tous ces<br />
hommes pour amis ; il suffit de ne pas les avoir comme ennemis. Voilà pourquoi le sage ne<br />
provoquera jamais la colère des puissants. Bien au contraire, il l’évitera, comme en mer on évite la<br />
tempête. »<br />
2 A. L. Motto & J.R. Clark, 1973, p. 76-79.<br />
3 F. R. Chaumartin, 1985, p. 241.<br />
4 F.R Chaumartin, 1985, p. 190.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
55
C/ La mort du prince et celle du philosophe : un ultime témoignage de leur<br />
affinité avec le théâtre.<br />
1/ La conjuration de Pison et ses conséquences.<br />
La conjuration de Pison précipite la chute de Sénèque. Selon E. Cizek 1 , l’idée d’une<br />
participation active et effective du philosophe à cette entreprise ne peut être admise : les<br />
désillusions de Sénèque et sa volonté de se maintenir dans une retraite studieuse ont dû<br />
l’amener à refuser d’y participer, contrairement à ce qu’affirme Dion Cassius 2 . Mais il ne<br />
devait cependant pas l’ignorer : son propre neveu était au nombre des conjurés 3 , ainsi que<br />
plusieurs de ses amis. Par ailleurs, le personnage de Sénèque, conseiller déchu et ultime<br />
rempart abattu contre le despotisme de Néron, fournissait un symbole de la résistance.<br />
Sénèque n’avait-il pas admis le tyrannicide, lorsque la situation devenait intenable 4 ? Une<br />
rumeur, rapportée par Tacite, fait état des intentions secrètes supposées des conjurés, qui<br />
auraient voulu placer Sénèque, et non Pison, à la tête de l’Etat 5 . S’il n’est pas assuré que le<br />
philosophe ait suscité ou accepté de telles vues, il n’est pas invraisemblable que d’autres aient<br />
voulu rétablir son influence, quitte à faire de lui l’éminence grise du nouveau prince, en<br />
accord avec le parti sénatorial. Toujours est il que cet événement marque de façon très claire<br />
l’écart qui s’est creusé au fil du temps entre le précepteur du prince, inspirateur de sa politique<br />
1 E. Cizek, 1972, p. 160.<br />
2 62, 24, 1.<br />
3 Tacite, Ann. XV, 49, 3.<br />
4 Prou. VI, 6, 7-9 : le traité se termine par une véritable exaltation du suicide.<br />
5 Tacite, Ann. XV, 65 ; Dion Cassius, 62, 2, 1, présente Sénèque comme le chef de la conspiration.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
56
et intercesseur du Sénat, et le ministre désabusé, privé de tout crédit, qui finit par réunir les<br />
opposants.<br />
Lorsque la conspiration est éventée, Sénèque est emporté par la tourmente de la<br />
répression, et contraint de se « soigner » lui-même, c’est-à-dire, en termes néroniens, de se<br />
donner la mort 1 . Le suicide du philosophe est donc une forme d’exécution, dont les historiens<br />
donnent des <strong>version</strong>s plus ou moins favorables. Ainsi, selon Dion Cassius, il aurait contraint<br />
sa femme à partager son sort, affirmant qu’elle témoignerait ainsi du mépris de la mort qu’il<br />
lui avait enseigné. Paulina ne devrait son salut qu’à la mort plus prompte de son époux.<br />
Suétone ne dit qu’un mot de cet événement 2 , et c’est à Tacite que nous devons le témoignage<br />
le plus complet, et le plus favorable, sur ce suicide devenu célèbre 3 . Il faut, bien entendu, faire<br />
la part de la mise en œuvre littéraire dans le récit de Tacite, qui suit la mode des récits de<br />
suicides d’hommes célèbres, en raison des ressources dramatiques qu’elles offrent. Pétrone 4 ,<br />
Thrasea Paetus 5 , offrent à cet égard deux autres exemples de suicides édifiants, et révélateurs<br />
de la personnalité de ces personnages. Cependant, Sénèque avait depuis trop longtemps<br />
médité sur la mort volontaire pour bâcler ce moment 6 , et il est probable qu’il fit de son suicide<br />
un exemple de sa philosophie, un exemplum qui le mettrait, pour ses amis, au rang de ses<br />
modèles, Caton et Socrate, qu’il cite fréquemment dans ses traités 7 :<br />
1 P. Treves, 1970.<br />
2 Ner. 35.<br />
3 Tacite, Ann. XV, 63, 3.<br />
4 Tacite, Ann. XVI, 19.<br />
5 Tacite, Ann. XVI, 34-35.<br />
6 M. T. Griffin, 1976, p. 367-388.<br />
7 H. Naumann, 1969 ; F. F. Schwartz, 1968.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
57
Dic tibi ex istis quae terribilia uidentur nihil est inuictum'. Singula uicere iam multi,<br />
ignem Mucius, crucem Regulus, uenenum Socrates, exilium Rutilius, mortem ferro<br />
adactam Cato: et nos uincamus aliquid. 1<br />
Le suicide de Sénèque peut donc être considéré comme un ultime acte politique, manifestant<br />
la liberté retrouvée à travers la mort, et contre laquelle la tyrannie la plus exacerbée ne peut<br />
rien.<br />
Quaeris quod sit ad libertatem iter? quaelibet in corpore tuo uena. 2<br />
Néron était d’ailleurs bien conscient de la portée de cet événement, puisqu’il empêcha Paulina<br />
de partager le sort de son époux 3 .<br />
2/ Des morts dramatisées.<br />
A l’heure de leur mort, Sénèque et Néron ont toutefois un point commun, qui est le<br />
caractère dramatique accentué de leurs derniers instants. L’un et l’autre jouent leur propre<br />
rôle, dans ce qui constitue le dernier acte de leur vie. La comparaison est d’autant plus<br />
intéressante que les deux termes n’en sont pas rapportés par la même source (il n’y a donc pas<br />
d’intention affichée d’établir un parallèle). Suétone développe longuement les derniers<br />
1 Sénèque, Ep. 98, 12 : « Oui, de tous ces maux qui paraissent effroyables, aucun n’est invincible.<br />
Nombreux sont ceux qui les ont vaincus, l’un après l’autre, Mucius le feu, Regulus la torture, Socrate<br />
le poison, Rutilius l’exil, Caton la mort donnée par le fer : à nous d’en vaincre un. »<br />
2 Ir. III, 15, 3-4 : « Tu me demandes le chemin de la liberté ? N’importe quelle veine de ton corps. » cf.<br />
Prou. 6, 7-8.<br />
3 Tacite, Ann. XV, 64, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
58
moments de Néron, et ne dit presque rien de la mort de Sénèque. Tacite en revanche consacre<br />
un assez long passage à Sénèque, mais les Annales s’achèvent bien avant la chute du prince.<br />
Bien sûr, les circonstances sont différentes, et l’attitude des deux hommes ne peut être<br />
comparée : courage et noblesse d’un côté, lâcheté de l’autre. Ce qui permet de mettre en<br />
parallèle les deux fins, c’est leur aspect théâtral, et la conscience plus ou moins nette qu’il faut<br />
bien remplir son rôle avant de quitter la scène.<br />
Dans les deux cas, c’est un suicide contraint. Néron, sur les conseils de ses<br />
compagnons, applique les leçons de son maître ! En effet, dans nombre des exemples qu’il<br />
convoque dans ses traités, la mort volontaire est un moyen de se soustraire à la torture, et c’est<br />
précisément le conseil qui est donné au prince : ut quam primum se impendentibus<br />
contumeliis eriperet 1 . La description du supplice qui l’attend, conformément à la coutume des<br />
ancêtres, achève de le convaincre : nudi hominis ceruicem inseri furcae, corpus uirgis ad<br />
necem caedi 2 . Ainsi, le suicide est pour Néron le seul moyen d’échapper à une mort<br />
ignominieuse. Ses hésitations contrastent cependant avec la tranquille résolution de Sénèque.<br />
Devant ses esclaves, Sénèque verse l’eau chaude qui doit hâter son trépas en libation à<br />
Jupiter Libérateur 3 , illustrant ainsi de manière dramatique l’idée que le suicide est une<br />
libération. La mort de Sénèque se joue devant une assistance choisie : il reçoit en effet l’ordre<br />
de Néron alors qu’il est en train de dîner avec sa femme et deux de ses amis 4 . Ses secrétaires<br />
1 Suétone, Ner. 49.<br />
2 « On déshabille le condamné, puis on lui passe le cou à travers une fourche, et on le frappe de verges<br />
jusqu’à ce que mort s’ensuive. »<br />
3 Tacite, Ann. XV, 64, 4. Thrasea fit de même, XVI, 35, 1. Une pièce d'or de Corinthe (B. M. C., Imp.<br />
I, no 110) assimilait Néron à Jupiter Liberator. Le geste de Sénèque prend alors une double<br />
signification : à l’idée de la libération par la mort s’ajoute l’affirmation symbolique de la<br />
responsabilité de Néron dans le suicide de son ancien précepteur.<br />
4 Tacite, Ann. XV, 60, 4. Il s’agit peut-être de Fabius Rusticus, source probable du récit de Tacite, et<br />
qui a vraisemblablement été témoin de la scène (XV, 61, 3), et de Statius Annaeus, qui est mentionné<br />
au chapitre 64, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
59
assistent à son dernier discours, dont il ne reste rien 1 . Les membres de la domus, esclaves et<br />
affranchis de Sénèque sont également présents, et c’est à eux que le philosophe adresse ses<br />
dernières paroles 2 . A cette petite assemblée s’ajoutent les soldats et un centurion, chargés de<br />
surveiller le déroulement des opérations, et, par exemple, de maintenir en vie Paulina. Devant<br />
cette assistance, Sénèque est comme un acteur qui joue le dernier acte d’une pièce, et dont<br />
l’inspiration socratique ne fait guère de doute. Ses dernières paroles s’adressent à ses amis et à<br />
sa familia, et au-delà, par le biais du discours qu’il prononce devant ses secrétaires, au public<br />
et à la postérité, à laquelle il offre l’exemple concret de la mort libératrice, conformément aux<br />
préceptes qu’il a développés par ailleurs. Ainsi, le centurion qui refuse de lui faire apporter les<br />
tablettes de son testament ne peut l’empêcher de livrer ses dernières volontés, et de laisser à<br />
ses amis le bien le plus précieux, imago uitae suae 3 .<br />
L’impression de dramatisation vient aussi des préparatifs ordonnés par Néron : l’eau,<br />
le bois, le marbre, la fosse qu’il ordonne de creuser, sont les éléments du décor que réclame la<br />
situation. Néron peine pourtant à convenir à ce dernier rôle, et se reproche sa lâcheté tout en<br />
s’exhortant à adopter un comportement convenable. Il répète ces mots : oujj prevpei Nevrwni,<br />
oujj prevpei. Il cite l’Iliade, comme pour s’encourager à se comporter comme les héros<br />
mythologiques dont il a auparavant joué les rôles. Néron, qui confère volontiers à ses crimes<br />
une dimension dramatique 4 , devient le metteur en scène pitoyable de sa propre mort. Il invite<br />
Sporus à commencer les lamentations, demande que quelqu’un lui montre l’exemple. Il est<br />
1 Tacite, Ann. XV, 63, 3.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 64, 1 et 4.<br />
3 Tacite, Ann. XV, 62, 1.<br />
4 R. M. Frazer, 1966-67, étudie cette tendance de Néron à dramatiser ses crimes. Il cite, outre<br />
l’exemple bien connu du complot contre Agrippine, dont l’idée lui aurait été donnée par une<br />
représentation théâtrale (Dion Cassius, 61, 12, 2), le meurtre de Rufrius Crispinus, qui réalise un<br />
épisode de la mythologie grecque (Suétone, Ner. 39, 2) : comme le fils de Nauplius, Crispinus est<br />
noyé lors d’une partie de pêche : voir infra, p. 420.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
60
aidé par Epaphrodite pour le geste fatal, échouant ainsi dans sa tentative de mourir en héros<br />
tragique. Dion Cassius présente explicitement cet épisode comme la dernière tragédie de<br />
Néron 1 . Après avoir tenté de déjouer la révolte de Vindex sur le mode dramatique, il<br />
interprète péniblement sa propre mort, dans ce qui apparaît comme le climax de son attitude<br />
théâtrale 2 . Acta est fabula…<br />
Ainsi, la mort du prince et celle du philosophe offrent un ultime témoignage de leur<br />
affinité pour le théâtre. On a souvent souligné la mise en œuvre tragique de l’histoire dans les<br />
Annales de Tacite, présentées comme une suite de tragédies 3 . Dans cette perspective, le<br />
suicide de Sénèque, dernier rempart contre la tyrannie de Néron et représentant du parti de la<br />
vertu, constitue un épisode capital de l’évolution du règne, et il est traité comme tel. D’un<br />
autre côté, la vie et les écrits de Sénèque rendent tout à fait plausible une telle dramatisation.<br />
La mort volontaire, maintes fois évoquée, avec des accents d’enthousiasme quelquefois,<br />
trouve dans cette réalisation sa pleine signification. Le philosophe présente, non sans orgueil,<br />
sa propre fin comme un exemple à méditer. En outre, l’auteur des tragédies, qui a mis en<br />
scène la mort glorieuse de tant de héros, trouve dans sa propre expérience une ultime<br />
inspiration. On peut raisonnablement penser que Sénèque, qui s’attendait sans doute à se voir<br />
signifier son arrêt de mort par son ancien disciple, avait médité et préparé ces derniers<br />
instants, et que le souci esthétique s’est allié aux préoccupations philosophiques.<br />
Sénèque a conservé une image d’opposant et de résistant à la tyrannie, même si<br />
certains soulignent la responsabilité qu’il a dû avoir dans l’évolution de Néron. La biographie<br />
de Sénèque montre pourtant que les relations du prince et du philosophe ne se laissent pas<br />
1 63, 28.<br />
2 A. M. Gowing, 1997, p. 2579. L’attitude d’Auguste, qui demande au moment de mourir s’il a bien<br />
joué son rôle (Suétone, Aug. 99, 1 ; Dion Cassius, 56, 30, 4), est comparée à celle de Néron, p. 2586.<br />
3 B. Segura-Ramos, 1998 ; R. Mellor, 1993, p. 120.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
61
éduire si facilement. L’évolution de l’attitude de Sénèque à l’égard de Néron, pendant la<br />
quinzaine d’années qui s’étend du préceptorat à la disgrâce et à la condamnation à mort,<br />
pourrait se résumer à un passage de l’influence au compromis, puis à la résistance et à<br />
l’opposition. Les espoirs qu’offrait le jeune prince de voir se mettre en place un<br />
gouvernement qui répondrait aux exigences politiques et philosophiques de son mentor et<br />
conseiller se sont avérés vains, et la déception a pris la place de l’enthousiasme qu’exprimait<br />
le De clementia.<br />
Cependant, la question de la politique spectaculaire de Néron, et de ses ambitions<br />
artistiques, demeure centrale, et vient mettre à mal la solidité de cette théorie. Sénèque a pu<br />
favoriser certaines tendances du prince, et l’encourager parfois dans cette voie, et ce parti-pris<br />
ne relève pas de la simple stratégie. Si c’était le cas, il faudrait incriminer la maladresse du<br />
ministre, qui a laissé se développer chez l’empereur une passion dont il savait qu’elle<br />
deviendrait incontrôlable, comme elles le sont toutes. Sénèque n’a pas laissé Néron chanter<br />
comme on passe un caprice à un enfant gâté, en espérant ainsi le mener où l’on veut. Il a<br />
participé à l’élaboration et à la mise en place de la révolution culturelle néronienne. Que les<br />
conséquences de cette politique lui aient échappé, c’est probable, et même certain, et c’est<br />
sans doute une part importante de sa déception dans les dernières années de sa vie.<br />
Cependant, la part dramatique de son œuvre révèle non seulement un goût réel et prononcé<br />
pour la poésie tragique, mais encore la conscience que la tragédie joue un rôle fondamental, et<br />
qu’elle est, plus que jamais, intimement liée à la politique impériale. La relation de Sénèque et<br />
Néron dépasse, on le voit, la contradiction fondamentale qui concourt souvent à la définir, et<br />
il faut sans doute rechercher l’origine de cette proximité dans ce qui constitue la base de la<br />
rencontre, l’éducation de Néron.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
62
Chapitre 2. L’éducation de Néron et la place des activités<br />
artistiques.<br />
L’éducation, et surtout celle d’un gouvernant, peut être, à juste titre, considérée<br />
comme l’une des clefs de sa personnalité et de ses motivations politiques : s’interroger sur<br />
l’enfance et la jeunesse de Néron permet, en d’autres termes, de remonter à la source de son<br />
caractère, et d’expliquer son évolution tout au long de sa vie et de son règne. Alors, de même<br />
que les récits héroïques insistent sur l’enfance et la formation, pour ajouter à l’aura d’un<br />
personnage exceptionnel, les textes qui font de Néron un monstre cherchent dans la jeunesse<br />
et l’éducation les germes d’un mal appelé à se développer, et à faire des ravages d’autant plus<br />
grands qu’ils rencontrent un terrain fertile et des circonstances favorables.<br />
I/ Etat de la question : deux grandes orientations.<br />
A/ Une éducation déplorable, expliquant la formation du monstre ?<br />
L’éducation de Néron, et son rôle dans la future politique impériale et les dérives qui<br />
s’ensuivirent, ont donné lieu à de nombreux débats. Les historiens anciens s’accordent à la<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
63
juger indigne, négligée et bâclée. Dion Cassius, qui considère Néron comme l’émule de<br />
Caligula, attribue la responsabilité de son évolution déplorable à son caractère autant qu’à son<br />
entourage 1 . Suétone développe les mêmes causes, et y ajoute l’hérédité 2 . Tacite, s’il ne retrace<br />
pas l’enfance du prince, insiste sur l’influence de son entourage, et surtout de sa mère,<br />
Agrippine 3 : celle-ci ne parle et n’agit que pour servir son ambition, dont Néron est<br />
l’instrument 4 . Il évoque également l’action concertée de Sénèque et Burrus 5 , leur effort pour<br />
modérer les instincts de Néron et leur opposition à la mère de l’empereur 6 . Parmi les autres<br />
personnages qui ont entouré la jeunesse du prince, Tacite nomme Anicetus 7 : ancien<br />
pédagogue de Néron, celui-ci lui suggère le plan d’exécution d’Agrippine, à l’aide d’un<br />
navire piégé. Pâris, pantomime de la maison de Lépida, et attaché à Néron dans sa petite<br />
enfance, est cité comme le compagnon de débauches du prince 8 . Ces deux derniers<br />
personnages, qui ont été chargés de l’éducation de Néron pendant une courte période, donnent<br />
de cette formation une image très négative, en raison du type d’influence qu’ils conservent<br />
auprès du prince. Enfin, les ennemis de Sénèque lui font aussi grief de l’éducation qu’il lui a<br />
donnée, et leurs critiques portent notamment sur la place de la rhétorique et de la poésie dans<br />
son enseignement 9 .<br />
1 Dion Cassius, 61, 4-5.<br />
2 Suétone, Ner. 1.<br />
3 E. Paratore,1952 ; L. W. Rutland, 1978/79.<br />
4 Tacite, Ann. XII, 3, XIII, 5 et 13, 4.<br />
5 Tacite, Ann. XIII, 2, 1 et 2. Dion Cassius, 60, 8 ; 32 ; 35.<br />
6 F. Giancotti, 1953d ; D. Gillis, 1963 ; D. Flach, 1973.<br />
7 Ann. XIV, 3, 3.<br />
8 Ann. XIII, 20, 1.<br />
9 Ann. XIV, 52, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
64
Parmi les savants modernes, I. Lana 1 soutient ces accusations : sous prétexte d’assurer<br />
l’éducation de Néron, Sénèque n’aurait cherché qu’à acquérir sur lui une influence de plus en<br />
plus importante, afin de supplanter celle d’Agrippine. Il confirme ainsi ce que Suétone<br />
rapporte de l’enseignement de la rhétorique par le philosophe : il n’aurait pas fait connaître au<br />
jeune homme les grands orateurs classiques, afin de concentrer sur lui seul et ses œuvres<br />
l’admiration de Néron 2 . En outre, Sénèque n’a fait que suivre les penchants de son élève, et<br />
s’est mis à composer les tragédies quand Néron a commencé à manifester de l’intérêt pour cet<br />
art. A ce compte, l’éducation de Néron n’est que l’enjeu d’une lutte pour le pouvoir dont<br />
Sénèque aurait été partie prenante, et qu’Agrippine a payée de sa vie.<br />
Les conséquences de l’éducation de Néron sur sa politique et sur son administration<br />
sont exposées par E. Lepore 3 : le caractère dilettante et superficiel que les sources anciennes<br />
reprochent aux actions de Néron 4 est, selon lui, lié à la formation qu’il a reçue. R.F. Martin 5<br />
s’intéresse davantage aux tout débuts de cette éducation : la situation de l’enfant, laissé à la<br />
garde de sa tante par une mère en exil, puis entouré des diverses intrigues qui se nouent autour<br />
de lui, ne réunit pas les conditions d’une formation solide et cohérente. Il précise cependant<br />
que cela s’arrange par la suite. On peut donc avoir, dans un premier temps, l’image d’un<br />
enfant mal influencé par une éducation sans véritable cohérence, dont la seule finalité est de<br />
satisfaire aux ambitions de son entourage. Les nombreuses carences de cette formation<br />
fourniraient ainsi des éléments d’explication à la dérive tyrannique qui entraîna Néron à la<br />
mort ignominieuse que l’on sait.<br />
1 I. Lana, 1955, p. 173-178.<br />
2 Suétone, Ner. 52, 1 ; Quintilien, I. O. X, 1, 128.<br />
3 E. Lepore, 1948, p. 85-86.<br />
4 Par exemple, ses prodigalités insensées : Dion Cassius, 61, 18 ; Suétone, Ner. 11.<br />
5 R. F. Martin, 1991, p 236-237.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
65
B/ Une éducation classique ?<br />
Cependant, d’autres auteurs nuancent ou révisent ce point de vue, en grande partie<br />
légué par les historiens anciens. D’après leurs études, Néron a reçu une éducation classique,<br />
largement comparable à celle de tout jeune garçon de la grande noblesse romaine de cette<br />
époque. M. A. Levi 1 affirme que la formation de Néron a été sans doute très proche de celle<br />
qu’a reçue Octave. G. Achard 2 distingue l’entourage du jeune garçon et son instruction<br />
proprement dite. Il souligne que l’atmosphère d’intrigues de cour et la grande liberté de<br />
mœurs qui règnent à l’époque ne sont guère favorables à l’épanouissement d’un enfant, qui<br />
est par ailleurs privé de tendresse. L’éducation elle-même est, au contraire, riche et complète,<br />
d’influence largement hellénistique, et la place des arts est naturellement importante dans ce<br />
programme. Mais le personnel en charge de Néron dans sa petite enfance, le danseur et le<br />
barbier que mentionne Suétone, n’a peut-être pas eu sur son développement ultérieur une<br />
influence excessive. C’est l’opinion d’E. Cizek 3 , qui rappelle que ces deux personnages ne se<br />
sont vus confier Néron que pendant une courte période, alors qu’il n’avait que trois ou quatre<br />
ans. Par la suite, le futur prince a reçu une éducation riche et complète, obéissant à un<br />
programme défini. Comme elle constituait un élément fondamental du plan politique<br />
d’Agrippine, qui entendait accéder au pouvoir par l’intermédiaire de son fils, elle n’a pas pu<br />
être négligée. Agrippine semble donc jouer un rôle essentiel dans la formation de son fils,<br />
qu’elle organise et contrôle avec une grande minutie : plusieurs études insistent sur la place<br />
1 M. A. Levi, 1949, p. 148.<br />
2 G. Achard, 1995, p. 12-14.<br />
3 E. Cizek, 1972, p. 44-45.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
66
centrale qu’elle occupe dans l’éducation de Néron, choisissant ses maîtres et coordonnant leur<br />
action 1 .<br />
C/ Enjeux du débat : des clefs pour comprendre l’évolution du règne de Néron,<br />
et le développement de ses penchants tyranniques.<br />
Le contenu de cette éducation ne peut être défini autrement que de manière très<br />
générale, selon F. Giancotti 2 . La place des activités artistiques pose donc un problème : selon<br />
l’importance qu’on leur a donnée, en effet, l’éducation de Néron aura joué un rôle plus ou<br />
moins décisif dans ce qui fait la particularité de la politique néronienne. La personnalité<br />
écrasante d’une mère, mue par sa seule passion, l’ambition, a-t-elle créé chez Néron un besoin<br />
d’évasion, qu’il a trouvée dans la poésie et la musique, comme le suggère G. C. Picard 3 ? Est-<br />
ce Sénèque qui, pour discipliner la nature colérique de son élève, lui a donné ce goût 4 ? Ou<br />
bien le précepteur s’est-il simplement servi de ce penchant pour affermir son influence 5 ? La<br />
multiplication des hypothèses est tout à fait significative de l’importance de l’art dans la vie<br />
personnelle et politique de Néron. Le goût de Néron pour l’art, et en particulier pour la<br />
représentation, a eu des conséquences si grandes que la recherche de ses causes préoccupe de<br />
nombreux savants.<br />
1 E. Parker, 1946 ; M. Morford, 1968, p. 57-65. G. C. Picard, 1962, p. 140, souligne les conséquences<br />
désastreuses de cette influence.<br />
2 F. Giancotti, 1953c, p. 102-118.<br />
3 F. Giancotti, 1953c, p. 145.<br />
4 M. Morford, 1968, p. 57-65. Les craintes de Sénèque quant aux prédispositions de son élève à la<br />
colère peuvent être signalées par ce que Suétone raconte du songe de Sénèque (Ner. 7), mais aussi par<br />
le présage cynique de son père (Ner. 6).<br />
5 Suétone, Ner. 52, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
67
On le voit, la question de l’éducation de Néron représente un enjeu fondamental dans<br />
l’étude de son règne. Une mère dominatrice, un précepteur philosophe, un danseur, sont<br />
autant d’éléments, apparemment disparates, d’un tout que l’on peine à saisir. Et pourtant,<br />
l’hypothèse de l’incohérence, que nous ont laissée les auteurs anciens, ne semble guère<br />
satisfaisante, car elle suppose que la personnalité de Néron s’est développée de manière<br />
aléatoire, sous des influences diverses et contradictoires, à partir d’un naturel corrompu. La<br />
passion que Néron a nourrie pour la musique et le théâtre n’est ni une per<strong>version</strong> parmi<br />
d’autres, ni un signe de son incapacité à régner, ni même la conséquence d’une éducation<br />
négligée.<br />
Pour expliquer l’évolution désastreuse du règne de Néron, les auteurs anciens insistent<br />
généralement sur la conjonction de la nature et de l’éducation 1 . Or, on sait que parmi les<br />
sources dont nous disposons, la plupart sont défavorables, voire franchement hostiles à ce<br />
prince 2 . Quand Suétone rapporte que Néron, tout jeune enfant, est confié aux soins d’un<br />
danseur et d’un barbier chez sa tante Lépida 3 , il entend montrer que, dès son plus jeune âge, le<br />
prince a été entouré de gens corrompus et débauchés, ou incompétents, qui ont laissé les vices<br />
croître et se fortifier dans l’âme de leur maître, pour aboutir au résultat déplorable que<br />
1 Dion Cassius, 61, 4 : Néron est naturellement enclin à la mollesse et à l’oisiveté, et son éducation,<br />
ainsi que l’attitude de Sénèque et Burrus dans les premières années du règne n’ont fait qu’aggraver<br />
cette tendance.<br />
2 Un schéma des sources est présenté par E. Cizek, 1972, p. 35. Il apparaît que la majorité des auteurs<br />
sont anti-néroniens, même si l’on trouve çà et là, chez certains, quelques éléments favorables. Ainsi,<br />
parmi les sources de Tacite, Cluvius Rufus passe pour être plus favorable à Néron. Par exemple, il<br />
attribue l’initiative de l’inceste à Agrippine, alors que Fabius Rusticus en attribue la responsabilité à<br />
Néron : M. M. Sage, 1990, p. 1013. Même parmi les partisans des Annaei, seuls Fabius Rusticus, M.<br />
Vacca et Martial tempèrent la condamnation générale de Néron. La tradition chrétienne, largement<br />
hostile à Néron, et pour cause, a suivi la pente générale.<br />
3 Suétone, Ner. 6, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
68
l’historien développe dans la deuxième partie de sa biographie 1 . Les tonsores, coiffeurs ou<br />
barbiers, ont en effet une solide réputation de bavards, et leurs boutiques sont souvent le lieu<br />
où circulent les potins les plus divers 2 : une telle superficialité donne l’image d’une éducation<br />
négligée, et d’un entourage peu choisi. Certains danseurs, les histrions ou ludions dont Pâris<br />
fait partie 3 , ont encore bien plus mauvaise réputation, celle d’être des débauchés qui exhibent<br />
et prostituent leur corps.<br />
La séparation affichée de l’ouvrage entre une « bonne » et une « mauvaise » partie,<br />
l’une traitant de l’homme, et l’autre du monstre, est à l’évidence artificielle, et l’on ne peut<br />
que ressentir une impression de continuité, confirmée par la lecture des Annales de Tacite :<br />
selon lui en effet, les vices de Néron se sont développés progressivement, à mesure que les<br />
obstacles à ses passions disparaissaient. L’évolution de Néron, son abandon progressif à des<br />
passions toujours moins bridées, s’accompagnent de l’élimination progressive de ceux qui<br />
tentaient de le maîtriser : Agrippine, bien sûr, en tout premier lieu, puisque l’ascendant qu’elle<br />
entendait garder sur son fils procédait de sa libido dominandi, et constituait un réel danger<br />
politique 4 . Burrus, ensuite 5 , trouva la mort dans des conditions mystérieuses, sans que l’on<br />
puisse pour autant arriver à des conclusions certaines sur la culpabilité de Néron. Il fut<br />
remplacé dans ses fonctions de préfet du prétoire par le sinistre Tigellin, dont l’influence<br />
1 Tacite, D. XXVIII : Recherche des causes de la décadence de l'éloquence. L'éducation. Autrefois les<br />
mères s'occupaient elles-mêmes de leurs enfants, assistées d'une vieille parente servant de caution<br />
morale. Aujourd'hui les enfants sont livrés à des "nourrices mercenaires" qui les dépravent dès la<br />
naissance.<br />
2 Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s.u. tonsor, p. 355.<br />
3 M.-H. Garelli-François, 1995, p. 29-43 : toutes les formes de danse ne sont pas également<br />
considérées à Rome : les danses rituelles, notamment représentées par les Saliens, ou les exercices<br />
virils des guerriers, constituent des activités dignes du citoyen romain.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 7, 5 ; Suétone, Ner. ; Dion Cassius 61, 12, 1.<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 51, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
69
croissante a renforcé le côté tyrannique du pouvoir 1 . Sénèque, enfin 2 , fut contraint au suicide<br />
après avoir été disgrâcié. Ces trois personnages, qui ont entouré la jeunesse de Néron et les<br />
débuts de son règne, sont des figures d’autorité que Néron supportait de plus en plus mal.<br />
Tigellin, en revanche, est parfois présenté comme un anti-Sénèque, un professeur en matière<br />
de tyrannie 3 , ce qui suppose que Néron s’est affranchi d’une influence bénéfique, celle du<br />
philosophe, pour suivre un autre modèle. Cependant, cette antithèse, bien que séduisante à<br />
première vue, donne l’impression que Néron n’a fait que décider par qui il souhaitait être<br />
dirigé. En réalité, l’ascendant de Tigellin n’égala jamais celui de Sénèque 4 .<br />
II/ La formation d’un futur empereur.<br />
Le débat ainsi posé amènerait à la conclusion que la rencontre du prince et du<br />
philosophe se solde par un échec, et que l’éducation de Néron ne donne, finalement, que des<br />
résultats déplorables. Mais que savons-nous de la formation du prince ?<br />
A/ L’enfance : le danseur et le barbier.<br />
Revenons à l’époque où le jeune Domitius, alors âgé de deux ans, est confié à sa tante<br />
Lépida. Agrippine est alors exilée, Caligula est au pouvoir, et le père de l’enfant, que Suétone<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 57, 1.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 61.<br />
3 Plutarque, Galb. 20.<br />
4 E. Cizek, 1972, p. 160. Voir supra, p. 49-50.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
70
décrit comme un sinistre personnage 1 , meurt en 40. A ce moment, Néron est entouré d’Eglogé<br />
et Alexandra, deux nourrices d’origine orientale, et fidèles comme les nutrices des tragédies.<br />
Le danseur est sûrement l’histrion Pâris, appartenant à la maison de Lépida, et dont la<br />
présence constante aux côtés de Néron, par la suite, peut confirmer l’influence qu’on est tenté<br />
de lui prêter : d’après Tacite, c’est le compagnon et l’instigateur des débauches du prince 2 , et<br />
à ce titre, il lui est indispensable. Quant au barbier, il est possible qu’il s’agisse de Thalamus,<br />
dont parle Martial dans ses Epigrammes 3 . L’idée que Pâris, présent dans l’entourage de Néron<br />
depuis sa tendre enfance, a pris sur lui un ascendant très important, au point de contribuer à<br />
lui donner la passion de l’art et du spectacle, est parfaitement plausible, même si cette<br />
influence est un facteur parmi d’autres de la formation de la personnalité de Néron. D’autre<br />
part, il serait imprudent de donner une trop grande importance au choix de ceux qui ont<br />
constitué à cette époque l’entourage du futur prince. Il est en effet tout à fait habituel de<br />
confier le soin des jeunes enfants à des esclaves ou à des affranchis. Bien plus, le fait de<br />
confier un jeune enfant à une nourrice n’est pas le symptôme déplorable de la démission<br />
parentale, bien au contraire 4 . Néron, recueilli par sa tante, est tout de même élevé dans<br />
l’entourage d’une princesse : l’indigence dont parle Suétone 5 ne désigne pas<br />
vraisemblablement le train de vie de Lépida.<br />
Un pantomime doit posséder une faculté de distraire, rendant sa présence souhaitable<br />
auprès d’un enfant qui rappelons-le, était séparé de sa mère. De plus, dans son traité sur la<br />
1 Suétone, Ner. 5.<br />
2 Tacite, Ann. XIII, 20, 1 : (...)Paris, solitus alioquin id temporis luxus principis intendere. «Pâris,<br />
qui d’ordinaire venait à cette heure ranimer les débauches du prince... » ; XIII, 22, 2 ; 27, 3 ; Suétone,<br />
Ner. 54, 2 ; Dion Cassius, 63, 18, 1. Sur ce personnage et son rôle à la cour de Néron, H. Leppin,<br />
1992, p 270-271.<br />
3 Martial, VIII, 52, 2. Référence citée par A. Bélis, 1989, p. 748.<br />
4 M. Corbier, 1999 : c’est le souci que les Romains avaient de leurs enfants qui les amenait à en<br />
confier le soin à des nourrices bien choisies.<br />
5 Suétone, Ner. 6.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
71
danse, Lucien établit longuement le catalogue des mythes, classés géographiquement, que le<br />
danseur doit parfaitement connaître afin de les représenter au plus juste 1 : c’est toute l’histoire<br />
du monde qui est ainsi convoquée, depuis le chaos jusqu’à Cléopâtre. A cela s’ajoutent une<br />
indispensable maîtrise des grands auteurs : Homère, Hésiode, les tragiques. 2 Le pantomime<br />
Pylade, à l’époque d’Auguste, pouvait s’enorgueillir des nombreux personnages<br />
mythologiques dont il pouvait jouer le rôle 3 . Ainsi, si les dérives futures de Néron trouvent<br />
dans l’influence de Pâris un élément d’explication, on ne peut en revanche affirmer qu’une<br />
éducation négligée en est la cause. Néron reçoit dès le départ les attentions que l’on porte<br />
habituellement aux enfants romains de bonne naissance, et la suite le confirme.<br />
B/ Sous la direction d’Agrippine, une éducation au service de ses ambitions<br />
politiques : Chaérémon et Sénèque.<br />
En 41, à la faveur de l’avènement de Claude, Agrippine rentre d’exil et prend soin de<br />
l’éducation de son fils, poussée selon Tacite par sa propre ambition, spes dominationis 4 : en<br />
effet, c’est seulement par l’intermédiaire de ce fils qu’elle peut espérer exercer un jour le<br />
pouvoir, et c’est de toute évidence ce qui motive ses actes, depuis le mariage avec Claude<br />
jusqu’à la mort de ce dernier, en passant bien sûr par l’adoption de Néron par l’empereur.<br />
Mais, encore une fois, il ne s’agit pas d’une nouveauté absolue. Par exemple, Cornelia, mère<br />
des Gracques, a suivi de près les études de ses fils, en choisissant pour eux les maîtres les plus<br />
1 Lucien, De la danse, 37-60.<br />
2 Lucien, De la danse, 61.<br />
3 G. Sauron, 1994, p. 554-555.<br />
4 Tacite, Ann. XII, 8. Anicetus détestait Agrippine et était haï d’elle : Tacite, Ann. XIV, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
72
compétents et les plus prestigieux 1 . En attendant, le jeune garçon reçoit le premier degré<br />
d’enseignement, celui du litterator, assuré par deux affranchis, Anicetus et Beryllus 2 . Encore<br />
une fois, rien ne déroge aux habitudes de la noblesse romaine. Néron reçoit une culture<br />
classique conforme à son rang : grec et latin, rhétorique et mathématiques.<br />
Un peu plus tard, Chaérémon, grand savant et figure de la culture hellénistique de<br />
l’époque, remplit la fonction de grammaticus auprès de Néron. Il s’agit d’un prêtre égyptien,<br />
un « greffier sacré » converti au stoïcisme 3 : l’influence orientale dans l’éducation du futur<br />
empereur est ici indéniable, et contribue sans doute à expliquer certaines orientations de la<br />
pensée et de la politique néroniennes. Mais il existe depuis longtemps à Rome une influence<br />
grecque sur l’éducation 4 . De plus, l’Egypte, où le pharaon était roi en même temps que Dieu,<br />
exerce depuis l’époque de la République une fascination particulière sur les Romains : Néron,<br />
comme avant lui Gallus, Germanicus, ou Caligula, a été fasciné par ce pays. La présence<br />
d’une figure de la culture égyptienne aux côtés du jeune Néron a sans doute renforcé certains<br />
aspects de l’idéologie impériale : souverain de l’Empire, le prince est donc également le<br />
maître de l’Egypte. Il peut ainsi être, lui aussi, associé à une divinité et traité comme tel. C’est<br />
ainsi qu’une inscription célèbre fait de Néron « le dieu bienfaisant de l’univers », et l’assimile<br />
à Osiris, à l’occasion d’une crue du Nil particulièrement bénéfique pour la région 5 .<br />
L’influence probable de Chaérémon est conforme à l’air du temps, et prend place dans un<br />
courant bien plus vaste, qui donne à l’Egypte une aura particulière à cette époque. D’autre<br />
1 H. I. Marrou, 1965, p. 362.<br />
2 Suétone, Ner. 22, 1.<br />
3 M. Frede, 1989, p. 2068.<br />
4 H. I. Marrou, 1965, p. 357.<br />
5 L. Janssens, 1988.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
73
part, le choix d’un personnage érudit et de bonne réputation 1 témoigne du prestige et de<br />
l’ascendant d’Agrippine dans ces années 46-47.<br />
En 49, Agrippine, nouvelle impératrice grâce à son mariage avec Claude, fait rappeler<br />
d’exil un homme brillant et apprécié dans la bonne société de Rome pour ses talents<br />
d’orateur : Sénèque 2 , relégué en Corse depuis huit ans sous l’influence de Messaline, à la suite<br />
d’une intrigue de palais, est désormais attaché à la personne de Néron, comme précepteur tout<br />
d’abord, puis comme amicus principis jusqu’à sa retraite et sa disgrâce. La même année,<br />
Agrippine arrange les fiançailles de son fils et de la fille que Claude a eue de Messaline,<br />
Octavie 3 : dès lors, la destinée de Néron est intimement liée à celle de la famille impériale, et<br />
le pouvoir suprême paraît à portée de main. Il reste encore à évincer Britannicus, fils de<br />
Claude, mais le temps n’en est pas encore venu. En attendant, la présence de Sénèque aux<br />
côtés de Néron confirme l’idée d’une éducation planifiée, avec un arrière-plan politique<br />
conscient. Sénèque est en effet un haut personnage, brillant et mondain, que son exil n’a pas<br />
fait oublier 4 . En le faisant rappeler, Agrippine manifeste aux yeux de tous son crédit (c’est la<br />
nouvelle impératrice), et se fait bien voir de l’opinion en favorisant un auteur dont le talent est<br />
apprécié 5 . Tacite témoigne de ce plan :<br />
At Agrippina, ne malis tantum facinoribus notesceret, ueniam exsilii pro Annaeo Seneca,<br />
simul praeturam impetrat, laetum in publicum rata ob claritudinem studiorum eius, utque<br />
Domitii pueritia tali magistro adolesceret, et consiliis eiusdem ad spem dominationis<br />
1 Sur Chaérémon, et sa possible assimilation au savant Chamandre, lié à Sénèque et cité dans les<br />
Questions Naturelles, VII, 5, 3, voir P. Grimal, 1991a, p. 68-70 et p. 160.<br />
2 Tacite, Ann. XII, 8.<br />
3 Tacite, Ann. XII, 9.<br />
4 G. W. Clarke, 1965.<br />
5 Tacite, Ann. XII, 8.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
74
uterentur, quia Seneca fidus in Agrippinam memoria beneficii, et infensus Claudio dolore<br />
iniuriae, credebatur. 1<br />
Sénèque était-il en outre un ancien amant d’Agrippine 2 ? Peut-être, mais, comme on le voit, il<br />
y avait bien d’autres raisons de confier à Sénèque l’éducation de Néron. L’impératrice choisit<br />
en Sénèque un allié, qui rende son fils capable de prendre la place de Claude, et qui, par la<br />
suite, l’aide à le diriger à sa guise. La suite montre que Sénèque, comme Burrus, loin de<br />
seconder l’influence d’Agrippine, aide Néron à se défaire de sa tutelle :<br />
Certamen utrique unum erat contra ferociam Agrippinae, quae, cunctis malae<br />
dominationis flagrans, habebat in partibus Pallantem, quo auctore Claudius nuptiis<br />
incestis et adoptione exitiosa semet peruerterat. 3<br />
En attendant, c’est en tant que personnalité intellectuelle et politique, et non comme<br />
philosophe, que Sénèque est appelé à se charger de l’éducation de Néron. Chacun y trouve<br />
son compte, puisque Sénèque doit à Agrippine et à ses projets son rappel d’exil, tandis que la<br />
nouvelle impératrice entend se concilier un allié de taille pour la satisfaction de sa libido<br />
dominandi.<br />
1 Tacite, Ann. XII, 8 : « Mais Agrippine, pour ne pas se faire connaître seulement par des méfaits,<br />
obtient le rappel d’exil de Sénèque, ainsi que sa nomination à la préture, comptant ainsi plaire au<br />
public à cause de la célébrité de son talent, et pour que l’enfance de Domitius grandisse avec un maître<br />
si excellent, et pour faire servir ses conseils à ses ambitions politiques, parce qu’elle était persuadée<br />
que le souvenir de ce bienfait ferait de Sénèque un allié d’Agrippine, tandis que le ressentiment d’un<br />
châtiment injuste en ferait un ennemi de Claude. »<br />
2 F. Giancotti, 1953a, admet le témoignage de Dion Cassius sur cette question (61, 10), et propose de<br />
dater cette liaison entre 49 et 54, dans les années qui suivent le retour d’exil de Sénèque.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 2, 2 : « Tous deux luttaient ensemble contre l’orgueil d’Agrippine, qui, brûlant de<br />
toutes les passions d’une ambition funeste, comptait parmi ses partisans Pallas, l’instigateur du<br />
mariage incestueux et de l’adoption fatale par lesquels Claude s’était perdu. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
75
III/ L’enseignement de Sénèque : enjeux et contenu.<br />
A/ Une méthode critiquée : l’impuissance de Sénèque à enrayer les penchants<br />
tyranniques de Néron.<br />
1/ L’art oratoire.<br />
Quel était le contenu de l’enseignement de Sénèque ? Suétone l’accuse de n’avoir pas<br />
fait connaître les grands auteurs à son élève, émet l’hypothèse qu’il voulait garder pour lui<br />
seul l’admiration de son élève, et explique ainsi le penchant du prince pour la poésie 1 . Tacite,<br />
quant à lui, attribue l’absence de talent oratoire de Néron à une inclination naturelle :<br />
contrairement à ses prédécesseurs, Néron n’a pas montré de talent particulier pour l’art<br />
oratoire, et Tacite passe en revue, dans l’ordre chronologique, les qualités de Jules César,<br />
Auguste, Tibère, Caligula et Claude.<br />
Nam dictator Caesar summis oratoribus aemulus ; et Augusto prompta ac profluens<br />
quaeque deceret principem eloquentia fuit ; Tiberius artem quoque callebat qua uerba<br />
expenderet, tum ualidus sensibus aut consulto ambiguus ; etiam C. Caesaris turbata mens<br />
uim dicendi non corrupit ; nec in Claudio, quotiens meditata dissereret, elegantiam<br />
requireres. 2<br />
1 Suétone, Ner. 52.<br />
2 Tacite, Ann. XIII, 3 : « En effet, le dictateur César était l’émule des plus grands orateurs ; Aguste, lui<br />
aussi, avait une éloquence aisée et abondante, digne d’un prince ; et Tibère maîtrisait l’art de peser les<br />
mots, dont il renforçait ou obscurcissait le sens à dessein ; même C. César ne vit pas le désordre de son<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
76
Aucun d’entre eux n’a manqué du talent estimé d’orateur, quoique celui-ci ne se soit jamais<br />
manifesté de la même manière. L’éloquence aisée de César n’a rien à voir avec les formules<br />
de Tibère, mais il semble bien que l’art de parler en public soit un signe tangible de la<br />
capacité à exercer le pouvoir. L’imperator doit savoir s’adresser à ses troupes, au Sénat, à la<br />
foule. D’autre part, d’après la remarque de Tacite, le type d’éloquence du prince est en<br />
quelque sorte, la marque personnelle de son autorité. C’est ainsi que le caractère ombrageux<br />
de Tibère et sa tendance à la dissimulation s’accordent parfaitement à ses paroles 1 . A<br />
l’inverse, faire appel à quelqu’un d’autre pour ses interventions publiques ne peut être, pour<br />
un prince, qu’un signe parmi d’autres de son incapacité à régner. Peu soucieux de manier la<br />
parole publique, Néron apparaît ainsi comme un usurpateur, tant l’éloquence et l’action<br />
politique sont liées dans l’esprit des Romains.<br />
Lors des funérailles de Claude, et après que le Sénat a décidé pour ce prince<br />
l’apothéose, Néron doit, conformément à la tradition, prononcer la laudatio du défunt,<br />
consacrant ainsi de manière officielle le double passage des pouvoirs au nouveau prince, et de<br />
l’empereur mort au rang des dieux. Ce type de discours funéraire fait partie d’un dispositif<br />
symbolique et politique, dont le but est d’assurer la cohésion du corps social à un moment<br />
délicat (la succession impériale ne va pas de soi, le principe dynastique n’étant pas établi en<br />
droit), et d’affirmer le plus tôt possible la domination du nouvel empereur 2 . Or, ce discours,<br />
nous dit Tacite, n’a pas été composé par Néron, mais par Sénèque 3 . A la même époque, si l’on<br />
admet la datation du 13 octobre 54 proposée par Pierre Grimal 4 , le précepteur impérial se<br />
esprit altérer sa vigueur oratoire ; Claude, enfin, chaque fois qu’il préparait ses discours, ne manquait<br />
pas lui non plus d’élégance. »<br />
1 Tacite, Ann. I, 11, 3 ; VI, 50, 1.<br />
2 A. Fraschetti, 1990, p. 86-87.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 3. W.T. Avery, 1959.<br />
4 P. Grimal, 1991a, p. 108.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
77
charge, avec l’Apocoloquintose 1 , de marquer, contrairement à la laudatio, une nette rupture<br />
avec le régime précédent, et d’affirmer les orientations du nouveau régime : la ridiculisation<br />
féroce de Claude, ainsi que la condamnation sans appel des abus perpétrés sous son règne,<br />
sert ainsi de repoussoir à une figure idéalisée du jeune Néron, porteur de tous les espoirs en<br />
l’avenir. Sénèque se fait ainsi le metteur en scène de l’arrivée de son élève au pouvoir. Pour<br />
compléter cette entreprise, il écrit aussi les discours que Néron prononce à l’adresse des<br />
Prétoriens et du Sénat 2 . Sénèque se fait ainsi la voix du prince, au début de son règne, lorsque<br />
la clémence apparaît comme la valeur fondamentale du régime néronien.<br />
Ainsi, Sénèque, brillant orateur, n’aurait pas su, ou pas voulu, initier son élève à cet<br />
art, pourtant indispensable à l’exercice du pouvoir, comme à toute participation aux affaires<br />
publiques. Néron, poussé par son inclination naturelle, emploie ses talents pour d’autres<br />
activités comme la poésie. Les ennemis de Sénèque ne se font d’ailleurs pas faute de lui faire<br />
ce reproche :<br />
Obiciebant etiam eloquentiae laudem uni sibi adsiscere carmina crebrius factitare,<br />
postquam Neroni amor eorum uenisset. 3<br />
1 L’attribution de ce pamphlet à Sénèque est sujet à discussion. B. Baldwin, 1964, p. 39-48, affirme<br />
que Sénèque n’en est pas l’auteur. La même thèse est développée par E. Rodriguez Almeida, 1996 :<br />
une série d’arguments historiques et littéraires plaide selon lui en faveur de l’inauthenticité de l’œuvre,<br />
dont l’auteur serait à chercher dans le cercle de Martial. Il pourrait s’agir de Canius Rufus, son ami.<br />
Cependant, la plupart des auteurs, et ce depuis l’Antiquité, admettent l’authenticité de<br />
l’Apocoloquintose : K. Bringmann, 1985. Deux éditions récentes adoptent cette idée : A. A. Lund,<br />
dans l’introduction de l’Apocolocyntosis Divi Claudii, Heidelberg, 1994, s’interroge davantage sur la<br />
date de composition et le titre original, lui aussi objet de débats. L’édition de R. Mugellesi,<br />
Apocolocyntosis, Milan, 1996, souligne dans sa présentation les rapports de l’œuvre avec le reste de la<br />
production de Sénèque.<br />
2 Dion Cassius, 61, 3, 1.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 52, 3 : « Ils lui reprochaient aussi de s’attribuer à lui seul la gloire de l’éloquence,<br />
et de faire bien plus souvent des vers, depuis que Néron en avait le goût. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
78
Suétone souligne également que Sénèque n’a pas fait étudier les orateurs classiques au jeune<br />
prince 1 : selon lui, le philosophe désirait accentuer son ascendant sur Néron en gardant pour<br />
lui seul son admiration. Il est clair que cette accusation reprend celle des ennemis de Sénèque,<br />
que Tacite présente pourtant comme des deteriores, des hommes corrompus 2 .<br />
La lecture des historiens antiques donne donc de l’éducation de Néron et du rôle de<br />
Sénèque une image assez négative : le précepteur impérial n’aurait pas suffisamment préparé<br />
son élève au rôle politique qu’il était amené à jouer. Il aurait fait en sorte de garder sur Néron<br />
une influence très importante, au point d’élaborer à sa place, dans les premières années du<br />
règne, les grandes lignes de sa politique. Par exemple, le thème de la clémence, récurrent dans<br />
les premiers discours, est repris et développé dans le De clementia, en 56, soit deux ans après<br />
la mort de Claude, et quelque temps après celle de Britannicus. Tacite reconnaît cependant<br />
aux mentors de Néron le mérite d’avoir eu sur lui suffisamment d’influence pour diriger sa<br />
jeunesse, et pour canaliser ses passions 3 . Il les appelle rectores imperatoriae iuuentae,<br />
« guides de la jeunesse de l’empereur », soulignant ainsi la nécessité de leur présence aux<br />
côtés de Néron pour contrecarrer l’influence d’Agrippine et ses ambitions.<br />
2/ Les elementa doctrinae et la place de la philosophie.<br />
Les « rudiments de culture », elementa doctrinae, que le prince a acquis grâce à son<br />
éducation, lui servent surtout à composer des vers 4 . Ainsi, un penchant naturel pour l’art et<br />
une éducation inadaptée ont contribué au développement des folies néroniennes. En outre,<br />
1 Suétone, Ner. 52, 1.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 52, 1.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 2, 1 ; Dion Cassius, 61, 4.<br />
4 Tacite, Ann. XIII, 3, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
79
Agrippine se méfiait de la philosophie, considérant que cette discipline ne convenait guère à<br />
un empereur 1 . Les philosophes, conviés à la cour, n’ont, d’après Tacite, d’autre fonction que<br />
de divertir le prince par le spectacle de leurs contradictions 2 . Tacite dépeint non sans mépris<br />
ces hommes graves, réduits à l’état de bouffons grotesques :<br />
Etiam sapientiae doctoribus tempus impertiebat post epulas, utque contraria<br />
adseuerantium discordia frueretur. Nec deerant qui ore uultuque tristi inter<br />
oblectamenta regia spectari cuperent. 3<br />
Les mines graves des philosophes, sans doute des stoïciens, ne sont que des grimaces<br />
accompagnant un discours, dont le seul intérêt aux yeux de Néron serait ses contradictions, et<br />
l’attention que leur porte l’empereur est celle que l’on accorde à une comédie bien jouée.<br />
Cette présentation des choses par Tacite est, bien entendue, très hostile au prince.<br />
L’information en elle-même pourrait au contraire plaider en sa faveur : Néron, tout<br />
simplement, se tient au fait des courants de pensée en assistant aux débats philosophiques<br />
actuels. Il faut donc croire que Sénèque a passé outre les prescriptions d’Agrippine, et qu’il a<br />
initié son élève à cette discipline fondamentale.<br />
Cependant, si l’on suit Tacite, l’éducation de Néron se limiterait à l’acquisition de la<br />
culture classique commune aux membres de la bonne société romaine, et Sénèque aurait une<br />
part de responsabilité dans cette insuffisante formation du prince. La place laissée vacante par<br />
la rhétorique et la philosophie aurait été, conformément aux inclinations du prince, comblée<br />
par des disciplines artistiques, peu convenables pour le maître du monde : caelare, pingere,<br />
1 Suétone, Ner. 52, 1.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 16, 2.<br />
3 « Il consacrait aussi aux philosophes quelques moments après ses repas, pour se repaître des disputes<br />
qui naissaient de leurs désaccords. Et il ne manqua pas de gens qui, avec leur attitude et leur visage<br />
austères, désiraient figurer parmi les amusements de la cour. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
80
cantus aut regimen equorum exercere 1 . Par conséquent, le rôle de Sénèque, et, plus largement,<br />
l’éducation de Néron dans sa globalité apparaissent comme des éléments du plan élaboré par<br />
Agrippine pour porter son fils au pouvoir et régner en son nom. Et l’on peut comprendre que<br />
le prince, privé de l’arme de l’éloquence, puisqu’il doit recourir au talent d’un autre, et occupé<br />
de disciplines éloignées des questions politiques fondamentales, soit plus malléable et<br />
davantage disposé à servir les desseins de sa mère. La chute de la « meilleure des mères »,<br />
d’ailleurs, s’explique aussi par ses idées politiques, en continuité avec celles de Claude, et par<br />
les nombreux opposants qu’elle a soulevés contre elle : parmi ses adversaires, Sénèque et<br />
Burrus ne furent pas les moindres.<br />
Ces derniers semblent tout d’abord tolérer les caprices artistiques du prince, tout en<br />
réfrénant ses abus. Ainsi, lorsque Néron éprouve le désir de chanter et de conduire un char en<br />
public, ils cèdent à sa volonté en tentant de limiter la publicité de l’exhibition 2 . Très vite,<br />
cependant, les mentors du prince sont dépassés par les événements, et finissent par être<br />
éliminés. On pourrait donc, dans un premier temps, conclure que l’éducation de Néron est<br />
globalement un échec, et que l’influence de Sénèque n’a pas donné les résultats qu’il aurait<br />
souhaités. Les divers compromis qu’il a consentis n’ont fait que confirmer, à terme, la<br />
propension du prince à la tyrannie. C’est ainsi que Néron détourne l’image d’Apollon,<br />
présenté dans le De clementia comme le modèle du nouveau prince, pour justifier son désir de<br />
chanter 3 .<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 3, 3 : « graver, peindre, chanter et conduire des chars. »<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 14.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 14, 1. Sénèque, Clem. I, 8, 4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
81
3/ Les tragédies.<br />
Enfin, il semble que les tragédies de Sénèque témoignent de la participation du<br />
philosophe à la réalisation des idéaux artistiques de son élève, et d’un goût commun pour la<br />
poésie. L’importance du corpus exclut l’hypothèse d’une production anecdotique et<br />
négligeable : nous avons conservé un ensemble de huit pièces complètes, et des fragments<br />
d’une neuvième, auxquelles est ajoutée dans l’un des <strong>manuscrit</strong>s une tragédie prétexte,<br />
certainement apocryphe, Octavie, dont le sujet touche de très près à la vie de Sénèque,<br />
puisqu’il s’agit de la répudiation et de l’exécution de la première épouse du prince. La<br />
question, pourtant cruciale, de la chronologie de la production dramatique de Sénèque, reste<br />
ouverte à ce jour. De nombreux travaux lui sont consacrés 1 , et la plupart conviennent que les<br />
tragédies ont dû, pour une partie d’entre elles, être rédigées pendant la période de l’exil, entre<br />
41 et 49. P. Grimal, dont on peut suivre les conclusions, étaie cette hypothèse en soulignant<br />
que Sénèque avait alors tout le loisir de composer avec le grand soin que l’on sait, certaines<br />
de ses pièces 2 . La seconde période pendant laquelle il a pu se consacrer à la rédaction des<br />
tragédies se situe vers l’année 61 ou 62, date à laquelle le crédit déclinant du philosophe a pu<br />
avoir pour conséquence une moindre participation aux affaires. Tacite rapporte les<br />
accusations des détracteurs de Sénèque, qui lui reprochent de s’être mis à écrire plus<br />
fréquemment des poèmes, carmina crebrius factitare, postquam Neroni amor eorum<br />
uenisset 3 . L’emploi du fréquentatif factitare suppose une activité relativement intense, et,<br />
probablement, la composition de plusieurs tragédies. D’autre part, le comparatif crebrius<br />
1 Ainsi, O. Herzog, 1928 ; L. Balzamo, 1957 ; I. Munoz Valle, 1967 ; E. Cizek, 1972, p. 156-159 et<br />
322-337 ; M. A. Cervellera, 1973 ; J. G. Fitch, 1981.<br />
2 P. Grimal, 1991a, p. 424-427.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 52 : « (ils lui reprochaient) de composer plus souvent des vers, depuis que Néron<br />
s’était pris de passion pour la poésie. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
82
semble indiquer assez clairement que Sénèque avait déjà fait la preuve de son talent dans ce<br />
domaine. Enfin, un passage fameux de la lettre 108 à Lucilius développe l’idée que les<br />
pensées du philosophe ont plus d’effet quand celui-ci se double d’un poète 1 . On peut supposer<br />
que Sénèque réfère à sa propre expérience d’auteur, et que la proximité de la composition de<br />
l’une de ses pièces a inspiré sa réflexion.<br />
Si l’on admet ces hypothèses comme vraisemblables, en laissant de côté le problème<br />
que pose la forme particulière d’Hercule sur l’Œta 2 et l’inachèvement des Phœniciennes 3 , on<br />
peut raisonnablement conclure que la production dramatique de Sénèque était connue, et sans<br />
doute appréciée, de Néron, et que les deux hommes partageaient un goût commun pour la<br />
poésie dramatique. Il faut signaler, en outre, l’utilisation traditionnelle de textes dramatiques<br />
dans l’enseignement du grammaticus, fonction que Sénèque remplit auprès de Néron. Si l’on<br />
en croit Suétone, il s’appuie en priorité sur ses propres écrits 4 . L’historien parle des ueteres<br />
oratores, mais il serait tentant d’en déduire qu’en matière de poésie, Sénèque a fait de même<br />
et utilisé dans son enseignement, ou au moins fait connaître à son élève, les tragédies qu’il<br />
avait composées auparavant. Ainsi, la démarche d’interprétation de la réalité par les mythes, à<br />
laquelle recourt volontiers le grammaticus, aurait pu constituer pour Néron une première<br />
initiation à la poésie. Matière à réflexion philosophique et politique, et non répertoire de<br />
leçons de morale étroite, les tragédies de Sénèque pouvaient parfaitement s’intégrer à un<br />
programme éducatif. L’incertitude qui demeure concernant la chronologique exacte de ces<br />
pièces, tout comme l’absence de témoignage tangible sur le contenu précis de l’enseignement<br />
dispensé à Néron, invitent à la plus grande prudence, mais l’hypothèse se trouvera peut-être<br />
1 Ep. 108, 9-11.<br />
2 A. S. Pease, 1918 ; V. Jorio, 1936 ; B. M. Marti, 1949 ; E. Paratore, 1972.<br />
3 Sénèque, Tragédies, t. 1, 1996, p. 117-119.<br />
4 Ner. 52.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
83
consolidée, lorsque nous examinerons les raisons qui font de Néron le destinataire privilégié<br />
des tragédies.<br />
B/ L’échec de Sénèque : condamnation et simplification.<br />
L’image assez négative du rôle de Sénèque et de la formation de Néron 1 mérite d’être<br />
nuancée. Il est vrai que le modèle du despote éclairé est bien loin, et que l’on ne peut faire du<br />
principat de Néron un idéal politique. Mais les sources que nous possédons sont en majorité<br />
hostiles à Néron, et les talents artistiques de l’empereur sont, comme nous le verrons, un motif<br />
de condamnation devenu traditionnel. Le jeune prince, rappelons-le, a reçu une éducation<br />
riche et classique, et a été entouré de maîtres prestigieux.<br />
1/ L’art oratoire.<br />
Il convient tout d’abord de corriger l’impression donnée par les premiers discours de<br />
Néron empereur, et composés par Sénèque. Que Néron doive son éloquence au talent d’autrui<br />
peut porter le soupçon sur la qualité de son éducation, d’autant plus que la parole publique est<br />
indissociable de l’action politique. Mais cette condamnation sans appel se doit d’être nuancée.<br />
Tacite lui même rapporte un épisode très intéressant, dans le livre XII des Annales. Néron a<br />
seize ans, il vient d’épouser Octavie, gravissant ainsi l’un des degrés qui le mènent au trône,<br />
1 Dion Cassius, 61, 10, 2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
84
avant son adoption par Claude 1 . Agrippine veille à l’élévation de son fils ainsi qu’à la<br />
réalisation de ses ambitions.<br />
Vtque studiis honestis et eloquentiae gloria nitesceret, causa Iliensium suscepta,<br />
Romanum Troia demissum et Iuliae stirpis auctorem Aeneam, aliaque haud procul<br />
fabulis uetera facunde exsecutus, perpetrat ut Ilienses omni publico munere<br />
soluerentur. 2<br />
Le discours en faveur des Troyens a une double signification politique : premièrement, il<br />
rappelle indirectement que Néron appartient à l’illustre gens Iulia, dont sont issus les<br />
empereurs. Le mariage avec Octavie ne fait que renforcer cette prestigieuse généalogie, et<br />
Néron apparaît comme un successeur logique et légitime à celui qui deviendra son père<br />
adoptif. Deuxièmement, il met en valeur les qualités d’éloquence du jeune homme, et donc sa<br />
capacité à exercer le pouvoir. Tacite lui reconnaît un certain talent, en notant qu’il s’exprime<br />
facunde, avec éloquence : c’est donc que Sénèque n’a pas tout à fait négligé cet aspect<br />
essentiel de son enseignement. La signification de cet épisode serait affaiblie s’il s’était agi<br />
d’un cas isolé. Or, Tacite évoque immédiatement trois autres discours, l’un en faveur de<br />
Bologne, l’autre de Rhodes, et le troisième d’Apamée. Il s’ensuit que le jeune Domitius doit<br />
maîtriser la parole publique, aussi bien en latin qu’en grec puisque, comme le note Suétone, il<br />
plaida en latin pour les habitants de Bologne, et en grec pour les Rhodiens et les Troyens 3 . En<br />
outre, Suétone précise qu’étant préfet de Rome, il se vit confier des affaires complexes et de<br />
1 Tacite, Ann. XII, 25.<br />
2 : « Pour que l’éclat de sa gloire commençât à se manifester grâce à des occupations honorables et à<br />
l’éloquence, il se chargea de la cause des Troyens ; il exposa avec éloquence l’ascendance troyenne de<br />
Rome, les origines de la famille Julia qui remonte à Enée, et les autres traditions anciennes qui se<br />
rapprochent des récits légendaires. Il fit si bien que les Troyens se virent exemptés de toutes les<br />
charges publiques. »<br />
3 Suétone, Ner. 7.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
85
premier ordre, contrairement à ce qui se faisait ordinairement, et contrairement aux<br />
prescriptions de Claude. On peut en conclure que ses activités judiciaires n’ont pas été<br />
seulement formelles, et qu’il disposait des qualités et de la formation nécessaires à leur<br />
exercice.<br />
On peut supposer que la situation politique très incertaine qui a suivi la mort de<br />
Claude a nécessité le recours aux talents de Sénèque pour les premiers discours, mais<br />
l’habileté remarquable de l’un ne suppose pas, comme on le voit, la totale incapacité de<br />
l’autre. Ainsi, en ce qui concerne la formation de Néron à l’éloquence, il semble bien que le<br />
philosophe ait bien rempli son rôle. C’est d’ailleurs le talent rhétorique de Sénèque qui a dû<br />
décider Agrippine à le choisir comme précepteur de son fils 1 . Au moment de son rappel<br />
d’exil, Sénèque est en effet connu surtout pour son éloquence brillante et pour ses discours. Il<br />
s’est enrichi sous les règnes de Tibère et Caligula grâce à ses succès d’avocat 2 . Si les<br />
Consolations et le De ira marquent le début de la carrière philosophique de Sénèque 3 , sa<br />
célébrité s’est bâtie sur son éloquence 4 . Le plus ancien de ces écrits, la Consolation à Marcia,<br />
a dû être rédigé entre 37 et 41, alors que Sénèque a déjà une quarantaine d’années 5 . Si l’on<br />
admet la chronologie établie par P. Grimal, le De ira a été composé en 41, la Consolation à<br />
Helvia au printemps 42, et la Consolation à Polybe pendant l’hiver 43-44. Ces deux dernières<br />
œuvres ont donc pour cadre l’exil de Sénèque, entre l’automne 41 et le printemps 49 6 .<br />
1 Tacite, Ann. XII, 8.<br />
2 E. Cizek, 1972, p. 60 ; P. Aubenque, J.M. André, 1964, p. 18.<br />
3 J. Fillion-Lahille, 1989.<br />
4 Dion Cassius, 59, 19, 7.<br />
5 Sénèque, Entretiens. Lettres à Lucilius, traduction, introduction et notes de P. Veyne, Paris, 1993, p.<br />
4. P. Grimal, 1991a, p. 269, propose plus précisément de dater cet ouvrage de l’automne ou de l’hiver<br />
39-40.<br />
6 P. Grimal, 1991a, p. 270-280.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
86
On connaît mal les discours que Sénèque a prononcés au début de sa carrière. On peut<br />
tout au plus en trouver des traces dans ses traités philosophiques : par exemple, dans le De<br />
constantia sapientis, on trouve une réflexion sur la définition du crime 1 . Ce que l’on sait, c’est<br />
que les talents rhétoriques de Sénèque ont été admirés par nombre de ses contemporains, et<br />
que son prestige a duré après sa mort 2 . Caligula, qui se voulait un grand orateur, critique le<br />
style de Sénèque, dont l’art est par ailleurs grandement estimé, comme le signale Suétone :<br />
Peroraturus stricturum se lucubrationis suae telum minabatur, lenius comptiusque<br />
scribendi genus adeo contemnens, ut Senecam tum maxime placentem "commissiones<br />
meras" componere et "harenam esse sine calce" diceret. 3<br />
Il a une profonde connaissance de la rhétorique qu’il tient de son père 4 . Son frère, Junius<br />
Gallio, était un excellent orateur 5 . Il semble que tous les deux aient profité des leçons de<br />
Sénèque le Père.<br />
En matière de rhétorique, les positions de Sénèque ne sont pas celles de l’école<br />
cicéronienne, mais cela ne veut pas dire qu’il a négligé cette discipline, bien au<br />
contraire. Dans la lettre 114, il adresse à la prose de Cicéron un certain nombre de critiques 6 :<br />
il juge en particulier avec assez de sévérité les clausules du prosateur, et l’ampleur monotone<br />
1 Sénèque, Const. VII, 4.<br />
2 Martial, IV, 40, 1 ; VII, 45, 1 : Sénèque est qualifié de doctus et de potens.<br />
3 Cal. 53, 3 : « Quand il devait parler en public, il menaçait de lancer les traits élaborés pendant ses<br />
veilles, méprisant tellement le style élégant et orné, qu'il disait de Sénèque, qui connaissait alors un<br />
immense succès, qu’il composait de purs discours d’apparat, et il les comparait à du sable sans<br />
ciment. »<br />
4 P. Grimal, 1991b.<br />
5 E. Cizek, 1972, p. 61.<br />
6 Ep. 114, 16. P. Grimal, 1984.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
87
de ses périodes 1 . Il s’agit là d’une opposition entre deux esthétiques. Les innovations de<br />
Sénèque en matière de style 2 lui attirent les foudres de Quintilien 3 . Celui-ci regrette que<br />
Sénèque soit devenu l’unique modèle des jeunes gens, qui ne font qu’imiter ses défauts 4 . Il lui<br />
reconnaît cependant de nombreuses qualités :<br />
Cuius et multae alioqui et magnae uirtutes fuerunt, ingenium facile et copiosum,<br />
plurimum studii, multa rerum cognitio (...) 5<br />
Les reproches que Quintilien adresse à Sénèque portent précisément sur son style :<br />
Nam si aliqua contempsisset, si praua non concupisset, si non omnia sua amasset, si<br />
rerum pondera minutissimis sententiis non fregisset, consensu potius eruditorum quam<br />
puerorum amore comprobaretur. 6<br />
L’originalité et l’invention du style de Sénèque 7 correspondent à une évolution, à<br />
laquelle ont largement participé les membres du cercle des Annaei 8 , mais quelles que soient<br />
les controverses auxquelles l’éloquence de Sénèque ont pu donner lieu, on ne peut en déduire<br />
1 A. L. Motto, J. R. Clark, 1975, p. 1-4.<br />
2 A. Guillemin, 1957.<br />
3 I. O. X, I, 125-131.<br />
4 Quintilien, I. O. X, 1, 125-126.<br />
5 Quintilien, I. O. X, 1, 128 : « Au reste, il avait de nombreuses et grandes qualités, un talent aisé et<br />
riche, une très grande application, une vaste érudition. »<br />
6 Quintilien, I. O. X, 1, 130 : « En effet, s’il avait eu certains mépris, s’il n’avait pas eu la passion des<br />
tournures affectées, s’il n’avait pas aimé tout ce qu’il produisait lui-même, s’il n’avait pas brisé la<br />
gravité des choses avec ses phrases trop minutieusement élaborées, il se serait attiré l’approbation<br />
unanime des gens instruits, plutôt que l’amour des jeunes gens. »<br />
7 G. Brugnoli, 1959 ; D. Gagliardi, 1966, p. 238-240.<br />
8 E. Cizek, 1972, p. 290-300.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
88
qu’il a négligé auprès de Néron cette discipline fondamentale, en particulier pour un futur<br />
souverain. D’ailleurs, les leçons du maître ont dû porter, si l’on en croit le brillant discours<br />
que Tacite attribue à Néron, en réponse à la demande de Sénèque de se retirer 1 . L’hommage<br />
de l’élève au maître, par lequel s’ouvre la réplique impériale, constitue aussi bien une<br />
valorisation des capacités d’improvisation de Néron :<br />
Quod meditatae orationi tuae statim occurram, id primum tui muneris habeo, qui me<br />
non tantum praeuisa, sed subita expedire docuisti. 2<br />
Dans son discours, le prince répond point par point aux arguments de son maître 3 , en faisant le<br />
même usage des exemples historiques 4 , et clôt lui aussi son discours par une sententia 5 . Ce<br />
face à face en forme de diptyque, qui marque de façon dramatique le début de la disgrâce de<br />
Sénèque et de sa retraite, met en scène un Néron sûr de lui et éloquent, et qui, à coup sûr, a<br />
tiré profit de la formation que Sénèque lui a dispensée.<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 53-56. Sur ce discours de Sénèque à Néron, et les raisons qui ont motivé cette<br />
démarche de Sénèque : R. Syme, 1958, p. 335 ; F. Giancotti, 1956 ; P. Grimal, 1967 ; D. C. A. Shotter,<br />
1969 ; W. Speyer, 1971.<br />
2 « J’oppose une réplique improvisée au discours que tu as élaboré, c’est là le premier de tes bienfaits ;<br />
car tu m’as appris à m’exprimer avec ou sans préparation. »<br />
3 Sur les richesses que Sénèque doit à Néron, le paragraphe 53, 4 répond aux paragraphes 53, 5 et 54,<br />
3 ; sur l’âge de Sénèque, 56, 1 et 54, 2-3.<br />
4 Sénèque cite l’attitude d’Auguste à l’égard d’Agrippa et de Mécène (53, 3). Néron réfute cet<br />
argument (55, 2) et cite Vitellius et Claude (56, 1).<br />
5 56, 2, cf la dernière phrase du discours de Sénèque (54, 3).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
89
2/ Le témoignage des Lettres à Lucilius.<br />
Les Lettres à Lucilius donnent quelques indications sur l’idée que Sénèque se faisait<br />
de l’éducation : un passage de la deuxième lettre, par exemple, répond à l’insinuation<br />
malveillante de Suétone, selon laquelle Sénèque n’aurait pas fait connaître à son élève les<br />
orateurs classiques, dans le seul but de rester pour lui un unique modèle, et ainsi de s’assurer<br />
une influence plus importante.<br />
Illud autem uide, ne ista lectio auctorum multorum et omnis generis uoluminum<br />
habeat aliquid uagum et instabile. Certis ingeniis immorari et innutriti oportet, si uelis<br />
aliquid trahere quod in animo fideliter sedeat. Nusquam est qui ubique est. 1<br />
L’argument de Sénèque est ici celui de la cohérence : à l’étude superficielle de nombreux<br />
auteurs, il préfère la connaissance approfondie d’un nombre plus restreint d’entre eux. En<br />
d’autres termes, la qualité doit l’emporter sur la quantité. Ce conseil est réitéré dans la lettre<br />
45 :<br />
Librorum istic inopiam esse quereris. Non refert quam multos sed quam bonos<br />
habeas : lectio certa prodest, uaria delectat. Qui quo destinauit peruenire uult unam<br />
sequatur uiam, non per multas uagetur : non ire istuc sed errare est. 2<br />
1 Sénèque, Ep. I, 2, 2 : « Veille encore à ce que ta lecture de nombreux auteurs et de livres de toutes<br />
sortes n’ait pas quelque chose de vague et d’instable. Il ne faut s’imprégner et se nourrir que de<br />
quelques talents déterminés, si l’on veut que l’esprit en tire un profit durable. Être partout, c’est n’être<br />
nulle part. »<br />
2 Sénèque, Ep. V, 45, 1 : « Tu déplores là-bas la rareté des livres. Ce qui importe n’est pas leur<br />
quantité, mais leur qualité : la lecture d’ouvrages déterminés est utile, celle d’ouvrages variés est une<br />
récréation. Celui qui veut atteindre le but qu’il s’est fixé ne doit suivre qu’une route, et non pas<br />
vagabonder sur plusieurs : ce n’est pas là voyager, mais divaguer. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
90
La métaphore du chemin et du voyage traduit bien la condition de Lucilius, proficiens, en<br />
route vers la sagesse, sous la conduite de Sénèque. On peut noter ici, outre la cohérence de<br />
l’attitude de Sénèque à l’égard de la culture livresque, une certaine parenté entre l’élève<br />
impérial et le disciple. Si Sénèque, comme tout porte à le croire, a tenté de former l’âme de<br />
Néron comme il soutient la quête de Lucilius, il faut bien reconnaître que les préjugés<br />
d’Agrippine quant à la philosophie sont restés lettre morte.<br />
Finalement, Suétone rend indirectement justice à Sénèque, en notant que le jeune<br />
prince n’a guère fréquenté les orateurs classiques. On peut raisonnablement penser que,<br />
conformément aux idées qu’il défend dans les Lettres à Lucilius, Sénèque a limité l’étude des<br />
orateurs à un petit nombre d’entre eux.<br />
Bien évidemment, on ne peut faire des lettres à Lucilius un manifeste pédagogique qui<br />
reflèterait fidèlement le programme de formation de Néron. Ces lettres, rédigées dans les<br />
dernières années de la vie de Sénèque, après qu’il s’est retiré de la vie politique, permettent au<br />
philosophe d’exposer ses idées et sa manière de vivre. Si, comme il le dit dans la lettre 38,<br />
philosophia bonum consilium est 1 , les lettres portent en elles l’expérience d’une vie, et l’on ne<br />
s’étonnera pas de reconnaître, ici, ou là, le reflet des préoccupations du vieil amicus principis,<br />
notamment en ce qui concerne son rôle auprès de Néron.<br />
A l’époque de la rédaction des Lettres à Lucilius, le régime a basculé du côté de la<br />
tyrannie : les procès de maiestate se multiplient 2 , Néron a épousé Poppée et éliminé Octavie,<br />
et Tigellin profite de l’influence que lui confère son statut de préfet du prétoire 3 . L’évolution<br />
du régime, selon toute apparence, jette le discrédit sur l’enseignement de Sénèque : ce n’est<br />
1 Sénèque, Ep. 38, 1 : « la philosophie, c’est le bon conseil ». Sur l’exhortation morale et l’instruction<br />
pratique, I. Hadot, 1969, p. 79-95.<br />
2 K. R. Bradley, 1973, p. 172-182.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 57-60 : parmi les victimes, on peut citer Cornelius Sulla et Rubelius Plautus.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
91
pas la raison, mais le désir et les passions qui semblent motiver le prince, et l’on est bien loin<br />
de l’idéal évoqué dans le De clementia. C’est pour cette raison que certains passages des<br />
Lettres peuvent résonner comme une affirmation a posteriori de la cohérence des idées de<br />
Sénèque, notamment quand il s’agit d’éducation. Au sujet des orateurs, et du style, on<br />
retrouve régulièrement l’idée que ce dernier doit être à l’image des qualités morales de l’âme<br />
et de l’esprit 1 : trop d’ornements, comme une sécheresse extrême, ne doivent pas être<br />
recherchés en tant que tels. C’est la formation de l’âme, en tout premier lieu, qui doit faire<br />
l’objet de nos soins : le style s’accordera à ses qualités.<br />
Ideo ille (animus) curetur : ab illo sensus, ab illo uerba exeunt, ab illo nobis est habitus,<br />
uultus, incessus. Illo sano ac ualente oratio quoque robusta, fortis, uirilis est : si ille<br />
procubuit, et cetera ruinam sequuntur. 2<br />
Il s’ensuit que l’étude formelle de discours devenus classiques ne se justifie guère, au regard<br />
de la première nécessité, qui est celle de la rectitude des idées et des principes.<br />
La lettre 88 replace les études libérales dans un ensemble plus vaste, dont la fin est<br />
l’accession à la vertu : la finalité de tout enseignement, et, d’autant plus de celle d’un prince,<br />
est de mettre l’âme en condition de parvenir à la sagesse.<br />
1 Sénèque, Ep. 114, 1-24.<br />
2 Ep. 114, 22 : « Il faut donc soigner l’âme : c’est d’elle que proviennent le jugement, les paroles, c’est<br />
d’elle que nous tenons notre attitude, notre physionomie, notre démarche. C’est elle qui, saine et<br />
vigoureuse, rend le discours lui aussi robuste, vigoureux, énergique : si elle croule, tout la suit dans sa<br />
ruine. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
92
De liberalibus studiis quid sentiam scire desideras : (...) Tamdiu enim istis immorandum<br />
est quamdiu nihil animus agere maius potest ; rudimenta sunt nostra, non opera. 1<br />
Parmi les arts libéraux, la grammaire désigne l’enseignement secondaire dispensé aux enfants.<br />
Sénèque examine les différents arts libéraux, et consacre une partie de sa réflexion à la<br />
musique, qui a été une passion de Néron.<br />
Ad musicum transeo. Doces me quomodo inter se acutae ac graues consonent,<br />
quomodo neruorum disparem reddentium sonum fiat concordia: fac potius quomodo<br />
animus secum meus consonet nec consilia mea discrepent. Monstras mihi qui sint<br />
modi flebiles: monstra potius quomodo inter aduersa non emittam flebilem uocem. 2<br />
Certaines remarques, comme celle-là, peuvent donc se comprendre à la lumière de<br />
l’expérience préceptorale du philosophe : Sénèque ne se montre pas hostile à l’apprentissage<br />
de la musique, mais souligne le caractère accessoire d’une telle discipline. Sa conception de la<br />
formation est à cet égard différente de celle de Quintilien, partisan d’une culture étendue et<br />
variée, dont la musique est un élément important 3 , car elle contribue à faire atteindre la<br />
perfection à l’orateur. Sénèque, dans la lettre 88, développe une idée comparable :<br />
1 Ep. 88, 1 : « Tu désires savoir ce que je pense des arts libéraux : (…) il ne faut s’y attarder qu’aussi<br />
longtemps que l’esprit ne peut rien faire de mieux ; ce sont nos travaux d’apprentissage et non nos<br />
œuvres accomplies. »<br />
2 Ep. 88, 9 : « J’en viens au musicien. Tu m’enseignes de quelle manière les voix aiguës et graves<br />
s’accordent entre elles, comment se produit l’accord des cordes qui rendent chacune un son différent :<br />
fais plutôt en sorte que mon âme s’accorde sur elle-même, et que mes décisions ne sonnent pas faux.<br />
Tu me montres ce que sont les modes plaintifs : montre-moi plutôt comment ne pas laisser échapper<br />
une parole plaintive dans l’adversité. »<br />
3 Quintilien, I. O. I, 10, 6.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
93
Quare ergo liberalibus studiis filios erudimus ? Non quia uirtutem dare possunt, sed<br />
quia animum ad accipiendum uirtutem praeparant. 1<br />
En outre, Sénèque est également poète, et dans la conception antique, poésie et musique sont<br />
inséparables 2 . Il serait donc surprenant de le voir laisser totalement cet art de côté.<br />
L’erreur principale n’a donc pas été d’initier Néron à la musique, mais de concentrer<br />
tous les efforts sur cette discipline. Et non seulement cette erreur n’est pas imputable à<br />
Sénèque, mais encore elle échappe à sa responsabilité. En effet, l’influence possible de Pâris<br />
s’est affirmée avant que le philosophe ne se voit confier l’éducation du prince : les penchants<br />
naturels, confortés par cet exemple, pouvaient tout au plus être détournés, mais ils étaient trop<br />
importants pour être tout à fait éradiqués. Et surtout, la véritable formation musicale de Néron<br />
commence avec son règne : Sénèque n’est plus le précepteur d’un jeune homme promis aux<br />
plus hautes destinées, il est le conseiller du prince.<br />
IV/ La formation artistique.<br />
A/ Terpnus.<br />
Le successeur du philosophe, si l’on peut dire, est l’un des citharèdes les plus en vogue<br />
du moment : il s’agit de Terpnus, dont Néron suit avec assiduité les leçons dès son<br />
1 Ep. 88, 20 : « Pourquoi donc formons-nous nos fils aux études libérales ? Ce n’est pas parce qu’elles<br />
ont le pouvoir de donner la vertu, mais parce qu’elles préparent l’âme à la recevoir. »<br />
2 F. Dupont, 1985, p. 442.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
94
avènement 1 . La citharédie est un art excessivement exigeant, qui nécessite la maîtrise de<br />
l’instrument en même temps que la performance vocale. En tant que tel, il est donc le plus<br />
souvent pratiqué par de véritables professionnels 2 . Dès lors qu’on s’y adonne, on ne peut donc<br />
se contenter de l’à-peu-près. Néron, qui au départ, comme le soulignent charitablement<br />
Suétone et Dion Cassius 3 , n’a guère de disposition naturelle pour le chant, se met au travail<br />
avec acharnement, suivant un régime sévère et des règles de vie très strictes.<br />
Inter ceteras disciplinas pueritiae tempore imbutus et musica, statim ut imperium<br />
adeptus est, Terpnum citharoedum uigentem tunc praeter alios arcessiit diebusque<br />
continuis post cenam canenti in multam noctem assidens paulatim et ipse meditari<br />
exercerique coepit neque eorum quicquam omittere, quae generis eius artifices uel<br />
conseruandae uocis causa uel augendae factitarent ; sed et plumbeam chartam<br />
supinus pectore sustinere et clystere uomituque purgari et abstinere pomis cibisque<br />
officientibus. 4<br />
1 Suétone, Ner. 20, 1 ; Dion Cassius, 63, 8, 4. Sur ce que les sources nous apprennent de ce<br />
personnage : H. Leppin, 1992, p. 303-304.<br />
2 A. Bélis, 1989, p. 749. Cicéron, Mur. 29.<br />
3 Suétone, Ner. 30, 5 : la voix de Néron est qualifiée d’exigua et fusca. Dion Cassius, 61, 20, 2 ; M. F.<br />
Gyles, 1962 ; M. P. Charlesworth, 1950.<br />
4 Suétone, Ner. 20, 1-2 : « Entre autres disciplines, il avait été formé à la musique pendant son enfance,<br />
et dès son accession au pouvoir, il fit venir le citharède Terpnus, qui à cette époque surpassait les<br />
autres. Pendant plusieurs jours, il resta près de lui, après le repas, à l’écouter chanter jusqu’à une heure<br />
avancée de la nuit, et peu à peu, il commença lui-même à étudier et à s’exercer à cet art, sans rien<br />
négliger de ce que des artistes de ce genre ont l’habitude de faire, dans le but de conserver leur voix ou<br />
de lui donner plus de puissance ; il allait jusqu’à se coucher sur le dos avec une feuille de plomb sur la<br />
poitrine, prendre des lavements et des purges, et s’abstenir de fruits et d’aliments contre-indiqués. » A<br />
propos du régime suivi par les chanteurs, A. Bélis, 1989, p. 749, cite par exemple le poireau, censé<br />
fortifier la voix (note 11) .<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
95
La formation musicale de Néron, qui est celle d’un véritable professionnel, est donc<br />
contemporaine de sa prise de pouvoir. Elle est en quelque sorte l’affirmation de sa volonté<br />
propre.<br />
B/ L’attitude de Sénèque face aux aspirations artistiques de son élève : l’art et la<br />
politique.<br />
Loin de s’opposer à une passion aussi forte, et depuis longtemps déclarée, Sénèque a<br />
utilisé les penchants de son élève pour élaborer sa philosophie du pouvoir. Il a, en particulier,<br />
accordé une place de tout premier ordre à Apollon, divinité propre à concilier un projet<br />
politique raisonnable et le goût du prince pour l’art. Il est le dieu citharède, donc pour Néron<br />
un modèle de choix. C’est aussi le dieu tutélaire d’Auguste, et Néron au début de son règne se<br />
réclame de sa filiation 1 . Mais Apollon rassemble également les valeurs stoïciennes et<br />
hellénistiques dont on trouve la trace dans le De clementia 2 ou l’Apocoloquintose, mais aussi<br />
dans d’autres œuvres contemporaines. Avec assez d’habileté et de réalisme, Sénèque a tenté<br />
de faire la synthèse entre le caractère du prince et ce qu’il pensait être la direction à prendre<br />
pour le pouvoir. S’il n’a pas pu détourner Néron de la pratique musicale, il a, au moins pour<br />
un temps, réussi à orienter les choix de son élève, et à freiner son désir de se produire en<br />
public.<br />
Enfin, les témoignages de Tacite et de Suétone 3 , concernant les rapports du prince à la<br />
philosophie, doivent être eux aussi corrigés. Suétone rapporte qu’Agrippine n’avait pas<br />
1 M. T. Griffin, 1976, p. 103-104.<br />
2 P. Grimal, 1971.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 16, 2 ; Suétone, Ner. 52, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
96
souhaité que son fils fût initié à la philosophie, discipline peu convenable à ses fonctions, et<br />
Tacite brosse le tableau d’un Néron se distrayant au spectacle des contradictions des<br />
philosophes. Ces derniers, d’ailleurs, ne se seraient pas fait faute de figurer, avec leurs mines<br />
austères, parmi les amusements du prince. Il paraît assez surprenant de voir la philosophie<br />
ainsi dévaluée à la cour de l’élève de Sénèque. En outre, le philosophe a trop combattu<br />
l’influence d’Agrippine, allant même jusqu’à donner de sa fin une <strong>version</strong> officielle au Sénat 1 ,<br />
pour que l’on puisse le soupçonner d’avoir tenu compte plus qu’en apparence de ses<br />
prescriptions. Il faut donc reconnaître avec P. Grimal que l’intérêt du prince pour les<br />
philosophes et leurs doctrines était sincère : celui-ci souligne que des débats philosophiques<br />
étaient traditionnellement menés à la cour des rois hellénistiques 2 , dont Néron s’est par<br />
ailleurs inspiré, notamment lorsqu’il a institué le corps des Augustiani 3 .<br />
Dans l’ensemble, pendant le règne de Néron, la vie artistique et intellectuelle connaît<br />
un essor et une vitalité remarquables. Le prince n’était peut-être pas un artiste génial, mais il<br />
fut un mécène passionné dans de nombreux domaines. C’est ainsi que les circuli, cercles<br />
culturels et politiques qui existaient déjà à l’époque de la République, et tendaient à se<br />
multiplier depuis Auguste, se révèlent particulièrement actifs sous Néron. Eugen Cizek<br />
recense dix groupes aux orientations philosophiques, politiques et esthétiques différentes, et<br />
parmi lesquels on remarque celui des Annaei, autour de Sénèque 4 . L’entourage immédiat du<br />
prince, les membres de sa cour, ont également participé au renouveau de la création littéraire.<br />
Il n’est guère raisonnable de penser que Néron, tout en s’intéressant passionnément aux arts et<br />
à la littérature, au point d’en faire un élément de sa politique, ait pu traiter avec dédain la<br />
philosophie.<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 10 sq ; Dion Cassius, 61, 14.<br />
2 P. Grimal, 1991a, p. 200.<br />
3 J.-L. Mourgues, 1990, p. 196-210. Sur les Iuuenes Augustiani, voir infra, p. 106 sq.<br />
4 E. Cizek, 1972, p. 415-416.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
97
Ferunt Senecam proxima nocte uisum sibi per quietem C. Caesari praecipere (...) 1<br />
Ce songe supposé de Sénèque, rapporté par Suétone, fait de Néron l’émule de Caligula, et<br />
jette le doute sur l’éducation du prince. En effet, Caligula, enfant des casernes, élevé parmi les<br />
soldats qui lui avaient donné son surnom, n’a pas reçu une éducation de la même qualité que<br />
celle de son neveu, loin s’en faut. Néron a bénéficié d’une formation traditionnelle et solide,<br />
propre à le rendre capable d’exercer de hautes fonctions politiques. La place de l’art, et de la<br />
musique en particulier, n’est pas prépondérante dans son éducation, même si les penchants<br />
naturels du jeune homme l’ont amené à cultiver les disciplines artistiques. La formation<br />
musicale de Néron, au sens professionnel du terme, commence réellement au moment de son<br />
avènement, quand il fait venir auprès de lui le célèbre citharède Terpnus. C’est alors que<br />
prend forme, dans l’esprit du nouvel empereur, le projet de mener une véritable carrière<br />
artistique, dont les implications politiques, nous le verrons, sont loin d’être négligeables.<br />
1 Suétone, Ner. 7, 1 : « On raconte que Sénèque, pendant la nuit, avait rêvé qu’il était le précepteur de<br />
Caius César. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
98
Chapitre 3. La carrière de l’empereur-artifex et la politique<br />
néronienne en matière de spectacles.<br />
La politique de Néron en matière de spectacles est présentée comme un trait<br />
caractéristique de son règne 1 . L’association de l’art et de la politique constitue tout d’abord<br />
une lecture du règne, car elle le distingue des choix et des orientations des autres empereurs :<br />
même si Caligula ou Commode ont pu fournir d’autres exemples de participation d’un prince<br />
à des manifestations spectaculaires, Néron est le seul qui ait érigé l’interaction de l’art et de la<br />
politique en système, avec une intention axiologique et une forme de cohérence toute<br />
particulière. Cette particularité du règne constitue en outre la pierre d’angle de la<br />
condamnation de Néron : la généralisation du spectacle aboutirait à une confusion du réel et<br />
de la fiction, de l’acteur et de son rôle. Cette confusion serait signe de déséquilibre et de<br />
folie : perte de repères, dévoiement de la politique, dont le résultat est la tyrannie. Le lien<br />
entre folie et tyrannie est constant, et les dérives du règne de Néron trouveraient leur origine<br />
dans le déséquilibre que crée l’intrusion du spectacle dans la politique.<br />
Le prince est le centre absolu du spectacle dans cette perspective : artifex, comme il se<br />
définit lui-même au moment de mourir, il se voit comme un technicien de l’ars, entendu<br />
1 Une nombreuse bibliographie sur ce sujet est recensée par G. F. Imperatore, Saggio di analisi critica<br />
della bibliografia neroniana dal 1934 al 1975, Milan, 1978, p. 60-65.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
99
comme une « habileté acquise par l’étude ou par la pratique » 1 . Le terme, réservé aux artistes<br />
professionnels de haut niveau, témoigne en outre de l’exigence qui accompagne les<br />
prétentions artistiques du prince. Il donne à voir cette maîtrise dans un cadre qui reste<br />
politique, ne cessant jamais d’être l’empereur lorsqu’il se produit comme artifex.<br />
Il convient donc de retracer le règne de Néron en fonction de sa politique<br />
spectaculaire. De fait, la carrière artistique du prince accompagne sa carrière politique : en<br />
quoi Néron est-il un prince artifex ? Comment cette politique a-t-elle pu se mettre en place et<br />
se développer, sur quelles bases culturelles et institutionnelles ? Une étude chronologique<br />
permettra de montrer comment, par un plan politique conscient, l’art est devenu le centre du<br />
pouvoir néronien avant de précipiter sa chute. C’est ainsi que le spectacle, entendu dans le<br />
sens relativement large de représentation artistique, nous conduira à faire un premier pas vers<br />
la tragédie.<br />
I/ L’infléchissement progressif de la politique spectaculaire.<br />
Si Néron s’était contenté de multiplier les jeux et de favoriser les représentations<br />
théâtrales, on aurait pu simplement souligner qu’il suivait par là les traces de son illustre<br />
ancêtre Auguste, comme le discours qu’il a prononcé au début de son règne le laissait<br />
entendre par ailleurs. L’importance accordée aux spectacles dans sa politique aurait alors<br />
constitué un infléchissement du modèle augustéen, en accentuant l’un de ses aspects, ce que la<br />
soif de popularité de Néron explique pour une large part 2 .<br />
1 A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, s. u. « ars ».<br />
2 Suétone, Ner. 53, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
100
A/ Premières armes.<br />
Maxime autem popularitate efferebatur, omnium aemulus, qui quoquo modo animum<br />
uulgi mouerentur. 1<br />
C’est ainsi que Suétone explique le désir de Néron de se donner en spectacle. Mais là encore,<br />
le prince n’a été ni le seul, ni le premier. Son grand père, Domitius Ahenobarbus, était connu<br />
pour son habileté à conduire des chars de course, et, l’année de son consulat, en 16, il avait<br />
fait jouer des chevaliers romains et des matrones comme acteurs de mimes 2 . Auguste lui-<br />
même avait parfois encouragé des jeunes gens de nobles familles à participer aux jeux du<br />
cirque, et introduisit même des chevaliers romains dans l’arène et au théâtre, ce qui fut par la<br />
suite interdit par un décret du Sénat 3 . C’est encore lui qui multiplia les jeux troyens, auxquels<br />
participait l’élite des enfants romains :<br />
Sed et Troiae lusum edidit frequentissime maiorum minorumque puerorum, prisci<br />
decorique moris existimans clarae stirpis indolem sic notescere 4<br />
Dans son enfance, Néron lui aussi participe à ces jeux :<br />
1 « Il recherchait avec passion la popularité, et s’efforçait d’égaler tous ceux qui, d’une manière ou<br />
d’une autre, soulevaient l’enthousiasme de la multitude. »<br />
2 Suétone, Ner. 4.<br />
3 Suétone, Aug. 44.<br />
4 Suétone, Aug. 43 : « Il fit également célébrer fréquemment des jeux troyens par une élite d'enfants de<br />
différents âges, estimant beau et digne des coutumes antiques de manifester les inclinations des<br />
illustres races. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
101
Tener adhuc necdum matura pueritia circensibus ludis Troiam constantissime<br />
fauorabiliterque lusit. 1<br />
En 47, lorsque Claude célèbre les jeux séculaires, Néron, qui n’est encore que Domitius, et<br />
Britannicus participent aux courses de chevaux, comme d’autres enfants de la noblesse, et<br />
c’est à Néron que va la faveur populaire 2 . Il devient, avec son adoption par Claude en 50, le<br />
rival officiel de Britannicus, et leur opposition se manifeste également sur le plan artistique.<br />
C’est ainsi qu’aux Saturnales de 54, Néron défie son frère adoptif et lui commande de<br />
chanter, espérant par là le ridiculiser :<br />
Ille constanter exorsus est carmen, quo euolutum eum sede patria rebusque summis<br />
significabatur. 3<br />
Sur ce terrain, la riposte de Britannicus est efficace, et dans le récit de Tacite, ce revers décide<br />
Néron à fomenter l’assassinat de son rival. L’épisode, ainsi relaté, montre clairement le lien<br />
qui unit la politique et l’art, par l’intermédiaire de la faveur que suscite ce dernier. A cet<br />
égard, il est significatif du règne de Néron, dont l’originalité tient à ce qu’il a été<br />
simultanément, et systématiquement, spectateur, acteur et dispensateur des spectacles qui se<br />
sont multipliés sous son règne, quand il n’est pas également l’auteur des textes récités à ces<br />
occasions. Prenant appui sur une tradition, qu’il a progressivement détournée et renforcée, il<br />
1 Suétone, Ner. 7 : « Dès l’âge le plus tendre, alors qu’il était encore enfant, il prit part aux jeux<br />
troyens, pendant les jeux du cirque, très assidûment et avec beaucoup de succès. »<br />
2 Tacite, Ann. XI, 11.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 15, 2 : « Et lui, avec résolution, se mit à chanter un poème, par lequel il faisait<br />
comprendre qu’il avait été dépossédé de la maison de son père et des fonctions suprêmes. » Il est<br />
possible que ce poème soit un canticum célèbre, extrait de l’Andromaque d’Ennius : Daremberg-<br />
Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, s.u. canticum.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
102
est devenu cet empereur histrion, cet artifex que les historiens anciens tiennent en<br />
abomination.<br />
Mais on ne devient pas acteur en un jour. Les apparitions de Néron, dans<br />
l’amphithéâtre ou sur la scène, ont été progressives, et c’est peu à peu que le prince s’est<br />
détaché de la tradition romaine en matière de spectacles, sans jamais rompre totalement avec<br />
elle. On vient de voir que le goût de Néron pour les spectacles s’est d’abord développé dans<br />
un cadre préexistant, pendant les jeux troyens par exemple. Son désir de se produire en public,<br />
aux dires de Tacite était ancien :<br />
Vetus illi cupido erat curriculo quadrigarum insistere nec minus fœdum studium<br />
cithara ludicrum in modum canere. 1<br />
Tout commence en 57 avec la construction d’un amphithéâtre en bois sur le Champ de<br />
Mars 2 . Une telle construction était de nature à renforcer la popularité de l’empereur, et<br />
s’inscrivait dans une tradition qui remonte au moins à 99 av. J.-C 3 . Néron met ainsi en place<br />
une politique dynamique en matière de spectacles 4 . Il lui faudra pourtant attendre la mort de<br />
sa mère pour réaliser son désir de participer à ces ludi. Agrippine, en effet, représente un<br />
obstacle à l’assouvissement de ses passions 5 . En attendant, Néron prend part en secret aux<br />
désordres qui se déroulent en marge des spectacles : il assiste aux disputes qui s’élevaient<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 14, 1 : « Depuis longtemps, il avait envie de monter sur un quadrige de course, et,<br />
passion non moins infâme, de chanter en s’accompagnant de la cithare, comme au théâtre. »<br />
2 Suétone, Ner. 12, 1 ; Tacite, Ann. XIII, 31, 1 ; Calpurnius Siculus, Ecl. 7, 23-84 ; G. B. Townend,<br />
1980, p. 169-171.<br />
3 J. C. Dumont, 2001, p301-305.<br />
4 M. Morford, 1985, p. 2019.<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 13, 2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
103
traditionnellement entre les partisans de différents acteurs, puis les encourage 1 . De cette<br />
manière, Néron se rapproche progressivement de la scène, et s’intègre au monde des acteurs,<br />
qu’il finit par diriger indirectement, puisqu’il donne aux affrontements leur impulsion.<br />
B/ L’instauration de jeux grandioses.<br />
1/ Les concours équestres.<br />
L’élimination d’Agrippine libère Néron de la menace d’un contre-pouvoir et de<br />
l’emprise d’une mère autoritaire. Cet événement politique considérable, dans lequel Sénèque<br />
et Burrus sont impliqués, constitue un véritable tournant de la politique néronienne. C’est<br />
alors que le prince institue des jeux grecs à Rome, et qu’il commence à se produire en public 2 .<br />
Mais il procède par étapes, et commence par des concours équestres : il y a dans ce domaine<br />
un précédent, sa participation aux jeux séculaires, et une tradition royale et héroïque que le<br />
prince se plaît à rappeler pour justifier son projet :<br />
Concertare equis regium et antiquis ducibus factitatum memorabat... 3<br />
Le problème qui se pose, notamment à Sénèque, est celui de la publicité de l’événement. Une<br />
arène privée est donc aménagée dans la vallée du Vatican, dans les jardins impériaux, où fut<br />
1 Dion Cassius, 61, 8 ; Suétone, Ner. 26.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 13-14 ; B. H. Warmington, 1969, p. 114.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 14, 1 : « Il rappelait que les compétitions équestres avaient été une activité royale,<br />
fréquemment pratiquée par les généraux des temps anciens » ; cf Homère, Iliade, XXIII, 287 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
104
créé le cirque de Caligula 1 . Le public romain est ensuite convié, et Néron remporte un grand<br />
succès 2 . Enfin, il court dans le grand cirque. Le récit de Suétone montre bien l’évolution et le<br />
caractère progressif des participations aux concours équestres : Néron assiste tout d’abord aux<br />
courses en secret, puis sans se cacher, il y participe d’abord dans le cadre privé, puis devant<br />
un public de plus en plus large. Cette évolution parallèle donne à la démarche du prince de la<br />
cohérence et de la logique, et souligne la prudence dont il a fait preuve pour imposer,<br />
graduellement, mais irrésistiblement, la place centrale qu’il entend occuper dans la vie des<br />
spectacles. Il se donne ainsi à voir, de plus en plus, et à un nombre toujours plus grand de<br />
spectateurs, dépassant chaque fois davantage les limites fixées par son entourage, Sénèque en<br />
tête. De même, il modifie petit à petit les règlements, renforçant ainsi progressivement sa<br />
maîtrise de l’espace spectaculaire. C’est un affranchi impérial, et non un magistrat comme le<br />
voulait la coutume, qui donne le départ de la course. C’est ainsi que le statut des participants<br />
et des organisateurs lui est soumis. Néron inaugure alors une ère de fêtes, dont la<br />
magnificence et la variété font l’objet de nombreux témoignages.<br />
2/ Les Maximi Ludi.<br />
Lors des Maximi Ludi, institués pour l’éternité de l’Empire, Néron est le dispensateur<br />
de la fête, son organisateur et son spectateur privilégié. On retient surtout de ces<br />
représentations leur gigantisme et leur caractère inouï. Elles sont longuement décrites par<br />
Suétone, qui commence significativement la seconde partie de sa monographie, consacrée au<br />
« monstre » Néron, par la mention de ces jeux. Dion Cassius rapporte les mêmes attractions,<br />
en les plaçant lors des jeux funèbres d’Agrippine, mais son témoignage paraît sujet à caution,<br />
1 Pline, N. H. XXXVI, 74.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 14 ; Suétone, Ner. 22 ; L. Duret, 1988.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
105
puisque lui seul évoque l’organisation de telles cérémonies 1 . Le récit de Tacite, au contraire,<br />
insiste sur l’adulation qui porta de nombreux citoyens à surenchérir dans l’exécration<br />
d’Agrippine, et à manifester leur joie, comme si l’empereur avait effectivement échappé à une<br />
tentative de complot 2 . Tacite ne dit rien de ces ludi, mais son attitude à l’égard du théâtre<br />
explique peut-être ce silence 3 : l’institution des Juvénales a sans nul doute une portée<br />
politique plus considérable. On retiendra des Maximi Ludi les prodigalités insensées de<br />
Néron, leur inspiration hellénique et leur gigantisme absolu : la naumachie, et la participation<br />
de sénateurs et de chevaliers en nombre dans des combats de gladiateurs, au cours desquels,<br />
par ailleurs, personne n’est tué. Suétone avance le chiffre de quatre cents sénateurs et six cents<br />
chevaliers. Pire encore, le personnel de l’arène est composé de membres de ces deux ordres 4 .<br />
Le récit de ces festivités, chez Suétone, consacre l’entrée en scène des membres de la<br />
noblesse, et montre en Néron un metteur en scène hors pair. Dans ce même passage, il émet<br />
l’hypothèse que Néron aurait joué, en professionnel, pour un particulier. Cette allégation, sans<br />
doute fausse, a en réalité pour but de flétrir le prince 5 .<br />
1 Sur cette question, voir P. Lebrecht Schmidt, 1990, p. 152. A propos de la signification des jeux<br />
funèbres, une manière d’associer tout le corps politique au deuil de la famille impériale, et d’assurer sa<br />
cohésion, comme une famille dont le père serait le prince. (comme en témoigne l’appellation Pater<br />
patriae), A. Fraschetti, 1990, p. 87.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 13.<br />
3 J. C. Dumont, 2003 ; E. Aubrion, 1990.<br />
4 Suétone, Ner. 11.<br />
5 H. Leppin, 1992, p. 221.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
106
C/ Les Juvénales de 59 et la création du corps des iuuenes Augustiani.<br />
1/ Les Juvénales.<br />
C’est lors des Juvénales, instituées en 59 pour commémorer le jour où il avait coupé sa<br />
première barbe, que Néron se produisit pour la première fois sur la scène 1 . Ces jeux ont pu<br />
être répétés annuellement, au moins jusqu’en 64 2 , et semblent avoir eu pour cadre les jardins<br />
du Vatican, où le prince s’était déjà adonné à la course de chars. Il ne s’agissait pas<br />
officiellement de jeux publics, puisqu’ils se déroulaient dans un espace privé et non dans un<br />
théâtre 3 . Le prince pouvait plus facilement, dans ce cadre, inviter des membres de la plus<br />
haute noblesse à y participer 4 . C’est ainsi, rapporte Suétone, que de vieux consulaires, et des<br />
matrones âgées se produisirent comme acteurs, ad lusum 5 . Tacite souligne également la<br />
participation de nombreux nobles 6 . Plus largement, Dion Cassius évoque la participation au<br />
spectacle de toutes les catégories de citoyens : les vieux et les malades chantent dans les<br />
chœurs, par exemple. Il cite même le nom d’une vieille matrone, riche et distinguée, Ælia<br />
1 Suétone, Ner. 11, 1 ; Tacite, Ann. XIV, 15 ; Dion Cassius, 61, 19-20.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 33, 1.<br />
3 J. L. Mourgues, 1988, p. 167 et la note 48 : les Juvénales ne sont que formellement des jeux privés ;<br />
H. Leppin, 1992, p. 220 : ces jeux poursuivaient des traditions plus anciennes, et n’étaient pas à<br />
proprement parler publics. G. Schumann, 1930, p. 62 ; F. Taeger, 1960, p. 307 ; M.T. Griffin, 1984, p.<br />
139-141.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 15, 4 ; Suétone, Ner. 11, 1 et B. H. Warmington, 1977, p. 65, note à Nero, 11, 1.<br />
5 Suétone, loc. cit.<br />
6 Tacite, Ann. XIV, 15, 1 : « La noblesse, l’âge, les charges honorifiques accomplies ne dispensèrent<br />
personne d’exercer le métier d’histrion grec ou latin, ni de s’abaisser à des gestes et à, des chants<br />
efféminés. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
107
Catella, qui à quatre-vingts ans danse à cette occasion 1 . Dès lors, la participation du prince à<br />
ces exhibitions semble aller de soi. Néron monte sur scène le dernier :<br />
Postremum ipse scaenam incedit, multa cura temptans citharam et praemeditans,<br />
adsistentibus phonascis. Accesserat cohors militum, centuriones tribunique et maerens<br />
Burrus ac laudans. 2<br />
C’est Gallion, le frère de Sénèque, qui remplit pour l’occasion la fonction de héraut, et<br />
annonce le prince par son propre nom, Lucius Domitius Ahenobarbus 3 : l’empereur, revêtu du<br />
costume des citharèdes, une sorte de robe assez ample 4 , joue une pièce intitulée Attis ou les<br />
Bacchantes 5 .<br />
2/ La constitution du corps des Iuuenes Augustiani.<br />
Outre la participation du prince au spectacle, un fait remarquable de ces Juvénales de<br />
59 fut la constitution du corps des Iuvenes Augustiani, que l’on peut rapidement définir<br />
comme la claque officielle de l’empereur, chargée de donner l’impulsion aux acclamations à<br />
la louange de l’artiste 6 .<br />
1 Dion Cassius, 61, 19-20.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 15, 4 : « Le dernier, il monte en personne sur la scène, accordant sa cithare et<br />
préludant avec beaucoup de soin, sous le regard de ses maîtres de chant. Il y avait là une cohorte de<br />
soldats, des centurions et des tribuns, et aussi Burrus, applaudissant à contre-cœur. »<br />
3 Dion Cassius, 61, 20, 1.<br />
4 J.-L. Mourgues, 1988, p. 160.<br />
5 Dion Cassius, loc. cit.<br />
6 G. Fusar-Imperatore, 1982, p. 186-189 ; J.-L. Mourgues, 1988, p. 156-181 ; J.-L. Mourgues, 1990 ;<br />
J.-M. Croisille, 1990, p. 196-210.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
108
Tuncque primum conscripti sunt equites romani, cognomento Augustianorum, aetate<br />
ac robore conspicui, et pars ingenio procaces, alli in spem potentiae. Ii dies ac noctes<br />
plausibus personare, formam principis uocemque deum uocabulis appellantes ; quasi<br />
per uirtutem, clari honoratique agere. 1<br />
La formation des Augustians reprend une tradition de l’Italie romaine, celle des associations<br />
de jeunes gens de l’aristocratie 2 , qui existaient déjà avant le règne de Néron, et dont Auguste a<br />
fait un élément de sa politique 3 : il avait en effet institué, dans le cadre des Ludi Troiani des<br />
organisations de jeunes nobles que l’on initiait au sens de la tradition romaine 4 . Les groupes<br />
de jeunes gens se caractérisaient par leur dévotion spéciale à une divinité désignée par leur<br />
cognomentum, comme dans les cas des Iuuenes Herculanei par exemple 5 , et leur organisation<br />
les rapprochait des collèges religieux. C’est ainsi que les Augustians se comportent, lorsqu’ils<br />
assimilent dans leurs louanges Néron à Apollon Pythien 6 . Leurs acclamations relèvent ainsi<br />
d’une forme du culte impérial, puisque l’assimilation de Néron à la divinité se réalise par ses<br />
chants. Les iuuenes Augustiani rappellent en outre les Basilikoi Paides des monarchies<br />
hellénistiques 7 , dont Néron, empereur philhellène, a pu s’inspirer 1 .<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 15, 5 : « C’est alors que, pour la première fois, des chevaliers romains que leur<br />
jeunesse et leur vigueur distinguaient, furent enrôlés, sous le nom d’Augustiani ; les uns étaient<br />
poussés par leur naturel effronté, les autres par leur ambition. Jour et nuit, ils faisaient retentir leurs<br />
applaudissements, louant la beauté et la voix du prince dans des termes réservés aux dieux ; comme<br />
s’ils les devaient à leur vertu, ils recevaient distinctions et honneurs. » ; Dion Cassius, 61, 20.<br />
2 M. Jaczynowska, 1970.<br />
3 J.-L. Mourgues, 1988, p. 164 ; Y. Roman, 2001, p. 297.<br />
4 Suétone, Aug. 43, 2 ; Virgile, Aen. V, 545-603 ; M. Morford, 1985, p. 2020.<br />
5 J.-L. Mourgues, 1988, p. 163.<br />
6 Dion Cassius, 61, 20.<br />
7 E. Cizek, 1982, p. 182. Cette influence de l’Orient hellénistique est confirmée par Suétone, Ner. 20,<br />
5-6 : Néron avait été charmé par les modulatae laudationes des marins d’Alexandrie, de passage à<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
109
Lors de sa création, en 59, le groupe des Augustiani se composait de jeunes gens<br />
appartenant à l’ordre équestre, dont ils abandonnaient l’anneau d’or, attribut de leur ordre 2 .<br />
Leurs vêtements les apparentaient à des citharèdes, et faisaient d’eux les émules du prince,<br />
dont ils adoptaient également la coiffure, une chevelure épaisse et flottante 3 . Ils se présentent<br />
comme les soldats de son triomphe 4 . Leur rôle consiste à faire retentir des applaudissements<br />
cadencés et des louanges modulées 5 . La variété des applaudissements et des manifestations<br />
de louange fait de ces jeunes gens, très organisés, et menés par des « chefs », duces, non<br />
seulement une claque destinée à susciter l’enthousiasme du reste de l’auditoire, mais aussi un<br />
véritable groupe d’accompagnement rythmique qui soutient la prestation de l’empereur. Le<br />
corps est élargi lorsque Néron se produit véritablement en public. Leur mission d’impulsion<br />
se double alors d’un rôle de contrôle et de surveillance des spectateurs. Des plébéiens<br />
complètent le groupe, composé alors de plus de cinq mille personnes (soit plus du quart du<br />
public que peut contenir le théâtre de Pompée 6 ), dont les « factions » peuvent se répartir dans<br />
le public pour ranimer la ferveur des spectateurs et dissuader d’éventuels trouble-fête de se<br />
manifester d’une quelconque manière 7 .<br />
La célébration des Juvénales marque donc une étape importante dans la carrière<br />
artistique de Néron. Il s’est produit devant une audience semi-publique, encore limitée, et<br />
Naples, ce qui justifia le recrutement d’Alexandrins parmi les Augustiani, et un élargissement<br />
consécutif du groupe.<br />
1 Sur le philhellénisme de Néron, voir J.-M. André, 1995, p. 170-174.<br />
2 Sur la signification de cet abandon, qui ne suppose pas la perte du statut de chevalier, mais la volonté<br />
de se consacrer exclusivement à l’empereur et de ne recevoir d’honneurs que de lui, J.-L. Mourgues,<br />
1988, p. 160.<br />
3 Suétone, Ner. 20.<br />
4 Dion Cassius, 63, 8.<br />
5 Suétone, loc. cit.<br />
6 J. C. Dumont, 2001, p. 302-303.<br />
7 J.-L. Mourgues, 1988, p. 170.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
110
dans « le cadre excentré du cirque de Caligula » 1 , mais qui inclut les membres les plus<br />
éminents de la société romaine. Avec les sénateurs et les personnages consulaires, le corps<br />
politique brûle les planches, préparant ainsi la prestation de l’artiste impérial. La création des<br />
Augustians, corps d’élite entièrement dévoué à sa gloire et formé pour entraîner l’adhésion de<br />
l’ensemble de l’assistance, annonce l’élargissement du public et l’ampleur des manifestations<br />
à venir. Par la suite, les exhibitions de Néron ne changeront guère de nature, mais se<br />
dérouleront devant un auditoire de plus en plus large.<br />
II/ Le prince au centre du spectacle.<br />
A/ Les premiers jeux néroniens.<br />
Dès l’année suivante, en 60, Néron institue des jeux quinquennaux, appelés<br />
« Néroniens » 2 . Tacite rapporte les débats qui ont eu lieu à cette occasion, entre opposants et<br />
partisans de ce concours 3 , dont Suétone souligne le caractère public et la nouveauté 4 .<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 4-5.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 20, 1 ; Suétone, Ner. 12, 3.<br />
3 J. C. Dumont, 2003 : Tacite présente selon un plan clair les arguments des deux partis, mais sa<br />
présentation des choses reflète sa désapprobation à l’égard de ce qu’il considère comme une<br />
déchéance.<br />
4 Suétone, Ner. 12, 3-4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
111
1/ Modèle grec et héritage augustéen.<br />
Ces jeux sont organisés sur le modèle des concours grecs, composés de trois volets,<br />
musical, gymnique et hippique. En outre, Néron se comporte en vrai gymnasiarque, puisqu’il<br />
fournit l’huile aux sénateurs et aux chevaliers, et décide de la construction d’un gymnase pour<br />
l’occasion 1 . Le modèle olympique est affirmé quand les vestales sont conviées à assister aux<br />
luttes athlétiques 2 , comme les prêtresses de Déméter. Néron dépasse ainsi le modèle<br />
d’Auguste, qui avait fait attribuer aux vestales une place d’honneur aux spectacles, mais avait<br />
interdit aux femmes les concours athlétiques, dont les participants concouraient nus 3 .<br />
L’influence grecque s’étendit aux vêtements, même si, comme le souligne Tacite, cette mode<br />
fut de courte durée 4 . Sur ce point, encore, Néron suit les traces d’Auguste, qui avait encouragé<br />
le port de vêtements à la mode grecque et l’emploi de cette langue 5 . La référence à Auguste<br />
est par ailleurs rendue manifeste par le geste de Néron, qui décline la couronne des citharèdes,<br />
que les juges lui décernent sans qu’il ait concouru, pour la placer aux pieds de la statue de son<br />
ancêtre 6 .<br />
Comme Auguste, il conjugua l’inspiration indiscutablement grecque de ces jeux avec<br />
la tradition romaine, tempérant ainsi leur caractère importé. Ainsi, l’intervalle de cinq années<br />
qui sépare deux sessions des Neronia ne reprend pas la périodicité de quatre ans des jeux<br />
grecs, mais correspond à un lustrum romain. Néron dédie sa première barbe à Jupiter<br />
Capitolin. De plus, les compétitions de poésie et de rhétorique ont pour langue le latin et non<br />
1 Suétone, Ner. 12, 3-4.<br />
2 Suétone, Ner. 12.<br />
3 Suétone, Aug. 44, 3.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 21, 4.<br />
5 Suétone, Aug. 98, 2.<br />
6 Suétone, Ner. 12.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
112
le grec. C’est d’ailleurs à cette occasion que Lucain attire l’attention du prince avec un poème<br />
à sa louange 1 . Les citoyens les plus éminents et les plus respectables s’affrontent aux<br />
compétitions de rhétorique et de poésie, dont les prix sont attribués au prince qui les préside 2 .<br />
Mais, si la personne de Néron est au centre de ces jeux, qui sont célébrés en son honneur, qui<br />
portent son nom, et dont il est le grand dispensateur, le prince n’y participe pas autrement que<br />
de manière symbolique : il assiste aux concours et les inspire, mais il ne se produit pas lui-<br />
même, il ne joue ni ne chante, comme le reconnaît Tacite 3 . Il n’accepte pas encore le prix de<br />
citharédie, qu’il mettra par la suite tant de soin à gagner.<br />
2/ Une étape décisive.<br />
Les Jeux Néroniens, dont tout, jusqu’à leur nom, se rapporte à la personne du prince, se<br />
déroulent sans incident particulier, Tacite lui-même en témoigne, lui dont on connaît pourtant<br />
la défiance envers ces spectacles 4 :<br />
Sane nullo insigni dehonestamento id spectaculum transiit ; ac ne modica quidem studia<br />
plebis exarsere, quia, redditi quamquam scaenae, pantomimi certaminibus sacris<br />
prohibebantur 5 .<br />
1 M. Morford, 1985, p. 2021.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 21, 4 ; Suétone, Ner. 12.<br />
3 J. C. Dumont, 2003 ; M. Morford, 1985, p. 2022.<br />
4 E. Aubrion, 1990 : dans le constat Tacite critique indirectement Hadrien ; J. C. Dumont, 2003.<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 21, 4 : « Il est vrai que ces festivités se déroulèrent sans aucun scandale<br />
particulier ; et les passions de la plèbe ne s’enflammèrent pas, même modérément, parce que les<br />
pantomimes, quoique rendus à la scène, avaient été exclus des concours sacrés. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
113
La création des Neronia est donc un succès. Le prince a manœuvré avec habileté, en<br />
s’imposant comme le centre absolu du spectacle, tout en affichant une certaine continuité avec<br />
la politique d’Auguste en ce domaine, et en intégrant la culture romaine à des traditions<br />
grecques importées. On peut cependant se demander pourquoi il n’a pas dès ce moment<br />
concouru : l’influence persistante de Sénèque sur son ancien élève l’en a-t-elle dissuadé ? A-t-<br />
il préféré procéder par étapes, pour ne pas risquer de manquer son entreprise par trop de<br />
précipitation ? Ces raisons se conjuguent sans doute, et il faudra y revenir, mais il est<br />
manifeste qu’au lendemain de ces jeux couronnés de succès, Néron a préparé toutes les<br />
conditions pour que sa prestation personnelle soit attendue comme la suite logique de ces<br />
événements.<br />
B/ Premiers pas sur une scène publique.<br />
Désormais, plus personne ne peut espérer contrecarrer les projets de Néron. Son<br />
insatisfaction et son impatience se font sentir en 64 :<br />
C. Laecanio, M. Licinio consulibus, acriore in dies cupidine adigebatur Nero<br />
promiscas scaenas frequentandi : nam adhuc per domum aut hortos cecinerat<br />
Iuuenalibus Ludis, quos ut parum celebres et tantae uoci angustos spernebat 1 .<br />
1 Tacite, Ann. XV, 33, 1 : « Sous le consulat de C. Laecanius et M. Licinius, Néron était poussé chaque<br />
jour plus violemment par le désir de se produire sur des scènes publiques : jusque là, en effet, il n’avait<br />
chanté que dans son palais ou dans ses jardins, aux Juvénales, qu’il jugeait trop peu fréquentés et trop<br />
limités pour une voix comme la sienne. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
114
Il désire naturellement passer à l’étape suivante, en se produisant sur une scène publique,<br />
devant une assistance à sa mesure. Il a assidûment travaillé son art et répète à l’envi : occultae<br />
musicae nullum esse respectum 1 . Mais Rome ne lui semble pas encore prête à le recevoir en<br />
costume de citharède dans ses théâtres, et déjà il rêve d’une grande tournée en Grèce, projet<br />
qu’il ne pourra concrétiser que plus tard.<br />
1/ Le récital de Naples.<br />
Les cités d’Achaïe, qui avaient pris l’habitude de lui faire envoyer toutes les couronnes<br />
de citharède, le confortaient dans le désir de se produire devant des spectateurs grecs, les seuls<br />
dignes de lui et de son art 2 . Il choisit alors Naples, quasi graecam urbem 3 , où il chanta à<br />
plusieurs reprises, devant une foule composée des habitants de cette ville, des colonies et des<br />
municipes voisins 4 . C’est à cette occasion qu’il élargit le corps des Iuuenes Augustiani en leur<br />
adjoignant cinq mille plébéiens, qui furent eux aussi initiés aux applaudissements cadencés,<br />
inspirés des acclamations des Alexandrins récemment débarqués dans cette ville 5 . Porté par<br />
l’enthousiasme public, Néron considère l’écroulement du théâtre (provoqué, d’après Suétone,<br />
par un tremblement de terre), comme une manifestation de la providence divine, puisqu’il se<br />
produisit après la sortie des spectateurs et ne fit aucune victime 6 . Cet incident devient même<br />
pour lui une occasion supplémentaire de se livrer à son art : il compose en effet des chants<br />
1 Suétone, Ner. 20 : « Pour la musique cachée, point de considération ».<br />
2 Suétone, Ner. 22.<br />
3 Tacite, Ann. XV, 33, 2 : Naples est une colonie de Cumes, elle-même fondée par Chalcis. Néron<br />
s’adresse d’ailleurs en grec à son public : Suétone, Ner. 20.<br />
4 Suétone, Ner. 20 ; Tacite, Ann. XV, 33, 2-3.<br />
5 Suétone, Ner. 20.<br />
6 Suétone, Ner. 20 ; Tacite, Ann. XV, 34, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
115
d’action de grâce, dans lesquels il remercie les dieux de l’heureuse issue de ce qui aurait pu<br />
être une catastrophe majeure 1 .<br />
Les spectacles de Naples marquent donc les véritables débuts de Néron sur une scène<br />
publique, et auraient dû constituer également le point de départ d’une tournée dans les<br />
provinces d’Orient, et à Alexandrie en particulier. Mais ce projet ne devait pas encore se<br />
réaliser. Les raisons pour lesquelles le prince renonça momentanément à son départ sont<br />
incertaines, aux dires de Tacite 2 : Suétone parle d’une crainte religieuse, provoquée par des<br />
présages dans le temple de Vesta 3 . La <strong>version</strong> officielle de cette annulation, qui met en avant<br />
la peine du peuple romain de voir son prince s’éloigner de lui, satisfait la plèbe, et donne<br />
peut-être une des clefs de la décision de Néron : la plèbe, considère Tacite, ne se soucie que<br />
de ses plaisirs et de son ventre, et elle craint que l’absence du prince ne provoque des troubles<br />
de l’approvisionnement en blé. Le risque de désordres et d’émeutes qu’engendrerait une telle<br />
pénurie contribue sans doute à retenir Néron à Rome, provisoirement 4 . Le prince est en effet<br />
très soucieux de sa popularité, lui qui s’appuie largement sur la plèbe pour renforcer son<br />
autorité aux dépens de la noblesse et du Sénat.<br />
Cette concession de Néron à l’ordre public n’a pas dû aller sans une profonde<br />
déception. La multiplication des fêtes, immédiatement après la décision de reporter le voyage,<br />
en témoigne. Le banquet organisé par Tigellin, en particulier, apparaît à cet égard comme une<br />
compensation : pour l’occasion, le préfet du prétoire sut faire preuve d’imagination, faisant<br />
disposer le festin sur un radeau, remorqué par des navires luxueusement décorés. Le luxe<br />
inouï du festin le dispute aux excès en tout genre, dont le point culminant est le mariage de<br />
1 Tacite, Ann. XV, 34, 1.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 36, 1.<br />
3 Suétone, Ner. 19, 1 ; Tacite, Ann. XV, 36, 2.<br />
4 Tacite, Ann. XV, 36, 4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
116
Néron avec un certain Pythagoras 1 . La cérémonie peut constituer le modèle ou le prélude de<br />
celle qui unira plus tard le prince et Sporus, émasculé et travesti en jeune mariée. Il y a, dans<br />
cette profusion même, un signe de la volonté de faire oublier au prince la frustration du<br />
voyage avorté : le festin apprêté sur un radeau, la présence de navires et de leurs rameurs lui<br />
offrent un succédané de voyage, de même que les animaux, venus de contrés lointaines, et<br />
même de l’océan, apportent une note exotique à l’ensemble. Tigellin, fait preuve, dans<br />
l’organisation de ce banquet, d’un grande habileté, et même d’un certain talent pour la mise<br />
en scène, qui ne saurait déplaire à son maître : ainsi, la disposition des rameurs obéit à une<br />
organisation précise, puisque ceux-ci sont classés selon leur âge et leurs talents érotiques, per<br />
aetates et scientiam libidinum. Le verbe componere, à la voix passive, donne bien<br />
l’impression qu’un ordonnateur supervise les moindres détails, à la manière d’un metteur en<br />
scène qui arrange un tableau scénique. C’est, en somme, du grand art.<br />
2/ Le durcissement du régime.<br />
L’incendie qui ravage Rome entre le 19 et le 27 juillet 64, détruisant, aux dires de<br />
Tacite, dix des quatorze régions de Rome 2 , retient encore Néron dans la Ville : l’organisation<br />
des secours, la reconstruction 3 , les mesures prises pour apaiser le trouble public, demandent la<br />
présence active du prince, et ce d’autant plus que la rumeur selon laquelle il aurait chanté la<br />
ruine de Troie devant Rome en flammes met à mal la popularité du prince :<br />
1 Tacite, Ann. XV, 37 ; Dion Cassius, 62, 15.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 40, 2.<br />
3 Tacite, Ann. XV, 41-43 ; E. Liénard, 1939.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
117
Quae, quamquam popularia, in inritum cadebant, quia peruaserat rumor, ipso tempore<br />
flagrantis Vrbis inisse eum domesticam scaenam et cecinisse Troianum excidium,<br />
praesentia mala uetustis cladibus adsimulantem. 1<br />
Que penser de cette rumeur ? Si Néron n’est probablement pas à l’origine de l’incendie 2 , il est<br />
tout à fait possible qu’il ait, face au désastre, comparé Rome à Troie, faisant naître ainsi la<br />
rumeur 3 . Il peut aussi avoir trouvé dans cette catastrophe une source d’inspiration poétique, à<br />
l’origine de ses Troica. Quoi qu’il en soit, cette rumeur hostile au prince a pu se développer à<br />
la faveur de l’exaspération du peuple de Rome, qu’une explication accidentelle de ce désastre<br />
inouï ne pouvait satisfaire. Le prince, effrayé des clameurs qui allaient jusqu’à l’accuser<br />
d’avoir intentionnellement provoqué l’incendie, détourna alors la fureur populaire sur les<br />
chrétiens 4 , membres d’une nouvelle secte qui n'était pas autorisée par le Sénat ni reconnue<br />
officiellement 5 , et qui provoquait la méfiance générale. Tacite qualifie ainsi le christianisme<br />
d'exitiabilis superstitio 6 , et Suétone de superstitio noua ac malefica 7 . Le prince offrit donc au<br />
peuple le spectacle de leur supplice, dans ses propres jardins 8 . La dramatisation des<br />
exécutions est remarquable : les condamnés étaient revêtus de peaux de bêtes, ou transformés<br />
1 Tacite, Ann. XV, 39, 3 : « Ces mesures, quoique populaires, n’eurent pas l’effet escompté, parce<br />
qu’une rumeur s’était répandue, selon laquelle, au moment même où la Ville flambait, il était monté<br />
sur la scène de son théâtre privé, et qu’il avait chanté la ruine de Troie, en comparant la catastrophe<br />
présente au désastre ancien. » cf. Pline, N. H. XVII, 5.<br />
2 E. Cizek, 1972, p. 187 et suiv.<br />
3 P. Vandenberg, 1982, p. 183 : contrairement à ce qu’affirme Dion Cassius, 62, 16, Néron n’a pas pu<br />
chanter en admirant le feu depuis les hauteurs du Palatin, car celui-ci était en flammes.<br />
4 C. Saumagne, 1962 ; R. Hanslik, 1963 ; C. Lepelley, 1969, p. 22-24 ; E. Kœstermann, 1967 ; P.<br />
Holson, 1976 ; M. Gray-Fow, 1998.<br />
5 E. Griffe, 1967, p. 33.<br />
6 Ann. XV, 44, 3 : « exécrable superstition ».<br />
7 Ner. 16, 3.<br />
8 Tacite, Ann. 44, 4-5.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
118
en torches humaines pour des illuminations. Néron, qui paradait lui-même en tenue d’aurige,<br />
est encore une fois le centre et l’organisateur du spectacle.<br />
Néron dut également faire face à la conjuration de Pison et à ses conséquences 1 .<br />
L’opposition au prince grandit et s’organise autour d’un rejeton de la très ancienne famille des<br />
Calpurnii, Pison 2 . Il rassemble nombre de mécontents, aux motivations diverses, des membres<br />
de l’ordre sénatorial hostiles à la politique du prince 3 , et désireux de le remplacer à la tête de<br />
l’Etat par un homme plus digne que lui de le diriger. Il est possible que, derrière Pison, la<br />
figure de Sénèque ait davantage rassemblé les conjurés 4 , mais on ne sait pas exactement dans<br />
quelle mesure le philosophe a inspiré ou pris part à cette conjuration. Le complot est<br />
dénoncé 5 , et dix-sept condamnations à mort sont prononcées pour quarante et un coupables ou<br />
supposés tels. Parmi eux, Sénèque fut contraint au suicide, suivi de peu par son neveu Lucain.<br />
En réprimant ce complot, Néron élimina ou exila un grand nombre de ses opposants, et<br />
radicalisa encore sa politique.<br />
1 E. Cizek, 1982, p. 258 sq.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 48.<br />
3 D. MacAlindon, 1956.<br />
4 P. Grimal, 1991, p. 238-239. Tacite, Ann. XV, 65.<br />
5 Pison avait repoussé l’idée d’assassiner Néron dans sa propre villa, craignant les conséquences<br />
politiques d’un acte qui contrevenait aux lois de l’hospitalité : E. Cizek, 1982, p. 222.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
119
C/ Les seconds jeux néroniens.<br />
1/ Vaine résistance du Sénat.<br />
La célébration des Jeux Néroniens, en 65 1 , obéit à la périodicité de ces jeux<br />
quinquennaux, et prend place naturellement dans le calendrier festif de cette année. Mais la<br />
prestation de Néron à Naples, et sa volonté désormais évidente de chanter en public, donnent<br />
à ces jeux un caractère bien différent des premiers. Les intentions du prince sont à ce point<br />
manifestes, que le Sénat lui décerne à l’avance les prix de chant et d’éloquence, dans l’espoir<br />
d’éviter qu’il ne participe effectivement au concours :<br />
Interea senatus, propinquo iam lustrali certamine, ut dedecus auerteret, offert imperatori<br />
uictoriam cantus, adicitque facundiae coronam, qua ludicra deformitas uelaretur. 2<br />
Les sénateurs espéraient-ils vraiment dissuader Néron de se produire sur la scène des Neronia<br />
en lui attribuant ces récompenses ? C’est peu probable, car nul n’ignorait à ce moment-là qu’il<br />
désirait plus que tout chanter en public. Une telle tentative, si elle était sincère, risquait de<br />
provoquer la colère de l’artiste qui avait déjà vu ses projets contrariés par les événements.<br />
1 Tacite, Ann. XVI, 4-5 ; Suétone, Ner. 21 et 23, 4 ; Dion Cassius, 62, 29.<br />
2 Tacite, Ann. XVI, 4, 1 : « Cependant le Sénat, à l’approche du prochain concours lustral, pour éviter<br />
ce déshonneur, offre à l’empereur la victoire à l’épreuve de chant, et y ajoute la couronne d’éloquence,<br />
afin de voiler la honte d’un succès théâtral. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
120
2/ Primus inter pares : La permanence de la fonction impériale.<br />
Le Sénat, paradoxalement, sert le dessein de Néron en le récompensant par avance : en<br />
refusant des couronnes qu’il n’a pas encore gagnées, le prince se présente comme un candidat<br />
semblable aux autres, et ne veut devoir son succès qu’à ses talents, déplaçant ainsi dans le<br />
domaine artistique le statut officiel de l’empereur qui, politiquement, se veut primus inter<br />
pares. C’est pour cette raison qu’il se fait inscrire sur la liste des citharèdes, ajoutant son<br />
bulletin à ceux de ses concurrents, et se conforme rigoureusement aux règlements en vigueur :<br />
ac sine mora nomen suum in albo profitentium citharœdorum iussit ascribi sortitulaque in<br />
urnam cum ceteris demissa intrauit ordine suo, simul praefecti praetorii citharam<br />
sustinentes, post tribuni militum iuxtaque amicorum intimi (...) 1<br />
Dans le même temps, Néron reste l’empereur, certains détails marquent de façon explicite la<br />
dimension politique de son apparition : il est accompagné des préfets du prétoire et de tribuns<br />
militaires, et entouré du cercle de ses amici, dont on devine qu’ils font partie du puissant<br />
consilium principis, au sein duquel des décisions majeures sont discutées.<br />
Néron se veut donc candidat au concours qui porte son nom, mais à aucun moment il<br />
n’oublie sa fonction, malgré la posture qu’il adopte et son respect du règlement. A cet égard,<br />
la surveillance des spectateurs est tout à fait significative : les Augustiani, renforcés par les<br />
cinq mille plébéiens recrutés et formés l’année précédente, sont chargés de donner<br />
l’impulsion aux acclamations et aux applaudissements. Mais leur fonction, somme toute<br />
1 Suétone, Ner. 21 : « et sans attendre, il se fit inscrire sous son propre nom dans la liste des candidats<br />
à l’épreuve de citharédie, déposa son bulletin dans l’urne avec ceux de tous les autres concurrents, et<br />
fit son entrée, à son tour, les préfets du prétoire qui portaient sa cithare, suivi des tribuns militaires, et<br />
accompagné de ses amis les plus proches. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
121
traditionnelle de la claque d’un artiste, se double d’une mission de contrôle et de surveillance.<br />
Tacite distingue dans son récit, parmi les observateurs placés au milieu les spectateurs et<br />
chargés de vérifier leur enthousiasme, ceux qui se montrent, et ceux qui se dissimulent. Les<br />
Augustiani, facilement reconnaissables à leur épaisse chevelure et à leur costume 1 , ainsi qu’à<br />
leur maîtrise des applaudissements 2 , constituent vraisemblablement la première catégorie,<br />
tandis que de véritables espions leur sont associés, afin que nul ne puisse modérer ses<br />
acclamations, de peur de se voir mener au supplice, ou d’encourir la disgrâce, non moins<br />
fatale, de l’empereur. Plus persuasive encore est la présence de soldats, debout entre les<br />
gradins de ce théâtre de Pompée, qui rappellent à leur devoir, par la violence, les étourdis et<br />
les récalcitrants 3 .<br />
Malgré ce dispositif impressionnant, l’attitude de Néron, à l’occasion de ces jeux, est<br />
celle d’un véritable professionnel : Les historiens anciens s’accordent à reconnaître (peut-être<br />
comme comble de l’infamie), que le prince respecte scrupuleusement les règles du concours,<br />
et témoigne aux juges la déférence de mise 4 . Il évite de s’asseoir, de cracher ou de se<br />
moucher 5 , les fautes qu’il commet, lorsque par exemple il laisse tomber un sceptre qui lui sert<br />
d’accessoire, le remplissent de l’inquiétude d’être éliminé. Cette humilité contraste<br />
singulièrement avec le dispositif de surveillance des spectateurs et la servilité des juges, mais<br />
témoigne du sérieux avec lequel le prince s’est engagé dans la carrière artistique. En<br />
revanche, il est peu vraisemblable qu’il soit allé jusqu’à participer, moyennant rémunération,<br />
à des spectacles privés donnés par des magistrats 6 : une telle attitude aurait bien fait de Néron<br />
1 Suétone, Ner. 20<br />
2 Tacite, Ann. XVI, 5, 1 : les Augustiani sont désignés par le terme gnari.<br />
3 Tacite, Ann. XVI, 5, 1.<br />
4 Tacite, Ann. XVI, 4, 4.<br />
5 Tacite, Annales, XVI, 4, 3 ; Suétone, Ner. 24, 1.<br />
6 Suétone n’affirme pas qu’il a effectivement pris part à ce type de spectacle, mais qu’il y a songé :<br />
Ner. 21.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
122
un acteur professionnel à part entière, mais elle aurait gravement entaché l’image du prince,<br />
en lui infligeant l’infamie attachée aux hommes libres qui se livrent à une telle pratique.<br />
Lors de la deuxième session des Jeux Néroniens, la situation a notablement évolué.<br />
Sur le plan politique, tout d’abord, la mort de Burrus en 62, suivie de peu par la disgrâce de<br />
Sénèque, constitue un tournant important du règne. C’en est fini de l’influence de ces deux<br />
hommes, dont Tacite fait l’éloge en soulignant leur capacité à modérer les mauvais penchants<br />
du prince 1 . Pire, Faenius Rufus et Ofonius Tigellinus, qui occupent désormais les fonctions de<br />
préfets du prétoire, sont enclins à suivre et même à entraîner Néron sur le chemin de la<br />
tyrannie 2 . Sénèque, en butte aux accusations de ses ennemis, se retire des affaires. Le régime<br />
se durcit alors, comme en témoigne la reprise des procès en majesté 3 . La répudiation puis<br />
l’exécution d’Octavie, que Néron remplace par Poppée, achève de renouveler l’entourage<br />
proche du prince, et marque une réelle rupture avec les débuts du règne. C’est dans ce<br />
contexte qu’il se produit devant le public romain, mais il n’affiche que sa volonté de<br />
concourir en tant qu’orateur. C’est l’insistance du peuple 4 , officiellement, qui le décide à<br />
chanter :<br />
mox, flagitante uulgo ut omnia studia sua publicaret, haec enim uerba dixere, ingreditur<br />
theatrum... 5<br />
Il remporte ainsi la victoire de chant pour son interprétation de Niobé 1 . Cette représentation,<br />
qui, aux dires de Suétone, dura de longues heures, constitue le point de départ des exhibitions<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 2.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 51.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 47, 4.<br />
4 Tacite, Ann. XVI, 4, 3.<br />
5 « bientôt, pressé par la foule de manifester tous ses talents (tels furent en effet les termes employés),<br />
il entre sur le théâtre... »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
123
publiques du prince-chanteur, encouragé par la plus grande partie de la plèbe 2 , alors que le<br />
Sénat reste impuissant face à ses ambitions artistiques.<br />
Aux Jeux Néroniens de 65, Néron chante donc pour la première fois à Rome, sur une<br />
scène publique. Une étape supplémentaire est donc franchie. Cependant, le prince affiche<br />
encore un certain respect des règlements, et ne modifie pas les règles ni les usages. D’après<br />
Suétone, il a fait avancer la date des jeux, dans son impatience, mais Tacite ne mentionne<br />
aucune distorsion de ce genre 3 . Sur la scène, il est en apparence un candidat comme les autres,<br />
soumis à la concurrence d’autres chanteurs, et à la décision souveraine des juges. Il participe à<br />
des certamina, concours de nature religieuse, et ainsi ne tombe pas sous le coup de la loi<br />
d’infamie 4 . Il commence ainsi par s’intégrer à un cadre préexistant, ces jeux néroniens qu’il a<br />
fait instituer, et qui se sont déroulés une première fois sans incident, tout en manifestant sur<br />
scène sa puissance politique : il est accompagné des préfets du prétoire et de tribuns<br />
militaires, et se fait annoncer par Cluvius Rufus, un personnage consulaire 5 . Les choses sont<br />
plus nettes encore dans les gradins du théâtre : tout se passe dans une atmosphère de méfiance<br />
et de suspicion générale, entre les soldats qui surveillent et réprimandent au besoin les<br />
spectateurs, le corps des Augustiani qui soutiennent Néron, et les espions, placés çà et là dans<br />
le public. Le respect que le prince affiche pour ses juges et ses concurrents ne prétend pas<br />
faire oublier qu’il est le prince, et que son excellence artistique n’a d’égale que sa toute<br />
puissance politique. Il remet encore à l’année suivante la fin du concours, s’imposant ainsi<br />
1 Suétone, Ner. 21, 1. D’après Dion Cassius, 62, 29, 1, Néron a chanté à cette occasion un poème<br />
emprunté à ses Troica.<br />
2 Z. Yavetz, 1969, p. 120.<br />
3 Tacite, Ann. XVI, 4. Suétone, Ner. 21, 1.<br />
4 J.-L. Mourgues, 1988, p. 162.<br />
5 Suétone, Ner. 21 : ce Cluvius Rufus, consul en 45, est également l’auteur d’une histoire qui fait<br />
partie des sources de Tacite.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
124
comme le maître des jeux, tout en suivant la tradition de l’instauratio, qui voulait que l’on<br />
trouve une raison pour recommencer les festivités 1 .<br />
III/ L’art au centre du pouvoir.<br />
A/ La Peregrinatio Achaica.<br />
Après le récital de Naples, Néron a très vite manifesté le désir de se rendre en Grèce,<br />
afin de laisser voir son art au public grec, le seul digne de lui. Comme on l’a vu<br />
précédemment, les circonstances ont empêché le prince de mener à bien son projet, mais il n’y<br />
a pas pour autant renoncé. L’évolution irrésistible de la carrière artistique de Néron devait se<br />
poursuivre, et l’étape suivante était naturellement la Grèce.<br />
1/ La longue maturation d’un projet grandiose.<br />
Depuis longtemps déjà, Néron avait manifesté son philhellénisme : pour justifier son<br />
désir de participer à des concours équestres ou musicaux, il se référait, mentionne Tacite, aux<br />
rois et aux généraux du passé 2 , que leurs victoires athlétiques dans les concours sacrés avaient<br />
assimilés aux héros de la mythologie. Hiéron de Syracuse, Théron d’Agrigente ou Arkésilas<br />
de Cyrène, célébrés par Pindare 3 , sont pour le prince avide de gloire agonistique autant de<br />
1 J. C. Dumont, 2001 ; Tite Live, II, 36.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 14, 1.<br />
3 Ol. I et Pyth. III ; Ol. II et III ; Pyth. IV et V.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
125
modèles et de cautions prestigieux. Le prince a en outre, et ce depuis l’enfance, un goût très<br />
prononcé pour les courses de char, dont il pressent très tôt la dimension héroïque : lorsqu’il<br />
fait le lien entre un cocher traîné par ses chevaux et Hector 1 , Néron ne se livre pas seulement à<br />
une pirouette destinée à le dispenser d’une réprimande de son maître. Il souligne la noblesse<br />
de cette discipline, et donne là une première ébauche de l’argument en faveur de sa<br />
participations aux courses. D’après la relation de Suétone, l’idée et le désir de prendre part<br />
aux concours musicaux organisés périodiquement dans les cités grecques lui ont été donnés<br />
par ces mêmes cités : leurs délégués avaient pris l’habitude de porter systématiquement au<br />
prince toutes les couronnes de citharédie 2 , avec des louanges si enthousiastes sur ses talents,<br />
que l’artiste impérial décida incontinent de partir pour la Grèce, afin de se produire devant ce<br />
public qui, sans nul doute, l’attendait.<br />
La décision, cependant, n’a pu être aussi brutale. Néron pensait depuis longtemps à la<br />
Grèce, son philhellénisme s’était manifesté à plusieurs reprises, lors de l’institution des<br />
Neronia, par exemple. En outre, le récital de Naples devait, à l’origine, constituer le point de<br />
départ d’une tournée en Grèce, envisagée, par conséquent, dès l’année 64 3 . Si l’autre projet de<br />
voyage, à destination d’Alexandrie, fut rapidement abandonné 4 , la tournée en Grèce fut, elle,<br />
simplement reportée en 66-67, après la visite du roi d’Arménie, Tiridate. Les raisons de ce<br />
report sont liées à la situation intérieure de Rome (l’incendie du 18 juillet, la conjuration de<br />
1 Suétone, Ner. 22.<br />
2 Suétone, Ner. 22.<br />
3 Selon J.-M. André, 1995, p. 173, le voyage a dû être à l’origine programmé pour l’année 65. Le<br />
calendrier des jeux s’y prêtait, à l’exception des jeux Pythiques, dont la prochaine session devait se<br />
dérouler en 67, et qu’il fallait donc avancer. Cette manipulation des dates, on le verra, a été effective<br />
par la suite.<br />
4 Suétone, Ner. 19, 1 ; Tacite, Ann. XV, 36, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
126
Pison et ses conséquences, la crainte de troubles civils provoqués par l’absence du prince 1 ),<br />
mais elles sont aussi d’ordre surnaturel : Néron aurait été effrayé, et momentanément détourné<br />
de son dessein, par des prodiges survenus dans le temple de Vesta 2 . Ainsi, de la même<br />
manière que le banquet organisé par Tigellin apparaît alors comme une compensation pour<br />
l’annulation provisoire du voyage, l’envoi des couronnes par les cités grecques a pu constituer<br />
à la fois une tentative de consolation de la part des « admirateurs » de Néron, et une<br />
manifestation symbolique de leur impatience de voir le prince gagner effectivement ces<br />
récompenses. De fait, le rêve de Néron se concrétisa quelque temps après.<br />
2/ Le témoignage des sources.<br />
Sur la peregrinatio achaica, les témoignages principaux sont ceux de Suétone et de<br />
Dion Cassius 3 . Les Annales de Tacite, qui s’achèvent pour nous sur la mort de Thrasea Paetus,<br />
ne nous fournissent pas d’indications sur ce voyage, et cette perte n’est guère compensée par<br />
le rapide rappel de cet épisode dans les Histoires 4 . Les ambitions de Néron d’égaler ou de<br />
surpasser les généraux des temps anciens sont évoquées par Plutarque 5 . Philostrate rappelle<br />
les victoires de Néron aux différents concours et son projet d’ouvrir l’Isthme 6 . Flavius<br />
Josèphe s’intéresse davantage à la cruauté de Néron et à sa mégalomanie 7 . Pausanias<br />
mentionne la tournée de Néron en Grèce, en insistant lui aussi sur les crimes du prince et sur<br />
1 Tacite, Ann. XV, 36, 4.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 36, 2 ; Suétone, Ner. 19, 1.<br />
3 Suétone, Ner. 22, 6-8 ; Dion Cassius, 62, 10-20 et 63, 8, 3.<br />
4 Tacite, Histoires, I, 23.<br />
5 Plutarque, Flam. 12-13.<br />
6 Philostrate, Vit. Apoll. IV, 24 ; V, 7-8 ; 39 ; 41.<br />
7 B. J. II, 22 et III, 67 ; A. J. XX, 5.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
127
les nombreuses œuvres d’art qui ont été, à cette occasion, arrachées au patrimoine de la<br />
Grèce 1 .<br />
L’épigraphie offre en outre des repères précis : le décret d’Akraiphia, en particulier,<br />
constitue un document essentiel, puisqu’il porte sur la libération de la province, et le discours<br />
composé et prononcé par Néron à ce sujet. Les informations fournies par ce célèbre décret<br />
sont confirmées par le témoignage des monnaies émises à Corinthe 2 . Les Actes des Frères<br />
Arvales 3 rapportent des vœux prononcés pour le salut et le retour du prince, et contribuent<br />
ainsi à la datation précise du départ.<br />
La chronologie du voyage, ainsi que ses enjeux, font l’objet de nombreuses<br />
discussions parmi les savants modernes, dont la plupart s’accordent pour critiquer l’entreprise<br />
d’un histrion mégalomane 4 . D’autres, moins nombreux, considèrent ce voyage comme un<br />
élément capital de la révolution néronienne 5 . Les dates et les étapes du périple ont été<br />
reconstituées par G. Schumann 6 , dont les conclusions ont été reprises par E. Cizek 7 . Les<br />
travaux de P. A. Gallivan 8 , dont J.-M. André admet globalement les résultats 9 , soulèvent un<br />
certain nombre de problèmes, et reconstituent le programme des concours auxquels Néron a<br />
participé, en comparant le récit de Suétone et les calendriers sacrés. Le programme des<br />
festivals a fait également l’objet d’une reconstitution détaillée et minutieuse par K. R.<br />
1 Pausanias, Per. II, 17, 6 et 37, 5 ; V, 12, 8 et 26, 3, etc.<br />
2 E. M. Smallwood, 1967, p. 37, no 66.<br />
3 A. F. A., éd. E. M. Smallwood, 1967, p. 26.<br />
4 R. Syme, 1963, II, p. 515-517 ; H. Halfmann, 1986, p. 173 sq ; P. A. Gallivan, 1973 ; K. R. Bradley,<br />
1978 ; R. Chevalier, 1988, p. 181 ; J.-M. André et M.-F. Baslez, 1993, 180-185.<br />
5 G.-Ch. Picard, 1962, p. 228-233 ; J.-M. André, 1995.<br />
6 G. Schumann, 1930, p. 67 et suiv.<br />
7 E. Cizek, 1972, p. 214.<br />
8 P. A. Gallivan, 1973<br />
9 J.-M. André, 1995, p. 174-176, « la chronologie vraisemblable du voyage ».<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
128
Bradley 1 , qui discute notamment les résultats des travaux de G. Schumann 2 . Il faut enfin<br />
mentionner les recherches de H. Halfmann sur la chronologie des événements, et en<br />
particulier sur la datation exacte du décret honorifique d’Akraiphia 3 .<br />
3/ Chronologie et itinéraire.<br />
a/ Le départ .<br />
Néron quitta Rome, en grand équipage, au mois d’août 66 4 . L’année nous est indiquée<br />
par Dion Cassius 5 . Il embarqua ensuite à Brindes pour Cassiope, ville de Corcyre 6 , où il<br />
chanta devant l’autel de Jupiter Cassius 7 , sacralisant ainsi sa voix céleste. G. Schumann<br />
s’appuie sur les vœux des Frères Arvales du 25 septembre pro salute et reditu imperatoris<br />
Neronis 8 pour dater le départ de Rome du début du mois de septembre 66. Cependant cette<br />
date pose un problème : le 14 septembre est en effet considéré comme la limite pour une<br />
navigation sûre. Le passage par le sanctuaire de Jupiter Cassius, dieu tutélaire des marins,<br />
aurait donc pour objectif de conjurer les risques pris par le prince, partant au-delà de cette<br />
limite 9 . Pourtant, il n’y a guère de raison connue pour laquelle Néron aurait ainsi débuté un<br />
1 K. R. Bradley, 1978a.<br />
2 Sur cette discussion, voir J.-M. André,1995, p. 175.<br />
3 H. Halfmann, 1986, p. 173-177.<br />
4 K. R. Bradley, 1978a, p. 63.<br />
5 63, 8.<br />
6 ILS 4043.<br />
7 Suétone, Ner. 22, 9.<br />
8 E. M. Smallwood, 1967, no 26 ; J.-M. André, 1995, p. 174, admet la date de spetembre 66 comme<br />
indubitable.<br />
9 J.-M. André, 1995.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
129
voyage en dehors des dates reconnues comme favorables à la navigation. La traversée a été<br />
préparée de longue date, et il serait étonnant que le prince ait négligé les dangers du périple en<br />
mer. On ne voit donc pas bien ce qui a pu ainsi retarder le départ. On connaît également les<br />
superstitions de Néron, qui, d’après Suétone, s’est laissé dissuader une première fois de partir<br />
après qu’il a été retenu par un pan de sa toge dans le temple de Vesta, et entouré d’une brume<br />
épaisse. Il a également évité Athènes et Sparte, et ne s’est pas initié aux mystères d’Eleusis.<br />
Le prince, effrayé par des prodiges et des interdits d’ordre religieux, a dû logiquement se<br />
conformer à une date traditionnellement fixée. En outre, la navigation, même aux moments<br />
les plus favorables, est toujours une entreprise hasardeuse : Néron a très bien pu demander<br />
l’assistance du dieu tutélaire des marins, sans avoir pour autant pris des risques inaccoutumés.<br />
D’ailleurs, le passage par Cassiope se justifie très bien sans cela : l’importance que la « voix<br />
céleste » du prince a prise au cours du temps, avec des vœux et des sacrifices, suffit à<br />
expliquer une forme de sacralisation préalable à la tournée en Grèce 1 .<br />
Il reste les vœux des Frères Arvales, datés du 25 septembre. On peut tout à fait<br />
supposer, avec K. R. Bradley 2 , qu’ils ont été prononcés après le départ de l’impérial équipage,<br />
il y a des précédents. Bien plus, ces vœux maintenaient de manière forte et symbolique la<br />
présence du prince à Rome, et assuraient la continuité du pouvoir en évoquant le retour de<br />
Néron peu de temps après son départ. Helius, affranchi impérial nanti des pleins pouvoirs en<br />
son absence 3 , avait également intérêt à ce que tout rappelât que son maître n’était que<br />
provisoirement absent.<br />
1 J.-P. Néraudau, 1982.<br />
2 K. R. Bradley, 1978a, p. 63.<br />
3 Dion Cassius, 62, 12, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
130
Les concours.<br />
Néron peut ensuite assister aux fêtes d’Actium, à Nicopolis, au début du mois de<br />
septembre 66 1 , avant de visiter les grands sites où se déroulent les concours 2 . Il est très<br />
difficile de reconstituer le programme des fêtes, et l’itinéraire exact de Néron et de sa suite.<br />
En effet, pour permettre au prince de prendre part à toutes les compétitions, il a fallu<br />
concentrer en une seule année chronologique les différents concours 3 :<br />
Nam et quae diuersissimorum temporum sunt, cogi in unum annum, quibusdam<br />
iteratis, iussit (...). 4<br />
C’est ainsi que la 211 e Olympiade, qui devait avoir lieu en juillet 65, a été reportée, pour que<br />
Néron puisse y assister 5 . La date des jeux Isthmiques de l’été 67 6 a également été modifiée, si<br />
l’on en croit la convocation du décret d’Akraiphia, qui donne la date du 27 novembre 7 . Si l’on<br />
maintient les dates fixées pour les autres jeux panhelléniques, on peut prendre comme point<br />
1 K. R. Bradley, 1978a, p. 71.<br />
2 Suétone, Ner. 23, 1 ; Dion Cassius, 63, 14, 1 ; Philostrate, Vit. Apoll. V, 7.<br />
3 Philostrate, Vit. Apoll. V, 7, dénonce ces entorses faites au calendrier sacré.<br />
4 Suétone, Ner. 23, 1 : « En effet, il fit rassembler en une seule année des concours qui ont lieu à des<br />
dates très différentes, et en fit même recommencer quelques uns. »<br />
5 Eusèbe, Ieron. Chron. X. Les jeux ont eu lieu, en octobre-novembre 66 selon H. Halfmann, 1986, p.<br />
176, en été 67 selon K. R. Bradley, 1978a, p. 71.<br />
6 A. Gallivan, 1973, p.234, cite S.I.G., 3, 814, lignes 41 sq pour dater les jeux Isthmiques précédents<br />
d’avril-mai 65. Comme ces jeux se déroulaient la première et la troisième année de chaque olympiade,<br />
alternativement au printemps et en été, on peut en déduire cette date.<br />
7 E. M. Smallwood, 1967. L’année 67 est majoritairement admise pour cette convocation : J.-M.<br />
André, 1995, p. 178 et la note 84, citant la discussion dans H. Halfmann, 1986, p. 175-176, et les<br />
conclusions de A. Gallivan, 1973, p 232-234.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
131
de repère les jeux Néméens de juillet 66 1 , et les jeux Pythiques prévus pour le mois d’août-<br />
septembre 67 2 . L’expression quibusdam iteratis signale également que certains concours ont<br />
dû être répétés 3 : il s’agit peut-être des jeux Pythiques, qui en principe se déroulaient vers le<br />
mois d’août-septembre, tous les quatre ans, à Delphes 4 . Entre temps, il est possible que Néron<br />
ait passé l’hiver 66-67 à Corinthe, capitale de l’Achaïe, dont il avait échangé l’administration<br />
au Sénat contre celle de la Sardaigne 5 . Les sites de Némée, Argos et Lerne ont pu recevoir le<br />
prince en été ou automne 67, et voir ainsi sa participation aux quatrièmes grands jeux<br />
panhelléniques, les Néméens 6 .<br />
c/ Un voyage officiel .<br />
Les difficultés que soulève le programme de Néron pendant ce séjour d’une année<br />
tiennent, on l’a vu, aux manipulations du calendrier officiel des jeux que la volonté impériale<br />
de participer à tous ces concours rend nécessaires, et le nombre important d’étapes : il faut<br />
imaginer l’imposante suite impériale, composée de l’entourage proche du prince (sans<br />
Poppée, morte avant le départ), de cohortes prétoriennes, qui entameront le percement de<br />
l’Isthme de Corinthe 7 , et des Augustiani, cette milice artistique qui l’accompagne et le<br />
1 J.-M. André, 1995, p. 173.<br />
2 Id.<br />
3 Cette hypothèse est confirmée par Dion Cassius, 63, 14, 3.<br />
4 K. R. Bradley, 1978a, parle de deux passages à Delphes, en septembre 66 et septembre 67.<br />
5 J.-M. André et M.-F. Baslez, 1993, p. 183. K. R. Bradley ne dit rien de cet hiver 66-67.<br />
6 Schumann date le passage dans ces cités des mois de juillet à septembre 67, tandis que K. R. Bradley<br />
distingue les jeux Néméens, qu’il date de l’été 67, entre les jeux Isthmiques et les jeux Olympiques, et<br />
la visite de Lerne et d’Argos, qu’il situe sans certitude aux mois d’octobre et novembre 67, soit juste<br />
avant la visite de l’Isthme et la libération de la province.<br />
7 Suétone, Ner. 19, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
132
soutient dans toutes ses exhibitions. A ce cortège prestigieux et déjà nombreux, il faut ajouter<br />
tout le personnel, les bagages, les équipements nécessaires à l’intendance, les costumes de<br />
scène de Néron et ses accessoires, cithares, plectres et masques entre autres 1 . De plus, le luxe<br />
de cet équipage ne contribuait guère à rendre les déplacements pratiques et rapides : Néron<br />
n’est pas seulement un artiste en tournée, il est aussi l’empereur de Rome en voyage officiel,<br />
et son équipage fastueux est le signe manifeste de sa puissance politique 2 . Dans ces<br />
conditions, les déplacements sur les routes de Grèce ne pouvaient se faire que très lentement,<br />
et avec de nombreuses étapes. Ainsi, le programme somme toute assez dense de festivités,<br />
associé aux conditions de voyage qu’on vient d’évoquer, montre le caractère très lourd de ce<br />
périple, et explique les intervalles de temps parfois assez longs entre les étapes.<br />
Il faut ajouter à tout cela les épisodes de la vie politique et personnelle du prince : les<br />
dépêches de son affranchi Helius lui permettent de régler certaines affaires. Il épouse en<br />
grande pompe le jeune Sporus 3 , et inaugure les travaux du percement de l’Isthme. Corbulon,<br />
accusé de fomenter un complot contre Néron 4 , est contraint au suicide alors qu’il revient<br />
victorieux à Corinthe. La même année, le pantomime Pâris est mis à mort 5 , et le voyage<br />
s’achève par la libération de la province. On le voit, les activités de l’empereur ne se limitent<br />
pas aux répétitions, aux exhibitions, et aux manœuvres pour intimider les concurrents et se<br />
concilier les juges, même si le programme du voyage est subordonné aux diverses<br />
participations de Néron aux jeux.<br />
1 Dion Cassius, 63, 8.<br />
2 Pline, N. H. XXXVII, 17 : Néron possédait, par exemple, des lits de voyages rehaussés de perles.<br />
3 Suétone, Ner. 18 ; Dion Cassius, 63, 13.<br />
4 Dion Cassius, 63, 17 ; R. Syme, 1970.<br />
5 Néron aurait vu en lui un rival : Suétone, Ner. 54 ; Dion Cassius, 63, 18, 1 allègue l’échec de Paris, à<br />
qui Néron avait ordonné de lui apprendre la danse ; H. Leppin, 1992, p. 271.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
133
c/ Sparte et Athènes .<br />
Deux cités ne figurent pas au programme des visites impériales, le fait est souligné par<br />
nos sources 1 . Il s’agit de Sparte et d’Athènes. Pourquoi Néron n’a-t-il pas participé aux<br />
Panathénées ou aux Carneia ? Il a pourtant séjourné à Argos, qui n’accueille aucun des quatre<br />
grands jeux panhelléniques. Suétone, lorsqu’il mentionne les remords et les frayeurs de Néron<br />
après qu’il a fait mourir sa mère 2 , précise que lors de son voyage en Grèce, il n’osa pas<br />
assister aux mystères d’Eleusis, interdits aux impies et aux criminels. Le prince matricide,<br />
plusieurs fois associé à Oreste, soit par des épigrammes 3 , soit parce qu’il interprétait ce<br />
personnage, a pu craindre la colère des Erinyes et le jugement de l’Aréopage. Quant à la cité<br />
de Lycurgue, elle ne correspondait pas à ses intentions, ni à son idéal artistique 4 . On peut<br />
discuter la vraisemblance de ces raisons alléguées par Suétone et Dion Cassius, et s’interroger<br />
sur le paradoxe apparent qu’il y a à craindre les divinités vengeresses tout en incarnant Oreste<br />
matricide. Il demeure que Néron, qui fait modifier les dates des jeux sacrés et parfois leur<br />
programme, en instituant, contre toute tradition, un concours musical à Olympie, choisit de<br />
donner, par sa présence, de l’importance à telle cité d’Achaïe, et non à celles qui représentent<br />
l’âge d’or de la Grèce classique.<br />
1 Suétone, Ner. 34 ; Dion Cassius, 63, 14.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 10, 1, fait également état de ces remords.<br />
3 Suétone, Ner. 39.<br />
4 Dion Cassius, 63, 14.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
134
d/ Les prestations de Néron.<br />
Les différentes compétitions auxquelles Néron participe lors de sa tournée en Grèce<br />
ont toutes un caractère sacré, comme les certamina dans le cadre desquels le prince s’était<br />
déjà produit. Il s’illustre dans les disciplines musicales et hippiques 1 , réalisant ainsi le<br />
programme qu’il avait déjà justifié en se référant aux rois et aux généraux de la Grèce 2 .<br />
Suétone rapporte qu’il prit part aux courses de chars dans plusieurs concours 3 , et qu’il<br />
conduisit même aux jeux Olympiques un attelage de dix chevaux. Les performances<br />
musicales de Néron reprennent le répertoire tragique et lyrique 4 qu’il affectionnait<br />
particulièrement. Enfin, l’empereur chanteur et aurige concourt même pour la palme du<br />
héraut 5 , affirmant ainsi sa volonté de victoire exhaustive, et se donnant le privilège d’être la<br />
voix de ses succès. Mais c’est la musique qui a la préférence du prince : avant ce voyage, il<br />
accordait déjà à l’exercice de sa voix une attention toute professionnelle 6 . Pour lui, une<br />
victoire aux jeux Olympiques sans prix de chant ne serait pas satisfaisante, c’est pourquoi il<br />
en fait modifier le programme traditionnel. De plus, les diverses sources insistent plus sur les<br />
concours musicaux que sur les compétitions sportives, et toute la tournée est placée sous le<br />
patronage d’Apollon 7 : Néron est acclamé Apollon citharède, Pythien, etc 8 .<br />
1 Dion Cassius, 63, 8.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 14, 1.<br />
3 Suétone, Ner. 24.<br />
4 Suétone, Ner. 21.<br />
5 Philostrate, Vit. Apoll. V, 24 ; Suétone, Ner. 24.<br />
6 voir supra, p. 94.<br />
7 H. Mattingly, 1965, p. 208-211 et p. 274, no 375.<br />
8 L’inspiration apollinienne des acclamations des Augustiani est attestée par Dion Cassius, 62, 20, 5.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
135
Ce mémorable voyage s’achève donc avec l’année 67, avec un retour triomphal en<br />
Italie, preuve que Néron n’a pas fait de son périple une parenthèse sans lendemain. Il a voulu,<br />
bien au contraire, affirmer ses victoires dans des processions où se mêlent tradition triomphale<br />
romaine et victoire à la grecque. Ainsi s’achève un épisode fondamental de la carrière<br />
artistique de Néron, et de son règne.<br />
B/ to ; tevcnion hJma~ı diatrevyei 1 .<br />
1/ La dispersion des derniers temps.<br />
Il reste alors à Néron moins de deux ans à vivre. Cette dernière période fait suite à un<br />
projet dont on ne peut nier qu’il a une certaine cohérence, et dont l’ampleur reste sans<br />
précédent. Mais la dernière étape de ce que l’on a pu appeler la révolution néronienne ne<br />
semble guère obéir à un plan politique conscient, et le prince paraît suivre ses passions dans la<br />
dispersion et la frénésie. Néron en effet ne se contente plus des concours sacrés ni de l’art<br />
noble qu’est la citharédie. Néron se spécialise dans le domaine musical, tout en élargissant ses<br />
compétences. C’est ainsi, nous dit Suétone, qu’il envisage de participer aux jeux en l’honneur<br />
de sa victoire (celle qu’il remporterait sur les Gaules insurgées), en tant que joueur de flûte,<br />
d’orgue hydraulique ou de cornemuse, et même en tant que pantomime, pour interpréter le<br />
rôle de Turnus 2 . Les intérêts du prince sont désormais exclusivement artistiques, et rien ne<br />
l’arrête dans cette quête, ni le mépris ordinairement attaché à un instrument comme la<br />
1 Suétone, Ner. 40 : « L’art nous fera vivre ».<br />
2 Suétone, Ner. 54. Il est frappant de voir Néron projeter de fêter sa victoire en jouant le rôle du<br />
vaincu, car Turnus, roi des Rutules, fut tué par Enée : Virgile, Aen. XII, 919-927.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
136
cornemuse 1 , ni l’aspect grotesque du joueur de flûte dont les traits sont déformés et rendus<br />
ridicules par le gonflement qu’il donne à ses joues 2 . L’art noble que constitue la citharédie ne<br />
lui suffit plus à ce moment. Il se passionne également pour les innovations techniques en<br />
matière de musique, allant jusqu’à bâcler un conseil pour se livrer à la démonstration des<br />
mécanismes d’un orgue hydraulique d’un modèle nouveau, alors que la révolte de Vindex le<br />
met plus que jamais en danger 3 . D’après Dion Cassius, cette démonstration fut même la seule<br />
cause de la convocation des sénateurs en pleine nuit 4 . Les projets politiques font place à des<br />
projets artistiques, et Néron semble désormais envisager le monde sous le seul angle du<br />
spectacle et de l’art.<br />
Il faut cependant faire la part, dans ce tableau, de la charge et de la rumeur. M.-H.<br />
Garelli-François a montré, dans un récent article, comment l’image d’un Néron pantomime a<br />
pu se forger par la superposition et la projection d’allégations de diverses sources 5 . En réalité,<br />
rien ne permet d’affirmer que Néron se soit adonné à cet art, ni que l’exécution de Pâris ait à<br />
voir avec une quelconque rivalité artistique 6 . La portée idéologique de cette accusation, qui<br />
permet de rapprocher Néron de Caligula, et de construire un portrait du tyran-saltator, n’est<br />
pas à négliger. En outre, il convient de distinguer la curiosité du prince pour les innovations<br />
techniques en matière de musique, et la pratique publique de la pantomime, qui ne sont pas du<br />
même ordre et ne mènent pas aux mêmes conséquences. Mais l’impression de dispersion de la<br />
dernière période du règne permet d’affirmer à des auteurs hostiles au prince l’incompatibilité<br />
de la fonction politique et de la pratique artistique. Cette forme d’invasion destructrice de<br />
l’art, au moment où le régime se délite, offre une conclusion édifiante à la peregrinatio<br />
1 Martial, X, 3, 8.<br />
2 A. Bélis, 1989, p. 761.<br />
3 Suétone, Ner. 41.<br />
4 63, 26.<br />
5 M.-H. Garelli-François, 2004.<br />
6 H. Leppin, 1992, p. 271.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
137
achaica : cette tournée artistique et politique, bien que scandaleuse aux yeux des historiens,<br />
pouvait être considérée comme l’affirmation triomphante du néronisme, associant le pouvoir<br />
et l’art au plus haut niveau. Avec la pantomime et la cornemuse, elle se laisse compter au<br />
nombre des symptômes de la folie tyrannique de Néron. Dans cette perspective, son projet de<br />
devenir un artiste professionnel à part entière est à la fois le rêve impossible d’un<br />
mégalomane déchu et l’aveu qu’entre le pouvoir politique et la pratique artistique, un choix<br />
s’impose forcément.<br />
2/ La tentation d’une carrière d’artiste professionnel.<br />
Lorsqu’il envisage la fin de son règne, Néron songe à devenir artiste professionnel, et<br />
ainsi à se consacrer entièrement à une carrière artistique. C’est ce que nos sources nous<br />
laissent déduire des paroles prononcées par le prince, par exemple en réponse aux astrologues<br />
qui lui annoncent qu’il sera un jour déposé 1 . Néron n’eut pas l’occasion de réaliser ce projet,<br />
si tant est qu’il le conçut véritablement, mais son goût pour toutes les formes de spectacle, et<br />
sa volonté de maîtriser les techniques du chant et de la musique instrumentale, rendent assez<br />
plausible la thèse selon laquelle Néron se serait finalement voulu artiste complet, et seulement<br />
artiste.<br />
La tentation de la professionnalisation apparaît dans les récits de Suétone et de Dion<br />
Cassius, et ce bien avant que la crise qui mit fin à son règne ne se noue. D’après Suétone, il<br />
avait songé à participer, moyennant une rétribution d’un million de sesterces, à un spectacle<br />
privé donné par un préteur 2 . Dion Cassius cite le nom d’un certain Larcius Lydus, qui lui<br />
aurait proposé 150000 drachmes pour une prestation de citharède. Selon lui, le prince aurait<br />
1 Suétone, Ner. 40.<br />
2 Suétone, Ner. 21.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
138
efusé cette proposition comme indigne et infamante 1 . Si Néron a envisagé de devenir<br />
citharède professionnel, ou si on le lui a proposé, c’est sans doute que son comportement, et le<br />
soin avec lequel il entretenait sa voix et s’exerçait à son art, engageaient à le considérer<br />
comme tel. Il semble bien qu’il n’ait pas franchi le pas, soucieux peut-être du scandale que<br />
n’aurait pas manqué de provoquer une telle décision. Mais il est tout à fait possible qu’il ait<br />
déjà réfléchi à la question. Ainsi, après que Galba a été proclamé empereur par les soldats, et<br />
à la suite de la défection de Rufus, il pense pouvoir encore s’enfuir et se réfugier à<br />
Alexandrie, pour y gagner sa vie comme citharède professionnel 2 . Ses dernières paroles,<br />
rapportées par Suétone et par Dion Cassius, sont également significatives : Qualis artifex<br />
pereo ! La dernière représentation que l’empereur a de lui-même est celle d’un artifex, et il<br />
l’exprime dans ce qui peut être une citation ou une improvisation d’un vers. Faute de devenir<br />
l’artiste fugitif qu’il a souhaité être dans ses derniers moments, Néron meurt en artiste dans le<br />
dernier acte de sa propre tragédie.<br />
Ainsi s’achève ce que l’on peut appeler la carrière artistique de Néron. Les étapes<br />
importantes de sa vie et de son règne peuvent être envisagées sous l’angle de l’art et de la<br />
représentation, à tel point que l’on comprend comment s’est forgé le mythe de l’empereur<br />
histrion, mégalomane et immature, que le cinéma a plusieurs fois représenté 3 . Et, de fait, les<br />
aspirations artistiques du prince ont constitué, depuis l’Antiquité, un motif essentiel de<br />
condamnation : Néron a dénaturé la fonction impériale, il a foulé aux pieds les valeurs<br />
romaines pour se complaire dans la débauche, dont ses prétentions musicales sont l’aspect le<br />
plus original. Ce tableau très sombre a été depuis largement nuancé, et l’on a pu parler à<br />
1 Dion Cassius, 63, 21.<br />
2 Dion Cassius, 63, 27.<br />
3 Ainsi, Peter Ustinov campe un Néron hystérique dans le film de Mervyn LeRoy, Quo Vadis ?, en<br />
1951.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
139
propos de Néron d’une véritable révolution culturelle et politique, obéissant davantage à la<br />
volonté affirmée du souverain qu’aux divagations d’un esprit malade.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
140
Conclusion<br />
La relation de Sénèque et Néron doit être considérée dans toute sa complexité. Il est<br />
vain, comme on l’a vu, de ne voir en Sénèque que le philosophe, dont le rôle serait de<br />
constituer un rempart contre toute tentation tyrannique. Tel n’était pas le dessein d’Agrippine,<br />
lorsqu’elle fit appel à lui pour lui confier l’éducation de son fils. Bien au contraire, elle<br />
considérait que cette discipline ne seyait guère à un futur empereur : elle comptait avant tout<br />
sur son soutien politique, et sur le crédit dont il jouissait dans les milieux sénatoriaux.<br />
Sénèque est un personnage complexe, et sa position vis à vis de Néron évolue au fil des<br />
années. Figure d’autorité au départ, de par ses fonctions de précepteur, il devient proche<br />
conseiller puis ministre réticent et finalement opposant et victime de la répression qui suit la<br />
conjuration de Pison. Entre temps, Néron a reçu une éducation de qualité, et Sénèque a<br />
participé dans une large mesure à la formation de son goût artistique, même si par la suite la<br />
mise en place du plan néronien de politique artistique éloigne Sénèque. Sa fonction politique,<br />
bien réelle, s’est traduite par une influence décisive sur la politique étrangère ou les relations<br />
avec le Sénat. Il joue un rôle plus obscur dans la lutte de pouvoir qui oppose Néron à<br />
Agrippine. Le changement de l’entourage du prince, avec l’arrivée de Tigellin, consacre la<br />
perte d’influence de Sénèque, mais l’évolution du règne de Néron, qui voit s’affirmer<br />
progressivement ses ambitions artistiques, commence alors que Sénèque est encore aux<br />
affaires. Il y a bien un échec de Sénèque, dans la mesure où Néron finit par rompre avec les<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
141
orientations politiques de son ministre, et par l’éliminer. Mais au-delà de cet échec demeure<br />
un intérêt commun pour le théâtre, et en particulier la tragédie. Cette proximité de ceux qui<br />
furent, à un moment, les deux personnages les plus puissants de Rome, amène naturellement à<br />
s’interroger sur le sens de cette importance du genre.<br />
Ce qui est remarquable dans le cas de Néron, c’est que ce qui le définit est aussi ce qui<br />
cause sa perte : or, c’est une des modalités de construction du personnage tragique. Lorsque<br />
c’est précisément son principal trait de caractère qui le mène à la catastrophe (on pense à<br />
Phèdre par exemple), l’émotion atteint son paroxysme, comme le rappelle Jean-Marie<br />
Domenach, commentant les analyses de Max Scheler dans Mort et survie :<br />
« (…) le tragique est d’autant plus virulent que le conflit est plus intime, et que la<br />
force adverse provient, non d’un impératif extérieur, mais du caractère du héros, de<br />
son projet, de ses moyens, de ses actes ; lorsqu’elle est, non l’ennemie d’une liberté,<br />
mais sa compagne, ou sa fille. » 1<br />
Comme pour resserrer encore le conflit et l’impression de clôture et d’enfermement qui<br />
accompagne le sentiment tragique, le conflit qui se noue dans la personne du prince a le<br />
spectacle pour objet. On peut y voir la première illustration des échanges entre tragique et<br />
politique, car Néron apparaît bel et bien comme un prince tragique.<br />
1<br />
J.-M. Domenach, 1998, p. 53.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
142
DEUXIEME PARTIE<br />
NERON, PRINCE TRAGIQUE<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
143
Introduction<br />
Du jeune prince adoré des premiers temps au fugitif lamentable, incapable de mettre<br />
lui-même fin à ses jours, le destin de Néron est exemplaire de la chute tragique, que pourrait<br />
illustrer cette parole du Cosroès de Rotrou : « On ne peut mieux tomber du trône qu’au<br />
cercueil. » Prince déchu, et qui a conscience de sa déchéance, Néron est aussi dépeint par<br />
Suétone comme le spectateur incrédule de sa propre tragédie. De fait, Néron est présenté très<br />
tôt comme un prince tragique : il y a par exemple une dramaturgie du règne de Néron, mise en<br />
œuvre par les récits de Tacite et Dion Cassius, qui laissent la tension se développer par degrés<br />
jusqu’au dénouement attendu et redouté.<br />
Le protagoniste de cette histoire tragique est bien entendu un tyran, à qui l’étendue de<br />
son pouvoir donne l’illusion pathologique de la toute puissance, le sentiment de dépasser<br />
hommes et dieux : Stulte uerebor, ipse cum faciam deos, s’écrie le Néron de l’Octavie 1 . Ce<br />
crime de démesure, porte ouverte à toutes les dérives despotiques, se manifeste pratiquement<br />
par la cruauté et l’arbitraire, qui servent à dessiner les contours de la catégorie du tyran. En<br />
cela, Néron ne se démarque guère de Caligula, dont les ambitions divines caractérisent la<br />
folie 2 . L’originalité de Néron, tel que le dépeint l’historiographie, est que cette folie a elle-<br />
1 Octavie, 449.<br />
2 « Il commença en effet d’abord par s’assimiler à ceux que l’on appelle les demi-dieux, Dionysos,<br />
Héraklès et les Dioscures, tournant en dérision Trophonios, Amphiareus et Amphilochos et ceux qui<br />
leur ressemblent par les oracles et les rituels, en comparant leur force avec la sienne (…). Puis sa folie<br />
devint à ce point délirante et frénétique qu’il en vint à dépasser les demi-dieux, et à s’attaquer à leur<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
144
même la tragédie pour objet, dans une imbrication vertigineuse et quelque peu déroutante. Il<br />
revendique en effet une liberté paradoxale, en mettant le spectacle au cœur de sa politique, et<br />
contribue à l’élaboration de cette image d’empereur-artifex, image à la fois contemporaine<br />
promise à la postérité. C’est alors qu’à la question de l’ars, constitué par les différentes<br />
formes d’expressions pratiquées par Néron, vient s’ajouter celle du tragique, qui en la source<br />
et le contenu.<br />
Il convient dès lors, dans un premier temps, de définir cette notion d’artifex par<br />
laquelle Néron se désigne dans le dernier cri que lui prête Suétone, cette parole conclusive, ce<br />
dernier écho censé rester dans l’air après l’anéantissement. En quoi Néron peut-il être<br />
considéré comme un artifex ? Quelle est la part de la tragédie dans la pratique artistique de<br />
Néron ? Si le conflit tragique se noue sur des contradictions inconciliables, que rien ne vient<br />
résoudre, et qui sont portées à leur paroxysme, c’est bien l’activité artistique du prince, tout<br />
spécialement lorsqu’elle se rapporte au théâtre, qui prépare et favorise l’irruption de la<br />
tragédie dans l’histoire. On étudiera donc l’incompatibilité des fonctions artistiques et<br />
politiques, dont Néron devient la claire illustration.<br />
Le tragique naît en outre, bien souvent, de la tension entre l’inconciliable et<br />
l’inévitable : si du point de vue de la pratique artistique, politique et tragédie sont<br />
incompatibles, du point de vue esthétique et symbolique, elle sont indissociables. Ainsi, alors<br />
qu’un même personnage ne peut exercer à la fois les fonctions de prince et d’acteur tragique,<br />
dans le même temps, la politique apparaît à bien des égards comme le domaine et le terrain de<br />
la tragédie. Le théâtre de Sénèque s’inscrit dans cette tradition de théâtre politique, qu’il<br />
contribue largement à renouveler et à revivifier, parce que le régime impérial se prête<br />
particulièrement à l’investigation par la tragédie.<br />
tour à des dieux plus grands et vénérés pour leur double parenté divine, Hermès, Apollon et Arès… »<br />
(Philon, Legatio ad Gaium, 11-13, trad. P. Petit, A. Colin).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
145
Chapitre 4. Le répertoire du prince-artifex.<br />
L’activité artistique de Néron est, conformément à la formation qu’il a voulu recevoir,<br />
liée au chant et à la musique. Les sources mentionnent principalement ses prestations comme<br />
interprète, mais aussi ses qualités d’auteur et de compositeur 1 . La danse, autre discipline en<br />
lien étroit avec la musique, n’apparaît que fugitivement, sous la forme d’un projet que le<br />
prince n’a pas réalisé 2 . Il est également question, assez fréquemment, des performances du<br />
prince en tant qu’acteur tragique. Là encore, ce sont ses qualités musicales qui sont<br />
convoquées, la tragédie requérant des capacités vocales. Néron se veut artifex, artiste au<br />
sommet de son art, maîtrisant parfaitement les techniques vocales et musicales, et ses<br />
différentes exhibitions publiques sont là pour le prouver. L’étude de la formation artistique du<br />
prince, ainsi que l’examen des étapes de sa « carrière » artistique, soulignent suffisamment le<br />
souci qu’il avait d’apparaître comme le premier musicien de l’empire, et signalent la place<br />
prépondérante de l’art dans sa vie personnelle et politique.<br />
Il convient à présent de prêter une attention plus soutenue aux disciplines pratiquées<br />
par Néron : la citharédie semble constituer son domaine de prédilection et son activité<br />
1 Suétone, Ner. 52 ; P. L. Schmidt, 1990, p. 162 : les termes Nevrwnoı mevlh et Nevrwnoı melw /divai<br />
dans Philostrate, Vit. Apoll. IV, 39 et V, 9 indiquent que Néron avait aussi composé la partie musicale<br />
des pièces qu’il interprétait.<br />
2 Suétone, Ner. 54 : Néron aurait projeté de danser le Turnus de Virgile, et aurait vainement tenté de<br />
s’initier à l’art de la danse auprès de Pâris. Cependant, il n’est guère vraisemblable que Néron se soit<br />
adonné à la danse et à la pantomime : M.-H. Garelli-François, 2000a, p. 255-261, et 2004.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
146
principale, mais qu’en est-il du théâtre ? Peut-on dire de Néron qu’il s’est donné comme<br />
acteur tragique ? Quel était précisément son répertoire, et quelle place les tragédies de son<br />
maître et ministre Sénèque ont-elles tenu ? La question du théâtre est complexe et<br />
fondamentale, pour comprendre les liens qui ont pu exister entre tragédie et politique, et pour<br />
éclairer le rôle du philosophe amicus principis.<br />
I/ Citharédie et tragédie.<br />
La citharédie est la discipline dans laquelle Néron désirait par-dessus tout exceller. Les<br />
références à ce sujet sont nombreuses. C’est aussi une spécialité réputée pour sa difficulté, et<br />
son niveau d’exigence, ce qui lui donne un prestige incomparable 1 . Le citharède exécute des<br />
chants en s’accompagnant lui-même de la cithare. Il doit donc réunir plusieurs qualités, et<br />
maîtriser en même temps un certain nombre de contraintes techniques, afin de produire un<br />
résultat harmonieux : à la maîtrise de l’instrument, d’un maniement délicat, s’ajoute en effet<br />
l’exercice nécessaire de la mémoire, puisque les citharèdes peuvent interpréter des morceaux<br />
assez longs (plusieurs centaines de vers), et d’indispensables qualités d’interprétation.<br />
Quintilien évoque la virtuosité de ces artistes, dont le talent vient à bout de ces difficultés<br />
conjuguées :<br />
An uero citharoedi non simul et memoriae et sono uocis et plurimis flexibus seruiunt,<br />
cum interim alios neruos dextra percurrunt, alios laeua trahunt continent praebent, ne<br />
pes quidem otiosus certam legem temporum seruat, et haec pariter omnia? 2<br />
1 A. Bélis, 1995.<br />
2 Quintilien, I. O. I, 12, 3 : « Quant aux citharèdes, ne sont-ils pas obligés de prêter attention en même<br />
temps à leur mémoire, au ton et aux diverses inflexions de leur voix, tandis qu’ils font jouer certaines<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
147
La citharédie est donc une discipline complexe, et les citharèdes sont des artistes dont les<br />
compétences techniques et artistiques sont devenues proverbiales 1 . Elle rencontre auprès du<br />
public une faveur particulière, et dans les concours, elle fait l’objet de la dernière épreuve, très<br />
attendue, ce qui souligne encore le prestige qui lui est attaché 2 . Les citharèdes sont le plus<br />
souvent des artistes professionnels, tandis que la lyre, par exemple, est plus volontiers<br />
pratiquée par des amateurs 3 .<br />
A/ La citharédie, discipline de prédilection.<br />
1/ Le costume.<br />
Dans son apparence extérieure, Néron cultive l’image du citharède. C’est avant tout<br />
son costume de scène, principalement la longue robe ample, que Néron porte aussi dans le<br />
cadre privé 4 . La splendeur de ces costumes sous le Haut-Empire contrastait avec la sobriété<br />
des premiers costumes des citharèdes 5 , et le prince pouvait paraître revêtu d’un costume<br />
cordes de la main droite, tout en tirant, retenant ou relâchant les autres de la main gauche, leur pied,<br />
loin d’être au repos, battant la mesure, et tout cela simultanément ? » ; Rhétorique à Herennius, IV,<br />
60, 3.<br />
1 Cicéron, Mur. 29 : Ut aiunt in Graecis artificibus eos auloedos esse qui citharoedi fieri non<br />
potuerint : « Comme on le dit chez les artistes grecs, on se fait joueur de flûte quand on ne parvient<br />
pas à devenir citharède. » Idem Quintilien, I. O. VIII, 3, 79.<br />
2 A. Bélis, 1999, p. 131-132.<br />
3 C. Vendriès, 1997.<br />
4 Suétone, Ner. 51.<br />
5 A. Bélis, 1999 p. 109-111 ; Juvénal, X, 210-215.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
148
esplendissant et richement orné. Il aurait également revêtu son costume de citharède au<br />
moment de l’incendie de Rome 1 . Les Iuuenes Augustiani, qui entouraient le prince et<br />
accompagnaient ses prestations de leurs applaudissements, étaient reconnaissables à leur<br />
mise, qui d’après Suétone les rendait insignes 2 . J.-L. Mourgues a montré qu’ayant<br />
certainement reçu une formation de citharèdes, ils devaient afficher une ressemblance au<br />
prince et au dieu qui l’inspirait 3 . Leur chevelure, tout d’abord, épaisse et flottante, rappelle la<br />
coiffure de Néron 4 , et des citharèdes à l’époque du Haut-Empire, qui à l’imitation d’Apollon<br />
citharède, portaient les cheveux longs et parfois bouclés au fer, et la barbe rasée 5 . Ils<br />
revêtaient vraisemblablement eux aussi le citharoedicus habitus, dont Suétone souligne la<br />
richesse, excellentissimus cultus. Ces détails vestimentaires confirment la référence<br />
apollinienne : Néron se veut un nouvel Apollon et s’affirme comme tel 6 . L’itinéraire du<br />
cortège triomphal, au retour du voyage en Grèce, aboutit non pas au temple de Jupiter<br />
Capitolin, comme le voulait la coutume, mais à celui d’Apollon, sur le Palatin 7 . Le prince se<br />
fait ensuite représenter par des statues en costume de citharède, et fait frapper des monnaies à<br />
cette effigie.<br />
1 Dion Cassius, 62, 18 ; Suétone parle de façon plus générale de son « costume de scène », in illo suo<br />
scaenico habitu : Ner. 38.<br />
2 Ner. 20, 6.<br />
3 J.-L. Mourgues, 1988, p. 159-160.<br />
4 Suétone, Ner. 51.<br />
5 A. Bélis, 1999, p. 111.<br />
6 N. Shiel, 1975-1976, p. 175-179.<br />
7 Suétone, Ner. 25.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
149
2/ Les concours.<br />
C’est à un citharède largement reconnu, Terpnus, que Néron fait appel dès les débuts<br />
de son règne pour sa formation artistique 1 : aux leçons théoriques et pratiques de son maître<br />
devaient s’ajouter des exercices et un régime destiné à entretenir et à amplifier sa voix. Chez<br />
Suétone, la narration du récital de Naples fait immédiatement suite aux indications sur les<br />
exercices et le régime des citharèdes, generis eius artifices. Ainsi, au cours de cette<br />
représentation, Néron a dû faire montre de ses talents de citharède 2 . Lors des premiers jeux<br />
néroniens, le prince avait emporté sans concourir le prix de citharédie, citharae coronam 3 ,<br />
signe que son goût pour cet art était déjà chose bien connue. Au cours des Juvénales de 59,<br />
Néron était monté sur la scène en costume de citharède, comme le précise Dion Cassius 4 . Lors<br />
de la deuxième session de ces jeux, il participe très officiellement à l’épreuve de citharédie, au<br />
cours de laquelle il chante Niobé, peut-être une pièce de sa composition 5 . Suétone souligne<br />
alors la longueur de la prestation, qui dure in horam fere decimam. Lors des différents<br />
concours sacrés, l’usage hérité de la Grèce voulait que les citharèdes interprétassent des<br />
nomes, qu’A. Bélis définit comme des « sortes de sonates de forme prédéterminée » 6 , ou des<br />
dithyrambes, dont la longueur pouvait être importante, et dont les parties chantées pouvaient<br />
être entrecoupées d’intermèdes exécutés à la cithare seule. C’est une pièce de ce type que<br />
Néron a pu donner à entendre à son public à ce moment-là.<br />
1 Suétone, Ner. 20. Il réalise ainsi un désir ancien : Tacite, Ann. XIV, 14, 1.<br />
2 Suétone, Ner. 20<br />
3 Suétone, Ner. 12.<br />
4 61, 20. Tacite, Ann. XIV, 14, 4 : postremum ipse scaenam incedit, multa cura temptans citharam et<br />
praemeditans, adsistentibus phonascis. E. Cizek, 1972, p. 121-123.<br />
5 Suétone, Ner. 21.<br />
6 A. Bélis, 1999, p. 185.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
150
Le prince désirait donc se faire connaître en tant que citharède, et les habitants de<br />
l’empire ont rapidement été au fait de ses ambitions artistiques dans ce domaine : c’est ainsi<br />
que les représentants des cités d’Achaïe surent faire preuve d’un certain à propos en matière<br />
de flagornerie, en envoyant à Néron les prix des concours de citharédie 1 : et le prince souligna<br />
alors que seuls les Grecs étaient dignes de l’art qu’il cultivait, studiis suis, cette expression<br />
désignant explicitement la citharédie comme sa spécialité.<br />
3/ Une spécialisation connue de tous.<br />
Les adversaires de Néron confirment, dans leurs attaques, l’importance de cette<br />
discipline artistique pour le prince : les détracteurs de Néron jugent en effet incompatible avec<br />
la dignité de la fonction impériale le fait de s’exhiber comme citharède 2 . Les ennemis de<br />
Néron, ainsi que ses opposants politiques, évoquent fréquemment les aspirations artistiques<br />
du prince pour les fustiger. C’est ainsi que Tacite prête à Boudicca un discours dans lequel<br />
s’affiche un profond mépris pour celui qui n’a d’homme que le nom : elle cite parmi les<br />
dépravations de l’empereur son goût pour la cithare 3 , qui devait être suffisamment connu de<br />
tous pour qu’elle le mentionne publiquement. La citharédie est pourtant pratiquée en grande<br />
majorité par des hommes 4 , mais la longue robe des citharèdes, ainsi que les chaussures qu’ils<br />
portent traditionnellement, et qui sont à l’origine des accessoires portés par les femmes en<br />
1 Suétone, Ner. 22 ; Dion Cassius, 61, 21.<br />
2 Pseudo-Lucien, Néron ou le Percement de l’Isthme, 6.<br />
3 Dion Cassius, 62, 6.<br />
4 C. Vendriès, 1997, p. 18.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
151
Grèce 1 , l’amènent peut-être à afficher son mépris de la sorte, pour un empereur qu’elle juge<br />
efféminé.<br />
F. Subrius, interrogé sur sa participation à la conspiration de Pison, répond qu’il ne<br />
saurait être l’esclave « d’un cocher ou d’un citharède » 2 . Il souligne ainsi le lien qui existe<br />
entre la tyrannie (c’est-à-dire un régime politique dans lequel il n’y a pas de citoyens, mais<br />
des esclaves), et la pratique d’activités telles que la conduite de char ou la citharédie,<br />
auxquelles Néron s’adonnait de notoriété publique. Dans le récit de Tacite, Subrius emploie le<br />
terme générique péjoratif histrio, dans une énumération où se mêlent, significativement, la<br />
mention des crimes de Néron et celle de ses prestations artistiques 3 :<br />
Oderam te, inquit ; nec quisquam tibi fidelior militum fuit, dum amari meruisti ; odisse<br />
coepi, postquam parricida matris et uxoris, auriga et histrio et incendiarius exstitisti. 4<br />
Au moment de la préparation de la conjuration, il désigne Néron par le terme citharoedus, et<br />
Pison par celui de tragoedus 5 ., développé dans la phrase suivante par l’expression tragico<br />
ornatu canere, chanter en costume tragique. Il semble bien qu’il s’agisse là de chant, d’autant<br />
que le terme tragoedus désigne généralement, à l’époque impériale, le chanteur de canticum<br />
tragique 6 .<br />
1 voir infra, p. 154.<br />
2 Dion Cassius, 62, 24.<br />
3 De la même manière, les prestations artistiques de Néron font partie des scelera du prince dans la<br />
présentation qu’en fait Suétone.<br />
4 Tacite, Ann. XV, 67 : « Je te haïssais, dit-il ; et nul parmi tes soldats ne te fut plus fidèle que moi, tant<br />
que tu méritais d’être aimé ; j’ai commencé à te haïr quand tu t’es révélé parricide, aurige, histrion et<br />
incendiaire. »<br />
5 Tacite, Ann. XV, 65.<br />
6 B. Zuchelli, 1964, p. 86.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
152
D’autres attaques, anonymes celles-là, soulignent les ambitions artistiques du prince,<br />
pour les critiquer ou pour les tourner en ridicule. Suétone cite à cet égard une épigramme<br />
intéressante :<br />
Dum tendit citharam noster, dum cornua Parthus,<br />
Noster erit Paean, ille Hecatebeletes. 1<br />
Le distique, dans sa brièveté, opère un rapprochement entre l’assimilation à Apollon, que<br />
Néron revendique, et ses prétentions artistiques. En opposant deux épithètes du dieu, elle fait<br />
de la cithare un attribut proverbial du prince, comme la flèche l’est au Parthe.<br />
Ces attaques contre Néron montrent, d’une part, que l’activité de Néron comme<br />
citharède était universellement connue, par ses récitals, par sa periodos et son retour<br />
triomphal en Italie, mais aussi par son comportement et sa mise habituelle. Du petit peuple<br />
aux Barbares et aux ennemis les plus lointains, tout le monde savait que le prince se voulait<br />
artifex. D’autre part, cette aspiration artistique était souvent considérée comme un élément à<br />
charge à verser au dossier du prince : ridicule, efféminé, oriental, Néron ne correspondait pas<br />
à l’image que ses ennemis se faisaient de la dignité impériale et romaine.<br />
B/ Nero tragoedus.<br />
Néron ne s’est pas limité à la pratique, pourtant très exigeante, de la citharédie : de<br />
nombreux témoignages lui attribuent une activité d’acteur tragique, dont l’étude est plus<br />
problématique. Lorsqu’il évoque les penchants artistiques de Néron, Tacite emploie des<br />
1 Suétone, Ner. 39 : « Tandis que notre homme accorde sa cithare, le Parthe bande son arc. L’un sera<br />
Péan, l’autre Hecatebeletes. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
153
termes assez vagues, dont les connotations péjoratives ne permettent pas d’établir de<br />
distinction entre la citharédie et le jeu tragique : ainsi l’expression ille scaenicus 1 , que<br />
l’utilisation du démonstratif emphatique rend lourde de mépris, peut désigner tout artiste de<br />
scène. Subrius Flavus le nomme histrio 2 . Ce terme a, à l’origine, une acception assez large,<br />
puisqu’il a le sens général d’acteur. Mais à l’époque impériale, histrio a désigné plus<br />
spécifiquement l’artiste de pantomime 3 , discipline dans laquelle Néron ne s’est certainement<br />
pas illustré 4 .<br />
Au cours de sa periodos, Néron n’a pas seulement pris part aux concours de citharédie.<br />
Lorsque Suétone rapporte le respect scrupuleux des règlements dont il faisait preuve pendant<br />
les concours sacrés, in certando 5 , il illustre son propos par un exemple qui réfère à la tragédie,<br />
in tragico quodam actu. Néron commet une faute, en laissant tomber son sceptre, et craint que<br />
celle-ci ne le conduise à l’élimination. Le sceptre, que P. Hernunez classe parmi les<br />
accessoires de caractère 6 , symbolise sur la scène la fonction royale. De plus, les pancartes qui<br />
accompagnent son triomphe agonistique comportent la mention des épreuves qu’il a<br />
remportées, ubi et quos quo cantionum quoue fabularum argumento uicisset 7 . La distinction<br />
est clairement établie entre les épreuves musicales, cantiones et théâtrales, fabulae. Dion<br />
Cassius précise également les quatre titres que le prince entend conquérir, conducteur de<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 59, 2. Pline, Pan. 46, 4, désigne Néron par une expression qui lui paraît<br />
oxymorique : imperator scaenicus.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 67.<br />
3 B. Zuchelli, 1964, p. 48.<br />
4 Voir infra, p. 157, note 6.<br />
5 Suétone, Ner. 24.<br />
6 P. Hernunez, 1987, p. 292-309. Les chaînes d’or dont on entoure Néron (note 69 p. 15)<br />
correspondent à la deuxième catégorie d’accessoires, les « accessoires de situation ».<br />
7 Suétone, Ner. 25 : « en quel lieu, sur quels concurrents, en interprétant quel chant ou quelle pièce il<br />
avait remporté la victoire. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
154
chars, héraut, citharède, acteur tragique. A cet effet, il emporte des cithares, des plectres et des<br />
masques 1 .<br />
Par la suite, Vindex semble se souvenir avec précision des spécialités de Néron,<br />
puisqu’il affirme l’avoir vu, ejn twï~~ tou~~ qeavtrou kuvklwï kai ; ejn thï~~ ojrchvstra/<br />
pote ; me ;n kiqavran e[conta kai ; ojrqostavdion kai ; koqovrnouı, pote ; de ; ejmbavtaı kai ;<br />
proswpei~on. 2 Ces indications donnent, par métonymie, des précisions sur les spécialités<br />
artistiques de Néron 3 . On distingue en effet deux groupes d’accessoires : premièrement, la<br />
cithare, l’habit orthostadien, longue tunique sans ceinture, et le kovqornoı, trois termes qui<br />
désignent la citharédie. Contrairement à ce que l’on pourrait penser tout d’abord, le kovqornoı<br />
n’est pas le cothurnus de l’acteur tragique. Il s’agit d’une chaussure orientale, portée à<br />
l’origine par les femmes en Grèce 4 . Adoptée par les citharèdes, elle complète l’apparence<br />
orientale et efféminée que Néron affecte et que ses détracteurs lui reprochent. On note que<br />
Vindex insiste sur la citharédie, puisqu’il cite trois accessoires relatifs à cette discipline, qu’il<br />
évoque en premier lieu.<br />
Le second groupe d’accessoires se compose de l’ejmbavthı, qui est le terme le plus<br />
souvent utilisé pour désigner le cothurnus, chaussure de théâtre qui grandit l’acteur, et du<br />
proswpei~on, masque de théâtre. La traduction d’ejmbavthı par « brodequin comique » n’a<br />
guère de sens, car elle ne rend pas à la double énumération du texte sa cohérence. D’autre<br />
part, il n’est attesté nulle part que Néron aurait joué des rôles comiques, peu compatibles avec<br />
ses ambitions artistiques et agonistiques. Il est bien dit qu’il a chanté des vers comiques,<br />
accompagnés de gestes, mais c’était dans le cadre privé d’un banquet, et à but de raillerie<br />
1 Dion Cassius, 63, 8.<br />
2 Dion Cassius, 63, 22, 4 : « dans l’enceinte du théâtre et dans l’orchestra, tantôt avec la cithare, l’habit<br />
orthostadien et la chaussure du citharède, tantôt aves le cothurne et le masque. »<br />
3 P. Hernunez, 1987, p. 287-291.<br />
4 Hérodote, 1, 155 ; 6, 125.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
155
envers ses adversaires 1 . Il existe par ailleurs de nombreux exemples de moqueries de Néron à<br />
l’égard de ceux qu’il avait abattus, ou qu’il se disposait à éliminer. Il faisait ainsi preuve<br />
d’une cruauté supplémentaire : jeu de mots féroce à propos de Claude 2 , défi lancé à Agrippine<br />
après l’exécution d’Aulus Plautius 3 , la liste est longue de ces traits de Néron qui, comme dit<br />
Tacite, ajoutait la dérision à des meurtres accomplis 4 . La petite représentation dont il est<br />
question est sans doute pour le prince une manière, quelque peu pathétique compte tenu de la<br />
situation, d’affirmer encore sa supériorité et la confiance qu’il a de venir à bout de ses<br />
ennemis. Peu après, il envoie dire à un acteur, au théâtre, abuti eum occupationis suis,<br />
soulignant ainsi qu’il ne doit ses succès qu’à l’absence de concurrence de la part de<br />
l’empereur 5 , qui se voulait donc également le meilleur dans ce domaine.<br />
La tragédie figure donc bien au répertoire de Néron, et l’importance qu’il lui accorde<br />
est rendue manifeste par sa participation à des concours 6 . Il a pu, par exemple, participer aux<br />
épreuves de tragédie qui avaient régulièrement leur place aux jeux de Delphes 7 . Il était en<br />
effet parfaitement possible de concourir dans plusieurs disciplines : A. Bélis cite l’exemple du<br />
Milésien Bassos, et de sa triple spécialisation comme héraut, acteur tragique et citharède 8 . Il y<br />
a même des exemples de candidatures et de victoires « transversales », comme celles<br />
1 Suétone, Ner. 52.<br />
2 Suétone, Ner. 33<br />
3 Suétone, Ner. 35.<br />
4 Tacite, Ann. XVI, 11, 3.<br />
5 Suétone, Ner. 42 : « (il lui fait dire) qu’il profite de ses occupations ».<br />
6 H. Leppin, 1992, p. 220-222. Dion Cassius, 63, 8, 2 ; Orose, Hist. VII, 7, 1 ; Suétone, Ner. 23, 1.<br />
7 A. Bélis, 1999, p. 142.<br />
8 A. Bélis, 1999, p. 136. Il n’était en revanche pas d’usage que le héraut proclamât lui-même sa<br />
victoire comme acteur tragique ou citharède. Le respect des règlements affiché par Néron est, on le<br />
sait, souvent superficiel, mais en l’occurrence il s’inscrivait parfaitement dans la tradition agonistique<br />
en participant à ces différentes épreuves.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
156
d’Hédéa, fille d’Hermésianax de Tralles, athlète et musicienne. Le désir de Néron de rivaliser<br />
avec Hercule après avoir égalé Apollon 1 est donc dans la continuité des compétences<br />
multiples que l’on voyait parfois s’affirmer au cours des agônes.<br />
C/ La double spécialisation du prince : citharédie et tragédie chantée.<br />
1/ Des disciplines assez proches.<br />
Comme Bassos, certains pouvaient exceller dans des domaines très différents, mais<br />
dans le cas de Néron, la double spécialisation d’acteur tragique et de citharède n’est pas à<br />
proprement parler exceptionnelle 2 .Les deux disciplines sont en effet assez proches, elles font<br />
appel aux mêmes capacités vocales, même si les anciens pouvaient distinguer les deux<br />
manières de chanter 3 : la dimension musicale du théâtre est en effet fondamentale 4 , et c’est le<br />
même répertoire qui est convoqué dans les deux cas : la thématique des textes chantés par le<br />
citharède emprunte au répertoire tragique, ou à l’épopée. C’est ainsi que Néron, en costume<br />
de citharède, chante en s’accompagnant de la cithare Attis ou Les Bacchantes. C’est pour<br />
cette raison que Tacite n’opère pas systématiquement la distinction, et qu’il désigne toutes ces<br />
pratiques par le même vocabulaire de la flétrissure et de l’infamie 5 . L’évolution de la tragédie<br />
vers la représentation d’extraits contribue encore à rapprocher les deux disciplines. Dans les<br />
1 Suétone, Ner. 53.<br />
2 La double spécialisation comme citharède et tragw /dovı était bien admise en Grèce : A. Chaniotis,<br />
1990, p. 89-108.<br />
3 Dion de Pruse, Or. 19, 4 ; 11, 119-122, cité par B. Schouler, 1987, p. 281.<br />
4 G. Wille, Musica Romana. Die Bedeutung der Musik im Leben der Römer, Amsterdam 1967, p 158.<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 14, 3 et 20, 4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
157
concours, en effet, on chantait des passages des tragédies, citharoedus et tragoedus se<br />
produisaient donc dans les mêmes occasions, lors des mêmes concours, quoique dans des<br />
catégories différentes. La proximité de ces deux spécialités explique ainsi que les artistes qui<br />
les pratiquent soient souvent mentionnés ensemble 1 .<br />
2/ Les conditions de représentation.<br />
Si la double spécialisation de Néron comme acteur tragique et comme citharède<br />
semble bien admise, la question des conditions de représentation reste toutefois posée. En<br />
effet, les prestations du prince comme citharède sont décrites dans toutes leurs étapes 2 : le<br />
prince, se pliant au règlement des concours, fait porter son nom sur la liste des citharèdes,<br />
puis le sort décide de l’ordre de passage. A son tour, le candidat impérial, après un prélude,<br />
fait annoncer par le héraut le titre du morceau qu’il va interpréter. Parfois, il s’adresse<br />
humblement aux juges avant de commencer 3 . Il n’en va pas de même pour les exhibitions de<br />
Néron comme tragoedus. La mention in tragico quodam actu 4 , par exemple, reste vague et ne<br />
donne aucune indication précise sur l’organisation du spectacle. Des témoignages tardifs,<br />
comme celui d’Eutrope 5 , ou du scholiaste de Juvénal 6 , attribuent à Néron des velléités de se<br />
produire comme danseur, dans des pantomimes. Ces allégations, qu’il convient de rattacher<br />
au portrait charge de Néron qui s’est élaboré au cours des générations qui lui ont succédé, ne<br />
1 Epictète, IV, 7, 37.<br />
2 Suétone, Ner. 21.<br />
3 Id. 23.<br />
4 Suétone, Ner. 24.<br />
5 Eutrope, Breuiarum historiae romanae, VII, 14 : Ad postremum se tanto dedecore prostituit, ut<br />
saltaret et cantaret in scaena, citharoedico uel tragico habitu.<br />
6 VIII, 228. Sur le caractère improbable d’une participation de Néron à des spectacles tels que les<br />
pantomimes, M. H. Garelli-François, 2000, p. 256- 260 et 2004.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
158
sont guère fiables. Alors, jusqu’à quel point Néron a-t-il fait l’acteur ? Quelle était la part de<br />
la mise en scène et de l’illusion dramatique dans les spectacles auxquels il a participé ?<br />
La spécialisation principale de Néron, celle dont il est le plus question dans le<br />
témoignage des historiens, et dans les paroles prêtées à ses contemporains, est la citharédie.<br />
Les Juvénales ont sans doute comporté des spectacles scéniques de ce type, comme semblent<br />
l’indiquer deux passages des Annales :<br />
Non nobilitas cuiquam, non aetas aut acti honores impedimento quo minus Graeci<br />
latiniue histrionis artem exercerent usque ad gestus modosque haud uirile 1 .<br />
Tacite emploie l’expression péjorative histrionis artem pour marquer son indignation de voir<br />
les membres des meilleures familles s’abaisser à pratiquer cette discipline infâme. Histrio<br />
désigne ici l’acteur professionnel, frappé en cela d’infamie, et son répertoire peut être la<br />
comédie ou la tragédie 2 . L’autre passage évoque la rancune de Néron, devant le refus de<br />
Thrasea Paetus de participer aux Juvénales :<br />
eaque offensio altius penetrabat, quia idem Thrasea Pataui, unde ortus erat, ludis<br />
cestatis a Troiano Antenore institutis habitu tragico cecinerat. 3<br />
Si les différents jeux néroniens ont pu faire une part à la tragédie, et ce quel que fût son mode<br />
de représentation, le témoignage de Tacite ne fait mention d’aucune participation du prince à<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 15, 1 : « La noblesse, l’âge, les charges honorifiques accomplies ne dispensèrent<br />
personne d’exercer le métier d’histrion grec ou latin, ni de s’abaisser à des gestes et à des chants<br />
efféminés. »<br />
2 B. Zuchelli, 1964, p. 46-47.<br />
3 Tacite, Ann. XVI, 21, 1 : « cet affront l’offensait d’autant plus, que ce même Thrasea avait chanté en<br />
costume tragique à Padoue, d’où il était originaire, aux jeux des cétacés institués par le Troyen<br />
Anténor. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
159
ce type de spectacle, ni à Naples, ni à Rome : les récitals du prince sont, explicitement, des<br />
citharédies 1 . Dans la relation de Suétone, l’évocation des performances de Néron tragoedus<br />
suit immédiatement le récit des jeux néroniens, mais les circonstances de ces spectacles ne<br />
sont pas précisées 2 . La mention des masques, que Néron faisait faire à son effigie ou à celle de<br />
ses maîtresses du moment, plaiderait davantage pour des représentations dans le cadre privé,<br />
devant le public restreint de la cour où de telles intrigues amoureuses se nouaient. L’anecdote<br />
du jeune soldat, volant au secours de son empereur qu’il voyait chargé de chaînes, dans le<br />
même passage, semble confirmer cette hypothèse : la méprise de la jeune recrue, postée à la<br />
garde de la porte, ad custodiam aditus, de la salle où se déroulait la représentation, paraît bien<br />
plus vraisemblable dans ces circonstances, que dans le cadre du théâtre, où les conventions de<br />
la mise en scène pouvaient moins prendre un jeune homme au dépourvu, aussi naïf fût-il. Par<br />
ailleurs, le récit de la periodos impériale est nettement séparé de cette anecdote, dans la<br />
relation de Suétone. Chez Dion Cassius en revanche, elle a pour cadre les concours grecs de la<br />
tournée, ce qui semble moins vraisemblable 3 .<br />
La participation de Néron à des spectacles tragiques a donc dû avoir lieu dans deux<br />
types de circonstances : à Rome, des représentations dans le cadre privé, comme l’usage s’en<br />
était répandu à l’époque d’Auguste 4 (les exhibitions publiques du prince dans le domaine<br />
musical étant réservées à la citharédie) ; en Grèce, lors de la peregrinatio achaica, pendant les<br />
concours organisés dans les différentes cités visitées par le prince.<br />
1 Ann. XIV, 15 ; XVI, 4, 3. J. C. Dumont, 2003.<br />
2 Suétone, Ner. 21, 2.<br />
3 P. L. Schmidt, 1990, p. 156.<br />
4 F. Della Corte, 1981, p. 233-234.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
160
3/ La tragoedia cantata.<br />
Une question reste toutefois posée : Néron a-t-il joué des tragédies entières, comme<br />
personnage, ou bien a-t-il simplement donné des récitals tragiques, composés d’extraits, de<br />
monodies par exemple ? Tout d’abord, l’hypothèse de la représentation d’une tragédie<br />
complète, avec son décor, ses chœurs et ses acteurs, paraît exclue. A propos des conditions de<br />
représentations des spectacles donnés par le prince, un passage de Suétone a fait l’objet de<br />
nombreux commentaires :<br />
atque etiam in tragico quodam actu, cum elapsum baculum cito resumpsisset, pauidus<br />
et metuens ne ob delictum certamine summoueretur, non aliter confirmatus est quam<br />
adiurante hypocrita non animaduersum id inter exultationes succlamationesque<br />
populi. 1<br />
La mention d’un acteur, hypocrita, semble supposer que Néron n’était pas seul en scène, ce<br />
qui est surprenant, étant donné le cadre de la représentation. Suétone raconte en effet cette<br />
anecdote pour illustrer le respect scrupuleux que le prince avait pour les règlements des<br />
concours (certamine dans le passage). Or, au cours de ces compétitions, les concurrents<br />
exécutaient en solo des extraits de tragédie, ce qui semble à peu près exclure la présence d’un<br />
autre personnage. En outre, c’est Néron qui porte l’accessoire qui le désigne comme roi de<br />
tragédie, le baculum, il est par conséquent impossible que l’acteur en question mime l’action<br />
1 Suétone, Ner. 24 : « bien plus, comme au cours d’une scène tragique, il s’était empressé de ramasser<br />
le sceptre qu’il avait laissé tomber, il se troubla, craignant d’être éliminé du concours en raison de<br />
cette faute, et ne fut rassuré que par un acteur, qui lui jura que l’enthousiasme et les acclamations du<br />
public avaient empêché que l’on s’en aperçût. » Cf Pseudo-Lucien, Néron ou le percement de l’Isthme,<br />
9.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
161
chantée par le candidat 1 . Comment expliquer alors la présence de cet acteur aux côtés de<br />
Néron ? Il pourrait s’agir d’un autre concurrent, qui flatte son impérial adversaire en le<br />
rassurant, à l’issue de sa prestation, car rien dans le texte n’indique formellement que cet<br />
acteur soit présent sur la scène, et l’échange entre celui-ci et Néron a dû vraisemblablement<br />
avoir lieu après son passage et les acclamations consécutives du public. On peut également<br />
supposer que cet hypocrita joue le rôle du serviteur qui, traditionnellement, accompagnait le<br />
personnage du roi afin, par exemple, de tenir son sceptre si celui-ci avait besoin de tirer son<br />
épée 2 ; mais dans ce cas, le terme attendu serait davantage celui de mutus actor, et non<br />
d’hypocrita 3 .<br />
La mention des masques et des accessoires utilisés par Néron lors de ses exhibitions<br />
semble également exclure l’hypothèse selon laquelle Néron aurait interprété tous les cantica<br />
d’une pièce. En outre, le jeu tragique, plus statique et solennel que celui de la comédie,<br />
permet à l’acteur de jouer et de chanter tout ensemble, sans avoir recours à la présence d’un<br />
acteur chargé de mimer l’action 4 : la distinction du chant et de l’action aurait pour origine,<br />
d’après Tite Live 5 , la difficulté de concilier performances vocales et gestuelles, mais il s’agit<br />
plus vraisemblablement d’une convention propre au théâtre grec contemporain de Livius<br />
Andronicus, introduite par celui-ci à Rome.<br />
Le sceptre, mais aussi les chaînes d’or avec lesquelles il est attaché lorsqu’il incarne<br />
Hercule furieux indiquent que le prince interprétait le rôle d’un personnage en particulier.<br />
C’est ce que confirme la liste que donne Suétone des personnages dont Néron chante les<br />
1 C’est pour cette raison que P. Hernunez (1987, p. 500, note 359) exclut la leçon hypocrita adiuuante.<br />
2 P. Hernunez, 1987, p. 303.<br />
3 Id. p. 500.<br />
4 Id. p. 431.<br />
5 Tite Live, VII, 2 ; J. C. Dumont, 1997, p. 48.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
162
mésaventures : Canacé, Oreste, Œdipe ou Hercule 1 . Ces noms sont, comme l’a fait remarqué<br />
G. Boissier 2 , accompagnés de circonstances trop précises, référant à des épisodes trop<br />
restreints pour constituer l’argument d’une tragédie entière. Les indications que nous<br />
possédons sur la pratique de Néron tragoedus correspondent davantage à un type de spectacle<br />
particulier, la tragoedia cantata ou tragédie chantée. L’acteur, en habit de tragoedus,<br />
déclame, accompagné de choreutes, un texte composé de monologues extraits d’une tragédie<br />
préexistante, ou écrit pour la circonstance à partir d’un thème tragique. Un hypocrita, présent<br />
sur scène, lui donne la réplique lors de courts passages dialogués 3 . Dans ces conditions, la<br />
performance vocale peut parfaitement s’accommoder d’éléments de mise en scène, propre à<br />
créer un début d’illusion dramatique et à affirmer la filiation de la représentation avec le genre<br />
tragique dont elle est issue.<br />
La tragédie chantée et la citharédie constituent donc les deux disciplines d’élection de<br />
Néron. Pour chacune d’elles, les qualités vocales sont essentielles, et nécessitent<br />
l’entraînement rigoureux auquel le prince s’astreint de façon régulière. Chacune emprunte au<br />
même répertoire thématique, et exalte les destinées de héros mythologiques. Enfin, ces deux<br />
types de spectacles requièrent la virtuosité d’un artiste vedette, dont les performances<br />
garantissent la qualité du spectacle. Si, d’un point de vue technique, la manière de chanter<br />
devait différer de l’une à l’autre, et ce de façon significative pour l’artiste comme pour le<br />
spectateur, la différence principale qui distingue ces deux disciplines tient à l’élément<br />
dramatique. Dans la tragédie chantée, en effet, la présence d’un acteur qui échange avec le<br />
personnage principal quelques paroles, les accessoires et les masques, constituent autant<br />
1 Suétone, Ner. 21.<br />
2 G. Boissier, 1861a, p. 339.<br />
3 H. A. Kelly, 1979, p. 27-30. Sur l’origine de cette pratique, sans doute importée de l’Orient grec, M.-<br />
H. Garelli-2000a, p. 89.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
163
d’éléments de mise en scène qui font la particularité de ce genre de spectacle : ainsi, les<br />
satellites qui chargent Néron-Hercule de chaînes d’or 1 , contribuent à créer l’illusion<br />
dramatique. L’importance que le prince accordait à l’élément scénique, et dont témoigne en<br />
particulier le soin qu’il apportait à ses masques tragiques, représentant ses propres traits ou<br />
ceux des femmes qui avaient sa faveur, est sans doute une des raisons pour lesquelles il ne<br />
s’est pas limité à la citharédie. L’intérêt que Néron montre pour le théâtre et ses mécanismes<br />
apparaît d’ailleurs dans une tout autre circonstance : d’après Dion Cassius, l’idée du bateau<br />
piégé destiné à éliminer Agrippine lui a été donnée par une machine de théâtre 2 . Suétone<br />
évoque également une machina, un mécanisme qui devait faire tomber sur elle les lambris de<br />
son plafond durant son sommeil 3 . Ainsi, l’attrait que la tragédie exerce sur le prince ne se<br />
manifeste pas seulement dans ses activités artistiques.<br />
II/ Le répertoire.<br />
A/ Les rôles.<br />
Les sources antiques permettent de recenser une douzaine de rôles interprétés par<br />
Néron 4 : certains sont explicitement présentés comme appartenant à la tragédie, d’autres en<br />
revanche, qu’ils empruntent à l’épopée ou que les conditions de représentations soient<br />
précisées, sont plus vraisemblablement des thèmes de citharédie. Il est parfois difficile de<br />
1 Dion Cassius, 63, 9.<br />
2 61, 12. Dion Cassius qualifie d’ailleurs la machination de tragwïdiva.<br />
3 Suétone, Ner. 24, 3.<br />
4 Les références sont recensées par S. Bartsch, 1994, p. 40, note 6. s<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
164
trancher en faveur de l’une ou l’autre discipline, car, comme on l’a vu, citharédie et tragédie<br />
exploitent le même répertoire, et les points de rencontre sont nombreux.<br />
Certaines sources mentionnent avec assez de précision le genre des textes interprétés<br />
par Néron. Ainsi, les rôles de Canacé 1 , Oreste 2 , Œdipe 3 et Hercule 4 sont joués personatus,<br />
c’est-à-dire avec le masque tragique. Juvénal dans ses satires, cite les masques d’autres héros :<br />
Thyeste, Antigone et Mélanippe. 5 Dion Cassius mentionne également Alcméon 6 et Thyeste 7 .<br />
Le rôle de Créon, comme celui d’Œdipe, est présenté par Philostrate 8 comme un rôle de<br />
tragédie, avec des éléments de mise en scène (le sceptre, la porte), qui ne permettent pas de<br />
douter. Enfin, on sait par Suétone que la dernière pièce représentée par Néron fut un Œdipe,<br />
en grec, dont il cite un vers :<br />
Obseruatum etiam fuerat nouissisama fabulam cantasse eum publice Œdipodem<br />
exulem atque in hoc desisse uersu :<br />
Qanei~n mæa[nwge suvggamoı, mhvthr, pathvr. 9<br />
Lors de son triomphe artistique à Rome, Néron, nous dit Suétone, était précédé d’un cortège<br />
dont les membres brandissaient des pancartes, sur lesquelles étaient mentionnés les thèmes de<br />
ses prestations victorieuses : il s’agit soit de fabulae, des tragédies, soit de cantiones 1 .<br />
1 Dion Cassius, 63, 10, 2.<br />
2 Dion Cassius, 63, 9, 4 ; 63, 22, 6 ; Juvénal, VIII, 228.<br />
3 Philostrate, Vit. Apoll. 5, 7 ; Dion Cassius, 63, 9, 4.<br />
4 Dion Cassius, 63, 9, 4.<br />
5 Juvénal, VIII, 223-230.<br />
6 63, 9, 4 ; 63, 22, 6.<br />
7 63, 9, 4 ; 63, 22, 6 ; Juvénal, VIII, 228.<br />
8 Philostrate, Vit. Apoll. 5, 7.<br />
9 Suétone, Ner. 46, 3 : « On avait également remarqué que la dernière tragédie qu’il avait chantée en<br />
public avait été Œdipe en exil, et qu’il avait terminé par ces vers : ‘Epouse, mère, père, tous me<br />
commandent de mourir’. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
165
Lors de la deuxième session des jeux néroniens, Néron interprète Niobé. Pour cela, il<br />
s’est inscrit très officiellement sur la liste des citharèdes, il fait une entrée solennelle,<br />
accompagné des tribuns militaires et de ses proches, et charge Cluvius Rufus d’annoncer le<br />
thème de son chant. Les malheurs de la fille de Tantale sont donc chantés par le prince, qui<br />
s’accompagne de la cithare et fait durer le récital jusqu’à la dixième heure. Le thème de Niobé<br />
était également un sujet tragique à la mode, tout comme ceux de Médée, Thyeste et<br />
Andromaque 2 . Lorsque Isidore le cynique lui reproche de bien chanter les malheurs de<br />
Nauplius 3 , mais de mal gérer ses propres affaires, il fait peut-être encore allusion à une pièce<br />
de citharédie. La douleur et la vengeance de Nauplius, dont le fils a été injustement tué, est en<br />
effet un épisode de la guerre de Troie, et l’on sait que Néron avait composé des Troica, dont il<br />
a interprété des passages avec l’accompagnement de la cithare. On peut supposer, mais<br />
l’hypothèse est bien fragile, que Nauplius était une pièce de citharédie, de même que l’Attis<br />
ou les Bacchantes, interprétés par Néron en costume de citharède 4 .<br />
Néron a-t-il joué les tragédies de Sénèque, ou plutôt, Sénèque a-t-il écrit pour Néron ?<br />
Notre ignorance de la date de rédaction rend la question difficile 5 . Les accusations des<br />
ennemis de Sénèque, rapportées par Tacite, invitent pourtant à faire le lien entre les tragédies<br />
du philosophe et les spectacles du prince :<br />
1 Suétone, Ner. 25.<br />
2 Martial, V, 53, 2.<br />
3 Suétone, Ner. 39, 3 ; Lucilius, Anth. gr. 11, 185.<br />
4 Dion Cassius, 61, 20, 1-2. Sur les origines de ces morceaux de citharédie, M.-H. Garelli-2000a, p.<br />
88-89.<br />
5 A propos de la datation des tragédies : P. Grimal, 1991, p 424-427.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
166
Obiciebant etiam (...) carmina crebrius factitare, postquam Neroni amor eorum<br />
uenisset. 1<br />
C’est que le règne de Néron associa, au sommet du pouvoir, un empereur-tragoedus et<br />
citharoedus et un ministre-auteur dramatique. Il ne peut s’agir d’une coïncidence et, au-delà<br />
des accusations de flagornerie répandues dans l’entourage de Néron, on doit se demander si la<br />
particularité de cette rencontre du prince et du philosophe n’est pas à rechercher du côté du<br />
théâtre, d’autant plus que Néron se mêla lui aussi de composer des poèmes dramatiques.<br />
B/ Néron auteur.<br />
Lors des Neronia de 65, Néron chante une pièce de sa composition, intitulée Niobé 2 . Il<br />
était donc suffisamment confiant en son talent pour se mesurer à d’autres poètes. Le goût du<br />
prince pour la poésie est aussi ancien que son désir de se produire sur la scène, et les<br />
performances de Néron acteur et chanteur sont indissociables de ses talents poétiques.<br />
Dans les premiers temps de son règne, il s’est livré à des déclamations publiques de ses<br />
poésies :<br />
Ad campestres exercitationes suas admisit et plebem declamauitque saepius publice ;<br />
recitauit et carmina, non modo domi sed et in theatro, tanta uniuersorum laetitia, ut<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 52, 3 : « Ils lui reprochaient en outre (…) de composer plus fréquemment des vers,<br />
depuis que Néron en avait pris la passion ».<br />
2 Suétone, Ner. 21, 2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
167
ob recitationem supplicatio decreta sit eaque pars carminum aureis litteris Ioui<br />
Capitolino dicata. 1<br />
L’authenticité des œuvres de Néron est affirmée par Suétone, qui affirme avoir eu en main des<br />
brouillons témoignant du travail de l’empereur 2 . Le goût du prince pour la poésie s’est<br />
manifesté lui aussi très tôt, dès la jeunesse 3 , mais il a pris une ampleur particulière lorsque<br />
Néron a commencé à se produire devant le public encore restreint des Juvénales, et s’est<br />
confirmé par la suite 4 . Tacite signale également la rivalité poétique de Néron et de Lucain 5 .<br />
Poésie et spectacle sont liés, d’abord parce que Néron chante des pièces de sa<br />
composition, et ensuite parce qu’il exploite toutes les occasions de chanter : les poèmes<br />
composés après l’écroulement du théâtre de Naples, les hymnes de victoire envisagés pendant<br />
le soulèvement de Vindex, etc. La création poétique souligne les faits marquants de la vie de<br />
Néron. C’est pourquoi il n’est pas absurde d’imaginer le prince chantant la ruine de Troie<br />
devant l’incendie de Rome, même si l’hypothèse est sans doute davantage dictée par la<br />
malveillance. Mais qu’une telle rumeur, même si elle est fausse, ait pu se répandre aussi<br />
facilement témoigne de sa vraisemblance et de sa conformité à ce que l’on sait de la<br />
personnalité et des habitudes de Néron.<br />
1 Suétone, Ner. 10 : « Il fit admettre même la plèbe à assister à ses exercices militaires, et se livra très<br />
souvent à des déclamations publiques ; il donna même lecture de ses poèmes, non seulement chez lui,<br />
mais aussi au théâtre, soulevant un enthousiasme général, au point que des actions de grâce furent<br />
décrétées pour l’une de ces lectures publiques, et qu’une partie de ses poèmes fut gravée en lettres d’or<br />
et dédiée à Jupiter Capitolin. »<br />
2 Suétone, Ner. 52.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 3, 3 ; Suétone, Ner. 52.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 16, 1 ; 52, 4.<br />
5 Id. XV, 49.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
168
Il nous reste peu de chose des écrits de Néron, quelques titres, et quatre fragments.<br />
Dans sa jeunesse, il a écrit des vers religieux et des poèmes 1 . Il a également composé des<br />
poèmes satiriques 2 , des vers (peut-être une épigramme) sur Mithridate 3 . La seule de ses<br />
tragédies qui nous soit connue est citée par Dion Cassius 4 : il s’agit d’Attis ou les Bacchantes.<br />
D’après Philostrate, il aurait également composé, entre autres, une Orestie et une Antigone 5 . Il<br />
s’essaya aussi au genre de l’épopée mythologique, avec les Troica 6 , à la gloire de Pâris qu’il<br />
oppose à Hector 7 , faisant ainsi du personnage controversé de ce prince troyen le héros de son<br />
œuvre 8 . Il est probable que la Halosis Ilii qu’il aurait chantée, selon Suétone, devant le<br />
spectacle de Rome en flammes 9 , faisait partie des Troica 10 .<br />
Suétone mentionne en outre un recueil de poésies de Néron, intitulé Dominicum :<br />
Et ne cui dubium foret, quod exemplar regendae rei publicae eligeret, medio Martio<br />
campo adhibita publicorum sacerdotum frequentia inferias Neroni dedit ac sollemni<br />
1 Martial, IX, 26, 9-10 ; H. Bardon, 1940, p. 202, et 1952-56, II, p. 124.<br />
2 Suétone, Dom. 1, 2 : un poème intitulé « le Borgne », contre un certain Clodius Pollion, ancien<br />
préteur. Tacite, Ann. XV, 49, 4 : des vers satiriques contre Afranius Quintianus, membre de l’ordre<br />
sénatorial.<br />
3 Suétone, Ner. 24, 4.<br />
4 61, 20, 2.<br />
5 Philostrate, Vit. Apol. IV, 39.<br />
6 Dion Cassius, 62, 29, 1 ; on trouve aussi une référence à cette œuvre chez le scholiaste de Perse, Sat.<br />
1, 121 et dans les scholies de Servius sur Virgile, Geor. 3, 36 et Aen. V, 370 : cf Juvénal, Sat. 8, 220-<br />
221. E. Cizek1972, p. 390 ; J. P. Néraudau, 1985.<br />
7 Servius, En. V, 370 ; Néron modifie ainsi la tradition, qui voulait que Pâris ait affronté Déiphobe et<br />
non Hector : J. P. Néraudau, 1982, p. 117.<br />
8 Horace, O. III, 3, 18-20.<br />
9 Suétone, Ner. 38, 2 ; Tacite, Ann. XV, 39, 3.<br />
10 Eglogue d’Einsiedeln, I, 36-41 : dans ces vers, le poète célèbre la ruine de Troie, dont la chute a<br />
inspiré à Néron son poème.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
169
conuiuio citharoedum placentem palam admonuit, ut aliquid et de dominico diceret,<br />
inchoantique Neroniana cantica primus exultans etiam plausit. 1<br />
Ces poèmes sont des cantica, chantés avec l’accompagnement de la cithare. Néron projetait<br />
également de composer en quatre-cents livres l’histoire épique de Rome 2 .<br />
Quelques fragments des poésies de Néron nous sont parvenus, et ne nous permettent<br />
que d’avoir une idée très approximative de son style et de son talent réel ou supposé. Le plus<br />
long, trois vers, est cité par le scholiaste de Lucain 3 :<br />
quique pererratam subductus Persida Tigris<br />
deserit et longo terrarum tractus hiatu<br />
reddit quaesitas iam non quaerentibus undas. 4<br />
Ces vers faisaient vraisemblablement partie des Troica 5 , et leur style correspond à l’esthétique<br />
de l’époque, promue et influencée par le prince : musicalité, jeux sur les mots et goût du<br />
1 Suétone, Vit. 11, 3 : « Et pour qu’il n’y eût pas de doute quant au modèle politique qu’il choisissait<br />
de prendre, il offrit un sacrifice aux Mânes de Néron en présence des Pontifes convoqués au Champ de<br />
Mars. Au cours d’un repas solennel, il pria publiquement un joueur de cithare qu’il appréciait de<br />
chanter un extrait du répertoire du maître, et lorsque l’artiste eut commencé à chanter un poème de<br />
Néron, il fut le premier à montrer sa joie et à applaudir. »<br />
2 Dion Cassius, 62, 29, 2. La mort empêche de toute façon Néron de réaliser ce projet : E. Cizek, op.<br />
cit., p. 395.<br />
3 Bellum Ciuile, III, 261 : K. Büchner (éd.), Fragmenta Poetarum Latinorum, Leipzig, 1982, p. 162-<br />
164.<br />
4 « Le Tigre se dérobe et abandonne la Perse qu’il a parcourue, et après avoir disparu dans une faille<br />
profonde de la terre, rend les eaux désirées que l’on ne cherchait plus. » Cf Lucain, B. C. III, 261-263.<br />
5 P. Grimal, 1994, p. 411. E. Cizek, 1972, p. 392 : les années 61-64 voient la confrontations de deux<br />
épopées, les Troica de Néron et la Pharsale de Lucain. L’hostilité du prince à l’égard de son rival le<br />
conduit à interdire la publication des derniers livres de son poème.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
170
paradoxe 1 , que l’on retrouve dans le deuxième fragment, cité par Sénèque dans les Questions<br />
naturelles 2 :<br />
Colla Cytheriacae splendent agitata columbae. 3<br />
Le troisième fragment est cité par Lucain 4 dans le contexte scatologique des latrines<br />
publiques :<br />
Sub terris tonuisse putas 5<br />
Enfin, l’épithète sucinos, « ambrés » attribuée à la couleur des cheveux de Poppée, est<br />
rapportée par Pline 6 .<br />
Les références à ses œuvres chez les auteurs anciens ne révèlent pas un jugement unanime.<br />
Lucain l’imite, Sénèque le complimente pour un vers composé disertissime. Il est difficile de<br />
donner trop d’importance à des marques d’admiration dans le contexte, étant donnée la<br />
susceptibilité de Néron en matière artistique. Tacite se montre assez sévère, lorsqu’il évoque<br />
les œuvres composites élaborées par Néron et les écrivains qui l’entourent :<br />
1 E. Cizek, 1972.<br />
2 Sénèque, Nat. 1, 5-6 : ut ait Nero Caesar disertissime.<br />
3 « Le cou de la colombe de Cythère, palpitant, resplendit. »<br />
4 Le contexte et sa référence sont précisés par M. Morford, 1985, note 71.<br />
5 « Tu crois que le tonnerre a grondé sous la terre ». Dans le contexte dans lequel ce fragment est cité,<br />
le double sens de tonuisse ne fait guère de doute.<br />
6 N. H. XXXVII, 50.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
171
Hi cenati considere simul et adlatos uel ibidem repertos uersus conectere atque ipsius<br />
uerba, quoquo modo prolata, supplere ; quod species ipsa carminum docet, non<br />
impetu et instinctu nec tenore uno fluens. 1<br />
Il reconnaît cependant que les vers de Néron montrent en lui un homme cultivé 2 . Suétone se<br />
montre plus favorable aux talents du prince, attestant l’authenticité de ses vers et le créditant<br />
d’une certaine aisance à composer :<br />
(...) ad poeticam pronus carmina libenter ac sine labore composuit nec, ut quidam<br />
putant, aliena pro suis edidit. 3<br />
Suétone ne se réfère sans doute pas aux poèmes élaborés collectivement dont parle Tacite, ce<br />
qui peut en partie expliquer cette différence de point de vue.<br />
Le problème n’est pas ici de savoir si les œuvres de Néron ne sont qu’honorables ou si elles<br />
révèlent un véritable talent 4 (elle ne sont, en tout cas, pas ridicules, pas plus que ne l’était sa<br />
voix), mais de voir à quel point le prince se voulait un artiste complet, un auteur-compositeur-<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 16, 1 : « Ceux-ci (des écrivains amateurs) se rassemblaient après le dîner, et<br />
rassemblaient des vers qu’il avait apporté, ou qu’il improvisait à cette occasion, et complétaient avec<br />
plus ou moins de bonheur ses propres expressions ; c’est ce dont témoigne le style même de ces<br />
poésies, sans souffle ni inspiration, et dont le cours n’est pas uni. » E. Cizek, 1972, p. 389, pense que<br />
cette disparité est à mettre au compte de l’évolution de l’esthétique néronienne, qui n’a pas toujours<br />
suivi les mêmes inspirations.<br />
2 Id. XIII, 3, 3 : elementa doctrinae ostendebat. Martial le dit doctus, faisant peut-être allusion à<br />
l’érudition mythologique du prince : E. Cizek, 1972, p. 391.<br />
3 Suétone, Ner. 52, 1 : « Comme il avait un penchant pour la poésie, il composa des vers avec plaisir et<br />
aisance, et il n’édita pas, comme le pensent certains, les œuvres d’autrui sous son nom. »<br />
4 Sur le style de Néron, on peut lire les témoignages très favorables d’H. Bardon, 1936, p. 337-349, et<br />
1940, p. 201-212. L’essentiel de ces analyses est repris dans La Littérature inconnue, Paris, 1956, II.<br />
132 et 138. On trouve également une brève étude des poésies de Néron dans l’édition de B. H.<br />
Warmington, 1977, notes à Ner. 52, 1, p. 116-117. Cf J. P. Néraudau, 1985, p. 2032-2045.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
172
interprète, si l’on peut oser l’anachronisme. Par ailleurs, l’étude de ces fragments donne une<br />
idée de l’inspiration et de l’esthétique néroniennes 1 .<br />
L’ambition de Néron de rivaliser avec les plus grands artistes de son époque, et même<br />
d’égaler Apollon pour la beauté de son chant 2 , (Sénèque, dans l’Apocoloquintose, assimile le<br />
prince à cette divinité 3 ) s’est donc manifestée dans une double spécialisation : la citharédie,<br />
discipline prestigieuse dont les exigences techniques et artistiques réclamaient une formation<br />
et un entraînement quotidien, et la tragédie chantée, apparentée au genre dramatique qui<br />
séduisait également le prince. Ces deux types de spectacles dans lesquels il voulait exceller<br />
offrent un double intérêt, de par leurs points communs et leurs différences. Dans les deux cas,<br />
un artiste-vedette exécute une pièce dont le thème est emprunté au répertoire tragique le plus<br />
souvent, et il déploie alors toute la palette de sa virtuosité vocale et musicale. L’artiste est en<br />
point de mire, et la qualité de sa prestation est sanctionnée par des prix remportés dans des<br />
concours de type grec, à caractère religieux, et hautement prestigieux. La tragédie chantée a<br />
sans doute séduit Néron de par sa dimension dramatique, qui lui permet d’incarner sur la<br />
scène des théâtres des héros mythologiques et des dieux, et de réaliser sur le plan artistique sa<br />
nature divine.<br />
1 M. Morford, 1985, p. 2017-2018. A propos de l’esthétique néronienne, un état de la question est<br />
établi par E. Cizek, 1972, p. 387. H. Bardon, 1936, p. 347-349, et 1940, p. 195, souligne l’hellénisme<br />
de Néron, et le goût du prince pour les légendes. Pour M. A. Levi, 1949, p. 79 et 158, son admiration<br />
pour les auteurs classiques grecs fait de Néron un adepte des doctrines littéraires classiques.<br />
L’influence homérique et virgilienne de certains fragments poétiques de Néron est mise en évidence<br />
par E. Paratore, 1970, p. 531. L’importance de l’influence de Sénèque sur l’esthétique de Néron, au<br />
moins pendant la première partie du règne, est étudiée par G. Charles-Picard, 1962, p. 148-151. Plus<br />
loin, G. Charles-Picard évoque le romantisme de Néron, op. cit. p. 194. Selon E. Cizek, l’esthétique<br />
néronienne n’a cessé d’évoluer tout au long du règne. Lorsque Néron se détache des idéaux politiques<br />
de Sénèque, il prend également ses distances avec ses influences esthétiques. Il est en cela encouragé<br />
par son entourage.<br />
2 Suétone, Ner. 53.<br />
3 Sénèque, Apoc. 4, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
173
III/ L’incompatibilité des fonctions artistiques et politiques : le cas exemplaire<br />
de Néron.<br />
A/ La critique esthétique.<br />
Néron est présenté, dès l’Antiquité, comme un artiste médiocre et un mauvais<br />
musicien, dont les exhibitions prêtent autant à sourire qu’à se scandaliser. Il est très difficile<br />
de juger des capacités artistiques du prince, car nous n’avons que des témoignages, cependant,<br />
quelques indices permettent d’apporter des éléments de réponse. Tout d’abord, ce type de<br />
critique paraît suspect, car dans un domaine proche, Suétone apporte à Tacite un démenti<br />
prouvant sa mauvaise fois. Dans un passage des Annales, les écrits poétiques de Néron, dont<br />
le style est critiqué, sont attribués non à l’empereur, qui serait dénué d’inspiration, mais à un<br />
groupe de poètes qui participent à la création de vers hétéroclites assemblés les uns aux autres<br />
pour constituer l’œuvre néronienne 1 . Or Suétone, qui n’est pourtant pas animé d’a priori<br />
favorables à Néron, affirme avoir eu en main les brouillons des compositions du prince, sur<br />
lesquels apparaissaient des corrections et des ratures, signes d’un travail personnel 2 . En<br />
conséquence, il est vraisemblable que la critique artistique adressée à Néron par la tradition<br />
doit être largement nuancée.<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 16, 2.<br />
2 Suétone, Ner. 52.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
174
1/ Un point de vue à relativiser.<br />
Lors de sa tournée en Grèce, Néron participe aux Pythia de Delphes, qui étaient le plus<br />
prestigieux de tous les concours musicaux, en plus d’être une fête solennelle en l’honneur<br />
d’Apollon. Néron devait donc pouvoir rivaliser, ou au moins égaler les meilleurs musiciens<br />
du temps, car la compétition était d’un niveau particulièrement excellent, et les attentes du<br />
public étaient à l’avenant. Une pratique régulière, assistée de maîtres de chant compétents, a<br />
pu donner à la voix de Néron une force et un timbre suffisants pour ses prestations, surtout si<br />
elle était soutenue par une pratique instrumentale de qualité 1 .<br />
Les tricheries de Néron, ses démonstrations de force à l’égard du public, et son attitude<br />
parfois violente à l’égard de ses adversaires, peuvent faire penser que Néron ne se sent pas au<br />
niveau des concours, et qu’il doit user de ruse, de flatterie ou d’intimidation pour emporter la<br />
victoire. Malgré ses craintes de commettre des erreurs, et ses angoisses au moment des<br />
représentations 2 , il devait quand même pouvoir concourir sans être ridicule. En outre,<br />
l’agressivité dont il fait preuve lors des compétitions ne peut être uniquement attribuée à sa<br />
prétendue incompétence. Les artistes ne s’épargnaient guère les uns les autres, et les critiques<br />
qu’ils s’adressaient pouvaient être féroces. A. Bélis cite le cas du cithariste athénien<br />
Stratonicos, qui entre 375 et 350 av. J.-C. éreintait régulièrement ses confrères par ses bons<br />
mots impitoyables 3 . Le public pouvait également manifester son mécontentement avec une<br />
certaine violence, et les lancers de projectiles de toutes sortes n’étaient pas rares 4 . Dans ce<br />
1 J.-P. Néraudau, 1982, p. 111-113.<br />
2 Philostrate, Vit. Apoll. IV, 39 ; V, 7 ; Suétone, Ner. 24, 1 ; H. Kelly, 1979.<br />
3 A. Bélis, 1999, p. 95-96, cite en particulier Athénée, Deipnosophistes, VIII, 352 a, 350 c, 337 f, etc.<br />
4 Les édiles romains avaient même dû décider une loi pour interdire le jet d’objets dangereux :<br />
Macrobe, Sat. II, 6, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
175
contexte de compétition féroce et de réactions exacerbées, les manœuvres d’intimidation de<br />
Néron sont, à la limite, à mettre au compte d’un certain professionnalisme...<br />
La citharédie est au programme de ces compétitions, comme l’épreuve du meilleur<br />
trompette et du meilleur héraut, qui débutaient les concours. Néron a concouru pour le prix du<br />
héraut, afin d’annoncer lui-même sa victoire. Il y avait aussi des épreuves d’aulos et<br />
d’aulodie, ainsi que de cithare solo. Néron participe à l’une des plus difficiles et les plus<br />
prestigieuses, et sa qualité comme musicien se déduit en principe des exigences fixées par le<br />
règlement 1 . La citharédie est la dernière épreuve, le clou du spectacle en quelque sorte. En<br />
général les candidats exécutaient une œuvre « au programme », la « nome » spécifique à<br />
chaque concours, et dont les difficultés devaient amener les concurrents à déployer l’éventail<br />
de leurs compétences techniques et artistiques. A. Bélis donne l’exemple de la nome pythique,<br />
la plus difficile 2 . Néron devait être capable de jouer cette nome, et de la jouer bien. Sa<br />
crédibilité comme Pythique était à ce prix, tout empereur qu’il fût.<br />
Par ses exhibitions sur scène, et surtout par sa periodos 3 , Néron s’affirme donc comme<br />
un artiste de haut niveau, et s’inscrit dans la tradition agonistique. Sa spécialisation dans le<br />
domaine de la citharédie ne fait guère de doute, on connaît sa formation musicale et ses<br />
différentes prestations, ainsi que ses participations aux grands concours de la période. Néron<br />
revendique et cultive cette image de citharède, qui contribue à son assimilation à Apollon.<br />
1 A. Bélis, 1999, p 131-132.<br />
2 Références données en note 24 et 25 : Liménios, Péan et prosodion en l’honneur d’Apollon. Texte et<br />
partition dans A. Bélis, Les Hymnes à Apollon, dans Corpus des Inscriptions de Delphes, t. 3, Paris,<br />
1992, no 2.<br />
3 La peregrinatio achaica fut une véritable tournée d’artiste professionnel : la tournée de Néron<br />
reproduit en effet l’itinéraire de l’artiste, qui une fois vainqueur remporte le titre de periodonivknı : N.<br />
M. Kennel, 1988.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
176
D’un autre côté, ses détracteurs font la part belle à cette discipline dans leur condamnation du<br />
prince.<br />
2/ Enjeux politique du dénigrement des talents de Néron.<br />
Que Néron soit un mauvais artiste confirme, en fait, l’incompatibilité des fonctions<br />
impériales et de la carrière artistique. D’où les jugements sans appel sur sa voix exigua et<br />
fusca 1 , les tricheries du prince lors des concours de la période 2 , sa transformation en<br />
grenouille 3 . Inversement, les flatteurs louent sa voix céleste, et des sacrifices sont célébrés en<br />
son honneur 4 . La réalité des talents du prince ne doit correspondre ni à ces condamnations<br />
sans appel, ni à ces célébrations excessives. Néron a travaillé sa voix, en se pliant à des<br />
exercices rigoureux pour la clarifier et l’amplifier : d’après le Pseudo-Lucien, ses qualités<br />
vocales n’étaient ni extraordinaires, ni ridicules 5 . Pourtant, un ennemi comme Vindex,<br />
multipliant les déclarations outrageantes à l’égard de Néron, le traite de mauvais citharède, ce<br />
qui affecte plus que tout le prince et provoque sa riposte, sous la forme d’une lettre adressée<br />
au Sénat :<br />
1 Suétone, Ner. 20, 2.<br />
2 Il aurait, par exemple, payé ses juges en Grèce : Dion Cassius, 63, 9.<br />
3 Plutarque, De ser. numin. 2 : aux enfers, Néron aurait pris la forme d’une bête qui chante dans les<br />
marais. Sur cette métamorphose et sa signification, voir Y. Perrin, 1992. A. Lesky, 1949, p. 385-389.<br />
4 Les accusateurs de Thrasea Paetus lui reprochent entre autres, de ne pas prendre part à ces<br />
cérémonies : Tacite, Ann. XVI, 22, 1.<br />
5 Neron ou le Percement de l’Isthme, 6.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
177
cetera conuicia, ut falsa, non alio argumento refellebat, quam quod etiam inscitia sibi<br />
tanto opere elaboratae perfectaeque a se artis obiceretur, singulos subinde rogitans,<br />
« nossentne quemquam praestantiorem. » 1<br />
De toute évidence, Tacite a mis dans la bouche de Vindex les paroles propres à blesser Néron,<br />
qui soignait sa voix avec tant de vigilance, qu’il évitait même de s’adresser à ses soldats pour<br />
en conserver la pureté 2 . Lorsque les critiques adressées à l’artiste qu’est Néron portent sur la<br />
qualité de ses prestations, la condamnation est complète. Néron est indigne du pouvoir qu’il<br />
exerce car il se comporte comme un histrion et il est, comble de tout, ridicule, ce qui signale<br />
aux yeux de tous son inaptitude à régner.<br />
B/ La critique sociale et politique.<br />
1/ La per<strong>version</strong> des valeurs romaines.<br />
Une confusion lourde de conséquences.<br />
Tacite ne cache pas son dédain de la ludicra deformitas 3 . Ce qui est reproché à Néron,<br />
ce n’est pas sa participation à un type de spectacle en particulier, c’est le fait même de<br />
1 Suétone, Ner. 41 : « Quant aux autres injures, il ne lui fallait, pour les réfuter, pas d’autre argument<br />
que celui-ci : on allait jusqu’à lui reprocher son ignorance d’un art qu’il avait cultivé et porté à sa<br />
perfection avec tant de soin ; et il demandait continuellement à chacun « s’il connaissait quelqu’un qui<br />
le surpassât ».<br />
2 Suétone, Ner. 25.<br />
3 Tacite, Ann. XVI, 4, 1. Leppin, 1992, p. 10-11.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
178
s’exhiber sur la scène, comme les histrions dont les débauches et les débordements sont autant<br />
de facteurs de troubles civils 1 . La sévérité de Tacite à l’égard des acteurs tient également à ce<br />
que la plupart d’entre eux sont d’origine servile : participer à des jeux scéniques, même une<br />
seule fois, rendrait donc le citoyen libre semblable à un esclave ou à un affranchi, et cette<br />
infamie ne saurait être effacée 2 . Les prétentions artistiques du prince le déshonorent<br />
irrémédiablement, d’autant plus qu’il est empereur. En effet, la condition d’acteur à Rome<br />
aboutissait à la déchéance des citoyens libres qui étaient tentés de le pratiquer : l’exemption<br />
du service militaire, par exemple, et la peine de mort infligée à tout soldat qui se livrerait à<br />
l’ars ludicra 3 , sont autant de mesures légales qui laissent l’artiste dramatique en marge de la<br />
communauté. A plus forte raison, l’empereur, chef militaire, ne peut participer à de tels<br />
spectacles. Pire, en réduisant son armée à un public de théâtre 4 , en pervertissant la pompe du<br />
triomphe pour célébrer ses victoires artistiques à son retour de Grèce, Néron foule aux pieds<br />
les valeurs romaines, et renie les qualités militaires que tout imperator doit, en principe,<br />
posséder 5 . Il s’éloigne ainsi définitivement de ses troupes, auxquelles il ne s’adresse plus<br />
directement afin de préserver sa voix. L’anecdote du jeune soldat, accouru sur la scène pour<br />
secourir son empereur enchaîné au cours d’une représentation, témoigne sans doute de cette<br />
étanchéité du monde dramatique et de la sphère politique et militaire 6 .<br />
1 Z. Yavetz, 1984, p. 44-51. B. Zucchelli, 1967, p. 46-47. H. Leppin, 1992, p. 137, à propos de la<br />
mauvaise réputation des histrions, jugés débauchés, vulgaires et obscènes.<br />
2 Cf Platon, Lois, 7, 816, d-e.<br />
3 Digeste, 47, 19, 14. La question de l’infamie liée au théâtre reste problématique : il n’est pas assuré<br />
que son origine soit le simple fait de se produire en public, ou de recevoir pour cela une rétribution. M.<br />
Ducos, 1990, p. 19-33 et la bibliographie.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 15 ; XV, 31 : la présence de Burrus (XIV, 15, 4) et la mention de son affliction,<br />
maerens, marque de façon très nette dans le récit de Tacite le bouleversement des valeurs opéré par<br />
Néron, lorsqu’il se décide à monter sur scène.<br />
5 Pline, Pan. Traj. 13-15.<br />
6 Suétone, Ner, 21 ; Dion Cassius, LXIII, 10 .<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
179
Lorsque Fabius Subrius, pendant les préparatifs de la conjuration, affirme qu’il n’est<br />
pas question de remplacer un citharède par un tragédien, c’est la question de la légitimité qui<br />
est posée. Un citharède, pas plus qu’un acteur tragique, n’a sa place à la tête de l’Empire 1 .<br />
Cette remarque de Subrius montre que c’est bien la citharédie qui apparaît aux yeux de ses<br />
contemporains comme la spécialité artistique de Néron, et que, d’autre part, les termes de<br />
citharoedus et de tragoedus sont, sur le plan politique, équivalents. Cette condamnation<br />
sévère de la pratique artistique par les membres des classes dirigeantes, fréquente chez Tacite,<br />
semble dans ce passage désigner Néron et Pison comme des cas, sinon exceptionnels, du<br />
moins particuliers. Pourtant, et c’est Tacite lui-même qui nous l’apprend, le goût de ces deux<br />
personnages pour le chant et la représentation est partagé par d’autres membres de<br />
l’aristocratie, et en particulier par l’austère Thrasea Paetus, qui pourrait apparaître comme le<br />
modèle du sage stoïcien, résistant au prix de sa vie à la tyrannie de Néron. Ce même Thrasea,<br />
qui paie son intégrité de sa vie, et qui refuse de participer aux spectacles impériaux, n’a<br />
cependant pas dédaigné les jeux sacrés de sa ville natale, et tout comme Pison, il a fait le<br />
tragoedus : habitu tragico cecinerat. 2<br />
1 La méfiance traditionnelle des Romains à l’égard de la musique et de la danse, disciplines orientales<br />
et, par conséquent, suspectes de favoriser la décadence des valeurs romaines, est bien connue : Polybe,<br />
XXX, 22 ; Macrobe, Sat. III, 14, 6-9. A plus forte raison, la pratique de ces arts ne convient pas à un<br />
personnage important : Cornelius Nepos, XV, 1.<br />
2 Tacite, Ann. XVI, 21, 1. Tacite donne de Thrasea, une image généralement très positive. Il apparaît<br />
notamment comme une figure de l’héroïsme face à la tyrannie de Néron et à la servilité des sénateurs,<br />
au moment du procès du préteur Antistius par exemple (XIV, 48-49). Mais le stoïcien n’échappe pas à<br />
quelques traits critiques : Tacite évoque très rapidement et comme en passant la vanité du personnage<br />
(XIV, 49, 3), et la mention de sa participation aux jeux de Padoue semble constituer un autre accroc à<br />
son image de sage stoïcien.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
180
L’influence orientale.<br />
Tacite critique l’inspiration hellénique des Neronia, qui va à l’encontre des valeurs<br />
romaines 1 . Il note avec mépris que la mode de porter des vêtements grecs, accoutrement<br />
efféminé et négligé dans lequel Néron se pavane à l’ordinaire 2 , passe assez vite 3 . Dans le récit<br />
de Suétone, l’énumération des per<strong>version</strong>s sexuelles et des débauches du prince succède<br />
immédiatement aux épisodes relatifs à sa participation à des spectacles : la mention de<br />
l’homosexualité passive, et de la tendance de Néron à jouer le rôle d’une vierge dans ses ébats<br />
avec Doryphore, complète l’image d’un empereur efféminé 4 . En outre, l’ambiguïté sexuelle<br />
de Néron est confirmée par les rôles qu’il interprète en tant qu’acteur, Canacé en mal d’enfant<br />
par exemple. Le fait qu’un acteur joue des rôles féminins est très habituel, mais cette<br />
indistinction des sexes prend une tout autre signification quand elle est le fait de l’empereur.<br />
On est tenté de rapprocher les cris de Canacé et ceux de la « vierge » que Néron<br />
interprète : Suétone entend ainsi montrer à quel point les activités artistiques de Néron sont<br />
incompatibles avec un gouvernement digne de ce nom, et qu’elles ne sont, finalement, qu’une<br />
autre manière de manifester sa perversité. La cruauté, la débauche et les exhibitions théâtrales<br />
sont les éléments d’un système particulier au règne de Néron tel que le décrivent les historiens<br />
anciens.<br />
1 J.-C. Dumont, 2003.<br />
2 Suétone, Ner. 51.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 21, 4.<br />
4 Suétone, Ner. 29.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
181
2/ Le statut social des acteurs.<br />
Conséquences juridiques et sociales de l’infamie qui frappe les artistes de scène.<br />
La marginalisation des acteurs s’est accentuée sous l’Empire 1 : des restrictions et des<br />
interdictions les frappent ainsi en matière de droit civil 2 . L’acteur n’est pas à proprement<br />
parler exclu de la communauté civique, mais ces mesures, qui se multiplient sous le principat,<br />
le laissent pour ainsi dire en marge de l’ensemble des citoyens. En outre, il est exclu des<br />
classes dirigeantes, chevaliers et sénateurs : sous Auguste et Tibère, cette interdiction est<br />
formalisée par des sénatus-consultes 3 . Le cas du comédien Roscius, qui, élevé au rang de<br />
chevalier, a pourtant continué à se produire sur scène, constitue une exception notable 4 .<br />
Cicéron a même plaidé en faveur de son entrée au Sénat 5 . L’exemple du chevalier Labérius 6 ,<br />
une trentaine d’années plus tard, montre que la dignité de chevalier ne peut s’accompagner<br />
d’une activité dramatique : contraint par César de se mesurer à l’affranchi Publilius Syrus,<br />
Laberius participe à un mime lors des Ludi Victoriae Caesaris, en septembre 46. Ce chevalier,<br />
qui se produit sur scène en échange d’un salaire, perd alors son rang, mais César lui remet son<br />
anneau d’or, symbole de son ordre, à la fin de la représentation, ce qui n’empêche pas les<br />
autres chevaliers de manifester leur désaccord.<br />
Cet acte symbolique de César, qui manifeste la puissance du dictateur, reste isolé, et sa<br />
signification politique ne fait pas de doute : il a le pouvoir d’un censeur, il peut à sa guise<br />
1 J. C. Dumont, 2001.<br />
2 M. Ducos, 1990, p. 23.<br />
3 Suétone, Aug. 43 ; Tib. 35, 1 ; Tacite, Hist. II, 62, 4. Ann. IV, 14.<br />
4 J. C. Dumont, 2004 : Macrobe, Sat. 3, 14,13 ; Sénèque le Rhéteur., Controuersiae, 7, 3, 8-9.<br />
5 Pro Roscio Comoedo, 17.<br />
6 J. C. Dumont, 2004.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
182
exclure de l’ordre un chevalier, et restituer son statut. Mais dans ce cas, l’acte de César<br />
confirme tout de même l’impossibilité d’appartenir à l’ordre équestre et de se produire sur<br />
scène dans le même temps. Or Néron fait participer des membres des classes équestres et<br />
sénatoriales à ses ludi.<br />
Le mépris pour les histrions, professionnels de la scène.<br />
Il est peu convenable pour un prince de donner des récitals de citharédie, mais il y a<br />
pire : s’engager en tant que professionnel dans des spectacles privés, en échange d’une<br />
rétribution. Il n’existe aucune preuve sérieuse de cet engagement de la part du prince, et les<br />
indications que nous en possédons n’apportent guère de certitude : Suétone affirme<br />
simplement que Néron « aurait songé » à participer comme citharède professionnel à un<br />
spectacle privé 1 , et Dion Cassius mentionne une proposition que le prince aurait refusée<br />
comme humiliante et indigne de lui 2 . Cette accusation tient d’une part au fait que les<br />
citharèdes sont les artistes dont les émoluments sont les plus importants 3 , et les sommes<br />
indiquées par nos sources, pour colossales qu’elles soient (Suétone avance le chiffre d’un<br />
million de sesterces), ne sont pas invraisemblables compte tenu du prestige que les citharèdes<br />
connaissaient. A plus forte raison, un citharède empereur devait valoir un tel salaire. Il est<br />
cependant fort improbable que Néron ait recherché un profit pécuniaire dans l’exercice de son<br />
art : les compétitions auxquelles il a participé lors de sa tournée en Grèce étaient des agônes,<br />
et des concours sacrés en l’honneur d’un dieu 4 . Les récompenses étaient purement<br />
honorifiques, des couronnes de feuillages dont l’obtention était éminemment prestigieuse,<br />
1 Ner. 21.<br />
2 63, 21.<br />
3 Martial, III, 4-6.<br />
4 A. Bélis, 1999, p. 125<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
183
mais les victoires dans de tels concours n’enrichissaient pas les artistes. C’est à ce type de<br />
concours que participe Néron, il n’est donc pas question de professionnalisation au sens strict<br />
du terme. En effet, il existe également des concours rétribués, dont les récompenses atteignent<br />
des sommes très importantes, les qematikoiv 1 . En outre, les musiciens professionnels à Rome<br />
sont le plus souvent de condition servile, ou des affranchis 2 . Un citoyen romain ne saurait se<br />
produire sur scène en échange d’une rétribution, sous peine de se voir l’objet d’une infamie<br />
morale et d’une dégradation civique 3 . Or, les concours que Néron institue à Rome sont à<br />
l’imitation des agônes grecs, on les appelle certamina. Ils supposent une compétition,<br />
contrairement aux ludi, aux jeux, et n’offrent pas aux vainqueurs de prix à forte valeur<br />
marchande. Le fait que le prince ait comblé certains artistes de cadeaux témoigne surtout de<br />
sa volonté de mener une politique artistique de grande envergure, en favorisant les disciplines<br />
auxquelles il attachait de l’importance, et de la munificence de cet empereur dont Suétone<br />
dénonce les excès 4 .<br />
On peut donc expliquer les anecdotes rapportées par Suétone et Dion Cassius de deux<br />
manières : ou bien l’idée de la professionnalisation du prince procède d’une exagération<br />
destinée à ternir un peu plus son image, en l’enveloppant dans le mépris réservé aux histrions,<br />
(d’où les appellations péjoratives désignant Néron comme artiste : histrio, scaenicus 5 ), ou<br />
bien cette anecdote est une extension rétrospective du désir de Néron de s’enfuir et de gagner<br />
sa vie comme citharède professionnel, lorsqu’il apprend le soulèvement de Vindex 6 .<br />
1 Ibid ; p. 146-148.<br />
2 G. Wille, 1967, p. 322.<br />
3 C. Vendriès, 1997, p. 21. Cicéron, De Officiis, I, 42, 150 , évoque le mépris dont les activités<br />
salariées font l’objet, surtout quand elles sont liées aux plaisirs.<br />
4 Suétone, Ner. 30.<br />
5 Tacite, Ann. XV 59, 2 ; XVI, 4, 1<br />
6 Suétone, Ner. 40 : to ; tevcnion hJma~ı diaqrevyei. il désigne ainsi la citharoedicam artem. cf Dion<br />
Cassius, 63, 27.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
184
3/ Implications de la participation des élites aux spectacles : le plan néronien.<br />
Les membres des familles les plus éminentes participent, le plus souvent contre leur<br />
gré, à des mises en scènes qui les ridiculisent parfois. Certains montent sur la scène à visage<br />
découvert, pour le plus grand plaisir d’une partie du public qui s’amuse à les reconnaître et à<br />
citer leur nom 1 . Il n’est cependant, à aucun moment, question d’un quelconque déclassement.<br />
Ces spectacles, antérieurs à la première apparition sur la scène de Néron, créent une série de<br />
précédents, et préparent l’exhibition du prince. C’est d’ailleurs l’analyse que fait Tacite, tout<br />
en condamnant le processus en termes virulents :<br />
ratusque dedecus molliri, si plures foedasset, nobilium familiarum posteros, egestate<br />
uenales, in scaenam deduxit. 2<br />
Dès lors que les citoyens les plus éminents ont participé à des jeux scéniques ou à des<br />
combats, il n’est plus inattendu de voir l’empereur en personne prendre part à des spectacles.<br />
Bien plus, on attend qu’il soit, dans ce domaine aussi, primus inter pares. Tacite, comme<br />
Suétone et Dion Cassius, sont bien évidemment scandalisés : les deux premiers ressentent<br />
sans doute plus vivement l’humiliation et l’abaissement de ces acteurs involontaires, qui<br />
flétrissent à leur corps défendant la dignité d’ordres auxquels eux-mêmes appartiennent :<br />
1 Dion Cassius, 61, 17 : les membres de familles illustres, dont les noms sont ainsi déshonorés,<br />
participent à des spectacles divers (flûte, danse, comédie et tragédie, lyre et courses de chevaux,<br />
combats comme gladiateurs ou contre des bêtes). Tacite, Ann. XIV, 14, 3, fait preuve de davantage de<br />
discrétion, en refusant de citer les noms de ces participants.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 14, 3 : « et, pensant amoindrir l’ignominie en généralisant la flétrissure, il fit<br />
monter sur la scène les descendants de nobles familles, poussés par l’indigence à la vénalité. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
185
Non nobilitas cuiquam, non aetas aut acti honores impedimento quo minus Graeci<br />
latiniue histrionis artem exercerent usque ad gestus modosque haud uiriles. 1<br />
On est bien loin de la faveur avec laquelle Suétone jugeait une initiative pourtant similaire<br />
d’Auguste, qui en créant les jeux troyens, souhaitait exposer l’excellence de ces mêmes<br />
familles 2 : Néron, dans sa perversité, entraîne l’ensemble de la classe dirigeante dans son<br />
déshonneur.<br />
Du point de vue néronien, en revanche, la participation de l’élite des citoyens à ses<br />
spectacles constitue une condition de l’évolution profonde qu’il entend donner à la société :<br />
les chevaliers et les sénateurs confèrent au spectacle leur dignité, qui sera encore confirmée<br />
par les performances du prince 3 . Ainsi, la critique des activités artistiques de Néron s’organise<br />
autour de deux pôles : d’une part, avec la citharédie, un jugement sans appel sur un empereur<br />
qui s’adonne à des pratiques venues de Grèce, et donc très éloignées des valeurs<br />
traditionnelles romaines 4 ; d’autre part, une prétention au métier d’acteur, qui met à bas les<br />
principes mêmes d’organisation de la société et des classes dirigeantes 5 . L’art, qui participe à<br />
la définition et à la caractérisation de la politique néronienne, occupe donc une place<br />
doublement cruciale, puisque la pratique artistique du souverain et des classes dominantes est<br />
une spécificité politique revendiquée par Néron, et constitue dans le même temps le cœur de<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 15, 1 : « La noblesse, l’âge, les charges honorifiques accomplies ne dispensèrent<br />
personne d’exercer le métier d’histrion grec ou latin, ni de s’abaisser à des gestes et à, des chants<br />
efféminés. »<br />
2 Suétone, Aug. 43 : Sed et Troiae lusum edidit frequentissime maiorum minorumque puerorum, prisci<br />
decorique moris existimans clarae stirpis indolem sic notescere.<br />
3 E. Aubrion, 1990, p. 202.<br />
4 J. Sirinelli, 1993, p. 223.<br />
5 C. Vendriès, 1999, p. 316-318 : c’est d’ailleurs cette attitude de Néron qui précipite les événements<br />
de 68.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
186
la critique de ses détracteurs, qu’ils soient contemporains comme les conjurés, ou qu’ils<br />
appartiennent à la postérité et formulent le jugement de l’histoire.<br />
Plus précisément, les disciplines dans lesquelles le prince se spécialise, citharédie et<br />
tragédie chantée, donnent au répertoire tragique une place fondamentale. D’une certaine<br />
manière, Néron renouvelle les relations que le genre tragique entretient, par nature, avec la<br />
politique, et dont les tragédies de Sénèque offrent également une illustration.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
187
Chapitre 5. Les tragédies de Sénèque et la tradition de théâtre<br />
politique, héritée de la République.<br />
L’implication de Sénèque dans les affaires politiques de son temps, sa place aux côtés<br />
de Néron, comme précepteur d’abord, puis comme conseiller et ami du prince, mais aussi les<br />
réflexions qu’offrent ses traités philosophiques sur la réalité et l’exercice du pouvoir, amènent<br />
naturellement à se poser la question de la portée politique de ses tragédies. En effet, si les<br />
sujets des pièces qui nous sont parvenues, et dont l’attribution au philosophe est peu<br />
contestable, sont tous empruntés à la mythologie, il semble bien que le théâtre de Sénèque ne<br />
peut se réduire à un exercice poétique détaché de toute considération politique, et même<br />
contemporaine.<br />
I/ La tragédie à Rome.<br />
On a longtemps considéré la production dramatique du philosophe, non sans une<br />
pointe de mépris, comme un ensemble de variations savantes sur des sujets conventionnels<br />
des écoles de rhétorique en vogue 1 . Dépositaire de l’héritage intellectuel de son père, Sénèque<br />
1 Cette idée a été formulée pour la première fois par F. Leo, 1878, qui a qualifié l’œuvre dramatique de<br />
Sénèque de tragoediae rhetoricae, adaptation pour la scène ou la recitatio de declamationes. la<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
188
le Rhéteur, le philosophe a bien intégré les thèmes et leçons paternelles, mais on ne peut s’en<br />
tenir là. La tentation de distinguer deux Sénèque, l’un philosophe, et l’autre poète, a été<br />
depuis longtemps abandonnée, et l’on admet qu’il faut tenir compte de l’influence de la<br />
réflexion philosophique sur la création poétique et dramatique. Ces questions, dans leurs<br />
grandes lignes, ne font plus guère l’objet de débat, et l’investigation se porte désormais sur la<br />
nature de ces échanges, et non sur leur réalité. Philosophie, politique et poésie se rencontrent<br />
dans les tragédies, dont la complexité rappelle celle de leur auteur, qui ne se laisse pas si<br />
facilement réduire à l’une ou l’autre de ses facettes.<br />
A/ La tradition républicaine.<br />
1/ Choix et traitement des mythes.<br />
La carrière de Sénèque, dont nous avons retracé les étapes, donne à la recherche du<br />
sens politique de ses tragédies un intérêt particulier, qu’attise encore le mystère dont s’entoure<br />
la chronologie de cette partie de son œuvre. Que nous apprennent ce traitement de mythes<br />
connus de tous, traditionnellement revisités par les auteurs tragiques, et les poètes en général,<br />
sur le contexte politique vu par Sénèque, le principat, et les règnes de Tibère, Caligula,<br />
Claude, et surtout Néron, au cours desquels les tragédies que nous connaissons furent<br />
composées ? La question paraît d’autant plus intéressante que Sénèque exerce ses talents<br />
poétiques dans un genre qui, par nature, et particulièrement à Rome, concentre et exprime les<br />
complexité du théâtre de Sénèque a rapidement été soulignée. Sur ce point, cf. B. Seidensticker, D.<br />
Armstrong, 1985, p. 916-968, et en particulier les pages 924 et suiv.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
189
tensions et les questions politiques cruciales de son époque 1 . C’est pourquoi, il convient, dans<br />
un premier temps, d’examiner la tradition de théâtre politique dans laquelle s’inscrivent les<br />
tragédies de Sénèque.<br />
Selon E. Paratore, la tragédie romaine républicaine est avant tout une imitation<br />
savante, et destinée à un public cultivé, des pièces grecques antérieures 2 . Cette vision<br />
littéraire, et proprement intellectuelle de l’art tragique romain ne semble cependant pas tout à<br />
fait satisfaisante. Si l’inspiration, et même l’imitation des modèles grecs, ne fait guère de<br />
doute, il semble au contraire que la tragédie s’est particulièrement bien adaptée aux attentes<br />
du public romain, justement parce qu’elle répondait à des préoccupations politiques<br />
contemporaines 3 . On trouve dans les textes plusieurs témoignages qui confirment la réception<br />
politique des tragédies représentées pendant la période républicaine, et ce à plusieurs niveaux.<br />
Tout d’abord, la dimension politique de la tragédie républicaine résulte d’une<br />
démarche consciente, opérée par son auteur. Le choix du mythe, et son traitement dépendent<br />
alors des orientations politiques du poète au moment de la composition. Le mythe de Thyeste,<br />
par exemple, particulièrement populaire auprès du public romain, est selon toute<br />
1 Dès l’origine, la tragédie pose des problèmes inhérents à la nature et à l’exercice du pouvoir dans une<br />
société donnée. Ainsi, le mythe d’Œdipe préexiste à la <strong>version</strong> qu’en donnent les tragiques. Un<br />
passage de l’Odyssée (XI, 271-280) évoque ce roi de Thèbes, qui épouse sans le savoir sa mère après<br />
avoir tué et dépouillé son père. La reine, Epicastè dans la légende, se pend et maudit son fils qu’elle<br />
laisse sur le trône de Thèbes. C’est dans la tragédie de Sophocle que le coupable est exclu de la cité et<br />
de la communauté, illustrant ainsi la pratique de l’ostracisme et celle du pharmakos, dont l’exclusion<br />
rituelle assure la purification de la cité. La mise en œuvre des mythes dans la tragédie ne peut donc<br />
être dissociée du contexte institutionnel et politique dans lequel elle s’inscrit. J.-P. Vernant, P. Vidal-<br />
Naquet, 1972, p. 117-119.<br />
2 E. Paratore, 1957, p. 1-7.<br />
3 A. La Penna, 1979, « Funzione e interpretazioni del mito nella tragedia arcaica latina », et « Aspetti e<br />
conflitti nella cultura dai Gracchi a Sulla », p. 65 et 118-119.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
190
vraisemblance l’un des plus représentés dans ce répertoire tragique 1 . Mais si le thème de<br />
l’effroyable festin est commun à toutes les pièces, chacune se distingue des autres par ses<br />
résonances et par la manière dont le mythe est représenté. Le signe le plus simple et le plus<br />
visible de ces différents traitement est d’abord dans le choix du titre, qui fera paraître au<br />
premier plan, en fonction des intentions du poète, l’un ou l’autre des frères de la dynastie<br />
maudite : Ennius, Varius Rufus ou Sénèque donnent à leur tragédie le titre de Thyeste, auquel<br />
Accius préfère Atrée, comme après lui Pomponius Secundus 2 . Plus encore que le titre, le<br />
contexte politique nous renseigne sur le sens dont l’auteur a chargé le mythe. Par exemple, le<br />
Thyeste d’Ennius, représenté au cours des jeux Apollinaires de 169, peu avant la bataille de<br />
Pydna, se caractérise par la couleur anti-macédonienne qui émane en particulier du portrait<br />
d’Atrée. Celui-ci est déjà devenu une figure archétypale, celle du tyran dont il concentre à un<br />
degré exemplaire la violence et l’ingéniosité cruelle. Or, dans le portrait qu’ils brossent du roi<br />
macédonien Persée, Polybe et Tite Live dessinent un certain nombre de traits qui permettent<br />
de voir dans l’Atrée représenté par Ennius une image du monarque ennemi de Rome 3 . Accius<br />
tire du même épisode de la légende des Atrides une tragédie, dans un contexte tout différent.<br />
Le danger cette fois n’est pas extérieur à Rome, il consiste selon certains dans la politique des<br />
tribuns de la plèbe, et des Gracques en particulier, sur la question agraire. La tyrannie que met<br />
en scène sa tragédie est à mettre en rapport avec l’attitude des dirigeants du parti des<br />
populares contre la noblesse sénatoriale 4 . L’histoire est alors vue à travers l’expérience du<br />
mythe ainsi actualisé 5 .<br />
1 M.-H. Garelli-François, 1998a.<br />
2 Sous le règne de Tibère, les tragédies de Pomponius Secundus ont marqué le renouveau du genre<br />
tragique, dont la mode était passée, comme le déplorait Auguste : Quintilien, I. O. X, 1, 98 ; Tacite, D.<br />
XIII.<br />
3 M.-H. Garelli-François : 1998a.<br />
4 B. Bilinski, 1958.<br />
5 J. Dangel, 1990.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
191
2/ La tragédie prétexte.<br />
La dimension politique de la tragédie romaine apparaît non seulement dans le choix et<br />
le traitement des mythes qui constituent la fabula, mais encore dans ce qui semble bien être<br />
une spécificité du théâtre romain par rapport à son prédécesseur et inspirateur grec 1 : la<br />
tragédie prétexte, dont le sujet est emprunté à l’histoire de Rome. A. Foucher 2 distingue ainsi,<br />
à l’origine de l’historiographie romaine, un courant « diplomatique » d’une part, représenté<br />
principalement par Fabius Pictor 3 , en langue grecque, et qui s’adresse aux autres nations du<br />
bassin méditerranéen, et une présentation des faits propre à exalter les vertus du peuple<br />
romain. Ce dernier courant prend alors la forme, selon les auteurs et les circonstances, de<br />
l’épopée ou de la fabula praetexta. Les plus anciennes dont nous ayons connaissance sont<br />
deux tragédies de Névius : Romulus ou La Louve s’inspire du passé historico-légendaire<br />
spécifiquement romain, puisqu’elle traite de l’enfance du fondateur ; et Clastidium,<br />
représentée à l’occasion des jeux funèbres de Claudius Marcellus, et qui célèbre une de ses<br />
victoires 4 . D’Ennius nous connaissons l’existence de deux tragédies prétextes, l’Ambracia et<br />
les Sabines. Le Paulus de Pacuvius, sans doute consacré aux exploits de Paul Emile, dut être<br />
joué à l’occasion du triomphe de 167 ou lors des jeux funèbres de 160. La tragédie prétexte a<br />
donc une relation étroite avec l’histoire et la politique, et ce à deux titres : par ses sujets, qui<br />
appartiennent à l’histoire nationale, et par le cadre de ses représentations, puisque les jeux<br />
funèbres exaltent la gloire politique d’un individu qui représente les valeurs aristocratiques et<br />
1 Dans ce que nous connaissons du théâtre grec, seule la tragédie des Perses d’Eschyle s’inspire d’un<br />
événement historique.<br />
2 A. Foucher, 2000, p. 780.<br />
3 D. Timpe, 1972.<br />
4 N. Zorzetti, 1980, p. 61.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
192
traditionnelles 1 . De même, Decius ou les Enéades d’Accius, qui traite de la deuotio de P.<br />
Decius Mus à la bataille de Sentinum contre les Gaulois et les Samnites, en 295, rappelle et<br />
célèbre les valeurs héroïques traditionnelles à une Rome engagée dans la guerre contre<br />
Jugurtha 2 . Brutus, seconde tragédie prétexte d’Accius, est un manifeste contre la tyrannie 3 .<br />
Pour la période impériale, l’étrange cas d’Octavie, sur lequel nous reviendrons, présente une<br />
apologie de Sénèque et une vibrante condamnation de la tyrannie néronienne.<br />
3/ La place du théâtre dans la vie civique.<br />
Le traitement des mythes qui inspirent les tragédies, et le choix de sujets historiques et<br />
romains, répondent en outre à l’horizon d’attente du public romain. L’importance croissante<br />
des ludi, offerts par l’aristocratie, puis par l’empereur, la multiplication des jours consacrés<br />
aux divertissements et aux représentations, montrent l’influence et la place du spectacle, et<br />
donc du théâtre dans la vie des citoyens. Parmi les témoignages qui nous sont parvenus sur la<br />
réception des pièces et l’attitude du public, plusieurs soulignent la tendance des spectateurs<br />
romains à ramener les sujets et les propos à l’actualité, surtout dans des moments de crise. Le<br />
théâtre est donc un moyen privilégié d’expression, non seulement pour les poètes, mais aussi,<br />
et peut-être surtout, pour le public. C’est ainsi que le texte de l’Eurysaces d’Accius, joué en<br />
57 par l’acteur tragique Esope, se charge d’allusions au récent exil de Cicéron 4 . En 44, lors de<br />
la reprise de la tragédie de Térée, très appréciée, Cicéron note l’enthousiasme des spectateurs,<br />
1 N. Zorzetti, 1980, p. 77.<br />
2 D’après Ch. Guittard (1984, p. 598), le récit de Tite Live de ce même épisode est significatif des<br />
échanges et correspondances qui existent entre la tragédie prétexte et l’histoire.<br />
3 E. Gabba, 1969.<br />
4 F. Della Corte, 1983 p. 235.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
193
qui applaudissent à ce qui semble être perçu comme un manifeste républicain, mais limitent<br />
leur ardeur à l’enceinte du théâtre 1 . Il existe donc, et depuis longtemps à Rome, un échange<br />
entre théâtre et politique, et des correspondances reconnues entre la scène représentée, qu’elle<br />
soit mythologique ou historique, et la situation contemporaine. Par conséquent, certains<br />
thèmes récurrents dans les tragédies répondent à des préoccupations actuelles pour les<br />
spectateurs.<br />
Des prises de parti, assumées par leur auteur, impliquent le théâtre dans la violence des<br />
conflits et des débats politiques de son temps. C’est ainsi que la question de la légitimité du<br />
pouvoir, et la figure de l’usurpateur qui tente de s’en emparer par la force, de le conserver par<br />
la terreur avant de le perdre, le plus souvent, dans la violence, sont des thèmes de prédilection<br />
du théâtre républicain. Or, le problème du rapport entre la force et le pouvoir s’est posé avec<br />
une acuité particulière à la fin de la République. Ainsi dans ses Commentaires, César fait de<br />
fréquentes références à la Fortuna, souvent personnifiée, notamment dans La Guerre civile 2 :<br />
le conflit qui l’oppose à Pompée doit en effet être assimilé à un bellum iustum, et le problème<br />
de la légitimité est central. C’est pourquoi César se présente dans La Guerre civile comme le<br />
représentant officiel de Rome, opposé à un ennemi qui n’est pas seulement le sien, mais aussi,<br />
et surtout, celui de Rome, un hostis. La victoire de César, et la fin lamentable de Pompée<br />
représentent, dans la propagande césarienne, une justification a posteriori de son combat et de<br />
sa domination politique 3 .<br />
1 Cicéron, Att. XVI, 2, 3 et XVI, 5.<br />
2 César, C. III, 95, 1 : avant de prendre d'assaut le camp pompéien, César exhorte ses troupes à<br />
"profiter des faveurs de la Fortune" (ut beneficio Fortunae uterentur). La victoire est donc une<br />
conséquence de l'habileté du chef à répondre aux appels de la Fortune qui le protège. Voir également I,<br />
40, 7 ; 72,2; II, 14,3; 28,2; 23,11, etc.<br />
3 J. Gaudemet, 1982, p 466 ; Velleius Paterculus, II, 103.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
194
B/ Evolutions du genre sous l’Empire.<br />
1/ Un déclin relatif.<br />
A l’époque d’Auguste, le genre tragique connaît un déclin que l’empereur déplore,<br />
mais demeure attaché à la situation politique contemporaine, comme il l’était à l’époque de la<br />
République. Malgré les efforts du prince pour redonner à la production théâtrale sa richesse et<br />
son abondance d’autrefois, le poète tragique le plus célèbre, Asinius Pollion, se consacre<br />
désormais à l’historiographie. Il avait été au nombre des partisans d’Antoine, et s’était rallié à<br />
Octave juste assez tôt pour ne pas être inquiété 1 . Pourtant, son passé politique pouvait encore<br />
faire porter sur lui la suspicion, et peut-être a-t-il jugé plus sage de laisser de côté un genre<br />
trop lié aux polémiques et aux enjeux politiques 2 . On ne peut attribuer au simple hasard, ou au<br />
concours de circonstances, cette attitude de retrait d’un auteur tragique à un moment où sa<br />
situation n’est guère affermie.<br />
Certaines tragédies voient toutefois le jour au cours du règne d’Auguste : Ovide<br />
compose ainsi une Médée, qui ne fut jamais représentée, et dont il ne nous reste que deux<br />
vers. En revanche, le Thyeste de L. Varius Rufus fut bel et bien porté à la scène, puisqu’il<br />
s’agit d’une œuvre de commande, qui figura au programme des jeux scéniques commémorant<br />
la bataille d’Actium. Ces deux pièces sont l’une et l’autre reconnues comme des œuvres<br />
majeures par Tacite ou Quintilien 3 , mais elles furent diversement appréciées par le pouvoir en<br />
place.<br />
1 Sur Asinius Pollion, A. B. Bosworth, 1972.<br />
2 F. Della Corte, 1981, p. 231.<br />
3 Tacite, D. XII ; Quintilien, I. O. X, 1, 98.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
195
2/ La permanence de la dimension politique des tragédies.<br />
Alors que la Médée d’Ovide aurait été, du moins selon certaines hypothèses, une<br />
œuvre d’opposition 1 , et ressentie comme tel par le pouvoir impérial, la tragédie de Varius<br />
devait naturellement participer à l’exaltation du vainqueur d’Actium. Pourtant, un<br />
commentaire de Quintilien 2 souligne la complexité et l’ambivalence des implications<br />
politiques contemporaines de la tragédie. Il affirme en effet qu’il ne faut pas voir dans les<br />
frères maudits de la tragédie une image d’Octave et Antoine. La précision en elle-même<br />
témoigne que la tentation d’associer l’affrontement des Tantalides et les luttes fratricides qui<br />
opposèrent Antoine et le futur Auguste après la mort de César. Une partie du public a pu<br />
trouver des correspondances entre les situations mythique et historique, d’autant plus que le<br />
souvenir des guerres civiles et de leur sinistre cortège d’exactions demeurait présent dans les<br />
esprits. Bien des années plus tard, c’est ce même souvenir que rappelle Lucain dans les<br />
premiers vers de La Pharsale, lorsqu’il évoque les bella plus quam ciuilia, et l’horreur d’un<br />
peuple qui tourne contre lui-même sa rage meurtrière 3 . Une telle abomination pouvait fort<br />
bien s’exprimer par la légende non moins épouvantable du festin de Thyeste. De fait, le public<br />
romain n’a guère changé, lorsqu’il est au théâtre, malgré la discipline qu’Auguste a voulu<br />
introduire dans les rangs des spectateurs... Et cette tendance à mettre en rapport la situation<br />
chantée sur la scène et les intrigues politiques du moment, qu’elle vienne de l’assistance ou<br />
qu’elle soit induite par le jeu des acteurs, perdure encore à l’époque de Néron. Suétone cite<br />
ainsi l’exemple d’un acteur d’atellanes, qui accompagne son chant de gestes désignant<br />
explicitement les morts de Claude et d’Agrippine, en les imputant à Néron, et finissant sa<br />
1 A. Arcellaschi, 1990, p. 334.<br />
2 Quintilien, I. O. III, 8, 45.<br />
3 Lucain, B. C. I, 1-7.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
196
prestation par une allusion évidente au danger que couraient les sénateurs 1 . Dans le même<br />
passage sont relevées des épigrammes, affichées ou transmises oralement, et qui comparaient<br />
Néron aux criminels mythologiques dont il aimait parfois jouer les rôles : Oreste et Alcméon.<br />
Ainsi le répertoire mythologique, qu’il soit ou non mis en œuvre au théâtre, est et demeure à<br />
Rome comme une grille de lecture des comportements des puissants. Les grands crimes des<br />
légendes trouvent un écho plus ou moins affaibli dans les actes des contemporains.<br />
3/ Les réactions des détenteurs du pouvoir.<br />
La critique contenue dans les tragédies comporte des risques, qui en disent long sur la<br />
portée des condamnations qu’elle induit. La tolérance des dirigeants à l’égard des œuvres<br />
littéraires a été plus ou moins grande suivant les périodes, un même prince a pu laisser<br />
impunis des propos véritablement subversifs, et par la suite sanctionner avec la dernière<br />
sévérité des vers plus innocents. Tibère, en revanche, s’est signalé par la constance de son<br />
attitude à l’égard du théâtre et de ses auteurs. Mamercus Aemilius Scaurus en a fait les frais,<br />
puisqu’il a été accusé d’avoir placé dans une de ses tragédies des propos injurieux, et<br />
contraint au suicide 2 . Suétone précise qu’il lui fut reproché d’avoir insulté Tibère par le biais<br />
d’Agamemnon. D’après Tacite, c’est la haine de Macron qui lui valut cette accusation, qui<br />
resta cependant officieuse. En public, Scaurus était accusé de magie et d’adultère : le premier<br />
motif, secret, paraît donc être celui qui décida réellement du sort du poète. Le reste n’était que<br />
prétextes commodes. Cette manière de procéder pour se débarrasser d’un individu gênant est<br />
significative d’une attitude ambiguë à l’égard de la tragédie : d’un côté, on prend les allusions<br />
et attaques indirectes au sérieux, au point qu’elles constituent un argument décisif en faveur<br />
1 Suétone, Ner. 39.<br />
2 Tacite, Ann. VI, 29 ; Dion Cassius, 58, 24, 4 sq ; Suétone, Tib. 61, 10.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
197
de la disgrâce de leur auteur ; mais d’un autre côté, cette raison est masquée par des griefs<br />
allégués, plus « sérieux » en quelque sorte. Il est vrai que le délit serait alors juridiquement<br />
mal constitué, et que condamner un auteur tragique sur ces seules bases reviendrait à<br />
reconnaître la force et le pouvoir de son œuvre, à admettre que l’on craint son influence sur le<br />
public, et que l’on s’est vu dans cet Agamemnon, dans ce roi de légende.<br />
La portée politique de la tragédie se révèle ainsi dans l’attitude de Britannicus, qui<br />
réplique à une provocation de Néron par un vers vraisemblablement emprunté à<br />
l’Andromaque ou au Thyeste d’Ennius 1 : O pater, o patria, o Priami domus. Britannicus<br />
répond ainsi à l’attaque de son frère, qui souhaitait le ridiculiser, en retournant contre son<br />
adversaire ses propres armes. En effet, la rivalité de Néron et Britannicus est, à cet instant au<br />
moins, à la fois poétique et politique. Le prince aurait vu dans le fils de Claude un rival, qu’il<br />
fallait abattre ou affaiblir. Il se serait alors servi de l’art dans lequel il voulait exceller, pour<br />
signaler dans ce domaine l’infériorité de Britannicus. Or celui-ci, non content de relever le<br />
défi artistique, choisit un canticum que l’on peut immédiatement interpréter comme une<br />
allusion transparente à sa condition d’héritier chassé de son trône et de son palais. Il<br />
dévoilerait ainsi, sous le jeu, l’importance des enjeux et la faute de Néron, usurpateur. Dans<br />
l’assistance, nul ne s’y serait trompé, nous dit Tacite, qui fait de cet épisode l’événement<br />
décisif , qui amène Néron à éliminer pour de bon ce dangereux rival, et affirme la force et la<br />
pertinence politique du discours tragique 2 .<br />
A l’époque de Tacite, la tragédie n’a donc, semble-t-il, rien perdu de sa force<br />
subversive, ou tout au moins contestataire, puisque l’un des protagonistes du Dialogue des<br />
orateurs se voit inquiété par les réactions que suscite sa tragédie prétexte, intitulée Caton. Son<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 15.<br />
2 Sur la mort de Britannicus, voir p. 29. Cet épisode, dont la réalité historique est douteuse, est<br />
cependant riche de sens : voir infra, chapitre 9, p. 419.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
198
interlocuteur, Secundus, évoque même les retouches nécessaires à opérer afin d’en supprimer<br />
les interprétations fâcheuses, susceptibles de froisser le pouvoir impérial :<br />
An ideo librum istum apprehendisti, ut diligentius retractares, et, sublatis, si quae<br />
prauam interpretandi materiam dederunt, emitteres Catonem, non quidem meliorem,<br />
sed tamen securiorem ? 1<br />
II/ Le témoignage de Sénèque.<br />
A/ L’illustration de la réflexion philosophique et politique.<br />
Dans ses œuvres en prose, Sénèque se réfère peu à la tragédie, ce qui peut étonner<br />
compte tenu de l’importance du corpus qui nous est parvenu. La lettre 108 est cependant<br />
célèbre pour ce jugement de Sénèque, qui affirme que l’efficacité du discours philosophique<br />
est plus grande avec le secours de la poésie 2 . Deux passages révèlent l’illustration que l’on<br />
peut tirer des tragédies à propos de sa pensée politique 3 . Il fait, dans les deux cas, référence à<br />
une citation de l’Atrée d’Accius, devenue proverbiale.<br />
1 Tacite, D. III, 1 : « N’as-tu pas plutôt repris ton ouvrage, pour le remanier soigneusement, et pour<br />
publier, après avoir supprimé ce qui pouvait donner lieu à une interprétation fâcheuse, un Caton non<br />
pas meilleur, mais plus inoffensif cependant ? »<br />
2 Ep. 108, 9 ; cf 94, 27.<br />
3 M.-H. François-Garelli, 1994, p. 93.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
199
1/ Oderint, dum metuant ! La tyrannie, principe de gouvernement fondé sur la crainte.<br />
Dans le De clementia, tout d’abord, il cite ces paroles d’Atrée : Oderint dum metuant,<br />
« Qu’ils me haïssent, pourvu qu’ils me craignent », comme un exemple de paroles<br />
mémorables mais exécrables (magnas, sed detestabiles). On dit que Caligula aimait<br />
particulièrement cette phrase 1 , qui reste attachée à ce prince comme la devise de son règne.<br />
Ici, on observe, en quelque sorte, une in<strong>version</strong> du phénomène de l’allusion tragique,<br />
puisqu’un personnage réel et historique se fait le miroir d’un de ses héros. Caligula représente<br />
donc, de nombreux autres éléments le confirment, le tyran cruel, dévoré par la colère,<br />
effectivement craint et haï de tous.<br />
Cette citation de l’Atrée d’Accius avait déjà été commentée dans le De ira :<br />
'Quid ergo? non aliquae uoces ab iratis emittuntur quae magno emissae uideantur<br />
animo?' ueram ignorantibus magnitudinem, qualis illa dira et abominanda<br />
'oderint, dum metuant'. Sullano scias saeculo scriptam. Nescio utrum sibi peius<br />
optauerit ut odio esset an ut timori. (...) Magno hoc dictum spiritu putas? Falleris; nec<br />
enim magnitudo ista est sed immanitas. 2<br />
La citation tragique illustre la réflexion philosophique, et lui sert de support : Sénèque<br />
distingue en effet la grandeur d’âme et la colère. Cette passion, la plus destructrice de toutes,<br />
1 Suétone, Cal. 30.<br />
2 Sénèque, Ir. I, 20, 4 : « Comment ? n’y a-t-il pas des paroles, prononcées par des gens en colère, et<br />
qui semblent émaner d’une grande âme ? C’est plutôt l’avis de ceux qui ignorent ce qu’est la véritable<br />
grandeur, par exemple, sur ces paroles sinistres et abominables : « Qu’ils haïssent, pourvu qu’ils<br />
craignent ». Sache qu’elles ont été écrites du temps de Sulla. Je ne sais ce qu’on peut souhaiter de pire,<br />
de la haine ou de la crainte. (...) Tu penses que cette phrase est d’une grande âme ? Tu te trompes : ce<br />
n’est pas de la grandeur, mais de la férocité. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
200
n’admet pas de demi-mesure : il n’y a pas d’usage raisonnable de la colère, contrairement à ce<br />
qu’énonce la théorie aristotélicienne que le philosophe critique dans le traité 1 . Le tyran se<br />
définit par sa sujétion à la colère, qui induit sa cruauté et sa folie. La citation fait l’objet d’un<br />
commentaire, dont le but est de montrer l’écart entre la colère et la grandeur d’âme. Des<br />
figures tyranniques se dessinent, à l’arrière plan de la réflexion, et viennent soutenir le propos.<br />
En effet, on trouve dans ce passage une triple référence politique, correspondant à l’histoire<br />
romaine plus ou moins récente. Atrée n’est pas nommé, la citation étant sans nul doute<br />
suffisamment connue pour permettre à Sénèque de se passer de cette précision, mais les trois<br />
personnages indirectement ou directement évoqués sont, d’une manière ou d’une autre,<br />
comparés implicitement à cette figure devenue proverbiale du tyran cruel et sanguinaire. Deux<br />
des empereurs sous le règne desquels Sénèque a vécu rejoignent alors le répertoire des<br />
exempla traditionnels de tyrans : Cambyse 2 , Apollodore ou Phalaris 3 .<br />
2/ Vellem litteras nescirem ! Une parole sublime de Néron.<br />
A la « devise » affichée par Caligula s’oppose une parole de Néron, l’exclamation<br />
inaugurale de son règne en quelque sorte, qui contient toutes les promesses que le jeune<br />
prince semble porter en lui, l’annonce d’un règne juste et d’un exercice du pouvoir modéré,<br />
fondé sur la clémence. C’est du moins ainsi que Sénèque présente les choses dans le De<br />
clementia, dont la signification politique est fondamentale, puisqu’il énonce les principes d’un<br />
régime stable et légitime, corrigé des excès et des abus des règnes précédents. 'Vellem litteras<br />
1 Sénèque, Ir. III, 3, 1 : Aristote, qui admet une place dans l’âme du sage pour la passion, est appelé<br />
defensor irae ; J. Fillion-Lahille, 1984, p. 203.<br />
2 Sénèque, Ir. III, 14.<br />
3 Id. II, 5, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
201
nescirem!' s’exclame Néron au moment de signer la condamnation à mort de deux brigands 1 .<br />
Cette parole sublime du souverain est, affirme encore Sénèque, à l’origine de son traité sur la<br />
clémence.<br />
Vt De clementia scriberem, Nero Caesar, una me uox tua maxime compulit, quam ego<br />
non sine admiratione et, cum diceretur, audisse memini et deinde aliis narrasse,<br />
uocem generosam, magni animi, magnae lenitatis, quae non composita nec alienis<br />
auribus data subito erupit et bonitatem tuam cum fortuna tua litigantem in medium<br />
adduxit. 2<br />
Dans ce début du livre II du De clementia, la citation tragique sert de contrepoint aux paroles<br />
clémentes du jeune empereur. Plus exactement, les deux exclamations, celle, generosa, de<br />
Néron, et celle, detestabilis, de Caligula, concentrent de manière frappante tout ce qui oppose<br />
les deux souverains : cruauté, crainte, tyrannie, instabilité d’une part, clémence, confiance,<br />
stabilité d’un pouvoir légitimé par son exercice d’autre part. Mais, si Caligula s’inscrivait<br />
dans la lignée du tyran de tragédie par excellence, Néron, lui, est à l’origine de ses paroles, il<br />
ne se met dans l’ombre de personne en les prononçant : elles sont, précise Sénèque, non<br />
composita nec alienis auribus data. On est donc loin de la composition poétique et de la<br />
recherche d’effets, c’est la nature de l’empereur qui se révèle, et qui le place au-delà même<br />
des modèles. Tout se passe comme si, abolissant la distance chronologique, les deux figures<br />
1 cf. Suétone, Ner, 10.<br />
2 Clem. II, 2, 1 : « Ce qui m’a surtout déterminé à écrire sur la clémence, Néron César, c’est une parole<br />
de toi, que je me rappelle avoir, non sans admiration, entendue prononcer, puis répétée à d’autres, une<br />
parole pleine de noblesse, de grandeur, de douceur, qui jaillit soudain, sans artifice ni pour flatter les<br />
oreilles d’autrui, et qui a dévoilé les conflits de ta bonté naturelle avec les devoirs de ta fonction. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
202
oyales s’affrontaient dans un agôn, dont l’enjeu et le thème seraient la nature de la véritable<br />
souveraineté.<br />
B/ La connexion de la parole tragique et du contexte de représentation.<br />
1/ Sulla et les luttes de la fin de la République.<br />
La mention du contexte historique montre que Sénèque considère comme admis que la<br />
tragédie a une signification politique contemporaine. Ainsi, lorsqu’il cite le vers célèbre de<br />
l’Atrée d’Accius, afin de distinguer la grandeur d’âme de la monstruosité, il précise que la<br />
pièce fut composée à l’époque de Sulla : Sullano scias saeculo scriptam. Le seul nom du<br />
dictateur rappelle à tout lecteur romain les proscriptions de 82 1 . La juxtaposition des paroles<br />
d’Atrée et du nom de Sulla l’invite à mettre en parallèle les mots de l’un et les actes de<br />
l’autre. Or, comme le fait remarquer J. Dangel 2 , cette interprétation repose sur une erreur (ou<br />
sur une distorsion volontaire) des dates. Accius, en effet, meurt en 86, soit trois ans avant que<br />
Sulla ne prenne le pouvoir. Il ne saurait donc, dans sa tragédie, inclure une condamnation du<br />
dictateur. L’interprétation de Sénèque demeure néanmoins significative, car Sénèque choisit<br />
comme référence une figure de tyran connue de tous, et un contexte politique hautement<br />
évocateur pour son lecteur. Ainsi, paradoxalement, le caractère véridique ou non de l’allusion<br />
importe moins que la réflexion qui en découle. Par ailleurs, la postérité de cette citation<br />
d’Accius en montre la portée politique, au-delà des intentions originelles de l’auteur.<br />
1 Ir. III, 18, 1. cf Clem. I, 12, 1-2.<br />
2 J. Dangel, 1990, p. 108.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
203
2/ Quid antiqua perscrutor 1 ? des références aux empereurs.<br />
La seconde référence peut être déduite du récit de Suétone, d’après qui Tibère aurait<br />
repris la formule, avec une modification, pour commenter les vers qui circulaient alors, et qui<br />
flétrissaient le prince."Oderint, dum probent." 2<br />
'Oderint' -- quid? 'dum pareant'? Non. 'dum probent'? Non. Quid ergo? 'dum timeant'.<br />
Sic ne amari quidem uellem. 3<br />
Les verbes parere, probere et timere se succèdent selon une logique de gradation vers le pire :<br />
l’approbation contenue dans le premier pose au moins le principe d’un gouvernement juste, de<br />
décisions impopulaires mais dont la légitimité s’impose aux yeux de tous. Avec l’obéissance<br />
érigée en principe de gouvernement, est introduite l’idée de l’arbitraire et du despotisme. Le<br />
pire, bien sûr, c’est la crainte, conséquence de la cruauté du tyran.<br />
Enfin, la troisième référence se rapporte à Caligula, le pire de ces trois personnages, et<br />
sera reprise dans le De clementia. Caligula apparaît fréquemment sous la plume du philosophe<br />
comme l’archétype du tyran, de nombreux exemples rappellent sa cruauté et sa folie 4 . En<br />
outre, la ressemblance du prince et du tyran mythologique se confirme dans ses actes. Ainsi,<br />
lorsqu’il ordonne le supplice du fils d’un chevalier romain, Pastor, le banquet auquel il le<br />
1 Ir. III, 18, 3.<br />
2 Suétone, Tib. 59.<br />
3 Ir. I, 20, 4 : « Qu’ils haïssent... et quoi ? pourvu qu’ils obéissent ? Non. Pourvu qu’ils<br />
m’approuvent ? Non plus. Alors quoi ? Pourvu qu’ils craignent. A ce prix je ne voudrais pas même<br />
être aimé. »<br />
4 Ir. III, 18-19.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
204
convie rappelle par de nombreux traits le festin de Thyeste, et la cruauté d’Atrée qui assiste au<br />
repas :<br />
Propinauit illi Caesar heminam et posuit illi custodem: perdurauit miser, non aliter<br />
quam si fili sanguinem biberet. 1<br />
Un père buvant malgré lui le sang de son propre fils, sous les yeux de son bourreau : voilà une<br />
image qui évoque forcément l’atroce repas de Thyeste, avec s’il est possible, un degré<br />
supplémentaire dans l’horreur ; car, alors que Thyeste se repaît de la chair de ses enfants sans<br />
le savoir, sous le regard d’un frère qui attend pour lui révéler la vérité, c’est en connaissance<br />
de cause que Pastor festoie pendant le supplice de son fils. Le tyran réalise ainsi, de manière<br />
métaphorique, le crime qu’Atrée regrette un instant de ne pas avoir élaboré pour son frère 2 .<br />
Caligula offre une variation sur le mythe, qui en dit long sur son inhumanité.<br />
La citation donne lieu aussi à une réflexion politique : le tyran est voué à une mort<br />
violente. Cette réflexion est elle-même illustrée d’une citation empruntée à l’auteur de mimes<br />
Labérius. Sénèque rappelle alors la réaction du public, qui voit dans cette maxime<br />
l’expression de l’opinion publique sur la situation, au cours des ludi Victoriae Caesaris de<br />
septembre 46. Il développe ainsi l’idée selon laquelle la crainte rend le pouvoir fragile :<br />
1 Ir. II, 33, 4 : « César lui fit passer une coupe, et plaça près de lui un gardien : le malheureux<br />
s’exécuta, comme s’il avait dû boire le sang de son fils ».<br />
2 Th. 1054 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
205
Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille uersus qui medio ciuili bello in theatro dictus<br />
totum in se populum non aliter conuertit quam si missa esset uox publici adfectus:<br />
necesse est multos timeat quem multi timent. 1<br />
Cet épisode est rapporté par Macrobe et par Sénèque le Rhéteur 2 : le vers, prononcé par un<br />
chevalier, que César affronte à l’affranchi Publilius Syrus, est une attaque contre celui qui l’a<br />
contraint à cette compétition. L’assistance comprend l’allusion et le public césarien accorde sa<br />
faveur à Syrus qui l’emporte 3 . Il y a donc chez Sénèque une conscience claire de la portée<br />
politique du texte de théâtre, qui tient compte de la manière dont le public recevait ces<br />
œuvres, et de la tendance des Romains à faire des rapprochements entre ce qui est représenté<br />
et l’actualité.<br />
C/ Une réflexion sur le personnage tragique.<br />
Enfin, le commentaire de la citation de l’Atrée d’Accius offre une réflexion sur le<br />
personnage tragique, et la question de la grandeur dans le crime. En effet, le raisonnement<br />
s’applique avant tout à l’exercice du pouvoir dans la réalité, et invite le lecteur à juger la<br />
manière dont Caligula, par exemple, exerçait son pouvoir. La fin violente du tyran, à laquelle<br />
il est possible de se référer, est en quelque sorte la conclusion logique de ses dérives<br />
tyranniques, et de la crainte érigée en principe de gouvernement. Le tyrannicide confirme<br />
l’analyse de Sénèque, et donne plus de poids à ses avertissements. Mais le recours à un vers<br />
1 Ir. II, 11, 3 : « Rappelle-toi à ce propos ce vers célèbre de Labérius, prononcé au théâtre en pleine<br />
guerre civile, auquel le peuple entier donna son approbation, tout comme s’il exprimait l’opinion de<br />
tous : ‘il doit craindre beaucoup, celui que beaucoup craignent. ’ »Clem. I, 12, 4.<br />
2 Controuersiae, 7, 3, 8-9. Macrobe, Sat. 2, 3, 10 ; 2, 7, 2 ; 2, 7, 10 ; 7, 3, 8.<br />
3 J.-C. Dumont, 2004, p. 241-251.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
206
tragique amène à considérer également le statut d’Atrée, non plus en tant qu’illustration du<br />
propos, et comme périphérique à celui-ci, mais comme personnage tragique. Dans ce passage<br />
Sénèque semble nier la possibilité d’un sublime du mal, lorsqu’il oppose les termes<br />
magnitudo et immanitas. On ne peut alors s’empêcher de penser au traitement du mythe par<br />
Sénèque lui-même, dans son Thyeste.<br />
1/ Le triomphe d’Atrée.<br />
Dans la tragédie de Sénèque, à première vue, le triomphe d’Atrée est total : face à son<br />
frère anéanti, qui rote lamentablement après avoir englouti ses enfants massacrés, il exulte de<br />
la joie de son pouvoir définitivement acquis et de sa liberté retrouvée 1 . Le prix de cette liberté<br />
est, justement, l’immanitas, la monstruosité du crime 2 . La uoluptas que lui apportent ses<br />
crimes est une conséquence de la liberté retrouvée : il l’exprime bruyamment dans la dernière<br />
scène qui l’oppose à son frère.<br />
1 W. M. Calder, 1983.<br />
Nunc mea laudo manus,<br />
nunc parta uera est palma. Perdideram scelus,<br />
nisi sic doleres. Liberos nasci mihi<br />
nunc credo, castis nunc fidem reddi toris. 3<br />
2 Th. 273 : Atrée se voit même surpasser l’immanitas de Térée.<br />
3 Th. 1096-1099 : « C’est maintenant que je loue mes mains, maintenant que j’ai véritablement<br />
remporté la palme. J’aurais perdu mon crime si tu n’avais pas tant souffert. Maintenant, je crois que<br />
des enfants me naissent, que ma couche nuptiale m’est rendue sans souillure. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
207
Atrée a le sentiment que son crime lui fait retrouver sa légitimité et annule les fautes passées,<br />
comme si l’union monstrueuse de Thyeste et de ses enfants effaçait celle, impie et adultère, de<br />
Thyeste et de sa belle-sœur.<br />
La tragédie s’achève sans que le châtiment d’Atrée soit annoncé, sur un dernier<br />
sarcasme du criminel. L’absence de transcendance, matérialisée par la fuite des dieux et des<br />
astres, laisse Atrée monter dans un ciel vide 1 :<br />
Aequalis astris gradior et cunctos super<br />
altum superbo uertice attingens polum. 2<br />
Il l’emporte sur tous, affirme son pouvoir par un crime inouï, et torture son frère par un<br />
raffinement de cruauté. Le tyran semble libéré de la crainte, et se dessine alors comme un<br />
personnage qui tient à la fois de la bête sauvage 3 et de la divinité maléfique, qui a le souci de<br />
commettre son forfait selon un ordre 4 . Il en est à la fois le sacrificateur, sacerdos 5 et le<br />
destinataire.<br />
2/ Une victoire illusoire.<br />
Cependant, certains indices dévoilent le caractère illusoire de sa victoire. Malgré la<br />
joie qu’il manifeste, Atrée est entraîné par sa propre logique, qui enchaîne les crimes aux<br />
1 892 : caelum uacat ; 1021 : fugere superi ; 995 : fugit omne sidus.<br />
2 Th. 885-886 : « Me voici, l’égal des astres, au-dessus de tous et touchant de mon front superbe les<br />
hauteurs du ciel. »<br />
3 Th. 708.<br />
4 Th. 715.<br />
5 Th. 691.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
208
crimes, et son insatisfaction le condamne au même supplice que Tantale 1 , dont l’ombre<br />
apparaît dans le prologue, évoquant même un châtiment plus grand que sa propre soif et sa<br />
faim éternelles :<br />
Peius inuentum est siti<br />
arente in undis aliquid et peius fame<br />
hiante semper ? 2<br />
Alors, si Atrée a dépassé en horreur et en cruauté son père, le supplice qui l’attend est à la<br />
mesure de son crime, qui le condamne à une insatisfaction infinie 3 . Sa dernière phrase, te<br />
puniendum liberis trado tuis, est encore un cri de haine, derrière l’ironie qu’il exprime. La<br />
punition de Thyeste, pour Atrée, est toujours à venir. Ainsi, le tyran de la tragédie manifeste<br />
sa monstruosité intrinsèque 4 , qu’il réalise dans un crime inouï, mais cet « héroïsme noir »,<br />
selon l’expression de F. Dupont 5 , est miné par l’incapacité où il se trouve de se libérer d’une<br />
passion incontrôlée et forcément destructrice. La tragédie ne s’achève pas sur une résolution<br />
des tensions, ni sur l’établissement d’un ordre inverse établi par le tyran. Au contraire, le<br />
chaos, la fuite des dieux et le bouleversement de la nature consacrent la réalité d’un échec<br />
général. En cela, le personnage d’Atrée n’est pas en contradiction avec l’image du tyran<br />
proposé dans les œuvres en prose.<br />
1 A. L. Motto, J. R. Clark, 1987.<br />
2 Th. 4-6 : « On a donc trouvé pire que la soif qui me brûle dans les ondes, pire que la faim qui me<br />
tenaille sans cesse ? »<br />
3 A. J. Boyle, 1983b, p. 200-221<br />
4 G. Meltzer, 1988.<br />
5 F. Dupont, 1985, p. 450-451.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
209
Sénèque a donc donné à ses tragédies une portée politique, et en cela il reprend une<br />
tradition aussi ancienne que le théâtre romain : conscient de l’attitude des spectateurs,<br />
facilement enclins à voir dans les pièces représentées des allusions ou des réflexions en<br />
rapport avec la situation contemporaine, il n’a pas pu envisager de détacher son théâtre de ce<br />
genre de considérations. Les tragédies, par ailleurs, ont dû se nourrir des théories et principes<br />
développés dans les traités, en particulier lorsqu’il s’agissait de la figure du tyran. Mais, qu’il<br />
existe des rapports entre les tragédies et les œuvres en prose ne doit pas nous amener trop<br />
rapidement à la conclusion que le théâtre de Sénèque n’est qu’une suite d’exempla destinés à<br />
illustrer les concepts examinés par ailleurs. Le cas d’Atrée dans la tragédie de Thyeste montre<br />
à cet égard la complexité des échanges entre philosophie et poésie. La pensée de Sénèque,<br />
dont il faut souligner l’unité et la cohérence, ne suppose pas l’uniformité de son œuvre. Pour<br />
le moment, on peut affirmer que des relations existent entre la pensée politique de Sénèque et<br />
ses tragédies, mais la nature de ces relations reste à définir, en particulier lorsqu’il s’agit du<br />
principat.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
210
Chapitre 6. Le principat, un régime tragique ?<br />
L’énormité du pouvoir impérial, ainsi que les dimensions exceptionnelles de l’empire<br />
exigent un dirigeant hors du commun. Le lien entre la nature de l’autorité et celui qui la<br />
détient est d’ailleurs établi par des auteurs antiques 1 . Cette immensité est avant tout<br />
géographique : les limites de l’empire ne sont pas loin de celles du monde connu, ce qui<br />
facilite l’assimilation de l’empereur au maître du monde, et donc à la divinité. D’un point de<br />
vue pratique, les prérogatives de l’empereur paraissent également extrêmement vastes :<br />
l’imperium proconsulaire, la puissance tribunicienne et le pontificat lui confèrent en effet<br />
l’ensemble des pouvoirs militaires, civils et religieux. Il peut intervenir dans les domaines<br />
législatif, exécutif et judiciaire. Les décisions capitales sont prises dans le cercle restreint de<br />
sa cour, le Sénat se voyant confier des affaires de moindre importance. Enfin, tout ce qui<br />
concerne l’Etat passe dans les mains du prince. Cet immense pouvoir est assorti d’une<br />
absence totale de contrôle 2 : le risque de tyrannie est donc permanent 3 . Par ailleurs, la<br />
direction des affaires de l’Empire peut sembler une charge bien trop lourde pour un homme<br />
ordinaire : seul Hercule peut prendre la place d’Atlas et porter le monde sur ses épaules.<br />
Alors, non seulement le principat présente les caractéristiques d’un régime monarchique qui<br />
1 Velleius Paterculus, II, 131, 1-2. Flavius Josèphe l'exprime en d'autres termes, A. J. XVIII, 256; Dion<br />
Cassius, 63, 14; Philostrate, V. Ap. V, 7; Pseudo-Sénèque, Oct. 250 ; Lucain, B. C. I, 45-66 ; Sénèque,<br />
Clem. I, 1, 2.<br />
2 R. F. Martin, 1991, p 31.<br />
3 Zosime, Hist. I, 5, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
211
le rapproche du contexte politique et idéologique traditionnel des tragédies, mais encore la<br />
figure du prince, élaborée dès les premiers temps de l’Empire, autorise l’assimilation du<br />
maître de Rome aux héros tragiques représentés.<br />
I/ Le prince, les dieux, les héros.<br />
La relation, riche et complexe, du prince et de la divinité, a évolué et s’est<br />
progressivement renforcée à partir de bases préexistantes. Elle est significative de la synthèse<br />
qui s’est opérée lors de l’établissement du régime impérial entre la tradition et les<br />
nouveautés : le principat se réclame dès le départ de l’héritage républicain, dont il se présente<br />
comme l’unique sauvegarde imaginable. On n’a pas vu surgir un culte du souverain, ni une<br />
divinisation personnelle du prince de son vivant, même si les excès d’un Caligula ont pu<br />
laisser cette image dans les esprits. La proximité de l’empereur et de la divinité, loin d’être au<br />
départ une forme de la dérive mégalomane d’un pouvoir incontrôlé, apparaît au contraire<br />
comme la garantie d’une légitimité d’origine et d’un exercice juste et modéré. Il justifie a<br />
posteriori le principat par sa nature particulière et surhumaine. C’est parce qu’il y a un prince<br />
que le principat est possible, et non le contraire. Dans cet aspect de la mise en place du<br />
régime, le rôle de César est fondamental. La tradition romaine républicaine s’est combinée<br />
avec des influences diverses, dont l’infléchissement a été assuré de façon plus systématique<br />
par Auguste.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
212
A/ La caution divine du pouvoir impérial.<br />
L’idée que tout pouvoir vient des dieux est un aspect important de la pensée politique<br />
romaine : en effet, selon une tradition que l’on trouve dans les textes homériques, les rois sont<br />
choisis par Zeus 1 . Les dieux, qui régissent et organisent le monde, sont en quelque sorte une<br />
métaphore du pouvoir ; par conséquent, toute autorité a dès le départ un caractère sacré, et pas<br />
seulement l’autorité personnelle telle que l’exerce le prince. A Rome même, le lien entre<br />
divinité et pouvoir politique est ancien : Les gentes, familles dirigeantes de Rome, ont très tôt<br />
légitimé leur autorité et leur influence par leur ascendance 2 . Le lien avec la divinité, (en<br />
l’occurrence l’ascendance) est à Rome dès les premiers temps de la République une<br />
expression de la légitimité du pouvoir.<br />
Les grands hommes et les chefs charismatiques jouissent également de la protection et<br />
de la caution divine. J. R. Frears 3 a montré à quel point l’idée que les hommes d’Etat sont<br />
choisis et protégés par les dieux pour accomplir une mission parmi les hommes est<br />
constitutive de la pensée politique romaine, et ce, dès l’époque de la République. Cette<br />
idéologie, qui a permis selon lui de poser les bases du Principat, est ainsi significative d’une<br />
certaine continuité dans la pensée politique, à travers les mutations qui ont amené à la création<br />
du nouveau régime par Auguste, sur les traces de Jules César.<br />
1 J. R. Fears, 1977 p 29-35.<br />
2 S. Weinstock, 1971, p 4.<br />
3 J. R. Frears, 1977.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
213
1/ L’ascendance.<br />
La relation privilégiée du chef charismatique et de la divinité est exprimée de la<br />
manière la plus évidente et la plus symbolique par l’ascendance : avoir un dieu pour ancêtre,<br />
c’est à la fois participer de la nature divine et affirmer une dépendance à son égard. C’est ainsi<br />
que les gentes, qui prétendaient être issues d’un lointain aïeul divin, affirmaient la légitimité<br />
de leur autorité par cette origine prestigieuse, sans pour autant s’attribuer une nature<br />
proprement divine. En effet, la divinité se place à l’origine d’une très longue généalogie, dont<br />
le point de départ se perd dans une temporalité plus mythique qu’historique. D’autre part, la<br />
cohérence veut que les membres d’une telle famille se montrent dignes de leur ancêtre, ce qui<br />
offre une garantie pour leurs actes. Aussi, la généalogie mythico-légendaire de César a-t-elle<br />
constitué un élément de sa propagande, pour être par la suite reprise et revendiquée par les<br />
empereurs julio-claudiens :<br />
Amitae mea Iuliae maternum genus ab regibus ortum, paternum cum diis<br />
immortalibus coniunctum est. Nam ab Anco Marcio sunt Marcii reges, quo nomine fuit<br />
mater; a Venere Iulii, cuius gentis familia est nostra. Est ergo in genere et sanctitas<br />
regum, qui plurimum inter homines pollent, et caerimonia deorum, quorum ipsi in<br />
potestate sunt reges. 1<br />
La proximité du chef et du dieu tient à la similitude de leur rôle, et est symbolisée par la<br />
généalogie, qui suppose à la fois une nature commune et un statut moindre, le fils devant<br />
1 Suétone, Caes. 6. 2 : "La famille de ma tante Julia est d'origine royale du côté maternel, et rattachée<br />
aux dieux immortels du côté paternel. En effet, les rois Marcius, dont ma mère portait le nom,<br />
descendent d'Ancus Marcius; les Iulii, auxquels appartient notre famille, descendent de Vénus. On<br />
trouve donc dans ma famille à la fois la sainteté des rois, qui ont le plus de pouvoir parmi les hommes,<br />
et la majesté des dieux, qui tiennent sous leur autorité les rois eux-mêmes."<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
214
espect et obéissance à son père. Mais ces références généalogiques ne sont pas nouvelles au<br />
temps de César : elles s’enracinent dans les légendes et les cultes individuels des familles.<br />
Jules César, très attaché à ces cultes familiaux 1 , appartenait à l’une des familles troyennes de<br />
Rome, qui se disaient issues d'Enée et de ses compagnons, donc aussi anciennes que la Ville<br />
dont leurs ancêtres avaient été les fondateurs. Les gentes les plus puissantes, dont les patres<br />
sont les personnages les plus influents de Rome, se réclament de leur origine héroïque, les<br />
plus prestigieuses comptant même un dieu au nombre de leurs ancêtres. La première idée est<br />
donc que le dirigeant est voué à exercer le pouvoir. Sa nature et celle du dieu ont quelque<br />
chose de commun : ainsi Auguste serait fils d’Apollon, venu visiter sa mère, Atia, après une<br />
cérémonie dans son temple 2 . On rejoint ainsi l’idée présente dès Homère, que les rois et les<br />
grands hommes descendent des dieux, et appartiennent à la lignée des héros mythologiques<br />
dont le destin inspire les poètes tragiques.<br />
L’enjeu est donc d’importance, lorsque Lycus, dans Hercule Furieux, affirme à<br />
plusieurs reprises qu’Hercule est d’origine humaine, et non divine. Il désigne donc<br />
Amphitryon par l’expression uerus Alcidae sator, le véritable père d’Hercule 3 , puis il signale<br />
l’impossibilité de l’union d’un dieu avec une mortelle 4 , et finalement fait sur le sort pénible<br />
qui accable le héros une preuve de sa condition humaine 5 . Inversement, Egisthe invoque<br />
l’oracle qui a présidé à sa naissance pour répondre à la nourrice de Clytemnestre, qui l’accuse<br />
1 S. Weinstock, 1971, p. 4 et p. 26.<br />
2 S. Weinstock, 1971, p. 20. Suétone, Aug. 92.<br />
3 H. F. 357.<br />
4 H. F. 448 : Mortale caelo non potest iungi genus.<br />
5 H. F. 463 : Quemcumque miserum uideris hominem scias.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
215
de n’être qu’un usurpateur de basse extraction 1 . C’est également la noblesse de ses origines<br />
divines que sa nourrice rappelle à Phèdre, afin de la détourner de sa passion funeste 2 .<br />
En outre, l’affirmation de l’ascendance divine ne pouvait que satisfaire les grandes<br />
familles romaines, qui se réclamaient elles aussi d’un ancêtre héroïque ou divin 3 . Pompée,<br />
admirateur inconditionnel d’Alexandre, se référait aux ancêtres mythiques de son illustre<br />
modèle, Héraklès et Dionysos 4 . Le fondateur de la Ville, Romulus, était né de Mars. Scipion<br />
l’Africain comptait Jupiter parmi ses ancêtres 5 . Ainsi la référence divine et mythologique, tout<br />
en renforçant le pouvoir de la dynastie régnante, faisait rejaillir son lustre sur les grandes<br />
familles romaines et confirmait leur autorité et leur influence, créant ainsi une coïncidence<br />
d’intérêts entre le prince et ses nobles sujets.<br />
2/ L’expression métaphorique d’un pouvoir illimité.<br />
Cette référence fait également appel à un fond culturel commun au peuple romain : les<br />
récits mythologiques et les légendes patriotiques se confondent depuis longtemps avec<br />
l’histoire nationale 6 , dans la continuité de laquelle se place le prince. Outre le prestige qui<br />
accompagne la représentation divine du prince, il faut en souligner la commodité : lier le<br />
1 Ag. 294 : Auctore Phoebo gignor : haud generis pudet. La naissance d’Egisthe est également<br />
évoquée par l’ombre de Thyeste, dans le prologue, v. 32-36.<br />
2 Phaed. 129 : Thesea coniux, clara progenies Ioui...<br />
3 S. Weinstock, 1971, p 4. Les familles individuelles cultivaient leurs propres légendes et leurs cultes,<br />
comme par exemple les Claudii, les Aemilii, les Iulii et les Cornelii : Macrobe. I. 16. 7 ; Tacite, Ann.<br />
15. 23. 3 ; Denys d'Halicarnasse, I. 70. 14.<br />
4 S. Weinstock, 1971, p 37.<br />
5 Id., p 19.<br />
6 J. Fabre-Serris, 1998, p10-12.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
216
prince à la divinité, c’est donner une image à la fois séduisante et précise de l’immensité de<br />
son pouvoir, sans pour autant rompre avec les représentations traditionnelles. Ainsi en 2 av.<br />
J.-C., lorsque Auguste se voit décerner le titre de Pater patriae, appellation qui remonte aux<br />
origines légendaires de Rome, il est assimilé à Romulus, et apparaît aux yeux de tous comme<br />
le second fondateur de la Ville. Sa légitimité s’ancre donc dans le passé en se référant à la<br />
légende nationale et s’ouvre vers l’avenir, dont l’idée est incluse dans celle de fondation. Il<br />
faut ajouter que le titre lui-même est un héritage de la République, puisqu’il fut décerné, par<br />
exemple, à Cicéron après la défaite de Catilina 1 . Une apparente continuité est ainsi assurée,<br />
au-delà des siècles et des changements de régime, et le prince peut, de son vivant, entrer dans<br />
la légende 2 .<br />
3/ Les bienfaits à l’origine de la divinisation des héros : l’exemple d’Hercule.<br />
Si la divinisation participe pour une part à la légitimation du pouvoir d’un chef ou<br />
d’un gouvernant, il existe aussi une tradition qui en fait la caution a posteriori de la fonction<br />
occupée par le chef. Il est en effet assez couramment admis que la divinisation des héros et<br />
des grands hommes résulte de leurs bienfaits envers la communauté. La cour d’Auguste a<br />
repris cette tradition, confirmée par l’attitude de Cicéron 3 , qui héroïse les bienfaiteurs de<br />
l’humanité. Certains héros mythologiques ont ainsi accédé au statut divin en raison de leurs<br />
exploits, et témoignent de points de rencontre entre les conditions divine et humaine : Hercule<br />
1 Cicéron, Att. 9, 10, 3.<br />
2 Le titre de Pater patriae donne aussi une idée de la manière dont le pouvoir est censé être exercé par<br />
le prince ; c'est l'image traditionnelle du bon roi, qui est un père pour ses sujets, c'est aussi le pater<br />
familias dont l'autorité souveraine assure la protection de son entourage : Sénèque, Clem. I, 14, 2 ;<br />
Pline, Pan. Traj. II, 3.<br />
3 Cicéron, Cat. 3. 2 ; Rep. I, 12. S. Weinstock, 1971, p. 290.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
217
après ses travaux et les épreuves infligées par sa marâtre Junon s’est vu accepté au rang des<br />
dieux 1 . Romulus, premier roi de Rome et fondateur de la ville, est divinisé sous le nom de<br />
Quirinus 2 . Plus récemment, des personnages historiques ont reçu un culte : c’est le cas par<br />
exemple du premier Scipion, de Tiberius et Caius Gracchus après leur mort, ou encore de<br />
Marius de son vivant, après sa victoire sur les Cimbres en 101, même si ces cultes ont été de<br />
courte durée 3 . La divinisation est donc une manière de reconnaître et d’entériner la valeur<br />
d’un mortel qui a causé les bienfaits pour le genre humain tout entier.<br />
Reprenant cette tradition, Sénèque insiste dans ses tragédies et dans ses traités sur le<br />
statut de bienfaiteur de l’humanité dévolu à Hercule : dans Hercule Furieux, Amphitryon,<br />
après avoir rappelé les exploits de son fils, lui donne le nom de pacis auctor 4 , “ pacificateur ”.<br />
Hercule est le héros destructeur de monstres et pourfendeur de tyrans 5 , et ainsi il contribue à<br />
rétablir l’ordre sur terre, comme les philosophes stoïciens le conçoivent 6 . En cela, il participe<br />
au dessein divin, et entre déjà dans l’immortalité. Dans le De beneficiis, Sénèque donne, entre<br />
autres, le nom d’Hercule à la divinité, dispensatrice de tout bienfait 7 . La cérémonie de<br />
l’apothéose paraît hériter de cette tradition : la divinité de l’empereur n’est donc effective<br />
qu’après sa mort, ce qui la rend plus acceptable des républicains les plus sourcilleux. Ce statut<br />
surhumain, comme justification du pouvoir et comme récompense des bienfaits, est une idée<br />
ancienne, accentuée sous l’Empire, et naturellement présente dans les tragédies de Sénèque.<br />
1 H. O. 1701-1704 ; 1713 ; 1942-43 ; 1980.<br />
2 Cicéron, Nat. II, 24. Cicéron évoque dans ce passage les héros que leurs bienfaits ont conduits à<br />
l'immortalité : Hercule, Castor et Pollux, Liber. Au sujet d’Hercule, Tite Live, I, 7.<br />
3 S. Weinstock, 1971, p 295, notes 3 et 4.<br />
4 H. F., 250.<br />
5 Id. 43-44<br />
6 Cicéron, Nat. II, 36.<br />
7 Sénèque, Ben. IV, 8, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
218
B/ Influences orientales et tradition romaine<br />
1/ Les monarchies hellénistiques.<br />
L’idée du souverain évergète, bienfaiteur universel, se développe en particulier à<br />
l’époque hellénistique, et se voit systématisée dans les traités de la royauté de cette époque 1 ,<br />
qui prônent une royauté de droit divin, dont le détenteur est par essence supérieur au reste des<br />
mortels, puisque la divinité lui a confié la mission de diriger les hommes. Le roi est donc le<br />
représentant des dieux sur la terre, et à cet égard il participe de leur nature divine. La garantie<br />
de cette nature exceptionnelle est la vertu hors du commun du souverain. La divinité se<br />
manifeste par lui, à travers ses actes. Dans l’Egypte hellénistique, le souverain et le couple<br />
royal sont divinisés de leur vivant : cette pratique est un héritage des coutumes pharaoniques.<br />
Ainsi, Ptolémée XI, surnommé l’Aulète, prit avant 64 le titre officiel de Nouveau Dionysos. Il<br />
semble que ce titre ait été repris par son fils 2 . D’autre part, la divinisation des héros<br />
bienfaiteurs est une croyance ancienne en Grèce. César y était traité comme un dieu 3 . Les<br />
influences des monarchies hellénistiques sont avérées, mais elles ne sont pas affirmées trop<br />
ouvertement : d’une part, en effet, le souci constant des premiers empereurs a été de se<br />
réclamer de la tradition romaine ; d’autre part, les monarchies en question font depuis<br />
longtemps partie des vaincus, ce qui porte quelque ombrage à leur gloire 4 .<br />
En Egypte, le pharaon est dieu en même temps que roi : il est l’incarnation d’Horus et<br />
le fils d’Osiris, et en tant que tel, il représente la force vitale et organisatrice du monde. A<br />
1 P. Carlier, 1982.<br />
2 H. Jeanmaire, 1951, p 464.<br />
3 S. Weinstock, 1971, p 289 et 297.<br />
4 H. Hammond, 1940.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
219
l’époque romaine, le statut particulier de cette province, qui a un poids économique et<br />
idéologique considérable, explique en partie la fascination exercée par l’Egypte sur Rome : le<br />
Prince, à l’instar des pharaons, y était vénéré comme un dieu, et recevait entre autres, des<br />
marques de gratitude pour avoir favorisé une crue du Nil 1 . Ainsi, une inscription trouvée à<br />
Memphis qualifie Néron de “ dieu bienfaisant de l’univers ” 2 . Or Sénèque, qui joua un rôle<br />
politique de premier ordre sous le règne de Néron, du moins dans les premières années, avait<br />
fait un séjour en Egypte, accompagnant sa tante et le préfet C. Galerius, son époux. Il y fit la<br />
connaissance de Chaérémon, prêtre égyptien converti à la doctrine stoïcienne, qui devait<br />
devenir plus tard l’un des précepteurs de Néron. Pendant son séjour, Sénèque a pu être<br />
influencé par les différents courants de la pensée orientale.<br />
Comme on le voit, les empereurs romains n’ont pas vraiment innové en matière de<br />
divinisation. Les anecdotes merveilleuses répandues au sujet de la naissance d’Alexandre,<br />
tendent à faire de lui un fils de Zeus, un nouveau Dionysos 3 , et participent à la formation<br />
d’une légende autour de lui. Ainsi, selon le témoignage d’Arrien, au cours de la descente<br />
triomphale de l’Indus, les compagnons d’Alexandre crurent se trouver en pays conquis par le<br />
dieu. Cette impression a dû être provoquée, ou entretenue, par la légende du voyage de<br />
mission accompli par Dionysos en Orient pour y répandre son culte 4 . Pendant deux ans, le<br />
dieu aurait parcouru l’Inde fabuleuse, accompagné de son armée de Ménades et de Satyres.<br />
Alexandre semble s’être souvenu de son retour triomphal par la Béotie sur un éléphant.<br />
1 L. Janssens, 1988 : La proclamation de Néron Agathos Daimôn en Egypte permet de favoriser son<br />
identification avec le Nil et Osiris, mais aussi avec les grands dieux solaires du mithraïsme et de<br />
l'orphisme.<br />
2 oJ ajgaqoı daivmwn th~~ı oijkoumevnhı : E. M. Smallwood, 1967, p. 126, no 418.<br />
3 Plutarque, Sur la fortune d'Alexandre, 6-8.<br />
4 H. Jeanmaire, 1951, p 171 : cette légende se serait formée au temps d'Euripide.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
220
2/ L’exemple d’Antoine.<br />
Plus proche, dans l’espace et dans le temps, des débuts de l’empire, l’exemple<br />
d’Antoine confirme la fascination de Rome pour l’orient, et constitue un autre précédent<br />
célèbre. Avec l’accord de Brindes, en 40, l’empire est partagé en trois : l’Afrique est confiée à<br />
Lépide, l’Occident à Octave et l’Orient à Antoine 1 . Ce dernier territoire est traditionnellement<br />
représenté comme le lieu de toutes les démesures et des aspirations tyranniques. D’ailleurs,<br />
Antoine est présenté par Plutarque comme un contre modèle, en raison de ses prétentions<br />
excessives. Il note cependant la ressemblance physique d’Antoine et d’Héraklès 2 , et<br />
mentionne la légende selon laquelle les Antonii seraient des Héraclides 3 . Antoine, par son<br />
attitude et son accoutrement, confirmait et rappelait cette glorieuse ascendance. Il<br />
revendiquait l’assimilation à Dionysos 4 , tout comme l’avait fait avant lui Ptolémée XI mais, et<br />
le choix de la référence divine est peut-être révélateur, Dionysos est une figure ambivalente :<br />
il est porteur de joie et source de paix, mais il est aussi le dieu des Ménades, qui préside à<br />
leurs rituels violents. Ainsi, Plutarque l’identifie plus volontiers 5 au Dionysos carnassier et<br />
sauvage.<br />
Après la victoire de Philippes, Antoine est accueilli à Ephèse par des congrégations<br />
dionysiaques qui le saluent comme leur dieu, avant de rejoindre à Tarse la reine Cléopâtre, à<br />
1 Plutarque, Vie d'Antoine, 30, 6.<br />
2 Plutarque, Ant. 4, 1.<br />
3 Ibid, 4, 2.<br />
4 Velleius Paterculus, II, 82, 4 : Antoine se proclame nouveau Liber Pater après le triomphe célébré à<br />
Alexandrie devant Cléopâtre. Plutarque, Ant. 50, 2 ; Dion Cassius, 49, 39, 6. A cette occasion, il défile<br />
avec la couronne d'or, le lierre, le thyrse et les cothurnes qui sont les attributs de Liber Pater.<br />
5 Ant. 24, 1-4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
221
laquelle il s’unit selon des rites et une mise en scène référant à une hiérogamie. Antoine ne<br />
prend pas officiellement le titre de Neos Dionysos, mais il en joue exactement le rôle, se<br />
conciliant ainsi, par une propagande qui lui convenait, les cercles dionysiaques dont<br />
l’influence était particulièrement forte.<br />
3/ Une certaine méfiance.<br />
Le culte du souverain et la monarchie idolâtrique à l’orientale constituent un danger<br />
que la démocratie grecque avait déjà soulevé, il y a bien longtemps, dans Les Perses<br />
d’Eschyle par exemple. Le système de l’empire établit un lien de vassalité entre le prince et<br />
les despotes orientaux : la tentation pour l’empereur d’être pour ces rois ce qu’ils sont pour<br />
leurs sujets s’est fait sentir. C’est ainsi que Tiridate déposa son diadème, et les insignes de sa<br />
royauté, aux pieds de Néron 1 .<br />
Certains empereurs, ceux qui ont laissé les plus mauvais souvenirs, se sont laissé aller<br />
à des dérives orientalistes qui constituaient, aux yeux des tenants de la tradition romaine, un<br />
gage certain de leur propension à la tyrannie. On peut citer l’exemple de la fascination de<br />
Caligula pour l’Egypte et le culte isiaque 2 , ou ses relations incestueuses avec Drusilla, sur le<br />
modèle des pharaons et des rois hellénistiques qui épousaient leurs sœurs. L’attitude<br />
d’Auguste consista à ne pas exagérer la divinisation du prince comme dans les royaumes<br />
hellénistiques ou en Egypte, et à minimiser les influences orientales. La propagande<br />
néronienne garde une place importante au mythe d’Apollon, divinité qui rassemble les<br />
influences égyptienne (Hélios) et romaine. Par la suite, Sénèque adapta sa pensée politique au<br />
1 Tacite, Ann. XV, 29.<br />
2 Suétone, Cal. 57, 10.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
222
schéma de Varron, à l’influence stoïcienne : les références à la divinité regroupent les trois<br />
faces de cette théologie tripartite. La tradition populaire romaine d’Apollon, et la tradition<br />
égyptienne du culte du soleil, en tant qu’elles concernent le peuple réuni en entité politique,<br />
appartiennent à la théologie politique. Apollon archer, aurige et lyricine relève de la théologie<br />
poétique. La royauté cosmique du soleil complète le triptyque avec la théologie<br />
philosophique, d’inspiration stoïcienne 1 . Les influences orientales, sans aboutir pour autant à<br />
un éloignement de la tradition romaine, jouent donc un rôle dans la constitution d’une image<br />
princière surhumaine.<br />
Le principat reprend et systématise un certain nombre de traditions, républicaines et<br />
orientales, afin de définir et de rendre intelligible la fonction impériale. En effet, le principat<br />
se défend d’être une nouvelle monarchie, ce qu’il est de fait, et se présente au contraire, dès<br />
les débuts, comme une restauration de la République, et la garantie de la sauvegarde de ses<br />
institutions. La référence aux dieux et aux héros, en supposant la nature exceptionnelle de<br />
l’empereur, constitue donc à la fois l’expression et la justification d’un pouvoir presque<br />
illimité. Le spectre du roi, tyran honni et ignominieusement chassé de Rome, s’éloigne ainsi<br />
au profit de l’image positive du héros, que l’on connaît par les légendes et que l’on voit<br />
représentée par les tragédies.<br />
C/ L’apport de Sénèque.<br />
La propagande impériale, qui tend à représenter le prince, sinon comme un dieu, du<br />
moins comme un être plus qu’humain, a également été relayée par la philosophie. En<br />
particulier, le stoïcisme, dont la domination est largement établie dans les milieux dirigeants<br />
1 Ben. IV, 12, 5 ; VII, 31, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
223
et dans les classes cultivées, a contribué à la justification théorique du principat. Sénèque ne<br />
dément pas cette orientation. Précepteur d’un tout jeune prince, il contribue à l’inauguration<br />
d’un nouveau règne, succédant à de longues années de tyrannie et de terreur : les règnes de<br />
Caligula et de Claude ont en effet marqué pour longtemps les mémoires de sanglants<br />
souvenirs.<br />
1/ L’idéologie du De clementia<br />
Le De clementia, composé au moment de l’accession de Néron au pouvoir, justifie le<br />
régime en place tout en posant les principes de son exercice idéal : le jeune empereur, à qui ce<br />
miroir est présenté, s’y conformera. C’est ainsi que l’on trouve dans ce traité, une justification<br />
métaphysique du principat. La monarchie y est présentée comme une loi de la nature, donc à<br />
la fois excellente et nécessaire. Sénèque convoque l’exemple de l’organisation sociale des<br />
abeilles, dont le roi (puisque l’on considère à l’époque qu’il s’agit d’un roi et non d’une reine)<br />
est dépourvu de dard, preuve du caractère contre-nature de la cruauté politique 1 . D’autre part,<br />
la monarchie apparaît, compte tenu des circonstances historiques, comme le meilleur régime<br />
possible. Sénèque montre par ailleurs une certaine méfiance à l’égard de la démocratie : c’est<br />
le peuple qui a condamné Socrate, comme il le rappelle dans le De tranquilitate animi 2 .<br />
Enfin, la physique stoïcienne suppose l’harmonie du Tout, régi par le Logos universel,<br />
qui n’est autre que l’expression de la divinité providentielle. Le Logos organise la Nature et<br />
l’univers, et cette organisation du Tout se retrouve dans ses parties 3 . Ainsi, le souverain régit<br />
l’Etat de la même manière que le Logos, la divinité providentielle, régit l’univers, et de la<br />
1 Sénèque, Clem. I, 19, 2. On trouve également une apologie de la monarchie dans Ben. II, 20.<br />
2 Sénèque, Tranq. V, 1, 3.<br />
3 V. Goldschmidt, 1953, p. 60-67.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
224
même manière que l’hegemonikon, l’esprit directeur, gouverne l’individu. Sénèque le traduit<br />
par le terme regium, dont la racine établit l’analogie politique. Une égalité de rapport s’établit<br />
donc : le Logos est à l’univers ce que le prince est à l’Etat, et ce que la raison est à l’individu.<br />
Ille est enim uinculum cuius ope vires publicae coharent, ille spiritus uitalis. 1<br />
L’analogie du corps et de l’âme montre bien à quel point le prince est l’agent de l’unité de<br />
l’empire : sans la raison qui dirige et unit les différents organes, il n’y aurait qu’une somme de<br />
membres, sans vie possible 2 . Le prince est celui sans qui le peuple serait voué à sa perte.<br />
D’autre part, l’analogie divine rend compte de l’immensité du pouvoir exercé et de<br />
l’ampleur de la tâche qui a été confiée au prince. Il possède une partie du Logos universel, et<br />
participe de ce fait à la nature divine et à la Providence. :<br />
Seruare proprius est excellentis fortunae, quae numquam magis suspice debet quam<br />
cum illi contigit idem posse quod dis, quorum beneficio in lucem edimur, tam boni<br />
quam mali. Deorum itaque sibi animum adserens princeps alios ex ciuibus suis, quia<br />
utiles bonique sunt, libens uideat, alios in numerum relinquat. 3<br />
1 Sénèque, Clem. I, 4, 1 : "Il (le roi) est le lien qui garantit la cohésion des forces publiques, il en est le<br />
souffle vital." L'idée que le souverain est l'âme du corps politique est également évoquée dans les<br />
Lettres à Lucilius, 95, 52.<br />
2 Clem. I, 3, 5.<br />
3 Sénèque, Clem. I, V, 7 : "Sauver est le propre d'une condition élevée, qui n'est jamais plus digne<br />
d'admiration que lorsqu'elle dispose du même pouvoir que les dieux, à qui nous devons tous la<br />
lumière, les bons comme les mauvais. Ainsi, que le Prince, conforme à l'exemple des dieux, porte un<br />
regard favorable, parmi ses sujets, sur les uns, parce qu'ils sont utiles et bons, et qu'il laisse les autres<br />
faire nombre."<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
225
La détention d’une puissance mondiale rend l’analogie plus évidente et plus accessible :<br />
comme les dieux gouvernent l’univers, le prince gouverne le monde connu. L’exemple divin<br />
est explicitement proposé au prince dans le De clementia. 1 Sénèque reprend, en accentuant sa<br />
couleur stoïcienne, un motif plus ancien. En effet, on trouvait déjà cette analogie dans l’une<br />
des odes d’Horace : Jupiter est aux rois ce que les rois sont aux peuples 2 .<br />
La justification du régime impérial, et, par extension, de l’activité politique de<br />
Sénèque, est reprise et nuancée dans plusieurs de ses traités. Si la métaphysique permet<br />
d’établir une théorie acceptable, Sénèque n’en délaisse pas pour autant la caution historique :<br />
selon lui en effet, c’est la mort de Caton qui marque la véritable fin de la République 3 . Il faut<br />
se soumettre à l’évolution historique, qui dépend de la Fortune et non de volontés<br />
particulières, et se lamenter ne sert à rien. Le sage admire les héros qui ont sacrifié leur<br />
existence et ont su ainsi se rendre éternels, mais loin de se retirer dans la douleur et les<br />
regrets, il cherche le moyen d’accomplir au mieux ses devoirs, et d’accorder ses actions et sa<br />
pensée. Sénèque, conseiller du prince, ne renie donc pas les idéaux de sa doctrine.<br />
Si la mise en place du régime impérial apparaît, d’un point de vue historique, assez<br />
nécessaire, après des décennies de guerres civiles au sein d’un empire dont les proportions<br />
sont sans commune mesure avec celles des débuts de la République, le spectre de la<br />
monarchie n’en plane pas moins sur l’opinion romaine. Il peut alors paraître étrange que<br />
Sénèque, dans le De clementia, utilise à plusieurs reprises le terme rex pour désigner le tout<br />
jeune prince à peine entré en fonction. Auguste, à l’inverse, avait tout fait pour maintenir la<br />
fiction d’une République sauvegardée, et s’était bien méfié de tout ce qui pouvait rappeler, de<br />
1 Clem. I, VII, 1.<br />
2 Horace, O. III, 15.<br />
3 Sénèque, Tranq. 16, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
226
près ou de loin, l’époque de la monarchie. Malgré les connotations négatives attachées à ce<br />
terme, Sénèque emploie plusieurs fois le mot rex 1 . Mais il prend soin de le débarrasser du<br />
soupçon de tyrannie qui pèse sur lui dès qu’on le prononce. Le roi dont parle le philosophe est<br />
un monarque idéal, maître de lui comme de l’univers, et fidèle aux idéaux des monarchies<br />
hellénistiques 2 . Attentif à la signification des mots, comme tout stoïcien, Sénèque établit<br />
explicitement une distinction fondamentale entre les mots rex et tyrannus. Tous deux exercent<br />
le même type de pouvoir, mais l’un est un père pour ses sujets, et l’autre les réduit en<br />
esclavage 3 . Xerxès apparaît comme l’archétype du tyran, et sert de référence pour juger les<br />
actions de Caligula et son rapport au pouvoir, dans le De brevitate uitae par exemple 4 .<br />
Auguste, au contraire, est le type même du bon roi, exerçant sa souveraineté conformément<br />
aux idéaux du philosophe.<br />
2/ La justification de l’engagement politique de Sénèque.<br />
La contrepartie de cette légitimation philosophique est très importante : si le prince est<br />
assimilé aux dieux, s’il détient une parcelle du Logos universel, alors ses actes doivent être<br />
conformes à la Raison. La première royauté est celle qu’il exerce sur lui-même, comme celle<br />
qu’évoque Sénèque dans le deuxième canticum de Thyeste 5 :<br />
1 Clem. III, 3; IV, 1; IV, 2; VIII, 1; XI, 4; XII, 1…<br />
2 M. T. Griffin, 1976, p. 143.<br />
3 Clem. I, 14, 2 et XII, 1 : le tyran diffère du roi non par son titre, mais par ses actes. Pline reprend<br />
cette idée dans son Panégyrique de Trajan, II, 3.<br />
4 Breu. 18, 5. M. T. Griffin, 1976, p 210.<br />
5 Th. 336-403.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
227
ex est qui posuit metus<br />
et diri mala pectoris... 1<br />
L’ambition tyrannique (ambitio impotens), la sujétion à la faveur inconstante du peuple<br />
(numquam stabilis fauor uulgi), la cupidité, la crainte 2 , sont les maux de l’âme dont le sage<br />
s’exempte et s’affranchit, en s’appliquant à reconnaître les vraies valeurs 3 . La véritable<br />
royauté est donc la sagesse. La position de Sénèque, conseiller et ami du prince, trouve du<br />
même coup sa justification, conformément aux principes du stoïcisme : si le sage ne peut lui-<br />
même être roi, il a vocation à les conseiller.<br />
Si la monarchie est un état de fait, et si l’on ne peut raisonnablement envisager de<br />
mettre en place un autre régime, on peut toutefois s’interroger sur la manière d’exercer le<br />
pouvoir dans les conditions données par la nécessité. Par la même occasion, Sénèque justifie<br />
son rôle d’amicus principis: conformément à la tradition stoïcienne, le philosophe a pour rôle<br />
de conseiller les rois et les grands personnages. C’est ainsi que, dans le De ira, la réflexion sur<br />
le rôle de la colère dans l’exercice du pouvoir s’adresse à Claude, au-delà de Novatus, frère<br />
aîné de Sénèque et destinataire officiel du traité 4 . C’est la colère qui fait du roi un tyran, car<br />
elle mène le souverain à un exercice passionnel du pouvoir. Or, comme l’explique Sénèque,<br />
reprenant un proverbe grec, on ne peut gouverner si l’on ne se gouverne pas soi-même<br />
1 Th. 348-349 : « le roi est celui qui s’est libéré de la crainte, et des vices funestes au cœur. »<br />
2 Th. 350 sq.<br />
3 Ep. 90, 28 : quae sint mala, quae uideantur ostendit. (La sagesse) nous montre quels sont les maux<br />
réels, et ceux qui n’en ont que l’apparence.<br />
4 J. Fillion-Lahille, 1984.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
228
d’abord 1 . C’est en cela que le philosophe est indispensable au souverain, et c’est ainsi que se<br />
justifie la tradition stoïcienne qui fait du sage l’adjuvant principal du pouvoir politique :<br />
Sapiens (…)in commune auxilium natus ac bonum publicum, ex quo dabit cuique<br />
partem. 2<br />
Si la vocation du sage est d’assurer le bien public, c’est de toute évidence auprès du prince<br />
qu’il accomplira le mieux sa tâche. Sénèque, proche conseiller et “ ami ” de Néron, offre une<br />
garantie que le pouvoir s’exercera conformément aux principes fondamentaux développés par<br />
la philosophie stoïcienne : la maîtrise de soi, l’usage modéré et motivé de la répression,<br />
l’intérêt pour la paix extérieure et l’unité intérieure de l’empire, feront du jeune prince le<br />
monarque idéal dont les traités brossent le portrait. Et c’est ainsi, dans son exercice le plus<br />
parfait, que se justifie théoriquement le pouvoir impérial. C’est également de cette manière<br />
que le prince, comme le sage, accède à l’immortalité. Cette idée est reprise dans l’Octavie du<br />
Pseudo-Sénèque, qui reprend la théorie développée dans le De clementia :<br />
1 Sénèque, Ir. II, XV, 4.<br />
Petitur hac caelum uia.<br />
Sic ille patriae primus Augustus parens<br />
Complexus astra est, colitur et templis deus. 3<br />
2 Sénèque, Clem. II, VI, 3 : "le sage est né pour l'aide de tous et pour le bien public, dont il donnera à<br />
chacun sa part."<br />
3 Pseudo-Sénèque, Oct. 476 sq : "C'est par cette voie que l'on atteint le ciel. C'est ainsi qu'Auguste, qui<br />
fut le premier père de la patrie, a obtenu l'apothéose et les temples où il est honoré comme un dieu."<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
229
La sagesse permet au philosophe et au souverain de dépasser la condition mortelle et de<br />
s’affranchir des coups de la fortune. Ainsi, selon Sénèque, l’immortalité du prince est du<br />
même ordre que celle du sage.<br />
Hi tibi dabunt ad aeternitatem iter et te in illum locum ex quo nemo deicitur<br />
subleuabunt. Haec una ratio est extendendae mortalitatis, immo in immortalitatem<br />
uertendae.(…) 1<br />
L’assimilation du sage à la divinité est rendue plus explicite encore dans la suite du texte :<br />
Sapientis ergo multum patet uita; non idem illum qui ceteros terminus cludit; solus<br />
generis humani legibus soluitur; omnia illi saecula ut deo seruiunt. 2<br />
Dans la lettre 73 à Lucilius, Sénèque invite son ami à prendre le chemin de la sagesse, qui<br />
mène au ciel. Entre la divinité et le sage, seule diffère la durée de l’existence, ce qui, comme<br />
le précise Sénèque, ne constitue qu’en apparence un avantage : l’homme de bien n’est pas au-<br />
dessous du dieu dans le domaine de la félicité 3 . D’ailleurs, tout homme possède en lui une<br />
parcelle de divinité, et cette parenté lui permet de s’élever au-dessus de sa condition mortelle,<br />
si le germe présent en chaque âme se développe et grandit convenablement 4 : c’est le but de<br />
l’exercice philosophique que Sénèque propose à Lucilius. On comprend dès lors pourquoi la<br />
1 Sénèque, Breu. XV, 4 : "Ceux-ci (les hommes vertueux) te donneront accès à l'éternité, et t'élèveront<br />
en un lieu d'où nul n'est précipité. C'est le seul moyen de prolonger la vie humaine, et même de la<br />
changer en immortalité."<br />
2 Breu. XV, 5 : "La vie du sage s'étend donc loin ; il n'est pas enfermé dans les mêmes limites que les<br />
autres ; lui seul est affranchi des lois du genre humain ; tous les siècles le servent comme un dieu."<br />
3 Sénèque, Ep. 73, 12.<br />
4 Sénèque, Ep. 73, 16.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
230
vocation du sage est de conseiller les rois : il leur permet d’exercer un gouvernement<br />
conforme à ces préceptes, et d’étendre leur influence sur le plus grand nombre. Ainsi, l’ordre<br />
politique serait à l’image de l’ordre cosmique. Il existe donc des liens étroits entre le sage, le<br />
roi et la divinité, qui justifient l’exercice monarchique du pouvoir, dans certaines conditions,<br />
ainsi que le rôle de Sénèque dans la vie politique de son temps, lorsque son influence à la<br />
Cour était prépondérante.<br />
Le système du principat contribue donc pour une large part à faire du souverain un être<br />
à part, au-dessus de l’humanité moyenne par l’étendue de ses pouvoirs et par la représentation<br />
qu’il donne de lui-même. Le phénomène n’est pas réductible à Néron, qui arrive au pouvoir<br />
alors que le régime est dans les faits une monarchie, même si les institutions républicaines<br />
sont officiellement sauvegardées depuis Auguste. Pour Sénèque, qui joue un rôle important à<br />
ce moment du règne, il s’agit moins de questionner le système que d’examiner de quelle<br />
manière le pouvoir peut être exercé dans les meilleures conditions, compte tenu des<br />
circonstances. Mais la concentration de tous les enjeux politiques autour de la personne du<br />
prince, outre qu’elle le rapproche des héros mythologiques qui inspirent les intrigues<br />
tragiques, donne à son entourage immédiat une importance cruciale, et c’est à la faveur de la<br />
personnalisation du pouvoir que se développe de manière significative l’influence politique<br />
des femmes. Sénèque en sait quelque chose, car jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Néron,<br />
l’évolution de sa carrière a été marquée par des personnages féminins : d’abord sa tante, qui<br />
employa son crédit et ses relations à lui obtenir la questure 1 , puis Agrippine bien sûr, grâce à<br />
laquelle il fut rappelé d’exil et nommé préteur. Sa relégation en Corse avait pour motif officiel<br />
une accusation d’adultère avec Julia Livilla, fille de Germanicus 2 . Plus anecdotique,<br />
1 Helu. 19, 2 : la sœur d’Helvie était veuve du préfet d’Egypte, et conservait à ce titre des relations<br />
précieuses pour son neveu.<br />
2 Dion Cassius, 60, 8.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
231
l’intervention d’une maîtresse de Caligula qui lui évita une élimination prématurée 1 , témoigne<br />
tout de même de l’influence capitale des femmes au plus haut niveau. Ce phénomène<br />
contribue, pour une large part, à donner au principat une dimension tragique.<br />
II/ Le rôle des femmes.<br />
A/ Une ascension politique notable.<br />
1/ Une conquête progressive.<br />
L’avènement du principat coïncide avec l’arrivée sur le devant de la scène de figures<br />
féminines dominatrices et inquiétantes, et qui n’ont rien à envier aux figures légendaires de<br />
Tanaquil ou Tullia. Dans les deux derniers siècles de la République, en effet, les femmes des<br />
classes supérieures participent plus activement à la vie politique romaine, et exercent une<br />
influence bien réelle sur les décisions des hommes, par l’intermédiaire desquels elles<br />
commencent à prendre du pouvoir. Parmi les conjurés qui ont pris part aux menées de<br />
Catilina, par exemple, Salluste cite des femmes dont le rôle n’est pas anecdotique, et en<br />
particulier Sempronia, décrite comme une femme galante, cultivée, instruite et énergique 2 .<br />
Dans la Vie d’Antoine, Plutarque évoque également le rôle de Fulvia, épouse d’Antoine, dans<br />
les décisions politiques de son mari 3 . Si, auparavant, les femmes servaient les ambitions de<br />
1 Dion Cassius, 59, 19, 7.<br />
2 Salluste, Conjuration de Catilina, 25.<br />
3 Plutarque, Ant. 10.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
232
leurs pères et époux, c’était surtout par les alliances que consacraient les mariages. Pompée<br />
épouse ainsi la fille de César, pour des raisons politiques. La mort de Julia, à laquelle Pompée<br />
s’était attaché, consacre la rupture définitive des deux hommes 1 . Par la suite, et en particulier<br />
à la fin de l’époque républicaine, les femmes commencent à prendre une part active à la vie<br />
sociale et politique romaine, et leur rôle devient capital sous l’Empire. En effet, malgré la<br />
politique d’Auguste, et ses tentatives pour consolider la famille et pour favoriser la natalité 2 ,<br />
l’émancipation féminine se poursuit. Le modèle traditionnel perdure toutefois, on le voit par<br />
exemple dans l’éloge que Sénèque fait de sa mère, de sa pudeur et de sa tempérance, qualités<br />
revendiquées de la matrone romaine 3 .<br />
2/ Le rôle des femmes dans la dynastie julio-claudienne.<br />
Les historiens de la période julio-claudienne font une place beaucoup plus large aux<br />
femmes que Tite Live, par exemple, dans ses Histoires, signe de leur rôle incontestable dans<br />
les affaires. En général c’est une présentation critique, qui vise à donner une image plus<br />
négative de la période (ce qui se comprend, compte tenu du contexte de rédaction des œuvres<br />
de Tacite, Suétone et Dion Cassius, sous les Flaviens et les Antonins). Bien que la succession<br />
dynastique ne soit pas établie en droit, l’appartenance à la famille régnante pèse très lourd.<br />
Des rivaux sont éliminés en raison, aussi, de leur illustre lignée, comme Junius Silanus,<br />
descendant d’Auguste, et qui à ce titre pouvait fragiliser le règne commençant de Néron 4 .<br />
1 Y. Roman, 2001, p. 131.<br />
2 G. Achard, La Femme à Rome, Paris, 1995, p. 89-90 ; Suétone, Aug. 34.<br />
3 Sénèque, Ad Helu. XVI, 3-4.<br />
4 Tacite, Ann. XIII, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
233
Tacite précise d’ailleurs que l’initiative de l’empoisonnement revint à Agrippine, qui à l’insu<br />
de son fils, ignaro Nerone, organisa le meurtre du proconsul.<br />
On voit souvent, dans les Annales, des femmes prendre part aux conjurations, au plus<br />
haut niveau de l’Etat : en 39, Caligula fit exiler ses sœurs, Agrippine et Julia Livilla, qui<br />
avaient participé à un complot contre lui. M. Aemilius Lepidus, époux de Drusilla puis amant<br />
d’Agrippine, fut quant à lui exécuté 1 . Lepidus, qui appartenait à la gens Iulia, pouvait songer à<br />
prétendre au pouvoir suprême, d’autant plus que son mariage avec Drusilla, et sa liaison avec<br />
Agrippine après la mort de son épouse, le rapprochait encore de la famille régnante.<br />
De plus, la situation enviée de femme du prince donne lieu à des rivalités meurtrières,<br />
et à des conspirations impitoyables. Agrippine élimine définitivement ses rivales, alors qu’elle<br />
en a triomphé en se voyant préférer par Claude pour succéder à Messaline. Elle suscite contre<br />
Lollia un délateur, qui l’accuse d’avoir consulté des astrologues au sujet du mariage du<br />
prince : la confiscation des biens, l’exil et, pour finir, la mort de Lollia consacrent la victoire<br />
définitive de la nouvelle impératrice. Calpurnia, elle, dut sa perte à une remarque de Claude<br />
sur sa beauté 2 . La conquête de la potentia uxoria 3 suppose, on le voit, une lutte acharnée, sans<br />
merci.<br />
Les amours scandaleuses de Messaline et Silius montrent que le pouvoir en place peut<br />
être déstabilisé par une femme. Tacite précise que la liaison naît à l’initiative de Messaline,<br />
qui force Silius à quitter sa femme. C’est elle qui tire les ficelles de cette sombre affaire, dans<br />
laquelle Silius apparaît comme un personnage pusillanime, qui hésite entre le péril causé par<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 2, 2 : Agrippine se serait donnée à lui dans l’espoir de prendre part au pouvoir, spe<br />
dominationis. Suétone, Cal. 24. Dion Cassius, LIX, 22, 5.<br />
2 Tacite, Ann. XII, 22.<br />
3 Tacite, Ann. XII, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
234
l’adultère et le danger de repousser les avances de l’impératrice 1 . Un commentaire de Tacite<br />
en montre l’importance politique :<br />
Illa non furtim, sed multo comitatu uentitare domum, egressibus adhaerescere, largiri<br />
opes, honores ; postremo, uelut translata iam fortuna, serui, liberti, paratus principis,<br />
apud adulterum uisebantur. 2<br />
C’est en effet le caractère public et quasi officiel de la liaison qui est ainsi soulignée avec<br />
insistance. Messaline se comporte non pas en femme coupable qui agirait clandestinement,<br />
furtim, mais demeure en la circonstance l’impératrice, et accompagne ses faveurs de toutes les<br />
marques du pouvoir qui lui sont d’ordinaire attachées : les courtisans, les richesses et les<br />
honneurs. Dès lors, le lustre de l’autorité impériale est comme transmise à son amant, qui se<br />
voit entouré du personnel normalement attaché au prince, comme si Messaline constituait,<br />
finalement, l’attribut décisif du règne.<br />
Alors, quand l’impératrice épouse publiquement son amant, le pouvoir de Claude est<br />
en grand danger, comme le lui dit Narcisse :<br />
An discidium, inquit, tuum nosti ? nam matrimonium Silii uidit populus et senatus et<br />
miles ; ac, ni propere agis, tenet Urbem maritus. 1<br />
1 Tacite, Ann. XI, 12<br />
2 Tacite, Ann. XI, 12 : « (Messaline), loin de se cacher, passait son temps chez lui avec une suite<br />
nombreuse, s’attachait à ses pas, lui prodiguait richesses et honneurs ; enfin, comme si le pouvoir<br />
suprême lui était déjà échu, on voyait les esclaves, les affranchis du prince et la pompe impériale<br />
entourer son amant. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
235
L’un des grands défauts de Claude fut, on le sait 2 , sa faiblesse pour les femmes qui prirent<br />
ainsi sur lui un ascendant critique. L’épisode des noces de Messaline en constitue l’exemple<br />
le plus frappant. Le terme discidium, employé par Narcisse, souligne ce renversement des<br />
forces et des valeurs : c’est le mari qui se voit répudié, et la situation pourrait être cocasse, et<br />
faire songer à une comédie 3 , si l’enjeu n’était pas Rome. La présence du peuple et du Sénat,<br />
comme témoins de l’événement, confirme le caractère politique de l’affaire, et l’expression<br />
tenet Urbem maritus montre par un raccourci expressif ce basculement de la farce du mari<br />
cocu dans la tragédie du roi détrôné.<br />
3/ Livie et Agrippine : femmes de pouvoir, femmes au pouvoir.<br />
L’ascension politique des femmes va jusqu’à l’extrême, impensable pour un vieux<br />
républicain : les femmes veulent exercer ce pouvoir qu’elle savent désormais conquérir.<br />
Comme il leur est impossible de régner personnellement, elles s’attachent alors de toutes leurs<br />
forces, qui sont parfois considérables, à la carrière de leur fils. Les deux exemples les plus<br />
significatifs, et les plus célèbres, sont ceux d’Agrippine et de Livie 4 . Celle-ci joua semble-t-il<br />
un rôle déterminant lors de la succession d’Auguste, la première du régime : Tibère se<br />
1 XI, 30 : « Est-ce que tu sais, dit-il, que tu es répudié ? car le mariage de Silius a eu pour témoins le<br />
peuple, le Sénat et l’armée ; et si tu n’agis pas promptement, Rome est aux mains de cet époux. »<br />
2 Suétone, Claud. 29, 1, par exemple, le dit « livré à ses femmes », uxoribus addictus.<br />
3 Suétone ne prend d’ailleurs pas la menace au sérieux, et choisit dans sa relation de présenter Claude<br />
sous un jour ridicule et honteux, mû par la peur plus que par le sentiment de l’outrage, et se voyant<br />
hâtivement détrôné : Claud. 36.<br />
4 L. W. Rutland, 1978/79.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
236
trouvait alors à Rhodes 1 , tandis que l’état de santé du prince se dégradait, et que se soulevait<br />
parmi ses proches et dans les rangs des sénateurs la question du choix de son successeur. En<br />
attendant le retour de son fils, Livie isola Auguste en faisant garder étroitement le palais, et<br />
multiplia pour le peuple les messages rassurants, afin que l’on apprenne en même temps la<br />
mort du prince et l’avènement de Tibère 2 . Son influence dans l’accession au pouvoir de son<br />
fils apparaît ainsi déterminante, alors que le principe de succession à l’empire n’avait fait<br />
l’objet d’aucune législation précise, dans la mesure où le régime ne se présentait,<br />
théoriquement, pas comme une monarchie. Celle que Caligula avait surnommée Vlixem<br />
stolatum 3 , est présentée dans les textes de deux manières : c’est l’épouse fidèle et avisée<br />
d’Auguste, qui l’aide par exemple à résoudre le problème posé par la conjuration de Cinna 4 ,<br />
ou une intrigante qui ne recule devant rien pour assurer l’accession au trône de son fils 5 . Les<br />
privilèges accordés à Livie tendraient cependant à la placer hors de la sphère étatique, en la<br />
rapprochant des vestales : en effet, Tibère s’est systématiquement opposé à ce que l’on<br />
décerne à sa mère des honneurs qui lui donneraient une position politique centrale : il lui<br />
refuse le titre de Mater Patriae, et le licteur que les sénateurs étaient prêts à lui accorder 6 .<br />
Suétone témoigne de l’opposition du prince à sa mère, et des vaines tentatives de celle-ci pour<br />
s’associer au pouvoir de son fils 7 . Eloignée par son fils, jusqu’à sa mort, Livie n’a donc pas pu<br />
exercer l’influence qu’elle aurait souhaitée.<br />
Elle fournit toutefois un exemple à la mère d’un autre empereur, Agrippine, dont les<br />
actions rappellent souvent celles de Livie. En particulier, l’épisode de la mort de Claude et de<br />
1 Tacite, Ann. I, 4.<br />
2 Tacite, Ann. I, 5.<br />
3 Suétone, Cal. 23.<br />
4 Sénèque, Clem. I, 9, 9, 6-12.<br />
5 C. Gafforini, 1996.<br />
6 Tacite, Ann. I, 14.<br />
7 Suétone, Tib. 50.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
237
la transmission du pouvoir impérial reprend, à bien des égards, les manœuvres de Livie 1 .<br />
Alors que le prince est mourant, Agrippine fait régner autour de lui une atmosphère de secret,<br />
tenant éloignés les enfants de Claude, et en particulier Britannicus, qui constitue le danger le<br />
plus immédiat. Ce n’est que lorsqu’elle est certaine du soutien des prétoriens et du Sénat<br />
qu’elle sort du palais, accompagnée de son fils Néron. Comme dans le cas de l’avènement de<br />
Tibère, l’annonce de la mort du prince est différée, afin de préparer l’avènement de son<br />
successeur. Encore une fois, c’est l’épouse de ce prince qui tire les ficelles de cette comédie<br />
du deuil, dans le but spécifiquement politique de maintenir et d’affirmer son pouvoir. Et<br />
même, selon Tacite, Agrippine était jalouse d’égaler la magnificence de sa bisaïeule, lors des<br />
obsèques de Claude 2 . Il en fait explicitement une émule de Livie, et le parallèle s’impose, sur<br />
bien des points.<br />
Agrippine faillit réussir là où Livie avait échoué, et aurait sans doute été plus loin dans<br />
sa participation au pouvoir 3 , sans les obstacles que lui opposaient Sénèque et Burrus, qu’elle<br />
avait elle-même placés aux côtés de Néron pour servir ses desseins. Au début du règne de<br />
Néron, sa domination se manifeste par des signes matériels : son buste figure sur le revers de<br />
monnaies avec la légende QEAN AGRIPPINAN, alors que sur l’avers est représentée une tête<br />
de Néron couronnée de lauriers 4 . Elle obtient les licteurs que Tibère avait refusés à sa mère 5 ,<br />
son nom est donné à la capitale des Ubiens 6 . La place éminente qu’elle occupe auprès de son<br />
fils se marque également de manière symbolique, dès le début du règne de Néron : le premier<br />
jour du principat, le prince donne en effet au tribun de garde le mot d’ordre « la meilleure des<br />
1 Tacite, Ann. XII, 67-69 ; cf E. Cattaneo, 1958.<br />
2 Tacite, Ann. XII, 69.<br />
3 consortium imperii : Tacite, Ann. XIV, 11, 1.<br />
4 E. M. Smallwood, 1967, no 141, p. 52.<br />
5 Tacite, Ann. XIII, 2.<br />
6 Tacite, Ann.. XII, 27.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
238
mères », et partage sa litière avec sa mère, privilège hautement significatif 1 . En outre,<br />
Agrippine reçoit des cohortes le serment de fidélité, « déshonneur » que partagent le Sénat et<br />
le peuple, qui prêtent le même serment 2 . Elle conserve la garde militaire qu’elle s’était vue<br />
accorder en tant qu’épouse de Claude, et Néron y adjoint encore des soldats germains 3 .<br />
Autrement dit, elle prend part à toutes les prérogatives du pouvoir impérial. Elle est en bonne<br />
voie pour obtenir le partage du pouvoir, mais Sénèque donne un coup d’arrêt, lors de<br />
l’épisode des ambassadeurs d’Arménie, au cours duquel, sous couvert de respect filial, il<br />
éconduit sa mère et l’empêche de siéger à ses côtés, comme elle en avait l’intention 4 . Et<br />
pourtant, sous le règne de Claude, l’impératrice avait siégé aux côtés de l’empereur et reçu les<br />
mêmes hommages de Caractacus après sa défaite 5 . Par une manœuvre dont Tacite souligne le<br />
caractère ironique 6 , Agrippine est rappelée à la sphère familiale et privée, alors que c’est<br />
justement comme épouse puis comme mère du prince qu’elle entendait étendre son pouvoir<br />
politique.<br />
B/ Femmes et pouvoir dans les tragédies de Sénèque.<br />
1/ La double trahison de Phèdre.<br />
1 Suétone, Ner. 9 ; Tacite, Ann. XIII, 2.<br />
2 Tacite, Ann. XIV, 11 ; cf I, 7, 2.<br />
3 Par la suite, Néron lui ôte ce privilège : Tacite, Ann. XIII, 18 ; Dion Cassius, 61, 8, 4-5.<br />
4 Tacite, Ann. XIII, 5 ; Dion Cassius, 61, 3, 3-4.<br />
5 Tacite, Ann. XII, 37.<br />
6 Ita specie pietatis obuiam itum dedecori : Ann. XIII, 5, 2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
239
Les femmes des tragédies voient leur rôle familial et politique coïncider jusqu’à se<br />
confondre, et la présence des femmes témoigne du rapprochement entre sphères politique et<br />
privée. Ainsi, l’obéissance que Phèdre doit à Thésée est à la fois celle d’une épouse et celle de<br />
l’un de ses sujets, comme le lui rappelle sa nourrice, qui veut la ramener à la raison et à son<br />
devoir, le decus :<br />
Quid deceat alto praeditam solio uides :<br />
metue ac uerere sceptra remeantis uiri. 1<br />
Phèdre, régente en l’absence de Thésée, offre à Hippolyte de prendre, politiquement, la place<br />
de son père :<br />
te imperia regere, me decet iussa exsequi ;<br />
muliebre non est regna tutari urbium... 2<br />
La spécificité de la condition de reine a donc pour conséquence qu’offrir le pouvoir revient à<br />
s’offrir comme épouse. Mais Phèdre connaît alors un double échec, puisque Hippolyte hait les<br />
femmes et ne se soucie pas d’action politique, au sens le plus large du terme, comme en<br />
témoigne sa passion de la chasse, à laquelle est consacré le prologue 3 , ainsi que son désir de<br />
1 Phaed. 216-217 : « Tu vois ce qui convient à une femme élevée au trône : craindre et respecter le<br />
sceptre de ton époux qui revient. »<br />
2 Phaed. 618-619 : « C’est à toi d’exercer le pouvoir, et à moi d’obéir aux ordres. Il ne convient pas à<br />
une femme de veiller à la sauvegarde de la royauté dans les cités. » L’idée que des deux sexes, l’un est<br />
fait pour obéir, et l’autre pour commander, est exprimée dans les premières phrases du De constantia<br />
sapientis.<br />
3 Phaed. 1-84 ; F. Dupont, 1991, p. 124-135.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
240
vivre à l’écart de la société des hommes 1 . Une farouche aspiration à la pureté, et un<br />
éloignement revendiqué de toute ambition, rendent Hippolyte inaccessible au désir de Phèdre.<br />
2/ Mégare : la loyauté comme arme politique.<br />
Confrontée elle aussi à l’absence de son mari, Mégare, dans Hercule Furieux, campe<br />
contrairement à Phèdre un personnage d’épouse fidèle et de reine loyale. Elle représente en<br />
outre un enjeu politique d’importance, puisque Lycus veut l’épouser pour légitimer sa<br />
position après son coup d’état :<br />
Alieno in loco<br />
haut stabile regnum est ; una sed nostras potest<br />
fundare uires uincta regali face<br />
thalamisque Megara... 2<br />
L’usurpateur développe une théorie dont l’empire a éprouvé la validité. En effet, les unions<br />
comptent au nombre des manœuvres politiques avantageuses afin de conquérir ou de<br />
conserver le pouvoir : c’est ce que pensait Séjan, par exemple, lorsqu’il séduisit Livie la<br />
Jeune, belle-fille de Tibère, dans l’espoir que cette union lui permettrait de se rapprocher du<br />
trône 3 . Macron, autre préfet du prétoire grisé par l’ambition, adopta une stratégie du même<br />
type en poussant sa femme Ennia dans les bras de Caligula, avec la mission d’obtenir du<br />
1 Phaed. 483 sq.<br />
2 Herc. f. 344-347 : « Usurpé, le pouvoir royal n’est pas stable ; Mégare, et elle seule, me permettra<br />
d’asseoir ma puissance, par les liens d’un mariage royal et de la couche nuptiale. »<br />
3 Tacite, Ann. IV, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
241
jeune homme une promesse de mariage 1 . Plus que le pouvoir des sentiments, c’est bien<br />
entendu le lien constitué par le mariage qui constitue ici une arme politique, car il établit une<br />
union qui légitime les ambitions politiques de ceux qui les contractent.<br />
Dans Hercule Furieux, en effet, le mariage est présenté comme un acte politique, un<br />
traité de paix, par lequel vainqueur et vaincus oublient leurs dissensions et s’accordent pour<br />
assurer la paix future 2 . La manière dont Lycus présente sa demande fait penser à des<br />
négociations diplomatiques :<br />
Pacem reduci uelle uictori expedit,<br />
uicto necesse est. Particeps regno ueni ;<br />
sociemus animis, pignus hoc fidei cape :<br />
continge dextram. 3<br />
Le raisonnement de Lycus se fonde sur l’affirmation de la coïncidence des rôles conjugal et<br />
politique. La personne politique primant sur l’individu, Mégare affirmerait sa fidélité en<br />
demeurant l’épouse du roi, même si cette fonction est incarnée par lui, Lycus, et non plus par<br />
Hercule. La réponse de Mégare renverse le sophisme, et rappelle l’imposture de Lycus : ayant<br />
conquis son pouvoir par la violence et les crimes, il n’est qu’un usurpateur que seuls ses<br />
forfaits signalent au monde. En restant fidèle à Hercule, à son devoir d’épouse, malgré la<br />
1 Tacite, Ann. VI, 45.<br />
2 L’épisode est d’autant plus intéressant qu’il résulte d’une innovation de Sénèque par rapport à ses<br />
prédécesseurs.<br />
3 Herc. f. 368-371 : « Vouloir que la paix revienne est avantageux pour le vainqueur, indispensable<br />
pour le vaincu. Viens prendre part au pouvoir royal : associons nos cœurs, prends ce gage de ma foi :<br />
touche ma main droite. » cf 402-413.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
242
mention ironique qu’en fait le tyran au vers 398 1 , Mégare dans le même temps met<br />
l’usurpateur en face de son imposture : elle reste fidèle au véritable roi en demeurant loyale<br />
envers son époux. En refusant le mariage, qui affermirait la position de son ennemi, elle<br />
l’empêche doublement de s’affirmer comme roi à part entière. Contre le tyran, il lui reste<br />
l’ultime recours de la mort libératrice, dernier témoignage de sa liberté 2 .<br />
C/ Impératrices et héroïnes tragiques : représentations communes.<br />
Dans les tragédies de Sénèque, la place accordée aux femmes et le rôle qu’elles jouent<br />
dans les différentes crises invitent donc à prendre en compte le cadre politique particulier du<br />
Haut Empire. R. Martin 3 a souligné cette importance accordée au rôle des femmes dans la<br />
littérature de l’époque, et a attribué cette inspiration nouvelle aux mutations sociales et<br />
politiques, qui ont vu les femmes prendre une place de plus en plus grande dans les affaires<br />
les plus cruciales de l’empire. A cette époque, les personnages féminins sont fréquemment<br />
présentés comme des êtres à la fois puissants et redoutables, investis d’un pouvoir quasi-<br />
maléfique, et dont les actions sont, à tout coup, destructrices. R. Martin élabore son étude à<br />
partir de deux séries de trois exemples, dont l’une appartient à l’histoire des Annales de<br />
Tacite, et l’autre, justement, aux tragédies de Sénèque. Chaque personnage historique trouve<br />
dans l’univers tragique un reflet assez troublant de lui-même : à Phèdre, Clytemnestre et<br />
Médée correspondent respectivement Messaline, Agrippine et Poppée. Il ne s’agit pas à<br />
1 disce regum imperia ab Alcide pati : « Apprends à te soumettre aux ordres des rois, comme tu l’as<br />
appris d’Alcide. »<br />
2 Herc. f. 419-421.<br />
3 R. Martin, 1995.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
243
proprement parler d’allusions ou de mises en code, mais de l’expression d’un imaginaire<br />
commun, nourri de figures féminines réelles, et qui se manifeste dans le théâtre de Sénèque.<br />
1/ Phèdre et Messaline : le furor amoureux.<br />
Phèdre et Messaline, tout d’abord, sont toutes deux soumises à un amour qui les<br />
conduit au crime. Tacite présente Messaline comme un être esclave de ses passions, qui<br />
l’amènent à tous les excès, comme en témoigne sa recherche frénétique des incognitas<br />
libidines 1 . Le point culminant de cette course à l’infamie est atteint lorsqu’elle épouse<br />
publiquement son amant, Silius, et qu’elle se rend coupable simultanément de lèse majesté et<br />
d’adultère. D’ailleurs, dans ce mariage, c’est l’ampleur même de l’infamie qui la séduit,<br />
comme le souligne Tacite dans l’expression oxymorique ob magnitudinem infamiae. Ainsi la<br />
logique déréglée de la folie pousse l’impératrice à dépasser toutes les limites concevables, et<br />
en même temps précipite sa chute 2 . Cet invraisemblable mariage de Messaline peut avoir un<br />
fondement politique, affirmant résolument une influence antonienne, bien loin de la politique<br />
menée par Claude. Le scandale qui en résulte peut même rappeler la fameuse affaire des<br />
1 Tacite, Ann. XI, 26, 1.<br />
2 L’atmosphère délirante qui entoure cet épisode du règne de Claude est encore accentuée par sa<br />
coloration dionysiaque : Tacite décrit une fête organisée par Messaline, alors même que Claude est<br />
dans les affres de la terreur, craignant de se voir supplanter par Silius dans sa fonction d’empereur,<br />
comme il l’est déjà dans son rôle d’époux. Le cadre, tout d’abord, évoque l’époque des vendanges,<br />
régulièrement consacrée à Dionysos. Le vin coule à flot, entraînant, comme de coutume, une joyeuse<br />
licence. Mais il y a plus, Messaline et les femmes de son entourage apparaissent comme de véritables<br />
ménades. Revêtues de peaux de bêtes, qui rappellent les nébrides ou les pardalides, attributs<br />
traditionnels de celles qui s’adonnent à la transe bacchique, elles se livrent à une danse désordonnée,<br />
comme l’exprime le verbe assultabant. Au milieu de cette troupe frénétique, Messaline, le thyrse à la<br />
main, semble véritablement possédée par le délire dionysiaque : H. Jeanmaire, 1951, p. 159.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
244
Bacchanales de 186 1 . Messaline est littéralement hors d’elle, rendue véritablement furieuse et<br />
ne concevant même plus les conséquences de ses actes, malgré les paroles prophétiques de<br />
Vectius Valens, annonçant l’arrivée d’un orage furieux 2 . Cette folie précipite sa chute et<br />
provoque sa mort.<br />
Phèdre paraît elle aussi en proie à la passion qui la dévore comme une maladie : aux<br />
vers 360-386, la nourrice en décrit les ravages sur le visage de sa maîtresse 3 , dans un passage<br />
qui rappelle la doctrine développée dans les œuvres en prose 4 . Hors d’elle-même, Phèdre l’est<br />
aussi, quand elle évoque le rêve impossible de suivre Hippolyte dans les contrées sauvages 5 ,<br />
elle assiste impuissante à l’évolution de son mal, et se débat en vain. Sa mort est alors le<br />
refuge de sa liberté :<br />
O mors amoris una sedamen mali,<br />
o mors pudoris maximum laesi decus,<br />
confugimus ad te : pande placatos sinus. 6<br />
Messaline et Phèdre apparaissent donc toutes deux comme les victimes d’une passion<br />
coupable et irrépressible, qui leur fait oublier leurs devoirs et met en danger la stabilité du<br />
trône.<br />
1 H. Jeanmaire, 1951, p. 453.<br />
2 Tacite, Ann. XI, 31 : tempestatem ab Ostia ferocem.<br />
3 Sur la présence physique de la passion dans les tragédies : M. Armisen-Marchetti, 1989 ; J. Fillion-<br />
Lahille, 1984. L’effet des passions apparaît sur le visage des personnages dans les tragédies, par<br />
exemple : Phaed. 363-383 ; Med. 380-396 ; 849-69 ; Tro. 615-18 ; 623-26 ; Œd. 921-25 ; Ag. 128 ;<br />
Herc. f. 329-30.<br />
4 Ep. 52, 12 ; 106, 5 ; 114, 3. M. Armisen-Marchetti, 1992.<br />
5 Phaed. 387-403.<br />
6 Phaed. 1188-1190 : « Ô mort, unique remède d’un amour pervers, ô mort, toi qui conviens le mieux<br />
à mon honneur flétri, je me réfugie vers toi : ouvre-moi ton sein où réside la paix. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
245
2/ Clytemnestre et Agrippine : la libido dominandi.<br />
La Clytemnestre d’Agamemnon partage avec Agrippine la passion du pouvoir, cette<br />
libido dominandi qui motive ses actions et justifie ses crimes à ses yeux. Clytemnestre finit<br />
par prendre la tête du coup d’Etat, et dirige Egisthe, qui est présenté comme un être faible et<br />
sans consistance. Clytemnestre représente le pouvoir politique des femmes, dans tout ce qu’il<br />
peut avoir d’inquiétant. Comme Phèdre, elle est en position de régente, fonction qu’elle<br />
évoque au passé, dans les vers 109-111 :<br />
Licuit pudicos coniugis quondam toros<br />
et sceptra casta uidua tutari fide. 1<br />
Si le système de la régence n’existe pas en droit sous l’empire, la situation des femmes des<br />
empereurs devait s’en rapprocher plus ou moins, dans la mesure où elles pouvaient assurer un<br />
semblant de continuité au régime dans les périodes de transition. C’est ce que firent Livie et<br />
Agrippine.<br />
Femme de pouvoir, Clytemnestre utilise les armes politiques des femmes, le meurtre et<br />
le poison 2 . Elle justifie ses intentions criminelles en mettant en avant la continuité dynastique,<br />
qui est une préoccupation officieuse mais bien réelle de la période julio-claudienne : par<br />
exemple l’un des arguments en faveur d’Agrippine pour le choix de la prochaine épouse de<br />
1 « Tu pouvais jadis garder chaste la couche conjugale, et tenir en épouse fidèle le sceptre confié à tes<br />
mains ». cf Eschyle, Agamemnon, 259 sq et 606 sq.<br />
2 Ag. 119-124. Ces armes typiquement « féminines » sont également évoquées par Euripide (par<br />
exemple, Andromaque, 157).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
246
Claude, après l’exécution de Messaline, est qu’elle associerait à la famille impériale un petit-<br />
fils de Germanicus, réunissant ainsi tous les descendants de la gens claudia 1 . Clytemnestre<br />
prétend éviter par le régicide que le pouvoir royal ne se perde, en tombant aux mains de la<br />
phrygienne Cassandre 2 . Elle accomplit elle-même le crime, et porte à son époux le coup<br />
mortel 3 . Egisthe, dans sa pusillanimité, n’est en effet pas allé au bout de son geste. Cassandre<br />
le qualifie d’ailleurs de semiuir, efféminé 4 . Des deux assassins, Clytemnestre apparaît, et de<br />
loin, comme la plus virile, une meurtrière impitoyable capable de manier la hache, mais qui<br />
ne cesse de réagir en reine, elle dont les actions sont motivées par la volonté de conserver son<br />
pouvoir 5 . Agrippine qui, bien que blessée, parvient à nager jusqu’au rivage après le<br />
« naufrage » de son bateau, pour faire porter à son fils la bonne nouvelle de son sauvetage,<br />
témoigne sans nul doute de la même détermination et de la même force. Sans aller jusqu’à<br />
parler de modèle, on peut toutefois affirmer qu’un tel personnage de femme trouve une<br />
consistance bien plus grande si l’on tient compte du contexte politique de l’époque. Agrippine<br />
dans l’histoire surgit au moment où Clytemnestre prend corps dans la littérature, à un moment<br />
où les hommes se sentent le jouet, ou même la victime de ces êtres effrayants.<br />
3/ Médée et Poppée : les ensorceleuses.<br />
Enfin, Poppée, comme la Médée de Sénèque, sont mises en relation l’une avec l’autre,<br />
dans l’étude de R. Martin, comme deux figures de calcul pervers et de propension aux<br />
1 Tacite, Ann. XII, 2.<br />
2 Ag. 194.<br />
3 Id. 897 sq.<br />
4 Id. 890.<br />
5 Par exemple, vers 579 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
247
machinations les plus diaboliques. Face à un Jason sans grande consistance, Médée accomplit<br />
sur scène le meurtre de ses enfants, contrevenant ainsi aux règles du théâtre antique. Elle joue<br />
de tous ses artifices pour ourdir la perte de ses ennemis, et par la ruse s’apprête à accomplir<br />
une vengeance impitoyable. Dans les Annales, Néron apparaît comme un enfant docile dans<br />
les mains de Poppée, qui le mène où elle veut en alternant cajoleries et réprimandes 1 . C’est<br />
une ensorceleuse, qui possède les secrets de la séduction comme la Colchidienne détient les<br />
formules magiques des philtres les plus puissants. Depuis longtemps, à Rome, la sorcellerie<br />
est convoquée pour lier des amants, les poètes élégiaques se sont largement fait l’écho de ces<br />
pratiques 2 , qui lient magie et séduction. En la matière, la puissance de Poppée est indéniable,<br />
et elle fait d’elle une redoutable sorcière.<br />
Quelle signification peut-on donner à ce parallélisme ? La question des allusions dans<br />
les tragédies de Sénèque, et du rapport que l’on peut y établir entre personnages tragiques et<br />
historiques ne saurait se résoudre si facilement. Ce que l’on peut, dans un premier temps,<br />
proposer comme hypothèse de travail, c’est que la littérature dessine, avec les tragédies de<br />
Sénèque, des personnages féminins puissants et redoutables, incarnant des passions violentes<br />
telles que l’amour, l’ambition et la vengeance, à un moment où des femmes occupent une<br />
place plus importante dans la vie politique de leur temps ; que ces passions ont des effets sur<br />
l’Etat, au plus haut niveau, dans la mesure où le pouvoir impérial se concentre au sein d’une<br />
dynastie ; enfin, que les personnages mythologiques sont en quelque sorte revivifiés par<br />
l’atmosphère politique contemporaine, et qu’ils en retirent plus de consistance et de<br />
complexité. Les femmes ont fait des progrès depuis Clytemnestre 3 .<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 1, 1. Sur l’influence de Poppée : Dion Cassius, 61, 11, 3-4.<br />
2 Tibulle, I, II, 43-60 ; Properce, III, 21-30 ; Ovide, Ars, II, 97-107, etc. Cf. Théocrite, Idylles, II.<br />
3 Juvénal, VI, 656-657.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
248
III/ Affaires familiales, affaires d’état : la personnalisation du pouvoir<br />
impérial et ses conséquences.<br />
A/ La question de la légitimité.<br />
1/ Un thème traditionnel.<br />
Le thème de la légitimité du pouvoir est récurrent dans la tragédie républicaine. Les<br />
tragédies de cette période insistent particulièrement sur le contraste entre pouvoir légitime et<br />
tyrannie. Dans les tragédies de Sénèque, ce thème est repris dans un contexte tout aussi<br />
proche. La question de la légitimité du pouvoir et de la continuité dynastique reste en effet<br />
posée avec une acuité particulière sous l’Empire, d’autant plus qu’elle fait intervenir, de<br />
manière plus ou moins nette, la question de la succession et de la continuité dynastique.<br />
A Rome, vers la fin de la République, il est courant de considérer le chef<br />
charismatique comme une sorte de surhomme, dont les victoires sont un signe de l’élection<br />
par les dieux. La vertu du chef est l’une des raisons de cette élection. Les écrivains de<br />
l’époque d’Auguste ont repris cette tradition, selon laquelle l’imperator est un sauveur envoyé<br />
par les dieux. Par exemple, la victoire à Actium en témoigne : la proximité d’un sanctuaire<br />
d’Apollon 1 a placé cette bataille dans ce que l’on pourrait appeler une zone d’influence du<br />
dieu, qui a favorisé son fils dans ces circonstances périlleuses. Mais avant même cet épisode,<br />
qui a marqué fortement la propagande impériale, quelques chefs des temps républicains ont<br />
1 J. R. Fears, 1977, p 319.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
249
été présentés comme des élus des dieux, à l’instar de Scipion l’Africain 1 , ou de Sulla qui<br />
voyait ses succès politiques comme une expression de la volonté divine 2 . Dans le même ordre<br />
d’idée, les songes divins de Sulla rappellent la tradition homérique, par exemple le songe<br />
d’Agamemnon dans l’Iliade 3 . Sulla et ses successeurs ont utilisé dans leur propagande ce<br />
portrait du chef charismatique, agent des dieux divinement choisi. C’est précisément<br />
l’argument que Cicéron invoque, dans le De Lege Manilia, pour appuyer le maintien et<br />
l’extension du commandement de Pompée à l’Est :<br />
Et quisquam dubitabit quin huic hoc tantum bellum transmittendum sit, qui ad omnia<br />
nostrae memoriae bella conficienda diuino quodam consilio natus esse uideatur? 4<br />
Certes, l’idée du dessein divin, diuinum consilium, est manipulée avec quelques précautions<br />
(uideatur), dans une tournure assez vague (quodam), mais le concept est tout de même cité,<br />
en même temps qu’est rappelé, avec la double occurrence de bellum, le caractère crucial de<br />
l’enjeu : omnia nostrae memoriae bella.<br />
L'idée que le prince est d’ascendance divine, si elle suppose un lien plus étroit avec les<br />
dieux, participe de la même volonté de légitimer le pouvoir impérial, en mettant cette fois en<br />
avant la nature extraordinaire du souverain. Exerçant une autorité absolue sur une bonne<br />
partie de l'univers, associé à la divinité de Rome, l'empereur participe de la nature divine, et<br />
son ascendance l'atteste, au moins de manière symbolique. Auguste, après avoir, au début de<br />
1 J. R. Fears, 1977, p 89 et 92.<br />
2 Plutarque, Sulla, 6.9 ; 19.8-10 ; 27.12.<br />
3 Homère, Iliade, II, 1-40.<br />
4 Cicéron, De lege Manilia, 14,42 : « et on hésitera à confier le soin de cette guerre si importante à un<br />
homme qui semble né, selon un dessein divin, pour venir à bout de toutes les guerres de notre temps<br />
? »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
250
son règne, privilégié la thèse de la délégation divine, s'en est peu à peu éloigné au profit de<br />
celle de l'origine divine de sa famille et du culte de Diuus Iulius. Une étape est ainsi franchie,<br />
qui rapproche encore le prince de la divinité. Mais il semble que cet infléchissement de la<br />
propagande impériale doive être mis en rapport avec le souci de la pérennité du régime : la<br />
succession dynastique ne pouvant être officiellement établie, sous peine de renier trop<br />
ouvertement la République et ses institutions, et surtout de rappeler une monarchie de sinistre<br />
mémoire, la mise en avant d'une ascendance divine, déjà admise en ce qui concerne les<br />
grandes familles romaine, permet de confisquer, par des voies détournées, le pouvoir au profit<br />
d'une gens. Ainsi, le rapport entre l'empereur et les dieux est mis en avant en vue de la<br />
légitimation tout à la fois d'un homme et d'un régime politique, pour permettre au principat de<br />
s'établir fermement. Mais la proximité du prince et de la divinité est également invoquée<br />
quand il s'agit de l'exercice du pouvoir impérial.<br />
2/ Le problème de la légitimité dans les tragédies de Sénèque.<br />
Dans quatre tragédies de Sénèque, la question de la légitimité du pouvoir est le thème<br />
central : Thyeste, Agamemnon, Les Phéniciennes et Œdipe. Dans Thyeste, tout d’abord, le<br />
crime d’Atrée est motivé par la nécessité de conquérir le pouvoir dans son intégralité. Atrée<br />
pose l’enjeu de son combat contre son frère. Il ne s’agit pas d’une simple trahison, d’un<br />
adultère habituel. Thyeste a rendu fragile sa succession, en faisant planer le doute sur la<br />
légitimité de sa descendance : fraude turbauit domum. Dans la tirade où il laisse éclater ses<br />
griefs contre son frère, Atrée insiste davantage sur le vol du bélier sacré, emblème du pouvoir<br />
de la maison de Pélops. Il ne s’agit donc pas, ou pas seulement, d’une affaire de famille, mais<br />
bel et bien d’une affaire d’Etat, dont l’enjeu est la conquête et la conservation du pouvoir<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
251
suprême. Thyeste et Atrée, tous deux fils de Tantale, peuvent l’un et l’autre prétendre au<br />
trône, comme le rappelle hypocritement Atrée pour attirer son frère dans le piège qu’il a<br />
préparé pour lui :<br />
(...)laetusque fraterni imperi<br />
capesse partem. Maior haec laus est mea<br />
fratri paternum reddere encolumi decus. 1<br />
Atrée se montre également soucieux d’assurer sa succession, c’est pour cette raison qu’il<br />
cherche à apaiser les doutes provoqués par l’infidélité de sa femme, et à tenir une preuve que<br />
Ménélas et Agamemnon, sont bien ses enfants légitimes :<br />
Consili Agamemnon mei<br />
sciens minister fiat et fratri sciens<br />
Menelaus adsit. Prolis incertae fides<br />
ex hoc petatur scelere. 2<br />
C’est dans leur participation à la vengeance paternelle que les fils prouvent leur appartenance<br />
à la lignée d’Atrée : la confirmation de leur naissance coïncide donc avec l’affirmation de leur<br />
nature criminelle. C’est ce que révèlent, également, Egisthe et Clytemnestre, dans<br />
Agamemnon, au moment de l’assassinat du roi.<br />
1 Th. 526-528 : « accepte avec joie une part du pouvoir de ton frère. Je tirerai une gloire plus grande<br />
d’avoir rendu à mon frère sain et sauf la place d’honneur qui lui vient de notre père. »<br />
2 Th. 325-327 : « Qu’Agamemnon sache qu’il est l’agent de mon dessein, et que Ménélas assiste son<br />
frère en connaissance de cause. C’est dans ce crime qu’il me faut chercher la confirmation d’une<br />
ascendance dont je doute. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
252
L’exercice légitime du pouvoir se fonde principalement sur la continuité dynastique :<br />
les rois sont fils de rois, et leurs enfants prétendent au trône. L’importance de la lignée,<br />
soulignée à mainte reprise dans les pièces, témoigne du caractère crucial que prit cette<br />
question sous l’Empire. En effet, le principe de la succession dynastique n’était pas établi en<br />
droit, mais les princes régnants se sont attachés à assurer l’accession au trône de leurs<br />
héritiers. Dans les tragédies, qu’ils exercent ou non le pouvoir, de nombreux personnages sont<br />
en position au moins d’y prétendre légitimement. Comme Thyeste, Les Phéniciennes<br />
développent le thème de la succession et de la rivalité des frères, prêts à tout pour conquérir le<br />
trône paternel. Etéocle et Polynice, tous deux fils d’Œdipe et comme lui issus d’une souche<br />
royale, regia stirpe 1 , ont des raisons de prétendre à l’exercice de la royauté sur Thèbes. Cette<br />
double légitimité est à l’origine de leur culpabilité, mais elle n’en est pas la cause.<br />
Dans les deux tragédies où il figure en tant que souverain 2 , Agamemnon est<br />
régulièrement présenté comme le roi des rois, conformément à la tradition homérique. Sa<br />
légitimité ne fait donc guère de doute, lorsque, par exemple, Hélène le désigne comme regum<br />
maximus rector 3 , ou lorsque la nourrice de Clytemnestre oppose le roi des rois à l’exilé<br />
Egisthe 4 . Le thème d’Agamemnon est en effet le coup d’état fomenté par la reine adultère et<br />
son amant, exilé, fils incestueux et usurpateur, dans la continuité de la malédiction qui frappe<br />
la maison de Tantale, comme le rappelle l’ombre de Thyeste dans le prologue 5 . Dans le<br />
dialogue qui le confronte à la nourrice, Egisthe tente d’affirmer contre Agamemnon une<br />
légitimité équivalente, en se réclamant de son ascendance :<br />
1 Phœn. 320.<br />
2 Il s’agit des Troyennes et d’Agamemnon.<br />
3 Tro. 978 : « le chef suprême des rois ».<br />
4 Ag. 291.<br />
5 Ag. 1-56.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
253
Et cur Atrida uideor inferior tibi<br />
gnatus Thyestae ? 1<br />
Mais cet argument montre vite ses limites : la naissance d’Egisthe est entachée d’un crime, et<br />
il s’emparera du pouvoir par un meurtre. Ainsi, l’ascendance de l’usurpateur ne se révèle que<br />
dans ses actions violentes, et ne lui confère aucune légitimité, comme le montrent les paroles<br />
de Cassandre, qui commente en ces termes l’assassinat d’Agamemnon :<br />
Vterque tanto scelere respondet suis :<br />
est hic Thyestae gnatus, haec Helenae soror. 2<br />
Le cas d’Œdipe est particulier. Comme Néron, descendant d’Auguste et d’Antoine, il est issu<br />
de deux lignées royales : par ses parents adoptifs, souverains de Corinthe, et par ses parents<br />
naturels, Jocaste et Laius. Au début de la tragédie, il ignore cette double ascendance, mais il<br />
se sait d’origine royale :<br />
Tori iugalis abnuit Merope nefas,<br />
sociata Plybo ; sospes absoluit manus<br />
Polybus meas : uterque defendit parens<br />
caedem stuprumque. 3<br />
1 Ag. 292-93 : « Et en quoi serais-je inférieur au fils d’Atrée, moi, fils de Thyeste ? »<br />
2 Ag. 906-907 : « L’un et l’autre se montrent dignes des leurs par un tel crime : il est fils de Thyeste, et<br />
elle sœur d’Hélène. »<br />
3 Œd. 661-664.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
254
Œdipe règne donc, au début de la pièce, en vertu de ses exploits qui lui ont permis<br />
d’épouser Jocaste, et d’accéder à une légitimité par alliance. Il se trouve ainsi dans la même<br />
situation qu’Hercule, à qui ses exploits ont valu la main de Mégare, et par conséquent, le<br />
royaume de Thèbes 1 . Polynice est lui aussi gendre d’un roi, en plus d’être le fils d’Œdipe. Il se<br />
considère cependant comme un exilé, et aspire en premier lieu au pouvoir auquel sa naissance<br />
lui donne droit : il montre ainsi que la légitimité dynastique l’emporte sur toute alliance<br />
matrimoniale 2 . La légitimité d’Œdipe est donc double, puisqu’elle est aussi la récompense de<br />
ses bienfaits, pretium et merces 3 . Cependant, l’ignorance où il se trouve de sa véritable origine<br />
vient perturber l’ordre dynastique : la destruction de la continuité familiale, en effet, aboutit<br />
au chaos et à l’exil du roi, qui ne peut continuer à régner dans ces conditions. Ironiquement,<br />
Œdipe perd sa légitimité au moment où il découvre le secret de sa naissance : être le fils de<br />
Jocaste et de Laius aurait dû lui permettre de régner sur Thèbes, mais dans les conditions où il<br />
se trouve, la révélation de l’identité de ses parents dévoile son crime.<br />
Le thème de la légitimité et de la succession peut aussi apparaître de manière<br />
périphérique dans les tragédies et occuper une place plus ou moins centrale dans l’intrigue.<br />
Dans Les Troyennes, par exemple, Astyanax représente pour les vainqueurs achéens un enjeu<br />
politique majeur, malgré son jeune âge, que sa mère rappelle à plusieurs reprises pour montrer<br />
son innocence. En effet, il est le dernier survivant de la maison de Priam, et en tant que tel, il<br />
est destiné à prendre la tête d’un royaume dévasté et à le faire renaître de ses cendres.<br />
Andromaque se lamente en ces termes sur ses espoirs déçus :<br />
1 De manière significative, Lycus cherche à affermir son pouvoir, fraîchement conquis par la violence,<br />
en épousant Mégare, afin d’accéder à une légitimité : Herc. f. 345-348.<br />
2 Phœn. 374-377.<br />
3 Œd. 104-105 : Laudis hoc pretium tibi<br />
sceptrum et peremptae Sphingis haec merces datur.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
255
Iliaca non tu sceptra regali potens<br />
gestabis aula, iura nec populis dabis<br />
uictasque gentes sub tuum mittes iugum,<br />
non Graia caedes terga, non Pyrrhum trahes. 1<br />
La mort d’Astyanax, précipité, symboliquement, du haut de la dernière tour de Troie, signifie<br />
à la fois la fin d’une lignée et la chute définitive de la ville, la destruction de son dernier<br />
rempart. Dans cette plainte d’Andromaque, l’emploi du futur, associé à la récurrence des<br />
tournures négatives, montre, avec un désespoir qu’aucune incantation ne peut conjurer, que le<br />
destin d’Astyanax est l’inverse exact de ce qu’il aurait dû être.<br />
Dans Phèdre, la question est évoquée comme en passant, et sert surtout à compléter la<br />
caractérisation d’Hippolyte, et en particulier son peu d’ambition et son désintérêt pour la<br />
politique 2 . En effet, il ne conteste pas un instant la décision de son père, qui destine à sa<br />
succession ses deux autres fils, Acamas et Démophon : il se préoccupe de leur sort, et se<br />
montre inquiet de leur sauvegarde 3 . Libre de tout sentiment de jalousie, d’envie et d’ambition,<br />
il témoigne de sa pietas à leur égard, et promet à Phèdre de veiller sur eux, si un malheur était<br />
arrivé à Thésée 4 . Toutefois, la question de la transmission du pouvoir est significative de la<br />
connexion des intrigues familiale et politique.<br />
Avec le thème de la légitimité, les tragédies de Sénèque suivent la tradition<br />
républicaine et s’inscrivent en même temps dans les débats et préoccupations contemporains.<br />
1 Tro. 771-774 : « Tu ne porteras pas le sceptre d’Ilion, étendant ton autorité sur ta cour royale, tu ne<br />
donneras pas de lois aux peuples, et tu ne plieras pas les nations vaincues sous ton joug, tu ne<br />
massacreras pas les Grecs en fuite, tu ne traîneras pas le corps de Pyrrhus. »<br />
2 Cette condamnation est contenue dans son éloge de la vie sauvage, v. 483 sq, et en particulier dans<br />
les vers 486-493.<br />
3 Phaed. 433-434.<br />
4 Phaed. 631.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
256
La tragédie républicaine, en effet, accorde une place importante au problème que pose<br />
l’usurpateur, qui tente de s’emparer par la force du pouvoir, et impose sa tyrannie après avoir<br />
triomphé du souverain légitime. Cette question prend une acuité particulière au moment où les<br />
chefs militaires acquièrent un pouvoir et une influence tels qu’ils sont susceptibles de mettre<br />
en danger les institutions républicaines, et le principe des magistratures temporaires, électives<br />
et collégiales. Dans cette perspective, l’installation du principat ravive les débats et donne à la<br />
mise en œuvre tragique des mythes une singulière actualité. Ainsi, la coïncidence de la<br />
légitimité dynastique et de l’appartenance à une lignée de criminels connecte très étroitement<br />
le pouvoir et le mal. La violence n’est pas, ou pas seulement, le fait de l’usurpateur, elle n’est<br />
pas le signe qui dénonce le pouvoir illégitime. Ce paradoxe inscrit le tragique au cœur du<br />
pouvoir monarchique : car si la question de la légitimité est importante, elle ne garantit en<br />
aucune manière le juste exercice du pouvoir, et l’on peut être à la fois, au-delà de la<br />
distinction que Sénèque lui-même établit dans son œuvre philosophique, rex et tyrannus.<br />
B/ La personnalisation de l’institution et ses conséquences.<br />
Un trait remarquable de l’établissement du principat est la personnalisation de<br />
l’institution. Le prince a en effet confisqué à son profit le caractère divin qui était attaché à la<br />
res publica. Le pouvoir qui, au temps de la République, était en réalité partagé par les<br />
quelques familles dirigeantes de Rome, échoit à la plus puissante d’entre elles, selon un<br />
double mouvement qui caractérise le passage à l’Empire : d’une part, un transfert de sacralité<br />
de l’Etat vers la personne du prince, qui finit par incarner l’institution, et d’autre part une<br />
extension du modèle familial à l’organisation politique.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
257
1/ La personnalisation institutionnelle et le transfert de sacralité.<br />
Comme le prince devient l’incarnation de l’Etat, sa sauvegarde personnelle se confond<br />
naturellement avec le salut public, dont elle est la condition et la garantie. C’est ainsi que la<br />
notion de Salus principis a progressivement remplacé celle de Salus publica, et ce dès<br />
l’époque de César. Aux uota pro salute rei publicae 1 se sont associées, puis substituées des<br />
prières annuelles pour son salut personnel. De tels vœux se poursuivent sous les empereurs<br />
suivants, et concernent peu à peu tous les membres de la famille régnante 2 . Un autre exemple<br />
significatif de ce transfert de sacralité peut-être trouvé dans les lois de maiestate : il s’agit au<br />
départ de la maiestas 3 de la République et du peuple romain, dont la souveraineté est indiquée<br />
par le comparatif de supériorité maior dont le substantif maiestas est dérivé. Le crimen<br />
maiestatis désigne donc les actes attentatoires à la sûreté de l’Etat et du peuple romain, et<br />
c’est Sulla qui a fait promulguer la première loi de majesté, la lex Cornelia de maiestate. En<br />
15 av. J.-C., Tibère renouvelle la loi sur les crimes de lèse-majesté, en l’appliquant aux<br />
actions ou aux paroles portant atteinte à la dignité du prince 4 . Les atteintes au prince, même<br />
insignifiantes, peuvent alors être considérées comme des sacrilèges : la maiestas principis a<br />
pris la place de la maiestas populi. 5 Sous le règne de Néron, en 62, la loi de majesté est remise<br />
en vigueur à l’encontre d’un préteur, Antistius, qui a écrit un poème satirique contre Néron 6 .<br />
1 Dion Cassius, 44, 6, 1.<br />
2 S. Weinstock, 1971, p 217.<br />
3 G. Dumézil, 1986, p. 128-142 ; J.-L. Ferrary, 1983.<br />
4 Tacite, Ann. I, 72.<br />
5 J. Gaudemet, 1964. Le crimen maiestatis, qui n'a jamais été clairement défini, prend une importance<br />
considérable sous l'Empire.<br />
6 Tacite, Ann. XIV, XLVIII, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
258
Lors du procès, Néron désigne l’affront qui lui a été fait par les termes grauissimae<br />
contumeliae.<br />
Le prince incarne donc à lui seul la majesté de l’Etat, il en confisque le caractère sacré,<br />
ce que Tacite présente comme une étape vers la tyrannie. Il finit par se voir transférer les<br />
épithètes et les attributions de la République. Il s’établit en outre, entre le peuple et<br />
l’empereur, un lien religieux, officialisé par le serment. Octave l’avait exigé des Italiens et des<br />
provinciaux en 32 1 . Ce serment, prêté à l’avènement d’un nouvel empereur, est une extension<br />
du sacramentum qui unit les soldats à leur imperator. Les ennemis du prince deviennent<br />
hostes publici, destinés à être poursuivis et exécutés sans jugement par tous ceux qui avaient<br />
prêté ce serment 2 .<br />
Le titre de pater patriae donne au prince les mêmes droits et les mêmes responsabilités<br />
que celles du père sur ses enfants 3 . L’autorité du pater se superpose, et se substitue<br />
finalement, à celle des patres qui représentaient avec le Sénat le fonctionnement républicain.<br />
Tel est aussi le sens de l’omission du Sénat, lors de l’inauguration des travaux de percement<br />
de l’Isthme de Corinthe, dans le discours de Néron : il souhaite la réussite du projet, pour lui<br />
et pour le peuple romain, sans utiliser la formule consacrée, senatus populusque romanus.<br />
Dans ce cas, c’est la relation d’ordre familial participe plus explicitement à la définition du<br />
lien politique entre le peuple et son dirigeant, reprenant ainsi l’antithèse classique entre le bon<br />
et le mauvais roi, qui peut être un père ou un tyran 4 . Le gouvernement paternel révoque tout<br />
1 Auguste, Res Gestae, XXV, 3-4.<br />
2 J. Le Gall, 1985, p 771.<br />
3 S. Weinstock, 1971, p 200.<br />
4 Cicéron, Rep. I. 64; 2. 47. La même idée est développée par Pline dans le Pan. Traj., 2. 3 ; 21.4.<br />
Ironiquement, Atrée porte sa réflexion sur la distinction entre le bon et le mauvais... tyran (v. 176-<br />
180).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
259
d’abord toute idée d’injustice dans son exercice, puisqu’un bon père se soucie avant tout du<br />
bien de ses enfants, en les corrigeant s’il le faut, mais toujours dans leur intérêt. Il est pour<br />
eux un guide et un exemple, c’est pourquoi l’exercice de ses vertus est fondamental. Par<br />
ailleurs, le lien qui unit un père et ses enfants est, par nature, indissoluble et sacré, et assure<br />
l’unité de la famille, et donc, dans le cas du pater patriae, de l’Etat. Ainsi, c’est la sphère<br />
privée, familiale, qui donne un modèle au gouvernement impérial. Au passage, l’identification<br />
du gouvernant au père justifie le régime en place, puisque cette métaphore convient<br />
parfaitement à une monarchie.<br />
Le développement du culte du Genius impérial est également significatif de<br />
l’extension du domaine privé vers la sphère publique et politique. Sur la base du Genius privé,<br />
et des rites familiaux qui lui étaient attanchés, un Genius d’Etat a été institué au temps de la<br />
République, Genius Publicus ou Genius populi romani. Progressivement, le Genius du prince<br />
s’est substitué à celui de l’Etat, et les célébrations qui avaient lieu dans le cadre de la famille<br />
sont devenues publiques et officielles 1 . Finalement, l’évolution des deux notions de Genius et<br />
de Salus illustre un aspect de la mutation politique que constitue le passage à l’Empire : d’une<br />
part, une confiscation du caractère auguste et sacré de l’Etat par la personne du prince, et<br />
d’autre part, des rites à l’origine privés qui s’étendent à la Cité. Dès lors, et comme dans<br />
l’univers de la tragédie, le destin du souverain s’est souvent confondu avec celui de l’Etat, les<br />
conflits d’ordre familial ayant des conséquences politiques majeures.<br />
2/ histoire et tragédie.<br />
1 S. Weinstock, 1971, p 209-211.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
260
La conséquence de ce que l’on pourrait appeler une privatisation de la politique, est<br />
que les intrigues politiques se confondent avec les intrigues familiales. Dans le livre IV de ses<br />
Annales, Tacite se livre à une digression sur ce sujet : il compare les œuvres des historiens<br />
anciens à son entreprise, et oppose les sujets d’envergure nationale aux intrigues qui se<br />
trament dans le cercle restreint du pouvoir impérial :<br />
nam situs gentium, uarietates proeliorum, clari ducum exitus, retinent ac redintegrant<br />
legentium animum : nos saeua iussa, continuas accusationes, fallaces amicitias,<br />
perniciem innocentium, et easdem exitu causas coniungimus… 1<br />
Dès lors, comme le fait remarquer A. Foucher 2 , l’histoire se rapproche de la tragédie, dans la<br />
mesure où ses événements se concentrent autour d’affaires privées. La suite des Annales<br />
illustrera cette observation.<br />
Le personnage d’Agrippine est particulièrement représentatif de ce phénomène 3 . C’est<br />
sa passion pour le pouvoir qui détermine ses actions. Ainsi, alors que Messaline a dû sa chute<br />
lamentable à ses désirs effrénés, la nouvelle épouse de Claude fait de la passion amoureuse un<br />
instrument au service de son ambition. Lorsque Claude délibère sur le choix d’une épouse<br />
pour remplacer Messaline, Agrippine bénéficie du soutien de Pallas, qu’elle s’attache encore<br />
plus étroitement en entretenant une liaison avec lui 4 . Le dévouement de l’affranchi se<br />
1 Tacite, Ann. IV, 33, 3 : « en effet, la description des populations, les péripéties des combats, les morts<br />
illustres des généraux, retiennent et raniment l’attention des lecteurs ; moi je rassemble les ordres<br />
cruels, les délations sans fin, les amitiés perfides, la perte d’innocents, et des événements qui ont tous<br />
une fin pareille… »<br />
2 A. Foucher, 2000, p. 786.<br />
3 C’est justement le récit de sa mort qu’A. Foucher (2000, p. 792-799) choisit pour illustrer<br />
l’ « écriture tragique » de Tacite.<br />
4 Tacite, Ann. XII, 25.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
261
manifeste encore au moment de l’adoption de Néron, qu’il favorise, permettant à sa maîtresse<br />
de se rapprocher de son but. Claude lui-même se laisse circonvenir par les démonstrations de<br />
tendresse de sa nièce, au point de consentir à un mariage incestueux, que le Sénat se voit<br />
obligé de ratifier 1 . Une rumeur rapporte même que Néron, enclin à s’affranchir de l’influence<br />
écrasante de sa mère, avait fait l’objet de tentatives de séductions scandaleuses de la part de<br />
celle-ci 2 . En effet, le pouvoir auquel les manœuvres d’Agrippine lui ont permis d’accéder<br />
provoque rapidement un conflit avec Néron, ce qui rappelle la situation de Tibère et Livie 3 .<br />
Cette lutte pour le pouvoir d’une mère et de son fils, en ce qu’elle mêle les motivations<br />
familiales et politiques, développe une thématique propre à la tragédie. Elle montre en effet<br />
comment les liens du sang se déchirent sous l’effet des passions, de l’ambition démesurée des<br />
personnages qui courent ainsi à leur perte. Certains épisodes réfèrent précisément à des<br />
situations tragiques : lorsque Agrippine interroge les Chaldéens au sujet de l’avenir de son<br />
fils, la réponse des astrologues fait en quelque sorte figure d’oracle, qui éclaire<br />
rétrospectivement la destinée des protagonistes :<br />
Hunc sui finem multos ante annos crediderat Agrippina contempseratque : nam<br />
consulenti super Nerone responderunt Chaldaei fore ut imperaret matremque<br />
occideret ; atque illa : « Occidat, inquit, dum imperet ! » 4<br />
1 Tacite, Ann. XII, 6.<br />
2 Suétone, Ner. 28 ; Tacite Ann. XIV, 2. Dion Cassius (61, 11) ajoute que Néron aima beaucoup une<br />
courtisane qui ressemblait à sa mère.<br />
3 B. Segura-Ramos, 1998, p. 232.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 9, 3 : « Cette fin qui fut la sienne, Agrippine, bien des années auparavant, en avait<br />
connu et bravé l’annonce : en effet, comme les Chaldéens qu’elle avait consultés, lui avaient répondu<br />
qu’il règnerait, mais qu’il tuerait sa mère, elle avait eu ces mots : Qu’il me tue, pourvu qu’il règne ! »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
262
Ainsi se réalise le destin de l’impératrice, dévorée par sa passion démesurée du pouvoir (une<br />
figure de l’hybris), et qui se trouve à la fois spectatrice et actrice des événements. Sa réponse<br />
à l’oracle, que Tacite tient de Cluvius Rufus, n’est pas sans rappeler le fameux Oderint dum<br />
metuant d’Accius. La prédiction des Chaldéens fait également d’Agrippine une émule de<br />
Clytemnestre, assassinée par son fils, ce qu’elle rappelle par ses dernières paroles : Ventrem<br />
feri. D’ailleurs, Néron réagit à cette mort comme Oreste, en se voyant poursuivi par les<br />
Furies 1 . Le destin d’Agrippine et de Néron montre à quel point l’histoire de Rome, sous<br />
l’Empire, baigne dans la tragédie. Le caractère quasi-illimité du pouvoir, qui fait du prince<br />
l’image des dieux sur terre, donne une idée de l’énormité de l’ambition de ceux qui veulent le<br />
conquérir ou le conserver, de la folie qui s’empare d’eux, et des conséquences funestes qui<br />
s’ensuivent.<br />
La tragédie est si présente qu’elle peut même inspirer les actions des protagonistes :<br />
Dion Cassius présente le complot visant à éliminer la mère de l’empereur par le moyen d’un<br />
bateau piégé comme une machina de tragédie 2 . A l’initiative d’Anicetus, qui joue ici le rôle<br />
du confident maléfique, le complot est ourdi en trois temps 3 . Au printemps 59, Néron se rend<br />
dans son domaine de Campanie pour y célébrer les Quinpatries, comme le faisaient<br />
régulièrement les riches Romains, et il invite Agrippine à le rejoindre 4 . Un festin est apprêté à<br />
Baules, villa de la région de Baïes, au cours duquel le prince se livre à des démonstrations de<br />
respect et de piété filiale, afin d’endormir les soupçons de sa mère. Puis le bateau sur lequel<br />
elle se voit conduite par son fils se disloque, conformément aux projets des comploteurs.<br />
Anicetus, qu’une haine farouche oppose à la mère du prince, commande alors la flotte<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 10.<br />
2 Dion Cassius, 61, 12.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 3-8.<br />
4 Suétone, Ner. 34 ; Tacite, Ann. XIV, 4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
263
impériale de Misène, a fait aménager un bateau piégé, sur le modèle d’une machine vue dans<br />
un spectacle, probablement une naumachie organisée à Rome 1 . Agrippine, qui a échappé à<br />
l’écrasement, et à la noyade, assiste à la mise à mort d’Acerronia qui, ironie tragique, s’est fait<br />
passer pour elle afin de hâter son sauvetage. Enfin, malgré l’habile dissimulation d’Agrippine,<br />
qui prend les devants, en assurant son fils qu’elle a fort heureusement échappé à un accident,<br />
le crime est consommé, encore une fois grâce aux bons offices d’Anicetus : accusée d’avoir<br />
conspiré contre l’empereur, Agrippine est finalement mise à mort. Le thème du complot n’est<br />
pas sans rappeler la machination tramée par Atrée pour attirer son frère dans ses filets, et ses<br />
feintes caresses destinées à mieux écraser son ennemi. Le matricide, autre thème tragique qui<br />
évoque Oreste, et la situation d’Agrippine qui assiste au déroulement du drame sans pouvoir<br />
en empêcher l’issue, confirment l’impression que pour cet événement essentiel dans la<br />
poursuite de son règne, Néron a mis son goût pour le théâtre au service de la conservation de<br />
son pouvoir. Ou alors certains de ses conseillers, qui auraient eu intérêt à éliminer la puissante<br />
mère du prince, auraient eu recours au théâtre et à ses ressources pour faire accepter à Néron<br />
un projet qui l’épouvantait… D’autre part, Dion Cassius affirme que l’idée du bateau piégé<br />
serait venue à l’empereur en voyant une machine de théâtre 2 . La dramaturgie est alors elle<br />
aussi une source d’inspiration pour le prince, acteur et metteur en scène des derniers instants<br />
de sa mère.<br />
L’histoire prend alors une coloration tragique. Cependant, cette vision des choses doit<br />
beaucoup à la présentation qu’en ont faite les historiens, et en particulier Tacite. L’épisode de<br />
la mort d’Agrippine, en particulier, a donné lieu récemment à des études sur l’art du récit de<br />
Tacite, et sur ses rapports avec la tragédie 3 . R. Mellor a montré que l’œuvre de Tacite laisse<br />
1 L. Herrmann, 1927, p. 68 sq ; R. D. Scott, 1974, p 105 sq.<br />
2 Dion Cassius, 61, 12.<br />
3 L. Muller, 1994, p. 27 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
264
apparaître dans sa construction une suite de tragédies, dont les héros sont successivement<br />
Tibère, dans la première partie des Annales, puis Germanicus, Agrippine, Séjan, Messaline,<br />
Agrippine la Jeune et Néron 1 . Le destin de Tibère, qui occupe la première partie des Annales,<br />
se prête particulièrement à une analyse tragique, comme l’a montré M. J. Lossau 2 . C’est ainsi,<br />
par exemple, qu’à la suite de l’exécution de Sextus Marius, riche Espagnol accusé d’adultère<br />
avec sa fille et précipité du haut de la roche Tarpéienne, en 31, une série d’exécutions rappelle<br />
la situation de l’Antigone de Sophocle. Les corps des suppliciés sont abandonnés aux eaux du<br />
Tibre, et personne n’ose leur offrir de sépulture 3 , conformément à la règle, mais la situation<br />
rappelle l’interdit posé par Créon, et bravé par Antigone. La crainte inspirée par le tyran<br />
paralyse alors les volontés : interciderat sortis humanae commercium ui metus 4 .<br />
D’une manière plus générale, la figure du tyran dans l’historiographie romaine hérite<br />
de la tragédie grecque 5 , et l’influence de la tragédie gréco-latine se fait ressentir dans les récits<br />
de Tacite 6 : le tyran, servi par la lâcheté des sénateurs et entraîné par la puissance destructrice<br />
que suscite le pouvoir suprême, se laisse aller à un débordement de crimes et d’infamies, et<br />
fait régner autour de lui la terreur 7 . B. Segura-Ramos 8 a également souligné, dans un article<br />
synthétique, les aspects tragiques de la narration dans l’œuvre de Tacite, en prenant l’exemple<br />
de deux épisodes du premier livre des Annales : la révolte des légions de Panonie et de celles<br />
1 R. Mellor, 1993, p. 19 – 20.<br />
2 M. J. Lossau, 1992.<br />
3 Tacite, Ann. VI, 19.<br />
4 « tout sentiment humain était étouffé par la violence de la crainte. »<br />
5 J. R. Dunkle, 1971, p. 12-20.<br />
6 C. Mendell, 1957, p. 97 sq ; E. Aubrion, 1985, p. 705 sq.<br />
7 C’est ainsi que Tacite commente, en guise d’épilogue au règne de Tibère, l’évolution de ce prince :<br />
Ann. VI, 51.<br />
8 B. Segura-Ramos, 1998.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
265
du Rhin. Dans les récits de Tacite, le pouvoir absolu et l’ambition mènent systématiquement à<br />
la tragédie et à l’autodestruction 1 .<br />
On peut donc dire que la présentation des événements du premier siècle, notamment<br />
par Tacite, contribue très largement à regarder ses acteurs comme des personnages de<br />
tragédie, qui se débattent dans les pièges du destin de Rome. Dion Cassius, lui aussi,<br />
commente la mort de Néron en parlant, non sans ironie, de sa « dernière tragédie » 2 . La pièce<br />
du Pseudo-Sénèque, Octavie, constitue alors, en quelque sorte, l’aboutissement du processus<br />
qui intègre les personnages historiques au mythe et à la tragédie, puisque Néron, comme<br />
Sénèque, y figure comme personnage tragique.<br />
3 /Expression des caractéristiques du régime impérial dans les tragédies de Sénèque.<br />
L’extension du domaine du privé à la vie publique, caractéristique du régime impérial,<br />
permet un rapprochement entre la situation du prince et celle des personnages des tragédies,<br />
car les conflits familiaux ont des conséquences politiques très importantes. Ainsi, Thyeste<br />
développe une intrigue politique autant que familiale 3 , et l’enjeu politique transfigure le<br />
conflit privé qui oppose les deux frères :<br />
Fas est in illo quicquid in fratre est nefas. 4<br />
1 A. Malissard, 1998 : de manière significative, la mise en scène des épisodes fait apparaître les<br />
protagonistes des drames qui se jouent comme des acteurs de tragédie.<br />
2 Dion Cassius, 63, 28.<br />
3 Comme Agamemnon. Par exemple, le vers 912 souligne que les points de vue familial et politique se<br />
confondent.<br />
4 Th. 220 : « A lui, il est permis de faire ce qu’il est défendu de faire à un frère ».<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
266
Le débat entre Atrée et son courtisan s’achève sur la promesse du second de garder secret les<br />
desseins du premier :<br />
Haud sum monendus : ista nostro in pectore<br />
fides timorque, sed magis claudet fides. 1<br />
Le courtisan évoque deux raisons d’obéir à un souverain : la crainte, que le tyran suscite pour<br />
affirmer un pouvoir illégitime, et sujet des réflexions de Sénèque sur l’exercice du pouvoir,<br />
dans les tragédies comme dans les œuvres en prose, et la fides, notion sur laquelle se clôt le<br />
débat. Or, cette notion de fides peut, semble-t-il, être mise en relation avec la personnalisation<br />
du pouvoir sous l’Empire, qui induit un rapport proche du clientélisme entre le prince et ses<br />
sujets 2 . L’empereur est le patronus de son peuple, dont il assure la protection et, le cas<br />
échéant, la subsistance, en échange de sa fides. C’est la personnalisation du pouvoir qui<br />
permet l’assimilation du prince au patron : il se doit de pourvoir aux besoins fondamentaux de<br />
son peuple, par des distributions d’argent ou de vivres, par l’organisation de divertissements 3 .<br />
Caligula, par exemple, permet l’indemnisation de nombreux citoyens ruinés par des<br />
incendies 4 . Cette extension du clientélisme à l’organisation politique est déjà mise en place<br />
sous le gouvernement de César, et se poursuit pendant les règnes suivants 5 . La propagande<br />
césarienne contribue largement à la diffusion de la notion de pietas due par ses concitoyens à<br />
lui-même. Le client devait la fides à son patron, en échange de sa protection et de son<br />
assistance. Progressivement, la pietas, qui au départ est due aux dieux, s’est adressée à un<br />
1 Th. 334-335 : « Je n’ai pas besoin d’ordres : tes paroles seront enfouies dans mon cœur par la fidélité<br />
et la crainte, mais surtout par la fidélité. »<br />
2 S. Weinstock, 1971, p 203.<br />
3 Par exemple, Suétone, Claud. 19, 1.<br />
4 Suétone, Cal. 15.<br />
5 S. Weinstock, 1971, p 256.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
267
homme, et s’est substituée à la fides, qui à l’origine désignait un lien privé entre particuliers,<br />
et s’adresse désormais à l’homme d’Etat. C’est bien de cette fides que se réclame<br />
l’interlocuteur d’Atrée, tout en indiquant que son souverain affermit également, et<br />
certainement davantage, son pouvoir par la crainte.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
268
Conclusion.<br />
Le principat, tel qu’il se met en place au début du premier siècle, semble donc bien<br />
être un régime politique qui offre à la tragédie une source nouvelle d’inspiration. Dépositaire<br />
des institutions de la République, le prince détient un pouvoir colossal, qui s’étend sur la plus<br />
grande partie du monde connu, et qui fait de lui l’équivalent sur la terre des dieux et des<br />
héros. La mise en valeur de l’ascendance divine souligne la nature particulière du prince, et<br />
ses actions lui assurent une place parmi les dieux, comme les héros bienfaiteurs de la<br />
mythologie, et en particulier Hercule. Cette tendance est favorisée par les influences<br />
orientales qui entrent en jeu dès les derniers temps de la République, avec des personnages<br />
comme Antoine, dont certains empereurs revendiquent l’héritage. Elle est également<br />
renforcée par l’apport du stoïcisme, qui contribue à justifier le principat sur le plan<br />
philosophique, en développant l’idée d’un prince gouvernant le monde comme l’âme dirige le<br />
corps. C’est également la proximité du prince et des dieux qui offre un début de réponse à la<br />
question fondamentale de la légitimité du souverain, et résout en partie le problème de la<br />
continuité du régime, en introduisant, par la bande, le principe de la succession dynastique<br />
sous les Julio-Claudiens. Dès lors, affaires familiales et affaires d’état coïncident, et le rôle<br />
des femmes s’accroît dans le cadre de la personnalisation du pouvoir, puisque les enjeux<br />
familiaux et dynastiques prennent une ampleur considérable.<br />
Dans ce cadre politique, le prince finit par ressembler aux rois des tragédies, qui<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
269
fournissent une catégorie de pensée pour le représenter. Dans cette perspective, il échappe au<br />
risque de se voir assimilé au tyran qui usurpe et confisque le pouvoir car, comme dans le<br />
théâtre grec, le roi n’appartient pas à la communauté humaine, qu’incarne le chœur. Il est<br />
explicitement désigné comme appartenant à la race des dieux. Ainsi, le caractère divin du<br />
prince l’apparente aux personnages mythologiques, rois légendaires, héros et dieux.<br />
Réciproquement, la tragédie retrouve dans ce contexte une force renouvelée, car elle peut<br />
exprimer les conflits qui se jouent et les forces qui s’affrontent. C’est dans cette voie qu’il<br />
faut chercher la signification politique du théâtre de Sénèque.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
270
TROISIEME PARTIE<br />
LES TRAGEDIES ET L’EXPRESSION DU POUVOIR IMPERIAL<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
271
Introduction<br />
La relation de Sénèque et de Néron, si elle ne se laisse pas facilement définir, semble<br />
bien tirer son originalité, et sa force tout à la fois, dans un goût commun pour le théâtre, et<br />
plus spécialement pour la tragédie. Plus particulièrement encore, c’est le rapport entre le<br />
prince et le tragique qui concentre l’intérêt, dans la mesure où les problématiques politiques<br />
liées au principat trouvent dans ce type de production dramatique une expression privilégiée.<br />
On peut alors se demander ce que les tragédies de Sénèque apportent à la réflexion, puisque<br />
l’importance du corpus qui nous est parvenu pourrait bien refléter l’importance et le caractère<br />
crucial de la question.<br />
Tout d’abord, la nature du régime impérial invite à le mettre en rapport avec la<br />
tragédie. La lecture des pièces de Sénèque semble offrir une réflexion sur Néron, qui apparaît<br />
à plusieurs titres comme un prince tragique. Cette impression est renforcée par l’ancrage des<br />
tragédies dans la réalité contemporaine, qui invite à faire le lien entre le mythe représenté sur<br />
scène et la réalité. Il y a une actualisation du mythe dans les tragédies. Ce que l’on peut<br />
appeler la romanisation du mythe est, en fait, permise par un certain nombre d’éléments<br />
culturels, des références à la réalité romaine, qui fonctionnent comme autant de signaux<br />
destinés à éveiller l’attention du spectateur.<br />
Dans quelle mesure les tragédies de Sénèque offrent-elles une grille de lecture au<br />
règne de Néron, et jusqu’à quel point peut-on rapprocher le mythe représenté et la réalité<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
272
historique ? C’est en ces termes que l’on pourra, dans un deuxième temps, poser la question<br />
des allusions dans certaines pièces du corpus sénéquien. L’examen des différents exemples,<br />
qui ont pour la plupart déjà fait l’objet de relevés et d’analyse, montrera la complexité de ce<br />
problème, que la thèse d’un théâtre codé ne saurait suffire à résoudre.<br />
Ce point nous amènera à nous interroger sur la signification politique des tragédies, qui<br />
constituent non seulement un reflet de la réalité, mais encore un élément essentiel de la<br />
relation de Sénèque et de Néron. Si les tragédies sont politiques, ce n’est pas en tant que<br />
manifeste d’opposition que comme expression de la part obscure inhérente au pouvoir absolu,<br />
que Néron détient, et que Sénèque côtoie. Le passage de l’histoire au mythe, tel que l’Octavie<br />
du Pseudo-Sénèque semble le consacrer, n’est-il pas à ce prix ?<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
273
Chapitre 7. Mythe et histoire dans les tragédies.<br />
Des mythes familiers.<br />
Aristote constate dans La Poétique que les tragédies les plus réussies sont composées à<br />
partir de l’histoire d’un petit nombre de familles, dont le destin suscite particulièrement<br />
l’intérêt 1 . Les sujets des tragédies de Sénèque ne dérogent guère à cette règle, puisqu’il<br />
reprend ceux des tragédies attiques que ses prédécesseurs latins avaient déjà adaptés 2 . Ainsi,<br />
Médée s’inspire d’Euripide, comme la douzième Héroïde et le chant VII des Métamorphoses<br />
d’Ovide 3 . Les Phéniciennes ont à l’origine trois sources : Œdipe-Roi et Œdipe à Colone de<br />
Sophocle, ainsi que Les Phéniciennes d’Euripide 4 . Deux pièces d’Euripide, Hécube et Les<br />
Troyennes 5 , sont les sources principales des Troyennes. Hercule Furieux s’inspire d’Euripide 6 .<br />
Phèdre présente une structure différente des tragédies grecques qui traitent du même sujet,<br />
comme Œdipe, ce qui suppose des sources intermédiaires et des innovations de Sénèque.<br />
Phèdre résulterait d’une contamination des deux Hippolyte d’Euripide, de la pièce de<br />
1 Aristote, Poet. 1453 a, 17-22.<br />
2 R. J. Tarrant, 1978.<br />
3 Sénèque, Tragédies, t. 1, texte établi et traduit par F. R. Chaumartin, Paris, 1996, p. 149-152.<br />
4 Id. p. 119.<br />
5 W. Calder, 1970 : Sénèque s’est inspiré de trois sources grecques, Les Troyennes d’Euripide,<br />
Polyxène de Sophocle et une pièce postérieure à celle d’Euripide pour l’acte III.<br />
6 Seneca, Teatro, vol. I, texte établi, traduit et commenté par G. Viansino, Milan, 1993, p. 87-90.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
274
Sophocle dont nous ne savons rien, et peut-être de Lycophron et Ovide 1 . Agamemnon se<br />
rapproche de la pièce d’Eschyle, avec des différences notables au début et à la fin 2 . Hercule<br />
sur l’Œta, qui pose par ailleurs un problème d’attribution, est adaptée des Trachiniennes de<br />
Sophocle 3 .<br />
L’adaptation de sujets grecs dans les tragédies latines est une chose ancienne et le<br />
Thyeste de Sénèque, par exemple, s’inscrit dans la lignée des pièces de ses prédécesseurs<br />
latins, Accius et Varius. On connaît également un Thyeste d’Ennius 4 , dont on ignore le<br />
modèle. A l’époque de Sénèque, les Romains se sont depuis longtemps approprié la<br />
mythologie grecque, d’autant qu’elle se rattache à l’histoire de Rome 5 . A l’époque impériale,<br />
l’Enéide de Virgile a donné une importance nouvelle à la légende d’Enée 6 , ancêtre mythique<br />
de la gens Iulia 7 , et déjà célébré dans les Annales d’Ennius et le Bellum Punicum de Névius.<br />
Les tragédies de Sénèque mettent donc en scène des personnages familiers au public romain,<br />
et dont les destinées ont déjà inspiré bien d’autres auteurs, dans un passé plus ou moins<br />
proche. Et cette appropriation est rendue plus définitive par la coloration résolument romaine<br />
que prend le traitement du mythe. Ainsi, le propos devient moins général, et le spectateur est<br />
invité à interroger son propre univers, le contexte proche de la représentation.<br />
1 P. Grimal, 1963. K. Heldmann, 1968.<br />
2 Sur l’innovation de Sénèque dans Agamemnon, R. J. Tarrant (éd.), Seneca, Agamemnon, Cambridge,<br />
1976, p. 15-18.<br />
3 M. Rozelaar, 1985 ; Sur les sources spécifiquement, voir par exemple l’édition de G. Viansiono,<br />
1993, p. 86, note 267.<br />
4 H. D. Jocelyn, The Tragedies of Ennius, Cambridge, 1969, p. 413.<br />
5 G. K. Galinsky, « Vergil's Romanitas and his Adaptation of Greek Heroes », ANRW, II, 31, 2, 1981,<br />
p. 985-1010.<br />
6 P. Grimal, 1982.<br />
7 R. S. Lorsch, 1997 ; M. Meulder 1996.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
275
L’actualisation du mythe représenté, et les questions qu’il peut alors soulever,<br />
demeurent assez problématiques. Ainsi, s’il est relativement aisé de relever les mentions<br />
d’éléments spécifiquement romains dans les tragédies de Sénèque, il est plus aléatoire, bien<br />
que toujours possible, de repérer des références aux structures de l’Empire. Et si l’on veut<br />
déceler dans telle ou telle tragédie une allusion précise à un événement proche ou<br />
contemporain, l’exercice se révèle périlleux, d’autant que, pour définir précisément le<br />
contexte d’une tragédie, il nous manque la chronologie du théâtre de Sénèque, qui reste<br />
encore impossible à établir exactement. L’entreprise, quelque hasardeuse qu’elle apparaisse<br />
dès l’abord, présente toutefois un intérêt réel : en effet, il paraît difficile d’affirmer<br />
raisonnablement que Sénèque ait pu faire totalement abstraction de la situation politique<br />
contemporaine, ou des crises et événements dont il avait été le témoin ou l’acteur, lorsqu’il a<br />
rédigé ses pièces. Il serait donc absurde de lire les tragédies comme si c’était le cas. En outre,<br />
comme on l’a vu, les allusions politiques sont fréquentes dans les tragédies latines, Sénèque<br />
en était bien conscient, et le public l’entendait ainsi. Il faut donc, après avoir défini le cadre<br />
romain des tragédies de Sénèque, examiner ce qui peut se rapporter au contexte politique, et<br />
en particulier aux règnes des empereurs sous lesquels vécut leur auteur.<br />
I/ Les indices de l’appropriation du mythe par la pensée romaine dans les<br />
tragédies.<br />
Dans le théâtre de Sénèque, un certain nombre d’expressions ou de termes ne réfèrent<br />
ni au passé mythique dans lequel l’action est censée se dérouler, ni au contexte culturel<br />
général de la tragédie. Il en résulte une confusion des dates et des époques, qui prête à<br />
réflexion. Il convient avant tout de distinguer les anachronismes, qui ressortent nettement à la<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
276
lecture du texte, des allusions à la situation politique contemporaine, et que nous envisagerons<br />
dans un second temps. L’anachronisme, en effet, se présente comme un indice manifeste, qui<br />
tranche généralement avec le contexte général du discours, et provoque une rupture de<br />
l’illusion scénique, tandis que l’allusion reste incertaine et ambiguë. Enfin, il convient dès à<br />
présent de libérer le terme de la connotation négative qui s’y attache généralement. Bien<br />
entendu, les anachronismes de Sénèque sont volontaires, et intentionnels. Ils ne relèvent en<br />
aucun cas d’une erreur ou de négligence. Leur rôle et leur signification restent toutefois à<br />
préciser. Tout d’abord, un certain nombre de termes et expressions renvoient à la réalité<br />
quotidienne des Romains, et constituent autant de points d’ancrage des mythes représentés<br />
dans l’univers familier du spectateur. D’autres références participent à l’inscription de<br />
l’intrigue tragique dans un cadre politique et idéologique qui oriente l’interprétation de<br />
l’auditoire. Tous ces indices fonctionnent comme une série de signaux qui éveillent<br />
l’attention, guident la réflexion et témoignent de l’appropriation du mythe par la pensée<br />
romaine.<br />
A/ Anachronismes culturels et religieux.<br />
1/ La chasse.<br />
Tout d’abord, des références aux coutumes et aux représentations romaines émaillent<br />
le texte des tragédies. Ainsi, au vers 52 de Phèdre, l’expression iam uictor associe,<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
277
conformément à la manière dont les Romains l’envisageaient, la chasse à la guerre 1 .<br />
D’ailleurs, dans ce monologue lyrique, la chasse est évoquée, avec une grande précision. Si<br />
les premiers vers énumèrent toute une série de sites attiques, comme le Parnès 2 , la vallée de<br />
Thria, au nord d’Eleusis 3 , celle de l’Ilissos 4 , la plaine de Marathon 5 ou encore l’Hymette 6 , la<br />
deuxième partie du prologue 7 décrit le déroulement de la chasse telle qu’elle se pratiquait<br />
ordinairement en Italie, et telle que Sénèque pouvait la connaître. Par exemple, au vers 46, il<br />
est question d’un cordeau coloré de plumes rouges, picta rubenti linea pinna, qui désigne sous<br />
la forme d’une périphrase la formido, sorte d’épouvantail destiné à rabattre le gibier,<br />
accessoire qui n’est employé que par les chasseurs romains 8 . Le prologue de Phèdre<br />
entremêle donc des références à la géographie des tragédies attiques, et des éléments<br />
spécifiquement romains, relatifs aux techniques de la chasse, signalant ainsi dès le début de la<br />
pièce la coloration romaine volontairement donnée au mythe. Le traitement de la chasse est<br />
d’autant plus significatif qu’il participe à la caractérisation d’Hippolyte, qui préfère les<br />
étendues sauvages à la compagnie des hommes et surtout au commerce des femmes, ce<br />
pourquoi il mérite le qualificatif de ferus qui lui est appliqué 9 .<br />
1 Sénèque, Phèdre, édition, introduction et commentaire de P. Grimal, 1965, p. 39 ; J. Aymard, 1951,<br />
p. 311.<br />
2 Ph aed. 4.<br />
3 Phaed. 5.<br />
4 Phaed. 13.<br />
5 Phaed. 17.<br />
6 Phaed. 23.<br />
7 Phaed. 31-53.<br />
8 J. Aymard, 1951, p. 218 et 225. Cf Clem. I, 12, 5.<br />
9 Phaed. 240.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
278
2/ Les jeux.<br />
Les anachronismes relatifs aux jeux introduisent un rapprochement temporel, mais<br />
aussi une transposition culturelle et une forme de mise en abyme, puisque le spectacle des<br />
jeux est convoqué comme référence, par les personnages eux-mêmes, à leur situation. Les<br />
affrontements des tragédies sont, en effet, à plusieurs reprises, décrits dans des termes qui<br />
appartiennent en principe au vocabulaire des combats de gladiateurs : c’est ainsi que l’on<br />
retrouve l’expression habet ou hoc habet, que l’on emploie quand un gladiateur est abattu, au<br />
vers 998 d’Œdipe et au vers 901 d’Agamemnon 1 . Les combats de gladiateurs constituent un<br />
loisir courant à Rome, et la référence est accessible au spectateur, en renvoyant à une réalité<br />
contemporaine, et suffisamment partagée pour donner lieu à des expressions proverbiales<br />
comme celle que cite Sénèque dans l’une de ses lettres : Vetus prouerbium est gladiatorem in<br />
harena capere consilium 2 .<br />
Le rapprochement que l’expression bene habet autorise, entre les personnages<br />
tragiques et les gladiateurs, souligne également la violence de l’affrontement, comme dans le<br />
De ira où Sénèque compare l’existence à une école de gladiateur 3 . Le meurtre d’Agamemnon,<br />
dont Cassandre décrit la violence sanguinolente, illustre bien la férocité des meurtriers, qui<br />
s’acharnent sur le corps mal décapité de leur victime. Par ailleurs, Cassandre, qui relate les<br />
faits dans une vision hallucinée, fait preuve d’une ironie vengeresse devant le sort de son<br />
ennemi, qui lui apporte la satisfaction de voir Agamemnon abattu à son tour. C’est en<br />
spectatrice attentive et satisfaite qu’elle s’apprête à jouir du combat :<br />
1 Herc. Œ. 1457 : Hyllus emploie également cette expression à propos de Déjanire.<br />
2 Ep. 22, 1 : « selon un vieux proverbe, le gladiateur prend sa décision une fois dans l’arène. »<br />
3 Ir. II, 8, 2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
279
Bene est, resurgit Troia ; traxisti, iacens,<br />
parens, Mycenas, terga dat uictor tuus.<br />
Tam clara numquam prouidae mentis furor<br />
ostendit oculis : uideo et intersum et fruor.<br />
Imago uisus dubia non fallit meos :<br />
Spectemus. 1<br />
Dans cette perspective, la référence au combat de gladiateurs introduit une distance, dont<br />
l’ironie cruelle renforce la bestialité du crime. Cassandre se fait, si l’on peut oser ce<br />
rapprochement anachronique, le commentateur sportif d’un combat décisif.<br />
Dans le cas d’Œdipe, c’est le héros lui-même qui s’applique cette expression :<br />
Bene habet, peractum est : iusta persolui patri.<br />
Iuuant tenebrae. Quis deus tandem mihi<br />
placatus atra nube perfundit caput ?<br />
Quis scelera donat ? Conscium euasit diem.<br />
Nil, parricida, dexterae debes tuae :<br />
lux te refugit. Vultus Œdipodam hic decet. 2<br />
Le détachement que le héros s’impose, et la distance qu’introduit le vers 908, sont confirmés<br />
par le fait qu’il parle de lui comme d’un tiers au vers 1003. Ici, Œdipe ressemble à ces<br />
1 Ag. 870-875 : « C’est bien, Troie se relève ; ô mon père, même abattu, tu traînes derrière toi le<br />
cadavre de Mycènes, et ton vainqueur est en déroute. Jamais le délire prophétique de mon esprit n’a<br />
montré à mes yeux des images aussi claires : je les vois, j’y assiste, et je m’en délecte. Ce n’est pas<br />
une vaine illusion qui abuse mes yeux : contemplons. »<br />
2 Œd. 998-1003 : « Le coup a porté, c’en est fait : je me suis acquitté de ma dette envers mon père. Les<br />
ténèbres me plaisent. Quel dieu enfin clément pour moi a répandu sur ma tête cette noire nuée ? Quel<br />
dieu me pardonne mes crimes ? J’ai échappé au jour complice. Non, parricide, tu ne dois rien à ta<br />
main : c’est la lumière qui t’a fui. Voilà le visage qui convient à Œdipe. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
280
gladiateurs vaincus qui mettaient un point d’honneur à tendre avec résolution leur gorge à leur<br />
adversaire, si les spectateurs le réclamaient. Comme ses contemporains, Sénèque admire les<br />
gladiateurs 1 : il cite souvent leur exemple, pour illustrer l’attitude du sage qui affronte la mort<br />
comme une issue inévitable 2 . Pendant un instant, Œdipe a l’illusion qu’il a rempli sa destinée,<br />
et que l’ordre est rétabli. Immédiatement après, la mort de Jocaste lui fait franchir une étape<br />
supplémentaire, et provoque son exil.<br />
3/ Les rites.<br />
Enfin, les références aux pratiques religieuses et cultuelles romaines sont plus<br />
nombreuses dans les tragédies de Sénèque. G. Freyburger, dans son article « Grieschicher<br />
Exotismus und römische Tradition in Senecas Theater » 3 , relève un certain nombre<br />
d’anachronismes religieux et culturels dans les tragédies, qu’il classe en six groupes : les<br />
mânes, les sacrifices, le mariage, le triomphe, les haruspices et les Pénates. Dans le domaine<br />
de la religion et des pratiques cultuelles, il convient de prendre certaines précautions avant de<br />
parler d’anachronismes ou de références spécifiquement romaines. En effet, les rites pratiqués<br />
par les Romains dans le cadre de leurs cérémonies religieuses ont parfois une origine grecque,<br />
et certains termes relèvent de la simple traduction. C’est un peu la même chose pour les lares<br />
et les pénates, qui sont très souvent employés comme métaphore du foyer, et qui ne sont plus<br />
guère signifiants, du fait de la généralisation de leur emploi. Ainsi la molla salsa, cette farine<br />
1 Ep. 30, 8.<br />
2 Const. XVI, 2 ; Ir. I, 11, 1 ; II, 8, 2 ; Prou. III, 4 ; Tranq. XI, 4, citant Cicéron, Mil. 92 ; Ep. 22, 1 ;<br />
30, 5, 95, 71.<br />
3 G. Freyburger, 1990, p. 123-130 .<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
281
torréfiée et trempée dans la saumure par les soins des vestales 1 , est employée dans les<br />
cérémonies religieuses romaines, mais elle hérite d’une pratique que l’on rencontre déjà dans<br />
l’Iliade 2 . Il n’est pas sûr du tout que cet élément ait fait figure d’anachronisme pour les<br />
spectateurs des tragédies, en fonctionnant comme « signaux romains ».<br />
On trouve cependant, dans Agamemnon par exemple, des termes religieux<br />
typiquement romains, comme l’adjectif lustrale 3 , et le verbe auspicari 4 . Le premier de ces<br />
termes rappelle en effet le sacrifice expiatoire offert tous les cinq ans pour la purification du<br />
peuple romain. Le second réfère au droit d’auspices des magistrats romains sous la<br />
République 5 , et dont le prince, dépositaire officiel de ses institutions, hérite à son tour sous<br />
l’Empire. Cette coutume, déjà pratiquée au temps de la monarchie, établit le lien entre le<br />
pouvoir et les dieux, puisque c’est Jupiter qui s’exprime à travers les auspices 6 . Le terme<br />
souligne donc, fugitivement, une certaine continuité dans la conception du pouvoir politique,<br />
la proximité des fonctions impériale et royale, et le lien que l’on peut dès lors établir entre un<br />
roi de tragédie et le prince de Rome.<br />
Les références à des rites précis portent la marque spécifique de Rome au-delà de la<br />
simple convention lexicale ou symbolique. Par exemple, lorsque Tirésias, dans Œdipe, décide<br />
de se livrer à un rituel de nécromancie, afin d’évoquer l’ombre de Laius, il rappelle à Œdipe<br />
qu’il lui est interdit, en tant que détenteur du pouvoir impérial, d’assister au rituel :<br />
1 G. Dumézil, 1974, p. 550.<br />
2 Iliade, I, 460 sq.<br />
3 Ag. 163. cf le commentaire de ce verbe dans Agamemnon, R. J. Tarrant, 1976.<br />
4 Ag. 8 ; Th. 657.<br />
5 Cicéron, Rep. 2, 16.<br />
6 J. R. Fears, 1977, p. 84.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
282
ede qui mandes sacrum ;<br />
nam te, penes quem summa regnorum, est nefas<br />
inuisere umbras. 1<br />
C’est donc Créon qui se voit confier cette mission. L’interdit ainsi rappelé par le vieux devin<br />
a un intérêt dramatique, dans la mesure où il provoque le récit de Créon et l’affrontement qui<br />
s’ensuit entre le roi et son beau-frère qui l’accuse de comploter contre lui. Il rappelle<br />
également un usage de la Rome impériale, qui juge incompatible les fonctions impériales et<br />
funéraires 2 .<br />
On peut voir dans ces anachronismes culturels un réseau d’indices, qui établissent<br />
entre l’auteur et le spectateur, par l’intermédiaire de l’action représentée, une forme de<br />
connivence, la reconnaissance de l’appartenance à une culture commune, mais aussi la<br />
conviction partagée que le mythe se connecte à l’histoire et à l’actualité.<br />
B/ Cadre juridique et vie publique : vers une lecture politique.<br />
1/ Indices lexicaux.<br />
Dans le prologue d’Agamemnon, l’ombre de Thyeste évoque, à la suite des célèbres<br />
criminels qui purgent au Tartare leur châtiment éternel, celui qui est à l’origine de leur<br />
condamnation : Minos, l’un des trois juges des enfers, est désigné par la périphrase quaesitor<br />
1 Œd. 397-399 : « désigne celui à qui tu confies cette mission sacrée ; car il ne t’est pas permis, à toi<br />
qui es en possession du pouvoir suprême, de voir les ombres. »<br />
2 Tacite, Ann. I, 62.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
283
gnosius, juge gnossien 1 . On trouve dans les Lettres à Lucilius une occurrence du terme pour<br />
définir le sage comme « celui qui recherche » 2 . Mais plus généralement, le terme a une<br />
acception juridique incluant l’idée d’enquête 3 . Celui qui mène une instruction criminelle dans<br />
le cadre de la quaestio perpetua lorsque le préteur ne s’en charge pas 4 , est appelé quaesitor, et<br />
d’une manière plus générale, le terme désigne tout magistrat habilité à mener une quaestio. Ce<br />
choix d’un terme juridique romain introduit donc dans la référence mythologique à Minos une<br />
dimension actuelle et familière pour le public de Sénèque. L’expérience du poète en la<br />
matière peut également expliquer cet anachronisme : il s’est en effet enrichi sous les règnes de<br />
Tibère et de Caligula 5 grâce à ses succès d’avocat 6 . La présence, dans ce prologue<br />
d’Agamemnon, d’un terme appartenant au lexique juridique s’explique ainsi doublement. A<br />
cet égard, les développements de F. Dupont sur la notion de furor confirment cette tendance<br />
de Sénèque à envisager les mythes qu’il traite dans ses tragédies à travers le prisme de notions<br />
romaines contemporaines 7 . L’état dans lequel se trouvent les criminels des tragédies les aliène<br />
et les fait sortir de l’humanité, ce qui rend les cadres habituels inopérants pour traiter de leur<br />
cas. Le daimon tragique grec trouve ainsi son équivalent romain dans une transposition qui<br />
convoque la législation romaine : le furor, état de folie transitoire, rend momentanément celui<br />
qu’il frappe irresponsable de ses actes au regard de la loi 8 . Cette notion permet donc<br />
d’introduire l’idée que le criminel tragique ne peut pas être jugé selon les cadres juridiques<br />
appropriés au reste de l’humanité.<br />
1 Sénèque, Ag. 24.<br />
2 Sénèque, Ep. 119, 5.<br />
3 Cicéron, Clu. 181.<br />
4 Cicéron, Verr. pr. 29.<br />
5 Suétone, Cal. 53, 3.<br />
6 E. Cizek, 1972, p. 60 ; P. Aubenque, J.-M. André, 1964, p. 18.<br />
7 F. Dupont, 1985, p. 184-185.<br />
8 Digeste, XXVI, 7, 61.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
284
La tragédie de Thyeste fournit un exemple très significatif de termes anachroniques :<br />
au vers 396, en effet, le chœur qui, rappelons-le, est composé de Mycéniens, chante les<br />
douceurs d’une vie oisive, à l’écart des honneurs et des craintes que leur possession engendre.<br />
me dulcis saturet quies,<br />
obscuro positus loco<br />
leni perfruar otio,<br />
nullis nota Quiritibus<br />
aetas per tacitum fluat.<br />
Sic, cum transierint mei<br />
nullo cum strepitu dies,<br />
plebeius moriar senex. 1<br />
Le substantif Quiritibus, qui est en un sens un synonyme de « Romains » (il n’y a de quirites<br />
qu’à Rome), et l’adjectif plebeius introduisent dans ce passage lyrique une référence à<br />
l’organisation de la société romaine d’autant plus nette qu’elle est double. Le spectateur est<br />
ainsi invité à convoquer ses propres références, et à mettre en relation ce qui est dit sur scène<br />
avec la situation réelle. Il ne s’agit pas, ici, d’un brouillage ou de la création d’une confusion,<br />
mais d’un mouvement de va et vient entre les deux univers. La leçon de sagesse, à n’en pas<br />
douter, s’adresse directement aux Romains qui l’écoutent.<br />
Dans le même registre, les termes curia et forum, dans Agamemnon, sont intéressants<br />
car ils renvoient à des lieux précis et identifiables immédiatement pour un Romain. L’effet de<br />
rapprochement, de raccourci, n’est donc plus seulement temporel, il s’inscrit également dans<br />
1 Th. 393-400 : « Moi, une douce quiétude puisse-t-elle me combler ; placé dans une modeste<br />
condition, puissé-je profiter d’une agréable oisiveté, que ma vie s’écoule en silence, ignorée de tous<br />
mes concitoyens. Ainsi, une fois que mon séjour aura passé sans le moindre vacarme, puissé-je mourir<br />
en vieillard plébéeien. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
285
un espace à la fois concret et symbolique. L’ombre de Thyeste, arrachée au Tartare,<br />
contemple les différentes pièces du palais de Pelops : locus hic habendae curiae 1 . Le terme<br />
curia désigne habituellement le lieu où se réunit le Sénat, et garde une connotation<br />
républicaine, tandis que le conseil du prince, qui correspond davantage à la situation des rois<br />
d’Argos, est plutôt appelé consilium.<br />
L'exemple de forum est sans doute plus significatif encore, car on peut mettre en<br />
regard deux de ses emplois dans la même pièce : il s'agit d'Hercule Furieux. On lit en effet<br />
aux vers 733-734 :<br />
Aditur illo Gnosius Minos foro,<br />
Rhadamanthus illo, Thetidis hoc audit socer. 2<br />
Ici, forum se traduit par "tribunal", et ne réfère à aucune réalité romaine. Dans les vers 172-<br />
173, le même terme désigne précisément ce que nous appelons le "forum", place de Rome qui<br />
était le centre de la vie publique, et peut à première vue n'être que la traduction latine du grec<br />
agora.<br />
hic clamosi rabiosa fori<br />
iurgia uendens improbus iras<br />
et uerba locat. 3<br />
1 Ag. 11. Sur cet emploi de curia, cf. Virgile, En. VII, 174.<br />
2 « dans un tribunal on est confronté à Minos, de Crète, dans un autre à Rhadamanthe, dans un autre<br />
encore siège le beau-père de Thétis. »<br />
3 « celui-ci, pour tirer un profit malhonnête des disputes enragées du forum bruyant, loue ses<br />
emportements et ses paroles. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
286
Pourtant, on peut voir dans ces vers une référence à la loi Cincia de donis et muneribus 1 , qui<br />
interdisait de faire des cadeaux aux orateurs pour plaider une cause, afin d'éviter les cas de<br />
corruption.<br />
Cette loi, qui date de l'année 204 2 , fut remise en vigueur au début du règne de Néron,<br />
conformément à la volonté du Sénat 3 . Suilius, orateur vénal selon Tacite 4 , exilé sous Tibère en<br />
24 5 , s'était fait l'allié de Messaline, dont la mort le jeta dans la disgrâce. Au début du règne de<br />
Néron, Suilius s'oppposa à Sénèque, à qui il reprochait d'effacer les décisions de Claude : il se<br />
mettait ainsi du côté d'Agrippine, qui voulait que la politique de l'empereur précédent fût<br />
respectée 6 . Plus personnellement, il reprochait à Sénèque de manœuvrer pour priver<br />
d'honnêtes orateurs de leur juste salaire, alors qu'il avait lui-même amassé une fortune<br />
colossale 7 . Ainsi Sénèque, en intentant un procès contre ce personnage, en 58, combattait non<br />
seulement un ennemi personnel, mais toute une politique, et en particulier, de façon indirecte,<br />
l'influence d'Agrippine sur son fils. En effet, Suilius accusait Sénèque, entre autres, de trahir<br />
la mémoire de Germanicus, mémoire dont se servait Agrippine pour maintenir son emprise<br />
sur son fils 8 . Les vers 172-174 d'Hercule Furieux font donc certainement référence à cette<br />
querelle, en l'intégrant au tableau critique de l'entourage des rois. Le terme forum prend alors<br />
une connotation romaine, puisqu'il désigne, dans un contexte particulier et daté, l'endroit où<br />
les orateurs se livraient à leurs harangues.<br />
1 Pour une bibliographie sur la lex Cincia, F. Casavola, Lex Cincia : contributo alla storia delle origini<br />
della donazione romana, 1960, rev. par W. M. Gordon, JRS 51, 1961, p. 248.<br />
2 Tite Live, XXXIV, 4, 9 ; Cicéron, De Or. II, 71, 286.<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 5, 1.<br />
4 Tacite, Ann. XII, 42 : Is fuit P. Suilius, imperitante Claudio terribilis ac uenalis...<br />
5 Tacite, Ann. IV, 31, 3.<br />
6 P. Grimal, 1991a, p 168 et 185 ; Tacite, Ann. XIII, 5.<br />
7 Tacite, Ann. IV, 31, 3.<br />
8 P. Grimal, 1991a, p 184-185, Tacite, Ann. XIV, 7, 6.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
287
2/ La place de la rhétorique.<br />
L’expérience du métier d’avocat, dans les premières années de la carrière de Sénèque,<br />
n’est pas seulement à l’origine de cet intérêt pour les notions juridiques. Elle suppose<br />
également une pratique assidue de la rhétorique et en particulier de certains des exercices qui<br />
avaient cours dans le cadre de la formation des orateurs. Sénèque avait eu, avec son père, un<br />
exemple de choix en la matière, et le caractère rhétorique des tragédies, qui doit beaucoup à<br />
Euripide par ailleurs, se trouve renforcé par l’influence de ces écoles. Il s’agit en particulier de<br />
deux types d’exercices proposés aux apprentis orateurs : les controuersiae et les suasoriae. La<br />
pratique des premières consiste en un débat contradictoire, qui mêle les considérations<br />
juridiques et morales, sur un sujet complexe. Un exemple célèbre de controverse est connu<br />
sous le titre de Serment des époux : deux époux ont fait le serment de ne pas se survivre. Parti<br />
en voyage, le mari fait annoncer sa mort à sa femme. Elle se jette donc du haut d’un rocher,<br />
mais n’est que blessée. Son père exige qu’elle divorce lorsque son mari revient. Elle refuse,<br />
son père la déshérite et la renie : il s’agit de présenter la défense de la femme 1 . Dans Les<br />
Troyennes, le débat entre Pyrrhus et Agamemnon au sujet du sacrifice de Polyxène 2 aurait pu<br />
fournir le sujet d’une controverse. Les deux adversaires affrontent leur point de vue en deux<br />
tirades symétriques, développant deux thèses opposées, puis un dialogue vif s’engage.<br />
Pyrrhus tout d’abord invoque la gloire d’Achille et son rôle dans la chute de Troie :<br />
puisque les autres chefs achéens ont reçu une illustre captive dans leur part de butin, Achille,<br />
le plus vaillant de tous, ne saurait être privé de sa récompense 3 . L’argument, quelque peu<br />
1 Sénèque le Rhéteur, Contr. II, 2. Ovide, sur ce sujet, avait brillamment plaidé sans la distinguer la<br />
cause des époux (II, 2, 12).<br />
2 Tro. 203 sq.<br />
3 Tro. 203-249.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
288
spécieux, évoque les colores que décrit Sénèque le Père dans ses Controuersiae 1 .<br />
Agamemnon répond par des considérations plus distanciées sur les droits du vainqueur 2 , et<br />
dénonce le caractère criminel du sacrifice exigé par l’ombre d’Achille 3 . Les arguments<br />
propres à la situation, qui font référence à des éléments significatifs comme le sacrifice<br />
d’Iphigénie au vers 331, sont complétés par un usage abondant de sententiae qui se répondent<br />
et s’enchaînent en stichomythie :<br />
A. Praeferre patriam liberis regem decet.<br />
P. Lex nulla capto parcit aut poenam impedit.<br />
A. Quod non uetat lex, hoc uetat fieri pudor. 4<br />
Enfin, l’affrontement verbal des deux chefs s’achève sur un échange d’attaques personnelles<br />
qui, suivant la tradition romaine de l’altercatio 5 , relèvent volontiers de l’ironie ou du<br />
sarcasme 6 :<br />
A. Hos Scyros animos ?<br />
P. Scelere quae fratrum caret.<br />
Inclusa fluctu.<br />
P. Nempe cognati maris :<br />
1 Sénèque le Rhéteur, Contr. II, 1, 24.<br />
2 Tro. 254-287.<br />
3 Tro. 255-256 : Quid caede dira nobiles clari ducis / aspergis umbras ? et v. 289-290 : et facinus<br />
atrox caedis ut thalamos uocent, / non patiar.<br />
4 Tro. 332-334 :<br />
« AGAMEMNON. - Un roi se doit de préférer sa patrie à ses enfants.<br />
PYRRHUS. - Il n’est pas de loi qui épargne les captifs, ou qui empêche les châtiments.<br />
AGAMEMNON. - Ce que la loi n’interdit pas, c’est l’honneur qui le défend. »<br />
5 Cicéron, De Or. II, 255.<br />
6 Quintilien, VI, 3, 4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
289
Atrei et Thyestae nobilem noui domum. 1<br />
Dans la même tragédie, on trouve trace d’un second type d’exercice pratiqué dans les<br />
écoles de rhétorique : les suasoriae, discours délibératifs dans lesquels l’orateur exhorte un<br />
personnage historique ou mythologique à prendre tel ou tel parti 2 . Cet exercice était<br />
généralement proposé aux élèves les plus jeunes, et on en connaît notamment des sujets grâce<br />
à l’ouvrage laissé par Sénèque le Rhéteur. On propose ainsi aux élèves de faire délibérer<br />
Agamemnon pour savoir s’il doit ou non sacrifier sa fille Iphigénie 3 , ou de se demander si<br />
Cicéron doit brûler ses Philippiques pour avoir la vie sauve 4 . Ovide avait du goût pour les<br />
suasoriae 5 , et les personnages des Héroïdes étaient familiers aux élèves des écoles de<br />
rhétorique (dans les Métamorphoses, la longue intervention d’Atalante suit ce procédé 6 ).<br />
Dans Les Troyennes, face à Ulysse qui tente de la convaincre de remettre son fils aux<br />
Grecs 7 , Andromaque se livre à un aparté d’une vingtaine de vers 8 , dans lequel elle délibère sur<br />
le parti à prendre, et décide finalement de continuer à cacher Astyanax. La longueur du<br />
monologue, qui suspend le dialogue des personnages, vient à l’encontre de la vraisemblance<br />
de la scène et de la continuité de l’action dramatique. Le discours d’Andromaque constitue<br />
1 Tro. 339-341 :<br />
« AGAMEMNON. - C’est Scyros qui te donne cette assurance ?<br />
PYRRHUS. - Elle qui ignore les crimes fraternels.<br />
AGAMEMNON C’est que les flots l’enferment.<br />
PYRRHUS. – les flots d’une mer qui est ma parente. La noble maison d’Atrée et de Thyeste,<br />
je la connais. »<br />
2 Quintilien, II, 4, 25.<br />
3 Sénèque le Rhéteur, Suas. 3.<br />
4 Sénèque le Rhéteur, Suas. 7.<br />
5 Sénèque le Rhéteur, Contr. II, 2, 9-12.<br />
6 M. X, 600-637.<br />
7 A propos de cette suasoria d’Ulysse : A. F. Caviglia, 1981.<br />
8 Tro. 642-662.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
290
une amplification rhétorique de son mouvement d’hésitation, et offre un morceau d’éloquence<br />
que le public romain appréciait. En même temps, l’impasse dans laquelle se trouve<br />
Andromaque accentue le caractère tragique des débats qui la déchirent : quelle que soit sa<br />
décision, en effet, c’est Hector qu’elle sacrifie irrémédiablement.<br />
Ingrata, dubitas ? Hector est illinc tuus.<br />
Erras : utrimque est Hector. 1<br />
Par les thèmes qu’elles invoquent, les suasoriae constituent une pratique au sein de laquelle<br />
les données mythologiques et historiques se mêlent, créant ainsi un univers ni réel ni fictif, où<br />
l’on peut entendre la voix de Cicéron ou d’Agamemnon. Parfois, le cas des personnages<br />
mythiques est envisagé à travers des données juridiques contemporaines, ce qui achève de<br />
brouiller les pistes 2 . La confusion qui en résulte alimente la critique de l’enseignement des<br />
écoles de rhétorique, dont Tacite se fait l’écho dans le Dialogue des orateurs 3 . A l’époque de<br />
Sénèque, Pétrone présentait les mêmes griefs au début du Satiricon :<br />
Nunc et rerum tumore et sententiarum uanissimo strepitu hoc tantum proficiunt ut,<br />
cum in forum uenerint, putent se in alium orbem terrarum delatos. 4<br />
1 Tro. 658-659 : « Ingrate, tu hésites ? Ton cher Hector d’un côté... Non, tu te trompes : des deux côtés<br />
se tient Hector. »<br />
2 G. Achard, 1996 ; E. Fantham, 1982, p. 253.<br />
3 Tacite, D. XXXV.<br />
4 Pétrone, Satiricon, 1 : « En réalité, tout ce qu’ils (les jeunes gens) retirent de cette enflure et de ce<br />
cliquetis verbal sans aucun intérêt, c’est qu’ils s’imaginent, quand ils se rendent au forum, être<br />
transportés dans un autre univers. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
291
Sénèque le Père confirme ce jugement, sur des exercices qui ne préparent pas bien les<br />
orateurs aux conditions réelles du barreau, et sur une pratique de l’éloquence coupée de la<br />
réalité 1 . Ce phénomène montre toutefois que la mythologie garde à l’époque de Sénèque la<br />
fonction d’interprétation de la réalité présente que l’enseignement des grammatici a contribué<br />
à fortifier, et que Sénèque a pratiquée en tant que précepteur de Néron. La frontière qui sépare<br />
la fiction de la réalité devient dès lors plus indécise, et plus incertaine encore du fait des<br />
anachronismes qui entraînent une confusion des repères temporels et culturels.<br />
II/ La signification de cette appropriation : l’exemple du thème de la<br />
divination dans Œdipe.<br />
La divination d’Œdipe présente un développement particulier, qui met en valeur les<br />
composantes étrusques du rite, et répond à l’intérêt des contemporains de Sénèque pour ces<br />
pratiques. Le thème est abondamment exploité dans la tragédie, pour les ressources<br />
esthétiques et les possibilités scéniques qu’il recèle, mais aussi parce qu’il corrrespond à un<br />
horizon d’attente du public de Sénèque, et ce quelles que soient les conditions de<br />
représentation ou de diffusion de la pièce. Enfin, en représentant des pratiques divinatoires<br />
familières aux Romains, le poète se fait l’écho de préoccupations contemporaines,<br />
philosophiques et politiques, dont il témoigne par ailleurs dans son œuvre en prose.<br />
Au départ, une situation analogue à celle de l’Œdipe Roi de Sophocle est mise en<br />
place : le roi a chargé son beau-frère, Créon, d’aller consulter l’oracle d’Apollon, à Delphes,<br />
sur le moyen de venir à bout de la peste qui sème à Thèbes la mort et la désolation. A son<br />
1 Contr. IV, préface.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
292
etour, Créon présente l’oracle sous son jour traditionnel, ambigu, qui vaut à Apollon le<br />
qualificatif de Loxias :<br />
Ambage flexa Delphico mos est deo<br />
arcana tegere. 1<br />
Puis vient le compte-rendu de la consultation de la Pythie, suivant le rite traditionnel évoqué<br />
dans la tragédie de Sophocle 2 . Œdipe désire alors connaître l’identité du meurtrier qui doit<br />
être châtié. C’est alors que survient Tirésias, accompagné de sa fille Mantô, pour se livrer à<br />
un sacrifice divinatoire. Ce sacrifice, propre à la tragédie de Sénèque, revêt toutes les<br />
apparences de la divination telle qu’elle était pratiquée à Rome par les haruspices.<br />
A/ Le sacrifice divinatoire (Œd. v. 291-389) et la pratique des haruspices.<br />
1/ Le déroulement du sacrifice.<br />
Dans les vers 336 à 350, la description du déroulement du sacrifice est prise en charge<br />
par Mantô, qui répond aux questions de son père. Tirésias souligne ainsi les trois étapes du<br />
sacrifice proprement dit : d’abord, l’attitude des victimes pendant la phase préparatoire 3 , puis<br />
le geste sacrificateur, qui doit en principe les abattre du premier coup 4 , et enfin l’aspect des<br />
1 Œd. 214-215 : « Le dieu de Delphes a coutume de voiler de mystère ses réponses incertaines. »<br />
2 Œd. 223-238.<br />
3 Œd . 336-337.<br />
4 Œd. 340.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
293
lessures provoquées par le couteau 1 . A chaque fois, le taureau manifeste une particularité<br />
inquiétante : il semble se dérober au rite, agonise péniblement après avoir reçu deux blessures,<br />
et son sang ne s’écoule pas conformément aux attentes formulées par le devin. En particulier,<br />
le sang qui reflue des plaies et rejaillit par les yeux de la victime, présente une in<strong>version</strong> du<br />
cours naturel des choses, et achève de provoquer l’inquiétude de Tirésias :<br />
Infausta magnos sacra terrores cient. 2<br />
Les vers 351-383 correspondent à la deuxième partie du rite, et permettent le rapprochement<br />
avec les pratiques des haruspices à Rome : il s’agit de l’examen des entrailles 3 . C’est en effet<br />
en tant que spécialistes de ce type d’observation que les haruspices avaient leur place dans la<br />
liturgie romaine, et ce depuis l’époque des Tarquins, si l’on en croit Tite Live 4 . La validité de<br />
cette consultation repose sur le principe d’une harmonie universelle et naturelle, qui permet de<br />
voir dans le corps de l’animal des correspondances avec les régions du monde. L’examen des<br />
exta, entrailles des animaux sacrifiés, comporte deux étapes : d’abord, il faut vérifier le bon<br />
état des viscères, comme un signe de l’approbation divine et de l’ordre qu’elle établit. Mantô<br />
observe donc, conformément aux exigences de la discipline, le cœur, le foie et les poumons<br />
des victimes. Mais c’est leur caractère inouï, manifestation de la colère des dieux, qui<br />
s’impose et provoque la crainte des assistants. Sa description s’ouvre en effet sur une question<br />
angoissée, qui manifeste son trouble devant l’aspect inhabituel des choses : Genitor, quid hoc<br />
est ? 5 Outre sa dimension expressionniste, la description des exta fait naître une inquiétude<br />
1 Œd. 345-346.<br />
2 Œd. 351 : « Ce funeste sacrifice me cause une immense terreur ».<br />
3 G. Dumézil, 1974, p. 595.<br />
4 XXV, 12, 2.<br />
5 Œd. 353.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
294
croissante, puisque les deux animaux sacrifiés sont désormais confondus, et présentent tous<br />
deux des anomalies manifestes, alors que, précédemment, le taureau semblait seul concerné.<br />
Mantô souligne à plusieurs reprises le bouleversement de l’ordre naturel qui se confirme à<br />
chaque étape de son discours. L’état général des viscères, tout d’abord, est inhabituel :<br />
Non leui motu, ut solent,<br />
agitata trepidant exta, sed totas manus<br />
quatiunt nouusque prosilit uenis cruor. 1<br />
Ensuite, la place des organes et leur fonction naturelle présentent des bouleversements et des<br />
in<strong>version</strong>s :<br />
mutatus ordo est, sede nil propria iacet,<br />
sed acta retro cuncta... 2<br />
Ainsi, la disposition et l’aspect des organes internes des victimes suscitent la terreur d’Œdipe,<br />
mais la signification des différents signes décrits par Mantô lui échappe encore, car ils<br />
n’apportent pas de réponse à la question fondamentale qui se pose, celle du nom du meurtrier<br />
de Laius.<br />
1 Œd. 353-355 : « Ce n’est pas, comme à l’accoutumée, un léger mouvement qui soulève les viscères<br />
palpitantes, elles repoussent entièrement les mains et un flot de sang renouvelé jaillit des veines ».<br />
2 Œd. 366-367 : «L’ordre naturel est bouleversé, rien ne se trouve à sa place mais tout est inversé. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
295
2/ La lecture des signes.<br />
Pour le spectateur au fait du mythe et du sort qui attend la maison de Thèbes, les<br />
entrailles des animaux fournissent un certain nombre d’indices. Le caractère divinatoire de ce<br />
genre de sacrifice apparaît alors au spectateur romain, d’autant plus qu’il connaît les pratiques<br />
des haruspices. Le bouleversement des lois de la nature, qui arrache à Mantô le terme nefas,<br />
est en effet à l’image du crime commis à son insu par Œdipe, meurtrier de son père et époux<br />
de sa mère. A l’énormité du sacrilège correspond l’étrangeté des viscères, et en particulier de<br />
la matrice de la génisse, innuptae, qui ne devrait pas porter de fœtus. Elle révèle donc la faute<br />
du roi, et la confusion des rôles de fils et d’époux. L’examen du foie, quant à lui, annonce des<br />
calamités à venir : la division des tissus en deux têtes est immédiatement interprétée sur le<br />
plan politique, comme un présage funeste à l’unité du royaume 1 . De façon transparente,<br />
l’affrontement d’Etéocle et de Polynice, issus d’un accouplement contre-nature, est ici<br />
annoncé. De même, la présence de sept veines menaçantes réfère à l’expédition des Sept<br />
contre Thèbes. Ces signes demeurent obscurs pour les personnages, mais ils font très<br />
clairement allusion, pour le public de Sénèque, à la situation présente et aux événements<br />
futurs.<br />
3/ L’importance de la pratique des haruspices à Rome.<br />
Selon les principes de la science des haruspices, le foie représente « un microcosme<br />
divisible en un certain nombre de régions qui correspondent à autant de régions homologues<br />
1 Œd. 359.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
296
du macrocosme qu’est l’univers » 1 . On connaît des exemples de cérémonies de ce type, qui<br />
avaient lieu par exemple avant des batailles. Tite Live rapporte ainsi le sacrifice auquel on<br />
procéda avant la bataille de Veseris, en 340 av. J.-C., et l’avis de l’haruspice qui décida P.<br />
Décius à se livrer à la deuotio pour assurer la défaite des ennemis 2 : une lésion du foie,<br />
observée à l’une de ses extrémités, annonçait en effet un danger qu’il fallait conjurer. Vers la<br />
fin de la République, Nigidius Figulus, a beaucoup contribué à répandre et à développer la<br />
discipline, notamment par son traité De extis 3 . Les haruspices pouvaient s’attacher à un<br />
personnage privé, c’est le cas de César 4 . Leur lien avec le pouvoir est confirmé par des<br />
mesures prises par Auguste 5 ou Tibère 6 , pour essayer de limiter l’influence de cette instance<br />
divinatoire. Mais c’est à partir du règne de Claude que les haruspices bénéficièrent d’une<br />
organisation et d’un statut officiels. Le prince, nous dit Tacite, soucieux de préserver un art si<br />
ancien dans l’Italie, et que les superstitions étrangères conduisaient à négliger 7 obtint par un<br />
sénatus-consulte l’intégration des haruspices dans le corps sacerdotal. C’est à ce collège que<br />
Néron fit appel en 55 pour purifier la ville après que la foudre se fut abattue sur le Capitole 8 .<br />
Les haruspices sont donc bien considérés comme spécifiquement romains, héritiers de<br />
la tradition étrusque. Dans l’épopée de Lucain 9 , l’haruspice Arruns, étrusque comme il se<br />
1 Y. Lehman, 1999, p. 253 ; Cicéron, Diu. II, 28 et 34.<br />
2 Tite Live, VIII, 9, 1.<br />
3 Sur Figulus : E. Rawson, 1978. On retrouve le personnage dans l’épopée de Lucain, I, 584-638, où il<br />
se livre à une prédiction de type astrologique.<br />
4 Cicéron, Fam. 9, 24 ; Suétone, Caes. 81.<br />
5 Dion Cassius, 56, 25.<br />
6 Suétone, Tib. 63.<br />
7 Tacite, Ann. XI, 15, 1-3. D. Briquel, 1995.<br />
8 Tacite, Ann. XIII, 14.<br />
9 M. Rambaud, 1985.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
297
doit 1 , est convoqué de more uetusto 2 , par les Romains épouvantés de savoir que César est en<br />
marche contre la Ville. Pour répondre à leurs questions, il consulte selon son art les entrailles<br />
d’animaux sacrifiés, et en tire des conclusions aussi mystérieuses qu’effrayantes. Dans la<br />
scène de sacrifice qui nous intéresse, Tirésias se comporte lui aussi comme un praticien de<br />
cette science 3 .<br />
B/ La scène de nécromancie (Œd. v. 530-658) : un parti pris esthétique.<br />
Le devin constate cependant l’inefficacité de ces méthodes pour dévoiler le nom du<br />
coupable, ce qui nécessite le recours à la nécromancie 4 . Cette scène, qui constitue<br />
l’aboutissement d’une gradation dans l’horreur et la terreur, fait l’objet d’un récit de Créon à<br />
Œdipe. Il est à noter qu’elle ne figure pas chez Sophocle, principale source de Sénèque. Le<br />
poète s’inspire en effet du chant XI de l’Odyssée, au cours duquel Ulysse se rend aux enfers<br />
pour interroger Tirésias. Les rites qui précèdent la nécromancie correspondent à ceux que l’on<br />
rencontre chez Homère et les auteurs tragiques grecs : libations de vin et de lait 5 et offrandes<br />
d’animaux destinés aux dieux infernaux 6 .<br />
1 Arruns fait partie des devins étrusques, Tusci uates (Pharsale, I, 584). Il nous est inconnu par ailleurs,<br />
mais son nom est caractéristique, puisqu’il rappelle le fils de Tarquin (Tite Live, I, 56, 7), et celui de<br />
Porsenna (Id. II, 14, 5).<br />
2 Tite Live, I, 56, 5.<br />
3 G. Freyburger, 1990, p. 125.<br />
4 Lucain a recours, dans son épopée, à une progression comparable, puisque trois prédictions se<br />
succèdent, de plus en plus précises : après l’haruspice en effet, intervient Nigidius Figulus (I, 639-<br />
672), puis le délire d’une matrone (673-695), sur lequel se clôt ce premier chant.<br />
5 Sénèque, Œd. 565-566 ; Homère, Od. XI, 25-33.<br />
6 Œd. 556-557 ; Eschyle, Les Perses, 603-622.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
298
1/ Le topos du lucus.<br />
Le modèle homérique semble donc, à première vue, éloigner le passage des réalités<br />
romaines et du contexte de composition de la pièce. Et pourtant, deux éléments au moins<br />
rapprochent cette scène, si exotique en apparence, des contemporains de Sénèque, comme l’a<br />
montré l’article de A.-M. Taisne 1 . D’abord, le lieu de la divination fait l’objet d’un assez long<br />
développement 2 : il s’agit d’un bois sacré, un lucus 3 , situé près de Thèbes, remarquable par<br />
l’enchevêtrement d’arbres de différentes essences. Sénèque en énumère neuf, parmi lesquelles<br />
le cyprès, consacré à Pluton, arbre funéraire part excellence. Horace le convoque à plusieurs<br />
reprises dans un contexte de mort 4 . Les bois sacrés 5 , dans lesquels il était interdit de prendre<br />
du bois 6 , présentaient un aspect extrêmement sombre et sauvage, dont les vers 534 à 537<br />
expriment l’inextricable désordre. L’obscurité épaisse qui en résulte (lucis et Phoebi inscius) 7<br />
compose une atmosphère à la fois effrayante et propice au sacrifice à venir. Le froid glacial de<br />
l’eau stagnante (restagnat umor frigore aeterno rigens), allié à l’absence de mouvement,<br />
complètent ce tableau où la mort semble déjà planer. Le décor est ainsi planté, en quelque<br />
sorte, instillant dans l’esprit des spectateurs, et d’Œdipe en premier lieu, une impression<br />
d’horror sacré.<br />
Mais si la présence de cette description se justifie dans l’économie de la pièce, et<br />
correspond par ailleurs au style de Sénèque, elle constitue également le développement d’un<br />
topos littéraire apprécié des auteurs latins. Dans un passage semblable qui sert de prélude au<br />
1 A.-M. Taisne, 1991.<br />
2 Œd. 530-547.<br />
3 J. Scheid, 1995.<br />
4 Horace, O. I, 9, 9-12 ; Epod. 5, 18 (cupressos funebris).<br />
5 J. Bayet, 1969, p. 26.<br />
6 Plutarque, Marius, 39.<br />
7 Œd. 545.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
299
monstrueux sacrifice d’Atrée, un lucus fait office de sanctuaire des Tantalides : on y retrouve<br />
les mêmes essences d’arbres au sombre feuillage, plus radicalement vouées aux puissances<br />
infernales 1 avec toujours un chêne dominant l’ensemble 2 , et une mare d’eau croupie rappelant<br />
les eaux du Styx 3 . Sénèque consacre également un passage de la lettre 41 à Lucilius à la<br />
description d’un bois sacré, en insistant sur son caractère impressionnant, pour affirmer le<br />
sentiment religieux que provoque l’atmosphère de l’endroit 4 . D’autres auteurs, et en<br />
particulier Horace, témoignent de la sensibilité des Romains à ces sanctuaires 5 , au point de<br />
fournir à l’expression littéraire et poétique un motif récurrent 6 . Par cette description du lucus<br />
de Thèbes, Sénèque fait subir à la cérémonie de la nécromancie un traitement qui correspond<br />
à la sensibilité de ses contemporains, et qui, de ce fait, contribue à romaniser l’ensemble.<br />
2/ Poétique de la terreur.<br />
La nécromancie est un mode de divination qui répond au goût des Romains du premier<br />
siècle 7 , au point d’apparaître dans toutes les épopées de la période 8 . L’évocation des morts, les<br />
rituels forcément effrayants qui l’entourent, contribuent à créer une atmosphère fantastique,<br />
1 Th. 650-656.<br />
2 Th. 656.<br />
3 Th. 665-667.<br />
4 Sénèque, Ep. 41, 3. Dans ce passage, Sénèque cite Virgile, En. VIII, 351-352 ; A.-M. Taisne, 1991,<br />
p. 262.<br />
5 P. Grimal, Les Jardins romains, 2 e éd. Paris, 1949, p. 53 sq.<br />
6 D. Vessey, Statius and the Thebaid, Cambridge, 1973, p. 245. Horace (A.P. 16 sq.) critique même le<br />
recours parfois excessif des poètes à ce topos, qui inspire cependant Lucain (B. C. III, 399 sq) et Stace<br />
(Théb. 419-433).<br />
7 F. Cumont, Lux Perpetua, Paris, 1949, p. 97.<br />
8 Valerius Flaccus, Argonautiques, I ; Silius Italicus, Guerres Puniques, XIII ; Lucain, B. C. VI.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
300
abolissant les frontières entre morts et vivants et la richesse expressive de ces scènes, comme<br />
la fascination horrifiée qu’elles provoquent offrent de multiples ressources à l’expression<br />
poétique de la terreur. Ainsi, la tragédie de Sénèque s’ouvre sur l’évocation de la peste qui<br />
dévore les habitants de Thèbes, objet de la désolation d’Œdipe 1 . Le chœur intervient peu après<br />
pour reprendre ce thème, décrivant la progression et les ravages de la maladie en des termes<br />
cliniques 2 qui ne font qu’ajouter, par leur précision, à l’impression pesante et étouffante qui se<br />
dégage de ces vers. Et déjà, dans la cité dévastée, avant que les incantations de Tirésias ne<br />
fassent remonter Laius des enfers, les morts se mêlent aux vivants 3 dans une atmosphère de<br />
fin du monde, provoquant l’horreur qui fait frissonner le roi. Le chaos est tel, à ce moment<br />
déjà, que les lois de la nature elles-mêmes semblent devenues caduques, ce qui affecte<br />
indifféremment les hommes, les animaux domestiqués ou sauvages, et la terre cultivée ou<br />
non 4 . Il ne s’agit cependant que du point de départ de la gradation vers une terreur de plus en<br />
plus grande, qui passe par le sacrifice de Tirésias pour culminer avec l’évocation de Laius.<br />
3/ Le goût de la magie.<br />
La tonalité fantastique que l’on remarque dans la tragédie se voit confirmée, de<br />
manière significative, par les correspondances que le texte invite à établir entre la divination<br />
de Tirésias et la magie. Encore une fois, il s’agit là d’un centre d’intérêt contemporain. Déjà, à<br />
1 Œd. 28-81.<br />
2 En particulier, les vers 180 et suivants détaillent de manière très réaliste et clinique les symptômes de<br />
la maladie.<br />
3 Les vers 160 à 178 développent le thème surnaturel des enfers envahissant le séjour des vivants, avec<br />
des images impressionnantes, comme celle de la confluence des fleuves terrestres et infernaux, v. 160-<br />
163.<br />
4 Œd. 145-158.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
301
l’époque d’Auguste, les poètes avaient trouvé une source d’inspiration dans ces pratiques : en<br />
ce temps-là, en effet, la magie connaissait un fort succès dans les quartiers mal famés de la<br />
capitale, en particulier le Subure, et touchait principalement le milieu populaire. C’est sans<br />
doute ce qui explique les nombreuses allusions que l’on rencontre chez les élégiaques latins,<br />
le plus souvent sur un mode détaché et humoristique, puisqu’ il s’agit le plus souvent de<br />
philtres d’amour ou de l’envoûtement d’un amant 1 . Cependant ces poètes ne décrivent pas à<br />
proprement parler les cérémonies.<br />
Dans les Métamorphoses d’Ovide, en revanche, un assez long passage est consacré<br />
aux rituels magiques auxquels Médée se livre pour obtenir le rajeunissement d’Eson. Cette<br />
fois, la description ne prête guère à sourire, elle présente la Colchidienne sous un jour<br />
effrayant. On retrouve, comme dans la scène de nécromancie d’Œdipe, le sacrifice aux dieux<br />
infernaux et les rites dédiés aux puissances chtoniennes 2 . Bien sûr, le thème de la magie et des<br />
pratiques occultes est abondamment développé dans la Médée de Sénèque 3 , lorsque au cours<br />
d’un long monologue, dont une grande partie est chantée, Médée se livre à ses incantations<br />
devant sa nourrice muette. Le thème même de la tragédie permet de montrer toute la<br />
puissance de la magicienne, bien qu’il soit impossible de voir là la raison d’être ni la<br />
signification profonde de la pièce. Il n’en demeure pas moins que le thème de la magie s’en<br />
trouve renforcé dans l’œuvre de Sénèque.<br />
Dans la Pharsale, la nécromancie est prise en charge par la sorcière Erichto, aussi<br />
thessalienne que les haruspices sont étrusques. Lucain affirme donc nettement le lien qui<br />
existe entre la magie et ce mode de divination. Hécate, déesse protectrice des tombeaux, n’est-<br />
1 Par exemple, Tibulle, El. I, II, 43-60 ; Properce, El. III, 21-30.<br />
2 Mét. VII, 238-261.<br />
3 Sénèque, Med. v 740-848.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
302
elle pas aussi par excellence celle de la sorcellerie 1 ? Dans ce long passage du chant VI, le<br />
poète se livre à une longue énumération des pouvoirs des magiciennes thessaliennes 2 , avant de<br />
détailler complaisamment l’horrible aspect d’Erichto 3 et les préparatifs abominables de la<br />
cérémonie 4 . Chez Sénèque, Tirésias se rapproche par son aspect sinistre des puissances qu’il<br />
s’apprête à convoquer :<br />
Ipse funesto integit<br />
uates amictu corpus et frontem quatit.<br />
Lugubris imos palla perfundit pedes ;<br />
squalente cultu maestus ingreditur senex ;<br />
mortifera canam taxus adstringit comam. 5<br />
Le caractère mortuaire de la mise est abondamment souligné, notamment par l’accumulation<br />
des termes lugubris, squalente et mortifiera en début de vers. Les vêtements de deuil et la<br />
couronne d’if, arbre spécialement funèbre, composent à Tirésias une apparence lugubre et<br />
effrayante, qui le place au bord du monde des morts auquel il se prépare à accéder. Les<br />
magiciens et sorcières, eux aussi, se livrent à des dévotions et incantations sépulcrales pour<br />
accomplir leurs prodiges 6 . Enfin, l’emploi du terme carmen 7 pour désigner les paroles de<br />
1 Cf Œd. 569.<br />
2 Lucain, B. C. VI, 452-494.<br />
3 Lucain, B. C. VI, 515-526.<br />
4 Lucain, B. C. VI, 624-749.<br />
5 Œd. 551-555 : « Lui-même, le devin recouvre son corps d’un vêtement funèbre et il secoue la tête.<br />
Un manteau de deuil lui descend jusqu’aux pieds ; dans ce sinistre appareil le sombre vieillard<br />
s’avance ; l’if des morts couronne sa chevelure blanche. »<br />
6 Comme la sorcière Méroé dans les Métamorphoses d’Apulée, II, 5.<br />
7 Œd. 561.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
303
Tirésias confirment cette parenté de la nécromancie et de la magie 1 . On peut en conclure que<br />
cette scène de divination dans l’Œdipe de Sénèque, outre qu’elle constitue une étape<br />
fondamentale de la gradation vers l’horreur qui se déploie dans la pièce, connaît un<br />
développement particulier qui correspond à l’horizon d’attente du public de Sénèque, qui<br />
manifeste un réel intérêt pour cet art.<br />
C/ Implications philosophiques et politiques.<br />
1/ Les pratiques divinatoires à Rome.<br />
Le constat d’échec de Tirésias porte sur deux des pratiques divinatoires : l’examen des<br />
entrailles, qui relève de l’haruspicine, et l’observation du vol des oiseaux qui est du ressort<br />
des augures 2 , mais c’est encore une pratique bien romaine :<br />
Nec alta caeli quae leuis pinna secat<br />
nec fibra uiuis rapta pectoribus potest<br />
ciere nomen ; alia temptanda est uia. 3<br />
La religion archaïque romaine établissait entre les sacerdoces une nette distinction<br />
entre les prêtres qu’étaient les augures et les haruspices, techniciens de la divination. Mais dès<br />
1 Cf Apulée, Métamorphoses, I, 10.<br />
2 Y. Lehman, 1999, p. 251, sur les signa ou auspicia destinés à l’observation des augures.<br />
3 Œd. 390-392 : « Ni le vol léger des oiseaux qui déchirent les hauteurs du ciel, ni les fibres arrachées<br />
aux poitrines des victimes encore vivantes ne peuvent révéler le nom : il faut tenter une autre voie. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
304
l’époque d’Auguste, on note une tendance à assimiler les fonctions des haruspices et des<br />
augures 1 , et c’est la dimension divinatoire de ces pratiques qui permet de faire le lien entre<br />
elles. Vers la fin de la République et au début de l’Empire, en effet, les Romains se<br />
montraient particulièrement sensibles aux différents signes et aux présages, attitude que<br />
Cicéron critique dans le De diuinatione :<br />
Quae si suscipiamus, pedis offensio nobis et abruptio corrigiae et sternumenta erunt<br />
obseruanda. 2<br />
Cette remarque ironique souligne la vogue de la divination qui s’est répandue à Rome dès le<br />
premier siècle. En outre, sa validité n’est pas restreinte à l’époque de Cicéron puisque c’est<br />
typiquement un signe de ce type qui a retenu Néron de partir en Grèce la première fois 3 . Au<br />
contraire, la tendance se poursuit et s’accentue sous l’Empire, et les présages de toutes sortes<br />
sont pris au sérieux, en particulier dans la sphère du pouvoir. C’est ainsi qu’Auguste, comme<br />
le rapporte Suétone, se montre particulièrement réceptif aux omina 4 , au point de ne jamais<br />
entreprendre d’affaire sérieuse le jour des nones, en raison de l’influence néfaste de ce nom,<br />
dans lequel on pouvait entendre non is, « tu ne pars pas », comme un avertissement.<br />
L’astrologie offre également une source d’inspiration poétique et esthétique : en<br />
particulier, deux œuvres lui sont entièrement consacrées. Manilius, tout d’abord, développe<br />
dans les Astronomica, une conception opposée à celle de Lucrèce, puisqu’il se fonde sur<br />
1 Y. Lehman, 1999, p. 257.<br />
2 Cicéron, Diu. II, 84 : « Si nous acceptons cela, il nous faudra tenir compte de l’achoppement du pied,<br />
de la rupture d’un lacet ou des éternuements ».<br />
3 Suétone, Ner. 19.<br />
4 Suétone, Aug. 92, 5.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
305
l’étude des astres pour démontrer l’existence d’un ordre divin de l’univers 1 . Vers la même<br />
époque, Germanicus, fils adoptif de Tibère, compose une adaptation des Phénomènes<br />
d’Aratos 2 . Cette inspiration n’est donc pas vraiment nouvelle, mais on trouve chez les<br />
contemporains de Sénèque un intérêt accru pour cette discipline, comme en témoigne, par<br />
exemple, le plafond zodiacal de la Domus aurea 3 , l’éloge de Néron dans la Pharsale 4 ou<br />
encore, sur le mode parodique, un plat représentant le zodiaque dans la Cena Trimalcionis 5 .<br />
Le lien de la divination et de l’astrologie est établi, entre autres, par le passage consacré à la<br />
prophétie de Nigidius Figulus dans l’épopée de Lucain 6 .<br />
2/ Le rôle politique de l’astrologie.<br />
La plupart des empereurs, à commencer par Auguste, firent appel à l'astrologie, d'une<br />
part à des fins politiques, en publiant leur horoscope, pour prouver au peuple qu'ils étaient<br />
destinés au pouvoir, d'autre part pour chercher à connaître l'avenir 7 . Tibère consultait<br />
fréquemment les astrologues, et s’était lui-même initié à la science des Chaldéens 8 . Il<br />
comptait ainsi l’astrologue Thrasylle parmi ses proches conseillers 9 . L’astrologue Balbillus,<br />
1 W. Hübner, 1984.<br />
2 A. Traglia, 1984.<br />
3 Suétone, Ner. 31, 2-3.<br />
4 Lucain, B. C. I, 45-66.<br />
5 Sat. XXXV, et le commentaire de Trimalcion, XXXIX<br />
6 Pharsale, v. 650 : Extremi multorum tempus in unum conuenere dies. « Les termes assignés à la vie<br />
de millions d’hommes sont venus converger sur un seul moment. »<br />
7 E. Grzybek, 1999.<br />
8 Tacite, Ann. VI, 20, 3.<br />
9 Tacite, Ann. VI, 21. Suétone, Tib. 62, Cal. 19.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
306
de qui Néron prenait les avis, avait été préfet d’Egypte sous Claude 1 . Ces personnages<br />
exerçaient donc une influence de premier ordre 2 .<br />
Corrélativement, des mesures furent adoptées, afin de limiter l’action des astrologues,<br />
dont les pratiques pouvaient être associées à la magie 3 : il était, en particulier, interdit de les<br />
consulter au sujet de la destinée des Césars. C’est, significativement, l’un des chefs<br />
d’accusation portés contre Lepida Aemilia, sous le règne de Tibère 4 , à côté des crimes<br />
d’adultère et d’empoisonnement. D’autres exemples célèbres confirment l’impression que la<br />
science astrologique était à la fois répandue et redoutée : ainsi, Agrippine accuse sa rivale<br />
Lollia d’avoir eu recours à des astrologues et des magiciens au sujet du mariage de<br />
l’empereur 5 . Quelque temps plus tard, Furius Scribonianus fut exilé sur l’accusation d’avoir<br />
consulté des astrologues au sujet de la durée de la vie du prince 6 . L’astrologie, à un moment<br />
où la question de la succession des empereurs et de la continuité du régime reste<br />
théoriquement indéfinie, joue donc un rôle non négligeable dans l’entourage des princes.<br />
3/ Sénèque et la divination.<br />
Les stoïciens s’intéressent à l’astrologie parce que cette doctrine pose la question du<br />
destin et de son immutabilité 7 . A l’exception de Panetius, qui manifeste un certain scepticisme<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 22.<br />
2 F. H. Cramer, 1954, p. 92-99 (Thrasylle sous Auguste), 99-108 (Thrasylle sous Tibère), 112-115<br />
(Balbillus sous Claude), 115-131 (Balbillus sous Néron).<br />
3 F. H. Cramer, 1951.<br />
4 Tacite, Ann. III, 22.<br />
5 Tacite, Ann. XII, 22.<br />
6 Tacite, Ann. XII, 52.<br />
7 R. J. Hankison, 1988.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
307
à l’égard de toute forme de divination, les disciples du Portique se sont penchés sur le<br />
problème que pose la connaissance d’une chaîne causale universelle, comme l’explique<br />
Cicéron dans le De diuinatione 1 . Sénèque s’intéresse aussi à la divination en général, et à<br />
l’astrologie en particulier 2 . Dans les œuvres en prose de Sénèque, quelques passages sont<br />
consacrés à l’astrologie 3 . Ainsi, la lettre 88 pose le problème du destin et du libre-arbitre : si<br />
les événements s’enchaînent de manière inéluctable, à quoi bon les connaître puisqu’on ne<br />
peut pas les modifier ? A cette objection traditionnelle 4 , l’éthique stoïcienne répond en<br />
déplaçant le problème : ce qui compte, c’est l’aptitude du sage à faire face aux événements,<br />
quels qu’ils soient. Donc l’astrologie fait partie des studia liberalia inutiles à celui qui aspire à<br />
la sagesse.<br />
Dans les tragédies, on trouve des références à l’astrologie, dans une optique<br />
eschatologique. Ainsi, le chœur de Thyeste manifeste, après le récit de l’atroce festin, sa<br />
terreur de voir l’univers entier bouleversé et son équilibre menacé par ce crime sans pareil :<br />
Solitae mundi periere uices ?<br />
Nihil occasus, nihil ortus erit ? 5<br />
Dans la suite du canticum, les constellations correspondant aux signes du zodiaque sont<br />
énumérées sur le thème du chaos céleste 6 : les bouleversements cosmiques, en rapport avec le<br />
crime d’Atrée, se lisent en effet dans les astres, dont la chute mettrait fin au mouvement<br />
1 Cicéron, Diu. II, 88.<br />
2 M. Armisen-Marchetti, 2000.<br />
3 Marc. 18, 3 ; N.Q. II, 37, 7 et VII, 8, 1 ; Ep. 88, 14-17.<br />
4 M. Armisen-Marchetti, 2000, p. 206 ; Cicéron, Diu. II, 21.<br />
5 Th. 813-814 : « Est-ce la fin du retour périodique des phénomènes célestes ? N’y aura-t-il plus ni<br />
Occident, ni Orient ? »<br />
6 Th. 848-874.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
308
incessant de l’univers, engagé dans une perpétuelle révolution 1 . Le thème correspond<br />
également aux conceptions orthodoxes de la physique stoïcienne, qui postule un retour<br />
périodique du monde au chaos. Le crime d’Atrée fait donc figure de signal déclencheur de la<br />
fin du monde :<br />
Sed quicquid id est, utinam nox sit !<br />
Trepidant, trepidant pectora magno<br />
percussa metu ne fatali<br />
cuncta ruina quassata labent<br />
iterumque deos hominesque premat<br />
deforme chaos, iterum terras<br />
et mare cingens, et uaga picti<br />
sidera mundi Natura tegat. 2<br />
A une époque proche de celle de la rédaction de l’Apocalypse de Jean, l’exploitation poétique<br />
de ce motif contribue à l’actualisation du mythe :<br />
1 Helu. VI, 8.<br />
Nos e tanto uisi populo<br />
digni premeret quos euerso<br />
cardine mundus ?<br />
In nos aetas ultima uenit ? 3<br />
2 Th. 827-834 : « Mais de quoi qu’il s’agisse (plût au ciel que ce fût d’une nuit !), nos cœurs tremblent,<br />
tremblent, frappés de la crainte immense que tout ne s’écroule, ébranlé par l’effondrement qu’annonce<br />
le destin, que le chaos sans forme n’accable à nouveau les dieux et les hommes, et qu’à nouveau la<br />
Nature ne recouvre les terres, et la mer qui les ceint, et les astres errants dont le ciel est brodé. »<br />
3 Th. 875-878 : « C’est nous qui, parmi la multitude, avons paru dignes d’être écrasés par le ciel dévié<br />
de son axe ? C’est à nous que vient la fin du monde ? »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
309
Dans son article sur Sénèque et la divination, M. Armisen-Marchetti renonce à prendre<br />
en compte les tragédies, car on ne peut être sûr qu’elles reflètent fidèlement la pensée<br />
philosophique de Sénèque. Et pourtant, le cas d’Œdipe est intéressant. Il est vrai qu’il choisit<br />
dans sa tragédie les modes de divination qui offrent le plus de ressources scéniques ainsi que<br />
les évocations les plus riches et les plus impressionnantes. Cependant, les trois types de<br />
divinations qui se succèdent : oracle, examen des entrailles et nécromancie, posent le<br />
problème de l’interprétation des signes, auquel Sénèque consacre un passage des Questions<br />
naturelles 1 : il y récuse l’idée que certains signes contradictoires puissent s’affronter à propos<br />
d’un même événement. L’idée d’une hiérarchie des modes de divination se trouve alors mise<br />
à mal dans la mesure où, selon Sénèque, c’est l’interprétation des hommes qui est en cause<br />
lorsque les signes sont imparfaits. On peut mettre cette idée en relation avec le recours<br />
successif à trois modes de divinations dansŒdipe : cette démarche traduit l’impuissance et<br />
l’ignorance des hommes face à leur destin et aux signes qui l’annoncent. En cela, la<br />
représentation tragique est conforme aux idées philosophiques de Sénèque sur la question.<br />
Ainsi, dans ses tragédies, Sénèque traite les données mythologiques selon les goûts et<br />
la sensibilité de son époque, en introduisant des références aux sujets de préoccupation et aux<br />
représentations de son public 2 . Le nombre et la fréquence d’anachronismes dans les tragédies,<br />
ainsi que la variété des domaines évoqués, a pu faire croire, à un moment, que Sénèque<br />
souhaitait rendre les mythes accessibles à ses contemporains, faisant ainsi, si l’on peut dire,<br />
œuvre de vulgarisateur 3 . Cette hypothèse, qui s’appuie par ailleurs sur le souci qu’a manifesté<br />
1 Nat. II, 32, 9 et 34, 2.<br />
2 Sénèque, Nat. III, 27 ; VI, 32.<br />
3 C’est, par exemple, l’opinion de L. Herrmann, dans les notes de son édition des tragédies aux Belles<br />
Lettres. Il commente ainsi le quiritibus de vers 396 de Thyeste : « Quiritibus constitue un<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
310
Sénèque de transcrire les concepts de la philosophie grecque en langue latine 1 , ne saurait être<br />
retenue pour les tragédies, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, tous ces mythes étaient<br />
parfaitement familiers au public romain, ils avaient déjà inspiré plus d’un auteur latin, et<br />
depuis longtemps : depuis Ennius au moins, le festin de Thyeste est connu des spectateurs<br />
romains. Les exemples empruntés aux mythes mis en œuvre dans les tragédies abondent dans<br />
les traités philosophiques, et ne sont pas spécifiques à Sénèque. Ensuite, le traitement de la<br />
mythologie par Sénèque ne révèle pas, c’est le moins que l’on puisse dire, des intentions de<br />
vulgarisation et de simplification, mais, bien au contraire, une érudition certaine et un goût<br />
pour l’exotisme. Dans les cantica, en particulier, Sénèque emploie les ressources d’une<br />
mythologie savante, à la manière de Properce par exemple 2 : il utilise des périphrases, des<br />
allusions parfois mystérieuses aux aspects les moins connus de la légende, et n’a pas<br />
systématiquement recours aux exemples les plus convenus. C’est ainsi qu’Hippodamie est<br />
appelée « fille de Lyrnesse » 3 , et Procné « l’oiseau de Bistonie » 4 . Dans Œdipe, le taureau<br />
associé à Zéthus n’évoque qu’indirectement Dircé 5 . Un tel traitement de la mythologie<br />
constitue au passage un argument en faveur de la recitatio, de la représentation des tragédies<br />
devant un public restreint et cultivé, appartenant à la coterie poétique de l’entourage de<br />
Néron. Dans une des Lettres à Lucilius, notre philosophe évoque avec mépris un noble<br />
anachronisme sans doute volontaire. L’auteur a romanisé ici le chœur des Mycéniens en lui faisant<br />
employer cette expression purement latine et par suite plus accessible à ses compatriotes. »<br />
1 M. Armisen-Marchetti, 1989, Ch. III : « Héritage et originalité ». Cicéron évoque également le<br />
problème de la transcription des concepts exprimés par la langue grecque en latin : Fin. III, 4, 15.<br />
2 P. Veyne, 1983, p 131. O. Wattel-De Croizant, 1991. Cf G. Danesi Marioni, 1995 : un examen<br />
détaillé montre que les influences de Properce sur Sénèque tragique sont plus nombreuses et<br />
significatives qu’on le croyait.<br />
3 Lyrnesida : Ag. 186.<br />
4 Bistonis ales : Ag. 673.<br />
5 Œd. 611.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
311
omain 1 , qui, malgré une inculture qui l’aurait fait prendre pour un affranchi, désirait passer<br />
pour un érudit, et pour cela, avait dépensé une fortune en esclaves cultivés, censés pallier<br />
l’ignorance d’un maître incapable de retenir la généalogie élémentaire des héros de l’Iliade.<br />
Dans la suite de la lettre, Sénèque fait allusion aux discussions savantes qui s’entretenaient au<br />
cours des banquets, entre convives issus de la même classe noble cultivée. En ce sens, le<br />
recours à des références typiquement romaines ne peut être interprété dans le sens d’un<br />
nivellement par le bas, puisque les jeux de reconnaissance culturelle et de références érudites<br />
faisaient intégralement partie des pratiques couramment adoptées dans les milieux que<br />
fréquente Sénèque. Ce dernier s’en amuse d’ailleurs, et parodie le grand style mythologique<br />
dans l’Apocoloquintose 2 . Dans ce cas, il reste une autre hypothèse ; l’actualisation du mythe<br />
sert la réflexion sur des sujets contemporains, en particulier politiques.<br />
III/ Réalités romaines et problématiques impériales : l’environnement<br />
politique et militaire.<br />
A/ Une géographie impériale.<br />
Le cadre géographique des tragédies de Sénèque est, conformément à la tradition,<br />
celui des cités grecques auxquelles la fabula est attachée : Œdipe se déroule donc à Thèbes, et<br />
l’espace lui-même est affecté par le crime ancien de son roi. Le premier chant du chœur<br />
rappelle les origines glorieuses de la cité avant de déplorer le sort lamentable qui l’accable<br />
1 Sénèque, Ep. 27, 5.<br />
2 Sénèque, Apoc. II, 1-2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
312
tout entière, urbe cum tota 1 . Les Phéniciennes ont naturellement le même décor. Thèbes est<br />
également le cadre d’Hercule Furieux, qui s’achève sur l’évocation d’Athènes, facere<br />
innocentes terra quae superos solet 2 . Cette même cité d’Athènes est le décor de Phèdre. La<br />
tragédie d’Agamemnon se déroule au moment du retour glorieux du roi à Mycènes, et le lien<br />
étroit qui l’unit à son royaume est exprimé par Eurybate au moyen de la périphrase telluris<br />
altum Argolicae decus 3 . Argos est également le sujet du premier canticum de Thyeste, dont les<br />
trois premiers vers accumulent les toponymes 4 . Thyeste, de retour d’exil, exprime sa joie de<br />
retrouver sa patrie, et les murailles cyclopéennes qui attestent de sa majesté 5 . Dans Les<br />
Troyennes, c’est sur le lieu que l’on s’apprête au contraire à quitter que s’ouvre la tragédie 6 :<br />
Troie en ruine, livrée au pillage, et que le meurtre d’Astyanax achève symboliquement<br />
d’abattre. Médée, la Colchidienne 7 , assouvit sa vengeance avant de quitter Corinthe. La<br />
tragédie fait également une place importante au périple des Argonautes 8 .<br />
Pourtant, l’univers géographique des tragédies dépasse de beaucoup ce cadre<br />
conventionnel. Il est vrai qu’Hercule a voyagé dans divers pays étrangers, ce qui permet à<br />
Sénèque d’évoquer les contrées lointaines où s’est rendu le conquérant 9 . On trouve en général<br />
de très nombreux noms de peuples, de régions, de fleuves ou de montagnes dans les parties<br />
lyriques des tragédies. Par exemple dans le prologue de Phèdre, on observe une extension de<br />
l’espace, à partir de l’Attique où se situe la scène, jusqu’aux extrémités du monde connu 10 :<br />
1 Œd. 110 sq.<br />
2 Herc. f. 1345 : « la terre qui rend aux dieux leur innocence ».<br />
3 Ag. 395.<br />
4 Th. 122 sq.<br />
5 Th. 407-408 : Cyclopum sacras turres, labore maius humano decus…<br />
6 Tro. 4 sq ; 1068 sq.<br />
7 Med. 871 : nefanda Colchis.<br />
8 G. Biondi, 1981, p. 421-445 ;<br />
9 Herc.f. 533-546.<br />
10 Phaed. 54-72.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
313
l’Araxe à l’Est, l’Hister au Nord, les Gétules, les Arabes ou les Garamantes au Sud. La<br />
géographie mythologique se superpose alors à celle du monde tel que le connaissaient les<br />
contemporains de Sénèque. Les comparaisons et métaphores qui font appel à des références<br />
géographiques sont fréquentes en poésie, les poètes de l’époque d’Auguste ont suivi en cela la<br />
tradition d’érudition des poètes alexandrins, qui l’avaient eux-mêmes héritée d’Homère. La<br />
description de l’hiver scythe est ainsi devenue un topos littéraire que Sénèque renouvelle à sa<br />
manière 1 .<br />
Les références sont cependant bien plus que des ornements poétiques, car les termes<br />
géographiques nous renseignent sur l’état de la connaissance du monde au moment de la<br />
composition. « En groupant les notions géographiques rencontrées dans les parties lyriques du<br />
théâtre de Sénèque, il est possible de faire le tour de l’empire romain » 2 . Outre le prologue de<br />
Phèdre, déjà cité, on peut évoquer un exemple de tour du monde par les fleuves dans Hercule<br />
Furieux 3 : revenu à la raison, Hercule accepte, comme une ultime épreuve, la vie que son père<br />
le supplie de conserver. Il lui faut désormais trouver un lieu d’exil. Il évoque alors toutes les<br />
directions que pourraient prendre ses pas : le Tanaïs, le Nil, le Tigre, le Rhin, le Tage.<br />
On remarque enfin l’évocation particulière des peuples qui ont été impliqués dans la<br />
politique étrangère des empereurs sous lesquels a vécu Sénèque, et en premier lieu des<br />
Parthes, ennemis héréditaires des Romains, à qui ils avaient infligé une sanglante défaite à<br />
Carrhae en 53 av. J.-C 4 . Le conflit est ravivé au début du règne de Néron 5 avec une incursion<br />
des Parthes, désireux de supplanter les Romains en Arménie, qui constitue la limite de<br />
l’empire. Cette brusque dégradation de la situation est connue vers la fin de l’année 54,<br />
1 Virgile, Georg. III, 349 sq ; Ovide, Tr. III, 10 ; Sénèque, H.F. 533-541. Pour la comparaison de ces<br />
trois passages : A. Cattin, 1963, p. 690-93.<br />
2 A. Cattin, 1963, p. 688.<br />
3 1323-1326.<br />
4 C’est sans doute de cet échec que se souvient Sénèque, Helu. X, 3.<br />
5 Tacite, Ann. XIII, 6.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
314
Sénèque a donc dû faire face à une crise extérieure dès son arrivée aux affaires. Il a en effet<br />
joué un rôle important lors du règlement du conflit. Le problème ressurgit en 62, alors que<br />
Néron s’est affranchi de l’influence de son ministre, et se clôt sur le couronnement de Tiridate<br />
par Néron à Rome, cérémonie à grand spectacle au cours de laquelle le roi-client reconnaît<br />
son suzerain 1 . On le voit, la question parthe se pose pendant la plus grande partie du règne de<br />
Néron, et les mentions de ces barbares dans les tragédies de Sénèque ne peuvent qu’évoquer<br />
les problèmes de politique étrangère qu’ils soulèvent. Ainsi, l’évocation traditionnelle de leurs<br />
techniques guerrières ou des défauts qui leur sont généralement prêtés 2 se charge d’une<br />
résonance actuelle.<br />
Ces références géographiques qui renvoient à un état du monde contemporain de<br />
Sénèque s’entremêlent aux données traditionnelles des modèles tragiques, esquissant ainsi un<br />
cadre qui n’est plus strictement celui de la fable, et contribuant à donner au mythe à la fois<br />
son universalité et son actualité. C’est ce que confirme le traitement du thème de la guerre<br />
civile, exemplaire de la connection de l’histoire et de la tragédie<br />
B/ Le cas des guerres civiles.<br />
Encore une fois, Sénèque s’inscrit dans la tradition du théâtre romain 3 : bien avant lui<br />
Ennius, avait traité de sujets grecs avec des termes et des notions typiquement romaines, qui<br />
contribuaient à ancrer davantage encore ces légendes dans la culture de Rome. Par exemple,<br />
dans son Achille, l’un des personnages s’adresse (sans doute) au héros et l’exhorte à sauver<br />
ses « concitoyens », ciues, référant ainsi dans un contexte homérique à des cadres de pensée<br />
1 Tacite, Ann. XV, 29.<br />
2 Phaed. 816 ; Œd. 119 ; Th. 384.<br />
3 P. Grimal, 1975.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
315
politique plus proches de ceux de la république 1 . On retrouve exactement la même démarche<br />
dans les Phéniciennes, lorsque la préparation de l’assaut des sept rois fait l’objet d’une<br />
description, faite par un garde à Jocaste. L’image du porte-enseigne donnant, aigle levée, le<br />
signal du combat 2 , rappelle davantage les guerres romaines que les affrontements homériques,<br />
et la présence dans le même vers de deux termes du vocabulaire militaire, aquila et signifer,<br />
donne à l’ensemble une couleur romaine.<br />
1/ Nefas : l’affrontement des frères, un thème tragique et une métaphore des guerres<br />
civiles.<br />
Dans les Phéniciennes, lorsque Œdipe maudit ses fils et les voue à se surpasser l’un<br />
l’autre dans le crime et la violence, et à commettre des crimes inouïs, il s’exprime en ces<br />
termes :<br />
Non satis est adhuc<br />
ciuile bellum : frater in fratrem ruat<br />
nec hoc sat est : quod debet, ut fiat nefas<br />
de more nostro, quod meos deceat toros :<br />
date arma matri. 3<br />
1 O. Ribbeck, 1871, vol. I, Tragicorum fragmenta, fr. 1 : Serua ciues, defende hostes, cum potes<br />
defendere.<br />
2 Phœn. 390.<br />
3 Phœn. 354-358 : « Ce n’est pas encore assez que la guerre civile : que le frère se jette sur son frère ;<br />
cela ne suffit pas encore ; voici ce qu’il faut, pour que l’abomination s’accomplisse selon mon<br />
habitude, voici ce qui convient à ma couche : donnez des armes à votre mère. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
316
Dans cette invocation au crime inouï, abominable, et dans la lignée du fratricide et de<br />
l’infanticide, Œdipe place la guerre civile, qui pour un public romain, après les expériences<br />
terrifiantes de la fin de la République, représente le point culminant du mal politique, une<br />
horreur absolue, que Lucain décrit dans le prologue de la Pharsale. A cet égard, la formule<br />
date arma matri relève à la fois de l’adynaton et de la métaphore de la guerre civile : l’image<br />
de Rome déchirant ses propres entrailles, dans les premiers vers de l’épopée de Lucain, peut<br />
trouver là un écho. A l’époque où Lucain compose son épopée, et Sénèque ses tragédies, le<br />
souvenir de l’affrontement de César et Pompée est encore douloureux et brûlant, il rappelle le<br />
désordre chaotique qui a précédé l’établissement d’un régime en quête de stabilité. Les<br />
guerres civiles, en effet, dépassent en violence et en cruauté les conflits menés contre les<br />
nations étrangères, du fait même de la proximité des combattants. Dion Cassius note ainsi que<br />
les soldats de chaque camp se connaissaient, au point d’appeler leurs adversaires par leur nom<br />
avant de les tuer 1 . Sénèque évoque cette cruauté particulière dans le De ira, en citant<br />
l’exemple célèbre de Marius Gratidianus 2 , dont le supplice illustre l’acharnement et la<br />
bestialité des affrontements. Bien plus, les outrages portés aux cadavres ennemis rapprochent<br />
l’histoire du mythe dans les manifestations de la cruauté des combattants. Ainsi, les corps des<br />
marianistes ou des sullaniens laissés sans sépulture, et livrés aux bêtes sauvages 3 , rappellent le<br />
sort d’Etéocle et de Polynice, après qu’ils se sont détruits l’un l’autre. L’image des morts des<br />
guerres civiles, abandonnés sur le champ de bataille, parfois même dans les rues de Rome, est<br />
particulièrement significative du caractère impie de ces combats, qui déchirent les familles 4 et<br />
annulent les devoirs les plus sacrés.<br />
1 41, 59, 2.<br />
2 Ir. III, 18, 1.<br />
3 Appien, B. C. I, 73, 338 ; Dion Cassius, 47, 3, 2.<br />
4 P. Jal, 1963, p. 396-401.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
317
Ainsi, lorsque Œdipe prononce sa malédiction contre ses fils criminels, il en appelle à<br />
une surenchère dans le crime, et il place la guerre civile dans la continuité du processus qui a<br />
permis la naissance de ses fils incestueux. Auparavant, il a rappelé en effet que les frères<br />
ennemis, en se faisant l’un à l’autre la guerre, ne font que poursuivre la logique criminelle que<br />
leur père a, malgré lui, initiée : nefasque nullum per nefas nati putant 1 . Le terme nefas, qui<br />
désigne le crime indicible, l’impiété absolue, caractérise à tout jamais leurs actes. Dans son<br />
étude sur Thyeste, G. Picone 2 examine en particulier les effets catastrophiques de la soif de<br />
pouvoir d’Atrée. Le regnum instauré par Atrée au cours de la tragédie est fondé sur le nefas,<br />
lui-même produit par le furor du protagoniste, et apparaît comme une manifestation du mal<br />
absolu.<br />
Jocaste, elle aussi, dans sa tentative pour réconcilier les frères et les ramener à la<br />
raison, emploie de façon récurrente le terme nefas pour qualifier la lutte doublement fratricide<br />
de ses fils 3 . Elle en souligne en outre le caractère inouï, même au royaume de Thèbes qui en a<br />
pourtant vus bien d’autres : fratresque facinus quod nouum et Thebis fuit / in se ruentes 4 . Au<br />
nefas, Jocaste oppose la sancta pietas 5 , qui s’étend du domaine familial à la sphère politique :<br />
la guerre civile apparaît donc ici comme le crime le plus grand, qui contrevient aux lois les<br />
plus sacrées, et mène à la catastrophe le royaume de Thèbes et la maison d’Œdipe. Elle est<br />
l’expression politique du nefas, et a pour conséquence la disparition de toute loi et de toute<br />
notion de droit 6 . Dans les tragédies de Sénèque, le crime tragique est souvent désigné par le<br />
terme nefas : il est cependant significatif que ce terme revienne plus souvent dans les<br />
Phéniciennes, où il s’agit de guerre civile.<br />
1 Phœ. 300 ; A. Borgo, 1988.<br />
2 G. Picone, 1984, p. 133.<br />
3 v 497, 526, 527, 531, nefandas faces v. 540, et aussi 412, 453...<br />
4 Phœ. 549-550.<br />
5 Phœ. 454 –458.<br />
6 E. Fantham, 1983.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
318
2/Furor : le ressort tragique des guerres civiles.<br />
Le rapprochement entre l’univers tragique et les guerres civiles est encore confirmé<br />
par le recours à la notion de furor. Dans les tragédies, en effet, les personnages criminels se<br />
laissent envahir par cette sorte de folie furieuse qui les fait sortir d’eux-mêmes et les conduit à<br />
accomplir des actes monstrueux 1 . Le héros devient alors absent à lui-même, échappant à tout<br />
contrôle de la raison et à tout argument sensé, il sort en quelque sorte de l’humanité, et se met<br />
en état de commettre les actes les plus invraisemblables. Le terme furor et ses dérivés sont<br />
récurrents dans les tragédies : Œdipe, sous l’effet de la révélation de son double crime, délire<br />
de rage 2 ; Médée prend le visage de la Fureur 3 , et lorsqu’elle prépare pour sa rivale ses<br />
présents empoisonnés, la folie et la magie semblent indissociables 4 ; furor est le dernier mot<br />
d’Agamemnon, prononcé par Cassandre, en allusion à la vengeance d’Oreste. Junon elle aussi<br />
apparaît comme une furieuse dans le prologue d’Hercule Furieux 5 . L’amour de Phèdre est<br />
qualifié de furor 6 , et le chœur confirme cette vision d’ailleurs traditionnelle de l’amour :<br />
1 F. Dupont, 1995, p. 71-90.<br />
2 ira furit, Œd. 957.<br />
3 Med. 396.<br />
4 Med. 738-739.<br />
5 Herc. f. 109.<br />
6 Phaed. 268.<br />
Labitur totas furor in medullas<br />
igne furtiuo populante uenas. 7<br />
7 Phaed. 279-280 : « Sa folie s’insinue dans toutes nos moelles, tandis que son feu ravage furtivement<br />
nos veines ».<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
319
Dans le prologue de Thyeste, c’est, significativement, l’une des Furies remontée des enfers<br />
qui fait revenir l’ombre de Tantale, afin qu’il répande sur ses fils une fureur propice à des<br />
crimes inouïs :<br />
Hunc, hunc furorem diuide in totam domum.<br />
Sic, sic ferantur et suum infensi inuicem<br />
sitiant cruorem. 1<br />
Par la suite, Atrée lui-même en appelle à la troupe des Furies, pour qu’elles mettent en lui ce<br />
furor seul capable de lui permettre d’accomplir sa vengeance :<br />
Excede, Pietas, si modo in nostra domo<br />
umquam fuisti. Dira Furiarum cohors<br />
discorsque Erinys ueniat et geminas faces<br />
Megaera quatiens : non satis magno meum<br />
ardet furore pectus, impleri iuuat<br />
maiore monstro. 2<br />
Cet appel se fait souvent au moment où le personnage hésite : il est retenu par des scrupules,<br />
des sentiments. C’est le cas de Médée, qui au moment de tuer ses enfants, invoque la troupe<br />
déchaînée des Furies pour affermir sa détermination et faire taire les dernières protestations de<br />
1 Th. 101-103 : « Cette fureur, cette fureur, distribue-la dans toute ta maison. Qu’ils soient ainsi, oui<br />
ainsi transportés par ce délire, et que dans leur haine réciproque, ils soient assoiffés de leur propre<br />
sang. »<br />
2 Th. 249-254 : « Va-t-en, Piété, si tu as été jamais dans notre maison. Que vienne la cohorte funeste<br />
des Furies, Erinyes qui répands la discorde, et Mégère brandissant ses deux torches : mon cœur ne<br />
brûle pas encore d’une assez grande fureur, il lui plaît de s’emplir de sentiments plus monstrueux. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
320
la pietas 1 . Seule cette rage peut lui permettre de réaliser jusqu’au bout sa vengeance. Ainsi le<br />
furor représente, d’un point de vue stoïcien, l’aboutissement du développement de la passion,<br />
que l’on ne peut plus réfréner dès lors qu’on l’a laissée se développer 2 . L’état dans lequel le<br />
personnage tragique se met correspond à une crise, au cours de laquelle le crime prend<br />
forme 3 .<br />
Les guerres civiles, où éclate le furor destructeur des chefs rivaux, mais aussi de la<br />
collectivité en armes, représentent également, sur le plan civique et politique, un moment de<br />
crise pendant lequel se déchaîne la folie meurtrière des partis en présence. Alors qu’au cours<br />
d’une guerre extérieure, menée contre des ennemis de Rome, des hostes, les combattants<br />
exercent les vertus du citoyen (courage, discipline, endurance), la guerre civile est le lieu où<br />
toute valeur est annulée au profit d’une forme de rage et de possession primitives 4 . Les actes<br />
de ceux qui prennent part à ces combats relèvent donc du furor, ce dont témoignent les<br />
auteurs latins 5 , condamnant la fureur collective caractéristique des guerres civiles. Le terme<br />
devient même un quasi-synonyme de bellum ciuile : chez Pétrone, l’expression furor et<br />
bellum désigne la guerre civile entre César et Pompée 6 ; Valère Maxime parle de la fureur de<br />
Catilina, Catilinae furor 7 .<br />
Dans le De ira de Sénèque, on trouve plusieurs références aux différentes guerres<br />
civiles : il cite ainsi la clémence de César à l’égard de Pompée 8 , la cruauté de Sulla 1 , ou<br />
1 Med. 937 sq.<br />
2 J. Fillion-Lahille, 1984.<br />
3 F. Dupont, 1985, p. 184-189 et 417-425.<br />
4 Sur ce furor primitif : G. Dumézil, 1956, p. 23 et 104.<br />
5 P. Jal, 1963, p. 421-425.<br />
6 Satiricon, 119, 60 .<br />
7 IV, 8, 3. références citées par P. Jal, 1963, p. 422.<br />
8 Ir., II, 23, 4<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
321
encore le supplice de Marcus Marius, neveu de Marius, lors de la victoire de Sulla, par les<br />
soins du jeune Catilina 2 . En outre, la guerre civile fournit un grand nombre d’exemples pour<br />
illustrer la rage qui s’empare des peuples. Dans un passage du livre II, il cite indistinctement<br />
les atrocités commises pendant les guerres civiles grecques et celles de la fin de la<br />
République 3 . Ces actes de cruauté résultent de la colère qui envahit les partisans des guerres<br />
civiles, colère qui se propage comme une folie collective. A plusieurs reprises, en effet,<br />
Sénèque établit l’équivalence de l’ira et du furor 4 . Pour lui, la colère est un mal contre-nature,<br />
il s’oppose en cela à la théorie aristotélicienne qui reconnaît à la passion un usage modéré et<br />
une place dans l’âme du sage 5 . La guerre civile illustre cet aspect antinaturel, puisqu’elle fait<br />
s’affronter les membres d’une même communauté, d’une même famille.<br />
On retrouve cette idée dans les Phéniciennes, dans la bouche de Jocaste, qui essaie, en<br />
vain, de modérer ses fils : leur haine est devenue irrationnelle, et aucun raisonnement ne peut<br />
donc en venir à bout. Face à Polynice, qui dénie toute valeur aux lois de la nature 6 , la reine de<br />
Thèbes tente de tenir un discours raisonnable et rationnel, afin de détourner son fils de la folie<br />
qui l’anime : Quis tenet mentem furor ? 7 Le combat que mène Polynice, doublement<br />
fratricide dans la mesure où il s’attaque à la fois à son frère et à sa patrie, est donc<br />
l’illustration tragique de la guerre civile, qui incarne aux yeux des Romains, et encore à<br />
l’époque de Sénèque, le mal politique le plus grand. Les Phéniciennes semblent donc offrir,<br />
même à l’état fragmentaire dans lequel cette tragédie nous est parvenue, un traitement du<br />
mythe à la lumière de concepts contemporains, et spécifiquement romains.<br />
1 Ir. III, 34, 3<br />
2 Ir. III, 18, 1-2<br />
3 Ir. II, 9, 3-4.<br />
4 Ir. . I, 1 ; 13, 3 ; II, 36, 5 ; III, 21, 5, etc.<br />
5 Ir. I, 5 sq ; J. Fillion-Lahille, 1984, p. 203 sq.<br />
6 Phœn. 478 : nihil iam iura naturae ualent.<br />
7 Phœn. 557.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
322
C/ L’expression du pouvoir dans les tragédies.<br />
Dans les tragédies, un certain nombre de termes et d’expressions laissent à penser que<br />
le pouvoir est exprimé en termes non seulement romains, mais encore impériaux : dès lors, le<br />
rapprochement qui s’opère entre les univers réel et scénique n’est pas seulement culturel, mais<br />
aussi temporel. En particulier, les éléments qui se rapportent à la fonction militaire du prince,<br />
à l’origine de son titre d’imperator, esquissent en touches successives une image du roi de<br />
tragédie ou du héros à laquelle on peut associer celle de l’empereur romain.<br />
1/ Le triomphe et les attributions de l’empereur.<br />
A l’époque impériale, le titre d’imperator et le triomphe sont exclusivement réservés à<br />
l’empereur, tandis que les généraux victorieux se voient simplement attribuer les ornementa<br />
triumphalia. C’est ainsi, par exemple, que cette distinction échut à Lucius Silanus, que Claude<br />
avait fiancé à sa fille Octavie avant qu’Agrippine n’envisageât pour la princesse une union<br />
avec Néron, qui servait ses desseins 1 . Agrippa avait, le premier, introduit cet usage qui devait<br />
se généraliser par la suite, par son exemple, lorsqu’il refusa, par modestie, le triomphe, tout en<br />
acceptant les ornementa 2 .<br />
Le triomphe peut donc apparaître comme l’expression officielle et institutionnelle de<br />
l’image de bienfaiteur qui est associée à certains dirigeants dès l’époque républicaine, et que<br />
la propagande impériale va confirmer. En ce sens, la cérémonie joue un rôle dans la<br />
1 Tacite, Ann. XII, 3.<br />
2 Dion Cassius, 54, 24, 7.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
323
divinisation des grands hommes, et dans l’accession du prince à un statut surhumain 1 . En<br />
effet, le triomphe, récompense suprême accordée à un général victorieux, prend place après<br />
une victoire militaire éclatante. À travers les honneurs rendus au vainqueur, ce sont les dieux<br />
qui sont remerciés, et en particulier Jupiter, à qui sont dédiées les dépouilles opimes dans son<br />
temple, but de la procession triomphale. Le triomphateur joue donc le rôle de médiateur entre<br />
la divinité et la cité reconnaissante, ce qui le place d’ores et déjà dans une position supérieure<br />
à celle de l’humanité ordinaire : remercier les dieux à travers le général victorieux revient à<br />
rendre grâce au général comme s’il était un dieu. D’autre part, les insignes du triomphateur<br />
sont assimilés à ceux de Jupiter Optimus maximus, et portés à l’occasion du triomphe 2 . Le<br />
triomphateur est littéralement le représentant de Jupiter sur terre.<br />
Dans le cas du triomphe, le rapport du chef à la divinité est de l’ordre de la délégation,<br />
car la victoire est une confirmation de l’élection divine. Ce rapport se complète par la notion<br />
de représentation (on remercie les dieux à travers le général, de même que la volonté divine<br />
s’est manifestée à travers lui en lui accordant la victoire). C’est ainsi que de l’idée de caution<br />
divine, on passe à celle de la divinité du personnage : une relation très étroite avec les dieux,<br />
associée à une fonction d’intermédiaire, amène par conséquent à diviniser le chef. Les<br />
victoires de César lui ont, par exemple, valu une statue en tant que deo inuicto 3 .<br />
Claude s’inscrit dans la lignée de César, justement, et entend même réussir là où celui-<br />
ci avait partiellement échoué, lorsqu’il entreprend la conquête de la Bretagne, pour atteindre<br />
les limites du monde connu 4 . Cette victoire, principale source de gloire du règne, se voit<br />
célébrée par un triomphe, le premier d’un prince depuis celui d’Octave, soixante-treize ans<br />
plus tôt.<br />
1 S. Weinstock, 1971, p 62-67.<br />
2 J. R. Fears, 1977 p 86.<br />
3 S. Weinstock, 1971, p 186.<br />
4 J. Melmoux, 1990, p. 171.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
324
Cum decretis sibi a senatu ornamentis triumphalibus leuiorem maiestati principali<br />
titulum arbitraretur uelletque iusti triumphi decus, unde adquireret Britanniam<br />
potissimum elegit, neque temptatam ulli post Diuum Iulium et tunc tumultuantem ob<br />
non redditos transfugas. 1<br />
La cérémonie, dont Suétone souligne la magnificence (maximo apparatu), exalte en Claude le<br />
maître du monde, comme en témoigne le texte de la laus Caesaris qui nous est parvenu :<br />
Ausoniis numquam tellus uiolata triumphis<br />
icta tuo, Caesar, fulmine procubuit<br />
Oceanusque tuas ultra se respicit aras :<br />
Qui finis mundo est, non erat imperio. 2<br />
Ce poème d’une quarantaine de vers, et d’un auteur inconnu, présente le prince comme le<br />
maître du monde, et l’identifie à Jupiter en lui attribuant la foudre qui frappe les peuples<br />
insoumis. Bien que la laus Caesaris ne semble pas pouvoir être attribuée à Sénèque 3 ,<br />
1 Suétone, Claud. 17 : « Le Sénat lui avait décerné les ornements triomphaux, mais comme il jugeait<br />
que ce titre n’était pas à la hauteur de sa majesté impériale, et qu’il voulait l’honneur d’un triomphe à<br />
part entière, il choisit de préférence pour l’obtenir la Bretagne, que nul n’avait attaquée depuis le divin<br />
Jules César, et qui se trouvait alors troublée parce que des déserteurs n’avaient pas été rendus. »<br />
2 Laus Caesaris, éd. A. Riese, Anthologia latina, Leipzig, 1869, I, No 419 : « La terre que les<br />
triomphes ausoniens n’avaient encore jamais dévastée est tombée sous les coups de ta foudre, César, et<br />
l’océan, au-delà de lui-même, contemple tes autels : ce qui est pour le monde une limite ne l’était pas<br />
pour ton règne. »<br />
3 L’attribution de ce texte à Sénèque, qui souffrait d’un exil auquel il voulait mettre un terme, est<br />
contestée par A. Barrett, 2000, p. 603, qui y voit plutôt l’œuvre maladroite d’un imitateur. J. Melmoux<br />
attribue plutôt la laus Caesaris à Polybe : « L’empereur Claude et la finium imperii propagatio :<br />
l’exemple breton », J.-M. Croisille, (éd.), 1990, p. 171.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
325
l’événement que constitua le triomphe de Claude n’a pas pu laisser le philosophe indifférent :<br />
à cette occasion, en effet, le prince fit rappeler certains exilés, parmi lesquels il ne figurait pas.<br />
C’est pourtant cet espoir que l’auteur de la Consolation à Polybe paraît nourrir, lorsqu’il<br />
souhaite ce triomphe pour le prince :<br />
Hic Germaniam pacet, Britanniam aperiat, et patrios triumphos ducat et nouos:<br />
quorum me quoque spectatorem futurum, quae ex uirtutibus eius primum optinet<br />
locum, promittit clementia. 1<br />
Le triomphe apparaît donc comme la manifestation la plus visible de la puissance impériale<br />
sous le principat de Claude. Les références à cette cérémonie dans Hercule Furieux, Les<br />
Troyennes et Agamemnon confirment l’hypothèse de P. Grimal, qui propose de dater la<br />
composition de ces trois pièces du règne de Claude, et en particulier de la période de l’exil 2 .<br />
2/ La symbolique du triomphe dans les tragédies.<br />
Des chefs victorieux qui rappellent les imperatores triomphants apparaissent à<br />
plusieurs reprises dans les tragédies. Par exemple, dans le prologue d’Hercule Furieux, Junon<br />
rappelle les exploits et l’excessive ambition de celui qui provoque sa rage :<br />
1 Sénèque, Pol. 13 : « Qu’il pacifie la Germanie, qu’il ouvre les portes de la Bretagne, qu’il conduise<br />
les triomphes de son père et les renouvelle : moi aussi, j’y assisterai ; celle qui parmi toutes ses vertus<br />
tient la première place, sa clémence, me le garantit. »<br />
2 P. Grimal, 1991a, p. 280 et 426.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
326
Nec satis terrae patent :<br />
effregit ecce limen infernis Iouis<br />
et opima uicti regis ad superos refert. 1<br />
L’emploi d’opima dans ce contexte réfère de manière évidente aux dépouilles opimes<br />
remportées par le général ayant lui-même tué le général ennemi, et consacrées à Jupiter<br />
Férétrien lors de la cérémonie.<br />
La référence au triomphe est également significative dans le contexte des plaintes de<br />
Junon. En effet, elle reproche à Hercule son aspiration à la divinité. Elle même a contribué à<br />
ce qu’elle déplore, car les épreuves qu’elle lui a imposées n’ont fait que révéler son courage et<br />
augmenter sa gloire. Déjà, sur la terre entière, il reçoit des honneurs dus aux dieux 2 , en raison<br />
justement de ses exploits. Les monstres qu’il a détruits n’ont servi, en définitive, qu’à affirmer<br />
aux yeux de tous la nature divine d’Hercule, magnifié par sa représentation en triomphateur.<br />
Or, la tradition romaine voulait qu’un esclave accompagne le chef victorieux pour lui<br />
rappeler, à chaque acclamation de la foule, sa condition mortelle. Dans la tragédie, c’est le<br />
chœur qui se charge d’évoquer l’ultime voyage vers la mort qui attend tout être humain :<br />
Omnis haec magnis uaga turba terris<br />
ibit ad manes facietque inerti<br />
uela Cocyto : tibi crescit omne<br />
et quod occasus uidet et quod ortus,<br />
1 Herc. f. 46-48 : « Et il ne suffit pas que les terres s’ouvrent à lui : voilà qu’il a forcé la porte du<br />
Jupiter infernal et qu’il ramène vers ceux d’en haut les dépouilles opimes du roi vaincu. »<br />
2 Herc. f. 39-40 : toto deus/ narratur orbe.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
327
parce uenturis, tibi mors paramur. 1<br />
Mais, significativement, Hercule n’entend pas cet avertissement : il a quitté la scène pour tirer<br />
vengeance de Lycus qui a usurpé son pouvoir et humilié sa famille. A son retour, il triomphe<br />
encore et adresse ses prières à des dieux qu’il considère comme ses égaux : Pallas est pour lui<br />
une alliée et une auxiliaire 2 , les autres dieux, et en particulier Apollon, sont ses frères 3 . En<br />
outre, la périphrase par laquelle Junon, dans le prologue, désigne Pluton comme le Jupiter<br />
infernal 4 , pose de manière plus cruciale la rivalité à venir du père et du fils, dans la mesure où<br />
l’image du dieu enchaîné comme un chef de guerre vaincu semble annoncer la défaite du roi<br />
des dieux et dénonce la démesure d’Hercule, qui est déjà la proie du furor.<br />
La symbolique du triomphe a également sa place dans la tragédie d’Agamemnon. Par<br />
exemple, dans le deuxième canticum, le chœur qui invoque tour à tour les divinités tutélaires<br />
d’Argos, fait allusion à la coutume romaine qui consiste à placer sur la statue de Jupiter<br />
Optimus Maximus les lauriers qui ont orné les fasces du triomphateur :<br />
tu nunc laurus Agamemnonias<br />
accipe uictrix. 5<br />
1 Herc. f. 868-872 : « Toute cette multitude errant par les vastes terres rejoindra les mânes et fera voile<br />
vers l’inerte Cocyte : c’est pour toi que grandit tout ce que voit le couchant et ce que voit le levant _<br />
épargne ceux qui arrivent _ c’est pour toi, mort, que nous sommes préparés. »<br />
2 Herc. f. 900 : socia et adiutrix.<br />
3 Herc. f. 907 : fraterque quisquis incolit caelum meus…<br />
4 Herc. f. 47.<br />
5 Ag. 346-347 : « A présent, déesse victorieuse, reçois les lauriers d’Agamemnon. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
328
La tonalité romaine est confirmée, dans le même passage, par la présence du terme matrona<br />
au vers 359. L’expression matres Graiae, au vers 351, souligne par un raccourci expressif<br />
l’intrication des références grecques et romaines, et la volonté de Sénèque de romaniser la<br />
scène tout en conservant les données du mythe.<br />
C’est cependant Junon qui reçoit l’hommage traditionnellement rendu à son époux, et<br />
cette variation prend une importance toute symbolique dans le contexte du retour<br />
d’Agamemnon : le roi en effet marche vers le piège que lui tend son épouse, Clytemnestre qui<br />
intervient juste après le chant du chœur. La figure de Junon, protectrice du mariage et honorée<br />
par les matrones de tous âges, contraste avec celle de l’épouse adultère, faisant ainsi ressortir<br />
sa trahison. Plus loin, le roi, couronné du laurier des vainqueurs 1 , rend un hommage à Jupiter<br />
qui évoque la dédicace rituelle des spolia 2 . Dans ce passage, les termes employés renvoient de<br />
manière explicite à la cérémonie du triomphe, d’autant plus que la situation d’Agamemnon est<br />
celle d’un chef de guerre victorieux, de retour d’une longue campagne d’où il ramène butin et<br />
captifs. Il se trouve alors au sommet de sa gloire, au moment où elle est célébrée avec le plus<br />
grand apparat, juste avant qu’il ne tombe dans le piège mortel que lui ont préparé<br />
Clytemnestre et Egisthe. Dans ce cas, le triomphe représente la situation la plus élevée, le plus<br />
haut degré de la puissance et du succès avant le meurtre. Ainsi le changement de fortune est<br />
plus manifeste, car le renversement est accentué par l’écart des situations initiale et finale,<br />
conformément à ce qu’Aristote préconise dans la Poétique 3 . Les réflexions du chœur sur les<br />
situations élevées, qui rendent la chute plus vertigineuse encore, confirment et soulignent cet<br />
écart :<br />
1 Ag. 779 : En deos tandem suos / uictrice lauru cinctus Agamemnon adit...<br />
2 Ag. 802-807 ; cf Ovide, Her. I, 25 sq.<br />
3 Aristote, Poet. 1453 a 10.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
329
Quicquid in altum Fortuna tulit<br />
ruitura leuat. 1<br />
Le triomphe offre ainsi une image expressive de la gloire et de la puissance pour le public<br />
romain.<br />
La pompe du triomphe est également évoquée assez précisément dans Les Troyennes,<br />
du point de vue des vaincus cette fois, pour insister sur le sort déplorable des captifs réduits à<br />
défiler enchaînés à la gloire de Mycènes :<br />
non Argolici praeda triumphi<br />
subiecta feret colla tropaeis ;<br />
non adsuetas ad sceptra manus<br />
post terga dabit currusque sequens<br />
Agamemnonios aurea dextra<br />
uincula gestans latis fiet<br />
pompa Mycenis. 2<br />
1 Ag. 100-101 : « Tout ce que la Fortune a porté au sommet, elle ne l’a élevé que pour mieux<br />
l’abattre. » cf Œd. 909-910 ; Thye. 391-392, etc.<br />
2 Tro. 149-155 : « Il ne sera pas un butin du triomphe des Argien, il ne présentera pas son cou assujetti<br />
à leurs trophées ; ses mains accoutumées à porter le sceptre, il ne les laissera pas attacher dans son dos,<br />
et suivant le char d’Agamemnon, les bras chargés de chaînes d’or, il ne deviendra pas le cortège<br />
triomphal de la vaste Mycènes. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
330
3/ Princeps, rex et tyrannus.<br />
On aurait pu s’attendre à compter parmi les termes anachroniques qui émaillent le<br />
texte des tragédies celui de princeps, ordinairement employé pour désigner l’empereur. On ne<br />
trouve ce mot dans aucune des pièces, où les occurrences de rex, regnum et regina abondent.<br />
Parfois, la connotation péjorative ordinairement attachée à la notion de royauté chez les<br />
Romains apparaît 1 , mais la plupart du temps, rex désigne le roi, voire le bon roi par opposition<br />
au tyrannus. Ainsi, dans le débat qui oppose Atrée à son courtisan, chacun emploie le mot rex<br />
pour défendre sa conception du pouvoir : Atrée revendique le bon plaisir du souverain comme<br />
seul moteur de ses actes, et la crainte comme garantie essentielle de la stabilité du pouvoir 2 .<br />
Son interlocuteur lui objecte une conception toute différente du gouvernement, basée sur les<br />
vertus du souverain et sur l’assentiment populaire qu’elles induisent 3 . La confrontation des<br />
deux personnages pourrait parfaitement illustrer cette pensée de Sénèque, lorsqu’il distingue<br />
le bon roi et le tyran dans le De clementia : Tyrannus autem a rege factis distat, non nomine 4 .<br />
Cette utilisation du champ sémantique de rex témoigne donc de l’unité et de la cohérence de<br />
la pensée politique de Sénèque. On se rappelle en effet l’emploi que le philosophe fait de rex<br />
dans le De clementia 5 . Le rex du traité philosophique et celui des tragédies détiennent tous<br />
deux un pouvoir autocratique, qui s’exprime de manière quasi-religieuse par le recours au<br />
verbe placere 6 . Dans un régime qui est, de fait, une monarchie, malgré la fiction républicaine<br />
qu’il prétend sauvegarder, ce sont les actes et non le titre qui déterminent la légitimité du<br />
1 Par exemple, dans Ag., v. 969 : Electre se félicite de savoir Oreste à l’abri du tyran qui vient de<br />
prendre le pouvoir, regna noua.<br />
2 Th. 205-207 et 217-218.<br />
3 Th. 213, 215-217.<br />
4 Clem. I, 12, 1 : « le tyran se distingue du roi non par son titre, mais par ses actes. »<br />
5 Voir supra, p. 226.<br />
6 Phaed. 258, 568 ; Phœn. 484 ; Med. 245…<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
331
souverain 1 . La distinction la plus opératoire est donc celle qui confronte le rex et le tyrannus :<br />
c’est elle également qui permet, du fait de la proximité des catégories, de recourir aux<br />
légendes mythologiques autant qu’aux exemples historiques pour éclairer la réflexion<br />
politique 2 .<br />
Le pouvoir du tyran est fondé sur la violence et sur la crainte : il ne se sent pas à l’abri<br />
des complots, et pense s’en garantir en faisant régner la terreur 3 . C’est ainsi que Œdipe, qui<br />
apparaît pourtant au début de la tragédie comme un roi paternel, soucieux de la sauvegarde de<br />
son peuple, accuse Créon de comploter contre lui dès qu’il sent son pouvoir chanceler, et le<br />
menace d’un châtiment immérité 4 . Certains, comme Egisthe et Lycus, sont en outre des<br />
usurpateurs, qui affermissent un pouvoir illégitimement conquis par des pratiques criminelles.<br />
L’Atrée du Thyeste systématise ce comportement en se livrant à une véritable apologie de la<br />
tyrannie 5 , qui constitue l’envers du De clementia : il fait ainsi l’éloge de la crudelitas quand<br />
Sénèque érigeait la clémence en valeur fondamentale du gouvernement 6 . Dans Les<br />
Phéniciennes, Etéocle affirme que la haine et le pouvoir royal sont indissolublement liés, et ce<br />
de par la volonté divine 7 . Sa volonté de puissance est telle, qu’il ne reculerait devant aucun<br />
sacrifice, fût-ce celui de sa patrie 8 . Tout étant pour lui subordonné à sa soif de pouvoir, la<br />
royauté n’est pas pour lui une charge qui lui est confiée, mais un privilège qui se conquiert de<br />
haute lutte. La tyrannie dans les tragédies se manifeste selon les modalités définies dans les<br />
dialogues, en particulier dans le De clementia et le De ira.<br />
1 Clem. 12, 3.<br />
2 La distinction est reprise dans les Lettres à Lucilius, 114, 23-24.<br />
3 Ir. I, 20 ; Clem. I, 12, 4.<br />
4 Œd. 668-708.<br />
5 Th. 204-248.<br />
6 Clem. I, 11, 4.<br />
7 Phœn. 655-656.<br />
8 Phœn. 665.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
332
Les figures tyranniques sont plus nombreuses que celles du bon roi dans les tragédies.<br />
Si l’on met de côté Hercule sur l’Œta, dont l’authenticité est plus que douteuse, seuls trois<br />
souverains se rapprochent plus ou moins de l’idéal défini dans les œuvres en prose. Tout<br />
d’abord, l’Agamemnon des Troyennes, fait face au bouillant Pyrrhus l’éloge des valeurs de<br />
pudor, de moderatio et de misericordia. Il se conduit avec modération dans la victoire, et pèse<br />
la justesse du châtiment infligé à Troie 1 , alors que Pyrrhus revendique pour le vainqueur des<br />
droits illimités 2 . Il assume son passé 3 , et se sent comme l’âme de son armée. Contrairement<br />
aux souverains tyranniques, il considère que la modération et non la violence assurent la<br />
stabilité du pouvoir, et il répugne à faire couler le sang. Cependant, Agamemnon s’en remet à<br />
l’avis de Calchas, avant de disparaître de la scène 4 , il ne peut ainsi faire prévaloir sa volonté.<br />
Créon est quant à lui confronté à Médée qui l’accuse d’exercer un pouvoir tyrannique<br />
et arbitraire, et de la condamner sans l’entendre 5 . Face à ces accusations, le roi de Corinthe se<br />
présente au contraire comme un souverain modéré et clément, soucieux avant toute chose du<br />
sort de son peuple 6 . C’est cette inquiétude qu’il présente d’ailleurs comme la raison décisive<br />
de l’exil de Médée, à plusieurs reprises 7 . Il accède cependant à ses prières, en lui accordant un<br />
jour de délai. Ce laps de temps permettra à Médée d’ourdir sa vengeance, et bien que Créon le<br />
pressente, il cède, semblant ainsi répondre à une définition de la clémence proposée par<br />
Sénèque :<br />
1 Tro. 286-87. Cf Clem. II, 4, 3.<br />
2 Tro. 335.<br />
3 Tro. 266-67.<br />
4 Tro. 352.<br />
5 Med. 192 sq.<br />
6 Med. 252 sq.<br />
7 Med. 185-86 et 270.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
333
Illa finitio contradictiones inueniet, quamuis maxime ad uerum accedat, si dixerimus<br />
clementiam esse moderationem aliquid ex merita ac debita poena remittentem. 1<br />
En réalité, Créon commet à ce moment une grave erreur de jugement. Face à la douleur d’une<br />
mère qui s’apprête à quitter pour toujours ses enfants, il faiblit dans sa décision et lui accorde<br />
une faveur qui sera fatale. Ce n’est pas la clémence qui motive sa décision, mais la<br />
compassion qui, selon Sénèque, est un état de l’âme perverti, « le défaut d’une âme chétive<br />
qui se laisse fléchir à la vue du malheur d’autrui » 2 . En effet, Créon cède devant les<br />
supplications d’une Médée qui, bien habilement, se présente à lui comme une mère<br />
infortunée, une malheureuse exilée pour qui plaident ses larmes 3 . Le portrait élogieux que le<br />
roi brosse de lui-même se trouve donc confronté à ce jugement sévère du philosophe :<br />
anus et mulierculae sunt, quae lacrimis nocentissimorum mouentur, quae, si liceret,<br />
carcerem effringerent. Misericordia non causam, sed fortunam spectat ; clementia<br />
rationi accedit. 4<br />
Créon se laisse ainsi abuser, malgré ses justes pressentiments, et donne un exemple de la<br />
faiblesse d’un roi qui, sous couleur de clémence, se laisse emporter par la compassion,<br />
mouvement fatal qui enclenche irrémédiablement le processus tragique.<br />
1 Clem. II, 3, 2 : « Voici enfin une définition qui rencontrera des objections, bien qu’elle approche au<br />
plus près de la vérité : la clémence consiste en une forme de modération qui remet partiellement une<br />
peine méritée et due. »<br />
2 Clem. II, 5, 1 : est enim uitium pusilli animi ad speciem alienorum malorum succidentis.<br />
3 Med. 285-90 et 293.<br />
4 Clem. II, 5, 1 : « ce sont les vieilles et les femmelettes qui sont ébranlées par les larmes des plus<br />
grands criminels ; elles forceraient la porte de la prison, si on les laissait faire. La compassion<br />
n’envisage pas le motif, mais la peine ; la clémence, elle, se rallie à la raison. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
334
En revanche, le personnage de Thésée dans Hercule Furieux semble répondre à l’idéal<br />
de clémence exprimé dans le traité de Sénèque. Il apparaît, à la fin de la tragédie, comme un<br />
roi éducateur qui, sans pour autant annuler la faute d’Hercule, lui donne la possibilité de<br />
progresser vers la sagesse en acceptant cette nouvelle épreuve qu’est sa vie. Il lui offre en<br />
effet l’asile à Athènes, et une promesse de rédemption 1 . Auparavant, Thésée a évoqué devant<br />
Amphitryon les enfers et le châtiment réservé aux grands criminels, dont il tire leçon pour<br />
mettre en garde les souverains terrestres contre les dangers de la tyrannie 2 . L’avertissement<br />
politique s’ancre d’ailleurs dans la réalité romaine lorsque Thésée évoque la plebeia manu qui<br />
inflige au tyran un juste supplice.<br />
Les trois rois « cléments » des tragédies paraissent donc imparfaits ou trop peu<br />
présents dans les pièces, par rapport aux tyrans qui étalent leur puissance néfaste.<br />
Agamemnon échoue à faire triompher son point de vue, et, significativement, disparaît après<br />
l’intervention de Calchas. Créon se veut juste et clément, mais il se trompe et se laisse abuser<br />
par Médée qui fait appel à sa compassion. Enfin Thésée intervient à l’extrême fin de la pièce,<br />
et son succès ne semble pas garanti. Les figures tyranniques dominent, par conséquent, les<br />
tragédies de Sénèque, dont nul idéal ne se détache, sur scène du moins.<br />
Les pièces de Sénèque, malgré leur sujet grec emprunté au répertoire tragique attique,<br />
prennent donc bien place dans un environnement où abondent les références culturelles,<br />
religieuses, sociales et politiques au monde romain, et en particulier à la Rome impériale. En<br />
effet, si les coutumes et les pratiques religieuses inscrivent ce théâtre dans un cadre de pensée<br />
romain, la présence conséquente de modes de divination particulièrement en vogue à l’époque<br />
de Sénèque répond sans nul doute au goût de ses contemporains. La nécromancie et<br />
1 C. Auvray-Assayas, 1987.<br />
2 Herc. f. 731-47.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
335
l’astrologie apparaissent d’ailleurs dans nombre d’œuvres de la période. Il est, bien entendu,<br />
naturel que les données mythologiques constituent une matière première que Sénèque élabore<br />
et travaille à sa manière, et en fonction de l’horizon d’attente de son auditoire, large ou<br />
restreint.<br />
Mais on ne peut s’en tenir là, si l’on considère les anachronismes qui concernent le<br />
droit et la vie publique : par l’effet de rupture qu’ils provoquent, et la surprise qu’ils suscitent<br />
chez le spectateur, ils invitent en effet ce dernier à passer outre la fiction scénique, et à mettre<br />
en relation le mythe et la réalité. De ce fait, s’instaure entre l’univers des tragédies et celui de<br />
la réalité un échange qui nourrit sa réflexion sur les situations mises en œuvre et leur<br />
signification. Enfin, l’environnement militaire et les références transparentes au système<br />
impérial ancrent cette réflexion et l’actualité pus ou moins immédiate. Ainsi, le thème de la<br />
guerre civile, outre qu’il ravive des souvenirs traumatisants pour les Romains, continue de<br />
faire planer la menace d’un mal politique absolu sur un régime qui, n’ayant pas établi de<br />
règles officielles de succession, risque de basculer dans le chaos et les guerres intestines à<br />
chaque changement de règne. Face à cette angoisse, se dresse la figure du héros de tragédie,<br />
roi ou chef militaire victorieux, auréolé de la gloire triomphale dont on pare les empereurs.<br />
C’est alors que se pose la question des allusions politiques dans les tragédies de Sénèque.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
336
Chapitre 8. La question des allusions.<br />
Dans les tragédies de Sénèque, des allusions au passé proche ou à la situation politique<br />
contemporaine ont été décelées, et leur évidence a été plus ou moins démontrée. Une tendance<br />
de la critique consiste à souligner les correspondances entre l’œuvre littéraire et le contexte<br />
historique et politique de sa composition 1 . Cette lecture, parfois trop systématique, peut<br />
amener à définir les tragédies de Sénèque comme des essais politiques. Comment poser le<br />
problème de la chronologie ? Jusqu’où peut-on aller dans la recherche d’allusions, et quelle<br />
signification faut-il leur donner?<br />
I/ L’actualité dans les œuvres de Sénèque.<br />
A/ Précisions préalables.<br />
En premier lieu, il convient d’affirmer la nécessité de penser le problème dans toute sa<br />
complexité : en effet, toute simplification et toute systématisation sont impossibles. C’est la<br />
dérive du code, de l’œuvre à clef, à laquelle on ne saurait raisonnablement réduire le théâtre<br />
1 R. Mc Mullen, 1967 ; W. M. Calder, 1976, et 1983 ; D. & E. Henry, 1983 et 1985.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
337
de Sénèque. Ainsi, J. D. Bishop 1 soutient que les tragédies ont été écrites pendant la retraite de<br />
Sénèque, et que, la rhétorique produisant des codes, l’auteur en utilise le matériau<br />
mythologique et métaphorique pour exprimer les réalités politiques de son temps. Cette thèse,<br />
qui se fonde sur la notion de code rhétorique, est généralement rejetée comme absurde, voire<br />
comme une erreur « grossière» 2 . Il est toutefois intéressant d’en examiner les dérives, car elles<br />
sont significatives et constituent un point de départ intéressant.<br />
1/ La thèse d’un théâtre à clef.<br />
J. D. Bishop propose un déchiffrage systématique du « code » que les tragédies<br />
mettent, selon lui, en place, avec pour résultat de livrer la pensée politique brute de Sénèque,<br />
dont la reconnaissance produirait le plaisir cognitif du lecteur 3 . Inversement, il repère dans la<br />
différence de traitement par rapport aux modèles la spécificité de la pensée politique et de la<br />
situation personnelle de Sénèque. Ainsi, la négation de toute consolation métaphysique et<br />
l’impossibilité de faire triompher la rationalité seraient le reflet de la volonté de Sénèque de se<br />
retirer de la vie publique 4 . Un exemple s’impose : l’étude de Médée postule un parallélisme<br />
strict entre personnages tragiques et historiques. L’héroïne de la tragédie renverrait à Poppée,<br />
Jason à Néron, Créüse à Octavie et Créon à Agrippine. La pièce dénoncerait alors l’influence<br />
destructrice de Poppée sur le prince. Les raisons pour lesquelles ce système est irrecevable<br />
sont nombreuses, mais il vaut la peine d’en citer quelques unes. D’abord, cette interprétation<br />
de la pièce présuppose une date de composition que J. D. Bishop prétend déduire : si les vers<br />
1 J. D. Bishop, 1985, p. 13. La même thèse est défendue spécifiquement pour Œdipe dans un article<br />
antérieur : J. D. Bishop, 1978.<br />
2 M.-H. Garelli-François, 1994, p. 94.<br />
3 M.-H. Garelli-François, 1994, p. 64.<br />
4 J. D. Bishop, 1985, p. 157-176 : « Tragedy and Imperial Power ».<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
338
1012-1013 font allusion à la mort de Poppée enceinte 1 , et si son élévation dans un ciel vide<br />
renvoie aux honneurs divins qui lui furent attribués, il faut supposer que Sénèque a survécu<br />
suffisamment longtemps à l’impératrice pour composer sa tragédie, ce que dément le récit de<br />
Tacite 2 .<br />
En outre, l’application du code conduit à certaines in<strong>version</strong>s acrobatiques, dont on ne<br />
voit pas bien d’autre justification que celle de valider le code en question : ainsi, Médée étant<br />
l’épouse originelle de Jason, elle a pour elle une certaine légitimité, et c’est elle qui se voit<br />
victime de la répudiation. Or, dans l’univers réel, la situation est rigoureusement inverse,<br />
puisque c’est Octavie, épouse légitime et princesse de naissance, qui est supplantée par<br />
Poppée. En toute logique, la violence de l’épouse abandonnée devrait être celle d’Octavie,<br />
mais J. D. Bishop y voit une référence à Poppée 3 . Bien plus, le chant du chœur des vers 56 et<br />
suivants, qui célèbre le mariage de Jason et Créüse, renverrait à la fois au mariage d’Octavie<br />
et à celui de Poppée. De telles distorsions confirment la suspicion qui pèse sur l’interprétation<br />
générale de la pièce. Enfin, l’arbitraire est de mise quand, dans les vers 301-317, le<br />
développement, par ailleurs traditionnel, sur les vicissitudes de la fortune est appliqué, sans<br />
raison décisive, à la situation d’Agrippine.<br />
2/ Une démarche réductrice.<br />
La démarche est d’autant plus intenable qu’elle nécessite, pour la « mise en code »,<br />
une simplification extrême de la pensée politique de Sénèque, réduite en vignettes, et<br />
aisément déchiffrable. Or, l’absence de leçon claire dans les tragédies, et la victoire de<br />
1 In matre si quod pignus etiamnunc latet,<br />
scrutabor ense uiscera et ferro extraham.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 61 et XVI, 6.<br />
3 Med. 579 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
339
personnages criminels comme Atrée ou Médée semble au contraire faire du mythe le moyen<br />
d’expression de doutes et d’interrogations, pour donner une idée de l’indicible qui, à plus<br />
forte raison, ne peut se couler dans des codes préétablis et simplifiés. Dans la même<br />
perspective, le nombre des tragédies semble bien trop important pour constituer les multiples<br />
déclinaisons d’une pensée si claire. Pourquoi est-il cependant intéressant de partir d’une telle<br />
construction ? L’impasse à laquelle elle conduit est si évidente que la plupart des chercheurs<br />
ne s’y arrêtent même pas. La thèse de l’œuvre à clef est incontestablement une dérive, mais de<br />
quoi dérive-t-elle ? Cette démarche nous montre aussi que les allusions ne peuvent aller dans<br />
le sens d’une simplification, mais qu’au contraire elles ouvrent vers une plus grande<br />
complexité. Enfin, la thèse de J. D. Bishop montre surtout une certaine réception des<br />
tragédies, due à une conception du règne de Néron élaborée au cours des siècles qui nous<br />
séparent de ce prince 1 .<br />
Il convient dès lors de rappeler que, pour que l’allusion fonctionne, deux conditions<br />
essentielles doivent être réunies : une intention de l’auteur, d’une part, et d’autre part une<br />
disposition favorable du public. La seconde est, comme on l’a vu, réalisée à Rome depuis<br />
longtemps : Cicéron, en particulier, avait souligné cette tendance des spectateurs romains à<br />
établir un lien entre la représentation et des situations réelles 2 . La question des intentions de<br />
l’auteur amène à une focalisation sur les œuvres de Sénèque, et dans cette perspective, le<br />
détour par ses écrits en prose s’avère utile. En effet, si l’on considère les seules tragédies, on<br />
court le risque de se livrer à une analyse partielle de leurs enjeux, en méconnaissant la<br />
cohérence et l’unité de pensée de Sénèque. On rétablirait ainsi, dans les faits, l’ancienne<br />
distinction entre un Sénèque philosophe et un Sénèque tragique, en laissant de côté les<br />
nécessaires interactions entre les différents ouvrages de l’auteur, quel que soit le genre auquel<br />
1 Y. Perrin, 1999.<br />
2 Sest. 106 ; Att. II, 19 et XIV, 3, 2. Cf M.-H. Garelli-François, 1998a, p. 170 ; C. Nicolet, 1976, p.<br />
479-494.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
340
ils appartiennent. En outre, les allusions que contiennent les traités et les lettres peuvent<br />
apporter une contribution essentielle à celles que l’on tentera de déceler dans les tragédies.<br />
B/Les références à l’actualité et au passé proche dans les œuvres<br />
philosophiques : le De ira.<br />
Certes, les écrits en prose de Sénèque ne bénéficient pas de l’opacité que permettent<br />
les mythes mis en œuvre dans les tragédies, et les allusions qu’elle contient risquent une<br />
interprétation plus aisée, du fait de cette plus grande transparence. Cependant, la complexité<br />
des notions que les traités permettent d’explorer la compense, dans une certaine mesure, et<br />
permet à l’allusion de prendre sa part.<br />
1/ Clarté des références dans les œuvres en prose : les exempla.<br />
Alors que dans les tragédies, les références à l’actualité ou au passé proche se voilent<br />
de l’intemporalité et de l’universalité du mythe, dans les œuvres en prose, elles s’abritent<br />
derrière des considérations présentées comme générales. Ainsi, I. Lana pense trouver des<br />
renseignements sur les sentiments de Sénèque à l’égard de la politique néronienne dans des<br />
développements historiques ou des réflexions généralisantes 1 . Et la critique de l’adulation<br />
contenue dans le De beneficiis peut être rapportée à Néron 2 , qui s’engage de plus en plus sur<br />
la voie de la tyrannie, et n’est plus en mesure d’entendre des avis dictés par la franchise. La<br />
1 I. Lana, 1955, p. 20-43.<br />
2 Ben. VI, 30, 6 : I. Lana, 1955, p. 22.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
341
validité de ces allusions, admise par F. R. Chaumartin 1 , est contestée par E. Cizek 2 , qui<br />
considère toutefois que la lettre 73 à Lucilius 3 , derrière des protestations de respect et de<br />
gratitude à Néron, affirme que ni Sénèque ni ses partisans ne cautionnent la nouvelle politique<br />
du régime 4 .<br />
Dans les œuvres en prose, les références au passé proche prennent parfois un caractère<br />
d’évidence et de clarté que le genre tragique ne permet pas. C’est ainsi que, dans le De ira,<br />
que l’on peut vraisemblablement dater de la période d’exil, donc après la mort de Caligula 5 ,<br />
Sénèque relate les atrocités et les pratiques tyranniques de ce prince. Le sujet du traité s’y<br />
prête particulièrement, qui développe abondamment les liens entre la propension à la colère et<br />
la tyrannie. Sénèque a recours à des exemples devenus proverbiaux, comme les tyrans de<br />
l’ancienne Grèce Apollodore et Phalaris 6 ou le cruel Cambyse 7 , mais il met également en<br />
cause Caligula, qu’il cite à plusieurs reprises 8 . Dans ce cas, bien sûr, il ne s’agit pas<br />
d’allusion, mais d’une mise en cause directe. Et de fait, la mort du prince affranchit l’auteur<br />
de la précaution que constitue l’allusion, permettant ainsi à la parole de se libérer elle aussi de<br />
la tyrannie précédente.<br />
1 F. R. Chaumartin, 1985, p. 162.<br />
2 E. Cizek, 1972, p. 152.<br />
3 Ep. 73, 4.<br />
4 E. Cizek, 1972, p. 155.<br />
5 P. Veyne, introduction à La colère, in Sénèque, Entretiens, Lettres à Lucilius, Paris, 1993, p. 107.<br />
6 Ir. II, 5, 2<br />
7 Ir. III, 14<br />
8 Ir. I, 20, 8 ; II, 33 ; III, 18, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
342
2/ Actualité et opacité.<br />
La prudence reste cependant de mise quand il s’agit du prince régnant, Claude. Les<br />
mentions de divers personnages appartenant à l’histoire de Rome, et la mise en cause directe<br />
de Caligula contribuent en effet à dissimuler, tout en invitant à l’établir, les liens avec<br />
l’empereur. De la même manière, le dédicataire officiel du traité, Novatus, voilent l’identité<br />
du véritable destinataire du De ira, qui est probablement, comme l’a démontré J. Fillion-<br />
Lahille, Claude lui-même 1 . Au début de son règne, en effet, celui-ci promulgua un édit dans<br />
lequel, reprenant la distinction traditionnelle entre ira et iracundia, il reconnaissait sa<br />
tendance à la colère et à l’irascibilité, tout en s’en excusant par avance : alteram quidem<br />
breuem et innoxiam, alteram non iniustam fore 2 . Sénèque, alors en exil, s’engage sur la voie<br />
du préceptorat princier, suivant ainsi la tradition stoïcienne qui veut que le sage, s’il ne peut<br />
lui-même gouverner, entoure et conseille le gouvernant. En effet, les conséquences de la<br />
colère en politique sont abondamment détaillées, le tyran étant celui qui considère cette<br />
passion, destructrice entre toutes, comme un privilège princier. C’est l’erreur que commit son<br />
prédécesseur, et dans laquelle Claude doit se garder de verser. Le choix de Caligula comme<br />
exemple de tyran porté à la colère et à la cruauté prend alors une signification toute<br />
particulière, car Claude était, de notoriété publique, le souffre-douleur de son neveu 3 . Sa<br />
stigmatisation devait donc forcément lui être agréable, et le disposer favorablement envers un<br />
Sénèque désireux de rentrer en grâce. Les trois derniers chapitres du traités sont tout<br />
particulièrement adressés à Claude : Sénèque, par exemple, admet implicitement les<br />
1 « le préceptorat de Claude », dans J. Fillion-Lahille, 1984.<br />
2 Suétone, Claud. 38, 1 : (il promettait) que l’une serait brève et innofensive, et que l’autre ne serait<br />
point injuste. Cf Ir., I, 4.<br />
3 Suétone, Claud. 9.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
343
allégations du prince, qui affirmait avoir simulé la stupidité face aux injures de Caligula, afin<br />
de garantir son salut 1 .<br />
Le De ira occupe donc une place dans le contexte de sa composition : les notions qu’il<br />
explore, abstraites et générales, trouvent leur illustration dans des situations concrètes, issues<br />
de la toute récente histoire politique de Rome. Les enjeux du traité sont toutefois bel et bien<br />
actuels, puisque Sénèque propose ses préceptes au prince, à une époque où les promesses de<br />
début de règne résonnent encore. Il élabore déjà la figure du bon souverain, clément et juste<br />
(et l’on imagine combien Claude, qui se voulait bon juge, pouvait être sensible à ce portrait),<br />
un souverain qui pourrait décider de le rappeler de l’exil où il se morfond. Et en effet, la<br />
publication du De ira n’est sans doute pas étrangère au choix d’Agrippine, qui désigne<br />
Sénèque pour lui confier l’éducation de son fils, et obtient pour ce faire la grâce du<br />
philosophe.<br />
On peut donc bien déceler des allusions à la situation politique contemporaine dans<br />
l’œuvre en prose de Sénèque. Dans le De ira, ces allusions sont alliées à des références<br />
explicites à l’histoire récente, qui mettent en cause Caligula en particulier, mais aussi d’autres<br />
personnages comme Calpurnius Pison 2 . On passe, logiquement, de la citation à l’allusion<br />
lorsque les références touchent à l’actualité.<br />
1 Suétone, Claud. 38 ; Ir. III, XLI, 2.<br />
2 Ir. I, 18, 3. Ce Pison, dont Sénèque rapporte un acte de cruauté, est par ailleurs présenté comme un<br />
homme vertueux. Or, ce même personnage avait été accusé d’avoir empoisonné Germanicus. Ce détail<br />
montre, comme le précise P. Veyne, dans son introduction au traité (1993, p. 106), que Sénèque ne<br />
pouvait pas être alors au service d’Agrippine, et que la rédaction se place nécessairement pendant<br />
l’exil.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
344
II/ De l’exemplum au personnage : Caligula.<br />
L’exemple du De ira souligne également l’unité et la cohérence de l’œuvre de<br />
Sénèque en général, et en particulier l’étroitesse du lien entre ses ouvrages en prose et son<br />
théâtre. La porosité des deux domaines apparaît clairement, encore une fois, à propos de<br />
Caligula. On a en effet souvent, et à juste titre, mis en rapport la figure de ce prince dans le<br />
De ira et celle d’Atrée dans Thyeste.<br />
A/ Caligula et Atrée.<br />
Ce rapprochement prend trois points d’appui : premièrement, une similitude politique,<br />
puisque l’un et l’autre sont des tyrans. Certes, les exemples de tyrans sont légion, tant dans<br />
l’histoire que dans la mythologie, et ce point commun ne saurait suffire, encore que, comme<br />
on l’a vu précédemment, l’acte de cruauté de Caligula envers Pastor n’est pas sans rappeler le<br />
festin de Thyeste, avec s’il est possible, une surenchère 1 . Ensuite, ce prince affectionnait tout<br />
spécialement une citation de l’Atrée d’Accius 2 , ce qui tendrait à indiquer qu’il se voyait en<br />
Atrée, et qu’il revendiquait une parenté politique avec le mythe 3 . Enfin, le De ira permet en<br />
outre un rapprochement visuel, par le portrait de l’homme en proie à la colère qui ponctue par<br />
trois fois le traité.<br />
1 Ir. II, 33.. Voir supra, p 203-204.<br />
2 Suétone, Cal. 30.<br />
3 Sur cette question, voir supra, p.201. La comparaison porte bien sur le plan politique, et sur le mode<br />
de gouvernement par la terreur. Caligula n’a pas précisément illustré le thème de la haine des frères<br />
associé au personnage d’Atrée.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
345
1/ Symptômes de la colère.<br />
Au tout début du premier livre, Sénèque justifie sa définition de la colère comme une<br />
aliénation en décrivant les symptômes du mal :<br />
Flagrant emicant oculi, multus ore toto rubor axaestuante ab imis praecordiis sanguine,<br />
labra quatiuntur, dentes comprimuntur, horrent ac surriguntur capilli, spiritus coactus ac<br />
stridens, articulorum se ipsos torquentium sonus, gemitus mugitusque et parum explanatis<br />
uocibus sermo praeruptus et complosae saepius manus et pulsata humus pedibus et totum<br />
concitum corpus magnasque irae minas agens, foeda uisu et horrenda facies<br />
deprauantium se atque intumescentium. 1<br />
La description fait de celui qui se laisse posséder par la colère l’équivalent d’un fou, d’un<br />
furiosus au sens juridique du terme, c’est-à-dire de quelqu’un qui a perdu tout contrôle de lui-<br />
même par la raison. Les signes du mal sont une rougeur intense, due à ce mal qui consume<br />
littéralement le patient (flagrant oculi, rubor), la conjonction de mouvements compulsifs et<br />
désordonnés (labra quatiuntur, complosae manus, totum concitum corpus…), et d’une<br />
crispation qui tend au contraire à le figer et à le paralyser (dentes comprimuntur, spiritus<br />
coactus…). La perte de la fonction du langage (parum explanatis uocibus sermo) témoigne<br />
également de la fuite de la raison.<br />
1 Ir. I, 1, 3-7 : « Les yeux brûlent et étincellent, une rougeur intense se répand sur tout le visage, sous<br />
l’afflux de sang qui bouillonne du cœur, les lèvres tremblent, les dents se serrent, les cheveux se<br />
dressent et se hérissent, la respiration est oppressée et sifflante, les articulations se tordent et craquent<br />
d’elles-mêmes, des gémissements et mugissements entrecoupent des paroles sans suite, les mains<br />
battent souvent, les pieds frappent le sol et le corps tout entier est pris d’agitation, et lance des<br />
menaces irritées, les traits, grimaçants et bouffis, sont défigurés et hideux. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
346
2/ Le miroir et la folie.<br />
On rencontre, à l’appui de la démonstration de Sénèque, deux portraits comparables de<br />
l’homo iratus dans la suite du traité 1 . A la fin du livre II, on retrouve exactement les mêmes<br />
manifestations : désordre, mouvements incontrôlés, gêne pour respirer 2 . Ces passages<br />
développent la conception stoïcienne des passions comme des maladies de l’âme, dont les<br />
symptômes se révèlent dans la physionomie de celui qui en est atteint 3 . En l’occurrence, la<br />
colère est la passion la plus visible, celle dont les manifestations sont les plus significatives.<br />
Pour détourner de la colère, il est donc utile, poursuit Sénèque, de présenter à celui qu’elle<br />
menace de conquérir un miroir, dans lequel se reflèterait la difformité de la passion : les<br />
ravages qu’elle cause sur la physionomie donnent une idée des dégâts intérieurs qu’elle<br />
provoque. Pourtant, note Sénèque, il est bien souvent trop tard quand la passion a pris<br />
possession d’un esprit :<br />
Speculo quidem neminem deterritum ab ira credideris. Quid ergo ? Qui ad speculum<br />
uenerat ut se mutaret, iam mutauerat ; iratis quidem nulla est formosior effigies quam<br />
atrox et horrida, qualesque esse etiam uideri uolunt. 4<br />
1 Ir. II, 35 ; III, 4.<br />
2 Ir. II, 35, 2.<br />
3 J. Fillion-Lahille, 1984. Un exemple célèbre est celui de Phèdre dans les tragédies. Par ailleurs, la<br />
pièce offre moins de prise à une interprétation politique, même si on a pu rapprocher le personnage de<br />
Messaline ou d’Agrippine, sans certitude toutefois. Ce qui demeure, c’est la figure de femme<br />
inquiétante qui apparaît en littérature. La tragédie est actuelle dans ce sens.<br />
4 Ir. II, 36, 3 : « On peut croire cependant qu’un miroir n’a jamais détourné quiconque de la colère.<br />
Pourquoi donc ? C’est que celui qui s’était placé devant un miroir pour changer d’aspect avait déjà<br />
changé ; pour les gens irrités, nulle image n’est plus belle que celle qui est atroce et horrible, et ils<br />
veulent paraître tels qu’ils sont. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
347
Ces passages dessinent l’image d’un homme possédé par la colère, au point d’en être<br />
transformé même physiquement, et de désirer ce changement. La mention du miroir invite à<br />
faire le lien avec Caligula, dont Suétone rapporte qu’il s’appliquait devant son propre reflet à<br />
rendre son aspect effrayant, et, en quelque sorte, conforme au tableau que Sénèque brosse de<br />
l’homo iratus.<br />
Vultum uero natura horridum ac taetrum etiam ex industria efferabat componens ad<br />
speculum in omnem terrorem ac formidinem. 1<br />
L’aspect horrible que provoque cette passion est même recherché par Caligula, qui<br />
conformément à la théorie stoïcienne des passions, adhère à celle-ci dès lors qu’il l’a laissée<br />
se développer en lui.<br />
3/ Atrée et l’homo iratus.<br />
C’est précisément la démarche que suit Atrée : comme bien d’autres héros tragiques<br />
de Sénèque, il invoque le furor afin qu’il vienne s’emparer de lui et lui permette d’accomplir<br />
le crime qui le révèlera, et le rendra digne de lui-même 2 . Les premières paroles du personnage<br />
consistent en la constatation de la distance qui reste à combler entre celui qui parle et l’iratus<br />
Atreus qu’il doit devenir 3 . Et en effet, le récit du messager, qui vient rendre compte du<br />
meurtre des enfants de Thyeste et des préparatifs du festin, prend acte de cette métamorphose<br />
1 Suétone, Cal. 50 : « Bien qu’il fût naturellement horrible et répugnant, il s’exerçait devant son miroir<br />
à rendre son visage le plus terrible et le plus effrayant possible. »<br />
2 F. Dupont, 1985, p. 446-451.<br />
3 Th. 176-180.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
348
du personnage. Dans le silence glacé du sanctuaire des Pélopides, Atrée s’avance, monstrueux<br />
et effrayant :<br />
Iamque dimissa mora<br />
assiluit aris toruum et obliquum intuens ;<br />
Ieiuna siluis qualis in Gangeticis<br />
inter iuuencos tigris errauit duos,<br />
utriusque praedae cupida quo primum ferat<br />
incerta morsus flectit hoc rictus suos,<br />
illo reflectit et famem dubiam tenet,<br />
sic dirus Atreus capita deuota impiae<br />
speculatur irae… 1<br />
Le regard torve et oblique évoque la folie, à laquelle la colère est assimilée dans le De ira, et<br />
le terme ira est cité. La soif de carnage du personnage le fait ressembler à une bête sauvage,<br />
en une comparaison épique redoublée au vers 732. Or, la mention des fauves suit de manière<br />
systématique les trois portraits de l’homo iratus dans le traité : sangliers, taureaux, lions et<br />
serpents dans le livre I 2 , ferarum aspectus plus généralement dans le livre II 3 , sanglier<br />
aiguisant ses défenses dans le livre III 4 . L’homme en colère, précise Sénèque, dépasse tous<br />
ces fauves en sauvagerie, car si la colère le rapproche par l’aspect des animaux les plus<br />
1 Th. 705-713 : « Alors, sans tarder davantage, il s’élance vers les autels en jetant des regards torves et<br />
obliques ; tel, dans les forêts du Gange, un tigre affamé hésite entre deux jeunes taureaux, et,<br />
également avide de ces deux proies, ne sachant lequel frapper en premier, tourne vers l’un, puis<br />
retourne vers l’autre sa gueule menaçante, et laisse hésiter sa faim, tel le cruel Atrée observe les têtes<br />
vouées à sa colère impie. »<br />
2 Ir. I, 1, 6.<br />
3 Ir. II, 35, 4.<br />
4 Ir. III, 4, 2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
349
effrayants, seule l’espèce humaine est susceptible de se laisser envahir par cette passion 1 . Il<br />
n’est pas indifférent que l’on retrouve, dans le passage cité de la tragédie, la même démarche<br />
que dans le traité. Par suite, l’image d’Atrée, qui se définit lui-même par l’adjectif iratus,<br />
renvoie à celle de l’homme en proie à la colère dans le traité, dont l’incarnation la plus<br />
frappante est bien Caligula, figure du tyran gouvernant par la cruauté en suscitant la crainte.<br />
En retour, on peut dire que l’Atrée de Sénèque a pris les traits de Caligula.<br />
Ce prince est fréquemment cité dans les traités, où il constitue un contre-modèle de<br />
choix à l’appui de la réflexion politique de Sénèque : ainsi, dans le De clementia, Sénèque<br />
rappelle le vers de l’Atrée d’Accius qu’il avait pris pour devise 2 . Dans le De tranquilitate<br />
animi 3 , Caligula est appelé « nouveau Phalaris », en référence à un tyran ancien devenu une<br />
figure proverbiale de cruauté. Il est également, à plusieurs reprises, comparé à Xerxès 4 , que<br />
son orgueil et sa démesure aveugles on fait entrer dans la légende, et qui est devenu un<br />
personnage de la seule tragédie grecque à sujet historique qui nous soit parvenue. Suétone fait<br />
lui aussi le lien entre Caligula et Xerxès 5 , que le prince admirait au point de vouloir le<br />
surpasser.<br />
1 Ir. I, 3, 4 et III, 4, 3.<br />
2 Clem. I, 12, 4 ; II, 2, 2.<br />
3 Tranq. XIV, 4.<br />
4 Breu.18, 5-6.<br />
5 Cal. 19.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
350
B/ L’apport de Caligula à l’élaboration des personnages tyranniques.<br />
1/ Œdipe et la naissance du tyran.<br />
Dès lors, toutes les conditions semblent réunies pour qu’apparaisse la silhouette de ce<br />
prince dans les pièces de Sénèque. On trouve en effet des allusions à Caligula dans Œdipe,<br />
comme l’a montré P. Grimal 1 . Comme le roi de Thèbes, le jeune prince de Rome n’était pas<br />
un tyran au départ, il était même l’objet de l’affection de Romains qui se souvenaient de son<br />
père. Suétone témoigne de cette évolution, très rapide il est vrai, par la structure binaire de la<br />
biographie qu’il consacre à Caligula. La transition entre les deux parties de la narration est on<br />
ne peut plus claire : Hactenus quasi de principe, reliqua ut de monstro narranda sunt 2 . Dans<br />
Œdipe, le héros, dont les intentions sont pures au départ, devient tyrannique, et la tragédie<br />
représente cette évolution. Le roi, qui dans le prologue, contemple horrifié les ravages que<br />
cause la peste dans sa cité, occupe un trône qui, comme le lui rappelle Jocaste, est la<br />
récompense de sa gloire et le salaire de sa valeur 3 . Pourtant, lorsque Créon lui rapporte la<br />
teneur des propos de l’ombre de Laïus, évoquée au cours de la cérémonie de nécromancie à<br />
laquelle il vient d’assister, Œdipe l’accuse de comploter et le fait jeter en prison 4 . Le dialogue<br />
qui oppose les deux personnages témoigne de l’évolution d’Œdipe : à la frayeur que provoque<br />
le récit de Créon succède rapidement la conviction qu’un complot s’ourdit, et la répression,<br />
même aux dépends de la justice, apparaît au roi comme la seule réponse possible à ses<br />
soupçons.<br />
1 P. Grimal, 1979, p. 214 ; M.-H. Garelli-François, 1994, p. 97.<br />
2 Suétone, Cal. 22.<br />
3 Œd. 104-105.<br />
4 Œd. 659-708.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
351
Enfin, la description de la folie d’Œdipe et de sa rage à se punir lui-même n’est pas<br />
sans rappeler les descriptions de l’homme en colère que l’on rencontre dans le De ira. Le récit<br />
du messager 1 fait la part belle à la folie furieuse qui s’est emparée du roi, après qu’il a appris<br />
le secret de sa naissance, et le double crime qu’il a commis malgré lui. La comparaison au<br />
lion de Libye 2 précède la description clinique de symptômes comparables à ceux évoqués<br />
dans le traité : les traits sont déformés (uultus furore toruus), il exhale des gémissements et<br />
des plaintes (gemitus et altum murmur), son corps entier est affecté 3 . Plus loin, la colère est<br />
nommée, associée à la folie 4 , dans une description qui insiste davantage sur les yeux d’Œdipe,<br />
prélude à la mutilation qui va suivre.<br />
2/ La question de la clémence.<br />
Face à un complot imaginaire, Œdipe adopte une attitude diamétralement opposée à<br />
celle d’Auguste, confronté à la trahison bien réelle de Cinna 5 . Cet épisode de l’histoire<br />
impériale illustre le propos de Sénèque plaidant en faveur de la clémence en politique dans le<br />
De clementia. Dans ce traité, le règne de Caligula était rappelé en des termes très négatifs ; il<br />
était notamment question de sa maladive cruauté, qui aboutit au coup d’état 6 . La clémence,<br />
affirme Sénèque, est la vertu qui distingue le roi du tyran 7 , et cette définition est assortie d’une<br />
allusion à Caligula, et d’un rappel de la citation d’Accius dont il avait fait sa devise, illustrant<br />
1 Œd. 915-979.<br />
2 Œd. 919. Cf Ir. I, 1, 6 ; II, 35, 4 ; III, 4, 2.<br />
3 Œd. 921-924.<br />
4 Œd. 957 : Dixit atque ira furit. Cf 960-961, iratus, ferox, / tantum furentis.<br />
5 Clem. I, 9.<br />
6 Clem. I, 25, 2.<br />
7 Clem. I, 12, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
352
l’engrenage dans lequel le tyran s’est engagé : il répond à la haine dont il est l’objet par la<br />
terreur, laquelle engendre la haine de ses sujets. Œdipe, par son attitude, reprend parfaitement<br />
ce propos, comme le montre cet échange avec Créon :<br />
CR. Sic odia fiunt.<br />
ŒD. Odia qui nimium timet<br />
regnare nescit : regna custodit metus.<br />
CR. Qui sceptra duro saeuus imperio regit<br />
timet timentes : metus in auctorem redit. 1<br />
La définition de la tyrannie, envisagée dans le De ira et reprise dans le De clementia,<br />
correspond donc à l’attitude d’Œdipe. On se trouve donc invité, encore une fois, à mettre en<br />
rapport Caligula avec un personnage de tragédie.<br />
C/ Autonomie des personnages tragiques.<br />
La prise en compte des œuvres philosophiques de Sénèque est indispensable dès lors<br />
que l’on cherche à établir des liens ou des ressemblances entre le mythe et la réalité. Il semble<br />
bien que les tragédies de Sénèque comportent des allusions aux empereurs précédents. Mais<br />
1 Œd. 703-706 :<br />
« CRÉON. - C’est ainsi qu’on suscite la haine.<br />
ŒDIPE. - Celui qui craint trop la haine ne sait pas régner : la terreur est la gardienne des<br />
trônes.<br />
CRÉON. - Celui qui tient le sceptre avec cruauté en exerçant un pouvoir sévère craint ceux qui<br />
le craignent : la terreur se retourne contre celui qui l’a provoquée. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
353
ces allusions sont complexes, ce qui empêche de recourir au code comme moyen<br />
d’investigation de ces pièces.<br />
Si Atrée peut être rapproché de Caligula, c’est plus comme une référence à un<br />
personnage qui est devenu, très tôt après sa mort, une figure emblématique du tyran cruel et<br />
sanguinaire, ce qui le met déjà quasiment au rang de mythe. Ce prince lui-même avait<br />
encouragé cette identification à un personnage de tragédie, en portant des cothurnes pour<br />
ressembler davantage au dieu qu’il voulait être 1 . Mais Caligula n’a pas tué son père, et s’il a<br />
pratiqué l’inceste 2 , ce ne fut pas à son insu, mais de manière quasi-officielle, en référence aux<br />
pratiques pharaoniques qu’il admirait, à l’instar d’Antoine dont il suivit les influences<br />
égyptiennes 3 . Si l’on peut déceler dans Œdipe des éléments qui autorisent le rapprochement<br />
entre le mythe et le prince, c’est que Sénèque a voulu explorer, dans sa tragédie, les modalités<br />
de la dérive tyrannique, que Caligula illustre par ailleurs. C’est donc le traitement du mythe,<br />
et non le mythe lui-même qui renvoie à la réalité.<br />
Il est d’autant plus impossible de faire correspondre un personnage réel à un autre,<br />
mythique et tragique, de manière stricte, que les références peuvent se superposer ou s’ajouter<br />
les unes aux autres. Ainsi, alors que, dans Thyeste, la figure de l’iratus Atreus semble bien<br />
pouvoir être rapprochée de Caligula et de sa folie tyrannique, la pièce a pu être lue comme<br />
une critique de Tibère. De fait, la tragédie contient une allusion que M.-H. Garelli-François<br />
considère comme incontestable 4 : il s’agit d’un passage du deuxième canticum, dans lequel est<br />
1 Const. XVIII, 4 ; cf. Suétone, Cal. 52.<br />
2 Avec sa sœur Drusilla en particulier : Suétone, Cal. 24.<br />
3 J. Colin, « Les consuls du César Pharaon Caligula », Latomus XIII, 1954, p. 399 et suiv.<br />
4 M.-H. Garelli-François, 1994, p. 95.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
354
évoquée la coalition de peuples barbares 1 dont les noms associés rappellent l’alliance des<br />
Sarmates, Parthes, Hibères et Alains sous le règne de Tibère alors qu’il cherchait à rétablir la<br />
domination de Rome en Arménie. P. Grimal a rapproché le passage du récit que fait Tacite de<br />
cet épisode de politique étrangère 2 , et en a tiré argument pour voir dans cette tragédie une<br />
critique de Tibère 3 .<br />
Dès lors, les mentions de l’exil peuvent faire penser à la retraite de Tibère à Rhodes,<br />
et en particulier les vers 37 à 40, relatifs aux crimes des anciens exilés. Les paroles d’Atrée,<br />
qui lorsqu’il délibère sur le sort qu’il réservera à son frère, considère la mort comme une<br />
faveur à obtenir 4 , font écho à un trait de cruauté que rapporte Suétone : à un condamné qui<br />
implorait qu’on l’achève, Tibère aurait répondu qu’il ne s’était pas encore réconcilié avec lui 5 .<br />
On trouve une réflexion similaire dans la bouche d’Egisthe, au vers 995 d’Agamemnon. Le<br />
tyran rétorque en effet à Electre, qui demande la mort : rudis est tyrannus morte qui poenas<br />
exigit 6 . Enfin, la haine d’Atrée pour son frère se prête à une méditation sur le règne de Tibère,<br />
dévoré de haine pour les membres de sa famille : son frère Drusus, sa femme et sa mère, dont<br />
il persécute tous les amis, Germanicus qu’il jalouse, sa belle-fille Agrippine, ses petits-fils<br />
Néron et Drusus qu’il fait périr. Les déchirements au sein de la famille régnante sont<br />
nombreux sous Tibère, en quoi le règne de ce prince se prête particulièrement bien à une<br />
investigation par la tragédie. C’est ainsi que dans Hercule Furieux, on a pu voir dans le<br />
1 Th. 369-380.<br />
2 Tacite, Ann. VI, 33 ; P. Grimal, 1979, p. 205 sq.<br />
3 Ainsi les vers 37 à 40 de Thyeste rappellent la retraite de Tibère à Rhodes : P. Grimal, 1979, p. 205<br />
sq.<br />
4 Th. 247-248 : in regno meo / mors impetratur.<br />
5 Suétone, Tib. 61.<br />
6 « C’est un tyran sans expérience que celui qui châtie par la mort. » Sur les allusions à Tibère dans<br />
Agamemnon, P. Grimal, 1979, p. 217.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
355
personnage de Lycus de nombreux traits rappelant Séjan, que le prince utilisait pour venir à<br />
bout de la descendance de Germanicus 1 .<br />
Les allusions aux empereurs précédents dans les œuvres de Sénèque sont souvent<br />
critiques, et en particulier dans les tragédies. Les vices et actions cruelles qui leur sont<br />
attribués, largement reconnus, ne font pas l’objet de discussion. Par exemple, les supplices et<br />
les humiliations que Caligula ordonnait étaient de notoriété commune, puisqu’ils participaient<br />
pleinement à la politique de terreur sur laquelle il comptait. La situation de Sénèque,<br />
précepteur et ami du prince, alliée au simple fait que les tragédies sont contemporaines de<br />
Néron, rend l’étude des allusions à la fois plus complexe et plus riche.<br />
III/ Les allusions à Néron dans les tragédies.<br />
A/ Des références manifestes et positives : Les Troyennes.<br />
Dans les tragédies, les allusions qui peuvent être considérées comme incontestables<br />
sont en général positives 2 . Ainsi, dans Les Troyennes, pièce que l’on date soit de la période<br />
d’exil de Sénèque, soit de l’année 49 3 , plusieurs passages se rapportent vraisemblablement à<br />
Néron.<br />
1 Suétone, Tib. 55. A. La Penna, 1980.<br />
2 M.-H. Garelli-François, 1994, p. 95.<br />
3 E. Fantham, 1982, p. 13.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
356
1/ Les origines troyennes de la gens Iulia.<br />
Dans les vers 470 à 474, Andromaque évoque son fils en ces termes :<br />
O nate sero Phrygibus, o matri cito,<br />
eritne tempus illud ac felix dies<br />
quo Troici defensor et uindex soli<br />
recidiua ponas Pergama et sparsos fuga<br />
ciues reducas, nomen et patriae suum<br />
Phrygibusque reddas ? 1<br />
Les Julio-Claudiens, et Néron tout particulièrement, aimaient célébrer les origines troyennes<br />
de leur famille, qui faisaient d’eux les maîtres naturels de Rome 2 . Cette longue tradition<br />
d’intérêt pour Ilion se manifeste, sous le règne de Néron, par les productions littéraires de son<br />
entourage, que l’on songe à l’Iliacon de Lucain, que cite la biographie de Vacca, à l’Ilias<br />
latina attribuée à P. Baebius Italicus 3 , ou encore à l’épopée que le prince lui-même composa 4 .<br />
Avant même de parvenir au pouvoir, le jeune Néron alors âgé de seize ans, poussé par son<br />
entourage à se distinguer dans le domaine prestigieux de l’éloquence, plaida la cause des<br />
Troyens dans un discours que Tacite mentionne 5 , et auquel Calpurnius Siculus fait allusion<br />
dans la première de ses églogues 6 . Au début du règne, en particulier, le rêve d’un retour de<br />
1 Tro. 470-474 : « Ô toi qui es né trop tard pour les Phrygiens, trop tôt pour ta mère, viendra-t-il le<br />
temps, le jour heureux qui te verra, défenseur et vengeur du sol troyen, fonder une Pergame<br />
renouvelée, ramener tes citoyens que l’exil a dispersés, et rendre leur renom à ta patrie et aux<br />
Phrygiens ? »<br />
2 Tacite, Hist. I, 16, 2.<br />
3 M. Scaffai, 1985.<br />
4 Dion Cassius, 62, 29, 1 ; Cizek, 1972, p. 390 ; J. P. Néraudeau, 1985.<br />
5 Tacite, Ann. XII, 58.<br />
6 I, 42-45.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
357
l’âge d’or, à la faveur de l’avènement du jeune prince, témoigne des espoirs qui entourèrent<br />
son accession au pouvoir 1 . Le <strong>manuscrit</strong> d’Einsiedeln, dans la première églogue, évoque la<br />
renaissance de Troie et la restauration de sa gloire 2 . Dans cette circonstance, Néron apparaît<br />
bien comme le « défenseur et vengeur du sol troyen » qu’Andromaque appelle de ses vœux, le<br />
« fondateur d’une Pergame renouvelée », qui « rend aux Phrygiens la gloire ».<br />
2/ Le lusus Troiae.<br />
Le second passage, dans le même ordre d’idée, est vraisemblablement une allusion au<br />
lusus Troiae auquel Néron prit part en 47 3 :<br />
1 G. B. Townend, 1980.<br />
2 A. Momigliano, 1960.<br />
Non arma tenera parua tractabis manu,<br />
sparsasque passim saltibus latis feras<br />
audax sequeris nec stato lustri die,<br />
solemne referens Troici lusus sacrum,<br />
puer citatas nobilis turmas ages ;<br />
non inter aras mobili uelox pede,<br />
reboante flexo concitos cornu modos,<br />
barbarica prisco templa saltatu coles. 4<br />
3 O. Herzog, 1928, p. 83. Cf Suétone, Ner. 7.<br />
4 Tro. 775-782 : « Tu ne manieras pas de ta tendre main de petites armes, tu ne poursuivras pas<br />
hardiment les fauves dispersés çà et là sur de vastes terrains, et au jour fixé pour le sacrifice,<br />
renouvelant la cérémonie solennelle du jeu troyen, tu ne conduiras pas, noble enfant, les escadrons<br />
rapides ; et parmi les autels, agile et le pied rapide, au son des modulations rythmées que fait retentir<br />
la corne recourbée, tu n’honoreras pas les temples barbares d’une danse antique. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
358
Andromaque regrette de ne pas voir son fils prendre part au Troicus lusus et manifester aux<br />
yeux de tous sa jeune gloire. L’expression employée dans ce passage, fait nettement<br />
références aux jeux troyens régulièrement donnés sous l’Empire, et en particulier pendant la<br />
période julio-claudienne. Les citatas turmas, dont il est question dans les lamentations<br />
d’Andromaque, désignent sans nul doute les groupes de participants placés sous la conduite<br />
de l’un d’entre eux, choisi pour son illustre famille et pour sa propre valeur, comme ce fut le<br />
cas pour le jeune Caton, à ce que rapporte Plutarque 1 . De fait, Suétone emploie ce même<br />
terme turma pour désigner les escadrons regroupant les participants aux jeux troyens 2 . Festus<br />
définit les Troia comme un rite équestre réservé aux jeunes garçons : lusus puerorum<br />
equestris 3 . Après Sulla, qui en fut, semble-t-il, l’initiateur 4 , César et les empereurs de la gens<br />
Iulia ont souvent fait représenter de tels jeux, au cours desquels les jeunes garçons des nobles<br />
familles s’illustraient dans une savante parade équestre 5 , dont les origines mythiques<br />
célébraient le passé troyen de Rome. On comprend dès lors que la gens Iulia, qui se réclamait<br />
d’une ascendance troyenne, ait manifesté à ces jeux une attention toute particulière, en ce<br />
qu’ils permettaient de mettre en avant les descendants de cette illustre lignée, justifiant du<br />
même coup le rôle politique de premier plan qu’ils étaient amenés à jouer.<br />
Les jeux troyens étaient donnés fréquemment, lors de l’inauguration de temples ou de<br />
la célébration de triomphes, et les jeunes garçons des nobles familles y participaient. Ainsi,<br />
1 Plutarque, Cato Minor, 3.<br />
2 Suétone, Caes. 39.<br />
3 H. Fuchs, 1990, p. 35 : Sextus Pomp. Festus v. Troia (ed. Lindsay, dans la Bibliotheca Teubneriana,<br />
Leipzig, 1913, 504, dans Glossaria <strong>Latina</strong> IV 455).<br />
4 H. Fuchs, 1990, p. 35.<br />
5 Ainsi, César, à l’occasion de l’inauguration du temple de Vénus, en 46 : Dion Cassius, 43, 23, 6 et 43,<br />
22, 3 ; Suétone, Caes. 39, 2. Sous Auguste : Suétone, Aug. 43, 2. Dion Cassius, 51, 22, 4 ; Sous<br />
Tibère : Suétone, Tib. 6,4. Sous Caligula : Suétone, Cal. 18. Dion Cassius, 59, 7, 4 et 59, 11, 2, à<br />
l’occasion des funérailles de Drusilla.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
359
Néron y prit part, avec beaucoup d’assurance et de succès, nous dit Suétone 1 , pendant son<br />
enfance. Les témoignages de Tacite et de Suétone permettent de placer cette manifestation<br />
lors des jeux séculaires, donnés par Claude en 47 2 . A cette occasion, Néron apparut aux yeux<br />
du public comme l’héritier du pouvoir :<br />
Sedente Claudio, Circensibus ludis, quum pueri nobiles equis ludicrum Troiae inirent,<br />
interque eos Britannicus, imperatore genitus, et L. Domitius, adoptione mox in<br />
imperium et cognomentum Neronis adscitus, fauor plebis acrior in Domitium loco<br />
praesagii acceptus est. 3<br />
La suprématie de Néron aux jeux troyens, plus qu’un présage, est une étape dans sa conquête<br />
du pouvoir orchestrée par Agrippine. Sa participation (comme la place prépondérante qu’il y<br />
occupe), est de façon significative associée à son adoption par Claude, qui fait de lui un<br />
concurrent sérieux pour Britannicus. En effet, en plus de la dimension sacrée et cultuelle des<br />
jeux, les dirigeants y ont vu rapidement un instrument pour atteindre des objectifs politiques.<br />
Ainsi, Sulla profita de ces cérémonies pour présenter au peuple son beau-fils M. Aemilius<br />
Scaurus, quand il lui fit conduire les jeux troyens 4 . C’était aussi une manière d’affirmer sa<br />
généalogie divine, en tant que descendant de Vénus. César mit lui aussi à profit cette<br />
dimension idéologique du rite 5 . La participation de Néron aux jeux troyens permit donc<br />
1 Suétone, Ner. 7 : Tener adhuc necdum matura pueritia circensibus ludis Troiam constantissime<br />
fauorabiliterque lusit.<br />
2 H. Fuchs, 1990, p. 59. Suétone, Claud. 21, 3 ; Ner. 7 ; Tacite, Ann. XI, 11.<br />
3 Tacite, Ann. XI, 11 : « Lors des jeux du cirque, les jeunes garçons de la noblesse exécutèrent à devant<br />
Claude une course troyenne à cheval ; parmi eux se trouvait Britannicus, fils de l’empereur, et L.<br />
Domitius, à qui l’adoption conféra bientôt l’empire et le surnom de Néron. On tint pour un présage la<br />
faveur de la plèbe qui pencha pour Domitius. »<br />
4 H. Fuchs, 1990, p. 46 ; Plutarque, Cato Minor, 3.<br />
5 S. Weinstock, 1971, p. 88 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
360
d’affirmer de façon officielle et spectaculaire la place qu’il occupait dans la famille régnante,<br />
par la naissance et par l’adoption (en attendant les fiançailles avec Octavie), et de le faire<br />
apparaître comme l’héritier légitime du pouvoir, face à un Britannicus plus jeune et sans<br />
doute moins brillant.<br />
La suite du passage des Troyennes précédemment cité mentionne enfin une danse<br />
guerrière, pratiquée par les jeunes garçons de la noblesse. L’ensemble du passage pourrait<br />
aussi bien décrire le tripudium, danse armée que les jeunes nobles romains pratiquaient lors<br />
de cérémonies civiques et religieuses 1 , les danseurs frappant le sol en cadence, sur un rythme<br />
ternaire, comme peut l’exprimer le groupe mobili uelox pede 2 . La mention des armes au début<br />
du passage amène à un autre rapprochement. L’expression parua arma associée à tenera<br />
manu peut en effet désigner des armes de petite taille, destinées aux exercices d’un enfant<br />
dans le cadre de son éducation guerrière, mais dans ce contexte, il peut s’agir également<br />
d’armes fictives telles que l’on en usait au cours des pyrrhiques 3 . Ces danses d’origine<br />
grecque se caractérisaient par un rythme rapide, dont le pied de base était la succession de<br />
deux brèves 4 . L’expression mobili uelox pede peut correspondre à cette pratique. Sous<br />
l’Empire, c’est semble-t-il la pyrrhique d’Ionie qui était dansée par de jeunes nobles lors de<br />
fêtes à caractère civique et religieux 5 . Ainsi, parmi les spectacles que César offrit au peuple,<br />
on compte des pyrrhiques, dansées par les enfants de nobles familles d’Asie et de Bithynie, et<br />
l’on sait que Néron donna des danses de ce type, exécutées par des jeunes gens qui, en retour,<br />
1 N. Zorzetti, 1991.<br />
2 Id. p. 316 ; H. Fuchs, 1990, p. 58 : La danse labyrinthique, reconnue dans le rite salien, apparaît à<br />
Rome dans le lusus Troiae.<br />
3 M.-H. Garelli-François, 2000b.<br />
4 Diomède, 475, 9-25 Keil. Platon propose une description de ce type de danse, dont la gestuelle se<br />
compose de mouvements mimant le combat (Lois, VII, 815 a) : M.-H. Garelli-François, 2000b.<br />
5 Suétone, Caes. 39 ; Ner. 12 ; Dion Cassius, 60, 7 et 23.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
361
eçurent la citoyenneté romaine. On peut donc voir dans ce passage des Troyennes une<br />
référence à une pratique répandue sous l’Empire, à laquelle Néron avait lui-même contribué,<br />
en tant que participant ou qu’organisateur.<br />
3/ Des allusions favorables.<br />
Ce passage des Troyennes rappelle donc bien les origines mythiques de Rome, que les<br />
empereurs de la dynastie Julio-Claudienne avaient particulièrement mises en valeur, tout en<br />
donnant indirectement de Néron une image favorable. En effet, la danse virile et guerrière<br />
échappe à la condamnation générale de la danse par les Anciens. Ainsi, Sénèque ne la<br />
désapprouve pas, comme en témoigne un passage du De tranquilitate animi :<br />
Scipio triumphale illud ac militare corpus mouebat ad numeros, (…) ut antiqui illi uiri<br />
solebant inter lusum ac festa tempora uirilem in modum tripudiare, nonfacturi<br />
detrimentum etiam si ab hostibus suis spectarentur. 1<br />
Dans un passage où il affirme la nécessité d’alterner les périodes de travail et de<br />
divertissement, Sénèque convoque l’illustre exemple de Scipion, qui pratiquait sans honte une<br />
sorte de danse qu’il distingue nettement de pratiques jugées indignes d’un homme de guerre.<br />
Cette discipline fait même partie de l’éducation du jeune Romain : Quintilien rappelle ainsi<br />
que les Lacédémoniens la comptaient parmi leurs exercices guerriers, et que les anciens<br />
1 Tranq. 17, 4 : « Scipion mouvait en cadence son corps de triomphateur et de guerrier (…), comme<br />
nos illustres ancêtres, qui avaient coutume, au cours des périodes de fête et de célébration, de pratiquer<br />
la danse martiale sur un rythme viril, sans que leur prestige en souffrît même si leurs propres ennemis<br />
assistaient au spectacle. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
362
Romains eux-mêmes se livraient à des danses dont les traces perdurent encore à son époque 1 .<br />
Citant le De Oratore de Cicéron, il souligne même le rôle que peut jouer ce type de pratique<br />
dans la formation de l’orateur 2 .<br />
On est bien loin des mouvements efféminés d’un Caligula, convoquant nuitamment<br />
des sénateurs fort inquiets afin de leur faire une démonstration de ses talents de danseur 3 . Il ne<br />
s’agit pas, alors, du type de danse admis et jugé convenable, du pôle constitué par les prêtres<br />
et les guerriers 4 , mais de l’activité honteuse d’un empereur artiste dont l’arbitraire est jugé<br />
insupportable. Typiquement, Caligula n’est pas un homme de guerre, et Suétone souligne à<br />
cet égard le peu d’intérêt qu’il porta aux choses militaires 5 . Son activité de saltator témoigne,<br />
entre autres, de son incapacité à gouverner 6 .<br />
En revanche, l’allusion que l’on a pu voir dans les vers 775 à 782 des Troyennes est, à<br />
plus d’un titre, favorable à Néron, dans la mesure où elle fait de lui le continuateur des valeurs<br />
de l’aristocratie. Elle met également en valeur le tempérament d’artiste de Néron, et sa<br />
tendance à transformer en spectacle la plupart de ses actions, dont certaines se rattachent aux<br />
fondements de la mentalité romaine. L’art de vivre fondé sur la théâtralisation que le prince a<br />
progressivement institué est, en fin de compte, doublement valorisé, puisque Astyanax est<br />
représenté favorablement dans des pratiques qui ont toutes trait au spectacle, dans une œuvre<br />
qui elle-même est, par essence, destinée à une représentation, qu’elle prenne une forme<br />
théâtrale achevée ou celle de la recitatio. Enfin, les premières apparitions de Néron en public,<br />
1 Quintilien, I. O. I, 11, 18.<br />
2 Cicéron, De Or. III, 83. Tacite dénoncera la per<strong>version</strong> de cette éducation, à une époque où, selon lui,<br />
l’avocat est quasiment devenu un danseur et un chanteur : D. XXI, 1-2<br />
3 Dion Cassius, 59, 5 ; Suétone, 54, 4.<br />
4 La distinction entre la « bonne danse », celle des guerriers ou des prêtres, et celle des histrions est<br />
établie par M.-H. Garelli-François, 1995. Le citoyen romain évoluait entre ces deux pôles.<br />
5 Suétone, Cal. 41.<br />
6 D’après Cicéron, Mur. VI, 13, Caton le Jeune donnait ce surnom méprisant à Murena, qui avait dansé<br />
au cours de banquets.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
363
les jeux troyens et ses discours, en particulier celui qu’il prononça en faveur d’Ilion, renouent<br />
avec les origines mythiques de Rome, et témoignent d’une volonté de s’inscrire dans la<br />
continuité qui lui donne de la légitimité.<br />
La signification politique de ces jeux apparaît en effet dans l’ensemble des propos<br />
d’Andromaque : dans ses ultimes paroles à son fils, elle dit adieu à l’espoir de voir Troie<br />
renaître de ses cendres, à celui qui aurait dû hériter du trône d’Ilion et venger la mort des<br />
princes phrygiens. Le passage, au futur, accumule les négations, signifiant ainsi l’espoir déçu<br />
d’une mère, genetricis spes uana 1 . Si la référence aux jeux troyens invite l’auditeur à faire le<br />
lien entre Astyanax et Néron, l’ensemble du passage peut être lu, négativement en quelque<br />
sorte, comme l’expression des espoirs que suscita le jeune Néron, puer nobilis, lors de son<br />
arrivée au pouvoir. Cette lecture, proposée par P. Grimal, est confirmée par M.-H. Garelli-<br />
François 2 , qui rappelle que le thème central de la confrontation entre Agamemnon et Pyrrhus 3<br />
est le même que celui de la politique officielle de Néron dans les premières années de son<br />
règne, la clémence, dont Sénèque se fit le promoteur 4 . En outre, l’expression genetricis spes<br />
du vers 768 correspond aussi bien à Agrippine, qui mit tous ses efforts et son industrie au<br />
service de l’ascension de son fils vers le pouvoir, et les vers 771 à 773 renvoient également à<br />
un type de domination qui rappelle celle du jeune prince. Ainsi, si l’on peut voir dans la<br />
référence aux jeux troyens une allusion à Néron, ce qui est très vraisemblable, l’ensemble de<br />
la pièce apparaît favorable au prince, et illustre, sur le mode de la tragédie, les espoirs<br />
soulevés par son avènement et dans les premières années de son règne 5 .<br />
1 Tro. 768.<br />
2 P. Grimal, 1979, p. 205 sq ; M.-H. Garelli-François, 1994, p. 95.<br />
3 Tro. 250-292.<br />
4 M.-H. Garelli-François, 1994, signale toutefois l’édit de Claude sur la clémence comme une<br />
référence possible à ce débat sur le ius et l’aequitas. Encore une fois, l’absence de chronologie fiable<br />
pour les tragédies de Sénèque ne permet pas de trancher.<br />
5 C’est l’analyse proposée par M.-H. Garelli-François, 1994.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
364
B/ Médée : des allusions moins claires et plus problématiques.<br />
La question des allusions au règne de Néron dans Médée est plus problématique.<br />
D’abord, cette tragédie est exemplaire des difficultés que rencontrent les savants quant à la<br />
chronologie du théâtre de Sénèque. En effet, les dates proposées à la suite de diverses études<br />
sont relativement éloignées les unes des autres. Principalement, deux périodes retiennent<br />
l’attention des chercheurs : ainsi, J. G. Fitch, se fondant sur des critères métriques, propose<br />
pour Médée une date de rédaction antérieure à l’année 54 1 , tandis que L. Herrmann estime<br />
qu’elle fut composée à l’époque de la retraite, pendant laquelle Sénèque jouissait de plus de<br />
loisir, soit au cours des années 60-62 2 . P. Grimal considère, tout en reconnaissant la fragilité<br />
de sa proposition, que Médée, tout comme Phèdre, daterait de la retraite, ou en tout cas du<br />
déclin politique de Sénèque 3 . En se fondant sur cette dernière hypothèse, A. Arcellaschi pense<br />
déceler des allusions à la politique de Néron et à ses projets 4 . Il propose même pour la<br />
tragédie une date assez précise, entre l’automne 63 et l’été 64.<br />
1/ L’incendie de Corinthe.<br />
En l’absence de certitude établie, l’examen de deux exemples se révèle toutefois<br />
fructueux. D’abord, A. Arcellaschi s’interroge sur le caractère prophétique de l’incendie de<br />
Corinthe, provoqué par les présents ensorcelés de Médée :<br />
1 J.G. Fitch, 1981 : en se fondant sur l’étude de la fréquence des pauses de sens dans les vers<br />
iambiques, J. G. Fitch propose de répartir la composition des tragédies de Sénèque en trois groupes,<br />
dont le deuxième, comprenant Médée, Les Troyennes et Hercule Furieux, daterait d’avant 54.<br />
2 L. Herrmann, 1924.<br />
3 P. Grimal, 1991, p. 427.<br />
4 A. Arcellaschi, 1990, p. 339-342.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
365
Auidus per omnem regiae partem furit<br />
ut iussus ignis : iam domum tota occidit ;<br />
urbi timetur. 1<br />
L’expression ut iussus, rejetée en début de vers, fait évidemment penser à la rumeur selon<br />
laquelle Néron aurait donné l’ordre d’allumer le grand incendie qui ravagea Rome entre le 19<br />
et le 27 juillet 64 2 . Mais au-delà de l’association d’idée, si naturelle qu’elle paraisse, la mise<br />
en relation de ces deux événements paraît bien problématique. Il faut en effet supposer que<br />
Sénèque a composé sa tragédie après les événements, ou qu’il avait connaissance des projets<br />
du prince en la matière, à un moment où son crédit avait considérablement décliné. Cette<br />
hypothèse implique en outre la culpabilité de Néron dans l’incendie de Rome, alors que la<br />
plupart des études récentes tendent à montrer la vraisemblance d’un sinistre accidentel 3 . Il<br />
faudrait, en dernier recours, admettre qu’il prête foi à une rumeur hostile au prince qui s’est<br />
développée par la suite, attitude aussi téméraire qu’inutile…<br />
Bien que la coïncidence soit plus que troublante, il faut bien reconnaître qu’il est<br />
impossible d’affirmer l’existence d’une allusion à un trait de « politique intérieure » de Néron.<br />
On trouve en outre peu d’échos de la catastrophe dans la lettre 91 à Lucilius, relative à<br />
l’incendie de Lyon en 64, et légèrement postérieure à celui de Rome 4 . On peut seulement voir<br />
une discrète allusion dans la mention de la « seule colline » de Lyon, en référence aux sept de<br />
1 Med. 885-887 : « un feu dévorant ravage toutes les parties du palais royal, comme sur ordre : déjà la<br />
demeure s’est entièrement effondrée ; il menace la ville. »<br />
2 Tacite, Ann. XV, 40, 2.<br />
3 J. Beaujeu, 1960, p. 10 ; P. Holson, 1976 ; Y. Perrin, 2002, p. 167-168.<br />
4 Tacite, Ann. XVI, 13. On admet que la lettre est datée du mois d’août 64 : M. T. Griffin, 1976, p.<br />
400.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
366
Rome 1 . Le fléau qui a récemment ravagé Lyon sert de point d’appui à une réflexion sur la<br />
fragilité des empires et sur les catastrophes, étayant la thèse de la destruction périodique du<br />
cosmos 2 .<br />
En réalité, il semble bien qu’il en soit des incendies comme du poison, les deux fléaux<br />
se trouvant, justement, étroitement liés dans la tragédie de Médée. Les affaires<br />
d’empoisonnements, réels ou supposés, ne se comptent plus, tant dans l’univers de la tragédie<br />
que dans le monde réel, en particulier dans l’entourage des rois et des princes, et il n’est nul<br />
besoin de se référer aux Borgia ou à la fameuse affaire des poisons qui défraya la chronique<br />
sous Louis XIV pour rassembler un grand nombre d’exemples illustrant le vers 453 de<br />
Thyeste : uenenum in auro bibitur. Ainsi, la lecture d’A. Arcellaschi est tributaire de l’image<br />
de Néron telle que l’a forgée sa « légende noire », élaborée entre la mort du prince et IV e<br />
siècle. Parmi les thèmes récurrents de cette image légendaire, le rôle eschatologique de Néron<br />
tient une place de premier ordre, et tout particulièrement son lien avec les grandes<br />
catastrophes. Par exemple, l’éruption du Vésuve en 79 a pu être associée à l’apparition d’un<br />
faux Néron 3 . Associer l’incendie de Rome et celui de Corinthe revient dès lors à confondre le<br />
Néron historique et celui de la légende.<br />
1 Sénèque, Ep. 91, 10.<br />
2 On trouve l’idée d’une catastrophe imminente chez Sénèque, puis dans les œuvres des poètes de<br />
l’époque flavienne : P. Jal, 1963, p. 246 ; P. G. Downing, 1995. Dans les écrits de Sénèque, la fin du<br />
monde prend la forme, soit d’un déluge universel ( Helu., 6, 8 ; Pol., 1, 2, Ep. 71, 15 et Nat. III, 27,<br />
2 : Vrbes constituit aetas, hora dissoluit), soit d’un embrasement général (Th. 827-843, Marc. 26, 6-<br />
7). Le thème de la conflagration finale hérite de l’ancien stoïcisme, et notamment de Chrysippe (SVF<br />
2, 131) : J. B. Gould, 1970, p. 123-126 et 135-136.<br />
3 J. Y. Perrin, 1999.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
367
La thèse de la coïncidence est donc vraisemblable 1 . En effet, l’hypothèse de l’allusion<br />
est soumise à bien trop de conditions pour que l’on puisse l’envisager sérieusement. D’abord,<br />
si la pièce est effectivement postérieure à l’incendie, l’allusion prend la forme d’une véritable<br />
provocation, car il devient impossible de ne pas faire le rapprochement entre Médée et Néron.<br />
Sénèque ferait alors preuve d’une imprudence inhabituelle et bien inutile, loin des prises de<br />
position courageuses mais réfléchies du De beneficiis par exemple. De plus, une telle attaque<br />
serait véritablement de nature à précipiter la condamnation de l’ancien amicus principis. Dès<br />
lors, on pourrait à juste titre se demander pourquoi aucune mention n’en est faite dans les<br />
récits de Tacite, Suétone ou Dion Cassius. Pourtant, on connaît par ces mêmes auteurs le sort<br />
réservé aux auteurs de théâtre dont les œuvres semblaient s’attaquer plus ou moins<br />
directement au prince régnant : Mamercus Aemilius Scaurus contraint au suicide sous Tibère 2 ,<br />
ou l’auteur d’une Atellane, brûlé vif pour un vers équivoque que sa pièce contenait 3 , en sont<br />
des exemples. En ce qui concerne Sénèque, ce n’est pas le contenu de ses pièces qui est<br />
incriminé, mais son activité même de poète dramatique, et encore ce reproche n’est-il pas à<br />
mettre au compte de Néron, mais de ses conseillers et ennemis du philosophe, qui lui<br />
reprochent de composer plus fréquemment des vers depuis que l’empereur en a pris le goût 4 .<br />
Par ailleurs, l’année 62 vit la remise en vigueur de la loi de majesté, signe d’un<br />
durcissement du régime et de son évolution vers la tyrannie. Tacite mentionne deux affaires 5<br />
impliquant, l’une le préfet Antistius, accusé d’avoir donné lecture, au cours d’un banquet,<br />
d’un poème satirique dans lequel il brocardait le prince, l’autre Frabicius Veiento, auteur<br />
d’une satire contre les sénateurs et les pontifes. Tous deux furent condamnés à l’exil, et leurs<br />
1 Une représentation de la Médée de Corneille fut interrompue par un incendie le 17 novembre 1700…<br />
2 Tacite, Ann. VI, 29 ; Dion Cassius, 58, 24, 4 ; Suétone, Tib. 61, 10.<br />
3 Suétone, Cal. 26.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 52.<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 48 et 49.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
368
iens furent confisqués. Le procès d’Antistius, s’il n’aboutit pas à une condamnation à mort,<br />
révèle le ressentiment de Néron, contraint en quelque sorte à la clémence par l’attitude de<br />
Thrasea Paetus, et pourtant profondément atteint par ce qu’il nomme lui-même grauissimae<br />
contumeliae. Dès lors, il paraît peu vraisemblable qu’une allusion à la responsabilité du prince<br />
dans le grand incendie de Rome soit à ce point passée inaperçue, et ne fasse pas l’objet d’un<br />
commentaire de la part de Tacite.<br />
Si, comme il est plus probable, la pièce est antérieure, il reste à invoquer la<br />
coïncidence : le feu fait partie des fléaux récurrents à Rome, comme les tremblements de terre<br />
ou les crues du Tibre. En outre, l’incendie de Corinthe fait partie du mythe… Si l’on veut<br />
absolument voir une allusion, il faut supposer que Sénèque était au courant du projet de Néron<br />
d’incendier la ville. Or Sénèque est en disgrâce, et la culpabilité de Néron est plus que<br />
douteuse. Quant à une valeur « prophétique » de ce vers, elle nous ferait verser dans<br />
l’irrationnel, à un stade où l’argumentation n’est plus guère possible. Tout au plus peut-on<br />
dire que l’incendie de Rome fait partie des éléments qui ont contribué à associer Néron à des<br />
personnages de tragédie, comme le matricide.<br />
2/ Le percement de l’Isthme.<br />
Un second passage, moins discutable mais tout aussi problématique, invite à faire le<br />
lien entre la politique de Néron et la tragédie de Médée :<br />
gemino Corinthos litori opponens moras<br />
cremata flammis maria committat duo. 1<br />
1 Med. 35-36 : «Que Corinthe, qui fait obstacle aux deux rivages, soit réduite en cendres et réunisse les<br />
deux mers dans les flammes. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
369
On a vu dans ces vers une allusion au percement de l’Isthme de Corinthe 1 , dont les travaux<br />
furent entrepris en 67 lors du voyage impérial en Grèce 2 , et donc après la mort de Sénèque.<br />
Pourtant on peut raisonnablement supposer que ces travaux avaient été évoqués, bien avant<br />
leur mise en œuvre, et que Sénèque, alors qu’il faisait encore partie de l’entourage proche du<br />
prince, en avait été informé. Néron, en effet, tenait beaucoup à cette entreprise surhumaine et<br />
démesurée, que Demetrios Poliorcète, César ou Caligula avaient envisagée avant lui 3 . Et si<br />
Pline juge que le destin funeste de ces derniers prouve le caractère sacrilège d’un tel chantier 4 ,<br />
le récit de Suétone ne contient aucune condamnation concernant César et Caligula 5 . De fait, le<br />
percement de l’Isthme est cité parmi les grands travaux du prince, dont l’énumération<br />
constitue la clôture du volet positif de la relation, la distinction entre le prince et le monstre<br />
suivant immédiatement le passage. On note dans le livre consacré à Néron le même type<br />
d’organisation. On a pu voir également dans ce projet un signe de sa volonté de marcher dans<br />
les pas d’Alexandre 6 , dont Strabon souligne l’intérêt pour les canaux 7 : Pausanias considère<br />
même que la volonté d’Alexandre de percer l’Isthme aurait joué un rôle décisif dans la<br />
décision de Néron de mener à bien le chantier, tout comme l’avortement de ce projet aurait,<br />
un peu plus tard, consolé le prince 8 .<br />
1 A. Arcellaschi, 1990, p. 343.<br />
2 Pline, N. H. IV, 9-11 ; Suétone, Ner. 19, 3 ; Dion Cassius, 63, 16 ; Philostrate, Vit. Apoll. IV, 24 ;<br />
Flavius Josèphe, B. J. III, 10.<br />
3 B. Gerster, 1884.<br />
4 Pline, N. H. IV, 4, 10-11.<br />
5 Suétone, Caes. 44 ; Cal. 21.<br />
6 S. E. Alcok, 1994 : cette émulation apparaît également dans le fait que Néron voulait apparemment<br />
mener une expédition en orient, non moins ambitieuse que celle d’Alexandre lui-même, et qu’il créa à<br />
cet effet les « phalanges d’Alexandre » (Suétone, 19, 2 ; Pline, N. H. VI, 15, 40). Sur sa volonté de<br />
rivaliser avec Alexandre, voire de le surpasser par cette entreprise : J. Kolendo, 1982.<br />
7 Strabon, XVI, 1, 11.<br />
8 Pausanias, II, 1, 5.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
370
L’allusion contenue dans les vers 35-36 de Médée pourrait donc correspondre à<br />
l’anticipation d’une entreprise qui tenait à cœur au prince, désireux de se mesurer à un illustre<br />
modèle, et d’affirmer par un symbole tangible sa domination et sa puissance. D’ailleurs, il<br />
avait déjà entrepris des travaux du même ordre à Rome même, après 64 : le percement d’un<br />
canal entre Pouzzoles et la basse vallée du Tibre fut ensuite abandonné, mais sa destination<br />
était sans doute de mieux relier Ostie au port fluvial 1 , afin d’assurer à la Ville un meilleur<br />
ravitaillement, condition de paix sociale et d’ordre civil. Le chantier de Corinthe ne peut donc<br />
être réduit à un caprice de mégalomane. Certes, au-delà de motivations économiques valables<br />
(le canal assurerait une meilleure sécurité maritime et favoriserait de ce fait les échanges)<br />
l’empereur se révèlerait capable de modifier les divisions du monde établies par les dieux. Si<br />
l’on admet, avec la plupart des savants, que la tragédie fut composée autour de l’année 63,<br />
l’opinion de M.-H. Garelli-François, qui compte cette allusion au nombre des flatteries «de<br />
dernière minute» insérées dans le poème par un Sénèque que sa disgrâce pousse à la<br />
prudence, paraît tout à fait vraisemblable.<br />
3/ Une allusion flatteuse, en apparence.<br />
Cependant, si l’on met en perspective les différents textes de Sénèque, cette référence<br />
au percement de l’Isthme de Corinthe ne se révèle pas aussi favorable au prince. Tout<br />
d’abord, le modèle d’Alexandre, suivi par Néron, ne peut pas agréer à Sénèque, qui présente<br />
dans ses écrits une image pour le moins contrastée du conquérant, qui « avait travaillé à se<br />
rendre maître de l’univers plutôt que de ses passions » 2 , un fou cupide et insatiable dont<br />
1 Suétone, Ner. 16 ; Y. Perrin, 2002, p. 166.<br />
2 Ep. 113, 29 : id enim egerat ut omnia potius haberet in potestate quam adfectus.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
371
l’autorité est fondée sur la terreur, au rebours de ses conceptions 1 . Enfin, le philosophe, hostile<br />
aux guerres de conquêtes 2 , ne peut cautionner un tel modèle 3 . Dès lors, une allusion au<br />
percement de l’Isthme de Corinthe, qui fait de Néron le successeur d’Alexandre, ne saurait<br />
constituer qu’une flatterie apparente au prince.<br />
En outre, les Lettres à Lucilius et les traités en prose témoignent en plusieurs endroits<br />
de l’hostilité du philosophe pour ces entreprises qui contrarient les lois de la nature et<br />
bouleversent l’ordre du cosmos divinement établi. Ainsi, dans la conclusion du De breuitate<br />
uitae 4 , Sénèque cite un exemple de la folie tyrannique de Caligula, qui avait fait construire un<br />
pont de bateaux long de cinq kilomètres à partir de Pouzzoles. A cet effet, il avait<br />
réquisitionné tous les navires disponibles alors que la Ville connaissait de sérieux problèmes<br />
de ravitaillement. La famine et la dissolution sociale furent le prix de cet acte de folie et de<br />
démesure, par lequel Caligula imitait « un roi barbare, un tyran fou que perdit son orgueil » 5 .<br />
Il s’agit, bien entendu, de Xerxès, qui avait jeté un pont de bateaux sur les Dardanelles, pour y<br />
faire passer son armée et envahir la Grèce, prélude au célèbre désastre de Salamine qui inspira<br />
Eschyle dans sa tragédie des Perses. La comparaison, qui témoigne en outre de la rencontre<br />
entre tragédie et histoire dans l’œuvre de Sénèque, montre que l’une des manifestations de la<br />
démesure tyrannique est qu’elle prétend substituer ses propres lois à celles de la nature et nier<br />
l’organisation du cosmos divinement établi. En ce sens, le canal est symétrique au pont de<br />
bateaux, puisqu’il s’agit, dans les deux cas, d’imposer à l’environnement naturel une<br />
modification qui permette le passage des hommes. Toutefois, l’intention de départ est au<br />
contraire diamétralement opposée : si Caligula néglige l’approvisionnement de Rome en<br />
1 Sénèque, Ep. 119, 7 et 12 ; 83, 19.<br />
2 Ir. II, 8, 2 ; Ben. VI, 30, 5.<br />
3 M.T. Griffin, 1976, p. 222-233.<br />
4 Breu. 18, 6 et 17, 2.<br />
5 Breu. 18, 6 : furiosi et externi et infeliciter superbi regis.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
372
denrées alimentaires, il semble que dans le cas de Néron, c’est justement le souci du<br />
ravitaillement qui le poussa à envisager le chantier du canal entre Pouzzoles et la basse vallée<br />
du Tibre.<br />
Ensuite, la construction d’un canal tient à la fois de l’entreprise démesurée sur la<br />
nature, comme le pont de bateau dont elle constitue le pendant, et de la recherche effrénée de<br />
la prouesse et de l’innovation technique suscitées par le goût du luxe. Ainsi, dans la lettre 90,<br />
alors que la construction de la Domus aurea, symbole du néronisme et de la révolution qu’il<br />
entend opérer, vient de commencer, Sénèque fait une allusion pour le moins critique aux<br />
machines architecturales alors en vogue, et tout particulièrement aux euripes, alimentés par un<br />
système d’écluses 1 . Un peu plus loin, ce sont les aqueducs, qui contraignent la direction de<br />
l’eau, qui font l’objet de l’indignation du philosophe 2 . Ces grands travaux et ces machines ne<br />
recueillent pas l’approbation de Sénèque, et l’on peut penser que, si les particuliers se voient<br />
critiqués pour leur attachement démesuré au luxe pour leur propre usage, le projet de<br />
percement de l’Isthme n’a pu, s’il a été évoqué devant Sénèque, l’enthousiasmer outre<br />
mesure.<br />
On trouve également une mention de ce type d’application de la mécanique aux lois de<br />
la nature dans le Thyeste. Alors que Tantale, fils de Thyeste, tente de convaincre son père<br />
d’accepter la proposition de paix d’Atrée, l’exilé se livre à un éloge de la vie modeste et de la<br />
paix qu’elle procure, loin des pièges et des dangers que recèle la grandeur. Si le thème est<br />
assez fréquent dans les cantica, les arguments qu’avance Thyeste sont assez semblables à<br />
ceux de la lettre 90 à Lucilius, en particulier lorsqu’il est question de l’inquiétude qui<br />
s’empare des habitants de riches demeures 3 . Encore une fois, le goût du luxe et la démesure<br />
1 Ep. 90, 15. Cf Suétone, Ner. 31, 2.<br />
2 Ep. 90, 43.<br />
3 Par exemple, v. 457 : somnosque non defendit excubitor meos, Cf Ep. 90, 41-42.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
373
qu’il entraîne trouvent un exemple dans les travaux qui visent à modifier les mouvements<br />
naturels de l’eau :<br />
non classibus piscamur et retro mare<br />
iacta fugamus mole (…)<br />
(…) nulla culminibus meis<br />
imposita nutat silua nec fumant manu<br />
succensa multa stagna… 1<br />
Dans des termes comparables à ceux que Sénèque emploie dans les Lettres à Lucilius 2 ,<br />
Thyeste condamne le luxe de maisons de plaisance qui ressemblent fort à celles que les riches<br />
Romains se faisaient construire à l’époque. On pense alors à la Domus aurea, qui devait<br />
réaliser les projets les plus magnifiques de Néron en matière d’architecture, mais Sénèque ne<br />
vit pas la réalisation de cet immense espace palatial 3 dont le grand édifice de l’Oppius<br />
constitue l’élément le plus monumental 4 . Toutefois, le prince montra très tôt un intérêt<br />
particulier pour les réalisations architecturales. Dans les premières années de son règne, il<br />
avait fait construire à Subiaco, à une centaine de kilomètres à l’Est de Rome 5 , une villa qui<br />
surplombait trois lacs artificiels. A Rome, les thermes néroniens du Champ de Mars, auxquels<br />
1 Th. 459-466 : « Je n’envoie pas mes flottes à la pêche, ni ne fais battre la mer en retraite, je n’élève<br />
pas des digues pour refouler la mer et la mettre en déroute (…), nulle forêt plantée sur mes terrasses ne<br />
s’y balance, je n’ai pas d’étangs nombreux dont les eaux fumantes sont chauffées par les hommes. »<br />
2 Ep. 89, 21.<br />
3 S. B. Platner, T. Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, Londres, 1929, p. 166-172 ;<br />
M. Royo, 1994.<br />
4 Y. Perrin, 2002, p. 194.<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 22. Cette villa se situait au-dessous du monastère de saint Benoît : J.B. Ward-<br />
Perkins, Roman Imperial Architecture, Pelican Hitory of Art, 1981, p. 186-206.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
374
un gymnase fut ajouté lors des Neronia de 60 1 , constituent les premiers thermes impériaux, et<br />
leur magnificence fait l’admiration d’un Martial peu suspect de néronisme 2 . De source<br />
archéologique, on sait également que la Domus tiberiana était en fait un quartier néronien, sur<br />
le site qui vit ensuite l’édification de la Domus flauia. L’ouverture du chantier de cette<br />
énorme bâtisse est datable entre 54 et 64 3 . Enfin, c’est après la destruction par un incendie<br />
d’un premier palais, la Domus transitoria, reliant le Palatin à l’Esquilin 4 , que Néron décida de<br />
faire construire sa Domus aurea 5 . Fait peu commun, Tacite en nomme les architectes,<br />
Severus et Celer 6 . Ils sont tournés vers l’innovation et la prouesse technique, illustrées par la<br />
coupole de l’Oppius ou la fameuse cenatio rotunda citée par Suétone 7 . Il n’est donc pas<br />
nécessaire de supposer une date précise pour la rédaction de Thyeste pour voir dans ces vers<br />
une allusion critique aux goûts luxueux de Néron en matière d’architecture.<br />
Enfin, le projet du percement de l’Isthme de Corinthe ne se place pas dans la<br />
continuité de la politique encouragée par Sénèque : de fait, la disgrâce du philosophe<br />
correspond à un infléchissement de la politique impériale, et l’on peut dire que le prince<br />
rompt avec son ancien précepteur et avec ses idées de manière simultanée. Ainsi, alors que<br />
Sénèque prônait la conciliation de l’empereur et des sénateurs, le percement de l’Isthme<br />
1 Y. Perrin, 2002, p. 166.<br />
2 Martial, VII, 34, 4 : Quid Nerone peius ?/ Quid thermis melius neronianis ?<br />
3 Y. Perrin, 2002, p. 193. Sur la Domus tiberiana : C. Giavarini, Il Palatino. Area sacra sud-ovest e<br />
Domus Tiberiana, Rome, 1998. M. Royo, 1994, p. 222.<br />
4 Suétone, Ner. 31 ; J. Gaillard, 1996, p. 35-36 : « La noua urbs de Néron ».<br />
5 La « maison de l’âge d’or » (J. Fabre-Serris, 1998, p. 140 sq.) suscite encore bien des controverses :<br />
Y. Perrin (« Néron, Antoine, Alexandrie. Quelques notes sur un paradoxe », dans Marc Antoine, son<br />
idéologie et sa descendance, 1993, p. 102) refuse la thèse héliaque avancée par J.-L. Voisin (1987, p.<br />
510 sq.), qui insiste également sur l’influence égyptienne (p. 519), alors qu’Y. Perrin souligne l’aspect<br />
dionysiaque du projet (p. 106 et « La Domus aurea et l’idéologie néronienne », p. 390 sq.).<br />
6 Tacite, Ann. XV, 42.<br />
7 Suétone, Ner. 31.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
375
confirme la rupture avec le Sénat : lors de l’inauguration des travaux, Néron souhaite<br />
publiquement la réussite de l’entreprise, pour lui et pour le peuple romain, et omet<br />
volontairement de mentionner le Sénat (dissimulata senatus mentione), alors que la formule<br />
consacrée, senatus populusque romanus, aurait due être employée, selon la tradition 1 . En<br />
conséquence, si la tragédie des Troyennes peut être considérée comme favorable à Néron, il<br />
semble bien que les allusions de Médée ne soient flatteuses qu’en apparence.<br />
Peu avant de recevoir l’ordre de mourir, Sénèque, interrogé sur sa participation à la<br />
conjuration de Pison, répondit qu’il n’avait pas de disposition à la flatterie (nec sibi promptum<br />
in adulationes ingenium 2 ), et que Néron le savait bien pour avoir éprouvé cette franchise. La<br />
lettre 73 à Lucilius illustre assez bien ce propos : Deux ans après que Néron a opposé un net<br />
refus à sa demande de se retirer des affaires, au motif qu’une telle retraite passerait pour un<br />
acte d’opposition 3 , Sénèque affirme qu’il est possible de maintenir, pour le philosophe, une<br />
distance qui lui permette de se consacrer à ses études. Sa liberté est garantie par la paix que<br />
maintient le régime, et dont Sénèque fait l’éloge 4 . Toutefois, il évoque le règne dans des<br />
termes très généraux, et pas un moment il ne parle de ce qui fait la spécificité du régime<br />
néronien, ce qui est une manière d’exprimer son désaccord. Il n’est donc pas question de la<br />
voix divine du prince, et la lettre contient un éloge de la philosophie, à un moment où Néron<br />
veut faire de l’art la pierre angulaire du régime, et où Tigellin tient les philosophes en grande<br />
suspicion. Cette lettre est exemplaire de la seule attitude d’opposition possible sous un tyran,<br />
1 Suétone, Ner. 37, 6.<br />
2 Tacite, Ann. XV, 61.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 52.<br />
4 Ep. 73, 6.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
376
celle qui se révèle sous la flatterie apparente 1 . Il n’est pas invraisemblable que le même<br />
procédé soit employé dans les tragédies, et en particulier dans Médée. Quoi qu’il en soit,<br />
l’étude de ces exemples montre la complexité des allusions, car les tragédies ne renvoient pas<br />
à une réalité, mais à plusieurs, et ne constituent, pas plus que les Lettres à Lucilius, un<br />
pamphlet ou une satire politique<br />
C/ Superposition des références.<br />
La question des allusions politiques dans les tragédies de Sénèque est donc bien plus<br />
complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Comme on l’a vu, elle pose le problème des<br />
relations qui peuvent s’établir entre deux univers, l’un fictif, l’autre réel. Si, dans un premier<br />
temps, on est tenté de trouver dans le traitement des mythes que propose Sénèque dans son<br />
théâtre, des correspondances avec la réalité contemporaine ou le passé proche, force est de<br />
constater qu’aucune symétrie nette ne se dégage de cette étude. Il est donc inutile de chercher<br />
dans les tragédies des clefs susceptibles d’en éclairer complètement la signification et la<br />
destination. Il n’est pas possible, en revanche, de poser la séparation des domaines, et<br />
d’envisager l’œuvre dramatique de Sénèque en dehors de son contexte. Il semble même que<br />
mythe et réalité s’interpénètrent, pour donner au mythe l’épaisseur du réel, tandis que la<br />
réalité prend la profondeur du mythe.<br />
1 E. Cizek, 1972, p. 155 : « Sénèque souhaite convaincre Néron que sa retraite ne doit pas être<br />
assimilée à une forme d’opposition. Nous subodorons, sous des flagorneries ou des promesses de<br />
soumission adressées à Néron, des propos qui laissent entendre que Sénèque ne souhaite pas se mêler<br />
à la nouvelle politique adoptée par le régime néronien. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
377
1/ De Tibère à Néron.<br />
a/ L’exil.<br />
Il convient dans un premier temps de revenir sur la tragédie de Thyeste. On a vu que<br />
cette pièce contient des allusions plus que probables à Tibère, et que la référence est rendue<br />
vraisemblable par le fait que la date de composition est postérieure, quoi qu’il en soit, à la<br />
mort de ce prince. Ainsi, les vers 37 à 40, qui évoquent les crimes que perpètrent les exilés à<br />
leur retour, peuvent renvoyer à la retraite de Tibère à Rhodes 1 . Mais le thème de l’exil prend<br />
une résonance particulière dans l’œuvre de Sénèque 2 , qui a été relégué en Corse pendant huit<br />
ans, sur ordre de Claude. Bien qu’il affiche une force d’âme de circonstance dans la<br />
Consolation à Helvie, le philosophe, on le sait, vécut douloureusement une peine qui brisait<br />
une carrière prometteuse, l’appel à la clémence du prince dans la Consolation à Polybe en<br />
témoigne.<br />
Ainsi, l’opinion commune, selon laquelle carere patria intolerabile est 3 , et que<br />
Sénèque affecte de ne pas partager, se trouve en quelque sorte illustrée par les vers 404 à 407.<br />
Thyeste, pour qui la résolution du conflit avec Atrée a pour conséquence la fin d’un long exil,<br />
exprime avec enthousiasme la joie que lui procure ce retour au pays :<br />
Optata patriae tecta et argolicas opes<br />
miserisque summum ac maximum exulibus bonum<br />
1 Voir supra, p. 354.<br />
2 A cet égard, la datation proposée par P. Grimal, pour qui la pièce a été composée pendant l’exil en<br />
Corse donne à cette évocation de l’exil une intensité plus forte, mais, comme on le verra plus loin,<br />
l’hypothèse de J. G. Fitch, 1981, qui date Thyeste entre 60 et 62, semble plus satisfaisante.<br />
3 Helu., VI, 2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
378
tractum soli natalis et patrios deos,<br />
si sunt tamen di, cerno… 1<br />
Le vers 405 en particulier, avec le chiasme, l’emploi de superlatif et les homéotéleutes,<br />
rassemble en une formule saisissante le comble du malheur qui frappe l’exilé, et le comble du<br />
bonheur que consacre son retour. Par la suite, la discussion entre Thyeste et son fils rappelle,<br />
encore une fois, les termes de la Consolation à Helvia :<br />
Modo inter illa quae putant cuncti aspera<br />
fortis fui laetusque. 2<br />
La relative quae putant cuncti aspera est, encore une fois, l’expression de l’opinion du<br />
vulgaire, dont Sénèque se démarque en affirmant à sa mère qu’il n’est pas malheureux :<br />
nunc in his quae mala uocantur nihil tam terribile ac durum inuenio quam opinio<br />
uulgi minabatur. 3<br />
Dans les vers 446 et suivants, l’argumentation de Thyeste selon laquelle on a tort de craindre<br />
la pauvreté est sensiblement la même que dans la Consolation à Helvia 1 . Certes, la<br />
1 Th. 404-407 : « Ce sont les toits de ma patrie, qui m’ont tant manqué, ce sont les richesses d’Argos et<br />
ce bien le plus précieux et le plus grand pour les malheureux exilés, le sol de ma terre natale et les<br />
dieux de mes pères, si toutefois les dieux existent, qui s’offrent à mes yeux. »<br />
2 Th. 417-18 : « Naguère, dans une situation qui semble si pénible à tous les hommes, j’ai fait preuve<br />
de courage et de gaîté. »<br />
3 Helu. V, 6 : « A présent, dans ce que l’on appelle malheur, je ne trouve rien de la situation effrayante<br />
et difficile dont l’opinion commune me menaçait. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
379
condamnation du luxe, dans les deux passages, n’est guère originale, et les motifs qu’elle<br />
emploie tiennent du lieu commun, de même que l’éloge d’une humble condition et de la<br />
quiétude qu’elle apporte fait partie des thèmes récurrents des cantica dans les tragédies de<br />
Sénèque 2 , mais il vaut la peine de souligner que, dans les deux cas, les privations qu’impose<br />
l’exil sont envisagées du point de vue de l’exilé, et que ces considérations sont le fruit d’une<br />
expérience vécue. L’apport de l’élément biographique, qui n’est pas anodin, a pour intérêt<br />
d’établir la connexion entre les différentes dimensions temporelles, et de faire entrer en ligne<br />
de compte l’époque contemporaine.<br />
b/ La question parthe.<br />
Alors, on peut examiner, dans la même tragédie, un exemple plus politique, et donc<br />
plus riche de significations, de ces différents niveaux de référence : il s’agit des vers 369 et<br />
suivants, dont on a vu qu’ils évoquaient la politique extérieure de Tibère, lorsqu’il s’employa<br />
à rétablir l’influence romaine en Arménie. Dans le dialogue qui suit, Thyeste fait encore<br />
mention des Parthes, au vers 462, comme le chœur au vers 603. Les Parthes sont donc cités<br />
trois fois dans Thyeste, ce qui constitue la fréquence la plus importante de ce terme dans le<br />
corpus des tragédies : on ne rencontre en effet le terme parthus ni dans Agamemnon, ni dans<br />
les Troyennes, ni dans Hercule Furieux, et une seule fois dans Œdipe 3 , Phèdre 4 et Médée 5 .<br />
Les occurrences plus nombreuses du terme dans Thyeste apportent un crédit supplémentaire à<br />
1 Helu. X-XII.<br />
2 Par exemple, Herc. f. 151 sq ; Phaed. 959 sq, Œd. 882 sq, etc.<br />
3 Œd. 119.<br />
4 Phaed. 816.<br />
5 Med. 710.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
380
l’hypothèse de J. G. Fitch, qui propose pour la tragédie une date de composition autour des<br />
années 60-62 1 , c’est-à-dire au moment où l’affaire parthe ressurgit dans l’actualité.<br />
En effet, Sénèque a dû faire face à la résurgence de la question parthe dès l’année 55 2 .<br />
Rome réussit à rétablir la situation sans déclencher la guerre, suivant en cela la politique<br />
initiée par Sénèque dans les premiers temps. Mais le problème se pose à nouveau en 61,<br />
deuxième étape de la guerre parthique, lorsque Vologèse fait chasser Tigrane V d’Arménie et<br />
installe son frère, Tiridate, à la place 3 . Au printemps 62, après la mort de Burrus, Sénèque se<br />
retire peu à peu de la cour et ne siège plus au conseil 4 . Pendant l’été, Néron envoie<br />
Caesennius Paetus en orient afin d’écraser l’Arménie 5 , entreprise qui se solde à la fin de<br />
l’année par une défaite romaine. Au printemps 63, Corbulon reprend la main en Arménie, et<br />
rétablit la situation sur le front oriental. Les Romains reconnaissent alors Tiridate comme roi<br />
d’Arménie et vassal de Rome 6 . C’est la fin de la guerre parthique 7 , qui constitue la principale<br />
crise de politique extérieure que connaît Néron, et ce, pendant presque toute la durée de son<br />
règne.<br />
1 J. G. Fitch, 1981.<br />
2 Tacite, Ann. XIII, 5-7.<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 23.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 52.<br />
5 Tacite, Ann. XV, 6.<br />
6 Tacite, Ann. XV, 31.<br />
7 Le couronnement de Tiridate à Rome, et que Suétone décrit comme l’un des spectacles donnés par<br />
Néron, a lieu après la mort de Sénèque, en 66.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
381
c/ La répétition tragique de l’histoire.<br />
Dès lors, l’allusion des vers 369 à 380 met en lumière une préoccupation commune de<br />
Tibère et de Néron, ce qui semble inviter à rapprocher ces deux princes. L’hypothèse,<br />
présentée comme intéressante par M.-H. Garelli-François 1 , est que la méditation sur le règne<br />
de Tibère pourrait alors nourrir la réflexion sur celui de Néron. Par cette référence aux affaires<br />
d’Arménie, Sénèque connecte en quelque sorte, dans le même temps, le mythe à l’histoire et<br />
le passé au présent, et crée les conditions de l’interprétation. Si l’on ne peut affirmer que le<br />
poète a voulu donner de sa tragédie une lecture politique contemporaine, on constate tout de<br />
même qu’il a rendu possible une telle lecture.<br />
Par exemple, dans les vers qui suivent la mention des crimes des anciens exilés, il est<br />
question de l’épouvante du frère contre le frère, invoquée par la Furie au vers 40 :<br />
fratrem expauescat frater et gnatum parens<br />
gnatusque patrem… 2<br />
Dans ses imprécations, la Furie annonce les événements funestes à venir, et appelle à une<br />
surenchère dans le crime, à une répétition amplifiée des forfaits qui ont dès l’origine marqué<br />
la maison de Tantale. Le nefas que la tragédie va voir s’accomplir prend ici sa source, et le<br />
passage remplit la fonction d’exposition qui est habituellement celle du prologue de la<br />
tragédie. Mais les termes généraux qui sont employés, puisque ce sont les liens de parenté qui<br />
sont ici mis en valeur, permettent également de songer à des crimes familiaux plus récents,<br />
qui semblent aussi constituer la malédiction de la famille impériale.<br />
1 M.-H. Garelli-François, 1994, p. 96.<br />
2 Th. 40-41 : « Que le frère épouvante le frère, le fils son père et le père son fils… »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
382
2/ Sur les traces de Caligula.<br />
Ce rapprochement peut être interprété comme un avertissement à Néron ? La lecture<br />
du De beneficiis, vient confirmer et compliquer cette hypothèse, en ajoutant une autre<br />
référence, à Caligula cette fois. C’est en effet pendant cette période de débauche que<br />
l’influence de Sénécion et d’Othon supplante celle de Sénèque et de Burrus, et que commence<br />
la liaison du prince avec Poppée. Les changements dans l’entourage du prince correspondent<br />
également à un durcissement du régime, et à la mise à l’écart progressive mais irrémédiable<br />
de Sénèque. En 58, les attaques de Suillius contre Sénèque 1 affaiblissent encore sa position.<br />
La mort d’Agrippine en 59 constitue aussi une grave crise qui participe à la décision de<br />
Sénèque de se retirer de la vie politique. En 59 cependant, Sénèque a encore son franc parler,<br />
et peut se permettre des remontrances au prince, comme en témoigne ce mot du philosophe,<br />
lui rappelant qu’il ne pourra pas tuer son successeur 2 .<br />
L’hypothèse selon laquelle les critiques contre Caligula, dans le De beneficiis, sont<br />
une mise en garde adressée à Néron qui se laisse aller à ses dérives tyranniques a été soutenue<br />
de façon convaincante par F. R. Chaumartin 3 . Le traité apparaît en effet comme le vecteur des<br />
désillusions de Sénèque face à l’évolution de son ancien élève, alors qu’une opposition plus<br />
radicale et plus spécifiquement politique s’est développée dans les milieux stoïciens contre le<br />
principat à partir de 60 4 . Or, on a vu que le portrait de l’homme en colère du De ira renvoie à<br />
Caligula et que la condamnation de cette passion en politique nourrit la réflexion sur le règne<br />
de ce prince maudit par Sénèque, qui en fait à maintes reprises le paradigme du tyran, et dont<br />
1 Tacite, Ann. XIII, 42-43.<br />
2 Dion Cassius, 61, 18, 3.<br />
3 F.-R. Chaumartin, 1985.<br />
4 T. Adam, 1970, p. 70.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
383
on retrouve, dans Thyeste, les traits caractéristiques 1 . La mise en relation d’un certain nombre<br />
d’éléments laisse à penser que les références à Caligula, comme à Tibère, constituent une<br />
sorte de passerelle par laquelle le personnage mythologique est connecté (mais non identifié)<br />
à Néron.<br />
Dans le De beneficiis, en effet, les mentions de Caligula peuvent être interprétées<br />
comme une critique indirecte à ce que Néron est en train de devenir 2 . Dans un passage crucial<br />
du traité 3 , Sénèque pose la question de l’ingratitude face au tyran. Il cite alors des exemples<br />
traditionnels, Apollodore et Phalaris. Mais l’évocation sanglante des exactions du tyran,<br />
manifestations de sa cruauté maladive, rappelle un passage du livre IV dans lequel il était<br />
question de Caligula, maître du monde, et avide du sang qu’il faisait ruisseler devant lui<br />
comme pour étancher sa soif 4 , et c’est, en particulier, la métaphore de l’anthropophagie, qui<br />
met le prince au rang de la bête sauvage, qui permet ce rapprochement :<br />
Si uero sanguine humano non tantum gaudet et pascitur, sed et suppliciis omnium<br />
aetatum crudelitatem insatiabilem exercet, nec ira, sed auiditate quadam saeuiendi<br />
furit ; si in ore parentum filios iugulat(…) parum est huic beneficium non reddere. 5<br />
1 Voir supra, p. 346 sq.<br />
2 F.-R. Chaumartin, 1985, p. 164.<br />
3 Ben. VII, 19, 5 – 20, 3.<br />
4 Ben. IV, 31, 2 : Quare Caium Caesarem orbi terrarum praefecit, hominem humani sanguinis<br />
auidissimum, quem non aliter fluere in conspectu suo iubebat, quam si ore excepturus esset ?<br />
5 Ben. VII, 19, 8 : « Mais si non seulement il se réjouit de verser le sang humain mais qu’il s’en repaît,<br />
s’il laisse aller son insatiable cruauté à supplicier tous les âges, si ce n’est plus la colère, mais comme<br />
une obsession de la répression qui le met en fureur (…), c’est trop peu de ne pas lui rendre un<br />
bienfait. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
384
La rage meurtrière, l’assassinat des enfants devant leurs parents, l’évocation, dans le reste de<br />
l’énumération, de leur cuisson éventuelle (perituros… excoquit), est conforme à l’image de<br />
Caligula telle qu’elle apparaît dans les autres dialogues, mais aussi telle qu’on l’a reconnue<br />
dans le personnage d’Atrée composé par Sénèque.<br />
Le philosophe justifie ainsi l’annulation des bienfaits du tyran par sa conduite cruelle,<br />
en apportant toutefois à sa démonstration une restriction en forme d’autojustification : le<br />
bienfait reste justifié, s’il ne doit pas contribuer à l’œuvre de destruction générale que le tyran<br />
entreprend 1 . Une série d’exemples vient corroborer ce point de vue, dans lesquels on<br />
reconnaît Caligula, mais aussi Néron :<br />
Si pro magno petet munere artifices scenae, et scorta, et quae feritatem eius emolliant,<br />
libens offeram. Cui triremes et aeratas non mitterem, lusorias et cubiculatas, et alia<br />
ludibria regum in mari lasciuientium mittam. 2<br />
Les artifices scaenae et les scorta, que Caligula affectionnait également, font penser à ces<br />
« plaisirs licites », que Sénèque et Burrus favorisaient au début du règne de Néron, afin de<br />
conserver sur le jeune prince une influence suffisante pour le guider dans des choix politiques<br />
plus cruciaux, au début du règne 3 . En particulier, les deux proches conseillers de Néron<br />
n’opposèrent pas d’obstacle, contrairement à Agrippine, à ses amours avec Acté 4 .<br />
1 Ben. VII, 20, 1 : id autem erit, quod illi reddi sine pernicie publica possit, reddam.<br />
2 Ben. VII, 20, 3 : «S’il me demande comme un grand service de lui procurer des artistes de scène et<br />
des filles, et d’autres plaisirs susceptibles d’adoucir sa férocité, je les lui fournirai bien volontiers. Je<br />
ne lui enverrai ni trirèmes ni navires de combat, je lui enverrai des bateaux de plaisance et des<br />
gondoles, et d’autres babioles qui servent aux amusements des rois sur la mer. »<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 2.<br />
4 Ben. XIII, 12.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
385
Les navires de plaisance semblent référer davantage aux loisirs de Caligula, qui s’était<br />
fait construire de somptueux bateaux, à l’imitation des souverains Lagides 1 , et dont on a peut-<br />
être retrouvé les restes au fond du lac de Némi (et non le long du golfe de Naples où Suétone<br />
situe les activités plaisancières du prince) au début du XX e siècle 2 . Mais on peut trouver ici<br />
une illustration des témoignages de Suétone et de Dion Cassius, selon lesquels Néron,<br />
lorsqu’il s’est affranchi de l’influence de Sénèque, a suivi l’exemple de Caligula 3 . Tacite<br />
décrit en effet un festin somptueux sur une sorte de pont de bateaux 4 . L’étang d’Agrippa est le<br />
cadre de ces festivités au cours desquelles, à en croire les historiens, Néron se livra à des<br />
débauches raffinées, entraînant avec lui, sans distinctions, illustres matrones et viles<br />
courtisanes.<br />
C’est Tigellin, dont l’influence néfaste prend le pas sur celle de Sénèque, qui est<br />
l’ordonnateur de ces festivités, dont la magnificence s’étend jusqu’aux navires, couverts d’or<br />
et d’ivoire. La dissolution de l’ordre social, manifestée par la présence de respectables<br />
Romaines dans des lupanars, et le comportement obscène de Néron qui va jusqu’à épouser un<br />
dénommé Pythagore et à revêtir le voile de la jeune mariée, sont tout à fait significatifs de la<br />
dimension tyrannique que prend le règne du prince, et que Tigellin, souvent présenté comme<br />
un anti-Sénèque, encourage. Certaines similitudes dans le comportement de Néron et de<br />
1 Suétone, Cal. 37.<br />
2 D. N. Carlson, D. Lacus, U. Ucelli, « Caligula’s Floating Palaces », Archaeology 55.3, Mai-Juin<br />
2002, p. 26-31.<br />
3 Suétone, Ner. 30 et Dion Cassius, 61, 5, 1. L’anecdote du rêve de Sénèque qui se voit devenir le<br />
précepteur de Caligula (Suétone, Ner. 7), est comme une confirmation par anticipation de cette<br />
évolution de Néron.<br />
4 Tacite, Ann. XV, 33. Cf. Dion Cassius, 62, 15. Cette fête scandaleuse précède de peu, chez ces deux<br />
auteurs, l’incendie de Rome, et est par conséquent vraisemblablement postérieure à la rédaction du De<br />
beneficiis si l’on admet l’hypothèse de F. R. Chaumartin. Il n’en demeure pas moins que l’influence de<br />
Caligula, si elle devient manifeste à cette occasion, a dû se faire sentir au cours des années<br />
précédentes.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
386
Caligula confirment donc une évolution du premier dans le sens d’une tyrannie débridée, et<br />
dont le second se fait pour ainsi dire le modèle le plus proche dans le temps.<br />
Le traité reprend, au sujet de la tyrannie, un avertissement que Sénèque avait adressé à<br />
Néron au début de son règne, dans le De clementia précisément : un souverain qui ne pratique<br />
pas la clémence, et qui de ce fait se mue en un tyran cruel, s’expose à la révolte de ses sujets<br />
et met son pouvoir en grand danger d’être renversé 1 . Dans le livre VI du De beneficiis, la<br />
réflexion se fait plus personnelle et résonne avec les douloureux accents de l’actualité. Les<br />
puissants courent à la catastrophe, car leurs conseillers ne remplissent plus leur tâche. La<br />
vérité leur devient dès lors inaccessible, et ils oscillent entre la crainte de complots<br />
imaginaires et l’ignorance des véritables dangers 2 . Au moment où Sénèque a perdu auprès de<br />
Néron tout crédit, et où l’entourage du prince se compose de Tigellin et des partisans de<br />
Poppée, l’issue paraît inévitable, et le conseiller déchu annonce avec assez de clairvoyance le<br />
désastre qui conclura le règne :<br />
Ingentia super se ac suos regna fregerunt, nec intellexerunt, in illa scena, et uanis et<br />
cito diffluentibus bonis refulgente, ex eo tempore ipsos nihil non aduersi exspectare<br />
debuisse, ex quo nihil ueri audire potuerunt. 3<br />
L’amertume que l’on peut percevoir dans ces lignes est proche de celle du courtisan d’Atrée,<br />
qui après avoir vainement tenté de rappeler à son souverain à la raison et à ses devoirs. La<br />
1 Clem. I, 11, 4.<br />
2 Ben. VI, 30.<br />
3 Ben. VI, 30, 6 : « Ils font craquer sur leur tête et celle des leurs de gigantesques empires, et ils ne<br />
comprennent pas, sur cette scène qui resplendit de l’éclat trompeur de biens vite évanouis, que le<br />
moment où ils n’ont dû s’attendre qu’à des malheurs est précisément celui où ils devinrent incapables<br />
d’entendre la moindre vérité. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
387
dernière phrase du courtisan sur la crainte et la fidélité résonne alors comme un écho<br />
désespéré 1 .<br />
1 Th. 334-335 : Haud sum monendus : ista nostro in pectore<br />
fides timorque, sed magis claudet fides.<br />
« Cet ordre est inutile : tes projets resteront enfermés dans mon cœur par ma crainte et ma fidélité,<br />
mais surtout par ma fidélité. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
388
Chapitre 9. Personam induisti, agenda est 1 : les tragédies à<br />
l’épreuve du pouvoir.<br />
Occultae musicae nullum esse respectum 2 . Ce proverbe, que Néron aimait répéter à<br />
son entourage pour justifier son désir de chanter en public, rappelle que le chant et la poésie,<br />
comme tout discours, ne sauraient prendre sens en dehors de leurs conditions de réception.<br />
Les tragédies de Sénèque, fortement ancrées dans la réalité romaine contemporaine, ne<br />
dérogent pas à ce principe, et doivent donc être envisagées dans leur rapport à un public. La<br />
destination du théâtre est en effet d’être joué, même si Aristote souligne que la lecture seule<br />
d’une tragédie permet d’en faire sentir les qualités 3 . On ne possède aucun témoignage<br />
permettant d’affirmer que ces pièces, ou au moins certaines d’entre elles, ont été portées à la<br />
scène. Du reste, on ne sait presque rien de la réception des tragédies de Sénèque à l’époque de<br />
Néron. La question doit cependant être examinée, car la fréquence des références romaines, et<br />
la possibilité de voir dans certains passages des tragédies des allusions à Néron, plaide pour<br />
une lecture politique de l’œuvre dramatique de Sénèque.<br />
Le théâtre de Sénèque a-t-il donné lieu à des représentations, et de quelle nature ? La<br />
critique n’apporte à cette question aucune réponse définitive, faute d’éléments déterminants et<br />
de témoignages assurés. Le débat est rendu plus complexe par son double enjeu, historique et<br />
1 Ben. II, 7, 2.<br />
2 Suétone, Ner. 20.<br />
3 Aristote, Poet. 1462 a 10-12.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
389
esthétique, car il porte forcément sur l’intérêt dramatique de ces pièces, longtemps contesté 1 .<br />
En effet, une première orientation consiste à souligner les défauts de composition comme le<br />
manque de continuité spatiale entre les scènes 2 , l’absence d’une vision cohérente de l’action 3 ,<br />
la longueur et le caractère rhétorique des monologues 4 , pour montrer que les tragédies sont<br />
avant tout des textes écrits, destinés à la déclamation dans le cadre de recitationes, et non au<br />
jeu 5 .<br />
Cependant, si nos sources ne nous livrent aucune information sur la représentation de<br />
ces pièces, elles n’en livrent pas plus sur des lectures publiques. De plus, on sait que des<br />
tragédies contemporaines ont fait l’objet de représentations dans des théâtres sous le règne de<br />
Claude 6 , et que cette pratique n’était donc pas tombée en désuétude. Les qualités dramatiques<br />
des tragédies de Sénèque ont en outre fait l’objet de plusieurs études 7 , montrant par exemple<br />
l’existence d’indications scéniques dans les pièces 8 , le respect des conventions théâtrales 9 et<br />
même la nécessaire prise en compte de la mise en scène 10 . Mais que les tragédies soient<br />
susceptibles d’être représentées ne répond que très partiellement à la question de leur<br />
1 Ainsi, G. Boissier, 1861b, p. 13, dénie tout intérêt dramatique au théâtre de Sénèque. On trouve un<br />
état des recherches récentes dans l’étude de J.G. Fitch, 2001, p. 1 sq.<br />
2 Voir par exemple, le commentaire d’E. Fantham du vers 203 des Troyennes, p. 240.<br />
3 R. J. Tarrant (éd.), Seneca, Agamemnon, Cambridge, 1976, aux vers 778 et suiv.<br />
4 Par exemple, G. Bonelli, 1978.<br />
5 W. Beare, 1964, p. 235 ; O. Zwierlein, 1966.<br />
6 Tacite, Ann. XI, 13 : il s’agit d’une pièce de Pomponius Secundus, contemporain de Sénèque.<br />
7 M.-H. Garelli-François, 1998b.<br />
8 J. G. Fitch, 1987, à propos des vers 515, 915-917 et 1018 d’Hercule Furieux par exemple.<br />
9 J. G. Fitch, 1987, p. 351-352, montre que la scène du meurtre de Mégare et des enfants, mais aussi<br />
l’acte tout entier (v. 895-1053) sont écrits dans le but de concilier contraintes scéniques et effet<br />
pathétique. G. Viansino, 1993, dans son édition des tragédies, souligne à plusieurs reprises les qualités<br />
de dramaturge de Sénèque, ainsi que le dynamisme et la force visuelle des scènes : p. 117 à propos de<br />
l’acte III, v. 895-1053, et p. 120 sur la dern ière scène.<br />
10 P. Grimal, 1983.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
390
éception. Il n’est pas sûr, loin de là, que toutes aient connu le même mode de diffusion. Il<br />
reste que, quelle que soit l’hypothèse que l’on envisage, représentation, recitatio à une ou<br />
plusieurs voix, c’est Néron qui apparaît comme le destinataire principal des tragédies de<br />
Sénèque.<br />
I/ Néron, destinataire privilégié des tragédies.<br />
A/ Néron spectateur.<br />
Les tragédies s’adressent tout d’abord à un spectateur particulier et privilégié : Néron<br />
est en effet l’ami de leur auteur, et ses activités poétiques, comme sa politique de promotion<br />
des arts, font de lui un interlocuteur incontournable. Les tragédies ont donc dû lui être<br />
présentées, sous la forme de recitationes ou de spectacle scénique.<br />
1/ Le prince mécène.<br />
Sénèque fait longtemps partie de l’entourage proche d’un prince qui encourage<br />
l’activité littéraire dans le cadre de l’amicitia dont il gratifie les auteurs. Renouant avec<br />
l’entreprise d’Auguste, que Tibère, Caligula et Claude avaient négligée avant lui, Néron se<br />
place ainsi sous la tutelle d’Apollon dont il entend être sur terre la vivante image. L’éloge de<br />
Néron dans le premier livre de la Pharsale de Lucain associe le prince à la divinité qui inspire<br />
les poètes :<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
391
Sed mihi iam numen, nec, si te pectore uates<br />
accipio, Cirrhaea uelim secreta mouentem<br />
sollicitare deum Bacchumque auertere Nysa :<br />
tu satis ad uires Romana in carmina dandas 1 .<br />
Néron est assimilé à Apollon, dieu citharède et source d’inspiration des poètes, et les flatteries<br />
des auteurs contemporains s’en font largement l’écho, de Calpurnius Siculus à Sénèque 2 . Ce<br />
modèle est notamment exhibé par la citharédie, spécialité à laquelle l’empereur-artiste se<br />
consacre, et cette association est complétée par la politique de promotion littéraire dans le<br />
cadre de la cour impériale 3 . De hauts personnages proches de l’empereur, tels Sénèque ou<br />
Calpurnius Pison, protègent les poètes et encouragent leur activité 4 . L’avancée du règne voit<br />
se confirmer cette tendance, mais Néron concentre entre ses mains l’activité de mécénat<br />
littéraire et se veut le centre du renouveau qui s’installe 5 . Il manifeste un intérêt particulier<br />
pour la poésie épique, la tragédie, mais aussi la philosophie, et s’entoure d’intellectuels qu’il<br />
réunit au cours de dîners dont Tacite se fait l’écho 6 .<br />
L’originalité du patronage littéraire de Néron consiste principalement dans son activité<br />
d’auteur : dans l’Apocoloquintose et dans les Questions naturelles, Sénèque fait l’éloge des<br />
1 Lucain, B. C. I, 63-66 : « Mais tu es déjà un dieu pour moi, et si je te reçois dans mon cœur et<br />
deviens ton prophète, je n’aurai nulle envie d’invoquer le dieu qui préside aux secrets de Cirrha, ni de<br />
détourner Bacchus de Nysa ». Voir P. Grimal, 1960.<br />
2 Calpurnius Siculus, Eglogues, 4, 70-72 ; 87-91 ; 158-159 etc ; Sénèque, Apoc. 4, 20-32.<br />
3 Les témoignages de cette association du prince à Apollon sont nombreux : on en trouve l’attestation<br />
par les auteurs (Calpurnius Siculus, Eglogues, 4, 70-72 ; 87-91, 158-159 ; Bucoliques d’Einsiedeln, 1,<br />
22-37 ; 2, 38 ; Apoc. 4, 20-32), et par les monnaies (Smallwood, 1967, 144-145).<br />
4 Juvénal, V, 109.<br />
5 M. Morford, 1985.<br />
6 Tacite, Ann. XIV, 16.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
392
poésies de son élève 1 . Le prince se pose alors comme le modèle et l’inspirateur de toute<br />
production artistique, dépassant et radicalisant ainsi le projet entrepris avant lui par Auguste.<br />
Cet aspect de la politique de Néron prend une importance de plus en plus grande au fur et à<br />
mesure de l’avancée du règne : Néron se défait des membres de son entourage qui pouvaient<br />
faire obstacle à ses desseins 2 , et s’affirme toujours davantage comme un artiste à part entière,<br />
dont le rayonnement doit s’étendre au-delà des limites de l’Urbs. Les échanges avec les<br />
auteurs se compliquent dès lors, parfois, d’une certaine rivalité, comme le montre l’exemple<br />
de Lucain, compromis dans la conjuration de Pison, et dont la brouille avec le prince avait<br />
peut-être pour origine la jalousie de celui-ci 3 .<br />
Il semble donc que sous le règne de Néron, toute activité artistique et créatrice le<br />
rencontre nécessairement : l’importance dévolue aux spectacles, l’activité littéraire<br />
personnelle de l’empereur et sa politique de mécénat font de lui le destinataire incontournable<br />
des œuvres composées par les membres de l’aristocratie qui constituent son entourage.<br />
Jusqu’à sa retraite, Sénèque, qui se trouve au cœur du pouvoir par ses fonctions et sa relation<br />
avec Néron, a très certainement participé à cette politique, en accordant sa protection et ses<br />
encouragement à des auteurs qui, par son intermédiaire, finissaient par s’adresser au prince,<br />
mais aussi en prenant lui-même part à la dynamique de création qui marqua son époque.<br />
1 Suétone, Cal. 53.<br />
2 Notamment sa mère : Tacite, Ann. XIV, 13.<br />
3 Tacite, Ann. XV, 49 ; Dion Cassius, 62, 29, 4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
393
2/ Littérature et politique.<br />
Sénèque lui-même doit en partie l’évolution de sa carrière à ses qualités d’auteur :<br />
alors que son talent l’avait mis en danger sous Caligula 1 , c’est une des raisons pour lesquelles<br />
Agrippine l’a fait rappeler 2 . Proche du prince, qui est à la fois son élève et son protecteur, il a<br />
participé au renouveau littéraire du règne, tant par ses écrits que par son patronage : Tacite<br />
signale ainsi que l’historien Fabius Rusticus, qui constitue l’une de ses sources pour la<br />
période du règne de Néron, a bénéficié de l’amitié de Sénèque, ce qui explique ses<br />
témoignages favorables au sujet du philosophe 3 . Lucilius, destinataire des Lettres, fait partie<br />
de ses protégés : Sénèque le conseille pour la rédaction d’un poème 4 , cite ses vers pour<br />
illustrer les échanges de la poésie et de la philosophie 5 , et rédige même la lettre 46 pour<br />
favoriser la publicité d’un ouvrage de son ami 6 . Enfin, son neveu Lucain connut très tôt la<br />
faveur impériale, depuis les Neronia de 60 où il récita un éloge en vers du prince, qui lui valut<br />
une récompense 7 .<br />
Dans le système de Néron, politique et littérature ne sont pas dissociables, à tel point<br />
qu’on a avancé l’hypothèse d’une opposition littéraire au règne du prince 8 . La volonté<br />
affichée de donner aux arts une nouvelle vitalité, grâce à l’inspiration d’un prince présentant<br />
avec Apollon plus d’une affinité, est au cœur du programme politique que l’on a par la suite<br />
1 Suétone, Cal. 53 ; Dion Cassius, 59, 19, 7.<br />
2 Tacite, Ann. XII, 8 : At Agrippina, (…), ueniam exsilii pro Annaeo Seneca, simul praeturam impetrat,<br />
laetum in publicum rata ob claritudinem studiorum eius…<br />
3 Tacite, Ann. XIII, 20.<br />
4 Ep. 79, 5-7.<br />
5 Ep. 8, 10.<br />
6 Ce type de promotion fait partie des devoirs de l’amitié que Sénèque rend à Lucilius : I. Hadot, 1969,<br />
p. 170.<br />
7 M. T. Griffin, 2002, p. 185.<br />
8 E. Cizek, 1972, p. 415. Cette théorie est contestée notamment par M.T. Griffin, 2002, p. 182.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
394
appelé néronisme. C’est pourquoi, même si la vie intellectuelle pouvait continuer à se<br />
développer indépendamment de Néron, autour d’aristocrates influents, la position de Sénèque<br />
demeure singulière : il n’est pas seulement un aristocrate riche et puissant, dont le talent et le<br />
crédit peuvent contribuer à former autour de lui un cercle d’auteurs. L’intimité qui existe<br />
nécessairement entre lui et Néron, et la part qu’il a prise à la formation de son goût et à son<br />
éducation, donnent aux échanges littéraires du prince et de son ancien précepteur un caractère<br />
d’évidence. En outre, compte tenu de la passion de l’empereur pour le théâtre, ne pas lui<br />
présenter ses tragédies, au moins celles qui datent d’avant la retraite, aurait été un véritable<br />
affront politique en même temps qu’un désaveu artistique. Enfin, les tragédies ont Néron<br />
comme destinataire privilégié parce qu’il est le référent politique dans la vie réelle, la figure<br />
du pouvoir hors scène, et qu’il y a une parenté de fait entre l’empereur et les rois des<br />
tragédies, une nature proche.<br />
B/ Le témoignage de la familiarité de Sénèque et Néron.<br />
C’est dans ce contexte que les tragédies ont dû parvenir à la connaissance de Néron,<br />
qui appréciait le genre, au point de faire de la tragédie chantée la seconde de ses spécialités<br />
artistiques, et de s’être essayé à la composition d’un Attis ou de Bacchantes. Outre le fait que<br />
les rôles tragiques qui auraient inspiré les prestations du prince sont souvent les sujets des<br />
tragédies, on trouve dans le théâtre de Sénèque plusieurs éléments qui répondent à ce que<br />
nous savons de ses préférences artistiques 1 .<br />
1 Un autre exemple d’œuvre de Sénèque répondant aux goûts de Néron peut être trouvé dans<br />
l’Apocoloquintose, rédigée peu après la mort de Claude, à la fin de l’année 54. Ce poème satirique, qui<br />
constitue le pendant de la laudatio du défunt, prononcée au cours des cérémonies de l’apothéose,<br />
ridiculise Claude et fait l’éloge de Néron. Les promesses du nouveau règne y sont exprimées dans les<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
395
1/ L’exemple du thème troyen.<br />
Ainsi, le thème troyen, qui suscitait l’enthousiasme impérial, inspire le théâtre de<br />
Sénèque : Les Troyennes, qui ont pour thème les derniers soubresauts de la défaite de Troie,<br />
contiennent au moins deux allusions qui peuvent renvoyer favorablement à Néron 1 et aux<br />
espoirs que suscitèrent son avènement et les premières années de son règne. Agamemnon,<br />
avec son chœur de Troyennes, fait une place importante à cette guerre, dont l’issue permet le<br />
retour du roi.<br />
Dans cette tragédie, deux passages ont pour thème la guerre de Troie : l’acte III, lieu<br />
où d’ordinaire dans la tragédie se noue le conflit, est largement occupé par le héraut Eurybate,<br />
qui se livre à un long récit du retour mouvementé des vaisseaux grecs 2 , au cours duquel les<br />
principaux épisodes de la guerre de Troie sont rappelés et ses héros cités 3 . Les thèmes épiques<br />
de la tempête, et de la mort d’Ajax, inspirés de l’Odyssée 4 , sont longuement développés,<br />
jusqu’à la mort du héros qui résulte de son défi au dieu 5 . Le récit de la tempête s’achève avec<br />
la vengeance de Nauplius, dont Néron a chanté les malheurs 6 , et qui constitue le dernier<br />
pallier des dangers qui frappent la flotte 7 .<br />
termes de la symbolique apollinienne qui avait déjà la faveur du jeune prince. Au-delà de la fonction<br />
politique du pamphlet, qui a dû donner lieu à des lectures dans un cadre privé, le style du ludus, avec<br />
ses attaques brutes et sa ridiculisation violente, est aussi du goût de Néron, qui s’est livré lui aussi à<br />
des plaisanteries sur l’élévation de Claude (Suétone, Ner. 33), et est lui-même l’auteur de vers légers :<br />
voir supra, p. 166 sq.<br />
1 Voir supra, p. 355 sq.<br />
2 Ag. 421-578. Cf M.-H. Garelli-François, 1998b, p. 15-32.<br />
3 Ag. 446-448 et 512-514.<br />
4 Od. , IV, 492-513.<br />
5 Ag. 528-556.<br />
6 Suétone, Ner. 39, 3 ; Lucilius, Anth. Gr. 11, 185.<br />
7 Ag. 557-576.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
396
Le canticum suivant est l’occasion pour les captives troyennes de rappeller la chute de<br />
Troie, causée par une ruse honteuse 1 . Dans l’ensemble de la tragédie, le destin d’Agamemnon<br />
est explicitement présenté comme la conséquence de ce désastre : la ville de Priam et Argos<br />
font l’objet de deux chants du chœurs qui se répondent en symétrie, le glorieux passé d’Argos<br />
contrastant avec la fin lamentable de Troie 2 . Lorsque Cassandre est saisie d’un délire<br />
prophétique, entre ces deux passages lyriques, ses visions mêlent le passé et l’avenir : à<br />
l’évocation de Pâris, fatalis arbiter, succède celle d’Egisthe, et tous deux sont cause de la<br />
ruine d’une maison royale 3 . Après l’annonce du meurtre d’Agamemnon, la prophétesse<br />
répond à l’appel des ombres, préfigurant ainsi sa propre mort : Priam, Hector, Troïlus et<br />
Déiphobe, ainsi que tous les morts Phrygiens sont appelés à contempler la ruine de Mycènes,<br />
et la vision s’achève sur les deux fondateurs des cités ennemies, Tantale et Dardanus, dont<br />
l’attitude contrastée annonce le dénouement de la tragédie 4 . Le destin du roi, présenté dans le<br />
prologue comme un épisode de la malédiction des Atrides, est de ce fait inscrit dans une<br />
logique d’hérédité et de surenchère, par l’apparition inaugurale de l’ombre de Thyeste 5 . Il est<br />
ensuite rapidement interprété comme la conséquence de la guerre de Troie : dès la scène qui<br />
la confronte à sa nourrice 6 , la reine rappelle ses griefs, le sacrifice d’Iphigénie 7 , le départ du<br />
roi 8 , son attitude impie 9 et sa passion pour une captive 10 . Cassandre exprime cette idée avant<br />
1 Ag. 610-658.<br />
2 Ag. 610-658 et 808-859.<br />
3 Ag. 730-733.<br />
4 Defessus senex, Ag. 769, et pater Dardanus, v. 774.<br />
5 Ag. 1-56.<br />
6 Ag. 108-225.<br />
7 Ag. 159 et 162-163.<br />
8 Decem per annos uidua respiciam uirum ? (Ag. 156) : « pendant dix ans laissée pour veuve, je<br />
devrais respecter mon mari ? »<br />
9 Ag. 174-188.<br />
10 Ag. 188-191.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
397
de mourir, dans les termes d’une vengeance triomphale : iam iam iuuat uixisse post Troiam,<br />
iuuat 1 . Le dénouement de la tragédie renverse ainsi le rapport du vainqueur au vaincu, pour la<br />
satisfaction des morts Prhygiens invités à se repaître du spectacle. Une telle lecture du mythe<br />
est en accord avec l’utilisation par la propagande impériale, depuis Auguste, du motif troyen.<br />
Finalement, la vengeance de Troie, au-delà de la défaite, préfigure sa renaissance par la<br />
fondation de Rome, et la grandeur des Enéades.<br />
2/ Une sensibilité commune.<br />
Sénèque a donc, dans ses tragédies, largement traité le thème troyen qui était en faveur<br />
à la cour de Néron, et les allusions qui renvoient vraisemblablement au prince dans les<br />
Troyennes confirment cette orientation. Par ailleurs, les rôles que l’empereur aimait à jouer<br />
sont aussi, bien souvent, les sujets des tragédies. Sur la douzaine de personnages que<br />
mentionnent nos sources, trois sont les personnages principaux de pièces de Sénèque :<br />
Thyeste, Œdipe et Hercule 2 . Antigone apparaît dans les Phéniciennes 3 , et Créon dans Œdipe 4 .<br />
On peut donc remarquer, dans un premier temps, que les mêmes personnages inspiraient<br />
l’écriture du ministre et les prestations artistiques du prince, ce qui témoigne au moins d’une<br />
sensibilité commune à certaines légendes mises en œuvre dans les tragédies.<br />
Cette inspiration, et la destination des tragédies peuvent en outre éclairer la question<br />
de la composition des pièces de Sénèque et de leur représentation. Il semble en effet que<br />
1 Ag. 1011 : « Maintenant je suis heureuse d’avoir survécu à Troie, oui, je m’en réjouis. »<br />
2 Thyeste : Dion Cassius, 63, 9, 4 ; 63, 22, 6 ; Juvénal, VIII, 228. Hercule : Suétone, Ner. 21, 3 ; Dion<br />
Cassius, 63, 9, 4. Œdipe : Philostrate, Vit. Apoll. 5, 7 ; Suétone, Ner. 21, 3 et 46, 3 ; Dion Cassius, 63,<br />
9, 4 et 63, 22, 6.<br />
3 Juvénal, VIII, 220.<br />
4 Philostrate, Vit. Apoll. 5, 7.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
398
l’évolution du genre tragique, perceptible dans l’œuvre de Sénèque, puisse s’expliquer<br />
justement par l’influence de Néron et sa pratique artistique. Si la cohérence dramatique des<br />
tragédies a pu être montrée par différentes études, que nous avons rappelées précédemment, il<br />
n’en demeure pas moins que certains passages tendent à se détacher de l’ensemble, en raison<br />
de leur longueur et de leur relative autonomie dans l’économie des pièces. Ainsi, l’hymne<br />
nuptial de Médée, ou le prologue d’Hercule Furieux, par exemple, constituent par leur<br />
développement particulier des innovations que la progression de l’action ne suffit pas à<br />
justifier 1 . L’interprétation selon laquelle l’influence de la rhétorique contribuerait à la<br />
composition de mouvements autonomes à l’intérieur des tragédies, dans la lignée des<br />
observations de F. Leo 2 , tend à nier au théâtre de Sénèque ses qualités dramatiques, et à le<br />
présenter comme une forme littéraire dont la dimension spectaculaire serait affaiblie. Or, de<br />
nombreuses études ont mis en lumière le caractère dramatique de ces pièces, qui se prêtent<br />
aisément à la représentation. La contradiction que soulèvent ces deux lectures ne paraît<br />
toutefois pas irréductible, et l’unité et la longueur de certains passages des tragédies ne<br />
signifient pas pour autant leur déconnection de la pratique spectaculaire. L’hypothèse d’un<br />
théâtre destiné aux recitationes, ou la caractérisation de « maniérisme post-classique » 3 ,<br />
participent de cette tendance, et ne peuvent résoudre la contradiction qu’en apparence.<br />
La composition des tragédies, comme les thèmes choisis et leur traitement, trouve<br />
peut-être sa clef dans leur destination. On se rappelle en effet que Néron pratiquait de<br />
préférence la citharédie ou la tragédie chantée, dont le répertoire emprunte au genre tragique,<br />
et en particulier aux monologues et parties lyriques. La longueur et l’unité de certains<br />
passages des pièces de Sénèque les rapprochent de ce que nous pouvons supposer des normes<br />
de la citharédie, et si la tragédie tend à présenter de larges mouvements qui peuvent être<br />
1 C. D. N. Costa, 2000.<br />
2 F. Leo, 1878, p. 158 : Istae uero non sunt tragoediae, sed declamationes (…) in actus deductae.<br />
3 G. Viansino, 1993, p. 35 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
399
autonomes, il n’est pas impensable d’y voir la marque des goûts du prince, dont l’influence<br />
sur la production littéraire de son entourage ne fait pas de doute. Si les tragédies ne peuvent<br />
être réduites à une succession de morceaux de bravoure sans unité structurelle, elles n’en<br />
témoignent pas moins d’une évolution du genre à laquelle Néron n’est pas étranger 1 . Alors,<br />
les accusations des détracteurs de Sénèque, selon lesquels l’activité poétique du philosophe<br />
aurait été stimulée par les goûts du prince, prendraient une tout autre signification, puisqu’il<br />
s’agit de véritable influence littéraire et non de simple flagornerie.<br />
Dès lors, les allusions à Néron que les tragédies peuvent contenir ne constituent plus<br />
un obstacle à la réception du théâtre de Sénèque par son ancien élève, mais un élément de<br />
l’échange qui se produit entre un prince acteur et un ministre poète. Néron, en effet, jouait<br />
Oreste matricide et Hercule furieux en portant des masques qui reproduisaient ses propres<br />
traits. Il devait donc bien faire le lien entre lui-même et les héros tragiques de Sénèque 2 . On<br />
1 Il est possible d’examiner dans cette perspective le cas particulier des Phéniciennes, pièce lacunaire,<br />
inachevée ou expérimentale, dans laquelle les longs monologues sont prépondérants. Th. Hirschberg<br />
(1989, p. 4-5) présente les points de vue prédominants : une suite de fragments, une tragédie<br />
incomplète ou encore une œuvre destinée à la lecture, ce qui expliquerait sa brièveté, et l’absence de<br />
prologue et de chœur. Dans l’introduction de son édition des Phéniciennes, M. Frank, 1995, émet<br />
l’hypothèse d’une forme expérimentale et nouvelle.<br />
2 Sénèque a-t-il écrit pour l’artiste Néron ? Nous ne possédons sur ce sujet aucun témoignage précis,<br />
mais les sources sont rares sur les tragédies de Sénèque en général. On sait toutefois que Néron a dû<br />
pratiquer la tragédie chantée. Or les pièces de Sénèque, avec leurs longs monologues lyriques, se<br />
prêtent assez bien à ce type de spectacle. De plus, les rôles de Néron cités par nos sources sont aussi<br />
bien souvent des sujets de tragédies de Sénèque : les rôles d’Oreste, Œdipe et Hercule sont même<br />
joués personatus, c’est-à-dire avec le masque tragique. Juvénal et Dion Cassius mentionnent<br />
également Thyeste (sur les rôles de Néron et leur mention dans les sources, voir p. 163 sq.). En outre,<br />
la langue des Neronia est le latin. Compte tenu de la révolution esthétique que Néron voulait mener, et<br />
de sa volonté de revivifier les arts, il serait étrange qu’il n’ait fait que reprendre des tragédies<br />
anciennes. Le prince jouant des pièces composées selon les critères esthétiques qu’il voulait donner en<br />
exemple serait un symbole politique fort. Enfin, comme le style de voix de Néron est propre à<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
400
peut penser que les tragédies sont comme une forme de dialogue entre un ministre qui peut<br />
encore faire preuve de franchise, et un prince qui est attentif au langage de la tragédie,<br />
d’autant plus que la longue fréquentation des deux hommes les a rendus familiers, intimes, se<br />
comprenant à demi-mot. Sénèque a formé Néron au théâtre par l’éducation qu’il lui a donnée,<br />
on peut donc considérer le prince comme le destinataire privilégié des tragédies sans en<br />
simplifier la portée, bien au contraire. Elles demeurent des objets esthétiques complexes que<br />
Néron devait pouvoir envisager en tant que tels. Que tout cela lui ait apparu insupportable dès<br />
lors que le vieux philosophe lui paraissait gênant demeure bien possible, mais les tragédies<br />
sont peut-être l’ultime témoignage de leur familiarité.<br />
3/ Les réactions de Néron, figure du pouvoir hors-scène.<br />
Enfin, les tragédies, parce qu’elles développent des intrigues propres à l’exercice du<br />
pouvoir, et tout particulièrement celles de Sénèque, qui contribuent à établir une parenté entre<br />
le prince et les personnages, renvoient à celui qui, dans la réalité, détient la puissance royale.<br />
Le référent politique réel se voit alors interrogé, par l’existence même de l’œuvre dramatique.<br />
Or, les rois des tragédies de Sénèque sont le plus souvent des tyrans, qu’ils aient conquis le<br />
pouvoir par la violence ou qu’ils l’exercent par l’arbitraire et la cruauté. Le philosophe, en<br />
cela, ne se démarque pas des exigences traditionnelles du genre, mais on aurait pu s’attendre,<br />
l’expression des passions, de longs passages des tragédies pouvaient correspondre à son répertoire.<br />
Sénèque a pu aussi l’aider à composer ses poèmes, comme il l’a fait pour ses discours. Ainsi, Niobé a<br />
pu porter la marque de Sénèque : c’est un thème tragique à la mode, et la famille des Tantalides a déjà<br />
inspiré deux tragédies du philosophe. Le thème des mères en deuil est de plus récurrent dans la<br />
production de Sénèque. Il s’agit de citharédie et non de tragédie, mais la proximité des deux<br />
disciplines a été clairement soulignée. Sénèque a donc pu, sinon composer, au moins aider, inspirer,<br />
corriger son élève.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
401
de la part d’un ministre impérial, à ce qu’il propose dans son théâtre un modèle de monarque<br />
qui contraste avec les tyrans, et réponde plus ou moins à l’idéal qu’il dessine dans ses traités :<br />
un roi juste qui ferait preuve de clémence, qui ne se laisserait pas guider par ses passions, la<br />
colère en particulier, et qui serait lié à son peuple par une réciprocité de bienfaits.<br />
Dans les tragédies, trois autocrates se rapprochent plus ou moins de ce modèle. Tout<br />
d’abord, l’Agamemnon des Troyennes se considère comme l’âme de son armée 1 face à un<br />
Pyrrhus qui ne respire que sang et vengeance. Agamemnon fait de la modération, et non de la<br />
violence, la garantie de la stabilité du pouvoir 2 , et montre à verser le sang humain une<br />
répugnance qui rappelle celle d’Auguste à la fin de son règne 3 . Thésée apparaît dans Hercule<br />
Furieux comme un prince éducateur, pratiquant la clémence et offrant au héros une chance de<br />
progresser vers la sagesse. Enfin, si l’on en croit le portrait que Créon, dans Médée, trace de<br />
lui-même, il représente une figure du bon roi, juste et clément, soucieux du sort de son peuple,<br />
et décidé pour cela à exiler Médée 4 . L’éloge peut sembler suspect, si l’on considère que les<br />
qualités attribuées à Créon n’ont d’autre garantie que le discours lui-même, et qu’il peut<br />
s’agir là d’une tentative de justification du souverain face à son ennemie. En cela, Créon est<br />
moins proche qu’Agamemnon du modèle du prince juste. Mais c’est Médée qui oppose à la<br />
condamnation d’exil qui la frappe des arguments propres à ébranler la détermination du roi :<br />
elle lui rappelle sa position de suppliante, qui lui a déjà valu l’asile de Corinthe. Revenir sur<br />
ce droit constitue donc, sinon un sacrilège, du moins un abus de pouvoir 5 , et c’est cette<br />
accusation que Créon réfute :<br />
1 Tro. 280, voir Clem. I, 3, 5.<br />
2 Tro. 258-259.<br />
3 Tro. 298. Dans le De clementia, Sénèque tire de l’anecdote de la clémence d’Auguste à l’égard de<br />
Cinna la conclusion que cette vertu garantit la sécurité politique : Clem. I, 11, 4.<br />
4 Med. 252-271.<br />
5 Med. 246-248.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
402
Non esse me qui sceptra uiolentus geram<br />
nec qui superbo miserias calcem pede<br />
testatus equidem uideor haud clare parum… 1<br />
Ainsi, contrairement à Atrée, Egisthe ou Lycus, tyrans exemplaires des tragédies, Créon ne<br />
fait pas l’apologie de la cruauté ni de l’arbitraire, et ne revendique à aucun moment la<br />
« qualité » de tyrannus. Face à la Colchidienne qui constitue un danger pour son royaume, il<br />
s’efforce de justifier sa décision au nom des principes qui fondent un juste gouvernement :<br />
clémence, modération, esprit de justice. En outre, l’accusation de tyrannie formulée par<br />
Médée n’est qu’un artifice destiné à obtenir le délai qui lui permettra d’assouvir sa vengeance,<br />
ce qui l’affaiblit grandement. Ainsi, si Créon se rapproche du modèle du bon roi, ce n’est que<br />
par l’intention : l’argument qu’il invoque, en effet, pour se démarquer de l’exercice inique du<br />
pouvoir, consitue de fait la faute politique majeure qui le mène à sa perte. Il a fait de Jason<br />
son gendre, semant le germe de la destruction de son royaume 2 .<br />
Cependant, la présence dans les tragédies de Sénèque de souverains pratiquant<br />
certaines des vertus du monarque idéal ne suffit pas à proposer au spectateur un modèle<br />
politique. Ce sont en effet des personnages secondaires, ils ne sont pas au cœur de l’intrigue<br />
tragique, contrairement aux tyrans. En outre, ils ont peu de prise sur les événements, qui<br />
consacrent souvent leur échec et révèlent leur inefficacité : Agamemnon disparaît rapidement<br />
après son dialogue avec Pyrrhus, tandis que le destin de Troie s’accomplit. Il n’est plus<br />
question de lui dans le récit de la mort des enfants, tandis que le fils d’Achille joue un rôle de<br />
1 Med. 252-254 : « Je ne suis pas homme à porter le sceptre en despote, ni à fouler les misères d’un<br />
pied orgueilleux, je crois en avoir donné, assurément, un témoignage assez éclatant …»<br />
2 Med. 255-257.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
403
premier plan au moment du sacrifice de Polyxène 1 . Dans Hercule Furieux, Thésée ne se<br />
présente explicitement comme roi qu’à la toute fin de la tragédie, dont seuls les derniers vers<br />
témoignent de sa politique clémente. Auparavant, dans sa description des enfers, et<br />
particulièrement lorsqu’il évoque les châtiments réservés aux tyrans, il semble s’exclure de la<br />
catégorie des dirigeants et ne parle pas en tant que roi 2 . Enfin, Créon commet au nom de la<br />
clémence une grave faute politique, en recueillant Jason et en faisant de lui son gendre, puis<br />
en accordant à Médée le délai nécessaire à la réalisation de sa vengeance et à la ruine de son<br />
palais. Finalement, les bons rois des tragédies sont largement minoritaires, impuissants ou<br />
marginaux, et c’est globalement la figure du tyran qui domine.<br />
Or, la représentation d’un mythe qui développe des problématiques propres à<br />
l’exercice du pouvoir suprême invite à la comparaison. Les références aux réalités romaines et<br />
impériales qui émaillent les tragédies confirment la relation que l’on peut établir entre les<br />
conflits qui se jouent sur la scène tragique et les événements du palais impérial. Par exemple,<br />
la réflexion sur la clémence que propose le dénouement d’Hercule Furieux, ou la<br />
problématique du partage du pouvoir qui décide du destin de Thyeste dans la pièce du même<br />
nom, amène le lecteur ou le spectateur, quelle que soit l’époque à laquelle il prend<br />
conaissance de l’œuvre, à penser à Néron, dont la politique de clémence est affirmée au début<br />
du règne, et qui se voit confronté au danger politique que représente Britannicus. Plus<br />
généralement, toute réflexion politique amène à s’interroger sur le souverain, surtout<br />
lorsqu’elle émane d’un proche du prince en question. Prince régnant, Néron apparaît<br />
forcément comme une référence dans la réalité face aux personnages de monarques du théâtre<br />
de Sénèque, d’autant que le régime impérial se prête particulièrement, par nature, à de telles<br />
1 Tro. 1147 sq.<br />
2 Herc. f. 739 : Quisquis est placide potens (« tous ceux qui exercent le pouvoir avec sérénité») et 745 :<br />
Sanguine humano abstine, / quicumque regnas (« gardez-vous de verser le sang humain, vous tous qui<br />
régnez »).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
404
comparaisons. Dès lors, c’est la question de la signification politique des tragédies qui se<br />
pose.<br />
II/ Signification politique des tragédies.<br />
Si les tragédies ont Néron pour principal destinataire, elles constituent une forme que<br />
prend le dialogue entre le souverain, et un ministre qui prend en compte les conditions de<br />
réception les meilleures pour s’adresser au prince dans une forme de code esthétique qui lui<br />
agrée. La question qui se pose alors est celle du contenu de ce dialogue. Si le De clementia<br />
prétendait présenter au nouvel empereur un miroir 1 , quelle image les tragédies veulent-elles<br />
renvoyer ? La question du bien et du mal affleure nécessairement, mais au-delà, n’est-ce pas<br />
la condition impériale elle-même qui est interrogée ?<br />
A/ le pouvoir impérial en question.<br />
La proximité du prince et des personnages de tragédie, que l’on a montrée<br />
précédemment, nourrit les échanges entre mythe et réalité, comme la présence de signaux tels<br />
que les anachronismes et les allusions aux périodes contemporaines ou au passé proche.<br />
L’évolution de Néron vers la tyrannie, à partir de la mort d’Agrippine et, plus nettement,<br />
après celle de Burrus et le retrait de Sénèque, le conduit à se rapprocher des personnages<br />
tragiques dont les pièces de Sénèque font leurs héros. Néron, semblable aux rois tragiques par<br />
1 Ce sont les premiers mots du traité : Scribere De clementia, Nero Caesar, institui, ut quodam modo<br />
speculi uice fungerer (« J’ai résolu d’écrire sur la clémence, Néron César, afin de jouer en quelque<br />
sorte le rôle d’un miroir »).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
405
sa puissance, et aux dieux par l’étendue du monde réduit à sa domination, est en effet<br />
confronté à des situations semblables à celles qui font le cœur de l’intrigue tragique : qu’il ait<br />
ou non provoqué la mort de Britannicus, la question du fratricide se pose pour lui et, comme<br />
pour Atrée, l’enjeu en est la permanence et la stabilité de son règne. Il connaît les tourments<br />
d’Œdipe et d’Oreste 1 , il sait quel poids la puissance impériale fait peser sur ses épaules. Quel<br />
regard les tragédies permettent-elles de poser sur le règne de Néron et ses dérives ?<br />
1 / Du conseil à l’opposition.<br />
Les fonctions de Sénèque au cours de sa carrière auprès de Néron, et les orientations<br />
de ses traités, pourraient faire des héros des tragédies des exempla négatifs, dont le destin<br />
illustrerait en action le bien fondé des prises de position du philosophe. Les personnages sont<br />
en effet confrontés à des situations concrètes, leur action et leurs réactions se développent au<br />
long de la tragédie, dont le dénouement constituerait alors une sorte de leçon. L’efficacité de<br />
la démonstration serait garantie par la représentation, et les nombreuses références à la réalité<br />
romaine inviteraient d’autant plus le spectateur impérial à tirer enseignement d’une œuvre<br />
dont il apprécie le genre. Selon la date des différentes tragédies, la condamnation de la<br />
tyrannie et des passions que l’on retrouve dans toutes les tragédies constituerait un conseil au<br />
jeune prince, un avertissement à un empereur exposé à des dérives despotiques, ou une<br />
condamnation du tyran, dans les dernières années.<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 10 ; Suétone, Ner. 34.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
406
Sénèque présente en effet des personnages totalement négatifs, qui revendiquent leur<br />
attitude tyrannique érigée en système 1 , et dont la défaite ou la victoire illusoire consacre la<br />
condamnation de leur folie 2 . C’est dans cette perspective qu’A. Rose propose une lecture<br />
didactique d’Hercule Furieux, comme une mise en garde adressée à Néron contre les dangers<br />
d’un pouvoir abusif 3 . Il faut alors supposer que la tragédie a été composée à un moment où le<br />
prince manifestait les premiers signes inquiétants de tyrannie, et où Sénèque avait encore un<br />
certain ascendant et une liberté de parole. Ainsi, dans ses fonctions d’amicus principis, le<br />
philosophe emploierait les ressources de l’enseignement qu’il dispensa à Néron avant son<br />
avènement. On lui reprocha, nous dit Suétone, de s’efforcer de garder pour lui seul<br />
l’admiration de son élève et par suite, de ne pas lui faire étudier les auteurs classiques 4 .<br />
Sénèque a-t-il composé ses tragédies dans un but didactique, en suivant la tradition de<br />
l’utilisation des textes de théâtre dans l’éducation ? A une date qu’il faudrait situer entre la<br />
mort de Britannicus et celle d’Agrippine, ou peu après, Sénèque tirerait parti de l’admiration<br />
de Néron pour Hercule, pour essayer de le détourner des penchants à la tyrannie qu’il<br />
commence à manifester.<br />
Cette interprétation de la tragédie revient finalement à proposer pour Hercule Furieux<br />
une lecture proche de celle du De clementia. Dans ce traité, Sénèque s’appuyait sur une figure<br />
spécialement appréciée de Néron, et donnait à son propos une coloration résolument<br />
apollinienne, à laquelle le jeune souverain serait tenté de se conformer. Au tout début du<br />
1 Ainsi, Atrée dans Thyeste, 204 sq et Egisthe dans Agamemnon, 888-1000. Même Œdipe, qui a<br />
apporté involontairement le mal à Thèbes, se comporte en tyran à l’égard de Créon qu’il soupçonne de<br />
vouloir le détrôner (Œd. 668-708).<br />
2 Par exemple Atrée, voir supra, p. 207-208. La mort de Lycus (H. F. 895-897), le ciel sans dieux de<br />
Médée (Med. 1026-1027), ou la fin lourde de menaces d’Agamemnon (Veniet et uobis furor, v. 1012),<br />
montrent la fragilité du pouvoir tyrannique, menacé par la violence même qui a contribué à sa<br />
conquête.<br />
3 A. Rose, 1980.<br />
4 Suétone, Ner. 52.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
407
ègne, le De clementia exprime à la fois l’admiration dont Néron fait l’objet et les espoirs<br />
qu’il suscite. Hercule Furieux pourrait constituer le pendant tragique de la stratégie éducative<br />
de Sénèque. De fait, on trouve des échos au De clementia dans la tragédie, notamment dans le<br />
débat final qui porte sur la culpabilité d’Hercule. Thésée s’impose comme la figure du prince<br />
idéal, bienveillant et pratiquant la clémence comme une vertu éducative 1 . Dans sa description<br />
des enfers, il évoque le châtiment réservé aux tyrans :<br />
Vidi cruentos carcere includi duces<br />
et impotentis terga plebeia manu<br />
scindi tyranni. 2<br />
La présence de l’adjectif plebeia invite le lecteur à faire le lien entre les souverains jugés aux<br />
enfers et les empereurs de Rome. Le destin d’Hercule peut alors apparaître comme un<br />
avertissement aux détenteurs du pouvoir suprême, et une invitation à vaincre leurs passions et<br />
à accepter finalement leur condition humaine, comme le fait le héros à la fin de la tragédie.<br />
Thésée propose en effet à Hercule de le suivre à Athènes, terre qui sait rendre aux dieux leur<br />
innocence 3 . La leçon est proche de celle du De clementia : la pratique de la clémence se<br />
justifie justement par l’apprentissage de l’innocence 4 . Le cas d’Hercule est d’autant plus<br />
exemplaire que le héros, dont l’action est généralement tournée vers l’élimination des<br />
1 C. Auvray-Assayas, 1987.<br />
2 Herc. f. 737-739 : « J’ai vu des chefs sanguinaires emprisonnés, et le dos d’un tyran effréné déchiré<br />
sous les coups d’une main plébéienne ».<br />
3 Herc. f. 1345 : facere innocentes terra quae superos solet.<br />
4 Clem. I, 6, 4.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
408
monstres et la destruction des tyrans cruels 1 , finit par se faire grâce à lui-même et par accepter<br />
son sort comme l’ultime de ses travaux. La conquête héroïque de l’innocence illustrée par<br />
Hercule pourrait, effectivement, renvoyer Néron à sa propre pratique du pouvoir, et tenter de<br />
conjurer l’évolution du prince vers la tyrannie.<br />
L’exemple d’Hercule Furieux illustre donc l’interprétation didactique des tragédies de<br />
Sénèque, qui pourraient constituer un recueil d’exempla adaptés aux goûts de Néron pour le<br />
théâtre, une entreprise pédagogique qui s’étendrait de la période de formation du prince<br />
jusqu’à la retraite de Sénèque, les conseils devenant peu à peu manifestes de la<br />
désapprobation de l’ancien ministre face au tournant que prend le règne vers l’année 62. Plus<br />
Néron s’affranchit de l’influence de Sénèque, et plus les tragédies se chargent d’un message<br />
d’opposition 2 . Il reste fort vraisemblable que Sénèque a rédigé une partie de ses tragédies<br />
pendant sa retraite et sa disgrâce politique. Or pour lui, la retraite n’est pas un retranchement<br />
absolu, ni une fuite, mais la manière, la dernière peut-être, dont on peut s’adapter aux<br />
circonstances les plus défavorables. Ainsi dans le De tranquilitate animi, daté d’environ 53 3 ,<br />
le philosophe répond à la doctrine d’Athénodore qui prône la retraite studieuse lorsque<br />
1 Les prières de Mégare et d’Amphitryon appelant au retour du héros soulignent cette action<br />
pacificatrice et protectrice d’Hercule : pour son père, il est pacis auctor (v. 250), le justicier qui<br />
pourchasse les criminels (v. 271-272 : Qui scelera terra quique persequitur mari / ac saeua iusta<br />
scpetra confringit manu) ; Mégare reprend comme en écho cette prière plaintive, et invoque le retour<br />
de son époux protecteur (v. 279 sq).<br />
2 Ce qui ne préjuge pas forcément de leur date de composition : dès lors que Néron s’éloigne du<br />
modèle qui lui était proposé, il se rapproche inévitablement des figures du tyran dont les tragédies<br />
montrent les actions.<br />
3 P. Grimal, 1991a, p. 288.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
409
l’engagement dans l’action n’est plus permis par les circonstances 1 . Pour Sénèque, ce<br />
retranchement doit être progressif et réfléchi :<br />
Hoc puto uirtuti faciendum studiosoque uirtutis : si praeualebit fortuna et praecidet<br />
agendi facultatem, non statim auersus inermisque fugiat, latebras quaerens, quasi<br />
ullus locus sit quo non possit fortuna persequi, sed parcius se inferat officiis et cum<br />
dilectu inueniat aliquid in quo utilis ciuitati sit. 2<br />
La retraite ne saurait donc être une fuite, puisque Sénèque affirme l’impossibilité de se<br />
soustraire à la fortune. Le comportement du philosophe semble bien correspondre dans les<br />
faits à celui qu’il préconise dans cet extrait. Après avoir demandé à Néron la permission de se<br />
retirer, Sénèque devant le refus du prince, dicté par des raisons politiques, adopte une attitude<br />
de réserve : il s’isole, sort peu et reste le plus possible chez lui, sous le prétexte de sa santé<br />
fragile ou de ses études 3 . En d’autres termes, parcius se infert officiis. Finalement, il reste au<br />
philosophe l’étude et l’écriture, activités qui s’imposent d’elles-mêmes comme les dernières à<br />
subir les conséquences d’une disgrâce bientôt consommée, et la rédaction des tragédies peut<br />
correspondre à cette activité qui demeure même lorsque la fortune impose l’impuissance.<br />
1 La position du stoïcisme orthodoxe est que le sage participe aux affaires publiques, sauf si les<br />
circonstances ne lui permettent pas de mener sa tâche à bien. Sénèque cite ainsi Zénon : Zenon ait :<br />
Accedet ad rempublicam, nisi si quid impedierit (Ot. III, 2). Il justifie une attitude conforme aux<br />
principes de ses maîtres du Portique: Nunc probabo tibi, nec desciscere me a praeceptis Stoicorum<br />
(Ot. II, 1 ).<br />
2 Tranq. IV, 2 : « Voici quel doit être, je pense, le comportement du sage ou de celui qui aspire à la<br />
sagesse : si la fortune l’emporte et le réduit à l’impuissance, qu’il ne s’empresse pas de tourner le dos<br />
et de jeter les armes, pour chercher une cachette, comme s’il existait un seul endroit où l’on pût se<br />
soustraire aux persécutions du sort, mais qu’il se consacre avec plus de réserve à ses devoirs et qu’il<br />
choisisse avec soin une activité qui lui permette de se rendre utile à la cité. »<br />
3 Tacite, Ann. XIV, 56.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
410
Le De otio apporte des éléments de justification à cette décision, qui n’est plus<br />
envisagée théoriquement comme dans le De tranquilitate animi, mais comme vécue, puisque<br />
ce traité est généralement daté de la retraite de Sénèque, après 62 1 , alors qu’il a renoncé à<br />
toute fonction politique. A un contradicteur qui lui fait reproche de ce retrait, il répond que ses<br />
écrits et son exemple sont utiles à la postérité 2 . Le spectacle de la nature et son observation<br />
enthousiaste sont présentés comme actions fondamentales de la retraite 3 , et révèlent le souci<br />
de Sénèque de se détacher des contingences immédiates, de prendre de la hauteur et de la<br />
distance et ainsi, de s’élever à l’universel et à l’intemporel, à la vertu et à la vérité.<br />
Cette activité intellectuelle s’accorde aussi bien à la politique, car la retraite permet au<br />
philosophe une méditation sur les années où il a pris part au pouvoir. C’est pour Sénèque une<br />
période riche d’étude et de réflexion, qu’il ne consacre pas seulement à l’étude de la nature,<br />
que préconisait le De otio, et dont témoignent les Questions naturelles, mais aussi au dialogue<br />
avec Lucilius 4 . Certaines lettres portent la trace de cette réflexion tirée de l’expérience. Par<br />
exemple, dans la lettre 56, après avoir décrit en détails tous les bruits et le vacarme qui,<br />
contrairement à l’opinion commune, ne forment pas un obstacle sérieux à l’étude de qui a<br />
conquis le calme intérieur, Sénèque évoque le malaise qui peut naître dans l’inaction :<br />
Saepe uidemur taedio rerum ciuilium et infelicis atque ingratae stationis paenitentia<br />
secessisse; tamen in illa latebra in quam nos timor ac lassitudo coniecit interdum<br />
1 P. Grimal, 1991a, p. 294-298 ; G. Maurach, 1996, p. 139.<br />
2 Ot. VI, 4 : « Dans quel esprit le sage s’isole-t-il dans le repos ? Avec la conviction qu’il servira<br />
activement, même alors, l’intérêt de la postérité. »<br />
3 C’est de cette période que date la rédaction des Questions naturelles.<br />
4 Ep. 8, 1.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
411
ecrudescit ambitio. Non enim excisa desit, sed fatigata aut etiam obirata rebus parum<br />
sibi cedentibus . 1<br />
Cette réflexion du philosophe, qui dans le même temps avoue ses faiblesses et les met à<br />
distance par la généralisation de la formulation, montre quel regard rétrospectif l’ancien<br />
précepteur et ministre pouvait porter sur sa participation aux affaires dans les dernières années<br />
de sa vie. Une telle attitude suppose une hauteur de vue et une prise de distance qui<br />
s’accordent assez bien avec la rédaction des tragédies : elles apparaissent, à bien des égards,<br />
comme une méditation sur le pouvoir, par laquelle Sénèque, bien que retiré, se montre encore,<br />
et conformément aux préceptes émis dans le De tranquilitate animi, utilis ciuitati.<br />
On peut donc considérer l’écriture de tragédies comme une constante de l’activité<br />
politique de Sénèque : un support éducatif pendant la période de formation du jeune Néron,<br />
puis pendant les premières années du règne, la contribution du ministre au renouveau littéraire<br />
voulu par le prince, et enfin pendant la retraite, une sorte de participation quand même à la vie<br />
politique, une manière d’être utile à la cité.<br />
2/ Un exemple de réalisme politique ?<br />
La question des allusions politiques dans les tragédies de Sénèque constitue l’aspect le<br />
plus visible d’un problème plus vaste, et sans nul doute plus essentiel, qui est celui de la<br />
1 Ep. 56, 9 : « Souvent nous croyons que le dégoût des affaires et le regret que nous a causé une<br />
fonction sans succès ni prestige nous ont fait rechercher la retraite. Et pourtant, dans cette cachette où<br />
la crainte et la fatigue nous ont jetés, l’ambition se ranime de temps en temps : on ne l’avait pas<br />
détruite, elle n’était que lassée, ou encore irritée d’une médiocre réussite. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
412
destination et, finalement, du sens de cette œuvre dramatique. En effet, le principe de<br />
l’allusion, qui invite à établir un lien entre le mythe représenté et l’actualité la plus brûlante,<br />
ou au moins l’histoire récente, permet d’envisager l’œuvre de Sénèque, au sens littéraire et<br />
politique, dans sa globalité, et dans sa cohérence. Si l’on considère que la visée pédagogique<br />
et moralisante des tragédies en constitue la signification essentielle, l’ensemble du théâtre de<br />
Sénèque apparaît cependant comme un remarquable aveu d’impuissance. Le nombre des<br />
tragédies et l’évolution du règne de Néron vers une tyrannie de plus en plus affirmée<br />
dénoncerait en effet l’échec d’un théâtre qui ne serait que didactique. Dès lors, il paraît<br />
nécessaire de s’interroger sur la complexité de ses enjeux.<br />
Prenant le contre-pied de l’interprétation la plus simple et, à première vue, la plus<br />
évidente, W. Calder fait de Thyeste un exemple de réalisme en politique, adressé à Néron pour<br />
lui montrer, au-delà des idéaux affichés dans la propagande impériale, les nécessités du<br />
pouvoir 1 . Selon lui, le crime est pour Atrée le seul moyen de conserver son trône : le pouvoir<br />
suprême en effet n’admet pas de partage, et Thyeste, qui détient la toison d’or, attribut du<br />
pouvoir des Pélopides, contrevient à cette règle d’une manière insupportable. C’est donc son<br />
crime qui apportera à Atrée la réalité du pouvoir et la liberté : qu’il renonce à la vengeance, et<br />
il vivra sous la menace constante de son frère 2 . La joie du tyran, qui éclate à la fin de la<br />
tragédie, ne relève donc pas du sadisme d’un déséquilibré ou d’un monstre, mais résulte de la<br />
liberté enfin conquise. Par l’exemple de ce mythe, Sénèque montrerait indirectement à Néron,<br />
quels moyens il se verra forcé d’employer pour survivre en tant que monarque. Atrée devient<br />
donc, grâce à Sénèque, l’inverse exact d’Auguste : un exemplum empruntant au mythe,<br />
illustrant le caractère indispensable de la cruauté, à l’opposé de l’exemplum historique<br />
confirmant la nécessité de la clémence en politique, et que le philosophe détaillait dans le De<br />
1 W. Calder, 1983.<br />
2 Th. 1104-1110.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
413
clementia au début du règne 1 . C’est encore le réalisme qui préside à une lecture d’Œdipe,<br />
selon laquelle, au-delà d’une hypothétique réprimande au prince après la mort d’Agrippine, la<br />
tragédie contiendrait en réalité une flatterie à Néron, confirmant le principe d’un nécessaire<br />
recours au meurtre politique dans certaines situations 2 .<br />
L’hypothèse est évidemment séduisante, et offre à l’esprit une bien belle symétrie,<br />
mais peut-on imputer à Sénèque un tel cynisme ? On est bien au-delà du réalisme qui décida<br />
du sort d’Agrippine, et le recours à la cruauté comme principe stabilisateur du pouvoir est à<br />
l’opposé des conceptions que Sénèque développe constamment par ailleurs. En particulier, les<br />
prises de position du De beneficiis 3 , et l’attitude de Sénèque qui se retire de la politique dès<br />
lors qu’il se sent impuissant, ne semblent pas s’accorder avec l’interprétation que propose W.<br />
Calder. La mise à l’épreuve des personnages dans des situations précises, leur confrontation<br />
aux problèmes que pose l’exercice du pouvoir, permettent cependant d’explorer les limites<br />
des préceptes défendus dans l’œuvre en prose qui, par nature, revêt un caractère systématique<br />
et dogmatique.<br />
3/ La tragédie, un espace pour le doute.<br />
L’incertitude et le doute ont leur place dans les tragédies, et c’est la rhétorique qui<br />
permet de les exprimer. Les personnages en effet s’affrontent au cours de longs débats, ils<br />
confrontent leurs points de vues, comme Agamemnon et Pyrrhus dans les Troyennes, après<br />
que le messager Talthybius a rendu compte de l’apparition de l’ombre d’Achille et de ses<br />
exigences. Les mânes du héros réclament en sacrifice Polyxène, au cours d’un mariage<br />
1 Clem. I, 9.<br />
2 W. Calder, 1976b.<br />
3 Voir supra, p. 382-386.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
414
funèbre 1 . La situation soulève entre les chefs acchéens une discussion sur les devoirs des<br />
vaincus et les droits des vainqueurs une fois la victoire acquise 2 . Pyrrhus se fait le défenseur<br />
ardent de son père, tandis qu’Agamemnon, que dix années de guerre et de massacre ont rendu<br />
sage, est partisan de la clémence. De manière significative, les sententiae d’ordre général se<br />
mêlent aux attaques personnelles rappelant des situations très précises comme le sacrifice<br />
d’Iphigénie ou le meurtre de Priam 3 . La réflexion est donc à la fois d’ordre général et<br />
particulier. Personne n’arrive pourtant à convaincre l’autre, et Agamemnon s’en remet au<br />
conseil de Calchas, interprète des dieux. La tragédie va suivre son cours, sous la direction de<br />
la fatalité, comme l’exige le genre 4 . Est-ce à dire que dans ce long passage de près de 150<br />
vers, la rhétorique tourne à vide et démontre l’inutilité du débat ? La conclusion serait hâtive,<br />
car, entre temps, l’affrontement des chefs a fait surgir des questions d’une importance<br />
capitale, et souligne la difficulté de prendre des décisions en ces circonstances.<br />
C’est ainsi que le dialogue tragique ouvre un espace d’incertitude, qui fait naître la<br />
réflexion, car les mêmes problèmes peuvent être traités dans une tragédie et dans un dialogue<br />
philosophique. Au théâtre, les débats sont soulevés dans des situations données, entre des<br />
personnages aux motivations et au caractère souvent complexes. La diversité des contextes et<br />
des réactions des personnages se rapproche alors davantage de ce que l’on peut rencontrer<br />
dans la réalité. Ainsi, la question du droit des vainqueurs se pose à plusieurs reprises dans<br />
l’œuvre de Sénèque. Le philosophe est en général défavorable aux guerres de conquêtes,<br />
même s’il lui arrive de citer Hercule comme un exemple de héros à l’action civilisatrice et<br />
1 Tro. 167-202.<br />
2 Tro. 203-348.<br />
3 Tro. 327-331.<br />
4 Tro. 360 : Dant fata Danais quo solent pretio uiam (« Les destins ouvrent aux Danaens la route au<br />
prix habituel »).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
415
pacificatrice 1 . Lorsqu’un conflit a lieu cependant, après la victoire de l’un des deux camps,<br />
l’amicitia doit au plus vite prendre le pas sur les intentions belliqueuses. La sagesse politique<br />
consiste à effacer la distinction entre vainqueurs et vaincus, pour faire de ses anciens ennemis<br />
des alliés fidèles. L’exemple des Espagnols et des Gaulois pourrait être cité à l’appui de cette<br />
idée. L’usage de la clémence est conseillé à l’issue des affrontements, car elle permet de<br />
diviser et de rallier 2 , et le pouvoir se conserve mieux par les bienfaits que par les armes 3 .<br />
Cette conception de la politique étrangère n’est pas propre à Sénèque, elle est même<br />
très répandue 4 . Mais elle prend une tout autre dimension quand elle est prise en charge par des<br />
personnages tragiques. : on songe par exemple au discours spécieux de Lycus, qui pour<br />
affirmer son trône, désire épouser Mégare. Il invoque donc la règle qui demande au vaincu de<br />
renoncer à sa haine, et établit une distinction radicale entre les causes de la guerre et son<br />
issue 5 . Le recours à la clémence n’est ici qu’une manœuvre employée par l’usurpateur pour<br />
acquérir un peu de légitimité. Il sait en effet que son pouvoir est fragile. Agamemnon<br />
développe aussi cette idée dans les Troyennes, mais elle se révèle inefficace 6 face à<br />
l’acharnement des destins. Agamemnon présente également le roi comme un vainqueur,<br />
couronné de lauriers 7 : dans un dialogue avec sa captive, il assure Cassandre de sa protection,<br />
et tient à l’associer à la fête de son retour. Pour la convier aux festivités, il s’exprime à deux<br />
reprises à la première personne du pluriel 8 . Encore une fois, le discours du vainqueur est miné<br />
par le meurtre préparé : non seulement l’assurance d’Agamemnon paraît dérisoire, mais en<br />
1 Ben. I, 13, 3.<br />
2 Clem. II, 7, 2.<br />
3 Pol. 12, 3 ; voir aussi Ep. 87, 4-11.<br />
4 Par exemple Cicéron, Off. II, 26.<br />
5 Herc. f. 397-413.<br />
6 Tro. 256-257.<br />
7 Ag. 779.<br />
8 ueneremur aras, v. 792, et Iouem precemur, v. 793.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
416
dénonçant par avance les illusions dont il se berce, elle fait porter la suspicion sur l’attitude<br />
magnanime qu’il défend 1 .<br />
Les anachronismes, ainsi que les correspondances que l’on peut établir entre le<br />
contexte politique contemporain de Sénèque et le mythe, donnent donc aux questions<br />
soulevées dans les tragédies à la fois une actualité et une intemporalité. Le mythe permet en<br />
effet au philosophe d’approfondir sa réflexion théorique, en confrontant des concepts à des<br />
situations certes fictives, mais dont la complexité leur donne l’épaisseur du réel.<br />
Paradoxalement, c’est donc le mythe et son traitement dans un poème tragique qui apportent à<br />
la réflexion politique les nuances et la souplesse qu’exige la complexité des situations réelles,<br />
tandis que l’œuvre philosophique, qui met l’accent sur l’exhortation, ne laisse guère de place<br />
au doute qui surgit des tragédies. Finalement, le personnage de Caton, figé dans une posture<br />
certes héroïque, mais bien peu humaine 2 , paraît bien plus loin de la réalité que les héros des<br />
tragédies.<br />
B/ Une lecture tragique de la politique.<br />
Le théâtre de Sénèque laisse apparaître la dimension tragique de la politique et de la<br />
condition impériale. En effet, il ne s’agit plus d’établir des correspondances strictes entre le<br />
mythe représenté et l’actualité, mais de voir comment, finalement, l’empire devient sa propre<br />
mythologie, en établissant un réseau de significations, qui s’enrichissent les unes les autres.<br />
La lecture politique de la tragédie qui en découle paraît alors de nature à approfondir la<br />
méditation sur l’empire, et plus particulièrement sur la période néronienne.<br />
1 Ag. 799 : Victor timere quid potest ?<br />
2 Dans le De constantia sapientis (7, 1), Caton apparaît non seulement comme l’incarnation de la<br />
sagesse stoïcienne, mais il semble encore s’élever au-dessus de cet idéal.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
417
1/ L’évocation mythologique de l’histoire<br />
A la lecture du prologue de Thyeste, on ne peut s’empêcher de penser à Néron, qui<br />
passe pour avoir provoqué la mort de Britannicus, et a ordonné l’exécution de sa mère, après<br />
avoir vainement tenté de la noyer dans le naufrage arrangé de son bateau. Le fratricide et le<br />
matricide sont évoqués l’un après l’autre, et cette proximité rapproche encore l’évocation<br />
mythologique de l’histoire. Ces crimes sont en effet reprochés à Néron au cours de son règne,<br />
comme le rapporte Suétone, qui cite des exemples d’épigrammes qui courent sur le compte du<br />
prince :<br />
Quis negat Aeneae magna de stirpe Neronem ?<br />
Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem. 1<br />
Le distique, qui joue sur le double sens du verbe sufferro, rappelle l’origine légendaire de la<br />
gens Iulia, et c’est en quelque sorte le matricide qui associe ironiquement Néron à un<br />
personnage mythologique. Une autre épigramme, plus explicite, dresse une liste de matricides<br />
célèbres, au nombre desquels Néron figure en première place, devant Oreste et Alcméon. La<br />
parenté du prince et des héros de tragédie est donc largement ressentie au cours même de son<br />
règne.<br />
Le régime impérial, en faisant se confondre affaires familiales et affaires d’Etat,<br />
permet une lecture tragique de la politique et de l’histoire. La période julio-claudienne, parce<br />
que les événements politiques se concentrent au sein d’une famille, qui s’éteint avec Néron,<br />
1 Suétone, Ner. 39 : « Qui peut nier que Néron est de la race illustre d’Enée ? L’un s’est chargé de son<br />
père, l’autre s’est chargé de sa mère ».<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
418
s’y prête particulièrement, et les œuvres des historiens montrent cette conscience du caractère<br />
tragique de l’histoire. Mais dans le cas du récit historique, la mise en forme tragique est<br />
favorisée par la distance temporelle : au moment où Tacite compose ses Annales, les crises du<br />
règne de Néron ont trouvé leur résolution, et les événements peuvent être replacés dans un<br />
enchaînement de causes qui devait échapper à ceux qui étaient en prise directe avec<br />
l’actualité. Rétrospectivement, ce qui est arrivé devient inévitable, et les événements sont lus<br />
à la lumière de leurs conséquences. Leur déroulement paraît alors déterminé, et laisse une<br />
place à la fatalité qui est au cœur de la tragédie. C’est pourquoi l’assimilation de Néron à un<br />
personnage mythologique, de son vivant, est riche de signification, d’abord, parce la distance<br />
temporelle ne permet pas cette vision globale qui permet de donner à la succession des<br />
événements un sens donné, et ensuite parce que Néron ne semble pas s’offusquer outre<br />
mesure de se voir critiqué de cette manière : Suétone note son indulgence pour ce type<br />
d’affront 1 . Outre les caractéristiques du régime impérial, et la situation familiale du prince,<br />
qui rapproche l’évolution du règne des intrigues des tragédies, le goût du prince pour le<br />
théâtre et sa tendance à s’exhiber comme acteur et comme personnage montrent à quel point<br />
Néron devait avoir conscience de ce rapprochement.<br />
Enfin, les tragédies de Sénèque semblent porter les germes de l’association du prince à<br />
un personnage mythologique. La présentation du règne de Néron par Tacite paraît même<br />
s’inspirer de manière significative de la tonalité et des thèmes de certaines tragédies. Ainsi, A.<br />
Foucher donne des exemples d’intertextualité tragique dans le récit de la mort d’Agrippine au<br />
livre XIV des Annales 2 : par exemple, l’utilisation du substantif progenies 3 , rarement<br />
employé en prose, rappelle le théâtre de Sénèque 4 dans lequel ce terme est employé à<br />
1 Ner. 39.<br />
2 A. Foucher, 2000, p. 795-96.<br />
3 XIV, 7, 4 et XIV, 61, 4.<br />
4 Phaed. 129 ; Phœn. 390 ; Th. 137 ; Tro. 460.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
419
plusieurs reprises. De nombreux autres parallèles textuels laissent penser que Tacite a<br />
composé son récit en s’inspirant des tragédies de Sénèque, qui de ce fait contribuent à la<br />
vision de Néron que nous livre l’historiographie. La question n’est donc plus tellement de<br />
savoir si Sénèque a voulu montrer en Atrée ce que devenait Néron, mais de constater que les<br />
tragédies de Sénèque créent les conditions d’une lecture politique, particulièrement adaptée à<br />
l’actualité ou à l’histoire proche, sans que le mythe perde pour autant de sa profondeur et de<br />
son universalité. Autrement dit, loin d’avoir réduit les mythes représentés à une signification<br />
univoque, Sénèque a donné à des personnages historiques, et en particulier à Néron, la<br />
richesse et la complexité des grands mythes.<br />
2/ La mort mise en scène.<br />
La mort de Britannicus, telle du moins que les historiens la rapportent 1 , est digne de la<br />
machination ourdie par Atrée : Néron, qui nourrit contre son frère d’adoption une jalousie à la<br />
fois artistique et politique, fait appel à Locuste, sorcière gauloise de sinistre réputation. Le<br />
poison fait l’objet de plusieurs expériences, après un essai infructueux sur celui à qui il est<br />
destiné : des animaux, un chevreau et un jeune porc, font les frais de ces funestes<br />
expérimentations 2 . L’expédient imaginé pour contourner l’obstacle que constituait le goûteur<br />
attaché à Britannicus 3 , et l’attitude impassible de Néron, qu’imitent les courtisans les plus<br />
avisés, et même Octavie, que la fréquentation de la cour a accoutumée à la dissimulation,<br />
1 Suétone, Ner. 33 ; Tacite, Ann. XIII, 15. Voir supra, p. 29 et 197.<br />
2 Les essais toxicologiques du prince ont inspiré l’un des tout premiers films de l’histoire du cinéma :<br />
Néron essayant des poisons sur des esclaves (G. Hatot et A. Promio), en 1896.<br />
3 C’est l’eau que l’on ajoute à la boisson du jeune homme, afin de la tiédir, qui contient le poison :<br />
Tacite, XIII, 16.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
420
contribuent à donner de Néron l’image d’un metteur en scène impitoyable et pervers, digne<br />
des plus grands criminels mythologiques.<br />
A cet égard, un autre crime dont est crédité Néron contribue à le rapprocher de ce<br />
modèle. Il s’agit de l’exécution de Rufrius Crispinus : comme le jeune garçon se donnait, dans<br />
ses jeux, le titre d’empereur, Néron donna à ses esclaves l’ordre de le noyer dans la mer,<br />
pendant qu’il pêcherait 1 . Si l’élimination d’un rival, même improbable, n’est pas un<br />
événement isolé, le fait que Néron se préoccupe des circonstances du meurtre a retenu<br />
l’attention de R. M. Frazer 2 , qui a rapproché ce passage d’une parole que le philosophe Isidore<br />
le Cynique adresse publiquement à Néron, lui reprochant de bien chanter les malheurs de<br />
Nauplius, mais de mal administrer ses biens 3 . Cet épisode de la guerre de Troie, qui prenait<br />
peut-être place dans les Troica de Néron, donne selon R. M. Frazer tout son sens à la<br />
remarque du philosophe : Néron aurait voulu donner à son crime une touche artistique, et<br />
réaliser un épisode mythologique en faisant mourir le fils de Poppée de la même manière que<br />
Palamède, noyé par Diomède et Ulysse alors qu’il était parti pêcher.<br />
Ensuite, l’assassinat d’Agrippine fait intervenir un trucage, comme au théâtre. D’après<br />
les abréviateurs de Dion Cassius 4 , l’idée du sabotage du bateau vient directement des<br />
mécaniques employées lors de représentations. La machination se voit même qualifiée de<br />
« tragédie ». Tacite parle d’un bateau disposé per artem à se disloquer en mer 5 . Il attribue<br />
toutefois cette idée à l’affranchi Anicétus, désireux de régler des comptes personnels avec<br />
1 Suétone, Ner. 35, 5.<br />
2 R. M. Frazer, 1966-67.<br />
3 Suétone, Ner. 39 : Transeuntem eum Isidorus Cynicus in publico clara uoce corripuerat quod Naupli<br />
mala bene cantitaret, sua bona male disponeret. Cf Euripide, Hel. 767 et 1126 sq.<br />
4 Dion Cassius, 61, 13, 3.<br />
5 Tacite, Ann. XIV, 3.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
421
Agrippine. Encore une fois, la mise en scène est remarquable, et fait penser à la vengeance<br />
d’Atrée : la feinte réconciliation, les témoignages de tendresse, le souper censé sceller la<br />
nouvelle entente et les liens familiaux resserrés 1 , sont également les étapes du pièges tendu<br />
par Atrée à son frère. L’habileté de Néron, ses talents d’acteurs se déploient à l’occasion de ce<br />
dîner. Tacite qualifie alors le prince de ferus, adjectif qui est appliqué à Atrée dans la tragédie<br />
de Sénèque. Agrippine ruse aussi en feignant de croire à l’accident 2 , mais elle échoue à<br />
prendre la direction de cette affaire, et à imposer sa propre mise en scène, quand un artifice<br />
supplémentaire démasque, pour la <strong>version</strong> officielle, ses intentions criminelles à l’égard de<br />
son fils.<br />
Dion Cassius donne de cette affaire une <strong>version</strong> bien plus hostile à Sénèque, en<br />
soutenant que c’est lui qui a poussé le prince à éliminer sa mère 3 . La réalité est-elle plus<br />
proche du récit de Tacite, selon lequel Sénèque fut contraint de se faire le complice de cette<br />
exécution, après qu’Agrippine eut échappé au complot 4 ? Le degré réel d’implication du<br />
ministre dans cette affaire reste inconnu. Il reste que l’opposition d’Agrippine risquait de se<br />
radicaliser et de mettre en danger la paix civile, et de provoquer une catastrophe politique<br />
qu’il fallait à tout prix éviter. On trouve un écho de cette grave crise dans le De beneficiis :<br />
Si patriae salus ac libertas mittit me etiam quo ire nollem, imperabo pudori meo (…) 5<br />
1 Tacite, Ann. XIV, 4.<br />
2 Suétone, Ner. 34.<br />
3 Dion Cassius, 61, 12, 1.<br />
4 Tacite, Ann. XIV, 7 et 11.<br />
5 Ben. V, 20, 7 : « Si le salut et la liberté de ma patrie me conduisent même là où je n’aurais pas voulu<br />
aller, je réprimerai mes scrupules …»<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
422
Un autre passage, plus explicite encore, évoque l’annulation des bienfaits du père ou de la<br />
mère :<br />
Quid ? Non tam duri quidam et tam scelerati patres sunt ut illos auersari et eiurare<br />
ius fasque sit ? 1<br />
On peut, certes, songer avec P. Veyne à des questions d’ordre juridique, et plus précisément<br />
au problème de la validité du testament d’un fils qui déshériterait son père 2 , mais dans le<br />
contexte de rédaction vraisemblable du traité 3 , le souvenir de l’exécution d’Agrippine affleure<br />
nécessairement. Le vers 220 de Thyeste semble relever de la même problématique, sur le<br />
mode de la tragédie, en une formule plus resserrée qui s’organise autour des antonymes fas et<br />
nefas : Fas est in illo quicquid in fratre est nefas. Ce sont les mots d’Atrée qui recherche, pour<br />
son frère, un châtiment non pas tant à la mesure des crimes commis, mais à la mesure de celui<br />
qui exécutera la sentence. Du point de vue d’Atrée, les crimes de Thyeste, et en particulier ses<br />
relations adultères avec la femme de son frère, qui jettent le doute sur la légitimité de sa<br />
descendance, le dispensent d’agir en se conformant aux lois divines et humaines, et justifient<br />
du même coup la haine furieuse qu’il porte à son frère. Le problème posé dans le De<br />
beneficiis, mais aussi dans la tragédie de Thyeste, est donc bien celui de la désobéissance à<br />
des principes fondamentaux et intangibles, dans certaines circonstances particulières : dans le<br />
cas du meurtre d’Agrippine, le risque de troubles civils et la nécessité de sauvegarder la<br />
1 Ben. VI, 4, 2 : « Eh quoi ? N’y a-t-il pas des pères si durs et si criminels que les lois divines et<br />
humaines autorisent à les combattre et à les renier ? »<br />
2 Sénèque, Entretiens, Lettres à Lucilius, éd. établie par P. Veyne, 1993, p. 530, n. 2. Cf. M. Kaser,<br />
Römisches Privatrecht : ein Studien Buch, Munich, 1960, I, 711, n. 15.<br />
3 D’après P. Grimal, 1991a, p. 303-304, le traité ne peut avoir été écrit avant 58, ni après 62 . F. R.<br />
Chaumartin, 1985, p. 195-197, propose de dater le traité de 59.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
423
stabilité de l’état, dans le cas de la vengeance d’Atrée, le danger que constitue la trahison de<br />
Thyeste. L’une et l’autre situations voient s’affronter les devoirs familiaux et les réalités<br />
politiques 1 .<br />
Quelle signification donner à ces convergences ? La tragédie et le traité offrent, à leur<br />
manière propre, une réflexion sur un problème qui a constitué pour Sénèque un cas de<br />
conscience douloureux, ou au moins délicat. La tragédie présente donc un cas pratique,<br />
comme une extension de l’usage courant de citer le théâtre pour illustrer une réflexion<br />
philosophique. Le théâtre de Sénèque propose une réflexion sur le pouvoir, qui se nourrit de<br />
l’expérience de son auteur, de l’intemporalité du mythe et des leçons de l’histoire. Parce<br />
qu’elle permet d’exprimer des doutes et des interrogations face au problème du Mal, la<br />
tragédie, conformément à ce qu’en dit Aristote, est plus philosophique que l’histoire 2 . Ce qui<br />
est probable, à l’issue de cette étude, c’est que Sénèque, dans son théâtre, a permis les<br />
conditions de l’assimilation de Néron à un criminel mythologique.<br />
III/ Le passage au mythe.<br />
La relation de Néron avec le spectacle n’est pas, comme on peut le dire de Caligula, de<br />
l’ordre du symptôme attestant la folie du prince et sa tyrannie. Il s’agit d’un système<br />
conscient, mis en place progressivement, avec une volonté de révolution sociale et culturelle.<br />
Mais dans les derniers mois du règne, la machine s’emballe, et Néron est emporté dans<br />
1 Cicéron, dans le De officiis, souligne que ce type de raisonnement risque de fournir des excuses à<br />
ceux qui ne désirent pas s’acquitter de leurs devoirs. Il cite l’exemple du parjure, qu’il illustre par un<br />
vers de l’Atrée d’Accius : Off. III, 28, 102 et 29, 106.<br />
2 Aristote, Poet. 1451 b 5.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
424
quelque chose qu’il ne maîtrise plus et qui l’entraîne jusqu’à la fin. Sa solitude dans ses<br />
derniers instants est comme la confirmation de son échec : lui, le prince acclamé des foules,<br />
en Grèce et à Rome, est contraint de jouer son dernier acte devant un affranchi, et de devenir<br />
son propre public. C’est à ce moment que la dimension tragique du pouvoir impérial trouve<br />
l’une de ses expressions les plus manifestes : seul, abandonné et rejeté de Rome, il se trouve<br />
dans une situation comparable à celle d’Œdipe, roi déchu devenu fléau pour son peuple, et<br />
contraint à l’exclusion de la Cité. Mais cette solitude ne doit pas faire oublier le rôle de<br />
Sénèque. Les tragédies, en effet, ne peuvent pas être mises en marge de la politique<br />
néronienne des spectacles. Dès lors, le discours qu’elles comportent sur le pouvoir est sujet à<br />
questions. En répondant aux goûts de son élève, en présentant par son théâtre une sorte de<br />
miroir tragique au prince, Sénèque contribue à l’assimilation de Néron à un personnage de<br />
tragédie, au cours même de son règne. La pratique néronienne de la tragédie, ou de spectacles<br />
qui empruntent à un répertoire commun, constitue le pivot du système, le lien entre la réalité<br />
et sa représentation. Si les tragédies de Sénèque expriment la dimension tragique du pouvoir<br />
impérial, et le caractère presque impossible et inhumain de la condition de prince, qui ne peut<br />
se dire que dans les catégories que fournit la tragédie, que révèlent-elles de la vision du<br />
pouvoir impérial par Sénèque ?<br />
A/ L’ambiguïté de la vision du pouvoir.<br />
Dans son œuvre en prose, Sénèque affirme à plusieurs reprises la nécessité pour le<br />
souverain de se conduire comme un sage ou, à défaut, d’être entouré de sages susceptibles de<br />
guider son action. Il s’agit là d’un motif traditionnel de la pensée politique romaine, hérité du<br />
stoïcisme, et que les fonctions du philosophe auprès de Néron amènent à développer. Dans les<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
425
tragédies, en revanche, cette idée n’est guère exploitée, et se trouve même mise à mal par le<br />
déroulement de l’intrigue, qui consacre l’impuissance de la sagesse à enrayer les passions qui<br />
minent les héros.<br />
1/ Le chœur et les limites de la philosophie.<br />
C’est le chœur qui, principalement, se fait la voix de la sagesse humaine dans les<br />
tragédies. Les choreutes appartiennent le plus souvent à l’humanité moyenne, ce sont des<br />
citoyens, comme les Thébains d’Hercule Furieux et d’Œdipe, les Athéniens de Phèdre, Les<br />
Corinthiens de Médée ou les Mycéniens de Thyeste ; des captives, comme les Troyennes de la<br />
tragédie du même nom, ou d’Agamemnon. Le chœur est une communauté humaine et<br />
politique, qui reste étrangère à la sphère étroite du pouvoir dans laquelle se nouent les<br />
intrigues tragiques dont elle subit toutefois les conséquences : ainsi, les Thébains dans Œdipe<br />
décrivent longuement les symptômes de la peste qui fait rage dans la cité, et se lamentent sur<br />
le fléau qui les accable.<br />
Stirpis inuictae genus interimus,<br />
labimur saeuo rapiente fato. 1<br />
L’emploi de la voix passive et du verbe rapere affirme l’impuissance du chœur face à des<br />
forces qui le dépassent, et souligne ironiquement le contraste avec la gloire passée d’un<br />
1 Œd. 124-125 : « Peuple de souche invincible, nous mourons, nous perdons pied, emportés par un<br />
cruel destin. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
426
peuple invaincu, et désormais au bord de l’anéantissement : Occidis, Cadmi generosa proles, /<br />
urbe cum tota. 1<br />
Dès lors, on comprend que le thème le plus chanté par le chœur des tragédies de<br />
Sénèque soit celui des dangers qui s’attachent aux hautes destinées, avec pour corollaire<br />
l’éloge d’une vie simple, éloignée des sommets exposés aux coups du destin. Les premières<br />
paroles des Mycéniennes dans Agamemnon, par exemple, dénoncent les fatigues et les périls<br />
de la royauté :<br />
O regnorum magnis fallax<br />
Fortuna bonis, in praecipiti<br />
dubioque locas nimis excelsos ;<br />
numquam placidam sceptra quietem<br />
certumue sui tenuere diem ;<br />
alia ex aliis cura fatigat<br />
uaxatque animos noua tempestas. 2<br />
L’image de la tempête et l’actualisation de la métaphore de l’élévation justifient<br />
poétiquement, selon un motif devenu traditionnel, l’éloge de la modération et de la sécurité,<br />
que le quatrième canticum d’Œdipe formule par une sententia concluant l’évocation d’Icare,<br />
qui illustre un propos similaire :<br />
1 Œd. 110 –111.<br />
2 Ag. 57-63 : « Fortune, toi qui fais voir aux rois de grands biens qui les trompent, tu places tout au<br />
bord du gouffre ceux que tu as trop élevés ; jamais les trônes ne connaissent ni un repos paisible ni un<br />
jour de sûreté ; l’un après l’autre les soucis les accablent, et une nouvelle tempête tourmente sans cesse<br />
leur âme. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
427
Quicquid excessit modum<br />
pendet instabili loco. 1<br />
Le thème, récurrent dans les parties lyriques, des dangers liés aux conditions élevées, fait<br />
alors contrepoint au sort des héros tragiques, qui justement se trouvent exposés, sur ces<br />
hauteurs périlleuses, aux catastrophes à venir.<br />
Peut-on parler pour autant de la sagesse du chœur ? On trouve bien dans Phèdre une<br />
méditation sur la Providence, assez proche du début du De prouidentia 2 . La royauté du sage,<br />
que célèbre le deuxième canticum de Thyeste, fait écho, à bien des égards, aux théories du De<br />
clementia 3 . Mais la sagesse du chœur n’est pas celle de Sénèque, même si on retrouve<br />
naturellement des thèmes communs dans les tragédies et dans les traités. Principalement,<br />
l’orientation philosophique du chœur, si l’on peut dire, s’articule autour de deux thèmes<br />
complémentaires : la condamnation des passions d’une part, l’éloge de la modération et de la<br />
sécurité d’autre part. Finalement l’humanité moyenne que représente le chœur manifeste le<br />
plus souvent une aspiration anti-tragique, dans la mesure où elle revendique des valeurs et un<br />
modèle qui ne sauraient s’accommoder des choix et des actions des personnages. Ainsi, la<br />
préférence pour un sort obscur et une destinée modeste, motivée par les dangers que la fortune<br />
trompeuse et instable réserve à quiconque aspire aux hautes destinées, fait l’objet du premier<br />
1 Œd. 909-910 : « Tout ce qui dépasse la mesure chancelle au bord d’un précipice». Hécube exprime la<br />
même idée au début des Troyennes : non umquam tulit / documenta fors maiora, quam fragili loco /<br />
starent superbi (Tro. 4-6).<br />
2 Phaed. 959-988 : les questions posées et les doutes exprimés dans ce canticum (pourquoi, alors que<br />
le spectacle de la Nature ne révèle qu’ordre et harmonie, la fortune se montre-t-elle si capricieuse<br />
quand il s’agit des hommes ?) trouvent leur réponse dans le De prouidentia : le dieu persécute et<br />
endurcit ceux qu’il estime (IV, 7 par exemple), l’exemple de l’homme de bien accablé est profitable à<br />
tous (V), et de plus cet homme n’éprouve pas de véritable malheur (VI).<br />
3 Th. 381-403 ; Cf Clem. I, 19, 5-8.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
428
canticum d’Hercule Furieux . Ce thème traditionnel, devenu un lieu commun 1 , présente la<br />
vision de l’humanité moyenne, de laquelle Hercule va se démarquer pour son malheur.<br />
Or, le chœur dans le théâtre de Sénèque rejette les passions exactement de la même<br />
manière qu’il se tient à distance de l’action, et tout se passe comme si, dans les tragédies, la<br />
philosophie, en tant que cheminement vers la sagesse, ne pouvait être d’aucun secours à la<br />
politique. Sénèque a bien recours, dans certaines de ses pièces, aux échanges entre le chœur et<br />
l’un des personnages présents sur la scène, comme dans Agamemnon par exemple : le chœur<br />
des Troyennes, conformément au modèle sophocléen, s’adresse à Cassandre avec laquelle il<br />
désire partager la déploration des malheurs communs 2 . Dans les Troyennes, Hécube mène un<br />
kommos pathétique auquel répondent les captives 3 . Mais les parties lyriques, cantica ou<br />
monodies, particulièrement nombreuses dans le théâtre de Sénèque, contribuent souvent à<br />
retarder l’événement, tout en apportant des éléments de compréhension, en le replaçant dans<br />
un cadre signifiant 4 .<br />
Il faut souligner la relative autonomie et la longueur de ces parties, qui occupent<br />
l’espace d’une action quand elle ne se déroule pas sur scène, ou qui se développent dans un<br />
temps qui correspondrait à un arrêt de l’action, une pause. Ces passages, relativement<br />
nombreux par rapport à l’ensemble des vers occupés par le chœur, se laissent regrouper selon<br />
trois catégories : la célébration de divinités, l’évocation d’épisodes mythologiques en rapport<br />
plus ou moins étroit avec la fabula représentée, et des méditations à coloration philosophique.<br />
1 Par exemple, Horace, O. III, 29, 9 sq… Cf Phaed. 483 sq.<br />
2 Ag. 664-92.<br />
3 Tro. 63-162.<br />
4 P. Grimal, 1978b, p. 240-245.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
429
Célébrations de divinités Evocations<br />
Développements<br />
mythologiques d’inspiration philosophique<br />
H. f. Chœur 2 : Orphée et<br />
Eurydice (569-591).<br />
Tro. Chœur 2 : méditation sur la<br />
mort (371-408).<br />
Med. Chœur 2 : l’invention de<br />
la navigation et le périple<br />
du navire Argo (301-379).<br />
Chœur 3 : la malédiction<br />
des Argonautes (607-<br />
Phaed. Chœur 1 : les pouvoirs de<br />
Cupidon (274-356).<br />
Œd. Chœur 2 : hymne à<br />
Bacchus (403-508 ).<br />
Ag. Chœur 2 : prières à<br />
Phébus, Junon, Pallas,<br />
Lucine, Apollon, Diane et<br />
Jupiter (310-387).<br />
669).<br />
Chœur 3 : histoire<br />
légendaire de<br />
Thèbes(709-763).<br />
Chœur 3 : la chute de<br />
Troie (611-658).<br />
Chœur 4 : les exploits<br />
d’Hercule (808-866).<br />
Th. Chœur 1 : le supplice de<br />
Tantale (122-175 ).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
Chœur 2 : l’œuvre<br />
destructrice du temps(736-<br />
828).<br />
Chœur 3 : le désordre du<br />
monde des hommes (959-<br />
988 ).<br />
Chœur 4 : les dangers de la<br />
grandeur, menacée par la<br />
Fortune inconstante (1123-<br />
1153).<br />
Chœur 4 : éloge de la<br />
modération, condition de la<br />
sécurité (882-910).<br />
Chœur 5 : l’ordre immuable<br />
des destins(980-997).<br />
Chœur 1 : instabilité de la<br />
fortune et dangers de la<br />
grandeur (57-107 ).<br />
Chœur 3 : savoir mourir<br />
(598-610 ).<br />
Chœur 2 : la royauté du sage<br />
(344-403).<br />
Chœur 3: l’instabilité du sort<br />
(596-622).<br />
Bien entendu, des liens évidents s’établissent entre les thèmes de ces cantica et<br />
l’action représentée : par exemple, l’évocation de la puissance de Cupidon renvoie très<br />
lisiblement à la passion qui accable Phèdre, et le rappel du supplice de Tantale replace<br />
430
l’intrigue de Thyeste dans la logique maudite de la dynastie des Atrides. Cependant, ils<br />
produisent au premier abord, sur le spectateur, un effet de rupture et de retrait. Ainsi, dans<br />
Médée, le premier canticum consiste en un chant d’hyménée en l’honneur de Jason et de<br />
Créuse 1 , qui provoque la colère de la magicienne et son désir de vengeance, exprimé dans<br />
l’acte II. Ensuite, Médée obtient de Créon un délai pour préparer son exil et dire adieu à ses<br />
enfants 2 . Puis, le roi annonce qu’il s’apprête à prendre part aux cérémonies sacrées du<br />
mariage 3 . C’est alors que prend place la deuxième intervention du chœur, qui sans transition<br />
avec l’action, évoque l’invention de la navigation et les péripéties du navire Argo. Les deux<br />
premiers mots du passage, audax nimium, désignent le premier navigateur, mais ils résonnent<br />
comme une condamnation de la décision de Créon, qui a fait taire sa terreur pour accorder à<br />
Médée ce délai, qui va lui permettre de se venger. Puis, le propos s’éloigne de la situation<br />
représentée, dans l’espace et dans le temps, et ne renoue qu’au vers 360 avec le contexte<br />
immédiat, en nommant celle qui fut le prix de la quête de la toison d’or.<br />
L’importance des parties lyriques correspond assez bien aux goûts de Néron en la<br />
matière et à ses pratiques artistiques, que l’on songe à la tragoedia cantata ou à la citharédie,<br />
dont les pièces pouvaient être composées à partir de passages des tragédies 4 . La longueur de<br />
ces chants, ainsi que leur relative autonomie structurelle et thématique, peuvent aboutir à une<br />
certaine déconnection, en particulier quand il s’agit de propos philosophiques ou moraux :<br />
généraux et prescriptifs, ils montrent finalement leur inadaptation plus que leur pertinence.<br />
Lorsque le chœur commente l’action en cours, il arrive qu’il se trompe. Un exemple<br />
particulièrement significatif est celui de Thyeste, où le chœur se caractérise par son ignorance<br />
1 Med. 56-115.<br />
2 Med. 294-295 : Etsi repugnat precibus infixus timor, / unus parando dabitur exilio preces.<br />
3 Med. 299 : sacra me thalami uocant.<br />
4 Voir supra, p. 162-165.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
431
et sa naïveté, au point que ses interventions semblent souvent en contradiction avec l’action<br />
tragique. Ainsi, dans l’acte II, Atrée dévoile son projet de vengeance à son courtisan, et insiste<br />
sur la nécessité du secret : il fait donc promettre à son interlocuteur le silence 1 . Le chœur des<br />
Mycéniens, qui enchaîne sur la célébration de la réconciliation des deux frères, paraît alors<br />
totalement dupe des machinations d’Atrée :<br />
Tandem regia nobilis<br />
antiqui genus Inachi<br />
fratrum composuit minas 2 .<br />
La transition avec la suite se fait par l’éloge d’une vie obscure et tranquille, de l’otium. Ce<br />
pourrait être précisément l’un des choix de Thyeste, qui intervient immédiatement après : les<br />
hésitations de l’exilé aux vers 412-420, rappellent les vers 391 et suivants du chœur, en<br />
posant l’alternative d’une vie obscure mais tranquille, à une gloire dangereuse. Il y a donc un<br />
lien thématique et dramatique entre le chœur et les dialogues, mais la définition de la véritable<br />
royauté, colorée de stoïcisme, et qui est en même temps une définition de la sagesse, est<br />
disqualifiée par l’état de duperie dans lequel le chœur se trouve.<br />
1 Th. 330-335.<br />
Rex est qui metuat nihil,<br />
rex est qui cupiat nihil :<br />
hoc regnum sibi quisque dat 3 .<br />
2 Th. 336-338 : « Enfin la noble dynastie, la race de l’antique Inachus a mis un terme aux menaces des<br />
frères. »<br />
3 Th. 388-390 : « Est roi qui est sans crainte, est roi qui est sans désir : telle est la royauté que chacun<br />
se donne à lui-même. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
432
Il persiste dans son erreur lors de son intervention suivante 1 : ironie tragique, il célèbre la<br />
pietas au moment même où Atrée accomplit hors scène son crime.<br />
opprimit ferrum manibusque uinctis<br />
ducit ad pacem Pietas negantes 2 .<br />
Les conseils de modération, qui reprennent ceux du chant précédent, jouent alors le rôle de<br />
contrepoint au déchaînement des passions qui se réalise ailleurs. La naïveté du chœur met<br />
alors en valeur la monstruosité d’Atrée, mais en même temps elle dénonce l’impuissance de la<br />
sagesse humaine face à ce que devient le tyran.<br />
2/ Une philosophie affaiblie.<br />
Dans les tragédies, l’insuffisance de la philosophie est surtout démontrée par la forme<br />
simplifiée et vulgarisée sous laquelle elle se présente dans le discours des personnages. La<br />
nourrice de Phèdre, par exemple, lui adresse des conseils qui rappellent au premier abord les<br />
idées de Sénèque sur les passions 3 :<br />
1 Th. 546-622.<br />
quisquis in primo obstitit<br />
pepulitque amorem, tutus ac uictor fuit ;<br />
qui blandiendo dulce nutriuit malum,<br />
2 Th. 558-559 : « La Piété fait baisser les armes, et conduit malgré eux à la paix ceux dont elle a uni les<br />
mains. »<br />
3 J. Fillion-Lahille, 1984.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
433
sero recusat ferre quod subiit iugum. 1<br />
Le développement de la passion ne peut se faire sans l’accord de la volonté, qui permet par un<br />
jugement erroné le passage de l’impetus, irrationnel et involontaire, à la passion, ne peut se<br />
faire sans l’assentiment donné par la raison 2 . Le désir, souligne Sénèque, a cette particularité<br />
qu’il se nourrit de son propre plaisir 3 , ce qui fait de lui un dulce malum, que l’on peut être<br />
tenté de laisser s’installer. Il faut donc réfréner la passion naissante, et l’empêcher de se<br />
développer :<br />
Compesce amoris impii flammas, precor 4 .<br />
La nourrice propose à Phèdre une thérapeutique comparable à celle que développe le livre III<br />
du De ira : quand la passion est installée, on peut la faire cesser par un effort de la volonté.<br />
Sénèque cite des exemples à méditer pour se garder de les suivre 5 , et la nourrice rappelle à la<br />
reine l’exemple de sa mère et les conséquences désastreuses de ses amours monstrueuses :<br />
expelle facinus mente castifica horridum<br />
1 Phaed. 132-135 : « Quiconque a résisté au premier élan et a chassé l’amour a gagné salut et victoire ;<br />
mais qui a nourri son mal délicieux par ses caresses refuse trop tard de porter le joug auquel il s’est<br />
soumis. »<br />
2 Ir. II, 4, 1.<br />
3 Ir. III, V, 5.<br />
4 Phaed. 165 : « Contiens, je t’en prie, les flammes d’un amour impie .»<br />
5 Ir. III, 20-21.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
434
memorque matris metue concubitus nouos. 1<br />
Ce discours, qui a les apparences de l’orthodoxie stoïcienne, pourrait constituer l’illustration<br />
tragique de la doctrine sénéquienne des passions : la nourrice cite des lieux communs<br />
stoïciens, en affirmant notamment que la proximité de la mort garantit le courage et la liberté 2 .<br />
Mais dans le même discours, elle admet une hiérarchie des fautes, recourant ainsi à une<br />
conception plus proche de la théorie péripatéticienne des passions, que Sénèque s’attache à<br />
réfuter dans le De ira, et qu’il conteste à plusieurs reprises dans les Lettres à Lucilius 3 . Le<br />
discours du personnage est d’autant plus suspect que son entreprise est vouée à l’échec, pour<br />
une raison qui n’est pas propre à la tragédie : la nourrice en effet présente à Phèdre un<br />
discours plein d’effets rhétoriques, dont elle exhibe la logique et la structure. Or, c’est une<br />
méthode que Sénèque rejette comme inefficace :<br />
Primam iram non audebimus oratione mulcere : surda est et amens ; dabimus illi<br />
spatium 4 .<br />
Et lorsque Phèdre parle à son tour, elle commence par affirmer l’inutilité de ces<br />
remontrances : Quae memoras scio / uera esse, nutrix 1 . La voix de la sagesse est donc<br />
1 Phaed. 169-170 : « Fais appel à ta chasteté pour chasser ce crime horrible, souviens-toi de ta mère et<br />
crains les accouplements monstrueux. »<br />
2 Phaed. 138-139.<br />
3 Phaed. 141 : pudor est secundus nosse pecandi modum, et 142-143 : Quid domum infamem<br />
aggrauas/ superasque matrem ? Maius est monstro nefas. Ep. 116, 3 et 85, 9 ; Ir. III, 3, 1. Voir J.<br />
Fillion-Lahille, 1984, p. 203. M. Armisen-Marchetti, 1992, défend la possibilité d’une double lecture<br />
de Phèdre.<br />
4 Ir. III, 39, 2 : « Nous ne tenterons pas d’apaiser par des paroles la colère naissante : elle est sourde et<br />
folle ; nous lui donnerons du temps. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
435
eprésentée par une vieille esclave qui raisonne à contre-temps, et dont les sophismes iront en<br />
s’aggravant, au moment par exemple de sa confrontation avec Hippolyte : un principe<br />
stoïcien, proinde uitae sequere naturam ducem, lui sert de prétexte à défendre un hédonisme<br />
qui n’a plus qu’une vague teinte d’épicurisme 2 .<br />
C’est donc une philosophie affaiblie qui se débat face à un ensemble de forces qu’elle<br />
se révèle impuissante à maîtriser. Les contradictions et les déchirements inhérents à l’exercice<br />
du pouvoir jaillissent de cette confrontation et de l’impossible échange entre la sagesse<br />
humaine et les lois de la royauté. Les tyrans des tragédies, qui exposent longuement leurs<br />
arguments et théorisent leur pratique, ont plus de profondeur et finalement plus de réalisme<br />
que les despotes cités dans les œuvres en prose comme exempla. Caligula et Cambyse sont<br />
interchangeables, ils n’agissent que dominés par leurs passions, sans réflexion ni hauteur de<br />
vue, alors que les criminels tragiques de Sénèque se livrent à des analyses détaillées de leurs<br />
actes et de leurs motivations. Comme la polyphonie théâtrale permet la multiplication et la<br />
confrontation des points de vue, les tragédies ne délivrent pas de message univoque, ce qui ne<br />
signifie pas qu’il faille les considérer en dehors de tout enjeu philosophique. Elles laissent la<br />
porte ouverte sur les complexités que recèle l’exercice du pouvoir et les difficultés qu’il<br />
comporte. Cette complexité, Sénèque l’a connue et rencontrée, quand il était aux affaires, et il<br />
sait que le tyran finit par s’échapper à lui-même.<br />
1 Phaed. 177-178.<br />
2 Phaed. 481.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
436
3/ Le côté obscur du pouvoir.<br />
Dans les tragédies, le pouvoir apparaît comme essentiellement corrupteur, la seule<br />
nuance pouvant être apportée par Hercule sur l’Œta dont l’authenticité est douteuse 1 . Les<br />
allusions aux empereurs autres que Néron portent en outre sur les périodes les plus sombres<br />
de la dynastie, en particulier Caligula et Tibère. En revanche, on ne trouve dans le théâtre de<br />
Sénèque aucune allusion à Auguste, alors qu’il y est abondamment fait référence dans l’œuvre<br />
en prose. Mais le côté obscur et inquiétant du pouvoir apparaît surtout dans l’insistance sur les<br />
<strong>version</strong>s les plus sanglantes des mythes, comme le montre l’exemple d’Œdipe.<br />
Dans la tragédie de Sophocle, qui a servi de modèle à celle de Sénèque, l’épisode de<br />
l’aveuglement du héros est déclenché par la découverte du corps de Jocaste, pendue à une<br />
écharpe. A la vue du cadavre, Œdipe se crève les yeux avec des bijoux arrachés aux<br />
vêtements de la morte 2 . Le récit de la mutilation proprement dite s’étend sur cinq vers 3 , et<br />
prend le sens d’une fuite du héros devant sa misère. La tragédie de Sénèque reprend ce motif,<br />
mais selon un traitement sensiblement différent. D’abord, le geste d’Œdipe, explicitement<br />
relié au furor qui s’empare de lui, précède le suicide de Jocaste, qui ne se pend pas mais se<br />
poignarde sur la scène. Ensuite, il fait l’objet d’un traitement sensiblement plus long, soit 25<br />
vers 4 . Les yeux du héros se chargent de la faute, ils sont appelés maritales oculi, en référence<br />
à l’inceste, et prennent dans le discours rapporté par le messager une autonomie, qui en fait à<br />
la fois l’objet et l’agent du châtiment, métonymie du héros qui choisit pour lui-même un<br />
supplice à la mesure de son crime.<br />
1 A. S. Pease, 1918 ; V. Jorio, 1936 ; B. M. Marti, 1949 ; E. Paratore, 1972, p. 3-44. M. Rozelaar, 1985<br />
; Sur les sources spécifiquement, voir par exemple l’édition de G. Viansiono, 1993, p. 86, note 267.<br />
2 Sophocle, Œdipe Roi, 1265-1270.<br />
3 Sénèque, Œd. 1275-1280.<br />
4 Œd. 954-979.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
437
ardent minaces igne truculento genae,<br />
oculique uix se sedibus retinent suis ;<br />
uiolentus, audax uultus, iratus, ferox,<br />
tantum furentis : gemuit et dirum fremens<br />
manus in ora torsit. At contra truces<br />
oculi steterunt et suam intenti manum<br />
ultro insecuntur, uulneri occurrunt suo. 1<br />
Par la vie que semble leur conférer les adjectifs minaces et truces, et par les mouvements<br />
indépendants dont ils paraissent animés, et qu’expriment les verbes d’action et de mouvement<br />
retinent, steterunt, insecuntur et occurrunt, ces yeux sont déjà hors du personnage, comme si<br />
le fait de les arracher n’était, en définitive, que la réalisation anatomique d’un état constaté :<br />
Le combat intérieur qui déchire le personnage est rendu par l’affrontement que se livrent sa<br />
main et ses yeux, devenues entités autonomes dans cette entreprise d’autodestruction que<br />
commande le furor.<br />
De plus, le thème de la blessure d’Œdipe, dans la tragédie de Sénèque, obéit à un<br />
mouvement inverse à ce que l’on peut lire chez Sophocle : ce n’est pas un objet qui pénètre<br />
dans le corps, ni une blessure interne, c’est un geste qui arrache, qui fait sortir : les yeux<br />
participent d’eux-mêmes à ce mouvement (occurrunt), ils sont arrachés (uulsos), évidés<br />
(euoluit), les fibres pendent (dependet) et sont rompues (rumpit) 2 . La violence du flot de sang,<br />
1 Œd. 958-964 : « ses yeux menaçants brûlent d’un feu sauvage, c’est à peine si ses globes restent dans<br />
leurs orbites ; violent, téméraire, irrité, farouche, c’est bien le visage d’un fou : il gémit et dans un<br />
terrible frémissement, il a tourné les mains vers son visage. Mais ses yeux féroces se sont dressés à<br />
leur rencontre, se tendant vers sa main et la suivant d’eux-mêmes, ils se jettent sur leur propre<br />
blessure. »<br />
2 Œd. 964, 966-67, 974-75.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
438
comme celle de la blessure de Jocaste qui rejette l’épée 1 , complète ce motif du jaillissement et<br />
de l’extraction, que conclut l’allitération expressive du vers 979 : largum reuulsis sanguinem<br />
uenis uomit. Le récit met en œuvre l’exhibition, l’étalage de la blessure, le renversement de<br />
l’intérieur et de l’extérieur correspondant au bouleversement des lois divines et humaines<br />
qu’Œdipe a causé. L’exhibition est aussi rendue dans tout le passage par la précision<br />
anatomique et l’insistance sur des gestes insoutenables, lorsque les ongles du personnage<br />
griffent le fond de ses orbites vidées par exemple 2 . Enfin, l’insistance sur la béance, le trou de<br />
la blessure, et le néant qui résulte du crime et de la folie, se révèle particulièrement dans le<br />
thème de la blessure ouverte, et du flot de sang, récurrent dans les tragédies de Sénèque 3 .<br />
Si l’on a pu voir dans la fréquence et le développement d’images horribles et concrètes<br />
une manifestation de l’influence d’Euripide 4 , radicalisée dans le théâtre de Sénèque,<br />
l’esthétique de l’horreur qui a souvent été soulignée 5 , l’insistance sur l’aspect horrible de la<br />
mort 6 et la tendance à décrire les atrocités dans le détail ont contribué pour une large part à la<br />
dépréciation de tragédies, qui s’éloignent, de ce point de vue, des principes de l’esthétique<br />
classique. Parfois qualifié de baroque, ou accusé de mauvais goût 7 , Sénèque se plaît à des<br />
1 Œd. 1040-41 : Vulneri immoritur manus / ferrumque secum nimius eiecit cruor.<br />
2 Med. 967-970.<br />
3 La description du meurtre d’Agamemnon par Cassandre est très réaliste, et deux fois plus longue que<br />
celle d’Eschyle.<br />
4 Voir le commentaire de J. G. Fitch, 1987 p. 46, à propos de l’acte IV d’Hercule Furieux et du<br />
meurtre par Hercule de ses enfants.<br />
5 O. Regenbogen, 1927/28.<br />
6 M. J. Mans, 1984.<br />
7 Récemment, des critiques ont interprété le théâtre de Sénèque à l’aune de traditions plus tardives :<br />
maniérisme (J. A. Shelton, 1979), baroque (Ch. Segal, 1984), grotesque (A.L. Motto, J.R. Clark,<br />
1978). La question de l’humour noir dans les tragédies a été posée notamment par l’article de G.<br />
Meltzer, 1988. La monstruosité du tyran trouve là une expression évidente, et c’est aussi un trait qui<br />
semble particulièrement caractériser les empereurs tyranniques. On en trouve de nombreux exemples<br />
dans les récits des historiens (Suétone, Tib. 52, 2 ; Cal. 29, 4 et 6 ; Ner. 33, 1 et 34, 9, etc.), mais aussi<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
439
descriptions expressionnistes, comme celle des enfers dans Hercule Furieux 1 , du sanctuaire<br />
du palais de Pélops dans Thyeste 2 , ou encore du cadre de la nécromancie dans Œdipe 3 .<br />
L’importance accordée à ces lieux confirme l’idée que la violence est toujours intimement liée<br />
au pouvoir. Le récit du crime d’Atrée, pris en charge par un messager, commence par une<br />
ekphrasis du palais des Pélopides, qui par un double mouvement d’assombrissement et de<br />
rétrécissement conduit au sanctuaire royal 4 . L’obscurité permanente et l’atmosphère mortuaire<br />
qui y règnent préparent le nefas d’Atrée, tout en liant étroitement la mort, la violence et la<br />
royauté.<br />
La présence obsédante de la mort et des massacres que l’on retrouve chez de<br />
nombreux auteurs du Haut-Empire 5 , a pu être reliée, historiquement, au traumatisme national<br />
qu’ont constitué les guerres civiles. Or, dans l’œuvre en prose de Sénèque, c’est la mort de<br />
Caton qui marque la véritable fin de la République 6 . Mais l’enthousiasme de Sénèque pour ce<br />
personnage, qu’il cite fréquemment dans ses traités, aux côtés de Socrate et de Régulus,<br />
confirme l’idée, qui se dégage des analyses précédentes, de la relation étroite qui s’établit<br />
entre l’horreur et l’échec politique : le suicide de Caton, en effet, est remarquable par son<br />
caractère double. On sait que le premier coup n’ayant pas suffi à le tuer, il repoussa le<br />
médecin venu l’assister et déchira ses entrailles de sa propre main 7 . C’est cette image<br />
dans les œuvres en prose de Sénèque (Ir. III, 14, 1 ; Const. XVIII, 3). L’humour noir est un signe par<br />
lequel se manifeste la monstruosité d’Atrée par exemple (Th. 976-1031).<br />
1 Herc. f. 639-827.<br />
2 Th. 641-682.<br />
3 Œd. 530-547.<br />
4 Th. 641 sq.<br />
5 J. P. Poe, 1969. P. Jal, 1963, p. 257 sq.<br />
6 Tranq. XVI, 1 : Cato ille, uirtutum uiua imago, incumbens gladio, simul de se ac de re publica<br />
palam facere…<br />
7 Plutarque, Vie de Caton, LXX.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
440
particulièrement frappante que Sénèque offre à son lecteur dans le De prouidentia 1 . Cicéron,<br />
qui, dans le De officiis, témoigne de son admiration pour Caton, ne s’étend pas sur cet aspect<br />
de sa mort 2 . Dès lors, la signification politique du spectacle de la blessure, et particulièrement<br />
du corps morcelé ou mutilé, comme signe tangible de la per<strong>version</strong> du pouvoir, se combine<br />
aux choix esthétiques de Sénèque, dont les tragédies font la part belle à ce motif.<br />
Dans le théâtre de Sénèque, c’est le pouvoir qui engendre les crimes ; politique et<br />
violence paraissent donc indissociables. La contemplation fascinée qu’induisent les tragédies<br />
va de pair avec une volonté d’exposer, d’exhiber cette violence et ce qui en résulte. Alors, le<br />
spectacle de la monstruosité du tyran et de ses actes peut-il porter en lui-même son<br />
explication, comme les entrailles des victimes, dans Œdipe, que le devin fouille pour<br />
interroger l’avenir ? Or, de même que le sacrifice divinatoire, s’il apporte des informations<br />
voilées sur le destin de Thèbes, ne répond pas à la question qui l’a suscité, les tragédies de<br />
Sénèque n’apportent pas vraiment de résolution à la crise qui a été ouverte. Le plus souvent,<br />
elles s’achèvent sur un paroxysme de tension : malédiction de Cassandre et de Thésée 3 , ironie<br />
cruelle d’Atrée 4 , meurtre triomphant et ciel vide de Médée 5 , désespoir et amertume d’Œdipe 6<br />
1 Prou. II, 11.<br />
2 Cicéron, Off. I, 112.<br />
3 Ag. 1012 ; Phaed. 1279-80.<br />
4 Th. 976-83 ; 1021-23 ; 1030-31, etc.<br />
5 Med. 1026-1027.<br />
6 Œd. 1042-1061, et en particulier les vers 1042-1046 :<br />
solum debui fatis patrem ;<br />
bis parricida plusque quam timui nocens<br />
matrem peremi : scelere confecta est meo.<br />
O Phoebe mendax, fata superaui impia.<br />
« Je ne devais aux destins que le meurtre de mon père ; deux fois parricide et plus coupable encore que<br />
je ne l’avais craint, j’ai tué ma mère : c’est mon crime qui l’a achevée. Phoebus menteur, j’ai dépassé<br />
ma destinée impie. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
441
et des Troyennes 1 . Hercule Furieux s’achève sur une défaite pour le héros, et sur une<br />
séparation pour Amphitryon. Hercule prend en effet à contrecœur la décision de continuer à<br />
vivre : il préfèrerait la mort, et ainsi il réalise les souhaits que formulait Junon dans le<br />
prologue. Finalement, la solution offerte par Thésée apparaît en quelque sorte en épilogue, et<br />
ne découle pas d’un développement dramatique, ce qui a tendance à l’affaiblir. La colère, le<br />
conflit et la souffrance restent les thèmes dominants du dernier acte.<br />
Les tragédies délivrent donc une image résolument pessimiste du pouvoir, lié, de<br />
manière presque consubstantielle, à la folie criminelle. Bien plus, aucun recours ne semble<br />
devoir être trouvé dans un monde extérieur à la tragédie, celui de la réalité contemporaine de<br />
Sénèque, d’une part parce que l’esthétique de l’horreur induit une contemplation fascinée du<br />
spectacle, et d’autre part parce que les interrelations qui s’établissent entre tragédie et réalité<br />
affirment la perméabilité de ces deux univers l’un à l’autre. Le théâtre de Sénèque permet<br />
alors d’exprimer la part d’ombre du pouvoir impérial : l’exploration de la réalité génère<br />
angoisse et fascination devant le spectacle du pouvoir absolu et des crimes qu’il engendre,<br />
dans un perpétuel recommencement dont l’éternité du mythe donne une idée. Philosophe,<br />
Sénèque s’oppose à la tyrannie, mais le poète en contemple les excès, comme si son théâtre<br />
constituait une forme de recours poétique.<br />
Pour Néron au contraire, le théâtre semble à bien des égards constituer une fuite,<br />
comme en témoigne son attitude des derniers temps : alors que Sénèque répond à une décision<br />
tyrannique par le spectacle édifiant d’une mort philosophique soigneusement préparée, Néron<br />
imagine riposter aux menaces des insurgés de Gaule en jouant l’affliction, et se préoccupe dès<br />
1 Tro. 1167-1168 : concidit uirgo ac puer ; / bellum peractum est. « une jeune fille et un enfant sont<br />
tombés ; la guerre est finie. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
442
lors de l’hymne de victoire approprié 1 . Le fait qu’il se soucie de son cortège artistique avant<br />
de faire prêter aux tribus le sacramentum est significatif dans le récit de Suétone : le spectacle<br />
prend le pas sur la réalité, dans une tentative de fuite qui se solde par une mort misérable.<br />
L’attitude de Sénèque face à la mort, si elle se veut exemplaire et se place dans la continuité<br />
des modèles de Socrate et de Caton, est avant tout celle d’un philosophe qui, ayant<br />
longuement médité le sujet, avec une insistance parfois très grande, applique dans ses derniers<br />
instants les préceptes qu’il a constamment prônés 2 .<br />
B/ Néron et le brouillage des limites de la réalité : fusion ou confusion ?<br />
Le théâtre de Sénèque présente de constants échanges entre le mythe représenté et la<br />
réalité proche ou contemporaine, qui révèlent les interactions de la tragédie et de la politique,<br />
notamment rapportées au règne de Néron. La porosité des univers politique et tragique permet<br />
au dramaturge de faire naître une réflexion sur l’un et sur l’autre, qui échappe aux<br />
développements traditionnels auxquels les œuvres en prose se consacrent. Néron, qui se vit<br />
1 Suétone, Ner. 43-45.<br />
2 Sur la mort de Sénèque, et sa conformité avec ses écrits philosophiques, on peut consulter le chapitre<br />
XI, « Mors diu meditata », de l’ouvrage de M. T. Griffin, 1976, p. 367-388. La plupart des exemples<br />
de mort volontaire dans les écrits de Sénèque sont des actes politiques de résistance à la tyrannie, alors<br />
que la morale stoïcienne propose d’autres justifications du recours au suicide, comme la pauvreté<br />
extrême ou la maladie (Ep. 30, 2 ; 98, 15-16). Il faut aussi faire la part, dans la mort de Sénèque, qui<br />
est en réalité une exécution, de la mise en œuvre littéraire, que l’on peut observer à deux niveaux :<br />
d’une part, l’évidente référence à Socrate, et la mise en scène des derniers instants montrent une<br />
dramatisation de la mort au moment de sa réalisation, et d’autre part, le motif du suicide politique est<br />
un thème littéraire qui inspire notamment Sénèque, et dont les héros, de Socrate à Caton, fournissent<br />
aux auteurs des sujets édifiants et pathétiques. Sénèque a donc participé, par ses écrits et par sa mort, à<br />
l’élaboration d’un thème littéraire et artistique : son suicide a fourni, par exemple, le sujet du concours<br />
de l’Académie en 1773, dans le cadre duquel le tableau de Peyron l’emporta sur celui de David.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
443
comme un poète et un artiste tragique, participe à cette confusion dans une large mesure.<br />
Toutefois, la démarche n’a à première vue ni la même signification ni la même portée selon<br />
qu’elle émane du prince ou de son ancien précepteur. Il semble en effet que Sénèque exploite<br />
le motif de la confusion pour exprimer ses interrogations sur le pouvoir absolu, tandis que<br />
Néron paraît subir l’effacement des frontières qui délimitent la réalité.<br />
1/ Discours impérial, discours théâtral.<br />
Lorsque, sur le point de mourir, Auguste compare sa vie à un mime 1 , il établit une<br />
distinction entre vie privée et vie publique : sa mort est l’équivalent de sa sortie de scène, pour<br />
laquelle on pouvait réclamer des applaudissements, si toutefois le spectacle avait plu. Il est<br />
tentant de comparer ce mot d’Auguste aux dernières paroles de Néron, qui s’affirme jusqu’au<br />
bout comme artifex, et refuse de distinguer théâtre et réalité 2 . Mais il faut encore distinguer<br />
les éléments comparants auxquels ont recours les deux empereurs, dans des situations à la fois<br />
proches (il s’agit dans les deux cas d’une parole conclusive, d’une clausule, référant au<br />
théâtre), et très éloignées, si l’on tient compte des circonstances dans lesquelles ces mots sont<br />
prononcés. Auguste en effet se réfère au mime, qui dès l’époque de Cicéron, constitue une<br />
métaphore habituelle de la vie, dont il imite et caricature la réalité ordinaire 3 . Lorsque Néron<br />
chante pour la dernière fois en public, c’est un vers tragique que retient Suétone 4 . Les<br />
1 Suétone, Aug. 99, 1.<br />
2 On peut citer en exemple sa réaction aux attaques de Vindex (Suétone, Ner. 41).<br />
3 Ainsi, M.-H. Garelli-François, 2001, cite Cicéron, Pro Caelio 27, 65 ; Sénèque, Ep. 26, 5 ; 80, 7-8 ;<br />
77, 20 ; 114, 6…<br />
4 Suétone, Ner. 46 : Oijktrw~~ı qanei~n mæa[gwge suvggamoı, mhvthr, pathvr.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
444
préparatifs de son bûcher sont scandés par le fameux qualis artifex pereo 1 , et il cite Homère<br />
avant de se tuer 2 . On est loin de la distance affichée par Auguste, car non seulement la citation<br />
affirme une communauté de destin entre le prince et les personnages tragiques ou épiques,<br />
mais la référence convoquée à plusieurs reprises par Néron en ses derniers moments n’est pas<br />
le mime, qui reflète davantage, tout en la déformant, la réalité ordinaire. L’univers dans lequel<br />
Néron se voit évoluer est celui, mythique, de la tragédie, à laquelle ses actes renvoient de<br />
façon constante, ce qui finit par en faire une grille de lecture pour son règne.<br />
Il n’est certes pas rare que le discours impérial se réfère à la tragédie : Tibère et<br />
Caligula en offrent des exemples 3 . Mais dans le cas de Néron, cette pratique est constante et<br />
omniprésente : il est prince en même temps qu’artiste, et cette indistinction entre les fonctions<br />
politique et artistique apparaît, par exemple, lors du couronnement de Tiridate, que Suétone<br />
compte au nombre des spectacles de Néron 4 . De la même manière, le spectacle des exercices<br />
militaires donné à la plèbe, et la récitation des poèmes du prince sont mis sur le même plan 5 .<br />
La dispersion des derniers temps donne l’image d’un Néron qui perd pied, et qui ne distingue<br />
plus la réalité du mythe. De la même manière, on oppose la sérénité d’Auguste avec<br />
l’affolement de Néron : le premier se réfère avec distance au théâtre, alors que le second<br />
semble s’y perdre, et d’une manière pathétique, il ne semble pas à la hauteur de la tragédie<br />
qu’il est contraint de jouer. Mais cet affolement et cette perte de contrôle, qui caractérisent les<br />
derniers moments du prince, ne doivent pas demeurer comme les seules mesures des rapports<br />
1 Sur cette parole, citée ou improvisée, A. Bélis, 1989a, p. 763-765.<br />
2 Suétone, 49 : ”Ippwn mæwjkupovdon ajm fi ; ktuvpoı ou[ata bavllei (Iliade, X, 535).<br />
3 Voir supra, p. 199 et 203.<br />
4 Suétone, Ner. 13 : Non immerito inter spectacula ab eo edita et Tiridatis in Urbem introitum<br />
rettulerim.<br />
5 Suétone, Ner. 10.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
445
de Néron à la fiction spectaculaire. Si la confusion semble bien, en définitive, l’emporter, sans<br />
doute à l’origine l’artifex impérial avait-il souhaité créer une fusion entre mythe et réalité.<br />
2/ Les conséquences du néronisme.<br />
La pratique artistique a évidemment une dimension politique, dans la mesure où l’art<br />
est la valeur fondamentale du néronisme. C’est pour cette raison que les éphèbes qui, au cours<br />
des spectacles organisés par le prince, dansent les pyrrhiques, obtiennent à l’issue de leur<br />
prestation la citoyenneté romaine 1 . C’est aussi sans doute ce qui explique l’attitude de Néron<br />
face à ses rivaux, et l’apparente contradiction entre son professionnalisme et ses manœuvres<br />
d’intimidation 2 . La proximité qu’il établit entre les fonctions artistique et politique donne un<br />
enjeu crucial à ses triomphes : remis en question dans son art, il est politiquement en danger.<br />
Cette dimension spectaculaire est constitutive du néronisme, mais elle finit par le dépasser.<br />
On a déjà vu à quel point la tragédie pouvait inspirer ses actions, dans des moments de crise<br />
comme l’exécution d’Agrippine.<br />
Mais le statut fictionnel du spectacle devient lui-même problématique, au point que les<br />
frontières de la réalité perdent de leur netteté, et c’est Néron lui-même qui initie ce brouillage.<br />
Suétone raconte ainsi comment, au cours de la représentation d’une comédie, l’Incendie,<br />
d’Afranius, les acteurs furent autorisés à piller le décor et à conserver les objets dérobés 3 : des<br />
accessoires quittent donc la scène, pour devenir des biens particuliers, et ils sont littéralement<br />
transportés d’un univers à l’autre. Plus encore, la démarche initiée par Néron constitue<br />
l’exacte in<strong>version</strong> d’un procédé habituel aux représentations théâtrales : une partie du butin<br />
1 Suétone, Ner. 12.<br />
2 Suétone, Ner. 23, 5 ; Dion Cassius, 63, 9, 2 ; 63, 14, 1 ; 63, 8, 5.<br />
3 Suétone, Ner. 11.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
446
emporté au cours de conquêtes pouvait provisoirement composer le décor d’une pièce. On<br />
peut également comparer les combats de gladiateurs, au cours desquels personne, pas même<br />
les condamnés, n’était tué 1 , avec la reconstitution de deux mythes grecs du cycle crétois. En<br />
effet, bien que les gladiateurs ne s’entretuassent pas systématiquement au cours des combats,<br />
la mort faisait partie du spectacle, au point d’offrir une illustration à des réflexions sur la vie,<br />
la mort et le courage 2 . Le fait de bannir l’issue fatale de ce type de spectacle tend à le<br />
déréaliser, en établissant une distance entre le combat et sa représentation 3 . Inversement,<br />
lorsque les spectateurs croient que la génisse de bois renferme une Pasiphaé, et que<br />
« l’interprète » du rôle d’Icare s’écrase réellement au pied de la tribune impériale 4 , la distance<br />
entre représentation et réalité tend à s’amenuiser jusqu’à disparaître. Lorsque Néron fait<br />
reconstituer des mythes, il les réalise, brouillant ainsi les frontières qui séparent la réalité de la<br />
représentation en les plaçant sur le même plan. De la même manière, le mythe d’Attis inspire<br />
à la fois sa tragédie et la castration du jeune Sporus, c’est-à-dire qu’il influe sur l’art et sur la<br />
vie du prince.<br />
Enfin, Néron manifeste sa volonté de donner sa vie à lire comme un mythe, en jouant<br />
des personnages qui ont un rapport avec lui. Telle serait la fonction des masques qui lui<br />
ressemblent et qu’il revêt pour interpréter ses rôles. Or, de tels masques affirment l’identité,<br />
ou au moins la ressemblance de l’acteur et des personnages qu’il interprète, mais la présence<br />
1 Suétone, Ner. 12, 2.<br />
2 Voir supra, p. 278.<br />
3 On peut lire cet épisode comme une illustration, dans le domaine du spectacle, de la clémence de<br />
Néron, et le relier à la fameuse phrase du prince qui, au moment de signer la condamnation à mort de<br />
deux criminels, s’exclame : Vellem litteras nescirem (Clem. II, 1, cf. Suétone, Ner. 10). Mais dans le<br />
récit de Suétone, ce qui pourrait effectivement passer pour une manifestation d’humanité se trouve<br />
miné par l’évocation, immédiatement après, de la représentation des mythes d’Icare et de Pasiphaé.<br />
4 Suétone, Ner. 12. Sur ces spectacles d’amphithéâtre, qu’il convient de distinguer de la pantomime,<br />
M.-H. Garelli-François, 2004, p. 359.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
447
de cet accessoire signale qu’on est dans le jeu, dans la fiction. Malgré la ressemblance<br />
affirmée, les masques de théâtre déforment les traits, et ils demeurent figés en une expression.<br />
Lorsqu’il joue ainsi masqué, Néron exhibe donc l’artifice et joue sur l’ambivalence mythe-<br />
réalité, comme s’il voulait donner à la réalité le goût du théâtre.<br />
Comme les personnages des tragédies Néron a une conscience du mythe. Il révèle dans<br />
sa pratique politique et artistique ce que Sénèque exprime dans ses tragédies : le prince est un<br />
être qui dépasse l’humanité ordinaire, son pouvoir immense fait de lui l’équivalent des dieux<br />
sur terre. Néron se veut le créateur d’un monde nouveau, il veut changer les règles et modeler<br />
le monde selon ses désirs. La Domus aurea, dont la décoration exploite le thème de la non<br />
séparation des espèces 1 , place tout un univers sous son contrôle. Le théâtre contribue à<br />
l’expression de ce pouvoir illimité, mais la réalité rappelle de manière dramatique ses droits<br />
dans les derniers instants du prince. Cet échec est aussi celui de Sénèque, si l’on se réfère au<br />
début programmatique du De clementia. Ce sont finalement les tragédies qui en disent le plus<br />
sur ce qu’est Néron. Mais en même temps, il est passé du côté du mythe, et le processus se<br />
poursuit après sa mort : il devient dans l’Octavie du Pseudo-Sénèque un personnage de<br />
tragédie.<br />
1 J. Fabre-Serris, 1999, p. 197 : « vit dans les monstra le symbole même d’une idée qui le<br />
séduisait : ces signes tangibles de l’état primitif d’indifférenciation des espèces prouvaient qu’aux<br />
origines, la nature ignorait toute règle. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
448
Chapitre 10. Au-delà des tragédies : Octavie du Pseudo-Sénèque.<br />
Octavie constitue le seul exemple de tragédie prétexte dont nous ayons conservé<br />
l’intégralité. Elle a aussi la particularité de présenter un argument emprunté à l’histoire<br />
impériale, alors que la prétexte est un genre qui se laisse plus volontiers rattacher à la période<br />
républicaine 1 . L’une de ses fonctions principales est la célébration de glorieux contemporains,<br />
au cours de jeux funèbres, par exemple 2 . Octavie ne se place manifestement pas dans cette<br />
perspective : le propos est de condamner la tyrannie de Néron, au cours d’un épisode<br />
exemplaire de son règne, la répudiation et la mort d’Octavie. Que la tragédie témoigne d’une<br />
certaine rupture avec les exigences traditionnelles du genre, en laissant de côté la célébration<br />
des héros nationaux pour se concentrer sur une rhétorique de l’opposition 3 , ou qu’elle se place<br />
malgré tout dans la continuité de ses modèles en prônant des valeurs républicaines 4 , elle<br />
demeure une œuvre singulière et mystérieuse à bien des égards. Témoignage original sur la<br />
période néronienne, cette praetexta apporte à la réflexion sur les relations du tragique et de la<br />
politique un éclairage particulier.<br />
1 La plupart des tragédies prétextes sont d’époque républicaine : les exemples à la fin de la République<br />
et au début de l’Empire sont moins nombreux.<br />
2 N. Zorzetti, 1980, p. 77. Voir supra, p. 191 sq.<br />
3 N. Zorzetti, 1980, 93-103 ; P. L. Schmidt, 1985.<br />
4 P. Kragelund, 2002.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
449
I/ Une tragédie qui reste mystérieuse.<br />
A/ Etat de la question<br />
1/ Une œuvre apocryphe.<br />
L’identification de l’auteur, ainsi que la date de composition de l’Octavie demeurent<br />
inconnues. Il est généralement admis que la pièce, qui ne se trouve pas dans la famille E des<br />
<strong>manuscrit</strong>s, datée de la fin du XI e siècle, mais parmi les descendants du <strong>manuscrit</strong> perdu A<br />
(qui datent au moins du XIII e siècle 1 ), n’est pas de Sénèque 2 . Des arguments historiques<br />
viennent étayer cette thèse, comme l’évocation très précise de la mort de Néron, postérieure à<br />
celle de Sénèque, par l’ombre d’Agrippine 3 , et dont les circonstances sont annoncées avec<br />
trop de précision pour que l’on puisse en attribuer l’annonce à Sénèque qui n’en fut pas<br />
témoin. De même, il paraît très improbable que le philosophe soit l’auteur d’une pièce dans<br />
laquelle il figure en tant que personnage : Cornelius Balbus s’était lui-même représenté en 43,<br />
dans une pièce de sa composition, mais une lettre d’Asinius Pollion à Cicéron 4 , dénonce le<br />
1 O. Zwierlein, L. A. Senecae tragoediae, Oxford, 1993, p. 53-59.<br />
2 Une petite minorité l’attribue encore à Sénèque : L. Y. Whitman, 1978, dans son édition commentée<br />
de l’Octavie, G. Gamba, 2000, p. 68-76. S. M. Goldberg, 2003, p. 13-17, rappelle au contraire les<br />
arguments historiques qui rendent peu probable cette attribution.<br />
3 Oct. 619-620. Un autre passage (Id. 629-631 ) se rapproche du récit de Suétone. On peut comparer<br />
ces vers avec le récit de Suétone, Ner. 49 (où il est question des verges, et du châtiment honteux qui<br />
attend le prince en fuite : nudi hominis ceruicem inseri furcae, corpus uirgis ad necem caedi…) et le<br />
rêve de Poppée, interprété à faux par la nourrice (Oct. 733 et 752-53).<br />
4 Fam. X, 32.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
450
idicule de la chose, et critique le personnage, montrant ainsi que la mise en scène de soi-<br />
même est davantage une faute de goût qu’un pratique admise par l’évolution du genre.<br />
Des arguments stylistiques viennent confirmer ces raisons historiques : un vocabulaire<br />
peu élaboré et répétitif, l’utilisation du seul dimètre anapestique dans les chœurs 1 , et l’abus de<br />
chevilles, comme la récurrence du réfléchi en fin de vers 2 . On peut donc considérer, avec la<br />
majorité des savants qui se sont penchés sur la question, que la tragédie n’a pas été composée<br />
par Sénèque. L’identité de son auteur, ainsi que la date de composition constitue cependant un<br />
problème qui demeure encore irrésolu, même si plusieurs pistes peuvent être explorées.<br />
2/ Date et circonstances de la composition : quel public ?<br />
Tout d’abord, l’Octavie a dû être composée à une date proche de la mort de Néron. En<br />
effet, les personnages au début de la pièce ne sont pas nommés, et les références à l’histoire<br />
sont suffisamment allusives pour que l’on suppose de la part du spectateur une connaissance<br />
précise des événements et de leurs acteurs. C’est ainsi que, dans les premiers vers, Octavie<br />
fait entendre les plaintes que lui inspire son triste sort, en ne désignant aucun des personnages<br />
par son nom, mais par les liens de parenté qui l’unissent à eux : Messaline est appelée<br />
genetrix au vers 10, Agrippine nouerca et coniux aux vers 21 et 31, Claude pater et Néron<br />
tyrannus aux vers 25 et 33 3 . En outre, l’inspiration de la tragédie fait de son auteur un<br />
admirateur de Sénèque, et témoigne de l’engouement que ce dernier provoquait parmi les<br />
jeunes gens à une époque qui, si l’on en croit Quintilien, est révolue lorsque paraît<br />
1 On peut consulter les références bibliographiques sur les arguments stylistiques montrant que la<br />
tragédie n’est pas de Sénèque et postérieure à Néron dans l’article de J. A. Smith, 2003, p. 392. Les<br />
critiques de la pièce (non poétique, non dramatique) sont rappelées dans la note 7.<br />
2 S. M. Goldberg, 2003, p. 18.<br />
3 J. A. Smith, 2003, p. 397.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
451
l’Institution oratoire 1 . Le règne de Néron appartient donc, pour le lecteur de la tragédie, à<br />
l’histoire très récente, et la mort d’Octavie a pu inspirer, sous le règne de Galba 2 ou de<br />
Vespasien 3 , un poète appartenant au courant pro-stoïcien et anti-néronien.<br />
3/ Pseudo-Sénèque ? Hypothèses.<br />
Mais quelle peut être son identité ? La profonde connaissance des tragédies de<br />
Sénèque, que révèle la lecture d’Octavie, et la tentation d’inclure cette pièce dans le corpus du<br />
théâtre de Sénèque, laissent penser qu’il s’agit d’un imitateur, mais l’incertitude reste grande :<br />
l’auteur de l’Octavie est-il un amateur sans grande expérience du théâtre, comme le supposent<br />
C. J. Herington et J.P. Poe 4 ? S’agit-il plutôt de P. Pomponius Secundus, comme A.<br />
Galimberti le juge probable 5 ? En l’absence de certitude, il paraît plus prudent de se contenter<br />
de définir le profil de l’auteur, d’après les éléments que nous fournit le texte. La lecture de<br />
l’Octavie témoigne d’une admiration esthétique, car l’imitation est un hommage, mais<br />
1 Quintilien, I. O. X, 1, 125-126.<br />
2 M. Wilson, 2003, p. 1-13 : selon l’hypothèse de T.P. Wiseman, (The Principal Thing, Classical<br />
Association Presidential Address, Sherborne, 2001, p. 10-14), la pièce fut jouée au théâtre de<br />
Marcellus en présence de Galba à l’ouverture des jeux plébéiens du 4 novembre 68. Cette datation est<br />
également retenue par T.D. Barnes, 1982, P. Kragelund, 2002, p. 52, et J.P. Sullivan, 1985, p. 72.<br />
3 C. Schubert, à la suite d’ O. Zwierlein (1983, 445-446), propose de dater la composition de la<br />
tragédie prétexte d’environ vingt ans après la mort de Néron, période pendant laquelle l’influence<br />
littéraire de Sénèque et le souvenir public du règne de Néron rend la pièce significative et<br />
compréhensible pour les spectateurs : C. J. Herington, 1961, p. 29 ; D.F. Sutton, 1983, p. 2 ; J.P. Poe,<br />
1989, p. 439 n. 24 ; P. Kragelund, 2002, p. 40. L’auteur de l’Octavie présume que son public connaît<br />
le contexte historique : R. Junge, 1999, p. 197-199 ; J. A. Smith, 2003. J. A. Smith en déduit que la<br />
pièce date du règne de Vespasien. Othon et Vitellius affirmant une certaine continuité avec la politique<br />
sociale de Néron, la coloration très hostile de la pièce l’aurait rendue dangereuse pour son auteur.<br />
4 C. J. Herington, 1961, p. 27 ; J.P. Poe, 1989, p. 435.<br />
5 A. Galimberti, 2002, p. 71-74 ; A. Galimberti, I. Ramelli, , 2001, p. 79-92.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
452
également politique, puisque Sénèque apparaît, dans la double scène centrale qui l’oppose à<br />
Néron, comme le dernier rempart contre le déchaînement de la tyrannie, dont la répudiation<br />
d’Octavie est le signe décisif. Son discours laisse voir un souci d’établir un consensus avec le<br />
Sénat, et une conception du pouvoir proche de celle du parti sénatorial, à laquelle s’oppose la<br />
volonté tyrannique de Néron 1 . Dans cet affrontement idéologique, si Néron a déjà sans<br />
ambiguïté adopté le point de vue du tyran, Sénèque se réfère à une théorie de pouvoir<br />
équilibré et modéré par le lien de fides unissant le souverain au Sénat et au peuple, qui ne<br />
pouvait qu’agréer aux sénateurs. Il apparaît dès lors, non pas comme un complice de la<br />
tyrannie, mais comme un opposant courageux, fidèle à ses convictions et victime de<br />
l’évolution du prince. A cet égard, l’image de Claude qui se dégage de la prétexte est bien<br />
éloignée de la caricature féroce que l’Apocoloquintose présentait, et contribue à innocenter<br />
Sénèque de l’accusation de connivence avec le tyran, à un moment 2 où la réalité de son rôle<br />
fait l’objet d’un débat 3 .<br />
Si la question de l’auteur ne peut pas être tranchée, l’état des études récentes permet<br />
tout de même de tracer la silhouette d’un imitateur de Sénèque, qui connaît précisément son<br />
œuvre, tant tragique que philosophique 4 , et qui présente à une époque relativement proche des<br />
événements une image favorable du philosophe, et surtout une vision très négative du règne<br />
de Néron. L’intention apologétique est à première vue évidente, mais quelle image de<br />
Sénèque cette tragédie donne-t-elle ? Que peut-elle apporter à notre lecture des tragédies, dans<br />
la mesure où l’imitation est le résultat d’une lecture, d’une interprétation ?<br />
1 Pseudo-Sénèque, Oct. 492-494.<br />
2 Dans les années 68-69.<br />
3 Dion Cassius (61, 10) accuse Sénèque d’être un tyrannodidaskalos, sa source est probablement Pline<br />
l’Ancien : I. Ramelli, 2002, p.75-76.<br />
4 Sur les rapports de l’Octavie avec l’œuvre de Sénèque, on peut consulter C. J. Herington, 1961, p.<br />
24-27 ; O. Zwierlein, 1984 ; J.P. Poe, 1989 ; G. Williams, 1994, p. 182-185 ; R. Junge, 1999, p. 273-<br />
285.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
453
B/ Matière historique, matière mythique : un traitement comparable.<br />
L’Octavie participe à la fusion des univers réel et mythique, dans la mesure où le sujet<br />
en est historique et politique, mais l’écriture tragique s’inspire de très près des tragoediae<br />
cothurnatae de Sénèque, dont les thèmes empruntent à la mythologie, mais aussi de l’Electre<br />
de Sophocle, dont la jeune impératrice rappelle à bien des égards la destinée 1 . Dès lors,<br />
l’histoire récente de Rome se laisse écrire sur le mode tragique, et à cet égard le propos de<br />
l’auteur de l’Octavie est proche de celui de Tacite, qui présente dans ses Annales une<br />
conception tragique des événements et des personnages de la dynastie julio-claudienne 2 .<br />
1/ Mort d’une impératrice.<br />
Dans les vers 882 à 951, le chœur inscrit la fin d’Octavie, qui constitue le sujet<br />
principal de la pièce, dans la lignée des exécutions des chefs populaires de la période<br />
républicaine 3 , et des femmes victimes de la dynastie julio-claudienne 4 . Elle-même se compare<br />
aux héroïnes de la République, modèle lointain et perdu, mais dont les valeurs restent une<br />
référence 5 , et aux femmes de sa famille qui ont subi un sort tragique 6 . Finalement, toutes<br />
intègrent la tragédie, comme équivalent au référent mythologique d’une part, et comme<br />
1 Pseudo-Sénèque, Octavie, texte établi et traduit par G. Liberman, p. XVIII de l’introduction, et la<br />
note 6.<br />
2 F. Billot, 2003.<br />
3 Les vers 882-891 font référence aux Gracques et à Marcus Livius Drusus.<br />
4 Agrippine l’Ancienne (932-940), Livia, sœur de Germanicus et épouse de Drusus (941-943), Julia<br />
(944-946), Messaline (947-951), et Agrippine (952-957).<br />
5 Virginie et Lucrèce (295-300 et 301-304).<br />
6 Agrippine l’Ancienne (932-941), Livilla (941-943), Julia (944-946), Messaline (947-951) et<br />
Agrippine la Jeune (952-957).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
454
ouage d’une implacable mécanique d’autre part. Mais les références à la mythologie ne sont<br />
pas oubliées, conformément aux exigences de la tragédie : la mention de Junon souligne ainsi<br />
le caractère impie et odieux de l’acte de Néron 1 , Philomèle apparaît comme un double<br />
impossible dans le discours d’Octavie 2 , et Electre, comme Iphigénie, sont convoquées pour la<br />
ressemblance de leur sort avec celui de la jeune impératrice 3 .<br />
Mais l’insistance sur la malédiction qui frappe la maison de Claude, thème tragique<br />
par excellence, prend tout son sens si l’on considère qu’Octavie porte sur l’extinction d’une<br />
dynastie. La situation est en effet exemplaire de la coïncidence des intrigues familiales et des<br />
affaires d’Etat qui fonde l’intrigue tragique, et que le principat vient réactualiser, sous les<br />
Julio-Claudiens en particulier : de Tibère à Néron, la Respublica était devenue comme la<br />
propriété d’une même famille, qui en avait confisqué la domination 4 . Le caractère politique<br />
des mariages, adoptions et filiations, était déjà sensible au temps de la République, lorsque les<br />
familles dirigeantes se partageaient le pouvoir, mais avec l’établissement du principat, les<br />
alliances stratégiques tendent à se concentrer au sein de l’une d’entre elles. Et comme pour<br />
affirmer davantage cette concentration, les liens qui unissent les membres d’une même<br />
famille se multiplient et se superposent : ainsi, Néron est d’abord le cousin d’Octavie, avant<br />
de devenir son frère adoptif, puis son mari. La conjonction du statut d’époux à celui de frère<br />
dénonce cette aliance comme impossible, comme une dévaluation des liens les plus sacrés, et<br />
l’union du frère et de la sœur est, comme il se doit, maudite, et propre à inspirer un poète<br />
tragique. Le meurtre 5 qui a permis ce mariage s’inscrit en outre dans une succession de crimes<br />
1 Oct. 201-221.<br />
2 Oct. 6-8 et 915-923.<br />
3 Oct. 59-64 et 975-980.<br />
4 Tacite, Hist. I, 16.<br />
5 L’élimination de Lucius Julius Silanus, fiancé d’Octavie : Oct. 145-146 ; Suétone, Claud. 29 ; Tacite,<br />
Ann. XII, 8.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
455
de sang, dont les auteurs deviennent à leur tour les victimes. Pour la nourrice, la source des<br />
malheurs qui frappent la maison d’Octavie est justement un mariage incestueux, le « flambeau<br />
du déplorable mariage » de Claude et d’Agrippine 1 : Hinc orta series facinorum.<br />
Le tragique, qui se nourrit volontiers d’in<strong>version</strong>s et de paradoxes, naît en partie du<br />
fait que cette union, loin de se voir renforcée par la superposition des alliances entre les<br />
personnages, aboutit à leur déchirement par leur multiplication même. De fait, Néron, comme<br />
Octavie, aspire à l’arrachement. Celle-ci tente, dans son discours, l’impossible distinction du<br />
familial et du politique : alors qu’elle multiplie les termes de parenté dans ses lamentations,<br />
évoquant tour à tour sa mère, son père et son frère, elle ne désigne Néron que dans des termes<br />
politiques et moraux, l’appelant tyran, fléau, ignoble assassin 2 . Lorsque la nourrice appelle<br />
Néron uirum, Octavie répond en comparant à un fauve celui qu’elle nomme saeuus tyrannus.<br />
Et quand elle invoque son statut d’époux, c’est pour mieux souligner la monstruosité du crime<br />
et des menées de Poppée 3 , ou pour opposer son mari criminel à son frère assassiné 4 .<br />
Cependant la situation impose à Octavie l’unité des différentes facettes de Néron : scelestus<br />
coniux, il est aussi nefandus princeps 5 .<br />
Néron lui aussi s’applique à nier les liens qui l’unissent à sa sœur, cousine et épouse :<br />
lorsque Sénèque fait l’éloge de cette union en la rapportant à l’inceste divin de Junon et<br />
Jupiter 6 , Néron répond en portant le doute sur la naissance d’Octavie, fille d’une mère<br />
adultère 7 . Après le soulèvement du peuple, il exige l’exécution de sa sœur : caedem sororis<br />
1 Oct. 141-145.<br />
2 Oct. 31-32 : seruitque domus / cum prole tua capta tyranno ; v. 86-88 ; v. 110, etc. ; hostis, v. 63 et<br />
110 ; auctor infandae necis, v. 114.<br />
3 Oct. 133.<br />
4 Oct. 222-226.<br />
5 Oct. 226 et 227.<br />
6 Oct. 533-535.<br />
7 Oct. 536.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
456
poscit 1 . Octavie est donc véritablement un personnage tragique, dont le destin s’inscrit dans la<br />
malédiction qui frappe sa famille ; et dans le discours du chœur et des personnages, histoire et<br />
mythologie se mêlent pour donner au mythe l’actualité de l’histoire, et à l’histoire,<br />
l’universalité et l’intemporalité du mythe.<br />
2/ La tyrannie de Néron.<br />
Le destin d’Octavie se prêtait fort bien à la mise en œuvre tragique. Mais les sphères<br />
politique et privée sont à ce point indissociable dans l’entourage impérial, que la pièce traite<br />
naturellement, et simultanément, du gouvernement de Néron. L’autre sujet de la tragédie est<br />
donc la tyrannie, et la critique d’une époque et d’un régime, qui prend la forme de<br />
l’opposition de deux idéologies, celle de Sénèque et celle de Néron, théoricien et praticien du<br />
despotisme. La tyrannie de l’amour qui mène à la tyrannie politique, constitue l’unité de<br />
l’ensemble. La parenté de Néron et des tyrans de tragédie est, du reste, clairement affirmée<br />
dans la prétexte, et le prince trouve sa place parmi les criminels mythologiques. Ainsi,<br />
l’ombre d’Agrippine, qui paraît au début de l’acte III, lorsqu’elle exhale ses plaintes devant<br />
les forfaits de son fils, le voue à un châtiment qui le ferait rejoindre les coupables suppliciés<br />
dans le Tartare.<br />
Vltrix Erinys impio dignum parat<br />
letum tyranno, uerbera et turpem fugam<br />
poenasque quis et Tantali uincat sitim,<br />
dirum laborem Sisyphi, Tityi alitem<br />
1<br />
Oct. 861.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
457
Ixionisque membra rapientem rotam. 1<br />
Le châtiment des criminels dans le Tartare est explicitement lié à la tyrannie dans Hercule<br />
Furieux : à la question d’Amphitryon, Thésée répond par les exemples d’Ixion, Sisyphe,<br />
Tithyos et Tantale, illustrant l’idée que les tyrans paient pour des crimes si anciens qu’ils<br />
peuvent eux-mêmes les avoir oubliés 2 . De même, Médée invoque pour Créon, qu’elle<br />
présente comme un tyran, un sort comparable à celui des suppliciés du Tartare 3 , qui servent<br />
généralement de référence aux rois dont on appelle le châtiment.<br />
De plus, la caractérisation de Néron est proche de celle d’Atrée. Ainsi, lorsque ce<br />
dernier apparaît, au vers 176 de Thyeste, sa colère l’incite au crime, et il s’irrite de n’avoir<br />
pas encore réalisé une vengeance digne de lui, et à la hauteur de la faute qu’il a subie :<br />
Ignaue, iners, eneruis et, quod maximum<br />
probrum tyranno rebus in summis reor,<br />
inulte, post tot scelera, post fratris dolos<br />
fasque omne ruptum, questibus uanis agis,<br />
iratus Atreus ? 4<br />
1 Oct. 619-623 : « La Furie vengeresse prépare au tyran une fin digne de lui, des coups, une fuite<br />
honteuse et des châtiments qui laissent loin derrière eux la soif de Tantale, les terribles efforts de<br />
Sisyphe, l’oiseau de Tityos et la roue qui emporte les membres d’Ixion. » Sauf indication contraire, la<br />
traduction des passages d’Octavie est celle de G. Liberman.<br />
2 Herc. f. 750-759.<br />
3 Med. 740-749.<br />
4 Th. 176-180 : « Lâche, faible, impuissant, et, ce que je considère comme la pire des hontes pour un<br />
tyran au sommet du pouvoir, sans vengeance, après tant de crimes, après les fourberies de ton frère, et<br />
l’abolition des lois les plus sacrées, tu te laisses aller à des jérémiades, et c’est là ta colère, Atrée ? »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
458
Dans l’acte V de l’Octavie, la réaction de Néron au soulèvement populaire en faveur de son<br />
épouse s’exprime dans des termes qui rappellent les imprécations d’Atrée :<br />
O lenta nimium militis nostri manus<br />
et ira patiens post nefas tantum mea,<br />
quod non cruor ciuilis accensas faces<br />
extinguit in nos, caede nec populi madet<br />
funerea Roma, quae uiros tales tulit ! 1<br />
L’ira patiens oxymorique de Néron répond à l’ironique iratus Atreus de Thyeste, et l’attitude<br />
du tyran, qui en appelle au furor destructeur permettant à la vengeance de s’accomplir définit<br />
l’un et l’autre comme un furiosus prêt à accomplir un crime inouï : le festin de Thyeste dans<br />
un cas, l’incendie de Rome dans l’autre 2 . D’autres correspondances, fort nombreuses, entre le<br />
discours de Néron et les paroles des tyrans criminels de Sénèque, viennent confirmer cet<br />
aspect de la caractérisation du Néron de l’Octavie : dans le dialogue Sénèque-Néron d’une<br />
part, et dans celui qui oppose Atrée à son serviteur d’autre part, les maximes d’apaisement et<br />
de politique raisonnable du courtisan font face aux sentences tyranniques. On retrouve ainsi<br />
dans l’une et l’autre pièce l’opposition de la crainte et de la fides comme principes de<br />
gouvernement. Les deux notions s’opposent nettement lorsque, dans un même vers de<br />
1 Oct. 820-824 : « Trop légère la main de ma soldatesque et trop faible mon courroux devant un tel<br />
crime, puisque le sang du peuple n’a pas éteint les brandons allumés contre moi, puisque Rome, la<br />
mère de ces révoltés, ne baigne pas dans le sang du carnage. »<br />
2 Rappelons l’anachronisme qui fait de l’incendie de Rome la réponse de Néron à la faveur populaire<br />
qui entoure Octavie : Rome brûla en juillet 64, deux ans après la mort de la jeune impératrice. Les<br />
événements sont au service du discours politique.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
459
l’Octavie, chacun des deux protagonistes fait de l’une d’entre elles le sujet de la proposition<br />
tuetur principem :<br />
NER. Ferrum tuetur principem. SEN. Melius fides. 1<br />
Ferrum, qui désigne par métonymie la politique de la terreur, et fides se font face de manière<br />
symétrique. L’antithèse, que renforce la concentration de l’expression, se superpose à<br />
l’affrontement de Sénèque et de Néron, qui représentent deux manières de gouverner<br />
diamétralement opposées. La dialectique de la crainte et de la fides était exprimée dans le<br />
Thyeste de Sénèque par le courtisan d’Atrée, dont les propos servent de conclusion au long<br />
échange qui a vu l’élaboration de la vengeance royale, considérée comme la garantie de sa<br />
conservation et de sa stabilité. 2 Dans Thyeste, la contradiction est peut-être plus intéressante<br />
dans la mesure où elle ne recouvre pas l’affrontement de deux personnages : intégrée au<br />
discours du courtisan, qui a pourtant essayé de dissuader Atrée de mener à bien son projet,<br />
elle affirme malgré tout la supériorité de la fides, cette relation bivalente de confiance et de<br />
loyauté, dont nul roi ne saurait se passer, au-delà de la terreur et de la tyrannie.<br />
Enfin, dans la scène qui oppose Sénèque et Néron, il faut faire la part du conflit de<br />
génération qui amène un jeune souverain à affirmer son autorité en se rebellant contre<br />
l’ascendant d’un précepteur et ministre bien plus âgé. Cet aspect de la relation du prince et du<br />
philosophe tend à souligner et à expliquer leur rupture, et contribue à la dimension<br />
1 Oct. 456 :<br />
2 Th. 334-335 :<br />
« NERON. - Le glaive protège le prince.<br />
SENEQUE. - La confiance le fait mieux. »<br />
Haud sum monendus : ista nostro in pectore<br />
fides timorque, sed magis claudet fides<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
460
apologétique de la prétexte. On se rappelle l’échange entre Agamemnon et Pyrrhus, au début<br />
des Troyennes, au cours duquel, encore une fois, deux conceptions du pouvoir sont<br />
confrontées. Agamemnon, en souverain que l’expérience a rendu sage, attribue les<br />
inclinations tyranniques de Pyrrhus à son jeune âge autant qu’à son ascendance :<br />
Iuuenile uitium est regere non posse impetum ;<br />
aetatis alios feruor hic primus rapit,<br />
Pyrrhum paternus. 1<br />
Ne pas freiner l’impetus, ce premier mouvement involontaire de l’âme, quand il en est encore<br />
temps, conduit à terme la passion à se développer au point de devenir irrépressible, et, du<br />
feruor au furor, le chemin semble tracé pour Pyrrhus, ce que confirmera la suite de la<br />
tragédie. Le Sénèque de l’Octavie propose à Néron un avertissement similaire, et l’on<br />
retrouve dans la sententia qu’il prononce au vers 446 le verbe regere et l’adjectif feruidus<br />
dérivé de feruor :<br />
Regenda magis est feruida adolescentia. 2<br />
Sénèque se présente ainsi clairement comme un rempart contre la tyrannie, et la rupture qui<br />
suit est comme la confirmation de la dérive despotique dont l’assassinat d’Octavie marquera<br />
le point de non-retour.<br />
1 Tro. 250-252 : « C’est un défaut de la jeunesse que de ne pouvoir diriger ses élans ; les autres se<br />
laissent emporter par cette ardeur première de leur âge, Pyrrhus par celle de son père. »<br />
2 Oct. 446 : « Plus que tout l’ardente jeunesse doit être dirigée. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
461
Néron est donc caractérisé comme les tyrans de Sénèque, ce qui induit une certaine<br />
lecture du corpus : l’auteur de l’Octavie a dû voir se dessiner dans les tragédies les traits de<br />
Néron, et a créé son personnage à partir des modèles sénéquiens. Un tel réquisitoire contre la<br />
tyrannie simplifie toutefois les personnages et leurs relations, car ils sont au service d’une<br />
thèse que la tragédie prétexte entend démontrer. La condamnation de Néron sert elle-même<br />
une apologie de son ministre, qui est posé comme une des victimes du despote et de sa folie 1 .<br />
Dès lors, on peut considérer que l’Octavie contribue à la vision tragique que nous avons du<br />
règne de Néron.<br />
II/ La question de l’image de Sénèque 2 dans l’Octavie.<br />
La tragédie du Pseudo-Sénèque s’articule autour de l’opposition de la figure du tyran<br />
et de celle du philosophe. Dans la double scène consacrée à leur affrontement, Sénèque tente<br />
vainement de faire revenir Néron sur sa décision de répudier Octavie, puis il disparaît<br />
définitivement de la scène, comme l’Agamemnon des Troyennes à l’issue du débat qui le<br />
confronte à Pyrrhus. La fonction du personnage de Sénèque dans la pièce est donc double : il<br />
permet d’une part de caractériser Néron comme un tyran, tout comme Agrippine dont le<br />
monologue répond à celui du philosophe de façon symétrique. D’autre part, son impuissance<br />
et sa résistance courageuse face à son ancien disciple doit contribuer à l’innocenter des<br />
soupçons de connivence qui pouvaient peser sur lui. Cependant, l’inefficience de son discours<br />
1 C’est aussi pour cette raison que l’on ne peut voir dans les tragédies de Sénèque un théâtre à thèse :<br />
la complexité le défend.<br />
2 M. Armisen-Marchetti montre que les paroles de Sénèque sont un montage de thèmes et de<br />
réflexions tirés des œuvres philosophiques, et que le sens en est parfois dénaturé : M. Armisen-<br />
Marchetti, 1998.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
462
finit par le décrédibiliser, et par l’affaiblir, comme si l’apologie ne pouvait se réaliser qu’à ce<br />
prix.<br />
A/ Le problème de l’action politique.<br />
L’étude de la vie de Sénèque et de son action politique dans l’entourage de Néron a<br />
montré, à bien des égards, le pragmatisme de Sénèque et sa capacité à faire face aux<br />
différentes crises qu’il a contribué à résoudre 1 . Or dans son monologue, et dans son débat<br />
avec Néron, il a recours à des développements cosmiques et à des sentences de philosophie<br />
générale, et n’oppose pas au prince les arguments politiques qui pourraient ébranler sa<br />
décision. Ainsi, pour le dissuader de répudier Octavie, il insiste sur l’immaturité de l’amour<br />
dans la jeunesse, vante les qualités traditionnelles d’une épouse, probitas, fides, mores, pudor,<br />
plus importantes que la beauté 2 , et se livre à des considérations généralisantes sur la puissance<br />
de l’amour qui rappellent les propos de la nourrice de Phèdre 3 . L’attachement du peuple à la<br />
jeune impératrice, qui constitue un argument plus consistant, a surtout une fonction<br />
dramatique, en annonçant le soulèvement du peuple en faveur d’Octavie, qui décidera le<br />
prince à la répression. Néron, au contraire, est dès l’abord engagé dans l’action : ses premières<br />
paroles sont performatives, puisqu’il s’agit d’un ordre d’exécution :<br />
1 On songe principalement à la mort d’Agrippine dont la responsabilité est attribuée au seul Néron :<br />
Oct. 593-613.<br />
2 Oct. 538-539 et 547-550.<br />
3 Oct. 557-565 ; Phaed. 195 sq.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
463
Perage imperata : mitte, qui Plauti mihi<br />
Sullaeque caesi referat abscisum caput. 1<br />
Sénèque se comporte donc en philosophe et non en ministre, et ce faisant il montre<br />
l’inadéquation du discours philosophique à la politique.<br />
De même, les termes dans lesquels l’exil est rappelé peuvent surprendre lorsqu’ils sont<br />
prêtés à un homme qui, comme on le sait, a durement ressenti les huit années qu’il s’est vu<br />
contraint de passer en Corse, ce dont témoigne la supplique qu’il adresse indirectement à<br />
Claude dans la Consolation à Polybe. Or, ses réflexions dans les vers 381-390 de l’Octavie<br />
sont plus proches de celles que l’on peut lire dans le De otio. On y retrouve en effet l’éloge<br />
enthousiaste de la contemplation des merveilles du cosmos :<br />
Curiosum nobis natura ingenium dedit : et artis sibi ac pulchritudinis suae conscia,<br />
spectatores nos tantis rerum spectaculis genuit... 2<br />
Les propos du personnage tragique expriment la même idée avec nostalgie 3 , et rappellent que<br />
Sénèque est aussi l’auteur des Questions naturelles, même si la période à laquelle il fait<br />
référence est bien antérieure. Peut-être ces réflexions doivent-elles garder le lecteur d’oublier<br />
qu’au moment des événements, Sénèque avait en vain essayé d’obtenir de Néron<br />
l’autorisation de se retirer des affaires ? Son impuissance à arrêter Néron sur la pente de la<br />
tyrannie serait donc la confirmation de la pertinence de cette requête, à laquelle le prince avait<br />
1 Oct. 437-438 : « Voilà mes ordres, exécute-les : envoie un agent assassiner Plautus et Sulla ; qu’on<br />
m’apporte leur tête tranchée. »<br />
2 Ot. V, 3 : « La nature nous a donné la curiosité : consciente de son génie et de sa beauté, elle nous a<br />
faits pour être les spectateurs de tant de merveilles… »<br />
3 Oct. 385-387.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
464
opposé un refus menaçant. On peut voir une forme d’ironie tragique dans le fait que la vie<br />
politique de Sénèque se déroule entre un exil forcé et une retraite interdite, comme si sa<br />
participation aux affaires relevait d’une tentative impossible de forcer le destin… Mais ces<br />
premières paroles du philosophe font également écho aux hésitations que formule Thyeste,<br />
lorsqu’il apparaît pour la première fois dans la tragédie de Sénèque 1 : l’exil figure, dans l’un<br />
et l’autre cas, l’éloignement de la vie politique, et la sécurité qu’il confère. Et pour Thyeste<br />
comme pour Sénèque, cette nostalgie est aussi ann onciatrice d’échec.<br />
B/ Limites de l’apologie.<br />
Le personnage de Sénèque dans l’Octavie occupe donc une fonction de repoussoir, et<br />
permet de montrer la nature profondément perverse de Néron. Il échoue, comme la nourrice<br />
de Phèdre, à persuader Néron de résister à la tyrannie de l’amour. Il semble prisonnier de la<br />
sagesse qu’il professe, et se montre incapable d’adapter son discours à la situation. Certes,<br />
laisser Sénèque à la philosophie est un moyen de le figer en modèle du sage, et de le<br />
dédouaner de la tyrannie de Néron. Pourtant, cet échec de la philosophie est aussi celui de<br />
Sénèque, qui se voit rabrouer comme un vieillard importun 2 .<br />
L’évocation préalable de l’exil le présente dès le début en retrait de la crise qui se<br />
noue, comme si cette aspiration à l’éloignement le plaçait déjà en marge des événements. Puis<br />
le dialogue présente tous les écueils de la relation du pouvoir et de la sagesse : l’impuissance,<br />
l’inadaptation, et finalement l’échec, puisqu’il s’achève sur la décision de Néron de fixer au<br />
1 Th. 417-420.<br />
2 Oct. 445.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
465
lendemain la date du mariage : loin d’avoir pu éviter la catastrophe, Sénèque n’a fait que la<br />
précipiter.<br />
L’impuissance de la sagesse, et plus particulièrement la faiblesse de la philosophie<br />
face au tyran est un thème que l’on retrouve dans les tragédies 1 . L’échec de Sénèque est aussi<br />
celui d’Agamemnon face à Pyrrhus, du courtisan face à Atrée et, on le devine, de Jocaste face<br />
à Etéocle. Finalement, dans l’Octavie, Sénèque incarne les contradictions que ses propres<br />
tragédies avaient esquissées. Dans la prétexte, le personnage de Sénèque est donc à la fois<br />
magnifié par la stylisation, qui fait de lui le modèle du philosophe pur, sans compromission, et<br />
dévalué dans son incapacité à être aux prises avec la réalité politique, lorsqu’il reprend à son<br />
compte l’argumentation d’une nourrice à propos de l’amour, Néron le fait taire d’un desiste<br />
que l’on attendrait davantage dans le contexte d’une comédie 2 , et la succession de sententiae<br />
généralisantes et abstraites laissent l’impression d’un discours automatique et mécanique. Lui<br />
qui connaît si bien Néron, arrive à le mettre en colère et à aggraver encore la situation.<br />
Finalement l’ombre d’Agrippine, avec ses plaintes violentes et pathétiques a plus de<br />
consistance que ce Sénèque qui n’est dans cette pièce que l’ombre de lui-même.<br />
III/ Ecueils de la simplification.<br />
La confrontation, à visée apologétique, du sage et du tyran, se met en place dans le<br />
cadre d’une imitation des œuvres dramatiques de Sénèque. L’image de l’auteur des tragédies<br />
vient donc se superposer à celle du personnage historique. Ainsi, lorsque Sénèque, dans son<br />
monologue, a recours au mythe pour donner du sens à son histoire, lorsqu’il développe le<br />
1 Voir supra, p. 432 sq.<br />
2 On ne rencontre l’impératif desiste dans aucune des tragédies de Sénèque, mais à plusieurs reprises<br />
chez Plaute (Ps. 496, Ep. 40, Men. 405, Rud. 682), et dans l’Hécyre de Térence (105).<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
466
topos des quatre âges, dont le règne de Néron est l’aboutissement funeste, ne s’exprime-t-il<br />
pas, non seulement en philosophe, mais aussi en poète tragique ? C’est peut-être, au-delà de la<br />
flagornerie qui affleure dans le propos, le sens que l’on peut donner au vers 535, qui place<br />
dans la bouche de Sénèque la comparaison du couple impérial à celui, divin, de Jupiter et<br />
Junon. Alors, si la prétexte procède d’une simplification, lorsqu’elle confronte le philosophe<br />
et le tyran, elle laisse en même temps apparaître la complexité du personnage de Sénèque,<br />
philosophe, ministre et poète : comment écrit-on des tragédies quand on est soi-même<br />
entraîné dans ce qui finit par y ressembler de très près ? Comment, à l’égard des événements,<br />
se comporter avec le pragmatisme du ministre, tout en portant sur eux le regard distancié du<br />
poète ? Finalement, l’intérêt de l’Octavie ne réside peut-être pas tellement dans la<br />
condamnation du tyran, même si l’image qu’elle contribue à former n’a cessé de s’enrichir et<br />
d’inspirer les artistes, mais dans ce qu’elle révèle de la richesse et de la complexité de l’image<br />
de Sénèque.<br />
A/ L’absence de l’art.<br />
Si l’Octavie présente indéniablement un portrait charge de Néron, force est de<br />
constater l’absence d’un des motifs principaux de la condamnation de ce prince, telle que la<br />
tradition historique et littéraire nous l’a transmise. Il n’est en effet à aucun moment question<br />
des activités artistiques de Néron. Or, la place de l’art dans le néronisme est fondamentale, et<br />
les sources anciennes insistent toutes, dans une mesure plus ou moins grande, sur ce point.<br />
Plus encore, le goût du spectacle, et l’influence orientale qui l’accompagne, participent à la<br />
définition de l’empereur tyrannique, comme la débauche ou la goinfrerie, tares par lesquelles<br />
se manifeste l’arbitraire impérial. Pourquoi l’auteur de l’Octavie a-t-il laissé de côté cet aspect<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
467
de la politique néronienne qui offrait, de surcroît, de riches possibilités dramatiques?<br />
1/ Choix politiques…<br />
Des raisons politiques, liées aux conditions de réception (sur lesquelles nous en<br />
sommes réduits à des hypothèses), peuvent fournir un début d’explication, si la tragédie<br />
prétexte a été composée sous le règne de Vespasien, comme le suppose J. A. Smith 1 . Ce<br />
prince se réclame en effet de la continuité avec Claude, dont l’image dans la pièce est très<br />
positive, et à qui il dédicace un temple 2 . Cependant, sa politique sociale a des points communs<br />
avec celle de Néron : il se fait ainsi le protecteur des arts et de tous les talents 3 , il est à<br />
l’origine de la restauration du théâtre de Marcellus et donne des jeux à l’occasion de sa<br />
dédicace 4 . Suétone cite le cas d’un certain Appellaris, acteur tragique, qui s’est vu gratifié<br />
d’un don de 400 000 sesterces. Alors, la concentration de la condamnation de Néron sur la<br />
répudiation d’Octavie et la répression qui s’ensuit contribue à distinguer très nettement les<br />
deux empereurs, tout en valorisant la référence à Claude, conformément à la ligne impériale,<br />
ce qui expliquerait le silence du poète sur la politique artistique du dernier des Julio-<br />
Claudiens.<br />
2/ … ou esthétiques ?<br />
1 J. A. Smith, 2003, p. 427 ; R. Junge, 1999, p. 199-200.<br />
2 Suétone, Vesp. 9, 1.<br />
3 Id.. 18 et 19, 2.<br />
4 Id. 19, 1-2.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
468
Un autre motif de cette omission d’un aspect pourtant important de la personnalité de<br />
Néron peut être d’ordre dramatique et esthétique. Puisque la tragédie a pour sujet la fin<br />
d’Octavie, le poète a pu désirer concentrer l’action, dans le but de favoriser l’intensité<br />
dramatique et le pathétique lié au sort d’Octavie. Un tel choix, s’il sert une certaine<br />
concentration dramatique et une stylisation du personnage au service du discours tragique,<br />
contribue donc à simplifier le personnage en le plaçant en situation de rupture. Dans l’Octavie<br />
en effet, le prince évoque la solitude qui est le lot du tyran, et le thème de la rupture constitue<br />
un motif important de la pièce. Il s’agit bien sûr, en premier lieu, de la répudiation d’Octavie,<br />
sur laquelle se fonde l’intrigue de la tragédie. La séparation et la mort sont associées dans les<br />
dernières paroles de l’héroïne, pour qui le royaume des Ombres et l’île de Pandataria sont une<br />
seule et même destination 1 . Sur le plan politique, c’est la rupture avec Sénèque qui consacre le<br />
passage à l’exercice de la tyrannie :<br />
Desiste tandem iam grauis nimium mihi,<br />
instare : liceat facere quod Seneca improbat. 2<br />
La liberté revendiquée par Néron est celle du tyran, qui nie les liens réciproques, le foedus qui<br />
l’attachent à son peuple. Il en résulte l’attentat suprême, l’incendie. Sénèque apparaît donc<br />
comme l’ultime recours contre la tyrannie, celui qui essaie de conserver les liens entre Néron<br />
et Octavie, et entre Néron et son peuple. C’est ce rempart que le prince renverse d’une phrase,<br />
mettant fin à toute parole de la part de Sénèque qui disparaît alors de la scène. Dans cette mise<br />
en scène de la rupture par laquelle s’affirme la tyrannie, l’antagonisme de Sénèque-Néron, qui<br />
s’affrontent au milieu de la pièce constitue véritablement le centre de la tragédie. Dès lors,<br />
1 Oct. 958-59 et 970-71.<br />
2 Oct. 588-589 : « Mets fin à ton insistance qui me devient par trop pénible : qu’il soit permis de faire<br />
ce que Sénèque désapprouve »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
469
parler d’art ou de spectacle reviendrait à affirmer, ou à laisser voir, la proximité du prince et<br />
de son ancien précepteur, alors que tout doit les séparer. C’est bien le signe que le théâtre<br />
demeure un point commun essentiel de Sénèque et Néron, ce qui empêcherait de les<br />
distinguer et de les opposer tout à fait.<br />
B/ Personnage historique, personnage tragique.<br />
L’Octavie, qui traite d’un épisode de l’histoire récente de Rome, emprunte ses thèmes<br />
et ses références aux tragédies de Sénèque, dont les sujets sont pourtant mythologiques.<br />
Toutefois, la présence dans ces pièces de références, parfois extrêmement précises, à la réalité<br />
romaine contemporaine, avait créé les conditions d’un traitement tragique de la matière<br />
historique. De même, les allusions que l’on croit parfois discerner dans certaines tragédies à<br />
Néron, Tibère ou Caligula, préparent, et invitent même à une telle lecture. Octavie, Néron et<br />
Sénèque, Agrippine et Poppée, passent alors de l’histoire au mythe. Mais l’Octavie peut-elle<br />
pour autant répondre à la question de savoir comment on devient un personnage tragique ?<br />
1/ Octavie, ou la métamorphose d’une impératrice en héroïne tragique.<br />
Le mythe est, dans le discours d’Octavie, une référence constante à sa propre situation,<br />
et contribue à la fois à l’explication de son sort et à sa déploration. Cette double fonction de<br />
l’exemple mythologique s’affirme dès les premiers vers de la tragédie, comme s’il pouvait<br />
seul rendre compte de son malheur, et remédiait partiellement à l’insuffisance des mots et des<br />
concepts de la réalité.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
470
Age, tot tantis onerata malis,<br />
repete assuetos iam tibi questus<br />
atque aequoreas uince Alcyonas,<br />
uince et uolucres Pandionias :<br />
grauior namque his fortuna tua est. 1<br />
Mais le mythe demeure encore en-deçà de ses maux, pour Octavie : quand elle se réfère à<br />
Philomèle et Procné, elle souligne que son destin est plus cruel encore, comme lorsqu’elle<br />
invoque Electre 2 . Alors que la nourrice, dans un discours qui se veut apaisant, lui propose<br />
avec l’exemple de Junon une grille de lecture de sa situation 3 , propre à rendre intelligible et<br />
supportable sa position de femme trompée et d’impératrice bafouée, Octavie est, au début de<br />
la tragédie, du côté de l’impossible : elle exprime son malheur par des comparaisons qui ne<br />
suffisent pas à en exprimer l’intensité, et par des adynata qui révèlent la monstruosité du tyran<br />
et de ses crimes 4 . Ainsi, dans le premier acte de la tragédie, le destin d’Octavie semble<br />
pouvoir être approché par le langage du mythe, mais le mode de la comparaison dévoile son<br />
insuffisance.<br />
C’est dans les derniers vers que la comparaison se trouve réalisée, et qu’Octavie<br />
devient véritablement un personnage tragique. Ce passage d’un univers à l’autre prend la<br />
forme du départ pour Pandataria.<br />
1 Oct. 5-9 : « Allons : accablée de malheurs si grands, si nombreux, reprends la plainte qui t’est<br />
maintenant habituelle ; qu’elle laisse derrière elle la plainte des alcyons marins, derrière elle la plainte<br />
des oiselles de Pandion, car plus terrible que le leur est ton sort. »Cf. 914-923.<br />
2 Oct. 57-71.<br />
3 Oct. 201-221.<br />
4 Oct. 86-88 et 222-226.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
471
Me quoque tristes mittit ad umbras<br />
ferus et manes ecce tyrannus. 1<br />
L’exil d’Octavie a la mort pour destination, et la pièce pourrait s’achever au vers 971,<br />
dans un mouvement qui rappelle la fin des Troyennes :<br />
Armate ratem, date uela fretis<br />
uentisque, petat puppis rector<br />
Pandatariae litora terrae. 2<br />
Néanmoins, on peut remarquer un dédoublement de la conclusion de la prétexte. Les<br />
vers 970-971 constituent en effet une première clôture, mais les derniers mots vont au chœur,<br />
qui reprend les termes mêmes d’Octavie aux vers 958-959 :<br />
hanc quoque tristi procul a poena<br />
portate, precor, templa ad Triuiae. 3<br />
1 Oct. 958-959 : « Me voilà moi aussi envoyée par ce cruel tyran au funeste royaume des Ombres et<br />
des Mânes. »<br />
2 Oct. 970-972 : « Gréez le navire, mettez à la mer et à la voile ; pilote, cap sur le rivage de<br />
Pandataria ! » Cf Tro. 1178-1179 :<br />
Repetite celeri maria, captiuae, gradu :<br />
iam uela puppis laxat et classis moue.<br />
« Hâtez-vous de regagner la mer, captives : déjà les navires étendent leur voile et la flotte est sur le<br />
départ<br />
3<br />
Oct. 976-977 : « elle aussi, emmenez la, à l’abri d’un châtiment terrible, dans le sanctuaire de<br />
Diane. »<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
472
L’intervention finale du chœur, qui insiste sur le thème de l’éloignement, avec une<br />
référence à Iphigénie, confirme et précise l’association d’Octavie aux héroïnes tragiques 1 . Il<br />
souhaite en effet que la jeune femme rejoigne la fille d’Agamemnon, victime innocente elle<br />
aussi, dans le sanctuaire de Diane, pour qu’elle échappe au sort qui l’attend. Ainsi, les<br />
derniers vers de la tragédie affirment le passage d’Octavie dans le monde de la tragédie, et le<br />
départ n’est plus seulement spatial, mais poétique : entre le début et la fin de la pièce, elle a<br />
intégré l’univers mythologique, aux côtés d’Electre et des filles de Pandion.<br />
2/ Néron, ou la préexistence du mythe.<br />
Il paraît bien difficile de faire la même lecture du personnage de Néron : Octavie n’est<br />
pas, comme le Britannicus de Racine, la tragédie du monstre naissant. Lorsque la pièce<br />
commence, il a déjà toutes les caractéristiques d’un tyran tragique. Ni Atrée, ni Œdipe, ni<br />
l’usurpateur Egisthe ne sont explicitement cités, alors que le rappel de ses crimes, dans les<br />
paroles d’Octavie ou d’Agrippine, pouvait fort bien se prêter à de telles correspondances. Il<br />
est significatif que les personnages invoqués par l’impératrice soient des victimes, tandis que<br />
les criminels semblent s’effacer devant le prince. Octavie le compare bien à Typhon, qu’il<br />
surpasse par sa bestialité 2 , et Jupiter est également convoqué, comme référent politique 3 . Mais<br />
Néron, qui a déjà acquis un statut d’exemplarité, apparaît dès l’abord comme le paradigme du<br />
tyran : c’est le terme tyrannus qui le désigne la première fois au vers 33, et il n’est nommé<br />
1 Oct. 973-978.<br />
2 Oct. 238.<br />
3 Oct. 201 ; 762-777 par exemple.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
473
qu’au vers 249 par la nourrice. La comparaison aux fauves, lion ou tigre, rappelle Atrée et sa<br />
cruelle sauvagerie 1 , comme les épithètes dirus et ferus qui lui sont associées par le chœur 2 .<br />
Dans l’acte I, la maison impériale est un champ de ruines et de cendres, peuplé<br />
d’ombres. L’apparition d’Agrippine, surgie des enfers pour maudire les noces prochaines de<br />
son fils, le songe funeste que Poppée confie à sa nourrice dans l’acte III, participent à cette<br />
invasion des morts parmi les vivants condamnés. Octavie, survivante provisoire, se voit elle-<br />
même comme une ombre :<br />
Nunc in luctus seruata meos<br />
magni resto nominis umbra. 3<br />
Au début de la pièce, Néron a en effet déjà commis les crimes qui le placent au rang des<br />
criminels mythologiques les plus enducis et les plus célèbres, car le scelus ingens, qui dans les<br />
tragédies de Sénèque constitue le centre de l’intrigue, est déjà non seulement accompli, mais<br />
répété : régicide et parricide, comme Octavie le rappelle au vers 91, meurtrier de Silanus 4 ,<br />
sacrilège et matricide, Néron paraît concentrer tous les exemples de crimes inouïs dont il<br />
devient le champion.<br />
hic grauior illo pestis, hic hostis deum<br />
hominumque templis expulit superos suis<br />
1 Oct. 86-88 : Vincam saeuos ante leones<br />
tigresque truces<br />
fera quam saeui corda tyranni.<br />
2 Oct. 671-72 (dirus Nero), et 689 (ferus princeps).<br />
3 Oct. 70-71 : « Ombre d’un grand nom, je ne survis à présent que pour mes deuils. »<br />
4 Oct. 146 : pro facinus ingens.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
474
ciuesque patria, spiritum fratri abstulit,<br />
hausit cruorem matris, et lucem uidet<br />
fruiturque uita noxiam atque animam trahit ! 1<br />
Les premières paroles d’Octavie sont un constat de cette situation, une forme de bilan qui<br />
ouvre sur une déploration éternelle : Tempore ab illo lux est tenebris / inuisa magis 2 . La mort<br />
de Messaline, qui laissa le champ libre aux intrigues d’Agrippine, consacre le passage à la<br />
destruction de la maison impériale, consommée dès le début de la tragédie : cet<br />
accomplissement est exprimé dans les vers 32 et 33 par le présent seruit et le participe capta,<br />
ainsi qu’au vers 269 : perdidit lapsam domum. Ombre entourée de morts, Octavie est en<br />
sursis : de fait, le discours des personnages, dans l’acte I, est comme jonché de cadavres,<br />
comme en témoigne la récurrence du verbe iacere au présent 3 .<br />
Avec le rappel des crimes qui ont permis l’accession et le maintien de Néron au<br />
pouvoir, la tragédie offre un regard rétrospectif sur un règne qui n’est pas encore achevé, mais<br />
dont l’issue paraît inévitable. Le jugement de la postérité a déjà commencé de s’exprimer,<br />
comme l’annonce Octavie 4 . Le discours de Néron ne comporte pas semblable distance : dans<br />
des termes qui font écho aux paroles des tyrans des tragédies de Sénèque, le tyran théorise et<br />
justifie son action, sans mentionner de personnages mythologiques. Les références de Néron<br />
sont historiques : les guerres civiles et leur cortège d’exactions ont mené Auguste au pouvoir,<br />
1 Oct. 240-244 : « cet homme, fléau plus terrible (que Typhon), cet homme, ennemi des dieux et du<br />
genre humain, exila de leur sanctuaire les habitants du ciel et ses concitoyens de leur patrie, il ôta le<br />
souffle de la vie à son frère, il but le sang de sa mère, et il voit la lumière du jour, il est vivant et emplit<br />
ses poumons d’un souffle criminel ! »<br />
2 Oct. 19-20 : « Depuis lors, la lumière m’est plus odieuse que les ténèbres ».<br />
3 Oct. 32-33 : heu me, pater, insidiis / oppresse iaces… ; 45-46 : extinctus iacet / frater uenenis ; 166-<br />
167 : tu quoque extinctus iaces, / deflende nobis semper, infelix puer…<br />
4 Oct. 96-97.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
475
puis à l’apothéose 1 . Comme dans le premier chant du chœur, l’empire devient sa propre<br />
mythologie, et le règne criminel de Néron est mis en perspective dans l’histoire romaine. Il y<br />
a ainsi une forme de déplacement de l’histoire vers le mythe, à la suite de Néron qui paraît<br />
entraîner non seulement sa famille, mais Rome entière dans la tragédie. Le statut tragique de<br />
Néron ne trouve donc pas son origine dans la pièce du Pseudo-Sénèque, comme on aurait pu<br />
être tenté de le penser : c’est au contraire une donnée de base. La tragédie est possible parce<br />
que Néron est déjà un personnage de théâtre, une figure du tyran tragique comme Atrée ou<br />
Œdipe, et comme Oreste matricide dont il aimait jouer le rôle. En étendant la caractérisation<br />
tragique à Octavie, la prétexte confirme et systématise ce qui était probablement la vision<br />
historique du prince. Même si l’Octavie est sa première apparition dans une œuvre de fiction,<br />
la première d’une longue série, ce n’est pas le travail du dramaturge qui fait de Néron un<br />
personnage tragique. Ce sont les tragédies de Sénèque qui constituent la première étape de<br />
cette assimilation, que la pratique néronienne du pouvoir, et tout particulièrement sa<br />
dimension artistique, ont rendue possible.<br />
Il paraît donc bien difficile de négliger la passion de Néron pour le spectacle et pour la<br />
poésie. D’une part en effet, la présence de ce prince dans une tragédie semble constituer<br />
l’aboutissement d’un processus engagé, de son vivant, par sa propre pratique de l’art, sa<br />
volonté manifeste de se donner à voir non seulement comme un artiste, mais aussi comme un<br />
personnage de tragédie. D’autre part, la création tragique aboutit à une certaine fixation et à<br />
une stylisation du personnage qui n’est pas exempte de schématisme, et dont la conséquence<br />
paradoxale est un affaiblissement notable de la figure de Sénèque.<br />
On le voit, la condamnation de Néron et l’apologie de Sénèque dans l’Octavie se<br />
réalisent au prix d’une simplification qui se révèle à bien des égards contre-productive.<br />
1 Oct. 492-532.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
476
Toutefois la richesse de la tragédie prétexte n’en est pas pour autant annulée, car elle confirme<br />
l’intérêt une lecture politique des tragédies de Sénèque, qui en disent davantage sur les<br />
complexités du pouvoir, mais dont elle reprend et exploite des thèmes. Ensuite, elle fait<br />
formellement de Néron un personnage tragique, même si la véritable consistance de cette<br />
figure tragique du prince est à chercher dans les tragédies de Sénèque. Enfin, elle contribue au<br />
dialogue et aux échanges entre mythe et histoire, et constitue l’aboutissement du passage de la<br />
réalité au mythe, et de l’assimilation de Néron à un personnage de tragédie.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
477
Conclusion<br />
Octavie présente une image simplifiée et stylisée de Néron et de Sénèque, et de leur<br />
relation. Le philosophe et le tyran s’opposent, au centre de la tragédie, dans une posture<br />
archétypale, au service d’un discours, qu’il faudrait replacer dans le contexte politique de<br />
rédaction (c’est-à-dire, vraisemblablement, pendant la période flavienne). Il ne s’agit donc<br />
pas, à proprement parler, d’un discours sur Néron, qui sert en quelque sorte de référent à une<br />
analyse critique de la tyrannie. Avec ce personnage de monarque totalement négatif, on est<br />
loin de la complexité liée au pouvoir que l’on peut voir dans les tragédies de Sénèque : Néron<br />
apparaît comme la force maléfique qui entraîne Octavie vers son destin tragique, une image<br />
inquiétante de la Fortuna dont il se réclame à plusieurs reprises. Mû par ses passions, l’amour<br />
et la colère, il devient un fléau pour son peuple dont il fomente l’assassinat en masse.<br />
Sénèque, qui au premier abord pouvait sembler favorablement représenté dans la prétexte, se<br />
révèle, à y regarder de plus près, impuissant et déconnecté de la crise qui est en train de se<br />
nouer. Finalement, l’intention apologétique, assez visible au demeurant, ne tient pas ses<br />
promesses, et l’on voit que la stylisation du personnage, figé dans la posture du philosophe<br />
qui se dresse avec courage contre le despote, aboutit à son affaiblissement par rapport à son<br />
modèle historique.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
478
Il est intéressant, dans cette perspective, de revenir sur une tragédie dont nous avons<br />
jusqu’à présent assez peu parlé, et de justifier davantage ce silence : Hercule sur l’Œta se<br />
démarque en effet du corpus des tragédies sénéquiennes. Hercule y est présenté en état<br />
d’apothéose, et l’on a souvent pu voir en lui la représentation du sage et du héros stoïcien, qui<br />
à force d’épreuves conquiert une forme d’immortalité 1 . Si l’on compare les souffrances et la<br />
mort du personnage à l’épreuve qui attend le héros de l’Hercule Furieux, on voit que dans le<br />
premier cas c’est une épreuve externe au héros qui lui est imposée, résultat de la fourberie de<br />
Nessus et de la jalousie de Déjanire, et dont il triomphe de manière éclatante 2 . Il résiste à une<br />
souffrance extrême, et transforme ce qu’il a un instant considéré comme une suprême<br />
humiliation (le fait d’avoir succombé, après tant de victoires, à la ruse d’une femme) en une<br />
véritable apothéose qui le place au rang des dieux et parfait sa gloire à tout jamais. Sans faire<br />
l’épreuve de la faiblesse qu’induit la culpabilité, Hercule sur son bûcher propose à sa mère et<br />
au spectateur un discours édifiant 3 . Le héros d’Hercule Furieux est au contraire profondément<br />
ambigu 4 , et cette complexité du personnage, entre violence et vaillance, trouve une illustration<br />
dans le motif de sa main, qui est tout à la fois l’instrument de ses exploits et l’agent de son<br />
crime 5 .<br />
1 I. Micu, 1981. Dans le De constantia sapientis (II, 1), Sénèque expose les raisons pour lesquelles les<br />
stoïciens ont fait d’Hercule un modèle de représentation du sage : Hos enim Stoici nostri sapientes<br />
pronuntiauerunt, inuictos laboribus et contemptores uoluptatis et uictores omnium terrorum. Il est<br />
question de l’immortalité du sage notamment dans le De tranquilitate animi, 16, 4.<br />
2 Herc. Œ. 1980 : Es numen et te mundus aeternum tenet.<br />
3 Herc. Œ. 1963-1976.<br />
4 T. Papadopoulou, 2004.<br />
5 Les mains sont en premier lieu le symbole de la force herculéenne et l’agent de ses exploits : iam diu<br />
pateris manus / cessare nostras, Iuno (614-615) ; contre Lycus, le bras vengeur, ultrice dextra,<br />
constitue donc l’instrument du juste châtiment du tyran (v. 895). Quelques vers plus loin, la main du<br />
héros, souillée du sang ennemi, manantes manus cruenta caede et hostili, constitue l’annonce d’un<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
479
Comme Octavie, Hercule sur l’Œta livre plutôt des certitudes, sur le pouvoir, la sagesse, la<br />
tyrannie, sur Néron. D’un côté le héros, magnifié dans son apothéose et sa victoire sur la<br />
mort, de l’autre le tyran, qui déploie son arbitraire et sa cruauté, sont au centre de l’action,<br />
comme si la tragédie mettait en forme des postures préétablies. Or, la tragédie, et<br />
particulièrement celle de Sénèque ménage, relativement au pouvoir, l’espace du doute et des<br />
ambiguïtés qui le définissent. Le discours tragique ne délivre pas sur le pouvoir et la sagesse<br />
un discours assuré et rassurant, car la tragédie est affaire de contradictions et d’angoissante<br />
incertitude. C’est ce qui plaide, en plus d’autres arguments, pour l’attribution d’Hercule sur<br />
l’Œta à un imitateur de Sénèque, dont l’identité demeure mystérieuse. Mais entre l’apothéose<br />
du sage et l’affirmation du tyran se situent les tragédies, qui en révèlent bien davantage sur la<br />
condition impériale et, par retour, sur Sénèque et son rôle.<br />
sacrilège possible, puisque Amphitryon doit rappeler son fils à l’ordre, pour qu’il n’offre pas aux<br />
dieux un sacrifice sans s’être au préalable purifié (v. 919-920). Enfin, après que ses mains ont répandu<br />
le sang de Mégare et de ses fils, Hercule s’adresse à son père, tendant vers lui des mains suppliantes<br />
(supplices manus, v. 1192), qui deviennent rapidement suspectes (Manus refugit. Hic errat scelus, v.<br />
1193), puis assurément criminelles (non quaero manum, v. 1196) car seul le bras d’Hercule a pu<br />
bander son arc. La conclusion de cette succession de significations tient en une formule, prononcée au<br />
vers 1236, qui semble répondre aux vers 614-615 : o nouercales manus. Ainsi, les mains d’Hercule<br />
symbolisent à la fois sa vaillance et son crime, et constituent une image frappante de son ambiguïté.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
480
CONCLUSION GENERALE<br />
Le théâtre de Sénèque apparaît comme une expression privilégiée des interactions de<br />
la politique et de la tragédie. L’auteur de Thyeste et du De clementia témoigne lui-même, par<br />
sa vie et par ses œuvres, des liens indissociables et complexes qui se tissent entre ces deux<br />
domaines. La lecture des tragédies de Sénèque que cette étude a proposée, loin d’en épuiser<br />
toutes les virtualités, contribue à dégager un ensemble de significations et de pistes de<br />
réflexion. Il semble bien qu’il existe un lien entre l’activité de Sénèque comme dramaturge et<br />
la politique artistique de Néron, et que la spécificité de cette rencontre du prince et du<br />
philosophe, bien loin de se laisser réduire à des catégories données, tient à un goût commun<br />
pour la tragédie, dont on a vu qu’elle constituait la principale source d’inspiration pour les<br />
activités artistiques du prince.<br />
Le prince, le philosophe et la tragédie.<br />
D’après le jugement des anciens, les dérives tyranniques de Néron résultent de la<br />
combinaison d’une nature corrompue et d’influences néfastes. Or, l’éducation de Néron fait<br />
l’objet d’attentions : il est formé comme un Romain de haute naissance, et préparé à un avenir<br />
brillant. Le choix de ses maîtres en témoigne, et l’image du danseur et du barbier auxquels ont<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
481
aurait abandonné l’enfant résulte d’une simplification caricaturale. Loin d’être négligée, cette<br />
éducation répond à des objectifs politiques. L’enseignement de Sénèque s’inscrit dans cette<br />
stratégie, il fait du jeune Néron un orateur habile et un homme cultivé, influencé, comme on<br />
pouvait s’y attendre, par son style et ses écrits.<br />
Si la formation artistique du prince est marginale, puisqu’elle commence<br />
véritablement après l’avènement de Néron, la passion du jeune prince pour le théâtre et la<br />
poésie a pu naître à la faveur de l’enseignement de Sénèque. En effet, le hasard seul ne<br />
suffirait pas à expliquer ce goût commun, quand la poésie tragique constitue une part notable<br />
de l’œuvre du maître. En l’absence de chronologie, on ne peut proposer d’affirmation<br />
catégorique, mais un faisceau d’indices rend l’hypothèse de l’utilisation des tragédies dans<br />
son programme pédagogique vraisemblable. Tout d’abord, les tragédies ont pu être, pour<br />
partie, rédigées pendant l’exil en Corse, c’est-à-dire avant qu’Agrippine ne fasse appel à<br />
Sénèque pour lui confier l’éducation de son fils. Ensuite, si, comme Suétone le lui reproche,<br />
Sénèque a principalement proposé ses propres écrits à l’étude de son élève, les tragédies ont<br />
pu occuper la fonction traditionnelle du théâtre dans l’enseignement du grammaticus, ce qui<br />
était précisément la mission du philosophe. En outre, avec les problématiques politiques que<br />
l’on rencontre dans les tragédies, la mythologie fournit matière à l’interprétation de la réalité,<br />
et cette réflexion pouvait être bien utile dans l’éducation d’un futur prince. Enfin, la peinture<br />
des passions et les réflexions du chœur offraient une occasion d’enseigner indirectement la<br />
philosophie sans qu’Agrippine n’en prenne trop ombrage.<br />
Il n’est pas besoin pour autant de faire du théâtre de Sénèque un répertoire des fables<br />
moralisantes ad usum delphini, et de réduire la complexité de ses enjeux. Mais on peut penser<br />
que la tragédie est très tôt un mode de communication entre le maître et l’élève, ce qui<br />
confirme cette proximité entre Sénèque et Néron, qui se fonde sur la poésie.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
482
La part de l’ombre.<br />
La relation de Sénèque et Néron est principalement pensée en termes politiques,<br />
recouvrant l’opposition entre un idéal théorique et une pratique déviante du pouvoir. Une telle<br />
approche rend problématique la prise en compte des tragédies de Sénèque, et révèle par là<br />
même ses insuffisances et ses contradictions. En effet, penser Néron et son ministre selon les<br />
catégories prédéfinies du « prince et du philosophe », c’est poser comme un principe ce qui<br />
oppose Sénèque et Néron, et inscrire l’action du philosophe dans une logique d’échec et de<br />
désillusion. Pourtant, une relation s’entend comme une combinaison de distance et de<br />
proximité, surtout lorsqu’elle évolue et se développe sur une période de plusieurs années, la<br />
quasi-totalité du règne en fait. S’il y a bien un éloignement, qui aboutit à la disgrâce et à<br />
l’élimination du philosophe, il demeure cependant une proximité permanente entre ces deux<br />
personnages, proximité au centre de laquelle se place l’art.<br />
Sénèque apparaît très tôt comme un homme de pouvoir. Ce n’est pas au philosophe<br />
qu’Agrippine fait appel, mais au personnage brillant et influent, déjà familier de l’entourage<br />
impérial et, de ce fait, propre à la seconder dans ses projets. Il est, par conséquent, légitime de<br />
voir en lui le complice de la constitution du régime qui se met en place avec la succession de<br />
Claude. Dans les premières années qui suivent l’avènement de Néron, il participe à installer et<br />
à consolider le nouveau règne, et cette action s’accompagne d’une opposition grandissante à<br />
Agrippine, qui n’avait probablement pas mesuré tous les risques de sa stratégie. Ce que l’on<br />
peut savoir du rôle de Sénèque auprès de Néron montre en effet une influence importante, et<br />
une indépendance certaine face aux projets de la mère du prince. Ainsi, avec la clémence,<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
483
s’affirme une volonté de rétablir ce qui a fait la stabilité du principat sous Auguste. Mais très<br />
vite, on voit apparaître ce qui va faire la spécificité du régime impérial selon Néron : la place<br />
de l’art.<br />
Dans cette évolution, qui devient évidente après la mort d’Agrippine, l’implication de<br />
Sénèque est indéniable. On admet assez généralement que la participation du ministre aux<br />
premiers balbutiements du néronisme relève d’une stratégie de compromis, qui lui échappe<br />
peu à peu et finit par le broyer : la folie du tyran aurait eu, peu à peu, raison de la sagesse du<br />
philosophe, et renverserait les garde-fous qu’il aurait tenté d’installer. Cependant, la politique<br />
artistique du prince se développe et s’affirme à une époque où Sénèque est encore influent, ce<br />
qui porte le doute sur l’équivalence que l’on serait tenté d’établir entre le développement de la<br />
politique artistique de Néron et le déclin de Sénèque. Pendant un moment, en effet, on<br />
observe une concordance entre la puissance politique du ministre et les aspirations de Néron.<br />
Il s’agit même d’une implication consciente, à laquelle Sénèque associe ses proches. Le rôle<br />
de l’art dans la politique pourrait alors témoigner, plus que d’un compromis qui tourne mal,<br />
de la synthèse entre l’idéologie augustéenne et les aspirations de Néron. A cet égard,<br />
l’exclamation du prince, que Sénèque rapporte dans le De clementia, concentre dans cette<br />
formule inaugurale le primat de la clémence, dans la lignée d’Auguste, et la recherche du<br />
sublime dans la parole impériale.<br />
Mais la synthèse suppose un équilibre, qui au cours du règne est fragilisé pour être<br />
ensuite rompu : plusieurs étapes jalonnent cette évolution, dont l’une des premières et des<br />
plus importantes est la mort d’Agrippine. Paradoxalement, cette élimination a fragilisé la<br />
situation au lieu de la consolider. La mort de Burrus et l’influence croissante de Tigellin<br />
constituent les étapes suivantes : chacun de ces deux personnages est envisagé par rapport à<br />
Sénèque, l’un est son allié, l’autre son rival. Mais l’entrée en scène du nouveau préfet du<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
484
prétoire marque moins un changement radical qu’une dégradation. Commodément opposé à<br />
Sénèque, il n’en a cependant ni l’influence ni l’envergure, et ne semble qu’encourager la<br />
tendance de Néron à s’adonner aux plaisirs et à la débauche. L’équilibre vacille encore plus<br />
avec l’affirmation de l’émancipation de Néron. L’idée de l’échec de Sénèque est d’abord<br />
donnée par Néron lui-même, qui lui obéit de manière transgressive lorsqu’il se réjouit d’être<br />
enfin logé « comme un homme » dans son palais démesuré, et affirme la permanence de son<br />
pouvoir en l’empêchant de se retirer. Néron refuse la synthèse, car elle suppose une obédience<br />
au passé. Sa politique résolument novatrice veut se tourner vers l’avenir exclusivement, en<br />
une nouvelle définition du pouvoir et de la société. Il se veut du côté de la création, et<br />
Sénèque représente à plusieurs égards cet ancrage dans le passé dont il se détache résolument.<br />
La mort de Sénèque, relatée par Tacite, a contribué dans une large mesure à forger la<br />
figure du sage victime de la tyrannie, d’un nouveau Socrate qui conquiert la liberté et<br />
manifeste aux yeux de la postérité la cohérence et la validité de son combat politique et<br />
philosophique. Le tableau de Luca Giordano, que l’on peut voir au musée du Louvre, délivre<br />
le même message, avec les disciples au regard tourné vers le maître, serein dans<br />
l’affaiblissement ultime. Cette mort, longuement méditée, constitue avec les œuvres<br />
philosophiques le testament de Sénèque, et l’affirmation de la distance irrémédiable qui le<br />
sépare de Néron. C’est dans la posture du philosophe que l’ancien amicus principis quitte la<br />
scène, en jouant jusqu’au bout un rôle qui le fait ressembler à Socrate, le Phédon constituant<br />
sa dernière lecture. L’agonie de Sénèque pourrait nous faire oublier ses tragédies, et pourtant,<br />
à bien des égards, il faut la mettre au nombre de ses œuvres : il s’agit d’une mort longtemps<br />
méditée, préparée et mise en scène dans tous ses détails, une mort dramatique qui ne laisse<br />
rien ou presque au hasard, un matériau de choix pour Tacite. L’épisode est en effet<br />
d’importance, parce qu’il constitue une première clôture du règne de Néron, annonciatrice<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
485
d’un dénouement attendu, mais aussi, et peut-être surtout, parce qu’il laisse, sans le dire, le<br />
dernier mot à la tragédie, dans laquelle il est possible de voir la clef du personnage. Bien loin<br />
de constituer une production marginale, le théâtre de Sénèque éclaire donc son œuvre et lui<br />
confère son unité.<br />
La tragédie et l’expression du pouvoir.<br />
Au récit du règne de Néron, on peut aisément faire correspondre celui de sa carrière<br />
artistique. Alors que cette activité d’artiste constitue précisément le principal motif de<br />
condamnation du prince, signe de folie grandissante ou plan politique inopérant, le spectacle<br />
et le théâtre occupent une place centrale dès le départ. De plus, ce qui fait l’originalité du<br />
règne de Néron est aussi ce qui fait la spécificité de sa relation avec Sénèque. On peut<br />
proposer une lecture du règne sous le signe de l’art et du spectacle, ce qui montre à quel point<br />
art et politique étaient liés dans l’esprit de Néron. La dimension politique de sa pratique<br />
artistique est fondamentale.<br />
Néron se veut artifex, et il est vu comme histrio. Si ce dernier terme prend dans la<br />
bouche de ses opposants toute sa dimension d’infamie, et exprime l’incompatibilité des<br />
fonctions politique et artistique, le premier témoigne de l’ambition du prince d’égaler et de<br />
surpasser les artistes du plus haut niveau, excellence qu’il entend manifester dans les<br />
différents concours auxquels il participe lors de sa peregrinatio achaica. Ses talents, que l’on<br />
ne peut nier tout à fait, s’expriment sans doute dans une double spécialisation : la citharédie et<br />
la tragédie chantée. Néron chante donc des rôles tragiques, puisque ses deux spécialités de<br />
prédilection empruntent au même répertoire, et il participe à des spectacles comme artiste<br />
vedette, les disciplines étant d’ailleurs sans doute choisies pour le vedettariat qu’elles<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
486
confèrent. Il en résulte deux conséquences : premièrement, comme Néron est au centre du<br />
spectacle, vedette et vainqueur systématique, sa fonction artistique est à l’image de sa<br />
fonction politique. Deuxièmement, la recherche de l’illusion dramatique, au moins dans la<br />
tragédie chantée, témoigne de l’intérêt de Néron pour l’élément scénique. Dès lors, le choix<br />
des rôles et des chants interprétés peuvent être mis en relation avec sa fonction de prince. En<br />
effet, les faits marquants de la vie de Néron sont fréquemment soulignés par la création<br />
poétique. Il répond aux cataclysmes (l’écroulement du théâtre de Naples), et à ses ennemis<br />
(Vindex) par la poésie. En outre, les rôles qu’il joue ont parfois un rapport avec son destin :<br />
c’est le cas d’Oreste ou d’Œdipe.<br />
Tout ramène donc à la tragédie. Au centre de la vie du prince, elle est aussi au cœur de<br />
sa condamnation par ses contemporains comme par la postérité : si la critique esthétique tire<br />
Néron vers le grotesque et la caricature, la critique politique, la plus fondée, et la plus<br />
signifiante, dont la critique artistique elle-même dépend, peut être envisagée selon une<br />
perspective tragique : les tensions se nouent en effet entre deux points de vue. Pour Néron, art<br />
et politique sont indissociables, pour ses détracteurs, ils sont inconciliables. C’est ce jeu de<br />
tension, plus que la mort du prince ou ses crimes, qui donne au règne de Néron sa dimension<br />
tragique. On serait tenté de reprendre le mot célèbre de Marx, selon lequel tous les grands<br />
personnages se répètent toujours deux fois : la première fois comme tragédie, la seconde fois<br />
comme farce, à cette différence près que dans le cas de Néron, farce et tragédie sont deux<br />
manières d’envisager le même personnage, dont la mort constitue la résolution du conflit.<br />
Les relations entre la tragédie et la politique, révélatrices des crises et des tensions du<br />
règne de Néron, trouvent une illustration dans les tragédies de Sénèque, qui s’inscrivent dans<br />
une tradition qu’elles contribuent à renouveler et à enrichir. Politique et tragédie sont en effet<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
487
étroitement liées dans l’histoire du théâtre, et ce que nous connaissons du répertoire romain,<br />
depuis la République, confirme cette relation. Les échanges sont de deux ordres : d’abord, une<br />
relation liée à l’essence du genre. La tragédie traite de conflits qui se nouent dans la sphère<br />
étroite du pouvoir, où enjeux privés et politiques se confondent. Elle soulèvent donc des<br />
problèmes tels que l’exercice du pouvoir, la succession, la tyrannie. Ensuite, la place du<br />
théâtre dans la vie civique connecte ces enjeux à l’actualité : c’est une prise de parti assumée<br />
par les auteurs, et attendue par le public. Le matériau mythique à l’origine de l’intrigue<br />
tragique contribue ainsi à l’interprétation de la réalité, en conservant néanmoins sa complexité<br />
et ses ambivalences.<br />
Dans son œuvre en prose, Sénèque convoque fréquemment les poètes à l’appui de ses<br />
réflexions. En cela, il n’est ni le premier ni le seul à établir l’assimilation du chef tyrannique<br />
aux monstres tragiques. Les tragédies offrent une réflexion sur le pouvoir impérial, qui, sans<br />
être normative ni prescriptive, en explore les limites et les zones d’ombre. Comment dire la<br />
réalité du principat, si ce n’est en recourant à la tragédie qui permet d’en réintroduire le<br />
caractère passionnel et les contradictions irréductibles ? Dévoilant l’impuissance de la sagesse<br />
humaine, et de la philosophie qui aspire à la conquérir, elle ouvre sur l’échec, la violence et la<br />
mort. Cette angoisse doit être prise en compte dans la vie politique de Sénèque. Certains<br />
membres de l’entourage du prince lui reprochaient de s’être mis à composer des vers plus<br />
fréquemment, depuis que Néron en avait pris le goût. On a souvent supposé qu’il était fait<br />
allusion aux tragédies, dont une partie a pu être rédigée pendant cette période. Mais comment<br />
expliquer cette intensification de la production dramatique de Sénèque ? Au moment où<br />
Néron affirme la politique artistique au centre de laquelle il entend bien se placer, et où le<br />
durcissement du régime commence de se faire sentir, Sénèque a-t-il compris que le pouvoir<br />
s’exprimerait désormais sur le mode de la tragédie ? Flagornerie pour les uns, entrée en<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
488
ésistance pour les autres, le théâtre de Sénèque peut être lu comme une expression de la prise<br />
de conscience que c’est là la forme qui convient au règne de Néron.<br />
Le corpus des tragédies contribue non seulement à la vitalité du genre, qui a connu un<br />
déclin relatif dans la période précédente, mais aussi à l’approfondissement de sa portée<br />
politique. Le principat affirme en effet la nature supérieure du souverain, entre humanité et<br />
divinité, et cette forme de surhumanité est confortée par les dimensions de l’empire, qui se<br />
rapprochent de celles du monde connu, et par le transfert de sacralité qui fait du prince le<br />
dépositaire des institutions. Il s’agit d’une tendance qui s’affirme et se formalise<br />
progressivement dès la fin de la République, mais qui se trouve renforcée par le principat et<br />
par la dimension dynastique du pouvoir au premier siècle. Dès lors, le rapprochement du<br />
prince et du roi de tragédie se trouve favorisé par un faisceau d’éléments, qui sont aussi ceux<br />
qui fondent la politique de Néron : tout d’abord, la prééminence de la gens Iulia et la<br />
référence à une ascendance divine, considérée comme garantie de la légitimité ; ensuite,<br />
l’évergétisme et l’idée que les héros sont divinisés pour leurs bienfaits, à l’exemple<br />
d’Hercule, auquel une légende associait le prince. On peut citer enfin les influences orientales<br />
et l’exemple d’Antoine notamment, auquel Néron a pu être sensible. Il en résulte une double<br />
représentation du prince : l’une, positive, le rapproche de héros comme Hercule, dont la<br />
représentation sert également les idéaux stoïciens de sagesse ; l’autre, négative, fait voir dans<br />
le prince tyrannique un nouveau criminel tragique comme Atrée, auquel Sénèque se réfère à<br />
plusieurs reprises dans son œuvre philosophique pour stigmatiser un despote tel que Caligula.<br />
C’est donc la figure du souverain qui révèle l’ambivalence des rapports entre politique et<br />
tragédie.<br />
Tacite peut alors composer son récit du règne de Néron comme une tragédie : si l’on<br />
retrouve les motifs de la tragédie grecque qui a notamment influencé l’historiographie<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
489
omaine, cette influence est probablement renforcée par l’apport des écrits de Sénèque,<br />
tragédies et œuvre en prose, et par les actes de Néron. Tout se passe comme si, finalement, la<br />
tragédie se glissait dans l’histoire avant qu’elle ne soit écrite. C’est que la dimension tragique<br />
du règne de Néron ne résulte pas seulement d’une mise en œuvre littéraire postérieure à sa<br />
mort, elle lui est en quelque sorte consubstantielle.<br />
Les tragédies de Sénèque ne sont pas étrangères à cette dimension tragique du règne.<br />
D’abord, elles ancrent de façon systématique les mythes représentés dans l’actualité hors-<br />
scène : l’appropriation du mythe par la pensée romaine n’est pas anecdotique, et on la<br />
retrouve à plusieurs niveaux significatifs : niveau juridique et institutionnel, culturel,<br />
religieux, esthétique et politique. La démarche, qui n’est par ailleurs pas propre au théâtre<br />
sénéquien, se voit confirmée par un ancrage plus précisément impérial. Ainsi, références<br />
géopolitiques contemporaines et données mythiques s’entremêlent pour créer un espace<br />
spécifique. On trouve aussi des échos significatifs au triomphe et aux attributions de<br />
l’empereur, rappelant la place symbolique du triomphe, qui représente une des manifestations<br />
les plus visibles et les plus spectaculaires de la puissance impériale. Il en résulte une forme de<br />
rupture de l’illusion théâtrale, qui invite le destinataire à mettre en relation le mythe et la<br />
réalité. De ce procédé résulte une double conséquence : premièrement, la signification du<br />
mythe se trouve enrichie et renforcée dans son caractère universel. En second lieu, associées<br />
aux correspondances que l’on peut établir entre le prince et les personnages, de telles<br />
références amènent à interroger l’actualité par le mythe.<br />
Les allusions à la situation politique contemporaine ou au passé proche relèvent d’une<br />
logique comparable : encore une fois, le poète renoue avec une pratique à laquelle ses<br />
prédécesseurs avaient volontiers recours, et que le public attendait plus ou moins. Les<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
490
allusions fonctionnent toutefois de manière complexe, avec un jeu d’écho et de renvois qui<br />
rend impossible tout décodage et les allusions toujours incertaines. La recherche de leur sens<br />
est rendue plus ardue par ce brouillage. Il n’en demeure pas moins que l’intérêt des<br />
anachronismes et des allusions est de connecter le mythe à la réalité plus étroitement encore.<br />
Ainsi, la superposition des références finit par constituer un réseau qui met en rapport les<br />
princes et les personnages tragiques, mais aussi les empereurs les uns avec les autres, par<br />
l’intermédiaire du mythe. On introduit ainsi un traitement de la réalité semblable à celui du<br />
mythe, et l’Empire devient sa propre mythologie. Le règne de Néron peut renvoyer à ceux de<br />
Tibère ou de Caligula, dans la logique des dynasties maudites et de l’enchaînement des crimes<br />
qui caractérisent les Atrides ou les Labdacides. On est ainsi tenté de lire cette histoire comme<br />
un mythe. Plus que les prétendues leçons que l’on ne tire qu’à grand effort d’une lecture<br />
supposée codée, c’est ce glissement de la réalité historique vers le mythe qui contribue à<br />
donner au théâtre de Sénèque sa force et sa richesse, et à revêtir Néron du masque du<br />
personnage tragique.<br />
L’empereur et son ministre ont donc l’un et l’autre recours à la tragédie pour exprimer<br />
le pouvoir impérial. La démarche peut être comparée, si le contenu du discours doit être<br />
distingué. Néron affiche à la fois sa volonté d’être le centre du spectacle, donc de déréaliser<br />
les choses pour tenter de les porter à une réalité supérieure, mais aussi de montrer comment le<br />
mythe offre dans son cas une image de la réalité. Il y a dans les tragédies une condamnation<br />
de la tyrannie, même si le poète en contemple les excès avec la fascination qui naît de la<br />
tentative d’inspirer l’horreur de la tyrannie, tout en en faisant un objet esthétique. Mais tous<br />
deux savent que la tragédie est le langage approprié pour parler de l’Empire. C’est pourquoi,<br />
loin d’être anodine, la production dramatique de Sénèque semble permettre d’établir l’unité<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
491
du personnage, en établissant le lien entre le philosophe et l’homme d’Etat.<br />
Limites.<br />
La datation des tragédies demeure incertaine, même si certaines hypothèses ont pu être<br />
confirmées : ainsi, il est vraisemblable que Les Troyennes datent des débuts du règne de<br />
Néron, et que Thyeste soit une pièce plus tardive, à un moment où le régime s’est orienté vers<br />
le despotisme. Mais en général, on est bien obligé de se résigner à ignorer la chronologie<br />
absolue des tragédies : car les enjeux du discours tragique, chez Sénèque, ne se laissent pas<br />
réduire à des problématiques actuelles. Le recours au matériau mythique suppose en effet<br />
l’aspiration à une certaine universalité, et les conflits qui se nouent dans les tragédies<br />
trouvent des échos dans nombre de situations particulières. En ancrant ses tragédies dans<br />
l’histoire, Sénèque montre que tout événement particulier trouve sa résonance dans le mythe,<br />
et cette dialectique du général et du particulier ne constitue pas le moindre intérêt de son<br />
théâtre, car il engage le lecteur ou le spectateur à envisager l’histoire dans sa dimension<br />
tragique. Telle est, dans une certaine mesure, l’intention de l’Octavie, dont l’auteur nous<br />
demeure inconnu.<br />
Néanmoins, la connection que l’on a pu établir entre mythe et réalité, si elle permet<br />
une réflexion sur le personnage du prince, n’est pas exempte des risques d’excès dans<br />
l’interprétation. La richesse essentielle de la fabula constitue en effet, dans le même temps,<br />
son principal piège, et la prudence reste de mise dans les affirmations. Les faisceaux<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
492
d’indices, les éléments significatifs que cette étude a pu contribuer à produire, ne peuvent<br />
faire oublier ni même voiler les pans d’incertitudes auxquels le lecteur moderne reste<br />
confronté. En l’absence de discours métalittéraire contemporain, et de témoignages sur la<br />
réception des tragédies de Sénèque, il est impossible de présenter de manière catégorique une<br />
lecture, au demeurant possible, de ces textes.<br />
De l’histoire au mythe.<br />
Il ne s’agit pas de faire de l’œuvre dramatique de Sénèque une source de documents<br />
historiques déchiffrables sur le règne de Néron. Toutefois, et en cela, elles échappent sans<br />
doute à leur auteur, les tragédies participent à la construction du Néron mythique dont l’image<br />
est encore présente. Si à la lecture de ces pièces, nous voyons Néron se dessiner sous les traits<br />
d’Atrée et d’Œdipe, c’est que notre vision de ce prince est influencée par les tragédies :<br />
Sénèque a fait sortir Néron de l’histoire en permettant, par la création poétique, l’assimilation<br />
d’une personne à un personnage. Le nombre des tragédies et leur complexité ne permet pas en<br />
effet d’établir une équivalence réductrice entre Néron et un personnage donné, mais par<br />
touches successives, des correspondances se laissent établir, qui amènent à penser le prince<br />
selon les modalités de la tragédie, et à voir en Néron, non pas un reflet plus ou moins dévalué<br />
d’Atrée ou d’Hercule furieux, mais une figure autonome qui ne dépare pas à leur côté.<br />
Quel est le sens d’une telle lecture des pièces de Sénèque ? Il faut revenir encore à<br />
Néron. Le prince apparaît décidément comme le destinataire principal et privilégié des<br />
tragédies, que l’on peut considérer aussi comme les éléments d’un échange, qui repose sur<br />
une sensibilité commune à certaines légendes, inspirant les tragédies de Sénèque et les<br />
prestations de Néron. On ne peut donc pas plus les réduire à un message politique réprobateur<br />
qu’à une manifestation de flagornerie. On peine à rechercher un modèle politique dans les<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
493
tragédies. Est-ce à dire que l’idéal est à chercher au-delà de la scène ? Est-ce un appel ou un<br />
reproche ? Il convient peut-être de laisser de côté la posture moralisante que l’on attribue<br />
systématiquement au philosophe, pour considérer les tragédies comme une forme<br />
d’expression du pouvoir impérial plus que comme un jugement sur son exercice. Signe de la<br />
familiarité et de l’intimité de Sénèque et Néron, elles ouvrent un espace pour le doute face à<br />
cet être impossible, ce monstre politique qu’est le prince.<br />
La condition impériale a en effet quelque chose de tragique, qui ne peut mieux se dire<br />
que dans le langage du mythe et dans la référence à des personnages qui contribuent à la<br />
rendre intelligible. La philosophie et la sagesse humaine y dévoilent leurs limites et leur<br />
impuissance face à ce qui reste profondément ambigu. Plus encore, les tragédies introduisent<br />
dans la réflexion la notion de pratique concrète dans une situation donnée : les personnages<br />
sont confrontés à des situations précises, à des conflits qu’ils doivent résoudre dans l’urgence<br />
lorsque la guerre ou la peste les presse. En cela elles sont davantage aux prises avec la réalité<br />
de l’exercice du pouvoir, alors que les traités philosophiques conservent toujours un caractère<br />
dogmatique et théorique qui les prive d’une certaine force. Finalement, la tragédie permet<br />
sans doute de mieux rendre compte de la réalité du pouvoir impérial, surtout de sa part<br />
d’ombre et d’incertitude.<br />
Néron ne parvient pas à sortir de ses contradictions, ni à établir la distance que<br />
suppose la lecture tragique de la politique impériale, et réalise ainsi sa condition tragique.<br />
Mais lorsqu’il apparaît comme personnage dans une tragédie, l’Octavie du Pseudo-Sénèque,<br />
c’est dans le sens d’une simplification, selon le topos du tyran. La prétexte correspond donc à<br />
la fois à une confirmation du statut tragique et à son affaiblissement, car l’ambiguïté disparaît<br />
au profit de la condamnation du prince et de l’apologie de son ministre. Affaiblissement et<br />
affirmation : dans cette association contradictoire commence la légende de Néron.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
494
C’est ainsi que les tragédies éloignent de la réalité _ car la figure anhistorique de<br />
Néron se distingue de sa figure historique, et s’en rapprochent à la fois _ car elles apparaissent<br />
comme la meilleure expression possible de la tyrannie, et en particulier de la tyrannie<br />
néronienne qui fait une part essentielle à l’art. Elles s’inscrivent, et elles inscrivent le règne de<br />
Néron, dans l’histoire et dans l’intemporalité. En cela, elles sont des tragédies philosophiques,<br />
qui permettent plus que jamais d’interroger le pouvoir absolu, de nourrir la réflexion sur le<br />
règne de Néron, mais aussi sur toute violence politique.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
495
I/ TEXTES ANCIENS<br />
ACCIUS<br />
ARISTOTE<br />
A/ Auteurs.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
- Œuvres. Fragments, texte établi et traduit par J. Dangel, Paris, 1995.<br />
- Poétique, texte établi et traduit par J. Hardy, Paris, 1923.<br />
- Poétique, texte établi et traduit par J. Lallot et R. Dupont-Roc, Paris, 1980.<br />
AURELIUS VICTOR<br />
- Livre des Césars, texte établi et traduit par P. Dufraigne, Paris, 1975.<br />
CALPURNIUS SICULUS<br />
- Bucoliques. PSEUDO-CALPURNIUS, Eloge de Pison, texte établi et traduit par J.<br />
Amat, Paris, 1991.<br />
DION CASSIUS<br />
ENNIUS<br />
- Cassii Dioni Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt, édité par U. P.<br />
Boissevain, Berlin, 1955.<br />
- Dio’s Roman History : in nine volumes, translated by E. Cary and H. B. Foster,<br />
Londres, 1970-1984.<br />
- The Tragedies, texte établi et traduit par H. D. Jocelyn, Londres, 1967.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
496
ESCHYLE<br />
EURIPIDE<br />
- Tragédies (2 vol.), texte établi et traduit par P. Mazon, Paris, 1935.<br />
- Tragédies, Tomes I et II. Alceste, Médée, Les Héraclides ; Hippolyte. Andromaque.<br />
Hécube texte établi et traduit par L. Méridier, Paris, 1926-1927.<br />
- Tragédies, Tomes III et IV. Héraklès, Les Suppliantes, Ion ; Les Troyennes,<br />
Iphigénie en Tauride, Electre texte établi et traduit par H. Grégoire et L. Parmentier,<br />
Paris, 1923-1925.<br />
- Tragédies, Tome V. Hélène, Les Phéniciennes, texte établi et traduit par H. Grégoire,<br />
L. Parmentier et F. Chapouthier, Paris, 1950.<br />
- Tragédies, Tome VI. Les Bacchantes, texte établi et traduit par H. Grégoire et J.<br />
Meunier, Paris, 1961.<br />
- Tragédies, Tome VII. Iphigénie à Aulis, texte établi et traduit par F. Jouan, Paris,<br />
1983.<br />
EUTROPE<br />
- Abrégé d’histoire romaine, texte établi et traduit par J. Hellegouarc’h, Paris, 1999.<br />
FLAVIUS JOSÈPHE<br />
JUVENAL<br />
LUCAIN<br />
LUCIEN<br />
PETRONE<br />
- Guerres des Juifs, texte établi et traduit par A. Pelletier, Paris, 1975-1982<br />
- Satires, texte établi et traduit par O. Sers, Paris, 2002.<br />
- La Guerre civile, I-V, texte établi et traduit par A. Bourgery, Paris, 1967.<br />
- Œuvres complètes, texte établi et traduit par E. Talbot, Paris, 1857.<br />
- Satiricon, texte établi et traduit par O. Sers, Paris, 2001.<br />
PHILON D’ALEXANDRIE<br />
- Legatio ad Gaium, texte établi et traduit par A. Pelletier, Paris, 1972.<br />
PHILOSTRATE<br />
- The Life of Apollonius of Tyana, with an English Translation of F. C. Conybeare,<br />
Londres, 1969-89.<br />
- Vie d’Apollonios de Tyane, dans Romans grecs et latins, textes présentés, traduits et<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
497
annotés par P. Grimal, Paris, 1986.<br />
PLINE LE JEUNE<br />
- Panégyrique de Trajan, texte établi et traduit par M. Durry, Paris, 1948.<br />
PLUTARQUE<br />
- Grecs et Romains en parallèle, introduction, traduction et notes par M. Nouilhan, J.-<br />
M. Pailler et P. Payen, Paris, 1999.<br />
PSEUDO – SENEQUE<br />
QUINTILIEN<br />
- Octavie, texte établi et traduit par G. Liberman, Paris, 2002.<br />
- Ottavia. Con note, , texte établi, traduit et commenté par G. Ballaira, Turin, 1974.<br />
- The Octavia, Introduction, Text and Commentary, L. Y. Whitman, Bern-<br />
Stuttgart, 1978.<br />
- Institution oratoire, livres I-XII, (7 vol.), texte établi et traduit par J. Cousin, Paris,<br />
1975-1976-1977-1978-1979-1980.<br />
- Le Secret de Démosthène, traduction et préface de F. Desbordes, Paris, 1995.<br />
Rhétorique à Herennius, texte établi et traduit par G. Achard, Paris, 1989.<br />
SÉNÈQUE LE PÈRE<br />
- Controverses et suasoires (2 vol.), texte établi et traduit par H. Bornecque, Paris,<br />
1932.<br />
SOPHOCLE<br />
- Tragédies (3 vol.), texte établi par A. Dain et traduit par P. Mazon, Paris, 1955, 1958,<br />
1960.<br />
- Les Tragiques grecs : Eschyle, Sophocle, Euripide. Théâtre complet avec un choix de<br />
fragments. Traduction, notices et notes de V. H. Debidour, éditée avec une<br />
introduction générale et un dossier sur la tragédie par P. Demont et A. Lebeau, Paris,<br />
1999.<br />
SUETONE<br />
- Vies des douze Césars, texte établi et traduit par H. Ailloud, Paris, 1993-1996.<br />
- Nero. Introduction, Text and Commentary, B. H. Warmington (éd.), Bristol, 1977.<br />
- Vies des douze Césars. Claude-Néron, texte établi et traduit par H. Ailloud et J.<br />
Maurin, Paris, 1998.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
498
TACITE<br />
- Dialogue des orateurs, texte établi et traduit par H. Goelzer et P. Bornecque, Paris,<br />
1967.<br />
- Annales, tome I, livres I-III, texte établi et traduit par P. Wuilleumier, 2 e tirage de la<br />
2 e édition revu et corrigé par J. Hellegouarc’h, Paris, 1990.<br />
- Annales, tome II, livres IV-VI, texte établi et traduit par P. Wuilleumier, 2 e tirage<br />
revu et corrigé par H. Le Bonniec, Paris, 1990.<br />
- Annales, tome III, livres XI-XII, texte établi et traduit par P. Wuilleumier, 2 e tirage<br />
revu et corrigé par J. Hellegouarc’h, Paris, 1994.<br />
- Annales, tome IV, livres XIII-XVI, texte établi et traduit par P. Wuilleumier, 4 e tirage<br />
revu et corrigé par J. Hellegouarc’h, Paris, 1996.<br />
- Histoires, livre I, texte établi et traduit par P. Wuilleumier et H. Le Bonniec, annoté<br />
par J. Hellegouarc’h, Paris, 1987.<br />
- Histoires, livres II à V (2 vol.), texte établi et traduit par H. Le Bonniec, annoté par J.<br />
Hellegouarc’h, Paris, 2 e édition, 1989-1992.<br />
VELLEIUS PATERCULUS<br />
- Histoire romaine, texte établi et traduit par J. Hellegouarc’h, Paris, 1982.<br />
B/ Recueils de textes<br />
CIL : Corpus Inscriptionum <strong>Latina</strong>rum, Deutsche Akademie der Wissenschaften, Berlin.<br />
ILS : DESSAU H. Inscriptiones <strong>Latina</strong>e Selectae, Berlin, 1882-1916, 5 vol. ; rééd. 1954-1955.<br />
BÜCHLER F., RIESE A. (éd.) Anthologia latina siue poesis latinae supplementum, Leipzig,<br />
1869.<br />
RIBBECK O., Scaenicae Romanorum poesis fragmenta, 2ème éd., Leipsig, 1871-1873 ; repr.<br />
Hildesheim, 1962 (I- Tragicorum ; II – Comicorum frag.)<br />
BÜCHNER K. (éd.), Fragmenta Poetarum Latinorum, Leipzig, 1982.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
499
C/ Œuvres de Sénèque.<br />
1/ Œuvre en prose et Apocoloquintose.<br />
- Apocoloquintose du Divin Claude, texte établi et traduit par R. Waltz, Paris, 1934.<br />
- Apocolocyntosis Divi Claudii, herausgegeben, übersetz und kommentiert von A.<br />
Lund, Heidelberg, 1994.<br />
- Apocolocyntosis, introd., trad. e note di R. Mugellesi, Milan, 1996.<br />
- Dialogues. De la colère ; De la vie heureuse, De la brièveté de la vie (2 vol.), texte<br />
établi et traduit par A. Bourgery, Paris, 1922-1930.<br />
- Dialogues. Consolations ; De la providence, De la constance du sage, De la tranquilité<br />
de l’âme, De l’oisiveté (2 vol.), texte établi et traduit par R. Waltz, Paris, 1923-1927.<br />
- Traités philosophiques, texte établi, traduit et annoté par F. et P. Richard (4 vol.), Paris,<br />
1954-1955.<br />
- Philosophische Schriften, herausgegeben von M. Rosenbach (5 vol.), Darmstadt, 1971.<br />
- Moral Essays, ed. with an English Translation by J. W. Basore (3 vol.), Londres, 1979-<br />
1989.<br />
- De la clémence, texte établi et traduit par F. Préchac, Paris, 1925.<br />
- De la clémence, texte établi et traduit par F. R. Chaumartin, Paris, 2005.<br />
- De uita beata, édition, introduction et commentaire de P. Grimal, Paris, 1969.<br />
- Des bienfaits (2 vol.), texte établi et traduit par F. Préchac, Paris, 1926-1928.<br />
- Lettres à Lucilius (5 vol) texte établi par F. Préchac et traduit par H. Noblot, Paris, 1945,<br />
1947, 1958, 1962, 1964. Tome II (livres V-VII), 6 e tirage revu, corrigé et indexé par C.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
500
Rambaux, 1993. Tome V (livres XIX-XX), 4 e tirage revu et corrigé par F. R. Chaumartin,<br />
1991.<br />
- Epistles, ed. with an English Translation by R. Gummere (3 vol.), Londres, 1970-1979.<br />
- Entretiens. Lettres à Lucilius, édition établie par P. Veyne, Paris, 1993.<br />
- Questions naturelles (2 vol.), texte établi et traduit par P. Oltramare, 1929, 4 e tirage<br />
corrigé par F. R. Chaumartin, Paris, 2003.<br />
2/ Tragédies.<br />
Œuvres complètes<br />
- L. Annaei Senecae Tragoediae. Recensuit et emendauit F. Leo, Berlin, 1878-79.<br />
- Sénèque. Tragédies (2 vol.), texte établi et traduit par L. Herrmann, Paris 1924-1926.<br />
- Seneca. Tragedies, ed. with an English translation by F. J. Miller (2 vol.), Londres,<br />
1979-1987.<br />
- L. Annaei Senecae Tragoediae, O. Zwierlein, Oxford Classical Texts, 1986.<br />
- Lucius Annaeus Seneca, Théâtre complet, traduction et notices de F. Dupont, Paris,<br />
1991-1992.<br />
- Seneca. Teatro, G. Viansino, Milan, 1993.<br />
- Sénèque. Tragédies, texte établi et traduit par F. R. Chaumartin, Paris, 1996-99.<br />
- Seneca, Hercules ; Trojan Women ; Phoenician Women ; Media ; Phaedra, Edited<br />
and Translated by J. G. Fitch, Londres, 2002.<br />
Editions commentées<br />
BILLERBECK M., GUEX S. 2002. Seneca, Hercules Furens. Introduction, texte, traduction<br />
et commentaire, Berlin.<br />
COSTA C. D. N. 2000. Seneca. Medea, Edited with an Introduction, Text, Translation and<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
501
Commentary, Warminster. (Oxford, 1973).<br />
FANTHAM E. 1982. Seneca’s Troades. A Literary Introduction with Text, Translation and<br />
Commentary, Princeton.<br />
FITCH J. G. 1987. Seneca’s Hercules Furens. A Critical Text witn Introduction and<br />
Commentary, Ithaca-Londres.<br />
FRANK M. 1995. Seneca’s Phoenissae. Introduction and Commentary, Leiden.<br />
GARELLI-FRANÇOIS M.-H. 1987. Les Troyennes de Sénèque : texte, apparat critique,<br />
traduction et notes explicatives, précédés d’une introduction générale, Thèse Paris<br />
IV.<br />
GIANCOTTI F. 1969. Lucius Annaeus Seneca, Tieste, con note, Testi universitari, Turin.<br />
GRIMAL P. 1965. Annaei Senecae Phaedra, édition, introduction et commentaire, Paris.<br />
HIRSCHBERG Th. 1989. Senecas Phoenissen, Einteilung und Kommentar, Berlin.<br />
TARRANT R. J. 1976. Seneca, Agamemnon, Cambridge.<br />
- 1985. Thyestes, Atlanta.<br />
ZWIERLEIN O. 1983. Kritischer Kommentar zu den Tragödien Senecas, Mainz.<br />
II/ INDICES VERBORUM<br />
OLDFATHER A., PEASE A. S., CANTER H. V. 1918. Index verborum quae in Senecae<br />
fabulis necnon in Octavia praetexta reperiuntur, dans University of Illinois Studies<br />
inLanguage and Literature, n°4, fév. 1918.<br />
BUSA R., ZAMPOLLI A. 1975. Concordantiae Senecanae, accedunt index inversus,<br />
indices frequentiae, 2 vol., Alpha-Omega 21, Hildesheim-New York.<br />
DENOOZ J. 1980. Tragoediae. Index verborum, relevés lexicaux et grammaticaux,<br />
Hildesheim-Olms.<br />
III/ BIBLIOGRAPHIES<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
502
BORGO A. 1999. « Per una rassegna senecana (1988-1998) », Bolletino di Studi Latini 29, p.<br />
159-186.<br />
CHAUMARTIN F. R. 1989. « Quarante ans de recherches sur les œuvres philosophiques de<br />
Sénèque (1945-1985) », ANRW II, 36, 3, p. 1545-1605.<br />
COFFEY M. 1957. « Seneca’s Tragedies. Report for the Years 1920-1955 », Lustrum 2, p.<br />
113-186.<br />
HILTENBRUNNER O. 1985. « Seneca als Tragödiendichter in der Forschung von 1965 bis<br />
1975 », ANRW II, 32, 2, p. 969-1051.<br />
MOTTO A. L., CLARK J. R. 1989. Seneca, a Critical Bibliography, 1900-1980 : Scholarship<br />
on his Life, Thought, Prose, and Influence, Amsterdam.<br />
SEIDENSTICKER B., ARMSTRONG D. 1985. « Seneca tragicus 1878-1978 », ANRW II,<br />
32, 2, p. 916-968.<br />
ACHARD G. 1995. Néron, Paris.<br />
IV/ ETUDES MODERNES<br />
- 1996. « La rhétorique de l’imaginaire », Rome, I er siècle ap. J.-C. Les orgueilleux<br />
défis de l’ordre impérial, dirigé par J. Gaillard, Paris, p. 134-142.<br />
ADAM T. 1970. Clementia Principis. Der Einfluss hellenistischer Führtenspiegel auf den<br />
Versuch einer rechtlichen Fundierung des Principats durch Seneca, Stuttgart.<br />
ALCOK S. E. 1994. « Nero at Play ? The Emperor’s Grecian Odyssey », ELSNER J. &<br />
MASTERS J. Masters (éd.), Reflections of Nero : culture, History & Representation,<br />
Londres, p. 98-110.<br />
ALLEN Jr. W. 1962. « Nero’s Eccentricities Before the Fire », Numen 9, p. 99-109.<br />
ANDRÉ J.-M. 1995. « La peregrinatio achaica et le philhellénisme de Néron », REL<br />
73, p. 170-174.<br />
ANDRÉ J.-M. et BASLEZ M.-F. 1993. Voyager dans l’Antiquité, Paris.<br />
ANLIKER K. 1960. Prologe und Anleitung in Senecas Tragödien, Berne.<br />
ARCELLASCHI A. 1990. Médée dans le théâtre latin d’Ennius à Sénèque, Rome.<br />
ARMISEN-MARCHETTI M. 1989. Sapientiae facies. Etude sur les images de Sénèque,<br />
Paris.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
503
- 1992. « Pour une lecture plurielle des tragédies de Sénèque : l’exemple de Phèdre, v.<br />
130-135 », Pallas 38, p. 379-390.<br />
- 1998. « Le Sénèque de l’Octavie : imago imaginis », Pallas, 49, Rome et le<br />
tragique, p. 197-209.<br />
- 2000. « Sénèque et la divination », Seneca e il suo tempo (Atti del Convegno<br />
internazionale di Roma-Cassino, 11-14 nov. 1998), Rome, p. 193-214.<br />
AUBENQUE P., ANDRÉ J.M. 1964. Sénèque, Paris.<br />
AUBRION E. 1985. Rhétorique et histoire chez Tacite, Metz.<br />
- 1990. « L’historien Tacite face à l’évolution des jeux et des autres spectacles »,<br />
BLÄNSDORF J. (éd.), Theater und Gesellschaft im Imperium romanum, Mainzer<br />
Forsch. zu Drama und Theater 4, Tübingen, p. 197-211.<br />
AUVRAY-ASSAYAS C. 1987. « La conclusion de l’Hercule Furieux de Sénèque. Tradition<br />
grecque et clémence stoïcienne », REL 65, p. 158-166.<br />
AVERY W. T. 1959. « Roman Ghost-Writers », CJ 54, p. 167-69.<br />
AYGON J.-P. 1998. « Descriptiones et vision stoïcienne du destin dans l’Œdipe de<br />
Sénèque », Pallas, 49, p. 135-148.<br />
AYMARD J. 1951. Les Chasses romaines : des origines à la fin du siècle des Antonins,<br />
Paris.<br />
BACQUET P. 1960/61. « Macbeth et l’influence de Sénèque », Bull. Fac. Lett. Strasbourg<br />
39, 1960/61, p. 399-411.<br />
BALDWIN B. 1964. « Executions under Claudius : Seneca’s Ludus de Morte Claudii »,<br />
Phoenix 18, p. 39-48.<br />
- 1970. « Seneca’s Potentia », CPh 65, p. 187-89.<br />
BALZAMO L. 1957. « Della possibilità di una poetica di Seneca in relazione alla<br />
cronologia delle sue tragedie », Ann. Fac. Lett. e Filos. Univ. Napoli 7, p. 93-106.<br />
BARDON H. 1936. « Les poésies de Néron », REL 14, p. 337-349.<br />
- 1940. Les Empereurs et les Lettres latines d’Auguste à Hadrien, rééd. 1968, Paris.<br />
- 1952. La Littérature latine inconnue, 2 vol. Paris.<br />
BARNES T. D. 1982. « The Date of the Octavia », MH 39, p. 215-217.<br />
BARRET A. 2000. « The Laus Caesaris : its History and its Place in Latin Literature »,<br />
Latomus 59, p. 596-606.<br />
BARTSCH S. 1994. Actors in the Audience. Theatricality and Doublespeak from Nero to<br />
Hadrian, Cambridge, Mass.-Londres.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
504
BAYET J. 1969. Histoire politique et psychologique de la religion romaine, 2 e éd., Paris.<br />
BEACHAM R. C. 1991. The Roman Theater and its Audience, Londres.<br />
BEARE W. 1964. The Roman Stage. A Short History of Latin Drama in the Time of the<br />
Republic, Londres.<br />
BEAUJEU J. 1960. « L’incendie de Rome en 64 et les chrétiens », Latomus 19, p. 65-<br />
80 et 291-311.<br />
BÉLIS A. 1988. « Les termes grecs et latins désignant des spécialités musicales », RPh, p.<br />
227-250.<br />
- 1989a. « Néron musicien », CRAI, p. 747-768.<br />
- 1989b. « L’organologie des instruments de musique de l’Antiquité : chronique<br />
bibliographique », R A, p. 127-142.<br />
- 1995. « Cithares, citharistes et citharodes en Grèce », CRAI, p. 1025-1065.<br />
- 1999. Les Musiciens dans l’Antiquité, Paris.<br />
BÉRANGER J. 1953. Recherches sur l’aspect idéologique du principat, Bâle.<br />
BESSONE L. 1988. « Nerone nel tardo antico », AFLM 21, p. 51-61.<br />
BETENSKY A. 1978. « Neronian Style, Tacitean Content. The Use of Ambiguous<br />
Confrontations in the Annals », Latomus 37, p. 419-435.<br />
BILLERBECK M. 1998. « Apostrophes de rôles muets et changements implicites<br />
d’interlocuteur. Deux observations sur l’art dramatique de Sénèque », GARELLI-<br />
FRANÇOIS M.-H. 1998, p. 101-110.<br />
BILINSKI B. 1958. Accio ed i Gracchi : contribute alla storia della tragedia romana,<br />
Rome.<br />
BILLOT F. 2003. « Tacitus Responds : Annals 14 and the Octavia », WILSON M.<br />
2003 (éd.), The Tragedy of Nero’s Wife. Studies on the Octavia Praetexta, Prudentia<br />
Vol. 35 No 1, Clearwater Cove, p. 126-141.<br />
BIONDI G. 1981. « Il mito argonautico nella Medea. Lo stile ‘filosofico’ del drammatico<br />
Seneca », Dioniso 52, p. 421-445.<br />
BISHOP J. D. 1972. « Seneca’s Troades. Dissolution of a Way of Life », RhM 115, p.<br />
329-337.<br />
- 1978. « Seneca’s Œdipus : Opposition Literature », CJ 73, 1978, p. 289- 301.<br />
- 1985. Seneca’s Daggered Stylus. Political Code in the Tragedies, Königstein.<br />
BLÄNSDORF J. (éd.). 1990. Theater und Gesellschaft im Imperium romanum, Tübingen.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
505
BLÜHER K. A. 1969. Seneca in Spanien, Bern.<br />
BOISSIER G. 1861a. « De la signification des mots saltare et cantare tragoediam », RA II, p.<br />
333-343.<br />
- 1861b. Les Tragédies de Sénèque ont-elles été représentées ? Paris, 1861.<br />
- 1905. L’Opposition sous les Césars, 5 e éd., Paris.<br />
BONELLI G. 1978. « Il carattere retorico delle tragedie di Seneca », Latomus 37, p.<br />
395-418.<br />
- 1980. « Autenticità o retorica nella tragedia di Seneca », Latomus 39, p. 612-638.<br />
BONNER S. F. 1986. L’educazione nell’antica Roma, Rome.<br />
BORGO A. 1988. « Pietas familiare e nefas originario. Terminologia dei rapporti parentali<br />
nelle Fenicie di Seneca », Vichiana 17, p. 275-283.<br />
BOSWORTH A. B. 1972. « Asinius Pollio and Augustus », Historia 21, p. 441-473.<br />
BOYLE A. J. 1983a (éd.). Seneca Tragicus : Ramus Essays on Senecan Drama,<br />
Melbourne.<br />
- 1983b. « Hic epulis locus : the Tragic Worlds of Seneca’s Agamemnon and<br />
Thyestes », BOYLE A. J. 1983a, Seneca Tragicus : Ramus Essays on Senecan Drama,<br />
Melbourne, p. 199-228.<br />
- 1988a (éd.). The Imperial Muse : Ramus Essays on Roman Literature of the Empire,<br />
Melbourne.<br />
- 1988b. Senecan Tragedy. Twelve Propositions, BOYLE A. J. 1988a, The Imperial<br />
Muse : Ramus Essays on Roman Literature of the Empire, Melbourne, p. 79-101.<br />
- 1997. Tragic Seneca : An Essay in the Theatrical Tradition, Londres-New York.<br />
BRACCESI L. et COPPOLA A. 1997. « Il matricida : Nerone, Agrippina e l’imitatio<br />
Alexandri », DHA, 23, I, p. 189-194.<br />
BRADLEY K. R. 1973. « Tum primum revocata ea lex », AJPh 94, p. 172-182.<br />
- 1978a. « The Chronology of Nero’s Visit to Greece », Latomus 37, p. 61-72.<br />
- 1978b. Suetonius’ Life of Nero. An Historical Commentary, Bruxelles.<br />
BRINGMANN K. 1985. « Senecas Apocolocyntosis. Ein Forschungsbericht 1959-1982 »,<br />
ANRW, II, 32, 2, p. 885-914.<br />
BRIQUEL D. 1995. « Tacite et l’haruspicine », Caesarodunum supplément 64, p. 27-37.<br />
- 1997. « Divination in Rom », Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, p. 714-<br />
718.<br />
BRUCKNER F. 1976. Interpretazionen zur Pseudo-Seneca Tragödie Octavia, Erlangen.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
506
BRUGNOLI G. 1959. « Quintiliano, Seneca e il De causis corruptae eloquentiae »,<br />
Orph. 6, p. 29-41.<br />
BURNETT A. 1984. « Nero's Visit to Greece. Two Numismatic Notes », GNS 34, p. 81-85.<br />
CALDER W. M. 1970. « Originality in Seneca’s Troades », CPh 65, p. 75-82.<br />
- 1976a. « Seneca’s Agamemnon », CPh 71, p. 27-36.<br />
- 1976b. « Seneca : Tragedian of Imperial Rome », CJ 72, p. 1-11.<br />
- 1983. « Secreti loquimur : an Interpretation of Seneca’s Thyestes », BOYLE A. J.<br />
1983a, Seneca Tragicus : Ramus Essays on Senecan Drama, Melbourne, p. 184-198.<br />
CARLIER P. 1982. La Royauté en Grèce avant Alexandre, Thèse Paris IV.<br />
CATTANEO E. 1958. « Sul parallelismo degli episodi della morte di Augusto e di Claudio<br />
negli Annali di Tacito », RIL 92, p. 476-482.<br />
CATTIN A. 1960. « Sénèque et l'astronomie », Hommages à Léon Herrmann,<br />
collection Latomus 44, Bruxelles-Berchem, p. 237-243.<br />
- 1963. « La géographie dans les tragédies de Sénèque », Latomus 22, p. 685-703.<br />
CAVIGLIA A. F. 1981. « L’inganno di Andromaca. Nota su Sen. Troades 524-604 »,<br />
Dioniso 52, p. 455-459.<br />
CERVELLERA M. A. 1973. « La cronologia delle tragedie di Seneca in relazione al<br />
trimetro recitativo », Riv. Cult. Class. e Medioev. 15, p. 19-34.<br />
CESARETTI M. P. 1984. « Nerone in Egitto », Aegyptus 64, p. 3-25.<br />
CHANIOTIS A. 1990. « Zur Frage der Spezialisierung im griechischen Theater des<br />
Hellenismus und der Kaiserzeit auf der Grundlage der neuen Prosopographie der<br />
dionysischen Techniten », Ktèma 15, p. 89-108.<br />
- 1997. « Theatricality Beyond the Theater. Staging Public Life in the Hellenistic<br />
World », LE GUERN B. (éd.), Théâtre et représentations dramatiques après<br />
Alexandre le Grand, Pallas, 47, p. 219-259.<br />
CHARLES - PICARD G. 1962. Auguste et Néron, le secret de l’Empire, Paris.<br />
CHARLES - SAGET A. 1998. « Sénèque et le théâtre de la cruauté », Pallas 49, p. 149- 155.<br />
CHARLESWORTH M. P. 1939. Documents Illustrating the Reigns of Claudius and Nero,<br />
Cambridge, 1939.<br />
- 1950. « Nero, some Aspects », JRS 40, p. 69 –72.<br />
CHAUMARTIN F.-R. 1984. « Autour de Sénèque (attitudes morales et action politique) »,<br />
REL 62, p. 26-34.<br />
- 1985. Le De beneficiis de Sénèque, sa signification philosophique, politique et<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
507
sociale, Paris.<br />
- 1989. « Les désillusions de Sénèque devant l’évolution de la politique néronienne et<br />
l’aspiration à la retraite. Le De uita beata et le De beneficiis », ANRW II, 36,<br />
3, p. 1686-1723.<br />
- 1994 et 1995. Observations critiques sur quelques passages des tragédies de<br />
Sénèque », RPh 68, p. 87-99 et RPh 69, p. 95-109.<br />
- 1998. « Les pièces Hercule furieux et Hercule sur l’Œta sont-elles des tragédies<br />
stoïciennes ? », Pallas 49, p. 279-288.<br />
CHEVALIER R. 1988. Voyages et déplacements dans l’Empire romain, Paris.<br />
CIZEK E. 1972. L’Epoque de Néron et ses controverses idéologiques, Leiden.<br />
- 1982. Néron, Paris.<br />
- 2002. « A propos de la lettre 100 de Sénèque », Latomus 61. 2, p. 388-397.<br />
CLARKE G. W. 1965. « Seneca the Younger under Caligula », Latomus 24, p. 62-69.<br />
CLAVEL-LÉVÊQUE M. 1984. L’Empire en jeux. Espace symbolique et pratique sociale<br />
dans le monde romain, Paris.<br />
CORBIER P. 1999. « La petite enfance à Rome », Annales (H.S.S.), 54 (6), p. 1257-1290.<br />
CRAMER F. H. 1951. .« Expulsion of astrologers from ancient Rome », C&M 12, p. 9-50.<br />
- 1954. Astrology in Roman Law and Politics, Philadelphie.<br />
CROISILLE J.-M. 1964a. « Lieux communs, sententiae et intentions philosophiques dans<br />
la Phèdre de Sénèque », REL 42, p. 276-301.<br />
- 1964b. « Le personnage de Clytemnestre dans l’Agamemnon de Sénèque », Latomus<br />
23, p. 464-472.<br />
- 1982. Poésie et art figuré de Néron aux Flaviens. Recherches sur l’iconographie et<br />
la correspondance des arts à l’époque impériale, Bruxelles (2 vol.), Coll. Latomus,<br />
179.<br />
- 1990 (éd.). Alejandro Magno, modelo de los emperadores romanos. Neronia, IV,<br />
Actes du IV e colloque international de la SIEN, Bruxelles.<br />
- 1994. Néron a tué Agrippine, Paris-Bruxelles.<br />
- 1995. « Sénèque et Néron », VL, 140, 1995, p. 2-12.<br />
CROISILLE J.-M., FAUCHÈRE P. M. 1982 (éd.). Neronia 1977. Actes du 2 e colloque de la<br />
S IE N, Clermont-Ferrand, 27-28 mai 1977), Clermont-Ferrand.<br />
CROISILLE J.-M., MARTIN R., PERRIN Y. (éd.). 1999. Neronia V. Néron : histoire et<br />
légende. Actes du V e Colloque international de la SIEN (Clermont-Ferrand et Saint-<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
508
Étienne, 2 - 6 novembre 1994), Bruxelles.<br />
DANGEL J. 1987. « Les dynasties maudites dans le théâtre latin de la République à<br />
l’Empire », Ktèma 12, p. 149-157.<br />
- 1990. « Sénèque et Accius : continuité et rupture », BLÄNSDORF J. (éd), Theater<br />
und Gesellaschaft im Imperium romanum, Tübingen, p. 107-122.<br />
- 1992. « Théâtre latin : un récital vocal », Ktèma 17, p. 17-28.<br />
DANESI MARIONI G. 1995. « Properzio nelle tragedie di Seneca : significato e modi di<br />
una presenza », Sileno 21, p. 5-47.<br />
DELLA CORTE F. 1983. « La tragédie romaine au siècle d’Auguste », Théâtre et<br />
spectacles dans l’Antiquité, Actes du Colloque de Strasbourg (5-7 novembre 1981),<br />
p. 227-243.<br />
DOMENACH J.-M. 1998. Le retour du tragique, Paris.<br />
DOWNING F. G. 1995. « Cosmic Eschatology in the First Century », L’Antiquité<br />
Classique 64, p. 99-109.<br />
DUCOS M. 1990. « La condition des acteurs à Rome. Données juridiques et sociales »,<br />
BLÄNSDORF J. (éd), Theater und Gesellaschaft im Imperium romanum, Tübingen, p.<br />
19-33.<br />
DUMÉZIL G. 1956. Aspects de la fonction guerrière chez les Indo-Européens, Paris.<br />
- 1974. La Religion romaine archaïque, Paris, 2 e éd.<br />
- 1986. Idées romaines, Paris.<br />
DUMONT J. C. 1997. « Cantica et espace de représentation dans le théâtre latin », LE GUEN<br />
B. (éd.), De la scène aux gradins, Pallas 47, p. 41-50.<br />
- 2001. « Le théâtre dans la Ville », LE BOHEC Y. (éd.), Rome, Ville et<br />
capitale de César à la fin des Antonin, Paris, 2001, p. 301-320.<br />
- 2003. « Les historiens et le théâtre », G. Lachenaud et D. Longrée, Grecs et Romains<br />
aux prises avec l’histoire. Représentations, récits et idéologie, Rennes, p. 415-423.<br />
- 2004. « Roscius et Laberius », HUGONIOT C., HURLET F., MILANEZI S. (éd.)<br />
2004. Le Statut de l’acteur dans l’Antiquité grecque et romaine, Tours.<br />
DUNKLE J. R. 1971. « Rhetorical Tyrant in Roman Historiography : Sallust, Livy and<br />
Tacitus », CW 65, p. 12-20.<br />
DUPONT F. 1975 « le personnage et son mythe dans les tragédies de Sénèque », Actes<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
509
du IX e Congrès de l’Association Guillaume Budé, Paris, p. 447-458.<br />
- 1985. L’Acteur roi ou le théâtre dans la Rome antique, Paris.<br />
- 1991. « Le prologue de la Phèdre de Sénèque », REL 69, p. 124-135.<br />
- 1995. Les Monstres de Sénèque, Paris.<br />
DURET L. 1988. « Néron-Phaéton ou la témérité sublime », REL 66, p. 139-155.<br />
DYSON S. L. 1970. « The Portrait of Seneca in Tacitus », Arethusa 3, p. 71-83.<br />
EDWARDS C. 1994. « Beware of Imitations : Theatre and the Sub<strong>version</strong> of Imperial<br />
Identity », ELSNER J. & MASTERS J. (éd.), Reflections of Nero. Culture, History<br />
and representation Londres, Chapel Hill, p. 83-97.<br />
EGERMANN F. 1940. « Seneca als Dichterphilosoph », Neue Jahrb. NF 3, 1940, p. 18-36.<br />
FABBRI R. 1978-79. « La Pagina ‘Senecana’ di Tacito (Ann. XV, 60-65) », AIV 137,<br />
p. 409-427.<br />
FABRE-SERRIS J. 1998. Mythologie et littérature à Rome. La réécriture des mythes aux I ers<br />
siècles avant et après J.-C., Lausanne.<br />
- 1999. « Néron et les traditions latines de l’âge d’or », CROISILLE J.-M., MARTIN<br />
R., PERRIN Y. (éd.). 1999. Neronia V, Néron: histoire et légende. Actes du V e<br />
Colloque international de la SIEN (Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, 2 - 6 novembre<br />
1994), Bruxelles, p. 187-200.<br />
FANTHAM E. 1983. « Nihil iam iura ualent. Incest and Fratricide in Seneca’s<br />
Phoenissae », Seneca Tragicus, Ramus Essays on Senecan Drama, Victoria, p. 61-76.<br />
- 1981. « Seneca’s Troades and Agamemnon : Continuity and Sequence », CJ 77,<br />
p.118-129.<br />
FERRARY J.-L. 1983. « Les origines de la loi de majesté à Rome », CRAI, p. 556-572.<br />
FILLION-LAHILLE J. 1984. Le De ira de Sénèque et la philosophie stoïcienne des<br />
passions, Paris, Klincksieck.<br />
- 1989. « La production littéraire de Sénèque sous les règnes de Caligula et de<br />
Claude, sens philosophique et portée politique : les Consolations et le De Ira », ANRW<br />
II, 36, 3, p. 1606-1938.<br />
FINI M. 1993. Nerone. Duemilia anni di calunnie, Milan.<br />
FITCH J. G. 1981. « Sense-Pauses and Relative Dating in Seneca, Sophocles and<br />
Shakespeare », AJPh 102, p. 289-307.<br />
- 2001. « Playing Seneca ? », HARRISON G. (éd.), Seneca in Performance, Londres.<br />
FITCH J. G., Mc ELDUFF S. 2002. « Construction of the Self in Senecan Drama »,<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
510
Mnemosyne, p. 18-40.<br />
FLACH D. 1973. « Seneca und Agrippina im antiken Urteil », Chiron 3, p. 265-76.<br />
FORTEY S., GLUCKER J. 1975. « Actus tragicus, Seneca on the Stage », Latomus 34,<br />
p.699-715.<br />
FOUCHER A. 2000. « Nature et formes de l’ ‘histoire tragique’ à Rome », Latomus 59,<br />
p.773-801.<br />
FRASCHETTI A. 1990. Roma e il principe, Rome-Bari.<br />
FRAZER R. M. 1966-67. « Nero the Artist Criminal », CJ 62, p. 17-20.<br />
FREARS J. R. 1977. Princeps a diis electus, The Divine Election of the Emperor as a<br />
Political Concept in Rome, American Academy in Rome, Papers and Monographs,<br />
XXVI.<br />
FREDE M. 1989. « Chaeremon der Stoiker », ANRW II, 36, 3, p. 2067-2103.<br />
FREYBURGER G. 1990. « Grieschicher Exotismus und römische Tradition in Senecas<br />
Theater », BLÄNSDORF J. (éd.), Theater und Gesellschaft im Imperium romanum,<br />
Tübingen, p. 123-131.<br />
FUCHS H. 1990. Lusus Toiae, Cologne.<br />
FUHRMANN M. 1997. Seneca und Kaiser Nero. Eine Biographie, Berlin.<br />
FUSAR-IMPERATORE G. 1978. Saggio di analisi critica della bibliografia neroniana dal<br />
1934 al 1975, Milan, p. 62-73.<br />
GABBA E. 1969. « Il Brutus di Accio », Dioniso 43, p. 377-384.<br />
GAFFORINI B. 1996. « Livia Drusilla tra storia e letteratura », RIL 130, p. 121-144.<br />
GAGÉ J. 1955. Apollon romain, Paris.<br />
GAGLIARDI D. 1966. « Il dibattito retorico-letterario a Roma nel I secolo dell’impero »,<br />
Aevum 40, p. 230-241, p. 238-240.<br />
GAILLARD J. (éd.)1996. Rome, 1 er siècle ap. J. C. Les orgueilleux défis de l’ordre<br />
impérial, Paris.<br />
GALIMBERTI A. 2002. « L’autore dell’Octavia », Pervertere : Ästhetik der<br />
Verkehrung.Literatur und Kultur neronischer Zeit und ihre Rezeption, Hrsg. von<br />
Luigi Castagna und Gregor Vogt-Spira unter Mitwirkung von Giovanna Galimberti<br />
Biffino und Bettina Rommel, K. G. Saur, Munich-Leipzig, p. 71-74.<br />
GALIMBERTI A., RAMELLI I. 2001. « L’Octavia e il suo autore : P. Pomponio<br />
Secondo ? », Aevum 75, p. 79-99.<br />
GALLIVAN P. A. 1973. « Nero’s Liberation of Greece », Hermes 101, p. 230-234.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
511
GALTIER F. 1999. « Néron, personnage tragique », Neronia V, 1999, p. 66-74.<br />
GAMBA G. 2000. Seneca revisitato, per una lettura contestuale dell’Apocolocyntosis e<br />
dell’ Octavia, Rome.<br />
GARELLI-FRANCOIS M.-H. 1992. « Le personnage entre deux regards. Réflexions à<br />
partir des Troyennes de Sénèque », Pallas 38, p. 397-405.<br />
- 1994. « Théâtre et politique dans l’œuvre de Sénèque »,<br />
Théâtre et cité. Séminaire du CRATA 1992-1994. Textes réunis par M. Menu,<br />
Toulouse, p. 87-105.<br />
- 1995.« Le danseur dans la cité. Quelques remarques sur la danse à Rome », REL 73,<br />
p. 29-43.<br />
- 1996. « Médée et les mères en deuil : échos, renvois, symétries dans le théâtre de<br />
Sénèque », Médée et la violence, Pallas 45, p. 191-204.<br />
- 1998a. « A propos du Thyeste d’Ennius : tragédie et histoire », Pallas 49, p. 159-171.<br />
- 1998b. « Tradition littéraire et création dramatique dans les tragédies de Sénèque :<br />
l’exemple des récits de messagers », Latomus 57, p. 15-32.<br />
- 2000a. Danser le mythe. La pantomime gréco-romaine : essai d’évaluation critique<br />
des documents pour une définition du genre, mémoire d’habilitation dactylographié,<br />
université Paris X.<br />
- 2000b. « Ludions, homéristes ou pantomimes ? (Sénèque, Ep. 117 ; Fronton, éd.<br />
Naber p. 158) », REA 102, p. 501-508.<br />
- 2001. « Des soldats sur la scène comique : espace dramatique et espace civique sous<br />
les Sévères dans l’Empire romain », Pallas 45, p. 321-336.<br />
- 2004. « Néron et la pantomime », HUGONIOT C., HURLET F., MILANEZI S.<br />
(éd.), Le Statut de l’acteur dans l’Antiquité grecque et romaine, Tours, p. 353-368.<br />
GASCOU J. 1984. Suétone historien, Rome.<br />
GAUDEMET J. Institutions de l'Antiquité, Paris, 1966 ; 2 e éd., Paris, 1982.<br />
- 1964. « Maiestas populi romani », Synteleia Arangio-Ruiz, p 708-709.<br />
GERSTER B. 1884. « L’Isthme de Corinthe : tentatives de percement dans l’Antiquité »,<br />
BCH 8, p. 224-232.<br />
GIANCOTTI F. 1953a. « Seneca amante d’Agrippina », PP 8, p. 53-62.<br />
- 1953b. « Il posto della biografia nella problematica senechiana, I : Dall’esilio al<br />
Ludus de Morte Claudii », RAL 8, p. 52-68.<br />
- 1953c. « Da quando e in che senso Seneca fu maestro di Nerone ? », RAL 8, p. 102-<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
512
118.<br />
- 1953d. « Il posto della biografia nella problematica senechiana, III : Seneca<br />
antagonista d’Agrippina », RAL 8, p. 238-262.<br />
-1954. « Il posto della biografia nella problematica senechiana, IV, 1 : Sfondo storico<br />
e data del De Clementia », RAL 9, p 329-344.<br />
- 1954. « Il posto della biografia nella problematica senechiana, IV, 2-4 : Il De<br />
Clementia », RAL 9, p 587-609.<br />
- 1981. « Seneca personnagio dell’Octavia », Dioniso 52, p. 67-107.<br />
- 1987. « Seneca tragico ed il potere : il Tieste », CHIABO M. ET DOGLIO F., Mito e<br />
realtà del potere nel teatro : dall’antichità classica al Rinascimento, Rome, p. 113-<br />
155.<br />
GILLIS D. 1963. « The Portrait of Afranius Burrus in Tacitus’ Annales », PP, 18, p. 5-22.<br />
GOLDBERG S. M. 1996. « The Fall and Rise of Roman Tragedy », TAPhA 126, p. 265-86.<br />
- 2003. « Authorizing Octavia », WILSON, M. (éd.), The Tragedy<br />
of Nero’s Wife. Studies on the Octavia Praetexta, Prudentia Vol. 35 No 1, Clearwater<br />
Cove, p. 13-36.<br />
GOLDSCHMIDT V. 1953. Le Système stoïcien et l’idée de temps, Paris.<br />
GORRICHON M. 1991. « L’influence de Sénèque sur une tragédie de Jean de la Taille, Saül<br />
le Furieux », Présence de Sénèque, éd. Par R. Chevalier et R. Poignault, coll.<br />
Caesarodunum 24 bis, Paris, Touzot éd., p. 155-170.<br />
GOULD J. B. 1970. The Philosophy of Chrysippus, Leiden.<br />
GOWING A. M. 1997. « Cassius Dio on the Reign of Nero », ANRW II, 34. 3, p. 2558-<br />
2590.<br />
GRAY-FOW M. 1998. « Why the Christians ? Nero and the Great Fire », Latomus 57,<br />
p. 595-616.<br />
GRIFFE E. 1967, Les persécutions contre les chrétiens, Paris.<br />
GRIFFIN M. T. 1976. Seneca, a Philosopher in Politics, Oxford.<br />
- 1984. Nero. The End of a Dynasty, New Haven.<br />
- 2002. Néron ou la fin d’une dynastie, traduction d’A. d’Hautcourt, Paris.<br />
GRIMAL P. 1960. « L’éloge de Néron au début de la Pharsale », REL 38, p. 296-305.<br />
-1963. « L’originalité de Sénèque dans la tragédie de Phèdre », REL 41, p. 297-314.<br />
- 1967. « Le discours de Sénèque à Néron dans les Annales de Tacite », GIF 20, p.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
513
131-138.<br />
- 1971. « Le De Clementia et la royauté solaire de Néron », REL 49, p. 205-217.<br />
- 1975. « le théâtre à Rome », Actes du IX e Congrès de l’Association G. Budé, 13-18<br />
avril 1973, Paris, p. 249-479.<br />
- 1976. « Sénèque et la vie politique au temps de Néron », Ktèma 1, p. 167-177.<br />
- 1978a. « Les rapports de Sénèque et de l’empereur Claude », CRAI, p. 469-78.<br />
- 1978b. Le lyrisme à Rome, Paris.<br />
- 1979. « Les allusions à la vie politique de l’Empire dans les tragédies de Sénèque »,<br />
CRAI, p. 205 –220.<br />
- 1982. « Le retour des Dardanides. Une légitimité pour Rome », Journal des Savants,<br />
juil-déc. p. 267-282.<br />
- 1983. « Le rôle de la mise en scène dans les tragédies de Sénèque. Clytemnestre et<br />
Cassandre dans l’Agamemnon », Théâtre et spectacles dans l’Antiquité. Actes du<br />
colloque de Strasbourg, 5-7 novembre 1981, Leiden, p. 123-139.<br />
- 1984. « Sénèque juge de Cicéron », MEFRA 96, p. 655-670.<br />
- 1991a. Sénèque ou la conscience de l’Empire, Paris.<br />
- 1991b. « Nature et fonction de la digression dans les œuvres en prose de Sénèque »,<br />
Entretiens sur l’antiquité classique, Fondation Hardt, Vandœuvres-Genève, 36,<br />
p. 219-245.<br />
- 1992. « L’image du pouvoir royal dans les tragédies de Sénèque », Pallas 38, p.<br />
409-416.<br />
- 1994. La Littérature latine, Paris.<br />
GRZYBEK E. 1999. « L' astrologie et son exploitation politique : Néron et les comètes »,<br />
CROISILLE J. M., MARTIN R. & PERRIN Y. (éd.), Neronia V. Néron, histoire et<br />
légende, p. 112-124.<br />
GUAGLIONE A. 1977. « Nerone ‘cantautore’ », AFLM 10, p. 91-134.<br />
GUILLAUMONT F. 1995. « Sénèque et l’Etrusca disciplina », Les Ecrivains et l’Etrusca<br />
disciplina, de Claude à Trajan, Tours, p. 1-14.<br />
GUILLEMIN A. 1957. « Sénèque, second fondateur de la prose latine », REL 35, p. 265-284.<br />
GUITTARD Ch. 1984. « Tite Live, Accius et le rituel de la deuotio », CRAI, p. 581-599.<br />
GYLES M. F. 1962. « Nero qualis artifex », CJ 57, p. 153-155.<br />
HADOT I. 1969. Seneca und die griechisch-römische Tradition der Seelenleitung, Berlin.<br />
HALFMANN H. 1986. Itinera Principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
514
Römischen Reich, Wiesbaden-Stuttgart.<br />
HAMMOND H. 1940. Hellenistic Influences on the Structure of the Augustan Principate,<br />
Mem. Amer. Ac. Rome XVII.<br />
HANKISON R. J. 1988. « Stoicism, Science and Divination », Apeiron 21, 2, p. 123-160.<br />
HANSLIK R. 1963, « Der Erzählungscomplex von Brand Roms und der Christenverfolgung<br />
bei Tacitus », Wiener Studien, 76, p. 92-109<br />
HARRISON G. 2001. Seneca in Performance, Londres.<br />
- 2003. « Forms of Intertextuality in the Octavia », WILSON, M. (éd.), The Tragedy of<br />
Nero’s Wife. Studies on the Octavia Praetexta, p. 112-125.<br />
HELDMANN K. 1968. « Senecas Phaedra und ihre griechischen Vorbilder », Hermes 96, p.<br />
88-117.<br />
HENRY D. & E. 1985. The Mask of Power. Seneca’s Tragedies and Imperial Rome,<br />
Warminster.<br />
- 1983. « The Œdipus of Seneca : an Imperial Tragedy », Ramus XII, p. 128-138.<br />
HENRY D. & WALKER B. 1963. « Tacitus and Seneca », G&R 2 e ser. 10, p. 98-110.<br />
- 1965. « The Futility of Action : a Study of Seneca’s Hercules Furens », CPh 60,<br />
p. 11-22.<br />
HERINGTON C. J. 1961. « Octavia Praetexta : a Survey », CQ 11, p. 18-30.<br />
- 1966. « Senecan Tragedy », Arion 5, p. 422-471.<br />
HERNUNEZ P. 1987. La Mise en scène dans la Rome antique, thèse Paris IV.<br />
HERRMANN L. 1924. Le Théâtre de Sénèque, Paris.<br />
- 1924. Octavie, tragédie prétexte, Paris.<br />
- 1927. « A propos du navire d’Agrippine », REA 29, p. 68-70.<br />
HERZOG O. 1928. « Datierung der Tragödien des Seneca », Rhein. Mus. 77, p. 51-104.<br />
HOLSON P. 1976. « Nero and the Fire of Rome. Fact and fiction », Pegasus 19, p. 37-44.<br />
HÜBNER W. 1984. « Manilius als Astrologue und Dichter », ANRW II, 32, 1, p. 126-320.<br />
HUGONIOT C., HURLET F., MILANEZI S. (éd.) 2004. Le Statut de l’acteur dans<br />
l’Antiquité grecque et romaine, Tours.<br />
IMPERATORE G. F. 1978. Saggio di analisi critica della bibliografia neroniana dal 1934 al<br />
1975, Milan.<br />
JACZYNOWSKA M. 1970. « Les organisations de jeunesse et l’aristocratie municipale au<br />
temps de l’Empire romain », NICOLET Cl. (éd.) 1970. Recherches sur les<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
515
structures sociales dans l’Antiquité classique, Colloque de Caen, 25-28 avril 1969,<br />
Paris, p. 265-274.<br />
JAL P. 1963. La Guerre civile à Rome. Etude littéraire et morale, Paris.<br />
JACQUEMIN A. 1996. « Pausanias et les empereurs romains », Ktèma 21, p. 29-42.<br />
JANSSENS L. 1988. « La datation néronienne de l’isopséphie », Aegyptus 68, p. 103-115.<br />
JEANMAIRE H. 1951. Dionysos. Histoire du culte de Bacchus, Paris.<br />
JORIO V. 1936. « L’autenticità della tragedia Hercules Œtaeus di Seneca », Riv. Indo<br />
Greco-Italica 20, p. 1-59.<br />
JUNGE R. 1999. « Nicolas Trevet und die Octavia Praetexta », Studien zur Geschichte<br />
und Kultur des Altertums 14, Paderborn, p. 197-199.<br />
KANNY-TURPIN J. 1999. « Comment échapper au destin : signes auguraux et pouvoir<br />
politique à Rome », SMADJA E. & GENY E. (éd.) 1999. Pouvoir, divination,<br />
prédestination dans le monde antique, Besançon, p. 259-272.<br />
KELLY H. A. 1979. « Tragedy and the Performance of Tragedy in Late Roman Antiquity »,<br />
Tradition 35, p. 27-30.<br />
KENNEL N. M. 1998. « Nevrwn periodonivkhı », AJPh 109, p. 239-251.<br />
KŒSTERMANN E. 1967. « Ein folgenschwerer Irrtum des Tacitus », Historia, Wiesbaden,<br />
16, p. 456-469.<br />
KOLENDO J. 1982. « Le projet d’expédition de Néron dans le Caucase », CROISILLE<br />
J.-M., FAUCHERE P. M. (éd.), Neronia 1977, Clermont-Ferrand, p. 23-30.<br />
KRAGELUND P. 1999. « Senecan Tragedy : Back on Stage ? », C&M 50, p. 235-247.<br />
- 2002. « Historical Drama in Ancient Rome : Republican Flourishing and Imperial<br />
Decline ? », SO 77, p. 5-51.<br />
KRILL R. M. 1972-73. « Allusions in Seneca’s Medea », CJ 68, p. 199-204.<br />
LANA I. 1955. Lucio Anneo Seneca, Turin.<br />
- 1964. L. Anneo Seneca e la posizione degli intellettuali romani de fronte al<br />
principate, Turin.<br />
LA PENNA A. 1979. Fra teatro, poesia et politica romana : con due scritti sulla cultura<br />
classica di oggi, Turin.<br />
- 1980. « Seiano in una tragedia di Seneca ? », Orpheus NS 1, p. 26-31.<br />
LARUE A. Délire et tragédie, Mont de Marsan, 1995<br />
LAWALL G. 1979. « Seneca’s Medea : the Elusive Triumph of Civilization », Arktouros.<br />
Hellenic Studies presented to B. M. W. Knox, p. 419-426.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
516
LE GALL J. 1985. « Le serment à l'empereur : une base méconnue de la tyrannie impériale<br />
sous le Haut-Empire? », Latomus 44, p. 767-783.<br />
LEFÈVRE E. 1969. « Quid ratio possit ?, Senecas Phaedra als stoisches Drama », Wiener<br />
Studien 82, p. 131-160.<br />
- (éd.). 1978. Der Einfluß Senecas auf das europäische Drama, Darmstadt.<br />
- 1985. « Die politische Bedeutung der römischen Tragödie und Senecas Œdipus »,<br />
ANRW II, 32, 3, p. 1242-1262.<br />
LEHMANN Y. 1999. « Divination et prédestination à Rome. Enjeux doctrinaux et<br />
politiques », SMADJA E. & GENY E. (éd.) SMADJA E. & GENY E. (éd.), Pouvoir,<br />
divination, prédestination dans le monde antique, Besançon. p. 249-258.<br />
LEO F. 1878. De Senecae tragoediis observationes criticae, Berlin.<br />
LEPELLEY C. 1969, L’Empire romain et le christianisme, Paris.<br />
LEPORE E. 1948. « Per la storia del principato neroniano », Parola del Passato, 3, p. 85-86.<br />
LEPPIN H. 1992. Histrionen. Untersuchungen zur sozialen Stellung von Bühnenkünstlern<br />
im Westen des Römischen Reiches zur Zeit der Republik und des Prinzipat, Bonn,<br />
Habelt.<br />
LESKY A. 1949. « Neroniana », Mélanges Henri Grégoire, Annuaire de l’Institut de<br />
philologie, usw. 9, Bruxelles, p. 385-389.<br />
LEVI M. A. 1949. Nerone e suoi tempi, Milan.<br />
LEVI M. A. 1967. L’impero romano, Milan.<br />
LIÉNARD E. 1939. « Les dégâts matériels causés par l’incendie de 64 », Latomus 3, p. 52-57.<br />
LORSCH R. S. 1997. « Augustus' Conception and the Heroic Tradition », Latomus, 56<br />
(4), p. 790-799.<br />
LOSSAU M. J. 1992. « jAmartiva, ajnagnwvrisiı, peripevteia : Tacite sur Tibère », REL<br />
70, p. 37-42.<br />
MACALINDON D. 1956. « Senatorial opposition to Claudius and Nero », AJPh 77, p. 113-<br />
132.<br />
MADER G. 2002a. « Masks and the Man : Atreus, Lycus and Performance of Power in<br />
Seneca », DEFOSSE P. (éd.), Hommages à Carl Deroux. 1, Poésie, Bruxelles, p. 336-<br />
347.<br />
-2002b. « Ut pictura poesis : Sea-bull and Senecan Baroque : Phaedra 1035-1049 »,<br />
C&M 53, p. 289-300.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
517
MALISSARD A. 1998. « Tacite et l’espace tragique », Pallas 49, p. 211-224 .<br />
MANNING C. E. 1975. « Acting and Nero’s Conception of the Principate », G&R II ser. 22,<br />
p. 164-175.<br />
MANS M. J. 1984. « The Macabre in Seneca’s Tragedies », Aclass 27, p. 101-119.<br />
Marc Antoine, son idéologie et sa descendance, Lyon (Société des Amis de Jacob Spon),<br />
1993.<br />
MANUWALD G. 2003. « The Concept of Tyranny in Seneca’s Thyestes and in Octavia »,<br />
WILSON M. (éd.) 2003. p. 37-59.<br />
MARROU H. I. 1965. Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Paris.<br />
MARTI B. M. 1949. « Place de l’Hercule sur l’Œta dans le corpus des tragédies de<br />
Sénèque », REL 27, p. 189-210.<br />
- 1945. « Seneca’s Tragedies, a New Interpretation », Trans. Am. Phil. Assoc. 76,<br />
p. 216-245.<br />
MARTIN R. F. 1991. Les Douze Césars. Du mythe à la réalité, Paris 2 e éd.<br />
- 1995. « La femme dans l’imaginaire romain, de Sénèque à Apulée », Les<br />
Imaginaires des Latins. Actes du colloque international de Perpignan (12-14<br />
novembre 1991), organisé par l’E.P.R.I.L., 2 e édition, Perpignan, p. 159-167.<br />
MATTINGLY H. 1965. Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. I, Augustus<br />
to Vitellius, Londres.<br />
MAURACH G. 1996. Seneca : Leben und Werk, Darmstadt.<br />
MAZZOLI G. 1998. « Les prologues des tragédies de Sénèque », Pallas 49, p. 121-134.<br />
MELLOR R. 1993. Tacitus, New-York- Londres.<br />
MELMOUX J. 1990. « L’empereur Claude et la finium imperii propagatio : l’exemple<br />
breton », CROISILLE J.-M. (éd.), Alejandro Magno modelo de los emperadores<br />
romanos. Neronia IV, Actes du IV e colloque international de la SIEN, Bruxelles, p.<br />
163-182.<br />
MELTZER G. 1988. « Dark Wit and Black Humor in Seneca’s Thyestes », TAPhA<br />
118, p. 309-330.<br />
MENDELL C. 1957. Tacitus, the Man and his Work, New Haven.<br />
MEULDER M. 1996. « Virgile n'a-t-il pas écrit la IV e Bucolique à la fin de 39 av. J.-C. ? »,<br />
Latomus 55 (4), p 815-828.<br />
- 2002. « Histoire et mythe dans la Vita Neronis de Suétone », Latomus 61.2, p. 362-<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
518
387.<br />
MICU I. 1981. « Quelques observations sur l’homme qui dépasse la condition humaine<br />
dans la tragédie Hercule sur l’Œta de Sénèque », Dioniso 52, p. 213-220.<br />
MICHEL A. 1969. La Philosophie politique à Rome, d’Auguste à Marc Aurèle, Paris.<br />
MOMIGLIANO A. 1960. « Literary Chronology of the Neronian Age », Secondo Contributo<br />
alla storia degli studi classici, Rome, p. 454-461.<br />
MOMMSEN Th. 1985. Histoire romaine, 5 vol., 3 e éd., Berlin.<br />
MORFORD M. 1985. « Nero’s Patronage and Participation in Litterature and the Arts »,<br />
ANRW II, 32, 3, p. 2003-2031.<br />
- 1968. « The Training of Three Roman Emperors », Phœnix 22, p. 57-72.<br />
MORTUREUX B. 1989. « Les idéaux stoïciens et les premières responsabilités politiques :<br />
le De clementia », ANRW II, 36, 3, p. 1639-1685.<br />
MOTTO A. L. 1966. « Seneca on Trial. The Case of the Opulent Stoic », CJ 61,<br />
p. 254-258.<br />
- 1973. Seneca, New York.<br />
- 2001. Further Essays on Seneca, Francfort-Bern.<br />
MOTTO A. L. & CLARK J.R. 1973. « Seneca’s Last Years », CO 50, p. 76-79.<br />
- 1975. « Ingenium facile et copiosum ; Point and Counterpoint in Senecan Style », CB<br />
52, p. 1-4.<br />
- 1978. « ‘There’s Something Wrong with the Sun’ : Seneca’s Œdipus and the Modern<br />
grotesque », CB 54, p. 41-44.<br />
- 1987. « Irony in Senecan tragedy », Philological Papers 33, p. 1-10.<br />
MOURGUES J.-L. 1988. « Les Augustians et l’expérience théâtrale néronienne », REL 66, p.<br />
156-181.<br />
- 1990. « Néron et les monarchies hellénistiques. Le cas des Augustians », Neronia IV.<br />
Alejandro Magno modelo de los emperadores romanos, Actes du IV e colloque de la<br />
S.I.E.N., Bruxelles, p. 196-210.<br />
MULLER L. 1994. « La mort d’Agrippine (Tacite, Annales, XIV, 1-13). Quelques<br />
éléments tragiques de la composition du récit », LEC 62, p. 27-43.<br />
MUNOZ VALLE I. 1967. « Cronologia de las tragedias de Séneca, estado actual de la<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
519
cuestion », Humanidades 19, p. 316-330.<br />
- 1975. « La critique adverse à Sénèque », RCCM 17, p. 257-268.<br />
MURRAY O. 1965. « The Quinquennium Neronis and the Stoics », Historia, p. 41-65.<br />
NAUMANN H. 1969. « Die Gestalt des Socrates und ihre Wirkungen auf die Weltliteratur »,<br />
AU 12, p. 64-103.<br />
NÉRAUDAU J.-P. 1982. « La parole et la voix », Neronia III, Actes du III e colloque<br />
international de la S.I.E.N., Varenna juin 1982, p. 101-124.<br />
- 1985. « Néron et le nouveau chant de Troie », ANRW II, 32, 3, p. 2032-2045.<br />
NICOLET C. 1976. Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris.<br />
NISBET-ROBIN G. M. 1990. « The Dating of Seneca’s Tragedies : with Special Reference<br />
to Thyestes », Papers of the Leeds International Latin Seminar, VI, p. 95-114.<br />
OLTRAMARE A. 1938. « Sénèque diplomate », REL 16, p. 318-335<br />
PAPADOPOULOU T. 2004. « Herakles and Hercules : the Hero’s Ambivalence in Euripides<br />
and Seneca », Mnemosyne, 57.3, p. 257-283.<br />
PARATORE E. 1952. « La figura di Agrippina Minor in Tacito », Maia 5, p. 32-81.<br />
- 1957. Storia del teatro tragico in Roma republicana, Milan.<br />
- 1970. Storia della letteratura latina, Florence.<br />
- 1972. « Di alcune questioni vivamente discusse, I. L’Hercules Œtaeus di Seneca »,<br />
Riv. Cult. Class. e Medioev. 14, p. 3-44.<br />
- 1975. « Le théâtre de Sénèque et celui du siècle d’or français », Actes du IX e congrès<br />
de l’Association Guillaume Budé (1973), Paris, 1975, I, p. 82-104.<br />
- 1981. « Seneca autore di theatro », Dioniso 52, p. 29-46.<br />
- 1985. « Studi su Seneca tragico », C&S 96, p. 58-64.<br />
PARKER E. 1946. « Education of Heirs in Julio-Claudian Family », AJPh. 67, p. 44-48.<br />
PEASE A. S. 1918. « On the authenticity of the Hercules Œtaeus », Trans. Am. Phil.<br />
Assoc. 49, p. 3-26.<br />
PERRENOUD A. 1963. « A propos de l’expression « redde crimen » (Sén., Méd., 246 ) »,<br />
Latomus 22, p. 489-497.<br />
PERRIN Y. 1992. « Le Prince, le Diable, le Bon Dieu et la Grenouille : images médiévales<br />
de Néron », Maisons de Dieu et hommes d’Eglise, florilège en l’honneur de Pierre-<br />
Roger Gaussin, Saint-Etienne, p. 237-263.<br />
- 1993. « Néron, Antoine, Alexandrie. Quelques notes sur un paradoxe », Marc<br />
Antoine, son idéologie et sa descendance. Actes du colloque organisé à Lyon le jeudi<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
520
28 juin 1990, Lyon-Paris, p. 93-106.<br />
- 1999. « L’image de Néron de sa mort à nos jours. Histoire et mémoire collective »,<br />
Neronia V. Néron: histoire et légende. Actes du V e Colloque international de la SIEN<br />
(Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, 2 - 6 novembre 1994) édités par Jean-Michel<br />
Croisille, René Martin et Yves Perrin. Bruxelles, p. 473-490.<br />
- 2002. Rome : paysage urbain et histoire, II e s. av.-II e s. ap., Paris.<br />
PETIT P. Histoire générale de l’Empire romain. I, le Haut-Empire (27 av. J. C.- 161 ap. J.<br />
C.), Paris, 1974.<br />
PICARD G.-Ch. 1962. Auguste et Néron, le secret de l’Empire, Paris.<br />
PICONE G. 1976. « Il significato politico di alcuni anacronismi nel Thyestes di Seneca », Pan<br />
III, p. 1-67.<br />
- 1981. « Ercole e Alessandro. Sen. De Ben. I, 13 », Pan VII, p. 135-144.<br />
- 1984. La fabula e il regno. Studi sul Thyestes di Seneca, Palerme.<br />
POE J. P. 1969. « An Analysis of Seneca’s Thyestes », TAPhA 100, p. 356-360.<br />
- 1989. « Octavia Praetexta and its Senecan Model », AJPh 110, p. 434-459.<br />
PRATT N. T. 1948. « The Stoic Base of Senecan Drama », TAPhA 79, p. 1-11.<br />
PRIETO F. 1977. El pensamiento politico de Seneca, Madrid.<br />
PRECHAC F. 1914. « Sénèque et la Maison d’Or », CRAI, p. 231-242.<br />
- 1934. « La date de la naissance de Sénèque » dans REL 12, p. 360- 375.<br />
RAMBAUD M. 1985. « L'aruspice Arruns chez Lucain, au livre I de la Pharsale (vv. 584-<br />
638) », Latomus 44, p. 281-300.<br />
RAMELLI I. 2002. « Ipotesi sulla datazione e sull’attribuzione dell’Octavia », Pervertere :<br />
Ästhetik der Verkehrung. Literatur und Kultur neronischer Zeit und ihre Rezeption,<br />
Hrsg. von Luigi Castagna und Gregor Vogt-Spira unter Mitwirkung von Giovanna<br />
Galimberti Biffino und Bettina Rommel, K. G. Saur, Munich-Leipzig, p. 75-76.<br />
RAWSON E. 1978. « Caesar, Caecina and the Disciplina Etrusca », JRS 68, p. 132-152.<br />
REGENBOGEN O. 1927/28« Schmertz und Tod in den Tragödien Senecas », Vorträge der<br />
Bibliothek Warbug, p. 167-218 = Kleine Schriften, Munich, 1961, p. 411-464.<br />
RODRIGUEZ ALMEIDA E. 1996. « Il Ludus de morte Claudii (Apocolocynthosis), un<br />
rebus storico-letterario », MEFRA 108 (1), p. 241-262.<br />
ROMAN Y. 2001. Empereurs et sénateurs. Une histoire politique de l’Empire romain,<br />
Paris.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
521
ROPER J. K. 1979. « Nero, Seneca and Tigellinus », Historia 28, p. 346-357.<br />
ROSE A. 1980. « Seneca’s Hercules Furens. A Politico-Didactic Reading », CJ 75, p. 135-<br />
142.<br />
ROUGÉ J. 1978. « Néron à la fin du IV e siècle », Latomus 37, p. 73-87.<br />
ROYO M. 1983. « L’Octavie entre Néron et les premiers Antonins », REL 61, p. 189-200.<br />
- 1994. « Le palais dans la Ville. Formes et structures topograpiques du pouvoir<br />
impérial d’Auguste à Néron », MEFRA 106, 1, p. 219-245.<br />
ROZELAAR M. 1985. « Neue Studien zu Tragödie Hercules Œtaeus», ANRW II, 32, 2,<br />
p. 1348-1419.<br />
RUTLAND L. W. 1978-79. « Women as Makers of Kings in Tacitus’ Annals », CW 72, p.<br />
15-29.<br />
SAGE M. M. 1990. « Tacitus’ Historical Works : A Survey and Appraisal », ANRW 33, 2,<br />
éd. W. Haase, Berlin-New York, p. 851-1030.<br />
SANCHEZ-OSTIZ A. 1999. TABULA SIARENSIS. Edicion, traduccion y comentario,<br />
Pampelune.<br />
SAUMAGNE C. 1962. « Les incendiaires de Rome (en 64 ap. J.-C.) et les lois pénales des<br />
Romains », Revue Historique, p. 337-360.<br />
SAURON G. 1994. Quis deum ? L’expression plastique des idéologies politiques et<br />
religieuses à Rome, Rome.<br />
SCAFFAI M. 1985. « Aspetti e problemi dell’Ilias <strong>Latina</strong> », ANRW II, 32, 3 p. 1926-<br />
1941.<br />
SCODEL R. 1993 (éd.). Theater and Society in the Classical World, University of Michigan<br />
Press.<br />
SCHEID J. 1995. « Les espaces cultuels et leur interprétation », Klio 77, p. 424-432.<br />
- 2002. La Religion des Romains, Paris.<br />
SCHMIDT P. L. 1985. « Die Poetisierung und Mythisierung der Geschichte in der Tragödie<br />
Octavia », ANRW, II, 32, 2, p. 1421-1453.<br />
- 1990. « Nero und das Theater », BLÄNSDORF J. (éd.), Teater und Gesellschaft im<br />
Imperium romanum, Tübingen, p. 149-169.<br />
SCHMITZ H. 1955. « Die Kaiserin Agrippina als Patronin der colonia Agrippinensium »,<br />
Gymnasium 62, p. 429-434.<br />
SCHOULER B. 1987. « Les sophistes et le théâtre au temps des empereurs », Anthropologie<br />
et théâtre antique. Actes du colloque international de Montpellier 6-8 mars 1986,<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
522
Cahiers du GITA n° 3, p. 273-294.<br />
SCHUBERT C. 1998. « Studien zum Nerobild in der lateinischen Dichtung der Antike »,<br />
Beiträge zur Altertumskunde 116, Stuttgart & Leipzig, p. 287-289.<br />
SCHUMANN G. 1930. Hellenistische und griechsiche Elemente in der Regierung Neros,<br />
Leipzig.<br />
SCHWARTZ F. F. 1968. « Senecas Tod, imitatio Socratis. Erlaüterungen aus Platon und<br />
Seneca zu Tacitus (Ann. XV, 62-64) », Jahr. des Real-Gymn. Graz 96, p. 1-14.<br />
SCOTT R. D. 1974. « The Death of Nero’s Mother », Latomus 33, p 105-115.<br />
SEGAL Ch. 1983. « Dissonant Sympathy : Song, Orpheus and the Golden Age in Seneca’s<br />
Tragedies », Ramus XII, p. 229-251.<br />
- 1984. « Senecan Baroque, the Death of Hippolytus in Seneca, Ovid and Euripides »,<br />
TAPhA 114, p. 311-325.<br />
SEGURA-RAMOS B. 1998. « Tacite ou la tragédie du pouvoir », Rome et le tragique,<br />
Pallas 49, p. 225-235.<br />
SEGURADO E CAMPO J. A. 1982. « Sur la typologie des personnages dans les tragédies de<br />
Sénèque », Neronia 1977, p. 223-232.<br />
SEITA M. 1979. « Seneca e il matricido di Nerone : analisi d’una drammatica notte », RSC<br />
37, p. 447-453.<br />
SHELTON J. A. 1978. Seneca’s Hercules Furens. Theme, Structure and Style, Göttingen.<br />
- 1979. « Seneca’s Medea as Mannerist Literature », Poetica, II, p. 38-82.<br />
SHIEL N. 1975-76. « Nero citharoedus », Euphrosyne VII, p. 175-179.<br />
SHOTTER D. C. A. 1969. « Two Notes on Nero », CPh 64, p. 109-111.<br />
SIRINELLI J. 1993. Les Enfants d’Alexandre. La littérature et la pensée grecque (331 av.<br />
J.-C.-519 ap. J.-C.) Paris.<br />
SMALLWOOD E. M. 1967. Documents Illustrating the principate of Gaius, Claudius and<br />
Nero, Cambridge.<br />
SMITH J. A. 1998. The Translation of Tragedy into Imperial Rome : a Study of Seneca’s<br />
Hercules Furens and Œdipus, Los Angeles.<br />
- 2003. « Flavian Drama : Looking Back with Octavia », BOYLE A. J. & DOMINIK<br />
W. J. (éd.), Flavian Rome. Culture, Image, Text, Leiden-Boston, p. 391-430.<br />
SORENSEN W. 1984. Seneca. Humanisten ved Neros hof, Copenhague 1976, trad. angl.<br />
par W. Glyn Jones, Seneca. The Humanist at the Court of Nero, Chicago.<br />
SPEYER W. 1971. « Tacitus Annalen 14, 53-56 und ein angeblicher Briefwechsel zwischen<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
523
Seneca und Nero », RhM 114, p. 351-359.<br />
SULLIVAN J. P. 1985. Literature and Politics in the Age of Nero, Ithaca N. Y. (Cornell<br />
University Press).<br />
SUTTON D. F. 1983. « The Dramaturgy of the Octavia », Beiträge zur klassischen<br />
Philologie 149, Königstein.<br />
- 1986. « Seneca on the Stage », Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava Suppl. 96,<br />
Leiden, p. VIII-72.<br />
SYME R. 1963. Tacitus, II, Oxford.<br />
- 1970. « Domitius Corbulo », JRS 60, p. 27-39.<br />
TAEGER F. 1960. Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes, t. II,<br />
Stuttgart.<br />
TAISNE A.-M. 1991. « Une scène de nécromancie à Thèbes chez Stace (Th. IV, 406-645)<br />
d’après Sénèque le dramaturge (Œd. 530-659) », Présence de Sénèque (colloque,<br />
Tours, 13-14 octobre 1989), Paris, p. 257-272.<br />
TANNER R. G. 1984. « Stoic Philosophy and Roman Tradition in Senecan Tragedy », ANRW<br />
II, 32, 3, p. 1100-1133.<br />
TARRANT R. J. 1978. « Senecan Drama and its Antecendents », HSCP 82, p. 213-263.<br />
TIMPE D. 1972. « Fabius Pictor und die Anfänge der römischen Historiographie », ANRW, I,<br />
2, p. 928-969.<br />
TOWNEND G. B. 1980. « Calpurnius Siculus and the Munus Neronis », JRS 70, p. 166-174.<br />
TRAGLIA A. 1984. « Germanico e il suo poema astronomico », ANRW II, 32, 1, p. 321-343.<br />
TREVES P. 1970. « Il giorno della morte di Seneca », Studia Florentina A. Ronconi oblata<br />
Rome, p. 507-527.<br />
VANDENBERG P. 1982. Néron, empereur et dieu, artiste et bouffon, Paris.<br />
VENDRIES C. 1997. « Les citharèdes : une élite de musiciens professionnels dans la Rome<br />
du Haut-Empire (I er -III e siècle ap. J.-C.) », Les Sociabilités musicales, textes réunis par<br />
L. Vadelorge et L. Tournès, Rouen, Cahiers du GRHIS 6, p.15-24.<br />
- 1999. Instruments à cordes et musiciens dans l’Empire romain. Etude historique et<br />
archéologique (II e siècle av. J. C. – V e siècle après), Paris.<br />
VERNANT J.-P., VIDAL-NAQUET P. 1972. Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris.<br />
VERSNEL H. S. 1970. Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning<br />
of the Roman Triumph, Leyde.<br />
VEYNE P. 1976. Le Pain et le cirque, Paris.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
524
- 1983. L’Elégie érotique romaine. L’amour, la poésie et l’Occident, Paris.<br />
VOISIN J.-L. 1987. « Exoriente sole (Suétone, Ner. 6). D’Alexandrie à la Domus aurea »,<br />
L’Urbs, espace urbain et histoire (I er siècle av. J.-C.-III e siècle apr. J.-C.), Actes<br />
du colloque international organisé par le CNRS et l’Ecole française de Rome (Rome,<br />
8-12 mai 1985), Rome, p. 509-543.<br />
WALTZ R. 1909. Vie de Sénèque, Paris.<br />
WARMINGTON B. H. 1969. Nero, Reality and Legend, Londres.<br />
- 1977. (éd.), Suetonius, Nero, Bristol.<br />
WATTEL DE CROIZANT O. 1991. « Sénèque amateur d’art : les tableaux mythologiques<br />
du chœur de Phèdre », Présence de Sénèque, éd. par R. Chevalier et R. Poingnault,<br />
Paris, p. 273-290.<br />
WEINSTOCK S. 1971. Divus Julius, Oxford.<br />
WILLE G. 1967. Musica Romana. Die Bedeutung der Musik im Leben der Römer,<br />
Amsterdam.<br />
WILLIAMS G. 1994. « Nero, Seneca and Stoicism in the Octavia », ELSNER J. &<br />
MASTERS J. (éd.), Reflections of Nero. Culture, History and representation Londres,<br />
Chapel Hill, p. 178-195.<br />
WILSON M. 2003. (éd.), The Tragedy of Nero’s Wife. Studies on the Octavia Praetexta,<br />
Prudentia Vol. 35 No 1, Clearwater Cove.<br />
YAVETZ Z. 1984. La Plèbe et le Prince. Foule et vie politique sous le Haut-Empire<br />
romain, Paris.<br />
ZORZETTI N. 1980. La Pretesta e e il teatro latino arcaico, Naples.<br />
- 1991. « Poetry and Ancient City, the Case of Rome », CJ 84, no 4, p. 311-329.<br />
ZUCHELLI B. 1964. Le Denominazioni latine dell’attore, Brescia.<br />
ZWIERLEIN O. 1966. Die Rezitationsdramen Senecas, Meisenheim am Glan.<br />
- 1984. Prolegomena zu einer kritichen Ausgabe der Tragödien Senecas, Wiesbaden.<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
525
TABLE<br />
INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................ 2<br />
I/ Présentation du sujet. .................................................................................................................... 2<br />
II/ Etat de la question ........................................................................................................................ 6<br />
A/ Les sources. ................................................................................................................................................ 7<br />
B/ Etat des études récentes sur Sénèque. ........................................................................................................ 9<br />
C/ Les tragédies. ............................................................................................................................................ 11<br />
III/ Enjeux et limites de l’étude : problématique. ......................................................................... 15<br />
IV/ Organisation d’ensemble. ......................................................................................................... 15<br />
PREMIERE PARTIE ............................................................................................................ 18<br />
LA RENCONTRE DU PRINCE ET DU PHILOSOPHE .................................................. 18<br />
Introduction ............................................................................................................................ 19<br />
Chapitre 1. Un philosophe stoïcien au service d’un empereur histrion : contradiction ou<br />
constat d’échec ? .................................................................................................................... 22<br />
I/ Un brillant parcours : l’ascension de Sénèque et l’accession de Néron au pouvoir. .............. 23<br />
A/ Sénèque avant sa rencontre avec Néron. .................................................................................................. 23<br />
B/ Le retour d’exil et le préceptorat de Néron. ............................................................................................. 25<br />
C/ La période d’influence de Sénèque. ......................................................................................................... 27<br />
II/ Sénèque conseiller et « ami » du prince : une proximité artistique et politique. .................. 32<br />
A/ Le rôle politique de Sénèque. ................................................................................................................... 32<br />
1/ Le rôle d’amicus principis. ................................................................................................................... 33<br />
2/ La fonction sénatoriale. ........................................................................................................................ 34<br />
3/ La politique étrangère. .......................................................................................................................... 36<br />
B/ Sénèque et la politique artistique de Néron. ............................................................................................. 37<br />
1/ Une stratégie de compromis ? .............................................................................................................. 37<br />
2/ Une implication relative dans la politique artistique du prince. ........................................................... 40<br />
III/ De la retraite à la disgrâce : l’affirmation des divergences et la confirmation d’une<br />
sensibilité commune. ........................................................................................................................ 45<br />
A/ Le déclin politique de Sénèque. ............................................................................................................... 45<br />
1/ Un événement décisif : la mort d’Agrippine. ....................................................................................... 45<br />
2/ L’influence croissante de Tigellin : un anti-Sénèque ? ........................................................................ 47<br />
3/ L’affirmation de l’indépendance de Néron. ......................................................................................... 51<br />
B/ L’aspiration à la retraite. .......................................................................................................................... 53<br />
C/ La mort du prince et celle du philosophe : un ultime témoignage de leur affinité avec le théâtre. .......... 56<br />
1/ La conjuration de Pison et ses conséquences. ...................................................................................... 56<br />
2/ Des morts dramatisées. ......................................................................................................................... 58<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
526
Chapitre 2. L’éducation de Néron et la place des activités artistiques. ............................ 63<br />
I/ Etat de la question : deux grandes orientations. ....................................................................... 63<br />
A/ Une éducation déplorable, expliquant la formation du monstre ? ........................................................... 63<br />
B/ Une éducation classique ? ........................................................................................................................ 66<br />
C/ Enjeux du débat : des clefs pour comprendre l’évolution du règne de Néron, et le développement de ses<br />
penchants tyranniques. .................................................................................................................................. 67<br />
II/ La formation d’un futur empereur. .......................................................................................... 70<br />
A/ L’enfance : le danseur et le barbier. ......................................................................................................... 70<br />
B/ Sous la direction d’Agrippine, une éducation au service de ses ambitions politiques : Chaérémon et<br />
Sénèque. ........................................................................................................................................................ 72<br />
III/ L’enseignement de Sénèque : enjeux et contenu. ................................................................... 76<br />
A/ Une méthode critiquée : l’impuissance de Sénèque à enrayer les penchants tyranniques de Néron. ...... 76<br />
1/ L’art oratoire. ....................................................................................................................................... 76<br />
2/ Les elementa doctrinae et la place de la philosophie. .......................................................................... 79<br />
3/ Les tragédies. ........................................................................................................................................ 82<br />
B/ L’échec de Sénèque : condamnation et simplification. ............................................................................ 84<br />
1/ L’art oratoire. ....................................................................................................................................... 84<br />
2/ Le témoignage des Lettres à Lucilius. .................................................................................................. 90<br />
IV/ La formation artistique. .......................................................................................................... 94<br />
A/ Terpnus. .................................................................................................................................................... 94<br />
B/ L’attitude de Sénèque face aux aspirations artistiques de son élève : l’art et la politique. ...................... 96<br />
Chapitre 3. La carrière de l’empereur-artifex et la politique néronienne en matière de<br />
spectacles. ................................................................................................................................ 99<br />
I/ L’infléchissement progressif de la politique spectaculaire. .................................................... 100<br />
A/ Premières armes. .................................................................................................................................... 101<br />
B/ L’instauration de jeux grandioses. .......................................................................................................... 104<br />
1/ Les concours équestres. ...................................................................................................................... 104<br />
2/ Les Maximi Ludi. ................................................................................................................................ 105<br />
C/ Les Juvénales de 59 et la création du corps des iuuenes Augustiani. ..................................................... 107<br />
1/ Les Juvénales. ..................................................................................................................................... 107<br />
2/ La constitution du corps des Iuuenes Augustiani. .............................................................................. 108<br />
II/ Le prince au centre du spectacle. ............................................................................................ 111<br />
A/ Les premiers jeux néroniens. .................................................................................................................. 111<br />
1/ Modèle grec et héritage augustéen. .................................................................................................... 112<br />
2/ Une étape décisive. ............................................................................................................................. 113<br />
B/ Premiers pas sur une scène publique. ..................................................................................................... 114<br />
1/ Le récital de Naples. ........................................................................................................................... 115<br />
2/ Le durcissement du régime. ............................................................................................................... 117<br />
C/ Les seconds jeux néroniens. ................................................................................................................... 120<br />
1/ Vaine résistance du Sénat. .................................................................................................................. 120<br />
2/ Primus inter pares : La permanence de la fonction impériale. .......................................................... 121<br />
III/ L’art au centre du pouvoir. .................................................................................................... 125<br />
A/ La Peregrinatio Achaica. ....................................................................................................................... 125<br />
1/ La longue maturation d’un projet grandiose. ..................................................................................... 125<br />
2/ Le témoignage des sources. ................................................................................................................ 127<br />
3/ Chronologie et itinéraire. .................................................................................................................... 129<br />
B/ to ; tevcnion hJma~ı diatrevyei. ............................................................................................................. 136<br />
1/ La dispersion des derniers temps. ...................................................................................................... 136<br />
2/ La tentation d’une carrière d’artiste professionnel. ............................................................................ 138<br />
Conclusion ............................................................................................................................ 141<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
527
DEUXIEME PARTIE ......................................................................................................... 143<br />
NERON, PRINCE TRAGIQUE ......................................................................................... 143<br />
Introduction .......................................................................................................................... 144<br />
Chapitre 4. Le répertoire du prince-artifex. ...................................................................... 146<br />
I/ Citharédie et tragédie. .............................................................................................................. 147<br />
A/ La citharédie, discipline de prédilection. ............................................................................................... 148<br />
1/ Le costume. ........................................................................................................................................ 148<br />
2/ Les concours. ...................................................................................................................................... 150<br />
3/ Une spécialisation connue de tous. .................................................................................................... 151<br />
B/ Nero tragoedus. ..................................................................................................................................... 153<br />
C/ La double spécialisation du prince : citharédie et tragédie chantée. ...................................................... 157<br />
1/ Des disciplines assez proches. ............................................................................................................ 157<br />
2/ Les conditions de représentation. ....................................................................................................... 158<br />
3/ La tragoedia cantata. ......................................................................................................................... 161<br />
II/ Le répertoire. ............................................................................................................................ 164<br />
A/ Les rôles. ................................................................................................................................................ 164<br />
B/ Néron auteur. .......................................................................................................................................... 167<br />
III/ L’incompatibilité des fonctions artistiques et politiques : le cas exemplaire de Néron. ... 174<br />
A/ La critique esthétique. ............................................................................................................................ 174<br />
1/ Un point de vue à relativiser. ............................................................................................................. 175<br />
2/ Enjeux politique du dénigrement des talents de Néron. ..................................................................... 177<br />
B/ La critique sociale et politique. .............................................................................................................. 178<br />
1/ La per<strong>version</strong> des valeurs romaines. .................................................................................................. 178<br />
2/ Le statut social des acteurs. ................................................................................................................ 182<br />
3/ Implications de la participation des élites aux spectacles : le plan néronien. .................................... 185<br />
Chapitre 5. Les tragédies de Sénèque et la tradition de théâtre politique, héritée de la<br />
République. ........................................................................................................................... 188<br />
I/ La tragédie à Rome. ................................................................................................................... 188<br />
A/ La tradition républicaine. ....................................................................................................................... 189<br />
1/ Choix et traitement des mythes. ......................................................................................................... 189<br />
2/ La tragédie prétexte. ........................................................................................................................... 192<br />
3/ La place du théâtre dans la vie civique. ............................................................................................. 193<br />
B/ Evolutions du genre sous l’Empire. ....................................................................................................... 195<br />
1/ Un déclin relatif. ................................................................................................................................. 195<br />
2/ La permanence de la dimension politique des tragédies. ................................................................... 196<br />
3/ Les réactions des détenteurs du pouvoir. ........................................................................................... 197<br />
II/ Le témoignage de Sénèque. ..................................................................................................... 199<br />
A/ L’illustration de la réflexion philosophique et politique. ....................................................................... 199<br />
1/ Oderint, dum metuant ! La tyrannie, principe de gouvernement fondé sur la crainte. ...................... 200<br />
2/ Vellem litteras nescirem ! Une parole sublime de Néron. .................................................................. 201<br />
B/ La connexion de la parole tragique et du contexte de représentation. ................................................... 203<br />
1/ Sulla et les luttes de la fin de la République. ..................................................................................... 203<br />
2/ Quid antiqua perscrutor ? des références aux empereurs. ................................................................. 204<br />
C/ Une réflexion sur le personnage tragique. .............................................................................................. 206<br />
1/ Le triomphe d’Atrée. .......................................................................................................................... 207<br />
2/ Une victoire illusoire. ......................................................................................................................... 208<br />
Chapitre 6. Le principat, un régime tragique ? ................................................................ 211<br />
I/ Le prince, les dieux, les héros. ................................................................................................... 212<br />
A/ La caution divine du pouvoir impérial. .................................................................................................. 213<br />
1/ L’ascendance. ..................................................................................................................................... 214<br />
2/ L’expression métaphorique d’un pouvoir illimité. ............................................................................. 216<br />
3/ Les bienfaits à l’origine de la divinisation des héros : l’exemple d’Hercule. .................................... 217<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
528
B/ Influences orientales et tradition romaine .............................................................................................. 219<br />
1/ Les monarchies hellénistiques. ........................................................................................................... 219<br />
2/ L’exemple d’Antoine. ........................................................................................................................ 221<br />
3/ Une certaine méfiance. ....................................................................................................................... 222<br />
C/ L’apport de Sénèque. .............................................................................................................................. 223<br />
1/ L’idéologie du De clementia .............................................................................................................. 224<br />
2/ La justification de l’engagement politique de Sénèque. .................................................................... 227<br />
II/ Le rôle des femmes. .................................................................................................................. 232<br />
A/ Une ascension politique notable. ............................................................................................................ 232<br />
1/ Une conquête progressive. ................................................................................................................. 232<br />
2/ Le rôle des femmes dans la dynastie julio-claudienne. ...................................................................... 233<br />
3/ Livie et Agrippine : femmes de pouvoir, femmes au pouvoir. .......................................................... 236<br />
B/ Femmes et pouvoir dans les tragédies de Sénèque. ................................................................................ 239<br />
1/ La double trahison de Phèdre. ............................................................................................................ 239<br />
2/ Mégare : la loyauté comme arme politique. ....................................................................................... 241<br />
C/ Impératrices et héroïnes tragiques : représentations communes. ........................................................... 243<br />
1/ Phèdre et Messaline : le furor amoureux. .......................................................................................... 244<br />
2/ Clytemnestre et Agrippine : la libido dominandi. .............................................................................. 246<br />
3/ Médée et Poppée : les ensorceleuses. ................................................................................................. 247<br />
III/ Affaires familiales, affaires d’état : la personnalisation du pouvoir impérial et ses<br />
conséquences. ................................................................................................................................. 249<br />
A/ La question de la légitimité. ................................................................................................................... 249<br />
1/ Un thème traditionnel. ........................................................................................................................ 249<br />
2/ Le problème de la légitimité dans les tragédies de Sénèque. ............................................................. 251<br />
B/ La personnalisation de l’institution et ses conséquences. ...................................................................... 257<br />
1/ La personnalisation institutionnelle et le transfert de sacralité. ......................................................... 258<br />
2/ histoire et tragédie. ............................................................................................................................. 260<br />
3 /Expression des caractéristiques du régime impérial dans les tragédies de Sénèque. ......................... 266<br />
Conclusion. ........................................................................................................................... 269<br />
TROISIEME PARTIE ........................................................................................................ 271<br />
LES TRAGEDIES ET L’EXPRESSION DU POUVOIR IMPERIAL ........................... 271<br />
Introduction .......................................................................................................................... 272<br />
Chapitre 7. Mythe et histoire dans les tragédies. .............................................................. 274<br />
Des mythes familiers. .................................................................................................................................. 274<br />
I/ Les indices de l’appropriation du mythe par la pensée romaine dans les tragédies. ........... 276<br />
A/ Anachronismes culturels et religieux. .................................................................................................... 277<br />
1/ La chasse. ........................................................................................................................................... 277<br />
2/ Les jeux. ............................................................................................................................................. 279<br />
3/ Les rites. ............................................................................................................................................. 281<br />
B/ Cadre juridique et vie publique : vers une lecture politique. .................................................................. 283<br />
1/ Indices lexicaux. ................................................................................................................................. 283<br />
2/ La place de la rhétorique. ................................................................................................................... 288<br />
II/ La signification de cette appropriation : l’exemple du thème de la divination dans Œdipe.<br />
......................................................................................................................................................... 292<br />
A/ Le sacrifice divinatoire (Œd. v. 291-389) et la pratique des haruspices. .............................................. 293<br />
1/ Le déroulement du sacrifice. .............................................................................................................. 293<br />
2/ La lecture des signes. ......................................................................................................................... 296<br />
3/ L’importance de la pratique des haruspices à Rome. ......................................................................... 296<br />
B/ La scène de nécromancie (Œd. v. 530-658) : un parti pris esthétique. .................................................. 298<br />
1/ Le topos du lucus. ............................................................................................................................... 299<br />
2/ Poétique de la terreur. ......................................................................................................................... 300<br />
3/ Le goût de la magie. ........................................................................................................................... 301<br />
C/ Implications philosophiques et politiques. ............................................................................................. 304<br />
1/ Les pratiques divinatoires à Rome. .................................................................................................... 304<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
529
2/ Le rôle politique de l’astrologie. ........................................................................................................ 306<br />
3/ Sénèque et la divination. .................................................................................................................... 307<br />
III/ Réalités romaines et problématiques impériales : l’environnement politique et militaire.<br />
......................................................................................................................................................... 312<br />
A/ Une géographie impériale. .................................................................................................................... 312<br />
B/ Le cas des guerres civiles. ...................................................................................................................... 315<br />
1/ Nefas : l’affrontement des frères, un thème tragique et une métaphore des guerres civiles. ............. 316<br />
2/Furor : le ressort tragique des guerres civiles. .................................................................................... 319<br />
C/ L’expression du pouvoir dans les tragédies. ......................................................................................... 323<br />
1/ Le triomphe et les attributions de l’empereur. ................................................................................... 323<br />
2/ La symbolique du triomphe dans les tragédies. ................................................................................. 326<br />
3/ Princeps, rex et tyrannus. ................................................................................................................... 331<br />
Chapitre 8. La question des allusions. ................................................................................ 337<br />
I/ L’actualité dans les œuvres de Sénèque. .................................................................................. 337<br />
A/ Précisions préalables. ............................................................................................................................. 337<br />
1/ La thèse d’un théâtre à clef. ............................................................................................................... 338<br />
2/ Une démarche réductrice. ................................................................................................................... 339<br />
B/Les références à l’actualité et au passé proche dans les œuvres philosophiques : le De ira. .................. 341<br />
1/ Clarté des références dans les œuvres en prose : les exempla. ........................................................... 341<br />
2/ Actualité et opacité. ............................................................................................................................ 343<br />
II/ De l’exemplum au personnage : Caligula. .............................................................................. 345<br />
A/ Caligula et Atrée. ................................................................................................................................... 345<br />
1/ Symptômes de la colère. ..................................................................................................................... 346<br />
2/ Le miroir et la folie. ............................................................................................................................ 347<br />
3/ Atrée et l’homo iratus. ....................................................................................................................... 348<br />
B/ L’apport de Caligula à l’élaboration des personnages tyranniques. ....................................................... 351<br />
1/ Œdipe et la naissance du tyran. .......................................................................................................... 351<br />
2/ La question de la clémence. ............................................................................................................... 352<br />
C/ Autonomie des personnages tragiques. .................................................................................................. 353<br />
III/ Les allusions à Néron dans les tragédies. .............................................................................. 356<br />
A/ Des références manifestes et positives : Les Troyennes. ........................................................................ 356<br />
1/ Les origines troyennes de la gens Iulia. ............................................................................................. 357<br />
2/ Le lusus Troiae. .................................................................................................................................. 358<br />
3/ Des allusions favorables. .................................................................................................................... 362<br />
B/ Médée : des allusions moins claires et plus problématiques. ................................................................. 365<br />
1/ L’incendie de Corinthe. ...................................................................................................................... 365<br />
2/ Le percement de l’Isthme. .................................................................................................................. 369<br />
3/ Une allusion flatteuse, en apparence. ................................................................................................. 371<br />
C/ Superposition des références. ................................................................................................................ 377<br />
1/ De Tibère à Néron. ............................................................................................................................. 378<br />
2/ Sur les traces de Caligula. .................................................................................................................. 383<br />
Chapitre 9. Personam induisti, agenda est : les tragédies à l’épreuve du pouvoir. ...... 389<br />
I/ Néron, destinataire privilégié des tragédies. ............................................................................ 391<br />
A/ Néron spectateur. .................................................................................................................................... 391<br />
1/ Le prince mécène. .............................................................................................................................. 391<br />
2/ Littérature et politique. ....................................................................................................................... 394<br />
B/ Le témoignage de la familiarité de Sénèque et Néron. ........................................................................... 395<br />
1/ L’exemple du thème troyen. ............................................................................................................... 396<br />
2/ Une sensibilité commune. .................................................................................................................. 398<br />
3/ Les réactions de Néron, figure du pouvoir hors-scène. ...................................................................... 401<br />
II/ Signification politique des tragédies. ...................................................................................... 405<br />
A/ le pouvoir impérial en question. ............................................................................................................. 405<br />
1 / Du conseil à l’opposition. .................................................................................................................. 406<br />
2/ Un exemple de réalisme politique ? ................................................................................................... 412<br />
3/ La tragédie, un espace pour le doute. ................................................................................................. 414<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
530
B/ Une lecture tragique de la politique. ...................................................................................................... 417<br />
1/ L’évocation mythologique de l’histoire ............................................................................................. 418<br />
2/ La mort mise en scène. ....................................................................................................................... 420<br />
III/ Le passage au mythe. .............................................................................................................. 424<br />
A/ L’ambiguïté de la vision du pouvoir. ..................................................................................................... 425<br />
1/ Le chœur et les limites de la philosophie. .......................................................................................... 426<br />
2/ Une philosophie affaiblie. .................................................................................................................. 433<br />
3/ Le côté obscur du pouvoir. ................................................................................................................. 437<br />
B/ Néron et le brouillage des limites de la réalité : fusion ou confusion ? ................................................. 443<br />
1/ Discours impérial, discours théâtral. .................................................................................................. 444<br />
2/ Les conséquences du néronisme. ....................................................................................................... 446<br />
Chapitre 10. Au-delà des tragédies : Octavie du Pseudo-Sénèque. ................................. 449<br />
I/ Une tragédie qui reste mystérieuse. .......................................................................................... 450<br />
A/ Etat de la question .................................................................................................................................. 450<br />
1/ Une œuvre apocryphe. ........................................................................................................................ 450<br />
2/ Date et circonstances de la composition : quel public ? ..................................................................... 451<br />
3/ Pseudo-Sénèque ? Hypothèses. .......................................................................................................... 452<br />
B/ Matière historique, matière mythique : un traitement comparable. ....................................................... 454<br />
1/ Mort d’une impératrice. ...................................................................................................................... 454<br />
2/ La tyrannie de Néron. ......................................................................................................................... 457<br />
II/ La question de l’image de Sénèque dans l’Octavie. ............................................................... 462<br />
A/ Le problème de l’action politique. ......................................................................................................... 463<br />
B/ Limites de l’apologie. ............................................................................................................................. 465<br />
III/ Ecueils de la simplification. .................................................................................................... 466<br />
A/ L’absence de l’art. .................................................................................................................................. 467<br />
1/ Choix politiques… ............................................................................................................................. 468<br />
2/ … ou esthétiques ? ............................................................................................................................. 468<br />
B/ Personnage historique, personnage tragique. ......................................................................................... 470<br />
1/ Octavie, ou la métamorphose d’une impératrice en héroïne tragique. ............................................... 470<br />
2/ Néron, ou la préexistence du mythe. .................................................................................................. 473<br />
Conclusion ............................................................................................................................ 478<br />
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................. 481<br />
Le prince, le philosophe et la tragédie. ....................................................................................................... 481<br />
La part de l’ombre. ...................................................................................................................................... 483<br />
La tragédie et l’expression du pouvoir. ....................................................................................................... 486<br />
Limites. ........................................................................................................................................................ 492<br />
De l’histoire au mythe. ................................................................................................................................ 493<br />
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 496<br />
I/ TEXTES ANCIENS ................................................................................................................... 496<br />
A/ Auteurs. ................................................................................................................................................. 496<br />
B/ Recueils de textes .................................................................................................................................. 499<br />
C/ Œuvres de Sénèque. ............................................................................................................................. 500<br />
1/ Œuvre en prose et Apocoloquintose. .................................................................................................. 500<br />
2/ Tragédies. ........................................................................................................................................... 501<br />
Œuvres complètes .................................................................................................................................. 501<br />
Editions commentées .............................................................................................................................. 501<br />
II/ INDICES VERBORUM ........................................................................................................... 502<br />
III/ BIBLIOGRAPHIES ............................................................................................................... 502<br />
IV/ ETUDES MODERNES ........................................................................................................... 503<br />
TABLE .................................................................................................................................. 526<br />
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
531
Nathalie Cros, L’Empereur et le tragique, thèse de doctorat, 2005<br />
532