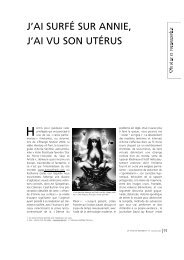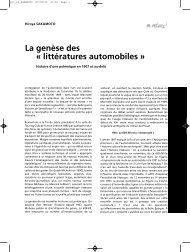LES PETITS MONDES DE L'ART - La Voix du regard
LES PETITS MONDES DE L'ART - La Voix du regard
LES PETITS MONDES DE L'ART - La Voix du regard
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Plus généralement d’ailleurs, et pour revenir sur l’hypothèse<br />
qui est la nôtre – la ré<strong>du</strong>ction pour une<br />
meilleure compréhension sensible de nos espaces de<br />
vie (artistiques ou non) – il semble que la maquette<br />
telle que la fabriquent les artistes puisse amener à une<br />
lecture inédite de notre environnement social et culturel.<br />
Chez Daniel Chust Peters, nous avons vu que<br />
l’atelier miniature pouvait se faire lieu de projection et<br />
de spéculation pour le spectateur, en déplaçant effectivement<br />
son rapport à l’œuvre. Cependant, le travail<br />
génère également un espace spécifique qui renvoie,<br />
comme chez Erwin Driessens et Maria Ve r s t a p p e n ,<br />
hors <strong>du</strong> contexte de l’art, pour questionner davantage<br />
notre lien au réel, à ce d é j à - l à révélé sous un jour<br />
inédit par la réappropriation de l’artiste. Pour son<br />
exposition à la galerie EOF par exemple 1 5 , Daniel<br />
Chust Peters a fabriqué une maquette manipulable en<br />
carton (Air Liquid), dans laquelle il a glissé une microcamera,<br />
l’image de l’intérieur de l’atelier reconstitué<br />
étant retransmise sur un écran externe situé juste à<br />
côté. Ce qui est remarquable dans ce type d’installation,<br />
c’est que le modèle ré<strong>du</strong>it ne constitue plus tout<br />
à fait une fin en soi, puisqu’il permet de créer des<br />
images en s’intro<strong>du</strong>isant à l’intérieur de l’objet.<br />
L’artiste génère par conséquent un autre mode de<br />
représentation, les vues intérieures étant d’autant<br />
plus saisissantes qu’elles pro<strong>du</strong>isent sur le spectateur<br />
un effet de réalité largement supérieur à la maquette<br />
elle-même. En outre, Daniel Chust Peters brouille les<br />
pistes, le <strong>regard</strong> hésite à faire un lien direct entre téléviseur<br />
et maquette, et peine à déterminer l’échelle de<br />
l’espace filmé. Il s’agit de jouer sur une perte de repère<br />
par trompe-l’œil, l’artiste utilisant à la fois les artifices<br />
de certains matériaux (comme le papier peint au<br />
motif mur de pierres), et la sensation de profondeur<br />
et de restitution détaillée des volumes <strong>du</strong>e à l’usage<br />
de la micro-caméra.<br />
On pense alors au troublant travail photographique<br />
de Thomas Demand, qui construit des maquettes en<br />
papier et carton servant uniquement à créer ses<br />
15. Galerie EOF, Carte blanche à Maribel Nadal Jové, 15-26 avril2003.<br />
images. Vues de bureaux ou de lieux d’habitation,<br />
couloirs, bibliothèques, salle de classes ou de<br />
réunion, l’artiste allemand reconstitue nos espaces<br />
de vie et les photographie pour pro<strong>du</strong>ire des images<br />
emblématiques, où la sobriété des maquettes<br />
accompagne l’absence de toute figure humaine. Du<br />
carton découpé avec rigueur au strict respect des<br />
proportions, <strong>du</strong> sens <strong>du</strong> détail à celui de la simplification,<br />
tout se fait avec application et exactitude, et<br />
même le désordre d’un bureau semble répondre à<br />
une logique secrète. Lorsque l’artiste fabrique un<br />
é v i e r, une chambre ou un magasin de photocopies,<br />
il cherche la forme générique qui contiendra toutes<br />
les autres, comme une i d é e d’espace dans laquelle<br />
chacun peut se retrouver. Il dit lui-même : « le papier<br />
que j’utilise étant celui que l’on trouve dans n’importe<br />
quel magasin de fourniture, la gamme chromatique<br />
disponible reflète et correspond toujours à<br />
ce qui se fait à ce moment. (…) Cela m’est très utile<br />
pour créer ce " d é j à - vu", de sorte que l’image nous<br />
apparaît comme une vieille connaissance» 1 6 . A nouveau,<br />
plus que de proposer une utopie, il s’agit de<br />
ramener l’attention aux choses qui nous entourent,<br />
aux espaces que nous habitons, la ré<strong>du</strong>ction mais<br />
aussi la réplication con<strong>du</strong>isant à épurer les formes<br />
pour mieux révéler ce qui fonde notre environnement<br />
familier. Conséquence directe <strong>du</strong> passage au<br />
modèle ré<strong>du</strong>it, toute anecdote, tout parasitage – y<br />
compris celui <strong>du</strong> langage que l’artiste évacue –<br />
n’existent plus, et le monde <strong>du</strong> travail comme celui<br />
de la sphère domestique, d’une manière presque<br />
limpide, dévoilent leur nature aliénante. Comme le<br />
suggère Régis Durand, l’œuvre de Thomas Demand<br />
libère « la vraie nature des intentions, l’inconscient<br />
ou l’impensé des bâtiments en quelque sorte, loin de<br />
tout ce qui peut les dissimuler, l’ornement ou l’activ<br />
i té » 1 7 . Dans sa lumière irréelle, par ses surf a c e s<br />
lisses et uniformes, la vie d’aujourd’hui apparaît bel<br />
et bien « a d m i n i s t r ée» 1 8 , réglée par une logique de<br />
gestion fonctionnelle et anonyme. De l’étagère remplie<br />
d’archives muettes et inaccessibles à la salle de<br />
16. Thomas Demand cité par François Quintin, « there is no innocent room », in Thomas Demand catalogue de l’exposition, Fondation Cartier, Edition<br />
Actes Sud, Paris, 2000, p. 68.<br />
17. Régis Durand, « <strong>La</strong> fin des récits ou “ la vie administrée ” », in Thomas Demand, op. cit., p. 76.<br />
18. Ibid. , p. 83. Régis Durand emprunte ici l’expression à théodore Adorno.<br />
Échelles indécidables<br />
179