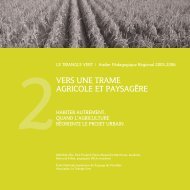Apprendre hors les murs - Paysage et urbanisme durable
Apprendre hors les murs - Paysage et urbanisme durable
Apprendre hors les murs - Paysage et urbanisme durable
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
éseau de territoires<br />
N° Hors-série de « Chronique d’un Atelier »<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Territoires d’enseignements<br />
Témoignages <strong>et</strong> points de vue d’acteurs
APPRENDRE HORS LES MURS<br />
TERRITOIRES D’ENSEIGNEMENTS<br />
TEMOIGNAGES ET POINTS DE VUE D’ACTEURS<br />
Rencontres réalisées de 2005 à 2009 entre l’Ecole Nationale Supérieure de Nancy<br />
<strong>et</strong> <strong>les</strong> communes du Parc naturel régional du Massif des Bauges (74) <strong>et</strong> du Revermont (01)
PARTENAIRES<br />
CONTRIBUTIONS<br />
REALISATION<br />
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy<br />
http://www.nancy.archi.fr<br />
Parc naturel régional du Massif des Bauges<br />
http://www.pnr-massif-bauges.fr<br />
Mairie-conseils - Caisse des Dépôts<br />
http://www<br />
Par ordre d’apparition dans la publication<br />
Lorenzo DIEZ, Directeur de l’ENSA de Nancy - André GUERRAZ, Président du PNR du Massif des Bauges - Yves GORGEU, Directeur d’études à Mairie-conseils - Simon<br />
PAILLET, Architecte-Urbaniste au PNR du Massif des Bauges - Vincent BRADEL, Architecte Maître Assistant à l’ENSA de Nancy - André VAXELAIRE, Architecte-Urbaniste<br />
Maître Assistant à l’ENSA de Nancy - Marc VERDIER, Architecte-Urbaniste Maître Assistant à l’ENSA de Nancy - Claire KLINGER, Architecte - Nicolas LAVAUD, Architecte<br />
- Jérémie HAYE, Architecte - Noémie AUSSEDAT, Architecte - Jean-Nicolas PINAIRE, Architecte - Benoit DHENNIN, Architecte - Jean THIRIET, Architecte - Jérémy<br />
ROUSSEL, Etudiant - Jean-Louis DUBOIS, Maire d’Héry-sur-Alby - Georges PACQUETET, Maire honoraire de Saint-Jorioz - Etienne PILARD, Maire de Cru<strong>et</strong> - Régis<br />
AMBROISE, Ingénieur Agronome - Jean-Vincent BERLOTTIER, Architecte-Urbaniste - Philippe GIRARDIN, Président du PNR des Ballons des Vosges - Jean-Jacques<br />
DAILLOT, Préseident de la Communauté de Communes du Val de Galilée - Jean PICCHIONI, Président de l’Espace Belledonne - Odile MARCEL, Philosophe - Martin<br />
CHENOT, Directeur de l’ENSA de Saint- Etienne - Xavier GUILLOT, Architecte Maître Assistant à l’ENSA de Saint-Etienne - Nathalie MEZUREUX, Directrice de l’ENSA de Lyon<br />
Document réalisé en Mai 2009 à l’ENSA de Nancy - par Pauline CASAROMANI, sous la direction de Marc VERDIER <strong>et</strong> de Vincent BRADEL-<br />
en collaboration avec Mairie-conseils, service de la Caisse des Dépôts<br />
C<strong>et</strong>te publication s’inscrit également comme numéro 4 Hors série de «Chronique d’un atelier», documents réalisés <strong>et</strong> publiés par l’ENSA de Nancy présentant <strong>les</strong> ateliers de proj<strong>et</strong><br />
enseignés dans le Master «Vil<strong>les</strong> territoires <strong>et</strong> Sociétés» depuis l’année Universitaire 2005-2006 <strong>et</strong> consultab<strong>les</strong> depuis le site de l’ENSA de Nancy.<br />
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES ET SOURCES DOCUMENTAIRES<br />
Les photographies ont été réalisées par <strong>les</strong> étudiants de l’ENSAN de Nancy au cours des ateliers 2006-2007-2008-2009<br />
à l’exception du portait de Nathalie MEZUREUX photographiée par Bernad<strong>et</strong>te FOREST de l’ENSA de Lyon<br />
ainsi que certains portraits-photos d’acteurs qu’ils nous ont volontairement communiqué ou en provenance de sites intern<strong>et</strong>
SOMMAIRE<br />
1<br />
2<br />
3<br />
PREAMBULES<br />
A LA RENCONTRE DU TERRITOIRE<br />
TEMOIGNAGES<br />
Le Directeur de l’ENSAN <strong>et</strong> le Président du PNRMB 1-4<br />
Le Réseau Territoire de Mairie-Conseils<br />
Le PNR du Massif des Bauges<br />
Le Master «Vil<strong>les</strong>, Territoires <strong>et</strong> Sociétés» de l’ENSAN<br />
Les étudiants : Que sont-ils devenus ?<br />
Les communes : Territoires d’expérimentation<br />
Agriculture <strong>et</strong> Urbanisme : des conivences à réinventer<br />
Echelle de territoire, échelle de proj<strong>et</strong> : Attentes <strong>et</strong> perspectives<br />
POUR UN URBANISME RURAL DURABLE<br />
Nathalie MEZUREUX, Directrice de l’ENSA de Lyon<br />
Vincent BRADEL <strong>et</strong> Marc VERDIER, <strong>les</strong> maîtres d’oeuvre des ateliers<br />
1<br />
6<br />
7<br />
9<br />
11<br />
19<br />
22<br />
23<br />
29<br />
35<br />
44<br />
Odile MARCEL, Philosophe 45<br />
Martin CHENOT , Directeur de l’ENSA de Saint-Etienne<br />
47<br />
49<br />
51
1<br />
Préambu<strong>les</strong><br />
Lorenzo DIEZ<br />
Directeur de l’ENSA de Nancy<br />
« 4 ans déjà que <strong>les</strong> étudiants de cycle Master de l’Ecole Nationale Supérieure<br />
d’Architecture de Nancy, travaillent sur le territoire du Parc naturel régional des<br />
Bauges grâce au soutient sans faille de son président, André Guerraz, <strong>et</strong> de<br />
son architecte, Simon Paill<strong>et</strong>.<br />
4 ans pour écouter, observer, analyser <strong>et</strong> vraisemblablement aimer un type<br />
de territoire, le rural, qui, après avoir été le cœur de nos sociétés, nous est<br />
devenu presque étranger laissant place au modèle urbain.<br />
4 ans pour imaginer, proposer <strong>et</strong> innover sur ces territoires ruraux, à diverses<br />
échel<strong>les</strong> : une place, un lotissement, une vallée, avec <strong>les</strong> « outils » de<br />
l’architecte.<br />
4 ans enfin à redécouvrir ou inventer puis à transm<strong>et</strong>tre aux étudiants des<br />
outils <strong>et</strong> des méthodes d’analyses <strong>et</strong> de conception architecturale efficients<br />
pour ces territoires.<br />
Aussi, après c<strong>et</strong>te première étape, un bilan <strong>et</strong> une mise en perspective nous est<br />
apparu intéressant ainsi qu’à nos partenaires.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
«Un bilan positif <strong>et</strong> porteur de perspectives»<br />
C’est l’obj<strong>et</strong> de notre numéro spécial de « Chronique d’un atelier ».<br />
Il rassemble ainsi, outre la présentation synthétique de nos différentes expériences<br />
pédagogiques dans <strong>les</strong> Bauges, un ensemble de témoignages d’acteurs qui nous<br />
font part de leur r<strong>et</strong>our d’expérience ou bien nous proposent une mise en<br />
perspective.<br />
Qu’ils soient remerciés pour ces contributions.<br />
Ce numéro spécial de « Chronique d’un atelier » vient aussi enrichir <strong>les</strong><br />
témoignages <strong>et</strong> <strong>les</strong> échanges de notre première rencontre du réseau « Territoire<br />
d’enseignements ».<br />
C<strong>et</strong>te rencontre, temps fort du parcours collectif vers un <strong>urbanisme</strong> rural <strong>durable</strong>,<br />
est possible aujourd’hui grâce au partenariat entre l’Ecole Nationale Supérieure<br />
d’Architecture de Nancy, Mairie-conseils, service de la Caisse des Dépôts <strong>et</strong> le<br />
Parc naturel régional du Massif des Bauges.
Je me réjouis de constater que ce bilan est positif pour bon nombre de<br />
nos partenaires <strong>et</strong> porteur de plusieurs perspectives fortes pour <strong>les</strong> éco<strong>les</strong><br />
d’architectures.<br />
En eff<strong>et</strong>, l’exemple de Nancy n’est pas unique.<br />
De plus en plus, <strong>les</strong> éco<strong>les</strong> d’architecture, avec notre partenaire institutionnel<br />
qu’est le Ministère de la culture <strong>et</strong> de la communication, s’intéressent au monde<br />
rural, à ses richesses <strong>et</strong> potentialités mais aussi à ses handicaps <strong>et</strong> ses limites.<br />
Devant la perspective d’un <strong>urbanisme</strong> économe <strong>et</strong> <strong>durable</strong>, <strong>les</strong> modè<strong>les</strong> des<br />
territoires ruraux sont très certainement à redécouvrir <strong>et</strong> à réinventer :<br />
une piste évidente <strong>et</strong> passionnante pour la formation initiale des architectes<br />
mais aussi pour la recherche architecturale <strong>et</strong> urbaine.»<br />
Commune de Lautenbach, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Atelier 2008-2009<br />
« 4 ans déjà »<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
2
Préambu<strong>les</strong><br />
André GUERRAZ<br />
Président du Parc naturel régional du Massif des Bauges<br />
3 <strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
«Les collectivités loca<strong>les</strong> assument des responsabilités croissantes en matière<br />
de paysage <strong>et</strong> de cadre de vie. Leur volonté d’agir en ce domaine répond à une<br />
demande sociale exprimée à la fois par <strong>les</strong> habitants, <strong>les</strong> entreprises en quête<br />
d’implantation, <strong>les</strong> visiteurs <strong>et</strong> <strong>les</strong> acteurs économiques du tourisme<br />
Le mot paysage nous évoque immédiatement de « beaux paysages », des sites<br />
exceptionnels. Mais le paysage, c’est aussi <strong>les</strong> espaces que nous traversons<br />
quotidiennement.<br />
A ce titre, la loi confère une forte légitimité à l’intervention en faveur du paysage.<br />
le paysage, patrimoine commun de la nation, est d’intérêt général ;<br />
<strong>les</strong> lois de décentralisation ont affirmé <strong>les</strong> responsabilités des collectivités publiques<br />
en matière de paysage ;<br />
la loi paysage a marqué l’importance de sa préservation, de sa mise en valeur, de<br />
sa gestion :<br />
« La préservation de la qualité de nos paysages est aujourd’hui une aspiration<br />
collective. Les paysages français constituent un patrimoine commun (…). L’Etat,<br />
<strong>les</strong> communes <strong>et</strong> l’ensemble des collectivités territoria<strong>les</strong> doivent participer à la<br />
protection <strong>et</strong> à la mise en valeur des paysages. »<br />
Les Parcs naturels régionaux constituent une forme d’organisation intercommunale<br />
ayant une responsabilité particulièrement forte en matière de paysage. C<strong>et</strong>te<br />
responsabilité a été renforcée par la loi sur le paysage.<br />
Certes, la dimension réglementaire reste un outil.<br />
Elle est la traduction d’un proj<strong>et</strong> mais ne le détermine pas ; le règlement d’un<br />
PLU sera d’autant plus pertinent que le proj<strong>et</strong> de la collectivité sera bien défini,<br />
par exemple dans <strong>les</strong> opérations d’extensions urbaines ou l’aménagement d’espaces<br />
publics.<br />
«accompagner la réflexion, stimuler l’innovation, perm<strong>et</strong>tre <strong>les</strong> échanges»<br />
Depuis plus de dix ans, le Parc naturel régional du Massif des Bauges est aux<br />
côtés des collectivités loca<strong>les</strong>.<br />
Le partenariat avec l’enseignement supérieur a renforcé d’autant c<strong>et</strong>te capacité<br />
de recherche <strong>et</strong> d’actions.<br />
Le travail que nous avons développé avec <strong>les</strong> étudiants de l’Ecole Nationale<br />
d’Architecture de Nancy nous renvoie à différentes interrogations.<br />
Comment répondre aux besoins <strong>et</strong> aux aspirations des habitants présents <strong>et</strong><br />
futurs du territoire ?<br />
Sommes-nous capab<strong>les</strong> d’audace <strong>et</strong> d’imagination ?
Aujourd’hui, je remercie chaleureusement le Directeur de l’Ecole Nationale<br />
Supérieure d’Architecture de Nancy, <strong>les</strong> enseignants <strong>et</strong> <strong>les</strong> étudiants pour<br />
l’intérêt qu’ils ont manifesté pour notre territoire, l’exigence de la réflexion <strong>et</strong><br />
<strong>les</strong> actions mises en œuvre.<br />
C<strong>et</strong>te association Parc / Ecole d’Architecture a permis de partager nos<br />
expertises, d’échanger <strong>et</strong> de proposer des proj<strong>et</strong>s.<br />
Sur la base des propositions de nos communes, je tiens à remercier cel<strong>les</strong><br />
qui ont tenté c<strong>et</strong>te expérience <strong>et</strong> invite nos maires à se risquer à c<strong>et</strong>te riche<br />
confrontation.<br />
Le regard de l’Ecole d’architecture intervient aussi comme un élément déclencheur<br />
de débat au sein d’une collectivité comme le Parc.<br />
Rien de mieux pour réagir que des sollicitations nouvel<strong>les</strong> formulées par de<br />
jeunes étudiants futurs professionnels de l’aménagement du territoire.»<br />
« Le regard de l’Enseignement supérieur comme élément déclencheur de débat »<br />
<strong>Paysage</strong> de grang<strong>et</strong>tes dans le Parc Naturel Régional des Bauges<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
4
5 <strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
1<br />
Quand l’enseignement supérieur part<br />
à la rencontre du territoire<br />
MAIRIE-CONSEILS ET LE RESEAU TERRITOIRE<br />
par Yves GORGEU, Directeur d’études à Mairie-conseils<br />
LE PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES<br />
par Simon PAILLET, Architecte-Urbaniste au Parc<br />
LA FILIERE «VILLES, TERRITOIRES & SOCIETES» A L’ENSAN,<br />
par Vincent BRADEL, André VAXELAIRE <strong>et</strong> Marc VERDIER,<br />
Architectes Maîtres Assistant à l’ENSAN<br />
L’ATELIER DU MASTER I,<br />
par Marc VERDIER, Architecte-Urbaniste Maître Assistant à l’ENSAN<br />
QUE SONT-ILS DEVENUS ?<br />
Parcours professionnel des étudiants des Ateliers 2005-2006-2007<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
6
1<br />
Yves GORGEU<br />
Directeur d’études à MAIRIE-CONSEILS<br />
7 <strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Quand l’enseignement supérieur part à la rencontre du territoire<br />
«Mairie-conseils, service de la Caisse des Dépôts, accomplit depuis 20 ans une<br />
mission d’intérêt général destinée aux élus des communes, communautés de<br />
communes <strong>et</strong> d’agglomération, pays, syndicats mixtes.<br />
Un service de renseignements téléphonique juridique est à la base d’une fonction<br />
d’accompagnement <strong>et</strong> de mise en réseau (rencontres d’élus intercommunaux,<br />
échanges d’expériences, expérimentation de démarches de travail, élaboration<br />
d’outils pédagogiques, constitution de réseaux thématiques, publications…).<br />
«Aider <strong>les</strong> élus à aborder de nouvel<strong>les</strong> compétences dans leur proj<strong>et</strong> de<br />
développement»<br />
Aujourd’hui, plus de 14000 communes <strong>et</strong> 2000 intercommunalités ont utilisé ce<br />
service - véritable observatoire des préoccupations des communes rura<strong>les</strong> <strong>et</strong> des<br />
territoires intercommunaux - en posant plus de 150000 questions.<br />
Les élus d’environ 900 territoires ont été reçus, informés <strong>et</strong> accompagnés dans leur<br />
réflexion sur la création <strong>et</strong> l’évolution de leur territoire, la mise en œuvre de leurs<br />
compétences ou le renforcement de leur proj<strong>et</strong> de développement.<br />
Pour réaliser ses missions, Mairie-conseils s’entoure de partenaires, organismes<br />
porteurs de réflexion <strong>et</strong> d’action sur l’évolution des territoires (réseaux nationaux,<br />
fédérations, associations, organisme publics, universités…)<br />
En fonction des demandes <strong>et</strong> besoins exprimés par <strong>les</strong> élus des territoires, Mairieconseils<br />
m<strong>et</strong> au point <strong>et</strong> expérimente des outils <strong>et</strong> des démarches de travail qui aident<br />
<strong>les</strong> élus à aborder de nouvel<strong>les</strong> compétences dans leur proj<strong>et</strong> de développement. Ces<br />
démarches <strong>et</strong> outils font l’obj<strong>et</strong> de publications.<br />
Ainsi Mairie-conseils joue un rôle structurant, par son appui à l’émergence de<br />
territoires organisés, porteur de compétences de développement.<br />
Dans le domaine de l’aménagement <strong>et</strong> de l’<strong>urbanisme</strong>, le service a développé une<br />
offre diversifiée pour répondre aux fortes préoccupations des élus.<br />
Il <strong>les</strong> accompagne dans leur réflexion sur l’étalement urbain <strong>et</strong> ses conséquences<br />
foncières, environnementa<strong>les</strong>, financières <strong>et</strong> socia<strong>les</strong> <strong>et</strong> dans la mise en œuvre, au<br />
quotidien d’un <strong>urbanisme</strong> plus viable à long terme (plus économe en sols, en coûts<br />
d’aménagement <strong>et</strong> d’entr<strong>et</strong>ien, en coûts énergétiques, en émission de gaz à eff<strong>et</strong> de<br />
serre <strong>et</strong> respectueux des ressources territoria<strong>les</strong>).<br />
Le réseau «<strong>Paysage</strong> rural, vers un <strong>urbanisme</strong> <strong>durable</strong>»<br />
Il a organisé <strong>et</strong> anime le réseau « <strong>Paysage</strong> rural, vers un <strong>urbanisme</strong> <strong>durable</strong> » composé<br />
aujourd’hui de soixante quinze territoires. Ce réseau organise pour <strong>les</strong> élus des<br />
échanges en réunions téléphoniques sur des expériences intéressantes, publie des<br />
« Mémentos » composés de témoignages, d’analyse <strong>et</strong> de questionnements sur ces<br />
expériences, initie des rencontres annuel<strong>les</strong> ou propose des voyages, ainsi qu’une<br />
réflexion permanente sur le thème des contre-feux à l’étalement urbain.
Ce réseau est porté par un comité de pilotage où se r<strong>et</strong>rouvent des représentants<br />
de différents réseaux de territoires très impliqués dans le domaine du paysage <strong>et</strong> de<br />
l’<strong>urbanisme</strong> tels que <strong>les</strong> Parcs naturels régionaux, <strong>les</strong> Grand Sites de France, <strong>les</strong><br />
CAUE, ainsi que des universitaires <strong>et</strong> professeurs d’éco<strong>les</strong> supérieures de paysage,<br />
d’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> d’architecture qui ont favorisé la rencontre entre leurs étudiants <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
élus <strong>et</strong> acteurs des territoires pour travailler sur des proj<strong>et</strong>s d’aménagement urbain<br />
qui enrichissent la réflexion des élus <strong>et</strong> bien sûr, la formation des étudiants.<br />
Dans ce cadre, Mairie-conseils a pris l’initiative d’organiser la rencontre 2009 du<br />
réseau <strong>Paysage</strong> rural, vers un <strong>urbanisme</strong> <strong>durable</strong> sur la coopération Territoires /<br />
Eco<strong>les</strong> supérieures <strong>et</strong> Universités, convaincu de l’intérêt d’un tel partenariat à la<br />
fois pour préparer la formation des professionnels aux réalités de terrain <strong>et</strong> aux<br />
besoins des territoires <strong>et</strong> pour participer à l’évolution de la réflexion <strong>et</strong> des pratiques<br />
sur l’<strong>urbanisme</strong> en milieu rural.<br />
En complément, Mairie-conseils propose aux élus des journées de réflexion sur leurs<br />
politiques intercommuna<strong>les</strong> de l’<strong>urbanisme</strong>, un dossier pédagogique sur ce thème,<br />
un document de 56 questions/réponses juridiques sur <strong>les</strong> outils <strong>et</strong> interventions des<br />
communautés sur l’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> l’aménagement réalisé en partenariat avec l’ADCF,<br />
des séminaires avec la FNCAUE sur des réalisations intercommuna<strong>les</strong> d’<strong>urbanisme</strong><br />
qui répondent à des objectifs de développement <strong>durable</strong>.»<br />
« Inciter <strong>les</strong> collectivités à m<strong>et</strong>tre en oeuvre au quotidien un <strong>urbanisme</strong><br />
plus viable à long terme »<br />
Extraits des «Mémento», publications de Mairie-Conseils<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
8
1<br />
Simon PAILLET<br />
Architecte-Urbaniste au Parc naturel régional du Massif des Bauges<br />
9 <strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Quand l’enseignement supérieur part à la rencontre du territoire<br />
« La Charte du PNR positionne le Massif des Bauges comme terrain d’expérimentation,<br />
avec la volonté d’en faire un territoire de référence pour le développement <strong>durable</strong>.<br />
C<strong>et</strong>te mission d’expérimentation dévolue aux Parcs naturels régionaux, trouve<br />
ici des justifications particulières de par son caractère de massif péri-urbain,<br />
entouré d’agglomérations en expansion, dont <strong>les</strong> aires d’influences couvrent la<br />
totalité du territoire du Parc. »<br />
Le proj<strong>et</strong> de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement m<strong>et</strong><br />
l’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> l’architecture au premier rang des préoccupations de l’Etat <strong>et</strong><br />
des collectivités. Tous <strong>les</strong> acteurs seront impliqués, élus, habitants, professionnels<br />
de l’aménagement. Aussi, L’originalité de la mission <strong>urbanisme</strong> du Parc, créer <strong>les</strong><br />
conditions de l’expérimentation en proposant des partenariats avec l’enseignement<br />
supérieur.<br />
«La stratégie gagnant-gagnant»<br />
Coopérer avec l’enseignement supérieur, cela tient de la stratégie « gagnantgagnant<br />
».Pour <strong>les</strong> communes rura<strong>les</strong>, un réservoir d’idées, de réflexions <strong>et</strong> de<br />
proj<strong>et</strong>s qui fournit aux élus de bonnes bases de travail, pour <strong>les</strong> futurs architectes<br />
urbanistes, la possibilité de montrer leur capacité à traiter des problèmes<br />
complexes sur un territoire en pleine mutation où <strong>les</strong> enjeux paysagers sont<br />
la clé de l’attractivité du territoire.<br />
Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce partenariat nous perm<strong>et</strong>tent :<br />
de donner un coup d’accélérateur aux initiatives engagées dans <strong>les</strong> communes<br />
en faveur du développement <strong>durable</strong> ;<br />
d’ouvrir des possibilités pour la réalisation de proj<strong>et</strong>s pilotes, dans le domaine<br />
de l’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> l’habitat <strong>durable</strong> ;<br />
de favoriser la capitalisation des expériences menées localement par <strong>les</strong> étudiants<br />
<strong>et</strong> le transfert de savoir-faire dans tout le territoire ;<br />
d’impulser de nouvel<strong>les</strong> expérimentations en s’appuyant sur la mobilisation des<br />
élus <strong>et</strong> des acteurs locaux.<br />
«Restons créatifs !»<br />
A coté du développement économique <strong>et</strong> de l’agriculture que nous poussons<br />
à être <strong>durable</strong>, l’<strong>urbanisme</strong> <strong>durable</strong> reste en grande partie à inventer, en tout<br />
cas à promouvoir. La culture de proj<strong>et</strong> doit être un des leviers de la mise en<br />
place d’une politique d’<strong>urbanisme</strong> <strong>durable</strong> pour nos territoires ruraux. Nous ne<br />
pouvons pas faire l’économie de c<strong>et</strong> effort de « recherche-action ». Restons<br />
créatifs !
Ce partenariat Parc-Universités devient un « atelier permanent de recherche »;<br />
il perm<strong>et</strong> à chacun d’entre nous :<br />
d’enrichir <strong>les</strong> réflexions loca<strong>les</strong> par des échanges entre <strong>les</strong> élus, <strong>les</strong> étudiants,<br />
<strong>les</strong> acteurs de l’aménagement, la découverte de nouvel<strong>les</strong> initiatives, la<br />
capitalisation <strong>et</strong> le transfert des savoir-faire sur l’<strong>urbanisme</strong> <strong>durable</strong> ;<br />
d’impulser l’innovation <strong>et</strong> l’expérimentation dans <strong>les</strong> nouvel<strong>les</strong> formes urbaines <strong>et</strong><br />
architectura<strong>les</strong> dans le but d’accélérer <strong>les</strong> actions Parc mais aussi <strong>les</strong> initiatives<br />
communa<strong>les</strong> ou intercommuna<strong>les</strong>.<br />
Ces échanges sont à la fois une source d’information <strong>et</strong> de formation mais surtout<br />
une opportunité unique pour des étudiants en fin d’études d’échanger <strong>et</strong> de<br />
travailler avec <strong>les</strong> acteurs d’un territoire. C’est perm<strong>et</strong>tre une mise en situation<br />
nécessairement formatrice.»<br />
Rencontre entre <strong>les</strong> acteurs à la Maison du Parc du Châtelard, Atelier 2006-2007<br />
« Etre un laboratoire d’idées, un laboratoire de proj<strong>et</strong>s »<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
10
1<br />
Vincent BRADEL, André VAXELAIRE, Marc VERDIER<br />
Maîtres Assistants à l’ENSA de Nancy<br />
11 <strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Quand l’enseignement supérieur part à la rencontre du territoire<br />
«Le champ « Ville, Territoire <strong>et</strong> Société » a été profondément remanié lors de la<br />
mise en place de l’organisation LMD (Licence, Master, Doctorat) de l’enseignement<br />
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de NANCY.<br />
L’enjeu est de considérer que tout étudiant en architecture acquiert une culture<br />
« urbaine » dans le cycle Licence qui lui perm<strong>et</strong>, soit de s’orienter en toute<br />
connaissance de cause vers le Master « Ville <strong>et</strong> Territoire » soit de rester dans<br />
le champ de la maîtrise d’œuvre architecturale tout en ayant la capacité de<br />
resituer toute intervention à des échel<strong>les</strong> de pertinence ouvertes.<br />
L’atelier de proj<strong>et</strong> de Master 1 « aménagement <strong>et</strong> développement des territoires<br />
», dans lequel s’inscrit depuis maintenant quatre ans, la collaboration avec le<br />
Parc naturel régional des Bauges (ainsi que celle plus ponctuelle avec le Parc<br />
naturel régional des Ballons des Vosges <strong>et</strong> le CAUE de l’Ain), doit être considéré<br />
à partir de l’ensemble de la « filière » de l’enseignement de l’<strong>urbanisme</strong> à l’école<br />
d’architecture de NANCY.<br />
Les modes d’approche développés dans c<strong>et</strong> atelier s’appuient en eff<strong>et</strong> sur une<br />
réelle culture urbaine acquise au fil des enseignements <strong>et</strong> proj<strong>et</strong>s de Licence <strong>et</strong><br />
constituent un élément fondamental du cycle Master identifié à l’école dans ce<br />
domaine de la Ville <strong>et</strong> des Territoires.<br />
Il ne s’agit en aucun cas d’un enseignement isolé que des étudiants pourraient<br />
choisir, en picorant dans une offre ouverte d’enseignements…<br />
Il nous semble que la qualité attendue des réflexions <strong>et</strong> des proj<strong>et</strong>s proposés<br />
doit s’ancrer dans des acquis établis, validés, garants d’une capacité d’analyse,<br />
de compréhension des contextes, des méthodes de travail dans ce domaine<br />
particulier de l’architecture qu’est le proj<strong>et</strong> urbain.<br />
Nous revendiquons fortement la spécificité d’une approche urbaine, clairement<br />
différente de celle d’une intervention « architecturale » en milieu urbain, rural,<br />
paysager… L’édifice (habitat, équipement…) est alors indispensable à penser,<br />
non pas en tant qu’obj<strong>et</strong>, mais bien comme matière constitutive d’un ensemble<br />
urbain <strong>et</strong> paysager.<br />
«Vil<strong>les</strong>, Territoire <strong>et</strong> Société : une dimension forte du métier d’architecte»<br />
Pour mémoire, l’enseignement de l’<strong>urbanisme</strong> à l’ENSA de NANCY est organisé à<br />
partir de :<br />
1 – Cycle Licence : une progression pédagogique affirmée.<br />
1ère année – semestre 2 - Cours d’introduction – « Cultures de l’Habiter »<br />
Le cours introduit à la fois <strong>les</strong> grandes problématiques du champ, <strong>les</strong> outils, <strong>les</strong><br />
questions posées…<strong>et</strong> tente de faire le lien entre <strong>les</strong> enseignements généraux<br />
du cycle secondaire de l’Education nationale (géographie, histoire, sciences<br />
humaines…) <strong>et</strong> <strong>les</strong> savoirs qui seront développés en Licence.
«Enseigner le domaine -Vil<strong>les</strong>, Territoires <strong>et</strong> Sociétés- dans une école d’architecture»<br />
2ème année – semestre 1 - Cours « histoire <strong>et</strong> analyse des formes<br />
urbaines 1 »<br />
Un cours d’histoire des vil<strong>les</strong> <strong>et</strong> des territoires replace la compréhension de la<br />
ville européenne dans un contexte historique, perm<strong>et</strong>tant d’apprécier, analyser<br />
<strong>et</strong> comprendre <strong>les</strong> vil<strong>les</strong> à partir de points d’appui culturels.<br />
Un TD d’analyse urbaine accompagne ce cours, donnant aux étudiants <strong>les</strong><br />
outils de compréhension <strong>et</strong> d’organisation des vil<strong>les</strong>, de puis l’échelle<br />
géographique jusqu’à l’échelle parcellaire.<br />
3ère année – semestre 1 - Cours « histoire <strong>et</strong> analyse des formes<br />
urbaines 2 »<br />
Le cours s’appuie sur <strong>les</strong> acquis de la mise en perspective historique de la<br />
2ème année <strong>et</strong> pose <strong>les</strong> grandes problématiques de la ville contemporaine,<br />
dont l’approche « <strong>durable</strong> » est un thème récurrent.<br />
Ce cours s’accompagne de la visite de quatre vil<strong>les</strong> (Luxembourg, Strasbourg,<br />
M<strong>et</strong>z <strong>et</strong> Nancy) m<strong>et</strong>tant en évidence des proj<strong>et</strong>s ou des politiques fortes (déplacement<br />
à Strasbourg, reconversion du quartier du Kirchberg à Luxembourg,<br />
quartier de l’Amphithéâtre à M<strong>et</strong>z…)<br />
3ère année – semestre 2 - Cours « <strong>Paysage</strong> <strong>et</strong> Territoire»<br />
Le cours introduit <strong>les</strong> contextes (politiques, institutionnels, réglementaires) des<br />
questions d’aménagement du territoire (infrastructures, paysage, politiques<br />
urbaines, intercommunalité, développement <strong>durable</strong>…) en insistant sur la<br />
nécessaire remise en question de notre organisation de société (économie,<br />
ressources, co-habitation des hommes…) à l’échelle des territoires (<strong>et</strong><br />
nécessairement en interrelation à l’échelle de la planète).<br />
3ère année – semestre 2 – Initiation au proj<strong>et</strong> urbain<br />
L’enseignement dans le champ « ville <strong>et</strong> territoire » en Licence se conclut par<br />
une mise en situation de proj<strong>et</strong> à l’échelle d’une ville (Nancy en 2005, M<strong>et</strong>z en<br />
2006, Strasbourg en 2007…), proj<strong>et</strong> organisé en partenariat avec <strong>les</strong> collectivités<br />
concernées.<br />
Le proj<strong>et</strong> se décline obligatoirement à trois échel<strong>les</strong> complémentaires : territoire<br />
(SCOT), quartier, <strong>et</strong> espace public.<br />
Le Proj<strong>et</strong> est « alimenté » par des cours <strong>et</strong> présentations de références, insistant<br />
particulièrement sur des vil<strong>les</strong> s’engageant fortement dans des modes de<br />
développement plus « durab<strong>les</strong> » (Barcelone, Amsterdam, Grenoble…), <strong>et</strong> un<br />
ou des voyages d’étude courts (Fribourg, Stuttgart, Tübbingen, Paris…).<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
12
13<br />
1<br />
Quand l’enseignement supérieur part à la rencontre du territoire<br />
2 – Cycle Master : un choix de filière ouvrant vers <strong>les</strong> métiers de la ville <strong>et</strong><br />
des territoires.<br />
1ère année – semestres 1 <strong>et</strong> 2 <strong>et</strong> 2ème année semestre 1 – Séminaire «<br />
Ville <strong>et</strong> Territoire – de la banlieue à la métropole »<br />
Cours <strong>et</strong> conférences complétant <strong>les</strong> enseignements du cycle Licence, impliquant<br />
<strong>les</strong> étudiants dans des travaux de recherche, de bibliographie <strong>et</strong> de mémoire.<br />
Les thèmes abordés pendant <strong>les</strong> cours ou <strong>les</strong> conférences sont organisés en lien<br />
avec <strong>les</strong> thèmes abordés dans <strong>les</strong> proj<strong>et</strong>s.<br />
1ère année – semestre 1 – Proj<strong>et</strong> « aménagement <strong>et</strong> développement des<br />
territoires »<br />
Proj<strong>et</strong> organisé systématiquement en partenariat avec le réseau des Parcs<br />
naturels régionaux (territoires d’expérimentation) en particulier le PNR du<br />
Massif des Bauges (Savoie).<br />
Problématiques des extensions urbaines dans des communes soumises à des<br />
enjeux importants de valeur naturel<strong>les</strong> <strong>et</strong> à de fortes pressions urbaines. Approche<br />
« développement <strong>durable</strong> » fondée sur une analyse fine des patrimoines <strong>et</strong> des<br />
savoir-faire locaux (logique de PNR).<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
2ème année – semestre 2 – Proj<strong>et</strong> urbain « ville <strong>durable</strong> Européenne »<br />
Proj<strong>et</strong> organisé en partenariat avec <strong>les</strong> universités <strong>et</strong> éco<strong>les</strong> d’architecture de<br />
Porto, Istanbul, Delft, Thessalonique <strong>et</strong> Grenoble <strong>et</strong> qui s’appuie sur des voyages<br />
organisés par <strong>les</strong> étudiants eux-mêmes dans des vi<strong>les</strong> « exemplaires » en<br />
matière de développement <strong>durable</strong> (Allemagne, Scandinavie…).<br />
Thème 2006 « <strong>les</strong> vil<strong>les</strong> port »<br />
- site r<strong>et</strong>enu : Strasbourg (Convention de partenariat avec la CUS – Communauté<br />
Urbaine de Strasbourg).<br />
Thème 2007 « la ville <strong>durable</strong> en marche… »<br />
- Site r<strong>et</strong>enu (partenariat) Grenoble.<br />
Thème 2008 « renouvellement urbain »<br />
- Sites militaires <strong>et</strong> extensions urbaines – M<strong>et</strong>z – Nancy<br />
C<strong>et</strong> atelier de proj<strong>et</strong> est, depuis trois ans, accompagné d’un « workshop »<br />
international d’une semaine à Istanbul.
2 – Proj<strong>et</strong> de Fin d’Etude (PFE)<br />
«Enseigner le domaine -Vil<strong>les</strong>, Territoires <strong>et</strong> Sociétés- dans une école d’architecture»<br />
Les PFE dans le domaine « Ville, Territoire <strong>et</strong> Société » sont organisés à partir<br />
d’une volonté de perm<strong>et</strong>tre aux étudiants de fonder leurs proj<strong>et</strong>s sur des travaux<br />
déjà engagés lors des séminaires <strong>et</strong> ateliers du cycle Master.<br />
Les étudiants choisissent donc des thèmes ou des sites qui se positionnent en<br />
continuité de problématiques <strong>et</strong> contextes déjà abordés.<br />
Tous <strong>les</strong> ans, la diversité des situations choisies, perm<strong>et</strong> de constituer une<br />
réelle richesse de propositions <strong>et</strong> de débats.<br />
Les contextes ruraux font évidemment partie de ces PFE, prétextes à approfondir<br />
des travaux réalisés lors des ateliers de 4e année.»<br />
L’ENSA de Nancy<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
14
15<br />
1<br />
Quand l’enseignement supérieur part à la rencontre du territoire<br />
Marc VERDIER<br />
Architecte-Urbaniste<br />
Maître Assistant «Vil<strong>les</strong> <strong>et</strong> Territoires» à l’ENSA de Nancy<br />
«L’Ecole Nationale d’Architecture de NANCY <strong>et</strong> le Parc naturel régional du Massif<br />
des Bauges collaborent depuis quatre ans sur le thème de l’<strong>urbanisme</strong> contemporain<br />
éco-responsable.<br />
Les cadres pédagogique de l’école (un cycle master qui développe une spécialisation<br />
en <strong>urbanisme</strong> pour <strong>les</strong> étudiants en architecture) <strong>et</strong> institutionnel du Parc (une charte<br />
qui affirme dans ses deux premières orientations qu’il est nécessaire de maîtriser<br />
l’étalement urbain en économisant l’espace <strong>et</strong> que promouvoir un <strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> une<br />
architecture de qualité sont des enjeux fondamentaux dans <strong>les</strong> Bauges) se sont<br />
rencontrés en 2005 autour de l’idée d’organiser un atelier « <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong> ».<br />
C<strong>et</strong> atelier se déroule sur un semestre (Master 1 – S8 (1)) articulé à partir de deux<br />
semaines intensives de terrain qui servent de point de départ <strong>et</strong> d’appui au travail<br />
de proj<strong>et</strong> sur des communes du Parc qui proposent des situations d’expérimentation<br />
<strong>et</strong> de débat.<br />
Les étudiants (entre 10 <strong>et</strong> 20 selon <strong>les</strong> années) sont ainsi immergés sur un territoire<br />
qu’ils doivent comprendre, interroger, analyser… rencontrant des acteurs (des élus,<br />
des chargés de mission du PNR, des architectes de CAUE, de SDAP, des bureaux<br />
d’étude, des agriculteurs, des bailleurs sociaux, des responsab<strong>les</strong> de SCoT…), bref<br />
ce système de partenaires territoriaux complexe avec lequel on doit composer une<br />
attitude pour intervenir sur <strong>les</strong> territoires.<br />
«Comprendre le jeu des acteurs <strong>et</strong> se forger des convictions»<br />
Les étudiants doivent à la fois comprendre le jeu des acteurs, s’imprégner des valeurs<br />
loca<strong>les</strong>, des identités, des proj<strong>et</strong>s qui existent, des ambitions, des règ<strong>les</strong>…mais<br />
également se forger des convictions sur ce que peut être le rôle d’un architecte qui<br />
intervient sur le proj<strong>et</strong> spatial territorial.<br />
(1) - S8 correspond au huitième semestre du cursus universitaire, soit le deuxième semestre de la quatrième année d’étude<br />
à l’ENSA de Nancy<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
L’atelier est coordonné avec un séminaire d’enseignement fondé sur un travail de<br />
mémoire individuel mené par chaque étudiant sur des thèmes directement en lien<br />
avec le proj<strong>et</strong> (espace public, structures urbaines <strong>et</strong> paysagères villageoises,<br />
patrimoine…).<br />
L’enjeu clairement posé dans ce partenariat Ecole/PNR est d’inscrire le travail des<br />
étudiants dans une double dimension :<br />
- être à la fois au plus près des réalités loca<strong>les</strong> (pressions urbaines, enjeux paysagers<br />
<strong>et</strong> agrico<strong>les</strong>, attentes des communes, proj<strong>et</strong> de parc…) en amenant <strong>les</strong> étudiants à<br />
élaborer des proj<strong>et</strong>s d’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> d’architecture.<br />
- positionner leurs propositions de proj<strong>et</strong> dans une dynamique de recherche <strong>et</strong><br />
d’expérimentation sur un <strong>urbanisme</strong> « <strong>durable</strong> », adapté au contexte porteur d’une<br />
situation d’approche transversale spécifique à un Parc naturel régional (préservation<br />
des ressources, agriculture de qualité, paysages, habitat…).<br />
«La recherche-action pour faire avancer le savoir»<br />
Les débats, lors des semaines de terrain, à l’école ou lors des restitutions dans <strong>les</strong><br />
communes, sont le résultat de c<strong>et</strong>te double dimension que l’atelier revendique dans<br />
un cycle de Master d’une école supérieure, la « recherche-action ». L’atelier ainsi<br />
positionné s’articule parfaitement à la vocation d’un Parc, territoire d’expérimentation<br />
<strong>et</strong> d’innovation.<br />
L’école qui s’est engagée dès le début à publier ses travaux souhaite ainsi contribuer<br />
à faire avancer le savoir dans un domaine sous investi, celui de l’<strong>urbanisme</strong> rural, tout<br />
en contribuant bien entendu à la formation initiale des architectes.
Les quatre ans de recul (2005-2009), nous démontrent aujourd’hui que le pari<br />
est en passe d’être réussi :<br />
- le Parc des Bauges a su valoriser ces ateliers (<strong>les</strong> communes du parc<br />
se positionnent chaque année pour recevoir l’atelier…) dans le cadre de sa<br />
politique plus générale en matière d’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> d’architecture animée par<br />
l’architecte du Parc <strong>et</strong> la commission d’aménagement du territoire.<br />
- <strong>les</strong> étudiants ont su démontrer que ce terrain d’exercice avait une valeur<br />
pédagogique qui allait bien au delà des exercices en situation proposés, en<br />
développant des savoirs plus globaux sur la stratégie territoriale, sur <strong>les</strong> enjeux<br />
d’un <strong>urbanisme</strong> plus responsable en matière environnementale <strong>et</strong> sociale, en<br />
ouvrant des perspective de métiers à des professionnels de l’architecture.<br />
L’avenir de c<strong>et</strong> atelier « <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong> » est bien d’être enrichi par d’autres<br />
expériences, sur d’autres territoires, en ouvrant <strong>les</strong> ateliers à d’autres disciplines,<br />
afin de mieux répondre aux enjeux que nous imposent <strong>les</strong> changements en route<br />
de notre société. L’<strong>urbanisme</strong> rural concerne 80% des territoires européens <strong>et</strong> ne<br />
pas développer des savoirs spécifiques dans ce domaine serait irresponsable.<br />
Les éco<strong>les</strong> d’architecture peuvent contribuer à c<strong>et</strong> effort général, <strong>les</strong> réseaux<br />
de territoires constitués (comme <strong>les</strong> Parcs) peuvent apporter leur capacité <strong>et</strong><br />
leurs terrains d’expérimentation.»<br />
« <strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong> : Histoire d’un atelier »<br />
Instants mêlés de trois années d’atelier :<br />
Découverte des communes avec leurs élus, Tab<strong>les</strong> rondes <strong>et</strong> débats, Réflexions en atelier, Le plaisir de vivre le grand paysage<br />
Extraits des 3 publications «Chronique d’un atelier», des années 2006-2007-2008<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
16
17<br />
1<br />
Quand l’enseignement supérieur part à la rencontre du territoire<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
Trois années de proj<strong>et</strong>s en images<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
18
19<br />
1 Que sont-ils devenus ?<br />
Quand l’école d’architecture part à la rencontre du territoire<br />
Claire KLINGER (Atelier 2005-06) Architecte chargée d’étude/assistante chef de proj<strong>et</strong> dans la<br />
SELARL Bécard & Palay, architecte-urbaniste associés à Paris <strong>et</strong> membre du collectif Urban Addict, pour<br />
une vision transversale du proj<strong>et</strong> nourrie par une méthodologie exploratoire qui joue de la dialectique<br />
entre recherche <strong>et</strong> pratique.<br />
«C<strong>et</strong> atelier fut tout d’abord notre première expérience de travail en relation avec une maîtrise d’ouvrage<br />
réelle, de rencontre des élus <strong>et</strong> autres acteurs territoriaux, dans la recherche d’une vision prospective ensemble<br />
pour leur territoire. D’autre part, il fut particulièrement intéressant <strong>et</strong> enrichissant de pouvoir explorer<br />
<strong>et</strong> travailler en profondeur à différentes échelle : réaliser une analyse diagnostic assez transversale <strong>et</strong> formuler<br />
une vision prospective à l’échelle du massif des Bauges ; puis réaliser le diagnostic urbain <strong>et</strong> paysager, <strong>et</strong><br />
concevoir un proj<strong>et</strong> urbain à l’échelle du territoire communal. »<br />
Nicolas LAVAUD (Atelier 2005-06) Architecte chargé d’étude en architecture <strong>et</strong> <strong>urbanisme</strong> au CAUE<br />
du Bas-Rhin (67) depuis novembre 2007.<br />
«L’atelier mené dans le massif des Bauges a représenté une mise en situation professionnelle jusqu’alors<br />
inédite dans mon cursus à l’école d’architecture. Les rencontres avec des élus passionnés, dans le contexte<br />
magnifique mais sensible que représentent <strong>les</strong> Bauges, m’ont fait prendre conscience de l’importance de<br />
l’aménagement des territoires ruraux.Il n’y a pas de p<strong>et</strong>its enjeux pour de p<strong>et</strong>ites communes. Au contraire,<br />
dans un environnement paysager, (social, économique...) aux équilibres sensib<strong>les</strong>, il est primordial d’intégrer<br />
<strong>les</strong> enjeux majeurs dès <strong>les</strong> premières réflexions, bien en amont des futurs aménagements. C’est grâce à<br />
c<strong>et</strong>te expérience que je me suis orienté vers l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage : être aux côtés des<br />
élus dans leur réflexion <strong>et</strong> leurs démarches pour un aménagement cohérent <strong>et</strong> <strong>durable</strong> de leur commune.»<br />
Jérémie HAYE (Atelier 2005-06) Architecte, chargé d’études «Service <strong>Paysage</strong>, Urbanisme, Architecture<br />
& Patrimoine» au Parc Naturel Régional du Lubéron<br />
«Au-delà de nos vil<strong>les</strong>… Quand on refait le chemin à l’envers, on se dit que nos choix reposent au départ sur<br />
peu de choses. Un cours magistral d’abord pour aiguiser le regard. Et puis s’enchaînent, <strong>et</strong> le plus naturellement<br />
du monde, un atelier sur le terrain, puis deux, pour se frotter à des suj<strong>et</strong>s dont on ne connaissait pas même<br />
l’existence auparavant : l’aménagement du territoire <strong>et</strong> la valorisation du patrimoine en milieu rural ! Et viennent<br />
ensuite un stage de fin d’études, un diplôme <strong>et</strong> une activé professionnelle… Et tous dans des parcs naturels<br />
régionaux.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Pourquoi ? Comment ? Il y a une part de hasard dans <strong>les</strong> rencontres que l’on fait <strong>et</strong> une forme d’évidence dans<br />
ce qu’el<strong>les</strong> nous apprennent toutes à leur manière : il y a un monde au-delà de nos vil<strong>les</strong> <strong>et</strong> une architecture<br />
au-delà de nos grands gestes. Et c’est c<strong>et</strong>te découverte <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te humilité dans notre pratique que l’on doit à ces<br />
p<strong>et</strong>ites choses au départ de notre formation.»<br />
Noémie AUSSEDAT (Atelier 2005-06), Architecte chargée d’étude chez J.M Jacqu<strong>et</strong>, Architecte-Urbbaniste<br />
à Reims<br />
«Après un diplôme obtenu avec M. Elleni en juill<strong>et</strong> dernier sur le thème du développement <strong>durable</strong> <strong>et</strong> des<br />
techniques constructives, j’intègre un cabin<strong>et</strong> d’architecture à Paris en octobre. Je traite alors essentiellement<br />
des proj<strong>et</strong>s de logements sociaux basés en région parisienne. La situation économique se dégradant, je suis<br />
licenciée après un mois de travail seulement.<br />
Je suis actuellement à Reims, depuis trois mois, chez Jean Michel Jacqu<strong>et</strong>, architecte urbaniste. Fonction<br />
principale : assurer des études de faisabilité sur la ville de Reims <strong>et</strong> ses alentours. Travail assez redondant<br />
malheureusement, pour l’instant je n’ai pas assez de recul pour réussir à mesurer <strong>les</strong> points forts que m’a apporté<br />
l’atelier, sûrement à cause d’une activité trop peu variée. Mes volontés pour demain : essayer d’intégrer<br />
un CAUE, un PNR ou encore un service d’<strong>urbanisme</strong> dans une mairie pour aller à la rencontre des citoyens<br />
<strong>et</strong> établir un contact porteur pour faire avancer concrètement des proj<strong>et</strong>s.»<br />
Jean-Nicolas PINAIRE (Atelier 2005-06) Architecte à l’ADUAN (l’Agence de développement <strong>et</strong> d’<strong>urbanisme</strong><br />
de l’aire urbaine Nancéienne)<br />
«Au cours des deux années du Master Vil<strong>les</strong>, Territoires <strong>et</strong> Sociétés, nous avons eu la chance d’expérimenter<br />
de nombreuses composantes de ce qu’on peut appeler « l’<strong>urbanisme</strong> ». Cependant ce terme peut sembler réducteur<br />
lorsqu’on le m<strong>et</strong> en rapport avec <strong>les</strong> différentes échel<strong>les</strong> auxquel<strong>les</strong> nous avons pu travailler <strong>et</strong> avec <strong>les</strong><br />
différents milieux que nous avons explorés (du très urbain au très rural).C<strong>et</strong>te diversité, ainsi que <strong>les</strong> conditions<br />
quasi professionnel<strong>les</strong> dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> nous avons été amenés à travailler dans le cadre du Master, nous a<br />
permis d’acquérir une réelle expérience <strong>et</strong> nous a facilité l’accès à une grande multiplicité de pratiques du métier<br />
d’architecte.<br />
C’était une expérience enrichissante au niveau professionnel <strong>et</strong> humain que nous n’oublierons pas de si tôt !»
Benoit DHENNIN (Atelier 2005-06) Architecte à l’Agence d’<strong>urbanisme</strong> Marc VERDIER, Nancy<br />
«Le master Vil<strong>les</strong>, Territoires <strong>et</strong> Sociétés <strong>et</strong> plus particulièrement l’atelier aménagement du territoire dans le massif des Bauges<br />
m’a permis de prendre conscience de la diversité des champs d’études <strong>et</strong> des métiers dans <strong>les</strong>quels interviennent <strong>les</strong> architectes.<br />
Plongés au cœur de ces territoires d’exception, nous avons, grâce à ce proj<strong>et</strong>, rencontré au cours de notre périple <strong>les</strong> différents<br />
acteurs qui interviennent dans l’aménagement des territoires. Très réceptifs à notre démarche, un échange enrichissant entre élus<br />
<strong>et</strong> étudiants s’est installé <strong>et</strong> m’a fait prendre conscience de l’intérêt <strong>et</strong> de la nécessité de travailler avec des professionnels formés <strong>et</strong><br />
attentifs aux questions de développement des villages <strong>et</strong> p<strong>et</strong>ites communes qui constituent l’essentiel du territoire français.<br />
C<strong>et</strong>te expérience dans <strong>les</strong> Bauges ne m’empêche pas de travailler à l’agence sur des proj<strong>et</strong>s urbains plus importants (ZAC de 400<br />
habitants) car <strong>les</strong> réflexions <strong>et</strong> <strong>les</strong> enjeux sur <strong>les</strong> p<strong>et</strong>ites communes se traduisent à une autre échelle sur des agglomérations plus<br />
importantes.»<br />
Jean THIRIET (Atelier 2006-07) Architecte Directeur Technique dans une agence d’Architecture à Istanbul<br />
«Diplômé en 2008 sur la thématique de la maqu<strong>et</strong>te virtuelle appliquée à l’architecture, <strong>et</strong> après un travail en juill<strong>et</strong> 2008 dans<br />
une entreprise de création de maqu<strong>et</strong>tes virtuel<strong>les</strong> pour des proj<strong>et</strong>s d’architectes, je travaille depuis Octobre en tant que Directeur<br />
technique à Istanbul. Au-delà d’une ouverture sur d’autres points de vue, ainsi que l’aspect sympathique <strong>et</strong> humain de l’atelier<br />
dans <strong>les</strong> Bauges, c’est d’un point de vue purement technique, la démonstration que le domaine dans lequel je travaille s’applique<br />
très bien aux suj<strong>et</strong>s concernés, <strong>et</strong> aide à la prise de décision <strong>et</strong> à la pédagogie, indispensable encore plus en <strong>urbanisme</strong> qu’en<br />
architecture.»<br />
Jérémy ROUSSEL (Atelier 2007-08) Etudiant en MasterI à l’ENSNP de Blois.<br />
«Après la 4ème année à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, <strong>et</strong> donc l’atelier de proj<strong>et</strong> « Ville, territoire <strong>et</strong> société»,<br />
je me suis décidé à passer le concours de l’école nationale supérieure de la nature <strong>et</strong> du paysage de Blois, car intéressé par ce<br />
cursus depuis très longtemps. Je suis donc actuellement en 3ème année d’ingénieur paysagiste au sein de c<strong>et</strong> établissement <strong>et</strong> me<br />
prépare à rentrer en Master 1ère année. Mon passage au sein de l’atelier de Mr Marc VERDIER m’a permis d’enrichir mes connaissances<br />
en aménagement du territoire, par une approche sensible des milieux ruraux (visite sur le terrain, rencontre avec des élus,<br />
des habitants, découverte de nouvel<strong>les</strong> formes de bâtis <strong>et</strong> d’<strong>urbanisme</strong> vernaculaires....). Toutes ces connaissances me perm<strong>et</strong>tent<br />
aujourd’hui de compléter ma formation de paysagiste par de bonnes bases en <strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> en architecture.»<br />
« Des besoins exprimés sur <strong>les</strong> territoires : des formations adaptées »<br />
De haut en bas <strong>les</strong> équipes respectives des ateliers 2005-06 ; 2006-07 ; 2007-08<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
20
21<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
2<br />
TEMOIGNAGES<br />
LES COMMUNES : Territoires d’expérimentations<br />
Jean-Louis DUBOIS, Maire de Héry-sur-Alby (74), Président de la Commission<br />
Aménagement du Territoire au PNRMB - Atelier 07-08<br />
Georges PACQUETET, Maire honoraire de Saint-Jorioz (74) - Atelier 06-07<br />
Etienne PILARD, Maire de Cru<strong>et</strong> (73) -Atelier 05-06<br />
AGRICULTURE ET URBANISME : des conivences à réinventer<br />
Régis AMBROISE, Ingénieur Agronome - Ministère de l’agriculture <strong>et</strong> de la pêche<br />
Jean-Vincent BERLOTTIER, Architecte-Urbaniste à Lyon<br />
ECHELLE DE TERRITOIRE, ECHELLE DE PROJET :<br />
Attentes <strong>et</strong> Perspectives<br />
Philippe GIRARDIN, Président du PNR des Ballons des Vosges (88)<br />
Jean-Jeacques DAILLOT, Président de la Communauté de Communes du Val<br />
de Galilée (88)<br />
Jean PICCHIONI, Président de l’Espace Belledone (38)<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
22
23<br />
2<br />
LES COMMUNES : TERRITOIRES D’EXPERIMENTATIONS<br />
Jean-Louis DUBOIS<br />
Maire de Héry-sur-Alby (74)<br />
Président de la Commission Aménagement du territoire au PNRMB<br />
Atelier 07-08<br />
«La première rencontre entre <strong>les</strong> étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure<br />
d’Architecture de Nancy (ENSAN) <strong>et</strong> <strong>les</strong> conseillers municipaux de la commune<br />
d’Héry sur Alby s’est déroulée en 2006.<br />
La commune venait de terminer son PLU, qui était complété par une orientation<br />
d’aménagement pour laquelle l’aide apportée par le fonds <strong>urbanisme</strong> du Parc<br />
naturel régional du Massif des Bauges (PNRMB) a été déterminante.<br />
Première rencontre intimidante pour des nouveaux élus qui avaient « ramé »<br />
quatre ans pour élaborer leur premier document d’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> qui attendaient<br />
d’être confrontés au regard des professionnels.<br />
«Une collaboration profitable <strong>et</strong> formatrice»<br />
Très rapidement nous nous sommes rendu compte que nous pouvions faire<br />
partager, non pas notre expérience trop récente, mais nos convictions dans ce<br />
qui nous avait conduit vers un PLU exigeant, respectueux de l’agriculture <strong>et</strong> des<br />
paysages, attentif au développement <strong>durable</strong> <strong>et</strong>, pour une commune rurale,<br />
innovant par le recentrage de l’urbanisation.<br />
C’est rassuré par <strong>les</strong> premiers échanges, la qualité des analyses <strong>et</strong> la pertinence<br />
des propositions que, avec enthousiasme, nous avons accepté de poursuivre<br />
c<strong>et</strong>te collaboration.Aucun élu du conseil municipal n’avait jusqu’alors réfléchi<br />
à l’<strong>urbanisme</strong>. La rencontre avec <strong>les</strong> étudiants nous a conduits à nous former<br />
pour entrer un peu plus profondément dans la démarche.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
«sortir des schémas, ouvrir <strong>les</strong> débats, pour aller à l’essentiel»<br />
C<strong>et</strong> apprentissage au fil des travaux réalisés dans <strong>les</strong> différentes communes<br />
nous a permis de sortir des schémas, des idées toutes faites sur l’organisation<br />
du territoire ouvrant entre nous des débats riches entre <strong>les</strong> anciens, qui<br />
curieusement n’étaient pas <strong>les</strong> élus <strong>les</strong> plus âgés, <strong>et</strong> <strong>les</strong> modernes.<br />
Le temps assez court dont disposent <strong>les</strong> étudiants pour aborder <strong>les</strong> problématiques<br />
territoria<strong>les</strong> obligent <strong>les</strong> élus à structurer la présentation de leur territoire <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
enjeux.<br />
Ce travail préparatoire indispensable est très profitable pour <strong>les</strong> élus car il<br />
perm<strong>et</strong> d’aller à l’essentiel.<br />
Par bonheur <strong>les</strong> étudiants n’ont aucun lien de subordination économique avec<br />
<strong>les</strong> décideurs locaux. Leur liberté est entière <strong>et</strong> la fraicheur avec laquelle ils<br />
abordent avec méthode <strong>les</strong> problématiques territoria<strong>les</strong> <strong>les</strong> dégagent de la gangue<br />
qui enferme parfois <strong>les</strong> décideurs.<br />
Cependant, pour aussi riches <strong>et</strong> innovantes que soient <strong>les</strong> restitutions, cel<strong>les</strong>-ci<br />
atteignent leur limite lorsqu’il faut aborder l’aspect opérationnel.<br />
En eff<strong>et</strong> l’<strong>urbanisme</strong>, s’il est affaire de spécialistes, doit être compris par <strong>les</strong><br />
habitants.<br />
Comment passer de la maison individuelle sur 1500 m² à des constructions<br />
sur 750m² ?<br />
L’architecte se r<strong>et</strong>ire, le politique entre en scène.<br />
La Porte des Bauges
Pour avoir suivi depuis trois ans <strong>les</strong> ateliers <strong>et</strong> ayant bénéficié de leurs travaux<br />
pour notre commune, ces ateliers trouvent pleinement leur utilité dans la<br />
confrontation entre des étudiants pour la plupart « urbain » <strong>et</strong> un milieu «rural».<br />
C<strong>et</strong>te opposition des termes porte en elle même une sorte de ségrégation.<br />
Pourtant l’habitat, le développement <strong>durable</strong>, la protection des ressources, des<br />
paysages sont de même valeur quelque soient <strong>les</strong> lieux.<br />
Aussi ce travail des étudiants architectes sur un <strong>urbanisme</strong> rural, dans sa<br />
forme mais pas dans ses principes, me parait un maillon essentiel du parcours<br />
de formation.<br />
Sur le terrain, depuis trois ans la communication circule entre élus <strong>et</strong> <strong>les</strong> communes<br />
prennent rang pour bénéficier de ce partenariat exemplaire.<br />
Pour notre part, la révision du PLU s’enrichira de certaines propositions formulées<br />
par <strong>les</strong> étudiants.<br />
«Alors demain ?»<br />
Continuons de nous enrichir mutuellement par c<strong>et</strong> aller r<strong>et</strong>our entre théorie <strong>et</strong><br />
pratique.<br />
Merci jeune gens <strong>et</strong> à vos enseignants de nous préparer un <strong>urbanisme</strong> humain.»<br />
Depuis <strong>les</strong> hauteurs d’Héry-surAlby, vue sur la vallée du Chéran <strong>et</strong> le Massif du Semnoz<br />
« Continuons de nous enrichir mutuellement par c<strong>et</strong> aller r<strong>et</strong>our<br />
entre théorie <strong>et</strong> pratique »<br />
Extraits des travaux d’étudiants sur la commune d’Héry-sur-Alby ( Atelier 07-08) 24<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
25<br />
2<br />
LES COMMUNES : TERRITOIRES D’EXPERIMENTATIONS<br />
Georges PACQUETET<br />
Maire Honoraire de Saint-Jorioz (74)<br />
Atelier 06-07<br />
«La commune de Saint-Jorioz, riveraine du Lac d’Annecy, a reçu avec un grand<br />
intérêt, <strong>les</strong> étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture de Nancy dans le<br />
cadre d’un atelier « Hors <strong>les</strong> Murs », en 2006 <strong>et</strong> 2007 sous l’autorité de Marc<br />
Verdier.<br />
Proj<strong>et</strong> établi par le PNR du massif des Bauges dont la commune fait partie, <strong>et</strong><br />
grâce au travail de l’équipe du Parc au sein de laquelle l’intelligente présence<br />
d’un architecte conseil est fort appréciée.<br />
Le travail des étudiants au cours de c<strong>et</strong> atelier nous paraît avoir mis en<br />
évidence trois grands enseignements dont chacun, y compris <strong>les</strong> élus, a<br />
pu tirer profit.<br />
1- La dynamique de l’équipe : partage, cohésion <strong>et</strong> multicompétence<br />
Aucun proj<strong>et</strong>, quelqu’en soit l’importance, ne peut aujourd’hui se réaliser par le<br />
travail d’une seule personne.<br />
C<strong>et</strong>te évidence conduit au partage des compétences dans le respect des qualités<br />
de chacun.<br />
Le rôle du maître d’œuvre est plus aujourd’hui la coordination que la<br />
conception.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
La volonté politique ne peut s’exprimer que dans la cohésion d’un ensemble<br />
pluridisciplinaire.<br />
Que ces notions soient intégrées à la formation de tous <strong>les</strong> corps de métier est<br />
un gage de réussite pour l’avenir.<br />
2- l’indispensable r<strong>et</strong>our aux réalités du terrain.<br />
Devant <strong>les</strong> magiques <strong>et</strong> souvent trompeuses possibilités de conception du<br />
virtuel, l’observation attentive des composantes d’un environnement redevient<br />
essentielle.<br />
Et dans un pays de montagne, <strong>les</strong> notions de pente, de versant, de paysage<br />
sont primordia<strong>les</strong>.<br />
Un paysage que la rencontre des étudiantes de l’Ecole Nationale du <strong>Paysage</strong><br />
de Versail<strong>les</strong>, sous la conduite du professeur Chazelle, venues enrichir le<br />
dossier de candidature du Lac d’Annecy au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,<br />
a rendu plus fort, dans la compréhension de sa structure <strong>et</strong> de sa théâtralité.<br />
Et comment ne pas comprendre que devant une telle force du paysage, toute<br />
création doit être empreinte de respect <strong>et</strong> d’humilité.<br />
Le lac d’Annecy
3- Contribuer à la réflexion pédagogique<br />
Réflexion, car tout proj<strong>et</strong> d’aménagement du territoire mobilise un grand nombre<br />
de données définissant l’espace <strong>et</strong> évoluant dans le temps.<br />
La cohérence <strong>et</strong> la richesse de l’équipe à l’origine du proj<strong>et</strong> s’expriment alors,<br />
dans c<strong>et</strong> indispensable temps de maturation.<br />
Pédagogique ensuite parce que tout proj<strong>et</strong> s’inscrit dans un environnement<br />
humain <strong>et</strong> culturel dont la méconnaissance est source de conflits.<br />
Il est donc nécessaire d’expliquer pour convaincre.<br />
Même si le conservatisme de toute chose installée exprime plus souvent la<br />
défense d’intérêts particuliers que collectifs.<br />
Dans c<strong>et</strong>te forme originale d’enseignement, l’Ecole de Nancy comme celle de<br />
Versail<strong>les</strong> ont démontré que, si <strong>les</strong> collectivités territoria<strong>les</strong> doivent apporter<br />
leur contribution à la formation <strong>et</strong> à la recherche appliquée, el<strong>les</strong> en tireront<br />
également l’incontestable profit d’une relation dont le « tempo » diffère du<br />
quotidien <strong>et</strong> conduit à l’analyse des actions passées <strong>et</strong> futures sous le regard<br />
d’une nouvelle génération.»<br />
« l’incontestable profit d’une relation dont le « tempo » diffère du quotidien »<br />
Découverte de la commune de Saint-Jorioz en compagnie du Maire (Atelier 06-07)<br />
Extraits des travaux d’étudiants sur la commune de Saint-Jorioz ( Atelier 06-07) 26<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
27<br />
2<br />
LES COMMUNES : TERRITOIRES D’EXPERIMENTATIONS<br />
Etienne PILARD<br />
Maire de Cru<strong>et</strong> (73)<br />
Atelier 05-06<br />
«En 2006, <strong>les</strong> élus de Cru<strong>et</strong> décident de se lancer dans une réflexion sur <strong>les</strong> enjeux<br />
fonciers <strong>et</strong> de développement « urbain » de leur p<strong>et</strong>ite commune rurale.<br />
Alors, avec l’aide du Parc naturel régional des Bauges, de Métropole Savoie<br />
<strong>et</strong> d’un bureau d’études, nous entamons une étude paysagère générale ainsi<br />
qu’une réflexion plus précise <strong>et</strong> pré-opérationnelle sur le secteur environnant<br />
l’école, la salle polyvalente, l’église…<strong>et</strong> qui fait l’obj<strong>et</strong> depuis de nombreuses<br />
années d’un patient effort de réserve foncière communale.<br />
Quid de l’aménagement respectant <strong>les</strong> enjeux environnementaux, répondant à<br />
notre échelle aux besoins de logements, économe en foncier <strong>et</strong>c.<br />
Un jour donc, Simon Paill<strong>et</strong> architecte du Parc nous propose d’accueillir un<br />
groupe d’étudiants de l’ENSA. En fait, nous n’avions ni raison précise de refuser,<br />
ni motivation particulière à accepter étant donné que notre étude avançait.<br />
Mais soit ! Pourquoi pas !<br />
Et puis finalement, qu’une école d’architecture aussi reconnue que celle de<br />
Nancy puisse s’intéresser à notre p<strong>et</strong>it coin de Savoie, c’est déjà un honneur.<br />
En général, <strong>les</strong> urbanistes s’intéressent aux vil<strong>les</strong> non ?<br />
Alors c’est avec une certaine curiosité que nous <strong>les</strong> avons accueillis.<br />
Qu’allaient- ils bien pouvoir nous dire sur notre village ?<br />
Je dois dire que nous gardons un excellent souvenir de c<strong>et</strong>te rencontre.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
«Redécouvrir notre environnement, bousculer nos convictions, faire mûrir<br />
notre proj<strong>et</strong>»<br />
Ce groupe d’étudiants a littéralement envahi <strong>les</strong> ruel<strong>les</strong> <strong>et</strong> hameaux, décodant<br />
notre paysage <strong>et</strong> notre organisation « urbaine », photographiant, dessinant,<br />
questionnant…<br />
Pour la plupart, ces jeunes gens découvraient notre région <strong>et</strong> en quelques jours<br />
ce sont eux qui nous ont fait découvrir notre environnement.<br />
Plus exactement, ils nous ont permis une « relecture » de ce qui est sous nos<br />
yeux au quotidien.<br />
Cela a déjà été un premier étonnement pour nous, <strong>et</strong> aussi un enseignement.<br />
Leur atelier a consisté également à esquisser l’aménagement du quartier sur<br />
lequel nous étions en plein débat <strong>et</strong> en pleine réflexion, <strong>et</strong> disons le en plein<br />
doute aussi.<br />
Le résultat de leur travail nous a réellement bousculé dans nos convictions <strong>et</strong><br />
nous a aidés à conforter certaines options majeures du proj<strong>et</strong>.<br />
Bien sûr, ils n’avaient eu que trop peu de temps pour travailler, mais je garde le<br />
souvenir d’échanges riches qui ont contribué au mûrissement de notre proj<strong>et</strong>.<br />
Vue panoramique depuis <strong>les</strong> hauteurs de Cru<strong>et</strong>
Aujourd’hui, rien n’est encore sorti de terre, mais nous approchons de la phase<br />
opérationnelle.<br />
«Si l’occasion se représentait ce serait avec grand plaisir»<br />
Avec le recul, je peux témoigner de tout l’intérêt de ces quelques jours d’échanges.<br />
Ce groupe d’étudiants nous a offert une vision libre <strong>et</strong> plus neutre de notre<br />
environnement nous perm<strong>et</strong>tant ainsi de nous rem<strong>et</strong>tre en question <strong>et</strong> de progresser<br />
dans nos choix <strong>et</strong> convictions.<br />
J’ai souvent l’occasion de faire référence à leur travail, <strong>et</strong> j’ai r<strong>et</strong>rouvé avec<br />
plaisir toutes ces sensations lors de la présentation qui a été faite récemment<br />
à Héry-sur-Alby, si l’occasion se représentait ce serait avec grand plaisir…»<br />
Découverte de la commune de Cru<strong>et</strong> en compagnie du Maire (Atelier 05-06)<br />
« une relecture de ce qui est sous nos yeux au quotidien »<br />
Extraits des travaux d’étudiants sur la commune de Cru<strong>et</strong> ( Atelier 05-06) 28<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
29<br />
2<br />
AGRICULTURE ET URBANISME : DES CONIVENCES A REINVENTER<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Hameau Mont July, Ceyzériat, Ain (01) - Atelier 07-08
«Habiter ou Occuper la campagne ? »<br />
Lotissement «Les Sorbiers», Ceyzériat, Ain (01) - Atelier 07-08 30<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
31<br />
2<br />
AGRICULTURE ET URBANISME : DES CONIVENCES A REINVENTER<br />
Régis AMBROISE<br />
Ingénieur Agronome<br />
Chargé de mission <strong>Paysage</strong> au Ministère de l’agriculture <strong>et</strong> de la pêche<br />
«Des étudiants en architecture qui viennent enquêter des agriculteurs.<br />
Est-ce bien sérieux?<br />
Sans doute, <strong>et</strong> cela pourrait inciter <strong>les</strong> agronomes à aller étudier comment se<br />
construisent aujourd’hui <strong>les</strong> vil<strong>les</strong> <strong>et</strong> <strong>les</strong> villages. Car l’avenir de l’agriculture<br />
dépend de celui de la ville comme ces jeunes architectes ont compris que la<br />
qualité de la ville dépend de la place accordée à l’agriculture.<br />
La période de l’exode rural est finie. Les vil<strong>les</strong> reconquièrent <strong>les</strong> campagnes<br />
pour satisfaire la demande des citadins qui espèrent trouver un habitat moins<br />
cher <strong>et</strong> un cadre de vie plus naturel.<br />
Les limites se brouillent. L’<strong>urbanisme</strong> s’étale dans <strong>les</strong> champs : zones d’activités,<br />
lotissements, supermarchés, routes <strong>et</strong> parkings ...<br />
De leur côté, <strong>les</strong> agriculteurs toujours moins nombreux agrandissent leurs exploitations.<br />
Mécanisés, spécialisés, ils produisent toujours plus, souvent mieux<br />
mais n’ont plus le temps d’entr<strong>et</strong>enir tout ce qui faisait le caractère de chaque<br />
territoire : <strong>les</strong> rigo<strong>les</strong> <strong>et</strong> <strong>les</strong> mares, <strong>les</strong> arbres <strong>et</strong> <strong>les</strong> haies, <strong>les</strong> mur<strong>et</strong>s <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
terrasses, <strong>les</strong> sentiers <strong>et</strong> <strong>les</strong> vieux bâtiments.<br />
Ces deux évolutions parallè<strong>les</strong> de l’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> de l’agriculture ont pour point<br />
commun de s’être appuyées sur le pétrole <strong>et</strong> le gaz pas chers.<br />
Avec ces énergies il a été possible de se dégager des contraintes naturel<strong>les</strong><br />
de chaque territoire mais aussi de négliger <strong>les</strong> potentiels qu’ils recèlent.<br />
Aujourd’hui, il devient clair pour tout le monde que ce modèle de développement<br />
devra profondément évoluer.<br />
Le coût des pollutions qu’il engendre continue de s’accroître.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Plus décisif encore, <strong>les</strong> ressources fossi<strong>les</strong> s’épuisent <strong>et</strong> leur prix va donc augmenter<br />
rem<strong>et</strong>tant en cause leur avantage économique par rapport aux richesses<br />
renouvelab<strong>les</strong> loca<strong>les</strong> oubliées.<br />
«Un autre développement est possible»<br />
Dans un tel contexte, <strong>les</strong> approches paysagères r<strong>et</strong>rouvent leur intérêt.<br />
Fondées sur la visite de terrain <strong>et</strong> une connaissance fine de l’histoire <strong>et</strong> de<br />
la géographie des lieux, el<strong>les</strong> guident <strong>les</strong> acteurs des territoires <strong>et</strong> <strong>les</strong> aident<br />
à harmoniser leurs actions pour valoriser toutes <strong>les</strong> ressources naturel<strong>les</strong> <strong>et</strong><br />
humaines.<br />
L’agriculture de montagne avec son lien si fort au paysage donne l’exemple<br />
qu’un autre développement est possible.<br />
«Utiliser au mieux <strong>les</strong> ressources agronomiques, par des solution économes<br />
<strong>et</strong> de qualité»<br />
Du fait des conditions de relief <strong>et</strong> de climat particulièrement diffici<strong>les</strong>, <strong>les</strong> agriculteurs<br />
de montagne n’ont pu s’approprier <strong>les</strong> modè<strong>les</strong> d’agriculture industrielle.<br />
Pour se maintenir, il leur a fallu trouver <strong>les</strong> moyens d’utiliser au mieux <strong>les</strong> ressources<br />
agronomiques de leurs terroirs. Ce n’est pas un hasard si <strong>les</strong> mesures<br />
de relance des prairies fleuries imaginées dans <strong>les</strong> Bauges ont autant de succès<br />
quand ailleurs l’intérêt économique <strong>et</strong> écologique des cultures fourragères<br />
faiblit.<br />
<strong>Paysage</strong> de prairie fleurie
Les agriculteurs ont appris également à répondre à la demande de qualité en<br />
m<strong>et</strong>tant en place des cahiers des charges exigeants.<br />
Enfin, ils ont trouvé des partenaires élus, associatifs, industriels, touristiques,<br />
pour <strong>les</strong> aider à faire reconnaître <strong>et</strong> rémunérer le travail d’entr<strong>et</strong>ien du paysage<br />
<strong>et</strong> du cadre de vie, qu’ils effectuent au service de tous.<br />
«Que l’agriculture devienne un élément reconnu de la composition urbaine»<br />
Le nouveau mot d’ordre du milieu agricole : produire plus (pour nourrir une population<br />
toujours plus nombreuse), mieux (pour obtenir des produits de bonne<br />
qualité sanitaire, gustative <strong>et</strong> biologique) avec moins d’intrants (engrais chimiques,<br />
traitements phytosanitaires <strong>et</strong> fuel) tout en partageant l’espace avec<br />
d’autres utilisateurs, est ici, en partie, déjà une réalité.<br />
Mais la qualité du paysage attire l’urbanisation <strong>et</strong> menace l’agriculture. Il faut<br />
donc que <strong>les</strong> agriculteurs <strong>et</strong> leurs conseillers apprennent à discuter avec <strong>les</strong><br />
élus <strong>et</strong> <strong>les</strong> citadins pour que l’agriculture devienne un élément reconnu de la<br />
composition urbaine.<br />
En <strong>les</strong> entraînant échanger leurs points de vue sur le terrain, <strong>les</strong> étudiants en<br />
architecture <strong>et</strong> leurs professeurs font la preuve qu’il est possible de trouver des<br />
solutions économes <strong>et</strong> de qualité.<br />
El<strong>les</strong> conduisent à des usages mixtes du territoire, au service de la production,<br />
de l’environnement <strong>et</strong> du cadre de vie.<br />
Une démarche pédagogique passionnante à étendre.»<br />
Depuis le Semnoz, vue sur la commune de Gruffy <strong>et</strong> la vallée du Chéran<br />
«Des architectes aux pieds nus »<br />
Extraits des travaux d’étudiants sur la commune d’Ecole ( Atelier 05-06) 32<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
33<br />
2<br />
AGRICULTURE ET URBANISME : DES CONIVENCES A REINVENTER<br />
Jean-Vincent BERLOTTIER<br />
Architecte-Urbaniste à Lyon<br />
«A défaut de pouvoir parler d’ «<strong>urbanisme</strong>» en territoire rural, il est sans doute<br />
nécessaire de parler des problématiques «d’aménagement» de ces territoires ;<br />
<strong>et</strong> ces problématiques sont en réalité plus complexes qu’en milieu urbain car la<br />
part du vivant, du biologique, y est beaucoup plus importante <strong>et</strong> spatialement<br />
prépondérante :<br />
que ce soit l’espace des ressources minéra<strong>les</strong>, des ressources des sols, des<br />
végétaux (naturels <strong>et</strong> cultivés), de l’eau, <strong>et</strong> du réservoir biologique animal.<br />
L’espace dit «rural» a toujours été sous la pression des autres modes de vie <strong>et</strong><br />
d’implantation humaine :<br />
Par <strong>les</strong> axes de déplacement,par <strong>les</strong> emprises, implantations <strong>et</strong> prélèvements<br />
stratégiques <strong>et</strong> commerciaux, <strong>et</strong> par le jeu de la propriété foncière.<br />
Et dès que l’économie du monde rural n’est plus uniquement autarcique, elle<br />
bénéficie ou dépend des milieux urbains qui lui sont connectés (qu’ils soient<br />
proches ou éloignés).<br />
«Des problématiques complexes qui nécessitent réflexions partagées <strong>et</strong><br />
multicompétences»<br />
Dans tous <strong>les</strong> pays, sur tous <strong>les</strong> continents, <strong>les</strong> modes de développements<br />
actuels sont accompagnés pour partie par des phénomènes de «rurbanisation»<br />
qui peuvent se résumer par un accroissement des déplacements «ville-campagne»<br />
jusqu’aux déplacements croisés <strong>et</strong> quotidiens entre lieux de travail <strong>et</strong> lieux d’habitat.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
La vitesse d’évolution <strong>et</strong> la complexification des relations entre vil<strong>les</strong> <strong>et</strong> campagnes<br />
nécessitent une réflexion partagée de tous <strong>les</strong> acteurs <strong>et</strong> de toutes <strong>les</strong> compétences.<br />
seul le débat perm<strong>et</strong> de faire apparaître toutes <strong>les</strong> problématiques, de proposer<br />
des options multip<strong>les</strong>, de procéder à des analyses multicritères, de dégager<br />
des synthèses sages <strong>et</strong> heureuses.<br />
Et ceci en temps voulu, c’est-à-dire en anticipation.<br />
«Les temps de l’analyse, de la réflexion, du débat sont incompressib<strong>les</strong>.<br />
Les temps des proj<strong>et</strong>s, des variantes, des synthèses sont nécessaires.»<br />
L’analyse économique est différente de celle du milieu urbain :<br />
<strong>les</strong> variantes économiques sont moins nombreuses, <strong>les</strong> amortissements plus<br />
longs, <strong>les</strong> coûts des déplacements (en investissement <strong>et</strong> en fonctionnement)<br />
plus importants qu’ils ne sont, en général, pris en compte.<br />
Et le foncier moins cher qu’en milieu urbain est un leurre qui pousse à un gaspillage<br />
encore parfois irraisonné.<br />
Dans ces débats, le croisement des expériences <strong>et</strong> compétences loca<strong>les</strong> avec<br />
des regards d’origine extérieure ont toujours été très bénéfiques :<br />
l’ «étranger», le «nomade» est très bien placé pour percevoir <strong>les</strong> spécificités,<br />
l’identité d’un lieu : ce qui le «frappe» à l’arrivée ;<br />
Commune de Treffort-Cuisiat (01)
il est également bien placé pour accumuler <strong>et</strong> transm<strong>et</strong>tre des expériences ;<br />
le dialogue avec <strong>les</strong> «résidents» l’oblige à formuler, donc à peser, soupeser,<br />
hiérarchiser ;<br />
enfin pour progresser il faut savoir imaginer, <strong>et</strong> imager.<br />
«Des territoires porteurs de rêve <strong>et</strong> d’imaginaire variés»<br />
Pour cel<strong>les</strong> <strong>et</strong> ceux qui veulent faire métier du proj<strong>et</strong> urbain à toutes ses échel<strong>les</strong>,<br />
<strong>les</strong> études d’aménagement dans <strong>les</strong> espaces ruraux ou naturels sont extrêmement<br />
formatrices par leur complexité, la subtilité de ces espaces, par la modestie <strong>et</strong> la<br />
prudence que requièrent <strong>les</strong> interventions dans la géographie (dont <strong>les</strong> déterminants<br />
sont incontournab<strong>les</strong>) ;<br />
qui plus est : ces territoires sont formidablement porteurs de rêve <strong>et</strong> d’imaginaires<br />
variés.<br />
Nomadiser, sortir des <strong>murs</strong>, c’est l’expérience par excellence.»<br />
Echange entre élu, architectes <strong>et</strong> étudiants dans le village de Treffort-Cuisiat (01) Atelier 07-08<br />
« Nomadiser, sortir des <strong>murs</strong>, c’est l’expérience par excellence.»<br />
Extraits des travaux d’étudiants sur la commune de Ceyzériat (01) ( Atelier 07-08) 34<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
35<br />
2<br />
ECHELLE DE TERRITOIRE, ECHELLE DE PROJET : Attentes <strong>et</strong> Perspectives<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Les Bauges, commune de Aillon
Proj<strong>et</strong> d’étudiant sur la commune de Saint-Jorioz (74) - Atelier 06-07 36<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
37<br />
2<br />
ECHELLE DE TERRITOIRE, ECHELLE DE PROJET : Attentes <strong>et</strong> Perspectives<br />
Philippe GIRARDIN<br />
Président du Parc naturel négional des Ballons des Vosges (88)<br />
«Le monde rural en général est naturellement peu enclin à faire appel aux<br />
chercheurs <strong>et</strong> aux étudiants de 3ème cycle pour défricher des questions spécifiques.<br />
Et pourtant <strong>les</strong> deux partenaires ont tout à gagner.<br />
«S’ouvrir au monde universitaire :<br />
démarches structurées <strong>et</strong> force de l’imaginaire»<br />
Le développement, <strong>et</strong> on pourrait même dire la survie, de l’Aubrac en tant que<br />
zone de production de viande <strong>et</strong> de lait s’est fondé sur un diagnostic très approfondi<br />
du CNRS dans <strong>les</strong> années 60-65 qui a permis de lancer une dynamique<br />
avec la création d’une coopérative laitière <strong>et</strong> demain, sans doute, la création<br />
d’un Parc naturel régional.<br />
L’INRA, de son côté, a été à l’origine du renouveau du fromage de Beaufort<br />
grâce à une étude sur la flore <strong>et</strong> l’entr<strong>et</strong>ien des prairies, la production du lait <strong>et</strong><br />
de son influence sur la qualité du fromage. S’y étaient impliqués de nombreux<br />
étudiants.<br />
Des groupes d’étudiants de 3ème ou 4ème année de l’Ecole du <strong>Paysage</strong> de<br />
Blois interviennent régulièrement à la demande de communes qui ont des proj<strong>et</strong>s<br />
d’<strong>urbanisme</strong> ou en amont de proj<strong>et</strong>s de PLU.<br />
C’est ainsi qu’un groupe d’étudiants, futurs architectes paysagistes, associés à<br />
des étudiants en architecture de Strasbourg a fait des propositions d’aménagement<br />
de trois futures zones constructib<strong>les</strong> de la commune de Lapoutroie dans<br />
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Ces propositions innovantes, voire décapantes, ont permis de faire bouger <strong>les</strong><br />
repères des élus municipaux <strong>et</strong> leurs ont ouvert de nouveaux horizons :<br />
intégration des constructions dans la pente, densification, zones de convivialité,<br />
liaison avec le cœur du village, mixité sociale… loin de la conformité <strong>et</strong> du<br />
souci de mode.<br />
Pour <strong>les</strong> étudiants il a fallu prendre en compte des contraintes inattendues :<br />
étroitesse des voies de circulation existantes, orientation au Nord, zone humide…<br />
Ces quelques exemp<strong>les</strong> parmi d’autres, montrent que <strong>les</strong> territoires ruraux ont<br />
tout à gagner d’une ouverture vers le monde universitaire, il leur apporte des<br />
démarches structurées mais aussi la force de l’imaginaire <strong>et</strong> peuvent leur faire<br />
partager des utopies.<br />
En r<strong>et</strong>our <strong>les</strong> étudiants <strong>et</strong> <strong>les</strong> enseignants y trouvent des terrains d’étude <strong>et</strong><br />
d’expérimentation qui leurs perm<strong>et</strong>tent d’affiner leurs formations en se rendant<br />
compte que la science est un savoir fragile qui ne peut vivre sans <strong>les</strong> sens, au<br />
contact du terrain.<br />
«Les parcs, des supports d’expérimentation privilégiés»<br />
Dans ces zones rura<strong>les</strong>, <strong>les</strong> Parcs naturels régionaux peuvent être des territoires<br />
privilégiés. En eff<strong>et</strong>, parmi <strong>les</strong> cinq missions assignées par la loi aux Parcs<br />
naturels régionaux, figure l’expérimentation.<br />
Visite du site de proj<strong>et</strong>s à Ceyzériat (01) Atelier 07-08
«Les parcs naturels régionaux : des territoires de choix pour l’accueil de travaux universitaires »<br />
Les chercheurs <strong>et</strong> <strong>les</strong> universitaires savent trop peu, en général, que <strong>les</strong> PNR<br />
qui sont par définition des zones au patrimoine naturel <strong>et</strong> culturel fragile, sont<br />
des supports propices aux travaux de terrain.<br />
En eff<strong>et</strong>, <strong>les</strong> équipes techniques des Parcs sont des relais privilégiés auprès<br />
des élus <strong>et</strong> acteurs économiques ou associatifs locaux.<br />
Ces équipes peuvent par la suite, aider à une bonne lisibilité <strong>et</strong> à une réelle<br />
appropriation des résultats par <strong>les</strong> acteurs de terrain.<br />
Reste à faire passer le message pour que <strong>les</strong> structures PNR soient mieux<br />
connues des éco<strong>les</strong> <strong>et</strong> des universités. Participer à des conseils scientifiques<br />
de Parcs peut être une bonne opportunité pour <strong>les</strong> enseignants <strong>et</strong> <strong>les</strong> chercheurs<br />
de s’impliquer avec <strong>les</strong> équipes techniques des PNR sur des territoires<br />
ruraux à la recherche de qualité.<br />
Ces échanges entre élus, acteurs ruraux, étudiants <strong>et</strong> enseignants, font prendre<br />
conscience aux premiers que si <strong>les</strong> faits s’imposent, leurs yeux sont peutêtre<br />
trahison, <strong>et</strong>, aux seconds qu’il faut quelquefois plus croire ce que disent<br />
leurs sens que ce que leurs cerveaux inventent.»<br />
Visite de la commune de Journans (01) <strong>et</strong> rencontre entre étudiants, élus <strong>et</strong> équipe du CAUE de l’Ain (Atelier 07-08)<br />
Extraits des travaux d’étudiants sur la commune de Ceyzériat centre-bourg <strong>et</strong> hameaux (01) Atelier 07-08<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
38
39<br />
2<br />
ECHELLE DE TERRITOIRE, ECHELLE DE PROJET : Attentes <strong>et</strong> Perspectives<br />
Jean-Jacques DAILLOT<br />
Président de la Communauté de Communes du Val de Galilée (88)<br />
«L’élu <strong>et</strong> l’architecte,<br />
Ce pourrait être le titre d’une fable (que je me garderai bien d’écrire) dans<br />
laquelle nos deux protagonistes se tiendraient dans une défiance si bien argumentée<br />
de part <strong>et</strong> d’autre que chacun considèrerait l’autre comme un mal nécessaire - jusqu’à<br />
ce que le hasard leur donne d’être utile l’un à l’autre.<br />
L’architecte serait évidemment assez imbu de sa personne <strong>et</strong> persuadé de la<br />
supériorité de son savoir, sa morgue n’aurait d’égale que sa méconnaissance<br />
des réalités <strong>et</strong> son discours se gargariserait de théories incompréhensib<strong>les</strong><br />
pour le commun des mortels.<br />
En foi de quoi il se sentirait fondé à penser à leur place l’environnement de ses<br />
semblab<strong>les</strong>, à imposer de façon subliminale son propre système de valeurs en<br />
usant du mépris du savant vis-à-vis de l’ignorant, à décréter ce qui sera bon<br />
pour eux au nom du bonheur qu’il leur prom<strong>et</strong>.<br />
L’élu, lui, serait bien sûr sans vision, sans proj<strong>et</strong> autre que celui de sa réélection,<br />
représentant incompétent d’une population abusée, <strong>les</strong> bottes si bien ancrée<br />
dans la glaise que tout mouvement lui serait interdit sous peine de perdre un<br />
équilibre chèrement acquis.<br />
Il serait d’abord soucieux d’être assez bien en cour pour être le premier à<br />
l’ouverture du guich<strong>et</strong> des subventions, dont l’évaluation en pourcentage serait<br />
le seul critère de sa réussite.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
La visière de sa casqu<strong>et</strong>te le laisserait inconscient des eff<strong>et</strong>s à long terme de<br />
ses choix, l’addition du nombre des habitants gagnés par sa commune au bénéfice<br />
des rec<strong>et</strong>tes prévisionnel<strong>les</strong> lui tenant lieu de Proj<strong>et</strong> Local d’Urbanisme.<br />
Et l’usage du sol ne serait pour lui que la résultante d’un rapport de forces<br />
naturel dont il n’aurait pas à se mêler, chacun ayant la liberté de disposer de<br />
son bien comme il l’entend, l’intérêt général étant garanti par une neutralité qui<br />
préserverait la somme des intérêts particuliers.<br />
Entre ces deux sphères pour le moins incompatib<strong>les</strong>, imaginons que le hasard<br />
d’une rencontre fortuite <strong>et</strong> la nécessité d’une compétence indispensable soient<br />
<strong>les</strong> catalyseurs d’une relation improbable qui se construirait sur <strong>les</strong> décombres<br />
de préjugés imbéci<strong>les</strong> mais tenaces, parce qu’un élu <strong>et</strong> un architecte se seraient<br />
fait confiance, auraient su s’écouter <strong>et</strong> auraient pris conscience de ce qu’ils<br />
pouvaient s’apporter l’un à l’autre.<br />
«C<strong>et</strong>te voie nouvelle ouverte par ces défricheurs de possib<strong>les</strong>...»<br />
Imaginons que c<strong>et</strong>te expérience inédite soit divulguée <strong>et</strong> que d’autres architectes<br />
<strong>et</strong> d’autres élus décident de suivre c<strong>et</strong>te voie nouvelle ouverte par ces défricheurs<br />
de possib<strong>les</strong>.<br />
Alors, dans un élan propre à ceux que <strong>les</strong> convictions m<strong>et</strong>tent en mouvement,<br />
<strong>les</strong> artisans du changement <strong>et</strong> <strong>les</strong> penseurs du vivre ensemble, <strong>les</strong> porteurs de<br />
proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> <strong>les</strong> proj<strong>et</strong>eurs de portes (à ouvrir), créent des ateliers, enclenchent<br />
des coopérations, travaillent en partageant leurs expériences, leurs savoirs <strong>et</strong><br />
leurs limites.<br />
Massif des Bauges
Alors on parle ensemble d’<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> d’urbanité, de paysages <strong>et</strong> de paysans,<br />
de liens <strong>et</strong> de liaisons, de culture <strong>et</strong> de nature, de bâti d’hier <strong>et</strong> de demain, d’habitat<br />
passif <strong>et</strong> d’habitants actifs, de collectif <strong>et</strong> de privatif, de terrains cultivés <strong>et</strong> de terrain<br />
conquis, de l’avenir choisi <strong>et</strong> du présent subi…<br />
«Quand <strong>les</strong> artisans du changement <strong>et</strong> <strong>les</strong> penseurs du vivre ensemble<br />
partagent leurs savoirs»<br />
Alors de jeunes citoyens, architectes ou non, font entendre leurs voix en écoutant<br />
celle des autres <strong>et</strong> posent <strong>les</strong> jalons d’un futur à construire avec compétence,<br />
conviction <strong>et</strong> modestie.<br />
Alors des élus appellent des architectes car ils ont compris que sans regard<br />
extérieur il n’est pas de connaissance intime de son territoire, que sans<br />
croisement des expériences la dégénérescence est inscrite dans un futur proche,<br />
que sans question dérangeante il n’est pas de réponse pertinente.<br />
Alors des architectes viennent à la rencontre des élus pour apprendre d’eux la<br />
complexité des interrelations qui font la vie d’un territoire, la difficulté d’être à<br />
la fois dans le présent tout en se proj<strong>et</strong>ant dans l’avenir, d’être dans l’urgence<br />
en se donnant du temps, de faire des choix <strong>et</strong> de poser des priorités alors que<br />
tout est crucial.<br />
Une fable, vraiment ?»<br />
Prairies à Héry-sur-Alby (74), le plateau de l’Albanais (Atelier 07-08)<br />
« L’Elu <strong>et</strong> l’Architecte »<br />
Extraits des travaux d’étudiants sur la commune de Saint-Jorioz (74) Atelier 06-07 40<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
41<br />
2<br />
ECHELLE DE TERRITOIRE, ECHELLE DE PROJET : Attentes <strong>et</strong> Perspectives<br />
Jean PICCHIONI<br />
Président de l’Espace Belledonne (38)<br />
«J’ai été élu Maire des Adr<strong>et</strong>s en 1983, après avoir accompli 2 mandats de 1er<br />
adjoint <strong>et</strong> j’ai présidé le Sivom de la Station des 7 Laux depuis mars 1990.<br />
C’est dans le cadre de ces deux responsabilités que j’ai eu l’occasion de tisser<br />
des liens <strong>et</strong> de travailler avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture de<br />
Grenoble : Jean-François LYON-CAEN <strong>et</strong> Char<strong>les</strong> ROCHE.<br />
C<strong>et</strong>te relation s’est organisée par l’intermédiaire du CAUE que je sollicitais<br />
souvent pour des conseils en <strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> architecture auprès de Serge<br />
GROS qui enseignait quelques heures à l’Ecole.<br />
Durant c<strong>et</strong>te période, différents suj<strong>et</strong>s ont été proposés :<br />
-Etude des bassins <strong>et</strong> des lavoirs de la commune pour leur réhabilitation,<br />
-Travail de recensement sur le p<strong>et</strong>it patrimoine <strong>et</strong> <strong>les</strong> granges désaffectées<br />
pour l’activité agricole,<br />
-Réflexions sur la zone PERRA, greffe du village, avec un programme de<br />
logements sociaux, locaux d’activités tertiaire, lots privatifs <strong>et</strong> services p<strong>et</strong>ite<br />
enfance en intégrant <strong>les</strong> nouvel<strong>les</strong> énergies possib<strong>les</strong> (chaufferie bois avec<br />
réseau de chaleur, énergie solaire).<br />
Sur la Station de Prapoutel, de nombreux suj<strong>et</strong>s ont été traités :<br />
-Etude sur <strong>les</strong> cheminements <strong>et</strong> circulations,<br />
-Amélioration des bâtiments actuels en modifiant <strong>les</strong> toits terrasses en deux<br />
pans avec création de nouveaux m² habitab<strong>les</strong>,<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
-Création d’une nouvelle ZAC de 1500 lits : implantation, lien avec l’ancien,<br />
<strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> architecture,<br />
-Etude d’une liaison câble vallée du Grésivaudan/Prapoutel <strong>et</strong> d’aménagements<br />
d’activités ludiques (centre de balnéothérapie <strong>et</strong> remise en forme, office du<br />
tourisme).<br />
«Elargir la réflexion jusqu’à l’utopie, pour engager <strong>les</strong> débats <strong>et</strong> choisir»<br />
Grâce à un contrat leader+ européen, nous avons pu organiser deux séjours<br />
en hébergement station, dans le cadre du programme ERASMUS, au cours<br />
desquels ont été abordés encore de nombreux thèmes avec des étudiants de<br />
différentes nationalités ; <strong>les</strong> rapports établis attestent du travail <strong>et</strong> de la<br />
richesse de la réflexion.<br />
C<strong>et</strong>te collaboration <strong>et</strong> ces échanges ont permis aux élus d’élargir le champ des<br />
suj<strong>et</strong>s abordés en allant même à l’utopie, pour engager des débats <strong>et</strong> choisir.<br />
Parmi <strong>les</strong> différents suj<strong>et</strong>s traités, certains ont vu le jour <strong>et</strong> se sont réalisés :<br />
le travail des étudiants a contribué, bien évidemment à c<strong>et</strong>te réalisation<br />
en « ouvrant » <strong>les</strong> élus décideurs sur le suj<strong>et</strong>, même si par la suite, c’est<br />
un cabin<strong>et</strong> d’architectes ou un urbaniste qui répond au programme <strong>et</strong> à la<br />
demande officielle.<br />
Randonnée-plaisir à la fin de l’atelier (07-08)
«Approfondir <strong>les</strong> proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> nourrir la réflexion en prenant conscience que quelques règ<strong>les</strong> ordonnent<br />
<strong>et</strong> organisent notre environnement ».<br />
J’ai également participé à des jurys de Diplôme concernant des suj<strong>et</strong>s <strong>les</strong> plus<br />
divers ;<br />
un jury a même été organisé dans la salle polyvalente de la commune <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
élus locaux, parents, amis, enseignants ont partagé avec <strong>les</strong> étudiants c<strong>et</strong><br />
évènement important dans leur vie professionnelle.<br />
C<strong>et</strong>te mise « en terrain » me semble indispensable pour <strong>les</strong> futurs professionnels<br />
de demain en architecture <strong>et</strong> <strong>urbanisme</strong> ;<br />
elle offre aux élus locaux <strong>et</strong> aux habitants la possibilité d’approfondir leur proj<strong>et</strong><br />
<strong>et</strong> de nourrir la réflexion en prenant conscience que quelques « règ<strong>les</strong> »<br />
ordonnent <strong>et</strong> organisent notre environnement.»<br />
Extraits des travaux d’étudiants sur l’architecture locale Atelier 05-06<br />
Commune d’Entrevernes (74)<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
42
43<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong>
3<br />
POUR UN URBANISME RURAL DURABLE<br />
«Elargir le cadre de réfléxion <strong>et</strong> d’action»<br />
Odile MARCEL, Philosophe<br />
«Connexions pédagogiques»<br />
Martin CHENOT, Architecte <strong>et</strong> urbaniste en chef de l’état, Directeur de l’ENSA de<br />
Saint-Etienne<br />
Co-écrit avec Xavier GUILLOT, Architecte <strong>et</strong> Maître Assistant à l’ENSA de Saint-Etienne<br />
«La prospective, la recherche <strong>et</strong> l’innovation en architecure, <strong>urbanisme</strong><br />
<strong>et</strong> paysage»<br />
Nathalie MEZUREUX, Architecte <strong>et</strong> urbaniste en chef de l’état, Directrice de<br />
l’ENSA de Lyon<br />
«Canaliser énergie <strong>et</strong> matière grise vers des territoires qui allient<br />
valeurs environnementa<strong>les</strong> <strong>et</strong> gestion raisonnée.»<br />
Vincent BRADEL <strong>et</strong> Marc VERDIER, Architectes <strong>et</strong> Maîtres Assistants à l’ENSA<br />
de Nancy<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
44
45<br />
3<br />
POUR UN URBANISME RURAL DURABLE - Ouverture<br />
Odile MARCEL<br />
Philosophe<br />
«Les territoires ruraux ont évolué de façon considérable depuis un demi-siècle.<br />
Ils le feront <strong>et</strong> auront à le faire encore ! Et tous, élus, population, experts, nous<br />
avons à imaginer de quelle façon donner un lendemain heureux à ces lieux<br />
d’excellence, nés du travail de l’homme <strong>et</strong> enrichis peu à peu par l’action de<br />
tous.<br />
La campagne a été aménagée par l’homme depuis des millénaires. L’habitat,<br />
<strong>les</strong> champs, <strong>les</strong> forêts, <strong>les</strong> routes, tout a été construit <strong>et</strong> dessiné par l’homme au<br />
cours des sièc<strong>les</strong>. L’homme a amendé <strong>les</strong> terres, épierré <strong>les</strong> champs, édifié des<br />
terrasses, enrichi <strong>les</strong> sols, entr<strong>et</strong>enu <strong>les</strong> forêts. Il a inventé un habitat adapté<br />
aux ressources <strong>et</strong> aux lieux.<br />
Dans <strong>les</strong> pays européens, la condition rurale a connu une évolution considérable<br />
depuis <strong>les</strong> derniers sièc<strong>les</strong> : de la pauvr<strong>et</strong>é à l’abondance, de la dur<strong>et</strong>é à une plus<br />
grande facilité de vie, des solidarités anciennes à l’individualisme récent. Les<br />
traditions <strong>les</strong> plus enracinées ont été amenées à disparaître.<br />
La société ancienne, souvent close sur elle-même, a vécu. Avec l’éducation <strong>et</strong><br />
l’urbanisation, une société nouvelle est née, plus ouverte, plus dynamique, avec<br />
aussi ses dur<strong>et</strong>és <strong>et</strong> ses contraintes, ses échecs, ses chantiers en cours.<br />
«Nous avons à imaginer de quelle façon donner un lendemain heureux à<br />
ces lieux d’excellence»<br />
Dans l’évolution récente des territoires ruraux, <strong>les</strong> rapports entre la ville <strong>et</strong> la<br />
campagne se sont transformés, m<strong>et</strong>tant à disposition de nouvel<strong>les</strong> richesses,<br />
créant aussi des réalités qu’il faut gérer : pour <strong>les</strong> campagnes éloignées des vil<strong>les</strong>,<br />
c’est souvent le déclin démographique, le vieillissement <strong>et</strong> la déprise ; pour <strong>les</strong><br />
zone rura<strong>les</strong> qui s’intègrent dans une périphérie urbaine dense ou demi-dense, le<br />
changement a apporté l’emploi, l’activité, mais aussi une banalisation du cadre de<br />
vie <strong>et</strong> une dissolution des liens de sociabilité <strong>et</strong> de solidarité.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Quand on se pose la question de comment construire dans <strong>les</strong> villages, il faut<br />
se demander pour quel<strong>les</strong> populations, quel mode de vie. Doit-on le faire en<br />
restaurant le vieux bâti ou en faisant du neuf ? En respectant un langage de<br />
formes loca<strong>les</strong>, ou en transportant à la campagne <strong>les</strong> formes de vie <strong>et</strong> d’habitat<br />
nées à la ville ?<br />
En m<strong>et</strong>tant partout des pavillons, on a éludé <strong>les</strong> termes de ce débat, <strong>et</strong> suscité<br />
de nouvel<strong>les</strong> nuisances : l’étalement urbain engendre la banalité, un gaspillage<br />
d’espace, de temps <strong>et</strong> d’énergie pour <strong>les</strong> hommes, une forme confuse <strong>et</strong> peu<br />
harmonieuse pour le territoire.<br />
«Un état des lieux qui nous invite à progresser»<br />
C<strong>et</strong>te façon de faire ne pourra se pérenniser. Outre le fait que l’économie<br />
connaisse actuellement une crise sans précédent dans nos sociétés, <strong>les</strong> réalités<br />
environnementa<strong>les</strong> y ont pris récemment le devant de la scène. La consommation<br />
actuelle d’énergie <strong>et</strong> d’espace nous invite à renouveler radicalement le type de<br />
mode de vie adopté par nos sociétés depuis quelques décennies. Nous nous<br />
croyions dans une société ouverte, essentiellement libre de son avenir <strong>et</strong> de ses<br />
choix. De nouvel<strong>les</strong> contraintes sont apparues : il se peut que l’épuisement des<br />
ressources planétaires menace la biosphère.<br />
Comment attaquer ce débat ? Comment avancer ? Nos modes de compréhension<br />
<strong>et</strong> d’action ont engendré un état des lieux qui nous invite à progresser. Des réalités<br />
nouvel<strong>les</strong>, des modes de vie différents, des enjeux sans précédent nous invitent<br />
à reprendre <strong>les</strong> choses, à définir de nouveaux objectifs, de nouveaux cadres, de<br />
nouvel<strong>les</strong> logiques d’action.
C’est pourquoi nous avons besoin de la juvénilité des futurs professionnels<br />
qui auront à imaginer nos lendemains ; de l’échange des compétences entre<br />
ceux qui <strong>les</strong> forment ; au-delà de cela, de l’invention des chercheurs <strong>et</strong> experts<br />
de toutes catégories ; <strong>et</strong> puis de la bonne volonté des décideurs <strong>et</strong> de ceux<br />
qui gouvernent pour engager un débat ample, radical, audacieux. Nous avons<br />
besoin d’un élargissement du cadre de réflexion, d’une créativité nouvelle, d’une<br />
ouverture.<br />
«Engager un débat ample, radical, audacieux»<br />
Les situations loca<strong>les</strong>, gérées par <strong>les</strong> générations successives du passé, ont<br />
permis à nos sociétés de sortir de la dur<strong>et</strong>é de vie, d’entrer dans une certaine<br />
modernité, d’introduire le bien-être plus largement. Mais <strong>les</strong> défis d’aujourd’hui<br />
<strong>et</strong> de demain nous imposent de réfléchir à nouveau, d’imaginer à nouveau.<br />
Le lendemain de nos campagnes aura à être dessiné autrement : urbanisation,<br />
répartition du temps <strong>et</strong> de l’espace entre lieux de travail <strong>et</strong> lieu de vie, gestion<br />
de l’énergie, organisation de la vie matérielle, tout invite à penser que nous<br />
sommes au début d’une ère qui apportera des transformations qui seront peut-être<br />
aussi importantes <strong>et</strong>, qui sait, aussi bel<strong>les</strong> que cel<strong>les</strong> qui ont eu lieu depuis un<br />
demi-siècle.<br />
Les défis nouveaux que notre époque doit relever de façon urgente impliquent<br />
de la part de tous une invention nouvelle, de la confiance, de grandes capacités de<br />
responsabilité <strong>et</strong> de puissance d’esprit pour réfléchir <strong>et</strong> pour agir.<br />
C’est pourquoi il importe de se réunir sur le terrain pour approfondir le débat ; pour<br />
se rencontrer <strong>et</strong> chercher à se comprendre ; pour échanger des connaissances,<br />
réfléchir aux situations loca<strong>les</strong> <strong>et</strong> aux urgences globa<strong>les</strong> afin de pouvoir inventer<br />
ensemble <strong>les</strong> formes de vie de la société de demain.»<br />
Alby-sur-Chéran (74)<br />
« Elargir le cadre de réflexion <strong>et</strong> d’action»<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
46
47<br />
3 Martin CHENOT<br />
Architecte <strong>et</strong> urbaniste en chef de l’état<br />
Directeur de l’ENSA de Saint-Etienne<br />
Texte co-écrit avec<br />
Xavier GUILLOT,<br />
architecte <strong>et</strong> Maître Assistant à l’ENSA de Saint-Etienne<br />
POUR UN URBANISME RURAL DURABLE<br />
«Depuis quelques années, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de<br />
Saint-Etienne, comme d’autres éco<strong>les</strong> d’architecture, développe des espaces<br />
pédagogiques d’enseignement du proj<strong>et</strong> où se côtoient des étudiants de<br />
disciplines différentes.<br />
C<strong>et</strong>te évolution repose principalement sur deux arguments.<br />
- Le premier est que l’interdisciplinarité est une pratique désormais générale<br />
dans <strong>les</strong> milieux professionnels où évoluent <strong>les</strong> architectes, pratique dont<br />
l’apprentissage doit s’effectuer dès la formation initiale.<br />
- Le second est que <strong>les</strong> suj<strong>et</strong>s d’études auxquels sont désormais soumis <strong>les</strong><br />
architectes intègrent un degré de complexité de plus en plus important dont la<br />
prise en compte est favorisée par une approche interdisciplinaire.<br />
Depuis trois ans, c<strong>et</strong>te volonté d’approche interdisciplinaire a été appliquée au<br />
travail de proj<strong>et</strong> sur <strong>les</strong> espaces dits ruraux – espaces à faible densité humaine<br />
<strong>et</strong> à forte présence végétale – dont <strong>les</strong> enjeux de mutation apparaissent<br />
particulièrement cruciaux pour le respect des grands équilibres.<br />
L’école d’architecture de Saint-Etienne a récemment mis en œuvre trois ateliers<br />
de territoire associant des étudiants d’autres disciplines :<br />
- Le premier en collaboration avec l’école nationale supérieure du paysage de<br />
Versail<strong>les</strong> (atelier de 3ème année encadré par Gil<strong>les</strong> Clément)<br />
- Le deuxième en collaboration avec l’IUT d’Agronomie d’Aurillac, expérience<br />
suivie <strong>et</strong> encadrée par des chercheurs de l’ENGREF.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
- Le troisième en collaboration avec l’Ecole Supérieure de la Nature <strong>et</strong> du <strong>Paysage</strong><br />
de Blois dans le cadre des Ateliers territoriaux du Grenelle de l’environnement.<br />
«Trois expériences pour apprendre de l’interdisciplinarité»<br />
La première collaboration portait sur l’élaboration d’un regard prospectif sur<br />
une vallée du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.<br />
Pour <strong>les</strong> étudiants paysagistes, il s’agissait d’un travail de proj<strong>et</strong> portant sur<br />
un semestre entier. La collaboration avec <strong>les</strong> architectes (étudiants de 4ème<br />
année encadrés par Stéphanie David <strong>et</strong> Marie Clément, architectes) a eu lieu à<br />
l’occasion d’un atelier intensif.<br />
La confrontation de ces deux disciplines de proj<strong>et</strong> a mis en évidence une réelle<br />
connivence dans <strong>les</strong> intentions <strong>et</strong> méthodes de travail, aboutissant à la production<br />
d’un regard « visionnaire » sur le territoire concerné. Simultanément, des différences<br />
d’approche significatives ont émergé, en particulier sur la question du vivant.<br />
La vision « biologique » défendue par <strong>les</strong> paysagistes complétait judicieusement celle<br />
plus humaniste défendue par <strong>les</strong> architectes. La capacité à représenter ce que<br />
pourrait être le futur constitue indéniablement un atout commun aux deux disciplines,<br />
outil fondamental pour transm<strong>et</strong>tre aux acteurs du territoire un exercice indispensable<br />
mais qui relève de l’abstraction.<br />
La seconde collaboration portait sur l’élaboration de proj<strong>et</strong>s de développement du<br />
Grand Site du Puy Mary dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.<br />
La rencontre entre <strong>les</strong> étudiants s’est réalisée sur la base de premiers travaux<br />
présentés par <strong>les</strong> étudiants architectes (étudiants de 4ème année encadrés par<br />
Stéphanie David, architecte). Les séances de travail ont mis en évidence un<br />
décalage entre l’attitude pragmatique des étudiants agronomes <strong>et</strong> le processus<br />
d’abstraction des architectes. Pourtant, l’approche fine des pratiques agrico<strong>les</strong>,<br />
intégrant la question du foncier <strong>et</strong> de l’organisation de l’espace s’est avérée un<br />
indispensable complément à celle plus prospective des architectes.
La question de l’intérêt collectif dans une visée de développement <strong>durable</strong>,<br />
exprimée de façon très distincte par <strong>les</strong> uns <strong>et</strong> <strong>les</strong> autres, a constitué un<br />
espace de rencontre productif.<br />
La troisième collaboration (en cours) porte sur l’évolution du Parc naturel régional<br />
des Volcans d’Auvergne, en particulier sa partie Nord très exposée à la pression<br />
foncière par la proximité de Clermont Ferrand.<br />
A l’échelle territoriale, l’objectif est de penser – <strong>et</strong> d’imaginer - l’évolution du<br />
Parc sur le long terme à partir de scénarios prospectifs, par le biais d’une réflexion<br />
sur <strong>les</strong> notions de « ressource territoriale » <strong>et</strong> de « proj<strong>et</strong> local ».<br />
A l’échelle du bâti, il s’agit d’élaborer des proj<strong>et</strong>s d’«unités de vie territoriale<br />
», où le renouvellement des formes d’habitat en milieu rural par le biais d’édifices<br />
intégrés – vivant avec leur environnement– économes en matériaux <strong>et</strong> en énergie,<br />
constituent un enjeu de conception central. La progression des travaux des étudiants<br />
de 4éme année en architecture (encadrés par Xavier Guillot, architecte, avec la<br />
collaboration de Pierre Buttion, architecte <strong>et</strong> de François Chomienne, paysagiste),<br />
s’appuie sur plusieurs rencontres-ateliers avec <strong>les</strong> acteurs du Parc naturel régional<br />
des Volcans d’Auvergne, durant <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> sont discutées la réalité des enjeux<br />
locaux d’aménagement <strong>et</strong> <strong>les</strong> attentes des habitants.<br />
«Préparer <strong>les</strong> futurs architectes à l’environnement professionnel évolutif<br />
qui <strong>les</strong> attend»<br />
Pour ces trois expériences, le regard intéressé des acteurs du territoire – élus,<br />
techniciens ou habitants – a constitué un environnement de travail réactif <strong>et</strong><br />
concr<strong>et</strong> particulièrement motivant pour <strong>les</strong> étudiants, leur perm<strong>et</strong>tant d’apprendre<br />
de la confrontation culturelle avec d’autres « points de vue ».<br />
Interdisciplinarité, confrontation au terrain, élaboration collective des proj<strong>et</strong>s,<br />
restitution aux acteurs du territoire : autant de principes simp<strong>les</strong> qui constituent<br />
progressivement une pédagogie responsable destinée à mieux préparer <strong>les</strong><br />
futurs architectes à l’environnement professionnel évolutif qui <strong>les</strong> attend.»<br />
Capture du paysage d’Ecole (74) par un étudiant (Atelier 05-06)<br />
«Connexions pédagogiques»<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
48
49<br />
3<br />
POUR UN URBANISME RURAL DURABLE<br />
Nathalie MEZUREUX<br />
Architecte <strong>et</strong> urbaniste en chef de l’état<br />
Directrice de l’ENSA de Lyon<br />
«L’enseignement supérieur <strong>et</strong> la recherche dans <strong>les</strong> domaines de l’architecture<br />
s’inscrivent inévitablement dans <strong>les</strong> enjeux de société.<br />
Dans leurs cursus de formation initiale <strong>les</strong> étudiants en architecture appréhendent<br />
ces enjeux au delà des cours théoriques par l’expérimentation de la conception<br />
architecturale <strong>et</strong> urbaine, sur des sites réels. Durant cinq années, leurs enseignants,<br />
majoritairement praticiens préparent des programmes de proj<strong>et</strong> sur des territoires de<br />
toutes dimensions, de tous types, de toutes nationalités.<br />
Pour favoriser l’apprentissage du métier, la mise en situation par recours aux<br />
décideurs locaux est fréquente. Elle perm<strong>et</strong> aux étudiants de se mesurer au<br />
rôle social qui sera le leur, autant qu’aux techniques de communication <strong>et</strong> de<br />
négociation du proj<strong>et</strong>. C<strong>et</strong>te méthode pédagogique est la seule à même de<br />
reproduire la complexité de l’acte de conception <strong>et</strong> le jeu de rô<strong>les</strong> propres au<br />
processus d’aménagement.<br />
Si l’enseignement de l’architecture s’en satisfait, il est permis de se demander<br />
si <strong>les</strong> décideurs qui donnent de leur temps <strong>et</strong> de leur énergie pour répondre à<br />
des sollicitations d’enseignants y ont finalement intérêt ou avantage.<br />
Sous réserve que <strong>les</strong> travaux pédagogiques ne soient jamais considérés comme<br />
une prestation opérationnelle mais bien comme une prospective pré opérationnelle,<br />
support de débat, voire de concertation, il semble que <strong>les</strong> décideurs <strong>et</strong> <strong>les</strong> acteurs<br />
d’un territoire puissent en tirer avantage.<br />
Mais il semble encore plus intéressant d’envisager c<strong>et</strong> intérêt pour la prospective,<br />
la recherche <strong>et</strong> l’innovation en architecture, <strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> paysage.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
En fin des années 70, une architecture s’intégrant harmonieusement dans son<br />
environnement était décrétée d’intérêt public.<br />
«Nos éco<strong>les</strong> ont à innover au plan pédagogique pour former <strong>les</strong><br />
professionnels du cadre de vie»<br />
C’est aujourd’hui une demande sociale repositionnée qui interroge <strong>les</strong> architectes,<br />
acteurs de l’espace construit, de l’espace urbain <strong>et</strong> des territoires.<br />
Une société qui se développe <strong>durable</strong>ment <strong>et</strong> équitablement est attendue.<br />
C’est une exigence de qualité qui renaît, <strong>et</strong> nos éco<strong>les</strong> ont en ce sens à innover<br />
au plan pédagogique pour former <strong>les</strong> professionnels du cadre de vie.<br />
Le développement équilibré des territoires, l’aménagement <strong>durable</strong>, l’<strong>urbanisme</strong><br />
équitable, la qualité environnementale des constructions, le recyclage des espaces<br />
bâtis entrent désormais dans <strong>les</strong> acquis fondamentaux d’un cursus d’étudiant en<br />
architecture.<br />
Or l’attitude soutenable n’est pas réservée à la construction neuve ou au<br />
développement urbain. Il se peut que des éco quartiers existent depuis longtemps<br />
sur nos territoires.<br />
Les espaces d’économie locale, peu exigeants en déplacement, <strong>les</strong> constructions<br />
usant des ressources proches <strong>et</strong> renouvelab<strong>les</strong>, <strong>les</strong> lieux de production <strong>et</strong> de<br />
consommation rapprochés, ne sont-ils pas certains villages, bourgs <strong>et</strong> vil<strong>les</strong><br />
moyennes qui se sont préoccupés de leurs racines ?<br />
(1). L’Arc latin est une aire géographique de coopération entre <strong>les</strong> collectivités territoria<strong>les</strong><br />
qui soutiennent des actions intégrées dans divers secteurs <strong>et</strong> dont sont membres la France,<br />
l’Italie <strong>et</strong> l’Espagne. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2008, l’Arc<br />
Latin a mis en place l’Observatoire Européen du <strong>Paysage</strong>, lui offrant comme siège la<br />
Chartreuse Saint Laurent de Padula, classée patrimoine mondial de l’Unesco. L’Observatoire<br />
sert aujourd’hui de plate forme à six proj<strong>et</strong>s pilotes en matière d’observation, de planification,
« Il semble encore plus important d’envisager c<strong>et</strong> intérêt pour la prospective, la recherche <strong>et</strong> l’innovation<br />
en architecure, <strong>urbanisme</strong> <strong>et</strong> paysage.»<br />
La notion d’équilibre entre protection <strong>et</strong> développement, présente dans <strong>les</strong> lois<br />
d’aménagement pour la montagne <strong>et</strong> le littoral autant que dans <strong>les</strong> textes fondateurs<br />
des Parcs naturels régionaux, ne comportait pas d’autres objectifs que ce que nous<br />
nommons aujourd’hui autrement.<br />
Ce qui alors était ambitionné sur ces espaces considérés d’exception aurait-il<br />
aujourd’hui l’ambition de se généraliser ?<br />
A l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, tous <strong>les</strong> champs disciplinaires<br />
de l’enseignement utilisent la mise en situation réelle.<br />
Cependant, certains enseignants la pratiquent délibérément sur des espaces à<br />
géographie remarquable, notamment dans des Parcs naturels régionaux ou dans<br />
<strong>les</strong> Parcs nationaux, ou plus simplement sur des espaces ruraux préservés.<br />
«Observer ces territoires comme des lieux d’avant-garde»<br />
A titre d’exemple, l’expérience de l’Observatoire européen du paysage de l’Arc<br />
Latin(1) qui fédère des compétences de chercheurs, professionnels <strong>et</strong> techniciens<br />
dans le cadre d’une politique ambitieuse de planification des paysages se situe dans<br />
ce cadre d’une géographie sensible identifiée comme un enjeu de d’aménagement<br />
<strong>durable</strong>.<br />
Observer ces territoires comme des lieux d’avant garde, analyser leur mode de<br />
gouvernance, leurs résultats, leur géographie sous bienveillance représente un<br />
potentiel important pour l’expérimentation de nos apprentis architectes <strong>et</strong> un<br />
obj<strong>et</strong> de recherche, à but observatoire ou d’innovation.»<br />
de recherche <strong>et</strong> d’expertise sur <strong>les</strong> paysages dans un objectif de développement <strong>durable</strong>.<br />
Il implique le parc national italien du Cilento <strong>et</strong> la fédération italienne des Parcs. Cf. article<br />
« L’Observatoire européen du paysage de l’Arc Latin » de Christiane Garnero Morena, maitre<br />
assistante associée à l’Ensal <strong>et</strong> Ensas co-signé avec Domenico Nicol<strong>et</strong>ti, directeur de l’Hispa<br />
pour la revue d‘information de la Commission Européenne.<br />
Terres agrico<strong>les</strong> à Lescheraines (74)<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
50
51<br />
3<br />
POUR UN URBANISME RURAL DURABLE<br />
Vincent BRADEL - Marc VERDIER<br />
Architectes <strong>et</strong> Maîtres Assistants à l’ENSA de Nancy<br />
«Que ce soit en terme de banlieue, de pays, ou de paysage, la ville a souvent<br />
fait des avances au territoire, en conquérant, en prédateur, réduisant ce dernier<br />
à un vaste réservoir, d’hommes <strong>et</strong> de lieux, de nourritures <strong>et</strong> de matières premières,<br />
dévolu à son seul service.<br />
Sollicité plus que jamais sur tous <strong>les</strong> fronts, enserré désormais dans de multip<strong>les</strong><br />
archipels, ce territoire ne pouvait manquer de reprendre la parole un jour ou<br />
l’autre, de faire campagne pour une autre manière de faire la ville.<br />
Des échos nous en étaient déjà parvenus, mais ces quelques semaines d’écoute<br />
beaucoup plus approfondie sur le terrain, leur ont donné une toute autre dimension.<br />
«Faire campagne pour une autre manière de faire la ville»<br />
Un écheveau de rencontres passionnantes <strong>et</strong> souvent passionnées avec des<br />
acteurs engagés <strong>et</strong> tout particulièrement des élus, nous a convaincu de l’existence<br />
d’une conscience aiguë des enjeux d’aménagement liés notamment à des<br />
pressions foncières de plus en plus fortes <strong>et</strong> lointaines.<br />
Alors que nous venions là pour expérimenter des hypothèses dans un cadre<br />
pédagogique, nous découvrions chez de nombreux interlocuteurs une attente<br />
très forte qui s’adressait non pas à de simp<strong>les</strong> étudiants mais déjà aux futurs<br />
professionnels qui venaient <strong>les</strong> solliciter.<br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
Il n’était pas indifférent que ces visions s’expriment dans des Parcs naturels<br />
régionaux, conçus à l’origine comme des réserves naturel<strong>les</strong> destinées à<br />
rem<strong>et</strong>tre sur pied des citadins stressés <strong>et</strong> devenus au fil du temps des territoires<br />
potentiels d’excellence.<br />
«Esquisser de nouvel<strong>les</strong> représentations <strong>et</strong> préparer le terrain à de<br />
nouveaux choix»<br />
En eff<strong>et</strong>, au delà de ces dialogues évoqués, l’atelier pouvait participer à un<br />
débat émergent dans ces territoires sur <strong>les</strong> questions urbaines <strong>et</strong> l’enrichir<br />
d’une compétence de proj<strong>et</strong> – fusse- t-elle en devenir - pour esquisser de<br />
nouvel<strong>les</strong> représentations <strong>et</strong> préparer le terrain à de nouveaux choix <strong>et</strong> de<br />
nouvel<strong>les</strong> réalisations.<br />
C<strong>et</strong>te épaisseur très vite acquise <strong>et</strong> partagée autour de tab<strong>les</strong> animées, nous<br />
ouvrait de nouvel<strong>les</strong> perspectives.<br />
Incontestablement il y avait là un champ d’investigation qui dépassait largement<br />
l’intérêt commun qui nous avait réunis, le temps d’un exercice de proj<strong>et</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong><br />
<strong>murs</strong>.<br />
«Vers des connivences renouvelées entre ville <strong>et</strong> paysage»<br />
Face à l’intensité <strong>et</strong> à la spécificité des enjeux exprimés, ne fallait-il pas<br />
encourager de nouvel<strong>les</strong> recherches, de nouvel<strong>les</strong> stratégies, de nouveaux<br />
savoir-faire ?
« C<strong>et</strong>te rencontre se veut une première étape pour canaliser énergie <strong>et</strong> matière grise vers<br />
des territoires qui allient valeurs environnementa<strong>les</strong> <strong>et</strong> gestion raisonnée. »<br />
Dans notre esprit, c<strong>et</strong>te rencontre se veut une première étape pour canaliser<br />
énergie <strong>et</strong> matière grise vers des territoires qui allient valeurs environnementa<strong>les</strong><br />
<strong>et</strong> gestion raisonnée.<br />
Ils deviennent dès lors des lieux d’expérimentation <strong>et</strong> d’innovation privilégiés<br />
dans une perspective de r<strong>et</strong>our vers des connivences renouvelées entre ville<br />
<strong>et</strong> paysage.<br />
«Pour une recherche institutionnalisée, au services des territoires <strong>et</strong> de<br />
la société»<br />
Les éco<strong>les</strong> d’architecture sont des institutions qui allient des missions de<br />
formation <strong>et</strong> de recherche <strong>et</strong> le positionnement d’ateliers de proj<strong>et</strong> en cycle<br />
Master constitue très certainement une opportunité d’allier ces deux composantes<br />
essentiel<strong>les</strong> au service de territoires qui font encore peu l’obj<strong>et</strong> de travaux<br />
universitaires.<br />
La matière accumulée dans <strong>les</strong> partenariats engagés depuis quatre ans par<br />
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, celle issue des expériences<br />
d’autres éco<strong>les</strong>, pourrait être la source d’une recherche institutionnalisée, au service<br />
de territoires dont on sent bien qu’ils sont de plus en plus demandeurs, mais<br />
également d’une société qui n’a plus le choix, qui doit mieux composer son<br />
espace, entre habitat <strong>et</strong> maintien des ressources essentiel<strong>les</strong> que sont <strong>les</strong> sols,<br />
l’eau, l’énergie…»<br />
Le Grand <strong>Paysage</strong><br />
<strong>Apprendre</strong> <strong>hors</strong> <strong>les</strong> <strong>murs</strong><br />
52
Des étudiants sur le terrain. Rencontrer, écouter, parcourir, regarder, analyser, interroger, discuter, comparer, débattre… Des p<strong>et</strong>ites<br />
communes ouvertes à l’expérience. Accueillir, présenter, reformuler, se livrer, former, écouter, réagir, débattre…<br />
Les éco<strong>les</strong> se délocalisent pour la bonne cause. Les étudiants <strong>et</strong> leurs enseignants se rendent là où la matière à proj<strong>et</strong> est la plus proche<br />
de sa source <strong>et</strong> tentent, au travers des problématiques formulées ensemble (habiter la campagne, préserver <strong>les</strong> ressources, considérer <strong>les</strong><br />
biens collectifs que sont le paysage, la valeur de production des terres agrico<strong>les</strong>…) de créer <strong>les</strong> conditions du débat à partir des proj<strong>et</strong>s.<br />
L’échange entre université <strong>et</strong> territoire est productif de plus-value, pour <strong>les</strong> éco<strong>les</strong>, qui y trouvent <strong>les</strong> moyens d’une pédagogie de proj<strong>et</strong><br />
active, pour <strong>les</strong> territoires qui peuvent s’appuyer sur <strong>les</strong> travaux des étudiants pour débattre sur l’avenir de leur territoire, de leur mode<br />
de transformation <strong>et</strong> d’adaptation au monde de demain.<br />
Ces proj<strong>et</strong>s d’étudiants sont l’occasion d’initier une véritable recherche sur la modernité du monde rural, <strong>et</strong> de participer à l’idée que<br />
l’innovation a toute sa place à la campagne !<br />
réseau de territoires<br />
<strong>Paysage</strong> <strong>et</strong> <strong>urbanisme</strong> <strong>durable</strong><br />
Mairie-conseils<br />
72, avenue Pierre-Mendès-France<br />
75914 Paris cedex 13<br />
Mai 2009<br />
Commande<br />
Référence : E117<br />
Mairie-conseils diffusion<br />
SDL329<br />
16, rue Berthol<strong>et</strong><br />
94110 Arcueil<br />
Tél : 01 58 50 17 00<br />
Fax : 01 58 50 00 74<br />
www.mairieconseils.n<strong>et</strong>