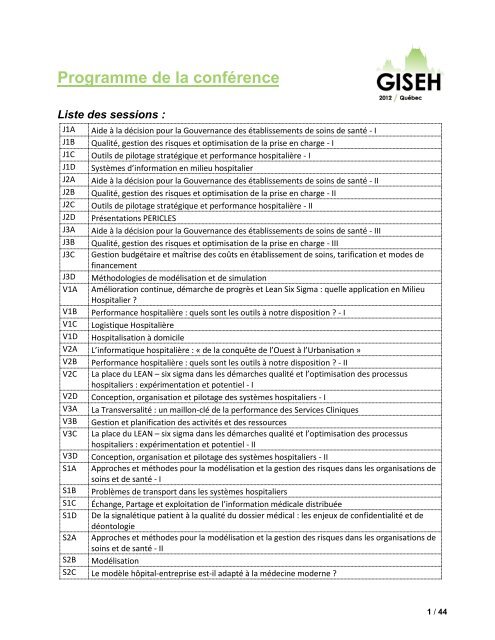Programme de conférence - giseh 2012 - cirrelt
Programme de conférence - giseh 2012 - cirrelt
Programme de conférence - giseh 2012 - cirrelt
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Programme</strong> <strong>de</strong> la <strong>conférence</strong><br />
Liste <strong>de</strong>s sessions :<br />
J1A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la Gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé - I<br />
J1B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge - I<br />
J1C Outils <strong>de</strong> pilotage stratégique et performance hospitalière - I<br />
J1D Systèmes d’information en milieu hospitalier<br />
J2A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la Gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé - II<br />
J2B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge - II<br />
J2C Outils <strong>de</strong> pilotage stratégique et performance hospitalière - II<br />
J2D Présentations PERICLES<br />
J3A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la Gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé - III<br />
J3B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge - III<br />
J3C Gestion budgétaire et maîtrise <strong>de</strong>s coûts en établissement <strong>de</strong> soins, tarification et mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
financement<br />
J3D Méthodologies <strong>de</strong> modélisation et <strong>de</strong> simulation<br />
V1A Amélioration continue, démarche <strong>de</strong> progrès et Lean Six Sigma : quelle application en Milieu<br />
Hospitalier ?<br />
V1B Performance hospitalière : quels sont les outils à notre disposition ? - I<br />
V1C Logistique Hospitalière<br />
V1D Hospitalisation à domicile<br />
V2A L’informatique hospitalière : « <strong>de</strong> la conquête <strong>de</strong> l’Ouest à l’Urbanisation »<br />
V2B Performance hospitalière : quels sont les outils à notre disposition ? - II<br />
V2C La place du LEAN – six sigma dans les démarches qualité et l’optimisation <strong>de</strong>s processus<br />
hospitaliers : expérimentation et potentiel - I<br />
V2D Conception, organisation et pilotage <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers - I<br />
V3A La Transversalité : un maillon-clé <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s Services Cliniques<br />
V3B Gestion et planification <strong>de</strong>s activités et <strong>de</strong>s ressources<br />
V3C La place du LEAN – six sigma dans les démarches qualité et l’optimisation <strong>de</strong>s processus<br />
hospitaliers : expérimentation et potentiel - II<br />
V3D Conception, organisation et pilotage <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers - II<br />
S1A Approches et métho<strong>de</strong>s pour la modélisation et la gestion <strong>de</strong>s risques dans les organisations <strong>de</strong><br />
soins et <strong>de</strong> santé - I<br />
S1B Problèmes <strong>de</strong> transport dans les systèmes hospitaliers<br />
S1C Échange, Partage et exploitation <strong>de</strong> l’information médicale distribuée<br />
S1D De la signalétique patient à la qualité du dossier médical : les enjeux <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ntialité et <strong>de</strong><br />
déontologie<br />
S2A Approches et métho<strong>de</strong>s pour la modélisation et la gestion <strong>de</strong>s risques dans les organisations <strong>de</strong><br />
soins et <strong>de</strong> santé - II<br />
S2B Modélisation<br />
S2C Le modèle hôpital-entreprise est-il adapté à la mé<strong>de</strong>cine mo<strong>de</strong>rne ?<br />
1 / 44
2 / 44
Mercredi 29 août <strong>2012</strong><br />
17h00 Inscription et cocktail <strong>de</strong> bienvenue à l’atrium Pierre-H.-Lessard,<br />
pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />
Jeudi 30 août <strong>2012</strong><br />
08h30 Inscription, accueil et café - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon<br />
Palasis-Prince (PAP)<br />
08h45 Ouverture<br />
Salle : Amphithéâtre IMB - local 0610 (PAP)<br />
Mot <strong>de</strong>s coprési<strong>de</strong>nts du comité organisateur, MM. Angel Ruiz et Patrick Soriano<br />
Mot du doyen <strong>de</strong> FSA Laval, M. Michel Gendron<br />
Mot du prési<strong>de</strong>nt du comité <strong>de</strong> pilotage, GISEH, Alain Guinet<br />
Mot du sous-ministre adjoint du ministère <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong>s services sociaux, M. Jean<br />
Rodrigue<br />
Plénière - I<br />
Salle : Amphithéâtre IMB - local 0610 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Stéphane Lemire<br />
09h00 Défis <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s maladies chroniques et du vieillissement<br />
Howard, Bergman, Université McGill et Hôpital général juif, howard.bergman@mcgill.ca<br />
09h45 Pause - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />
J1A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong><br />
soins <strong>de</strong> santé - I<br />
Salle : 1317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>ntes : Nadine Meskens et Christine Di Martinelly<br />
10h05 Automatisation <strong>de</strong>s diagnostics comme ai<strong>de</strong> au codage dans les systèmes<br />
utilisant les DRG<br />
Meyer, Rodolphe, HUG, rodolphe.meyer@hcuge.ch<br />
The Geneva University Hospital is using the diagnosis related group (DRG) as the<br />
cornerstone of its billing system. Conventional international use of the DRG calculation is<br />
based on a list of diagnoses and interventions quoted in the patient’s hospital discharge<br />
documents. In Switzerland, we co<strong>de</strong> the information using a German instantiation of the<br />
international classification of diseases (ICD10) with an acts and interventions dictionary<br />
called CHOP2011. The co<strong>de</strong>s are chosen manually by professional co<strong>de</strong>rs from all the<br />
3 / 44
documents accessible in our electronic health record (HER). Patients who are more<br />
seriously ill tend to require more hospital resources than patients who are less seriously ill,<br />
even though they are admitted to the hospital for the same reason. Recognizing this, the<br />
diagnosis-related group (DRG) manual splits certain DRGs based on the presence of<br />
secondary diagnoses for specific complications or comorbidities (CC). Comorbidities have<br />
then a major importance when it comes to compute the DRG of a particular hospital stay.<br />
Comorbidities carry consi<strong>de</strong>rable weight in <strong>de</strong>termining the reasonable length of<br />
hospitalization and its price. Some of these comorbidities are often forgotten on the hospital<br />
discharge summaries. They are so common and easy to manage that doctors often overlook<br />
mentioning them. However, it is possible to recreate them from the hospital information<br />
system data warehouse. In this work we are showing that an alert can be created regarding<br />
urinary infectious diseases using automated diagnosis from the EHR via a computer-ai<strong>de</strong>d<br />
<strong>de</strong>cision support system (DSS). Based on very strict biological results and prescribing<br />
criterions, we were able to i<strong>de</strong>ntify 606 real urinary infectious diseases in 2009 not appearing<br />
in our discharge summaries although they should have. After being inclu<strong>de</strong>d into the coding<br />
process, 97 of these urinary infections influenced the final outcome of the DRG leading to an<br />
additional income in 2009. This could potentially provi<strong>de</strong> an annual benefit of more than<br />
160K CHF per year using this type of alert system for this pathology alone. On this basis we<br />
intend to extend this work to other comorbidities like dyskalemias, hemorrhages or<br />
malnutrition.<br />
10h30 Développement d’un système <strong>de</strong> monitorage unifié du réseau <strong>de</strong> soins et<br />
services gériatriques au Québec<br />
Murray, William, Ministère <strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong>s Services sociaux,<br />
william.murray@msss.gouv.qc.ca<br />
Lemire, Stéphane, Interniste-Gériatre et Professeur <strong>de</strong> clinique, CHUQ,<br />
stlemire@googlemail.com<br />
Au cours <strong>de</strong>s vingt prochaines années, le Québec connaîtra une progression marquée du<br />
nombre <strong>de</strong> personnes âgées. Ce phénomène impose d’ores et déjà <strong>de</strong>s exigences<br />
particulières en termes d’efficacité et d’efficience du système <strong>de</strong> soins. L’optimisation en<br />
continu <strong>de</strong>s processus cliniques <strong>de</strong>vient ainsi une tâche incontournable. De plus, les enjeux<br />
<strong>de</strong> continuité <strong>de</strong>s services propres à une clientèle âgée vulnérable, incitent plus que jamais<br />
à modéliser le système <strong>de</strong> soins comme un ensemble <strong>de</strong> composantes interdépendantes. Il<br />
s’avère alors nécessaire d’intégrer l’offre <strong>de</strong> services en amont et en aval <strong>de</strong> l’hôpital, au<br />
processus d’optimisation <strong>de</strong>s performances du milieu hospitalier lui-même. En relation avec<br />
ces enjeux, un cadre d’analyse du continuum <strong>de</strong> soins offerts aux personnes âgées en perte<br />
d’autonomie est ici proposé. Il intègre à la fois <strong>de</strong>s données sur l’offre <strong>de</strong> services dans la<br />
communauté et différentes mesures <strong>de</strong> performance <strong>de</strong>s milieux hospitaliers. Appliqué <strong>de</strong><br />
façon appropriée en situation <strong>de</strong> gestion, il contribue à l’optimisation d’un grand ensemble<br />
<strong>de</strong> processus cliniques. Mais la non disponibilité <strong>de</strong> certaines données pertinentes limite<br />
d’autant l’expansion du cadre d’analyse.<br />
10h55 Vers un outil d’ai<strong>de</strong> à la décision basé sur la simulation d’un service<br />
d’imagerie<br />
Moussa, Mohamed, Université USTO-MB, assuom78@gmail.com<br />
Belkadi, Khaled, Université USTO-MB, belkadi1999@yahoo.fr<br />
Ce document porte sur l'application <strong>de</strong> la simulation par <strong>de</strong>s événements discrets en tant<br />
que technique d'ai<strong>de</strong> à la prise <strong>de</strong> décision dans un service d'imagerie d'un grand hôpital<br />
militaire régional universitaire à Oran Algérie (HMRUO). Le modèle <strong>de</strong> simulation qui a été<br />
construit décrit les principales caractéristiques <strong>de</strong> la simulation par <strong>de</strong>s événements discrets,<br />
en se concentrant sur les processus opérationnels et le temps <strong>de</strong> passage <strong>de</strong>s patients. Le<br />
4 / 44
modèle a démontrer le potentiel <strong>de</strong> l'utilisation <strong>de</strong> la modélisation <strong>de</strong> simulation comme une<br />
métho<strong>de</strong> rentable pour comprendre les enjeux <strong>de</strong> la simulation par <strong>de</strong>s événement discret,<br />
la gestion <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé et le rôle <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> simulation dans la<br />
résolution <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers.<br />
11h20 L’erreur médicamenteuse : proposition d’un modèle d’analyse <strong>de</strong>s causes<br />
Filali El Ghorfi, Souad, UCL MONS, souad.filali@uclouvain-mons.be<br />
Meskens, Nadine, UCL MONS, nadine.meskens@uclouvain-mons.be<br />
Riane, Fouad, Faculté <strong>de</strong>s Sciences et techniques, Hassan I, Université <strong>de</strong> Settat, Maroc,<br />
riane@bpc-ma.com<br />
Les erreurs médicamenteuses (EM) sont fréquentes dans les hôpitaux et à toutes les étapes<br />
du processus thérapeutique. Ces erreurs entraînent <strong>de</strong>s événements indésirables graves<br />
qui ont un impact nuisible sur la santé du patient et engendrent <strong>de</strong>s coûts importants pour<br />
l’organisation hospitalière. La maîtrise <strong>de</strong> l’EM s’impose comme une priorité pour les<br />
professionnels <strong>de</strong> santé afin <strong>de</strong> réduire ces effets néfastes. L’objectif <strong>de</strong> cet article est <strong>de</strong><br />
faire une analyse critique <strong>de</strong> la littérature d’une part, et <strong>de</strong> contribuer à la gestion <strong>de</strong> l’erreur<br />
médicamenteuse en développant un modèle d’analyse <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> l’EM d’autre part.<br />
J1B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge<br />
- I<br />
Salle : 1325 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Hervé Hubert<br />
10h05 L’apport du suivi automatique <strong>de</strong> protocoles médicaux pour la qualité et la<br />
gestion <strong>de</strong>s risques en unité <strong>de</strong> soins intensifs : le cas du traumatisé crânien<br />
Zitouni, Djamel, Université <strong>de</strong> Lille 2, djamel.zitouni@univ-lille2.fr<br />
Guinhouya, Benjamin, Université <strong>de</strong> Lille 2, benjamin.guinhouya@univ-lille2.fr<br />
Lemdani, Mohamed, Université <strong>de</strong> Lille 2, mohamed.lemdani@univ-lille2.fr<br />
Vilhelm, Christian, Université <strong>de</strong> Lille 2, christian.vilhelm@univ-lille2.fr<br />
Zgaya, Hayfa, Université <strong>de</strong> Lille 2, hayfa.zgaya@univ-lille2.fr<br />
Hubert, Hervé, Université <strong>de</strong> Lille 2, herve.hubert@univ-lille2.fr<br />
La complexité du domaine médical et le caractère souvent implicite <strong>de</strong>s connaissances<br />
impactent directement la qualité <strong>de</strong>s soins. La mise en œuvre <strong>de</strong>s protocoles médicaux,<br />
dans les cas les plus complexes, peut déboucher sur un risque iatrogène. Dès lors, la<br />
question se pose <strong>de</strong> réduire ce risque et ainsi d’améliorer la qualité <strong>de</strong>s soins. La gestion<br />
automatique <strong>de</strong> protocoles est une voie prometteuse pour faire progresser et réduire le<br />
risque iatrogène et améliorer la qualité <strong>de</strong>s soins dans la pratique quotidienne <strong>de</strong> la<br />
mé<strong>de</strong>cine. En effet, la supervision automatique <strong>de</strong>s protocoles ai<strong>de</strong> le praticien à déléguer à<br />
la machine une partie <strong>de</strong> la prise en charge. Dès lors, celui-ci peut se concentrer sur le<br />
patient et délaisser la partie plus technique du protocole <strong>de</strong> soins (surveillance <strong>de</strong>s<br />
constantes physiologiques, prescriptions et interactions médicamenteuses, planifications<br />
<strong>de</strong>s actes, retour <strong>de</strong> laboratoires…). Dans cet article, nous proposons, par une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas<br />
(protocole du traumatisé crânien), une méthodologie permettant aux praticiens d'entrer leurs<br />
connaissances dans un système automatisé sans connaissance particulière en<br />
informatique. Ce procédé permet <strong>de</strong> construire rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> nouvelles connaissances<br />
directement exploitables par un PDMS (patient data management system) en temps réel et<br />
au chevet du patient.<br />
5 / 44
10h30 Analyser la relation mé<strong>de</strong>cin-patient : proposition d’un protocole <strong>de</strong><br />
coopération multi-agent<br />
Zgaya, Hayfa, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />
hayfa.zgaya@univ-lille2.fr<br />
Guinhouya, Benjamin, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />
benjamin.guinhouya@univ-lille2.fr<br />
zitouni, djamel, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />
djamel.zitouni@univ-lille2.fr<br />
Hubert, Hervé, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />
herve.hubert@univ-lille2.fr<br />
La relation mé<strong>de</strong>cin-patient a toujours évoqué <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s et discussions,<br />
notamment à cause <strong>de</strong> son caractère complexe à appréhen<strong>de</strong>r. Depuis les premières<br />
définitions et les nombreuses étu<strong>de</strong>s économiques, sociologiques ou philosophiques <strong>de</strong> la<br />
relation mé<strong>de</strong>cin-patient, il y a eu plusieurs changements dans les aspects sociaux, moraux<br />
ou économiques <strong>de</strong> cette relation. Le patient <strong>de</strong>vient le consommateur d’un service <strong>de</strong> soin<br />
produit par le mé<strong>de</strong>cin grâce au savoir <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, à son dévouement, à son sens du<br />
dialogue et à sa compréhension. Dans ce papier, nous modélisons la relation mé<strong>de</strong>cinpatient<br />
par un protocole <strong>de</strong> coopération en se basant sur l’approche multi-agent. L’objectif<br />
étant <strong>de</strong> comprendre cette relation afin <strong>de</strong> l’évaluer et <strong>de</strong> pouvoir améliorer le processus <strong>de</strong><br />
prise en charge. La solution proposée nous a permis <strong>de</strong> démontrer que le service <strong>de</strong> soin<br />
est coproduit par le mé<strong>de</strong>cin (à 70% en moyenne) et par son patient (à 30% en moyenne).<br />
Cette évaluation peut être un support microéconomique scrupuleux pour la Tarification à<br />
l’Activité (T2A). En outre, nous démontrons que le protocole proposé permet d’améliorer la<br />
prise en charge en produisant une interaction dynamique entre le mé<strong>de</strong>cin et son patient.<br />
10h55 Proposition d’un modèle <strong>de</strong> connaissance à base d’agents pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
rapports entre l’activité physique et l’obésité infantile<br />
Rabia, Aziza, Faculté <strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong> Tunis, Université <strong>de</strong> Tunis El-Manar,<br />
rabia.aziza@gmail.com<br />
Zgaya, Hayfa, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />
hayfa.zgaya@univ-lille2.fr<br />
Guinhouya, Benjamin, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />
benjamin.guinhouya@univ-lille2.f<br />
Borgi, Amel, Faculté <strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong> Tunis, Université <strong>de</strong> Tunis El-Manar,<br />
amel.borgi@insat.rnu.tn<br />
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche multidisciplinaire au croisement <strong>de</strong><br />
l’épidémiologie et <strong>de</strong> l’informatique. Dans la première discipline, nous nous intéressons à<br />
l’effet <strong>de</strong> l’activité physique sur l’obésité infantile, qui représente un véritable problème<br />
mondial <strong>de</strong> santé publique. Avec l'augmentation constante <strong>de</strong> leur prédominance dans la<br />
population infantile, il semble aujourd'hui nécessaire <strong>de</strong> stimuler l'engagement <strong>de</strong>s enfants<br />
dans une activité physique régulière. Par conséquent, <strong>de</strong> nombreux travaux ont tenté <strong>de</strong><br />
comprendre les déterminants et les facteurs clés principaux <strong>de</strong> l'activité physique habituelle<br />
<strong>de</strong>s enfants en surpoids/obésité. Nous pensons qu’une approche <strong>de</strong> simulation <strong>de</strong> la réalité<br />
permettrait une étu<strong>de</strong> approfondie <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s comportements <strong>de</strong>s enfants selon <strong>de</strong>s<br />
facteurs dynamiques et interactifs <strong>de</strong> nature diverse. La <strong>de</strong>uxième discipline, qu’est<br />
l’informatique, nous permet <strong>de</strong> proposer un tel modèle <strong>de</strong> simulation, et ce grâce à<br />
l'approche multi-agent. Les systèmes multi-agents (SMA) s'appuient sur les caractéristiques<br />
observées du mon<strong>de</strong> réel, et permettent une conception efficace, dynamique et flexible d'un<br />
environnement où <strong>de</strong>s entités autonomes et rationnelles peuvent cohabiter, communiquer et<br />
évoluer. Dans cet article, nous proposons une conception d’un SMA pour caractériser le<br />
comportement d’activité physique <strong>de</strong>s enfants et l’environnement dans lequel ce<br />
6 / 44
comportement se déroule. Cette proposition servira <strong>de</strong> base pour simuler et tester <strong>de</strong>s<br />
scénarii dans le but d’étudier l’impact <strong>de</strong> différents programmes d’activité physique sur le<br />
<strong>de</strong>venir pondéral <strong>de</strong>s enfants.<br />
J1C Outils <strong>de</strong> pilotage stratégique et performance hospitalière - I<br />
Salle : 2307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Brigitte Rorive Feytmans, Caroline Merdinger-Rumpler et Thierry Nobre<br />
10h05 Outils <strong>de</strong> pilotage <strong>de</strong> la performance pour le service <strong>de</strong>s urgences adultes<br />
d’un hôpital universitaire : mise en pratique et premiers résultats<br />
Bréant, Claudine, HUG, claudine.breant@hcuge.ch<br />
Mauvais, Florian, HUG, florian.mauvais@hcuge.ch<br />
Jason-Keller, Armelle, HUG, armelle.jasonkeller@hcuge.ch<br />
Piccand-Villar, Beatriz, HUG, beatriz.villar@hcuge.ch<br />
Rutschmann, Olivier, HUG, olivier.rutschmann@hcuge.ch<br />
Sarasin, François, HUG, francois.sarasin@hcuge.ch<br />
Rorive-Feytmans, Brigitte, HUG, brigitte.rorivefeytmans@hcuge.ch<br />
Cet article décrit le développement d’outils <strong>de</strong> pilotage et <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> la performance pour<br />
le service <strong>de</strong>s urgences <strong>de</strong>s hôpitaux universitaires <strong>de</strong> Genève et donne <strong>de</strong>s résultats<br />
préliminaires quant à leur utilisation. Le contexte est celui <strong>de</strong> l’objectif prioritaire <strong>de</strong><br />
désengorgement et <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s durées <strong>de</strong> séjour dans le service. Deux niveaux<br />
d’indicateurs sont développés : les indicateurs institutionnels qui découlent <strong>de</strong>s objectifs du<br />
plan stratégique et mis en œuvre selon l’approche Balanced Scorecard (BSC), et les<br />
indicateurs opérationnels choisis par les acteurs du terrain pour orienter leur prise <strong>de</strong><br />
décision. Un troisième niveau d’information est également mis à disposition du service <strong>de</strong>s<br />
urgences et concerne la vue détaillée <strong>de</strong> données patients, administratives et cliniques,<br />
utilisées pour le calcul <strong>de</strong>s indicateurs. La conception <strong>de</strong> ‘schémas d’analyse’ formalisée<br />
avec <strong>de</strong>s logigrammes est ici présentée à titre expérimental pour répondre au souci<br />
d’organisation et <strong>de</strong> hiérarchisation <strong>de</strong>s indicateurs et pour faciliter l’articulation <strong>de</strong> l’analyse<br />
<strong>de</strong>s indicateurs. Finalement, <strong>de</strong>ux exemples <strong>de</strong> boucles d’amélioration sont présentés<br />
concernant la durée <strong>de</strong> séjour et la qualité <strong>de</strong> l’enregistrement <strong>de</strong>s données d’admission <strong>de</strong>s<br />
patients.<br />
10h30 A quelles conditions un outil <strong>de</strong> pilotage, type balanced scorecard, peut<br />
valoriser et structurer le dialogue <strong>de</strong> gestion au sein d’une institution<br />
hospitalière ?<br />
Jason-Keller, Armelle, Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève, Direction <strong>de</strong> l'Analyse Médico-<br />
Economique, armelle.jasonkeller@hcuge.ch<br />
Bréant, Claudine, Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève, Direction <strong>de</strong> l'Analyse Médico-<br />
Economique, claudine.bréant@hcuge.ch<br />
Meshreky, Andreia, Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève, Direction <strong>de</strong> l'Analyse Médico-<br />
Economique, andreia.meshreky@hcuge.ch<br />
Rorive-Feytmans, Brigitte, Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève, Direction <strong>de</strong> l'Analyse<br />
Médico-Economique, brigitte.rorivefeytmans@hcuge.ch<br />
Basé sur l’expérience <strong>de</strong>s Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève (HUG), cet article décrit les<br />
conditions selon lesquelles un outil <strong>de</strong> pilotage type balanced scorecard peut favoriser et<br />
structurer le dialogue <strong>de</strong> gestion au sein <strong>de</strong> l’hôpital. Le contexte est celui d’un<br />
environnement tendu, avec une limitation <strong>de</strong>s ressources à disposition et la mise en<br />
concurrence <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> soins, obligeant les HUG à faire face à <strong>de</strong>s enjeux multiples<br />
7 / 44
: économicité, qualité, nouveaux besoins en santé <strong>de</strong> la population, maitrise <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> la<br />
santé et attractivité. Pour l’hôpital, la réponse à ces nouveaux défis passe par une<br />
amélioration <strong>de</strong> la performance sur plusieurs dimensions. La mise en place d’un dialogue <strong>de</strong><br />
gestion au sein <strong>de</strong> l’institution est alors essentielle pour avoir une vision commune <strong>de</strong> la<br />
performance, déterminer <strong>de</strong>s objectifs et mesurer les améliorations. Ce dialogue <strong>de</strong> gestion<br />
est d’autant plus primordial dans une organisation décentralisée, comme les HUG, où les<br />
différents pôles d’activité / départements jouissent d’une forte autonomie <strong>de</strong> gestion. Les<br />
outils <strong>de</strong> type balanced scorecards peuvent alors jouer un rôle crucial dans la valorisation et<br />
la structuration <strong>de</strong> ce dialogue <strong>de</strong> gestion, sous certaines conditions, comme le montre<br />
l’expérience <strong>de</strong>s HUG. Tout d’abord, la construction <strong>de</strong>s tableaux <strong>de</strong> bord part d’une<br />
approche collaborative et pluridisciplinaire, avec le développement d’un langage commun<br />
aux opérationnels, analystes et déci<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> tout niveau. Ensuite la détermination <strong>de</strong>s cibles<br />
<strong>de</strong>s indicateurs est, autant que faire ce peut, rationnelle et objective, avec l’utilisation <strong>de</strong><br />
normes, et d’outils statistiques. Et enfin, <strong>de</strong>s grilles communes <strong>de</strong> lecture <strong>de</strong> résultats sont<br />
mises en place, elles formalisent les liens <strong>de</strong> causalités entre les indicateurs clés et<br />
permettent une structuration et un renforcement du dialogue <strong>de</strong> gestion.<br />
10h55 La représentation <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> santé à partir d’un outil<br />
<strong>de</strong> pilotage stratégique<br />
Merdinger-Rumpler, Caroline, EM Strabourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManis,<br />
caroline.merdinger@em-strasbourg.eu<br />
Nobre, Thierry, EM Strabourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManis, thierry.nobre@emstrasbourg.eu<br />
Lemaire-Pouget, Célia, EM Strasbourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManiS,<br />
celia.pouget@etu.unistra.fr<br />
La recherche s’articule autour <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s<br />
acteurs du secteur médico-social lors <strong>de</strong> l’introduction d’un outil <strong>de</strong> gestion innovant. La<br />
confrontation entre la représentation institutionnelle et celle <strong>de</strong>s acteurs du secteur a été<br />
analysée à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la grille <strong>de</strong> lecture du Balanced Scorecard. Les données issues <strong>de</strong><br />
questionnaires montrent que les représentations <strong>de</strong>s acteurs s’avèrent peu homogènes et<br />
peu convergentes avec la représentation institutionnelle <strong>de</strong> la performance.<br />
11h20 Marketing stratégique à l’hôpital : les apports d’une démarche d’analyse du<br />
marché à la performance<br />
Merdinger-Rumpler, Caroline, EM Strabourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManis,<br />
caroline.merdinger@em-strasbourg.eu<br />
Faujour, Véronique, Hospices Civils <strong>de</strong> Lyon, veronique.faujour@chu-lyon.fr<br />
Nobre, Thierry, EM Strabourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManis, thierry.nobre@emstrasbourg.eu<br />
Cet article interroge les apports d’une approche <strong>de</strong> marketing stratégique fondée sur une<br />
analyse <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données d’activités hospitalières dans une perspective <strong>de</strong><br />
positionnement concurrentiel <strong>de</strong> l'offre <strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> structuration <strong>de</strong> la livraison <strong>de</strong> cette<br />
offre afin d'améliorer la performance globale <strong>de</strong> l'organisation <strong>de</strong> santé. Cette problématique<br />
est adressée à partir <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> du cas <strong>de</strong> la cardiologie dans un CHU.<br />
J1D Systèmes d’information en milieu hospitalier<br />
Salle : 2317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Wieser Philippe et Gnaegni Alex<br />
8 / 44
10h05 Système d’Information d’Ai<strong>de</strong> à la Décision pour le dépistage et la<br />
coordination <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> support en cancérologie<br />
Chen, Linjie, University of Lyon, LASPI, linjie.chen@univ-st-etienne.fr<br />
Masmoudi, Malek, Université <strong>de</strong> Lyon, LASPI, malek.masmoudi@univ-st-etienne.fr<br />
Wang, Tao, IUT <strong>de</strong> Roanne, LASPI, tao.wang@univ-st-etienne.fr<br />
Monteiro, Thibaud, Université <strong>de</strong> Lyon, LASPI, thibaud.monteiro@univ-st-etienne.fr<br />
Les soins en cancérologie sont lourds et complexes. Ils doivent respecter <strong>de</strong>s protocoles<br />
prédéfinis qui s'étalent souvent sur <strong>de</strong> longues pério<strong>de</strong>s. De nombreuses informations<br />
concernant l'état <strong>de</strong> santé du patient sont disponibles à travers <strong>de</strong> nombreux traitements<br />
médicaux et paramédicaux. Aujourd’hui, nous faisons face au problème <strong>de</strong> dépistage et <strong>de</strong><br />
coordination <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> support pour les patients avant et après les séances <strong>de</strong> traitement<br />
du cancer. L'objectif principal <strong>de</strong> ce travail <strong>de</strong> recherche est d’automatiser le dépistage <strong>de</strong>s<br />
besoins <strong>de</strong> supports <strong>de</strong>s patients en intégrant certaines informations pluridisciplinaires,<br />
ensuite optimiser la coordination <strong>de</strong>s consultations <strong>de</strong>s différentes unités <strong>de</strong> service <strong>de</strong>s<br />
soins <strong>de</strong> support et enfin optimiser la planification <strong>de</strong>s consultations sous contraintes <strong>de</strong><br />
disponibilités <strong>de</strong>s patients et <strong>de</strong>s soignants. Un Système d’Information d’Ai<strong>de</strong> à la Décision<br />
(SIAD) a été conçu pour couvrir cette démarche. Il comporte <strong>de</strong>s techniques avancées<br />
d’orientation et d’optimisation à savoir les réseaux <strong>de</strong> neurones et la programmation linéaire<br />
et non linéaire. Des résultats numériques à la fin <strong>de</strong> cette communication montrent la<br />
performance du système conçu.<br />
10h30 Enregistrement <strong>de</strong>s données infirmières : exploitation <strong>de</strong>s données et<br />
intégration dans le financement <strong>de</strong>s soins infirmiers<br />
Thonon, Olivier, CHU Liège - Département Infirmier, olivier.thonon@chu.ulg.ac.be<br />
Leroy, Stéphanie, CHU Liège, stephanie.leroy@chu.ulg.ac.be<br />
Maclot, Eric, CHU Liège - Département Infirmier, direction.infirmiere@chu.ulg.ac.be<br />
Akafomo, Valère, CHU Liège, vakafomo@chu.ulg.ac.be<br />
Louis, Pol, CHU Liège<br />
Gillet, Pierre, CHU Liège, Pierre.gillet@chu.ulg.ac.be<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Refléter la richesse d’une activité, qui plus est infirmière, au travers <strong>de</strong> données<br />
standardisées n’est pas chose aisée. Depuis 2008, une nouvelle législation fédérale oblige<br />
les hôpitaux belges non psychiatriques à enregistrer un ensemble minimum <strong>de</strong> données<br />
regroupées au sein d’un outil appelé Données Infirmières du Résumé Hospitalier Minimal<br />
(DI-RHM). En comparaison avec le système d’enregistrement existant précé<strong>de</strong>mment, ces<br />
données ont pour objectif <strong>de</strong> mieux refléter l’activité infirmière et la démarche en soins qui la<br />
sous-tend, mais aussi le financement <strong>de</strong> cette activité puisque cet enregistrement minimum<br />
<strong>de</strong> données constitue un <strong>de</strong>s indicateurs dans le financement hospitalier, appelé Budget <strong>de</strong>s<br />
Moyens Financiers (BMF), et octroyé annuellement par le Service Public Fédéral Belge <strong>de</strong><br />
la Santé Publique. L’implémentation d’une telle obligation <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s données passe<br />
donc nécessairement par une gestion efficace <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> temps et<br />
métho<strong>de</strong> afin <strong>de</strong> s’intégrer, parfois s’imposer, dans les rouages existant d’une institution <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> taille. Une fois cette récolte d’information effectuée, faut-il encore l’analyser,<br />
l’enregistrer et la traiter afin <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> données <strong>de</strong> qualité reflétant au mieux l’activité<br />
concernée.<br />
10h55 Infomed : un projet d’échange électronique <strong>de</strong> données médicales<br />
Wieser, Philippe, EPFL-CDM-IML, philippe.wieser@epfl.ch<br />
Michelet, Cédric, Hôpital du Valais, cedric.michelet@hopitalvs.ch<br />
9 / 44
Gnaegi, Alex, Hôpital du Valais, alex.gnaegi@hopitalvs<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la mise en place d’un système d’information sanitaire valaisan, il est prévu<br />
d’implémenter une plateforme d’échange électronique <strong>de</strong> données médicales selon la<br />
stratégie eHealth Suisse. Le projet Infomed permettra à tous les mé<strong>de</strong>cins valaisans<br />
d’accé<strong>de</strong>r, avec l’accord du patient, à un dossier patient partagé dans lequel se trouveront<br />
les documents utiles pour la prise en charge <strong>de</strong>s patients.<br />
11h20 Enjeux et limites d'un itinéraire clinique informatisé<br />
Gnaegi, Alex, Hôpital du Valais, alex.gnaegi@hopitalvs.ch<br />
Schaer, Roger, Haute Ecole Spécialisée <strong>de</strong> Suisse occi<strong>de</strong>ntale Valais,<br />
roger.schaer@hevs.ch<br />
Les itinéraires cliniques informatisés présentent <strong>de</strong> nombreux avantages théoriques pour<br />
améliorer la prise en charge <strong>de</strong>s patients. Ils décrivent les principales étapes <strong>de</strong> prise en<br />
charge d’un patient pour une pathologie donnée avec <strong>de</strong>s objectifs mesurables <strong>de</strong><br />
processus et <strong>de</strong> résultats. Néanmoins leur implémentation est rendue extrêmement difficile<br />
par <strong>de</strong>s contraintes technologiques liées aux dossiers patients informatisés actuels et le<br />
manque <strong>de</strong> standards permettant la réutilisation <strong>de</strong> composants d’un itinéraire clinique.<br />
L’expérience menée en Valais permet <strong>de</strong> montrer qu’il est néanmoins possible<br />
d’implémenter un itinéraire clinique dans un dossier patient informatisé reposant sur une<br />
architecture ancienne, mais au prix d’un développement compliqué.<br />
12h00 Repas - Salle Le Cercle, 4 e étage, pavillon Alphonse-Desjardins<br />
(ADJ)<br />
J2A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong><br />
soins <strong>de</strong> santé - II<br />
Salle : 1317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>ntes : Nadine Meskens et Christine Di Martinelly<br />
13h30 L’allocation <strong>de</strong>s priorités opératoires : les cas du CHUQ et du CSSS Laval<br />
Beaulieu, Isabelle, HEC Montréal, isabelle.2.beaulieu@hec.ca<br />
Ruiz, Angel, Université Laval, angel.ruiz@fsa.ulaval.ca<br />
Soriano, Patrick, HEC Montréal, patrick.soriano@hec.ca<br />
Cette étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas vise à déterminer les impacts <strong>de</strong> l’allocation <strong>de</strong>s priorités opératoires sur<br />
l’atteinte <strong>de</strong>s objectifs et sur l’utilisation <strong>de</strong>s ressources pré-opératoires, opératoires et postopératoires.<br />
13h55 Scheduling the Operating Theatre: a Hybrid Multi-Objective Approach<br />
Di Martinelly, Christine, IESEG School of Management, c.dimartinelly@ieseg.fr<br />
Duenas, Alejandra, IESEG School of Management, a.duenas@ieseg.fr<br />
This paper proposes an approach that consi<strong>de</strong>rs two stages of the operating theatre<br />
planning process: operating rooms planning and nurse scheduling (un<strong>de</strong>r human resources<br />
availability constraints). Three different objectives were consi<strong>de</strong>red: to minimize costs, to<br />
minimize the maximum number of nurses nee<strong>de</strong>d to participate in surgeries and to minimize<br />
the number of open operating rooms. A hybrid multi-objective approach based on<br />
10 / 44
compromise programming is <strong>de</strong>veloped. The preliminary results gotten from its application to<br />
solve a real-world problem in a Belgium hospital are encouraging.<br />
14h20 Ordonnancement multiobjectif <strong>de</strong>s interventions chirurgicales<br />
Meskens, Nadine, UCL MONS, nadine.meskens@uclouvain-mons.be<br />
Tylski, Remi, UCL-Mons, remi.tylski@uclouvain-mons.be<br />
Monteiro, Thibaud, Université <strong>de</strong> Lyon, LASPI, thibaud.monteiro@univ-st-etienne.fr<br />
Duvivier, David, Univ Lille Nord <strong>de</strong> France et Univ. Valenciennes (LAMIH),<br />
david.duvivier@gmail.com<br />
La gestion d'un bloc opératoire conduit à résoudre <strong>de</strong>s problèmes complexes largement<br />
traités dans la littérature. Ces problèmes ont leurs spécificités, leurs contraintes, leurs<br />
variables <strong>de</strong> décision... Cependant, peu d'auteurs prennent en compte les contraintes<br />
relatives aux ressources matérielles et humaines et rares sont ceux qui appliquent leur<br />
métho<strong>de</strong> à <strong>de</strong>s cas réels. Dans cet article, nous présentons un modèle multiobjectif basé sur<br />
la métho<strong>de</strong> e-constraint. Ce modèle est <strong>de</strong>stiné à constituer les équipes chirurgicales et à<br />
ordonnancer les opérations. Nous avons essayé d’optimiser cinq objectifs dont <strong>de</strong>ux tout-àfait<br />
inédits : la maximisation <strong>de</strong>s préférences <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’équipe chirurgicale et<br />
maximiser la diversité <strong>de</strong> compétences dans lesquelles exercent les infirmiers. Nous<br />
terminons cet article par une présentation <strong>de</strong> nos perspectives <strong>de</strong> recherche.<br />
14h45 Hospitalisation à domicile : une solution à développer en Belgique ?<br />
Meskens, Nadine, UCL MONS, nadine.meskens@uclouvain-mons.be<br />
Lambert, Albert, albert.lambert@swing.be<br />
Face aux profonds changements et contraintes sociales, sanitaires et budgétaires<br />
engendrés essentiellement par le vieillissement <strong>de</strong> la population, et face à l’accroissement<br />
<strong>de</strong>s dépenses en soins <strong>de</strong> santé, il est urgent <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s solutions pour répondre à ces<br />
différents enjeux du 21ème siècle. Les pouvoirs publics ont compris la nécessité <strong>de</strong><br />
répondre à cette problématique et tentent <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s solutions. En Belgique, <strong>de</strong>s appels<br />
à projets sont lancés, visant la mise en place <strong>de</strong> solutions permettant le maintien à domicile<br />
<strong>de</strong> personnes âgées fragilisées. A contrario, la Belgique, comparativement à la France, est<br />
très en retard dans la création <strong>de</strong> structures d’hospitalisation à domicile. Les hôpitaux<br />
connaissent <strong>de</strong> leur côté <strong>de</strong>s problèmes d’engorgement ou problèmes <strong>de</strong> transfert vers<br />
d’autres institutions suite à un manque <strong>de</strong> places disponibles. Le financement <strong>de</strong>s hôpitaux<br />
est basé sur l’activité réelle avec comme conséquence <strong>de</strong>s durées moyennes <strong>de</strong> séjour qui<br />
diminuent sans cesse. L’hospitalisation à domicile (HAD) apparait dès lors comme une <strong>de</strong>s<br />
solutions envisageables. Nous avons mené une étu<strong>de</strong>, sur base <strong>de</strong> données provenant d’un<br />
hôpital belge « standard », qui a calculé dans quelle mesure <strong>de</strong>s séjours en hospitalisation<br />
classique pourraient être, à un moment donné, transformés en hospitalisation à domicile, si<br />
ce type <strong>de</strong> structure serait mise en place en Belgique. L’ensemble <strong>de</strong>s analyses globales et<br />
par pathologie permet <strong>de</strong> conclure qu’une part non négligeable <strong>de</strong>s séjours sont candidats à<br />
un transfert vers l’HAD.<br />
J2B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge<br />
- II<br />
Salle : 1325 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Lahcen El Hiki<br />
11 / 44
13h30 Elaboration d’un plan <strong>de</strong> formation continue à partir <strong>de</strong> l’approche processus<br />
dans un service <strong>de</strong> Radiothérapie<br />
Lenaerts, Eric, CHU Liège, eric.lenaerts@chu.ulg.ac.be<br />
Delgaudine, Marie, CHU Liège, marie.<strong>de</strong>lgaudine@chu.ulg.ac.be<br />
Coucke, Philippe, CHU Liège, pcoucke@chu.ulg.ac.be<br />
Pour garantir l’intégration <strong>de</strong>s évolutions technologiques régulières et <strong>de</strong>s changements<br />
organisationnels qui en découlent, le service <strong>de</strong> radiothérapie s’est engagé <strong>de</strong>puis 2007<br />
dans la définition et la coordination d’une politique <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s soins et <strong>de</strong> sécurité du<br />
patient cohérente et globale. L’équipe dirigeante du service considère la gestion <strong>de</strong>s<br />
compétences comme un impératif indispensable afin <strong>de</strong> pouvoir intégrer rapi<strong>de</strong>ment<br />
l’utilisation <strong>de</strong>s nouvelles technologies <strong>de</strong> traitement tout en fournissant <strong>de</strong> manière continue<br />
<strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> haute qualité aux patients. L’approche processus consiste à décrire <strong>de</strong> façon<br />
méthodique une organisation en processus en vue d’organiser sa contribution à la<br />
satisfaction du patient. Cette approche appliquée dans le service <strong>de</strong> radiothérapie a permis<br />
une meilleure visibilité du fonctionnement du service ainsi qu’une meilleure maîtrise <strong>de</strong>s<br />
relations entre les collaborateurs et avec les patients. Elle permet <strong>de</strong> maîtriser la valeur<br />
ajoutée <strong>de</strong> chaque processus, d’i<strong>de</strong>ntifier les points <strong>de</strong> risques et d’en anticiper les dérives.<br />
Plus précisément, l’approche processus a conduit à préciser les compétences requises pour<br />
garantir une haute qualité <strong>de</strong>s soins et à concevoir un plan <strong>de</strong> formation continue spécifique<br />
aux besoins d’un service <strong>de</strong> radiothérapie. Ce plan est en cours <strong>de</strong> reconnaissance au<br />
travers <strong>de</strong> la création d’un certificat universitaire spécifique.<br />
13h55 Transposition en réseau <strong>de</strong>s trajets cliniques d’un Service <strong>de</strong> Radiothérapie<br />
dans le modèle <strong>de</strong> Reason pour la prévention et la gestion <strong>de</strong>s évènements<br />
indésirables<br />
Delgaudine, Marie, CHU Liège, marie.<strong>de</strong>lgaudine@chu.ulg.ac.be<br />
Lenaerts, Eric, CHU Liège, eric.lenaerts@chu.ulg.ac.be<br />
Renard, André, Labage Liège, a.j.renard@skynet.be<br />
Princen, Fabienne, CHU Liège, Fabienne.Princen@chu.ulg.ac.be<br />
Coucke, Philippe, CHU Liège, pcoucke@chu.ulg.ac.be<br />
La qualité <strong>de</strong> la prise en charge <strong>de</strong>s patients et la sécurité <strong>de</strong> leur traitement sont un objectif<br />
commun à l’ensemble du mon<strong>de</strong> médical. Trop <strong>de</strong> patients souffrent d’évènements<br />
secondaires directement imputables à la prise en charge <strong>de</strong> leur pathologie (toxicité<br />
médicamenteuse, infections nosocomiales,…). Une démarche proactive, en vue d’éviter au<br />
maximum la survenue d’acci<strong>de</strong>nt(s), a été mise en place dans le Service <strong>de</strong> Radiothérapie<br />
du CHU <strong>de</strong> Liège. Dans ce but, une métho<strong>de</strong> fondée sur les principes <strong>de</strong> sécurité du secteur<br />
aérien a été retenue. Le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> cette métho<strong>de</strong> est basé sur l’i<strong>de</strong>ntification,<br />
l’enregistrement et l’exploitation systématiques <strong>de</strong>s évènements précurseurs qui peuvent<br />
aboutir à <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts ou acci<strong>de</strong>nts. Face à l'ampleur <strong>de</strong>s données collectées, aux désir et<br />
nécessité d'exploiter ces informations afin d'obtenir <strong>de</strong>s répercussions concrètes pour la<br />
prise en charge <strong>de</strong>s patients, nous avons besoin d'outils puissants pour soutenir cette<br />
démarche. Pour ce faire, nous avons transposé en réseau, <strong>de</strong>ux trajets cliniques du Service<br />
dans le modèle théorique <strong>de</strong> Reason. Nous travaillons actuellement au développement<br />
d’une application informatique qui permettra l’intégration <strong>de</strong> la gestion du système Qualité et<br />
Sécurité et qui reposera entre autre sur la prévention et la gestion <strong>de</strong>s évènements<br />
indésirables.<br />
14h20 Role of FMEA in diagnosing failures in Healthcare services; Findings and<br />
future <strong>de</strong>velopments<br />
12 / 44
Jamshidi, Afshin, Université Laval, afshin.jamshidi.1@ulaval.ca<br />
Abbasgholiza<strong>de</strong>h Rahimi, Samira, Université Laval, samira.samira-abbasgholiza<strong>de</strong>hra.1@ulaval.ca<br />
Ait-Kadi, Daoud, Université Laval, Daoud.Aitkadi@gmc.ulaval.ca<br />
Ruiz, Angel, Université Laval, Angel.Ruiz@fsa.ulaval.ca<br />
The main scope of this paper is to review the role of FMEA (failure mo<strong>de</strong> and effect analysis)<br />
as an effective method in healthcare services and introduce the main shortcomings of<br />
implementation of FMEA and service-specific FMEA in healthcare services. In addition, this<br />
paper addresses recent applications of FMEA in healthcare services. Since, this form of<br />
prevention is best geared toward processes that are vulnerable to serious medical errors,<br />
and by consi<strong>de</strong>ring all mentioned discussions about importance of patient safety and<br />
service-specific FMEA as an effective tool, we discussed which integrating methods can be<br />
used for presenting service-specific FMEA as a more effective tool to prevent service<br />
failures in the future.<br />
14h45 Du Management <strong>de</strong> la Qualité au Management Stratégique, itinéraire vers<br />
l’Agilité organisationnelle au sein d’un Laboratoire <strong>de</strong> Biologie Clinique.<br />
Expérience <strong>de</strong> l'Hôpital André Vésale, CHU <strong>de</strong> Charleroi, Belgique<br />
Govaerts, Danielle, Laboratoires du CHU <strong>de</strong> Charleroi, danielle.govaerts@chu-charleroi.be<br />
Courbe, Anne, Laboratoires du CHU <strong>de</strong> Charleroi, anne.courbe@chu-charleroi.be<br />
Lequeu, Raphaël, Laboratoires du CHU <strong>de</strong> Charleroi, raphael.lequeu@chu-charleroi.be<br />
El Hiki, Lahcen, UMONS-Faculté Polytechnique, lahcen.elhiki@umons.ac.be<br />
Le modèle du Système Agile est défini comme étant la capacité d’une organisation à<br />
structurer <strong>de</strong>s réponses stratégiques dans un contexte complexe et incertain. Dans cette<br />
perspective et face aux exigences croissantes <strong>de</strong>s partenaires politico-socioéconomiques et<br />
aux fluctuations environnementales, le système hospitalier est appelé à développer, sur le<br />
plan organisationnel, un potentiel d’Agilité lui permettant <strong>de</strong> réagir efficacement à ces<br />
contraintes et <strong>de</strong> garantir in fine le développement durable <strong>de</strong> ses activités. En tant que<br />
plateau médico-technique et au vu <strong>de</strong> l’implication <strong>de</strong> ses résultats dans les prestations<br />
diagnostiques et thérapeutiques, le Laboratoire <strong>de</strong> Biologie Clinique (LBC) doit s’inscrire<br />
dans cette culture managériale. Dans ce papier, nous relatons le modèle <strong>de</strong> notre LBC en<br />
matière d’Agilité organisationnelle. A la lumière <strong>de</strong> cette approche, nous traçons l’itinéraire<br />
<strong>de</strong> nos projets entrepris au LBC (Hôpital André Vésale/CHU <strong>de</strong> Charleroi-Belgique) qui ont<br />
permis d’une part d’instaurer les leviers <strong>de</strong> cette Agilité, d’autre part <strong>de</strong> faire évoluer le<br />
dispositif managérial d’une logique normative (ISO 9001, ISO 15189) visant la conformité<br />
vers une logique stratégique visant la gouvernance. Cette <strong>de</strong>rnière nous permet d’optimiser<br />
la réorganisation et le regroupement <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux LBC dans un nouveau site hospitalier à<br />
l’horizon 2013.<br />
J2C Outils <strong>de</strong> pilotage stratégique et performance hospitalière - II<br />
Salle : 2307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Brigitte Rorive Feytmans, Caroline Merdinger-Rumpler et Thierry Nobre<br />
13h30 Outils <strong>de</strong> mesure et <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s couts <strong>de</strong> non qualité pour le pilotage<br />
<strong>de</strong>s processus<br />
Zahar, Mouna, FST Fès Maroc, mouna_svt@hotmail.com<br />
El Barkany, Ab<strong>de</strong>llah, FST Fès Maroc, a_elbarkany2002@yahoo.fr<br />
El Biyaali, Ahmed, FST Fès Maroc, biyaali@yahoo.fr<br />
13 / 44
Nous présentons dans cet article une synthèse <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’art du coût d’obtention <strong>de</strong> la<br />
qualité et les enjeux <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> non-qualité. Nous avons proposé un outil <strong>de</strong> mesure et <strong>de</strong><br />
réduction <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> non qualité pour le pilotage <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong>s<br />
préparations chimiothérapies du service <strong>de</strong> la pharmacie centrale du Centre Universitaire<br />
Hassan II au Maroc.<br />
13h55 Indicateurs <strong>de</strong> performance & Qualité <strong>de</strong>s données : Vers une démarche<br />
industrielle dans un grand Hôpital Français.<br />
Aubin, Cédric, IFROSS, cedric.aubin@keyrus.com<br />
La multiplication <strong>de</strong>s projets Performance pose dans <strong>de</strong> nombreux hôpitaux la question <strong>de</strong> la<br />
qualité <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s garanties qu’elle peut offrir dans la production d’indicateurs <strong>de</strong><br />
performance. Le système d’information doit faire l’objet d’une attention systématique afin <strong>de</strong><br />
mesurer la capacité à restituer une information fiable, <strong>de</strong> qualité, qui répon<strong>de</strong> bien aux<br />
qualités exigées pour l’élaboration <strong>de</strong> ces indicateurs. Dans cet article, nous proposons une<br />
démarche industrielle <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’information permettant <strong>de</strong> mesurer et<br />
d’améliorer le contenu <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> santé. Nous expérimentons cette métho<strong>de</strong> sur <strong>de</strong>s<br />
données réelles dans le cadre d’un projet Performance d’un grand Centre Hospitalier<br />
Français.<br />
14h20 Pilotage <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> la performance pour les établissements <strong>de</strong> santé<br />
et <strong>de</strong> services sociaux avec le Hoshin Kanri<br />
Valéra, Ludovick, Université du Québec à Trois-Rivières, valera@uqtr.ca<br />
Lagacé, Denis, Université du Québec à Trois-Rivières, <strong>de</strong>nis.lagace@uqtr.ca<br />
Longval, Jacques, Centre <strong>de</strong> Santé et <strong>de</strong>s Services sociaux <strong>de</strong> Trois-Rivières,<br />
jacqueslongval@gmail.com<br />
Dans leur planification stratégique, les établissements <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> services sociaux<br />
(ESSS) du Québec doivent prendre en considération plusieurs critiques sur leur<br />
performance. Ce qui rend l’amélioration <strong>de</strong> leur performance complexe. Cette recherche<br />
exploratoire analyse la compatibilité du Hoshin Kanri (HK) avec la planification stratégique<br />
telle que prescrite par le gouvernement du Québec aux ESSS. Les résultats démontrent que<br />
le HK peut avantageusement se greffer à ce processus <strong>de</strong> planification stratégique. En effet,<br />
le HK peut servir à piloter l’amélioration <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s ESSS avec la matrice en X.<br />
De plus, cette matrice permet <strong>de</strong> discriminer <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> performance Lean à partir du<br />
plan stratégique. Le HK offre <strong>de</strong>s avantages facilitant la cohérence entre les objectifs<br />
stratégiques et les projets réalisés, la mobilisation du personnel, l’adhésion du personnel<br />
aux objectifs stratégiques et l’imputabilité <strong>de</strong>s équipes <strong>de</strong> projets. Cette recherche contribue<br />
au développement <strong>de</strong>s connaissances sur la gestion <strong>de</strong> la performance et sur les structures<br />
<strong>de</strong> pilotage <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s ESSS.<br />
14h45 Inversion du flux patient: application à l’urgence d’un hôpital régional<br />
Olivier, Clau<strong>de</strong>, École <strong>de</strong> technologie supérieure. Université du Québec,<br />
clau<strong>de</strong>.olivier@etsmtl.ca<br />
Boudreau, Marie-Clau<strong>de</strong>, Urgence <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Maria,<br />
boudreau.csssbc@ssss.gouc.qc.ca<br />
Les institutions <strong>de</strong> santé québécoises font face aux mêmes problèmes que l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
pays du G20 : vieillissement <strong>de</strong> la population, engorgement du système <strong>de</strong> santé,<br />
augmentation continuelle <strong>de</strong>s coûts. Plusieurs méthodologies ont été avancées pour tenter<br />
14 / 44
<strong>de</strong> corriger cette situation. L'approche Lean, même si elle est décriée par plusieurs dans le<br />
système <strong>de</strong> santé québécois, a l’avantage <strong>de</strong> permettre l’évaluation objective <strong>de</strong> situations<br />
problématiques et d’impliquer les équipes locales dans la recherche <strong>de</strong> solutions. Cette<br />
communication décrit son application dans l’amélioration du flux patient à l’urgence d’un<br />
hôpital régional, à Maria en Gaspésie. Elle a été utilisée pour réduire le nombre <strong>de</strong> patients<br />
sur civière et leur durée du séjour à l'urgence. Elle a également permis d’améliorer le flux<br />
<strong>de</strong>s patients vers les unités <strong>de</strong> soins. L'hôpital est la principale institution du CSSS <strong>de</strong> la<br />
Baie <strong>de</strong>s Chaleurs. Un CSSS est une organisation gouvernementale qui gère les soins <strong>de</strong><br />
santé et les services sociaux dans une région spécifique. Physiquement, l'organisation<br />
structurelle et opérationnelle <strong>de</strong> ce CSSS est particulière. Il s'agit d'un réseau <strong>de</strong> plusieurs<br />
établissements ayant <strong>de</strong>s vocations spécifiques sur une distance <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 200 kilomètres<br />
le long <strong>de</strong> la côte atlantique et <strong>de</strong>sservant environ 40,000 personnes. En plus <strong>de</strong> l’urgence<br />
principale <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Maria, une <strong>de</strong>uxième urgence, située à environ 80 km <strong>de</strong>ssert la<br />
population locale. Cependant, comme ses plateaux techniques sont limités, plusieurs<br />
patients sont transférés à l'urgence principale après avoir été stabilisé. Cette organisation<br />
augmente considérablement l’engorgement <strong>de</strong> l’urgence <strong>de</strong> l’hôpital. Cette communication<br />
présentera le contexte global, le flux patient et i<strong>de</strong>ntifiera les goulots. On présentera les<br />
solutions déployées, particulièrement l’inversion du flux patient entre les unités : la<br />
transformation d’une approche en flux poussée vers celle en flux tiré.<br />
J2D Présentations PERICLES<br />
Salle : 2317 (PAP)<br />
13h30 <strong>Programme</strong> d'Étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> Recherche en Informatique : Collaboration entre<br />
Laboratoires et Établissements <strong>de</strong> Santé<br />
Bernard Aleksy, CHU <strong>de</strong> Clermont-Ferrand, baleksy@chu-clermontferrand.fr<br />
Michel Gourgand, Université Blaise Pascal, gourgand@isima.fr<br />
Sophie Rodier, Assistance Publique - Hôpitaux <strong>de</strong> Marseille, Sophie.rodier@ap-hm.fr<br />
15h30 Pause - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />
J3A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la Gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong><br />
soins <strong>de</strong> santé - III<br />
Salle : 1317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>ntes : Nadine Meskens et Christine Di Martinelly<br />
15h50 Planification et optimisation en temps réel <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>z-vous patients en<br />
radiothérapie<br />
Legrain, Antoine, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, antoine.legrain@polymtl.ca<br />
Lahrichi, Nadia, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, nadia.lahrichi@polymtl.ca<br />
Rousseau, Louis-Martin, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, louismartin.rousseau@polymtl.ca<br />
La gestion efficace <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> traitement du cancer par radiothérapie dépend<br />
principalement <strong>de</strong> l'optimisation <strong>de</strong> l'utilisation <strong>de</strong>s accélérateurs linéaires. Dans ce projet,<br />
nous faisons la planification <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>z-vous patients en tenant compte <strong>de</strong> leur priorité, du<br />
temps d'attente maximal et <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> traitement en collaboration avec le Centre Intégré<br />
<strong>de</strong> Cancérologie <strong>de</strong> Laval. De plus, nous intégrons l'incertitu<strong>de</strong> reliée à l'arrivée <strong>de</strong>s patients<br />
15 / 44
au centre. Nous développons une métho<strong>de</strong> hybri<strong>de</strong> alliant optimisation stochastique et<br />
optimisation en temps réel pour mieux répondre aux besoins <strong>de</strong> planification du centre.<br />
Nous utilisons donc l'information <strong>de</strong>s arrivées futures <strong>de</strong>s patients pour dresser le portrait le<br />
plus fidèle possible <strong>de</strong> l'utilisation attendue <strong>de</strong>s ressources. Des résultats préliminaires<br />
montrent que notre métho<strong>de</strong> dépasse les stratégies typiquement utilisées dans les centres.<br />
16h15 Proposition d’un modèle d’optimisation pour la planification <strong>de</strong>s thérapies<br />
innovantes en radiothérapie<br />
Shtiliyanova, Anastasiya, Université d'Auvergne/ISIT, Anastasiya.Shtiliyanova@uclermont1.fr<br />
Kemmoé Tchomté, Sylverin, Université d’Auvergne /CRCGM ,<br />
Sylverin.KEMMOE_TCHOMTE@u-clermont1.fr<br />
Feschet, Fabien, Université d'Auvergne / ISIT, Fabien.Feschet@u-clermont1.fr<br />
Tchernev, Nikolay, Université d'Auvergne / LIMOS, tchernev@isima.fr<br />
Pommier, Pascal, Centre Léon Bérard / Lyon, pascal.pommier@lyon.unicancer.fr<br />
Dans cet article nous proposons la modélisation d'un prototype médico-économique pour les<br />
centres <strong>de</strong> radiothérapie utilisant <strong>de</strong>s techniques innovantes. La conception <strong>de</strong> l'outil<br />
informatique est basée sur quatre modèles. Un modèle <strong>de</strong> recrutement évaluant le nombre<br />
et le type <strong>de</strong> patients intéressés par les techniques proposées. Un modèle économique<br />
estimant le prix par traitement. Un modèle médico-économique comparant les prix <strong>de</strong>s<br />
stratégies thérapeutiques. Un modèle <strong>de</strong> planification <strong>de</strong>s traitements <strong>de</strong>s patients au sein<br />
<strong>de</strong>s établissements hospitaliers. Ce <strong>de</strong>rnier est un modèle d'optimisation <strong>de</strong>s séances dans<br />
les différents centres <strong>de</strong> traitements <strong>de</strong>s patients, et fera l'objet <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>. Dans la<br />
littérature, ce problème présente <strong>de</strong>s analogies avec le modèle théorique du problème<br />
d'ordonnancement <strong>de</strong> ressources avec contraintes <strong>de</strong> ressources (RCPSP) avec la prise en<br />
compte <strong>de</strong>s fenêtres <strong>de</strong> temps (time-lags). Une formulation mathématique présentant les<br />
affectations <strong>de</strong>s patients aux différents centres, la planification <strong>de</strong>s différentes séances <strong>de</strong><br />
traitement respectant les contraintes <strong>de</strong> fenêtre <strong>de</strong> temps a été proposée. Les résultats<br />
obtenus sont encourageants et permettent <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r notre démarche.<br />
16h40 Développement et mise en place d'un projet <strong>de</strong> flux <strong>de</strong>s patients<br />
Del Bianco, Murielle, Hôpital du Valais, murielle.<strong>de</strong>l-bianco@hopitalvs.ch<br />
Mieux accueillir nos patients dans les hôpitaux, être à leur écoute et répondre à leurs<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s, sont <strong>de</strong>s défis <strong>de</strong> ce début <strong>de</strong> siècle. Comment valoriser la qualité <strong>de</strong> la prise en<br />
charge médico-soignante <strong>de</strong> nos patients et respecter l’ensemble <strong>de</strong>s professionnels<br />
hospitaliers ? Comment permettre à l’ensemble <strong>de</strong>s sites hospitaliers <strong>de</strong> travailler en<br />
collaboration après <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> concurrence ? Comment mieux communiquer pour<br />
changer les idées reçues ? Comment gérer au mieux nos capacités hospitalières et<br />
rentabiliser nos infrastructures ? Cet article tend à répondre à ces questions en présentant<br />
le développement d’un projet Flux <strong>de</strong>s patients au sein d’un pôle hospitalier composé <strong>de</strong><br />
plusieurs hôpitaux et cliniques.<br />
J3B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge<br />
- III<br />
Salle : 1325 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Hayfa Zgaya et Djamel Zitouni<br />
16 / 44
15h50 Une application pratique du retour d’expérience : la démarche qualité-sécurité<br />
relative à la contention physique <strong>de</strong>s patients au Centre Hospitalier<br />
Universitaire <strong>de</strong> Liège<br />
Boulanger, Jean-Marie, CHU Liège, Belgique, jmboulanger@chu.ulg.ac.be<br />
Mutsers, Jacques, CHU Liège, Belgique, Jacques.Mutsers@chu.ulg.ac.be<br />
En Belgique, la législation décrit la contention physique <strong>de</strong>s patients comme un acte<br />
infirmier autonome. Suite à 2 acci<strong>de</strong>nts graves consécutifs en 2009 dans le service <strong>de</strong><br />
gériatrie, nous avons décidé <strong>de</strong> nous enrichir <strong>de</strong> cette expérience et <strong>de</strong> développer un projet<br />
institutionnel. Après une revue <strong>de</strong> la littérature, un groupe <strong>de</strong> travail composé d’infirmiers <strong>de</strong><br />
terrain fut mis en place et un premier audit « d’état <strong>de</strong>s lieux » fut réalisé. Seuls 8% <strong>de</strong>s<br />
services disposaient d’une ai<strong>de</strong> décisionnelle relative à la mise en place d’une contention, le<br />
matériel <strong>de</strong> contention n’était pas toujours adéquat, il existait peu d’alternative, et<br />
l’évaluation ou la justification était peu documentée et empirique. Une procédure et un<br />
algorithme décisionnel furent développés et <strong>de</strong>s investissements considérables ont été<br />
consentis. Plusieurs évaluations sont prévues (courant <strong>2012</strong>) après formation et mise en<br />
place <strong>de</strong>s outils et du matériel. D’autres pistes <strong>de</strong> mesures alternatives sont également en<br />
cours, notamment l’implémentation d’un système <strong>de</strong> géolocalisation pour les patients à<br />
risque <strong>de</strong> fugue ou « déambulateur ». Avec ces initiatives, le C.H.U. <strong>de</strong> Liège espère<br />
diminuer la contention physique ou la rendre la moins restrictive possible et garantir une<br />
plus gran<strong>de</strong> humanisation <strong>de</strong>s soins.<br />
16h15 Risk analysis in sterilization services: A first step towards a generic mo<strong>de</strong>l of<br />
risk<br />
Negrichi, Khalil, G-scop, khalil.negrichi@gmail.com<br />
Di Mascolo, Maria, G-scop, Maria.Di-Mascolo@g-scop.grenoble-inp.fr<br />
Flaus, Jean-Marie, G-scop, Jean-Marie.Flaus@g-scop.grenoble-inp.fr<br />
Sterilization services are vulnerable to risks, due to the contagious nature of their<br />
environment and to the <strong>de</strong>gradation that risks can cause to the safety of patients and staff.<br />
In relation to this issue, our work aims to reduce the risk level of these services, in or<strong>de</strong>r to<br />
improve their toughness and their behavior in <strong>de</strong>gra<strong>de</strong>d mo<strong>de</strong>. We <strong>de</strong>velop here a risk<br />
mo<strong>de</strong>l for sterilization services, using a mo<strong>de</strong>l driven approach. Then we show the relevance<br />
of such an approach by comparing it to the conventional approach.<br />
16h40 Mise en place d’un processus <strong>de</strong> notification <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts : vers une maîtrise<br />
organisationnelle <strong>de</strong>s risques hospitaliers (Centre Hospitalier Jolmont-<br />
Lobbes/Belgique)<br />
Van Den Berge, Pierre, Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes,<br />
pierre.van<strong>de</strong>nberge@entitejolimontoise.be<br />
Beauduin, Marc, Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes, marc.beauduin@skynet.be<br />
To<strong>de</strong>schini, Nadine, Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes,<br />
nadine.to<strong>de</strong>schini@entitejolimontoise.be<br />
Delvosalle, Christian, Faculté Polytehnique/Université <strong>de</strong> Mons,<br />
christian.<strong>de</strong>lvosalle@umons.ac.be<br />
El Hiki, Lahcen, Institut sciences & management risques/Université <strong>de</strong> Mons,<br />
lahcen.elhiki@umons.ac.be<br />
Face à l’augmentation <strong>de</strong> la prévalence <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts dans les organisations hospitalières,<br />
nous assistons à une véritable prolifération méthodologique concernant le développement et<br />
l’implémentation <strong>de</strong>s démarches liées à la gestion <strong>de</strong>s risques. Inspirées par l’arsenal<br />
17 / 44
méthodologique développé dans les entreprises industrielles, force est <strong>de</strong> reconnaître que<br />
ces démarches souffrent <strong>de</strong> nombreux déficits d’adaptation sur les plans méthodologique et<br />
conceptuel. Dans ce papier, nous proposons l’innovation organisationnelle comme réponse<br />
à la maîtrise <strong>de</strong>s risques hospitaliers et le modèle organisationnel réticulaire comme concept<br />
adapté à cette dynamique. Ce modèle est actuellement en cours d’implantation au sein du<br />
Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes et du Centre Hospitalier Nivelles-Tubize (Belgique). Et<br />
ce, sur <strong>de</strong>s thématiques s’articulant sur les chutes, les infections nosocomiales, les pertes<br />
<strong>de</strong> prothèses, les risques transfusionnels et les risques postopératoires. Notre approche<br />
intègre le diagnostic organisationnel, la réingénierie du processus et l’ingénierie du facteur<br />
humain.<br />
J3C Gestion budgétaire et maîtrise <strong>de</strong>s coûts en établissement <strong>de</strong><br />
soins, tarification et mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financement<br />
Salle : 2307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Pol Leclercq et Caroline Delo<br />
15h50 La tarification à la pathologie en Tunisie : la réalité et les perspectives<br />
Ladjimi, Raoudha, Ministère <strong>de</strong> la santé publique, raoudhaladjimi@yahoo.fr<br />
L’Etat tunisien a décidé, par la loi du 4 Août 2004, <strong>de</strong> réformer le système d’assurance<br />
maladie dont les principaux objectifs sont :<br />
- L’uniformisation <strong>de</strong>s régimes d’assurance maladie actuels par la mise en place d’un régime<br />
<strong>de</strong> base obligatoire, géré par une caisse publique unique.<br />
- La conception <strong>de</strong> régimes complémentaires facultatifs.<br />
- L’ouverture progressive du financement public <strong>de</strong>s prestations dans le secteur privé.<br />
A cette occasion, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> coûts à la pathologie ont été engagées pour servir <strong>de</strong> base<br />
à la tarification à la pathologie et remplacer progressivement la tarification à la spécialité<br />
adoptée <strong>de</strong>puis 1996 dans les structures hospitalières publiques. l’adoption d’un coût moyen<br />
par admission comme tarif unique applicable à chaque spécialité dans tous les hôpitaux<br />
occulte les variations plus ou moins importantes <strong>de</strong> coût inhérentes aux pathologies prises<br />
en charge et techniques utilisées ce qui pénalise certains établissements par rapport à<br />
d’autres. En effet, ce système <strong>de</strong> paiement à la pathologie a permis d'éviter le manque<br />
d'équité en matière <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong>s prestations inhérent au système <strong>de</strong>s<br />
tarifications par spécialité. Notre article consiste à présenter l’expérience tunisienne dans le<br />
domaine <strong>de</strong> la tarification à la pathologie, et les perspectives <strong>de</strong> son amélioration.<br />
16h15 Coût par intervention chirurgicale <strong>de</strong>s produits médicaux non facturables aux<br />
patients<br />
Leclercq, Pol, ULB, CP 592, pleclerc@ulb.ac.be<br />
Delo, Caroline, ULB, CP 592, c<strong>de</strong>lo@ulb.ac.be<br />
Biloque, Véronique, ULB, CP 592, vbiloque@ulb.ac.be<br />
Martins, Dimitri, ULB, CP 592, dmartins@ulb.ac.be<br />
Pirson, Magali, ULB, CP 592, magali..pirson@ulb.ac.be<br />
La fixation <strong>de</strong>s tarifs <strong>de</strong>s actes médicaux ou <strong>de</strong>s forfaits par pathologie doit reposer dans la<br />
mesure du possible sur <strong>de</strong>s données objectives concernant les ressources consommées.<br />
Celles-ci sont généralement bien i<strong>de</strong>ntifiées au niveau <strong>de</strong>s blocs opératoires (durée<br />
d'intervention <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins, <strong>de</strong>s infirmières, immobilisation <strong>de</strong>s équipements, spécialités<br />
pharmaceutiques). Il n'en va pas <strong>de</strong> même pour les produits médicaux courants qui<br />
représentent pourtant <strong>de</strong>s charges considérables. La fixation <strong>de</strong> tarifs standardisés par type<br />
d'intervention ou <strong>de</strong> pathologie ainsi que la maîtrise <strong>de</strong> la consommation <strong>de</strong> ces produits<br />
18 / 44
dans les hôpitaux se heurte donc à ce déficit d'information. L'étu<strong>de</strong> présente une<br />
méthodologie pour enregistrer et pour analyser la consommation et le coût <strong>de</strong>s produits<br />
médicaux courants par type d'intervention chirurgicale.<br />
J3D Méthodologies <strong>de</strong> modélisation et <strong>de</strong> simulation<br />
Salle : 2317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Angel Ruiz<br />
15h50 Mise en place d'un système d’ai<strong>de</strong> à la décision par fouille <strong>de</strong> données pour la<br />
prédiction du <strong>de</strong>gré d'Autonomie <strong>de</strong> Patients atteints <strong>de</strong> cancer<br />
Abouab<strong>de</strong>llah, Ab<strong>de</strong>llah, ENSET-Rabat, université Med V souissi,<br />
a.abouab<strong>de</strong>llah@um5s.net.ma<br />
Aguezzoul, Aicha, LGIPM, Université <strong>de</strong> Metz, aguezzou@univ-metz.fr<br />
Cherkaoui, Ab<strong>de</strong>lghani, Ecole Mohammedia d’Ingénieurs, cherkaoui_a@yahoo.com<br />
Le but <strong>de</strong> ce papier est <strong>de</strong> mettre en place un système d’ai<strong>de</strong> à la décision basé sur un<br />
processus d’extraction <strong>de</strong> connaissances. Ce système permet une prédiction pour<br />
l’autonomisation d’un patient atteint d’un cancer et traité par chimiothérapie. La première<br />
partie <strong>de</strong> cet article définit le processus d’autonomisation d’un patient, La <strong>de</strong>uxième partie<br />
rappelle le principe <strong>de</strong>s systèmes d’ai<strong>de</strong> à la décision et explique le principe du processus<br />
d’extraction <strong>de</strong> connaissance (ECD), inspiré <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fouilles <strong>de</strong> données<br />
(Datamining). La troisième partie décrit l’approche suivie pour la mise en place du dit<br />
système. La quatrième partie applique cette approche aux données brutes historisées <strong>de</strong>s<br />
différents patients.<br />
16h15 Patient file traceability management in a health-care complex<br />
Augusto, Vincent, École <strong>de</strong>s Mines <strong>de</strong> Saint-Étienne, augusto@emse.fr<br />
Roesch, Lionel, Institut <strong>de</strong> Cancérologie Lucien Neuwirth, lionel.roesch@icloire.fr<br />
Orsi, Yves, Institut <strong>de</strong> Cancérologie Lucien Neuwirth, yves.orsi@icloire.fr<br />
Rueda, Séverine, Institut <strong>de</strong> Cancérologie Lucien Neuwirth, severine.rueda@icloire.fr<br />
A large majority of health care systems are still using physical patient files in or<strong>de</strong>r to store<br />
administrative and medical data, medical imaging files, biological analysis results, etc. Such<br />
files are required when the patient shows up in the system for any kind of medical<br />
consultation (medical consultation with a physician, long stay in the hospital, or visit in an<br />
outpatient unit). Hence patient file traceability must be managed carefully in or<strong>de</strong>r to avoid<br />
file loss and improve file sorting in the archive <strong>de</strong>partment. This paper aims at proposing a<br />
new tool for managing patient medical file traceability and improving file sorting in or<strong>de</strong>r to<br />
reduce <strong>de</strong>lays during <strong>de</strong>livery and globally improve quality of care. This study is part of a<br />
project conducted with the Lucien Neuwirth Cancer Institute (Saint-Etienne, France). A<br />
formal mo<strong>de</strong>ling of medical file flows is proposed to i<strong>de</strong>ntify risks related to lack of<br />
traceability. A discrete-event simulation mo<strong>de</strong>l is also proposed to test various organization<br />
scenarios related to file management outsi<strong>de</strong> and insi<strong>de</strong> the archive <strong>de</strong>partment of the<br />
cancer institute. New traceability software has been implemented to support the newly<br />
proposed organization.<br />
16h40 Modélisation et simulation <strong>de</strong> l’évacuation d’un hôpital face à un tsunami<br />
fluvial : exemple d’un plan blanc<br />
Guinet, Alain, INSA <strong>de</strong> Lyon, alain.guinet@insa-lyon.fr<br />
Ruiz, Angel, Université Laval, Angel.Ruiz@fsa.ulaval.ca<br />
19 / 44
L'hôpital, Isabelle, Hospices Civils <strong>de</strong> Lyon, isabelle.lhopital@chu-lyon.fr<br />
Lavignon, Jean-Pierre, Hôpital Saint Joseph / Saint Luc, jplavignon@ch-stjoseph-stluclyon.fr<br />
Nous étudions la réponse à apporter à la situation occasionnée par la rupture d’un barrage<br />
situé sur la Commune <strong>de</strong> Cernon dans le Jura. L’arrivée <strong>de</strong> l´on<strong>de</strong> <strong>de</strong> submersion après<br />
rupture du barrage sur le centreville <strong>de</strong> Lyon est comprise entre 8h et 9h, pour une hauteur<br />
d´eau prévue <strong>de</strong> 4 et 6 mètres. L´hôpital Saint-Joseph/Saint-Luc <strong>de</strong> Lyon à évacuer est<br />
localisé sous le passage <strong>de</strong> la vague. La problématique est d’organiser l´évacuation totale<br />
<strong>de</strong> l’hôpital dans un laps <strong>de</strong> temps le plus court possible et <strong>de</strong> dimensionner les ressources<br />
nécessaires à sa réalisation.<br />
17h30 Départ en autobus vers le Musée national <strong>de</strong>s beaux-arts du<br />
Québec<br />
Ren<strong>de</strong>z-vous à la porte Ouest du pavillon Palasis-Prince (près <strong>de</strong> la table d’inscription).<br />
18h00 Cocktail au Musée national <strong>de</strong>s beaux-arts du Québec<br />
Le cocktail sera suivi d’un dîner libre au centre-ville <strong>de</strong> Québec.<br />
20 / 44
Vendredi 31 août <strong>2012</strong><br />
08h30 Inscription, accueil et café - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon<br />
Palasis-Prince (PAP)<br />
Plénière - II<br />
Salle : Amphithéâtre IMB - local 0610 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Patrick Soriano<br />
09h00 Quantitative Mo<strong>de</strong>lling and Analysis Applied to Healthcare Policy and Tactical<br />
Decision Making<br />
Carter, Mike, Université <strong>de</strong> Toronto, carter@mie.utoronto.ca<br />
09h45 Pause - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />
V1A Amélioration continue, démarche <strong>de</strong> progrès et Lean Six Sigma :<br />
quelle application en Milieu Hospitalier ?<br />
Salle : 1317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : André Lemaire et Fouad Riane<br />
10h05 Démarche d’amélioration du processus <strong>de</strong> programmation opératoire<br />
Dupont, Isabelle, Hôpital Sainte Balndine, Metz, zaboobel@gmail.com<br />
Chaabane, Son<strong>de</strong>s, Université <strong>de</strong> Valenciennes, son<strong>de</strong>s.chaabane@univ-valenciennes.fr<br />
Husson, Julien, ESM – IAE, Université Paul Verlaine Metz, julien.husson@univ-metz.fr<br />
Dar<strong>de</strong>nne, Gilles, Hôpital Sainte Balndine, Metz, gdar<strong>de</strong>nne@laposte.net<br />
Rakotondranaivo, Auguste, Institut National Polytechnique <strong>de</strong> Lorraine,<br />
rak.auguste@gmail.com<br />
Si une programmation opératoire efficiente constitue la pierre angulaire <strong>de</strong> toute<br />
l’organisation du bloc opératoire, son insuffisance peut aussi être la source <strong>de</strong> graves<br />
dysfonctionnements. L’utilisation d’outils d’analyse issus du mon<strong>de</strong> industriel nous a permis<br />
d’i<strong>de</strong>ntifier et <strong>de</strong> porter un regard critique pertinent sur les problématiques soulevées, en vue<br />
<strong>de</strong> leur résolution et dans le but <strong>de</strong> réduire le gaspillage non négligeable <strong>de</strong>s ressources,<br />
prouvant par là même l’applicabilité possible et utile <strong>de</strong> ces métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> management<br />
industrielles au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé. Cependant, la recherche <strong>de</strong> solutions doit composer<br />
avec un facteur humain prévalent dans l’univers <strong>de</strong>s soins.<br />
10h30 L’amélioration continue au laboratoire clinique par l’utilisation <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong><br />
modélisation et <strong>de</strong> simulation<br />
Moreno, Jenny, CIM - Conseil en immobilisation & management inc., jmoreno@cimconseil.qc.ca<br />
Massieye, Fanny, CIM - Conseil en immobilisation & management inc., FMassieye@cimconseil.qc.ca<br />
Baril, Sylvain, CIM - Conseil en immobilisation & management inc., sbaril@cimconseil.qc.ca<br />
21 / 44
Poitras, Lucie, CIM - Conseil en immobilisation & management inc., lpoitras@cimconseil.qc.ca<br />
Cet article décrit comment les outils <strong>de</strong> modélisation et <strong>de</strong> simulation peuvent ai<strong>de</strong>r à la<br />
prise <strong>de</strong> décision dans un contexte d’optimisation et d’amélioration <strong>de</strong>s services, et<br />
comment ces outils peuvent être utilisés dans le secteur <strong>de</strong> la santé. D’autre part, nous<br />
présentons les avantages <strong>de</strong> leur utilisation afin <strong>de</strong> réduire les risques liés à l’introduction <strong>de</strong><br />
nouveaux facteurs (mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong>s installations physiques, <strong>de</strong>s équipements et <strong>de</strong>s<br />
technologies ; optimisation <strong>de</strong>s processus et <strong>de</strong>s ressources ; mise aux normes ; etc.).<br />
10h55 Retour d’expérience sur les impacts et les facteurs <strong>de</strong> succès <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux projets<br />
Lean menés dans <strong>de</strong>s CHU québécois<br />
Dagenais, Martine, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, martine-2.dagenais@polymtl.ca<br />
<strong>de</strong> Marcellis-Warin, Nathalie, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, nathalie.<strong>de</strong>marcelliswarin@polymtl.ca<br />
Imbeau, Daniel, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, daniel.imbeau@polymtl.ca<br />
Piché, Christian, CHU Sainte-Justine, christian.piche.hsj@ssss.gouv.qc.ca<br />
Chaussé, Sylvain, CHUS, schausse.chus@ssss.gouv.qc.ca<br />
L’approche Lean, inspirée du Toyota Production System <strong>de</strong> l’entreprise automobile Toyota,<br />
est utilisée <strong>de</strong>puis 2001 dans les systèmes <strong>de</strong> santé pour améliorer la performance par<br />
l’élimination <strong>de</strong>s gaspillages sous le nom <strong>de</strong> Lean Healthcare. Bien que plusieurs auteurs<br />
énoncent les bienfaits <strong>de</strong> cette approche, plusieurs auteurs critiquent son implantation,<br />
comme le manque <strong>de</strong> vision systémique ainsi que les impacts négatifs possibles du Lean<br />
sur la santé et sécurité au travail (SST) <strong>de</strong>s employés. Depuis 2008, cette approche est<br />
appliquée dans le milieu <strong>de</strong> la santé québécois pour venir en ai<strong>de</strong> au système en manque<br />
<strong>de</strong> performance, mais peu d’étu<strong>de</strong>s critiques ont été recensées dans la littérature sur son<br />
implantation. Deux étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cas avec entrevues et questionnaires dans <strong>de</strong>ux centres<br />
hospitaliers universitaires québécois ont permis <strong>de</strong> documenter le contexte, les impacts et<br />
les facteurs <strong>de</strong> succès <strong>de</strong> l’implantation <strong>de</strong> l’approche Lean. À l’avenir, les projets Lean au<br />
Québec <strong>de</strong>vraient viser l’intégration systémique du Lean, intégrer <strong>de</strong>s objectifs en lien avec<br />
la diminution <strong>de</strong>s risques pour la SST <strong>de</strong>s employés et mettre en place plusieurs facteurs <strong>de</strong><br />
succès.<br />
11h20 La démarche lean <strong>de</strong> l'Hôpital Saint-Boniface : sur la route <strong>de</strong> l'appropriation<br />
Foropon, Cyril, I.H. Asper School of Business, Université du Manitoba,<br />
foropon@cc.umanitoba.ca<br />
Landry, Sylvain, HEC Montréal, sylvain.landry@hec.ca<br />
Ce papier a pour objectif principal <strong>de</strong> rendre compte <strong>de</strong> la démarche lean en cours <strong>de</strong><br />
déploiement à l’Hôpital Saint-Boniface (HSB) <strong>de</strong>puis 2008, puis <strong>de</strong> mettre en lumière<br />
l’appropriation <strong>de</strong> cette démarche à différents échelons <strong>de</strong> cet établissement <strong>de</strong> santé. Au<br />
Manitoba, HSB est <strong>de</strong>venu un véritable fer <strong>de</strong> lance en matière <strong>de</strong> déploiement <strong>de</strong> la<br />
démarche lean en santé. Ce cas se fon<strong>de</strong> sur une série d’entrevues menées à l’hiver <strong>2012</strong><br />
auprès du prési<strong>de</strong>nt directeur général <strong>de</strong> l’HSB, <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’équipe <strong>de</strong> direction, <strong>de</strong><br />
plusieurs membres du personnel ayant participé à <strong>de</strong>s projets d’amélioration lean, et<br />
s’appuie également sur une documentation variée mise à notre disposition.<br />
V1B Performance hospitalière : quels sont les outils à notre<br />
disposition ? - I<br />
Salle : 1325 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Pierre Gillet et Jessica Jacques<br />
22 / 44
10h05 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la performance opérationnelle d’un service universitaire<br />
odontologique <strong>de</strong> la chaine hospitalière<br />
Housni, Boubaker, CRCGM, boubaker.housni@u-clermont1.fr<br />
Bertel, Sylvain, CRCGM, sylvain.bertel@u-clermont1.fr<br />
Fenies, Pierre, CRCGM, pierre.fenies@u-clermont1.fr<br />
Cet article est original par sa double approche en sciences <strong>de</strong> gestion et en sciences <strong>de</strong><br />
l’ingénieur. En sciences <strong>de</strong> gestion, il propose un état <strong>de</strong> l’art sur les logiques distinctes<br />
qu’on trouve dans un service hospitalier et la double complexité dans la mise en œuvre<br />
d’outils pour la chaine hospitalière. En sciences <strong>de</strong> l’ingénieur, on propose un modèle formel<br />
multicritère qui permettra par la suite <strong>de</strong> dialoguer avec les différents acteurs <strong>de</strong> la chaine<br />
hospitalière en vue <strong>de</strong> sa réorganisation.<br />
10h30 Financement à l’activité justifiée : réalité ou abus <strong>de</strong> langage ?<br />
Fontaine, Pierre, Université Liège, Pierre.fontaine@chh.be<br />
Gillain, Daniel, CHU Liège, Daniel.gillain@chu.ulg.ac.be<br />
Jacques, Jessica, CHU Liège, jessica.jacques@chu.ulg.ac.be<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Gillet, Pierre, CHU Liège, pierre.gillet@chu.ulg.ac.be<br />
La Belgique a adopté un système <strong>de</strong> financement hospitalier en fonction <strong>de</strong> l’activité dite<br />
justifiée. Cette activité correspond aux durées <strong>de</strong> séjours moyennes nationales en fonction<br />
<strong>de</strong>s pathologies traitées et regroupées en APR-DRG. Parallèlement, une enquête a été<br />
menée durant laquelle l’Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) a été enregistré. L’objet<br />
<strong>de</strong> l’AEP est d’évaluer l’opportunité <strong>de</strong>s journées hospitalières en fonction <strong>de</strong>s soins prestés<br />
et <strong>de</strong> l’état du patient. Ces <strong>de</strong>ux approches <strong>de</strong> la journée justifiée sont confrontées dans le<br />
présent texte L’AEP se montre plus sévère que le critère du financement puisqu’en effet<br />
globalement un quart <strong>de</strong>s journées sont jugées inopportunes. On note que la nature <strong>de</strong>s<br />
raisons générant <strong>de</strong>s journées non-justifiées évoluent avec la durée <strong>de</strong> séjour, passant <strong>de</strong><br />
facteurs liés à l’organisation interne <strong>de</strong> l’institution vers <strong>de</strong>s facteurs liés à une insuffisance<br />
<strong>de</strong> l’offre extra-hospitalière. Parler <strong>de</strong> financement à l’activité justifiée constitue bel et bien<br />
un abus <strong>de</strong> langage, puisque l’ensemble <strong>de</strong>s pratiques, justifiées ou non, contribuent à le<br />
déterminer. Mais au-<strong>de</strong>là d’un problème <strong>de</strong> sémantique, c’est un problème d’allocation <strong>de</strong>s<br />
ressources et <strong>de</strong> pratiques médicales qui est mis en évi<strong>de</strong>nce.<br />
10h55 Développement d’un benchmark concernant <strong>de</strong>s indicateurs d’activité<br />
hospitalière.<br />
Laport, Nancy, CHU <strong>de</strong> Liège, nancy.laport@chu.ulg.ac.be<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Peeters, Frank, Aexis, kcockx@aexis.com<br />
Moons, Carl, Aexis, cmoons@be.aexis.com<br />
Gillain, Daniel, CHU Liège, Daniel.gillain@chu.ulg.ac.be<br />
Gillet, Pierre, CHU Liège, pierre.gillet@chu.ulg.ac.be<br />
Afin d’améliorer sa performance, l’hôpital a besoin <strong>de</strong> se comparer aux autres sur base<br />
d’indicateurs. Cet article relate la construction, l’utilisation et les résultats d’un benchmark<br />
développé par une petite dizaine d’hôpitaux aigus en Belgique. Ce benchmark s’est<br />
concentré sur <strong>de</strong>s indicateurs d’activité dans chacun <strong>de</strong>s domaines clé <strong>de</strong> l’hôpital. Suite à<br />
la récolte <strong>de</strong>s informations dans chaque hôpital, les indicateurs sont calculés, agrégés et<br />
23 / 44
mis à la disposition <strong>de</strong>s participants via une application Web avec <strong>de</strong>s fonctionnalités<br />
d’analyses complémentaires possible par l’utilisateur. Des éléments essentiels tels la<br />
construction <strong>de</strong>s indicateurs et leur mise à jour, la fiabilité <strong>de</strong>s données, la mise à disposition<br />
<strong>de</strong>s résultats et leur utilisation, sont repris et analysés.<br />
11h20 Variabilité inter hospitalière <strong>de</strong>s Patient Safety Indicators (PSI) en Belgique<br />
Jacques, Jessica, CHU Liège, jessica.jacques@chu.ulg.ac.be<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Vanhove, Mikael, SPF Santé publique, Sécurité <strong>de</strong> la Chaine alimentaire et Environnement,<br />
Mikael.Vanhove@health.fgov.be<br />
Haelterman, Margareta, SPF Santé publique, Sécurité <strong>de</strong> la Chaine alimentaire et<br />
Environnement, Margareta.Haelterman@health.fgov.be<br />
Sei<strong>de</strong>l, Laurence, Université <strong>de</strong> Liège, laurence.sei<strong>de</strong>l@ulg.ac.be<br />
Albert, A<strong>de</strong>lin, Université <strong>de</strong> Liège, aalbert@ulg.ac.be<br />
Gillet, Pierre, CHU Liège, pierre.gillet@chu.ulg.ac.be<br />
Les Patient Safety Indicators (PSI) sont <strong>de</strong>s indicateurs permettant <strong>de</strong> repérer <strong>de</strong>s<br />
complications <strong>de</strong> soins potentielles à partir <strong>de</strong>s données medico-administratives. De plus en<br />
plus utilisées dans <strong>de</strong>s programmes d’évaluation <strong>de</strong> la performance hospitalière, il est<br />
important d’estimer l’impact <strong>de</strong>s pratiques <strong>de</strong> codification <strong>de</strong>s données médicoadministratives<br />
sur les taux obtenus. Ce projet tente d’observer la variation <strong>de</strong>s indicateurs<br />
entre les hôpitaux belges et <strong>de</strong> quantifier l’effet <strong>de</strong> l’exhaustivité <strong>de</strong> la codification sur les<br />
taux obtenus. Des variations systématiques <strong>de</strong>s taux sont observées en Belgique. Les<br />
disparités étaient les plus fortes pour les indicateurs utilisant <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s ICD-9-CM non<br />
spécifiques et étaient moindres entre hôpitaux présentant un même profil <strong>de</strong> patient<br />
(hôpitaux académiques) Une relation est observée entre une codification exhaustive et <strong>de</strong>s<br />
taux plus élevés. Toutefois, cette étu<strong>de</strong> suggère que les variations entre hôpitaux belges<br />
étaient plus le reflet <strong>de</strong> différences <strong>de</strong> casemix que <strong>de</strong> pratiques <strong>de</strong> codification.<br />
V1C Logistique Hospitalière<br />
Salle : 2307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Slim Hammadi et Hayfa Zgaya<br />
10h05 La simulation, un atout dans la prise <strong>de</strong> décision : le cas d’un service <strong>de</strong><br />
stérilisation au Québec<br />
Ollivier, Sébastien, CIM Conseil en Immobilisation et Management inc., sollivier@cimconseil.qc.ca<br />
Baril, Sylvain, CIM - Conseil en immobilisation & management inc., sbaril@cimconseil.qc.ca<br />
Moreno, Jenny, CIM - Conseil en immobilisation & management inc., jmoreno@cimconseil.qc.ca<br />
Cloutier, Jean-François, CIM - Conseil en immobilisation & management inc.,<br />
jfcloutier@cim-conseil.qc.ca<br />
Les établissements <strong>de</strong> santé québécois sont soumis à <strong>de</strong> nombreux changements. Que l’on<br />
parle <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> rénovation, <strong>de</strong> réaménagement ou <strong>de</strong> déménagement <strong>de</strong> services, les<br />
gestionnaires <strong>de</strong>s établissements sont confrontés à <strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> décisions complexes. À<br />
cet effet, la simulation se présente comme un outil d’ai<strong>de</strong> à la décision flexible permettant<br />
d’expérimenter différents scénarios sans risque opérationnel pour l’hôpital. Le présent article<br />
s’intéresse à l’apport <strong>de</strong> la simulation pour faciliter la prise <strong>de</strong> décision relative aux systèmes<br />
24 / 44
logistiques <strong>de</strong>s hôpitaux, ces <strong>de</strong>rniers étant <strong>de</strong> plus en plus ciblés comme étant <strong>de</strong>s points<br />
stratégiques d’amélioration <strong>de</strong> la performance. À cette fin, le circuit <strong>de</strong> retraitement et <strong>de</strong><br />
distribution <strong>de</strong>s dispositifs médicaux du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU<br />
Sainte-Justine) est pris comme exemple. Dans le cadre du déménagement <strong>de</strong> son bloc<br />
opératoire, cet hôpital a fait appel à la simulation pour évaluer les impacts opérationnels liés<br />
à différents mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fonctionnement pour le futur circuit <strong>de</strong> distribution. Les résultats<br />
obtenus ont permis <strong>de</strong> mesurer les impacts liés aux différents scénarios <strong>de</strong> fonctionnement<br />
afin <strong>de</strong> favoriser une prise <strong>de</strong> décision éclairée.<br />
10h30 Evolutionary Approach for Multi-Objective Scheduling in Surgical Unit<br />
Wi<strong>de</strong>d, chandoul, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, wi<strong>de</strong>d.chandoul@ec-lille.fr<br />
Hammadi, Slim, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, slim.hammadi@ec-lille.fr<br />
Camus, Hervé, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, herve.camus@ec-lille.fr<br />
Zgaya, Hayfa, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />
hayfa.zgaya@univ-lille2.fr<br />
Di Pompeo, Christophe, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />
dipompeo@univ-lille2.fr<br />
Trincaretto, Francis, Sambre-Avesnois Hospital, f_trincaretto@ch-sa.com<br />
Currently Sambre-Avesnois Hospital doesn’t have a system to generate schedule taking into<br />
account operating theatre constraints and objectives. This workload is a part of the surgical<br />
unit supervisor’s responsibilities. It is done manually, which makes it more susceptible to<br />
errors and can be extremely time-consuming. Thus, our work handles the conception and<br />
the realization of a computer-ai<strong>de</strong>d which schedules surgeries and optimize the unit<br />
program. Firstly, we have ma<strong>de</strong> an analogy between the functioning of the surgical unit and<br />
the flexible job shop problem. And so the i<strong>de</strong>a of conceive a scheduling tool using an<br />
evolutionary approach was born. Furthermore we found a codification close to the reality.<br />
Then we implemented the various adapted genetic operators and realized a simulation with<br />
Java for one day in the surgical unit. We also ma<strong>de</strong> a comparative study with the static<br />
method currently used in the Sambre-Avesnois Hospital to <strong>de</strong>monstrate the efficiency of our<br />
mo<strong>de</strong>l.<br />
10h55 Supply chain et innovation : quelles perspectives pour l’organisation <strong>de</strong>s flux<br />
<strong>de</strong>s médicaments anticancéreux <strong>de</strong> l’hôpital à domicile ?<br />
Rakotondranaivo, Auguste, Institut National Polytechnique <strong>de</strong> Lorraine,<br />
auguste.rakotondranaivo@univ-lorraine.fr<br />
Augustin, Marie-Dominique, Hospitalisation à Domicile <strong>de</strong> l’Agglomération Nancéenne,<br />
marie-dominique.augustin@hadan.fr<br />
Les systèmes hospitaliers sont complexes. Ils sont contraints à mieux organiser et à innover<br />
pour maîtriser les dépenses tout en garantissant la qualité et la sécurité <strong>de</strong>s soins. La place<br />
<strong>de</strong> la chaine logistique pharmaceutique et son impact sur les performances <strong>de</strong>s<br />
établissements <strong>de</strong> santé sont bien reconnus. Nous avons travaillé sur l’organisation à<br />
l’échelle régionale <strong>de</strong> la chaine logistique globale <strong>de</strong>s médicaments anticancéreux <strong>de</strong><br />
l’hôpital au domicile <strong>de</strong>s patients, en combinant une démarche fonctionnelle basée sur la<br />
modélisation <strong>de</strong> la supply chain et l’analyse fonctionnelle d’une part et une démarche<br />
dysfonctionnelle <strong>de</strong> type AMDEC d’autre part. Cette démarche a permis <strong>de</strong> dégager <strong>de</strong>s<br />
scénarios d’organisation à évaluer par <strong>de</strong>s outils d’ai<strong>de</strong> à la décision comme les approches<br />
d’analyse multicritère, système multi-agent et recherche opérationnelle. Elle ouvre <strong>de</strong>s<br />
pistes <strong>de</strong> réflexions sur les innovations organisationnelles et technologiques possibles.<br />
25 / 44
11h20 Système d’Ai<strong>de</strong> à la Gestion et à l’Anticipation <strong>de</strong> la Tension dans les<br />
Hôpitaux<br />
Ajmi, Inès, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, ines.ajmi@ec-lille.fr<br />
Zoghlami, Nesrine, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, nesrine.zoghlami@ec-lille.fr<br />
Benoit, Yoann, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, yoann.benoit@centraliens-lille.org<br />
Chandoul, Wi<strong>de</strong>d, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, wi<strong>de</strong>d.chandoul@ec-lille.fr<br />
Kaddoussi, Ayda, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, ayda.kaddouci@ec-lille.fr<br />
Hammadi, Slim, Ecole Centrale <strong>de</strong> Lille, slim.hammadi@ec-lille.fr<br />
Dans ce travail, nous proposons un système d’ai<strong>de</strong> à la décision qui nous permettra <strong>de</strong><br />
prévoir, prévenir et gérer les événements exceptionnels susceptibles <strong>de</strong> perturber le<br />
fonctionnement interne <strong>de</strong> l’hôpital. En coopération avec un partenaire hospitalier, nous<br />
avons pu prélever une liste pertinente d’indicateurs révélateurs <strong>de</strong>s moments <strong>de</strong> tension au<br />
sein <strong>de</strong> l’hôpital ; c’est donc en utilisant le prototype « Ai<strong>de</strong> à la Gestion et Anticipation <strong>de</strong> la<br />
Tension dans les Hôpitaux » (AGATH), que nous proposons d’analyser au mieux ces<br />
indicateurs et d’y associer un état d’alerte proche <strong>de</strong> la réalité quotidienne <strong>de</strong> l’hôpital. Ce<br />
travail <strong>de</strong> recherche s’intègre dans le cadre d’un projet ANR HOST (ANR-11-TecSan-010).<br />
V1D Hospitalisation à domicile<br />
Salle : 2317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Alain Guinet et Yannick Kergosien<br />
10h05 Problématiques <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s structures <strong>de</strong> soins à domicile : un état <strong>de</strong>s<br />
investigations<br />
Ben Bachouch, Rym, DISP, INSA <strong>de</strong> Lyon, rym.ben-bachouch@insa-lyon.fr<br />
Guinet, Alain, INSA <strong>de</strong> Lyon et DISP , alain.guinet@insa-lyon.fr<br />
Ruiz, Angel, Université Laval, Angel.Ruiz@fsa.ulaval.ca<br />
Depuis une vingtaine d’années le nombre <strong>de</strong> lits dans les établissements hospitaliers et les<br />
cliniques privées n’a fait que diminuer entraînant la naissance <strong>de</strong> nouveaux besoins et <strong>de</strong><br />
nouvelles <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s patients. Pour pallier à cette situation, un nouveau mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> prise<br />
en charge a vu le jour : il s'agit <strong>de</strong> l'hospitalisation à domicile. Dans cet article, nous nous<br />
intéressons aux problématiques auxquelles doivent faire face les établissements d’HAD.<br />
Ces <strong>de</strong>rniers nécessitent la mise en place d’un pilotage stratégique, tactique et opérationnel<br />
<strong>de</strong>s différents professionnels intervenants dans le projet thérapeutique, avec l’objectif<br />
d’assurer un suivi et <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> qualité, <strong>de</strong> garantir une efficience d’emploi <strong>de</strong>s ressources<br />
humaines ainsi que <strong>de</strong> maîtriser les coûts.<br />
10h30 Partitionnement à horizon glissant du territoire <strong>de</strong>sservi par une structure<br />
d’hospitalisation à domicile<br />
Benzarti, Emna, École Centrale Paris, emna.benzarti@ecp.fr<br />
Sahin, Evren, École Centrale Paris, evren.sahin@ecp.fr<br />
Dallery, Yves, École Centrale Paris, yves.dallery@ecp.fr<br />
L’hospitalisation à domicile (HAD) représente une alternative à l’hospitalisation traditionnelle<br />
assurant la prise en charge coordonnée et continue <strong>de</strong>s patients à leur domicile en leur<br />
offrant <strong>de</strong>s soins techniques, plus au moins complexes et intenses, qui en l’absence d’un tel<br />
service nécessiteraient une hospitalisation complète. Dans ce travail, nous nous intéressons<br />
au problème <strong>de</strong> partitionnement à horizon glissant du territoire <strong>de</strong>sservi par une structure<br />
d’hospitalisation à domicile caractérisée par la variabilité <strong>de</strong>s opérations. Ce partitionnement<br />
26 / 44
doit prendre en compte les différentes sources <strong>de</strong> variabilité tout en garantissant la<br />
compacité <strong>de</strong>s zones conçues et la continuité <strong>de</strong>s soins en vue d’équilibrer au mieux la<br />
charge <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s différentes zones tout au long <strong>de</strong> l’horizon <strong>de</strong> partitionnement afin<br />
d’atteindre les objectifs <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> coûts.<br />
10h55 Optimisation du travail infirmier en soutien à domicile selon les principes du<br />
modèle toyota<br />
St-Pierre, Liette, Université du Québec à Trois-Rivières, Liette.St-Pierre@uqtr.ca<br />
Lazzara, Laura, UQTR, Laura.Lazzara@uqtr.ca<br />
Le vieillissement <strong>de</strong> la population et <strong>de</strong> la main d’œuvre, la complexification <strong>de</strong>s soins et la<br />
volonté <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s soins à domicile le principal mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé font<br />
en sorte que le travail <strong>de</strong>s infirmières à domicile s’alourdi. Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s croissantes<br />
donnent place à une réorganisation quotidienne du travail <strong>de</strong>s infirmières. Le centre <strong>de</strong><br />
santé et <strong>de</strong>s services sociaux (CSSS) étudié a voulu optimiser le travail <strong>de</strong>s infirmières et<br />
par le fait même les changements organisationnels. La présente étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> type rechercheaction<br />
s’est intéressée au fonctionnement <strong>de</strong>s infirmières aux services <strong>de</strong> soins à domicile<br />
du CSSS en interprétant les données recueillies selon le Modèle Toyota. En mai 2010, suite<br />
à une première collecte <strong>de</strong> données sur la clientèle nécessitant <strong>de</strong>s soins infirmiers à<br />
domicile, <strong>de</strong>s pistes d’améliorations ont été suggérées quant à l’organisation du travail<br />
infirmier ainsi que les processus cliniques et administratifs. En octobre 2011, plusieurs<br />
changements organisationnels ont été mis en place : la délégation <strong>de</strong> tâches cléricales <strong>de</strong><br />
l’assistante du supérieur immédiat (ASI) à l’agente administrative, l’ouverture <strong>de</strong> trois postes<br />
<strong>de</strong> rehaussement dans l’équipe d’infirmières, la conscientisation <strong>de</strong>s infirmières à l’entrée<br />
<strong>de</strong>s données statistiques, la réorganisation du matériel et l’intégration temporaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
infirmières auxiliaires pendant la pério<strong>de</strong> estivale.<br />
11h20 Conception d'un outil d'ai<strong>de</strong> à la décision pour la gestion <strong>de</strong> soins à domicile :<br />
le cas d'un service <strong>de</strong> prélèvement <strong>de</strong> sang<br />
Kergosien, Yannick, CIRRELT, yannick.kergosien@gmail.com<br />
Ruiz, Angel, Université Laval, angel.ruiz@fsa.ulaval.ca<br />
Soriano, Patrick, CIRRELT, patrick.soriano@hec.ca<br />
Smith, Joanne, CSSS <strong>de</strong> Laval, jsmith.csssl@ssss.gouv.qc.ca<br />
Les soins et les services à domicile sont <strong>de</strong>s pratiques <strong>de</strong> plus en plus utilisées par les<br />
centres hospitaliers <strong>de</strong> la plus part <strong>de</strong>s pays développés. Parmi tous les types <strong>de</strong> soins à<br />
domicile, le prélèvement <strong>de</strong> sang est un service très <strong>de</strong>mandé par les mé<strong>de</strong>cins. Le<br />
déploiement d'une organisation pouvant dispenser ce type <strong>de</strong> service nécessite une gestion,<br />
une coordination et une planification <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>z-vous chez les patients et les personnels <strong>de</strong><br />
soins. Ce travail est d'autant plus complexe qu'il y a un grand nombre <strong>de</strong> contraintes à<br />
respecter : horaire <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s intervenants, préférences <strong>de</strong>s patients, temps <strong>de</strong> transport<br />
limité pour les échantillons <strong>de</strong> sang sujets à certaines analyses, etc. Nous présentons dans<br />
cet article notre expérience lors <strong>de</strong> la mise en place d'un outil d'ai<strong>de</strong> à la décision et<br />
d'optimisation afin d'assister les déci<strong>de</strong>urs lors <strong>de</strong> ce travail et <strong>de</strong> palier à ces difficultés.<br />
Cette étu<strong>de</strong> est réalisée dans le cadre d'une collaboration avec le centre <strong>de</strong> prélèvement <strong>de</strong><br />
sang à domicile <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Laval au Québec.<br />
27 / 44
12h00 Repas - Salle Le Cercle, 4e étage, Pavillon Alphonse-Desjardins<br />
(ADJ)<br />
V2A L’informatique hospitalière : « <strong>de</strong> la conquête <strong>de</strong> l’Ouest à<br />
l’Urbanisation »<br />
Salle : 1317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Philippe Kolh et Christophe Lejeune<br />
13h30 Prescription informatisée <strong>de</strong>s biologies cliniques et <strong>de</strong>s examens<br />
complémentaires au CHU <strong>de</strong> Liège<br />
Raze, Michel, CHU Liège, michel.raze@chu.ulg.ac.be<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Simon, Isabelle, CHU Liège, i.simon@chu.ulg.ac.be<br />
Lejeune, Christophe, CHU Liège, christophe.lejeune@chu.ulg.ac.be<br />
Akafomo, Valère, CHU Liège<br />
Pol, Louis, CHU Liège<br />
L’informatisation <strong>de</strong>s prescriptions autres que le médicament est souvent peu ou mal<br />
décrite. Ces prescriptions constituent pourtant un élément clé <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> communication et<br />
<strong>de</strong> travail au sein <strong>de</strong> l’hôpital avec <strong>de</strong>s répercussions sur la qualité <strong>de</strong>s soins et les durées<br />
<strong>de</strong> séjours. Dans le cadre <strong>de</strong> son projet <strong>de</strong> Dossier Médical Informatisé, le Centre<br />
Hospitalier Universitaire <strong>de</strong> Liège a porté une attention particulière à ces prescriptions en<br />
dépassant les simples notions <strong>de</strong> partage d’information et en axant les optimisations sur la<br />
gestion <strong>de</strong>s processus et <strong>de</strong>s flux. La sécurisation <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s patients constitue<br />
également une approche originale et novatrice.<br />
13h55 Le parcours du Québec en iSanté : un regard sur son futur<br />
Powers, Patrick, Himss Analytics, patrick.powers@himssanalytics.org<br />
Depuis plus d’une décennie, le Québec reconnait que sa vision <strong>de</strong> la prestation <strong>de</strong> soins <strong>de</strong><br />
santé doit comporter une composante <strong>de</strong> solutions <strong>de</strong> partage i-Santé. Afin d’assurer que le<br />
citoyen se trouve au cœur <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong>s soins au Québec, l’offre <strong>de</strong> services est<br />
organisée en réseaux locaux qui regroupent tous les fournisseurs <strong>de</strong> services qui se<br />
partagent la responsabilité <strong>de</strong> la santé <strong>de</strong> leur territoire. Le Dossier <strong>de</strong> santé du Québec<br />
(DSQ) contiendra les renseignements jugés essentiels concernant l’état <strong>de</strong> santé <strong>de</strong>s<br />
patients, particulièrement en situation d’urgence : les données d’i<strong>de</strong>ntification, les résultats<br />
d’examens et analyses <strong>de</strong> laboratoire, les résultats d’imagerie diagnostique, le profil<br />
pharmacologiques, les ordonnances électroniques, les allergies et intolérances.<br />
L’Association québecoise d’établissements <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> services sociaux (AQESSS), en<br />
collaboration avec le Ministère <strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong>s Services sociaux (MSSS), a formé un<br />
partenariat avec le Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)<br />
Analytics afin <strong>de</strong> faire l’inventaire <strong>de</strong> tous les systèmes d’information (applicatifs et<br />
quincaillerie) <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> santé au Québec. Si le Québec souhaite tenir son<br />
engagement d’un DSQ déployé pour tous les rési<strong>de</strong>nts d’ici 2016, il est essentiel qu’il<br />
poursuive la prise d’inventaire et le maintien d’outils <strong>de</strong> balisage lui permettant <strong>de</strong> confirmer<br />
sa stratégie d’un DSQ interopérable.<br />
14h20 De la ruée vers l’or à l’urbanisation<br />
Lejeune, Christophe, CHU Liège, christophe.lejeune@chu.ulg.ac.be<br />
28 / 44
L’évolution du paysage <strong>de</strong> l’informatique hospitalière a été spectaculaire ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières<br />
décennies et a vu la couverture applicative s’étendre du domaine administratif ou domaine<br />
clinique. La masse d’information gérée a donc augmenté mais a également atteint une taille<br />
critique qui ne peut plus être gérée par les organisations initialement en place. De nombreux<br />
rôles doivent être créés afin d’assurer une saine gestion <strong>de</strong> cette nouvelle informatique et<br />
ce, avant <strong>de</strong> passer à d’autres projets d’ouverture vers l’extérieur <strong>de</strong> l’hôpital. Ces rôles<br />
concernent la gestion en général et plus particulièrement la gestion <strong>de</strong> la sécurité et du<br />
changement mais également la gestion <strong>de</strong> programme et la mise ne place d’un niveau <strong>de</strong><br />
service. La mise en place <strong>de</strong> ces principes <strong>de</strong> bonne gouvernance est indispensable à la<br />
pérennisation <strong>de</strong>s infrastructures en place ainsi qu’à leur évolution vers une interconnexion<br />
avec le mon<strong>de</strong> extérieur.<br />
V2B Performance hospitalière : quels sont les outils à notre<br />
disposition ? - II<br />
Salle : 1325 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Pierre Gillet et Jessica Jacques<br />
13h30 L’estimation <strong>de</strong> la valeur ajoutée <strong>de</strong>s projets accompagnés par le Bureau <strong>de</strong><br />
soutien à la transition du Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill (CUSM)<br />
Richer, Marie-Claire, Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill, marieclaire.richer@muhc.mcgill.ca<br />
Biron, Alain, Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill, alain.biron@muhc.mcgill.ca<br />
St-Hilaire, Carole, Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill, carole.st-hilaire@muhc.mcgill.ca<br />
Vezina, Michel, HEC Montréal, michel.vezina@hec.ca<br />
Rivard Fra<strong>de</strong>tte, Alexandra, Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill, alexandra.rivardfra<strong>de</strong>tte@muhc.mcgill.ca<br />
Beaudry, Stéphane, Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill,<br />
stephane.beaudry@muhc.mcgill.ca<br />
Depuis plusieurs années, le réseau <strong>de</strong> la santé québécois et les établissements qui le<br />
composent sont confrontés à <strong>de</strong>s défis qui les incitent à améliorer leur performance et ce,<br />
dans un contexte budgétaire <strong>de</strong>s plus restreints. Ce contexte ajoute un far<strong>de</strong>au<br />
supplémentaire aux hôpitaux universitaires qui doivent répondre à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s sans<br />
cesse croissantes pour <strong>de</strong>s soins et services <strong>de</strong> fine pointe exigeant l’utilisation <strong>de</strong><br />
technologies coûteuses. En 2008 le CUSM a mis sur pied le Bureau <strong>de</strong> Soutien à la<br />
Transition afin d’accompagner les équipes cliniques dans le contexte d’un projet <strong>de</strong><br />
redéveloppement majeur. Ce papier présente un abrégé <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> d’estimation <strong>de</strong> la<br />
valeur ajoutée <strong>de</strong>s projets accompagnés par le BST.<br />
13h55 Développement d’un modèle <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> la performance d’un processus<br />
administratif séquencé et non ca<strong>de</strong>ncé dans une organisation du réseau <strong>de</strong> la<br />
santé du Québec par le calcul du <strong>de</strong>gré d’articulation<br />
Fournier, Pierre-Luc, Université du Québec à Trois-Rivières, Pierre-Luc.Fournier@uqtr.ca<br />
Lagacé, Denis, Université du Québec à Trois-Rivières, Denis.Lagace@uqtr.ca<br />
Le Rouzès, Marie-Sylvie, Université du Québec à Trois-Rivières, Marie-<br />
Sylvie.Lerouzes@uqtr.ca<br />
Les problématiques reliées à la performance du système sociosanitaire québécois ont été<br />
largement documentées. Par contre, celle <strong>de</strong>s services administratifs du réseau est<br />
rarement l’objet <strong>de</strong> questionnements plus approfondis. Cet article a donc comme but <strong>de</strong><br />
29 / 44
présenter un modèle <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> la performance d’un processus administratif séquencé et<br />
non ca<strong>de</strong>ncé par le calcul du <strong>de</strong>gré d’articulation. Ce modèle a ensuite été utilisé dans une<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas pour en vérifier l’applicabilité.<br />
14h20 Hospital Performance Indicator (HPI) : Développement d’un set d’indicateurs<br />
dans la cadre <strong>de</strong> l’amélioration continue <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s hôpitaux<br />
aigus en Belgique<br />
Gillet, Pierre, CHU Liège, pierre.gillet@chu.ulg.ac.be<br />
Jacques, Jessica, CHU Liège, jessica.jacques@chu.ulg.ac.be<br />
Lucet, Catherine, CHU Liège<br />
Ficet, Joël, CHU Liège<br />
Van Boven, Caroline, CHU Liège<br />
La mesure <strong>de</strong> la performance hospitalière est considérée comme un élément indispensable<br />
du processus d’amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s soins. De plus, dans un contexte économique<br />
<strong>de</strong> plus en plus exigent, elle participe à une utilisation optimale <strong>de</strong>s ressources humaines et<br />
financières. En Belgique, les autorités fédérales se sont récemment engagées dans cette<br />
démarche d’évaluation <strong>de</strong> la performance hospitalière. L’objectif <strong>de</strong> ce projet <strong>de</strong> recherche<br />
était donc d’analyser les conditions <strong>de</strong> mise en place d’un set d’indicateurs d’évaluation <strong>de</strong><br />
la performance dans le contexte belge et <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>s recommandations pour une<br />
opérationnalisation <strong>de</strong>s indicateurs. Pour ce faire, nous avons dressé un inventaire <strong>de</strong>s<br />
expériences mises en place à l’étranger. Nous avons également rassemblé l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
initiatives introduites en Belgique. Enfin, nous avons réalisé <strong>de</strong>s interviews semi-structurées<br />
auprès <strong>de</strong>s directions <strong>de</strong> 13 hôpitaux volontaires afin <strong>de</strong> cerner la perception qu’ont les<br />
acteurs <strong>de</strong> terrain <strong>de</strong> la performance hospitalières.<br />
V2C La place du LEAN – six sigma dans les démarches qualité et<br />
l’optimisation <strong>de</strong>s processus hospitaliers : expérimentation et<br />
potentiel - I<br />
Salle : 2307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Marianne Philippe et Sylvain Landry<br />
13h30 Le système <strong>de</strong> gestion lean <strong>de</strong> ThedaCare : un modèle à suivre pour le<br />
Québec?<br />
Lemire, Stéphane, CHUQ, stlemire@googlemail.com<br />
Legentil, Jean-Marc, Bell Nordic., jean-marc.legentil@bell-nordic.com<br />
Landry, Sylvain, HEC Montréal, sylvain.landry@hec.ca<br />
Cet article présente la démarche lean adoptée par ThedaCare, un système <strong>de</strong> santé<br />
américain à but non lucratif <strong>de</strong> renommée mondiale. Tour à tour le ThedaCare Improvement<br />
System (TIS) et le ThedaCare Business Performance System sont décrits. Des exemples<br />
concrets, tirés <strong>de</strong> la pratique courante <strong>de</strong> ThedaCare, illustrent les points soulevés. L’article<br />
synthétise les éléments clés <strong>de</strong> la démarche, en guise <strong>de</strong> propositions pour faciliter<br />
l’intégration du lean aux outils d’amélioration <strong>de</strong> la performance utilisés dans le domaine <strong>de</strong><br />
la gestion appliquée au domaine <strong>de</strong> la santé. Enfin, une analyse relative à l’applicabilité <strong>de</strong><br />
ces concepts au contexte du Québec, est présentée.<br />
13h55 Le lean au Centre hospitalier universitaire <strong>de</strong> Sherbrooke : un déploiement<br />
par « contamination »<br />
30 / 44
Landry, Sylvain, HEC Montréal, sylvain.landry@hec.ca<br />
Chaussé, Sylvain, CHUS, schausse.chus@ssss.gouv.qc.ca<br />
Paris, Yvon, CHUS, yparis.chus@ssss.gouv.qc.ca<br />
Le Centre hospitalier universitaire <strong>de</strong> Sherbrooke (CHUS) a initié une démarche lean à<br />
l’automne 2005 et plus d’une trentaine <strong>de</strong> projets lean ont été réalisés <strong>de</strong>puis. Cet article<br />
décrit la démarche lean <strong>de</strong> cet établissement, construite au fil <strong>de</strong>s expériences et en mettant<br />
l’accent sur le caractère « contaminant » <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière. L’aventure lean au CHUS est<br />
décrite en trois phases, soit la phase <strong>de</strong> démarrage, la phase <strong>de</strong> consolidation et la phase<br />
d’expansion. L’analyse présentée à la suite du cas permet <strong>de</strong> comparer cette démarche à<br />
celles d’autres hôpitaux décrites dans la littérature et d’en i<strong>de</strong>ntifier les principaux défis.<br />
14h20 Ingénierie du changement dans le bloc opératoire comme paradigme du<br />
changement du système <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé<br />
Lahrichi, Nadia, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, nadia.lahrichi@polymtl.ca<br />
Troy, Philip, Hôpital Général Juif, phil@philtroy.com<br />
Vandal, Valérie, Hôpital Général Juif, vvandal@jgh.mcgill.ca<br />
Rosenberg, Lawrence, Hôpital Général Juif, lawrence.rosenberg@mcgill.ca<br />
Pour aligner l’activité opératoire <strong>de</strong> l’hôpital général juif avec l’évolution <strong>de</strong> la mission<br />
clinique <strong>de</strong> l'établissement et <strong>de</strong> se conformer aux temps d’attente cibles mandatés par le<br />
gouvernement, nous avons entrepris <strong>de</strong> réinventer totalement la chaîne <strong>de</strong> valeur en salle<br />
d'opération. Nous avons adopté une approche « système » basée sur la correspondance<br />
entre l’offre et la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en conjugaison à l’approche Lean et à la réingénierie <strong>de</strong>s<br />
processus internes liés à la circulation <strong>de</strong>s patients chirurgicaux.<br />
V2D Conception, organisation et pilotage <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers - I<br />
Salle : 2317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Sylvain Baril<br />
13h30 La collaboration <strong>de</strong>s familles au sein <strong>de</strong>s transformations du système <strong>de</strong><br />
santé mentale<br />
Lavoie-Tremblay, Melanie, Ecole <strong>de</strong>s Sciences Infirmieres Universite McGill,<br />
melanie.lavoie-tremblay@mcgill.ca<br />
Bonin, Jean-Pierre, Faculté <strong>de</strong>s sciences infirmières, Université <strong>de</strong> Montréal, jeanpierre.bonin@umontreal.ca<br />
Au Québec, <strong>de</strong>s changements majeurs dans la réorganisation <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> santé<br />
mentale sont en cours et l’on peut se questionner sur la situation <strong>de</strong>s familles <strong>de</strong> personnes<br />
atteintes <strong>de</strong> troubles mentaux et leur participation à l’implantation <strong>de</strong> ces transformations.<br />
Cette <strong>conférence</strong> présente les facteurs qui facilitent ou entravent l’implication et la<br />
collaboration <strong>de</strong>s familles au sein <strong>de</strong> ces transformations. Dans le cadre <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>vis mixte,<br />
573 familles ont complété un questionnaire et 54 d’entre eux ont participé à <strong>de</strong>s entrevues<br />
<strong>de</strong> groupes (2009-2011). Il ressort <strong>de</strong>s pistes d’actions à mettre en œuvre ciblant : 1) la<br />
confi<strong>de</strong>ntialité; 2) l’information; 3) l’accessibilité; 4) la reconnaissance <strong>de</strong>s organismes<br />
communautaires et 5) le rétablissement (empowerment <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’entourage).<br />
13h55 Gestion <strong>de</strong> l’information par le système <strong>de</strong> management <strong>de</strong> la qualité (SMQ)<br />
pour la prise <strong>de</strong> décision<br />
Barrijal, Said, Faculté <strong>de</strong>s sciences et techniques <strong>de</strong> Tanger, barrijal@yahoo.fr<br />
31 / 44
El idrissi, Hicham, Faculté <strong>de</strong>s sciences et techniques <strong>de</strong> Tanger, heidrissi@yahoo.fr<br />
Charif Chefchaouni, Al Montacer, Centre Hospitalier Ibn, chefchaouni@gmail.com<br />
Kerak, Ebrahim, Faculté <strong>de</strong>s sciences et techniques <strong>de</strong> Mohammedia, b.kerak@gmail.com<br />
Le SMQ ISO 9001 organise la collecte et la gestion <strong>de</strong> l’information au profit <strong>de</strong>s différents<br />
acteurs <strong>de</strong> l’organisation. Le gestionnaire s’y base pour prendre les décisions appropriées.<br />
Cependant, ses préférences et son environnement lui dictent, en matière d’information et <strong>de</strong><br />
prise <strong>de</strong> décision, un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> fonctionnement dont la compatibilité avec ceux explicités<br />
dans la norme reste à confirmer. Notre recherche consiste à apprécier la pertinence du<br />
retour d’information prévu par le SMQ pour le gestionnaire. A cette fin, nous avons choisis<br />
un modèle décrivant le travail du gestionnaire : Modèle <strong>de</strong> Mintzberg [Mintzberg, 2011].<br />
Ensuite, nous avons réalisé une lecture <strong>de</strong> la norme ISO 9001 [ISO, 2008] sur la base du<br />
canevas « Information / Prise <strong>de</strong> décision ». Ceci nous amena à discerner <strong>de</strong>s écarts qu’on<br />
évaluera dans le cadre d’une étu<strong>de</strong> par questionnaire.<br />
14h20 La simulation comme outil <strong>de</strong> validation <strong>de</strong> la conception <strong>de</strong>s services<br />
hospitaliers : le cas d’un bloc d’endoscopie au Québec<br />
Baril, Sylvain, CIM - Conseil en immobilisation & management inc., sbaril@cimconseil.qc.ca<br />
Moreno, Jenny, CIM - Conseil en immobilisation & management inc., jmoreno@cimconseil.qc.ca<br />
Cet article décrit comment les outils <strong>de</strong> simulation, accompagnés d’une démarche <strong>de</strong><br />
modélisation, permettent <strong>de</strong> soutenir la prise <strong>de</strong> décisions dans un contexte <strong>de</strong> validation <strong>de</strong><br />
la conception <strong>de</strong>s services dans le secteur <strong>de</strong> la santé. Cette approche permet notamment<br />
<strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r les capacités requises pour les différentes installations physiques, tout en<br />
réduisant les risques et les coûts associés à la réorganisation <strong>de</strong>s services (mo<strong>de</strong>rnisation<br />
<strong>de</strong>s installations, <strong>de</strong>s équipements et <strong>de</strong>s technologies, optimisation <strong>de</strong>s processus et <strong>de</strong>s<br />
ressources humaines, etc.).<br />
V3A La Transversalité : un maillon-clé <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s Services<br />
Cliniques<br />
Salle : 1317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nte : Françoise Paillassard<br />
14h50 Flux du patient : Impact du projet Gestion <strong>de</strong>s Flux sur les logiciels<br />
informatiques – interaction entre les logiciels<br />
Fontannaz, Dominique, Hôpital du Valais, dominique.fontannaz@hopitalvs.ch<br />
Del Bianco, Murielle, Hôpital du Valais , murielle.<strong>de</strong>l-bianco@hopitalvs.ch<br />
L’hôpital du Valais hospitalise 39'300 patients et assure 377'000 visites ambulatoires.<br />
Différents problèmes dans la gestion <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> patients ont été mis en exergue par le<br />
projet <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s flux : pas ou peu d’annonces, pas ou peu d’informations, pas ou peu<br />
<strong>de</strong> planification, responsabilités mal définies, pas d’organisation entre les divisions. Dans un<br />
1er temps, au niveau administratif, la mise en place d’un module <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s lits avec la<br />
gestion <strong>de</strong> mouvements prévisionnels, une structure <strong>de</strong> lits détaillées (lit réguliers – lits <strong>de</strong><br />
réserve) et <strong>de</strong>s statistiques d’occupation ont permis <strong>de</strong> résoudre une partie <strong>de</strong> ces carences.<br />
Au niveau clinique, le développement d’un formulaire <strong>de</strong> sortie et d’un tableau <strong>de</strong> transport<br />
et une interface <strong>de</strong> confirmation <strong>de</strong>s mouvements prévisionnels vers le système administratif<br />
constitue la 2ème étape en cours <strong>de</strong> réalisation. Dans un 3ème volet, la généralisation <strong>de</strong><br />
32 / 44
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’admission avec un agenda <strong>de</strong>s entrées par discipline facilitera l’échange<br />
d’information entre les différents intervenants impliqués dans la prise en charge d’un patient.<br />
15h15 Application <strong>de</strong> la Transversalité Organisationnelle <strong>de</strong> la Logistique 1<br />
Paillassard, Françoise, Expert conseil performance hospitalière,<br />
fr.paillassard@hotmail.com<br />
Charbonneau, Francine, Expert conseil performance hospitalière, charf@vi<strong>de</strong>otron.ca<br />
L’hôpital, structure très complexe dans sa pyrami<strong>de</strong> hiérarchique, ses multidisciplinarités<br />
professionnelles, ses disparités pathologiques, représente un défi gigantesque, pour qui<br />
veut comprendre, et en faciliter son exploitation. Le but <strong>de</strong> cet atelier, est <strong>de</strong> transgresser<br />
toutes les idées préconçues, que seules les <strong>de</strong>rnières technologies hospitalières pourront<br />
venir à bout d’un modèle d’organisation qui se voudrait parfait. La création « d’ateliers<br />
d’arrimage » entre différents services hospitaliers, a permis <strong>de</strong> mettre en oeuvre, la plus<br />
belle marche en avant, vers une performance hospitalière basée sur <strong>de</strong>s efforts humains, en<br />
ayant fédéré <strong>de</strong>s équipes autour d’un projet commun, et surtout d’une volonté d’aboutir à un<br />
« mieux-être » patients/RH, dans un quotidien hospitalier, mangeur d’énergie.<br />
15h40 Application <strong>de</strong> la Transversalité Organisationnelle <strong>de</strong> la Logistique 2<br />
Charbonneau, Francine, Expert conseil performance hospitalière, charf@vi<strong>de</strong>otron.ca<br />
Paillassard, Françoise, Expert conseil performance hospitalière,<br />
fr.paillassard@hotmail.com<br />
L’hôpital, structure très complexe dans sa pyrami<strong>de</strong> hiérarchique, ses multidisciplinarités<br />
professionnelles, ses disparités pathologiques, représente un défi gigantesque, pour qui<br />
veut comprendre, et en faciliter son exploitation. Le but <strong>de</strong> cet atelier, est <strong>de</strong> transgresser<br />
toutes les idées préconçues, que seules les <strong>de</strong>rnières technologies hospitalières pourront<br />
venir à bout d’un modèle d’organisation qui se voudrait parfait. La création « d’ateliers<br />
d’arrimage » entre différents services hospitaliers, a permis <strong>de</strong> mettre en oeuvre, la plus<br />
belle marche en avant, vers une performance hospitalière basée sur <strong>de</strong>s efforts humains, en<br />
ayant fédéré <strong>de</strong>s équipes autour d’un projet commun, et surtout d’une volonté d’aboutir à un<br />
« mieux-être » patients/RH, dans un quotidien hospitalier, mangeur d’énergie.<br />
V3B Gestion et planification <strong>de</strong>s activités et <strong>de</strong>s ressources<br />
Salle : 1325 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Patrick Soriano et Mélanie Lavoie-Tremblay<br />
14h50 Une métho<strong>de</strong> flexible et portable pour résoudre les problèmes d’horaires<br />
d’infirmières<br />
Crowe, Julien, HEC Montréal, julien.crowe@hec.ca<br />
Gendreau, Michel, École Polythecnique <strong>de</strong> Montréal, michel.gendrau@<strong>cirrelt</strong>.ca<br />
Soriano, Patrick, HEC Montréal, patrick.soriano@hec.ca<br />
Nous proposons une heuristique appelée CHAISE (Colonnes heuristiques pour horaires<br />
automatisés intégrées dans un système évolué) pour résoudre un large éventail <strong>de</strong><br />
problématiques <strong>de</strong> confection d’horaires dans le secteur <strong>de</strong> la santé. L’objectif <strong>de</strong> cette<br />
approche est <strong>de</strong> fournir aux établissements <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé un seul système qui puisse<br />
produire l’ensemble <strong>de</strong>s horaires <strong>de</strong> travail tout en requérant un nombre d’ajustements limité<br />
lors <strong>de</strong> la reconfiguration pour un autre département et/ou type d’emplois. Nous testons en<br />
profon<strong>de</strong>ur l’approche proposée sur <strong>de</strong>ux ensembles d’instances d’horaires <strong>de</strong> personnel<br />
infirmier : le premier est théorique et simule plusieurs cas, et le second est composé<br />
33 / 44
uniquement <strong>de</strong> cas réels précé<strong>de</strong>mment étudiés dans la littérature. Les résultats sont très<br />
satisfaisants sur les <strong>de</strong>ux ensembles d’instances.<br />
15h15 Hôpital promoteur <strong>de</strong> Santé : le défi mieux-être pour les employés<br />
Lavoie-Tremblay, Melanie, Ecole <strong>de</strong>s Sciences Infirmieres Universite McGill,<br />
melanie.lavoie-tremblay@mcgill.ca<br />
Sounan, Charles, Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill, Charles.sounan@muhc.mcgill.ca<br />
Martin, Kara, Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill, Kara.martin@muhc.mcgill.ca<br />
Créer un milieu <strong>de</strong> travail promoteur <strong>de</strong> santé est une priorité incontournable pour améliorer<br />
la qualité <strong>de</strong>s soins et l’efficience du système <strong>de</strong> santé. Une <strong>de</strong>s stratégies à considérer<br />
pour implanter avec succès <strong>de</strong>s milieux <strong>de</strong> travail sains est la promotion <strong>de</strong> l’activité<br />
physique / nutrition auprès <strong>de</strong>s employés. Dans ce contexte, un programme bien-être pour<br />
les travailleurs a été mis en place au Centre Universitaire <strong>de</strong> Santé McGill CUSM<br />
(subvention <strong>de</strong>s Instituts <strong>de</strong> recherche en santé du Canada). En septembre 2011, le<br />
programme Défi mieux être du CUSM a été lancé en partenariat avec le <strong>Programme</strong><br />
d’amélioration <strong>de</strong> la santé cardiovasculaire <strong>de</strong> McGill. Le programme, auquel 309<br />
participants se sont inscrits, consistait à porter un podomètre pendant huit semaines. Selon<br />
les résultats préliminaires <strong>de</strong> l’analyse qualitative <strong>de</strong>s entrevues individuelles (N = 13), les<br />
participants se sentent en meilleure santé à la suite <strong>de</strong> l’intervention et sont très motivés.<br />
L’analyse quantitative démontre une amélioration quant au stress, le niveau <strong>de</strong> fatigue et<br />
d’activité physique chez les participants. De plus, les participants sont davantage conscients<br />
<strong>de</strong>s habitu<strong>de</strong>s alimentaires saines et perçoivent la marche dans le milieu <strong>de</strong> travail comme<br />
une activité physique agréable, efficace et réalisable.<br />
V3C La place du LEAN – six sigma dans les démarches qualité et<br />
l’optimisation <strong>de</strong>s processus hospitaliers : expérimentation et<br />
potentiel - II<br />
Salle : 2307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>ntes : Elisabeth Raymakers et Brigitte Rorive Feytmans<br />
14h50 Analyse du traitement <strong>de</strong>s ordonnances (premières doses) dans une<br />
pharmacie d’hôpital par l’approche Lean.<br />
Baril, Chantal, Université du Québec à Trois-Rivières, chantal.baril@uqtr.ca<br />
Brouillette, Christel, Université du Québec à Trois-Rivières, christel.brouillette@uqtr.ca<br />
Suite à une étu<strong>de</strong> comparative <strong>de</strong> l’impact du système automatisé et robotisé <strong>de</strong> la<br />
distribution <strong>de</strong>s médicaments (SARDM) sur les étapes du circuit du médicament dans <strong>de</strong>ux<br />
centres <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong>s services sociaux (A et B) <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> la Mauricie et du Centredu-Québec,<br />
nous avions recommandé d’analyser plus en profon<strong>de</strong>ur le processus <strong>de</strong><br />
traitement <strong>de</strong>s ordonnances à la pharmacie du CSSS B afin <strong>de</strong> réduire le temps <strong>de</strong><br />
traitement <strong>de</strong>s ordonnances. Dans ce papier, nous présentons comment les principes du<br />
Lean management ont été utilisés pour améliorer le traitement <strong>de</strong>s premières doses dans<br />
une pharmacie d’hôpital. Nous discutons ensuite <strong>de</strong>s aspects méthodologiques du projet<br />
ainsi que <strong>de</strong> ses limites.<br />
15h15 Amélioration du processus <strong>de</strong> retraitement <strong>de</strong>s endoscopes : une intégration<br />
<strong>de</strong>s outils du génie industriel et <strong>de</strong> l’approche Lean.<br />
Côté, Nadine, UQTR, nadine.cote@uqtr.ca<br />
Baril, Chantal, Université du Québec à Trois-Rivières, chantal.baril@uqtr.ca<br />
34 / 44
Cartier, Stéphanie, UQTR, stephanie.cartier@uqtr.ca<br />
Suite à la publication d’une nouvelle édition <strong>de</strong> la norme concernant la décontamination <strong>de</strong>s<br />
dispositifs médicaux réutilisables, un centre hospitalier <strong>de</strong> la Mauricie, qui souhaitait<br />
améliorer ses processus dans l’optique <strong>de</strong> mieux satisfaire aux exigences <strong>de</strong> cette norme, a<br />
utilisé l’approche Lean et les outils du génie industriel pour réaliser un projet d’amélioration<br />
<strong>de</strong> la qualité. Ce papier présente la méthodologie et les outils utilisés pour conduire le projet<br />
Lean ainsi que les principaux résultats obtenus.<br />
15h40 Optimisation <strong>de</strong> la prise en charge <strong>de</strong>s patients dans un centre <strong>de</strong><br />
prélèvement hospitalier<br />
Fillée, Catherine, Cliniques universitaires St-Luc, catherine.fillee@uclouvain.be<br />
Philippe, Marianne, Cliniques universitaires St-Luc, marianne.philippe@uclouvain.be<br />
Raymakers, Elisabeth, Cliniques universitaires St-Luc, elisabeth.raymakers@uclouvain.be<br />
V3D Conception, organisation et pilotage <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers - II<br />
Salle : 2317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nte : Florence Hut<br />
14h50 Prévention <strong>de</strong> l’erreur médicamenteuse en gériatrie : Application <strong>de</strong> l’AMDEC<br />
au circuit du médicament<br />
Goubella, Fadma, Faculté Polytehnique/Université <strong>de</strong> Mons, fadmagoub@yahoo.fr<br />
Delvosalle, Christian, Faculté Polytehnique/Université <strong>de</strong> Mons,<br />
christian.<strong>de</strong>lvosalle@umons.ac.be<br />
El Hiki, Lahcen, Faculté Polytehnique/Université <strong>de</strong> Mons, lahcen.elhiki@umons.ac.be<br />
Les erreurs médicamenteuses étaient fréquemment évoquées dans le cadre <strong>de</strong> réunions <strong>de</strong><br />
« performance » menées au sein du service <strong>de</strong> Gériatrie d’un hôpital privé belge. De ce fait,<br />
il nous a semblé intéressant d’évaluer l’étendue <strong>de</strong> cette problématique sur base <strong>de</strong> la<br />
métho<strong>de</strong> AMDEC. Et ce, afin <strong>de</strong> réduire le risque d’erreur médicamenteux chez les<br />
personnes âgées hospitalisées dans le service. Dans ce papier, nous allons rapporter les<br />
types <strong>de</strong> défaillances relevés. Nous avons menés plusieurs réunions et avons répertorié 32<br />
facteurs <strong>de</strong> risques. Il apparaît que les étapes posant le plus <strong>de</strong> problèmes en termes <strong>de</strong><br />
fréquence et <strong>de</strong> gravité sont les phases <strong>de</strong> préparation et d’administration. De plus,<br />
comparativement aux données publiées, les résultats nous démontrent que parmi les<br />
actions d’amélioration proposées, la pharmacie clinique peut contribuer à réduire<br />
sensiblement le risque d’erreur et améliorer la détection <strong>de</strong> ces erreurs.<br />
15h15 Une nouvelle approche <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong>s quartiers opératoires : les<br />
sciences <strong>de</strong> la complexité<br />
Hut, Florence, CHU Brugmann, florence.hut@chu-brugmann.be<br />
Les quartiers opératoires sont considérés <strong>de</strong>puis longtemps comme les structures <strong>de</strong><br />
l'hôpital les plus difficiles à manager. Ils doivent respecter <strong>de</strong>s règles strictes <strong>de</strong><br />
fonctionnement liées à l’hygiène et à la sécurité mais sont en plus affectés par <strong>de</strong> multiples<br />
contraintes. En effet, c’est le lieu d’exercice principal <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s spécialités<br />
chirurgicales et ils se situent à l’interface <strong>de</strong> presque toutes les activités <strong>de</strong> l’hôpital. Les<br />
directions hospitalières ont pour souci principal d’optimiser leur efficience économique et <strong>de</strong><br />
rentabiliser l’utilisation <strong>de</strong> leur outil. Afin d’atteindre ces objectifs, les hôpitaux se sont<br />
tournés vers l’operating management. Les processus ont été décrits, <strong>de</strong>s solutions<br />
35 / 44
pragmatiques ont été développées comme l’implémentation <strong>de</strong> logiciels <strong>de</strong> gestion,<br />
l’exploitation <strong>de</strong> tableaux <strong>de</strong> bord, le recours à <strong>de</strong>s modèles d’ordonnancement <strong>de</strong>s<br />
interventions et la création <strong>de</strong> nouveaux profils <strong>de</strong> compétences. Ces tentatives améliorent<br />
certaines dynamiques mais leurs résultats restent aléatoires et actuellement peu validés. La<br />
réflexion amène à abor<strong>de</strong>r les problèmes sous un angle nouveau, celui <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> la<br />
complexité. Elles intègrent l'impossible maîtrise <strong>de</strong> l'organisation et l'acceptation qu'il existe<br />
une place centrale <strong>de</strong> l'action humaine dans le développement. Elles abor<strong>de</strong>nt l'incertitu<strong>de</strong><br />
sous l'angle d'une opportunité plutôt que dans une dynamique <strong>de</strong> lutte et plai<strong>de</strong>nt en faveur<br />
<strong>de</strong> l’idée que le centre <strong>de</strong> gravité n’est plus constitué par les règlements mais par l’intérêt<br />
collectif.<br />
16h10 Pause - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />
16h30 Conseil GISEH<br />
Salle : 1307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Alain Guinet<br />
Réservé aux membres du comité scientifique <strong>de</strong> Giseh.<br />
16h30 Jeux d'entreprise (CollaborAction)<br />
Salle : Terrasse FIÉSA (salle adjacente à l’Amphithéâtre IBM)<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Benoit Montreuil<br />
CollaborAction est un jeu d’apprentissage collectif, inventé en 2005 par le professeur Benoit<br />
Montreuil, qui permet <strong>de</strong> démontrer la puissance <strong>de</strong> collaborer en réseau <strong>de</strong> manière à<br />
maximiser la performance collective.<br />
18h30 Départ en autobus vers le restaurant Le Parlementaire, Assemblée<br />
nationale du Québec<br />
Ren<strong>de</strong>z-vous à la porte Ouest du pavillon Palasis-Prince (près <strong>de</strong> la table d’inscription).<br />
19h00 Cocktail, visite <strong>de</strong> l’Assemblée nationale du Québec, et dîner au<br />
restaurant Le Parlementaire.<br />
36 / 44
Samedi 01 septembre <strong>2012</strong><br />
09h00 Inscription, accueil et café matin - Atrium Pierre-H.-Lessard,<br />
pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />
S1A Approches et métho<strong>de</strong>s pour la modélisation et la gestion <strong>de</strong>s<br />
risques dans les organisations <strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> santé - I<br />
Salle : 1317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Didier Gourc, Fouad Riane et Clau<strong>de</strong> Pourcel<br />
09h30 Modèle <strong>de</strong> maitrise <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong>s processus définis par un Système <strong>de</strong><br />
management intégré et globale (SMIG) De la modélisation UML à<br />
l’implémentation d’un outil d’ai<strong>de</strong> à la décision pour le management <strong>de</strong>s<br />
risques QHSE<br />
Elouadi, Ab<strong>de</strong>lmajid, CHU ibn sina, elouadiqualitis@gmail.com<br />
Chefchaouni, Al Mountacer Charif, CHU ibn sina<br />
Barrijal, Said, Faculté <strong>de</strong>s sciences et techniques <strong>de</strong> Tanger, barrijal@yahoo.fr<br />
Rifai, Said, Ecole Supérieur <strong>de</strong> la technologie<br />
Face aux difficultés multiples rencontrées dans le fonctionnement <strong>de</strong> son système <strong>de</strong><br />
management et compte tenu d’enjeux stratégiques majeurs, le Centre Hospitalier Ibn Sina a<br />
fait le choix <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une reconfiguration <strong>de</strong> son Système <strong>de</strong> management, en<br />
s’appuyant sur une forte implication <strong>de</strong>s professionnels et sur un pilotage <strong>de</strong>s structures par<br />
les processus. L’objectif <strong>de</strong> cet article est <strong>de</strong> présenter un outil d’ai<strong>de</strong> au pilotage <strong>de</strong>s<br />
processus et maitrise <strong>de</strong>s risques QHSE. La méthodologie retenue, axée sur la modélisation<br />
<strong>de</strong>s processus, s’inscrit dans un environnement propice : la certification ISO 9001 v2008<br />
d’un laboratoire <strong>de</strong> biologie médicale et <strong>de</strong>ux pharmacies et la volonté <strong>de</strong> migrer avec le<br />
même dispositif organisationnel vers d’autres structures médico-techniques et clinique. De<br />
cette méthodologie résulte un méta modèle du modèle conceptuel <strong>de</strong>s processus<br />
génériques mettant en évi<strong>de</strong>nce principalement les concepts <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> la<br />
prestation, <strong>de</strong> la santé et sécurité du personnel et <strong>de</strong> l’environnement /processus, <strong>de</strong><br />
diagnostic <strong>de</strong>s non conformités et risques QHSE /processus, et <strong>de</strong> suivi d’actions<br />
correctives et préventives pour remédier a ces non conformités.<br />
09h55 Analyse exploratoire à l’utilisation du taux <strong>de</strong> réadmission comme indicateur<br />
<strong>de</strong> qualité<br />
Beguin, Claire, Cliniques Universitaires Saint Luc, claire.beguin@uclouvain.be<br />
Luyckx, Anne, Cliniques Universitaires Saint Luc, anne.luyckx@uclouvain.be<br />
Regout, Sabine, Cliniques Universitaires Saint Luc, sabine.regout@uclouvain.be<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce travail est une analyse exploratoire préalable à l’utilisation du taux <strong>de</strong><br />
réadmission comme indicateur <strong>de</strong> qualité et comme incitant à la réflexion sur la qualité. Il<br />
analyse le nombre d’hospitalisations <strong>de</strong>s patients dans un même hôpital et essaie <strong>de</strong><br />
déterminer le profil <strong>de</strong>s patients ré-hospitalisés à partir <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données<br />
administratives <strong>de</strong> l’hôpital, à savoir les résumés hospitaliers minimaux (RHM). L’étu<strong>de</strong> porte<br />
sur les hospitalisations <strong>de</strong> 2009 et 2010 dans un hôpital universitaire général. Pour chaque<br />
patient, le nombre d’hospitalisations au cours <strong>de</strong> ces 2 années a été calculé. L’impact <strong>de</strong><br />
différents facteurs présents lors du premier séjour hospitalier a été étudié. L’analyse se<br />
concentre ensuite sur quelques aspects particuliers, à savoir le nombre d’hospitalisations<br />
37 / 44
chez les patients atteints <strong>de</strong> pathologies cancéreuses, <strong>de</strong> décompensation cardiaque ou <strong>de</strong><br />
complications <strong>de</strong> soins mais également en fonction du service dans lequel le patient est<br />
hospitalisé. En conclusion, pour être un indicateur <strong>de</strong> qualité utile, le taux <strong>de</strong> réadmission<br />
<strong>de</strong>vra être défini pour chaque spécialité médicale.<br />
S1B Problèmes <strong>de</strong> transport dans les systèmes hospitaliers<br />
Salle : 1325 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nte : Viviane Gascon<br />
09h30 Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> stratégies <strong>de</strong> redéploiement pour une flotte <strong>de</strong> véhicules<br />
ambulanciers par simulation<br />
Bélanger, Valérie, CIRRELT, valerie.3.belanger@hec.ca<br />
Kergosien, Yannick, CIRRELT, yannick.kergosien@gmail.com<br />
Ruiz, Angel, Université Laval, angel.ruiz@fsa.ulaval.ca<br />
Soriano, Patrick, CIRRELT, patrick.soriano@hec.ca<br />
Les services préhospitaliers d’urgence sont quotidiennement confrontés à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
service incertaines. L’état du système est donc amené à évoluer <strong>de</strong> façon imprévisible et<br />
<strong>de</strong>s correctifs ponctuels sont parfois nécessaires afin <strong>de</strong> maintenir un service adéquat à la<br />
population. Le redéploiement <strong>de</strong>s véhicules d’urgence fait partie <strong>de</strong> ces mesures. Cette<br />
étu<strong>de</strong> présente donc une analyse <strong>de</strong> différentes stratégies <strong>de</strong> redéploiement par simulation.<br />
Elle vise à comparer certaines stratégies <strong>de</strong> redéploiement dans un contexte présentant<br />
différents niveaux <strong>de</strong> congestion.<br />
09h55 Problème <strong>de</strong> tournées à séquence fixée pour la livraison <strong>de</strong> préparations <strong>de</strong><br />
chimiothérapies<br />
Kergosien, Yannick, HEC Montréal, yannick.kergosien@<strong>cirrelt</strong>.ca<br />
Lenté, Christophe, Université <strong>de</strong> Tours, christophe.lente@univ-tours.fr<br />
Billaut, Jean-Charles, Université <strong>de</strong> Tours, jean-charles.billaut@univ-tours.fr<br />
Soukhal, Ameur, Université <strong>de</strong> Tours, ameur.soukhal@univ-tours.fr<br />
Tournamille, Jean-François, CHRU <strong>de</strong> Tours, jf.tournamille@chu-tours.fr<br />
L'Unité <strong>de</strong> Biopharmacie Clinique et Oncologique (UBCO) est un service du CHRU <strong>de</strong> la<br />
ville Tours (France), qui a pour mission <strong>de</strong> réaliser les préparations <strong>de</strong> chimiothérapies<br />
(médicaments anticancéreux) et <strong>de</strong> les livrer aux infirmières <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> soins pour<br />
l'administration aux patients. Comme ces services sont éparpillés au sein d'un vaste<br />
complexe hospitalier, une personne est dédiée à leur livraison, parfois à l'ai<strong>de</strong> d'un véhicule.<br />
L'objectif <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est <strong>de</strong> proposer une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> planification <strong>de</strong>s tournées <strong>de</strong><br />
livraison contraintes par l'ordre dans lequel les préparations sont produites en amont.<br />
10h20 Analyse et résolution d'une problématique <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>s usagers âgés<br />
vers un centre <strong>de</strong> jour<br />
Gascon, Viviane, Université du Québec à Trois-Rivières, gascon@uqtr.ca<br />
Nous présentons le cas d’un centre <strong>de</strong> jour rattaché à un centre <strong>de</strong> santé public qui accueille<br />
quotidiennement <strong>de</strong>s personnes âgées pour leur offrir diverses activités. La plupart <strong>de</strong>s<br />
usagers bénéficiant <strong>de</strong> ces services sont transportés par autobus ou par taxi vers le centre.<br />
Les tournées <strong>de</strong>s autobus peuvent être apparentées aux tournées <strong>de</strong> véhicules avec<br />
contraintes additionnelles. Dans cet article, nous analysons la situation qui prévalait au<br />
38 / 44
moment <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> ainsi que les coûts <strong>de</strong> transport. Les approches utilisées pour réorganiser<br />
le transport <strong>de</strong>s usagers sont également présentées.<br />
S1C Échange, Partage et exploitation <strong>de</strong> l’information médicale<br />
distribuée<br />
Salle : 2307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Wi<strong>de</strong>d Guédria, Cédric Pruski, Yannick Nau<strong>de</strong>t et Elyes Lamine<br />
09h30 GINSENG, une infrastructure <strong>de</strong> grille au service <strong>de</strong> l’e-santé et <strong>de</strong><br />
l’épidémiologie<br />
Cipière, Sébastien, CNRS LPC, sebastien.cipiere@gmail.com<br />
De Vlieger, Paul, Clermont Université, Université Blaise Pascal, vlieger@moniut.univbpclermont.fr<br />
Gaspard, Sébastien, MAAT France, GNUBILA Group, Argonay, F-74370,<br />
sgaspard@maatg.fr<br />
Manset, David, MAAT France, GNUBILA Group, Argonay, F-74370, dmanset@maatg.fr<br />
Revillard, Jérôme, MAAT France, GNUBILA Group, Argonay, F-74370, jrevillard@maatg.fr<br />
Sarramia, David, CNRS/IN2P3, UMR 6533, LPC, F-63177, sarramia@clermont.in2p3.fr<br />
Hill, David R.C., UBP LIMOS ISIMA, david.hill@univ-bpclermont.fr<br />
Maigne, Lydia, CNRS/IN2P3, UMR 6533, LPC, F-63177, maigne@clermont.in2p3.fr<br />
Le projet GINSENG a pour but <strong>de</strong> mettre en place une infrastructure <strong>de</strong> grille pour l’e-santé<br />
et l’épidémiologie en Auvergne. Il s’agit <strong>de</strong> mettre en réseau <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données<br />
médicales distribuées <strong>de</strong> manière sécurisée afin <strong>de</strong> pouvoir les interroger et obtenir <strong>de</strong>s<br />
informations statistiques pour <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s épidémiologiques. L’objectif étant <strong>de</strong> décentraliser<br />
au maximum les données médicales et bénéficier <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> grille informatique<br />
pour la mise en place <strong>de</strong> l’infrastructure. Les sites médicaux participant au projet se<br />
rassemblent autour <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux thématiques médicales : le suivi <strong>de</strong>s cancers (plus<br />
particulièrement les cancers suivis dans le cadre d’un dépistage organisé) et les soins<br />
périnataux (11 maternités). Dans chaque site médical est déployé un serveur disposant <strong>de</strong>s<br />
services <strong>de</strong> grille sur lequel est dupliquée la base <strong>de</strong> données médicale. La solution adoptée<br />
permet un haut niveau <strong>de</strong> sécurité, <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ntialité, <strong>de</strong> disponibilité, et <strong>de</strong> tolérance aux<br />
fautes. Les requêtes effectuées sur les bases <strong>de</strong> données médicales distribuées sont<br />
réalisées via un portail web sécurisé. Les requêtes utilisent pour effectuer leurs calculs le<br />
logiciel R en mo<strong>de</strong> distribué via <strong>de</strong>s services webs. Le service <strong>de</strong> santé publique bénéficie<br />
<strong>de</strong> cette infrastructure informatique pour la veille sanitaire, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s épidémiologiques<br />
plus spécifiques et l’évaluation <strong>de</strong>s pratiques médicales.<br />
09h55 L’informatisation du dossier <strong>de</strong> santé du patient et l’accès aux stagiaires et<br />
aux intérimaires<br />
Simon, Isabelle, CHU Liège, i.simon@chu.ulg.ac.be<br />
Boulanger, Jean-Marie, CHU Liège, jmboulanger@chu.ulg.ac.be<br />
Schney<strong>de</strong>rs, Michel, CHU Liège, michel.scnhey<strong>de</strong>rs@chu.ulg.ac.be<br />
Dumont, Ghislaine, CHU Liège, ghislaine.dumont@chu.ulg.ac.be<br />
Raze, Michel, CHU Liège, michel.raze@chu.ulg.ac.be<br />
Menager, Denis, CHU Liège, <strong>de</strong>nis.menager@chu.ulg.ac.be<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Lejeune, Christophe, CHU Liège, christophe.lejeune@chu.ulg.ac.be<br />
Akafomo, Valère, CHU Liège, vakafomo@chu.ulg.ac.be<br />
Louis, Pol, CHU Liège<br />
39 / 44
L’informatisation du dossier <strong>de</strong> santé <strong>de</strong>s patients pose la question <strong>de</strong> l’accès à divers<br />
intervenants qui ne font pas partie du personnel, comme les stagiaires et les intérimaires. Il<br />
est essentiel d’i<strong>de</strong>ntifier ces groupes <strong>de</strong> personnes afin <strong>de</strong> mettre en place une stratégie <strong>de</strong><br />
prise en charge adéquate. Les accès concernés sont souvent limités dans le temps mais<br />
concernent <strong>de</strong>s groupes importants <strong>de</strong> personnes. Le CHU <strong>de</strong> Liège (Belgique) met en<br />
place une stratégie intégrant la gestion <strong>de</strong>s droits d’accès et la formation <strong>de</strong> ces<br />
intervenants extérieurs.<br />
10h20 Contribution à l’évaluation du potentiel d’interopérabilité dans le domaine <strong>de</strong><br />
santé au Luxembourg<br />
Bouzid, Hanan, CRP HENRI TUDOR, hanan.bouzid@tudor.lu<br />
Guédria, Wi<strong>de</strong>d, CRP HENRI TUDOR, wi<strong>de</strong>d.guedria@tudor.lu<br />
Nau<strong>de</strong>t, Yannick, CRP HENRI TUDOR, yannick.nau<strong>de</strong>t@tudor.lu<br />
L’interopérabilité dans le domaine <strong>de</strong> la santé est une formalité obligatoire pour pouvoir<br />
améliorer la qualité <strong>de</strong>s soins et la prise en charge <strong>de</strong>s patients. Dans ce contexte, les<br />
institutions <strong>de</strong> santé doivent résoudre les problèmes d'interopérabilité ou les prévenir, et ce,<br />
en adaptant les bonnes pratiques d’interopérabilité. Ce papier propose d’une part une<br />
analyse différentielle par rapport aux objectifs visés par le ministère <strong>de</strong> la santé<br />
luxembourgeois en termes d’interopérabilité, et d’autre part une évaluation du potentiel<br />
d'interopérabilité d’une institution <strong>de</strong> santé en particulier, en utilisant comme métho<strong>de</strong>, le<br />
modèle <strong>de</strong> maturité MMEI (Maturity Mo<strong>de</strong>l for Enterprise Interoperability). Le but étant<br />
d’avoir une première ébauche sur les problèmes possibles d’interopérabilité et leurs<br />
solutions éventuelles dans le domaine <strong>de</strong> la santé.<br />
S1D De la signalétique patient à la qualité du dossier médical : les<br />
enjeux <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ntialité et <strong>de</strong> déontologie<br />
Salle : 2317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Philippe Kolh et Stéphanie Leroy<br />
09h30 L’accès au Registre national <strong>de</strong>s Personnes Physiques en Belgique, un outil<br />
qui garantit la fiabilité <strong>de</strong>s données signalétiques <strong>de</strong>s patients à l’hôpital<br />
Jansen, Brigitte, CHU Liège, b.jansen@chu.ulg.ac.be<br />
Leroy, Stéphanie, CHU Liège, stephanie.leroy@chu.ulg.ac.be<br />
Louis, Pol, CHU Liège<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Le C.H.U <strong>de</strong> Liège gère une activité considérable, tant en hospitalisation qu’en policliniques,<br />
qui implique la gestion d’un volumineux fichier <strong>de</strong>s patients, soit 1.190.000 actifs au 15<br />
février <strong>2012</strong>. L’institution met en place un dossier médical électronique <strong>de</strong>puis le 1er<br />
septembre 2004. Dans ce contexte, il est impératif que chaque patient soit correctement<br />
i<strong>de</strong>ntifié, toute erreur étant préjudiciable et pouvant avoir <strong>de</strong>s conséquences extrêmement<br />
graves sur le plan médical. Le C.H.U. actualise régulièrement la base <strong>de</strong> données<br />
signalétiques <strong>de</strong>s patients afin d’éviter :<br />
- qu’une même personne soit enregistrée à plusieurs reprises dans le système ;<br />
- que <strong>de</strong>s informations incomplètes ou erronées compromettent l’i<strong>de</strong>ntification du patient ;<br />
- <strong>de</strong> confondre <strong>de</strong>s patients.<br />
Parallèlement, aux actions entreprises (élaboration <strong>de</strong> nouvelles règles d’encodage <strong>de</strong>s<br />
données signalétiques <strong>de</strong>s patients, formations du personnel à l’uniformisation <strong>de</strong> cet<br />
encodage, mise en place d’une cellule chargée <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> la signalétique<br />
patients, mise en place d’une procédure <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong>s doublons...), le CHU a jugé<br />
40 / 44
indispensable <strong>de</strong> pouvoir accé<strong>de</strong>r au Registre National <strong>de</strong>s Personnes Physiques, seule<br />
base fiable <strong>de</strong> données à caractère privé en Belgique.<br />
09h55 Le contrôle <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> communication électroniques en réseau : un outil<br />
au service <strong>de</strong> la sécurité et <strong>de</strong> la confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong>s données à caractère<br />
personnel<br />
Dumont, Ghislaine, CHU Liège, Ghislaine.Dumont@chu.ulg.ac.be<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Bonnet, Fabienne, CHU Liège<br />
Louis, Pol, CHU Liège<br />
Au cours <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières années, les moyens <strong>de</strong> communication électroniques se sont<br />
largement développés dans le milieu professionnel. Le support électronique constitue en<br />
effet un avantage en termes <strong>de</strong> disponibilité <strong>de</strong> l’information. Outre les emails et les<br />
connexions internet, la plupart <strong>de</strong>s informations à caractère strictement professionnel sont<br />
gérées par <strong>de</strong>s applications informatiques fonctionnant en réseau au sein <strong>de</strong> l’hôpital. Parmi<br />
ces informations figurent notamment les données à caractère personnel relatives aux<br />
patients <strong>de</strong> l’hôpital. Depuis 2003, le Centre Hospitalier Universitaire <strong>de</strong> Liège s’est engagé<br />
dans l’informatisation du dossier médical afin d’améliorer la prise en charge <strong>de</strong>s patients.<br />
L’emploi <strong>de</strong> ce nouveau média en milieu hospitalier nécessite toutefois <strong>de</strong>s efforts constants<br />
sur le plan technique et organisationnel et doit répondre aux normes légales qui régissent le<br />
traitement <strong>de</strong> données à caractère personnel ainsi que les droits et <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong>s utilisateurs<br />
eux-mêmes. C’est ainsi que <strong>de</strong>s contrôles sont menés sur les données <strong>de</strong> communication<br />
électroniques en réseau. Ceux-ci s’expliquent par la spécificité <strong>de</strong> l’Institution, le caractère<br />
sensible <strong>de</strong>s données traitées ainsi que par la gestion même du système informatique.<br />
10h20 L’i<strong>de</strong>ntito-vigilance : comparaison d’une mise en œuvre concrète belge par<br />
rapport aux exigences françaises dans le cadre <strong>de</strong> la certification<br />
Leroy, Stéphanie, CHU Liège, stephanie.leroy@chu.ulg.ac.be<br />
Jansen, Brigitte, CHU Liège, b.jansen@chu.ulg.ac.be<br />
Waseige, Eric, CHU Liège<br />
Louis, Pol, CHU Liège<br />
Gillet, Pierre, CHU Liège, Pierre.gillet@chu.ulg.ac.be<br />
Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />
Sécuriser le parcours hospitalier d’un patient commence par une bonne i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong><br />
celui-ci. Il en va <strong>de</strong> la qualité et <strong>de</strong> la sécurité <strong>de</strong>s soins dispensés. Instaurer dans une<br />
institution <strong>de</strong>s procédures concernant cet objectif peut paraître élémentaire mais est<br />
fondamental afin <strong>de</strong> sécuriser l’i<strong>de</strong>ntification du patient à toutes les étapes <strong>de</strong> sa prise en<br />
charge. L’apparition <strong>de</strong>s systèmes informatiques intégrés renforce cette nécessaire<br />
i<strong>de</strong>ntification unique et univoque. Le terme d’ « i<strong>de</strong>ntitovigilance » désigne ainsi un nouveau<br />
champ d’action <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s risques. Ce terme est retrouvé notamment en France,<br />
dans la mouvance <strong>de</strong> la certification <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong>s recommandations<br />
<strong>de</strong> la HAS (Haute Autorité <strong>de</strong> Santé). Nous comparerons ainsi un cas pratique, le CHU <strong>de</strong><br />
Liège, qui a mis en place en 2006 une structure organisée autour <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité<br />
du patient, par rapport aux recommandations <strong>de</strong> la HAS, dans la version 2010, révision<br />
2011, <strong>de</strong> son manuel qualité.<br />
41 / 44
10h45 Pause - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />
S2A Approches et métho<strong>de</strong>s pour la modélisation et la gestion <strong>de</strong>s<br />
risques dans les organisations <strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> santé - II<br />
Salle : 1317 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Didier Gourc, Fouad Riane et Clau<strong>de</strong> Pourcel<br />
11h10 Application d’une nouvelle métho<strong>de</strong> d’analyse du risque pour une meilleure<br />
prise en charge <strong>de</strong>s patients sous chimiothérapie : la métho<strong>de</strong> FRAM<br />
Cri<strong>de</strong>lich, Cécile, Université <strong>de</strong> Nice, cecile.cri<strong>de</strong>lich@unice.fr<br />
Rigaud, Eric, MINES ParisTech, CRC<br />
Malléa, Patrick, EA Cobtek<br />
Guérin, Olivier, Université <strong>de</strong> Nice<br />
Collomp, Rémy, Centre Hospitalier Universitaire <strong>de</strong> Nice<br />
Le secteur <strong>de</strong> la santé en France fait régulièrement l’objet <strong>de</strong> réformes qui ont pour objectif<br />
d’optimiser la prise en charge <strong>de</strong>s patients grâce à une amélioration <strong>de</strong> la sécurisation du<br />
système sanitaire, tout en <strong>de</strong>vant tenir compte <strong>de</strong>s contraintes économiques. Cependant, ce<br />
n’est que très récemment, bien <strong>de</strong>s années après les Etats-Unis, qu’une véritable prise <strong>de</strong><br />
conscience a eu lieu chez les différents acteurs, positionnant désormais la sécurité du<br />
patient comme une priorité nationale. Les efforts portent notamment sur la réduction <strong>de</strong>s<br />
évènements iatrogènes graves évitables, dont une <strong>de</strong>s sources principales est représentée<br />
par la prise en charge médicamenteuse. Dans le domaine hospitalier, <strong>de</strong> nombreuses<br />
métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques validées existent et leur utilisation est recommandée par la<br />
Haute Autorité <strong>de</strong> Santé. Elles présentent certaines limites, ne prenant pas ou peu en<br />
compte certains facteurs comme notamment les facteurs organisationnels et humains alors<br />
qu’ils interviennent <strong>de</strong> manière importante dans la survenue <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts et au sein <strong>de</strong>s<br />
systèmes actuels, <strong>de</strong> plus en plus complexes. Parallèlement, plusieurs méthodologies<br />
intégrant ces facteurs existent et commencent à être utilisées dans différents secteurs, mais<br />
elles n’ont pas encore été évaluées dans le domaine <strong>de</strong> la santé. C’est notamment le cas<br />
d’une métho<strong>de</strong>, nommée Functional Resonance Analysis Method (FRAM), que nous avons<br />
souhaité appliquer dans le cadre d’une <strong>de</strong>s prises en charge médicamenteuses les plus<br />
complexes : la prise en charge <strong>de</strong>s patients par chimiothérapie anticancéreuse.<br />
11h35 Modélisation <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers : proposition d’une étu<strong>de</strong><br />
comparative <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> modélisation<br />
Rabai, Haifa, Ecole <strong>de</strong>s mines d'albi Carmaux, hrabai@mines-albi.fr<br />
Gourc, Didier, CGI - EMAC, didier.gourc@enstimac.fr<br />
Basti<strong>de</strong>, Rémi, ISIS, remi.basti<strong>de</strong>@gmail.fr<br />
Lamine, Elyes, ISIS, elyes.lamine@gmail.com<br />
Nous proposons dans cet article une étu<strong>de</strong> comparative <strong>de</strong>s logiciels <strong>de</strong> modélisation<br />
d’entreprise dans le cadre <strong>de</strong> la modélisation <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> la prise en charge<br />
à domicile. La complexité <strong>de</strong> ces systèmes requiert l’utilisation d’une bonne modélisation<br />
facilitant la compréhension du fonctionnement <strong>de</strong> l’organisation. Dans ce cadre, il importe <strong>de</strong><br />
rappeler la diversité <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> modélisation existants. Dans le but <strong>de</strong><br />
choisir un logiciel <strong>de</strong> modélisation pour modéliser le processus <strong>de</strong> la prise en charge <strong>de</strong>s<br />
patients à domicile, nous proposons dans cet article un recueil <strong>de</strong> fonctionnalités qui<br />
peuvent être offertes par les logiciels <strong>de</strong> modélisation et que nous jugeons pertinentes pour<br />
42 / 44
épondre au mieux aux besoins <strong>de</strong> cette modélisation. Sur la base <strong>de</strong> ces critères, nous<br />
présenterons une analyse comparative <strong>de</strong> ces logiciels <strong>de</strong> modélisation.<br />
S2B Modélisation<br />
Salle : 1325 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Chantal Baril et Michel Gourgand<br />
11h10 Modèles génériques <strong>de</strong> simulation <strong>de</strong> la chaine logistique médicamenteuse du<br />
système hospitalier marocain<br />
Ouzayd, Fatima, ENSEM, ouzayd@gmail.com<br />
Saadi, Janah, ENSEM, janah.saadi@gmail.com<br />
Benhra, Jamal, ENSEM, jbenhra@ensem.ac.ma<br />
Hospital mission’s is to insure patient safety and quality of care associated with any medical<br />
processor. Among to provi<strong>de</strong> performance hospitals processors is supply medicine drugs<br />
chain. Mo<strong>de</strong>ling and simulating is an excellent tool that allows un<strong>de</strong>rstanding this complexity<br />
and analyzing performances. In this paper, we propose a simulation mo<strong>de</strong>l with Unified<br />
Mo<strong>de</strong>ling Language (UML) and Colored Petri Net (CPN) on Supply Medicine Drugs Chain.<br />
Being based on these mo<strong>de</strong>ls, we present a simulating Queue Patient mo<strong>de</strong>l with CPN<br />
Tools which will allow some statistics measures.<br />
11h35 Prédiction <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> séjour post-opératoire à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la distribution<br />
phase-type<br />
Dorval, Valérie, Université Laval, valerie.dorval.1@ulaval.ca<br />
Ruiz, Angel, Université Laval, Angel.Ruiz@fsa.ulaval.ca<br />
Soriano, Patrick, HEC Montréal, patrick.soriano@hec.ca<br />
Les lits d’hospitalisation post-chirurgicaux constituent une ressource limitée dans le système<br />
hospitalier québécois. Dans le but <strong>de</strong> modéliser la durée <strong>de</strong> séjour post-opératoire <strong>de</strong><br />
patients en orthopédie, et ainsi étudier différentes stratégies <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> cette ressource,<br />
plusieurs métho<strong>de</strong>s sont présentées. Celle qui a retenue plus particulièrement notre<br />
attention est la distribution phase-type, basée sur la théorie chaînes <strong>de</strong> Markov.<br />
S2C Le modèle hôpital-entreprise est-il adapté à la mé<strong>de</strong>cine<br />
mo<strong>de</strong>rne?<br />
Salle : 2307 (PAP)<br />
Prési<strong>de</strong>nts : Daniel Gillain, Philippe Kolh et André Le Maire<br />
11h10 Systèmes <strong>de</strong> formation et systèmes <strong>de</strong> soins : quelques réflexions vers une<br />
fertilisation croisée<br />
Guinet, Alain, INSA <strong>de</strong> Lyon et DISP, alain.guinet@insa-lyon.fr<br />
Dans un mon<strong>de</strong> qui favorise le profit immédiat à l’instar du bien-être <strong>de</strong>s générations futures,<br />
les systèmes <strong>de</strong> production <strong>de</strong> biens et <strong>de</strong> services s’affrontent dans une course à la<br />
rentabilité. Les valeurs telles la préservation <strong>de</strong>s ressources naturelles ou le développement<br />
social <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong> leur milieu, ne sont uniquement considérées que pour mieux<br />
combattre la concurrence. Seuls <strong>de</strong>ux secteurs <strong>de</strong> l’économie échappent encore<br />
partiellement à ce phénomène : la santé et l’enseignement. Ils représentaient 20% du PIB<br />
43 / 44
français en 2008. Ils ont en commun le fait qu’ils interviennent tous <strong>de</strong>ux sur l’humain en<br />
employant majoritairement <strong>de</strong>s ressources humaines dans le cadre d’un métier humaniste.<br />
Beaucoup <strong>de</strong> travaux sur le pilotage ont étudié durant ces dix <strong>de</strong>rnières années le domaine<br />
<strong>de</strong> la production <strong>de</strong>s soins, peu <strong>de</strong> travaux ont investi le domaine <strong>de</strong> la formation hormis<br />
l’évaluation <strong>de</strong>s structures et <strong>de</strong>s acteurs. Il serait intéressant <strong>de</strong> réfléchir à la possibilité <strong>de</strong><br />
réutiliser les connaissances acquises pour le pilotage <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> production <strong>de</strong> soins<br />
à une meilleure gouvernance <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> formation et inversement. En comparant ces<br />
<strong>de</strong>ux systèmes en termes d’acteurs, <strong>de</strong> métiers, <strong>de</strong> processus et d’organisations, cet article<br />
présente une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité <strong>de</strong> ce questionnement.<br />
12h00 Repas - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />
44 / 44