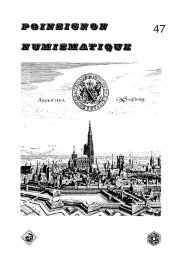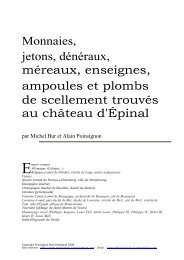Les monnaies du tresor de colmar - Poinsignon Numismatique
Les monnaies du tresor de colmar - Poinsignon Numismatique
Les monnaies du tresor de colmar - Poinsignon Numismatique
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
103). Deux autres <strong>de</strong>niers alsaciens sont <strong>de</strong> provenance moins assurée: le premier a été<br />
attribué à l'abbaye <strong>de</strong> Wissembourg (n° 104) et le second reste indéterminé (n° 105). Plusieurs <strong>de</strong><br />
ces <strong>monnaies</strong> posent un problème particulier : certaines séries ont en effet été frappées soit avec<br />
<strong>de</strong>ux coins, soit avec un seul. Quand <strong>de</strong>ux coins ont été utilisés, cela est peu visible : le coin <strong>de</strong><br />
revers gravé avec peu <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur laisse peu <strong>de</strong> traces i<strong>de</strong>ntifiables. Quand un seul coin<br />
est utilisé, il faut parler alors <strong>de</strong> bractéate.<br />
Plus <strong>de</strong> 90% <strong>de</strong>s <strong>monnaies</strong> <strong>du</strong> trésor <strong>de</strong> Colmar appartiennent à cette catégorie fort<br />
particulière : les bractéates sont <strong>de</strong>s <strong>monnaies</strong> extrêmement légères (souvent moins <strong>de</strong><br />
0,30 g), frappées avec un seul coin, dont le type s'empreint en relief au droit et en creux au<br />
revers, <strong>du</strong> fait même <strong>de</strong> la minceur <strong>du</strong> flan. Ces <strong>monnaies</strong> sont souvent frappées plusieurs à<br />
la fois, une pile <strong>de</strong> flans recevant l'empreinte <strong>du</strong> coin unique : évi<strong>de</strong>mment le relief <strong>de</strong> la<br />
pièce la plus éloignée <strong>du</strong> coin est alors assez mou. Ces <strong>monnaies</strong> portent peu <strong>de</strong> légen<strong>de</strong>s,<br />
souvent ré<strong>du</strong>ites à quelques lettres, et leur i<strong>de</strong>ntification n'est pas toujours commo<strong>de</strong>. Leur<br />
datation reste également fréquemment très incertaine.<br />
Seules quatre <strong>de</strong> ces bractéates ont été émises à Colmar même : une est au type <strong>de</strong> la<br />
colombe (n° 82, fig. 52), et trois sont au type <strong>de</strong> l'aigle (n° 83-85). <strong>Les</strong> autres ateliers sont<br />
tous situés sur le Rhin ou à proximité, <strong>du</strong> lac <strong>de</strong> Constance à la région <strong>de</strong> Strasbourg, à<br />
l'exception d'Erfurt (n° 139) et d'Ulm (n° 71 et 172) : en Allemagne, quatre ateliers<br />
incertains <strong>du</strong> Brisgau (n° 120-132), Constance (n° 134-138), Fribourg-en-Brisgau<br />
(n° 140-145), Lindau (n° 158-161), Offenbourg (n ° 162), Rottweil (n o 163), Tiengen (n° 164<br />
et 165) et Uberlingen (n° 166-170); en Suisse, Bâle (n° 173-304, 428), Berne (n° 305-<br />
309), Burgdorf (n o 310), Laufenbourg (n° 311-373), l’abbaye <strong>de</strong> Saint-Gall (n° 374-377),<br />
Schaffhouse (n° 378-380), Soleure (n° 381-392), Zofingen (n° 146, 393-409) et le couvent <strong>de</strong><br />
Zurich (n° 410-427). La nombreuse série <strong>de</strong>s bractéates <strong>de</strong> l'évêché <strong>de</strong> Bâle s'interrompt pendant<br />
l'épiscopat <strong>de</strong> Jean II <strong>de</strong> Münsingen (1335-1365), avant l'émission <strong>de</strong>s bractéates avec BA, qui est<br />
datée <strong>de</strong> 1340-1349.<br />
La monnaie qui nous donne le terminus post quem <strong>du</strong> trésor <strong>de</strong> Colmar, la date après<br />
laquelle il a été enfoui, est fort curieusement, et malgré son origine lointaine, la seule monnaie<br />
d'or, le florin <strong>de</strong> Hongrie, qui est daté <strong>de</strong> 1342-1353. Même si certaines <strong>de</strong>s bractéates présentes<br />
dans le trésor <strong>de</strong> Colmar ont parfois été datées <strong>de</strong> 1360, <strong>de</strong> 1370, <strong>de</strong> la fin <strong>du</strong> XIVe siècle, ou<br />
même <strong>de</strong> 1395-1411, il semble que l'on ne puisse pas s'éloigner <strong>de</strong> la décennie 1342-1353. Il<br />
conviendra d'examiner <strong>de</strong> façon critique les fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong>s datations aberrantes, qui concernent<br />
souvent <strong>de</strong>s pièces mal connues, parfois même non attribuées. La comparaison avec les<br />
trésors <strong>de</strong> la même pério<strong>de</strong> sera intéressante ; malheureusement le trésor <strong>de</strong> Marbach<br />
trouvé l'année précédant la découverte <strong>de</strong> Colmar, à quelques kilomètres seulement <strong>de</strong> la ville,<br />
date <strong>de</strong> 1275 et nous sera donc peu utile. Par contre le trésor <strong>de</strong> Lingenfeld 12 , qui contenait <strong>de</strong>s<br />
objets d'orfèvrerie parfois très apparentés à ceux <strong>de</strong> la trouvaille <strong>de</strong> Colmar, présente<br />
également, en ce qui concerne les <strong>monnaies</strong>, une composition très similaire. La trouvaille<br />
<strong>de</strong> Colmar a été faite dans une maison <strong>de</strong> la rue <strong>de</strong> Juifs, appellation ancienne ; il<br />
contenait <strong>de</strong>s objets <strong>de</strong> provenance juive : la bague <strong>de</strong> mariage en particulier. Il est donc<br />
probable que ce trésor a été caché par un membre <strong>de</strong> la communauté juive entre 1342 et<br />
1353. L'hypothèse émise par l'un d'entre nous en 1984 sur l'origine bâloise <strong>du</strong> propriétaire<br />
<strong>de</strong> ce trésor est sans doute plus fragile qu'il n'y paraît : la circulation monétaire <strong>de</strong> la région<br />
<strong>de</strong> Colmar même était en gran<strong>de</strong> partie alimentée par les <strong>monnaies</strong> <strong>de</strong> Bâle, et un habitant<br />
<strong>de</strong> Colmar n'aurait sans doute pas caché un trésor <strong>de</strong> composition différente.<br />
<strong>Les</strong> événements <strong>de</strong> 1348-1349 sont à l'origine, sinon <strong>de</strong> la cachette <strong>du</strong> trésor <strong>de</strong><br />
Colmar, tout au moins <strong>de</strong> son abandon. <strong>Les</strong> Juifs furent alors accusés d'empoisonner les<br />
fontaines et <strong>de</strong> propager la peste noire, en particulier dans la région <strong>de</strong> Zofingen et <strong>de</strong> Bâle,<br />
mais aussi en Alsace: en février 1349 les villes se concertèrent à Benfeld et se prononcèrent<br />
pour l'extermination <strong>de</strong>s Juifs ; celle-ci fut entreprise immédiatement et tous ceux qui ne<br />
purent s'enfuir ou refusèrent le baptême périrent sur le bûcher. A Colmar <strong>de</strong>s bûchers<br />
furent établis hors les murs, en un lieu appelé <strong>de</strong>puis la «Fosse aux Juifs» 13 . Le trésor <strong>de</strong><br />
Colmar, comme celui <strong>de</strong> Lingenfeld, doit être daté <strong>de</strong> 1349 : c'est un témoignage <strong>de</strong> ces<br />
persécutions racistes.<br />
Copyright <strong>Poinsignon</strong> <strong>Numismatique</strong> 2006<br />
Site Internet : http://www.poinsignon-numismatique.com - Email : contact@poinsignon-numismatique.com<br />
4