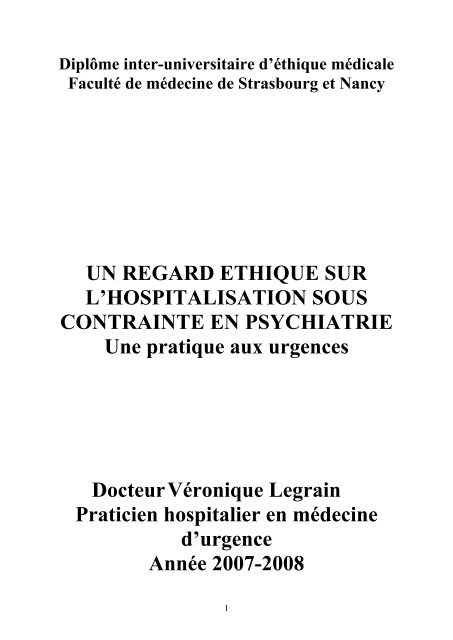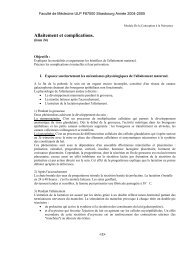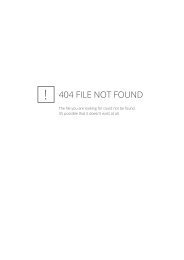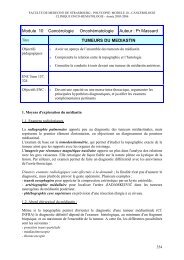Veronique LEGRAIN - Faculté de médecine de l'université Louis ...
Veronique LEGRAIN - Faculté de médecine de l'université Louis ...
Veronique LEGRAIN - Faculté de médecine de l'université Louis ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Diplôme inter-universitaire d’éthique médicale<br />
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Strasbourg et Nancy<br />
UN REGARD ETHIQUE SUR<br />
L’HOSPITALISATION SOUS<br />
CONTRAINTE EN PSYCHIATRIE<br />
Une pratique aux urgences<br />
Docteur Véronique Legrain<br />
Praticien hospitalier en mé<strong>de</strong>cine<br />
d’urgence<br />
Année 2007-2008<br />
1
BIBLIOGRAPHIE<br />
Pierre Le Coz, Petit traité <strong>de</strong> la décision médicale, Seuil 2007<br />
Michela Marzano, Je consens, donc je suis…, Puf 2007<br />
Yannick Ripa, La ron<strong>de</strong> <strong>de</strong>s folles Femme, folie et enfermement au XIXème siècle, Aubier<br />
1986<br />
Michel Foucault, Histoire <strong>de</strong> la folie à l’âge classique, Gallimard 1972<br />
José Coelho, Hospitalisations psychiatriques sous contrainte, Les étu<strong>de</strong>s hospitalières<br />
Collection Tout Savoir 2006<br />
Recommandation REC (2004)10 du Comité <strong>de</strong>s Ministres aux Etats membres relative à la<br />
protection <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> la dignité <strong>de</strong>s personnes atteintes <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
Axel Kahn, L’homme, ce roseau pensant… Essai sur les racines <strong>de</strong> la nature humaine,<br />
Edition Pocket<br />
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s et à la qualité du système <strong>de</strong><br />
santé<br />
Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection <strong>de</strong>s personnes<br />
hospitalisées en raison <strong>de</strong> troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation<br />
Co<strong>de</strong> la santé publique, articles L.3212-1 à 12 relatifs à l’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un<br />
tiers<br />
Co<strong>de</strong> la santé publique, articles L.3213-1 à 10 relatifs à l’hospitalisation d’office<br />
Co<strong>de</strong> la santé publique, articles L.3223-1 à 3 relatifs aux Commissions Départementales <strong>de</strong>s<br />
Hospitalisations Psychiatriques<br />
Suzanne Rameix, Fon<strong>de</strong>ments philosophiques <strong>de</strong> l’éthique médicale, Ellipses 1998<br />
Loi sur les aliénés n°7443 du 30 juin 1838<br />
Charte <strong>de</strong> la personne hospitalisée, circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits <strong>de</strong>s personnes<br />
hospitalisées.<br />
Clau<strong>de</strong> Barthélémy, Ethique <strong>de</strong> la contrainte en psychiatrie, L’information psychiatrique,<br />
Volume 79, N°7, 577-82, Septembre 2003<br />
2
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME<br />
1948<br />
Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé<br />
3
Introduction<br />
PLAN<br />
Première partie : l’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers en pratique<br />
I Une situation <strong>de</strong> crise : l’intervention en SMUR<br />
II L’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers en chiffres<br />
III Mensonge, menace et force <strong>de</strong> persuasion<br />
IV Une hospitalisation en psychiatrie ou comment convaincre d’aller chez les fous ?<br />
Deuxième partie : historique et cadre légal<br />
I Un peu d’histoire<br />
1) L’imaginaire<br />
2) Avant 1838<br />
3) Pinel et Esquirol<br />
4) 1838 : La Loi Esquirol<br />
II La législation actuelle française<br />
1) L’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers<br />
2) L’hospitalisation d’office<br />
3) Les commissions départementales <strong>de</strong>s hospitalisations psychiatriques<br />
III Les recommandations européennes<br />
Troisième partie : la réflexion<br />
I La relation mé<strong>de</strong>cin-mala<strong>de</strong><br />
II Le concept d’autonomie<br />
III Le consentement<br />
IV Le suici<strong>de</strong><br />
Conclusion<br />
4
ABREVIATIONS<br />
HDT : Hospitalisation à la Deman<strong>de</strong> d’un Tiers<br />
HO : Hospitalisation d’Office<br />
HL : Hospitalisation Libre<br />
SMUR : Service Mobile d’Urgence et <strong>de</strong> Réanimation<br />
SAMU : Service d’Ai<strong>de</strong> Médicale Urgente<br />
UHCD : Unité d’Hospitalisation <strong>de</strong> Courte Durée<br />
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé<br />
CDHP : Commission Départementale <strong>de</strong>s Hospitalisations Psychiatriques<br />
TDS : Tentative <strong>de</strong> Suici<strong>de</strong><br />
IMV : Intoxication Médicamenteuse Volontaire<br />
5
INTRODUCTION<br />
Mé<strong>de</strong>cin urgentiste <strong>de</strong>puis une dizaine d’années, je suis amenée dans ma pratique à<br />
hospitaliser <strong>de</strong>s patients en psychiatrie contre leur gré que ce soit dans le cadre <strong>de</strong> mon<br />
activité au service <strong>de</strong>s urgences ou en intervention avec une équipe du SMUR. J’ai voulu<br />
remettre en question l’apparente évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> cet acte maintes fois répété, codifié et très<br />
encadré par la loi.<br />
Cette démarche m’a semblé nécessaire pour prendre conscience <strong>de</strong> ce qui se joue au moment<br />
<strong>de</strong> la décision, qui parfois n’est vue que comme une lour<strong>de</strong>ur dans le quotidien <strong>de</strong>s urgences.<br />
Dans la préface du Petit traité <strong>de</strong> la décision médicale <strong>de</strong> Pierre Le Coz, Didier Sicard, ancien<br />
prési<strong>de</strong>nt du Comité consultatif national d’éthique écrit :<br />
« Ce qu’il y a <strong>de</strong> plus novateur dans son ouvrage est la place donnée à la nécessaire<br />
interrogation a posteriori sur ce qui s’est joué ou pas dans la relation. Faire retour sur les<br />
décisions éthiquement problématiques pour ne pas s’habituer à la simple résolution technique<br />
ou à l’indifférence routinière suscitée par l’expérience. La routine est la pire menace pour<br />
l’éthique <strong>de</strong> la décision. Car une relation <strong>de</strong> soin est, par essence, toujours une expérience<br />
nouvelle pour celui qui en est l’auteur et celui qui en est l’acteur souffrant. » (Petit traité <strong>de</strong> la<br />
décision médicale, p.8).<br />
Dans le quotidien <strong>de</strong> l’urgence, les particularités <strong>de</strong> notre métier ajoutent à la difficulté <strong>de</strong><br />
l’hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. Le manque <strong>de</strong> temps inhérent à l’urgence<br />
nous met alors face à une histoire chronophage. Comment, en effet, faire vite quand en face<br />
<strong>de</strong> soi, une personne est en détresse morale, est en crise, est en possible décalage par rapport à<br />
son quotidien, n’est pas dans son état « normal » ? Cette personne, nous ne la connaissons<br />
pas, il faut nous laisser le temps <strong>de</strong> la rencontrer, <strong>de</strong> rencontrer ses proches, <strong>de</strong> comprendre les<br />
faits qui nous sont rapportés et alors <strong>de</strong> prendre une décision juste et adaptée.<br />
Une autre <strong>de</strong>s composantes <strong>de</strong> cette rencontre est la violence. Violence <strong>de</strong>s faits qui ont<br />
amené le patient aux urgences, violence <strong>de</strong>s rapports du patient avec son entourage, violence<br />
<strong>de</strong> la réaction suite à notre décision. Il peut y avoir une spirale ascendante dans la violence<br />
qui peut avoir pour conséquence une rapi<strong>de</strong> décision d’hospitalisation sous contrainte en<br />
psychiatrie alors que, l’état <strong>de</strong> crise passé, la nécessité <strong>de</strong> l’hospitalisation n’est plus évi<strong>de</strong>nte.<br />
Nous verrons que la loi permet <strong>de</strong>s réajustements rapi<strong>de</strong>s et réitérés <strong>de</strong> décision prise au<br />
moment <strong>de</strong> la crise.<br />
Un troisième élément déterminant dans cette prise <strong>de</strong> décision est la rencontre avec le tiers.<br />
C’est une tierce personne qui vient nous dire « cela ne va plus », « ce n’est plus possible »,<br />
« faites quelque chose ». Le mé<strong>de</strong>cin va écouter les uns et les autres, va peut-être <strong>de</strong>voir se<br />
poser en arbitre d’un conflit familial, va essayer <strong>de</strong> comprendre les enjeux <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>,<br />
éclairé par le type <strong>de</strong> relation qui lie les personnes entre elles.<br />
A l’heure où le consentement <strong>de</strong>vient un pivot central <strong>de</strong> la relation mé<strong>de</strong>cin-mala<strong>de</strong> faisant<br />
évoluer celle-ci d’une relation paternaliste toute puissante à une relation plus contractuelle où<br />
le patient prend une part active aux soins et à sa santé, il subsiste un domaine où ce<br />
consentement ne peut pas être obtenu et où les soins vont <strong>de</strong>voir être imposés au patient :<br />
l’hospitalisation en psychiatrie sous contrainte.<br />
Dans la pratique <strong>de</strong> l’urgence, cette question revient régulièrement et, dans ce contexte<br />
particulier qu’est l’urgence, <strong>de</strong>s décisions aussi difficiles qu’une hospitalisation sous<br />
contrainte en psychiatrie vont être prises, sans toutefois pouvoir prendre le recul nécessaire à<br />
la portée <strong>de</strong> telles décisions. Nous verrons quelques histoires d’urgence qui illustreront ces<br />
difficultés tout en essayant d’éclairer ces différentes histoires <strong>de</strong> vie par le questionnement<br />
éthique qu’elles soulèvent.<br />
6
Dans la <strong>de</strong>uxième partie, nous replacerons ces exemples dans le cadre légal actuel après avoir<br />
retracé l’histoire à la fois <strong>de</strong> la perception <strong>de</strong> la folie et celle <strong>de</strong> la psychiatrie dans ses prises<br />
<strong>de</strong> conscience et dans ses évolutions.<br />
Dans la troisième partie, nous essaierons <strong>de</strong> développer les fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> la relation<br />
mé<strong>de</strong>cin-mala<strong>de</strong> ainsi que le concept d’autonomie pour montrer comment ils participent à la<br />
décision d’une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie.<br />
Nous reviendrons ensuite sur la notion <strong>de</strong> consentement, si centrale actuellement en montrant<br />
pourquoi les mé<strong>de</strong>cins peuvent et doivent passer outre ce consentement pour le bien du<br />
mala<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> la société.<br />
7
PREMIERE PARTIE<br />
L’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers en pratique<br />
I Une situation <strong>de</strong> crise : l’ intervention en SMUR<br />
Durant les treize années <strong>de</strong> ma pratique médicale dans les Services Mobiles d’Urgence et <strong>de</strong><br />
Réanimation <strong>de</strong> Strasbourg et <strong>de</strong> Sélestat et dans le service d’urgence <strong>de</strong> Sélestat, j’ai été<br />
confrontée maintes fois à l’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers (HDT).<br />
Les premières HDT, je les ai vécues pendant mon activité au SAMU en tant que jeune interne,<br />
précision non négligeable puisqu’il a fallu gérer <strong>de</strong>s situations tendues sans l’expérience que<br />
confèrent et la maturité et la réflexion éthique portée sur <strong>de</strong> telles situations.<br />
Ces interventions sont <strong>de</strong> réels états <strong>de</strong> crise, uniques, difficiles, chargés <strong>de</strong> tensions et <strong>de</strong><br />
violences. Les appels sont motivés bien souvent par un débor<strong>de</strong>ment d’une personne au-<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong>s normes supportables par la société : une bouffée délirante aiguë, la déambulation d’une<br />
personne nue dans la rue, la menace <strong>de</strong> suici<strong>de</strong> sur le rebord d’une fenêtre au cinquième étage<br />
ou une arme à feu à la main, le « pétage <strong>de</strong> plomb », que ce soit une colère sans limite avec jet<br />
d’objets par la fenêtre sur la voie publique, que ce soit <strong>de</strong>s menaces <strong>de</strong> mort sur autrui, que ce<br />
soit un burn-out professionnel avec transgression <strong>de</strong>s limites habituelles acceptées dans les<br />
rapports <strong>de</strong> travail. Les situations sont multiples, mais <strong>de</strong> façon constante, l’entourage ne peut<br />
plus maîtriser la personne en état <strong>de</strong> crise, n’a plus accès à sa raison. Il existe une perte <strong>de</strong>s<br />
repères, une perte du contact, une perte <strong>de</strong> la parole.<br />
L’équipe <strong>de</strong> SMUR est alors fréquemment associée à la police. Un regard médical se pose sur<br />
la personne en crise et l’ordre public veille. L’état d’extrême tension entre les différents<br />
protagonistes, la présence d’un public pas toujours souhaitable ni souhaité, la présence<br />
également <strong>de</strong> la police à la fois rassurante, à la fois source d’agressivité, ne ren<strong>de</strong>nt pas les<br />
négociations faciles. Dans ces interventions, la décision <strong>de</strong> l’hospitalisation n’a pas forcément<br />
été prise par le mé<strong>de</strong>cin du SMUR. Au mieux, le premier certificat médical a été préparé par<br />
un mé<strong>de</strong>cin généraliste, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du tiers est déjà écrite par un membre <strong>de</strong> la famille. Il ne<br />
reste plus à l’équipe du SMUR que <strong>de</strong> transporter le patient dans le Centre Hospitalier<br />
Spécialisé référent. C’est là que commence la tâche difficile pour un mé<strong>de</strong>cin qui ne connaît<br />
pas le patient, qui n’a pas été acteur <strong>de</strong> la décision, qui n’était pas témoin <strong>de</strong> l’action passée,<br />
qui a été souvent brièvement mis au courant, <strong>de</strong> convaincre quelqu’un <strong>de</strong> consentir à monter<br />
dans une ambulance qui l’emmènera pour une hospitalisation à laquelle il n’a pas consenti.<br />
Selon les équipes, cette épreuve peut se dérouler <strong>de</strong> différentes manières. Dans la version<br />
caricaturale (mais véridique) <strong>de</strong> l’efficacité sans perte <strong>de</strong> temps : intervention musclée avec<br />
plaquage au sol du patient non compliant, injection intramusculaire d’un tranquillisant à<br />
travers le pantalon ou après un déculottage public, ligotage du patient sur le brancard <strong>de</strong><br />
l’ambulance pour le transport…<br />
L’autre version met en place une négociation longue et parsemée d’embûches, attentive au<br />
choix <strong>de</strong>s mots, essayant d’amadouer l’autre et <strong>de</strong> le convaincre du bienfait <strong>de</strong><br />
l’hospitalisation par une argumentation douce, mais persuasive, lente mais décisive, en<br />
donnant l’impression <strong>de</strong> laisser le choix alors qu’il ne l’a pas. Au pire, cette <strong>de</strong>uxième version<br />
finit par se dérouler comme la première après échec <strong>de</strong> la discussion.<br />
Cette violence <strong>de</strong> l’intervention dans l’échange verbal, dans la contention physique, dans la<br />
sédation chimique appliquée et surtout dans la finalité du propos : hospitaliser quelqu’un en<br />
psychiatrie sans son consentement, est difficilement acceptable et ne peut pas être<br />
satisfaisante. Qu’elle soit intégrée dans un délire (« ils sont venus me chercher, ai<strong>de</strong>z-moi »),<br />
8
qu’elle soit en contrebalance d’une agitation incontrôlée, qu’elle soit le <strong>de</strong>rnier recours à une<br />
situation qui semble bloquée, cette violence semble contraire à l’idée <strong>de</strong> bienfaisance.<br />
II L’HDT en chiffres<br />
On observe ces <strong>de</strong>rnières années une augmentation croissante du nombre <strong>de</strong> transferts, toute<br />
forme confondue, en hôpital psychiatrique, sans vouloir y apporter <strong>de</strong> raisons sociologiques à<br />
ce sujet.<br />
Année<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
2003 2004 2005 2006 2007<br />
transferts en 87<br />
111 140 154 179<br />
psychiatrie<br />
Evolution du nombre <strong>de</strong> transferts <strong>de</strong>s urgences <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Sélestat en hôpital<br />
psychiatrique <strong>de</strong> 2003 à 2007.<br />
Pour avoir une photographie actuelle <strong>de</strong> la place <strong>de</strong>s hospitalisations à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers<br />
dans notre quotidien <strong>de</strong>s urgences, j’ai repris les dossiers <strong>de</strong> janvier 2008 à juin 2008 et j’ai<br />
comptabilisé le nombre d’HDT effectuées. Sur cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> six mois, j’ai relevé 71<br />
hospitalisations en psychiatrie dont neuf HDT sur un nombre <strong>de</strong> passages aux urgences <strong>de</strong><br />
13612.<br />
Les HDT représentent donc 12.68% <strong>de</strong>s hospitalisations en psychiatrie sur ces six <strong>de</strong>rniers<br />
mois.<br />
Les raisons <strong>de</strong> ces hospitalisations sont :<br />
- pour trois d’entre elles <strong>de</strong>s phlébotomies ou atteintes à l’intégrité physique <strong>de</strong> la<br />
personne par arme blanche, ceci étant accompagné d’une prise d’alcool,<br />
- pour <strong>de</strong>ux d’entre elles une intoxication médicamenteuse volontaire avec désir <strong>de</strong> mort<br />
réitéré,<br />
- pour une autre <strong>de</strong>s idées suicidaires sans passage à l’acte avec répétition d’un scénario<br />
déjà vécu dans les années précé<strong>de</strong>ntes,<br />
- pour <strong>de</strong>ux autres un délire dans le cadre d’une psychose connue<br />
- pour le <strong>de</strong>rnier un mélange complexe <strong>de</strong> toxicomanie, <strong>de</strong> prise médicamenteuse et<br />
d’alcool dans un contexte <strong>de</strong> rupture avec la société.<br />
Dans le fonctionnement <strong>de</strong> notre service <strong>de</strong>s urgences, nous bénéficions du passage d’un<br />
psychiatre le matin en jour <strong>de</strong> semaine. Sur ces neuf HDT, quatre patients ont eu un entretien<br />
avec le psychiatre <strong>de</strong> notre service qui a pris l’initiative <strong>de</strong> l’HDT. Pour les cinq autres, elles<br />
ont eu lieu en heure <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>.<br />
Il était important <strong>de</strong> connaître le parcours <strong>de</strong> ces patients suite à leur passage aux urgences et à<br />
la décision <strong>de</strong> les hospitaliser sous contrainte. On peut déplorer que nous ne recevions pas<br />
d’informations sur la suite <strong>de</strong> ces hospitalisations <strong>de</strong> façon systématique, ce qui nous<br />
permettrait d’ajuster nos pratiques, voire <strong>de</strong> les remettre en cause. Mais ceci reste un<br />
problème chronique aux urgences quelque soit le type d’hospitalisations effectuées.<br />
Sur ces neuf personnes, huit ont été hospitalisées au Centre Hospitalier Spécialisé d’Erstein,<br />
une au CHS <strong>de</strong> Hoerdt.<br />
9
Pour la première HDT (épiso<strong>de</strong> maniaque d’un trouble bipolaire connu), la levée <strong>de</strong> l’HDT<br />
s’est faite un mois plus tard.<br />
Pour la secon<strong>de</strong> (phlébotomie), levée <strong>de</strong> l’HDT trois jours plus tard.<br />
Pour la troisième (intoxication médicamenteuse volontaire), l’HDT n’a pas été levée mais une<br />
sortie à l’essai a eu lieu dix jours plus tard. La personne est décédée dans le mois suivant pour<br />
<strong>de</strong>s raisons que je ne connais pas.<br />
Pour la quatrième (phlébotomie, agitation et alcoolisation), la levée <strong>de</strong> l’HDT a été requise<br />
dès le len<strong>de</strong>main par le tiers qui avait signé la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
Pour la cinquième (idées suicidaires), levée vingt jours plus tard.<br />
Pour la sixième (phlébotomie), l’HDT n’a pas pu être confirmée pour <strong>de</strong>s raisons<br />
administratives (certificat inadapté), mais la personne est restée en hospitalisation libre.<br />
Pour la septième (psychose), je n’ai pas obtenu l’information.<br />
Pour la huitième (toxicomanie, intoxication médicamenteuse), l’HDT était poursuivie à<br />
l’heure <strong>de</strong> ma <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’information.<br />
Pour la neuvième (intoxication médicamenteuse volontaire), elle a été levée dès le len<strong>de</strong>main<br />
à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du psychiatre.<br />
Par rapport à la justesse <strong>de</strong> nos décisions, je constate qu’une seule <strong>de</strong> ces décisions a été très<br />
rapi<strong>de</strong>ment remise en cause. A noter également le certificat inadéquat qui montre une<br />
méconnaissance <strong>de</strong> la loi.<br />
En prenant connaissance <strong>de</strong>s différents dossiers d’hospitalisation en psychiatrie, j’ai pu<br />
constater qu’à plusieurs reprises, la question <strong>de</strong> l’HDT avait été soulevée au moment <strong>de</strong><br />
l’admission, mais finalement la personne était gardée dans l’Unité d’Hospitalisation <strong>de</strong> Courte<br />
Durée (UHCD) et, le len<strong>de</strong>main, l’hospitalisation libre était acceptée. L’ouverture <strong>de</strong> l’UHCD<br />
est récente (1 er janvier 2007) ; les patients étaient auparavant gardés dans un <strong>de</strong>s services <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine. Il aurait été intéressant <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r l’évolution du nombre d’HDT avant et après<br />
l’ouverture <strong>de</strong> l’UHCD pour montrer si celle-ci a eu un impact sur nos décisions. On pourrait<br />
penser que les HDT étaient plus nombreuses pour faciliter une surveillance, qui, dans les<br />
services <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en heures <strong>de</strong> nuit, n’est pas si simple.<br />
La solution transitoire <strong>de</strong> l’hospitalisation en UHCD est une façon adéquate <strong>de</strong> faire face à ce<br />
moment <strong>de</strong> crise qui peut parfois faire irruption dans la vie <strong>de</strong> quelqu’un. Elle permet la<br />
réévaluation au calme du trouble présenté, un entretien qui <strong>de</strong>vient alors possible, un avis<br />
spécialisé. Elle évite ainsi le traumatisme potentiel d’une hospitalisation en psychiatrie,<br />
surtout sous contrainte.<br />
III Mensonge, menace et force <strong>de</strong> persuasion<br />
La pratique du mensonge est une pratique qui, je l’espère, est amenée à disparaître. Elle a été<br />
rapportée à la fois par <strong>de</strong>s ambulanciers, par <strong>de</strong>s psychiatres à l’accueil et par <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s.<br />
C’est celle <strong>de</strong> transporter le mala<strong>de</strong> dans un centre hospitalier spécialisé sans le lui dire et <strong>de</strong><br />
le mettre <strong>de</strong>vant le fait accompli aux portes du service <strong>de</strong> psychiatrie avec tous les papiers<br />
adéquats préparés. Ceci doit permettre d’éviter toutes palabres et toute violence au moment <strong>de</strong><br />
la montée dans l’ambulance, mais ne fait que reporter le problème à plus tard, sur d’autres<br />
personnes et ce qui donne au patient le sentiment grave d’avoir été trompé. Il me semble<br />
évi<strong>de</strong>nt que, quelque soit l’histoire, et ce malgré la peine qu’on doit se donner pour négocier<br />
une hospitalisation sous contrainte avec un patient, cette pratique est contraire à tout bon sens.<br />
Tout d’abord, elle met à mal les relations entre professionnels, ce qui est délétère à la prise en<br />
10
charge <strong>de</strong> futurs patients, mais surtout elle nie véritablement toute reconnaissance <strong>de</strong> la<br />
moindre autonomie à la personne, en altérant sa confiance dans la relation avec le corps<br />
médical et soignant et dans la thérapie proposée. Si le patient est hospitalisé sans son<br />
consentement, que ce soit au moins en pleine connaissance <strong>de</strong> cause.<br />
Ceci est d’ailleurs explicitement stipulé dans les recommandations européennes relative à la<br />
protection <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> la dignité <strong>de</strong>s personnes atteintes <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
à l’article 17 (critères pour le placement involontaire), alinéa 1.v. « l’avis <strong>de</strong> la personne<br />
concernée a été pris en considération ».<br />
Pendant ma pério<strong>de</strong> d’interne au SAMU, la psychiatrie était désignée dans les transmissions<br />
par radio <strong>de</strong>vant le patient comme « en face Leriche », pavillon qui faisait face à la<br />
psychiatrie !<br />
A cours d’arguments pour persua<strong>de</strong>r quelqu’un <strong>de</strong> la nécessité d’être pris en charge en<br />
psychiatrie, il reste la menace : « si vous n’acceptez pas l’hospitalisation, nous serons<br />
contraints <strong>de</strong> la faire sans votre consentement » avec les explications entourant la lour<strong>de</strong>ur <strong>de</strong><br />
cette procédure. Etrange choix que nous proposons alors : c’est la psychiatrie ou la<br />
psychiatrie, il vous reste le choix <strong>de</strong>s modalités !<br />
Dans le colloque singulier entre le mé<strong>de</strong>cin et le mala<strong>de</strong>, surtout quand celui-ci vient pour un<br />
problème psychiatrique, on sent combien le fil du lien entre ces <strong>de</strong>ux personnes est tendu et<br />
toujours prêt à se rompre. Un mot <strong>de</strong> trop, une parole trop incisive, une réaction mal perçue et<br />
tout est bien souvent à refaire. La force <strong>de</strong> persuasion ne suffit pas, il faut également<br />
beaucoup <strong>de</strong> tact et <strong>de</strong> finesse pour amener le patient à accepter sa prise en charge. Il va sans<br />
dire que ceci est dépendant <strong>de</strong> tellement <strong>de</strong> paramètres qu’une HDT reste parfois le <strong>de</strong>rnier<br />
choix possible après un entretien où le lien a été rompu. Sans compter le nombre <strong>de</strong> patients<br />
qui changent d’avis rapi<strong>de</strong>ment, ce qui est le reflet du flou <strong>de</strong> leurs pensées en souffrance, on<br />
préfère alors organiser l’HDT pour être sûr que la prise en charge aura lieu.<br />
IV Une hospitalisation en psychiatrie ou comment convaincre d’aller chez les « fous » ?<br />
J’ai choisi ces <strong>de</strong>ux histoires récentes pour montrer les difficultés possibles rencontrées aux<br />
urgences et le questionnement qui en découle.<br />
1) Une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’HDT par la police<br />
Lundi soir, aux urgences, un jeune homme <strong>de</strong> 22 ans est accompagné par la police suite à une<br />
nouvelle fuite <strong>de</strong> gaz dans son appartement. La veille, il est venu aux urgences tard dans la<br />
soirée pour un motif similaire. Le dossier est très succinct. Les voisins auraient perçu une<br />
o<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> gaz provenant <strong>de</strong> son appartement et auraient appelé la police et les services<br />
d’urgence pour fuite <strong>de</strong> gaz. Le jeune homme a été vu aux urgences pour une éventuelle<br />
intoxication au gaz, mais est sorti rapi<strong>de</strong>ment contre avis médical.<br />
Ce lundi, les soupçons se font plus précis. Problème <strong>de</strong> gaz sur la chaudière le dimanche, sur<br />
la gazinière le lundi. N’est-ce que le fruit du hasard ? Les voisins ont peur, la police doute <strong>de</strong><br />
la sécurité du quartier et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> une HDT.<br />
Le jeune est tranquille, plutôt goguenard, ne perçoit aucune contradiction dans les faits, ne se<br />
sent responsable <strong>de</strong> rien. D’évi<strong>de</strong>nce, il a une fragilité psychique : au chômage, avec un<br />
questionnement d’adolescent, un humour cynique, bercé par une vision pessimiste <strong>de</strong> la vie et<br />
<strong>de</strong> la société, entouré par <strong>de</strong>s parents dépassés et inquiets. Ses propos ne comportent aucun<br />
11
élément délirant, ni suicidaire. Il a eu <strong>de</strong>ux problèmes consécutifs sur ses tuyauteries <strong>de</strong> gaz et<br />
alors ?<br />
Je n’ai pas pu discuter avec les voisins mais ces propos m’ont été rapportés par la police : il<br />
aurait, dans un geste <strong>de</strong> colère, détérioré sa voiture quelques temps auparavant et d’autre part,<br />
il se plaindrait chez ses voisins du niveau sonore <strong>de</strong> leur musique, alors que cette musique<br />
proviendrait <strong>de</strong> son propre appartement !! Et encore, il aurait voulu allumer une cigarette dans<br />
son appartement alors que la fuite <strong>de</strong> gaz n’était pas résolue !!!<br />
Voilà <strong>de</strong> quoi créer un bon climat <strong>de</strong> peur et <strong>de</strong> rejet.<br />
Le diagnostique psychiatrique n’est pas évi<strong>de</strong>nt. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’hospitalisation en psychiatrie<br />
sous contrainte pour danger envers autrui n’est pas évi<strong>de</strong>nte non plus. Il n’y a aucune preuve<br />
et le jeune nie toute intervention <strong>de</strong> sa part dans les faits. Voudrait-on l’hospitaliser en<br />
psychiatrie parce qu’il aurait eu la malchance d’avoir <strong>de</strong>ux jours <strong>de</strong> suite un problème sur ses<br />
conduites <strong>de</strong> gaz dans un contexte où un questionnement sur le sens <strong>de</strong> sa vie le rend un peu<br />
plus « marginal » ?<br />
Au cours <strong>de</strong> l’entretien, il ne récuse pas le fait qu’il a, en tout cas, besoin d’une ai<strong>de</strong><br />
psychologique.<br />
Le laisser rentrer seul chez lui me semble trop risqué (je ne peux pas éliminer la possible<br />
explosion <strong>de</strong> tout un quartier !), je le gar<strong>de</strong> alors pour la nuit dans un <strong>de</strong>s lits <strong>de</strong> l’Unité<br />
d’Hospitalisation <strong>de</strong> Courte Durée pour réévaluation le len<strong>de</strong>main avec le psychiatre et en<br />
attendant d’avoir peut-être plus d’informations sur ces « fuites » <strong>de</strong> gaz.<br />
Le psychiatre, tout aussi perplexe, le laisse rentrer le len<strong>de</strong>main avec un ren<strong>de</strong>z-vous pris pour<br />
un suivi.<br />
Comme il arrive malheureusement souvent aux urgences, je n’ai pas <strong>de</strong> nouvelles <strong>de</strong> ce jeune.<br />
Cette histoire éclaire la difficulté du premier point <strong>de</strong> la loi : il faut l’existence <strong>de</strong> troubles<br />
mentaux pour une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’HDT. Facile quand la personne tient <strong>de</strong>s propos délirants ou<br />
suicidaires, cela l’est beaucoup moins quand les faits sont rapportés par <strong>de</strong>s tiers dans un<br />
contexte où la stigmatisation <strong>de</strong> l’Autre dans toute son étrangeté est vite faite.<br />
2) Un geste déplacé<br />
Une femme <strong>de</strong> 38 ans est amenée aux urgences par son compagnon un soir <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> pour<br />
scarifications à l’ai<strong>de</strong> d’un couteau sur la face antérieure du poignet et à la base du cou. Cette<br />
femme, voyante <strong>de</strong> métier, est alcoolique et a, quinze jours auparavant fait une cure <strong>de</strong><br />
sevrage dans un service <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Elle explique tranquillement les raisons <strong>de</strong> son geste :<br />
elle voulait faire peur à son concubin pour qu’il accepte <strong>de</strong> payer enfin la moitié du loyer. Elle<br />
a un discours clair, logique dans son système <strong>de</strong> pensée. Elle ne voulait pas se faire du mal.<br />
Elle est malgré tout énervée par la situation, sentant bien qu’on ne va pas la laisser rentrer tout<br />
simplement. Elle sent l’alcool, dit qu’elle n’a bu qu’un verre <strong>de</strong> vin la veille et un ce jour-là.<br />
Mais…<br />
Son concubin nous dit qu’elle ment, qu’elle n’a tenu qu’une journée <strong>de</strong> sevrage à sa sortie<br />
d’hôpital.<br />
Manifestement elle manipule, veut nous lire les lignes <strong>de</strong> la main, jette un mauvais sort à<br />
l’infirmier. Mais il n’y a pas d’élément délirant dans son discours.<br />
Pour couronner le tout et nous faciliter la tâche, elle a ren<strong>de</strong>z-vous le len<strong>de</strong>main matin à 8<br />
heures au tribunal pour essayer <strong>de</strong> récupérer la gar<strong>de</strong> <strong>de</strong> ses enfants qu’elle a perdue au cours<br />
du divorce et suite à son alcoolisme. Elle veut bien évi<strong>de</strong>mment être absolument présente à ce<br />
ren<strong>de</strong>z-vous et me jure que l’histoire est close, qu’elle sera sage, qu’elle cachera ses plaies au<br />
tribunal par un foulard…<br />
12
Je sens que la décision à prendre est teintée par <strong>de</strong>s sentiments contraires. A la fois, si je<br />
l’hospitalise, je lui enlève toute chance <strong>de</strong> récupérer ses enfants, et d’autre part, ce serait<br />
plutôt normal que la justice ne lui accor<strong>de</strong> pas la gar<strong>de</strong>, surtout si elle savait ce qui c’était<br />
passé. Je prends un rôle qui ne m’appartient pas, celui <strong>de</strong> juge.<br />
Je ne veux pas lui faire confiance, la laisser rentrer et laisser la justice faire son travail. Le<br />
geste est irréfléchi, grave et dans ce contexte <strong>de</strong> veille d’un ren<strong>de</strong>z-vous aussi important, il me<br />
semble encore s’aggraver d’une irresponsabilité manifeste.<br />
Je prends la décision <strong>de</strong> l’hospitaliser sous contrainte, c’est le concubin qui ne paie pas le<br />
loyer qui signera la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>…<br />
Logiquement et dans sa détresse <strong>de</strong> mère qui sait très bien les conséquences <strong>de</strong> ma décision,<br />
l’agressivité monte et va nécessiter une sédation pour que nous puissions imposer notre<br />
décision.<br />
Cette histoire m’a beaucoup questionnée : j’ai eu l’impression <strong>de</strong> me substituer à la justice et<br />
d’autre part, je n’ai absolument pas reconnu d’autonomie à cette patiente.<br />
13
I Un peu d’histoire<br />
1) L’imaginaire<br />
DEUXIEME PARTIE<br />
Historique et cadre légal<br />
Dans l’imaginaire collectif, les hôpitaux psychiatriques ne jouissent pas d’une réputation<br />
encourageante. Une <strong>de</strong>s insultes usitées <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mon enfance n’était pas d’envoyer<br />
l’autre au diable, mais à Prémontré. Tous les enfants connaissaient le nom <strong>de</strong> cet hôpital<br />
psychiatrique <strong>de</strong> l’Aisne, aucun ne connaissait l’existence <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong>s chanoines <strong>de</strong><br />
Prémontré !<br />
Le mot asile, utilisé en 1838 pour désigner ces hôpitaux, a complètement été abandonné, tant<br />
il était entaché d’images nuisibles. Et pourtant, asile veut dire « lieu où l’on peut trouver<br />
refuge, protection » (Le Petit Larousse). L’asile a été associé à ses habitants, les « fous »,<br />
personnage hagard, ou hurlant ou parlant dans le vent, à la crainte que représente la folie, à la<br />
peur d’un internement arbitraire, à l’obscurité portée sur les traitements tels l’électrothérapie<br />
ou l’hydrothérapie, à l’insalubrité.<br />
Être enfermé parce que l’autre désigne la folie et que rien ne peut venir défendre cette<br />
accusation. On a tous à l’esprit cette image <strong>de</strong> quelqu’un qui hurle « je ne suis pas fou » en se<br />
débattant comme s’il allait au bûcher et tout le mon<strong>de</strong> hoche la tête d’un air entendu. Et plus il<br />
se débat, et plus chacun est conforté dans son idée. Il y a <strong>de</strong> quoi <strong>de</strong>venir fou…<br />
Être enfermé parce qu’on ne correspond pas à la normalité, mais quelle normalité ? <strong>de</strong> quelle<br />
époque ? <strong>de</strong> quel pays ? sous quel régime politique ? dans quel milieu social ? dans quelle<br />
cellule familiale ?<br />
Tout cet imaginaire peut se comprendre par l’histoire <strong>de</strong> la folie, l’histoire <strong>de</strong> la psychiatrie,<br />
l’histoire <strong>de</strong>s asiles et nous verrons que cette peur est justifiée et qu’elle doit nous rester<br />
présente à l’esprit. Ce passé <strong>de</strong> la folie doit rester vivant dans nos consciences lorsque nous<br />
prenons la décision d’hospitaliser en psychiatrie sous contrainte. Il ne faut pas oublier que<br />
potentiellement « la mé<strong>de</strong>cine aliéniste flirte avec la religion, la morale, la police ; elle se fait<br />
gardienne <strong>de</strong> l’ordre » (La ron<strong>de</strong> <strong>de</strong>s folles, Yannick Ripa, p.11).<br />
Cet imaginaire porté par chacun nuit aussi à la prise en charge psychiatrique d’un patient qui<br />
ne veut pas être assimilé à cette folie-là.<br />
2) Avant 1838<br />
A la lecture <strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong> la folie à l’âge classique <strong>de</strong> Michel Foucault et <strong>de</strong> La ron<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
folles <strong>de</strong> Yannick Ripa, on trouve une nette confusion sur ce que peut être la folie. Les<br />
mendiants, les simples d’esprit, les prostituées, les libertins, les vénériens, les opposants<br />
politiques, les épileptiques, les fous furieux, les déments, tous ceux qui gênent le bon<br />
fonctionnement <strong>de</strong> la société, tous ceux-là peuvent, sur simple <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, être enfermés,<br />
parfois à vie sans autre forme <strong>de</strong> procès. Il suffit d’une lettre <strong>de</strong> cachet, à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
famille ou <strong>de</strong> toute autre personne pour que, sur décision royale, quelqu’un soit mis au ban <strong>de</strong><br />
la société.<br />
C’est le temps du « grand renfermement », où les objectifs <strong>de</strong> l’Hôpital général, créé en 1656<br />
à Paris, n’ont rien <strong>de</strong> médical, mais sont d’un ordre moral, social et économique.<br />
14
La confusion existait entre l’univers carcéral et l’hôpital. Les aliénés étaient dépouillés <strong>de</strong><br />
leurs vêtements pour revêtir un uniforme, leur chambre s’apparentait plus à une cellule et le<br />
manque <strong>de</strong> moyens donnait à ses enfermements une déshumanisation proche <strong>de</strong> l’animalité.<br />
« Je les ai vus nus, couverts <strong>de</strong> haillons, n’ayant que la paille pour se garantir <strong>de</strong> la froi<strong>de</strong><br />
humidité du pavé sur lequel ils sont étendus. Je les ai vus grossièrement nourris, privés d’air<br />
pour respirer, d’eau pour étancher leur soif, et <strong>de</strong>s choses les plus nécessaires à la vie. Je les ai<br />
vus livrés à <strong>de</strong> véritables geôliers, abandonnés à leur brutale surveillance. Je les ai vus dans<br />
<strong>de</strong>s réduits étroits, sales, infects, sans air, sans lumière, enfermés dans <strong>de</strong>s antres où l’on<br />
craindrait <strong>de</strong> renfermer <strong>de</strong>s bêtes féroces, que le luxe <strong>de</strong>s gouvernements entretient à grands<br />
frais dans les capitales. » Esquirol, Des établissements consacrés aux aliénés en France<br />
(1818) in Des maladies mentales, Paris, 1838, t.II, p.134.<br />
Les aliénés pouvaient subir <strong>de</strong>s soins proches <strong>de</strong> la torture. Traitement et punition sont<br />
souvent confondus. L’hydrothérapie en est un exemple marquant : les douches d’eau froi<strong>de</strong><br />
prolongées avec un jet <strong>de</strong> forte puissance <strong>de</strong>vaient ramener le « patient » à la raison et lui faire<br />
oublier ses délires. Mais l’isolement pur et simple, le gavage <strong>de</strong>s anorexiques, les contentions<br />
du type <strong>de</strong>s camisoles, les appareillages antimasturbatoires, les saignées, l’électrothérapie sont<br />
autant d’autres moyens utilisés alors pour intimi<strong>de</strong>r, réprimer, punir, terroriser, faire régner<br />
l’ordre et face auxquels la raison pouvait avoir bien du mal à résister.<br />
« A force <strong>de</strong> vivre dans ce mon<strong>de</strong> délirant, au milieu du triomphe <strong>de</strong> la déraison, comment ne<br />
pas rejoindre, par la fatalité <strong>de</strong>s lieux et <strong>de</strong>s choses, ceux-là mêmes qui en sont le vivant<br />
symbole ». Michel Foucault, Histoire <strong>de</strong> la folie à l’âge classique, p.499.<br />
3) Pinel et Esquirol<br />
Deux figures <strong>de</strong> la psychiatrie française ont contribué à <strong>de</strong> grands changements dans l’histoire<br />
<strong>de</strong> la folie : Philippe Pinel et Jean-Etienne Esquirol.<br />
Philippe Pinel (1745-1826) fut dénommé le « libérateur <strong>de</strong>s fous ». La même époque voit<br />
également la naissance <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme et du citoyen <strong>de</strong> 1789 qui, à<br />
l’article 7 nous dit :<br />
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et<br />
selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font<br />
exécuter <strong>de</strong>s ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu<br />
<strong>de</strong> la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance »,<br />
et à l’article 10 :<br />
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation<br />
ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».<br />
Pinel est à l’origine <strong>de</strong>s premières classifications <strong>de</strong>s maladies mentales, ce qui met <strong>de</strong> l’ordre<br />
dans la confusion régnant sur le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la folie, qui peu à peu se réduit à la maladie<br />
mentale. Le mé<strong>de</strong>cin, qui intervenait peu jusqu’alors dans le processus d’internement, <strong>de</strong>vient<br />
un personnage prépondérant et par-là même un relais entre la société et la maladie, usant <strong>de</strong><br />
son autorité pour désigner la folie. Sa tâche est autant juridique et morale que médicale.<br />
« L’âge positiviste, pendant plus d’un <strong>de</strong>mi-siècle, a témoigné sans répit <strong>de</strong> cette bruyante<br />
prétention à avoir le premier délivré le fou d’une confusion pitoyable avec les condamnés,<br />
d’avoir partagé l’innocence <strong>de</strong> la déraison et la culpabilité <strong>de</strong>s criminels ». Michel Foucault,<br />
Histoire <strong>de</strong> la folie à l’âge classique, p.495.<br />
15
Jean-Etienne Esquirol (1772-1840) fait suite à Pinel à la Salpêtrière. Il est à l’origine <strong>de</strong> la loi<br />
du 30 juin 1838 concernant les aliénés qui met fin aux décisions d’internements arbitraires par<br />
simple lettre <strong>de</strong> cachet et qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> la création <strong>de</strong>s asiles.<br />
4) 1838 : la loi Esquirol<br />
La Loi du 30 juin 1838 a été, à l’initiative <strong>de</strong> Jean-Etienne Esquirol, promulguée sous le règne<br />
du roi <strong>Louis</strong>-Philippe. Celle-ci exigea <strong>de</strong> chaque département la création d’un établissement<br />
psychiatrique. Ces établissements, publics ou privés étaient mis sous contrôle <strong>de</strong> l’autorité<br />
publique. Elle fut à l’origine <strong>de</strong> différentes modalités d’internement : le placement volontaire<br />
et le placement d’office, avec la nécessité d’un certificat médical. Un statut juridique pour les<br />
mala<strong>de</strong>s mentaux fut également mis en vigueur. Malgré les critiques fondées sur l’absence <strong>de</strong><br />
la reconnaissance <strong>de</strong> l’hospitalisation libre et sur la poursuite d’abus d’internements<br />
arbitraires, elle fut effective jusqu’en 1990 !<br />
On peut s’interroger sur la dénomination <strong>de</strong> volontaire pour le placement puisque <strong>de</strong> volonté,<br />
il ne s’agit que <strong>de</strong> celle du tiers qui en fait la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
Dans le récit <strong>de</strong> Yannick Ripa qui traite <strong>de</strong> l’internement <strong>de</strong>s femmes au XIXème siècle, on<br />
comprend bien qu’il ne suffit pas d’une loi pour éviter tout abus. Les mentalités <strong>de</strong> l’époque et<br />
le regard porté sur la folie restent les grands responsables d’internements injustifiés, dont les<br />
femmes ont particulièrement souffert. Sous le prétexte <strong>de</strong> l’ordre établi, on enferme les<br />
femmes trop ambitieuses, les femmes aux activités politiques antinomiques à leur condition<br />
féminine, les femmes qui refusent le <strong>de</strong>voir conjugal, les femmes libertines, les femmes qui ne<br />
correspon<strong>de</strong>nt pas aux schémas féminins courus.<br />
« […] féminité, féminisme et activisme politique sont trois tares qui additionnées les font<br />
basculer dans l’anormalité et le déséquilibre mental. L’activité politique <strong>de</strong>s femmes est un<br />
acte contre nature. L’adage a acquis, au fil <strong>de</strong>s ans, tant <strong>de</strong> force qu’il n’est pas besoin d’isoler<br />
d’autres symptômes d’aliénation. » Yannick Ripa, La ron<strong>de</strong> <strong>de</strong>s folles, p.35.<br />
Les troubles invoqués pour le recours au placement sont <strong>de</strong> quatre types :<br />
- les troubles <strong>de</strong> la personnalité : indifférence, jalousie, peur, colère, vanité, ambition et<br />
susceptibilité.<br />
- les troubles du comportement : excentricité, excès divers, conduites suicidaires, vie <strong>de</strong><br />
débauche, rejet du travail et révolte.<br />
- les troubles <strong>de</strong>s idées : diminution <strong>de</strong> l’intelligence, hallucinations, exaltations diverses.<br />
- les troubles physiques : gâtisme, fièvre puerpérale, anorexie, aménorrhée et pertes blanches.<br />
« Où s’arrête l’originalité pour <strong>de</strong>venir excentricité, quand cesse-t-elle d’être un trait <strong>de</strong><br />
caractère pour se transformer en symptôme psychiatrique ? La réponse se trouve dans la<br />
définition <strong>de</strong> la normalité féminine fixée par l’homme et même pour l’homme. » Yannick<br />
Ripa, La ron<strong>de</strong> <strong>de</strong>s folles, p.43.<br />
On retrouve chez Michel Foucault les mêmes constatations : « On cherche les formes<br />
morbi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la folie ; on n’a guère trouvé que <strong>de</strong>s déformations <strong>de</strong> la vie morale. » Histoire <strong>de</strong><br />
la folie à l’âge classique, p.254.<br />
Laissons-là toute une société et ses psychiatres s’interroger sur la définition <strong>de</strong> la folie, sur la<br />
normalité, sur l’ordre et la moralité pendant encore un siècle et <strong>de</strong>mi pour aboutir à notre<br />
régime actuel…<br />
« L’homme, en tant que citoyen, est appelé à exercer dans son groupe le pouvoir,<br />
provisoirement absolu, <strong>de</strong> la police, c’est à lui d’accomplir ce geste obscur et souverain, par<br />
lequel une société désigne un individu comme indésirable ou étranger à l’unité qu’elle forme ;<br />
16
c’est lui qui a pour tâche <strong>de</strong> juger les limites <strong>de</strong> l’ordre et du désordre, <strong>de</strong> la liberté et du<br />
scandale, <strong>de</strong> la morale et <strong>de</strong> l’immoralité. C’est en lui maintenant, et dans sa conscience,<br />
qu’est déposé le pouvoir par lequel doit s’opérer immédiatement, et avant toute libération, le<br />
partage <strong>de</strong> la folie et <strong>de</strong> la raison. » Histoire <strong>de</strong> la folie à l’âge classique, Michel Foucault,<br />
p.555.<br />
II La législation actuelle française<br />
Les hospitalisations sans consentement en psychiatrie suivent la loi du 27 juin 1990, dite loi<br />
Evin n°90-527 relative aux droits et à la protection <strong>de</strong>s personnes hospitalisées en raison <strong>de</strong><br />
troubles mentaux (modifiée par la loi « Kouchner » du 4 mars 2002 relative aux droits <strong>de</strong>s<br />
mala<strong>de</strong>s et à la qualité du système <strong>de</strong> santé). Ces textes sont repris dans les articles L3212-1 et<br />
suivants et L3213-1 et suivants du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé Publique.<br />
Cette loi se veut plus respectueuse <strong>de</strong>s droits et libertés <strong>de</strong> l’homme que la loi Esquirol du 30<br />
juin 1838 qui était qualifiée <strong>de</strong> loi <strong>de</strong> police et qui ne reconnaissait pas l’existence <strong>de</strong><br />
l’hospitalisation libre.<br />
Le principe <strong>de</strong> la loi est d’écarter au maximum le risque d’internements arbitraires.<br />
Les hospitalisations en psychiatrie se font sous trois régimes :<br />
-l’hospitalisation libre sur laquelle nous ne nous attar<strong>de</strong>rons pas puisqu’elle est basée sur le<br />
consentement propre à toute hospitalisation<br />
-l’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers<br />
-l’hospitalisation d’office<br />
1) l’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers<br />
a) Les conditions :<br />
Trois conditions doivent être réunies pour mettre en place une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’hospitalisation à la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers :<br />
-présence <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
-les troubles présentés ren<strong>de</strong>nt impossible le consentement du patient<br />
-son état impose <strong>de</strong>s soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu<br />
hospitalier.<br />
b) Les auteurs <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> :<br />
C’est un tiers qui fait la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’hospitalisation en psychiatrie, il peut être un membre <strong>de</strong> la<br />
famille ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient.<br />
La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> doit être formulée par écrit en notifiant les nom, prénom, profession, âge et<br />
domicile du tiers et nom, prénom, date <strong>de</strong> naissance et domicile <strong>de</strong> la personne à hospitaliser,<br />
ainsi que la nature <strong>de</strong>s relations entre les <strong>de</strong>ux parties.<br />
c) Les certificats médicaux :<br />
Deux certificats médicaux sont nécessaires à l’HDT, ceux-ci doivent être <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> quinze<br />
jours.<br />
17
Les <strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins ne doivent pas être parents ou alliés au 4 ème <strong>de</strong>gré ni entre eux, ni avec le<br />
directeur du centre <strong>de</strong> soins, ni avec le tiers, ni avec le patient.<br />
Le premier certificat ne peut pas être établi par un mé<strong>de</strong>cin exerçant dans le centre <strong>de</strong> soin<br />
d’accueil du patient.<br />
Ces certificats doivent comporter les nom, prénom du mé<strong>de</strong>cin. Ils doivent mentionner les<br />
symptômes présentés par le patient.<br />
Chaque mé<strong>de</strong>cin doit examiner et constater lui-même les troubles mentaux présentés après un<br />
entretien avec le patient.<br />
Les certificats sont adressés au directeur <strong>de</strong> l’établissement d’accueil et c’est lui qui prononce<br />
l’admission du patient.<br />
En cas <strong>de</strong> péril imminent, un seul certificat médical peut suffire.<br />
d) Les problèmes soulevés par cette première démarche :<br />
-la reconnaissance <strong>de</strong>s troubles mentaux<br />
-trouver le tiers<br />
-le recours abusif au certificat unique<br />
-la notion <strong>de</strong> péril imminent n’est pas définie par la législation et est laissée au libre arbitre du<br />
mé<strong>de</strong>cin<br />
-la confiance mutuelle entre les <strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins qui entraînerait une confirmation automatique<br />
<strong>de</strong>s conclusions du premier mé<strong>de</strong>cin sans entretien avec le mala<strong>de</strong><br />
e) Les différents contrôles :<br />
A l’admission : une vérification est faite par le directeur <strong>de</strong><br />
l’établissement <strong>de</strong> l’impossibilité du consentement, <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong>s soins et <strong>de</strong> la<br />
surveillance constante en milieu hospitalier, <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’auteur <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, <strong>de</strong> la<br />
validité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux certificats médicaux et <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s différents protagonistes.<br />
Après l’admission :<br />
Un certificat médical est à nouveau établi par un psychiatre <strong>de</strong> l’établissement après 24<br />
heures, au quinzième jour et une fois par mois.<br />
Tous ces certificats sont envoyés à la Commission Départementale <strong>de</strong>s Hospitalisations<br />
Psychiatriques (CDHP) sur laquelle nous reviendrons dans un prochain paragraphe, et au<br />
Préfet.<br />
Les i<strong>de</strong>ntités <strong>de</strong> la personne hospitalisée et du tiers sont communiquées au procureur <strong>de</strong> la<br />
République près le tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du<br />
patient et au procureur <strong>de</strong> la République près le tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance dans le ressort<br />
duquel est situé l’établissement.<br />
f) La fin <strong>de</strong> l’hospitalisation :<br />
Celle-ci peut être décidée<br />
-sur avis médical<br />
-sur ordre du Préfet : décision motivée par la disparition <strong>de</strong>s troubles ou l’absence <strong>de</strong>s<br />
certificats<br />
-à l’initiative d’un tiers qui peut être différent du tiers qui a fait la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> initiale :<br />
curateur, conjoint, ascendant, <strong>de</strong>scendant, personne signataire, personne désignée par le<br />
18
conseil <strong>de</strong> famille. Il faut signaler alors que si le mé<strong>de</strong>cin n’est pas d’accord, il peut alors<br />
faire la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’une hospitalisation d’office.<br />
-sur ordre du juge <strong>de</strong>s libertés et <strong>de</strong> la détention qui peut être saisi par les tiers ou par la<br />
personne hospitalisée.<br />
Toutes ces mesures montrent bien que la loi s’est évertuée à empêcher toute possibilité<br />
d’internements arbitraires. Bien trop <strong>de</strong> personnes sont impliquées dans la prise <strong>de</strong> décisions<br />
pour qu’un complot soit réalisable. D’autant plus qu’il existe un regard à la fois médical,<br />
administratif, judiciaire et familial porté sur ces décisions ainsi que la possibilité <strong>de</strong> la<br />
personne elle-même <strong>de</strong> recourir à la justice. Encore faudrait-il qu’elle soit bien consciente <strong>de</strong><br />
ses droits et que son état <strong>de</strong> faiblesse, voire <strong>de</strong> « folie » ne l’en empêche pas.<br />
2) l’hospitalisation d’office<br />
a) Les conditions :<br />
Les troubles mentaux présentés nécessitent <strong>de</strong>s soins et compromettent la sûreté <strong>de</strong>s<br />
personnes ou portent atteinte <strong>de</strong> façon grave à l’ordre public.<br />
La mention « <strong>de</strong> façon grave » a été rajoutée par la loi Kouchner <strong>de</strong> 2002 mais n’a pas été<br />
explicitée dans la loi.<br />
b) La décision :<br />
Elle est <strong>de</strong> la compétence du représentant <strong>de</strong> l’Etat dans les départements, du préfet <strong>de</strong> police<br />
à Paris au vu d’un certificat médical circonstancié. C’est un arrêté préfectoral. Des mesures<br />
provisoires peuvent être prises par les maires et par le commissaire <strong>de</strong> police à Paris.<br />
c) Les contrôles :<br />
Ils sont du même ordre que pour l’hospitalisation à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers.<br />
d) La fin <strong>de</strong> l’hospitalisation :<br />
Elle peut survenir à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du préfet, du psychiatre et <strong>de</strong>s autorités judiciaires.<br />
3) Les Commissions Départementales <strong>de</strong>s Hospitalisations Psychiatriques :<br />
Ces commissions, les CDHP, ont été instituées par la loi du 27 juin 1990. Elles ont pour<br />
mission le contrôle a posteriori <strong>de</strong>s hospitalisations sans consentement. Le législateur a rejeté<br />
l’option du contrôle a priori. Le statut <strong>de</strong>s CDHP est i<strong>de</strong>ntifié aux articles L.3223-1 à L.3223-<br />
3 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique.<br />
a) La composition <strong>de</strong>s CDHP<br />
- un psychiatre désigné par le Procureur général près la cour d’appel<br />
- un psychiatre désigné par le représentant <strong>de</strong> l’Etat<br />
- un magistrat désigné par le premier prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la cour d’appel<br />
- une personnalité qualifiée, membre d’une organisation représentative <strong>de</strong> familles <strong>de</strong><br />
personnes atteintes <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
19
Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s et à la qualité du<br />
système <strong>de</strong> santé, <strong>de</strong>ux nouvelles personnes ont été ajoutées à la composition <strong>de</strong>s CDHP. Il<br />
s’agit d’un généraliste et d’un représentant d’associations agréées d’usagers du système <strong>de</strong><br />
santé. Ces <strong>de</strong>ux membres supplémentaires sont désignés par le représentant <strong>de</strong> l’Etat dans le<br />
département.<br />
b) Les missions <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s CDHP<br />
Les CDHP sont chargées d’examiner la situation <strong>de</strong>s personnes hospitalisées en raison <strong>de</strong><br />
leurs troubles mentaux au regard du respect <strong>de</strong>s libertés individuelles et <strong>de</strong> la dignité <strong>de</strong>s<br />
personnes.<br />
Elles ont un rôle d’ai<strong>de</strong>, <strong>de</strong> recours et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>s personnes.<br />
Les CDHP sont informées <strong>de</strong> toute HDT, <strong>de</strong> leur renouvellement et <strong>de</strong> leur levée.<br />
Elles doivent procé<strong>de</strong>r à une visite <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong>ux fois par an.<br />
Elles doivent écrire un rapport d’activité au représentant <strong>de</strong> l’Etat et au Procureur <strong>de</strong> la<br />
République.<br />
III Les recommandations européennes<br />
Convention européenne <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong> l’Homme et <strong>de</strong>s Libertés<br />
Fondamentales (1950)<br />
« Article 5 : Droits à la liberté et à la sûreté<br />
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé <strong>de</strong> sa liberté, sauf dans<br />
les cas suivants et selon les voies légales :<br />
e. s’il s’agit <strong>de</strong> la détention régulière d’une personne susceptible <strong>de</strong> propager une maladie<br />
contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. »<br />
A l’initiative du Conseil <strong>de</strong> l’Europe, une réflexion a été engagée sur la protection <strong>de</strong>s droits<br />
<strong>de</strong> l’homme et la dignité <strong>de</strong>s personnes atteintes <strong>de</strong> troubles mentaux. Celle-ci s’est soldée en<br />
2004 par la rédaction d’une recommandation du Comité <strong>de</strong>s Ministres aux Etats Membres<br />
portant sur 38 articles en vue d’une harmonisation <strong>de</strong>s législations sur <strong>de</strong>s questions d’intérêt<br />
commun. Cette réflexion fait suite aux travaux du Comité européen pour la prévention <strong>de</strong> la<br />
torture et <strong>de</strong>s peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’aux travaux du Comité<br />
directeur pour la bioéthique. L’objectif <strong>de</strong> cette recommandation est <strong>de</strong> favoriser une<br />
meilleure protection <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong> la dignité <strong>de</strong>s personnes atteintes <strong>de</strong> troubles<br />
mentaux, en particulier <strong>de</strong> celles qui font l’objet d’un placement ou d’un traitement<br />
involontaire. Elle souligne la nécessité pour les professionnels <strong>de</strong> la santé mentale d’agir dans<br />
un cadre réglementaire, <strong>de</strong> réexaminer régulièrement leur pratique et <strong>de</strong> garantir, autant que<br />
possible, la mise en œuvre <strong>de</strong>s principes consacrés dans les lignes directrices.<br />
On gar<strong>de</strong> à l’esprit le spectre d’internements abusifs sous certains régimes totalitaires avec le<br />
prétexte fallacieux <strong>de</strong> maladies telle la « schizophrénie lente » non reconnue dans les<br />
classifications internationales, retirant à la personne tous droits, toute possibilité <strong>de</strong><br />
communication vers l’extérieur et lui faisant subir <strong>de</strong>s traitements la rendant inapte à se<br />
défendre.<br />
Le champ d’application <strong>de</strong> cette recommandation concerne les troubles mentaux définis<br />
conformément aux normes médicales internationalement reconnues (par exemple le chapitre<br />
V <strong>de</strong> la classification statistique internationale <strong>de</strong>s maladies et <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> santé<br />
20
connexes <strong>de</strong> l’Organisation Mondiale <strong>de</strong> la Santé : CIM-10). Il est à noter que dans une autre<br />
classification, celle-ci américaine, le DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental<br />
disor<strong>de</strong>r), l’homosexualité a été retirée <strong>de</strong> la classification en 1973…<br />
L’article 2 est posé comme un principe fondateur <strong>de</strong> nos sociétés.<br />
« Article 2 : Le défaut d’adaptation aux valeurs morales, sociales, politiques ou autres d’une<br />
société ne <strong>de</strong>vrait pas être, en lui-même, considéré comme un trouble mental. »<br />
Il est rappelé à l’article 17 dans le chapitre III concernant le placement involontaire pour<br />
trouble mental dans <strong>de</strong>s établissements psychiatriques, et le traitement involontaire pour<br />
trouble mental, les critères qui doivent être réunis pour réaliser ce placement involontaire.<br />
« Article 17 : Critères pour le placement involontaire<br />
1. Sous réserve que les conditions suivantes sont réunies, une personne peut faire l’objet d’un<br />
placement involontaire :<br />
-la personne est atteinte d’un trouble mental<br />
-l’état <strong>de</strong> la personne présente un risque réel <strong>de</strong> dommage grave pour sa santé ou pour autrui<br />
-le placement a notamment un but thérapeutique<br />
-aucun autre moyen moins restrictif <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s soins appropriés n’est disponible<br />
-l’avis <strong>de</strong> la personne considérée a été pris en considération<br />
2. La loi peut prévoir qu’exceptionnellement une personne peut faire l’objet d’un placement<br />
involontaire, en accord avec les dispositions du présent chapitre, durant la pério<strong>de</strong> minimale<br />
nécessaire pour déterminer si elle est atteinte d’un trouble mental représentant un risque réel<br />
<strong>de</strong> dommage grave pour sa santé ou pour autrui, si :<br />
-son comportement suggère fortement la présence d’un tel trouble<br />
-son état semble présenter un tel risque<br />
-il n’existe aucun moyen approprié moins restrictif <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’évaluation <strong>de</strong> son état<br />
-l’avis <strong>de</strong> la personne concernée a été pris en considération »<br />
Dans l’exposé <strong>de</strong>s motifs attenant à la recommandation, <strong>de</strong>s précisions sont apportées pour<br />
éclairer cet article. Il me semble important <strong>de</strong> souligner le principe <strong>de</strong> restriction minimale,<br />
qui énonce que le recours à <strong>de</strong> telles mesures doit être limité le plus possible, en insistant sur<br />
les efforts faits pour permettre à une personne d’accepter le placement.<br />
L’existence d’un trouble mental ne sous-entend pas le fait qu’un placement involontaire soit<br />
approprié quelque soit le type <strong>de</strong> ce trouble, l’expérience montrant que les personnes abusant<br />
<strong>de</strong> l’alcool ou <strong>de</strong> drogue n’ont pas montré <strong>de</strong> réponse durable au placement ou au traitement<br />
involontaires.<br />
Le placement doit avoir un but thérapeutique. Il ne doit pas être motivé par <strong>de</strong>s considérations<br />
politiques, morales, économiques ou sociales, ni uniquement par <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> privation <strong>de</strong><br />
liberté. Si la privation <strong>de</strong> liberté est le but du placement, celui-ci ne doit pas se faire dans un<br />
établissement psychiatrique.<br />
« Article 20 : Procédures pour la prise <strong>de</strong> décision sur le placement et/ou le traitement<br />
involontaires<br />
Décision<br />
1. La décision <strong>de</strong> soumettre une personne à un placement involontaire <strong>de</strong>vrait être prise<br />
par un tribunal ou une autre instance compétente. Le tribunal ou l’autre instance<br />
compétente <strong>de</strong>vrait :<br />
21
– prendre en considération l’avis <strong>de</strong> la personne concernée<br />
– prendre sa décision selon les procédures prévues par la loi, sur la base du<br />
principe suivant lequel la personne <strong>de</strong>vrait être vue et consultée.<br />
3. Toute décision <strong>de</strong> soumettre une personne à un placement ou à un traitement<br />
involontaires <strong>de</strong>vrait être consignée par écrit et indiquer la pério<strong>de</strong> maximale au-<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> laquelle, conformément à la loi, elle doit être officiellement réexaminée. Cela<br />
s’entend sans préjudice <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la personne aux réexamens et aux recours, en<br />
accord avec les dispositions <strong>de</strong> l’article 25.<br />
Procédures préalables à la décision<br />
4. Le placement ou le traitement involontaire, ou leur prolongation, ne <strong>de</strong>vraient être<br />
possibles que sur la base d’un examen par un mé<strong>de</strong>cin possédant les compétences et<br />
l’expérience requises, en accord avec <strong>de</strong>s normes professionnelles vali<strong>de</strong>s et fiables.<br />
5. Ce mé<strong>de</strong>cin ou l’instance compétente <strong>de</strong>vrait consulter les proches <strong>de</strong> la personne<br />
concernée, sauf si cette <strong>de</strong>rnière s’y oppose, si cela ne peut être réalisé pour <strong>de</strong>s<br />
raisons pratiques ou si, pour d’autres raisons, cela n’est pas approprié.<br />
6. Tout représentant <strong>de</strong> cette personne <strong>de</strong>vrait être informé et consulté. »<br />
La recommandation européenne requiert que la décision <strong>de</strong> placement soit prise par un<br />
tribunal ou une autre instance compétente, ceci pour que la décision soit prise <strong>de</strong> façon<br />
indépendante par rapport à la personne qui propose la mesure. Cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> européenne est<br />
encore soumise à la discussion, par crainte d’alourdir la procédure et également par crainte <strong>de</strong><br />
la plainte, car celle-ci serait potentiellement traitée par le tribunal qui a statué sur le<br />
placement.<br />
« Article 21 : Procédures pour la prise <strong>de</strong> décision sur le placement et/ou le traitement<br />
involontaires dans les situations d’urgence<br />
Les procédures prévues dans les situations d’urgence ne <strong>de</strong>vraient pas être utilisées dans le<br />
but <strong>de</strong> contourner <strong>de</strong>s dispositions énoncées à l’article 20.<br />
Dans le cadre d’une procédure d’urgence, le placement involontaire ne <strong>de</strong>vrait être effectué<br />
que pendant une courte pério<strong>de</strong>, sur la base d’une évaluation médicale appropriée à la mesure<br />
envisagée. »<br />
Cette courte pério<strong>de</strong> est effective en France, puisqu’il y a une réévaluation par le psychiatre à<br />
24 heures et que la disparition <strong>de</strong>s troubles entraîne l’arrêt du placement.<br />
La recommandation européenne précise également les qualifications nécessaires aux<br />
professionnels <strong>de</strong> la santé mentale, rappelle le droit à l’information <strong>de</strong>s patients, le droit <strong>de</strong><br />
communiquer avec le mon<strong>de</strong> extérieur, explicite les procédures pour les traitements<br />
involontaires, énonce le cadre <strong>de</strong> l’isolement et <strong>de</strong> la contention et impose un contrôle régulier<br />
<strong>de</strong>s établissements où ces placements et traitements involontaires ont lieu.<br />
22
TROISIEME PARTIE<br />
Dans l’acte <strong>de</strong> pratiquer une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie, on met en jeu<br />
plusieurs concepts : celui <strong>de</strong> l’autonomie puisque celle-ci n’est plus reconnue au patient, celui<br />
du consentement puisque la décision médicale fait fi consciemment <strong>de</strong> ce consentement qui ne<br />
peut être recueilli, celui <strong>de</strong> la liberté puisque celle-ci est enlevée au patient. Nous abor<strong>de</strong>rons<br />
ces sujets en introduisant d’abord la relation mé<strong>de</strong>cin-mala<strong>de</strong> pour éclairer les principes qui<br />
l’animent. Nous traiterons pour finir <strong>de</strong> la difficile question du suici<strong>de</strong> et du « droit » au<br />
suici<strong>de</strong>.<br />
I La relation mé<strong>de</strong>cin-mala<strong>de</strong><br />
Parallèlement à l’évolution <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> la société, la relation entre le mé<strong>de</strong>cin et son<br />
patient a considérablement changé au siècle <strong>de</strong>rnier. Sur l’échelle du temps, c’est finalement<br />
récemment que nous passons doucement d’une relation paternaliste à une reconnaissance <strong>de</strong><br />
l’autonomie du patient et à la prise en compte <strong>de</strong> son avis.<br />
Le discours à l’Académie <strong>de</strong>s sciences morales et politiques du Dr <strong>Louis</strong> Portes, ancien<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins, cité par les trois auteurs Suzanne Rameix, Pierre Le Coz et<br />
Michela Marzano dans leurs ouvrages respectifs, nous montre bien le côté paternaliste <strong>de</strong><br />
cette relation, admis par tous en 1950 : « Tout patient est et doit être pour le mé<strong>de</strong>cin comme<br />
un enfant à apprivoiser, non certes à tromper – un enfant à consoler, non pas à abuser -, un<br />
enfant à sauver, ou simplement à guérir. » et encore « Face au patient, inerte et passif, le<br />
mé<strong>de</strong>cin n’a en aucune manière le sentiment d’avoir affaire à un être libre, à un égal, à un<br />
pair. »<br />
Le mé<strong>de</strong>cin, fort <strong>de</strong> son savoir peu partagé et fort <strong>de</strong> sa notoriété sociale, savait ce qui était<br />
bon pour l’autre. Le doute avoué avait peu <strong>de</strong> place dans cet échange basé sur le principe <strong>de</strong><br />
bienfaisance <strong>de</strong> la part du mé<strong>de</strong>cin et sur une confiance « aveugle et aveuglée » <strong>de</strong> la part du<br />
mala<strong>de</strong>. La responsabilité <strong>de</strong> la décision était entièrement dévolue au mé<strong>de</strong>cin.<br />
On retrouve dans le discours <strong>de</strong> certaines personnes âgées cette confiance totale avec, pour<br />
corollaire, une méconnaissance <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> certains <strong>de</strong> leurs traitements, voire une<br />
méconnaissance <strong>de</strong> ce qui leur a été enlevé lors d’opérations chirurgicales anciennes. Et ceci<br />
n’est pas à mettre sur le compte d’une mémoire défaillante, mais bien sur une attention sans<br />
failles accordée à leur mé<strong>de</strong>cin. A ce sujet, il faut d’ailleurs souligner le fait que, pour ces<br />
personnes âgées, habituées à ce que l’autre déci<strong>de</strong> et sait ce qui est bon pour elles, il est<br />
soudainement très déstructurant <strong>de</strong> les associer aux décisions : c’est un doute qui s’installe.<br />
Combien <strong>de</strong> fois ne nous répond-on pas : « c’est vous le mé<strong>de</strong>cin, faites ! ».<br />
Durant mes étu<strong>de</strong>s médicales, j’ai eu l’occasion <strong>de</strong> passer une année <strong>de</strong> mon externat en<br />
Allemagne en 1991-1992 . A l’époque, j’avais été frappée, dans les différents services où j’ai<br />
travaillé, par la présence <strong>de</strong>s formulaires <strong>de</strong> consentement à remplir par le patient pour tout<br />
examen complémentaire. Dans ces formulaires, outre la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> ce qui allait se passer,<br />
étaient également décrits tous les effets secondaires et les risques <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong> ces examens.<br />
A vous faire renoncer à ces examens <strong>de</strong>vant la crainte <strong>de</strong> voir se réaliser toutes les<br />
catastrophes prédites ! Il m’avait semblé que la relation entre patients et mé<strong>de</strong>cins étaient<br />
moins centrée sur le paternalisme et les patients étaient très en <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’explications,<br />
d’argumentations, <strong>de</strong> négociations sur leurs traitements et leur maladie, mettant plus<br />
facilement à mal leur mé<strong>de</strong>cin dans leurs incertitu<strong>de</strong>s, leurs imprécisions ou la justesse <strong>de</strong><br />
leurs paroles. Mais dans toute l’inexpérience manifeste <strong>de</strong> mon statut d’externe, il est difficile<br />
<strong>de</strong> tirer <strong>de</strong>s conclusions sur ces impressions. Seule la réalité <strong>de</strong> ces formulaires détaillés,<br />
23
inconnus <strong>de</strong> nos hôpitaux alors, rend compte <strong>de</strong> l’avancée <strong>de</strong> la relation qui pouvait se nouer<br />
Outre-Rhin entre le mé<strong>de</strong>cin et son patient.<br />
La relation actuelle entre le mé<strong>de</strong>cin et le mala<strong>de</strong> analysée par Pierre Le Coz dans le Petit<br />
traité <strong>de</strong> la décision médicale s’appuie sur les trois principes éthiques : le principe<br />
d’autonomie, le principe <strong>de</strong> bienfaisance et le principe <strong>de</strong> non-malfaisance.<br />
« - Le principe d’autonomie est la norme qui dicte le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> valoriser la capacité du patient<br />
(considéré alors comme un agent) <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r par lui-même et pour lui-même, ce qui suppose<br />
qu’il soit informé en connaissance <strong>de</strong> cause (il n’est <strong>de</strong> consentement libre qu’éclairé) et qu’il<br />
ne subisse pas <strong>de</strong> coercition, <strong>de</strong> quelque nature qu’elle soit.<br />
- Le principe <strong>de</strong> bienfaisance est la norme qui enjoint d’accomplir en faveur du patient un<br />
bien, ce qui implique, sur le plan thérapeutique, <strong>de</strong> réfléchir sur les bénéfices possibles, en<br />
terme <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> vie, que la mé<strong>de</strong>cine est susceptible <strong>de</strong> lui apporter.<br />
- Le principe <strong>de</strong> non-malfaisance est la norme qui dicte au mé<strong>de</strong>cin le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> ne pas<br />
exposer le mala<strong>de</strong> au risque <strong>de</strong> subir un mal qui ne serait pas la contrepartie du rétablissement<br />
<strong>de</strong> sa santé. Il a pour lointaine origine le primum non nocere hippocratique. » (Petit traité <strong>de</strong><br />
la décision médicale, Pierre Le Coz, p.57).<br />
Ces trois principes se conjuguent selon le contexte. Il est possible que, dans certaine situation,<br />
l’un <strong>de</strong> ses piliers <strong>de</strong>vienne prépondérant, voire même efface complètement l’un d’entre eux.<br />
Dans notre cas d’une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie, le patient ne pouvant être<br />
considéré comme ayant la pleine aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> son autonomie, les principes <strong>de</strong> bienfaisance et<br />
<strong>de</strong> non-malfaisance prévalent. Il s’agit alors <strong>de</strong> peser sa décision pour que l’hospitalisation ne<br />
soit pas source d’une stigmatisation, d’un jugement qui serait plus délétère pour le patient en<br />
l’enfermant dans un sentiment d’échec, <strong>de</strong> dévalorisation, <strong>de</strong> révolte contre les soignants et<br />
contre le tiers qui a signé la procédure et en renforçant peut-être alors sa pathologie<br />
psychiatrique. Il faudrait pouvoir prendre le temps <strong>de</strong> le convaincre <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong> la prise<br />
en charge psychiatrique et <strong>de</strong> l’amener doucement à participer activement à cette prise en<br />
charge. La frontière entre bienfaisance et paternalisme est bien fine dans ces cas !<br />
« Être bienfaisant envers le mala<strong>de</strong> revient donc à respecter sa représentation personnelle <strong>de</strong><br />
ce qui est préférable pour lui. Si le mé<strong>de</strong>cin cédait à la tentation <strong>de</strong> lui imposer sa vision du<br />
bien, son attitu<strong>de</strong> ne serait plus bienfaisante mais paternaliste. » (Petit traité <strong>de</strong> la décision<br />
médicale, Pierre Le Coz, p.59).<br />
Chemin difficile que celui qui se fraie entre le paternalisme qui serait l’absolutisation du<br />
principe <strong>de</strong> bienfaisance et déresponsabilisation du mé<strong>de</strong>cin qui serait l’absolutisation du<br />
principe d’autonomie.<br />
Suzanne Rameix, dans les Fon<strong>de</strong>ments philosophiques <strong>de</strong> l’éthique médicale, analyse la<br />
relation mé<strong>de</strong>cin-patient entre autonomie et paternalisme. Considérant l’évi<strong>de</strong>nce première du<br />
principe <strong>de</strong> bienfaisance et du paternalisme, elle met en lumière la fragilité du mala<strong>de</strong>, sa<br />
vulnérabilité. « Le mala<strong>de</strong> affaibli dans sa raison, d’une part, dans sa volonté, d’autre part, ne<br />
peut prendre une décision ni éclairée ni libre. Il y a donc une obligation morale fondée sur la<br />
protection du faible à se substituer à lui pour faire son bien. » (Fon<strong>de</strong>ments philosophiques <strong>de</strong><br />
l’éthique médicale, Suzanne Rameix, p.91).<br />
Elle explique pourquoi ce modèle n’est plus d’actualité, à la fois pour <strong>de</strong>s raisons liées à la<br />
mé<strong>de</strong>cine : cette science s’étant considérablement élargie, la quantité d’informations à<br />
délivrer <strong>de</strong>vient problématique (« une mé<strong>de</strong>cine moins savante avait moins à dire »), et la<br />
diversité <strong>de</strong>s thérapeutiques proposables <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, <strong>de</strong> plus, d’y confronter le patient.<br />
24
Il n’est plus d’actualité également pour <strong>de</strong>s raisons d’évolution <strong>de</strong> société : « la<br />
démocratisation <strong>de</strong> l’enseignement, l’accroissement <strong>de</strong>s connaissances et <strong>de</strong> l’autonomie <strong>de</strong>s<br />
citoyens, le développement <strong>de</strong> l’information médicale mettent en question le paternalisme et<br />
appellent une relation moins dissymétrique ». Elle souligne enfin que « le pluralisme <strong>de</strong>s<br />
conceptions politiques, philosophiques et religieuses » rend la notion du bien plus floue.<br />
On retrouve chez Suzanne Rameix dans les Fon<strong>de</strong>ments philosophiques <strong>de</strong> l’éthique médicale<br />
et chez Michela Marzano dans Je consens, donc je suis… la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux modèles <strong>de</strong><br />
relation mé<strong>de</strong>cin-mala<strong>de</strong>, celui français éclairé par Rousseau et Kant et celui anglo-saxon basé<br />
sur les théories <strong>de</strong> John Stuart Mill. Ces <strong>de</strong>ux modèles se distinguent par <strong>de</strong>s conceptions<br />
différentes <strong>de</strong> l’autonomie.<br />
II Le concept d’autonomie<br />
Comme nous l’avons vu, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> consentement aux soins et éventuellement<br />
l’acceptation d’un refus reposent sur le principe du respect <strong>de</strong> l’autonomie du patient. Mais<br />
qu’est-ce qu’être autonome ? Peut-on se déclarer autonome et vouloir se détruire, ne pas se<br />
soigner, voire en finir avec la vie ? Reconnaître l’autonomie <strong>de</strong> l’autre, est-ce se<br />
déresponsabiliser et justifier <strong>de</strong> sa non ingérence dans la vie <strong>de</strong> l’autre. De quel droit peut-on<br />
déci<strong>de</strong>r que la personne en face <strong>de</strong> soi n’est pas ou plus autonome ? Est-on vraiment<br />
autonome ?<br />
C’est bien sûr avec cette notion d’autonomie que nous jouons quand nous prenons la décision<br />
d’hospitaliser un patient en psychiatrie contre sa volonté. Quand il s’agit d’une pathologie<br />
psychiatrique bien définie dans les classifications telle une bouffée délirante aiguë, une phase<br />
maniaque d’une psychose maniaco-dépressive, une mélancolie, nous nous confortons dans<br />
notre savoir médical pour admettre avec évi<strong>de</strong>nce l’inexistence <strong>de</strong> l’autonomie <strong>de</strong> la personne.<br />
De la même façon, il peut être évi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> prendre les décisions à la place d’un patient atteint<br />
d’une démence <strong>de</strong> type Alzheimer.<br />
Mais cela me semble beaucoup plus délicat <strong>de</strong> définir l’autonomie <strong>de</strong> l’autre <strong>de</strong>vant un patient<br />
suicidaire ou <strong>de</strong>vant un patient qui se détruit par l’alcool ou par l’abus d’autres toxiques. Nous<br />
reviendrons sur le suici<strong>de</strong> dans un prochain paragraphe.<br />
Revenons donc sur le concept d’autonomie traité par les philosophes.<br />
Suzanne Rameix et Michela Marzano distinguent <strong>de</strong>ux conceptions différentes <strong>de</strong><br />
l’autonomie : l’une dans la philosophie continentale et française où ce concept découle <strong>de</strong>s<br />
écrits <strong>de</strong> Rousseau sur le plan politique dans le Contrat social <strong>de</strong> 1762 et <strong>de</strong> Kant sur le plan<br />
moral dans les Fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> la métaphysique <strong>de</strong>s mœurs <strong>de</strong> 1785 et l’autre dans la<br />
philosophie anglo-saxonne imprégnée par la pensée <strong>de</strong> John Stuart Mill.<br />
Dans la première, « l’autonomie est la faculté <strong>de</strong> se donner à soi-même la loi <strong>de</strong> son action,<br />
sans la recevoir d’un autre » (Fon<strong>de</strong>ments philosophiques <strong>de</strong> l’éthique médicale, Suzanne<br />
Rameix, p.94). L’origine <strong>de</strong> la norme morale se situe dans l’homme lui-même et ces auteurs,<br />
Rousseau et Kant, soulignent le caractère universalisable <strong>de</strong> cette norme. On ne peut pas<br />
vouloir quelque chose qui ne pourrait pas être applicable à autrui ce qui implique la<br />
production <strong>de</strong> lois. « Etre autonome c’est être moral, et être moral c’est poser et vouloir<br />
l’universalisable » (ibid).<br />
Ceci pose le problème évi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> ceux qui ne veulent pas quelque chose d’universalisable :<br />
celui qui se drogue, celui qui refuse la transfusion, celui qui refuse <strong>de</strong> se nourrir. « On le<br />
forcera à être libre » dit alors Rousseau dans le Contrat social !<br />
25
Dans la pensée anglo-saxonne, l’autonomie est plutôt le reflet d’une liberté individuelle. Il n’y<br />
a pas une unique vision du bien commun, mais une multiplicité <strong>de</strong> libertés individuelles.<br />
Chaque individu déci<strong>de</strong> pour lui-même sa propre conception du bien.<br />
Ces différences <strong>de</strong> conception seraient à l’origine du fait que la France se soit dotée <strong>de</strong> lois<br />
bioéthiques par la voie législative alors que les Nord-Américains règlent ces problèmes par la<br />
voie jurispru<strong>de</strong>ntielle.<br />
Michela Marzano dans Je consens, donc je suis... apporte quelques nuances dans la pensée <strong>de</strong><br />
John Stuart Mill. Cette « indépendance absolue » dont il parle dans De la liberté, est atténuée<br />
par l’affirmation que « ceux qui sont encore dépendants <strong>de</strong>s soins d’autrui doivent être<br />
protégés contre leurs propres actions, aussi bien que contre les risques extérieurs ». Elle<br />
montre que Mill a une conception optimiste <strong>de</strong> l’être humain selon laquelle on peut toujours<br />
convaincre quelqu’un <strong>de</strong>s conséquences préjudiciables <strong>de</strong> ses actes. Enfin elle n’oppose pas<br />
fondamentalement les <strong>de</strong>ux philosophes, Kant et Mill, en affirmant que, pour tous les <strong>de</strong>ux,<br />
l’autonomie renvoie à un projet <strong>de</strong> vie et à une affirmation <strong>de</strong> sa propre humanité.<br />
III Le consentement<br />
La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s et à la qualité du système <strong>de</strong><br />
santé représente une reconnaissance juridique, en France, <strong>de</strong> la nécessité du consentement<br />
préalable, libre, éclairé et révocable <strong>de</strong>s patients aux actes médicaux dans son article 6. Les<br />
caractéristiques <strong>de</strong> cette loi sont reprises dans la charte <strong>de</strong> la personne hospitalisée qui doit<br />
être portée à la connaissance <strong>de</strong> tout un chacun.<br />
Article 1 <strong>de</strong> cette charte : «Toute personne est libre <strong>de</strong> choisir l’établissement <strong>de</strong> santé qui la<br />
prendra en charge ».<br />
Ce premier article ne vaut pas pour les patients hospitalisés en psychiatrie, puisque les<br />
hôpitaux psychiatriques sont sectorisés et qu’un patient n’a pas le choix <strong>de</strong> son<br />
établissement…<br />
Article 4 : « Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du<br />
patient ».<br />
Sauf quand le mé<strong>de</strong>cin considère que, malgré la non obtention du consentement, le patient<br />
doit être hospitalisé en raison <strong>de</strong> troubles mentaux…<br />
Article 7 : « La personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l’établissement ».<br />
Sauf pour les personnes ayant nécessité, en raison <strong>de</strong> troubles mentaux, une hospitalisation à<br />
la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers ou une hospitalisation d’office…<br />
La loi met en avant le principe du consentement, mais ne l’explicite pas. Un patient en état <strong>de</strong><br />
vulnérabilité peut-il prendre <strong>de</strong>s décisions concernant sa santé ? Le consentement est-il<br />
l’expression <strong>de</strong> l’autonomie personnelle ? Le patient est-il vraiment libre <strong>de</strong> consentir ? Le<br />
patient peut-il être éclairé <strong>de</strong> telle sorte qu’il ait en mains tous les éléments qui lui permettent<br />
<strong>de</strong> prendre une décision ? Comment s’assurer que le « je » qui consent est en état d’énoncer<br />
clairement sa volonté et <strong>de</strong> manifester ainsi son autonomie ?<br />
« Consentir, c’est toujours un moyen pour l’individu <strong>de</strong> manifester son opinion, son point <strong>de</strong><br />
vue et ses préférences ; c’est pouvoir empêcher que quelqu’un d’autre déci<strong>de</strong> à notre place ou<br />
nous impose une décision nous concernant. Au point que ne pas prendre en compte le<br />
consentement <strong>de</strong> quelqu’un, ou ne pas le respecter, signifierait exercer sur cet individu une<br />
violence d’ordre physique ou symbolique ». Michela Marzano, Je consens, donc je suis…,<br />
p.5.<br />
26
Dans la prise <strong>de</strong> décision d’une hospitalisation en psychiatrie sans consentement, il faut<br />
gar<strong>de</strong>r à l’esprit tous ces questionnements qui permettent peut-être d’orienter l’entretien et <strong>de</strong><br />
laisser une porte entrouverte au patient afin qu’il ne se sente pas complètement dépossédé <strong>de</strong><br />
son pouvoir <strong>de</strong> consentement.<br />
IV Le suici<strong>de</strong><br />
« Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suici<strong>de</strong>. Juger que la vie<br />
vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale <strong>de</strong> la<br />
philosophie. Le reste, si le mon<strong>de</strong> a trois dimensions, si l’esprit a neuf ou douze catégories,<br />
vient ensuite. Ce sont <strong>de</strong>s jeux ; il faut d’abord répondre. » Albert Camus, Le mythe <strong>de</strong><br />
Sisyphe.<br />
De nombreux patients arrivent aux urgences après avoir ingurgité une quantité déraisonnable<br />
<strong>de</strong> médicaments.<br />
Sur l’année 2007, nous avons pris en charge, aux urgences <strong>de</strong> Sélestat, 168 personnes pour<br />
intoxication médicamenteuse volontaire. Sur ces 168 personnes, 60 ont accepté<br />
l’hospitalisation en psychiatrie, et 12 ont été hospitalisées à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers. Les<br />
hospitalisations libres en psychiatrie représentent donc 35.71% <strong>de</strong>s admissions aux urgences<br />
pour intoxication médicamenteuse volontaire, les hospitalisations à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers<br />
7.14%. Les 96 autres patients sont rentrés à domicile avec la proposition d’un suivi<br />
psychiatrique en ambulatoire (57.14% <strong>de</strong>s admissions pour intoxication médicamenteuse<br />
volontaire).<br />
Tous ces patients ne font pas ce geste à visée suicidaire. Certains veulent simplement<br />
s’étourdir, dormir, oublier. D’autres le font dans un geste <strong>de</strong> colère, <strong>de</strong> menace, <strong>de</strong><br />
provocation, <strong>de</strong> chantage affectif, comme ce jeune patient trentenaire qui venait <strong>de</strong><br />
commencer un traitement anticoagulant pour une phlébite et qui, suite à une contrariété <strong>de</strong> sa<br />
femme, a pris la boîte entière –une colère <strong>de</strong> petit garçon !<br />
Les intoxications médicamenteuses que nous surveillons dans l’unité d’hospitalisation <strong>de</strong><br />
courte durée ne sont pas dangereuses par essence. Les patients ayant pris <strong>de</strong>s substances plus<br />
toxiques sont pris en charge en réanimation. Il y a donc <strong>de</strong> toute évi<strong>de</strong>nce un biais <strong>de</strong><br />
recrutement. Les réels désirs <strong>de</strong> mourir sont finalement plutôt rares ou alors peu crédibles.<br />
Même en lisant quatre lettres d’adieux, à sa femme, à ses enfants, à ses parents et aux<br />
sauveteurs, j’ai <strong>de</strong> la peine à croire au désir <strong>de</strong> mourir du patient quand il a pris une boîte <strong>de</strong><br />
benzodiazépines.<br />
Il me semble qu’une personne autonome, en pleine possession <strong>de</strong> ses capacités <strong>de</strong> réflexion,<br />
luci<strong>de</strong> quant à son désir <strong>de</strong> vivre ou <strong>de</strong> mourir, ayant élaboré une pensée honnête, construite<br />
sur son projet <strong>de</strong> suici<strong>de</strong> n’arrive pas aux urgences après avoir avalé une boîte <strong>de</strong><br />
benzodiazépines. Elle n’arrive tout simplement pas, parce qu’elle a trouvé un moyen <strong>de</strong><br />
« réussir » son suici<strong>de</strong>.<br />
Ricardo Paseyro en parlant du suici<strong>de</strong> <strong>de</strong> Guy Debord, écrivain et fondateur <strong>de</strong><br />
l’internationale situationniste nous dit dans le Figaro en 1995 : « Prévu <strong>de</strong> longue main, son<br />
suici<strong>de</strong> ne recèle nul secret : Debord refusa à la maladie le droit <strong>de</strong> lui ravir son indépendance.<br />
Il n’était pas un homme mystérieux : il était un être rare, impossible à dompter, contraindre ou<br />
manipuler. Il n’aliénait sa liberté à personne –ni à la vie qu’il aimait, ni à la mort, qu’il<br />
domina. »<br />
27
Selon mon expérience, tous ces patients se présentant pour une intoxication médicamenteuse<br />
volontaire se trouvent dans un état <strong>de</strong> souffrance qui entrave leur sentiment d’autonomie. Ils<br />
sont dans un climat <strong>de</strong> détresse telle qui nous interdit <strong>de</strong> les abor<strong>de</strong>r comme pure conscience<br />
libre. Il me paraît justifié <strong>de</strong> leur tracer un chemin sans tenir compte <strong>de</strong> leur prétendue<br />
indépendance, même si ce chemin passe par une hospitalisation sous contrainte.<br />
Un jeune patient, pourtant bien décidé à en finir, tenait un discours clair sur sa vie, sur sa<br />
dépression interminable, sur ce qu’il faisait subir à sa femme et à ses enfants, sur son<br />
épuisement et sa souffrance insupportable et s’insurgeait <strong>de</strong> ne pas avoir réussi à mourir après<br />
avoir pris dix comprimés <strong>de</strong> lysanxia ! Comment prendre au sérieux son désir <strong>de</strong> mourir ?<br />
C’est sa souffrance morale qu’il exprime et qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à être entendue, soulagée. Pierre Le<br />
Coz nous dit dans le Petit traité <strong>de</strong> la décision médicale, p.71 : « Or, comment un homme<br />
peut-il être libre <strong>de</strong> vouloir mourir si sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est formulée sous l’influence d’une<br />
souffrance persistante qui pourrait être apaisée ? »<br />
Un autre patient, peu <strong>de</strong> temps après la mort <strong>de</strong> sa femme, s’était présenté aux urgences pour<br />
une intoxication médicamenteuse volontaire. Le len<strong>de</strong>main, il était encore fermement décidé à<br />
recommencer son geste. Dans ses antécé<strong>de</strong>nts, il avait 25 ans auparavant procédé à une<br />
défenestration du neuvième étage dont il avait miraculeusement réchappé. En lui expliquant<br />
que nous serons dans l’obligation <strong>de</strong> l’hospitaliser en psychiatrie, celui-ci s’est révolté :<br />
« Mais vous n’avez pas le droit ? ». Mais avons-nous le droit <strong>de</strong> laisser partir un patient qui<br />
nous exprime clairement son désir <strong>de</strong> mort ? On peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si, dans ce cas-là,<br />
l’hospitalisation sans consentement en psychiatrie n’est pas, pour nous mé<strong>de</strong>cins, une<br />
démarche médico-légale. Que se passerait-il si un patient se suicidait peu <strong>de</strong> temps après son<br />
passage aux urgences pour tentative <strong>de</strong> suici<strong>de</strong> ?<br />
Le suici<strong>de</strong> a été dépénalisé en France en 1810. Il pouvait être ironiquement passible <strong>de</strong> la<br />
peine <strong>de</strong> mort. Il est permis dans le sens où la loi ne le réprime pas.<br />
« On ne condamne plus ceux qui ont cherché à se suici<strong>de</strong>r, on les enferme, et on leur impose<br />
un régime qui est à la fois une punition et un moyen <strong>de</strong> prévenir toute nouvelle tentative.<br />
C’est à eux qu’on a appliqué, pour la première fois au XVIIIème siècle, les fameux appareils<br />
<strong>de</strong> contrainte, que l’âge positiviste utilisera comme thérapeutique : la cage en osier, avec un<br />
couvercle échancré en haut pour la tête, et dans laquelle les mains sont liées, ou l’armoire qui<br />
enferme le sujet <strong>de</strong>bout, jusqu’à la hauteur du cou, laissant seulement la tête libre ». (Michel<br />
Foucault, Histoire <strong>de</strong> la folie à l’âge classique, p130).<br />
Selon le courant philosophique, le suici<strong>de</strong> est perçu <strong>de</strong> manière très différente. Il peut être<br />
considéré comme un acte <strong>de</strong> liberté ou comme une marque <strong>de</strong> faiblesse. Pour Kant, il existe<br />
un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> conserver sa vie et un interdit moral du suici<strong>de</strong>. Un être autonome ne peut pas<br />
vouloir ce qui n’est pas universalisable. Le geste du suici<strong>de</strong> est celui qui contredit le plus<br />
profondément la liberté, puisqu’il en abolit définitivement l’usage :<br />
« Un argument apparemment rigoureux prétend d’abord que le suici<strong>de</strong> doit être permis et<br />
toléré. Les défenseurs <strong>de</strong> cette position soutiennent que l’homme, aussi longtemps qu’il ne<br />
viole pas le droit d’autrui sur les biens <strong>de</strong> cette terre, est libre <strong>de</strong> ces actes. [ …] Celui qui<br />
s’enlève la vie ne conserve cependant pas sa personne mais en dispose intégralement ; il ne<br />
fait donc pas que disposer <strong>de</strong> son état. Par son acte, il se vole à lui-même sa propre<br />
personne. » Kant, Leçons d’éthique, Le livre <strong>de</strong> poche, 1997, p.269-270.<br />
Nietzsche s’est également beaucoup penché sur la question du suici<strong>de</strong>. Il développe l’idée <strong>de</strong><br />
la liberté du choix <strong>de</strong> sa mort dans la plénitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> toute sa conscience. Dans Humain trop<br />
humain, Nietzsche se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : « Pourquoi y aurait-il plus <strong>de</strong> gloire pour un homme <strong>de</strong>venu<br />
vieux, qui pressent la déchéance <strong>de</strong> ses forces, à atteindre son lent épuisement et la<br />
28
dissolution, qu’à fixer un terme en pleine conscience ? Le suici<strong>de</strong> est dans ce cas une action<br />
toute évi<strong>de</strong>nte et toute naturelle, qui, étant une victoire <strong>de</strong> la raison, <strong>de</strong>vrait en équité exciter le<br />
respect ; et le fait est qu’elle l’excitait, aux temps où les chefs <strong>de</strong> la philosophie grecque et les<br />
patriotes romains les plus courageux avaient coutume <strong>de</strong> mourir par suici<strong>de</strong>. Au contraire, la<br />
soif <strong>de</strong> se prolonger <strong>de</strong> jour en jour par la consultation inquiète <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins et le régime <strong>de</strong><br />
vie le plus pénible, sans la force <strong>de</strong> se rapprocher du terme propre <strong>de</strong> la vie, est beaucoup<br />
moins respectable. »<br />
Les partisans du mouvement antipsychiatrique se basent sur <strong>de</strong>s affirmations <strong>de</strong> Nietzsche<br />
dans Humain trop humain telles que « Il y a un droit en vertu duquel nous pouvons ôter la vie<br />
à un homme, mais aucun qui permette <strong>de</strong> lui ôter la mort » pour défendre l’idée du droit légal<br />
au suici<strong>de</strong>. Dans leurs défenses véhémentes pour ce droit, ils font un amalgame entre<br />
l’hospitalisation sous contrainte en psychiatrie et l’incarcération. Ils mettent en doute la liberté<br />
d’expression puisque, dès que quelqu’un affirme son désir <strong>de</strong> mort, il est hospitalisé contre<br />
son gré. Ce serait donc un emprisonnement pour délit d’opinion. Ils encensent la liberté<br />
individuelle comme inaliénable et l’autopropriété comme valeur inhérente à l’individu. Enfin,<br />
ils réfutent la croyance dans la maladie mentale en démontrant que cette croyance se base sur<br />
un refus <strong>de</strong> la différence <strong>de</strong> l’autre et sur un jugement <strong>de</strong> valeur. Ils réclament le respect <strong>de</strong><br />
l’autonomie <strong>de</strong> l’autre si sa conduite ne nuit pas à autrui.<br />
Le débat du droit au suici<strong>de</strong> rejoint celui <strong>de</strong> l’euthanasie, car qui pourra dire qu’une<br />
souffrance physique est plus insupportable qu’une souffrance morale, celle-ci se rajoutant<br />
d’ailleurs bien souvent à la première et <strong>de</strong>venant par là même la raison du désir <strong>de</strong> mort ?<br />
Comment pourrons-nous justifier une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie pour<br />
motifs suicidaires si par ailleurs le trouble véhiculé par les médias sur les différents termes<br />
utilisés persiste ?<br />
Malgré tous ces débats, il me semble que les patients que nous recevons nous signifient un<br />
appel à l’ai<strong>de</strong>, sinon ils auraient trouvé un moyen plus radical d’en finir. Il s’agit alors surtout<br />
<strong>de</strong> trouver les mots justes pour les amener à accepter une hospitalisation, premier pas dans la<br />
prise <strong>de</strong> conscience que tout n’est pas joué et qu’ils sont acteurs <strong>de</strong> leur propre vie. Et peutêtre<br />
le temps serait pour nous un grand allié…<br />
29
CONCLUSION<br />
La rencontre entre le mé<strong>de</strong>cin et le patient est une rencontre entre <strong>de</strong>ux consciences, <strong>de</strong>ux<br />
perceptions différentes, <strong>de</strong>ux imaginaires, <strong>de</strong>ux savoirs qui visent un même objectif : le bienêtre<br />
du patient. C’est avec la connaissance <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s que va se jouer<br />
la prise <strong>de</strong> décision pour une thérapeutique adaptée et juste, autour d’un pivot central : le<br />
consentement. Progressivement, celui-ci est <strong>de</strong>venu une donnée incontournable dans le<br />
dialogue entre le mé<strong>de</strong>cin et le mala<strong>de</strong>. Il nous incite à réfléchir sur notre manière d’expliquer<br />
la pathologie, <strong>de</strong> clarifier la thérapeutique, <strong>de</strong> faire participer la personne soignée à nos<br />
décisions. Ce consentement reste paradoxalement un principe crucial <strong>de</strong> l’hospitalisation en<br />
psychiatrie sous contrainte. Dans la rencontre avec le patient aux prises avec son trouble<br />
mental, avec sa souffrance morale, il faut pouvoir lui restituer la possibilité <strong>de</strong> donner un<br />
consentement, lui faire entrevoir une ouverture où il pourra prendre conscience <strong>de</strong> son<br />
autonomie, même si momentanément un autre va <strong>de</strong>voir déci<strong>de</strong>r à sa place. Dans l’urgence, le<br />
temps <strong>de</strong>vient alors une valeur à rechercher pour ne pas bloquer ce dialogue quelque fois si<br />
tendu, pour comprendre l’imaginaire porté par le patient sur l’hôpital psychiatrique, sa crainte<br />
<strong>de</strong> la folie, l’amenant parfois à rejeter brutalement l’hospitalisation proposée.<br />
Nous avons vu que l’histoire <strong>de</strong>s internements en psychiatrie se lit avec l’évolution d’une<br />
société, qui définit, outre la pathologie mentale, ce qu’est l’ordre public. C’est cette notion<br />
d’ordre public qui génère la peur <strong>de</strong> l’arbitraire. Depuis la loi Esquirol <strong>de</strong> 1838, le mé<strong>de</strong>cin est<br />
<strong>de</strong>venu une interface entre le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé et celui d’un ordre établi par la société. Les<br />
décisions prises autrefois par lettres <strong>de</strong> cachet sans avis médical sont maintenant assurées par<br />
les mé<strong>de</strong>cins. Nous ne pouvons pas oublier <strong>de</strong>s pratiques encore récentes, voire actuelles<br />
d’internements pour opinions politiques divergentes et gênantes. Quelle place a alors le<br />
mé<strong>de</strong>cin dans la société ?<br />
La loi <strong>de</strong> 1990, les propositions <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> cette loi, les recommandations européennes<br />
sont autant <strong>de</strong> cadres <strong>de</strong>vant éviter tout arbitraire. Elles garantissent la protection du citoyen<br />
dans sa liberté individuelle. Il est logique <strong>de</strong> s’interroger sur la nécessité d’une intervention <strong>de</strong><br />
la justice dans la validation d’une privation <strong>de</strong> liberté. Dans certains pays, cette pratique<br />
existe, comme en Belgique et dans certains Län<strong>de</strong>r allemands par exemple. Cette question a<br />
été soulevée dans les recommandations européennes du Conseil <strong>de</strong> l’Europe et est débattue en<br />
France. L’intervention d’un tribunal pour entériner une hospitalisation sous contrainte en<br />
psychiatrie rendrait au mé<strong>de</strong>cin son rôle initial d’acteur <strong>de</strong> la santé et non pas <strong>de</strong> garant <strong>de</strong><br />
l’ordre public. Mais ce serait évi<strong>de</strong>mment alourdir la procédure en ajoutant encore un<br />
nouveau membre dans ce groupe <strong>de</strong> décision (à titre d’exemple, le <strong>de</strong>uxième certificat<br />
médical n’est bien souvent qu’une confirmation du premier sans réel débat, ni surtout sans<br />
réexamen <strong>de</strong> la personne concernée). Ne serait-ce pas avant tout une dilution <strong>de</strong> la<br />
responsabilité ?<br />
Les outils législatifs sont présents, il nous reste à les utiliser avec honnêteté et vigilance. La<br />
formation <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins est évi<strong>de</strong>mment un pilier <strong>de</strong> la prise en charge psychiatrique, mais la<br />
réflexion a posteriori est certainement encore à développer pour une meilleure compréhension<br />
<strong>de</strong>s enjeux. Face au patient et son désordre mental, le mé<strong>de</strong>cin, fort <strong>de</strong> ses connaissances<br />
médicales et <strong>de</strong> la loi, est seul à déci<strong>de</strong>r dans l’instant et dans l’urgence.<br />
30