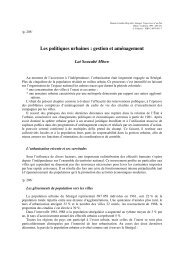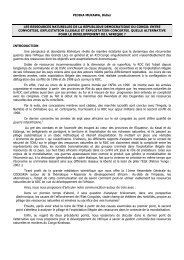CODESRIA CODESRIA
CODESRIA CODESRIA
CODESRIA CODESRIA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>CODESRIA</strong><br />
12th General Assembly<br />
Governing the African Public Sphere<br />
12e Assemblée générale<br />
Administrer l’espace public africain<br />
12a Assembleia Geral<br />
Governar o Espaço Público Africano<br />
عشر الثانية العمومية الجمعية<br />
ﻰﻘﻳﺮﻓﻹا مﺎﻌﻟا ءﺎﻀﻔﻟا ﻢﻜﺣ<br />
Comment peut-on « muséographier » un espace public sacré ?<br />
Cas d'Akaba Idéna, la porte monumentale de la cité<br />
historique de Ketu (République du Bénin)<br />
Alexis B.A. Adandé<br />
Département d'histoire et d'archéologie<br />
Université d'Abomey-Calavi<br />
07-11/12/2008<br />
Yaoundé, Cameroun
Introduction<br />
L'Afrique post-coloniale n'a toujours pas liquidé le passif des ruptures provoquées ou<br />
entretenues par l'administration coloniale et surtout l'idéologie du mépris de soi, infiltrée<br />
jusqu'au niveau religieux. Pourtant il n'aura pas manqué, en son temps, des Africains patriotes<br />
ou simplement lucides pour poser le diagnostic des traumatismes hérités (Fanon, 1951) et<br />
pour indiquer les voies de la décolonisation mentale. Le rôle fondamental de l'éducation avait<br />
été rappelé dans cette indispensable ascèse sociale et culturelle à la suite de la domination<br />
coloniale (Moumouni, 1964). Au regard de la situation actuelle, il nous faut bien constater la<br />
réalité du dicton selon lequel: "Nul n'est prophète chez soi"! Il serait d'une rare justesse sur<br />
notre continent...<br />
En choisissant le thème général : "Administrer l'espace public africain", pour sujet de<br />
réflexion de la XIIème Assemblée générale, le Conseil scientifique du <strong>CODESRIA</strong> offre, une<br />
fois de plus une occasion à la communauté des chercheurs et à l'intelligentsia moderniste du<br />
continent de faire le point de la situation en Afrique. Mieux, c'est une interpellation directe<br />
non seulement des professionnels de la recherche mais aussi des décideurs politiques et des<br />
opérateurs économiques africains, pour faire l'état des lieux du continent et se prononcer sur<br />
son devenir. A ce propos, nous ne pouvons manquer de saluer, ici, la pertinence du choix du<br />
thème central et nous féliciter du dynamisme impulsé par l'équipe du secrétariat général qui<br />
nous permet de commémorer, cette année, le trente-cinquième anniversaire du Conseil pour le<br />
développement des sciences sociales en Afrique, autour d'un thème aussi dense. Pour notre<br />
part, nous avons retenu de contribuer à cet effort de réflexion, sous l'angle du rapport au sacré,<br />
à la gestion d'un espace spécifique et au sacrilège. Autrement dit, en partant d'une étude d'un<br />
cas replacé dans son contexte culturel yoruba-nago, en République du Bénin, montrer les<br />
paradoxes de la prise de décision unilatérale de la bureaucratie d'Etat quand celle-ci choisit de<br />
se situer dans la logique de l'extraversion. Ketu est une cité historique dont le rayonnement<br />
dépasse les frontières actuelles du Bénin contemporain, non seulement en direction du Nigeria<br />
et des foyers de la diaspora récente en Côte d'Ivoire, au Ghana et autres contrées africaines<br />
mais aussi des descendants de la diaspora issue de la tragédie transatlantique, à Cuba et au<br />
Brésil notamment. Cette cité a été donc marquée par l'histoire et elle en garde encore les<br />
stigmates, elle a été détruite au XIXème siècle et sa population dispersée, avant d'amorcer sa<br />
reconstruction à la fin du même siècle et au début du suivant. Toutefois, la vieille ville<br />
conserve toutes les caractéristiques de la cité yoruba, outre ses vieux quartiers et marchés<br />
intérieurs, les ruines de palais royaux, les vestiges de son rempart et fossé d'enceinte et<br />
2
surtout sa porte monumentale désignée: Akaba Idéna, siège de la divinité protectrice de la<br />
cité. Pour les natifs de Ketu, Akaba Idéna à une valeur au moins double: y réside une grande<br />
déité protectrice et est le symbole de leur résistance à l'adversité. Pour les bureaucrates en<br />
charge de la gestion du patrimoine culturel national, c'est au plus une attraction touristique<br />
susceptible de générer des ressources financières. Là, se situe, probablement, l'écart entre<br />
deux fractions d'une même société, la société béninoise post-coloniale, porteuses chacune de<br />
différences culturelles et idéologiques quasi antagoniques.<br />
1. Le concept de patrimoine vivant et les rapports de l'élite africaine à la culture<br />
populaire<br />
La question culturelle reste récurrente sur le continent africain. Certes, elle n'a pas la même<br />
tonalité dans chaque pays, certains sont plus avancés que d'autres dans la réduction de la<br />
fracture entre l'élite au pouvoir et les valeurs culturelles vécues par le peuple, à commencer<br />
par l'usage des les langues ou d'une langue nationale dans l'administration, dans le système<br />
éducatif officiel. Les pays anglophones en général et ceux d'Afrique orientale et australe en<br />
particulier, paraissent avoir une nette avance sur les pays dits francophones ou lusophones. Le<br />
cas des pays dits arabophones n'est pas abordé car il nous semble devoir requérir une analyse<br />
en profondeur, si le patrimoine populaire doit servir de fondement à toute approche sérieuse,<br />
débarrassée de tout cliché réducteur.<br />
En fait, c'est au sein du peuple que vit la culture séculaire dans toutes ses dimensions, cette<br />
culture vivante n'est pas que immatérielle, elle a des aspects tangibles sous forme de la culture<br />
matérielle qui permet à nos populations de produire encore une part importante des biens<br />
nécessaires à la vie quotidienne malgré la concurrence parfois mortelle des objets<br />
manufacturés locaux ou d'importation massive. Les artisanats, les savoirs 'locaux',<br />
'endogènes', traditionnels', les savoir-faire et savoir être, sont autant d'éléments d'un<br />
patrimoine qui reste vivant tant qu'ils servent mais ce n'est pas sans érosion, au fur et à mesure<br />
que des pans entiers de connaissance tombe dans l'oubli (Adandé, 1992:228-229). Ce qui est<br />
valable dans le domaine du profane, l'est dans le domaine du religieux, du sacré, les<br />
croyances, les valeurs spirituelles que leurs supports matériels. Sur ce continent de la diversité<br />
tant dans le domaine de la nature très contrastée que des cultures très riches et variées, la<br />
signification, le sens attribué aux sites peut rester constant, permanent ou changer selon les<br />
groupes en présence ou les rapports de force. Ainsi, les bois sacrés, les forêts consacrées,<br />
des lieux construits ou non porteurs de sens, ont survécu jusqu'à nos jours et d'autres ont<br />
3
disparu à divers moments de l'histoire en raison des forces en présence et de la prédominance<br />
à un moment donné de celles porteuses de destruction ou au contraire de celles favorables à la<br />
conservation du patrimoine qu'il soit dit naturel ou culturel.<br />
Après la période coloniale, les nouveaux pouvoirs politiques africains sont<br />
généralement restés ambigus ou ambivalents par rapport à la question patrimoniale. Héritières<br />
d'un appareil bureaucratique pour l'essentiel répressif, en tout cas hostile aux initiatives<br />
populaires, les élites africaines mettent du temps à le réformer de fond en comble, si elles ne<br />
sont pas à l'origine du dysfonctionnement des tentatives de réformes effectuées çà et là. En<br />
fait il y a le discours volontiers radical et la praxis sociale souvent source de chaos, d'échec<br />
(Adandé, 2007:149-156). Cette attitude souvent inconséquente des cadres de la gestion des<br />
espaces publics, des ressources patrimoniales nationales ou déclarées telles, est à la source du<br />
divorce de plus en plus patent entre le peuple ou des communautés d'avec les décideurs ou du<br />
moins ceux qui s'arrogent le titre ou la fonction dans les Etats africains<br />
contemporains quelque soit la procédure employée (voie des urnes, nomination<br />
administrative, coup de force, etc.) pour accéder à ce pouvoir de décider pour les autres.<br />
2. Un cas de tentative de 'muséographier' du patrimoine vivant: Akaba Idena, la porte<br />
monumentale de Ketu<br />
La question culturelle est généralement considérée comme un domaine sensible car elle<br />
touche le champ de l'identité que implique le niveau de la sphère du privé voire de l'intimité<br />
mais également le collectif ceux avec qui on a en partage le véhicule linguistique, des valeurs,<br />
des croyances. Comme nous l'avons évoqué plus haut, la culture vivante implique aussi bien<br />
des aspects immatériels que des supports tangibles.<br />
En République du Bénin, à la faveur du "Renouveau démocratique" qui a été consécutif à la<br />
Conférence des forces vives de la Nation de février 1990, le gouvernement de Nicéphore<br />
Soglo, avait sollicité la coopération bilatérale française pour financer la réhabilitation, entre<br />
autre, de la porte monumentale de la ville de Ketu. Les travaux ont été confiés à une<br />
entreprise béninoise qui a respecté scrupuleusement le cahier de charge et pour la réalisation<br />
des opérations, elle s'est appuyée sur le savoir - faire des artisans locaux sous la supervision<br />
des autorités traditionnelles de la localité (le souverain-alaketu/kabiyessi et les chefs<br />
religieux). Il convient de rappeler que la conservation de Akaba Idéna était assurée jusqu'à<br />
cette intervention de la puissance publique, essentiellement par la communauté locale, les<br />
4
natifs et les sympathisants de la cité historique de Ketu. Ainsi, à la réception de l'ouvrage en<br />
1994, les responsables béninois du département de la gestion du patrimoine culturel, dévoile<br />
leur projet de faire de cet espace public, un nouveau musée national à accès tarifé (WAMP,<br />
2007:28). Les dispositions matérielles avaient été immédiatement prises en aménageant un<br />
enclos en avant et en arrière de ce monument à double porte (une mâle, à laquelle on accède<br />
après le franchissement du fossé et l'autre femelle que l'on atteint après avoir parcouru un<br />
vestibule et une cour pour entrer dans la vieille cité) (fig. 3). L'ensemble est couvert, excepté<br />
la cour à impluvium, des meurtrières sont ménagées vers l'extérieur ainsi que des chambres de<br />
garde pour les sentinelles. Au-dessus de la porte un escalier dont l'accès est réglementé,<br />
conduit vers l'autel de la déité protectrice de la cité et qui donne à ce monument son caractère<br />
sacré. En temps de paix, les portes doivent rester ouvertes et il serait agréable à cette divinité<br />
que le sol soit foulé par des personnes bien intentionnées qui franchissent pieds-nus le seuil<br />
principal.<br />
Ainsi deux logiques étaient mises face à face, d'une part celle des héritiers directs d'un<br />
patrimoine pluriséculaire et, d'autre part, celle du politique représenté par les gestionnaires du<br />
patrimoine de la direction du patrimoine culturel (D.P.C.) et leur projet "sacrilège"! Elles ne<br />
tarderont pas à s'affronter.<br />
Avant de venir au récit de cette confrontation malheureuse, faisons un bref rappel<br />
historique pour mieux cerner les enjeux actuels. La cité de Kétu est née, selon les traditions<br />
orales, de la première génération des villes issues des migrations à partir de Ile Ife le " berceau<br />
de la culture yoruba". A défaut de recherches archéologiques approfondies dans la vieille cité<br />
et en l'absence de données chronométriques, les historiens du monde yoruba situent sa<br />
fondation à la fin du XVIème ou au début du XVIIème siècle (Adédiran, 1994: 90). Elle a<br />
organisé un royaume autonome qui a occupé un espace géographique que l'on situe à cheval<br />
de la frontière bénino-nigériane et autour d'elle et de son deuxième pôle Meko, aujourd'hui en<br />
territoire de la République fédérale du Nigeria.<br />
Si le fondateur de la cité de Ketu est Ese, c'est à Alaketu Sa, le quatorzième sur la liste royale,<br />
que sont attribués les ouvrages de défense de la ville pour la protéger des attaques des voisins<br />
et ils ont été achevés par son successeur, Ekpo:<br />
" L'ensemble de la fortification mesure environ 3 500 mètres de circonférence (sic). Le<br />
fossé, large de 5 mètres environ, est interrompu à l'Est par la porte d'entrée, l'unique<br />
5
porte de la ville, appelée ici AKABA IDENA (porte de la sentinelle). Cette porte est<br />
'certainement le plus important exemple d'architecture militaire du monde<br />
yoruba'(Ajayi & Smith, 1964:27). Il s'agit d'un ensemble assez massif et assez<br />
imposant, d'une dizaine de mètres de côté. ' La porte d'IDENA possède deux entrées,<br />
intérieure et extérieure, de profonds porches situés à un angle, face à face, avec une<br />
porte externe s'avançant sur la ligne de la tranchée; entre les porches, il y a une cour<br />
avec une véranda couverte. Les murs en terre ont une épaisseur de 60 à 100<br />
centimètres; l'édifice était couvert de chaume'. Aujourd'hui, le toit de chaume est<br />
remplacé par des feuilles de tôle ondulée." (Iroko & Igué, 1975:8; Igué, 2008: 151).<br />
Ainsi il existe une documentation de base sur cette cité et des données anthropologiques sont<br />
disponibles mais elles ne semblent pas avoir été prise en compte dans le projet de<br />
muséographie du monument historique vivant et spirituellement fonctionnel pur les habitants<br />
de Ketu. Il est vrai que le réflexe documentaire semble constamment absent dans cette<br />
institution en charge de la gestion du patrimoine culturel, en République du Bénin. Nous<br />
avons déjà eu à déplorer l'absence de normes dans le projet de 'réhabilitation' de l'ancien fort<br />
portugais "Sâo Joâo Baptista de Ajuda"qui abrite le musée d'histoire de la ville de Ouidah<br />
(Adandé, 2000:129-131). Par ailleurs, pour des raisons à élucider, régulièrement, cette<br />
direction omet d'inclure dans le cahier de charge des entreprises ou dans le budget des projets<br />
d'intervention sur des sites historiques, les fouilles de sauvetage. Le même regret a été<br />
exprimé pour les travaux de restauration de Akaba Idéna, aux résultats par ailleurs<br />
remarquables, comme nous l'avons déjà souligné.<br />
A défaut d'un dialogue avec la population, un conservateur a été nommé et affecté au musée<br />
de site Akaba Idéna. Inutile de préciser que ce fonctionnaire n'était pas le bienvenu et qu'il<br />
n'avait pas l'appui de l'Alaketu alors régnant. Une lourde atmosphère d'hostilité a entouré ce<br />
conservateur jusqu'à ce qu'il se sente contraint de se retirer après avoir, d'après lui reçu des<br />
menaces et surtout après un grave accident de la circulation auquel il a survécu. Depuis le<br />
poste est vacant et l'administration centrale semble avoir laissé de facto, la gestion du<br />
monument à la communauté. L'accès y est à nouveau libre, à condition de respecter la<br />
coutume de se déchausser avant de franchir le seuil principal. Des guides "spontanés"<br />
proposent leurs services pour vous conduire à travers le monument et vous débiter les<br />
fragments de tradition qu'ils ont glanés on ne sait trop où.<br />
6
Il y a, là, manifestement un vide que des guides imprimés du genre Le petit futé, n'arrivent<br />
pas vraiment à combler quand ils ne cultivent pas des contre-vérités.<br />
3. Le drame de l'extraversion: une bureaucratie occidentalisée, la légèreté culturelle du<br />
politique<br />
Ce cas de projet muséal est un révélateur des nombreux problèmes des Etats héritiers des<br />
distorsions consécutives aux pratiques de l'administration et à l'éducation de la<br />
période coloniale et aux inaptitudes des décideurs actuels à les surmonter. Bien que plus de<br />
trois décennies se soient écoulées depuis l'octroi de l'indépendance et que ce ne soient plus<br />
des coloniaux ou des assistants techniques français ou autres qui prennent des décisions ou<br />
qui conçoivent des projets de musées , force est de constater que des nationaux agissent<br />
comme des étrangers à leur propre culture, vis à vis des "masses populaires", avec mépris<br />
(Gbédjinou, 2008:29-36) et une suffisance étonnante quand on considère l'absence d'une<br />
démarche documentaire élémentaire pour des cadres qui ont aujourd'hui un niveau<br />
universitaire relativement élevé, la maîtrise, le DEA ou l'équivalent. Manifestement, le<br />
problème se situe ailleurs. Pour nombre de responsable y compris hélas du domaine de la<br />
culture, notre patrimoine ne mérite d'être préservé que s'il peut rapporter de l'argent<br />
(Gbédjinou,2008:32). La conception qu'ils ont concrètement du musée, en dehors de toute<br />
rhétorique, c'est d'abord une attraction touristique. Et le touriste c'est avant tout celui qui a un<br />
pouvoir d'achat conséquent, l'Occidental, le Blanc. Notre culture dans cette conception du<br />
patrimoine est programmée pour être un simple folklore au sens le plus vulgaire du terme.<br />
Cette attitude mentale des cadres de conception peut d'autant plus se donner libre cours<br />
d'autant que les politique culturelles quand elles sont couchées sur papier ne quittent pas cette<br />
position ou très rarement. En clair on peut ausculter les pays de notre continent, on pourrait,<br />
dans la perspective la plus optimiste compter sur les doigts d'une main ceux qui se sont dotés<br />
d'une politique culturelle cohérente au profit des couches populaires en priorité. La légèreté<br />
des politiques africains en matière culturelle semble refléter leur ignorance de leur propre<br />
culture ou celle de leur peuple dont la diversité est une grande constante sur notre continent.<br />
Un simple test:, combien de ministres de la culture ont-ils visité les musées de leur propre<br />
pays en-dehors de l'accompagnement d'un visiteur "de marque"? Je n'oserai faire l'affront à<br />
nos chefs d'Etat mais combien de cadres le font? L'extraversion est d'abord un mode de se<br />
penser étranger à soi et s'exprime par des attitudes et des exclusions, des omissions. Les<br />
conséquences ne sont pas toujours évaluées en profondeur. Elles ont des répercussions<br />
désastreuses y compris dans la sphère socio-économiques puisqu'elle dicte jusqu'à nos<br />
7
modèles de consommation matérielle voire spirituelle.Elle contribue à distordre les schèmes<br />
de penser des couches populaires quand elle n'accentue pas le divorce entre ces dernières<br />
et cette élite extravertie qui se veut moderne ou moderniste.<br />
En guise de conclusion à cette rapide étude de cas de sacrilège administratif, nous sommes<br />
contraint de constater que dans le domaine du culturel, le zèle de l'élite "instruite" à<br />
déconstruire sa culture, son histoire et à "bazarder" son patrimoine culturel et naturel a<br />
quelque chose d'ahurissant. Ainsi notre constat rejoint celui de Boubacar Boris Diop qui dit<br />
ceci:" Un demi-siècle après, on se rend compte que notre vraie tragédie se résume ainsi: les<br />
élites africaines, après avoir tout 'oublié', n'apprennent finalement rien. Il y a un nom assez<br />
courant pour cette forme de monstruosité: la folie. Et, d'une certaine façon, notre démence, si<br />
ravageuse, consiste à s'imaginer que la modernité signifie la rupture totale d'avec son passé<br />
alors qu'elle doit être l'approfondissement des héritages les plus anciens, omniprésents et<br />
chaque fois différents" ( Celhto:92-93). Certes, notre continent est réputé être à un carrefour<br />
décisif pour son avenir, des bouleversements irréversibles seraient en cours et il appartiendrait<br />
à ses élites de donner les impulsions nécessaires pour que les peuples africains prométhéens<br />
transforment radicalement les paysages de misère et de famines qui semblent dominer sur un<br />
continent réduit à lutter contrer la pauvreté sans chercher à comprendre les causes<br />
fondamentales de ses misères....<br />
En fait, nous sommes interpelés par nos propres inconséquences et un examen de nos attitudes<br />
vis à vis de notre propre culture, de notre propre patrimoine et les réponses que nous<br />
trouverons au cours de cette quête, nous éclairerons sur nos chances d'avoir choisie la bonne<br />
ou les bonnes voies au carrefour de notre histoire. La sagesse populaire ne dit-elle pas: "si tu<br />
ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens...".<br />
Références bibliographiques<br />
Adandé Alexis 1992 "Recherche archéologique et information des nationaux", Quels musées<br />
pour l'Afrique? Patrimoine en devenir, Paris: ICOM, pp. 227-230.<br />
___________ 2000 "Benin- Buried heritage, surface heritage: the Portuguese fort of Sâo<br />
Joâo<br />
Baptista de Ajuda", ch. 18, pp. 127-131. In C.D. Ardouin & E. Arinze (eds.),<br />
8
Museums & History in West Africa, Washington: Smithsonian Institution Press,<br />
Oxford:James Currey.<br />
___________ 2002" Entre panache discursif et praxis chaotique: de la nécessité d'une<br />
autocritique de l'intelligentsia africaine", ch. 8, pp. 145-160. In Alexis B.A. Adandé<br />
(dir.), Intégration régionale, démocratie et panafricanisme - paradigmes anciens,<br />
nouveaux défis, Dakar: Codesria.<br />
Adandé Alexis et alii 2005 Reconnaissance archéologique sur l'axe routier Pobè - Kétou, 02-<br />
16 décembre 2005 (rapport provisoire), Abomey-Calavi: UAC/DHA/ERAB/Projet<br />
bénino-danois d'archéologie (BDArch), 10 p.+ XI p. annexes.<br />
Adediran Biodun 1994 The Frontier States of Western Yorubaland, circa 1600-1889 – State<br />
Formation and Political Growth in an Ethnic Frontier Zone, Ibadan: Institut Français<br />
de Recherche en Afrique (IFRA), 248 p.<br />
CELHTO 2008 La Charte de Kurukan Fuga - Aux sources d'une pensée politique en Afrique,<br />
Conakry:Société Africaine d'Edition e de Communication Paris: Editions Karthala,<br />
162 p.<br />
Ajayi J.F.A. and R.S. Smith 1964 Yoruba warfare in the Nineteenth Century, Cambridge:<br />
C.U.P.<br />
Gbédjinou Rodrigue, 2008, Le changement - idéologie ou réalité, hommage à Mgr Isidore de<br />
Souza, Cotonou: Star Editions, 161p.<br />
Hountondji Paulin J., 1997, Combats pour le sens- itinéraire africain, Cotonou: Les éditions<br />
du Flamboyant, 300 p.<br />
Igué John O. 2008, Les villes précoloniales d'Afrique noire, Paris: Les éditions Karthala,<br />
pp. 149-155.<br />
Moumouni Abdou 1964, Education en Afrique noire, Paris: François Maspéro.<br />
Ojo G.J.A. 1966 Yoruba Culture: A geographical analysis, University of Ifê and<br />
University of London.<br />
Parrinder E.G. 1997 Les vicissitudes de l'histoire de Ketu, traduit de l'anglais par Toussaint<br />
Sossouhounto (titre original: The Story of Ketu, 1956/1967, Ibadan: Ibadan<br />
University Press), Cotonou: Les éditions du Flamboyant, 151 p.<br />
WAMP 2007 Directory of Museums in West Africa / Répertoire des musées de l'Ouest<br />
africain, Dakar: West African Museums Programme, p. 28.<br />
9
Figure n°1 : Situation de Ketu<br />
Figure n° 2 : Akaba Idéna, porte sacrée de Ketu<br />
10
Figure n° 3 : Plan de Akaba Idéna et de la fortification de Ketu<br />
11