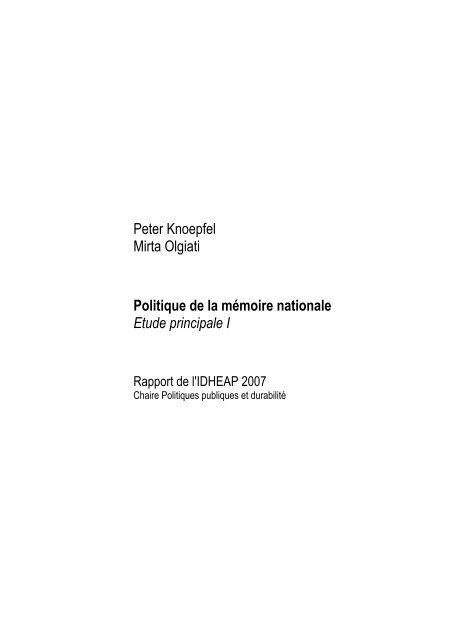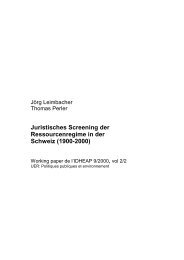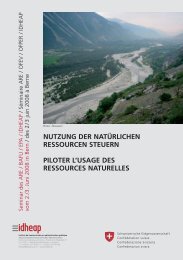Politique de la mémoire nationale Etude principale I - IDHEAP
Politique de la mémoire nationale Etude principale I - IDHEAP
Politique de la mémoire nationale Etude principale I - IDHEAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Peter Knoepfel<br />
Mirta Olgiati<br />
<strong>Politique</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> I<br />
Rapport <strong>de</strong> l'<strong>IDHEAP</strong> 2007<br />
Chaire <strong>Politique</strong>s publiques et durabilité
Institut <strong>de</strong> hautes étu<strong>de</strong>s en administration publique<br />
Unité <strong>de</strong> recherche : <strong>Politique</strong>s publiques et durabilité<br />
<strong>Politique</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
Prof. Peter Knoepfel<br />
Mirta Olgiati<br />
<strong>Politique</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>.<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> I<br />
Cette étu<strong>de</strong> constitue <strong>la</strong> suite <strong>de</strong>s rapports :<br />
- Peter Knoepfel, Mirta Olgiati, <strong>Politique</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>. Etu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> base. Idheap, UER : <strong>Politique</strong>s publiques et durabilité, Chavannesprès-Renens,<br />
2005.<br />
- Peter Knoepfel, Mirta Olgiati, <strong>Politique</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>.<br />
Compléments à l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base. Idheap, UER : <strong>Politique</strong>s publiques et<br />
durabilité, Chavannes-près-Renens, 2007.<br />
Chavannes-près-Renens<br />
18 juin 2007
Avant-propos<br />
Le présent document constitue <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong>s recherches empiriques sur <strong>la</strong> politique<br />
<strong>nationale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>. Il doit être considéré comme le prolongement du rapport <strong>Politique</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>. Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base publié en février 2005 et réalisé sur mandat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bibliothèque<br />
<strong>nationale</strong> suisse et <strong>de</strong>s Compléments à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base, publiés en 2007.<br />
Après <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base et grâce au travail <strong>de</strong> sensibilisation réalisé par<br />
Jean-Frédéric Jauslin – ainsi que tous les autres membres du groupe <strong>de</strong> travail chargé <strong>de</strong><br />
concevoir une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> en Suisse 1 – auprès <strong>de</strong> politiciens et opérateurs du<br />
secteur, le thème <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémopolitique s’est considérablement diffusé et est entré à faire partie<br />
<strong>de</strong>s débats et <strong>de</strong>s préoccupations <strong>de</strong>s responsables d’archives, bibliothèques, centres <strong>de</strong><br />
documentation, musées, mais aussi <strong>de</strong> toutes les administrations ayant <strong>de</strong>s stocks <strong>de</strong> données<br />
importantes et nécessaires pour le bon fonctionnement <strong>de</strong> leurs politiques publiques, etc. Au<br />
fur et à mesure que ce sujet <strong>de</strong>vient d’actualité, il s’avère donc d’autant plus important <strong>de</strong><br />
poursuivre les étu<strong>de</strong>s empiriques qui permettent d’une part <strong>de</strong> donner une image du<br />
fonctionnement actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation documentaire et d’autre part d’essayer <strong>de</strong><br />
comprendre quels sont les documents ou les informations dont une nation a impérativement<br />
besoin pour pouvoir fonctionner et qui doivent être conservés à long terme.<br />
Ainsi, l’<strong>IDHEAP</strong> a été mandatée par l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture, en accord avec M.<br />
Marc Wehrlin, <strong>de</strong> compléter l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base et <strong>de</strong> poursuivre ses travaux sous forme d’une<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> d’une durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans. Il est prévu que <strong>la</strong> suite <strong>de</strong>s recherches soit<br />
organisée en quatre volets : pratiques d’archivage dans <strong>de</strong>s instances fédérales qui<br />
collectionnent <strong>de</strong>s documents à caractère juridique ; pratiques d’archivage dans un nombre<br />
choisi <strong>de</strong> cantons et communes ; pratiques d’archivage dans <strong>de</strong>s entreprises privées ou<br />
privatisées ; pratiques d’archivage dans un pays étranger déterminé. A <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans, s’appuyant sur l’ensemble <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s empiriques, il s’agira <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>s<br />
éléments pour <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce institutionnelle d’une politique publique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> au<br />
niveau fédéral, ceci sous forme d’un rapport synthétique. L’ensemble <strong>de</strong>s recherches<br />
effectuées par l’<strong>IDHEAP</strong> dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mémopolitique prendra <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> différents<br />
documents à considérer dans leur ensemble, organisés ainsi :<br />
Mandant Document Contenu<br />
BN Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base Pratiques d’archivage dans <strong>de</strong>s institutions spécialisées<br />
OFC<br />
d’importance fédérale.<br />
Compléments à Pratiques d’archivage dans <strong>de</strong>ux autres institutions<br />
l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base. spécialisées d’importance fédérale.<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> I Pratiques d’archivage <strong>de</strong> données à caractère <strong>de</strong>scriptif,<br />
juridique et financier au niveau fédéral.<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> II Pratiques d’archivage dans un nombre choisi <strong>de</strong> cantons et<br />
communes.<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> III Pratiques d’archivage dans <strong>de</strong>s entreprises privées ou<br />
privatisées.<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> IV Pratiques d’archivage dans un pays étranger déterminé.<br />
Rapport synthétique Eléments pour <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce institutionnelle d’une<br />
politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> au niveau fédéral.<br />
1<br />
David Streiff, Christoph Graf, Bettina Nyffeler, Stephan Bieri, Kurt Deggeller, Rosemarie Simmen, Peter<br />
Knoepfel.
Cette Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> I est consacrée à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pratiques d’archivage dans <strong>de</strong>s<br />
instances fédérales qui collectionnent <strong>de</strong>s données ou documents à caractère <strong>de</strong>scriptif,<br />
juridique et financier. Elle comprend également une partie conceptuelle, qui constitue un pas<br />
en avant par rapport aux notions analytiques déjà présentées dans l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base, qui est<br />
exploitée dans les chapitres dédiés à l’analyse empirique <strong>de</strong>s pratiques d’archivage appliquées<br />
à <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> données déterminés. Le document se termine par une synthèse, une analyse<br />
du matériel récolté, l’annonce <strong>de</strong> <strong>la</strong> suite <strong>de</strong>s travaux, quelques éléments anticipatifs<br />
concernant <strong>la</strong> construction d’une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> et, enfin, par le renvoi aux<br />
références utilisées.<br />
Nous soulignons en outre que ce texte est un document <strong>de</strong> travail qui est appelé à évoluer<br />
d’ici <strong>la</strong> fin du mandat.
Table <strong>de</strong>s matières<br />
1 Introduction .............................................................................................................. 1<br />
2 Champs d’application.............................................................................................. 3<br />
3 Eléments conceptuels complémentaires ................................................................. 5<br />
3.1 Ressource « <strong>la</strong>ngage ».................................................................................... 7<br />
3.2 Ressource « raison » ...................................................................................... 8<br />
3.3 Ressource « espace & temps »..................................................................... 10<br />
3.4 Ressource « espace public »......................................................................... 11<br />
4 Analyse d’exemples choisis.................................................................................... 15<br />
4.1 Données météorologiques et climatologiques.............................................. 17<br />
4.1.1 Présentation <strong>de</strong>s données.................................................................. 17<br />
4.1.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................... 26<br />
4.1.3 Commentaires .................................................................................. 29<br />
4.2 Données statistiques..................................................................................... 31<br />
4.2.1 Présentation <strong>de</strong>s données.................................................................. 31<br />
4.2.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................... 43<br />
4.2.3 Commentaires .................................................................................. 48<br />
4.3 Données d’observation <strong>de</strong>s sols ................................................................... 51<br />
4.3.1 Présentation <strong>de</strong>s données.................................................................. 51<br />
4.3.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................... 62<br />
4.3.3 Commentaires .................................................................................. 65<br />
4.4 Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle........................................................... 67<br />
4.4.1 Présentation <strong>de</strong>s données.................................................................. 67<br />
4.4.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................... 79<br />
4.4.3 Commentaires .................................................................................. 85<br />
4.4.4 Complément d’information.............................................................. 86<br />
4.5 Données du registre foncier ......................................................................... 87<br />
4.5.1 Présentation <strong>de</strong>s données.................................................................. 87<br />
4.5.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................... 93<br />
4.5.3 Commentaires .................................................................................. 95<br />
4.6 Données <strong>de</strong> l’état civil.................................................................................. 97<br />
4.6.1 Présentation <strong>de</strong>s données.................................................................. 97<br />
4.6.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................. 106<br />
4.6.3 Commentaires ................................................................................ 110<br />
4.7 Données du casier judiciaire ...................................................................... 113<br />
4.7.1 Présentation <strong>de</strong>s données................................................................ 113<br />
4.7.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................. 120<br />
4.7.3 Commentaires ................................................................................ 124
4.8 Données <strong>de</strong> l’assurance-vieillesse et survivants ........................................ 125<br />
4.8.1 Présentation <strong>de</strong>s données................................................................ 125<br />
4.8.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................. 131<br />
4.8.3 Commentaires ................................................................................ 134<br />
4.9 Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée.................................................... 137<br />
4.9.1 Présentation <strong>de</strong>s données................................................................ 137<br />
4.9.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............................................. 142<br />
4.9.3 Commentaires ................................................................................ 145<br />
5 Synthèse................................................................................................................. 147<br />
5.1 Synthèse <strong>de</strong>s paragraphes <strong>de</strong> présentation <strong>de</strong>s données............................. 148<br />
5.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier........................................................... 149<br />
5.1.2 Contenu .......................................................................................... 150<br />
5.1.3 Supports.......................................................................................... 151<br />
5.1.4 Organe compétent .......................................................................... 153<br />
5.1.5 Bases légales .................................................................................. 154<br />
5.1.6 Coûts .............................................................................................. 156<br />
5.2 Synthèse <strong>de</strong>s paragraphes d’étu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation ............ 156<br />
5.3 Synthèse <strong>de</strong>s commentaires ....................................................................... 159<br />
6 Analyse du matériel empirique ........................................................................... 163<br />
6.1 Régu<strong>la</strong>tions par processus.......................................................................... 163<br />
6.2 Régu<strong>la</strong>tions par ressources......................................................................... 166<br />
6.2.1 « Mémorisabilité » – ressource « <strong>la</strong>ngage »................................... 167<br />
6.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation – ressource « raison » .......................... 170<br />
6.2.3 Mémorisation réelle – ressource « espace & temps ».................... 173<br />
6.2.4 Accessibilité – ressource « espace public » ................................... 175<br />
6.3 Constats...................................................................................................... 177<br />
7 Conclusion du rapport......................................................................................... 179<br />
8 Suite prévue .......................................................................................................... 181<br />
9 Vers une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>....................................................... 183<br />
10 Références ............................................................................................................. 187<br />
10.1 Entretiens ................................................................................................... 187<br />
10.2 Sites Internet .............................................................................................. 188<br />
10.3 Références bibliographiques...................................................................... 190<br />
10.4 Références légis<strong>la</strong>tives............................................................................... 194<br />
11 Annexe : questionnaire Memopolicy (orientation données).............................. 199
Liste <strong>de</strong>s abréviations<br />
AES Association <strong>de</strong>s entreprises électriques suisses<br />
AF Archives fédérales suisses<br />
AFC Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions<br />
AI Assurance-invalidité<br />
APG Allocations pour perte <strong>de</strong> gain<br />
ARE Office fédéral du développement<br />
ART Station <strong>de</strong> recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon<br />
ASS Association suisse <strong>de</strong> Statistique<br />
AVS Assurance-vieillesse et survivants<br />
CdC Centrale <strong>de</strong> Compensation<br />
CEN Comité européen <strong>de</strong> normalisation<br />
CEPMMT Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme<br />
CFF Chemins <strong>de</strong> fer fédéraux suisses<br />
CODAM Corporate Data Management<br />
CORSTAT Conférence suisse <strong>de</strong>s offices régionaux <strong>de</strong> statistique<br />
CSI Centre <strong>de</strong> service informatique du DFJP<br />
CWH Core Warehouse<br />
DDPS Dép. féd. <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense, <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s sports<br />
DETEC Dép. féd. <strong>de</strong> l'environnement, <strong>de</strong>s transports, <strong>de</strong> l'énergie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication<br />
DFF Département fédéral <strong>de</strong>s finances<br />
DFI Département fédéral <strong>de</strong> l’intérieur<br />
DFJP Département fédéral <strong>de</strong> justice et police<br />
D+M Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales<br />
DP TVA Division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée<br />
EFIM Sys. électr. <strong>de</strong> lecture <strong>de</strong> formu<strong>la</strong>ires et d’informations <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA<br />
EMG Etat-major général<br />
ENA Institut fédéral pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> neige et <strong>de</strong>s ava<strong>la</strong>nches<br />
EUMETSAT Org. européenne pour l’exploitation <strong>de</strong>s satellites météorologiques<br />
EUROSTAT Office statistique <strong>de</strong>s Communautés Européennes<br />
FSN Fédération Suisse <strong>de</strong>s Notaires<br />
GPS Global Positioning System<br />
IACETH Institut für Atmosphäre und Klima<br />
ICR Intelligent character recognition<br />
IMO Interface <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle
II<br />
INTERLIS Langage <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s données géographiques<br />
ISO Organisation inter<strong>nationale</strong> <strong>de</strong> normalisation<br />
KABO Kantonales Bo<strong>de</strong>nbeobachtungsnetz<br />
MétéoSuisse Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> météorologie et climatologie<br />
MO Mensuration officielle<br />
MOLIS Mehrwertsteuer Online Informations - System<br />
MTP Modèle topographique du paysage<br />
NABO Nationales Bo<strong>de</strong>nbeobachtungsnetz<br />
NAPOL Réseau national suisse <strong>de</strong>s mesures du pollen<br />
NUD Netzwerk Umweltdaten<br />
OCDE Organisation <strong>de</strong> coopération et <strong>de</strong> développement économiques<br />
OCR Optical character recognition<br />
OC-TVA Organe consultatif en matière <strong>de</strong> TVA<br />
OFAC Office fédéral <strong>de</strong> l’aviation civile<br />
OFAG Office fédéral <strong>de</strong> l’agriculture<br />
OFAS Office fédéral <strong>de</strong>s assurances sociales<br />
OFCL Office fédéral <strong>de</strong>s constructions et <strong>de</strong> <strong>la</strong> logistique<br />
OFEC Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil<br />
OFEV Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement<br />
OFIT Office fédéral <strong>de</strong> l’informatique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication<br />
OFRF Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier<br />
OFS Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique<br />
OMM Organisation Météorologique Mondiale<br />
PC Prestations complémentaires<br />
PP Prévoyance professionnelle<br />
SIA Société suisse <strong>de</strong>s ingénieurs et architectes<br />
SIDIS Système d’information sur les droits à inci<strong>de</strong>nce spatiale<br />
SIG Systèmes d’information géographiques<br />
SSCRF Société Suisse <strong>de</strong>s Conservateurs du Registre Foncier<br />
SSIGE Société suisse <strong>de</strong> l’industrie du Gaz et <strong>de</strong>s Eaux<br />
SSP Société suisse <strong>de</strong> pédologie<br />
SWISS-CABLE Association suisse <strong>de</strong> réseaux <strong>de</strong> communication<br />
swisstopo Office fédéral <strong>de</strong> topographie<br />
TVA Taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée<br />
UN United Nations<br />
VSA Association suisse <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> l’épuration <strong>de</strong>s eaux<br />
VSS Union <strong>de</strong>s professionnels suisses <strong>de</strong> <strong>la</strong> route
Liste <strong>de</strong>s figures<br />
Fig. 3.1 : Schéma du bien collectif <strong>mémoire</strong> et <strong>de</strong>s quatre ressources qui lui sont<br />
théoriquement à l’origine.<br />
Fig. 4.1.1 : Processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données météorologiques et<br />
climatologiques, <strong>de</strong>s données source jusqu’à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s données<br />
analysées.<br />
[Librement adapté suivant Christian Häberli, Hintergrundinformationen<br />
und Situationsbeurteilung für die Erarbeitung <strong>de</strong>r Datenarchitektur,<br />
version 1.0, 2.05.2005, ill. 6, p. 35].<br />
Fig. 4.2.1 : Processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données statistiques, <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte <strong>de</strong>s<br />
données brutes jusqu’à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s informations statistiques.<br />
Fig. 4.2.2 : Les organes <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale.<br />
[Tiré <strong>de</strong> : site Internet <strong>de</strong> l’OFS, page<br />
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/in<strong>de</strong>x/institutionen/oeffentliche_stati<br />
stik/bun<strong>de</strong>sstatistik.html, 16.01.07].<br />
Fig. 4.2.3 : Représentation schématique du transfert <strong>de</strong>s données dans le Core<br />
Warehouse et dans le système CODAM.<br />
Fig. 4.3.1 : Carte synoptique <strong>de</strong>s 105 sites du réseau NABO.<br />
[Tiré <strong>de</strong> : Desaules André, Schwab Peter, Keller Armin, Ammann<br />
Stefan, Paul Jean, Bachmann Hans-Jörg, Polluants inorganiques dans<br />
les sols suisses et évolutions après 10 ans, Agroscope FAL Reckenholz,<br />
Station <strong>de</strong> recherches fédérale en agroécologie et agriculture, Zurich,<br />
2006].<br />
Fig. 4.3.2a: Schématisation du processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données du NABO, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> zone d’étu<strong>de</strong> jusqu’aux résultats <strong>de</strong>s analyses.<br />
[Librement adapté à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fig. 3 à <strong>la</strong> p. 15 du Manuel Prélèvement<br />
et préparation d’échantillons <strong>de</strong> sols pour l’analyse <strong>de</strong> substances<br />
polluantes, Manuel <strong>de</strong> prélèvement sol (OSol), Berne, Office fédéral <strong>de</strong><br />
l’environnement, <strong>de</strong>s forêts et du paysage OFEFP, 2003].<br />
Fig. 4.3.2b : Schématisation du processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données du NABO, <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> base jusqu’aux publications.<br />
Fig. 4.3.3 : Structure organisationnelle <strong>de</strong> l’observation <strong>nationale</strong> <strong>de</strong>s sols NABO.<br />
[Tiré <strong>de</strong> :<br />
http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n/00972/00975/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr,<br />
Contexte, 27.02 2007].<br />
Fig. 4.4.1 : Schéma simplifié du système cadastral en Suisse : <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle.<br />
[Tiré et librement adapté <strong>de</strong> : Manuel sur l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle, Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo,<br />
Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, 2002, p. 10, fig. 1].<br />
Fig. 4.4.3 : Structuration en huit couches <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
numériques et <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns du registre foncier.<br />
[Tiré <strong>de</strong> : http://www.cadastre.ch/fr/target/<strong>la</strong>yerstructure.html,
II<br />
31.01.2007].<br />
Fig. 4.4.4 : Processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle.<br />
Fig. 4.5.1: Schéma simplifié du système cadastral en Suisse : le registre foncier.<br />
[Tiré et librement adapté <strong>de</strong> : Manuel sur l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle, Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo,<br />
Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, 2002, p. 10, fig. 1]<br />
Fig. 4.6.1 : Représentation schématique d’un système tenu en fonction <strong>de</strong>s familles<br />
et d’un système organisé par individu, comme c’est le cas pour<br />
INFOSTAR.<br />
Fig. 4.6.2 : Schéma simplifié du système <strong>de</strong> l’état civil.<br />
Fig. 4.6.3 : Représentation visuelle <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s que couvrent les registres spéciaux,<br />
le registre <strong>de</strong>s familles et INFOSTAR.<br />
Fig. 4.8.1 : Schéma simplifié <strong>de</strong>s principaux groupes d’acteurs <strong>de</strong> l’AVS.<br />
Fig. 6.1.1 : Représentation schématique <strong>de</strong>s phases au travers <strong>de</strong>squelles un type <strong>de</strong><br />
données hypothétique transite au cours <strong>de</strong> son existence, ainsi que <strong>de</strong>s<br />
acteurs concernés.<br />
Fig. 6.1.2 : Représentation schématique <strong>de</strong>s phases au travers <strong>de</strong>squelles chacun <strong>de</strong>s<br />
neuf types <strong>de</strong> données étudiées transite au cours <strong>de</strong> son existence, ainsi<br />
que <strong>de</strong>s niveaux d’acteurs concernés.<br />
Fig. 6.2.1 : Représentation schématique <strong>de</strong>s cercles <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tions caractérisant une<br />
politique publique durable.<br />
Fig. 9.1 : Représentation schématique <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>.
Liste <strong>de</strong>s tableaux<br />
Tab. 3.1 : Ressource « <strong>la</strong>ngage ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s<br />
supports adéquats pour rendre l’information mémorisable.<br />
Tab. 3.2 : Ressource « raison ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> jugement <strong>de</strong> ce qui est digne <strong>de</strong><br />
faire partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>.<br />
Tab. 3.3 : Ressource « espace et temps ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong><br />
construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> stockage<br />
Tab. 3.4 : Ressource « espace public ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong><br />
construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> mise en valeur et<br />
accessibilité.<br />
Tab. 5.2.1 : Tableau comparatif <strong>de</strong>s éléments qui caractérisent les quatre étapes du<br />
processus <strong>de</strong> mémorisation selon le domaine étudié.<br />
Tab. 5.3.1 : Tableau comparatif <strong>de</strong>s éléments qui caractérisent les quatre étapes du<br />
processus <strong>de</strong> mémorisation selon le domaine étudié.<br />
Tab. 6.2.1.1 : Ressource « <strong>la</strong>ngage ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s<br />
supports adéquats pour rendre l’information mémorisable.<br />
Tab. 6.2.2.1 : Ressource « raison ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> jugement <strong>de</strong> ce qui est digne <strong>de</strong><br />
faire partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>.<br />
Tab. 6.2.3.1 : Ressource « espace et temps ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong><br />
construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> stockage.<br />
Tab. 6.2.4.1 : Ressource « espace public ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong><br />
construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> mise en valeur et<br />
accessibilité.
1 Introduction<br />
La <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> – bien que nous ayons opté <strong>de</strong> ne prendre en considération que son<br />
volet matériel – peut être représentée par n’importe quel type <strong>de</strong> document, elle se trouve<br />
donc pour ainsi dire partout. Le choix <strong>de</strong> désigner une certaine catégorie <strong>de</strong> documents ou <strong>de</strong><br />
données comme étant partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> et <strong>de</strong> sélectionner par ce biais ce qui doit<br />
et ce qui ne doit pas être conservé à long terme est, par <strong>la</strong> force <strong>de</strong>s choses et dans une mesure<br />
plus ou moins gran<strong>de</strong>, arbitraire. Cependant, comme il s’avère absolument indispensable <strong>de</strong><br />
faire une sélection parmi <strong>la</strong> masse <strong>de</strong> documents et d’informations produites et susceptibles<br />
d’être transmises à travers les décennies, il est nécessaire <strong>de</strong> se poser <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir<br />
qu’est-ce qui pourrait constituer cette <strong>mémoire</strong> helvétique.<br />
Dans l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base et dans <strong>la</strong> première partie <strong>de</strong> cette Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> I nous avons<br />
étudié un nombre choisi d’institutions oeuvrant à un niveau national et ayant explicitement<br />
une fonction – au moins partiellement – <strong>de</strong> conservation patrimoniale (archives,<br />
bibliothèques, centres <strong>de</strong> documentation, musées). Ces institutions, au travers <strong>de</strong> leurs<br />
responsables et col<strong>la</strong>borateurs·trices, se caractérisent toutes par une sensibilité et une attention<br />
marquées pour <strong>la</strong> réflexion autour du patrimoine national et, par conséquent, <strong>de</strong> ce qui<br />
constitue <strong>la</strong> « <strong>mémoire</strong> » d’une nation. La gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s documents, objets et informations<br />
qui sont conservés par ces institutions le sont justement parce qu’il a été considéré qu’ils ont<br />
une valeur patrimoniale et qu’ils méritent d’être conservés à (très) long terme. Il s’est donc<br />
avéré re<strong>la</strong>tivement aisé <strong>de</strong> réaliser le travail empirique comparatif que nous avons fait dans <strong>la</strong><br />
perspective qui est <strong>la</strong> nôtre : un document ayant passé à travers les quatre étapes <strong>de</strong> sélection<br />
qui caractérisent schématiquement l’aboutissement du processus <strong>de</strong> mémorisation 2 entre à<br />
faire partie d’une forme officielle <strong>de</strong> patrimonialisation au travers <strong>de</strong> l’institution qui l’a pris<br />
en charge.<br />
Néanmoins, il serait justement très limitatif <strong>de</strong> réduire <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> aux seuls<br />
documents, objets et informations conservés dans <strong>de</strong>s archives, <strong>de</strong>s bibliothèques ou <strong>de</strong>s<br />
musées. Quelles sont alors les autres types <strong>de</strong> données qui pourraient être considérées comme<br />
étant une partie importante <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> et qui sont produites, utilisées et<br />
conservées par <strong>de</strong>s institutions publiques au niveau national ? Dans l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base nous<br />
avions proposé plusieurs pistes possibles, notamment celles d’étudier les documents liés à <strong>de</strong>s<br />
produits <strong>de</strong> politiques publiques, les outputs juridiques et les outputs statistiques et<br />
inventaires 3 .<br />
Après avoir réalisé quelques entretiens préa<strong>la</strong>bles, nous avons pris le parti <strong>de</strong> nous<br />
concentrer sur <strong>de</strong>s exemples d’outputs <strong>de</strong>scriptifs, juridiques et financiers (qui ont tous une<br />
valeur statistique), car nous nous sommes rendu compte qu’ils sont constitués <strong>de</strong> données qui<br />
ne rentrent souvent pas dans les processus d’archivage habituels. Nous avons donc décidé <strong>de</strong><br />
modifier notre point <strong>de</strong> vue et <strong>de</strong> nous concentrer sur <strong>de</strong>s données qui ne sont pas archivées au<br />
sens technique du terme, mais qui doivent être conservées à plus ou moins long terme.<br />
Ce choix a été motivé pour <strong>de</strong>ux raisons : <strong>la</strong> première est que les Archives fédérales,<br />
institution officiellement chargée d’archiver à long terme les documents produits par les<br />
instances fédérales, ont déjà été présentées dans l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base. Nous considérons donc qu’il<br />
n’y a pas lieu <strong>de</strong> se pencher sur les documents soumis à <strong>la</strong> Loi fédérale sur l'archivage (Lar)<br />
du 26 juin 1998 (RS 152.1) et à l’Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur l'archivage<br />
2 Se référer au chapitre « 2 Conception analytique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Memopolicy » <strong>de</strong> l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base, pp. 3-9 en particulier.<br />
3 Se référer au chapitre « 2.3 Champs d’application » <strong>de</strong> l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base, pp. 9 et sv.
2 INTRODUCTION<br />
(OLAr) du 8 septembre 1999 (RS 152.11) et qui aboutissent à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> leur cycle <strong>de</strong> vie aux<br />
Archives fédérales. La <strong>de</strong>uxième raison est que les Archives fédérales connaissent mieux que<br />
quiconque les processus d’archivage <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> documents ; il serait donc redondant <strong>de</strong> les<br />
étudier ici.<br />
Ainsi, cette <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> l’Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> I consacrée à <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> se propose <strong>de</strong> se pencher sur l’analyse <strong>de</strong> quelques exemples <strong>de</strong> catégories<br />
d’informations (surtout sous forme <strong>de</strong> données informatiques) sans lesquelles une nation ne<br />
pourrait pas fonctionner et qui sont mal connues, car il s’agit <strong>de</strong> données dont <strong>la</strong> durée du<br />
cycle <strong>de</strong> vie – et donc leur utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s institutions compétentes – peut s’étaler sur<br />
plusieurs décennies et même sur une durée <strong>de</strong> temps indéterminée. Leur archivage au sens<br />
stricte du terme n’est donc pas possible, mais leur conservation à long terme doit être<br />
garantie.<br />
Il s’agira ainsi <strong>de</strong> déterminer à travers <strong>de</strong>s exemples quelles sont ces catégories <strong>de</strong><br />
données, <strong>de</strong> les désigner, d’essayer <strong>de</strong> les décrire et d’en déterminer les caractéristiques afin<br />
d’en avoir un aperçu plus précis. Cette connaissance empirique préa<strong>la</strong>ble, outre le fait<br />
d’é<strong>la</strong>rgir <strong>la</strong> réflexion, permettra <strong>de</strong> sensibiliser les différents acteurs impliqués au fait que les<br />
gran<strong>de</strong>s questions liées aux processus d’archivage ou <strong>de</strong> conservation documentaire à long<br />
terme sont le commun dénominateur <strong>de</strong> toutes les institutions et que, en dépit <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques qui différencient les processus en usage dans chacune d’entre elles, <strong>de</strong>s<br />
similitu<strong>de</strong>s peuvent être mises en relief. Suite à cette prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s acteurs<br />
concernés et, si possible, à un échange <strong>de</strong> compétences entre eux, <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> décisions dans ce<br />
domaine pourrait se révéler pour chacun plus aisée.<br />
En lisant les pages qui suivront, le lecteur <strong>de</strong>vra ainsi tenir compte du fait que, par rapport<br />
aux chapitres traités précé<strong>de</strong>mment sur <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>, ici <strong>la</strong> perspective<br />
d’observation n’est plus <strong>la</strong> même : on traitera ici du processus <strong>de</strong> conservation à long terme<br />
du point <strong>de</strong> vue du type <strong>de</strong> données (produites par différents acteurs), et non pas du point <strong>de</strong><br />
vue <strong>de</strong>s institutions.
2 Champs d’application<br />
Plusieurs types <strong>de</strong> données ou d’informations nous apparaissent comme étant<br />
fondamentales pour le fonctionnement d’un Etat, dans le cas présent <strong>la</strong> Confédération suisse :<br />
nous avons pris l’option <strong>de</strong> nous concentrer ici sur <strong>de</strong>s exemples <strong>de</strong> données d’outputs<br />
<strong>de</strong>scriptifs, juridiques et financiers.<br />
Nous utilisons ici le terme d’output au sens d’acte <strong>de</strong> mise en œuvre d’une politique<br />
publique. Nous partons donc <strong>de</strong> l’idée qu’il existe <strong>de</strong>s informations, sous forme <strong>de</strong> données<br />
informatisées ou sous forme <strong>de</strong> documents, qui représentent le produit (au sens <strong>de</strong> résultat)<br />
d’une activité administrative <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> politiques publiques. Ce type d’information<br />
peut possé<strong>de</strong>r différentes formes <strong>de</strong> valeur, dont les plus utilisées nous paraissent justement<br />
être <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>scriptive, juridique et financière. Toutes ces données sont en outre utilisées à<br />
<strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> statistiques.<br />
Les données que nous définissons comme étant <strong>de</strong>scriptives sont constituées<br />
essentiellement d’informations décou<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> mesures et d’observations : elles constituent le<br />
produit <strong>de</strong> politiques publiques déjà existantes et permettent en même temps d’anticiper et <strong>de</strong><br />
concevoir <strong>de</strong>s politiques publiques futures suivant les variations que le milieu qu’elles<br />
observent et décrivent subit. Les exemples que nous avons choisis, toujours au niveau fédéral,<br />
pour illustrer cette catégorie <strong>de</strong> données sont les suivants :<br />
• données météorologiques et climatologiques<br />
• données statistiques<br />
• données d’observation environnementale (sol)<br />
Les données d’ordre juridiques sont par contre individuelles, personnalisées et<br />
constitutives pour l’existence <strong>de</strong> droit. Les données qui seront étudiées sont <strong>de</strong>s exemples <strong>de</strong><br />
données juridique <strong>de</strong> nature spatiale (<strong>de</strong>ux premiers exemples) et personnelle (trois exemples<br />
suivants) :<br />
• données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
• données du registre foncier<br />
• données <strong>de</strong> l’état civil<br />
• données du casier judiciaire<br />
• données <strong>de</strong>s assurances sociales (AVS)<br />
Enfin, nous avons pris un exemple <strong>de</strong> données qui ont essentiellement un caractère<br />
financier :<br />
• données <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée<br />
Ces groupes <strong>de</strong> données, ou d’informations, sont produits par plusieurs groupes d’acteurs<br />
se situant à niveaux administratifs, mais leur surveil<strong>la</strong>nce est attribuée au niveau fédéral à <strong>de</strong>s<br />
administrations ou organes déterminés. Des entretiens effectués avec <strong>de</strong>s personnes travail<strong>la</strong>nt<br />
dans ces institutions <strong>de</strong> centralisation fédérales ont constitué <strong>la</strong> porte d’entrée pour étudier ces<br />
données sans <strong>de</strong>voir interviewer chaque groupe d’acteur concerné dans <strong>la</strong> production <strong>de</strong> ces<br />
informations. Les personnes qui se sont engagées pour ces entretiens ont ensuite relu et validé<br />
les chapitres rédigés ; ce travail a donc impliqué <strong>de</strong> leur part un engagement en termes <strong>de</strong><br />
temps et d’effort que nous avons tout particulièrement apprécié. Nous tenons à les remercier
4 CHAMPS D’APPLICATION<br />
pour cet effort. D’autres institutions ont été sollicitées mais n’ont pas pu accepter <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
d’entretien, essentiellement pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> temps et <strong>de</strong> charge <strong>de</strong> travail 4 .<br />
Cette nouvelle étape <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> nous rapproche <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong>s supports informatiques<br />
et aux banques <strong>de</strong> données. Comme il s’agit en effet <strong>de</strong> données actuellement en utilisation et<br />
non pas <strong>de</strong> documents déjà archivés, le papier est <strong>de</strong> moins en moins utilisé dans <strong>la</strong> réalisation<br />
courante <strong>de</strong>s tâches dans l’administration fédérale. La numérisation <strong>de</strong>s informations<br />
produites à l’origine sur papier et <strong>la</strong> production sous forme informatique <strong>de</strong>s données permet<br />
<strong>de</strong> mieux les partager et <strong>de</strong> mieux les faire circuler. De plus, il s’agit <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong><br />
données sous forme <strong>de</strong> textes écrits, d’images et <strong>de</strong> sons. La distinction entre catégories <strong>de</strong><br />
produits et <strong>de</strong> supports <strong>de</strong>vient donc très rapi<strong>de</strong>ment caduque.<br />
Comme nous le verrons tout au long <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> empirique, les questions liées à<br />
l’archivage <strong>de</strong>s données informatiques si diverses et nombreuses sont encore à résoudre, les<br />
Archives fédérales travaillent d’ailleurs actuellement à <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> solutions.<br />
4 Il s’agit <strong>de</strong> l’Office fédéral du registre du commerce et <strong>de</strong> l’Institut fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelle (IPI).
3 Eléments conceptuels complémentaires<br />
Nous avions présenté au début <strong>de</strong> l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base le concept analytique qui soutient notre<br />
représentation théorique <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> et <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s chapitres d’analyse<br />
empirique. Ce concept était représenté par un schéma résumant le processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> (comprise dans son acception physique) ainsi que les prestations collectives<br />
nécessaires à son existence 5 . Le schéma montrait comment le processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> au niveau <strong>de</strong> l’action <strong>de</strong>s opérateurs du secteur se caractérise par <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong><br />
choix successives qui interviennent le long du processus <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s documents, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
création d’une masse indéterminée d’informations jusqu’à <strong>la</strong> mise à disposition du public<br />
d’un document donné. Nous avions montré également que les quatre sélections qui<br />
caractérisent ce processus ne sont réalisables que dans <strong>la</strong> mesure où l’on dispose d’un nombre<br />
correspondant <strong>de</strong> capacités déterminées (ou prestations) qui <strong>de</strong>vraient être gérées par <strong>de</strong>s<br />
régu<strong>la</strong>teurs afin d’en assurer <strong>la</strong> subsistance et <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> qualité du déroulement <strong>de</strong> tout le<br />
processus.<br />
Dans les entretiens menés jusque là, ce cadre analytique a été opératif et structurant. Il a<br />
permis <strong>de</strong> mettre en relief un certain nombre d’aspects intéressants d’une manière<br />
comparative. Aussi, les personnes interviewées suivant cette structure théorique ont souvent<br />
été amenées à réfléchir au fonctionnement <strong>de</strong> l’institution dans <strong>la</strong>quelle elles travaillent<br />
suivant un regard qui leur était inhabituel, à prendre du recul et à se poser <strong>de</strong>s questions<br />
d’ordre général.<br />
Néanmoins, il nous est apparu que, avec l’entrée en jeu <strong>de</strong>s nouveaux supports<br />
informatiques, les étapes qui mènent <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’information jusqu’à <strong>la</strong> mise à<br />
disposition du public d’un document donné se complexifient davantage et poursuivent un<br />
chemin <strong>de</strong> moins en mois linéaire. Certains aspects, pratiquement absents dans les processus<br />
d’archivage traditionnels, prennent du ressort et <strong>de</strong>viennent fondamentaux. Ainsi, dans <strong>la</strong><br />
suite <strong>de</strong> nos réflexions théoriques, nous nous sommes <strong>de</strong>mandé comment il était possible <strong>de</strong><br />
compléter le cadre conceptuel afin <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> ces nouveaux éléments. Nous avons<br />
pris l’option d’appliquer les concepts <strong>de</strong> ressources et <strong>de</strong> durabilité, traditionnellement<br />
utilisés dans le domaine <strong>de</strong>s politiques environnementales, à celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
<strong>nationale</strong>.<br />
Les quatre capacités (capacité <strong>de</strong> production <strong>de</strong> supports, capacité <strong>de</strong> jugement, capacité<br />
<strong>de</strong> stockage, capacité <strong>de</strong> mise en valeur appropriée) nécessaires à gérer <strong>la</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> peuvent être considérées comme <strong>de</strong>s services fournis par <strong>de</strong>s ressources en<br />
partie matérielles et en partie immatérielles. Si le régu<strong>la</strong>teur veut veiller à ce que ces quatre<br />
capacités soient toujours actives, il doit également s’assurer que <strong>la</strong> reproduction et par là<br />
même l’existence <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong> base soient garanties. Nous avons pour le moment appelé<br />
ces quatre ressources « <strong>la</strong>ngage », « raison », « espace & temps », « espace public ». Ce<br />
concept est néanmoins encore à développer et subira certainement encore <strong>de</strong>s changements.<br />
Les quatre ressources 6 , schématisées dans <strong>la</strong> figure 3.1 ci-<strong>de</strong>ssous, peuvent être définies<br />
comme suit :<br />
5 Se référer à <strong>la</strong> Fig. 1 <strong>de</strong> l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base, p. 2.<br />
6 Se référer à Peter Knoepfel/Mirta Olgiati, "National Memory Building Processes: the Emergence of<br />
Institutional Regimes for collective resources in the field of Sustainable Management of the Documentary<br />
Heritage", Paper for the International Association for the Study of Common Property Europe Regional Meeting<br />
(Brescia – Italy – March 23-25, 2006), February 2006. [http://iascpeurope.eco.unibs.it/]
6 ELEMENTS CONCEPTUELS COMPLEMENTAIRES<br />
(1) le « <strong>la</strong>ngage » est <strong>la</strong> ressource permettant <strong>la</strong> mémorisabilité <strong>de</strong>s documents ou<br />
<strong>de</strong>s informations, au sens <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité d’une société à produire <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s et<br />
<strong>de</strong>s supports adéquats pour fixer une information ;<br />
(2) <strong>la</strong> « raison » est <strong>la</strong> ressource qui produit <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> juger si un document<br />
est digne ou non d’être mémorisé ;<br />
(3) l’« espace & temps » est <strong>la</strong> ressource responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> stocker<br />
<strong>de</strong>s documents ou <strong>de</strong>s données ;<br />
(4) l’« espace public » est <strong>la</strong> ressource capable <strong>de</strong> permettre <strong>la</strong> mise à disposition<br />
et <strong>la</strong> valorisation <strong>de</strong>s documents et <strong>de</strong>s informations aux utilisateurs<br />
intéressés.<br />
Producteurs<br />
Capacité <strong>de</strong><br />
production<br />
<strong>de</strong> supports<br />
prestations<br />
Données<br />
Ressource<br />
« <strong>la</strong>ngage »<br />
T<br />
Filtre<br />
« Mémorisabilité<br />
»<br />
Ressource<br />
«raison»<br />
Capacité <strong>de</strong><br />
jugement<br />
Données<br />
mémorisables<br />
Dignité à <strong>la</strong><br />
mémorisation<br />
Ressource<br />
« espace & temps »<br />
Capacité <strong>de</strong><br />
stockage<br />
Données à<br />
mémoriser<br />
Mémorisation<br />
réelle<br />
Données<br />
mémorisées<br />
Ressource<br />
« espace public »<br />
Données<br />
accessibles<br />
Accessibilité<br />
au public<br />
Capacité <strong>de</strong><br />
mise en valeur<br />
Fig. 3.1 : Schéma du bien collectif <strong>mémoire</strong> et <strong>de</strong>s quatre ressources qui lui sont<br />
théoriquement à l’origine.<br />
La prise en considération d’une perspective axée sur les ressources nous permet<br />
d’englober dans notre analyse l’approche <strong>de</strong>s régimes institutionnels 7 . Ceci nous permet <strong>de</strong><br />
prendre en considération dans <strong>la</strong> réflexion <strong>de</strong>s groupes d’acteurs, <strong>de</strong>s éléments et <strong>de</strong>s<br />
régu<strong>la</strong>tions qui ne sont pas directement en lien avec les politiques substantielles qui régissent<br />
les domaines analysés. Ces aspects complémentaires que l’approche <strong>de</strong>s régimes<br />
institutionnels – couplée avec les concepts tirés <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s politiques publiques que nous<br />
avons utilisés jusqu’ici – permet <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce sont essentiellement trois :<br />
7 Se référer à Peter Knoepfel, Ingrid Kissling-Näf, Frédéric Varone (éds.), Institutionelle Regime für natürliche<br />
Ressourcen: Bo<strong>de</strong>n, Wasser und Wald im Vergleich – Régimes institutionnels <strong>de</strong> ressources naturelles: analyse<br />
comparée du sol, <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt, Bâle: Helbing & Lichtenhahn (série Ecologie & Société, vol. 17), 2001 ;<br />
Peter Knoepfel, Ingrid Kissling-Näf, Frédéric Varone (éds.), Institutionelle Ressourcenregime in Aktion<br />
(Régimes institutionnels <strong>de</strong> ressources naturelles en action), Bâle: Helbing & Lichtenhahn (série Ecologie &<br />
Société, vol. 19), 2003.<br />
Utilisateurs
ELEMENTS CONCEPTUELS COMPLEMENTAIRES 7<br />
• les différents services que <strong>la</strong> ressource concernée fournit pour produire <strong>la</strong> capacité<br />
correspondante, nécessaire à <strong>la</strong> construction <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective ;<br />
• les rivalités d’usage (plus ou moins exclusives) potentielles ou effectives entre ces<br />
services nécessaires et d’autres services dérivant <strong>de</strong> <strong>la</strong> même ressource et<br />
susceptibles d’entraver <strong>la</strong> mise à disposition <strong>de</strong>s services utilisés pour les processus<br />
<strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> collective ;<br />
• certaines régu<strong>la</strong>tions déjà existantes ou alors imaginables permettant <strong>de</strong> gérer les<br />
rivalités mentionnées en créant ou en modifiant par exemple les droits <strong>de</strong> propriété<br />
susceptibles d’atténuer ou <strong>de</strong> maîtriser les rivalités et <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong><br />
reproduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource en question.<br />
L’idée qui soutient cette nouvelle perspective est que, pour créer une bonne régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> à travers une nouvelle politique publique, il n’est pas suffisant <strong>de</strong> se limiter aux<br />
capacités (ou prestations) nécessaires aux quatre étapes <strong>de</strong> mémorisation que nous avons<br />
mises en lumière. Ces capacités sont générées par <strong>de</strong>s ressources qui –comme pour les<br />
ressources naturelles – ne doivent pas faire l’objet d’une sur ou sous exploitation. Ces<br />
ressources ne servent pas uniquement les capacités que permettent <strong>de</strong> générer (et gérer) le<br />
processus <strong>de</strong> production du bien collectif que nous avons appelé <strong>mémoire</strong>, elles servent<br />
également à <strong>de</strong> nombreux autres processus. C’est pourquoi les capacités qu’elles génèrent<br />
sont <strong>de</strong> plus en plus exploitées et peuvent entrer en conflit et générer <strong>de</strong>s rivalités d’utilisation<br />
avec d’autres prestations.<br />
Dans les sous chapitres qui suivent, nous nous efforçons <strong>de</strong> montrer sous forme <strong>de</strong><br />
tableaux <strong>de</strong>s exemples <strong>de</strong> facteurs à considérer parmi les éléments individuels <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource,<br />
les potentielles ou effectives rivalités d’usage et, enfin, les possibles régu<strong>la</strong>tions<br />
envisageables.<br />
Ces tableaux constituent une première réflexion autour <strong>de</strong> ces éléments et ne se réfèrent<br />
pas en particulier aux chapitres d’analyse empirique qui suivront plus loin. Ils se fixent<br />
comme but <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s pistes et <strong>de</strong>s idées éventuellement à développer 8 .<br />
3.1 Ressource « <strong>la</strong>ngage »<br />
Le terme <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngage au sens où nous l’entendons recouvre tout type <strong>de</strong> signe (écriture,<br />
son, mouvement, peinture, etc.) qui rend un message compréhensible à <strong>de</strong>ux individus qui<br />
désirent communiquer. Ce signe doit pouvoir être fixé sur un support physique qui permet sa<br />
reproduction dans le temps et dans l’espace. Sa régu<strong>la</strong>tion concerne d’une part <strong>la</strong> structure et<br />
<strong>la</strong> construction <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s qui le composent et, d’autre part, les caractéristiques physiques du<br />
support. Les droits d’usage affectent donc aussi l’utilisation <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s et/ou <strong>de</strong>s supports.<br />
8 Se référer à Peter Knoepfel/Mirta Olgiati, 2006, op. cit.
8 ELEMENTS CONCEPTUELS COMPLEMENTAIRES<br />
Tab. 3.1 : Ressource « <strong>la</strong>ngage ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s supports adéquats pour<br />
rendre l’information mémorisable.<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Elément 1<br />
Continuité dans le temps<br />
(perpétuité)<br />
Elément 2<br />
Reproductibilité dans le<br />
temps et dans l’espace<br />
Elément 3<br />
Universalité<br />
Elément 4<br />
Transférabilité (coûts<br />
d’interaction limités)<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
• Destruction/modification <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>ngages existants, co<strong>de</strong>s ou<br />
supports<br />
• arrivée <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngages, co<strong>de</strong>s ou<br />
supports nouveaux<br />
• Destruction <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>ngages informatiques<br />
• reproductibilité restreinte<br />
• etc.<br />
• Utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngages-club<br />
(par ex. les SMS)<br />
• <strong>la</strong>ngages techniques<br />
• hiéroglyphes<br />
incompréhensibles<br />
• etc.<br />
3.2 Ressource « raison »<br />
• Langages non traduisibles<br />
(espaces linguistiques fermés)<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
(droits <strong>de</strong> propriétés / politiques publiques)<br />
• Licences (pour <strong>la</strong>ngages) informatiques<br />
• propriété intellectuelle <strong>de</strong> textes, objets<br />
d’art, etc.<br />
• interdiction <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction<br />
• droit <strong>de</strong> l’homme d’utiliser sa <strong>la</strong>ngue<br />
maternelle<br />
• interdiction d’utiliser n’importe quelle<br />
<strong>la</strong>ngue maternelle, etc.<br />
• Record management (archives), obligation<br />
d’utiliser les documents et supports officiels<br />
• régu<strong>la</strong>tion ISBN<br />
• obligation <strong>de</strong> dépôt légal<br />
• etc.<br />
• Propriété intellectuelle (y compris le droit <strong>de</strong><br />
détruire un support)<br />
• droits <strong>de</strong> copie (reproduction limitée,<br />
contrôlée)<br />
• droits d’utilisation <strong>de</strong>s équipements<br />
• etc.<br />
• droits <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong> mots clés, co<strong>de</strong>s,<br />
secrets, etc.<br />
• autres droits <strong>de</strong> propriété intellectuelle sur<br />
<strong>de</strong>s données personnelles<br />
• accès public aux d’informations<br />
administratives (Loi sur <strong>la</strong> transparence)<br />
• interdictions <strong>de</strong> publier<br />
• accès libre à <strong>de</strong>s régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong><br />
l’information<br />
• etc.<br />
• Régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s droits d’usage <strong>de</strong><br />
dictionnaires, interdictions <strong>de</strong> traduire<br />
• protectionnisme linguistique<br />
• senseurs qui permettent <strong>de</strong> détecter les<br />
traductions<br />
• règles <strong>de</strong> traduction, obligations<br />
La ressource « raison » permet <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong>s connaissances nécessaires à <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong><br />
juger si un document est digne ou non d’être mémorisé ; cette ressource renvoie à <strong>de</strong> plus en<br />
plus <strong>de</strong> prestations différentes, car <strong>la</strong> multiplication <strong>de</strong>s supports et <strong>de</strong> <strong>la</strong> production<br />
d’informations requiert une telle différenciation <strong>de</strong>s savoirs, qu’elle se trouve difficilement<br />
dans un même groupe d’acteurs. Cette ressource permet d’i<strong>de</strong>ntifier les différents savoirs (ou<br />
valeurs) nécessaires à estimer <strong>la</strong> valeur archivistique ou conservative d’une information ou<br />
d’un document.
ELEMENTS CONCEPTUELS COMPLEMENTAIRES 9<br />
Tab. 3.2 : Ressource « raison ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
collective : capacité <strong>de</strong> jugement <strong>de</strong> ce qui est digne <strong>de</strong> faire partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
<strong>nationale</strong>.<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Elément 1<br />
Valeurs généralement<br />
partagées (sens commun)<br />
dans le domaine <strong>de</strong><br />
l’esthétique (jugement <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> valeur esth. d’un doc.)<br />
Elément 2<br />
Valeurs généralement<br />
partagées (sens commun)<br />
dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
justice (jugement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
valeur légale d’un<br />
document)<br />
Elément 3<br />
Valeurs généralement<br />
partagées (sens commun)<br />
dans le domaine <strong>de</strong><br />
l’histoire (jugement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
valeur historique d’un<br />
document)<br />
Elément 4<br />
Valeurs généralement<br />
partagées (sens commun)<br />
dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
science (jugement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
valeur scientifique d’un<br />
document)<br />
Elément 5<br />
Valeurs généralement<br />
partagées (sens commun)<br />
dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
culture (jugement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
valeur culturelle d’un<br />
document)<br />
Elément 6<br />
Valeurs généralement<br />
partagées (sens commun)<br />
dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
vérité (jugement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
véracité d’un document)<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
Argumentations en faveur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
« <strong>la</strong>i<strong>de</strong>ur »<br />
Argumentations pour interdire /<br />
détruire <strong>de</strong>s documents légaux<br />
Argumentations sur l’absence <strong>de</strong><br />
valeur historique d’un document<br />
Argumentations pour dénigrer <strong>la</strong><br />
valeur scientifique d’un<br />
document<br />
Argumentations contre <strong>la</strong> valeur<br />
culturelle d’un document<br />
Argumentations contre <strong>la</strong><br />
véracité d’un document<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
(droits <strong>de</strong> propriétés / politiques publiques)<br />
• Interdiction <strong>de</strong> collectionner un art <strong>la</strong>id, <strong>de</strong><br />
porter <strong>de</strong>s habits <strong>la</strong>ids, etc. (Entartete Kunst)<br />
• protection <strong>de</strong>s droits d’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>i<strong>de</strong>ur<br />
• votations popu<strong>la</strong>ires sur<br />
l’acquisition/<strong>de</strong>struction d’objets d’art<br />
• etc.<br />
• Droits d’usage individuels sur <strong>de</strong>s<br />
documents légaux personnels<br />
• ordre <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> registres officiels<br />
(par exemple : registres fonciers, registres<br />
électoraux, etc.)<br />
• interdiction <strong>de</strong>s droits d’usage <strong>de</strong> documents<br />
légaux<br />
• régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> conserver <strong>de</strong>s<br />
archives dans le secteur public et privé<br />
• Garantie <strong>de</strong>s droits d’usage sur l’histoire<br />
collective et individuelle<br />
• droits d’usage sur l’histoire, interdiction <strong>de</strong><br />
falsification historique, campagnes d’oubli<br />
historique ("Ley <strong>de</strong>l Punto final")<br />
• reconnaissance <strong>de</strong>s droits d’usages sur<br />
l’histoire<br />
• reconstruction <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s historiques<br />
controverses<br />
• Droits d’usage <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s scientifiques (le<br />
droit <strong>de</strong> s’y référer)<br />
• doits d’usage <strong>de</strong> participer à <strong>de</strong>s débats<br />
scientifiques ouverts (y compris le droit <strong>de</strong><br />
refuser)<br />
• droits <strong>de</strong> propriété intellectuelle sur <strong>de</strong>s<br />
cadres conceptuels, <strong>de</strong>s modèles, etc. (par<br />
exemple, les brevets, etc.)<br />
• interdiction <strong>de</strong>s recherches (par exemple<br />
dans le domaine <strong>de</strong>s génomes humains, etc.)<br />
• Droit d’usage <strong>de</strong>s traditions culturelles et<br />
éventuelle restriction <strong>de</strong> ces droits<br />
• interdiction <strong>de</strong> cultures indigènes<br />
• politiques <strong>de</strong> promotion culturelle<br />
• Droits d’usages <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice (Recht auf <strong>de</strong>n<br />
Richter)<br />
• droits d’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérité (par exemple,<br />
dans les mains <strong>de</strong>s juges)<br />
• droit <strong>de</strong> participer à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
vérité, <strong>de</strong> critiquer et <strong>de</strong> questionner <strong>la</strong> vérité
10 ELEMENTS CONCEPTUELS COMPLEMENTAIRES<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Elément 7<br />
Valeurs généralement<br />
partagées (sens commun)<br />
dans le domaine <strong>de</strong><br />
l’éthique (jugement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
valeur éthique d’un<br />
document)<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
Argumentations pour réduire <strong>la</strong><br />
valeur éthique d’un document<br />
3.3 Ressource « espace & temps »<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
(droits <strong>de</strong> propriétés / politiques publiques)<br />
• Droits (plus ou moins exclusif) <strong>de</strong> participer<br />
à <strong>de</strong>s commissions d’éthique, à <strong>de</strong>s<br />
jugements éthiques, etc.<br />
• droits d’usage <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s éthiques (droit <strong>de</strong><br />
s’y référer)<br />
• régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> chartes éthiques<br />
professionnelles<br />
• etc.<br />
La capacité <strong>de</strong> stockage d’un document ou d’une donnée peut être considérée comme un<br />
bien privé ou comme un club good ; elle <strong>de</strong>vient un bien commun si elle est possédée et gérée<br />
par les opérateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction d’une <strong>mémoire</strong> publique, qui ne recherchent pas<br />
l’exclusion politique <strong>de</strong>s utilisateurs intéressés à l’accès <strong>de</strong>s informations stockées. Il ne faut<br />
pas oublier que le manque <strong>de</strong> capacités <strong>de</strong> stockage est l’un <strong>de</strong>s déclencheurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> remise en<br />
question <strong>de</strong>s processus actuels <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>. Cette capacité, qui dérive <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ressource que nous avons appelée « espace & temps » est très importante, car elle peut avoir<br />
une influence directe – dans le sens qu’elle en affecte l’utilisation – sur <strong>la</strong> ressource<br />
« raison » : le manque <strong>de</strong> temps ou <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce peut en effet faire varier les choix quant à ce qui<br />
est digne d’être mémorisé (en les rendant plus ou moins sélectifs). En outre, cette ressource<br />
est c<strong>la</strong>irement man ma<strong>de</strong> et sa reproduction ou extension dépend directement <strong>de</strong>s décisions<br />
politiques.<br />
Tab. 3.3 : Ressource « espace et temps ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> stockage.<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Elément 1<br />
Capacité <strong>de</strong> stockage en<br />
fonction <strong>de</strong>s catégories<br />
<strong>de</strong> supports (livres,<br />
supports audio, objets,<br />
documents légaux, etc.)<br />
Elément 2<br />
Capacités particulières<br />
<strong>de</strong> conservation pour les<br />
documents prioritaires<br />
(par ex. : peintures,<br />
documents historiques,<br />
conditions <strong>de</strong><br />
conservation<br />
particulières)<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
Stockage <strong>de</strong> toutes les autres<br />
catégories <strong>de</strong> supports (affectés<br />
par le privilège)<br />
Extension <strong>de</strong>s services à <strong>de</strong>s<br />
documents non prioritaires (non<br />
privilégiés)<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
(droits <strong>de</strong> propriétés / politiques publiques)<br />
• Système <strong>de</strong> quota suivant <strong>la</strong> cat. <strong>de</strong> support<br />
• privilèges explicites pour une catégorie <strong>de</strong><br />
support<br />
• extension <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong><br />
stockage/réduction <strong>de</strong>s doublettes par une<br />
meilleure coordination<br />
• droits d’usage (publics ou privés) <strong>de</strong>s<br />
capacités <strong>de</strong> stockage négociables<br />
• droits <strong>de</strong> propriété sur les bâtiments<br />
• possibilité d’hériter <strong>de</strong>s droits sur les<br />
capacités <strong>de</strong> stockage pour <strong>de</strong>s producteurs<br />
<strong>de</strong> documents spécifiques<br />
• droits <strong>de</strong> partage dans les mains <strong>de</strong>s futurs<br />
utilisateurs pour l’attribution <strong>de</strong>s capacités<br />
• déc<strong>la</strong>ssement et désherbage au détriment <strong>de</strong>s<br />
droits d’usage <strong>de</strong> catégories jusqu’ici non<br />
privilégiées (« expropriation »)
ELEMENTS CONCEPTUELS COMPLEMENTAIRES 11<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Elément 3<br />
Capacités<br />
d’inventorisation<br />
(ressources humaines)<br />
Elément 4<br />
Capacités <strong>de</strong><br />
conservation<br />
(restauration, besoins <strong>de</strong><br />
réhabilitation et<br />
compétences)<br />
Elément 5<br />
Capacités <strong>de</strong> préarchiver<br />
(stockage<br />
provisoire avant <strong>de</strong><br />
dresser les inventaires)<br />
Elément 6<br />
Capacités <strong>de</strong> stockage<br />
physique (surfaces,<br />
p<strong>la</strong>ce, hard discs, etc.)<br />
Elément 7<br />
Autres utilisations <strong>de</strong>s<br />
surfaces (enseignement,<br />
conférences, boutiques,<br />
cafétéria, etc.)<br />
Elément 8<br />
D’autres éléments<br />
(externes) du service<br />
(par exemple : droits sur<br />
le bâtiment,<br />
approvisionnement<br />
électrique, fonctions<br />
urbaines, monuments<br />
historiques, etc.)<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
Augmentation <strong>de</strong> toutes les<br />
autres capacités au détriment du<br />
budget pour le personnel<br />
Tous les autres éléments <strong>de</strong> ce<br />
service (sans augmenter le<br />
budget)<br />
Tous les autres éléments<br />
Privilèges en faveur <strong>de</strong>s droits<br />
d’usage <strong>de</strong>s capacités<br />
Tous les autres éléments<br />
Potentiellement tous les autres<br />
éléments (exclusion <strong>de</strong>s<br />
capacités pour d’éventuelles<br />
modifications ou extensions,<br />
mesures d’épargne énergétique,<br />
utilisations sociales <strong>de</strong> bâtiment,<br />
etc.)<br />
3.4 Ressource « espace public »<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
(droits <strong>de</strong> propriétés / politiques publiques)<br />
• Régu<strong>la</strong>tion du marché du travail pour les<br />
employés civils, comme le droit à une p<strong>la</strong>ce<br />
<strong>de</strong> travail<br />
• introduction <strong>de</strong> nouvelles techniques<br />
d’inventorisation (nécessitant <strong>de</strong> nouvelles<br />
qualifications d’une partie plus ou moins<br />
gran<strong>de</strong> du personnel)<br />
• standards et régu<strong>la</strong>tions (professionnelles,<br />
inter<strong>nationale</strong>s) pour l’inventorisation<br />
• Régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> conservation<br />
• droit <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong> documents <strong>de</strong><br />
restaurer ou non leurs œuvres<br />
• propriété intellectuelle attribuée aux<br />
producteurs<br />
• règles prioritaires pour documents<br />
spécifiques<br />
• régu<strong>la</strong>tions sur les conditions <strong>de</strong><br />
conservation (température, humidité, etc.)<br />
• Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s obligations d’accepter<br />
automatiquement <strong>de</strong>s documents spécifiques<br />
(liste d’attente)<br />
• Droits d’usage <strong>de</strong> capacités privilégiées<br />
• régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s compressions techniques<br />
• (Attribution, modification) <strong>de</strong>s droits<br />
d’usage pour <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> soutien,<br />
clubs, universités ou magasins<br />
• Droits d’usage pour le public <strong>de</strong>s<br />
monuments historiques : interdictions <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>struction ou <strong>de</strong> modification<br />
• licences pour le stockage/l’inventorisation<br />
<strong>de</strong> programmes informatiques, etc.<br />
L’« espace public » produit <strong>de</strong>s services vitaux pour tous les acteurs <strong>de</strong>s sociétés<br />
démocratiques ouvertes. Il s’agit d’une ressource très dynamique, dont les services peuvent
12 ELEMENTS CONCEPTUELS COMPLEMENTAIRES<br />
nourrir ou gêner les autres ressources en jeu (par exemple modifier les co<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
communication électroniques, modifier les connaissances nécessaires à juger <strong>de</strong> ce qui doit<br />
être transmis, etc.). Ils peuvent être menacés <strong>de</strong> privatisation ou d’utilisation monopolisante<br />
les documents, les données, les informations ; elle peut exclure ou favoriser l’accès à <strong>de</strong>s<br />
groupes spécifiques d’acteurs. Ces phénomènes sont aujourd’hui quotidiennement visibles, il<br />
existe en effet <strong>de</strong>s processus d’appropriation ou <strong>de</strong> création <strong>de</strong> droits d’utilisation <strong>de</strong> l’espace<br />
public (sous ses différentes formes, physique ou virtuelle) plus ou moins exclusifs (par<br />
exemple l’accès à Internet, aux médias, aux télécommunications, à <strong>la</strong> culture).<br />
L’accessibilité plus ou moins amplement garantie est une caractéristique importante pour<br />
tout le processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> (stockage d’informations mémorisables et<br />
d’intérêt public, qui méritent <strong>de</strong> figurer dans une <strong>mémoire</strong> collective). Comme nous pourrons<br />
le constater dans <strong>la</strong> partie empirique <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, il convient <strong>de</strong> noter en outre que ce<br />
postu<strong>la</strong>t affecte également d’autres types d’informations d’importance publique, mais qui ne<br />
figurent pas dans <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>.<br />
Tab. 3.4 : Ressource « espace public ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> mise en valeur et accessibilité.<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Elément 1<br />
Accessibilité physique<br />
(archives, bibliothèques,<br />
musées)<br />
Elément 2<br />
Accessibilité virtuelle<br />
(Internet)<br />
Elément 3<br />
Possibilité d’utilisation:<br />
documents secrets<br />
Elément 4<br />
Possibilité d’utilisation:<br />
reproduction<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
• Surexploitation homogène<br />
par le même groupe<br />
d’usagers : utilisations<br />
massives et simultanées<br />
• rivalités d’usage hétérogènes<br />
par différents groupes<br />
d’usages : horaires<br />
d’ouverture, manque <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>ces <strong>de</strong> lecture<br />
• etc.<br />
• Rivalités d’usage homogènes:<br />
surexploitation <strong>de</strong>s accès<br />
Internet (arrivée massive)<br />
• rivalités d’usage hétérogènes:<br />
limitations (temp.) <strong>de</strong> l’accès<br />
Internet à certains doc.<br />
• Vol <strong>de</strong> documents secrets<br />
• piratage sur ordinateur<br />
• etc.<br />
Reproduction <strong>de</strong> documents pour<br />
lesquels <strong>la</strong> reproduction est<br />
interdite<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
(droits <strong>de</strong> propriétés / politiques publiques)<br />
• Vente (temporelle) <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
• limitations suivant un quota global<br />
• régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> l’accès<br />
• limitation du temps pour les visiteurs<br />
• politiques publiques concernant les heures<br />
d’ouverture<br />
• services <strong>de</strong> prêt<br />
• obligation <strong>de</strong> déposer <strong>de</strong>s garanties <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong>s acteurs utilisateurs<br />
• interdiction particulière d’accès à certains<br />
groupes d’utilisateurs (par exemple : les<br />
enfants, etc.)<br />
• etc.<br />
• Accessibilité payante<br />
• limitation temporelle <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
• co<strong>de</strong>s d’accès particuliers<br />
• interdiction particulière d’accès à certains<br />
groupes d’acteurs utilisateurs (par exemple :<br />
les enfants, etc.)<br />
• Droits d’usage (temporaires) à <strong>de</strong>s<br />
documents inaccessibles pour <strong>de</strong>s individus<br />
affectés par l’information (secret concernant<br />
les données personnelles)<br />
• droits d’accès particuliers pour <strong>de</strong>s acteurs<br />
spécifiques à <strong>de</strong>s documents secrets<br />
• ouverture <strong>de</strong>s droits d’accès suite à une<br />
décision judiciaire<br />
• sanctions pénales pour utilisations abusives<br />
• Droits <strong>de</strong> reproduction pour certains groupes<br />
d’utilisateurs<br />
• régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s taxes <strong>de</strong> reproduction, etc.<br />
• régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> propriété<br />
intellectuelles dans les mains <strong>de</strong>s<br />
producteurs, etc.<br />
• interdictions <strong>de</strong> reproduction
ELEMENTS CONCEPTUELS COMPLEMENTAIRES 13<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Elément 5<br />
Possibilité d’utilisation:<br />
exploitation économique<br />
Elément 6<br />
Possibilité d’utilisation:<br />
modification<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
Rivalités homogènes:<br />
exploitation économique (par<br />
exemple : brevets) par <strong>de</strong>s<br />
personnes non autorisées<br />
Modification <strong>de</strong> documents<br />
(<strong>de</strong>struction, dommage,<br />
changements substantiels<br />
illicites, falsification)<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
(droits <strong>de</strong> propriétés / politiques publiques)<br />
• Droits d’usage (plus ou moins exclusifs)<br />
garantis par les brevets<br />
• Régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s droits d’usage <strong>de</strong>s brevets<br />
• interdiction d’exploitation économique<br />
• tous les types <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tions du commerce<br />
(inter<strong>nationale</strong>s)<br />
• Tous les types d’interdiction <strong>de</strong> modification<br />
dans l’intérêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s droits<br />
intellectuels pour les auteurs, <strong>la</strong> vérité<br />
historique, etc.<br />
• Persécution pénale<br />
• Obligation <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s garanties
4 Analyse d’exemples choisis<br />
Afin d’étudier empiriquement les groupes <strong>de</strong> données qui seront présentés dans les<br />
chapitres suivants il a été fait usage du questionnaire Memopolicy (Annexe) en l’adaptant<br />
néanmoins à <strong>la</strong> nouvelle perspective étudiée, axée sur <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> données et non plus<br />
sur <strong>de</strong>s institutions d’archivage.<br />
Ainsi, l’organisation <strong>de</strong>s chapitres <strong>de</strong> cette partie <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> a été modifiée et suivra<br />
désormais le schéma que voici : <strong>la</strong> première partie, intitulée Présentation <strong>de</strong>s données,<br />
s’occupera tout d’abord <strong>de</strong> justifier le choix <strong>de</strong>s données à étudier ; elle décrira ensuite leur<br />
contenu substantiel et leurs caractéristiques, montrera leur évolution et accroissement dans le<br />
temps ; elle abor<strong>de</strong>ra <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s supports (type <strong>de</strong> supports sur lesquels les données sont<br />
fixées, gestion <strong>de</strong>s supports, problèmes et changements) ; elle décrira le fonctionnement,<br />
l’organisation, les <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> ou <strong>de</strong>s organe(s) <strong>de</strong> production, <strong>de</strong> compétence ou <strong>de</strong> (haute)<br />
surveil<strong>la</strong>nce qui s’occupe(nt) <strong>de</strong>s données en question ; elle expliquera quelles sont les bases<br />
légales qui concernent le fonctionnement <strong>de</strong> ou <strong>de</strong>s organe(s) en question d’une part et <strong>la</strong><br />
conservation à long terme ou l’archivage <strong>de</strong>s données d’autre part ; enfin, elle donnera les<br />
informations disponibles concernant les coûts liés à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données. La <strong>de</strong>uxième<br />
partie <strong>de</strong> chaque chapitre, intitulée Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation, s’occupera <strong>de</strong><br />
décrire ce processus suivant les quatre étapes du modèle déjà exploité dans les chapitres<br />
précé<strong>de</strong>nts. La troisième et <strong>de</strong>rnière partie, Commentaires, s’occupera <strong>de</strong> mettre en relief les<br />
points essentiels que chaque chapitre aura permis <strong>de</strong> mettre en exergue.<br />
Nos démarches n’ont pas permis, dans cette première partie <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, d’analyser<br />
précisément les régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s quatre ressources présentées dans le chapitre précé<strong>de</strong>nt. En<br />
effet, cette régu<strong>la</strong>tion se fait dans beaucoup <strong>de</strong> cas à l’extérieur <strong>de</strong>s groupes d’acteurs<br />
interrogés. L’analyse sera par conséquent reprise ultérieurement à partir <strong>de</strong>s traces empiriques<br />
présentes dans le matériel empirique récolté.<br />
Il est en outre à souligner que dans cette nouvelle perspective d’étu<strong>de</strong>, par rapport aux<br />
chapitres développés dans l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base, les informations obtenues pendant les entretiens<br />
acquièrent une importance beaucoup plus centrale : il n’existe en effet que très peu <strong>de</strong><br />
documents écrits qui permettent <strong>de</strong> comprendre et compléter les informations orales obtenues<br />
sur le processus <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s données.
4.1 Données météorologiques et climatologiques<br />
[Etat en mars 07]<br />
En Suisse, l’institution responsable <strong>de</strong> l’observation du temps présent, d’établir les<br />
prévisions et d’avertir les organes d’intervention et <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en cas <strong>de</strong> danger est l’Office<br />
fédéral <strong>de</strong> météorologie et <strong>de</strong> climatologie MétéoSuisse, fondé en 1881.<br />
Outre les documents et les actes produits à travers le fonctionnement administratif <strong>de</strong><br />
l’institution (Verwaltungsakten) et ceux concernant le personnel (Persona<strong>la</strong>kten) – archivés<br />
suivant les prescriptions dictées par <strong>la</strong> Loi fédérale sur l’archivage 9 – une importante masse<br />
<strong>de</strong> données (et <strong>de</strong> documents) concernant <strong>la</strong> météorologie et <strong>la</strong> climatologie est produite par<br />
les activités <strong>de</strong> MétéoSuisse. Ces données sont <strong>principale</strong>ment constituées <strong>de</strong> relevés<br />
(Messwerte) se situant à différents <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> traitement suivant l’avancement <strong>de</strong> leur<br />
exploitation, c’est-à-dire <strong>de</strong> leur collecte jusqu’à leur analyse et publication.<br />
En dépit <strong>de</strong> l’importance économique, sociale et politique <strong>de</strong> ce type d’informations, <strong>la</strong><br />
connaissance <strong>de</strong> leurs caractéristiques du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation à long terme est à ce<br />
jour encore partielle. Le chapitre qui suit leur sera par conséquent consacré.<br />
4.1.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
4.1.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Les données météorologiques et climatologiques dont MétéoSuisse s’occupe <strong>de</strong> récolter –<br />
en partie également au travers d’autres acteurs, comme nous le verrons plus loin – permettent<br />
d’observer les phénomènes météorologiques 24 heures sur 24, d’établir les prévisions et<br />
d’avertir les organes d’intervention et <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à l’approche d’intempéries, <strong>de</strong> fortes<br />
précipitations, d’orages ou <strong>de</strong> vagues <strong>de</strong> chaleur. De plus, elles permettent <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s<br />
prévisions qui répon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s besoins et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s spécifiques, ainsi que <strong>de</strong>s prestations<br />
détaillées. Ces données permettent également à plus long terme d’étudier et <strong>de</strong> mieux<br />
comprendre <strong>de</strong>s phénomènes météorologiques et climatologiques propres à l’espace alpin et<br />
d’entretenir <strong>de</strong>s échanges d’informations avec les pays voisins.<br />
La récolte et le traitement <strong>de</strong> ces données permettent à MétéoSuisse d’accomplir <strong>de</strong>s<br />
tâches importantes au service <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en général, mais aussi <strong>de</strong> l’Etat et <strong>de</strong><br />
l’économie privée. En effet, un nombre très élevé d’acteurs publics et privés ont besoin<br />
d’informations météorologiques spécifiques : dans le domaine public, il s’agit par exemple<br />
<strong>de</strong>s services en charge <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> transports, <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong>s services d’entretien <strong>de</strong>s routes, <strong>de</strong> l’armée, etc. ; dans le domaine privé, il<br />
s’agit par exemple <strong>de</strong>s assurances, <strong>de</strong> l’industrie agricole et <strong>de</strong>s centrales électriques. Deux<br />
autres groupes d’acteurs, qui peuvent être publics ou privés, sont les médias (télévisions,<br />
radios, presse) et l’aviation (civile, militaire, privée).<br />
Les relevés et les données récoltées et produites par MétéoSuisse constituent en somme<br />
<strong>de</strong>s informations indispensables au bon fonctionnement <strong>de</strong> notre pays. Elles servent un très<br />
grand nombre d’acteurs et d’individus et ont un impact social, économique et politique<br />
considérable. Il serait en effet inimaginable à l’heure actuelle <strong>de</strong> renoncer à ce type<br />
d’informations, qui sont indispensables <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s décennies, mais dont le processus <strong>de</strong><br />
production et <strong>de</strong> mémorisation à long terme n’est pas très bien connu : ces données sont<br />
9 Loi fédérale sur l’archivage (LAr) du 26 juin 1998, RS 152.1.
18 DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES<br />
stockées et conservées sur <strong>de</strong>s supports informatiques et <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir comment au<br />
juste les archiver reste toujours ouverte et nous sommes actuellement dans une phase <strong>de</strong><br />
réflexion.<br />
4.1.1.2 Contenu<br />
Les données météorologiques et climatologiques récoltées sont utilisables seulement si<br />
elles sont accompagnées d’un minimum d’informations les concernant. Pour caractériser le<br />
contenu <strong>de</strong>s données que MétéoSuisse produit et conserve à long terme, il convient donc <strong>de</strong><br />
tenir compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> distinction existante entre <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> données :<br />
(1) les relevés météorologiques et climatologiques au sens <strong>la</strong>rge du terme<br />
(Messwerte), récoltées par MétéoSuisse ainsi que toutes les données et<br />
informations qui en découlent (données épurées, agrégées, analysées,<br />
interprétées), y compris <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> couche d’ozone, <strong>de</strong>s indices UV,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong>s pollens. De plus, l’institution<br />
échange, utilise et conserve <strong>de</strong>s données qui sont récoltées par d’autres<br />
acteurs publics ou privés, travail<strong>la</strong>nt au niveau international, national,<br />
cantonal ou régional. Des relevés, qui concernent <strong>de</strong>s domaines proches <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
météorologie, sont sous <strong>la</strong> responsabilité d’autres institutions et ne se trouvent<br />
par conséquent pas chez MétéoSuisse : il s’agit notamment <strong>de</strong>s domaines <strong>de</strong>s<br />
prévisions <strong>de</strong>s ava<strong>la</strong>nches et <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution <strong>de</strong> l’air.<br />
(2) Les données contextuelles (Kontextdaten) ou métadonnées, qui permettent <strong>de</strong><br />
donner un sens aux relevés ; ces <strong>de</strong>rniers ne peuvent en effet pas être utilisés,<br />
interprétés et analysés s’ils ne sont pas accompagnés d’un certain nombre<br />
d’informations, comme par exemple le nom <strong>de</strong> l’observateur ou <strong>de</strong> l’appareil<br />
qui a fait le relevé, le lieu, <strong>la</strong> date, l’heure, l’instrument <strong>de</strong> mesure utilisé, les<br />
conditions ambiantes, etc.<br />
Ces <strong>de</strong>ux groupes d’informations constituent le matériel sur <strong>la</strong> base duquel toutes les<br />
activités <strong>de</strong> MétéoSuisse se fon<strong>de</strong>nt. Il ne s’agit pas d’un ensemble <strong>de</strong> données d’une même<br />
nature, mais du résultat d’un processus <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données qui se réalise par couches<br />
successives. La valeur, le contenu et l’accessibilité <strong>de</strong>s différentes couches <strong>de</strong> données<br />
diffèrent donc suivant l’étape <strong>de</strong> traitement à <strong>la</strong>quelle on se situe.<br />
Le schéma ci-<strong>de</strong>ssous (figure 4.1.1) 10 représente les <strong>principale</strong>s couches <strong>de</strong> données<br />
(niveaux <strong>de</strong> données : <strong>de</strong>s données source jusqu’aux données du niveau 5) et les différentes<br />
étapes <strong>de</strong> traitement auxquelles elles sont soumises (<strong>de</strong> l’étape A à l’étape E) qui peuvent être<br />
mises en évi<strong>de</strong>nce dans le processus <strong>de</strong> production d’informations à caractère météorologique<br />
et climatologique. Cette schématisation montre à quel point le processus <strong>de</strong> transformation<br />
<strong>de</strong>s données ainsi que leur conservation et mise à disposition entre une étape et l’autre est<br />
complexe, car il se déroule dans le temps suivant plusieurs phases <strong>de</strong> traitement. Ces<br />
transformations, d’ordre technique, sont réalisées quotidiennement par les<br />
col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’institution et se déroulent par conséquent suivant un processus<br />
bottom up. Il est re<strong>la</strong>tivement difficile <strong>de</strong> décrire ces processus complexes <strong>de</strong> manière<br />
linéaire ; néanmoins, dans une démarche <strong>de</strong> conservation à long terme <strong>de</strong>s données – et<br />
encore plus dans une perspective d’archivage – il est indispensable <strong>de</strong> les connaître pour se<br />
rendre compte que <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> ces informations doit se faire par couches et doit<br />
10 Ce schéma et les explications qui lui sont associées se fon<strong>de</strong>nt sur un document interne rédigé par Christian<br />
Häberli, Hintergrundinformationen und Situationsbeurteilung für die Erarbeitung <strong>de</strong>r Detenarchitektur, version<br />
1.0 du 2.05.2005.
DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES 19<br />
pouvoir être retracée à <strong>de</strong>s décennies d’intervalle, puisque ces données nécessitent d’être<br />
recalculées périodiquement.<br />
Réseau <strong>de</strong><br />
mesure,<br />
stations <strong>de</strong><br />
relevage<br />
Données<br />
source,<br />
sensorielles,<br />
décentralisées<br />
Simu<strong>la</strong>tions,<br />
premières<br />
corrections<br />
Etape<br />
A<br />
Données<br />
externes<br />
Provenance<br />
externe <strong>de</strong>s<br />
relevés<br />
Niveau 1<br />
Données<br />
brutes,<br />
en unités<br />
physiques<br />
Raw Data<br />
Repository<br />
Calibration,<br />
Ier contrôle <strong>de</strong> qualité,<br />
regroupement<br />
dans <strong>de</strong>s systèmes<br />
<strong>de</strong> récolte<br />
Etape<br />
B<br />
Données qui ne peuvent pas être distribuées<br />
Centralisation DWH,<br />
IIe contrôle <strong>de</strong> qualité,<br />
agrégation, calcul <strong>de</strong>s<br />
valeurs dérivées,<br />
propagation dans<br />
bases <strong>de</strong> données<br />
analytiques<br />
Niveau 2<br />
Données<br />
brutes,<br />
centralisées,<br />
uniformisées<br />
Data<br />
Warehouse<br />
System<br />
Etape<br />
C<br />
Niveau 3<br />
Données<br />
agrégées<br />
prêtes pour<br />
analyse<br />
Bases<br />
<strong>de</strong> données<br />
analytiques<br />
Contrôle consistance<br />
temporelle et spatiale<br />
<strong>de</strong>s données,<br />
résolution <strong>de</strong>s erreurs,<br />
historicisation du<br />
traitement<br />
Etape<br />
D<br />
Données <strong>de</strong> comman<strong>de</strong><br />
Logiciels <strong>de</strong> distribution<br />
Niveau 4<br />
Données<br />
analysées<br />
Logiciels <strong>de</strong> préparation, agrégation et calcul <strong>de</strong>s données<br />
Homogénéisation,<br />
données contextuelles<br />
Etape<br />
E<br />
Niveau 5<br />
Données<br />
analysées et<br />
contextualisées<br />
Données qui peuvent être distribuées<br />
Fig. 4.1.1 : Processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données météorologiques et climatologiques, <strong>de</strong>s<br />
données source jusqu’à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s données analysées. [Librement adapté suivant<br />
Christian Häberli, Hintergrundinformationen und Situationsbeurteilung für die<br />
Erarbeitung <strong>de</strong>r Datenarchitektur, version 1.0, 2.05.2005, ill. 6, p. 35]<br />
Les différentes couches <strong>de</strong> données représentées, ainsi que les étapes <strong>de</strong> transformation<br />
qu’elles subissent, peuvent être décrites comme suit :<br />
Données<br />
source :<br />
Clients<br />
MétéoSuisse récolte ces données grâce à un réseau <strong>de</strong> mesures couvrant<br />
l’ensemble du territoire suisse, aux images radar, aux ballons-son<strong>de</strong>s, aux<br />
satellites et à l’observation directe au sol.<br />
Etape A : Les données source, sous forme <strong>de</strong> données sensorielles (par exemple :<br />
impulsions numériques) sont transformées en unités physiques qui ont une<br />
signification pour une utilisation climatologique ou météorologique<br />
ultérieure (par exemple : température, pression atmosphérique, volume <strong>de</strong><br />
précipitations). Un premier contrôle <strong>de</strong> qualité est effectué.<br />
Niveau 1 : Les données ainsi produites sont <strong>de</strong>s données en unités physiques et sont<br />
centralisées dans un dépôt <strong>de</strong> données brutes (Raw Data Repository).<br />
Etape B : Les données sont calibrées et épurées <strong>de</strong>s erreurs les plus visibles dans un<br />
<strong>de</strong>uxième contrôle <strong>de</strong> qualité. Les <strong>la</strong>cunes sont elles aussi signalées. En cas<br />
<strong>de</strong> besoin, il est possible dans un <strong>de</strong>uxième temps <strong>de</strong> transformer à nouveau<br />
ces données déterminées suivant <strong>de</strong>s polynômes <strong>de</strong> calibration améliorés
20 DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES<br />
(réévaluation <strong>de</strong>s données).<br />
Niveau 2 : Les données, provenant <strong>de</strong> différents systèmes, sont centralisées dans un<br />
Data Warehouse System (banque <strong>de</strong> données).<br />
Etape C : Un même type <strong>de</strong> données (par exemple : toutes les données produites dans<br />
une station au sol) et provenant <strong>de</strong> différents systèmes <strong>de</strong> récolte sont<br />
soumises à un même contrôle <strong>de</strong> qualité. Dans cette étape <strong>de</strong> transformation,<br />
les tests <strong>de</strong> p<strong>la</strong>usibilité appliqués sont plus rigoureux et systématiques que<br />
ceux réalisés auparavant. Les données sont ensuite désignées avec <strong>de</strong>s<br />
symboles déterminés, agrégées et propagées dans <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données<br />
analytiques, au travers <strong>de</strong>squelles leurs utilisateurs peuvent y accé<strong>de</strong>r.<br />
Niveau 3 : Les données sont maintenant prêtes pour les différentes analyses et sont<br />
accessibles à certains groupes d’acteurs au travers <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> données.<br />
Elles sont également enrichies <strong>de</strong> données provenant d’autres producteurs.<br />
Etape D : Cette étape <strong>de</strong> transformation <strong>de</strong>s données constitue <strong>la</strong> véritable préparation<br />
<strong>de</strong>s données météorologiques et climatologiques. Ici, sont contrôlées<br />
qualitativement également <strong>la</strong> consistance temporelle et spatiale <strong>de</strong>s données.<br />
Des corrections ultérieures (automatiques ou manuelles) peuvent être<br />
apportées. Ces transformations peuvent être faites à plusieurs reprises, mais<br />
tous les changements apportés doivent pouvoir être retracés (historisation et<br />
démarches <strong>de</strong> correction).<br />
Niveau 4 : Les données du niveau 4 sont prêtes à être concrètement utilisées pour les<br />
analyses météorologiques et climatologiques.<br />
Etape E : Une sélection <strong>de</strong>s données du niveau 4 sont homogénéisées à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> (Steuerdaten) et <strong>de</strong>s données contextuelles<br />
(Kontextdaten).<br />
Niveau 5 : Les données sont associées aux données <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> et aux données<br />
contextuelles et peuvent être utilisées à différentes pério<strong>de</strong>s temporelles.<br />
Ces différents niveaux <strong>de</strong> données sont regroupés dans l’Ordonnance du DFI sur les<br />
émoluments perçus dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> météorologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> climatologie (OEMét) du 3<br />
décembre 2003 (RS 429.111) en trois catégories <strong>principale</strong>s désignées comme données<br />
météorologiques, informations météorologiques traitées et produits météorologiques. Cette<br />
distinction permet d’attribuer une valeur différente aux données en fonction <strong>de</strong> leur niveau <strong>de</strong><br />
traitement (les tarifs <strong>de</strong>s émoluments sont en effet plus élevés pour les produits que pour les<br />
données météorologiques).<br />
4.1.1.3 Supports<br />
Chez MétéoSuisse, <strong>la</strong> très gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s relevés sont produits sous forme<br />
électronique, en partie <strong>de</strong> manière automatique ; lorsque ce n’est pas le cas (par exemple pour<br />
les relevés au sol effectués par <strong>de</strong>s observateurs·trices), ils sont aussitôt informatisés. Ainsi,<br />
les différentes couches <strong>de</strong> données suivant les étapes <strong>de</strong> transformation mises en relief<br />
précé<strong>de</strong>mment sont <strong>de</strong> nature informatique et sont gérées par leurs utilisateurs·trices sur <strong>de</strong>ux<br />
bases <strong>de</strong> données Oracle (l’une qui est optimisée pour l’épuration <strong>de</strong>s données, l’autre pour<br />
l’analyse), qui sont soumises à <strong>de</strong>s sauvegar<strong>de</strong>s automatisées journalières (incremental
DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES 21<br />
backups) et hebdomadaires (full backups). Tous ces processus sont centralisés grâce à un<br />
Metadata driven system qui permet <strong>de</strong> les piloter et <strong>de</strong> s’assurer que les données et les<br />
transformations qu’elles subissent restent uniformes et soient ainsi comparables. Les serveurs<br />
qui stockent toutes ces informations sont situés au siège <strong>de</strong> Zürich. Il est en outre à signaler<br />
que – afin <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> pérennité à long terme <strong>de</strong> cette énorme masse d’informations – il<br />
existe <strong>de</strong>s copies sur DVD <strong>de</strong>s données informatiques (réalisées chaque mois), qui sont<br />
conservées dans l’un <strong>de</strong>s sièges <strong>de</strong> MétéoSuisse à l’extérieur <strong>de</strong> Zürich.<br />
Cette institution fait d’ailleurs partie <strong>de</strong>s administrations qui, <strong>de</strong> par le domaine <strong>de</strong><br />
compétence hautement technologique dont elle s’occupe, sont graduellement passées à l’ère<br />
informatique à une pério<strong>de</strong> très précoce, c’est-à-dire à partir <strong>de</strong>s années 60. Avant cette<br />
révolution, les données étaient relevées à <strong>la</strong> main par <strong>de</strong>s observateurs·trices et transcrites sur<br />
<strong>de</strong>s fiches, reliées ensuite sous forme <strong>de</strong> cahiers à couverture noire (dont il existe <strong>de</strong>s copies<br />
sur microfilms). Progressivement, suivant l’évolution technologique et <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong>s<br />
systèmes et <strong>de</strong>s appareils <strong>de</strong> mesure, l’informatique et l’automatisation ont supp<strong>la</strong>nté les<br />
relevés manuels. Toutefois, les relevés qui ont été faits à <strong>la</strong> main dans les décennies situées<br />
entre <strong>la</strong> création <strong>de</strong> MétéoSuisse en 1881 et le passage à l’informatisation complète <strong>de</strong>s<br />
activités <strong>de</strong> l’institution autour <strong>de</strong>s années 80 ont été en partie sélectionnés suivant <strong>de</strong>s critères<br />
<strong>de</strong> pertinence et <strong>de</strong> comparabilité bien déterminés, puis retranscrits et insérés dans les bases <strong>de</strong><br />
données actuelles lors <strong>de</strong> campagnes d’informatisation ; <strong>de</strong>s <strong>la</strong>cunes existent cependant<br />
encore. La même opération se déroule actuellement avec le très petit pourcentage <strong>de</strong> relevés<br />
qui sont toujours effectués manuellement : les démarches <strong>de</strong> digitalisation a posteriori sont<br />
néanmoins très coûteuses et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt un grand investissement en termes <strong>de</strong> temps.<br />
Actuellement, les serveurs <strong>de</strong> MétéoSuisse stockent environ 2 Terabytes d’information<br />
numérique ; parmi cette masse <strong>de</strong> données, il existe encore <strong>de</strong>s redondances qui pourraient<br />
être supprimées. La capacité <strong>de</strong> stockage nécessaire est actuellement disponible et ne<br />
constitue donc pas un problème pour l’institution à court terme. L’accroissement <strong>de</strong>s données<br />
recueillies est difficile à déterminer, mais il apparaît qu’elle <strong>de</strong>vient exponentielle : en effet, <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière année constitue le double <strong>de</strong> l’année précé<strong>de</strong>nte. La<br />
raison <strong>de</strong> cette augmentation est due en particulier au fait que les instruments <strong>de</strong>s stations au<br />
sol ont été renouvelés : ils mesurent désormais plus <strong>de</strong> paramètres et donnent plus<br />
d’informations techniques. Toutes les données sont centralisées et contrôlées par <strong>de</strong>s serveurs<br />
se trouvant au siège central à Zurich. Les compétences nécessaires pour faire fonctionner tout<br />
le système sont en partie internes et en partie externes, notamment pour ce qui concerne<br />
l’appareil<strong>la</strong>ge informatique.<br />
Aucun changement significatif concernant les supports n’est prévu pour les temps à venir.<br />
Le souci principal concernant <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données, outre le problème <strong>de</strong> leur archivage,<br />
est constitué par <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s migrations. Ce problème, qui a été pour le moment résolu<br />
grâce à l’uniformisation et l’homogénéisation <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données ainsi que grâce à une<br />
architecture qui permet à un système <strong>de</strong> migrer sur un autre en conservant le noyau <strong>de</strong><br />
l’information, risque toutefois <strong>de</strong> refaire surface si <strong>la</strong> masse d’informations à conserver<br />
continue d’augmenter <strong>de</strong> manière trop exponentielle. Une telle augmentation risquerait en<br />
effet <strong>de</strong> mettre en péril une gestion <strong>de</strong> l’information qui fonctionne actuellement bien,<br />
notamment à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite imposée par les processeurs, qu’il faudrait alors rendre plus<br />
puissants dans un futur re<strong>la</strong>tivement proche.<br />
4.1.1.4 Organe compétent<br />
MétéoSuisse est le service national <strong>de</strong> météorologie et <strong>de</strong> climatologie et se trouve sous <strong>la</strong><br />
responsabilité du département <strong>de</strong> l’Intérieur. Elle fait partie <strong>de</strong>s offices GMEB (2 ème cercle <strong>de</strong>
22 DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES<br />
l’administration fédérale) <strong>de</strong>puis 1997. Ses activités sont établies par <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong><br />
météorologie et <strong>la</strong> climatologie (LMét) du 18 juin 1999 (RS 429.1), ainsi que par<br />
l’ordonnance y re<strong>la</strong>tive (OMét, RS 429.11). L’office a fêté en 2006 ses 125 ans d’existence et<br />
compte aujourd’hui près <strong>de</strong> 316 col<strong>la</strong>borateurs·trices (282 postes <strong>de</strong> travail) répartis dans cinq<br />
sièges régionaux, à savoir :<br />
Siège Abréviation<br />
MeteoSchweiz ZUE<br />
MétéoSuisse Genève GVE<br />
MeteoSvizzera Locarno-Monti LOM<br />
MeteoSchweiz Zürich-Flughafen KLO<br />
MétéoSuisse Payerne PAY<br />
L’organigramme <strong>de</strong> MétéoSuisse est structuré en une Direction générale (subdivisée en<br />
Direction, Personnel et Formation, Controlling et Management <strong>de</strong> l’intégration) et en trois<br />
domaines nommés Temps (domaine subdivisé en MétéoZurich, Météo aéronautique, Météo<br />
Genève, Météo Locarno-Monti, Modèles), Climat (Données atmosphériques, Technique <strong>de</strong><br />
mesures, Services climatologie, Biométéorologie et météorologie <strong>de</strong> l’environnement) et<br />
Soutien (Economie et logistique, Informatique). Chacun <strong>de</strong> ces trois domaines possè<strong>de</strong> son<br />
propre Etat-major et <strong>de</strong>s services transversaux suivant une logique axée sur les processus.<br />
Le siège central <strong>de</strong> MétéoSuisse est à Zurich, où se trouve <strong>la</strong> Direction générale, ainsi que<br />
les Etats-major <strong>de</strong>s trois domaines. C’est ici que sont organisés les projets et que les<br />
col<strong>la</strong>borations inter<strong>nationale</strong>s sont coordonnées. Les données météorologiques et<br />
climatologiques sont centralisées à Zurich, ainsi que les archives et <strong>la</strong> bibliothèque<br />
scientifique spécialisée <strong>de</strong> l’institution (météorologie, climatologie, hydrologie, physique,<br />
mathématique, géophysique et géographie), par ailleurs accessible au public. En outre, le<br />
siège <strong>de</strong> Zurich est responsable <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s conditions météo <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> région<br />
alémanique. Le centre <strong>de</strong> Genève, qui est situé dans le même immeuble que l’Organisation<br />
Météorologique Mondiale (OMM), est essentiellement responsable <strong>de</strong>s pronostics<br />
météorologiques et <strong>de</strong>s avertissements d’intempéries pour <strong>la</strong> Suisse occi<strong>de</strong>ntale et pour le<br />
Va<strong>la</strong>is, ainsi que pour les prévisions et le conseil météorologique pour l’aéroport <strong>de</strong> Genève<br />
(sécurité aérienne). MeteoSvizzera à Locarno s’occupe <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s conditions<br />
météo, par ailleurs très particulières, du Sud <strong>de</strong>s Alpes. Il est également le centre <strong>de</strong><br />
compétence au niveau national <strong>de</strong>s satellites et <strong>de</strong>s radars météorologiques. Le centre <strong>de</strong><br />
Zurich-aéroport étudie les conditions météos à <strong>de</strong>s échéances d’une heure pour le trafic<br />
aérien. La station aérologique <strong>de</strong> Payerne est le centre technique pour les relevés<br />
météorologiques : c’est <strong>de</strong>puis là que l’on prend soin <strong>de</strong>s nombreuses stations météo (environ<br />
500) et que l’on envoie les ballons-son<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s son<strong>de</strong>s radio dans l’atmosphère. En outre,<br />
dans les <strong>la</strong>boratoires à Payerne et à <strong>la</strong> centrale à Zürich sont analysés et comptés les pollens<br />
présents dans l’air sous l’égi<strong>de</strong> du Réseau national suisse <strong>de</strong>s mesures du pollen (NAPOL),<br />
qui comprend 14 stations <strong>de</strong> mesure et est géré par MétéoSuisse.<br />
Cette répartition régionale, qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un certain effort d’organisation et <strong>de</strong><br />
coordination, présente <strong>de</strong>ux avantages importants : d’une part, elle permet <strong>de</strong> suivre <strong>de</strong> près<br />
les événements météorologiques et, d’autre part, d’assurer un contact plus proche avec <strong>la</strong><br />
clientèle <strong>de</strong> l’institution.<br />
Suivant l’art. 1 <strong>de</strong> <strong>la</strong> LMét, les domaines <strong>de</strong> compétence et les <strong>de</strong>voirs (sous forme <strong>de</strong><br />
prestations <strong>de</strong> base) <strong>de</strong> MétéoSuisse peuvent être résumés en quatre points :<br />
• établir et communiquer <strong>de</strong>s prévisions météo, c’est-à-dire <strong>de</strong>s pronostics sur le temps<br />
atmosphérique dans le présent et le futur qui sont transmis aux services publics,
DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES 23<br />
civils et militaires et, en tant que prestations, sont vendus aux clients privés <strong>de</strong><br />
MétéoSuisse ;<br />
• assurer le service météorologique dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> sécurité et alerter<br />
les autorités fédérales, cantonales, communales à l’approche d’intempéries, fortes<br />
précipitations ou orages ; assurer <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité dans<br />
l’atmosphère et fournir les bases météorologiques nécessaires au calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
propagation <strong>de</strong>s polluants atmosphériques ;<br />
• récolter, analyser et conserver <strong>de</strong>s données météorologiques, ce qui permet une<br />
meilleure compréhension <strong>de</strong>s phénomènes météorologiques et climatologiques ;<br />
• réaliser et favoriser les recherches scientifiques dans ses domaines <strong>de</strong> compétence,<br />
notamment pour ce qui concerne l’espace alpin.<br />
L’institution peut ensuite fournir <strong>de</strong>s prestations supplémentaires répondant à <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s particulières, dans le sens où elle peut traiter les données et les résultats<br />
météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont elle dispose pour<br />
répondre à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s spécifiques et les exploiter sur une base commerciale, c’est-à-dire<br />
sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> contrats <strong>de</strong> droit privé (art. 4, LMét).<br />
Il apparaît que les différentes activités <strong>de</strong> MétéoSuisse ne peuvent être réalisées qu’en<br />
col<strong>la</strong>borant avec un nombre important d’acteurs publiques, militaires et privés, que ce soit au<br />
niveau régional, national ou international (art. 5, LMét). Suivant <strong>la</strong> distinction <strong>de</strong> ses quatre<br />
tâches <strong>principale</strong>s, les col<strong>la</strong>borations les plus importantes que cet office fédéral entretient sont<br />
les suivantes :<br />
• une re<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> proximité – dans le temps (échéances rapprochées <strong>de</strong>s prévisions) et<br />
dans l’espace (positionnement géographique <strong>de</strong> l’un ou l’autre centre) – avec les<br />
bénéficiaires <strong>de</strong> ses prestations, c’est-à-dire ses clients directs, ainsi que les<br />
intermédiaires qui transmettent les informations plus loin. Il s’agit <strong>de</strong> toute sorte<br />
d’acteurs : publics ou para-publics, comme les médias, les entreprises <strong>de</strong> transport<br />
aérien, terrestre, <strong>la</strong>custre, les organisateurs <strong>de</strong> manifestations culturelles ou sportives,<br />
les services d’entretien <strong>de</strong>s routes, etc. ; militaires, comme les aéroports militaires,<br />
Armasuisse ou l’Etat-major du DPPS, etc. ; privés, comme les entreprises <strong>de</strong><br />
construction, les assurances, etc. ; <strong>de</strong>s instituts également chargés <strong>de</strong> tâches du<br />
service météorologique, comme l’Institut für Atmosphäre und Klima (IACETH) et<br />
l’Institut fédéral pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> neige et <strong>de</strong>s ava<strong>la</strong>nches (ENA), etc. ; d’autres<br />
administrations fédérales s’occupant <strong>de</strong> domaines proches <strong>de</strong> <strong>la</strong> météorologie et <strong>la</strong><br />
climatologie, comme l’Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement (OFEV) pour <strong>la</strong> politique<br />
climatologique, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement et l’hydrologie, l’Office fédéral <strong>de</strong><br />
l’aviation civile (OFAC) et skygui<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> sécurité aérienne civile et l’Office<br />
fédéral <strong>de</strong> l’agriculture (OFAG) pour l’agriculture ;<br />
• les col<strong>la</strong>borations, grâce à ses Domaines coordonnées, avec <strong>de</strong>s services civiles et<br />
militaires <strong>de</strong> sécurité, d’alerte et <strong>de</strong> prise en charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, au travers<br />
notamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> Centrale <strong>nationale</strong> d’a<strong>la</strong>rme (CENAL), les autorités civiles <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Confédération, <strong>de</strong>s cantons et <strong>de</strong>s communes, l’armée, les services <strong>de</strong> protection <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion (police, sapeurs-pompiers, premiers secours, services industriels,<br />
protection civile) ;<br />
• <strong>la</strong> météo ne s’arrête pas aux frontières géopolitiques, ni au niveau régional, ni au<br />
niveau international. C’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle MétéoSuisse échange <strong>de</strong>s données<br />
météorologiques au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s frontières, suivant <strong>de</strong>s conventions va<strong>la</strong>bles dans le<br />
mon<strong>de</strong> entier, ainsi que <strong>de</strong>s compétences techniques et scientifiques (é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>
24 DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES<br />
modèles) ; les col<strong>la</strong>borations lui permettent en outre l’exploitation <strong>de</strong> matériel<br />
particulièrement onéreux comme par exemple les satellites. MétéoSuisse fait ainsi<br />
partie entre autres <strong>de</strong> l’Organisation météorologique mondiale (OMM) – institution<br />
spécialisée <strong>de</strong>s Nations Unies (NU) – ainsi que <strong>de</strong> l’Organisation européenne pour<br />
l’exploitation <strong>de</strong>s satellites météorologiques (EUMETSAT). Elle col<strong>la</strong>bore<br />
notamment avec le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen<br />
terme (CEPMMT), etc. ;<br />
• enfin, MétéoSuisse col<strong>la</strong>bore avec <strong>de</strong>s partenaires tels que les Hautes écoles, les<br />
Universités et les Ecoles polytechniques, ainsi que d’autres instituts <strong>de</strong> recherche<br />
météorologique ou climatologique en Suisse et à l’étranger.<br />
Bien que l’Office fédéral <strong>de</strong> météorologie et <strong>de</strong> climatologie soit l’institution<br />
officiellement responsable <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> météorologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> climatologie en Suisse, on<br />
comprend bien qu’il ne s’agit pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> seule institution qui produit <strong>de</strong>s données dans ces <strong>de</strong>ux<br />
domaines et qu’elle ne peut pas fonctionner <strong>de</strong> manière isolée. Les données qu’elle produit et<br />
récolte par ses propres moyens ou au travers d’autres institutions, puis qu’elle traite et<br />
analyse, ont par conséquent une pertinence qui va bien au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cette administration : elle<br />
traverse en effet les échelons administratifs (du communal au fédéral et à l’international) et<br />
embrasse un nombre conséquent d’organisations <strong>de</strong> droit privé ou public.<br />
4.1.1.5 Bases légales<br />
Outre <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong> météorologie et <strong>la</strong> climatologie (LMét) du 18 juin 1999 (RS<br />
429.1), l'Ordonnance sur <strong>la</strong> météorologie et <strong>la</strong> climatologie (OMét) du 23 février 2000 (RS<br />
429.11) et l'Ordonnance du DFI sur les émoluments perçus dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
météorologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> climatologie (OEMét) du 3 décembre 2003 (RS 429.111) déjà citées<br />
précé<strong>de</strong>mment, dans l'accomplissement <strong>de</strong> son mandat et <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong> ses multiples<br />
tâches, MétéoSuisse est liée par un nombre élevé <strong>de</strong> lois et d’ordonnances fédérales<br />
concernant différents domaines, ainsi qu'à <strong>de</strong>s conventions et protocoles internationaux<br />
ratifiés par <strong>la</strong> Suisse et qui ne seront pas pris en considération ici 11 .<br />
En ce qui concerne l’archivage <strong>de</strong>s données qui nous intéressent ici, MétéoSuisse –<br />
comme tout office <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération – est soumise à <strong>la</strong> Loi fédérale sur l'Archivage (LAr)<br />
du 26 juin 1998 (RS 152.1) et à l'Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur l'archivage<br />
(Ordonnance sur l'archivage, OLAr) du 8 septembre 1999 (RS 152.11). Suivant l’art. 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
LAr, elle est donc tenue <strong>de</strong> proposer aux Archives fédérales tous les documents dont elle n’a<br />
plus besoin en permanence, au plus tard après une échéance <strong>de</strong> 10 ans (art. 4, al. 1 OLAr).<br />
Cependant, au contraire <strong>de</strong>s actes produits à travers le fonctionnement administratif <strong>de</strong><br />
l’institution et <strong>de</strong> ceux concernant le personnel, qui suivent les procédures d’archivage<br />
prévues par <strong>la</strong> loi suivant un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement, les données météorologiques ne peuvent pas<br />
être archivées <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière en raison du fait que leur cycle <strong>de</strong> vie ne se termine pour<br />
ainsi dire jamais. En effet, tous les différents niveaux <strong>de</strong> données mis en évi<strong>de</strong>nce<br />
précé<strong>de</strong>mment sont périodiquement recalculés, analysés, utilisés <strong>de</strong> différentes manières<br />
même sur <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s très longues, notamment pour les besoins <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s climatologiques.<br />
11 Par exemple, <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> l’Organisation météorologique mondiale conclue à Washington le 11 octobre<br />
1947 (RS 0.429.01), <strong>la</strong> Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à<br />
moyen terme conclue à Bruxelles le 11 octobre 1973 (RS 0.420.514.291), <strong>la</strong> Convention portant création d’une<br />
Organisation européenne pour l’exploitation <strong>de</strong> satellites météorologiques (Eumetsat) conclue à Genève le 24<br />
mai 1983 (RS 0.425.43), <strong>la</strong> Convention-cadre <strong>de</strong>s Nations Unies sur les changements climatiques conclue à New<br />
York le 9 mai 1992 (RS 0.814.01), le Protocole <strong>de</strong> Kyoto à <strong>la</strong> Convention-cadre <strong>de</strong>s Nations Unies sur les<br />
changements climatiques du 11 décembre 1997 (RS 0.814.011), le Protocole <strong>de</strong> Montréal re<strong>la</strong>tif à <strong>de</strong>s<br />
substances qui appauvrissent <strong>la</strong> couche d’ozone du 16 septembre 1987 (RS 0.814.021), etc.
DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES 25<br />
On ne peut donc pas parler d’archivage pour ce type <strong>de</strong> données, mais il convient plutôt<br />
<strong>de</strong> parler <strong>de</strong> conservation à long terme. Dans cette perspective, il n’existe actuellement aucune<br />
base légale ou règlement officiel stipu<strong>la</strong>nt comment conserver ce type <strong>de</strong> documents, mais<br />
uniquement <strong>de</strong>s conventions internes ad hoc. MétéoSuisse est en train <strong>de</strong> préparer un<br />
règlement qui concerne cet aspect en col<strong>la</strong>boration avec les Archives fédérales : l’enjeu <strong>de</strong>s<br />
décisions qui seront prises dans ce cadre est <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un système d’archivage qui<br />
puisse garantir <strong>la</strong> conservation effective à long terme <strong>de</strong>s données météorologiques et<br />
climatologiques, tout en <strong>la</strong>issant aux usager <strong>la</strong> possibilité d’y accé<strong>de</strong>r sans attendre<br />
l’expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> protection minimal <strong>de</strong> 30 ans (art. 9, LAr) ; ceci sur <strong>la</strong> base d’une<br />
exception qui pourrait se justifier pour <strong>de</strong>s raisons commerciales.<br />
Ainsi, à l’heure actuelle, <strong>la</strong> question <strong>de</strong> l’archivage (au sens formel du terme) <strong>de</strong>s données<br />
météorologiques et climatologiques n’est pas encore résolue. Il est néanmoins à préciser que<br />
cette situation <strong>de</strong> partielle incertitu<strong>de</strong> – ne concernant que <strong>de</strong>s informations numériques et<br />
ayant un cycle <strong>de</strong> vie très prolongé – est partagée par <strong>de</strong> nombreuses autres administrations<br />
fédérales se trouvant dans une situation simi<strong>la</strong>ire. Des réflexions autour <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong> ce<br />
type <strong>de</strong> données sont d’ailleurs en cours non seulement aux Archives fédérales mais, comme<br />
nous le verrons dans les chapitres suivants, dans <strong>de</strong> nombreuses institutions et<br />
administrations.<br />
Il convient encore <strong>de</strong> préciser que l’institution, en tant qu’administration fédérale, est<br />
également soumise à différentes bases légales concernant <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données. Il s’agit<br />
en particulier <strong>de</strong> l’art. 57a <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur l’organisation du gouvernement et <strong>de</strong> l’administration<br />
(LOGA) du 21 mars 1997 (RS 172.010), qui concerne le traitement <strong>de</strong>s données personnelles,<br />
<strong>de</strong> l’Ordonnance concernant <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données personnelles dans l’administration<br />
fédérale du 3 juillet 2001 (RS 172.220.111.4), ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong> protection<br />
<strong>de</strong>s données (LPD) du 19 juin 1992 (RS 235.1) et <strong>de</strong> son ordonnance 12 . Ces bases légales ne<br />
concernent cependant que marginalement les données météorologiques et climatologiques,<br />
qui contiennent peu <strong>de</strong> données personnelles.<br />
Enfin, en ce qui concerne <strong>la</strong> gestion informatique <strong>de</strong>s données, MétéoSuisse est<br />
également soumise à l’Ordonnance sur l’informatique et <strong>la</strong> télécommunication dans<br />
l’administration fédérale (Ordonnance sur l’informatique dans l’administration fédérale,<br />
OIAF) du 26 septembre 2003 (RS 172.010.58).<br />
4.1.1.6 Coûts<br />
Les <strong>de</strong>scriptions précé<strong>de</strong>ntes montrent que <strong>la</strong> récolte, le traitement, l’analyse, l’insertion<br />
dans <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données et <strong>la</strong> conservation à long terme <strong>de</strong>s données météorologiques et<br />
climatologiques font partie du travail quotidien <strong>de</strong>s col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> MétéoSuisse. Il<br />
n’est donc pas possible <strong>de</strong> déterminer et <strong>de</strong> détailler quels sont les coûts <strong>de</strong> tout ce processus<br />
<strong>de</strong> production et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données, qui s’imbrique étroitement avec toutes les<br />
activités <strong>de</strong> l’institution. La production <strong>de</strong>s données et leur conservation à long terme sont<br />
considérées comme constituant un tout.<br />
MétéoSuisse faisant partie du 2 ème cercle <strong>de</strong> l’administration fédérale, elle est gérée par<br />
mandats <strong>de</strong> prestations et enveloppes budgétaires ; elle reçoit par conséquent tous les quatre<br />
ans <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’Etat fédéral un mandat <strong>de</strong> prestation traçant les gran<strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> ses<br />
activités. Chaque année, un document obligatoire précise ce mandat en fixant <strong>de</strong>s objectifs<br />
concrets et <strong>de</strong>s mesures contrô<strong>la</strong>bles. Le budget <strong>de</strong> MétéoSuisse est actuellement <strong>de</strong> 76,5<br />
12 Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données (OLPD) du 14 juin 1993 (RS 235.11).
26 DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES<br />
millions <strong>de</strong> francs. MétéoSuisse engrange quelque 30 millions <strong>de</strong> francs par an avec les<br />
émoluments et les recettes commerciales.<br />
4.1.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Quelles sont les données météorologiques et climatologiques qui doivent être conservées<br />
à long terme et comment sont-elles sélectionnées ? Au contraire <strong>de</strong> ce que nous avions mis en<br />
relief dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> mémorisation tels qu’ils ont lieu dans les institutions<br />
d’archivage, soit, que <strong>la</strong> masse <strong>de</strong>s documents à archiver diminue au fur et à mesure que les<br />
différentes étapes <strong>de</strong> sélection ont lieu, <strong>la</strong> masse <strong>de</strong> données météorologiques et<br />
climatologiques conservées par MétéoSuisse dans ses serveurs augmente au fil du processus.<br />
En effet, les relevés passent à travers différentes étapes <strong>de</strong> transformation qui s’additionnent<br />
les unes aux autres, faisant ainsi augmenter <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> données. Toutes ces informations<br />
sont ensuite centralisées dans <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données gérées par <strong>de</strong>s organes transversaux.<br />
La question qui se pose alors en termes <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong> l’information et d’archivage,<br />
est celle <strong>de</strong> savoir s’il est nécessaire <strong>de</strong> faire un tri et si <strong>la</strong> réponse est oui, <strong>de</strong> quelle manière.<br />
Le chapitre qui suit vise à décrire comment ces processus ont actuellement lieu.<br />
4.1.2.1 Mémorisabilité<br />
Toutes les données que MétéoSuisse récolte, traite, analyse et publie sont mémorisables<br />
dans le sens qu’elles sont toutes traitées par voie informatique ou, si ceci n’est pas le cas,<br />
transférées sur <strong>de</strong>s supports informatiques qui permettent <strong>de</strong> les introduire dans le système et<br />
<strong>de</strong> les conserver sous forme numérique. Parmi tous les relevés météorologiques ou<br />
climatologiques recueillis sont écartées seules les données erronées mises en évi<strong>de</strong>nce grâce<br />
aux contrôles <strong>de</strong> qualité. On peut donc dire qu’en principe toutes les données météorologiques<br />
et climatologiques récoltées et produites par MétéoSuisse sont conservées pour <strong>de</strong>s raisons<br />
utilitaires, c’est-à-dire, dans un premier temps, pour leur exploitation immédiate (prévisions<br />
météorologiques essentiellement) et, dans un <strong>de</strong>uxième temps, pour <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
climatologiques à plus long terme.<br />
En plus <strong>de</strong>s données que MétéoSuisse produit elle-même, elle conserve également les<br />
données produites par d’autres acteurs. Il s’agit en particulier <strong>de</strong>s données mesurées dans les<br />
pays avoisinants ou d’autres pays européens, ceci en particulier pour les besoins <strong>de</strong> l’aviation<br />
et <strong>de</strong>s prévisions météo générales. Il s’agit aussi <strong>de</strong>s données relevées dans <strong>de</strong>s stations<br />
appartenant à d’autres offices fédéraux ou cantonaux qui s’occupent <strong>de</strong> domaines ayant un<br />
lien direct avec <strong>la</strong> météorologie (pollution <strong>de</strong> l’air, hydrologie, environnement) ou qui<br />
surveillent <strong>de</strong>s conditions météorologiques très localisées (stations météo au bord <strong>de</strong>s routes<br />
cantonales). En effet, alors qu’il y a quelques décennies, MétéoSuisse était le seul organe à<br />
prélever <strong>de</strong>s mensurations météorologiques, il existe actuellement <strong>de</strong> plus en plus d’acteurs<br />
qui le font pour <strong>de</strong>s besoins spécifiques.<br />
Ainsi, toutes les données qui ont à voir avec <strong>la</strong> météorologique sont susceptibles<br />
d’intéresser MétéoSuisse et donc <strong>de</strong> compléter et d’être conservées avec les données qu’elle<br />
produit, sans néanmoins que ceci représente une contrainte. La condition pour que<br />
l’institution puisse conserver les données produites par d’autres acteurs est qu’elle soit mise<br />
au courant <strong>de</strong> leur existence. En effet, alors que l’échange <strong>de</strong>s données est bien réglé au<br />
niveau international, il n’existe actuellement pas <strong>de</strong> véritable coordination à l’intérieur <strong>de</strong>s<br />
frontières suisses pour ce qui concerne l’échange <strong>de</strong>s données environnementales sur l’air.<br />
Ainsi, nous pouvons dire que a priori tous les relevés <strong>de</strong> MétéoSuisse et <strong>de</strong>s autres<br />
acteurs qui lui sont proches par leur domaine <strong>de</strong> compétence sont mémorisables, pour autant
DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES 27<br />
que l’institution soit au courant <strong>de</strong> leur existence, qu’elle puisse les utiliser à court ou à long<br />
terme et qu’ils aient été épurés au travers <strong>de</strong> contrôles <strong>de</strong> qualité.<br />
Suivant notre concept, <strong>la</strong> mémorisabilité <strong>de</strong>s données ne peut être assurée qu’en tenant<br />
compte d’un niveau conceptuel plus abstrait, suivant <strong>la</strong> ressource que nous avons nommée<br />
« <strong>la</strong>ngage ». En effet, les données sont mémorisables dans le temps – c’est-à-dire<br />
transmissibles, reproductibles, comparables, universelles – pour autant qu’un <strong>la</strong>ngage ou co<strong>de</strong><br />
informatique commun soit utilisé : il s’agit notamment <strong>de</strong> faire les relevés suivant <strong>de</strong>s<br />
standards déterminés, <strong>de</strong> gérer les bases <strong>de</strong> données <strong>de</strong> manière unifiée, <strong>de</strong> faire en sorte que<br />
les divers systèmes informatiques utilisés puissent communiquer entre eux.<br />
4.1.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Comme nous l’avons vu, les données météorologiques ou climatologiques sont<br />
facilement mémorisables grâces aux technologies actuellement à disposition. La question est<br />
maintenant <strong>de</strong> savoir s’il vaut effectivement <strong>la</strong> peine <strong>de</strong> tout conserver, ceci en tenant compte<br />
en particulier <strong>de</strong> l’augmentation massive <strong>de</strong>s données qui est à prévoir dans les années à venir.<br />
MétéoSuisse n’a pas encore trouvé une réponse à cette question. En effet, en l’absence <strong>de</strong><br />
directives qui permettent aux col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’office <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s décisions<br />
sélectives dans leur travail quotidien sur les données météorologiques et climatologiques,<br />
l’institution a opté pour une conservation <strong>de</strong>s données sans sélection. Les différents niveaux<br />
<strong>de</strong> données mis en évi<strong>de</strong>nce plus haut sont donc tous conservés, au même titre. Ceci permet à<br />
MétéoSuisse <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> toutes les informations recueillies et, au besoin, <strong>de</strong> les retravailler<br />
et les analyser à nouveau selon <strong>de</strong>s critères différents.<br />
Les différentes étapes <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données sont réalisées par les producteurs ou les<br />
groupes <strong>de</strong> producteurs <strong>de</strong>s données, à l’intérieur <strong>de</strong> l’office. C’est donc le personnel<br />
spécialisé <strong>de</strong> MétéoSuisse qui seul possè<strong>de</strong> les connaissances substantielles nécessaires pour<br />
juger <strong>de</strong> quelles informations il a besoin pour effectuer son travail à court et à long terme.<br />
Dans ce cadre, nous constatons donc l’importance fondamentale que <strong>la</strong> ressource que nous<br />
avons conceptuellement appelée « raison » revêt. Le jugement <strong>de</strong> ce qui est digne d’être<br />
conservé nécessite <strong>de</strong>s connaissances spécifiques au domaine et ne peut que difficilement être<br />
imposé par un régu<strong>la</strong>teur.<br />
4.1.2.3 Mémorisation réelle<br />
Les données météorologiques et climatologiques conservées chez MétéoSuisse sont<br />
informatiques et suivent leur cycle <strong>de</strong> vie sous cette même forme. Pour être effectivement<br />
mémorisées, il est donc indispensable <strong>de</strong> les faire migrer d’un système informatique à l’autre<br />
à une échéance régulière. Comme expliqué précé<strong>de</strong>mment, leur conservation à long terme est<br />
assurée du moment que l’institution possè<strong>de</strong> les ressources nécessaires pour assurer cette<br />
migration (homogénéisation <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données, architecture informatique uniforme,<br />
processeurs suffisamment puissants, temps et financement suffisants). De plus, les relevés<br />
conservés sont utilisables à long terme pour autant qu’ils soient associés aux données<br />
contextuelles qui les concernent. MétéoSuisse réussit actuellement à faire face à ces tâches<br />
indispensables, car elle dispose <strong>de</strong>s ressources nécessaires à leur réalisation. Une réflexion<br />
autour <strong>de</strong> ces problématiques est cependant en cours, car l’évolution à <strong>la</strong> hausse <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> données <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s solutions à court terme.<br />
Dans notre concept, nous avons lié <strong>la</strong> mémorisation réelle à <strong>la</strong> ressource que nous avons<br />
dénommée « espace & temps ». Alors que l’élément « temps » ne semble pas ici jouer un rôle<br />
prépondérant, puisque MétéoSuisse a déjà informatisé les données qui méritaient <strong>de</strong> l’être
28 DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES<br />
(action qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un énorme investissement en termes <strong>de</strong> temps), <strong>la</strong> ressource « espace »<br />
acquière différentes significations. D’une part, elle peut se référer à l’espace <strong>de</strong> stockage,<br />
c’est-à-dire au réseau <strong>de</strong>s machines informatiques qu’il est nécessaire d’entretenir, d’autre<br />
part, elle peut se référer au réseau <strong>de</strong> mesure, qui permet <strong>de</strong> collecter les données<br />
météorologiques. Quoiqu’il en soit, ces réseaux doivent être entretenus au même titre qu’un<br />
réseau routier, ils <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt par conséquent d’investir périodiquement dans leur entretien ou<br />
renouvellement. Chaque changement en re<strong>la</strong>tion à ces réseaux engendre un changement dans<br />
<strong>la</strong> production et <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données (par exemple : augmentation substantielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> masse<br />
<strong>de</strong> données à sauvegar<strong>de</strong>r).<br />
4.1.2.4 Accessibilité<br />
Les données météorologiques, les informations météorologiques traitées et les produits<br />
météorologiques, suivant les définitions données par l’Ordonnance du DFI sur les<br />
émoluments perçus dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> météorologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> climatologie, sont <strong>de</strong>s<br />
prestations <strong>de</strong> base <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> météorologie et <strong>de</strong> climatologie et sont soumises à<br />
<strong>de</strong>s émoluments. Ce ne sont donc pas <strong>de</strong>s informations publiques auxquelles tout un chacun<br />
aurait accès. Les émoluments varient en fonction du type (données, sondages, images radar,<br />
résultats <strong>de</strong> modèles numériques <strong>de</strong> prévision, prévisions, informations, bulletins, avis, etc.) et<br />
du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s informations (temps consacré au traitement). Les<br />
émoluments peuvent aussi être perçus sous forme <strong>de</strong> forfait, établi en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> quantité<br />
<strong>de</strong>s prestations acquises (nombre d’unités achetées par type) et sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’estimation <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fréquence avec <strong>la</strong>quelle les prestations fournies seront utilisées.<br />
Les utilisateurs <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> base sont regroupés par type (art. 2 OEMét) :<br />
l’utilisateur final, qui acquiert <strong>de</strong>s prestations pour ses propres besoins et n’est pas autorisé à<br />
les redistribuer à <strong>de</strong>s tiers ; les médias, c’est-à-dire les diffuseurs et les éditeurs, qui<br />
transmettent les prestations qu’ils ont acquises par l’intermédiaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> radio, <strong>la</strong> télévision ou<br />
<strong>la</strong> presse ; les fournisseurs <strong>de</strong> contenu, qui transmettent les prestations acquises par Internet à<br />
partir <strong>de</strong> leur propre site ; les prestataires <strong>de</strong> service, qui conçoivent eux-mêmes <strong>de</strong>s<br />
prestations météorologiques et les diffusent à leurs clients ; les prestataires <strong>de</strong> service, qui<br />
disposent <strong>de</strong> l’infrastructure pour transmettre les données et informations acquises à <strong>de</strong>s<br />
utilisateurs finaux et à <strong>de</strong>s médias. Lorsque les prestations <strong>de</strong> base sont utilisées à <strong>de</strong>s fins<br />
d’enseignement et <strong>de</strong> recherche, aucun émolument n’est perçu (art. 16). De même, les<br />
conseils ainsi que les données, les informations et les produits fournis en situation <strong>de</strong> crise aux<br />
organes d’intervention fédéraux, cantonaux et communaux ou à <strong>de</strong>s organes d’intervention <strong>de</strong><br />
droit privé oeuvrant sur mandat public pour protéger <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion contre les répercussions<br />
d’événements météorologiques extrêmes sont gratuits (art. 17).<br />
Afin <strong>de</strong> faciliter <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s informations et tenant compte <strong>de</strong>s<br />
directives données par l’OEMét, certaines institutions bénéficient d’un accès direct aux bases<br />
<strong>de</strong> données suivant <strong>de</strong>s accords stipulés avec MétéoSuisse. Il s’agit en particulier <strong>de</strong> médias,<br />
d’assurances, <strong>de</strong> tribunaux, d’autres administrations fédérales et d’universités, écoles<br />
polytechniques et autres instituts universitaires.<br />
Le public, c’est-à-dire tout un chacun, ne peut prendre connaissance que <strong>de</strong>s informations<br />
météorologiques et climatologiques qui résultent à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> tout le processus <strong>de</strong> traitement et<br />
d’analyse, à savoir, les informations publiées. De ce point <strong>de</strong> vue, il est à noter qu’un<br />
changement important est en cours : les informations météorologiques <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong> plus en<br />
plus mobiles et sont accessibles à tout le mon<strong>de</strong> à tout moment grâce aux nouveaux supports<br />
<strong>de</strong> communication (Internet, SMS, MMS, etc.). La ressource que nous avons nommée
DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES 29<br />
« espace public » prend ainsi une nouvelle signification : l’accessibilité <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> plus en<br />
plus virtuelle.<br />
4.1.3 Commentaires<br />
Ce chapitre, réalisé grâce aux informations recueillies lors d’entretiens avec M. Christian<br />
Häberli, Chef du projet Data Warehouse et M. Gregor Stork, Bibliothécaire et Archiviste <strong>de</strong><br />
MétéoSuisse, ainsi qu’à travers <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s bases légales, <strong>de</strong>s documents internes et publiés<br />
ayant trait à l’institution et <strong>de</strong> son site Internet, ont permis <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce les aspects<br />
suivants, du général au particulier :<br />
(1) L’exemple <strong>de</strong> MétéoSuisse montre bien que <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisation<br />
<strong>de</strong>s données ou <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> pertinence <strong>nationale</strong> est <strong>de</strong> nature<br />
transversale : elle concerne tout autant <strong>de</strong>s domaines environnementaux et<br />
économiques (comme les données météorologiques et climatologique) que<br />
<strong>de</strong>s domaines historiques (comme les institutions d’archive). Les données<br />
recueillies par MétéoSuisse n’ont pas en soi un caractère patrimonial et<br />
public, car elles se situent en amont <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> publication. Elles sont<br />
conservées par leurs producteurs·trices pour <strong>de</strong>s raisons avant tout utilitaires,<br />
mais leur sauvegar<strong>de</strong> à travers le temps pour permettre d’effectuer <strong>de</strong>s<br />
vérifications et <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s climatologiques à long terme revêt une<br />
importance capitale pour tout le mon<strong>de</strong>, non seulement en Suisse, mais bien<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s frontières, notre pays présentant une morphologie particulière<br />
(alpine) qui permet <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce plus rapi<strong>de</strong>ment les changements<br />
climatiques en cours.<br />
(2) Les données météorologiques et climatologiques, suivant toutes les étapes <strong>de</strong><br />
transformations qu’elles subissent, sont actuellement conservées dans leur<br />
intégralité. Néanmoins, il ne sera pas possible <strong>de</strong> tout stocker et conserver à<br />
l’infini, <strong>la</strong> masse <strong>de</strong> données en question ayant tendance à <strong>de</strong>venir trop<br />
conséquente. La question <strong>de</strong> savoir comment réaliser une sélection parmi<br />
toutes ces informations <strong>de</strong>vra être discutée à court terme. Les variantes<br />
actuellement envisageables pour un choix <strong>de</strong>s données à sauvegar<strong>de</strong>r sont<br />
actuellement <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux sortes : une sélection transversale <strong>de</strong>s différents niveaux<br />
<strong>de</strong> données (gar<strong>de</strong>r un certain pourcentage <strong>de</strong> données pour chaque étape<br />
mise en relief) ou alors une sélection par niveau <strong>de</strong> donnée (par exemple :<br />
conserver les données <strong>de</strong>s niveaux 1 et 2 et ne pas conserver ni les données<br />
source, ni les niveaux 3 à 5). Ce qui paraît essentiel, est <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s<br />
données qui ne peuvent pas être reconstituées.<br />
(3) La prise en considération <strong>de</strong>s quatre ressources théoriques mises en évi<strong>de</strong>nce<br />
dans <strong>la</strong> partie conceptuelle <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> permet <strong>de</strong> mettre en lumière <strong>de</strong>s<br />
aspects pertinents dans le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données<br />
météorologiques et climatologiques. La ressource appelée « <strong>la</strong>ngage », se<br />
référant ici <strong>principale</strong>ment à l’utilisation <strong>de</strong> standards informatiques, montre<br />
le lien qui existe entre <strong>la</strong> récolte et gestion <strong>de</strong>s données déterminées (record<br />
management) et les facteurs économiques (dépendance du marché et <strong>de</strong><br />
services spécialisés) et politiques (dépendance dans les décisions) qui<br />
déterminent <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> décisions dans ce domaine (infrastructure,<br />
équipement, entretien du réseau, etc.). La ressource « raison » permet <strong>de</strong><br />
mettre en relief l’importance <strong>de</strong>s compétences spécifiques nécessaires au<br />
jugement <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur pour ainsi dire archivistique <strong>de</strong>s données. La prise en
30 DONNEES METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES<br />
considération <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « espace » (en re<strong>la</strong>tion au « temps ») permet <strong>de</strong><br />
se rendre compte <strong>de</strong>s investissements nécessaires à <strong>la</strong> maintenance et au<br />
renouvellement <strong>de</strong>s réseaux informatiques et <strong>de</strong> mesure. Enfin, <strong>la</strong> ressource<br />
« espace public » permet <strong>de</strong> constater le passage à une communication <strong>de</strong> plus<br />
en plus virtuelle <strong>de</strong> l’information, information qui <strong>de</strong>meure cependant<br />
payante.<br />
L’exemple suivant <strong>de</strong> données d’importance <strong>nationale</strong> qui sont mémorisées et qu’il<br />
convient d’étudier est celui <strong>de</strong>s données statistiques. Comme nous le verrons, les processus<br />
qui mènent <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte à <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> et ensuite à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s données statistiques sont<br />
par certains aspects simi<strong>la</strong>ires à ceux qui concernent les données météorologiques et<br />
climatologiques, mais ne se situent pas encore à une étape d’informatisation et <strong>de</strong><br />
centralisation aussi avancée.
4.2 Données statistiques<br />
[Etat en janvier 2007]<br />
Un autre type d’information d’importance capitale – qui renseigne notamment sur l’état<br />
et l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong> l’économie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, du territoire et <strong>de</strong><br />
l’environnement – est constitué par les données statistiques. Ces données permettent en effet<br />
aux instances publiques, privées ainsi qu’à tout un chacun, <strong>de</strong> se tenir au courant, <strong>de</strong> prendre<br />
<strong>de</strong>s décisions et <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nifier <strong>de</strong>s activités futures. En Suisse le système <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique<br />
publique, connu sous le nom <strong>de</strong> Statistique suisse, est coordonné par l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
statistique (OFS) à Neuchâtel, officiellement créé en 1860 sous le nom <strong>de</strong> Bureau fédéral <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> statistique 13 . L’OFS est donc le centre national <strong>de</strong> compétences et <strong>de</strong> services <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
statistique et fait fonction d’observateur <strong>de</strong>s secteurs clés <strong>de</strong> l’Etat, <strong>de</strong> <strong>la</strong> société et <strong>de</strong><br />
l’économie : il est le plus important producteur <strong>de</strong> statistiques du pays.<br />
Ce chapitre se propose d’appliquer les réflexions <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> aux données<br />
statistiques en utilisant comme point d’ancrage <strong>la</strong> production <strong>de</strong> cette importante et gran<strong>de</strong><br />
administration, qui joue un rôle centralisateur pour <strong>la</strong> statistique suisse. Il est fondamental <strong>de</strong><br />
souligner que les processus <strong>de</strong> production, traitement, diffusion et conservation <strong>de</strong>s données<br />
statistiques tel qu’il a lieu à l’OFS est ici présenté sous une forme simplifiée et suivant une<br />
perspective globale. Ces processus sont en effet multiples et variés : plus on s’efforce <strong>de</strong> les<br />
décrire dans le détail, moins il s’avère possible <strong>de</strong> les observer <strong>de</strong> manière générale.<br />
Une partie <strong>de</strong>s informations contenues dans ce chapitre a été tirée du site Internet <strong>de</strong><br />
l’institution.<br />
4.2.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
4.2.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Les données statistiques – entendues comme étant l’ensemble d’informations al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s<br />
simples relevés jusqu’aux données analysées – constituent l’instrument qui permet d’observer<br />
et d’étudier <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière <strong>la</strong> plus objective possible <strong>de</strong>s phénomènes sociaux, économiques,<br />
territoriaux, environnementaux, etc. complexes. Ce type d’observation quantitative permet <strong>de</strong><br />
mesurer les changements et d’é<strong>la</strong>borer, dans un <strong>de</strong>uxième temps, <strong>de</strong>s scénarios d’évolution ;<br />
elle a également pour objectif d’assurer le suivi <strong>de</strong>s changements au travers <strong>de</strong>s décennies,<br />
pour autant que les données soient conservées <strong>de</strong> manière adéquate, mises à disposition <strong>de</strong>s<br />
utilisateurs <strong>de</strong> manière transparente, complète et rapi<strong>de</strong> et que les relevés concernant le thème<br />
étudié continuent d’être faits.<br />
Par leur ambition à <strong>la</strong> pertinence <strong>de</strong> l’information, à l’indépendance, à <strong>la</strong> rigueur<br />
scientifique du travail exécuté, à l’attention apportée à <strong>la</strong> comparabilité <strong>de</strong>s données, à<br />
l’actualité <strong>de</strong>s données, à leur protection et à <strong>la</strong> garantie à l’accessibilité <strong>de</strong> l’information –<br />
suivant les principes universels <strong>de</strong> l’activité statistique 14 – les données statistiques constituent<br />
13 Il est néanmoins intéressant <strong>de</strong> savoir que <strong>la</strong> statistique acquiert <strong>de</strong> l’importance en tant que source<br />
d’information en Suisse dès le XVIIIe siècle. Le tessinois Stefano Franscini publie une <strong>de</strong>s premières analyses<br />
quantitatives en 1827, <strong>la</strong> Statistica <strong>de</strong>l<strong>la</strong> Svizzera. Les premiers offices <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique sont créés au niveau<br />
cantonal (Berne, Zurich, Argovie) juste avant <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’Etat fédéral en 1848. Le premier recensement <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion a lieu peu <strong>de</strong> temps après, en 1850 sous l’égi<strong>de</strong> du Département fédéral <strong>de</strong> l’intérieur.<br />
14 Se référer à <strong>la</strong> Charte 2002 <strong>de</strong>s principes éthiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique publique sur le site <strong>de</strong> l’OFS à l’adresse<br />
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/in<strong>de</strong>x/institutionen/oeffentliche_statistik/ethische_prinzipien/charta_2002/<br />
praeambel.html, 31 janvier 2007.
32 DONNEES STATISTIQUES<br />
un ancrage privilégié pour l’étu<strong>de</strong> du fonctionnement et <strong>de</strong> l’évolution d’une société d’un<br />
point <strong>de</strong> vue non seulement quantitatif mais aussi, <strong>de</strong> plus en plus, qualitatif. Elles ont alors<br />
une importance fondamentale aussi bien au moment <strong>de</strong> leur création et analyse – car elles sont<br />
utilisées immédiatement par un grand nombre <strong>de</strong> personnes – que a posteriori, puisqu’elles<br />
permettent <strong>la</strong> comparaison thématique <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s actuelles avec <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s passées (séries<br />
temporelles) et, enfin, car elles ont une valeur historique particulièrement importante.<br />
Le choix <strong>de</strong> prendre l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique comme porte d’entrée pour l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> données permet d’avoir une vision d’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> création, du traitement et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> ces données sans passer par une enquête auprès d’une multitu<strong>de</strong> d’acteurs<br />
différents : cet office fonctionne en effet également comme organe <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production statistique publique <strong>de</strong>s offices fédéraux et cantonaux et <strong>de</strong>s services <strong>de</strong>s villes 15 .<br />
Il veille à <strong>la</strong> comparabilité <strong>de</strong>s données et établit pour chaque légis<strong>la</strong>ture le programme<br />
pluriannuel <strong>de</strong>s activités statistiques approuvé par le Parlement. Comme nous le verrons plus<br />
loin, il entretient également un lien privilégié avec d’autres organes, institutions et entreprises<br />
suisses et étrangers producteurs d’informations statistiques.<br />
4.2.1.2 Contenu<br />
L’information statistique constitue donc un instrument qui permet <strong>de</strong> représenter <strong>de</strong>s faits<br />
complexes <strong>de</strong> manière c<strong>la</strong>ire et <strong>de</strong> les comparer dans l’espace et dans le temps, ceci sur <strong>la</strong><br />
base d’un chiffre, l’indicateur statistique. La statistique officielle est regroupée dans les 21<br />
domaines déterminés suivants :<br />
1. popu<strong>la</strong>tion ; 12. monnaie, banques, assurances ;<br />
2. espace et environnement ; 13. protection sociale ;<br />
3. vie active et rémunération du travail ; 14. santé ;<br />
4. économie <strong>nationale</strong> ; 15. éducation et science ;<br />
5. prix ; 16. culture, médias ;<br />
6. industrie et services ; 17. politique ;<br />
7. agriculture et sylviculture ; 18. administration et finances publiques ;<br />
8. énergie ; 19. droit et justice ;<br />
9. construction et logements ; 20. revenus et qualité <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ;<br />
10. tourisme ; 21.<br />
11. transports et communications ;<br />
développement durable et disparités<br />
régionales.<br />
Le travail <strong>de</strong> production d’informations statistiques sur ce <strong>la</strong>rge panel <strong>de</strong> domaines<br />
d’activité produit une énorme masse <strong>de</strong> données, qui toutes se basent sur <strong>de</strong>s relevés et <strong>de</strong>s<br />
enquêtes auprès <strong>de</strong> personnes physiques ou morales, sur l’exploitation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong>s<br />
registres administratifs et sur d’autres sources <strong>de</strong> provenance externe. Toutes ces données<br />
doivent pouvoir être comparées entre elles et être conservées à long terme, afin notamment<br />
d’être réutilisées pour les analyses quantitatives et/ou qualitatives diachroniques.<br />
Les données statistiques au sens <strong>la</strong>rge sont en fait constituées <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux groupes<br />
d’informations :<br />
• les microdonnées, qui sont <strong>de</strong>s données individuelles, élémentaires ; elles constituent<br />
l’information <strong>la</strong> plus petite à un moment donné sur l’objet observé par <strong>la</strong> statistique<br />
en question.<br />
15 Il est toutefois à souligner que l’OFS n’est pas le seul producteur <strong>de</strong> statistiques et que son rôle <strong>de</strong><br />
coordinateur se limite à <strong>la</strong> statistique publique. Les autres acteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, comme par exemple les<br />
cantons et les villes, produisent leurs données propres, <strong>de</strong> manière indépendante à l’office fédéral.
DONNEES STATISTIQUES 33<br />
• les macrodonnées, qui se situent à un niveau <strong>de</strong> traitement supérieur, car elles sont<br />
<strong>de</strong>s données agrégées et résument le contenu <strong>de</strong>s microdonnées (par exemple : <strong>de</strong>s<br />
moyennes, <strong>de</strong>s sommes, etc.) ;<br />
Aux microdonnées et aux macrodonnées il faut ensuite toujours associer les<br />
métadonnées, c’est-à-dire les éléments qui fournissent <strong>de</strong>s informations sur les données, qui<br />
les documentent et qui, en somme, leur donnent un sens contextuel et par conséquent<br />
permettent l’accessibilité dans l’espace et dans le temps <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s données. Comme<br />
nous l’avions déjà relevé pour les données météorologiques et climatologiques, dans le cas<br />
présent également les données (qu’elles soient micro ou macro) n’ont aucune pertinence si<br />
elles ne sont pas associées aux métadonnées, qui permettent <strong>de</strong> les interpréter et, par <strong>la</strong> suite,<br />
<strong>de</strong> les comprendre. Les métadonnées assurent aussi l’information quant à <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
travail utilisée (par exemple : <strong>la</strong> manière dont un indice du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation a été<br />
calculé), elles assurent <strong>la</strong> traçabilité du travail et acquièrent ainsi <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> valeur au<br />
fur et à mesure que le temps passe.<br />
Il apparaît par conséquent que les données statistiques prises au sens <strong>la</strong>rge sont – comme<br />
les données météorologiques et climatologiques – un énorme ensemble d’informations<br />
concernant <strong>de</strong>s thématiques disparates mais toujours en re<strong>la</strong>tion avec l’action <strong>de</strong> l’Etat. Elles<br />
sont composées <strong>de</strong> couches d’informations ayant subi différents niveaux <strong>de</strong> traitement,<br />
associées et comparées entre elles lors <strong>de</strong>s analyses et interprétations, toujours accompagnées<br />
<strong>de</strong> métadonnées qui permettent <strong>de</strong> les comprendre et <strong>de</strong> les interpréter et provenant <strong>de</strong><br />
différentes sources. En effet, bien que l’OFS soit le plus grand producteur d’informations<br />
statistiques en Suisse, une partie <strong>de</strong>s données qu’il développe est récoltée par d’autres acteurs<br />
et services publics <strong>de</strong>s statistiques.<br />
Le schéma ci-<strong>de</strong>ssous (figure 4.2.1) résume le processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données<br />
statistiques, <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte <strong>de</strong>s données brutes jusqu’à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s informations<br />
statistiques :<br />
Initialisation,<br />
définition <strong>de</strong><br />
l’enquête<br />
Questionnaires,<br />
enquêtes<br />
Autres<br />
données<br />
(provenance<br />
externe <strong>de</strong>s<br />
relevés, reprise<br />
d’autres<br />
données<br />
CODAM)<br />
Collecte<br />
et saisie<br />
<strong>de</strong>s données<br />
Etape<br />
A<br />
Niveau 1<br />
Données<br />
brutes,<br />
microdonnées<br />
métadonnées<br />
Transformation:<br />
contrôle <strong>de</strong> qualité,<br />
consolidation,<br />
anonymisation<br />
Etape<br />
B<br />
Niveau 2<br />
Données<br />
anonymes<br />
prêtes pour<br />
analyse,<br />
macrodonnées<br />
métadonnées<br />
Bases<br />
<strong>de</strong> données et<br />
<strong>de</strong> métadonnées<br />
<strong>de</strong>s différentes<br />
sections<br />
Données en traitement, ne sont pas accessibles aux utilisateurs<br />
Analyse,<br />
agrégation<br />
intégration,<br />
interprétation<br />
Etape<br />
C<br />
Core<br />
Warehouse<br />
et système<br />
CODAM<br />
Niveau 3<br />
Données<br />
analysées,<br />
métadonnées<br />
Préparation<br />
à <strong>la</strong> diffusion<br />
et diffusion<br />
Etape<br />
D<br />
Niveau 4<br />
Données<br />
publiées<br />
Utilisateurs,<br />
clients<br />
Données accessibles<br />
(utilisateurs déterminés, clients)<br />
Fig. 4.2.1 : Processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données statistiques, <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte <strong>de</strong>s données brutes<br />
jusqu’à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s informations statistiques.
34 DONNEES STATISTIQUES<br />
Les différentes couches <strong>de</strong> données représentées, ainsi que les étapes <strong>de</strong> transformation<br />
qu’elles subissent, peuvent être décrites comme suit :<br />
Initialisation : L’une <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte <strong>de</strong>s données statistiques renvoie<br />
au fait qu’elles nécessitent une définition préa<strong>la</strong>ble du champ d’enquête.<br />
Une fois établi le périmètre du sujet, il faut déterminer les questions que<br />
l’enquête posera, les valeurs qui seront mesurées, etc. Cette initialisation<br />
constitue un passage obligé, que ce soit pour les enquêtes nouvelles ou<br />
pour celles qui se poursuivent dans le temps (comme par exemple le<br />
recensement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion) : les changements d’époque <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt en<br />
Etape A<br />
(collecte) :<br />
effet une mise à jour du questionnement.<br />
Une fois l’enquête définie, les données sont collectées et ensuite, si elles<br />
ont été récoltées sous forme papier, saisies à l’ordinateur. La collecte <strong>de</strong>s<br />
données se fait suivant différentes stratégies (les relevés directs, c’est-àdire<br />
<strong>la</strong> collecte à <strong>la</strong> source <strong>de</strong> données nouvelles via les enquêtes réalisées<br />
par les col<strong>la</strong>borateurs⋅trices <strong>de</strong> l’OFS, par exemple par questionnaire ou<br />
par téléphone ; les relevés indirects en utilisant les données fournies par<br />
d’autres personnes morales <strong>de</strong> droit public ; les relevés fondés sur <strong>de</strong>s<br />
observations ou sur <strong>de</strong>s mesures 16 ; les données déjà existantes et reprises<br />
une nouvelle fois). Les personnes physiques ou morales interrogées<br />
peuvent être obligées <strong>de</strong> répondre aux questions ; elles doivent fournir<br />
<strong>de</strong>s informations véridiques, gratuitement et sous <strong>la</strong> forme prescrite, dans<br />
un dé<strong>la</strong>i imparti.<br />
Niveau 1 : Les données brutes ainsi rassemblées constituent le matériau <strong>de</strong> base pour<br />
réaliser les analyses statistiques. Comme ce sera le cas dans tout le<br />
Etape B<br />
(transformation) :<br />
processus <strong>de</strong> traitement, ces données sont associées à leurs métadonnées.<br />
Les données brutes nécessitent d’être contrôlées et épurées <strong>de</strong>s erreurs.<br />
Ceci est réalisé <strong>de</strong> manière automatique d’abord (élimination <strong>de</strong>s<br />
invraisemb<strong>la</strong>nces évi<strong>de</strong>ntes) et ensuite dans le cadre d’une analyse<br />
(complément d’enquête pour vérifier <strong>la</strong> pertinence <strong>de</strong>s informations).<br />
Cette étape dans le traitement <strong>de</strong>s données statistiques est<br />
particulièrement importante, car <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s données dépend<br />
directement <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s informations ayant été fournies par les<br />
personnes participant à l’enquête. Les questionnaires qui auront été<br />
utilisés seront détruits après un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> contrôle.<br />
Les microdonnées sont associées entre elles <strong>de</strong> manière à créer les<br />
macrodonnées. Elles sont totalement dépersonnalisées afin d’assurer <strong>la</strong><br />
protection <strong>de</strong>s données 17 .<br />
Il est à noter qu’au fur et à mesure que le processus <strong>de</strong> traitement avance,<br />
les métadonnées associées aux données augmentent.<br />
Niveau 2 : Les macrodonnées sont donc en principe <strong>de</strong>s microdonnées anonymes,<br />
mais il se peut que <strong>de</strong>s macrodonnées ne soient pas encore<br />
dépersonnalisées.<br />
Ces données serviront comme base pour faire les véritables analyses<br />
statistiques. A ce sta<strong>de</strong>, elles peuvent être conservées soit dans <strong>de</strong>s bases<br />
<strong>de</strong> données décentralisées et gérées par les différentes sections<br />
16<br />
Se référer à l’art. 4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> statistique fédérale (LSF) du 9 octobre 1992, RS 431.01.<br />
17<br />
Cet aspect sera développé dans le sous-chapitre consacré aux bases légales et, plus loin encore, dans celui qui<br />
concerne l’accessibilité au public.
DONNEES STATISTIQUES 35<br />
Etape C<br />
(analyse) :<br />
thématiques <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, soit déjà dans CODAM.<br />
Les macrodonnées ou microdonnées – toujours accompagnées <strong>de</strong>s<br />
métadonnées qui les concernent – sont associées entre elles pour réaliser<br />
les analyses statistiques. Les col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’OFS vérifient dans<br />
le détail que l’assemb<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> l’un ou <strong>de</strong> l’autre groupe <strong>de</strong> macrodonnées<br />
ne permet pas <strong>de</strong> déduire <strong>de</strong>s informations susceptibles <strong>de</strong> passer outre <strong>la</strong><br />
protection <strong>de</strong>s données.<br />
Niveau 3 : Les données analysées, associées aux métadonnées et aux microdonnées,<br />
sont regroupées dans une banque <strong>de</strong> données appelée Core Warehouse<br />
(CWH), elle-même faisant partie d’un système central nommé Corporate<br />
Data Management (CODAM), récemment mis en p<strong>la</strong>ce à l’OFS 18 . Toutes<br />
les données utiles et utilisables pour effectuer le travail d’analyse<br />
statistique actuel et futur seront donc regroupées dans un même<br />
Etape D<br />
(diffusion) :<br />
environnement informatique.<br />
Les données sont enfin préparées pour <strong>la</strong> diffusion et <strong>la</strong> publication : elles<br />
peuvent l’être sous forme <strong>de</strong> publications papier ou sous forme <strong>de</strong><br />
publications thématiques interactives on et off line (tableaux, rapports<br />
commentés, ouvrages, données statistiques à disposition <strong>de</strong>s<br />
utilisateurs⋅trices leur permettant <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s analyses sur mesure, etc.).<br />
Niveau 4 : Les données ainsi publiées, que ce soit sur Internet, sur support<br />
informatique ou sur papier, entrent dans les processus habituels<br />
d’archivage (en tant que Helvetica, elles sont conservées à <strong>la</strong><br />
Bibliothèque <strong>nationale</strong> suisse suivant <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong> Bibliothèque<br />
<strong>nationale</strong> suisse (LBNS) du 18 décembre 1992).<br />
Ces <strong>de</strong>scriptions nous montrent que les termes <strong>de</strong> « données statistiques » au sens <strong>la</strong>rge<br />
désignent en fait un ensemble <strong>de</strong> données associées à <strong>de</strong>s métadonnées, ayant subi différents<br />
niveaux <strong>de</strong> traitement et étant regroupées thématiquement. Elles sont produites en très gran<strong>de</strong><br />
partie par les col<strong>la</strong>borateurs⋅trices <strong>de</strong> l’OFS et, dans une moindre mesure et suivant <strong>de</strong>s<br />
processus <strong>de</strong> production différents, par d’autres acteurs <strong>de</strong> droit public et <strong>de</strong> droit privé (s’ils<br />
sont soumis à l’obligation <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s données). Leur gestion au niveau <strong>de</strong> l’exploitation et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation à long terme se révèle complexe, car leur caractère thématique et les<br />
différentes phases <strong>de</strong> traitement et d’analyse qu’elles subissent ren<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> standardisation et<br />
l’uniformisation <strong>de</strong>s processus plus difficiles.<br />
4.2.1.3 Supports<br />
Comme dans toutes les administrations <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération, le passage à l’ère <strong>de</strong><br />
l’informatique – qui a eu lieu progressivement à l’OFS autour <strong>de</strong>s années 90 – a sensiblement<br />
changé <strong>la</strong> manière <strong>de</strong> traiter, d’analyser et ensuite <strong>de</strong> conserver les données produites<br />
directement sous forme informatique. Alors que les documents administratifs <strong>de</strong> l’OFS sont<br />
imprimés systématiquement et archivés sur papier en raison du fait qu’il n’existe pas encore<br />
d’outil accrédité qui garantisse une conservation électronique à long terme, les données<br />
statistiques passent au travers du processus <strong>de</strong> traitement, d’analyse et <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> sans<br />
plus passer par les supports papier ; le traitement <strong>de</strong>s données et les résultats <strong>de</strong>s analyses sont<br />
effectués beaucoup plus rapi<strong>de</strong>ment que par le passé.<br />
Depuis quelques années, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données à l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique se<br />
trouve dans une phase <strong>de</strong> complète réorganisation. Jusqu’à récemment et, en partie, encore<br />
18<br />
Les caractéristiques du système CODAM seront re<strong>la</strong>tées plus bas dans le sous chapitre concernant les<br />
supports.
36 DONNEES STATISTIQUES<br />
maintenant, l’office fonctionnait suivant un système <strong>de</strong> production <strong>de</strong> donnée appelée stow<br />
pipe : chacun <strong>de</strong> ses services, articulé suivant une logique thématique, travail<strong>la</strong>it en effet <strong>de</strong><br />
manière imperméable par rapport aux autres et suivant une organisation interne indépendante.<br />
Ce système <strong>de</strong> travail était à <strong>la</strong> source <strong>de</strong> nombreuses redondances et incohérences au niveau<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> production et du traitement <strong>de</strong>s données statistiques ; d’une part, les différentes sections<br />
récoltaient, traitaient et conservaient les données sans se coordonner entre elles, créant ainsi<br />
<strong>de</strong>s doublons dans les données ; d’autre part, ni les données (micro et macro), ni les<br />
métadonnées, ni les infrastructures (informatiques) étaient harmonisées, créant ainsi <strong>de</strong>s<br />
redondances d’une section à l’autre. Outre <strong>la</strong> nuisance que cette structure inefficace pouvait<br />
donner à l’image <strong>de</strong> l’institution (envoi <strong>de</strong> différents questionnaires contenant <strong>de</strong>s mêmes<br />
questions, publication d’analyses statistiques donnant <strong>de</strong>s chiffres ou <strong>de</strong>s résultats légèrement<br />
discordants, etc.) et <strong>la</strong> lour<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> collecte et d’analyse <strong>de</strong> l’institution, elle<br />
faisait augmenter considérablement les coûts <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l’information statistique.<br />
Pour pallier ces problèmes, l’OFS a envisagé dans les années 90 un p<strong>la</strong>n global qui<br />
permette <strong>de</strong> passer d’un système <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données vertical et sous <strong>la</strong><br />
responsabilité individuelle <strong>de</strong> chaque section <strong>de</strong> l’office (stow pipe) à un système horizontal<br />
qui favorise l’unification et l’uniformisation <strong>de</strong>s processus, notamment concernant <strong>la</strong><br />
définition <strong>de</strong>s enquêtes, <strong>la</strong> récolte, <strong>la</strong> consolidation, l’agrégation et <strong>la</strong> dépersonnalisation <strong>de</strong>s<br />
données (étapes A, B et C). L’une <strong>de</strong>s réalisations majeures <strong>de</strong> ce p<strong>la</strong>n a été <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce<br />
du projet CODAM (Corporate Data Management).<br />
CODAM, qui a été <strong>la</strong>ncé en 1998, est considéré comme un concept qui prône une<br />
philosophie <strong>de</strong> partage <strong>de</strong> l’information et d’uniformisation <strong>de</strong>s processus, ainsi que comme<br />
un système informatique qui sert d’une certaine manière <strong>de</strong> « <strong>mémoire</strong> institutionnelle » : il<br />
regroupe en effet les données (macrodonnées et microdonnées) et les métadonnées récoltées<br />
et utilisées pour produire les statistiques officielles (créées par l’OFS, mais aussi par les autres<br />
producteurs officiels <strong>de</strong> statistiques). De cette manière, <strong>la</strong> création <strong>de</strong> CODAM permet <strong>de</strong><br />
regrouper les informations statistiques disponibles sous un même toit, <strong>de</strong> créer un accès<br />
facilité, <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s synergies et, incontestablement, <strong>de</strong> faire baisser les coûts : les<br />
différents systèmes informatiques qui étaient utilisés auparavant dans les diverses sections<br />
vont se réduire, les processus sont en train d’être standardisés et on est en train <strong>de</strong> faire baisser<br />
<strong>de</strong> manière très sensible les coûts <strong>de</strong>s licences pour les programmes informatiques utilisés. Le<br />
système CODAM est actuellement encore en train <strong>de</strong> subir <strong>de</strong>s adaptations qui <strong>de</strong>vraient<br />
répondre aux besoins <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’OFS. L’importation <strong>de</strong>s<br />
données et <strong>de</strong>s métadonnées (qui est impérative et est faite au préa<strong>la</strong>ble) se réalise petit à petit,<br />
au fur et à mesure que les données sont récoltées et traitées : elle a démarré en 2005 et prendra<br />
vraisemb<strong>la</strong>blement quelques années.<br />
Ainsi, alors que <strong>la</strong> récolte <strong>de</strong>s données statistique se réalise encore souvent sur support<br />
papier (mais <strong>de</strong> plus en plus via l’Internet et les enquêtes en ligne), le traitement et l’analyse<br />
<strong>de</strong>s données se réalise sur <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données et <strong>de</strong>s supports informatiques. Toutes ces<br />
informations, auparavant très décentralisées, sont en train d’être réunies au sein <strong>de</strong> périmètres<br />
informatiques gérés sur <strong>de</strong>s serveurs centraux. La gestion <strong>de</strong>s conditions cadre <strong>de</strong> leur<br />
conservation à long terme, qui jusqu’à récemment était un souci <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong>s données<br />
(c’est-à-dire les col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong>s diverses unités thématiques <strong>de</strong> l’OFS, qui jouaient<br />
ainsi en même temps le rôle d’opérateurs et <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>teurs) est désormais du ressort <strong>de</strong> l’Etatmajor<br />
<strong>de</strong> direction et <strong>de</strong> <strong>la</strong> division Infrastructure statistique : elle est techniquement assurée<br />
par le biais <strong>de</strong> l’OFIT (Office fédéral <strong>de</strong> l’informatique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication), responsable
DONNEES STATISTIQUES 37<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion informatique <strong>de</strong>s administrations du DFI 19 . La sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données est<br />
assurée par <strong>de</strong>s backups réguliers (incremental et full backups) et par <strong>de</strong>s migrations (<strong>de</strong>ux<br />
migrations dans les 10 <strong>de</strong>rnières années).<br />
Le volume <strong>de</strong>s données et métadonnées statistiques actuellement conservées à l’OFS est<br />
d’environ 5 Terabytes ; il est estimé que leur croissance s’élève à 5% par année. La p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong><br />
stockage nécessaire à sauvegar<strong>de</strong>r ces informations ne représente pas un obstacle : on<br />
considère en effet que les ressources techniques à <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> cet objectif existent et sont<br />
accessibles.<br />
Une <strong>de</strong>s questions qui se pose à l’office concernant <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s<br />
supports, et à <strong>la</strong>quelle une réponse définitive n’a pas encore été donnée, est <strong>de</strong> savoir que faire<br />
avec les données qui n’ont pas été produites sous une forme digitale. En effet, <strong>la</strong> saisie<br />
informatique <strong>de</strong> ces données <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un investissement énorme en termes <strong>de</strong> travail, <strong>de</strong><br />
temps et <strong>de</strong> coûts. Si l’on considère que CODAM constitue une sorte <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong> historique<br />
et actuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> données <strong>de</strong> l’office, les anciennes données <strong>de</strong>vraient également<br />
y figurer. Si l’on abor<strong>de</strong> par contre cette question du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’effort nécessaire (en<br />
termes <strong>de</strong> ressources) pour réaliser cet objectif et qu’on le met en re<strong>la</strong>tion avec le bénéfice<br />
direct qui en est tiré en termes d’utilisation, les anciennes données sur papier risquent dans ce<br />
cas <strong>de</strong> ne pas y être intégralement intégrées.<br />
4.2.1.4 Organe compétent 20<br />
L’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fait partie du Département fédéral <strong>de</strong> l’intérieur ; suivant<br />
le modèle <strong>de</strong>s cercles <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nouvelle gestion publique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération, par son mandat <strong>de</strong><br />
réalisation d’une politique publique fédérale (<strong>la</strong> statistique officielle) et par son rôle <strong>de</strong><br />
coordinateur, il est intégré dans le premier cercle <strong>de</strong>s administrations fédérales.<br />
L’organigramme <strong>de</strong> l’OFS, réorganisé en 2004, se compose d’une Direction (Direction,<br />
Secrétariat <strong>de</strong> direction, Communication), d’un Etat-major <strong>de</strong> direction (Métho<strong>de</strong>s<br />
statistiques, <strong>Politique</strong> statistique et coopération, P<strong>la</strong>nification et processus, Technologies <strong>de</strong><br />
l’information), d’une division <strong>de</strong> support et <strong>de</strong> sept divisions spécialisées.<br />
La Direction <strong>de</strong> l’OFS – outre le fait qu’elle veille à ce que toutes les divisions et sections<br />
<strong>de</strong> l’office col<strong>la</strong>borent <strong>de</strong> manière efficace afin <strong>de</strong> pouvoir remplir le mandat d’information<br />
statistique avec les ressources disponibles, en définissant précisément les objectifs et <strong>la</strong><br />
répartition <strong>de</strong>s tâches – est responsable du domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique publique en Suisse : elle<br />
établit quelles informations statistiques il convient <strong>de</strong> fournir et à quels intervalles, selon<br />
quelle métho<strong>de</strong>, en coopération avec quels services, pour quels groupes cible, etc. Elle<br />
s’interroge sur les besoins en information statistique à l’avenir et sur <strong>la</strong> manière d’y répondre.<br />
L’Etat-major <strong>de</strong> direction, en fonction <strong>de</strong>puis le début <strong>de</strong> 2003, joue le rôle d’une entreprise<br />
<strong>de</strong> services pour l’ensemble <strong>de</strong> l’OFS et ses structures. Il est chargé <strong>de</strong> quatre tâches<br />
essentielles : <strong>la</strong> gestion stratégique, le management <strong>de</strong> l’évaluation, le soutien <strong>de</strong>s processus<br />
19 Dans les années 1999 à 2001, plusieurs administrations fédérales (y compris l’OFS) ont perdu leur propre<br />
unité informatique. La Confédération avait en effet décidé <strong>de</strong> les centraliser sous un même toit par département<br />
suivant le projet NOVE IT : c’est donc le service informatique du Département fédéral <strong>de</strong> l’intérieur (IDZ,<br />
Information Dienstleitung Zentrum) qui était responsable du parc informatique <strong>de</strong> l’OFS. Actuellement c’est<br />
l'Office fédéral <strong>de</strong> l'informatique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> télécommunication (OFIT) qui fournit à l'ensemble <strong>de</strong> l'administration<br />
fédérale les prestations informatiques centrales. L’OFS ne possè<strong>de</strong> qu’une petite unité informatique qui sert <strong>de</strong><br />
médiateur et <strong>de</strong> re<strong>la</strong>is entre les <strong>de</strong>ux institutions.<br />
20 Pour ce sous-chapitre, se référer au site Internet <strong>de</strong> l’OFS, aux adresses suivantes:<br />
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/in<strong>de</strong>x/institutionen/oeffentliche_statistik.html pour <strong>la</strong> statistique publique<br />
et http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/in<strong>de</strong>x/institutionen/bun<strong>de</strong>samt_fuer_statistik.html pour l’OFS. 31<br />
janvier 2007.
38 DONNEES STATISTIQUES<br />
<strong>de</strong> production et <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> l’OFS. L’unité <strong>de</strong> support, appelée Ressources et<br />
logistique, joue un rôle <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s ressources et <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services (logistique,<br />
personnel, finances, infrastructure, produits statistiques, services linguistiques, publication,<br />
archives, etc.).<br />
Les sept divisions spécialisées sont organisées suivant les différentes thématiques<br />
traitées ; elles s’occupent <strong>de</strong> <strong>la</strong> collecte, <strong>la</strong> gestion et l’analyse <strong>de</strong>s données dans leurs<br />
domaines. Il est à noter que <strong>la</strong> division Infrastructure statistique représente le centre <strong>de</strong><br />
services pour <strong>la</strong> collecte <strong>de</strong> données sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s registres, pour <strong>la</strong> gestion et le traitement<br />
<strong>de</strong> données statistiques et pour l’utilisation <strong>de</strong>s statistiques. Les autres six divisions <strong>de</strong> l’OFS<br />
constituent les centres <strong>de</strong> compétence statistique <strong>de</strong>s domaines thématiques que leurs noms<br />
respectifs indiquent :<br />
1. Infrastructure<br />
statistique :<br />
2. Etu<strong>de</strong>s démographiques<br />
et enquêtes auprès <strong>de</strong>s<br />
ménages :<br />
3. Enquêtes auprès <strong>de</strong>s<br />
entreprises :<br />
Registres <strong>de</strong>s entreprises et <strong>de</strong>s établissements<br />
Bâtiments et logements<br />
Géo-information<br />
CODAM<br />
Popu<strong>la</strong>tion et recensement<br />
Démographie et migration<br />
Revenus, consommation et conditions <strong>de</strong> vie<br />
Travail et vie active<br />
Enquêtes auprès <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong>s ménages<br />
Structure <strong>de</strong>s entreprises<br />
Statistiques monétaires <strong>de</strong>s entreprises<br />
Prévoyance professionnelle<br />
Enquêtes conjoncturelles<br />
4. Sa<strong>la</strong>ires et prix : Sa<strong>la</strong>ires et conditions <strong>de</strong> travail<br />
Prix<br />
5. Santé, éducation et Systèmes d’éducation et science<br />
sciences :<br />
Formation sco<strong>la</strong>ire et professionnelle<br />
Hautes écoles<br />
Santé et Observatoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
6. Economie, Etat et Comptes nationaux<br />
société :<br />
Structures et conjoncture économiques<br />
Analyses socio-économiques<br />
<strong>Politique</strong>, culture et médias<br />
Sécurité sociale<br />
Criminalité et droit pénal<br />
7. Economie spatiale et Environnement, développement durable,<br />
développement durable : agriculture<br />
Transports<br />
Analyses spatiales<br />
Tourisme<br />
En tant que service statistique central <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération, suivant l’art. 10 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur<br />
<strong>la</strong> statistique fédérale (LSF) du 9 octobre 1992 (RS 431.01), l’OFS accomplit <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong><br />
différentes natures. Elles peuvent être résumées ainsi :<br />
• il fournit <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> nature statistique aux unités administratives <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Confédération, ainsi qu’à d’autres utilisateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale et au public<br />
en général ;
DONNEES STATISTIQUES 39<br />
• il coordonne <strong>la</strong> statistique fédérale et crée <strong>de</strong>s bases homogènes permettant <strong>la</strong><br />
comparabilité <strong>nationale</strong> et inter<strong>nationale</strong> ;<br />
• il établit le programme pluriannuel avec le concours d’autres services et après<br />
consultation <strong>de</strong>s milieux intéressés ;<br />
• il effectue en principe les relevés, é<strong>la</strong>bore <strong>de</strong>s aperçus et <strong>de</strong>s statistiques <strong>de</strong> synthèse ;<br />
• il tient <strong>de</strong>s registres et <strong>de</strong>s fichiers, en particulier le Registre <strong>de</strong>s entreprises et <strong>de</strong>s<br />
établissements (REE), qui sert à l’exécution <strong>de</strong>s relevés auprès <strong>de</strong>s entreprises et <strong>de</strong>s<br />
établissements, et le Registre fédéral <strong>de</strong>s bâtiments et <strong>de</strong>s logements (RegBL) en<br />
col<strong>la</strong>boration avec les cantons et le Fichier suisse <strong>de</strong>s étudiants, en col<strong>la</strong>boration<br />
cette fois-ci avec les hautes écoles ;<br />
• il est en re<strong>la</strong>tion avec d’autres unités administratives et organismes soumis à <strong>la</strong><br />
surveil<strong>la</strong>nce, touchant <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s financières et <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités ou exerçant une<br />
activité fondée sur une concession ou autorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération, qui lui<br />
communiquent les bases et les résultats <strong>de</strong> leurs travaux statistiques et, au besoin, lui<br />
fournissent <strong>de</strong>s données provenant <strong>de</strong> leurs fichiers et relevés.<br />
Afin <strong>de</strong> réaliser ses tâches, l’OFS emploie 693 col<strong>la</strong>borateurs·trices permanent·e·s<br />
correspondant à 588 postes <strong>de</strong> travail. Lors <strong>de</strong> certaines gran<strong>de</strong>s enquêtes, comme le<br />
recensement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, jusqu’à 150 auxiliaires (122 postes) peuvent venir compléter<br />
cet effectif 21 . Pour réaliser son rôle <strong>de</strong> coordinateur, l’office peut en outre s’appuyer sur divers<br />
organes, comme le montre le schéma ci-<strong>de</strong>ssous (figure 4.2.2) :<br />
Fig. 4.2.2 : Les organes <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale [Tiré <strong>de</strong> : site Internet <strong>de</strong> l’OFS, page<br />
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/in<strong>de</strong>x/institutionen/oeffentliche_statistik/bun<strong>de</strong>sstatistik.<br />
html, 16.01.07].<br />
21 Le personnel est ainsi réparti (état en février 2007) : 45 personnes (42.1 postes) travaillent à <strong>la</strong> Direction et à<br />
l’Etat major <strong>de</strong> direction ; 100 personnes (80,6 postes) à l’unité <strong>de</strong> support Ressources et logistique ; 103<br />
personnes (90,9 postes) à <strong>la</strong> division Infrastructure statistique ; 52 personnes (47,6 postes) à <strong>la</strong> division Etu<strong>de</strong>s<br />
démographiques et enquêtes auprès <strong>de</strong>s ménages ; 58 personnes (51,5 postes) à <strong>la</strong> division Enquêtes auprès <strong>de</strong>s<br />
entreprises ; 57 personnes (51,8 postes) à <strong>la</strong> division Sa<strong>la</strong>ires et prix ; 122 personnes (96,1 postes) à <strong>la</strong><br />
division Santé, éducation et sciences ; 93 personnes (75,6 postes) à <strong>la</strong> division Economie, Etat et société ; 63<br />
personnes (52 postes) à <strong>la</strong> division Economie spatiale et développement durable.
40 DONNEES STATISTIQUES<br />
La Commission <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale a pour tâche <strong>de</strong> conseiller le Conseil fédéral,<br />
l’OFS et les autres producteurs <strong>de</strong> statistiques pour tout ce qui a trait à <strong>la</strong> politique statistique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération (suivi et évaluation du programme pluriannuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale,<br />
établissement du rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral, adoption <strong>de</strong>s<br />
recommandations et directives s’appliquant aux travaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale, évaluation<br />
<strong>de</strong> projets d’introduction, suppression ou modification <strong>de</strong> statistiques importantes, promotion<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration entre les différents producteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique publique, évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
politique <strong>de</strong> diffusion), suivant les 21 domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique mis en évi<strong>de</strong>nce<br />
précé<strong>de</strong>mment. Ses membres, nommés par le Conseil fédéral et p<strong>la</strong>cés sous l’autorité du DFI,<br />
sont les représentants <strong>de</strong>s cantons, <strong>de</strong>s communes, <strong>de</strong> l’économie, <strong>de</strong>s partenaires sociaux, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Banque <strong>nationale</strong>, <strong>de</strong> l’administration fédérale et du mon<strong>de</strong> académique.<br />
FEDESTAT, présidé par <strong>la</strong> directrice <strong>de</strong> l’OFS, constitue un organe <strong>de</strong> coordination<br />
s’occupant <strong>de</strong> tâches <strong>de</strong> nature conceptuelle, organisationnelle et administrative : elle réunit<br />
les producteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération et d’autres institutions soumises à <strong>la</strong> Loi<br />
sur <strong>la</strong> statistique fédérale. Suivant une même logique, REGIOSTAT (lui aussi présidé par <strong>la</strong><br />
directrice <strong>de</strong> l’OFS) réunit les représentants <strong>de</strong> l’OFS, <strong>de</strong>s offices cantonaux <strong>de</strong> statistique,<br />
<strong>de</strong>s services statistiques <strong>de</strong>s cantons qui n’ont pas leur propre office <strong>de</strong> statistique et <strong>de</strong>s<br />
services statistiques <strong>de</strong>s villes ; son comité règle les affaires courantes.<br />
Les groupes d’experts – qui traitent <strong>de</strong>s questions statistiques ou <strong>de</strong>s besoins en données<br />
– sont composés <strong>de</strong> représentants d’offices fédéraux, <strong>de</strong> cantons, <strong>de</strong> communes, <strong>de</strong><br />
l’économie, <strong>de</strong>s partenaires sociaux et <strong>de</strong>s sciences qui ont <strong>de</strong>s connaissances particulières<br />
dans <strong>de</strong>s domaines déterminés ainsi que <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique<br />
fédérale, <strong>de</strong> FEDESTAT et <strong>de</strong> REGIOSTAT. Les domaines concernés sont les suivants : le<br />
système <strong>de</strong>s enquêtes auprès <strong>de</strong>s ménages et <strong>de</strong>s personnes ; <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s paiements ; les<br />
statistiques économiques ; les transports ; <strong>la</strong> protection sociale ; <strong>la</strong> santé ; l’éducation et <strong>la</strong><br />
formation ; les hautes écoles et les sciences ; <strong>la</strong> criminalité.<br />
La Conférence suisse <strong>de</strong>s offices régionaux <strong>de</strong> statistique (CORSTAT) regroupe les<br />
offices régionaux <strong>de</strong> statistique <strong>de</strong> Suisse et l’Association suisse <strong>de</strong> Statistique (ASS)<br />
s’occupe <strong>de</strong> promouvoir l’usage et le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique en Suisse, <strong>de</strong> représenter<br />
les intérêts <strong>de</strong>s enseignants, chercheurs et praticiens du domaine et <strong>de</strong> contribuer à faire<br />
reconnaître <strong>la</strong> statistique comme une discipline scientifique à part entière.<br />
En somme, <strong>la</strong> statistique en Suisse (comme ailleurs) est l’affaire d’un nombre<br />
incalcu<strong>la</strong>ble d’acteurs et doit être le résultat d’un effort soutenu <strong>de</strong> coordination. L’OFS en<br />
constitue d’une certaine manière le pivot central ; chacune <strong>de</strong> ses divisions et sections doit<br />
donc s’investir dans <strong>de</strong> nombreuses col<strong>la</strong>borations. Les acteurs qui entretiennent <strong>de</strong>s<br />
col<strong>la</strong>borations ou <strong>de</strong>s liens re<strong>la</strong>tivement proches avec l’Office fédéral <strong>de</strong> statistique peuvent<br />
être délimités en trois groupes principaux : les producteurs <strong>de</strong> statistique (en Suisse et à<br />
l’étranger), les fournisseurs d’informations (surtout en Suisse) et les clients <strong>de</strong> l’OFS.<br />
Les producteurs <strong>de</strong> statistique sont <strong>principale</strong>ment :<br />
• les institutions <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique en Suisse, à savoir :<br />
- au niveau national, <strong>de</strong>s Administrations fédérales (<strong>de</strong>s contributions, <strong>de</strong>s<br />
douanes, <strong>de</strong>s finances) et <strong>de</strong>s Offices fédéraux (<strong>de</strong> l’aviation civile, <strong>de</strong><br />
l’énergie, <strong>de</strong> l’environnement, <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication, <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique, <strong>de</strong>s<br />
routes, <strong>de</strong>s transports, du développement territorial, du logement), ainsi que <strong>la</strong><br />
Banque Nationale Suisse, le Bureau suisse <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts, <strong>la</strong><br />
Direction du développement et <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération, l’Institut fédéral <strong>de</strong>
DONNEES STATISTIQUES 41<br />
recherches sur <strong>la</strong> forêt, <strong>la</strong> neige et le paysage, MétéoSuisse, l’Observatoire<br />
suisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, l’Office vétérinaire fédéral et <strong>la</strong> régie fédérale <strong>de</strong>s alcools ;<br />
- les différents offices et institutions cantonaux (tous les cantons sauf ZG et<br />
AR) ;<br />
- les services statistiques <strong>de</strong> six villes (Bienne, La Chaux-<strong>de</strong>-Fonds, St. Gallen,<br />
Winterthur, Zurich et Berne) ;<br />
- <strong>de</strong>s écoles polytechniques (Centre <strong>de</strong> recherches conjoncturelles <strong>de</strong> l’EPFZ) et<br />
<strong>de</strong>s hautes écoles (Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz) ;<br />
- d’autres institutions (Santésuisse, Service <strong>de</strong> centralisation <strong>de</strong>s statistiques <strong>de</strong><br />
l'assurance-acci<strong>de</strong>nts LAA, Union suisse <strong>de</strong>s paysans).<br />
• les institutions statistiques au niveau international :<br />
- les services nationaux ou centraux <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique ;<br />
- diverses organisations inter<strong>nationale</strong>s ainsi que leurs organisations spéciales ou<br />
régionales, comme <strong>la</strong> division statistique <strong>de</strong>s Nations Unies ou le portail <strong>de</strong>s<br />
statistiques <strong>de</strong> l’Organisation <strong>de</strong> coopération et <strong>de</strong> développement économiques<br />
(OCDE), qui définissent <strong>de</strong>s normes inter<strong>nationale</strong>s qui visent à rendre les<br />
données comparables ;<br />
- EUROSTAT, qui est l’Office statistique <strong>de</strong>s Communautés européennes et qui<br />
fournit <strong>de</strong>s efforts en vue <strong>de</strong> l’harmonisation et <strong>la</strong> normalisation <strong>de</strong>s statistiques<br />
publiques ; ses normes et standards sont appliqués également par <strong>la</strong><br />
Suisse suivant les accords bi<strong>la</strong>téraux <strong>de</strong> coopération dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
statistique 22 .<br />
Le groupe <strong>de</strong>s fournisseurs d’information est constitué par <strong>de</strong>s personnes physiques ou<br />
morales – ces <strong>de</strong>rnières pouvant être aussi bien <strong>de</strong>s institutions publiques que privées<br />
(entreprises, organes représentant l’économie, etc.) – qui doivent fournir <strong>de</strong>s données à l’OFS<br />
pour lui permettre <strong>de</strong> réaliser ses analyses statistiques. Suivant l’art. 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong><br />
statistique fédérale, ces groupes d’acteurs peuvent être contraints à fournir <strong>de</strong>s informations<br />
(véridiques et suivant les indications données).<br />
Enfin, comme nous le verrons dans le sous-chapitre consacré à l’accessibilité, les clients<br />
<strong>de</strong> l’OFS sont toutes les personnes ou institutions qui nécessitent et utilisent les informations<br />
statistiques fournies par l’office. Parmi celles-ci, un groupe important d’acteurs est constitué<br />
par les universités, les écoles polytechniques et le milieu scientifique en général.<br />
4.2.1.5 Bases légales<br />
C’est tout d’abord l’art. 65 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution fédérale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération suisse du 18<br />
avril 1999 (RS 101) qui attribue à <strong>la</strong> Confédération le mandat <strong>de</strong> collecter les données<br />
statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong> l’économie, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société, <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation, <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, du territoire et <strong>de</strong> l’environnement en Suisse. La<br />
légis<strong>la</strong>tion concernant <strong>la</strong> statistique est ensuite composée d’un très grand nombre <strong>de</strong> lois,<br />
d’ordonnances et d’articles regroupés dans le recueil systématique sous le domaine 431<br />
suivant différentes thématiques (l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique tout d’abord ; ensuite les<br />
22 Un accord d’eurocompatibilité <strong>de</strong>s données économiques est d’ailleurs entré en vigueur au début <strong>de</strong> l’année<br />
2007. L’harmonisation totale <strong>de</strong> l’appareil statistique helvétique avec Eurostat <strong>de</strong>vrait être terminée en 2011. Se<br />
référer à l’article <strong>de</strong> Willy Bo<strong>de</strong>r apparu dans Le temps le mercredi 10 janvier 2007, intitulé « L’Office fédéral<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique se donne cinq ans pour s’aligner sur l’Europe ».
42 DONNEES STATISTIQUES<br />
statistiques démographiques, <strong>de</strong>s étrangers, sur les élections et les votations, afférentes aux<br />
marchés publics, l’acquisition d’immeubles par <strong>de</strong>s personnes domiciliées à l’étranger, <strong>la</strong><br />
statistique en droit pénal, celle sur les écoles, les statistiques sportives, en matière <strong>de</strong><br />
recherche, sur le cinéma, en matière d’approvisionnement du pays, <strong>de</strong>s recettes provenant <strong>de</strong><br />
l’exportation <strong>de</strong> l’énergie électrique, <strong>de</strong>s transports, dans le domaine <strong>de</strong>s postes et<br />
télécommunications, sur l’environnement, sanitaire, du travail, sociale, <strong>de</strong>s bâtiments et <strong>de</strong>s<br />
logements, économique, etc.) 23 . Les divisions et les sections <strong>de</strong> l’OFS possè<strong>de</strong>nt ainsi <strong>de</strong>s<br />
instruments légaux sur mesure suivant leurs domaines <strong>de</strong> compétence.<br />
D’un point <strong>de</strong> vue général et organisationnel, c’est <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> statistique fédérale (LSF)<br />
du 9 octobre 1992 (RS 431.01) déjà citée, l’Ordonnance concernant l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
statistique fédérale du 30 juin 1993 (RS 431.011) et l’Ordonnance sur les émoluments et<br />
in<strong>de</strong>mnités perçus pour les prestations <strong>de</strong> services statistiques <strong>de</strong>s unités administratives <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Confédération du 25 juin 2003 (RS 431.09) qui sont centrales. Ces documents englobent<br />
d’ailleurs tous les aspects fondamentaux : ces lois et ordonnances visent à assurer à <strong>la</strong><br />
Confédération les fon<strong>de</strong>ments statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches (LSF,<br />
art. 1, let. a.), à mettre <strong>de</strong>s résultats statistiques à disposition <strong>de</strong>s cantons, <strong>de</strong>s communes, <strong>de</strong>s<br />
milieux scientifiques, <strong>de</strong> l’économie privée, <strong>de</strong>s partenaires sociaux et du public (let. b.), à<br />
organiser <strong>la</strong> statistique fédérale <strong>de</strong> manière à assurer une collecte et un traitement efficaces<br />
<strong>de</strong>s données, tout en ménageant les personnes interrogées (let. c.), à encourager <strong>la</strong> coopération<br />
<strong>nationale</strong> et inter<strong>nationale</strong> en matière <strong>de</strong> statistique (let. d.) et à garantir <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
données (let. e.). La section 4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> LSF (art. 14 à 17) abor<strong>de</strong> <strong>la</strong> question fondamentale <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
protection et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s données, dont les éléments essentiels sont les aspects suivants :<br />
• les données collectées ou communiquées à <strong>de</strong>s fins statistiques ne peuvent en<br />
principe pas être utilisées à d’autres fins et le secret <strong>de</strong> fonction doit être garanti (art.<br />
14) ;<br />
• l’OFS peut apparier <strong>de</strong>s données (même sensibles), mais uniquement à condition <strong>de</strong><br />
les rendre anonymes et, si l’appariement permet d’établir <strong>de</strong>s profils <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux<br />
statistiques d’exploitation terminés (art. 14a, al. 1) ;<br />
• tous les services traitant <strong>de</strong>s données personnelles en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> statistique<br />
fédérale ont l’obligation <strong>de</strong> les protéger (art. 15, al. 1) ; les organes responsables <strong>de</strong>s<br />
relevés n’ont le droit <strong>de</strong> conserver les listes <strong>de</strong>s noms et adresses établis pour <strong>la</strong><br />
préparation, l’exécution et <strong>la</strong> coordination <strong>de</strong>s relevés que tant qu’ils en ont besoin<br />
pour leurs travaux (art. 15, al. 2) ; les questionnaires et autres documents d’enquête<br />
qui contiennent les noms <strong>de</strong>s personnes concernées doivent être détruits dès que le<br />
dépouillement est achevé (art. 15, al. 3) ; les données auxquelles ne sont attachés ni<br />
les noms <strong>de</strong>s personnes concernées ni <strong>de</strong>s numéros d’i<strong>de</strong>ntification personnels<br />
peuvent être conservées et archivées (art. 14, al. 4).<br />
La personnalité et les droits fondamentaux <strong>de</strong>s personnes qui font l’objet d’un traitement<br />
<strong>de</strong> données sont en outre protégés par <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données (LPD) du<br />
19 juin 1992 (RS 235.1) et <strong>de</strong> son Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
données (OLPD) du 14 juin 1993 (RS 235.11). Actuellement les questions liées à <strong>la</strong><br />
protection <strong>de</strong>s données, qui <strong>de</strong>vient un sujet <strong>de</strong> plus en plus sensible, sont d’ailleurs en train<br />
<strong>de</strong> prendre du ressort. La dépersonnalisation <strong>de</strong>s informations et <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s profils <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
personnalité lors <strong>de</strong> l’appariement <strong>de</strong> données <strong>de</strong>viennent en effet <strong>de</strong>s aspects influençant <strong>de</strong><br />
23 Il est également à signaler qu’il existe <strong>de</strong> nombreux documents internationaux qui régu<strong>la</strong>risent et codifient le<br />
travail <strong>de</strong>s statisticiens, comme <strong>de</strong>s principes fondamentaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations sur l’éthique<br />
professionnelle ou <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s <strong>de</strong> déontologie. Ces documents ne seront pas pris en considération ici.
DONNEES STATISTIQUES 43<br />
plus en plus le travail <strong>de</strong> récolte, <strong>de</strong> traitement et d’analyse <strong>de</strong>s données à cause <strong>de</strong> leur nature<br />
électronique et d’une mise à disposition <strong>de</strong> l’utilisateur <strong>de</strong> plus en plus rapi<strong>de</strong> et facilitée.<br />
L’OFS est d’ailleurs en train <strong>de</strong> préparer un règlement concernant ces aspects.<br />
La conservation à long terme ou l’archivage <strong>de</strong>s données statistiques ne font pas encore<br />
l’objet d’une base légale, d’un règlement ou d’instructions internes à l’OFS. En effet, alors<br />
que <strong>la</strong> Loi fédérale sur l’archivage et l’Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur l’archivage<br />
s’appliquent sans autre aux documents administratifs <strong>de</strong> l’office 24 , il <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> plus en plus<br />
difficile <strong>de</strong> les appliquer pour les données statistiques, qui sont utilisées en permanence et qui<br />
sont désormais <strong>de</strong> nature électronique uniquement (ce qui n’était évi<strong>de</strong>mment pas le cas<br />
auparavant). L’OFS est conscient que ces questions nécessitent d’être abordées et, à court<br />
terme, <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s solutions formelles pour garantir <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s données. Cependant,<br />
puisque CODAM se trouve encore dans sa phase <strong>de</strong> construction (importation <strong>de</strong>s données,<br />
etc.) et <strong>de</strong> consolidation (calibrages, etc.), il apparaît encore prématuré <strong>de</strong> fixer <strong>de</strong>s règles<br />
dans ce domaine. L’OFS attend en outre une prise <strong>de</strong> décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s Archives<br />
fédérales quant à l’archivage <strong>de</strong>s données électroniques.<br />
4.2.1.6 Coûts<br />
Comme nous l’avons vu, les données statistiques – suivant tout le processus qui va <strong>de</strong><br />
leur récolte jusqu’à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s analyses – sont le résultat du travail <strong>de</strong> l’OFS additionné à<br />
celui d’un nombre important d’autres administrations ou organisations publiques suisses et<br />
étrangères et d’institutions académiques. Aucune tentative n’a été entreprise jusqu’ici pour<br />
attribuer une valeur à <strong>la</strong> masse <strong>de</strong> données que tous ces acteurs manient et fournissent, il n’est<br />
donc pas possible <strong>de</strong> le faire dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>. Les coûts du système CODAM ne<br />
peuvent pas non plus être pris actuellement comme indicateurs pour calculer les coûts du<br />
processus <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données dans son ensemble, le projet n’étant pas encore<br />
entièrement abouti.<br />
A titre purement indicatif, le budget <strong>de</strong> l’OFS dépasse actuellement (2006) les 100<br />
millions <strong>de</strong> francs, dont presque 2,3 millions sont budgétés pour l’infrastructure et<br />
l’exploitation 25 .<br />
4.2.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Avec l’entrée en jeu <strong>de</strong> l’informatique, tout le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s<br />
informations est en train <strong>de</strong> changer, d’évoluer. En effet, si jusqu’ici un certain pourcentage<br />
<strong>de</strong> données était déjà produit sous forme électronique, lorsqu’il s’agissait <strong>de</strong> les archiver ces<br />
données étaient habituellement imprimées.<br />
L’exemple <strong>de</strong>s données météorologiques et climatologiques présenté dans le chapitre<br />
précé<strong>de</strong>nt, ainsi que celui <strong>de</strong>s données statistiques abordé ici, montrent que nous sommes en<br />
train <strong>de</strong> passer à un autre sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’évolution dans <strong>la</strong> gestion informatique <strong>de</strong>s données. Ces<br />
<strong>de</strong>rnières sont en effet désormais récoltées (ou si ce n’est pas le cas, saisies sur ordinateur<br />
après-coup), traitées, puis conservées uniquement sous forme digitale.<br />
Quelle est <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l’archivage dans ce contexte ? Comment faire une distinction entre<br />
les données qui ont terminé leur cycle <strong>de</strong> vie (à archiver) et les autres données (à conserver en<br />
vue d’une réutilisation programmée) ? Telles sont les questions qu’il convient désormais <strong>de</strong> se<br />
poser.<br />
24 A ce propos, il est à signaler que l’OFS dispose <strong>de</strong>puis 2000 d’un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement, appliqué par l’ensemble<br />
<strong>de</strong> l’office, et organisé par domaines, thèmes et activités.<br />
25 Se référer au Budget 2006, Berne, Administration fédérale <strong>de</strong>s finances, pp. 440 et 441.
44 DONNEES STATISTIQUES<br />
4.2.2.1 Mémorisabilité<br />
Du point <strong>de</strong> vue technique, il est actuellement possible <strong>de</strong> tout mémoriser : toutes les<br />
données statistiques produites et traitées sous forme informatique sont en effet mémorisables<br />
et peuvent ensuite être réutilisées pour autant qu’elles correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s standards<br />
déterminés, qu’elles soient traitées suivant <strong>de</strong>s processus comparables, qu’elles soient gérées<br />
<strong>de</strong> manière centralisée ou coordonnée et qu’on sache <strong>de</strong> quelles données on dispose.<br />
L’OFS, important producteur <strong>de</strong> données, a su se doter d’un puissant concept et système<br />
permettant <strong>la</strong> centralisation <strong>de</strong>s données électroniques pour assurer leur mise à disposition et<br />
leur subsistance dans le temps, suivant <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s standards établis. Nous pouvons ainsi<br />
considérer le système CODAM comme le support physique qui permet – à travers ses<br />
serveurs informatiques, les mises à jour et les migrations <strong>de</strong> données nécessaires – <strong>de</strong><br />
conserver pour une durée indéterminée l’ensemble <strong>de</strong>s données qu’il contient. Suivant notre<br />
modèle d’analyse, les données <strong>de</strong>viennent donc mémorisables lorsqu’elles sont susceptibles<br />
d’être introduites et centralisées dans CODAM.<br />
La mémorisabilité en termes <strong>de</strong> supports peut donc être assurée pour les différents types<br />
<strong>de</strong> données statistiques pour autant que les moyens nécessaires soient disponibles : il s’agit<br />
évi<strong>de</strong>mment <strong>de</strong>s moyens financiers, techniques et infrastructurels, il s’agit également d’un<br />
consensus au niveau <strong>de</strong>s employés (confiance dans le système informatique) et <strong>de</strong>s moyens<br />
cognitifs à disposition (nouvel apprentissage <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s utilisateurs·trices). Ces <strong>de</strong>ux<br />
<strong>de</strong>rnières ressources sont particulièrement importantes, puisque le passage à un nouveau<br />
système <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>man<strong>de</strong> l’implication directe <strong>de</strong>s col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’office et <strong>de</strong>s<br />
autres institutions concernées.<br />
Enfin, suivant notre concept, <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> prendre en considération également les<br />
ressources nécessaires à une réelle « mémorisabilité » <strong>de</strong>s données statistiques – ressources<br />
que nous avons regroupées sous le terme <strong>de</strong> « <strong>la</strong>ngage » et qui assurent <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s<br />
données, leur reproductibilité, leur universalité, leur transférabilité – apparaît ici c<strong>la</strong>irement :<br />
comment serait-il envisageable <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r et par <strong>la</strong> suite d’utiliser à distance <strong>de</strong> temps<br />
une telle quantité <strong>de</strong> données <strong>de</strong> nature informatique s’il n’existait pas <strong>de</strong>s règles et <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s<br />
communs qui permettent <strong>de</strong> les comprendre ? Ces aspects sont <strong>la</strong> condition nécessaire à <strong>la</strong><br />
mise en p<strong>la</strong>ce d’un système comme CODAM et le Core Warehouse qu’il gère.<br />
4.2.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Actuellement, l’OFS est justement en train d’importer les données statistiques anciennes<br />
et actuelles – lesquelles se trouvaient auparavant disséminées dans plusieurs bases <strong>de</strong> données<br />
gérées individuellement par les diverses divisions et sections <strong>de</strong> l’office – dans le<br />
système CODAM : le principe poursuivi est que toutes les données doivent être introduites<br />
dans le système (les données actuelles, ainsi que les données anciennes). Néanmoins, sachant<br />
qu’il n’est pas possible <strong>de</strong> tout mémoriser (notamment les données anciennes), l’institution est<br />
en train <strong>de</strong> faire une réflexion approfondie quant aux données qui sont dignes ou non d’être<br />
mémorisées.<br />
Sont en premier lieu considérées dignes d’être mémorisées dans CODAM les<br />
métadonnées reliées aux données statistiques qui seront ensuite introduites dans le système.<br />
En effet, celles-ci étant absolument indispensables à <strong>la</strong> compréhension et à l’utilisation <strong>de</strong>s<br />
données, CODAM a été conçu et construit <strong>de</strong> manière à ce que, avant d’y introduire les<br />
données statistiques proprement dites, il faut y introduire d’abord les métadonnées. Dignes<br />
d’être mémorisées sont ensuite les macrodonnées (justement associées aux métadonnées qui<br />
les concernent), car elles répon<strong>de</strong>nt à toutes les conditions nécessaires à leur exploitation,
DONNEES STATISTIQUES 45<br />
analyse et future diffusion : elles sont consolidées, dépersonnalisées et agrégées.<br />
L’importation <strong>de</strong> macrodonnées dans le système se concentre pour l’instant sur les données<br />
actuelles et sur les données anciennes nécessaires aux analyses diachroniques (comparaisons<br />
dans le temps). Les macrodonnées concernant <strong>de</strong>s sujets qui ne sont plus analysés ou dont il<br />
est prévu que les enquêtes périodiques pour lesquelles elles sont utilisées ne seront à l’avenir<br />
plus menées ; elles ne sont par contre introduites dans le système que lorsqu’il est possible.<br />
Quant aux microdonnées, elles sont actuellement systématiquement introduites dans CODAM<br />
suivant <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> conservation choisie par l’OFS, mais on peut se poser <strong>la</strong> question <strong>de</strong><br />
savoir si elles sont effectivement toutes dignes d’être mémorisées : en effet, il ne semble pour<br />
l’instant pas possible d’établir <strong>de</strong>s règles préa<strong>la</strong>bles qui déterminent <strong>de</strong> manière générale s’il<br />
est nécessaire oui ou non <strong>de</strong> les introduire dans le système. Par exemple, pour une analyse<br />
statistique faite dans quelques décennies, aura-t-on besoin du prix individuel <strong>de</strong>s différentes<br />
marques <strong>de</strong> bouteilles <strong>de</strong> bière au fil du temps (microdonnées) ou plutôt <strong>de</strong> l’oscil<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s<br />
prix <strong>de</strong>s bouteilles dans le temps (macrodonnées) ? Difficile à dire. Ainsi, afin d’assurer <strong>la</strong><br />
reconstruction d’une analyse statistique, il a été pour l’instant choisi <strong>de</strong> conserver et importer<br />
dans le système toutes les microdonnées. Quant aux anciennes données (celles qui se réfèrent<br />
à <strong>de</strong>s enquêtes passées mais qui sont réutilisées à titre comparatif – c’est-à-dire les données<br />
évolutives – et celles qui ont totalement terminé leur cycle <strong>de</strong> vie, car l’enquête à <strong>la</strong>quelle ils<br />
servaient <strong>de</strong> base n’est plus réalisée – c’est-à-dire les données ponctuelles), elles sont jugées<br />
dignes d’être mémorisées suivant un <strong>de</strong>gré d’urgence moins élevé. Ces données posent<br />
d’ailleurs parfois problème du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> CODAM, puisque <strong>la</strong> manière dont elles ont été<br />
documentées (métadonnées) n’est pas forcément suffisante en vue <strong>de</strong> leur introduction dans le<br />
système, qui est très exigeant.<br />
Ainsi, <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> dignité à <strong>la</strong> mémorisation est actuellement posée en termes<br />
utilitaires, <strong>de</strong> reconstitution et <strong>de</strong> priorités. Il n’existe pour l’instant pas <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion qui<br />
permette <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s indications sur le type ou le niveau <strong>de</strong> donnée correspondant à ces<br />
critères ; une analyse ponctuelle et sur mesure est faite au cas par cas suivant un processus<br />
bottom up, l’autonomie <strong>de</strong>s producteurs et utilisateurs <strong>de</strong>s données dans les différentes<br />
sections <strong>de</strong> l’OFS reste donc gran<strong>de</strong>. C’est ainsi que <strong>la</strong> capacité à juger <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur<br />
« utilitaire » d’une donnée <strong>de</strong>vient fondamentale : faute <strong>de</strong> tout pouvoir mémoriser, il faut être<br />
à même <strong>de</strong> juger ce qu’il vaut et ce qu’il ne vaut pas <strong>la</strong> peine d’introduire dans le système.<br />
Nous constatons enfin que, bien que tous les instruments matériels nécessaires à <strong>la</strong><br />
gestion <strong>de</strong>s données statistique soient en p<strong>la</strong>ce, <strong>la</strong> ressource que nous avons appelée « raison »<br />
et qui se manifeste dans les compétences substantielles spécialisées <strong>de</strong>s col<strong>la</strong>borateurs·trices<br />
<strong>de</strong> l’office reste indispensable pour déterminer qu’est-ce qui est digne d’être mémorisé. La<br />
valeur utilitaire, <strong>la</strong> qualité scientifique, le jugement d’une éventuelle réutilisation d’une<br />
microdonnée ne peut être fait que par les producteurs et analystes statistiques eux-mêmes. Les<br />
compétences qu’ils possè<strong>de</strong>nt ne peuvent pas être remp<strong>la</strong>cées, le processus bottom up <strong>de</strong><br />
l’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur en termes <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> d’un certain type <strong>de</strong> données ne peut pas<br />
être remp<strong>la</strong>cé pour l’instant par un processus top down.<br />
4.2.2.3 Mémorisation réelle<br />
Le système CODAM et ses p<strong>la</strong>teformes informatiques permettent donc <strong>de</strong> gérer et mettre<br />
à disposition <strong>de</strong> manière rationnelle les données statistiques indispensables aux<br />
col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’OFS, ainsi qu’à toutes les personnes qui y ont accès ; il ne peut<br />
néanmoins pas être considéré comme un système d’archivage électronique central. La<br />
mémorisation réelle <strong>de</strong> ces données n’est garantie qu’en partie, ceci essentiellement pour <strong>de</strong>ux<br />
raisons. D’une part, nous ne savons pas exactement comment ces systèmes informatiques <strong>de</strong><br />
sauvegar<strong>de</strong> évolueront dans le temps, <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données qu’ils contiennent dépendant
46 DONNEES STATISTIQUES<br />
très directement <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s infrastructures mises à disposition par le marché<br />
(machines, processeurs, programmes informatiques, etc.), <strong>de</strong>s moyens à disposition <strong>de</strong><br />
l’institution pour les entretenir (sauvegar<strong>de</strong>s, mises à jour, migrations <strong>de</strong>s données, etc.) et<br />
enfin <strong>de</strong> <strong>la</strong> bonne ou mauvaise gestion <strong>de</strong> crise en cas <strong>de</strong> problème majeur (bug, incendie,<br />
panne électrique, etc.).<br />
T 1<br />
Thème 1<br />
Thème 2<br />
Thème 3<br />
Sauvegar<strong>de</strong><br />
Enquête<br />
périodique<br />
Document<br />
papier<br />
T 2 T 3 T 4<br />
Base <strong>de</strong><br />
donnée<br />
2005<br />
Thème 2<br />
Thème 3<br />
Enquête<br />
périodique<br />
Core<br />
Warehouse<br />
et système<br />
CODAM<br />
Fig. 4.2.3 : Représentation schématique du transfert <strong>de</strong>s données dans le Core Warehouse et<br />
dans le système CODAM.<br />
D’autre part, il n’est désormais plus possible <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r toutes les données<br />
statistiques produites dans les différents sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traitement, car il s’agirait d’un travail sans<br />
fin d’importation <strong>de</strong> données. L’utilisation <strong>de</strong> systèmes informatiques centraux comme<br />
CODAM permet <strong>de</strong> gérer les données produites et insérées dans le système en temps réel<br />
<strong>de</strong>puis <strong>la</strong> mise en route <strong>de</strong> celui-ci (l’importation <strong>de</strong>s données à commencé en 2005), mais<br />
d’un point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisation réelle elle implique <strong>la</strong> subsistance <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux univers<br />
parallèles (figure 4.2.3): l’univers CODAM pour les données actuelles et futures (partie à<br />
droite du schéma) ; l’univers « papier » et « bases <strong>de</strong> données décentralisées » pour les<br />
données passées, qu’on peut comparer aux dossiers clos et archivés (partie gauche du<br />
schéma). En effet, l’introduction dans le Corporate Data Management <strong>de</strong> données statistiques<br />
anciennes <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un énorme investissement en termes <strong>de</strong> temps, <strong>de</strong> personnel et <strong>de</strong> moyens<br />
financiers et ne peut être faite que lorsque le cycle <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> ces données n’est pas terminé,<br />
c’est-à-dire lorsque leur réutilisation à long terme est assurée.<br />
Il n’est pas possible <strong>de</strong> décrire comment les données statistiques sont actuellement<br />
archivées (au sens technique du terme), car cette tâche est exécutée au niveau <strong>de</strong>s services <strong>de</strong><br />
l’office, <strong>de</strong> manière individuelle et non coordonnée ; avec l’introduction du système<br />
CODAM, tout le processus se trouve en outre dans une phase <strong>de</strong> transition et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> une<br />
réadaptation. La re<strong>la</strong>tion entre CODAM et <strong>la</strong> LAr – et par conséquent les Archives fédérales –<br />
est encore à établir. L’OFS attend que <strong>de</strong>s prescriptions concernant l’archivage <strong>de</strong>s données<br />
électroniques soient faites avant <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s décisions formelles.<br />
T
DONNEES STATISTIQUES 47<br />
En termes <strong>de</strong> ressources, <strong>la</strong> « p<strong>la</strong>ce » ne semble définitivement plus constituer une réelle<br />
préoccupation dans le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> informatique <strong>de</strong>s données. Le « temps », par<br />
contre, est en facteur décisif notamment pour l’informatisation <strong>de</strong>s données historiques, c’està-dire<br />
<strong>de</strong>s données qui ont déjà terminé leur cycle <strong>de</strong> vie et dont <strong>la</strong> conservation sous forme<br />
informatique ne constitue pas une priorité.<br />
4.2.2.4 Accessibilité<br />
Les données statistiques s’adressent à <strong>de</strong>s publics ou acteurs différents suivant leur <strong>de</strong>gré<br />
<strong>de</strong> traitement. Les données enregistrées dans CODAM sont rendues accessibles uniquement<br />
aux col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’OFS concernés par <strong>la</strong> thématique en question : les accès au<br />
système sont donc régulés <strong>de</strong> manière détaillée et sont modulés suivant différents niveaux<br />
d’information (accès à <strong>de</strong>s informations <strong>de</strong> base ou à <strong>de</strong>s informations plus détaillées). Un<br />
<strong>de</strong>uxième groupe d’acteurs est composé par les personnes qui utilisent les données à <strong>de</strong>s fins<br />
<strong>de</strong> recherche (universités, polytechniques, hautes écoles, autres administrations, etc.). Ces<br />
acteurs ont accès à <strong>de</strong>s microdonnées dépersonnalisées suivant <strong>de</strong>s contrats détaillés et bien<br />
déterminés. Enfin, les données publiées sont accessibles à tout public : en effet, suivant l’art.<br />
18 al. 1 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> statistique fédérale et l’art. 11 <strong>de</strong> l’Ordonnance concernant<br />
l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale, les bases et les principaux résultats statistiques sont<br />
publiés au moyen <strong>de</strong> communiqués <strong>de</strong> presse, publications, supports <strong>de</strong> données<br />
informatiques et banques <strong>de</strong> données.<br />
Indépendamment du type <strong>de</strong> public auquel on s’adresse, ce qui caractérise les résultats<br />
statistiques, c’est qu’ils se distinguent en données qui se rapportent à <strong>de</strong>s personnes<br />
(physiques ou morales), en données qui ne se rapportent pas à <strong>de</strong>s personnes et en données<br />
rendues anonymes. Ainsi, suivant l’art. 18 al. 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> LSF (ainsi que <strong>la</strong> LPD), l’OFS est dans<br />
l’obligation <strong>de</strong> protéger les données personnelles, c’est-à-dire <strong>de</strong> présenter les résultats sous<br />
une forme qui rend impossible toute déduction sur <strong>la</strong> situation d’une personne physique ou<br />
morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par <strong>la</strong> personne concernée. L’art.<br />
19 al. 2 prévoit néanmoins que les producteurs <strong>de</strong> statistiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération sont en<br />
droit <strong>de</strong> communiquer les données personnelles à <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> statistique, à <strong>de</strong>s institutions<br />
<strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération ou à <strong>de</strong>s tiers, notamment dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique si ces données sont rendues anonymes et si un certain<br />
nombre <strong>de</strong> conditions garantissant <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données sont respectées. L’art. 20 précise<br />
enfin que l’utilisation et <strong>la</strong> reproduction <strong>de</strong> résultats publiés, rendus accessibles ou é<strong>la</strong>borés à<br />
partir <strong>de</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale est libre, moyennant l’indication <strong>de</strong> <strong>la</strong> source. Des<br />
exceptions peuvent exister pour les utilisations à <strong>de</strong>s fins lucratives. Les prestations <strong>de</strong><br />
services que l’OFS fournit sont en outre soumises à l'Ordonnance sur les émoluments et<br />
in<strong>de</strong>mnités perçus pour les prestations <strong>de</strong> services statistiques <strong>de</strong>s unités administratives <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Confédération.<br />
Or, <strong>de</strong>puis quelques années, l’Office fédéral <strong>de</strong>s statistiques favorise <strong>la</strong> diffusion qui<br />
donne <strong>la</strong> possibilité aux utilisateurs d’avoir à disposition <strong>de</strong>s données statistiques qu’ils<br />
peuvent préparer et combiner eux-mêmes suivant leurs besoins. L’institution publie <strong>de</strong> moins<br />
en moins sur papier et augmente les publications sur Internet, non plus seulement sous forme<br />
<strong>de</strong> tabelles d’analyse statistique, mais également sous forme <strong>de</strong> petites bases <strong>de</strong> données<br />
thématiques (appelées cubes), qui permettent aux utilisateurs <strong>de</strong> préparer eux-mêmes les<br />
tableaux statistiques dont ils ont besoin. Bien que l’intention à <strong>la</strong> base <strong>de</strong> ces initiatives<br />
consiste à augmenter les prestations aux utilisateurs tout en réduisant les coûts (diminution du<br />
travail d’analyse, <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> publication, <strong>de</strong>s renseignements par téléphone, etc.), l’OFS est<br />
obligé d’analyser dans <strong>la</strong> mesure du possible les combinaisons possibles <strong>de</strong> ces données<br />
statistiques avant <strong>de</strong> les mettre à disposition : en dépit du fait que ces données soient
48 DONNEES STATISTIQUES<br />
totalement dépersonnalisées, leur appariement risque en effet <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s informations qui<br />
permettent <strong>de</strong> retracer <strong>de</strong>s éléments concernant une personne (physique ou morale qu’elle<br />
soit) et <strong>de</strong> lui porter préjudice. Pour éviter <strong>de</strong> telles dérives, les col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’OFS<br />
doivent fournir un très important travail d’analyse préa<strong>la</strong>ble. Il apparaît donc que, avec une<br />
mise à disposition <strong>de</strong>s informations <strong>de</strong> plus en plus rapi<strong>de</strong> et facilitée, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong>vient un aspect toujours plus sensible et difficile à assurer. Il est d’ailleurs à<br />
signaler que ce problème existait déjà auparavant, mais que les moyens informatiques<br />
désormais à disposition <strong>de</strong> tout un chacun facilitent <strong>la</strong> diffusion d’informations à protéger.<br />
Les utilisateurs <strong>de</strong>s données statistiques publiées peuvent être distingués en trois<br />
catégories, suivant <strong>la</strong> terminologie définie dans les concepts <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> l’OFS : les<br />
Beobachter (ou, suivant une vision imagée, les randonneurs), c’est-à-dire tout un chacun<br />
désirant se renseigner sur un domaine qui l’intéresse ; les Benutzer (ou agriculteurs),<br />
notamment les écoles et les médias, qui désirent possé<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s informations un peu plus<br />
approfondies ; et enfin les Bearbeiter (ou mineurs), comme par exemple les chercheurs ou les<br />
services <strong>de</strong> l’administration qui nécessitent <strong>de</strong>s informations très détaillées. Par les moyens<br />
d’information et <strong>de</strong> diffusion que l’OFS met à disposition – comme les publications papier,<br />
les publications off line comme les CD-Rom et les publications on line – l’ensemble <strong>de</strong> ces<br />
trois groupes d’utilisateurs peuvent accé<strong>de</strong>r aux données désirées. L’office dispose en outre<br />
d’un espace public qui comprend un centre d’information pour <strong>la</strong> statistique avec une<br />
bibliothèque spécialisée, ainsi qu’un espace réservé pour <strong>de</strong>s expositions.<br />
La ressource que nous avons dénommée « espace public » prend du ressort à l’OFS. Elle<br />
est <strong>la</strong> condition qui permet, dans <strong>la</strong> société <strong>de</strong> l’information dans <strong>la</strong>quelle nous vivons, une<br />
accessibilité accrue aux données statistique et une utilisation personnalisée <strong>de</strong> celles-ci. Son<br />
désavantage est qu’elle est strictement dépendante d’une autre ressource qu’il s’agit <strong>de</strong><br />
réguler afin qu’elle ne se tarisse jamais : l’énergie électrique.<br />
4.2.3 Commentaires<br />
Ce chapitre a été réalisé grâce aux informations recueillies lors d’entretiens avec M.<br />
C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Macchi, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section CODAM, et M. Rolf Lerjen, Chef du service Document<br />
Management, ainsi qu’à travers <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s bases légales, <strong>de</strong> documents publiés et non<br />
concernant <strong>la</strong> thématique traitée, ainsi que du site Internet <strong>de</strong> l’OFS. Suite à ce qui a été<br />
décrit, se font jour les commentaires suivants (organisés du général au particulier).<br />
(1) Les données statistiques ne constituent pas <strong>de</strong>s informations qui ne<br />
s’adressent qu’à <strong>de</strong>s spécialistes sur <strong>de</strong>s domaines pointus ; elles servent<br />
globalement à <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> l’opinion publique, à <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> décisions<br />
politiques, à l’évaluation <strong>de</strong> l’action <strong>de</strong> l’Etat et à <strong>la</strong> prédiction <strong>de</strong>s<br />
problématiques futures ; elles donnent une image <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation économique,<br />
politique, sociale, culturelle, etc. du pays. En d’autres termes, elles sont<br />
nécessaires au fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> démocratie. Elles acquièrent évi<strong>de</strong>mment<br />
aussi une valeur historique avec le temps qui passe puisque, si elles sont<br />
conservées, elles renseignent <strong>de</strong> manière quantitative sur <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nation à <strong>de</strong>s époques antérieures. Les données statistiques font donc partie du<br />
patrimoine et constituent une tranche <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>.<br />
(2) La production, le traitement, l’analyse et enfin <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s données<br />
statistiques – tout comme <strong>de</strong>s données récoltées dans d’autres domaines – se<br />
trouve dans une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> grands changements. Nous sommes en effet en<br />
train <strong>de</strong> passer à <strong>la</strong> phase d’automatisation <strong>de</strong>s processus, c’est-à-dire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
récolte <strong>de</strong>s données, jusqu’à leur diffusion. En même temps, nous passons
DONNEES STATISTIQUES 49<br />
d’un système <strong>de</strong> gestion décentralisé et organisé thématiquement, à un<br />
système central. Ce passage constitue un moment privilégié pour réfléchir <strong>de</strong><br />
manière globale aux processus <strong>de</strong> mémorisation, car il nous permet <strong>de</strong> savoir<br />
quels sont les groupes <strong>de</strong> données sauvegardées ; l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces processus<br />
n’aurait certainement pas été possible dans une organisation atomisée <strong>de</strong>s<br />
données, où l’information quant à leur existence et leur gestion serait<br />
fragmentaire.<br />
(3) La distinction entre l’archivage (au sens technique du terme) <strong>de</strong>s données qui<br />
ne sont plus utilisées et <strong>la</strong> conservation à long terme <strong>de</strong>s données dont le<br />
cycle <strong>de</strong> vie est toujours actif <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> plus en plus difficile à faire dans le<br />
cadre d’une gestion centralisée et totalement informatisée. Elle est encore<br />
plus difficile à faire lors du passage d’un système à l’autre, ce qui est<br />
justement le cas aujourd’hui. Les réflexions autour <strong>de</strong> ces problématiques<br />
sont actuellement dictées par les besoins et les nécessités, et non pas par une<br />
réflexion <strong>de</strong> fonds sur <strong>la</strong> signification globale <strong>de</strong> <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong><br />
données ; cet état <strong>de</strong> fait est <strong>la</strong> conséquence <strong>de</strong>s impératifs financiers et<br />
temporels.<br />
(4) Le traitement et l’utilisation <strong>de</strong>s données statistiques se caractérisent par<br />
l’obligation d’assurer <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données personnelles. Dans un mon<strong>de</strong><br />
où l’information circule <strong>de</strong> plus en plus, cet aspect prend une importance<br />
énorme, notamment avec <strong>la</strong> mise à disposition facilitée et à <strong>la</strong> carte <strong>de</strong>s<br />
données. Les régu<strong>la</strong>teurs (le gouvernement et le parlement) <strong>la</strong>ncent parfois <strong>de</strong><br />
nouveaux processus <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s données sans tenir compte<br />
<strong>de</strong> tous les tenants et aboutissants <strong>de</strong>s nouvelles possibilités technologiques à<br />
disposition.<br />
(5) Les métadonnées jouent un rôle fondamental. Alors que les données actuelles<br />
sont bien documentées et peuvent être introduites dans les bases <strong>de</strong> données<br />
et les systèmes <strong>de</strong> centralisation comme CODAM associées à <strong>de</strong>s<br />
métadonnées fiables, les données anciennes (évolutives ou ponctuelles)<br />
posent problème : plus elles sont anciennes, moins les métadonnées sont<br />
complètes et fiables. Ces données ont moins <strong>de</strong> chance d’être intégrées dans<br />
ces nouveaux systèmes <strong>de</strong> mémorisation.<br />
(6) Une gestion centralisée et bien réfléchie <strong>de</strong>s données statistiques implique<br />
une réflexion théorique approfondie sur les ressources dont il faut se<br />
préoccuper afin d’assurer leur durabilité dans le temps. Sans vouloir<br />
aucunement émettre un jugement <strong>de</strong> valeur, alors que les « <strong>la</strong>ngages »<br />
informatiques (co<strong>de</strong>s, standardisations, migration, etc.) sont <strong>de</strong>s ressources<br />
très sérieusement prises en considération lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> projets<br />
comme CODAM, il apparaît que <strong>la</strong> ressource « raison », à savoir les<br />
compétences internes <strong>de</strong> l’office, risque <strong>de</strong> ne pas être suffisamment ménagée<br />
et <strong>de</strong> subir <strong>de</strong>s impositions venant du haut (suivant une structure top down).<br />
La ressource « temps » peut également poser problème dans <strong>la</strong> mesure où elle<br />
est exclusive pour <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données moins indispensables à court<br />
terme. Enfin, <strong>la</strong> ressource « espace public » est très sérieusement prise en<br />
considération et tous les moyens nécessaires sont mis en p<strong>la</strong>ce pour <strong>la</strong><br />
valoriser.
4.3 Données d’observation <strong>de</strong>s sols<br />
[Etat en janvier 2007]<br />
4.3.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
Sujet <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> actualité, <strong>la</strong> raréfaction <strong>de</strong>s ressources naturelles <strong>de</strong>vient un souci <strong>de</strong> plus<br />
en plus présent dans les débats politiques, en Suisse comme ailleurs. Afin <strong>de</strong> définir, gérer et<br />
surtout p<strong>la</strong>nifier les futures politiques publiques <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement <strong>de</strong> manière<br />
efficace, il faut pouvoir disposer <strong>de</strong> données qui informent sur son état : plus ces données sont<br />
complètes et fiables, mieux les mesures à prendre peuvent être déterminées. Actuellement, les<br />
données d’observation <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’environnement sont recueillies et gérées suivant le<br />
domaine concerné (air, eau, sol, forêt, etc.), l’aspect étudié (état biologique, chimique,<br />
physique, etc.) et par différents acteurs publics (Confédération, cantons). Quoiqu’il existe <strong>de</strong>s<br />
projets al<strong>la</strong>nt dans ce sens, les processus qui permettent <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> ces informations ne<br />
sont pour le moment pas encore centralisés : c’est pourquoi nous avons pris l’option d’étudier<br />
un domaine déterminé qui puisse donner une image représentative du fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
récolte, du traitement, <strong>de</strong> l’analyse et surtout <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation à long terme <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong><br />
données, qui, en particulier est mal connue : ce sera le domaine <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong> l’état<br />
chimique du sol (polluants inorganiques) 26 .<br />
Afin d’observer l’évolution <strong>de</strong>s polluants dans <strong>la</strong> terre, <strong>la</strong> Confédération a créé en 1984 le<br />
Réseau national d’observation <strong>de</strong>s sols (NABO : Nationales Bo<strong>de</strong>nbeobachtungsnetz). Celuici<br />
est géré par l’Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral <strong>de</strong> l’Agriculture<br />
(OFAG) et sa mise en œuvre est réalisée par <strong>la</strong> Station fédérale <strong>de</strong> recherches en agroécologie<br />
et agriculture (Agroscope ART Reckenholz-Tänikon, appelé ci-après Agroscope).<br />
L’étu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données d’observation <strong>de</strong>s sols utilisera donc<br />
l’Agroscope comme porte d’entrée.<br />
4.3.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Il n’y a pas <strong>de</strong> hiérarchie d’importance parmi les ressources naturelles : toutes doivent<br />
être utilisées durablement pour éviter leur surexploitation et toutes doivent être protégées<br />
d’une pollution excessive. En tant que tel, le sol présente néanmoins <strong>de</strong>s caractéristiques<br />
distinctives qui font <strong>de</strong> lui un excellent exemple pour étudier <strong>la</strong> manière dont <strong>de</strong>s données<br />
d’observation environnementale sont gérées et conservées dans le temps :<br />
• tout d’abord, le sol évolue lentement, ce qui fait qu’il recèle les éléments polluants<br />
qu’il contient plus que <strong>de</strong>s ressources comme l’eau ou l’air ;<br />
• les polluants qui sont contenus et transportés dans d’autres ressources naturelles<br />
finissent tôt ou tard par s’y déposer ou par le traverser, on trouvera par conséquent<br />
leur trace dans le terrain : le sol est ainsi un média indicateur primordial ;<br />
26 Quoique dans le reste du chapitre nous utiliseront à plusieurs reprises une terminologie plus généraliste<br />
(données d’observation du sol, données sur l’état du sol, évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution du sol, etc.), il est sousentendu<br />
que nous nous référons en particulier aux données sur l’analyse <strong>de</strong> l’état chimique du sol et en<br />
particulier aux polluants inorganiques. L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s polluants organiques est encore à ses débuts, <strong>de</strong> même que<br />
les analyses biologiques ou physiques <strong>de</strong> l’état du sol.
52 DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS<br />
• le sol possè<strong>de</strong> une valeur économique considérable, d’une part car sa surface<br />
constitue le support physique <strong>de</strong>s activités anthropiques et d’autre part car il est <strong>la</strong><br />
base <strong>de</strong> notre chaîne alimentaire ;<br />
• pour les mêmes raisons, il constitue un domaine politiquement fortement débattu et<br />
tout changement <strong>de</strong> son état chimique, biologique ou physique peut avoir une<br />
inci<strong>de</strong>nce directe dans <strong>de</strong> multiples domaines (propriété foncière, agriculture,<br />
transports, etc.) ;<br />
• l’observation <strong>de</strong> son état chimique au niveau national constitue un domaine pilote,<br />
puisqu’elle se fait déjà <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> 20 ans ;<br />
• afin que les observations <strong>de</strong> l’état du sol puissent donner <strong>de</strong>s résultats, elles doivent<br />
se dérouler <strong>de</strong> manière permanente et sur une longue pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> temps, car les<br />
polluants restent présents dans le sol très longtemps.<br />
Le sol, ou plus précisément <strong>la</strong> terre, peut alors être considéré comme une sorte d’archive<br />
vivante possédant une valeur économique, politique et sociale particulière. Les données qui<br />
font état <strong>de</strong>s changements qu’il vit – en particulier celles qui déterminent <strong>la</strong> charge en<br />
polluants qu’il subit – sont à <strong>la</strong> base <strong>de</strong> prises <strong>de</strong> décisions politiques importantes et doivent<br />
par conséquent être gérées attentivement : <strong>de</strong>s erreurs d’interprétation peuvent être lour<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
conséquences.<br />
Suivant les prescriptions données par l’Ordonnance sur les atteintes portées aux sols<br />
(OSol) du 1 er juillet 1998 (RS 814.12), cette tâche est réalisée par les cantons et <strong>la</strong><br />
Confédération à partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux logiques différentes. En effet, les cantons sont chargés <strong>de</strong><br />
surveiller en priorité <strong>de</strong>s sols dont le vécu ou <strong>la</strong> proximité d’une source <strong>de</strong> pollution <strong>la</strong>isse<br />
supposer qu’ils sont (ou pourraient être) pollués. Comme nous le verrons dans le détail, <strong>la</strong><br />
Confédération est pour sa part responsable <strong>de</strong> surveiller <strong>de</strong>s sols dont l’état est a priori<br />
« normal » – c’est-à-dire ni particulièrement préservé ni particulièrement pollué – et établir<br />
ainsi <strong>de</strong>s références. L’étu<strong>de</strong> d’un choix <strong>de</strong> terrains correspondant à cette définition permet<br />
non seulement <strong>de</strong> mesurer le niveau <strong>de</strong>s atteintes diffuses portées aux sols, <strong>de</strong> remarquer un<br />
éventuel changement <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> leur état chimique, d’apprécier l’efficacité <strong>de</strong>s mesures<br />
<strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s sols, mais également <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> données <strong>de</strong> référence pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
sols pollués.<br />
Ayant ainsi choisi <strong>de</strong> se concentrer sur le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données qui<br />
visent à étudier l’état chimique du sol, ce chapitre se concentrera plus spécifiquement sur les<br />
données récoltées par <strong>la</strong> Confédération, qui constituent d’une certaine manière <strong>la</strong> référence<br />
dans ce domaine. Nous expliquerons dans les sous-chapitres qui suivent <strong>de</strong> quelles<br />
informations il s’agit, comment elles sont récoltées, traitées, analysées et conservées dans le<br />
temps pour permettre l’analyse comparative diachronique dont elles font l’objet<br />
périodiquement.<br />
4.3.1.2 Contenu<br />
Le mandat <strong>de</strong> l’observatoire national <strong>de</strong>s sols NABO comprend trois tâches <strong>principale</strong>s 27 ,<br />
qui sont liées l’une à l’autre et dont <strong>la</strong> première constitue le fon<strong>de</strong>ment du réseau :<br />
• <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce dans le temps et dans l’espace <strong>de</strong> l’évaluation <strong>de</strong>s atteintes au sol ;<br />
• le contrôle <strong>de</strong> l’efficacité <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection ;<br />
27 Se référer au site Internet consacré au NABO, qui fait partie du site <strong>de</strong> l’OFEV et qui est régulièrement mis à<br />
jour : http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n/00972/00975/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr, 22 février 2007.
DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS 53<br />
• l’i<strong>de</strong>ntification précoce <strong>de</strong>s tendances négatives et l’établissement <strong>de</strong> prévisions<br />
concernant l’évolution <strong>de</strong> ces atteintes.<br />
Afin <strong>de</strong> répondre à ce mandat et <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong>s informations nécessaires, il a été mis en<br />
p<strong>la</strong>ce un concept détaillé, le réseau NABO 28 . Ce réseau est composé <strong>de</strong> 105 sites<br />
d’observation, regroupés selon le type d’exploitation dont ils font l’objet : cultures, pâturages,<br />
cultures maraîchères, arboriculture et viticulture, forêts, sites protégés et parcs (figure<br />
4.3.1) 29 .<br />
Cultures (35)<br />
Pâturages (25)<br />
Cultures maraîchères, arboriculture, viticulture (11)<br />
Forêt (28)<br />
Sites protégés (4)<br />
Parcs (2)<br />
Fig. 4.3.1 : Carte synoptique <strong>de</strong>s 105 sites du réseau NABO. [Tiré <strong>de</strong> : Desaules André, Schwab<br />
Peter, Keller Armin, Ammann Stefan, Paul Jean, Bachmann Hans-Jörg, Polluants<br />
inorganiques dans les sols suisses et évolutions après 10 ans, Agroscope FAL<br />
Reckenholz, Station <strong>de</strong> recherches fédérale en agroécologie et agriculture, Zurich, 2006]<br />
Un site d’observation se définit par <strong>de</strong>s éléments tels que le climat, <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’air, <strong>la</strong><br />
végétation, l’occupation et l’exploitation <strong>de</strong>s sols, <strong>la</strong> géologie, le relief et le sol lui-même (<strong>la</strong><br />
pédologie). Ces éléments sont déterminants pour <strong>la</strong> charge en polluants du sol, ainsi que pour<br />
le comportement dans le temps <strong>de</strong> ceux-ci. La sélection <strong>de</strong>s sites et leur répartition a par<br />
28 La <strong>de</strong>scription du fonctionnement du réseau NABO est faite ici <strong>de</strong> manière linéaire et globale afin d’en<br />
faciliter <strong>la</strong> compréhension et <strong>de</strong> ne pas alourdir <strong>la</strong> lecture. Nous n’avons pas englobé dans les <strong>de</strong>scriptions les<br />
changements ponctuels intervenus dans le temps <strong>de</strong>puis sa mise en œuvre, comme par exemple l’augmentation<br />
<strong>de</strong>s sites d’observation, le changement <strong>de</strong> certains éléments dans les techniques d’extraction ou d’analyse, etc.<br />
Nous nous sommes efforcés d’en rester à <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription du processus.<br />
29 La <strong>de</strong>scription concernant le réseau NABO, sa mise en p<strong>la</strong>ce, son programme, ses métho<strong>de</strong>s analytiques, etc.<br />
se base très <strong>la</strong>rgement sur le troisième et <strong>de</strong>rnier rapport NABO : Desaules André, Schwab Peter, Keller Armin,<br />
Ammann Stefan, Paul Jean, Bachmann Hans-Jörg, Polluants inorganiques dans les sols suisses et évolutions<br />
après 10 ans, Agroscope FAL Reckenholz, Station <strong>de</strong> recherches fédérale en agroécologie et agriculture, Zurich,<br />
2006. Cette publication contient également les indications concernant l’emp<strong>la</strong>cement précis <strong>de</strong>s différents sites.
54 DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS<br />
conséquent été faite sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> critères bien déterminés en utilisant comme référence <strong>la</strong><br />
carte <strong>de</strong>s sols (1:500'000) 30 . Ces critères peuvent être résumés ainsi :<br />
• le type <strong>de</strong> végétation présente, le type d’occupation et d’exploitation du sol : environ<br />
50% <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong>vaient se trouver dans <strong>de</strong>s secteurs agricoles représentatifs <strong>de</strong>s<br />
différents types et intensités d’exploitation, 30% sous forêts, 20% dans <strong>de</strong>s surfaces<br />
ouvertes proches du milieu naturel (pâturages, zones protégées) ;<br />
• les caractéristiques pédologiques et <strong>de</strong>s différentes catégories <strong>de</strong> sols sur tout le<br />
territoire suisse ;<br />
• une répartition géographique aussi régulière que possible ;<br />
• <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’air et les différences <strong>de</strong> climat ;<br />
• les immissions polluantes probables ;<br />
• <strong>la</strong> perspective <strong>de</strong> <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s sites ;<br />
• <strong>la</strong> coordination <strong>de</strong>s sites avec d’autres programmes d’observation <strong>de</strong><br />
l’environnement.<br />
Le choix définitif <strong>de</strong> l’emp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s sites a été fait en 1985 après une reconnaissance<br />
sur le terrain et en accord avec les propriétaires et les autorités cantonales concernées. Chaque<br />
site a fait l’objet d’une <strong>de</strong>scription au travers d’un questionnaire (Questionnaire pour<br />
l’analyse <strong>de</strong>s polluants dans le sol) portant notamment sur l’emp<strong>la</strong>cement géographique<br />
(p<strong>la</strong>n, croquis), <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription du profil du sol, les caractéristiques du site et l’adresse du<br />
propriétaire, <strong>de</strong> l’exploitant ou autre acteur concerné. L’emp<strong>la</strong>cement exact <strong>de</strong>s sites n’est pas<br />
signalé sur le terrain ; il est repéré avec <strong>de</strong>s détecteurs par les personnes concernées grâce à<br />
<strong>de</strong>ux aimants p<strong>la</strong>cés sous terre.<br />
Suivant l’annexe I <strong>de</strong> l’OSol, le programme <strong>de</strong> mesures permanent du NABO porte en<br />
particulier sur les teneurs totales, c’est-à-dire <strong>la</strong> concentration au sol, <strong>de</strong> neuf polluants<br />
inorganiques :<br />
• cadmium (Cd) • cuivre (Cu) • chrome (Cr)<br />
• zinc (Zn) • mercure (Hg) • cobalt (Co)<br />
• plomb (Pb) • nickel (Ni) • fluor (F)<br />
Depuis 1998, <strong>de</strong>s analyses <strong>de</strong> micropolluants organiques sont également faites ; elles sont<br />
moins avancées, car elles posent une série <strong>de</strong> problèmes techniques qu’il s’agit encore<br />
d’apprivoiser (instabilité <strong>de</strong>s micropolluants, etc.) :<br />
• hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA)<br />
• biphényles polychlorés (PCB)<br />
• dioxines et furanes (PCDD/F) (sur un nombre <strong>de</strong> sites limité)<br />
Les prélèvements du réseau NABO comprenant 105 sites <strong>de</strong>stinés aux analyses <strong>de</strong><br />
référence à long terme sont effectués sur <strong>de</strong>s surfaces carrées <strong>de</strong> 100m 2 . Les échantillonnages<br />
sont faits suivant une logique <strong>de</strong> quadril<strong>la</strong>ge stratifié régulier : chaque surface est divisée en<br />
25 carrés <strong>de</strong> 4 m 2 , dont chacun fait l’objet d’un prélèvement <strong>de</strong> 4 échantillons composés (I, II,<br />
III et IV, donc une carotte par m 2 ). La raison <strong>de</strong> cette multiplication <strong>de</strong>s points<br />
d’échantillonnage rési<strong>de</strong> dans le besoin d’éliminer et <strong>de</strong> contrôler le plus possible <strong>la</strong> variation<br />
spatiale afin <strong>de</strong> <strong>la</strong> discriminer <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation temporelle. La profon<strong>de</strong>ur du carottage est <strong>de</strong> 20<br />
30 Se référer au premier rapport NABO : Desaules André, Stu<strong>de</strong>r Konrad, NABO - Réseau d'observation <strong>de</strong>s sols:<br />
pério<strong>de</strong> d'observation 1985-1991, Cahier <strong>de</strong> l'environnement n° 200, Office fédéral <strong>de</strong> l'environnement, <strong>de</strong>s<br />
forêts et du paysage, Berne, 1993, p. 8 et sv.
DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS 55<br />
cm à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface du terrain conformément à l’OSol, le diamètre <strong>de</strong>s prélèvements est<br />
<strong>de</strong> 3 cm.<br />
Les échantillons sont mis tels quels dans un sac en p<strong>la</strong>stique puis conduits au <strong>la</strong>boratoire,<br />
où ils sont nettoyés <strong>de</strong>s pierres et autres corps étrangers, séchés, broyés et passé par un tamis<br />
<strong>de</strong> 2 mm <strong>de</strong> maille, divisés <strong>de</strong> manière représentative et remplis dans <strong>de</strong>s bocaux. Les<br />
analyses chimiques <strong>de</strong> polluants sont faites à partir d’un échantillon <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire<br />
repésentatif. Les manipu<strong>la</strong>tions, les traitements, les métho<strong>de</strong>s, les dosages, etc. dont les<br />
échantillons font l’objet sont consignés sur un journal <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire par les chimistes qui<br />
réalisent les tests. Ces journaux assurent <strong>la</strong> traçabilité <strong>de</strong> ce qui a été entrepris et <strong>de</strong>s résultats<br />
obtenus. Les résultats <strong>de</strong>s analyses déterminent combien <strong>de</strong> métaux ou polluants organiques<br />
sont présents dans un tel échantillon ; ces mêmes résultats, associés aux métadonnées <strong>de</strong><br />
procédure qui les concernent, subissent à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure un contrôle <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part du NABO et sont ensuite déc<strong>la</strong>rés vali<strong>de</strong>s ; ils sont stockés dans une banque <strong>de</strong> données<br />
Access accessible uniquement aux col<strong>la</strong>borateurs⋅trices du réseau. Ces valeurs constituent le<br />
matériau <strong>de</strong> travail qui permet <strong>de</strong> réaliser les évaluations <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> charge <strong>de</strong><br />
polluants dans les sites choisis par le NABO.<br />
Tous les échantillons <strong>de</strong> terre sont divisés représentativement et conditionnés dans <strong>de</strong>s<br />
bocaux hermétiques, archivés dans un local sombre et sec à température ambiante. Les<br />
échantillons <strong>de</strong> terre <strong>de</strong>stinés à l’analyse <strong>de</strong>s micropolluants organiques sont par contre<br />
conservés congelés, dans <strong>de</strong>s bocaux hermétiques mais sans traitement préa<strong>la</strong>ble, dans un<br />
local à -20°C.<br />
Les campagnes d’échantillonnage pour les observations à long terme <strong>de</strong>s sites du réseau<br />
NABO ont lieu à une ca<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> 5 ans et durent chacune 5 ans. Ainsi, <strong>de</strong>puis le début du<br />
programme en 1985, quatre campagnes <strong>de</strong> prélèvement et d’analyse ont été faites, <strong>la</strong><br />
cinquième étant actuellement en cours :<br />
Première campagne : 1985 - 1989<br />
Deuxième campagne : 1990 - 1994<br />
Troisième campagne : 1995 - 1999<br />
Quatrième campagne : 2000 - 2004<br />
Cinquième campagne : 2005 - 2009<br />
Le réseau NABO surveille pour l’instant les pollutions chimiques, mais il prévoit à terme<br />
d’étendre ses activités aux propriétés physiques et biologiques du sol : un projet pilote al<strong>la</strong>nt<br />
dans cette direction a été <strong>la</strong>ncé au début <strong>de</strong> l’année 2000. Cependant, l’observation à long<br />
terme n’intégrera <strong>de</strong> nouveaux paramètres ou indicateurs que s’il est établi qu’ils sont<br />
significatifs pour l’interprétation <strong>de</strong> <strong>la</strong> fertilité – et donc <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité – <strong>de</strong>s sols, ce qui n’as<br />
pas encore été déterminé 31 .<br />
Comme cette rapi<strong>de</strong> présentation du réseau NABO l’a montré, il apparaît que les données<br />
<strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution <strong>de</strong>s sols, et en particulier <strong>de</strong> polluants inorganiques, sont<br />
constituées d’informations <strong>de</strong> nature chimique qui ont été récoltées au fil <strong>de</strong>s années et qui<br />
doivent pouvoir être comparées entre elles en dépit <strong>de</strong> tout changement qui puisse intervenir<br />
entre une campagne et l’autre.<br />
Si nous essayons <strong>de</strong> schématiser les processus qui permettent d’obtenir les données qui<br />
constituent <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s évaluations du NABO, nous obtenons les schémas ci-<strong>de</strong>ssous (figures<br />
4.3.2a et 4.3.2b, partie supérieure):<br />
31<br />
Se référer <strong>la</strong> page Internet http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n/00972/00975/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr, Perspectives,<br />
consultée le 27 janvier 2007.
56 DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS<br />
Zone<br />
d’étu<strong>de</strong><br />
P<strong>la</strong>n <strong>de</strong><br />
prélèvement Prélèvement Préparation<br />
Etape<br />
A<br />
Site <strong>de</strong><br />
prélèvement<br />
Etape<br />
B<br />
Dossiers <strong>de</strong><br />
documentation<br />
Echantillon<br />
<strong>de</strong> terrain<br />
Etape<br />
C<br />
Echantillon<br />
<strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>boratoire<br />
Archives <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre<br />
(bocaux hermétiques)<br />
Partage <strong>de</strong><br />
l’échantillon<br />
Etape<br />
D<br />
Prise pour<br />
analyse<br />
Extraction<br />
Etape<br />
E<br />
Quantité<br />
nécessaire à<br />
<strong>la</strong> mesure<br />
Cahiers et<br />
documentation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire<br />
Analyse<br />
Etape<br />
F<br />
Résultats<br />
<strong>de</strong>s analyses<br />
Contrôle <strong>de</strong><br />
qualité<br />
Fig. 4.3.2a: Schématisation du processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données du NABO, <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone<br />
d’étu<strong>de</strong> jusqu’aux résultats <strong>de</strong>s analyses. [Librement adapté à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fig. 3 à <strong>la</strong> p.<br />
15 du Manuel Prélèvement et préparation d’échantillons <strong>de</strong> sols pour l’analyse <strong>de</strong><br />
substances polluantes, Manuel <strong>de</strong> prélèvement sol (OSol), Berne, Office fédéral <strong>de</strong><br />
l’environnement, <strong>de</strong>s forêts et du paysage OFEFP, 2003]<br />
Bases <strong>de</strong> données<br />
KABO et<br />
d’autres institutions<br />
et réseaux<br />
Contrôle <strong>de</strong><br />
qualité<br />
Etape<br />
G<br />
Données <strong>de</strong> base<br />
NABO:<br />
- données analytiques<br />
environnementales<br />
- métadonnées<br />
stationnelles<br />
- métadonnées <strong>de</strong><br />
procédure<br />
Agrégation,<br />
analyse,<br />
évaluation<br />
Etape<br />
H<br />
Base <strong>de</strong><br />
données<br />
Access<br />
En projet<br />
Evaluation<br />
<strong>de</strong>s<br />
variations <strong>de</strong><br />
polluants<br />
dans les sols,<br />
tendances<br />
Diffusion<br />
Etape<br />
I<br />
Publications,<br />
rapports,<br />
etc.<br />
NABODAT:<br />
- données analytiques<br />
environnementales<br />
- métadonnées stationnelles<br />
Fig. 4.3.2b: Schématisation du processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données du NABO, <strong>de</strong>s données<br />
<strong>de</strong> base jusqu’aux publications.<br />
Les données <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s évaluations réalisées par le NABO constituent le résultat validé<br />
d’un processus <strong>de</strong> récolte d’échantillons <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s responsables du réseau et d’analyse <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoires spécialisés. Ce processus a lieu quatre fois par site pour chacun <strong>de</strong>s<br />
quatre échantillons composés prélevés. Les données finales constituent ainsi une moyenne <strong>de</strong><br />
4 résultats obtenus pour chaque site et polluant analysé.
DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS 57<br />
Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> première campagne d’échantillonnage servent <strong>de</strong> témoin pour les<br />
campagnes suivantes ; cependant, puisque les résultats auxquels les analyses aboutissent<br />
d’une fois à l’autre sont sensiblement variables (changement <strong>de</strong> techniques, <strong>de</strong> personnel,<br />
d’appareils, etc.), les échantillons <strong>de</strong> <strong>la</strong> première campagne sont à chaque fois analysés à<br />
nouveau suivant exactement <strong>la</strong> même procédure et les mêmes techniques que pour <strong>la</strong><br />
campagne en cours, <strong>de</strong> manière à ce que les résultats puissent être comparés avec un risque<br />
d’erreur réduit. Cette démarche est réalisée pour chacun <strong>de</strong>s polluants pris en considération.<br />
C’est <strong>la</strong> différence qui apparaît entre les résultats obtenus (données <strong>de</strong> base) pour <strong>la</strong> campagne<br />
en cours et <strong>la</strong> première campagne d’échantillonnage qui font l’objet <strong>de</strong> l’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
variation <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> pollution du sol. Suivant les attentes, les résultats auxquels les<br />
différentes campagnes NABO ont donné lieu montrent beaucoup <strong>de</strong> variations (évolution <strong>de</strong>s<br />
résultats en zig-zag) et se situent dans une fourchette <strong>la</strong>rge (ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> fiabilité). Seule<br />
l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> périodicité <strong>de</strong>s campagnes d’échantillonnage (chaque année) et/ou <strong>la</strong><br />
poursuite <strong>de</strong>s activités NABO sur une très longue pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> temps permettrait <strong>de</strong> disposer<br />
d’une quantité suffisante d’échantillonnages pour permettre <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s erreurs<br />
(aléatoires ou systématiques) et, par conséquent, <strong>de</strong> <strong>la</strong> ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> fiabilité <strong>de</strong>s résultats.<br />
L’interprétation <strong>de</strong>s résultats ne doit donc pas se faire d’une campagne à une autre, mais au<br />
long d’une série temporelle suffisante. Si le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> comparabilité <strong>de</strong>s analyses entre <strong>la</strong><br />
majorité <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires est sous un excellent contrôle <strong>de</strong> qualité grâce au programme<br />
d’essais inter<strong>la</strong>boratoire Osol <strong>de</strong>puis 1989 32 , il en est encore insuffisant du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
comparabilité <strong>de</strong> l’évolution dans le temps <strong>de</strong>s différents réseaux.<br />
Les sept cantons <strong>de</strong> Saint-Gall, <strong>de</strong>s Grisons, <strong>de</strong> Schaffhouse, <strong>de</strong> Bâle-Campagne,<br />
d’Argovie, <strong>de</strong> Fribourg et <strong>de</strong> Schwytz sont les seuls parmi les 17 cantons possédant un réseau<br />
d’observation <strong>de</strong>s sols ayant publié <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> plus d’une campagne.<br />
Comme les résultats et les interprétations nuancés <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong>s teneurs en polluants<br />
<strong>de</strong>s sites NABO le montrent 33 , l’observation <strong>de</strong> l’état chimique <strong>de</strong>s sols paraît être une tâche<br />
complexe. Il a été montré également que si les augmentations significatives dominent après<br />
une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 5 ans (Zn, Pb, Cu, Hg, Cr, Co), les diminutions sont plus fréquentes après 10<br />
ans (Zn, Cu, Hg, Ni, Cr, Cou, F). Le déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s valeurs (augmentation après 5 ans et<br />
diminution après 10 ans) n’as pas encore pu être expliqué <strong>de</strong> manière univoque : il montre<br />
cependant que les évolutions continues sont plutôt rares et que les fluctuations importantes, en<br />
zig-zag, sont fréquentes.<br />
4.3.1.3 Supports<br />
Comme le suggèrent les figures 4.3.2a et 4.3.2b, partie inférieure, les informations<br />
concernant chacune <strong>de</strong>s étapes du processus <strong>de</strong> récolte, d’analyse et d’évaluation <strong>de</strong>s données<br />
NABO décrites sont fixées sur <strong>de</strong>s supports qui permettent <strong>de</strong> les conserver à plus ou moins<br />
long terme :<br />
• dossiers <strong>de</strong> documentation : les informations sur chaque zone d’étu<strong>de</strong>, site <strong>de</strong><br />
prélèvement et échantillon <strong>de</strong> terrain sont confiées dans <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong><br />
documentations sur papier par les col<strong>la</strong>borateurs·trices du NABO, conservés à<br />
l’Agroscope en double copie. Les informations liées à chacun <strong>de</strong>s sites sont ainsi<br />
32<br />
Se référer à l’adresse Internet http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n/00972/00981/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr, consultée le<br />
28 février 2007.<br />
33<br />
Se référer à Desaules André, Schwab Peter, Keller Armin, Ammann Stefan, Paul Jean, Bachmann Hans-Jörg,<br />
Polluants inorganiques dans les sols suisses et évolutions après 10 ans, Agroscope FAL Reckenholz, Station <strong>de</strong><br />
recherches fédérale en agroécologie et agriculture, Zurich, 2006, pp. 38-49.
58 DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS<br />
documentées <strong>de</strong>puis le début et permettent <strong>de</strong> conserver un regard sur chaque<br />
changement survenu ;<br />
• archives <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre : les échantillons prélevés sur le terrain constituent <strong>la</strong> base<br />
informative <strong>de</strong> tout le processus, leur réutilisation se fait en outre périodiquement<br />
pour augmenter <strong>la</strong> comparabilité <strong>de</strong>s résultats. Par conséquent, ils doivent être<br />
conservés avec soin dans <strong>de</strong>s conditions adéquates par rapport à l’utilisation qui en<br />
est faite (à température ambiante pour les polluants inorganiques, congelés pour les<br />
polluants organiques). Ces échantillons constituent une petite archive <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre et se<br />
trouvent à l’Agroscope ;<br />
• cahiers et documentation <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire : les informations techniques qui concernent<br />
les analyses <strong>de</strong>s échantillons (données et métadonnées analytiques) sont consignées<br />
sur <strong>de</strong>s cahiers <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire et sur <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données personnelles par les<br />
chimistes qui effectuent ces travaux. Ces informations ne sont pas accessibles à <strong>de</strong>s<br />
tierces personnes, car il est admis qu’elles constituent l’apanage <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires<br />
engagés ; <strong>la</strong> couche supérieure <strong>de</strong> ces informations est néanmoins associée aux<br />
résultats <strong>de</strong>s analyses (sous forme <strong>de</strong> métadonnées <strong>de</strong> procédure) et communiquée au<br />
NABO ;<br />
• données <strong>de</strong> base et évaluations du NABO : les résultats <strong>de</strong>s analyses et les<br />
métadonnées <strong>de</strong> procédure sont transmis au NABO ; une fois qu’ils sont validés, ils<br />
sont introduits dans <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données Access qui permet d’y accé<strong>de</strong>r et <strong>de</strong> les<br />
évaluer. L’ensemble <strong>de</strong> ces informations est ainsi constitué <strong>de</strong> :<br />
- données analytiques environnementales (c’est-à-dire les résultats validés <strong>de</strong>s<br />
analyses) ;<br />
- métadonnées stationnelles (c’est-à-dire une <strong>de</strong>scription du site avec ses<br />
coordonnées, son altitu<strong>de</strong> et son environnement, une <strong>de</strong>scription du relief, du<br />
climat et <strong>de</strong> l’humidité du sol, <strong>de</strong>s sources d’émissions, <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation et <strong>de</strong><br />
l’utilisation du site, une <strong>de</strong>scription minéralogique et pédologique) ;<br />
- et métadonnées <strong>de</strong> procédure (Labordaten) fournies par les <strong>la</strong>boratoires au<br />
NABO.<br />
C’est cette banque <strong>de</strong> données Access, associée aux archives <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre, qui doit<br />
assurer <strong>la</strong> pérennité à long terme <strong>de</strong>s données et métadonnées sur l’état <strong>de</strong>s sols et<br />
permettre ainsi <strong>la</strong> comparabilité <strong>de</strong>s informations : elle constituera par conséquent le<br />
pilier <strong>de</strong> nos réflexions autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données d’observation <strong>de</strong>s<br />
sols ;<br />
• publications, rapports : enfin, les résultats auxquels les évaluations du NABO<br />
parviennent, à savoir l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s polluants dans les sols, sont<br />
publiés et disponibles à tout un chacun. Parmi ces publications, celles qui sont faites<br />
sur support papier sont envoyées et archivées à <strong>la</strong> Bibliothèque <strong>nationale</strong> suisse.<br />
Toutefois, <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> publications dans ce domaine sont mises à disposition<br />
uniquement sur Internet34 et ne sont donc plus archivées. Comment assurer, dès lors,<br />
leur conservation à long terme ?<br />
Nous pouvons ainsi dire que <strong>la</strong> gestion et conservation <strong>de</strong>s données d’observation <strong>de</strong>s<br />
sols est <strong>principale</strong>ment assurée par les col<strong>la</strong>borateurs·trices du NABO et par l’Agroscope.<br />
Néanmoins, toutes les données d’observation <strong>de</strong>s sols récoltées par le NABO et par les<br />
34<br />
Se référer à <strong>la</strong> page Internet http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n/00972/00991/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr, consultée le<br />
28 février 2007.
DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS 59<br />
différents KABO qui ont fourni les résultats <strong>de</strong> leurs analyses font l’objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong><br />
l’OFEV d’un projet <strong>de</strong> centralisation dans une banque <strong>de</strong> données NABODAT (banque <strong>de</strong><br />
données sur les polluants du sol). En effet, grâce aux prescriptions techniques qui déterminent<br />
comment l’extraction <strong>de</strong>s polluants à partir <strong>de</strong>s échantillons doit être réalisée 35 – prescriptions<br />
contenues dans l’OSol et par conséquent va<strong>la</strong>bles pour tous les organes concernés en Suisse –<br />
il existe en Suisse une certaine standardisation et harmonisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong>mandée par<br />
l’OSol qui est respectée et qui permet un <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> comparabilité <strong>de</strong>s données re<strong>la</strong>tivement<br />
élevé. Le but final <strong>de</strong> <strong>la</strong> centralisation <strong>de</strong>s données d’observation <strong>de</strong>s sols est <strong>de</strong> pouvoir<br />
effectuer <strong>de</strong>s analyses comparatives <strong>nationale</strong>s et intercantonales : <strong>la</strong> mise à disposition <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong> ces informations <strong>de</strong>vrait permettre <strong>de</strong> tirer <strong>de</strong>s conclusions va<strong>la</strong>bles au niveau<br />
<strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution <strong>de</strong>s sols pour l’ensemble du territoire. NABODAT dans son ensemble<br />
représente une quantité <strong>de</strong> données analytiques estimée à plus <strong>de</strong> 330'000, recueillies entre<br />
1990 et 1996 par 24 institutions (en gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s offices cantonaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
sols, mais aussi <strong>de</strong>s hautes écoles ou autres stations <strong>de</strong> recherche), issues <strong>de</strong> 1'350 sites<br />
environ, analysées par 31 <strong>la</strong>boratoires différents et dont le 90% a fait l’objet d’un contrôle <strong>de</strong><br />
qualité externe. Parmi toutes ces données (données analytiques environnementales et<br />
métadonnées stationnelles) ne seront néanmoins intégrées que marginalement les<br />
métadonnées <strong>de</strong> procédure. Une gestion centralisée <strong>de</strong>s données d’observation <strong>de</strong>s sols<br />
permettra <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s analyses spatiales, <strong>de</strong>s interpo<strong>la</strong>tions et une cartographie <strong>de</strong>s teneurs<br />
en polluants <strong>de</strong>s sols à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> systèmes d’information géographiques (SIG) au niveau <strong>de</strong><br />
l’harmonisation atteinte.<br />
A une plus <strong>la</strong>rge échelle encore et sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s expériences en cours avec NABODAT,<br />
il existe <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> mise en réseau <strong>de</strong> toutes les données d’observation environnementales<br />
actuellement disponibles : il s’agit du réseau NUD (Netzwerk Umweltdaten). Ce réseau vise à<br />
long terme <strong>la</strong> comparabilité <strong>de</strong>s données récoltées en Suisse avec les données disponibles au<br />
niveau européen. Le frein qui empêche actuellement l’effective réalisation <strong>de</strong> ces mises en<br />
réseau, dont l’un <strong>de</strong>s buts est d’assurer leur conservation à long terme, reste néanmoins le<br />
problème <strong>de</strong> <strong>la</strong> comparabilité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> compatibilité <strong>de</strong>s données. Il y a en ce sens encore un<br />
long apprentissage à faire.<br />
4.3.1.4 Organe compétent<br />
L’observation <strong>de</strong>s sols est considérée comme partie intégrante <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong><br />
l’environnement. C’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle le réseau NABO est géré stratégiquement par<br />
l’Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement avec le concours <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> l’Agriculture 36 –<br />
qui sont également responsables <strong>de</strong> surveiller, soutenir techniquement et conseiller les<br />
observatoires <strong>de</strong>s sols cantonaux – alors que sa mise en œuvre opérationnelle a été confiée à<br />
l’institution spécialisée dans <strong>la</strong> recherche en agroécologie et agriculture, à savoir l’Agroscope.<br />
Celle-ci applique <strong>la</strong> GEMB, c’est-à-dire <strong>la</strong> gestion par mandat <strong>de</strong> prestations et enveloppe<br />
budgétaire (2 ème cercle <strong>de</strong>s administrations fédérales suivant le modèle <strong>de</strong>s cercles <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Nouvelle Gestion Publique).<br />
Les col<strong>la</strong>borateurs·trices directement rattachés au NABO sont à moitié employé·es par<br />
l’OFEV et à moitié par l’Agroscope, dans <strong>la</strong> division Observation <strong>de</strong> l’environnement et<br />
prévisions environnementales : il s’agit <strong>de</strong> 6 personnes pour un taux d’emploi total <strong>de</strong> 490%.<br />
Les personnes qui effectuent les analyses <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire, ainsi que toutes les personnes<br />
35 Soit, l’utilisation d’un échantillon se situant entre 0 et -20 cm <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface du terrain et, lors <strong>de</strong> l’extraction<br />
proprement dite du polluant à partir <strong>de</strong> l’échantillon, l’utilisation d’aci<strong>de</strong> nitrique (HNO3).<br />
36 L’OFEV est intégré au Département fédéral <strong>de</strong> l’environnement, <strong>de</strong>s transports, <strong>de</strong> l’énergie et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
communication (DETEC), alors que l’OFAG fait partie du Département fédéral <strong>de</strong> l’économie (DFE).
60 DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS<br />
participant <strong>de</strong> manière indirecte aux activités du réseau (informaticiens, techniciens, etc.), ne<br />
sont pas considérées dans ces chiffres.<br />
Comme <strong>la</strong> figure ci-<strong>de</strong>ssous le montre (figure 4.3.3), le réseau NABO comprend six<br />
modules qui visent à assurer <strong>la</strong> réalisation du mandat qui lui a été confié (surveil<strong>la</strong>nce dans le<br />
temps et dans l’espace <strong>de</strong> l’évaluation <strong>de</strong>s atteintes ; contrôle <strong>de</strong> l’efficacité <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong><br />
protection ; i<strong>de</strong>ntification précoce <strong>de</strong>s tendances négatives et l’établissement <strong>de</strong> prévisions<br />
concernant l’évolution <strong>de</strong> ces atteintes) ; ces modules sont liés à l’observation cantonale <strong>de</strong>s<br />
sols afin d’améliorer <strong>la</strong> comparabilité <strong>de</strong>s données 37 .<br />
Fig. 4.3.3 : Structure organisationnelle <strong>de</strong> l’observation <strong>nationale</strong> <strong>de</strong>s sols NABO. [Tiré <strong>de</strong> :<br />
http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n/00972/00975/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr, Contexte, 27.02<br />
2007].<br />
L’objectif du module NABO-Trend est <strong>de</strong> détecter rapi<strong>de</strong>ment les atteintes portées au sol<br />
et d’évaluer leur évolution : les résultats <strong>de</strong> cette observation à long terme fournissent les<br />
bases nécessaires à <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s sols et permettent <strong>de</strong><br />
contrôler leur efficacité. NABO-Flux se concentre sur le suivi <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> polluants, c’est-àdire<br />
sur l’établissement <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong>s concentrations mesurées dans les<br />
sols. Il permet ainsi <strong>de</strong> détecter suffisamment tôt d’éventuelles accumu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> polluants et<br />
<strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s pronostics. NABO-Status analyse et évalue <strong>la</strong> répartition géographique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pollution <strong>de</strong>s sols en Suisse ; <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s analyses<br />
effectuées au niveau cantonal et au niveau fédéral <strong>de</strong> 1990 à 1996 a permis <strong>de</strong> mieux étayer<br />
les valeurs indicatives légales dans <strong>la</strong> nouvelle Ordonnance sur les atteintes portées aux sols<br />
(OSol) du 1 er juillet 1998. Ce module s’occupe également <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque <strong>de</strong><br />
données sur les polluants du sol (NABODAT). Le module NABO-Quality assure <strong>la</strong> qualité<br />
<strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’observation <strong>nationale</strong> <strong>de</strong>s sols en quantifiant les incertitu<strong>de</strong>s liées à<br />
l’analyse, au prélèvement et à <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong>s échantillons. Un outil important pour le<br />
contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> comparabilité <strong>de</strong>s résultats analytiques est le programme <strong>de</strong>s essais<br />
inter<strong>la</strong>boratoires Osol, qui inclut une trentaine <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoires impliqués dans l’analyse <strong>de</strong><br />
37<br />
Se référer à <strong>la</strong> page Internet http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n/00972/00975/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr, Contexte,<br />
consultée le 27 février 2007.
DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS 61<br />
polluants dans le sol 38 . Concernant les procédés d’échantillonnage, le NABO s’efforce<br />
également <strong>de</strong> développer et optimiser les métho<strong>de</strong>s. Le module NABO-Public a pour tâches<br />
<strong>de</strong> présenter <strong>de</strong>s exposés, d’éditer les publications, <strong>de</strong> promouvoir <strong>la</strong> formation et d’assurer <strong>la</strong><br />
maintenance du site Internet du réseau 39 . NABO-expertise, enfin, a été créé pour assurer le<br />
conseil aux institutions publiques et privées concernées. Il permet également <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s<br />
expertises et <strong>de</strong> représenter <strong>la</strong> Suisse dans les organisations <strong>nationale</strong>s et inter<strong>nationale</strong>s.<br />
L’observatoire national <strong>de</strong>s sols est par exemple représenté dans les groupes <strong>de</strong> travail<br />
Protection <strong>de</strong>s sols, cartographie pédologique et c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société suisse <strong>de</strong><br />
pédologie (SSP). Il col<strong>la</strong>bore en outre avec d’autres groupes <strong>de</strong> travail et <strong>de</strong> pilotage dans le<br />
domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution <strong>de</strong>s sols. Au niveau international, il col<strong>la</strong>bore sur <strong>de</strong>s thématiques<br />
liées à <strong>la</strong> caractérisation <strong>de</strong>s sols avec le Comité européen <strong>de</strong> normalisation (CEN) et<br />
l’Organisation inter<strong>nationale</strong> <strong>de</strong> normalisation (ISO).<br />
4.3.1.5 Bases légales<br />
Le mandat du réseau national d’observation <strong>de</strong>s sols repose sur les bases légales<br />
suivantes :<br />
• l’art. 44 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement (Loi sur <strong>la</strong> protection<br />
<strong>de</strong> l’environnement, LPE) du 7 octobre 1983 (RS 814.01), qui oblige <strong>la</strong><br />
Confédération et les cantons à procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s enquêtes sur les nuisances grevant<br />
l’environnement et à contrôler l’efficacité <strong>de</strong>s mesures prises (al. 1) ; le même article<br />
(al. 2) prévoit <strong>la</strong> coordination <strong>de</strong>s enquêtes et <strong>de</strong>s banques <strong>de</strong> données sur le p<strong>la</strong>n<br />
fédéral et cantonal <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du Conseil fédéral ;<br />
• l’art. 3 <strong>de</strong> l’Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) du 1 er juillet 1998<br />
(RS814.12), qui prévoit l’observation par <strong>la</strong> Confédération <strong>de</strong>s atteintes portées aux<br />
sols, ceci au moyen du réseau NABO géré par l’OFEV et l’OFAG (al. 1) ; l’OFEV,<br />
propriétaire <strong>de</strong>s données, est responsable d’informer les cantons et <strong>de</strong> publier les<br />
résultats (al. 2). L’art. 4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> même ordonnance prévoit <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s<br />
cantons <strong>de</strong>s atteintes portées aux sols ; ceux-ci doivent également informer l’OFEV<br />
<strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> leur surveil<strong>la</strong>nce et les publier (al. 3) ;<br />
• l’art. 8 <strong>de</strong> l’Ordonnance sur <strong>la</strong> recherche agronomique (ORAgr) du 9 juin 2006 (RS<br />
915.7) attribue à <strong>la</strong> Station <strong>de</strong> recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon <strong>la</strong><br />
responsabilité primaire du contrôle et <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection chimique,<br />
physique et biologique du sol et <strong>de</strong>s polluants dans le sol (al. 2, let. c., ch. 1.).<br />
Une uniformisation avec <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion européenne pourrait impliquer un changement<br />
dans les références légales citées, en particulier dans l’OSol : en effet, l’extractant utilisé<br />
partout en Suisse pour analyser les polluants inorganiques <strong>de</strong>s échantillons <strong>de</strong> terre (l’aci<strong>de</strong><br />
nitrique) n’est pas utilisé par <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s pays européens. Les résultats <strong>de</strong>s analyses ne<br />
sont donc pas comparables pour le moment ; un changement <strong>de</strong> procédure <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s<br />
institutions suisses impliquerait néanmoins une rupture dans <strong>la</strong> suite temporelle <strong>de</strong>s analyses<br />
et donc une perte <strong>de</strong> comparativité avec les données anciennes.<br />
Concernant plus spécifiquement <strong>la</strong> conservation à long terme ou l’archivage <strong>de</strong>s données<br />
il est à souligner que, alors que <strong>la</strong> LPE reconnaît implicitement l’importance et <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s<br />
données concernant les atteintes à l’environnement (art. 44, al. 2), il n’existe à l’heure actuelle<br />
aucune base légale ni document formel qui règle <strong>la</strong> conservation ou l’archivage <strong>de</strong> ce type<br />
38<br />
Se référer à <strong>la</strong> page Internet http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n/00972/00981/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr, consultée le<br />
28 février 2007.<br />
39<br />
L’adresse Internet du NABO est : http://www.nabo.admin.ch.
62 DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS<br />
d’informations, dont le cycle <strong>de</strong> vie reste toujours actif et qui ne rentrent donc pas dans les<br />
processus établis par <strong>la</strong> Loi fédérale sur l’archivage (LAr) du 26 juin 1998 (RS 152.1).<br />
4.3.1.6 Coûts<br />
Il n’existe pas <strong>de</strong> chiffres publiés qui puissent nous éc<strong>la</strong>irer sur les coûts du réseau NABO<br />
et encore moins sur les coûts liés à <strong>la</strong> gestion et à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> l’information qu’il<br />
produit. Les coûts <strong>de</strong> l’infrastructure, du fonctionnement et <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s<br />
col<strong>la</strong>borateurs·trices engagés par NABO sont estimés à 800'000 francs par année, mais ce<br />
chiffre est purement indicatif, car il ne comprend que partiellement les dépenses liées aux<br />
col<strong>la</strong>borations externes, aux analyses <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire et autres frais <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
4.3.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
L’étu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong>s sols auquel nous<br />
nous apprêtons n’est pas à considérer comme un simple exercice <strong>de</strong> style : ce domaine, très<br />
technique et spécifique, nous permet <strong>de</strong> réfléchir par domaine interposé aux enjeux et aux<br />
défis que les nouvelles technologies nous imposent. Il nous donne l’occasion <strong>de</strong> mettre en<br />
évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s éléments très intéressants au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong> nous<br />
questionner sur les chemins et les formes que l’archivage prendra dans les décennies à venir.<br />
4.3.2.1 Mémorisabilité<br />
Dans les domaines étudiés jusqu’ici – à savoir celui <strong>de</strong>s données météorologiques et<br />
climatologiques et celui <strong>de</strong>s données statistiques – nous avons affirmé que toutes les données<br />
traitées le long <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaîne <strong>de</strong> <strong>la</strong> production d’information sont a priori mémorisables, ceci<br />
grâces aux nouvelles possibilités offertes par les supports informatiques. Ce discours est bien<br />
sûr va<strong>la</strong>ble aussi pour les données du réseau NABO. Il est intéressant <strong>de</strong> noter ici qu’un<br />
nouvel élément susceptible d’être mémorisé entre en jeu : <strong>la</strong> terre, ou plutôt les polluants<br />
contenus dans les échantillons prélevés et archivés. Alors que dans les autres domaines pris en<br />
considération il serait impossible <strong>de</strong> « figer » par l’archivage les objets décrits par les données<br />
conservées (à savoir les manifestations météorologiques ou, dans le cas <strong>de</strong>s statistiques, toute<br />
sorte d’activité humaine), nous nous trouvons ici dans un champ qui permet <strong>de</strong> mémoriser<br />
l’objet étudié 40 . La conservation <strong>de</strong>s échantillons prélevés est faite pour <strong>de</strong>s raisons<br />
utilitaires : en effet, ce qui est étudié n’est pas <strong>la</strong> concentration <strong>de</strong> polluants dans les sols, mais<br />
<strong>la</strong> variation <strong>de</strong> cette concentration sur une périodicité <strong>de</strong> cinq années, ce qui requiert <strong>de</strong><br />
disposer <strong>de</strong>s anciens échantillons. De plus, les échantillons <strong>de</strong> <strong>la</strong> première campagne servent<br />
<strong>de</strong> référence et sont analysés <strong>de</strong> nouveau à chaque nouvelle campagne : ces échantillons<br />
seront d’ailleurs bientôt en rupture <strong>de</strong> stock c’est pourquoi, <strong>de</strong>puis peu, tous les échantillons<br />
<strong>de</strong>s différentes campagnes sont désormais utilisés comme référence, ce qui permet également<br />
d’avoir une bonne vue d’ensemble.<br />
Si nous considérons <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisabilité à travers l’œil du scientifique<br />
qui effectue ces analyses du sol, nous nous rendons compte à quel point tout est mouvant et<br />
combien il est difficile <strong>de</strong> fixer les choses (figures 4.3.2a et 4.3.2b, partie inférieure). Les<br />
dossiers <strong>de</strong> documentation ont pour but <strong>de</strong> fixer par écrit les informations sur les zones<br />
d’étu<strong>de</strong>, les sites <strong>de</strong> prélèvement et les échantillons <strong>de</strong> terrain prélevés : alors que les zones<br />
d’étu<strong>de</strong> restent toujours les mêmes, les sites <strong>de</strong> prélèvement subissent <strong>de</strong>s dégâts, sont<br />
40 Dans ce contexte, il est utile <strong>de</strong> consulter <strong>de</strong>s informations sur <strong>la</strong> banque d’échantillons environnementales<br />
d’Allemagne (http://www.umweltbun<strong>de</strong>samt.<strong>de</strong>/umweltproben/upb4.htm).
DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS 63<br />
modifiés, voir détruits 41 et les échantillons <strong>de</strong> terre sont à chaque fois prélevés d’une manière<br />
légèrement différente due à <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> l’environnement (<strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />
compactage et d’humidité du sol), ce qui peut biaiser les résultats. En créant <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> terre on vise à fixer un matériau contenant <strong>de</strong>s éléments qui ne sont pas inertes et qui<br />
risquent <strong>de</strong> se modifier avec le temps (en particulier les polluants organiques, c’est pourquoi<br />
les échantillons sont congelés à une température très basse). Les cahiers et autres<br />
documentations <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire ont pour fonction <strong>de</strong> permettre <strong>la</strong> reconstitution <strong>de</strong>s analyses<br />
faites et <strong>de</strong>s techniques utilisées, qui varient énormément dans le temps et qui sont effectuées<br />
par quelque dizaine <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoires différents.<br />
En introduisant les données analytiques validées et les métadonnées essentielles dans <strong>la</strong><br />
banque <strong>de</strong> données NABO on désire regrouper ces informations électroniques et<br />
décentralisées et les sauvegar<strong>de</strong>r dans le temps, pour qu’elles soient à disposition au moment<br />
venu : les données analytiques environnementales constituent <strong>de</strong>s résultats et n’évoluent pas<br />
(elles s’enrichissent d’une campagne d’échantillonnage à l’autre), les métadonnées<br />
stationnelles s’efforcent <strong>de</strong> fixer par écrit une situation mouvante (changements <strong>de</strong>s<br />
conditions dans les sites) et les métadonnées procédurales permettent <strong>de</strong> contrôler <strong>de</strong>s<br />
résultats obtenus par le travail effectué par un nombre <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoires, et donc <strong>de</strong> personnes et<br />
<strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s différentes, très élevé. Les données d’observation <strong>de</strong> l’état chimique <strong>de</strong>s sols<br />
constituent ainsi un exemple qui montre une corré<strong>la</strong>tion entre le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> précision qu’on<br />
désire obtenir au niveau <strong>de</strong>s résultats et <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> mémoriser une information, une<br />
donnée, un objet. Plus on désire <strong>de</strong> <strong>la</strong> précision au niveau technique, plus il s’avère nécessaire<br />
<strong>de</strong> conserver toutes les traces du travail effectué et, dans ce cas, <strong>de</strong> l’objet analysé.<br />
Dans ce cas spécifique également, <strong>la</strong> ressource que nous avons désignée sous le nom <strong>de</strong><br />
« <strong>la</strong>ngage » prend toute son importance. En effet, tout le long du processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s<br />
données NABO et, ensuite, <strong>de</strong> leur conservation, un <strong>la</strong>ngage et <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s communs<br />
doivent être utilisés afin que les informations soient durables dans le temps, compréhensibles<br />
par tous les acteurs concernés, reproductibles et, enfin, transférables. Cette réflexion est<br />
d’autant plus va<strong>la</strong>ble dans le cas du NABODAT : plus <strong>la</strong> production d’information se<br />
diversifie et se complexifie (supports, technologies, métho<strong>de</strong>s, acteurs), plus il s’avère<br />
indispensable <strong>de</strong> fixer <strong>de</strong> manière commune les co<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traitement et <strong>de</strong> mémorisation<br />
nécessaires.<br />
4.3.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Du point <strong>de</strong> vue du réseau NABO, est digne d’être mémorisé tout ce qui permet <strong>de</strong><br />
reconstituer le processus qui mène aux évaluations <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong> polluants dans les sols.<br />
Se référant toujours aux figures 4.3.2a et 4.3.2b, partie inférieure, il s’agit <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong><br />
documentation, <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre et <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> base NABO, à savoir : les données<br />
analytiques environnementales, qui ont été communiquées par les différents <strong>la</strong>boratoires au<br />
NABO et qui ont été validées ; les métadonnées stationnelles, qui sont compilées par les<br />
col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’observatoire ; enfin, les métadonnées <strong>de</strong> procédure, qui sont<br />
transmises par les <strong>la</strong>boratoires au NABO pour qu’il puisse avoir un regard sur les<br />
manipu<strong>la</strong>tions effectuées. Les cahiers et documentations <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire, produits par d’autres<br />
acteurs que le NABO, restent à l’extérieur du processus.<br />
41 En dépit <strong>de</strong>s accords, <strong>de</strong> nature informelle, établis avec les propriétaires et exploitants <strong>de</strong>s parcelles choisies,<br />
<strong>de</strong> nombreuses modifications sont intervenues : <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s sites sélectionnés a en effet subi un changement <strong>de</strong><br />
type d’occupation ou d’exploitation, notamment suite au passage à une production agricole intégrée. En outre,<br />
certains sites ont été endommagés par l’ouragan Lothar.
64 DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS<br />
Concernant les données NABO (ainsi que <strong>de</strong>s données KABO ou autres résultats<br />
d’observations <strong>de</strong>s sols), le projet NABODAT montre indirectement que leur valeur est<br />
reconnue : ces données sont considérées comme étant dignes d’être conservées et, surtout,<br />
mises à disposition d’un plus <strong>la</strong>rge nombre d’usagers potentiels. Néanmoins, comme anticipé<br />
dans le sous-chapitre consacré aux supports (4.3.1.2), cette banque <strong>de</strong> données centralisée, qui<br />
pourrait fonctionner comme élément dynamique <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données, ne prévoit pas<br />
d’intégrer les données <strong>de</strong> procédure : ceci constituera une perte <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong> dans le sens<br />
qu’une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> traçabilité <strong>de</strong>s analyses effectuées ne sera pas possible à partir <strong>de</strong>s données<br />
mises à disposition. NABODAT s’oriente par conséquent vers une mise à disposition <strong>de</strong>s<br />
données sans possibilité <strong>de</strong> remonter dans le processus <strong>de</strong> leur production.<br />
Concernant les échantillons <strong>de</strong> terre conservés, il est à signaler que leur valeur ne se<br />
limite pas à l’utilisation qui en est faite par l’observatoire. Ces échantillons peuvent receler <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> d’événements majeurs <strong>de</strong> pollution environnementale, tel que par exemple<br />
Tchernobyl l’a été le 26 avril 1986. Les archives <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre <strong>de</strong> l’Agroscope abritent en effet<br />
<strong>de</strong>s prélèvements <strong>de</strong> terre <strong>de</strong> <strong>la</strong> première campagne d’échantillonnage qui ont été faits avant <strong>la</strong><br />
catastrophe. En outre, les échantillons archivés peuvent se révéler d’une gran<strong>de</strong> utilité<br />
lorsqu’un nouveau polluant est découvert : leur conservation permet un regard en arrière qui<br />
serait impossible sinon.<br />
En conclusion, suivant l’orientation ressourcielle <strong>de</strong> notre concept, nous pouvons dire que<br />
<strong>la</strong> ressource « raison » joue un rôle fondamental dans ce domaine également : les responsables<br />
<strong>de</strong> l’observatoire NABO savent précisément ce qui est digne d’être conservé suivant leurs<br />
besoins techniques actuels et futurs, ceci grâce à leurs compétences. D’autres compétences<br />
doivent ensuite se greffer sur les leurs pour qu’il soit possible <strong>de</strong> déterminer <strong>de</strong> quelle manière<br />
mémoriser effectivement ces données. Dans ce domaine, les rôles <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>teur et d’opérateur<br />
se chevauchent donc, il n’existe pas <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion explicite.<br />
4.3.2.3 Mémorisation réelle<br />
La réflexion autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong>s sols est<br />
simi<strong>la</strong>ire à celles qui ont déjà été menées pour les données météorologiques et<br />
climatologiques. En tant que données électroniques, <strong>la</strong> mémorisation réelle à long terme <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> base NABO (qu’ils soient considérés sous l’angle <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données Access<br />
ou <strong>de</strong> NABODAT) ne peut être assurée que si les transferts nécessaires à leur pérennité sont<br />
faits (migrations) et que si les conditions <strong>de</strong> base pour que ce<strong>la</strong> se fasse sont garanties<br />
(homogénéité <strong>de</strong>s données, architecture informatique uniforme, processeurs adéquats,<br />
métadonnées suffisantes, etc.). Ces conditions (mises à disposition sous forme <strong>de</strong> temps et<br />
financements) n’existent actuellement pas suffisamment. L’observation <strong>de</strong>s sols comprend<br />
encore <strong>de</strong>s <strong>la</strong>cunes méthodologiques sérieuses et les questions <strong>de</strong> résolution nécessaire dans le<br />
temps et dans l’espace ne sont pas résolues. Les moyens limités sont en général toujours<br />
investis au dépends <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> documentation, et donc <strong>de</strong> mémorisation, suffisants.<br />
La conservation à long terme <strong>de</strong>s échantillons <strong>de</strong> terre semble être plus délicate à<br />
surveiller, puisque l’expérience dans ce domaine est encore insuffisante : on ne sait en effet<br />
pas exactement dans quelle mesure les échantillons – conservés à température ambiante ou<br />
congelés – sont stables. Des contrôles <strong>de</strong> qualité sont donc faits régulièrement pour vérifier ce<br />
paramètre : jusqu’ici les conditions <strong>de</strong> conservation se sont avérées optimales. En outre, leur<br />
utilisation périodique pour <strong>de</strong>s nouvelles analyses comparatives a pour conséquence le risque<br />
<strong>de</strong> se retrouver en rupture <strong>de</strong> stock : il existe ainsi une contradiction – que nous avions déjà<br />
mise en évi<strong>de</strong>nce dans le cadre d’institutions d’archivage – entre les besoins d’utilisation et<br />
les besoins <strong>de</strong> conservation d’un support.
DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS 65<br />
Concernant <strong>la</strong> ressource que nous avons désignée « espace & temps », les mêmes<br />
remarques que nous avons faites pour les données météorologiques et climatologiques sont<br />
va<strong>la</strong>bles. L’investissement nécessaire en termes d’espace et <strong>de</strong> temps pour faire fonctionner<br />
l’observatoire NABO n’est pas si important en termes <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong>s<br />
échantillons, mais il s’étale sur tout le processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données : NABO est<br />
justement un réseau, et c’est son entretien global qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s grands investissements.<br />
Sans ça, <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données ne peut pas non plus être garantie.<br />
4.3.2.4 Accessibilité<br />
Comme expliqué, les données <strong>de</strong> base du NABO ne sont pas en tant que telles <strong>de</strong>s<br />
données publiques. Les instituts universitaires et les écoles polytechniques peuvent accé<strong>de</strong>r<br />
aux données sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, suivant une procédure formelle qui remonte jusqu’à l’OFEV,<br />
véritable « propriétaire » <strong>de</strong>s données (Datenherr). Par contre, les résultats <strong>de</strong>s évaluations<br />
<strong>de</strong>s variations <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> polluants dans le sol <strong>de</strong>vraient être publiés, suivant l’art. 3 <strong>de</strong><br />
l’OSol.<br />
La création <strong>de</strong> <strong>la</strong> NABODAT ou, d’autant plus, du NUD, montre néanmoins que <strong>la</strong><br />
tendance est <strong>de</strong> mettre à disposition ce type d’information à un cercle d’utilisateurs <strong>de</strong> plus en<br />
plus <strong>la</strong>rge, qui pourront en bénéficier pour réaliser à leur tour <strong>de</strong>s évaluations et analyses<br />
comparatives (dans le temps ou dans l’espace) 42 . Toutefois, cette possibilité ne sera<br />
réellement effective que lorsque les questions liées aux droits d’auteur, invoquées en<br />
particulier par les cantons sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits<br />
voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA) du 9 octobre 1992 (RS 231.1), seront résolues.<br />
L’accessibilité aux informations (ressource « espace public ») a ainsi tendance à <strong>de</strong>venir<br />
toujours plus rapi<strong>de</strong>, virtuelle et sans rivalités d’usage.<br />
4.3.3 Commentaires<br />
Ce chapitre a été réalisé grâce aux informations recueillies lors d’un premier entretien<br />
préa<strong>la</strong>ble avec M. Rolf Brunner, Responsable <strong>de</strong> l’informatique, <strong>de</strong> <strong>la</strong> logistique et <strong>de</strong><br />
l’information à l’OFEV, ensuite d’un <strong>de</strong>uxième entretien préa<strong>la</strong>ble avec M. Brunner et M.<br />
Tom Klingl, Responsable du projet Umwelt data management dans le même office fédéral.<br />
Un troisième entretien avec M. André Desaules, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> division Observation <strong>de</strong><br />
l’environnement et prévisions environnementales <strong>de</strong> l’Agroscope ainsi que <strong>de</strong>s aspects<br />
opérationnels du réseau NABO, a permis d’entrer dans le vif du sujet <strong>de</strong>s données NABO.<br />
Les informations récoltées lors <strong>de</strong> ces rencontres ont été ensuite complétées par <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s<br />
bases légales, <strong>de</strong>s documents internes et publiés ayant un lien direct avec <strong>la</strong> thématique.<br />
En conclusion <strong>de</strong> ce travail nous désirons mettre en relief les aspects suivants :<br />
(1) Tout d’abord, le domaine <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution <strong>de</strong>s<br />
sols à long terme – qui est très technique et peut paraître bien éloigné <strong>de</strong>s<br />
réflexions archivistiques – fournit en réalité un excellent exemple qui montre<br />
<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion très directe qui peut exister entre le processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong><br />
l’information et celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> celle-ci. Les données du NABO<br />
sont à considérer comme <strong>de</strong>s données vivantes, c’est pourquoi elles ne<br />
rentrent pas dans un processus d’archivage. Leur sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>vrait<br />
42 Il est imaginable qu’un jour les différents réseaux d’observation environnementale col<strong>la</strong>borent et centralisent<br />
<strong>la</strong> mise à disposition <strong>de</strong>s données. Il s’agit <strong>de</strong> réseaux tels que NADUF (réseau national d’observation <strong>de</strong>s eaux<br />
<strong>de</strong> surface), NAQUA (réseau d'observation <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s eaux souterraines), NABEL (réseau national<br />
d'observation <strong>de</strong>s polluants atmosphériques), etc.
66 DONNEES D’OBSERVATION DES SOLS<br />
(2)<br />
néanmoins pouvoir être régulée et, par là, garantie, ce qui n’est pas encore le<br />
cas aujourd’hui.<br />
Un autre aspect qui est mis en évi<strong>de</strong>nce dans ce cadre est qu’il faut tenir<br />
compte <strong>de</strong> différentes couches d’informations, qui vont <strong>de</strong> l’objet documenté<br />
par l’information à conserver (les échantillons <strong>de</strong> terre), à l’information ellemême<br />
(les données analytiques environnementales) et, enfin, aux<br />
métadonnées qui les accompagnent (métadonnées stationnelles et<br />
(3)<br />
procédurales). La <strong>mémoire</strong> <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> l’état chimique <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre ne<br />
peut être véritablement assurée qu’en conservant tous les éléments,<br />
informations et supports qui entrent dans les étapes <strong>de</strong> production <strong>de</strong> ces<br />
données. Une sélection <strong>de</strong>s informations ou supports à conserver équivaut à<br />
une perte <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong> ou, en tout cas, à une perte <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong> du point <strong>de</strong> vue<br />
scientifique.<br />
La production d’information, d’un point <strong>de</strong> vue thématique, <strong>de</strong>vient<br />
aujourd’hui un processus transversal. Des domaines qui étaient auparavant<br />
traités par un acteur déterminé <strong>de</strong>viennent l’affaire <strong>de</strong> plusieurs acteurs<br />
(OFEV, Agroscope, les cantons, les hautes écoles, etc.), ce qui nécessite alors<br />
une recentralisation <strong>de</strong>s données récoltées. Et aussi, plus les technologies<br />
mo<strong>de</strong>rnes nous offrent <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> dissocier l’information <strong>de</strong>s supports<br />
analogiques et <strong>de</strong> les mettre à disposition d’une manière plus démocratique à<br />
partir <strong>de</strong> banques <strong>de</strong> données ou autres moyens informatiques, plus les acteurs<br />
qui entrent en jeu dans le processus <strong>de</strong>viennent nombreux. Dès lors, les<br />
solutions d’archivage ou, du moins, <strong>de</strong> conservation à long terme <strong>de</strong> ces<br />
informations doivent elles aussi être conçues <strong>de</strong> manière transversale. Par<br />
quelles voies ?<br />
(4) Le noyau <strong>de</strong> <strong>la</strong> réflexion autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation et l’archivage <strong>de</strong> ce type<br />
<strong>de</strong> données concerne <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> traçabilité. S’il s’avère qu’il existe <strong>de</strong>s<br />
interruptions temporelles dans <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données qui assurent <strong>la</strong><br />
traçabilité <strong>de</strong>s analyses, le danger <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s fausses interprétations ou<br />
<strong>de</strong>s surinterprétations augmente considérablement. Cette problématique est<br />
tout particulièrement sensible pour ce qui concerne les métadonnées, qui ont<br />
tendance à être l’objet <strong>de</strong> ces <strong>la</strong>cunes <strong>de</strong> mémorisation.<br />
(5) La prise en compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> perspective ressourcielle que nous avons développée<br />
dans le concept <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> montre qu’il faut impérativement tenir compte<br />
<strong>de</strong>s ressources que nous appelons « <strong>la</strong>ngage », « raison », « espace & temps »<br />
et « espace public » afin <strong>de</strong> garantir une véritable mémorisation <strong>de</strong><br />
l’information : cette réflexion <strong>de</strong>vient d’autant plus importante que le<br />
processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données se fait désormais <strong>de</strong> manière<br />
électronique et sous forme <strong>de</strong> réseaux. Une autre question qui se posera <strong>de</strong> ce<br />
point <strong>de</strong> vue, sera celle <strong>de</strong> savoir comment garantir le lien entre l’objet étudié<br />
(échantillons <strong>de</strong> terre archivés) et les données conservées sous forme<br />
virtuelle.
4.4 Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
[Etat en janvier 2007]<br />
Comment fonctionne le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition spatiale <strong>de</strong>s biensfonds<br />
en Suisse ? Comment sont récoltées, traitées et surtout mémorisées les données qui<br />
permettent <strong>de</strong> cartographier le territoire helvétique, c’est-à-dire les données qui sont à <strong>la</strong> base<br />
du système cadastral et qui permettent <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> propriété du sol ? Ces processus ont une<br />
importance fondamentale pour le fonctionnement économique du pays car ils garantissent les<br />
valeurs patrimoniales immobilières : qu’en est-il donc <strong>de</strong> l’archivage et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation à<br />
travers les décennies <strong>de</strong> ce type d’informations ?<br />
Ce chapitre se propose <strong>de</strong> répondre à ces questions en utilisant comme porte d’entrée les<br />
données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (MO), introduite en Suisse voilà plus <strong>de</strong> 90 ans et<br />
actuellement pilotée par <strong>la</strong> Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales (D+M) <strong>de</strong><br />
l’Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo. Ce domaine étant très technique et complexe, nous<br />
le présenterons ici <strong>de</strong> manière simplifiée.<br />
4.4.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
En Suisse, le système cadastral est constitué par <strong>de</strong>ux piliers : <strong>la</strong> mensuration officielle,<br />
dont <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données sera traitée dans ce chapitre 4.4, et le registre foncier, que nous<br />
abor<strong>de</strong>rons à <strong>la</strong> suite, au chapitre 4.5. Les tâches sont reparties sur les différents niveaux<br />
administratifs et impliquent également <strong>de</strong>s bureaux privés, qui possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s compétences<br />
spécifiques (figure 4.4.1).<br />
Données<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle /<br />
p<strong>la</strong>n du registre foncier<br />
DDPS<br />
Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo<br />
Direction fédérale<br />
<strong>de</strong>s mensurations cadastrales<br />
Services cantonaux<br />
du cadastre<br />
Services communaux<br />
du cadastre (villes)<br />
Système cadastral suisse<br />
Bureaux<br />
<strong>de</strong> géomètres privés<br />
Données du<br />
registre foncier<br />
Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice<br />
Office chargé<br />
du droit du registre foncier<br />
et du droit foncier<br />
Offices cantonaux,<br />
régionaux et communaux<br />
du registre foncier<br />
Bureaux<br />
<strong>de</strong> notaires privés<br />
Fig. 4.4.1 : Schéma simplifié du système cadastral en Suisse : <strong>la</strong> mensuration officielle. [Tiré et<br />
librement adapté <strong>de</strong> : Manuel sur l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, Office<br />
DFJP
68 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo, Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, 2002,<br />
p. 10, fig. 1].<br />
Que faut-il donc mesurer pour pouvoir attribuer <strong>la</strong> propriété d’une parcelle déterminée à<br />
quelqu’un ? La mensuration officielle s’occupe <strong>de</strong> décrire <strong>la</strong> position, <strong>la</strong> forme et le contenu<br />
d’une parcelle (c’est-à-dire <strong>de</strong> lever le bien-fonds), <strong>de</strong> mettre à jour ces informations et <strong>de</strong> les<br />
consigner dans le p<strong>la</strong>n du registre foncier, dont l’échelle peut varier <strong>de</strong> 1:500 à 1:10'000.<br />
C’est tout d’abord en suivant cette procédure <strong>de</strong> nature graphique qu’il est possible <strong>de</strong> garantir<br />
<strong>la</strong> propriété du sol. Le p<strong>la</strong>n du registre foncier constitue un document officiel et les<br />
délimitations <strong>de</strong>s biens-fonds qui y figurent ont force <strong>de</strong> loi. Il ne contient par contre pas<br />
d’informations sur le régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété foncière, informations qui se trouvent justement<br />
dans son pendant, le registre foncier.<br />
4.4.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle servent <strong>de</strong> base à toute sorte d’activités<br />
humaines qui sont en lien avec <strong>la</strong> propriété du sol : elles mesurent avec précision et fiabilité <strong>la</strong><br />
surface terrestre et déterminent par exemple les points limites <strong>de</strong>s parcelles, le genre <strong>de</strong><br />
couverture au sol ou l’altitu<strong>de</strong> du terrain. Ces données, qui possè<strong>de</strong>nt une valeur officielle,<br />
sont soigneusement levées et mises en permanence à jour. Elles sont ensuite directement<br />
utilisées dans d’innombrables domaines, comme par exemple l’aménagement du territoire, les<br />
projets <strong>de</strong> construction, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification du trafic, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement, le<br />
tourisme ou l’agriculture. Il existe aussi <strong>de</strong> nombreux produits dérivés qui se basent<br />
substantiellement sur les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, notamment différents types <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>ns et les systèmes d’information géographique :<br />
• les p<strong>la</strong>ns d’ensemble, qui ont pour fonction <strong>de</strong> reproduire le mon<strong>de</strong> réel dans une<br />
échelle al<strong>la</strong>nt du 1:2'500 au 1:10'000 en incluant également les informations ayant<br />
trait à l’altimétrie (courbes <strong>de</strong> niveau) ;<br />
• les modèles numériques <strong>de</strong> terrain, qui reproduisent <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface terrestre ;<br />
• les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> ville et les p<strong>la</strong>ns régionaux, qui sont communément utilisés par tout un<br />
chacun pour trouver une adresse ;<br />
• les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> zones, qui déterminent les zones à bâtir dans le cadre <strong>de</strong> l’aménagement<br />
du territoire ;<br />
• les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong>s conduites, où figurent les conduites aériennes et souterraines, comme<br />
par exemple celles servant au transport <strong>de</strong> l’électricité, <strong>de</strong> l’eau, <strong>de</strong>s eaux usées, du<br />
gaz, les conduites pour le téléphone, <strong>la</strong> télévision, etc. ;<br />
• les systèmes d’information géographiques (SIG), qui saisissent, gèrent, analysent et<br />
présentent <strong>de</strong>s informations géographiques à référence spatiale décrivant les<br />
caractéristiques d’un terrain sous forme <strong>de</strong> coordonnées, noms <strong>de</strong> lieu, adresses<br />
postales, etc.<br />
Sans les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, les p<strong>la</strong>ns et les systèmes d’information<br />
géographiques qu’elles permettent <strong>de</strong> réaliser, il serait impossible d’avoir une connaissance et<br />
une maîtrise spatiale du territoire, <strong>de</strong> gérer <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong>s biens-fonds et <strong>de</strong> faire fonctionner<br />
<strong>de</strong> nombreux domaines directement liés à <strong>la</strong> cartographie du sol. Ces données <strong>de</strong> base ont par<br />
conséquent une importance fondamentale non seulement dans le présent, mais aussi a<br />
posteriori puisque – avec le registre foncier – elles permettent <strong>de</strong> transmettre dans le temps<br />
les informations spatiales et juridiques associées à une parcelle <strong>de</strong> terrain.
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 69<br />
C’est en tenant compte <strong>de</strong> l’importance et <strong>de</strong>s multiples utilisations <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> données<br />
que nous avons choisi <strong>de</strong> les étudier dans le cadre <strong>de</strong> cette recherche. Comme nous le verrons<br />
plus loin, <strong>la</strong> tâche <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle est accomplie suivant une répartition <strong>de</strong>s<br />
compétences sur l’ensemble <strong>de</strong>s niveaux administratifs (ce qui caractérise notre état fédéral<br />
dans <strong>de</strong> nombreuses politiques publiques) et jusqu’aux bureaux <strong>de</strong>s géomètres privés pour le<br />
travail sur le terrain. De plus, comme c’est le cas pour les données récoltées et traitées dans<br />
d’autres domaines, les données et les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle sont <strong>de</strong> plus en plus<br />
traités et sauvegardés sous forme numérique. Par conséquent, d’une part les démarches <strong>de</strong><br />
conservation à long terme et d’archivage s’effectuent <strong>de</strong> manière décentralisée, et d’autre part<br />
cet univers se trouve lui aussi dans une phase <strong>de</strong> grands changements. Nous nous situons donc<br />
à un moment stratégique <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> données et il s’avère du<br />
plus grand intérêt <strong>de</strong> se pencher sur les processus <strong>de</strong> conservation à long terme et d’archivage<br />
qui les caractérisent.<br />
4.4.1.2 Contenu<br />
C’est suite à l’entrée en vigueur en 1912 du Co<strong>de</strong> civil suisse (CC) du 10 décembre 1907<br />
(RS 210) que le registre foncier, et par conséquent <strong>la</strong> mensuration <strong>de</strong>s biens-fonds, acquière<br />
une valeur juridique qui garantit <strong>la</strong> propriété au citoyen. Dès lors, cette propriété ne peut être<br />
garantie en Suisse qu’en suivant trois principes <strong>de</strong> base : <strong>la</strong> démarcation <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété sur le<br />
terrain, <strong>la</strong> représentation <strong>de</strong> celle-ci sur un p<strong>la</strong>n et enfin son inscription dans un inventaire (le<br />
registre foncier). Il est d’ailleurs intéressant <strong>de</strong> noter que le CC p<strong>la</strong>ce le p<strong>la</strong>n et <strong>la</strong> démarcation<br />
sur le terrain à un même niveau (art. 668, al. 1), mais s’il existe une contradiction entre les<br />
limites du p<strong>la</strong>n et celles du terrain, c’est l’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s premières qui est présumée (art. 668,<br />
al. 2). C’est dire combien les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle sont importantes, qu'elles<br />
doivent être relevées dans les règles <strong>de</strong> l’art, être précises et garantir une représentation<br />
graphique juste et fiable. C’est dire aussi combien leur transmission dans le temps est<br />
essentielle.<br />
Environ 80% du territoire suisse est ainsi actuellement mensuré et représenté sur un p<strong>la</strong>n<br />
suivant <strong>de</strong>s prescriptions très précises et toujours i<strong>de</strong>ntiques, que ce soit sur le contenu ou sur<br />
<strong>la</strong> forme. Le sol et son occupation représentant une réalité qui évolue et leur représentation<br />
précise nécessitent par conséquent une continuelle mise à jour (levé <strong>de</strong>s biens-fonds,<br />
représentation dans le p<strong>la</strong>n). Les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle sont construits sur un jeu<br />
<strong>de</strong> données récoltées par <strong>de</strong>s géomètres au niveau <strong>de</strong>s communes et <strong>de</strong>s cantons. Les p<strong>la</strong>ns<br />
contiennent essentiellement trois éléments :<br />
• les limites <strong>de</strong>s propriétés ;<br />
• les constructions ;<br />
• <strong>de</strong>s éléments topographiques (couverture du sol et altimétrie).<br />
Pour réaliser une représentation du terrain, il est nécessaire <strong>de</strong> pouvoir bénéficier d’un<br />
cadre <strong>de</strong> référence, c’est-à-dire d’un moyen qui permette <strong>la</strong> superposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> représentation<br />
graphique sur <strong>la</strong> réalité physique. Pour ce faire, les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle se<br />
basent sur les coordonnées et les altitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration <strong>nationale</strong> suisse : le cadre <strong>de</strong><br />
référence est constitué d'un réseau <strong>de</strong> points fixes p<strong>la</strong>nimétriques et altimétriques déterminés<br />
avec exactitu<strong>de</strong>. Depuis 1992, un réseau <strong>de</strong> base suisse nommé AGNES, composé <strong>de</strong> 29<br />
stations qui fonctionnent en permanence et qui sont imp<strong>la</strong>ntées sur tout le territoire, permet <strong>de</strong><br />
déterminer <strong>de</strong>s coordonnées et <strong>de</strong>s altitu<strong>de</strong>s à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie GPS avec une précision<br />
<strong>de</strong> l'ordre du centimètre.
70 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
Il existe ensuite plusieurs techniques pour relever les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle :<br />
• le levé terrestre, qui est <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>la</strong> plus ancienne et qui consiste à déterminer les<br />
coordonnées à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration au sol en utilisant un appareil appelé<br />
tachéomètre, qui mesure les angles et les distances ;<br />
• <strong>la</strong> photogrammétrie terrestre ou aérienne, métho<strong>de</strong> qui consiste à photographier <strong>de</strong><br />
manière systématique le terrain. La photogrammétrie aérienne est réalisée à partir<br />
d’un avion : on effectue <strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> vue verticales, couloir par couloir, au moyen<br />
d’un appareil spécialement conçu à cet effet. Les prises ont un chevauchement entre<br />
60 et 80%, ce qui permet ensuite <strong>de</strong> fondre optiquement les prises <strong>de</strong> vue en une<br />
seule image <strong>de</strong> manière à ce que <strong>la</strong> surface du sol apparaisse en trois dimensions<br />
(effet stéréoscopique) au moyen d’un restituteur photogrammétrique. On peut ainsi<br />
restituer les courbes <strong>de</strong> niveau et saisir <strong>de</strong>s objets tridimensionnels ;<br />
• le Global Positioning System (GPS), qui utilise les signaux envoyés par <strong>de</strong>s satellites<br />
spéciaux qui tournent autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre et qui sont enregistrés au moyen <strong>de</strong><br />
récepteurs GPS. A partir <strong>de</strong> ces signaux et <strong>de</strong> points <strong>de</strong> références (réseau AGNES),<br />
il est possible <strong>de</strong> calculer <strong>de</strong>s distances et <strong>de</strong>s coordonnées avec une précision <strong>de</strong><br />
quelques centimètres ;<br />
• le nivellement, qui permet <strong>de</strong> déterminer les différences d’altitu<strong>de</strong> en partant <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> hauteur <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>la</strong>ttes p<strong>la</strong>cées verticalement.<br />
Le schéma ci-<strong>de</strong>ssous montre sous forme simplifiée comment les données sont récoltées<br />
et traitées (figure 4.4.2) :<br />
Systèmes<br />
<strong>de</strong> référence<br />
Appareils<br />
<strong>de</strong> mesure<br />
Réalité<br />
du terrain<br />
Levé <strong>de</strong>s<br />
données<br />
Bureaux <strong>de</strong> géomètres:<br />
on complète et affine les<br />
données relevées<br />
Banques<br />
<strong>de</strong> données<br />
cantonales<br />
Données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration<br />
officielle<br />
Interface <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle<br />
Modèle <strong>de</strong> données<br />
(structure)<br />
Règles du format<br />
(architecture)<br />
Bureaux <strong>de</strong> géomètres:<br />
on réalise et<br />
met à jour les p<strong>la</strong>ns<br />
P<strong>la</strong>ns<br />
Banques <strong>de</strong><br />
données<br />
cantonales<br />
Utilisateurs<br />
Géomètres conservateurs:<br />
Banques <strong>de</strong> données<br />
et/ou documents papier<br />
Fig. 4.4.2 : Processus <strong>de</strong> levé, <strong>de</strong> traitement, d'échange et <strong>de</strong> représentation visuelle <strong>de</strong>s données<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle.
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 71<br />
Les données qui permettent <strong>de</strong> mesurer les parcelles sont donc relevées sur le terrain par<br />
<strong>de</strong>s géomètres brevetés suivant ces différentes métho<strong>de</strong>s ; elles sont ensuite travaillées sous<br />
forme informatique en utilisant divers logiciels (dépendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> choisie pour <strong>la</strong><br />
mensuration) et sont ensuite complétées et affinées. Afin d’obtenir <strong>de</strong>s données standardisées<br />
dans toute <strong>la</strong> Suisse, il a été défini et introduit au niveau national 43 une Interface <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle (IMO), c’est-à-dire un système neutre et indépendant qui permet<br />
l’échange <strong>de</strong>s données géographiques entre <strong>de</strong>s logiciels différents 44 . Cette interface IMO se<br />
compose du modèle <strong>de</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, qui définit <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s<br />
données, ainsi que du format <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong>s données géographiques mis en service en 1998<br />
(INTERLIS), qui définit les règles d’architecture <strong>de</strong>s fichiers et qui permet <strong>la</strong> modélisation et<br />
l’intégration <strong>de</strong>s données et, par conséquent, leur échange entre les divers systèmes<br />
d’information du territoire. Ce système <strong>de</strong> standardisation permet ainsi d’échanger (recevoir<br />
et envoyer) les données entre les acteurs concernés, ainsi qu’entre divers systèmes<br />
d’information du territoire 45 . Celui qui souhaite obtenir <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle a le droit d'exiger qu'elles lui soient fournies par l'IMO; celui qui fournit <strong>de</strong>s<br />
données pour <strong>la</strong> mensuration officielle a le droit d'exiger que le <strong>de</strong>stinataire accepte ces<br />
données par le biais <strong>de</strong> l'IMO (art. 44 OTEMO).<br />
Une fois les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle complétées et standardisées suivant les<br />
indications <strong>de</strong> l’Ordonnance technique du DDPS sur <strong>la</strong> mensuration officielle (OTEMO), il<br />
est possible <strong>de</strong> réaliser <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle qui est composée <strong>de</strong><br />
données numériques structurées en huit couches thématiques <strong>principale</strong>s qui peuvent être<br />
associées ou dissociées (figure 4.4.3). Une couche d’information (ou <strong>de</strong> donnée, par exemple<br />
couverture du sol) comprend un ou plusieurs thèmes (par exemple eau) et un thème comprend<br />
un ou plusieurs objets (par exemple eau stagnante, cours d’eau, roselière).<br />
→ Points fixes : points faisant le lien avec le système <strong>de</strong>s coordonnées ;<br />
→ Couverture du sol : bâtiments, routes, cours/p<strong>la</strong>ns d’eau, forêts, etc. ;<br />
→ Objets divers : murs, fontaines, ponts, etc. ;<br />
→ Altimétrie : modèle numérique <strong>de</strong> terrain ;<br />
→ Nomenc<strong>la</strong>ture : noms <strong>de</strong> lieux, noms locaux, etc. ;<br />
→ Biens-fonds : parcelles ;<br />
→ Conduites : gazoducs, oléoducs;<br />
→ Divisions administratives : limites cantonales et communales,<br />
adresses, zones <strong>de</strong> mouvement permanent, etc.<br />
Fig. 4.4.3 : Structuration en huit couches <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle numériques et<br />
<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns du registre foncier.<br />
[Tiré <strong>de</strong> : http://www.cadastre.ch/fr/target/<strong>la</strong>yerstructure.html, 31.01.2007].<br />
Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle sont donc constituées <strong>de</strong> différents types<br />
d’informations, <strong>de</strong> documents et mêmes d’objets physiques dont il faut garantir <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong><br />
dans le temps. Dans le détail, il s’agit <strong>de</strong> :<br />
• les points <strong>de</strong> repère et les signes <strong>de</strong> démarcation, qui délimitent le bien-fonds (bornes<br />
fixées dans le terrain) ;<br />
43<br />
Se référer à l’Ordonnance technique du DDPS sur <strong>la</strong> mensuration officielle (OTEMO) du 10 juin 1994, RS<br />
211.432.21.<br />
44<br />
Se référer à <strong>la</strong> brochure Amtliche Vermessungsschnittstelle / Interface <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo, Wabern, 2004.<br />
45<br />
Pour une <strong>de</strong>scription plus détaillée d’INTERLIS, se référer à http://www.interlis.ch.
72 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
• les données récoltées selon le modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (données<br />
informatiques, gérées par <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données) ;<br />
• le p<strong>la</strong>n du registre foncier et les autres extraits <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle établis en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> tenue du registre foncier (représentations graphiques<br />
sous forme papier ou électronique) ;<br />
• les documents techniques à établir (documents papier) ;<br />
• les éléments et les documents <strong>de</strong> l’ancienne mensuration officielle (<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns et <strong>de</strong>s<br />
registres anciens, sur papier).<br />
Le p<strong>la</strong>n du registre foncier est un produit graphique standardisé qui est établi à partir <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle. En tant qu'élément constitutif du registre foncier, il<br />
délimite les biens-fonds et les droits distincts et permanents et il acquiert <strong>la</strong> force juridique au<br />
sens du Co<strong>de</strong> civil. Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> représentation du p<strong>la</strong>n du registre foncier est définit par <strong>la</strong><br />
Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales <strong>de</strong> manière uniforme pour l'ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Suisse.<br />
Actuellement, le rôle <strong>de</strong> conservation et d’archivage <strong>de</strong>s données, <strong>de</strong>s documents et <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ns est confié à <strong>de</strong>s géomètres conservateurs ; ceux-ci assurent <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
répartition spatiale du territoire au nom du canton. La délégation <strong>de</strong> cette tâche à un seul<br />
géomètre permet d’assurer <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’information suivant <strong>de</strong>s règles déterminées et <strong>de</strong><br />
réglementer les exigences <strong>de</strong> sécurité. Concernant le contenu, les procédures et les manières<br />
<strong>de</strong> stocker les informations il subsiste néanmoins une gran<strong>de</strong> hétérogénéité <strong>de</strong>s procédés,<br />
puisque les lieux <strong>de</strong> stockage sont multiples (entre 250 et 300) et décentralisés. L'IMO<br />
garantit cependant que les données pourront être échangées entre ces différents systèmes et<br />
vers les utilisateurs.<br />
4.4.1.3 Supports<br />
L’introduction <strong>de</strong> l’Ordonnance sur <strong>la</strong> mensuration officielle (OMO) en 1992 a marqué<br />
un changement <strong>de</strong> mentalité concernant les supports : à partir <strong>de</strong> son entrée en vigueur en<br />
janvier 1993, il est considéré que <strong>la</strong> mensuration officielle ne doit plus être constituée<br />
d’informations textuelles et graphiques fixées sur du papier – ou même, dans certains cas,<br />
enregistrées sous forme électroniques, mais suivant encore une logique analogique – mais<br />
qu'elle doit désormais être le résultat d’un traitement informatique avec <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong><br />
catalogage et <strong>de</strong> structuration numériques déterminées, qui permettent <strong>la</strong> communication <strong>de</strong><br />
ces données fondamentales avec d’autres systèmes informatiques qui contiennent <strong>de</strong>s<br />
informations géographiques. Les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle sont donc désormais à<br />
considérer comme un jeu <strong>de</strong> données structuré en une superposition <strong>de</strong> couches<br />
d’informations qu’il s’agit <strong>de</strong> gérer (et mettre à disposition) sous forme électronique 46 . Ce<br />
changement radical <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s temps <strong>de</strong> réalisation très longs, c’est pourquoi il est encore<br />
en cours : il est estimé que cette réforme, appelée MO93, <strong>de</strong>vrait aboutir en 2008. Tous les<br />
cantons, dont le <strong>de</strong>gré d’informatisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle varie<br />
sensiblement, <strong>de</strong>vraient par <strong>la</strong> suite parvenir à gérer les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
sur <strong>de</strong>s banques <strong>de</strong> données informatiques. Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’information, ce<br />
46 Cette réforme a eu pour but d’améliorer les prestations que <strong>la</strong> mensuration officielle proposait, notamment<br />
grâce à une présentation nouvelle <strong>de</strong>s données re<strong>la</strong>tives au territoire, ainsi qu’à une simplification <strong>de</strong> l’accès à<br />
ces données. Pour atteindre cet objectif il fal<strong>la</strong>it donc recourir à l’informatique, par exemple pour le traitement et<br />
<strong>la</strong> diffusion électroniques <strong>de</strong>s données, ainsi que <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns (tracé) assistée par ordinateur. Se référer<br />
au Message re<strong>la</strong>tif à l’arrêté fédéral concernant les in<strong>de</strong>mnités fédérales dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle du 14 novembre 1990, 90.074.
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 73<br />
passage d’un mon<strong>de</strong> « papier » à un mon<strong>de</strong> « informatique » permet une centralisation et une<br />
standardisation <strong>de</strong>s données.<br />
Ce changement <strong>de</strong> pensée et <strong>de</strong> support a un impact considérable également du point <strong>de</strong><br />
vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> l’information. Son grand avantage est tout d’abord celui d’avoir pu<br />
créer l'interface IMO, qui permet <strong>de</strong> communiquer et conserver <strong>de</strong>s données créées avec<br />
différentes métho<strong>de</strong>s et en utilisant une multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> programmes différents sous une forme<br />
standardisée, c’est-à-dire suivant <strong>de</strong>s normes <strong>de</strong> format et <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngage déterminées et égales<br />
dans toute <strong>la</strong> Suisse. Son désavantage du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’archivage est que désormais les<br />
changements <strong>de</strong>s parcelles au fil du temps ne sont plus mémorisés 47 : les données, et par<br />
conséquent les p<strong>la</strong>ns, évoluent en effet à travers les années et les générations. Puisque<br />
juridiquement ce qui compte est <strong>de</strong> montrer l’état actuel <strong>de</strong>s biens-fonds, les changements ne<br />
sont pas enregistrés. Le dép<strong>la</strong>cement d’une limite, qui apparaissait auparavant parfois dans un<br />
p<strong>la</strong>n en papier sous forme d’une ligne biffée à l’encre rouge et qui était remp<strong>la</strong>cée par une<br />
autre ligne, n’est plus visible dans les systèmes informatiques d’aujourd’hui. Auparavant,<br />
lorsqu’un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> registre foncier risquait <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir difficilement lisible à cause <strong>de</strong>s<br />
nombreux changements enregistrés, il était re<strong>de</strong>ssiné et l'ancien p<strong>la</strong>n était déposé aux<br />
Archives cantonales ou communales. Ces traces <strong>de</strong> l’évolution historique d’une parcelle,<br />
c’est-à-dire leur historisation, se per<strong>de</strong>nt avec l’avènement du traitement informatique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle. Comme nous le montrerons plus bas dans le détail, <strong>de</strong>s mesures<br />
spécifiques pour l’éviter sont prévues dans le projet <strong>de</strong> loi sur <strong>la</strong> géoinformation et <strong>de</strong>vront<br />
par contre être prises.<br />
Quel est le volume que l’ensemble <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle représente ?<br />
Il n’est actuellement pas possible <strong>de</strong> le calculer, car ces informations sont enregistrées,<br />
comme expliqué, sur différents supports. Même en ne considérant que celles qui sont gérées<br />
sous forme <strong>de</strong> banques <strong>de</strong> données, il n’est actuellement pas possible <strong>de</strong> les quantifier, car il<br />
n’existe pas encore un système central qui les rassemble. Ce qu’il est par contre possible <strong>de</strong><br />
dire est que leur accroissement n’est pas très important, puisque 80% du territoire a déjà fait<br />
l’objet <strong>de</strong> mesures détaillées (il reste donc 20% du territoire à mesurer). L’augmentation <strong>de</strong>s<br />
données est donc <strong>principale</strong>ment représentée par les mises à jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle.<br />
Si l’on <strong>de</strong>vait passer à l’avenir à un système <strong>de</strong> mensuration en trois dimensions, il est évi<strong>de</strong>nt<br />
que dans ce cas, l’augmentation <strong>de</strong>s données à traiter pourrait être plus significative. Ainsi,<br />
puisque le traitement et <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle se font<br />
actuellement <strong>de</strong> manière décentralisée, <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> stockage nécessaire à<br />
garantir leur sauvegar<strong>de</strong> ne pose pas <strong>de</strong> problème, ni d’un point <strong>de</strong> vue technique, ni d’un<br />
point <strong>de</strong> vue physique.<br />
4.4.1.4 Organes compétents<br />
Comme indiqué plus haut (figure 4.4.1), dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle <strong>la</strong><br />
répartition <strong>de</strong>s tâches s’effectue sur les trois échelons administratifs que sont <strong>la</strong><br />
Confédération, les cantons et les bureaux privés d’ingénieurs géomètres ou les villes qui<br />
possè<strong>de</strong>nt un service du cadastre.<br />
La Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales (D+M) est, <strong>de</strong>puis 1999, l’un <strong>de</strong>s<br />
domaines <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo (créé en 1838) rattaché au<br />
Département fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense, <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s sports (DDPS). A<br />
partir du début <strong>de</strong> cette année 2007 il <strong>de</strong>vrait y avoir un sensible rapprochement entre <strong>la</strong><br />
mensuration officielle et les autres domaines <strong>de</strong> swisstopo du fait <strong>de</strong> l'introduction du Modèle<br />
47<br />
Cette situation existait en fait déjà auparavant : il se pouvait en effet que les anciennes limites ne fussent pas<br />
biffées, mais carrément effacées.
74 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
topographique du paysage (MTP), banque <strong>de</strong> données topographique permettant l'édition <strong>de</strong>s<br />
cartes et dont une partie <strong>de</strong>s données proviendra <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle.<br />
Le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> D+M est <strong>principale</strong>ment stratégique, car elle exerce <strong>la</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce sur<br />
<strong>la</strong> mensuration officielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse. Elle édicte ainsi <strong>de</strong>s instructions et <strong>de</strong>s directives,<br />
définit d’entente avec les cantons <strong>la</strong> stratégie <strong>nationale</strong> pour le relevé, le renouvellement et le<br />
développement ultérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, ainsi que les exigences posées en termes<br />
<strong>de</strong> qualité ; elle coordonne <strong>la</strong> mensuration officielle avec les projets <strong>de</strong> mensuration d’autres<br />
services fédéraux et veille à leur développement ultérieur ; elle conseille les organes fédéraux<br />
en matière d’acquisition <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle et représente les intérêts <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Confédération vis-à-vis <strong>de</strong>s cantons et <strong>de</strong>s tiers. Au niveau <strong>de</strong> l’organisation, elle se<br />
structure en trois processus: <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, <strong>la</strong> Coordination et<br />
développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, et les Prestations <strong>de</strong> service <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle 48 .<br />
La conduite opérationnelle et <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle est l’affaire <strong>de</strong>s<br />
cantons (Services cantonaux du cadastre) : ceux-ci définissent les concepts <strong>de</strong> réalisation,<br />
p<strong>la</strong>nifient et dirigent les travaux, déterminent les normes d’exécution spécifiques à leur<br />
niveau, contrôlent le travail <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle et approuvent l’œuvre cadastrale<br />
après avoir remédié aux défauts éventuels : c’est cette approbation qui confère d’ailleurs à ces<br />
documents le caractère officiel qui les caractérise.<br />
L’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle varie d’un canton à l’autre, mais dans les<br />
gran<strong>de</strong>s lignes trois cas <strong>de</strong> figure peuvent être distingués :<br />
• vingt cantons ont leur propre organe cantonal chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle (le service cantonal du cadastre) ;<br />
• les six cantons d’Appenzell Rho<strong>de</strong>s-Intérieures, Appenzell Rho<strong>de</strong>s-Extérieures,<br />
G<strong>la</strong>ris, Nidwald, Obwald et Uri ont délégué <strong>la</strong> conduite opérationnelle à <strong>la</strong> Direction<br />
fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, <strong>de</strong> même que <strong>la</strong> Principauté du Liechtenstein ;<br />
Il existe <strong>de</strong>s différences entre un canton et l’autre également pour ce qui concerne <strong>la</strong><br />
répartition <strong>de</strong>s tâches et <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s informations :<br />
• 3 cantons, (Bâle ville, Neuchâtel et Schaffhouse), se chargent <strong>de</strong> tout le processus <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mensuration officielle, <strong>de</strong>s relevés jusqu’à <strong>la</strong> conservation et à l’archivage <strong>de</strong>s<br />
données ;<br />
• Vaud, Genève et Fribourg confient les travaux sur le terrain à <strong>de</strong>s bureaux <strong>de</strong><br />
géomètres privés, mais assurent eux-mêmes <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données ;<br />
• les autres cantons, comme le Tessin, le Jura ou le Va<strong>la</strong>is, confient <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mensuration officielle, suivant une division en arrondissements ou par communes,<br />
à <strong>de</strong>s géomètres conservateurs qui gèrent également les documents.<br />
• Quelques villes (environ 15) sont dotées <strong>de</strong> leur propre service du cadastre<br />
responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle <strong>de</strong> leur territoire.<br />
Les mensurations proprement dites sont effectuées presque exclusivement par <strong>de</strong>s<br />
bureaux d’ingénieurs et <strong>de</strong> géomètres privés. Comme <strong>la</strong> mensuration officielle relève <strong>de</strong>s<br />
données ayant force <strong>de</strong> droit, seuls les titu<strong>la</strong>ires du brevet fédéral d’ingénieur géomètre<br />
entrent en ligne <strong>de</strong> compte pour un certain nombre <strong>de</strong> travaux. En Suisse, près <strong>de</strong> 270 bureaux<br />
d’ingénieurs et géomètres privés sont chargés <strong>de</strong> relever, <strong>de</strong> gérer et <strong>de</strong> mettre à jour les<br />
48 Se référer à l’organigramme publié dans le Rapport annuel 2005 (état au 1 er février 2005).
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 75<br />
données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle. Ils sont systématiquement p<strong>la</strong>cés sous <strong>la</strong> conduite d’un·e<br />
ingénieur·e géomètre breveté·e 49 .<br />
Le déroulement d’une œuvre cadastrale se décompose en quatre phases : p<strong>la</strong>nification,<br />
réalisation, exploitation, contrôle <strong>de</strong>s résultats. Celles-ci correspon<strong>de</strong>nt à trois domaines <strong>de</strong><br />
conduite qui se déroulent comme un système en boucle qui traverse les échelons<br />
administratifs et qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un haut niveau <strong>de</strong> coordination entre les divers acteurs<br />
concernés : <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, qui est définie sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
quatre ans, est déterminée par <strong>la</strong> D+M en tenant compte <strong>de</strong>s concepts et programmes<br />
cantonaux <strong>de</strong> réalisation et se réalise suivant <strong>de</strong>s mandats et <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> prestation entre <strong>la</strong><br />
Confédération et les cantons ; <strong>la</strong> réalisation et l’exploitation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
concerne l’exécution <strong>de</strong>s travaux et <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> comptes rendus <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s cantons ;<br />
enfin, le contrôle <strong>de</strong>s résultats est fait une fois par an et sert à comparer les résultats obtenus<br />
au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation et <strong>de</strong> l’exploitation avec les objectifs déterminés par <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle et à mettre en œuvre d’éventuelles mesures <strong>de</strong><br />
correction. Ce processus permet à l’ensemble <strong>de</strong>s acteurs concernés <strong>de</strong> réaliser une mesure<br />
officielle suivant <strong>de</strong>s principes communs.<br />
Il apparaît donc que <strong>la</strong> mensuration officielle est le résultat d’un processus <strong>de</strong> travail<br />
défini dans le détail et très contrôlé, réalisé par quelques milliers <strong>de</strong> personnes, toutes tâches<br />
confondues, dont il s’agit <strong>de</strong> coordonner l’action dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique publique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle : 15 personnes travail<strong>la</strong>nt à <strong>la</strong> D+M, 21 géomètres cantonaux et environ<br />
3'000 col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> bureaux d’ingénieurs et géomètres privés.<br />
Enfin, <strong>la</strong> mensuration officielle constituant, avec le registre foncier, l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux piliers<br />
du système cadastral suisse, les différents niveaux administratifs entretiennent un échange<br />
d’information suivi avec l’office fédéral (Office fédéral chargé du droit du registre foncier et<br />
du droit foncier, OFRF) et les offices cantonaux et communaux correspondants (offices du<br />
registre foncier). La coordination <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle requiert en outre <strong>la</strong><br />
col<strong>la</strong>boration avec d’autres offices fédéraux, comme par exemple l’Office fédéral <strong>de</strong><br />
l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique (OFS), l’Office fédéral du<br />
développement territorial (ARE) et l’Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement (OFEV). La<br />
mensuration officielle col<strong>la</strong>bore également avec les hautes écoles (écoles polytechniques,<br />
hautes écoles spécialisées, écoles techniques).<br />
4.4.1.5 Bases légales<br />
La mensuration officielle est donc une tâche assumée en commun par différents groupes<br />
d’acteurs publics et privés. Au niveau fédéral, les textes légis<strong>la</strong>tifs les plus importants pour <strong>la</strong><br />
réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle sont les articles 942, 943, 950 et 38 à 42 du Titre final<br />
du Co<strong>de</strong> civil suisse 50 , l’Ordonnance sur <strong>la</strong> mensuration officielle (OMO) du 18 novembre<br />
1992 (RS 211.432.2), l’Ordonnance technique sur <strong>la</strong> mensuration officielle (OTEMO) du 10<br />
juin 1994 (RS 211.432.21), l’Arrêté fédéral concernant les in<strong>de</strong>mnités fédérales dans le<br />
domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle du 20 mars 1992 (RS 211.432.27) 51 , ainsi que <strong>la</strong> Loi<br />
49 L’obtention du titre d’ingénieur géomètre breveté est d’ailleurs régie par une ordonnance, l’Ordonnance<br />
concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre du 16 novembre 1994 (RS 211.432.261). C’est <strong>la</strong> condition<br />
nécessaire pour pouvoir exécuter <strong>de</strong>s mensurations officielles dans toute <strong>la</strong> Suisse. Les émoluments perçus pour<br />
l’examen qui permet d’acquérir ce titre sont soumis à l’Ordonnance concernant les émoluments perçus pour<br />
l’examen <strong>de</strong> technicien géomètre du 6 octobre 1980 (RS 211.432.263.1).<br />
50 En résumant l’essentiel, ces articles du CC déterminent le lien entre <strong>la</strong> mensuration du sol (ainsi que sa<br />
représentation graphique) et le registre foncier, ainsi que <strong>la</strong> responsabilité financière <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération<br />
concernant <strong>la</strong> mensuration officielle.<br />
51 Cet arrêté sera abrogé très vraisemb<strong>la</strong>blement à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 2007.
76 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
fédérale sur <strong>la</strong> géoinformation (Loi sur <strong>la</strong> géoinformation, LGéo), approuvée le 6 mars 2007<br />
par le Conseil national et qui entrera en vigueur vraisemb<strong>la</strong>blement le 1 er janvier 2008.<br />
Pour <strong>la</strong> question qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, <strong>la</strong> base légis<strong>la</strong>tive est constituée par l’art. 31 <strong>de</strong> l’OMO,<br />
consacré à l’entretien <strong>de</strong> ces données et inséré au chapitre 5 (Conservation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle) <strong>de</strong> l’ordonnance. Cet article dit :<br />
Art. 31 Entretien<br />
1 Les éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle doivent être entretenus <strong>de</strong> manière à conserver<br />
constamment leur intégralité et leur qualité.<br />
2 Le département édicte <strong>de</strong>s instructions sur les exigences d’ordre technique et organisationnel<br />
concernant l’entretien <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, et notamment sur <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s données.<br />
Ces <strong>de</strong>ux alinéas font c<strong>la</strong>irement référence à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données dans leur état le<br />
plus actuel. Il n’est donc pas question d’archivage au sens technique du terme. Puisque c’est<br />
l’état actuel <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns qui importe du point <strong>de</strong> vue juridique, <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion exige uniquement<br />
que l’information <strong>la</strong> plus actuelle soit garantie. Elle se réfère donc à <strong>de</strong>s données toujours<br />
vivantes.<br />
L’OTEMO consacre pour sa part un titre (titre septième) à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle et à l’archivage <strong>de</strong>s documents (art. 80 à 88). Dans le premier chapitre,<br />
consacré aux généralités, cette tâche est définie comme suit :<br />
Art. 80 Définition<br />
La conservation comprend les mesures techniques et organisationnelles utiles à <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />
données ainsi qu’à <strong>la</strong> gar<strong>de</strong>, à l’archivage et à <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
afin d’en maintenir <strong>la</strong> valeur.<br />
L’article 81 attribue <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s<br />
données aux cantons et l’art. 82 détermine <strong>la</strong> commune comme étant <strong>la</strong> plus petite unité <strong>de</strong><br />
gestion <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle. Le <strong>de</strong>uxième chapitre est consacré à<br />
l’entretien <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (art. 83 à 85) : l’art. 83 prévoit <strong>la</strong> création<br />
d’un document <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s données, c’est-à-dire l’obligation <strong>de</strong> fixer par écrit les<br />
métadonnées <strong>de</strong> gestion, <strong>de</strong> manière à ce qu’il soit possible <strong>de</strong> retracer a posteriori les actions<br />
effectuées en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> mensuration officielle :<br />
Art. 83 Document <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s données<br />
Des documents <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s données doivent être établis et constamment actualisés ; leur teneur<br />
minimale est <strong>la</strong> suivante :<br />
a. situation <strong>de</strong> départ au moment <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong> données numériques d’une ou <strong>de</strong><br />
plusieurs communes avec appréciation <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité, <strong>de</strong> l’actualité et du caractère complet <strong>de</strong>s<br />
travaux antérieurs et <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentation et du mo<strong>de</strong> d’archivage <strong>de</strong>s documents<br />
existants ;<br />
b. responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données ;<br />
c. compétence pour toute intervention ou modification ;<br />
d. diagramme <strong>de</strong> l’organisation interne pour <strong>la</strong> mise à jour <strong>de</strong>s données ;<br />
e. <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentation technique établie lors <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
et à établir lors <strong>de</strong>s mises à jour, indications concernant l’archivage <strong>de</strong> cette documentation ;<br />
f. directives en cas d’erreurs dans les données ou <strong>de</strong> contradictions dans <strong>la</strong> base <strong>de</strong> données et<br />
g. procès-verbal d’exploitation.<br />
La let. e. mentionne une activité d’archivage, mais celle-ci est mise en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong><br />
documentation technique établie lors <strong>de</strong>s mensurations et non pas les données <strong>de</strong> <strong>la</strong>
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 77<br />
mensuration elles-mêmes. L’art. 84 prévoit un contrôle <strong>de</strong>s modifications <strong>de</strong>s données<br />
(exhaustivité, cohérence, p<strong>la</strong>usibilité et qualité) consigné dans un procès-verbal, mais pas une<br />
historisation <strong>de</strong> celles-ci. Enfin, l’art. 85 se concentre sur <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s données, qui doit être<br />
garantie indépendamment du fait qu’elles soient <strong>de</strong> nature informatique (suivant une norme<br />
suisse en vigueur) ou analogique. Le chapitre 3 est dédié à l’entretien <strong>de</strong>s autres éléments <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mensuration officielle – à savoir les repères <strong>de</strong>s points fixes et signes <strong>de</strong> démarcation (art.<br />
86) et les p<strong>la</strong>ns, documents et éléments <strong>de</strong> l’ancienne mensuration officielle (art. 87) – dont <strong>la</strong><br />
compétence est attribuée aux cantons. L’art 87 parle d’entretien <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns, extraits et<br />
documents ; il mentionne l’obligation <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s cantons d’édicter <strong>de</strong>s mesures sur<br />
l’archivage <strong>de</strong>s anciens éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, c’est-à-dire <strong>de</strong>s données,<br />
documents et p<strong>la</strong>ns établis avant l’entrée en vigueur <strong>de</strong> l’ordonnance OMO :<br />
Art. 87 P<strong>la</strong>ns, documents et éléments <strong>de</strong> l’ancienne mensuration officielle<br />
1<br />
Chaque canton édicte les directives nécessaires à l’entretien<br />
a. <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns du registre foncier ;<br />
b. <strong>de</strong>s autres extraits établis en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> tenue du registre foncier et<br />
c. <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentation technique.<br />
2<br />
Le canton édicte <strong>de</strong>s directives sur l’archivage <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle établis<br />
selon les anciennes dispositions.<br />
Enfin, le chapitre 4 et l’art. 88 qui le compose sont consacrés explicitement à<br />
l’archivage :<br />
Art. 88<br />
1 L’archivage <strong>de</strong>s documents techniques doit permettre <strong>de</strong> reconstituer toutes les modifications<br />
intervenues pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> citée à l’al. 2.<br />
2 Les documents établis selon les art. 68, 70 et 71 sont gardés jusqu’à l’approbation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration, ceux qui sont établis selon les art. 69, 72 et 73 le sont jusqu’au renouvellement <strong>de</strong>s<br />
couches d’information correspondantes.<br />
3<br />
Les mesures et calculs effectués pour <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s points fixes selon les art. 54 à 56 sont<br />
archivés <strong>de</strong> manière complète et adéquate.<br />
4 Les cantons règlent l’archivage <strong>de</strong>s extraits établis selon les art. 65 à 67.<br />
On remarque que l’archivage est compris comme ayant essentiellement pour but <strong>de</strong><br />
permettre <strong>la</strong> reconstruction du travail technique effectué (al. 1), <strong>de</strong> permettre <strong>la</strong> vérification<br />
<strong>de</strong>s mensurations jusqu’à leur approbation (al. 2) et <strong>de</strong> garantir l’archivage <strong>de</strong>s mesures<br />
effectuées pour <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s points fixes (al. 3). L’al. 4 concerne l’archivage <strong>de</strong>s<br />
extraits pour <strong>la</strong> tenue du registre foncier, à savoir l’état <strong>de</strong>scriptif du bien-fonds (art. 65), le<br />
p<strong>la</strong>n et le tableau <strong>de</strong> mutation (art. 66) et le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> glissement : cet alinéa se réfère<br />
donc explicitement aux données qui nous intéressent ici ; c’est leur sauvegar<strong>de</strong> en particulier<br />
qui permet en effet <strong>de</strong> conserver <strong>la</strong> « <strong>mémoire</strong> » d’une parcelle, c’est-à-dire <strong>de</strong> déterminer<br />
quelles sont les modifications intervenues sur un bien-fonds. La compétence pour régler<br />
l’archivage <strong>de</strong> ce type d’information est entièrement attribuée aux cantons.<br />
En conclusion <strong>de</strong> ce regard sur les textes légis<strong>la</strong>tifs, nous remarquons qu’une distinction<br />
est faite entre l’entretien <strong>de</strong>s données (c’est-à-dire <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong> leur constante actualité),<br />
leur conservation en tant que données toujours actuelles, vivantes et ayant une relevance<br />
juridique et, enfin, leur archivage en tant qu'informations ayant terminé leur cycle <strong>de</strong> vie.<br />
Alors que l’entrée en vigueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> MO93 et le passage à l’informatisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> ces<br />
données est un gros avantage du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’entretien et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données<br />
actuelles, le risque existe que du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s informations se per<strong>de</strong>nt : il<br />
s’agit en particulier <strong>de</strong> celles qui permettent l’historisation d’une parcelle. Un autre problème
78 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
est que, l’archivage étant <strong>de</strong> compétence cantonale, il est difficile <strong>de</strong> savoir comment il est<br />
globalement réalisé, dans quelles conditions, suivant quels moyens.<br />
Cet état <strong>de</strong> fait pourrait changer si le projet actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong><br />
géoinformation (Loi sur <strong>la</strong> géoinformation, LGéo) 52 <strong>de</strong>vait aboutir, puisqu’il prévoit un art. 9<br />
comme suit :<br />
Art. 9 Garantie <strong>de</strong> disponibilité<br />
1<br />
Le service chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise à jour et <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s géodonnées <strong>de</strong> base garantit <strong>la</strong><br />
pérennité <strong>de</strong> leur disponibilité.<br />
2<br />
Pour les géodonnées <strong>de</strong> base <strong>de</strong> droit fédéral, le Conseil fédéral règle :<br />
a. les modalités <strong>de</strong> leur archivage ;<br />
b. les modalités et <strong>la</strong> périodicité <strong>de</strong> l’établissement <strong>de</strong> leur historique.<br />
Cet article prévoit en d’autres termes une régu<strong>la</strong>tion au niveau fédéral <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s<br />
géodonnées <strong>de</strong> base, dont les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle font partie, ainsi que<br />
l’historisation <strong>de</strong> celles-ci à une périodicité qui n’est pas déterminée. Il apparaît ainsi qu’il<br />
existe une conscience <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisation à long terme <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> données,<br />
conscience qui n’était peut être pas encore actuelle il y a quelques années à cause du<br />
changement <strong>de</strong> support (passage <strong>de</strong> l’ère du papier à l’ère <strong>de</strong> l’informatique) que les différents<br />
producteurs et gestionnaires d’informations sont en train <strong>de</strong> vivre. Il est donc politiquement<br />
reconnu que <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> mettre continuellement à jour les géodonnées n’enlève en rien<br />
l’importance <strong>de</strong> leur sauvegar<strong>de</strong> et exploitabilité à long terme grâce à l’archivage : celui-ci est<br />
compris comme <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s informations sous une forme totalement indépendante <strong>de</strong>s<br />
logiciels ou <strong>de</strong>s supports informatiques utilisés à un moment donné. Cette règle doit en outre<br />
s’appliquer non seulement aux données en tant que telles, mais aussi aux métadonnées qui<br />
doivent y être associées, aux modèles <strong>de</strong> données (c’est-à-dire <strong>la</strong> structuration architecturale<br />
<strong>de</strong>s données), ainsi qu’aux modèles <strong>de</strong> représentation correspondants (à savoir <strong>la</strong> manière<br />
dont une telle ou telle information est représentée graphiquement) 53 .<br />
Il est cependant fondamental <strong>de</strong> souligner que, si ce souhait <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> est<br />
compréhensible du point <strong>de</strong> vue historique, il peut susciter une certaine crainte du point <strong>de</strong><br />
vue du droit foncier. En effet, le principe qui veut qu'un droit nouveau remp<strong>la</strong>ce et ren<strong>de</strong><br />
caduc tout droit antérieur est très important : il est par exemple exclu qu'un propriétaire<br />
revendique un droit plus ancien que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière inscription ou mutation entrée en force, sauf<br />
dans le cas d’une erreur manifeste, qui serait alors reconnue et corrigée 54 . Ainsi, il faut<br />
considérer que <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> données anciennes pourrait d’une certaine manière ouvrir <strong>la</strong><br />
voie à <strong>de</strong>s quérulents inattentifs au moment d’une mutation.<br />
4.4.1.6 Coûts<br />
Il n’est pas possible <strong>de</strong> donner une estimation <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation et <strong>de</strong><br />
l’archivage <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>.<br />
Il apparaît néanmoins utile <strong>de</strong> mentionner le fait que ces données, qui permettent <strong>de</strong><br />
donner une image du territoire et d’en fixer <strong>la</strong> propriété foncière, sont à <strong>la</strong> base d’un système<br />
52 er<br />
Cette nouvelle loi pourrait être mise en vigueur au 1 janvier 2008. Elle a pour objet les géoinformations,<br />
c’est-à-dire les données liées à l'espace et qui décrivent les particu<strong>la</strong>rités d'un pays : elles constituent en somme<br />
<strong>la</strong> base pour l'établissement <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nifications et pour <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> mesures ou <strong>de</strong> décisions liées au territoire. Le<br />
p<strong>la</strong>n du registre foncier fait justement partie <strong>de</strong> ces données.<br />
53<br />
Se référer au Message re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> loi fédérale sur <strong>la</strong> géoinformation (Loi sur <strong>la</strong> géoinformation, LGéo),<br />
06.000.<br />
54<br />
Les cas d'erreurs nécessitant une reconstitution sont par contre extrêmement rares.
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 79<br />
qui se chiffre en milliards <strong>de</strong> francs. La valeur globale du parc immobilier en Suisse est en<br />
effet actuellement estimée à 2’000 milliards <strong>de</strong> francs. La réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle, débutée en 1993, avait été estimée en 1990 à 3530 millions <strong>de</strong> francs<br />
(dont 2800 millions concernant <strong>la</strong> mensuration officielle, le reste l’abornement), dont un peu<br />
moins d’un tiers était pris en charge par <strong>la</strong> Confédération 55 . Actuellement, <strong>la</strong> subvention<br />
fédérale annuelle pour <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme est <strong>de</strong> 30 millions <strong>de</strong> francs. Puisque celleci<br />
<strong>de</strong>vrait se terminer en 2008, cette subvention est en nette diminution.<br />
4.4.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
La partie <strong>de</strong>scriptive et explicative du fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, qui se<br />
termine ici, nous donne les instruments nécessaires pour interpréter les processus <strong>de</strong><br />
conservation <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> données spécifiques suivant notre modèle d’analyse.<br />
4.4.2.1 Mémorisabilité<br />
Comme nous l’avons déjà constaté pour les autres domaines pris en considération,<br />
techniquement toutes les données qui entrent en jeu dans le processus <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle – <strong>de</strong> leur récolte jusqu’à leur fixation sur un p<strong>la</strong>n ou dans une banque<br />
<strong>de</strong> données – sont mémorisables. Néanmoins, puisque nous sommes en train <strong>de</strong> passer d’un<br />
traitement sur papier à un traitement entièrement informatisé, <strong>la</strong> réflexion sur <strong>la</strong><br />
mémorisabilité se pose également en termes <strong>de</strong> ce qu’il est possible <strong>de</strong> transférer d’un support<br />
à l’autre. De ce point <strong>de</strong> vue, <strong>de</strong>ux réflexions peuvent être faites.<br />
Comme nous l’avons mis en évi<strong>de</strong>nce, quoique <strong>la</strong> mensuration officielle en Suisse se<br />
fasse sur <strong>la</strong> base d’un travail réalisé <strong>de</strong> manière très décentralisée, <strong>la</strong> normalisation et <strong>la</strong><br />
volonté d’assurer <strong>la</strong> compatibilité entre systèmes (grâce à IMO) sont telles que l’homogénéité<br />
<strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, même lors <strong>de</strong> l’étape <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation, est garantie.<br />
Actuellement, il existe une intention très marquée <strong>de</strong> centraliser l'accès aux données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle via <strong>de</strong>s portails cantonaux et régionaux. Ces données publiques sont en<br />
outre <strong>de</strong> plus en plus mises en réseau afin <strong>de</strong> pouvoir les associer à d’autres informations <strong>de</strong><br />
caractère géographique ou à référence spatiale (systèmes d’information du territoire comme egeo.ch<br />
ou geowebforum.ch). Nous pouvons imaginer que, dans un futur plus ou moins<br />
proche, seront considérées comme données mémorisables au niveau fédéral celles qui seront<br />
accessibles par un système central <strong>de</strong> mise à disposition <strong>de</strong> l’information.<br />
L’autre aspect qu’il est intéressant <strong>de</strong> relever est lié à <strong>la</strong> complémentarité <strong>de</strong>s bases<br />
graphiques par rapport aux informations textuelles. Le <strong>la</strong>ngage graphique comporte en effet<br />
une série <strong>de</strong> métadonnées qui lui sont implicites et qu’il faut également mémoriser : l’échelle,<br />
<strong>la</strong> couleur, l’épaisseur et <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s traits, les dimensions, etc. La question est donc <strong>de</strong><br />
savoir comment respecter et rendre compte <strong>de</strong> ces métadonnées sur un écran d’ordinateur 56 .<br />
En conclusion, dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle comme dans d’autres, <strong>la</strong><br />
question <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisabilité ne se pose plus tellement en termes <strong>de</strong> possibilités techniques<br />
(réussir à fixer une certaine information sur un support matériel), car l’informatisation dont<br />
nous disposons offre en ce sens <strong>de</strong>s possibilités quasiment infinies. Il s’agit plutôt <strong>de</strong> trouver<br />
55 I<strong>de</strong>m, p. 16.<br />
56 La conversion du papier vers le numérique pose <strong>de</strong>s problèmes différents selon qu’elle est faite par scannage<br />
ou par vectorisation. Le scannage permet <strong>de</strong> reprendre l’ensemble <strong>de</strong> l’image, mais n’est que difficilement<br />
maniable ou modifiable et donne lieu à un fichier <strong>de</strong> volume important. La vectorisation, qui consiste à<br />
transformer les éléments d’un <strong>de</strong>ssin en éléments géométriques, permet une structuration par couches et une<br />
bonne maniabilité, mais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> beaucoup plus <strong>de</strong> travail et entraîne une perte <strong>de</strong> métainformation. Se référer<br />
au projet du Rapport final du groupe SIDIS, version 2 du 30 août 2006, p. 2 et 18.
80 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
les moyens et <strong>la</strong> volonté politique <strong>de</strong> centraliser les données – au travers <strong>de</strong> systèmes<br />
d’information – et, en reprenant les termes <strong>de</strong> notre approche basée sur les ressources, <strong>de</strong><br />
s’assurer que cette centralisation électronique soit formatée suivant un seul et même<br />
« <strong>la</strong>ngage ».<br />
4.4.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Nous l’avons vu, les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle sont le résultat d’un processus<br />
complexe et impliquant <strong>de</strong> nombreux acteurs, elles sont textuelles et graphiques, organisées<br />
par couches, récoltées et traitées suivant différentes métho<strong>de</strong>s et systèmes, conservées ou<br />
archivées <strong>de</strong> diverses manières, etc. Comment décrire dans cette variété <strong>de</strong> cas <strong>de</strong> figure ce<br />
qui est actuellement considéré comme étant digne d’être mémorisé ?<br />
Le schéma ci-<strong>de</strong>ssous représente une tentative <strong>de</strong> décrire <strong>de</strong> manière générale ce qui,<br />
suivant le processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, est digne d’être<br />
mémorisé (figure 4.4.4).<br />
Les données qui sont récoltées directement sur le terrain subissent <strong>de</strong>s transformations<br />
significatives une fois qu’elles sont importées dans les ordinateurs <strong>de</strong>s géomètres : sur le<br />
terrain on mesure en effet <strong>de</strong>s angles et <strong>de</strong>s distances suivant les coordonnées po<strong>la</strong>ires ; au<br />
bureau, elles sont transformées en coordonnées orthogonales (comme sur une carte<br />
géographique). Dans un <strong>de</strong>uxième temps, à partir <strong>de</strong> ces données, on crée une couche <strong>de</strong><br />
données en les associant entre elles : on obtient ainsi par exemple <strong>la</strong> surface d’un terrain.<br />
Enfin, dans un troisième temps, on représente ce jeu <strong>de</strong> données (Datensatz) dans une image<br />
graphique et on l’associé aux métadonnées qui le concernent : c’est le produit final <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle. Les données <strong>de</strong>s relevés faits sur le terrain sont conservées mais ne<br />
sont pas tenues à jour (art. 69 OTEMO).<br />
Systèmes<br />
<strong>de</strong> mesure<br />
Données<br />
<strong>de</strong>s relevés,<br />
brutes,<br />
(angles et<br />
distances,<br />
coordonnées<br />
po<strong>la</strong>ires)<br />
Transformation<br />
<strong>de</strong>s données<br />
Données<br />
source,<br />
(angles et<br />
distances,<br />
coordonnées<br />
orthogonales)<br />
et<br />
métadonnées<br />
Agrégation<br />
<strong>de</strong>s données<br />
Données<br />
agrégées<br />
(mensurations,<br />
surfaces, etc.)<br />
et<br />
métadonnées<br />
Contrôle<br />
<strong>de</strong>s résultats<br />
Conservées<br />
à l’état le<br />
plus actuel<br />
Données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle:<br />
Jeu <strong>de</strong><br />
données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration<br />
officielle<br />
Métadonnées<br />
P<strong>la</strong>ns<br />
graphiques<br />
Géomètres conservateurs:<br />
Banques <strong>de</strong> données<br />
et/ou documents papier<br />
Fig. 4.4.4 : Processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle.
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 81<br />
Nous pouvons donc considérer que, indépendamment <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong> pratique qui<br />
peuvent exister d’un canton à l’autre, c’est le produit final du processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle qui est considéré comme étant digne d’être mémorisé. Le<br />
critère <strong>de</strong> choix qui est appliqué ici est donc celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> potentialité d’utilisation d’une<br />
donnée : en effet, les données brutes <strong>de</strong>s relevés ne constituent qu’une base <strong>de</strong> travail et ne<br />
peuvent pas être exploitées en tant que telles. On va s'intéresser aux informations (ou aux<br />
produits) plutôt qu'aux données brutes.<br />
Néanmoins, comme dit précé<strong>de</strong>mment, ce qui compte du point <strong>de</strong> vue juridique, c’est<br />
toujours l’état le plus actuel <strong>de</strong>s données. Il se pose donc <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir si les états<br />
antérieurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (toujours sous forme <strong>de</strong> jeu <strong>de</strong> données, <strong>de</strong><br />
métadonnées et <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ns graphiques) sont, eux, dignes d’être mémorisés. Comme le souschapitre<br />
consacré aux bases légales l’a montré, <strong>la</strong> réponse à cette question varie actuellement<br />
d’un canton à l’autre, car c’est bien à eux que revient actuellement <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r<br />
l’historisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle ou bien pas. Pour déterminer quelles sont les<br />
pratiques <strong>de</strong> conservation et d’archivage <strong>de</strong>s états antécé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, ce<br />
qui dépend également du <strong>de</strong>gré d’informatisation <strong>de</strong> celle-ci, il serait par conséquent<br />
nécessaire <strong>de</strong> mener l’étu<strong>de</strong> au niveau cantonal.<br />
Si <strong>la</strong> LGéo <strong>de</strong>vait entrer en vigueur telle qu’elle se présente actuellement sous forme <strong>de</strong><br />
projet (ce qui est pratiquement certain), il serait alors considéré que oui, suivant l’art. 9, les<br />
éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle caducs sont eux aussi dignes d’être mémorisés et<br />
<strong>de</strong>vraient par conséquent être archivés suivant un p<strong>la</strong>nning périodique. L’exécution <strong>de</strong> cette<br />
nouvelle obligation, dont le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> réalisation serait déterminé par une ordonnance, n’est<br />
toutefois pas si facile à réaliser, ceci pour une raison en particulier : les données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle sont en fait un jeu <strong>de</strong> données (figure 4.4.4) organisées en huit<br />
couches, chacune composée d’un ou plusieurs thèmes et qui doivent être conservées dans leur<br />
ensemble. Chacune <strong>de</strong> ces couches et chacun <strong>de</strong>s thèmes est indépendant <strong>de</strong>s autres et<br />
constitue le résultat d’un processus individuel suivant <strong>de</strong>s rythmes et <strong>de</strong>s opérations<br />
variables : chaque couche ou thème évolue dans le temps <strong>de</strong> manière autonome, à une vitesse<br />
différente 57 . Si l’on désire permettre une historisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle, il s’agira donc <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s « coupes » au travers <strong>de</strong>s différents niveaux <strong>de</strong><br />
données qui permettent <strong>de</strong> photographier l’état <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle à un moment<br />
déterminé. C’est en tenant compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> rapidité à <strong>la</strong>quelle les changements interviennent sur<br />
le terrain et sont mémorisés dans le jeu <strong>de</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle qu’il faudra<br />
déterminer à quelle fréquence réaliser ces « coupes photographiques » (périodicité <strong>de</strong><br />
l’historisation) : si les changements ont lieu fréquemment, les « coupes » <strong>de</strong>vront avoir lieu<br />
plus souvent, si au contraire les changements sont plus rares, elles pourront se faire suivant<br />
<strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is plus longs, l’important étant que <strong>la</strong> périodicité <strong>de</strong> l’historisation se fasse à <strong>de</strong>s<br />
intervalles <strong>de</strong> temps toujours i<strong>de</strong>ntiques. L’hypothétique historien ou chercheur du futur<br />
<strong>de</strong>vrait ainsi disposer d’un échantillonnage d’informations (sur les données, mais aussi sur les<br />
processus) sauvegardées (au moyen <strong>de</strong> back up) à <strong>de</strong>s intervalles déterminés qui <strong>de</strong>vraient lui<br />
permettre <strong>de</strong> reconstituer les informations liées à <strong>la</strong> mensuration officielle sur une pério<strong>de</strong><br />
57 Dans <strong>la</strong> mise à jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, on émet une distinction entre <strong>la</strong> mise à jour permanente et <strong>la</strong><br />
mise à jour périodique. La mise à jour permanente concerne les éléments pour lesquels un système d’annonces<br />
peut être organisé, suivant les art. 23 <strong>de</strong> l’OMO et 66 <strong>de</strong> l’OTEMO : par exemple, le service <strong>de</strong>s routes qui<br />
annonce un nouveau projet, une commune qui annonce <strong>la</strong> construction d’un nouveau bâtiment, un propriétaire<br />
qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> une mutation <strong>de</strong> limites. La mise à jour périodique, suivant l’art. 24 <strong>de</strong> l’OMO, concerne les<br />
modifications naturelles ou spontanées <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration : par exemple, l’avancement <strong>de</strong>s lisières<br />
<strong>de</strong> forêts, les dép<strong>la</strong>cements <strong>de</strong> cours d'eau, etc.
82 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
donnée. Ces « photographies ponctuelles » <strong>de</strong>vront par ailleurs être coordonnés avec d'autres<br />
informations à référence spatiale (aménagement du territoire, zones <strong>de</strong> protection, etc).<br />
Une <strong>de</strong>rnière réflexion autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> dignité à <strong>la</strong> mémorisation concerne <strong>la</strong> distinction entre<br />
les informations figées et celles qui sont interactives. Les données figées, comme par exemple<br />
un p<strong>la</strong>n cadastral au format .pdf, peuvent être facilement gérées et conservées dans le temps<br />
grâce au fait qu’il s’agit <strong>de</strong> produits passifs, qu’on ne peut modifier et qui ne livrent que ce<br />
qui est visible immédiatement. Les données interactives, comme une banque <strong>de</strong> données,<br />
permettent d'effectuer par exemple <strong>de</strong>s choix sur les données à représenter, sur le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
représentation, elles permettent <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s recoupements entre différents niveau (quelle<br />
surface <strong>de</strong> pré sur <strong>la</strong> parcelle 132 ?) ou encore <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s agrandissements ou à <strong>de</strong>s<br />
réductions dynamiques. La sauvegar<strong>de</strong> dans le temps <strong>de</strong> ce genre d’informations exige un<br />
système <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong>s moyens informatiques poussés.<br />
En conclusion, si nous reprenons <strong>la</strong> partie <strong>de</strong> notre modèle d’analyse centrée sur les<br />
ressources – <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> jugement <strong>de</strong> ce qui est digne d’être mémorisé faisant appel à <strong>la</strong><br />
ressource « Raison » – nous constatons que le passage à l’ère <strong>de</strong> l’informatisation <strong>de</strong>s<br />
processus nous <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un changement radical dans notre manière <strong>de</strong> penser <strong>la</strong> conservation<br />
et surtout l’archivage <strong>de</strong> l’information. Le jeu <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle en est<br />
un exemple par<strong>la</strong>nt, puisqu’il nous montre que plus les informations sont traitées <strong>de</strong> manière<br />
informatique, plus il est possible <strong>de</strong> les organiser par couches et par conséquent <strong>de</strong> les<br />
associer ou les dissocier librement. Le choix, parmi ces processus à plusieurs vitesses, <strong>de</strong> ce<br />
qu’il convient <strong>de</strong> conserver à long terme <strong>de</strong>vient toujours plus <strong>la</strong>borieux et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
compétences extrêmement spécialisées et, pour ainsi dire, un don <strong>de</strong> c<strong>la</strong>irvoyance.<br />
4.4.2.3 Mémorisation réelle<br />
De nouveau, pour savoir ce qui est effectivement conservé ou archivé et dans quelles<br />
conditions ce<strong>la</strong> s’effectue il faudrait mener une étu<strong>de</strong> ciblée au niveau <strong>de</strong>s cantons,<br />
responsables <strong>de</strong> ces aspects. Deux réflexions générales concernant <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s<br />
données peuvent tout <strong>de</strong> même être faites.<br />
Tout d’abord, nous avons vu que <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle s’effectuant <strong>de</strong><br />
manière décentralisée et par une multitu<strong>de</strong> d’acteurs, il est extrêmement difficile d’imposer<br />
<strong>de</strong>s standards dans l’utilisation <strong>de</strong>s logiciels et <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données.<br />
Afin que les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle puissent être communiquées d’un canton à<br />
l’autre, être utilisées à un niveau national et en re<strong>la</strong>tion également avec d’autres données à<br />
caractère géographique, une certaine uniformisation <strong>de</strong>s données est cependant indispensable.<br />
C’est justement <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> mensuration officielle a mis en service le <strong>la</strong>ngage<br />
INTERLIS, ainsi que l’Interface <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle. Ces instruments informatiques,<br />
indispensables pour <strong>la</strong> communication <strong>de</strong>s données, représentent un outil intéressant<br />
également au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données.<br />
Deuxièmement, nous avons mis en évi<strong>de</strong>nce les difficultés <strong>principale</strong>s que le passage<br />
d’un traitement <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns graphiques sur papier à un traitement électronique pose. Du point <strong>de</strong><br />
vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation et <strong>de</strong> l’archivage, un retour en arrière (<strong>de</strong> <strong>la</strong> forme électronique à <strong>la</strong><br />
forme papier) poserait encore plus <strong>de</strong> problèmes et ne peut donc pas être envisagé. En effet, il<br />
n’est actuellement plus possible <strong>de</strong> considérer les différents éléments et couches <strong>de</strong>s données<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (y compris les p<strong>la</strong>ns) individuellement : il s’agit désormais<br />
d’informations interactives qui suivent <strong>de</strong>s processus évolutifs différents. Pour cette raison, il<br />
serait désormais difficile <strong>de</strong> les imprimer <strong>de</strong> manière complète en vue <strong>de</strong> leur archivage. La<br />
conservation à long terme et l’archivage <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle doivent par
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 83<br />
conséquent être réalisés sous forme numérique par <strong>de</strong>s sauvegar<strong>de</strong>s ; leur subsistance dans le<br />
temps doit être assurée par <strong>de</strong>s migrations réalisées périodiquement.<br />
En conclusion, nous constatons l’importance que ces systèmes d’information sont en train<br />
d’acquérir : en effet, ils permettent une uniformisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle ainsi que leur mise en réseau avec d’autres systèmes. Ces processus doivent<br />
néanmoins être régulés <strong>de</strong> près, car ils sont extrêmement complexes et requièrent <strong>la</strong><br />
compétence <strong>de</strong> nombreux groupes d’acteurs. Ces réseaux permettent ainsi <strong>de</strong> gérer <strong>de</strong> manière<br />
plus durable <strong>la</strong> ressource que nous avons nommée « espace », pour autant que leur entretien<br />
soit assuré dans le temps. Concernant <strong>la</strong> ressource « temps » : alors que leur mise en p<strong>la</strong>ce<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> un investissement énorme en termes temporels, une fois qu’ils sont fonctionnels, le<br />
temps que les opérateurs du secteur gagnent est très significatif.<br />
4.4.2.4 Accessibilité<br />
L’Ordonnance sur <strong>la</strong> mensuration officielle (OMO) détermine au chapitre 6 (Diffusion<br />
d’extraits et <strong>de</strong> restitutions <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle) le caractère public <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle (art. 33) ainsi que les conditions <strong>de</strong> consultation et <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong><br />
celles-ci. Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle peuvent être consultées par tout un chacun,<br />
on peut en <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s extraits ou <strong>de</strong>s restitutions (art. 34 al. 1) ; si l’intérêt public l’exige,<br />
les cantons peuvent néanmoins subordonner à <strong>de</strong>s conditions <strong>la</strong> consultation ou <strong>la</strong> remise <strong>de</strong>s<br />
données, en particulier <strong>la</strong> remise d’extraits (art. 34 al. 2 et al. 2 bis). Ce sont toujours les<br />
cantons qui déterminent qui est autorisé à remettre <strong>de</strong>s extraits et <strong>de</strong>s restitutions <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle (art. 34 al. 3 OMO) et qui règlent l’accès direct par ordinateur aux<br />
données (art. 36 al. 1). L’utilisateur doit être renseigné sur l’actualité et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s données<br />
ainsi que sur l’intégralité et le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> généralisation <strong>de</strong> celles-ci, même via ordinateur (art.<br />
35, art. 36 al. 2). Les extraits <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns du registre foncier émis doivent porter, à titre<br />
d’attestation d’exactitu<strong>de</strong>, <strong>la</strong> date et <strong>la</strong> signature <strong>de</strong>s personnes autorisées à les remettre (art.<br />
37. al 1) ; cette attestation doit pouvoir être garantie également par accès direct par ordinateur<br />
(art. 37 al. 3). La remise <strong>de</strong>s extraits et restitutions est soumise à émolument, dont le montant<br />
et les modalités <strong>de</strong> paiement sont fixées par les cantons (art. 38).<br />
La reproduction <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (art. 39) à <strong>de</strong>s fins<br />
professionnelles et pour <strong>la</strong> publication est régie par l’Ordonnance sur <strong>la</strong> reproduction <strong>de</strong><br />
données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (ORDMO) du 9 septembre 1998 (RS 510.622), qui sera<br />
très vraisemb<strong>la</strong>blement abrogée à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 2007. Elle est définie à l’art. 3 al. 1 comme étant<br />
toute mise en <strong>mémoire</strong> ou visualisation, même temporaire, d’informations qui se basent sur<br />
<strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, quel que soit le support utilisé. La reproduction <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle – y compris sur support informatique – est donc fixée <strong>de</strong><br />
manière très détaillée et soumise à autorisation. De même, les émoluments que les autorités<br />
compétentes (cantonales ou communales) perçoivent suivent <strong>de</strong>s calculs bien établis en<br />
fonction du tirage, <strong>de</strong> <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> données contenues dans le produit, du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
reproduction <strong>de</strong>s données, <strong>de</strong> <strong>la</strong> précision <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproduction <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong> l’usage qu’il<br />
est prévu d’en faire (art. 14). Les aspects techniques liés à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation et aux<br />
émoluments sont encore réglés dans une ordonnance à part, l’Ordonnance du DFJP sur <strong>la</strong><br />
reproduction <strong>de</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (ORDMO-DFJP) du 9 septembre 1998<br />
(RS 510.622.2). Concernant les émoluments, il est néanmoins important <strong>de</strong> préciser que ce<br />
qui est facturé est le travail fourni et non pas les données en tant que telles.<br />
Les domaines d’application <strong>de</strong> politiques publiques qui utilisent <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle se sont considérablement é<strong>la</strong>rgis au fil <strong>de</strong>s années du fait d’une<br />
sollicitation accrue du sol. Ce sont <strong>de</strong>s domaines comme l’aménagement du territoire, <strong>la</strong>
84 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
protection civile, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement, <strong>la</strong> défense, <strong>la</strong> construction routière, les<br />
transports, l’agriculture, l’économie forestière, <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s monuments, le tourisme, <strong>la</strong><br />
statistique, etc. De même, on assiste à une augmentation <strong>de</strong>s principaux clients <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle, c’est-à-dire <strong>de</strong>s acheteurs réguliers <strong>de</strong> ses produits, qui sont<br />
actuellement les suivants 58 :<br />
• les administrations fédérales, cantonales et communales ;<br />
• les services du registre foncier ;<br />
• les associations <strong>de</strong> propriétaires fonciers ;<br />
• <strong>la</strong> Fédération Suisse <strong>de</strong>s Notaires (FSN) ;<br />
• <strong>la</strong> Société suisse <strong>de</strong>s propriétaires fonciers ;<br />
• <strong>la</strong> Société suisse <strong>de</strong>s ingénieurs et architectes (SIA) ;<br />
• <strong>la</strong> Société suisse <strong>de</strong> l’industrie du Gaz et <strong>de</strong>s Eaux (SSIGE) ;<br />
• l’Association suisse <strong>de</strong> réseaux <strong>de</strong> communication (SWISSCABLE) ;<br />
• l’Association suisse <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> l’épuration <strong>de</strong>s eaux (VSA) ;<br />
• l’Association <strong>de</strong>s entreprises électriques suisses (AES) ;<br />
• l’Union <strong>de</strong>s professionnels suisses <strong>de</strong> <strong>la</strong> route (VSS) ;<br />
• les CFF ;<br />
• <strong>la</strong> Poste ;<br />
• Swisscom ;<br />
• etc.<br />
Les acteurs qui ont besoin <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle sont en général <strong>de</strong>s<br />
clients spécialisés, qui connaissent son fonctionnement dans le détail ou <strong>de</strong>s propriétaires dans<br />
le cas <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'autorisations administratives ou <strong>de</strong> crédits. Néanmoins, <strong>la</strong> Direction<br />
fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales informe son public cible sur le fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle, sur l’avancement <strong>de</strong>s différents projets en cours, sur les changements<br />
qui interviennent, etc. au moyen <strong>de</strong> son site Internet (www.cadastre.ch) et <strong>de</strong> publications <strong>de</strong><br />
vulgarisation ou spécifiquement adressées à un public <strong>de</strong> spécialistes.<br />
En conclusion, nous pouvons mettre en évi<strong>de</strong>nce le fait que l’informatisation <strong>de</strong>s données<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle les rend accessibles à un nombre toujours plus élevé d’acteurs et,<br />
surtout, permet <strong>la</strong> mise en réseau <strong>de</strong> ces données avec celles d’autres domaines en re<strong>la</strong>tion<br />
avec le territoire. Ces nouvelles possibilités informatiques constituent un é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ressource que nous avons appelée « espace public » : par conséquent, elles <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
nouvelles régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> l’accès, <strong>de</strong>s nouveau canaux <strong>de</strong> communication qui permettent <strong>de</strong><br />
renseigner sur l’état <strong>de</strong>s données (actualité, qualité, intégralité, <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> généralisation), <strong>de</strong>s<br />
procédures qui garantissent et attestent d’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s extraits 59 .<br />
58 Se référer à <strong>la</strong> brochure intitulée Manuel sur l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, Office fédéral <strong>de</strong><br />
topographie swisstopo, Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, 2002, p. 31.<br />
59 L’un <strong>de</strong>s buts du projet SIDIS est d’ailleurs bien celui <strong>de</strong> définir les moyens permettant <strong>de</strong> diffuser <strong>de</strong> manière<br />
fiable les informations re<strong>la</strong>tives aux restrictions <strong>de</strong> droit public, <strong>de</strong> décrire les conditions juridiques re<strong>la</strong>tives à<br />
ces restriction et <strong>de</strong> décrire les conditions juridiques re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s informations.
DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE 85<br />
4.4.3 Commentaires<br />
Les informations rassemblées dans ces pages ont été recueillies grâce à <strong>de</strong>s entretiens<br />
avec M. Jean-Paul Miserez (Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s cantons <strong>de</strong> VS, VD, FR<br />
et BS, géomètre cantonal d’OW et NW et chargé du projet SIDIS) et M. Pierre Gerber<br />
(Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> bibliothèque et <strong>de</strong> <strong>la</strong> collection <strong>de</strong>s cartes), ainsi qu’à travers <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s<br />
bases légales et <strong>de</strong>s documents publiés ayant trait aux données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle.<br />
Les commentaires principaux qui peuvent être faits à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> ce travail <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription du<br />
fonctionnement du processus <strong>de</strong> production, <strong>de</strong> traitement et <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mensuration officielle sont les suivants :<br />
(1) les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (jeu <strong>de</strong> données, métadonnées et<br />
p<strong>la</strong>ns graphiques), constituent un bon exemple pour illustrer <strong>la</strong> tendance<br />
actuelle <strong>de</strong> réunir les outputs d’une politique publique décentralisée afin <strong>de</strong><br />
les mettre à disposition plus facilement. En effet, <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, fortement liée au territoire, ne peut être<br />
que régionale. C’est pourquoi elle est <strong>de</strong> compétence cantonale et est réalisée<br />
sur le terrain par un grand nombre <strong>de</strong> bureaux privés d’ingénieurs géomètres<br />
possédant un brevet fédéral. Alors que durant <strong>de</strong>s décennies ce processus a<br />
fonctionné tout au long <strong>de</strong> ses étapes <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> manière décentralisée,<br />
nous assistons actuellement à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’une centralisation du<br />
système, non pas au travers d’un changement <strong>de</strong> politique, mais au moyen<br />
d’une mise en commun <strong>de</strong>s données.<br />
(2) Il s’agit d’un changement radical dû aux possibilités que les technologies<br />
informatiques nous offrent : il facilite <strong>la</strong> mise en réseau, <strong>la</strong> communication et<br />
l’accessibilité aux informations, mais pose <strong>de</strong> nouvelles difficultés qu’il faut<br />
être à même <strong>de</strong> prévoir à l’avance et <strong>de</strong> réguler par <strong>de</strong>s droits d’utilisation,<br />
notamment afin d’éviter <strong>de</strong> trop nombreuses rivalités. Ceci d’autant plus que<br />
les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle acquièrent dans ce contexte une<br />
importance énorme, car on tend à vouloir gérer <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> politiques à<br />
partir d’éléments spatiaux.<br />
(3) Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle décrivent toujours l’état le plus<br />
actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>s biens fonds, leurs continuelles mises à jour radient<br />
d’une certaine manière le passé, ceci afin <strong>de</strong> correspondre toujours<br />
exactement à <strong>la</strong> situation réelle du terrain et à l'état <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété<br />
foncière. Il est néanmoins fondamental <strong>de</strong> conserver et archiver également les<br />
données anciennes – ou du moins un échantillon d’entre elles, prélevé suivant<br />
<strong>de</strong>s périodicités régulières – ceci afin <strong>de</strong> permettre une historisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle. Ces anciennes données représentent en effet un capital<br />
vo<strong>la</strong>til qu’il s’agit <strong>de</strong> fixer : elles permettent par exemple <strong>de</strong> se renseigner sur<br />
l’état passé <strong>de</strong>s biens-fonds, <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s vérifications a posteriori, <strong>de</strong><br />
constater l’évolution <strong>de</strong>s biens fonds, <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travail, etc.<br />
(4) Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle (ancienne et actuelle) constituent<br />
ainsi une tranche très importante <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>, non seulement<br />
parce qu’elles donnent <strong>la</strong> représentation <strong>la</strong> plus fine du territoire (jusqu’à<br />
1:100, en général 1:500), mais aussi parce qu’elles sont à <strong>la</strong> base d’un<br />
important nombre <strong>de</strong> politiques publiques liées au territoire.<br />
(5) Le rôle du régu<strong>la</strong>teur <strong>de</strong>vient absolument fondamental, tout au long du<br />
processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle. Suivant
86 DONNEES DE LA MENSURATION OFFICIELLE<br />
notre modèle <strong>de</strong>s quatre ressources, nous constatons que les ressources<br />
« <strong>la</strong>ngage » (communication informatisée qui requiert <strong>de</strong>s règles déterminées)<br />
et « raison » (changement <strong>de</strong> mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> pensée concernant <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong><br />
l’information) prennent <strong>de</strong> plus en plus d’importance et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> maîtrise<br />
<strong>de</strong> compétences très spécifiques et techniques ; <strong>la</strong> ressource « espace &<br />
temps » <strong>de</strong>vient une question <strong>de</strong> mise en réseau électronique (dépendance du<br />
marché, à <strong>de</strong>s groupes d’acteurs publics ou privés, à d’autres politiques<br />
publiques, comme le réseau électrique) et, enfin, l’« espace public » s’é<strong>la</strong>rgit<br />
considérablement et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> nouvelles régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong><br />
l’accès.<br />
4.4.4 Complément d’information<br />
Ce chapitre a été consacré aux données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, suivant le mandat <strong>de</strong><br />
cette partie <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>. Les entretiens menés à l’Office fédéral <strong>de</strong><br />
topographie, dont <strong>la</strong> Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales fait partie, nous ont<br />
néanmoins permis <strong>de</strong> découvrir une autre tranche <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong> d’importance <strong>nationale</strong><br />
extrêmement intéressante qu’il vaut <strong>la</strong> peine <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce ici 60 .<br />
M. Pierre Gerber nous a en effet introduits dans le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s collections <strong>de</strong>s cartes<br />
géographiques, <strong>de</strong>s pierres lithographiques, <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ques <strong>de</strong> cuivre et <strong>de</strong> verre, <strong>de</strong>s photos (et<br />
négatifs) aériennes, <strong>de</strong>s images satellites et <strong>de</strong>s appareils <strong>de</strong> mensuration que l’office recèle.<br />
Tout ce matériel, conservé dans d’innombrables locaux dans les sous-sols du bâtiment <strong>de</strong><br />
Wabern, a été estimé à 170 tonnes <strong>de</strong> matériel.<br />
La collection <strong>de</strong>s cartes géographiques – qui est <strong>la</strong> plus riche et <strong>la</strong> plus importante <strong>de</strong><br />
l’institution, puisqu’elle ne comprend pas moins <strong>de</strong> 600'000 pièces – a été rassemblée à partir<br />
<strong>de</strong> 1838 au fil <strong>de</strong>s décennies en conservant toutes les cartes que l’office produisait (saufs<br />
exceptions, quelques <strong>la</strong>cunes existent) 61 . La collection se compose <strong>de</strong> toutes les cartes qui ont<br />
été et sont produites et imprimées par l’Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo ou, en Suisse<br />
ou ailleurs, par l’un·e <strong>de</strong> ses col<strong>la</strong>borateurs·trices ; elle comprend notamment <strong>la</strong> série <strong>de</strong>s<br />
cartes Dufour et celle <strong>de</strong>s cartes Siegfried, ainsi que les anciennes cartes <strong>nationale</strong>s. Il s’agit<br />
donc en gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> cartes du territoire suisse, mais aussi <strong>de</strong> pays étrangers éloignés et<br />
<strong>de</strong>s pays limitrophes.<br />
Ce patrimoine – dont l’existence à été officiellement légitimée à partir <strong>de</strong> l’entrée en<br />
vigueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale concernant l’établissement <strong>de</strong> nouvelles cartes fédérales du 21 juin<br />
1935 (RS 510. 62), qui contient à l’art. 3 une référence à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s cartes – n’est<br />
malheureusement pas directement accessible au public (sauf exceptions). Un projet <strong>de</strong><br />
numérisation <strong>de</strong>s collections historiques, qui <strong>de</strong>vrait faciliter l’accessibilité et <strong>la</strong> prise <strong>de</strong><br />
conscience <strong>de</strong> ce patrimoine, est en cours.<br />
60<br />
Se référer à Gerber Pierre, Klöti Thomas, „Die Kartensammlung <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>samtes für Lan<strong>de</strong>stopographie als<br />
Landschaftsgedächtnis <strong>de</strong>s Schweiz“, Die kartographischen Sammlungen <strong>de</strong>r Schweiz, Kartographische<br />
Schriften, Band 2, Bonn, Kirschbaum Ver<strong>la</strong>g GmbH, [à paraître en 2007].<br />
61<br />
Font exception à cette règle les cartes contenant <strong>de</strong>s informations militaires secrètes, qui sont conservées aux<br />
Archives fédérales.
4.5 Données du registre foncier<br />
[Etat en mars 2007]<br />
Nous venons <strong>de</strong> montrer comment le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition spatiale<br />
<strong>de</strong>s biens-fonds en Suisse fonctionne. Ce chapitre se propose maintenant, par le biais du<br />
registre foncier, <strong>de</strong> se pencher sur le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>s droits sur les<br />
immeubles. Pour ce faire, l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit<br />
foncier (OFRF), qui fait partie <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice (OFJ), sera utilisé comme point<br />
d’ancrage. Comme ça a été le cas pour les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, ce domaine<br />
étant très technique, complexe et traversant une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s réformes, nous le<br />
présenterons ici <strong>de</strong> manière simplifiée et sous forme complémentaire avec le chapitre<br />
précé<strong>de</strong>nt.<br />
4.5.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
Le <strong>de</strong>uxième pilier du système cadastral en Suisse est le registre foncier. Dans ce<br />
domaine, comme nous l’avons constaté pour <strong>la</strong> mensuration officielle, les tâches sont<br />
reparties sur les différents niveaux administratifs et impliquent également <strong>de</strong>s bureaux privés,<br />
qui possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s compétences spécifiques (figure 4.5.1).<br />
Données<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle /<br />
p<strong>la</strong>n du registre foncier<br />
DDPS<br />
Office fédéral <strong>de</strong> topographie<br />
Direction fédérale<br />
<strong>de</strong>s mensurations cadastrales<br />
Services cantonaux<br />
du cadastre<br />
Services communaux<br />
du cadastre (villes)<br />
Système cadastral suisse<br />
Bureaux<br />
<strong>de</strong> géomètres privés<br />
Données du<br />
registre foncier<br />
Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice<br />
Office chargé<br />
du droit du registre foncier<br />
et du droit foncier<br />
Offices cantonaux,<br />
régionaux et communaux<br />
du registre foncier<br />
Bureaux<br />
<strong>de</strong> notaires privés<br />
Fig. 4.5.1: Schéma simplifié du système cadastral en Suisse : le registre foncier. [Tiré et<br />
librement adapté <strong>de</strong> : Manuel sur l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo, Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, 2002,<br />
p. 10, fig. 1]<br />
DFJP
88 DONNEES DU REGISTRE FONCIER<br />
Que faut-il donc immatriculer au registre foncier pour déterminer les droits qui sont<br />
rattachés à <strong>de</strong>s immeubles ? Comment le système fonctionne-t-il, <strong>de</strong> quelles données est-il<br />
composé ?<br />
4.5.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Les informations qui figurent dans le registre foncier sont <strong>de</strong> nature juridique et ont force<br />
<strong>de</strong> loi. Elles garantissent <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> faire valoir les droits réels (Sachenrechte) rattachés<br />
aux immeubles ou, plus simplement dit, elles garantissent <strong>la</strong> propriété d’un bien immeuble<br />
(bene immobiliare). Il s’agit donc d’informations possédant une valeur économique très<br />
étendue et leur conservation dans le temps doit être garantie.<br />
L’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce type d’informations est notamment constatée lors<br />
<strong>de</strong>s conflits civils et <strong>de</strong>s guerres (par exemple : en Palestine) ou lors <strong>de</strong> changements <strong>de</strong><br />
régimes (par exemple : le passage <strong>de</strong> <strong>la</strong> RDA à l’actuelle République Fédérale d’Allemagne) :<br />
les registres fonciers, les p<strong>la</strong>ns cadastraux et toutes les archives qui permettent <strong>de</strong> fixer <strong>la</strong><br />
propriété <strong>de</strong>s immeubles et <strong>de</strong>s biens-fonds font souvent l’objet dans ces situations<br />
conflictuelles d’une <strong>de</strong>struction systématique. La disparition <strong>de</strong> ces informations entraîne<br />
l’anarchie non seulement dans <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété foncière, mais dans tous les domaines<br />
qui lui sont rattachés.<br />
La connaissance du fonctionnement <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> production, traitement, conservation<br />
et archivage <strong>de</strong>s données du registre foncier est donc fondamentale et indispensable.<br />
4.5.1.2 Contenu<br />
Le registre foncier fédéral, réglé aux art. 942 et sv du Co<strong>de</strong> civil suisse du 10 décembre<br />
1907 (RS 210), est un registre qui donne l’état et <strong>la</strong> portée <strong>de</strong>s droits privés sur les biens<br />
immeubles ; ceux-ci constituent son élément <strong>de</strong> base 62 , dans le sens qu’il s’agit <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus<br />
petite unité (objet) sur <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>s droits peuvent être fixés.<br />
La tenue <strong>de</strong>s registres du registre foncier n’est pas centralisée en Suisse : lorsque l’on<br />
utilise les termes <strong>de</strong> registre foncier, on se réfère donc en réalité aux différents registres gérés<br />
par les offices du registre foncier (tenus au niveau <strong>de</strong>s cantons, <strong>de</strong>s arrondissements ou <strong>de</strong>s<br />
communes) et qui peuvent présenter <strong>de</strong>s caractéristiques individuelles, mais qui tous<br />
possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s éléments communs et minimaux.<br />
L’art. 943, al. 1 CC précise quel est le contenu du registre foncier, c’est-à-dire ce qui peut<br />
être immatriculé comme immeuble au registre foncier. Il s’agit :<br />
• <strong>de</strong>s biens-fonds ;<br />
• <strong>de</strong>s droits distincts et permanents sur <strong>de</strong>s immeubles ;<br />
• <strong>de</strong>s mines ;<br />
• <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong> copropriété d’un immeuble.<br />
Tous les immeubles ne sont pas immatriculés au registre foncier (art. 944 CC) : ceux qui<br />
servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard <strong>de</strong>s droits réels dont<br />
l’inscription doit avoir lieu ou si l’immatricu<strong>la</strong>tion est prévue par <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion cantonale.<br />
Les inscriptions au registre foncier se font en règle générale sur <strong>la</strong> base d’une déc<strong>la</strong>ration<br />
écrite du propriétaire <strong>de</strong> l’immeuble sur lequel le droit <strong>de</strong> disposition s’est exercé (dépôt<br />
62 En non pas, par exemple, sur le propriétaire. Les propriétaires <strong>de</strong>s immeubles sont répertoriés dans un registre<br />
accessoire (ou sur une liste), tenu par commune ou arrondissement <strong>de</strong> registre foncier.
DONNEES DU REGISTRE FONCIER 89<br />
d’une réquisition). Les réquisitions sont fondées sur <strong>de</strong>s actes (contrats <strong>de</strong> vente, <strong>de</strong> donation,<br />
<strong>de</strong> constitution <strong>de</strong> servitu<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> partage successoral, etc.) ainsi que sur <strong>de</strong>s consentements et<br />
<strong>de</strong>s autorisations.<br />
L’art. 942, al. 2 du CC précise <strong>de</strong> quels éléments le registre foncier est composé :<br />
• le grand livre ;<br />
• le journal ;<br />
• les documents complémentaires (p<strong>la</strong>n, rôle, pièces justificatives, état <strong>de</strong>scriptif) ;<br />
C’est donc en tenant compte <strong>de</strong>s informations contenues dans ces différents types <strong>de</strong><br />
documents qu’il est possible <strong>de</strong> connaître l’état <strong>de</strong>s droits sur les immeubles, c’est-à-dire le<br />
régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété foncière qui est appliqué. Voici en quelques mots une <strong>de</strong>scription du<br />
contenu formel <strong>de</strong> ces documents :<br />
• Le grand livre (art. 945 CC) est l’élément statique du registre foncier ; il est composé<br />
<strong>de</strong> feuillets, un par immeuble. Chaque immeuble qui y figure est i<strong>de</strong>ntifié par un<br />
numéro attribué par le canton 63 et par le nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune sur lequel il se trouve.<br />
Le feuillet est composé <strong>de</strong> différentes rubriques (art. 946 CC), dans lesquelles sont<br />
portées les inscriptions concernant (art. 958 CC) :<br />
- <strong>la</strong> propriété ;<br />
- les servitu<strong>de</strong>s et les charges foncières établies en faveur <strong>de</strong> l’immeuble ou sur<br />
l’immeuble ;<br />
- les droits <strong>de</strong> gage dont l’immeuble est grevé.<br />
D’autres droits, comme les droits personnels, peuvent également être annotés au<br />
registre foncier (art. 959 CC). Il se peut que, avec l’assentiment du propriétaire,<br />
plusieurs immeubles même non contigus puissent être immatriculés sur un feuillet<br />
unique (art. 947 CC).<br />
• Le journal (art. 948 CC) est un document dynamique. Il contient les réquisitions<br />
d’inscription, qui y sont insérées à mesure qu’elles ont lieu et à <strong>la</strong> suite les unes <strong>de</strong>s<br />
autres, avec l’indication <strong>de</strong> leur auteur et leur objet. Ces réquisitions sont faites par<br />
les notaires. Le conservateur du registre foncier ne peut opérer d’inscription au<br />
registre que sur réquisition.<br />
• Les documents complémentaires : suivant l’art. 1 <strong>de</strong> l’Ordonnance sur le registre<br />
foncier (ORF) du 22 février 1910 (RS 211.432.1) pour immatriculer un immeuble au<br />
registre foncier il ne suffit pas d’ouvrir un feuillet au grand livre, il est également<br />
nécessaire <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> son tracé sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, <strong>de</strong><br />
connaître son rôle et d’établir son état <strong>de</strong>scriptif. Les pièces justificatives doivent<br />
contenir une série d’indications re<strong>la</strong>tives aux personnes du disposant et <strong>de</strong><br />
l’acquéreur (art. 13a ORF) ; elles sont c<strong>la</strong>ssées et conservées (art. 948, al. 2 CC).<br />
• Il existe en outre <strong>de</strong>ux registres accessoires dans tous les cantons (art. 108 ORF) : ce<br />
sont le registre <strong>de</strong>s propriétaires et le registre <strong>de</strong>s créanciers ; les cantons peuvent<br />
prescrire l’établissement d’autres registres.<br />
Cette brève <strong>de</strong>scription du système nous montre que le registre foncier est composé <strong>de</strong><br />
plusieurs couches d’informations qui se superposent, se complètent et sont mises en re<strong>la</strong>tion<br />
63 A l’avenir un numéro d’immeuble sera attribué également par <strong>la</strong> Confédération, ce qui évitera entre autres les<br />
problèmes <strong>de</strong> redondance (attribution d’un même numéro à <strong>de</strong>s immeubles différents se situant dans le territoire<br />
<strong>de</strong> différentes communes) et les confusions causées par les fusions <strong>de</strong> communes.
90 DONNEES DU REGISTRE FONCIER<br />
entre elles. L’ensemble <strong>de</strong> ces informations dans leur état actuel doit pouvoir être conservé<br />
afin qu’elles puissent être juridiquement reconnues.<br />
4.5.1.3 Supports<br />
Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen <strong>de</strong> l’informatique. Si les<br />
données sont traitées électroniquement, elles ne produisent <strong>de</strong>s effets juridiques que si elles<br />
sont correctement enregistrées dans le système (art. 942 CC). Suivant <strong>la</strong> distinction formelle<br />
en trois types <strong>de</strong> documents constituant le registre foncier que nous avons déterminée plus<br />
haut, les supports qui peuvent être utilisés sont les suivants :<br />
• Le grand livre – qui était historiquement un grand livre au sens propre du terme<br />
(format A3) et est <strong>de</strong>venu ensuite une superposition <strong>de</strong> feuillets fédéraux standardisés<br />
– est actuellement formellement informatisé dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s cantons. D’un point<br />
<strong>de</strong> vue juridique, son informatisation exige une base légale cantonale ainsi qu’une<br />
autorisation du Département fédéral <strong>de</strong> justice et police (art. 949a CC). Dans les<br />
cantons où l’informatisation du grand livre n’est pas encore réalisée, soit aucune<br />
démarche al<strong>la</strong>nt dans ce sens n’a été entreprise par le canton, soit l’une ou l’autre <strong>de</strong><br />
ces <strong>de</strong>ux conditions manque encore. Jusqu’ici 21 cantons ont obtenu l’autorisation<br />
d’informatiser le grand livre <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération ; tous ne l’ont néanmoins<br />
pas fait. Les cantons les plus avancés <strong>de</strong> ce point <strong>de</strong> vue sont Bâle-ville, Berne, Jura,<br />
Lucerne, Soleure et Zug. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation à l’OFRF permet <strong>de</strong> garantir une<br />
certaine uniformité dans <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong>s registres.<br />
• Le journal peut être tenu sur support informatique seulement si le grand livre est lui<br />
aussi informatisé.<br />
• Les documents complémentaires sont constitués en règle générale d’actes en papier,<br />
sauf pour les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle qui, comme nous l’avons montré au<br />
chapitre précé<strong>de</strong>nt, sont pratiquement totalement informatisés. Les pièces<br />
justificatives conservées au registre foncier, en particulier, sont <strong>de</strong>s copies conformes<br />
d’actes authentiques établis par les notaires (qui détiennent les documents originaux).<br />
Suivant l’art. 110a <strong>de</strong> l’ORF, elles peuvent faire l’objet d’une numérisation, mais les<br />
documents numérisés n’ont pas les effets juridiques du registre foncier informatisé.<br />
• Les registres accessoires peuvent être tenus sous forme <strong>de</strong> livres, <strong>de</strong> fiches ou avec<br />
l’assistance d’un ordinateur (art. 108).<br />
Si le <strong>de</strong>gré d’informatisation du registre foncier varie fortement d’un canton à l’autre,<br />
c’est justement parce que ce sont eux qui possè<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r quel est le<br />
support à utiliser. Comme nous l’avons dit, il n’y a en effet pas <strong>de</strong> registre central du registre<br />
foncier pour l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse. La Confédération est néanmoins en train <strong>de</strong> travailler à<br />
un grand projet appelé eGRIS 64 , qui constitue le concept pour une <strong>de</strong>uxième génération <strong>de</strong><br />
registre foncier informatisé. Ce système vise, à terme, à une gestion harmonisée et plus<br />
uniforme <strong>de</strong>s données du registre foncier, en donnant les orientations stratégiques du<br />
développement <strong>de</strong>s systèmes informatiques cantonaux actuels. Le but est donc d’arriver à<br />
utiliser sur tout le territoire <strong>de</strong>s systèmes informatiques compatibles qui <strong>de</strong>vraient faciliter<br />
l’échange intercantonal <strong>de</strong>s données et permettre une vision d’ensemble qui manque<br />
actuellement. eGris aura donc essentiellement une fonction <strong>de</strong> mise en réseau et <strong>de</strong><br />
coordination. L’utilisation d’un modèle <strong>de</strong> données uniforme et d’une interface standardisée<br />
pour le registre foncier en Suisse <strong>de</strong>vrait techniquement permettre <strong>la</strong> consultation et <strong>la</strong><br />
communication <strong>de</strong> tous les systèmes informatiques <strong>de</strong>s registres fonciers à l’ai<strong>de</strong> d’un même<br />
64 Se référer au site Internet http://www.egris.ch, consulté le 07 mars 2007.
DONNEES DU REGISTRE FONCIER 91<br />
outil. Par cette évolution, eGRIS vise également à une conservation facilitée <strong>de</strong>s données ainsi<br />
qu’à une reprise plus aisée pour leur archivage. L’introduction d’eGRIS prévoit d’ailleurs que<br />
l’OFRF réalise <strong>de</strong>s sauvegar<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s données sur microfiches. De même, une éventuelle<br />
migration dans un hypothétique nouveau système <strong>de</strong>vrait se faire plus facilement.<br />
4.5.1.4 Organe compétent<br />
Comme schématisé dans <strong>la</strong> figure 4.5.1, les données du registre foncier sont le résultat du<br />
travail <strong>de</strong> différents acteurs.<br />
L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) a <strong>la</strong><br />
responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce du registre foncier et du registre <strong>de</strong>s bateaux (qui n’a<br />
pas été pris en considération ici), ainsi que <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion dans ces domaines<br />
et dans celui <strong>de</strong>s droits réels immobiliers. La haute surveil<strong>la</strong>nce consiste essentiellement à<br />
veiller à <strong>la</strong> mise en œuvre uniforme du droit par le biais <strong>de</strong> directives, d’inspections et<br />
d’explications, ainsi qu’au moyen <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> recours prévues par le droit du registre<br />
foncier. Il s’agit également <strong>de</strong> fournir un appui aux cantons par <strong>de</strong>s propositions et <strong>de</strong>s<br />
conseils, notamment en ce qui concerne l’informatisation du registre foncier et<br />
l’interconnexion <strong>de</strong> celui-ci avec d’autres systèmes d’information (mensuration officielle,<br />
agriculture, aménagement du territoire).<br />
Suivant l’art. 953 CC, les cantons règlent l’organisation <strong>de</strong>s bureaux du registre foncier,<br />
<strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s arrondissements, <strong>la</strong> nomination et le traitement <strong>de</strong>s fonctionnaires ainsi que<br />
<strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce 65 ; ils sont en outre responsables pour tous les dommages qui résultent d’une<br />
tenue incorrecte du registre foncier (art. 955 CC). Les cantons d’Uri, Zoug, Nidwald, G<strong>la</strong>ris,<br />
Bâle-ville, Schaffhouse, Appenzell Rho<strong>de</strong>s-Intérieures et Genève n’ont qu’un seul office du<br />
registre foncier pour le territoire cantonal ; les autres cantons ont prévu <strong>de</strong>s arrondissements<br />
du registre foncier comprenant chacun plusieurs communes ou chacun une seule commune.<br />
Les communes municipales <strong>de</strong> Winterthur et <strong>de</strong> Zurich comptent chacune plusieurs offices du<br />
registre foncier.<br />
Les conservateurs du registre foncier, qui sont soumis à une surveil<strong>la</strong>nce régulière <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong>s cantons (art. 956 CC), peuvent être <strong>de</strong>s notaires travail<strong>la</strong>nt dans <strong>de</strong>s bureaux privés<br />
(notamment dans les cantons suisses alémaniques) ou directement pour le canton (en<br />
particulier dans les cantons <strong>la</strong>tins). Ils sont organisés en une Société Suisse <strong>de</strong>s Conservateurs<br />
du Registre Foncier (SSCRF) 66 .<br />
Enfin, un <strong>de</strong>rnier groupe d’acteurs à citer est constitué par les notaires, qui établissent<br />
notamment les pièces justificatives du registre foncier.<br />
Ainsi, comme nous l’avions constaté pour <strong>la</strong> mensuration officielle, le registre foncier est<br />
lui aussi le résultat d’un processus <strong>de</strong> travail défini dans le détail et très contrôlé, réalisé par<br />
quelques milliers <strong>de</strong> personnes. Ce spectre se trouve encore é<strong>la</strong>rgi en tenant compte <strong>de</strong>s<br />
échanges d’informations et les innombrables col<strong>la</strong>borations qui ont lieu avec les différents<br />
niveaux administratifs concernés.<br />
65 Une liste complète <strong>de</strong> tous les registres fonciers, <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce ou inspectorats cantonaux est<br />
disponible sur Internet à l’adresse http://www.registre-foncier.ch/download/adresses_GBIBA.pdf, consultée le<br />
07 mars 2007.<br />
66 Se référer au site Internet http://www.registre-foncier.ch, consulté le 07 mars 2007.
92 DONNEES DU REGISTRE FONCIER<br />
4.5.1.5 Bases légales<br />
En plus <strong>de</strong> l’Ordonnance sur <strong>la</strong> mensuration officielle (OMO) du 18 novembre 1992 (RS<br />
211.432.2) présentée dans le chapitre précé<strong>de</strong>nt, les <strong>de</strong>ux <strong>principale</strong>s bases légales qui<br />
régissent le registre foncier sont le Co<strong>de</strong> civil suisse, en particulier les art. 942 à 977, et<br />
l’Ordonnance sur le registre foncier, qui en développe les articles suivant les thèmes que<br />
voici : immatricu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s immeubles et établissement du grand livre ; réquisition, inscription<br />
au journal ; inscriptions ; délivrance <strong>de</strong>s cédules hypothécaires, <strong>de</strong>s lettres <strong>de</strong> rente et <strong>de</strong>s<br />
titres hypothécaires ; modifications et radiations, cancel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s titres ; annotations ;<br />
mentions ; observations concernant les inscriptions <strong>de</strong> gages immobiliers ; division et réunion<br />
<strong>de</strong>s immeubles, report <strong>de</strong>s inscriptions ; rectifications ; surveil<strong>la</strong>nce, recours ; extraits et<br />
renseignements ; forme du grand livre, pièces justificatives et registres accessoires ;<br />
dispositions spéciales sur <strong>la</strong> tenue du registre foncier au moyen <strong>de</strong> l’informatique ;<br />
dispositions finales et transitoires.<br />
Concernant <strong>la</strong> thématique qui nous intéresse, puisque <strong>la</strong> tenue du registre foncier est <strong>de</strong><br />
compétence cantonale, <strong>la</strong> conservation et l’archivage <strong>de</strong>s données dont il est constitué relèvent<br />
elles aussi du niveau cantonal et est réglée au moyen <strong>de</strong> directives et instructions. L’art. 110<br />
<strong>de</strong> l’Ordonnance sur le registre foncier prévoit <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s données et<br />
documents du registre foncier :<br />
Art. 110 Conservation <strong>de</strong>s livres, <strong>de</strong>s registres et <strong>de</strong>s documents du registre foncier<br />
1 Les livres et les registres, les feuillets indépendants du grand livre et les fichiers sont conservés et<br />
c<strong>la</strong>ssés soigneusement et, comme les actes servant <strong>de</strong> base aux inscriptions dans le registre, ne<br />
peuvent pas être détruits.<br />
2 Les conservateurs doivent dresser un inventaire <strong>de</strong>s registres existant dans leur bureau.<br />
L’art. 111i détermine l’obligation <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s cantons <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s<br />
données informatiques, leur sauvegar<strong>de</strong> et leur archivage :<br />
Art. 111i Disponibilité et sécurité <strong>de</strong>s données<br />
[…]<br />
2 Les données du registre foncier informatisé doivent être maintenues et sauvegardées <strong>de</strong> manière que<br />
leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données doit être garantie selon un<br />
concept cantonal répondant à <strong>de</strong>s normes reconnues et correspondant à l’état actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> technique.<br />
3 Les données tenues dans le registre foncier informatisé doivent être mises en dépôt périodiquement<br />
dans <strong>de</strong>s formats <strong>de</strong> données appropriés et conservées <strong>de</strong> manière sûre. Les données archivées<br />
doivent pouvoir être lues sans moyens informatiques auxiliaires, mais aussi pouvoir être récupérées<br />
sous forme numérique <strong>de</strong> façon automatisée. L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du<br />
droit foncier édicte <strong>de</strong>s directives sur <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> à long terme, <strong>la</strong> mise en dépôt, <strong>la</strong> conservation et<br />
l’archivage <strong>de</strong>s données du registre foncier.<br />
La manière dont ces <strong>de</strong>ux articles sont mis en application varie beaucoup d’un canton à<br />
l’autre. Il sera par conséquent intéressant d’en reprendre l’analyse dans <strong>la</strong> partie <strong>de</strong> ce mandat<br />
qui leur sera consacrée.<br />
Concernant <strong>la</strong> tenue informatisée centrale du registre foncier (suivant le projet eGRIS) il<br />
faut se référer à l’art. 949a du CC, qui attribue au Conseil fédéral un certain nombre <strong>de</strong><br />
compétences – dont <strong>la</strong> conservation et l’archivage <strong>de</strong>s données – afin <strong>de</strong> garantir une certaine<br />
uniformité au registre foncier :<br />
Art. 949a<br />
b. Tenue informatisée du registre foncier<br />
1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen <strong>de</strong> l’informatique doit obtenir une<br />
autorisation du Département fédéral <strong>de</strong> justice et police.
DONNEES DU REGISTRE FONCIER 93<br />
2<br />
Le Conseil fédéral règle:<br />
1. <strong>la</strong> procédure d’autorisation;<br />
2. l’étendue et les détails techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> tenue du registre au moyen <strong>de</strong> l’informatique, en<br />
particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;<br />
3. les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites<br />
avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;<br />
4. les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans<br />
justification d’un intérêt peuvent être mises à <strong>la</strong> disposition du public;<br />
5. l’accès aux données, l’enregistrement <strong>de</strong>s interrogations et les conditions justifiant le retrait<br />
du droit d’accès en cas d’usage abusif;<br />
6. <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données;<br />
7. <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données à long terme et leur archivage.<br />
3<br />
Le Département fédéral <strong>de</strong> justice et police ainsi que le Département fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s sports définissent <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> données et <strong>de</strong>s interfaces<br />
uniformes pour le registre foncier et pour <strong>la</strong> mensuration cadastrale.<br />
Concrètement, <strong>la</strong> conservation à long terme <strong>de</strong>s données informatiques, ainsi que leur<br />
archivage, n’est pas encore réglementée au niveau fédéral. Une révision partielle <strong>de</strong>s droits<br />
réels immobiliers et du droit du registre foncier est actuellement en cours, elle prévoit<br />
notamment <strong>la</strong> transformation du registre foncier en un système mo<strong>de</strong>rne d’informations<br />
foncières, qui sera justement effective grâce à <strong>la</strong> mise en œuvre d’eGRIS. C’est dans le cadre<br />
<strong>de</strong> cette révision que ces thématiques ont repris du poids dans les discussions et seront<br />
concrètement régulées.<br />
4.5.1.6 Coûts<br />
Il n’a pas été possible dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faire une estimation <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
conservation et <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s données du registre foncier, ceux-ci étant repartis sur un<br />
nombre important d’acteurs. Comme nous l’avons écrit dans le chapitre précé<strong>de</strong>nt, <strong>la</strong> valeur<br />
globale du parc immobilier en suisse est estimée à 2'000 milliards <strong>de</strong> francs. La valeur <strong>de</strong>s<br />
données du registre foncier ne doit donc pas être sous-estimée, car elles constituent une<br />
représentation juridique <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur effective <strong>de</strong>s biens immeubles.<br />
4.5.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
L’analyse <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> mémorisation du registre foncier est à lire en parallèle avec<br />
celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, c’est pourquoi cette <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> chapitre n’abor<strong>de</strong>ra<br />
que les éléments qui différencient les <strong>de</strong>ux domaines. En effet, non seulement les données du<br />
registre foncier se basent sur les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, mais aussi <strong>la</strong> gestion<br />
informatisée <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration se trouve à un sta<strong>de</strong> plus avancé. D’après les<br />
informations récoltées lors <strong>de</strong>s entretiens, il apparaît que <strong>la</strong> gestion informatisée du registre<br />
foncier suivra dans les gran<strong>de</strong>s lignes les mêmes structures et les mêmes systèmes déjà mis en<br />
p<strong>la</strong>ce pour <strong>la</strong> mensuration officielle.<br />
4.5.2.1 Mémorisabilité<br />
De nouveau, nous constatons que les techniques et les métho<strong>de</strong>s actuellement à<br />
disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération comme <strong>de</strong>s cantons permettent <strong>de</strong> mémoriser tout ce que l’on<br />
désire. Ce qu’il est intéressant <strong>de</strong> constater dans le cadre du registre foncier et que <strong>la</strong><br />
mémorisation <strong>de</strong>s données juridiquement va<strong>la</strong>bles se fait actuellement sur différents supports<br />
(papier, supports informatiques), qui sont mis en re<strong>la</strong>tion entre eux moyennant <strong>la</strong>
94 DONNEES DU REGISTRE FONCIER<br />
numérotation <strong>de</strong>s objets et <strong>de</strong>s opérations. En d’autres termes, une mémorisation<br />
« re<strong>la</strong>tionnelle » n’est pas possible sans l’utilisation <strong>de</strong> l’informatique ; dans les faits, elle est<br />
réalisée grâce à une définition procédurale très détaillée qui s’appuie justement sur <strong>la</strong><br />
numérotation. Alors que les procédures sont uniformes dans toute <strong>la</strong> Suisse, <strong>la</strong> numérotation<br />
(en tout cas en ce qui concerne les immeubles) ne l’est pas, ce qui peut poser problème.<br />
Les changements en cours ten<strong>de</strong>nt à l’amélioration <strong>de</strong> ces faiblesses avec d’une part une<br />
uniformisation <strong>de</strong>s numérotations et, d’autre part, <strong>la</strong> mise en réseau du registre foncier. Celleci<br />
est d’ailleurs envisageable, car l’uniformisation <strong>de</strong>s procédures est garantie en dépit d’une<br />
mise en œuvre extrêmement décentralisée et liée au territoire régional. Le rôle <strong>de</strong> l’opérateur<br />
est c<strong>la</strong>irement pris en charge par les offices du registre foncier, par les notaires et les<br />
géomètres ; le rôle du régu<strong>la</strong>teur est partagé selon le domaine entre <strong>la</strong> Confédération et les<br />
organes <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce cantonaux. Suite à l’introduction d’eGRIS, l’OFRF assumera sans<br />
doute d’autres domaines <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion, en particulier les questions <strong>de</strong> conservation et<br />
d’archivage <strong>de</strong>s données en réseau.<br />
4.5.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Les réflexions autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir ce qui est digne d’être mémorisé<br />
s’éloignent <strong>de</strong> ce que nous avons dit à propos <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle.<br />
Dans le cas du registre foncier, toutes les informations qui sont requises pour qu’une<br />
inscription soit va<strong>la</strong>ble sont dignes d’être mémorisées ; elles le sont suivant <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong><br />
c<strong>la</strong>ssement et <strong>de</strong> conservation bien déterminées. Le conservateur du registre foncier s’occupe<br />
justement <strong>de</strong> ces tâches. Ce qui paraît essentiel dans ce cadre est le lien temporel qui existe<br />
entre une information et l’immeuble auquel elle se réfère : en d’autres termes, une information<br />
doit se référer à un immeuble donné à un moment donné (art. 111b ORF).<br />
Lorsque le registre foncier est informatisé, les données sont organisées temporellement en<br />
<strong>de</strong>ux couches : les données juridiquement va<strong>la</strong>bles et les données qui ne le sont plus. Parmi<br />
celles-ci font partie les données « historiques », mais aussi celles qui ont résulté d’une erreur<br />
et qui ont fait l’objet d’une radiation, d’une modification ou d’une rectification (art. 111h<br />
ORF). Par contre, lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à<br />
l’immatricu<strong>la</strong>tion, il est éliminé du registre foncier (art. 944 CC). Les <strong>de</strong>ux couches <strong>de</strong><br />
données sont considérées comme dignes d’être mémorisées, car il est nécessaire <strong>de</strong> toujours<br />
pouvoir reconstituer l’historique d’un bien immeuble. Ainsi, d’une certaine manière, les<br />
données du registre foncier font partie <strong>de</strong>s informations qui restent toujours vivantes. Le<br />
passage à une gestion totalement informatisée <strong>de</strong> ces données, telle que le projet eGRIS<br />
l’envisage, va ultérieurement accentuer cette caractéristique.<br />
Ce changement en direction d’une informatisation générale du registre foncier et d’une<br />
mise en réseau au niveau fédéral <strong>de</strong>s données ne <strong>de</strong>vrait introduire aucun changement dans <strong>la</strong><br />
régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> ce qui est digne d’être mémorisé.<br />
4.5.2.3 Mémorisation réelle<br />
La question <strong>de</strong> l’archivage du registre foncier est actuellement encore <strong>de</strong> compétence<br />
cantonale. Les cantons doivent garantir <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong> données du registre foncier.<br />
Si l’on désire néanmoins en savoir plus sur les processus actuels <strong>de</strong> conservation et<br />
d’archivage <strong>de</strong>s données, il est indispensable <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s entretiens au niveau cantonal.<br />
Concernant eGRIS, les mêmes observations que pour les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle peuvent être faites. La mise en p<strong>la</strong>ce d’un réseau commun exige l’utilisation d’un<br />
<strong>la</strong>ngage commun qui permette <strong>de</strong> communiquer et transférer les données. Le registre foncier
DONNEES DU REGISTRE FONCIER 95<br />
utilisera comme base le <strong>la</strong>ngage INTERLIS développé pour <strong>la</strong> mensuration officielle. Une<br />
interface, qui est déjà en p<strong>la</strong>ce, sera utilisée pour l’échange <strong>de</strong> données entre le registre<br />
foncier et <strong>la</strong> mensuration officielle : il s’agit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Petite interface (Kleine Schnittstelle, KS).<br />
Les mêmes constatations déjà faites pour <strong>la</strong> mensuration officielle sont va<strong>la</strong>bles : nous<br />
constatons l’importance que les systèmes d’information sont en train d’acquérir. La tendance<br />
va vers une uniformisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> plus en plus poussée qui permet <strong>la</strong> mise en réseau<br />
<strong>de</strong> tous les registres fonciers mais pas seulement : elle peut avoir lieu avec tous les systèmes<br />
électroniques qui concernent <strong>la</strong> gestion du sol.<br />
4.5.2.4 Accessibilité<br />
La consultation du registre foncier est strictement régulée (art. 970 CC). Elle se base sur<br />
<strong>la</strong> distinction entre une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> consultation sans avoir un intérêt à justifier et une<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> qui justifie d’un intérêt. S’agissant d’un immeuble, sans avoir à justifier d’un intérêt,<br />
chacun peut apprendre (art. 106a ORF) :<br />
• sa désignation et son <strong>de</strong>scriptif ;<br />
• le nom et l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> son propriétaire ;<br />
• le type <strong>de</strong> propriété et <strong>la</strong> date d’acquisition ;<br />
• les servitu<strong>de</strong>s et charges foncières qui s’y rapportent ;<br />
• dans une certaine mesure, les mentions.<br />
Celui qui justifie d’un intérêt a en outre le droit <strong>de</strong> consulter d’autres données plus<br />
confi<strong>de</strong>ntielles du registre foncier (comme par exemple <strong>la</strong> situation hypothécaire) ou <strong>de</strong> s’en<br />
faire délivrer un extrait (art. 105 et 106 ORF). La raison <strong>de</strong> cette gran<strong>de</strong> accessibilité est<br />
juridique : au sujet <strong>de</strong> l’existence ou non <strong>de</strong> droits réels sur un immeuble, il n’est en effet pas<br />
possible d’objecter ne pas connaître une inscription au registre foncier.<br />
Sous réserve <strong>de</strong> quelques exceptions, les cantons peuvent aussi prescrire que l’acquisition<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété foncière doit en plus être publiée spécialement, par exemple dans une feuille<br />
d’avis officielle ou encore par Internet (art. 970a CC ; 111k ORF).<br />
Au contraire <strong>de</strong> ce qui se passe pour les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, <strong>la</strong> mise en<br />
réseau grâce à eGRIS <strong>de</strong>s données du registre foncier ne changera pas les règles<br />
d’accessibilité et n’é<strong>la</strong>rgira donc pas le nombre d’acteurs susceptibles d’y accé<strong>de</strong>r.<br />
Simplement, elle facilitera <strong>la</strong> communication <strong>de</strong> ces informations et permettra <strong>de</strong> les mettre en<br />
re<strong>la</strong>tion avec d’autres données <strong>de</strong> nature spatiale.<br />
4.5.3 Commentaires<br />
Ce chapitre a été rédigé sur <strong>la</strong> base d’entretiens avec Mme. Maria-Pia Portmann-Tinguely<br />
(Cheffe <strong>de</strong> projet suppléante et spécialiste du registre foncier à l’OFRF) et M. Libor F. Stoupa<br />
(Dirigeant <strong>de</strong> Stoupa & Partners AG, Beratungsgesellschaft für Betriebwirtschaft et Chef <strong>de</strong><br />
projet eGRIS & KS <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération), ainsi qu’à travers <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s bases légales et <strong>de</strong><br />
quelques documents publiés sur Internet et ayant trait aux données du registre foncier. Les<br />
conclusions qui peuvent être tirées <strong>de</strong>s observations précé<strong>de</strong>ntes sont les suivantes :<br />
(1) l’analyse <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> production et conservation <strong>de</strong>s données du registre<br />
foncier confirment le fait que certaines politiques publiques, notamment<br />
celles qui sont liées au territoire, ne peuvent être mises en œuvre que <strong>de</strong><br />
manière décentralisées et régionale. La conservation <strong>de</strong> ces informations
96 DONNEES DU REGISTRE FONCIER<br />
s’effectue donc elle aussi <strong>de</strong> manière décentralisée, ce qui a pour conséquence<br />
qu’une vision d’ensemble manque. La tendance est donc celle <strong>de</strong> vouloir<br />
réunir dans <strong>de</strong>s systèmes informatiques centralisateurs les outputs <strong>de</strong> ces<br />
politiques et, également, d’harmoniser <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong> ces banques <strong>de</strong> données<br />
afin <strong>de</strong> pouvoir les mettre en re<strong>la</strong>tion.<br />
(2) L’analyse plus rapi<strong>de</strong> qui a été faite dans ce chapitre montre que l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
processus <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s données du registre foncier doit se faire au<br />
niveau cantonal. Le fait que eGRIS se trouve dans une phase <strong>de</strong> projet et pas<br />
encore <strong>de</strong> mise en œuvre a en effet pour conséquence que les caractéristiques<br />
globales <strong>de</strong> ces processus ne sont pas très bien connues.<br />
(3) La conservation <strong>de</strong>s données du registre foncier est absolument fondamentale.<br />
La distinction entre données actuelles et données historiques, que nous avions<br />
faite pour les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, ne semble pas pertinente<br />
ici. Ceci sera néanmoins à vérifier lors <strong>de</strong>s entretiens au niveau cantonal.<br />
(4) Il apparaît que le rôle <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>teur et d’opérateur sont très bien i<strong>de</strong>ntifiables<br />
pour toutes les étapes <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> cette politique publique, sauf pour les<br />
questions <strong>de</strong> conservation et d’archivage. La division <strong>de</strong>s compétences<br />
régu<strong>la</strong>tives entre <strong>la</strong> Confédération et les cantons ne paraît pas encore très<br />
c<strong>la</strong>ire pour ce qui concerne les données informatiques. La raison en est qu’on<br />
se trouve dans une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> transition et <strong>de</strong> réformes.<br />
(5) Suivant notre modèle d’analyse basé sur <strong>la</strong> prise en considération <strong>de</strong>s<br />
ressources, les mêmes remarques faites pour <strong>la</strong> mensuration officielle sont<br />
va<strong>la</strong>bles pour les trois premières : les ressources « <strong>la</strong>ngage » (communication<br />
informatisée requérant <strong>de</strong>s règles déterminées) et « raison » (changement <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> pensée concernant <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’information) prennent <strong>de</strong> plus en<br />
plus d’importance et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> maîtrise <strong>de</strong> compétences spécifiques et<br />
techniques ; <strong>la</strong> ressource « espace & temps » <strong>de</strong>vient une question <strong>de</strong> mise en<br />
réseau électronique. Par contre, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « espace public » ne<br />
<strong>de</strong>vrait pas varier avec les changements en cours.
4.6 Données <strong>de</strong> l’état civil<br />
[Etat en janvier 2007]<br />
Outre l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, d’autres<br />
offices faisant partie <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> justice (OFJ) gèrent les données à caractère<br />
juridique dont ils sont responsables suivant <strong>de</strong>s processus qui diffèrent <strong>de</strong> ceux utilisés dans le<br />
reste <strong>de</strong> l’OFJ 67 . Il s’agit – en plus <strong>de</strong> l’Office du registre du commerce, qui ne sera pas étudié<br />
dans ce cadre 68 – <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil et du Casier judiciaire suisse. Nous allons<br />
ainsi nous intéresser aux processus <strong>de</strong> production, <strong>de</strong> traitement et <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s<br />
données substantielles <strong>de</strong> ces offices : les données <strong>de</strong> l’état civil seront étudiées dans ce<br />
chapitre 4.6, les données du casier judiciaire dans le chapitre 4.7.<br />
4.6.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
Comme tout un chacun le sait, les faits d’état civil qui rythment <strong>la</strong> vie personnelle <strong>de</strong> tout<br />
individu sont confiés dans les différents registres <strong>de</strong> l’état civil. Ces informations doivent être<br />
enregistrées et conservées afin que les événements auxquels elles se réfèrent soient<br />
juridiquement reconnus et transmis dans le temps. Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong><br />
l’information et suivant notre terminologie, c’est à travers ces registres que les informations<br />
sont donc mémorisées à long terme. Or, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> ces registres a subi une révolution il y a<br />
quelques années : elle a en effet été totalement informatisée et, grâce à ce<strong>la</strong>, mise en réseau.<br />
Les données <strong>de</strong> l’état civil constituent ainsi un bon exemple pour montrer dans quelle<br />
mesure l’utilisation <strong>de</strong>s nouvelles possibilités technologiques transforment les processus <strong>de</strong><br />
conservation <strong>de</strong> l’information et, par là, pose <strong>de</strong> nouveaux défis en matière d’archivage. Ce<br />
chapitre se propose <strong>de</strong> décrire cette révolution et <strong>de</strong> réfléchir aux enjeux qu’elle pose.<br />
4.6.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Les données <strong>de</strong> l’état civil représentent <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> officielle <strong>de</strong> l’état civil <strong>de</strong>s personnes.<br />
Leur gestion et officialisation au moyen <strong>de</strong> différents registres est très ancienne.<br />
Traditionnellement, elles étaient gérées et tenues à jour par <strong>de</strong>s ecclésiastiques à l’échelle <strong>de</strong>s<br />
paroisses ; en Suisse cette tâche a été attribuée à <strong>de</strong>s <strong>la</strong>ïcs à partir <strong>de</strong> 1876. Dès lors, les faits<br />
directement liés à une personne (naissance, mariage, décès, etc.), son statut personnel et<br />
familial (majorité, filiation, lien matrimonial, etc.), ses noms, ses droits <strong>de</strong> cité cantonaux et<br />
communaux ainsi que sa nationalité doivent être inscrits dans <strong>de</strong>s registres gérés par les<br />
offices d’état civil compétents quant au lieu <strong>de</strong> l’événement.<br />
Cet enregistrement à l’état civil <strong>de</strong>s informations sur l’état <strong>de</strong>s personnes a une force<br />
probante et est d’une importance fondamentale, que ce soit du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’individu ou<br />
<strong>de</strong> l’Etat. En tout premier lieu, il attribue une i<strong>de</strong>ntité à <strong>la</strong> personne, c’est-à-dire qu’il<br />
reconnaît son existence. En <strong>de</strong>uxième lieu, il fait en sorte que <strong>la</strong> société reconnaisse<br />
l’événement qui a eu lieu et, par là, qu’elle en tienne compte. Cette reconnaissance <strong>de</strong><br />
l’individu et <strong>de</strong> l’événement qui est enregistré se manifeste par l’attribution <strong>de</strong> toute une série<br />
<strong>de</strong> droits – mais aussi <strong>de</strong> <strong>de</strong>voirs – essentiels dans <strong>la</strong> vie d’une personne : ce sont tous les<br />
67 Les données et les documents <strong>de</strong>s différents offices <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice sont gérés suivant <strong>de</strong>ux<br />
systèmes distincts, le système VOSTRA et le système PAGIRUS. Les quatre offices cités font exception.<br />
68 Les données produites par l’Office du registre du commerce faisaient partie <strong>de</strong>s exemples à étudier dans le<br />
cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, mais <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’entretien qui a été formulée à son encontre a été écartée.
98 DONNEES DE L’ETAT CIVIL<br />
droits civils reconnus par le Co<strong>de</strong> civil 69 , à savoir les droits qui fon<strong>de</strong>nt un état démocratique.<br />
En outre, <strong>de</strong> très nombreuses politiques publiques utilisent les données <strong>de</strong> l’état civil comme<br />
élément <strong>de</strong> base pour leur mise en œuvre : le contrôle <strong>de</strong>s habitants et <strong>de</strong>s étrangers en<br />
particulier, mais aussi <strong>la</strong> formation obligatoire, le système <strong>de</strong> l’AVS, <strong>de</strong> l’AI ou celui <strong>de</strong>s<br />
assurances ma<strong>la</strong>die, le recrutement à l’armée, etc. sont quelques exemples parmi tant d’autres<br />
<strong>de</strong> politiques publiques qui ne pourraient pas fonctionner autrement.<br />
C’est ainsi que les données <strong>de</strong> l’état civil constituent un ancrage fondamental pour <strong>la</strong> vie<br />
<strong>de</strong> tout un chacun. Elles sont tout d’abord <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie civile <strong>de</strong>s personnes, elles<br />
permettent ensuite <strong>de</strong> reconstituer <strong>la</strong> composition d’une famille en remontant même sur<br />
plusieurs centaines d’années et d’effectuer <strong>de</strong>s analyses généalogiques. Leur conservation doit<br />
alors être impérativement assurée, ceci pour une durée <strong>de</strong> temps aussi longue que possible.<br />
4.6.1.2 Contenu<br />
Il existe <strong>de</strong>s règles bien précises qui déterminent quelles sont les données <strong>de</strong> l’état civil<br />
qui doivent être enregistrées, ainsi que comment et par qui cette tâche doit être réalisée. Du<br />
point <strong>de</strong> vue du contenu, c’est l’art. 7, al. 2 <strong>de</strong> l’Ordonnance sur l’état civil (OEC) du 28 avril<br />
2004 (RS 211.112.2) qui précise quelles sont les données sur lesquelles l’enregistrement<br />
porte. Les voici :<br />
a. Naissance ;<br />
b. Enfant trouvé ;<br />
c. Décès ;<br />
d. Décès d’une personne non-i<strong>de</strong>ntifiée ;<br />
e. Déc<strong>la</strong>ration concernant le nom ;<br />
f. Reconnaissance d’un enfant ;<br />
g. Droit <strong>de</strong> cité ;<br />
h. Préparation du mariage ;<br />
i. Mariage ;<br />
j. Dissolution du mariage ;<br />
k. Changement <strong>de</strong> nom ;<br />
l. Lien <strong>de</strong> filiation ;<br />
m. Adoption ;<br />
n. Déc<strong>la</strong>ration d’absence ;<br />
o. Changement <strong>de</strong> sexe ;<br />
p. Préparation <strong>de</strong> l’enregistrement du partenariat ;<br />
q. Enregistrement du partenariat ;<br />
r. Dissolution du partenariat.<br />
L’art. 8 précise ensuite que dans le registre <strong>de</strong> l’état civil (au sens <strong>la</strong>rge) sont enregistrées<br />
plus précisément les données suivantes :<br />
a. Données propres au système :<br />
1. Numéros d’ordre dans le système,<br />
2. Type d’inscription,<br />
3. Statut <strong>de</strong> l’inscription,<br />
4. Listes (communes, arrondissements <strong>de</strong> l’état civil, Etats, adresses);<br />
b. Numéro d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s personnes ;<br />
c. Noms :<br />
69<br />
Co<strong>de</strong> civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210), en particulier le livre premier (droit <strong>de</strong>s personnes) et le livre<br />
<strong>de</strong>uxième (droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille).
DONNEES DE L’ETAT CIVIL 99<br />
1. Nom <strong>de</strong> famille,<br />
2. Nom avant le premier mariage,<br />
3. Prénoms,<br />
4. Autres noms officiels;<br />
d. Sexe ;<br />
e. Naissance :<br />
1. Date,<br />
2. Heure,<br />
3. Lieu,<br />
4. Naissance d’un enfant mort-né ;<br />
f. Etat civil :<br />
1. Statut (célibataire – marié/divorcé/veuf/non marié – lié par un<br />
partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous<br />
judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite<br />
<strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration d’absence),<br />
2. Date ;<br />
g. Décès :<br />
1. Date,<br />
2. Heure,<br />
3. Lieu ;<br />
h. Domicile ;<br />
i. Lieu <strong>de</strong> séjour ;<br />
j. Statut <strong>de</strong> vie ;<br />
k. Tutelle ;<br />
l. Parents :<br />
1. Nom <strong>de</strong> famille <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère,<br />
2. Prénoms <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère,<br />
3. Autres noms officiels <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère,<br />
4. Nom <strong>de</strong> famille du père,<br />
5. Prénoms du père,<br />
6. Autres noms officiels du père;<br />
m. Parents adoptifs :<br />
1. Nom <strong>de</strong> famille <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère adoptive,<br />
2. Prénoms <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère adoptive,<br />
3. Autres noms officiels <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère adoptive,<br />
4. Nom <strong>de</strong> famille du père adoptif,<br />
5. Prénoms du père adoptif,<br />
6. Autres noms officiels du père adoptif;<br />
n. Droit <strong>de</strong> cité/nationalité :<br />
1. Date (va<strong>la</strong>ble dès le/va<strong>la</strong>ble jusqu’au),<br />
2. Motif <strong>de</strong> l’acquisition,<br />
3. Annotation concernant le motif <strong>de</strong> l’acquisition,<br />
4. Motif <strong>de</strong> <strong>la</strong> perte,<br />
5. Annotation concernant le motif <strong>de</strong> <strong>la</strong> perte,<br />
6. Référence au registre <strong>de</strong>s familles,<br />
7. Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;<br />
o. Données afférentes aux re<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> famille :<br />
1. Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)<br />
2. Date (va<strong>la</strong>ble dès le/va<strong>la</strong>ble jusqu’au),<br />
3. Motif <strong>de</strong> <strong>la</strong> dissolution.
100 DONNEES DE L’ETAT CIVIL<br />
La lecture <strong>de</strong> ces listes nous permet <strong>de</strong> constater que les données <strong>de</strong> l’état civil sont<br />
composées <strong>de</strong> couches d’informations qui se superposent : elles donnent tout d’abord les<br />
informations d’état civil sur <strong>la</strong> personne (nom, nom <strong>de</strong> célibataire, prénoms, sexe ; date et lieu<br />
<strong>de</strong> naissance, lieux d’origine, filiation, statut matrimonial) et, ensuite, les informations<br />
concernent les événements d’état civil qui ont eu lieu (naissance, mariages, décès, etc.), ainsi<br />
que les décisions judiciaires et administratives concernant l’état civil (divorce, changement <strong>de</strong><br />
nom, etc.). En effet, toute procédure d’enregistrement d’un fait implique au préa<strong>la</strong>ble<br />
l’enregistrement <strong>de</strong> l’état civil <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne concernée (art. 15, al. 2). Par l’utilisation <strong>de</strong>s<br />
termes « données <strong>de</strong> l’état civil » nous désignons ainsi l’ensemble <strong>de</strong>s différentes couches<br />
d’informations <strong>de</strong>vant, par force <strong>de</strong> loi, être inscrites à l’état civil.<br />
Les données <strong>de</strong> l’état civil sont enregistrées sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> pièces justificatives que les<br />
cantons doivent sauvegar<strong>de</strong>r <strong>de</strong> manière appropriée (art. 31) ; elles doivent être conservées<br />
pendant 50 ans, à moins qu’elles soient copiées sur un autre support : dans ce cas, elles<br />
peuvent être détruites après 10 ans (art. 32).<br />
4.6.1.3 Supports<br />
Dans le domaine <strong>de</strong> l’état civil, l’année 2004 restera dans les esprits comme <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
ayant marqué un changement radical dans <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil. En effet,<br />
avant cette année butoir, les données <strong>de</strong> l’état civil étaient gérées <strong>de</strong> manière totalement<br />
décentralisée. Elles étaient systématiquement enregistrées dans différents registres, sur<br />
support papier, organisés par événement :<br />
• le registre <strong>de</strong>s naissances,<br />
• le registre <strong>de</strong>s décès,<br />
• le registre <strong>de</strong>s mariages et<br />
• le registre <strong>de</strong>s reconnaissances.<br />
Ces registres – qui, comme nous le verrons, existent toujours – étaient tenus par les<br />
offices <strong>de</strong> l’état civil compétents, au niveau local (dans les communes ou, <strong>de</strong> plus en plus<br />
souvent, au niveau <strong>de</strong>s arrondissements ou <strong>de</strong>s régions) : les inscriptions s’effectuaient en<br />
effet au lieu <strong>de</strong> survenance <strong>de</strong> l’événement. Leur tenue permettait à tout individu directement<br />
concerné par l’information d’obtenir un extrait ou une confirmation <strong>de</strong> l’état civil afin <strong>de</strong> faire<br />
valoir ses droits et <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> citoyen. En plus <strong>de</strong> ces quatre registres thématiquement<br />
indépendants, un cinquième registre rassemble toutes ces informations : le registre <strong>de</strong>s<br />
familles. Celui-ci – qui a été créé sur <strong>la</strong> base du registre <strong>de</strong>s bourgeois, institué en Suisse en<br />
1650 – est tenu par l’office <strong>de</strong> l’état civil du lieu d’origine <strong>de</strong>s citoyens suisses et a <strong>la</strong> fonction<br />
d’un registre collecteur, c’est-à-dire d’un registre où sont transcrits tous les événements d’état<br />
civil ainsi que les décisions judiciaires et administratives concernant l’état civil. Ce système<br />
<strong>de</strong>s registres impliquait un échange parfois <strong>la</strong>borieux <strong>de</strong> données entre les quatre registres<br />
spéciaux et le registre <strong>de</strong>s familles.<br />
Or, <strong>de</strong>puis le <strong>de</strong>uxième semestre <strong>de</strong> 2004, les données <strong>de</strong> l’état civil sont centralisées<br />
pour toute <strong>la</strong> Suisse grâce à un seul registre informatisé – c’est-à-dire une banque <strong>de</strong> données<br />
centrale – baptisé INFOSTAR et é<strong>la</strong>boré <strong>de</strong>puis 1997. Cette banque <strong>de</strong> données a été mise sur<br />
pieds par l’Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil dans le but <strong>de</strong> mettre en réseau <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données<br />
et d’éliminer les doublons (enregistrement au lieu <strong>de</strong> survenance <strong>de</strong> l’événement et<br />
enregistrement au lieu d’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille). Ainsi, les événements d’état civil qui ont lieu à<br />
partir <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> sont désormais enregistrés uniquement dans <strong>la</strong> nouvelle banque <strong>de</strong><br />
données. Les quatre registres spéciaux ne font plus l’objet <strong>de</strong> nouvelles inscriptions, sauf pour
DONNEES DE L’ETAT CIVIL 101<br />
<strong>de</strong>s exceptions 70 . Le registre <strong>de</strong>s familles continue pour le moment à être tenu, il sert <strong>de</strong> base à<br />
<strong>la</strong> nouvelle banque <strong>de</strong> données. Celle-ci fonctionne comme les registres conventionnels : le<br />
seul changement significatif du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> l’information est le passage<br />
d’un système organisé en fonction <strong>de</strong>s familles à un système structuré en fonction <strong>de</strong>s<br />
individus (figure 4.6.1). En effet, les fiches du registre <strong>de</strong>s familles étaient organisées sur <strong>la</strong><br />
base du père <strong>de</strong> famille ; INFOSTAR marque ainsi le passage à une mentalisé qui n’est plus<br />
patriarcale et qui respecte le principe d’égalité entre hommes et femmes : chaque individu y<br />
est inscrit séparément et y est traité <strong>de</strong> manière i<strong>de</strong>ntique, sur <strong>la</strong> base d’une même hiérarchie.<br />
Des liens entre les différents masques informatiques permettent ensuite d’avoir un aperçu <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong>s liens familiaux qui relient les individus.<br />
Indications tenues par famille: Indications tenues par individu:<br />
Monsieur XY<br />
Enfant 1<br />
Femme<br />
Feuillet<br />
Monsieur XY<br />
Enfant XY<br />
Madame XY<br />
Feuillet Feuillet<br />
Feuillet<br />
Fig. 4.6.1 : Représentation schématique d’un système tenu en fonction <strong>de</strong>s familles et d’un<br />
système organisé par individu, comme c’est le cas pour INFOSTAR.<br />
Comme nous l’expliquerons <strong>de</strong> manière plus détaillée dans <strong>la</strong> partie analytique <strong>de</strong> ce<br />
chapitre, il est important <strong>de</strong> comprendre que les registres conventionnels et <strong>la</strong> banque <strong>de</strong><br />
données INFOSTAR sont <strong>de</strong>stinés à coexister encore pour <strong>de</strong> nombreuses décennies. Les<br />
événements <strong>de</strong> l’état civil qui auront lieu dans le siècle à venir concerneront en effet pendant<br />
encore un bon bout <strong>de</strong> temps <strong>de</strong>s personnes qui sont toujours en vie ou dont les liens<br />
familiaux doivent être tenus en considération. Les anciens registres conservent par conséquent<br />
toute leur utilité et valeur juridiques.<br />
Alors que l’activation <strong>de</strong>s registres conventionnels par <strong>la</strong> réalisation d’extraits se réduira<br />
au fur et à mesure que le temps passe, INFOSTAR est au contraire <strong>de</strong>stinée à être <strong>de</strong> plus en<br />
plus activée et, aussi, à s’enrichir <strong>de</strong> données. Jusqu’à présent, il a été estimé qu’environ 4,3<br />
millions <strong>de</strong> personnes ont été saisies dans le système : chacune <strong>de</strong> ces saisies comprend<br />
différentes couches d’informations et donc <strong>de</strong> masques, suivant les événements qui ont<br />
70 Les inscriptions qui sont encore faites dans les registres conventionnels sont re<strong>la</strong>tivement rares. Elles<br />
concernent en particulier le registre <strong>de</strong>s naissances. Un exemple : <strong>la</strong> reconnaissance en 2006 d’un fils né en 1995<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> son père (qui n’est pas marié à <strong>la</strong> mère <strong>de</strong> l’enfant) doit figurer dans l’acte <strong>de</strong> naissance et, par<br />
conséquent, elle doit être inscrite dans le registre <strong>de</strong>s naissances car <strong>la</strong> reconnaissance d’un enfant a un effet<br />
rétroactif.
102 DONNEES DE L’ETAT CIVIL<br />
marqué les existences <strong>de</strong>s personnes. L’accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données avait lieu<br />
re<strong>la</strong>tivement lentement au début <strong>de</strong> l’introduction du système, car il y avait un apprentissage à<br />
faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s officiers d’état civil responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie ; il est <strong>de</strong>stiné à s’accélérer<br />
dans les prochains mois, puis à se stabiliser. Son accroissement dans les prochaines années<br />
sera continuel dans le temps et dépendra d’une part <strong>de</strong>s événements d’état civil ayant lieu sur<br />
le territoire helvétique et, d’autre part, <strong>de</strong>s événements touchant les suisses à l’étranger. Il ne<br />
faut pas oublier en effet que les événements <strong>de</strong> l’état civil doivent être enregistrés pour toute<br />
personne se trouvant en sol helvétique, qu’elle soit suisse ou étrangère. Le nombre <strong>de</strong><br />
transactions actuellement enregistrées dans le système est <strong>de</strong> 7,5 millions. Pour les raisons<br />
expliquées, il est par contre extrêmement difficile d’en quantifier l’accroissement : on estime<br />
qu’en moyenne une personne est susceptible <strong>de</strong> subir 4 à 5 transactions (à savoir <strong>de</strong>s<br />
événements <strong>de</strong> l’état civil).<br />
Ainsi, grâce à ce nouveau système informatique, les données <strong>de</strong> l’état civil sont<br />
désormais raccordées pour l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse : <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données est exploitée par <strong>la</strong><br />
Confédération au nom <strong>de</strong>s cantons, mais <strong>la</strong> saisie <strong>de</strong>s données s’effectue toujours <strong>de</strong> manière<br />
décentralisée, <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière que pour les registres conventionnels. La gestion<br />
informatique du système INFOSTAR est assurée par le Centre <strong>de</strong> service informatique (CSI)<br />
du Département fédéral <strong>de</strong> justice et police sur mandant <strong>de</strong> l’OFJ : c’est ce service qui doit<br />
garantir <strong>la</strong> conservation et <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s données et qui, par conséquent, doit prendre toutes<br />
les mesures nécessaires à remplir ce mandat. Les données sont conservées sur <strong>de</strong>ux serveurs<br />
séparés, ce qui signifie qu’elles existent toutes en double copie. Néanmoins, il n’existe plus <strong>de</strong><br />
copies analogiques <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil, alors qu’auparavant, en tant que registre<br />
collecteur, le registre <strong>de</strong>s familles était microfilmé tous les dix ans. Cependant, les pièces<br />
justificatives à <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’inscription sont conservées pendant 50 ans.<br />
En conclusion, il apparaît qu’avec le temps INFOSTAR est <strong>de</strong>stinée à <strong>de</strong>venir le seul<br />
support <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil. Au fur et à mesure que les décennies<br />
s’écouleront, les registres conventionnels glisseront d’une fonction juridique vers une<br />
fonction purement historique et <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong>. Il est donc indispensable <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s mesures<br />
qui assurent <strong>de</strong> manière inconditionnelle le fonctionnement et <strong>la</strong> perpétuité <strong>de</strong>s informations<br />
enregistrées <strong>de</strong> manière uniquement électronique.<br />
4.6.1.4 Organe compétent<br />
Le système <strong>de</strong> l’état civil en Suisse s’organise selon une répartition <strong>de</strong>s tâches sur les<br />
différents niveaux administratifs (figure 4.6.2).<br />
L’Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil (OFEC) fait partie <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> justice (OFJ),<br />
soumis au Département fédéral <strong>de</strong> justice et police (DFJP). Suivant l’art. 84, al. 1 <strong>de</strong> l’OEC,<br />
l’OFEC est l’organe <strong>de</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l’état civil. En tant que tel, il est autorisé à régler<br />
certaines affaires <strong>de</strong> manière autonome : il s’agit <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration d’instructions concernant <strong>la</strong><br />
tenue <strong>de</strong>s registres <strong>de</strong> l’état civil, les formules à utiliser, <strong>la</strong> procédure préparatoire et <strong>la</strong><br />
célébration du mariage, <strong>la</strong> procédure préliminaire et l’enregistrement du partenariat ainsi que<br />
<strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s registres et <strong>de</strong>s pièces justificatives (al. 3, let. a) ; l’inspection <strong>de</strong>s offices <strong>de</strong><br />
l’état civil, <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce et <strong>de</strong>s archives cantonales <strong>de</strong> l’état civil (al. 3, let. b);<br />
l’échange et l’obtention <strong>de</strong> documents d’état civil (al. 3, let. c), notamment avec les<br />
représentations <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse à l’étranger ainsi qu’avec les autorités et services étrangers (al. 4).<br />
La surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l’état civil s’exerce au niveau cantonal (art. 84, al. 2) ; plusieurs<br />
cantons peuvent prévoir une répartition <strong>de</strong>s tâches entre eux et unir leurs autorités <strong>de</strong><br />
surveil<strong>la</strong>nce en entente avec l’OFEC. La Conférence <strong>de</strong>s autorités cantonales <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce<br />
<strong>de</strong> l’état civil regroupe les représentants <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> l’état civil au niveau cantonal.
DONNEES DE L’ETAT CIVIL 103<br />
Les exécutants (c’est-à-dire les opérateurs) <strong>de</strong> l’état civil sont les Offices <strong>de</strong> l’état civil,<br />
qui sont inspectés tous les <strong>de</strong>ux ans au moins ; suite à ces inspections, les autorités <strong>de</strong><br />
surveil<strong>la</strong>nces présentent un rapport à l’OFEC (art. 85). Les Offices <strong>de</strong> l’état civil, qui<br />
existaient dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s communes et qui étaient par conséquent extrêmement<br />
nombreux, sont <strong>de</strong> plus en plus souvent regroupés dans <strong>de</strong>s arrondissements <strong>de</strong> l’état civil<br />
définis par les cantons 71 .<br />
Il existe en outre une Commission fédérale pour les questions <strong>de</strong> l’état civil (art. 88), qui<br />
conseille les autorités fédérales dans l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce et qui peut être<br />
consultée notamment pour <strong>de</strong>s questions liées aux domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
légis<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>s questions techniques concernant l’exploitation et le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
banque <strong>de</strong> données centrale. Cette commission est composée du chef <strong>de</strong> l’OFEC, <strong>de</strong> trois à<br />
cinq représentants <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce et d’autant <strong>de</strong> représentants <strong>de</strong>s Offices <strong>de</strong><br />
l’état civil.<br />
Système <strong>de</strong> l’état civil<br />
DFJP<br />
Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice<br />
Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil<br />
Autorités cantonales <strong>de</strong><br />
surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l’état civil<br />
Offices <strong>de</strong> l’état civil<br />
Données <strong>de</strong><br />
l’état civil<br />
Commission fédérale<br />
pour les questions <strong>de</strong><br />
l’état civil<br />
Fig. 4.6.2 : Schéma simplifié du système <strong>de</strong> l’état civil.<br />
En Suisse, l’inscription <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil doit donc être faite par un officier<br />
spécialisé. L’entrée en vigueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> version révisée <strong>de</strong> l’OEC a correspondu, en plus <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mise en oeuvre <strong>de</strong> INFOSTAR, à une professionnalisation <strong>de</strong> l’état civil : les officiers <strong>de</strong><br />
l’état civil doivent en effet travailler désormais à un taux minimal d’occupation fixé à 40%<br />
(art. 1, al. 1) et, outre l’obligation <strong>de</strong> détenir <strong>la</strong> nationalité suisse et d’avoir l’exercice <strong>de</strong>s<br />
droits civils déjà obligatoires auparavant, possé<strong>de</strong>r le certificat fédéral d’officier <strong>de</strong> l’état civil<br />
(art. 4, al. 3). Les officiers <strong>de</strong> l’état civil sont représentés par l’Association suisse <strong>de</strong>s officiers<br />
<strong>de</strong> l’état civil.<br />
L’état civil, comme <strong>de</strong> nombreuses autres politiques publiques en Suisse, fonctionne donc<br />
suivant une structure pyramidale. Il existe à l’heure actuelle (début 2007) en Suisse environ<br />
250 services et offices <strong>de</strong> l’état civil (niveau cantonal et local), où travaillent en moyenne<br />
entre 4 et 5 personnes à différents taux d’emplois : il s’agit en tout d’environ 1200 officiers <strong>de</strong><br />
71 Le site Interne <strong>de</strong> l’OFEC met à disposition une liste complète <strong>de</strong>s arrondissements <strong>de</strong> l’état civil en Suisse à<br />
l’adresse http://www.infostar.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/zivilstand/dokumentation.html consultée<br />
le 07 mars 2007.
104 DONNEES DE L’ETAT CIVIL<br />
l’état civil. Ce chiffre est néanmoins <strong>de</strong>stiné à diminuer sensiblement, d’une part parce que <strong>la</strong><br />
tendance est <strong>de</strong> regrouper les offices au niveau régional et d’autre part parce que <strong>la</strong> mise sur<br />
pieds <strong>de</strong> INFOSTAR réduira ultérieurement les besoins en personnel. A l’Office fédéral <strong>de</strong><br />
l’état civil à Berne 12 personnes sont engagées ; en plus <strong>de</strong> celles-ci, <strong>de</strong>s informaticiens·nes<br />
du CSI-DFJP sont également impliqués dans les processus qui assurent le fonctionnement<br />
technique d’INFOSTAR.<br />
L’enregistrement <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil n’est en outre possible que sur <strong>la</strong> base d’un<br />
certain nombre <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borations, qui sont essentiellement <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux natures : l’enregistrement<br />
<strong>de</strong> données <strong>de</strong> l’état civil à l’étranger et les communications officielles. Les représentations <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Suisse à l’étranger (art. 5) col<strong>la</strong>borent à l’enregistrement <strong>de</strong> l’état civil <strong>de</strong> même qu’à <strong>la</strong><br />
procédure <strong>de</strong> préparation <strong>de</strong>s mariages et <strong>de</strong> l’enregistrement <strong>de</strong>s partenariats. Les<br />
communications officielles (art. 40 à 43) sont celles que certaines autorités doivent faire à<br />
l’autorité <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l’état civil. Comme nous le verrons plus loin, il s’agit notamment<br />
<strong>de</strong>s autorités judiciaires (qui communiquent par exemple <strong>de</strong>s jugements <strong>de</strong> constatation ou<br />
déc<strong>la</strong>ratifs) et <strong>de</strong>s autorités administratives (qui communiquent <strong>de</strong>s décisions).<br />
4.6.1.5 Bases légales<br />
Outre les articles constitutionnels concernant l’état civil 72 , les <strong>principale</strong>s bases légales<br />
sur lesquelles l’état civil se fon<strong>de</strong> sont les suivantes 73 :<br />
• le Co<strong>de</strong> Civil Suisse (CC) du 10 décembre 1907 (RS 210) notamment les art. 33 à 39<br />
et 39 à 49, ainsi que les art. 90 et ss. ;<br />
• l’Ordonnance sur l’état civil (OEC) du 28 avril 2004 (RS 211.112.2) ;<br />
• et l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) du 27 octobre<br />
1999 (RS 172.042.110).<br />
L’introduction du registre informatisé <strong>de</strong> l’état civil a impliqué une modification du<br />
chapitre consacré aux actes <strong>de</strong> l’état civil dans le Co<strong>de</strong> Civil Suisse (chapitre II, art. 39 à 49),<br />
modification en vigueur <strong>de</strong>puis le 1 er juillet 2004. Ainsi, il est désormais affirmé à l’art. 39, al.<br />
1 que l’état civil est constaté par <strong>de</strong>s registres électroniques ; l’art. 45a prévoit l’exploitation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération d’une banque <strong>de</strong> données centrale pour les cantons (al. 1), qui<br />
doivent en assurer le financement en fonction du nombre d’habitants (al. 2).<br />
Toujours dans le cadre <strong>de</strong> ces changements liés à INFOSTAR, l’Ordonnance sur l’état<br />
civil (OEC) a subi une révision totale. Les démarches d’inscription à l’état civil ayant été<br />
simplifiées et <strong>la</strong> charge d’officier d’état civil professionnalisée, l’ordonnance a été raccourcie<br />
<strong>de</strong> moitié : ses contenus se limitent désormais essentiellement à <strong>de</strong>s principes. Ainsi, elle<br />
détermine tout d’abord les dispositions générales <strong>de</strong> l’état civil, quel est l’objet et les<br />
procédures <strong>de</strong> l’enregistrement, quelles sont les obligations d’annoncer, les communications<br />
officielles, les règles <strong>de</strong> divulgation <strong>de</strong>s données, les procédures <strong>de</strong> préparation du mariage et<br />
<strong>de</strong> sa célébration, les procédures préliminaires et l’enregistrement du partenariat, les<br />
procédures <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce, <strong>la</strong> procédure et voies du droit ; elle se clôt sur les dispositions<br />
pénales et finales. En plus <strong>de</strong>s chapitres cités, elle consacre spécifiquement le chapitre 8 à <strong>la</strong><br />
72 Constitution fédérale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), art. 7 (Dignité humaine), 14<br />
(Droit au mariage et à <strong>la</strong> famille), 37 (Nationalité et droits <strong>de</strong> cité), 38 (Acquisition et perte <strong>de</strong> <strong>la</strong> nationalité et<br />
<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> cité) et 122 (Droit civil).<br />
73 Le site Internet <strong>de</strong> l’OFEC donne le détail complet <strong>de</strong> toutes les bases légales que, dans le cadre <strong>de</strong> leur<br />
activité, les autorités <strong>de</strong> l’état civil appliquent (droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse, droit international et pratique <strong>de</strong> l’OFEC :<br />
http://www.infostar.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/zivilstand/rechtliche_grund<strong>la</strong>gen.html, consultée le<br />
08 mars 2007.
DONNEES DE L’ETAT CIVIL 105<br />
banque <strong>de</strong> données centrale INFOSTAR (organes responsables, financement, col<strong>la</strong>boration<br />
avec les cantons, protection et sécurité <strong>de</strong>s données).<br />
Enfin, un autre changement intéressant et significatif en re<strong>la</strong>tion directe avec l’état civil<br />
est à signaler : l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur le partenariat<br />
enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart) du 18 juin 2004 (RS<br />
211.231), qui correspond dans les fait à l’augmentation <strong>de</strong>s événements d’état civil<br />
susceptibles d’être enregistrés.<br />
Concernant le thème qui nous intéresse plus spécifiquement, on peut dire que <strong>la</strong><br />
conservation et l’archivage <strong>de</strong>s informations se font suivant <strong>de</strong>ux processus distincts. La<br />
conservation <strong>de</strong>s registres <strong>de</strong> l’état civil est <strong>de</strong> compétence cantonale. Ceux-ci se trouvent<br />
dans les offices <strong>de</strong> l’état civil et ne sont archivés qu’après <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is très longs (plus d’un<br />
siècle) : en effet, les registres contiennent <strong>de</strong>s données qui restent vivantes et actuelles très<br />
longtemps, les offices <strong>de</strong> l’état civil doivent être à même <strong>de</strong> délivrer <strong>de</strong>s extraits à tout<br />
moment. L’OEC précise en outre aux art. 31 et 32 que les cantons doivent conserver à long<br />
terme (en principe 50 ans) les pièces justificatives qui ont servi <strong>de</strong> base à l’enregistrement :<br />
ces articles concernent donc <strong>de</strong>s documents sur papier (ou, éventuellement, <strong>de</strong>s copies<br />
conformes) :<br />
Art. 31 Dépôt<br />
Les cantons veillent à ce que les pièces justificatives qui ont servi à l’enregistrement <strong>de</strong> données <strong>de</strong><br />
l’état civil soient conservées <strong>de</strong> manière appropriée (art. 7).<br />
Art. 32 Durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation<br />
1<br />
Les pièces justificatives doivent être conservées pendant 50 ans.<br />
2 Si les pièces justificatives sont microfilmées ou enregistrées sur un support électronique, elles<br />
peuvent être détruites au terme d’un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> 10 ans, avec l’autorisation <strong>de</strong> l’autorité <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce.<br />
Par contre, <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> et <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s données sur INFOSTAR doit être garantie et<br />
assurée par <strong>la</strong> Confédération. Leur archivage est soumis à <strong>la</strong> Loi fédérale sur l’archivage<br />
(LAr) du 26 juin 1998 (RS 152.1) et à son ordonnance. La manière dont l’archivage sera<br />
effectué n’est pas encore établie, le moment d’archiver ces données étant encore loin.<br />
Enfin, l’art. 82 <strong>de</strong> l’OEC se réfère à <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s données informatiques, c’est-à-dire les<br />
données enregistrées dans INFOSTAR, mais aussi les métadonnées <strong>de</strong> comman<strong>de</strong><br />
(programmes et documentation) :<br />
Art. 82 Sécurité <strong>de</strong>s données<br />
1 Les données <strong>de</strong> l’état civil, les programmes et <strong>la</strong> documentation sur les programmes doivent être<br />
protégées par <strong>de</strong>s mesures organisationnelles et techniques appropriées contre tout accès,<br />
modification ou <strong>de</strong>struction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.<br />
2 Les offices <strong>de</strong> l’état civil, les autorités <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce et l’Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil prennent<br />
chacun dans leur ressort les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir <strong>la</strong><br />
mise en sûreté <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil et pour sauvegar<strong>de</strong>r l’enregistrement en cas <strong>de</strong> défail<strong>la</strong>nce<br />
du système.<br />
3 L’Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil édicte <strong>de</strong>s directives sur les exigences auxquelles doit satisfaire <strong>la</strong><br />
sécurité <strong>de</strong>s données; ce faisant il se fon<strong>de</strong> sur les prescriptions du Conseil fédéral et du département<br />
en matière <strong>de</strong> sécurité informatique; il veille à assurer <strong>la</strong> coordination avec les cantons.<br />
4.6.1.6 Coûts<br />
L’art. 77 <strong>de</strong> l’OEC détermine le financement, les besoins et les décomptes liés à<br />
INFOSTAR. Dans ce domaine, l’OFJ tient <strong>la</strong> comptabilité <strong>de</strong> l’exploitation et <strong>de</strong>s nouveaux<br />
investissements éventuels sur un compte séparé <strong>de</strong>s finances fédérales ; il évalue le besoin
106 DONNEES DE L’ETAT CIVIL<br />
annuel et comptabilise les frais effectifs. Ce sont les cantons qui financent <strong>la</strong> banque <strong>de</strong><br />
données centrale INFOSTAR ; les détails du financement sont réglés dans une convention<br />
d’exploitation passée entre l’OFJ et <strong>la</strong> Conférence <strong>de</strong>s autorités cantonales <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong><br />
l’état civil.<br />
L’introduction d’INFOSTAR a <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong>s coûts d’investissement importants ; les frais<br />
d’exploitation <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données centrale sont supportés par l’ensemble <strong>de</strong>s utilisateurs<br />
(à savoir les cantons) comme participation aux frais centraux. Néanmoins, il permettra à plus<br />
long terme <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s économies significatives : les inscriptions à double (dans les<br />
registres spéciaux et dans le registre <strong>de</strong>s familles) ont été éliminées et <strong>la</strong> communication <strong>de</strong>s<br />
informations entre autorités s’effectue <strong>de</strong> manière beaucoup plus rapi<strong>de</strong> et simple. Un autre<br />
effet <strong>de</strong> l’introduction <strong>de</strong> ce système informatique, couplé avec le regroupement <strong>de</strong>s Offices<br />
<strong>de</strong> l’état civil en arrondissements, est une réduction importante du nombre d’officiers d’état<br />
civil à l’échelle <strong>nationale</strong>.<br />
4.6.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Cette présentation du système qui régit l’état civil en Suisse et <strong>de</strong>s changements qu’il a<br />
vécus et qu’il est encore en train <strong>de</strong> subir nous permet d’analyser les processus <strong>de</strong><br />
mémorisation tels qu’ils fonctionnent au moment présent. Le passage à INFOSTAR nous<br />
permet <strong>de</strong> montrer quelles sont les transitions qui ont lieu entre un système conventionnel <strong>de</strong><br />
conservation <strong>de</strong> l’information et un système totalement informatisé. Ces <strong>de</strong>ux systèmes sont<br />
<strong>de</strong>stinés à subsister en parallèle et à se compléter l’un l’autre.<br />
4.6.2.1 Mémorisabilité<br />
En Suisse les bases légales régissant l’état civil déterminent <strong>de</strong> manière très précise<br />
quelles sont les informations qui peuvent faire l’objet d’un enregistrement. L’utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
banque <strong>de</strong> données n’a fondamentalement pas modifié l’organisation <strong>de</strong> l’état civil : les<br />
procédures existantes continuent d’être utilisées et <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s tâches entre les différents<br />
exécutants est restée <strong>la</strong> même. L’utilisation <strong>de</strong> moyens informatiques a offert <strong>de</strong> nouvelles<br />
possibilités permettant <strong>de</strong> simplifier le traitement <strong>de</strong>s affaires 74 et n’a pas introduit <strong>de</strong><br />
changement particulier concernant <strong>la</strong> mémorisabilité <strong>de</strong>s données.<br />
Les données <strong>de</strong> l’état civil sont facilement mémorisables, que ce soit sur support papier<br />
(registres) ou sur support informatique (INFOSTAR) ; ce qui a changé est simplement <strong>la</strong><br />
métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> mémorisation. En effet, suivant notre concept d’analyse orienté sur les ressources,<br />
l’introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données a <strong>de</strong>mandé le développement, l’instal<strong>la</strong>tion,<br />
l’exploitation et l’apprentissage d’un nouveau « <strong>la</strong>ngage » commun qui permette aux<br />
différents acteurs <strong>de</strong> communiquer entre eux. Les prestations nécessaires à <strong>la</strong> nouvelle<br />
métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> mémorisation sont les suivantes 75 :<br />
• le développement <strong>de</strong> l’application d’INFOSTAR au niveau fédéral ;<br />
• son instal<strong>la</strong>tion et, ensuite, son exploitation (serveurs, logiciels, banque <strong>de</strong> données) ;<br />
• l’instal<strong>la</strong>tion et, ensuite, l’exploitation <strong>de</strong> toute l’infrastructure locale d’INFOSTAR<br />
(instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s logiciels client, intégration <strong>de</strong>s logiciels dans l’environnement<br />
74 Par exemple, les événements survenus à l’étranger peuvent désormais être traités directement pas les autorités<br />
cantonales <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l’état civil ; <strong>de</strong> même, les événements concernant le registre <strong>de</strong>s familles peuvent<br />
être enregistrés directement au lieu <strong>de</strong> l’événement et non plus besoin d’être traités par <strong>la</strong> commune d’origine.<br />
75 Se référer à Infostar. Registre informatisé <strong>de</strong> l’état civil. Rapport sur le concept informatique, Département<br />
fédéral <strong>de</strong> justice et police, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil, Version 1.0, 1 er juin 1999.
DONNEES DE L’ETAT CIVIL 107<br />
informatique déjà existant, mise à disposition <strong>de</strong> services <strong>de</strong> réseau comme les<br />
raccords, les connections, etc.) ;<br />
• <strong>la</strong> formation et le soutien <strong>de</strong>s utilisateurs d’INFOSTAR, à savoir les officiers d’état<br />
civil et tous les autres acteurs y ayant accès.<br />
Ces nouvelles prestations permettent ainsi aux données <strong>de</strong> l’état civil, qui doivent être<br />
sauvegardées suivant les règles en vigueur, d’être mémorisées sur leur nouveau support.<br />
Par contre, les données sont mémorisées suivant une autre logique que sur le papier. En<br />
effet, le support informatique permet une gestion <strong>de</strong> l’information interactive et organisée en<br />
différentes couches, selon <strong>la</strong> hiérarchie et l’actualité <strong>de</strong>s informations. L’art. 15, al. 2 <strong>de</strong><br />
l’OEC le précise, toute procédure d’enregistrement d’un fait d’état civil implique au<br />
préa<strong>la</strong>ble l’enregistrement le l’état civil <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne concernée (al. 2). Les données <strong>de</strong><br />
l’état civil sont mémorisées selon un ordre bien déterminé : tout d’abord, les indications sur <strong>la</strong><br />
personne enregistrée (Suisse ou étrangère), qui reçoit un numéro permettant <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntifier (le<br />
numéro STAR) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mettre en re<strong>la</strong>tion avec les événements qui surviennent ; <strong>la</strong> saisie <strong>de</strong>s<br />
informations sur son état civil ensuite et, enfin, <strong>la</strong> saisie <strong>de</strong>s événements d’état civil qui <strong>la</strong><br />
concernent. Le système comprend également <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong> métadonnées (qui a effectué<br />
<strong>la</strong> transaction, où, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> quels documents, etc.). INFOSTAR fonctionne ensuite selon<br />
le principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise à jour : chaque événement ou décision qui a un effet sur l’état civil<br />
entraîne <strong>la</strong> mise à jour <strong>de</strong> l’état civil et <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> famille <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne concernée.<br />
En conclusion, nous pouvons remarquer que le système <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong><br />
l’état civil est parfaitement régulé. En effet, les officiers <strong>de</strong> l’état civil suivent les procédures<br />
d’enregistrement suivant les indications <strong>de</strong> l’OFEC, <strong>de</strong> manière standardisée et uniforme sur<br />
tout le territoire suisse. Cette situation est exceptionnelle, puisque aucun autre pays n’a réussi<br />
jusqu’à présent à uniformiser et centraliser à tel point les données <strong>de</strong> l’état civil.<br />
4.6.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Nous avons ainsi vu que l’introduction <strong>de</strong> l’état civil informatisé n’a pas modifié <strong>de</strong><br />
manière fondamentale <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisabilité <strong>de</strong>s données : elle a simplement exigé<br />
<strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> nouvelles prestations. Par contre, l’introduction d’INFOSTAR a <strong>de</strong>mandé<br />
une réflexion approfondie <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’OFEC autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressaisie <strong>de</strong>s<br />
données inscrites dans les registres conventionnels 76 : en d’autres termes, il fal<strong>la</strong>it répondre à<br />
<strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir quelles données <strong>de</strong> l’état civil étaient dignes d’être introduites dans le<br />
système.<br />
En effet, comme nous l’avons expliqué, les données <strong>de</strong> l’état civil sont enregistrées<br />
(c’est-à-dire saisies) dans le système à partir du <strong>de</strong>uxième semestre <strong>de</strong> 2004 : ainsi, <strong>la</strong><br />
naissance d’un enfant survenue après 2004 a été enregistrée sur INFOSTAR, une naissance<br />
ayant eu lieu avant cette année-là a été enregistrée dans le registre <strong>de</strong>s naissances où<br />
l’événement a eu lieu et dans le registre <strong>de</strong> famille <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune d’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille qui<br />
a eu le bébé. Néanmoins, puisque les événements ne peuvent être enregistrés dans le système<br />
que si les données concernant <strong>la</strong> personne en question ont déjà été saisies, l’OFEC a décidé <strong>de</strong><br />
procé<strong>de</strong>r à une ressaisie dans INFOSTAR – opération qui est toujours en cours. Puisqu’une<br />
ressaisie globale <strong>de</strong>s suissesses et <strong>de</strong>s suisses vivant·es n’était opérationnellement pas<br />
envisageable, il a été décidé <strong>de</strong> se concentrer en premier lieu sur les personnes « riches en<br />
événements », à savoir celles qui sont nées après 1968 : en effet, ce sont bien les générations<br />
nées à partir <strong>de</strong> cette année là qui sont en train <strong>de</strong> vivre le plus grand nombre d’événements<br />
76 Se référer à Infostar. Registre informatisé <strong>de</strong> l’état civil. Rapport sur le concept <strong>de</strong> ressaisie, Département<br />
fédéral <strong>de</strong> justice et police, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil, Version 1.0, 1 er juin 1999.
108 DONNEES DE L’ETAT CIVIL<br />
d’état civil. Une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressaisie a eu lieu préa<strong>la</strong>blement, avant l’introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nouvelle banque <strong>de</strong> données, mais <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> partie du travail s’est faite (et se fait encore)<br />
après l’introduction d’INFOSTAR. La ressaisie se fait au lieu d’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne en<br />
utilisant comme base le registre <strong>de</strong>s familles, car celui-ci est re<strong>la</strong>tivement ancien (il existe<br />
<strong>de</strong>puis 1929) et contient par conséquent presque toutes les données re<strong>la</strong>tives aux Suisses en<br />
vie (figure 4.6.3). L’état civil <strong>de</strong>s personnes nées avant 1968 n’est ressaisi que lorsque a lieu<br />
un événement nécessitant un enregistrement. Dans ce cas, on effectue une saisie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
personne avec le minimum d’indications indispensables au lieu <strong>de</strong> l’événement. Le système<br />
enregistre <strong>la</strong> ressaisie comme une ressaisie en suspens ; elle est complétée a posteriori au lieu<br />
d’origine sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s documents probants nécessaires.<br />
Registres spéciaux<br />
Registre <strong>de</strong>s familles Base <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressaisie<br />
2004<br />
INFOSTAR<br />
Fig. 4.6.3 : Représentation visuelle <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s que couvrent les registres spéciaux, le registre<br />
<strong>de</strong>s familles et INFOSTAR.<br />
INFOSTAR sera réellement profitable pour <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil lorsqu’il<br />
comportera toutes les données re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s personnes concernées par un<br />
enregistrement ou par <strong>la</strong> délivrance d’un extrait ou d’une confirmation. Néanmoins, on ne sait<br />
actuellement pas encore s’il sera réellement possible <strong>de</strong> saisir dans le nouveau système<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s données dont <strong>la</strong> nécessité juridique est encore effective.<br />
Une autre réflexion sur <strong>la</strong> dignité à <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil concerne<br />
les inscriptions n’ayant plus <strong>de</strong> relevance juridique, c’est-à-dire les données historiques : il<br />
s’agit <strong>de</strong> données concernant <strong>de</strong>s événements et <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> famille, qui, bien qu’ils aient<br />
conduit à l’état civil actuel, n’en font plus partie. Pour comprendre cette idée il suffit <strong>de</strong><br />
penser à l’exemple d’une femme s’étant mariée et ayant changé <strong>de</strong> nom, ayant ensuite divorcé<br />
et repris son nom <strong>de</strong> jeune fille et s’étant mariée et ayant changé à nouveau <strong>de</strong> nom <strong>de</strong> famille.<br />
D’un point <strong>de</strong> vue juridique, c’est l’état civil actuel qui est pris en considération : les anciens<br />
noms <strong>de</strong> famille <strong>de</strong> cette personne ont plutôt une valeur que nous pourrions qualifier<br />
d’historique. Pour éviter que ce type d’information se per<strong>de</strong>, INFOSTAR a été conçu <strong>de</strong><br />
manière à ce que plusieurs niveaux <strong>de</strong> masques puissent être activés : il est dès lors possible<br />
<strong>de</strong> connaître les anciens états et événements ayant marqué <strong>la</strong> vie <strong>de</strong> cette personne. De cette<br />
manière, l’historisation <strong>de</strong> l’information est elle aussi garantie.<br />
Comme nous l’avons déjà constaté pour les questions liés à <strong>la</strong> mémorisabilité, <strong>la</strong> dignité à<br />
<strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil est c<strong>la</strong>irement régulée et couvre aussi bien le<br />
présent (valeur juridique) que le passé (valeur historique). La ressource que nous avons<br />
définie sous le nom <strong>de</strong> « raison » a été mobilisée et tous les cas <strong>de</strong> figure ont été pris en<br />
considération.<br />
T
DONNEES DE L’ETAT CIVIL 109<br />
4.6.2.3 Mémorisation réelle<br />
C’est au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisation réelle que <strong>de</strong>s solutions concrètes doivent encore être<br />
déterminées. En effet, si les données confiées aux registres conventionnels 77 pouvaient très<br />
facilement être archivées au niveau cantonal, être copiées sur un autre support analogique<br />
(microfilms) à <strong>de</strong>s échéances régulières (chaque 10 ans) et garantir ainsi leur sauvegar<strong>de</strong> pour<br />
une durée <strong>de</strong> temps indéfinie, il est difficile <strong>de</strong> prévoir dans quelle mesure <strong>de</strong>s données<br />
électroniques survivront effectivement aux décennies qui passent. Comme nous l’avons écrit<br />
au sous chapitre dédié aux bases légales, <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données à l’intérieur du système<br />
est essentiellement <strong>de</strong> <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> l’OFEC et du Centre <strong>de</strong> service informatique du<br />
DFJP. En cas <strong>de</strong> panne, par exemple électrique, les données enregistrées ne risquent pas<br />
d’être effacées, car elles font l’objet <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>s ; l’enregistrement <strong>de</strong>s données ou le<br />
fournissement d’extraits peuvent eux aussi se faire au moyen <strong>de</strong> formu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> secours, qui<br />
permettent ainsi d’exercer tout <strong>de</strong> même les fonctions <strong>de</strong> l’état civil. Des directives qui<br />
expliquent précisément ce que les opérateurs <strong>de</strong> l’état civil doivent faire dans ces cas <strong>de</strong> figure<br />
sont en préparation à l’OFEC.<br />
La question <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s données est par contre <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Confédération, qui est censée trouver <strong>de</strong>s solutions concrètes. On ne sait actuellement pas<br />
encore comment ces données seront archivées. On remarque par conséquent que <strong>la</strong> question<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> perpétuité <strong>de</strong>s données a été régulée au niveau fédéral, mais pas celle <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s<br />
données sur INFOSTAR. La raison en est que le support informatique ne permet plus <strong>de</strong><br />
distinguer physiquement les données actuelles <strong>de</strong>s données historiques : toutes se trouvent<br />
fixées sur un même support et restent par conséquent vivantes.<br />
Pour conclure, nous pouvons dire que si <strong>la</strong> ressource que nous avons nommée « espace &<br />
temps » paraît essentielle pour garantir <strong>la</strong> perpétuité <strong>de</strong>s données informatiques ou pour<br />
archiver les données sur papier, elle ne paraît pas jouer un rôle pour trouver une solution qui<br />
permette d’archiver <strong>de</strong>s données électroniques.<br />
4.6.2.4 Accessibilité<br />
La divulgation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil fait l’objet d’une réglementation très précise,<br />
que ce soit sur <strong>la</strong> forme (directives <strong>de</strong> l’OFEC sur les formules <strong>de</strong> l’état civil et leurs mo<strong>de</strong>s<br />
d’écriture) ou sur le fond (OEC). De plus, l’OEC impose aux col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> l’état<br />
civil (art. 44) ainsi qu’aux autorités qui reçoivent <strong>de</strong>s communications ou <strong>de</strong>s avis (art. 56) le<br />
secret <strong>de</strong> fonction.<br />
Il existe <strong>de</strong>ux formes <strong>de</strong> divulgation : <strong>la</strong> divulgation d’office (section 2 <strong>de</strong> l’OEC) et <strong>la</strong><br />
divulgation sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> (section 3 <strong>de</strong> l’OEC). La divulgation d’office concerne les données<br />
<strong>de</strong> l’état civil qui doivent être transmises aux administrations concernées par <strong>de</strong>s changements<br />
d’état civil ou par un événement <strong>de</strong> l’état civil ; ces données sont communiquées sous forme<br />
électronique ou papier. Il s’agit en particulier <strong>de</strong> l’administration communale du domicile ou<br />
du lieu <strong>de</strong> séjour <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne (art. 49), <strong>de</strong> l’office <strong>de</strong> l’état civil <strong>de</strong> son lieu d’origine (art.<br />
49a), <strong>de</strong> l’autorité tuté<strong>la</strong>ire (art. 50), <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong>s migrations (art. 51), <strong>de</strong> l’Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique (art. 52), <strong>de</strong>s organes <strong>de</strong> l’AVS et <strong>de</strong> l’AI (art. 53), <strong>de</strong>s autorités<br />
étrangères (art. 54), <strong>de</strong>s représentations étrangères (pour les avis <strong>de</strong> décès, art. 55). En outre,<br />
<strong>de</strong>s faits d’état civil (naissances, décès, célébrations <strong>de</strong> mariage et enregistrements <strong>de</strong><br />
partenariats) peuvent faire l’objet <strong>de</strong> publications <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s cantons pour autant que les<br />
proches immédiats ne fassent pas opposition (art. 57). La <strong>de</strong>uxième forme <strong>de</strong> divulgation <strong>de</strong>s<br />
77 Les registres conventionnels étaient à l’origine <strong>de</strong>s volumes reliés en format A3 ; ils ont par <strong>la</strong> suite été<br />
remp<strong>la</strong>cés par <strong>de</strong>s feuillets. Ce changement n’a néanmoins pas eu d’impact sur leur archivage.
110 DONNEES DE L’ETAT CIVIL<br />
données <strong>de</strong> l’état civil est celle qui est faite sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et qui est communiquée sur papier<br />
(extrait ou communication) : celle-ci peut être faite par <strong>de</strong>s tribunaux ou <strong>de</strong>s autorités<br />
administratives suisses si ceci est indispensable à l’accomplissement <strong>de</strong> leurs tâches (art. 58) ;<br />
par <strong>de</strong>s particuliers lorsqu’un intérêt direct et digne <strong>de</strong> protection est établi et que l’obtention<br />
<strong>de</strong>s données auprès <strong>de</strong>s personnes concernées est impossible (art. 59) ; par <strong>de</strong>s chercheurs<br />
pour <strong>de</strong>s recherches scientifiques ou <strong>de</strong>s recherches généalogiques (art. 60) ; par <strong>de</strong>s autorités<br />
étrangères, suivant <strong>de</strong>s conditions précises (art. 61).<br />
L’art. 81 <strong>de</strong> l’OEC prévoit que toute personne peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s renseignements à<br />
l’office <strong>de</strong> l’état civil du lieu <strong>de</strong> survenance <strong>de</strong> l’événement ou <strong>de</strong> son lieu d’origine sur les<br />
données <strong>la</strong> concernant. Les renseignements sont fournis sous <strong>la</strong> forme d’extraits du registre ou<br />
<strong>de</strong> confirmations. Les frais sont facturés conformément à l’Ordonnance sur les émoluments<br />
en matière d’état civil (OEEC) du 27 octobre 1999 (RS 172.042.110).<br />
L’art. 79 <strong>de</strong> l’OEC règle les droits d’accès <strong>de</strong>s autorités impliquées à <strong>la</strong> banque <strong>de</strong><br />
données centrale INFOSTAR : ceux-ci sont entièrement gérés par l’OFEC, qui peut les<br />
accor<strong>de</strong>r, les modifier ou les supprimer (al. 3). Cet article est complété par un annexe qui<br />
détaille quelles sont les opérations que les titu<strong>la</strong>ires du droit d’accès peuvent effectuer sur<br />
INFOSTAR. Ces acteurs se distinguent en trois groupes : l’Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil et les<br />
autres autorités habilitées et désignées à l’art. 43a, al. 4 du CC 78 (abrégés OFEC + Aut. hab.) ;<br />
les autorités cantonales <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l’état civil (abrégé ACS) et les offices <strong>de</strong> l’état<br />
civil, habilités à signer (c'est-à-dire les officiers <strong>de</strong> l’état civil, abrégés CH EC). Les<br />
opérations que ces différents groupes d’acteurs peuvent ou ne peuvent pas effectuer sont<br />
l’appel <strong>de</strong>s données (A), leur enregistrement (E) ou leur saisie (S).<br />
La protection <strong>de</strong>s données doit être garantie. L’art. 83 <strong>de</strong> l’OEC prévoit même que<br />
l’OFEC puisse se faire conseiller par le Préposé fédéral à <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données à <strong>la</strong><br />
transparence et par l’unité <strong>de</strong> stratégie informatique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération.<br />
En conclusion, on comprend aisément que <strong>la</strong> mise en réseau électronique <strong>de</strong> tous les<br />
offices <strong>de</strong> l’état civil en suisse a permis une rationalisation importante et une communication<br />
simplifiée <strong>de</strong>s informations aux autorités raccordées à INFOSTAR. La saisie <strong>de</strong>s données au<br />
lieu <strong>de</strong> survenance actualise automatiquement les données d’état civil <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne dans <strong>la</strong><br />
banque centrale INFOSTAR : il n’est donc plus nécessaire <strong>de</strong> transmettre, puis <strong>de</strong> ressaisir les<br />
données au lieu d’origine. Cette mise en réseau permet en outre d’éliminer <strong>de</strong>s sources<br />
potentielles d’erreurs et <strong>de</strong> doublons, que ce soit dans <strong>la</strong> saisie <strong>de</strong>s données ou dans leur<br />
communication. Ainsi, comme nous l’avons constaté dans d’autres domaines, <strong>la</strong> ressource que<br />
nous avons appelée « espace publique » prend ici une nouvelle forme grâce aux nouvelles<br />
technologies. Dans ce cas spécifique, néanmoins, elle ne correspond pas à un é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong><br />
l’accessibilité, qui est très précisément régulée.<br />
4.6.3 Commentaires<br />
Ce chapitre, rédigé grâce aux informations recueillies lors d’un entretien à l’OFEC avec<br />
Mme. Susanne Ny<strong>de</strong>gger (Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation et <strong>de</strong> l’introduction à Infostar et<br />
chargée <strong>de</strong> projets), M. Joseph Broquet, (employé spécialisé, anciennement Officier <strong>de</strong> l’état<br />
civil) et M. Gottfried Janz (chargé du support Infostar, anciennement Officier <strong>de</strong> l’état civil)<br />
ainsi qu’à travers <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s bases légales, <strong>de</strong>s documents internes et publiés ayant trait à<br />
l’institution et <strong>de</strong> son site Internet, a permis <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce les aspects suivants :<br />
78 Il s’agit notamment <strong>de</strong>s autorités chargées d’établir les documents d’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s ressortissants suisse, du<br />
service fédéral qui gère le système <strong>de</strong> recherche informatisé <strong>de</strong> police et <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> filtrage <strong>de</strong>s corps <strong>de</strong><br />
police cantonaux et municipaux raccordés à ce système, du service fédéral qui tient le casier judiciaire et, enfin,<br />
du service fédéral chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>s personnes disparues.
DONNEES DE L’ETAT CIVIL 111<br />
(1) Le passage d’un système <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s informations sur papier à un système<br />
informatisé et central, tel que nous l’avons décrit ici, ne correspond pas<br />
forcément à un changement substantiel dans <strong>la</strong> manière <strong>de</strong> traiter et<br />
d’organiser les informations. Il s’agit surtout d’un changement <strong>de</strong> support qui<br />
permet une mise en réseau <strong>de</strong>s données. Alors que celle-ci facilite<br />
gran<strong>de</strong>ment les processus d’enregistrement <strong>de</strong> l’information (mémorisabilité,<br />
dignité à <strong>la</strong> mémorisation) ainsi que sa mise à disposition <strong>de</strong>s groupes<br />
d’acteurs habilités à y accé<strong>de</strong>r (accessibilité), le changement du support pose<br />
<strong>de</strong> gros problèmes en termes <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong> l’information et, surtout,<br />
d’archivage (mémorisation réelle).<br />
(2) La question <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> l’information implique une réelle<br />
dépendance <strong>de</strong> l’office fédéral concerné par le contenu substantiel <strong>de</strong>s<br />
données (dans ce cas l’OFEC) à un autre acteur institutionnel ou même<br />
externe à l’administration (dans ce cas le CSI du département) concerné par <strong>la</strong><br />
forme, désormais électronique, que les données prennent. La dissociation<br />
entre le contenu <strong>de</strong> l’information et son support implique également une<br />
dissociation et une multiplication <strong>de</strong>s acteurs appelés à gérer l’information.<br />
La question <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> l’information fait néanmoins l’objet d’une<br />
régu<strong>la</strong>tion très précise <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération.<br />
(3) Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’archivage, l’exemple <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil est<br />
intéressant parce qu’il montre qu’il existe <strong>de</strong>s informations qui ont un cycle<br />
<strong>de</strong> vie extrêmement long. Dans ce cas, leur archivage n’intervient que <strong>de</strong>s<br />
décennies après <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’information. Les décisions quant à <strong>la</strong> mise en<br />
œuvre <strong>de</strong> celui-ci, du ressort <strong>de</strong>s Archives fédérales, peuvent ainsi être prises<br />
dans un <strong>de</strong>uxième temps. Par contre, <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s données informatiques<br />
suite au passage à INFOSTAR, qui doit être garantie, a fait l’objet d’une<br />
régu<strong>la</strong>tion dès <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> celui-ci.
4.7 Données du casier judiciaire<br />
[Etat en mars 2007]<br />
Le processus <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s données du casier judiciaire – <strong>de</strong> <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> l’Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice par l’intermédiaire du Casier judiciaire suisse – sont très simi<strong>la</strong>ires à ceux<br />
que nous avons étudiés dans le chapitre précé<strong>de</strong>nt, dédié aux données <strong>de</strong> l’état civil. Ce qui<br />
différencie ces <strong>de</strong>ux domaines est que, alors que les données <strong>de</strong> l’état civil exigent d’être<br />
mémorisées à très long terme, les données du casier judiciaire doivent être éliminées après <strong>de</strong>s<br />
dé<strong>la</strong>is déterminés.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> nos réflexions autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>, nous utiliserons<br />
ainsi les données du casier judiciaire comme un contrexemple pour montrer comment, dans<br />
<strong>de</strong>s domaines spécifiques, l’Etat a non pas un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong> mais, au contraire, d’oubli.<br />
4.7.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
La pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> transition entre une gestion sur papier et une gestion informatique dans<br />
<strong>la</strong>quelle les données <strong>de</strong> l’état civil se trouvent actuellement (février 2007) s’est terminée pour<br />
les données du casier judiciaire en 2005. Celles-ci sont en effet désormais entièrement gérées,<br />
centralisées et mises en réseau grâce à une banque <strong>de</strong> données appelée VOSTRA. Les fiches<br />
en papier qui permettaient <strong>de</strong> gérer ces données par le passé ont été détruites et n’existent<br />
plus, ni au niveau fédéral, ni au niveau cantonal.<br />
4.7.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Ce que nous appelons aujourd’hui casier judiciaire a été introduit en Suisse au XIXe<br />
siècle par quelques cantons en tant qu’enregistrement <strong>de</strong>s condamnations. Par <strong>la</strong> suite, il s’est<br />
avéré rapi<strong>de</strong>ment indispensable <strong>de</strong> pouvoir bénéficier <strong>de</strong> renseignements complets et fiables<br />
sur les condamnations au niveau <strong>de</strong> tout le territoire helvétique : il a ainsi été fondé à Berne le<br />
Bureau central suisse <strong>de</strong> police, qui s’est occupé <strong>de</strong> tenir le casier judiciaire dès 1905 79 . A<br />
partir <strong>de</strong> là et jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1999, les données du casier judiciaire ont toujours été gérées<br />
sur support papier : le casier judiciaire était donc tenu à <strong>la</strong> main sous forme <strong>de</strong> dossiers<br />
personnels, entreposé et sécurisé dans <strong>de</strong>s armoires à archives. Ce même système était utilisé<br />
au niveau fédéral et cantonal jusqu’en 2000 ; à partir <strong>de</strong> là sa gestion a été attribuée à <strong>la</strong><br />
Confédération.<br />
Les informations contenues dans ces dossiers permettaient – et permettent toujours,<br />
indépendamment <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> support qui ont eu lieu entre temps – aux autorités <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Confédération et <strong>de</strong>s cantons d’accomplir un certain nombre <strong>de</strong> tâches fondamentales liées à<br />
leurs fonctions relevant du droit pénal, <strong>de</strong>s affaires inter<strong>nationale</strong>s et <strong>de</strong> l’entrai<strong>de</strong> judiciaire. Il<br />
s’agit entre autres <strong>de</strong> :<br />
• <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> procédures pénales ;<br />
• l’exécution <strong>de</strong>s peines et mesures ;<br />
• <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> procédures <strong>de</strong> naturalisation ;<br />
79 Pour cette petite introduction historique se référer à Roger Dol<strong>de</strong>r, « VOSTRA – le casier judiciaire<br />
automatisé <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse. La Confédération et les cantons se répartissent maintenant le travail en ligne », Bulletin<br />
info. Informations sur l’exécution <strong>de</strong>s peines et mesures, Département fédéral <strong>de</strong> justice et police DFJP, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice OFJ, Section <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong>s peines et mesures, 1/2006, p. 19.
114 DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE<br />
• l’examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> « qualité » <strong>de</strong> réfugié ;<br />
• l’octroi et le retrait <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> conduire ou <strong>de</strong> permis d’élève conducteur ;<br />
• <strong>la</strong> procédure d’entrai<strong>de</strong> judiciaire inter<strong>nationale</strong> et d’extradition.<br />
Un extrait <strong>de</strong>s informations contenues dans ces dossiers – à savoir, un extrait du casier<br />
judiciaire – peut être exigé par un certains nombre d’acteurs publics ou même <strong>de</strong>mandé par<br />
<strong>de</strong>s acteurs privés, afin que <strong>de</strong>s particuliers puissent faire valoir certains droits (par exemple,<br />
faire une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> naturalisation ou se faire délivrer un visa) ou accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s biens et<br />
services ou à <strong>de</strong>s prestations (par exemple : obtenir un emploi ou louer un appartement, etc.).<br />
Un extrait avec jugement portera sans doute préjudice à <strong>la</strong> personne concernée, dans le sens<br />
que celui-ci <strong>la</strong> désignera aux yeux <strong>de</strong> <strong>la</strong> société comme n’étant pas fiable et pourrait donner<br />
lieu à <strong>de</strong>s discriminations sociales et économiques.<br />
Pour cette raison, le Co<strong>de</strong> pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937 (état le 19 septembre<br />
2006, RS 311.0) prévoit à l’art. 369 que, passé un certain dé<strong>la</strong>i en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong><br />
l’acte commis, les jugements ne doivent plus figurer dans ce registre, ils doivent y être<br />
éliminés. Ceci correspond dans les faits à une mesure <strong>de</strong> déni <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong>, qui vise c<strong>la</strong>irement<br />
à une réhabilitation sociale <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne jugée. Ainsi fonctionne le système du casier<br />
judiciaire, qui constitue donc un excellent exemple <strong>de</strong> <strong>la</strong> nécessité qui existe, dans <strong>de</strong>s cas<br />
déterminés, d’un effacement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>.<br />
4.7.1.2 Contenu<br />
Le casier judiciaire s’occupe en particulier <strong>de</strong> centraliser les informations concernant les<br />
personnes (<strong>de</strong> nationalité suisse et étrangère) ayant commis <strong>de</strong>s infractions et qui ont été<br />
condamnées à une peine privative <strong>de</strong> liberté ou à <strong>de</strong>s mesures pénales par un tribunal<br />
suisse ainsi que, dans <strong>de</strong>s cas spécifiques, à <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s. La toute nouvelle Ordonnance sur<br />
le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) du 29 septembre 2006 (RS 331), entrée en<br />
vigueur le 1 er janvier 2007, donne le détail <strong>de</strong>s données qui doivent être enregistrées dans le<br />
casier judiciaire.<br />
Nous les rapportons ici sous forme abrégée.<br />
• Les sanctions suivantes (art. 4) : les peines <strong>principale</strong>s ; les peines accessoires ; <strong>la</strong><br />
peine privative <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong> substitution prononcée par le tribunal dans le jugement ;<br />
les mesures thérapeutiques et l’internement ; le cautionnement préventif ;<br />
l’interdiction d’exercer une profession ; l’interdiction <strong>de</strong> conduire ; <strong>la</strong> dégradation ;<br />
l’exclusion <strong>de</strong> l’armée. Les condamnations infligées à <strong>de</strong>s mineurs ne sont<br />
enregistrées qu’en cas <strong>de</strong> privation <strong>de</strong> liberté ou <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cement dans un établissement<br />
fermé.<br />
• Les décisions qui entraînent une modification <strong>de</strong> l’inscription, à savoir les décisions<br />
ultérieures suivantes (art. 5) : <strong>la</strong> révocation ou <strong>la</strong> non-révocation du sursis ou du<br />
sursis partiel, ainsi que ses conséquences ; le remp<strong>la</strong>cement d’une peine par une<br />
autre ; <strong>la</strong> levée d’une interdiction d’exercer une profession, <strong>la</strong> limitation <strong>de</strong> sa durée<br />
ou <strong>de</strong> son contenu.<br />
• Les décisions d’exécution <strong>de</strong>s peines ou <strong>de</strong>s mesures rendues par les autorités<br />
compétente ou le tribunal, ainsi que <strong>la</strong> grâce et l’amnistie (art. 6).<br />
• Les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit selon le<br />
droit fédéral est pendante en Suisse, avec <strong>la</strong> mention :<br />
- <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité du prévenu ;
DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE 115<br />
- <strong>de</strong> <strong>la</strong> date d’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure pénale ;<br />
- <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure compétente ;<br />
- <strong>de</strong>s infractions qui sont reprochées au prévenu,<br />
ainsi que les modifications notables telles que le transfert d’une procédure ou <strong>la</strong><br />
modification <strong>de</strong> l’inculpation (art. 7).<br />
• Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’extraits <strong>de</strong> casiers judiciaires étrangers présentées par les autorités<br />
suisses (art. 8).<br />
L’annexe 1 <strong>de</strong> <strong>la</strong> même ordonnance, basée sur l’art. 10, détaille ensuite très précisément<br />
tous les types <strong>de</strong> données et champs <strong>de</strong> données qui doivent figurer dans le casier judiciaire,<br />
comme suit :<br />
1. Données concernant les personnes<br />
1.1 Numéro attribué aux données concernant les personnes (numéro <strong>de</strong> système<br />
successif)<br />
1.2 Nom, nom <strong>de</strong> naissance, prénom<br />
1.3 Anciens noms<br />
1.4 Date, lieu, pays <strong>de</strong> naissance<br />
1.5 Sexe<br />
1.6 Lieu d’origine, nationalité<br />
1.7 Parents<br />
1.8 Etat civil<br />
1.9 Conjoint ou conjointe<br />
1.10 Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe<br />
1.11 Note à usage interne (informations supplémentaires <strong>de</strong>stinées à l’i<strong>de</strong>ntification<br />
<strong>de</strong> personnes)<br />
1.12 Titre <strong>de</strong> séjour (ressortissants étrangers)<br />
1.13 Mention d’un éventuel jugement<br />
1.14 Mention d’une éventuelle procédure pénale en cours<br />
1.15 Mention d’une éventuelle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en suspens auprès d’un casier judiciaire à<br />
l’étranger<br />
1.16 Dates <strong>de</strong> <strong>la</strong> première inscription et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière mutation<br />
2. Données concernant les fausses i<strong>de</strong>ntités<br />
2.1 Nom, prénom<br />
2.2 Date <strong>de</strong> naissance<br />
3. Données concernant les procédures pénales en cours<br />
3.1 Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1<br />
3.2 Date <strong>de</strong> l’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure<br />
3.3 Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure compétente<br />
3.4 Numéro <strong>de</strong> référence utilisé par <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure compétente<br />
3.5 Infractions reprochées au prévenu<br />
4. Données concernant les jugements<br />
4.1 Numéro du jugement (numéro <strong>de</strong> système successif)<br />
4.2 Date du jugement, date <strong>de</strong> <strong>la</strong> notification et <strong>de</strong> l’entrée en force, autorité qui a<br />
statué<br />
4.3 Date du jugement <strong>de</strong> l’instance précé<strong>de</strong>nte, instance précé<strong>de</strong>nte<br />
4.4 Numéro <strong>de</strong> référence utilisé par l’autorité qui a rendu le jugement<br />
4.5 Canton d’exécution (jugements militaires)<br />
4.6 Contradictoire, par défaut, mandat pénal<br />
4.7 Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement
116 DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE<br />
complémentaire, peine d’ensemble<br />
4.8 Infraction et mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> commission<br />
4.9 Taux d’alcoolémie<br />
4.10 Date <strong>de</strong> l’infraction (date ou pério<strong>de</strong>)<br />
4.11 Genre, durée ou montant et forme <strong>de</strong> l’exécution (sans ou avec sursis ou sursis<br />
partiel) <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine <strong>principale</strong><br />
4.12 Pour les peines pécuniaires, nombre <strong>de</strong> jours-amen<strong>de</strong>s ainsi que montant et<br />
monnaie du jour-amen<strong>de</strong><br />
4.13 En cas <strong>de</strong> peine avec sursis partiel, durée totale <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine, ainsi que durée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine avec sursis<br />
4.14 Montant <strong>de</strong> l’amen<strong>de</strong>, monnaie, peine privative <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong> substitution<br />
4.15 Durée du dé<strong>la</strong>i d’épreuve<br />
4.16 Sorte <strong>de</strong> mesure<br />
4.17 En cas d’interdiction d’exercer une profession, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> l’interdiction et<br />
l’espèce <strong>de</strong> l’activité interdite ainsi que l’étendue <strong>de</strong> l’interdiction (interdiction<br />
d’exercer l’activité <strong>de</strong> façon indépendante ou interdiction complète)<br />
4.18 Durée (en jours) <strong>de</strong> <strong>la</strong> détention préventive imputée sur <strong>la</strong> peine<br />
4.19 Mention d’une éventuelle règle <strong>de</strong> conduite, d’une assistance <strong>de</strong> probation<br />
4.20 Peines accessoires<br />
4.21 Règles <strong>de</strong> <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine<br />
5. Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d’exécution<br />
5.1 Numéro <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision (numéro <strong>de</strong> système successif)<br />
5.2 Date <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision, date <strong>de</strong> <strong>la</strong> notification et <strong>de</strong> l’entrée en force<br />
5.3 Autorité qui a statué<br />
5.4 Type <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision<br />
5.5 Date <strong>de</strong> <strong>la</strong> libération<br />
5.6 Peine exécutée, non exécutée<br />
5.7 Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)<br />
5.8 Durée du dé<strong>la</strong>i d’épreuve prolongé<br />
5.9 Mention d’une éventuelle règle <strong>de</strong> conduite ou d’une assistance <strong>de</strong> probation<br />
5.10 Avertissement<br />
5.11 Sursis révoqué, non révoqué<br />
5.12 Réintégration, pas <strong>de</strong> réintégration<br />
5.13 Reste <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine<br />
5.14 Sursis à l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine prononcé ultérieurement<br />
5.15 Grâce et amnistie<br />
6. Données concernant les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s adressées à <strong>de</strong>s casiers judiciaires à<br />
l’étranger<br />
6.1 Données concernant les personnes selon ch. 1<br />
6.2 Motif <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
6.3 Mention d’une éventuelle détention<br />
6.4 Autorité requérante, date <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
6.5 Autorité étrangère sollicitée<br />
Comme nous l’avions observé pour les données <strong>de</strong> l’état civil, ces listes nous montrent<br />
qu’il s’agit <strong>de</strong> données sensibles et <strong>de</strong> profils <strong>de</strong> <strong>la</strong> personnalité, constitués <strong>de</strong> différents types<br />
d’informations et organisés par couches : les données sensibles et <strong>de</strong>s profils <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
personnalité re<strong>la</strong>tifs aux condamnations et ceux re<strong>la</strong>tifs aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’extraits du casier<br />
judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours sont traitées séparément dans le<br />
casier judiciaire. En outre, comme nous le verrons dans le sous-chapitre dédié à l’accessibilité
DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE 117<br />
<strong>de</strong>s données, les autorisations <strong>de</strong>s autorités cantonales ou fédérales <strong>de</strong> traiter ces données sont<br />
différentes et dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> leur besoin d’information.<br />
4.7.1.3 Supports<br />
Le système VOSTRA (Vol<strong>la</strong>utomatisiertes Strafregister) a été mis sur pieds suite à un<br />
essai pilote en 1997 dans 9 cantons (ZH, BE, LU, FR, SO, BS, SG, AG et VD). Une fois <strong>la</strong><br />
décision prise <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une informatisation générale du casier judiciaire, tous les extraits<br />
<strong>de</strong> jugement et <strong>de</strong>s décisions qu’il comporte (détaillés dans <strong>la</strong> liste précé<strong>de</strong>mment citée) ont<br />
été codifiés et, ensuite, les dossiers sur papier ont été informatisés. L’informatisation <strong>de</strong>s<br />
données s’est déroulée en <strong>de</strong>ux étapes, <strong>la</strong> première ne comportant que les données concernant<br />
les personnes. Ces différentes opérations ont duré presque huit ans, puisqu’elles ont<br />
commencé en 1998 et se sont achevées en 2005.<br />
Le casier judiciaire est donc actuellement constitué par une banque <strong>de</strong> données centrale<br />
qui permet <strong>la</strong> mise en réseau <strong>de</strong>s données <strong>de</strong>s autorités concernées au niveau cantonal et<br />
fédéral et est désormais tenu uniquement par l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice. Ce système<br />
implique une série d’avantages, dont les plus importants sont les suivants :<br />
• les données sont introduites dans le système directement par les autorités qui<br />
prononcent les jugements, si celles-ci y sont reliées ;<br />
• les échanges entre les autorités qui nécessitent <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> ces informations sont<br />
simplifiées et se font <strong>de</strong> manière plus rapi<strong>de</strong>, sans <strong>de</strong>voir effectuer <strong>de</strong>s envois <strong>de</strong><br />
papier ;<br />
• <strong>la</strong> sécurité dans l’échange <strong>de</strong> ces informations est plus gran<strong>de</strong> et <strong>la</strong> sécurité du<br />
système est garantie ;<br />
• les données sont à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>s instances habilitées à y accé<strong>de</strong>r 24 heures sur<br />
24 ;<br />
• toutes les données pour VOSTRA sont codées et peuvent y être introduites en trois<br />
<strong>la</strong>ngues.<br />
La gestion informatique du système VOSTRA est – tout comme INFOSTAR pour les<br />
données <strong>de</strong> l’état civil – assurée par le Centre <strong>de</strong> service informatique (CSI) du Département<br />
fédéral <strong>de</strong> justice et police. Les données sont enregistrées sur <strong>de</strong>ux serveurs distincts qui se<br />
trouvent à Zollikofen et existent donc en double copie.<br />
Le nombre <strong>de</strong> personnes enregistrées dans VOSTRA se situe actuellement (mars 2007)<br />
autour <strong>de</strong> quelques 550'000 personnes pour un total <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 800'000 jugements, ce qui<br />
correspond à environ 4,8 millions d’entrées. L’accroissement <strong>de</strong>s enregistrements se fait en<br />
fonction <strong>de</strong>s infractions commises sur le territoire suisse. Les statistiques sont réalisées à une<br />
ca<strong>de</strong>nce hebdomadaire : <strong>la</strong> moyenne <strong>de</strong> l’accroissement par semaine <strong>de</strong> l’année 2006 était <strong>de</strong><br />
2’000 jugements environ.<br />
4.7.1.4 Organe compétent<br />
Le casier judiciaire informatisé est géré par l’OFJ par l’intermédiaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Casier<br />
judiciaire suisse (qui faisait auparavant partie <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> police), subordonnée à <strong>la</strong><br />
subdivision <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction Droit pénal et recours, ceci en col<strong>la</strong>boration avec d’autres autorités<br />
fédérales et les cantons. La responsabilité du système lui est attribuée suivant l’art. 2 <strong>de</strong><br />
l’Ordonnance VOSTRA. En outre, il coordonne les activités <strong>de</strong>s autorités et <strong>de</strong>s services<br />
raccordés au système et veille à ce qu’ils remplissent leurs tâches conformément aux
118 DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE<br />
prescriptions en vigueur ; il les ai<strong>de</strong> à résoudre les problèmes d’application et organise <strong>de</strong>s<br />
cours <strong>de</strong> formation et <strong>de</strong> perfectionnement ; il vérifie les données introduites dans le système,<br />
qu’il peut même rectifier en cas d’erreur ; il délivre et retire les droits individuels d’accès pour<br />
le traitement <strong>de</strong>s données et il édicte <strong>de</strong>s directives concernant l’utilisation <strong>de</strong> VOSTRA. La<br />
section Casier judiciaire suisse est organisée en <strong>de</strong>ux services : le service qui s’occupe <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s faites par <strong>de</strong>s privés et celui qui s’occupe <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s faites par <strong>de</strong>s autorités. Le<br />
premier service comporte 17 col<strong>la</strong>borateurs·trices (13,8 postes), le <strong>de</strong>uxième 7 (6,4 postes).<br />
La section 5 <strong>de</strong> l’Ordonnance VOSTRA détaille quelles sont les autorités participantes au<br />
système et quelles sont leurs obligations en matière d’enregistrement, d’information et <strong>de</strong><br />
coopération. L’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice (art. 13), tout d’abord, enregistre dans VOSTRA<br />
les données qui lui sont communiquées par <strong>de</strong>s autorités fédérales non raccordées (art. 17, al.<br />
3 et al. 4) et les jugements prononcés à l’étrangers ; il traite les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’extraits qui<br />
émanent <strong>de</strong>s particuliers, <strong>de</strong>s autorités fédérales non raccordées et d’autorités étrangères ; il<br />
traite les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’extraits <strong>de</strong> casiers judiciaires étrangers déposées par <strong>de</strong>s autorités<br />
suisses raccordées au système et, enfin, il communique les condamnations et les décisions<br />
ultérieurs concernant <strong>de</strong>s ressortissant étrangers à l’état dont <strong>la</strong> personne est ressortissante. Il<br />
existe ensuite <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong>s cantons (art. 14 et 17, al. 1 et al. 5) et un<br />
service <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice militaire (art. 15 et 17, al. 2) qui jouent <strong>principale</strong>ment le<br />
rôle <strong>de</strong> trait d’union entre les autorités cantonales ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice militaire qui émettent les<br />
informations qui doivent être enregistrées dans le système et n’y sont pas raccordées et le<br />
système lui-même. Aussi, ils établissent les extraits <strong>de</strong> VOSTRA pour les autorités cantonales<br />
ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice militaire qui n’y son pas raccordées. Enfin, les autorités <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice pénale,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> justice militaire et d’exécution <strong>de</strong>s peines sont habilitées à saisir les données dans<br />
VOSTRA, dans <strong>la</strong> mesure où elles y sont raccordées (art. 16).<br />
Toutes les autorités participant au casier judiciaire doivent veiller à ce que les données<br />
soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur (art. 18, al. 1) et doivent s’assurer<br />
que les informations enregistrées dans VOSTRA ou communiquées pour l’enregistrement<br />
soient complètes, exactes et à jour (art. 18, al. 2) ; si un doute sur l’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> celles-ci<br />
existe ou si elles sont incomplètes, l’autorité habilitée à enregistrer les données renvoie l’avis<br />
pour vérification à l’autorité dont il émane (art 18, al. 3).<br />
4.7.1.5 Bases légales<br />
Le casier judiciaire se fon<strong>de</strong> essentiellement sur les bases légales suivantes :<br />
• les art. 365 à 371 du Co<strong>de</strong> pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937 (RS 311), qui<br />
vient <strong>de</strong> subir une importante révision et dont les modifications ont également<br />
concerné les dispositions sur le casier judiciaire, en particulier <strong>la</strong> question <strong>de</strong><br />
l’élimination <strong>de</strong>s données radiées du casier ; <strong>de</strong>s changements al<strong>la</strong>nt dans <strong>la</strong> même<br />
direction ont été introduits également dans le Co<strong>de</strong> pénal militaire du 13 juin 1927<br />
(RS 321.0) et dans <strong>la</strong> Loi fédérale régissant <strong>la</strong> condition pénale <strong>de</strong>s mineurs (Droit<br />
pénal <strong>de</strong>s mineurs, DPMin) du 20 juin 2003 (état au 1 er janvier 2007, RS 311.1) ;<br />
• l’Ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) du 29 septembre 2006<br />
(RS 331) déjà citée maintes fois, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 et qui<br />
remp<strong>la</strong>ce l’ancienne Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé du 1 er décembre<br />
1999 ;<br />
• l’Ordonnance du DFJP fixant les émoluments pour les extraits du casier judiciaire<br />
établis pour les particuliers du 15 octobre 2003 (RS 331.1) ;
DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE 119<br />
• <strong>la</strong> Convention européenne d’entrai<strong>de</strong> judiciaire en matière pénale conclue à<br />
Strasbourg le 20 avril 1959 (RS 0.351.1).<br />
Les données du casier judiciaire sont soumises à <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
données (LPD), du 19 juin 1992 (RS 235.1) et à l’ordonnance y re<strong>la</strong>tive 80 . Il s’agit en effet <strong>de</strong><br />
données personnelles (c’est-à-dire se rapportant à une personne i<strong>de</strong>ntifiée, art. 3, let. a) et<br />
sensibles (art. 3, let. c, ch. 4), car elles portent sur <strong>de</strong>s poursuites ou sanctions pénales et<br />
administratives. Ces données permettent <strong>de</strong> dresser un profil <strong>de</strong> <strong>la</strong> personnalité, dans le sens<br />
que leur assemb<strong>la</strong>ge permet d’apprécier les caractéristiques essentielles <strong>de</strong> <strong>la</strong> personnalité<br />
d’une personne physique (art. 3, let. d). Suivant <strong>la</strong> loi, ces données doivent donc être exactes,<br />
sécurisées et les droits d’accès doivent être c<strong>la</strong>irement établis, que ce soit pour <strong>de</strong>s privés ou<br />
<strong>de</strong>s autorités juridiques ou administratives. Toujours conformément à <strong>la</strong> LPD (art. 17, al. 2),<br />
le traitement <strong>de</strong>s données personnelles sensibles enregistrées dans le casier judiciaire implique<br />
une base légale formelle.<br />
Il s’agit en l’occurrence <strong>de</strong>s articles 365 à 371 du Co<strong>de</strong> pénal (numérotation <strong>de</strong>s articles<br />
après <strong>la</strong> révision). Ces articles précisent tout d’abord le but du casier judiciaire informatisé<br />
(art. 365), son contenu (art. 366), le traitement et <strong>la</strong> consultation <strong>de</strong>s données (art. 367), <strong>la</strong><br />
communication <strong>de</strong> faits donnant lieu à une inscription (art. 368), l’élimination <strong>de</strong> l’inscription,<br />
dont nous reparlerons plus loin (art. 369), le droit <strong>de</strong> consultation (art. 370) et, enfin, les<br />
extraits du casier judiciaire <strong>de</strong>stinés à <strong>de</strong>s particuliers.<br />
L’Ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) du 29 septembre 2006<br />
détaille ensuite chacun <strong>de</strong>s points abordés dans <strong>la</strong> loi. Ce qu’il est intéressant <strong>de</strong> relever en<br />
re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> thématique qui nous intéresse, est que les données contenues dans VOSTRA<br />
ne doivent pas faire l’objet d’un traitement externe au système. L’art. 18 précise aux al. 3 et 5<br />
que :<br />
Art. 18 Devoirs <strong>de</strong> diligence et principes régissant le traitement <strong>de</strong>s données<br />
3 Si l’autorité habilitée à enregistrer les données doute <strong>de</strong> l’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> celles-ci ou si une<br />
communication ne contient pas toutes les indications requises, elle renvoie l’avis pour vérification à<br />
l’autorité dont il émane ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Elle<br />
peut imprimer l’extrait du casier judiciaire d’une personne aux fins <strong>de</strong> vérifier l’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
données enregistrées; le document imprimé doit être détruit sitôt <strong>la</strong> vérification terminée.<br />
5 Les données du casier judiciaire au sens <strong>de</strong> l’art. 366, al. 2 à 4, CP ne peuvent être enregistrées ou<br />
conservées <strong>de</strong> manière isolée dans un nouveau fichier, a moins que ce<strong>la</strong> soit nécessaire pour motiver<br />
une décision ou une ordonnance qui a été rendue ou une démarche <strong>de</strong> procédure qui a été engagée.<br />
Ainsi, les éventuels extraits du casier faits à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> vérification doivent ensuite être<br />
détruits ; les données ne peuvent pas être conservées ailleurs que dans VOSTRA, sauf<br />
exception. En outre, les données du casier judiciaire ne sont pas archivées (art. 369, al. 8, voir<br />
citation plus bas) et sont conservées seulement jusqu’à ce que l’élimination d’une inscription<br />
ne soit effective. Il s’agit <strong>de</strong> données toujours actuelles, qui doivent disparaître une fois que<br />
leur cycle <strong>de</strong> vie se termine.<br />
Pour terminer cette revue <strong>de</strong>s bases légales, l’Ordonnance du DFJP fixant les<br />
émoluments pour les extraits du casier judiciaire établis pour les particuliers fixe à 20 francs<br />
par exemp<strong>la</strong>ire l’émolument dû pour l’établissement d’un extrait. Enfin, <strong>la</strong> Convention<br />
européenne d’entrai<strong>de</strong> judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20 avril 1959<br />
prévoit à l’art. 22 l’échange d’avis <strong>de</strong> condamnations, c’est-à-dire <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong>s<br />
informations sur les ressortissants enregistrés dans les casiers judiciaires <strong>de</strong>s parties<br />
contractantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention.<br />
80 Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur al protection <strong>de</strong>s données (OLPD) du 14 juin 1993 (RS 235.11).
120 DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE<br />
4.7.1.6 Coûts<br />
L’art. 31 <strong>de</strong> l’Ordonnance VOSTRA détermine quelle est <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s charges<br />
financières entre <strong>la</strong> Confédération et les cantons. La Confédération finance le raccor<strong>de</strong>ment et<br />
le fonctionnement <strong>de</strong>s circuits <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong>s données jusqu’au dispositif central <strong>de</strong><br />
connexion sis dans le chef-lieu du canton. Les cantons assument pour leur part les frais<br />
d’instal<strong>la</strong>tion et d’exploitation du réseau <strong>de</strong> distribution sur leur territoire. Enfin, les autorités<br />
raccordées au système assument les frais d’acquisition et d’exploitation <strong>de</strong> leurs appareils.<br />
Il n’est pas possible dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> déterminer les coûts globaux <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
gestion informatisée du casier judiciaire.<br />
4.7.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Dans le chapitre consacré aux données <strong>de</strong> l’état civil, nous avions mis en évi<strong>de</strong>nce les<br />
enjeux d’un passage à <strong>la</strong> gestion informatisées <strong>de</strong> données d’importance capitale et <strong>de</strong>s<br />
conséquences que cette révolution a pour <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> l’information et l’archivage au<br />
sens propre du terme. Dans le cadre du casier judiciaire, ce passage a déjà eu lieu et ne semble<br />
pas avoir d’impact sur <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données, puisque celle-ci ne doit être garantie que<br />
pour une pério<strong>de</strong> bien déterminée. Les réflexions <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> chapitre se<br />
concentreront ainsi sur <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> dignité à <strong>la</strong> mémorisation et sur l’accessibilité <strong>de</strong>s<br />
données.<br />
4.7.2.1 Mémorisabilité<br />
Comme nous l’avons mis en évi<strong>de</strong>nce et comme c’est le cas également pour les données<br />
<strong>de</strong> l’état civil, les bases légales qui régissent le casier judiciaire déterminent précisément<br />
quelles sont les données à insérer dans le système informatique central qui gère les données.<br />
Les mêmes remarques déjà faites sont donc va<strong>la</strong>bles ici aussi : les procédures n’ont<br />
fondamentalement pas changé avec le passage à une gestion informatisée <strong>de</strong> l’information,<br />
mais a offert <strong>de</strong> nouvelles possibilités et a simplifié les procédures <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong>s<br />
données. Les données du casier judiciaire informatisé sont structurées elles aussi par couches<br />
superposées, qui permettent d’introduire <strong>de</strong>s filtres dans leur accessibilité aux différents<br />
groupes d’acteurs concernés et qui permettent <strong>de</strong> faire une distinction entre les données qui<br />
concernent les condamnations et celles qui concernent <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’extraits du casier<br />
judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours.<br />
En somme, tout les processus d’enregistrement <strong>de</strong>s données est régulé dans les plus petits<br />
détails, d’autant plus que le régu<strong>la</strong>teur est le même que pour les données <strong>de</strong> l’état civil, à<br />
savoir l’OFJ.<br />
4.7.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Dans le cadre du casier judiciaire, sont dignes d’être mémorisées les données<br />
personnelles sensibles et les profils <strong>de</strong> personnalité qui permettent aux autorités et acteurs<br />
compétents d’être au courant <strong>de</strong>s procédés en cours. Il est néanmoins considéré que, passé un<br />
certain dé<strong>la</strong>i suivant <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong> l’acte commis après qu’une mesure ait été exécutée,<br />
l’individu concerné doive pouvoir être à nouveau réhabilité aux yeux <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Pour cette<br />
raison, le Co<strong>de</strong> pénal prévoit l’élimination <strong>de</strong>s inscriptions du casier judiciaire suivant <strong>de</strong>s<br />
règles précises.<br />
Avant <strong>la</strong> révision du Co<strong>de</strong> pénal, <strong>la</strong> loi prévoyait <strong>de</strong>ux étapes dans <strong>la</strong> réhabilitation d’un<br />
individu dans le cadre du casier judiciaire : <strong>la</strong> radiation et, ensuite, l’élimination. Ces <strong>de</strong>ux
DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE 121<br />
étapes suivaient une procédure différentes selon qu’il s’agissait d’une peine sans dé<strong>la</strong>i<br />
d’épreuve (ou avec un dé<strong>la</strong>i d’épreuve révoqué) ou avec un dé<strong>la</strong>i d’épreuve. Dans le premier<br />
cas, une inscription pouvait être radiée d’office ou sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiation<br />
d’office pouvait aller <strong>de</strong> 5 à 20 ans plus <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> date du jugement ; <strong>la</strong><br />
durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiation sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pouvait aller <strong>de</strong> 2 à 10 ans <strong>de</strong>puis l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine.<br />
Dans tous les cas, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiation était très précisément fixée tenant compte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
gravité <strong>de</strong> l’acte commis. Après l’étape <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiation venait l’élimination définitive <strong>de</strong><br />
l’inscription dans le casier judiciaire suivant dans ce cas également <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is déterminés.<br />
Dans le cas <strong>de</strong>s mesures avec un dé<strong>la</strong>i d’épreuve, <strong>la</strong> radiation survenait après expiration <strong>de</strong><br />
celui-ci et l’élimination avait lieu entre 5 et 10 ans après l’expiration du dé<strong>la</strong>i d’épreuve si<br />
l’inscription était radiée. Ce qu’il est encore intéressant <strong>de</strong> souligner est que dans les extraits<br />
du casier judiciaire <strong>de</strong>stinés aux privés, les données radiées du casier n’apparaissaient plus,<br />
alors qu’elles étaient toujours accessibles aux autorités chargées <strong>de</strong> <strong>la</strong> poursuite pénale. Cette<br />
mesure avait c<strong>la</strong>irement pour fonction <strong>de</strong> ne pas porter ultérieurement préjudice à une<br />
personne ayant déjà exécuté <strong>la</strong> peine et faisant <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un extrait du casier dans le cadre<br />
<strong>de</strong> sa vie civile (recherche d’un emploi, d’un appartement, etc.). Ce système présentait<br />
néanmoins <strong>de</strong>s problèmes, <strong>de</strong>s incohérences 81 et <strong>de</strong>s désavantages majeurs, dont <strong>la</strong> complexité<br />
extrême requérait l’utilisation <strong>de</strong> calcu<strong>la</strong>teurs électroniques pour calculer les dé<strong>la</strong>is et pour<br />
s’assurer que les radiations et les éliminations étaient bien effectuées dans le casier judiciaire<br />
en temps voulu.<br />
Or, le Co<strong>de</strong> pénal révisé ne prévoit plus <strong>de</strong> radiation. L’inscription est donc éliminée,<br />
suivant <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is déterminés. C’est l’art. 369 du CP qui détaille les règles d’élimination <strong>de</strong><br />
l’inscription :<br />
Art. 369 Elimination <strong>de</strong> l’inscription<br />
1<br />
Les jugements qui prononcent une peine privative <strong>de</strong> liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est<br />
écoulé, dès <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine fixée par le jugement:<br />
a. 20 ans en cas <strong>de</strong> peine privative <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong> cinq ans au moins;<br />
b. quinze ans en cas <strong>de</strong> peine privative <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong> un an ou plus, mais <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> cinq ans;<br />
c. dix ans en cas <strong>de</strong> peine privative <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong> moins d’un an;<br />
d. dix ans en cas <strong>de</strong> privation <strong>de</strong> liberté selon l’art. 25 DPMin.<br />
2<br />
Les dé<strong>la</strong>is fixés à l’al. 1 sont augmentés d’une fois <strong>la</strong> durée d’une peine privative <strong>de</strong> liberté déjà<br />
inscrite.<br />
3 Les jugements qui prononcent une peine privative <strong>de</strong> liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un<br />
travail d’intérêt général ou une amen<strong>de</strong> comme peine <strong>principale</strong> sont éliminés d’office après dix ans.<br />
4<br />
Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit<br />
exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d’office:<br />
a. après quinze ans en cas <strong>de</strong> mesure ordonnée en vertu <strong>de</strong>s art. 59 à 61 et 64;<br />
b. après dix ans en cas <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cement en établissement fermé au sens <strong>de</strong> l’art. 15, al. 2, DPMin.<br />
4bis<br />
Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambu<strong>la</strong>toire au sens <strong>de</strong> l’art. 63 sont<br />
éliminés d’office après dix ans.<br />
4ter Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens <strong>de</strong>s art. 66 à 67b ou 48, 50 et 50a<br />
du co<strong>de</strong> pénal militaire, dans sa version du 21 mars 2003 sont éliminés d’office après dix ans.<br />
5 Les dé<strong>la</strong>is fixés à l’al. 4 sont augmentés <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée du sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine.<br />
81 Nous ne désirons pas nous aventurer dans une <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s problèmes que ce système extrêmement<br />
complexe et technique posait. Se référer pour plus <strong>de</strong> détails à Message re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> modification du co<strong>de</strong> pénal<br />
dans sa version du 13 décembre 2002 et du co<strong>de</strong> pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003 du 29 juin<br />
2005 (05.060), FF 2005 4425, pp. 4456 et sv.
122 DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE<br />
6<br />
Le dé<strong>la</strong>i court:<br />
a. à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4 ter ;<br />
b. à compter du jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> levée <strong>de</strong> <strong>la</strong> mesure ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> libération définitive <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne<br />
concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4 bis .<br />
7 L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne<br />
peut plus être opposé à <strong>la</strong> personne concernée.<br />
8 Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.<br />
L’Ordonnance VOSTRA précise encore à l’art. 12 que, en plus <strong>de</strong>s cas cités ci-<strong>de</strong>ssus,<br />
doivent être immédiatement éliminés du système les inscriptions re<strong>la</strong>tives à <strong>de</strong>s personnes<br />
dont une autorité a annoncé le décès ; les jugements annulés, les procédures pendantes qui<br />
sont clôturées par une ordonnance <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement ou par un jugement et les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d’extraits d’un casier judiciaire étranger, dès qu’elles ont été satisfaites.<br />
Que pouvons-nous apprendre <strong>de</strong> tout ce<strong>la</strong> du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> ? Premièrement,<br />
que <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données du casier judiciaire ne comporte pas les données historiques,<br />
à savoir passées, mais qu’elle se concentre sur le présent. Deuxièmement, que l’élimination<br />
d’une <strong>mémoire</strong> – c’est-à-dire l’effacement d’informations qui sont introduites dans un<br />
système <strong>de</strong>stiné, au fond, à les conserver – est tout aussi compliquée, sinon plus, et <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
un <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion qui est tout à fait comparable à ce qui est nécessaire à sa sauvegar<strong>de</strong>.<br />
En outre, quoique les données faisant l’objet d’une élimination du système VOSTRA<br />
disparaissent effectivement, il est possible <strong>de</strong> les reconstituer a posteriori par le biais <strong>de</strong>s<br />
dossiers archivés par les autorités judiciaires (tribunaux) ou administratives (comme le<br />
Schattenregister <strong>de</strong>s archives administratives <strong>de</strong> <strong>la</strong> police) qui ont traité les dossiers <strong>de</strong>s<br />
personnes concernées. L’effacement d’une <strong>mémoire</strong> n’est donc pas si aisé et, suivant<br />
comment, n’est pas à souhaiter selon quel est l’acteur concerné par cette <strong>mémoire</strong> et selon les<br />
droits d’accessibilité en vigueur.<br />
4.7.2.3 Mémorisation réelle<br />
Au contraire <strong>de</strong> ce que nous avions dit à propos <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil, on peut<br />
considérer que <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données du casier judiciaire est assurée, dans le<br />
sens qu’elle ne requiert pas leur archivage mais uniquement leur conservation pour une<br />
pério<strong>de</strong> déterminées (quoiqu’elle puisse durer plusieurs décennies). La conservation <strong>de</strong>s<br />
données informatiques est ici aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> responsabilité du Centre <strong>de</strong> service informatique du<br />
département. Celui-ci l’assure par <strong>de</strong>s sauvegar<strong>de</strong>s et par l’utilisation parallèle <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
serveurs.<br />
Lors du passage à VOSTRA, l’OFJ a dû déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> conserver ou non les dossiers et les<br />
extraits qui composaient le casier judiciaire tenu manuellement. Il a été décidé <strong>de</strong> les détruire<br />
pour <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong> sécurité. La banque <strong>de</strong> données<br />
nouvellement mise en route ne contient que les informations actuelles.<br />
4.7.2.4 Accessibilité<br />
Les données du casier judiciaire sont accessibles à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés différents à <strong>de</strong>ux groupes<br />
d’acteurs : les particuliers personnellement concernés par ces informations et un certain<br />
nombre d’autorités.<br />
Tout particulier a le droit d’obtenir un extrait <strong>de</strong> son casier judiciaire (art. 371 CP et art.<br />
26 Ordonnance VOSTRA). Le Service pour les particuliers du Casier judiciaire suisse traite<br />
en moyenne plus <strong>de</strong> 1200 requêtes par jour ouvrable. Depuis l’introduction <strong>de</strong> VOSTRA, les
DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE 123<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’extrait sont effectuées en remplissant un formu<strong>la</strong>ire accessible sur Internet et<br />
l’envoyant au service avec un document d’i<strong>de</strong>ntité va<strong>la</strong>ble et en s’acquittant à l’avance <strong>de</strong><br />
l’émolument <strong>de</strong> 20 frs. Le service du guichet est fermé <strong>de</strong>puis le 1 er novembre 2006. Les<br />
extraits avec jugements sont produits au format A4, les extraits sans jugements sont produits<br />
au format A5. Les <strong>de</strong>ux formes d’extrait sont imprimées sur papier sécurisé et portent une<br />
signature qui les vali<strong>de</strong>. Une personne peut, par procuration, faire délivrer son extrait <strong>de</strong> casier<br />
judiciaire à un tiers. Lorsque l’extrait est exigé par une autorité étrangère ou une ambassa<strong>de</strong><br />
(par exemple pour un visa), une légalisation par <strong>la</strong> Chancellerie fédérale est nécessaire.<br />
Le Co<strong>de</strong> pénal suisse précise à l’art. 367, al. 1 et 2 quelles sont les autorités qui sont<br />
habilitées à traiter et consulter les données du casier judiciaire :<br />
Art. 367 Traitement et consultation <strong>de</strong>s données<br />
1<br />
Les données personnelles re<strong>la</strong>tives aux condamnations (art. 366, al. 2) sont traitées par les autorités<br />
suivantes:<br />
a. l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice;<br />
b. les autorités <strong>de</strong> poursuite pénale;<br />
c. les autorités <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice militaire;<br />
d. les autorités d’exécution <strong>de</strong>s peines;<br />
e. les services <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong>s cantons.<br />
2<br />
Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:<br />
a. les autorités énumérées à l’al. 1;<br />
b. le Ministère public <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération;<br />
c. l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> police, dans le cadre <strong>de</strong>s enquêtes <strong>de</strong> police judiciaire;<br />
d. le Groupe du personnel <strong>de</strong> l’armée;<br />
e. l’Office fédéral <strong>de</strong>s migrations;<br />
f. ...<br />
g. les autorités cantonales <strong>de</strong> <strong>la</strong> police <strong>de</strong>s étrangers;<br />
h. les autorités cantonales chargées <strong>de</strong> <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion routière;<br />
i. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles <strong>de</strong> sécurité re<strong>la</strong>tifs à <strong>de</strong>s personnes visés à<br />
l’art. 2, al. 4, let. c, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi fédérale du 21 mars 1997 instituant <strong>de</strong>s mesures visant au<br />
maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté intérieure;<br />
j. l’organe d’exécution du service civil.<br />
L’Ordonnance VOSTRA précise ensuite les modalités <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation (art. 21) et<br />
traitement en ligne (art. 10, al. 2) <strong>de</strong>s données, <strong>de</strong> l’établissement d’extraits établis à <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite <strong>de</strong>stinés aux autorités suisses (art. 22) et étrangères (art. 8, al 3 et art. 23). Les<br />
art. 8 et 10 sont complétés par <strong>de</strong>s annexes qui donnent <strong>la</strong> liste complète <strong>de</strong>s autorisations <strong>de</strong><br />
traitement <strong>de</strong>s données dans le casier judiciaire accordées aux autorités fédérales (Annexe 2)<br />
et cantonales (Annexe 3). Ces autorisations sont tout d’abord régulées suivant s’il s’agit d’un<br />
accès direct (à savoir en ligne) ou par <strong>la</strong> voie écrite et ensuite suivant le type <strong>de</strong> données dont<br />
il s’agit (se référer à <strong>la</strong> liste donnée dans le sous-chapitre intitulé Contenu). Les opérations qui<br />
peuvent être effectuées sont trois : <strong>la</strong> consultation (C), l’enregistrement y compris<br />
consultation (enregistrement initial ou mutation, E) ou <strong>la</strong> notification sans consultation (N).<br />
Les conclusions concernant l’accessibilité du casier judiciaire sont simi<strong>la</strong>ires à celles qui<br />
ont été faites dans <strong>la</strong> réflexion autour <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil. La mise en réseau<br />
électronique facilite <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong>s données et réduit par les codifications <strong>de</strong>s opérations<br />
le risque d’introduire <strong>de</strong>s erreurs dans le système. Ces avantages ne correspon<strong>de</strong>nt par contre
124 DONNEES DU CASIER JUDICIAIRE<br />
pas à un é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> l’accessibilité à d’autres acteurs, accessibilité qui est très<br />
précisément légiférée.<br />
4.7.3 Commentaires<br />
Ce chapitre, rédigé grâce aux informations recueillies lors d’un entretien à <strong>la</strong> Section du<br />
Casier judiciaire suisse avec M. Roger Dol<strong>de</strong>r, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> Section du casier judiciaire suisse à<br />
l’OFJ, et M. Albert-Marc Probst, Col<strong>la</strong>borateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> même section, ainsi qu’à travers <strong>la</strong><br />
lecture <strong>de</strong>s bases légales et <strong>de</strong>s documents publiés et sur Internet ayant trait à l’institution,<br />
nous permettent <strong>de</strong> faire les commentaires suivants :<br />
(1) Comme remarqué dans le cadre <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil, le passage à un<br />
système informatisé et central ne correspond pas à un changement substantiel<br />
dans <strong>la</strong> manière <strong>de</strong> traiter et organiser les informations : il s’agit plutôt d’une<br />
mise en réseau qui permet l’accessibilité au système <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s autorités<br />
concernées et qui facilite gran<strong>de</strong>ment leur travail.<br />
(2) L’exemple du casier judiciaire a pour but <strong>de</strong> montrer qu’il existe <strong>de</strong>s<br />
informations qui ne doivent pas être mémorisées, mais au contraire, elles<br />
doivent être détruites après un certain temps. Cette élimination <strong>de</strong>man<strong>de</strong> une<br />
régu<strong>la</strong>tion très détaillée, car il faut être à même d’une part <strong>de</strong> trier entre les<br />
données qui doivent être conservées et celles qui doivent être éliminées et<br />
d’autre part <strong>de</strong> mettre ces données en re<strong>la</strong>tion avec les décisions prises par les<br />
autorités compétentes. En outre, il apparaît que l’élimination <strong>de</strong> cette<br />
<strong>mémoire</strong> n’est pas absolue et qu’elle est plus ou moins pertinente et effective<br />
selon l’acteur dont il s’agit (Casier judiciaire suisse vs tribunaux vs police).<br />
(3) Il ne faut pas tout archiver : il existe c<strong>la</strong>irement <strong>de</strong>s domaines qui doivent<br />
échapper à cette règle.<br />
(4) Dans le cas <strong>de</strong>s données du casier judiciaire, comme c’est le cas pour les<br />
données <strong>de</strong> l’état civil (mais nous ne l’avons pas mis en relief dans les<br />
commentaires du chapitre précé<strong>de</strong>nt), les ressources que nous avons définies<br />
« <strong>la</strong>ngage », « raison », « espace & temps » et « espace public » jouent à<br />
nouveau un rôle fondamental dans les quatre étapes <strong>de</strong> mémorisation que<br />
nous utilisons comme point <strong>de</strong> repère. La prise en considération <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ressource « <strong>la</strong>ngage » a permis à l’OFJ <strong>de</strong> développer toutes les mesures<br />
nécessaire pour mettre en réseau les acteurs concernés, afin qu’ils puissent<br />
communiquer. La ressource « raison » a permis <strong>de</strong> déterminer précisément et<br />
<strong>de</strong> réguler quelles sont les données dignes d’être mémorisées dans ces<br />
systèmes électroniques. La prise en compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « espace &<br />
temps » permet <strong>de</strong> gérer correctement <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données, qui<br />
<strong>de</strong>vient <strong>de</strong> plus en plus virtuelle, mais elle intervient aussi en amont du<br />
processus : le passage du mon<strong>de</strong> « papier » au mon<strong>de</strong> « informatique » prend<br />
en effet un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> temps qui a été re<strong>la</strong>tivement bref pour le casier judiciaire,<br />
mais qui sera bien plus long pour les données <strong>de</strong> l’état civil. Enfin, <strong>la</strong> prise en<br />
considération <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « espace public » permet <strong>de</strong> réguler<br />
l’accessibilité à l’information.
4.8 Données <strong>de</strong> l’assurance-vieillesse et survivants<br />
[Etat en mars 2007]<br />
4.8.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
Les données <strong>de</strong> l'assurance-vieillesse et survivants, communément appelée AVS,<br />
constituent <strong>de</strong>s données personnelles qui concernent toute <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s assurés AVS/AI.<br />
Nous avons pris l'option d'en étudier les processus <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> à titre<br />
d'exemple pour les assurances sociales. Pour ce<strong>la</strong>, nous utiliserons comme porte d'entrée les<br />
registres centraux que <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong> Compensation (CdC) gère à Genève. Ce choix a été fait<br />
après un entretien préparatoire auprès <strong>de</strong> l'Office fédéral <strong>de</strong>s assurances sociales (OFAS) à<br />
Berne.<br />
4.8.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Parmi les neuf différentes assurances qui forment le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale en Suisse<br />
(assurance-invalidité, AI; allocations pour perte <strong>de</strong> gain, APG; prestations complémentaires,<br />
PC; partie obligatoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévoyance professionnelle, PP; assurance ma<strong>la</strong>die et acci<strong>de</strong>nts;<br />
assurance-chômage; assurance-militaire), l'assurance-vieillesse et survivants touche toute <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion active vivant sur le territoire helvétique, <strong>de</strong> même qu’en partie à l’étranger: elle est<br />
en effet obligatoire pour toutes les personnes qui sont domiciliées en Suisse (y compris les<br />
indépendants et les personnes sans activité lucrative). Elle constitue d'ailleurs avec l'AI le 1 er<br />
pilier <strong>de</strong>s assurances sociales 82 et, plus que les autres, elle est sensiblement influencée par les<br />
changements démographiques qui caractérisent notre époque, à savoir <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong>s natalités et<br />
l'augmentation <strong>de</strong> l'espérance <strong>de</strong> vie: l'AVS se base en effet sur un contrat <strong>de</strong> solidarité entre<br />
les différentes générations, car elle est financée selon le principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition; <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion active, qui cotise, finance les rentes <strong>de</strong>s assurés. Cette rente garantit (avec les<br />
prestations complémentaires) le minimum vital aux personnes âgées et aux survivants.<br />
L’origine <strong>de</strong> l’AVS remonte à 1925, lorsque le peuple approuva un article constitutionnel qui<br />
visait à créer une assurance vieillesse et survivants. Les premières rentes ont été versées à<br />
partir du 1 re janvier 1948, date <strong>de</strong> l’entrée en vigueur <strong>de</strong> cette assurance.<br />
Ainsi, il nous est apparu intéressant d’étudier <strong>la</strong> manière dont les données <strong>de</strong> l’AVS,<br />
c’est-à-dire les informations qui permettent <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> cette assurance sociale<br />
fondamentale, sont gérées en Suisse 83 . Nous avons choisi d’abor<strong>de</strong>r l’étu<strong>de</strong> en passant par<br />
l’administration qui attribue les numéros d’assurés (c’est-à-dire <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong><br />
Compensation), qui constituent l’élément <strong>de</strong> base du fonctionnement <strong>de</strong> cette politique<br />
sociale.<br />
82 En Suisse, les assurances sociales sont organisées en trois piliers qui, en se fondant et se complétant les uns les<br />
autres, doivent couvrir les besoins financiers <strong>de</strong>s assurés. Le premier pilier comprend l'AVS et l'AI. Les rentes <strong>de</strong><br />
ces <strong>de</strong>ux assurances doivent couvrir les besoins vitaux. Le <strong>de</strong>uxième pilier est constitué <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévoyance<br />
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Elle doit permettre aux assurés <strong>de</strong> maintenir leur niveau<br />
<strong>de</strong> vie antérieur et n'est obligatoire que pour les sa<strong>la</strong>riés et les employeurs. Le troisième pilier est constitué par <strong>la</strong><br />
prévoyance individuelle <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong> couverture d'autres besoins et est facultatif. Ce concept <strong>de</strong>s trois piliers est<br />
inscrit dans <strong>la</strong> Constitution fédérale <strong>de</strong>puis 1972. Pour une explication brève et c<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> ce système, se référer à<br />
Prévoir l'avenir. Les assurances sociales suisses. Nécessité d'agir et options pour l'avenir, Berne, Département<br />
<strong>de</strong> l'intérieur, Office fédéral <strong>de</strong>s assurances sociales, pp. 4 et sv.<br />
83 Les informations contenues dans ce chapitre sont en gran<strong>de</strong> partie va<strong>la</strong>bles également pour l’assuranceinvalidité<br />
(AI), mais celle-ci ne sera pas développée dans ce chapitre, car elle ne concerne qu’une partie<br />
déterminée <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.
126 DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS<br />
4.8.1.2 Contenu<br />
Afin <strong>de</strong> pouvoir mettre effectivement en œuvre l’AVS, un certain nombre d’informations<br />
doivent être gérées <strong>de</strong> manière centralisée. Pour ce faire, <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong> Compensation (CdC)<br />
située à Genève, gère les trois registres suivants 84 , conformément à l’art. 71, al. 4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi<br />
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 (RS 831.10) :<br />
• le registre central <strong>de</strong>s assurés AVS/AI ;<br />
• le registre central <strong>de</strong>s rentes AVS/AI ;<br />
• et le registre central <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong>s prestations en nature <strong>de</strong> l’AI 85 .<br />
Pour <strong>la</strong> thématique que nous désirons développer ici, c’est le registre central <strong>de</strong>s assurés<br />
qui paraît être le plus intéressant : en effet, il sert tout d’abord à attribuer les numéros AVS<br />
pour l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse. Toutes les personnes qui sont tenues <strong>de</strong> payer <strong>de</strong>s cotisations ou<br />
qui bénéficient <strong>de</strong> prestations sans <strong>de</strong>voir cotiser reçoivent un certificat d’assurance 86 . Il s’agit<br />
d’une carte grise (qui atteste justement l’inscription au registre <strong>de</strong>s assurés) et qui porte le<br />
numéro d’assuré, structuré ainsi : xxx.xx.xxx.xxx. Il est composé d’un numéro <strong>de</strong> base (trois<br />
premiers groupes <strong>de</strong> chiffres) – constitué par le groupe du nom, le groupe <strong>de</strong> l’année <strong>de</strong><br />
naissance, le groupe du sexe, du jour et du mois <strong>de</strong> naissance – et d’un numéro d’ordre et d’un<br />
chiffre <strong>de</strong> contrôle (<strong>de</strong>rnier groupe <strong>de</strong> chiffres). Le certificat d’assurance contient en outre les<br />
numéros <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> compensation qui tiennent un compte individuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne<br />
assurée 87 . Ce registre a été créé en 1948.<br />
Le registre <strong>de</strong>s assurés contient essentiellement les informations qui figurent sur le<br />
certificat d’assurance, à savoir :<br />
• numéro AVS ;<br />
• autre(s) numéro(s) AVS éventuellement attribué(s) à <strong>la</strong> même personne ;<br />
• nom, prénom <strong>de</strong> l’assuré ;<br />
• sexe ;<br />
• date <strong>de</strong> naissance ;<br />
• nationalité ;<br />
• liste <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> compensation où <strong>la</strong> personne a cotisé en fonction <strong>de</strong> son parcours<br />
professionnel, ce qui permettra à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière caisse où l’assuré aura cotisé – au<br />
moment où il faudra verser <strong>la</strong> rente – d’effectuer ce qu’on appelle un rassemblement<br />
<strong>de</strong>s comptes individuels et <strong>de</strong> calculer <strong>la</strong> prestation.<br />
Le registre central <strong>de</strong>s rentes rassemble les informations concernant toutes les personnes<br />
bénéficiaires d’une rente AVS/AI ou d’une allocation pour impotent ; il sert à détecter les<br />
84<br />
Se référer à http://www.avs-ai-international.ch/ccv12_cdc/cdc.php?pagid=12, consultée le 19 mars 2007.<br />
85<br />
Ce registre ne sera pas abordé ici. Il comprend les décisions <strong>de</strong>s offices AI autorisant <strong>de</strong>s mesures<br />
individuelles <strong>de</strong> réadaptation d’ordre médical, professionnel ou <strong>de</strong> formation sco<strong>la</strong>ire spéciale, ainsi que l’octroi<br />
<strong>de</strong> moyens auxiliaires et contient les factures y re<strong>la</strong>tives dont le contrôle et le paiement s’effectuent par <strong>la</strong> CdC.<br />
Il continent environ 10 millions d’entrées.<br />
86<br />
Les personnes assurées à l’AVS exerçant une activité lucrative sont tenues <strong>de</strong> payer <strong>de</strong>s cotisations à partir du<br />
1 er janvier qui suit l’année durant <strong>la</strong>quelle elles accomplissent leur 17 e anniversaire, ceci jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> leur<br />
activité. Les personnes assurées à l’AVS sans activité lucrative sont tenues <strong>de</strong> payer <strong>de</strong>s cotisations à partir <strong>de</strong> 1 er<br />
janvier qui suit l’année durant <strong>la</strong>quelle elles accomplissent leur 20 e anniversaire, et ceci jusqu’à l’âge <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
retraite.<br />
87 er<br />
Se référer au document Le numéro d’assuré, va<strong>la</strong>ble dès le 1 janvier 1994, Office fédéral <strong>de</strong>s assurances<br />
sociales, Diffusion AFCL/EDMZ, Berne.
DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS 127<br />
doubles paiements éventuels et à informer les caisses <strong>de</strong> compensation <strong>de</strong>s décès <strong>de</strong><br />
bénéficiaires <strong>de</strong> prestations et il permet <strong>la</strong> conversion centralisée <strong>de</strong>s rentes AVS/AI lors <strong>de</strong>s<br />
augmentations ou <strong>de</strong>s révisions. Ce registre a été créé en 1949.<br />
Au moment du rassemblement <strong>de</strong>s comptes individuels on a un aperçu très général du<br />
parcours professionnel <strong>de</strong> l’assuré : on peut par exemple savoir pour quelle entreprise<br />
générale cette personne a travaillé, mais pas à quel endroit précisément (par exemple, qu’elle<br />
a travaillé chez Migros, mais sans savoir dans quelle succursale) ; dans quel domaine, mais<br />
pas à quel taux d’activité ; si elle a cotisé à l’étranger à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s déterminées, etc. Plus un<br />
assuré est jeune, plus il est aisé d’avoir ces informations, puisque les différentes caisses ont<br />
commencé à fournir ces informations à <strong>la</strong> CdC après 1981. Une autre information intéressante<br />
concerne les travailleurs « au gris », qui sont inscrits dans les registres au même titre que les<br />
autres assurés (on en peut donc pas les distinguer) : il s’agit <strong>de</strong>s personnes qui cotisent à<br />
l’AVS sans être déc<strong>la</strong>rées à d’autres instances administratives, comme l’Office <strong>de</strong>s étrangers.<br />
La raison <strong>de</strong> cette apparente incohérence dépend du fait qu’être assuré au 1 er pilier est<br />
indépendant du fait d’être déc<strong>la</strong>ré aux autres administrations.<br />
Les données <strong>de</strong> l’AVS contenues dans les <strong>de</strong>ux registres renvoient essentiellement à :<br />
• <strong>la</strong> vie économique <strong>de</strong>s assurés ;<br />
• leur mobilité professionnelle (Suisse / étranger) ;<br />
• où ces personnes perçoivent leur rente (Suisse / étranger).<br />
Nous pouvons donc constater que, en dépit <strong>de</strong> l’importance et <strong>de</strong> l’intérêt <strong>de</strong> ces données,<br />
il s’agit d’informations pauvres du point <strong>de</strong> vue socio-économique. Elles sont en effet<br />
récoltées et gérées pour un but bien déterminé et restreint à un domaine précis ; elles ne<br />
contiennent par conséquent pas d’informations substantielles al<strong>la</strong>nt au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce but et qui ne<br />
peuvent pas, dans une certaine mesure, être reconstituées ailleurs (notamment dans<br />
INFOSTAR pour les données <strong>de</strong> l’état civil). Au contraire <strong>de</strong> ce que nous avons observé dans<br />
les exemples précé<strong>de</strong>nts, les données ne sont pas structurées ici par superposition <strong>de</strong> couches.<br />
Concernant le contenu <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’AVS il est encore à signaler que, comme nous le<br />
verrons plus loin, à partir <strong>de</strong> fin 2008, un nouveau numéro d’assuré sera introduit. Il ne<br />
remp<strong>la</strong>cera pas l’ancien numéro, mais il y sera associé. Les personnes qui seront enregistrées<br />
à partir du 1 er janvier 2009, par contre, ne recevront que ce nouveau numéro.<br />
4.8.1.3 Supports<br />
Le registre central <strong>de</strong>s assurés et celui <strong>de</strong>s rentes sont gérés <strong>de</strong> manière informatique<br />
<strong>de</strong>puis les années 70. Depuis 1996 ils sont gérés au travers <strong>de</strong> banques <strong>de</strong> données<br />
re<strong>la</strong>tionnelles qui permettent <strong>de</strong> mettre les <strong>de</strong>ux registres en re<strong>la</strong>tion.<br />
Le registre <strong>de</strong>s assurés contient 20 millions d’entrées (numéros AVS), ce qui correspond<br />
à environ 15 millions <strong>de</strong> personnes enregistrées. En effet, le système d’enregistrement<br />
actuellement en p<strong>la</strong>ce fait que, si l’une <strong>de</strong>s données personnelles composant le numéro AVS<br />
change (par exemple le nom ou <strong>la</strong> nationalité), l’assuré reçoit un nouveau numéro ; une même<br />
personne peut recevoir un certain nombre <strong>de</strong> numéros AVS au cours <strong>de</strong> sa vie. Ce qu’il est<br />
intéressant <strong>de</strong> constater est que, une fois qu’un assuré a été enregistré dans le système sous un<br />
numéro AVS déterminé, il y reste toujours, même après son décès. Une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong> ce registre sont donc <strong>de</strong>s données historiques (personnes décédées) et passives<br />
(personnes vivantes mais ne bénéficiant pas encore d’une rente). Lorsqu’un assuré <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
une rente, les données qui le concernent sont activées. Chaque année sont attribués environ<br />
320'000 nouveaux numéros AVS.
128 DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS<br />
Le registre <strong>de</strong>s rentes contient 4.4 millions d’entrées, correspondant à 2.5 millions <strong>de</strong><br />
personnes percevant une rente : <strong>la</strong> différence correspond à une partie historique <strong>de</strong>s rentes<br />
éteintes. Dans ce registre, les personnes qui décè<strong>de</strong>nt sont bien évi<strong>de</strong>mment enlevées du<br />
système. Ces informations sur les décès sont communiquées à <strong>la</strong> CdC par l’Office fédéral <strong>de</strong><br />
l’état civil. Les assurés qui rési<strong>de</strong>nt à l’étranger, par contre, doivent confirmer leur droit à <strong>la</strong><br />
rente chaque année, <strong>la</strong> CdC ne pouvant savoir que difficilement si un décès a eu lieu. Ces<br />
registres sont régulièrement mutés, c’est-à-dire qu’on y introduit les modifications ou les<br />
informations nécessaires <strong>de</strong> manière très régulière. Le registre <strong>de</strong>s assurés est muté tous les<br />
soirs, le registre <strong>de</strong>s rentes tous les mois.<br />
Les serveurs qui font tourner <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données qui contient toutes ces informations<br />
sont gérés <strong>de</strong>puis 2001 par l’Office fédéral <strong>de</strong> l’informatique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication (OFIT),<br />
rattaché administrativement au Département fédéral <strong>de</strong>s finances (DFF) tout comme <strong>la</strong><br />
Centrale <strong>de</strong> Compensation. C’est cet office fédéral qui doit garantir <strong>la</strong> conservation et <strong>la</strong><br />
pérennité <strong>de</strong>s données et qui s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires. En outre, afin<br />
d’assurer <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> à long terme <strong>de</strong> toutes ces informations qui, comme nous l’avons<br />
montré, peuvent rester passives pendant très longtemps, elles sont enregistrées sur d’autres<br />
supports à <strong>de</strong>s échéances régulières. Le registre <strong>de</strong>s assurés est microfilmé tous les 5 ans, le<br />
registre <strong>de</strong>s rentes est enregistré sur ban<strong>de</strong> magnétique chaque 10 ans. Ces supports externes<br />
sont archivés aux Archives fédérales à Berne.<br />
4.8.1.4 Organe compétent<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s politiques publiques, il est très intéressant <strong>de</strong> constater<br />
que les données <strong>de</strong> l’AVS contenues dans les <strong>de</strong>ux registres cités permettent concrètement <strong>de</strong><br />
créer le lien entre les différentes caisses <strong>de</strong> compensation et d’effectuer ainsi le<br />
rassemblement <strong>de</strong>s comptes individuels pour le calcul <strong>de</strong>s rentes. La figure 4.8.1 ci-<strong>de</strong>ssous<br />
met en évi<strong>de</strong>nce les principaux acteurs <strong>de</strong> l’AVS en Suisse, ainsi que le rôle qu’ils sont<br />
appelés à jouer dans cette constel<strong>la</strong>tion :<br />
Commission fédérale<br />
pour l’AVS et l’AI<br />
OFAS<br />
(organe <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce)<br />
Centrale <strong>de</strong> compensation<br />
(organe <strong>de</strong> liaison)<br />
Registre central<br />
<strong>de</strong>s assurés<br />
DFI DFF<br />
Registre central<br />
<strong>de</strong>s rentes<br />
Caisses <strong>de</strong> compensation<br />
fédérales, cantonales,<br />
professionnelles, interprofessionnelles<br />
(organes d’exécution)<br />
Employeurs<br />
Assurés<br />
Fig. 4.8.1 : Schéma simplifié <strong>de</strong>s principaux groupes d’acteurs <strong>de</strong> l’AVS.
DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS 129<br />
L’organe <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> l’AVS 88 , responsable également <strong>de</strong> l’appareil légis<strong>la</strong>tif, est<br />
l’Office fédéral <strong>de</strong>s assurances sociales (OFAS), qui fait partie du Département fédéral <strong>de</strong><br />
l’intérieur (DFI). La Commission fédérale pour l’AVS et l’AI veille aux questions<br />
d’application et à l’évolution <strong>de</strong>s assurances.<br />
Les Caisses <strong>de</strong> compensation AVS, ainsi que leurs agences, constituent les organes<br />
d’exécution 89 : elles appliquent les dispositions légales et constituent le contact avec les<br />
assurés et les employeurs, elles fixent les cotisations et les encaissent, elles sont responsables<br />
du calcul et du versement <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> l’AVS aux ayant droit. Il en existe environ 100 et<br />
elles émanent d’associations professionnelles et interprofessionnelles, <strong>de</strong>s cantons et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Confédération. L’activité <strong>de</strong>s organes d’exécution <strong>de</strong> l’AVS est périodiquement contrôlée par<br />
<strong>de</strong>s bureaux <strong>de</strong> révision indépendants.<br />
Les employeurs, qui sont tenus <strong>de</strong> prélever sur tous les sa<strong>la</strong>ires versés les cotisations <strong>de</strong>s<br />
employés et <strong>de</strong> les faire parvenir à <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong> compensation choisie, font également partie<br />
<strong>de</strong>s acteurs qui participent à <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’assurance.<br />
La Centrale <strong>de</strong> Compensation (CdC), qui est rattachée au Département fédéral <strong>de</strong>s<br />
finances (DFF) et fait partie <strong>de</strong>s administrations FLAG (mandat <strong>de</strong> prestation, <strong>de</strong>uxième<br />
cercle <strong>de</strong> l’administration fédérale), fait office d’organe <strong>de</strong> liaison entre les différentes caisses<br />
<strong>de</strong> compensation : outre le fait qu’elle tient les registres et qu’elle attribue le numéro d’assuré,<br />
elle gère <strong>la</strong> comptabilité générale <strong>de</strong> l’AVS, elle centralise les cotisations <strong>de</strong> toutes les caisses<br />
et leur met à disposition les moyens pour le paiement <strong>de</strong>s rentes.<br />
Enfin, d’autres instances contribuent au fonctionnement <strong>de</strong> l’AVS : il s’agit entre autres<br />
<strong>de</strong>s administrations fiscales cantonales et <strong>de</strong>s offices d’état civil. Il est néanmoins à souligner<br />
que <strong>la</strong> CdC ne communique pas ses informations à d’autres acteurs publics, sauf sous forme<br />
anonyme (par exemple à l’OFAS ou à l’OFS).<br />
L’organisation <strong>de</strong> l’AVS se caractérise ainsi par un contrôle (OFAS) et une mise en<br />
œuvre (CdC) centralisés au niveau fédéral, ainsi que par une application décentralisée (caisses<br />
<strong>de</strong> compensation, employeurs, etc.). Le nombre <strong>de</strong> personnes qui sont impliquées dans <strong>la</strong><br />
réalisation <strong>de</strong> cette politique publique est donc très conséquent.<br />
4.8.1.5 Bases légales<br />
Beaucoup <strong>de</strong> changements concernant le système <strong>de</strong> l’AVS sont actuellement en cours et<br />
marqueront sans doute les prochaines décennies ; nous ne désirons pas développer ici toutes<br />
les révisions en cours ou prévues dans le cadre <strong>de</strong> l’AVS 90 . Les bases légales sur lesquelles<br />
l’attribution du numéro AVS et <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong>s registres se fon<strong>de</strong>nt restent <strong>principale</strong>ment les<br />
suivantes :<br />
• l’art. 92a <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20<br />
décembre 1946 (RS 831.10), qui règle <strong>la</strong> constitution et l’utilisation du numéro<br />
AVS ;<br />
88 Pour un bref <strong>de</strong>scriptif <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s tâches au sein <strong>de</strong> l’AVS, se référer à <strong>la</strong> page Internet suivante :<br />
http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv/00011/01259/in<strong>de</strong>x.html?<strong>la</strong>ng=fr, consultée le 21 mars 2007.<br />
89 La page Internet suivante donne <strong>la</strong> liste complète <strong>de</strong> toutes les caisses <strong>de</strong> compensation AVS en Suisse :<br />
http://www.avs.admin.ch/Home-F/Generalites/Caisses/CaissesListeComplete/caisseslistecomplete.html,<br />
consultée le 21 mars 2007.<br />
90 Un aperçu détaillé <strong>de</strong>s révisions en cours est donné par le document édité par le Centre d’information AVS/AI<br />
et intitulé Révisions. AVS, édition 2006. Etat : 1 er janvier 2007. Ce texte est accessible à <strong>la</strong> page Internet<br />
http://www.avs.admin.ch/Home-F/Generalites/Legis<strong>la</strong>tifs/Revisions.htm, consultée le 22 mars 2007.
130 DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS<br />
• l’art. 133, 134 bis et 71 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)<br />
du 31 octobre 1947 (RS 831.101) ; l’art. 133 détermine <strong>la</strong> composition du numéro<br />
AVS, l’art. 134 bis dispose que le numéro est attribué par <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong> Compensation<br />
et l’art. 71, al. 4 détermine l’obligation pour <strong>la</strong> CdC <strong>de</strong> tenir le registre <strong>de</strong>s assurés et<br />
le registre <strong>de</strong>s rentes ;<br />
Aucune mention <strong>de</strong>s questions liées à <strong>la</strong> conservation ou à l’archivage <strong>de</strong>s numéros<br />
d’AVS ou <strong>de</strong>s données contenues dans les registres n’est faite dans ces textes <strong>de</strong> loi. La raison<br />
en est que ces données sont soumises à <strong>la</strong> Loi fédérale sur l’archivage (LAr) du 26 juin 1998<br />
(RS 152.1) et à l’Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur l’archivage (Ordonnance sur<br />
l’archivage, OLAr) du 8 septembre 1999 (RS 152.11). Comme souligné, il apparaît d’ailleurs<br />
que toutes les mesures nécessaires pour garantir <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong> ces informations sont<br />
effectivement prises.<br />
Concernant les données <strong>de</strong>s registres, le changement le plus significatif sera, comme<br />
signalé précé<strong>de</strong>mment, le passage à un nouveau numéro d’assuré dès 2009. L’ancien numéro<br />
à 11 chiffres a en effet atteint son exploitation maximale, c’est-à-dire <strong>la</strong> possibilité d’attribuer<br />
un numéro différent à chaque assuré : puisque le registre <strong>de</strong>s assurés ne supprime jamais les<br />
numéros attribués à cause du fait qu’il n’y a pas <strong>de</strong> procédure systématique d’annonce <strong>de</strong><br />
décès, ceux-ci ne peuvent pas être réutilisés. Il s’est donc avéré indispensable <strong>de</strong> changer le<br />
système. Il est en outre considéré que le numéro AVS, qui existe sous sa forme actuelle<br />
<strong>de</strong>puis 1972, qui est par<strong>la</strong>nt et se base sur <strong>de</strong>s données personnelles, posait un problème <strong>de</strong><br />
fond du point <strong>de</strong> vu <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données, <strong>de</strong>vant être garantie suivant <strong>la</strong> Loi fédérale<br />
sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données (LPD) du 19 juin 1992 (RS 235.1) et l’Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong><br />
loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données (OLPD) du 14 juin 1993 (RS 235.11). Ainsi, le<br />
nouveau numéro, qui sera composé <strong>de</strong> 13 chiffres (dont les trois premiers désigneront le pays<br />
qui émet le numéro, donc <strong>la</strong> Suisse) sera totalement anonyme ; il sera attribué sans équivoque<br />
à une seule personne dès <strong>la</strong> naissance et ne changera plus tout au long <strong>de</strong> sa vie. Il sera en<br />
outre utilisé comme numéro <strong>de</strong> sécurité sociale dans toutes les assurances sociales régies par<br />
le droit fédéral, dans certaines assurances complémentaires privées, dans les domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fiscalité fédérale et <strong>de</strong> l’administration militaire, ainsi qu’au niveau <strong>de</strong>s cantons et <strong>de</strong>s<br />
communes (réduction <strong>de</strong>s primes <strong>de</strong> caisse-ma<strong>la</strong>die, <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> sociale, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiscalité et <strong>de</strong><br />
l’éducation). Ce numéro sera protégé par <strong>la</strong> loi, ce qui empêchera les acteurs autres que ceux<br />
expressément mentionnés dans <strong>la</strong> loi d’en faire un usage systématique.<br />
Un autre changement significatif qui aura un impact sur <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’AVS<br />
– <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière que sur les données d’INFOSTAR – est <strong>la</strong> récente entrée en vigueur<br />
(au 1 er novembre 2006) <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur l’harmonisation <strong>de</strong>s registres <strong>de</strong>s habitants et<br />
d’autres registres officiels <strong>de</strong> personnes (Loi sur l’harmonisation <strong>de</strong>s registres, LHR) du 23<br />
juin 2006 (RS 431.02). Cette loi vise (art. 1, al. 1) à simplifier <strong>la</strong> collecte <strong>de</strong> données à <strong>de</strong>s<br />
fins statistiques (recensement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> 2010) par l’harmonisation <strong>de</strong>s registres<br />
officiels <strong>de</strong> personnes et l’échange <strong>de</strong> données personnelles entre registres. Cette loi aura un<br />
impact sur <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s registres <strong>de</strong> l’AVS dans <strong>la</strong> mesure où <strong>de</strong>s normes, <strong>de</strong>s caractères et<br />
<strong>de</strong>s modalités seront établis par l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique afin d’atteindre les buts<br />
préfixés (art. 1, al. 2).<br />
4.8.1.6 Coûts<br />
Le volume <strong>de</strong>s rentes <strong>de</strong> l'AVS s'élève actuellement à près <strong>de</strong> 29 milliards <strong>de</strong> francs, il<br />
s’agit donc d’un domaine qui a un poids financier considérable. Les <strong>principale</strong>s sources <strong>de</strong><br />
financement <strong>de</strong> l'AVS (et, aussi, <strong>de</strong> l'AI) sont les cotisations <strong>de</strong>s assurés, les cotisations <strong>de</strong>s<br />
employeurs, les contributions <strong>de</strong>s pouvoirs publics (Confédération et cantons) et <strong>la</strong> TVA.
DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS 131<br />
La conservation <strong>de</strong>s informations qui permettent au système <strong>de</strong> fonctionner a donc elle<br />
aussi un poids financier important. Dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, réalisée sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
temps très courte, il n’est néanmoins pas possible <strong>de</strong> déterminer quels sont les coûts liés à <strong>la</strong><br />
gestion, à <strong>la</strong> conservation et à l’archivage <strong>de</strong>s données contenues dans les registres <strong>de</strong> l’AVS.<br />
4.8.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Dans chacun <strong>de</strong>s domaines que nous avons abordés dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong><br />
politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>, nous nous sommes efforcés d’i<strong>de</strong>ntifier les données <strong>de</strong> base qui<br />
permettent à une politique publique donnée <strong>de</strong> fonctionner. Dans le cadre <strong>de</strong> l’AVS nous<br />
avons considéré que cette assurance, dans son état d’organisation légis<strong>la</strong>tive et institutionnelle<br />
actuel, ne pourrait pas fonctionner sans que les données liées au numéro d’AVS et contenues<br />
dans le registre <strong>de</strong>s assurés – mais aussi dans le registre <strong>de</strong>s rentes – soient gérées <strong>de</strong> manière<br />
centralisée et soient conservées à long terme.<br />
Dans l’étu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation qui suit, nous essaierons d’expliciter les<br />
diverses étapes à travers lesquelles ces données passent afin d’être sauvegardées dans le temps<br />
et mises à disposition <strong>de</strong>s acteurs concernés par leur utilisation. Nous tiendrons également<br />
compte <strong>de</strong>s changements en cours concernant le numéro d’AVS.<br />
4.8.2.1 Mémorisabilité<br />
D’un point <strong>de</strong> vue substantiel, les données <strong>de</strong> l’AVS mémorisables dans les <strong>de</strong>ux<br />
registres cités sont essentiellement celles qui permettent <strong>de</strong> faire le lien entre les caisses <strong>de</strong><br />
compensation et <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong> Compensation. Comme nous l’avons souligné, le numéro AVS<br />
actuellement encore utilisé 91 repose presque entièrement sur <strong>de</strong>s données personnelles :<br />
chaque changement concernant ces données (en particulier <strong>de</strong> nom, <strong>de</strong> nationalité, <strong>de</strong> sexe)<br />
engendre l’attribution d’un nouveau numéro. De même, chaque erreur qui a donné naissance à<br />
l’attribution d’un tel numéro – causé par une information incorrecte au départ, concernant par<br />
exemple <strong>la</strong> date <strong>de</strong> naissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne, ou par <strong>la</strong> mauvaise compréhension <strong>de</strong><br />
l’orthographe d’un nom, etc. – a pour conséquence, une fois que cette erreur est détectée,<br />
l’attribution d’un nouveau numéro. Tous les numéros d’AVS qu’une personne peut possé<strong>de</strong>r<br />
au cours <strong>de</strong> sa vie doivent être mis en re<strong>la</strong>tion entre eux, qu’ils soient « justes » ou qu’ils<br />
soient <strong>la</strong> conséquence d’une imprécision. Il se peut aussi que <strong>de</strong>s numéros puissent être reliés<br />
par erreur. Tout ce processus est géré par le bureau <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> CdC. Les numéros<br />
enregistrés dans le registre <strong>de</strong>s assurés – qui est un registre brut où les données ne peuvent pas<br />
être éliminées – sont ainsi mémorisés pour <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> sécurité (gestion unique <strong>de</strong>s<br />
numéros), ce qui permet <strong>de</strong> modifier en tout temps les données erronées et <strong>de</strong> conserver en<br />
même temps un contrôle sur le paiement <strong>de</strong>s rentes et <strong>de</strong>s cotisations liés à chacun <strong>de</strong>s<br />
assurés. Ce système, certes compliqué et présentant <strong>de</strong>s limites, permet néanmoins <strong>de</strong><br />
mémoriser toutes ces opérations et <strong>de</strong> conserver le lien entre les différents groupes d’acteurs<br />
concernés. Le nouveau numéro d’assurance rendra ces processus beaucoup plus aisé : en<br />
dissociant les données personnelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure du numéro, il sera possible <strong>de</strong> mémoriser<br />
les données en réduisant sensiblement les erreurs potentielles et en permettant une correction<br />
91 Pour plus <strong>de</strong> détails sur le numéro AVS actuel et futur se référer à <strong>la</strong> documentation suivante, disponible sur le<br />
site Internet www.avs-ai.info : Nouveau numéro AVS. Etat du projet au 1 er novembre 2006. Introduction du<br />
nouveau numéro AVS, Centre d’information AVS/AI, en col<strong>la</strong>boration avec l’Office fédéral <strong>de</strong>s assurances<br />
sociales, novembre 2006 ; Projet NNSS – Nouveau numéro <strong>de</strong> sécurité sociale. Pourquoi un nouveau numéro<br />
d’assuré AVS, Centre d’information AVS/AI, mars 2005 ; Projet NNSS – Nouveau numéro <strong>de</strong> sécurité sociale.<br />
Information concernant le nouveau numéro d’assuré, Centre d’information AVS/AI, mars 2006 ; Message<br />
re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (Nouveau numéro d’assuré<br />
AVS) du 23 novembre 2005 (05.079).
132 DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS<br />
<strong>de</strong> celles-ci sans conséquences sur <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s rentes et <strong>de</strong>s cotisations. En outre, il<br />
permettra une mise en réseau et un échange d’informations – notamment avec les assurances<br />
sociales <strong>de</strong>s autres pays européens – qui pose actuellement problème à cause <strong>de</strong><br />
l’i<strong>de</strong>ntification parfois équivoque <strong>de</strong>s personnes. Le seul bémol <strong>de</strong> ce système, toujours du<br />
point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisabilité, concerne les annonces <strong>de</strong> décès, notamment pour ceux qui<br />
ont lieu à l’étranger et qui souvent ne sont pas communiqués aux caisses <strong>de</strong> compensation ou<br />
aux offices d’état civil en Suisse. Dans ces cas, <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong> Compensation doit effectuer<br />
<strong>de</strong>s recherches spécifiques.<br />
D’un point <strong>de</strong> vue technique, toutes les données sont facilement mémorisables sur les<br />
supports informatiques, d’autant plus que le système a été informatisé <strong>de</strong>puis longtemps.<br />
Néanmoins, <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce du nouveau numéro AVS correspondra au remp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s<br />
systèmes informatiques et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données utilisés à <strong>la</strong> CdC, qui sont anciens et qui<br />
répondront aux nouvelles exigences <strong>de</strong>s organes d’exécution et <strong>de</strong>s assurés.<br />
Comme nous l’avions constaté pour les données gérées par <strong>de</strong>s registres, celles <strong>de</strong> l’état<br />
civil et celles du registre <strong>de</strong>s migrations, le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’AVS<br />
est régulé dans les détails : les opérateurs (caisses <strong>de</strong> compensation) et le régu<strong>la</strong>teur (Centrale<br />
<strong>de</strong> Compensation) se distinguent c<strong>la</strong>irement, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données est centralisée et est<br />
attribuée au régu<strong>la</strong>teur. La gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource que nous avons appelée « <strong>la</strong>ngage » et qui<br />
permet <strong>de</strong> déterminer <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s applications, <strong>de</strong>s architectures, etc. informatiques qui<br />
permettent <strong>de</strong> gérer les données est cette fois-ci encore dans les mains d’un acteur externe au<br />
système (OFIT), mais appartenant au même département que le régu<strong>la</strong>teur (DFF).<br />
4.8.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Ces mêmes réflexions sont va<strong>la</strong>bles du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> dignité à <strong>la</strong> mémorisation. Les<br />
données qui sont mémorisables dans les registres correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s informations dignes<br />
d’être mémorisées : ceci non pas d’un point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> leur intérêt mémorial, archivistique,<br />
historique ou autre, mais du point <strong>de</strong> vue du fonctionnement du système <strong>de</strong> l’assurancevieillesse<br />
et survivants. Les critères <strong>de</strong> ce qui est digne d’être mémorisé ont été mis en p<strong>la</strong>ce<br />
dès l’introduction du numéro AVS et <strong>de</strong>s registres, ils ont été légèrement modifiés lors <strong>de</strong>s<br />
changements <strong>de</strong> 1972 (passage d’un numéro <strong>de</strong> 8 à 10 chiffres à un numéro à 11 chiffres).<br />
Il est aussi intéressant <strong>de</strong> remarquer que dans le registre <strong>de</strong>s assurés aucune distinction<br />
n’est faite entre les données historiques ou mortes (celles qui concernent <strong>de</strong>s personnes déjà<br />
décédées), les données passives (celles qui concernent <strong>de</strong>s personnes encore vivantes mais qui<br />
ne bénéficient pas pour le moment d’une rente) et les données actives ou vivantes, qui<br />
concernent les personnes qui bénéficient au moment présent d’une rente et qui figurent donc<br />
également dans le registre <strong>de</strong>s rentes. Cette double présence est <strong>la</strong> seule manifestation<br />
physique du fait qu’il s’agit là <strong>de</strong> données activées. Toutes ces données sont dans un même<br />
ensemble, ce qui constitue <strong>la</strong> condition sine qua non pour gérer le contrôle <strong>de</strong> l’attribution <strong>de</strong><br />
nouveaux numéros.<br />
Un changement important <strong>de</strong>s informations qui sont introduites dans les registres aura<br />
lieu dès l’introduction du nouveau numéro, qui modifie sensiblement le fonctionnement du<br />
système : <strong>de</strong> quelle portée seront ces changements ? Est-ce que les données personnelles qui<br />
figurent actuellement dans le registre <strong>de</strong>s assurés seront-elles maintenues ? Ces changements<br />
sont en lien direct avec les révisions légis<strong>la</strong>tives (11 ème révision <strong>de</strong> l’AVS), qui impliquent à<br />
chaque fois <strong>de</strong>s modifications dans <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données. Ces changements ont lieu <strong>de</strong> plus<br />
en plus fréquemment.
DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS 133<br />
Nous constatons que <strong>la</strong> dignité à <strong>la</strong> mémorisation est elle aussi très bien réglementée. Le<br />
régu<strong>la</strong>teur, dans ce contexte, n’est plus <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong> Compensation, mais l’Office fédéral <strong>de</strong>s<br />
assurances sociales. C’est en effet cet acteur qui détermine quelles sont les informations qui<br />
doivent figurer dans les registres et qui sont associées au numéro d’assurance AVS. C’est<br />
donc au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération que <strong>la</strong> ressource que nous appelons « raison » est gérée.<br />
4.8.2.3 Mémorisation réelle<br />
Comme souligné, les processus qui garantissent <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s données au niveau<br />
informatique dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’OFIT. Ayant désormais une vue d’ensemble plus précise <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
gestion <strong>de</strong> quelques registres (état civil, casier judiciaire, AVS), il s’avère que pour effectuer<br />
une analyse plus approfondie <strong>de</strong>s conditions nécessaires à une mémorisation réelle <strong>de</strong>s<br />
données il faut réaliser <strong>de</strong>s entretiens dans les offices qui s’occupent spécifiquement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
gestion informatique. Le regroupement <strong>de</strong>s compétences informatiques par département ont<br />
en effet comme conséquence une perte <strong>de</strong> contrôle (ou, du moins, <strong>de</strong> connaissance technique)<br />
<strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données auprès <strong>de</strong>s régu<strong>la</strong>teurs et <strong>de</strong>s opérateurs<br />
traditionnels.<br />
Dans le cas <strong>de</strong>s registres <strong>de</strong> l’AVS, <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données est absolument<br />
garantie par l’enregistrement <strong>de</strong>s informations à <strong>de</strong>s échéances régulières sur <strong>de</strong>s supports<br />
analogiques qui sont ensuite versés au Archives fédérales suisses (AF). Les régu<strong>la</strong>teurs <strong>de</strong> ces<br />
processus sont donc dans ce contexte l’OFIT pour <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s données informatiques et<br />
les AF pour <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> analogique à long terme <strong>de</strong> ces mêmes informations. La ressource<br />
« espace & temps » se trouve alors ici divisée entre acteurs : alors que l’« espace », en termes<br />
<strong>de</strong> stockage, est une ressource dont le soin est attribué à l’OFIT et aux AF, le « temps » doit<br />
être pris en considération par <strong>la</strong> CdC, qui doit réaliser et livrer les microfiches et les ban<strong>de</strong>s<br />
magnétiques aux AF.<br />
4.8.2.4 Accessibilité<br />
Les données <strong>de</strong> l’AVS <strong>de</strong>s registres gérés par <strong>la</strong> CdC ne sont bien évi<strong>de</strong>mment pas<br />
accessibles au public. Puisqu’elles sont utilisées seulement pour les assurances sociales au<br />
sens strict du terme, elles ne sont accessibles qu’à un nombre restreint d’acteurs publics.<br />
L’art. 33 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur <strong>la</strong> partie générale du droit <strong>de</strong>s assurances sociales (LPGA) du<br />
6 octobre 2000 (RS 830.1) stipule d’ailleurs que :<br />
Art. 33 Obligation <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le secret<br />
Les personnes qui participent à l’application <strong>de</strong>s lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son<br />
contrôle ou à sa surveil<strong>la</strong>nce sont tenues <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le secret à l’égard <strong>de</strong>s tiers.<br />
La Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoit à l’art. 50a <strong>la</strong><br />
possibilité <strong>de</strong> dérogation à l’art. 33 LPGA et <strong>de</strong> communiquer les données aux organes<br />
suivants, dans <strong>la</strong> mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose :<br />
• d’autres organes chargés <strong>de</strong> l’application, le contrôle ou <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong><br />
l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> LAVS ;<br />
• aux organes d’une autre assurance sociale si une loi fédérale le prévoir ;<br />
• aux organes <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale ;<br />
• aux autorités d’instruction pénale ;
134 DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS<br />
• à d’autres autorités compétentes en matière d’ai<strong>de</strong> sociale, aux tribunaux civils,<br />
pénaux ou autres organes d’instruction pénale, aux offices <strong>de</strong>s poursuites et aux<br />
autorités fiscales, pour autant qu’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite et motivée soit faite.<br />
La transmission <strong>de</strong>s informations se passe entièrement au travers <strong>de</strong>s réseaux<br />
informatiques, qui permettent également <strong>de</strong> fixer et mettre en œuvre <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
différents selon l’acteur dont il s’agit.<br />
L’introduction du nouveau numéro AVS, qui sera anonyme (pas <strong>de</strong> données<br />
personnelles) et l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur l’harmonisation <strong>de</strong>s registres (communication entre<br />
différents registres et possibilité <strong>de</strong> relier les données concernant une même personne d’un<br />
registre à l’autre) auront probablement pour conséquence un é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> palette <strong>de</strong><br />
l’accessibilité à ces données.<br />
En conclusion, nous constatons que les droits d’usage <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’AVS sont<br />
re<strong>la</strong>tivement restreints, notamment en respect à <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données. Ces droits sont<br />
c<strong>la</strong>irement régulés. Comme nous l’avions affirmé dans le cadre <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil,<br />
l’utilisation <strong>de</strong> supports informatiques permet une mise en réseau qui n’a pas pour but<br />
d’é<strong>la</strong>rgir l’accès à <strong>la</strong> ressource « espace public », mais <strong>de</strong> faciliter l’accès à l’information <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong>s acteurs habilités.<br />
4.8.3 Commentaires<br />
Le présent chapitre a été rédigé grâce à un entretien préa<strong>la</strong>ble avec M. Markus Büschi,<br />
Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Information, savoir et logistique <strong>de</strong> l’OFAS et M. Michel Giriens,<br />
Economiste <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Organisation et comptabilité AVS/APG/PC du même office. Le<br />
thème choisi a ensuite été approfondi lors d’un entretien avec M. Jacek Micuta, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
section Statistique et Registres centraux <strong>de</strong> <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong> Compensation à Genève, ainsi que<br />
par <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s bases légales, <strong>de</strong> documents et <strong>de</strong>s pages Internet ayant trait au sujet. Les<br />
aspects qui peuvent être relevés en guise <strong>de</strong> conclusion sont les suivants :<br />
(1) Le registre central <strong>de</strong>s assurés et le registre central <strong>de</strong>s rentes, ainsi que toutes<br />
les données qu’ils contiennent, constituent l’assemb<strong>la</strong>ge à un même endroit<br />
d’une multitu<strong>de</strong> d’informations disséminées parmi une multitu<strong>de</strong> d’acteurs et<br />
faisant partie d’un même puzzle. Cette constatation est intéressante d’un point<br />
<strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>, car elle montre qu’il existe <strong>de</strong>s<br />
structures centralisatrices dont il convient, plus que pour d’autres, d’en<br />
conserver le contenu. La centralisation ou <strong>la</strong> mise en réseau <strong>de</strong>s données<br />
pourrait donc constituer un moment susceptible <strong>de</strong> se poser <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s<br />
critères <strong>de</strong> sélection qui déterminent ce qui est digne d’être mémorisé.<br />
(2) Dans le cas <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’AVS contenues dans ces registres, nous avons<br />
montré que pratiquement tout le processus est précisément réglé : <strong>la</strong><br />
distinction entre opérateurs et régu<strong>la</strong>teurs est aisée à déterminer. A ce sujet, il<br />
est extrêmement intéressant <strong>de</strong> noter que d’une part <strong>la</strong> répartition entre ces<br />
<strong>de</strong>ux tâches peut varier d’une étape à l’autre <strong>de</strong> notre modèle d’analyse et<br />
que, d’autre part, le rôle du régu<strong>la</strong>teur peut être partagé entre plusieurs<br />
acteurs, ceci selon qu’il s’agit d’une conservation active <strong>de</strong>s données<br />
(informatiques) ou passive (archivage).<br />
(3) Les quatre ressources que nous utilisons comme point <strong>de</strong> repère théorique<br />
sont ici c<strong>la</strong>irement prises en considération et font elles aussi l’objet d’une<br />
régu<strong>la</strong>tion.
DONNEES DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS 135<br />
(4) Enfin, nous remarquons que les changements dans les processus qui<br />
caractérisent les quatre étapes qui vont <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisabilité à l’accessibilité<br />
au public dépen<strong>de</strong>nt directement <strong>de</strong>s changements légis<strong>la</strong>tifs qui influent sur<br />
<strong>la</strong> structure <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s données. Ces modifications sont <strong>de</strong> plus en plus<br />
aisées à faire, grâce aux nouvelles technologies <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> donnée, et<br />
<strong>de</strong>viennent <strong>de</strong> plus en plus fréquents. Quelles sont les conséquences <strong>de</strong> ces<br />
changements du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> mémorisations ?
4.9 Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée<br />
[Etat en avril 2007]<br />
Parmi les différents groupes <strong>de</strong> données que nous avons choisi d’abor<strong>de</strong>r dans cette<br />
étu<strong>de</strong>, celui <strong>de</strong>s données à caractère financier sera présenté à travers l’exemple <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur<br />
<strong>la</strong> valeur ajoutée (TVA). Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA seront donc brièvement abordées en utilisant<br />
comme porte d’entrée <strong>la</strong> Division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée (DP TVA) <strong>de</strong><br />
l’Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions (AFC).<br />
4.9.1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
4.9.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
La TVA est un impôt perçu au niveau fédéral et géré <strong>de</strong> manière centralisée <strong>de</strong>puis son<br />
introduction en 1995 92 . L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> données permet ainsi <strong>de</strong> disposer d’un exemple<br />
<strong>de</strong> processus <strong>de</strong> gestion soumis à <strong>la</strong> responsabilité d’un acteur unique et ayant suivi une<br />
évolution linéaire. Il s’agit d’un impôt indirect sur <strong>la</strong> consommation : elle est perçue à chaque<br />
sta<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong> biens ou <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong> services par<br />
<strong>la</strong> Confédération. Elle est fondamentale, car elle représente une contribution importante aux<br />
moyens financiers dont <strong>la</strong> Confédération a besoin pour accomplir ses tâches et concerne<br />
directement un grand nombre <strong>de</strong> contribuables assujettis (et, indirectement, chacun d’entre<br />
nous). Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>, s’agissant <strong>principale</strong>ment <strong>de</strong> données<br />
financières, leur contenu ne présente qu’un intérêt socio-historique limité ; leur importance,<br />
qui est <strong>de</strong> nature économique et juridique, requiert une gestion sans faille <strong>de</strong> tout le processus<br />
<strong>de</strong> production et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s données.<br />
4.9.1.2 Contenu<br />
L’étu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> ces données exige <strong>de</strong> connaître quelques éléments <strong>de</strong><br />
base sur le fonctionnement général <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA, que nous présentons brièvement ici 93 .<br />
La TVA est un impôt indirect qui se calcule sur le volume <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation, c’est-àdire<br />
sur ce que les particuliers dépensent pour acquérir <strong>de</strong>s prestations en tout genre (<strong>de</strong>s<br />
biens, mais aussi <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> services). Trois différents taux <strong>de</strong> TVA sont appliqués, à<br />
savoir un taux normal (7,6%), un taux réduit qui s’applique en particulier aux biens <strong>de</strong><br />
consommation courants (3,6%) et un taux spécial pour les prestations du secteur <strong>de</strong><br />
l’hébergement (2,4%). Il s’agit d’un impôt indirect dans le sens que sa perception intervient<br />
chez les producteurs, les fabricants, les commerçants, les artisans et les prestataires <strong>de</strong><br />
services qui livrent <strong>de</strong>s biens aux consommateurs ou fournissent <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> services.<br />
Pour éviter les distorsions <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence on impose également l’importation <strong>de</strong>s biens,<br />
l’acquisition <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong> services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger ainsi que les<br />
prestations à soi-même (sur le territoire suisse, avec quelques exceptions). En outre, <strong>de</strong>s<br />
mesures légis<strong>la</strong>tives sont prévues pour favoriser l’ouverture et <strong>la</strong> compatibilité avec <strong>la</strong><br />
communauté européenne. La TVA est également un impôt multista<strong>de</strong>, c’est-à-dire qu’elle est<br />
perçue à tous les échelons <strong>de</strong> <strong>la</strong> production, du commerce et du secteur <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong><br />
92 Avant <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA, en Suisse le chiffre d’affaire était grevé par le biais <strong>de</strong> <strong>la</strong> ICHA (impôt sur le<br />
chiffre d’affaires), introduite en 1941 ; l’obligation <strong>de</strong> payer l’impôt incombait au grossiste, soit au <strong>de</strong>rnier<br />
maillon <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaîne <strong>de</strong>s opérations.<br />
93 Se référer aux Instructions 2001 sur <strong>la</strong> TVA, 610.525, Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions AFC,<br />
Division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA, 2000, p. 12 et sv.
138 DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE<br />
services, à savoir sur toute opération réalisée entre un assujetti et le <strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
prestation.<br />
Le fournisseur ou le prestataire <strong>de</strong> services assujetti calcule <strong>la</strong> TVA sur son chiffre<br />
d’affaires et <strong>la</strong> transfère à l’acquéreur ; périodiquement (en principe chaque trimestre ou<br />
semestre), il doit adresser à l’AFC un décompte qui déc<strong>la</strong>re son chiffre d’affaires global, ainsi<br />
que <strong>la</strong> TVA s’y rapportant. Dans ce même décompte, il opère <strong>la</strong> déduction <strong>de</strong> l’impôt<br />
préa<strong>la</strong>ble en soustrayant <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA due sur son chiffre d’affaires <strong>la</strong> TVA que ses fournisseurs<br />
<strong>de</strong> prestations lui ont transférée et celle qu’il a payée à l’importation : il ne versera à l’AFC<br />
que le montant restant. Lorsque l’impôt préa<strong>la</strong>ble dépasse l’impôt dû, l’AFC rembourse ou<br />
crédite <strong>la</strong> différence.<br />
Les informations concernant <strong>la</strong> TVA que <strong>la</strong> DP TVA gère sont donc essentiellement <strong>de</strong>s<br />
décomptes, <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations, <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> correspondance ou juridiques (décisions,<br />
jugement, etc.) ainsi que <strong>de</strong>s données à caractère financier (chiffres) qu’il s’agit <strong>de</strong> vérifier. La<br />
gestion <strong>de</strong> toutes ces données est régulée à l’intérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> DP TVA <strong>de</strong> manière très précise et<br />
peut être décrite comme suit.<br />
Chaque contribuable potentiel comman<strong>de</strong> à l’AFC un questionnaire d’enregistrement en<br />
donnant quelques indications <strong>de</strong> base (coordonnées, genre d’activité, etc.) sur un formu<strong>la</strong>ire<br />
spécifique. Il remplit le questionnaire, qui est très détaillé et dont les rubriques <strong>principale</strong>s<br />
concernent les données personnelles, juridiques et fiscales ; un réviseur <strong>de</strong> l’AFC détermine si<br />
le contribuable est assujetti ou non à <strong>la</strong> TVA (le chiffre d’affaires doit être supérieur à 75'000<br />
francs par année). S’il l’est, le contribuable reçoit un certificat qui le confirme ainsi qu’un<br />
numéro TVA, qui correspond à l’inscription du contribuable assujetti dans le Registre <strong>de</strong>s<br />
contribuables ; le premier décompte, qui servira ensuite <strong>de</strong> base pour les suivants, peut alors<br />
être fait. Suivant le modèle d’échéance que le contribuable aura choisi (trimestriel ou<br />
semestriel), il aura ensuite 30 jours pour envoyer le décompte à <strong>la</strong> DP TVA et pour payer ou<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s remboursements.<br />
Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA sont donc elles aussi, tout comme les données que nous avons<br />
étudiées dans les chapitres précé<strong>de</strong>nts, composées <strong>de</strong> différents types et couches<br />
d’informations, qui peuvent être distinguées ainsi :<br />
• le numéro <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA, qui permet <strong>de</strong> mettre le contribuable assujetti en re<strong>la</strong>tion avec<br />
les données (traitées dans différentes bases <strong>de</strong> données) et les documents qui le<br />
concernent ;<br />
• les données personnelles <strong>de</strong> celui-ci, qui permettent <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntifier précisément ;<br />
• les données fiscales liées à son activité en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> TVA ;<br />
• <strong>la</strong> documentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspondance.<br />
Toutes ces informations sont actuellement entièrement gérées sous forme électronique. A<br />
leur arrivée dans les locaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> Division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée, les<br />
décomptes ainsi que les pièces significatives <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspondance sont immédiatement dotés<br />
d’un co<strong>de</strong> barre qui permet <strong>de</strong> les i<strong>de</strong>ntifier et sont ensuite scannés. Ils peuvent alors être<br />
introduits dans le système EFIM (système électronique <strong>de</strong> lecture <strong>de</strong> formu<strong>la</strong>ires et<br />
d’informations <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée). De cette manière, le personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> DP TVA<br />
concerné dispose à tout moment et en même temps <strong>de</strong>s chiffres comptables <strong>de</strong>s décomptes<br />
ainsi que d’une copie électronique <strong>de</strong>s documents originaux. A partir <strong>de</strong> ces documents<br />
scannés (en format .pdf ou .tif), un programme informatique ad hoc utilisant une technologie<br />
<strong>de</strong> reconnaissance (OCR, Optical character recognition pour les données à lecture optique et<br />
ICR, Intelligent character recognition) permet d’extraire <strong>de</strong>s décomptes uniquement les
DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE 139<br />
chiffres (qui sont ensuite vérifiés manuellement, car les décomptes sont pour <strong>la</strong> plupart<br />
manuscrits); ces chiffres sont ensuite introduits dans l’application MOLIS, qui est une base <strong>de</strong><br />
données mathématiques permettant <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s calculs et d’automatiser en partie les<br />
contrôles. Les accès à ces bases <strong>de</strong> données sont régulés avec <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s d’accès, suivant les<br />
tâches que les col<strong>la</strong>borateurs·trices doivent exécuter. Les documents originaux en papier sont<br />
rapi<strong>de</strong>ment archivés dans un dépôt externe suivant les indications <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi fédérale sur<br />
l’archivage (LAr) du 26 juin 1998 (RS 152.1) et sous le contrôle <strong>de</strong>s Archives fédérales<br />
suisses.<br />
En Suisse, les contribuables assujettis à <strong>la</strong> TVA sont environ 300'000. Ceux-ci envoient<br />
les décomptes ou d’autres documents en re<strong>la</strong>tion à <strong>la</strong> TVA en moyenne quatre fois par année ;<br />
à chaque échéance, <strong>la</strong> DP TVA reçoit en moyenne 120 caisses <strong>de</strong> décomptes à introduire dans<br />
le système et à vérifier. La DP TVA estime ainsi que les informations <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA qu’elle gère<br />
constituent environ 2 millions <strong>de</strong> documents, qui augmentent d’environ 5% chaque année<br />
(augmentation régulière <strong>de</strong>s contribuables assujettis à <strong>la</strong> TVA).<br />
4.9.1.3 Supports<br />
Comme les explications précé<strong>de</strong>ntes le montrent, le processus <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> traitement<br />
<strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA est entièrement informatisé ; <strong>de</strong> cette manière les informations sont<br />
conservées sous trois formes :<br />
• sous forme <strong>de</strong> chiffres comptables électroniques, dans l’application MOLIS. Cette<br />
application date <strong>de</strong> 1995 et a subi une réadaptation en 2000 ; elle est le résultat du<br />
jume<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> cinq bases <strong>de</strong> données différentes. MOLIS est actuellement composée<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux interfaces <strong>principale</strong>s. La première contient les données <strong>de</strong> base (l’adresse du<br />
contribuable assujetti, <strong>la</strong> commune où il exerce son activité, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue, le numéro<br />
TVA, <strong>de</strong>puis quand il est assujetti, <strong>la</strong> branche dans <strong>la</strong>quelle il exerce son activité) ; <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième interface contient <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s (co<strong>de</strong> du réviseur responsable, contrôles<br />
effectués, etc.) et les chiffres comptables (chiffre d’affaire, impôt préa<strong>la</strong>ble, TVA<br />
payée, etc.). Les co<strong>de</strong>s permettent <strong>de</strong> réguler l’accès aux données (accès déterminé<br />
par chaque employé en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> tâche, possibilité ou non <strong>de</strong> modifier les<br />
données) et <strong>de</strong> déterminer plusieurs dizaines <strong>de</strong> fonctions (par exemple décomptes,<br />
comptabilité, contrôle du système, poursuites, inspectorat, etc.) ;<br />
• sous forme <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rations et autres documents scannés, dans le système EFIM, qui<br />
a été mis en œuvre en 2005 après 7 ans <strong>de</strong> projet et qui a permis <strong>de</strong> libérer les locaux<br />
<strong>de</strong> stockage <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> <strong>la</strong> DP TVA, qui étaient encombrés ;<br />
• sous forme <strong>de</strong> dossiers originaux sur papier, immédiatement archivés, qui seuls font<br />
foi au niveau juridique et qui acquièrent toute leur importance lorsque <strong>de</strong>s fautes (très<br />
rares) introduites dans le système sont détectées, car ils permettent un retour en<br />
arrière.<br />
Le numéro TVA permet <strong>de</strong> faire le lien entre ces différents supports <strong>de</strong> l’information. A<br />
travers ce système <strong>de</strong> gestion, qui a été créé en fait pour faciliter le suivi <strong>de</strong>s dossiers, <strong>la</strong><br />
mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA, ainsi que leur archivage, sont absolument garantis. La<br />
mémorisation est en effet faite à trois niveaux <strong>de</strong> détail différents : seulement les chiffres, les<br />
copies électroniques <strong>de</strong>s documents, les documents originaux. Si un contribuable assujetti<br />
cesse ou change d’activité, les informations qui le concernent restent dans le système pendant<br />
5 ans. Après ce dé<strong>la</strong>i elles sont effacées et le numéro TVA qui lui était attribué est donné à un<br />
autre contribuable.
140 DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE<br />
Les serveurs qui gèrent les données <strong>de</strong> MOLIS et d’EFIM sont gérés par l’Office fédéral<br />
<strong>de</strong> l'informatique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication (OFIT) et se trouvent dans différents centres <strong>de</strong><br />
calcul <strong>de</strong> l’Office. Leur pérennité est assurée par un système miroir qui permet <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r<br />
les informations à double.<br />
Le plus grand changement prévu au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données est le projet<br />
INSIEME, qui représentera un changement important dans l’ensemble <strong>de</strong> l’AFC 94 . La base <strong>de</strong><br />
données qui sera constituée dans le cadre <strong>de</strong> ce projet regroupera toutes les bases <strong>de</strong> données<br />
existantes actuellement à l’AFC en une seule. Toujours dans le cadre <strong>de</strong> cette réforme, on<br />
unifiera le numéro <strong>de</strong> l’impôt fédéral direct et le numéro <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA. On passera à ce momentlà<br />
à un numéro par<strong>la</strong>nt. La réalisation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> ce projet durera encore quelques<br />
années.<br />
4.9.1.4 Organe compétent<br />
La division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée (DP TVA) fait partie <strong>de</strong><br />
l’Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions (AFC), qui constitue le centre <strong>de</strong> compétence <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Confédération pour les affaires fiscales <strong>nationale</strong>s et inter<strong>nationale</strong>s. L’AFC, qui emploie<br />
près <strong>de</strong> 1100 col<strong>la</strong>borateurs <strong>de</strong> formation commerciale, administrative, économique ou<br />
juridique, fait partie du Département fédéral <strong>de</strong>s finances (DFF). Il existe en outre un organe<br />
consultatif en matière <strong>de</strong> TVA (OC-TVA) <strong>de</strong>puis mars 2004.<br />
La DP TVA emploie environ 640 personnes, elle représente d’ailleurs l’une <strong>de</strong>s plus<br />
gran<strong>de</strong>s unités organisationnelles du DFF. Elle se structure en un Etat-major légis<strong>la</strong>tion, en<br />
trois divisions (Perception, Contrôle externe et Droit) et en <strong>de</strong>ux sections (Analyse, projets,<br />
gestion <strong>de</strong>s risques et Services généraux). Chacune <strong>de</strong> ces subdivisions est responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
totalité d’une tâche ou d’un processus, <strong>de</strong> même que chacune <strong>de</strong>s équipes qui en font partie.<br />
Ainsi, chaque équipe est responsable d’un groupe <strong>de</strong> contribuables bien défini (suivant une<br />
répartition territoriale en 12 zones pour <strong>la</strong> Suisse).<br />
La DP TVA entretient <strong>de</strong>s col<strong>la</strong>borations avec <strong>de</strong> nombreux partenaires commerciaux.<br />
Plus étroitement, elle col<strong>la</strong>bore avec l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, notamment afin<br />
d’accé<strong>de</strong>r aux données du Registre <strong>de</strong>s entreprises et <strong>de</strong>s établissements, ce qui lui permet<br />
notamment <strong>de</strong> suivre l’évolution économique en Suisse. D’autres partenaires proches <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
DP TVA (et <strong>de</strong> l’AFC) sont <strong>la</strong> Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation, où toutes les recettes sont<br />
versées, l’OFIT, pour les aspects informatiques, ainsi que l’Office fédéral <strong>de</strong>s constructions et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> logistique (OFCL).<br />
4.9.1.5 Bases légales<br />
Une révision en profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA est en cours : les buts qu’elle vise sont<br />
<strong>principale</strong>ment une simplification <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique (actuellement très complexe et contenant <strong>de</strong><br />
nombreuses exceptions qui constituent une source d’erreurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s contribuables<br />
assujettis), l’assurance d’une plus gran<strong>de</strong> sécurité du droit pour les contribuables assujettis,<br />
une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> transparence, un recentrage <strong>de</strong> l’administration sur le service aux<br />
assujettis 95 et, globalement, moins <strong>de</strong> « formalisme ». Cette révision impliquera notamment<br />
<strong>de</strong>s modifications dans les bases légales <strong>principale</strong>s qui régissent <strong>la</strong> TVA, à savoir <strong>la</strong> Loi<br />
94 INSIEME désigne un programme qui vise à concrétiser <strong>la</strong> nouvelle vision TI adoptée par <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’AFC<br />
en 2001. Il est divisé en trois grands domaines : Personnel, Processus et Technologie. Le domaine Personnel<br />
concerne l’organisation structurelle <strong>de</strong> l’institution, le domaine Processus le déroulement <strong>de</strong> ceux-ci à l’intérieur<br />
<strong>de</strong> l’organe, le domaine Technologie essentiellement <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle informatique.<br />
95 Se référer au rapport intitulé Simplification <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi fédérale régissant <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée : avantprojet<br />
<strong>de</strong>stiné à <strong>la</strong> consultation. Rapport explicatif, Département <strong>de</strong>s finances DFF, Février 2007.
DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE 141<br />
fédérale régissant <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée (Loi sur <strong>la</strong> TVA, LTVA) du 2 septembre 1999<br />
(RS 641.20) et l’Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> TVA (OLTVA) du 29 mars 2000 (RS<br />
641.201), en vigueur <strong>de</strong>puis le 1 er janvier 2001.<br />
Dans ces bases légales, les articles touchant à <strong>de</strong>s questions en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> gestion, le<br />
traitement, l’accessibilité <strong>de</strong> l’information sont nombreux et détaillés.<br />
Premièrement, l’art. 53 <strong>de</strong> <strong>la</strong> LTVA affirme <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> l’Administration fédérale<br />
<strong>de</strong>s contributions <strong>de</strong> gérer une banque <strong>de</strong> données d’adresses et une banque <strong>de</strong> données<br />
juridiques qui permettent <strong>de</strong> déterminer et <strong>de</strong> prélever l’impôt et qui contiennent également<br />
<strong>de</strong>s données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales (al. 1). Le même<br />
article prévoit que les dispositions d’exécution re<strong>la</strong>tives à l’organisation et au fonctionnement<br />
<strong>de</strong>s banques <strong>de</strong> données, aux données à collecter, à l’accès aux données, aux autorisations <strong>de</strong><br />
les traiter, à <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> leur conservation, à leur archivage et à leur effacement soient arrêtées<br />
par le Conseil fédéral (al. 2). L’art. 58 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi attribue à l’assujetti l’obligation <strong>de</strong> tenir<br />
dûment les livres comptables, <strong>de</strong> manière à ce que les faits importants pour <strong>la</strong> détermination<br />
<strong>de</strong> l’assujettissement, le calcul <strong>de</strong> l’impôt et celui <strong>de</strong> l’impôt préa<strong>la</strong>ble déductible puissent y<br />
être constatés aisément et <strong>de</strong> manière sûre ; pour ce faire, l’AFC peut édicter <strong>de</strong>s dispositions<br />
particulières. Ainsi, l’assujetti doit conserver dûment pendant 10 ans ses livres comptables,<br />
pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents, conformément à l’art. 962 du<br />
Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s obligations (RS 220). Il est en outre précisé que les pièces justificatives se<br />
rapportant aux biens immobiliers doivent être conservées pendant 20 ans. Cette obligation<br />
persiste au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces dé<strong>la</strong>is pour les créances fiscales à <strong>la</strong>quelle les documents se rapportent<br />
et qui ne sont pas encore prescrites, jusqu’à <strong>la</strong> prescription <strong>de</strong> celles-ci. Enfin, l’art. 90, al. 2,<br />
let. h. <strong>de</strong> <strong>la</strong> LTVA donne le droit au Conseil fédéral d’arrêter, après avoir préa<strong>la</strong>blement<br />
consulté les milieux intéressés, les conditions auxquelles les pièces justificatives nécessaires à<br />
l’administration <strong>de</strong> l’impôt peuvent être transmises et conservées électroniquement.<br />
La OLTVA consacre <strong>la</strong> section 8 (art. 16 à 19) à <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> données d’adresses et à <strong>la</strong><br />
banque <strong>de</strong> données juridiques. L’art. 16, al. 1 donne le détail <strong>de</strong> quelles sont précisément les<br />
données et les informations que l’AFC est autorisée à traiter. Il est intéressant <strong>de</strong> noter que<br />
l’al. 3 du même article affirme que les données qui sont conservées électroniquement ou <strong>de</strong><br />
façon analogue par l’AFC ont <strong>la</strong> même force probante que les enregistrements qui sont<br />
lisibles sans moyen auxiliaire. Sont réservées les réglementations légales spéciales qui exigent<br />
<strong>la</strong> présentation ou <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong> données et informations sous une forme particulière (al.<br />
4). L’art. 17 affirme que <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’organisation et l’exploitation <strong>de</strong>s banques <strong>de</strong><br />
données <strong>de</strong> l’AFC est <strong>de</strong> compétence du Département fédéral <strong>de</strong>s finances. Les données<br />
contenues dans ces banques <strong>de</strong> données ne peuvent être traitées que par les col<strong>la</strong>borateurs <strong>de</strong><br />
l’AFC ou le personnel spécialisé p<strong>la</strong>cé sous contrôle (art. 18, al. 1). La garantie <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité<br />
<strong>de</strong>s données (art. 18, al. 2) est assurée au moyen <strong>de</strong> l’Ordonnance sur l’informatique et <strong>la</strong><br />
télécommunication dans l’administration fédérale (OIAF) du 26 septembre 2003 (RS<br />
172.010.58), les directives y re<strong>la</strong>tives <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> l’informatique et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
télécommunication et l’Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données du<br />
14 juin 1993 (RS 235.11). Enfin, l’art. 19 est spécifiquement consacré à <strong>la</strong> durée <strong>de</strong><br />
conservation, à l’effacement et à l’archivage <strong>de</strong>s données et précise à l’al. 3 que<br />
3 Avant d’effacer <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s informations, l’obligation <strong>de</strong> proposer les documents aux<br />
Archives fédérales doit être respectée, conformément à l’art. 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi fédérale du 26 juin 1998 sur<br />
l’archivage (RS 152.1).<br />
La TVA n’ayant que 12 années <strong>de</strong> vie, aucune donnée ou information n’a été jusqu’ici<br />
effacée. La DP TVA étant partie <strong>de</strong> l’AFC, elle est donc soumise à <strong>la</strong> LAr et l’applique aussi<br />
strictement que possible ; un contrôle périodique <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s Archives fédérales est<br />
effectué.
142 DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE<br />
Il existe enfin une Ordonnance concernant les données et les informations transmises par<br />
voie électronique (OelDI) du 30 janvier 2002 (RS 641.201.1) qui règle les exigences <strong>de</strong> nature<br />
technique, organisationnelle et procédurale concernant <strong>la</strong> force probante et le contrôle <strong>de</strong>s<br />
données et <strong>de</strong>s informations (données électroniques) qui sont transmises et conservées<br />
électroniquement ou <strong>de</strong> façon analogue (art. 1).<br />
Ce rapi<strong>de</strong> survol <strong>de</strong>s articles contenus dans <strong>la</strong> loi et dans l’ordonnance re<strong>la</strong>tive nous<br />
montre que <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion, le traitement et l’accessibilité <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA<br />
est établie dans le détail.<br />
4.9.1.6 Coûts<br />
Comme anticipé, <strong>la</strong> TVA a été introduite en suisse en 1995. Depuis lors, cet impôt est<br />
<strong>de</strong>venu <strong>la</strong> plus importante source <strong>de</strong> revenus <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération : avec <strong>de</strong>s recettes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong><br />
18 milliards <strong>de</strong> francs, elle a en effet financé un bon tiers <strong>de</strong>s dépenses (51 milliards <strong>de</strong><br />
francs) <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération en 2005 96 . Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA ont donc une valeur<br />
économique très élevée. La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux systèmes informatiques <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
documentation et <strong>de</strong>s données a été très coûteuse, mais les chiffres exacts ne sont pas<br />
disponibles.<br />
4.9.2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Suivant les indications données ci-<strong>de</strong>ssus, il apparaît que <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> TVA est assurée et suit trois différentes voies (MOLIS, EFIM, documents originaux). Dans<br />
les paragraphes qui suivent nous allons mettre en évi<strong>de</strong>nce les différentes étapes qui<br />
caractérisent ce processus <strong>de</strong> mémorisation.<br />
4.9.2.1 Mémorisabilité<br />
Toutes les données concernant <strong>la</strong> TVA dont <strong>la</strong> DP TVA a besoin pour gérer cet impôt<br />
sont mémorisables dans le sens que les producteurs <strong>de</strong> ces données, à savoir les contribuables<br />
assujettis, ont l’obligation <strong>de</strong> les lui transmettre (conformément à l’art. 61 <strong>de</strong> <strong>la</strong> LTVA),<br />
<strong>principale</strong>ment sous forme <strong>de</strong> décomptes et autres documents <strong>de</strong> nature financière ou<br />
juridique. Comme nous l’avons expliqué, les informations contenues dans ces documents sont<br />
ensuite numérisées et gérées par les <strong>de</strong>ux systèmes informatiques actuellement en p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong><br />
DP TVA : ceci non pas dans le but <strong>de</strong> les mémoriser (conserver dans le temps), mais d’en<br />
faciliter l’accessibilité et le traitement aux employé·es <strong>de</strong> <strong>la</strong> DP TVA concerné·es.<br />
Nous pouvons ainsi constater que <strong>la</strong> ressource que nous avons nommée « <strong>la</strong>ngage » dans<br />
<strong>la</strong> partie conceptuelle <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est parfaitement régulée suivant toutes les étapes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> l’information : l’assujetti doit en effet fournir un type bien déterminé<br />
d’informations dès le début du processus (à savoir dès qu’il remplit le formu<strong>la</strong>ire Comman<strong>de</strong><br />
du questionnaire pour l’enregistrement comme contribuable TVA) et ensuite à chaque fois<br />
qu’il fournit un décompte. La même observation est va<strong>la</strong>ble pour <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’information<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> part du régu<strong>la</strong>teur, c’est-à-dire <strong>de</strong> <strong>la</strong> DP TVA : les données sont mémorisées suivant un<br />
processus bien déterminé ; l’accès aux données ainsi que les fonctions qui sont associées à<br />
toutes les opérations qui peuvent être faites sont précisément codifiées.<br />
96 Simplification <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi fédérale régissant <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée : avant-projet <strong>de</strong>stiné à <strong>la</strong> consultation.<br />
Rapport explicatif, Département <strong>de</strong>s finances DFF, Février 2007, p.2.
DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE 143<br />
4.9.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
Sont dignes d’être mémorisées les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA dont l’AFC a besoin pour réaliser<br />
son mandat et dont une liste est dressée à l’art. 16, al. 1 <strong>de</strong> <strong>la</strong> OLTVA :<br />
Art. 16 Acquisition <strong>de</strong> données et force probante<br />
1<br />
L’Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions est autorisée à traiter les données et les informations<br />
dont elle a besoin pour exécuter ses tâches légales, notamment pour:<br />
a. constater l’assujettissement <strong>de</strong> personnes, d’établissements, <strong>de</strong> sociétés et <strong>de</strong> collectivités <strong>de</strong><br />
personnes (données et informations concernant le nom, <strong>la</strong> forme juridique, l’inscription au<br />
registre du commerce, <strong>la</strong> date <strong>de</strong> naissance ou <strong>de</strong> fondation, l’adresse, le domicile ou le siège<br />
social, le lieu d’origine, le genre d’activité commerciale, les chiffres d’affaires réalisés ou<br />
prévisibles, <strong>la</strong> date d’inscription et <strong>de</strong> radiation);<br />
b. constater les chiffres d’affaires imposables et pour déterminer et vérifier l’impôt dû et l’impôt<br />
préa<strong>la</strong>ble déductible qui en résultent (données et informations provenant <strong>de</strong>s livres comptables,<br />
<strong>de</strong>s pièces justificatives, <strong>de</strong>s papiers d’affaires et autres documents, <strong>de</strong>s décomptes d’impôt et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> correspondance commerciale);<br />
c. vérifier les chiffres d’affaires déc<strong>la</strong>rés exclus du champ <strong>de</strong> l’impôt (données et informations<br />
provenant <strong>de</strong>s livres comptables, <strong>de</strong>s pièces justificatives, <strong>de</strong>s papiers d’affaires et autres<br />
documents, <strong>de</strong>s décomptes d’impôt et <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspondance commerciale);<br />
d. vérifier l’exonération <strong>de</strong> l’impôt <strong>de</strong>s opérations qui sont soumises à l’impôt en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi ou<br />
qui sont imposables en raison <strong>de</strong> l’option (données et informations provenant <strong>de</strong>s papiers<br />
d’affaires et <strong>de</strong>s pièces justificatives, notamment <strong>de</strong>s preuves d’importation ou d’exportation ainsi<br />
que <strong>de</strong>s preuves concernant le lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> prestation);<br />
e. garantir le recouvrement <strong>de</strong>s montants <strong>de</strong> l’impôt dus par les assujettis et par les personnes<br />
solidairement responsables (données et informations concernant les procédures <strong>de</strong> poursuite, <strong>de</strong><br />
faillite ou <strong>de</strong> séquestre, concernant l’état <strong>de</strong> <strong>la</strong> fortune, notamment les liquidités, les comptes<br />
postaux ou bancaires, les papiers-valeurs, les immeubles et autres valeurs mobilières, ainsi que<br />
les successions indivises);<br />
f. infliger et exécuter, en cas d’infraction, les sanctions administratives ou pénales (données et<br />
informations concernant les infractions constatées dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure administrative<br />
ou pénale et concernant les motifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong> <strong>la</strong> peine, notamment l’état <strong>de</strong>s revenus et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fortune);<br />
g. faire les statistiques nécessaires à <strong>la</strong> perception <strong>de</strong> l’impôt (données et informations d’ordre<br />
économique).<br />
Les critères qui déterminent quelles sont les données que l’AFC peut traiter et conserver<br />
sont donc précisément fixées déjà au niveau <strong>de</strong> l’ordonnance.<br />
Une fois qu’un assujetti cesse son activité, le numéro <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA qui lui avait été attribué<br />
reste bloqué pour une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> cinq ans et est ensuite attribué à nouveau. Du point <strong>de</strong> vue<br />
du fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA, <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données est donc nécessaire seulement<br />
pour une durée <strong>de</strong> temps re<strong>la</strong>tivement courte. Le critère <strong>de</strong> ce qui est digne d’être mémorisé<br />
est directement en re<strong>la</strong>tion avec l’utilité <strong>de</strong> l’information. Une fois que celle-ci n’est plus<br />
nécessaire, elle rentre dans le cycle <strong>de</strong> l’archivage.<br />
Nous constatons que <strong>la</strong> ressource que nous appelons « raison » a été prise en<br />
considération dans le cadre <strong>de</strong>s régu<strong>la</strong>tions qui sont en p<strong>la</strong>ce à partir <strong>de</strong> critères<br />
essentiellement utilitaires et juridiques.<br />
4.9.2.3 Mémorisation réelle<br />
Comme nous l’avons expliqué, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> Division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe<br />
sur <strong>la</strong> valeur ajoutée permet <strong>la</strong> réelle mémorisation <strong>de</strong>s informations. Cette mémorisation
144 DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE<br />
s’effectue sous forme d’archives digitalisées – composées majoritairement <strong>de</strong> chiffres<br />
(MOLIS) et <strong>de</strong> documents scannés (EFIM) dès 1995 – ainsi que sous forme d’archives papier<br />
– documents originaux archivés. La mémorisation en parallèle <strong>de</strong> ces données et documents<br />
est possible grâce au numéro TVA, qui permet <strong>de</strong> mettre en re<strong>la</strong>tion les informations qui<br />
concernant un contribuable assujetti déterminé. La structure du numéro TVA, telle qu’elle est<br />
en vigueur maintenant, présente néanmoins le désavantage <strong>de</strong> ne pas contenir un numéro <strong>de</strong><br />
contrôle, ce qui permet d’éviter l’introduction d’éventuelles erreurs. En effet, si on<br />
introduisait dans le système un numéro TVA erroné, on n’arriverait que très difficilement à<br />
retrouver les dossiers dans les bases <strong>de</strong> données et, dans le pire <strong>de</strong>s cas, il faudrait remonter<br />
aux documents papier archivés pour retrouver les bons documents. C’est l’une <strong>de</strong>s raisons<br />
pour <strong>la</strong>quelle, dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> révision en cours, il est prévu <strong>de</strong> changer <strong>la</strong> clé du numéro.<br />
Cette modification permettra <strong>de</strong> réaliser un ultérieur pas en avant dans <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong><br />
mémorisation réelle <strong>de</strong>s données.<br />
Les données traitées et conservées par <strong>la</strong> DP TVA ne sont pas les seules données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
TVA qui sont mémorisées : ces données-là sont en effet en elles-mêmes déjà le résultat d’un<br />
processus <strong>de</strong> mémorisation qui se déroule au niveau <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong> ces données, à savoir<br />
les contribuables assujettis qui, conformément à l’art. 58 <strong>de</strong> <strong>la</strong> LTVA déjà cité, doivent en<br />
principe conserver pendant 10 ou 20 ans (pour les pièces se rapportant aux biens immobiliers)<br />
ou jusqu’à prescription <strong>de</strong>s créances fiscales les livres comptables, pièces justificatives,<br />
papiers d’affaires et autres documents <strong>de</strong> manière à ce que les faits importants pour <strong>la</strong><br />
détermination <strong>de</strong> l’assujettissement puissent y être constatés.<br />
La mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA se fait donc à <strong>la</strong> fois chez les producteurs <strong>de</strong>s<br />
données et chez l’opérateur <strong>de</strong> cette politique publique. Nous constatons que <strong>la</strong> mémorisation<br />
est prévue pour une durée <strong>de</strong> temps déterminée ; il s’agit donc <strong>de</strong> données dont le cycle <strong>de</strong> vie<br />
est re<strong>la</strong>tivement court et ne présentant pas <strong>de</strong> particulier intérêt mémorial du point <strong>de</strong> vue du<br />
producteur une fois ce cycle terminé. Les données détenues par l’opérateur sont par contre<br />
<strong>de</strong>stinées à une sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> longue durée via leur archivage.<br />
La ressource « temps & espace » est elle aussi gérée <strong>de</strong> manière optimale : le temps qui a<br />
dû être investi à <strong>la</strong> DP TVA pour <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s systèmes informatiques <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong><br />
l’information est désormais rattrapé dans le suivi <strong>de</strong>s dossiers ; l’espace <strong>de</strong> stockage physique<br />
<strong>de</strong>s dossiers qui, avant l’introduction d’EFIM, était pratiquement épuisé, a pu être trouvé<br />
ailleurs (pour les besoins <strong>de</strong> l’archivage). Pour les besoins courants, l’espace <strong>de</strong> stockage est<br />
désormais pratiquement illimité.<br />
4.9.2.4 Accessibilité<br />
Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA constituent <strong>de</strong>s données personnelles sensibles et ne sont pas<br />
accessibles à tout un chacun. La LTVA détermine quels sont les acteurs qui y ont accès, pour<br />
quelles raisons et suivant quelles conditions. L’art. 54 est consacré à l’entrai<strong>de</strong><br />
administrative ; les autorités fiscales <strong>de</strong>s cantons, <strong>de</strong>s districts, <strong>de</strong>s arrondissements et <strong>de</strong>s<br />
communes et l’Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions se prêtent assistance dans<br />
l’accomplissement <strong>de</strong> leurs tâches : elles doivent faire les communications appropriées,<br />
donner les renseignements nécessaires et permettre <strong>la</strong> consultation <strong>de</strong>s dossiers (al. 1). L’art<br />
55 oblige quiconque est chargé <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le secret dans l’exercice <strong>de</strong><br />
ses fonctions et <strong>de</strong> refuser <strong>la</strong> consultation <strong>de</strong>s pièces officielles (al. 1). Cette obligation<br />
n’existe pas en cas d’entrai<strong>de</strong> administrative, à l’égard <strong>de</strong>s organes judiciaires ou<br />
administratifs autorisés à <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s renseignements officiels, à l’égard <strong>de</strong>s autorités<br />
chargées <strong>de</strong>s poursuites pour <strong>de</strong>ttes et faillite, lorsqu’il s’agit d’indiquer si une entreprise est<br />
enregistrée ou non en tant que contribuable (al. 2). En outre, comme déjà noté, les données
DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE 145<br />
enregistrées dans les systèmes informatiques EFIM et MOLIS ne sont pas non plus<br />
accessibles à tous les col<strong>la</strong>borateurs·trices <strong>de</strong> <strong>la</strong> DP TVA (ou <strong>de</strong> l’AFC) : les accès sont en<br />
effet filtrés au moyen <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s d’accès qui permettent <strong>de</strong> réguler <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s informations et<br />
leur modification. Ainsi, une information n’est accessible ou modifiable que par les personnes<br />
qui doivent y travailler directement. De même, l’accès aux archives n’est possible que sous<br />
<strong>de</strong>s conditions strictes, déterminées dans <strong>la</strong> LAr et son ordonnance.<br />
Nous constatons que <strong>la</strong> ressource « espace public » est elle aussi régulée <strong>de</strong> manière très<br />
précise au moyen <strong>de</strong> systèmes <strong>de</strong> gestion informatiques sur mesure.<br />
4.9.3 Commentaires<br />
Ce chapitre a été rédigé grâce aux informations recueillies lors d’un long entretien et<br />
visite <strong>de</strong>s locaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> DP TVA avec M. Peter Maibach, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Services généraux,<br />
ainsi que par <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s bases légales et <strong>de</strong>s documents publiés en lien avec <strong>la</strong> thématique<br />
abordée. En conclusion <strong>de</strong> ce chapitre nous désirons souligner les aspects suivants :<br />
(1) Les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA, par leur valeur économique et juridique, suivent un<br />
processus <strong>de</strong> mémorisation qui est parfaitement régulé et qui a été<br />
gran<strong>de</strong>ment facilité par <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> systèmes <strong>de</strong> gestion<br />
informatiques. La conservation <strong>de</strong>s informations est garantie, premièrement<br />
sous forme <strong>de</strong> chiffres, <strong>de</strong>uxièmement sous forme <strong>de</strong> copies électroniques <strong>de</strong>s<br />
documents relevants pour <strong>la</strong> réalisation du mandat légal <strong>de</strong> <strong>la</strong> DP TVA,<br />
ensuite sous forme <strong>de</strong>s documents originaux transmis et enfin, au niveau du<br />
producteur <strong>de</strong>s données, sous forme <strong>de</strong> tous les documents et pièces<br />
comptables qui servent à dresser les décomptes.<br />
(2) La mémorisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s producteurs <strong>de</strong> ces<br />
informations, à savoir les contribuables assujettis, est <strong>de</strong> courte durée et se<br />
fait pour <strong>de</strong>s raisons juridiques et <strong>de</strong> contrôle. La mémorisation <strong>de</strong>s données<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’opérateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique publique, à savoir <strong>la</strong> DP<br />
TVA, se fait sur supports électroniques pour <strong>de</strong>s raisons utilitaires et<br />
juridiques (réalisation du mandat légal, accessibilité à plusieurs personnes en<br />
même temps) et pour une durée temporelle indéterminée ; elle se fait<br />
également au moyen <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s documents originaux, pour <strong>de</strong>s<br />
raisons <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>.<br />
(3) Les obligations juridiques et utilitaires (gestion <strong>de</strong>s flux) qui constituent <strong>la</strong><br />
source du système <strong>de</strong> gestion très détaillé qui caractérise les données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
TVA sont un catalyseur qui favorise <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong> ces informations.<br />
(4) Nous constatons dans cet exemple également que le ressort <strong>de</strong> l’utilisation<br />
<strong>de</strong>s technologies informatiques pour <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s documents implique<br />
l’entrée en force <strong>de</strong> nouveaux acteurs (l’OFIT, quoiqu’il fasse partie du même<br />
département, ainsi que <strong>de</strong>s acteurs privés spécialisés dans <strong>la</strong> gestion<br />
informatique <strong>de</strong> processus) qui prennent en charge une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion,<br />
ce qui p<strong>la</strong>ce l’AFC dans une situation <strong>de</strong> dépendance qui pourrait avoir <strong>de</strong>s<br />
conséquences (essentiellement financières et techniques) si les règles du jeu<br />
<strong>de</strong>vaient être modifiées (payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> stockage sur les serveurs ou<br />
changement trop rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s formats sur le marché <strong>de</strong>s documents scannées<br />
par exemple). Il est en outre à remarquer que l’utilisation <strong>de</strong> l’informatique<br />
comme outil facilitateur pour le traitement et le suivi <strong>de</strong>s dossiers a un impact
146 DONNEES DE LA TAXE SUR LA VALEUX AJOUTEE<br />
direct sur <strong>la</strong> composition du personnel et sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions<br />
interpersonnelles (diminution <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions sociales en milieu professionnel).<br />
(5) Enfin, les quatre ressources que nous avons mises en évi<strong>de</strong>nce ont été prises<br />
en considération dans les régu<strong>la</strong>tions actuellement en p<strong>la</strong>ce.
5 Synthèse<br />
Les neuf exemples <strong>de</strong> types <strong>de</strong> données que nous avons développés au chapitre 4 sont le<br />
résultat d’un travail <strong>de</strong> recherche visant une meilleure connaissance <strong>de</strong>s différents processus<br />
que les données traversent au cours <strong>de</strong> leur existence.<br />
Les exemples présentés n’ont pas été choisis suivant une logique d’archivage (distinction<br />
entre données archivées et données non archivées), mais plutôt en tenant compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur<br />
économique, politique et sociale, etc. qu’ils représentent dans le cadre <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> données<br />
que nous avons définis dans le chapitre 2 (Champs d’application) comme étant <strong>de</strong>scriptives,<br />
juridiques spatiales, juridiques personnelles et financières 97 . En effet, si tous les domaines<br />
qui produisent ces données sont en principe soumis aux obligations légales <strong>de</strong> l’archivage (via<br />
<strong>la</strong> loi fédérale ou <strong>de</strong>s lois cantonales), le chemin que celles-ci parcourent, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> leur<br />
exploitation et, par conséquent, l’application effective <strong>de</strong> l’archivage varient d’un cas à<br />
l’autre. Ainsi, le but central <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> empirique a été d’observer et <strong>de</strong> décrire l’intégralité du<br />
parcours <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> données en suivant toutes les étapes qu’elles<br />
traversent : création, traitement, utilisation, mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion appliqués, métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
sauvegar<strong>de</strong> adoptées, archivage ou, à défaut, les dispositions prévues pour l’archivage ou,<br />
encore, les réflexions faites à ce sujet.<br />
L’idée fondamentale qui sous-tend cette approche est que, dans notre perspective <strong>de</strong><br />
préparation à <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique publique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>, il n’est possible <strong>de</strong><br />
déterminer quels sont les éléments qui requièrent une régu<strong>la</strong>tion qu’en tenant compte <strong>de</strong><br />
l’ensemble du processus qui va <strong>de</strong> <strong>la</strong> production jusqu’à <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données. C’est<br />
d’ailleurs l’une <strong>de</strong>s raisons pour <strong>la</strong>quelle nous parlons ici <strong>de</strong> processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
(entendu comme un processus qui couvre tout le parcours <strong>de</strong> vie d’une donnée) plutôt que<br />
d’archivage. Avec l’entrée en jeu <strong>de</strong>s nouveaux outils informatiques (par exemple les banques<br />
<strong>de</strong> données re<strong>la</strong>tionnelles), <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données (toujours suivant notre terminologie,<br />
leur mémorisation) peut d’ailleurs prendre différentes formes : il peut s’agir d’une sauvegar<strong>de</strong><br />
informatique dont <strong>la</strong> finalité est d’assurer <strong>la</strong> perpétuité <strong>de</strong>s données pour <strong>de</strong>s raisons utilitaires<br />
(qui concerne les données en cours d’utilisation) ou, à l’autre extrême, d’un archivage en<br />
bonne et due forme (qui concerne les données dont l’exploitation dans le cadre d’une<br />
politique publique est terminée et qui, par conséquent, ne subissent plus aucune<br />
transformation).<br />
Les neuf chapitres développés décrivent ainsi les étapes fondamentales qui caractérisent<br />
<strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s divers types <strong>de</strong> données ainsi que les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion, les changements<br />
importants en cours et, surtout, permettent <strong>de</strong> déterminer si <strong>la</strong> mémorisation s’effectue en<br />
suivant un seul ou plusieurs processus. Aussi, nous nous sommes efforcés <strong>de</strong> souligner les<br />
différences qui caractérisent un type <strong>de</strong> données plutôt qu’un autre.<br />
Le contenu et les <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong>s chapitres sont <strong>de</strong> nature empirique. Ceci signifie que<br />
nous avons utilisé notre concept <strong>de</strong> recherche pour structurer les informations recueillies, qui<br />
constituent un reflet aussi fidèle que possible <strong>de</strong> <strong>la</strong> vision <strong>de</strong>s opérateurs <strong>de</strong>s domaines traités.<br />
Les différents textes ont en effet été rédigés suivant <strong>la</strong> démarche que voici :<br />
• réalisation d’entretiens semi-directifs sur <strong>la</strong> base du questionnaire en annexe et<br />
préa<strong>la</strong>blement préparés afin <strong>de</strong> disposer d’une connaissance globale du domaine<br />
97 Nous aurions donc pu sélectionner également d’autres exemples <strong>de</strong> types <strong>de</strong> données, mais nous estimons que<br />
les informations recueillies ici sont représentatives pour les groupes choisis.
148 SYNTHESE<br />
abordé. En tout, 18 entretiens avec une, <strong>de</strong>ux ou trois personnes ont été menés.<br />
Chacun <strong>de</strong> ces entretiens a duré au minimum <strong>de</strong>ux heures, mais <strong>la</strong> plupart du temps<br />
trois heures ont été consacrées à <strong>la</strong> discussion ;<br />
• lecture <strong>de</strong> textes légis<strong>la</strong>tifs, <strong>de</strong> publications ou autres documentations directement<br />
reliées à <strong>la</strong> thématique, <strong>de</strong> pages Internet concernant le domaine, parfois <strong>de</strong><br />
documents internes mis à disposition par les personnes interviewées pour une<br />
meilleure compréhension du sujet. Il est à signaler qu’il n’existe que très peu <strong>de</strong><br />
textes écrits décrivant les processus <strong>de</strong> production, <strong>de</strong> traitement, <strong>de</strong> gestion,<br />
d’exploitation, <strong>de</strong> conservation et, enfin, d’archivage <strong>de</strong>s données spécifiques aux<br />
domaines étudiés ;<br />
• rédaction <strong>de</strong>s différents chapitres sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s informations recueillies. Nous nous<br />
trouvons dans une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> grands et rapi<strong>de</strong>s changements : parfois, <strong>de</strong>s<br />
changements significatifs ont eu lieu entre <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l’entretien et le moment <strong>de</strong><br />
rédaction du chapitre. Les informations contenues dans les textes <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong><br />
correspon<strong>de</strong>nt dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s cas à l’état <strong>de</strong>s choses au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> validation<br />
<strong>de</strong>s chapitres [Etat en…] ;<br />
• validation du chapitre <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s personnes interviewées. Cette étape a <strong>de</strong>mandé<br />
un important investissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s col<strong>la</strong>borateurs·trices contacté·es, elle a<br />
parfois été faite en plusieurs étapes afin <strong>de</strong> disposer d’un texte <strong>de</strong> bonne qualité.<br />
Dans plusieurs cas <strong>la</strong> relecture du chapitre a été faite également par <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s institutions concernées, qui ont ainsi été sensibilisés à leur tour à <strong>la</strong><br />
thématique qui nous occupe.<br />
Les chapitres sont tous structurés <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière et contiennent, sur certains points,<br />
<strong>de</strong>s redondances. Ceci a été fait d’une part pour que les personnes interviewées puissent<br />
comprendre <strong>la</strong> logique du texte concernant leur domaine sans <strong>de</strong>voir se référer aux parties<br />
introductives <strong>de</strong> ce rapport et d’autre part pour conserver une approche aussi systématique que<br />
possible et favoriser ainsi <strong>la</strong> comparabilité <strong>de</strong>s chapitres. Chaque chapitre est donc<br />
indépendant et peut être lu, utilisé et valorisé individuellement. Les <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong>nses en<br />
informations qui caractérisent chaque première partie <strong>de</strong> chapitre (Présentation <strong>de</strong>s données)<br />
ont été rédigées ainsi pour pouvoir disposer <strong>de</strong> suffisamment <strong>de</strong> matériau d’analyse jusqu’à <strong>la</strong><br />
fin du mandat, et pouvoir ainsi, au besoin, renforcer et compléter ultérieurement les<br />
<strong>de</strong>uxièmes parties <strong>de</strong> chapitre (Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation) et les conclusions<br />
générales au fur et à mesure que les connaissances liées à cette recherche s’enrichissent.<br />
Ce chapitre 5 (Synthèse) constitue un résumé <strong>de</strong>s informations empiriques recueillies, ce<br />
qui permettra <strong>de</strong> visualiser les éléments fondamentaux et <strong>de</strong> les intégrer au chapitre 6<br />
(Analyse du matériel empirique).<br />
5.1 Synthèse <strong>de</strong>s paragraphes <strong>de</strong> présentation <strong>de</strong>s données<br />
Dans cette étu<strong>de</strong> nous avons distingué les données en quatre groupes : celles <strong>de</strong> nature<br />
essentiellement <strong>de</strong>scriptive, comme les données météorologiques et climatologiques, les<br />
données statistiques et les données d’observation <strong>de</strong> l’état chimique du sol ; les données<br />
juridiques <strong>de</strong> nature spatiale, comme celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle et celles du registre<br />
foncier, et les données juridiques personnelles, comme les données <strong>de</strong> l’état civil, celles du<br />
casier judiciaire et celles <strong>de</strong> l’AVS ; enfin, les données financières comme celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA.<br />
Cette synthèse sera organisée en respectant ces subdivisions.
SYNTHESE 149<br />
5.1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
Les sous-chapitres intitulés Choix <strong>de</strong>s données à étudier avaient essentiellement pour but<br />
<strong>de</strong> justifier le choix <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> données étudiées parmi tant d’autres produites par d’autres<br />
acteurs (par exemple, les données <strong>de</strong> l’AVS parmi celles <strong>de</strong>s autres assurances sociales), <strong>de</strong><br />
justifier le choix <strong>de</strong>s données étudiées en re<strong>la</strong>tion avec les autres données produites ou gérées<br />
par le(s) même(s) opérateur(s) (par exemple, les données d’observation <strong>de</strong> l’état chimique du<br />
sol plutôt que les données d’observation <strong>de</strong> l’état physique du sol) et d’en montrer <strong>la</strong> valeur et<br />
l’utilisation. De manière générale, les caractéristiques qui distinguent ces groupes <strong>de</strong> données<br />
sont les suivantes :<br />
• données <strong>de</strong>scriptives :<br />
- elles se caractérisent par le fait que leur utilisation (exploitation <strong>de</strong><br />
l’information) peut être immédiate (sauf peut-être pour les données<br />
d’observation du sol) ou s’étaler sur <strong>de</strong> très longues pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> temps<br />
(évaluation <strong>de</strong>s changements) ;<br />
- il s’agit d’informations extrêmement importantes du point <strong>de</strong> vue économique,<br />
social, politique et scientifique ; leur valeur historique augmente au fil du<br />
temps qui passe ;<br />
- une mise à disposition <strong>la</strong>rge est fondamentale pour le fonctionnement présent<br />
et futur du pays (utilité universelle, périmètre d’impact très <strong>la</strong>rge) ;<br />
- elles ont pour but <strong>la</strong> prévisibilité ;<br />
- elles sont très nombreuses et contiennent une très gran<strong>de</strong> quantité<br />
d’informations ;<br />
- elles découlent <strong>de</strong> domaines régis par les sciences dures et sont gérées <strong>de</strong>puis<br />
longtemps au moyen <strong>de</strong> l’informatique ; pour cette raison, elles constituent un<br />
champ d’étu<strong>de</strong> qui peut donner lieu à <strong>de</strong>s éléments précurseurs si appliqués à<br />
d’autres domaines ;<br />
• données juridiques spatiales :<br />
- elles se caractérisent par une utilisation qui peut avoir lieu à tout moment ;<br />
- il s’agit d’informations extrêmement importantes surtout du point <strong>de</strong> vue<br />
économique et politique ; leur valeur historique est également très élevée ;<br />
- leur mise à disposition poursuit <strong>de</strong>s buts en re<strong>la</strong>tion au domaine concerné ;<br />
elles sont exploitées par <strong>de</strong> nombreuses politiques publiques en re<strong>la</strong>tion au<br />
territoire ;<br />
- elles ont pour but <strong>la</strong> maîtrise spatiale du territoire et <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété<br />
et <strong>de</strong>s droits réels ;<br />
- elles sont nombreuses ;<br />
- elles sont produites par un nombre très important d’acteurs se situant sur tous<br />
les échelons administratifs et dans le secteur privé ; pour cette raison, elles<br />
représentent très bien <strong>la</strong> nature fédéraliste <strong>de</strong> <strong>la</strong> démocratie helvétique ;<br />
• données juridiques personnelles :<br />
- elles se caractérisent toutes par une gestion au moyen <strong>de</strong> registres ; leur<br />
utilisation peut avoir lieu à tout moment ;
150 SYNTHESE<br />
- il s’agit d’informations possédant une valeur sociale et personnelle, leur intérêt<br />
économique et politique est par contre limité ;<br />
- étant <strong>de</strong>s données personnelles, leur accès est strictement régulé et limité aux<br />
personnes ou instances directement concernées ;<br />
- elles ont pour but <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> faits (événements civils, condamnations,<br />
interruption <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie professionnellement active) rythmant <strong>la</strong> vie personnelle<br />
<strong>de</strong>s individus ;<br />
- leur contenu est bien déterminé et re<strong>la</strong>tivement limité ;<br />
- elles sont produites et gérées par un nombre limité d’acteurs ;<br />
- leur mémorisation (ou leur oubli, dans le cas <strong>de</strong>s données du casier judiciaire)<br />
est fondamentale à titre privé (individus), mais également pour le bon<br />
fonctionnement d’un très grand nombre <strong>de</strong> politiques publiques ;<br />
• données financières :<br />
- elles sont centralisées, traitées, gérées, exploitées et sauvegardées par un acteur<br />
unique, leur utilisation est immédiate ;<br />
- elles représentent un intérêt purement économique et juridique ;<br />
- étant <strong>de</strong>s données personnelles sensibles, leur accès est strictement régulé et<br />
limité aux instances directement concernées ;<br />
- elles ont uniquement pour but <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA ;<br />
- leur contenu est bien déterminé et très limité.<br />
5.1.2 Contenu<br />
Les sous-chapitres consacrés au Contenu avaient pour objectif <strong>de</strong> décrire dans le détail les<br />
informations substantielles contenues par les différents types <strong>de</strong> données en fonction <strong>de</strong> leur<br />
utilisation, <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce leurs caractéristiques spécifiques, <strong>de</strong> suivre le ou les<br />
parcours que chacun d’entre eux suit tout au long <strong>de</strong> son existence.<br />
• données <strong>de</strong>scriptives :<br />
- elles sont produites à partir d’un réseau (appareils <strong>de</strong> mesure, acteurs, stations<br />
<strong>de</strong> prélèvement) ;<br />
- leur contenu substantiel peut être modifié selon les besoins ;<br />
- elles sont le résultat <strong>de</strong> processus <strong>de</strong> traitement (agrégations, analyses,<br />
évaluations, etc.) sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> relevés (prélevés grâce au réseau) et doivent<br />
impérativement être associées aux métadonnées (contextuelles, procédurales,<br />
spatiales, etc.) ;<br />
- les processus <strong>de</strong> traitement s’effectuent par couches successives ; selon l’étape<br />
à <strong>la</strong>quelle se situent les données, leur valeur n’est pas <strong>la</strong> même (<strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />
traitement élevé ou réduit) ;<br />
• données juridiques spatiales :<br />
- elles sont produites par différents acteurs mais leur contenu substantiel est<br />
précisément défini et ne peut varier ;
SYNTHESE 151<br />
- elles sont constituées <strong>de</strong> couches d’informations indépendantes traitées et <strong>de</strong><br />
différentes catégories d’informations ;<br />
• données juridiques personnelles :<br />
- leur gestion se base sur l’existence d’un numéro ou d’un co<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence ;<br />
- leur contenu substantiel est précisément défini et ne peut varier ;<br />
- elles sont constituées d’un nombre restreint <strong>de</strong> couches d’informations<br />
indépendantes traitées (référence, données personnelles, événement / décision /<br />
procédure, données du système) ;<br />
• données financières :<br />
- leur gestion se base sur l’existence d’un numéro ou d’un co<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence ;<br />
- leur contenu substantiel est précisément défini et ne peut varier ;<br />
- elles sont constituées d’un nombre restreint d’informations (données<br />
personnelles, données fiscales, procédure, données du système).<br />
Nous constatons ainsi que presque toutes les données sont constituées par couches<br />
superposées plus ou moins complexes selon le type <strong>de</strong> données en question, mais que le <strong>de</strong>gré<br />
<strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> ces couches peut varier (données en cours <strong>de</strong> traitement, données déjà<br />
traitées). Les données dont l’architecture est <strong>la</strong> plus complexe sont les données <strong>de</strong>scriptives et<br />
les données juridiques spatiales. Ces structurations par couches, qui évoluent dans certains cas<br />
à <strong>de</strong>s rythmes différents, ren<strong>de</strong>nt plus compliqués les processus <strong>de</strong> mémorisation. L’état actif<br />
(données exploitées par <strong>la</strong> politique publique concernée) ou passif (données historiques) dans<br />
lequel les données se trouvent <strong>de</strong>vient plus difficile à détecter, celles-ci étant <strong>de</strong> plus en plus<br />
conservées dans <strong>de</strong> mêmes « paniers » (bases <strong>de</strong> données, <strong>de</strong> plus en plus souvent<br />
re<strong>la</strong>tionnelles).<br />
5.1.3 Supports<br />
Les sous-chapitres consacrés aux Supports ont permis <strong>de</strong> distinguer le contenu et le<br />
contenant afin d’observer sur quels supports les données sont globalement gérées et <strong>de</strong> mettre<br />
en évi<strong>de</strong>nce les changements actuellement en cours :<br />
• données <strong>de</strong>scriptives :<br />
- <strong>de</strong>s différents groupes <strong>de</strong> données étudiés, les données <strong>de</strong>scriptives sont celles<br />
qui – tout au long <strong>de</strong>s différents processus <strong>de</strong> gestion – possè<strong>de</strong>nt globalement<br />
le plus haut <strong>de</strong>gré d’informatisation, en particulier dans les domaines<br />
scientifiques ; ceci est essentiellement dû au fait que ce type <strong>de</strong> données est<br />
majoritairement produit sur support informatique (relevés faits au moyen<br />
d’appareils <strong>de</strong> mesure). Les données qui ne sont pas produites directement sur<br />
support informatique mais qui passent d’abord sur support papier (une gran<strong>de</strong><br />
partie <strong>de</strong>s données statistiques), sont numérisées dans un <strong>de</strong>uxième temps ;<br />
- <strong>la</strong> numérisation <strong>de</strong>s données historiques (c’est-à-dire celle dont l’exploitation<br />
directe est conclue) pose problème dans le sens qu’elle ne peut pas être réalisée<br />
<strong>de</strong> manière complète (à cause du financement et du temps nécessaires, trop<br />
élevés pour <strong>de</strong>s données qui ne seront plus utilisées par l’acteur concerné, mais<br />
aussi à cause du fait que souvent les métadonnées sont insuffisantes) ; il<br />
s’avère donc indispensable <strong>de</strong> déterminer <strong>de</strong>s critères précis pour pouvoir<br />
réaliser une sélection <strong>de</strong>s données à numériser ;
152 SYNTHESE<br />
- les données – qu’elles soient produites et traitées essentiellement par un seul<br />
acteur (données météorologiques et climatologiques) ou par plusieurs (données<br />
statistiques, données <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong> l’état chimique du sol) – sont<br />
généralement gérées sur différentes banques <strong>de</strong> données et ensuite centralisées<br />
dans <strong>de</strong>s systèmes informatiques dont l’architecture est créée sur mesure et qui<br />
respecte leurs caractéristiques ;<br />
- les données se situant à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s différents processus <strong>de</strong> traitement sont toutes<br />
<strong>de</strong> nature informatique et sont stockées sur <strong>de</strong>s serveurs internes (acteurs<br />
possédant une certaine autonomie vis-à-vis <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération, 2 ème cercle <strong>de</strong><br />
l’administration) ou sur <strong>de</strong>s serveurs externes gérés par l’office chargé <strong>de</strong><br />
l’informatique (acteurs appartenant au 1 er cercle) ; <strong>la</strong> perpétuité <strong>de</strong>s données est<br />
assurée par <strong>de</strong>s sauvegar<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s migrations et <strong>de</strong>s copies (par exemple sur<br />
DVD) ;<br />
- l’accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> masse <strong>de</strong> données à stocker est directement en re<strong>la</strong>tion<br />
avec le domaine concerné en fonction <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s connaissances, <strong>de</strong><br />
l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> précision et du nombre <strong>de</strong>s relevés, du bassin ou<br />
périmètre étudié (constant, plus grand), <strong>de</strong> l’appareil<strong>la</strong>ge utilisé.<br />
• données juridiques spatiales :<br />
- le <strong>de</strong>gré d’informatisation <strong>de</strong>s données juridiques spatiales varie beaucoup d’un<br />
canton à l’autre et <strong>de</strong>s couches ou catégories d’informations dont il s’agit,<br />
puisque celles-ci comprennent également <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns graphiques et <strong>de</strong>s<br />
documents juridiques validés par une signature ;<br />
- le but visé après avoir atteint une bonne informatisation <strong>de</strong>s données au niveau<br />
<strong>de</strong>s différents acteurs cantonaux (gestion <strong>de</strong>s données au moyen <strong>de</strong> banques <strong>de</strong><br />
données, standardisation, signature électronique, etc.) est <strong>la</strong> centralisation <strong>de</strong><br />
l’information par <strong>la</strong> création d’un réseau (informatique) au niveau national ;<br />
- l’accroissement <strong>de</strong> ces données est limité, notamment pour les données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle (il s’agit <strong>de</strong> faire essentiellement <strong>de</strong>s mises à jour) ;<br />
• données juridiques personnelles :<br />
- les données juridiques personnelles étant essentiellement gérées au moyen <strong>de</strong><br />
registres, leur passage du papier à l’informatique ne s’est pas fait au fil <strong>de</strong>s<br />
années comme dans le cas <strong>de</strong>s autres groupes <strong>de</strong> données (évolution), mais<br />
suite à une décision politique (« révolution ») ; dans le cas <strong>de</strong>s données <strong>de</strong><br />
l’état civil, qui ont un cycle <strong>de</strong> vie extrêmement long, l’utilisation <strong>de</strong>s moyens<br />
informatiques va néanmoins <strong>de</strong> pair avec les traditionnels registres papier ;<br />
- le passage à une gestion informatisée correspond ici également à une<br />
centralisation (création d’une banque <strong>de</strong> données centrale ou d’un réseau) ;<br />
- <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s serveurs se fait par l’office chargé <strong>de</strong> l’informatique, qui<br />
s’occupe également <strong>de</strong> <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données à plus long terme<br />
(sauvegar<strong>de</strong>s informatiques, migrations, copies sur d’autres supports) ;<br />
- l’accroissement <strong>de</strong> ces données est difficilement prévisible mais est<br />
re<strong>la</strong>tivement régulier (pas d’accroissement exponentiel).
SYNTHESE 153<br />
• données financières :<br />
- les données financières sont entièrement gérées et traitées <strong>de</strong> manière<br />
informatique ; les données et documents électroniques constituent une copie<br />
<strong>de</strong>s documents en papier ;<br />
- les données sont centralisées ;<br />
- <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s serveurs se fait par l’office chargé <strong>de</strong> l’informatique, qui<br />
s’occupe également <strong>de</strong> <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données à plus long terme<br />
(sauvegar<strong>de</strong>s informatiques, migrations, copies sur d’autres supports) ;<br />
- l’accroissement <strong>de</strong>s données est régulier.<br />
Dans tous les domaines couverts par l’étu<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s grands changements sont en cours,<br />
caractérisés par un passage <strong>de</strong>s supports papiers aux supports informatiques. La tendance va<br />
vers une centralisation et une mise en réseau <strong>de</strong>s données à l’intérieur d’un même système,<br />
mais aussi entre différents systèmes thématiquement reliés. Dans plusieurs domaines, ceci<br />
signifie que <strong>la</strong> structuration <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données prend une nouvelle<br />
forme qui est typiquement informatique et qui permet <strong>de</strong> les mettre en re<strong>la</strong>tion autrement que<br />
sur le papier. Cette tendance est nouvelle, auparavant on gérait plutôt les informations sur<br />
support informatique en utilisant encore une logique « papier ».<br />
5.1.4 Organe compétent<br />
Les sous-chapitres intitulés Organe compétent avaient pour objectif <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s<br />
informations concernant l’organisme utilisé comme porte d’entrée pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> chaque<br />
type <strong>de</strong> donnée. Les données étant <strong>la</strong> plupart du temps le résultat du travail <strong>de</strong> différents<br />
acteurs, il a fallu en effet en choisir un pour pouvoir réaliser l’étu<strong>de</strong>. Les acteurs choisis sont<br />
ceux qui jouent le plus important rôle au long du processus <strong>de</strong> production, traitement, gestion,<br />
exploitation et conservation <strong>de</strong>s données. Il peut s’agir d’un organe <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce ou <strong>de</strong><br />
haute surveil<strong>la</strong>nce, d’un organe d’exécution ou du principal producteur d’un type déterminé<br />
<strong>de</strong> données ; ces différentes fonctions ont ainsi été regroupées sous <strong>la</strong> dénomination « Organe<br />
compétent ». Concrètement, le choix <strong>de</strong>s institutions s’est fait grâce à <strong>de</strong>s entretiens<br />
téléphoniques préa<strong>la</strong>bles et, parfois, après avoir réalisé un entretien préliminaire.<br />
A l’intérieur <strong>de</strong>s organes sélectionnés il a parfois été difficile <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s personnes<br />
aptes à décrire tout le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données, <strong>de</strong> leur production jusqu’à leur<br />
archivage, car les compétences sont <strong>la</strong> plupart du temps réparties sur différentes institutions<br />
(dissociation <strong>de</strong>s rôles du régu<strong>la</strong>teur et <strong>de</strong> l’opérateur). La priorité a été attribuée au contenu<br />
substantiel <strong>de</strong>s données et à <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s différents processus. Pour un développement<br />
plus approfondi <strong>de</strong>s aspects techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données électroniques il serait<br />
nécessaire <strong>de</strong> réaliser d’autres entretiens au sein <strong>de</strong>s organes informatiques responsables.<br />
De manière générale, les points qui méritent d’être mis en évi<strong>de</strong>nce sont les suivants :<br />
• données <strong>de</strong>scriptives :<br />
- l’importance et l’utilisation <strong>de</strong>s données <strong>de</strong>scriptives ne se limitent pas aux<br />
institutions compétentes en <strong>la</strong> matière en Suisse ; les col<strong>la</strong>borations et <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> ces institutions dans <strong>de</strong>s organes spécialisés au niveau européen ou<br />
mondial est essentiel, notamment car elles permettent <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s<br />
standards tout le long du processus <strong>de</strong> mémorisation et <strong>de</strong> favoriser les<br />
échanges et les comparaisons ;
154 SYNTHESE<br />
- les col<strong>la</strong>borations avec d’autres acteurs publics sont nécessaires pour le bon<br />
fonctionnement d’une longue série <strong>de</strong> politiques publiques basées sur ces<br />
données ;<br />
• données juridiques spatiales :<br />
- <strong>la</strong> mise en réseau <strong>de</strong>s données tend à dép<strong>la</strong>cer <strong>de</strong>s compétences <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion<br />
<strong>de</strong>s cantons vers <strong>la</strong> Confédération (organes <strong>de</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce) et <strong>de</strong> les<br />
dissocier ainsi du rôle <strong>de</strong>s opérateurs ;<br />
- les organes <strong>de</strong> compétence profitent <strong>de</strong>s changements en cours pour réfléchir à<br />
<strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données et aux sélections possibles et, par<br />
conséquent, également aux métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> conservation et d’archivage ;<br />
- les col<strong>la</strong>borations avec d’autres acteurs publics sont nécessaires pour le bon<br />
fonctionnement d’une série <strong>de</strong> politiques publiques concernant le territoire et <strong>la</strong><br />
propriété basées sur les données en question ;<br />
• données juridiques personnelles :<br />
- <strong>la</strong> mise en réseau <strong>de</strong>s données tend à dép<strong>la</strong>cer <strong>de</strong>s compétences <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tions<br />
concernant le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s cantons vers <strong>la</strong> Confédération<br />
(organes <strong>de</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce) et <strong>de</strong> les dissocier ainsi du rôle <strong>de</strong>s opérateurs ;<br />
- les col<strong>la</strong>borations avec d’autres acteurs publics sont nécessaires pour le bon<br />
fonctionnement d’une série <strong>de</strong> politiques publiques basées sur les données en<br />
question ;<br />
• données financières :<br />
- l’exemple <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA est intéressant car elles sont gérées par un<br />
seul et même acteur tout au long du processus et, en plus <strong>de</strong> 10 ans d’existence,<br />
peu <strong>de</strong> changements institutionnels sont survenus ; il existe par conséquent une<br />
bonne continuité dans le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données.<br />
Ainsi, dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s cas, nous constatons qu’il existe une tendance à <strong>la</strong> dissociation<br />
<strong>de</strong>s rôles <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion dans les différentes étapes <strong>de</strong> mémorisation et, d’autre part, une<br />
augmentation <strong>de</strong>s groupes d’opérateurs directement concernés (production, traitement,<br />
utilisation ou exploitations <strong>de</strong>s données, sauvegar<strong>de</strong>). Nous avons également constaté que <strong>la</strong><br />
mise sur pieds <strong>de</strong> nouveaux systèmes <strong>de</strong> gestion ou <strong>de</strong> centralisation <strong>de</strong>s données (à l’intérieur<br />
ou à l’extérieur <strong>de</strong> l’institution) correspond à un moment privilégié pour réfléchir à <strong>la</strong><br />
question <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données et aux sélections possibles et, par conséquent, également<br />
aux métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> conservation et archivage.<br />
5.1.5 Bases légales<br />
Les sous-chapitres Bases légales avaient pour but <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce le cadre légis<strong>la</strong>tif<br />
dans lequel <strong>la</strong> production, le traitement, <strong>la</strong> mise à disposition, <strong>la</strong> protection et, surtout, <strong>la</strong><br />
sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> données s’inscrit. Les lois et ordonnances citées dans ces<br />
sous-chapitres constituent les <strong>principale</strong>s bases légales et sont celles qui ont été<br />
prioritairement citées pendant les entretiens ; d’autres bases légales contiennent néanmoins<br />
<strong>de</strong>s articles qui se réfèrent aux domaines considérés ou qui peuvent avoir un impact sur ceuxci.<br />
Les aspects que nous désirons mettre en relief ici concernent les questions liées à <strong>la</strong><br />
conservation et à l’archivage <strong>de</strong>s données :
SYNTHESE 155<br />
• données <strong>de</strong>scriptives :<br />
- <strong>la</strong> compétence en matière d’archivage est dans les mains <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération ;<br />
les données <strong>de</strong>scriptives sont donc elles aussi soumises à <strong>la</strong> LAr ;<br />
- une distinction est faite entre <strong>la</strong> conservation à long terme <strong>de</strong>s données<br />
(garantie <strong>de</strong> pérennité) et leur archivage : <strong>la</strong> pérennité informatique <strong>de</strong>s<br />
données est garantie par les bases légales qui fon<strong>de</strong>nt les activités du domaine<br />
concerné ou par <strong>de</strong>s conventions internes ; concernant l’archivage,<br />
l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> LAr est difficile pour ce groupe particulier <strong>de</strong> données, car<br />
leur exploitation est continuelle et ne se conclut pour ainsi dire jamais ; <strong>de</strong>s<br />
réflexions pour trouver <strong>de</strong>s solutions durables à ce problème sont en cours<br />
(entre les opérateurs du secteur et les Archives fédérales) ;<br />
- une uniformisation avec <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion européenne est nécessaire ;<br />
• données juridiques spatiales :<br />
- actuellement, <strong>la</strong> compétence en termes d’archivage <strong>de</strong>s données juridiques<br />
spatiales est attribuée aux cantons ; <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en œuvre<br />
effective <strong>de</strong> l’archivage par les cantons est <strong>la</strong>cunaire au niveau fédéral ;<br />
- une distinction est faite entre l’entretien <strong>de</strong>s données (vérification <strong>de</strong> leur<br />
actualité), <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données (garantie <strong>de</strong> <strong>la</strong> perpétuité <strong>de</strong>s données<br />
vivantes et ayant une relevance juridique) et l’archivage proprement dit <strong>de</strong>s<br />
données qui ne sont plus actuelles ;<br />
- <strong>la</strong> tendance <strong>de</strong>s changements en cours ou futurs (centralisation) est d’attribuer<br />
<strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s données à <strong>la</strong> Confédération pour qu’une<br />
historisation soit réalisée ;<br />
• données juridiques personnelles :<br />
- <strong>la</strong> conservation et l’archivage <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> données regroupés ici présentent <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques propres, dans le sens que <strong>la</strong> durée du cycle <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> ces<br />
données est différent d’un cas à l’autre (extrêmement long pour les données <strong>de</strong><br />
l’état civil et, à l’opposé, aussi court que possible pour les données du casier<br />
judiciaire) ;<br />
- les compétences pour <strong>la</strong> pérennité et l’archivage <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’état civil se<br />
fait selon le support utilisé ; pour les données sur papier <strong>la</strong> compétence est<br />
cantonale, pour les données sur INFOSTAR elle est fédérale : pour ces données<br />
<strong>la</strong> LAr n’a pas encore été appliquée, <strong>de</strong>s réflexions sur comment s’y prendre<br />
sont en cours ;<br />
- alors que les données du casier judiciaire ne sont pas archivées, les données <strong>de</strong><br />
l’AVS sont elles aussi soumises à <strong>la</strong> LAr ;<br />
• données financières :<br />
- <strong>la</strong> compétence en matière <strong>de</strong> conservation et d’archivage <strong>de</strong>s données est<br />
fédérale ;<br />
- s’agissant <strong>de</strong> données qui sont exploitées durant une courte pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> temps et<br />
dont <strong>la</strong> gestion se fait à <strong>la</strong> fois sur papier (originaux) et sur supports<br />
informatiques (copies), <strong>la</strong> perpétuité <strong>de</strong>s données est garantie et l’archivage est<br />
effectué dans les règles <strong>de</strong> l’art.
156 SYNTHESE<br />
Les bases légales qu’il faut prendre en considération pour étudier tout le processus <strong>de</strong><br />
mémorisation sont nombreuses : nous avons observé qu’il peut déjà exister un déca<strong>la</strong>ge entre<br />
les obligations légales et leur mise en œuvre effective ou, du moins, <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> leur<br />
mise en œuvre par les acteurs directement concernés, notamment pour ce qui concerne<br />
l’archivage <strong>de</strong>s données (qui souvent n’est pas considéré comme une priorité).<br />
De plus, le nombre <strong>de</strong> bases légales à prendre en considération suite à l’utilisation <strong>de</strong>s<br />
outils informatiques a tendance à augmenter. Des nouvelles ordonnances – qui <strong>de</strong>viennent<br />
déterminantes pour les questions liées aux processus <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s données – ont fait leur<br />
apparition au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années : il s’agit en particulier <strong>de</strong> l’Ordonnance concernant<br />
les données et les informations transmises par voie électronique (OelDI) du 30 janvier 2002<br />
(RS 641.201.1) et <strong>de</strong> l’Ordonnance sur l’informatique et <strong>la</strong> télécommunication dans<br />
l’administration fédérale (OIAF) du 26 septembre 2003 (RS 172.010.58) 98 .<br />
En outre, différents changements qui risquent d’avoir un impact sur l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
processus <strong>de</strong> mémorisation sont en cours. On pense notamment à <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi<br />
fédérale sur le principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> transparence dans l’administration (Loi sur <strong>la</strong> transparence,<br />
LTrans) du 17 décembre 2004 (RS152.3), qui pourrait avoir comme effet <strong>la</strong> création d’un<br />
processus <strong>de</strong> mémorisation parallèle, ainsi qu’à <strong>la</strong> Loi fédérale sur l’harmonisation <strong>de</strong>s<br />
registres <strong>de</strong>s habitants et d’autres registres officiels <strong>de</strong> personnes (Loi sur l’harmonisation<br />
<strong>de</strong>s registres, LHR) du 23 juin 2006 (RS431.02), qui pourrait modifier les choix <strong>de</strong>s données à<br />
mémoriser.<br />
5.1.6 Coûts<br />
Comme nous l’avions prévu, il n’a pas été possible d’obtenir <strong>de</strong>s chiffres permettant<br />
d’estimer <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données et les coûts <strong>de</strong> leur mémorisation. Ceci aurait en effet<br />
<strong>de</strong>mandé aux personnes interviewées un travail <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> calcul al<strong>la</strong>nt bien au <strong>de</strong>là <strong>de</strong><br />
leurs disponibilités en termes <strong>de</strong> temps. Dans les différents chapitres, nous avons par<br />
conséquent essayé <strong>de</strong> mettre en relief <strong>la</strong> valeur économique du domaine que les données<br />
couvrent. Nous estimons en effet que <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> ces données est en re<strong>la</strong>tion avec celle-ci.<br />
5.2 Synthèse <strong>de</strong>s paragraphes d’étu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Nous avons pris l’option <strong>de</strong> faire une synthèse <strong>de</strong>s paragraphes d’étu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong><br />
mémorisation sous forme d’un tableau, sans regrouper les neuf types <strong>de</strong> données dans les<br />
groupes énoncés. Ceci nous permet d’avoir un aperçu global <strong>de</strong>s éléments principaux <strong>de</strong>s<br />
quatre étapes du processus <strong>de</strong> mémorisation et <strong>de</strong> mieux pouvoir en apprécier les similitu<strong>de</strong>s<br />
et les différences.<br />
Type <strong>de</strong><br />
donnée<br />
Tab. 5.2.1: Tableau comparatif <strong>de</strong>s éléments qui caractérisent les quatre étapes du processus <strong>de</strong><br />
mémorisation selon le domaine étudié.<br />
Météor. et<br />
climat.<br />
Processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Mémorisabilité Dignité à <strong>la</strong><br />
mémorisation<br />
• Possible pour toutes<br />
les données qui<br />
peuvent être<br />
réutilisées<br />
• uniquement sous<br />
• Aucune sélection<br />
• critère: réutilisation<br />
• absence <strong>de</strong><br />
directives internes<br />
• une éventuelle<br />
Mémorisation réelle Accessibilité<br />
• Uniquement sous<br />
forme informatique<br />
• dépendance <strong>de</strong>s<br />
moyens financiers à<br />
disposition et <strong>de</strong><br />
• Ne sont pas<br />
publiques<br />
• soumises à<br />
émoluments en<br />
fonction du type <strong>de</strong><br />
98 Cette ordonnance a remp<strong>la</strong>cé l’ancienne Ordonnance concernant <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s applications et <strong>de</strong>s<br />
systèmes informatiques dans l’administration fédérale du 10 juin 1991 (RS 313.0).
SYNTHESE 157<br />
Type <strong>de</strong><br />
donnée<br />
Processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
Mémorisabilité Dignité à <strong>la</strong><br />
mémorisation<br />
forme informatique<br />
• pas <strong>de</strong> limitations<br />
techniques mais les<br />
ressources<br />
financières doivent<br />
être garanties<br />
• comprend les<br />
données produites<br />
par d’autres acteurs<br />
Statistiques • possible pour toutes<br />
les données<br />
produites par les<br />
acteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
statistique<br />
(production interne<br />
et externe)<br />
• <strong>de</strong> plus en plus<br />
informatisée<br />
(informatisation <strong>de</strong>s<br />
processus); données<br />
introduites dans<br />
CODAM<br />
• suivant <strong>de</strong>s<br />
standards, <strong>de</strong>s<br />
processus<br />
comparables, une<br />
gestion centralisée<br />
ou coordonnée<br />
• pas <strong>de</strong> limitations<br />
techniques, mais les<br />
limitations<br />
financières doivent<br />
Observ. du<br />
sol<br />
être observées<br />
• possible pour toutes<br />
les données<br />
produites (papier ou<br />
support<br />
informatique) et<br />
pour les échantillons<br />
• domaine qui<br />
requiert <strong>la</strong><br />
mémorisation d’une<br />
gran<strong>de</strong> masse<br />
d’informations pour<br />
aboutir à <strong>de</strong>s<br />
résultats<br />
scientifiquement<br />
va<strong>la</strong>bles<br />
• lien entre le <strong>de</strong>gré<br />
<strong>de</strong> précision désiré<br />
et <strong>la</strong> quantité<br />
d’informations à<br />
mémoriser<br />
sélection requiert<br />
<strong>de</strong>s compétences<br />
substantielles et<br />
scientifiques<br />
approfondies<br />
spécifiques au<br />
domaine<br />
• association<br />
indispensable <strong>de</strong>s<br />
relevés aux données<br />
contextuelles<br />
• correspondra à<br />
l’introduction dans<br />
CODAM<br />
• très peu <strong>de</strong><br />
sélection, réflexions<br />
en cours<br />
• priorité <strong>de</strong>s<br />
métadonnées,<br />
ensuite<br />
macrodonnées,<br />
ensuite<br />
microdonnées<br />
• données évolutives<br />
ponctuelles <strong>de</strong>s<br />
anciennes enquêtes<br />
mémorisées dans un<br />
2 ème temps<br />
• critères: utilité,<br />
reconstitution et<br />
priorité<br />
• pas <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion<br />
formelle mais<br />
analyse sur mesure<br />
• tout ce qui permet<br />
<strong>de</strong> reconstituer les<br />
processus<br />
d’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong><br />
polluants dans les<br />
sols: données<br />
analytiques,<br />
métadonnées<br />
stationnelles et <strong>de</strong><br />
procédure,<br />
échantillons<br />
• critère: traçabilité<br />
• les cahiers <strong>de</strong>s<br />
<strong>la</strong>boratoires restent<br />
à l’extérieur du<br />
processus<br />
• projet NABODAT<br />
exclura les<br />
métadonnées <strong>de</strong><br />
procédure<br />
Mémorisation réelle Accessibilité<br />
l’évolution <strong>de</strong>s<br />
marchés<br />
• réflexions en cours,<br />
augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong><br />
données<br />
• compétence fédérale<br />
• archivage réalisé <strong>de</strong><br />
manière<br />
décentralisée à<br />
l’intérieur <strong>de</strong><br />
l’office, réflexions<br />
en cours<br />
• existence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
processus <strong>de</strong><br />
mémorisations<br />
parallèles (CODAM<br />
vs univers papier et<br />
banques <strong>de</strong> données<br />
décentralisées)<br />
• dépendance <strong>de</strong>s<br />
moyens financiers à<br />
disposition et <strong>de</strong><br />
l’évolution <strong>de</strong>s<br />
marchés<br />
• compétence fédérale<br />
• données toujours<br />
actives<br />
• projets <strong>de</strong> mise en<br />
réseau<br />
• dépendance <strong>de</strong>s<br />
moyens financiers à<br />
disposition<br />
• dissociation <strong>de</strong><br />
l’opérateur et du<br />
régu<strong>la</strong>teur pose<br />
problème<br />
(impositions)<br />
donnée et du <strong>de</strong>gré<br />
<strong>de</strong> traitement<br />
• diffusion très <strong>la</strong>rge,<br />
différents groupes<br />
d’utilisateurs<br />
• accès direct aux<br />
banques <strong>de</strong> données<br />
pour certains<br />
groupes<br />
• informations<br />
publiées accessibles<br />
à tous,<br />
é<strong>la</strong>rgissement du<br />
spectre <strong>de</strong><br />
communication par<br />
les nouvelles<br />
technologies<br />
• différents groupes<br />
d’utilisateurs<br />
suivant le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />
traitement:<br />
distinction entre<br />
Beobachter,<br />
Benutzer et<br />
Bearbeiter<br />
• publications<br />
virtuelles en<br />
augmentation, mise<br />
à dispositions <strong>de</strong><br />
petites banques <strong>de</strong><br />
données<br />
thématiques<br />
• protection <strong>de</strong>s<br />
données<br />
personnelles<br />
(problème <strong>de</strong><br />
l’appariement <strong>de</strong>s<br />
résultats)<br />
• données qui ne sont<br />
pas publiques, mises<br />
à disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
recherche<br />
• résultats <strong>de</strong>s<br />
analyses publiés<br />
• tendance vers un<br />
é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong><br />
l’accessibilité
158 SYNTHESE<br />
Mensur.<br />
officielle<br />
Registre<br />
foncier<br />
• possible pour toutes<br />
les données<br />
produites, pour<br />
autant qu’elles<br />
soient homogènes<br />
• bien informatisée et<br />
passage à une mise<br />
en réseau<br />
• complémentarité <strong>de</strong>s<br />
bases graphiques et<br />
informations<br />
textuelles<br />
indispensable<br />
• toutes les données<br />
contenues dans les<br />
différents éléments<br />
du registre<br />
• informatisation du<br />
RF très variable<br />
d’un canton à<br />
l’autre, tendance à<br />
une mise en réseau<br />
• différents supports<br />
qui doivent être mis<br />
en re<strong>la</strong>tion entre eux<br />
et avec les biens<br />
immeubles<br />
concernés<br />
Etat civil • toutes les données<br />
contenues dans les<br />
anciens registres<br />
(papier) et dans<br />
INFOSTAR<br />
Casier<br />
judiciaire<br />
• toutes les données<br />
contenues dans<br />
VOSTRA<br />
• uniquement sous<br />
forme informatique<br />
• seulement le produit<br />
final, les données <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mensuration<br />
officielle: jeu <strong>de</strong><br />
données,<br />
métadonnées, p<strong>la</strong>ns<br />
graphiques<br />
• distinction entre<br />
données figées et<br />
interactives<br />
• seulement l’état le<br />
plus actuel <strong>de</strong>s<br />
données<br />
• critère: valeur<br />
juridique, toutes les<br />
informations qui<br />
sont requises pour<br />
qu’une inscription<br />
soit va<strong>la</strong>ble<br />
• données historiques<br />
exclues; projet<br />
d’historisation<br />
• tout<br />
• critère: valeur<br />
juridique, toutes les<br />
informations ou<br />
documents qui sont<br />
requis pour qu’une<br />
inscription soit<br />
va<strong>la</strong>ble<br />
• données historiques<br />
aussi<br />
• tout<br />
• critère: toutes les<br />
informations qui<br />
sont requises pour<br />
qu’une inscription<br />
soit va<strong>la</strong>ble<br />
• données ressaisies<br />
selon le temps et les<br />
moyens financiers<br />
disponibles et les<br />
besoins<br />
d’inscription<br />
• données historiques<br />
aussi<br />
• toutes les données<br />
personnelles<br />
sensibles et profils<br />
<strong>de</strong> personnalité qui<br />
permettent aux<br />
autorités et acteurs<br />
concernés d’être au<br />
courant <strong>de</strong>s<br />
procédés en cours<br />
• critère: valeur<br />
juridique et pénale<br />
• seulement les<br />
données actuelles<br />
• compétence<br />
cantonale et fédérale<br />
• nécessité d’étudier<br />
les processus<br />
d’archivage au<br />
niveau cantonal<br />
• nécessité d’une<br />
p<strong>la</strong>teforme <strong>de</strong><br />
communication<br />
(INTERLIS) et<br />
d’une interface<br />
(IMO)<br />
• évolution<br />
indépendante <strong>de</strong>s<br />
différentes couches<br />
d’information<br />
• compétence<br />
cantonale<br />
• nécessité d’étudier<br />
les processus<br />
d’archivage au<br />
niveau cantonal<br />
• système<br />
centralisateur en<br />
projet (eGRIS)<br />
• compétence fédérale<br />
• dépendance <strong>de</strong>s<br />
moyens financiers à<br />
disposition et <strong>de</strong><br />
l’évolution <strong>de</strong>s<br />
marchés<br />
• dépendance d’un<br />
régu<strong>la</strong>teur externe<br />
(informatique)<br />
• données vivantes:<br />
solutions concrètes<br />
d’archivage à longue<br />
échéance encore à<br />
déterminer<br />
• compétence fédérale<br />
• conservation pour<br />
une durée limitée <strong>de</strong><br />
temps; pas<br />
d’archivage<br />
• <strong>la</strong>rge et soumise à<br />
émolument<br />
• reproduction<br />
soumise à<br />
autorisation<br />
• augmentation <strong>de</strong>s<br />
clients <strong>de</strong> <strong>la</strong> MO<br />
(acheteurs <strong>de</strong>s<br />
produits)<br />
• accessibilité<br />
facilitée par les<br />
moyens<br />
informatiques<br />
• restreinte<br />
• régu<strong>la</strong>tion stricte <strong>de</strong>s<br />
droits d’accès<br />
• distinction entre<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
consultation sans<br />
avoir un intérêt à<br />
justifier et avec une<br />
justification<br />
d’intérêt (protection<br />
<strong>de</strong>s données<br />
personnelles)<br />
• publication <strong>de</strong><br />
certaines<br />
informations<br />
• protection <strong>de</strong>s<br />
données<br />
personnelles<br />
• régu<strong>la</strong>tion stricte <strong>de</strong>s<br />
droits d’accès<br />
• distinction entre<br />
divulgation d’office<br />
et divulgation sur<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
• rationalisation <strong>de</strong><br />
l’accès sans<br />
é<strong>la</strong>rgissement<br />
• protection <strong>de</strong>s<br />
données<br />
personnelles<br />
sensibles<br />
• régu<strong>la</strong>tion stricte <strong>de</strong>s<br />
droits d’accès<br />
• <strong>de</strong>ux groupes<br />
d’acteurs: les<br />
particuliers<br />
directement<br />
concernés et les<br />
autorités<br />
compétentes
SYNTHESE 159<br />
AVS • toutes les données<br />
contenues dans les<br />
<strong>de</strong>ux registres<br />
• uniquement sous<br />
forme informatique<br />
• utilité concrète du<br />
numéro d’assuré<br />
TVA • toutes les données et<br />
les informations que<br />
les contribuables<br />
assujettis doivent<br />
fournir<br />
• sur papier et sous<br />
forme informatique<br />
en même temps<br />
• utilité concrète du<br />
numéro d’assujetti<br />
• élimination <strong>de</strong>s<br />
inscriptions une fois<br />
qu’elles ne sont plus<br />
actuelles<br />
• numéro AVS et<br />
toutes les données<br />
qui permettent <strong>de</strong><br />
faire le lien entre<br />
l’assuré et les<br />
différentes caisses<br />
<strong>de</strong> compensation<br />
• critère: utilisation<br />
directe<br />
• pas <strong>de</strong> distinction<br />
entre données<br />
historiques, passives<br />
ou vivantes<br />
• tout<br />
• critère: toutes les<br />
données dont <strong>la</strong> DP<br />
TVA a besoin pour<br />
réaliser son mandat<br />
(ordonnance)<br />
• compétence fédérale<br />
• dépendance <strong>de</strong>s<br />
moyens financiers à<br />
disposition et <strong>de</strong><br />
l’évolution <strong>de</strong>s<br />
marchés<br />
• compétence fédérale<br />
et <strong>de</strong>s contribuables<br />
assujettis euxmêmes<br />
• conservation<br />
informatique <strong>de</strong>s<br />
données vivantes et<br />
archivage pour<br />
toutes les données<br />
• rationalisation <strong>de</strong><br />
l’accès sans<br />
é<strong>la</strong>rgissement<br />
• protection <strong>de</strong>s<br />
données<br />
personnelles<br />
• régu<strong>la</strong>tion stricte <strong>de</strong>s<br />
droits d’accès<br />
• seulement un<br />
nombre restreint<br />
d’organes<br />
• protection <strong>de</strong>s<br />
données<br />
personnelles<br />
sensibles<br />
• régu<strong>la</strong>tion stricte<br />
<strong>de</strong>s droits d’accès<br />
• seulement un<br />
nombre restreint<br />
d’acteurs, même à<br />
l’intérieur <strong>de</strong><br />
l’institution<br />
La lecture <strong>de</strong> ce tableau nous permet <strong>de</strong> constater que, en dépit du fait que les exemples<br />
<strong>de</strong> types <strong>de</strong> données étudiés appartiennent tous à <strong>la</strong> Confédération et ont une importance<br />
<strong>nationale</strong>, les processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données (processus toujours compris comme<br />
regroupant les étapes qui vont <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s données jusqu’à leur éventuel archivage)<br />
varient considérablement d’un domaine à l’autre, puisque chacun d’entre eux présente <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques particulières et s’est historiquement et institutionnellement mis en p<strong>la</strong>ce selon<br />
un parcours qui lui est propre.<br />
Comme nous le verrons dans le chapitre 6, consacré à l’analyse <strong>de</strong>s données rassemblées<br />
et synthétisées, ces variations dans les processus <strong>de</strong> mémorisation sont en re<strong>la</strong>tion au nombre<br />
plus ou moins grand d’acteurs et <strong>de</strong> politiques publiques externes au domaine et tout <strong>de</strong> même<br />
impliquées dans l’une ou l’autre étape <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> mémorisation. Les régu<strong>la</strong>tions<br />
nécessaires à un domaine ou à un autre peuvent donc présenter <strong>de</strong>s similitu<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong>s<br />
différences.<br />
5.3 Synthèse <strong>de</strong>s commentaires<br />
Chacun <strong>de</strong>s neuf chapitres développés dans cette étu<strong>de</strong> se concluaient sur <strong>de</strong>s<br />
Commentaires, qui avaient pour but <strong>de</strong> souligner les aspects sail<strong>la</strong>nts d’un type <strong>de</strong> donnée par<br />
rapport à un autre. En particulier, ces commentaires soulignaient l’importance <strong>de</strong>s données<br />
dans une vision patrimoniale globale (réflexions en rapport avec <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>),<br />
les changements en cours et les mesures prises en conséquences, les caractéristiques<br />
<strong>principale</strong>s <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion actuellement en p<strong>la</strong>ce et, enfin, <strong>la</strong> ressource qui est<br />
actuellement centrale dans les réflexions <strong>de</strong> l’Organe compétent ou qui paraît fondamentale<br />
dans <strong>la</strong> gestion actuelle <strong>de</strong>s données. Le tableau ci-<strong>de</strong>ssous résume tous ces points.<br />
Tab. 5.3.1: Tableau comparatif <strong>de</strong>s éléments qui caractérisent les quatre étapes du processus <strong>de</strong><br />
mémorisation selon le domaine étudié.
160 SYNTHESE<br />
Type <strong>de</strong><br />
donnée<br />
Météor. et<br />
climat.<br />
Commentaires<br />
Importance Changements Situation actuelle Ressource<br />
fondamentale<br />
• Analyses<br />
climatologiques à<br />
long terme,<br />
vérifications<br />
• importance<br />
économique<br />
régionale et<br />
<strong>nationale</strong> très<br />
accentuée,<br />
importance <strong>nationale</strong><br />
et inter<strong>nationale</strong><br />
pour <strong>la</strong> recherche<br />
• lien entre l’évolution<br />
technologique<br />
(appareils) et <strong>la</strong><br />
conservation <strong>de</strong>s<br />
données<br />
Statistiques • analyses<br />
transversales<br />
• très <strong>la</strong>rge palette<br />
d’utilisateurs<br />
• importance<br />
politique, sociale,<br />
historique régionale,<br />
<strong>nationale</strong> et<br />
inter<strong>nationale</strong><br />
Observ. du<br />
sol<br />
Mensur.<br />
officielle<br />
Registre<br />
foncier<br />
• analyses<br />
scientifiques et<br />
décisions politiques<br />
• importance<br />
scientifique et<br />
politique, <strong>nationale</strong><br />
et inter<strong>nationale</strong><br />
• re<strong>la</strong>tion directe entre<br />
processus <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong>s<br />
données et<br />
conservation<br />
• exigences très<br />
élevées pour une<br />
mémorisation<br />
scientifiquement<br />
va<strong>la</strong>ble<br />
• mensuration exacte<br />
du territoire<br />
• importance juridique<br />
et patrimoniale,<br />
régionale et<br />
<strong>nationale</strong><br />
• re<strong>la</strong>tion entre<br />
données <strong>de</strong>scriptives<br />
et territoire physique<br />
• mémorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
propriété <strong>de</strong> biens<br />
immeubles<br />
• Agrandissement <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> masse <strong>de</strong> données<br />
trop rapi<strong>de</strong><br />
• recherche <strong>de</strong> critères<br />
<strong>de</strong> sélection qui<br />
permettent <strong>de</strong><br />
conserver tout ce<br />
qui ne peut pas être<br />
reconstitué à<br />
posteriori<br />
• passage à une<br />
automatisation <strong>de</strong>s<br />
processus <strong>de</strong> gestion<br />
• réflexions sur les<br />
processus <strong>de</strong><br />
mémorisation<br />
• distinction difficile<br />
entre données<br />
historiques et<br />
données encore<br />
exploitées<br />
• importance<br />
grandissante <strong>de</strong>s<br />
métadonnées<br />
• possibilités<br />
d’appareil<strong>la</strong>ge en<br />
augmentation<br />
• rupture <strong>de</strong> stocks<br />
<strong>de</strong>s échantillons<br />
anciens<br />
• augmentation <strong>de</strong>s<br />
producteurs et, en<br />
général, <strong>de</strong>s acteurs<br />
concernés<br />
• questions <strong>de</strong><br />
sauvegar<strong>de</strong> à<br />
c<strong>la</strong>rifier<br />
• mise en réseau en<br />
cours<br />
• nécessité d’une<br />
historisation <strong>de</strong>s<br />
données<br />
• informatisation <strong>de</strong>s<br />
RF en cours<br />
• Système bien en<br />
p<strong>la</strong>ce ; centralisation<br />
interne<br />
• système récent et<br />
encore en évolution<br />
(CODAM),<br />
centralisation<br />
interne et externe<br />
• projet<br />
(NABODAT),<br />
centralisation<br />
externe<br />
• système en p<strong>la</strong>ce<br />
(IMO et INTERLIS)<br />
en évolution : mise<br />
en réseau interne<br />
(échelons<br />
administratifs) et<br />
externe (MO vs RF<br />
et autres systèmes<br />
liés au territoire)<br />
• interface en p<strong>la</strong>ce<br />
(Petite interface) et<br />
projet (eGRIS) <strong>de</strong><br />
• « Raison »<br />
• « <strong>la</strong>ngage »<br />
• « espace public »<br />
prend du ressort<br />
• « <strong>la</strong>ngage »<br />
• « <strong>la</strong>ngage »<br />
• « raison »<br />
• « espace public »<br />
prend du ressort<br />
• « <strong>la</strong>ngage »
SYNTHESE 161<br />
Type <strong>de</strong><br />
donnée<br />
Commentaires<br />
Importance Changements Situation actuelle Ressource<br />
fondamentale<br />
• importance régionale<br />
et <strong>nationale</strong>,<br />
juridique et<br />
patrimoniale<br />
• re<strong>la</strong>tion entre<br />
données, documents<br />
et territoire<br />
Etat civil • mémorisation <strong>de</strong><br />
l’état civil<br />
• très haute<br />
importance<br />
politique, juridique,<br />
patrimoniale, etc.<br />
• cycle <strong>de</strong> vie<br />
extrêmement long<br />
Casier<br />
judiciaire<br />
<strong>de</strong>s données<br />
• mémorisation <strong>de</strong>s<br />
condamnations et<br />
leur exécution pour<br />
une pério<strong>de</strong><br />
déterminée<br />
• importance<br />
juridique et pénale<br />
• effacement <strong>de</strong><br />
<strong>mémoire</strong><br />
AVS • mémorisation et<br />
centralisation <strong>de</strong>s<br />
assurés et <strong>de</strong>s rentes<br />
• importance<br />
économique<br />
• rassemblement <strong>de</strong>s<br />
différents éléments<br />
d’un même puzzle<br />
TVA • mémorisation <strong>de</strong>s<br />
contribuables et <strong>de</strong>s<br />
informations<br />
financières<br />
concernant leurs<br />
activités<br />
commerciales<br />
• importance<br />
économique et<br />
juridique<br />
• mémorisation<br />
facilitée par les<br />
systèmes <strong>de</strong> gestion<br />
en p<strong>la</strong>ce<br />
• cycle <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s<br />
données<br />
re<strong>la</strong>tivement court<br />
• mise en réseau <strong>de</strong>s<br />
données terminées<br />
• nouvelle<br />
dépendance <strong>de</strong>s<br />
organes<br />
informatiques<br />
• mise en réseau <strong>de</strong>s<br />
données terminée<br />
• nouvelle<br />
dépendance <strong>de</strong>s<br />
organes<br />
informatiques<br />
• nouvelle<br />
dépendance <strong>de</strong>s<br />
organes<br />
informatiques<br />
• changement du<br />
numéro d’assuré<br />
• ont déjà eu lieu<br />
• évolution linéaire <strong>de</strong><br />
l’institution et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
gestion <strong>de</strong>s données<br />
• nouvelle<br />
dépendance <strong>de</strong>s<br />
organes<br />
informatiques<br />
• changement du<br />
numéro d’assujetti<br />
mise en réseau<br />
interne (échelons<br />
administratifs) et<br />
externe (RF vs MO<br />
et autres systèmes<br />
liés au territoire)<br />
• système en p<strong>la</strong>ce<br />
(INFOSTAR), mais<br />
toujours en<br />
évolution<br />
• mise en réseau<br />
interne, accessibilité<br />
facilitée<br />
• système en p<strong>la</strong>ce<br />
(VOSTRA)<br />
• « temps & espace »<br />
• « <strong>la</strong>ngage »<br />
• système en p<strong>la</strong>ce • « raison »<br />
• système en p<strong>la</strong>ce • « <strong>la</strong>ngage » et<br />
« raison »<br />
La synthèse <strong>de</strong>s commentaires nous permet tout d’abord <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce le fait que<br />
le fonctionnement <strong>de</strong>s politiques publiques sous-jacentes aux domaines que nous avons pris<br />
en considération s’appuie fortement sur un ensemble <strong>de</strong> données bien précis et qui en<br />
constituent pour ainsi dire le fon<strong>de</strong>ment. Ces données sont donc primordiales, dans le sens<br />
qu’elles permettent <strong>de</strong> réaliser le contenu substantiel <strong>de</strong> ces politiques publiques. Leur valeur<br />
patrimoniale ne rési<strong>de</strong> pas dans <strong>la</strong> richesse et <strong>la</strong> variété <strong>de</strong>s informations qu’elles contiennent,<br />
ni du périmètre d’intérêt qu’elles recouvrent (toute <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion helvétique ou seulement <strong>de</strong>s<br />
catégories déterminées), mais dans le fait qu’elles sont indispensables pour le fonctionnement
162 SYNTHESE<br />
<strong>de</strong> ces politiques publiques. Leur mémorisation permet en outre <strong>de</strong> reconstituer a posteriori<br />
un ensemble d’autres informations qui se construisent sur cette base.<br />
Il apparaît ensuite que le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> détail dans lequel <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion est faite n’est pas en<br />
re<strong>la</strong>tion avec le périmètre d’acteurs susceptibles d’être intéressés aux données aux différents<br />
sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> celles-ci, car <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion plus ou moins poussée dépend d’autres<br />
facteurs, comme par exemple le nombre d’acteurs impliqués dans le processus <strong>de</strong><br />
mémorisation ou <strong>la</strong> valeur juridique et économique <strong>de</strong>s données. Le tableau montre encore<br />
que nous nous situons dans une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> grands changements pour ce qui concerne <strong>la</strong><br />
gestion <strong>de</strong>s données dans presque tous les domaines étudiés. Les acteurs interviewés profitent<br />
d’ailleurs <strong>de</strong> ces changements – qui touchent souvent <strong>de</strong>s aspects plus vastes <strong>de</strong>s politiques<br />
publiques concernées – pour réfléchir <strong>de</strong> manière plus approfondie aux différentes étapes <strong>de</strong><br />
traitement <strong>de</strong>s données, y compris les questions <strong>de</strong> conservation et d’archivage.<br />
Dans le chapitre qui suit nous allons tirer les conséquences <strong>de</strong> toutes ces constatations<br />
empiriques d’un point du vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion.
6 Analyse du matériel empirique<br />
Au sta<strong>de</strong> actuel <strong>de</strong> nos recherches pour <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>,<br />
l’analyse <strong>de</strong>s données empiriques rassemblées dans les neuf chapitres présentés consiste<br />
essentiellement dans l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s régu<strong>la</strong>tions actuellement en p<strong>la</strong>ce dans les domaines<br />
étudiés ainsi que <strong>de</strong> celles (plus ou moins pertinentes, parfois même contradictoires) qu’on<br />
pourrait encore imaginer.<br />
6.1 Régu<strong>la</strong>tions par processus<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s exemples choisis nous permet <strong>de</strong> constater qu’il existe un lien entre <strong>la</strong><br />
linéarité du processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> données et le nombre d’acteurs<br />
impliqués dans les diverses étapes au travers <strong>de</strong>squelles les données transitent long <strong>de</strong> leur<br />
existence : plus le nombre d’acteurs impliqués est grand, moins le processus est linéaire.<br />
La figure ci-<strong>de</strong>ssous (Figure 6.1.1) représente <strong>de</strong> manière schématique les groupes<br />
d’acteurs (lignes horizontales), ainsi que les différentes phases au travers <strong>de</strong>squelles un type<br />
<strong>de</strong> données déterminé passe au long <strong>de</strong> son parcours <strong>de</strong> vie (petits ronds organisés en<br />
colonnes). Le schéma indique uniquement le nom <strong>de</strong> l’organe compétent utilisé pour cette<br />
étu<strong>de</strong>, ainsi que le niveau administratif où se situent les autres groupes d’acteurs qui<br />
interagissent dans l’une ou l’autre <strong>de</strong>s phase suivantes : <strong>la</strong> production (par exemple au moyen<br />
<strong>de</strong> relevés ou d’enquêtes), le traitement (par exemple les contrôles <strong>de</strong> qualité, l’agrégation <strong>de</strong>s<br />
données, l’insertion dans un système informatique central), l’exploitation (par exemple<br />
l’utilisation <strong>de</strong>s données à l’interne pour <strong>la</strong> mise en œuvre d’une politique publique donnée),<br />
<strong>la</strong> conservation (par exemple les mesures prises pour <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> pérennité informatique<br />
<strong>de</strong>s données), <strong>la</strong> diffusion (par exemple, <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong>s données à <strong>de</strong>s acteurs externe, <strong>la</strong><br />
publication <strong>de</strong>s résultats auxquels elles permettent d’aboutir). L’archivage est désigné par <strong>de</strong>s<br />
traits-tillés dans <strong>la</strong> même colonne que <strong>la</strong> diffusion pour désigner le fait que ces phases<br />
peuvent être parallèles et dans une autre ligne, car il peut être sous <strong>la</strong> responsabilité du même<br />
acteur ou, plus souvent, conjointement aux archives du niveau administratif compétent en <strong>la</strong><br />
matière. Les différentes phases n’ont pas forcément lieu à <strong>la</strong> suite, comme représenté ; il s’agit<br />
ici d’une simplification.<br />
Acteur<br />
Autres<br />
acteurs au<br />
niveau fédéral<br />
ou cantonal<br />
Modèle hypothétique « linéaire »<br />
Production Traitement Exploitation Conservation Diffusion<br />
Archivage<br />
Fig. 6.1.1 : Représentation schématique <strong>de</strong>s phases au travers <strong>de</strong>squelles un type <strong>de</strong> données<br />
hypothétique transite au cours <strong>de</strong> son existence, ainsi que <strong>de</strong>s acteurs concernés.<br />
Dans ce modèle, qui est hypothétique, les phases au travers <strong>de</strong>squelles les données<br />
transitent sont sous <strong>la</strong> responsabilité d’un acteur unique, éventuellement doublé d’un<br />
<strong>de</strong>uxième acteur pour l’archivage <strong>de</strong>s données. Ainsi, les régu<strong>la</strong>tions nécessaires pour assurer<br />
le processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données ne concernent ici que l’action <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux acteurs<br />
déterminés.
164 ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE<br />
Cette même représentation schématique appliquée aux neuf types <strong>de</strong> données étudiés<br />
(Figure 6.1.2) montre que dans <strong>la</strong> réalité les groupes d’acteurs qui interviennent dans l’une ou<br />
l’autre phase sont nombreux. La complexification croissante <strong>de</strong> <strong>la</strong> programmation et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mise en œuvre <strong>de</strong>s politiques publiques, l’entrée en jeu <strong>de</strong>s nouvelles technologies, les<br />
exigences <strong>de</strong> précision et d’exhaustivité <strong>de</strong> plus en plus élevés ont d’ailleurs pour effet une<br />
augmentation du nombre d’acteurs directement concernés par une politique publique donnée<br />
et, en conséquence, une augmentation <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion.<br />
MétéoSuisse<br />
Autres<br />
acteurs au<br />
niveau fédéral<br />
OFS<br />
Autres<br />
acteurs au<br />
niveau fédéral<br />
Agroscope<br />
OFEV / OFAG<br />
Autres<br />
acteurs au<br />
niveau fédéral<br />
Acteurs privés<br />
Swisstopo<br />
Acteurs au<br />
niveau cantonal<br />
Acteurs au<br />
niveau communal<br />
et privés<br />
OFRF<br />
Acteurs au<br />
niveau cantonal<br />
Acteurs au<br />
niveau communal<br />
et privés<br />
1. Données météorologiques et climatologiques<br />
Production<br />
2. Données statistiques<br />
Production<br />
Traitement Exploitation Conservation Diffusion<br />
Traitement Exploitation<br />
3. Données d’observation <strong>de</strong>s sols<br />
Production<br />
Traitement<br />
4. Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
Production Traitement<br />
5. Données du registre foncier<br />
Production Traitement<br />
Conservation<br />
Archivage<br />
Diffusion<br />
Archivage<br />
Exploitation Diffusion<br />
Exploitation<br />
Exploitation<br />
Conservation<br />
Conservation<br />
Conservation<br />
Archivage<br />
Diffusion<br />
Archivage<br />
Diffusion<br />
Archivage<br />
OFEC<br />
Autres acteurs au<br />
niveau fédéral<br />
Acteurs au<br />
niveau cantonal<br />
Autres acteurs au<br />
niveau cantonal<br />
Acteurs au<br />
niveau<br />
communal<br />
Casier judiciaire<br />
suisse<br />
Autres acteurs au<br />
niveau fédéral<br />
Centrale <strong>de</strong><br />
compensation<br />
Autres acteurs<br />
au niveau fédéral<br />
Autres acteurs<br />
privés<br />
AFC<br />
(Division<br />
<strong>principale</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA)<br />
Autres acteurs<br />
au niveau fédéral<br />
6. Données <strong>de</strong> l’état civil<br />
Production Traitement<br />
7. Données du casier judiciaire<br />
Production<br />
Traitement Exploitation<br />
8. Données <strong>de</strong> l’assurance-vieillesse et survivants<br />
Production Traitement<br />
Exploitation Conservation<br />
Exploitation<br />
9. Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée<br />
Conservation<br />
Conservation<br />
Conservation<br />
Fig. 6.1.2 : Représentation schématique <strong>de</strong>s phases au travers <strong>de</strong>squelles chacun <strong>de</strong>s neuf types<br />
<strong>de</strong> données étudiées transite au cours <strong>de</strong> son existence, ainsi que <strong>de</strong>s niveaux<br />
d’acteurs concernés.<br />
Ces représentations permettent <strong>de</strong> se rendre compte visuellement du fait que ceux que<br />
nous avons appelés « organes <strong>de</strong> compétence » sont en fait constitués <strong>de</strong>s institutions qui<br />
prennent en charge le plus grand nombre <strong>de</strong> phases au travers <strong>de</strong>squelles les données<br />
transitent : elles ont d’ailleurs été choisies pour réaliser les entretiens, car elles détiennent une<br />
gran<strong>de</strong> part du savoir sur les aspects substantiel <strong>de</strong>s politiques publiques concernées et sur le<br />
fonctionnement <strong>de</strong> l’ensemble du processus.<br />
Acteurs<br />
privés<br />
Production<br />
Traitement<br />
Exploitation<br />
Diffusion<br />
Archivage<br />
Diffusion<br />
Archivage<br />
Diffusion<br />
Diffusion<br />
Diffusion<br />
Archivage<br />
Diffusion<br />
Archivage
ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE 165<br />
Les diverses figures montrent également que <strong>la</strong> phase <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s données est<br />
majoritairement dans les mains d’autres acteurs, qui peuvent dans certains cas être <strong>de</strong>s privés<br />
(acteur institutionnel ou individus). Même dans les cas où les données sont produites par le<br />
même organe, une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> production est externe. La phase du traitement <strong>de</strong>s données se<br />
situe dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s cas au niveau du producteur ; ce n’est pas le cas lorsque les phases<br />
suivantes sont centralisées chez un acteur unique. L’exploitation <strong>de</strong>s données ne se situe pas<br />
forcément uniquement chez le Datenherr : d’autres acteurs peuvent entrer en jeu, notamment<br />
dans les politiques publiques mises en réseau au moyen <strong>de</strong> p<strong>la</strong>teformes informatiques. La<br />
conservation <strong>de</strong>s données (garantie <strong>de</strong> perpétuité) requiert dans <strong>de</strong> nombreux cas<br />
l’intervention d’acteurs externes spécialisés, en particulier lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> données<br />
électroniques ; si le producteur <strong>de</strong>s données est un autre acteur, souvent elles sont conservées<br />
à plusieurs endroits en même temps (doublons), ou alors <strong>de</strong> manière parcel<strong>la</strong>ire (suivant les<br />
phases <strong>de</strong> traitement, chez les différents acteurs concernés). La diffusion est du ressort du<br />
Datenherr ; lorsque <strong>de</strong>s réseaux sont mis en p<strong>la</strong>ce, elle peut être faite par d’autres acteurs<br />
participant à <strong>la</strong> même politique publique. Enfin, <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> l’archivage est toujours<br />
attribuée au Danteherr et à l’instance responsable au niveau fédéral ou cantonal.<br />
De manière générale, les caractéristiques qui distinguent ces trois groupes <strong>de</strong> données<br />
sont les suivantes :<br />
• données <strong>de</strong>scriptives :<br />
- le processus <strong>de</strong> mémorisation qu’elles suivent est composé d’un seul processus<br />
(ou, si ce n’est pas encore le cas, tend à ce but), dans le sens qu’il a été pensé<br />
du début (production <strong>de</strong>s données) à <strong>la</strong> fin (conservation) comme étant un tout ;<br />
- elles s’appuient très fortement sur les métadonnées ou données contextuelles<br />
qui les accompagnent, qu’il <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> plus en plus important <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r ;<br />
- dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s cas, elles ont un parcours <strong>de</strong> vie perpétuel et ne suivent pas<br />
les processus d’archivage habituels, leur pérennité dans le temps doit donc être<br />
assurée autrement ;<br />
• données juridiques spatiales :<br />
- leur mémorisation se fait en passant par plusieurs processus : en particulier,<br />
leur conservation suit <strong>de</strong>s chemins différents selon qu’elles sont<br />
-<br />
informatiquement mises en réseau et centralisées (responsabilité attribuée à <strong>la</strong><br />
Confédération) ou non (responsabilité attribuée aux cantons) ;<br />
leur conservation dans le temps, qui a une énorme importance économique <strong>de</strong><br />
par le fait qu’elles permettent <strong>de</strong> donner une représentation et une <strong>de</strong>scription<br />
juridique <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété, doit pouvoir s’assurer en dépit <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong><br />
processus qui peuvent intervenir sans que leur re<strong>la</strong>tion aux biens-fonds et aux<br />
biens immobiliers se per<strong>de</strong>nt ;<br />
• données juridiques personnelles :<br />
- les processus <strong>de</strong> mémorisation qui les caractérisent suivent <strong>de</strong>s chemins<br />
beaucoup moins compliqués et diversifiés que les <strong>de</strong>ux groupes <strong>de</strong> données<br />
précé<strong>de</strong>ntes ; leur architecture est donc plus simple ;<br />
- leur intérêt socio-économique est moins élevé, mais leur gestion est plus<br />
complexe, car il s’agit justement <strong>de</strong> données personnelles ;<br />
- comme ces données sont gérées au travers <strong>de</strong> registres, leur structuration varie<br />
peu lors du passage à d’autres supports (du papier à l’informatique) ;
166 ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE<br />
• données financières :<br />
- le processus <strong>de</strong> mémorisation suit un processus unique et est extrêmement bien<br />
régulé ;<br />
- elles représentent un intérêt purement économique et juridique ;<br />
- leur structuration varie peu suivant le support sur lequel elles sont fixées.<br />
Les représentations schématiques que nous avons faites <strong>de</strong>s différentes phases<br />
correspon<strong>de</strong>nt, avec plus ou moins d’exactitu<strong>de</strong> selon <strong>la</strong> complexité et le nombre d’acteurs<br />
concernés, à <strong>la</strong> situation dans <strong>la</strong>quelle les opérateurs se trouvent actuellement. Les régu<strong>la</strong>tions<br />
formelles (et même informelles) qui existent dans cette situation et que nous avons mises en<br />
évi<strong>de</strong>nce tout au long <strong>de</strong>s chapitres empiriques concernent donc ces mêmes opérateurs<br />
appartenant à <strong>de</strong>s politiques publiques substantielles (ou sectorielles) et les activités qu’ils<br />
exercent ; elles ne s’éten<strong>de</strong>nt en principe pas à <strong>de</strong>s domaines qui ne sont pas directement en<br />
re<strong>la</strong>tion avec leur activités mais qui sont susceptibles d’avoir une influence sur les processus<br />
<strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données dont il sont responsables. Dans certains cas, <strong>de</strong> plus en plus<br />
nombreux, <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion sont également mises en p<strong>la</strong>ce en fonction <strong>de</strong>s exigences<br />
inter<strong>nationale</strong>s (régu<strong>la</strong>tions « corporatives » dans un domaine déterminé, chartes, co<strong>de</strong>s,<br />
standards, etc.).<br />
6.2 Régu<strong>la</strong>tions par ressources<br />
La régu<strong>la</strong>tion qu’il faut envisager dans le cadre d’une politique publique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
ne doit pas se limiter aux institutions d’archivage, aux acteurs et aux activités directement en<br />
lien avec les différentes phases au travers <strong>de</strong>squelles les données transitent au cours <strong>de</strong> leur<br />
existence ou aux exigences inter<strong>nationale</strong>s <strong>de</strong>s domaines concernés. Il existe en effet <strong>de</strong><br />
nombreux autres acteurs – publics ou même privés – qui peuvent avoir une influence<br />
significative sur les processus <strong>de</strong> mémorisation. Pour cette raison, il est important d’é<strong>la</strong>rgir<br />
autant que possible les réflexions préa<strong>la</strong>bles à <strong>la</strong> mise sur pieds <strong>de</strong> cette nouvelle politique.<br />
Le modèle conceptuel en quatre phases (mémorisabilité, dignité à <strong>la</strong> mémorisation,<br />
mémorisation réelle, accessibilité au public) que nous avons proposé au début <strong>de</strong> notre<br />
recherche, ainsi que les éléments conceptuels complémentaires introduisant les quatre<br />
ressources désignées comme « <strong>la</strong>ngage », « raison », « espace & temps » et « espace public »<br />
permettent justement d’abor<strong>de</strong>r les réflexions autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion d’un autre angle <strong>de</strong> vue<br />
et <strong>de</strong> déterminer quels sont les autres acteurs et activités qui peuvent, même <strong>de</strong> manière<br />
indirecte, avoir un impact sur <strong>la</strong> nouvelle politique (Figure 6.2.1).<br />
Seules <strong>de</strong>s régu<strong>la</strong>tions é<strong>la</strong>rgies sont à même <strong>de</strong> préserver et exploiter <strong>de</strong> manière<br />
contrôlée (ni excessive, ni insuffisante) les ressources qui permettent à l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
processus <strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong> fonctionner à long terme. Le rôle <strong>de</strong> ces régu<strong>la</strong>tions, qu’elles<br />
soient directes ou indirectes, est <strong>de</strong> réduire au maximum les rivalités d’usage d’une même<br />
ressource par différentes politiques publiques, ce qui conduirait, à terme, à son épuisement.<br />
Les aspects dont il faut tenir compte concernant les rivalités et les régu<strong>la</strong>tions sont à i<strong>de</strong>ntifier<br />
à partir <strong>de</strong>s services nécessaires au processus <strong>de</strong> construction d’une <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>,<br />
éléments qui s’i<strong>de</strong>ntifient à leur tour grâce aux <strong>de</strong>scriptions empiriques et aux expériences<br />
re<strong>la</strong>tées.
ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE 167<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
politique publique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
Régu<strong>la</strong>tions « directes »:<br />
elles sont le noyau <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique publique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>. Elles concernent les groupes<br />
d’acteurs exerçant une activité directement<br />
en lien avec une ou plusieurs phases au<br />
travers <strong>de</strong>squelles les données transitent au<br />
cours <strong>de</strong> leur existence (production,<br />
traitement, exploitation, conservation,<br />
diffusion, archivage).<br />
Régu<strong>la</strong>tions « indirectes »:<br />
elles concernent <strong>de</strong>s zones plus périphériques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> politique publique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>, mais<br />
elles sont indispensables et garantissent <strong>la</strong><br />
durabilité <strong>de</strong> celle-ci. Elles concernent les<br />
groupes d’acteurs dont l’activité peut avoir un<br />
impact sur l’une ou l’autre <strong>de</strong>s ressources<br />
(« <strong>la</strong>ngage », « raison », « espace & temps »,<br />
« espace public ») qui permettent au processus<br />
<strong>de</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données<br />
(« mémorisabilité », dignité à <strong>la</strong> mémorisation,<br />
mémorisation réelle, accessibilité au public)<br />
d’avoir lieu sans arriver à un sta<strong>de</strong><br />
d’épuisement.<br />
Fig. 6.2.1: Représentation schématique <strong>de</strong>s cercles <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tions caractérisant une politique<br />
publique durable.<br />
Le matériel empirique récolté jusqu’ici et <strong>la</strong> synthèse qui en a été faite nous permettent <strong>de</strong><br />
reformuler les tableaux dédiés aux rivalités et aux régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s ressources présentés une<br />
première fois au chapitre 3 (Eléments conceptuels complémentaires). Alors que dans le<br />
chapitre 3 les tableaux avaient été réalisés <strong>de</strong> manière intuitive et sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s exemples<br />
d’institutions d’archivage présentés dans l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base, ils sont conçus ici suivant une<br />
démarche inductive, c’est-à-dire en s’appuyant sur les données empiriques présentées dans les<br />
neuf chapitres présentés (<strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité vers <strong>la</strong> théorie) selon les quatre groupes <strong>de</strong> données<br />
utilisées (données <strong>de</strong>scriptives, données juridiques spatiales, données juridiques personnelles,<br />
données financières).<br />
Ces nouveaux tableaux contiennent <strong>de</strong>s régu<strong>la</strong>tions déjà en p<strong>la</strong>ce mais aussi <strong>de</strong>s<br />
régu<strong>la</strong>tions (plus ou moins réalistes) qui pourraient être imaginées dans le cadre <strong>de</strong>s domaines<br />
étudiés ; il peut s’agir <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tions importantes, qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt une réflexion <strong>de</strong> base<br />
substantielle, ou <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tions moins vastes, qui portent sur <strong>de</strong>s aspects très ponctuels. Les<br />
abréviations entre parenthèses (météo, stat, sol, mo, rf, ec, cj, avs, tva) – qui désignent les neuf<br />
types <strong>de</strong> données étudiées – indiquent quel est le domaine qui a permis d’insérer dans le<br />
tableau l’une ou l’autres <strong>de</strong>s rivalités d’usage indiquée. Ces renvois ne signifient pas que le<br />
domaine indiqué présente ces rivalités ; ils indiquent uniquement le domaine qui nous a<br />
suggéré l’idée <strong>de</strong> ces régu<strong>la</strong>tions potentielles et ont pour but <strong>de</strong> montrer <strong>la</strong> systématique qui a<br />
été suivie dans <strong>la</strong> construction <strong>de</strong>s tableaux.<br />
6.2.1 « Mémorisabilité » – ressource « <strong>la</strong>ngage »<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « <strong>la</strong>ngage », qui permet d’assurer <strong>la</strong> « mémorisabilité »<br />
<strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s informations, les services nécessaires au processus <strong>de</strong> construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> sont les suivants :<br />
• homogénéité : pour pouvoir être mémorisables, les données doivent pouvoir être<br />
comparables entre elles ;<br />
• pérennité : pour pouvoir être mémorisables, les données et les supports doivent<br />
survivre dans le temps ;
168 ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE<br />
• reproductibilité : pour pouvoir être mémorisables, les données et les supports doivent<br />
pouvoir être reproduits ou copiés ;<br />
• universalité : pour pouvoir être mémorisables, les données doivent être<br />
compréhensibles par tous les acteurs susceptibles <strong>de</strong> vouloir les mémoriser ;<br />
• transférabilité : pour pouvoir être mémorisables, les données doivent pouvoir être<br />
transférées d’un support à l’autre ;<br />
• lisibilité : pour pouvoir être mémorisables, les données doivent être<br />
compréhensibles ;<br />
• durabilité : pour pouvoir être mémorisables, les données doivent être récoltées sur<br />
une durée <strong>de</strong> temps suffisante et selon <strong>de</strong>s critères durables ;<br />
En tenant compte <strong>de</strong>s sept services que nous avons i<strong>de</strong>ntifiés, les rivalités d’usage<br />
potentiellement existantes et les régu<strong>la</strong>tions qui peuvent être imaginées sont re<strong>la</strong>tées dans le<br />
tableau ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
Tab. 6.2.1.1 : Ressource « <strong>la</strong>ngage ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
collective : capacité <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s supports adéquats pour rendre<br />
l’information mémorisable.<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Homogénéité<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
• Augmentation <strong>de</strong>s producteurs<br />
(météo, stat, sol, mo, rf, tva)<br />
• métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong>s différents producteurs<br />
(stat, sol)<br />
• concurrence excessive /<br />
insuffisante dans <strong>la</strong> production<br />
<strong>de</strong>s données (stat, mo, rf, tva)<br />
• refus <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong>s<br />
compétences (thésaurisation /<br />
rétention <strong>de</strong>s informations) <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> part <strong>de</strong>s producteurs (sol,<br />
avs, tva)<br />
• enchevêtrement entre<br />
production publique et privée<br />
(météo, stat, mo, rf, tva)<br />
• fédéralisme, démocratie,<br />
dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s compétences<br />
(stat, sol, mo, rf)<br />
• évolution / modification <strong>de</strong>s<br />
appareils <strong>de</strong> mesure suite à<br />
l’évolution du marché privé<br />
(météo, sol, mo)<br />
Pérennité • disparition / modification <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>ngages existants suite aux<br />
exigences du marché privé<br />
(météo, stat, sol, mo, rf, ec, cj,<br />
avs, tva)<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage (droits <strong>de</strong><br />
propriété / politiques publiques)<br />
• Standards dans <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s données<br />
• régu<strong>la</strong>tion externe <strong>de</strong> <strong>la</strong> production<br />
• standardisation <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> production<br />
selon le domaine<br />
• normes <strong>de</strong> production<br />
• régu<strong>la</strong>tion externe aux opérateurs<br />
• mise en réseau <strong>de</strong>s données<br />
• détermination précise <strong>de</strong>s acteurs compétents<br />
• contrôles externes<br />
• obligation <strong>de</strong> transférer les compétences et les<br />
connaissances<br />
• mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> systèmes d’information<br />
• mise en réseau <strong>de</strong>s données<br />
• établissement du Datenherr<br />
• détermination <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur collective <strong>de</strong>s<br />
informations<br />
• centralisation post-production<br />
• standardisation au niveau national<br />
• standards et normes dans <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s<br />
appareils<br />
• garanties <strong>de</strong> compatibilité<br />
• standardisation <strong>de</strong>s <strong>la</strong>ngages informatiques<br />
• garanties <strong>de</strong> durabilité<br />
• standardisation <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s utilisés<br />
• contrôle public <strong>de</strong>s produits du marché privé<br />
• licences pour <strong>la</strong>ngages informatiques<br />
• propriété intellectuelle<br />
• normes <strong>de</strong> caractères, <strong>de</strong> format, etc.
ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE 169<br />
Reproductibilité<br />
Universalité<br />
• création <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngages, co<strong>de</strong>s,<br />
systèmes, programmes, etc.<br />
nouveaux suite aux exigences<br />
du marché privé (météo, stat,<br />
sol, mo, rf, ec, cj, avs, tva)<br />
• perte <strong>de</strong> connaissance <strong>de</strong>s<br />
co<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lecture <strong>de</strong>s <strong>la</strong>ngages<br />
suite aux exigences <strong>de</strong>s acteurs<br />
sectoriels ou du marché <strong>de</strong><br />
l’informatique (météo, stat, sol,<br />
mo, rf, ec, cj, avs, tva)<br />
• disparition <strong>de</strong>s appareils <strong>de</strong><br />
lecture <strong>de</strong>s données suite aux<br />
exigences du marché privé<br />
(météo, stat, sol, mo, rf, ec, cj,<br />
avs, tva)<br />
• manque d’uniformité dans les<br />
systèmes informatiques utilisés<br />
(architecture, programmes,<br />
etc.) (météo, stat, sol, mo, rf,<br />
ec, cj, avs, tva)<br />
• réduction <strong>de</strong>s moyens<br />
financiers à disposition<br />
(irrégu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s financements),<br />
(météo, stat, sol, mo, rf, ec, cj,<br />
avs, tva)<br />
• impossibilité <strong>de</strong> mettre en<br />
re<strong>la</strong>tion <strong>la</strong> réalité avec sa<br />
représentation et les différentes<br />
couches <strong>de</strong> données qui <strong>la</strong><br />
décrivent, potentielle<br />
introduction d’erreurs (mo, rf,<br />
tva)<br />
• régu<strong>la</strong>tion disputée par divers<br />
acteurs (sol)<br />
• insuffisance d’informations <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> part <strong>de</strong>s producteurs<br />
(traçabilité impossible) (stat,<br />
sol)<br />
• protection excessive <strong>de</strong>s<br />
données (reproductibilité<br />
restreinte) (rf, tva)<br />
• utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngages<br />
sectoriels par les différents<br />
producteurs /<strong>la</strong>ngages-club<br />
(météo, stat, sol, mo, rf, ec, cj,<br />
avs, tva)<br />
• refus / insuffisance <strong>de</strong><br />
col<strong>la</strong>borations (inter<strong>nationale</strong>,<br />
<strong>nationale</strong>, régionale),<br />
information concernant les<br />
autres acteurs insuffisante (sol)<br />
• garanties <strong>de</strong> compatibilité à long terme<br />
• conservation d’une partie <strong>de</strong>s compétences<br />
techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s acteurs politicoadministratif<br />
<strong>de</strong>s politiques publiques<br />
• contrôle public <strong>de</strong>s produits du marché privé<br />
• droits <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong> mots clés, co<strong>de</strong>s,<br />
systèmes, etc.<br />
• obligation <strong>de</strong> conserver les clés <strong>de</strong> lecture<br />
• régu<strong>la</strong>tion externe à <strong>la</strong> politique publique<br />
• obligation <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s garanties <strong>de</strong><br />
transférabilité <strong>de</strong>s données<br />
• obligation d’anticipation<br />
• conservation d’une partie <strong>de</strong>s compétences<br />
techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s acteurs politicoadministratif<br />
<strong>de</strong>s politiques publiques<br />
• gestion financière pluriannuelle<br />
• obligation <strong>de</strong> prévoir un budget pour ce<br />
domaine<br />
• uniformisation <strong>de</strong>s numéros <strong>de</strong> référence<br />
• introduction <strong>de</strong> numéros <strong>de</strong> contrôle<br />
• centralisation <strong>de</strong>s fonctions régu<strong>la</strong>trices<br />
• obligation d’assurer <strong>la</strong> traçabilité<br />
• obligation <strong>de</strong> pouvoir renseigner<br />
• régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données<br />
externe<br />
• analyse détaillée <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproduction<br />
• droit <strong>de</strong> copie<br />
• régu<strong>la</strong>tion institutionnelle (vs substantielle),<br />
c’est-à-dire généralisée<br />
• transparence<br />
• encouragement à <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration<br />
• obligation à une formation continue adéquate<br />
du personnel
170 ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE<br />
Transférabilité<br />
Lisibilité<br />
• utilisation <strong>de</strong> programmes et<br />
p<strong>la</strong>teformes non transférables<br />
(mo, rf)<br />
• impossibilité <strong>de</strong> distinguer<br />
contenu et contenant (stat, sol,<br />
mo, rf)<br />
• manque <strong>de</strong> temps ou d’autres<br />
moyens<br />
• utilisation immédiate ou<br />
différée dans le temps (météo,<br />
stat, sol, rf, ec, cj, avs)<br />
• noya<strong>de</strong> d’information par<br />
manque <strong>de</strong> sélection (météo,<br />
stat)<br />
• perte / rétention <strong>de</strong><br />
métadonnées par gestion<br />
insuffisante dans le passé (stat)<br />
Durabilité • perte d’information suite à <strong>de</strong>s<br />
changements <strong>de</strong> politique (stat,<br />
sol)<br />
• création <strong>de</strong> p<strong>la</strong>teformes <strong>de</strong> communication<br />
• création <strong>de</strong> copies (numériques)<br />
• <strong>de</strong>scriptions du contenant<br />
• obligation <strong>de</strong> programmer les ressources<br />
nécessaires à <strong>la</strong> mémorisabilité<br />
• garantie <strong>de</strong> lisibilité pour une durée <strong>de</strong> temps<br />
suffisante<br />
• création <strong>de</strong> critères <strong>de</strong> sélection qui réduisent<br />
les quantités (frein à <strong>la</strong> production)<br />
• attribution <strong>de</strong> moyens suffisants pour pouvoir<br />
suivre dans <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données<br />
• obligation <strong>de</strong> connaître les groupes <strong>de</strong> données<br />
• obligation <strong>de</strong> conserver les métadonnées<br />
• création <strong>de</strong> standards<br />
• garanties d’indépendance au niveau du<br />
contenu<br />
Nous constatons que les <strong>de</strong>ux éléments qui requièrent <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong><br />
régu<strong>la</strong>tions sont <strong>la</strong> garantie d’homogénéité et <strong>de</strong> pérennité <strong>de</strong>s données. Les éléments qui<br />
risquent <strong>de</strong> se trouver en rivalité avec l’homogénéité dépen<strong>de</strong>nt en gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
tendance à l’augmentation <strong>de</strong>s producteurs, ce qui conduit à un manque d’uniformité dans les<br />
métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> production, une tendance à <strong>la</strong> thésaurisation <strong>de</strong>s informations par politique<br />
publiques sectorielle, un enchevêtrement encore plus poussé entre ce qui est « public » et ce<br />
qui est « privé » ; les changements <strong>de</strong>s infrastructures (appareils <strong>de</strong> mesure, appareils<br />
informatiques, etc.) peuvent également représenter un danger <strong>de</strong> rivalités. Les rivalités<br />
d’usage liées à <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s données sont une conséquence typique du passage massif à<br />
l’informatique et à l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production. Dans ce contexte, le souci principal <strong>de</strong>s<br />
opérateurs consiste à pouvoir assurer une constance dans <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’information<br />
indépendamment <strong>de</strong>s changements dictés par le marché informatique, qui stimule une<br />
innovation toujours plus rapi<strong>de</strong> (lois <strong>de</strong> consommation).<br />
6.2.2 Dignité à <strong>la</strong> mémorisation – ressource « raison »<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « raison », qui garantit <strong>la</strong> dignité à <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s<br />
données et <strong>de</strong>s informations, les services nécessaires au processus <strong>de</strong> construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> sont les suivants :<br />
• évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur juridique, économique, politique, scientifique, personnelle,<br />
historique <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s supports : pour pouvoir juger <strong>de</strong> ce qui est digne d’être<br />
mémorisé, il faut être à même d’évaluer <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s supports suivant<br />
différents points <strong>de</strong> vue ;<br />
• évaluation <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données : pour pouvoir juger <strong>de</strong> ce qui est<br />
digne d’être mémorisé, il faut être à même d’évaluer l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s<br />
données (et <strong>de</strong>s supports) ;<br />
• prévisibilité : pour pouvoir juger <strong>de</strong> ce qui est digne d’être mémorisé, il faut être à<br />
même d’évaluer le besoin futur en information ;
ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE 171<br />
• quantité : pour pouvoir juger <strong>de</strong> ce qui est digne d’être mémorisé, il faut être à même<br />
d’évaluer <strong>la</strong> masse <strong>de</strong> données nécessaire au fonctionnement démocratique du pays.<br />
En tenant compte <strong>de</strong>s quatre services que nous avons i<strong>de</strong>ntifiés (dont le premier présente<br />
une série <strong>de</strong> services secondaires), les rivalités d’usage potentiellement existantes et les<br />
régu<strong>la</strong>tions qui peuvent être imaginées sont re<strong>la</strong>tées dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
Tab. 6.2.2.1 : Ressource « raison ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
collective : capacité <strong>de</strong> jugement <strong>de</strong> ce qui est digne <strong>de</strong> faire partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
<strong>nationale</strong>.<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Evaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur<br />
juridique, économique,<br />
politique, scientifique,<br />
personnelle, historique<br />
<strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s<br />
supports<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
• Concurrence entre différentes<br />
valeurs (ex : juridique vs<br />
historique / économique vs<br />
personnelle) (mo, rf / ec, cj,<br />
avs, tva)<br />
• changement <strong>de</strong>s besoins<br />
substantiels en re<strong>la</strong>tion avec<br />
l’évolution sociale et <strong>de</strong><br />
nouvelles orientations <strong>de</strong>s<br />
politiques publiques (météo,<br />
stat, sol, cj, avs, tva)<br />
• changements<br />
environnementaux,<br />
historiques, politiques, etc.<br />
(qui modifient <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s<br />
données, par exemple <strong>la</strong><br />
valeur historique,<br />
documentaire) (météo, stat,<br />
sol, mo, rf, ec, avs)<br />
• manque <strong>de</strong> critères<br />
permettant d’évaluer<br />
l’importance <strong>de</strong>s informations<br />
• séparation « physique »<br />
impossible entre données<br />
actuelles et données<br />
historiques, entre données<br />
« figées » et données<br />
interactives (météo, stat, sol,<br />
mo, rf, ec)<br />
• absence ou perte <strong>de</strong><br />
métadonnées (contextuelles,<br />
stationnelles, procédurales,<br />
macrodonnées,<br />
microdonneés) (météo, stat,<br />
sol, mo, rf, ec, cj, avs, tva)<br />
• manque <strong>de</strong> distinction <strong>de</strong>s<br />
diverses étapes <strong>de</strong> traitement<br />
<strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s<br />
opérateurs, manque <strong>de</strong><br />
critères <strong>de</strong> sélection définis<br />
(stat)<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage (droits <strong>de</strong><br />
propriété / politiques publiques)<br />
• Hiérarchisation <strong>de</strong>s valeurs<br />
• établissement d’une échelle <strong>de</strong> valeur<br />
suivant <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is temporels<br />
• mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> droits d’usage selon le type<br />
<strong>de</strong> document ou <strong>de</strong> donnée<br />
• obligation d’anticipation dans les besoins en<br />
données <strong>de</strong>s politiques publiques<br />
• réalisation <strong>de</strong> prévisions sectorielles<br />
• chartes<br />
• favoriser les réflexions transversales entre<br />
politiques publiques<br />
• tenir compte <strong>de</strong>s changements en cours dans<br />
d’autres domaines<br />
• obligation <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s réflexions<br />
substantielles <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s opérateurs et <strong>de</strong>s<br />
régu<strong>la</strong>teurs <strong>de</strong>s politiques publiques<br />
• établissement <strong>de</strong> critères <strong>de</strong> distinction<br />
• hiérarchisation <strong>de</strong> l’information<br />
• obligation <strong>de</strong> lier les données aux<br />
métadonnées<br />
• distinction <strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong><br />
métadonnées<br />
• distinction par couches <strong>de</strong>s données<br />
• établissement d’une hiérarchie dans<br />
l’importance <strong>de</strong>s données<br />
• établissement <strong>de</strong> critères
172 ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE<br />
Evaluation <strong>de</strong> l’évolution<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données<br />
(et <strong>de</strong>s supports)<br />
Prévisibilité<br />
Quantité<br />
• distinction difficile entre<br />
entretien, conservation et<br />
archivage <strong>de</strong>s données<br />
(météo, stat, sol, mo, rf)<br />
• existence <strong>de</strong> doublons ou<br />
<strong>la</strong>cunes<br />
• manque <strong>de</strong> compétences<br />
spécifiques au domaine ou <strong>de</strong><br />
compétences techniques<br />
(informatique) (stat, sol, mo,<br />
rf, ec, cj)<br />
• exclusion d’acteurs externes,<br />
limitations territoriales<br />
(météo, stat, sol)<br />
• méconnaissance du contenu<br />
<strong>de</strong>s données (météo, stat, sol,<br />
mo, rf)<br />
• méconnaissance <strong>de</strong>s<br />
interactions entre couches<br />
d’information (météo, stat,<br />
sol, mo, rf)<br />
• utilisation <strong>de</strong>s données<br />
passées et actuelles comme<br />
champs d’étu<strong>de</strong> pour le futur<br />
(météo, stat, sol, avs, tva)<br />
• méconnaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en<br />
œuvre <strong>de</strong>s politiques<br />
publiques concernées (mo, rf)<br />
• impossibilité <strong>de</strong> réaliser une<br />
historisation (mo, rf)<br />
• <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> précision souhaité<br />
insuffisamment défini<br />
(météo, sol)<br />
• rupture <strong>de</strong> stock <strong>de</strong>s données<br />
(échantillons, sol)<br />
• chevauchement <strong>de</strong>s couches<br />
<strong>de</strong> données (mo, rf)<br />
• établissement <strong>de</strong> distinctions formelles<br />
• régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s questions liées à l’archivage<br />
informatique<br />
• mise en p<strong>la</strong>ce d’une coordination<br />
transversale<br />
• contrôle <strong>de</strong> l’externalisation <strong>de</strong>s tâches<br />
• conservation <strong>de</strong> compétences polyvalentes à<br />
l’interne<br />
• consolidation <strong>de</strong>s échanges<br />
• réalisation <strong>de</strong> comparaisons inter<strong>nationale</strong>s,<br />
<strong>nationale</strong>s, cantonales, etc.<br />
• soutient <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité plutôt que <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
quantité<br />
• interdiction <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion d’une quantité <strong>de</strong><br />
données ingérable<br />
• réalisation d’une sélection pertinente<br />
• obligation <strong>de</strong> conserver les métadonnées<br />
• distinction <strong>de</strong>s différentes couches<br />
d’information et les processus <strong>de</strong> traitement<br />
• conservation <strong>de</strong>s liens entre les couches<br />
d’information et les processus <strong>de</strong> traitement<br />
• mise à disposition <strong>de</strong>s données pour <strong>la</strong><br />
recherche<br />
• évitement d’une gestion trop fédéraliste<br />
• suivi <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s données au niveau<br />
fédéral<br />
• encouragement <strong>de</strong>s sauvegar<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
conservation <strong>de</strong>s exemp<strong>la</strong>ires à <strong>de</strong>s<br />
échéances déterminées<br />
• définition du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> précision <strong>de</strong>s relevés<br />
en fonction <strong>de</strong> l’acteur<br />
• attribution <strong>de</strong>s nouvelles tâches à un nouvel<br />
acteur<br />
• régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s données, <strong>de</strong>s<br />
supports, <strong>de</strong>s objets d’étu<strong>de</strong><br />
• évitement <strong>de</strong>s doublons, mise en réseau <strong>de</strong>s<br />
acteurs<br />
L’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données est l’élément central <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « raison ». Les<br />
difficultés liées à cet élément décisionnel rési<strong>de</strong>nt dans le fait que les rivalités qui risquent <strong>de</strong><br />
faire surface en faisant un choix plutôt qu’un autre (sélections) touchent <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> fond<br />
pour lesquelles il est très difficile <strong>de</strong> trancher. L’informatisation <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s processus<br />
à <strong>la</strong>quelle nous assistons actuellement dans tous les domaines (y compris dans les institutions<br />
c<strong>la</strong>ssiques d’archivage, avec <strong>la</strong> numérisation <strong>de</strong>s collections) permet <strong>de</strong> contourner les<br />
questions <strong>de</strong> sélection et <strong>de</strong> stocker ainsi virtuellement une plus gran<strong>de</strong> portion <strong>de</strong> patrimoine<br />
et <strong>de</strong> données. Dans ce tableau nous avons regroupé l’élément <strong>de</strong> l’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s<br />
données en une seule rubrique : il faut néanmoins tenir en considération <strong>la</strong> multiplicité <strong>de</strong>s<br />
formes que cette valeur – et les définitions qui lui sont associées – peut prendre.<br />
Toutes ces difficultés sont démultipliées par <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong> l’évaluation <strong>de</strong><br />
l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données (et <strong>de</strong>s supports).
ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE 173<br />
6.2.3 Mémorisation réelle – ressource « espace & temps »<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « espace & temps », qui garantit <strong>la</strong> mémorisation réelle<br />
<strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s informations, les services nécessaires au processus <strong>de</strong> construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> sont les suivants :<br />
• Conservation : pour pouvoir garantir <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s<br />
supports, leur conservation à long terme doit pouvoir être techniquement possible.<br />
• Stockage : pour pouvoir garantir <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s supports,<br />
leur stockage durable (en termes d’espace et <strong>de</strong> temps) doit être possible.<br />
• I<strong>de</strong>ntification : pour pouvoir garantir <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong>s données, elles<br />
doivent pouvoir être i<strong>de</strong>ntifiées.<br />
Suivant ces services, les rivalités d’usage potentiellement existantes et les régu<strong>la</strong>tions qui<br />
peuvent être imaginées sont re<strong>la</strong>tées dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
Tab. 6.2.3.1 : Ressource « espace et temps ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> stockage.<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Conservation<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
• Utilisation immédiate ou<br />
différée dans le temps<br />
(météo, stat, sol, mo, rf, ec)<br />
• données toujours actives<br />
(météo, stat, sol) ou actives<br />
pour une très longue pério<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> temps (mo, rf, ec, avs)<br />
• variabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> vie<br />
(exploitation) <strong>de</strong>s données<br />
(météo, stat, sol, mo, rf, ec,<br />
cj, avs, tva)<br />
• organisation <strong>de</strong>s données par<br />
couches (météo, stat, sol, mo,<br />
rf, ec, cj, avs, tva)<br />
• existence <strong>de</strong> plusieurs<br />
processus <strong>de</strong> mémorisation en<br />
parallèle (stat, sol, mo, rf)<br />
• evolution du marché<br />
informatique et donc <strong>de</strong>s<br />
programmes, etc. (météo,<br />
stat, sol, mo, rf, ec, cj, avs,<br />
tva)<br />
• évolution du marché<br />
informatique et donc <strong>de</strong>s<br />
appareils, etc. (météo, stat,<br />
sol, mo, rf, ec, cj, avs, tva)<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage (droits <strong>de</strong><br />
propriété / politiques publiques)<br />
• Hiérarchisation <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is d’exploitation<br />
• règles d’utilisation déterminées en fonction<br />
<strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is d’exploitation<br />
• garantie <strong>de</strong> pérennité <strong>de</strong>s systèmes,<br />
programmes, etc.<br />
• vérifications <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation effective <strong>de</strong>s<br />
données<br />
• sauvegar<strong>de</strong>s régulières<br />
• historisation <strong>de</strong>s données à archiver<br />
• recherche <strong>de</strong> consensus pour une sauvegar<strong>de</strong><br />
durable <strong>de</strong>s données (avec ou sans<br />
archivage)<br />
• création <strong>de</strong> liens entre les couches<br />
(utilisation <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> données<br />
re<strong>la</strong>tionnelles)<br />
• analyse et <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s processus<br />
• création <strong>de</strong> lien entre les processus (ex :<br />
numéros <strong>de</strong> référence)<br />
• exigences <strong>de</strong> garanties <strong>de</strong> pérennité <strong>de</strong>s<br />
données<br />
• exigences <strong>de</strong> garanties <strong>de</strong> possibilité <strong>de</strong><br />
transfert et <strong>de</strong> migration<br />
• prise en considération du temps nécessaire<br />
aux transferts <strong>de</strong> données<br />
• exigences <strong>de</strong> compatibilité <strong>de</strong>s appareils<br />
• prise en considération <strong>de</strong>s moyens financiers<br />
nécessaires aux changements infrastructurels<br />
• démarches prônant le ralentissement <strong>de</strong><br />
l’évolution
174 ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE<br />
Stockage<br />
I<strong>de</strong>ntification<br />
• dissociation excessive <strong>de</strong>s<br />
rôles du régu<strong>la</strong>teur et <strong>de</strong><br />
l’opérateur, étalement <strong>de</strong>s<br />
compétences (sol, mo, rf)<br />
• attribution <strong>de</strong>s différentes<br />
étapes <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> ou<br />
conservation à différents<br />
acteurs selon le support<br />
concerné (stat, sol, mo, rf)<br />
• augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production <strong>de</strong> données<br />
(météo, stat, avs, tva)<br />
• danger d’irrégu<strong>la</strong>rité dans les<br />
financements (météo, stat,<br />
sol, mo, rf, ec, cj, avs, tva)<br />
• mauvaise connaissance <strong>de</strong>s<br />
procédures <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong><br />
informatique ou d’archivage<br />
(rf, ec)<br />
• puissance <strong>de</strong>s processeurs<br />
informatiques limitée (météo,<br />
stat, sol, mo, rf, ec, cj, avs,<br />
tva)<br />
• insuffisance <strong>de</strong> temps ou <strong>de</strong><br />
personnel, concurrence <strong>de</strong><br />
priorités (météo, stat, sol, mo,<br />
rf, ec, cj, avs, tva)<br />
• p<strong>la</strong>ce physique limitée (cj,<br />
tva)<br />
• moteurs <strong>de</strong> recherche<br />
inadaptés ou insuffisamment<br />
puissants<br />
• organisation <strong>de</strong> l’information<br />
sectorielle ou par acteur<br />
• transparence <strong>de</strong>s processus, <strong>de</strong>s décisions<br />
• transparence dans <strong>la</strong> communication<br />
• recommandations <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration<br />
• mise en réseau <strong>de</strong>s données (interne)<br />
• création <strong>de</strong> p<strong>la</strong>teformes <strong>de</strong> communication<br />
et d’interfaces<br />
• recommandations <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration entre les<br />
différents acteurs sectoriels<br />
• création <strong>de</strong> p<strong>la</strong>teformes <strong>de</strong> communication<br />
et d’interfaces<br />
• mise en réseau <strong>de</strong>s données (externe)<br />
• création d’un lien entre les différents<br />
supports (par exemple : numéro <strong>de</strong><br />
référence)<br />
• établissement <strong>de</strong> critères plus stricts <strong>de</strong><br />
sélection<br />
• augmentation <strong>de</strong> l’espace <strong>de</strong> stockage<br />
• prise en considération anticipée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ressource « espace et temps »<br />
• évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur financière <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mémorisation <strong>de</strong>s données<br />
• prise en compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong><br />
mémorisation à court et long terme<br />
• recommandations <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration et <strong>de</strong><br />
communication entre les acteurs <strong>de</strong>s<br />
politiques institutionnelles d’archivage et les<br />
acteurs <strong>de</strong>s politiques sectorielles<br />
• anticipation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong> données et<br />
<strong>de</strong>s informations électroniques<br />
• anticipation du temps nécessaire pour <strong>la</strong><br />
mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s processus<br />
• sensibilisation <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
sauvegar<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s données<br />
• anticipation <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production documentaire<br />
• développement <strong>de</strong> moteurs et <strong>de</strong> structures<br />
<strong>de</strong> recherche adéquats<br />
• création <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong><br />
l’information<br />
• clé <strong>de</strong> lecture <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s toujours disponible<br />
• uniformisation <strong>de</strong>s architectures qui<br />
organisent l’information (<strong>de</strong> <strong>la</strong> production à<br />
l’archivage)<br />
• obligation <strong>de</strong> remplir les rubriques<br />
informatiques qui i<strong>de</strong>ntifient l’information<br />
• recommandations <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong><br />
l’information<br />
• mise en p<strong>la</strong>ce d’instructions communes<br />
Nous constatons que les questions liées à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s données prennent <strong>de</strong><br />
l’ampleur avec l’utilisation <strong>de</strong>s supports informatiques dans les processus <strong>de</strong> mémorisation.<br />
En effet, <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong> <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s données afin d’assurer <strong>la</strong> mémorisation réelle <strong>de</strong><br />
celles-ci se complexifie essentiellement à cause du fait que l’utilisation <strong>de</strong>s données peut<br />
subvenir à différents moments, que <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> leur exploitation tend à augmenter, qu’elles
ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE 175<br />
sont composées <strong>de</strong> différentes couches et, aussi, que le marché <strong>de</strong>s produits informatiques<br />
nécessaires aux processus <strong>de</strong> mémorisation réelle évoluent <strong>de</strong> plus en plus rapi<strong>de</strong>ment. Les<br />
aspects techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> informatique sont donc actuellement prioritaires.<br />
Il apparaît également <strong>de</strong> manière c<strong>la</strong>ire que les questions liées au stockage, qui restent<br />
prioritaires pour les institutions d’archivage étudiées dans l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base et dans les<br />
Compléments à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base en dépit <strong>de</strong>s changements technologiques en cours, ne<br />
constituent plus ici un véritable souci.<br />
Enfin, l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s données apparaît facilitée, d’une part parce que les bases <strong>de</strong><br />
données généralement utilisées prévoient <strong>de</strong>s rubriques obligatoires qui permettent<br />
d’i<strong>de</strong>ntifier les données et d’autre part parce que le pré-archivage (stockage provisoire) que<br />
nous avions constaté dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s institutions d’archivage n’est pas envisageable pour<br />
les données électroniques.<br />
6.2.4 Accessibilité – ressource « espace public »<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> ressource « espace & temps », qui garantit <strong>la</strong> mémorisation réelle<br />
<strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s informations, les services nécessaires au processus <strong>de</strong> construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> sont les suivants :<br />
• Utilisation : pour pouvoir être effectivement accessibles, les données doivent pouvoir<br />
être utilisées.<br />
• Accessibilité: pour pouvoir être effectivement accessibles, les données doivent<br />
pouvoir être mises à disposition.<br />
• Impact : pour pouvoir être effectivement accessibles, les données doivent pouvoir<br />
susciter un certain impact auprès <strong>de</strong>s utilisateurs potentiels.<br />
• Prévisibilité : pour pouvoir être effectivement accessibles, l’utilisation potentielle <strong>de</strong>s<br />
données doit pouvoir faire l’objet d’une estimation préa<strong>la</strong>ble.<br />
Suivant ces services, les rivalités d’usage potentiellement existantes et les régu<strong>la</strong>tions qui<br />
peuvent être imaginées sont re<strong>la</strong>tées dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
Tab. 6.2.4.1 : Ressource « espace public ». Service nécessaire au processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong> collective : capacité <strong>de</strong> mise en valeur et accessibilité.<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Utilisation<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
• Production <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part d’acteurs privés :<br />
privatisation <strong>de</strong>s données<br />
(météo, sol, tva)<br />
• excessive ou insuffisante<br />
protection <strong>de</strong>s données<br />
(piratage, droits d’auteur,<br />
protection <strong>de</strong>s données,<br />
transparence) selon le <strong>de</strong>gré<br />
<strong>de</strong> traitement (par exemple :<br />
problème <strong>de</strong> l’appariement<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage (droits <strong>de</strong><br />
propriété / politiques publiques)<br />
• Création d’une discussion <strong>de</strong> fond sur <strong>la</strong><br />
valeur publique <strong>de</strong>s données produites par<br />
<strong>de</strong>s acteurs privés<br />
• fixation <strong>de</strong> règles qui permettent d’établir<br />
qui est le vrai Datenherr (le producteur,<br />
l’exploitant, le manager, le conservateur,<br />
etc. <strong>de</strong>s données)<br />
• création <strong>de</strong> compromis d’accès aux données<br />
privées<br />
• réflexions sur l’application <strong>de</strong>s droits<br />
d’auteur à <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s données<br />
• réflexions sur l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection<br />
aux différentes couches <strong>de</strong> données selon<br />
leur traitement<br />
• réflexions autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> transparence<br />
appliquées aux données
176 ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE<br />
Service nécessaire au<br />
processus <strong>de</strong><br />
construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Accessibilité<br />
Rivalités d’usage (plus ou<br />
moins gran<strong>de</strong>s)<br />
Régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage (droits <strong>de</strong><br />
propriété / politiques publiques)<br />
<strong>de</strong>s données) (stat, ec, cj, avs) • réflexions sur les questions d’appariement<br />
<strong>de</strong>s données<br />
• régu<strong>la</strong>tion suivant <strong>la</strong> justification <strong>de</strong> l’intérêt<br />
à accé<strong>de</strong>r aux données<br />
• distinction entre divulgation d’office et<br />
divulgation sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
• distinction entre particuliers, acteurs privés<br />
et acteurs publics (mise en œuvre d’autres<br />
politiques publiques<br />
• garanties <strong>de</strong> sécurité (contre le piratage, etc.)<br />
• sanctions contre le piratage<br />
• etc.<br />
• émoluments excessifs<br />
(absence <strong>de</strong> forfaits) ou<br />
insuffisants (météo, stat)<br />
• reproduction facilitée (météo,<br />
stat, sol, mo)<br />
• utilisation concurrentielle ou<br />
contradictoire <strong>de</strong>s données<br />
par différents groupes<br />
d’acteurs (stat, rf, tva)<br />
• absence ou difficulté<br />
d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s groupes<br />
d’utilisateurs (stat, sol)<br />
• absence <strong>de</strong> références<br />
communes pour <strong>de</strong>s<br />
domaines proches (par<br />
exemple : politiques<br />
publiques concernant le sol)<br />
(sol, mo, rf)<br />
• moment d’utilisation<br />
indéterminé (ec, cj, avs)<br />
• nouvelles technologies<br />
facilitant trop / pas assez<br />
l’accès aux données (météo,<br />
stat, sol, mo, rf, ec, cj, avs,<br />
tva)<br />
• concurrence potentielle entre<br />
différentes politiques<br />
publiques (mo, rf)<br />
• réévaluation <strong>de</strong>s émoluments appliqués aux<br />
données (et non uniquement aux produits<br />
finaux)<br />
• droits <strong>de</strong> reproduction<br />
• taxes <strong>de</strong> reproduction<br />
• droits <strong>de</strong> propriété intellectuelle<br />
• brevets<br />
• obligation <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s garanties<br />
• réflexions transversales autour <strong>de</strong><br />
l’utilisation <strong>de</strong>s données<br />
• dévalorisation du cloisonnement par secteur<br />
• évitement <strong>de</strong>s utilisations contradictoires<br />
• mise à disposition é<strong>la</strong>rgie (création <strong>de</strong><br />
« cubes » <strong>de</strong> données on line)<br />
• mise en p<strong>la</strong>ce d’une accessibilité sur<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
• création <strong>de</strong> p<strong>la</strong>teformes d’échange<br />
• création <strong>de</strong> numéros <strong>de</strong> référence intra<br />
politiques publiques (coordination entre<br />
politiques publiques d’un même domaine)<br />
• mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tions dans<br />
l’accessibilité correspondantes aux couches<br />
<strong>de</strong> données<br />
• mise en p<strong>la</strong>ce d’une accessibilité en temps<br />
réel<br />
• garanties <strong>de</strong> l’état actuel <strong>de</strong>s données<br />
• englobement <strong>de</strong>s informations temporelles<br />
dans les métadonneés à conserver<br />
• attribution <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’accès au<br />
Datenherr<br />
• détermination <strong>de</strong> règles d’accès précises et<br />
transparentes<br />
• création <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s d’accès<br />
• centralisation du contrôle à l’accès<br />
• distinction entre données accessibles et<br />
données protégées<br />
• évaluation <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> conflit d’intérêt<br />
entre politiques publiques (droits <strong>de</strong> recours)
ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE 177<br />
Impact<br />
• surexploitation <strong>de</strong>s accès<br />
Internet<br />
• impossibilité d’évaluer le<br />
périmètre d’impact et d’utilité<br />
potentielle <strong>de</strong>s données (sol)<br />
• impossibilité <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
données, <strong>de</strong>s documents<br />
numériques<br />
Prévisibilité • impossibilité <strong>de</strong> prévoir<br />
l’utilisation <strong>de</strong>s données<br />
• limitations <strong>de</strong>s droits d’usage<br />
• accessibilité payante<br />
• co<strong>de</strong>s d’accès particuliers<br />
• accès possible seulement à certains groupes<br />
d’utilisateurs<br />
• évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s données en<br />
re<strong>la</strong>tion avec le poids économique, politique,<br />
historique, etc. <strong>de</strong>s politiques publiques<br />
correspondantes<br />
• introductions <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sécurité ou <strong>de</strong><br />
garanties <strong>de</strong> véridicités<br />
• introduction <strong>de</strong> signatures électroniques<br />
• évaluation <strong>de</strong> l’utilisation potentielle <strong>de</strong>s<br />
données sur <strong>la</strong> base d’une politique<br />
publiques simi<strong>la</strong>ire<br />
Suivant <strong>la</strong> logique <strong>de</strong>s choses, <strong>la</strong> plus ou moins gran<strong>de</strong> accessibilité aux supports et aux<br />
données est en re<strong>la</strong>tion avec les besoins et à <strong>la</strong> possibilité d’utilisation qui existent. Ainsi, les<br />
données produites dans <strong>la</strong> mise en œuvre d’une politique publique donnée doivent aussi<br />
pouvoir être utilisées dans le cadre d’une autre politique publique. L’utilisation <strong>de</strong>s données<br />
paraît être en plein essor, puisque <strong>la</strong> tendance va vers un rapprochement entre politiques<br />
publiques sectorielles mais appartenant à un même domaine. Les nouvelles technologies <strong>de</strong><br />
mise en réseau informatique permettent cette ouverture, qui est <strong>de</strong> plus en plus exploitée.<br />
Nous constatons également l’importance que <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données ou <strong>de</strong>s droits<br />
d’auteur prennent à une pério<strong>de</strong> où <strong>la</strong> transparence est considérée comme étant centrale.<br />
Les questions d’accessibilité per<strong>de</strong>nt leur priorité, dans le sens qu’elles peuvent être<br />
résolues plus facilement (mise à disposition au travers <strong>de</strong> nouvelles technologies plutôt que<br />
d’exiger un dép<strong>la</strong>cement physique <strong>de</strong>s utilisateurs intéressés ou alors l’envoi par courrier <strong>de</strong>s<br />
données <strong>de</strong>mandées).<br />
6.3 Constats<br />
En étudiant <strong>de</strong> manière globale l’ensemble <strong>de</strong>s services nécessaires au processus <strong>de</strong><br />
construction d’une <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>, les rivalités d’usage qui peuvent apparaître lors <strong>de</strong><br />
l’utilisation <strong>de</strong> ces services ainsi que les régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s droits d’usage par <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong><br />
propriété ou par <strong>de</strong>s politiques publiques (régu<strong>la</strong>tions actuellement existantes ou<br />
imaginables), nous constatons qu’elles sont réparties différemment selon <strong>la</strong> ressource<br />
concernée. Il apparaît en effet que certaines ressources sont plus fondamentales que d’autres,<br />
ce qui transparaît également dans les réflexions (orientation <strong>de</strong>s préoccupations actuelles) que<br />
les opérateurs étaient en train <strong>de</strong> mener pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s entretiens (se référer au<br />
Tableau 5.3.1, colonne intitulée Ressource fondamentale).<br />
Les différents tableaux (Tableaux 6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.2.3.1, 6.2.4.1 et 5.3.1) montrent que<br />
les ressources « <strong>la</strong>ngage » et « raison » sont fondamentales et prennent <strong>de</strong> plus en plus<br />
d’importance : ceci non seulement parce que les rivalités potentielles et les régu<strong>la</strong>tions<br />
proposées sont nombreuses, mais également parce que elles concernent <strong>de</strong>s aspects centraux<br />
et extrêmement vastes, qui requièrent une réflexion poussée <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s opérateurs et <strong>de</strong>s<br />
régu<strong>la</strong>teurs. La ressource « espace & temps » n’est actuellement plus prédominante, car les<br />
nouvelles technologies utilisées permettent un stockage pratiquement illimité <strong>de</strong>s données et<br />
un gain <strong>de</strong> temps considérable à long terme (après un investissement initial). La ressource
178 ANALYSE DU MATERIEL EMPIRIQUE<br />
« espace public » est en développement et se trouve confrontée à <strong>de</strong> nouvelles possibilités<br />
<strong>de</strong>squelles elle peut <strong>la</strong>rgement profiter essentiellement grâce à <strong>la</strong> mise en réseau <strong>de</strong>s données,<br />
qui permet d’une part une ouverture illimitée vers l’extérieur (accès aux données <strong>de</strong>puis<br />
n’importe où) et d’autre part une régu<strong>la</strong>tion très précise et fine <strong>de</strong>s droits d’utilisation (mise<br />
en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> filtres selon les groupes d’utilisateurs concernés).<br />
Nous constatons ainsi qu’une partie conséquente <strong>de</strong>s réflexions nécessaires à <strong>la</strong> mise en<br />
p<strong>la</strong>ce d’une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> doivent se concentrer sur les <strong>de</strong>ux premières ressources.<br />
Cette tendance <strong>de</strong>vrait se confirmer dans les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cas qui sont prévues pour <strong>la</strong> prochaine<br />
partie du mandat.
7 Conclusion du rapport<br />
L’analyse <strong>de</strong>s neuf chapitres empiriques présentés dans ce rapport part du principe que<br />
les réflexions préa<strong>la</strong>bles à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> ne doivent pas se<br />
limiter à ce qu’il y a déjà dans les institutions d’archivage (étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation actuelle <strong>de</strong>s<br />
institutions chargées <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation du patrimoine, comme nous l’avons fait dans l’Etu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> base et le Complément à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base), mais doit s’étendre à <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir ce<br />
qu’il risque <strong>de</strong> se trouver ou <strong>de</strong> ne pas se trouver à l’avenir dans les dépôts <strong>de</strong> ces organes,<br />
afin <strong>de</strong> pouvoir anticiper l’évolution <strong>de</strong> leur action (étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’ensemble du processus <strong>de</strong><br />
mémorisation <strong>de</strong>s données produites par <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> politiques publiques, comme<br />
nous l’avons fait dans l’étu<strong>de</strong> présente, Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> I). C’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle nous<br />
avons dép<strong>la</strong>cé en amont l’objet d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce rapport.<br />
En conséquence à cette nouvelle orientation et en conclusion à l’étu<strong>de</strong> empirique <strong>de</strong>s<br />
chapitres traités ici, les points essentiels que nous désirons souligner sont quatre.<br />
• La question <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémorisation <strong>de</strong>s données ou <strong>de</strong> l’archivage <strong>de</strong>s documents ne doit<br />
pas être circonscrite aux politiques culturelles et d’archivage : il existe justement <strong>de</strong>s<br />
données, comme celles qui ont été présentées ici, qui transcen<strong>de</strong>nt ces domaines et<br />
qui possè<strong>de</strong>nt avant tout une importance économique, politique, juridique, sociale,<br />
etc. En limitant les réflexions <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> au cadre <strong>de</strong>s politiques<br />
culturelles et d’archivage, <strong>de</strong>s domaines fondamentaux <strong>de</strong> l’information sont <strong>la</strong>issés<br />
<strong>de</strong> côté. Ces domaines ne doivent pas être exclus <strong>de</strong>s réflexions, car ils représentent<br />
l’évolution actuelle et future <strong>de</strong> <strong>la</strong> production documentaire (documents,<br />
informations, données).<br />
• La pério<strong>de</strong> actuelle se caractérise par une véritable révolution dans <strong>la</strong> manière dont<br />
les données sont gérées aux différents sta<strong>de</strong>s qui caractérisent leur durée <strong>de</strong> vie :<br />
nous passons d’une gestion traditionnelle à une gestion qui informatise l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s processus. Ce changement a un impact direct sur <strong>la</strong> manière dont les<br />
informations peuvent être conservées et, encore plus, sur le sens que le mot archivage<br />
acquière : il se peut qu’une nouvelle vision <strong>de</strong> celui-ci doive être constituée.<br />
L’archivage est en effet un processus fait sur mesure pour le papier et les autres<br />
supports analogiques ; puisqu’il apparaît que les supports informatiques permettent<br />
aux données <strong>de</strong> prolonger leur vie et <strong>de</strong> les gérer avec les données dont l’exploitation<br />
est terminée, il n’est plus possible <strong>de</strong> les archiver suivant les processus habituels.<br />
• Il existe parfois un déca<strong>la</strong>ge entre les régu<strong>la</strong>tions actuellement en p<strong>la</strong>ce et leur mise<br />
en œuvre effective. Du fait que les régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> mémorisation sont<br />
<strong>de</strong> plus en plus souvent attribuées à d’autres acteurs (parfois même plusieurs) que les<br />
producteurs <strong>de</strong>s données et qu’elles changent d’une étape à l’autre, nous avons<br />
constaté une perte <strong>de</strong> compétence <strong>de</strong> ceux-ci, notamment dans les processus <strong>de</strong><br />
conservation <strong>de</strong>s données ou d’archivage <strong>de</strong>s documents. Si ceux-ci connaissent<br />
parfaitement les processus traditionnels (supports papier), ils connaissent désormais<br />
moins biens les processus actuels (supports informatiques).<br />
• Ce rapport a été réalisé <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière <strong>la</strong> plus souple possible. Nous n’avons pas<br />
cherché à trouver les réponses que nous attendions, nous avons <strong>la</strong>issé toutes les<br />
portes ouvertes. Les informations contenues dans les chapitres empiriques utilisent<br />
une terminologie, notamment en ce qui concerne les questions informatiques et<br />
d’archivage, qui n’est pas technique et qui respecte le vocabu<strong>la</strong>ire utilisé par les
180 VERS UNE POLITIQUE DE LA MEMOIRE NATIONALE<br />
acteurs interviewés. Ceci reflète également les changements en cours, qui brouillent<br />
d’une certaine manière l’utilisation traditionnelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> terminologie (conservation,<br />
sauvegar<strong>de</strong>, archivage, archivage électronique ; donnée, information, document ;<br />
<strong>mémoire</strong>, mémorisation, patrimoine, etc.). Nous assumons cet état <strong>de</strong> fait et nous<br />
considérons qu’il fait partie du processus d’apprentissage et d’immersion qui<br />
caractérise toute recherche.<br />
Enfin, nous tenons à souligner que cette étu<strong>de</strong> représente une plus value qui va en<br />
direction d’une mise en œuvre microscopique <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>. Les entretiens<br />
réalisés, les relectures <strong>de</strong>s textes, les téléphones faits, les discussions que nous avons menées<br />
afin <strong>de</strong> faire avancer <strong>la</strong> recherche ont sensibilisé les acteurs à cette question et leur a montré<br />
qu’ils ne sont pas isolés dans leurs réflexions.
8 Suite prévue<br />
Le travail <strong>de</strong> recherche sur <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong> que nous effectuons sur<br />
mandat <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture peut subir <strong>de</strong>s modifications en réponse aux exigences<br />
du mandant et du groupe <strong>de</strong> travail qui le soutient dans ses démarches, ainsi qu’à l’évolution<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche. La fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong>s différents rapports est généralement suivie d’une<br />
discussion commune qui détermine <strong>la</strong> suite à donner à l’étu<strong>de</strong>.<br />
Durant <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière réunion (17 avril 2007) ayant rassemblé toutes les personnes<br />
concernées (les auteurs <strong>de</strong> ce rapport, M. Marc Wehrlin et les membres du groupe <strong>de</strong> travail<br />
restreint, composé <strong>de</strong> Mme Marie-Christine Doffey, M. Kurt Deggeller, M. Andreas<br />
Kellerhals et d’un col<strong>la</strong>borateur <strong>de</strong> l’OFC, M. Emanuel Amrein) il a été décidé <strong>de</strong> modifier<br />
ainsi <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche dans le but d’i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s aspects nouveaux (pour <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nification d’origine, se référer à l’avant-propos) :<br />
Mandant Document Contenu<br />
BN Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base Réalisée.<br />
OFC Compléments à<br />
l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> base.<br />
Réalisée.<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> I Réalisée.<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> II • Pratiques d’archivage (données) d’un organe se situant<br />
entre <strong>la</strong> Confédération et les cantons : Office fédéral <strong>de</strong>s<br />
routes (OFROU)<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> III • Pratiques d’archivage (données) d’un choix d’entreprises<br />
privées :<br />
- Industrie pharmaco-chimique<br />
- Banques (standards internationaux)<br />
- Industrie atomique (standards internationaux)<br />
- Assurances (se situant entre le secteur privé et<br />
public)<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>principale</strong> IV Pratiques d’archivage en France.<br />
Rapport synthétique Anticipation d’éléments substantiels dans l’épilogue <strong>de</strong> ce<br />
rapport, intitulée Vers une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
<strong>nationale</strong><br />
Ainsi, nous tenons à souligner que les différents rapports constituent un work in progress,<br />
publié sous forme <strong>de</strong> Working paper <strong>de</strong> l’<strong>IDHEAP</strong> pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> transparence, pour<br />
susciter les débats autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> et, aussi, pour permettre aux acteurs<br />
interviewés <strong>de</strong> comparer les démarches <strong>de</strong> leur organe avec celles entreprises dans <strong>la</strong> mise en<br />
œuvre <strong>de</strong> politiques publiques simi<strong>la</strong>ires.
9 Vers une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong><br />
Nous désirons clore ce document en anticipant quelques éléments qui feront partie du<br />
Rapport synthétique, rapport qui terminera le mandat qui nous a été confié et qui contiendra<br />
nos recommandations. Cette anticipation permettra au mandant et aux lecteurs <strong>de</strong> mieux<br />
cerner <strong>la</strong> perspective qui est <strong>la</strong> nôtre et <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> quelques pistes <strong>de</strong> réflexion sur <strong>la</strong><br />
manière dont nous concevons <strong>la</strong> construction et <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>mémoire</strong>.<br />
Comme nous l’avons déjà anticipé, nous pensons que les futurs architectes <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>de</strong>vront veiller à ce que les régu<strong>la</strong>tions à mettre en p<strong>la</strong>ce ne se limitent pas aux<br />
domaines directement concernés, mais touchent également <strong>de</strong>s domaines plus éloignés qui<br />
risquent néanmoins d’avoir un impact sur les processus <strong>de</strong> mémorisation (Figure 6.2.1).<br />
Toutes ces régu<strong>la</strong>tions ne seront pas sous <strong>la</strong> responsabilité d’un seul régu<strong>la</strong>teur. Nous<br />
considérons en effet que les régu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>vront être attribuées à différents groupes d’acteurs<br />
(régu<strong>la</strong>teurs ou opérateurs) en fonction <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> généralisation.<br />
Les tableaux qui i<strong>de</strong>ntifient les services nécessaires au processus <strong>de</strong> construction d’une<br />
<strong>mémoire</strong> <strong>nationale</strong>, les potentielles rivalités d’usage et les actuelles ou possibles régu<strong>la</strong>tions<br />
<strong>de</strong>s droits d’usages – que nous avons présentés sur <strong>la</strong> base du matériel empirique (Tableaux<br />
6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.2.3.1 et 6.2.4.1) – ont pour but <strong>de</strong> lister toutes les régu<strong>la</strong>tions qu’on peut<br />
actuellement i<strong>de</strong>ntifier ou imaginer et, aussi, <strong>de</strong> leur attribuer une échelle d’importance en<br />
fonction <strong>de</strong> l’étendue du nombre d’acteurs et d’activités qu’elles sont susceptibles<br />
d’intéresser. Ainsi, plus d’acteurs une régu<strong>la</strong>tion est susceptible d’intéresser, plus elle est<br />
générale et fondamentale ; au contraire, une régu<strong>la</strong>tion qui ne touche qu’un nombre très limité<br />
d’opérateurs est spécifique et ne doit pas être appliquée à d’autres acteurs. En poursuivant les<br />
étu<strong>de</strong>s empiriques, <strong>de</strong> nouveaux éléments, <strong>de</strong> nouvelles rivalités et <strong>de</strong> nouvelles régu<strong>la</strong>tions<br />
pourront être i<strong>de</strong>ntifiés et être ajoutés ainsi à celles que nous connaissons déjà ; en outre, une<br />
hiérarchie basée sur le périmètre d’impact et sur l’importance d’une régu<strong>la</strong>tion donnée pourra<br />
être dressée. A un moment donné, les listes arriveront à un sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> saturation : nous pourrons<br />
alors considérer l’étu<strong>de</strong> empirique épuisée et procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> hiérarchisation <strong>de</strong>s régu<strong>la</strong>tions.<br />
On comprend maintenant que les tableaux et les listes que nous dressons à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong>s<br />
analyses empiriques servent à i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong> quelle manière <strong>la</strong> politique publique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
déterminera <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong>s différentes régu<strong>la</strong>tions nécessaires, <strong>de</strong>s plus générales aux plus<br />
spécifiques.<br />
Ainsi, notre modèle <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’une politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> proposera l’existence<br />
<strong>de</strong> différents espaces <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion, organisés en tenant compte <strong>de</strong>s quatre phases <strong>de</strong><br />
mémorisation, comme <strong>la</strong> Figure 9.1 ci-<strong>de</strong>ssous le schématise :<br />
• les régu<strong>la</strong>teurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique publique institutionnelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>, qui<br />
s’occuperont <strong>de</strong> réguler les éléments susceptibles <strong>de</strong> couvrir toutes les politiques<br />
substantielles ;<br />
• les régu<strong>la</strong>teurs <strong>de</strong>s politiques publiques substantielles (ou sectorielles), qui<br />
s’occuperont <strong>de</strong> réguler les éléments caractéristiques d’une politique publique<br />
déterminée ;<br />
• les opérateurs <strong>de</strong>s politiques publiques substantielles, qui s’occuperont <strong>de</strong> réguler en<br />
interne les éléments les plus spécifiques <strong>de</strong> leur domaine.
184 VERS UNE POLITIQUE DE LA MEMOIRE NATIONALE<br />
<strong>Politique</strong>s publiques<br />
substantielles<br />
Pol. publ. <strong>de</strong>s musées<br />
Pol. publ. <strong>de</strong>s bibliothèques<br />
Pol. publ. <strong>de</strong>s statistiques<br />
Pol. publ. <strong>de</strong> <strong>la</strong> prot.<br />
environnement (sol)<br />
Pol. publ. <strong>de</strong>s assurances<br />
sociales (AVS)<br />
etc.<br />
« mémorisabilité »,<br />
Régu<strong>la</strong>tions à charge <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
politique institutionnelle<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
Phases <strong>de</strong><br />
mémorisation<br />
dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
mémorisation réelle<br />
accessibilité au public<br />
Régu<strong>la</strong>tions à charge<br />
<strong>de</strong>s politiques<br />
substantielles<br />
« mémorisabilité »,<br />
dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
mémorisation réelle<br />
accessibilité au public<br />
« mémorisabilité »,<br />
dignité à <strong>la</strong> mémorisation<br />
mémorisation réelle<br />
accessibilité au public<br />
Régu<strong>la</strong>tions à<br />
charge <strong>de</strong>s<br />
opérateurs<br />
Fig. 9.1 : Représentation schématique <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>.<br />
La politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> est à considérer comme une politique institutionnelle, dans le<br />
sens qu’elle se caractérise par sa transversalité, puisqu’elle touchera pratiquement toutes les<br />
autres politiques publiques. Cette caractéristique <strong>la</strong> rapproche <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique publique<br />
d’archivage actuellement en p<strong>la</strong>ce, qui est elle aussi transversale et qui impose à d’autres<br />
politiques publiques le respect d’un certain nombre <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tions. Ce qui distinguera<br />
essentiellement ces <strong>de</strong>ux politiques institutionnelles est le fait que <strong>la</strong> première touchera un<br />
périmètre d’action beaucoup plus vaste et qu’elle sera bâtie selon une formule qui sera<br />
probablement plus flexible. La fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> sera ainsi d’assurer <strong>la</strong><br />
gestion d’une <strong>mémoire</strong> « <strong>nationale</strong> » et coordination avec <strong>la</strong> politique d’archivage.<br />
Les politiques substantielles (que l’on peut appeler également sectorielles) permettent<br />
aux différents domaines <strong>de</strong> l’existence pris en charge par l’Etat <strong>de</strong> fonctionner ; elles aussi se<br />
caractérisent chacune par un besoin <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong>. Celui-ci assure leur survie, leur stabilité, leur<br />
permet <strong>de</strong> produire du sens, leur permet <strong>de</strong> suivre leur propre évolution, <strong>de</strong> justifier les<br />
changements, <strong>de</strong> fixer les attentes dans un mon<strong>de</strong> qui change <strong>de</strong> plus en plus rapi<strong>de</strong>ment. Ce<br />
besoin <strong>de</strong> <strong>mémoire</strong> est néanmoins individuel, car il présente <strong>de</strong>s caractéristiques sectorielles<br />
qui ne peuvent pas être généralisées. Ces différentes politiques substantielles ne sont pas<br />
figées, elles évoluent et se modifient dans le temps. Elles se trouveront donc confrontées à <strong>la</strong><br />
politique institutionnelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> à différents moments <strong>de</strong> leur évolution : les<br />
régu<strong>la</strong>tions qu’elle leur imposera auront pour but <strong>de</strong> faciliter les processus et <strong>de</strong> permettre les<br />
changements en rappe<strong>la</strong>nt aux opérateurs du secteur <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> créer leur propre<br />
<strong>mémoire</strong>.<br />
Ce qui appartient à <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> en tant que politique institutionnelle<br />
générale et ce qui appartient aux politiques sectorielles <strong>de</strong>vra être défini politiquement selon<br />
le <strong>de</strong>gré d’autodétermination <strong>de</strong>s politiques sectorielles voulu, ainsi que le <strong>de</strong>gré<br />
d’harmonisation nécessaire. Le rapport entre les régu<strong>la</strong>tions attribuées aux régu<strong>la</strong>teurs et
VERS UNE POLITIQUE DE LA MEMOIRE NATIONALE 185<br />
celles <strong>la</strong>issées aux opérateurs constituera également une décision politique : celle-ci <strong>de</strong>vra<br />
distinguer les régu<strong>la</strong>tions portant sur <strong>de</strong>s questions stratégiques (à confier aux régu<strong>la</strong>teurs) et<br />
celles portant sur les questions d’ordre opérationnel (à confier aux opérateurs). Notons<br />
néanmoins que tout opérateur <strong>de</strong>vra disposer <strong>de</strong> qualifications professionnelles le rendant<br />
capable d’œuvrer dans le domaine qui lui aura été confié.<br />
Enfin, <strong>la</strong> rencontre <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique institutionnelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> et <strong>de</strong>s politiques<br />
substantielles pourra donner lieu à <strong>de</strong>s tensions. Celles-ci pourront se manifester par <strong>de</strong>s<br />
mesures visant à se protéger contre <strong>de</strong>s obligations et <strong>de</strong>s immiscions <strong>de</strong>s acteurs publics<br />
externes (comme les régu<strong>la</strong>teurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong>) en développant par exemple<br />
<strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s sectoriels incompréhensibles à l’extérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique concernée ou <strong>de</strong>s<br />
processus <strong>de</strong> décision internes exclusivement basés sur l’oralité. Dans ce contexte, les<br />
questions fondamentales auxquelles il faudra réfléchir seront alors les suivantes :<br />
• dans quelle mesure <strong>la</strong> politique institutionnelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> sera-t-elle<br />
effectivement à même <strong>de</strong> piloter ces <strong>mémoire</strong>s sectorielles ou, en d’autres termes,<br />
dans quelle mesure le modèle <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> ses ressources (« <strong>la</strong>ngage », raison,<br />
espace & temps, espace public) sera-t-il généralisable ?<br />
• dans quelle mesure les impositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong> risquent d’étouffer<br />
les différentes politiques substantielles en réduisant leur efficacité ?<br />
Telles sont les considérations que l’état actuel <strong>de</strong> nos recherches nous permet <strong>de</strong> formuler<br />
sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> 23 étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cas (14 institutions d’archivage et 9 types <strong>de</strong> données). La<br />
poursuite <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> nous permettra <strong>de</strong> les approfondir ultérieurement.
10 Références<br />
10.1 Entretiens<br />
Mme. Anita Ruf, Responsable du Geschäftskontrolling à l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice<br />
<strong>de</strong>puis 2006. Berne, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, le 31 août 2006.<br />
Données météorologiques et climatologiques :<br />
M. Christian Häberli, Chef du projet Data WareHouse <strong>de</strong>puis 2003. Zürich, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> météorologie et <strong>de</strong> climatologie, le 19 septembre 2006.<br />
M. Gregor Stork, bibliothécaire et archiviste <strong>de</strong> MétéoSuisse <strong>de</strong>puis 2002. Zürich, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> météorologie et <strong>de</strong> climatologie, le 25 juillet 2006.<br />
Données statistiques :<br />
M. Rolf Lerjen, Chef <strong>de</strong> service Document Management (Section service d’exploitation)<br />
<strong>de</strong>puis 2002. Neuchâtel, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, le 3 octobre 2006.<br />
M. C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Macchi, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section CODAM (Corporate Data Management) <strong>de</strong> 2001<br />
à fin 2006. Neuchâtel, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, le 9 janvier 2007.<br />
Données <strong>de</strong> l’observation du sol :<br />
M. Rolf Brunner, Responsable <strong>de</strong> l’informatique, <strong>de</strong> <strong>la</strong> logistique et <strong>de</strong> l’information<br />
<strong>de</strong>puis 2004. Ittigen, Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement, le 20 septembre et le 20<br />
octobre 2006.<br />
M. Thomas Klingl, Responsable du projet Umwelt data management <strong>de</strong>puis 2005.<br />
Ittigen, Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement, le 20 octobre 2006.<br />
M. André Desaules, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> division Observation <strong>de</strong> l’environnement et prévisions<br />
environnementales <strong>de</strong> l’Agroscope ainsi que <strong>de</strong>s aspects opérationnels du réseau<br />
NABO <strong>de</strong>puis son début en 1984. Reckenholz, Station fédérale <strong>de</strong> recherche<br />
Agroscope Reckenholz-Tänikon, le 29 janvier 2007.<br />
Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle :<br />
M. Pierre Gerber, Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> bibliothèque (<strong>de</strong>puis 1990) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> collection <strong>de</strong>s<br />
cartes (<strong>de</strong>puis 1978). Wabern, Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo, les 29<br />
août et 6 septembre 2006.<br />
M. Jean-Paul Miserez, Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> haute surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s cantons <strong>de</strong> VS, VD, FR<br />
et BS, Géomètre cantonal d’OW et chargé du projet SIDIS. Wabern, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo, le 18 septembre 2006.<br />
Données du registre foncier :<br />
Mme. Maria-Pia Portmann-Tinguely, Cheffe <strong>de</strong> projet suppléante et spécialiste du<br />
registre foncier à l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit<br />
foncier. Berne, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, le 11 octobre 2006 et le 7 mars 2007.
188 REFERENCES<br />
M. Libor F. Stoupa, Dirigeant <strong>de</strong> Stoupa & Partners AG, Beratungsgesellschaft für<br />
Betriebwirtschaft et Chef <strong>de</strong> projet eGRIS & KS <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération. Berne,<br />
Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, le 11 octobre 2006.<br />
Données <strong>de</strong> l’état civil :<br />
Mme. Susanne Ny<strong>de</strong>gger, Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation et <strong>de</strong> l’introduction à Infostar et<br />
chargée <strong>de</strong> projets à l’OFEC <strong>de</strong>puis 2001. Berne, Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil, le<br />
18 janvier 2007.<br />
M. Joseph Broquet, employé spécialisé <strong>de</strong>puis 1979. Berne, Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil,<br />
le 18 janvier 2007.<br />
M. Gottfried Janz, chargé du support Infostar <strong>de</strong>puis début 2006. Berne, Office fédéral <strong>de</strong><br />
l’état civil, le 18 janvier 2007.<br />
Données du casier judiciaire :<br />
M. Roger Dol<strong>de</strong>r, chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> Section du Casier judiciaire suisse à l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
justice <strong>de</strong>puis 2000. Berne, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, le 11 octobre 2006.<br />
M. Albert-Marc Probst, col<strong>la</strong>borateur à <strong>la</strong> section du Casier judiciaire suisse à l’Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice <strong>de</strong>puis 1973. Berne, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, le 11 octobre<br />
2006.<br />
Données <strong>de</strong> l’assurance-vieillesse et survivants :<br />
M. Jacek Micuta, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Statistique et Registres centraux <strong>de</strong> <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong><br />
Compensation jusqu’en 2007. Genève, Centrale <strong>de</strong> Compensation, le 6 février<br />
2007.<br />
M. Markus Büschi, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Information, Savoir et Logistique <strong>de</strong> l’OFAS.<br />
Berne, Office fédéral <strong>de</strong>s assurances sociales, le 4 septembre 2006.<br />
M. Michel Giriens, Economiste <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Organisation et comptabilité AVS/APG/PC<br />
à l’OFAS. Office fédéral <strong>de</strong>s assurances sociales, le 4 septembre 2006.<br />
Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée :<br />
M. Peter Maibach, Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Services généraux <strong>de</strong> <strong>la</strong> Division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée à l’Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions. Berne,<br />
Division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée, le 15 février 2007.<br />
10.2 Sites Internet<br />
Données météorologiques et climatologiques :<br />
http://www.meteosuisse.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> MétéoSuisse)<br />
http://www.wmo.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Organisation Météorologique Mondiale)<br />
http://www.iac.ethz.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Institut für Atmosphäre und Klima)<br />
http://www.eumetsat.int
REFERENCES 189<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Organisation européenne pour l’exploitation <strong>de</strong>s satellites<br />
météorologiques)<br />
http://www.ecmwf.int<br />
(site Internet du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen<br />
terme)<br />
Données statistiques :<br />
http://www.statistique.admin.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique)<br />
http://www.annuaire-stat.ch<br />
(encyclopédie statistique en ligne, accès avec mot <strong>de</strong> passe)<br />
http://news-stat.admin.ch<br />
(communiqués <strong>de</strong> presse avec résultats actuels)<br />
http://statweb.admin.ch<br />
(banque <strong>de</strong> données statistiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse, accès avec mot <strong>de</strong> passe)<br />
http://www.stat.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Association suisse <strong>de</strong> Statistique)<br />
Données <strong>de</strong> l’observation du sol :<br />
http://www.bafu.admin.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement)<br />
http://www.blw.admin.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> l’agriculture)<br />
http://www.art.admin.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Agroscope)<br />
http://www.bafu.admin.ch/bo<strong>de</strong>n<br />
(page d’accueil <strong>de</strong> <strong>la</strong> section Sol <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> l’environnement)<br />
http://www.nabo.admin.ch<br />
(site Interne du NABO)<br />
Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle :<br />
http://www.swisstopo.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo)<br />
http://www.cadastre.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle en Suisse)<br />
http://www.interlis.ch<br />
(site Internet d’INTERLIS)<br />
http://www.e-geo.ch<br />
(site Internet consacré à <strong>la</strong> geoinformation)<br />
http://www.geowebforum.ch<br />
(site Internet du Forum suisse <strong>de</strong> l’information géographique)<br />
Données du registre foncier :<br />
http://www.bj.admin.ch
190 REFERENCES<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> justice)<br />
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/wirtschaft/grundbuch___egris.html<br />
(page d’accueil <strong>de</strong> l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit<br />
foncier)<br />
http://www.egris.ch<br />
(page Internet du projet eGRIS)<br />
http://www.registre-foncier.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Suisse <strong>de</strong>s Conservateurs du Registre Foncier)<br />
Données <strong>de</strong> l’état civil :<br />
http://www.ofj.admin.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice)<br />
http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/zivilstand.html<br />
(pages Internet <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil)<br />
Données du casier judiciaire :<br />
http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/staat_und_buerger/strafregister.html<br />
(pages Internet <strong>de</strong> <strong>la</strong> Section du Casier judiciaire suisse à l’OFJ)<br />
Données <strong>de</strong> l’assurance-vieillesse et survivants :<br />
http://www.avs-ai-international.ch<br />
(site Internet <strong>de</strong> <strong>la</strong> Centrale <strong>de</strong> Compensation)<br />
http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv<br />
(pages Internet dédiées à l’AVS sur le site <strong>de</strong> l’OFAS)<br />
http://www.avs-ai.info<br />
(site Internet du Centre d’information AVS/AI)<br />
Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée :<br />
http://www.estv.admin.ch/f/in<strong>de</strong>x.php<br />
(site Internet <strong>de</strong> l’Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions)<br />
http://www.estv.admin.ch/f/themen/mwst.htm<br />
(pages Internet consacrés à <strong>la</strong> TVA dans le site <strong>de</strong> l’AFC)<br />
10.3 Références bibliographiques<br />
Peter Knoepfel, Ingrid Kissling-Näf, Frédéric Varone (éds.), Institutionelle Regime für<br />
natürliche Ressourcen: Bo<strong>de</strong>n, Wasser und Wald im Vergleich – Régimes<br />
institutionnels <strong>de</strong> ressources naturelles: analyse comparée du sol, <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> forêt, Bâle: Helbing & Lichtenhahn (série Ecologie & Société, vol. 17), 2001.<br />
Peter Knoepfel, Ingrid Kissling-Näf, Frédéric Varone (éds.), Institutionelle<br />
Ressourcenregime in Aktion (Régimes institutionnels <strong>de</strong> ressources naturelles en<br />
action), Bâle: Helbing & Lichtenhahn (série Ecologie & Société, vol. 19), 2003.<br />
Peter Knoepfel/Mirta Olgiati, "National Memory Building Processes: the Emergence of<br />
Institutional Regimes for collective resources in the field of Sustainable
REFERENCES 191<br />
Management of the Documentary Heritage", Paper for the International<br />
Association for the Study of Common Property Europe Regional Meeting (Brescia<br />
– Italy – March 23-25, 2006), February 2006 [http://iascpeurope.eco.unibs.it/].<br />
Données météorologiques et climatologiques :<br />
Brochure Gut zu wissen, Eidgenössischen Departement <strong>de</strong>s Innern EDI, Bun<strong>de</strong>samt für<br />
Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz, [s. d.].<br />
Häberli Christian, Markus von <strong>de</strong>r Crone, Hintergrundinformationen und<br />
Situationsbeurteilung für die Erarbeitung <strong>de</strong>r Datenarchitektur, MeteoSchweiz,<br />
Version 1.0, mai 2005.<br />
Häberli Christian, Tombros Dimitrios, A Data Warehouse Architecture for MeteoSwiss:<br />
An Experience Report, International Workshop on Design and Management of<br />
Data Warehouses (DMDW’01) in conjunction with the 13th Conference on<br />
Advanced Information Systems Engineering (CaiSE’01), 2001 [avai<strong>la</strong>ble from<br />
Swiss Life, IT Research&Development, CC/ITRD, P.O. Box, 8022 Zurich,<br />
Switzer<strong>la</strong>nd].<br />
Jahresbericht / Rapport annuel 2000, Zürich, MeteoSchweiz.<br />
Jahresbericht / Rapport annuel 2001, Zürich, MeteoSchweiz.<br />
Jahresbericht / Rapport annuel 2002, Zürich, MeteoSchweiz.<br />
Jahresbericht / Rapport annuel 2003, Zürich, MeteoSchweiz.<br />
Jahresbericht / Rapport annuel 2004, Zürich, MeteoSchweiz.<br />
Jahresbericht / Rapport annuel 2005, Zürich, MeteoSchweiz.<br />
Mandat <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong> MétéoSuisse pour 2004-2007, MétéoSuisse, Version du<br />
05.12.03.<br />
Données statistiques :<br />
Bo<strong>de</strong>r Willy, « L’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique se donne cinq ans pour s’aligner sur<br />
l’Europe », Le temps, 10 janvier 2007.<br />
Brochure www.statistique.admin.ch… et autres sources d’information, Neuchâtel, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, nro. <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> 572-0400, [s. d.]<br />
Budget 2006, Berne, Administration fédérale <strong>de</strong>s finances.<br />
CODAM. Conditions-cadre, Neuchâtel, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, novembre 2004.<br />
CODAM, Bericht Konzept – Fachlich, Neuchâtel, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, octobre<br />
2003.<br />
CODAM, Bericht Konzept – Anhang 1. Anfor<strong>de</strong>rungen an das System, Neuchâtel, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, octobre 2003.<br />
CODAM, Bericht Konzept – Anhang 2. Use Cases, Neuchâtel, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
statistique, octobre 2003.<br />
CODAM, Bericht Konzept – Anhang 3. CODAM Prozesse, Neuchâtel, Office fédéral <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> statistique, octobre 2003.<br />
Programme pluriannuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale, 2003-2007, Neuchâtel, Office fédéral<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique, nro. <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> 192-0700, 2004.
192 REFERENCES<br />
Données <strong>de</strong> l’observation du sol :<br />
Desaules André, Stu<strong>de</strong>r Konrad, NABO - Réseau d'observation <strong>de</strong>s sols: pério<strong>de</strong><br />
d'observation 1985-1991, Cahier <strong>de</strong> l'environnement n° 200, Office fédéral <strong>de</strong><br />
l'environnement, <strong>de</strong>s forêts et du paysage, Berne, 1993.<br />
Desaules André, Dahin<strong>de</strong>n Ruedi, Réseau national d'observation <strong>de</strong>s sols - Variations<br />
<strong>de</strong>s teneurs en polluants après 5 et 10 ans <strong>de</strong> suivi, Cahier <strong>de</strong> l'environnement n°<br />
320, Office fédéral <strong>de</strong> l'environnement, <strong>de</strong>s forêts et du paysage, Berne, 2000.<br />
Desaules André, Schwab Peter, Keller Armin, Ammann Stefan, Paul Jean, Bachmann<br />
Hans-Jörg, Polluants inorganiques dans les sols suisses et évolutions après 10<br />
ans, Agroscope FAL Reckenholz, Station <strong>de</strong> recherches fédérale en agroécologie<br />
et agriculture, Zurich, 2006.<br />
Manuel Prélèvement et préparation d’échantillons <strong>de</strong> sols pour l’analyse <strong>de</strong> substances<br />
polluantes, Manuel <strong>de</strong> prélèvement sol (OSol), Berne, Office fédéral <strong>de</strong><br />
l’environnement, <strong>de</strong>s forêts et du paysage OFEFP, 2003.<br />
Rausch Heribert, Panorama du droit <strong>de</strong> l’environnement, Cahier <strong>de</strong> l’environnement n°<br />
226, Office fédéral <strong>de</strong> l'environnement, <strong>de</strong>s forêts et du paysage, Berne, 2005.<br />
Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle :<br />
Brochure Amtliche Vermessungsschnittstelle / Interface <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle,<br />
Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo, Wabern, 2004.<br />
Brochure La mensuration officielle suisse, Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo,<br />
Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, Wabern, 2003.<br />
Brochure Manuel sur l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, Office fédéral <strong>de</strong><br />
topographie swisstopo, Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, Wabern,<br />
2002.<br />
Gerber Pierre, Klöti Thomas, « Die Kartensammlung <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>samtes für<br />
Lan<strong>de</strong>stopographie als Landschaftsgedächtnis <strong>de</strong>s Schweiz », Die<br />
kartographischen Sammlungen <strong>de</strong>r Schweiz, Kartographische Schriften, Band 2,<br />
Bonn, Kirschbaum Ver<strong>la</strong>g GmbH, [à paraître en 2007].<br />
Gerber Pierre, Oehrli Markus, « Unsere Kartensammlung », Topo. Bulletin <strong>de</strong> l’Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> topographie, 88 / 1997, pp. 12-16.<br />
Gerber Pierre, « UnsereSpezialsammlung Übersichtsp<strong>la</strong>n », Topo. Bulletin <strong>de</strong> l’Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> topographie, 89 / 1998, pp. 6-7.<br />
Gerber Pierre, « Unsere Instrumentensammlung », Topo. Bulletin <strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
topographie, 89 / 1998, p. 5.<br />
Gerber Pierre, Oehrli Markus, « Unsere Spezialsammlung Festungskarte », Topo. Bulletin<br />
<strong>de</strong> l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> topographie, 89 / 1998, pp. 8-9.<br />
Gerber Pierre, Böhlen Ruth, « Notre photothèque / Unsere Fotothek », Topo. Bulletin <strong>de</strong><br />
l’Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> topographie, 89 / 1998, pp. 10-11.<br />
Info D+M. Bulletin d’information pour les professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo, Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales,<br />
Wabern, 2/2006.
REFERENCES 193<br />
Message re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> loi fédérale sur <strong>la</strong> géoinformation (Loi sur <strong>la</strong> géoinformation, LGéo),<br />
06.000.<br />
Message re<strong>la</strong>tif à l’arrêté fédéral concernant les in<strong>de</strong>mnités fédérales dans le domaine <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mensuration officielle du 14 novembre 1990, 90.074.<br />
Projet du Rapport final du groupe SIDIS. Les systèmes d’information sur les droits à<br />
inci<strong>de</strong>nce spatiale et plus particulièrement le cadastre <strong>de</strong>s restrictions <strong>de</strong> droit<br />
public à <strong>la</strong> propriété foncière (cadastre RDPPF), version 4, 13.02.2007.<br />
Rapport annuel 2005, Office fédéral <strong>de</strong> topographie swisstopo, Wabern.<br />
Données du registre foncier :<br />
Manuel sur l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration officielle, Office fédéral <strong>de</strong> topographie<br />
swisstopo, Direction fédérale <strong>de</strong>s mensurations cadastrales, 2002.<br />
Données <strong>de</strong> l’état civil :<br />
Infostar. Glossaire. Terminologie re<strong>la</strong>tive au passage à <strong>la</strong> tenue informatisée <strong>de</strong>s<br />
registres <strong>de</strong> l’état civil. Annexe 1 à <strong>la</strong> Circu<strong>la</strong>ire du 9.4.2001, Introduction<br />
d’INFOSTAR.<br />
Infostar. Registre informatisé <strong>de</strong> l’état civil. Rapport sur le concept, Juin 99, Aperçu,<br />
Département fédéral <strong>de</strong> justice et police, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> l’état civil, Version 1.0, 1 er juin 1999.<br />
Infostar. Registre informatisé <strong>de</strong> l’état civil. Rapport sur le concept d’organisation,<br />
d’exploitation et <strong>de</strong> financement, Département fédéral <strong>de</strong> justice et police, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, Office fédéral <strong>de</strong> l’état civil, Version 1.0, 1 er juin 1999.<br />
Infostar. Registre informatisé <strong>de</strong> l’état civil. Rapport sur le concept informatique,<br />
Département fédéral <strong>de</strong> justice et police, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> l’état civil, Version 1.0, 1 er juin 1999.<br />
Infostar. Registre informatisé <strong>de</strong> l’état civil. Rapport sur le concept <strong>de</strong> ressaisie,<br />
Département fédéral <strong>de</strong> justice et police, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, Office<br />
fédéral <strong>de</strong> l’état civil, Version 1.0, 1 er juin 1999.<br />
Données du casier judiciaire :<br />
Dol<strong>de</strong>r Roger, « VOSTRA – le casier judiciaire automatisé <strong>de</strong> <strong>la</strong> Suisse. La<br />
Confédération et les cantons se répartissent maintenant le travail en ligne »,<br />
Bulletin info. Informations sur l’exécution <strong>de</strong>s peines et mesures, Département<br />
fédéral <strong>de</strong> justice et police DFJP, Office fédéral <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice OFJ, Section <strong>de</strong><br />
l’exécution <strong>de</strong>s peines et mesures, 1/2006, pp. 19-21.<br />
Message re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> modification du co<strong>de</strong> pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et<br />
du co<strong>de</strong> pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003 du 29 juin 2005<br />
(05.060), FF 2005 4425.<br />
Co<strong>de</strong> pénal suisse et co<strong>de</strong> pénal militaire (Correctifs en matière <strong>de</strong> sanctions et casier<br />
judiciaire), Modifications du 24 mars 2006, RO 2006 3539.
194 REFERENCES<br />
Données <strong>de</strong> l’assurance-vieillesse et survivants :<br />
Brochure Prévoir l'avenir. Les assurances sociales suisses. Nécessité d'agir et options<br />
pour l'avenir, Berne, Département <strong>de</strong> l'intérieur, Office fédéral <strong>de</strong>s assurances<br />
sociales, (s. d.), no. <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> 318.130f.<br />
Brochure L’assurance-vieillesse et survivants AVS, Berne, Centre d’information AVS/AI,<br />
Office fédéral <strong>de</strong>s assurances, 2005.<br />
Document Le numéro d’assuré, va<strong>la</strong>ble dès le 1 er janvier 1994, Office fédéral <strong>de</strong>s<br />
assurances sociales, Diffusion AFCL/EDMZ, Berne.<br />
Document Nouveau numéro AVS. Etat du projet au 1 er novembre 2006. Introduction du<br />
nouveau numéro AVS, Centre d’information AVS/AI, en col<strong>la</strong>boration avec<br />
l’Office fédéral <strong>de</strong>s assurances sociales, novembre 2006.<br />
Document Projet NNSS – Nouveau numéro <strong>de</strong> sécurité sociale. Information concernant<br />
le nouveau numéro d’assuré, Centre d’information AVS/AI, mars 2006.<br />
Document Projet NNSS – Nouveau numéro <strong>de</strong> sécurité sociale. Pourquoi un nouveau<br />
numéro d’assuré AVS, Centre d’information AVS/AI, mars 2005.<br />
Document Révisions. AVS, édition 2006. Etat : 1 er janvier 2007, Centre d’information<br />
AVS/AI.<br />
Message concernant l’harmonisation <strong>de</strong>s registres officiels <strong>de</strong> personnes du 23 novembre<br />
2005 (05.083), FF 2006 439.<br />
Message re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et<br />
survivants (Nouveau numéro d’assuré AVS) du 23 novembre 2005 (05.079), FF<br />
2006 515.<br />
Données <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée :<br />
Instructions 2001 sur <strong>la</strong> TVA, 610.525, Administration fédérale <strong>de</strong>s contributions AFC,<br />
Division <strong>principale</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA, 2000.<br />
Rapport du Conseil fédéral sur <strong>de</strong>s améliorations <strong>de</strong> <strong>la</strong> TVA (10 ans <strong>de</strong> TVA), du 27<br />
janvier 2005.<br />
Simplification <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi fédérale régissant <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée : avant-projet<br />
<strong>de</strong>stiné à <strong>la</strong> consultation. Rapport explicatif, Département <strong>de</strong>s finances DFF,<br />
Février 2007.<br />
10.4 Références légis<strong>la</strong>tives<br />
101 Constitution fédérale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération suisse du 18 avril 1999.<br />
152.1 Loi fédérale sur l'archivage (LAr) du 26 juin 1998.<br />
152.11 Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur l'archivage (OLAr) du 8<br />
septembre 1999.<br />
172.010 Loi sur l’organisation du gouvernement et <strong>de</strong> l’administration (LOGA)<br />
du 21 mars 1997.<br />
172.010.58 Ordonnance sur l’informatique et <strong>la</strong> télécommunication dans<br />
l’administration fédérale (Ordonnance sur l’informatique dans<br />
l’administration fédérale, OIAF) du 26 septembre 2003.
REFERENCES 195<br />
172.042.110<br />
Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) du 27<br />
octobre 1999.<br />
172.220.111.4 Ordonnance concernant <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données personnelles dans<br />
l’administration fédérale du 3 juillet 2001.<br />
210 Co<strong>de</strong> civil suisse du 10 décembre 1907.<br />
211.112.2 Ordonnance sur l’état civil (OEC) du 28 avril 2004.<br />
211.432.1 Ordonnance sur le registre foncier (ORF) du 22 février 1910.<br />
211.432.2 Ordonnance sur <strong>la</strong> mensuration officielle (OMO) du 18 novembre<br />
1992.<br />
211.432.21 Ordonnance technique du DDPS sur <strong>la</strong> mensuration officielle<br />
(OTEMO) du 10 juin 1994.<br />
211.432.261 Ordonnance concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre du 16<br />
novembre 1994.<br />
211.432.263.1 Ordonnance concernant les émoluments perçus pour l’examen <strong>de</strong><br />
technicien géomètre du 6 octobre 1980.<br />
211.432.27 Arrêté fédéral concernant les in<strong>de</strong>mnités fédérales dans le domaine <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mensuration officielle du 20 mars 1992.<br />
220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le co<strong>de</strong> civil suisse (Livre<br />
cinquième: Droit <strong>de</strong>s obligations) du 30 mars 1911 (Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
obligations, CO).<br />
231.1 Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit<br />
d’auteur, LDA) du 9 octobre 1992.<br />
231.11 Ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins (Ordonnance sur<br />
le droit d’auteur, ODAu) du 26 avril 1993.<br />
235.1 Loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données (LPD) du 19 juin 1992.<br />
235.11 Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s données<br />
(OLPD) du 14 juin 1993.<br />
311.0 Co<strong>de</strong> pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937.<br />
321.0 Co<strong>de</strong> pénal militaire du 13 juin 1927.<br />
331 Ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) du 29<br />
septembre 2006.<br />
331.1 Ordonnance du DFJP fixant les émoluments pour les extraits du casier<br />
judiciaire établis pour les particuliers du 15 octobre 2003.<br />
311.1 Loi fédérale régissant <strong>la</strong> condition pénale <strong>de</strong>s mineurs (Droit pénal <strong>de</strong>s
196 REFERENCES<br />
mineurs, DPMin) du 20 juin 2003.<br />
429.1 Loi fédérale sur <strong>la</strong> météorologie et <strong>la</strong> climatologie (LMét) du 18 juin<br />
1999.<br />
429.11 Ordonnance sur <strong>la</strong> météorologie et <strong>la</strong> climatologie (OMét) du 23<br />
février 2000.<br />
429.111 Ordonnance du DFI sur les émoluments perçus dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
météorologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> climatologie (OEMét) du 3 décembre 2003.<br />
431.01 Loi sur <strong>la</strong> statistique fédérale (LSF) du 9 octobre 1992.<br />
431.011 Ordonnance concernant l’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> statistique fédérale du 30<br />
juin 1993.<br />
431.02 Loi fédérale sur l’harmonisation <strong>de</strong>s registres <strong>de</strong>s habitants et d’autres<br />
registres officiels <strong>de</strong> personnes (Loi sur l’harmonisation <strong>de</strong>s registres,<br />
LHR) du 23 juin 2006.<br />
431.09 Ordonnance sur les émoluments et in<strong>de</strong>mnités perçus pour les<br />
prestations <strong>de</strong> services statistiques <strong>de</strong>s unités administratives <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Confédération du 25 juin 2003.<br />
432.21 Loi fédérale sur <strong>la</strong> Bibliothèque <strong>nationale</strong> suisse (LBNS) du décembre<br />
1992.<br />
510. 62 Loi fédérale concernant l’établissement <strong>de</strong> nouvelles cartes fédérales<br />
du 21 juin 1935.<br />
510.622 Ordonnance sur <strong>la</strong> reproduction <strong>de</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong> mensuration<br />
officielle (ORDMO) du 9 septembre 1998.<br />
510.622.2 Ordonnance du DFJP sur <strong>la</strong> reproduction <strong>de</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mensuration officielle (ORDMO-DFJP) du 9 septembre 1998 (RS).<br />
641.20 Loi fédérale régissant <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée (Loi sur <strong>la</strong> TVA,<br />
LTVA) du 2 septembre 1999.<br />
641.201 Ordonnance re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> loi fédérale régissant <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur<br />
ajoutée (OLTVA) du 29 mars 2000.<br />
641.201.1 Ordonnance concernant les données et les informations transmises par<br />
voie électronique (OelDI) du 30 janvier 2002.<br />
814.01 Loi fédérale sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement (Loi sur <strong>la</strong> protection<br />
<strong>de</strong> l’environnement, LPE) du 7 octobre 1983.<br />
814.12 Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) du 1 er juillet 1998.<br />
830.1 Loi fédérale sur <strong>la</strong> partie générale du droit <strong>de</strong>s assurances sociales<br />
(LPGA) du 6 octobre 2000.<br />
831.10 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20
REFERENCES 197<br />
décembre 1946.<br />
831.101 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) du 31<br />
octobre 1947.<br />
915.7 Ordonnance sur <strong>la</strong> recherche agronomique (ORAgr) du 9 juin 2006.<br />
En projet Loi fédérale sur <strong>la</strong> géoinformation (Loi sur <strong>la</strong> géoinformation, LGéo)<br />
du…, approuvée par le Conseil national le 6 mars 2007.<br />
0.351.1 Convention européenne d’entrai<strong>de</strong> judiciaire en matière pénale conclue<br />
à Strasbourg le 20 avril 1959.<br />
0.420.514.291 Convention portant création du Centre européen pour les prévisions<br />
météorologiques à moyen terme conclue à Bruxelles le 11 octobre<br />
1973.<br />
0.425.43<br />
Convention portant création d’une Organisation européenne pour<br />
l’exploitation <strong>de</strong> satellites météorologiques (Eumetsat) conclue à<br />
Genève le 24 mai 1983.<br />
0.429.01 Convention <strong>de</strong> l’Organisation météorologique mondiale conclue à<br />
Washington le 11 octobre 1947.<br />
0.814.01 Convention-cadre <strong>de</strong>s Nations Unies sur les changements climatiques<br />
conclue à New York le 9 mai 1992.<br />
0.814.011 Protocole <strong>de</strong> Kyoto à <strong>la</strong> Convention-cadre <strong>de</strong>s Nations Unies sur les<br />
changements climatiques du 11 décembre 1997.<br />
0.814.021 Protocole <strong>de</strong> Montréal re<strong>la</strong>tif à <strong>de</strong>s substances qui appauvrissent <strong>la</strong><br />
couche d’ozone du 16 septembre 1987.
11 Annexe<br />
Questionnaire Memopolicy (orientation données)<br />
1 Présentation <strong>de</strong>s données<br />
1.1 Choix <strong>de</strong>s données à étudier<br />
1.1.1 Quelles sont les différents types <strong>de</strong> données, d’informations ou <strong>de</strong> documents que<br />
l’institution produit et conserve / archive à long terme ?<br />
1.1.2 Quelles sont les données, informations ou documents qui ne suivent pas le<br />
parcours habituel d’archivage ?<br />
1.1.3 Commentaire éventuel.<br />
1.2 Contenu substantiel <strong>de</strong>s données choisies<br />
1.2.1 Quelles sont les informations que ce type <strong>de</strong> données contient ? Quelles sont leurs<br />
caractéristiques ? Qui les produit ?<br />
1.2.2 Sont-elles structurées par couches ?<br />
Si oui, comment, lesquelles ?<br />
1.2.3 Pourquoi faut-il conserver ces données à long terme ? Dans quelle mesure fontelles<br />
partie du patrimoine national, dans quelle mesure sont-elles un bien<br />
commun ?<br />
1.2.4 Quel est le volume <strong>de</strong>s données actuellement sauvegardées (en mètres linéaires,<br />
unités, bytes ou autre entité <strong>de</strong> mesure) par votre institution ?<br />
1.2.5 Quel est l’accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> masse <strong>de</strong> données par année (estimation) ?<br />
1.2.6 Où sont conservées actuellement ces données ?<br />
1.2.7 Comment sont-elles stockées ?<br />
1.2.8 Pour combien <strong>de</strong> temps <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce à disposition sera-t-elle suffisante ?<br />
1.2.9 Y a-t-il <strong>de</strong>s changements prévus ?<br />
Si oui, dans quelle mesure ? Pour quand ?<br />
1.2.10 Commentaire éventuel.<br />
1.3 Supports<br />
1.3.1 Quels sont les différents supports utilisés par votre institution pour conserver ces<br />
données ?<br />
1.3.2 Comment ces supports sont-ils gérés ? Où se trouvent-ils ?<br />
1.3.3 Y a-t-il un changement <strong>de</strong> supports récemment intervenu ou prévu pour les années<br />
à venir? (Par exemple grâce à l’avancée technologique)<br />
Si oui, lequel ? Quand ?<br />
1.3.4 Quels sont les problèmes principaux associés aux supports utilisés actuellement ?<br />
(Par exemple <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce qu’ils occupent, leur durée <strong>de</strong> vie, leur capacité <strong>de</strong><br />
mémorisation)
200 ANNEXE<br />
1.3.5 Commentaire éventuel concernant les supports.<br />
1.4 Organe compétent<br />
1.4.1 Quelles sont les compétences <strong>de</strong> votre institution pour ce qui concerne les données<br />
choisies ?<br />
1.4.2 De quel organe dépend votre institution ?<br />
1.4.3 Quels sont ses différents services ?<br />
1.4.4 Combien <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borateurs y travaillent ?<br />
1.4.5 A quelles autres institutions est-elle rattachée ?<br />
1.4.6 Qui sont les autres producteurs <strong>de</strong> données dans le domaine concerné ?<br />
1.4.7 Commentaire éventuel.<br />
1.5 Bases légales<br />
1.5.1 Sur quelles bases légales repose votre institution ? Sur quelles bases légales<br />
reposent les activités <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s données, <strong>de</strong>s informations, <strong>de</strong>s<br />
documents ?<br />
1.5.2 Quelles sont les <strong>de</strong>rnières modifications survenues concernant ces bases légales ?<br />
1.5.3 Y a-t-il <strong>de</strong>s changements prévus dans un futur proche ?<br />
Si oui, lesquels ?<br />
1.5.4 Pour quelles raisons et selon quels arguments les <strong>de</strong>rnières modifications ou les<br />
éventuels changements prévus ont-ils été introduits ?<br />
1.5.5 Y a-t-il d’autres bases légales <strong>de</strong>squelles il faut tenir compte ?<br />
1.5.6 Commentaire éventuel concernant les bases légales. (Par exemple <strong>de</strong>s <strong>la</strong>cunes, <strong>de</strong>s<br />
problèmes d’application)<br />
1.6 Coûts<br />
1.6.1 Quels sont et à quel montant sont estimés les coûts directs globaux que<br />
l’institution doit assumer en rapport avec <strong>la</strong> conservation / l’archivage à long<br />
terme <strong>de</strong>s données, <strong>de</strong>s informations, <strong>de</strong>s documents ? Si possible, détaillez les<br />
différents montants entre 2000 et 2006.<br />
1.6.2 Quels sont et à quel montant sont estimés les coûts indirects ? Si possible,<br />
détaillez les différents montants entre 2000 et 2006.<br />
1.6.3 Commentaire éventuel sur les coûts. (Par exemple leur évolution, les coupures, les<br />
changements <strong>de</strong> financement)<br />
2 Etu<strong>de</strong> du processus <strong>de</strong> mémorisation<br />
2.1 Sélection <strong>de</strong>s données<br />
2.1.1 De toutes les données que votre institution pourrait conserver parmi le type qui a<br />
été choisi (analogiques et numériques), lesquelles sont écartées d’emblée <strong>de</strong> votre<br />
activité <strong>de</strong> collectionnement et sont donc <strong>de</strong>stinées à disparaître ?<br />
2.1.2 Pour quelles raisons ces données sont-elles écartées ?
ANNEXE 201<br />
2.1.3 Quels sont les critères <strong>de</strong> jugement appliqués pour déci<strong>de</strong>r qu’il ne faut pas les<br />
mémoriser ?<br />
2.1.4 Qui est responsable <strong>de</strong>s décisions prises à ce sujet ?<br />
2.1.5 Est-ce que <strong>la</strong> situation a changé par rapport au passé ? (Par exemple <strong>la</strong><br />
conservation <strong>de</strong> nouvelles données grâce à l’amélioration <strong>de</strong>s supports en termes<br />
<strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce)<br />
Quelle évolution prévoyez-vous pour le futur ?<br />
2.1.6 Commentaire éventuel sur <strong>la</strong> sélection <strong>de</strong>s données.<br />
2.2 Sélection <strong>de</strong>s documents<br />
2.2.1 Quels sont les données qui sont jugés dignes d’être conservés à long terme?<br />
Lesquelles ne le sont pas ?<br />
2.2.2 A quel moment <strong>la</strong> sélection est-elle opérée ?<br />
2.2.3 Quel sont les critères appliqués pour faire cette sélection ?<br />
2.2.4 Qui applique ces critères dans l’institution ?<br />
2.2.5 Y a-t-il dans les bases légales sur lesquelles l’institution s’appuie un article qui<br />
spécifie comment <strong>la</strong> sélection <strong>de</strong>s documents doit être opérée ?<br />
Si oui, lequel ? Si non, qui établit ces critères <strong>de</strong> sélection ?<br />
2.2.6 Quelle est <strong>la</strong> marge <strong>de</strong> manœuvre dans l’application <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> sélection ?<br />
(Par exemple suite aux différentes manières <strong>de</strong> les interpréter)<br />
2.2.7 Commentaire éventuel sur <strong>la</strong> sélection <strong>de</strong>s documents (Par exemple les<br />
changements <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> sélection ou <strong>de</strong> leur application).<br />
2.3 Conservation, c<strong>la</strong>ssement, répertoriage<br />
2.3.1 Quels sont les procédés <strong>de</strong> conservation que les données conservés par<br />
l’institution nécessitent pour ne pas se dégra<strong>de</strong>r ou pour qu’elles soient<br />
effectivement sauvegardées à long terme ?<br />
2.3.2 Est-ce que les procédés <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt un transfert sur d’autres<br />
supports ?<br />
Si oui, lesquels ?<br />
2.3.4 Quelles sont les conditions <strong>de</strong> stockage nécessaires pour <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>s<br />
données ?<br />
2.3.5 Quel est le système <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement appliqué ?<br />
2.3.6 Quel est le système <strong>de</strong> répertoriage utilisé ?<br />
2.3.7 Dans quelle mesure toutes les dispositions <strong>de</strong> conservation, <strong>de</strong> stockage, <strong>de</strong><br />
c<strong>la</strong>ssement et <strong>de</strong> répertoriage nécessaires à une bonne sauvegar<strong>de</strong> et mise à<br />
disposition <strong>de</strong>s données sont effectivement appliquées ?<br />
Où sont les <strong>la</strong>cunes, quelles données concernent-elles?<br />
Quelles sont les causes <strong>de</strong> ces <strong>la</strong>cunes ?
202 ANNEXE<br />
2.3.8 Quelles sont les mesures <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> protection mises en oeuvre pour<br />
sauvegar<strong>de</strong>r les données ?<br />
2.3.9 Commentaire éventuel.<br />
2.4 Accessibilité<br />
2.4.1 A qui sont accessibles ces données ?<br />
2.4.2 Dans les bases légales sur lesquelles l’institution se fon<strong>de</strong> y a-t-il <strong>de</strong>s articles qui<br />
concernent l’accessibilité <strong>de</strong>s données ?<br />
Si oui, lesquels ?<br />
2.4.3 Y a-t-il <strong>de</strong>s données dont l’accès est réservé seulement à certaines catégories<br />
d’utilisateurs ?<br />
Si oui, lesquels et à qui sont-ils accessibles ? Sous quelles conditions ?<br />
2.4.4 Y a-t-il <strong>de</strong>s émoluments à payer pour y accé<strong>de</strong>r ?<br />
Si oui, quels sont les tarifs appliqués ?<br />
2.4.6 Qui sont les utilisateurs qui désirent prioritairement accé<strong>de</strong>r aux données ?<br />
(Par exemple <strong>de</strong>s acteurs publics, <strong>de</strong>s privés, <strong>de</strong>s chercheurs, etc.) ?<br />
2.4.7 Quelles sont les dispositions mises en p<strong>la</strong>ce par l’institution pour informer le<br />
public ?<br />
2.4.8 Commentaire éventuel sur l’accessibilité.<br />
3 Observations finales<br />
3.1 Dans quelle mesure l’institution réussit effectivement à sauvegar<strong>de</strong>r les données et<br />
les documents qu’elle aimerait conserver ? Dans quelle mesure peuvent-ils être<br />
considérés comme étant partie du patrimoine national ?<br />
3.2 Quels sont les principaux problèmes auxquels l’institution est confrontée ?<br />
3.3 Commentaire final.<br />
MO/PK, <strong>IDHEAP</strong>, Chavannes-près-Renens, le 18 juin 2007