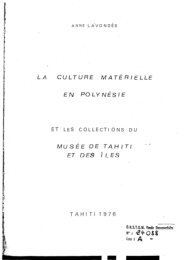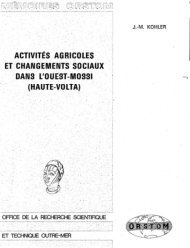A propos de l'opération Yabassi-Bafang (Cameroun) - IRD
A propos de l'opération Yabassi-Bafang (Cameroun) - IRD
A propos de l'opération Yabassi-Bafang (Cameroun) - IRD
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
OCCICB NATIONAL DE LA RHCHERCHE SCi@NTlFlOU@<br />
ONAREST<br />
A PROPOS DE L'OPERATION<br />
YABASSI - BAFANG<br />
(CAMEROUN)<br />
J. C. BARBIER<br />
Sociologue <strong>de</strong> I'ORSTOM<br />
CENTRE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES<br />
(CS ES)
OFFICE NATIONAL DE L4 RECHARCHE<br />
SCIEr\TTIFIQUl.C ET TECHIVI'?UI;:<br />
INSTITUT D3S SCIEDTCES m,i.AIWSS<br />
------<br />
CENTRE DES SCISNCES ECONOZSIQU3S<br />
ET SOCIALiS<br />
------<br />
B.P. 193 YAOUNDE Tél. 22.46.88<br />
REPUBLIQUE UNIT3 DU CA23R.OUN<br />
Paix - T ravail - Patrie<br />
J .Ce BIIRBIZR<br />
Sociologue <strong>de</strong> 1 'ORSTOEI<br />
O. R.S.T. O. hl. Fonds Documentaire<br />
Sujet <strong>de</strong> recherche no 5 322 inclu dana les accords <strong>de</strong> coopération<br />
scientifique entre 1'ORSTOM et 1' ONJJ?29T.
Droits <strong>de</strong> reproduction et d'adaptation soumis pour tous pays ltautori-<br />
sation écrite préalable <strong>de</strong>s dépositaires du copyright. Sont autorisées<br />
les citations et reproductions <strong>de</strong> figures accompagnées <strong>de</strong>s références bi-<br />
bliographiques.<br />
Al1 rights reserved. Bo part of this boolr may be translated or reproduced<br />
by any means without the prior written permission from the copyright<br />
owners. Quotations and reproductions of drawings can be ma<strong>de</strong> only with<br />
bibliographical references.
Nous avons commencé l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mouvements migratoires dlorigine<br />
bamiléké, dans l'Ouest du <strong>Cameroun</strong>, par une enquete sur les villages<br />
pionniers <strong>de</strong> llOpération <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>, en 1970-71. Les résultats <strong>de</strong><br />
cette enquete ont été publiés dans un premier rapport :<br />
. J.C. BARBIER - Les village6 pionniers <strong>de</strong> 1,Opération <strong>Yabassi</strong>-<br />
<strong>Bafang</strong>. Aspects sociologiques <strong>de</strong> liérnig-ration<br />
bamiléké en zone <strong>de</strong> foret, dans le département<br />
du Nkam. 1971, Yaoundé, ORSTOM, 303p., rnultigr.<br />
Des missions du F.A.C. et <strong>de</strong> la Banque Mondiale ont, en 1972 et<br />
1973, été amenées à évaluer <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> en vue <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> llopportunité <strong>de</strong> prolonger le financement par <strong>de</strong>s sources extérieures,<br />
<strong>de</strong> définir les besoins en ai<strong>de</strong> technique, et <strong>de</strong> conseiller dféventuelles<br />
réorientations. Les rapports <strong>de</strong> ces missions ont pu abondamment utiliser<br />
notre premier rapport :<br />
. BONNAMOUR - Opération <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>. Mission d'évaluation.<br />
CREPIN 1972, Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères,<br />
Paris, 214p., multigr.<br />
. BELLONCLZ G. - Une expérience <strong>de</strong> colonisation <strong>de</strong> terres nou-<br />
GENTIL D. velles au <strong>Cameroun</strong> : la SODENKAM. 1973,<br />
IRAM, 96p., multigr.<br />
- Pour une nouvelle méthodologie du d6velo~-<br />
ment rural en Afrique Noire. Les leçons <strong>de</strong> trois<br />
expériences <strong>de</strong> âéveloppement intégré au <strong>Cameroun</strong>:<br />
ZAPI Centre-Sud, ZAPI Est, SODENKAM. 1973, 28~.<br />
dactylogr.<br />
Lors du passage d'une récente mission du F.A.C. (cOMITI, DUBOIS,<br />
FIORESE, NOBILE, 19771, nous avons eu la satisfaction <strong>de</strong> constater qu'un<br />
oertain nombre <strong>de</strong> suggestions que.nous avions faites lors <strong>de</strong> notre en-<br />
quete et concernant le développement régional <strong>de</strong> l'arrondissement <strong>de</strong><br />
Nkondjok, se trouvaient sérieusement prises en compte par les consul-<br />
tants <strong>de</strong>s organismes financiers, citons entre autres :<br />
,
- l'intégration <strong>de</strong> llOp&ration <strong>de</strong> colcnisation agricole dans un plan<br />
régio~d <strong>de</strong> développement afin d'éviter le clivage autochtones- immi--<br />
grés, et <strong>de</strong> donner davantage d'ampleur à 1Jopérntion en premnt<br />
en considération les activités économiques <strong>de</strong>s populations<br />
autochtones productrices <strong>de</strong> ca2é et d'huile <strong>de</strong> palme ;<br />
- le déblocage <strong>de</strong>s populations diburn et d-es petites chefferies bamiléké<br />
en foret (Wbiam, Ploya, Bakwa, Tocgo, etc. ..) par un pont sur la ~akornbé<br />
'et un réseau <strong>de</strong> pistes carroasables reliées à l'axe <strong>Yabassi</strong>-Bafcng ;<br />
- Le bitumage d'une partie <strong>de</strong> l'axe <strong>Bafang</strong>-<strong>Yabassi</strong> ;<br />
- une plus gran<strong>de</strong> confiance accordée aux quant à leur capacité<br />
d'organisation sociale, ce qui doit ~erniettre un allégemen-t <strong>de</strong><br />
l'encadrement agricole au prof2t <strong>de</strong> la qxalité <strong>de</strong> cet encadrement ;<br />
- le maintien d'un contact direct et personnalisé entre les dirigeants<br />
<strong>de</strong> liopération et les intéressés, ceci afin d'éviter les dangers d'une<br />
distanciation bureaucratique source <strong>de</strong> nombreux malentendus, et la<br />
pléthore d'un personnel administratif plus encombrant qu'efficace ;<br />
0 0<br />
- la nécessité <strong>de</strong> doter Nkondjok, chef-lieu d'arrondissement, <strong>de</strong>s ele-.<br />
ments urbains (équipements scolaires et sanitaires, services adininis.-<br />
tratifs et techniques, etc...) susceptibles <strong>de</strong> retenir la pogul:i.-Li~n<br />
et dtûttirer les investissements privés au niveau <strong>de</strong>s activités du<br />
secteur tertiaire (commerce, artisanat, transport, etc...) ;<br />
Nous avons nous-mgmes continue - notre réflexion sur cette opgi-as-<br />
tion <strong>de</strong> colonisation agricole, en référence à certaine thèmes scicnti-<br />
fiques a méthodologie et étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s communautés rurales, migrations et<br />
déséquilibres villes - campagnes, transformations sociales dans Les nou-<br />
velles zones d'implantation humaine, etc... Ceci a abouti à la public?-<br />
.tien <strong>de</strong> trois articles :<br />
- Les sociétés bamiléké <strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong>: Etu<strong>de</strong> régionale<br />
aartir dJun cas particulier. in n~omrnunautés rurales et paysan-<br />
neries tropicales1', 1976, ORSTOM, Paris, coll. Travaux et Docu-<br />
ments <strong>de</strong> llORSMM, no 53, pp. 103-133,
- Colonisation agricole et référence au milieu urbain : exemple -<br />
<strong>de</strong>s villages pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>, au nord-<br />
est <strong>de</strong> Douala (~ameroun). in Cahiers ORSTOM, série Sciences<br />
Humaines, volume X, no 2-3, 1973, pp. 203-216.<br />
- Opérations <strong>de</strong> développement et histoire <strong>de</strong>s populations : cas<br />
<strong>de</strong> 110pération <strong>Yabassi</strong>-Bnfang (~ameroun), à paraître dans un<br />
Cahier <strong>de</strong> lIORSTOM, série Sciences Humaines, consacré au thème<br />
nTransformations sociales dans les nouvelles zones d'implanta-<br />
tion humaine".<br />
Afin que ces articles soient mis à la portée du plus grand<br />
nombre possible <strong>de</strong> lecteurs, nous avons estimé souhaitable leur pu-<br />
blication par llONAREST, dans la collection TRAVAUX ET DOCUIJIENTS DE<br />
LtINSTITUT DES SCIENCES HUMAINES (ISH). Nous y avons ajouté un épilo-<br />
gue afin dtactunliser certaines <strong>de</strong> nos données statistiques.<br />
J.C. BARSIER<br />
Juillet 1977
A PABTIR D'UN CAS PARTICULIXR<br />
J.C. BARBIER<br />
texte déjà paru in 'fCOi.~TTBAUT~S RURAL-:S ET PAYSAIm::",I:;S TROI-ICAmS"<br />
1976, OIISTOI:, P3IS, coll. Travaux et Documents <strong>de</strong> l1OJZSSO~v~ no 53,<br />
PEI. 103 - 122.<br />
O. R.S.T. O. !il. Fonds Documentaire<br />
No :IL(. Sm/<<br />
-"-+. .. - -<br />
Cote ,. -----
excentrique<br />
VJn cas singulier/. .le micro cosme plo-<br />
démé tien concentre, dans son originale<br />
diversité, <strong>de</strong> multiples problèmes que<br />
sa singularité et son excentricité posent<br />
<strong>de</strong> façon radicale."<br />
Edgar MORIN (1)<br />
Jlai commencé, en septembre 1970, une enquête sociologique<br />
sur l'émigration bamiléké. Je me suis ainsi trouvé <strong>de</strong>vant un ensemble<br />
démographique <strong>de</strong> près d'un million d'individus: le pays bamiléké lui-<br />
m&me totalisait 634,000 habitants en 1967, répartis sur près <strong>de</strong><br />
7,000 km2 et on peut y ajouter environ 300.000 émigrés (2).<br />
Amorcée dès le début du XXe siècle lors <strong>de</strong> la construction<br />
du Chemin <strong>de</strong> Fer du Nord qui <strong>de</strong>vait atteindre Nkongsamba en 1911,<br />
l'émigration hors du plateau a investi progressivement <strong>de</strong>s milieux<br />
ruraux et urbains trés variés. En plus <strong>de</strong>s prestations sur les chan-<br />
tiers routiers et ferroviaires <strong>de</strong> l'administration coloniale, les<br />
Bamiléké servirent d'abord comme manoeuvres agricoles dans les plan-<br />
tations du Mungo tant européennes qulautochtones. Les gares <strong>de</strong><br />
l'axe Douala-Nkongsamba <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s centres semi-urbains avec une<br />
population <strong>de</strong> manoeuvres et <strong>de</strong> petits commerçants désirant s'instal-<br />
ler localement comme planteurs en achetant <strong>de</strong>s terres aux autochtones.<br />
Par ailleurs, les maisons <strong>de</strong> commerce au terminus <strong>de</strong> Nkongsamba<br />
avaient aussi besoin <strong>de</strong> main-d'oeuvre pour le portage vers l'intérieur<br />
du pays (3), <strong>de</strong> meme les activités portuaires <strong>de</strong> Douala. A cette<br />
émigration provoquée par la mise en place <strong>de</strong> l~économie coloniale,<br />
s'ajoutèrent, dès les années trente, les efforts <strong>de</strong>s pouvoirs publics<br />
pour dScongestionner le plateau bamiléké qui apparaît déjà surpeuplé.<br />
Des zones <strong>de</strong> colonisation agricole, dont la <strong>de</strong>rnière en date est<br />
I@Opération <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> lancée en 1966, furent aménagées sur le<br />
pourtour <strong>de</strong> ce plateau. Nous sommes donc <strong>de</strong>vant <strong>de</strong>s mouvements mi-<br />
gratoires d'une gran<strong>de</strong> ampleur, commencés <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> cinquante<br />
ans et qui aboutissent à une gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong>s milieux d'immigra-<br />
(1) Edgar MORIN - 1967 - ()ozne en France, la métamorphose <strong>de</strong>-.<br />
Fayard éd,, Paris, p. 14.<br />
(2) Section <strong>de</strong> Géographie - 1972 - &bleau <strong>de</strong> la population du u ~ a ~<br />
ORSTOM, Yaoundé,<br />
-<br />
1964 - Carte <strong>de</strong> localisation <strong>de</strong>s gr- -<br />
mains, ORSTOM, Yaoundé.<br />
--<br />
(3) Bernard NKUISSI - 1967 - Nkongsamba, les annees obscures <strong>de</strong> la<br />
fondation <strong>de</strong> 1898 à 1923. ~ES-ai <strong>de</strong> mono~~a~hi~ urb * ~Emoire <strong>de</strong><br />
n ~ i s t o i r <strong>de</strong> e la Fac. Lettres et Sci. Hum., ~i=q56p,
Echelle : 1/2 000 000<br />
moins <strong>de</strong> 300 m<br />
<strong>de</strong> 300 B 900 m<br />
da 900 B 1500 m<br />
, Limites administratives 5 Arrondissement <strong>de</strong> Nkondjok<br />
1 & 2 Ex - <strong>Cameroun</strong> britannique 5 & 6 Dbpartemant du Nkam<br />
plus <strong>de</strong> 1 500 m 3 Dbpartrment Bamoun 7 Dbpartemant du Mungo<br />
J.C. BARBIER - O.R.S.T.O.M. 1971 d'aprbs Cartes I.G.N. à 112 000 000
tien: zone rurale ou urbaine, immigration ancienne ou récente,<br />
colonisation "spontanée" ou "dirigée" ( 1 ) ; e t à <strong>de</strong>s activités é cono-<br />
miques multiples : du manoeuvre agricole au commerçant d'import-<br />
export.<br />
L'exemple bamiléké, par sa taille démographique et sa super-<br />
ficie, par sa gran<strong>de</strong> diversité tant dans l'aire d'habitat traditionnel<br />
(le plateau bamiléké) que dans les zones d'immigration, par son mor-<br />
cellement politique en chefferies, $ar ses multiples activités écono-<br />
miques, ne peut que décourager le chercheur soucieux <strong>de</strong> trouver une<br />
aire dtenquete relativement homogène et représentative <strong>de</strong> l'ensemble<br />
qu'il doit appréhen<strong>de</strong>r. Le chercheur se voit contraint <strong>de</strong> justifier<br />
le ~Soix <strong>de</strong> son terr2in, qui est forcément ponctuel et particulier,<br />
et <strong>de</strong> délimiter la généralisation <strong>de</strong> ses résultats dans le but <strong>de</strong><br />
saisir, si possible, un ensemble régional. La relation du chercheur<br />
et du terrain commence par la sélection <strong>de</strong> celui-ci. Certes, ce pro-<br />
blème est classique mais les sociétés bamiléké, par leur ampleur et<br />
la variété <strong>de</strong> leurs manifestations, le posent d'une façon radicale,<br />
J'ai choisi d'étudier dans la première phase <strong>de</strong> mon enquete<br />
les villages pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>. De 1965 1970,<br />
le Génie Flilitaire constrxit unc route qui <strong>de</strong>scend le rebord rnEri-<br />
dional du plateau bamiléké ct traverse, du nord au sud, la forêt <strong>de</strong><br />
l'actuel département du Nkam. Cet axe, paraïGdle à celui du Mungo, ou-<br />
vre une nouvelle zone <strong>de</strong> colonisation agricole: treize villages y<br />
étaient déjà installés en juin 1971, soit un total <strong>de</strong> 2.800 habitants.<br />
Les imniigrés, qui reçoivent le qualificatif <strong>de</strong> "pionniers", sont<br />
pour la plupart <strong>de</strong>s Bamiléké (2). Nous avons à faire à une zone d'irn-<br />
migr:i.tion récente (<strong>de</strong>puis 1966) sous la forme d'une colonisation<br />
'fdirigée" (une soci6t8 <strong>de</strong> dévcloppernent, la SODENKAM (3) encadre les<br />
-<br />
(1) Selon la typologTe <strong>de</strong> J.P. RAISON. La colonisation <strong>de</strong>s terres neuves<br />
tronicales, Et. rilrales, juillet-sept. 19-1.<br />
-UD-<br />
(2) En juin 1970, après cinq ans <strong>de</strong> recrutement, 84% <strong>de</strong>s inscrits sont<br />
originaires <strong>de</strong>s départements bamiléké, J.C. BARBIER - 1971 - -- Les<br />
villages lionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>, Aspects socip_lo-<br />
&c~-es dc llém&ration bamilé_ké en zone <strong>de</strong> forêt, dans le dégar_tement<br />
du Nkam (OR~TOM, ~aoundé, 303p., p. 151).<br />
(3) La SociEté <strong>de</strong> Développement du Nkam (SODENKAM)<br />
est gérée selon la<br />
loi 63/L~/9 du 11 juin 1968 portant création <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> dhve-<br />
loppeinent. Avant cette date, c'est la Société Centrale pour 1' Equi-<br />
pement a.1 Territoire - CoopGration (SCET-COOP) qui a été chargée<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préliminaires et du lancement <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> sous la<br />
tutelle du Ministère du Plan.
co1ons)et hors <strong>de</strong>s lieux habituels <strong>de</strong> l'immigration bamiléké, Il<br />
stagit donc dluc cas particulier, voire même excentrique, par rapport<br />
à l'ensemble bamiléké.<br />
Je suis donc averti, dès le début, que les formes socizles<br />
que je vais y inventorier ne seront nullement généralisables. Cepen-<br />
dant, cette étu<strong>de</strong> a permis <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce un mo<strong>de</strong> d'organisa-<br />
tion sociale qui semble &tre spécifique aux populations <strong>de</strong>s plateaux<br />
<strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong>. Ce mo<strong>de</strong> d'organisation a déjà opéré lors du<br />
peuplement <strong>de</strong> ces plateaux du XVIe au XIXe siècles et a abouti à une<br />
mosaPque <strong>de</strong> chefferies - on en compte plus d'une centaine. Aujourdthui<br />
les émigrés baailék; réutilisent ce modèle cxlturel dans le contexte<br />
économique et politique contemporain où il reste opérationnel, De ce<br />
fait, la structuration sociale <strong>de</strong>s milieux d'immigration bamiléké<br />
est particulièrement rapi<strong>de</strong>. De nouvelles formes <strong>de</strong> sociabilité<br />
srélaborent en continuité avec les formes traditionnslles, sans pour<br />
autant les répétcr. Elles assurent aux émigrés une effic2cité sociale<br />
qui n'est pas sans inci<strong>de</strong>nce sur leur réussite économique. Jfai con-<br />
sidéré les villages pionniers comme un lieu d'observation privilégié<br />
où slamorçait une telle structuration sociale à partiy d'un point<br />
zéro.<br />
En quoi les villages pionniers <strong>de</strong> llOpé?ation <strong>Yabassi</strong>-Bafznk:,<br />
dont d'ai souligné le particularisme, ont-ils été un laboratoire crpo7:-<br />
tun, un moyen d'accès à l'ensemble <strong>de</strong>s sociétés bamiléké ? En d'auLre?<br />
termes, l'étu<strong>de</strong> régionale peut-elle s'appuyer sur <strong>de</strong>s cas extr$me,?<br />
choisis pour leur pouvoir révélateur ? Une telle démarche, diff6rcnte<br />
<strong>de</strong> la monographie villageoise qu'on étend ensuite à l'ensemble ethni-<br />
que, n'est pas sans intérêt, à mon avis, pour une sociologie <strong>de</strong>s<br />
changements et <strong>de</strong> la genèse <strong>de</strong> nouveaux milieux sociaux.<br />
C'est la reconstitution d'un processus d'organisation oci in le,<br />
dans un milieu d'immigration récente, que je vais essayer <strong>de</strong> présenter<br />
dans cet article. Je ne retracerai pas les tâtonnements dans ln mi,sc<br />
au point <strong>de</strong> cette problématique - ils furent nombreux - mais plut8t<br />
la logique interne <strong>de</strong> son élaboration. Nous verrons ensuite que<br />
c'est au niveau <strong>de</strong> ces dynamismes sociaux qu'une g6ngralisation à<br />
l'ensemble <strong>de</strong>s populations <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong><br />
pourra &tre tentée,
1 - PRESENTATION GENERALE DES POPULATIONS DES<br />
PLATEAUX DE L'OUEST DU CAMEROUN<br />
Les plateaux <strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong>, entre les 5 O et 6'301<br />
parallèles nord, dominent, par plus <strong>de</strong> 1.000m dt31titu<strong>de</strong>, la forêt<br />
tropicale du littoral et <strong>de</strong>s bassins <strong>de</strong> la Cross-River et 2~1. idouri,<br />
Ces platcnux s'étalent <strong>de</strong> part et d'autre <strong>de</strong> lt9'échine dorsale1' du<br />
<strong>Cameroun</strong>, <strong>de</strong> direction SW-NE, qui va <strong>de</strong> ltIle Fernando-Po et du i4ont<br />
Cancroun jusqutaux Monts du Mandara. 11s sont séparés <strong>de</strong>s plnten~?~<br />
<strong>de</strong> 1iAdamaoua par la haute vallée du Mbam. La frontière Nigérin-<br />
. .<br />
<strong>Cameroun</strong>, qui délimite ces plateaux au nord et 5 llouest, correspond<br />
au bassin <strong>de</strong> la Bénoué. Une même civilisation s'est développée sur<br />
l'ensemble <strong>de</strong> ces plateaux, <strong>de</strong> Foumban à Wum et <strong>de</strong> Bankim à Bnfûn$.<br />
Une première observation empirique dégage les traits communs sui-<br />
vants :<br />
Par opposition à la forêt, les Allemands ont utilisé le tcrme<br />
<strong>de</strong> 1lg1.nsl:ind~, qui Gera traduit plus tard en anglais yl~rassf iel~l~~,<br />
pour désigner la savane <strong>de</strong> ces plateaux et les formations montngnür<strong>de</strong>s<br />
qui s'y trouvent en altitu<strong>de</strong>. L'habitat traditionnel est dispers&,<br />
et le bocage témoigne d'un reboisement par lthomme : vallées peuplSes<br />
<strong>de</strong> pahiers-raphia, hafes en courbes <strong>de</strong> niveau, clStures pour canaliser<br />
le petit élevage, arbres fruitiers tels que les kolatiers, euarllgptz?<br />
introduits par l'administration coloniale, etc.. , Les collines s,.,n-l;<br />
sillonnées par <strong>de</strong>s billons qui remontent <strong>de</strong> plus en plus haut, dx::<br />
le sens <strong>de</strong> la pente, Des femmes y travaillent en groupes et cultivent<br />
surtout <strong>de</strong>s tubercules (taro), macabo, igname, manioc) et du mars.<br />
A ces cultures vivrières stajoutent, <strong>de</strong>puis lés années cinquanta, <strong>de</strong>s<br />
plantations <strong>de</strong> café robusta et arabica.<br />
(1) J. CHAPiPAUD - 1972 - Atlas régional Ouest 2- OZSTOII, Yaoundé,<br />
192p., ctes.<br />
(2) J. HURAULT - 1970 - L'organisation du terroir dans les grouperoents<br />
Bamiléké. Et. Rurales, 37-33-39, pp. 232-256.<br />
J.L. NDONGMO - 1972 - L'aménagement <strong>de</strong> ltespace rural ejt?>:<br />
bamiléké. Thèse <strong>de</strong> 3e cycle géographie, Fac. Lettres et Sci. Humni-<br />
iGe%i-T;iTi e .
)- L'architecture et l'art (1)<br />
La case traditionnelle <strong>de</strong> l'ouest, <strong>de</strong> plan carré et surmontée<br />
drun toit <strong>de</strong> chaume volumineux qui lui donne, vue <strong>de</strong> loin, la silhouet-<br />
te dtun champignon, s'oppose à la fois à la case circulaire du Nord-<br />
Camerour~ e t à la case rectangulaire au toit <strong>de</strong> nattes (2) <strong>de</strong>s zones<br />
forestières. Les chefferies sont <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> concentration <strong>de</strong> telles<br />
=ses : s'ajoutent à celle du Chef (mfo) les nombreuses cases <strong>de</strong> ses<br />
femmes, disposées <strong>de</strong> part et d'autre d'une allée <strong>de</strong>scendant <strong>de</strong> la<br />
place du à la chefferie, les cases <strong>de</strong>s serviteurs, les gran<strong>de</strong>s<br />
cases <strong>de</strong> réunion <strong>de</strong>s associations coutumières, etc... On peut parler<br />
d'un véritable ensemble architectural, La sculpture accompagne la<br />
construction <strong>de</strong> ces cases et extériorise le rang social du propriétai-<br />
re : encadrement <strong>de</strong> porte, piliers qui soutiennent le toit, sièges<br />
pour participer aux réunions <strong>de</strong>s associations, statues et masques<br />
reprhsentant <strong>de</strong>s ancgtres. Par ailleurs, la sortie d'une association<br />
coutumière sur la place du marché est l'occasion, pour ses membres,<br />
d'exhiber sa richesse et son prestige : tissus et calebasses recou-<br />
verts <strong>de</strong> perles <strong>de</strong> traite colorées, pièces <strong>de</strong> tissus teints à l'in-<br />
digo selon la technique <strong>de</strong>s réserves par bro<strong>de</strong>ries (31, peaux <strong>de</strong> pan-<br />
thères, etc...<br />
c)- Des dialectes apparentés<br />
Les chefferies voisines se comprennent et il nt existe pas <strong>de</strong><br />
ligne <strong>de</strong> rupture linguistique. Cependant, la distance introduit pro-<br />
gressivement <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> compréhension selon le schéma chs::i-<br />
que : A comprend B qui comprend C, mais la communication <strong>de</strong>vient diffi-<br />
le entre A et C. De là l'existence <strong>de</strong> nombreux dialectes à ltint~~rieur<br />
d'un ensemble linguistique qui englobe toutes les sociétés instt~-llées<br />
sur les plateaux <strong>de</strong> l'ouest. Cet ensemble s'oppose, d'une part aux<br />
Lxngues bantoues plus méridionales <strong>de</strong>s populations forestières, et<br />
d'autre part aux parlers d-es populations <strong>de</strong> l'Adamaoua. Malcolm<br />
GUTHRIE <strong>propos</strong>e l'appellation <strong>de</strong> Bantol<strong>de</strong> pour désigner cet ensemble<br />
et plus récemment J. VOORIJOEVE a délimité un groupe Mbam-Nkam (4).<br />
(1) R. LECOQ - 1953 - Les - Bamiléké, une civilisation africaine, 6d.<br />
Presence Afric., Paris, 221~.<br />
(2) Ces nattes sont faites avec <strong>de</strong>s folioles <strong>de</strong> plamier raphia.<br />
(3) Cette technique est décrite par Wme BOSRR-SARIVAXFVANIS - 1367 -<br />
-- -eV-p<br />
Qerçu sur<br />
13 teinture à-l'indigo en Afrique Occi<strong>de</strong>ntale, B$le.<br />
(4) M. GUTHRIE - 1353 - The Bmtu languages of 'Vestcrn Equatoria&<br />
Africa. Handbook of African Languages. International African Inst.<br />
0- Univ. Press, 94p.<br />
Je VOOHHOEVE - 1971 - The -- linguistic unit Mbam-Nkam (~~miliké ---.,A<br />
&moun and related lûnguages?. J O Afri. bguages, Pp. 7-32.
cl.)- Des chefferies<br />
- 9 -<br />
Avec un pouvoir centralisé autour <strong>de</strong> la personne du mfo, aie<br />
hierarchie <strong>de</strong> notables nettement affirmée et <strong>de</strong>s associations coutu-<br />
mières à base territoriale. Les sociétés <strong>de</strong>s plateaux se distinguent<br />
<strong>de</strong>s cociétés claniques zt acéphales du Sud-<strong>Cameroun</strong>. Les chefferies,<br />
<strong>de</strong> taille variable (<strong>de</strong> 1.000 à 30.000 habitants) sont indépendantes<br />
les unes <strong>de</strong>s autres et <strong>de</strong>ssinent une mosarque politique. Les chefs<br />
(mfo) succèd.ent <strong>de</strong> père en fils et un conseil <strong>de</strong> notables - l e<br />
. . -, . .<br />
rrkamvefr - organise l'intronisation. La possession d'un titre <strong>de</strong> nota-<br />
bilité ouvre l'accès aux gran<strong>de</strong>s associ'ations coutumières qui se<br />
réunissent périodiquement sous la prési<strong>de</strong>nce du hfo ou dlun.serviteur<br />
qui le représente. Ces associations se différencient selon leur re-<br />
crutement (serviteurs, membres du lignage royal, autres notables),<br />
leurs fonctions, et se hiérarchisent iar le prestige qui leur est<br />
reconnu dans la structure <strong>de</strong> la chefferie. entrée dans le systSme<br />
<strong>de</strong>s titres, contrclée par le mfo, ,est relativement ouverte aux indi-<br />
vidus entreprenants, et une forte mobilité sociale est encouragée<br />
l'intérieur mÉme <strong>de</strong> la chefferie traditionnelle.<br />
Aucune dénomination n'est utilishe par les populations con-<br />
cernées pour désigner l'ensemble démographique que nous venons <strong>de</strong><br />
présenter. Chaque chefferie place le préfixe -bn- qui veut dire "]-es<br />
gens duef1, <strong>de</strong>vant le nom qui llindividualise. Le terme llbamilék&ri est<br />
né <strong>de</strong>s contingences historiques <strong>de</strong> la pénétration coloniale et srap-<br />
plique 5 une partie seulement <strong>de</strong> cet ensemble. Lorsque les Allemands<br />
at-beignirent la crête <strong>de</strong>s Monts Barnboutos et découvrirent la cuvette<br />
<strong>de</strong> Dscliang (bassin supérieur du ~kam), l'interprète dEsigna les popu-<br />
lations <strong>de</strong> la zone par 11 expression IfBa mbu léké", ce qui signifie<br />
'fle~ ~oi?ul~.tions <strong>de</strong> ln valléeff (1). Cette appellation ne slapplique<br />
pas à unc cheffarie précise mais à un ensemble gkographique. Le premier<br />
texte allemand qul mentionne le terme t~ban~ilékéft date <strong>de</strong> 1905 : c'est<br />
le r6ci-k <strong>de</strong> l'expédition <strong>de</strong> Manengouba qui a effectivement atteint<br />
<strong>de</strong>s chefferies au sud <strong>de</strong> Dschang. Ce terme s'étendit ensuite à d'autres<br />
populz.tions <strong>de</strong>s plateaux. Cette extension se heurta, au nord, au terme<br />
fftik?Lrll qui lui aussi fut utilisé avec excès par l'administration.<br />
. - -<br />
(1) C'est cc qulexplique l'administrateur Le GEAY à Mme Le DUGRLT<br />
dans une lettre du 29 mars 1944, Cette version se trouve confirmée<br />
du côté du <strong>Cameroun</strong> anglophone, par le Dr. Elisabeth DUNTTAN.
Les TTlcnr sont un ensemble ethnique constitué d'éléments Mboum &mi-<br />
grés dans la haute vallée du Mbsm et d'autochtones au parler Tumu.<br />
Iles &migrés Mboum dominèrent politiquement mais adoptèrent la culture<br />
locnle. 3e nombreuses dynasties régnantes, dans la region <strong>de</strong> Barnenda,<br />
se diser.ü originaires <strong>de</strong> cette haute vallée du Mbam, la plaine Tikar<br />
et le:: c.dministration anglaises et françaises en ont déduit une riire<br />
cultureile ittikarll <strong>de</strong> Bankin à Wum (1). Ltextension du terme tlbainilé-<br />
kE" a 6t3 aussi limitée par la vallée du Noun, no man's land histori-<br />
quu cntr-. les chefferies à l'ouest du Noun et le royaume Barnoun. Le<br />
district <strong>de</strong> Fontem, quant à lui, a toujours été considéré, par les<br />
ciii~ii~_ist~~tcurs, comme apparenté au pays Bamiléké, bien qu'il en ?oit<br />
s6pa.ré par la frontière franco-anglaise.<br />
Fhlgré le caractère artieiciel <strong>de</strong> son étymologie qui relève<br />
drnllo intervention extérieure, le terme l1bamiléké1' est adopté pnr<br />
7(1:7 intiressés eux-mames. En outre, il se justifie ob jectivemont U. ins<br />
11 rxsure où il individualise effectivement un sous-ensemble dans<br />
lrairc c~lturelle que nous venons <strong>de</strong> présenter. Le plateau ttbarililékétf<br />
se distirgue <strong>de</strong>s autres régions <strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong> p3r les traits<br />
suivLmts :<br />
a)- l'importance <strong>de</strong> son bocage<br />
Il s';tend <strong>de</strong> Dschang à Bandjoun et le <strong>de</strong>gré d'humanisation<br />
clc son pysage correspond à une forte occupation du no1 avec hzbitat<br />
dioper~i?.<br />
II)- -* <strong>de</strong> très fortes <strong>de</strong>nsités<br />
ùclns le quadrilatère Dschang-Bangangté-Bnfoussam-Mbouda, les<br />
<strong>de</strong>nsitSs <strong>de</strong>s chefferies dépassent toutes 150 h au km2. Bahounn, à<br />
lfouoct clc Bandjoun, atteint 320 h au km2. Ces fortes <strong>de</strong>nsités nli-<br />
mentent uil im-ioi-tant courant migrateur.<br />
- -<br />
( 7 ) Danc un xrticle récent, B.M. CHILVER et P.M. KABERRY - 1972 -<br />
ién~~is~~ent contre cette extension abusive du terme Tikar qui ne<br />
zcc~u~ïre plus une entité linguistique ou ethnique: The Tikar<br />
prohlcm : non-problem. IN J. of African Languages.<br />
W.
c)- une ad.ministration coloniale française<br />
Elle a reduit progressivement ltautonomie <strong>de</strong>s chefs tradi-<br />
tionnels afin <strong>de</strong> les transformer en agents d'exécution. Cette politi-<br />
que a introduit une nette différenciation par rapport à la zone sous<br />
tutelle anglaise. Cette évolution du pouvoir traditionnel et sa col-<br />
laboration avec l'administration coloniale ne furent d'ailleurs pas<br />
snns inci<strong>de</strong>nce sur la révolte upéciste <strong>de</strong> 1958-1960 où les chefs<br />
(ilifo) furent violemment contestés dans un contexte <strong>de</strong> lutte ouverte<br />
anti-coloniale. Il est significatif que cette révolte qui affecta<br />
1' enscmble du plateau bamiléké et qui troubla le département du i\lu-ny,o<br />
et 13 ville <strong>de</strong> Douala, n'empiéta ni sur le pays Barnoun ni sur 12<br />
zone anglophone. Elle ne s'articula pas non plus avec les maquis<br />
Bassa qui lui furent antérieurs.<br />
d)- le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> son intégration à l'économie marchan<strong>de</strong><br />
L'ex-<strong>Cameroun</strong> Occi<strong>de</strong>ntal sous administration anglaise étzit<br />
rest6 une région marginale du Nigéria. La région <strong>de</strong> Bamenda était<br />
considérée comme un réservoir <strong>de</strong> main-d'oeuvre pour les gran<strong>de</strong>s plail-<br />
tztions <strong>de</strong> type européen <strong>de</strong> la partie sud. Du c8té frnnça-is, le d6-<br />
veloppement <strong>de</strong> la caféiculture à partir <strong>de</strong>s années cinquante, ltétn-<br />
blisseriient d'un réseau routier <strong>de</strong>nse, et la participation active <strong>de</strong>s<br />
~zrniléké au secteur commercial, accordaient à 1' économie marchan<strong>de</strong><br />
une place <strong>de</strong> plus en plus importante. Pour faciliter la pacification<br />
<strong>de</strong> la région, les populations furent regroupées et un axe routier<br />
stratégique traverse maintenant le plateau <strong>de</strong> <strong>Bafang</strong> à Bafoussnm,<br />
prolongeant ainsi la route Douala-Nkongsamba . Ln rkgion bnmi léké se<br />
trouve donc plus étroitement reliée à ltaire d'influence <strong>de</strong> Douala<br />
et un processus d'urbanisation s'amorce au niveau <strong>de</strong>s chefs-lieux <strong>de</strong><br />
département. Le cas <strong>de</strong> Bsfoussam est éloquent : <strong>de</strong> 6.000 habitants en<br />
1956, elle passait à 35.000 en 1967. Cette urbanisation s'accompagne<br />
d'une mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong>s campagnes; équipements sociaux (écoles, dis-<br />
pensaires, etc...), cases en dur (parfois avec étage et groupe Clet-<br />
troghe) construites par les émigrés dans leur chefferie d'origine,<br />
multiplication <strong>de</strong>s bâtiments administratifs, intensification du<br />
trafic routier, etc.. .
Dans l'état actuel <strong>de</strong> mes recherches, le terme "bamiléké"<br />
apyardt adéquzt, à la condition cependant <strong>de</strong> l'inscrire dans un<br />
ensemble plus vaste : les populstions <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> l'ouest du<br />
<strong>Cameroun</strong>. Je dirai : "les sociétes bamiléké", pour sous-entendre que<br />
les grouyes humains concernés continuent encore à se référer princi-<br />
palement à leur chefferte respective.<br />
2 - LE CHOIX D'UN TERRAIN<br />
Le pays biimilélré totalise plus d'une centaine <strong>de</strong> chefferies<br />
qui sont différentes dans leur taille (<strong>de</strong> 1.000 à 30.000 h) et leur<br />
milieu é~ologir~ue (bocage, savane, forêt), Les titres <strong>de</strong> notnbilitc<br />
et les noms <strong>de</strong>s associations coutumières varient linguis'tiquement<br />
d'une chefferie à une autre. filieux, les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> R, BRAIN sur les<br />
Bangvrs <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Fontem revèlent <strong>de</strong>s variations importantes<br />
quant aux structures sociales, par exemple le régime mntrimoni~.l du<br />
nkp (1). Le choix d'une chefferie risque alors <strong>de</strong> relever <strong>de</strong> l'arbi-<br />
traire et du contingent,<br />
Ce choix fut épargné car la monographie drune chefferie du<br />
plateau se trouva écartée, comme moyen d'approche, à cause <strong>de</strong>s séquel-<br />
les éventuelles <strong>de</strong> la crise <strong>de</strong>s années soixante qui auraient pu gzner<br />
une enqugte intensive, Cette appréhension s'est d'ailleurs révélGe,<br />
par 13 suite, nettement exagérée puisque <strong>de</strong>puis 1970 trois mgnogrx-<br />
phies <strong>de</strong> chefferie ont pu être conduites avec la collhborntion <strong>de</strong>s<br />
intéressés (2). Cet éloignement <strong>de</strong> l'aire d'habitat traditionnel bîmi-<br />
18ké n'a pas été un handicap gr,$ce aux travaux <strong>de</strong> J. HURAULT et C.<br />
TARDITS (3) qui apportent une connaissance <strong>de</strong> 1s société trndition-<br />
nelle, Vu ces travaux, il n'était pas absolument indispensable que<br />
je conlinence l'enquête Pr l'investigation d'une zone <strong>de</strong> départ d.e<br />
l'&migration.<br />
(1) R. BRAIS - 1365 - Bangwa (western ~amiléké) marringe wnrds, -<br />
Africa, 39, janv., pp. 11-25.<br />
(2) BALENG par J. BLUM?\
Bien qu'étant conscient <strong>de</strong> 1' importanoe, pour le migrant, <strong>de</strong><br />
sa soaiété d'origine, c'est donc vers les zones d'immigration que je<br />
me suis tourné. Cette restriction dans le choix du terrain n'était pas<br />
pour me déplaire. Certes, l'étu<strong>de</strong> d'un milieu traditionnel, rela2i-<br />
vement bien "conservé fi, réserve toujours au chercheur un certain<br />
plaisir exotique et apporte une dimension historique indispensable à<br />
toute étu<strong>de</strong> isociologique; mais l'étu<strong>de</strong> d'un nouveau milieu facilite<br />
mieux l'appréhension <strong>de</strong>s changements, renseigne surles stratégies<br />
adoptées par les agents sociaux, groupes et individus. C'est en effet<br />
par celles-ci que se réalise, en définitive, l'adaptation d'un ensem-<br />
ble ethnique aux variations du champ économique et politique ce qui<br />
correspond, dans la phase actuelle, à son insertion dans un contexte<br />
<strong>de</strong> construction nationale.<br />
J. HURAULT a su mettre en évi<strong>de</strong>nce la dynamique interne <strong>de</strong>s<br />
sodétés bamiléké : une forte mobilité sociale s'y manifeste, en<br />
s'articulant à <strong>de</strong>s statuts sociaux rigoureusement hiérarchisés et à<br />
un pouvoir politique centralisé et personnifié par le hef (mfo).<br />
LIindividualisation <strong>de</strong>s lignées non héréditaires après la secon<strong>de</strong><br />
génération, un droit succeseoral qui privilégie un héritier parmi<br />
tous les fils du défunt, une éducation qui valorise le travail et<br />
llenrichissement individuel, la possibilité <strong>de</strong> vcapitaliserv <strong>de</strong>s<br />
femmes par le régime matrimonial du Nkap (l), apparaissent dans l'ana-<br />
lyse <strong>de</strong> J. HURAULT comme les principaux moteurs <strong>de</strong> la promotion<br />
sociale <strong>de</strong>s individus. Cependant, cet auteur traite principalement<br />
<strong>de</strong> la société traditionnelle et s'arrête aux années cinquante.<br />
(1) n...Une fille est donnée en mariage par son père ou par le titu-<br />
laire d'un droit <strong>de</strong> disposition matrimoniale sur elle, le tnnkap,<br />
à un homme sans que celui-ci ait à verser <strong>de</strong> dot, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> quel-<br />
ques services ou <strong>de</strong> la remise <strong>de</strong> faibles ca<strong>de</strong>aux (chèvre et huile<br />
<strong>de</strong> palme) au père et à la mère <strong>de</strong> la fille, en contre partie <strong>de</strong><br />
quoi ce mari, une fois <strong>de</strong>venu père, n'exercera lui-même aucun droit<br />
<strong>de</strong> disposition matrimoniale sur une ou plusieurs <strong>de</strong>s filles issues<br />
<strong>de</strong> cette union...ce droit revenant à l'homme qui lui a procuré<br />
une femme, le tankap. Ce <strong>de</strong>rnier pourra donner en mariage cette<br />
fille, la younkap, sous le même régime que sa père ou bien sous<br />
régime dotal; il pourra également se procurer par échange, en<br />
la fiançant, une épouse <strong>de</strong> plus.. ," C. TARDITS, op.cit., p. 20.
Le comportement économique actuel <strong>de</strong>s Bamiléké, qualifié <strong>de</strong><br />
'fdynarnique't, reste encore inexpliqué dans la littérature existante,<br />
Aujourdrhui, Ilaxe Douala-Bafoussam est la région la plus développée<br />
du <strong>Cameroun</strong> et Douala fait figure <strong>de</strong> capitale économique pour tout<br />
ltouest du <strong>Cameroun</strong>. Dans cette économie régionale, les Bamiléké &mi-<br />
grés, <strong>de</strong>venus planteurs, artisans, transporteurs, commerçants, jouent<br />
un r81e <strong>de</strong> premier plan. Une bourgeoisie nationale, intermédiaire du<br />
capitalisme international, contrôle les maisons d'import-export et<br />
<strong>de</strong> redistribution. Ce ,dynamismef1 qui étonne l'observateur par ses<br />
initiatives d'envergure, est souvent interprété en termes pré-scien-<br />
tifiques qui font appel à la notion vague <strong>de</strong> "mentalité", concept<br />
aristctélicien par excellence pour reprendre l'expression di? psycho-<br />
logue Kurt LEWIN (l), ctest-à-dire qui explique les attitu<strong>de</strong>s sociales<br />
d'un individu ou d'un groupe par une qualité innée possédée par cet<br />
individu ou ce groupe, Dans le cas bamiléké, cette affirmation est<br />
souvent liée à une assimilation avec l'européen: m&me mentalité, m8me<br />
réussite. Le patrilignage, du fait <strong>de</strong> sa faible étendue et da l'indi-<br />
vidualisation <strong>de</strong> ses lignées, n'exerce pas une emprise familiale trop<br />
forte sur l'individu. Le droit successoral favorise un fils et les<br />
autres enfants doivent faire preuve d'initiative pour s'établir. De-<br />
vant ces faits, on se plait à évoquer lllfindividualisme't <strong>de</strong> cette<br />
population, son sens <strong>de</strong> l'épargne et <strong>de</strong> l'effort et les possibilités<br />
qu'elle a d'élaborer sur 1.e plan économique un capitalisme libéral<br />
comparable au modèle européen. Afin d'éviter <strong>de</strong> tels jugements, élo-<br />
gieux certes mais qui sont <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription et non <strong>de</strong> la<br />
causalité, il me fallait étudier les comportements économiques actuels<br />
<strong>de</strong>s Bamiléké en les reliant aux structures sociales <strong>de</strong> leurs aociété~.<br />
Pour celà, l'étu<strong>de</strong> d'une zone d'immigration a semblé <strong>de</strong>voir &tre plus<br />
fructueuse. Celle-ci peut être, en effet, définie comme un lieu d'ac-<br />
tualisation <strong>de</strong>s stratégies économiques.<br />
Pour les beoins d'une enquête qualitative, avec intervention<br />
d'une équipe limitée à un chercheur et à un ou <strong>de</strong>ux collaborateurs,<br />
il fallait trouver une zone d'immigration qui soit géographiquement<br />
aisée à cerner et <strong>de</strong> volume démographique relativement réduit..Les<br />
étu<strong>de</strong>s géographiques <strong>de</strong> J. CHAMPAUD (2) qui couvrent l'ensemble <strong>de</strong>s<br />
plateaux <strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong> et qui situent les zones <strong>de</strong> colonisa-<br />
tion agricole, me furent un gui<strong>de</strong> précieux.<br />
(1 ) Kurt LEYiIN - Psychologie dynamique, les relations humaines,<br />
PUF, Ad,, Paris.<br />
(2) JO CHAMPAUD, op. cit.
MUNGO<br />
10"<br />
Chef-lieu d'arrondissement<br />
Echelle :<br />
O 100 200 km<br />
LEGENDE<br />
ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>partement F j<br />
Aire d'habitat traditionnel<br />
Zone d'immigration rurale<br />
( dont la répartition ethnique Zone d'immigration urbaine<br />
n'est pas connue )<br />
- Limites administratives<br />
J.C. BARBIER - O.R.S.T.O.M. 1971 Source :d'après carte O.R.S.T.O.M. 1364 ;
Un premier choix slimposait entre les divers types dlimmigra-<br />
tion (1) illustrés dans le tabliau suivant :<br />
Tableau 1<br />
Les zones d'immigration bamiléké<br />
lr~=-=-=-=-=-=~=i=-=-=-=-=-T-=-=-=œ= -=-=-=- = -=-=-=-= - =-=-=".=- = ---=-=-=- -<br />
!<br />
TYPe urbaine<br />
rurale<br />
! d 1 immigration ! 1 ancienne 1 récente !<br />
1 spontanée ! Douala ! Mungo (1 910) 1 Plaines <strong>de</strong>s Mbo I<br />
1<br />
Yaoundé Makénéné (1940)<br />
!<br />
centres du1 Tombe1<br />
! Plaine <strong>de</strong> ~~3.0~ (l960) '<br />
I<br />
1 ! hiungo ! 1 1<br />
I orientée<br />
1<br />
' dirigée<br />
! New Deido ! Nkogam (1937) 1 Galim (1969) I<br />
(arrond. ~oumbot) , Magba (plaine *ikar)<br />
f (1961) !<br />
(~ouala)<br />
1 I<br />
!<br />
rive gauche du ~oun' Opération Yabnssi-<br />
1 ! ! (1932) 1 <strong>Bafang</strong> (1966) !<br />
1 ! ! 1<br />
........................................... - --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- !<br />
Les villages <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> répondaient aux<br />
critères sus-indiqués : 2.500 habitants en juin 1970, répartis dans<br />
treize villages et vivant dans un isolat géographique. Son principal<br />
intérgt I-ésidait dans son caractère récent: les trois premiers villa-<br />
ges, fondés en 1966 en pleine forêt, dans une zone jusqu'à présent<br />
marginale et sous-équipée, avîient cinq ans d'existence au début <strong>de</strong><br />
l'enqugte. Je pouvais considérer <strong>de</strong> tels villages comme un véritable<br />
laboratoire où s'élaborait-à partir d'un point zéro - la vie sociale<br />
<strong>de</strong>s immigrés. La faible <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong>s populations autochtones, la poli-<br />
tique résolument ségrégationiste <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> (2) et l'application<br />
<strong>de</strong> la loi foncière concernant le Patrimoine Collectif National (3)<br />
confirmaient ce point <strong>de</strong> vue.<br />
(1) J,P, RAISON, op.cit.<br />
(2) La SODENKAM limite son encadrement technique aux seuls villages<br />
pionniers et les autochtones doivent donc se faire pionniers,<br />
stil veulent bénéficier directement <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>.<br />
(3) Décret-loi no 63-2 du 9 janvier 1963.
Je risquais, par contre, <strong>de</strong> me heurter au caractère artificiel<br />
<strong>de</strong> villz-ges créés par une colonisation agricole <strong>de</strong> type dirigé. Cette<br />
opbrntion, qui repose en gran<strong>de</strong> partie sur un financement extérieur,<br />
ne risque-t-elle pas <strong>de</strong> vSgéter si cette source se tarit ? L'imniigra-<br />
tion spontanée prendra-t-elle le relais <strong>de</strong>s campagnes <strong>de</strong> recrutement ?<br />
Les relations verticales qui se développernt par rapport à l'adminis-<br />
tration et à l'encadrement, ne vont-elles pas étouffer les relations<br />
horizontales entre immigrés ? La société pionnière saura-t-elle<br />
acquérir son autonomie ?<br />
Jfai pu ultérieurement remarquer que ce type <strong>de</strong> relations ver-<br />
ticales, en faveur <strong>de</strong>s pouvoirs administratifs et techniques, se<br />
retrou.vnit sur l'ensemble du pays bamiléké où un système d'allégeance<br />
aux structures étatiques mises en place dans la phase actuelle <strong>de</strong><br />
construction na~iomle, concurrence en maint endroit le systsme <strong>de</strong><br />
dbpendance traditionnelle au ohef (mfo). Nfy aurait-il pas là un<br />
trznsfert aboutissant à la consécration <strong>de</strong>s relations verticales 7<br />
D',?utre p.~lit, l'enquête sur les villages pionniers a révélé les multi-<br />
ples initiatives <strong>de</strong>s colons qui n'ont nullement un rôle passif d'assis-<br />
tés. D'ailleurs, les interventions <strong>de</strong> l'encadrement ne se révèlûnt<br />
pleinement efficaces que si elles coïnci<strong>de</strong>nt avec les calculs écono-<br />
miques à 16ng terme qui ont conduit ces pionniers dans cette zone.<br />
<strong>de</strong><br />
C'est en <strong>de</strong>finitive ce <strong>de</strong>gre/compatibilitG qui détermine la réusaitc<br />
<strong>de</strong> l'Opération.<br />
Ces initiatives <strong>de</strong> la société pionnière en réponse aux incita-<br />
tions <strong>de</strong>s responsables <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> se trûduisent par une partici-<br />
pation <strong>de</strong>s colons aux institutions mises en place par les pouvoirs<br />
publics. J1ai pu observer aussi la naissance d'institutions spontanées<br />
dans les secteurs <strong>de</strong> la vie sociale non soumis directement à ces<br />
rapports d'extériorité. près cinq ans d'existence, les villages<br />
pionaiers sont <strong>de</strong>venus <strong>de</strong> véritables communautés villageoises, auto-<br />
nomes, spécifiques et conscientes.
3 - DYNAPlIZUE DE L'ORGANISATION SOCIALE DES<br />
VILLAGES PIONNIERS<br />
Venus <strong>de</strong> Douala, du Mungo et <strong>de</strong>s cinq départements bamilcké,<br />
sur décision individuelle, peu <strong>de</strong> colons - sauf quelques groupes <strong>de</strong><br />
gar<strong>de</strong>s civiques (1) - se connaissaient déjà avant leur arrivée dans<br />
h. zone. Chaque village peut donc être considéré cornme un groupe pri-<br />
maire, non encore différencié ni hiérarchisé, où les individus sont<br />
dans une situation <strong>de</strong> face à face. En outre, on doit noter l'absence<br />
quasi totale d'un cadre matériel préétabli - sinon un espace <strong>de</strong> foret<br />
à défricher !<br />
Tout est à créer pour organiser cet espace villageois. A<br />
le entrée du périmètre <strong>de</strong> colonisation agricole, une pancarte donne<br />
au visiteur un rninim~~d'information historique : "En 1964, 12, for$t<br />
partout...". Eh fait, la forêt était <strong>de</strong> type secondaire et l'occupation<br />
<strong>de</strong> l'espace par les gopulations autochtones, non négligeable. Ccpen-<br />
dûnt, la partie septentrionale du département du Nkam, marginclisee<br />
par le réseau routier mis en place par la colonisation (2),victime<br />
d'un exo<strong>de</strong> rural qui s'est accentué à partir <strong>de</strong>s années cinquante*<br />
occupee par <strong>de</strong>s maquis en 1960; présentait un état tel <strong>de</strong> sous-Êqui-<br />
pement, <strong>de</strong> léthargie économique et <strong>de</strong> faible <strong>de</strong>nsité démographique,<br />
qu'on peut considérer que la mise en valeur <strong>de</strong> la région par <strong>de</strong>s<br />
cultures dt exportation, a pratiquement démarré a1re c <strong>l'opération</strong> (3).<br />
Au début, les relhtions avec les autochtones ont été <strong>de</strong>s plus<br />
réduites. Lorsque les premiers colons arrivèrent à Sohok, ils y trou-<br />
vèrent 40 cases dispersées et 184 habitants. Ceux-ci ne purent pas<br />
assurer la totalité du ravitaillement en produits vivriers, ni fournir<br />
(1) Les gcirdrs civiques constituent une milice qui a été formée au no-<br />
ment <strong>de</strong>s troubles <strong>de</strong>s années 60, Le succès <strong>de</strong> la pacification les<br />
obligea 5 se reconvertir et plusieurs entrèrent dans l'Op6ration<br />
Yûbnssi-<strong>Bafang</strong> dès 1966.<br />
(2) En 1911, le Chemin <strong>de</strong> Fer du Nord, <strong>de</strong> Douala à Nkongsamba, comnen-<br />
ce à drainer à son profit les produits d'exportation et les mou-<br />
vements migratoires. La piste précoloniale qui traverse l~zctuel<br />
dCpartement du Nkam par Nkondjok et qui aboutit à <strong>Yabassi</strong> sera<br />
progressivement délaissée.<br />
(3) Trois jours <strong>de</strong> portage étaient nécessaires pour évacuer tines<br />
d'huile, palmistes, café et cacao, vers <strong>Yabassi</strong>, <strong>Bafang</strong> ou Nkong-<br />
samba.
<strong>de</strong>s nattes en quantité suffisante pour couvrir les toits <strong>de</strong>s premiers<br />
campements. La seule activité économique notable <strong>de</strong>s autochtones<br />
(Plbang et ~ibum) était l'échange, sur le marché <strong>de</strong> Bankambé à la 1i-<br />
mite du plateau bamiléké, <strong>de</strong> tines d'huile <strong>de</strong> palme contre du sel,<br />
du poisson séché et <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> consommation mo<strong>de</strong>rne (vêtements,<br />
savon, pétrole, etc...), Ce sont les colons eux-mêmes qui ouvrirent<br />
le marché actuel <strong>de</strong> Sohok.<br />
L'occupatioii <strong>de</strong> 1' espace par les populations auto clitones n'ap<br />
padt donc pas au début très zontraignante. D'ailleurs, les terroii-c<br />
<strong>de</strong>s nouveaux villages cn-b été délimités à l'écart <strong>de</strong>s habitations<br />
autochtones, EU^ <strong>de</strong>s terres non-utilisées qui tombaient sous la loi<br />
foncière <strong>de</strong> 1963 portant création du Patrimoine Collectif National.<br />
Deux catégories <strong>de</strong> colons fournirent les premiers contingents:<br />
les gar<strong>de</strong>s tir-iqileç et lcs 01:iginaires du Haut Nkam, Formés rapi<strong>de</strong>mer,?<br />
en 7960 pour cecondsr 11arm6e dans les opérations <strong>de</strong> pacification, les<br />
gar<strong>de</strong>s civiqul:~ <strong>de</strong>vaient envisager leur reconversion après leurs succès<br />
militaires, Ils répondirent volontiers à l'appel que leur lancèrent<br />
les progoteurs <strong>de</strong> l'Opération, puisqu'ils représentent 1776 <strong>de</strong>s trois<br />
premiers villages. Le <strong>de</strong>parternent bamiiék6 le plus proche, lc Hant<br />
Nkam, dont les chefferies les plus méridionales (Petit Diboum et<br />
l'arrondissement <strong>de</strong> ana) ont une économie <strong>de</strong> foret avec exploitation<br />
du palmier à huile, a <strong>de</strong> son côté alimenté <strong>l'opération</strong> par un ahéno-<br />
mène d'osmose: plvs <strong>de</strong> 407d <strong>de</strong>? pionniers pour les <strong>de</strong>ux premières<br />
années <strong>de</strong> rccruterictnt. Enfin, dans une secon<strong>de</strong> phase, l'information<br />
peut faire preuve du démarrage déjà effectué <strong>de</strong> la colonisation ct<br />
touche alors <strong>de</strong>s jeunes qui sortent <strong>de</strong> l'école ou qui sont en chômage<br />
dans les centres urbains. C'est ainsi que les <strong>de</strong>rniers villages ins-<br />
tallés se carsctérisent par une plus gran<strong>de</strong> jeunesse <strong>de</strong> leurs membres:<br />
657; ont moins <strong>de</strong> 25 ans nu village <strong>de</strong> I{ouenjou, contre 32% dans les<br />
trois premiers villages au niolnent d? leur installation.<br />
Un Froceszus <strong>de</strong> diffsrenciakion sociale va opérer rapi<strong>de</strong>ment<br />
parmi 12s immigrants. kcs gar<strong>de</strong>s civiques apparaissent, dès le début,<br />
cornme une catégorie privilégiée. DEjà initiés à la forêt par leur<br />
lutte contre les nqquis du Nkam et habitués à la vie <strong>de</strong>s campements<br />
(ce que furent les premicrs villagès lors <strong>de</strong> leur installation), ils
constituèrent un contingent d'élite, %ritable l'fer <strong>de</strong> lanceH <strong>de</strong><br />
<strong>l'opération</strong>. Leur présence armée assura, d'ailleurs, une fonction<br />
~Scurisante indispensable en 1966 où <strong>de</strong>s troubles étaient encore 5.<br />
craindre à 1' est <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong> colonisation. En outre, leurs fusil-s,<br />
aliment& par <strong>de</strong>s cartouches obtenues auprès <strong>de</strong> l'administration pour<br />
chasser les singes auteurs <strong>de</strong> déprédations dans les champs, augmentè-<br />
rent la qualité <strong>de</strong> l'approvisionnement <strong>de</strong>s pionniers par la vente ou<br />
le don <strong>de</strong> gibier. Protecteurs et pourvoyeurs en vian<strong>de</strong>, les gar<strong>de</strong>s<br />
civiques les plus dynamiques bénéficièrent <strong>de</strong> la reconnaissance <strong>de</strong>s<br />
autres pionniers le jour <strong>de</strong>s élections <strong>de</strong>s comités <strong>de</strong> direction <strong>de</strong><br />
village (1). Ce prestige sociale s'ajoute à d'importants avantages<br />
matériels. Salariés <strong>de</strong>puis 1960, la plupart d'entre eux ont eu le<br />
tcinps <strong>de</strong> se marier, ou du moins d'économiser en prévision <strong>de</strong> la dot.<br />
En plus, l'inscription comme pionnier n'entrafne pas une rupture<br />
dans le .versement <strong>de</strong> la sol<strong>de</strong>: celle-ci va, certes, en diminuant mais<br />
elle reste à un niveau plus élevé que la prime alimentaire touch<strong>de</strong><br />
par les autres pionniers (2). Enfin, une prime <strong>de</strong> licenciement leur<br />
est également versée. La plupart <strong>de</strong>s gar<strong>de</strong>s civiques utilisèrent à<br />
bon escient cette rentrée dl argent: ventes à emporter, petits comi;idr-<br />
ces <strong>de</strong> vêtements ou <strong>de</strong> biens d'usage courant, divers dépÔts(pain, sel<br />
poisson séché, pétrole, etc.) s'ouvrirent très tat dans chaque villa-<br />
ge. CIcst ainsi, qu'en plus <strong>de</strong>s fonctions déjà évoquees, les gar<strong>de</strong>s<br />
civiques acquerirent, par leurs investisseinents, une fonction coinaer-<br />
ciale.<br />
Les expériences professionnelles antérieures jouent ausri un<br />
r61e important dans ce processus <strong>de</strong> différenciation sociale. Les<br />
origineires <strong>de</strong> la partie méridionale du plateau bamiléké (du Pctit<br />
Dibourn à la chefferie <strong>de</strong> ~azou) ont mis à profit leur connaissance<br />
<strong>de</strong>s techniques d'exploitation <strong>de</strong> la forêt : cueillette du vin cie pd-<br />
et <strong>de</strong>s palmistes (31, taille <strong>de</strong>s piquets, débitage <strong>de</strong> carabottes (4),<br />
.uI<br />
(1) C'est un organe collectif qui veut jviter les inconv8niento <strong>de</strong> ln<br />
nomination d'un chef <strong>de</strong> village. Il est l'intermédiaire entre l'en-<br />
cadrement et la population pionnière et doit coordonner les acti-<br />
vités collectives du village. J.C. BARBIER, op.cit., p. 192.<br />
(2) Chaque pionnier reçoit au total une ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> 81.000 F CFA qui s'&tale<br />
sur les trois premières années d'installation avec un tarif dégres-<br />
sif. J.C. BARBIEH, op.cit., p. 142.<br />
(3) Il faut grimper le tronc <strong>de</strong> l'elaeis <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 20m <strong>de</strong> haut avec un<br />
cerceau <strong>de</strong> lianes qui entoure à la fois le tronc et le grimpeur. Ce<br />
<strong>de</strong>rnier monte par coups <strong>de</strong> reins.<br />
(4) Certains arbres comme le parasolier se débitent facilement en plan-<br />
ches éclatzes appelées localement llcarabottesl' du nom anglais<br />
'farved boards1'.
pose <strong>de</strong> pièges, travaux <strong>de</strong> vannerie, etc... Une terminologie consa-<br />
cre ces diverses activités en les assimilant à <strong>de</strong>s nétiers spécin-<br />
liséS que les intéressés exhibent volontiers comme i<strong>de</strong>ntité profes-<br />
sionnelle : grimpeur, vigneron, scieur. D'autre part, les migrants,<br />
qui ont transité en milieu urbain ou semi-urbain où ils ont exercé<br />
une activité non agricole (les trois-quarts <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers villa-<br />
ges) arrivent dans la zone avec un savoir-faire technique qu'ils peu-<br />
vent mettre imrfl6diatemen-l; en 2.pplicîtion car chaque village est un<br />
chantier <strong>de</strong> construction, Anciens masons, menuisiers et charpentiers,<br />
sont requis par leurs voisins, Suite à un effet <strong>de</strong> démonstration, lcs<br />
autochtones qui souhaitent mo<strong>de</strong>rniser l ~ u habitat r font aussi appel<br />
à eux. D'autre; activités artlsannles sont également opportunes pour<br />
l'organisation <strong>de</strong> la vie sociale <strong>de</strong>s nouveaux villages : tailleurs,<br />
matelassiers, cordonniers, coiffeurs, réparzteurs <strong>de</strong> vélo, etc,.. se<br />
font une clientclc. Ces activité? artisanales apportent à leurs auteurs<br />
une contribution monétaire non négligeable. En effet, avant les pre-<br />
mières rEcoltes substantielles <strong>de</strong> caf 2 c t <strong>de</strong> cacao, ct est-à-dire zrant<br />
un délai ininirrium <strong>de</strong> six ans, le budget <strong>de</strong>s colons nta comme seules<br />
ressources que la prime alimentaire <strong>de</strong>s trois premières années et la<br />
vente <strong>de</strong>s produits vivriers,<br />
Ln répartition <strong>de</strong>s lots est egslement créatrice dtinégalités,<br />
Un qundrillage géométrique découpe uniformément ltensemble du terroir<br />
en lots <strong>de</strong> superficie égale (environ 4 ha). Sont éliminés ceux doat<br />
le relief est trop mouvementé (par exemple, <strong>de</strong>s pentes trop fortes)<br />
ou qui se situent dans une zone inondable. Les autres sont distribu&?<br />
par tirage au sort 5 raison fie <strong>de</strong>ux lots par pionnier. Or, la qualit6<br />
<strong>de</strong>s sols est variable car <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> basalte recouvran-t, pur cn?.roit,<br />
le socle <strong>de</strong> roches métnmorphiques. Cela donne <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> sols aux-<br />
quels les cvlturns vivrières réagissent très différemment : nnl[;ré<br />
l'humus <strong>de</strong> la forc^t défrichke, la fertilité <strong>de</strong>s sols sur socle din1inv.e<br />
dès la secon<strong>de</strong> année culturale.<br />
Ces inégalités <strong>de</strong> dé~art sont accentuées par la strat8gie <strong>de</strong>s<br />
agents sociaux. Les gar<strong>de</strong>s civiques et les artisans btnéficient <strong>de</strong><br />
rentrées d'argent qui leur permettent d'investir dans <strong>de</strong>s activités<br />
non-agricoles, dfemployer <strong>de</strong> la main-d'oeuvre salariée pour continuer<br />
le d6frichemen-t <strong>de</strong> leurs ?-ois, eZ dtcntretenir leurs plantations avec
DEFRICHEMENTS ANNUELS<br />
<strong>de</strong> 39 exploitations<br />
( Villages pionniers <strong>de</strong> Ngoman, Njingang et Ndock-Samba -<br />
Arrondissement <strong>de</strong> NKONDJOK)<br />
: 4 IU<br />
u<br />
Annees<br />
1971<br />
1970<br />
Statut social <strong>de</strong> l'exploitant :<br />
A- scolarisés (C.E. et plus)<br />
B- ex - gar<strong>de</strong>s civiques<br />
1969<br />
G originaires <strong>de</strong>s chefferies<br />
?<br />
n<br />
Eo z<br />
3<br />
1968<br />
1967<br />
Bamileke meridionales<br />
D- CBlibataires<br />
E- Pionnieres<br />
d<br />
0;<br />
VI<br />
LL<br />
c<br />
al<br />
VI<br />
3<br />
c<br />
~40.000-<br />
al<br />
CT<br />
30.00ll<br />
20.000-<br />
10.000 -<br />
-<br />
RECOLTE DE CAFE ET DE CACAO 1970 - 1971<br />
REVENUS DE 39 EXPLOITATIONS COMMENCÉES EN 1967<br />
y<br />
(Villages pionniers <strong>de</strong> Ngoman, Njingang, Ndock-Samba<br />
Arrondissement <strong>de</strong> NKONDJOK)<br />
Statut social <strong>de</strong> I'exploitanf<br />
A- Scolarisés (C.E. et plus)<br />
B- Ex - gar<strong>de</strong>s civiques<br />
- C- Originaires <strong>de</strong>s chefferies<br />
BarnilBk6 meridionales<br />
D- Cblibataires<br />
E- Pionnieres<br />
:;<br />
D D I<br />
E<br />
!<br />
1.C. BARBIER 1971
les trnitements phytosanitaires. D'autre part, ces catégories plus<br />
aisées accè<strong>de</strong>nt plus facilement aux femmes. Or, un phénomène <strong>de</strong> rnrctc<br />
existe à ce niveau. Il se retrouve dans toute zone d'immigration ré-<br />
cente mais s'ajoute dans notre cas l'inhospitalité d'une zone fores-<br />
tière dtaccès relativement difficile à partir du plateau, ce qui, nu<br />
début <strong>de</strong> llOpération, effraya épouses et fiancées. De nombreux pioa-<br />
niers restent encore célibataires : 40% dans les trois premiers vil-<br />
lages.<br />
Le planimétrage <strong>de</strong> 39 exploitations choisies dans les troi;<br />
. -<br />
premiers villages permet <strong>de</strong> constater qufaprès cinq ans <strong>de</strong> trz.vù?.,<br />
dans les plan.t.at~o~s-, <strong>de</strong> -- profon<strong>de</strong>s<br />
- différences économiques se !n~.ilif cs- -- -. - -.,-.-.<br />
tent (cf. graphiques). Les catégories les plus privilegiées sont Ics<br />
scolarisés et les ex-gar<strong>de</strong>s civiques. Celibataire~ et pionilière.:, 1-1:<br />
contre, avancent moins vite.<br />
Cependant, la r6ussite economique individuelle ne sufPit p?.~<br />
à elle seule à assurer le prestige social. Elle doit être complétée<br />
par une participation active aux institutions sociales. C'est en cfiet,<br />
à ce niveau institutionnel <strong>de</strong> la communauté villageoisc que le,? leaiiczs<br />
vont se trouver consacrés dans leur promotion économique et socilïc.<br />
La bonne gestion <strong>de</strong> son exploitation ne rend-elle dlailleiiro pan :?l.us<br />
crédiblc celle <strong>de</strong>s affaires publiques ? Un planteur <strong>de</strong> médiocre repu-<br />
tation, qui postulerait la responsabilité d'une fonction socicle Ici-<br />
portante, se verrait vite accusé <strong>de</strong> "faire <strong>de</strong> la politicluel!. Le pla:î-<br />
teur, dont on connait la réussite personnelle, se doit d'être le pre-<br />
mier à cotiser lorsqulun <strong>de</strong>uil atteint un membre du village, quLxnd Il<br />
faut organiser l'accueil d'une personnalité administrative ou rncoura--<br />
ger liéquipe <strong>de</strong> footbzll. La générosité du plahteur aisé ne sert> pnr<br />
une exhibition égocentrique <strong>de</strong> sa richesse 1~13is essentiellement la<br />
preuve <strong>de</strong> l'intérêt qu'il porte aux évènements communautaires. Un<br />
tel plahteur sera alors sollicité pour préoi<strong>de</strong>r le v'bureaul! d'une<br />
association. Ce transfert ùe -&a réussika é c m u ~ à _ la prise en<br />
charge <strong>de</strong> fonctions institutionnelles à 1' intérieur <strong>de</strong> la com,.iuila.iitL<br />
villageoise explique le militantisme <strong>de</strong>s pionniers : dans chaque vil-<br />
lage, j'ci pu constater le fonctionnement effectif <strong>de</strong> nombreuses<br />
institutions qui, dans d'autres régions restent souvent à l'état <strong>de</strong><br />
simples organigrammes.
Les comités <strong>de</strong> direction <strong>de</strong> village, les comités <strong>de</strong> base du<br />
parti politique U.N.C. (union Nationale <strong>Cameroun</strong>aise) et <strong>de</strong>s associa-<br />
tionfi affiliées (1'O.F.U.N.C. pour les femmes et la J.U.N.C. pour<br />
les jeunes), La coopérative (c.R.E.A.) et ln mutuelle (c.R.EI.P.I.)(~),<br />
les associations <strong>de</strong> parents d'élèves, les associations <strong>de</strong> football,<br />
les bureaux <strong>de</strong>s foyers chargés du programme <strong>de</strong>s activités culturelles,<br />
etc... ont tous à leur tête la trilogie <strong>de</strong> titres : prési<strong>de</strong>nt, secré-<br />
taire, trésorier; à laquelle stajoutent les vice..., les adjoints,<br />
et, selon les cas : un délégué aux comptes, agent aux conflits, un<br />
responsable <strong>de</strong> la propagan<strong>de</strong>, etc... Cette énumération montre conbicn<br />
l'accès aux titres est très ouvert.<br />
Une attention toute particulière doit être portée aux as~o-<br />
ciations <strong>de</strong> danses traditionnelles qui se multiplient dans tous Ics<br />
milieux d'immigration bamiléké. Ces associations s'intitulent ellsr-<br />
m&mes ffsociétés <strong>de</strong> danses folkloriq~es~~. Par là, elles affirment leu;.<br />
fonction ludique et sont présentes à toutes les réjouissnnces publi--<br />
ques. Elles entrent notamment dans le programme <strong>de</strong>s festivités <strong>de</strong>s<br />
fgtes nationales et <strong>de</strong>s visites <strong>de</strong> personnalités administratives ou<br />
politiques. Elles représentent, à ce moment là, ln soci6té pioniii5rc<br />
dans sa spécificité culturelle, en face <strong>de</strong>s autorités. Par ailleurs,<br />
lcétu<strong>de</strong> <strong>de</strong> leur fonctionnement interne révèle leur efficacité au<br />
niveau <strong>de</strong> l'entrai<strong>de</strong>. Toutes ces associations pratiquent, en effet,<br />
la ootisation et le groupe <strong>de</strong> travail, lorsqutun rnenibre du groupe<br />
est affecté par un <strong>de</strong>uil, une maladie ou un ncci<strong>de</strong>nt. Il s'agit là<br />
dtun soutien efficace dont la caractéristique essentielle est dt&tre<br />
interne à la société pionnière. Ltassociation £onctionne aussi coiIlne<br />
"tontine" ce qui oblige chaque membre à ltépargne dans l'attente d'une<br />
forte rentrée d'argent quand son tour sera venu. Lorsque la caisse <strong>de</strong><br />
l'association est suffisamment remplie par les amen<strong>de</strong>s (2), un cystéme<br />
bancaire peut etre mis en place avec <strong>de</strong>s prêts à court terme.<br />
(1) J.C. BARBIER, op.cit., pp. 492-201.<br />
(2) Un règlement intérieur strictement appliqué multiplie les occa-<br />
sions d'amen<strong>de</strong> : retard à la réunion, absence injustifiée, bn-<br />
vxrdage, prise <strong>de</strong> parole sans autorisation, lenteur à cotiser,<br />
comporteinents repréhensibles tels que l'ivresse et ln gourrnnn-<br />
dise, etc.
Instruments particulièrement efficaces pour 1'Economie <strong>de</strong>s<br />
milieux dfiminigrés en phase d'installation, ces associations sont<br />
aussi crcn.trices d'originalité et <strong>de</strong> prestige social. Elles rivali-<br />
sent en pas et parures <strong>de</strong> danse et, à l'intérieur <strong>de</strong> chacune d'elles,<br />
une hiérarchie <strong>de</strong> titres mo<strong>de</strong>rnes remplace les titrez traditionnels<br />
<strong>de</strong> notabilité. Cotisation plus élevée, assiduité aux réunions, ini-<br />
tiatives opportunes <strong>propos</strong>ées à la discussion, conseils et avis<br />
donnés avec conviction mais modération, discipline et génkrosité 5 la<br />
suite <strong>de</strong>s décisions du groupe (montrer l'exemple en versant le pre-<br />
mier sa part lors d'une collecte et en dépassant la somme minimalc<br />
prescrite) etc... sont autant <strong>de</strong> comportements valorisés par le groa-<br />
Pe I~~accès aux fonctions, à 1' intérieur <strong>de</strong> ces asso ciations, dspend.<br />
d'une stratégie à base <strong>de</strong> mérite individuel où le lea<strong>de</strong>r doit cl.onnt-r<br />
constamment <strong>de</strong>s preuves <strong>de</strong> son dévouement aux affaires collective:;.<br />
Cet accès aux fonctions n'est pas immédiatement 156 au statut soctr.1<br />
<strong>de</strong> départ : âge, nombre <strong>de</strong> dépendants, niveav d'instruction, richense<br />
Qconomique, etc... 11 s'acquiert par une stratégie que l'on peut qu3.-<br />
lifier <strong>de</strong> politique au sens large du terme.<br />
MODELE CULTUREL ET CONTINUITE HISTORIQUE<br />
L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s villages pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> Yabassl-I;nfn~ig<br />
a donc permis <strong>de</strong> dégager un procès d'organisation sociale qui oyère<br />
clans ce milieu d'immigration récente. Je <strong>propos</strong>e <strong>de</strong> le formuler po~w<br />
l'instant en termes <strong>de</strong>scriptifs :<br />
- <strong>de</strong>s individus (et non <strong>de</strong>s groupes déjà constitués).<br />
- originaires <strong>de</strong> l'ensemble du gays bamiléké (même aire culturelle, mais<br />
chefferies ind6pendantes politiquement les unes <strong>de</strong>s autres),<br />
- qui bGn8ficient d'une relative autonomie par rapport aux autoritl::; t:.-e-<br />
ditionnelles (les chefferies d'origine et les populationô nutoch-<br />
tones <strong>de</strong> la zone d'arrivée),<br />
- émigrent pour accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s activités économiques susceptible^ dc<br />
<strong>de</strong> clcncher, dans le contexte contemporain, un processus d'ncc~i~u-<br />
lation du capital: la plantation <strong>de</strong> café et <strong>de</strong> cacao conplêtée pl1.r<br />
<strong>de</strong>s activités non-agri coles lucratives ( commerce, transport, ai: i-<br />
sanat, etc.. .),
- cette rlussite économique individuelle est valorisse par le gïoupc.<br />
Elle se trouve consacrée par l'accès aux multiples fonctions distri-<br />
bu6es par les institutions villageoises.<br />
- ces lea<strong>de</strong>rs, en participant activement aux institutions communautai-<br />
res, se trouvent dans une situation privilégiée par rapport aux<br />
pbles d'autorite existants, vis-à-vis <strong>de</strong>squels ils entrent dans<br />
une relation verticale.<br />
Ce mo<strong>de</strong> d'organisation sociale a été dég~gs d'autant plus<br />
aisément que <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> différenciation économique se sont nd-<br />
nifestbs rapi<strong>de</strong>ment par la présence, dès le d6but <strong>de</strong> la colonisation<br />
.i;7icl,lc, d'une c-.t~~,roric;-~pri~il6~iée (Icç c-x-gar<strong>de</strong>-:; civiques TT) ) ;<br />
et qv.2 l'organisation institutionnelle <strong>de</strong>s nouveaux villages a 6tG<br />
provoquée et encouragée par le contexte d'une opération d'iinmigration<br />
dirigée. En cela, la zone choisie a bien joué le rôle <strong>de</strong> laboratoire<br />
pour l~observation <strong>de</strong> faits sociaux en accélérant une évolution qui<br />
se serait produite spontanément mais avec plus <strong>de</strong> lenteur.<br />
Il reste cependant à vérifier cette dynamique <strong>de</strong> l'organisa-<br />
tion sociale dans d'autres lieux d'immigration afin <strong>de</strong> d5terrniner son<br />
<strong>de</strong>gré <strong>de</strong> g6n;ralité. Compte tenu <strong>de</strong>s divers types d'immigration yr6-<br />
sentés préce<strong>de</strong>mment, j'envisage entre autres 1';tu<strong>de</strong> d'un centre semi-,<br />
urbain du Mungo.<br />
11 reste aussi à déterminer si ce mo<strong>de</strong> d'organisation sociale<br />
correspond à un modèle culturel, spécifique d'un milieu ethnique :<br />
les sociétés bamiléké. Pour cela, j 'ai amorcé <strong>de</strong>ux approches, l'une<br />
comparative, l'autre historique.<br />
Une analyse comparative avec <strong>de</strong>s zones d'immigration d'autres<br />
régions, par exemple les périmètres d'accueil du Nord-<strong>Cameroun</strong>, aména-a<br />
gés pour faciliter la <strong>de</strong>scente <strong>de</strong>s montagnards "kirdiIl, perrnettm2t <strong>de</strong><br />
vhifier ce lien entre l'appartenance ethnique et le mo<strong>de</strong> dforçnnisa-<br />
tion sociale élaborée par <strong>de</strong>s immigrés (2).<br />
pi--- - -- -- -- ------.----------<br />
(1) l?ar leur situation économique plus aisée, les ex-gar<strong>de</strong>s civiques<br />
annoncent 1'6volution <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong> ln société pionnière. Leur<br />
oomportenent d'entrepreneurs locaux capables d'investir dùns <strong>de</strong>s<br />
secteurs non-agricoles, apparaft comme un prototype pour l'encemble<br />
<strong>de</strong>s colons et r6vèle le pro jet pionnier.<br />
(2) C'est dans cette perspective que j'ai effectué une première visite<br />
<strong>de</strong> la zone aménagée <strong>de</strong> Eabouri au S.W. <strong>de</strong> Gui<strong>de</strong>r où inmigrent <strong>de</strong>s<br />
Fali, Guidar, Daba, Guiziga et Moundang.
Llenquete historique, quant à elle, peut donner <strong>de</strong>r. 6?-L>tient:;<br />
<strong>de</strong> r6ponse à la question suivante : y a-t-il pour un milieu c~~ltu~cl<br />
donné une certaine continuité dans le temps et dans l'espace, dus<br />
formes <strong>de</strong> socia8ilité 3 L'éloignement par rapport à l'aire dfhabi-bat<br />
traditionnel, les changements écologiques (par exemple le passage <strong>de</strong>s<br />
savanes <strong>de</strong>s plateaux à la forêt), le^ variations du champ écono~i~iqire~<br />
introduisent-ils <strong>de</strong>s distorsions notables <strong>de</strong> ces for~nes <strong>de</strong> soclnbi-<br />
lit; 7 Sur ce point, une confrontation avec l'histoire du pe~ple;~ieliL<br />
<strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> 1' ouest du <strong>Cameroun</strong>, du XVIc au XIXe siècles, stcL?t<br />
rGvBl6e particulièrement riche d'enseignements.<br />
La documentation historique qui 6voque le peuplement du 1717.-<br />
tenu br?r.li16ké, est reduite pratiquement aux seules riionographica <strong>de</strong>?;<br />
ndrninictrateupi coloniaux. A défaut df une étu<strong>de</strong> cri tique et syntkiéti-<br />
que d.e cette documentation, qui reste 4 faire par un historien, nous<br />
ne pouvons avancer un schéma <strong>de</strong> l'histoire <strong>de</strong> ce peuplement au's -i;it?e<br />
dihypothèse. Cependant, nous po.uvons déjà faire quelques remarques qui<br />
vont dnns le sens d'une analogie avec le mo<strong>de</strong> dforgani:;a?ion soc5.:;l%?<br />
<strong>de</strong>s villages pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> que nous ve;?orrs<br />
d'exposer :<br />
. Le peuplement du plateau bamiléké a 8th progressif c7:>.??-i: 7.2<br />
teinps et l'espace, puisque les dates <strong>de</strong> fondation <strong>de</strong>s cheffe~i~c~: ir;.;:.<br />
plus anciennes remontent aux XVI-XVIIe si6 cles, et les ]?lus r:. c\::.i.k,-.r..<br />
- -<br />
celles du rebord m6~idional du plateau, se situent au XIXe sf~cci~.<br />
Le l?euplement progresse d'une façon diffuse et par habitnt di:.:p?r;+,,;,<br />
en t2che d'huile. Les cheffesies, qui affirnent avoir ét6 fonc5.':cc ;?i,r?<br />
un groupe déjà structuré avant sa montée sur le plateau, soiît jn?.r~s~<br />
Sefies les chefferies originaires <strong>de</strong> l'est du Noun ct qni ont et(:<br />
par la pression b~moun au XVIIe siècle et surtout au XIXe<br />
siècle, ont Grnigré en tant que chefferies. Partout ailleurs, ln fon-<br />
dation d'une chefferie est 1' aboutissement d'une structuration sur<br />
place <strong>de</strong>s populations. Les mouvements migratoires qui alimentèrent le<br />
peuplefilent <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong>, apparaissent plutfit
comrfle les résultantes <strong>de</strong> multiples décisions ind.ividuelles que co.i::!e<br />
le transfert <strong>de</strong> groupes cohérents et <strong>de</strong> taille importante. Une telle<br />
occupation <strong>de</strong> l'espace ne &pond nullement nu schéma classique <strong>de</strong> la<br />
conquet territoriale par un groupe ethnique dominateur. De là, Fnns<br />
doute, l'hétérogénéité <strong>de</strong>s éléments migrants et cette très gran<strong>de</strong><br />
complexité <strong>de</strong>s mouvements migratoires d'où se dégage malgré tout une<br />
direction principale NE-SW.<br />
. Les populatioils autoc2-itones rencontrées sur place pai. Ics<br />
migrants n'ont laissé aucun souvenir qui puinse ai<strong>de</strong>r à la reconsti-<br />
tution <strong>de</strong> leurs so ciGtés. L' émigration en tache d'huile juxtapose,<br />
dans une premiSre phase, <strong>de</strong>s groupes familiaur <strong>de</strong> taille restreinke<br />
et d'origines souvent très diverses (1). Cette occupation <strong>de</strong> l'espace<br />
srefïectue autour <strong>de</strong> multiples pôles dont aucun ne semble disposcï<br />
<strong>de</strong> suffisamment d'influence pour structurer, sur un grand espace, la<br />
populstion ré ceminent immigrée : petits chefs locaux rencontrés sur<br />
place ct notables charg5s <strong>de</strong> la gestion d'un quartier, Chacun <strong>de</strong> ces<br />
pales jouit, nu d&but, d'une très gran<strong>de</strong> indépendance politique.<br />
. Au sein <strong>de</strong> cette population, la mobilité sociale proce<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s activités économiques individuelles et lucratives : trafic<br />
d'esclaves et <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> traite (ivoire puis, plus tard, paliii4.s.-<br />
tes), commerce local (huile <strong>de</strong> palme, kola, tissus teints à l'indigo:<br />
petit élevage) avec la zone forestière et la vallée <strong>de</strong> la Bénolié,<br />
chassej etc.<br />
. Enrichi par le commerce ou la chasse, à la tête drUn li~nage<br />
producteur <strong>de</strong> biens et <strong>de</strong> femmes, 1' individu- ambitieux entretient<br />
autour <strong>de</strong> lui un réseau <strong>de</strong> clients :<br />
- il distribue génkreusement <strong>de</strong>s biens, par exemple <strong>de</strong> ln<br />
vian<strong>de</strong>, s'il est chasseur ;<br />
- il achète <strong>de</strong>s esclaves pour üugmenter 13 volume d6ciog~L?,phi-.<br />
que <strong>de</strong> ses dépendants (2) ;<br />
- - -- - - - -- - -<br />
(1) A l~imrcigration <strong>de</strong> population <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> direction NE-S;Y!, se<br />
sont ajoutés <strong>de</strong>s mouvements migratoires en provenance <strong>de</strong> ln zone<br />
forestière. C'est ainsi que les Yambassa, les Bakem, les Pibo et<br />
les \z/idékum pûrticipgrent activement au peuplement du rebord<br />
mL:ridional <strong>de</strong>s plnteaux <strong>de</strong> l'ouest.<br />
(2) Ce fut par exemple la stratégie du chef fondateur <strong>de</strong> Bandjoun<br />
d'où lrap:,3elbbtion <strong>de</strong> sa chefferie, 'lnjol' signifiant 'lacheter11.
- 27 -<br />
- il donne <strong>de</strong>s femmes sous le régime matrimonial du Nkas<br />
(le mariage est alors un échange différé qui fait du gendre<br />
un client et un producteur <strong>de</strong> fermes au service du donneur(1) ;<br />
- il achète <strong>de</strong>s fusils <strong>de</strong> traite et <strong>de</strong> ln poudre.<br />
Parallèlement à cet enrichissembnt, il fréquente assidunent<br />
un notable ou un chef local susceptikle <strong>de</strong> l'élever dans la hiérnrchie<br />
<strong>de</strong>s titres. L'autorisation <strong>de</strong> constttuer sa propre association coutu-<br />
iLiiGre va lui permettre <strong>de</strong> structu:-er ses relations <strong>de</strong> clientèle.<br />
Znsuite, il lui s~iff ira dtappara:tre comme le protecteur ef f ic
<strong>de</strong> ses parents. L'âge et l'appartenance à un lignage ne suffisent<br />
pas à situer un individu dans la hiérarchie sociale. Ce <strong>de</strong>rnier aura<br />
donc intbr&t à saisir les occasions d'enrichissement offertes, à un<br />
moment donné, par le contexte économique. Cette strategie expliqilc,<br />
à notre avis, la très gran<strong>de</strong> sensibilité <strong>de</strong> ces populations zux<br />
grands courants commerciaux du XIXe si; cle et sa participation, comiiie<br />
planteurs et commerçants, à l'économie introduite par la colonisation,<br />
Llimage d'une paysannerie bamiléké cultivant avec soin les sols <strong>de</strong><br />
son plateau me para!?t trop restrictive. Déjà, à la veille <strong>de</strong> l'arri-<br />
vée <strong>de</strong>s Allemands, <strong>de</strong>s popul3tions étaient résolument <strong>de</strong>scenduec du<br />
plateau, en pleine foret tropicale riche <strong>de</strong> palmeraies naturelles,<br />
entre le Nd& et la Makombé, le long <strong>de</strong>s pistes d'orientations NE-S!!<br />
qui acheminaient les produits vers la côte. Dès cette époque (se-<br />
con<strong>de</strong> moitié du XIXe siècle) les sociétés bamilékC débordaient<br />
nettement le seul milieu écologique du plateau, annonçant par là leur<br />
expansion contemporaine.<br />
Cette confrontation avec l'histoire tend à confirmer que nouz<br />
sommes bien en présence d'un modèle culturel : l a civilisation <strong>de</strong>s<br />
popuL2tions <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> 1' ouest du <strong>Cameroun</strong> <strong>propos</strong>e ef f e ctivetïle::+<br />
un type dlorganisation sociale qui lui est spécifique. Cette dynai:liq.~.t-.,<br />
sociale s'apphie sur <strong>de</strong>s initiatives individuelles qui se situent<br />
dtabord au niveau économique. Ces entreprises n'hésitent pas à se<br />
r6aliser en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la chefferie d'origine et alimentent <strong>de</strong>s ii~ou-<br />
vements migratoires qui sont orientés par le champ économique et :?O?..;..<br />
tique <strong>de</strong> l'époque. Par les associations coutumières, dont les as,~oc.!.:~.<br />
tions <strong>de</strong> bnse et <strong>de</strong> cotisation sont les hGritières, s'effectuent le<br />
conversion <strong>de</strong> la richesse économique en prestige social. Ce systerfie<br />
<strong>de</strong> promotion, qui met les initiatives individuelles zu service <strong>de</strong> IL-,.<br />
colleotivité, s'organise autour d'un pôle dominant, distributeur <strong>de</strong><br />
titres honorifiques et <strong>de</strong> fonctions, qui situe hiérarchiquement les<br />
individus en termes directement politiques, indépendamment <strong>de</strong> leuy<br />
appartenance lignagère. Ce pôle d'autorité est le Chef traditiurmel<br />
(Mfo) mais aussi, <strong>de</strong>puis l'Indépendance, le pouvoir étatique.
- 29 -<br />
C'est donc en termes <strong>de</strong> continuité que je suis conduit à<br />
. .<br />
analyser les populations bamiléké dans la variété <strong>de</strong> leurs zones<br />
d'immigration et dans leur évolution historique. L'expansion actuelle<br />
<strong>de</strong> ces populations, leur irruption dans <strong>de</strong>s secteurs économiques qui<br />
néoessitent une gran<strong>de</strong> capacité d'investissement, leur participation<br />
active au phénomène urbaine, la mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> leurs milieux ruraux,<br />
le maintien plus que dans d'autres régions <strong>de</strong>s formes et valeurs tra-<br />
ditionnelles, sont autant <strong>de</strong> phénomènes couramment pr8sentes cornrjie<br />
la manifestation du ttdynamisme bamilékétt. Ils apparaissent - dans<br />
l'état actuel <strong>de</strong> mes recherches - comme l'adaptation d'un ensemble<br />
ethnique aux changements économiques par les multiples initiatives<br />
<strong>de</strong> ses agents sociaux. En reprenant les expressions <strong>de</strong> G. BALANDIL2<br />
(1 1, nous pouvons dire que la dynamique Ifdu <strong>de</strong>dans", interne au üys-<br />
tème sociale, s'articule avec la dynamique du tf<strong>de</strong>horstl li@e aux re1:i-<br />
tions dlextériorité dont nous avons vu toute l'importance pour les<br />
sociétés <strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong>.<br />
5 - ACTUALISATION DlUNE SOCIETE DANS DES SITUATIONS<br />
PARTICULIERES<br />
Au terme <strong>de</strong> la première phase <strong>de</strong> l'enquete sur l'émigr~tion<br />
bamiléké, je ne regrette pas le choix d'une zone qui pourtant ap:?-.rais-<br />
sait, à première vue, nullement représentative <strong>de</strong>s phénomènes migra-<br />
toires <strong>de</strong> l'ouest du <strong>Cameroun</strong>. Ces villages pionniers, nés d'une con-<br />
joncture historique exceptionnelle, ne s'apparenteront qu'à long<br />
terrne aux zones d'immigration plus spontanée et plus ancienne. Or<br />
le chercheur en sciences humaines a souvent tendance à choisir, pour<br />
une étu<strong>de</strong> monographique, une unité sociale et géographique suscepti-<br />
ble d'englober la plupart <strong>de</strong>s phénomènes observés dans la région.<br />
Cette unité est alors considérée comme le véritable microcosme d'un<br />
ensemble régional où le chercheur peut étudier le^ institutions et<br />
les divers groupes sociaux d'une société globale. La prGférence va<br />
donc aux unités <strong>de</strong> taille limitée (pour les besoins <strong>de</strong> 1)observ~~tion<br />
directe). , homogène (appartenance à une meme entité culturelle) et<br />
suffisamment cornpl-exe pour y retrouver les acteurs <strong>de</strong> la sociétC<br />
globale. Les cas extrêmes sont souvent écartés : villages ethniquenent<br />
h&t&rog&nes, villages récents, villages créés et encadrés par les<br />
pouvoirs publics, etc... C'est finalement toute une série <strong>de</strong> faits<br />
sociaux, indices d'une réalité en gestation, qui se trouve néglig6e.<br />
UU ----<br />
(1) G. BALANDIER - 1971 - Sens et Puissance - P.U.F., Paris.
Or, le choix <strong>de</strong> tels cas particuliers, non directement re-<br />
présentatifs dlun ensemble, s'il fait perdre en nuances et en com-<br />
plexité, peut cependant faciliter le repérage <strong>de</strong>s faits PO ciaux<br />
fondamentaux. Pour une société en expansion, comme c'est le cns <strong>de</strong>s<br />
sociét&s bamiléké, il est indispensable <strong>de</strong> saisir les stratégies <strong>de</strong><br />
ses agents sociaux dans les situations nouvelles où elles opèrent -<br />
ort te <strong>de</strong> front pionnier où les sociétés s'actualisent sans cesse pour<br />
stadapter aux changements économiques et politiques. De m&me que<br />
lfanthropologue se doit <strong>de</strong> saisir les temps forts d'une société dans<br />
le jeu <strong>de</strong>s institut ions sociales qui lui révèleront les principaux<br />
acteurs et les rapsorts sociaux fondamentaux; <strong>de</strong> même doit-il saisir<br />
aussi cette société dans toutes ses initiatives et ses innovations,<br />
dans ses réactions aux interventions extérieures, dans le réagence-<br />
melit <strong>de</strong> ses institutions en face <strong>de</strong>s nouvelles structures 6tatiques<br />
et du développement <strong>de</strong> 1' conomie marchan<strong>de</strong>.<br />
Loin dl être nartificiellcu, l10pér:1tion <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> cor-<br />
respond 2 un moment précis <strong>de</strong> l'histoire <strong>de</strong>s populations bamilék6, et<br />
niest pas seulement l'histoire d'une intervention extérieure qui<br />
aurait pu rester sans réponse. C'est d'ailleurs parce que cette in-<br />
tervention rencontre effectivement les initiatives <strong>de</strong>s migrants qu'elle<br />
peut dCjà faire état dlune certaine réussite. Celle-ci se confirnierz.<br />
si llOpération accentue sa compatibilité avec ce que nous avcns appelé:<br />
le projet pionnier, clest-à-dire les calculs économiques à long terme<br />
<strong>de</strong>s colons concernés par l'avenir d'une zone d'immigration dont ils<br />
sont, en définitive, les principaux acteurs.
EX& :PU DES VILLAG1:S E101nJI:~:;:s<br />
DE II' OPCil:!.TION YABASSI-BABAMG,<br />
AU NORD-EST D2.3 DOU?AISi (~ameroun)<br />
Texte déjà paru in Cahiers ORBTOH, Série Sciences Humaines,<br />
Volume X, no 2-3, 1373, pp. 203-216.<br />
O. R. S. 7.0. Li. Fiiriis Docürnentairt:<br />
ibAV~iL1986 ,<br />
cote i R..<br />
> *
Dans un contexte d'exo<strong>de</strong> rursl, milieu urbain<br />
et milieu riiral sont habituellement présentés en termes antago-<br />
nistes qui s'excluent mutuellement. Le jeune rural qui pari en<br />
ville, <strong>de</strong>vient l'déracinéu, "détribalisé". 11 sera "parasite",<br />
chômeur déguisé vivant <strong>de</strong> micro-activités, scolaiï-e irrécupéra-<br />
ble pour 1' agricult-are . La ruralisation <strong>de</strong> 1' enseignement et les<br />
opérations <strong>de</strong> développement a.:ricole sont motivés, dans les dis-<br />
cours officiels, pca- la nécessité, <strong>de</strong> plus en plus inpérieuse, <strong>de</strong><br />
"freiner" cet exo<strong>de</strong> rural, d'en ralentir le rythme, <strong>de</strong> détourner<br />
vers dl@utres espaces ruraux les flu migatoires qui aboutissent<br />
aux grai<strong>de</strong>s villes. Un véritable re-tour à la terre peut inême être<br />
préconisé et le discours s'adresse alors, en prioï-ité, aux chameurs<br />
<strong>de</strong>s villes et aux jeunes scolaires.<br />
Le colon est celui qui échappe à une double fata-<br />
lité. Il est le portrait inverse du chômeur resté en ville qui ris-<br />
que <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir dangereux pour sa société : improductif et non enca-<br />
dré. Il est aussi le portrzit inverse <strong>de</strong> l'agriculteur traditionnel<br />
qui reste dans son milieu d'origine sans introduire les techniques<br />
agricoles susceptibles d1augnenter9 quantitativement et qualitative-<br />
ment, la productiol <strong>de</strong>s cultures d'exportation,<br />
Le colon, fier d'un choix volontaire et conscient<br />
qui le situe comme citoyen participant au développement iie son pays,<br />
tout en lui assurant la perspective d 'une réussi.I;e . économique indi-<br />
viduelle, <strong>de</strong>vient le pionnier d'une nouvelle société. C'est ainsi<br />
que les "pionniers" <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> déîilent la tête<br />
haute, dans les gran<strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> l'ûuest du Cmeroun, en chantant,<br />
la hache sur 1' ipaule :
Si tu veux ïnanger<br />
Il f "LU% travailler<br />
Le paresseux n'a pas droit au<br />
Cultivoris la terre<br />
Amis travaillons<br />
Il f ?'ut que nous travaillons<br />
4oiis serons heureux<br />
Plus que les paresseu<br />
Le voleur est vn méchant<br />
Qui détruit 1' économie <strong>de</strong> ln nation<br />
Le voleur n'a pas <strong>de</strong> champ<br />
iii <strong>de</strong> maison<br />
Vive, vive ie Pp&md6r,t -@G~L<br />
+oa !<br />
<strong>Cameroun</strong>, non pays, tu es grand<br />
Nous voulons que tu <strong>de</strong>viennes plus grand<br />
C ' est pourquoi nous voulons travailler<br />
Pour que tu <strong>de</strong>viennes plus développé ". (1)<br />
Dans une prerr,ière phase, les intérêts <strong>de</strong>s colons<br />
colnci<strong>de</strong>nt avec ceux <strong>de</strong> la classe dirigeante : d'une part, recherche<br />
<strong>de</strong> teires disponibles dont l'accès est, en fait, contrôlé per les<br />
pouvoirs publics seuls capables <strong>de</strong> les viabiliser (infrastructure<br />
routière, circuits cornmerciaux, irrigation, équipements sociaux et<br />
administratifs, etc ...) ; d'autre part, augmentation <strong>de</strong>s exportations<br />
et allè2e:nent <strong>de</strong>s chzrges familiales du citadin.<br />
Dcs périmètres <strong>de</strong> colonisation sont nénaghs par les<br />
pouvoirs publics autour <strong>de</strong>s ré:,ions qui manifestent un net surpeu-<br />
plenent, dans <strong>de</strong>s zones où l'occupation <strong>de</strong> l'espace par les<br />
(1) Cet hymne a été conpos6 par Elorno Grégoire, responsable adminis-<br />
tratif et politiclue <strong>de</strong>s pioiïi!iers lors du lancement ile llO&ra-<br />
tion et actuel député <strong>de</strong> Dschang.
autochtones laisse encore <strong>de</strong>s terres uissonibles. Au Uord-<strong>Cameroun</strong>,<br />
les périmètres d 'accueil invitent les montagnards "Kirdi" dcscen-<br />
dre en plaine pour y pratiquer la culture du coton. Des opéra-Lions<br />
sont lancées, avec <strong>de</strong>s succès divers, pour tenter <strong>de</strong> décongestion-<br />
ner les plateaux <strong>de</strong> ltOuas-i;, no-tamient le pays bamiléké. L'opération<br />
<strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> s'inscrit à la suite <strong>de</strong> nombreuses autres tentatives<br />
et réalisations partielles : colo: isation <strong>de</strong> la Rive Gauche 2-11 Noun<br />
(1 932), puis du Nkogsa (arrondissement <strong>de</strong> ~oumbot ) (1 337), lotissement<br />
<strong>de</strong> Galim (1969)~ aménagement <strong>de</strong> la Plaine <strong>de</strong> Bdop, projet <strong>de</strong> Bw,<br />
etc... On attend, par un processur d'osmose entre <strong>de</strong>ux rézions ddno-<br />
grcl-phiques <strong>de</strong> signe contraire, uile meilleure répartition <strong>de</strong>s popula-<br />
tions dans l'espace natLonal.<br />
Hécemcnt ~ise en valeur, la zonc <strong>de</strong> colonisation<br />
a~ricole reste, pendant plüsi~urs années encore, handiczpée par les<br />
séquelles <strong>de</strong> sa mareinali ;é iérieuîe . D 'autre part, elle peut g~i-r-<br />
<strong>de</strong>r un caractèi-e toujours e .~érimental tant qu'elle n'a pas atteint<br />
un seuil dtirr6versibilité. A L'extrême, une telle zone pourrait se<br />
définir, B prenière vuc, co!ace un isolat, certes no<strong>de</strong>rne, inais cn-<br />
t ièreme~t rural.<br />
Ccpenddnt , la d-inension pronotionnelle qui est à<br />
la base même du projzt du colont réintroduit, dès le débiic, la réfé-<br />
rence au milieu urbain. La rCuuuitc <strong>de</strong> la colonisation a2,ricule en-<br />
treprise dus la partie nord Ju déaartement du Nkm (1'0~ér~~tion<br />
bassi si-~afan~) nous est appsrue, en partie, tribu :zire du milieu<br />
urbain : dans cc cas précis, elle ne se fait pas contre la ville.<br />
Elle se développe, au cont:aire, cn s 'articulant au milieu urbaln,<br />
et c ' est f inalemcnt en termes d ' échan::es ville-campagne que nous<br />
<strong>propos</strong>ons Ci'analyser ici cettc expCrience.
L'opération <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> s'inscrit dans l'histoi-<br />
re récente du pays bamilaké et par rapport aux courants nigratoifcs<br />
qui affectent l'Ouest ?.a <strong>Cameroun</strong>.<br />
Dès lc début <strong>de</strong> la colonisation, les plateaux <strong>de</strong><br />
l'ouest ont offert une main-d'oeuvre importante. Les côtiers, qui<br />
s 'y approvisionnaient déjà en esclaves (1 ), y dirigèrent les Allen,ands<br />
à la recherche d'une main-d'oeuvre sour leurs gran<strong>de</strong>s plantations <strong>de</strong><br />
la région <strong>de</strong> Buga. C'est principalement dans ce but (2) que ZIThTC;E*i..ilP<br />
établit, en 1889, un pacte <strong>de</strong> seng avec Galega 1, Fon <strong>de</strong> Bali - une<br />
<strong>de</strong>s chefferies 12s plus puisssrites militairement du rebord méridional<br />
du plateau. C'est encore aux chcfferieu ba1izil6li;é que lcç Allemands<br />
s1ad7esseront pour la construction du chemin <strong>de</strong> fer du Nord, <strong>de</strong><br />
Douala à Nkongsmba (1 903-1 31 1 ). Les Fr,ançais firent <strong>de</strong> mgme pour<br />
prolonger, dans lcs années 20, la ligne <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> fer du Centre<br />
jusqu'B Yaoundé. Plus réce~xnent, à la veille <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> guerre<br />
mondiale, 12s planteurs europCens du Ilungo et <strong>de</strong> la ré;?;ion <strong>de</strong> %oum-<br />
hot firent recru-Lcr, par lc biais <strong>de</strong>s OTfices Régionaux du Travail <strong>de</strong><br />
Dscha~=; et <strong>de</strong> PoumSan, le personnel dont ils avaient besoin (3).<br />
Aujoilrd'hui, c'est encore du pays bamilélré qu'on<br />
attend- une rrise en valeur <strong>de</strong>s ré,:ions avoisinantes -i;rop îaiblerlcg-t<br />
peuplées pour répondre aux incitations <strong>de</strong> d6velo-pemunt : la pl~~in~<br />
(1) Les "Polyglotta AfricanaH, listes d'esclaves lihérés et vivant en<br />
Sierra Leone, rccucill.ics par le niissio~~nai~e Ç .iir .Koellc entre 1847 et<br />
1853, énumgrent <strong>de</strong>s noms à consoiinance bamildké. Le terne "hayon'! utilis6<br />
par les populations baasa <strong>de</strong> la ï:é,:;ion <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong>-et qui siznifie<br />
e scla.ve-scrt il désigner, dans ,un sens péjoratif, les habitant s cles<br />
plateaux <strong>de</strong> l'Ouest.<br />
(2) Il sla;;.issait aussi <strong>de</strong>
Nkondjok dans la partie septe~trionp-le du départenent du l?k:im (d = 7),<br />
le tlépartc~~ent du Zibam (arrondis~cr~lcnt <strong>de</strong> Ndikininéki : d = 10, et<br />
district rie llôkénéné : cl = Is), la Rive Gauche du Moun (d = 14), 12<br />
district <strong>de</strong> Eankin, c'est-a-dire ln Plaine Tikclr (d = 4).<br />
Cette attente rencontre effectivement une r6ponse<br />
banilélcé. Constatons d'abord que lcs <strong>de</strong>nsi.Lés <strong>de</strong>s cinq départements<br />
bamiléké sont très fortes :<br />
l<br />
i<br />
Département Population totale<br />
-- - i<br />
- -. - -<br />
1----<br />
i<br />
Haut-Bknn ..,... I<br />
l<br />
Barnboutos ......, i<br />
Ndé .....*...<br />
i Ensemble<br />
.......<br />
Source : J. CIL1,IP 'UIJ, Atlas Régional Ouest-2.<br />
Densité 1<br />
Dans le quadrilathre, Dscl-iang-l.ibouda-I3afoussam-Eangangt, les chef-<br />
fcrics dépassent toujours 150 habitants au km2. Bahouan, & l'Ou,-st<br />
<strong>de</strong> Bandjoun atteint 320 hab./h2.
L'adrilinistration coloniale voulant évit2r la diffusion<br />
<strong>de</strong>s naladies phytopatholo~iques du café par une extension insuf-<br />
f isai,mcnt encadréc <strong>de</strong>s plantations, et désireuse d 'a.ssurer une ali-<br />
rien-taiion <strong>de</strong>s marchés urbains en produits vivriers, pratiqua une po-<br />
li-bique inalthusieilne en limitant; la caféiculture, sur les pïateaq,<br />
aux seuls no-t:l.bles et chefs. Ce n'est qu'à partir <strong>de</strong>s années 50 qu'~:n<br />
changeigcnt <strong>de</strong> politique éconor~i-ue fit <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> 1' Oucst une<br />
<strong>de</strong>s priricipalcs zones cnféières du <strong>Cameroun</strong>. La dénocratisa-l;ion <strong>de</strong><br />
cette cultu~e acccntua considérablement la pression démographique sur<br />
lcs terres. Une solution tenl?orairc fut trouvée, à l'encontre <strong>de</strong>s<br />
conseils <strong>de</strong> llencadrcment agricole : l a pratique <strong>de</strong>s plantatioiis mix-<br />
tes (les feues 'Imettent <strong>de</strong> la propreté" en cultivant <strong>de</strong>s produits<br />
vivriers entre les rangs <strong>de</strong> caféiers, du rnoins durant les pre~cières<br />
années, ce qui dispcrlse dcs sarclages). Cependant, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> quel-<br />
quss notables qui possèLcnt un capi-tâl foncier plus inportant,<br />
l'agriculteur ne dispose que Ci lune superficie trop rcstrei:a-ce :<br />
1 ' exploitation a,.::ricole du plateau bamiléké ne dépasse guère la<br />
moyenne d 'un hectare.<br />
Tableau 2. - L1exploitation agricole<br />
Régions<br />
Burfnce to- ,Cultu=.er;<br />
]tale culti- ,vivrières<br />
' Nombre total<br />
lnniations : ~lan$stions ;<br />
, mutes ,<strong>de</strong> pcrsoilnes,<br />
bée (ares)<br />
a (73)<br />
l<br />
Ilbang-Nord (1 ) 9 6 6,F;<br />
l<br />
I<br />
i<br />
1 Plateau bardildké' 111 3 4 1 397<br />
1. '. .. . . .... .- .- . S . .. .<br />
Nbam (cacao) / 283 ; 34 ( 49<br />
! 17 77 7<br />
Source : J. CH;Jil?'JJ1), p. 82, op. cit., d'après les travaux <strong>de</strong> CAPOT-TL :Y9<br />
NPPHDAVI et IU7l)-CB.L:iIT <strong>de</strong> la Direz t ion <strong>de</strong> l'Agriculture, Yaouni:4.<br />
(1 ) Pa~.-i;ie<br />
nord du canton 19ban{;, arrondissement <strong>de</strong> l\Tkond j ok, C?.&pû.~.-t~'r'.,~:~~t<br />
du Nlram.
La révolte upéciate dcs années 00 (l), par ses conséquen-<br />
ces, va accen-Lucr ce phénomène <strong>de</strong> surpeuplrncnt. Pour les besoins<br />
stratégiques dc la paciIicatiori, lcs po pill~~tioiis, jusque 1& disper-<br />
sées dans un payscge dc boc?"ge, vont êtï-e recroupées. Des cl-sups pcr-<br />
dront <strong>de</strong> leur intérêt par suite d'une distance trop gran<strong>de</strong> par rap-<br />
port au centre <strong>de</strong> rcgroupemcn-t, et <strong>de</strong>s activités traditionnelles ne<br />
pourront plus s'exercer, dzns ce nouveau coiltr xte, avec autant <strong>de</strong><br />
rentabilité : petit élevnge do chèvres et <strong>de</strong> porcs, cueillette du vin<br />
<strong>de</strong> raphia, exploitation Cles palrL?iers h huile (pour les chefferies les<br />
plus méridionaliis), lutte nnti-érosive pa.r l'entretien du bocage,<br />
ramassz,ge du bois mort, etc... Dans les zonc:s d'iilii;~igrlti~n, les<br />
troublcs vont $tïë l'occasion 6. 'une remise cn czuse <strong>de</strong>s statuts f mi-<br />
cicrs par les autochtoiies. Ce-;te insécurité foncière, particulièreincnt<br />
vive daxs lc ;iungo, renfirii-t souhaitable 1 ' ou-~eriure <strong>de</strong> nouvellcs<br />
zones d 'accucil.<br />
-En 1964, aTin 6.e délogcr 12s maquis upécistes gui <strong>de</strong>meu-<br />
rent h l'sbri <strong>de</strong> la vaste foret tropicale qxi s'étend, au suc!. du<br />
plateau, <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong> à S?-:?aii~;, et i:~- Ngongsanba à Ndikiniméki, le<br />
projet d'une rouJ~e BS truversant l2 zone est formulé et abou-tit rüpi-<br />
d,~i:ient (2). Cette réalisa-Lion d 'envergure (il a fallu frsnchir le rc-<br />
bord méridional du platem baixil4ké surf isalment abrupt pour être<br />
appelé "falaisesi) va s 'accomsazner d 'une opération <strong>de</strong> coloni~ation<br />
agricole pour rentzbiliser le nouvel axe routier. Les pronotsuro dc<br />
llOpGration pensent d 'abord zm gar<strong>de</strong>s c Fviques (3) dont lrt reconIrer-<br />
. .<br />
sion est à envishgcr après lcs ::uccès <strong>de</strong> 13. pacification, Ils peccent<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
IifUaion <strong>de</strong>s Popula-tions Camcrouiiz.ises (~-.P.C.) fut fondée en 154.5<br />
pFLr Bubcn Um Nyob6, Dés~~pprouvunt ln façon dont se déroulait<br />
1'accer;si.on h, l.'Indépcr,C.-~nce, 1'U.P.C. engagea dès 1952 <strong>de</strong>s actions<br />
vio1c~ntc.s qzi engc;~idr.&~ciit <strong>de</strong>s maquis cn pays beosa, pdis<br />
bamiléké,<br />
La construction <strong>de</strong> la rou'~c co~icncéc en 1955 se termine en 1370<br />
par 1' inaugurz.'~lon du pont <strong>de</strong> Toumbassala . Le génie milit aise<br />
camerounais cil a été 1c maîtrc d 'ocuvre.<br />
Milice recrutée pcirmi 12s origiïl:?.ires <strong>de</strong> llOuest, A partir <strong>de</strong><br />
1350, pour combattre lés maquisar6.s upécistes.
uussi aux quartiers surpcuplén <strong>de</strong> llouela où les chômeurs forment una<br />
nasse dansereuseinent mobiliçz~blc a-u moinsre inci<strong>de</strong>nt (1 ) ; et à<br />
1 laccroissen~cnt spectaculai~c du volume démographique <strong>de</strong>s chefs -<br />
lieux clcs ci6parteincnts ba:nil-6lré, accroissement qui ne correspond pas<br />
au nombre d'cn;:,lois qui y sont oîfcrts. Bn 1966, le chantier routier<br />
<strong>de</strong>sceïid la ufalctiseu baïliilék6, C'G les trois premiers villa~csa son?<br />
installhs (2). Les colons reqoivent un lot <strong>de</strong> 6 à 8 hectares dont il-n<br />
<strong>de</strong>viendront sropriétc~ireau terme d'un délai <strong>de</strong> 5 ans pendant lequel<br />
ils auront r~spec té certaines normes : présencc effective, construc-<br />
tion d'une case tôlée c.1î briiju-es <strong>de</strong> terre sèche défriclnzmei-L i;.iuile<br />
9<br />
superficie minimum (3). Le contexte historique qui a vu naître<br />
<strong>l'opération</strong> ct les difficultés rencoiltrécs p:.?r les preiiliers colons<br />
lors <strong>de</strong> leur izistallation en pleine l'orct, justilial~i; lc -tcir!n~ 2.c<br />
"pionnierss' qui leur a été at-tribué et qui renvoie conscieix~cnt à la<br />
conriuête du désert par les kibboutz isra6lii.n~.<br />
En juin 1972, le rccenseinent d6rilo~raphiquc <strong>de</strong>s villa.,e;.<br />
pioniiiers doïinait 1::s ril:;u.lt~~'is ouiv=lnts :<br />
- 14 villagcs installés ;<br />
- 1180 cxploitn!its agricoles, Cont 74 fcvaes ;<br />
- 54.2 feiiiiies miiriées, 1 51 1 enfan-bs, 107 personnes à ck1:;ï-t;e ;<br />
- populati.on totale = 3 540 h;~bitants.<br />
Les promoteurs <strong>de</strong> l'Opération n'ont pas Stt5 déçus pnr les<br />
gar<strong>de</strong>u-civiques. Ceux-ci ont répondu A l'appel puisqu ' i ls représen-<br />
tent 17 $ <strong>de</strong>s pioniiiers <strong>de</strong>s trois preiricrs villages. Origin:?,i:r.cs d?,?<br />
départements bcmil&ké, déjh inities à la vie eiî forQt pai-. ln lutte<br />
(1 ) Far exemple, 1'incenGie Cu qua--Licr Coilgo à DouL~l-. le 2'5 a-mil<br />
1960.<br />
(2) Financée en piwtie par l1a5.<strong>de</strong> extérieure (~onc1.s d 'Ai<strong>de</strong> et (':s<br />
~oo~é:ratiori), la gestion Ge <strong>l'opération</strong> est coafiée à 1a S(:;'T--<br />
COO17~I.ii!TIOW. Une sciciét-é dlEtat (soI~?~BK;~-~ = Soci6té <strong>de</strong> :léve3.oppe~nent<br />
du f~kan) prenctr~ la relève en 1971.<br />
(3) Il s'azit d'une colonization agricole <strong>de</strong> type dirigse selon 1-<br />
typologie préscn-bée pal* J.P.I'iAISON dans son raticle qsLr~ CO:.C.:~.sation<br />
(!es terres neuves tropicales" in Etucies ilur~iles, ne 7'1,<br />
juillèt-sept embre 1960.
contre les maquis du Nkam, habitués aux cai:,?perilents (ce que furent, 3.u<br />
début, les premicrs villages), &lgrrorrsti-tuèrent cont.*en-t; cl 'élite,<br />
véritable 'If er <strong>de</strong> lance" <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>.<br />
La référence au surpeupli>ment du pays banilélré se trorve<br />
confirnéc puisque 84 $ <strong>de</strong>s colons (96 9; la première année) sont ori-<br />
ginnircu <strong>de</strong> cette région.<br />
. .<br />
Tableau 3.- Orieinc géograpliic].ue <strong>de</strong>s colons (lieu <strong>de</strong> nnissznce)<br />
. .- - . - .<br />
I i<br />
Départe- 1 ' i!utrca<br />
ment c?éparte- 1 ment I Nkan Id6par.-te-<br />
/ . ,<br />
BanilékQ ments ..-d IEa~ilékG<br />
I<br />
....- . .....-....-... mcnt s: .-........ ..-.....-<br />
.<br />
!<br />
ombre )<br />
9 6 2 2 2<br />
-. ~. ><br />
104 9 3 I<br />
l<br />
i<br />
276 1 E 11 396<br />
4.6 !<br />
I<br />
. -- L ~- . -<br />
Tableau 4.- Origine g6ograp:iiyue <strong>de</strong>s colons barililélrii<br />
. .-.- -.<br />
1966 1967<br />
i<br />
1 1968 ! 1969<br />
.-<br />
1970 i<br />
..........<br />
7- ' ......<br />
! ienoua..<br />
....<br />
Sainbou-t os.<br />
Nd é ...........<br />
1Ténou.a. .......<br />
Ganbout os<br />
. -- . -- .... . . . . -. .. ........ .... 8<br />
. . __ .--<br />
/<br />
-<br />
En nombre absolu<br />
. .-A - --<br />
- . .-- ... .................. . . . . !<br />
92 ! 104 376 1 268 ; 233 1 973<br />
-~ - - -<br />
En pourcent zge<br />
- -..--.p.- . ..............<br />
. , . '~<br />
47 I 4-3>3 , 16<br />
76,5<br />
2095 19,2<br />
I<br />
1 21,4 28<br />
1 /<br />
Ndé...........<br />
~otal ......... - 100 - / 100 IOC .~_*.____________. 1 100 100 1 00 .~ .<br />
Source : SO:'~I.???K/I?!I, nov, 1 370
ORIGINE GEOGRAPHIQUE<br />
( lieux di iuùunca )<br />
DES PIONNIERS BAMILEKE<br />
& I'Opaition V.basi-Bafirp
l<br />
Tableau 5.- Participation <strong>de</strong>s départenents bûmiléké A <strong>l'opération</strong><br />
Hau t-Nkan .......<br />
Iïif i., ..........<br />
Illénoua. .........<br />
Bz.nboutos. ......<br />
Nd&.............<br />
Znsemble.. ......<br />
proportionnellernent à leur population totale.<br />
Nombre cl ' inscyits<br />
pour 100 000<br />
habitants<br />
Source : SOD31JICrAi4, nov. 1370<br />
Nombre <strong>de</strong> départs<br />
pour 100 inscrits<br />
Un phénomène d'osmose s'est prodilit avec le département<br />
bamiléké le plus proche.. Le IIaut-Nkam, dans sa partie méridionale ap-<br />
pelée "Petit-DiboumIr, est 21 moins d'une journée <strong>de</strong> marche <strong>de</strong> l'entrée<br />
du périmètre <strong>de</strong> coloniaatioii. Les originaires <strong>de</strong> cette zone peuvent<br />
aller se ravitailler, en ~ïoduits vivriers, cla.i~s leur famille respec-<br />
tive, et reçoivent plus fréquemment la visite d 'lm ai<strong>de</strong>-f arnilial gour<br />
la plantiltiori. A l'avuntage <strong>de</strong> la proximii;é, s'ajoute celui d'un ni-<br />
lieu écolosique apparenté : les chefferies les plus méridio:iales du<br />
Iiaut-Bksm <strong>de</strong>scenfi-cnt résolument en forêt et leur economie est tradi-<br />
tionnellement centrée sur lrexploitat5-on du palmier huile (élaéis).<br />
L'économie forestière n'est donc pas une inconnue pour les originai-<br />
res (3~e cette zonz qui se ci6clareiikvolonl;iers griilipeurs (pour uller<br />
cueillir les pc!,Lnistes cri h2.u-tcle 1' élaé'ïs), vignerons (<strong>de</strong> vin <strong>de</strong><br />
plme), ou scieurs (carabottes et (1)- Par rapport à la<br />
(1 ) Certains arbres com.le le payasolier se débitent facilement en<br />
plaiiclies éclatées appelées localcinent carabottes.<br />
1<br />
Nombre <strong>de</strong> cololis<br />
pour 100 000<br />
habitants
population totale <strong>de</strong> chsque dkpartenent, clcrist le I-Iaut-Nkam qui four-<br />
nit le plus fort contingent ?.e colons. Sa p~.rticipation s'élevait &<br />
près <strong>de</strong> 50 '/.: <strong>de</strong>s inscrits <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux pre~ilières années, et les abandons<br />
y sont proportionnellement moins nombreux. Conscients <strong>de</strong> leur nombre,<br />
ces originaires exercèrent une vive pression électorale au moment du<br />
renouvellement <strong>de</strong>s cornités <strong>de</strong> dij?ection <strong>de</strong> villp.ge (en 1971 ) par op-<br />
posiFion aux ex-gar<strong>de</strong>s-civi; & sues.<br />
Nous retrouvons 13 ï-éférence au surpuplenen-L baniléké<br />
en constatant la présence <strong>de</strong> 74 femmes pionnières. Plusieurs sont<br />
veuves ou divorcées. Les plus 8gées se contentent <strong>de</strong> faire surtout<br />
<strong>de</strong>s cul-tures vivrières et <strong>de</strong> coIEnencer la plantation eiz attendat la<br />
relève par la génération suivante. Quant aux plus jeunes, elles s'in-<br />
tègrent dans Ica .g;-oupés <strong>de</strong> trn~~ii.1 et, p27 ce biais, leurs slanta-<br />
tions rivalisent avec celles ?-es exploitants masculins. Zn pays bami-<br />
léké, les feimes n'ont culun Croit d'usage sur les terres et elles<br />
doivent sladrcsser a plusieurs homnes pour obtenir une sup:>r2icir<br />
cultivable correspondant à leur force physique : "vivant dnns une<br />
perpétuelle i:~sGcurité en ce qui coiicerne leurs droits d'usage sur<br />
les terrairis, les fe::n,ies son3 ocins ccsr;e à la recherche Lie nouvelles<br />
terres..." (1). Cette insécurité s'est intensifiée <strong>de</strong>puis l'expansio:~<br />
<strong>de</strong> la caf éiculture qui concurreiice les chalti~ps vivriers. De plus,<br />
l'émigration ct lcs troubles &es almées 60 où <strong>de</strong> nombreux c:lefs dc<br />
famille trouvèrent 13 riioït, ont ?Léséquil.ibré le sex-ratio : en moyén-<br />
ne, chaque lior~:~e <strong>de</strong> 20 à 50 ans a à charge <strong>de</strong>ux fermes, <strong>de</strong> la rnêlnc<br />
tranche d'âge, qui lui <strong>de</strong>mûll,.ient du terrain. Il s'agit aussi, pour<br />
plusieurs <strong>de</strong> ces ferniles, d'ncqu~rir uile entière indépendance écono-<br />
mique en <strong>de</strong>venant planteurs. I'Joixs ystr~uvons là ulre at.titu<strong>de</strong> foi~da-<br />
nentalc <strong>de</strong> la femme bnmileké.<br />
(1)<br />
Jealî Hurault.- L1or,qaliisa-Lion GU terroir d.ans les ,rrroulsements<br />
bamiléké . In EtuJe M ?.
Tableau 6.- Répartition en âge <strong>de</strong> 100 coloiis au bioment <strong>de</strong> leur<br />
- iiiscription.<br />
-A 40 ct plus ........<br />
---<br />
S ourc e : S ODETJIUT,!T.<br />
Village (le<br />
Icouend ou<br />
(1 370)<br />
Par contre, lf0p4ration <strong>Yabassi</strong>-Baf ans ne aeniblc pas<br />
avoir eu juaqufà prssent un effet <strong>de</strong> décon~;estioninei_:.cat iles ;-;rail?.?,?<br />
villes. Xares sont les pionniers qui citent Bouala c orme ri;uiiLcnce<br />
immédiatellient antérieure. Depuis 1 971 , cependant , un effort d i9fo:r-<br />
1s-tioïl a été entrepris auprès <strong>de</strong>s jeunes <strong>de</strong>s villes 6.u Sui!. <strong>de</strong> Isex-<br />
Cuineroun Occi<strong>de</strong>ntal- Ces jcunes, souvcnt oîi~;innir,?s <strong>de</strong> 12 région d.e<br />
Barnenda, se sont enbaucliés dans 12s grnnd.!>s p1:ini;ations <strong>de</strong> la. C.J.?.<br />
(l), puis se sont retrouvés chameurs dans lcs centres urbains. Cet<br />
asport Ce jeunes cita?.ins aboutiL à la formation <strong>de</strong> villnl;?s<br />
où les moins 2e 25 ans sont nettcxent najoritaires.<br />
(1 ) LCa Caneroo:îs Dcvelopmrn-i; Corpora ti~n cc V une Coopéra-tive cl ' :tat<br />
chc?r=;éc 6.e gérer les yrs~i<strong>de</strong>s pla,itclt;ions laissées en 1918 par 1c;s<br />
nlleni?L1iU~<br />
.
En définitive, nous retrouvons Zans cette nouvelle eapk-<br />
ricilce acricole 1' importa~ce du p1atc::lu bamiléké comjqe pcle d 'é~iiigrc,-<br />
tion, bien que le rythne annuel Ce l1iui1i;;ration &ont bénéficie la<br />
zone <strong>de</strong> Nkond jok reste très mo<strong>de</strong>ste par rapport à l'ampleur <strong>de</strong>s mou-<br />
vements migratoires qui affectent l'Ouest-Cc7~~eroun (1). Le nilieu ur-<br />
bain, par contre, nlaspara!?t ni dans l'étu<strong>de</strong> géographique <strong>de</strong>s lieur<br />
<strong>de</strong> naissance, ni dans celle <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces antérie~~es. L'étu<strong>de</strong> géo-<br />
graphique <strong>de</strong> la seule rési<strong>de</strong>nce antérieure <strong>de</strong>s migrants valorise, ci?<br />
fai-E, la chefferie cilorigine en tant que lieu <strong>de</strong> refuge à la si..~itc<br />
cl 'un écliec d 'intégratioli urbüiiie. C 'est f inalenent 1' ensemble du cir-<br />
cuit migratoire d'un individu qui peut révélcr l'importznce du fait<br />
urbain. ( (2). -!+<br />
Le processus <strong>de</strong> colonisation agricole n'est pas un sin-.<br />
pleple transfert (le popiilntion dluiie aire d'habi'cat triiditionncl 5<br />
une nouvelle zone ouverte à lîi~~mi~r~~tion. Une analyse en seuls teï-<br />
mes <strong>de</strong> passage ?'une region à une autre, 11-e répulsion <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong><br />
départ, d 'attraction <strong>de</strong> la zone U 'arrivée, :jhladaptation <strong>de</strong> l'inmitré<br />
au nouveau niilieu écolon ic,ue, ne rendrci-it pas compte <strong>de</strong> l'cnseinblz<br />
du phénomène,<br />
(1) Le rythme znnucl CI~ l'immi~rîtion dans lis villages pionilicrs: .'
L'installation du colon n'est que la dcrni6re étape, peut-<br />
$ tre provisoiïe, cl. 'un r.iouvci?l~;nt mi3ratoire souvent conp1e:te. Les co-<br />
lons ont vécu <strong>de</strong> nultiplcs expéricncés antérieures où ils ont appris<br />
à tenir compte <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong> ll&cononie actuelle, et à pzrtir dss-<br />
quelics ils ont élab~~é Ces c:~.lcu.ls long terne, Cc détour, Ce lon-<br />
. - gueur et <strong>de</strong> ciurée variables selon les individus, est finalo~ilent plus<br />
important que le pqint Ce CCpart. Nous allons voir qu'il r6introS. rit<br />
l'importa~ce du fait urbain.<br />
Une telle notion Ce >:;tour, dans le temps et ltési~ric~, ~ s t<br />
à rcsituer dans une gcrspcctive <strong>de</strong> p:comotion sociale <strong>de</strong> 11iriclivi6u. En<br />
eL'fet, ;;ans los sociétés bamiléké traditionnelles, l,.s ststu-ts sociaux<br />
nc sont p,=~s d 0nn6~à llorizinc. Ils sont essentiellement acquis. Au<br />
sein meme dc son liyagc, ce ne sont ni 1c rang <strong>de</strong> naissance, ni l'âge<br />
qui accor<strong>de</strong>nt A llindividu une position prééninente : c'est par ses<br />
qualités persoilne1lc.s qu'il sera dis-tingué par son père pour être<br />
11h6r.itier. A la tête d'un lignage, il n'aura ccpenc2ant pas une posi-<br />
tion coropsi-able à celle ci 'un t1a4né11 ü::ms une société <strong>de</strong> type segmen-<br />
taire : <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> segr~entû.tion opèrent après <strong>de</strong>ux géniirations<br />
ct limitent la taille du lignage (1). Les frères non héritiers <strong>de</strong>vien-<br />
nent, quaxit à eux, fonC~ateurs <strong>de</strong> nouveaux lignages et s 'instnllent<br />
sur iine terre qini 1-curest accori-cée, au non 121: chef, par le ilotablc<br />
responsable J. 'un qurrticr. Jusqulau XXè siècle, l'accès à la terre l e<br />
posait pas cle problsmcs majeurs et ne créait pas <strong>de</strong> différenciation<br />
sociale. C'était essentiel.leinci?t par llaccroissoment cle la force<br />
<strong>de</strong> travail (f cnucs mzriées et serviteurs), par <strong>de</strong>s activit Cs particu-<br />
Ilèrenent lucrzlives dans uii colitcxte c!. lkcoiiornie <strong>de</strong> traite (ch,?.s:.e et<br />
tra:::'ic d'ivoire, coimerce d'enclaves e-b Clll~uile <strong>de</strong> palme, etc.. .), ou<br />
p2r dcs services rcnclus a::: chef, ci~us llindivi?.u xnbitieux pouvait<br />
f;'en~ichir, ?,a réusaite éconoillique pouw.it être alors consacr6c paf<br />
un titre cic 20-i;abili;;Fj, resu dil chcf, qui lui permettait d'entrer clans<br />
les grancles associations co~tumitrcs <strong>de</strong> ln chefferie ; et pour lcs<br />
plus grands nota'!les, respons:lblcs d 'un quar'iier, llc,utorisetion<br />
c? ' o ~g~~riiser leur propre ass.ociaJ~iori. Au XXè siècle, les contraictes<br />
(1 ) J, IIUtll',ULT.- L3. structv-i-c? soci;-
liaitant lIaccès aux cultures dlexpOrtation sur le olatesu - et donc le<br />
principal moyen dlenrichissement - alimcntent un impcrtant mouvement mi-<br />
gratoire. L'éniigration offre la possibilité <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir planteur en milieu<br />
rural, commerçant ou artisan en milieu semi-urbain ou urbain.<br />
La promotion sociale commence aujourd'hui pr la fréquenta-<br />
tion scolaire. Nous constatons que le niveau dlinstructicn <strong>de</strong>s colons est<br />
relativenent élevé pour une socié-té rurale. Dans les <strong>de</strong>ux premiers villages:<br />
- 60,3$ n'ont jamais été à l'école ;<br />
- 16,2$ ont quitté l'école avant le CM2 ;<br />
- 23,5 ont atteint le niveau CI92 et plus (1).<br />
Le jeune qui reste dans le milieu rwal sans la perspective<br />
d'hériter, ou si cet heritage est insuffisant, ne peut survivre qu'en se<br />
spécialisant dans <strong>de</strong>s activités négligées par les planteurs plus aisos,<br />
ce qui masque un début <strong>de</strong> prolé3arisation agricole. Nombre d'entre eu:,<br />
dans la partie méridionale du plateau bamiléké, louent leurs services com-<br />
me ai<strong>de</strong>s-familiaux ou manoeuvres agricoles. Là, ils ont pu s'initier aux<br />
métho<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnes d'entretien d'une plantation <strong>de</strong> café robusta ou <strong>de</strong><br />
bananiers.<br />
Les centres urbains secondaires du plateau bamiléké et dv.<br />
1~~u11g-O, donnent l'occasion d 'apprendre un métier <strong>de</strong> type mo<strong>de</strong>rne. C 'est<br />
ainsi qu'on trouve dans les villages pionniers <strong>de</strong> nombreux colons spécia-<br />
lisCs dans la construction <strong>de</strong> l'habitat : maçons, charpentiers, menuisiers,<br />
etc. Dans la phase actuelle <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> l'habitat, qui est parti-<br />
culièrement nette dans tout liOuest-<strong>Cameroun</strong>, ces métgers sont valorisés.<br />
Nous avons trouvé, aussi, parmi les pionniers : <strong>de</strong>s tailleurs, matelas-<br />
siers, réparateurs <strong>de</strong> vélo, cordonniers, coiffeurs, photographes, bou-<br />
chers. Un personnel domestique a 6té formé par les européens <strong>de</strong> Dschang<br />
et <strong>de</strong> Nkongsamba. Cependant, ces métiers ne peuvent pas s 'exercer A<br />
temps complet dans les milieux ruraux<br />
(1) Nous avons même trouvé <strong>de</strong>s colons du niveau <strong>de</strong> la troisième !
ou sémi-ruraux : le marché solvable n'est pas trks étendu, et les<br />
clients tar<strong>de</strong>nt à payer les services rendus. Par ailleurs, en plus<br />
<strong>de</strong>s frais d'apprentissage qui accompagnent le stage chez un patron,<br />
il faut compter un capital <strong>de</strong> départ pour s'installer à son propre<br />
compte. Ce savoir-faire artisanal nlcst donc pas suffisant lui seul<br />
pour garantir une intégrntion urbaine. Ces difficultés conduisent<br />
l'artisan bamiléké à <strong>de</strong>venir planteur pour pouvoir exercer ensuite le<br />
inétier qu'il a appris, comme acJLivité complémentaire. C'est un tel<br />
projet qui s'actualise par exemple dans les villages pionniers. La<br />
colorïisation agricole, dans Le cas <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-Tafarîg,<br />
permet la valorisation dcs métiers artismaux appris lors d'une e :p6-<br />
rience semi-urbaine antérieure.<br />
Plusieurs colons étaient, auparavant, salariés, et béné-<br />
ficiaient Jonc d'une intégration urbaine plus poussée : employés<br />
dtadministrntion, moniteurs d'enseignement, gérants <strong>de</strong> bar, etc.<br />
Pourquoi ont-ils préféré <strong>de</strong>venir planteurs ? Frais <strong>de</strong> logement et <strong>de</strong><br />
nourr:iture, difficultés dlécofioriziser une partie <strong>de</strong> son salaire à cau-<br />
se <strong>de</strong>s loisirs et du parns:i.tisne faïnilial bref' tout ce qui fzit la<br />
fragilité en ville <strong>de</strong>s sn1aj.r.e~ $-es cntbgories inférieures est net-<br />
tement perçu par les intéicsshs. Devenu planteurs, ces ex-salariés<br />
sont fiers dlhabitcr une ca.sc spacieuse doat ils scnt propriétaires,<br />
et <strong>de</strong> se nourrir Ce leurs produits vivriers. Ce retour h la terre est<br />
l'exemple d'un comportement "réalisteN qui contreeit l'irrationnalité<br />
prêtée aux urbsiris" fascines pa.r llanbiance iie la grzn<strong>de</strong> ville".<br />
Sur 72 pioriiliers, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux preiiiiclrs villages installés,<br />
85 $ avaient CU c',>s activités non-agricûles dans un ml;.lieu urbain ou<br />
semi-urbains, et 1/3 ont eu cette activité clans une ville même du<br />
pays bamiléké. Le détour réalisé par le colon, avant son arrivée dans<br />
ln zone, est donc très souvent un clétour par le milieu urbain.<br />
X<br />
Un style <strong>de</strong> vie seni-urbain va s élaborer pro;~ressivement<br />
dzns la zone <strong>de</strong> colonisation agricole. Les campements en carabottes et<br />
toits <strong>de</strong> nattes <strong>de</strong>s premiers colons, installés en pleine forêt, avant<br />
même l'arrivée <strong>de</strong> la route, ont fait place à <strong>de</strong>s villages attrayents<br />
qui étonnent favorablement le visiteur. C'est un peu par un discours<br />
d 'anciens combattnnts que lcs pionniers évoquent, au j ourd 'hui, les
souffr~nces <strong>de</strong>s prerriiers jours ; 1" forêt oppressante qui d6~0~l'age,<br />
les singes qui déterrent les tubercules, les moustiques et les colcn-<br />
iles <strong>de</strong> fouraiis qui attaquent le c:uiipement la nuit, les reptiles qui<br />
gobent les preiaiers poussins, la crnin-Le <strong>de</strong>s maquisarfis, les épouses<br />
qui refusent <strong>de</strong> suivre leur mari düiis une forêt qui leur apparaft<br />
lointaine et inhospitalière, les Jeunes filles qui, pour le même no-<br />
tif, fuient coïme la peste les colons cdlibataires, etc. A la placé<br />
<strong>de</strong> ces cas~pemerits, nous trouvo:?~ maintenant <strong>de</strong>s cornunautés villa-<br />
gesoises fières d'elles-mêmes. L'abri construit la première ancée est<br />
<strong>de</strong>venu la cuisine ; et, <strong>de</strong>vnn-t, s'est élevée, sur <strong>de</strong>s fonriations 4.e<br />
pierres, une case en briques sèches, couverte d'une ch~rpente et
852 enfants (1). Une "école sous l'arbre", dans chaque village, invite<br />
les adultes à s'alphabétiser.<br />
- <strong>de</strong>ux dispensaires (~ohok et ~kondjok) sont complétés par $.es tourn6es<br />
<strong>de</strong> soins nédiceux et <strong>de</strong>s stages <strong>de</strong> puériculture et <strong>de</strong> nutrition. Une<br />
prophaxmacie serait déjà ouverte s'il n'y avait pas eu <strong>de</strong>s difficultés<br />
bureaucratiques au niveau du chef-lieu <strong>de</strong> département.<br />
- au centre <strong>de</strong> chaque village, un foyer culturel offre un cadre a6équat<br />
pour les nombreuses réunions ; et <strong>de</strong>ux aninateurs <strong>de</strong> I'Educetion Popu-<br />
laire ont été affectés Cans la zone. Des terrains <strong>de</strong> football ont dté<br />
anéna~és et un match inter-villageois se déroule souvent le dirilaîcllc'<br />
après-midi.<br />
- trois marchés hebd-ornaclaires &talent les procluit s complément aires $.es<br />
autochtones et ces colons : huile et vin <strong>de</strong> palme pour les uns ;<br />
petit élevage, produits artisanaux et commerce anbulant pour les autres.<br />
La liaison routiére avec <strong>Bafang</strong>, par taxi ou en bén6fici:int<br />
du passage d'un camion <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> apporte un complément nécessaire :<br />
fréquentation d 'un grand mzrché, ambiaiice cles rues coi.arierçarites où lcs<br />
produits sont noins chers, bars dansants, etc. De plus, grâce 5 son pzrc<br />
<strong>de</strong> taxis qui atten<strong>de</strong>nt les voyzgeurs, <strong>Bafang</strong> ouvre la porte Ge tout<br />
l'ouest et <strong>de</strong> Douz.la. La route sort les colons <strong>de</strong> leur marginalité, les<br />
rattache à la vie llm~<strong>de</strong>rne~~ en leur permetttzilt la fréq~~eiltatSon du nilieu<br />
urbain à défaut d'y rési<strong>de</strong>r. De là, la très gran~Ce sensibilité <strong>de</strong>s pion-<br />
niers à l'entretien Cie la route (la portion C.e route correspon?.~~nte à la<br />
!If alaiscll, non biturnéc, est souvent impraticable en saison cles pluies),<br />
au prix du transport (le prix dfu? aller <strong>Bafang</strong> peut stteiiiG.rc 600 F<br />
CFA pour urie cinquaiitaine <strong>de</strong> kilomètres), <strong>de</strong> là aussi le rêve d'un séjour<br />
à Douala. Le milieu urbain reste pour les colons un groupe <strong>de</strong> référence<br />
yt un groupe d 'appaïtcnance te~:?.poruire.<br />
(1 ) Deux écoles à cycle complet sont également ouvertes à Nkond jok pcur<br />
la populntion autochtonca et ,?.es villages pionniers environnants.
Les formes <strong>de</strong> sociabilité élaborées dans les nouveaux vil-<br />
lages sont proches <strong>de</strong> celles du milieu urbain. Nous so11~cs~ dans les<br />
<strong>de</strong>ux cas, en <strong>de</strong>hors du contrôle dss pouvoirs trz
- 50 -<br />
se caractérise par une nette spécialisation sur lus cultures d'expor-<br />
tation et l'existence d'activités non-agricoles (coï~<strong>de</strong>rce, :~rtissn~t,<br />
transport.. . ) qui se greïf ent très rspiJ-emcn-& sur l'exploitation. Zn-<br />
fin elle se maiifeste par une capacité d'investir nori-négligéable.<br />
Les exploitntions agricoles misés en plilcc par les colons<br />
soizt très ceiltr6es sur les plantations <strong>de</strong> café et cle cacao. Les cou-<br />
traintes écologiques ont . erûpêché le développement <strong>de</strong> certaines acti-<br />
vités comrnc lc petit élevage et, l'absence d'une politique en faveur<br />
<strong>de</strong> l'cxploitution du palmier à huile a rendu les colons tributaires<br />
<strong>de</strong>s autochtones pour l'huile et le vin <strong>de</strong> palme. Les pionniers ac-<br />
centuent cet'tc! li~riitatioi? cles activit6s a:;ricoles par leur attitu<strong>de</strong>.<br />
vis à vis Zes cultures vivri&.res. Dans un premier temps, elles b6n6-<br />
f icicn-t du frorit pioniiiér dc 4éfrichage <strong>de</strong> 1.1 foret. Ce front cul-tu-<br />
ral est, en gdnéral, ium&G-iateneiit planté <strong>de</strong> caféiers robusta. Ccux-<br />
ci, bien alignés et cspacés <strong>de</strong> trois mètres selon les consignes du<br />
raoniteur agricole, sont surchar,ycis par <strong>de</strong>s cultures vivrières anni~elles<br />
(macabos, taros, riz) et pluriannuelles (babaniers, manioc, cannes à<br />
sucre). Tendu vers l'attente
- raretd <strong>de</strong>s sols sur basalte qui auraient pu être utilisés pour <strong>de</strong>s<br />
champs vivriers permanents, alors que les sols sur socle peu profonds<br />
et victimes <strong>de</strong> la sécheresse s'épuisent très rapi<strong>de</strong>ment malgré l'humus<br />
d'une forêt récemment défrichée, Or ces sols n'ont pas été repérés<br />
dans l'organisation du terroir villageois, celui-ci se réduisant à une<br />
simple grille géométriqus qui délimite <strong>de</strong>s lots d'égale gran<strong>de</strong>ur, indé-<br />
pendamment <strong>de</strong> la qualité clrlturale <strong>de</strong>s sols.<br />
Les pionniers alimer.tent, aujourdthui, par camions entiers<br />
les marchés <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux centres urhins les plus proches : <strong>Bafang</strong> et Yalns-<br />
si, Nais lorsque le défrichernent z."e ralentira il est probable que les<br />
colons laisseront aux autochtones le soin dtapprovisionner les marches<br />
locaux et le centre <strong>de</strong> NkondjoK. Cn fait, 12s colons se sont inscrit à<br />
<strong>l'opération</strong> pour <strong>de</strong>venir essentiellc~lent planteurs, Nous n'avons pas re-<br />
trouvé, dans cette zone dc colonisati31i~ ce paysan "acharnéff - pour re-<br />
pr-endre l'expression <strong>de</strong> Pierre Gourou i 1 ) - créateur du bocage baixiléké<br />
et qui est souvent <strong>propos</strong>é c0n.e modèle d'adaptation au milieu naturel.<br />
Le colon n'envisage pas la reproduction du système agricole traditi~n~el,<br />
ni une adaptation <strong>de</strong> cc systène à un miYieu écologique diî2érent. Il<br />
se fait planteur pour accé<strong>de</strong>r à l'économie marchan<strong>de</strong>s et ne vise pas<br />
comme le paysan à utiliser toutes les possibilités du milieu naturel en<br />
vue d'une auto-conoommation.<br />
La plantation une fois rnise en valeur peut être entretenue<br />
par un ai<strong>de</strong>-familial (et le surpeuplement du plateau bamiléké le permet<br />
aisément), ce qui libère le temps <strong>de</strong> travaLl <strong>de</strong> l'exploitant. Ce <strong>de</strong>rnier<br />
peut alors se consacrer à une activité non-agricole dont les revenus<br />
s'ajoutent à ceux <strong>de</strong> la plantation, L'accwulation rapi<strong>de</strong> du capital par<br />
une activité commerciale ou artisanale reyose sur une base économique -<br />
la plantation - qui garantit une stabiliti à l'entreprise. Le comporte-<br />
ment économique <strong>de</strong> s ex gar<strong>de</strong> s-civiques, cc tant que groupe f inancièrcmen-t<br />
privilégiés, est révélateur. Arrivés déjà mariés dans la zone, avec<br />
meme quelques économies en poche, ils on; brkéficié d'une in<strong>de</strong>mnité<br />
qu'ils touchent pour la durée <strong>de</strong> leur reconversion, plus<br />
Blevée que la prime à alimentaire accorkBe aux autres, colons; enCiri,<br />
(1 ) Pierre GOUROU qualifie l'agriculture bamiléké dl "acharnée" .-<br />
l'Afrique - 1970, éd. Eschette, p, 178.<br />
. -
une prime <strong>de</strong> licenciement leur apporte un capizal substantiel. La<br />
plupart <strong>de</strong>s ex-gar<strong>de</strong>s-civiques utilisent à bon escient ces revenus :<br />
petits commerces <strong>de</strong> vêtements ou ?.e biens C'usage courant, dépôts <strong>de</strong><br />
pain, &e pétrole, <strong>de</strong> sel, <strong>de</strong> poissons $cllés, etc. S'ouvrent très tôt<br />
dans les villages. Dans une secon<strong>de</strong> phase, les investissements<br />
se font i Nkond jok, chef-lieu <strong>de</strong> l'arrondissement, qui cornait une<br />
expansion démographique notable; enfin, ils pourront s'orienter vers<br />
le milieu urbain le plus proche ai le développement régional n'est pas<br />
capable d 'absorber cette czpacité d 'investir.<br />
Aujourd'hui plari-beur, le colon <strong>de</strong>vient le plus vite pos-<br />
sible conmerçnnt, artisan ou salarié, et prolongera sa promotion indi-<br />
viduelle par une scolarisation poussée <strong>de</strong> ses enfants. Il aura ncqiiis<br />
à llOpiration Yal?assi-BzJr'ang, uxz bcloe 6coiiomique soli<strong>de</strong>. Ce que nous<br />
<strong>propos</strong>ons d'appeler projet, et qui correspond à un cctlcill économique a<br />
long terme, n'est certes pas conscient chez tous, d'autant plus que<br />
la pério3e C'eustérité actuelle, que traversent les pionniers (avant<br />
la phase <strong>de</strong> plein ren<strong>de</strong>nent Ues plantations) n'incite pas lz<br />
confi<strong>de</strong>nce d'un tel espoir ; nénmoins ce projet est nettenent affirmé<br />
par les plus avancés d~ms leur rbussi-Le économioue. Leurs intérêts<br />
individuels colncidcnt avec la démarginaPisation <strong>de</strong> la zone et son<br />
intégration ?!ans l'économie mzrchan$.e.<br />
Un tel projet, en diversifiant los activités éconorri.iques,<br />
est facteur <strong>de</strong> transformation ce la zone <strong>de</strong> colonisation. A long terne,<br />
et si les investisscrnents publica facilitent cette évolution, carzc-<br />
tères ruraux et urbains s'interpénétremnt<strong>de</strong> plus en plus. Le centre<br />
administratif <strong>de</strong> Nkondjok en sera évi6.enmcnt le premier bénéficiaire.<br />
Le département voisin du Nungo, colonj-sé <strong>de</strong>puis les années 20 par une<br />
immigration spontanée d'origine bizrL:i14ké, se présente conme le proto-<br />
type d'une telle évolution : lx route qui conduit rapiCiement à<br />
D~uala et les rcultiples centres urbains secondaires, constituent un<br />
réseau qui structure le milieu rural et le fait participer aux<br />
avantages <strong>de</strong> la ville, lieu 3.e noCernit6.
X X<br />
Une zone <strong>de</strong> colonisa-tioil ü,_,ricole, dans l'ouest du<br />
<strong>Cameroun</strong>, ne saurait rester un isolat rural sans péricliter. L1expé-<br />
rience <strong>de</strong> colonisation <strong>de</strong> la rive gauche ciu Noun, ..lancée en 1972 par<br />
1 'administration coloiiiale pour attéiiuar les trop fort es dciisités du<br />
plateau, est là pour en téinoigner : en 1367 on ne comptait que<br />
2 400 habitants (1). Restée à l'écart iles principales voiL, OS <strong>de</strong> coiil-<br />
nunication, loin d 'un centre urbain, cette zone <strong>de</strong>me~re f andmentale-<br />
ment rurale. L'Opération <strong>Yabassi</strong>-Eafan~ peut connaître le même sort<br />
si l'axe routier n'est pas suffisai.m~ent entretenu, et si cles investis-<br />
sements pu'ûlics ne sont pas faits pour doter Nkond jok d ' dqilipenents<br />
socioculturels. Les migrants baniléké recherchent <strong>de</strong>s terres 2ispvni-<br />
bles pour ouvrir <strong>de</strong>s planta-tions, mais nlacccptent p ~ pour s ~~tzilt (!e<br />
vivre $.a~s une situation trop marginale. Paradoxaleirient, une plznta-<br />
tion est, pour cux, le moyen C'exercer <strong>de</strong>s activités non-a.,ricoles.<br />
Ces activités exigent une région traversée par un axe ?.e circulation,<br />
et un volume démographique suffisant. Le retour à la terre n'est<br />
donc pas une rupture par rapport aux expériences urbaines sntérieures.<br />
Dans le cas <strong>de</strong>s villages pionniers <strong>de</strong> 110p6rat ion <strong>Yabassi</strong>-Caf ang, il<br />
est au contraire un moyen <strong>de</strong> SC réint6grer 6conomiquenent et sociale-<br />
olent dans une dconomie dc type moilerne, 2c bénéficier à la fois cies<br />
avantages du milieu rural et <strong>de</strong>s services offerts habituellement par<br />
le milieu urbain. La proxir'ité c7.tun pôle urbain ne peut donc qu'aug-<br />
menter les chacoes Ge réussite d'une opéra-Lion <strong>de</strong> colonis?.tion agri-<br />
cole. Ceci va à l'encontre dc la tendance <strong>de</strong>s planificateurs qui sou-<br />
haitent orienter les mouvements nigratoirès vers <strong>de</strong>s rézions restées<br />
jusqulà présent marginales, peut peuplécs, et dépourvues d'armature<br />
urbaine - c.e qui se traduit sur une carte fies <strong>de</strong>nsités pu un recteur<br />
impératif allant gL1unc zone <strong>de</strong> forte pression dénographique 5, une zone<br />
<strong>de</strong> faible Censité. Celu vu aussi à ltencoctre d'une ruralisation <strong>de</strong><br />
1 'enseigiienent qui se préscnterri.it sous la forme négative d 'un barrage<br />
freinant l'accès <strong>de</strong>s jeunes au ~iilieu urbain.<br />
Ia pzr-ticipation au fait urbain, tell,: que nous l'avons<br />
cléfinie, n'est pas liée exclusiveilient à la rési~ldnce actuelle. Le<br />
détour urbain est, dans ln plupart <strong>de</strong>s cas, une étape migratoire<br />
~ ~ -<br />
(1) J.C. CIN?~IPiiUD, op. cït. 1972.<br />
~<br />
--------
iiaportante p?r la qualification professionnelle qui y est acquise. Il<br />
en reste un ~iodèle réactivé pcr lcs s6jours teriporaires en ville. Le<br />
d6vc lopperzcnt <strong>de</strong>s voies cle coï~ununicstioiis, 1' économie <strong>de</strong> plantation,<br />
la nul-tiplication <strong>de</strong>s équipements, socio-culturels, ne reii2ent pas<br />
indispensables la rési<strong>de</strong>nce citsdine pour bénéficier <strong>de</strong> la consorc-<br />
mation urbaine. Par la mo2ernisa-tion <strong>de</strong>s milieux ruraux, sous l'ini-<br />
tiative cle nultiplcs agents sociaux, une continuité s'instailre entre<br />
ville et caI;lpaznc et rerriplace le schéma classique <strong>de</strong> llexoJe rural.<br />
Pûr ses caract6ristiqucs, la zone <strong>de</strong> colonisùtion agricole se prête<br />
souvent plus aishrncnt à ce processus <strong>de</strong> moJerriisation.<br />
Janvier 1373<br />
Bhnuscrit reçu ail S.C.D. le 2 juin IS!7J.
BIL"LB1-:R (J.c. ) .- Les villages pioiiniers <strong>de</strong> l'Opération <strong>Yabassi</strong>-<br />
Bafnng. Aspects sociologiques Ce l'émigration<br />
balilil&ks (23 ednc ?.e forêt, ?:ans le zépartenent<br />
du N~GLL. Ohil.;ii'Oi!S, Yaoun[.'.é, 1971, 303 p.<br />
CHABlPkUD (Je) .- Atlas régional Ouest 2. OLXTO~!, Yaoimdé, 19'71,<br />
lS2 p.<br />
CHATflPI'~-In, (J. ) .- L'utilisation <strong>de</strong>s équipci.lent s tertiaires dans<br />
l'ouest i'.u Ca~ncroun. Colloque internat ional du<br />
CNRS sur : lrLz croissance urbaine en kfric uc<br />
Noire et à E1adagascarn, Talence 29 septenbre -<br />
2 octobre 1970. EL'. ClGU, Paris, 1972, p. 401-4-1;.<br />
HAZRINGZR (ph.).- L'observation rétrospective appliquée à l'étu?.e 3i22 -<br />
migration.; africaines, in C3.h. OESTOII, nér. Sci.<br />
Hum., vol, V, no 2, 1968.<br />
HURAULT (,T.).- La st;ructtire sociale L'.es Bailiiléké, éU. Tlouton et<br />
Co., Paris, La Haye, 1962, 133 p.<br />
RAISON (J.F.).- la coloniss.tion ?.es terres neuves tropicales, in<br />
Etu<strong>de</strong>s Rurales, no 31, juillet-septenbrc 1966.<br />
T:.XDITS (c. ) .- Les $ainil&ké Cie l10uest-Canicroun, éd. Berger-<br />
Levrault, I'aris, 1960, 135 p.<br />
Cah. OllS'i'OhI, sér. Sci. Hum. vol. ::, no 2/3-1973 : 205-210,
ET HISSOIJIC DXS POPULiiTIONS :<br />
Tex'üe à paraître dans un Caiiier <strong>de</strong> l109:jTOEI, SGrie Sciences IIumaines,<br />
consacré au théne : l~Tr~ansformatinnn ü o c i ~ l ~ dans n Les liouvellcs zonps<br />
d fiïùplantc:-tinn hiiïnnj nc".
LlOpération <strong>de</strong> développement formule un projet pour <strong>de</strong>s po-<br />
pulations donn6es qui ne tient pas compte en général <strong>de</strong> leur pnss6<br />
historiqua puisqulil s'agit précisément d'orienter ces popul~tions<br />
vers <strong>de</strong>s ~~ctivités économiques nouvelles et bien souvent vers un 2.u-<br />
tre <strong>de</strong>stin. On doit s'attendre alors à <strong>de</strong>s transformations sociilcs<br />
notables du fait <strong>de</strong> l'impact <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>veloppement, et du<br />
déplctceinent éventuel <strong>de</strong> populations hors <strong>de</strong> leur sire d'habitat tra-<br />
ditionnel. Cependant il ne faudrait pas, sous prétexte que l'op
- 57 -<br />
1 - L'OPERATIOM YABASSI-BAFANG<br />
Entre les plateaux <strong>de</strong> l'ouest du Cnnieroun et le littoral,<br />
1'0pGration <strong>Yabassi</strong>-Bùfang échelonne ses 14 villqges d'immigrés <strong>de</strong><br />
part et d'autre d'une route qui traverse l'actuel arrondissement <strong>de</strong><br />
Nkondjok. Il :s'agit d'u'ne opération <strong>de</strong> colonisation agricole dxns<br />
une zonc forestière restée jusqu'à présent à l'écart <strong>de</strong>s grands<br />
axes <strong>de</strong> circulation mis en place par 1' économie coloniale. L'op&r~?,-<br />
tion a &te lancée en jancier 1966, date à laquelle trois villages <strong>de</strong><br />
tlcolons9r (localement appelés llpionniersll) furent installés, conjoin-<br />
tement avec ltnvancée dtun chantier routier.<br />
En 1970, la construction <strong>de</strong> la nouvelle route s'achève p7r<br />
liinauguration du pont <strong>de</strong> Toumbassala sur le Nkam (riv.), mettant<br />
ainsi en relxtion les chefs-lieux <strong>de</strong>s départements vcisins du Ilr.~~l;-<br />
Nkam et du Nkam : <strong>Bafang</strong> et <strong>Yabassi</strong> distants <strong>de</strong> 125 km environ. En<br />
1971, date à laquelle nous avons procédé à une enquête sociologique (11,<br />
14 villages étaient déjà installée et on y recensait 2.500 habitants.<br />
(1) Mous avons effectué 4 missions sur le terrain, dans ltarrond5.?ccfilent<br />
<strong>de</strong> Nkondjok : 3 missions entre le 19 octobre 1970 et 1-c 25<br />
j,?.nvier 1971, et la <strong>de</strong>rnière du 5 juillet nu 5 septembre 1971,<br />
Nous avons surtout fréquenté les 3 premiers villages pionniers<br />
imp1,intés en 1966 (NJINGAM , NGOMAN et NDOK-SAMBA) ainsi que Ie<br />
village MALE près <strong>de</strong> Nkondjok. Du côté autochtone, nous avons<br />
choisi le village <strong>de</strong> Mkokbang-Matin.<br />
Les rGsultats <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> ont été publiés dans un r~~2port ~~1.1tigraphié<br />
: !Iles villages pionniers <strong>de</strong> 1' Opération <strong>Yabassi</strong>-B:- ---- f s<br />
cj.spects sociologiques <strong>de</strong> l'émigration bamil6ké en zone <strong>de</strong> forét<br />
d a<br />
d:lns le Département du Nkam ( <strong>Cameroun</strong>)". ...-. 1971. Yaoundé. ORP'I'OIi.<br />
& I -.<br />
3Ojp, ainsi que dans divers articles :<br />
colonisations agricoles et référence au milieu urbain, exe: 2 le<br />
<strong>de</strong>s villages pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> Yabnssi-<strong>Bafang</strong>, au 1qorT:<br />
Est <strong>de</strong> Doualn (<strong>Cameroun</strong>). in Cah. OlISTOM, sér. Sci. Huin,, vol.<br />
X, no 2/3, 1973, pp. 203-216 ;<br />
- -<br />
-'!Les sociétés bamiléké <strong>de</strong> l'Ouest du <strong>Cameroun</strong> : étu<strong>de</strong> régioilnle<br />
YY-<br />
- a partir d'un cas particulier", 1976, Paris, ORSTOM, coll.<br />
Travaux et Docurilents no 53, lq~ommunautés rurales et paysznfieries<br />
tropicalesf1, pp. 103 à 122.
Ln zone utilisée par cette opération <strong>de</strong> colonisation agricole<br />
est g&ogrnphiquement bien délimitée : le plateau <strong>de</strong> Nkondjok entre le<br />
Nknm (riv.) et -la ~akombé (riv.), au pied <strong>de</strong> la ltfalaise bamilékéti<br />
- clest-à-dire du rebord méridional <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> l'ouest (1). Le<br />
périmètre <strong>de</strong> mise en valeur a une superficie totale <strong>de</strong> 120.000 ha,<br />
partie concernée par la première phase dé l'Op&ration, les cantons<br />
idbang et Ban<strong>de</strong>m Rive-Gauche, représente environ 53.800 ha; mais<br />
compte tenu du relief mouvement6 <strong>de</strong> la region où les pentes sont<br />
souvent très fortes, et, par ailleurs, <strong>de</strong> lloccupntion <strong>de</strong> l'esp-:ca<br />
pnr les populations autochtones,, la superficie pouvant être attri-<br />
buée aux pionniers est plus réduite. En 1971, les terroirs <strong>de</strong>s vil-<br />
lages <strong>de</strong> colonisation couvraient 7 4.350 ha. Dnns une secon<strong>de</strong> phase,<br />
il &tait prévu que <strong>l'opération</strong> franchirait la Makombé (riv.) pnr un<br />
axe E;indjen-HOU~ en direction <strong>de</strong> l'Est vers Ndikinimcki où <strong>de</strong>s<br />
espaces forestiers immenses sont entièrement disponibles.<br />
Cette opération <strong>de</strong> développement, décidée très rapi<strong>de</strong>ment<br />
car il y a très peu d'écart entre le projet (1963) et le dhbut <strong>de</strong><br />
realisntion (les travaux routiers commencent en 19651, répond 5<br />
plusieurs impératifs :<br />
la)- Cette opération est d'abord la conséquence d'une situa-<br />
tion militaire. A la veille <strong>de</strong> ltnccession du <strong>Cameroun</strong> à<br />
l'indépendance, la région <strong>de</strong> Douala et les pays basm et<br />
bamiléké connaissent <strong>de</strong> graves troubles politiques ausés<br />
par <strong>de</strong>s éléments upécistes (2) qui contestent b. fû~on<br />
dont s'opère cette nccession à l'indépendance. En 3960,<br />
l'ensemble du pays bamiléké connait une véritable guerre<br />
civile. L'intervention <strong>de</strong> l'Armée y met rapi<strong>de</strong>ment fin<br />
mais <strong>de</strong>s upécistes se réfugient à la psriphérie <strong>de</strong>s<br />
plateaux bamiléké où-ils forment <strong>de</strong>s maquis. Ils s'ins-<br />
tallent notamment dans--la région <strong>de</strong> Nkondjok (3) où<br />
(1) La d6nivellation est importante et mérite le qualificatif <strong>de</strong><br />
1'Lalaise1' puisque ncus passons en quelques kilomètres <strong>de</strong> 1600m<br />
dfzltitu<strong>de</strong> (les collines <strong>de</strong> ~dumkasa- et <strong>de</strong> Dakkasa dans l'arrondissefilent<br />
<strong>de</strong> ana) à 400-600m qui est l'.altitu<strong>de</strong> du plateau <strong>de</strong><br />
Nkond jok.<br />
(2) L'Union <strong>de</strong>s Populations <strong>Cameroun</strong>aises (U.P.C. ) fut fondée en 1/45<br />
par Ruben Um Nyobé . Desapprouvant la façon dont se déroulait la<br />
d6colonisation, 1'UPC engagea dès 1955 <strong>de</strong>s actions violentes et<br />
forma <strong>de</strong>s maquis en pays basaa puis bamiléké. Des troubles impor-<br />
tants durèrent jusqu'en 7965.<br />
(3) mps maquisards <strong>de</strong> N'doubian, Mbiam, Moya.
e<br />
le relief tourmenté, couvert <strong>de</strong> foret, et à 116.cart <strong>de</strong><br />
toute voie <strong>de</strong> communication, constitue un excellent refu-<br />
ge pour <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> formation et dtentrainement, puis<br />
<strong>de</strong> repli. Le centre administratif <strong>de</strong> Nkondjok qui nv-:it<br />
été créd en 1952 est attaqué en 1960. Par la main mise<br />
sur cette région, les maquisards ont accès au Mungo, à<br />
Douala, et au pays bama, sans avoir besoin d'emprunter<br />
les sxes routiers où les contrôles policiers et nilit,~i-<br />
res sont fréquents. Lors du lancement <strong>de</strong> ltop6ration,<br />
les maquis ont déjà été désorganisés, mais <strong>de</strong>s 61Crnents<br />
isolés restent encore dangereux, et les opérations Cc<br />
nettoyage ont besoin d'un appui logistique : une rout.e<br />
qui traverse cette forêt-refuge. 85 km <strong>de</strong> route nouvelle<br />
furent construits par le Génie Militaire (1) entre<br />
Fopouanga et Toumbassala, et les tronçons <strong>de</strong> route dSjà<br />
existants (<strong>Bafang</strong>-Fopouanga et ~oumbassala- aba as si)<br />
furent élargis (2). Le Département du Nkam était enfin<br />
désenclavé par un axe routier le tr
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les<br />
autorités publiques essaient <strong>de</strong> canaliser les flux rii-<br />
gratoires originaires <strong>de</strong>s plateaux bamiléké, En 1932,<br />
l'administration coloniale constatant ln s~rpopul~~tion<br />
<strong>de</strong> cette région avait dirigé une colonisation xgricole<br />
en pays M6m (~amoun) sur la riv,e gauche du Noun. Loin<br />
<strong>de</strong>s centres urbains et <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> circulation, et uti-<br />
lisant d-es sols relativement pauvres, cet essai ne fut<br />
jmais très probant et en 1967 on recensait seulement<br />
2.400 habitants, Plus au Nord, toujours sur la rive<br />
gauche du Noun, quelques villages bamilbké furent instal-<br />
lés à partir <strong>de</strong> 1937 dans la région du Nkogam sur <strong>de</strong>s<br />
sols plus fertiles.<br />
3 O ) - Les gar<strong>de</strong>s civiques, milice formée en 1960 pour lutter<br />
contre les maquisards, et qui a-~nicnt achevé les princi-<br />
pales t3ches <strong>de</strong> pacification, posaient un problème <strong>de</strong><br />
reconversion, Ils formèrent le premier contingent <strong>de</strong><br />
pionniers (17% dans trois premiers villages) avcc <strong>de</strong>s<br />
civils du plus proche département bamiléké (~aut-~lcam).<br />
A long terme, <strong>l'opération</strong> vise à augmenter la production <strong>de</strong>s<br />
cultures industrielles exportables (café robusta, cacao); quantitltl-<br />
vernent en ouvrant à ltimmigrztion les vastes étendues forestières 2u<br />
Nknm et, qualit,.itiveme.nt, par un encadrement agricole très <strong>de</strong>nse (l),<br />
sélection <strong>de</strong>s plants par <strong>de</strong>s pépinières gérées directement p,?r<br />
l'encadrement technique et l'implantation d'une ferme expérimenta-<br />
le (2).<br />
Lt Opération <strong>Yabassi</strong>-Baf ang , financée par le budget n?.tioilzl<br />
du Cnmeroun et le Fond d'Ai<strong>de</strong> et <strong>de</strong> Coopération (F.H.C.) a &t& lnncse<br />
et g6rée au début par un organisme françqis d'intervention : Soci6-<br />
té Centrale pour 1'Equipement du Territoire - coopération (SCET-COUP),<br />
sous la tutelle du Ministère du Plan. Depuis le 27 octobre 1970, la<br />
gestion est assurée par une société <strong>de</strong> développement selon la loi du<br />
11 juin 1968 : la SODENKAPI (SociGté <strong>de</strong> Développement du Nkam),<br />
(1) Un moniteur agricole par village, soit en moyenne un moniteur<br />
pour 78 pionniers (en 1977).<br />
(2) Le Centre d'Appui ~echni~ue (C .A. T. ) installé à Nkond jok,
- 61 -<br />
II - LA RENAISSANCE DU NKAM<br />
LrOpération Ynbassi-<strong>Bafang</strong> a trouvé les sociét5s autochtones<br />
en plein dGsarroi, affaiblies par l'exo<strong>de</strong> rural vers le Mungo et<br />
Douala, et par les troubles récents. A première vue, le périmètre <strong>de</strong><br />
colonisation correspond à <strong>de</strong>s terres disponibles, c'est-à-dire non-<br />
occupbes, En fait, le déroulement <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> stest heurté 6 une<br />
résistance autochtone, preuve que l'occupation <strong>de</strong> lfespace était plus<br />
iin~ortante qu'on ne l'avait pensée. ~'o~érn-bion a ubrusqu611 (1) les<br />
populations autochtones, mais inversement, on peut dire que lfopGrn-<br />
tion n &té surprise par LE rencontre <strong>de</strong> ces sociétés.<br />
1 1- Pccupation d.e l1 espace par les sociétés autochtones -<br />
Le Département du Nkam est un <strong>de</strong>s dél~nrtements du C,iineroiin<br />
le moins <strong>de</strong>nsément peuplé: 5,72 hab. au km2 en 1966/67. Cependant,<br />
13 répartition <strong>de</strong> population à llintCrieur <strong>de</strong> ce d8pnrtement est<br />
très inégcile : <strong>de</strong>s zones comme celle entre le Nkam (riv.) et 13 limi-<br />
te du D6partement du Mungo sont totalement vi<strong>de</strong>s; à lloppos6, le<br />
Canton Diboum atteint une <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> 21,4 hab. au km2, En gsnéral, la<br />
partie nord du département, malgré son relief mouvementé, a une <strong>de</strong>n-<br />
sité plus &levée que la partie méridionale du département (; llexce~j-<br />
tion toutefois <strong>de</strong>s cantons du Wouri). Une certaine concentration <strong>de</strong><br />
popu1.1tion existe donc au voisinage du Plateau bcimilék@,<br />
Cette situation démographique n'est que le p3le reflet du<br />
peuplement pré-coloninl, et il nous faut comliiencer par Gvoquer la<br />
~ituation <strong>de</strong> cette région qui fût, au XIXe siècle, l'un <strong>de</strong>s princi-<br />
paux rixes <strong>de</strong> pénétration <strong>de</strong>s,produits <strong>de</strong> traits vers ltint6rieur,<br />
notamment vers les chefferies b3milSké et le pays môm (~amoun) une<br />
histoire du peuplement est donc nécessaire.<br />
-<br />
(1) pour reprendre une expression locale courante lorsqulon arrive<br />
à l'improviste chez quelqu'un.
Populations - autochtones <strong>de</strong> l'Arrondissement<br />
<strong>de</strong> Nkondjok en 1966/67<br />
P<br />
G~ntons Pop. totale Superfice Densité<br />
1<br />
en km2<br />
I,---------------------------------------------l<br />
! Bcn<strong>de</strong>in R.G. ..... 782 273 2,8 !<br />
1 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<br />
1<br />
source ORSTOM - Dictionnaire <strong>de</strong>s Villages du Nkam.<br />
Notre enqu&te ne porta pas sur les trnditions d'origine dcs<br />
populations Mbang et nous nous contenterons ici <strong>de</strong> repéter les iiifor-<br />
mxtions déjà publiées à ce sujet. L'Administrateur RAYNAUD dans un<br />
rapport <strong>de</strong> 1937 situe l'origine <strong>de</strong>s Dibum nu Plateau <strong>de</strong> Bnbimbi, à<br />
nBoulig' près <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong>, et au pays bakem près <strong>de</strong> Nkongsarnba. Jean<br />
DIHANG, lui-même originaire du Pays mbang, a recueilli et traduit en<br />
1969, un récit qui situe l'origine <strong>de</strong>s Mbang dans la région <strong>de</strong> Yzbas-<br />
"Kom Ndik (2) serait l'ancêtre <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong>scendants : Mb?ng lfafné,<br />
Yabnssi, Ndogpendn, Yangom et Yabo. Kom Ndik avait donné à ch?-<br />
cun <strong>de</strong> ses fils, <strong>de</strong>s épouses et <strong>de</strong>s moutons. Des querelle?<br />
sfélevèrent bient8t entre Mbang et ses autres frères car, lors<br />
<strong>de</strong>s cultures agricoles, Mbang négligeait <strong>de</strong> parquer ses nou-<br />
tons. Un jour qu'il était parti vers la gran<strong>de</strong> mer pour rendre<br />
visite <strong>de</strong>s amis, ses autres frères profitèrent <strong>de</strong> son 3-bsence<br />
pour tuer ses moutons. De retour, Mbang se sépare <strong>de</strong> ses frè-<br />
res. Il part accompagné <strong>de</strong> sa femme et <strong>de</strong> son fils Ndoun qui<br />
était d&jà né. Il suit le cours du Nkam et le remonte jucqu'à<br />
sa confluence avec la Makombé. Là, il découvre en provenince<br />
<strong>de</strong> la Makombé, <strong>de</strong>s épluchures <strong>de</strong> bananes et par ailleurs llenu<br />
(1) J. DIHANG a traduit dans CAMELANG, Bulletin <strong>de</strong> la Section <strong>de</strong> Linguistique<br />
~ppliquée <strong>de</strong> l'université E'édgrsle du <strong>Cameroun</strong><br />
(no 2, 1969) ce récit <strong>de</strong> Missongui M i Nkongo, du village <strong>de</strong><br />
Ndokonto II.<br />
(2) kom = empoisonné; ndik - liane.<br />
1
semble plus claire. Lorsque Mbang verra <strong>de</strong> la cendre entrninée<br />
pr le cours <strong>de</strong> la Makombé, il aura la certitu<strong>de</strong> que <strong>de</strong>s<br />
groupes humains sont installés dans cette vallée. Il suit<br />
alors cette vallée et la remonte jusqu'à sa source.au lieu<br />
nommé lihngri près' <strong>de</strong> l'actuel village <strong>de</strong> Ndotoron. Durant<br />
cette longue migration, lui et sa famille se nourrissent <strong>de</strong><br />
terre rouge et <strong>de</strong> fruits sauvages. ~rrivé à Lang, le groupe<br />
migrant est <strong>de</strong>couvert. par <strong>de</strong>s chasseurs dibum. Ceux-ci souhaitent<br />
faire du nouvel arrivant un captif, mais ce <strong>de</strong>rnier<br />
e 1Ei ruse <strong>de</strong> se présenter comme l'avant gar<strong>de</strong> d'un groupe<br />
nombreux et menace les chasseurs dibum <strong>de</strong> représailles :<br />
il est chef et <strong>de</strong>s gens le suivent 1''.<br />
Ces quelques renseignements ne sont pas suffisants à eux seuls<br />
pour nous donner.une histoire du peuplement. Notons seulement qu'ils<br />
distinguent les populations Mbang et Dibum llinstallation <strong>de</strong> ces<br />
<strong>de</strong>rnières étant antérieure 8 et par ailleurs, ils évoquent un lien<br />
avec la région <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong> qui est confirmé par les étu<strong>de</strong>s linguisti-<br />
ques t Mbang et Diboum sont inclus dans l'aire bnsaa (1).<br />
Le peuplement <strong>de</strong> cette région au XIXe siècle est par contre<br />
mieux connu. Il dépend étroitement <strong>de</strong> la situation économique d.e<br />
lfépoque. Nous sommes dans un contexte d'économie <strong>de</strong> traite où les<br />
marchandfaee européennes débarquées sur la c8te entre les mains <strong>de</strong>s<br />
tltribus courtièrestl (2) étaient échangées <strong>de</strong> groupes en groupes vers<br />
1~intErieu.r sous forme <strong>de</strong> troc. Sel, fusils, poudre, et pagnes en<br />
provenance <strong>de</strong> la c8te, étaient échangés aux frontières <strong>de</strong> chaque grou-<br />
pe contre <strong>de</strong>s défenses d'ivoire, <strong>de</strong>s esclaves et <strong>de</strong>s noix <strong>de</strong> pah~ier.<br />
Dans cet ensemble socio-6conomique, chaque tribu conservait son en-<br />
tière inclépendance politique et possédait un territoire délimite diune<br />
façon précise. Le réseau hydrographique très <strong>de</strong>nse du département du<br />
Nkzm offre d'ailleurs la possibilité d'établir <strong>de</strong>s frontières Ifnatu-<br />
rellesqi. Au commerce <strong>de</strong> traite se superposait un commerce local parti-<br />
culièrement intense entre <strong>de</strong>ux régions écologiquement distinctes et<br />
. ...<br />
(1) Signalons les étu,<strong>de</strong>s récentes <strong>de</strong> D. BARRETEAU dans le d6partement<br />
du Nkam pour l'élaboration <strong>de</strong> l'Atlas socio-linguistique du Czmerom.<br />
Ces étu<strong>de</strong>s ont trabté~s <strong>de</strong>s langues suivantes : dibubum,<br />
mGpà, kwâ?, ~d~n-ti , bàsàa.<br />
(2) Selon l'expression <strong>de</strong> HJ~RUNSCHWIG - L'avènement <strong>de</strong> 118frique<br />
Noire du XIXe siècle à nos jours. 1963, Paris, Al Colin.
économiquement complémentaires : les plateaux <strong>de</strong> l'Ouest couverts<br />
dtune savane arborée qui est'en maints endroits organisée en bocage, et<br />
les forets du sud du Cgmeroun. Descen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s plateaux (en plus <strong>de</strong>s<br />
termes d'échange <strong>de</strong> l'économie d-e traite, c'est-à-dire <strong>de</strong>s esclaves<br />
et <strong>de</strong>s ivoires) <strong>de</strong>s outils en fer (houes pour la culture, cou.teaux<br />
pour le traitement <strong>de</strong>s palmiers à huile, etc...), <strong>de</strong>s poulets, et<br />
<strong>de</strong>s produits vivriers (haricots, arachi<strong>de</strong>s, etc.. .) ; ceci en échange<br />
principalement <strong>de</strong> l'huile <strong>de</strong> palme car les oléagineux manquent sur<br />
. .<br />
les plateaux.<br />
Les populations diboum profitaient directement <strong>de</strong>s échanges<br />
économiques avec les chefferies du plateau bamiléké. Ces échanges se<br />
faisaient sur <strong>de</strong>s marchés à proximité <strong>de</strong>s frontières, et parfois sous<br />
forme <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>aux que les chefs ou <strong>de</strong> grands notables bamiléké adres-<br />
saient à certains chefs <strong>de</strong> lignage importants <strong>de</strong> la zone forestière,<br />
et réciproquement. Les populations diboum se sont donc massées au bzs<br />
du plateau bamiléké et ce sont elles qui furent les principales pour-<br />
voyeuses <strong>de</strong>s chefferies voisines en huile <strong>de</strong> palme.<br />
Les populations mbang sont immédiatement plus au Sud et ('oivent<br />
transiter par les Diboum pour atteindre les chefferies bamileké. Par<br />
contre elles ont l'avantage <strong>de</strong> se situer le long d'une piste <strong>de</strong><br />
traite importante qui part <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong>, passe par Nkondjok, et se diri-<br />
ge par plusieurs ramifications vers les Plateaux <strong>de</strong> l'ouest. Il s'agis-<br />
sait dtun <strong>de</strong>s principaux axes <strong>de</strong> pénétration <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> traite<br />
<strong>de</strong> ltépoque car, ces produits empruntaient la voie fluviale du iyouri<br />
dontl'cmbouchure était aux mains <strong>de</strong>s Dwala dont nous avons d6ji signa-<br />
lé le r81e prépondérant dans les échanges avec les commerçants euro-<br />
péens. Cette voie fluviale était contrôlée à son terminus par les<br />
Basaa <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong>, et c'est précisément à cet endroit, qui est une rup-<br />
ture <strong>de</strong> charge car les produits ne peuvent remonter ni le Makombé<br />
(riv), ni le Nkam (rivr),lesquels sont pratiquepent <strong>de</strong>s torrents, que<br />
l'enjeu fut principal entre les groupes locaux: BalNd&m et Mbang en-<br />
trèrent en conflit à la fin du XIXe siècle dans leur course pour se<br />
rapprocher <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong>. Les ban^ ef f ectüèrent une vigoureuse avancée<br />
NE-SirI et avaient atteint la rivière Mahé à 18 km au Nord <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong><br />
lorsque les Allemands établirent le statut quo. Ceci confère au pays<br />
mbang un aspect geographique très étiré le long <strong>de</strong> la piste Nkondjok-<br />
<strong>Yabassi</strong>.
Le peuplement <strong>de</strong>s BalNdèm obéit à la même logique. Eux aussi<br />
tendaient vers <strong>Yabassi</strong>. Par contre ils n'offrirent que peu <strong>de</strong> rlois-<br />
tance dans leur partie septentrionale à la <strong>de</strong>scente <strong>de</strong> groupes bai~li-<br />
léké en forêt : quelques bouscula<strong>de</strong>s eurent lieu et les BafNdém d.écro-<br />
chèrent facilement en échange <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>aux en femmes, esclaves et ivoire.<br />
LA pratique <strong>de</strong> ltagriculture itinérante ajoute en plus un cri-<br />
tère p6dologique à notre analyse <strong>de</strong> l'occupation <strong>de</strong> l'espace par les<br />
sociétés autochtones. Par tâtonnement, elle conduisit la plupart <strong>de</strong>s<br />
grouiws à choisir <strong>de</strong>s sols sur basalte en général plus fertiles que<br />
ceux sur socle. Ces sols sur basalte se situaient sur <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong><br />
faible dimension : ainsi à Ndomalang, Sohok, Nkokbang Matin, Nkondjok-<br />
Sahé, et la région <strong>de</strong> Bindjen. Ce critère pédologiyue va dla?lleurü<br />
dans l e meme sens que le premier car, les pistes utilisaient les yuel-<br />
ques plateaux basaltiques <strong>de</strong> la région pour éviter le relief trop<br />
chaotique du socle.<br />
L'administration coloniale trouva donc sur place <strong>de</strong>s socistz~<br />
acéphales dont les populations étaient regroupées le long <strong>de</strong>s pistes,<br />
sous ln forme d'un habitat linéaire échelonné où les chefs <strong>de</strong> famj.1-le,<br />
à distance respectable les uns <strong>de</strong>s autres, gardaient jalousement lcar<br />
autonomie. Elle stabilisa et renforça même cette localisation du peu-<br />
plement en fonction <strong>de</strong>s pistes afin d'exercer un contrôle effectif dc<br />
la population, d'assurer l'entretien <strong>de</strong>s pistes et <strong>de</strong>s $tes ~Itét~~pc .,<br />
et <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong> la main-d'oeuvre pour les corvées du portage. Ili<br />
l'absence d'une route automobilisable, les administrateurs <strong>de</strong>vnicnL<br />
entreprendre une longue marche à pied <strong>de</strong> plusieurs jours : 2 oii 3<br />
étapes pour atteindre Nkondjok à partir <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong>, Ltadainistration<br />
coloniale eut désiré <strong>de</strong> véritables agglomérations, mais un esszi <strong>de</strong><br />
regroupement coercitif avec gar<strong>de</strong>s, mené du 3 au 13 fevrier 1333<br />
nt aboutit cependant qul à I1ef f rayer1' davantage la population; et I- ' ,id -<br />
ministrateur RAYNAUD évoque ainsi la situation du Pays diboum en 1940 :<br />
npopulation évoluée et anarchique, chefs sans autorité, habitations<br />
déplorables. Les gens se dispersent à la seule annonce d'une tournée<br />
administrative, dans les innombrables massifs boisés et acci<strong>de</strong>ntés1I S
La pério<strong>de</strong> coloniale n'entraîna donc pas, au début, <strong>de</strong> :rands<br />
déplacements <strong>de</strong> population. L'administration alleman<strong>de</strong>, puis française<br />
se contenta <strong>de</strong> faire entretenir le réseau <strong>de</strong> pistes existantes, sans<br />
créer d'axe nouveau. Seule la fréquentation plus assidue d'une piste,<br />
au détriment d'autres pistes parallèles, pouvait entrainer quelques<br />
modifications dans la répartition géographique <strong>de</strong>s populations. C'est<br />
ainsi que les Français abandonnèrent la piste par Toumbassala, Bidjen<br />
et Mnkalcan, préférant franchir le Nkma entre Benga et Sahé au SM <strong>de</strong><br />
Nkondjok. Le Pays bat ndêm souffrit à la longue <strong>de</strong> ce délaissement et<br />
oe n'est qu'avec le nouvel axe routier <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>, qui reprend<br />
en partie l'ancien itinéraire I1allemand", que cette région se réarticu-<br />
le avec l'extérieur.<br />
20)- L'adoption <strong>de</strong>s cultures d'exportation<br />
Du fait <strong>de</strong> leur relative proximité <strong>de</strong> la c8te et <strong>de</strong> leur r8le<br />
dtintermédiaires par rapport aux populations <strong>de</strong>s plateaux <strong>de</strong> l10uzst,<br />
les populations autochtones du Nkam (Diboum, Mbang, Ba8 Ndsin, etc.. . )<br />
participèrent activement au commerce <strong>de</strong> traite avant m&me la coloni-<br />
sation. La pren~ière gran<strong>de</strong> spéculation fut d'abord l'huile <strong>de</strong> palme,<br />
non plus seulement pour alimenter les plateaux <strong>de</strong> l'Ouest ( commerce<br />
locd) mais pour exporter sous forme d'huile <strong>de</strong> palme et <strong>de</strong> palmistes<br />
vers 1' Europe.<br />
La p&che a la baleine dans les mers australes et les oliveraies<br />
méditerranaennes, n'étaient plus suffisantes pour faire face aux be-<br />
soins croissants <strong>de</strong> l'Europe en corps gras. L'huile <strong>de</strong> palme prit au<br />
milien du XIXe siècle une telle importance que H. BRUNSCHViIG (1)<br />
n'hésita pas à parler d'une ffcivilisation" <strong>de</strong> l'Afrique caractérisée<br />
par ce produit :<br />
"L'Afrique, enfin, avait autre chose à offrir que <strong>de</strong>s produits<br />
<strong>de</strong> luxe, comme l'or, l'ivoire, les bois <strong>de</strong> teinture. Elle<br />
<strong>de</strong>venait un marché <strong>de</strong> matière première indispensable...<br />
L'huile, <strong>de</strong> palme a été le premier grand produit capable <strong>de</strong><br />
remplamer l'esclave dans lee relations commerciales entre<br />
l'Afrique et le mon<strong>de</strong>, le premier qui ne fat pas ùn luxe<br />
et dont la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> persistaff (p.52).<br />
(1) H. BRUNSCHWIG, op. déjà cité.
'!En 1850.,. aux boucles du Niger, l'huile <strong>de</strong> palme attirait<br />
autant <strong>de</strong> commerçants honnêtes que <strong>de</strong> contrebandiers csclnvn-<br />
gistes. Ce qui était neuf, c'était que, pour la prerniere fois<br />
<strong>de</strong> eon histoire, l'Afrique Noire <strong>de</strong>venait fournisseur drune<br />
matière première indispensable, dont les multiples utilisa~ions<br />
ne cessèrent d'augmenter la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en Europev! (p. 50).<br />
La date <strong>de</strong> 1840 marque un net tournant dans le commerce <strong>de</strong><br />
traite : l'huile <strong>de</strong> palme <strong>de</strong>vient plus important que les esclnves (1).<br />
L'estuaire du Wouri, dans le prolongement <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> la baie du Bis-<br />
fm, connait alors une vive activité car l'arrière pays est riche en<br />
palmeraies naturelles.<br />
Cette activité durera jusqu'à la crise économique <strong>de</strong>s =nnées<br />
30 et fera la prospérité <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong>. En 1922, le missionnaire NICOD<br />
qui allait s'installer à <strong>Yabassi</strong> croise plusieurs embarcations :<br />
",..quelques embarcations, venant <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong>, massives et<br />
lour<strong>de</strong>s, conduites par <strong>de</strong>s hommes musclés et presque nus,<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nt vers la mer <strong>de</strong>s barils d'huile <strong>de</strong> palme, <strong>de</strong>s sacs<br />
<strong>de</strong> cacao et <strong>de</strong> palmistes, les principaux produits d'exporta-<br />
tion'! (2).<br />
En 1930, on recense 17 factories à <strong>Yabassi</strong> dont 9 sont ghrées<br />
directement par <strong>de</strong>s Européens, Ces maisons <strong>de</strong> commerce achètent les<br />
produits <strong>de</strong> l'intérieur, notamment <strong>de</strong>s palmistes, qui leur sont appor-<br />
tés par les indigènes, La concurrence est vive et chaque maison <strong>de</strong><br />
commerce entretient une pirogue sur le Wouri pour faciliter le ps i.GSû.-<br />
ge <strong>de</strong> la clientèle, L'Administration <strong>de</strong> son c8té entretient 4 pirogues,<br />
A l'exploitation <strong>de</strong> l'huile <strong>de</strong> palme qui relève d'une économie<br />
<strong>de</strong> oueillette, s'ajoute une economie <strong>de</strong> plantations : cacaoyers,<br />
hévéas pour le caouthcouc, et bananiers (bananes douces d' exportation).<br />
Avant la crise économique <strong>de</strong>s années 30, la r6gion <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong> faisait<br />
partie, avec le département du Mungo et <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Buéa, <strong>de</strong> la<br />
(1) 13. BRUNSCKWIG, op. déjà cité, pp, 29-51.<br />
(2) K. NICOD - Sur les sentiers <strong>de</strong> l'Afrique Equaotira1e.- s.d.,<br />
Paris, éd. Société <strong>de</strong>s Missions Evangéliques, p. 117.
zone où se sont installées <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s plantztions européennes ('1).<br />
Une pldn-1;ation <strong>de</strong> cacaoyère fut même ouverte en 1913 à Nkond jok, 5<br />
50 km au nord <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong> (2). Au <strong>de</strong>là <strong>de</strong>s plantations européenne^.,<br />
se multiplièrent dès la pério<strong>de</strong> alleman<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s plantations indivi-<br />
duelles autochtones. On retrouve encore aujourd'hui <strong>de</strong> nombreuses<br />
cacaoyères abandonnées tant dans la vallée du biouri que dans la région<br />
<strong>de</strong> Nlïond jok. Vers 1950, le développement <strong>de</strong> la caf éi culturz renouvelle<br />
l'espoir dlun enrichissement par les cultures dlexportation. Les I~Ibang<br />
et Diboum ont en cela un comportement radicalement différent <strong>de</strong>q po-<br />
pulations basaa plus méridionales dont l'économie reste r6solumcn.i;<br />
centrée sur le palmier à huile ce qui a permis à J. CHAMPAUD d'inti-<br />
tuler une étu<strong>de</strong> sur les structures agraires du village basla, MOI1 :<br />
'!*!on ou le refus <strong>de</strong> l'agriculture <strong>de</strong> plantationl1.<br />
3')- La marginalisation du département du Nkam.<br />
Plalgr& ce départ prometteur, le département du Nkam ne va pas<br />
pouvoir dévelspper son économie <strong>de</strong> plantation. Ceci est principalement<br />
dfl à sa marginalisation par rapport aux nouveaux axes <strong>de</strong> communica-<br />
tion mis en place par l'économie coloniale. La région <strong>de</strong> Bu62 et le<br />
dépnrtemcnt du Mungo vont bénéficier en effet d'une infrastructure<br />
rohtière et ferroviaire qui va drainer les produits d'exportation an<br />
détriment du département du Nkam dont le relief est jugé trop chûoti-<br />
que. L'accès aux plateaux <strong>de</strong> l'ouest va se faire dorénavant pzr lc<br />
iilungo . Les planteurs autochtones <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Nkondjok cont-nuér'2nt<br />
d'évacuer leurs produit:, à d.is d'hommes vers <strong>Yabassi</strong>, <strong>Bafang</strong> GLI I2:oil.;-<br />
samba. >'rois Sour-;leur étaient nécessaires. L'encadrement agricole<br />
- -<br />
(1) 11 1gj0, on dénombrait trois plantations européennes dans la r&gio~~<br />
<strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong> :<br />
- Heyward ct RoSins : 141 ha <strong>de</strong> part et d'autre du 'iouri, dont ~ C I I ~<br />
sont exploités en cacaoyers et bananiers. Cette compagnie di::pose<br />
en outr~ <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 100 ha <strong>de</strong> palrreraie naturelle.<br />
- John Holt : 739 ha sur la rive droite, dont 110 ha sont pl~.ntés<br />
en hévéas.<br />
- Lovet : 20 ha <strong>de</strong> bananiers et <strong>de</strong> cacaoyers.<br />
(2) Il s'agit <strong>de</strong> la plantation Kuntz à Sahe, immédiatement au sudouest<br />
du centre administratif actuel <strong>de</strong> Nkondjok.
-.<br />
rerta quasi-inexistant (1 ) . Des caféiers furent'-plantés, mais ils ne<br />
furent ni espacés régulièrement, ni taillés, ni traités.<br />
Les éléments les plus jeunes tireront la leçon <strong>de</strong> ce cous.--<br />
équipement et la décennie 1950-1960 verra une nette accélération Ge<br />
lt émigration. Un quartier "Yaba~si'~ se constitue à Douala. 11 agit<br />
15 d'une émigration définitive typique d'un exo<strong>de</strong> rural. La :-:coL~risx-<br />
tion précoce <strong>de</strong>. la région par les missionnaires (le 21 lvril 1923, le<br />
missionnaire Pierre MBOCK s'installe à IVIoya comme 6ecrétair.e-catécl~iste<br />
du chef <strong>de</strong> ~oya) facilite par ailleurs ces mouvements migratoires. La<br />
partie méridionale du département, dont les sols sont plus pnuvres et<br />
qui ne b6néficie pas <strong>de</strong>s échanges avec les plateaux <strong>de</strong> l'Ouest, est la<br />
plus touchée par cet exo<strong>de</strong> rural.<br />
La région du Nkam fut particulièrement touchée par les -i;z.oubles<br />
<strong>de</strong>s années 60. Les maquisards qui n'étaient plus en sécurité sur lco<br />
plateaux, <strong>de</strong>scendirent en forêt, en Pays diboum et dans les environs<br />
<strong>de</strong> Ii'ioya, pour y installer leurs bases logistiques. Le poste aclrniliis-<br />
tratiî <strong>de</strong> Nkondjok qui avait été créé en 1952, fut attaqué. Le:. villa-<br />
geois subirent le pillage et dûrent payer l'imp8t aux maquisnrd: ,<br />
Lorsyue l'armée contre-attaqua, les villageois furent recrut;,s.pour<br />
1-e portage du matériel. Ceci acheva la dégradation démographique et<br />
économique <strong>de</strong> l'arrondissement <strong>de</strong> Nkondjok.<br />
40-2- -- renaissance . démograph,i,que<br />
LlOp6ration aba as si-~afang fut d'abord pour les autochtones,<br />
ï.a route et avec elle l'installation d'une infrastructure. "I,a route<br />
c'est Iri civilisation" eût l'occasion <strong>de</strong> nous dire un vieux Mbniiz.<br />
Elle apportnit en effet avec elle la possibilité d'une évacuation ino-<br />
<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s produits agricoles, l'implantation d'équipements sociaux<br />
et administrstifs (dispensaires, écoles., postes agricoles, centres<br />
ad~iinistratifs, etc...) .lesquels ne seront plus boudés par le fonc-<br />
tionnaire. La route introduisait également le coinmerce.<br />
(1) En 1959, 12.000 caféiers et 4.000 cacaoyers sont distribuha par<br />
la recente pépinisre <strong>de</strong> Nkondjok, mais cette initiative est<br />
tt;;, rdive .
La route eQt un effet immédiat sur la localisation <strong>de</strong> l'habi-<br />
tat rural et ia taille <strong>de</strong>s exploitations. Deux recensements agricoles<br />
successifs, l'un en 1966 au moment du lancement <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>, l'au-<br />
tre en 1968, permettent <strong>de</strong> saisir parfaitement cette évolution. Les<br />
ohamps vivriers trop éloignés <strong>de</strong> la nouvelle route sont délaissés au<br />
profit <strong>de</strong>s abords immédiats <strong>de</strong> cette route (1). Ils accompagnent l'ha-<br />
bitat qui s'est regroupé linéairement le long <strong>de</strong> l'axe routier. Avec<br />
eux apparaissent aussi <strong>de</strong>s plantations <strong>de</strong> caféiers. Ces déplacements<br />
sont si rapi<strong>de</strong>s que les premiers plans <strong>de</strong> délimitation <strong>de</strong>s terroirs<br />
<strong>de</strong>s villages <strong>de</strong> colonisation agricole s 1 en trouvent perturbés, les<br />
autochtones s'étant installés là où les prospections n'avaient trouvé<br />
que la brouse 1 Les responszbles <strong>de</strong> ces recensements agricoles ne ca-<br />
chent pas leur surprise : "cela correspond à un sursaut d'énergie <strong>de</strong><br />
la population autochtone... cette population que l'on croyait irrémé-<br />
diablement réfractaire à lt effort commence donc à manifester son acti-<br />
vité".<br />
Cette installation le long <strong>de</strong> la route s'accompagne d'un accrois-<br />
sernent <strong>de</strong> la superficie cultivée, d'une part pour faire face aux nou-<br />
veaux débouchés offerts aux produits vivriers (la route alimente désor-<br />
mais le marché <strong>de</strong> <strong>Bafang</strong>, et la main d'oeuvre salariée venue pour le<br />
chantier routier ou pour les besoins <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> est ncmbreuse)(2);<br />
dtautre part parce que l'extension <strong>de</strong>s plantations <strong>de</strong> caféiers ne se<br />
heurte plus au problème du transport <strong>de</strong> la récolte.<br />
-<br />
(1) Le recensement agricole <strong>de</strong> 1968 note le progrès intervenu <strong>de</strong>puis<br />
l'ouverture <strong>de</strong> la route : "...la superficie moyenne <strong>de</strong> l1exploita-<br />
tion passe <strong>de</strong> 110 à 157 ares sur la route (<strong>de</strong> 1966 à 1968), elle<br />
diminue <strong>de</strong> moitié en brousse (1 10 à 55 ares) I La petite exploita-<br />
tion <strong>de</strong> subsistance, souvent inférieure à un <strong>de</strong>mi-hectare, <strong>de</strong>vient<br />
h règle le long <strong>de</strong>s pistes piétonnières(57% en 1968). Cela est dû<br />
essentiellement à ia diminution <strong>de</strong> l'effectif <strong>de</strong> la fanille. Les<br />
exploitations <strong>de</strong> plus d'un hectare, 42% du total en 1966, ne repré-<br />
sentent plus aujourd'hui que 14%. .<br />
Le long <strong>de</strong> la route, le phénomène est inverse : on voit doubler<br />
le nombre d'exploitations <strong>de</strong> plus d'un hectare (38% en 1966, 72%<br />
en 1968). Cette augmentation étant dbe d'une part à llinstalh.tion<br />
<strong>de</strong>s ahamps vivriers le long <strong>de</strong> la route sur les défrichements la-<br />
téraux, et d'autre part aux débouchés que les autochtones ont<br />
trouvés pour écouler leurs récoltes auprès <strong>de</strong>s militaires et <strong>de</strong>s<br />
pionniers dont les champs n'avnient pas encore produit <strong>de</strong> récolte1'.<br />
(P. CAPOT-REY, Do AUDEBERT, R. OWONA - Opération <strong>Yabassi</strong>-Bafaq -<br />
Enquate agricole. Direction <strong>de</strong> l'Agriculture, mai-juin 1968, p. 9.<br />
(2) 300 employés en 1969 pour le chantier routier et 418 employés en<br />
aoat 1971 à la SODENKAM pour les besoins <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>,
-- .<br />
A ces mouvements <strong>de</strong> population internes s'ajoutent d'antres<br />
mouvements d'immigration, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>de</strong> colonisation<br />
agricole proprement dit .<br />
- Des ressortissants rnbang et diboum, stimulés par le développement<br />
actuel <strong>de</strong> l'Arrondissement <strong>de</strong> Nkondjok, n'hésitent p à ren-<br />
trer pour ouvrir une plantation dans leur village d'origine. Ils re-<br />
viennent souvent du Mungo où ils ont pu observer <strong>de</strong>s plantations<br />
bien entretenues. Il s'agit donc là d'un apport dynamique.<br />
- Les populzttions <strong>de</strong>s petites chefferies bamiléké (Mbiarn,<br />
IIoya, Bakwa, Tongo, etc.. .) installées au XIXe siècle à l'Est <strong>de</strong> la<br />
Makombé (riv.) se sont réfugiées au centre administratif <strong>de</strong> Nkondjok<br />
lors <strong>de</strong>s troubles <strong>de</strong>s années 60. La route les retient maintenant.<br />
Cette population est active et ouvre <strong>de</strong>s plantations entre Nkondjok<br />
et la ~akombé(riv.). C'est ~récisément cette immigration qui a nis<br />
en échec le projet d'implantation d'un village pionnier à l'est <strong>de</strong><br />
Nkond j ok.<br />
- Des Bamiléké du département voisin du Haut-Nkarn, viennent<br />
acheter <strong>de</strong>s terrains aux autochtones (1). Le phénomène était encore<br />
très limité lors <strong>de</strong> notre enquête, mais significatif d'une évolution<br />
à long terme : 1~Arrondissement <strong>de</strong> Nkondjok fait désormais partie <strong>de</strong>s<br />
zones où les spéculations économiques sont rentables.<br />
-Le centre administratif <strong>de</strong> Nkondjok végétait <strong>de</strong>puis 1952,<br />
date <strong>de</strong> sa création. En 1966/67 sa population atteignait presque<br />
1.500 habitants et se répartissait en <strong>de</strong> nombreux quartiers ruraux. k<br />
cette date Nkondjok bénéficiait déjà <strong>de</strong> l'immigration <strong>de</strong>s ressortis-<br />
sants bamiléké <strong>de</strong> l'est <strong>de</strong> la Makombé (riv,) venus s'y réfugier, et<br />
<strong>de</strong> la présence <strong>de</strong> nombreux salariés <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>. Le regroupement<br />
<strong>de</strong> la population lors <strong>de</strong>s troubles et l'impact <strong>de</strong> la route, confère<br />
à Nkondjok l'aspect d'une véritable agglomération avec habitat con-<br />
tinu. Aujourd'hui, Nkondjok donne l'impression d'un petit centre du<br />
Ilun$o avec ses cases en carbottes qui se recouvrent <strong>de</strong> t8les, ses<br />
nombreuses constructions, l'ambiance <strong>de</strong> son centre.<br />
(1) Il y a achat du terrain lorsque celui-ci est déjà défriché. Si<br />
c'est la for&t, le nouvel arrivant <strong>de</strong>man<strong>de</strong> lfautorisation au chef<br />
<strong>de</strong> famille le plus proche et lui verse <strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>aux afin d1entre-<br />
tenir <strong>de</strong> bonnes relations.<br />
.
Si on tient compte du fait que la plupart <strong>de</strong>s pionniers sont<br />
d'origine bamiléké, nous constatons que cette renaissance démogrnphi-<br />
que du Nkam s'effectue avec une population composite. Nous <strong>de</strong>vons donc<br />
~rreter, là, notre présentation <strong>de</strong>s populations autochtones (Diboum,<br />
Mbang, ~al~<strong>de</strong>m) afin d'analyser la <strong>de</strong>scente <strong>de</strong>s populations bamiléké<br />
dans la zone forestière du Nkam.<br />
III - LA DESCENTE DES POPULATIONS BPJiILEKE DANS LA<br />
-<br />
ZONE FORESTIERE DU NKAM<br />
Les tr~ditions orales que nous avons pu collecter nuprès <strong>de</strong>s<br />
chefferies bamiléké <strong>de</strong> la partie méridionale du Plateau (7), évoquent<br />
les relations étroites qui se sont très t8t Btablies entre les popu-<br />
lations <strong>de</strong>s plateaux et celles <strong>de</strong> la zone forestière. Ce furent 6.labord<br />
<strong>de</strong>s relations agressives qui se traduisaient par <strong>de</strong>s rafds <strong>de</strong>s popula-•<br />
tions <strong>de</strong> forêt contre <strong>de</strong>s populsti~ns récemment immigrées sur le<br />
rebord du plateaü et non encore orgînisées en gran<strong>de</strong>s chefferies, Le<br />
rapport <strong>de</strong> force s'inversa lorsque les chefferies bamiléké se furert<br />
consolidées et elles effectèrent alors une première <strong>de</strong>scente en for3t<br />
en conquérant le rebord même du plateau et en y assimilant les popil-<br />
lntions. C'est le cas par exemple <strong>de</strong>s quartiers "~otcha" dcs chcfic-<br />
ries Ba-, Bandounkassa, Bakassa et Bntcha. A partir <strong>de</strong> c~tte siti~c..-.<br />
tion srétablirent <strong>de</strong> nombreux échanges foret-savane.<br />
1')- Deux économies complémentaires<br />
Du fait <strong>de</strong> la complémentarité agricole <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux milieux n~.turcls<br />
distincts, le contact forêt-savane est un lieu d'échanges intances. En<br />
plus <strong>de</strong> leurs propres volailles et chèvres, les habitants du platena<br />
allaient chercher dans la zone <strong>de</strong> bocage plus septentrionale d'al~t~L<br />
volaill-as et chèvres pour <strong>de</strong>scendre le tout sur les marchés lii?it:.c-r,k.es<br />
(1) J.C. BARBIER - Le peuplement <strong>de</strong> la partie méridionale du Plntenr-<br />
I&miléké, l'exemple <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Bana. Communication du COI-lc-<br />
que International du CNRS ltContribution <strong>de</strong> la Recherche Ethnolo-<br />
gique à l'Histoire <strong>de</strong>s Civilisations du <strong>Cameroun</strong>", 24-28 septem-<br />
bre-7973, Paris.
aveo les populations forestières, en contrebas du plateau..._ Il-s-<br />
<strong>de</strong>soendaient en outre <strong>de</strong>s produits vivriers qui ne poussent pas faci-<br />
lement en foret : maïs, arachi<strong>de</strong>s, haricots, etc... Les Bamiléké re-<br />
montaient en échange l'huile <strong>de</strong> palme et la diffusait vers la partie<br />
septentrionale du Plateau handicapée par le manque d'oléagineux.<br />
Ltemplacement <strong>de</strong>s anciens marchés ne laisse aucun doute sur llimpor-<br />
tance <strong>de</strong> ces tractations puisqu'une ligne continue <strong>de</strong> ces marchés<br />
<strong>de</strong>ssine la limite entre les <strong>de</strong>ux populations.<br />
A ces échanges foret-savane s'ajoutaient <strong>de</strong>s produits 1ow.u~<br />
commeroialisés sur <strong>de</strong> longues distances : <strong>de</strong> la foret montaient <strong>de</strong>s<br />
peaux <strong>de</strong> léopards, pièces <strong>de</strong> choix dans les trophées <strong>de</strong>s chefferies<br />
bamiléké, <strong>de</strong> la poudre <strong>de</strong> padouk utilisée comme enduit corporel rouge,<br />
<strong>de</strong>s kolas qui seront acheminées jusqulau nord du <strong>Cameroun</strong>, etc...<br />
Inversement, les plateaux alimentaient la zone forestière en outils<br />
<strong>de</strong> fer : houes pour l'agriculture, couteaux et perçoirû pour l'ex-<br />
ploitation du palmier à huile. Les forgerons du quartier Lum à Ba-<br />
bouantou, et ceux <strong>de</strong> Bangoulap, semblent avoir joué un rôle important<br />
pour la region que nous étudions.<br />
Enfin, le commerce <strong>de</strong> traite.superpose à ces échanges loczux<br />
un vaste va et vient <strong>de</strong> produits d'exportation (esclaves et ivoires<br />
en provenance <strong>de</strong>s plateaux) et <strong>de</strong> produits d'importation (fusils,<br />
poudre, sel, perles, etc. .. en provenance <strong>de</strong> la c8te).<br />
Tous ces produits circulent par un réseaux <strong>de</strong>nse <strong>de</strong> pistes dont<br />
la oarte Moisel <strong>de</strong> 1913 donne une première image. L'ensemble est<br />
orienté du Nord-Est au Sud-Ouest vers les estuaires, Les marchés se<br />
situent aux frontières <strong>de</strong> chaque groupe qui cherche à maintenir et à<br />
augmenter son r81e d'intermédiaire par rapport aux autres groupes.<br />
Les passages difficiles <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong>s points stratégiques dont le<br />
ooï?1tr8le assure <strong>de</strong>s avantages économiques certains : les gués, les<br />
ponts <strong>de</strong> liane&, le6 pistes qui <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nt le rebord abrupt du Pla-<br />
teau, etc.. . Les chefferies méridionales du Pays bamiléké, au contact<br />
<strong>de</strong> 12 savane et <strong>de</strong> la foret, contrôlent chacune une ou plusieurs<br />
pistes qui les relient à la région <strong>de</strong> Nkondjok laquelle introduit à<br />
ltestmire du Wouri.
20)- Les chefferies bamiléké installées au XIXe siècle<br />
à l'Ouest <strong>de</strong> la Plakombé<br />
La pénétration <strong>de</strong> la forêt par <strong>de</strong>s migrants <strong>de</strong>scendus du<br />
Plateau, illustre, avec pertinence, le contexte économique et poli-<br />
tique du XIXe siècle. De Bana à Bangangté, les chefferies du rebord<br />
du Plabau prennent <strong>de</strong> l'importance et exercent un contr8le plus au-<br />
toritaire sur leurs propres populations et les nouveaux immigrants.<br />
Face à ce renforcement <strong>de</strong>s pouvoirs centraux, les notables préfèrent<br />
parfois s'exiler nvec leurs partisans et aller grossir le front pion-<br />
nier du peuplement. Ils y sont, par ailleurs, souvent poussés par <strong>de</strong>s<br />
mSds <strong>de</strong> cavaliers Bamoun qui atteignent le Nd;. Or, dans la secon<strong>de</strong><br />
moitié du XIXe siècle, l'occupation <strong>de</strong> l'espace sur le Plateau barni-<br />
léké est en voie d'achèvement. Par contre, la forêt, entre les vallées<br />
<strong>de</strong> la Makomsé et du Ndé, n'offre pratiquement pas <strong>de</strong> résistance, Les<br />
popuhtions Ba'Nd&m regar<strong>de</strong>nt maintenant vers 1s &te, et luttent nvec<br />
les Banen et les Mbang pour se rapprocherl <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong> jusqu'où remontent<br />
les pirogues <strong>de</strong>s Dwala et <strong>de</strong>s populations <strong>de</strong> l'estuaire du Wouri. C'est<br />
ainsi que les groupes BatNd&m les plus septentrionaux, en contact avec<br />
les populations <strong>de</strong>scendues <strong>de</strong>s plateaux, cè<strong>de</strong>nt volontiers leurs ter-<br />
rains en échange d'outils en fer, <strong>de</strong> femmes et d'esclaves.<br />
La foret, outre l'assurance <strong>de</strong> pouvoir conserver une grnn<strong>de</strong><br />
autonomie politique, <strong>propos</strong>e aussi l'occasion <strong>de</strong> s'enrichir ra2i<strong>de</strong>-<br />
ment par le trafic esclavagiste, la vente <strong>de</strong> l'huile <strong>de</strong> palme sur le<br />
Plateau* et l'exportation <strong>de</strong>s palmistes vers la c8te.<br />
Cette <strong>de</strong>scente en forêt aboutit, dans un premier temps, à une<br />
multiplication <strong>de</strong> petites unités politiques - chacune étant un groupe<br />
d'immigrants dirigé par un notable qui, une fois installé, s'arrange<br />
avec les chefs voisins pour recevoir le titre <strong>de</strong> chef. Ces groupes<br />
conservent jalousement leur indépendance vis-à-vis <strong>de</strong>s chefferies du<br />
Plateau* telles que Bazou et Banunga qui ont <strong>de</strong>s visées sur les pal-<br />
meraies.
dcssinf iiar lc Service Caitgraphique du Centre ORSTOM <strong>de</strong> Yaoundk<br />
u 11400 mètres et plus<br />
Limlie ~ptentrion<strong>de</strong> <strong>de</strong> la foret<br />
a Chefferle<br />
O uni~kcfirls, quutler ou Ilsu-dl1<br />
10?30'<br />
, 1.C. BARBIER, ORSTOM,1972
Nous avons affaire à un véritable front pionnier <strong>de</strong> peuple-<br />
ment orienté par les activités les plus spéculatives <strong>de</strong> l'époque<br />
c'est à dire le trafic esclavagiste et l'exploitation <strong>de</strong> la palmeraie<br />
ni~turelle. Les notables et les chefs pratiquent eux mêmes pe~sonnel-<br />
lement ces activités. Ainsi cette histoire <strong>de</strong> Ngantchu, Chef <strong>de</strong><br />
Bakwa qui, très vieux et aveugle, se mettait au bord <strong>de</strong> la piste en<br />
ayant caché <strong>de</strong>s servi6eurs aux alentours. Il interpellait , alors,<br />
le passant :<br />
- "Qui es-tu ?Il<br />
- llClest moi"<br />
IlQui ga 2'1<br />
- "Clest moi, un tel"<br />
-<br />
l'As-tu vu Ngantchu<br />
IlNonu.<br />
Cette <strong>de</strong>rnière réponse était fatale au malheureux passant qui n'avait<br />
pas su reconnaitre son chef sous les traits d'un pauvre aveugle<br />
attendant 11aum8ne 1<br />
Ainsi Kolonga qui fonda la chefferie Bakakan, et qu'une chan-<br />
son populaire présente comme un croque-mitaine pour les enfants déso-<br />
béissants qui ne veulent pas marcher vite :<br />
1lKolonga sort t8t le matin<br />
Il met son fusil à l'épaule<br />
S'il trouve un enfant, il ramasse seulement<br />
comme l'épervier ramasse les poulets,<br />
et si l'enfant résiste il tape <strong>de</strong>ssus 1<br />
S'il trouve un homme, il ramasse seulement.<br />
S'il trouve une femme, il ramasse aussi.<br />
Si tu ne marches pas vite, attention à Kolonga,<br />
oar c'est un homme sans pitié.<br />
Si tu ne marches pas vite, cela te regar<strong>de</strong> :<br />
marche comme tu le fais, et tu verras".<br />
Et les Bakakan évoquent la gaieté <strong>de</strong> Kolonga lorsqu'il enten-<br />
dait <strong>de</strong>s bruits <strong>de</strong> bagarres dans un quartier ennemi. Sa réputation<br />
était telle que les habitants <strong>de</strong> la région le précédaient sur son<br />
itinéraire par un appel sonore pour prévenir les passants éventuels:<br />
11kdlo k8loho".
Ces petites chefferies bamiléké installées en foret grossis-<br />
saient rapi<strong>de</strong>ment car le noyau initial intégrait d'autres groupes<br />
'lignagers et les esclaves non vendus pouvaient trouver place dnns la<br />
catégorie <strong>de</strong>s'serviteurs, ces <strong>de</strong>rniers étant ensuite installés comme<br />
notable6 une fois leur service accompli auprès du Chef. En l'espace<br />
dtun <strong>de</strong>mi-siècle, <strong>de</strong>s groupes bamiléké occupèrent toute la foret <strong>de</strong><br />
la vallée du Nd6 à celle <strong>de</strong> la Makombé. Le groupe <strong>de</strong>s Bakakan fran-<br />
chit m&me la Makombé et s'installa au sud <strong>de</strong> Nkondjok. Le comporte-<br />
ment cocio-économique <strong>de</strong> ces groupes ne se différenciait pas <strong>de</strong>s po-<br />
pulz.tions autochtones voisines (~iboum, Mbang, Banen, ~a'n<strong>de</strong>m) puisque<br />
nous avons vu précé<strong>de</strong>mment que tous ces groupes participaient nctive-<br />
ment au commerce <strong>de</strong> traite. Par ailleurs les chefferies restaient <strong>de</strong><br />
taille restreinte, guère distinctes en volume d'un segment lignnger.<br />
Seule lforganisation sociale différait suffisamment gour avoir attiré<br />
l'attention <strong>de</strong>s premiers visiteurs européens. Ainsi le témoignage du<br />
premier missionnaires à avoir franchi la Makombé :<br />
"Quand nous y pénétrâmes pour la première fois, nous eûmes<br />
tout <strong>de</strong> suite l'impression <strong>de</strong> nous trouver dan6 une sociéte<br />
mieux organisée que celle <strong>de</strong>s tribus dont nous venions <strong>de</strong><br />
parler (1) et paraissant avoir gardé une empreinte plus pro-<br />
fon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s coutumes ancestrales. Les chefs, autoritaires, ha-<br />
bitent <strong>de</strong>s agglomérations <strong>de</strong> hautes cases protégées par <strong>de</strong>s<br />
palissa<strong>de</strong>s. Ils ont <strong>de</strong> grands harems. On rencontre là <strong>de</strong>s mni-<br />
sons affectées aux sociétés secrètes, <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s femmes<br />
portant <strong>de</strong> longues chevelures grasses, <strong>de</strong>s individus dont le<br />
visage est caché par une cagoulef1 (2).<br />
Cette immigration bamiléké en foret se fait en tâche d'huile<br />
qvec une occupation continue <strong>de</strong> l'espace. Lec BatN<strong>de</strong>m qui étcient les<br />
occupants <strong>de</strong> cette région se retirent progressivement en échangeant<br />
leurs terres et ieurs palmeraies contre <strong>de</strong>s fammes, <strong>de</strong>s esclaves et<br />
- -<br />
(1) Ltauteur avait parlé précé<strong>de</strong>mment <strong>de</strong>s Basaa, Badjop, Minié, Banen<br />
et Dibum. La différence qu'il note est celle qui existe entre une<br />
société centralisée en chefferies (~amiléké) et une société li-<br />
gnagère ét aoéhhale (~asaa).<br />
(2) Henri NICOD - La vie mystérieuse <strong>de</strong> l'Afrique Noire - 1943. éd.<br />
Pnyot - busanne - p. 20.
<strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> fer. Il ne s'agit donc pas d'une intrusion brutale. Ce<br />
mo<strong>de</strong> dtoccupation <strong>de</strong> l'espace délimite <strong>de</strong>s frontières ent~e les groupes,<br />
frontières qui sont jalousement gardées comme en témoigne l'inci<strong>de</strong>nt<br />
qui o?posa le Chef administratif du Canton Mbang et le Chef <strong>de</strong> Noya en<br />
1933 à <strong>propos</strong> du quartier Yabien qui était un enclos mbang à l'est <strong>de</strong><br />
la Makombé, et que le Chef <strong>de</strong> Moye voulait accaparer en invoquant les<br />
nouvelles limites départementales qui empruntaient la vallée <strong>de</strong> la Ma-<br />
koinbé. Les groupes ethniques restaient donc juxtaposés et les &changes<br />
se faisaient <strong>de</strong> groupe à groupe, souvent sur <strong>de</strong>s marchés loccilisés aux<br />
frontières.<br />
Il n'en est plus <strong>de</strong> même aujourd.'hui où les groupes sont iin-<br />
briqués les uns les autres dans un même espace régional.<br />
IV- UN ENSEMBLE REGIONAL PLURI-ETHNIQUE<br />
Au début du XXe siècle, les pays dibum et mbang sub5-sseizt do115 rrrt-<br />
pression démographique directe <strong>de</strong>s populations bamiléké. Nous venons <strong>de</strong><br />
voir que les groupes bamiléké avaient atteint la vallée <strong>de</strong> la I~ial~om'o<<br />
qu'un élément avait meme franchi. Au nord du Pays dibum nou;: avons 72<br />
m&me situation, à savoir la <strong>de</strong>scente en forêt <strong>de</strong> populations bnniléki.<br />
Celles-ci s'inscrivent aujourd'hui dans lfArrondissement du IlPetit<br />
Diboumn sous la forme d'une mosaïque <strong>de</strong> petites chefferies : Fondjanti,<br />
Bakambé, Fopouanga, Komako, Bagouaka, Bapouate, Mboma, Kounov, B~.boutcha<br />
Fongam, Balouk et Makouk dans la vallée m&me du Nkam. On peut penser que<br />
si le département du Nkam n'avait pas 6té marginalisé comme il l'a été<br />
- par le nouveau réseau <strong>de</strong> voies <strong>de</strong> communication, bref s'il n'avait pas<br />
été <strong>de</strong>sservi par son relief chaotique, c'est sur son territoire et non<br />
dans la région voisine du Mungo que se serait effectuée ltex:~ansion<br />
bamiléké. L'absence d'axe routier Ôtait en effet tout intérêt à un?<br />
éventuelle immigration. Seuls quelques commerçants bamiléké se fixè-<br />
rent à Nkondjok lorsque s'ouvrit le centre adi~inistratif en 1952,<br />
L'axe routier Bafan-<strong>Yabassi</strong> en m8me temps quf il déçenchvnf.t<br />
le Département du Nkam, l'ouvrait à l'immigration bamiléké, Celle-ci<br />
nurait d'ailleurs pu se réaliser spontanément, sans encadrement techni-<br />
.que particulier, du sipple jeu <strong>de</strong>s spéculations économiques <strong>de</strong>s E&rniléké<br />
et <strong>de</strong>s autochtones. Nous savons qu'il n'en fut pas ainsi car les pou-<br />
voirs publics voulurent contraler <strong>de</strong> près ce processus et l'immigra-<br />
tion fut dirigée.
Le résultat en a été une ingérence directe, en plein coeur du<br />
Pays mbang. L'application <strong>de</strong> la loi domaniale <strong>de</strong> 1963 periiict <strong>de</strong> consi-<br />
dérer cornine faisant partie du Patrimoine National Collectif tous les<br />
terrains non utilisés par les populations autochtones (1). D?.n:: le cas<br />
<strong>de</strong> 110pération <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>, on délimita en fait <strong>de</strong> véritables ré-<br />
serves autochtones réduites aux seuls terrains cultivés ou. en friche,<br />
rGp6tant ainsi quelques dizaines d'années plus tard la <strong>de</strong>me situation<br />
qu'il y eut dans le Mungo lorsque lladministration voulut encourager<br />
les mouvements d'immigration.<br />
Le plan directeur <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> visa d'emblée une occupation<br />
maximum du périmètre <strong>de</strong> mise en valeur et les terroirs <strong>de</strong>s nouveau vil-<br />
lages englobèrent d'anciennes cacaoyères abandonnées mais sur lesquelles<br />
continuaient à s1 exercer <strong>de</strong>s droits fonciers car, ln forêt appartient<br />
ici à celui qui la défriche, ainsi que <strong>de</strong>s palmeraies naturelles. Les<br />
travaux <strong>de</strong> délimitation avaient en effet été réalisés en burecux à par-<br />
tir dtuiz fond topographique et d'une couverture <strong>de</strong> photographies :lérien-<br />
nes, sans avoir été préc6dés par une étu<strong>de</strong> suffisante <strong>de</strong> ltéconoinie <strong>de</strong>s<br />
villages mbang.<br />
Les premiers contacts au niveau <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> village furent ce-<br />
pendant positifs car ces <strong>de</strong>rniers voyaient dans les ltpionniersn <strong>de</strong> nou-<br />
veaux habitants capables <strong>de</strong> gonfler la taille <strong>de</strong> leurs vilhgcs et donc<br />
indirectement leurs in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> collecteur d'imp8ts. Les Chefs <strong>de</strong> vil-<br />
(1) L'article 3 du décret-loi no 63-2 du 9 janvier 1963 définit les<br />
terrains coutumiers qui ne peuvent pas etre inclus dans le Pntrimoi-<br />
ne Collectif National : "sont considérés comme en la possession <strong>de</strong>s<br />
individus ou collectivités :<br />
Io)- les superficies qu'elles occupent effectivement et conformé-<br />
ment à la coutume (construction, cultures, etc) et celles<br />
nécessaires à la pratique <strong>de</strong> ln jachère et <strong>de</strong>s pfitura~cs ;<br />
20)- les superficies jugées indispensables à une extension ulté-<br />
rieure <strong>de</strong>s cultures pour tenir compte <strong>de</strong> llnugmentation <strong>de</strong><br />
la population et <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> mise en vnleur,<br />
Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong> ces superficies sera fixé par décret.<br />
Le terme <strong>de</strong> collectivité coutumière désigne un ensemble <strong>de</strong> personnes<br />
réunies par <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> parenté, adoption ou associ~tion ct<br />
qui vivent ensemble sur un même territoire". L'art. 27 <strong>de</strong> la présente<br />
loi stipule que ''les collectivités gar<strong>de</strong>nt sur l'ensemble <strong>de</strong><br />
ces terres leurs droits d'usage traditionnels (chasse, cueillette,<br />
?arc, parcours, etc.) tant que l'exercice <strong>de</strong> ces droits nlest pas<br />
incompatible avec la <strong>de</strong>stination que leur aura donnée ltEtatlt.
kges s'aperçurent très vite que les nouveaux arrivants 6chnppaicnt en<br />
tièrenent à leur contrôle. Les conflits fonciers provoqués par une<br />
d6limitation trop restreinte <strong>de</strong>s "réserves autochtones" dbtériorèrent<br />
rapi<strong>de</strong>ment la situzttion (1). Les responsables <strong>de</strong> l'Opération durcnt<br />
méme supprimer <strong>de</strong>s villages qui avaient été initialement prCvus par<br />
le plan directeiir. Dès le début se posa donc un problème <strong>de</strong> reLitions<br />
inter-ethniques du fait même du caractère directif <strong>de</strong> la coloni~ation<br />
ngs-icole, et <strong>de</strong> la reconnaissance, et du type <strong>de</strong> relation qui présidait<br />
aux échanges commerciaux entre ces populations à une époque ant6rieure.<br />
A cette ingérence foncière s 'a joute un encadrement technique et<br />
<strong>de</strong>s équipements sociaux-culturels au service <strong>de</strong>s pionniers et dont ceux-<br />
ci sont les premiers b6neficiûires. Ceci ne peut que provoquer une<br />
jalousie <strong>de</strong>s villngeois autochtones. Certes les équipements m i s en place<br />
poir lrOpération profitent à tous : les dispensaires et les écoles reçoivent<br />
les autochtcnes au même titre que les pionniers, mais ceux-ci<br />
- outre l'ai<strong>de</strong> directe qui leur est accordée du fait <strong>de</strong> leur engagefi-ent<br />
dz.1l.s lt Opération - profitent <strong>de</strong> leurs relations directes avec 1' encadre-<br />
ment et apparaissent privilégiés :<br />
- un moniteur agricole se trouve dans chaque village pionnier, alors que<br />
<strong>de</strong>ux moniteurs seulement s'occupent <strong>de</strong> l'ensemble du Canton nhang ;<br />
- L- SODENKAM distribue volontiers <strong>de</strong>s plants aux autochtones lorsque<br />
les pionniers ont déjà été servis. Or les pépinières ne cuuvren-t, pas<br />
toujours les besoins <strong>de</strong>s seuls pionniers.<br />
II n'en est plus <strong>de</strong> même aujourd'hui où les groupes sont i m -<br />
briqués les uns les autres <strong>de</strong>n6 un même espace régional.<br />
- l es programmes d'animation sanitaire se limitent aux villages y~ion-<br />
niers ;<br />
- les premières années <strong>de</strong> l'Opération, les camions <strong>de</strong> ln SODETJiIAPI<br />
starrêtnient volontiers pour prendre au passage <strong>de</strong>s pionniers2 qui<br />
voulaient se rendre à Nkondjoc, Sohok, ou <strong>Bafang</strong>.<br />
(1') Ces c~nflits<br />
prennent <strong>de</strong> It-i.npleur iu niveau symbolique même si<br />
2 l'origine les biens économiques qui font l'enjeu du litige sont<br />
<strong>de</strong> peu <strong>de</strong> valeur ; l a terre dans la région <strong>de</strong> Xkondjok n'a p:is<br />
encore acquis une véritable valeur marchan<strong>de</strong>.
Ces quelques exemples parmi bien d'autres suffisent à expli-<br />
quer qu'une telle comparaison quotidienne avec les pionniers ait fait<br />
=ftre chez les autochtones une frustration relative. Certes, la SO-<br />
DENKAM ne reçoit pas <strong>de</strong> budget complémentaire pour s'occuper <strong>de</strong> l'&qui-<br />
pement <strong>de</strong> tout IfArrondissement <strong>de</strong> Nkondjok et il serait injuste <strong>de</strong><br />
lui faire grief d'une telle situation, mais c'est tout le problène <strong>de</strong><br />
l'articulation dtune opération <strong>de</strong> développement avec les services tech-<br />
niques existcnts dans une unité administrative qui se trouve ainsi posé.<br />
Le recensement agricole <strong>de</strong> 1968 débouchait déjà sur un tel<br />
problème r<br />
t'Malgré les efforts <strong>de</strong> la SCET-Coopération qui apporte son nssistance<br />
technique aux familles autochtones dès que celles-ci<br />
en manifestent le désir, on risque <strong>de</strong> voir se creuser un fossé<br />
entre les populations autochtones sous-encadrées et les villages<br />
pionniers qui ont chacun leur moniteur. Deux ethnies différentes,<br />
l'une d'un niveau <strong>de</strong> vie plus élevé que l'autre et vivant c8te<br />
à c8te, voilà les conditions idéales pour aboutir à <strong>de</strong>s frictions<br />
qui pourraient être graves. Il faut associer dans toute<br />
mesure du possible les autochtones à toutes les innov n t' ions<br />
techniques et ne pas attendre que les M'bangs sollicitent une<br />
ai<strong>de</strong>, un conseil" (1).<br />
Et les auteurs <strong>de</strong> ce recensement souhaitaient que <strong>de</strong>s ressources finsn-<br />
oières supplhrnentaires soient dégagées afin que <strong>l'opération</strong> contribue<br />
à la promotion <strong>de</strong>s populationfi autochtones.<br />
~us~u'à présent, la politique <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> vis-à-vis <strong>de</strong>s so-<br />
ciétés autochtones a ét6 résolument intégrationniste: les autochtones<br />
sont invités à regrouper leur habitat dispersé en village et à s'ins-<br />
crire comme pionniers, et ceux qui sont proches d'un village pionnier<br />
à sty intégrer. En fait, une telle <strong>propos</strong>ition n'a reçu d'écho que chez<br />
les jeunes revenus <strong>de</strong> ville et qui souhaitent eux-aussi, bénéficier <strong>de</strong><br />
l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>'ltEtat pour le démarrage <strong>de</strong> leur plantation. Trois villages<br />
(1) P. CAPOT-REY, D. AUDEBERT, R. OWONA. - Opération Yobassi-Bafas,<br />
enquete agricole. Direction <strong>de</strong> l'Agriculture - m ai- juin 1968, p.41.
<strong>de</strong> jeunes autochtones ont été ainsi Ins.kallSs (1). Cette intcgration<br />
<strong>de</strong>s jeunes autochtones dans la société pionnière se fait avec l'auto-<br />
risation <strong>de</strong>s vieux : c'est pour eux le moyen <strong>de</strong> faire venir ln piste<br />
carrossable et <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> ln proximité diéquipements socixux.<br />
Elle se fait aussi sur les conseil-s <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> ln famille <strong>de</strong>venus<br />
fonctionnaires et ci tac.i.ns et qui voient dans les conditions d'ai<strong>de</strong><br />
offertes par l'Op8rakion, 12 moyen diinstaller à peu <strong>de</strong> frais un jeune<br />
frère ca<strong>de</strong>t,<br />
Une telle politique Intégrationniste pose aux sociétéo nutoch-<br />
tones une alterns-tive qui ressemble à an ultimatum : rester d3ns une<br />
situation marginale où accepter la présence d'un village pionnier pro-<br />
che, ce qui entrnine le départ <strong>de</strong>s jeunes mmme pionniers. Ceux-cf- sont<br />
certes sztisfaits <strong>de</strong> banéficier <strong>de</strong> liai<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1lEta.L: p0u.r la mise en<br />
valeur diune plantation, nais c'est au prix d'un Eclatement <strong>de</strong> lcur<br />
propre société et <strong>de</strong> ln disparition <strong>de</strong> son originalité 6cononique, 0ï.<br />
voit mal en effet comment <strong>de</strong>s adultes, ayant déjà une plmtation et uile<br />
palmeraie, et un statut social dans leur société traditioncellc, pal-~r-<br />
raient se faire pionniers : Dans llimnédiat cet apport autochtoric. c:iV:.c:<br />
dans les bilans <strong>de</strong>s campagnes <strong>de</strong> recrutement et laisse à penscr -~ii.:-~:<br />
effort est fait en faveur <strong>de</strong>s autochtones. Cependant, cette politlqze<br />
intégrationniste supprime toute possibilité d 1 établir une çornpl6rlc:? '-7..<br />
rité économique entre immigrés et autochtones. Or cette notion dc coc-<br />
plémentarito économique entre groupes sociaux distincts mais rS~id?r:L<br />
" sur un meme territoire, nous apparait comme le début d'une éconoL1ie p:us<br />
complexe où les échanges locaux se multiplient et où les activltcs &ci-<br />
nomiques se diversifient.<br />
Le développement d'une telle complémentairté &conornique exige.-<br />
rait la création d'un réseau <strong>de</strong> pistes secondaires carrossables? un<br />
encadrement agricole renforcé <strong>de</strong>s populations autochtones, et l10r.g~-<br />
nisation <strong>de</strong>s circuits commerciaux.<br />
(1) JIPe RAISON - ïa colonisation <strong>de</strong>s terres neuves tropicales.- in<br />
Etu<strong>de</strong>s Rurales no 31, juillet-septembre 1968.<br />
Ce texte représente une première synthèse <strong>de</strong>s tr3vaux menés par<br />
plusieurs géographes <strong>de</strong> llORSTOM sur le thème : colonisation ücs<br />
terres neuves.
En fait, cette compiémentarité économique est vécue quotidien-<br />
nement et donne lieu à <strong>de</strong>s initiatives individuelles, mais elle n'est<br />
pns reprise nu niveau <strong>de</strong>s pouvoirs publics dans un plan <strong>de</strong> dévelopse-<br />
ment régional.. LI 3 autochtones peuvent apporter sur les marchés locaux<br />
<strong>de</strong> l'huile et <strong>de</strong>s produit:^ vivriers. Les pionniers quant à eux arrivent<br />
avec c.n savoir-fai1.o tech~iique acquis lors <strong>de</strong> séjours ant6rieurs dans<br />
les petits centres urbains <strong>de</strong> Mnngo ou à Dou2la; on trouve parmi eux<br />
<strong>de</strong>s maçonc, dzs charpentiers, Ces menuisiers, <strong>de</strong>s matelassiers, <strong>de</strong>s<br />
cordonniers, <strong>de</strong>s coiffeur?, dcs réparateurs <strong>de</strong> vélo, <strong>de</strong>s couturier(e)s,<br />
etc*. , Certains :iutochtones qui veulent consoli<strong>de</strong>r leur statut social<br />
<strong>de</strong> planteurs ais;s, n'hésitent pas à faire appel à ce savoir faire<br />
technique <strong>de</strong>s pionniers pour améliorer leur habitat. En plus <strong>de</strong> ces<br />
activités artisanales, les pionniers ouvrent <strong>de</strong>s boutiques <strong>de</strong> commerce<br />
et <strong>de</strong>s débits <strong>de</strong> boisson, puis investissent dms les moyens <strong>de</strong> tr-.ns-<br />
port.<br />
Les rivalités entre groupes ethniques se situent également à<br />
un nLvcxu politique. Comme dans les autres zones où s'effectue une im-<br />
migration bamiléké massive, les populations autochtones conservent -<br />
meme si elles sont minoritaires - l a "chefferieIl administrative du<br />
canton. Nous disons chefferie administrative car il ne s'agit nulleirient<br />
d'une institution traditionnelle, mais d'une création pour les besoins<br />
<strong>de</strong> lla&iiinistration coloniale puis actuelle. Elles cherchent aussi à<br />
conserver la prisi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s organes locaux du Parti Politique. Or cette<br />
institution politique est relativement ouverte et la compétition dans oci<br />
cadre là peut s'avérer vive. P?r ailleurs, <strong>de</strong>s pressions en termes<br />
ethniques s'exercent sur l'administration lors <strong>de</strong> la nomination <strong>de</strong>s<br />
cadres responsables <strong>de</strong> 1' Opération.<br />
L'Opération <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> a donc eu comme effet <strong>de</strong> rét,zblir<br />
lcs rehtions entre <strong>de</strong>ux ensembles ethniques après une phase historique<br />
où elles s'étaient estompées. Cette mise en relation s'est faite dans<br />
un contexte <strong>de</strong> colonisation agricole dirigée et la situation a donc 6th<br />
imposhe nux populations autochtones, ce qui modifie quelque peu le mo<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> relation inter-ethniques qui présidait aux XIXe siècle où les groupes<br />
entretenaient <strong>de</strong>s rapports relativement égnlitaires.
DCsencL,-~vées et confrontées <strong>de</strong> nouveau à <strong>de</strong>s groupes ethniques<br />
voisins, les populations autochtones vont en quelque sorte renouer nvec<br />
une histoire où ils pouvaient avoir <strong>de</strong>s initiatives économiques. Il en<br />
est <strong>de</strong> meme <strong>de</strong>s populations bamiléké déjà immigrées en forêt ou désirant<br />
le faire. On peut s'attendre à ce que cette reprise <strong>de</strong> l'histoire,<br />
accélér6e par l'impact d'une opération <strong>de</strong> dévelo~pement, induise <strong>de</strong>s<br />
cb.ngements .notables pour les so.ciétés concernées.<br />
V - CONTINUITE HISTORIQUE ET CHANGEMENTS SOCIAUX<br />
Désenclavées par la route, les populations autochtones se rer-<br />
saisirent rapi<strong>de</strong>ment. Elles s'installèrent au bord <strong>de</strong> la nouvelle route<br />
et agrmdirent leur superficie cultivée participant ainsi <strong>de</strong> nouveau<br />
activement à l'économie <strong>de</strong> plantation.<br />
Les activités économiques <strong>de</strong>s Dibum et <strong>de</strong>s Mbang au XIXe siècle<br />
domient lieu à <strong>de</strong>s transactions commerciales <strong>de</strong> groupe à groupe,<br />
chaque groupe ayant intér8t à préserver sa cohésion pour ne pas être<br />
court-circuité par un groupe concurrent dans la circulation <strong>de</strong>s produits<br />
<strong>de</strong> traite, et pour ne pas &tre réduit en esclavage. Cette cohésion so-<br />
ciale n'était d'ailleurs pas exempte d'inégalités sociales : en plus<br />
<strong>de</strong>s différenciations entre ai'nés et ca<strong>de</strong>ts, hommes et femmes, inhérentes<br />
à toutes les sociétés acéphales et lignagères, le contexte <strong>de</strong> trnite<br />
avait introduit la possibilité d'une certaine promotion par enrichis-<br />
sementrcnpitalisation <strong>de</strong> femmes et possession d'une main d'oeuvre ser-<br />
vile, C'est ainsi que la société rnbang distingue l'homme libre (kwenxa)<br />
du cz-ptif acheté (mlyong) et du fils d'esclave (mbiahi). L'agriculture<br />
<strong>de</strong> plantation qui fut adoptée dès le début <strong>de</strong> la colonisation donne à<br />
certains le statut <strong>de</strong> llplanteurlf. L'encadrement agricole souligne<br />
d'ailleurs b. pertinence <strong>de</strong> cette réussite économique en désignant<br />
dans chaque village un "chef planteur". Les chefs <strong>de</strong> famille les plus<br />
riches n'hésitent pas à construire un habitat mo<strong>de</strong>rne, en faisant appel<br />
aux compétences artisanales <strong>de</strong>s pionniers. L'organisation adniinistrati-<br />
ve et politique distribue par ailleurs <strong>de</strong>s titres qui sanctionnent en<br />
fait lfappûrition <strong>de</strong> lea<strong>de</strong>rs locaux : "chefferie administrativeti du<br />
village, prési<strong>de</strong>nce du Comité <strong>de</strong> Base U.N.C., direction du groupe auto-<br />
défense (milice du village formée pour résister aux attaques <strong>de</strong>s ma-<br />
quisardS).~l semble que le contrôle social laisse possible uns certaine
promotion iadividuelle, et soit moins étouffant que dxns d'autre ragions<br />
du Pays basaa. Cependant aucun lea<strong>de</strong>r ne peut s'affirmer indépendainment<br />
<strong>de</strong> l'accord <strong>de</strong>s autres chefs <strong>de</strong> famille, et la moindre initiative pu-<br />
blique exige une réunion préalable <strong>de</strong> tous. L~individualisstion <strong>de</strong>s<br />
mémgcs nlest somme toute que très relative, c'est plus un procès en<br />
cours quiun résultat acquis,<br />
Lt irruption dl une colonisation agricole dirigée, en plein Cc ?u:<br />
du Pays mbnng, a imposé aux autochtones <strong>de</strong>s rapports d'extériorité,<br />
Ceux-ci ont valorisé le rôle administratif <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> canton puisque<br />
c'est ce <strong>de</strong>rnier qui n été chargé <strong>de</strong> transmettre aux responsable15 <strong>de</strong><br />
IfOpération et aux autorités administratives locales les revendic~.tions<br />
<strong>de</strong>s autochtones.<br />
Naguère, ci1 pays mbang, le pouvoir csntonal - pure création <strong>de</strong><br />
liadminis-braLlon col~niaic alleman<strong>de</strong>s puis françnise - revêtit une<br />
importance consid6rable en ln personne <strong>de</strong> Long Mayouko Ce <strong>de</strong>rnicr<br />
11règna11 vcritablement <strong>de</strong> 1917 à 1954. Le Canton mbang était, à cette<br />
époque, loin du réseau routier et l'administrstion coloniale s'appuya<br />
sur la personnalité autoritaire <strong>de</strong> Long Mayouk, ancien agent d'exécu-<br />
tion socs llndninistrntion alleman<strong>de</strong>, pour collecter les impôts et in-<br />
poser ses ordres. Long Ilayoiilc b6néficia pendant <strong>de</strong> nombreuses annhes <strong>de</strong><br />
cette ad~ninistrntion indirecte et ce n'est qu'après l'installation d'un<br />
centre administratif à Nkondjok en 1952, qu'il ne fut plus jugé indis-<br />
pensable d'où sa <strong>de</strong>stitution en 1954.<br />
L'actuel chef <strong>de</strong> canton hérite donc d'un rôle important, d'une<br />
z.utorit8 qui ssest constituCe au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> l'organisation clmique <strong>de</strong><br />
ln société nbang, Lorsqulon intorroge les Mbang sur leur histoire,<br />
cf est princiyalement <strong>de</strong> Long Mayouk qu' ils parlent avec crainte in,?.is<br />
aussi avec fierté. Il serait donc erroné <strong>de</strong> traiter la chefferie <strong>de</strong><br />
canton en terme d'a2rtiÊicialité, bien qu'à son point <strong>de</strong> départ ce fut<br />
une structure purement administrative. Le pouvoir cantonal est <strong>de</strong>venu<br />
une réalité pour les Blbang et ils l'utilisent actuellement face à<br />
1rCpératj.on. Cette acceptation <strong>de</strong> ln chefferie <strong>de</strong> canton n'est d'ail-<br />
leurs pas c:;clasive d'une très grnn<strong>de</strong> sutonomie <strong>de</strong>s divers groupes<br />
claniques et villageoisl Ltautorité du chef <strong>de</strong> canton est acceptée Pour<br />
son utilit6 et reste dépendante <strong>de</strong> la personnalité <strong>de</strong> son d8tenteur et<br />
du soutien que 1u.i accor<strong>de</strong> il Administration.
Si on ne saurait parler <strong>de</strong> véritable mutntion sociale pou les<br />
sociStGs autochtones affectées par <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-Bz-fang, il s fzgit<br />
néanmoins <strong>de</strong> lfaccélération notable d'une évolution amorcée par llSco-<br />
nomie <strong>de</strong> tr?Ate, puis les premières années <strong>de</strong> lléconomie <strong>de</strong> plmtrtion.<br />
Ces üociétés autochtones entrent désormais dans un ensemble inter-cth-<br />
nique rGgionnl, reproduisant ainsi, quelques décennies plus tard, l~.<br />
m&mc situation que celle du département voisin du Mungo à ln mite <strong>de</strong><br />
lfimmigr2tion bamiléké qui y a commencé tres tôt vers les années vingt.<br />
Du c8té <strong>de</strong>s immigrés bamiléké on peut sfnttendre à d'importants<br />
changements sociaux puisque le terme même <strong>de</strong> colonisation agricole im-<br />
plique la notion <strong>de</strong> changement, Pour J.P. *Raison (1) cette notion est<br />
un critère plus important que la seule occupation <strong>de</strong> "terres neuvesf1.<br />
La translation géographique dans l'espace (la colonisation est 12 mise<br />
en vnleur <strong>de</strong> terres par <strong>de</strong>s paysans qui ont quikté leur pays d'origine<br />
avec l'intention <strong>de</strong> s'installer définitivement dans une région nouvelle<br />
pour eux) s'accompagne en effet d'une rupture écologique et donc drune<br />
modifimtion du système <strong>de</strong> culture et <strong>de</strong>s techniques agricoles (terres<br />
plus riches, ou du moins espaces disponibles plus vastes d'où p~,~>~:ibili-<br />
té <strong>de</strong> o~ltures extensives et <strong>de</strong>s cultures d'exportation, conditions<br />
diiniltiques nouvelles, etc.. .) . Changement géographique qui est ::ussi<br />
sociologique : o rigindité agronomique et sociale <strong>de</strong>s communaut~s d1im-<br />
migrés qui ont conscience <strong>de</strong> former une nouvelle entité distincte cles<br />
autres groupes précé<strong>de</strong>mment instîllés : "Le groupe pionnier doit être<br />
en Ctat, sinon <strong>de</strong> conflit, du moins <strong>de</strong> contestation ou <strong>de</strong> dia1ogv.c 7,vec<br />
les anciens occupants ; il ne peut pas par dJfinition leur être sounisu<br />
(J.P. H.:ISON). Le terme colonisation exclut à priori, lelr individus qui<br />
se fon<strong>de</strong>nt dans une ma6ee.d'aatochtones, ln mise en valeur par eas:~im;-<br />
ge <strong>de</strong> la population d'anciens villages qui à la suite d'une ::ugment:ition<br />
dGmographique occupe la partie négligée du terroir, ou un no-mansrland<br />
les séparant <strong>de</strong>s populations voisines. Il exige un volume minimum d'nu<br />
moins 500 habitants (2) pour être assuré dtune stabilit6 démogr~.phique<br />
(1) JoP. RAISON, op. cit,<br />
(2) JoP* RAISON avance cette norme en citant SUTTER et TI'IBPLH,
et <strong>de</strong> ne pas Qtre rapi<strong>de</strong>ment assimilé par les populations environnan-<br />
.tes. Une zone <strong>de</strong> colonisation n'est donc pas une simple extension en<br />
superficie <strong>de</strong> l'aire d'habitat traditionnel, il n'est pas non plus la<br />
simple reproduction sous d'autres cieux <strong>de</strong> l'économie <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong><br />
d6part. Elle acquiert après les années dlinstallation, une vkritzble<br />
autonomie et une originalité par rapport à la zone <strong>de</strong> départ et par<br />
rapport aux autres populations environnantes : ainsi nos villnges<br />
pionniers. Finalement J.P. RAISON <strong>propos</strong>e une définition où les appro-<br />
ches géographiques et sociologiques se complètent mutuellement :<br />
"L'occupation nouvelle <strong>de</strong> terres vierges ou reconstituces p u<br />
un long resos, à l'occasion d'un déplacement <strong>de</strong> popul?-tion<br />
d'ampleur variable, provoquant la formation <strong>de</strong> groupes ~oci\-.ux<br />
nouveaux; le dsplacement considéré peut être parfois fz-ible,<br />
voire très faible, ou n'affecter qu'une fraction minoritaire <strong>de</strong><br />
ia population, pour peu que le phénomène migratoire s'accoiL~pz-<br />
gne d'une révolution dnns le mo<strong>de</strong> d'utilisation du sol et d'une<br />
altération profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'organisation sociale traditionnel-<br />
let1 (1).<br />
Ic, colonisation s'accompagne donc dlun chxngement économique et <strong>de</strong> nou-<br />
veaux rapports sociaux.<br />
Entre le plateau d'où sont originaires les immigres bamil6ké et<br />
- Le colon bnmilkké <strong>de</strong>laisse la savane anthropique du Plateau pour une<br />
foret relativement <strong>de</strong>nse - forêt qu'il faut d6fricher en abattant<br />
1s foret où ils s'installent, il y a effectivement rupture Gcologique :<br />
<strong>de</strong>s arbres <strong>de</strong> grosse t2ille avant <strong>de</strong> pouvoir construire une G-se, <strong>de</strong><br />
cultiver un premier champ <strong>de</strong> cultures vivrières, et <strong>de</strong> commencer la<br />
mise en valeur d'une plantation.<br />
- Il déhisse un plateau au climat réputé salubre par son altitu<strong>de</strong><br />
(plus <strong>de</strong> 1200m). Les épidémies en sont rarcfiées, les statistiques<br />
sanitaires indiquent moins <strong>de</strong> parasites pour l'homme, et le petit éle-<br />
vage (volnilles, ovins et porcins) se développe dans <strong>de</strong> bonnes condi-<br />
tions, <strong>de</strong> m8me pour les bovins. Par contre dans la zone d'immigration<br />
(1) A noter que l'auteur, en introduisant l'idée d'un changement r~d-ical<br />
écc--rte les simples actions <strong>de</strong> vulgarisation agricole,
les épidémies ravagent le petit élevage - meme dnns la ferme expéri-<br />
mentale (11, et le porc qui a le malheur <strong>de</strong> <strong>de</strong>scendre la tlfalaise"<br />
nu bout d'une car<strong>de</strong> pour entrer en foret, voit son espérance <strong>de</strong> vie<br />
subitement réduite à moins <strong>de</strong> 6 mois 1<br />
- Le climat est très humi<strong>de</strong> (2.937rnm par an), cependant la saison sèche<br />
est particulièrement accentuée <strong>de</strong> décembre à mars. L'effet est immédiat<br />
sur les sols sur socle, peu profonds, et les réserves d'eau s'épui-<br />
sent rapi<strong>de</strong>ment, Lee caféiers plantés sur le sommet <strong>de</strong>s collines en<br />
souffrent. Par ailleurs les cours d'eau et les sources tarissent, ce<br />
qui pose le problème <strong>de</strong> l'alimentation en eau du village.<br />
- En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> quelques tgches basaltiques, les sols sont en général<br />
nettement moins bons qu'en Pays bamiléké ou dans le Mungo, dl06 une<br />
frustration relative ressentie vivement par le pionnier. Les sols<br />
sur socle sont <strong>de</strong> qualité médiocre : les cultures vivrières (banane<br />
plantain, taro, macabo, etc...) sont sujettes à une baisse nette <strong>de</strong><br />
ren<strong>de</strong>ment dès la <strong>de</strong>uxième année et ceci malgré la couche dthmus <strong>de</strong><br />
la foret défrichée. Les sols sur basalte sont plus rares et en partie oc-<br />
.rcupés par les autochtones. Les vallées aux versants abruptes et au lit<br />
rooaillewc n'offrent pas <strong>de</strong> bonnes conditions pour la riziaulture <strong>de</strong><br />
marécztge et le palmier raphia.<br />
- La faune <strong>de</strong> la forêt ne laisse pas le nouvel arrivant bénéficier<br />
pleinement <strong>de</strong>s prémices <strong>de</strong>s récoltes : les singes déterrent les tu-<br />
bercules, les serpents s'infiltrent dans les poulaillers, les oiseaux<br />
rapaaes plongent sur les poussins lorsque l'aire villageoise est suf-<br />
.fisamment dégagée, les premières plantations ont même été visit6es<br />
par <strong>de</strong>s é16phents. Le repos <strong>de</strong>s pionniers est troublé la nuit par<br />
<strong>de</strong>s moustiques et <strong>de</strong>s processions <strong>de</strong> fourmis tant que la foret reste<br />
encore proche <strong>de</strong>s premières cases construites.<br />
Cette dure confrontation avec la forgt eQt l'occasion dtetre<br />
exprimée publiquement par un pionnier, dans un discours adress; au Pré-<br />
si<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République le 10 avril 1968 lors <strong>de</strong> l'inauguration <strong>de</strong><br />
l@Opération : "Quand nous sommes arrivés pour la première fois dnns<br />
cette zone, nous étions vraiment effrayés par la foret. Maintenant,<br />
cette foret qui nous effrayait commence à fuir <strong>de</strong>vant nous1'.<br />
(1) C.A.T. (centre diAppui Technique), implanté à Nkondjok pour soutenir<br />
les progrès agronomiques <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>, L'épidémie dont nous faisons<br />
allusion a vidé les poulaillers au début <strong>de</strong> la saison <strong>de</strong>s pluies<br />
1 971 .
Dans ces conditions, il ne saurait &tre question pour les pion-<br />
niers <strong>de</strong> reproduire le bocage bamiléké. Ce <strong>de</strong>rnier n'est en effet<br />
apparu que dans <strong>de</strong>s conditions précises : sols fertiles sur basalte<br />
autorisant la pratique d'une agriculture sur place - non itinérante -<br />
et avea cultures intensives, pression démographique suffisante pour<br />
"humaniser1' entièrement le paysage, dispersion <strong>de</strong> l'habitat facilitant<br />
une exploitation maximum du terroir, ~ossibilité <strong>de</strong> développer l'éleva-<br />
ge, etc... Par contre, en forêt, l'espace n'est plus une contrainte et<br />
les pionniers n'ont pas manqué à la règle qui consiste à abandonner<br />
toute pratique intensive - coûteuse en main d'oeuvre - chaque fois<br />
qu'un <strong>de</strong>sserrement est possible (1). Mieux, alors que sur le Plateau<br />
le Baniléké esi un paysan acharné pour reprendre l'expression <strong>de</strong> P.<br />
GOUROU, en foret il <strong>de</strong>vient planteur <strong>de</strong> café et <strong>de</strong> cacao. La différen-<br />
oe est ?-mportante au niveau <strong>de</strong>s stratégies économiques mises en oeuvre.<br />
Le paysan pratique toutes les activités agricoles et artisanales sus-<br />
oeptiblcs <strong>de</strong> répondre à ses besoins familiaux. Il vend sur le marché<br />
quelques surplus pour acquérir d'autres biens en contrepartie et <strong>de</strong><br />
l'argent pour faire face entre autres à <strong>de</strong>s contraintes externes. Le<br />
planteup quant à lui, concentre son travail sur les produits d'exporta-<br />
tion et réduit ses champs vivriers aux strictes besoins <strong>de</strong> sa famille.<br />
Il produit essentiellement pour vendre sur le marché, et à la limite<br />
se procure auprès d'autres agents économiques <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> consomnlation<br />
compl6mentaires (compléments vivriers, objets artisanaux, etc...). 11<br />
entre <strong>de</strong> plein pied dans l'économie <strong>de</strong> marché et accepte le principe<br />
d'une division du travail. Il tend aussi à abandonner le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> faire<br />
valoir direct pour utiliser <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> la main d'oeuvre salariée.<br />
L'argent entre dors dans le processus <strong>de</strong> la production et n'est plus<br />
seulement un intermédiaire pour la consommation.<br />
Dans le Pays bamiléké lui-même, seuls quelques chefs et grands<br />
notables possè<strong>de</strong>nt suffisamment <strong>de</strong> terres pour <strong>de</strong>venir sur place <strong>de</strong>s<br />
planteurs. La plupart <strong>de</strong>s autres chefs <strong>de</strong> ménage, y compris <strong>de</strong>s héri-<br />
tiers, doivent émigrer pour acquérir ce statut. C'est ce que firent pré-<br />
cisément les pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> originaires<br />
<strong>de</strong> l'Ouest.<br />
- - -<br />
(1) Par exemple au Nord du <strong>Cameroun</strong> où les populations <strong>de</strong>s Monts Mandara<br />
qui <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nt en plaine, abandonnent les pratiques intensives.<br />
Cf, Jean BOUTRJIIS - La colonisation <strong>de</strong>s plaines par les montagnards<br />
au Nord-<strong>Cameroun</strong> (~onts Mandara).-<br />
Paris, 1973, 277~.<br />
Coll. Travaux et Documents,<br />
TORSTOM,
- 89 -<br />
Sous cet angle là, la colonisation agricole bamiléké aboutit à<br />
une nouvelle orientation <strong>de</strong> l'entreprise économique. Par ailleurs,<br />
elle se fait hors du contr8le social direct <strong>de</strong> La hiérarchie trndi-<br />
tionnelie,<br />
En fait, la comparaison directe, entre zone <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> lismi-<br />
gration et lieu d'immigration se révèle par trop statique. Nous avons<br />
déjà co:istaté précé<strong>de</strong>mment que l'ensemble du Plateau bamiléké était<br />
orienté par ltéconomie <strong>de</strong> traite et que celle-ci avait été suffi.~am-<br />
ment dé3isive - entre autres causes - pour déclencher une première im-<br />
migration en foret. Les sociétés bamiléké du XIXe siècle n'étaient donc<br />
plus à 100% <strong>de</strong>s communautés paysannes vivant en auto-consommation.<br />
On peut même dire que <strong>de</strong> nombreux notables du rebqrd du Plateau<br />
étaient déjà à cette époque plus commerçan~qu~agriculteur~,c~est-à-<br />
dire pr6occupés essentiellement par les transactions sur les marchés<br />
limitrophes à la zone forestière, les femmes assumant la plupart <strong>de</strong>s<br />
activith agricoles, du moins celles les plus consommatrices <strong>de</strong> temps.<br />
Llexemple <strong>de</strong>s groupes bamiléké immigrés en forêt au XIXe siècle<br />
montre nvcc pertinence que la civilisation bamiléké bien qu'ayant été<br />
trmsf~rrn~:~t~ice d'un milieu écologique précis : les plateaux <strong>de</strong> l'Ouest<br />
du <strong>Cameroun</strong>, n'est pas liée "éternellement11 à ce milieu. Le XXe siècle<br />
a prouve que les Bamiléké ont été aussi à l'aise en foret et dans les<br />
oentres urbains quiils l'étaient sur leurs plateaux. La comparxison doit<br />
donc stdtnblir à notre avis au niveau <strong>de</strong>s stratégies déployées par les<br />
acteurs sociaux et <strong>de</strong> 11Glaborntion <strong>de</strong>s nouvelles structures sociales.<br />
Or à ce niveau l'analyse peut se conduire en termes <strong>de</strong> conti-<br />
nuita, L'économie <strong>de</strong> plantation offre en effet <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> pro-<br />
motion économique comme naguère le trafic <strong>de</strong>s esclaves et <strong>de</strong>s ivoires,<br />
et le commerce dc lPhuile. Cette économie <strong>de</strong> plantation implique un dé-<br />
plncenent en zone forestière, mais les structures sociales bamiléké<br />
acceptent la scission d'un individu ou d'un groupe hors du territoire<br />
d'une chefferie. Cette tolérance a été effectivement utilisée <strong>de</strong> tout<br />
temps par les éléments non héritiers d'un titre <strong>de</strong> notabilité et qui<br />
par le biais d'une réussite économique vant essayer d'en acquérir un.<br />
La réussite économique facilite en effet l'accès aux épouses donc la<br />
fondation d'un lignage selon le principe <strong>de</strong> la filiation patrilinéaire,<br />
. ..
et pnnrmet une affirmation sociale sous la forme <strong>de</strong> multiples services<br />
rendus à la communauté et <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>aux au Chef et aux grands notcbles.<br />
La réussite économique dans les sociétés bamiléké est donc directement<br />
traduisible en prestige sociale et en pouvoir politique. On comprend<br />
alors que <strong>de</strong>s éléments ambitieux stinstallent dans les zones les plus<br />
ouvertes aux spénulations économiques (espaces disponibles avec possi-<br />
bilité <strong>de</strong> transactions commerciales fructueuses, et cm.. ) et où le jeu<br />
politique n'est pas encore enfermé par le contr8le <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s chef-<br />
feries. De là <strong>de</strong>s zones d'immigration qui sont <strong>de</strong> véritables fronts<br />
pionniers et où ia structuration en chefferies est en voie <strong>de</strong> se faire.<br />
La <strong>de</strong>scente <strong>de</strong> groupes bamiléké au XIXe siècle dans la zone forestière<br />
<strong>de</strong> la partie septentrionale du Département du Nkam est un exemple typi-<br />
que <strong>de</strong> ce processus. Les villages pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<br />
<strong>Bafang</strong>, prenant la relève <strong>de</strong>s petits centres urbains du Mungo, procè-<br />
<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la m8me dynamique.<br />
Certes nous avons à faire à <strong>de</strong>s villages et non à <strong>de</strong>s cheffe-<br />
ries, mais la forme extérieure ne doit pas masquer la structuration<br />
sociale interne. Que ce soit dans le Mungo, ou dans cette nouvelle<br />
zone <strong>de</strong> colonisation agricole que sont les villages pionniers, on ne<br />
peut évi<strong>de</strong>mment assister à la reproduction <strong>de</strong> la chefferie tradition-<br />
nelle du seul fait <strong>de</strong> l'opposition <strong>de</strong> l'administration coloniale, puais<br />
actuelle, à un tel processus. Le chef <strong>de</strong> village est nommé par l~,ldmi-<br />
nistration après consultation <strong>de</strong>s principaux chefs <strong>de</strong> famille. En<br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s chefferies traditionnelles, la chefferie <strong>de</strong> village est un<br />
simple rouage administratif tout à fait lalc. Cependant le vrai pouvoir<br />
politique échappe souvent à celui qui a été nommé chef <strong>de</strong> village,<br />
ce <strong>de</strong>rnier est en quelque sorte mis en avant pour les contacts ?Cri-<br />
phériques avec l'extérieur (1).<br />
Les promoteurs <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> ont mis à la tete<br />
<strong>de</strong> chaque village pionnier un organe collectif, le comité <strong>de</strong> direction<br />
du fillagel afin acéviter les inconvénients <strong>de</strong> la nomination d'un chef<br />
administratif <strong>de</strong> village : "ce nouveau chef pourra <strong>de</strong>venir vite orgueil-<br />
leux, iiiipérialiste, exploiteur et rival du chef coutumier autochtone.<br />
-<br />
(1) C'est notamment ce qu'on peut constster dans <strong>de</strong> nombreux villages<br />
du Sud du <strong>Cameroun</strong>. Cf. P.L. GESCHIERE - Quelques aspects <strong>de</strong><br />
-<br />
l'organisation sociale <strong>de</strong>s villages Maka sur le Ndjonkol. Ln zone<br />
~':~~LOSS~S~ Arrondissement dtAbong-Mbang (<strong>Cameroun</strong>).- Amsterdam,<br />
UI;mal,<br />
1972, doc. rnultigr,
-. 91 -<br />
Nous préconisons donc un système démocratique d'administration du<br />
village par la constitution dans chaque unité" d'un comité <strong>de</strong> direc-<br />
tion" (l),<br />
Ce comité <strong>de</strong> direction est l'intermédiaire entre l'encadrement<br />
et la pop-~iation ?ionnière, et doit coordonner les activités collecti-<br />
ves Cu vilZ~~gs : fiassurer 1' exécution <strong>de</strong>s ordres données par l'équipe<br />
d~enca6rernent - organiser <strong>de</strong>s assemblées générales périodiques du vil-<br />
lage.,, se rsunir régulièrement pour arrêter le programme <strong>de</strong> trzvail et<br />
contr8ler 'son exécution - concilier les pionniers en conflit - contr8ler<br />
ln coop~~ûti~re - ~Cglcmenter les permissions d'absence et <strong>de</strong> congés -<br />
orgnnise'r le P,rti <strong>de</strong> l'Union Nationale <strong>Cameroun</strong>aise - faciliter la<br />
t3che <strong>de</strong>s ministres <strong>de</strong> culte en misdion dans le village - surveiller<br />
l'esprit et la rnor4lité <strong>de</strong>s pionniers - organiser les fêtes du village1'(2),<br />
Ln composition <strong>de</strong> ce comité <strong>de</strong> direction vise d'une part à la<br />
repr6sentativité <strong>de</strong>s diverses catégories sociales du village : jeunes,<br />
pionniers plus âg8s, femmes, 'TcivilslT et ex-gar<strong>de</strong>s-civiques; et d'autre<br />
part, le soutien <strong>de</strong>s principales activités collectives : l e d618gué <strong>de</strong><br />
la cooprrative et l'éducateur sanitaire font partie du comité. Ce comité<br />
est corn;~oô6 <strong>de</strong> 7 membres et parmi eux sont choisis un prési<strong>de</strong>nt, un<br />
vice-pr6si<strong>de</strong>nt et un secrétaire.<br />
Pîr ailleurs, il a été décidé d'implanter un comité <strong>de</strong> base<br />
<strong>de</strong> lrU.X.C. dans chaque village, et cette structure politique offre à<br />
son tour <strong>de</strong>s titres et <strong>de</strong>s fonctions : prési<strong>de</strong>nt, vice-prési<strong>de</strong>nt,<br />
trésoric-*, secrétaire, agent aux conflits, d6légué à 1'OFUNC (3), res-<br />
poneg.ble dc ln propagan<strong>de</strong>, etc...<br />
(1) Brochure <strong>de</strong> la SODENKAM prssentant 190pération : Représentation du<br />
w e <strong>de</strong>s pionniers - <strong>de</strong> mise en valeur agricole.<br />
-<br />
(2) OFUNC : Organisation <strong>de</strong>s Femmes <strong>de</strong> l'Union Nationale <strong>Cameroun</strong>aise,<br />
(3) Le Conseil <strong>de</strong>s Fionniers <strong>de</strong> 1s zone <strong>de</strong> Mise en Valeur Agricole réunit<br />
les pr{>si<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s comités <strong>de</strong> direction accompagnés <strong>de</strong> d6lBgu6s en<br />
nombre ' lvoportionnel à 1 ' importance dEmographique <strong>de</strong> chaque village.<br />
Ce C~nsei.1 <strong>de</strong>s Pionniers net en relation directe les ~adres techniques<br />
e-t aC-?inistratifs et les représentant-s :<strong>de</strong>s ?ionniers,<br />
. : .<br />
'
La coopérative CC.R.E .A. Coopérative rurale dt é couiement et<br />
d'approvisionnement) et ln mutuelle (c.A.M.P.I. Caisse d'assurance<br />
mladie pour les pionniers) sont également dispensatrices <strong>de</strong> titres et<br />
<strong>de</strong> fonctions.<br />
Diautres activités collectives donnent également ltoccasion pour<br />
les pionniers socialement les plus actifs <strong>de</strong> se manifester : les asso-<br />
cis.tions <strong>de</strong> parents d'élèves, les associations sportives (football<br />
principalement), les équipes d'animation <strong>de</strong>s foyers culturels. Il en<br />
est <strong>de</strong> m&me pour les institutions plus spontanées dépendant entièrement<br />
drun accord entre pionniers sans intervention <strong>de</strong> l'encadrement : groupes<br />
<strong>de</strong> travail, communautés chrétiennes, associations <strong>de</strong> danses tradition-<br />
nelles, etc...<br />
De m&me que dans la chefferie bamiléké traditionnelle, la réus-<br />
site économique et sociale individuelle était sanctionnée par la récep-<br />
tion dfun titre <strong>de</strong> notabilité <strong>de</strong> la part d'un chef ou d'un grand notable;<br />
<strong>de</strong> m&me les associations <strong>de</strong> type mo<strong>de</strong>rne, par la répartition <strong>de</strong> respon-<br />
sabilit6s sociales et la distribution <strong>de</strong> titres fonctionnels (prési<strong>de</strong>nt,<br />
trésorier, secrétaire, etc...) offrent aux lea<strong>de</strong>rs qui émergent la<br />
possibilité d'une institutionnalisation <strong>de</strong> leur r81e. Cette continuité<br />
historique explique la vitalité <strong>de</strong>s associations actuelles en Pays bami-<br />
léké et dans les zones d'immigrations rurales et urbaines où se trouvent<br />
<strong>de</strong>s originaires <strong>de</strong>s Plateaux <strong>de</strong> l'ouest, car, sous le couvert du parti<br />
politique ou diune association <strong>de</strong> danse folklorique, ctest en fait tout<br />
l'héritage <strong>de</strong>s associations coutumières qui se transmet avec, en plus,<br />
une ouverture aux non-notables. De là un réel militantisme <strong>de</strong> masse<br />
qui tranche avec les autres régions du <strong>Cameroun</strong> où la participation<br />
active aux associations mo<strong>de</strong>rnes n'est bien souvent que l'affaire d'une<br />
minorité .<br />
On ne saurait oublier dans le processus <strong>de</strong> structuration d'un<br />
milieu social <strong>de</strong> tradition bamiléké, la dimension verticale. C'est en<br />
effet dren haut que viennent les titres. Aujourd'hui, dans les zones<br />
d'immigrations, l'Administration ou l'encadrement technique d'une opéra-<br />
tion <strong>de</strong> développement prennent la relève du chef traditionnel. Chefs <strong>de</strong><br />
village et chefs <strong>de</strong> quartier reçoivent leur investiture <strong>de</strong> l'Administra-<br />
tion. Dans le cas <strong>de</strong>s villages pionniers <strong>de</strong> l'Opération Yabaçsi-<strong>Bafang</strong>,
la seule perspective d'un renouvellement <strong>de</strong>s comités <strong>de</strong> direction par<br />
<strong>de</strong>r élections libres, déclancha <strong>de</strong> telles rivalités que l'encadrement<br />
jugea bon d'annuler les élections et <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r par nomination. Ceci<br />
ne mit dcailleurs pas fin aux rivalités <strong>de</strong> personnes et <strong>de</strong> groupes,<br />
lesquell~es ressortirent au niveau <strong>de</strong> la Coopératiiqe montrant ainsi<br />
tout llznjeu que représente le pouvoir local; cependant le principe<br />
dcune intervention extérieure, c'est-à-dire celle <strong>de</strong> l'encadrement par<br />
rapport à la société pionnière, fat relativement bien acceptée par les<br />
intdressés et prise lors d'une réunion du Conseil <strong>de</strong>s Pionniers.<br />
Cet inci<strong>de</strong>nt manifeste, entre autres, le r6le important joué par un<br />
p81e dtautorité dans le processus <strong>de</strong> hiérarchisation sociale <strong>de</strong>s nou-<br />
veaux milieux sociaux issus du Pays bamiléké. C'est précisément ce<br />
m8me processus qui a donné naissance à la vaste mosaTque <strong>de</strong> petites<br />
chefferles sur les plateaux <strong>de</strong> l'Ouest : les lea<strong>de</strong>rs se faisaient con-<br />
sacrer chef par un chef voisin déjà installé, ceci en entretenant <strong>de</strong><br />
bons rapports <strong>de</strong> voisinage et parfois la ruse<br />
Le fait que nous soyons renvoyés à l'économie <strong>de</strong> traite pour<br />
ex~liquer la participation actuelle <strong>de</strong>s populations autochtones à <strong>de</strong>s<br />
ltéconoiliie <strong>de</strong> plantation, et d'autre part à l'histoire <strong>de</strong> la formation<br />
<strong>de</strong>s chcfferics bamiléké en évoquant la structuration sociale <strong>de</strong>s villa-<br />
ges pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>, témoigne <strong>de</strong> l'importance<br />
dcune approche historique pour capter les stratégies <strong>de</strong>s agents sociaux<br />
dam les nouveaux milieux sociaux. Tout se passe comme si les modèles<br />
sociaux-culturels <strong>de</strong>s milieux d'origine étaient réutilisés dans la nou-<br />
velle situation, remoulées dans <strong>de</strong> nouvelles formes externes, adaptées<br />
pour répondre aux besoins présents. Les ruptures n'affectent bien sou-<br />
vent que les apparences. Le cas <strong>de</strong>s villages pionniers <strong>de</strong> 110p6ration<br />
<strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> n'est certes pas immédiatement généralisable, mais il<br />
permet dt attirer l'attention <strong>de</strong>s promoteurs dl opérations <strong>de</strong> développe-<br />
ment sur l a nécessité <strong>de</strong> connaître l'histoire <strong>de</strong>s populations concernées<br />
afin <strong>de</strong> prévoir les comportements socio-économiques.
En conclusion <strong>de</strong> cet article, nous ne pouvons nous empêcher<br />
dtévoquer certaines possibilités <strong>de</strong> développement économique qui ont<br />
été négligées dans le cas <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong>, du fait <strong>de</strong><br />
la méconnaissance quasi totale <strong>de</strong> l'histoire <strong>de</strong>s populations concer-<br />
nées tant autochtones qu'immigrées.<br />
Alors que la politique intégrationniste actuelle visant à trans-<br />
former les villageois mbang et dibum en colons agricoles au méme titre<br />
que les immigrés, n'aboutit un recrutement limité <strong>de</strong> jeunes et tend<br />
à les couper <strong>de</strong> leurs villages d'origine; une politique plus confiante<br />
dans le comportement socio-économique <strong>de</strong>s autochtones aurait pu promou-<br />
voir un <strong>de</strong>veloppement sur place <strong>de</strong>s forces productives; ceci par un<br />
renforcement en quantité et en qualité <strong>de</strong> l'encadrement technique agri-<br />
cole, et la mise en place <strong>de</strong> circuits <strong>de</strong> commercialisation. Outre h<br />
regénération <strong>de</strong>s plantations existantes, une telle politique aurait pu<br />
encourager la réexploitation <strong>de</strong>s palmeraies naturelles en vue dlalimen-<br />
ter les centres urbains <strong>de</strong> la partie méridionale du Plateau banilgké<br />
Enfin une prise en charge directe, par llAdministration, <strong>de</strong>s équipements<br />
socio-culturels aurait permis d'éviter toute discrimination.<br />
L'Opération organisa l'immigration en la considérant comme le<br />
seul facteur du développement régional, reléguant les autochtones dans<br />
la litt8rature mythique du paysan routinier insensible aux perspectives<br />
cilenrichissement offertes par l'économie <strong>de</strong> plantation. Le réseau routier<br />
mis en place <strong>de</strong>ssert exclusivement les nouveaux villages implantés <strong>de</strong><br />
part et d'autre <strong>de</strong> l'axe central. Ce n1 est qu'inci<strong>de</strong>mment que <strong>de</strong>s vil-<br />
lages autochtones en bénéficient. Jusqulà présent, le Pays dibum et<br />
les chefferies bamiléké <strong>de</strong> la zone forestière à l'est <strong>de</strong> la Makombé (riv)<br />
se trouvent toujours enclavés bien qu'une population nombreuse y vit.<br />
Non encore décimée par l'exo<strong>de</strong> rural, cette population apporterait<br />
d'emblée à <strong>l'opération</strong> un capital démographique et économique non négli-<br />
geable. Nous pensons notamment à tout l'intérêt qu'aurait eu <strong>l'opération</strong><br />
à se situer dans la prolongation <strong>de</strong> l'immigration bamiléké en zone<br />
forestière au XIXe siècle. Ce n'est d'ailleurs pas une <strong>de</strong>s moindres
oontradictions <strong>de</strong> cette opération d'être ouverte à l'immigration bami-<br />
léké tout en étant aveugle vis-à-vis d'une population <strong>de</strong>.même tradition<br />
mais immigr8s anterieuement. Le franchissement <strong>de</strong> la Makombé (riv) au<br />
niveau <strong>de</strong> Ndoubian ou <strong>de</strong> Moya donnerait sans nul doute à <strong>l'opération</strong><br />
une dimension régionale qu'elle n'a pas encore acquise.<br />
Etre planteur n'est qu'une étape dans la promotion économique<br />
du colon bamiléké, La plantation <strong>de</strong> café et <strong>de</strong> cacao assurera à lfinté-<br />
reas6 . . une base économique stable (c'est-à-dire la garantie d'un revenu<br />
an~uel minimum)* sur laquelle il pourra greffer <strong>de</strong>s activités du secteur<br />
tertiaire: artisanat, commerce, tra,nspcsrt Au moment <strong>de</strong> notre enquete<br />
en 1977, les 6léments les plus avancés <strong>de</strong> la société pionnière envisa-<br />
geaient d6jà l'achat <strong>de</strong> véhicules <strong>de</strong> transport, Un. ggrant, en génGrcil<br />
-<br />
un frère ca<strong>de</strong>t, prend alors la relève pour l'entretien <strong>de</strong> la plantation.<br />
Ces investissement@ à caractére cumulatif constituent la trame <strong>de</strong> ce que<br />
nous avons appelé le projet pionnier (7). Dans cette perspective, la<br />
route <strong>Bafang</strong>-<strong>Yabassi</strong>, non bitumée et donc sujette à une vigoureuse<br />
érosion du fait <strong>de</strong>s fortes pentes, se révèle manif estement incuf fisante<br />
et constitue un véritable goulôt d'étranglement. Dans son état acki!el,<br />
elle apparait plus proche d'une simple voie d' évacuation <strong>de</strong>s produit2<br />
agricoles diexportation, que d'un véritable axe économique parallèle<br />
celui du Mungo. . .<br />
Nous pensons aussi que les dirigeants <strong>de</strong> la SODENKAM auraient pu<br />
faire davantage appel au savoir faire technique <strong>de</strong>s pionniers pour réali-<br />
ser l'infrastructure nécessaire au bon fonctionnement <strong>de</strong> l'Opération.<br />
Tous les métiers <strong>de</strong> construction sont en effet représentgs dans les vil-<br />
lage~ et on aurait pu se dispenser d'un afflux <strong>de</strong> main d'oeuvre per-<br />
manente et salariée laquelle alourdit le budget <strong>de</strong> la SODENKAM (2).<br />
Ltavantnge aurait été d'accélérer le décollage économique <strong>de</strong>s planteurs<br />
artisans en les rémunérant pour <strong>de</strong>s tâches ar2tsanales temporaires.<br />
(2) 300 employés en 1969 pour le chantier routier et 418 employ6s<br />
en aoQt 1971 à la SODENKAM pour les besoins <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>.
Enfin une meilleure connaissance <strong>de</strong> la capacité <strong>de</strong>s immigrés<br />
dlorigine bamiléké à s'organiser socialement aurait pu dispenser l'Op&-<br />
ration d'un encadrement lourd, non rentabilisé par le nombre <strong>de</strong> pion-<br />
niers, et qui se révèle par ailleurs d'un niveau qualitatif insuffisant<br />
pour diagnostiquer les cas particuliers (maladies phytosanitaires,<br />
situation écologique d'une plantation, etc...). Bien qu'au dsbut, le<br />
lancement précipité <strong>de</strong> l'opé~ation obligea les responsables à établir<br />
un contact direct avec les oolohs, et que Certains responsables aient<br />
su maintenir ce contact par leur équation personnelle, la bureaucr2ti-<br />
sation <strong>de</strong> l'appareil apparut très vite et <strong>l'opération</strong> <strong>de</strong> colonisation<br />
agricole <strong>de</strong> dirigée <strong>de</strong>vint dirigiste.<br />
En définitive, une opération <strong>de</strong> développement ne peut qufaugmen-<br />
ter ses chances <strong>de</strong> rentabiliser les investissements publics en s'appuyant<br />
eur les oomportements socio-économiques <strong>de</strong>s populations concernées. Or<br />
ces oomportements, jusqu'à présent définis sous forme d'hypothèses dans<br />
les projets <strong>de</strong> développement, peuvent être observés dans d'autres régions<br />
et se sont manifestés bien souvent à <strong>de</strong>s époques économiques antérieures.<br />
Il s'agit finalement d'accélérer ou <strong>de</strong> débloquer l'histoire particulière<br />
<strong>de</strong> ces populations, au moyen d'opérations <strong>de</strong> développement, et non <strong>de</strong><br />
créer artificiellement <strong>de</strong> nouveaux milieux sociaux qui répondraient aux<br />
normes considérées par certains planificateurs bureaucrates comme néces-<br />
saires pour l'intégration <strong>de</strong>s milieux ruraux à l'économie <strong>de</strong> marché.
- 97 -<br />
& PILOGUE 1 9 7 7<br />
En 1977, il ans après son lancement, IIOpération <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong><br />
continue et c'est déjà une réussite 1<br />
Le rythme <strong>de</strong>immigration est toujours nettement inférieur aux pré-<br />
vieions qui avaient été faites avant le démarrage <strong>de</strong> l'Opération et qui<br />
situaient à 500 le contingent annuel <strong>de</strong> nouveaux pionniers. Mais nous<br />
avions déjà dit en 1977, que ce chiffre n'était nullement ue référenoe.<br />
D'autres zones d'immigration existent en effet et ltarrondissement <strong>de</strong><br />
Nkondjok nia pas le monopole <strong>de</strong> l'immigration bamiléké. Il est en con-<br />
currence avec le Mungo, la Pbine <strong>de</strong>s Mbo, la région <strong>de</strong> Makénéné, et<br />
tous les centres administratifs du sud du <strong>Cameroun</strong> où les Bamiléké ou-<br />
vrent <strong>de</strong>s boutiques <strong>de</strong> commerce et d'artisanat, sans compter les grands<br />
centres urbains t Yaoundé, Douala, Nkongsarnba, et les chefs-lieux dépar-<br />
tementaux à l'intérieur m&me du Pays bamiléké. Par ailleurs, nous consta-<br />
tons que liaxe routier <strong>Bafang</strong>-<strong>Yabassi</strong> n'a toujours pas été bitwné dznc<br />
mes parties les plus en pente t La <strong>de</strong>scente du rebord méridional du ph-<br />
teau bamiléké constitue par exemple un véritable goul8t d'étranglement<br />
pour la circulation car, en saison <strong>de</strong>s pluies, la chaussée dégradée ne<br />
permet pas à tous les véhicules <strong>de</strong> s'y aventurer. Cette situation eot<br />
incontestablement un frein aux activités <strong>de</strong> mmrnerce et <strong>de</strong> transport que<br />
plusieurs pionniers envisagent.<br />
Le fait que l'immigration se poursuit est en lui-m&me encourageant I<br />
pour liavenir <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>. 4<br />
Cependant, les statistiques concernant le recrutement <strong>de</strong>s pion- \<br />
niers ne nous invitent pas à l~optimisme, et <strong>l'opération</strong> doit &tre diri-<br />
gée activement pendant plusieurs années encore pour prendre toute son<br />
ampleur.<br />
t
i& courbe donnant l'effectif <strong>de</strong>s pionniers présente accuse un<br />
net fléchinsement en 1974 à cause d'un fort contingent <strong>de</strong> partants.<br />
Le sol<strong>de</strong> aigratoire est resté néanmoins positif cette année là, anis<br />
avec un chii"fre dérisoire. Plus généralement, cette courbe t~nd à ra-<br />
lentir sa progression du fait d'une diminution sensible <strong>de</strong>s effectifs<br />
recrut5r. annuellement <strong>de</strong>puis 1970, et du plus grand nombre <strong>de</strong> partants.<br />
Ce ralentissement explique qu'aucun nouveau village n'ait été cr65 en-<br />
tre le 6/1971 (date <strong>de</strong> fondation du village Tarn) et le 1/1976 (date <strong>de</strong><br />
fondation du village 6e bis).
100<br />
l" chefs <strong>de</strong> ménage<br />
sol<strong>de</strong> migratoire annuel<br />
I<br />
arri vees<br />
départs
Evo1utio.n recrutement <strong>de</strong> 1966 à 1972<br />
r------- .iir-...UII---.u.u----- T----- --Y"-- 7-<br />
I<br />
Années Nb. <strong>de</strong> pion- ! Nombre <strong>de</strong> 1 Nombre ! Pionniere ! Sol<strong>de</strong> migra-<br />
1 ! ' niers recrut4 départe 1 <strong>de</strong> déch précents ! toire muel 1<br />
1 ! A B 1 A B A B 1 ! I<br />
A r Effectif annuel<br />
B = Total cumulé
Lors <strong>de</strong> notre rapport dfenquête <strong>de</strong> 1971, nous ntétions pas encore<br />
<strong>de</strong>vant une situation aussi alarmante. Nous avions même alors cherché<br />
à dédramatiser le choc psychologique produit inévitablement par les<br />
départs :<br />
if2431eds sont répartis entre le début <strong>de</strong> ltopération et le<br />
30 juin 1970, soit 21% <strong>de</strong>6 recrutés. Les étu<strong>de</strong>s portant sur <strong>de</strong>s<br />
zones dtimmigration présentent toujours un migrant hésitant 5<br />
se fixer définitivement. Ce <strong>de</strong>rnier préfère fréquenter plusieurs<br />
villages entre lesqueh il choisira. Dans la zone que nous &tu-<br />
dions, ltirnplantation dans un village n'est pas laissé au libre<br />
choix et la plantation est un élément <strong>de</strong> fixation. Le système<br />
pr6sente ainsi une certaine rigidité et le colon n'aura le choix<br />
qu'entre partir ou rester.<br />
Compte tenu <strong>de</strong>s difficultés que nous avons évoquées, les<br />
départs ne semblent pas atteindre un seuil alarmant. Le terne<br />
<strong>de</strong> Itd8serteur" attribué au partant manifeste la réaction d'une<br />
societé qui se sent atteinte dans ses valeurs par l'attitu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> rejet <strong>de</strong> ces partants" (P. 157).<br />
En fait, la brusque augmentation <strong>de</strong>s départs résulte d'une modi-<br />
f ication dz.ns le recrutement.<br />
Au d8but nous avions une majorité d'hommes adultes, ayant déjà<br />
un passé dc migrant (à Douala et dans le Mungo) et désireux <strong>de</strong> se fixer<br />
définitivement. Un certain nombre dlentre eux était <strong>de</strong>s ex-gar<strong>de</strong>s civi-<br />
ques contraints <strong>de</strong> se reconvertir après la pacification <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers<br />
maquis up6cistes. Mais déjà lors <strong>de</strong> notre enquete, en 1971, nous avions<br />
signalé la plus gran<strong>de</strong> jeunesse <strong>de</strong>s plus récents villages : à Kouendou,<br />
par exemple, 65% <strong>de</strong>s pionniers avaient moins <strong>de</strong> 25 ans (contre 327; your<br />
les trois premiers villages, les Bges étant calculés à la date d'instal-<br />
lation).<br />
Le recrutement s'est également modifié par une plus gran<strong>de</strong> h6té-<br />
rogénéité. Les statistiques renforcent d'ailleurs cette hétérogénéité<br />
en util-isant <strong>de</strong>s catégories géographiques qui divisent le courant migra-<br />
toire d'origine bamiléké : les pionniers bamiléké peuvent en effet pro-<br />
venir <strong>de</strong> plusieurs provinces (l'ouest qui correspond aux départements<br />
bamilék6 et le Littoral avec le Mungo et la ville <strong>de</strong> Douala). Par ail-<br />
leurs, les effectifs en provenance du Littoral sont en gran<strong>de</strong> majorité
<strong>de</strong>s autochtones - donc <strong>de</strong>s non migrants - qui ont été intégrés à l'Op&-<br />
ration. Ils étaient environ 200 en 1975, soit 14,18% <strong>de</strong>s effectifs,<br />
répartis dans les villages Ndocktiba (Ba-Nd&), Tam (Ba-Nd&m) et Mndip<br />
(Dibum <strong>de</strong> Wdoubian et Bamiléké <strong>de</strong>s chefferies Bbiam et Moya).<br />
Cette plus gran<strong>de</strong> hétérogénéité modifie le profil du pionnier.<br />
L'origine ethnique du migrant a en effet une gran<strong>de</strong> importance qunnt 5<br />
sa stabil-ité, et le type <strong>de</strong> relation qu'il établit avec sa région dtori-<br />
gine.<br />
Le migrant bamiléké cherche en général à s'installer définitive-<br />
ment en ouvrant une plantation <strong>de</strong> café et en pratiquant <strong>de</strong>s activit5c<br />
tertiaires i transport, commerce, artisanat, etc... Siil part, se zera<br />
pour y laisser un frère ca<strong>de</strong>t poursuivre son oeuvre. Il se lancerL slozs<br />
dans <strong>de</strong>s activités plus lucratives, en général dans un milieu urbzin<br />
proche. Clest ce que nous avons appelé le projet pionnier.<br />
Il ne faudra pas, par contre, attendre la m&me stabilité dlau-<br />
tres migr?.nts, car les comportements socio-économiques peuvent &tre<br />
variables.<br />
Les originaires <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Bamenda (Province du ~ord-Ouest)<br />
par excm~le, recherchent un travail salarié et temporaire. Dès 1970,<br />
plusieurs ortçinaires <strong>de</strong> cette région se trouvaient déjà dans ia zone<br />
et &toffrz.ient pour exécuter <strong>de</strong>s travaux Ponctuels à la tâche : d8fri-<br />
chemcnt, etc,.. L'existence d'une prime alimentaire durant les trois<br />
premi5res nnnbes d'installation ne peut qu'inviter ces migrants à une<br />
présence plus stable en adoptant le statut <strong>de</strong> pionnier. Il nien rente<br />
pas moins que leur migration reste temporaire car, contrairement ?.LW<br />
Bamilcké, terre ne manque pas dans leur chefferie diorigine et ils<br />
peuvent f:i.cilement y retourner après avoir gagner quelque argent. Cge:;t<br />
en eEPet la recherche <strong>de</strong> ltzrgent qui motive leur déplacement. Ils cont<br />
par exemple nombreux dans leg gran<strong>de</strong>s plantations industrielles <strong>de</strong> la<br />
C.D.C. et <strong>de</strong> la Pamol, dans la région <strong>de</strong> Buéa (Sud-Ouest). Nous doutons<br />
qu'ils puissent assurer à <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<strong>Bafang</strong> une base stable.
Il en ressort <strong>de</strong> m&me <strong>de</strong>s migrants originaires du Nord du Cane-<br />
roun : quelques Mbororo sont venus et repartis, <strong>de</strong> même <strong>de</strong>s Guiziga<br />
qu'on avzit fait ven5.r pour jouer le rôle <strong>de</strong> bouviers lorsque les diri-<br />
geants <strong>de</strong> l'Opération visaient la multiplication d'un troupeau <strong>de</strong> boeufs<br />
<strong>de</strong> race ndam.<br />
Les jeunes &ton sont souvent sollicités par les recruteurs <strong>de</strong><br />
main dtoeuvre. Leur situation est en effet comparable aux Bamiléké :<br />
la terre nianque en pys eton et les jeunes ne peuvent y ouvrir <strong>de</strong>s pb-n-<br />
tations à leur propre compte. Ils se réfugient alors dans <strong>de</strong>s activités<br />
en liaison zvec le niilieu urbain le plus proche qui est Yaoundé (ventc<br />
<strong>de</strong> v5n <strong>de</strong> palme, maraichage, etc...), où ils émigrent. Jusqu'à prjbent<br />
on constcite e1v.e les Eton n'investissent pas d'autres milieux ruraux que<br />
ceux c;u' ils occupent traditionnellement. Des pro jets qui envisagent 11 ins-<br />
tallation d'Eton au nord <strong>de</strong> la Sanaga, dans 13 région <strong>de</strong> Ntui,rencon-<br />
trent bc,iucoup <strong>de</strong> crainte <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s intéressés (1). Nous soinxes donc<br />
surpris <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong> nombreux Eton dans leo villages pionniers. Il::<br />
y sont arrivGs <strong>de</strong>puis 73/74, et 141 ont été recrutGs jusqu'à ce jnur.<br />
Ce chiffre est néanmoins amputé <strong>de</strong> nombreux départs (39,74% <strong>de</strong> part>ri~;:i;<br />
et il ne reste actuellement que 85 pionniers originaires du déparkemeit<br />
<strong>de</strong> la ~~1:ié!~ie caractère récent <strong>de</strong> cette immigration ne nous permet. pl:;<br />
encore <strong>de</strong> savoir s'il s'agit d'une immigration <strong>de</strong> type définitif ou<br />
temporaire.<br />
Sans doute, la présence parmi les responsables actuels <strong>de</strong> 1'0i25-<br />
ration <strong>de</strong> plusieurs cadres <strong>de</strong> m&me origine n'a pas ét6 snns rassurer les<br />
jeunes 1nigr;lnts <strong>de</strong> la Lékié en créant un climat psychologique Îrzvor;-.-<br />
ble.<br />
voir les articles <strong>de</strong> B. DELPECH - Le pont <strong>de</strong> l'enfance et le 3roje.t<br />
"10(,0 Î~ni2-les"¬e .. sur les opinions et aspirations <strong>de</strong> Seuner<br />
'i ~2.-.-.=- & <strong>de</strong>xékié - m, Yaoundé, ONARPY T, 25p multigr. ; et<br />
--- E t:ai <strong>de</strong> nrospective sociale : esquisse d'une communauté<br />
---L - -<br />
-unes ruraux sud-camerounais - 1977, Yaoundé, ON<br />
Trciv;:~ et Documents dc llI.S.H., 6dp. multigr.<br />
(2) chif:?'re communiqué par N. COMITI <strong>de</strong> la Mission FAC 1977.
Imm-i~ration Eton dans les villages pionniers<br />
<strong>de</strong> I~Oyération <strong>Yabassi</strong>-Bafaq<br />
Nombre <strong>de</strong> recrutés<br />
Total -..........141<br />
Source : SODENTKAM, Rapports annuels.<br />
Dms les années à venir, <strong>l'opération</strong> pourra vraisemblablement<br />
recruter <strong>de</strong>s jeunes, originaires du Littoral, qui auront binéfici6 dt~me<br />
formation rurale dispensée dans le cadre du Service Civique National <strong>de</strong><br />
Participation au Développement (S.C.N.P.D.) dont un centre a été cuvert<br />
à Ynbasci. Une première promotion sortait <strong>de</strong> ce centre le 10 juin 1977,<br />
soit une quiczzl-ine <strong>de</strong> jeunes. Des zones <strong>de</strong> colonisation agricole aux<br />
abords <strong>de</strong> quelques villages autochtones <strong>de</strong>s environs <strong>de</strong> <strong>Yabassi</strong> (1) salit<br />
actuellenent envisagées par le SCNPD pour offrir <strong>de</strong>s débouchés à ces<br />
jeunes ruraux, mais on peut penser que c'est principalement avec liOp6-<br />
rations k',lbassi-<strong>Bafang</strong> que l'articulation se fera.<br />
Enfin l'immigration spontanée qui se fixe aux abords du périnetre<br />
mis en v,?.le~u et dont nous avions évoqué les premières manifestations<br />
dès notre cnqu3te <strong>de</strong> 1971, se continue. La terre acquiert une valeur<br />
marcfiajl<strong>de</strong> et les achats <strong>de</strong> terrains se font actuellement autour <strong>de</strong><br />
20.0G0 j!', CI;'!!, à l'hectare.<br />
-<br />
(1 ) Ndoir lio-G, Ndok Bao, Ndokati.
Actuellement, les villages pionniers <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> <strong>Yabassi</strong>-<br />
<strong>Bafang</strong> ont une population totale <strong>de</strong> 5 162 habitants ce qui représente<br />
le ticrc <strong>de</strong> la population totale <strong>de</strong> l'Arrondissement <strong>de</strong> Nkondjok.<br />
Cette population totale se décompose ainsi :<br />
- cliefs <strong>de</strong> faniille homme ..... 1 441 soit 27,9%<br />
femmes ..... 137 2,7%<br />
- éïlouçes .................... 811 15,7$<br />
v enfants .................... 2 544 49,376<br />
- l7crsonnes à charge ......... 229 4,4%<br />
Pour attirer et retenir les colons ûgricoles, les dirigecntz<br />
<strong>de</strong> lc JCLi2NICAYl ont tout mis en oeuvre pour améliorer le sort du ncuveau<br />
pioniii er<br />
Com;!te tenu <strong>de</strong> l'inflation actuelle <strong>de</strong>s prix, la prime aliinen-<br />
taire p.ttYibuGe durant les trois premières années d'installation a Qtd<br />
augment 6e sub:3tanbiellement :<br />
nnci ens tarifs<br />
Aère nli!i<strong>de</strong> 3 O00 F CFA<br />
2ème mii\~e 2 250<br />
3ème xni~ce 1 500<br />
nouveaux tarifs<br />
i2n illus, le nouvel arrivant trouve déjà construite une cnzc <strong>de</strong><br />
5 x 3 rn ;?ci7: uii hébergement provisoire. Cette case servira eiisuit2 c?e<br />
cuisiiie lorsque le pionnier aura terminé la construction <strong>de</strong> sa m:.e<br />
défii1i.t ive.
L~OOO Operat ion ~abas/si- ~afanq<br />
/<br />
population totale<br />
9<br />
pionnier<br />
H+F<br />
épouses
Un effort particulier a été fait pour le développement du cport<br />
dans les villages. En octobre 1975, la SODENKAM,avait amémgé 7 temains<br />
<strong>de</strong> football et 5 terrains <strong>de</strong> volley-ball. 10 équipes <strong>de</strong> football, 11<br />
équipes <strong>de</strong> volley-ball (dont 4 équipes <strong>de</strong> femmes) et 2 équipes <strong>de</strong> hand-<br />
ball, y Cvoluaient. Le PIONNIER SPORTING CLUB réunit les meilleurs<br />
joueurs <strong>de</strong> liArrondissement <strong>de</strong> Nkondjok et affronte les équipes <strong>de</strong>s<br />
départements voisins.<br />
Les villages ont continué à se doter <strong>de</strong> foyers culturels (on en<br />
dénombre actuellement 17), <strong>de</strong> dispensaires (6 en 1977), dl écoles pi-<br />
maires et maternelles (12 Stablissements), etc... Nkondjok s'enorgueillit<br />
d'un coll5ge d'enseignement général, d'un centre d.e santé dEvelopyé,<br />
et surtout, d'une usine <strong>de</strong> décorticage <strong>de</strong> café qui a commencé à fonction-<br />
ner en 1~76/77~ et d'une poste ouverte le 31 octobre 76 et qui concrétise<br />
la promesoe du Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République lors d'une visite à Nlcondjok<br />
le 12 avril 1976.<br />
Ces équipements participent au mieux 8tre <strong>de</strong>s populations 10~-<br />
les. Nous <strong>de</strong>vons cependant mentionner quelques problèiiles qui sont sou-<br />
vent évoques par les intéressés.<br />
Des titreü <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong>vaient ?tre délivrés aux pionniers après<br />
5 annGes. Or les premiers pionniers installés ne disposent, jusqu'a cette<br />
date, que d'un titre <strong>de</strong> concession provisoire. Cette situation nfer;t<br />
pas s'-ns inquiGter les intéressés d'autant plus qulun arrêté du 13 aoQt<br />
1976 :~r;?cise le cahier <strong>de</strong>s charges du pionnier <strong>de</strong> la SODENEAM et prevoit<br />
le retrait du titre en cas dlnbsence prolongée : 30 jours consécutifs<br />
d'absence qour les nouveaux arrivés, 3 mois dfabsence pour ceux qui<br />
disposent d'un titre provisoire, 1 an d'absence pour ceux qui ont un<br />
titre d6finitiftsuffissent pour être sanctionné.<br />
Une distance s'est introduite dans les relations entre les pion-<br />
niers et l'encadrement technique et administratif. Les premiers pion-<br />
niers Bvoquent avec chaleur les premières années où les dirigeants <strong>de</strong><br />
1~0pérz.tion discutaient fréquemment avec eux, au sein m8me <strong>de</strong>s villnzes,
- 106 -<br />
<strong>de</strong> leurs problèmes et <strong>de</strong>s décisions à prendre* L'encadrement s'est<br />
parfois bureaucratisé, et par ailleurs, ne souhaite pas maintenir le<br />
lien dtzssishnce parternaliste qui prévalait au début.<br />
En aoQt 1971, la SODENKAM employait 418 salariés. Elle n'en<br />
emploie plus aujourdthui que 332 (1). Cette diminution est sans doute<br />
due au lancement <strong>de</strong> pépinières villageoises lesquelles ont allégé le<br />
dispositif <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>. Mais ce nombre reste manifestement ;levé<br />
puisqu'o2 'a 1 salarié pour 4,75 pionniers.<br />
Ces salariés, notamment ceux qui travaillent dans les bureaux,<br />
ont parfois tendance à se comporter comme une entité tout à fait indé-<br />
pendante <strong>de</strong> l'existence <strong>de</strong> ceux qui justifient pourtant leur présence,<br />
à savoir les pionniers* Ces <strong>de</strong>rniers se heurtent parfois à un comporte-<br />
ment bureaucratique, source <strong>de</strong> nombreux conflits relationnels souvent<br />
interprétss en termes ethniques car le recrutement <strong>de</strong>s salariés ne<br />
coïnci<strong>de</strong> pas forcément avec celui <strong>de</strong>s pionniers*<br />
*<br />
* *<br />
Sur le plan économique, la zone <strong>de</strong> mise en valeur agricole<br />
apparaft aujourd'hui comme une région productrice <strong>de</strong> café et <strong>de</strong> cacao,<br />
pratiquent en outre le petit élevage et participant à llapprovisionnenent<br />
en produits vivriers <strong>de</strong>s centres urbains les plus proches (<strong>Bafang</strong><br />
et Ynbassi) ,<br />
Lcs caféiers sont beaucoup plus nombreux que les cacaoyers, En<br />
1977, on avait la situation suivante pour l'ensemble <strong>de</strong>s villages<br />
"pionnieru" :<br />
(1) sont inclus dans ce chiffre les cadres techniques et administratifs,<br />
<strong>de</strong>s infirmiers et <strong>de</strong>s instituteurs, Les manoeuvres agricoles cons- !<br />
ti tuent la majorité .
2500<br />
CAFE CACAO<br />
d'après les plant s<br />
d ist ri bu& et utilisés<br />
w w<br />
67 68 6970 71 72 73 74757677 67 a69 70 71 7273 74 75 76 77<br />
O p6rat ion <strong>Yabassi</strong> - <strong>Bafang</strong>
nombre <strong>de</strong> plants . . . ..<br />
distribues et utilisés<br />
- CAFE<br />
CACAO -<br />
1967-1977 (1) .a.o.....ama.aa..w.**. 2747000 1176000<br />
superficie pI,-intée (en ha) (2) . .. 1 960 480<br />
dont en procluction . . . . . . . r.. ' , . . . . , 1 330 350<br />
production comnercialisée erî kg)(3). 493 500 5 800<br />
1)- -- EL CACAO<br />
1ntSre.t port6 gar les ~lpionnierst~ au cacao<br />
---YU--.."-U--o -----œœ---o-------------o<br />
Le cacaoyer a été très tôt introduit dans la région <strong>de</strong> Nkondjok<br />
par la coloniu~.tion alleman<strong>de</strong>. En 1913 une plantation européenne (plaiif-::--l;io;i<br />
Kuntz) fut :lise en valeur au sud immédiat <strong>de</strong> Nkondjok, dans l'actuel q.u:ir%ier<br />
Sahé. La ruerre 14-18 empécha son exploitation. Par ailleurs, on retrouve<br />
encore au jourdlhui , aux abords <strong>de</strong>s villages autochtones, <strong>de</strong> nombreuse;? camo-<br />
yères iib:;nd.onnc:es.<br />
:Des le début <strong>de</strong> ltOpération, l'accent fut m i s sur la cr'cric)c;.il-<br />
ture afiii cir6chn~1~,cr aux riq,ues d'une monoculture. De 1967 à 1977, 3,:: <strong>de</strong>s<br />
plants dir-;tribues (et utilisés) ' (caféiers + cacaoyers) sont <strong>de</strong>s cacaoyer::,<br />
et ce pourcent2,ge d6passe les 50% pour les <strong>de</strong>ux villages <strong>de</strong> Ndoktibn et <strong>de</strong><br />
Madip dont li posulc?,tion originaire <strong>de</strong> 1' Arrondissement m6me <strong>de</strong> Nkond jolz c:k<br />
déjà fnini!.iarisL:e avec cette culture (ce qui n'est pas le cas pour 1:-i i?ll~l.-<br />
part <strong>de</strong>r: c.'J.-L-~cL; $;!migrés dont beaucoup viennent <strong>de</strong>s P1;itcnux <strong>de</strong> ltOue:i%).<br />
' h; " .' "<br />
Viennent ensu?-te les villages lefi plus récents sur lesquels 12 SODL; -?,ii<br />
accentue sa ::olitique d' encouragement à la cacao culture.<br />
-0 -<br />
---. .<br />
(1) La SOlIE?T!~;AFI effectue chaque année une v6rification <strong>de</strong> l'utilisatioii efîec-<br />
tive <strong>de</strong>s :3lcin'cs qui elle a distribués. Pour la <strong>de</strong>rnière anliée, 1376/7';',<br />
nous nI,:voi~s eu que les effectifs distribués czr ln vérification nt,-v,:fi.t<br />
pas encore eii. lieu.<br />
(2) dluprCs LI:^ recensement dc la SODENKAM en avril' 1977.<br />
(3) Produckion Cl et? seuls villages llpionnierslt car L2 SODENKAM commercic.lise<br />
en plu:: 1~; produits du Centre d'Appui technique <strong>de</strong> Nkondjok (feri~:e ::zpérirneni;r:lc<br />
qu'elle gère directement) et ceux <strong>de</strong>s planteurs nu-l;oc?'stojici,<br />
<strong>de</strong>s vill:~,.gcz voisins qui se sont inscrits à ln coop6rntive mise cil f)lace<br />
dans lc c:tdre <strong>de</strong> ltOpérstion (la C.R.E.A.).
Nombre <strong>de</strong> cacaoyers pour 100 plants distribués<br />
et utilisCs - pc-r village -<br />
Ndoktiba 10 ......... 53'6%<br />
Ivi2d i~ 16ter ...... 52,6<br />
.........<br />
......<br />
Iio~i.cn jou 7 39'0<br />
Dissouk 2bis 37'6<br />
bIiné 16 ......... 36,2<br />
Tarn 8 ......... 31,8<br />
ilgoman 2 ......... 3092<br />
moyenne générale - ......... 30'0<br />
IbIatoubé<br />
Malé<br />
TsIdo clcsarnba<br />
:Do ckouma<br />
1\J j ingang<br />
Ms.bo1nbé<br />
DBi;oulé<br />
Gène bis<br />
Cependant, tous les plants n'arrivent pas à croftre dans <strong>de</strong> bon-<br />
nes conditions. D'après le nombre total <strong>de</strong> cacaoyers distribués et estimés<br />
avoir ét8 htiliscs, et en appliquant la moyenne <strong>de</strong> 1600 plants par hectzre<br />
(indice utilis6 pûr les services techniques <strong>de</strong> la SODENKAM), ont <strong>de</strong>vrait<br />
obtenir LUI total <strong>de</strong> 735 ha <strong>de</strong> cac
Compte tenu d'une part <strong>de</strong> ces pertes qui sont plus fortes que pour<br />
les caféiers (1 22,4%)* et d'autre part qu'on peut mettre davantage <strong>de</strong><br />
cacaoyers sur un hectare que <strong>de</strong> caféiers (1600 plants en moyenne contre<br />
1089), on nt, finalement que 79,8% <strong>de</strong> la superficie <strong>de</strong>s plantations occu-<br />
pés par <strong>de</strong>s cncaoyers.<br />
La situation est très variables selon les villages et on peut<br />
dresser un second classement prirallèle au précé<strong>de</strong>nt.<br />
e occupés par <strong>de</strong>s cacaoyers pour<br />
100 - hectares <strong>de</strong> plantation - par village -<br />
Mzdip 16ter ........ 40,8%<br />
Iidoktiba 70 ........... 32,8<br />
Koiieil jou 7 ........... 31,9<br />
6ème bis 6b .......... 28.3<br />
Na16 6 ........... 25,6<br />
Tarn 8 o.....m.... 23.5<br />
Ngoman 2...i ....... 22.5<br />
moyenne générale ........... 19,8<br />
Fiabombé<br />
Dissouk<br />
Mdo cksamba<br />
Miné<br />
Njingnng<br />
Wcttoub6<br />
Dékoitlé<br />
Do c!;ouma<br />
On constate en comparant les <strong>de</strong>ux classements que les villages<br />
Miné et Dissouk ont été éliminés <strong>de</strong> la tete du second classement, ce qui<br />
donne à penser que les pertes ont été particulièrement importantes kns<br />
ces villages.<br />
En dLfinitive, on a pour chaque village la superficie moyenne yc,r<br />
exploitation (diaprès ie recensement <strong>de</strong> la SODENKAM d'avril 1977) :
Superficie~lcntée en cacaoyers par village<br />
moyenne pur un exploitant<br />
Ngo iimn<br />
i'.Iadip<br />
Malé<br />
Di::soulc<br />
Mabombé<br />
Kouen jou<br />
rd jinpang<br />
2 ..........<br />
l6ter .......<br />
6 ..........<br />
2b .........<br />
4 ..........<br />
7 ..........<br />
1 ..........<br />
moyenne générale ...........<br />
Iddo clcsümba<br />
Nntoubé<br />
Min6<br />
D&roiili;<br />
3 ..............<br />
4 ...........<br />
16 ............ i<br />
3b ...........<br />
Ta fil 8 • , ..........<br />
lidoktiba 1 O ............<br />
Do clc O umz. 13 ...........<br />
6èze bis 6b ...........<br />
A la meme date, et selon le même recensement, la superficie moyenne<br />
par exploitant pour le café est <strong>de</strong> 1,2 ha, soit quatre fois plus.<br />
Cette prééminence <strong>de</strong> la caféiculture sur la cacaoculture est d'au-<br />
tant plus frappante qu'après un début prometteur, la production <strong>de</strong> =tao<br />
(du moins celle cornmercialisée par 1s SODENKAM) s'est effondrée ces <strong>de</strong>r-<br />
nières annbeu : en 1974/75, 9,36 tonnes avaient Ct6 commercialisées (soit<br />
une moyenne <strong>de</strong> 12,4 kg par exploitant), mais seulement 5,8 tonnes en 1976/77<br />
(soit 4,6 kg exploitant).<br />
Ce f,?ibIe développement <strong>de</strong> la cacaoculture s'explique du fait qtie<br />
les villages pionniers se situent à la limite septentrionale <strong>de</strong> zone &CO-<br />
logique du G-.c~.o (<strong>de</strong> 4043 <strong>de</strong> latitu<strong>de</strong> nord pour le village Ndoktiba, à<br />
4O59 pour Njin~2.n~)~ et que la plupart <strong>de</strong>s colons ne sont pas initiés à<br />
cette culture. Cependant, un <strong>de</strong>s premiers villages fondés, Ngoman, nlavnit
pas reculé <strong>de</strong>vant l'effort d'initiation et plusieurs <strong>de</strong> ses membres avaient<br />
participé am stages <strong>de</strong> formation organisés par liOpération, ce qui exsli-<br />
que sa p06itioh en tete du classement précé<strong>de</strong>nt. On peut rappeler à ce<br />
<strong>propos</strong> que les prix d'achat officiels pratiqués ces <strong>de</strong>rnières années ont<br />
.<br />
quelque peu dC couragés le paysannat ( ' 1 .<br />
On peut remarquer par ailleurs que le relief chaotique <strong>de</strong> la rcgion<br />
n'offre bien souvent que <strong>de</strong>s vallées trop encaissées aux pentes convcxeü,<br />
peu aptes; la culture du cacaoyer lequel préfère les bas-fonds plus hul~i<strong>de</strong>s,<br />
Ce facteur explique sans doute la dffrérence entre Malé et Dockoumn, et<br />
entre Ngonün et Njingang.<br />
La rofiuction cacao ère<br />
2111-W"UIIII--Y--II<br />
TA2 production cacaoyère dépend plus précisément d.es superficitr; '!cil<br />
prod~ction~~, à-dire <strong>de</strong>s plants ayant au moins 4 ans et qui coinmence~~t<br />
à fructifier. En 1977, 72,3% <strong>de</strong> la superficie plantée en cacaoyers étz-it<br />
productive ( 1 ) .<br />
On aboutit à un nouveau classement <strong>de</strong>s villages où seules les<br />
cacaoyères e2 zroduction sont prises en compte (2).<br />
Superficie plrintcie en cacaoyers ,' et en produc.tion,<br />
- par villi?~ - nne pour un exploitant -<br />
-<br />
Ndo ck~amba<br />
ICouond jou<br />
Madip,<br />
i\T j i ngzng<br />
Do ckouna<br />
3...,... 0,23<br />
7 ..-....i.. 0,23<br />
I6ter .... 0,23<br />
1 ....... 0,22<br />
13 ....... 0,13<br />
Di::?.c;oi!]:<br />
i:in&<br />
ï'u'cl«l.z-tiba<br />
2b ....O. 0913<br />
16 ..W.... 0913<br />
10 ..... '.a 0,10<br />
- -<br />
(1) On a psr vi!.lage : 13 (IOCYL), 6 (99,3%), 4 (98,6$), 3b (97.,9%), 4 (93,1?;)<br />
2 (80 A;:), g ('12,6%) 10 (64,3%), 1 (63,8%) 7 (56,4%), 16 (54,3%), ~Gter<br />
41,~$j, 23 (34,0%), ! e t 6b (0%).<br />
(2) Rap2ort entre ln superficie en production en 1977, et le nombre diexploi-<br />
tants en 1973 (date à laquelle les cacaoyers plantés peuvent effectivement<br />
commencer A produire à partir <strong>de</strong> 1977). Ceci explique que cer'cl-,inca moyen-<br />
nes soient plus blevées que pour le classement précé<strong>de</strong>nt.
La production dépend aussi <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments. Pour l'ensemble <strong>de</strong>s<br />
villages, le ren<strong>de</strong>ment était en 1976/77 <strong>de</strong> 16,5 kg. par hectare, ce qui est<br />
une moyenne très f'zible. Ceci c'explique en partie par une chute <strong>de</strong> la<br />
production ces <strong>de</strong>rnières années. En fait, ln production maximum a 8t6<br />
atteinte en 1$74/75. A cette date là, mais d'après un autre mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> czlo~'.l<br />
à partir <strong>de</strong>s plants distribues et utilisés, les ren<strong>de</strong>ments moyens dépassnicnt<br />
les 50 kg/ha.<br />
Ren<strong>de</strong>ments-<strong>de</strong>s (kg/ha) par village et<br />
selon <strong>de</strong>ux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calcul distincts A et B<br />
en 7976/1977 en 1974/1975<br />
A B B<br />
Miné 16... 40,7 11,8 37,6<br />
Madip 16ter 37 ,l 23,O /<br />
Mal6 6. .. 26,4 27,7 703<br />
Kouenjou 7 26,2 15,s 119,9<br />
Dissouk 2b 25,2 9t8 /<br />
Ndo cksnmbr. 3 22,8 l3,2 47,7<br />
Matoubé 5 14,2 11,4 50,6<br />
Dékoulé 2b r 11,g 11,8 4895<br />
Ngoman 2 8,4 6,2 33.7<br />
Mabombé 4... 7 13 4 9 53,6<br />
Dokouma 13.. 410 1 ,Lt 799<br />
Njingang 1 . 3v4 2s4 27,3<br />
Ndoktiba 10, / / 17,6<br />
Tarn<br />
r,<br />
Ur / / /<br />
6ème bis 6b / /<br />
moyenne g6ii6r:.le 16,5 11,8 57,7<br />
----l-------"----II-..----I.I----------<br />
A : Production commercialisée par la SODENKAM en 1976/1977 par rap~ort<br />
à lc supr2icie "en productiont! (1977).<br />
B : Production conmercialisée par la SODENKAM en 1976/77 et en 1974/75 pu<br />
rapyort 2 12 superficie calculée à partir <strong>de</strong>s plants distribués aux<br />
annees antcrieures et qui sont susceptib3Bs <strong>de</strong> produire à la date <strong>de</strong><br />
production.
L'analyse <strong>de</strong> ces résultats s'avère complexe. L'année 1976/1977<br />
est une annGc <strong>de</strong> très faible production. Nous avons esos.yé <strong>de</strong> compenser<br />
cette situation pxr une réference à l'année 1974/75, mais nous avons dQ<br />
alors faire an~~el un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul@) beaucoup plus approximatif. Au ni-<br />
veau d'un village, nous sommes d'autre part amenés à travailler sur <strong>de</strong>s<br />
petite nombres, ce qui n'est pas ststistiquement satisfaisant. Enfin, les<br />
recensements, of-Fectués par les services techniques <strong>de</strong> la SODENIUM ont Ct6<br />
utilisés telc; quels sans vérification supplémentaire.<br />
On con;tLl.'ce que Mal6 et Miné rejoignent en tete du classement le<br />
village FIc.dip dont nous avions précé<strong>de</strong>mment signalé son intérêt pour 1;.<br />
cacaoculture du E-it <strong>de</strong> sa population autochtone. Malé et Miné sont pr2ci-<br />
sérnent <strong>de</strong>ux v?-l-lq,es qui ont fait un effort particulier, entre autres en<br />
achetant <strong>de</strong>s pulvérisateurs T 16.<br />
Nombre <strong>de</strong> - pulvérisateurs T 16 pour 100 exploitants en 1972<br />
PI& 6 ........ 26,l pulvérisateurs<br />
Mini. 16 ........ 22.6<br />
Iiix-toub6 4 .O. 73.2<br />
Ndo clrsninba 3 ........ 17.9<br />
Dékoulé 3b ....... 70.9<br />
moyenne g&néraie ....... 8.2<br />
IUg J omn<br />
110 &oula<br />
I.Iabomb6<br />
Icouend jou<br />
r1<br />
lafil<br />
N j ingang<br />
Mn'd ip<br />
'U~GUOLI':<br />
Iddo'rtiba<br />
GGme bis
Finalement, on aboutit à <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s disparit6s entre les vil12ges<br />
quant à Ica :?;io(u
a)- Superficies plantées<br />
a-- m...---------------<br />
Zn niai 1977, la superficie plantée en caféiers atteignait prèc Il'e<br />
2000 ha (1) soit une moyenne <strong>de</strong> 1,24 ha par exploitant. Apparemment cecl<br />
est peu. En fait, il convient <strong>de</strong> se rappeler que nous sommes dnns une Loi7-:<br />
d'immigration oci les nouveaux venus font baisser automaticiueiaent la irlo:t un -<br />
ne par exp1oit:~nt.<br />
Si on tient compte <strong>de</strong>s seules plantations en production on z<br />
(toujourz en i:;vril 1977) : 1328 ha. Cette superficie est à mettre en r~.?~~or-t<br />
avec le nombre diexploitants qui ont pu mettre en valeur ces plant2tion:3,<br />
c'est-à-dire ccux qui etaierit déjà présents en 1973; il faut en effet li- :,n:-<br />
pour qu'une -1s.n-Lntion arrive à mztturité. Ceci donne une moyenne <strong>de</strong> 1 ,O5 hi<br />
en production par exploitant ce qui n'est pas négligeable.<br />
LA :.ut:ci, la situation pzr village est très variable. Hormis quel-<br />
ques cas (Ndoi:tibn qui n'a pas consacré <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s superficies & ln ct.f:i-<br />
culture; Eiic6 et Dissouk qui au contraire ont mené à bien ln mise en v,ilclct-<br />
<strong>de</strong> leurs pl;;-n-i;c.tlons <strong>de</strong> café) la performance <strong>de</strong>s villages quant aux su2erfi-<br />
cies mise.? en vxl-eur, correspond à leur ancienneté (2)<br />
-<br />
(1)~'éval~tion dcs superficies à partir- <strong>de</strong>s plants distribuCs et utilis6s<br />
<strong>de</strong> 1?37 à 1!'77, donne près <strong>de</strong> 2500 ha soit + 22,4 (mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul B<br />
dont ilou:: avons dkjà dit qu'il était plus aléatoire que le Recensc?;.lcnt<br />
fait eii avril 1977).<br />
(2) Il fact se rappeler néanmoins que'les villages peuvent recevoir <strong>de</strong>r,<br />
éléments conplémentaire ultérieurement à leur fondation par un premier<br />
contin2en-t .
Superfi ciec -1.intées en caféiers, par village<br />
(moyenne pT.r exploitant)<br />
Villages I?,).r o~d.re<br />
d'anciennetc<br />
S. en ha S. en production (a)<br />
Ndolrtib. . 10 ........ 0137 0,11<br />
Do c!ccuma 13 ........ 0,97 0,84<br />
Miné 16 ........ 1,23 0, 47<br />
Kouend. j ou 7 ........ 0,82 0,41<br />
Ma di p I6tcr ..... 0,75 0,48<br />
D~S::DI& 2b ....... 1,89 1,lO<br />
Tarn<br />
6ème bi:i<br />
8 ........ 0,65<br />
6b ....... 0,16<br />
. -<br />
1,15<br />
/<br />
-------I-I"-I-I--U----------"----------------------------------------<br />
(a) par rapport aux pionniers présents en 1973 qui ont pu mettre en va-<br />
leur ces 21,-.ntations actuellement arrivées à maturité. Ce ci explique<br />
que ln i~loyenne puisse Qtre parfois supérieure à celle d.e la superfi-<br />
ficie tutale,<br />
Les rendc:ients<br />
" - 0<br />
Ut:?.-rCc la production comnercialisée en 196/77 soit près <strong>de</strong><br />
500 tonnez <strong>de</strong> c2f6 cérises, on a un ren<strong>de</strong>ment moyen <strong>de</strong> 372 kg à 11hect7.re d:<br />
caféiers en p~oduction. Ce ren<strong>de</strong>ment varie selon les villages et ceci in-
dépendamment <strong>de</strong> leur ancienne té (1 ) .<br />
Classement <strong>de</strong>s villages selon le ren<strong>de</strong>ment en 1977<br />
(nombre <strong>de</strong> kg/ha en production9<br />
c)- La production<br />
Ndoktiba (2) 10 ....... 817<br />
kl; 6 ....... 756<br />
Do c!:ouma 13 ....... 451<br />
Eloueiid j ou 7 ....... 421<br />
Nabombé 4. ....... 402<br />
Ndoksnrnba 3 ....... 386<br />
moyenne gén6rale ....... 372<br />
b21-le est en rapi<strong>de</strong> augmentation du fait <strong>de</strong> l(accroissement <strong>de</strong>s<br />
superficieci nises en valeur. En 1975/76 et 1973/74 <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts au nivenu<br />
<strong>de</strong> la ~~~~~~~~~~~~sûtion du café (la C.R.E.A.) a été concur. ncés per <strong>de</strong>s<br />
usiniers i~~t~~1.1;~ dans le Petit Diboum et à Sohok) marquent la courbe <strong>de</strong><br />
production sans cependant en infléchir l'allure générale.<br />
(1) Un autre riodc <strong>de</strong> calcul à partir <strong>de</strong>s plants distribués et utilisés <strong>de</strong><br />
1967 l:;gj, et compte tenu d'une moyenne <strong>de</strong> 1089 caféiers par hectare,<br />
donne un classement légèrement différent :<br />
Halé 8% 1, Kouend jou 471, Mabombé 469, Madip 422, Ndocksamba 401,<br />
M~itoubé 393, Ndoktiba 394, Miné 361, Dockouma 358, Dékoulé 324,<br />
l:gon,zn 309, Njingang 303 et Dissouk 123.<br />
Les valeurs sont plus groupéeBque dans le classement précé<strong>de</strong>nt et la<br />
moyenne plus &levée : 416 kg à l'hectare en production.<br />
(2) Les superficies en production à Ndoktib et à Malé ont sans doute 6tE<br />
sous-estin&eo,
En prcnant les années hors <strong>de</strong> ces inci<strong>de</strong>nts, nous avons établi <strong>de</strong>s<br />
courbes par vil-lage. Les villages les plus anciens plafonnent dans leur<br />
production, voire n&me diminuent s'ils n'ont pas eu un nouvel apport d'in-<br />
migrés dé 3~i.i~ lcur fondation: cl est le cas <strong>de</strong> Ngoman, N jingnng et Dékou.16.<br />
En 1?76/1977, les exploitants qui étaient déjà présents en 137~ ot<br />
dont les :~lr.nt~tionç étaient en production en 1976/1377, ont rccolté ex<br />
moyenne 370 1:g <strong>de</strong> café cérises. Par village, on obtient un classeinent crir-<br />
respondaiit f:roç::o-modo à ltancienneté mais, où Malé se signale par sa pcr-•<br />
formance positive alors que Ndoktiba stsligne avec les vil-lages les ?lus<br />
récents.<br />
Classement <strong>de</strong>s villxs selon la production moyenne<br />
par expïoit~~nt A----. (en&c%fé cérises 1976/77)(1)<br />
blnl; 6 .....o.. 891 kg.<br />
Iigordan 2 ....,... 796<br />
Ildo cküLl-mba 3 ........ 603<br />
I:nboilib& 4 .....*.O 497<br />
iiCl.;oul6 3b ....... 403<br />
Do clcoun~<br />
T,! j in~y::~.nc;<br />
PIa t0ubC<br />
Kouond jou<br />
FIadip<br />
MinC<br />
i'ido!.:tibn<br />
i)ir!nauk<br />
- -- P<br />
(1) Production 1?'76/1977 par rapport au nombre dtexploitcnts en 1/73.
500000<br />
Opération ~a bassi - <strong>Bafang</strong>'<br />
PRODUCT~O N <strong>de</strong> CAFE<br />
-400 O00 1969-1976<br />
300 O00<br />
. -<br />
L<br />
. Njingang<br />
N docksa m ba
En 11.11s <strong>de</strong>s 500 000 kg cerises produits en 1976/77 par les villa-<br />
ges <strong>de</strong> llOpGr:>iLm, la SODENKAM commercialise 163 OC0 kg que lui apportent<br />
les planteu-rn .iutochtoncs inscrits à la coopérstive <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong> (C.J:.,,~l.).<br />
Dfautre ,7-rl, rl:ielqiies employés <strong>de</strong> 13. SODENKAM ont ouvert une plantation<br />
personnellc et le Centre d'Appui Technique commercialise les produits <strong>de</strong><br />
ses p1ant;tioiis expkrimentales. Ces apports complémentaires, non négliye~~bles,<br />
permettenl :L 1,. BODENKAM <strong>de</strong> commercialiser près <strong>de</strong> 700 000 kg cériçes.<br />
Iles per.:pectives <strong>de</strong> diveloppement <strong>de</strong> ltOpérntion par la continuit;<br />
<strong>de</strong> 1'imriii::r- tioii, et lt intégration potentielle <strong>de</strong> ln production caf&itire<br />
dss villd.{{ûs ive<br />
C.R.E.A. 2 pv-.~~?er par camion <strong>de</strong>:; ~roduits vivriers vers Bafzng, Pnbx : i<br />
et parf0i.s Doil.;.la. Ceci permet à ia C.R.E,A. <strong>de</strong> faire 6tat <strong>de</strong> st 'ti 2; 5 .!,<br />
<strong>de</strong> commerci;ilisation. On peut ailisi dresser le tableau auiv~int qui ii~or.i:?c.<br />
que, lors <strong>de</strong>s i.iei!.lers qnnues, C.R.E.A. commercialise environ % toanc<br />
<strong>de</strong> vivre piir exploitant en moyenne. La baisse <strong>de</strong>fi ann6es 7')72/74- est d.uc.<br />
drapréfi<br />
r;Ll~;?ortc annuels <strong>de</strong> la SODENKAM à un niauvnis étnt <strong>de</strong> la 1-i:l~";~e<br />
Produits --Amoyenne<br />
pc1.r cx:~loitant - en tonnes -<br />
vivriers commercialisés par la C.R.E.A.<br />
--<br />
0,17 tonnes<br />
O,42<br />
0,53<br />
0 ,:18<br />
0 ,?a<br />
O,%<br />
0,47<br />
O, 77
En 1974/1975, le rapport annuel <strong>de</strong> la SODENKAM ventile les pro-<br />
duits vivricrr,, commercialis6s par la C.R.E.A. selon leur nature. On a pou7<br />
cette date la :<br />
67,4 fd <strong>de</strong> plantains et bananes douces<br />
2:1,8 $ c!e mncabo et taro<br />
3 , tie divers (ignames, cannes à sucre, piment, arachi<strong>de</strong>s<br />
huile, etc..,).<br />
A noter que la production <strong>de</strong> riz, qui en 1969/70 avait atteint<br />
9 tonnes Ze saddy, a étG abandonnée par les pionniers.<br />
lt - Li!; :IJRTIT EUVAGE'<br />
Tr6s t8t, les nouveau immigrés ont voulu pratiquer le petit &le-<br />
vage. Certains ro,lriig;ont voulu se lancer dans une production importante. En<br />
fait, ln zone foi-e6:;-ti&re tropicale, en l'absence d'une infrastructure ~6th-<br />
rinaire , rc::tc sropice aux épidéniies et n'est guère favorable à un 6lhage<br />
intensif. L~~lêv,~.p:e est donc restb limité au niveau <strong>de</strong> chaque exploitation<br />
et ne f:.it ;xi.:.: l'objet d'investissements importants. En 1977, on avait en<br />
. .<br />
moyenne par cxnloitant 3,10 animaux,<br />
Moyenne nc.xii3urn Moyenne genérale<br />
...........<br />
..........<br />
volaillcç 2,j5 Ngoman 5,28<br />
chèvres, mou kons .... 0,54<br />
porcs ............... O,18<br />
Dissouk ......... 2,13<br />
Malé ............ O,48<br />
lapine 0,06 Ndocksamba 0,54<br />
..............<br />
...............<br />
......<br />
..........<br />
Total 3,10 Nguman ?,O1<br />
Le vj.;.lnc
1 Opération <strong>Yabassi</strong> - BAfang<br />
NOMBRE ~'AN~MAUX 1<br />
pour 100 Exploita t ions<br />
et par Village<br />
2 5 2b3b13 6 3 16 7 16ter10 1 4 8 6b<br />
villa g e s
Un 35ne groupe <strong>de</strong> villages n'a pas développé son cheptel <strong>de</strong> clièv~es<br />
et moutons et n'a -as diversifié sa production (pas <strong>de</strong> lapins par exemple!.<br />
Dans ce gïou;?e ler, villages <strong>de</strong> pionniers autochtones (16ter et 10) ne pri:ti-<br />
quent p2.s l1Glcvqe du porc. Le nombre moyen d'animaux p2r exploitant<br />
s' écheloime, 2our ce groupe, <strong>de</strong> 1,50 à 2,50.<br />
Znfin lez villages le6 plus récents, constituent un <strong>de</strong>rnier pouse.<br />
Cette l~r>$ve présentation <strong>de</strong> la situation démographique et économi-<br />
que <strong>de</strong>s vil-ï.a,-;cs -ionniers complète utilement notre analyse sociologique f~i-<br />
te en 1971. !L cette date en effet, les plantations <strong>de</strong>s premiers villages<br />
commençaient zeul~\rncnt à produire et nous n'avions pas pu alors d6veioy~er<br />
cet aspect .<br />
Lr ... ~i~ilyse lxTr village qui est actuellement possible gr3ce aux sé-<br />
ries statisti::ucs collectées la SODENKAM <strong>de</strong> 1967 à 1977, et au recense-<br />
ment <strong>de</strong>s i:u:ierficies plantées en avril 1977, nous a permis <strong>de</strong> iiiod~zle~<br />
les moyennes 6conomiq.ues concernant l'ensemble <strong>de</strong> <strong>l'opération</strong>. Ceci est<br />
d'autant plu:.; n6ce:c:saire que l'immigration continue diminue sensib1einen.t<br />
les perfornz.i~cec: dcns ln mesure où les nouveaux arrives cornmencent seulement<br />
la mise en v..~l.cur <strong>de</strong> leurs lots. Cependant, cette analyse par village slavé-<br />
re malgré tout tres insuffisante : l e village n'est pas en effet une unit;<br />
homogène. Si qnelques villages ont été remplis d' emblSe, donc sont homog6nc:-:<br />
quant à li2.ncieilrieté <strong>de</strong>s exploitations, d'autres au contrzire se sont reniplis<br />
progressivcilient ou ont eu <strong>de</strong>s a]?ports ultérieurs à un premier contingent.<br />
Ne serait-ce q,ue ;?Our cette raison, mais aussi pour d'autres (nous pcnsc1ir-i<br />
notamment 5 1-1 u;::iy;ine ethnique et géographique <strong>de</strong>s immigrés qui renvoie à<br />
leurs stratY,:ies uccialc~ et Gconorniques, aux caractkristiques démogrnphiques,<br />
au nive:.u dfins truction, etc.. . ) , il serait souhaitable <strong>de</strong> procéaer A<br />
une analyse lus fine par exploitation.<br />
C'czt dire que cet Gpilogue, qui est une mise à jour statistique,<br />
ne veut 2:~-s etre une conclusion définitive.
Entrée <strong>de</strong> la zone<br />
<strong>de</strong> colonisation agricole<br />
Pont <strong>de</strong> TOUMBASSALA sur le NKAM<br />
Pionniers <strong>de</strong>vant une case<br />
1<br />
,.+d ",<br />
- 7-'&,<br />
, ,&!,<br />
1 iJ..t,g:<br />
\ 1, \ l!]<br />
-1<br />
1 -*,<br />
, , 1 8''s 1 0 ,,'~
Extraction artisanale <strong>de</strong> l'huile <strong>de</strong> Palme<br />
par foulage au pied<br />
Tronçonneur<br />
-<br />
Une pépinière<br />
Défrichage <strong>de</strong> la forêt<br />
Une plantation <strong>de</strong> Caféiers