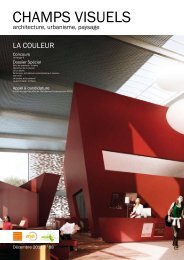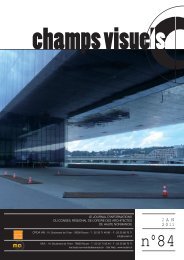Télécharger - Maison de l'Architecture de Haute-Normandie
Télécharger - Maison de l'Architecture de Haute-Normandie
Télécharger - Maison de l'Architecture de Haute-Normandie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHAMPS VISUELS n°83 • septembre 2010 - 1<br />
FORMATION<br />
QUANTIFIER L’INQUANTIFIABLE ?<br />
L’utilisation d’outils et <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s quantitatives<br />
en architecture est loin <strong>de</strong> prendre en<br />
considération le caractère subjectif qui qualifie<br />
un espace. La mesure ne reflète pas ce<br />
que l’on voit ou ce que l’on ressent. Dès lors<br />
chercher à évaluer l’inquantifiable <strong>de</strong>vient<br />
une aventure périlleuse qui pourtant semble<br />
vouloir prendre peu à peu son essor <strong>de</strong> par<br />
l’évolution notamment <strong>de</strong>s connaissances en<br />
neurosciences ou par le biais <strong>de</strong> critères économiques<br />
et sociologiques <strong>de</strong> plus en plus<br />
pris en compte. L’hégémonie <strong>de</strong> la mesure<br />
analytique et cartésienne dont on subit les effets<br />
à l’heure actuelle, a encore <strong>de</strong> beaux jours<br />
<strong>de</strong>vant elle : manque <strong>de</strong> pratiques, approche<br />
pas encore généralisée et ni systématique,<br />
besoin <strong>de</strong> prise <strong>de</strong> recul et <strong>de</strong> vérification…<br />
mais il ne fait aucun doute que la frénésie<br />
d’évaluation et d’expertise exponentielle risque<br />
d’aboutir à d’ahurissantes élucubrations<br />
visant à quantifier l’inquantifiable et à mesurer<br />
l’incommensurable.<br />
Quand on voit le contexte actuel du développement<br />
durable dans le domaine <strong>de</strong> la<br />
construction (dans d’autres domaines également),<br />
il apparaît que d’une manière généralisée<br />
sous <strong>de</strong>s airs <strong>de</strong> prises <strong>de</strong> bonne<br />
conscience généralisée, il n’en reste pas<br />
moins qu’une arrière-pensée marchan<strong>de</strong> est<br />
avant tout la principale motivation. A l’instar<br />
d’une mo<strong>de</strong>, le développement durable fait<br />
vendre et consommer, au risque <strong>de</strong> se contredire<br />
et <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s situations paradoxales<br />
qui embrouillent le commun <strong>de</strong>s mortels.<br />
Les lobbies industriels autant qu’énergétiques<br />
ont largement compris le caractère fécondant<br />
et rémunérateur <strong>de</strong> ce nouveau courant idéologique,<br />
structurant ainsi <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong><br />
normes opposables qui cadrent et régissent<br />
la « physicalité » <strong>de</strong> l’art <strong>de</strong> construire. Qu’en<br />
est-il <strong>de</strong> l’inquantifiable et <strong>de</strong> la subjectivité<br />
qui pour le moment semble leur échapper ?<br />
L’art <strong>de</strong> vivre ensemble – d’habiter ensemble<br />
– et la qualité d’usage feront-t-ils à leur tour<br />
l’objet d’une valeur immobilière exploitable<br />
transposée en normes, critères d’évaluation ?<br />
Il semble que cela en prenne le chemin,<br />
comme nous le montrent certains travaux en<br />
cours du CTSB, par exemple, autour <strong>de</strong> la<br />
<strong>Haute</strong> Qualité d’Usage, nouveau label parmi<br />
les labels. Bien entendu, certains diront que<br />
du moment que cela fait avancer les choses,<br />
c’est toujours bon à prendre. Mais ne soyons<br />
pas dupes, le « bon à prendre » rapporte et<br />
ne s’applique qu’à une vision une nouvelle<br />
fois limitée à la cellule individuelle ou au<br />
mieux à l’échelle d’un groupe afin d’en tirer<br />
un bénéfice immédiat… pour ce qui en est<br />
<strong>de</strong> la société et <strong>de</strong>s civilisations au sens large,<br />
tout reste à faire.<br />
La pensée holistique aussi louable soit-elle<br />
n’est pas encore monnaie courante, et la pratique<br />
quotidienne prouve combien le chemin<br />
à parcourir est escarpé. Dans cette perspective,<br />
les tentatives d’approche quantitative <strong>de</strong><br />
la réception sensorielle ou qualitative d’une<br />
construction sont à attendre.<br />
MÉMOIRE : suite<br />
HÉDONISME, PLAISIR, ÉMOTION…<br />
POUR UNE QUALITÉ DE VIE SUBJECTIVE<br />
DURABLE<br />
« Réfugiés dans villes, blindés dans nos<br />
voitures, en sécurité sur nos routes asphaltées<br />
ou dans nos maisons chauffées et<br />
climatisées, nous nous sommes détachés<br />
<strong>de</strong> ce qui est au cœur <strong>de</strong> l’humanité : nos<br />
racines biologiques, qui plongent dans le<br />
mon<strong>de</strong> naturel, la relation psychique avec la<br />
diversité <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> vie, l’ancrage dans<br />
<strong>de</strong> beaux paysages et la fraternité avec le<br />
mon<strong>de</strong> animal. »<br />
Une écologie du bonheur, E. LAMBIN<br />
L’architecture « verte » puise maintenant ses<br />
modèles dans la vision vertigineuse <strong>de</strong>s microcosmes<br />
biologiques, <strong>de</strong>s macrocosmes<br />
<strong>de</strong> l’astrophysique, dans les énigmes fractales,<br />
la complexité croissante <strong>de</strong> l’intelligence<br />
artificielle et les spirales <strong>de</strong> la manipulation<br />
génétique. Cette prise en compte <strong>de</strong> nouveaux<br />
champs, associée à la crise environnementale<br />
actuelle, interroge notre rapport<br />
avec notre milieu. Au travers d’approches<br />
sophistiquées ou plus traditionnelles, différents<br />
courants architecturaux se positionnent<br />
et cherchent <strong>de</strong>s solutions. Dans un premier<br />
temps, il semble que chacun <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong><br />
l’acte <strong>de</strong> construire doit se soumettre au dictat<br />
du tout justifier quantitativement. Mais la complexité<br />
<strong>de</strong> notre rapport à l’environnement<br />
et les structures sociétales actuelles nous<br />
conduisent à ouvrir notre champ <strong>de</strong> vision<br />
sur une approche multicritère et holistique<br />
<strong>de</strong>s disciplines autour <strong>de</strong> l’acte <strong>de</strong> construire.<br />
Il ne s’agit plus d’avoir une démarche unidirectionnelle<br />
mais bien au contraire d’ouvrir<br />
les champs <strong>de</strong>s possibles, même si pour cela<br />
il nous faut revenir à certains fondamentaux<br />
oubliés qui conditionnent notre qualité <strong>de</strong> vivre<br />
ensemble : s’abriter, se réunir, dialoguer,<br />
échanger, communiquer, etc.<br />
S’agissant <strong>de</strong>s finalités plus que <strong>de</strong>s modalités<br />
du développement durable en architecture,<br />
mieux vaut un instant délaisser les<br />
quantifications mathématiques qui s’épuisent<br />
à justifier un objet construit, pour retrouver<br />
la réalité du vivant avec son langage, ses<br />
dynamiques, ses tensions et ses surprises.<br />
Parce que nous construisons avant tout pour<br />
l’homme, il s’agit donc, <strong>de</strong> proposer l’élaboration<br />
d’un critère <strong>de</strong> qualité environnemental<br />
plus complexe et plus approfondi, où utilité et<br />
beauté, aspects quantifiables et non quantifiables,<br />
performances immédiates et promesses<br />
futures sont imbriqués, et ce, dans un profond<br />
respect du substrat naturel qui fon<strong>de</strong> notre<br />
existence même.<br />
Pour reprendre les termes d’Ezio MANZINI,<br />
l’idée est <strong>de</strong> proposer « une culture capable<br />
<strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s « artefacts » qui soient,<br />
comme autrefois, « faits avec art » ; autrement<br />
dit, <strong>de</strong>s produits nés du souci du détail,<br />
<strong>de</strong> l’amour pour la vie <strong>de</strong>s choses dans leur<br />
relation avec les hommes et l’environnement<br />
– <strong>de</strong>s produits qui seraient <strong>de</strong>s expressions<br />
subtiles et profon<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’intelligence, <strong>de</strong> la<br />
créativité et <strong>de</strong> la sagesse humaine. »<br />
« Le climat, ses intempéries, les matériaux,<br />
leurs propriétés, la stabilité, ses lois, l’optique,<br />
ses déformations, le sens éternel et<br />
universel <strong>de</strong>s lignes et <strong>de</strong>s formes imposent<br />
<strong>de</strong>s conditions qui sont permanentes.<br />
La fonction les usages, les règlements, la<br />
mo<strong>de</strong> imposent <strong>de</strong>s conditions qui sont passagères.<br />
C’est par la construction que l’architecte<br />
satisfait aux conditions tant permanentes<br />
que passagères. (…) L’architecte est<br />
un poète qui pense et parle en construction.<br />
(…) L’édifice, c’est la charpente munie <strong>de</strong>s<br />
éléments et <strong>de</strong>s formes imposées par les<br />
conditions permanentes qui, le soumettant à<br />
la nature, le rattachent au passé et lui confèrent<br />
la durée. » Contribution à une théorie <strong>de</strong><br />
l’architecture, A. PERRET (Paris 1952)<br />
Pour que l’on parle réellement <strong>de</strong> développement<br />
durable, cette adhésion morale ne<br />
doit-elle pas être intéressée, épicurienne et<br />
même hédoniste…L’émotion est gratuite en<br />
ressources naturelles, et favorable au bien<br />
vivre. Chaque société, chaque citoyen, peut<br />
la rechercher dans son jardin. Partagée, elle<br />
crée <strong>de</strong>s complicités, <strong>de</strong>s réseaux d’amitié,<br />
<strong>de</strong>s solidarités... au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> tous registres <strong>de</strong><br />
calculs.<br />
Si l’on considère la notion d’ « habiter » fondamentale<br />
en architecture, la question est <strong>de</strong><br />
produire autour <strong>de</strong> chacun un espace le plus<br />
généreux, le plus accessible, le plus confortable<br />
possible. De tout temps, l’architecture s’est<br />
inventée <strong>de</strong> l’intérieur vers l’extérieur (ou vice<br />
versa), <strong>de</strong> l’espace individuel jusqu’à la fabrique<br />
<strong>de</strong> la ville, sans discontinuité, autour d’un<br />
dénominateur commun : la personne.<br />
L’architecture est une discussion, un échange<br />
qui vise avant tout à qualifier chaque espace,<br />
puis définir les relations entre eux. La<br />
représentation qui implique la quantification<br />
(échelle, mesure, performance, quantité <strong>de</strong><br />
matières, surfaces, volumes…) vient ensuite.<br />
On enrichit, on simplifie, etc. L’objectif est <strong>de</strong><br />
créer un contexte spatial qui pose la question<br />
<strong>de</strong> l’usage et <strong>de</strong> sa qualité: le confort. L’enjeu<br />
actuel pour l’ingénierie est <strong>de</strong> réfléchir, à budget<br />
donné, à la manière <strong>de</strong> faire le maximum.<br />
Le challenge est désormais économique :<br />
comment produire plus avec moins ? Or,<br />
fondamentalement, rien ne pousse dans ce<br />
sens. La tendance actuelle à suréquiper, favorisée<br />
par les normes et l’application mécanique<br />
<strong>de</strong>s standards, semble oublier l’échelle<br />
<strong>de</strong> l’individu qui « habite » et pratique l’espace.<br />
Combien d’ « usines à gaz » voient le<br />
jour sous prétexte du développement durable<br />
? Mettre un pull-over, ouvrir les fenêtres<br />
<strong>de</strong>viennent <strong>de</strong>s pratiques presque honteuses<br />
et abjectes… une insulte à la raison pour reprendre<br />
les mots <strong>de</strong> R. RICCIOTTI.<br />
L’architecture est épicurienne : elle attrape<br />
ce qui passe à sa portée pour en tirer parti.<br />
L’architecture se vit, se pratique, s’habite. La<br />
gadgétisation qui semble contenter un grand<br />
nombre <strong>de</strong> maîtres d’ouvrage tant il est aisé<br />
<strong>de</strong> communiquer <strong>de</strong>ssus, ouvre les portes<br />
d’un assistanat <strong>de</strong> l’espace qui ne se réfère<br />
qu’à <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> mesures, <strong>de</strong>s son<strong>de</strong>s qui<br />
placent la personne au cœur d’un système<br />
technologique <strong>de</strong> plus en plus complexe qui<br />
lui échappe dans sa pratique quotidienne. A<br />
FORMATION<br />
l’heure où l’on parle <strong>de</strong> qualité d’usage dans<br />
l’art <strong>de</strong> construire, n’est-il pas encore temps<br />
<strong>de</strong> s’interroger sur ces pratiques consuméristes<br />
normalisées et <strong>de</strong> retrouver certains<br />
gestes simples, voire d’en inventer, afin <strong>de</strong> réduire<br />
cette emphase technologique et mettre<br />
l’homme dans une position d’acteur <strong>de</strong> l’espace,<br />
plutôt que <strong>de</strong> subissant.<br />
Qu’allons-nous prioritairement financer sur<br />
le principe <strong>de</strong> qualité, <strong>de</strong>s m 2 , <strong>de</strong>s matériaux,<br />
<strong>de</strong> l’isolation, <strong>de</strong> la climatisation ? La qualité<br />
a un grand défaut, elle ne se mesure pas<br />
avec un litre, ou une chaîne d’arpenteur. Elle<br />
s’apprécie en fonction <strong>de</strong>s circonstances, <strong>de</strong><br />
la culture <strong>de</strong>s utilisateurs, <strong>de</strong> leur capacité à<br />
en tirer profit. Cette appréciation nécessite du<br />
temps, <strong>de</strong> la confrontation, du dialogue, <strong>de</strong><br />
l’usure et <strong>de</strong> l’usage. Elle implique un effort<br />
qui place l’usage au cœur du débat, et c’est<br />
bien normal puisque, quel que soit le produit,<br />
c’est finalement sur son utilité et sa capacité<br />
à répondre à une attente qu’il doit être jugé<br />
(société du chiffre et <strong>de</strong> consommation).<br />
Revenir à la qualité d’usage n’est pas spontané,<br />
ni chose facile car souvent elle fait appel<br />
à <strong>de</strong>s notions sensorielles et subjectives difficiles<br />
à faire rentrer dans <strong>de</strong>s abaques « rassurantes<br />
» et objectives.<br />
Des raisonnements partiels viennent souvent<br />
troubler le jeu. On parle souvent du « coût<br />
global », en associant le coût <strong>de</strong> la construction<br />
et celui du fonctionnement du bâtiment.<br />
Mais on oublie <strong>de</strong> parler <strong>de</strong> son utilité. On<br />
sait que la qualité <strong>de</strong>s ambiances offertes aux<br />
employés d’un bureau peut faire varier leur<br />
productivité <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 10%, en intégrant les<br />
maladies du travail et l’absentéisme. Il y a là<br />
<strong>de</strong>s sommes d’argent considérables, et bien<br />
plus importantes (au moins cinq fois) que le<br />
prix à payer pour un surplus <strong>de</strong> qualité. Le<br />
projet subit un changement d’échelle. Au coût<br />
<strong>de</strong> l’équipement, on doit opposer sa valeur,<br />
marchan<strong>de</strong> mais aussi d’usage. On sort alors<br />
d’une économie unijambiste, celle où l’on ne<br />
considère que les dépenses, pour retrouver<br />
l’équilibre sur <strong>de</strong>ux jambes, avec d’un côté<br />
les dépenses, et <strong>de</strong> l’autre, en regard, les utilités,<br />
la valeur, les richesses créées. Une posture<br />
indispensable pour avancer sur la piste<br />
du développement durable..<br />
A l’instar <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> la commission STI-<br />
GLITZ, les critères d’évaluation d’un bâtiment<br />
vont sans semble-t-il prendre un chemin<br />
i<strong>de</strong>ntique. Une marche inéluctable vers le tout<br />
quantifier pointe peu à peu son nez. D’ores et<br />
déjà, <strong>de</strong>s chercheurs sont en passe <strong>de</strong> proposer<br />
<strong>de</strong> nouveaux indices à intégrer dans<br />
nos grilles d’évaluation…surtout lorsqu’il<br />
s’agit <strong>de</strong> vendre <strong>de</strong> la certification. Ne nous<br />
leurrons pas, le mon<strong>de</strong> du bâtiment connaîtra<br />
son lot <strong>de</strong> critères relatifs à la qualité d’usage<br />
ou la qualité d’ « habiter ». Des acteurs <strong>de</strong> la<br />
certification comme le CTSB en France y travaillent<br />
déjà. Au Canada, le BEEFP (Bureau<br />
d’examen <strong>de</strong>s édifices fédéraux du patrimoine)<br />
a mis en place toute une série <strong>de</strong> critères<br />
d’évaluation plus ou moins subjectifs afin <strong>de</strong><br />
mesurer la valeur patrimoniale et historique<br />
<strong>de</strong> certains édifices.<br />
MÉMOIRE : suite<br />
Alors que la pensée philosophique a longtemps<br />
réfléchi à la question <strong>de</strong> ce qui détermine<br />
la qualité <strong>de</strong> la vie, les récents progrès <strong>de</strong><br />
la recherche ont donc abouti à <strong>de</strong>s mesures<br />
à la fois nouvelles et crédibles. Ces recherches<br />
montrent un besoin d’aller au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong><br />
l’approche purement technicienne qui a encore<br />
<strong>de</strong> beaux jours <strong>de</strong>vant elle. S’ils ne remplacent<br />
pas les indicateurs traditionnels, ces<br />
indices seront - j’ose espérer - une occasion<br />
d’enrichir les discussions et <strong>de</strong> ré-intégrer la<br />
personne et ses conditions <strong>de</strong> vie ou d’usage<br />
dans les différentes échelles où se traduit la<br />
société (nations, régions, villes, bâtiments…).<br />
Plus important encore, ces nouvelles mesures<br />
tout en restant critiquables (car elles <strong>de</strong>vront<br />
l’être) offrent l’opportunité <strong>de</strong> dépasser<br />
la recherche statistique classique et sont l’occasion<br />
<strong>de</strong> mettre en cause la justification purement<br />
technocratique à outrance. Certaines<br />
d’entre elles reflèteront <strong>de</strong>s conditions structurelles<br />
relativement peu changeantes dans<br />
le temps mais <strong>de</strong>vront être adaptées selon les<br />
cultures et pratiques, d’autres sont plus sensibles<br />
aux mo<strong>de</strong>s en cours pourront être mises<br />
en oeuvre et pourront donc être suivies pour<br />
analyser les évolutions <strong>de</strong>s usages sur <strong>de</strong>s<br />
pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> temps plus courtes.<br />
Les enjeux du développement durable sont<br />
multiples et font directement appel, tant à<br />
notre conscience, nos émotions, notre sensibilité,<br />
notre sens <strong>de</strong>s responsabilités, qu’à<br />
nos connaissances, notre compréhension du<br />
mon<strong>de</strong>, notre logique, notre imaginaire, notre<br />
capacité à nous projeter dans l’avenir, à<br />
extrapoler, etc. Comprendre ce que signifie<br />
le développement durable, percevoir les enjeux<br />
dont il est porteur, le contextualiser, l’apprivoiser<br />
pour qu’il entre dans notre sphère<br />
privée et professionnelle, semblent donc <strong>de</strong>s<br />
éléments nécessaires pour permettre l’investissement<br />
individuel en faveur <strong>de</strong> la mise en<br />
place <strong>de</strong> ce processus et espérer ainsi voir<br />
naître l’implication et l’action indispensable à<br />
son émergence.<br />
Espérons que ces nouvelles valeurs contribueront<br />
à une re-valorisation et un re-positionnement<br />
<strong>de</strong> l’homme dans et en relation<br />
avec son environnement. A nous architectes<br />
et acteurs du bâtiment, <strong>de</strong> relever le défi et <strong>de</strong><br />
montrer qu’il sera encore possible <strong>de</strong> proposer<br />
<strong>de</strong>s cellules <strong>de</strong> « rêves », respectueuses,<br />
voire si possible réparatrices, <strong>de</strong> cet espace<br />
public lessivé par nos agressions qu’est notre<br />
planète.<br />
BIBLIOGRAPHIE CHOISIE<br />
SOCIETE<br />
Artefacts, vers une nouvelle écologie <strong>de</strong> l’environnement<br />
artificiel - Ezio Manzini - Ed. Les Essais,<br />
Centre Georges Pompidou, 1991.<br />
Changer le mon<strong>de</strong>, un gui<strong>de</strong> pour le citoyen du<br />
XXI ème siècle - Ed. La Martinière, 2006.<br />
Nous réconcilier avec la terre - Hervé René<br />
Martin & Claire Cavazza - Ed. Flammarion, 2009.<br />
Rapport <strong>de</strong> la Commission sur la mesure <strong>de</strong>s<br />
performances économiques et du progrès social<br />
- Joseph E. Stiglitz, Armatya Sen, Jean-Paul<br />
fitoussi - 2009.<br />
Repères pour un développement humain et solidaire<br />
- Paul Houée - Ed. Les Editions <strong>de</strong> l’Atelier,<br />
2009.<br />
Une écologie du bonheur - Eric Lambin, Les Essais<br />
du Pommier, 2009.<br />
ARCHITECTURE<br />
L’architecture écologique - Dominique Gauzin-<br />
Müller - Ed. Le moniteur, 2001.<br />
GREEN, architecture now - Philip Jodidio - Ed.<br />
Taschen, 2009.<br />
Habiter écologique, quelles architecture pour<br />
une ville durable ? Benoït Goez, Philippe Ma<strong>de</strong>c,<br />
Chris Younès, Ed <strong>de</strong> La Villette, 2009.<br />
H.Q.E. Rudy Ricciotti, Ed Transbor<strong>de</strong>urs, 2006<br />
Indéfinition <strong>de</strong> l’architecture - Actes Sud / Cité<br />
<strong>de</strong> l’architecture et du patrimoine, 2009<br />
Traité <strong>de</strong> construction durable - Collectif, Ed Le<br />
Moniteur, 2007<br />
PHILOSOPHIE<br />
L’architecture en théorie - Collectif, Ed. Jean Michel<br />
Place, 1996<br />
L’invention du plaisir - Michel Onfray, Ed Grasset,<br />
2002<br />
Le Nouvel Ordre écologique, l’arbre, l’animal et<br />
l’homme - Luc Ferry, Ed Grasset, 2002<br />
Politique du rebelle, traité <strong>de</strong> résistance et d’insoumission<br />
- Michel Onfray, Ed. Grasset, 1997<br />
FILMOGRAPHIE<br />
Equilibrium<br />
Film <strong>de</strong> science fiction <strong>de</strong> Kurt Wimmer (USA,<br />
2002). « Dans une cité du futur, John Preston,<br />
chargé <strong>de</strong> veiller au bon fonctionnement <strong>de</strong> la<br />
société se révolte contre une loi interdisant aux<br />
citoyens d’éprouver <strong>de</strong>s sentiments… »<br />
Origine<br />
Fable écologique <strong>de</strong> Keiichi Sugiyama, d’après<br />
une histoire d’Umanosuke Iida (Japon, 2006).<br />
« 300 ans après notre ère, la Terre vit meurtrie<br />
<strong>de</strong>s blessures causées par l’inconscience <strong>de</strong><br />
l’homme. Le mon<strong>de</strong> est désormais dominé par la<br />
toute puissance <strong>de</strong>s esprits <strong>de</strong> la forêt qui infligent<br />
à l’humanité leur colère pour les souffrances<br />
passées. Dans ce nouveau mon<strong>de</strong>, <strong>de</strong>ux cités coexistent<br />
: Ragna qui œuvre pour le retour <strong>de</strong> la<br />
civilisation, et la Cité Neutre, qui prône l’harmonie<br />
avec la forêt. Mais le <strong>de</strong>stin s’en mêle lorsque le<br />
jeune Agito réveille par hasard Toola, une jeune<br />
fille du temps passé. Le fragile équilibre qui régente<br />
cette Terre est à nouveau menacé… »<br />
Soleil vert<br />
Film d’anticipation <strong>de</strong> Richard Fleisher et Leigh<br />
Taylor-Young (USA, 1973). « New York, 2022. Un<br />
brouillard a envahi la surface du globe, tuant la<br />
végétation et la plupart <strong>de</strong>s espèces animales.<br />
D’un côté les nantis qui peuvent avoir accès à la<br />
nourriture rare et très chère. De l’autre, les affamés<br />
nourris d’un produit synthétique, le Soleil, rationné<br />
par le gouvernement… »<br />
Won<strong>de</strong>rful days<br />
Film <strong>de</strong> science fiction <strong>de</strong> Kim Moon-Saeng (Japon,<br />
2003). « 2142, à l’issue <strong>de</strong> terribles guerres<br />
ayant engendré une catastrophe écologique,<br />
quelques milliers <strong>de</strong> riches survivants ont<br />
construit Ecoban, une cité qui tire son énergie <strong>de</strong><br />
la pollution. Repliés sur eux-mêmes ils rejettent<br />
les réfugiés contaminés qui créent alors la citée<br />
voisine <strong>de</strong> Marr. Mais les séquelles <strong>de</strong> la guerre<br />
commencent à s’estomper et la pollution baisse.<br />
Craignant pour la survie d’Ecoban, ses dirigeants<br />
déci<strong>de</strong>nt d’incendier Marr afin <strong>de</strong> créer d’énormes<br />
sources d’énergie et mettre fin du même coup<br />
aux révoltent qui se multiplient… »<br />
Conseil Régional <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong>s Architectes - 1