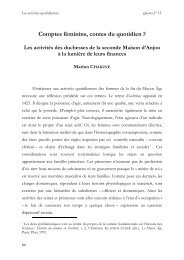Ruches, ruchers et récoltes de miel et de cire - Questes
Ruches, ruchers et récoltes de miel et de cire - Questes
Ruches, ruchers et récoltes de miel et de cire - Questes
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
<strong>Ruches</strong>, <strong>ruchers</strong> <strong>et</strong> <strong>récoltes</strong> <strong>de</strong> <strong>miel</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>cire</strong><br />
en France du Moyen Âge à l’époque mo<strong>de</strong>rne (XIII e - XVIII e s.)<br />
Catherine MOUSINHO<br />
L’abeille, l’Apis Mellifera, est un <strong>de</strong>s insectes à avoir été domestiqué par l’homme<br />
<strong>et</strong> les produits <strong>de</strong> son élevage occupèrent une place non négligeable dans la vie<br />
domestique <strong>et</strong> économique <strong>de</strong>s sociétés passées. Il existe peu d’étu<strong>de</strong>s historiques sur<br />
l’apiculture en France ; la plupart proviennent <strong>de</strong> l’anthropologie 1. Tous les historiens<br />
qui abor<strong>de</strong>nt ce suj<strong>et</strong> 2 s’accor<strong>de</strong>nt à souligner l’importance <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> la ruche <strong>et</strong><br />
donc <strong>de</strong> l’élevage <strong>de</strong>s abeilles en s’appuyant sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s documents comptables,<br />
notariaux <strong>et</strong> législatifs, mais sans réellement analyser la composante technique. Ceux<br />
qui l’abor<strong>de</strong>nt pour la pério<strong>de</strong> médiévale reprennent pour la plupart la thèse <strong>de</strong> la<br />
pratique <strong>de</strong> l’étouffage par opposition aux pratiques antiques, avec un regard péjoratif 3.<br />
Il m’a donc semblé pertinent d’examiner la variabilité <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong><br />
<strong>récoltes</strong> <strong>et</strong> les différents mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s ruches <strong>et</strong> <strong>de</strong>s <strong>ruchers</strong> pour la pério<strong>de</strong><br />
du XIII e au XVIII e siècle. Cela nous amène à nous interroger sur la chaîne opératoire<br />
1<br />
Voir Marlène ALBERT LLORCA, « Les servantes du seigneur, l’abeille <strong>et</strong> ses œuvres », Terrain,<br />
n° 10, Paris, Mission du Patrimoine Ethnologique, 1988, p. 23-37 ; Remy CHAUVIN (dir.), Traité <strong>de</strong><br />
biologie <strong>de</strong> l’abeille, Paris, Masson <strong>et</strong> Cie, 1968 ; 5 vol. ; Charles JAILLARDON, Contribution à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
rapports <strong>de</strong> l’homme <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’abeille dans la préhistoire <strong>et</strong> l’histoire, Lyon, Bosc frères <strong>et</strong> L. Riou, 1945,<br />
92 p. ; Philippe MARCHENAY, L’Homme <strong>et</strong> l’abeille, Paris, Berger-Levrault, 1984, 210 p. ; Gilles<br />
TETART, Le Sang <strong>de</strong>s fleurs : une anthropologie <strong>de</strong> l’abeille <strong>et</strong> du <strong>miel</strong>, Paris, Odile Jacob, 2004, 284 p.<br />
2<br />
Claudine BILLOT, Chartres à la fin du Moyen Âge, Paris, Édition <strong>de</strong> l’École <strong>de</strong>s Hautes Étu<strong>de</strong>s en<br />
Sciences Sociales, 1987, 360 p. ; P. BOYE, Les Abeilles, la <strong>cire</strong> <strong>et</strong> le <strong>miel</strong> en Lorraine jusqu’à la fin du<br />
XVIII<br />
19<br />
E siècle : Étu<strong>de</strong> d’économie historique, Nîmes, Lacour, 1997, 108 p. (Rediviva) ; Robert DELORT,<br />
Les animaux ont une histoire, Paris, Édition du Seuil, 1984, 509 p. (Point histoire ; H 174) ; Jean-<br />
Marc MORICEAU, Histoire <strong>et</strong> géographie <strong>de</strong> l’élevage français du Moyen Âge à la Révolution, Paris, Fayard,<br />
2005, 477 p. ; Roger GRAND, Raymond DELATOUCHE, L’Agriculture au Moyen Âge, <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong><br />
l’empire romain au XVI e siècle, Paris, De Boccard, 1950, 740 p. ; Perrine MANE, Le Travail à la<br />
campagne au Moyen Âge : étu<strong>de</strong> iconographique, Paris, Picard, 2006, 471 p.<br />
3<br />
Voir Philippe Marchenay : « le Moyen Âge n’a pas été marqué par une évolution sensible <strong>de</strong>s<br />
techniques apicoles. Nous pouvons même affirmer que comparé aux procédés antiques<br />
relativement rationnels, l’élevage <strong>de</strong>s mouches à <strong>miel</strong> <strong>de</strong>meurait dans ses métho<strong>de</strong>s, assez arriéré<br />
[…] la colonie entière était sacrifiée par l’asphyxie. », dans L’Homme <strong>et</strong> l’abeille, op. cit., p. 70.
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te activité <strong>et</strong> sur sa finalité. Il est nécessaire d’analyser le lien existant entre le<br />
type <strong>de</strong> ruche <strong>et</strong> les choix techniques <strong>de</strong> <strong>récoltes</strong> en tenant compte <strong>de</strong>s facteurs<br />
culturels, économiques <strong>et</strong> environnementaux, comme l’a suggéré Jean-Pierre<br />
Digard dans son ouvrage sur la domestication 4 . C<strong>et</strong>te interrogation <strong>de</strong>vrait nous<br />
perm<strong>et</strong>tre in fine <strong>de</strong> repenser la place <strong>et</strong> l’organisation <strong>de</strong> ce « métier » dans le temps,<br />
dans l’espace <strong>et</strong> dans la société pour les époques médiévales <strong>et</strong> mo<strong>de</strong>rnes.<br />
En l’absence <strong>de</strong> sources archéologiques, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s constructions<br />
apicoles 5 , l’analyse <strong>de</strong> la typologie <strong>de</strong>s ruches, <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> <strong>récoltes</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> la<br />
chaîne opératoire peut se faire par l’étu<strong>de</strong> dynamique <strong>et</strong> critique <strong>de</strong>s sources écrites<br />
<strong>et</strong> iconographiques confrontées aux sources <strong>et</strong>hnographiques <strong>et</strong> aux données<br />
biologiques <strong>de</strong> l’abeille. Après une présentation succincte <strong>de</strong>s sources <strong>et</strong> <strong>de</strong> leurs<br />
étu<strong>de</strong>s, nous allons examiner, dans un second temps, les différents types <strong>de</strong> ruches<br />
existant à l’époque médiévale <strong>et</strong> mo<strong>de</strong>rne <strong>et</strong> montrer en quoi le type <strong>de</strong> ruche<br />
conditionne en gran<strong>de</strong> partie le type <strong>de</strong> récolte.<br />
1. Présentation <strong>de</strong>s sources<br />
Les sources écrites qui ont été consultées pour c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> 6 sont les textes<br />
d’agronomie 7 <strong>et</strong> <strong>de</strong> commerce 8 . Les sources <strong>et</strong>hnographiques sont constituées <strong>de</strong>s<br />
4<br />
Jean-Pierre DIGARD, L’Homme <strong>et</strong> les animaux domestiques : Anthropologie d’une passion, Paris, Fayard,<br />
1990, p. 220.<br />
5<br />
Voir le très bon ouvrage <strong>et</strong> les articles d’Eva Crane sur l’archéologie <strong>de</strong> l’apiculture pour<br />
l’Angl<strong>et</strong>erre, ainsi que les publications <strong>et</strong> travaux publiés par l’association APISTORIA sur le<br />
même suj<strong>et</strong>, pour la France dans la revue Les cahiers d’Apistoria. Eva CRANE, « Des ruches <strong>et</strong><br />
parties <strong>de</strong> ruches découvertes dans les fouilles <strong>de</strong>puis 1970 », dans Écomusée <strong>de</strong> la cité <strong>de</strong>s<br />
abeilles, Bâtir pour les abeilles : L’architecture vernaculaire en apiculture traditionnelle : Actes <strong>de</strong>s rencontres <strong>de</strong><br />
Saint-Faust, 1998. Saint-Faust, Saint-Faust, Écomusée <strong>de</strong> la cité <strong>de</strong>s abeilles, 1999, p. 136-145 ; ID,<br />
The Archaelogy of Beekeeping, London, Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1983, 360 p. ; Jean-René<br />
MESTRE, Gaby ROUSSEL, <strong>Ruches</strong> <strong>et</strong> abeilles : Architecture, Traditions, Patrimoine, Non<strong>et</strong>te, Édition<br />
Créer, 2005, 204 p.<br />
6<br />
C<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> s’insérant dans un travail <strong>de</strong> thèse en cours, d’autres sources écrites viendront<br />
compléter celles citées ci-<strong>de</strong>ssous, afin d’affiner la recherche.<br />
20
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
étu<strong>de</strong>s régionales 9 sur les pratiques apicoles au XIX e siècle, ainsi que <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s<br />
muséographiques liés à l’activité apicole. Quant aux sources iconographiques 10 , les<br />
images rassemblées jusqu’ici sont issues du dépouillement <strong>de</strong> manuscrits<br />
occi<strong>de</strong>ntaux conservés à la Bibliothèque Nationale <strong>de</strong> France <strong>et</strong> <strong>de</strong> la consultation<br />
<strong>de</strong> divers fac-similés <strong>et</strong> ouvrages sur les jardins, les bestiaires <strong>et</strong> l’histoire <strong>de</strong><br />
l’alimentation. Ce sont, pour l’essentiel, <strong>de</strong>s enluminures pour la pério<strong>de</strong> médiévale<br />
<strong>et</strong>, pour l’époque mo<strong>de</strong>rne, <strong>de</strong>s gravures, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins, <strong>et</strong> quelques peintures 11 .<br />
Les manuscrits contenant <strong>de</strong>s illustrations faisant référence à l’abeille <strong>et</strong> à son<br />
élevage sont <strong>de</strong> différentes natures (religieux <strong>et</strong> profanes) <strong>et</strong> <strong>de</strong> provenances variées<br />
(italienne, française, anglaise, alleman<strong>de</strong>, grecque, <strong>et</strong> autres pays européens). Ces<br />
images nous renseignent d’une part sur la forme <strong>de</strong>s ruches <strong>et</strong> le type du rucher <strong>et</strong><br />
d’autre part sur certains gestes apicoles. Les différentes représentations du corpus,<br />
actuellement en cours <strong>de</strong> constitution, sont tirées <strong>de</strong>s Exult<strong>et</strong>, <strong>de</strong> plusieurs<br />
encyclopédies du XIII e siècle, <strong>de</strong> bestiaires, <strong>de</strong> textes agronomiques <strong>et</strong> <strong>de</strong> livres<br />
médicaux. Ces documents répon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s enjeux divers.<br />
7<br />
CHARLES ESTIENNE, Jean LIEBAULT, L’Agriculture <strong>et</strong> maison rustique <strong>de</strong> Charles Estienne & Jean<br />
Liébault, en laquelle est contenu tout ce qui peut-être requis pour bâtir maison champêtre, suivi d’un bref recueil <strong>de</strong><br />
la chasse <strong>et</strong> <strong>de</strong> la fauconnerie, Paris, Iam<strong>et</strong> M<strong>et</strong>tayer, Libraire & Imprimeur, 1598. Le développement<br />
sur l’élevage <strong>de</strong>s abeilles se situe dans le livre II qui porte sur les jardins, du chapitre LXIII au<br />
chapitre LXXIII. Louis LIGER, La Nouvelle Maison Rustique ou Économie générale <strong>de</strong> tous les biens <strong>de</strong><br />
campagne, Paris, Clau<strong>de</strong> Prudhomme, 1732, 782 p. L’élevage <strong>de</strong>s abeilles est développé au chapitre<br />
1 du livre V du tome I. C<strong>et</strong> ouvrage est une reprise corrigée <strong>et</strong> augmentée du livre <strong>de</strong> Charles<br />
Estienne qu’il supplanta tant fut grand son succès. Voir également OLIVIER DE SERRES, Le Théâtre<br />
d’agriculture <strong>et</strong> mesnage <strong>de</strong>s champs, la Maison Rustique, Paris, Actes Sud, 1996, 1 461 p. (Thésaurus).<br />
L’auteur abor<strong>de</strong> l’élevage <strong>de</strong>s abeilles au chapitre XIV du cinquième lieu. Voir enfin l’abbé<br />
ROZIER, Cours compl<strong>et</strong> d’agriculture ou Dictionnaire universel d’agriculture, tome 1, Paris, 1781.<br />
8<br />
Jacques SAVARY DES BRUSLON, Dictionnaire universel <strong>de</strong> commerce, Genève, les héritiers Cramer <strong>et</strong><br />
les frères Philibert, 1744, 4 vol.<br />
9<br />
Voir Marlène ALBERT LLORCA, « Les servantes… », art. cité ; Denis CHEVALIER, L’Homme, le<br />
porc, l’abeille <strong>et</strong> le chien : la relation homme-animal dans le Haut-Diois, Paris, Institut d’Ethnologie, 1987.<br />
10<br />
Sur l’analyse <strong>de</strong>s représentations iconographiques, il faut consulter les travaux <strong>de</strong> Perrine Mane<br />
qui a travaillé sur le suj<strong>et</strong> pour la pério<strong>de</strong> médiévale, mais son étu<strong>de</strong> sur les ruches <strong>et</strong> les activités<br />
apicoles n’est pas reliée directement aux textes : Perinne MANE, Le Travail…, op. cit.<br />
11<br />
C<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> sur l’iconographie <strong>de</strong>s ruches a fait l’obj<strong>et</strong> d’un premier travail lors <strong>de</strong> la maîtrise<br />
d’Archéologie, à l’Université <strong>de</strong> Paris 1 : Catherine MOUSINHO, L’Élevage <strong>de</strong>s abeilles au Moyen Âge<br />
<strong>et</strong> à l’époque mo<strong>de</strong>rne : État <strong>de</strong> la question, Mémoire <strong>de</strong> Maîtrise d’Archéologie Médiévale, Paris,<br />
Université <strong>de</strong> Paris 1, 3 tomes, 2001.<br />
21
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
Les Exult<strong>et</strong> 12 sont <strong>de</strong>s rouleaux liturgiques qui servaient à l’office <strong>de</strong> la vigile<br />
pascale du Samedi Saint au cours <strong>de</strong> laquelle on récitait un éloge <strong>de</strong>s abeilles. Ces<br />
documents sont originaires d’Italie méridionale <strong>et</strong> ils sont diffusés du X e au XIII e<br />
siècle. Sur ces documents, les ruches figurées sont exclusivement <strong>de</strong>s ruches<br />
horizontales cylindriques ou rectangulaires 13 . C’est également sur ces documents<br />
que se trouvent la majorité <strong>de</strong>s scènes <strong>de</strong> récolte <strong>de</strong> <strong>miel</strong> car la <strong>cire</strong> <strong>et</strong> le <strong>miel</strong> sont<br />
les principaux éléments symboliques du récit. L’abeille <strong>et</strong> la <strong>cire</strong> sont divinisées.<br />
C<strong>et</strong>te charge symbolique <strong>de</strong> la <strong>cire</strong> est bien soulignée dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Catherine<br />
Clément sur « la lumière <strong>et</strong> le luminaire dans la vie religieuse du XIII e au XVI e<br />
siècle » 14 .<br />
Quant aux encyclopédies du XIII e siècle 15 , elles offrent plusieurs<br />
développements illustrés sur le suj<strong>et</strong>, notamment :<br />
— De propri<strong>et</strong>atibus rerum (Le Livre <strong>de</strong>s propriétés <strong>de</strong>s choses, vers 1240),<br />
encyclopédie en latin <strong>de</strong> Barthélemy l’Anglais 16 , franciscain originaire d’Angl<strong>et</strong>erre.<br />
Le chapitre sur l’abeille est situé au chapitre V du livre XII.<br />
— Liber <strong>de</strong> natura rerum 17 (Le Livre <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s choses, vers 1240),<br />
somme en latin <strong>de</strong> Thomas <strong>de</strong> Cantimpré (1186-1263), originaire du Brabant <strong>et</strong><br />
appartenant à l’ordre <strong>de</strong>s Dominicains. L’abeille est traitée au chapitre II du livre<br />
IX.<br />
12<br />
Myrtilla AVERY, The Exult<strong>et</strong> Rolls of South Italy, 3 vol., Princ<strong>et</strong>on, Princ<strong>et</strong>on University Press,<br />
1975. C<strong>et</strong> ouvrage rassemble un grand nombre d’images <strong>de</strong>s Exult<strong>et</strong> italiens. Voir également <strong>de</strong><br />
Émile BERTAUX, L’Art dans l’Italie méridionale : iconographie comparée <strong>de</strong>s rouleaux <strong>de</strong> l’Exult<strong>et</strong>, tableau<br />
synoptique, Paris, Albert Fontemoing, 1903.<br />
13<br />
Voir par exemple l’exult<strong>et</strong> <strong>de</strong> Rome, Bibliothèque du Vatican, Lat. 9820.<br />
14 e<br />
Catherine VINCENT, Fiat lux : lumière <strong>et</strong> luminaire dans la vie religieuse en occi<strong>de</strong>nt du XIII au début du<br />
XVI<br />
22<br />
e siècle, Paris, Éd. du Cerf, 2004, 693 p.<br />
15<br />
Voir les nombreux articles sur le suj<strong>et</strong> dans Annie BECQ (dir.), L’Encyclopédisme : Actes du colloque<br />
<strong>de</strong> Caen, 12-16 janvier 1987, Paris, Les Amateurs <strong>de</strong> Livres, 1991, 511 p.<br />
16<br />
Voir Sylvain LOUIS, « Le proj<strong>et</strong> encyclopédique <strong>de</strong> Barthélemy l’Anglais », dans Annie BECQ<br />
(dir.), L’Encyclopédisme, op. cit.<br />
17<br />
THOMAS CANTIMPRATENSIS, Liber <strong>de</strong> natura rerum : editio princeps secundum codices<br />
manuscriptos, Berlin/New York, Walter <strong>de</strong> Gruyter, 1973.
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
— Speculum Maius 18 (Grand miroir, 1244-1258), encyclopédie en latin <strong>de</strong><br />
Vincent <strong>de</strong> Beauvais (1190-1264), dominicain <strong>et</strong> lecteur à l’abbaye royale <strong>de</strong><br />
Royaumont. Ce livre est composé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux tomes, l’abeille fait l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> plusieurs<br />
chapitres dans le Speculum naturale, chapitres LXXVII à CXI du livre XX.<br />
— Li Livres dou Tresor, somme en français <strong>de</strong> Brun<strong>et</strong>to Latini (1220-1294),<br />
Florentin exilé en France.<br />
À la lecture <strong>de</strong>s plans énoncés par les encyclopédistes dans le premier livre <strong>de</strong><br />
leur ouvrage, il est aisé <strong>de</strong> repérer le chapitre se référant à l’abeille. Selon<br />
l’organisation <strong>de</strong> la matière choisie par l’auteur, l’abeille est traitée soit dans le livre<br />
<strong>de</strong>s oiseaux – pour les encyclopédies <strong>de</strong> Brun<strong>et</strong>to Latini <strong>et</strong> <strong>de</strong> Barthélemy l’Anglais<br />
– soit dans celui <strong>de</strong>s insectes – pour les encyclopédies <strong>de</strong> Vincent <strong>de</strong> Beauvais <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
Thomas <strong>de</strong> Cantimpré.<br />
Les représentations <strong>de</strong> ruches issues <strong>de</strong> ces encyclopédies proviennent en<br />
majorité <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Barthélemy l’Anglais. Ceci peut s’expliquer par l’immense<br />
succès <strong>de</strong> ce texte qui fit l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> plusieurs copies <strong>et</strong> par l’existence d’une<br />
traduction française faite au XIV e siècle. Les ruches représentées dans les manuscrits<br />
<strong>de</strong>s encyclopédies consultées sont en gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s ruches verticales en<br />
vannerie 19 .<br />
Les bestiaires 20 <strong>et</strong> les fables décrivent le mon<strong>de</strong> animal sous l’éclairage <strong>de</strong> la<br />
symbolique chrétienne. Les animaux sont envisagés sous trois aspects : réel,<br />
allégorique <strong>et</strong> moral. Le chapitre sur l’abeille figure, le plus souvent, dans la partie<br />
traitant <strong>de</strong>s oiseaux. Dans la majeure partie <strong>de</strong>s cas, l’abeille est placée juste après<br />
l’aigle <strong>et</strong> pour illustrer le chapitre, l’enlumineur représente généralement une ruche<br />
18<br />
VINCENTIUS BELLOVACENCIS, Speculum quadruplex sive Speculum majus, Graz, Aka<strong>de</strong>mische<br />
Druck-u, Verlagsanstalt, 1964-1965, 4 vol. (fac-similé <strong>de</strong> l’édition <strong>de</strong> Douai, 1624).<br />
19<br />
Voir par exemple pour l’encyclopédie <strong>de</strong> Brun<strong>et</strong>to Latini, le manuscrit Paris, BnF, ms fr. 556,<br />
f. 73v ; pour l’encyclopédie <strong>de</strong> Barthélemy l’Anglais, les manuscrits Paris, BnF, ms fr. 22532,<br />
f. 167 (image 5, p. 39) <strong>et</strong> Paris, BnF, ms fr. 136, f. 16.<br />
20<br />
Sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s bestiaires, voir le livre <strong>de</strong> Gabriel BIANCIOTTO, Bestiaires du Moyen Âge, Paris,<br />
Stock, 1995, 229 p. (Stock Moyen Âge).<br />
23
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
verticale en vannerie 21 . Les copies médiévales <strong>de</strong>s textes <strong>de</strong>s agronomes latins <strong>et</strong><br />
grecs qui sont relativement bien enluminées <strong>et</strong> qui possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s images <strong>de</strong> ruches<br />
sont essentiellement les Géorgiques <strong>de</strong> Virgile 22 <strong>et</strong> l’Histoire naturelle <strong>de</strong> Pline l’ancien 23 .<br />
Dans ces manuscrits, la ruche représentée peut tre une ruche verticale ou<br />
horizontale en bois ou bien une ruche verticale en vannerie. C<strong>et</strong>te différence peut<br />
éventuellement s’expliquer par la date du manuscrit <strong>et</strong>/ou par sa provenance. En ce<br />
qui concerne les livres <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, dans la plupart <strong>de</strong>s manuscrits du Livre <strong>de</strong>s<br />
simples <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Pla<strong>et</strong>arius 24 <strong>et</strong> du Tacuinum Sanitatis 25 consultés, les ruches<br />
figurées sont verticales <strong>et</strong> en vannerie.<br />
Les représentations <strong>de</strong> ruches ou <strong>de</strong> scènes apicoles issues <strong>de</strong> tous ces<br />
manuscrits sont <strong>de</strong> nature didactique, au contraire <strong>de</strong>s représentations d’ordre<br />
décoratif que l’on r<strong>et</strong>rouve dans les mois <strong>de</strong>s calendriers ou les marges <strong>de</strong>s livres<br />
d’heures, <strong>de</strong>s psautiers <strong>et</strong> <strong>de</strong>s bréviaires. Dans ces <strong>de</strong>rniers, la ruche apparaît<br />
comme un élément ornemental <strong>de</strong>s marges 26 ou bien comme un élément du<br />
paysage 27 .<br />
L’ensemble <strong>de</strong>s images constituant le corpus d’étu<strong>de</strong> a été inséré dans une<br />
base <strong>de</strong> données qui a permis <strong>de</strong> constituer un premier tableau synthétique<br />
présentant la répartition chronologique <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> ruches (voir tableau n° 1).<br />
21<br />
Les manuscrits : Paris, BnF, ms lat. 6838B, f. 29v, Paris, BnF, ms fr. 1951, f. 10v.<br />
22<br />
Voir par exemple les manuscrits : Dijon, BN, ms 493, f. 45 ; Oxford, Bodleian Library, ms<br />
Rawlinson G. 98, f. 49v ; Cambridge, University Library, ms Ee 5, f. 45.<br />
23<br />
Voir le manuscrit <strong>de</strong> Londres, Victoria <strong>et</strong> Albert Museum, L 1504-1896.<br />
24<br />
Nous pouvons citer les manuscrits Paris, BnF, ms fr. 623, f. 124v ; Paris, BnF, ms fr. 1307,<br />
f. 183 ; Paris, BnF, ms fr. 12322, f. 193v.<br />
25<br />
Voir par exemple les manuscrits : Paris, BnF, ms nal. 01673, f. 82, Paris, BnF, ms lat. 9333,<br />
f. 91v.<br />
26<br />
C’est le cas d’une représentation <strong>de</strong> ruche dans le Livre d’Heures <strong>de</strong> Catherine <strong>de</strong> Clèves (1440) :<br />
New York, Pierpont Morgan Library, ms 945, f. 20.<br />
27<br />
Nous pouvons citer <strong>de</strong>ux manuscrits richement illustrés : le mois <strong>de</strong> septembre <strong>de</strong>s Heures <strong>de</strong><br />
Rohan : Paris, BnF, ms lat. 9471, f. 13 (image 2, p. 35), <strong>et</strong> le mois <strong>de</strong> février <strong>de</strong>s Très riches heures du<br />
duc <strong>de</strong> Berry : Chantilly, Musée <strong>de</strong> Condé, ms 64, f. 2v.<br />
24
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
Le pourcentage élevé <strong>de</strong> représentations pour le XV e <strong>et</strong> le XVI e siècle<br />
s’explique en partie par une plus gran<strong>de</strong> abondance <strong>de</strong>s sources (nombreuses copies<br />
<strong>de</strong> l’encyclopédie <strong>de</strong> Barthélemy l’Anglais, du Livre <strong>de</strong>s simples mé<strong>de</strong>cines <strong>et</strong> du<br />
Tacuinum sanitatis), <strong>et</strong> également par une diversification <strong>de</strong>s sources avec la prise en<br />
compte <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins, gravures <strong>et</strong> peintures.<br />
D’après ce tableau, les images <strong>de</strong> ruches en vannerie sont plus nombreuses<br />
(56 sur 86), soit les <strong>de</strong>ux tiers environ, avec 31 ruches en vannerie clayonnée, 21<br />
ruches en vannerie spiralée <strong>et</strong> 5 en vannerie dont la technique <strong>de</strong> fabrication ne<br />
peut être i<strong>de</strong>ntifiée. Les ruches en planches assemblées représentent près <strong>de</strong> 20%<br />
<strong>de</strong>s images <strong>et</strong> les ruches en tronc ou en écorce <strong>de</strong> chêne-liège, environ 15%. Il est à<br />
noter que les ruches en tronc ou en planches sont essentiellement présentes dans<br />
les images du XI e au XIII e siècle. Elles sont, à partir du XIV e siècle, en minorité par<br />
rapport aux ruches en vannerie. Celles-ci, peu figurées avant le XIV e siècle,<br />
<strong>de</strong>viennent la représentation par excellence à partir <strong>de</strong> ce siècle. Ces différences<br />
peuvent s’expliquer par l'origine géographique <strong>de</strong>s enlumineurs, mais le nombre<br />
peu important d’images récoltées ne perm<strong>et</strong> pas <strong>de</strong> tirer <strong>de</strong>s conclusions. Il est fort<br />
probable que ces écarts soient plutôt dus à un eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> source (le nombre important<br />
<strong>de</strong> copies <strong>de</strong> certains manuscrits, un modèle <strong>de</strong> ruches en circulation, une plus<br />
gran<strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s ouvrages à partir du XVI e siècle). Le maniement <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong><br />
sources n’est donc pas aisé. Il est fort difficile <strong>de</strong> déterminer la part stylistique <strong>et</strong><br />
symbolique du réel ; sans oublier les conventions <strong>de</strong> représentations qui se<br />
traduisent par la production <strong>et</strong> la répétition du même modèle <strong>de</strong> ruche dans les<br />
manuscrits <strong>de</strong> même nature.<br />
Ces images font donc l’obj<strong>et</strong> d’une lecture critique, à l’instar <strong>de</strong>s autres<br />
sources. Elles sont resituées dans leur contexte <strong>de</strong> production <strong>et</strong> analysées en<br />
fonction <strong>de</strong> la nature du texte qu’elles illustrent ou qu’elles décorent. Ces images ne<br />
sont que l’ombre d’une réalité complexe. Elles ne prennent réellement sens qu’à la<br />
confrontation avec les autres sources <strong>et</strong> <strong>de</strong>s données issues <strong>de</strong> la biologie <strong>de</strong><br />
25
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
l’abeille. Ainsi, à partir <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te confrontation, il a été possible <strong>de</strong> construire une<br />
typologie <strong>de</strong>s ruches anciennes, du Moyen Âge à l’époque mo<strong>de</strong>rne <strong>et</strong> <strong>de</strong> bâtir une<br />
réflexion sur la chaîne opératoire <strong>de</strong> la récolte du <strong>miel</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> la <strong>cire</strong> en fonction du<br />
type <strong>de</strong> ruche.<br />
2. Typologie <strong>de</strong>s ruches du XIII e au XVIII e siècle<br />
L’analyse croisée <strong>de</strong>s sources a permis <strong>de</strong> distinguer <strong>de</strong>ux grands groupes<br />
dans la gran<strong>de</strong> famille <strong>de</strong>s ruches fixes indivisibles 28 pour la pério<strong>de</strong> du XIII e au<br />
XVIII e siècle, en prenant comme critère <strong>de</strong> classification principal l’axe d’ouverture<br />
<strong>de</strong> la ruche. En eff<strong>et</strong>, selon l’axe, l’approche technique pour la récolte est différente<br />
(voir tableau n° 2).<br />
Groupe 1 Groupe 2<br />
<strong>Ruches</strong> en bois - Tronc d’arbre évidé<br />
- Planches <strong>de</strong> bois assemblées<br />
<strong>Ruches</strong> en<br />
vannerie<br />
<strong>Ruches</strong> en terre<br />
cuite<br />
- Écorce <strong>de</strong> chêne-liège<br />
- Ruche horizontale en vannerie<br />
clayonnée<br />
- Ruche horizontale<br />
- Ruche verticale ?<br />
Autres matériaux - Ruche horizontale en férule<br />
- Ruche en céramique ?<br />
- Ruche verticale en vannerie<br />
spiralée<br />
- Ruche verticale en vannerie<br />
clayonnée<br />
- Ruche en céramique ?<br />
Tableau 2 : Typologie <strong>de</strong>s ruches fixes indivisibles ou simples<br />
28<br />
Il existe un <strong>de</strong>uxième grand ensemble <strong>de</strong> ruches qui comprend les ruches modulaires<br />
constituées <strong>de</strong> plusieurs éléments. Ces <strong>de</strong>rnières sont bien attestées dans les textes à partir du<br />
XVIII<br />
26<br />
e siècle, mais certains auteurs ém<strong>et</strong>tent l’hypothèse d’une utilisation antérieure. Dans le cadre<br />
<strong>de</strong> la présente étu<strong>de</strong>, c<strong>et</strong> ensemble <strong>de</strong> ruches a été écarté.
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
- Le groupe 1 comprend toutes les ruches dont l’axe d’accès aux rayons se<br />
situe au somm<strong>et</strong>, sur l’un <strong>de</strong>s côtés, ou sur la face opposée à l’entrée <strong>de</strong>s abeilles<br />
(trou <strong>de</strong> vol). Ce sont les ruches assemblées par <strong>de</strong>s planches en bois <strong>et</strong> les ruches<br />
constituées d’un tronc d’arbre évidé ou d’écorces <strong>de</strong> chêne-liège. Ces ruches sont<br />
verticales <strong>et</strong> horizontales. On a également dans ce groupe les ruches en vannerie, en<br />
férules <strong>et</strong> en céramiques horizontales.<br />
- Le groupe 2 comprend toutes les ruches dont l’accès aux rayons se situe en<br />
bas. Ce sont donc les ruches verticales en vannerie spiralée <strong>et</strong> en vannerie<br />
clayonnée.<br />
Les ruches du groupe 1 perm<strong>et</strong>tent un meilleur accès aux rayons <strong>de</strong> <strong>miel</strong> à<br />
l’inverse <strong>de</strong>s ruches en vannerie du groupe 2 dont l’ouverture se situe en <strong>de</strong>ssous.<br />
En eff<strong>et</strong>, d’après les données <strong>de</strong> l’éthologie <strong>et</strong> <strong>de</strong>s agronomes consultés, les abeilles<br />
ont tendance à déposer le <strong>miel</strong> dans la partie supérieure <strong>de</strong>s rayons <strong>et</strong> à l’arrière <strong>de</strong><br />
la ruche. Par conséquent, l’éleveur a plus <strong>de</strong> chance <strong>de</strong> récolter <strong>de</strong>s rayons<br />
contenant majoritairement du <strong>miel</strong> dans les ruches verticales dont l’ouverture est<br />
située au somm<strong>et</strong> <strong>et</strong> dans les ruches horizontales où l’ouverture est située à l’arrière.<br />
Contrairement aux ruches du groupe 2, l’autre avantage <strong>de</strong>s ruches du groupe 1 est<br />
<strong>de</strong> perm<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> récolter sans avoir à secouer la ruche, ce qui déplaît fortement aux<br />
abeilles, rendant ainsi toute manipulation piquante <strong>et</strong> difficile.<br />
Ces <strong>de</strong>ux grands groupes <strong>de</strong> ruches se subdivisent ensuite selon la matière<br />
première <strong>de</strong> la ruche <strong>et</strong> la technique <strong>de</strong> fabrication. Certains types <strong>de</strong> ruches ne sont<br />
pas figurés ou reconnus en iconographie, alors qu’ils sont mentionnés dans les<br />
textes. Ainsi, Charles Estienne mentionne les ruches en terre cuite <strong>et</strong> en brique qu’il<br />
déconseille <strong>et</strong> il situe les ruches en férule qualitativement juste après les ruches en<br />
écorce <strong>de</strong> chêne-liège 29 . Olivier <strong>de</strong> Serres ajoute à c<strong>et</strong>te liste les ruches en pierre,<br />
mais il ne cite pas les ruches en férules 30 . Dans son dictionnaire agronomique,<br />
29 CHARLES ESTIENNE, Jean LIEBAULT, L’Agriculture <strong>et</strong> maison rustique, op. cit., p. 306.<br />
30 OLIVIER DE SERRES, Le Théâtre d’agriculture, op. cit., p. 634.<br />
27
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
publié à la fin du XVIII e siècle, l’abbé Rozier, mentionne également les ruches en<br />
terre cuite <strong>et</strong> leur emploi en France pour les pério<strong>de</strong>s anciennes 31 . Il est curieux<br />
qu’en fouille archéologique, on n’ait r<strong>et</strong>rouvé encore aucune trace <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong><br />
ruche, contrairement à l’Espagne 32 <strong>et</strong> à la Grèce 33 .<br />
28<br />
À l’instar <strong>de</strong> Charles Estienne 34 , Olivier <strong>de</strong> Serre marque sa préférence pour<br />
les ruches faites <strong>de</strong> planches <strong>de</strong> bois assemblées, puis en tronc d’arbres évidés <strong>et</strong> en<br />
troisième lieu en écorce <strong>de</strong> chêne-liège 35 . A contrario, dans la nouvelle maison<br />
rustique, Liger, <strong>de</strong>ux siècles plus tard, marque une préférence pour les ruches en<br />
vannerie spiralée, en paille, qui selon lui sont les plus commo<strong>de</strong>s, les plus faciles à<br />
transporter <strong>et</strong> les moins coûteuses 36 . Il en est <strong>de</strong> même pour les ruches en vannerie<br />
clayonnée. Ce changement <strong>de</strong> préférence peut s’expliquer par une plus gran<strong>de</strong><br />
utilisation <strong>de</strong> la transhumance <strong>et</strong> par une gestion différente <strong>de</strong>s forêts.<br />
Les sources utilisées ne nous perm<strong>et</strong>tent pas <strong>de</strong> cartographier la répartition<br />
<strong>de</strong>s différents types <strong>de</strong> ruches pour la France. Le choix du matériau se faisait sans<br />
doute selon la disponibilité <strong>de</strong> celui-ci dans la région, comme le souligne Charles<br />
Estienne 37 . Cependant, Olivier <strong>de</strong> Serre remarque très justement que la disponibilité<br />
<strong>de</strong> la matière première n’est pas le seul critère à rentrer en jeu dans le choix <strong>de</strong> la<br />
ruche ; il faut également tenir compte <strong>de</strong>s spécificités culturelles <strong>et</strong> <strong>de</strong>s coutumes :<br />
Si toutefois l’usage du pays le veut ainsi ; car où l’on a accoutumé faire les<br />
ruches <strong>de</strong> paille, comme en France, en Flandres, Hollan<strong>de</strong>, Zélan<strong>de</strong>, Danemarch, à<br />
la paille conviendra s’arrester. 38<br />
31<br />
Abbé ROZIER, Cours compl<strong>et</strong>, op. cit., p. 71.<br />
32<br />
José <strong>de</strong> JAIME GOMEZ, José M. <strong>de</strong> JAIME LOREN, Historia <strong>de</strong> la apicultura española : <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los origenes<br />
hasta 1492, Valencia, Calamocha, 2001, t. 1, p. 48 <strong>et</strong> 60.<br />
33<br />
Eva CRANE, « Des ruches… », art. cité.<br />
34<br />
CHARLES ESTIENNE, Jean LIEBAULT, L’Agriculture <strong>et</strong> maison rustique, op. cit., p. 306.<br />
35<br />
OLIVIER DE SERRES, Le Théâtre d’agriculture, op. cit., p. 634-635.<br />
36<br />
Louis LIGER, La Nouvelle Maison Rustique, op. cit., p. 385.<br />
37<br />
Ibid.<br />
38<br />
OLIVIER DE SERRES, Le Théâtre d’agriculture, op. cit., p. 635.
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
Toutefois, il est fort probable que <strong>de</strong>s ruches différentes coexistent dans un<br />
même rucher. Un exemplaire <strong>de</strong>s Géorgiques, conservé à Oxford, illustre c<strong>et</strong>te<br />
possibilité 39 .<br />
La présence <strong>de</strong> types différents <strong>de</strong> ruches dans un même rucher peut<br />
s’expliquer par la nécessité <strong>de</strong> récolter <strong>de</strong>s produits différents (<strong>miel</strong>, <strong>cire</strong>, abeilles). À<br />
chaque type <strong>de</strong> ruche peut correspondre un produit récolté différent. Par<br />
conséquent, on peut s’interroger sur la possibilité d’une concurrence entre les<br />
produits <strong>de</strong> la ruche <strong>et</strong> plus spécifiquement entre le <strong>miel</strong> <strong>et</strong> la <strong>cire</strong>, induisant alors<br />
<strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> <strong>récoltes</strong> opposées. En eff<strong>et</strong>, il existe <strong>de</strong>ux grands types <strong>de</strong> récolte<br />
<strong>de</strong>s ruches fixes indivisibles : la récolte partielle <strong>et</strong> la récolte totale.<br />
La récolte partielle consiste à ne prélever qu’une partie <strong>de</strong>s rayons pour en<br />
r<strong>et</strong>irer le <strong>miel</strong> <strong>et</strong> la <strong>cire</strong>. C<strong>et</strong>te récolte est la plus estimée par les agronomes <strong>et</strong> c’est<br />
également celle qui est la plus représentée. Il faut, cependant, être pru<strong>de</strong>nt quant à<br />
l’interprétation <strong>de</strong>s images. En eff<strong>et</strong>, la gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong> ces scènes <strong>de</strong> <strong>récoltes</strong><br />
sont figurées dans les Exult<strong>et</strong> 40 <strong>et</strong> les manuscrits <strong>de</strong>s Géorgiques <strong>de</strong> Virgile. Ces<br />
images ont donc une fonction didactique très marquée. La récolte partielle peut<br />
s’effectuer en théorie sur tout type <strong>de</strong> ruche. Mais en pratique, c<strong>et</strong>te technique est<br />
malaisée sur les ruches fixes simples en vannerie verticale, les ruches du groupe 2.<br />
Pour l’abbé Rozier :<br />
C’est une expédition militaire que d’entreprendre <strong>de</strong> tailler une ruche <strong>de</strong> l’ancien<br />
système 41.<br />
Elle semble surtout appropriée pour les ruches en tronc, en planche ou en<br />
écorce <strong>de</strong> chêne-liège, ou pour les ruches horizontales du groupe 1. Ceci semble<br />
être confirmé par les pratiques <strong>de</strong> <strong>récoltes</strong> du XIX e siècle. En iconographie, ce sont<br />
également <strong>de</strong>s ruches du groupe 1 que l’on représente dans une scène <strong>de</strong> récolte.<br />
39<br />
Oxford, Bodleian Library, ms Rawlinson. G.98, f. 49v (image 4, p. 38).<br />
40<br />
Voir par exemple l’Exult<strong>et</strong> <strong>de</strong> Rome, Bibliothèque du Vatican, Barb. Lat. 592 (image 1, p. 35).<br />
41<br />
Abbé ROZIER, Cours compl<strong>et</strong>, op. cit., p. 135.<br />
29
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
30<br />
C<strong>et</strong>te récolte sur les ruches du groupe 1 est plus rentable en <strong>miel</strong> <strong>et</strong> en <strong>cire</strong><br />
d’un point vue qualitatif <strong>et</strong> quantitatif. En eff<strong>et</strong>, celle-ci, pratiquée sur ce type <strong>de</strong><br />
ruche, perm<strong>et</strong> d’obtenir <strong>de</strong>s rayons propres contenant presque uniquement du <strong>miel</strong>,<br />
sans couvain ni pollen, contrairement à une récolte qui s’effectuerait sur une ruche<br />
en vannerie du groupe 2 où l’ouverture est située vers le bas. En revanche, avec ce<br />
type <strong>de</strong> ruche, on peut obtenir une belle quantité <strong>de</strong> <strong>cire</strong> blanche si l’on taille<br />
régulièrement les rayons du bas. Ceci est clairement mentionné dans l’ouvrage<br />
d’Olivier <strong>de</strong> Serre publié en 1600 :<br />
Le <strong>miel</strong> est tiré par le haut <strong>de</strong> la rusche, <strong>et</strong> la <strong>cire</strong> par le bas, auquel endroit les<br />
abeilles font les semences <strong>de</strong> leur race 42.<br />
Ainsi, il semblerait que certaines ruches soient plus appropriées à la récolte<br />
du <strong>miel</strong> <strong>et</strong> d’autres à celle <strong>de</strong> la <strong>cire</strong>, ce qui peut alors expliquer la présence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
types <strong>de</strong> ruche 43 . Ce système n’est rentable que si le rucher est important, avec au<br />
moins une dizaine <strong>de</strong> ruches. Ceci est également vrai si l’on pratique une récolte<br />
totale <strong>de</strong> la ruche, ce qui est la <strong>de</strong>uxième technique <strong>de</strong> récolte sur les ruches fixes<br />
simples.<br />
Il existe <strong>de</strong>ux façons <strong>de</strong> pratiquer une récolte totale que l’on r<strong>et</strong>rouve dans<br />
les textes d’agronomie <strong>et</strong> dans les documents <strong>et</strong>hnographiques : le transvasement <strong>et</strong><br />
l’étouffage. Par contre, cela n’est quasiment pas figuré en iconographie. À ma<br />
connaissance, il n’existe qu’un seul exemple <strong>de</strong> représentation <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te opération <strong>de</strong><br />
récolte 44 . Ainsi, la première façon <strong>de</strong> pratiquer une récolte totale c’est <strong>de</strong> tuer les<br />
abeilles <strong>et</strong> la <strong>de</strong>uxième manière est <strong>de</strong> transvaser les abeilles dans un sac ou dans<br />
une ruche.<br />
42 OLIVIER DE SERRES, Le Théâtre d’agriculture, op. cit., p. 651-652.<br />
43 C’est l’exemple d’une image représentant peut-être une scène <strong>de</strong> récolte <strong>de</strong> <strong>miel</strong> par étouffage,<br />
tiré d’un manuscrit <strong>de</strong>s Géorgiques : Oxford, Bodleian Library, ms Rawlinson, G.98, f. 49v<br />
(image 4, p. 38).<br />
44 Ibid.
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
La récolte totale par transvasement consiste à chasser les abeilles <strong>de</strong> la ruche<br />
<strong>et</strong> à les installer dans une nouvelle ruche. L’avantage <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te récolte est d’obtenir<br />
une gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> <strong>miel</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>cire</strong> tout en sauvegardant la colonie. Cependant,<br />
si c<strong>et</strong>te récolte a lieu en fin <strong>de</strong> saison, comme cela est indiqué, il y a <strong>de</strong> très gran<strong>de</strong>s<br />
chances que la colonie n’ait pas le temps <strong>de</strong> reconstituer ses réserves pour passer<br />
l’hiver. Par conséquent, la mort <strong>de</strong> la colonie n’est que reportée dans le temps avec<br />
c<strong>et</strong>te métho<strong>de</strong> ; en revanche, le <strong>miel</strong> n’est pas gâché par le soufre <strong>et</strong> l’eau,<br />
contrairement à la récolte totale par l’étouffage ou la noya<strong>de</strong>. C<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière<br />
métho<strong>de</strong> est condamnée <strong>et</strong> répudiée par tous les agronomes consultés, sauf par<br />
l’abbé Rozier qui ne la cite pas. Ces auteurs jugent c<strong>et</strong>te pratique irrationnelle pour<br />
un éleveur d’abeilles, car en condamnant la colonie, il se prive l’année suivante d’un<br />
essaim <strong>et</strong> par conséquent <strong>de</strong> la possibilité d’agrandir son rucher. Il existe <strong>de</strong>ux<br />
moyens pour éliminer la colonie : la noya<strong>de</strong> ou étouffage à l’ai<strong>de</strong> d’une mèche <strong>de</strong><br />
soufre. Olivier <strong>de</strong> Serre conseille la noya<strong>de</strong> 45 alors qu’un siècle plus tard Liger<br />
préconise plutôt la mèche <strong>de</strong> soufre, en précisant que c<strong>et</strong>te technique <strong>de</strong> récolte est<br />
surtout utilisée par les marchands <strong>de</strong> <strong>miel</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>cire</strong>, en France 46 . C<strong>et</strong>te technique <strong>de</strong><br />
récolte totale perm<strong>et</strong> d’obtenir une gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> <strong>cire</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>miel</strong>, mais elle a<br />
également <strong>de</strong>ux grands inconvénients :<br />
- Le premier est d’affaiblir le rucher. En eff<strong>et</strong>, ce sont les ruches les plus<br />
lour<strong>de</strong>s qui sont sacrifiées ; il reste par conséquent les plus faibles qui ont moins <strong>de</strong><br />
chances <strong>de</strong> passer l’hiver. On risque alors une très forte mortalité à la sortie <strong>de</strong><br />
l’hiver.<br />
- L’autre inconvénient est que le <strong>miel</strong> est <strong>de</strong> qualité inférieure à celui pris<br />
grâce à la récolte partielle ou par transvasement. En eff<strong>et</strong>, l’eau, le soufre <strong>et</strong> les<br />
45 Ibid., p. 654.<br />
46 Louis LIGER, La Nouvelle Maison Rustique, op. cit., p. 433.<br />
31
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
abeilles mortes doivent donner une certaine o<strong>de</strong>ur au <strong>miel</strong>, comme le suggère<br />
Olivier <strong>de</strong> Serre 47 .<br />
ont une histoire.<br />
32<br />
La récolte partielle, pratiquée a priori plutôt sur les ruches fixes du groupe 1,<br />
perm<strong>et</strong> donc à l’éleveur d’obtenir une quantité importante <strong>de</strong> <strong>miel</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>cire</strong> <strong>de</strong><br />
bonne qualité, si le rucher possè<strong>de</strong> un nombre important <strong>de</strong> ruches. Dans ce cas <strong>de</strong><br />
figure, la quantité est proportionnelle au nombre <strong>de</strong> ruches récoltées <strong>et</strong> le<br />
pourcentage <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> ruche durant l’hiver est relativement faible, si l’éleveur n’a<br />
pas trop prélevé. L’avantage majeur est que les colonies survivantes donneront <strong>de</strong>s<br />
essaims dès le mois <strong>de</strong> mai si le climat en début <strong>de</strong> saison a été clément. L’éleveur<br />
pourra ainsi remplacer facilement la perte hivernale <strong>et</strong> augmenter son « cheptel <strong>de</strong><br />
ruche » ou bien vendre le surplus, contrairement à celui qui pratique la récolte totale<br />
qui induit une forte mortalité hivernale. Dans ce cas <strong>de</strong> figure, l’apiculteur est donc<br />
plutôt ach<strong>et</strong>eur d’essaim <strong>et</strong> il est surtout marchand <strong>de</strong> <strong>cire</strong>, car les quantités<br />
récoltées sont bien plus importantes, à nombre égal <strong>de</strong> ruches. On peut alors se<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r légitimement si la concurrence entre le <strong>miel</strong> <strong>et</strong> la <strong>cire</strong> n’a pas pu infléchir<br />
<strong>et</strong> favoriser un type <strong>de</strong> récolte, la récolte totale. En eff<strong>et</strong>, <strong>de</strong> nombreux auteurs 48<br />
s’accor<strong>de</strong>nt pour souligner la place importante <strong>de</strong> la <strong>cire</strong> dans la société médiévale.<br />
Le choix <strong>de</strong> la ruche <strong>et</strong> la qualité <strong>de</strong>s produits dépen<strong>de</strong>nt également <strong>de</strong><br />
l’environnement dans lequel sont installées les ruches. Tous les agronomes insistent<br />
sur ce point. Le lieu doit être choisi <strong>et</strong> aménagé en fonction du couvert végétal, <strong>de</strong>s<br />
vents <strong>et</strong> <strong>de</strong>s autres animaux domestiques <strong>et</strong> sauvages. Par conséquent, les<br />
techniques d’élevage <strong>et</strong> <strong>de</strong> récolte <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> la ruche dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> données<br />
environnementales, paysagères <strong>et</strong> économiques. En eff<strong>et</strong>, la chaîne opératoire <strong>de</strong><br />
l’élevage <strong>de</strong>s abeilles doit être appréhendée à la lumière <strong>de</strong>s circuits <strong>de</strong><br />
consommation du <strong>miel</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> la <strong>cire</strong>, <strong>de</strong>ux produits qui jouent un rôle plus ou moins<br />
47 OLIVIER DE SERRES, Le Théâtre d’agriculture, op. cit., p. 654.<br />
48 Voir les ouvrages déjà cités <strong>de</strong> Catherine VINCENT, Fiat lux, <strong>et</strong> Robert DELORT, Les Animaux
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
important dans <strong>de</strong> nombreux secteurs <strong>de</strong> la vie quotidienne (alimentation, liturgie,<br />
pharmacopée, éclairage) pour l’époque médiévale <strong>et</strong> mo<strong>de</strong>rne. L’abeille semble<br />
donc être au centre d’un réseau <strong>de</strong> liens entre l’animal <strong>et</strong> le végétal, d’une part, <strong>et</strong><br />
entre la nature <strong>et</strong> la culture, d’autre part. Ainsi, à travers c<strong>et</strong>te réflexion, c’est une<br />
partie <strong>de</strong> la vie quotidienne <strong>de</strong>s hommes du Moyen Âge <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’époque mo<strong>de</strong>rne qui<br />
est éclairée.<br />
Image 1 : Exult<strong>et</strong>, XI e siècle,<br />
Rome, Bibliothèque du Vatican, Barb Lat. 592<br />
33
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
34<br />
Image 2 : Les Heures <strong>de</strong> Rohan,<br />
Paris, BnF ms lat. 9471, f. 13 (XV e siècle)
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
Image 3 : Platearius, Livre <strong>de</strong>s simples <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
Paris, BnF ms fr. 1936, f. 126 (XV e siècle)<br />
35
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
36<br />
Image 4 : Détail tiré <strong>de</strong>s Géorgiques <strong>de</strong> Virgile,<br />
Oxford, Bodleian Library, ms Rawlinson, G. 98, f. 49v (XV e siècle)
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
Image 5 : Détail tiré du Livre <strong>de</strong>s propriétés <strong>de</strong>s choses <strong>de</strong> Barthélémy l’Anglais,<br />
Paris, BnF, ms 22532, f. 163v (XV e siècle)<br />
37
Les activités quotidiennes <strong>Questes</strong> n° 15<br />
38<br />
Image 6 : Dioscori<strong>de</strong>, Tractabus <strong>de</strong> herbis,<br />
Modène, Bibliothèque Estence, ms lat. 933, f. 92 (XV e siècle)