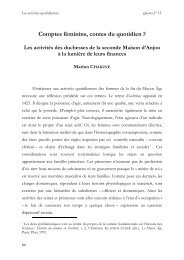Des figures royales à l'ombre du mythe - Questes
Des figures royales à l'ombre du mythe - Questes
Des figures royales à l'ombre du mythe - Questes
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Des</strong> <strong>figures</strong> <strong>royales</strong> <strong>à</strong> <strong>l'ombre</strong> <strong>du</strong> <strong>mythe</strong><br />
Mythes <strong>à</strong> la cour, <strong>mythe</strong>s pour la cour<br />
29 juillet – 4 août 2007<br />
XII e Congrès international de la Société Internationale de Littérature Courtoise<br />
Proposition de session double sur le thème<br />
« <strong>Des</strong> <strong>figures</strong> <strong>royales</strong> <strong>à</strong> l’ombre <strong>du</strong> <strong>mythe</strong> »,<br />
inscrit dans l’axe n° 1 <strong>du</strong> colloque : « Figures exemplaires »<br />
Projet collectif organisé dans le cadre de l’association <strong>Questes</strong>,<br />
groupe interdisciplinaire de jeunes chercheurs médiévistes<br />
La session, intitulée « <strong>Des</strong> <strong>figures</strong> <strong>royales</strong> <strong>à</strong> l’ombre <strong>du</strong> <strong>mythe</strong> », portera sur des textes<br />
narratifs en langue vernaculaire, échelonnés entre le XII e et le XV e siècle. On essaiera de<br />
montrer comment s’élaborent, <strong>à</strong> partir ou <strong>à</strong> l’intérieur de paradigmes mythiques déj<strong>à</strong><br />
constitués (soit : <strong>à</strong> l’ombre <strong>du</strong> <strong>mythe</strong>), des <strong>figures</strong> <strong>royales</strong>. La cour, imaginaire ou réelle, et,<br />
plus largement, le cadre idéologique dans lequel naissent les œuvres, demeureront <strong>à</strong> l’horizon<br />
de la réflexion, le contexte de réception (pour la cour) ou de pro<strong>du</strong>ction (<strong>à</strong> la cour)<br />
infléchissant l’orientation <strong>du</strong> projet d’écriture. Dans cette perspective, on s’attachera en<br />
particulier <strong>à</strong> la dimension exemplaire (ou contre-exemplaire) de l’écriture ou de la réécriture<br />
<strong>du</strong> <strong>mythe</strong>.<br />
La première session considèrera le <strong>mythe</strong> comme un paradigme <strong>à</strong> partir <strong>du</strong>quel se<br />
construit le texte médiéval, que ce paradigme fournisse un cadre herméneutique ou une trame<br />
narrative ; la seconde session réfléchira sur les modalités d’insertion de médaillons mythiques<br />
allogènes dans le tissu textuel, ces médaillons revêtant des emplois et des supports variés.<br />
LE MYTHE COMME CADRE<br />
Sophie ALBERT (Université de Paris IV)<br />
« <strong>Des</strong> <strong>mythe</strong>s pour penser le roi. Lectures de la figure d’Uterpandragon,<br />
de Geoffroy de Monmouth au Roman de Melia<strong>du</strong>s »<br />
Uterpandragon, comme l’ont montré les critiques, est pris, chez Geoffroy de Monmouth<br />
aussi bien que chez Wace, dans un paradigme mythique qui le dépasse, celui de la naissance<br />
<strong>du</strong> héros. Les critiques ont aussi montré que ce schéma mythique, dès le Roman de Brut, cesse<br />
d’être compris, le translateur juxtaposant, <strong>à</strong> la conception illicite d’Arthur, une conception en<br />
bonne et <strong>du</strong>e forme, accomplie sous les lois <strong>du</strong> mariage chrétien. Aussi l’a<strong>du</strong>ltère <strong>du</strong> roi va-t-il<br />
être interprété, de plus en plus explicitement, comme un péché : désigné comme tel par<br />
Ygerne et par le <strong>du</strong>c de Tintagel, personnages, certes, partiaux, et donc peu dignes de foi, dans<br />
le Roman de Merlin, il est <strong>à</strong> l’origine des reproches dont Arthur est accablé dans le Lancelot<br />
propre, où le roi est clairement accusé, par un prud’homme cette fois, d’être un fil <strong>du</strong> péché<br />
« d’avotire ». Or, <strong>à</strong> partir de ce roman, Uterpandragon se trouve engagé dans des récits<br />
rétrospectifs destinés <strong>à</strong> expliquer l’origine de « mauvaises coutumes ». Il y fait figure<br />
d’élément perturbateur, engendrant, <strong>à</strong> son insu, les maux dont est frappée la cour arthurienne.<br />
Du <strong>mythe</strong> de la naissance héroïque, on est passé <strong>à</strong> un autre paradigme mythique, celui d’un<br />
primus peccator dont les erreurs provoquent irrémédiablement la Chute ; le péché,<br />
simplement, s’est déplacé <strong>du</strong> registre spirituel <strong>à</strong> un registre nettement mondain et, dans le<br />
Lancelot et le Roman de Melia<strong>du</strong>s, nettement « socio-politique ». La question de l’articulation<br />
1
<strong>Des</strong> <strong>figures</strong> <strong>royales</strong> <strong>à</strong> <strong>l'ombre</strong> <strong>du</strong> <strong>mythe</strong><br />
entre valeurs mondaines et spirituelles, diversement résolue par les textes sur lesquels<br />
s’appuiera la communication, et le poids d’un contexte largement empreint de réflexes<br />
chrétiens, informent ainsi en profondeur le choix ou le rejet des paradigmes mythiques qui<br />
permettent de penser la figure <strong>du</strong> roi.<br />
Pierre LEVRON (Université de Paris IV)<br />
« Quand l’ours devient faible, ou : Arthur et ses défaillances »<br />
La royauté médiévale est un phénomène historique, mais aussi littéraire. Elle suscite<br />
effectivement la perpétuation de <strong>mythe</strong>s <strong>du</strong> souverain idéal ou exemplaires hérités de<br />
l’Antiquité (comme César et Alexandre), et la création de <strong>figures</strong> mythiques médiévales.<br />
Celles-ci correspondent <strong>à</strong> plusieurs fonctions importantes d’un récit mythique : expliquer<br />
l’origine d’une structure politique et mettre en cause le comportement des hommes face <strong>à</strong> des<br />
épreuves existentielles fondamentales. Bien que les deux « rois exemplaires » <strong>du</strong> Moyen Âge,<br />
Charlemagne et Arthur, servent <strong>à</strong> imaginer une royauté idéale définie par des discours<br />
normatifs, Arthur suscite un <strong>mythe</strong> de la royauté « idéale » plus profondément peut-être que<br />
Charlemagne, qui est un exemple de transformation mythique d’un personnage historique. La<br />
réflexion s’attachera aux « failles » temporaires ou permanentes <strong>du</strong> roi Arthur dans l’exercice<br />
de ses fonctions politiques, judiciaires ou guerrières, mais aussi mondaines. Fondée sur un<br />
corpus représentatif de la matière de Bretagne (romans en prose ou en vers), elle examinera<br />
les relations que le discours des écrivains entretient avec certains textes médicaux ou<br />
didactiques. On envisagera trois avatars essentiels des défaillances <strong>du</strong> roi Arthur :<br />
-L’immaturité d’un très jeune roi (sensible dans L’Estoire de Merlin et le Livre d’Artus).<br />
-L’impuissance judiciaire ou politique face <strong>à</strong> des adversaires moraux ou militaires.<br />
-Les crises psychiques ou intellectuelles (mélancolie, désespoir, tristesse…).<br />
L’enjeu de cette enquête est de montrer la sensibilité des écrivains <strong>à</strong> la tension entre un<br />
idéal très élevé et l’humanité <strong>du</strong> détenteur d’une fonction référentielle.<br />
Natalia BERCEA BOCSKAI (Université de Genève)<br />
« La part de l’imaginaire chez Raoul Lefèvre : Jason <strong>à</strong> la cour de la reine Mirro »<br />
L’Histoire de Jason de Raoul Lefèvre (vers 1460) se compose de trois volets centrés<br />
respectivement sur les premiers exploits <strong>du</strong> chevalier Jason, l’histoire légendaire <strong>du</strong> bélier <strong>à</strong> la<br />
toison d’or et l’expédition argonautique en Colchos. Si la figure complexe de Médée,<br />
magicienne amoureuse et mère infanticide, domine la troisième section <strong>du</strong> roman, celle de<br />
Mirro, jeune reine d’Olyferne et premier amour de l’Argonaute, s’impose dans la première.<br />
« Vray ymage de sçavoir » et « cler miroir de noblesse », la belle Mirro représente le modèle<br />
de la dame courtoise ; son exemplarité, contrairement <strong>à</strong> celle de Médée, n’est jamais remise<br />
en doute. Premier amour de Jason, « mise en oubliance » suite aux enchantements de la<br />
Colchidienne et de sa nourrice, la noble Mirro délivrera l’Argonaute de ces sortilèges et<br />
deviendra son épouse. Le roman se clôt sur sa mort tragique, suivie de l’errance <strong>du</strong> chevalier<br />
et de sa réconciliation avec une Médée repentie.<br />
Le personnage de la reine Mirro, positif par excellence, est inventé par Raoul Lefèvre.<br />
La création et l’insertion de cette figure féminine exemplaire <strong>à</strong> l’intérieur de la réécriture <strong>du</strong><br />
<strong>mythe</strong> argonautique, dédiée au <strong>du</strong>c de Bourgogne, répond <strong>à</strong> un dessein idéologique. Plusieurs<br />
motivations semblent sous-tendre ce geste innovant : le désir de proposer une figure en<br />
rapport de concurrence et de complémentarité avec Médée et de subordonner son exemplarité<br />
2
<strong>Des</strong> <strong>figures</strong> <strong>royales</strong> <strong>à</strong> <strong>l'ombre</strong> <strong>du</strong> <strong>mythe</strong><br />
sans faille au projet global de relecture et réhabilitation de l’image de Jason, et, sans doute,<br />
l’intention de se conformer au goût esthétique de la cour de Philippe, public visé pour lequel<br />
le clerc écrit. Cet exposé se propose de réfléchir sur la manière dont ce nouveau personnage<br />
fascinant se construit et s’intègre dans le tissu narratif ainsi que sur sa place dans la<br />
configuration <strong>du</strong> <strong>mythe</strong> de la Toison d’or ainsi reconstruit.<br />
INSERTIONS DE L’EXEMPLE MYTHIQUE DANS LE CADRE TEXTUEL<br />
Amandine MUSSOU (ENS d’Ulm)<br />
« Charles VI <strong>à</strong> l’ombre d’Evilmerodag : la figure <strong>du</strong> tyran<br />
dans Le Songe <strong>du</strong> vieil Pelerin »<br />
Dans le Songe <strong>du</strong> vieil Pelerin, Philippe de Mézières donne la parole <strong>à</strong> la Reine Vérité<br />
qui, pour é<strong>du</strong>quer le jeune Moïse, identifié explicitement <strong>à</strong> Charles VI, utilise dans la<br />
troisième partie de l’ouvrage le paradigme <strong>du</strong> jeu d’échecs. Les soixante-quatre cases de<br />
l’échiquier fournissent le prétexte <strong>à</strong> une série de digressions morales et politiques. Afin<br />
d’intro<strong>du</strong>ire ces considérations, l’auteur rappelle une légende, déj<strong>à</strong> présente dans le Liber de<br />
moribus hominum vel officiis nobilium sive super ludo scacchorum de Jacques de Cessoles.<br />
C’est afin d’adoucir le tyran Evilmerodag, roi de Babylone et fils de Nabuchodonosor, que le<br />
philosophe Philométor aurait inventé les échecs. Tout en lui apprenant les règles <strong>du</strong> jeu, il lui<br />
aurait donné des instructions pleines de sagesse et de modération. Philippe de Mézières,<br />
conseiller de Charles V et précepteur <strong>du</strong> futur Charles VI, fait appel <strong>à</strong> une histoire légendaire,<br />
léguée par le dominicain Jacques de Cessoles. La figure d’Evilmerodag est traitée sur le mode<br />
<strong>du</strong> <strong>mythe</strong> et s’inscrit dans la perspective édifiante <strong>du</strong> Songe <strong>du</strong> vieil Pelerin. Figure contreexemplaire<br />
– puisqu’il s’agit d’un tyran, Evilmerodag est néanmoins conquis et adouci par<br />
l’invention de Philométor : le roi Charles VI, <strong>à</strong> qui s’adresse ce manuel de bon gouvernement,<br />
doit s’inspirer de cette attitude. Il s’agira de montrer en quoi l’utilisation intertextuelle de la<br />
figure <strong>du</strong> tyran est subordonnée au projet é<strong>du</strong>catif <strong>du</strong> texte. Nous examinerons notamment le<br />
statut de la légende dans un texte qui récuse les « bourdes » des romans au profit de la vérité<br />
de l’histoire et des chroniques.<br />
Sophie O. POITRAL (Université de Paris IV)<br />
« L’empreinte des hommes illustres.<br />
Lecture des blasons royaux <strong>du</strong> Livre <strong>du</strong> Cuer d’Amour espris de René d’Anjou »<br />
Dans Le Livre <strong>du</strong> Cuer d’Amour espris, composé en 1457 par René d’Anjou, le<br />
chevalier Cœur en quête de sa dame, la Douce Merci, débarque sur l’île d’Amour. Il découvre<br />
en ces lieux un cimetière dont le portail est orné d’une série d’écus armoriaux, déposés en<br />
hommage au dieu d’Amour. Composé de signes et d’emblèmes, le blason est un objet qui<br />
représente celui qui le possède. Dans l’œuvre de René, chaque insigne s’enrichit d’une devise<br />
précédée <strong>du</strong> nom et <strong>du</strong> titre <strong>du</strong> personnage auquel l’écu appartient et rédigée <strong>à</strong> la première<br />
personne <strong>du</strong> singulier. Cette fonction identitaire <strong>du</strong> blason pose la question de l’orientation de<br />
l’image <strong>du</strong> possesseur de l’écu, transmise <strong>à</strong> travers celui-ci.<br />
Parmi les personnages ayant déposé leur blason se trouvent des <strong>figures</strong> <strong>royales</strong> – rois,<br />
princes et souverains de <strong>du</strong>chés – tirés de la Bible, de la mythologie gréco-latine et de<br />
l’histoire des XIV e et XV e siècles. Certains ont déj<strong>à</strong> profondément marqué de leur empreinte<br />
mythique l’imaginaire <strong>du</strong> Moyen Âge, comme le roi David, dont le combat avec Goliath<br />
3
<strong>Des</strong> <strong>figures</strong> <strong>royales</strong> <strong>à</strong> <strong>l'ombre</strong> <strong>du</strong> <strong>mythe</strong><br />
participe <strong>à</strong> son insertion parmi les « Neuf Preux », le roi d’Athènes Thésée ou encore Énée, le<br />
prince troyen. A ces <strong>figures</strong> sont associés les noms de René d’Anjou, roi de Sicile et de<br />
Jérusalem, et de onze de ses contemporains, souverains de France, parmi lesquels Louis de<br />
France et Jean de Berry. L’objectif de notre étude sera de montrer comment René d’Anjou<br />
utilise le thème des armoiries – écus, devises et ornements – pour contribuer <strong>à</strong> la pérennité de<br />
<strong>mythe</strong>s attachés <strong>à</strong> ces <strong>figures</strong> <strong>royales</strong>, <strong>à</strong> leur réécriture ou encore <strong>à</strong> leur démythification, dans<br />
le cadre <strong>du</strong> Livre <strong>du</strong> Cuer, œuvre composée par un prince et dédiée <strong>à</strong> Jean II <strong>du</strong>c de Bourbon.<br />
Anne SALAMON (ENS d’Ulm)<br />
« Les Neuf Preux : entre glorification et édification »<br />
Le motif littéraire et esthétique des Neuf Preux connaît une immense fortune en Europe<br />
entre le XIV e et le XVI e siècle. La liste des Neuf Preux, composée de « rois » historiques ou<br />
pseudo-historiques, s’organise en trois triades, la première, biblique (Josué, David, Judas<br />
Macchabée), la seconde, païenne (Hector, Alexandre, Jules César), et la dernière, chrétienne<br />
(Arthur, Charlemagne, Godefroy de Bouillon).<br />
Fixée sous sa forme canonique dans les Vœux <strong>du</strong> Paon de Jacques de Longuyon au<br />
début <strong>du</strong> XIV e siècle, cette liste s’est répan<strong>du</strong>e sur des supports et sous des formes<br />
extrêmement variés. Motif privilégié de la tapisserie, les Preux apparaissent également<br />
sculptés ou peints dans les châteaux de grands seigneurs, ou encore comme sujets de tableaux<br />
vivants lors de grandes occasions. Intimement liées <strong>à</strong> l’héraldique, ces <strong>figures</strong> mythiques de<br />
rois, véritables cristallisations de toute l’idéologie aristocratique, sont enracinées dans la<br />
culture nobiliaire de l’époque ; L’Histoire des Neuf Preux et des Neuf Preuses (fin <strong>du</strong> XV e<br />
siècle) de Sébastien Mamerot par exemple, première œuvre entièrement consacrée <strong>à</strong> ce thème,<br />
est une œuvre de commande réalisée pour Louis de Laval, grand seigneur de la cour de<br />
Louis XI.<br />
Chez Mamerot ou chez Thomas III de Saluces, les Neuf Preux ont pu être utilisés dans<br />
un but didactique, comme références exemplaires, pour l’édification des nobles et des<br />
chevaliers. La forme de la liste close et l’autorité attachée aux <strong>figures</strong> invoquées a cependant<br />
aussi donné lieu <strong>à</strong> des exercices de variation et de réécriture. En ajoutant une liste parallèle de<br />
Preuses, un dixième Preux contemporain ou en modifiant la liste canonique, certains auteurs<br />
ont utilisé le motif pour faire rejaillir sur la noblesse de leur temps un peu de la gloire des<br />
Preux ou pour glorifier un personnage ou une lignée particulière. C’est cette diversité<br />
d’emplois qui nous intéressera dans le cadre de la constitution d’un véritable motif esthétique<br />
de cour.<br />
4