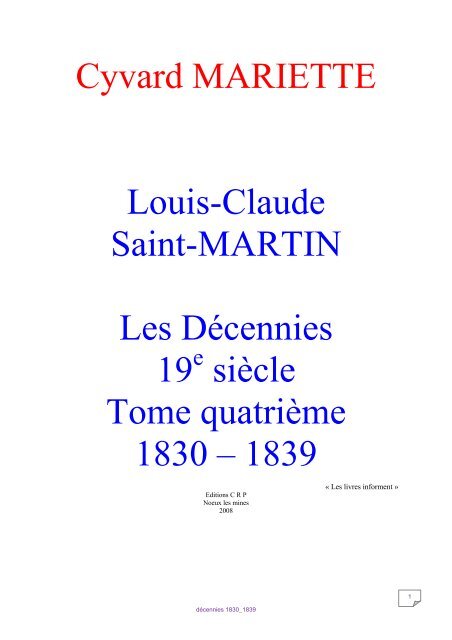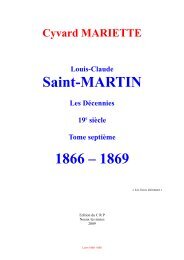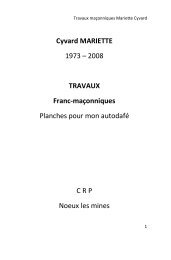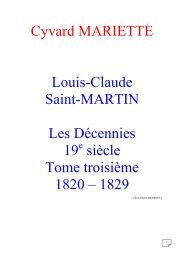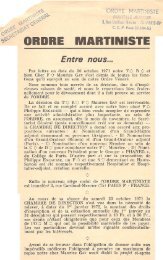Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Cyvard</strong> <strong>MARIETTE</strong><br />
<strong>Louis</strong>-<strong>Claude</strong><br />
<strong>Saint</strong>-<strong>MARTIN</strong><br />
<strong>Les</strong> <strong>Décennies</strong><br />
<strong>19</strong> e siècle<br />
Tome quatrième<br />
1830 – 1839<br />
Editions C R P<br />
Noeux les mines<br />
2008<br />
décennies 1830_1839<br />
« <strong>Les</strong> livres informent »<br />
1
Voici une nouvelle décennie des ouvrages en relation avec <strong>Louis</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Saint</strong>-Martin.<br />
Vous trouverez dans ces textes une doctrine mieux étudiée. <strong>Les</strong> détracteurs continuent leur<br />
travail à l’emporte pièce. Ceux qui écrivent sur lcsm et respectent l’homme ou les idées m’ont<br />
paru avoir fait l’effort d’une étude si ce n’est de l’œuvre, au moins de textes qui ont pu leur<br />
être signalés essentiels.<br />
Si c’est exact, qui aurait pu signaler « les bonnes pages » de lcsm ?<br />
Comme pour les décennies précédentes, il m’a semblé intéressant de développer un peu le<br />
texte pour mieux cerner le sens des lignes écrites directement sur <strong>Saint</strong>-Martin.<br />
Dans la recherche effectuée, les graphies autres que <strong>Saint</strong>-Martin n’ont pas été traitées, vous<br />
pouvez encore faire des découvertes, d’autant que Google ajoute régulièrement de nouveaux<br />
textes dans sa banque de livres. Ex. de graphies St. Martin… vous pouvez aussi les signaler.<br />
Lcsm 1830 1839<br />
Homonymies sources de légendes urbaines :<br />
Le Marquisat<br />
Le titre de marquis va être accolé à lcsm à plusieurs reprises dans différents ouvrages ; voici<br />
deux marquis de <strong>Saint</strong>-Martin, sans lien avec lcsm :<br />
Antoine de la Baume-Montrevel, marquis de <strong>Saint</strong>-Martin + Île de France, Paris<br />
23.07.1745<br />
Et<br />
1611 +1688 Charles François de La Baume, marquis de <strong>Saint</strong>-Martin<br />
Il y eut des <strong>Saint</strong>-Martin, hors la lignée de lcsm, marquis :<br />
Octavien Antoine de <strong>Saint</strong>-Martin d'Aglié Marquis de <strong>Saint</strong>-Germain et de <strong>Saint</strong>-<br />
Damian, par exemple.<br />
Le lecteur doit encore se souvenir que le nom <strong>Saint</strong>-Martin, noble ou roturier est un nom<br />
fréquent qui s’est souvent illustré au cours des temps et dans divers domaines !<br />
Relire à propos des titres de noblesse de lcsm la belle démonstration documentée de Robert<br />
Amadou dans la revue l’initiation, et diffusée sur maitrespasses, puisque sans copyright sur la<br />
source.<br />
Lcsm est noble, fils d’écuyer, sans autre titre, et condamné comme noble à sortir de Paris par<br />
les révolutionnaires.<br />
Le titre d’écuyer devait lui échoir à la mort de son père, la révolution les a aboli, et à sa mort<br />
Buonaparte n’est pas encore devenu Napoléon et n’a pas créé sa noblesse ni autorisé<br />
l’ancienne noblesse !<br />
Vous pourrez lui trouver, avec son nom, les titres de chevalier (on pouvait le supposer<br />
chevalier de <strong>Saint</strong>-<strong>Louis</strong>, ce qu’il ne fut pas, ce titre figure sur un acte paroissial, sans valeur<br />
légale), de comte (il dira lui-même que dans certaines sociétés, on affublait les visiteurs de<br />
titres de noblesse), de marquis.<br />
décennies 1830_1839<br />
2
1830<br />
L'Ami de la religion et du roi: journal ecclésiastique, politique et littéraire Page 371<br />
1830<br />
[369] 3 FÉVRIER 1830. (N° 1616)<br />
Supplément au Dictionnaire historique de Feller, publié à Lyon par J.-F. Rolland (1).<br />
On se rappelle qu'il parut à Lyon, de 1821 à 1823, une édition du Dictionnaire historique des<br />
grands hommes, de Feller, en 10 gros volumes in-8°. Cette édition était faite sur un plan un<br />
peu différent de celui de l'édition de Paris ; on n'y touchait point au texte de Feller, et on y<br />
ajoutait seulement un assez grand nombre d'articles de personnages morts depuis ou omis par<br />
le premier auteur. Nous rendîmes compte de cette édition, numéros 790, 820 et autres.<br />
Aujourd'hui M. Rolland vient de donner deux volumes de supplément, où il a fait entrer les<br />
personnages morts dans ces dernières années et ceux qui avoient pu être encore omis dans les<br />
premiers volumes. Il s'est aidé pour cela des ouvrages les plus récents, de la Biographie<br />
universelle, de L’Annuaire de M. Mahul, de l'Ami de la religion; il a emprunté, entre autres, à<br />
ce dernier recueil, la plupart des articles sur des ecclésiastiques. Nous sommes bien loin de lui<br />
en faire un reproche, d'autant plus que l'éditeur cite quelquefois notre journal comme lui ayant<br />
été utile. Il a d'ailleurs beaucoup d'autres articles nouveaux et rédigés avec soin; et nous<br />
donnerons ici l'extrait de quelques-uns qui ne seront point déplacés dans ce journal :<br />
« François-David Aynès, né à Lyon, fut principal du collège de Villefranche, puis revint à<br />
Lyon, où il publia des livres classiques et élémentaires. En 1811, il fut arrêté par la police,<br />
comme ayant fait imprimer des brefs et rescrits émanés de Rome et comme ayant fait<br />
connaître la bulle d'excommunication contre Buonaparte. Conduit à Paris, il resta onze mois à<br />
la Force, fut ensuite exilé à Avignon, et ne revint à Lyon qu'à la restauration. Le Pape lui<br />
envoya son portrait comme une marque de son estime.<br />
(1) 2 gros vol. in-8, prix, 14 fr. et 18 fr. franc de port. A Lyon, chez Rolland, et, à Paris, au<br />
bureau de ce journal.<br />
…<br />
[370] Nous n'indiquerons qu'en passant d'autres articles sur des personnages et des écrivains<br />
morts récemment. On distinguera surtout ceux de Léon XII, de l'empereur Alexandre, de<br />
Mme Krüdener, de Mlle Labrousse, de MM. Marchangy, Laveaux, Nougaret, etc. L'éditeur<br />
s'est trompé en mettant au nombre des morts M. de Champagny, duc de Cadore; cet ancien<br />
ministre vit toujours. L'article de Mme la duchesse de Bourbon, morte en 1822, aurait été<br />
susceptible de plus de développements; l'éditeur a sans doute été retenu par des considérations<br />
respectables, et nous-mêmes nous avions usé de la même réserve en annonçant la mort de la<br />
duchesse dans notre n° 775, tome XXX. Mais depuis, on a rendu publics des faits qui étaient<br />
jusque-là peu connus [371], et les écrits de la princesse ont été mentionnés dans plusieurs<br />
recueils. Nous ne croyons donc point commettre d'indiscrétion en donnant ici une notice où<br />
nous rappelons les opinions singulières de la duchesse.<br />
<strong>Louis</strong>e-Marie-Thérèse-Mathilde d'Orléans, née à St-Cloud le 9 juillet 1750, était fille du duc<br />
d'Orléans et épousa, en 1770, M. le duc de Bourbon, plus jeune qu'elle de six années. Ils<br />
eurent un fils, M. le duc d'Enghien, né en 1772. Ils se séparèrent en 1780. La duchesse, douée<br />
d'un esprit vif, instruite même, était par caractère disposée à croire au merveilleux ; elle<br />
s'engoua du magnétisme et eut des relations suivies avec saint Martin, dit le philosophe<br />
décennies 1830_1839<br />
3
inconnu. Elle nous apprend elle-même que la lecture des écrits de Mme Guyon faisait son<br />
bonheur. Elle fut, au commencement de la révolution, admiratrice zélée de la fille Labrousse,<br />
l'admit dans son palais et y tenait des réunions avec dom Gerle, l'évêque Pontard et d'autres<br />
chefs du parti constitutionnel. Un chapelain de la duchesse, ecclésiastique estimable qui vit<br />
encore, M. l'abbé F. fut obligé de sortir de sa maison, parce qu'il refusa de recevoir la fille<br />
Labrousse à la communion. La duchesse fit, dit-on, les frais d'une édition des prophéties de<br />
cette fille.<br />
Elle ne sortit point de France au commencement de la révolution, fut enfermée à Marseille en<br />
I793 par suite des décrets de la Convention, et lui écrivit, le 17 octobre, qu'elle faisait don à la<br />
nation de ses biens ; on passa à l'ordre du jour sur cette offre. Le 29 avril 1795, la Convention<br />
accorda 18,000 fr. à la princesse. Un décret la bannit le 18 fructidor; on lui avait promis sur<br />
ses biens une rente de 50,000 fr., qui fut fort mal payée. Elle se retira en Espagne et resta<br />
jusqu'en 1814 en Catalogne. C'est, à ce qu'on croit, à Barcelone que fut imprimée, en 1812, la<br />
Correspondance entre madame de B. et M. R. sur leurs opinions religieuses, 2 vol. in-8. A la<br />
suite de cette Correspondance, il y a dans le second volume des Opuscules ou Pensées d'une<br />
âme de la foi sur la religion chrétienne pratiquée en esprit et en vérité. Cet ouvrage ne fut tiré,<br />
dit-on, qu'à 200 exemplaires, et fut prohibé en 18<strong>19</strong> par l'inquisition d'Espagne, comme<br />
obscène, plein de propositions hérétiques, impies, blasphématoires, séductrices et téméraires.<br />
La première qualification s'applique sans doute au récit d'un voyage de Barcelone, qui se<br />
trouve en tête du premier volume, et qui a pour titre : Voyage tragique et tendrement comique<br />
pour servir d'introduction.<br />
La Correspondance est adressée à M. R. que Barbier dit être Ruffin, et que la duchesse appelle<br />
son cher ange; il est mort depuis et chrétiennement, à ce qu'on assure- La duchesse lui parle<br />
avec force en faveur de la révélation, et lui déclare que J.-C. est la seule porte pour arriver au<br />
ciel ; mais elle ne l'engage pas à croire aux prêtres ni à leur Eglise visible (*). Elle demande à<br />
Dieu de bons pasteurs, mais elle doute si les prêtres actuels sont les vrais successeurs des<br />
apôtres, s'ils ont les clés du royaume des cieux pour lier et pour délier. Elle espère qu'elle ne<br />
sera pas rejetée par le Sauveur, si<br />
(*) Nous tirons ces citations d'un chapitre curieux de l'Histoire des sectes religieuses par M.<br />
Grégoire, tome II, page 72.<br />
[372] elle est rejetée par les prêtres, qui refusent de l’admettre aux sacrements de l'Eglise,<br />
parce qu'elle ne croit pas à eux. <strong>Les</strong> promesses ont été faites, dit-elle, non au corps des<br />
pasteurs, mais à la généralité des êtres purs et saints.<br />
Dans une profession de foi insérée dans les Opuscules, la duchesse semble dire que l'Eglise<br />
actuelle a un bandeau sur les yeux. Elle ne voit pas la nécessité de rejeter ou d'adopter tous les<br />
articles de croyance de l'Eglise ; elle croit à ce qu'elle peut croire, elle rejette ce qu'elle ne peut<br />
adopter. Tantôt elle se tait sur la maxime hors de l'Eglise point de salut, tantôt elle l'admet.<br />
Dans toutes les sectes qui croient en Jésus- Christ, il y a des âmes qui sont ses épouses. Dans<br />
ce système, l'Eglise véritable serait la réunion de toutes les églises chrétiennes ; d'ailleurs,<br />
l'auteur reconnait que Jésus- Christ a fondé son Eglise, qu'elle est la colonne de la vérité, que<br />
celui qui ne l'écoute pas doit être regardé comme un païen, et que Jésus-Christ sera avec elle<br />
jusqu'à la consommation des siècles. Sur 1 eucharistie, la duchesse pense que le corps et le<br />
sang de Jésus-Christ ne résident que dans la foi et non dans le pain et le vin ; elle soutient<br />
même que le sacrement est indépendant des paroles du prêtre dans le saint sacrifice, et que,<br />
quiconque se nourrit du pain et du vin avec une foi vive, participe au corps et au sang du<br />
Seigneur. Ainsi la duchesse s'était fait une religion à part, ou plutôt elle écrivait suivant l'idée<br />
qui la frappait au moment même, et qu'une autre idée effaçait ensuite. Il y a dans ses<br />
Opuscules des propositions très-extraordinaires. « Nous sommes une des portions de cette<br />
âme universelle que Jésus est venu racheter… notre être est composé de trois choses, esprit,<br />
âme et corps ; l’âme est à l’égard de l’esprit ce que le corps est à l’égard d’elle, càd son<br />
décennies 1830_1839<br />
4
enveloppe femelle, il pouvait engendrer lui-même en son prototype divin ; mais ayant péché<br />
et mangé du fruit défendu, Dieu lui envoya le sommeil et tira la femme de son côté. » Nous ne<br />
ferons point de réflexions sur ces idées bizarres, que la duchesse n'entendait peut-être pas bien<br />
elle-même, et nous finirons par des citations d'un autre genre.<br />
Dans des Fragments sur la morale chrétienne, au tome 1er, l'auteur dit : « Née dans l'opulence<br />
et la grandeur, la révolution m'ayant offert les moyens de m'abaisser, je les ai saisis avec<br />
empressement en femme chrétienne. Jésus-Christ ayant dit anathème aux riches, j'ai joui de<br />
me voir enlever ce qui pouvait m'éloigner du centre de la vie. » La princesse voudrait que<br />
toutes les professions fussent également honorées, que l'on n'admît d'autre distinction que<br />
celle des vertus et des talents, que l'on abolît la peine de mort. Elle se déclare pour le<br />
gouvernement de fait. « Ces maximes, dit-elle encore dans ses Fragments, furent la règle<br />
invariable de mes sentiments et de ma conduite. Placée dans le monde par ma naissance pour<br />
commander, et par mon sexe pour obéir, libre alors de suivre ma volonté, j'ai cru devoir rester<br />
dans ma patrie et me soumettre aux puissances diverses qui ont paru successivement sur la<br />
scène, sans cherchera examiner si le gouvernement était juste et leurs lois bonnes. Il me suffit<br />
que Dieu permette qu'ils possèdent l'autorité pour la respecter, car Jésus-Christ n'a point<br />
spécifié qu'il fallait se soumettre aux puissants légitimes, mais seulement aux puissances. » La<br />
princesse se trouvait à Barcelone lorsque les armées françaises envahirent l'Espagne en 1809 ;<br />
on assure qu'elle n'eut point à se plaindre des procédés des généraux français. Elle rentra en<br />
France en 1814 et on lui [373] rendit ses biens. Elle profita de son opulence pour encourager<br />
un grand nombre de bonnes œuvres. Il est certain qu'elle donnait beaucoup. Elle paraissait<br />
souvent aux assemblées de charité et on ne l'implorait point en vain pour les malheureux. Elle<br />
établit dans son hôtel même, rue de Varennes, un hospice qui fut nommé hospice d'Enghien,<br />
en mémoire de son fils si indignement assassiné en 1804; elle y mit des Sœurs de la charité.<br />
L'hospice a depuis été transféré à Picpus, où il est plus commodément. Le 10 janvier 1822, la<br />
duchesse étant allée à <strong>Saint</strong>e- Geneviève pour prier pendant l'octave, fut frappée d'apoplexie<br />
en entrant dans l'Eglise; elle tomba sur le pavé et fut transportée à l'école de droit où elle<br />
expira quelques instants après. Son corps fut depuis porté à Dreux et inhumé dans le caveau<br />
destiné à la maison d'Orléans.<br />
L'auteur auquel nous avons emprunté les extraits des écrits de la princesse, M. Grégoire<br />
s'exprime ainsi dans son Histoire des sectes : Hâtons-nous de dire cependant, sur des<br />
témoignages irrécusables, que, dans les derniers temps de sa vie, son cœur et son esprit étaient<br />
complètement soumis à la morale évangélique et au joug de la foi. Nous aurions voulu<br />
pouvoir confirmer un fait si consolant et nous avons consulté des personnes qui avaient eu des<br />
relations étroites avec la princesse. Leur témoignage irrécusable nous a convaincus que ses<br />
jugements et ses dispositions n'avoient pas changé depuis 1812. Elle faisait un amalgame des<br />
vérités de la foi et de ses opinions particulières; tantôt catholique, tantôt protestante, tantôt<br />
inclinant pour le quakerisme. Elle ne parlait jamais en public contre la religion, mais dans ses<br />
entretiens, surtout avec des ecclésiastiques, elle ne manquait guère de mettre la conversation<br />
là-dessus et de leur proposer ses objections. Elle lisait beaucoup saint Paul, qu'elle expliquait<br />
à sa manière. Des ecclésiastiques distingués essayèrent plusieurs fois de l'éclairer et de la<br />
toucher ; sa bonté et sa charité leur donnaient l'espérance d'y parvenir, mais elle leur échappait<br />
bientôt par la singularité et par le désordre de ses idées. Il en est un, homme singulièrement<br />
estimable et aussi sage que pieux, qu'elle pria de la confesser ; mais elle ne voulut point sans<br />
doute se soumettre à ce que par préliminaire il exigeait d'elle, et elle se retira. On ne peut que;<br />
déplorer qu'elle ait persévéré dans un système et dans des illusions dont l'âge, la réflexion et<br />
les conseils auraient dû la désabuser. Puisse Dieu l'avoir éclairée à ses derniers moments !<br />
Prions-le, pour elle, comme autrefois saint François pour Henri IV, son aïeul, et demandonslui<br />
de faire miséricorde pour celle qui la fit à tant de malheureux ! »<br />
décennies 1830_1839<br />
5
On excusera la longueur de cet article, où nous avons voulu réunir tout ce qui regardait la vie<br />
et les opinions de la duchesse. Nous revenons actuellement au Supplément du Dictionnaire de<br />
Feller. Nous rendons volontiers hommage au bon esprit qui anime l'éditeur et à la sagesse de<br />
ses jugements sur la plupart des personnages. Son Supplément est pour les principes et pour la<br />
rédaction tout-à-fait en harmonie avec le Dictionnaire de Feller, et il pourrait se joindre aux<br />
anciennes éditions de cet ouvrage. [374] …<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
6
Journal des Savants Page 61 de Institut de France, Académie des inscriptions & belleslettres<br />
(France) 1830<br />
… [61] …<br />
Entretien sur les principes de la philosophie, dans lequel des idées systématiques modernes en<br />
métaphysique sont discutées, et les notions de la raison ramenées à celles des rapports<br />
qu'exprime la pensée active de l'homme par l'affirmation et l'induction; publié par M. J.-B -M.<br />
Gence, avec des notes et le tableau de la classification générale des connaissances, développé<br />
dans l'ouvrage. Paris, imprimerie de Migneret, 1830, 48 pages in-8, avec un tableau. <strong>Les</strong><br />
interlocuteurs qui figurent dans cet entretien, sont Descartes, Gassendi, <strong>Claude</strong> <strong>Saint</strong>-Martin,<br />
un ami de <strong>Saint</strong>-Martin, et un grammairien philosophe de l'école de Port-Royal. Cet opuscule,<br />
destiné, ce semble, à faire revivre la doctrine théosophique de M. <strong>Saint</strong>-Martin, est dédié à M.<br />
Ant. BertoIacci. — MM. Gence et Monnard se proposent de publier une traduction de<br />
l'ouvrage allemand intitulé Stunden der Andach, qui a paru de 1809 à 1816, à Arau, sous la<br />
forme de feuilles hebdomadaires, et dont on assure qu'il s'est fait douze éditions successives,<br />
donnant un total de 60,000 exemplaires. La version française portera le titre de Méditations<br />
religieuses, en forme de discours, pour toutes les époques, circonstances et situations de la vie<br />
domestique et civile: elle paraîtra, par livraisons, le samedi de chaque semaine. Le prix de 12<br />
livraisons in-8 est fixé à 5 fr. on souscrit chez MM. Treuttel et Wurtz, à Paris, à Strasbourg et<br />
à Londres.<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
7
1831<br />
Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des hommmes et des choses, des ... Page<br />
269 de Eustache Marie Pierre Courtin 1831<br />
Page 269<br />
SAINT-<strong>MARTIN</strong> (<strong>Louis</strong> CLAUDE DE), dit le Philosophe inconnu, né à Amboise en 1743,<br />
d'une famille honorable, puisa de bonne heure dans la lecture du livre intitulé l’Art de se<br />
connaître soi-même, par le théologien protestant J. Abbadie, les principes de philosophie, de<br />
morale et de religion qu'il professa toute sa vie. Destiné par ses parents à la magistrature, il<br />
étudia le droit ; mais ensuite préférant la profession des 'armes, qui lui laissait plus de loisirs<br />
pour s'occuper de méditations, il entra comme lieutenant dans le régiment de Foix, à l'âge de<br />
22 ans. C'est alors qu'il fut initié par des formules, des rites et des pratiques, à la secte dite des<br />
martinistes, du nom de Martinez Pasqualis, qui en était le chef. Il n'adopta point entièrement<br />
les doctrines de cette secte ; mais ce fut par là qu'il entra dans la voie du spiritualisme. Plus<br />
tard, il exposa cette même doctrine dans ses ouvrages, et notamment dans son tableau naturel<br />
des rapports entre Dieu, l'homme, etc. Dans les associations de diverses nuances qui<br />
succédèrent à l'école de Martinès, après la mort de celui-ci, <strong>Saint</strong>-Martin suivait les réunions<br />
où l'on s'occupait d'exercices qui annonçaient, suivant son expression, des venus actives. Il<br />
regardait comme étant d'un ordre sensible inférieur celles où l'on s'occupait do magnétisme<br />
somnambulique, auquel il croyait toutefois. Il eut l'occasion de se lier avec l'astronome<br />
Lalande ; mais la différence des opinions rompit bientôt cette liaison. Il eut aussi des rapports<br />
avec J.-J. Rousseau, dont il regardait la misanthropie comme un excès de sensibilité. Pour lui,<br />
il aimait les hommes comme meilleurs au fond qu'ils ne paraissaient être. La musique<br />
instrumentale, des promenades champêtres, des conversations amicales, étaient les<br />
délassements de son esprit, et des actes de bienfaisance, ceux de son âme. Il voyagea, comme<br />
Pythagore, pour étudier l'homme et la nature, et pour confronter le témoignage des autres avec<br />
le sien. De retour en France, après avoir visité l'Allemagne et l'Angleterre, il reçut la croix de<br />
<strong>Saint</strong>-<strong>Louis</strong> pour ses anciens services militaires. II n'émigra point à l'époque de la révolution,<br />
dans laquelle il reconnaissait les desseins terribles de la Providence, comme il crut voir plus<br />
tard un grand instrument temporel dans Bonaparte. Expulsé d'abord de Paris, comme noble,<br />
en 1794, il fut arrêté peu de temps après dans la retraite qu'il s'était choisie, comme faisant<br />
partie de la prétendue conjuration de la Mère de Dieu, Catherine Théos (voyez ce nom). Le 9<br />
thermidor le rendit à la liberté, et vers la fin de la même année (1794) il fut désigné par le<br />
district ou arrondissement d'Amboise, sa patrie, comme un des élèves de l'école normale,<br />
destinée à former des instituteurs pour propager l'instruction. De retour à Paris, il y publia<br />
successivement une partie des écrits que nous indiquerons ci-après, faisant de temps à autre de<br />
petites excursions en province pour visiter quelques amis. Il mourut en 1803, au village<br />
d'Aulnay (près Paris), où il était allé voir le sénateur Lenoir de La Roche, avec lequel il était<br />
lié depuis longtemps. <strong>Saint</strong>-Martin a beaucoup écrit, et ses livres ont été commentés et<br />
traduits en partie, principalement dans les langues du nord de l'Europe. Le but de ces mêmes<br />
livres est non-seulement d'expliquer la nature par l'homme, mais de ramener toutes nos<br />
connaissances au principe, dont l'esprit humain peut être le centre. L'auteur s'efforce du<br />
démontrer que le spiritualisme n'est pus simplement la science des esprits, mais celle de Dieu.<br />
Voici la liste des ouvrages de ce philosophe : des Erreurs et de la Vérité, etc., par un<br />
philosophe inconnu, Edimbourg (Lyon), 1775, in-8° : écrit inintelligible, mais le plus<br />
remarquable de l'auteur et qui Page 270 lui valut le titre qu'il y prend lui-même, celui de<br />
décennies 1830_1839<br />
8
philosophe inconnu (une suite des Erreurs et de la Vérité, etc., publiée en 1784, in 8», a été<br />
signalée par <strong>Saint</strong>-Martin comme frauduleuse). <strong>Les</strong> Oeuvres posthumes de <strong>Saint</strong>-Martin, ont<br />
été publiées à Tours, 1807, 2 vol. in-8. On y trouve un journal, depuis 1782, des relations, des<br />
entretiens, etc., de l'auteur, sous le titre de Portrait de <strong>Saint</strong>-Martin, fait par lui même. On a<br />
confondu cet écrivain philosophe avec Martinez-Pasqualis (voyez ce nom), son maître. M.<br />
Gence a publié en 1824, chez Migneret, une Notice biographique sur <strong>Saint</strong>-Martin, in-78° de<br />
28 pages. '<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
9
1832<br />
Essai sur l'histoire de la philosophie en France au dixneuvième siècle - Page 32 de Jean<br />
Philibert Damiron, Ph Damiron - 1832 - 444 pages<br />
Page 32<br />
Si, dans la période que nous venons de parcourir," c'est-à- dire de 1795 à 1803 et 1804, il se<br />
manifesta quelques oppositions à la philosophie sensualiste, elle fut plus indirecte que directe,<br />
plus littéraire que scientifique. Elle aurait peine à compter quelques métaphysiciens dans ses<br />
rangs ; ce ne serait pas <strong>Saint</strong>-Martin, le philosophe inconnu, qui put bien aux écoles normales,<br />
sur le terrain de la critique, combattre avec succès le principe de la sensation, mais qui, dans<br />
ses dogmes positifs, obscur, bizarre et enveloppé, affecta le mysticisme, et écrivit pour les<br />
initiés et nullement pour le public. Son spiritualisme singulier ne sortit pas de l'arcane où il se<br />
plut à le renfermer. M. de Maistre, à cette époque, quoiqu'il eût déjà dans quelques écrits<br />
déposé le germe de son système, n'avait encore, dans le monde savant, ni nom, ni rôle de chef<br />
d'école : retiré en Russie, où il vécut jusqu'au moment de la restauration, il était ignoré du plus<br />
grand nombre. M. Bonald s'était fait connaître par sa Théorie du pouvoir politique et religieux<br />
dans la Société civile, et c'était déjà là tout entière sa législation primitive ; mais, outre que la<br />
métaphysique ne s'y montrait que sous forme politique et historique, la forme et le ton n'en<br />
étaient pas propres à lui faire alors beaucoup de disciples. Il fallait la persistance de l'auteur<br />
dans les idées qu'il [33] soutenait, son industrieuse obstination à les poser en système, à les<br />
formuler, à les appliquer, le talent remarquable qu’il a déployé au sein des difficultés dans<br />
lesquelles elles le jetaient ; il fallait aussi les évènements qui ont mis en faveur son opinion,<br />
pour qu'il eût, il vaut mieux dire, un parti qu'une école, et de l’autorité que de la popularité.<br />
(…)<br />
Page 97<br />
On y retrouve de Garat, outre plusieurs discussions pleines d'art et d'habileté, un programme<br />
très-remarquable Sur les questions qu'il était appelé à traiter dans sa chaire : c'est un excellent<br />
plan d'idéologie théorique et pratique. L'opinion qui y domine est, comme nous l'avons<br />
montré, exclusive et incomplète ; mais il n'est pas moins à regretter qu'il ne l'ait pas plus<br />
développée : on y eût gagné Certainement un ouvrage bien composé, et qui d'ailleurs, écrit<br />
avec ce sens logique commun aux condillaciens, et que Garat possède à un éminent degré, se<br />
fût placé avec avantage à côté de ceux qui dans ce genre occupent le premier rang.<br />
L'exactitude de la méthode, la clarté du langage, la finesse des aperçus, l'eussent rapproché<br />
naturellement du livre de M. de Tracy et de celui de M. la Romiguière (i). …<br />
(1) II ne serait pas sans intérêt de lire, dans le Recueil des écoles normales, les discussions<br />
auxquelles donnaient lieu les leçons de Garat; on y remarquerait surtout une réponse de <strong>Saint</strong>-<br />
Martin, sur le sens moral, qui mérite attention.<br />
décennies 1830_1839<br />
10
Essai sur l'histoire de la philosophie en France au dix-neuvième<br />
Page 222<br />
Article<br />
<strong>Saint</strong>-<strong>MARTIN</strong>.<br />
(Philosophe inconnu)<br />
Né en 1743, et mort en 1803.<br />
[222] Voici un nom que nous avions omis dans notre première édition ; nous croyons<br />
aujourd’hui devoir le rétablir, afin de rendre plus complet l’examen auquel nous nous livrons.<br />
Il est au reste difficile en parlant de <strong>Saint</strong>-Martin de le rattacher avec analogie à l’une ou<br />
l’autre des écoles dont il est question dans cet Essai : c’est à peine un philosophe, ce n’est<br />
surtout pas un philosophe d’une école ou même d’une secte ; il y a quelque chose en lui de<br />
singulier, de retiré, de bizarre qui l’isole, et le sépare de tous ; s’il appartient à quelque centre<br />
c’est plutôt à une initiation, une société secrète de métaphysique, qu’à une philosophie<br />
publique, Rien de moins patent, rien de moins avoué que le système dont on peut suivre de<br />
loin en loin la trace cachée dans ses ouvrages. Néanmoins quand à travers le mysticisme, et le<br />
secret volontaire dont il enveloppe sa pensée, on parvient à la saisir et à la réduire en<br />
abstraction, on reconnaît que la doctrine dont elle parait s’éloigner le moins est celle de<br />
l’école théologique. Voilà pourquoi nous le plaçons à la suite des écrivains que nous classons<br />
dans cette école. Il n’est pas un d’entre eux, ce n’est ni un catholique, ni même précisément<br />
un chrétien, dans le sens vulgaire du mot, mais il a des dogmes communs avec les chrétiens et<br />
les catholiques. Peut-être que si l’on remontait loin dans le passé, et qu’on recherchât dans<br />
toute sa suite la tradition d’idées dont il est l’interprète, on trouverait qu’il se [223] rattache à<br />
une de ces religions philosophiques qui, préparées et venues en même temps que le<br />
christianisme, sans se confondre avec lui, eurent pourtant de son esprit, et en ont retenu,<br />
jusqu’à nos jours, quelques traits et quelques principes. Peut-être arriverait-on au gnosticisme,<br />
ou à quelque doctrine du même genre, dont l’histoire montrerait la transmission et la<br />
perpétuité. Quoi qu’il en soit, <strong>Saint</strong>-Martin n’a certainement nulle part ailleurs une place plus<br />
convenable qu’a côté des théologiens. 1<br />
1<br />
Voici comment M. de Maistre s’explique sur les Illuminés en général, et sur <strong>Saint</strong>-Martin en particulier ; il peut<br />
être curieux de voir ce qu’il en pense.<br />
« En premier lieu, je ne dis pas que tout illuminé soit franc-maçon ; je dis seulement que ceux que j’ai connus, en<br />
France surtout, l’étaient ; leur dogme fondamental est que le christianisme, tel que nous le connaissons<br />
aujourd’hui, n’est qu’une véritable loge bleue faite pour le vulgaire ; mais qu’il dépend de l’homme de désir de<br />
s’élever de grade en grade jusqu’aux connaissances sublimes, telles que les possédaient les premiers chrétiens,<br />
qui étaient de véritables initiés. C’est ce que certains Allemands ont appelé le christianisme transcendantal.<br />
Cette doctrine est un mélange de platonisme, d’origénianisme, et de philosophie hermétique sur une base<br />
chrétienne.<br />
» <strong>Les</strong> connaissances surnaturelles sont le grand but de leurs travaux et de leurs espérances ; ils ne doutent point<br />
qu’il ne soit possible à l’homme de se mettre en communication avec le monde spirituel, d’avoir un commerce<br />
avec les esprits, et de découvrir ainsi les plus rares mystères.<br />
» Leur coutume invariable, est de donner des noms extraordinaires aux choses les plus connues sous des noms<br />
consacrés : ainsi, un homme pour eux est un mineur, et sa naissance, une émancipation. Le péché originel<br />
s’appelle le crime primitif, les actes de la puissance divine ou de ses agents dans l’univers s’appellent des<br />
bénédictions, et les peines infligées aux coupables, des pâtiments. Souvent je les ai tenus en pâtiment lorsqu’il<br />
m’arrivait de leur soutenir que tout ce qu’ils disaient de vrai n’était que le catéchisme couvert de mots étranges.<br />
» J’ai eu l’occasion de me convaincre, il y a plus de trente ans, dans une grande ville de France, qu’une certaine<br />
classe de ces illuminés avait des grades supérieurs inconnus aux initiés admis à leurs assemblées ordinaires ;<br />
qu'ils avaient même un culte et des prêtres qu’ils nommaient du nom hébreu Cohen.<br />
» Ce n’est pas, au reste, qu’il ne puisse y avoir et qu’il n’y ait réellement dans leurs ouvrages des choses vraies,<br />
raisonnables et touchantes, mais qui sont trop rachetées par ce qu’ils ont mêlé de faux et de dangereux, surtout à<br />
cause de leur aversion pour toute autorité et hiérarchie sacerdotales. Ce caractère est général parmi eux : jamais<br />
je n’y ai rencontré d’exception parfaite parmi les nombreux adeptes que j'ai connus.<br />
» Le plus instruit, le plus sage et le plus élégant des théosophes modernes, <strong>Saint</strong>-Martin, dont les ouvrages furent<br />
décennies 1830_1839<br />
11
[224]<br />
Trois principales circonstances semblent avoir influé sur la tournure de son esprit : l’éducation<br />
douce et pieuse qu’il dut à sa belle-mère et qui, comme il le disait lui-même, le fit aimer toute<br />
sa vie de Dieu et de ses semblables ; la liaison qu’il forma avec Martinez Pasqualis, chef<br />
d’une secte d’illuminés ; enfin la connaissance qu’il eut des ouvrages de Jacob Bœhm dont il<br />
traduisit les plus importants. 2 Il fallait bien que de bonne heure, et avec la sollicitude la plus<br />
active, son âme eût été nourrie de sentiments religieux pour que, jeune, libre et militaire, au<br />
lieu de la vie de garnison, qu’il pouvait mener comme tant d’autres, il ait consacré ses loisirs à<br />
des études saintes et sévères ; pour que, dans le temps où il était, et avec la philosophie qui<br />
régnait, il ait pris dans ses spéculations une direction si opposée au sensualisme du jour. Il<br />
n’était pas ordinaire alors que, comme début dans le monde savant, on se livrât au<br />
mysticisme. En sa position et à son époque, <strong>Saint</strong>-Martin fut certainement une exception<br />
extrêmement rare. On conçoit sans peine comment dans de telles dispositions, mis en rapport<br />
avec Martinez, qu’il rencontra à Bordeaux, saisi de cette espèce de révélation qui lui était faite<br />
sous le secret par un homme enthousiaste, enchanté de ces dogmes à huis clos, qui<br />
satisfaisaient son cœur, il ait, dès ce moment, voué toute sa pensée à ces recherches<br />
enveloppées dont il fut occupé toute sa vie. La lecture de Bœhm, en modifiant quelque peu<br />
ses premières vues, ne changea cependant rien à la route qu’il suivait : ce ne fut pour lui<br />
qu’une nouvelle lumière, du moins comme il l’entendait, qui servit à mieux éclairer tous ses<br />
travaux ultérieurs. Ainsi s’explique, en partie, le génie si singulier du philosophe inconnu.<br />
Sans doute aussi dans cette âme il devait y avoir, de naissance, de tempérament si l’on veut,<br />
une faculté particulière qui se prêtât à ces influences ; toute âme n’y eût pas cédé : il devait y<br />
avoir ce besoin de s’instruire par voie d’inspiration ou de croyance, qui porte [225] à se fier à<br />
un sentiment comme à une théorie, et, à une confidence comme à une raison ; c’était une<br />
curiosité de poète, plutôt que de savant et de philosophe, sur des questions où il est plus aisé<br />
de rêver et d’espérer, que de savoir et de comprendre. On voit de ces esprits qui aiment à aller<br />
vite à la lumière, et qui, dans l’impatience de la trouver, descendent d’abord dans des<br />
profondeurs, sans autre guide que la foi, ou une ardente imagination ; leur penchant est le<br />
mysticisme ; car le mysticisme consiste à ne faire de la vérité qu’un objet de tradition ou de<br />
simple intuition : il y avait de cela dans <strong>Saint</strong>-Martin, c’était une intelligence mystique,<br />
merveilleusement propre en conséquence à recevoir les impressions des maîtres qu’il écouta.<br />
Ajoutons que bientôt, quittant le métier des armes pour être mieux à ses études, donnant<br />
presque à sa vie quelque chose du secret de sa doctrine, retiré, solitaire, lié seulement .avec<br />
quelques amis qui étaient ses adeptes, discutant peu, prêchant beaucoup, mais dans des livres ;<br />
ne répondant aux objections que par des obscurités ou des réticences, s'y croyant obligé, et<br />
rentrant à chaque instant dans l’arcane mystérieux où il était impossible de le suivre, il eut<br />
nécessairement peu d’occasion de réformer ses idées, et de sortir de son système. La<br />
révolution même, qui le trouva en pleine méditation, ne parvint pas à le troubler, quoiqu’il n’y<br />
fût pas indifférent : il y vit une image en miniature du jugement dernier ; un événement dont<br />
le mobile secret et la venue se liaient avec ses idées, et le comblaient d’avance d’une<br />
satisfaction inconnue même à ceux qui s’en montraient les plus ardents défenseurs ; c’est-àdire<br />
qu’au bruit que faisaient les choses autour de sa solitude, il se détourna un moment de ses<br />
paisibles imaginations pour jeter un regard, les juger de son point de vue, et revenir ensuite à<br />
ses pensées habituelles. Tel fut <strong>Saint</strong>-Martin jusqu’à la fin de ses jours ; dévoué à ses travaux<br />
avec un calme, désintéressement et une constance admirables.<br />
Il y a deux choses dans ses ouvrages, la critique et le dogme ; il importe de les distinguer.<br />
le code des hommes dont je parle, participait cependant à ce caractère général. Il est mort sans avoir voulu<br />
recevoir un prêtre ; et ses ouvrages présentent la preuve la plus claire qu’il ne croyait pas à la légitimité du<br />
sacerdoce chrétien. » (Soirées de <strong>Saint</strong>-Pétersbourg, tome 2, page 332.).<br />
2 Entre autres : l’Aurore naissante, ou la Racine de la Philosophie.<br />
décennies 1830_1839<br />
12
Dans la critique, il s’adresse aux observateurs de son temps ; c’est le mot dont il se sert pour<br />
désigner les sensualistes. Il les [226] attaque sur plusieurs points, et les attaque avec<br />
avantage ; il a toute raison contre eux dans les objections qu’il leur propose sur leur manière<br />
d’expliquer Dieu, l’homme et la nature ; il leur en montre clairement le défaut et la fausseté.<br />
N’admettre au monde que la matière avec ses éléments et ses propriétés, nier les forces, les<br />
esprits, les principes simples et actifs, ne pas leur accorder une existence propre, et les<br />
confondre avec les corps, c’est, selon lui, se réduire à l'impossibilité de reconnaître dans la<br />
cause première la puissance qui crée et gouverne tout, dans l’homme la moralité ; dans la<br />
nature, la vie et le mouvement, dont elle est pleine. A chaque instant il arrête les observateurs<br />
par quelques remarques, qui sont aussi justes qu'embarrassantes : il y joint fréquemment des<br />
paroles du fond du cœur, dans lesquelles, avec son amour de tout ce qui lui semble beau,<br />
saint, consolant pour l’humanité, il déplore des erreurs qui tournent contre ses croyances. Il ne<br />
manque ni de force, ni de vérité, ni d’éloquence tant qu’il demeure en ces termes, et, comme<br />
la plupart des hommes, tant qu’il critique il a l'avantage ; mais il est plus fort pour détruire<br />
que pour construire et édifier.<br />
Aussi, dans la partie dogmatique est-il loin de valoir autant. D’abord, ainsi que nous l’avons<br />
dit, il pèche par une double obscurité, celle qui lui est naturelle comme mystique, et celle qu’il<br />
s’impose comme croyant, comme membre d’une loge métaphysique qui a ses secrets et son<br />
chiffre. En voici un exemple : il pense que l’homme, à son origine, a vécu dans un tel état de<br />
pureté et de lumière, qu’il approchait de Dieu même ; une faute l’a souillé et depuis, dégradé,<br />
désunit de son principe, il ne lui reste plus qu’à expier en lui-même ou dans les siens le crime<br />
dont il s’est rendu et dont il les a rendus coupables. <strong>Saint</strong>-Martin énonce à peu près en ces<br />
termes ce dogme déjà obscur d’une ontologie toute mystique : autrefois l’homme avait une<br />
armure impénétrable, il était muni d’une lance, composée de quatre métaux, et qui frappait<br />
toujours en deux endroits à la fois ; il devait combattre dans une forêt formée de sept arbres,<br />
dont chacun avait seize racines et quatre cent quatre-vingt-dix branches ; il devait occuper le<br />
centre de ce pays ; mais s’en étant éloigné il changea sa bonne [227] armure contre une autre<br />
qui ne valait rien, il s’était égaré en allant de quatre à neuf, et il ne pouvait se retrouver qu’en<br />
revenant de neuf à quatre. Il ajoute que cette loi terrible était imposée à tous ceux qui<br />
habitaient la région des pères et des mères, mais qu’elle n’était point comparable à<br />
l’effrayante et épouvantable loi du nombre cinquante-six, et que ceux qui s’exposaient à celleci<br />
ne pouvaient arriver à soixante-quatre qu’après l’avoir subie dans toute sa rigueur, etc., etc.<br />
— Il est clair que, pour saisir le sens caché sous ces ses énigmes, il faut avoir le mot de passe,<br />
sans quoi il y a impossibilité d’interpréter ; or, ce mot n’est pas donné, ou ne l’est qu’aux<br />
initiés. Pour les autres, qu’ils ne cherchent pas, ils ne trouveraient pas : on ne veut pas qu’ils<br />
entendent, et certainement ils m’entendront pas.<br />
C’est dans le livre des erreurs et de la vérité, le principal des ouvrages de <strong>Saint</strong>-Martin, celui<br />
dans lequel il philosophe le plus (car, dans les autres, il ne fait guère que prêcher et prier),<br />
qu’il faut surtout voir quel est son système sur les principales questions dont il s’occupe. On y<br />
peut démêler un certain nombre de points tous liés les uns aux autres, dont se compose son<br />
hypothèse.<br />
Il n’est pas bien certain, en premier lieu, et, dans son idée du bien et du mal, il n’y ait pas un<br />
fonds de manichéisme ; on pourrait le conclure de certains passages, où il semble regarder ces<br />
deux choses comme deux substances, deux êtres, deux principes, qui ne sont pas, il est vrai,<br />
égaux en pouvoir, le bien étant infiniment supérieur au mal, mais qui n’en pas moins en<br />
présence et en combat. Cependant quelquefois, on dirait aussi qu’il n’admet qu’un principe, le<br />
bon, et qu’il explique le mal par l’activité nécessairement imparfaite, ou volontairement<br />
déréglée des forces libres et intelligentes. Il serait difficile de dire quelle est au juste son<br />
opinion ; cependant ce serait peut-être plutôt dans ce dernier sens qu’il conviendrait de la<br />
comprendre.<br />
décennies 1830_1839<br />
13
Quoi qu’il en soit, l’homme, sujet du bon principe, a d’abord vécu uni en lui, et tant qu’a duré<br />
cette union, parfait, puissant, presque divin, il a commandé à la nature, n’a eut ni besoin ni<br />
souffrance, n’a point connu l’expiation. Mais sa [228] volonté a failli ; il s’est détaché de<br />
Dieu ; en tombant, il s’est affaibli, corrompu, mis dans la dure condition de se laver de son<br />
péché, et de revenir par le repentir à la source de toute pureté, de toute lumière et de toute<br />
force.<br />
Cela explique ses misères vis-à-vis de la nature, et le rude travail qu’il lui faut faire pour<br />
reprendre sur elle un pouvoir qu’il avait primitivement dans toute sa plénitude.<br />
Cela explique aussi la société telle que nous la voyons aujourd’hui, avec ses institutions, ses<br />
lois, et ses gouvernements. Il est assez curieux de voir quelle politique <strong>Saint</strong>-Martin déduit de<br />
ces données.<br />
Si les hommes étaient restés dans leur pureté primitive, il n’y aurait point parmi eux<br />
d’inférieurs ni de supérieurs, il n’y aurait point de souveraineté ; tous seraient égaux<br />
parfaitement ; ils l’étaient tous dans leur état de gloire ; il n’y avait pas alors de rangs entre<br />
eux ; il n’y avait nulle distinction, parce qu’ils jouissaient tous sans défaut de la plénitude de<br />
leurs facultés. Si donc ils commandaient, ce n’était pas leurs semblables, qui ne pouvaient être<br />
leurs sujets, c’était des êtres moins parfaits, aux animaux, à la nature, à tout ce qui avait<br />
besoin d’être relevé et amélioré. Mais eux, dans leur espèce, ils n’avaient ni maîtres, ni<br />
esclaves, ni rois, ni gouvernés, ils vivaient libres et sans loi. Il a fallu la chute, et des degrés<br />
dans la chute, il a fallu des vices et des défauts de toute espèce pour amener dans l’ordre<br />
social, des inégalités et des différences, pour y introduire la souveraineté. Elle n’a sa raison<br />
que dans le plus ou moins de malice qui se trouve dans chacun de nous. « Dans cet état de<br />
réprobation où l’homme est condamné à ramper, et où il n’aperçoit que le voile et l’ombre de<br />
la vraie lumière, il conserve plus ou moins le souvenir de sa gloire ; il nourrît plus ou moins le<br />
désir d’y remonter, le tout en raison de l’usage libre de ses facultés intellectuelles, en raison<br />
des travaux qui lui sont préparés par la justice, et de l’emploi qu’il doit avoir dans l’œuvre.<br />
« <strong>Les</strong> uns se laissent subjuguer, et succombent aux écueils semés sans nombre dans ce<br />
cloaque élémentaire, les autres ont le courage et le bonheur de les éviter.<br />
On doit donc dire que celui qui s’en préservera le mieux [229] aura le moins laissé défigurer<br />
l’idée de son principe, et se sera le moins éloigné de son premier état. Or, si les autres<br />
hommes n’ont pas fait les mêmes efforts, qu’ils n’aient pas les mêmes dons, il est clair que<br />
celui qui aura tous ces avantages sur eux doit être leur supérieur et les gouverner. »<br />
Ainsi la valeur morale des individus, mesurée sur la règle d’expiation, voilà ce qui doit faire,<br />
en politique, le rang des classes et des personnes.<br />
Si telle est l’origine du pouvoir souverain, il est aisé de s’expliquer les différentes formes,<br />
selon lesquelles il a été et dû être exercé. Un seul homme, une seule grande âme s’est-elle<br />
élevée à un point de purification et de lumière, qui dépasse de bien loin tout ce qui est autour<br />
d’elle, celle-là a de droit la monarchie ; quand un seul est capable, un seul doit gouverner :<br />
mais un certain nombre a-t-il ce mérite, c’est-à-dire a-t-il le mérite de s’être rapproché<br />
davantage de cette bonté originelle, qui est la seule légitimité, il doit régner de concert avec<br />
tel arrangement et en telles combinaisons que la justice exige : enfin si un plus grand nombre<br />
encore, si les masses, si le peuple entier est en position morale de faire lui-même ses affaires,<br />
qu’il contribue directement ou indirectement en personne ou par représentation, peu importe,<br />
pourvu que l’autorité soit toujours en raison de la pureté ; car c’est toujours là le principe. <strong>Les</strong><br />
formes quelles qu’elles soient n’ont pas vertu par elles-mêmes, elles ne sont bonnes que par la<br />
manière dont elles satisfont à l’ordre social : c’est pourquoi toutes ont et doivent avoir leurs<br />
chances et leur moment.<br />
Du reste, l’idéal des souverains serait non pas seulement de posséder les lumières qu’on leur<br />
voit communément, mais d’avoir cette science qui, embrassant tout, comprenant tout,<br />
universelle et complète, véritable omniscience, ne les laisserait étrangers à rien : alors ils ne<br />
décennies 1830_1839<br />
14
orneraient pas leurs soins au gouvernement général de la société ; ils pourvoiraient à mille<br />
besoins que d’ordinaire ils négligent ; ils veilleraient à mille affaires qui leur échappent trop<br />
souvent ; en se montrant plus éclairés, ils deviendraient plus puissants, et leur sagesse serait le<br />
titre et la garantie de leur pouvoir.<br />
Telles sont quelques unes des idées extraites de l’ouvrage [230] que nous avons citées, et<br />
ramenées, non pas sans peine, du langage mystique qu’emploie l’auteur, au langage commun<br />
qui pourrait les rendre.<br />
Si on ne l’aperçoit bien nettement, on l’entrevoit du moins ; cette politique, a dans son<br />
mysticisme, une tendance au fond libérale ; elle est certainement philanthropique ; il ne<br />
faudrait, pour s’en convaincre, que lire un peu l’auteur, que faire connaissance avec lui, et<br />
apprécier les sentiments qui lui dictent ses écrits. Ce n’est comme pas M. de Maistre avec<br />
lequel il a quelque rapport de croyance et de système, au sujet du premier état, de la chute et<br />
de l’expiation. Tandis que celui-ci, avec son génie sévère, haut et implacable, ne tire de ces<br />
principes que de dures maximes d’état, <strong>Saint</strong>-Martin, avec son cœur si bienveillant et si<br />
tendre, n’aspire qu’à les tourner au bonheur de ses semblables ; il les tempère de toute son<br />
âme, les adoucit par pitié, y mêle une onction qui en corrige heureusement la terrible austérité.<br />
S’il a de l’analogie avec quelqu’un qui est aussi un peu de sa foi, c’est plutôt avec M.<br />
Ballanche : il a même affection, même charité, même sympathie pour le genre humain.<br />
Pour achever de donner une idée de l’espèce de philosophie qu’on trouve dans les ouvrages de<br />
<strong>Saint</strong>-Martin, nous rapporterons un morceau extrait d’article inséré dans les Archives<br />
littéraires 3 : cet article est d’un rédacteur qui parait avoir étudié avec attention les diverses<br />
productions du philosophe inconnu : « Son système permet d’expliquer tout par l’homme :<br />
l’homme, selon lui, est la clef de toute énigme l’image de toute vérité. Prenant ainsi à la lettre<br />
ce fameux oracle de Delphes, noce te ipsum, il soutient que, pour ne pas se méprendre sur<br />
l’harmonie de tous les êtres de l'univers, il suffit à l’homme de se bien connaître lui-même,<br />
parce que le corps de l’homme a un rapport nécessaire avec tout ce qui est visible, et que son<br />
esprit est le type de tout ce qui est invisible. Que l’homme étudie donc, et ses facultés [231]<br />
physiques dépendantes l'organisation son corps, et ses facultés intellectuelles, dont l’exercice<br />
est souvent influencé par les sens ou par les objets extérieurs, et ses facultés morales ou sa<br />
conscience, qui suppose en lui une volonté libre. C’est dans cette étude qu’il doit rechercher la<br />
vérité, et il trouvera en lui-même tous les moyens nécessaires pour y arriver : voilà ce que<br />
l’auteur appelle la révélation naturelle. Par exemple, la plus légère attention suffit, dit-il, pour<br />
nous apprendre que nous ne communiquons, et que nous ne formons même aucune idée<br />
qu’elle ne soit précédée d’un tableau ou d'une image engendrée par notre intelligence : c’est<br />
ainsi que nous créons le plan d’un édifice et d’un ouvrage quelconque. Notre faculté créatrice<br />
est vaste, active, inépuisable mais, en l’examinant de près, nous voyons qu’elle n’est que<br />
secondaire, temporelle, dépendante, c’est-à-dire qu’elle doit son origine à une faculté créatrice<br />
supérieure, indépendante, universelle, dont la notre n’est qu’une faible copie : l’homme est<br />
donc un type qui doit avoir son prototype, et ce prototype est Dieu. » Voilà pourquoi <strong>Saint</strong>-<br />
Martin dit quelque part que l’homme n’est qu’une pensée de Dieu, pensée qu’il peut laisser<br />
s’obscurcir et s’altérer, mais qu’il peut aussi ramener à la vérité et à la lumière en prenant soin<br />
de se purifier, et alors il connaît Dieu, qui est cette pensée même, il l’a et le sent en lui. Celui<br />
qui connaît Dieu, disent les philosophes indiens, devient Dieu lui-même ; selon <strong>Saint</strong>-Martin,<br />
il en devient au moins l’image, quand il s’est lavé de la corruption dont sa chute l’a souillé.<br />
On sait trop ce qu’il peut y avoir de faux et de vrai, ou plutôt d’ombre et de vérité dans les<br />
idées que nous venons de parcourir, pour qu’il soit nécessaire de le montrer expressément ; la<br />
manière seule dont elles ont été exposées en est une critique suffisante. Nous nous bornerons<br />
donc à remarquer que, sauf la forme et la couleur, rentrant dans celles de M. de Maistre, au<br />
3 En 1804 peu après la mort de <strong>Saint</strong>-Martin.<br />
décennies 1830_1839<br />
15
moins sous quelques rapports principaux, elles donneraient lieu aux objections, et laisseraient<br />
prise aux mêmes arguments ; ce seraient mêmes preuves à reproduire, nous aimons mieux y<br />
renvoyer.<br />
Ajoutons que, si l’on voulait suivre le système de <strong>Saint</strong>-Martin dans sa partie physique et<br />
mathématique, on n’y trouverait que des étrangetés qui, dans l'état actuel de ces sciences, ne<br />
mériteraient pas une discussion sérieuse. [232]<br />
Tel est, dans sa plus grande généralité, c’est-à-dire dans tout ce qui peut avoir quelque intérêt<br />
pour le public, l’illuminisme de <strong>Saint</strong>-Martin 4 . Pour qui aurait plus de curiosité, nous citerons<br />
les ouvrages suivants, que chacun peut consulter :<br />
1° des Erreurs et de la Vérité (Lyon) 1775, in-8° ;<br />
2° du Tableau naturel ;<br />
3° de l’Esprit des choses ;<br />
4° du Crocodile, la plus bizarre et la obscure des compositions de l’auteur ;<br />
5° du Ministère de l’Homme-esprit ;<br />
6° Éclair sur l’Association humaine (Paris, an V, 1797), in-8°.<br />
Il va sans dire qu’en plaçant <strong>Saint</strong>-Martin à la fin de l'école théologique, nous ne suivons pas<br />
l’ordre de date, car à ce compte il serait en tête ; c’est plutôt comme un lieu à part, que nous<br />
avons voulu lui donner ; nous l’avons placé le dernier pour isoler, et par là mieux marquer la<br />
nuance qui le distingue ; à peu près comme nous avons fait, dans l’école sensualiste pour le<br />
docteur Gall et M. Azaïs.<br />
Page 332<br />
Titre école éclectique, le nom <strong>Saint</strong>-Martin n’apparaît pas ci-dessous malgré l’intérêt de<br />
cette école qui combat, comme lcsm mais différemment, Condillac et autres disciples.<br />
… elle a [331] l'idée de sa durée ; elle comprend sa durée d'après la succession de ses<br />
actions ; elle comprend en général la durée par la succession; et par suite de ce jugement elle<br />
parvient bientôt à la croyance aussi ferme qu'inévitable d'une durée non seulement indéfinie,<br />
mais infinie, au-delà et en-deçà de laquelle il n'y a et ne peut rien y avoir : cette durée, c'est<br />
le temps, c'est l'éternité. C'est par un procédé en quelques points analogue que l'esprit<br />
comprend l'espace. En percevant un corps, il le perçoit dans un lieu, et ce lieu n'est pas tout ;<br />
il tient dans un lieu plus grand, et celui-ci dans un plus grand encore, ainsi de suite jusqu'à ce<br />
que paraisse l'espace indéfini, infini, l'immensité, qui contient tout.<br />
Telles sont, mais abrégées, mais affaiblies et dépouillées de leurs traits d'éclat et de leur<br />
force, les explications que donna M. Royer-Collard des faits dont Condillac avait si peu<br />
rendu raison. Pour faire sentir à nos lecteurs tout ce qu'ils perdent à notre analyse, nous<br />
citerons quelques passages empruntés à une des leçons que l'illustre professeur consacra au<br />
sujet qui vient de nous occuper : ce sera une espèce de dédommagement. Voulant prouver<br />
que, si la durée se conçoit par succession, elle n'est cependant pas la succession, il la<br />
considère dans le moi :<br />
« Le premier acte de la mémoire emporte la conviction de notre existence identique et<br />
continue, depuis l'événement qui est l'objet de cet acte. Mais notre identité continue n'est<br />
autre chose que notre durée. La durée est renfermée dans l'identité ; l'une et l'autre le sont<br />
dans l'exercice de la mémoire 5 . Puisque nous ne nous souvenons que de nous-mêmes, la<br />
durée qui nous est donnée par la mémoire est nécessairement la nôtre : car si elle n'était pas<br />
la nôtre, nous n'aurions pas le sentiment de notre identité. Mais le moi seul est identique ; ses<br />
pensées varient à tout moment. La durée qui est renfermée dans l'identité appartient donc au<br />
moi seul, non à ses pensées : elle est donc antérieure à la succession de celles-ci. Il ne dure<br />
pas parce que ses pensées se succèdent, mais ses pensées se succèdent parce qu'il dure. La<br />
4 Voyez l’article <strong>Saint</strong>-Martin dans la Biographie universelle, tome 40<br />
5 Nous savons désormais que notre mémoire n’offre aucune « assurance ».<br />
décennies 1830_1839<br />
16
succession présuppose la durée, dans laquelle elle n'est qu'un rapport [332] de nombre,<br />
comme le mouvement présuppose l'étendue. Qu'on ne cherche pas l'origine de la durée dans<br />
la succession : on ne la trouvera que dans l'activité du moi. Le moi dure, parce qu'il agit ; il<br />
dure sans cesse, parce qu'il agit sans cesse : sa durée, c'est son action continue, réfléchie<br />
dans la conscience et dans la mémoire : de la continuité de l'action naît la continuité de la<br />
durée ; si l'action cessait pour recommencer, et cessait encore pour recommencer encore, le<br />
moi se sentirait à chaque instant défaillir et renaître ; la durée serait une quantité discrète<br />
comme le nombre ; ses parties seraient séparées par des intervalles où il n'y aurait pas de<br />
durée. Elle est une quantité continue parce que le moi se sent continu, et il se sent continu,<br />
parce que son action est continue. Et plus loin il s'exprime en ces termes, pour montrer<br />
comment la pensée passe de la durée limitée à la durée illimitée :<br />
« A l'occasion de la durée contingente et limitée des choses, nous comprenons une durée<br />
nécessaire et illimitée, théâtre éternel de toutes les existences ; et non seulement nous la<br />
comprenons, mais nous sommes invinciblement persuadés de sa réalité. Cette durée est le<br />
temps. Que la pensée anéantisse, elle le peut, et les choses et leurs successions ; il n'est pas en<br />
son pouvoir d'anéantir le temps : il subsiste vide d'événements ; il continue de s'écouler,<br />
quoiqu'il n'entraîne plus rien dans son cours. Dans l'ordre de la connaissance, c'est la durée<br />
particulière du moi qui amène le temps ; dans l'ordre de la nature, le temps est antérieur, à<br />
toutes les vicissitudes qui s'opèrent en lui, à toutes les révolutions par lesquelles nous le<br />
mesurons. Le commencement du temps implique contradiction ; la supposition d'un temps qui<br />
aurait précédé le temps est absurde. »<br />
Enfin voici comment il compare en elles-mêmes et dans leurs idées le temps et l'espace :<br />
« Comme la notion de durée devient indépendante des événements qui nous l'ont donnée, de<br />
même la notion de l'étendue, aussitôt que nous l'avons acquise, devient indépendante des<br />
objets où nous l'avons trouvée. Quand la pen[333]sée anéantit ceux-ci, elle n' anéantit pas<br />
l'espace qui les contenait. Comme la notion d'une durée limitée nous suggère la notion du<br />
temps, c'est-à-dire d'une durée sans bornes, qui n'a pas pu commencer et qui ne pourrait pas<br />
finir, de même la notion d'une étendue limitée nous suggère la notion de l'espace, c'est-à-dire<br />
une étendue infinie et nécessaire qui demeure immobile, tandis que les corps s'y meuvent en<br />
tout sens. Le temps se perd dans l’éternité, l'espace dans l'immensité. Sans le temps il n'y<br />
aurait pas de durée; sans l'espace il n'y aurait pas d'étendue. Le temps et l'espace contiennent<br />
dans leur ample sein toutes les existences finies, et ils ne sont contenus dans aucune. Toutes<br />
les choses créées sont situées dans l'espace, et elles ont aussi leur moment dans le temps ;<br />
mais le temps est partout, et l'espace aussi ancien que le temps. »<br />
Reprenons. Le système qui réduit toute l'intelligence à la sensation n'est pas incomplet<br />
seulement parce qu'il n'explique pas les notions de substance, de cause, de temps et d'espace,<br />
il l'est aussi parce qu'il n'explique bien aucune idée morale. En effet, si la sensation est tout le<br />
sens humain, il ne peut y avoir que la matière qui soit un objet de connaissance : car la<br />
sensation ne tombe jamais que sur l'étendue, la figure, la couleur, etc. ; elle ne porte pas sur<br />
les faits qui sont du domaine de la conscience ; elle se fixe sur le monde, et ne se retour ne<br />
pas sur l'âme ; elle est la vue de l'esprit par les sens; et par les sens l'esprit ne voit ni passion,<br />
ni pensée, ni volonté ; il ne voit rien d'intime, de moral : il ne perçoit que le physique, du<br />
moins si on le réduit rigoureusement à la sensation, et qu'on ne prête pas à la sensation une<br />
propriété qu'elle n'a pas. Ainsi, borner l'homme au toucher, à la vue, au goût, à l'ouïe et à<br />
l'odorat, le borner à la sensibilité externe, c'est nier qu'il ait le sentiment des faits<br />
psychologiques ; ou, si on ne le nie pas, on désavoue, on contredit le principe duquel on part.<br />
Condillac serait en opposition avec lui-même s'il reconnaissait à l'âme humaine d'autres<br />
notions que celles des sens. Or, une telle conséquence ruine le système dont elle sort, et M.<br />
Royer-Collard n'eut pas de peine à le faire voir : il démontra qu'une idéologie qui se<br />
condamne [334] à ne rien dire du sens moral et des idées dont il est la source est par là même<br />
décennies 1830_1839<br />
17
exclusive et défectueuse. Et, pour cela, il n'eut qu'à appeler l’attention sur cette foule de faits<br />
internes dont, à chaque instant, nous avons sans organes, sans moyen physique de perception,<br />
une connaissance tout aussi certaine et tout aussi claire que celle que nous devons à la<br />
sensation et à ses instruments.<br />
Mais ce n'était pas assez que le système fût jugé sous le point de vue métaphysique, il fallait<br />
qu'il le fût aussi sous le point de vue pratique. Quel en était le principe sous ce rapport ? Si la<br />
sensation est tout l'homme, la seule chose que l'homme ait à faire est de céder à la sensation,<br />
car c'est là sa nature. Or, que veut la sensation ? le plaisir par instinct, l'utilité par calcul, le<br />
bien-être dans tous les cas. Et où voit-elle ce bien-être ? dans la matière apparemment,<br />
puisqu'elle ne conçoit pas d'autre objet: c'est donc aux jouissances physiques qu'elle réduit<br />
tout le bonheur ; et comme un tel bonheur ne peut être qu'à la condition de l'exercice facile et<br />
continu des sens, veiller à ce que le corps ne s'altère ni ne se détruise, telle est la loi suprême,<br />
la grande loi de la vie. Si Condillac ne le dit pas, Volney le dit pour lui ; et il ne le dit qu'en<br />
raisonnant d'après le maître dont il suit les idées. Le Catéchisme du citoyen n'est en effet que<br />
le commentaire moral du Traité des Sensations. Et il ne faudrait pas objecter que le<br />
matérialisme d'un de ces ouvrages et le spiritualisme de l'autre empêchent qu'il n'y ait entre<br />
eux le rapport que nous supposons. Cette différence n'y fait rien : car, si Condillac est<br />
spiritualiste, il l'est de telle manière, qu'il autorise, disons plus qu'il force l'application<br />
pratique que nous venons d'indiquer de sa théorie. Qu'importe l'âme, en effet, si elle n'a de<br />
faculté que pour la matière ? Qu’importe l'esprit s'il se réduit à la sensation ? En est-il moins<br />
vrai que dans cette hypothèse la destination de l'homme est de sentir, de ne sentir que les<br />
choses matérielles, et d'y chercher toute sa félicité. Le spiritualisme ne sert donc de rien dans<br />
cette question. C'est une pensée à part, une spéculation sans conséquence, qui, adoptée ou<br />
rejetée, n'en laisse pas moins la logique aller son train et déduire avec rigueur du<br />
sensualisme métaphysique le sensualisme moral, qui y est contenu ; et il n'y a pas<br />
d'injus[335]tice à accuser, je ne dis pas Condillac, mais sa doctrine, d'avoir fait la<br />
philosophie d'une morale qui, certainement, a des effets fâcheux. S'il n'a pas voulu cette<br />
morale, il l'a pensée ; s'il ne l'a pas avouée comme conséquence, il en a posé le principe ; et il<br />
ne peut être à l'abri de reproche d'un côté, que pour être accusé de l'autre de n'avoir pas<br />
assez prévu toutes les suites de son système. Nous ne reproduirons pas les arguments par<br />
lesquels M. Royer-Collard porta coup à cette morale ; nous avons .essayé, de le faire en<br />
examinant le, Catéchisme de Volney. Mais nous, rappellerons l'effet que produisait sur son<br />
auditoire cette parole grave, puissante, pleine d'émotion et de sérieux, avec laquelle il<br />
flétrissait les principes qu'il réfutait. Il imposait aux intelligences qui ne se rendaient pas ou<br />
qui ne comprenaient pas ; il captivait les autres ; il les élevait, les fortifiait, les remplissait de<br />
sagesse et de raison ; il eut du rôle de Socrate auprès de la jeunesse qui l'écoutait.<br />
Mais en même temps qu'il éprouva sévèrement les fâcheuses maximes d'un égoïsme étroit, il<br />
n'accorda pas plus de faveur à cette morale sentimentale ou mystique, qui peut bien être une<br />
religion de cœur, mais qui n'est pas une conviction de l'esprit. Il s'écarta également de l'école<br />
sensualiste et de l'école rêveuse ; et sur les pas des sages écossais il chercha le fondement du<br />
devoir dans une connaissance, exacte de la nature humaine. Au lieu de déduire les règles de<br />
la vie d'une mesquine ou vague idée du bien, il les tira d'une philosophie à la fois positive et<br />
large ; il les traça pleines de sens, d'élévation et de vérité. Le temps et la nature même de<br />
l'enseignement dont il était chargé ne lui permirent pas d'exposer toute sa pensée sur ce sujet.<br />
Mais, chaque fois qu’il y toucha, ce ne fut jamais sans en faire sortir ces leçons de sagesse et<br />
d'honneur moral que plus tard il reproduisait à la tribune avec tant d éloquence et d'autorité.<br />
Aussi ce ne fut pas en vain qu'il jeta dans les âmes ces excellentes impressions : elles<br />
gagnèrent, se répandirent, passèrent dans le public; et grâce à lui, grâce à ceux qui<br />
travaillèrent avec lui dans le même sens, quand il eut à parler, non plus devant des disciples,<br />
décennies 1830_1839<br />
18
mais devant des concitoyens, devant le pays, il trouva de toute part des cœurs qui [336]<br />
l'entendirent, des hommes de son école, des partisans de ses disciples.<br />
…<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin. Pas trace du mot !<br />
Page 443<br />
Table des matières<br />
<strong>Saint</strong>-Martin. Page 222<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
<strong>19</strong>
1833<br />
Dictionnaire historique, ou histoire abrégée de hommes qui se sont fait un ... Page 40 de<br />
François-Xavier Feller 1833<br />
SAINT-<strong>MARTIN</strong> (<strong>Louis</strong>-<strong>Claude</strong> de), surnommé le Philosophe inconnu, né à Amboise le 18<br />
janvier 1743, appartenait à une famille distinguée dans les armes, fit de bonnes études, et<br />
possédait plusieurs langues anciennes et modernes. Il s'était plu dans la lecture du livre du<br />
théologien protestant, Abbadie, sur l’Art de se connaître soi-même, et c'est là qu'il avait puisé<br />
la plus grande partie de ses principes de conduite. Destiné par ses parents à la magistrature, il<br />
étudia le droit ; mais ensuite, préférant la carrière des armes, qui lui laissait plus de loisir pour<br />
s'occuper de ses méditations philosophiques, il entra, à l'âge de 22 ans, dans le régiment de<br />
Foix en qualité de lieutenant. Il fut initié alors, par des formules, des rites et des pratiques, à la<br />
secte dite des Martinistes, du nom de Martinez-Pasqualis qui en était le chef. Quoiqu'il<br />
n'adoptât point entièrement les [40] doctrines de cette secte, ce fut par-là qu'il entra dans les<br />
voies du spiritualisme. L'état militaire n'étant guère conforme à ses inclinations, il le quitta au<br />
bout de six ans. <strong>Saint</strong>-Martin avait un caractère tranquille, aimait l'étude et le recueillement,<br />
où il se plongeait dans ses idées métaphysiques. Après avoir voyagé en Suisse, eu Allemagne,<br />
en Angleterre et en Italie, il revint à Lyon, où il demeura trois ans, presque inconnu, dans la<br />
retraite, ne voyant qu'un petit nombre d'amis. Il mena la même vie obscure et paisible à Paris,<br />
où il s'était rendu après cette époque; impassible au milieu des évènements de la révolution, il<br />
put en éviter les suites. Il ne blâmait ni ne louait rien avec excès, et son âme, concentrée en<br />
elle-même, ne se nourrissait que d'idées philosophiques, ne regardant les affreuses scènes qui<br />
se passaient autour de lui que comme des maux inévitables ou mérités. Il voyait dans la<br />
révolution les desseins terribles de la Providence, comme il crut trouver plus tard un grand<br />
instrument temporel dans Buonaparte. Expulsé de Paris en 1704 comme noble, il fut arrêté<br />
peu de temps après dans la retraite qu'il s'était choisie, comme faisant partie de la prétendue<br />
conjuration de la mère de Dieu, Catherine Theos. Le 9 thermidor le rendit à la liberté. Vers la<br />
fin de la même année, il fut désigné par le district d'Amboise, sa patrie, comme un des élèves<br />
de l'école normale. Il publia ensuite un grand nombre d'ouvrages qui ont clé commentés et<br />
traduits en partie, principalement dans les langues du nord de l'Europe. Nous citerons les<br />
suivants :<br />
1° Des Erreurs et de la Vérité, ou les hommes rappelés au principe universel de la science, par<br />
un philosophe inconnu, Edimbourg (Lyon), 1775, in-8. Ce livre fit beaucoup de bruit dans le<br />
temps; cependant il est inintelligible. Quelle est la science? Selon lui, c'est la révélation<br />
naturelle ; et cette même révélation, qu'est-elle en substance ? C'est ce que <strong>Saint</strong>-Martin, ou<br />
n'a pas su concevoir, ou qu'il a mal expliqué. « Son système, dit M. Tourlet, a pour but -<br />
d'expliquer tout par l'homme. L'homme, selon <strong>Saint</strong>-Martin, est la clef de toute énigme et<br />
l'image de toute vérité : prenant ensuite à la lettre le fameux oracle de Delphes, nosce te<br />
ipsum, il soutient que pour ne pas se méprendre sur l'existence et l'harmonie des êtres<br />
composant l'univers, il suffit à l'homme de se bien connaître lui-même, parce que le corps de<br />
l'homme a un rapport nécessaire avec tout ce qui est visible, et que son esprit est le type de<br />
tout ce qui est invisible ; que l'homme doit étudier, et ses facultés physiques dépendantes de<br />
l'organisation de son corps, et ses facultés intellectuelles, dont l'exercice est souvent influencé<br />
par les sens ou par les objets extérieurs, et ses facultés morales ou sa conscience, qui suppose<br />
en lui une volonté libre ; c'est dans cette étude qu'il doit chercher la vérité, et il trouvera en<br />
lui-même tous les moyens nécessaires pour y arriver. Voilà ce que <strong>Saint</strong>-Martin appelle la<br />
décennies 1830_1839<br />
20
évélation naturelle. Par exemple, la plus légère attention suffit, dit-il, pour nous apprendre<br />
que nous ne communiquons, et que nous ne formons même aucune idée, qu'elle ne soit<br />
précédée d'un tableau ou d'une image engendrée par notre intelligence ; c'est ainsi que nous<br />
créons le plan d'un édifice ou d'un ouvrage quelconque. Notre faculté créatrice est vaste,<br />
active, inépuisable; mais en l'examinant de près, nous voyons qu'elle est secondaire,<br />
temporelle, dépendante, c'est-à-dire qu'elle doit son origine à une faculté créatrice supérieure,<br />
indépendante, universelle, dont la nôtre n'est qu'une faible copie. L'homme est donc un type<br />
qui doit avoir son prototype ; c'est une effigie, une monnaie qui suppose une matrice, et le<br />
Créateur ne pouvant puiser que dans son propre fonds, a dû se peindre dans ses œuvres, et<br />
retracer en nous son image et sa ressemblance, base essentielle de toute réalité. Malgré le<br />
rapport et la tendance que nous conservons vers ce centre commun, nous avons pu, en vertu<br />
de notre libre arbitre, nous en approcher ou nous en éloigner. La loi naturelle nous ramène<br />
[41] constamment à notre première origine, et tend à conserver en nous l'empreinte a de<br />
l'image primitive ; mais notre volonté peut refuser d'obéir à cette loi ; et alors la chaîne<br />
naturelle étant interrompue, notre type ne se rapporte plus à son modèle, il n'en dépend plus,<br />
et le place sous l'influence des êtres corporels qui ne doivent servir qu'à exercer nos facultés<br />
créatrices, et par lesquelles nous devons naturellement remonter à la source de tout bien et de<br />
toutes jouissances. Cette disposition vicieuse, une fois contractée par notre faute, peut, comme<br />
les autres facultés organiques, se transmettre par la voie de la génération : ainsi nous héritons<br />
des vices de nos parents. Mais la vertu, mais l'étude et la bonne volonté pourront toujours<br />
diminuer ou détruire ces affections dépravées, et corriger en nous ces altérations faites à<br />
l'image de la Divinité ; nous pouvons, en un mot, nous régénérer, et seconder ainsi les vues<br />
réparatrices de l'Homme-Dieu. » Malgré cette analyse que nous avons rapportée en entier, on<br />
ne voit d'un peu clair dans la doctrine de <strong>Saint</strong>-Martin, sinon que Dieu voit tout en l'homme,<br />
qui est son image, tandis que Malebranche voit, comme cela doit être, tout en Dieu, comme le<br />
principe infini d'où dérive tout ce qui est créé. Celui qui connaît Dieu, disaient les philosophes<br />
anciens, devient Dieu lui-même. » Et <strong>Saint</strong>-Martin soutient que l'homme vertueux redevient<br />
l'image de Dieu. » Parmi plusieurs maximes erronées ou mal connues du philosophe français,<br />
celle-ci est plus à la portée de tout le monde : II est bon, dit-il, de jeter continuellement les<br />
yeux sur la science, pour ne pas se persuader qu'on sait quelque chose ; sur la justice, pour ne<br />
pas se croire irréprochable ; sur toutes les vertus, pour ne pas penser qu'on les possède. Le<br />
livre de <strong>Saint</strong>-Martin a trouvé beaucoup de partisans en Angleterre, et on en a imprimé à<br />
Londres une suite en anglais, 1784, en 2 volumes in-8 ; mais l'auteur français n'y a eu aucune<br />
part, et elle s'éloigne des principes de son système.<br />
2° Le ministère de l’homme-esprit, Paris, an 11 (1802), 3 part., in-S;<br />
3° Eclair sur l'association humaine, an 5 (1797), in-8. Il y cherche les fondements du pacte<br />
social dans le régime théocratique, et les communications entre Dieu et l'homme,<br />
4° Le Livre rouge ;<br />
5° Ecce Homo, Paris, an 4 (1796), in-12 ;<br />
6° L'homme, de désir, Lyon, 1790, in-8, nouv. édit., Metz, an 10 (1802), in-12;<br />
7° Le Cimetière d'Amboise ;<br />
8° Le Crocodile ou La Guerre du bien et du mal, arrivée sous le règne de <strong>Louis</strong> XV, poème<br />
épico-macaronique en 102 chants, Paris, 1799, in-8. C'est l'ouvrage le plus obscur qu'ait<br />
décennies 1830_1839<br />
21
enfanté l'imagination ténébreuse de l’auteur, et qui ne fait nul honneur à ses talents poétiques.<br />
On y voit figurer une Jof (la foi), un Sédir (le désir), et un Ourdeck (le jeu), qui sont la clef de<br />
tout le poème, sans que cela le rende ni moins ennuyeux, ni plus intelligible.<br />
9° Tableau naturel des rapports qui existent entre. Dieu, l’homme et l'univers, deux parties,<br />
Edimbourg (Lyon, 1782, in-8), traduit en allemand, ainsi que le livre des Erreurs.<br />
10° Le Nouvel Homme, 1796, in-8 ;<br />
11° De l’esprit des choses ou Coup-d'œil philosophique sur la nature des êtres, etc., Paris, an 8<br />
(1800), 2 vol. in-8;<br />
12° Lettre à un ami, ou Considérations politiques, philosophiques et religieuses sur la<br />
révolution française, Paris, an 3 (1795), in-8 ;<br />
13° Réflexions d'un observateur sur la question proposée par l'Institut, Quelles sont les<br />
institutions les plus propres à former la morale d'un peuple, .an 6 (1798), in-8 ;<br />
14° Discours en réponse au citoyen Garat, professeur d'entendement humain aux écoles<br />
normales, sur l'existence d'un sens moral, etc., imprimé dans la Collection des écoles<br />
normales, an 1801, tome 3;<br />
15° Essai sur celte question proposée par l’Institut : Déterminer l'influence des signes sur la<br />
formation des idées, an 7 (1799), in-8 de 80 pages.<br />
<strong>Saint</strong>-Martin a traduit de l'allemand de Bœhm les Principes, l'Aurore naissante. Il avait, diton,<br />
un caractère doux, bienfaisant ; ses connaissances étaient très variées; il aimait les arts, et<br />
surtout la musique. Ses auteurs favoris [42] étaient Burlamaqui et Rabelais ; il lisait le premier<br />
pour s'instruire, et c'est de lui, dit-il, qu'il prit le goût de la méditation ; il lisait le second pour<br />
son amusement. Nous pensons au contraire qu'il y a assez de ces deux écrivains pour se gâter<br />
l'esprit et se corrompre le cœur. <strong>Les</strong> Œuvres posthumes de <strong>Saint</strong>-Martin ont été publiées à<br />
Tours, 180T, 2 volumes in-8; on y trouve un Journal depuis 1782, dans lequel l'auteur a<br />
rapporte les entretiens, les relations, etc. qu'il avait eus ; ce morceau est intitulé : Portrait de<br />
<strong>Saint</strong>-Martin fait par lui-même. Plusieurs biographes ont confondu <strong>Saint</strong>- Martin avec<br />
Martinez Pasqualis, auquel nous n'avons point consacré d'article, et qui fut le chef de la secte<br />
des Martínistes, dont <strong>Saint</strong>-Martin fit d'abord partie, on croit que ce Martinez était un juif<br />
portugais. En 1754, il s'annonça par l'institution d'un Rite cabalistique d'élus, dits cohens, mot<br />
hébreu qui veut dire prêtre ; il l'introduisit dans quelques loges maçonniques de France. Après<br />
avoir prêché sa doctrine à Paris, il s'embarqua pour St.-Domingue, et il mourut au Port-au-<br />
Prince en 1779. Ses écrits et ceux de ses disciples fout croire que sa doctrine est cette cabale<br />
des Juifs qui est leur métaphysique, c'est-à-dire la science de l'être comprenant les notions de<br />
Dieu, des esprits et de l'homme dans ses divers états.<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
22
Biographie universelle ou Dictionnaire historique, par une société de gens ... Page 287 de<br />
Biographie 1833<br />
BOEHM (JACOB), chef de la secte des Boehmistes, espèce d'illuminés, né en 1575, mort en<br />
1624. On a de lui plusieurs ouvrages tels que l’aurore naissante, les trois principes; la triple<br />
vie, imp. à Amsterdam, 1682 et 1730, in-8, sous le titre de Theosophia revelata trad. en<br />
français par le Philosophe inconnu (de <strong>Saint</strong>-Martin). Sa vie a été publiée en allemand par<br />
Franckenberg (voir ce nom).<br />
Affichage du livre entier<br />
A General Biographical Dictionary: Containing a Summary Account of the Lives ... de<br />
John Gorton 1833<br />
ST <strong>MARTIN</strong> (<strong>Louis</strong> <strong>Claude</strong> de) a visionary of the last century, who styled himself " Le<br />
Philosophe inconnu." He was born of a noble family, at Amboise, in 1743. Having received a<br />
collegiate education to qualify him for the magistracy, he preferred entering into the army, for<br />
the sake of applying himself to study in the intervals of military duty. While a subaltern in<br />
garrison at Bordeaux, he became a follower of Martinez Pasqualis, founder of the sect of<br />
Martinists, whose school, after the death of their leader in 1779, was transferred to Lyons,<br />
where St Martin published his work " Des Erreurs et de la Vérité, ou les Hommes rappelés au<br />
Principe universel de la Science," 8 volumes. This was followed by a number of other<br />
publications, including translations of many of the productions of Jacob Boehmen, of whom<br />
he was a great admirer. He quitted the army, that he might be at liberty to prosecute his<br />
favourite studies, and travelled, like Pythagoras, in search of knowledge. In 1787 he visited<br />
England, and the following year he went to Italy, with the Russian prince Alexis Galitzin,<br />
whom he made a convert to his opinions. On his return to France he received the cross of St<br />
<strong>Louis</strong>, in reward of his military services ; but the Revolution shortly after deprived him of this<br />
as well as his other aristocratic privileges. In other respect he was but little affected by the<br />
political changes which he witnessed, continuing his philosophical speculations till the close<br />
of his life, he died of apoplexy, October 13, 1803. — Biographie nouvelle des contemporains;<br />
biographie universelle.<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
23
Revue universelle, bibliothèque de l'homme du monde et de l'homme politique ... Page<br />
169 1833<br />
... [166] SCIENCES — DOCTRINES.<br />
DE LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE selon les systèmes du XIXe SIÈCLE.<br />
Trois hommes en Europe ont, depuis un siècle, change la direction des études historiques; le<br />
premier est l'italien Vico, dont voici les idées dans un rapide aperçu.<br />
Pareil à ce Dieu dont il est question dans Homère, qui en trois pas parcourait l'immensité du<br />
ciel, Vico, jetant son profond regard sur les diverses successions d'âges qui se déroulent dans<br />
le domaine de l'histoire, y détache trois points fixes ou phases générales, à travers lesquelles il<br />
est dans les destinées des peuples de passer invariablement. Ces trois époques, Vico les<br />
caractérise sous les noms de divine, héroïque et humaine, âges des dieux, des héros et des<br />
hommes : distinction analogue à celle du romain Varron, qui partageait aussi le temps en<br />
obscur, fabuleux et historique.<br />
Plongeant à l'origine des premières traditions des peuples, il fouille dans cette nuit; il tente<br />
d'explorer ce qu'il y a au fond de toute histoire, et de faire saisir aux regards ces pierres<br />
fondamentales angulaires sur lesquelles repose tout l'édifice des sociétés humaines. Or, la<br />
sonde irrésistible dont il sert pour pénétrer dans ces profondeurs, c'est l’étymologie,<br />
instrument admirable que lui prête la linguistique, surtout la science des origines latines, et<br />
qu'il manie avec un art merveilleux. Aussi, aux lueurs de ce flambeau des conjectures<br />
étymologiques, voyez comme, d'une part, il vivifie, comme, de l'autre, il fait évanouir les<br />
croyances transmises de siècle en siècle sur la foi des premiers historiens, comme il fait et<br />
défait à plaisir et à volonté les héros et les grands hommes ; demandez-lui ce que deviennent,<br />
sous son audacieuse investigation, les grandes figures qui, aux temps les plus reculés,<br />
rayonnent dans les pages conventionnelles de l'histoire. Il vous dira que ce sont des types<br />
universels, produits par la tendance de l'esprit humain, qui toujours aspire à simplifier et à<br />
comprendre les époques les plus brillantes et les plus compliquées sous une expression<br />
générale et formelle, et qui, dans ces temps obscurs, se complaisait à réaliser dans un Dieu,<br />
dans un héros, dans un homme, tout l'ordre des pensées d'un siècle. Oui, c'est suivant Vico,<br />
une pensée populaire qui se personnifie, se fait homme, et se transmet inaltérable sous son<br />
enveloppe symbolique aux raisons crédules des générations naissantes, jusqu'au jour où la<br />
raison progressive se lève, pénètre dans l'abîme, et répand le jour historique à travers ces<br />
ténèbres visibles du monde primitif. Ainsi les Hermès, les Orphée, les Numa, les Lycurgue<br />
furent des époques, des types, et n'eurent jamais existence d'homme. Ainsi le vieux et<br />
mendiant aveugle, chantre d'Achille et d'Ulysse, ne fut jamais aveugle, ne parut jamais sur les<br />
bords du Mêlès, ne mendia jamais dans les villes d'Ionie; mais on appela [167] Homère une<br />
légion de poètes réalisant la pensée totale de l'héroïsme grec, recevant l'art par le même<br />
souffle divin, et se léguant la continuation de l'œuvre admirable que les grammairiens de<br />
Pisistrate auraient ensuite réuni dans un seul poème, comme si c'eût été le produit d'une seule<br />
et identique inspiration.<br />
De sorte que, parmi les peuples primitifs vers lesquels l'investigation historique remonte avec<br />
tant d'efforts, le spectacle permanent qui se manifeste est la lutte incessante et essentiellement<br />
dramatique de l'idée et du symbole, de la lettre et de l'esprit ; c'est l'idée, tendant et aspirant<br />
sans repos à briser l'enveloppe symbolique des temps divins et héroïques, et à apparaître pure,<br />
brillante, claire aux yeux de la raison, qui, elle-même, devenant humaine, c'est-à-dire<br />
décennies 1830_1839<br />
24
civilisée, croît, grandit, et se déroule dans sa puissance et sa majesté, à la lumière toujours<br />
croissante de la science. Mais cette histoire est progressive ; le règne des Dieux se fond et se<br />
perd dans celui des héros; le règne des héros se fond et se perd dans celui des hommes, et<br />
successivement ainsi, en suivant toujours les mêmes phases ; car toujours, avec une étonnante<br />
uniformité, selon les siècles et les peuples, vous voyez les mœurs passer et changer, avec <strong>Les</strong><br />
droits qui en jaillissent, aveu les jurisprudences et les gouvernements, avec les langues surtout<br />
dans leurs trois degrés, hiéroglyphique, symbolique et vulgaire, conformément eux trois<br />
grandes divisions de tout l'ordre historique, qui font le point de départ de la théorie de Vico.<br />
Puis, lorsqu'il a d'une main ferme, et avec une étonnante divination du passé, reconstruit<br />
l'antiquité entière au gré d'une formule qu'il appelle idéale, c'est-à-dire conforme a ce que<br />
devait être l'humanité, et qu'il nomme éternelle, parce qu'elle résulte des lois inaltérables et<br />
constitutives de notre nature ; lorsqu'il a assisté aux funérailles d'une époque humaine, comme<br />
au bûcher du phénix, d'où sortira une nouvelle branche de l'humanité appelée à recommencer<br />
sans fin le cercle inévitable, Vico poursuit, avec un regard dominateur, tous les replis de la<br />
spirale éternelle. Partout, dans l'ancien, dans le moyen, comme dans le nouvel âge, il retrouve<br />
l'uniforme retour des destinées sociales; partout les Dieux, les héros, les hommes, les<br />
gouvernements qui, sortis des ténèbres et aux éclairs de la théocratie, deviennent tour à tour<br />
aristocratiques, démocratiques, monarchiques ; partout les mêmes lois produites par les<br />
mêmes mœurs, les mêmes langues, sauf quelques différences de dialectes, issues des mêmes<br />
besoins intellectuels. Et ne lui parlez pas des exceptions trop nombreuses que lui présente le<br />
tableau fidèle des événements de l'histoire, événements qu'il n'est pas toujours facile de plier<br />
et d'assimiler dans une théorie ; n'en parlez pas à Vico, car il se plaît à les poursuivre, à les<br />
saisir, à les dissoudre, à fondre tous les détails exubérants et inharmoniques des choses<br />
humaines sous la roue tournante de sa synthèse irrésistible.<br />
Le second philosophe de l'histoire est l'allemand Herder (1) 6 , qui, reculant le cercle, étroit<br />
encore, tracé par Vico, a agrandi le point de vue que celui-ci n'avait pas développé. Au lieu de<br />
ces retours périodiques, de ces phases uniformes à chaque naissance de peuple et sans progrès<br />
définitif, au lieu de regarder chaque peuple comme une individualité à part, ayant son<br />
développement et sa vie intégrale en [168] loi même, et dont il faut étudier à part le<br />
mouvement intellectuel, Herder a conçu, une synthèse plus large et plus généreuse ; c'est le<br />
genre humain qui est ici un seul peuple, dont les peuples en particulier sont les divers<br />
membres, et dont les empires sont les accidents ; à l'individualité des peuples succède<br />
l'individualité du genre humain. Or, le genre humain ne recommence jamais son œuvre,<br />
comme le veut Vico ; dans cette voie indéfinie de perfectibilité à travers laquelle il s'avance, il<br />
n'y a point le monde ancien et le monde moderne, mais un seul monde qui naît, grandit et se<br />
développe sans interruption, quoique avec des retours soudains, dans le vaste cercle du temps<br />
que la Providence lui a donné de parcourir. Et le genre humain, c'est l'homme lui-même;<br />
l'homme qui, jeté sur la terre comme le gland dans la forêt, y produit un arbre immense qui ne<br />
connaîtra pas de déclin, et verra croitre ses rameaux jusqu'à un point que nous ne saurions<br />
imaginer.<br />
Herder n'a point l'érudition étymologique de Vico; mais il a, plus que l'Italien, un vif<br />
pressentiment, une vaste compréhension de la pensée humaine dans le présent et dans l'avenir;<br />
il plane de plus haut et avec une vue plus large sur l'histoire humaine ; car c'est vraiment<br />
6 (1) Lisez, dans l'introduction de l'ouvrage de Vico, par M. Michelet, et dans le premier tome du Cours de<br />
philosophie de M. Cousin, d'excellents aperçus sur Vico et Herder.<br />
décennies 1830_1839<br />
25
l'histoire de l'humanité dont il entreprend de produire l'empreinte palpitante; et voilà pourquoi<br />
il ne néglige aucun élément important, et embrasse dans sa grande généralisation, la religion,<br />
la philosophie, la morale et l'art. Oui, tout ce que les hommes adorent et croient, tout ce qu'ils<br />
apprennent et exécutent, Herder le voit et le réfléchit dans un vaste tableau ; il se place au<br />
centre des religions et des poésies, il fait mouvoir autour de l'humanité toutes ces brillantes<br />
constellations de science et d'art qui font notre splendeur mortelle, et surtout il cherche à<br />
démontrer le parallélisme que soutiennent tous ces grands objets avec le développement<br />
progressif des sociétés, et l'ordre providentiel qui préside aux grands événements, c'est-à-dire<br />
aux révolutions ou aux renouvellements des empires.<br />
Le troisième de ceux que j'ai voulu citer est Ballanche, illustre contemporain, noble génie<br />
français, poète de l'histoire, comme Vico en est le métaphysicien et Herder l'orateur.<br />
Ballanche évoque le génie des temps antiques, il en possède le secret, il en a reçu le souffle<br />
inspirateur. Ce grand prosateur est armé d'une lyre à la fois sublime et touchante, sur laquelle<br />
vibrent tous les accords, toutes les harmonies de l'homme individuel et social. Disciple de<br />
Vico, dont il a été l'introducteur dans notre pays, il ne l’enferme point dans la formule<br />
universelle et fatale du maître; il prolonge indéfiniment le cercle agrandi de l'humanité, et,<br />
comme Herder, il a conviction que ces spirales qui forment les évolutions de la société à ses<br />
époques rétrogrades, sont en réalité des pas en avant, qui toujours ramènent le genre humain à<br />
un degré plus haut que la dernière plate-forme sur laquelle il a précédemment stationné.<br />
Dans sa préoccupation de cette idée, que le monde est la grande cité, et que la cité n'est que la<br />
forme symétrique du monde, le véritable microcosme, comme disaient les anciens, renfermant<br />
en lui tous les éléments qui font l'univers, Ballanche s'attache aussi à l'histoire romaine, que<br />
les travaux des Allemands postérieurs à Vico lui ont permis d'approfondir, et il cherche à<br />
symboliser cette histoire dans une formule qu'il lui semble possible d'appliquer, soit aux<br />
autres nations en particulier, soit aux développements et à la durée du monde entier.<br />
Ce qui se fait surtout remarquer dans Ballanche, ce qui plane au-dessus de ces [169] hautes et<br />
pénétrantes divinations synthétiques du passé ; ce qui lui fait dire qu'une idée est en lui et qu'il<br />
a été appelé à la divulguer tout entière, c'est la conviction intime et profonde qu'il a de<br />
l'avenir; c'est cette foi au progrès, au cercle indéfini et toujours s'élargissant de la pensée, à<br />
cette vie essentiellement perfectible de l'esprit humain, à cette aile de l'intelligence qui<br />
toujours plane, s'agrandit et acquiert de la puissance dans son vol, et dont rien, que la volonté<br />
de Dieu en brisant le monde, ne suspendra l'essor et n'arrêtera les destinées glorieuses. Et, par<br />
dessus tout cela, on aperçoit cette idée, profondément religieuse, du monde considéré comme<br />
la cité mystique, telle qu'elle était conçue par le sentiment religieux des premiers Romains,<br />
quand leurs augures enfermaient la cité dans les murailles consacrées, et circonscrivaient dans<br />
le ciel, avec le bâton augural, les limites du templum, ou de l'enceinte sacrée ; haute et antique<br />
conception, selon laquelle la cité est le symbole de l'univers, et l'univers lui-même est<br />
considéré comme le temple dont la terre est l'autel, et l'homme le prêtre.<br />
Cet homme est poète, soit, lorsqu'après avoir préludé par son excellent essai sur les<br />
Institutions Sociales, dans lequel il apprend aux gouvernements qu'ils ne doivent point<br />
résister, pour s'aller briser en aveugles contre l'irrésistible mouvement qui précipite les nations<br />
dans la voie providentielle des transformations, il développe dans sa Palingénésie cet axiome<br />
social : que « l'homme, hors de la société, n'est, pour ainsi dire, qu'en puissance d'être ; qu'il<br />
n'est progressif et perfectible que par la société, destiné qu'il est à lutter à la fois contre les<br />
forces de la nature physique et de la nature morale, ce double combat dont la civilisation, la<br />
vertu et la vérité doivent sortir triomphantes ; soit que, dans Orphée, admirable épopée de la<br />
décennies 1830_1839<br />
26
muse civilisatrice, il essaie de marquer le passage de l'âge héroïque à l'âge humain, et de<br />
donner ainsi, sous la formule poétique, l'histoire idéale et mystique des premières évolutions<br />
de l'esprit humain dans les temps antiques.<br />
Ce qui distingue surtout Ballanche de Herder, c'est la pensée religieuse beaucoup plus intime<br />
et plus profonde qui semble le rapprocher de l'illuminisme de <strong>Saint</strong>-Martin, à part les ténèbres<br />
mystiques qui altèrent ce théosophe ; c'est la base chrétienne qui supporte toutes ses théories<br />
idéales ; c'est cette loi première, universelle de l'initiation douloureuse' par laquelle chaque<br />
homme, chaque peuple, le monde entier ont passé et passeront dans leurs phases de<br />
renouvellement ; c'est l'idée primitive de l'épreuve et de l'expiation, notion sainte, ayant sa<br />
racine dans celle de la chute et de la réintégration de l'homme, et qui forme le double tissu de<br />
la vie des hommes ici-bas, jusqu'à ce que, la dernière épreuve terrestre étant consommée,<br />
l'humanité subisse sa définitive transformation, pour être, de là, tout entière transfigurée et<br />
renouvelée dans le ciel.<br />
Autour de Ballanche, de ce Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre des harmonies sociales avec plus de<br />
spiritualisme et de religion, de cet homme dont la parole est plus douce que le miel, ***,<br />
comme parle Homère, il s'est formé de nos jours, et dans notre pays, une fertile et brillante<br />
élite d'écrivains, poètes, rhéteurs, jurisconsultes, qui ont aussi placé le résultat de leurs<br />
recherches sous le jour si pur, naguère encore si nouveau, de la science nouvelle. L'histoire,<br />
depuis quelques années, dans les chaires et dans les livres a été philosophique ; et l'histoire de<br />
France, dans les éloquentes leçons professées à la Faculté des Lettres par M. Guizot, a eu son<br />
érudit interprète, comme l'histoire romaine avait suscité [170] l'allemand Niebuhr ; tous les<br />
deux ont subordonné les résultats positifs de leurs vastes travaux au cercle philosophique du<br />
développement évolutif, qui semble être la découverte ou la conquête du génie de l'histoire au<br />
dix-neuvième siècle.<br />
Et bien plus, nous avons vu, dans nos derniers jours, un spectacle, dirai-je un triomphe, que la<br />
science n'avait dû jamais se promettre de voir réalisé. Nous avons vu la formule de l'avenir<br />
des sociétés selon la nouvelle doctrine philosophique croître et se développer soudainement,<br />
au point de briser les limites trop resserrées de l'enseignement scientifique ou littéraire ; au<br />
point de se construire un autel avec les d »bris de doctrines déjà vulgaires dans les livres et<br />
dans les écoles, de se poser comme religion, et de faire un appel à la foi des peuples, afin de<br />
convertir des croyances philosophiques sur les phases et les rénovations de la société en un<br />
culte véritable, accompagné des cérémonies et des pratiques extérieures inhérentes aux<br />
religions positives; enthousiasme malheureux, qui a été jusqu'à diviniser la société ou la vie<br />
sociale, et à fonder dans les formes mystiques d'un nouveau panthéisme, et les lois, et les<br />
devoirs, et les biens de la vie individuelle, et tout ce que les hommes ont cru, aimé, cultivé et<br />
adoré sur la terre et au ciel. « L'âge d'or, que la poésie antique a placé au berceau des sociétés,<br />
disait <strong>Saint</strong>-Simon, n'est point derrière nous, mais devant nous. » Et, là dessus, ses disciples<br />
ont eu foi à cet âge d'or, et ils ont marché au devant, crédules et confiants ; et ils ont pensé, ils<br />
ont proclamé qu'ils allaient renouveler la merveille de la propagation du christianisme ; et ils<br />
se sont étonnés que leur nouveau culte, après avoir été l'objet de quelques regards distraits<br />
dans notre temps si fertile, où chaque jour voit éclore un événement social, se soit si vite<br />
évanoui dans le ridicule, dernier partage des tentatives que les hommes ont faites et inventées,<br />
et que n'ont pu soutenir ni la force ni la vérité.<br />
Et ainsi le <strong>Saint</strong>-Simonisme a joué son rôle ; il a vécu son jour, il a jeté sa lumière<br />
phosphorescente, et il n'est plus. C'est un fait qui par lui-même est très insignifiant, mais qui<br />
ne l'est pas comme symptôme ; il montre si l'on peut espérer désormais l'établissement d'une<br />
religion nouvelle. Aux disciples de <strong>Saint</strong>-Simon rien n'a manqué, ni le talent, ni les idées, ni<br />
l'enthousiasme ; ils ont presque obtenu le bonheur de la persécution, et ils ne sont plus. Or<br />
décennies 1830_1839<br />
27
écoutons, et voyons s'il ne se lève pas quelque nouveau Dieu revendiquant à son tour les<br />
croyances du genre humain, qui pourtant, lorsqu'il est destitué de religion et de vérité,<br />
chancelle et ne sait plus de quel côté se tourner pour respirer. О pitié ! Mais afin de considérer<br />
les théories historiques en elles-mêmes, et à part l'enivrement qui les a poussées jusqu'au<br />
délire religieux, si l'on s'approche de ces théories si brillantes, si éthérées, il faut bien se<br />
résigner à reconnaître leur inconsistance et leur peu de profondeur. Certes, c'est un pays étroit,<br />
de bien légère superficie, et que l'on peut traverser vite dans toutes ses dimensions ; doctrines<br />
prismatiques et mêlées d'ombres, doctrines mobiles, incertaines, dont il est difficile de ne pas<br />
dire avec Virgile :<br />
…Tenues volitare cava sub imagine formas 7<br />
Elles ont la prétention de se dilater outre mesure, et de représenter l'univers entier dans un<br />
miroir étroit, qui, dans le fait, ne recueille rien que l'image de quelques conceptions plus ou<br />
moins bizarres, plus on moins ingénieuses. [171] On est tenté de croire qu'à cet égard le<br />
champ de la théorie est aussi trop facile à remuer; car depuis quelques années, quels points de<br />
vue philosophiques en matière d'histoire n'avons-nous pas vus éclore, depuis que des esprits<br />
supérieurs, au premier rang desquels il faut encore placer M. Cousin, dans sa grande<br />
introduction à son cours de 1828, ont ouvert et clos dans le cercle subjectif de leur pensée<br />
vaste et pénétrante le cercle illimité des destinées humaines ? Il n'est point d'esprit quelque<br />
peu méditatif, point de jeune écrivain préludant à sa réputation dans les colonnes légères des<br />
feuilles publiques, qui ne se soit essayé à ces jeux brillants et innocents de l'imagination, et<br />
qui, jetant aussi, lui, dans le tourbillon des idées, sa conjecture plus ou moins hardie sur<br />
l'avenir de cette vie intellectuelle (que dans ce moment nous vivons avec tant d'intensité ),<br />
n'ait un jour battu des mains devant son propre génie, disant : « Et moi aussi je suis créateur<br />
de système, et j'ai trouvé, comme Galilée, le véritable mouvement de la planète morale de<br />
l'humanité; et que l'on dise ce que l'on voudra, toujours est-il vrai que le monde se meut ainsi<br />
que je l'ai découvert et proclamé. » Qu'est-ce donc qui a été découvert ? Approchons, et<br />
voyons. Ce n'est rien moins que l'avenir probable de l'humanité ; c'est l'humanité que l'on dote<br />
gratuitement et à trop peu de frais d'une destinée; c'est la Providence auprès de laquelle on<br />
s'installe, et à qui on vole audacieusement son secret : et remarquez qu'à peine si l'indigence<br />
du fond se dissimule sous l'uniformité des formes; toujours c'est la loi immuable, presque<br />
géométrique, selon laquelle se meuvent les nations, que ces nouveaux Newton du système<br />
moral veulent avoir découvert, et toujours ils jettent au monde indifférent la formule italienne<br />
ou allemande, commentée, arrangée, et qu'ils appellent leur dernier mot sur la nature et sur<br />
l'humanité.<br />
Et certes, le fond de cette idée, ce qu'elle a de vrai et d'incontestable n'est point chose nouvelle<br />
si vous connaissez un remarquable fragment de l'historien Velléius, dans lequel sont<br />
comparées les diverses phases d'un empire aux diverses époques de la vie de l'homme, tous<br />
les deux ayant enfantement, jeunesse, âge mûr, décrépitude ; c'est bien le cercle de Vico :<br />
7 Virgile Enéide, livre VI, verset …280…<br />
Eneas, strictamque aciem venientibus offert;<br />
Et, ni docta comes tenues sine corpore vitas<br />
Admoneat volitare cava sub imagine formae,<br />
Irruat, et frustra ferro diverberet umbras,<br />
Hinc via tartarei quae fert Acherontis ad undas…<br />
Selon les croyances païennes, les ombres conservaient, dans les enfers, la forme extérieure des corps, cava sub<br />
imagine formae. Virgile appelle les âmes vitas, parce qu'elles sont immortelles.<br />
Ici, tremblant d'une crainte soudaine, Énée saisit son épée, tend sa lame dégainée vers ceux qui<br />
viennent à sa rencontre et, si sa docte compagne ne l'avertissait que ces vies ténues, sans corps,<br />
voltigent sous l'image inconsistante d'une forme, il se ruerait tête en avant et, de son arme,<br />
pourfendrait vainement les ombres…<br />
décennies 1830_1839<br />
28
comme lui, Velléius ne franchit pas la ligne courbe de l'identique et perpétuel ricosso ; il<br />
n'avait pas pressenti le célèbre point de vue de Herder, la progression indéfinie du génie de<br />
l'esprit humain.<br />
Tout le monde a lu, dans le songe de Scipion, cet admirable débris d'inspirations<br />
pythagoriciennes, la grande idée moitié philosophique, moitié astronomique des globes du<br />
monde qui s'avancent avec une progression régulière pour renouveler, à des époques reculées<br />
et fixées par la providence des dieux, le cours des astres avec le cours des empires. Chez les<br />
modernes, les systèmes de Leibnitz sur l'harmonie préétablie et sur la raison suffisante offrent<br />
de réelles analogies, avec les hypothèses historiques de notre école; et, dans le dernier siècle,<br />
ce temps des systèmes aventureux, mais trop souvent stériles, sans élévation et sans portée,<br />
souvenez-vous combien furent inventées de théories sur la marche et la progression de l'esprit<br />
humain, et comme les Epicuriens de ce temps se prononçaient sur cet avenir intellectuel,<br />
illimité; comme aussi ils se prenaient d'amour en présence de cette nature panthéistique qui<br />
absorbe tout dans l'univers matériel.<br />
Ils rêvent les progrès indéfinis de l'esprit; mais hélas ! emprisonnés qu'ils sont librement et par<br />
leur propre volonté dans les limites de cette vie d'un jour, par delà laquelle ils ne pressentent<br />
rien que ce puisse être, ils closent tout leur avenir dans cette terre ; et alors, comme ils se<br />
plaisent à parer ce tombeau éternel » [172] comme ils font l'apothéose de la vie, et que de<br />
merveilles ils prodiguent à leur espérance ! jusque-là que le plus éloquent parmi eux, dans son<br />
célèbre tableau des progrès de l'esprit humain, arrive à établir comme probable l'espoir qu'un<br />
jour la race humaine étant parvenue au point culminant de son irrésistible progression, tous les<br />
secrets de la nature étant explorés et divulgués, la science, devenue victorieuse de la faux du<br />
temps, pourra bien abolir la nécessité de mourir, et ne plus rien laisser à désirer à l'infaillible<br />
et constante félicité de l'homme. Rêveur infortuné, qui s'épanouit à l'idée d'une terrestre<br />
immortalité qu'il promet aux races à venir, et qu'en attendant, son siècle, parvenu comme il le<br />
pense au plus haut point de la raison progressive, étendra sur la route publique, mourant du<br />
poison que lui-même aura pris pour se soustraire à la hache des bourreaux émancipateurs.<br />
Grâce au ciel, le système de Condorcet, qui est la plus haute et la dernière expression des<br />
espérances humaines, selon les matérialistes du dix-huitième siècle, a été placé sur une base<br />
plus généreuse par les écrivains que j'ai cités précédemment ; ils se sont élevés bien plus haut<br />
pour voir de bien plus loin dans l'horizon de la destinée de l'homme ; ils ont senti que le vaste<br />
théâtre du monde, dans lequel s'ébattait et se jouait la scène de la vie, était encore trop étroit<br />
pour contenir la destinée définitive de l'homme ; comme Alexandre, ils ont étouffé dans les<br />
limites du monde, angusto in limite mundi ; ils ont cherché le ciel à travers les successives<br />
évolutions terrestres qu'ils s'attachent à expliquer. Quœsivit coelo lucem, comme dit le poète,<br />
et ils n'ont point gémi comme la reine de Carthage, ingemuitque reperta, en saisissant le rayon<br />
bienfaiteur; car ils ont senti que là se trouvait le repos définitif des générations incessamment<br />
en marche pour ne s'arrêter que dans l'infini. Mais peut-être ils n'ont point assez vu que la vie<br />
de ce monde n'était guère que le cours du pèlerinage laborieux que chacun a reçu mission<br />
d'accomplir ; et négligeant trop l'homme individuel pour ne voir que le tout social, cette école,<br />
en général, semble s'être attachée à reconnaître un but terrestre, spécial et manifeste, soit dans<br />
l'humanité, soit dans chaque peuple, ces fractions de l'humanité ; dans chaque halte des<br />
générations, elle a cru voir une pensée qu'il lui semblait facile de divulguer, et dans chaque<br />
phase organisatrice enfin, un point fixe dont il est permis de déterminer a priori, et comme par<br />
une formule infaillible, la destination absolue et le but providentiel.<br />
Ce n'est pas que nous prétendions nier quelques résultats heureux et vraiment nouveaux de<br />
leurs contemplations historiques. Sans doute il est permis de saisir quelques lueurs à l'égard<br />
des directions que Dieu exerce sur les choses de la vie sociale, ne fût-ce que cette loi que les<br />
gouvernails devraient se poser comme un axiome et une règle invariable de conduite, savoir :<br />
que les États sont soumis à de certains degrés de développement, à des évolutions irrésistibles<br />
décennies 1830_1839<br />
29
contre lesquelles ne sauraient s'élever, sans courir le risque d'être brisée en éclats, aucune<br />
force gouvernementale ; ce qui fait que l'art de gouverner consiste surtout à connaître le siècle<br />
et le pays, afin d'harmoniser la législation avec les mœurs. Mais cette idée est ancienne, elle<br />
n'a point attendu, pour être comprise et avoir cours dans le monde, d'être frappée d'un<br />
nouveau coin, et de se produire sous le terme déjà vieux d'idée libérale.<br />
…<br />
Adolphe Mazure<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
30
1834<br />
Revue du progrès social: recueil mensuel politique, philosophique et littéraire Page 426 1834<br />
[118] Page 118<br />
NÉCROLOGIE.<br />
GARAT (Dominique-Joseph), né à Uslaritz, près Bayonne, mort le 9 décembre 1833. — II fut<br />
successivement avocat au parlement, député à l'assemblée nationale, ministre de la justice et<br />
de l'intérieur, sénateur sous l'empire. — Sa carrière scientifique et littéraire le conduisit à<br />
l'Institut et à la chaire d'Entendement humain, lors de la fondation de l'école normale. C'est<br />
particulièrement sous ce dernier rapport que nous avons à réclamer pour Garât une place<br />
distinguée parmi les contemporains. Ses travaux philosophiques sont cependant peu<br />
nombreux, et écrits dans un ordre d'idées qui paraîtrait aujourd'hui bien superficiel, soit aux<br />
philosophes de l'école psychologique, soit même aux partisans de l'idéologie physiologique et<br />
de la philosophie positive, école dont le professeur d’Entendement humain se rapproche<br />
pourtant sur les points principaux de son système. Nous aurions tort, au reste, de prendre pour<br />
un système quelques leçons brillantes prononcées à l'ancienne école normale à côté de Monge<br />
et de Laplace. Le théosophe <strong>Saint</strong>-Martin combattit énergiquement la tendance matérialiste du<br />
professeur.<br />
Un titre fort honorable dans la carrière scientifique de Garât, c'est la part active qu'il a prise<br />
avec M. de Tracy aux travaux du Conseil d'instruction publique, pour le perfectionnement du<br />
système des écoles centrales. Nous aurons bientôt à parler des travaux de ce conseil où<br />
siégeaient Lagrange, Palissot, Ginguené, Darcet, etc. Dans sa vie politique, Garât s'est élevé à<br />
des fonctions éminentes ; [1<strong>19</strong>] mais il a fallu que la révolution usât bien des capacités plus<br />
compétentes, avant d'appeler au ministère de la justice et de l'intérieur un homme que ses<br />
goûts, ses habitudes et son talent destinaient de préférence à la philosophie et surtout aux<br />
lettres. L'amitié de Condorcet et les hautes relations sociales qu'il entretint des son arrivée à<br />
Paris, contribuèrent beaucoup à l'élévation rapide de Garât; mais on reconnut toujours en lui<br />
l'homme d'esprit et de goût plutôt que l'homme d'état. Le sénat en le choisissant plusieurs fois<br />
pour interprète, lorsqu'il s'agissait de célébrer les grandes victoires du Consulat et de l'Empire,<br />
se ressouvint qu'il avait commence sa carrière par des Eloges académiques.<br />
Voici la liste des principaux ouvrages de D.-J. Garât.<br />
Plusieurs Eloges académiques.<br />
Considérations sur la révolution française et sur la conjuration des puissances de l'Europe<br />
contre la liberté et contre les droits des hommes ; un Examen de la proclamation du<br />
gouvernement des Pays-Bas.<br />
Mémoires sur la révolution, ou Exposé de ma conduite dans les affaires et dans les fonctions<br />
publiques. — Paris, an III.<br />
Plusieurs Discours politiques.<br />
Leçons prononcées à l'école normale et recueillies par la sténographie.<br />
Mémoire sur la Hollande, sur sa population, son commerce, ion esprit public et sur les<br />
moyens, soit de la maintenir dans son indépendance comme état, soit de lui rendre ses<br />
anciennes prospérités comme nation commerçante.<br />
Mémoires sur le dix-huitième siècle et sur la vie de M. Suard.<br />
décennies 1830_1839<br />
31
Page 408<br />
PHILOSOPHIE RELIGIEUSE.<br />
EXAMEN DE LA DOCTRINE DE J. Boehm et de SAINT-<strong>MARTIN</strong>.<br />
Le mouvement philosophique de notre âge a fait naître le besoin d'étudier les mystiques. La<br />
faim et la soif de la vérité devaient finir, en effet, par nous la faire chercher en dehors de<br />
toutes les méthodes scholastiques et de toutes les institutions régulières, formées eu apparence<br />
dans l'unique dessein de la produire et de la propager, et ayant peut-être pour résultat de la<br />
voiler, de l'amoindrir, d'en retarder les développements, de l'exploiter en un mot, en la<br />
réduisant à la taille de ses interprètes officiels.<br />
Quel penseur ne comprend aujourd'hui que si Charles Fourier, Hoëné Wronski, Fabre<br />
d'Olivet, Ballanche, et quelques autres hommes de cette importance, sont aujourd'hui en<br />
dehors de la Sorbonne éclectique ; s'ils sont condamnés pour un temps à demeurer a peu près<br />
obscurs et méconnus, sous le coup de la perfide conspiration du silence, [409] ils ne sont pas<br />
pour cela eu dehors du progrès humanitaire, qu'ils en sont peut-être les chefs, et que cette<br />
inique proscription, loin d'être un titre légitime au dédain et a l'oubli, pourrait être aussi bien<br />
une sorte de critérium de leur valeur philosophique et sociale ? Quel penseur ne s'est pas senti<br />
attiré, surtout dans les rêves de sa jeunesse pleine de sève et de vigueur, vers une science plus<br />
large que la science fragmentaire, aride et désenchantée des temps modernes ? Avant de se<br />
déterminer, par désespoir d'être compris, à suivre l'ornière tracée, c'est-à-dire a consumer ses<br />
heures à de niaises puérilités, pour obtenir l'inauguration de son nom, à propos de quelque<br />
mémoire à l'Institut, sur le nombre des mètres cubes d'eau passant, dans un temps donné, a<br />
travers un canal d'une dimension donnée, ou tout autre sujet d'égale importance, quel savant<br />
vraiment digne de ce nom n'a soupiré avec ardeur vers une époque où, dégagée des voies<br />
mesquines d'un terne individualisme, la culture intellectuelle, agrandie et fortifiée par<br />
l'association, dirigée par quelque haute pensée, rallierait a un foyer unitaire ses innombrables<br />
expériences de détail. D'ailleurs ces expériences ne peuvent recevoir que par là un sens et une<br />
valeur philosophique. Et, au moyen d'une synthèse nouvelle, l'on tenterait enfin de concilier et<br />
de satisfaire toutes les tendances de l'humanité, en rapprochant du triple flambeau de<br />
l'expérience, de l'observation et du calcul, le flambeau non moins imposant de l'imagination<br />
poétique, de l'érudition traditionnelle et de l'inspiration religieuse ?<br />
Beaucoup d'hommes ont déjà sympathisé en France avec les puissants efforts de la<br />
philosophie allemande, pour légitimer ces nobles tendances de notre nature qui nous crient<br />
que nous ne sommes pas faits seulement pour nommer, analyser, mesurer, peser et décrire les<br />
productions de ce globe, mais bien plutôt pour nous en emparer comme de notre domaine,<br />
pour nous l'assimiler, le régir, et le pénétrer de toutes parts. La nature et l'homme n'ont-ils pas<br />
été [410] dans un rapport plus intime, et je rapport ne pouvons-nous le reproduire ? <strong>Les</strong><br />
admirables prévisions de de Maistre, opposant aux laborieuses et stériles investigations de la<br />
science moderne « affublée de l'habit étriqué du nord, le front sillonné d'algèbre, perdu dans<br />
les volutes d'une chevelure menteuse, (1) 8 » la science intuitive des temps primitifs, fille<br />
radieuse de l'Orient, embrassant la nature dont elle comprend le symbolique langage, et<br />
agissant sur elle avec la sympathie et la puissance d'un amant, ces majestueuses paroles ne<br />
pourraient-elles pas servir de frontispice au siècle présent ? N'avons-nous pas besoin d'une<br />
immense restauration scientifique ; et pouvons-nous nous attendre à trouver l’organon novum<br />
destiné à ce travail, dans les voies désormais épuisées de l'empirisme analytique de Descartes<br />
8 (1) J. de Maistre, Soirées de <strong>Saint</strong>-Pétersbourg.<br />
décennies 1830_1839<br />
32
et de Bacon ? Non, non sans doute. Et pour me servir encore des paroles de ce saint Jean,<br />
précurseur de l'âge futur, qui, s'il n'a rien pu établir, a du moins tout pressenti : La Providence<br />
n'efface que pour écrire à nouveau. Or, qu'a-t-elle effacé de notre temps ? Quel est le résultat<br />
de tout le mouvement philosophique et politique de notre époque ? Dans la science,<br />
l'annihilation de l'esprit scholastique qui procède par voie de syllogisme et d'analyse<br />
seulement, et dans l'ordre politique et religieux, l'annihilation du libéralisme et du<br />
protestantisme, en tant que doctrines critiques. Doctrines dominées par un esprit de défiance<br />
purement défensif, qui leur fait nier, a l'une, la nécessité d'une providence sociale, et à l'autre,<br />
celle d'une croyance unitaire imposée aux masses, pour s'absorber dans la préoccupation des<br />
intérêts individuels qu'elles réduisent a une désespérante nullité, et qu'elles tuent en les isolant<br />
(2) 9 .<br />
[411] Celte importante prévision de de Maistre, que les grandes découvertes qui signaleront<br />
notre dix-neuvième siècle seront dues a l'emploi de la méthode hardie et aventureuse de<br />
l'hypothèse, et non pas à celle plus timide, plus défiante et plus laborieuse de l’analyse et de la<br />
démonstration scholastiques, est justifiée à la fois, et par la direction actuelle des travaux<br />
philosophiques de 1’Allemagne, et par l'application faite à l'industrie de la sublime hypothèse<br />
des destinées proportionnelles aux attractions.<br />
Notre revue cherche à placer la société française à ce point de vue transcendantal où l'on<br />
comprend, — comment d'une part l'appareil logique qui constitue l'entendement ne fournit à<br />
la philosophie que la forme de la connaissance, et sera éternellement impuissant a en légitimer<br />
didactiquement le fonds, donné à l'homme dans l'intuition de la raison pure ; — et comment,<br />
d'autre part, les passions, principe actif et recteur, se débattront contre tout pouvoir restrictif,<br />
aussi longtemps que la conscience n'apura pas obtenu la formule absolue du bien, a savoir<br />
l'équation du bonheur et de la vertu. Parvenu à ce terme, on est dans la meilleure disposition<br />
possible pour s'enquérir de la vérité en dehors de toutes les formes convenues, on ne connaît<br />
plus de grande route qu'elle soit tenue de prendre, d'uniforme obligé dont elle doive se revêtir,<br />
pour avoir droit a l'examen ; on peut alors, libre de tout préjugé, s'occuper avec fruit des<br />
écoles mystiques ou excentriques.<br />
Ces écoles ont cru pouvoir s'emparer sans effort des sources du bien et du vrai, et y puiser<br />
toute connaissance, dans une intuition qui se pose, qui se sert de preuve à elle-même, et se<br />
légitime eu coordonnant une multitude de faits par voie de ralliement au centre ou foyer<br />
qu'elles ont choisi. Ce foyer est toujours une hypothèse logiquement arbitraire, mais [412]<br />
d'autant plus voisine de la vérité qu'elle est moins laborieuse et plus attrayante, d'autant plus<br />
certaine qu'elle est moins démontrable au point de vue scholastique, d'autant plus puissante<br />
qu'elle satisfait davantage aux inspirations les plus compréhensives de l'âme. La base fixe<br />
donnée à la science par la philosophie mystique, que nous appellerions plus volontiers la<br />
théosophie, c'est l'utile et le beau, c'est-à-dire une vue téléologique, dont nous affirmons la<br />
vérité par cela seul que nous ne pouvons nous empêcher de la désirer, puisqu' étant donnée,<br />
celte vérité, elle satisferait a nos tendances instinctives, et expliquerait tout en reliant<br />
l'homme, l'univers et Dieu.<br />
La synthèse du savoir et de l'être, de l'humanité et de la nature, tant cherchée dans les écoles<br />
philosophiques modernes, est le point de départ des mystiques ; elle est toujours supposée<br />
dans leurs écrits, elle doit être considérée comme l'idéal de la science et son critérium<br />
9 (2) II ne peut entrer dans notre intention de nier la haute valeur do protestantisme cl du libéralisme comme<br />
protestations contre l'unité catholique et féodale, qui ne se relèvera jamais des coups qu'ils lui ont porté. Cette<br />
unité peu compréhensive, laissant hors de sa sphère un grand nombre d'intérêts, et d'ailleurs plus externe<br />
qu'interne, doit faire place à une unité plus large, plus intime et plus forte, que signalera sans doute notre siècle.<br />
Le protestantisme et le libéralisme seront jugés alors n'avoir été qu'une anarchie transitoire nécessaire entre ces<br />
deux systématisations<br />
décennies 1830_1839<br />
33
suprême. <strong>Les</strong> livres ouverts à la science humaine sont la langue de la nature, les traditions<br />
religieuses universelles, la conscience et la raison de l'homme isolé, l'histoire générale : tout<br />
principe en opposition avec quelqu'un de ces grands témoignages de la vérité universelle, est<br />
par là même frappé du caractère de l'erreur, puisqu'il répugne à quelqu'une des facultés qui<br />
nous constituent. Si tous ces témoins, au contraire, se contrôlant l'un par l'autre, déposent<br />
unanimement, quelle plus grande et plus solennelle sanction de la vérité pourrions-nous<br />
désirer ?<br />
Et pourtant il n'y aura pas la démonstration scholastique ; l'exigence illégitime de ce genre de<br />
preuve serait, au contraire, le principal obstacle à l'acquisition du vaste ensemble de<br />
confirmations réciproques, qui peut seul engendrer le sentiment profond de la vérité absolue<br />
ou de la certitude. L'esprit humain n'arrivera jamais au sentiment de la certitude absolue que<br />
par la conciliation de toutes les tendances de notre nature. 11 faut que la vérité morale,<br />
sociale, religieuse, nous arrive par toutes sortes de voies, afin que nous [413] obtenions cette<br />
intime et délicieuse satisfaction qui est un des plus grands besoins de notre être, de voir l'unité<br />
reproduisant dans l'immense variété des phénomènes sa glorieuse et ineffaçable empreinte.<br />
La démonstration ne saurait jamais nous livrer le sens profond des origines, l'esprit des<br />
choses, leur synthèse et leur destination ; car la démonstration n'est que l'évolution de ce qui<br />
est renfermé dans une définition — de vérité conventionnelle, s'il s'agit de droit positif ou de<br />
problèmes linguistiques ; — de vérité absolue, mais bornée aux simples propriétés de<br />
l'étendue et du nombre, s'il s'agit de mathématiques. C'est parce que nous sentons, avec Kant,<br />
que l'entendement n'étant que la faculté de coordonner en faisceaux, par l'application de si<br />
diverses catégories, la matière de l'expérience sensible, ne peut nous conduire qu'a un ordre de<br />
vérités purement subjectives et relatives, profondément impuissant qu'il est à livrer .autre<br />
chose à la raison pure, pour tout ce qui sort de ce domaine, que des antinomies insolubles ;<br />
c'est parce que nous répétons avec Fichte qu'une affirmation émanant des entrailles de<br />
l'homme, une croyance est nécessaire pour fournir à la science la base sur laquelle elle<br />
construira tout l'édifice dont elle sent invinciblement le besoin, croyance arbitraire au point de<br />
vue logique, mais à défaut de laquelle l'esprit flotterait éternellement sur un océan sans fond et<br />
sans rives ; c'est parce qu'avec Jacobi nous considérons les notions comme l'incarnation des<br />
sentiments ou leur schématisation, faisant ainsi dériver l'homme intellectuel de l'homme<br />
passionnel, que le vrai nous est apparu comme la manifestation du bien, n'ayant de valeur et<br />
de critérium réel qu'an point de vue téléologique. ; c'est enfin parce qu'avec Schelling nous<br />
avons compris que le savoir intuitif était le seul organon suffisant à nous révéler la chaîne<br />
immense de toutes les transformations de l'être, toujours identique avec lui-même, dans la<br />
série de ses polarisations et neutralisations [414] successives, c'est, disons-nous, en<br />
considérant cette tendance unitaire si remarquable des écoles philosophiques les plus<br />
avancées, et frappés, comme nous ne pouvions manquer de l'être, de ses rapports avec la haute<br />
conception qui préside a la doctrine sociale de M. Fourier (1) 10 , que nous avons été amenés à<br />
soupçonner la valeur des écrivains mystiques, eux qui, sans s'embarrasser des préventions et<br />
des prétentions de la raison spéculative, sans se laisser arrêter par ses méticuleuses fins de non<br />
recevoir, se sont livrés avec abandon à quelque hypothèse favorite, et à son aide ont créé tout<br />
un monde.<br />
10 (1) Le savoir intuitif ou immédiat correspond, par l'importance de ses résultats dans l’ordre<br />
scientifique, au travail attrayant dans l'industrie. M. Fourier a donné le plus bel exemple d'un<br />
immense développement intuitif dans son grand ouvrage, où rien n'est démontré<br />
scholasliquement, mais où tout est amené au plus haut degré de vraisemblance, par la seule<br />
coordination synthétique des idées.<br />
décennies 1830_1839<br />
34
Il résulte de tout le mouvement philosophique de notre temps, comme nous croyons l'avoir<br />
fait suffisamment pressentir, que ces sortes de tentatives n'étaient pas autant à dédaigner<br />
qu'elles ont dû le paraître aux époques où la manière de philosopher de Descartes, de Bacon et<br />
de Locke prévalait impérieusement. Nous pensons que l'esprit humain tend de toutes parts a<br />
se soustraire à leur joug, et qu'il est à la veille de se livrer à la systématisation synthétique<br />
avec autant d'obstination qu'il en a rois, pendant les trois siècles d'où nous sortons, à explorer,<br />
à l'aide de la méthode analytique, tous les filons de la connaissance expérimentale. Le second<br />
mouvement aura plus de grandeur, comme aussi de plus durables résultats : il correspond a la<br />
nécessité d'édifier, comme l'autre a celle de détruire ; il est organique, comme l'autre était<br />
critique ; il rétablira la paix et l'harmonie dans tous les domaines de la science, il conciliera les<br />
diverses branches également importantes de l'arbre encyclopédique, lesquelles ne pouvaient<br />
atteindre a leur perfection respective, par cela [415] seul qu'on les avait constituées en<br />
hostilité réciproque ; il légitimera par la science les pressentiments du poète ; il donnera un<br />
sens à l'histoire ; il fera de l'érudition une puissance philosophique et de la religion un<br />
flambeau.<br />
Nous ne pouvons mieux entrer dans l'appréciation des écrits de Bœhme et de son disciple<br />
<strong>Saint</strong>-Martin qu'en montrant à quel point tous deux avaient pressenti, et avec quelle netteté et<br />
quelle éloquence ce dernier avait formulé, dès le commencement de ce siècle, l'importante<br />
distinction qu'on doit établir entre la raison critique, procédant par voie syllogistique et<br />
analytique, à l'aide des formes ou catégories fournies par l'entendement, et la raison pure ou<br />
intuitive spéculant sur une hypothèse ou croyance émanée d'un foyer supérieur. Quiconque se<br />
sera suffisamment pénétré de l'esprit actuel de la discussion philosophique en Allemagne, si<br />
bien résumé par M. Amédée Prévost à propos de F. Jacobi (1) 11 , sentira bien que c'est la le<br />
point capital, le levier destiné à soulever un nouveau monde intellectuel, et ne pourra<br />
s'empêcher d'être frappé de la singulière coïncidence des vues de l'école mystique avec celles<br />
des écoles le plus justement célèbres. On lit au Ministère de l'Homme-Esprit, pages 407 à 410<br />
(ouvrage de <strong>Saint</strong>-Martin) :<br />
« Pourquoi les instituteurs religieux des peuples ont-ils souvent défendu que l'on marchât par<br />
la raison ? C'est qu'ils n'ont pas fait attention que s'il y a une raison humaine qui est contre la<br />
vérité, il y a aussi une raison humaine qui est pour elle. Ils sont sages et prudents lorsqu'ils<br />
nous défendent la première espèce de raison ; car, en effet, elle est l'ennemie de toute vérité,<br />
comme on le voit aisément aux outrages que font à cette vérité les docteurs dans les sciences<br />
externes qui sont l'objet et le résultat de la simple raison de ce monde naturel. La principale<br />
propriété de cette espèce de raison est de craindre l'erreur, et de ne se li-[416]-vrer qu'avec<br />
défiance a ce qui est la vérité. Toujours occupée de scruter les preuves, elle ne laisse presque<br />
jamais à l'esprit le temps de goûter le charme des jouissances vives. Elle a une marche<br />
ombrageuse qui empêche que le goût du vrai ne pénètre jusqu'à elle. Voila ce qui entraîne à la<br />
fin les sociétés savantes dans l'incroyance, après les avoir retenues si longtemps dans le doute.<br />
» Mais ils ne seraient plus ni sages ni prudents, s'ils nous défendaient l'usage de la seconde<br />
espèce de raison, parce que cette seconde espèce de raison est au contraire le défenseur de la<br />
vérité. C'est l'œil perçant qui la découvre continuellement et ne tend qu'à en faire apercevoir<br />
les trésors ; et, loin que sous ce rapport la raison soit condamnable, ce sera au contraire un<br />
crime pour nous de ne l'avoir pas suivie, puisque ce présent avait été fait à tous les hommes,<br />
dans le seul et unique but qu'ils s'en serviraient, et dans la persuasion où est l'agent suprême<br />
que ce flambeau, en se présentant humblement au foyer de la lumière universelle, eût suffi<br />
pour nous apprendre tout et nous conduire à tout.<br />
11 (1) Voir notre livraison de février.<br />
décennies 1830_1839<br />
35
» En effet, comment l'agent suprême aurait- il pu exiger que nous crûssions a lui et à toutes<br />
ses merveilles, si nous n'avions pas, par notre essence, tous les moyens nécessaires pour les<br />
découvrir ? Oui, la vérité serait injuste, si elle n'était pas clairement et ouvertement écrite<br />
partout aux yeux de la pensée de l'homme. Si cette éternelle vérité veut être crue, elle et tout<br />
ce qui dérive d'elle, c'est qu'il nous est donne, à tous les pas, de pouvoir nous assurer de son<br />
existence, et cela, non pas sur le témoignage de la simple assertion des hommes, ni des<br />
ministres même de la vérité, mais par des témoignages directs, positifs et irrésistibles.<br />
» Car la croyance que vous faites naître quelquefois dans la pensée de vos prosélytes, quelque<br />
utile qu'elle soit, est bien loin de cette certitude qui doit s'appuyer sur de pareils témoignages.<br />
Ce n'est pas une chose rare que de rencontrer des hommes sur la croyance desquels on puisse<br />
exercer quelque [417] que empire ; ce n'est pas même une chose rare que d'entendre dire dans<br />
le monde qu'il n'y a rien de plus aisé que de croire ; on y trouve même des gens qui prétendent<br />
qu'ils croient en effet tout ce qu'ils veulent.<br />
» J'accorde cela pour la croyance aveugle, parce qu'elle ne consiste qu'à écarter l'universalité<br />
et à ne saisir qu'un seul point. Dès lors on est dispensé de toute comparaison ; et même par<br />
cette loi, plus on descendra dans les particularités, plus on sera disposé à croire, ce qui<br />
explique le fanatisme des superstitieux, qui est en raison directe de leur ignorance.<br />
» Mais je le nie par rapport a la certitude, qui est l'opposé de la croyance aveugle, parce qu'on<br />
n'arrive à cette certitude qu'a mesure que l'on monte vers l'universalité ou vers l'ensemble des<br />
choses, attendu que lorsque l'on fait des confrontations dans cet ensemble des choses, et qu'on<br />
y découvre l'unité ou l'universalité de la loi, il est impossible que l'on n'ait pas la certitude. Et<br />
en effet, cette certitude est l'opposé de la croyance, parce qu'elle est en raison directe de<br />
l'élévation et des connaissances. »<br />
Quant à la supériorité et à l'antériorité du foyer passionnel par rapport au foyer rationnel,<br />
<strong>Saint</strong>-Martin, d'accord avec Jacobi et Fourier, s'exprime ainsi :<br />
« Comme tout est amour, et comme la parole est l'hymne continuel et universel de l'amour,<br />
cette parole remplit toutes les voies de l'homme par des progressions douces, appropriées à<br />
tous les degrés de son existence. C'est pour cette raison que, pour l'âme humaine, tout<br />
commence par le sentiment et l'affection, et que c'est par là que tout se termine.<br />
» Aussi notre intelligence ne se développe qu'après que notre être intérieur a éprouvé eu soimême<br />
les premiers sentiments de son existence. C'est ce qui se fait connaître dans l'âge où<br />
l'homme va commencer à penser. A cette époque de notre vie, nous sentons naître en nous un<br />
foyer neuf et une sensation morale que nous ne connaissions pas auparavant. L'intelligence ne<br />
tarde pas à donner aussitôt des signes de sa présence ; [418] mais cela n'arrive, à cet âge-la,<br />
qu'après que le foyer moral (passionnel) s'est développé.<br />
» Dans un âge plus avancé, la sève monte à force vers la région de notre intelligence. Aussi,<br />
c'est alors que les savants mettent les idées avant le moral, puisque même ils l'en font<br />
dépendre, comme ils font dépendre les idées des sensations et des objets externes.<br />
» Mais si ce foyer moral de sentiment et d'affection a l'initiative par droit de nature, il faudrait<br />
par conséquent que tout lui revînt en dernier résultat, comme nous voyons que les aliments<br />
que nous prenons ne nous sont utiles et ne remplissent leur objet qu'autant qu'ils portent leurs<br />
sucs et leurs propriétés jusque dans notre sang ou dans le foyer de notre vie.<br />
» Aussi sera-t-on obligé de convenir que toutes les clartés que l'intelligence des hommes<br />
acquiert par le raisonnement ne leur servent qu'autant qu'elles pénètrent jusqu'au foyer moral,<br />
où elles apportent chacune l'espèce de propriété dont elle est dépositaire. C'est un tribut et un<br />
hommage qu'elles doivent rendre toutes à cette source, en venant témoigner par le fait le<br />
caractère de leur relation avec elle. » (Ministère de l'Homme-Esprit, pages 421, 422.)<br />
Qu'il me soit permis d'insister encore sur cet important principe de l'analogie du bien et du<br />
vrai, que je voudrais pouvoir présenter dans cet article, sous tous ses aspects, au moyen des<br />
innombrables formules qu'il a revêtues, dans les écoles mystiques, dans celles de la<br />
décennies 1830_1839<br />
36
philosophie allemande moderne, et dans celle de M. Fourier. Ce principe est la base de la<br />
philosophie, delà religion et de la science sociale. Nul ne peut le méconnaître dans la formule<br />
des destinées proportionnelles aux attractions, qui est la clé de voûte de la théorie sociétaire.<br />
Ce principe, en effet, ne fût-ce qu'à cause de sa fixité et de sa permanence, implique<br />
nécessairement l'aveu de la supériorité de l'être passionnel sur l'être intelligent. Si M. Fourier<br />
a tant déclamé contre la raison et les philosophes, c'est qu'il ignorait les deux espèces de<br />
raison et les deux es-[4<strong>19</strong>]pèces de philosophie que les mystiques ont distinguées avec tant de<br />
netteté et de soin. Il ne s'est pas douté que cette méthode psychologique, pour laquelle il<br />
exprime en mille endroits de ses écrits une si juste et si profonde aversion, avait conduit<br />
pourtant des hommes tels que Kant, Fichte, Schelling, Jacobi, etc., a reconnaître que leur vie<br />
entière s'était épuisée en de vaines recherches ; il ne s'est pas douté que, selon l'éloquente<br />
expression de madame de Staël, la philosophie, magicienne irritée, après avoir tout détruit,<br />
avait incendié son propre palais, c'est-à-dire qu'examinant avec curiosité son propre<br />
instrument, l'appareil des formes de l'entendement, elle l'avait reconnu et déclaré inhabile a lui<br />
livrer autre chose que l'apparence, la vérité purement subjective et relative du phénomène,<br />
sans valeur dans les applications qu'on en pouvait tenter hors du domaine étroit de<br />
l'expérience sensible. Par conséquent force était à la philosophie de s'adresser à une faculté<br />
plus puissante, à une plus haute raison, prenant son point de départ, ou la première hypothèse<br />
nécessaire à toutes ses recherches, dans le principe attractionnel.<br />
Elle est donc enfin posée, comme inébranlable base h toutes les constructions scientifiques de<br />
l'avenir, cette affirmation arbitraire au point de vue logique, mais toutefois nécessaire et<br />
sublime, que la valeur de tous les faits sociaux, moraux, religieux, physiques et<br />
physiologiques même est déterminée, comme bonne ou mauvaise, par leur conformité ou leur<br />
opposition avec le génie de l’humanité, ses désirs, ses besoins, ses tendances natives, son<br />
attrait indestructible, et qu'il doit y avoir unité, plan général subordonné à l'homme, ainsi<br />
science synthétique de Dieu, de l'homme et de la nature. Il faudrait faire une telle science, si<br />
elle n'était pas faite ; maison en retrouvera partout les traces. <strong>Les</strong> illusions même en ce genre<br />
vaudraient mieux que les connaissances arides et fragmentaires qui nous sont données par la<br />
simple méthode analytique, parce que ces illusions correspondraient du moins à ce qu'il y a de<br />
plus vivace et de plus actif dans [420] l'homme ; elles satisferaient, par exemple, son génie<br />
poétique et religieux en vertu de quoi il veut impérieusement que tout lui soit subordonné, et<br />
la conscience de sa dignité, qui lui crie que le vrai ne pouvant être que la forme de son bien, le<br />
point de vue des causes efficientes, recherché en dehors du lien téléologique qui unit toutes<br />
choses, ne peut constituer qu'une science puérile et menteuse, sans valeur, parce qu'elle est<br />
sans grandeur, sans rapport avec nos plus immenses, nos plus pressants et nos plus<br />
impérissables besoins. L'humanité protesterait donc nécessairement, éternellement contre<br />
cette science brisée, ces disjecta membra, qui ne lui livrent le dernier mot de rien, si<br />
prétendant, comme elle l'a fait pendant trois siècles, constituer autre chose qu'une simple<br />
nomenclature, une pure description des phénomènes, une démonstration qui n'atteint que<br />
l'écorce des êtres, elle osait se produire comme le dernier terme de la connaissance permise et<br />
promise a l'homme ; laissant ainsi le roi de la création dans l'affreux désert de toutes ses<br />
espérances déçues, sous le coup d'un martyre incessant, dans l'attente continuellement<br />
trompée d'un bonheur qu'elle lui rendrait impossible, puisqu'elle ne lui fournit aucun idéal de<br />
ce bonheur, et aucun moyen d'y parvenir. Assez et trop longtemps nous nous sommes laissés<br />
diriger par l'idolâtrie de la raison logique, principe qui commence par anéantir l'être sublime<br />
qui, en nous, est la mesure et la clef de toutes choses (***) principe funeste qui nous impose<br />
pour devoir la prétendue observation impossible des faits, comme si nous n'en étions pas<br />
nous-mêmes le sens et le lien ; comme si nous ne portions pas en nous cette vie qu'on nous dit<br />
d'aller puiser au dehors ; comme si nos opinions étaient jamais autre chose que le masque de<br />
nos affections ; comme si l'homme sans désir, ne serait point par là même sans intelligence ;<br />
décennies 1830_1839<br />
37
comme si, pour tout homme, pour toute secte, pour toute époque, l'édifice scientifique n'avait<br />
pas toujours été la rigoureuse expression de ses tendances morales et passionnelles ; comme si<br />
la foi [421] et le désir de l'homme n'en étaient pas les prestigieux artistes, qui rendent vrai ce<br />
qu'ils veulent, qui le feraient être s'il n'était pas.<br />
A l'instant où on le voudra, et bien que la pédantesque fatuité des historiens de la philosophie,<br />
des Brucke, des Tiedemann et des Tennemann, daigne à peine les honorer d'un regard, parce<br />
qu'ils sont en dehors de la grande route des bancs scholastiques, on trouvera dans les<br />
gnostiques, cabalistes et néoplatoniciens de l'école d'Alexandrie, et dans les écoles modernes<br />
Martinistes et Swedenborgistes, une philosophie plus compréhensive que ne l'ont pu faire les<br />
plus puissants efforts tentés de nos jours en Allemagne. Cette philosophie couronnera<br />
magnifiquement ces efforts, et légitimera toutes les tendances de la science nouvelle,<br />
tendances faibles encore et obscures, parce qu'elles sont inconscientes d'elles-mêmes, de leur<br />
vrai caractère et de leur destination. On verra avec admiration cet esprit philosophique<br />
agrandir et assurer le cercle de la connaissance ; l’ agrandir par le principe de l'unité et de<br />
l'analogie, en ralliant toutes les sphères a l'histoire de l'homme, et en l'étudiant tout entier,<br />
c'est-à-dire autant dans son appareil passionnel que dans son appareil intellectuel ; l'assurer,<br />
en donnant a la science des critérium nouveaux, d'une importance infinie : 1° dans le point de<br />
vue téléologique, critérium pris de la nature même du vrai, qui n'est que la forme ou la<br />
manifestation du bien, toujours relatif a la réceptivité de l'être sentant et agissant ; 2° dans le<br />
principe de la vérité composée, qui fournit des contre preuves, au moyen desquelles la<br />
certitude morale s'élève jusqu'au degré d'évidence qu'on ne croyait pouvoir atteindre que par<br />
le procédé mathématique. Lorsqu'une immense série de faits se coordonne en faisceaux se<br />
liant et se soutenant les uns les autres, et qu'on trouve en même temps l'empreinte de ces faits<br />
exprimés avec tous leurs détails, dans trois autres livres, tels que la Nature, l’Histoire et les<br />
Traditions, quand les rayons de la connaissance jusque là en hostilité dans l'homme, [422] et<br />
qui faisaient de lui un royaume divisé avec lui-même, émanant majestueusement d'une même<br />
source, se rallient à un même foyer, l'homme en paix avec lui-même goûte le sublime<br />
repos qui résulte de l'harmonie active de toutes ses facultés, sorti pour jamais de la torpeur où<br />
le jetait le désespoir d'une connaissance incomplète et antinomique, il ne doute plus, il ne peut<br />
plus douter, il a reconnu qu'il portait à son doigt cet anneau de Gygès qu'il avait si vainement<br />
cherché partout. Suprême hiéroglyphe, auquel tous les autres se rapportent, ce que l'homme lit<br />
en lui, il le voit confirmé au dehors ; clé universelle, sa parole ouvre tous les domaines ; ils lui<br />
apportent tous leur tribut ; ils viennent tous lui rendre hommage.<br />
Par quelques citations de <strong>Saint</strong>-Martin, mises en rapport avec les débats actuels des écoles<br />
allemandes, et avec le principe attractionnel, base de la théorie sociétaire, j'ai cherché a faire<br />
voir que les mystiques avaient formulé nettement ce qui ne parait être encore, dans ces écoles,<br />
qu'à l'état d'obscur pressentiment, j'aurais pu mettre cette importante connexion dans tout son<br />
jour, en examinant Swedenborg, qui a été le plus didactique de tous les théosophes ; je me<br />
bornerai à faire une citation de Bœhme, dans le même sens. Elle est extraite d'un ouvrage que<br />
sa lucidité, son élégance toutes françaises, jointes à sa profondeur germanique, rendent<br />
infiniment précieux, bien qu'il soit presque inconnu, comme l'est aujourd'hui h peu près tout<br />
ce qui est vraiment remarquable.<br />
Je veux parler de La Voie de la Science divine, de Law, traducteur anglais du célèbre<br />
théosophe de Görlitz. Cet ouvrage me paraît contenir tout ce qu'on peut assimiler à l'état<br />
actuel de notre culture philosophique et religieuse, dans la doctrine de J. Bœhme, si<br />
prodigieusement excentrique, et, de plus, presque inintelligible dans l'original. Voici ce<br />
passage, 208 à 212.<br />
« Je suppose que, guidé par votre raison incertaine, vous soyez parvenu à vous donner des<br />
doutes sur l'essence divine, [423] et sur les soins de la providence de Dieu à votre égard, en<br />
vain alors auriez-vous recours aux démonstrations des philosophes païens, ou à celles des<br />
décennies 1830_1839<br />
38
théologiens, des déistes ou des athées, même quant ils concluraient tous qu'il faut<br />
nécessairement qu'il existe une cause première éternelle de laquelle tout soit provenu. En<br />
effet, quel Dieu est celui-là, dont l'existence n'est prouvée que parce qu'il existe quelque<br />
chose, et que conséquemment il faut qu'il ait toujours existé quelque chose d'éternel et<br />
d'infini, qui ait eu le pouvoir de produire tout ce qui est venu en être ? Quel Dieu, dis-je, est<br />
celui-là que l'arien, le déiste et l'athée sont autant disposés à reconnaître que le chrétien, et qui<br />
sert également de base a l'édifice des uns et des autres ? car l'athée même admet une cause<br />
première, éternelle, toute-puissante, aussi bien que ceux qui disputent en faveur de l'existence<br />
d'un Dieu.<br />
» Mais si, laissant de côté toutes ces vaines discussions et démonstrations de la raison<br />
humaine, vous rentrez au dedans de vous, à l'instant vous y trouverez une démonstration<br />
sensible et évidente par elle-même de l'existence du véritable Dieu de vie, de lumière, d'amour<br />
et de bonté, qui vous le rendra aussi manifeste que votre propre vie. En effet, l'existence réelle<br />
des sentiments de bonté, d'amour, de bienveillance, de douceur, de compassion, de sagesse, de<br />
paix, de joie, etc., ne vous est-elle pas démontrée d'une manière aussi certaine et aussi<br />
évidente que celle de votre propre vie ? Eh bien, l'être qui est la source, le principe et le centre<br />
de ces sentiments, c'est la le véritable Dieu évident par lui-même, et qui a voulu se révéler de<br />
telle manière que chaque homme le trouvât, le connût et le sentît aussi évidemment et aussi<br />
réellement qu'il sent et connaît ses propres pensées et sa propre vie ; c'est la ce Dieu dont l'être<br />
et la providence se font sentir en nous d'une manière si évidente, qui demande de notre part<br />
culte, amour, adoration et obéissance. Or, l'adorer l'aimer, tâcher de devenir bon, comme lui,<br />
c'est véritablement croire en lui, d'après l'évidence qu'il nous donne de [424] la réalité de son<br />
existence. L'athée ne rejette point une cause première et toute-puissante, il ne fait que nier la<br />
bonté, la bienveillance, la douceur, etc., et tous les sentiments par lesquels la nature divine se<br />
rend évidente en nous, et s'y manifeste comme le véritable objet de notre culte, de notre<br />
amour et de notre adoration. Ce n'est donc qu'en ayant recours à cette démonstration<br />
d'évidence que nous trouvons en nous, que nous pouvons arriver à la seule vraie connaissance<br />
de Dieu et de la nature divine, et cette connaissance est à l'épreuve de toutes les objections de<br />
la raison, puisqu'elle est aussi évidente en nous que notre propre vie. Jamais on ne parviendra<br />
à connaître Dieu, en réalité, par aucune preuve extérieure, ni par autre chose que par Dieu luimême,<br />
manifesté en évidence au dedans de nous. Ni le ciel, ni l'enfer, ni l'esprit pervers, ni le<br />
monde, ni la chair ne peuvent nous être connus, qu'autant qu'ils se manifestent en nous ; et la<br />
connaissance que nous en acquérons, indépendamment de cette évidence sensible qui résulte<br />
de leur naissance et de leur manifestation en nous, ressemble nécessairement celle qu'un<br />
aveugle-né prétendrait avoir de la lumière qu'il n'a jamais vue.<br />
» C'est ainsi que tout homme, par la nature de son être, naît, pour ainsi dire, a la certitude<br />
évidente et sensible de la réalité de toutes ces choses ; et si, a force de raisonner et de disputer,<br />
nous parvenons à en douter, c'est nous-mêmes qui créons notre incertitude, et elle ne vient<br />
point de Dieu ni de la nature. Dieu a ordonné toutes choses avec tant de sagesse, que les<br />
vérités qui sont pour nous de la plus grande importance, sont celles qui nous sont démontrées<br />
avec le plus de facilité et de certitude, puisque nous pouvons les connaître avec le même degré<br />
d'évidence, que nous connaissons, que nous souffrons, ou que nous avons du plaisir. Rien ne<br />
peut nous faire en réalité du bien ou du mal, que ce qui a pris naissance en nous. Aussi la<br />
religion n'est véritable pour nous, qu'autant qu'elle est devenue en nous principe de vie. Mais<br />
[425] dès que l'esprit et la vie de Dieu sont ainsi devenus vivants en nous, et qu'ils sont<br />
conséquemment évidents par eux-mêmes en nous, dès lors nous sommes dans la vérité ; cette<br />
vérité nous affranchit de tout doute, et nous n'avons pas plus d'égards à tout ce qu'une raison<br />
disputeuse peut opposer à notre croyance, qu'à ce qu'elle dirait contre l'évidence de ce que<br />
nous voyons, de ce que nous entendons, et du sentiment que nous avons de notre propre vie.<br />
décennies 1830_1839<br />
39
Mais délaisser cette démonstration d'évidence, pour se livrer aux doutes de la raison et à<br />
l'opinion, c'est vraiment abandonner l'arbre de vie, pour devenir le jouet de l'illusion. »<br />
Après avoir essayé de faire comprendre l'importance de ce grand principe de la philosophie<br />
mystique, ainsi formulée par <strong>Saint</strong>-Martin : chaque chose doit faire elle-même sa propre<br />
révélation, et par Bœhme : le développement de tout être est un magisme continu ; ce qui veut<br />
dire que rien n'est réellement assimilé à un être que par l'action de sa volonté, organe de son<br />
amour, et que rien de ce qui a été ainsi communique ne peut plus lui être enlevé par les doutes<br />
qui naissent de l'exercice de la raison spéculative agissant dans l'isolement ; après avoir<br />
montré que tous les efforts de la science étaient venus se résumer, pour les écoles allemandes,<br />
dans la négation des droits de cette raison critique isolée ; après avoir enfin mis en lumière<br />
l'identité de ce principe avec celui des destinées proportionnelles aux attractions, base de la<br />
théorie sociale proposée par M. Fourier, il me reste a soutenir ce parallèle par l'exposition<br />
rapide de quelques autres rapports, si essentiels et si frappants, qu'ils semblent faire de l'une<br />
de ces doctrines le simple développement des autres.<br />
Nous avons déjà vu que l'école mystique considère l'homme comme pivot de la nature,<br />
mesure de toutes choses ; elle subordonne toutes les connaissances fragmentaires fournies par<br />
l'analyse à la science foyère ou rectrice, synthèse de Dieu, de l'homme et du monde, révélée<br />
par la raison intuitive et confirmée par les traditions. Le savoir empirique n'a [426] de valeur<br />
pour elle qu'autant qu'il peut être employé dans la construction de l'édifice élevé par ce savoir<br />
de plus haute origine, dont le propre est de relier en systématisant. Elle s'occupe autant du<br />
pourquoi et du comment des choses, autant du rapport des moyens aux buts, que de celui des<br />
causes aux effets. Bien que l'école sociétaire n'ait pas encore complètement formulé sa<br />
philosophie, nous croyons qu'elle tend aussi à cet encyclopédisme unitaire et téléologique, que<br />
les écoles allemandes ont en vue dans leur célèbre formule de la synthèse du savoir et de<br />
l'être, et qui est l'esprit et la vie même de la théosophie.<br />
Le système des correspondances ou analogies se retrouve dans les trois écoles. Pour Schelling<br />
et Kant, qui n'ont guères fait qu'énoncer le principe, sans lui donner les immenses<br />
développements qu'il comporte, c'est l'unité dans la variété, caractère suprême de l'ordre et du<br />
beau ; pour les mystiques, c'est la langue de la nature, le inonde visible devenant le relief du<br />
monde invisible. M. Fourier, d'accord avec eux, n'en diffère qu'en ce qu'il applique ses<br />
analogies à l'ordre social, tandis que Bœhme, <strong>Saint</strong>-Martin et Swedenborg les appliquent<br />
surtout à l'ordre religieux, et s'en servent comme de principal flambeau pour interpréter les<br />
antiques et obscures traditions de l'humanité.<br />
Le système optimiste de la Théodicée de Leibnitz, si justement qualifié dans ce recueil<br />
d'hypothèse malencontreuse, puisqu'elle tend à paralyser l'activité humaine, en lui enlevant<br />
tout espoir de voir jamais guérir ses maux les plus graves et lever des obstacles qu'elle<br />
considère comme nécessaires, a été flétri à la fois par l'acre ironie de Voltaire et la tristesse<br />
imposante de Lamartine et de Byron, alliés comme à dessein pour appliquer l'indélébile<br />
stigmate de leur réprobation commune à la plus lourde et à la plus funeste méprise qui ait<br />
jamais pesé sur l'esprit humain. <strong>Les</strong> écrivains les plus célèbres de l'Allemagne moderne, tant<br />
poètes que philosophes, les théosophes mystiques et l'école sociétaire ont re-[427) poussé<br />
avec une égale force la conception absurde et ridicule de l'optimisme quand même. Pour<br />
Bœhme et <strong>Saint</strong> -Martin, comme pour M. Fourier, le globe et l'humanité sont dans un état<br />
subversif, seulement la vue pessimiste de ces théosophes est plus étendue encore que celle du<br />
réformateur social ; ils n'ont pas cru, comme lui, que le mal fût fatalement attaché a<br />
l'évolution préparatoire qui signale les premières périodes de l'existence d'un globe et aux<br />
convulsions de sa décrépitude ; ils ont jugé que le mal social et le mal physique devaient avoir<br />
eu pour cause le mal moral, parce que d'une part les traditions de tous les peuples déposent<br />
avec unanimité en faveur du dogme de la déchéance, et que d'autre part ils ont compris avec<br />
décennies 1830_1839<br />
40
une foule de penseurs illustres (1) 12 , que la raison et la conscience pouvaient se rallier à ce<br />
dogme, en tant qu'on ne le séparerait jamais de la doctrine consolatrice d'une réhabilitation, et<br />
que non seulement ils peuvent s'y rallier, mais qu'ils lui fournissent à leur tour la plus<br />
imposante sanction.<br />
Je ne pense pas que l'école sociétaire attache une grande importance à la solution qu'a donnée<br />
son fondateur du problème de l'origine du mal ; il est évident qu'il n'a traité ce sujet<br />
qu'accessoirement, soit qu'il le jugeât en dehors de son but, ou que la direction habituelle de<br />
ses idées ne lui permît pas de s'en occuper avec le soin qu'il réclame à un autre point de vue.<br />
M. Fourier s'est borné à peu près à cette simple assertion, que le Créateur ne pouvait<br />
empêcher la prédominance du mal dans l'enfance et la décrépitude d'un globe. C'était trancher,<br />
au lieu de la résoudre, la plus grave de toutes les questions religieuses. Il n'est pas hors de<br />
propos de remarquer ici que cette solution ne se lie en aucune façon à tout le reste du système<br />
sociétaire, qu'elle semble même le contrarier visiblement. Une des plus belles idées de M.<br />
Fourier,<br />
. [428] qu'il a eue en commun avec les mystiques, est celle de la régénération de la nature,<br />
comme conséquence directe de celle de l'humanité ! Il a dit dans le même sens et avec la<br />
même portée que saint Paul : toutes les créatures gémissent attendant de l’homme leur<br />
délivrance. Il a représenté cette nature, impatiente de procéder à de plus belles créations,<br />
enchaînée par le désordre dans lequel persistent les sociétés. Comment, dès lors, l'humanité,<br />
pivot du monde, élément libre destiné à régir l'élément fatal, a-t-elle pu être arrachée par<br />
celui-ci à l'état de bonheur dont il nous la montre en possession dans Éden. Il a bien fallu,<br />
dans l'ordre des idées de cet écrivain, que l'humanité engendrât elle-même le mal moral ou<br />
social dont elle a été la victime, et que, par suite, la nature, esclave docile, engendrât le mal<br />
physique, par une création subversive rigoureusement correspondante à la subversion qui<br />
avait eu lieu dans l'élément supérieur ; il l'a bien fallu, dis-je, puisque la restauration de<br />
l'humanité dans l'état primitif de bonheur, ou état sociétaire, par la pratique universelle de la<br />
justice et de la vérité, pourra seule opérer, par correspondance, la restauration de la nature. Le<br />
principe analogique dépose donc contre l'hypothèse de M. Fourier sur l'origine du mal. Le<br />
principe attractionnel et le principe téléologique lui sont formellement opposés. En vertu du<br />
premier, tout ce que l'homme n'aimera jamais, tout ce qu'il ne saurait désirer, est absolument<br />
mauvais et n'a qu'une existence factice. Le mal est le schisme de l'être, et à ce titre n'a pas<br />
d'existence per se. On doit donc supposer, si l'on se laisse diriger par le flambeau de<br />
l'attraction, que la décrépitude et la mort, cette mort qui sera toujours le roi des<br />
épouvantements, disparaîtront ; car elles constituent la victoire de l'élément fatal sur l'élément<br />
libre. Aussi l'Écriture dit-elle que le dernier ennemi qui sera vaincu c'est la mort. En vertu du<br />
second principe, qui est celui des causes finales, l'âme et la vie de toute la théorie sociétaire, le<br />
but de la création, à savoir l'état heureux et glorieux de l'humanité et du globe, ce [429] but<br />
une fois atteint, pourquoi les ferait-on retomber dans l'incohérence et le malheur ? Il faudrait<br />
faire de cet article un volume, pour donner seulement une faible esquisse de la théosophie de<br />
Bœhme et de <strong>Saint</strong>-Martin. Nous avons dû nous borner à indiquer son point de départ et son<br />
caractère principal, son étroite connexion avec l'état présent de la culture intellectuelle, en<br />
France et en Allemagne. La citation de <strong>Saint</strong>-Martin, par laquelle nous allons terminer ce<br />
travail, nous paraît ne pouvoir manquer de frapper les hommes disposés à regarder comme<br />
chimérique, ou comme trop vague, le rapprochement de doctrines qui en est la principale<br />
pensée. Ils y remarqueront encore un point commun entre le christianisme mystique et l'école<br />
sociétaire, le désir d'arracher l'homme h la passivité fataliste avec laquelle il se résigne au mal,<br />
que les fausses religions lui font considérer comme une expiation utile, tandis qu'a titre<br />
d'administrateur de la terre, seul organe de la Providence divine, l'homme doit sentir qu'il n'est<br />
12 (1) Fabre d'Olivet, Ballanche, de Maistre, Hoëne Wronsky, etc.<br />
décennies 1830_1839<br />
41
placé sur ce globe que pour en éliminer toutes les sortes de souffrances et de désordres, par sa<br />
gestion unitaire, radicalement médicatrice, et non pas dérisoirement palliative.<br />
« Nous ne pouvons guère nous dispenser de croire qu'indépendamment des fruits terrestres<br />
que la terre nous prodigue tous les jours, elle a encore d'autres fruits à produire. Le premier<br />
des indices que nous en ayons est de voir la différence qui se trouve entre les fruits sauvages<br />
que la terre porte naturellement, et ceux que nous lui faisons produire par notre culture, ce qui<br />
pourrait annoncer à des yeux pénétrants que la terre n'attend que le secours de l'homme, pour<br />
faire sortir de son sein des merveilles encore plus intéressantes.<br />
« Un second indice est qu'il y a eu peu de nations païennes qui n'aient rendu un culte religieux<br />
à la terre.<br />
» Enfin la mythologie vient appuyer notre conjecture en nous offrant les pommiers d'or placés<br />
dans le jardin des Hespérides, [430] en faisant enseigner aux hommes par une déesse l'art de<br />
l'agriculture, et en nous apprenant, selon Hésiode, que la terre naquit immédiatement après le<br />
chaos, qu'elle épousa le ciel, et qu'elle fut mère des dieux et des géants, des biens et des maux,<br />
des vertus et des vices. »<br />
Si, de ces observations naturelles et mythologiques, nous passons à des traditions d'un autre<br />
ordre, nous verrons dans la Genèse (4-, 1 -1 et i 2) qu'après le meurtre d'Abel il fut dit à Gain :<br />
Désormais tu seras maudit sur la terre qui a ouvert son sein, et qui a reçu de ta main le sang de<br />
ton frère. Lorsque tu la cultiveras, elle ne te rendra point ses fruits. »<br />
Or, nous ne remarquons pas que la terre ne puisse être labourée que par la main d'un juste,<br />
sous peine de demeurer stérile. Nous ne remarquons pas non plus que ce soit le sang des<br />
hommes qui s'oppose à sa fécondité. Lors donc qu'il fut dit à Caïn, après son crime, que quand<br />
il travaillerait la terre elle ne lui rendrait point ses fruits, tout nous engage à penser qu'il était<br />
question dans ce travail d'une autre culture que de la culture commune et ordinaire ; or, cette<br />
autre culture, quelle idée pourrions-nous nous en former qui ne rentrât pas dans le véritable<br />
ministère de l'homme-esprit, ou dans cet éminent privilège qui lui est donné de pouvoir faire<br />
sabbatiser la terre ; privilège toutefois qui est incompatible avec le crime, et qui doit cesser et<br />
être suspendu dans ceux qui ne marchent pas selon la justice. »<br />
« Mais nous ne pouvons guère pénétrer dans le sens du mot sabbatiser sans recourir aux sept<br />
formes ou aux sept puissances que Boehm établit pour base de la nature.<br />
» II nous faut en outre reconnaître avec lui que par une suite de la grande altération, ces sept<br />
formes, ou ces sept puissances sont ensevelies dans la terre comme dans les autres astres ;<br />
qu'elles y sont comme concentrées et en suspension ; et que c'est cette suspension qui tient la<br />
terre en privation et en souffrance, puisque ce n'est que par le développement [431] de ces<br />
puissances ou de ces formes, qu'elle pourrait produire elle-même toutes les propriétés dont<br />
elle est dépositaire et qu'elle désire manifester, observation que l'en peut appliquer a toute la<br />
nature.<br />
» Enfin, il nous faudrait retracer le tableau de l'homme qui annonce universellement une<br />
tendance a tout améliorer sur la terre, et qui fut chargé par la sagesse suprême, selon Moïse,<br />
de cultiver le paradis de délices, et de veiller à sa conservation .<br />
» Or, quelle pouvait être cette culture de la part de l'homme, sinon de maintenir en activité,<br />
selon les mesures et proportions convenables, le jeu de ces sept puissances ou de ces sept<br />
formes, dont le jardin de délices avait besoin, comme tous les antres lieux de la création.<br />
» II fallait donc, par conséquent, que l'homme fût dépositaire du mobile de ces sept puissances<br />
pour pouvoir les faire agir selon les plans qui lui étaient tracés, et pour maintenir ce lieu choisi<br />
dans son repos ou dans son sabbat, puisqu'il n'y a de repos ou de sabbat pour un être qu'autant<br />
qu'il peut librement développer toutes ses facultés.<br />
» Aujourd'hui, quoique le mode de l'existence de l'homme ait prodigieusement changé par<br />
l'effet de la grande altération, l'objet de la création n'a pas changé pour cela, et l'homme-esprit<br />
est encore appelé a la même œuvre, qui est de faire sabbatiser la terre.<br />
décennies 1830_1839<br />
42
» Quant à ces sept puissances renfermées aujourd'hui dans la terre comme dans toute la<br />
nature, nous en voyons une image sensible dans le phénomène physique que notre atmosphère<br />
offre a nos yeux quand par la présence du soleil les nuages se fondent en eau.<br />
» Cette substance aqueuse, qui, selon de profondes et justes observations, est dans toutes les<br />
classes le vrai conducteur ou le propagateur de la lumière, présente en remplissant l'espace un<br />
miroir naturel aux rayons solaires. [432]<br />
» Ceux-ci, en pénétrant dans le sein de cet élément, marient leurs propres puissances avec<br />
cellesdont.il est lui-même dépositaire, et par cette féconde union le soleil et l'eau, c'est-à-dire<br />
la région supérieure et la région inférieure, manifestent aussitôt à notre vue le signe septénaire<br />
de leur alliance, qui est en même temps le signe septénaire de leurs propriétés, puisque les<br />
résultats sont analogues à la source qui les engendre.<br />
» Ce fait sensible et physique nous offre, en nature, l'enseignement le plus instructif sur l'état<br />
de concentration et d'invisibilité où sont ces sept puissances dans la nature, sur la nécessité<br />
que leurs entraves se rompent pour qu'elles puissent rentrer dans leur liberté ; sur l'action<br />
constante du soleil, qui ne travaille qu'a faciliter leur délivrance, et a montrer ainsi à tout<br />
l'univers qu'il est ami de la paix, et qu'il n'existe que pour le bonheur des êtres.<br />
» Lorsque cette pluie, ainsi fécondée par le soleil, descend sur la terre, elle vient opérer, en se<br />
mariant avec elle à son tour, les salutaires résultats de la végétation, que nous secondons par<br />
notre travail et dont nous recueillons les heureux fruits, et c'est ainsi que la vie, ou le sabbat<br />
matériel de la nature, se propage par des progressions douces, depuis le chef solaire jusqu'à<br />
nous.<br />
» Mais ce phénomène physique et figuratif, et tout ce qui en est le résultat, s'opère sans le<br />
ministère spirituel de l'homme, et cependant c'est à l'homme à faire sabbatiser la terre ; aussi<br />
avons-nous reconnu ci-dessus qu'elle attendait de lui une autre culture.<br />
» Je ne craindrai point de dire que ce glorieux sabbat que l'homme-esprit est chargé de rendre<br />
a la terre est de lui aider à célébrer les louanges de l'éternel principe, et cela d'une manière<br />
plus expressive qu'elle ne le peut faire par toutes les productions qu'elle laisse sortir de son<br />
sein.<br />
» Car c'est là le terme réel où tendent tous les êtres de la [433] nature. Leurs noms, leurs<br />
propriétés, leurs sept puissances, leur langue enfin, tout est enseveli sous les décombres de<br />
l'univers primitif ; c'est à nous à les seconder dans leurs efforts pour qu'ils puissent redevenir<br />
des voix harmonieuses et capables de chanter chacun dans leur classe les cantiques de la<br />
souveraine sagesse.<br />
« Mais comment chanteront-ils ces cantiques si cette souveraine sagesse n'employait un<br />
intermède pour pénétrer jusqu'à eux, puisqu'elle leur est si supérieure, et si par son<br />
représentant et une image d'elle-même elle ne leur faisait pas ainsi parvenir ses douceurs ?<br />
» Nous ne cherchons plus a établir ici que l'homme est cet intermède ; tout ce qui a précédé<br />
n'a eu pour objet que de nous amener a cette persuasion, et malgré les nuages ténébreux qui<br />
enveloppent la famille humaine, malgré le poids énorme du fardeau qui l'accable depuis<br />
qu'elle a été plongée dans la région de la mort, je me plais a croire que parmi mes semblables<br />
il s'en trouvera encore qui dans cette sublime destination n'apercevront rien que leur véritable<br />
nature désavoue, et peut-être même, ne fût-ce qu'en perspective, ils n'en envisageront pas le<br />
charme sans tressaillir. Ne nous occupons donc ici que de chercher à quel prix l'homme peut<br />
parvenir à s'acquitter de cet important ministère.<br />
» Ce ne peut être qu'en employant ces mêmes puissances, qui sont cachées dans son être<br />
corporel comme dans tous les autres êtres delà nature ; car l'homme étant l'extrait de la région<br />
naturelle, de la région spirituelle et de la région divine, les sept puissances ou les sept formes<br />
qui servent de base à toutes choses doivent agir en lui, mais d'une manière diverse et graduée,<br />
selon son être naturel, selon son être spirituel, et selon son être divin ou divinisé.<br />
décennies 1830_1839<br />
43
« Mais, pour qu'elles puissent agir en lui dans quelques-unes de ces classes qui le constituent,<br />
il faut que ces puissances elles-mêmes soient ramenées en lui à leur état de liberté originelle.<br />
[434] Or, quand l'homme se contemple sous ce rapport, quand il considère à quel état de<br />
désordre, de désharmonie, de débilité et d'esclavage ces puissances sont réduites dans tout son<br />
être, la douleur, la honte et la tristesse s'emparent de lui au point que tout pleure en lui, et que<br />
toutes ses essences se transforment eu autant de torrents de larmes.<br />
» C'est sur ces torrents de larmes représentées matériellement par les pluies terrestres que le<br />
soleil de vie dirige ses rayons vivificateurs, et que par l'union de ses propres puissances avec<br />
le germe des nôtres, il manifeste à notre être intime le signe de l'alliance qu'il vient contracter<br />
avec nous.<br />
» C'est alors, homme, que tu deviens susceptible de sentir les douleurs de la terre, ainsi que de<br />
tout ce qui constitue l'univers ; c'est alors qu'en vertu de l'énorme différence qui se trouve<br />
entre l'état infirme des sept puissances cachées dans la terre, et entre tes propres puissances<br />
revivifiées, tu peux apporter du soulagement à ses souffrances, parce que tu peux répéter a son<br />
égard ce qui vient de s'opérer sur toi. Enfin, ce n'est qu'en jouissant toi-même de ton propre<br />
sabbat et de ton propre repos que tu peux parvenir à la faire sabbatiser à son tour.<br />
» Ce n'est.que par là que tu deviens réellement le maître de la nature, et que tu peux l'aidera<br />
manifester tous les trésors qu'elle gémit de voir concentrés dans son sein, ainsi que tous ces<br />
prodiges et tous ces faits merveilleux dont les mythologies de tous les peuples et de toutes les<br />
traditions, soit sacrées, soit profanes, sont remplies, et qu'elles attribuent, les unes à des dieux<br />
imaginaires, les autres aux droits réels qui appartient à l'homme revivifié dans ses facultés par<br />
le principe même qui lui a donné l'être.<br />
» C'est par là que tu peux en quelque sorte soumettre les éléments à ton empire, disposer à ton<br />
gré des propriétés de la nature, et contenir dans leurs bornes toutes les puissances qui la<br />
composent, afin qu'elles n'agissent que dans leur union [435] et leur harmonie ; car ce n'est<br />
qu'en agissant dans leur désordre et leur désharmonie qu'elles produisent ces formes et ces<br />
êtres monstrueux que l'on remarque dans les différents règnes de la nature. » (Ministère de<br />
l’Homme-Esprit, 135 à 142.)<br />
Il nous reste à donner quelques détails biographiques sur ces deux grands théosophes.<br />
Jacob Bœhme, connu en Allemagne sous le nom du philosophe teutonique, naquit en 1575,<br />
dans une petite ville de la Haute -Lusace, nommée l'ancien Seidenburg, à un demi mille<br />
environ de Görlitz. Ses pareils étaient de la dernière classe du peuple, pauvres, mais honnêtes.<br />
Ils l'occupèrent pendant ses premières années à garder les bestiaux. Il passa sa vie entière dans<br />
un état voisin de l'indigence, occupé des soins de sa profession de cordonnier concurremment<br />
avec les hautes spéculations religieuses qui l'ont rendu si célèbre. Il le fut beaucoup dans le<br />
dix-septième siècle ; il rencontra en Allemagne et en Angleterre surtout, un grand nombre de<br />
partisans, dont quelques-uns très-distingués par leurs connaissances et d'autres par leur rang.<br />
Au nombre de ces derniers, plaçons le roi Charles 1 er qui envoya à Görlitz Jean Sparrow,<br />
avocat, homme d'une vertu rare et d'un grand talent, pour étudier avec soin les profondeurs de<br />
la langue allemande, afin d'être en état de traduire parfaitement les œuvres de Bœhme en<br />
anglais. William Law est son autre traducteur dans cette langue. <strong>Saint</strong>-Martin nous a fait<br />
connaître ses principaux ouvrages, qui sont : l’Aurore naissante, les Quarante questions, et la<br />
Triple vie. D'autres ont été traduits en latin. Ce sont Mysterium magnum, et Signatura rerum.<br />
Bœhme mourut à Görlitz en 1620.<br />
<strong>Claude</strong>-<strong>Louis</strong> de <strong>Saint</strong>-Martin naquit a Amboise en Touraine, -d'une famille appartenant a la<br />
noblesse. Il manifesta, [436] dès sa jeunesse, la vocation la plus décidée pour les études<br />
religieuses et philosophiques, et spécialement pour la recherche des points de doctrine les plus<br />
décennies 1830_1839<br />
44
obscurs : on peut dire de lui, avec plus de raison encore qu'on ne l'a dit de Kant, que,<br />
semblable à la colonne qui marchait en tête du peuple hébreu, dans son pèlerinage a travers le<br />
désert, nébuleuse pendant le jour et étincelante dans les ténèbres, il est embarrassé et diffus<br />
dans les choses faciles qu'on peut expliquer par des lieux communs, et admirablement lucide<br />
dans les choses difficiles et naturellement obscures.<br />
Sa vie présente peu d'événements remarquables ; il avait été amené, par des circonstances<br />
complètement étrangères à ses goûts et à ses opinions, à embrasser la carrière militaire. Il sut<br />
féconder l'oisiveté des garnisons par de nombreux et importants travaux littéraires. La<br />
connaissance qu'il prit d'une mauvaise traduction d'un des ouvrages de Boehm le remplit<br />
d'admiration pour le génie de ce théosophe, et lui fit sentir vivement l'assujettissement qui<br />
résultait des devoirs de sa profession.<br />
Il la quitta donc pour pouvoir visiter l'Allemagne, en apprendre la langue, peu répandue alors<br />
eu France, dans le but unique de traduire lui-même les ouvrages de Bœhme, ce qu'il a fait<br />
pour les plus remarquables d'entre eux. Il n'émigra point à l'époque de la révolution. La<br />
considération qu'il avait acquise par sa vie studieuse et simple le fit même porter comme<br />
candidat sur la liste, présentée par l'Assemblée constituante, des noms parmi lesquels le<br />
pouvoir exécutif avait à choisir le gouverneur du dauphin. A l'exemple de Rousseau, qui<br />
refusa l'éducation du prince de Parme 13 , <strong>Saint</strong>-Martin crut devoir se soustraire à une mission<br />
dont il n'attendait pas de bien possible. Il mourut en 1804, à la maison de campagne du<br />
sénateur Lenoir Laroche, son ami. Il avait blâmé le mode de conversion de La Harpe, et,<br />
fidèle à ses principes, il ne voulut à ses derniers moments le secours d'aucun ministre officiel<br />
de la religion. L'établissement d'une église externe, le métier de prêtre, la transmission d'un<br />
pou-[437] voir spirituel quelconque, à tout autre titre que celui de la sainteté, toutes ces choses<br />
résultant d'idées qu'il n'avait jamais pu admettre, lui apparaissaient comme la tentative d'une<br />
domination directement opposée a l'esprit chrétien. <strong>Les</strong> ouvrages propres à <strong>Saint</strong>-Martin sont :<br />
l’homme de désir, le Nouvel Homme, le Ministère de l'Homme-Esprit, le Crocodile, sorte de<br />
poème emblématique, dans la manière de Rabelais, écrivain dont <strong>Saint</strong>-Martin faisait le plus<br />
grand cas ; l'Esprit des choses, le Tableau naturel, et une brochure sur la révolution française.<br />
Ph. HAUGER.<br />
Affichage du livre entier<br />
13 L’éducation du prince de Parme, où comment la philosophie, la raison et la science conduisent au<br />
rétablissement de l’inquisition par celui qu’elles sont censées avoir « éduqué » !<br />
décennies 1830_1839<br />
45
Essai sur l'histoire de la philosophie en France au XIXe siècle Page 298 de Philibert Damiron 1834<br />
Voir 1832, la pagination est différente, l’amateur peut travailler les variantes.<br />
Prévoir un dossier Damiron<br />
Page 46<br />
Elle aurait eu peine à compter quelques métaphysiciens dans ses rangs ; ce ne serait pas <strong>Saint</strong>- Martin, le<br />
philosophe inconnu, qui pût bien aux écoles ...<br />
Page 135<br />
... <strong>Saint</strong>- Martin sur le sens moral, qui mérite attention. ...<br />
Page 225<br />
... articles. h) <strong>Saint</strong>-Martin dit à peu près la même chose. ...<br />
Page 286<br />
... <strong>Saint</strong>Martin.<br />
Page 296<br />
... et, dans son transport plein d'ardeur, il s'égare dans sa propre pensée, pour se relever ensuite riche d'idées<br />
généreuses et hautes. » SAINT-<strong>MARTIN</strong> ...<br />
Page 297<br />
Il est au reste difficile en parlant de <strong>Saint</strong>-Martin de le rattacher avec analogie à l'une ...<br />
Page 298<br />
(i) Voici comment M. de Maistre s'explique sur les Illuminés en général, et sur <strong>Saint</strong>-Martin en particulier ; il<br />
peut être curieux de voir ce qu'il en ...<br />
Page 299<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin, dont les ouvrages furent le code des hommes dont je parle, participait cependant à ce caractère<br />
général. Il est mort sans avoir voulu ...<br />
Page 300<br />
En sa position et à son époque, <strong>Saint</strong>-Martin fut certainement une exception extrêmement rare. On conçoit sans<br />
peine comment, dans de telles dispositions, ...<br />
Page 301<br />
Tel fut <strong>Saint</strong>-Martin jusqu'à la fin de ses jours; dévoué à ses travaux avec un calme, un désintéressement et une<br />
constance admirables. ...<br />
Page 303<br />
<strong>Saint</strong>-Martin énonce à peu près en ces termes ce dogme déjà obscur d'une ontologie toute mystique : Autrefois<br />
l'homme avait une armure impénétrable ...<br />
Page 304<br />
principal des ouvrages de <strong>Saint</strong>-Martin, celui dans lequel il philosophe le plus (car, dans les autres, il ne fait<br />
guère que prêcher et prier), ...<br />
Page 305<br />
II. est assez curieux de voir quelle politique <strong>Saint</strong>-Martin déduit de ces données. Si les hommes étaient restés<br />
dans leur pureté primitive, il n'y aurait ...<br />
Page 307<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 308<br />
dures maximes d'état, <strong>Saint</strong>-Martin, avec son cœur si bienveillant et si tendre, n'aspire qu'à les tourner au<br />
bonheur de ses semblables ; il les tempère de ...<br />
Page 309<br />
Voilà pourquoi <strong>Saint</strong>-Martin dit quelque part que l'homme n'est
Spiritualisme et progrès social, esquisses du temps présent: Esquisses du ... Page 85 de<br />
Adolphe Mazure 1834 383 pages<br />
Page xii<br />
Chapitre 1 er<br />
O hommes, exilés de la terre pairie, voulez-vous donc<br />
faire de la terre présente votre habitacle éternel? Ah!<br />
plutôt sortez de la région des sens, et, vous tournant vers<br />
la VÉRITÉ, remontez à la royauté primitive dont vous êtes<br />
déchus.<br />
SAINT-<strong>MARTIN</strong>, des Erreurs et de la Vérité.<br />
Du progrès social, selon le principe matériel<br />
A vous, matérialistes dorés de salon et d'académie, qui vous éblouissez de vos témérités<br />
religieuses, sociales, physiologiques, je voudrais, dans ce premier chapitre d'un livre destiné à<br />
établir la réalité du progrès social fondé sur le spiritualisme, montrer à quel néant vous êtes<br />
amenés par le principe matériel d'où vos systèmes sont sortis.<br />
…<br />
[71] § Il<br />
Illustre contemporain, génie français, poète et prophète de l'histoire, comme Vico en est le<br />
métaphysicien et Herder l'orateur, Ballanche évoque le génie des temps antiques, il en<br />
possède le secret, il en a reçu le souffle inspirateur. Ce grand prosateur est armé d'une lyre à la<br />
fois sublime et touchante, sur laquelle vibrent tous les accords, toutes les [72] harmonies de<br />
l'homme individuel et social. Disciple de Vico, il ne s'enferme pas dans la formule universelle<br />
et fatale du maître, il prolonge indéfiniment le cercle agrandi de l'humanité, et, comme<br />
Herder, il a conviction que ces spirales qui forment les évolutions de la société, aux époques<br />
rétrogrades, sont en réalité des pas en avant, qui toujours ramèneront le genre humain un<br />
degré plus haut que la dernière plate-forme sur laquelle il a précédemment stationné.<br />
Ce qui se fait surtout remarquer dans cet auteur, ce qui plane au-dessus de ses hautes et<br />
pénétrantes divinations du passé, ce qui lui fait dire qu'une idée est en lui et qu'il a été appelé à<br />
la divulguer tout entière, c'est la conviction intime et profonde qu'il a de l'avenir, c'est cette foi<br />
au progrès, au cercle indéfini et toujours s'élargissant de la pensée, à cette vie essentiellement<br />
perfectible de l'esprit humain, à cette aile de l'intelligence qui toujours monte, s'agrandit,<br />
acquiert de la puissance dans son vol, et dont rien, que la volonté de Dieu en brisant le monde,<br />
ne [73] suspendra l'essor et n'arrêtera les destinées glorieuses.<br />
La pensée de Ballanche se ramène à une grande conception d'unité. Cette unité n'est point<br />
celle d'un artiste dont le tableau, soumis à des règles aristotéliques, doit représenter une scène<br />
unique à laquelle concourent les personnages divers, isolés ou groupés sur sa toile intelligente.<br />
Ce n'est pas non plus l'unité de l'historien positif, qui descend pas à pas et de siècle en siècle<br />
dans les profondeurs du temps ; évoque, chacune en leur lieu, les générations, à chacune<br />
assigne la place qui lui convient ; dessine avec une parfaite netteté de contours les linéaments<br />
de la physionomie d'une époque ou d'une nation. Non, l'unité qui se fait jour à travers les<br />
ouvrages multipliés de cet auteur, c'est plutôt l'unité philosophique qui appelle et fait<br />
converger en elle, comme dans un foyer primitif, tous les rayons émanés des sphères<br />
brillantes répandues dans l'espace intelligible. Là, apparaissent les conceptions poétiques,<br />
formes indécises, vagues émotions de l'âme, qui, se répandant sur [74] toute surface, lui<br />
donnent leur lumière et leur couleur; là, se reflètent les souvenirs et les traditions historiques,<br />
noblement exaltées, symbolisées au souffle de la poésie ; là aussi les traditions religieuses<br />
apportent leur tribut; et ces multiples rayons, décomposés et réunis sous le prisme<br />
décennies 1830_1839<br />
47
palingénésique, composent cette grande unité à laquelle se ramène toute sa pensée. Ballanche<br />
est à la fois historien, poète, métaphysicien, et il n'est rien de cela en particulier ; tout cela<br />
descend en lui, sans efforts, par jets simultanés, s'absorbe, se fond, et de là rejaillit en pure et<br />
sainte théosophie.<br />
Cette pensée générale palingénésique qui est le cercle unitaire de Ballanche, la voici :<br />
Le monde est déchu ; sorti pur et parfait des mains de l'auteur des choses, il a été altéré,<br />
dégradé, rejeté de la vie par le mal entré en lui arec le premier péché. Mais aussi, ce monde a<br />
été relevé, réparé, ramené à l'unité par la volontaire immolation du Christ. C'est là le thème<br />
universel dont Page 75 toutes les théologies anciennes et modernes, profanes et sacrées,<br />
reproduisent l'empreinte plus ou moins effacée, plus ou moins transparente. Il devait donc<br />
mourir ce monde de l'humanité, ayant rompu la chaîne d'attraction qui le maintenait dans<br />
l'unité avec son auteur ; mais l'intervention du sacrifice éternel a comblé l'abîme. L'homme a<br />
vécu, à condition qu'il travaillerait avec effort pour remonter à la lumière dont il est descendu.<br />
On voit ici la première vérité du dogme chrétien ; Ballanche en fait son point de départ ;<br />
d'autres écrivains, Pascal, <strong>Saint</strong>- Martin, et de nos jours, Baader et Gœrres à Munich, l'ont<br />
creusée avec plus de profondeur, et en ont fait sortir une psychologie transcendante, dans<br />
laquelle ils ont planté, comme sur un sol producteur, l'arbre révéré du catholicisme. M.<br />
Ballanche s'est surtout attaché à faire voir les effets de la chute et de la réparation dans la<br />
société, de même que les écrivains et les prédicateurs catholiques représentent la même<br />
pensée dans l’individu sous [76] le symbole du vieil homme, rétabli et renouvelé par la grâce.<br />
Ainsi le monde social, aussi lui, est condamné à suivre ou à subir les mêmes phases que celui<br />
de la vie individuelle, à marcher sa voie entre ces deux pivots extrêmes, la déchéance et la<br />
réhabilitation. Car le monde social, c'est le monde moral, considéré dans l'ensemble des<br />
intelligences et des volontés, au lieu d'être pris sous la forme primitive de l'humaine<br />
individualité. Or, de même que toutes les religions spiritualistes donnent pour loi à la nature<br />
humaine de se consommer dans la vertu, d'y remonter si on est déchu de sa lumière, et<br />
toujours de se perfectionner ; ainsi la société a reçu une loi identique, la loi de se<br />
perfectionner indéfiniment en parcourant avec travail, de cercle en cercle et dans une<br />
progression directe, le chemin de la civilisation. Ainsi la société, qui est mystiquement<br />
l'homme chrétien se développant dans la chaîne des générations, s'en va se dégageant comme<br />
la chrysalide de son enveloppement [77] primitif, passant du vieil homme à l'homme nouveau,<br />
s'édifiant elle-même, et marquant chacune de ses évolutions palingénésiques par une grande<br />
douleur, une grande expiation. Car telle est la mission providentielle des révolutions dans la<br />
société, elles sont des moyens expiatoires, et procèdent par la douleur à l'initiation d'une<br />
époque transformée. Toujours, d'épreuves en épreuves, d'expiations en expiations, ce monde,<br />
comme un grand voyageur qui gravit les montagnes après les montagnes, traverse tout le<br />
chemin pour arriver au but que Dieu lui a donné entre la chute et la complète réparation. Mais<br />
en définitive, et au bout de ces spirales renaissantes, se trouve toujours le perfectionnement,<br />
l'émancipation physique et intellectuelle des hommes, laquelle deviendra universelle, sitôt que<br />
la mission du Christ, qui est venu briser l'esclavage, sera accomplie. Quand M. Ballanche<br />
publiait son Antigone, œuvre de poésie antique et de prévision moderne ; plus tard, quand il<br />
mettait au jour [78] l'Homme sans nom, suivi d'une élégie sociale pleine de profondeurs<br />
mystérieuses, et des fragments remplis des parfums d'une poésie suave, était-il dominé déjà<br />
par la pensée qui depuis a présidé à toutes ses conceptions ? Il le dit, il faut l'en croire.<br />
Pensons du moins que là, dans ses œuvres premières, se cachait recelée, comme au fond d'un<br />
sanctuaire, la pensée qui se dévoile dans ses autres ouvrages ; c'était comme autant de fleurs<br />
symboliques contenant quelque chose de plus intime que le parfum même de leurs corolles.<br />
décennies 1830_1839<br />
48
On voit qu'il s'est fait ce qu'il est, de lui-même, sans effort, et par la vertu de sa puissante<br />
intuition. Lui-même a procédé par initiation successive à sa propre lumière ; il a commencé<br />
par le spontané de deux fables dans lesquelles le monde ancien et le monde moderne lui ont<br />
fourni, comme à son insu, deux types pleins de grandeur ; et alors cette pensée, d'abord<br />
confuse, et pareille à l'exposition d'un grand drame, est devenue une pensée réfléchie,<br />
lumineuse, intégrale, dans l'Essai sur les [79] Institutions, puis dans la Palingénésie, pour<br />
s'épanouir, splendide, dans l’Orphée, cette œuvre inimitable dont le mérite littéraire survivrait<br />
à la pensée philosophique qui l'a produite. Orphée est en effet le point central de toute cette<br />
poésie, c'est l'épopée sociale, l'épopée de la muse civilisatrice. Le poète a comme une seconde<br />
vue des générations éteintes, comme une prophétie du passé ; il marque le passage de l'âge<br />
héroïque à l'âge humain, donne, sous la formule poétique, l'histoire idéale des premières<br />
évolutions de l'esprit humain dans les temps antiques, évoque enfin le monde primitif au<br />
souffle palingénésique et au flambeau d'une singulière érudition.<br />
M. Ballanche a remarqué dans l'histoire du genre humain des sortes de haltes régulières, des<br />
époques obscures dans lesquelles le monde est en travail d'une nouvelle réalisation de la vérité<br />
sociale. Il a essayé de marquer le dégagement successif de cette vérité, apparaissant au jour<br />
après avoir brisé l'enveloppe laborieuse qui recouvre la civilisation. [80] Comme Hegel et son<br />
disciple Ganz, il raconte l'esprit humain, à ses époques primitives, sortant de l'enveloppement<br />
oriental où règne et pèse le despotisme religieux, pour entrer dans le développement<br />
démocratique, produit d'une époque plus avancée; il dévoile le secret de la hiérarchie des<br />
castes antiques, et fait suivre de l'œil l'émancipation du plébéianisme sur les patriciats<br />
orgueilleux et dégénérés.<br />
Cela est surtout admirable pour le monde romain, c'est Vico incomparablement agrandi. Dans<br />
sa préoccupation de cette idée que le monde est la grande cité, et que la cité n'est que la forme<br />
symétrique du monde, le véritable microcosme, comme disaient les anciens, renfermant en lui<br />
tous les éléments qui font l'univers, M. Ballanche s'attache à l'histoire romaine, que les<br />
travaux des Allemands postérieurs à Vico lui ont permis d'approfondir, et il cherche à<br />
symboliser cette histoire dans une formule qu'il lui semble possible d'appliquer soit aux autres<br />
nations en particulier, soit aux développements [81] et à la durée du monde entier. C'est là<br />
qu'on trouve cette idée profondément religieuse du monde considéré comme la cité mystique,<br />
telle qu'elle était conçue par le sentiment religieux des premiers Romains, quand leurs augures<br />
enfermaient la cité dans des murailles consacrées., et circonscrivaient dans le ciel, avec le<br />
bâton augurai, les limites du templum, ou de l'enceinte sacrée : haute et antique conception,<br />
selon laquelle la cité est le symbole de l'univers, et l'univers lui-même est considéré comme le<br />
temple dont la terre est l'autel, et l'homme le prêtre.<br />
Il a montré l'évolution sociale dans l'histoire du passé; il a, dans son élégie, représenté ce<br />
moment de transition, ce malaise qui saisit les peuples dans leurs jours de fin et de<br />
renouvellement, où les croyances sociales s'éteignent pour être remplacées par de nouvelles<br />
croyances, où une partie des hommes vit encore dans le passé, pendant que l'autre s'avance<br />
dans l'avenir : maintenant le poète se répand dans cet avenir qu'il regarde et pressent comme<br />
accompli ; il suppose l'esprit humain [82] parvenu à ce haut degré de perfectionnement qu'il a<br />
rêvé ; et alors, comme un commencement d'organisation de cet état, il fonde la ville des<br />
expiations, haute conception que nous ne connaissons encore que par fragments, et dont voici<br />
l'idée générale. Le monde est purifié, la peine de mort est abolie : que faire des criminels ? Eh<br />
bien, qu'ils soient placés dans une ville où, subissant la dernière épreuve, ils seront ramenés à<br />
la vertu de laquelle ils sont déchus, où le châtiment sera un moyen de réforme, où ils<br />
marcheront avec la cité universelle vers le bien, le bien qui finira par envelopper d'un réseau<br />
décennies 1830_1839<br />
49
doux et involontaire l'espèce humaine entière parvenue à son sommet palingénésique. Ainsi se<br />
développe un régime pénitentiaire à la perfection duquel ne parviendront jamais ceux qui<br />
s'occupent de cette partie si intéressante et si vive de l'économie sociale.<br />
Et afin que l'immense conception de M. Ballanche soit entièrement accomplie, afin que l'on<br />
ne puisse se tromper sur la portée chrétienne de sa conception du progrès humain, [84] suivezle<br />
dans la vision d'Hébal. Là, passant dans une revue rapide, et comme sous l'influence du<br />
vertige et de l'extase, l'histoire universelle de la race humaine, et se projetant dans l'avenir<br />
infini, voilà le théosophe qui achève sa pensée, et se perd dans la contemplation des temps<br />
derniers où la perfection indéfinie de la terre sera devenue la perfection infinie du ciel. Ici,<br />
cette pensée ramenée au christianisme achève de s'engloutir dans les visions apocalyptiques,<br />
ainsi qu'elle avait pris pour son point de départ le premier chapitre de la Genèse et la<br />
promesse de la rédemption. On comprend un système de perfectibilité qui parle de se réaliser<br />
dans l'homme religieux, dans l'homme immortel. M. Ballanche appartient dans ses<br />
développements à l'école de Vico ; mais sa philosophie s'est entée sur une tige chrétienne. Le<br />
principe religieux ne l'embarrasse pas comme Vico, il n'a pas hâte d'en sortir, il s'y enferme au<br />
contraire, et dans ce cercle il trouve une dilatation immense, qui toujours s'élargit, à mesure<br />
que les races humaines [83] marchent dans le temps et s'accroissent dans la lumière. Disciple,<br />
dans l'origine, du théosophe de Maistre, Ballanche a repoussé du pied la barrière trop étroite<br />
dont celui-là étouffait la liberté du disciple et son besoin d'air, sa soif d'espace infini. En<br />
admettant avec de Maistre la sublime solidarité qui fait la vertu du sacrifice chrétien, il pense<br />
que ce dernier sacrifice a tout accompli ; que désormais ce n'est pas du sang qu'il faut, mais<br />
l'oblation de l'intelligence et du cœur. Il pense que le christianisme a brisé la chaîne de fer<br />
dont les cultes antiques avaient muré les consciences humaines ; et déjà on sent, à chaque<br />
page de cet ami de l'humanité, tressaillir l'hymne qu'il prépare pour le jour où la peine de mort<br />
abolie deviendra la plus haute, et non pas encore la définitive initiation à laquelle l'espèce<br />
humaine sera parvenue.<br />
Le point de départ de M. Ballanche est autrement pur que celui de Herder : il a rompu tout-àfait<br />
avec le naturalisme antique; et, bien que son imagination fertile emprunte à [85] cette<br />
nature de brillantes couleurs, l'homme qu'il envisage, ce n'est pas l'homme sortant par l'art et<br />
la puissance des siècles d'une nature inférieure, mais jaillissant à la parole de Dieu, son corps<br />
du limon, son âme du souffle divin. Ballanche s'est donc placé dans le centre vivant des<br />
antiques traditions chrétiennes. Ce qui distingue surtout notre philosophe de Herder, c'est la<br />
pensée beaucoup plus religieuse et plus élevée qui semble le rapprocher de l'illuminisme de<br />
<strong>Saint</strong>-Martin, à part des ténèbres mystiques qui altèrent ce dernier théosophe ; c'est la base<br />
chrétienne qui supporte toutes ses théories idéales, cette loi première, universelle, de<br />
l'initiation douloureuse par laquelle chaque homme, chaque peuple, le monde entier ont passé,<br />
passeront dans leurs phases de renouvellement ; c'est l'idée primitive de L'ÉPREUVE et de<br />
L'EXPIATION, idée sainte qui a sa racine dans celle de la chute et de la réintégration de<br />
l'homme, et qui forme le double tissu de la vie de l'homme ici-bas, jusqu'à ce que, la [86]<br />
dernière épreuve étant consommée, l'humanité subisse sa définitive transformation, pour être<br />
de là tout entière transfigurée et renouvelée dans le ciel. La philosophie de Ballanche est<br />
calme, assurée, pleine d'avenir. Ne croyez pas que le bruit des révolutions qui vient, aussi lui,<br />
le heurter dans sa retraite, et contrister son âme placide et méditative, l'épouvante sur le sort<br />
de l'humanité ; non, il y voit plutôt l'espérance du progrès ; car c'est à la société qu'il a été dit,<br />
comme à la première femme : « Tu enfanteras avec douleur. » Et sait-il si du sein de ces<br />
commotions violentes ne sortira pas le rayon consolateur qui doit rasséréner la terre, et<br />
accélérer la marche progressive de l'humanité, de manière à la transporter, comme dans un<br />
tourbillon, de 'sommets en sommets, en lui épargnant la fatigue d'un pas-à-pas journalier ?<br />
décennies 1830_1839<br />
50
Parmi les théoriciens du passé et de l'avenir social, nul ne s'est mis au premier plan comme M.<br />
Ballanche; nul n'a parlé avec cette foi, cette candeur; nul n'a revêtu un plus [87] grand nombre<br />
de vérités de ce style que l'on oserait appeler évangélique, tant il s'y montre une force<br />
intérieure et cachée, sous l'empreinte d'une diction doucement colorée, sereine, persuasive,<br />
pleine de conviction.<br />
M. Ballanche a des rivaux, il n'a pas de maîtres. M. Cousin a la pensée plus puissante; sa<br />
parole aussi, comme son regard, ébranle et déconcerte ; c'est un torrent qui suffit à déraciner<br />
les chênes, mais s'il n'a pas triomphé soudainement, il passe, il ne revient plus. M. Ballanche<br />
est un fleuve majestueux qui ne passe et ne tarit jamais, qui vous charme par les mille<br />
accidents qu'il reflète, qui vous environne de ses flots rafraîchissants dans lesquels il y a<br />
plaisir à descendre, tant la sérénité parfaite de son âme se déploie dans son éloquence, et se<br />
montre comme le sable pur sous la surface étincelante d'une eau tranquille, constamment<br />
dorée par le soleil.<br />
§ III<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
51
MORTEMART-BOISSE (le baron). Histoire, voyage et scènes intimes. Paris, 1834, in-8.<br />
- mentionné à titre de curiosité, rappelons que le martinisme fait parfois référence à Amélie de<br />
Boisse-Mortemart…<br />
Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften: Nebst ihrer ... Page<br />
179 de Wilhelm Traugott Krug 1834<br />
... (le philosophe inconnu). ... écriture dite gothique…<br />
Affichage du livre entier<br />
Angelus Silesius und <strong>Saint</strong>-martinAuszüge - Page 232 de Johann Scheffler, <strong>Louis</strong> <strong>Claude</strong> de <strong>Saint</strong>-Martin – 1834 Le livre rouge,<br />
L'Aurore naissante. Traduit de l'allemand de Jacob Böhme par le Philosophe inconnu. Paris, 1800. 2 vols. ...<br />
Page 150<br />
... DE M. DE SAINT -<strong>MARTIN</strong>, FAIT PAR LUI-MÊME.<br />
1. J'ai été gai; mais la gaieté, n'a été qu'une nuance secondaire de mon caractère; ...<br />
Page 155<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 158<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 160<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 164<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 166<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 168<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 169<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 170<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 171<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 177<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 181<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 183<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 184<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 185<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 186<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 187<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page <strong>19</strong>8<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 201<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 202<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 203<br />
... DUN MANUSCRIT DE SAINT -<strong>MARTIN</strong>. ...<br />
Page 208<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 209<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
décennies 1830_1839<br />
52
Page 212<br />
PENSÉES EXTRAITES D'UN MANUSCRIT DE SAINT-<strong>MARTIN</strong>.<br />
2. Réjouis -toi lorsque Dieu t'éprouve, c'est un signe évident qu'il ne ...<br />
Page 216<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 2<strong>19</strong><br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 221<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 226<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 231<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 232<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Liste des Ecrits de lcsm<br />
Des Erreurs et de la Vérité. Par un Phi . . . inc . . . 1775. Edimbourg, 1782. 2 vols. Traduit par<br />
M Claudius Breslau, 1782.<br />
Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et l'Univers. Edimbourg, 1782.<br />
2 volumes. Deutsch von einem Ungenannten Reval et Leipzig, 1783. 1785.<br />
L'Homme de désir. Lyon, 1790. Metz, 1802. Traduit par Adolf Wagner Leipzig, 1813.<br />
Ессе Нomo Paris, 1792. 'Deutsch von einem Ungenannten, Leipzig, 18<strong>19</strong>.<br />
Le Nouvel Homme. Paris, 1796.<br />
Lettre à un ami etc. sur la révolution française. Paris, 1796.<br />
Eclair sur l'association humaine. Paris, 1797<br />
Le Crocodile, ou la guerre du bien et du mal. Poème épico-magique (en prose). Paris, 1798.<br />
Essai relatif à la question proposée par l'institut: déterminer l'influence des signes sur la<br />
formation des idées. Paris, 1799. 1801.<br />
De l'esprit dos choses. Paris, 1800. 2, vols. Deutsch von Schubert, Leipzig, 1811. 1812.<br />
Le livre rouge, s. a.<br />
L'Aurore naissante. Traduit de l'allemand de Jacob Böhme par le Philosophe inconnu. Paris,<br />
1800. 2 vols.<br />
Discours en réponse au citoyen Garat sur l'existence d'un sens moral etc. Paris, 1801.<br />
Le cimetière d'Amboise. Paris, 1801.<br />
Le Ministère de l'Homme-Esprit. Paris, 1802.<br />
Des trois principes de l'essence divine. Par Jacob Böhme. Paris, 1802. 2 vols.<br />
Oeuvres posthumes de M. de St. Martin. Tours, 1807. 2 vols.<br />
Munster 1833.<br />
Quarante questions sur l'âme. Par Jacob Böhme. Paris, 1807.<br />
De la triple vie de l'Homme. Par Jacob Böhme<br />
Page 150 (273)<br />
Avec un portrait DE M. DE SAINT -<strong>MARTIN</strong>, FAIT PAR LUI-MÊME.<br />
L’auteur agrémente le texte de réflexions, parfois de traductions très intéressantes.<br />
Page 203<br />
PENSÉES TIRÉES D UN MANUSCRIT DE SAINT -<strong>MARTIN</strong>.<br />
INCONSÉQUENCES.<br />
Il y a des hommes qui croient en Dieu, et qui cependant ne veulent pas qu'il y ait d'autres<br />
principes que les faits. D'après leur doctrine, il faudrait que leur Dieu même ne fût que le<br />
résultat des faits. C'est une extrême inconséquence. Je veux bien néanmoins leur accorder que<br />
décennies 1830_1839<br />
53
Dieu est le résultat d'un fait, mais c'est d'un fait qui se fait lui-même, et qui, comme tel, est le<br />
principe de tous les faits.<br />
Affichage du livre entier<br />
Voir dossier et pages déjà diffusées sur une autre décennie<br />
décennies 1830_1839<br />
54
Economie politique chrétienne ou recherches sur la nature et les causes du ... Page 139 de<br />
Alban de Villeneuve-Bargemont 1834 1764 pages<br />
ÉCONOMIE POLITIQUE CHRÉTIENNE, OU RECHERCHES SUR LA NATURE ET<br />
LES CAUSES DU PAUPÉRISME.<br />
TOME PREMIER.<br />
PARIS. : PAULIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR…<br />
Livre I<br />
… [138] Madame de Staël, dans son admirable ouvrage sur l'Allemagne, peint à grands traits<br />
les principaux caractères des deux sectes philosophiques.<br />
« C'est en vain, dit-elle, qu'on veut se réduire aux jouissances matérielles ; l'âme revient de<br />
toutes parts. »<br />
« Tout ce qui est visible parle en nous de commencement et de fin, de décadence et de<br />
destruction; une étincelle divine est seule en nous l'indice de l'immortalité. »<br />
« Il n'y a plus de nature spirituelle dès qu'on l'unit tellement à la nature physique que ce n'est<br />
plus que par respect humain qu'on les distingue encore. Cette métaphysique n'est conséquente<br />
que lorsqu'on en fait dériver, comme en France, le matérialisme fondé sur les sensations, ou la<br />
morale fondée sur l'intérêt. La théorie abstraite de ce système est née en Angleterre. <strong>Les</strong><br />
métaphysiciens français avaient établi que les objets extérieurs étaient le mobile de toutes les<br />
impressions. D'après cette doctrine rien ne devait être plus doux que de se livrer au monde<br />
physique et de l'inviter comme un convive à la fête de la nature. Mais, par degrés, la source<br />
intérieure s'est tarie, et jusqu'à l'imagination, qu'il faut pour le luxe et pour les plaisirs, va se<br />
flétrissant à tel point qu'on n'aura plus bientôt assez d'âme pour goûter un bonheur<br />
quelconque, si matériel qu'il soit. »<br />
« Un abîme sépare ceux qui se conduisent par le calcul, de ceux qui sont guidés par le<br />
sentiment. »<br />
« Quand on veut s'en tenir aux intérêts, aux convenances, aux lois du monde, le génie, la<br />
sensibilité, l'enthousiasme agitent péniblement notre âme. »<br />
« Ce n'est pas assurément pour les avantages de cette vie, pour assurer quelques jouissances<br />
de plus à quelques jours d'existence, et retarder un peu la mort de quelques moments, que la<br />
conscience et la religion nous ont été données. C'est pour que les créatures en possession du<br />
[139] libre arbitre choisissent ce qui est juste, en sacrifiant ce qui est probable, préfèrent<br />
l'avenir au présent, l'invisible au visible, et la dignité de l'espèce humaine à la conservation<br />
même des individus. »<br />
« La morale fondée sur l'intérêt serait aussi évidente qu'une vérité mathématique, qu'elle<br />
n'exercerait pas plus d'empire sur les passions qui foulent aux pieds tous les calculs. Il n'y a<br />
qu'un sentiment qui puisse juger d'un sentiment. Quand l'homme se plaît à dégrader la nature<br />
humaine, qui donc en profitera? »<br />
décennies 1830_1839<br />
55
« Quelque effort que l'on fasse, il faut en revenir par reconnaître que la religion est le véritable<br />
fondement de la morale. C'est l'objet sensible et réel au dedans de nous qui seul peut<br />
détourner nos regards des objets extérieurs. » Un philosophe spiritualiste, moins connu qu'il<br />
ne mériterait de l'être (1) 14 , a, ce semble, jeté à son tour de [140] grandes lumières sur ces<br />
hautes questions qui intéressent si vivement l'ordre social. »<br />
« Il y a des êtres, dit-il, qui ne sont qu'intelligents ; il y en a qui ne sont que sensibles.<br />
L'homme est à la fois l'un et l'autre : voilà le mot de l'énigme. Ces différentes classes ont<br />
chacune un principe d'action différent. L'homme seul les réunit tous les deux, et quiconque<br />
voudra ne les pas confondre sera sûr de trouver la solution de toutes les difficultés. »<br />
« Depuis la dégradation primitive, l'homme s'est trouvé revêtu d'une enveloppe corruptible,<br />
parce qu'étant composée, elle est sujette aux différentes actions du sensible qui n'opère que<br />
sensiblement, et qui, par conséquent, se détruisent les unes les autres. Mais, par cet<br />
assujettissement au sensible, il n'a point perdu sa qualité d'être intelligent ; en sorte qu'il est à<br />
la fois grand et petit, mortel et immortel. Toujours libre dans l'intellectuel, mais lié dans le<br />
corporel par des circonstances indépendantes de sa volonté, en un mot, étant un assemblage<br />
de deux natures diamétralement opposées, il en démontre alternativement les effets d'une<br />
manière si distincte, qu'il est impossible de s'y tromper. Si l'homme actuel n'avait que des<br />
sens, ainsi que des systèmes humains le voudraient établir, on verrait toujours le même<br />
14 (1) S. Martin, auteur des Erreurs et de la Vérité, ou les hommes rappelés au principe<br />
universel de la science, par un philosophe inconnu ; de l’Ecce homo; du Tableau naturel des<br />
rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers ; de l'Homme de désir, etc.<br />
S. Martin pensait que les hommes sont naturellement bons ; mais il entendait, par la nature,<br />
celle qu'ils avaient originairement perdue, et qu'ils pouvaient recouvrer par leur bonne<br />
volonté; car il les jugeait, dans le monde, plutôt entraînés par l'habitude vicieuse que par la<br />
méchanceté.<br />
Ce philosophe reconnut les desseins terribles de la Providence dans la révolution française, et<br />
crut voir un grand instrument temporel dans l'homme qui vint plus tard la comprimer. Il prit la<br />
défense de la cause, du sens moral contre Garat, professeur de la doctrine du sens physique,<br />
on de l'analyse de l'entendement humain. Son but était d'expliquer la nature par l'homme, et de<br />
ramener toutes nos connaissances au principe dont l'esprit humain peut être le centre. « La<br />
nature actuelle, dit-il, déchue et divisée d'avec elle-même, et d'avec l'homme, conserve dans<br />
ses lois comme dans plusieurs de ses facultés, une disposition à rentrer dans l'unité originelle.<br />
Par ce double rapport, la nature se met en harmonie avec l'homme, de même que la nature se<br />
coordonne à son principe. » Il pensait qu'il y a une raison à tout ce qui existe, et que l'œil<br />
interne de l'observateur en est le juge ; il considérait l'homme comme ayant en lui un miroir<br />
vivant qui lui réfléchit tous les objets, et qui le porte à tout voir et a tout connaître. Mais ce<br />
miroir vivant étant lui-même un reflet de la Divinité, c'est par cette lumière que l’homme<br />
acquiert des idées saines, el découvre l’éternelle lumière dont parle Jacob Bœhm.<br />
L'objet de son ouvrage intitulé Ecce homo, est de montrer à quel degré d'abaissement l'homme<br />
infirme est déchu. On y trouve cette belle expression : « l'âme de l'homme est primitivement<br />
une pensée de Dieu. »<br />
décennies 1830_1839<br />
56
caractère dans toutes ses actions, et ce serait celui des sens, c'est-à-dire qu'a l'égal de la bête,<br />
toutes les fois qu'il serait excité par ses besoins corporels, il tendrait avec effort à les<br />
satisfaire, sans jamais résister à aucune de leurs impulsions, si ce n'est pour céder à une<br />
impulsion plus forte provenant d'une source analogue. »<br />
[141] « Pourquoi donc l'homme peut-il s'écarter de la loi des sens ? Pourquoi peut-il se refuser<br />
à ce qu'ils lui demandent ? Pourquoi, pressé par la faim, est-il néanmoins le maître de refuser<br />
les mets les plus exquis qu'on lui présente ? de se laisser tourmenter, dévorer, anéantir même<br />
par le besoin, et cela, à la vue de ce qui serait le plus propre à le calmer ? Pourquoi, dis-je, y<br />
a-t-il dans l'homme une volonté qu'il peut mettre en opposition avec nos sens, s'il n'y a pas en<br />
lui plus d'un être? Et deux actions si contraires peuvent-elles tenir à la même source ? »<br />
« En vain on m'objecterait à présent que quand la volonté agit ainsi, c'est qu'elle est<br />
déterminée par quelque motif. J'ai assez fait entendre, en parlant de liberté, que la volonté de<br />
l'homme étant cause elle-même, devait avoir le privilège de se déterminer seule et sans motif,<br />
autrement elle ne devrait pas prendre le nom de volonté. Mais en supposant que, dans le cas<br />
où il s'agit, sa volonté se déterminât en effet par un motif, l'existence des deux natures de<br />
l'homme n'en serait pas moins évidente, car il faudrait toujours chercher ce motif ailleurs que<br />
dans l'action de ses sens, puisque sa volonté la contrarie ; puisque lors même que son corps<br />
cherche toujours à exister et à vivre, il peut vouloir le laisser souffrir, s'épuiser et s'éteindre.<br />
Cette double action de l'homme est donc une preuve convaincante qu'il y a en lui plus d'un<br />
principe. »<br />
Un auteur élégant, qui a su parer d'une douce lumière et des formes les plus gracieuses les<br />
aspérités, arides ou confuses de la science, vient, dans un ouvrage très remarquable (1), de<br />
donner un nouvel appui à ces notions que la raison et le sentiment s'accordent à proclamer<br />
comme infaillibles.<br />
(1) De l'Education des mères de famille, ou de la Civilisation du genre humain par les<br />
femmes, par M. Aimé Martin,<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
57
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik Page 343 de Societät für wissenschaftliche Kritik, Berlin 1834<br />
Page 339<br />
... in welchem die reine Mystik Objektiv wird, andrerseits <strong>Saint</strong>-Martin, in welchem die Mystik durch die<br />
wiederkehrende Reflexion auf das Subject, ...<br />
Page 343<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 344<br />
... und <strong>Saint</strong>-Martin, zage. Als Handschrift. ...<br />
Page 351<br />
Vom Tode kommt <strong>Saint</strong>-Martin auf das Krens: bezieht sich ausdrücklich auf seine Erfahrung, wenn schreibt: S.<br />
167. C'est par expérience çue je peux dire que ...<br />
Page 354<br />
Ein Herze noller Gott mit einem Leib voll Leiden, T/tu l um am betten kund den Weg zu cw'geii Freuden. Aber<br />
<strong>Saint</strong>-Martin mit seinem in Tränen und Verhei- ...<br />
Page 355<br />
Auch insofern ist sie die Vorläuferin der spekulativen Theologie. Auch in <strong>Saint</strong> -Martin finden sich dazu<br />
Belege: solche finden sich...<br />
.<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
58
Encyclopédie des gens du monde: répertoire universel des sciences, des ... Page 601 1834 Article<br />
Boehm<br />
BŒHME ou Boehm (Jacques), théosophe allemand et auteur mystique très célèbre, né en<br />
1575 dans un village de la haute Lusace. Fils de pauvres paysans, il fut réduit jusqu'à l'âge de<br />
10 ans, sans instruction aucune, à faire le métier de pâtre. Au milieu des forêts et des<br />
montagnes, en face d'une nature imposante, l'imagination de cet enfant se développa avec une<br />
prodigieuse vivacité. Il trouvait un sens caché à toutes ces voix du désert ; son âme pieuse y<br />
croyait entendre la parole de Dieu, et il prêtait l'oreille à une révélation qu'il croyait<br />
directement lui être adressée. Ses parents lui firent apprendre l'état de cordonnier, métier qu'il<br />
exerça plus tard à Görlitz. Loin d'étouffer sa tendance mystique, cette occupation sédentaire<br />
ne fit qu'accroître ses goûts contemplatifs. Pendant sa tournée de compagnonnage, il parait<br />
s'être abandonné en plein à ses rêves religieux. Sévère, zélé pour les bonnes mœurs, renfermé<br />
en lui-même, les uns le trouvaient orgueilleux, les autres le prenaient pour un fou. Ce<br />
jugement était inévitable : toute éducation scientifique manquant à Bœhme, comment ses<br />
pensées philosophiques ou religieuses, imparfaitement communiquées à d'autres, n'auraientelles<br />
pas été obscures, confuses, dénuées de logique ? Son sens intime, religieux, était vrai,<br />
sans doute; mais longtemps séparé des hommes, il avait fini par voir les objets extérieurs à<br />
travers le prisme trompeur de la solitude.<br />
De retour à Görlitz, en 1594, il se maria. Bon époux, bon père, il n'en fut pas moins<br />
visionnaire; il parait même que, tourmenté parla répétition décès rêves que son âme,<br />
singulièrement affectée, attribuait à l'influence du <strong>Saint</strong>- Esprit, il se décida enfin à prendre la<br />
plume. Son premier ouvrage, intitulé Aurora, écrit en 1610, publié en 1612, contient ses<br />
révélations sur Dieu, l'homme et la nature. On y reconnaît l'étude assidue de la Bible,<br />
spécialement de l'Apocalypse, vers laquelle il se sentait mystérieusement attiré. Le clergé<br />
intolérant de Görlitz, en condamnant l'Aurora, répandit le nom de Boehm dans toute<br />
l'Allemagne, et lui valut la visite et le patronage île beaucoup d'hommes marquants. A partir<br />
de 16<strong>19</strong>, il publia une trentaine de traités, parmi lesquels nous ne citerons que la Description<br />
des trois principes de l'essence divine. Elle contient ses vues sur la divinité, la création, la<br />
révélation, le péché, le tout basé sur l'Écriture-<strong>Saint</strong>e, entremêlé de fantasmagories poétiques,<br />
où la métaphore remplace presque toujours l'idée, où l'enchaînement des idées est<br />
dithyrambique. Cette manière de procéder, Bœhme l'attribue à une illumination divine, à une<br />
révélation qui est, selon lui, le sine qua non de toute connaissance Mais sous une enveloppe<br />
bizarre se trouve cachée, sans contredit, plus d'une belle pensée religieuse qui, dégagée de son<br />
attirail mystique, ne déparerait pas les livres des plus grands philosophes. <strong>Les</strong> dernières<br />
années de Bœhme furent en butte aux attaques des théologiens. Son traité Sur le repentir,<br />
imprimé à son insu par ses amis, y avait donné lieu. L'auteur se rendit lui-même à Dresde (en<br />
1724), pour faire examiner sa doctrine. La cour le protégea; mais, à peine de retour chez lui, il<br />
mourut rempli de cette foi chrétienne qui fait l'essence de tous ses ouvrages. Abraham de<br />
Frankenberg, son disciple et son ami, a commenté ses ouvrages, qui ne parurent complets<br />
qu'en 1682, en 10 volumes, à Amsterdam, sous la direction de Gichtel, qui a donné son nom à<br />
une secte religieuse fort inoffensive, professant les doctrines de Bœhme. Une autre édition<br />
parut à Amsterdam, en 1730, sons le litre de Theologia revelata, 2 volumes, in-4°. L'aurore, la<br />
Triple vie et les Trois Principes de Jacob Boehm ont été traduits en français par L. Cl. de<br />
<strong>Saint</strong>-Martin. <strong>Les</strong> doctrines de Boehm se sont répandues en Angleterre; William Law traduisit<br />
le premier les ouvrages du théosophe saxon. Il existe encore de nos jours une secte appelée<br />
philadelphique, fondée en 1697 par Jane Leade, femme enthousiaste qui révérait Bœhme à<br />
l'instar d'un saint. Enfin, un médecin anglais, nommé John Pordage, s'est fait connaître comme<br />
commentateur de Jacob Boehm. C. L Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
59
Revue des deux mondes Page 627 1834<br />
Ce lien ne fonctionne plus ce jour !<br />
… un article Alchimie, de M. Gilbert, l'ancien ami et éditeur du théosophe <strong>Saint</strong>-Martin. ...<br />
La recherche nouvelle introduite donne :<br />
Page 712<br />
Article de <strong>Saint</strong>e-Beuve<br />
… [712] L'influence des écrits de M. Ballanche a été lente, mais réelle, croissante, et très<br />
active même dans une certaine classe d'esprits distingués. Pour n'en citer que le plus<br />
remarquable exemple, la lecture de ses Prolégomènes, vers 1828, contribua fortement à<br />
inspirer le souffle religieux à l'école, encore matérialiste alors, de <strong>Saint</strong>-Simon. Témoin de<br />
l'effet produit par cette lecture sur quelques-uns des plus vigoureux esprits de l'école, je puis<br />
affirmer combien cela fut direct et prompt. L'influence, du reste, n'alla pas au-delà de cette<br />
espèce d'insufflation religieuse. Historiquement, l'école saint-simonienne partit toujours de ce<br />
que M. Ballanche appelle l'erreur du XVIIIe siècle, erreur admise par Benjamin Constant luimême<br />
; elle persista à voir le commencement de la société dans le sauvagisme, comme lui,<br />
Benjamin Constant, commençait la religion par le fétichisme. M. Ballanche est peut-être<br />
l'homme de ce temps-ci qui a eu à la fois le plus d'unité et de spontanéité dans son<br />
développement. Sans varier jamais autrement que pour s'élargir autour du même centre, il a<br />
touché de côté beaucoup de systèmes contemporains et, pour ainsi dire, collatéraux du sien; il<br />
en a été informé plutôt qu'affecté, il a continué de tirer tout de lui-même. La doctrine de <strong>Saint</strong>-<br />
Martin semble assurément très voisine de lui, et pourtant, au lieu d'en être aussi imbu qu'on<br />
pourrait croire, il ne l'a que peu [713] goûtée et connue. Je remarque seulement dans les<br />
Prolégomènes le magisme de la parole, le magisme de l'homme sur la nature, expressions qui<br />
doivent être empruntées du mystérieux théosophe. M. Ballanche connut de bonne heure à<br />
Lyon Fourier, auteur des Quatre Mouvements ; mais il entra peu dans les théories et les<br />
promesses de ce singulier ouvrage publié en 1808; aujourd'hui il se contente d'accorder à<br />
l'auteur une grande importance critique en économie industrielle. Il lut les Neuf Livres de<br />
Coëssin dès 1809, et dans un voyage qu'il fit à Paris, il visita ce prophète d'une époque<br />
pontificale ; mais l'esprit envahissant du sectaire le mit d'abord sur ses gardes, M. Ballanche<br />
voulait avant tout rester lui-même. Il vit une fois Hoëné Wronski, lequel, dans son Prodrome,<br />
revendique l'honneur d'avoir le premier émis en 1818 une vue politique que l'Essai sur les<br />
Institutions exprimait en même temps que lui. M. Ballanche vit plus d'une fois, bien que<br />
rarement, Fabre d'Olivet dont les idées l'attiraient assez, s'il ne les avait senties toujours<br />
retranchées derrière une science peu vérifiable et gardées par une morgue qui ne livre jamais<br />
son dernier mot. Il a profité pourtant des écrits originaux de ce philosophe qui aurait pu se<br />
passer d'être charlatan; l'idée d'Adam, l'homme universel, et d'Eve qui est la faculté volitive<br />
d'Adam, lui a probablement été suggérée par Fabre. <strong>Les</strong> hommes qui ont le plus agi sur M.<br />
Ballanche, mais par contradiction surtout, sont MM. de Bonald, de Maistre et de La Mennais.<br />
Ce dernier, ainsi que l'abbé Gerbet, est devenu son ami, et la contradiction première a cessé<br />
bientôt dans une conciliation que le christianisme qui leur est commun rend solide et<br />
naturelle.<br />
Pour nous qui n'approchons qu'avec respect de tous ces noms, et qui ne les quittons qu'à<br />
regret, il faut nous arrêter pourtant. Heureux si, à défaut d'une exposition complète de<br />
système, cette étude de biographie psychologique a insinué à quelques-uns la connaissance,<br />
ou du moins l'avant-goût, d'un homme dont la noble ingénuité égale la profondeur, et si cette<br />
décennies 1830_1839<br />
60
explication intérieure et continue que nous avons cherché à démêler en lui peut servir de<br />
prolégomènes en quelque sorte à ses prolégomènes ! Préparer à la lecture de notre auteur, c'est<br />
là en général dans les essais que nous esquissons, et ce serait dans celui-ci en particulier, notre<br />
plus entière récompense. SAINTE-BEUVE.<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
61
Mémoires sur la cour de <strong>Louis</strong> XVI et la société française: avant 1789 - Page 76 de<br />
Baronne d'Oberkirch, Henriette <strong>Louis</strong>e von Waldner Oberkirch, Léonce de Montbrison<br />
– 1834<br />
Voir décennie précédente où le texte est développé<br />
… [76] Mme la duchesse de Bourbon croyait non-seulement au magnétisme, mais à la<br />
sympathie et aux pressentiments. La princesse parlait souvent de Martinez Pasqualis, ce<br />
théosophe, ce chef d'illuminés, qui a établi une secte et qui se trouvait à Paris en 1778. Elle l'a<br />
beaucoup vu, beaucoup écouté; elle est martiniste ou à peu près. Elle reçoit dans son cabinet,<br />
et fort souvent, M. de <strong>Saint</strong>-Martin, l'auteur des rapports entre Dieu, l'homme et l'Univers. Ce<br />
livre a fait sensation dans les sectes. Une chose très-étrange à étudier, mais très-vraie, c'est<br />
combien ce siècle-ci, le plus immoral qui ait existé, le plus incrédule, le plus<br />
philosophiquement fanfaron, tourne, vers sa fin, non pas à la foi, mais à la crédulité, à la<br />
superstition, à l'amour du merveilleux.<br />
…<br />
Il est possible de suivre les liens suivants pour 1834<br />
Page 66<br />
<strong>Saint</strong>-Martin. — Le magnétisme. — Étrange fatuité de Vestris. — M. <strong>Saint</strong>-Huberti. —<br />
Fontainebleau. — La veille de la présentation. ...<br />
Page 76<br />
Elle reçoit dans son cabinet, et fort souvent, M. de <strong>Saint</strong>-Martin, l'auteur des rapports entre<br />
Dieu, l'homme et l'Univers. Ce livre a fait sensation dans ...<br />
Page 323<br />
Table des matières<br />
...<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
62
1835<br />
Essai sur l'histoire de la philosophie en France au dix-neuvième siècle Page 341 de Philibert<br />
Damiron 1835<br />
Voir 1832 et 1834<br />
<strong>Les</strong> tableaux comparatifs avec les variantes seraient les bienvenus.<br />
Page 49<br />
Elle aurait eu peine à compter quelques métaphysiciens dans ses rangs ; ce ne serait pas <strong>Saint</strong>-Martin, le<br />
philosophe inconnu, qui ...<br />
Page 256<br />
(2) <strong>Saint</strong>-Martin dit à peu près la même chose. ...<br />
Page 340<br />
... et, dans son transport plein d'ardeur, il s'égare dans sa propre pensée, pour se relever ensuite riche d'idées<br />
généreuses et hautes. » SAINT-<strong>MARTIN</strong> ...<br />
Page 341<br />
Bel article sur lcsm<br />
SAINT-<strong>MARTIN</strong>, (LE PHILOSOPHE INCONNU), Né en ...<br />
Il est au reste difficile en parlant de <strong>Saint</strong>-Martin de le rattacher avec analogie à l'une ou l'autre des écoles dont<br />
il est question dans cet Essai : c'est ...<br />
Page 342<br />
(i) Voici comment M. de Maistre s'explique sur les Illuminés en général, et sur <strong>Saint</strong>-Martin en particulier ; il<br />
peut être curieux de voir ce qu'il en ...<br />
Page 344<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 345<br />
En sa position et à son époque, <strong>Saint</strong>-Martin fut certainement une exception extrêmement rare. On conçoit sans<br />
peine comment, dans de telles dispositions ...<br />
Page 346<br />
... cela dans <strong>Saint</strong>-Martin, c'était une intelligence mystique, merveilleusement propre en conséquence à recevoir<br />
les impressions des maîtres qu'il écouta. ...<br />
Page 347<br />
Tel fut <strong>Saint</strong>-Martin jusqu'à la fin de ses jours ; dévoué à ses travaux avec un calme, un désintéressement et une<br />
constance admirables. ...<br />
Page 348<br />
<strong>Saint</strong>-Martin énonce à peu près en ces termes ce dogme déjà obscur d'une ontologie toute mystique : Autrefois<br />
l'homme avait une armure impénétrable, ...<br />
Page 349<br />
C'est dans le livre des erreurs et de la vérité, le principal des ouvrages de <strong>Saint</strong>-Martin, celui dans lequel il<br />
philosophe le plus (car ...<br />
Page 350<br />
Il est assez curieux de voir quelle politique <strong>Saint</strong>-Martin déduit de ces données. Si les hommes étaient restés<br />
dans leur pureté primitive, il n'y aurait ...<br />
Page 353<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 354<br />
Pour achever de donner une idée de l'espèce de philosophie qu'on trouve dans les ouvrages de <strong>Saint</strong>-Martin,<br />
nous rapporterons un morceau extrait d'un ...<br />
Page 355<br />
Voila pourquoi <strong>Saint</strong>-Martin dit quelque part que l'homme n'est qu'une pensée de Dieu, pensée qu'il peut laisser<br />
s'obscurcir et s'altérer, mais qu'il peut ...<br />
décennies 1830_1839<br />
63
Page 356<br />
Ajoutons que, si l'on voulait suivre le système de M. <strong>Saint</strong>-Martin dans sa partie physique et mathématique, on<br />
n'y ...<br />
Page 357<br />
Il va sans dire qu'en plaçant <strong>Saint</strong>-Martin à la fin de l'école théologique, nous ne suivons pas l'ordre de date, car<br />
à ce compte il serait en tête ; c'est ...<br />
Page 360<br />
328 <strong>Saint</strong>-Martin. ...<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
64
Revue de Rouen et de Normandie Page 254 de Société des émules, Rouen 1835<br />
Le terme émules me paraît particulièrement intéressant… Relire les lettres de<br />
Martinès…<br />
Page 253<br />
PHILOSOPHIE RELIGIEUSE.<br />
— 1er -volume : SAINT-<strong>MARTIN</strong>. — Rouen, Nicétas Periaux.<br />
— Se trouve chez Frère, Legrand, etc.<br />
Ceci est un livre de bonne foi. Cette publication n'est, ni une spéculation d'argent, ni une<br />
spéculation de vanité ; elle n'a qu'un seul but : faire fructifier dans l'âme des lecteurs la parole<br />
de <strong>Saint</strong>-Martin, comme elle a fructifié dans l'âme de son abréviateur. Pourquoi faut-il que<br />
notre reconnaissance soit réduite à soupçonner le bienfaiteur sous le voile de l'anonyme ?<br />
Sans doute l'abréviateur du Philosophe inconnu s'est répété ces paroles de son maître : « J'ai<br />
désiré de faire du bien, mais je n'ai pas désiré de faire du bruit, parce que j'ai senti que le bruit<br />
ne faisait pas de bien, comme le bien ne faisait pas de bruit ?"» Rien de plus juste que cette<br />
maxime en une foule de circonstances ; mais toute règle à ses exceptions, et un beau nom n'est<br />
pas inutile à une bonne œuvre ; il la rend plus fructueuse, en lui communiquant quelque chose<br />
de sa popularité.<br />
Peu de temps avant de mourir, <strong>Saint</strong>-Martin disait :<br />
Je sens que je m’en vais ; la Providence peut m'appeler, je suis prêt : les germes que j'ai<br />
tâché de semer fructifieront. Je rends grâce au ciel de m'avoir accordé la dernière faveur que<br />
je lui demandais. »<br />
Certainement, l'homme de désir devait souhaiter un disciple loyal et fervent qui le traduisit à<br />
l'intelligence des masses, qui fit luire à leurs yeux la lumière cachée dans les nuages<br />
impénétrables dont il avait trop souvent eu le tort de s'environner. Après plus de trente ans, ce<br />
service vient enfin de lui être rendu : on peut espérer que désormais <strong>Saint</strong>-Martin, mis à la<br />
portée, sinon de tous, du moins du plus grand nombre, ne sera plus le philosophe inconnu.<br />
Tout en rendant justice au zèle et aux excellentes intentions de son abréviateur, nous<br />
avouerons que nous ne l'avons pas, sans quelque étonnement, entendu affirmer que, depuis<br />
1807, il n'avait été question de ce philosophe nulle part, si ce n'est dans quelques écrits de M.<br />
<strong>Saint</strong>e-Beuve. Non, l'homme qui, selon sa propre expression, avait jeté une pierre au front du<br />
sensualisme, n'a pas été oublié à ce point par ceux qui de nos jours ont combattu, comme lui,<br />
quoiqu'avec d'autres armes, cette triste et sèche philosophie. M. Cousin (cours de 1829, leçon<br />
13), observant que, même dans la dernière moitié du dix-huitième siècle, le sensualisme<br />
Page 254<br />
n'a pas régné sans opposition, ajoute : « il est juste de reconnaître que jamais le mysticisme n'a<br />
eu en France un représentant plus complet, un interprète plus profond, plus éloquent, et qui ait<br />
exercé plus d'influence que <strong>Saint</strong>-Martin. » Et M. Damiron, dans son Essai sur l'Histoire de la<br />
Philosophie en France, au dix-neuvième siècle (deuxième édition), consacre un article assez<br />
long à l'exposition de la doctrine de ce philosophe.<br />
Nous ne voudrions pas ajouter au trouble tardivement inspiré à l'auteur anonyme de cet<br />
opuscule, au sujet de l'orthodoxie de <strong>Saint</strong>-Martin : nous devons lui dire, cependant, que ces<br />
doutes ne sont pas nouveaux, et nous lui rappellerons, sans avoir la prétention de décider cette<br />
question, ce que disait M. de Maistre ( Soirées de <strong>Saint</strong>-Pétersbourg, t. II, p. 332 ) : « Le plus<br />
instruit, le plus sage et le plus élégant des théosophes modernes, <strong>Saint</strong>-Martin, dont les<br />
décennies 1830_1839<br />
65
ouvrages furent le code des hommes dont je parle (des illuminés) participait à caractère<br />
général de leurs doctrines (aversion pour toute autorité et hiérarchie sacerdotales). Ses<br />
ouvrages présentent la preuve la plus claire qu'il ne croyait pas à la légitimité du sacerdoce<br />
chrétien. »<br />
Du reste, M. de Maistre reconnaît qu'il y a, dans les ouvrages de ces illuminés en général et en<br />
particulier dans ceux de <strong>Saint</strong>-Martin, des choses vraies, raisonnables et touchantes. Il suffira,<br />
pour s'en convaincre, de parcourir rapidement, ou même d'ouvrir au hasard le précieux recueil<br />
que nous signalons à l'attention de nos lecteurs<br />
H.<br />
Sur L’imprimeur de la revue de Rouen et de l’ouvrage sur lcsm : « M. Nicétas Periaux ne<br />
pouvait, sans péril pour son industrie d'imprimeur, braver les petits ressentiments et les<br />
colères bouffonnes de certains écrivains de haute et basse littérature normande. On m'a<br />
raconté comment il perdit le boire et le manger, en apprenant qu'un très inoffensif article de sa<br />
Revue avait été taxé de diffamation. »<br />
Revue de Rouen et de Normandie page 10 1835 tome cinquième<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
66
Histoire générale de la philosophie ancienne et moderne jusqu'a nous jours Page 280 de<br />
Sylvestre Guillon Mar-Mie 1835<br />
[280]<br />
3°. ÉCOLE ÉCLECTIQUE.<br />
A sa tête, nous plaçons l'auteur du livre des Erreurs et de la vérité (Lyon, 1775. 1 vol. in-8°),<br />
et d'autres productions marquées du même caractère, M. de SAINT-<strong>MARTIN</strong>, distingué par<br />
le nom de philosophe inconnu. Ce n'est ni un catholique, ni même précisément un chrétien,<br />
dans le sens vulgaire du mot; mais il a [281] des dogmes communs avec les Chrétiens et les<br />
Catholiques. On pourrait le compter indifféremment parmi les gnostiques ou les illuminés,<br />
affectant de paraître en rapport avec le monde spirituel, s'élevant de grade en grade jusqu'aux<br />
connaissances les plus sublimes : prétention des éclectiques d'autrefois, tels qu'ils dominaient<br />
à Alexandrie, se composant un système de doctrines choisies ailleurs.<br />
Affichage du livre entier<br />
Histoire générale de la philosophie ancienne et moderne jusqu'à nos jours Page 308 de<br />
Marie Nicolas Silvestre Guillon 1835<br />
Même texte que ci-dessus, autre pagination<br />
Oeuvres de F. Rabelais Page 438 de François Rabelais 1835 677 pages<br />
Paroles gelées, 273. <strong>Saint</strong>-Martin le théosophe a usé de cette fiction dans son livre intitulé<br />
le Crocodile, ou de la guerre du bien et du mal.<br />
Déjà commenté décennie précédente.<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
67
Réponses aux questions de philosophie contenues dans le programme adopté ... de<br />
Antoine Charma 1835 203 pages<br />
… [Page 188]<br />
9. Ecoles mystiques.<br />
I. Mysticisme particulier connu sous le nom de quiétisme.<br />
-Un prêtre espagnol, MOLINOS, né dans le diocèse de Saragosse en 1627, mort en 1696 dans<br />
une prison où il passa, à cause de ses opinions, une partie de sa vie ; la célèbre madame<br />
GUYON, né à Montargis en 1648, morte à [189] Blois en 1717, après avoir été enfermée<br />
pendant quatre ans à la Bastille ; et surtout notre illustre FÉNÉLON, né au château de Fénelon<br />
en Quercy, l'an 1651, mort en 1715, et condamné par Innocent XII, ont fondé, ou pour parler<br />
plus exactement, ont renouvelé, sous un nom particulier, le premier par son livre intitulé<br />
Conduite spirituelle, la seconde par différents ouvrages tels que le Moyen court et très facile<br />
de faire oraison et les Torrents spirituels, le troisième enfin par sa fameuse Explication des<br />
Maximes des <strong>Saint</strong>s, la plupart des dogmes du mysticisme chrétien. La volonté de Dieu se<br />
proposant à la volonté de l'homme constitue pour nous le devoir. Le devoir peut être considéré<br />
soit dans les actes particuliers que produit l'agent vertueux, soit dans le motif qui le détermine<br />
à les produire. <strong>Les</strong> actes ne changent pas ; ce qui est juste sous ce point de vue a toujours été<br />
juste et le sera toujours ; mais le motif déterminant peut et doit varier. L'amour qui seul nous<br />
pousse à l'action se présente sous un triple aspect ; il est servile, quand la crainte d'un<br />
châtiment s'y mêle; mercenaire, lorsque l'espoir d'une récompense le soutient ; filial enfin,<br />
quand il est supérieur à ces deux causes intéressées ; l'amour filial, c'est l'amour pur. Arrivée à<br />
ce dernier état, l'âme humaine n'a plus qu'à contempler, dans une quiétude parfaite, le Dieu<br />
auquel elle s'unit. Le moi s'efface ; comme sainte Catherine de Gênes, le quiétiste n'a plus<br />
d'autre moi que Dieu. —<br />
II. Mysticisme connu sous le nom de théosophie.<br />
- JEAN-BAPTISTE VAN HELMONT, né à Bruxelles en 1577, mort à Vienne en 1644,<br />
médecin enthousiaste, faisait provenir toute connaissance et toute sagesse de l'intuition<br />
immédiate de la divinité et de la lumière reçue passivement par la raison. Il composa une<br />
physiologie spiritualiste, dans laquelle il reconnaît un archeum ou principe qui engendre les<br />
objets de la nature par ses transformations ou combinaisons diverses.<br />
- FRANÇOIS-MERCURE VAN HELMONT, son fils, né en 1618, mort en 1699, prétendit<br />
réunir, dans un système que contiennent ses Opuscula philosophica et son Seder olam sive<br />
ordo sœculorum, les plus pures doctrines du platonisme, de la cabbale et du christianisme.<br />
- ROBERT FLUDD, savant médecin, né à Milgat, dans le comté de Kent, en 1574, mort en<br />
1637, combina les idées enthousiastes de Paracelse avec les livres de Moïse ; son livre est<br />
intitulé : Historia macro –et- microscomi metaphysica, physica et technica.<br />
- Le cordonnier JACQUES BOHME, né à Alt-Seidenberg, près Görlitz, en 1574, mort en<br />
1624, forma un amalgame d'idées théologiques avec les principes théosophiques et la<br />
terminologie médicale. Ses œuvres, recueillies en 4 volumes in-8°, ont été traduites en<br />
hollandais, en anglais et en français. Ses principaux ouvrages sont : l'aurore naissante, les<br />
Quarante questions, la triple vie. Il avait acquis une telle réputation en Angleterre, que le roi<br />
Charles 1er envoya à Görlitz l'avocat Jean Sparrow, homme d'une vertu rare et d'un grand<br />
talent, pour apprendre à fond l'allemand et se mettre en état de traduire parfaitement les<br />
œuvres de Boehm en anglais.<br />
- JEAN PODARGE, prédicateur et médecin, né vers 1625, mort à Londres en 1698, rédigea<br />
en système les extravagances théosophiques de Böhme, et prétendit avoir reconnu la vérité de<br />
ses idées dans des visions qu'il avait eues lui-même. Un de ses ouvrages a été imprimé à<br />
Amsterdam, en 1698, sous ce titre : Theologia mystica [<strong>19</strong>0] sive arcana mysticaque doctrina<br />
de invisibilibus, œternis, etc., non rationali arte, sed cognitione intuitif a descripta.<br />
décennies 1830_1839<br />
68
- Henri MORE, collègue de Cudworth, né en 1614, mort en 1687, en étant venu à douter de sa<br />
propre personnalité individuelle, finit par embrasser le néoplatonisme de Plotin, auquel il<br />
associa la cabbale. Voici les titres de quelques uns de ses ouvrages : Conjectura cabbalistica<br />
in tria prima capita exesos ; — Trium tabularum cabbaliiticarum decem Sephiroth ; —<br />
Questiones et considerationes in tractation primum libri Druschim.<br />
- POIRET, né à Metz, en 1646, mort en 17<strong>19</strong>, après avoir débuté par le cartésianisme, crut<br />
tirer des principes de Descartes la démonstration de l'action immédiate de Dieu et des esprits<br />
sur l'humanité ; et soutint les doctrines mystiques dans le traité De eruditione triplici, solida<br />
superficiaria et falsa; et dans un ouvrage écrit contre Locke : Fides et ratio collatœ ac suo<br />
utraque loco redditœ. Il donna une édition de quelques uns des livres de madame Guyon, et<br />
publia en dix-neuf volumes tous les écrits à une autre femme enthousiaste née à Lille, en<br />
1616, morte à Francker en 1616, et qui se nommait ANTOINETTE BOURIGNON.<br />
- EMMANUEL SWEDENBORG, né en Suède, l'an 1689, d'un père évêque luthérien, se<br />
distingua d'abord comme mathématicien, physicien et astronome et mécanicien; il était<br />
membre des Académies de Stockholm, d'Upsal et de <strong>Saint</strong>-Pétersbourg. Le roi de Suède<br />
l'ayant nommé assesseur à l'Ecole des mines, il visita les mines de Saxe, de Suède, d'Autriche<br />
et de Hongrie. Tous ses travaux dans les sciences naturelles l'avaient amené à reconnaître<br />
dans le monde visible une harmonie parfaite, et par conséquent le disposaient aux idées<br />
religieuses. <strong>Les</strong> ouvrages de Boehm durent aussi avoir sur son imagination une action<br />
puissante. Ce qui détermina complètement sa vocation, ce fut une vision qu'il eut à Londres<br />
en 1743 - Le ciel, l'enfer, le monde des esprits lui furent, pour ainsi dire, ouverts, et il<br />
s'entretenait sans cesse, non seulement avec ses amis morts, mais avec les grands hommes de<br />
tous les lieux et de tous les temps. Il s'établit alors comme médiateur entre le monde visible et<br />
le monde invisible, et il écrivit, sous la dictée du Seigneur, ses œuvres théologiques, qui, à<br />
côté des bizarreries les plus étranges, laissent percer partout les signes non équivoques d'une<br />
raison éclairée et d'une haute vertu. Il mourut, avec la réputation d'un saint, des suites d'une<br />
attaque d'apoplexie, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Il avait dans sa jeunesse publié un recueil<br />
de poésies latines sous le titre de Carmina miscellanea; plus tard, et comme savant, il donna<br />
son Doedalus hyperboreus, ses Opera philosophica et mineralogica, son Oeconomica regni<br />
animalis, et ses Principia rerum naturalium; enfin, et comme mystique, il produisit, entre<br />
autres traités, ses Arcana cœlestia de coelo et inferno, et les livres De equo albo,De nova<br />
Hierosolyma et ejus doctrina cœlesti, De commercio animœ et corporis, et une Apocalypsis<br />
explicata.<br />
- SAINT-<strong>MARTIN</strong>, dit le Philosophe inconnu, naquit à Amboise, d'une famille noble, en<br />
1743- Il fut initié au mysticisme par les martinistes, secte que venait de fonder et que dirigeait<br />
Martinez Pasqualis; et il se livra avec eux à toutes les folies de la théurgie et à la recherche du<br />
grand œuvre. <strong>Les</strong> livres de Böhme achevèrent de l'illuminer : Böhme était, selon lui, la plus<br />
grande lumière humaine qui eût jamais paru. <strong>Saint</strong>-Martin, après avoir vécu dans une<br />
profonde obscurité, [<strong>19</strong>1] mourut, en 1803, d'une attaque d'apoplexie, au village d'Aulnay. Ses<br />
principaux ouvrages portent les titres qui suivent : 1° Des erreurs et de la vérité, ou les<br />
hommes rappelés au principe universel de la science ; 2° Tableau naturel des rapports qui<br />
existent entre Dieu, l'homme et l'univers, avec cette épigraphe tirée de l'ouvrage précédent : «<br />
Expliquer les choses par l'homme, non l'homme par les choses ; » 3° l'Homme de désir ; 4°<br />
Ecce homo ; 5° Nouvel homme; 6° De l'esprit des choses, avec cette épigraphe : « Mens<br />
hominis rerum universalitatis speculum est » 7° le Crocodile ou la guerre du bien et du mal<br />
arrivée sous le règne de <strong>Louis</strong> XV, poème épico-magique en 102 chants, mêlé de prose et de<br />
vers ; enfin il a traduit en français quelques uns des ouvrages de Böhme. Quelques lignes<br />
extraites du livre des Erreurs et de la vérité donneront une idée de la forme énigmatique sous<br />
laquelle cette philosophie s'enveloppe : « Autrefois l'homme avait une armure impénétrable,<br />
et il était muni d'une lance composée de 4 métaux et qui frappait toujours en 2 endroits à la<br />
décennies 1830_1839<br />
69
fois ; il devait combattre dans une forêt formée de 7 arbres, dont chacun avait 16 racines et<br />
<strong>19</strong>0 branches; il devait occuper le centre de ce pays ; mais s'en étant éloigné, il perdit sa<br />
bonne armure pour une autre qui ne valait rien ; il s'était égaré en allant de 4 à 9; il ne pouvait<br />
se retrouver qu'en revenant de 9 à 4 » Cependant ce n'est pas toujours dans ce style que <strong>Saint</strong>-<br />
Martin écrit, et on trouve de temps à autre, dans ses livres, des pages remarquables à la fois<br />
par l'originalité de la pensée et par l'élégance du style.<br />
§ 10. Sceptiques.<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
70
France pittoresque: ou description pittoresque, topographique et statistique ... Page 99<br />
de Abel Hugo 1835<br />
France pittoresque département d’Indre et Loire ci-devant Touraine<br />
Lorsque CESAR fit la conquête des Gaules, la Touraine était habitée par les Turones peuples<br />
guerriers qui entrèrent dans la ligue formée par Vercingétorix, <strong>Les</strong> Turones donnèrent leur<br />
nom au pays ainsi qu'à sa capitale. Sous Honorius, cette province fut comprise dans la<br />
troisième Lyonnaise. — De la domination romaine, elle passa sous celle des Visigoths en 475,<br />
puis des Francs en 507, et fut gouvernée longtemps par des comtes particuliers, qui,<br />
d'amovibles qu'ils étaient d'abord, se rendirent plus tard héréditaires, à condition néanmoins<br />
de réversion à la couronne, faute d'hoirs mâles ou en cas de félonie. — Geoffroi Martel,<br />
comte d'Anjou, s'en empara en 1044, sous prétexte qu'elle avait fait partie du domaine de ses<br />
prédécesseurs, et la transmit à ses descendants, comtes d'Anjou et rois d'Angleterre. — Mais<br />
Philippe-Auguste en prit possession eu 1202, comme des autres fiefs confisqués sur Jeansans-Terre.<br />
— Jean Ier érigea la Touraine en duché-pairie en 1356, en faveur de Philippe son<br />
fils, depuis duc de Bourgogne. Elle servit dès lors d'apanage à plusieurs fils de France, et<br />
même à des reines. Marie Stuart, devenue veuve de François II, fut nommée duchesse de<br />
Touraine; mais de son vivant même la province lui fut enlevée et donnée en apanage au frère<br />
de Henri III, François, duc d'Alençon, après la mort duquel elle fut pour toujours réunie à la<br />
couronne.<br />
Avant la division par départements, en 1790, la Touraine formait une des trente-deux<br />
provinces ou grands gouvernements de France, et donnait son nom à une des vingt-cinq<br />
généralités, qui comprenait, outre cette province, l’Anjou, le Maine et une partie du Bas-<br />
Poitou.<br />
ANCIENNES MONNAIES.<br />
— Tours possédait un hôtel des monnaies qui fut supprimé eu 1772. Cet hôtel était après celui<br />
de Paris le plus ancien de France, quoique Tours, par sa lettre distinctive E, n'occupât que le<br />
cinquième rang. Toutes les pièces frappées à Tours s'appelaient jadis Tournois (nom, qui se<br />
retrouve fréquemment dans les anciens titres), de même qu'on appelait Parisis celles<br />
fabriquées à Paris. La monnaie de Tours existait déjà du temps des Romains. Bouterone a fait<br />
graver quelques-unes des pièces qui y avaient été frappées, dans son Traité des monnaies de<br />
France. On en frappait encore sous les rois de la première race, et Grégoire de Tours rapporte<br />
un miracle arrivé de son temps à l'occasion de la femme d'un monnayeur de Tours. Cette ville<br />
n'était pas d'ailleurs la seule de la province qui eut le privilège de battre monnaie. De vieux<br />
titres prouvent qu'on en a frappé à Loches et à Chinon. Il existe encore quelques monnaies de<br />
Chinon, sur lesquelles on lit : Caïno Castrum, et qui semblent appartenir au règne de <strong>Louis</strong>d'outre-Mer.<br />
ANTIQUITÉS.<br />
Le département renferme quelques antiquités druidiques, parmi lesquelles ou remarque les<br />
dolmens de Marcilly, de <strong>Saint</strong>-Antoine-du-Rocher, de Charnizay et de Crouzille. — On voit à<br />
Ferrières des restes d'une forge et quelques pierres celtiques. Le village de Louans, dont toutes<br />
les habitations sont construites en terre, soutenues par des traverses de bois et couvertes en<br />
chaume, offre l'aspect d'un de ces bourgs (pagus) qui renfermaient les habitations des Gaulois.<br />
— Dans la plaine de Champeigne, se trouvent deux monticules qui, d'après la tradition,<br />
auraient servi de limites aux états de Clovis roi des Francs, et d'Alaric roi des Visigoths.<br />
Quelques auteurs prétendent que ces tumulus étaient des tombeaux ; en effet la plaine où ils se<br />
trouvent a été plusieurs fois le théâtre de sanglants combats. — Il existe, comme monument<br />
de l'alliance qui unit pendant quelque temps Clovis et Alaric, d'anciens sous d'or frappés à<br />
décennies 1830_1839<br />
71
Amboise en 505 ; d'un côté on y voit l'effigie du roi des Francs, et de l'autre une croix. Outre<br />
des autels, des fragments de colonnes et de sculptures, des médailles, des vases, des<br />
ustensiles, des statuettes découvertes en différentes localités, on trouve parmi les monuments<br />
qui appartiennent à l'époque romaine des vestiges de voies militaires (à <strong>Saint</strong>-Avertin, à<br />
Noizay, à <strong>Saint</strong>-Lenoch et Barou-sur-Creuse), de camps (à Boussay et à Cinais), d'aqueducs (à<br />
Chambourg). — On a longtemps montré à Tours, comme étant le tombeau de Turnus, auquel<br />
on attribuait la fondation de cette ville, un bloc de pierre long de 9 pieds, et large de 2, sans<br />
aucune inscription, mais orné de sculptures, et qui parait avoir appartenu à la frise de<br />
quelques-uns des édifices que les romains avaient élevé dans cette ville.<br />
C’est dans le département que se trouve, près du village de Miré, le champ de bataille où<br />
Charles Martel, en 732, défit les sarrasins commandés par Abdérame, et près de Bourgueil<br />
celui où en 990, Hugues Capet remporta une victoire signalée sur Guillaume de Poitiers, dit<br />
Fier-à-Bras. – l’ancienne église de <strong>Saint</strong>e-Catherine de Fierbois était celle où, en 1429, Jeanne<br />
d’Arc envoya chercher dans le tombeau d’un ancien chevalier l’épée de Charles Martel ; elle a<br />
été démolie sous François 1 er , et remplacée par une église nouvelle, joli monument de la<br />
renaissance.<br />
On rencontre dans la Touraine, conservés en ruines, un grand nombre de châteaux riches en<br />
souvenirs historiques, tels sont : Plessis-les-Tours, triste demeure du sombre <strong>Louis</strong> XI,<br />
Amboise, qui [98] rappelle le souvenir de <strong>Louis</strong> XII, cher au peuple, et où éclata celte<br />
conspiration dont le but était de renverser la puissance des Guises ; Chanteloup, célèbre par<br />
l'exil du comte de Choiseul, et dont il ne reste plus aujourd'hui que la fameuse pagode ;<br />
Chenonceau, dont nous parlons plus loin avec détails; Chàteau-La-Vallière qui fui érigé en<br />
duché-pairie en faveur de la maîtresse de <strong>Louis</strong> XIV ; Montbazon, où Charles VII tint sa cour<br />
pendant quelque temps; Semblançay, successivement habité par trois rois de France, et dont<br />
l'infortuné propriétaire fut pendu à Montfaucon; Rochecorbon, dont il ne reste qu'un haut<br />
pilier, vulgairement appelé, à cause de son ancien usage de transmettre des signaux de nuit,<br />
lanterne de Rochecorbon ; Loches,où l'on voyait encore en 1789 les deux cages de fer où<br />
furent renfermés l'historien Commines et le cardinal de La Balue ; Verneuil, qui est, dit-on, le<br />
plus bel édifice moderne du pays ; Paulmy, résidence de la famille d'Argenson, avant qu'elle<br />
eût embelli la terre des Ormes ; Chinon, où l'on montre encore la chambre où Jeanne d'Arc<br />
vint trouver Charles VII; Ussé, qui fut, dit-on, le château du sir Jehan de <strong>Saint</strong>ré, dont les<br />
amours avec la dame des Belles-Cousines sont si naïvement racontées dans les écrivains du<br />
moyen-âge, et ont été si spirituellement rajeunies par le comte de Tressan; enfin, une foule<br />
d'autres forts du moyen-âge, dont l'énumération serail trop longue : nous mentionnerons<br />
cependant encore le château de Cinq-Mars, qui a appartenu à l'infortuné favori de <strong>Louis</strong> XIII,<br />
et le monument singulier qui en est voisin, dont un grand nombre d'antiquaires se sont<br />
vainement efforcés de deviner l'origine et la destination.— La Pile de Cinq-Mars, située à 4<br />
lieues de Tours, sur la route de Saumur, est une tour quadrangulaire, dont la largeur est de 4<br />
m. 38 cent, sur chaque face, et la hauteur totale de 32 m. 43 cent. : ce monument, entièrement<br />
construit en briques de la plus grande dimension, était autrefois surmonté de cinq petits piliers<br />
placés au sommet et aux angles ; il n'en reste plus que quatre, celui du milieu ayant été<br />
renversé en 1751 par un ouragan; sa construction a été successivement attribuée aux Celtes,<br />
aux Goths et aux Romains; quelques mosaïques grossières ornent son sommet méridional.<br />
L'opinion la plus commune parait être que cet édifice est un tombeau ou mausolée élevé à la<br />
mémoire de cinq personnes désignées par les cinq piliers qui le surmontent.<br />
CARACTÈRE, LANGAGE, ETC.<br />
S'il faut en croire le nouvel historien de la Touraine M. Chalmel, « Cet esprit actif et<br />
entreprenant qui produit les succès et les fortunes manque à l'habitant du département d'Indreet-Loire.<br />
Modéré dans ses goûts, exempt de passions fortes, rarement stimulé par ce sentiment<br />
décennies 1830_1839<br />
72
ambitieux qui porte aux grandes entreprises, il s'arrête au point où commence pour lui une<br />
aisance honnête, et les exceptions en ce genre ne sont pas très communes. Il est d'ailleurs d'un<br />
caractère doux, affable, prévenant, quoique naturellement un peu frondeur.<br />
Né avec beaucoup d'esprit, il néglige peut-être trop de le cultiver, et de remplacer par des<br />
connaissances positives ce qui lui manque en imagination. Si la Touraine a produit des<br />
hommes recommandables dans les lettres et dans les arts, il en est fort peu dont les ouvrages<br />
aient été marqués au coin du génie. L'esprit, les mœurs, le caractère, tout en général y porte<br />
l'empreinte douce et molle du climat. On ne sera donc point surpris qu'elle n'ait encore offert<br />
aucun poète, dans la rigoureuse acception de ce mot, c'est-à-dire réunissant la verve et<br />
'invention ; nous n'en exceptons pas même Racan. Un Fait assez remarquable, c'est que les<br />
meilleurs poètes nés sous son climat sont des poètes latins, tels que Rapin, Commire, etc. En<br />
citant ce passage, nous trouvons que l'historien tourangeau a été sévère pour ses compatriotes.<br />
Le pays qui a produit autrefois Rabelais et Descartes, celui qui de nos jours a fourni à la jeune<br />
littérature Alfred de Vigny et Balzac, méritait à notre avis d'être mieux traité. Ce que dit<br />
l'auteur, du caractère doux et facile des habitants du pays, est confirmé par les opinions des<br />
observateurs de tous les temps et de tous les pays. — On s'accorde à trouver que le Tasse,<br />
dans cette strophe de sa Jérusalem, a bien peint le caractère des peuples des bords de la Loire<br />
et de l'Indre :<br />
Non è gente robusta o faticosa,<br />
Soben hint di ferro ella riluce.<br />
La terra molle, e lieta, e dilettosa,<br />
Simili a se gli habitatori produce :<br />
Impeto fa nelle battaglie prime,<br />
Ma di leggier poi langue, e si reprime.<br />
(Quoique couvert d'armures où le fer brille, ce n'est point un peuple robuste et dur aux<br />
fatigues. — La terre d'où il vient, molle, agréable, délicieuse, produit des habitants qui lui sont<br />
semblables. — Impétueux au début d'une bataille, leur élan bientôt se ralentit, languit et<br />
s'arrête.)<br />
Le long séjour que la cour des rois de France a fait sur les bords de la Loire a complètement<br />
popularisé la langue nationale. — On y parle français purement et sans accent. Le costume<br />
des habitants des campagnes, sauf quelques coiffures plus ou moins bizarres adoptées par les<br />
jeunes coquettes des villages des bords de la Loire, n'offre rien de particulièrement<br />
remarquable.<br />
NOTES BIOGRAPHIQUES.<br />
La Touraine s'honore d'avoir produit un grand nombre d'hommes pieux dont les vertus ont été<br />
honorées de la canonisation. Elle a donné un pape à l'Église catholique, <strong>MARTIN</strong> IV, né à<br />
Reignac, et un roi à la France, CHARLES VIII, né à Amboise. Elle a produit des illustrations<br />
dans tous les genres. On remarque parmi ses hommes de guerre plusieurs maréchaux de<br />
France, tels que les BOUCICAUT, les d'EFFIAT, les D'HUMIÈRES, les ROCHEFORT, et<br />
des généraux qui se sont distingués pendant les guerres de la République et de l'Empire :<br />
l'héroïque MEUSNIER, tué à Mayence; le fameux MENOU, général en chef en Egypte;<br />
l'habile MARESCOT; le général PILLET, qui nous a si vivement retracé les horreurs<br />
commises par le gouvernement anglais sur nos malheureux prisonniers, etc., etc.<br />
— La poésie française y est représentée par RACAN et par GRÉCOURT, dont les talents et<br />
les ouvrages sont de nature si diverse. — La poésie latine, par Сommire, Rapin, Quillet, etc.<br />
— L'art dramatique y compte Néricault-Destouches, un de nos premiers auteurs comiques du<br />
second ordre, et Bouilly, notre contemporain, auteur du drame de l'abbé de l'Epée et d'une<br />
foule d'ouvrages qui ont obtenu un succès général et l'estime de tous les gens de bien. — <strong>Les</strong><br />
décennies 1830_1839<br />
73
personnages dont le département s'honore encore à divers titres, sont : le surintendant des<br />
finances SEMBLANÇAY, dont la mémoire, juridiquement réhabilitée, avait été d'avance<br />
lavée de toute souillure par de beaux vers de Clément Marot ; le célèbre curé de Meudon, le<br />
caustique RABELAIS ; le savant orientaliste CIVET ; l'illustre DESCARTES, homme de<br />
génie comme philosophe et comme mathématicien; le géographe Duchesne ; le receveur<br />
général Graslin, qui a tant contribué aux embellissements de la ville de Nantes. – le célèbre<br />
médecin Heurteloup ; le musicien Lambert, qui fit les délices de la cour de <strong>Louis</strong> XIV ;<br />
l’horloger Julien Le Roy, habile mécanicien ; l’abbé de Marolles<br />
Traducteur infatigable, grand amateur d'estampes, dont le cabinet a servi de base à la<br />
précieuse collection de la Bibliothèque royale; l'intrépide marin POINTIS, vainqueur de<br />
Carthagène; JENSON et PLANTIN, imprimeurs du XVIe siècle, célèbres dans les annales de<br />
la typographie.<br />
SAINT-<strong>MARTIN</strong>, chef de la secte des illuminés du XVIIIe siècle, longtemps caché sous le<br />
titre de Philosophe inconnu ; Beroalde de VERVILLE, auteur du Moyen de parvenir, un des<br />
livres les mieux écrits du XVIe siècle ; le peintre VIGNON, estimé au commencement du<br />
XVIIe siècle ; le baron de BRETEUIL, ministre des princes français à Coblentz et pendant<br />
l'émigration ; la marquise de LA FERANDIÈRE, dont les poésies fugitives sont remplies de<br />
grâce et de délicatesse, etc. — Enfin, le pays qui avait produit Agnès Sorel pour Charles VII,<br />
a fourni Gabrielle d'Estrées à Henri IV et La Vallière à <strong>Louis</strong> XIV.<br />
Parmi les contemporains, outre les noms que nous avons déjà cités, nous mentionnerons<br />
encore Alfred DE VIGNY, auteur du beau roman de Cinq-Mars, jeune poète qu'une verve<br />
soutenue, un talent gracieux et un style pittoresque, placent à côté d'André Chénier;<br />
BALZAC, écrivain original dont les compositions philosophiques et les ouvrages<br />
d'imagination obtiennent un succès si mérité; CHALBIEL, auteur d'une bonne Histoire de<br />
Touraine ; BRETONNEAU, médecin distingué par ses connaissances scientifiques ; G. DE<br />
LA BILLENERIE, ancien magistrat, connu par divers ouvrages de jurisprudence et par une<br />
Histoire critique des Jésuites, publiée à l'époque de leur toute-puissance, et qui a obtenu un<br />
grand succès.<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
74
Volupté Page 179 de Charles Augustin <strong>Saint</strong>e-Beuve 1835 291 pages<br />
… [264] Mais pour revenir aux lectures dont je vous parlais celle qui contrastait sans doute le<br />
plus avec le tourbillon agité de cette crise, et qui me rappela un moment assez haut vers la<br />
région invisible, avait pour objet quelques écrits d'un théosophe que j'aime à vous citer<br />
souvent, parce qu'il a beaucoup influé sur moi. Le livre Des Erreurs et de la Vérité et<br />
L'Homme de Désir, m'apportèrent avec obscurité plusieurs dogmes précieux, mêlés et comme<br />
dissous au milieu de mystiques odeurs. Une Réponse de <strong>Saint</strong>-Martin à Garat, que j'avais<br />
trouvée dans le Recueil des Ecoles Normales me renvoya à ces deux ouvrages dont j'avais<br />
déjà feuilleté le premier à Couaën, mais sans m'y arrêter.<br />
Cette Réponse elle-même où le sage énonce ses principes le plus simplement qu'il a jamais<br />
fait, cette manière calme et fondamentale, si opposée en tout à l'adresse de langage et, comme<br />
l'auteur les désigne, aux brillantes fusillades à poudre de l'adversaire, ce ton prudent, toujours<br />
religieux à l'idée, me remettaient aisément en des voies de spiritualisme ; car, sur ce point,<br />
j'étais distrait et égaré plutôt que déserteur. Une vérité entre autres m'y toucha sensiblement, et<br />
fit révélation en moi ; C'est l'endroit où il est dit que “ l'homme naît et vit dans les pensées ”.<br />
Bien des vérités qu'on croit savoir de reste et tenir, si elles viennent à nous être exprimées<br />
d'une certaine manière imprévue, se manifestent réellement pour la première fois ; en nous<br />
arrivant sous un angle qui ne s'était pas rencontré jusqu'alors, elles font subitement étincelle.<br />
Ainsi ce mot opéra à l'instant sur moi, comme si j'avais les yeux dessillés. Toutes les choses<br />
visibles du monde et de la nature, toutes les oeuvres et tous les êtres, outre leur signification<br />
matérielle, de première vue, d'ordre élémentaire et d'utilité, me parurent acquérir la<br />
signification morale d'une pensée, - de quelque pensée d'harmonie, de beauté, de tristesse,<br />
d'attendrissement, d'austérité ou d'admiration. Et il était au pouvoir de mon sens moral<br />
intérieur, en s'y dirigeant, d'interpréter ou du moins de soupçonner ces signes divers, de<br />
cueillir ou du moins d'odorer les fruits du verger mystérieux, de dégager quelques syllabes de<br />
cette grande parole qui, fixée ici, errante là, frémissait partout dans la nature. J'y voyais<br />
exactement le contraire du monde désolant de Lamarck, dont la base était muette et morte. La<br />
Création, comme un vestibule jadis souillé, se rouvrait à l'homme, ornée de vases sonores, de<br />
tiges inclinées pleine de voix amies, d'insinuations en général bonnes et probablement<br />
peuplées en réalité d'innombrables Esprits vigilants. Au-dessous des animaux et des fleurs, les<br />
pierres elles-mêmes, dans leur empêchement grossier, les pierres des rues et des murs<br />
n'étaient pas dénuées de toute participation à la parole universelle. Mais plus la matière<br />
devenait légère, plus les signes volatils et insaisissables et plus ils étaient pénétrants.<br />
Pendant plusieurs jours tandis que je marchais sous cette impression, le long des rues désertes,<br />
la face aux nuages, le front balayé des souffles de l'air, il me semblait que je sentais en effet,<br />
au-dessus de ma tête, flotter et glisser les pensées.<br />
Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on peut être homme et tout à fait ignorer cela. On peut être<br />
homme de valeur, de génie spécial et de mérite humain et ne sentir nullement les ondulations<br />
de cette vraie atmosphère qui nous baigne ; ou, si l'on n'évite pas sans doute d'en être atteint,<br />
en quelque moment, on sait y rester glacé, s'en préserver comme d'un mauvais air, et fermer<br />
les canaux supérieurs de l'esprit à ces influences aimables qui le veulent nourrir.<br />
décennies 1830_1839<br />
75
Il est donc un grand nombre d'hommes, et d'hommes de talents divers, dont on doit dire qu'ils<br />
ne vivent jamais dans les pensées. Parmi ceux-là, il en est d'habiles à toutes les sortes<br />
d'anatomie, de logique et de tactique, aux récits des faits et des histoires, à l'observation ou à<br />
l'expression des phénomènes, et de ce premier masque qu'on appelle la réalité. Mais au-delà<br />
du sens immédiat, ne leur demandez rien des choses. Ils se sont retranchés de bonne heure sur<br />
la cime aérée, ils se sont établis dans l'étage qu'ils estiment le seul solide ; ils n'en sortent pas.<br />
Ce vide exact qu'ils font autour d'eux, par rapport à l'atmosphère divine, les appesantit et les<br />
attache avec succès à ces travaux plus ou moins ingénieux où ils excellent. Qui croirait, à voir<br />
de tels exemples, que les pensées sont l'aliment naturel des esprits? s'il en circule quelquesunes<br />
devant eux dans les conversations, ils ne s'y mêlent que pour les nier ou les restreindre,<br />
ou bien ils se taisent jusqu'à ce qu'elles soient passées. s'il leur en vient au réveil, dans le lit,<br />
par surprise, entendez leur aveu ! ils se hâtent de les secouer, non pas comme orageuses<br />
parfois, ce qui serait prudent, mais comme vagues, comme follement remuantes et importunes<br />
en tant que pensées. Quelle idée écrasée se font de la nature humaine, des hommes, rares<br />
après tout, et qui en sont eux-mêmes un ornement! Si on leur crie, comme Descartes à<br />
Gassendi : O Chair ! ils s'honorent, comme celui-ci, de l'injure, et vous répondent en raillant :<br />
O Esprit. - Que ce soit chez eux caractère, habitude ou système, remercions le Ciel d'être<br />
moins négatifs que cela, mon ami. La nourriture délicate et préparatoire des âmes est souvent<br />
la vôtre ; ne désespérez pas ! s'il convient de la tempérer dans l'usage, comme trop enivrante<br />
en cette vie et peu rassasiante sans la foi, il serait mortel de s'en sevrer.<br />
A certains moments que discerne d'abord un coeur sincère, laissons sans crainte les pensées<br />
venir, les sources d'en haut s'essayer; ouvrons-nous à cette rosée qui pleut des nuages : la<br />
Grâce elle-même n'est qu'une goutte féconde.<br />
Le soudain attrait qu'avait pour moi la lecture de <strong>Saint</strong>-Martin, me suggéra l'envie toute<br />
naturelle d'entrevoir sa personne. Je n'aurais jamais songé à l'aborder, lui si humble, à<br />
l'interroger, lui, homme de prière et de silence ; je désirais de l'apercevoir seulement. m'étant<br />
informé à son sujet auprès de mon ami l'idéologue, j'appris que, durant l'été, il vivait<br />
volontiers à Aulnay, dans la maison du sénateur Lenoir-Laroche. Un jour de septembre, à tout<br />
hasard et dans le plein de ma disposition précédente, je tentai ce petit pèlerinage : “ Si je le<br />
rencontre en quelque sentier, me disais-je, je le devinerai bien, et le doute même où je resterai<br />
ensuite ajoutera à l'effet de sa vue. ” J'allai, et par une sorte de retenue conforme à l'objet, sans<br />
vouloir questionner personne, je parcourus cet étroit vallon, ce coteau boisé, qu'il regardait, le<br />
doux vieillard comme un des lieux les plus agréables de la terre. Je rôdai aux charmilles des<br />
jardins, je crus découvrir les détours par lesquels il gravissait de préférence ; en m'asseyant au<br />
haut, je m'imaginais occuper une des places qui lui étaient familières : mais je ne fis pas de<br />
rencontre qui pût prêter à ma fantaisie. Cette course timide dans les bois, sur les traces de<br />
l'homme pieux, me laissa un intérêt, riant d'abord, bientôt solennel et consacré. Après moins<br />
de quinze jours, je sus qu'il ne se trouvait pas à Aulnay lors de ma visite, mais qu'y étant<br />
retourné depuis, il venait subitement d'y mourir.<br />
C'est peut-être plus tard quoique je veuille vous le mentionner ici, que certains endroits de<br />
Vauvenargues me causèrent une inexprimable sensation par leur convenance parfaite avec le<br />
train d'esprit et de conduite où j'étais.<br />
Page 147<br />
Ces merveilleuses histoires, que je me faisais redire dans toutes leurs circonstances, et qui<br />
s'entremêlaient aux détails de l'infatigable charité et de cet art d'aumône qui était le génie<br />
décennies 1830_1839<br />
76
propre à l'abbé Carron, trouvaient en moi une âme docile, heureuse de les admettre. J'estimais<br />
tout simple et légitime qu'il en advînt de la sorte à ces natures bienfaitrices, que n'arrêtent,<br />
dans leur essor vers le bien, ni les murailles des cachots ni les distances. Le sillon qu'elles<br />
tracent s'illumine sous leurs pas, me disais-je, tant elles ont déjà l'agilité de l'ange. L'invisible<br />
doigt écrit des lettres mystérieuses dans chaque vie ; mais il faut un certain jour céleste, un<br />
certain degré d'embrasement, pour que ces lettres se déclarent. Un miracle, ce n'est que cet<br />
éclat inopiné des lettres, d'ordinaire obscures. Dès mes précédentes excursions<br />
philosophiques, j'avais appris à reconnaître, dans le théosophe <strong>Saint</strong>-Martin, au milieu d'un<br />
encens perpétuel d'amour, de mystérieux rapports, des communications d'esprit à esprit, une<br />
vue facile à travers les interstices et les crevasses du monde visible. Toutes ces parcelles d'audelà<br />
me revenaient, et m'avertissaient que ce n'était qu'attente et vestibule en cette demeure ;<br />
je m'élevais à la signification chrétienne des choses. Nunc videmus per speculum in<br />
aenigmate.<br />
Par une singulière coïncidence que je ne puis omettre ici, le saint abbé Carron dont je vous<br />
parle, et qui, tout absent qu'il était, devint un de mes maîtres spirituels, je ne l'ai vu qu'une fois<br />
dans ma vie, mais je l'ai vu en ce cul-de-sac même des Feuillantines, près de la maison où<br />
nous nous entretenions de ses oeuvres. C'était en 1815, je crois, aussitôt après les Cent-Jours ;<br />
il arrivait d'Angleterre. Un prêtre de ses amis, peu connu alors, depuis bien illustre, l'abbé de<br />
La Mennais, était logé avec lui. Ils ne se quittèrent presque plus jusqu'à la mort du vieillard.<br />
Ainsi l'aumône et la doctrine s'étaient rencontrées ; l'éloquence tenait embrassée la<br />
miséricorde.<br />
Page 175<br />
Il y avait dans Port-Royal un esprit de contest et de querelle que je n'y cherchais pas et qui<br />
m'en gâtait la pureté. J'entrais le moins possible dans ces divisions mortes et corruptibles que<br />
l'homme en tout temps a introduites dans le fruit abondant du Christianisme. Heureux et sage<br />
qui peut séparer la pulpe mûrie de la cloison amère ; qui sait tempérer en silence Jérôme par<br />
Ambroise, <strong>Saint</strong>-Cyran par Fénelon ! Mais cet esprit contentieux, qui avait promptement aigri<br />
tout le Jansénisme au dix-huitième siècle, était moins sensible ou moins aride dans la<br />
première partie de Port-Royal réformé et durant la génération de ses grands hommes. C'est à<br />
cette ère d'étude, de pénitence, de persécution commençante et subie sans trop de murmure,<br />
que je m'attachais. Parmi les solitaires dans la familiarité desquels j'entrai de la sorte plus<br />
avant, derrière les illustres, les Arnauld, les Saci, les Nicole et les Pascal, il en est un surtout<br />
que je veux vous dire, car vous le connaissez peu, j'imagine, et pourtant, comme <strong>Saint</strong>-Martin,<br />
comme l'abbé Carron, il devint bientôt l'un de mes maîtres invisibles.<br />
Tous ont et se font plus ou moins dans la vie de tels maîtres. Mais s'il est des natures fortes<br />
qui osent davantage, qui prennent plus aisément sur elles-mêmes et marchent bientôt seules,<br />
regardant de temps en temps en arrière si on les suit, il en est d'autres qui ont particulièrement<br />
besoin de guides et de soutiens, qui regardent en avant et de côté pour voir si on les précède,<br />
si on leur fait signe, et qui cherchent d'abord autour d'elles leurs pareilles et leurs supérieures.<br />
Le type le plus admirable et divin de ces filiales faiblesses est Jean, qui avait besoin pour<br />
s'endormir de s'appuyer contre l'épaule et sur la poitrine du Sauveur. Plus tard il devint fort à<br />
son tour, et il habita dans Patmos comme au haut d'un Sinaï. - J'étais un peu de ces natures-là,<br />
premièrement infirmes, implorantes et dépareillées au milieu d'une sorte de richesse qu'elles<br />
ont ; j'avais hâte de m'attacher et de m'appuyer. Ainsi; dans le monde actif et belliqueux,<br />
décennies 1830_1839<br />
77
j'aurais été avec transport l'écuyer de Georges, l'aide de camp de M. de Couaën ; je me serais<br />
fondu corps et âme en quelque destin valeureux.<br />
Passionné de suivre et d'aller, j'aurais choisi éperdument Nemrod à défaut du vrai Pasteur. Des<br />
natures semblables, vouées envers les autres au rôle de suivantes affectueuses ou de<br />
compagnes, se retrouvent dans tous les temps et dans les situations diverses ; elles sont<br />
Héphestion aux Alexandre, elles sont l'abbé de Langeron aux Fénelon. Elles se<br />
décourageraient souvent et périraient à terre si elles ne rencontraient leur support ; Jean<br />
d'Avila se mourait d'abattement quand il fut relevé par Thérèse. Mais il en est aussi qui errent<br />
et se perdent en toute complaisance d'amitié, comme Mélanchthon qu'emmena Luther. Dans<br />
les Lettres mêmes, il est ainsi des âmes tendres, des âmes secondes, qui épousent une âme<br />
illustre et s'asservissent à une gloire :<br />
Wolff, a dit quelqu'un, fut le prêtre de Leibnitz. Dans les Lettres sacrées, Fontaine suivait<br />
Saci, et le bon Camus M. de Genève. Oh ! quand il m'arrivait d'entrer pas à pas en ces<br />
confidences pieusement domestiques, comme ma nature admiratrice et compréhensive se<br />
dilatait! comme j'aurais voulu avoir connu de près les auteurs, les inspirateurs de ces récits !<br />
Comme j'enviais à mon tour d'être le secrétaire et le serviteur des grands hommes! Ce titre<br />
d'acolyte des saints et des illustres me semblait, ainsi que dans l'Eglise primitive, constituer un<br />
ordre sacré. Après mon désappointement dernier dans les guides turbulents de ma vie<br />
extérieure, j'étais plus avide encore de me créer des maîtres invisibles, inconnus, absents ou<br />
déjà morts, humbles eux-mêmes et presque oubliés, des initiateurs sans bruit à la piété, et des<br />
intercesseurs ; je me rendais leur disciple soumis, je les écoutais en pensée avec délices.<br />
Ainsi je fis, alors pour M. Hamon, car c'est lui de qui je veux parler .<br />
M. Hamon était un médecin de la Faculté de Paris qui, à l'âge de trente-trois ans, vendit son<br />
bien et se retira à Port-Royal-des-Champs. Toujours pauvre, vêtu en paysan, couchant sur un<br />
ais au lieu de lit, ne mangeant que du pain de son qu'il dérobait sur la part des animaux, et<br />
distribuant ses repas en cachette aux indigents, sa vie fut une humilité, une mortification et<br />
une fuite continuelles. Il anéantissait sa science dont les malades seuls ressentaient les effets.<br />
On l'aurait jugé, à le voir, un homme du commun et un manant des environs; dans la<br />
persécution de 1664 contre Port-Royal, il dut à ce mépris que sa simplicité inspira, de rester<br />
au monastère à portée des religieuses captives, auxquelles il rendit tous les soins de l'âme et<br />
du corps. Cet homme de bien, consommé d'ailleurs dans les Lettres, avait pris en amitié le<br />
jeune Racine, qui était aux écoles de Port-Royal, et il se plaisait à lui donner des conseils<br />
d'études. Racine s'en souvint toujours; il apprécia cette sainteté couronnée de Dieu dans<br />
l'ombre, et, par testament, il demanda à être inhumé à Port-Royal, aux pieds de M. Hamon.<br />
Image et rétablissement du règne véritable ! O vous qui avez passé votre vie à vous rabaisser<br />
comme le plus obscur, voilà que les grands poètes, chargés de gloire, qui meurent dans le<br />
Seigneur, demandent par grâce à être ensevelis à vos pieds, selon l'attitude des écuyers fidèles<br />
!<br />
Je trouvai dans cette bibliothèque précieuse et je lus tous les écrits de M. Hamon. Ils sont<br />
négligés de composition et de style ; il se serait reproché de les soigner davantage. Il n'écrivait<br />
qu'à son corps défendant, par ordre de ses amis illustres, de ses directeurs, et leur injonction<br />
ne le rassurait pas sur son insuffisance. Il se repentait de se produire et de violer la religion du<br />
silence, qui sied disait-il, aux personnes malades et qu'il ne leur faudrait rompre que par le<br />
gémissement de la prière. La bonne opinion de ceux qu'il estimait ses supérieurs lui était<br />
comme un remords, comme un châtiment de Dieu et une crainte : “ Que sais-je si Dieu ne me<br />
décennies 1830_1839<br />
78
punit pas de ma vanité du temps passé, en permettant maintenant que mes supérieurs aient<br />
trop d'estime pour moi ! ” Il aurait dit volontiers avec le Philosophe inconnu que, par respect<br />
pour les hautes vérités, il eût quelquefois mieux aimé passer pour un homme vicieux et<br />
souillé, que pour un contemplateur intelligent qui parût les connaître : “ La grande et<br />
respectable vérité, s'écriait <strong>Saint</strong>-Martin dans un accès d'adoration, m'a toujours semblé si loin<br />
de l'esprit des hommes, que je craignais bien plus de paraître sage que fol à leurs yeux. ”<br />
M. Hamon était habituellement ainsi. Il raconte lui-même, dans une Relation ou confession,<br />
tracée à son usage, de quelques circonstances de sa vie, la première occasion qui le détermina<br />
à écrire. Avec quelle émotion n'en lisais-je pas les détails, qui me rappelaient des lieux si<br />
fréquentés de moi, des alternatives si familières à mon propre cœur !<br />
- “ La première fois, disait M. Hamon, que je vis M. de Saci, je lui demandai s'il y aurait du<br />
mal à écrire quelque chose sur quelques versets des Cantiques; il l'approuva fort, mais la<br />
difficulté était de commencer, et je ne savais comment m'y prendre. Comme j'allai à Paris, un<br />
jour que je n'avais fait que courir sans prier Dieu et dans une dissipation entière, toutes sortes<br />
de méchantes pensées ayant pris un cours si libre dans mon coeur et avec tant d'impétuosité,<br />
que c'était comme un torrent qui m'entraînait, je m'en retournais à la maison tout hors de moi,<br />
lorsque me trouvant proche l'église de <strong>Saint</strong>-Jacques dans le faubourg, j'y entrai n'en pouvant<br />
plus. Ce m'était un lieu de refuge : elle était fort solitaire les après-dîners. J'y demeurai<br />
longtemps, car j'étais tellement perdu et comme enterré dans le tombeau que je m'étais creusé<br />
moi-même, qu'il ne m'était pas possible de me retrouver. Quand je commençai d'ouvrir les<br />
yeux, la première chose que je vis fut ce verset du cantique : Sicut turris David collum tuum<br />
quae aedificata eit cum propugnaculis. Je m'y appliquai fortement, parce que j'étais fort las de<br />
moi et de mes fantômes. Comme il me sembla que cela m'avait édifié, je résolus de l'écrire,<br />
etc. ” Tout palpitant de ces lectures, j'entrais aussi dans cette église de <strong>Saint</strong>-Jacques-du-Haut-<br />
Pas : c'était celle même où j'avais entendu la messe dès le premier matin et dès le premier<br />
dimanche que j'avais passés à Paris. En songeant à ce jour de loin si éclairé, j'étais comme un<br />
homme qui remonte sa montagne jusqu'au point d'où il est parti, mais sur un rocher opposé à<br />
l'ancien : le torrent ruineux gronde dans l'intervalle. Je m'approchais en cette église vers<br />
l'endroit du sanctuaire où est le tombeau de <strong>Saint</strong>-Cyran ; M. Hamon n'avait pas manqué de<br />
s'y agenouiller avant moi, et je me répétais cette autre parole de lui : “ Il n'y a tien qui nous<br />
éloigne tant du péril qu'un bon sépulcre. ” Et quel était ce péril de M. Hamon au prix du<br />
mien?<br />
Quelles étaient ces méchantes pensées, dont il s'accusait avec tant d'amertume dans ses<br />
courses un peu distraites, au prix de l'emportement du moindre de mes assauts ? Et méditant<br />
cette parole de lui encore : “ Il faut avoir demeuré longtemps dans un désert et en avoir fait un<br />
bon usage, afin de pouvoir demeurer ensuite dans les villes comme dans un désert ”, je<br />
combinais une vie de retraite aux champs, à quelques lieues de Paris, à Chevreuse même, près<br />
des ruines labourées du monastère, ne venant de là à la grande ville qu'une fois tous les quinze<br />
jours, à pied en été, pour des objets d'étude, pour des livres à prendre aux bibliothèques, pour<br />
deux ou trois visites d'amis graves qu'on cultive avec révérence, et m'en retournant toujours<br />
avant la nuit.<br />
Je retrouvais exactement dans ces projets simples l'impression chastement puérile des temps<br />
où je rêvais d'apprendre le grec à Paris, sous un pauvre petit toit gris et janséniste, ainsi que je<br />
disais. Il semble qu'à chaque progrès que nous faisons dans le bien est attaché, comme<br />
récompense intérieure, un arrière-souvenir d'enfance qui se réveille en nous et sourit : notre<br />
jeune Ange de sept ans tressaille et nous jette des fleurs. Je sentais aussi en ces moments<br />
décennies 1830_1839<br />
79
edoubler mon affection pour ces pierres et ces rues innocentes où l'on a semé tant de pensées,<br />
où tant de réflexions lentes se sont accumulées en chemin comme une mousse, comme une<br />
végétation invisible, plus douce pourtant et plus touffue à l'oeil de l'âme que les gazons.<br />
A défaut d'établissement, l'idée de visiter, au moins en pèlerin, Chevreuse, les ruines de Port-<br />
Royal, et d'y chercher la trace des hommes révérés, ne pouvait me manquer, à moi qui avais<br />
déjà visité Aulnay, s'il vous en souvient, dans une intention semblable. Une ou deux fois<br />
donc, les jours de mes courses aux environs après les rechutes, je me dirigeai vers ce désert,<br />
prenant par Sceaux et les collines d'au-delà; mais mes pieds, n'étant pas dignes, se lassaient<br />
bientôt, ou je me perdais dans les bois de Verrières. Un simple caillou jeté à la traverse<br />
dérange tant nos plus proches espérances, que je n'exécutai jamais le voyage désiré.<br />
Qu'importe, après tout, la réalité matérielle des lieux, dès qu'un impatient désir nous les a<br />
construits? La pensée et l'image vivaient en moi; je n'ouvrais jamais un de ces livres imprimés<br />
à Cologne, avec l'abbaye de Port-Royal-des-Champs gravée au frontispice, sans reconnaître<br />
d'abord la cité de mes espérances, sans m'arrêter longtemps à ce clocher de la patrie.<br />
Au nombre des règles particulières que j'avais tirées de M. Hamon, il y en a qui ne me<br />
quittèrent plus, et qui s'ajoutèrent en précieux versets à mon viatique habituel.<br />
Tandis que j'étais si sensible à l'idée des lieux, je le trouvais qui recommande de ne pas trop<br />
s'y attacher, de ne pas se les figurer surtout comme un cadre essentiel à notre bonne vie. Il me<br />
rappelait par là le mot de l'Imitation : Imaginatio locorum et mutatio multos fefellii? ; l'idée<br />
qu'on se fait des lieux, et le désir d'en changer, sont un leurre pour beaucoup. Il citait le mot<br />
de saint Augustin : Loca offerunt quod amemus et relinquunt in anima turbas phantasmatum ;<br />
les lieux qui charment nos sens nous remplissent l'âme de distraction et de rêverie : “ Et cela<br />
est si vrai, disait-il, qu'il y a plusieurs personnes qui sont obligées de fermer leurs yeux<br />
lorsqu'elles prient dans des églises qui sont trop belle. ” Quelques-unes de ses maximes, en<br />
nos temps de querelle, me furent d'un conseil fréquent : “ On voit partout tant de semences de<br />
division, qu'il est fort difficile de n'y contribuer en rien qu'en se mêlant de peu de choses, en<br />
parlant peu et en priant beaucoup dans la retraite de sa chambre. ” Et ailleurs, au sujet des<br />
diversions inévitables et des secousses : “ Je vis bien qu'il fallait m'accoutumer à me faire une<br />
chambre qui pût me suivre partout, et dans laquelle je pusse me retirer, selon le précepte de<br />
l'Evangile, afin de m'y mettre à couvert du mauvais temps du dehors. ” Moi qui aimais tant à<br />
juger les autres, à séparer les nuances les plus intérieures, et à remonter aux racines des<br />
intentions ; qui, sans en avoir l'air, fouillais, comme ces médecins avides, à travers les<br />
poitrines, pour saisir les formes des coeurs et la jonction des vaisseaux cachés, il y avait bien<br />
lieu de m'appliquer cette parole : “ Je me trouvai, disait M. Hamon, si peiné et si las de juger,<br />
de parler, de m'inquiéter des autres, que je ne pouvais assez prier Dieu qu'il me délivrât de ce<br />
défaut qui m'empêchait de me convertir tout de bon. Je résolus de ne plus juger personne,<br />
voyant avec douleur que j'avais jugé des gens qui étaient meilleurs que moi... Car, si je<br />
méritais qu'on me définît, on pourrait me définir un homme qui, quand il dit quelque chose de<br />
bien, fait toujours le contraire de ce qu'il dit. ” Ainsi M. Hamon s'emparait de moi et me<br />
pénétrait par mes secrètes avenues. Je me voyais de plus avec lui des rapports fortuits,<br />
singuliers, comme quand il s'écrie : “ Je n'ai aucun parent; je n'avais qu'un oncle, Dieu me l'a<br />
ôté. ” Ces ressemblances ajoutaient à notre union. Il me préparait par l'attrait de son<br />
commerce à goûter de plus forts que lui, et me devenait un acheminement vers l'apôtre<br />
universel, saint Paul. Oh ! qu'ils sont plus chers que tous les autres, les guides inattendus,<br />
obscurs, rencontrés dans ces voies de traverse, par lesquelles les égarés rejoignent un peu<br />
avant le soir l'unique voie sacrée !<br />
décennies 1830_1839<br />
80
<strong>Saint</strong>-Martin, l'abbé Carron et lui me firent merveilleusement sentir ce que c'est qu'édifier sa<br />
vie et y porter le don de spiritualité. Ce dur consiste à retrouver Dieu et son intention vivante<br />
partout, jusque dans les moindres détails et les plus petits mouvements, à ne perdre jamais du<br />
doigt un certain ressort qui conduit. Tout prend alors un sens, un enchaînement particulier,<br />
une vibration infiniment subtile qui avertit, un commencement de nouvelle lumière. La trame<br />
invisible, qui est la base spirituelle de la Création et des causes secondes, qui se continue à<br />
travers tous les événements et les fait jouer en elle comme un simple épanouissement de sa<br />
surface, ou, si l'on veut, comme des franges pendantes, cette trame profonde devient sensible<br />
en plusieurs endroits, et toujours certaine là même où elle se dérobe. Il y a désormais deux<br />
lumières ; et la terrestre, celle des sages selon les intérêts humains, et des savants dans les<br />
sciences secondes, n'est que pareille à une lanterne de nos rues quand les étoiles sont levées,<br />
que les vers luisants émaillent la terre, et que la lune du firmament admire en paix celle des<br />
flots. Dans cette disposition intérieure de spiritualité, la vigilance est perpétuelle ; pas un point<br />
ne reste indifférent autour de nous pour le but divin ; tout grain de sable reluit. Un pas qu'on<br />
fait, une pierre qu'on ôte, le verre qu'on range hors du chemin de peur qu'il ne blesse les<br />
enfants et ceux qui vont pieds nus, tout devient significatif et source d'édification, tout est<br />
mystère et lumière dans un mélange délicieux. Que sait-on ? - Dieu le sait, c'est là, en chaque<br />
résultat, le doute fécond l'idée rassurante qui survit. <strong>Les</strong> explications riantes abondent ; tel<br />
minime incident, qu'on n'eût pas auparavant remarqué, ouvre la porte aux conjectures<br />
aimables, adorantes, infinies : “ Quelquefois, dit <strong>Saint</strong>-Martin, Dieu prépare secrètement pour<br />
nous une chose qui nous peut être utile et même agréable, et, au moment où elle va arriver, il<br />
nous en inspire le désir avec l'envie de la lui demander, afin de nous donner l'occasion de<br />
penser qu'il l'accorde à nos prières, et de faire filtrer en nous quelque sentiment de sa bonté,<br />
de sa complaisance et de son amour pour nous. ” - C'est ainsi, mon ami, que, tandis qu'un<br />
diadème exagéré s'inaugurait après la tempête sous la splendeur des victoires, je suivais ma<br />
trace imperceptible à l'écart de la grande influence qui semblait tout envahir ; je subissais<br />
d'autres influences plus vraies, bien profondes et directes ; l'infiltration en moi des célestes<br />
rosées s'augmentait au travers du soleil de l'Empire. A mesure que je m'habituais dans cet<br />
univers de l'esprit, j'en appréciais davantage les cercles et l'étendue ; je sentais mieux, en<br />
présence de mon seul coeur, l'immensité des conquêtes à faire, la difficulté de les maintenir, et<br />
ainsi que l'Archevêque de Cambrai disait qu'il était à lui-même tout un grand diocèse ?, j'étais<br />
à moi-même toute une Europe à pacifier et à combattre, en cette année où se préparait<br />
Austerlitz.<br />
Qui eût pensé toutefois que ces trois hommes de peu de nom, que je vous ai dits, eussent<br />
usurpé tant d'empire sur une âme, si ouverte d'ailleurs et si prompte, à une époque où régnait<br />
l'Homme mémorable ? Et combien d'autres que j'ignore se trouvaient dans des cas plus ou<br />
moins pareils au mien, avec leurs inspirations immédiates, singulières, qui ne provenaient en<br />
rien de lui! Ne grossissons pas, mon ami, l'action, déjà assez incontestable, de ces colosses de<br />
puissance. <strong>Les</strong> trombes orgueilleuses de l'Océan, si haut qu'elles montent et si loin qu'elles<br />
aillent, ne sont jamais qu'une ride de plus à la surface, au prix de l'infinité des courants cachés.<br />
Page 217<br />
L'heure de la récréation était celle des visites que faisaient les personnes du dehors. Je n'avais<br />
pas à en recevoir, hors deux ou trois fois que mon aimable ami de Normandie me vint exprès<br />
embrasser. Je lui montrais, je lui expliquais tout ; il s'enchantait de ce calme à chaque pas et<br />
de cette économie des lieux et des heures. Je lui racontais, chemin faisant, mes histoires<br />
favorites de M. Hamon, de Limoëlan, de <strong>Saint</strong>-Martin et de l'abbé Canon ; son don de<br />
spiritualité s'avivait en m'écoutant, et il me répondait par d'autres traits non moins<br />
décennies 1830_1839<br />
81
merveilleux, qu'il avait lus ou qui s'étaient opérés sur lui-même et autour de lui, par des<br />
histoires de pauvres, pareilles à celles de Jean l'aumônier, par des récits de visites de Jésus-<br />
Christ, comme il les appelait, et qui étaient d'hier et qui semblaient du temps du bon<br />
patriarche d'Alexandrie :<br />
“ Tout cela s'étend se tient, se correspond disait-il, et l'on apprend des choses à vous faire<br />
vendre vos meubles et à ne plus avoir qu'un plat à sa table. ” Et puis c'étaient, à travers nos<br />
jardins pieux, des exclamations qui lui échappaient, d'une peinture heureuse, et d'une beauté<br />
naturellement trouvée. Lui qui m'avait écrit tant de fois sur l'amertume des printemps, il<br />
m'entretenait alors de leur douceur : “ <strong>Les</strong> hivers me deviennent durs maintenant, disait-il un<br />
jour qu'il m'avait visité vers une fin d'automne.<br />
Oh ! encore un printemps, encore un printemps ! Quand on a gardé seulement un grain de<br />
l'Evangile, les printemps avec Dieu surpassent ceux de l'amour, ” Je lui faisais admirer nos<br />
promenoirs, nos treilles protégées, les rideaux impénétrables de nos allées, en lui taisant<br />
pourtant celle que se réservait mon coeur ; et il me parlait de sa maison à lui, que je n'avais<br />
jamais visitée, maison silencieuse aussi, disait-il, claire, grande, aérée, - sur la colline, - une<br />
herbe verte, des marguerites splendides. - Et il m'en dépeignait les printemps, qui tantôt<br />
survenaient brusques, rapides, par bouffées et comme par assauts dans une tempête, et tantôt,<br />
plus souvent, s'apprêtaient peu à peu,- “ avec ordre, sans accès, sans crises, tandis que les<br />
fleurs des coudriers sont déjà comme des franges par toute la forêt, et que les milliers de houx<br />
brillent et étincellent au soleil sous les grands arbres encore secs ”. Et il ajoutait incontinent :<br />
“ Oh ! qu'il y a de choses saintes dans la vie, mon ami, et de quels trésors nos passions nous<br />
éloignaient! ” Il était tenté par moments de demeurer avec moi, et me le disait; mais je lui<br />
rappelais sa voie toute tracée ailleurs, et nous nous séparions avec tendresse. Ainsi cette vie<br />
aimable s'affermissait de plus en plus, et il redescendait sa fin de jeunesse par de belles<br />
pentes.<br />
Page 265<br />
Une réponse de <strong>Saint</strong>-Martin à Garat, que j'avais trouvée dans le Recueil des Ecoles Normales, me renvoya à<br />
ces deux ouvrages, dont j'avais déjà feuilleté ...<br />
Page 269<br />
Le soudain attrait qu'avait pour moi la lecture de <strong>Saint</strong>-Martin, me suggéra l'envie toute naturelle d'entrevoir sa<br />
personne. Je n'aurais jamais songé à ...<br />
Page 147<br />
... saint Martin ...<br />
Page 175<br />
... car vous le connaissez peu, j'imagine, et pourtant, comme saint Martin, comme l'abbé Car- ron, il devint<br />
bientôt l'un de mes maîtres invisibles. ...<br />
Page 179<br />
... que pour un contemplateur intelligent qui parût les connaître. / La grande et respectable vérité, s'écriait saint<br />
Martin dans un accès ...<br />
Page 186<br />
<strong>Saint</strong> Martin, l'abbé Carron et lui me firent merveilleusement sentir ce que c'est qu'édifier sa vie et y porter le<br />
don de spiritualité. ...<br />
Page 188<br />
Quelquefois, dit « saint Martin, Dieu prépare secrètement pour » nous une chose qui nous peut être utile et »<br />
même agréable, et, au moment où elle va ...<br />
Page 217<br />
Je lui racontais, chemin faisant, mes histoires favorites de M. Hamon, de Limoëlan, de <strong>Saint</strong> Martin et de l'abbé<br />
Carron; son don de spiritualité ...<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
82
Revue de Paris Page 316 1835<br />
TABLE DES MATIÈRES.<br />
Le Chandelier, proverbe, par M. Alfred de Musset, (Extrait de la Revue des Deux-Mondes.). 5<br />
La Samaritaine, par M. Rosseeuw S'.-Hilaire. 73<br />
Le nez rouge, par lord Feeling 105<br />
Bulletin littéraire 115<br />
La mise en scène depuis les Mystères jusqu'au Cid, par Emile Morice 147<br />
Vers au général Allard, par Méry 183<br />
<strong>Les</strong> vieilles lettres, par Philarète Chasles 188<br />
Histoire delà marine française, par Eugène Sue. 201<br />
Souvenirs de l'Ariége, par Frédéric Soulié 216<br />
<strong>Les</strong> prisonniers de Ham, par Antony Deschamps. 264<br />
L'émeute et les légitimistes. 266<br />
Le lys dans la vallée, par M. de Balzac. 275<br />
L’extrait habituel du lys dans la vallée de Balzac où lcsm est cité<br />
[315] Esterhazy, auxquels le voyageur demandait le pain que le gentilhomme n'aurait pas<br />
accepté du maître, et qu'il refusa maintes fois des mains ennemies de la France, je n'ai jamais<br />
senti dans mon cœur de fiel pour l'émigré, même quand je le vis ridicule dans le triomphe. <strong>Les</strong><br />
cheveux blancs de M. de Mortsauf m'avaient dit d'épouvantables douleurs, et je sympathise<br />
trop avec les exilés pour pouvoir les juger. La gaieté française et tourangelle succomba chez<br />
M. de Mortsauf, il devint morose, tomba malade, et fut soigné par charité dans je ne sais quel<br />
hospice allemand. Sa maladie était une inflammation du mésentère ; cas souvent mortel, mais<br />
dont la guérison entraîne des changements d'humeur, et cause presque toujours l'hypocondrie.<br />
Ses amours, ensevelis dans le plus profond de son âme, et que moi seul ai découverts, furent<br />
des amours de bas étage qui n'attaquèrent pas seulement sa vie, ils en ruinèrent l'avenir. Après<br />
douze ans de misères, il tourna les yeux vers la France où le décret de Napoléon lui permettait<br />
de rentrer. Quand en passant le Rhin, le piéton souffrant aperçut le clocher de Strasbourg par<br />
une belle soirée, il défaillit. — « La France ! la France ! » — Je criai : « voilà la France ! » me<br />
dit-il, comme un enfant crie: Ma mère ! quand il est blessé. Riche avant de naître, il se<br />
trouvait pauvre ; fait pour commander un régiment ou gouverner l'étal, il était sans autorité,<br />
sans avenir ; né sain et robuste, il revenait infirme et tout usé. Sans instruction au milieu d'un<br />
pays où les hommes et les choses avaient grandi, nécessairement sans influence possible, il se<br />
voyait dépouillé de tout, même de ses forces corporelles et morales. Son manque de fortune<br />
lui rendait son nom pesant. Ses opinions inébranlables, ses antécédents à l'armée de Condé,<br />
ses chagrins, ses souvenirs, sa santé perdue, lui donnaient une susceptibilité de nature à être<br />
peu ménagée en France, le pays des railleries. A demi mourant, il atteignit le Maine, ou par un<br />
hasard dû peut-être à la guerre civile, le gouvernement révolutionnaire avait oublié de faire<br />
vendre une ferme considérable en étendue, et que son fermier lui conservait en laissant croire<br />
qu'il en était propriétaire. Quand la famille de Lenoncourt, qui habitait Givry, château situé<br />
près de cette ferme, sut l'arrivée du comte de Mortsauf, le duc de Lenoncourt [316] alla lui<br />
proposer de demeurer à Givry, pendant le temps nécessaire pour arranger une habitation. La<br />
famille de Lenoncourt fut noblement généreuse envers M. de Mortsauf qui se répara là durant<br />
plusieurs mois de séjour, et fit des efforts pour cacher ses douleurs pendant cette première<br />
halte. <strong>Les</strong> Lenoncourt avaient perdu leurs immenses biens. Par le nom, M. de Mortsauf était<br />
un parti sortable pour leur fille. Loin de s'opposer à son mariage avec un homme âgé de<br />
trente-cinq ans, maladif et vieilli, mademoiselle de Lenoncourt en parut heureuse. Un mariage<br />
lui acquérait le droit de vivre avec sa tante, la marquise d'Uxelles, sœur du prince de Blamont-<br />
Chauvry, qui pour elle était une mère d'adoption. Amie intime de la duchesse de Bourbon,<br />
madame d'Uxelles faisait partie d'une société sainte dont l'âme était M. <strong>Saint</strong>-Martin, né en<br />
Touraine, et surnommé le Philosophe inconnu. <strong>Les</strong> disciples de ce philosophe pratiquaient les<br />
vertus conseillées par les hautes spéculations de l'illuminisme mystique. Cette doctrine donne<br />
décennies 1830_1839<br />
83
la clef des mondes divins, explique l'existence par des transformations où l'homme s'achemine<br />
à de sublimes destinées, libère le devoir de sa dégradation légale, applique aux peines de la<br />
vie la douceur inaltérable du quaker, et ordonne le mépris de la souffrance en inspirant je ne<br />
sais quoi de maternel pour l'ange que nous portons au ciel. C'est le stoïcisme ayant un avenir.<br />
La prière active et l'amour pur sont les éléments de cette foi qui sort du catholicisme de<br />
l'église romaine pour rentrer dans le christianisme de l'église primitive. Mademoiselle de<br />
Lenoncourt resta néanmoins au sein de l'église apostolique à laquelle sa tante fut toujours<br />
également fidèle. Rudement éprouvée par les tourmentes révolutionnaires, la marquise<br />
d'Uxelles avait pris, dans les derniers jours de sa vie, une teinte de piété passionnée qui versa<br />
dans l'âme de son enfant chéri, la lumière de l'amour céleste et l'huile de la joie intérieure,<br />
pour employer les expressions mêmes de <strong>Saint</strong>-Martin. Madame de Mortsauf reçut plusieurs<br />
fois cet homme de paix et de vertueux savoir à Clochegourde après la mort de sa tante, chez<br />
laquelle il venait souvent. <strong>Saint</strong>-Martin surveilla de Clochegourde ses derniers livres<br />
imprimés à Tours chez Lelourmy. Inspirée par la sagesse des vieilles femmes qui ont<br />
expérimenté led détroits orageux de la vie, madame d'Uxelles donna Cloche-[317]gourde à la<br />
jeune mariée, pour lui faire un chez elle. Avec la grâce des vieillards qui est toujours parfaite<br />
quand ils sont gracieux, la marquise y abandonna tout à sa nièce, en se contentant d'une<br />
chambre au-dessus de celle qu'elle occupait auparavant et que prit la comtesse. Sa mort<br />
presque subite jeta des crêpes sur les joies de cette union, et imprima d'ineffaçables tristesses<br />
sur Clochegourde comme sur l'âme superstitieuse de la mariée. <strong>Les</strong> premiers jours de son<br />
établissement à Clochegourde furent pour la comtesse le seul temps, non pas heureux, mais<br />
insoucieux de sa vie. Après les pénibles navigations de son séjour à l'étranger, M. de<br />
Morlsauf, satisfait d'entrevoir un clément avenir, eut comme une convalescence d'âme. Il<br />
respira dans cette vallée les enivrantes odeurs d'une espérance fleurie. Forcé de songer à sa<br />
fortune, il se jeta dans les préparatifs de l'agriculteur et commença par goûter quelque joie.<br />
Mais la naissance de Jacques fut un coup de foudre qui ruina le présent et l'avenir. Le médecin<br />
condamna le nouveau-né. Le comte cacha soigneusement cet arrêt à la mère; puis, il consulta<br />
pour lui-même et reçut de désespérantes réponses que confirma la naissance de Madelaine.<br />
Ces deux événements, une sorte de certitude intérieure sur la fatale sentence, augmentèrent les<br />
dispositions maladives de l'émigré. Son nom à jamais éteint, une jeune femme pure,<br />
irréprochable, malheureuse à ses côtés, vouée aux angoisses de la maternité, sans en avoir les<br />
plaisirs; cet humus de son ancienne vie d'où germaient de nouvelles souffrances lui tomba sur<br />
le cœur, et paracheva sa destruction. Madame de Morlsauf devina le passé par le présent et lut<br />
dans l'avenir. Quoique rien ne soit plus difficile que de rendre heureux un homme qui se sent<br />
fautif, madame de Morlsauf tenta cette entreprise digne d'un ange. En un seul jour, elle devint<br />
stoïque. Après être descendue dans l'abîme d'où elle vit encore le ciel, elle se voua, pour un<br />
seul homme, à la mission qu'embrasse la sœur de charité pour tous. Pour le réconcilier avec<br />
lui-même, elle lui pardonna ce qu'il ne se pardonnait pas à lui-même; M. de Mortsauf devint<br />
avare, elle accepta les privations imposées ; il avait la crainte d'être trompé, comme l'ont tous<br />
ceux qui n'ont connu la vie du monde que pour en rapporter des répugnances, elle resta dans<br />
la solitude, et se plia sans murmure à ses défiances. Elle employa …<br />
Page 316<br />
<strong>Saint</strong>-Martin surveilla de Clochegourde ses derniers livres imprimés à Tours ...<br />
Le joli village de Pont-de-Ruan (600 Ruanopontins, 574 ha), dont le nom ancien de<br />
Rotomagus signifiait le marché du gué, y abrite le château de Vonne (17 e s., récemment<br />
restauré), dont Balzac fit Clochegourde, et l'ancien prieuré du Relay (12 e et 16 e s.); moulin dit<br />
de Balzac, église du 12 e s.; laiterie-fromagerie …<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
84
Revue de Paris Page 262 publié par <strong>Louis</strong> Désiré Véron 1835<br />
Même texte mais on le trouve à la page 162<br />
… [162] … Amie intime de la duchesse de Bourbon, madame d'Uxelles faisait partie d'une<br />
société sainte dont l'ame était M. <strong>Saint</strong>-Martin, né en Touraine, et surnommé le Philosophe<br />
inconnu. <strong>Les</strong> disciples de ce philosophe pratiquaient les vertus conseillées par les hautes<br />
spéculations de l'illuminisme mystique. Cette doctrine donne la clé des mondes divins,<br />
explique l'existence par des transformations où l'homme s'achemine à de sublimes destinées,<br />
libère le devoir de sa dégradation légale, applique aux peines de la vie la douceur inaltérable<br />
du quaker, et ordonne le mépris de la souffrance en inspirant je ne sais quoi de maternel pour<br />
l'ange que nous portons au ciel. C'est le stoïcisme ayant un avenir. La prière active et l'amour<br />
pur sont les éléments de cette foi qui sort du catholicisme de l'église romaine pour rentrer dans<br />
le christianisme de l'église primitive.<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
85
1836<br />
La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants ... Page 354 de Joseph<br />
Marie Quérard – 1836<br />
Page 352 – 353 – 354<br />
SAINT-<strong>MARTIN</strong> (le marquis <strong>Louis</strong>-<strong>Claude</strong> de), dit le Philosophe inconnu, écrivain<br />
mystique ; né à Amboise (Indre-et- Loire), le 18 janvier 1743, mort à Aulnay, près Châtenay<br />
(Seine), dans la maison de campagne de M. Lenoir-La roche, le 15 octobre 1803.<br />
- * Cimetière (le) d'Amboise, par un philosophe inconnu. Paris, Laran et Cie, an IX(1801), in-<br />
8 de 16 pages, 4o c.<br />
- * Crocodile (le), ou la Guerre du bien et du mal, arrivée sous le règne de <strong>Louis</strong> XV, poème<br />
épico-magique en cent deux chants, dans lequel il y a de longs voyages sans accidents qui<br />
soient mortels, un peu d'amour sans aucune de ses fureurs, de grandes batailles sans une<br />
goutte de sang répandu; quelques instructions sur le bonnet de Docteur, et qui, parce qu'il<br />
renferme de la prose et des vers, pourrait bien en effet n'être ni l'un ni l'autre. Ouvrage<br />
posthume d'un amateur de choses cachées. Paris, de l'imprimerie du Cercle social, an VII<br />
(1799), in-8 de 470 pages, 4 fr. 5o c.<br />
- * Discours en réponse au citoyen Garat, professeur d'entendement humain aux Écoles<br />
normales, sur l'existence d'un sens moral, et sur la distinction entre les sensations et la<br />
connaissance. Ce Discours, prononcé à la suite d'une conférence publique (17 février 1796),<br />
se trouve imprimé dans la collection des Ecoles normales (tome. Ill des Débats), publiée en<br />
1801.<br />
- *Ecce-homo. Paris, imprimerie du Cercle social, an IV (1796), in-12. Ce fut à Paris que<br />
l'auteur écrivit cet opuscule, d'après une action vive, dit-il, qu'il avait eue à Strasbourg. Son<br />
objet est de montrer à quel degré d'abaissement l'homme infirme est déchu, et de le guérir du<br />
penchant au merveilleux d'un ordre inférieur, tel que le somnambulisme, les prophéties du<br />
jour, etc. Il avait plus particulièrement en vue la duchesse de Bourbon, son amie de cœur,<br />
modèle de vertus et de piété, mais livrée a ce même entraînement pour le merveilleux.<br />
— * Éclair sur l'association humaine. Paru, an V (1797), in-8. L'auteur découvre dans le<br />
principe de l'ordre social le foyer d'où émanent la sagesse, la justice et la puissance, sans<br />
lesquelles il n'existe point d'association durable, etc.<br />
— * Erreurs (des) et de la Vérité, ou les Hommes rappelés an principe universel de la science,<br />
par un Ph*** Inc. Edimbourg (Lyon), 1775, in-8. — Nouv. édit. Salomonopolis, 1784, 3 vol.<br />
in-8. Le troisième volume, qui a pour titre « Suite des Erreurs de la vérité », est une critique<br />
de l'ouvrage ; elle a été signalée par <strong>Saint</strong>-Martin, comme frauduleuse et entachée du vice des<br />
faux systèmes qu'il combattait. On a publié contre cet ouvrage : Clef des « Erreurs de la<br />
vérité, ou les Hommes rappelés an principe universel de la raison». Par un serrurier (par Ch.<br />
Suze). Herselaim, 1790, in-8. — * Esprit (de l’) des choses, ou Coup d'œil philosophique sur<br />
la nature des êtres et sur l'objet de leur existence, avec l'épigraphe : Mens hominis rerum<br />
universalitatis spéculum est. Ouvrage dans lequel on considère l'Homme comme étant le mot<br />
de tontes les énigmes, par le Philosophe inconnu. Paris, Laran, etc., an VIII (1800), 2 vol. in-<br />
8, 7 fr. 5o c.<br />
— * Essai sur les signes et sur les idées, relativement a la question de l'Institut : Déterminer<br />
l'influence des signes sur la formation des idées. 1800.<br />
décennies 1830_1839<br />
86
— * Homme (l’) de désir, par l'auteur « des Erreurs et de la Vérité». Lyon, 1790, in-8.<br />
— Nouvelle édition revue et corrigée par l'auteur, sous le masque du « Philosophe inconnu».<br />
Metz, an X (1801), 2 vol. petit in-8. Lcsm composa cet ouvrage à l’instigation du philosophe<br />
Thiemann durant ses voyages à Strasbourg et à Londres. Lavater, dans son Journal allemand<br />
de décembre 1790, en fait l'éloge comme l'un des livres qu'il avait le plus goûtés, quoiqu'il<br />
avoue ingénument, quant au fond de la doctrine l’avoir peu entendu.<br />
— Extraits tirés de l'ouvrage intitulé « l'Homme de désir. Francfort-sur-le-Main, Schmerber,<br />
1831, in-12 de 96 pages, 1 fr. 25 c.<br />
— Lettre à un ami, ou Considérations politiques, philosophiques et religieuses sur la<br />
Révolution française. Paris, Migneret, an III (1795), in-8, 2 fr. <strong>Saint</strong>-Martin regardait la<br />
Révolution française comme celle du genre humain, et comme une image en miniature du<br />
jugement dernier, mais où les choses devaient se passer successivement, a commencer par la<br />
France.<br />
— * Livre (le) rouge...<br />
— * Ministère (le) de l'Homme-Esprit (en trois parties, qui traitent de l'homme, de la nature,<br />
de la parole). Paris, Migneret, an X (1800), in-8, 6 fr.<br />
Barbier, n° 11,972 présente cet ouvrage comme étant de la composition de <strong>Saint</strong>-<br />
Martin ; il y a pourtant lieu de croire que ce n'est qu'une traduction d’un livre de Boehm.<br />
L'objet de ce livre est de montrer comment 1’Homme-Esprít (en exerçant un ministère<br />
spirituel) peut s’améliorer, et régénérer lui-même et les autres, en rendant la parole ou le logos<br />
(le verbe) à l'homme et à la nature.<br />
— * Nouvel (le) Homme. Paris, an IV (1796), in-8. C'est plutôt une exhortation qu'un<br />
enseignement. <strong>Saint</strong>-Martin l'écrivit à Strasbourg, en 1790, par le conseil du chevalier<br />
Silverhielm, ancien aumônier du roi de Suède, et neveu de Swedenborg. L'idée fondamentale<br />
de cet ouvrage est que l'homme porte en lui- même une espèce de texte, dont sa vie entière<br />
devrait être le développement, parce que l'âme de l'homme, dit-il, est primitivement une<br />
pensée de Dieu. I1 a dit, plus tard, qu'il n'aurait pas écrit ce livre, ou qu'il l'aurait écrit<br />
autrement, si alors il avait en la connaissance des ouvrages de Boehm.<br />
— Oeuvres posthumes. Tours, Letourny, 1807, 2 vol. in-8. On distingue dans ce recueil : 1°<br />
un Choix des pensées de St.-Martin, par M. Tournier; 2° un Journal, depuis 1782, de ses<br />
relations, de ses entretiens, sous le titre de Portrait de <strong>Saint</strong>- Martin fait par lui-même ; 3°<br />
plusieurs questions et fragments de littérature, de morale et de philosophie, entre autres : un<br />
Fragment sur l'admiration, et un Parallèle entre Voltaire et J.-J. Rousseau, et un autre entre<br />
Rousseau et Buffon (par Hérault de Séchelles) ; 4° des Poésies, où, comme on le pense bien,<br />
l'auteur s'attache plus au fond qu'à la forme ; 5° des Méditations et des prières, où se peint<br />
l'Homme de désir, qui forme de nouveau le voeu si souvent énoncé par l'auteur, pour<br />
que ses semblables recherchent les vraies connaissances, les jouissances pures de l'esprit<br />
en les puisant dans leur propre centre, dans la source de la lumière et de l'amour pour<br />
laquelle il avait soupiré toute sa vie.<br />
— Réflexions d'un observateur sur la question proposée par l'Institut : « Quelles sont les<br />
institutions les plus propres à fonder la morale d'un peuple. An VI (1798). Après avoir passé<br />
en revue les divers moyens qui peuvent tendre à ce but, en liant la morale à la politique, il<br />
montre l'insuffisance de ces moyens, si le législateur n'assoit lui-même, sur les bases intimes<br />
de notre nature, cette morale dont un gouvernement ne doit être que le résultat mis en action.<br />
Il avait traité, quinze ans auparavant, un sujet analogue, proposé par l'Académie de Berlin, sur<br />
la meilleure manière de rappeler à la raison les peuples livrés à l'erreur ou aux superstitions ;<br />
question qu'il croit insoluble par les seuls moyens humains.<br />
-* Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers. Avec cette<br />
épigraphe : Expliquer les choses par l'homme, et non l’homme par les choses. Edimbourg<br />
(Lyon], 1782, 2 vol. in-8. Cet ouvrage parut en allemand, avec Commentaires par un<br />
décennies 1830_1839<br />
87
anonyme. Qu'à cette liste on ajoute les traductions de quatre ouvrages du théosophe Boehm<br />
(voy. ce nom), formant ensemble six volumes in-8, et l'on aura une nomenclature complète<br />
des Oeuvres de <strong>Saint</strong>-Martin.<br />
Voir les autres données sous le nom de Quérard, question : pourquoi lcsm est-il qualifié de<br />
Marquis ? sur quelles sources ?<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
88
<strong>Les</strong> soirées de <strong>Saint</strong> Petersbourg: ou Entretiens sur le gouvernement temporel ... Page 294 de Joseph<br />
Marie Maistre 1836<br />
Livre numérisé en ses 11 entretiens, notes incluses<br />
Page 224<br />
Vous rappelez-vous ce que nous lisions ensemble, il ya quelque temps, dans un livre de saint Martin ? ...<br />
Question : les disciples de lcsm ont-ils l’habitude de lire ensemble et de commenter, éventuellement, le<br />
texte ?<br />
Le font-ils en suivant des « formes » ou librement ?<br />
Page 267<br />
On donne ce même nom au disciple vertueux de saint Martin, qui ne. professe pas seulement le Christianisme,<br />
mais qui ne travaille qu'à s'élever aux plus ...<br />
Page 287<br />
... <strong>Saint</strong>-Martin ...<br />
Page 294<br />
(1) <strong>Saint</strong>-Martin mourut en effet le 13 octobre 1804, sans avoir voulu recevoir un prêtre. (Mercure de France,<br />
18 mars 1809.N°408,...<br />
Page 295<br />
J'irai cependant mon train, messieurs, comme si le Tout-Puissant avait réussi, et tandis que les pieux disciples de<br />
<strong>Saint</strong>-Martin, dirigés, ...<br />
Voir dossier Maistre<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
89
Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire Page 633<br />
781 SAINT-<strong>MARTIN</strong>. Oeuvres posthumes. Tours, 1807, 2 vol. in-8<br />
782 Le Crocodile, ou la Guerre du Bien et du Mal, arrivée sous le règne de <strong>Louis</strong> XV, poème<br />
épico-magique en 102 chants. Paris, impr. du Cercle Social, an vu, in-8, rel. (Rare). ...<br />
788 ---- Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers.<br />
Edimbourg, 1782, 2 vol. in-8, d.-rel 12<br />
784 — — — L'Homme de Désir. Lyon, 1790, cart.<br />
785 Le Ministère de l'Homme d'esprit, par le philosophe inconnu. Paris, an XI (1802), in-8,<br />
cart.<br />
786 Le Nouvel Homme. Paris, an VI, in-8<br />
787 — Jacob Behm. Des trois Principes de l'Essence divine, ou de l'Eternel engendrement<br />
sans origine, etc., trad par <strong>Saint</strong>-Martin. Paris, 1802, 2 vol. in-8-, br.<br />
788 ---- Jacob Behme. De la Triple vie de l'Homme, selon le mystère des trois principes de la<br />
manifestation divine (trad. par <strong>Saint</strong>-Martin). Paris, Mignerct, 1809, in-8, broché.<br />
789 --- L'Aurore naissante, ou le Racine de la Philosophie traduit de l'allemand (par <strong>Saint</strong>-<br />
Martin). Paris, an IX (1800), 2 vol. in-8, part. .<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
90
Oeuvres complètes de Madame la baronne de Staël-Holstein Page 243 de Staël (Anne-<br />
<strong>Louis</strong>e-Germaine) 1836<br />
Page 235 CHAPITRE V.<br />
De la disposition religieuse appelée mysticité. La disposition religieuse appelée mysticité n'est<br />
qu'une manière plus intime de sentir et de concevoir le christianisme. Comme dans le mot de<br />
mysticité est renfermé celui de mystère, on a cru que les mystiques professaient des dogmes<br />
extraordinaires, et faisaient une secte à part. II n'y a de mystères chez eux que ceux du<br />
sentiment appliqués à la religion, et le sentiment est à la fois ce qu'il y a de plus clair, de plus<br />
simple et de plus inexplicable : il faut distinguer cependant les théosophes, c'est-à-dire, ceux<br />
qui s'occupent de la théologie philosophique, tels que Jacob Boehm, <strong>Saint</strong>-Martin, etc., des<br />
simples mystiques; les premiers veulent pénétrer le secret de la création, les seconds s'en<br />
tiennent à leur propre cœur. Plusieurs Pères île l'Église, Thomas A Kempis, Fénelon, saint<br />
François de Sales, etc. ; et, chez les protestants, un grand nombre d'écrivains anglais et<br />
allemands ont été des mystiques, c'est-à-dire, des hommes qui faisaient de la religion un<br />
amour, et la mêlaient à toutes leurs pensées comme à toutes leurs actions.<br />
Le sentiment religieux qui est la base de toute la doctrine des mystiques, consiste dans une<br />
paix intérieure pleine de vie. <strong>Les</strong> agitations des passions ne laissent point de calme; la<br />
tranquillité de la sécheresse et de la médiocrité d'esprit tue la vie de l'âme : ce n'est que dans le<br />
sentiment religieux qu'on trouve une réunion parfaite du mouvement et du repos. Cette<br />
disposition n'est continuelle, je crois, dans aucun homme, quelque pieux qu'il puisse être; mais<br />
le souvenir et l'espérance de ces saintes émotions décident de la conduite de ceux qui les ont<br />
éprouvées.<br />
Si l'on considère les peines et les plaisirs de la vie comme l'effet du hasard ou du bien joué,<br />
alors le désespoir et la joie doivent être, pour ainsi dire, des mouvements convulsifs. Car quel<br />
hasard que celui qui dispose de notre existence ! quel orgueil ou quel regret ne doit-on pas<br />
éprouver, quand il s'agit d'une démarche qui a pu influer sur tout notre sort ! A quels<br />
tourments d'incertitude ne devrait-on pas être livré, si notre raison disposait seule de notre<br />
destinée dans ce monde !<br />
Page 236<br />
… L'élévation de l'âme vers son Créateur est le culte suprême des chrétiens mystiques; mais<br />
ils ne s'adressent point à Dieu pour demander telle ou telle prospérité de cette vie. Un écrivain<br />
français qui a des lueurs sublimes, M. de <strong>Saint</strong>-Martin, a dit que la prière était la respiration<br />
de l’âme. <strong>Les</strong> mystiques sont, pour la plupart, convaincus qu'il y a réponse à cette prière, et<br />
que la grande révélation du christianisme peut se renouveler en quelque sorte dans l'âme,<br />
chaque fois qu'elle s'élève avec ardeur vers le ciel. Quand on croit qu'il n'existe plus de<br />
communication immédiate entre l'Être suprême et l'homme, la prière n'est, pour ainsi dire,<br />
qu'un monologue ; mais elle devient un acte bien plus secourable, lorsqu'on est persuadé que<br />
la Divinité se fait sentir au fond de notre cœur. En effet, on ne saurait nier, ce me semble, qu'il<br />
ne se passe en nous des mouvements qui ne nous viennent en rien du dehors, et qui nous<br />
calment ou nous soutiennent, sans qu'on puisse les attribuer à la liaison ordinaire des<br />
événements de la vie. Des hommes qui ont mis de l'amour - propre dans une doctrine<br />
entièrement fondée sur l'abnégation de l'amour-propre, ont tiré parti de ces secours inattendus<br />
pour se faire des illusions de tout genre : ils se sont crus des élus ou des prophètes; ils se sont<br />
imaginé qu'ils avaient des visions ; enfin ils sont entrés en superstition vis-à- vis d'euxmêmes.<br />
Que ne peut l'orgueil humain, puisqu'il s'insinue dans le cœur sous la forme même de<br />
l'humilité ! Mais il n'en est pas moins vrai que rien n'est plus simple et plus pur que les<br />
rapports de l'âme avec Dieu, tels qu'ils sont conçus par ce qu'on a coutume d'appeler les<br />
mystiques, c'est-à-dire, les chrétiens qui mettent l'amour dans la religion.<br />
décennies 1830_1839<br />
91
…<br />
Page 242 CHAPITRE VII.<br />
Des philosophes religieux appelés Théosophes. Lorsque j'ai rendu compte de la philosophie<br />
moderne des Allemands, j'ai essayé de tracer une ligne de démarcation entre celle qui<br />
s'attache à pénétrer les secrets de l'univers, et celle qui se borne à l'examen de la nature de<br />
notre âme. La même distinction se fait remarquer parmi les écrivains religieux : les uns, dont<br />
j'ai déjà parlé dans les chapitres précédents, s'en sont tenus à l'influence de la religion sur<br />
notre cœur ; les autres, tels que Jacob Bœhme, en Allemagne, <strong>Saint</strong>-Martin, en France, et bien<br />
d'autres encore, ont cru trouver dans la révélation du christianisme. des paroles mystérieuses<br />
qui pouvaient servir à dévoiler les lois de la création. Il faut en convenir, quand on commence<br />
à penser, il est difficile de s'arrêter; et soit que la réflexion conduise au scepticisme, soit<br />
qu'elle mène à la foi la plus universelle, on est souvent tenté de passer des heures entières,<br />
comme les faquirs, à se demander ce que c'est que la vie. Loin de dédaigner ceux qui sont<br />
ainsi dévorés par la contemplation, on ne peut s'empêcher de les considérer comme les<br />
véritables seigneurs de l'espèce humaine, auprès desquels ceux qui existent sans réfléchir ne<br />
sont que des serfs attachés à la glèbe. Mais comment peut-on se flatter de donner [243]<br />
quelque consistance à ces pensées, qui, semblables aux éclairs, replongent dans les ténèbres,<br />
après avoir un moment jeté sur les objets d'incertaines lueurs ?<br />
Page 243<br />
Le plus fameux de ces philosophes religieux, c'est Jacob Bœhme, un cordonnier allemand, qui<br />
vivait au commencement du dix-septième siècle ; il a fait tant de bruit dans son temps, que<br />
Charles 1er envoya un homme exprès à Görlitz, lieu de sa demeure, pour étudier son livre et<br />
le rapporter en Angleterre. Quelques-uns de ses écrits ont été traduits en français par M. de<br />
<strong>Saint</strong>-Martin : ils sont très-difficiles à comprendre, cependant l'on ne peut s'empêcher de<br />
s'étonner qu'un homme sans culture d'esprit ait été si loin dans la contemplation de la nature.<br />
Il la considère en général comme un emblème des principaux dogmes du christianisme;<br />
partout il croit voir dans les phénomènes du monde les traces de. la chute de l'homme et de sa<br />
régénération, les effets du principe de la colère et de celui de la miséricorde ; et tandis que les<br />
philosophes grecs tâchaient d'expliquer le monde par le mélange des éléments de l'air, de l'eau<br />
et du feu, Jacob Bœhme n'admet que la combinaison des forces morales, et s'appuie sur des<br />
passages de l'Évangile pour interpréter l'univers.<br />
De quelque manière que l'on considère ces singuliers écrits qui, depuis deux cents ans, ont<br />
toujours trouvé des lecteurs, ou plutôt des adeptes, on ne peut s'empêcher de remarquer les<br />
deux routes opposées que suivent, pour arriver à la vérité, les philosophes spiritualistes et les<br />
philosophes matérialistes. <strong>Les</strong> uns croient que c'est en se dérobant à toutes les impressions du<br />
dehors, et en se plongeant dans l'extase de la pensée, qu'on peut deviner la nature ; les autres<br />
prétendent qu'on ne saurait trop se garder de l'enthousiasme et de l'imagination, dans l'examen<br />
des phénomènes de l'univers : l'on dirait que l'esprit humain a besoin de s'affranchir du corps<br />
ou de l'âme, pour comprendre la nature, tandis que c'est dans la mystérieuse réunion des deux<br />
que consiste le secret de l'existence.<br />
Quelques savants, en Allemagne, affirment qu'on trouve, dans les ouvrages de Jacob Boehm,<br />
des vues très-profondes sur le monde physique; l'on peut dire au moins qu'il y a autant<br />
d'originalité dans les hypothèses des philosophes religieux sur la création, que dans celles de<br />
Thalès, de Xénophane, d'Aristote, de Descartes et de Leibnitz. <strong>Les</strong> théosophes déclarent que<br />
ce qu'ils pensent leur a été révélé, tandis que les philosophes en général se croient uniquement<br />
conduits par leur propre raison; mais puisque les uns et les autres aspirent à connaître le<br />
mystère des mystères, que signifient à cette hauteur les mots de raison et de folie ? et<br />
décennies 1830_1839<br />
92
pourquoi flétrir de la dénomination d'insensés, ceux qui croient trouver dans l'exaltation de<br />
grandes lumières ? C'est un mouvement de l'âme d'une nature très-remarquable, et qui ne lui a<br />
sûrement pas été donné seulement pour le combattre.<br />
Page 245<br />
De tout temps, et dans tous les pays, il a existé des associations secrètes, dont les membres<br />
avaient pour but de se fortifier mutuellement dans la croyance à la spiritualité de l'âme; les<br />
mystères d'Eleusis, chez les païens, la secte des Esséniens, chez les Hébreux, étaient fondés<br />
sur cette doctrine, qu'on ne voulait pas profaner en la livrant aux plaisanteries du, vulgaire. Il<br />
y a près de trente ans qu'à WilhelmsBad il y eut une assemblée de francs-maçons présidée par<br />
le duc de Brunswick ; cette assemblée avait pour objet la réforme des francs-maçons<br />
d'Allemagne, et il paraît que les opinions mystiques en général, et celles de <strong>Saint</strong>- Martin en<br />
particulier, influèrent beaucoup sur cette réunion. <strong>Les</strong> institutions politiques, les relations<br />
sociales, et souvent même celles de famille, ne prennent que l'extérieur de la vie : il est donc<br />
naturel que de tout temps on ait cherché quelque manière intime de se reconnaître et de<br />
s'entendre; et tous ceux dont le caractère a quelque profondeur se croient des adeptes, et<br />
cherchent à se distinguer par quelques signes du reste des hommes. <strong>Les</strong> associations secrètes<br />
dégénèrent avec le temps; mais leur principe est presque toujours un sentiment<br />
d'enthousiasme comprimé par la société. Il y a trois classes d'illuminés : les illuminés<br />
mystiques, les illuminés visionnaires, et les illuminés politiques. La première, celle dont Jacob<br />
Bœhme, et, dans le dernier siècle, Pasqualis et <strong>Saint</strong>-Martin peuvent être considérés comme<br />
les chefs, tient par divers liens à cette église intérieure, sanctuaire de ralliement pour tous les<br />
philosophes religieux; ces illuminés s'occupent uniquement de la religion, et de la nature<br />
interprétée par les dogmes de la religion. <strong>Les</strong> illuminés visionnaires, à la tête desquels on doit<br />
placer le Suédois Swedenborg, croient que par la puissance de la volonté ils peuvent faire<br />
apparaître des morts et opérer des miracles. Le feu roi de Prusse, Frédéric-Guillaume, a été<br />
induit en erreur par la crédulité de ces hommes, ou par leurs ruses, qui avaient l'apparence de<br />
la crédulité. <strong>Les</strong> illuminés idéalistes dédaignent ces illuminés visionnaires comme des<br />
empiriques; ils méprisent leurs prétendus prodiges, et pensent que la merveille des sentiments<br />
de l'âme doit l'emporter à elle seule sur toutes les autres. Enfin, des hommes qui n'avaient<br />
pour but que de s'emparer de l'autorité dans tous les États, et de se faire donner des places, ont<br />
pris le nom d'illuminés; leur chef était un Bavarois, Weisshaupt, homme d'un esprit supérieur,<br />
et qui avait très- bien senti la puissance qu'on pouvait acquérir en réunissant les forces éparses<br />
des individus, et en les dirigeant toutes vers un même but. Un secret, quel qu'il soit, flatte<br />
l'amour-propre des hommes; et quand on leur dit qu'ils sont de quelque chose dont leurs<br />
pareils ne sont pas, on acquiert toujours de l'empire sur eux. L'amour-propre se blesse de<br />
ressembler à la multitude; et dès qu'on veut donner des marques de distinction, connues ou<br />
cachées, on est sûr de mettre en mouvement l'imagination de la vanité, la plus active de<br />
toutes. <strong>Les</strong> illuminés politiques n'avaient pris des autres illuminés que quelques signes pour se<br />
reconnaître, mais les intérêts, et non les opinions, leur servaient de point de ralliement. Ils<br />
avaient pour but, il est vrai, de reformer l'ordre social sur de nouveaux principes ; toutefois, en<br />
attendant l'accomplissement de ce grand œuvre, ce qu'ils voulaient d'abord, c'était de<br />
s'emparer des emplois publics.<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
93
Critiques et portraits littéraires Page 501 de Charles Augustin <strong>Saint</strong>e-Beuve 1836<br />
Page 501<br />
[494] OBERMAN 15 .<br />
Nous vivons dans un temps où la publicité met un tel empressement à s'emparer de toutes<br />
choses, où la curiosité est si indiscrète, la raillerie si vigilante, et l'éloge si turbulent, qu'il<br />
semble à peu près impossible que rien de grand ou de remarquable passe désormais dans<br />
l'oubli. Chaque matin, une infinité de filets sont jetés en tous sens à travers les issues du<br />
courant, et remplacent ceux de la veille, qu'on retire humides et chargés. C'est, à une certaine<br />
heure de réveil, un bruit confus, un mouvement universel de ces filets qu'on retire à l'envie et<br />
de ces filets qui tombent. Pas un instant d'intervalle, pas une ligne d'interstice, pas [495]<br />
maille brisée dans ce réseau : tout s'y prend, tout y reste, le gros, le médiocre, et jusqu'au plus<br />
menu; tout est saisi à la fois ou tour à tour, et comparaît à la surface. On peut trouver à redire<br />
au pêle-mêle, désirer plus de discernement dans cette pêche miraculeuse de chaque matin,<br />
demander trêve pour les plus jeunes, qui ont besoin d'attendre et de grandir, pour les plus<br />
mûrs, dont cette impatience puérile interrompt souvent la lenteur fécondante; mais enfin il<br />
semble qu'au prix de quelques inconvénients on obtient au moins cet avantage de ne rien<br />
laisser échapper qui mérite le regard. Cela est assez vrai et le sera de plus en plus, j'espère;<br />
pourtant, jusqu'ici, il y aurait lieu de soutenir, sans trop d'injustice, que cette fièvre de<br />
publicité, cette divulgation étourdissante, a eu surtout pour effet de fatiguer le talent, en<br />
l'exposant à l'aveugle curée des admirateurs, en le sollicitant à créer hors de saison, et qu'elle a<br />
multiplié, en les hâtant, l'essaim des médiocrités éphémères, tandis qu'on n'y a pas gagné<br />
toujours de découvrir et d'admirer sous leur aspect favorable certains génies méconnus. [496]<br />
Le mal, au reste, n'est pas bien grand pour ces sortes de génies, s'ils savent de bonne heure,<br />
abjurant l'apparence, se placer au point de vue du vrai, et il conviendrait de les féliciter, plutôt<br />
que de les peindre, de cette obscurité prolongée où ils demeurent. Il existe une sorte de<br />
douceur sévère et très-profitable pour l'âme à être méconnu ; ama nesciri; c'est le contraire du<br />
digito monstrari, et dicter hic est; c'est quelque chose d'aussi réel et de plus profond, de moins<br />
poétique, de moins oratoire et de plus sage, un sentiment continu, une mesure intérieure et<br />
silencieusement présente du poids des circonstances, de la difficulté des choses, de l'aide<br />
infidèle des hommes, et de notre propre énergie au sein de tant d'infirmité, une appréciation<br />
déterminée, durable, réduite à elle-même, dégagée des échos imaginaires et des lueurs de<br />
l'ivresse, et qui nous inculque dans sa monotonie de rares et mémorables pensées. Si on ignore<br />
ainsi l'épanouissement varié auquel se livrent les natures heureuses ; si, sous ce vent aride, les<br />
couleurs sèchent plus vite dans les jeux de la sève et bien avant que les combinaisons riantes<br />
soient épuisées ; si, par cette [497] oppression qui nous arrête d'abord et nous refoule, quelque<br />
portion de nous-même se stérilise dans sa fleur, et si les plus riches ramures de l'arbre ne<br />
doivent rien donner} — quand l'arbre est fort, quand les racines plongent au loin, quand la<br />
sève continue de se nourrir et monte ardemment; — qu'importe ? — les pertes seront<br />
15 L'Oberman de Senancour, publié en 1804 sans aucun succès, est un de ces livres du seuil de la modernité, où<br />
se révèle, à l'état pur et hors de toute catégorie générique, une conscience. Bien sûr, Oberman, l'« homme des<br />
hauteurs », est avec René ou Adolphe un des premiers « enfants du siècle ». Mais il faut relire cette œuvre pour<br />
mesurer aussi que la mélancolie est le point initial d'une quête qui nous est essentiellement proche - « Senancour,<br />
c'est moi », dira Proust ; celle d'un lieu où être. « Ce n'est pas un ouvrage » Il est tentant d'identifier l'auteur,<br />
Étienne Pivert de Senancour, à son personnage : <strong>Saint</strong>e-Beuve, l'un des premiers, suivit cette piste voyant dans<br />
Oberman moins une réécriture de sa biographie qu'une projection de sa vie. Mais Oberman n'est pas une<br />
autobiographie, insiste l'auteur qui brouille à plaisir les références (dates, lieux, noms). Est-ce même un roman ?<br />
C'est, dans son genre, un roman par lettres, mais à la manière du Werther de Goethe : les quatre-vingt-neuf<br />
lettres de la première édition - auxquelles s'ajoute le supplément de la seconde (1833) - sont celles du seul<br />
Oberman, qui ne se nomme jamais (...)<br />
décennies 1830_1839<br />
94
compensées par de solides avantages, le tronc s'épaissira, l'aubier sera plus dur, les rameaux<br />
plus fixes se noueront. Ainsi pour les génies vigoureux atteints du froid oubli dès leur virilité.<br />
J'aime qu'ils ne s'irritent pas de cet oubli, qu'ils ne se détériorent pas et qu'ils tournent à bien.<br />
Qu'ont-ils à faire ! Ils s'asseyent, ils s'affermissent, ils se tassent en quelque sorte; leur vie se<br />
réfugie au centre; ils donnent moins, parce qu'ils n'y sont pas excités, mais ils ne donnent rien<br />
contre leur désir, ni contre leur secrète loi. Ils s'élèvent et se constituent définitivement à partir<br />
d'eux seuls, sur leur propre base, sans déviation au dehors, par un développement restreint,<br />
laborieux, mais nécessaire. Tout dévoués au réel, à l'effectif, au vrai, ils ne sont pas privés<br />
pour cela d'une manière de beauté et de bonheur ; beauté nue, [498] rigide, sentencieuse,<br />
expressive sans mobilité, assez pareille au front vénérable qui réunit les traits sereins du calme<br />
et les traits profonds des souffrances; bonheur rudement gagné, composé d'élévation et<br />
d'abstinence, inviolable à l'opinion, inaccessible aux penchants, porté longtemps comme un<br />
fardeau, pratiqué assidument comme un devoir, et tenant presque en entier dans l'origine à<br />
cette âpre et douloureuse circoncision du cœur, dont on reste blessé pour la vie.<br />
L'bomme dont nous avons à parler est un grand exemple. Ce contemporain, dont le nom<br />
n'étonnera que ceux qui n'ont lu aucun de ses trois ouvrages caractéristiques, et qu'un instinct<br />
heureux de fureteur ou quelque indication bienveillante n'a pas mis sur la voie des Rêveries,<br />
d’Oberman et des Libres Méditations; l'éloquent et haut moraliste qui débuta en 1799 par un<br />
livre d'athéisme mélancolique, que Rousseau aurait pu écrire comme talent, que Boulanger et<br />
Condorcet auraient ratifié comme penseurs; qui bientôt, sous le titre d'Oberman, individualisa<br />
davantage ses doutes, son aversion sauvage de la société, sa contemplation fixe, opiniâtre,<br />
passionnément sinistre de la [499] nature, et prodigua, dans les espaces lucides de ses rêves,<br />
mille paysages naturels et domestiques, d'où s'exhale une inexprimable émotion, et que cerne<br />
à l'entour une philosophie glacée; qui, après cet effort, longtemps silencieux et comme<br />
stérilisé, mûrissant à l'ombre, perdant en éclat, n'aspirant plus qu'à cette chaleur modérée qui<br />
émane sans rayons de la vérité lointaine et de l'immuable justice, s'est élevé, dans les Libres<br />
Méditations, à une sorte de théosophie morale, toute purgée de cette âcreté chagrine qu'il avait<br />
sucée avec son siècle contre le christianisme, et toute pleine, au contraire . de confiance, de<br />
prière et de douce conciliation ; fruit bon, fruit aimable d'un automne qui n'en promettait pas<br />
de si savoureux; cet homme éminent que le chevalier de Boufflers a loué, à qui Nodier<br />
empruntait des épigraphes vers 1804, que M. Jay estime, que les anciens rédacteurs du<br />
Constitutionnel et du Mercure ont connu ; que plusieurs littérateurs de cinquante ans regardent<br />
comme aussi ingénieux que modeste; dont les femmes ont lu le livre de l'amour, un peu sur la<br />
foi du titre, et que les jeunes gens de notre âge se rappellent [500] peut-être avoir vu figurer<br />
dans quelque réquisitoire sous la restauration; — M. de Sénancour a eu, à tous égards, une de<br />
ces destinées fatigantes, malencontreuses, entravées, qui, pour être venues ingratement et<br />
s'être heurtées en chemin, se tiennent pourtant debout à force de vertu, et se construisent à<br />
elles-mêmes leur inflexible harmonie, leur convenance majestueuse. Si l'on cherche la raison<br />
de cet oubli bizarre, de cette inadvertance ironique de la renommée, on la trouvera en partie<br />
dans le caractère des débuts de M. de Sénancour, dans cette pensée trop continue à celle du<br />
dix-huitième siècle, quand tout poussait à une brusque réaction, dans ce style trop franc, trop<br />
réel, d'un pittoresque simple et prématuré, à une époque encore académique de descriptions et<br />
de périphrases; de sorte que, pour le fond comme pour la forme, la mode et lui ne se<br />
rencontrèrent jamais; on la trouvera dans la censure impériale qui étouffa dès lors sa parole<br />
indépendante et suspecte d'idéologie, dans l'absence de public jeune, viril, enthousiaste; ce<br />
public était occupé sur les champs de batailles, et, en fait de jeunesse, il n'y avait que [501] les<br />
valétudinaires réformés, ou les fils de famille à quatre remplaçants, qui vécussent de régime<br />
littéraire. Marie-Joseph Chénier, de la postérité du dix-huitième siècle comme M. de<br />
Sénancour, l'a ignoré complètement, puisqu'il ne l'a pas mentionné dans son Tableau de la<br />
littérature depuis 89, où figurent tant de noms. L'empire écroulé, l'auteur d'Oberman ne fit rien<br />
décennies 1830_1839<br />
95
pour se remettre en évidence et attirer l'attention des autres sur des ouvrages déjà loin de lui. Il<br />
persévéra dans ses habitudes solitaires, dans les travaux parfois fastidieux imposés à son<br />
honorable pauvreté. Il s'ensevelit sous la religion du silence, à l'exemple des gymnosophistes<br />
et de Pythagore; il médita dans le mystère, et s'attacha par principes à demeurer inconnu,<br />
comme avait fait l'excellent <strong>Saint</strong>-Martin. « <strong>Les</strong> prétentions des moralistes, comme celles des<br />
théosophes, dit-il en tête des Libres Méditations, ont quelque chose de silencieux; c'est une<br />
réserve conforme, peut-être, à la dignité du sujet. » Désabusé des succès bruyants, réfugié en<br />
une région inaltérable dont l'atmosphère tranquillise, il s'est convaincu que cette gloire qu'il<br />
n'avait [502] pas eue ne le satisferait pas s'il la possédait, et s'il n'avait travaillé qu'en vue de<br />
l'obtenir. « Car, remarque-t-il, la gloire obtenue passe »; en quelque sorte derrière nous, et n'a<br />
plus d’éclat; nous en aimions surtout ce qu'elle offrait dans l'avenir, ce que nous ne pouvions<br />
connaître que sous un point de vue favorable aux illusions. » II n'est pas étonnant qu'avec<br />
cette manière de penser le nom de M. de Sénancour soit resté à l'écart dans cette cohue<br />
journalière de candidatures à la gloire, et que, n'ayant pas revendiqué son indemnité<br />
d'écrivain, personne n'ait songé à la lui faire compter. Il eut pourtant, du milieu de l'oubli qu'il<br />
cultive, le pouvoir d'exciter ça et là quelques admirations vives, secrètes, isolées, dont<br />
plusieurs sont venues vibrer jusqu'à lui, mais dont le plus grand nombre, sans doute, ne se<br />
sont jamais révélées à leur auteur. Nodier, avons-nous dit, le connut et le comprit dès<br />
l'origine; Ballanche, qui, parti d'une philosophie tout opposée, a tant de conformités morales<br />
avec lui, l'apprécie dignement. Il y a quelques années, une petite société philosophique, dont<br />
MM. Victor Cousin, J.-J. Ampère, Stapfer, Sau-[503] telet, faisaient partie, et qui, durant le<br />
silence public de l'éloquent professeur, se nourrissait de sérieuses discussions familières, en<br />
vit naître de très-passionnées au sujet d’Oberman, qui était tombé entre les mains de l'un des<br />
jeunes métaphysiciens. Oberman, en effet, quand on le lit à un certain âge et dans une certaine<br />
disposition d'âme, doit provoquer un enthousiasme du genre de celui que Young, Ossian et<br />
Werther inspirèrent en leur temps. Beaucoup d'hommes du Nord (car Oberman a un sentiment<br />
admirable de la nature, de celle du Nord en particulier) ont répondu avec transport à la lecture<br />
du livre de M. de Sénancour; Oberman vit dans les Alpes, et la nature alpestre, comme l'a dit<br />
M. Ampère, est en relief ce qu'est la nature de Norwége en développement. L'auteur de cet<br />
article a rencontré pour la première fois les deux volumes d'Oberman à une époque où il<br />
achevait lui-même d'écrire un ouvrage de rêverie individuelle qui rentre dans l'inspiration<br />
générale de son aîné; il ne saurait rendre quelle étonnante impression il en reçut, et combien<br />
furent senties son émotion, sa reconnaissance envers le devancier obscur qui avait…<br />
Page 569<br />
L'ABBÉ de LA MENNAIS.<br />
[533] « Vous êtes à l'âge où l'on se décide; plus tard on subit le joug de la destinée qu'on s'est<br />
faite, on gémit dans le tombeau qu'on s'est creusé, sans pouvoir en soulever la pierre. Ce qui<br />
s'use le plus vite en nous, c'est la volonté. Sachez donc vouloir une fois, vouloir fortement;<br />
fixez votre vie flottante et ne la laissez plus emporter à tous les souffles comme le brin d'herbe<br />
séchée. » Ce conseil donné quelque part à une âme malade par le prêtre illustre dont nous<br />
avons a nous occuper pourrait s'adresser à presque toutes les âmes en ce siècle<br />
(…)<br />
[568] Vers le même temps où l'esprit de M. de La Mennais acceptait si largement l'union du<br />
catholicisme avec l'état par la liberté, il tendait aussi à se déployer dans l'ordre de science et à<br />
le remettre en harmonie avec la foi. Pendant les intervalles de la controverse vigoureuse à<br />
laquelle on l'aurait cru tout employé, serein et libre, retiré de ce monde politique actif où le<br />
Conservateur l'avait vu un instant mêlé et d'où tant d'intrigues hideuses l'avaient fait fuir,<br />
décennies 1830_1839<br />
96
entouré de quelques pieux disciples, sous les chênes druidiques de la Chesnaye, seul débris<br />
d'une fortune en ruines, il composait les premières parties d'un grand ouvrage de philosophie<br />
religieuse qui n'est pas fini, mais qui promet d'embrasser par une méthode toute rationnelle<br />
l'ordre entier des connaissances humaines, à partir de la plus simple notion de l'être : le but<br />
dernier de l'auteur, .dans cette conception encyclopédique, est de rejoindre d'aussi près que<br />
possible les vérités primordiales [569] d'ailleurs imposées, et de prouver à l'orgueilleuse<br />
raison elle-même qu'en poussant avec ses seules ressources, elle n'a rien de mieux à faire que<br />
d'y aboutir. La logique la plus exacte jointe à un fonds d'orthodoxie rigoureuse s'y fraie une<br />
place entre <strong>Saint</strong>-Martin et Baader. Nous avons été assez favorisé pour entendre durant<br />
plusieurs jours de suite les premiers développements de cette forte recherche : ce n'était pas à<br />
la Chesnaye, mais plus récemment à Juilly, dans une de ces anciennes chambres d'oratoriens,<br />
où bien des hôtes s'étaient assis sans doute depuis Malebranche jusqu'à Fouché; je ne me<br />
souvenais que de Malebranche. Pendant que lisait l'auteur, bien souvent distrait des paroles,<br />
n'écoutant que sa voix, occupé à son accent insolite et à sa face qui s'éclairait du dedans, j'ai<br />
subi sur l'intimité de son être des révélations d'âme à âme qui m'ont fait voir clair en une bien<br />
pure essence. Si quelques enchaînements du livre me sont ainsi échappés, j'y ai gagné<br />
d'emporter avec moi le plus vif de l'homme. Entre les disciples les plus chers de M. de La<br />
Mennais, il en est deux surtout dont, la destinée [570] se lie à la sienne, .et qu'on ne peut<br />
s'empêcher de nommer à côté de lui. Tous les deux en effet complètent, couronnent leur<br />
illustre maître, et, par une sorte de dédoublement heureux, nous présentent chacun une de ses<br />
moitiés agrandie et plus en lumière. L'abbé Gerbet a la logique aussi certaine mais moins<br />
armée d'armes, étrangères, une lucidité posée et réfléchie, persuasive avec onction et<br />
rayonnante d'un doux amour : l'abbé Lacordaire exprime plutôt le côté oratoire militant avec<br />
de la nouveauté et du jeune éclat; il a l'hymne sonore toujours prêt à s'élancer de sa lèvre, et la<br />
parole étincelante comme le glaive du, lévite.<br />
(…)<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
97
Nouveax portraits et critiques littéraires Page 35 de Charles Augustin <strong>Saint</strong>e-Beuve<br />
1836<br />
Page 35<br />
Lamartine<br />
(…)<br />
… [33] Mais où trouver l'âme sacrée qui chante? Fénelon n'avait pas de successeur pour la<br />
tendresse insinuante et fleurie, pas plus que Malebranche pour l'ordre majestueux et lucide.<br />
En même temps que l'esprit grave, mélancolique, de Vauvenargues, retardé par le scepticisme,<br />
s'éteint avant d'avoir pu s'ap-[34] pliquer à la philosophie religieuse où il aspire, des natures<br />
sensibles, délicates, fragiles et repentantes, comme mademoiselle Aïssé, l'abbé Prévost,<br />
Gresset, se font entrevoir et se trahissent par de vagues plaintes ; mais une voix expressive<br />
manque à leurs émotions; leur monde intérieur ne se figure ni ne se module en aucun endroit.<br />
Plus tard, Diderot et Rousseau, puissances incohérentes, eurent en eux de grandes et belles<br />
parties d'inspiration ; ils ouvrent des jours magnifiques sur la nature extérieure et sur l'âme ;<br />
mais ils se plaisent aussi à déchaîner les ténèbres. C'est une pâture mêlée et qui n'est pas saine<br />
que la leur. La raison s'y gonfle, le cœur s'y dérange, et ils n'indiquent aucune guérison. Ils<br />
n'ont rien de soumis ni de constamment simple : la colère en eux contrarie l'amour. Cela est<br />
encore plus vrai de Voltaire, qui toutefois dans certains passages de Zaïre, surtout dans<br />
quelques unes de ses poésies diverses, a effleuré des cordes touchantes, deviné de secrets<br />
soupirs, mais ne l'a fait qu'à la traverse et par caprices rapides. Il y a de la rage et trop d'insulte<br />
dans les cris étouffés de Gilbert. Un homme, un homme seul au dix-huitième siècle, nous<br />
semble recueillir en lui, amonceler dans son sein et n'exhaler qu'avec mystère, tout ce qui<br />
tarissait ailleurs de pieux, de lucide et de doux, tout ce qui s'aigrissait au souffle du siècle dans<br />
de bien nobles âmes; humilité, sincérité parfaite, goût de silence et de solitude, inextinguibles<br />
élancements de prière et de désir, [35] encens perpétuel, harpe voilée, lampe du sanctuaire,<br />
c'était là le secret de son être, à lui ; cette nature mystique, ornée des dons les plus subtils<br />
éveille l'idée des plus saints emblèmes. Au milieu d'une philosophie matérialiste envahissante<br />
et d'un christianisme de plus en plus appesanti, la quintessence religieuse s'était réfugiée en sa<br />
pensée comme en un vase symbolique, soustrait aux regards vulgaires. Ce personnage, alors<br />
inconnu et bien oublié de nos jours, qui s'appelait lui-même à travers le désert bruyant de son<br />
époque le Robinson de la spiritualité, que M. de Maistre a nommé le plus aimable et le plus<br />
élégant des théosophes, créature de prédilection véritablement faite pour aimer, pour croire et<br />
pour prier, <strong>Saint</strong>-Martin s'écriait, en s'adressant de bien loin aux hommes de son temps, dans<br />
ce langage fluide et comme imprégné d'ambroisie, qui est le sien : « Non, homme, objet cher<br />
et sacré pour mon cœur, je ne craindrai point de t'avoir abusé en te peignant ta destinée sous<br />
des couleurs si consolantes. Regarde-toi au milieu de ces secrètes et intérieures insinuations<br />
qui stimulent si souvent ton âme, au milieu de toutes les pensées pures et lumineuses qui<br />
dardent si souvent sur ton esprit, au milieu de tous les faits et de tous les tableaux des êtres<br />
pensants, visibles et invisibles, au milieu de tous les merveilleux phénomènes de la nature<br />
physique, au milieu de tes propres œuvres et de tes propres productions [36] ; regarde-toi<br />
comme au milieu d'autant de religions ou au milieu d'autant d'objets qui tendent à te rallier à<br />
l'immuable vérité. Pense avec un religieux transport que toutes ces religions ne cherchent qu'à<br />
ouvrir tes organes et tes facultés aux sources de l'admiration, dont tu as besoin Marchons donc<br />
ensemble avec vénération dans ces temples nombreux que nous rencontrons à tous les pas, et<br />
ne cessons pas un instant de nous croire dans les avenues du <strong>Saint</strong> des <strong>Saint</strong>s. » N'est-ce pas<br />
un prélude des Harmonies qu'on entend? Un bon nombre des psaumes ou cantiques, qui<br />
composent l'Homme de Désir, pourraient passer pour de larges et mouvants canevas, jetés par<br />
notre illustre contemporain, dans un de ces moments d'ineffable ébriété où il chante :<br />
Encore un hymne, ô ma lyre !<br />
décennies 1830_1839<br />
98
Un hymne pour le Seigneur !<br />
Un hymne dans mon délire,<br />
Un hymne dans mon bonheur !<br />
Aux soi-disants poètes de son époque qui dépensaient leurs rimes sur des descriptions, des<br />
tragédies ou des épopées, toutes de convention et d'artifice, <strong>Saint</strong>-Martin fait honte de ce<br />
matérialisme de l'art :<br />
Mais voyez à quel point va votre inconséquence !<br />
Vous vous dites sans cesse inspirés par les cieux,<br />
[37]<br />
Et vous ne frappez plus notre oreille, nos yeux,<br />
Que par le seul tableau des choses de la terre ;<br />
Quelques traits copiés de l'ordre élémentaire,<br />
<strong>Les</strong> erreurs des mortels, leurs fausses passions,<br />
<strong>Les</strong> récits du passé, quelques prédictions<br />
Que vous ne recevez que de votre mémoire,<br />
Et qu'il vous faut suspendre où s'arrête l'histoire ;<br />
Voilà tous vos moyens, voilà tous les trésors<br />
Dont vous fassent jouir vos plus ardents efforts.<br />
Par malheur, <strong>Saint</strong>-Martin lui-même, ce réservoir immense d'onction et d'amour, n'avait qu'un<br />
instrument incomplet pour se répandre ; le peu de poésie qu'il a essayée, et dont nous venons<br />
de donner un échantillon, est à peine tolérable ; bien plus, il n'eut jamais l'intention d'être<br />
pleinement compris. Lié à des doctrines occultes, s'environnant d'obscurités volontaires,<br />
tourné en dedans et en haut, il n'est là, en quelque sorte, que pour perpétuer la tradition<br />
spiritualiste dans une vivacité sans mélange, pour protester devant Dieu par sa présence<br />
inaperçue, pour prier angéliquement derrière la montagne durant la victoire passagère des<br />
géants. J'ignore s'il a gagné aux voies trop détournées, où il s'est tenu, beaucoup d'âmes de<br />
mystère; mais il n'a en rien touché le grand nombre des âmes accessibles d'ailleurs aux belles<br />
et bonnes paroles, et dignes de consolation. Il faut, en effet, pour arriver à elles, pour<br />
prétendre à les ravir et à être nommé d'elles leur bienfaiteur, joindre à un fonds aussi précieux,<br />
aussi excellent [38] que celui de l'Homme de Désir, une expression peinte aux yeux sans<br />
énigme, la forme à la fois intelligente et enchanteresse, la beauté rayonnante, idéale, mais<br />
suffisamment humaine, l'image simple et parlante comme l'employaient Virgile et Fénelon, de<br />
ces images dont la nature est semée, et qui répondent à nos secrètes empreintes; il faut être un<br />
homme du milieu de ce monde, avoir peut-être moins purement vécu que le théosophe, sans<br />
que pourtant le sentiment du saint se soit jamais affaibli au cœur; il faut enfin croire en soi et<br />
oser, ne pas être humble de l'humilité contrite des solitaires, et aimer un peu la gloire comme<br />
l'aimaient ces poètes chrétiens qu'on couronnait au Capitule. Rousseau, disions-nous, avait eu<br />
de grandes parties d'inspiration ; il avait prêté un admirable langage à une foule de<br />
mouvements obscurs de l'âme et d'harmonies éparses dans la nature. La misanthropie et<br />
l'orgueil qui venaient à la traverse, les perpétuelles discussions qui entrecoupent ses rêveries,<br />
le recours aux hypothèses hasardées, et, pour parler juste, un génie politique et logique, qui ne<br />
se pouvait contraindre, firent de lui autre chose qu'un poète qui charme, inonde et apaise. Et<br />
puis c'était de la prose; or, la prose, si belle, si grave, si rythmique qu'on la fasse (et quelle<br />
prose que celle de Jean-Jacques !) n'est jamais un chant. A Rousseau, par une filiation plus ou<br />
moins soutenue, mais étroite et certaine à l'origine, se [39] rattachent Bernardin de <strong>Saint</strong>-<br />
Pierre, madame de Staël et M. de Châteaubriand. Tous les trois se prirent de préférence au<br />
côté spiritualiste, rêveur, enthousiaste, de leur auteur, et le fécondèrent selon leur propre<br />
génie. Madame de Staël se lança dans une philosophie vague sans doute et qui, après quelque<br />
velléité de stoïcisme, devint bientôt abandonnée, sentimentale, mais resta toujours adoratrice<br />
décennies 1830_1839<br />
99
et bienveillante. Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre répandit sur tous ses écrits la teinte évangélique du<br />
vicaire savoyard. M. de Châteaubriand, sorti d'une première incertitude, remonta jusqu'aux<br />
autels catholiques dont il fêta la dédicace nouvelle. Ces deux derniers, qui, sous l'appareil de<br />
la philanthropie ou de l'orthodoxie, couvraient des portions de tristesse chagrine et de<br />
préoccupation assez amère, dont il n'y a pas trace chez leur rivale expansive, avaient le mérite<br />
de sentir, de peindre, bien autrement qu'elle, cette nature solitaire qui, tant de fois, les avait<br />
consolés des hommes ; ils étaient vraiment religieux par là, tandis qu'elle, elle était plutôt<br />
religieuse en vertu de ses sympathies humaines. Chez tous les trois, ce développement plein<br />
de grandeur auquel, dans l'espace de vingt années, on dut les Etudes et les Harmonies de la<br />
Nature, Delphine et Corinne, le Génie du Christianisme et les Martyrs, s'accomplissait au<br />
moyen d'une prose riche, épanouie, cadencée, souvent métaphysique chez madame de Staël,<br />
purement poétique dans les [40] deux autres, et d'autant plus désespérante, en somme, qu'elle<br />
n'avait pour pendant et vis-à-vis que les jolis miracles de la versification delilienne. Mais<br />
Lamartine était né. Ce n'est plus de Jean-Jacques qu'émane directement Lamartine ; c'est de<br />
Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre, de M. de Châteaubriand et de lui-même. La lecture de Bernardin de<br />
<strong>Saint</strong>-Pierre produit une délicieuse impression dans la première jeunesse. Il a peu d'idées, des<br />
systèmes importuns, une modestie fausse, une prétention à l'ignorance, qui revient toujours et<br />
impatiente un peu. Mais il sent la nature, il l'adore, il l'embrasse sous ses aspects magiques,<br />
par masses confuses, au sein des clairs de lune où elle est baignée ; il a des mots d'un effet<br />
musical et qu'il place dans son style comme des harpes éoliennes, pour nous ravir en rêverie.<br />
Que de fois, enfant, le soir le long des routes, je me suis surpris répétant avec des pleurs son<br />
invocation aux forêts et à leurs résonnantes clairières ! Lamartine, vers 1808, devait beaucoup<br />
lire les Études de Bernardin; il devait dès lors s'initier par lui au secret de ces voluptueuses<br />
couleurs dont plus tard il a peint dans le Lac son souvenir le plus chéri :<br />
Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,<br />
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,<br />
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface<br />
De ses molles clartés !<br />
[41] Le génie pittoresque du prosateur a passé tout entier en cette muse : il s'y est éclipsé et<br />
s'est détruit lui-même en la nourrissant. Aussi, à part Paul et Virginie, que rien ne saurait<br />
atteindre, Lamartine dispense à peu près aujourd'hui de la lecture de Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre<br />
; quand on nommera les Harmonies, c'est uniquement de celles du poète que la postérité<br />
entendra parler. Lamartine, vers le même temps, aima et lut sans doute beaucoup le Génie du<br />
Christianisme, René: si sa simplicité, ses instincts de goût sans labeur ne s'accommodaient<br />
qu'imparfaitement de quelques traits de ces ouvrages, son éducation religieuse, non moins que<br />
son anxiété intérieure, le disposait à en saisir les beautés sans nombre. Quand il s'écrie à la fin<br />
de l'Isolement, dans la première des premières Méditations :<br />
Et moi je suis semblable à la feuille flétrie<br />
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !<br />
Il n'est que l'écho un peu affaibli de cette autre voix impétueuse:<br />
Levez-vous, orages désirés, qui devez emporter René, etc. Rousseau, je le sais, agit aussi très<br />
puissamment sur Lamartine ; mais ce fut surtout à travers Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre et M. de<br />
Chateaubriand qu'il le sentit. Il n'eut rien de Werther; il ne connut guère Byron de bonne<br />
heure, et même en savait peu de chose au delà du renom fantastique qui circulait, quand il lui<br />
[42] adressa sa magnifique remontrance. Son génie préexistait à toute influence lointaine.<br />
André Chénier, dont la publication tardive (18<strong>19</strong>) a donné l'éveil à de bien nobles muses,<br />
particulièrement à celle de M. Alfred de Vigny, resta, jusqu'à ces derniers temps, inaperçu et,<br />
disons-le, méconnu de Lamartine, qui n'avait rien, il est vrai, à tirer de ce monde d'inspiration<br />
antique, et dont le style était déjà né de lui-même à la source de ses pensées. J'oserai affirmer,<br />
sans crainte de démenti, que, si les poésies fugitives de Ducis sont tombées aux mains de<br />
décennies 1830_1839<br />
100
Lamartine, elles l'ont plus ému dans leur douce cordialité et plus animé à produire, que ne<br />
l'eussent fait les poésies d'André, quand elles auraient paru dix ans plus tôt. Il ne goûte, il ne<br />
vénère que depuis assez peu d'années Pétrarque, le grand élégiaque chrétien, et son plus<br />
illustre ancêtre. <strong>Saint</strong>-Martin, que j'ai nommé, n'aura jamais été probablement de sa bien<br />
étroite connaissance. Lamartine n'est pas un homme qui élabore et qui cherche ; il ramasse, il<br />
sème, il moissonne sur sa route ; il passe à côté, il néglige ou laisse tomber de ses mains; sa<br />
ressource surabondante est en lui ; il ne veut que ce qui lui demeure facile et toujours présent.<br />
Simple et immense, paisiblement irrésistible, il lui a été donné d'unir la profusion des<br />
peintures naturelles, l'esprit d'élévation des spiritualistes fervents, et l'ensemble de vérités en<br />
dépôt au fond des moindres cœurs. C'est une sensibilité reposée, méditative, [43] avec le goût<br />
des mouvements et des spectacles de la vie, le génie de la solitude avec l'amour des hommes,<br />
une ravissante volupté sous les dogmes de la morale universelle. Sa plus haute poésie traduit<br />
toujours le plus familier christianisme et s'interprète à son tour par lui. Son âme est comme<br />
l'idéal accompli de la généralité des âmes que l'ironie n'a pas desséchées, que la nouveauté<br />
n'enivre pas immodérément, que les agitations mondaines laissent encore délicates et libres.<br />
Et en même temps, sa forme, la moins circonscrite, la moins matérielle, la plus diffusible des<br />
formes dont jamais langage humain ait revêtu une pensée de poète, est d'un symbole constant,<br />
partout lucide et immédiatement perceptible.<br />
(…)<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
101
Histoire de la philosophie allemande depuis Leibnitz jusqu'à Hegel Page 123 de Auguste<br />
Théodore H. Barchou de Penhoën, Barchou de Penhoen 1836<br />
Page 101 … [101] …<br />
En France, la philosophie avait fait quelques efforts pour sortir des voies matérialistes du<br />
XVIIIe siècle. Déjà nous avons mentionné la noble protestation de <strong>Saint</strong>-Martin contre le<br />
matérialisme éloquemment professé par Garat. Sous le nom du philosophe inconnu, <strong>Saint</strong>-<br />
Martin avait publié, plusieurs années avant la Révolution, quelques uns de ses livres, où se<br />
trouve le système spiritualiste auquel il a donné son nom. Au milieu des orages<br />
révolutionnaires grondant autour de lui, sur le sol ensanglanté et couvert des débris de la<br />
patrie, il continua ses paisibles méditations. Ses ouvrages, demeurés inconnus de la foule,<br />
écrits même parfois dans une langue convenue, n'en agissaient que plus activement peut- être<br />
sur un petit nombre d'esprits, de fidèles disciples. On le sait : la doctrine de [102] <strong>Saint</strong>-Martin<br />
est un mysticisme chrétien. <strong>Saint</strong>-Martin croyait trouver dans la Bible, dans les Évangiles, des<br />
paroles mystérieuses, des sens inconnus de la foule, qui devaient dévoiler les lois de l'histoire<br />
et de la création. <strong>Saint</strong>-Martin, de même que ce Jacob Bœhm, dont il s'était fait le traducteur,<br />
considérait la terre, le monde comme une sorte d'emblème du christianisme. C'est le point de<br />
vue absolument opposé de celui du matérialisme, qui n'explique le monde, l'homme, la<br />
création, que par l'action des éléments. Moins mystiques, les idées d'un autre philosophe se<br />
trouvent pourtant, sur quelques points, en harmonie avec celles de <strong>Saint</strong>-Martin : nous<br />
voulons parler de M. de Bonald. M. de Bonald n'écrivit point sur la philosophie proprement<br />
dite ; mais ses théories religieuses et sociales se trouvaient encore en opposition absolue avec<br />
celles de la philosophie du XVIIIe siècle. La Philosophie du XVIIIe siècle avait eu pour but la<br />
destruction de la monarchie française. M. de Bonald se porta le défenseur de la vieille<br />
constitution française dans son intégrité. Le premier il prêcha parmi nous la [103] théorie<br />
d'une révélation primitive ; il soutint les idées innées, la révélation du langage à l'homme par<br />
un souffle divin. Sa théorie politique était toute chrétienne ; c'était la Bible que l'auteur de la<br />
législation primitive opposait au Contrat social. Il voyait dans la famille, non dans l'individu,<br />
l'élément de la société ; il voyait dans la constitution de la famille le modèle idéal, le type de<br />
la constitution de l'État. Par <strong>Saint</strong>-Martin et Bonald la philosophie française tendait donc à<br />
sortir du matérialisme du XVIIIe siècle, à la même époque où, par l'organe de Schelling, la<br />
philosophie allemande tendait à sortir de l'idéalisme exalté de Fichte. La philosophie de Fichte<br />
repoussait énergiquement le matérialisme français ; la philosophie de Schelling se trouvait en<br />
harmonie avec la nouvelle tendance spiritualiste de l'école française.<br />
(…)<br />
Page 123<br />
… [122]…<br />
Contemporain de Hobbes, le lord Edouard Herbert de Cherbury, suivant une direction<br />
opposée, s'efforçait, au contraire, de créer une philosophie toute religieuse, toute spiritualiste.<br />
Son enseignement n'eut que peu de retentissement.<br />
A la même époque, un médecin, Jean-Baptiste Van-Helmont (i577-i644), alliait le mysticisme<br />
à l'étude des sciences naturelles ; il cherchait à faire une philosophie du grand tout. Selon<br />
Van-Helmont, toute science, toute connaissance de l'intuition immédiate de a Divinité ; la<br />
nature entière est animée; dans l'univers sont enfermées, emprisonnées des substances<br />
spirituelles qui se manifestent à nous sous la forme de puissances naturelles. Van-Helmont<br />
faisait sortir toutes choses de l'air et de l'eau. En Angleterre, les idées de Paracelse trouvaient<br />
un ardent sectateur dans le médecin Robert Fludd (1574-1637). En Allemagne apparaissait<br />
(1575-1624) le fameux [123] Jacob Bœhm. Bœhm cherchait dans la Bible l'explication du<br />
monde extérieur. Selon Bœhm, ce monde n'était autre chose que le relief, la mise en saillie<br />
d'un monde invisible caché dans son propre sein; la Bible, la tradition en étaient comme<br />
décennies 1830_1839<br />
102
autant de révélations. La réputation de Bœhm fut immense dans son temps; le roi d'Angleterre<br />
envoya près de lui un savant, avec l'unique mission de le comprendre et de le traduire. De nos<br />
jours il a conservé de nombreux adeptes : le lecteur a déjà nommé le plus célèbre d'entre eux,<br />
le fameux <strong>Saint</strong>-Martin, le philosophe inconnu. Singulier spectacle, qui appelle tout à la fois<br />
admiration et sympathie. Voyez ce pauvre cordonnier; vous le croyez peut-être préoccupé des<br />
misères de son humble condition ; mais, sur les ailes de l'inspiration, il voyage avec Platon<br />
dans les sphères les plus élevées du monde des intelligibles.<br />
A la suite de tous ces noms, célèbres à degrés et à titres différents, se présentent ceux de<br />
Descartes, de Malebranche, de Spinoza. C'est dans ce moment qu'il eût été opportun [124]<br />
d'en parler, si nous n'eussions consulté que le seul ordre chronologique.<br />
Mais on l'a vu, avant ce rapide coup d'œil jeté sur le mouvement de l'esprit philosophique<br />
dans les XVe, XVIe et XVIIIe siècles, nous avons commencé par esquisser rapidement<br />
quelques uns des grands traits de leur système. Pour agir ainsi, nous n'avons pas manqué de<br />
motifs. La philosophie de Leibnitz, par conséquent la philosophie allemande tout entière, se<br />
trouvait en germe dans le cartésianisme ; et, par ce motif, nous avons d'abord dit en quoi<br />
consistait ce germe. L'examen des autres systèmes antérieurs au cartésianisme, et dont<br />
Leibnitz put avoir connaissance, ne devait venir qu'après ; ces systèmes, ces doctrines, ces<br />
opinions, sont seulement comme le terrain où a grandi ce germe, où il a développé, en s'en<br />
assimilant une portion, un mouvement progressif et continu que nous allons étudier dès à<br />
présent.<br />
Dans sa jeunesse, Leibnitz ne montra d'inclination particulière vers aucun genre d'études ; les<br />
plus diverses, en apparence les plus opposées entre elles, l'attiraient également.<br />
…<br />
Page 325<br />
… [322] … toutes ces voies, la pensée de Condillac est indiquée comme la dernière borne à<br />
laquelle il soit donné à l'esprit humain de toucher. Il s'en faut de peu qu'aux yeux de Garat<br />
Condillac ne soit a lui seul l'intelligence, le génie de l'humanité. Avec de telles dispositions, il<br />
eût été difficile à Garat de faire autre chose que continuer Condillac devant l'École normale ;<br />
suivant Garat, la sensation est aussi la source, le fondement de nos connaissances ; il se<br />
propose d'abord de l'analyser, de la décrire avec un soin tout spécial. « Ici, disait Garat, je<br />
traduirai, au tribunal de la philosophie de notre siècle et du bon sens du genre humain,<br />
l'opinion de ces philosophes anciens et modernes, qui, dans la recherche de la vérité, ont<br />
récusé le témoignage de tous les sens, qui ont tenté d'anéantir la raison humaine sous sa<br />
propre autorité, et d'arracher les sciences comme de leurs racines. Voilà ce qu'ont fait dans la<br />
Grèce Platon, en France Malebranche, et, ce qu'il y a d'étonnant, en Angleterre, plusieurs<br />
disciples de Locke (1). » Garât se pro-<br />
(1) Recueil des leçons de l'Ecole normale, 1 er volume page 7<br />
[323] pose de traiter des facultés de l'entendement, qu'il réduit, ainsi que Condillac, à la<br />
sensation transformée. Il s'élève fortement contre la supposition d'un sens moral. « Je<br />
prouverai, dit-il, que la douleur et le plaisir, qui nous apprennent à nous servir de nos sens et<br />
de nos facultés, nous apprennent encore à nous faire les notions du vice et de la vertu (1). » A<br />
propos de l'invention des langues, il blâme Rousseau d'avoir cru l'institution des langues<br />
impossible par l'homme. « Puisque tous les mots, avait dit Rousseau, sont établis par suite<br />
d'une convention, il paraît que l'usage de la parole a été une condition indispensable pour<br />
l'établissement de la parole. » Garat lui reproche aigrement et amèrement cette proposition ; il<br />
ne peut lui pardonner de rapporter l'enseignement de la parole à une révélation primitive; il lui<br />
reproche d'avoir recours au moyen favori des mauvais poètes, qui eût de faire descendre la<br />
Divinité sur la terre pour amener le dénouement du drame. Le professeur devait ensuite<br />
traiter, dans sa cinquième<br />
(1) Recueil des leçons de l’Ecole normale. 2 e ligne, page 25.<br />
décennies 1830_1839<br />
103
[324] partie, de la méthode : « Dans cette partie, je n'aurai, ajoute-t-il, presque rien à dire de<br />
nouveau; je me bornerai à recueillir les résultats que j'aurai exposés et développés dans les<br />
sections précédentes. Je ferai voir que bien sentir, bien se servir de ses facultés, bien former<br />
ses idées, bien parler, sous des points de vue et des termes divers, ne sont qu'une seule et<br />
même chose (1). M Toujours donc la sensation transformée, toujours l'intérêt bien entendu,<br />
toujours l'interjection, toujours, en un mot, la philosophie du XVIIIe siècle. Cette philosophie<br />
dominait alors avec une puissance qui en faisait comme une religion ; elle était non seulement<br />
la vérité, mais toute la vérité : ses nombreux disciples n'admettaient pas qu'il y eût possibilité<br />
à croire en quelque autre symbole philosophique.<br />
Le spiritualisme essaya pourtant d'une timide récrimination. A cette école, les élèves avaient<br />
le droit d'interpeller les professeurs, soit pour les combattre, soit pour leur deman-<br />
(1) Recueil des leçons de l'Ecole normale, 2e volume, page 39.<br />
[325] der de plus amples explications : un jour par semaine était réservé à ces débats. Or,<br />
parmi les auditeurs de Garat, se trouvait ce fameux <strong>Saint</strong>-Martin, auteur mystérieux de tant<br />
d'ouvrages mystiques, traducteur et commentateur de Jacob Bœhm, celui que M. de Maistre a<br />
nommé le plus élégant des théosophes modernes, et probablement seul alors à oser professer<br />
en France une autre philosophie que celle de Condillac. <strong>Saint</strong>-Martin eut d'abord quelque<br />
peine à se faire au langage du jour. La langue du matérialisme ne ressemblait en rien à celle<br />
parlée dans ces hautes sphères de la spéculation où l'emportait son génie. Enfin, le professeur<br />
ayant amèrement blâmé cette célèbre proposition de Jean-Jacques : « La parole semble avoir<br />
été fort nécessaire à l'institution de la parole, » <strong>Saint</strong>-Martin, de son banc, et du milieu de la<br />
foule, entreprit la défense de Rousseau. Profitant de l'occasion, il défendait de même, contre<br />
une autre attaque du professeur, la doctrine de Hutcheson sur le sens moral. Mais le débat ne<br />
tarda pas à devenir plus important, le dialogue suivant s'engagea entre l'élève et le professeur :<br />
« Vous paraissez vouloir, [526] disait ce dernier, qu'il y ait dans l'homme un organe<br />
d'intelligence autre que nos sens extérieurs et notre sensibilité intérieure ? — Oui, citoyen. —<br />
Un organe d'intelligence ? — Oui, citoyen. — Vous avez pour doctrine que sentir les choses<br />
et les connaître sont des choses différentes ? — J'en suis persuadé. — Cependant, lorsque je<br />
reçois en présence du soleil les sensations que me donne cet astre éclatant qui échauffe et qui<br />
éclaire la terre, est-ce que j'en connais autre chose que les sensations mêmes que j'en reçois ?<br />
— Vous sentez les sensations; mais les réflexions que vous ferez sur le soleil, mais... (1). »<br />
<strong>Saint</strong>-Martin aurait eu sans doute bien d'autres mais à ajouter; mais le professeur, prenant tout<br />
à coup un ton solennel : « Ce qu'il importe d'abord de dire, c'est que par cette doctrine dans<br />
laquelle on suppose que nos sensations et nos idées sont des choses différentes, c'est le<br />
platonisme, le cartésianisme, le malebranchisme que vous ressuscitez. Quand on a une foi, il<br />
est beau de la professer, il est beau de la pro-<br />
(1) Débats, t. 3, p. 18<br />
[327] fesser du haut des toits ; mais il n'est pas bon de porter une foi dans la métaphysique<br />
comme en physique. La philosophie observe les faits, elle les classe, elle les combine, mais<br />
elle ne s'écarte jamais des résultats immédiats, soit dans leur simplicité, soit dans leur<br />
combinaison. Ce n'est point là le procédé de Malebranche et de Platon : l'un et l'autre<br />
supposent dans l'homme des agents qui ne nous sont connus par aucun fait sensible, et des<br />
faits qui ne nous sont connus par aucune de nos sensations. De pareils agents sont précisément<br />
de ces idoles qui ont obtenu si longtemps un culte superstitieux de l'esprit humain, de ces<br />
idoles dont les écoles étaient.les temples, et dont Bacon le premier a brisé les statues et les<br />
autels. Ce serait un grand malheur si, à l'ouverture des écoles normales et des écoles centrales,<br />
décennies 1830_1839<br />
104
ces idoles pouvaient y pénétrer : toute bonne philosophie serait perdue, tous les progrès des<br />
connaissances seraient arrêtés, et c'est pour cela que je regarde comme un devoir sacré, dans<br />
un professeur de l'analyse, de traiter ces idoles avec le mépris qu'elles méritent (1). »<br />
(1) Débats, t. 3, p. 21.<br />
[328] Peu de minutes avant cette terrible conclusion, il s'en était fallu de fort peu que la<br />
question ne fût mise aux voix. ici en très grand nombre, disait le professeur, nous sommes<br />
deux ou trois mille personnes ; je vous invite donc, citoyens, à vous recueillir au fond de vos<br />
âmes, et à vous demander si les sensations que vous avez reçues et gardées de la chaleur, de<br />
l'éclat et du mouvement apparent du soleil, et la connaissance de cet éclat, de cette chaleur, de<br />
ce mouvement, sont pour vous deux choses différentes, ou si elles ne sont pas une seule et<br />
même chose sous deux points de vue et sous deux dénominations (1). » La majorité était, sans<br />
aucun doute, au professeur; <strong>Saint</strong>-Martin, après avoir répété sa profession de foi, n'eut plus<br />
qu'à se rasseoir, bien dûment convaincu de platonisme, de cartésianisme, de malebranchisme.<br />
Ainsi condamné, Galilée, agenouillé pour confesser erreur ce qu'il savait vérité, se releva pour<br />
prononcer le fameux et pur si muove; « et pourtant, dit <strong>Saint</strong>-Martin<br />
(1) Débats, t. 3, p. 21.<br />
[529] en se rasseyant, les sensations que je reçois du soleil et l'idée que j'ai de cet astre n'en<br />
sont pas moins deux choses éminemment différentes ; et pourtant il y a, outre les impressions<br />
éparses de chaleur, d'éclat, que je reçois, l'impression complexe où se trouvent confondues<br />
toutes ces impressions de détail par une faculté tout autre que la sensibilité qui a reçu cellesci.<br />
» La question mise aux voix, et résolue dans le sens du professeur, n'eût pas été un des<br />
moins singuliers épisodes de l'histoire des assemblées délibérantes.<br />
La philosophie de Kant avait fait, à cette époque, de grands progrès en Allemagne ; son<br />
influence sur la littérature était immense : depuis plusieurs années, il n'avait pas paru un seul<br />
livre de quelque importance qui ne s'y rattachât plus ou moins directement. Elle continuait en<br />
même temps à se développer sous sa forme propre, mais d'abord presque exclusivement par<br />
son côté purement idéaliste. Or, l'organe le plus éloquent, le représentant principal de cette<br />
nouvelle phase de la pensée allemande, fut Johannes-Gottlieb Fichte. Né dans la Haute-<br />
Lusace, successivement [330] professeur à léna, à Erlangen, à Berlin, Fichte fut le<br />
contemporain de Kant. A une époque pénible de sa propre vie, il se trouva même en rapport<br />
avec ce dernier. <strong>Les</strong> premiers pas de Fichte dans la vie furent amers et douloureux : il connut<br />
l'inconstance du sort, les caprices des hommes, les pressants aiguillons du besoin. Force lui<br />
fut de ployer son génie superbe et hautain aux conditions les plus humbles, aux emplois les<br />
plus subalternes. Contraint d'abandonner l'éducation d'un gentilhomme polonais qu'il<br />
accompagnait, il passait par Königsberg pour retourner dans sa patrie : là, il fut l'auditeur et le<br />
commensal de Kant. Il avait écrit le livre de la critique de toutes les révélations, pour s'en<br />
faire un moyen d'introduction auprès de ce dernier. Le passage suivant d'un journal écrit de sa<br />
propre main, et publié par son fils il y a quelques années, suffit pour donner une idée de la<br />
situation où il se trouvait en ce moment : « Le 27 juin 178... Je termine ce journal après avoir<br />
fait des extraits des leçons de Kant sur l'anthropologie, que m'a prêtées M. de S.... Je prends la<br />
résolution de continuer ce journal…<br />
[…]<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
105
La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants ... Page 352<br />
La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants ...<br />
de Joseph Marie Quérard – 1836<br />
Page 352 – 353 – 354<br />
SAINT-<strong>MARTIN</strong> (le marquis <strong>Louis</strong>-<strong>Claude</strong> de), dit le Philosophe inconnu, écrivain<br />
mystique ; né à Amboise (Indre-et- Loire), le 18 janvier 1743, mort à Aulnay, près Châtenay<br />
(Seine), dans la maison de campagne de M. Lenoir- La roche, le 15 octobre 1803.<br />
- * Cimetière (le) d'Amboise, par un philosophe inconnu. Paris, Laran et Cie, an IX(1801), in-<br />
8 de 16 pages, 4o c.<br />
- * Crocodile (le), ou la Guerre du bien et du mal, arrivée sous le règne de <strong>Louis</strong> XV, poème<br />
épico-magique en cent deux chants, dans lequel il y a de longs voyages sans accidents qui<br />
soient mortels, un peu d'amour sans aucune de ses fureurs, de grandes batailles sans une<br />
goutte de sang répandu; quelques instructions sur le bonnet de Docteur, et qui, parce qu'il<br />
renferme de la prose et des vers, pourrait bien en effet n'être ni l'un ni l'autre. Ouvrage<br />
posthume d'un amateur de choses cachées. Paris, de l'imprimerie du Cercle social, an VII<br />
(1799), in-8 de 470 pages, 4 fr. 5o c.<br />
- * Discours en réponse au citoyen Garat, professeur d'entendement humain aux Écoles<br />
normales, sur l'existence d'un sens moral, et sur la distinction entre les sensations et la<br />
connaissance. Ce Discours, prononcé à la suite d'une conférence publique (17 février 1796),<br />
se trouve imprimé dans la collection des Ecoles normales (tome. Ill des Débats), publiée en<br />
1801.<br />
- *Ecce-homo. Paris, impr. du Cercle social, an IV (1796), in-12. Ce fut à Paris que l'auteur<br />
écrivit cet opuscule, d'après une action vive, dit-il, qu'il avait eue a Strasbourg. Son objet est<br />
de montrer à quel degré d'abaissement l'homme infirme est déchu, et de le guérir du penchant<br />
au merveilleux d'un ordre inférieur, tel que le somnambulisme, les prophéties du jour, etc. Il<br />
avait plus particulièrement en vue la duchesse de Bourbon, son amie de coeur, modèle de<br />
vertus et de piété, mais livrée a ce même entraînement pour le merveilleux.<br />
— * Éclair sur l'association humaine. Paru, an V (1797), in-8. L'auteur découvre dans le<br />
principe de l'ordre social le foyer d'où émanent la sagesse, la justice et la puissance, sans<br />
lesquelles il n'existe point d'association durable, etc.<br />
— * Erreurs (des) et de la Vérité, ou les Hommes rappelés an principe universel de la science,<br />
par un Ph*** Inc. Edimbourg (Lyon), 1775, in-8. — Nouv. édit. Salomonopolis, 1784, 3 vol.<br />
in-8. Le troisième volume, qui a pour titre « Suite des Erreurs de la vérité », est une critique<br />
de l'ouvrage ; elle a été signalée par <strong>Saint</strong>-Martin, comme frauduleuse et entachée du vice des<br />
faux systèmes qu'il combattait. On a publié contre cet ouvrage : Clef des « Erreurs de la<br />
vérité, ou les Hommes rappelés an principe universel de la raison». Par un serrurier (par Ch.<br />
Suze). Herselaim, 1790, in-8. — * Esprit (de l’) des choses, ou Coup d'oeil philosophique sur<br />
la nature des êtres et sur l'objet de leur existence, avec l'épigraphe : Mens hominis rerum<br />
universalitatis spéculum est. Ouvrage dans lequel on considère l'Homme comme étant le mot<br />
de tontes les énigmes, par le Philosophe inconnu. Paris, Laran, etc., an VIII (1800), 2 vol. in-<br />
8, 7 fr. 5o c.<br />
— * Essai sur les signes et sur les idées, relativement a la question de l'Institut : Déterminer<br />
l'influence des signes sur la formation des idées. 1800.<br />
— * Homme (l’) de désir, par l'auteur « des Erreurs et de la Vérité». Lyon, 1790, in-8.<br />
— NOUV. édit., rev. et corr. par l'auteur, sous le masque du « Philosophe inconnu». Metz, an<br />
X (1801), 2 vol. petit in-8. Lcsm composa cet ouvrage à l’instigation du philosophe Thiemann<br />
durant ses voyages à Strasbourg et à Londres. Lavater, dans son Journal allemand de<br />
décennies 1830_1839<br />
106
décembre 1790, en fait l'éloge comme l'un des livres qu'il avait le plus goûtés, quoiqu'il avoue<br />
ingénument, quant au fond de la doctrine l’avoir peu entendu.<br />
— Extraits tirés de l'ouvrage intitulé « l'Homme de désir. Francfort-sur-le-Main, Schmerber,<br />
1831, in-12 de 96 pages, 1 fr. 25 c.<br />
— Lettre à un ami, ou Considérations politiques, philosophiques et religieuses sur la<br />
Révolution française. Paris, Migneret, an III (1795), in-8, 2 fr. <strong>Saint</strong>-Martin regardait la<br />
Révolution française comme celle du genre humain, et comme une image en miniature du<br />
jugement dernier, mais où les choses devaient se passer successivement, a commencer par la<br />
France.<br />
— * Livre (le) rouge...<br />
— * Ministère (le) de l'Homme-Esprit (en trois parties, qui traitent de l'homme, de la nature,<br />
de la parole). Paris, Migneret, an X (1800), in-8, 6 fr.<br />
Barbier, n° 11,972 présente cet ouvrage comme étant de la composition de <strong>Saint</strong>-<br />
Martin ; il y a pourtant lieu de croire que ce n'est qu'une traduction d’un livre de Boehm.<br />
L'objet de ce livre est de montrer comment 1’Homme-Esprit (en exerçant un ministère<br />
spirituel) peut s’améliorer, et régénérer lui-même et les autres, en rendant la parole ou le logos<br />
(le verbe) à l'homme et à la nature.<br />
— * Nouvel (le) Homme. Paris, an IV (1796), in-8. C'est plutôt une exhortation qu'un<br />
enseignement. <strong>Saint</strong>-Martin l'écrivit à Strasbourg, en 1790, par le conseil du chevalier<br />
Silverhielm, ancien aumônier du roi de Suède, et neveu de Swedenborg. L'idée fondamentale<br />
de cet ouvrage est que l'homme porte en lui- même une espèce de texte, dont sa vie entière<br />
devrait être le développement, parce que l'âme de l'homme, dit-il, est primitivement une<br />
pensée de Dieu. I1 a dit, plus tard, qu'il n'aurait pas écrit ce livre, ou qu'il l'aurait écrit<br />
autrement, si alors il avait en la connaissance des ouvrages de Boehm.<br />
— Oeuvres posthumes. Tours, Letourny, 1807, 2 vol. in-8. On distingue dans ce recueil : 1°<br />
un Choix des pensées de St.-Martin, par M. Tournier; 2° un Journal, depuis 1782, de ses<br />
relations, de ses entretiens, sous le titre de Portrait de <strong>Saint</strong>- Martin fait par lui-même ; 3°<br />
plusieurs questions et fragments de littérature, de morale et de philosophie, entre autres : un<br />
Fragment sur l'admiration, et un Parallèle entre Voltaire et J.-J. Rousseau, et un autre entre<br />
Rousseau et Buffon (par Hérault de Séchelles) ; 4° des Poésies, où, comme on le pense bien,<br />
l'auteur s'attache plus au fond qu'à la forme ; 5° des Méditations et des prières, où se peint<br />
l'Homme de désir, qui forme de nouveau le voeu si souvent énoncé par l'auteur, pour que<br />
ses semblables recherchent les vraies connaissances, les jouissances pures de l'esprit en les<br />
puisant dans leur propre centre, dans la source de la lumière et de l'amour pour laquelle il<br />
avait soupiré toute sa vie.<br />
— Réflexions d'un observateur sur la question proposée par l'Institut : « Quelles sont les<br />
institutions les plus propres à fonder la morale d'un peuple. An VI (1798). Après avoir passé<br />
en revue les divers moyens qui peuvent tendre à ce but, en liant la morale à la politique, il<br />
montre l'insuffisance de ces moyens, si le législateur n'assoit lui-même, sur les bases intimes<br />
de notre nature, cette morale dont un gouvernement ne doit être que le résultat mis en action.<br />
Il avait traité, quinze ans auparavant, un sujet analogue, proposé par l'Académie de Berlin, sur<br />
la meilleure manière de rappeler à la raison les peuples livrés à l'erreur ou aux superstitions ;<br />
question qu'il croit insoluble par les seuls moyens humains.<br />
-* Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers. Avec cette<br />
épigraphe : Expliquer les choses par l'homme, et non l’homme par les choses. Edimbourg<br />
(Lyon], 1782, 2 vol. in-8. Cet ouvrage parut en allemand, avec Commentaires par un<br />
anonyme. Qu'à cette liste on ajoute les traductions de quatre ouvrages du théosophe Boehm<br />
(voy. ce nom), formant ensemble six volumes in-8, et l'on aura une nomenclature complète<br />
des Oeuvres de <strong>Saint</strong>-Martin.<br />
décennies 1830_1839<br />
107
Dictionnaire historiqueou, Biographie universelle des hommes qui se sont ... - Page 64 de<br />
François-Xavier Feller – 1836<br />
DICTIONNAIRE HISTORIQUE<br />
Ou<br />
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE<br />
DES HOMMES QUI SE SONT FAIT UN NOM PAR LEUR GÉNIE, LEURS<br />
TALENTS, LEURS VERTUS, LEURS ERREURS OU LEURS CRIMES,<br />
Depuis LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS ;<br />
Par François-Xavier DE FELLER; 1735 – 1802<br />
Continué jusqu'en 1835, sous la direction de M. R.-A. Henrion.<br />
Huitième Edition, AUGMENTÉE DE PLUS DE 5,000 ARTICLES INTERCALÉS PAR<br />
ORDRE ALPHABÉTIQUE.<br />
TOME DOUZIÈME. PARIS. E. HOUDAILLE, LIBRAIRE-ÉDITEUR<br />
RUE DU COQ-SAINT-HONORÉ,11.<br />
DELLOYE, PLACE DE LA BOURSE, 13<br />
1836.<br />
KIRCHBERGER (Nicolas-Antoine), baron de Liebisdorf, né en 1759 à Berne, mort en 1800,<br />
cultiva, dans les camps d'abord, puis au milieu des fonctions civiles les plus importantes, les<br />
lettres, les sciences et la philosophie. Il fut lié avec le savant Zimmermann, avec le mystique<br />
Eckartshausen, avec Daniel Bernoulli, enfin avec Jean-Jacques Rousseau, qui correspondit<br />
quelquefois avec lui et qui parle de lui dans ses Confessions (livre XII). Il eut aussi un long<br />
commerce de lettres avec St-Martin sur des matières obscures de théosophie. On a de<br />
Kirchberger : | un Discours sur un acte de générosité des habitants de Soleure, sous le titre<br />
d'Histoire de la vertu helvétique, Baie, 1765, in-8°, | et un Mémoire sur l'agriculture inséré<br />
dans le Journal de l'abbé Rosier en 1774. Il écrivit en outre, en 1790, dans une feuille<br />
périodique, contre une secte "d'illuminants" ou "d'éclaireurs "dirigée par Frédéric Nicolaï.<br />
Lettre de Jean Jacques Rousseau<br />
CCCCXLI. — A M.<br />
Motiers, le 17 mars 1763.<br />
Si jeune et déjà marié ! Monsieur, vous avez entrepris de bonne heure une grande tâche. Je<br />
sais que la maturité de l'esprit peut suppléer à l'âge, et vous m'avez paru promettre ce<br />
supplément. Vous vous connaissez d'ailleurs en mérite, et je compte sur celui de l'épouse que<br />
vous vous êtes choisie. Il n'en faut pas moins, cher Kirchberger, pour rendre heureux un<br />
établissement si précoce. Votre âge seul m'alarme pour vous ; tout le reste me rassure. Je suis<br />
toujours persuadé que le vrai bonheur de la vie est dans un mariage bien assorti; et, je ne le<br />
décennies 1830_1839<br />
108
suis pas moins que tout le succès de cette carrière dépend de la façon de la commencer. Le<br />
tour que vont prendre vos occupations, vos soins, vos manières, vos affections domestiques,<br />
durant la première année, décidera de toutes les autres. C'est maintenant que le sort de vos<br />
jours est entre vos mains ; plus tard, il dépendra de vos habitudes. Jeunes époux, vous êtes<br />
perdus si vous n'êtes qu'amans ; mais soyez amis de bonne heure pour l'être toujours. La<br />
confiance, qui vaut mieux que l'amour, lui survit et le remplace. Si vous savez l'établir entre<br />
vous, votre maison vous plaira plus qu'aucune autre ; et dès qu'une fois vous serez mieux chez<br />
vous que partout ailleurs, je vous promets du bonheur pour le reste de votre vie. Mais ne vous<br />
mettez pas dans l'esprit d'en chercher au loin, ni dans la célébrité, ni dans les plaisirs, ni dans<br />
la fortune. La véritable félicité ne se trouve point au dehors ; il faut que votre maison vous<br />
suffise, ou jamais rien ne vous suffira.<br />
Conséquent à ce principe, je crois qu'il n'est pas temps, quant à présent, de songer à<br />
l'exécution du projet dont vous m'avez parlé. La société conjugale doit vous occuper plus que<br />
la société helvétique : avant que de publier les annales de celle-ci, mettez-vous en état d'en<br />
fournir le plus bel article. Il faut qu'en rapportant les actions d'autrui vous puissiez dire<br />
comme le Corrège : « Et moi aussi je suis homme. »<br />
Mon cher Kirchberger, je crois voir germer beaucoup de mérite parmi la jeunesse suisse ;<br />
mais la maladie universelle vous gagne tous. Ce mérite cherche à se faire imprimer; et je<br />
crains bien que, de cette manie dans les gens de votre état, il ne résulte un jour à la tête de vos<br />
républiques plus de petits auteurs que de grands hommes. Il n'appartient pas à tous d'être des<br />
Haller.<br />
Vous m'avez envoyé un livre très-précieux et de fort belles cartes ; comme d'ailleurs vous<br />
avez acheté l'un et l'autre, il n'y a aucune parité à faire en aucun sens entre ces envois et le<br />
barbouillage dont vous faites mention. De plus, vous vous rappellerez, s'il vous plaît, que ce<br />
sont des commissions dont vous avez bien voulu vous charger, et qu'il n'est pas honnête de<br />
transformer des commissions en présents.<br />
Ayez donc la bonté de me marquer ce que vous coûtent ces emplettes, afin qu'en acceptant la<br />
peine qu'elles vous ont donnée d'aussi bon cœur que vous l'avez prise, je puisse au moins vous<br />
rendre vos déboursés, sans quoi je prendrai le parti de vous renvoyer le livre et les cartes.<br />
Adieu, très-bon et aimable Kirchberger ; faites, je vous prie, agréer mes hommages à madame<br />
votre épouse ; dites-lui combien elle a droit à ma reconnaissance en faisant le bonheur d'un<br />
homme que j'en crois si digne, et auquel je prends un si tendre intérêt.<br />
Œuvres de J.-J. Rousseau (publiées par M. Musset-Pathay). Paris, Firmin Didot, 1823, 21 vol.<br />
in-8 dans le tome 2 de la correspondance on trouve une lettre adressée à M. K.... M. MUSSET<br />
PATHAY a supposé par erreur que cette initiale désignait le nom de M. KEIT, tandis qu'il<br />
s'agit ici de M. KIRCHBERGER (Nicolas Antoine), né à Berne en 1739, et dont ROUSSEAU<br />
parle dans ses Confessions. C'est ce qu'a prouvé d'une manière incontestable le savant M.<br />
GENCE, dans l'article sur KIRCHBERGER, de la Biog. univ.<br />
Le tome XXI et dernier de cette édition renferme, entre autres choses, quinze lettres<br />
nouvelles, dont quelques-unes, adressées à madame la baronne d'Houdetot, ont été<br />
communiquées à l'éditeur par M. BARBIER.<br />
décennies 1830_1839<br />
109
DICTIONNAIRE HISTORIQUE<br />
Ou<br />
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE<br />
DES HOMMES QUI SE SONT FAIT UN NOM PAR LEUR GÉNIE, LEURS<br />
TALENTS, LEURS VERTUS, LEURS ERREURS OU LEURS CRIMES,<br />
Depuis LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS ;<br />
Précédée d'un Tableau par ordre chronologique des époques célèbres et des événements<br />
remarquables, tant en France qu'à l'étranger, depuis 1787 jusqu'à ce jour, et d'une<br />
Table alphabétique des assemblées législatives, à partir de l'assemblée constituante<br />
jusqu'aux dernières chambres des pairs et des députés.<br />
PAR MM. A. V. ARNAULT, ANCIEN MEMBRE DE L'INSTITUT; A. JAY; E. JOUY,<br />
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; J. NORVINS, ET AUTRES HOMMES DE<br />
LETTRES, MAGISTRATS ET MILITAIRES.<br />
ORNEE DE З00 PORTRAITS AU BURIN<br />
D'APRÈS LES PLUS CÉLÈBRES ARTISTES.<br />
TOME DIXIÈME.<br />
De la lettre J à LANJ<br />
PARIS,<br />
A LA LIBRAIRIE HISTORIQUE ET DES ARTS ET METIERS D'EMILE BABEUF,<br />
Hôtel D'ALIGRE, RUE ST.-HONORÉ, № 123; ET A Bruxelles, MÊME MAISON, rue<br />
DE LA MONTAGNE, № З07<br />
KIRCHBERGER (Nicolas-Antoine, BARON DE LlEBISDORF), philosophe suisse, naquit à<br />
Berne, le 13 janvier 1739, et mourut en 1800. Il appartenait à une famille ancienne, qui le<br />
destina à l'état militaire : il n'en consacra pas moins une partie de sa jeunesse à l'étude de la<br />
philosophie et des belles-lettres. Passé au service de Hollande, il commandait un détachement,<br />
formant la garnison de fort <strong>Saint</strong>-Pierre près de Maastricht. Après avoir lu avec fruit les écrits<br />
de Leibnitz et de Wolf, il conçut le projet d'un grand ouvrage philosophique, en donna le plan,<br />
et en confia depuis l'exécution au conseiller Eckartshausen, son ami. Kirchberger commença à<br />
fixer l'attention de ses compatriotes, par le discours qu'il prononça en 1765, dans une<br />
assemblée de jeunes patriciens bernois, et dans lequel il célébra l'héroïque générosité des<br />
habitants de Soleure, qui, pendant le siège que soutint leur ville, en 1318, contre Léopold Ier,<br />
duc d'Autriche, voyant, par la rupture du pont de l'Aar, une foule d'assiégeants tomber dans le<br />
fleuve, s'empressèrent de voler à leur secours, et parvinrent à les arracher à la mort. <strong>Les</strong><br />
Soleurois ne se contentèrent pas de cette seule action généreuse; ils donnèrent à ces<br />
malheureux des vivres et des habillements, et les renvoyèrent sans rançon, Un pareil trait<br />
d'humanité était fait pour exciter l'enthousiasme des enfants d'un peuple hospitalier, que<br />
l'égoïsme n'avait point encore corrompu. Kirchberger prononça son discours avec une onction<br />
qui pénétra les cœurs, et fut dès lors considéré comme un écrivain éloquent et un bon citoyen.<br />
Quoique porté par ses goûts à l'étude de la philosophie, il ne s'y livra pas exclusivement, et<br />
s'occupa aussi avec succès de l'étude des sciences naturelles, qu'il appliqua spécialement à<br />
l'agriculture, ce qui rendit ses connaissances très utiles à son pays. Membre de la société<br />
économique et physique de Berne, il fit sous ses yeux plusieurs expériences agricoles, avec le<br />
gypse employé dans les prairies artificielles. Nommé membre du conseil souverain de Berne,<br />
en 1775, il exerça aussi les fonctions de bailli de Gottstadt, près de Bienne, pendant l'espace<br />
de 6 ans, et entretint à cette époque une correspondance suivie avec Jean-Jacques Rousseau.<br />
Kirchberger, dont la philosophie était éclairée. et religieuse sans superstition, s'éleva avec<br />
décennies 1830_1839<br />
110
force contre une secte d'illuminants ou d'éclaireurs, dont le chef était Frédéric Nicolaï, éditeur<br />
de la Bibliothèque germanique. Cette secte se propageait rapidement en Allemagne.<br />
Kirchberger engagea le chevalier de Zimmermann, son ami, à rédiger, ainsi que lui, des<br />
mémoires contre elle. Ces mémoires, qui parvinrent à l'empereur Joseph II, déterminèrent ce<br />
prince à prendre, de concert avec la cour de Berlin, des mesures capables d'arrêter les progrès<br />
de ces dangereux sectateurs. Ce philosophe fut lié jusqu'à sa mort, avec les hommes les plus<br />
recommandables de l'Allemagne.<br />
décennies 1830_1839<br />
111
Philosophie de L'histoire, Professee en Dix-huit Lecons Publiques, a Vienne... Page 367 de<br />
Friedrich von Schlegel 1836<br />
LEÇON XVIII.<br />
De la franc-maçonnerie. — Son influence ésotérique sur les événements modernes. — De la restauration.<br />
— Etat présent des choses, des esprits, et des différents royaumes. — Nécessité d'une restauration<br />
religieuse. — Danger des écarts de l'absolutisme, soit dans la vie réelle, soit dans la science. — La<br />
tolérance n'est pas l'indifférence. — L'esprit de parti, l'intolérance part d'un fond d'orgueil coupable. —<br />
En quoi consistera la restauration universelle qui doit se faire plus prochainement peut-être qu'on ne le<br />
pense. — L'état devra être chrétien et la science chrétienne. — Ni l'un ni l'autre but n'a été parfaitement<br />
atteint jusqu'ici. — Pour obtenir cet heureux résultat, la destruction de toute espèce d'idolâtrie politique<br />
est nécessaire; et la philosophie, en s'aidant de l'histoire, doit renoncer à l'absolu sous quelque forme qu'il<br />
se présente. — Avis à l'Allemagne, moins absolue que tout autre pays, dans la vie et le gouvernement, mais<br />
chez qui l'absolu est impatronisé dans la science. — Récapitulation et conclusions. — L'homme a eu sans<br />
cesse à lutter contre l'esprit du mal, qui s'est montré successivement comme le prince du monde, et l'esprit<br />
du siècle, revêtissant d'âge en âge des formes nouvelles. — Dieu ne lui a pas manqué dans cette lutte ; il<br />
s'est montré verbe, force, lumière. — Ainsi, foi, amour et espérance.<br />
« Je viendrai bientôt, et je renouvellerai tout. »<br />
Le dix-huitième siècle vit éclater à la fois et d'une façon si soudaine tant d'événements mûris<br />
au même jour, que bien qu'une réflexion attentive puisse leur trouver un motif et une cause<br />
suffisante dans leurs précédents, dans l'état [361] tat naturel des choses, dans la situation<br />
générale où se trouvait le monde, on est cependant dispose à croire qu'ils avaient été préparés<br />
d'avance, à dessein, et dans le secret ; maintes circonstances viennent ensuite corroborer ce<br />
pressentiment, et donnent sur le complot des indications qui ont toute l'autorité de l'histoire.<br />
Pour compléter le tableau de cette époque où le principe des lumières exerça une influence<br />
dominante, et pour achever de caractériser en lui-même ce principe qui eut tant d'action sur<br />
les évènements historiques, nous avons à ajouter quelques mots sur ce côté secret et<br />
mystérieux de son développement, afin qu'on saisisse mieux son rapport d'une part avec le<br />
principe et l'esprit de la révolution, qui, elle aussi, dans le fanatisme qui l'animait, avait la<br />
prétention de restaurer le monde ; et d'un autre côté avec le caractère de la vraie restauration,<br />
qui repose sur la base religieuse de la justice chrétienne.<br />
Mais dans l'examen critique que l'histoire entreprend sur cet objet, elle doit se prémunir<br />
toujours par cette pensée, que ceux qui, comme acteurs ou témoins oculaires, pourraient, s'ils<br />
voulaient faire part de leur expérience, donner les meilleurs renseignements, ne doivent pas<br />
cependant être considérés toujours comme des autorités sur lesquelles on puisse le mieux<br />
compter, parce qu'on ne peut jamais savoir exactement ce [362] que, par calcul ou par<br />
conviction, il leur arrivera de dire ou de taire, en tout ou en partie. Cependant cette secousse<br />
universelle, qui jeta tout pêle-mêle a mis à nu tant de bouts de ce fil ésotérique de l'histoire<br />
moderne, que la réunion de ces indications suffit pour nous donner une juste idée de cet<br />
élément spécial des lumières subversives du dix-huitième siècle, où le vrai, le faux et le<br />
spécieux ont été mêlés et confondus, et pour nous initier à la connaissance d'un point auquel<br />
donne tant d'importance sa coopération visible à tous les événements, et son influence si<br />
diverse sur la marche générale des choses.<br />
C'est donc uniquement sous ce point de vue historique, qui d'ailleurs répond parfaitement à<br />
notre but, et même est le seul ici qui puisse être pris en considération, que je me sens en état<br />
de juger; ou, comme je devrais plutôt dire, de caractériser toute cette trame souterraine ; et<br />
c'est aussi dans ces sources, dans ces indications, dans ces faits connus et publics, qu'est<br />
puisée la description que je vais en faire.<br />
Pour ce qui concerne l'origine ou la source d'où cette influence ésotérique s'est répandue en<br />
Europe; quelque motif ou quelque intérêt qu'on ait à le nier ou à le .contester, il résulte à peu<br />
décennies 1830_1839<br />
112
près évidemment du seul examen des faits, que l'ordre des Templiers a été comme le pont sur<br />
lequel tout cet ensemble de mystères a passé en occident, [363] du moins quant à leur forme,<br />
qui continue aujourd'hui d'être la même qu'alors.<br />
Ce n'est que parles traditions sur Salomon et sur son temple, auxquelles se rattache<br />
l'institution même de l'ordre, qu'on peut expliquer les symboles religieux de la maçonnerie,<br />
quoiqu'on en trouve aussi des motifs dans quelques autres passages et parties de l'écriture et<br />
de l'histoire sainte : aussi peuvent-ils très bien être entendus dans un sens parfaitement<br />
chrétien, et en retrouve-t-on des traces dans plusieurs monuments gothiques de l'ancienne<br />
architecture germanique du moyen-âge. Cependant une association spirituelle, fondée sur<br />
l'esprit ésotérique, ne saurait avoir professé le christianisme dans toute sa pureté ; elle n'a pu<br />
du moins rester entièrement Chrétienne, puisque, répandue chez les chrétiens, elle se retrouve<br />
aussi chez les Mahométans.<br />
Il y a plus : l'idée même d'une pareille société, d’une pareille doctrine purement ésotérique, et<br />
de sa propagation secrète, n'est guère compatible avec le christianisme ; car le christianisme<br />
est déjà en soi un mystère divin; mais un mystère qui, d'après les vues de son fondateur, est<br />
exposé à tous les yeux, et célébré quotidiennement sur tous les autels. Or à cause de cela<br />
même, le secret qui dans les mystères païens, subsistait à côté de la mythologie et de la<br />
religion [364] nationale et populaire, et n'était le partage que des savants et des initiés, ce<br />
secret, dis-je, ne peut s'allier avec une révélation destinée à tous les hommes, puisque, par sa<br />
nature, elle le condamne et le repousse.<br />
Ce serait toujours une Église dans l'Église ; et elle ne peut pas être plus autorisée ou tolérée<br />
qu'un État dans l'État. Ajoutons que dans un siècle où les intérêts temporels et les vues<br />
politiques prévaudraient d'une manière ouverte ou cachée sur les sentiments et les idées<br />
religieuses, un tel établissement parasite et mystérieux ne manquerait pas de devenir bientôt<br />
un directoire occulte de tous les mouvements, de tous les changements intérieurs de l'Etat,<br />
C'est ce qui est effectivement arrivé.<br />
L'esprit antichrétien, que l’illuminisme, cette opposition régularisée, enveloppe dans des<br />
sentences d'une philanthropie universelle, pourrait bien être, selon toute analogie historique,<br />
d'une date assez moderne; tandis que le principe chrétien, qui même encore de nos jours,<br />
après une lutte si étonnamment diverse entre les partis de cette secte, se maintient toujours,<br />
quoique chez une très faible minorité, dérive peut-être, conformément à l'origine qu'elle<br />
revendique, d'une source orientale et gnostique.<br />
Quant à la grandeur, ou du moins à l'importance de son influence politique, comment la [365]<br />
nier ; surtout depuis les violentes révolutions de nos jours qui, de notre Europe, se sont ruées<br />
sur les autres parties du monde ; et en apprenant que dans une contrée méridionale de<br />
l'hémisphère américain, les deux partis qui figuraient dans la révolution de cet état, dont les<br />
troubles durent encore, s'appellent des noms d'Ecossais et de Yorkais, d'après l'opposition qui<br />
existe dans les loges anglaises ? Est-il quelqu'un qui ignore, ou qui ait oublié avec quelle<br />
adresse l'homme qui dans ces derniers temps régnait sur le monde, se servit dans tous les pays<br />
conquis, de ce véhicule, et l'employa comme un organe propre à fourvoyer et à nourrir de<br />
fausses espérances, l'opinion publique ? C'est pour cela qu'il fut appelé par ses partisans<br />
l'homme du siècle, et qu'il fut du moins, en effet, le serviteur de l'esprit du siècle.<br />
Une société du sein de laquelle, comme du laboratoire où le génie destructeur du siècle<br />
forgeait ses armes, sortirent successivement les illuminés, les Jacobins et les Carbonari, ne<br />
pouvait avoir une tendance vraiment chrétienne, ni être politiquement juste, ni exercer une<br />
action bienfaisante sur l'humanité en général. Je dois cependant observer ici que c'est le sort<br />
inévitable de la plus vieille des sociétés secrètes, que chaque nouvelle conspiration aime à<br />
revêtir ses formes vénérables, déjà connues des initiés, [366] Il ne faut pas non plus oublier<br />
que cet ordre est partout divisé en une foule de partis, de sectes, qui ont des opinions, dés<br />
façons de penser diverses ; de sorte qu'on ne doit pas croire que ces extrémités terribles, que<br />
décennies 1830_1839<br />
113
ces sauvages excès d'une irréligion, d'un esprit révolutionnaire, qui mine secrètement ou<br />
renverse avec une violence ouverte, se soient produits partout où cet ordre existe ; l'histoire<br />
convaincrait une pareille supposition de fausseté ou du moins d'exagération.<br />
Une simple liste de tant d'hommes trompés, il est vrai, sur ce point unique, mais d'ailleurs<br />
respectables ; de tant de noms connus et vraiment distingués, qui dans le cours du dixhuitième<br />
siècle faisaient partie de cette société, suffirait pour démentir une pareille<br />
condamnation générale, ou pour y apporter du moins d'essentielles modifications. Mais ce<br />
qu'on peut, d'après beaucoup d'indices, regarder comme positif, ou du moins comme<br />
éminemment vraisemblable, c'est que nulle part cette société ésotérique et son action n'ont été<br />
mises en harmonie avec l'ordre subsistant et avec l'état lui-même, aussi bien qu'en Angleterre,<br />
pays où tous les éléments opposés de la vie et de la société moderne paraissent être en général<br />
le plus artistement combinés et équilibrés.<br />
D'ailleurs si nous portions nos regards sur le reste de l'Europe et même sur les pays qui furent<br />
[367] les principaux théâtres des révolutions, il est incontestable qu'il y exista toujours, au<br />
sein de tant de loges diverses, un parti chrétien; et bien qu'il n'ait été qu'en très faible minorité,<br />
il n'en a pas moins eu une grande influence qu'il a due à la profondeur des idées, et à tout ce<br />
qu'il avait conservé de l'antique tradition. C'est au reste une chose prouvée jusqu'à l'évidence<br />
par les faits historiques et par des documents écrits et livrés à la publicité.<br />
Au lieu de présenter des exemples allemands, moins généralement connus, j'appuierai plutôt<br />
ce que je viens de dire du nom d'un écrivain français bien remarquable, et bien propre à<br />
caractériser ce qu'il y avait de plus intime et de plus caché dans la révolution. <strong>Saint</strong>-Martin, ce<br />
chrétien théosophe, se tient tout-à-fait isolé, à l'écart, de ce parti athée, qui dominait alors,<br />
quoique sorti de la même école et de la même sphère ; lui aussi, il est décidément<br />
révolutionnaire ; mais c'est un révolutionnaire désintéressé, romanesque, qui obéit à une<br />
conviction fondée sur des raisons supérieures et spirituelles. Il montre le plus grand mépris, la<br />
répugnance la plus vive pour l'état moral et politique d'alors; et souvent on est tenté d'accéder<br />
à son opinion, ou du moins de lui donner négativement raison.<br />
Enfin il est animé d'un espoir enthousiaste d'une restauration chrétienne générale, qu'il entend,<br />
[368] il est vrai, à sa manière ou dans l'esprit de son parti. Parmi les écrivains français de la<br />
restauration, personne, aussi bien que le comte de Maistre, n'a su apprécier ce philosophe<br />
remarquable, distinguer ce qu'il a de profondément faux, et ce qu'il a de réellement bon, en un<br />
mot en tirer un aussi bon parti, en y ajoutant toutefois des correctifs nécessaires.<br />
Pour juger et caractériser pleinement l'histoire de la révolution, il ne faut donc pas négliger ce<br />
fil ésotérique, puisqu'il a grandement contribué à induire en erreur tant de gens, dont on ne<br />
peut accuser l'intention, qui voyaient ou voulaient voir dans la révolution, malgré la forme<br />
dure et repoussante sous laquelle elle s'est manifestée à son début, une restauration nécessaire,<br />
indispensable, des états et des peuples chrétiens, détournés de leur destination véritable.<br />
Cette erreur, l'illusion trompeuse de cette prétendue restauration, ne fut jamais aussi active<br />
que durant le règne de cet homme extraordinaire, dont la vraie biographie paraît encore audelà<br />
des mesures d'appréciation de notre siècle, qui ne peut avoir l'intime compréhension de<br />
sa vie, et, pour ainsi dire, la clef théologique de sa destination. Sept ans étaient consacrés à<br />
l'accroissement de sa puissance ; quatorze ans le monde fut dans ses mains ; et encore une fois<br />
sept ans lui furent laissés pour la réflexion [369] solitaire ; mais il employa mal la première de<br />
ces années, en essayant de jeter de nouveau le trouble dans le monde.<br />
L'histoire a déjà porté son jugement sur l'usage qu'il a fait de cette force extraordinaire, de<br />
cette formidable toute-puissance dont il fut doté ; mais jamais le ciel ne permet chose<br />
semblable que dans le temps et dans le but d'un grand compte à rendre, lorsque se préparent<br />
les jours encore plus redoutables de la dernière lutte décisive.<br />
Si donc la restauration qu'il effectua, c'est- à-dire, si cette restauration que ses partisans<br />
éblouis lui attribuaient, n'a été décidément qu'une vaine et fausse restauration, il reste<br />
décennies 1830_1839<br />
114
cependant à savoir si celle qui l'a suivie a été la véritable, si du moins elle a été complète, puis<br />
ce qui lui manque, ce qu'il faut ajouter pour la rendre telle. Un simple traité qui ne règle que<br />
des délimitations de pays, ne sera jamais une paix de Dieu, une paix générale des peuples ; et<br />
de même, le rétablissement des trônes renversés, la réintégration des souverains et des<br />
dynasties expulsés, n'offriraient aucune garantie de durée et de solidité, si la restauration<br />
n'était en même temps faite dans les croyances et dans les esprits.<br />
Il était donc très naturel de donner une base religieuse à la restauration qui suivit la leçon<br />
inopinée, la vengeance terrible infligée au monde ; [370] et si l'idée de cette base religieuse<br />
est restée vague, on ne saurait en faire un reproche ; car c'était une nécessité, surtout au<br />
commencement, d'écarter tout prétexte à un malentendu et à une fausse interprétation, ainsi<br />
que tout soupçon d'une arrière pensée égoïste.<br />
La conservation et l'existence future, non seulement du système général des états chrétiens et<br />
des peuples civilisés de l'Europe, mais encore de chaque grande puissance en particulier,<br />
dépendent de ce lien intérieur et religieux ; et l'on doit désirer qu'il se resserre et se fortifie<br />
chaque jour davantage. Que la force et le maintien de l'empire russe ne puissent reposer que<br />
sur ce fondement, que chaque déviation de cet esprit ne puisse avoir sur l'état qu'une action<br />
destructive et dissolvante, le monarque des derniers temps, qui s'est illustré dans le malheur<br />
aussi bien que dans le succès, l'a érigé en un principe d'état, qui sera difficilement méconnu à<br />
l'avenir.<br />
Seulement ce que doit bien observer cet empire, où les pensées et les principes, les germes de<br />
la civilisation et l'ensemble du corps politique sont tout imprégnés d'éléments de<br />
protestantisme, dans le sens général et spirituel du mot; ce qu'il doit observer, dis-je, comme<br />
absolument indispensable, c'est que la tolérance, qui actuellement embrasse toutes les<br />
croyances, ne soit jamais retirée à la mère Eglise, dominant dans le reste [371] de l'Europe, et<br />
parmi les pays soumis à la Russie, notamment en Pologne; c'est en un mot que la liberté<br />
religieuse ne reçoive jamais d'atteinte sous ce rapport. « II est tout aussi évident que, dans le<br />
pays où s'est faite une restauration monarchique, celle-ci est inséparable d'une restauration<br />
religieuse, et que sans cet appui l'édifice politique doit nécessairement crouler. Dans cette<br />
monarchie pacifique, toujours inébranlablement attachée à son vieux système ; cette base<br />
religieuse a été publiquement posée depuis longtemps, et plus que tout autre principe, elle fait<br />
sa force. Quant à la quatrième monarchie, à cette monarchie allemande, dont l'influence en<br />
Europe est de fraîche date, elle ne peut se maintenir, elle ne peut se consolider pour l'avenir,<br />
que par un esprit religieux, seul moyen de calmer les agitations propres à un .état de ce genre ;<br />
Une hostilité dirigée même indirectement contre le catholicisme professé par la moitié de la<br />
nation ; la moindre atteinte portée à la liberté individuelle sur ce point sacré, dont<br />
l'indépendance doit être non-seulement assurée par la lettre de la loi, mais consolidée de fait<br />
dans la vie réelle ; une opposition en un mot qui serait en contradiction avec l'esprit religieux<br />
dont les progrès sont incessants dans le reste de l'Europe, et nommément en Allemagne, ne<br />
[372] pourrait que léser et faire chanceler de nouveau la base de cette monarchie déjà scellée<br />
par le temps; et tout prouve que jusqu'à présent on l'a parfaitement senti.<br />
Dans l'Angleterre seule, des doutes tout anglicans s'élevèrent dès lors contre ce lien religieux<br />
qui doit serrer les rapports généraux entre les états et les peuples de l'Europe: ces doutes se<br />
lient à sa constitution politique, toujours exclusivement protestante, et peuvent à cause de cela<br />
amener une rupture schismatique de l'Angleterre avec les autres puissances 16 *; et déjà<br />
plusieurs circonstances tendraient à faire naître la triste pensée que la grande Angleterre, qui<br />
16 * Ceci a été écrit en 1828. En cet endroit et en plusieurs autres de cette leçon surtout, l'auteur a<br />
vraiment prophétisé. Nous avons vu la réalisation de ces prédictions. Quelle preuve plus frappante de<br />
la hauteur et de la justesse de ses vues ? Quelle meilleure garantie pour ses espérances et ses<br />
conjectures sur le sort définitif de la chrétienté et de l'humanité !<br />
décennies 1830_1839<br />
115
au dix-huitième siècle était si brillante et si forte, même par l'influence prépondérante qu'elle<br />
exerçait sur la pensée et la civilisation européenne, maintenant au dix-neuvième siècle se sent<br />
presque étrangère chez elle et ne sait plus comment s'orienter.<br />
Si nous revenons à considérer l'Europe en général, les principes libéraux ne sont pour elle<br />
qu'une rechute un peu modifiée vers la révolu[373]tion, et ils n'ont pas d'autre but; mais ils ne<br />
peuvent gagner une majorité parmi les hommes loyaux et bien intentionnés soit de l'Europe,<br />
soit d'un état particulier, qu'au moyen de fautes décisives, ou d'une grande dégénération dans<br />
un parti qui, au surplus, ne devrait pas en être un, ni en porter le nom ; dans le parti de ceux<br />
qui suivent les principes monarchiques par rapport à l'état, et les maximes religieuses par<br />
rapport au monde et à la vie.<br />
Cette règle sans intelligence et sans vie, d'un équilibre purement matériel, qui ne tend qu'à<br />
mettre un frein négatif à la prépondérance d'une puissance quelconque, tel que fut ce système<br />
né en Angleterre, qui gouverna l'Europe du dix-huitième siècle, a cessé d'offrir des garanties,<br />
et d'être applicable aux affaires actuelles ; car tous les remèdes qu'il aurait à présenter encore<br />
ne feraient qu'aggraver le mal, s'il venait à éclater. Encore une fois, ce n'est que dans la<br />
religion, prise comme base, que le monde, que chaque état, doit trouver salut et consolidation,<br />
remède et préservatif.<br />
Mais le plus grand danger de l'époque gît dans les écarts de l'absolutisme, qui pourrait abuser<br />
de ces principes religieux. Rien de plus pernicieux et de plus fatal, que si, dans l'esprit d'une<br />
réaction passionnée, le caractère et l'action révolutionnaire allaient se mêler à la cause<br />
légi[374]time ; si la passion venait à être érigée en principe de raison, en système seul valable<br />
et seul juste; si enfin la sainteté des idées religieuses n'était présentée et propagée que comme<br />
une chose de mode ; la vertu de la foi et de la vérité qui seules peuvent sauver les hommes et<br />
les âges, que dépendant plus aux yeux des hommes que d'une lettre morte, que d'une formule<br />
extérieurement articulée, tandis que la vraie vie, le principe générateur de la vie véritable ne<br />
peuvent être donnés que par l'esprit vivifiant de l'éternelle vérité. Dans la science l'absolu est<br />
le gouffre où se perd la vérité vivante, et qui ne représente à sa place qu'une idée creuse et<br />
qu'une vaine formule ; mais lorsqu'il s'agit de l'application et de la vie réelle, l'absolu dans les<br />
opinions et les actes se manifeste, sous la forme du faux esprit du siècle, de cet esprit qui,<br />
contraire au bien et à la plénitude de la vie divine dans l'éternelle vérité, règne ordinairement<br />
sur le monde, voudrait le maîtriser, et le jeter pour toujours dans une fausse voie et dans une<br />
confusion complète.<br />
L'esprit du siècle, qui dans ses projets de destruction, change de forme à tout moment, depuis<br />
qu'il s'est détaché de la vérité éternelle, et qu'il l'a prise pour son ennemie, se reconnaît<br />
précisément à cette tactique générale et constante; qu'il détache de tout son entourage<br />
historique [375] une particularité qu'il représente et pose comme le centre et le but universel,<br />
et que sans aucun égard pour l'histoire, il fait de cet incident un principe absolu ; avec un<br />
grand soin de donner pour passeport à ses erreurs quelques vérités ou du moins quelques<br />
ombres de vérité, sans lesquelles, il le sait bien, elles ne seraient ni actives, ni dangereuses.<br />
Mais le vrai centre et le but réel de l'existence de l'humanité, ainsi que de la vie d'un individu,<br />
ne se laissent pas extraire ainsi violemment, ne veulent pas être ainsi détachés de l'ensemble<br />
de la marche graduelle du développement naturel et ne peuvent être saisis que par une<br />
méthode toute relative et non absolue. La méthode passionnée de l'absolutisme n'est propre<br />
qu'à faire fuir l'esprit de vie, et à ne laisser en son lieu qu'une Lettre morte et propre à donner<br />
la mort. Il est impossible de prédire d'avance quelles peuvent être les idoles qu'encensera l'une<br />
après l'autre l'esprit du siècle, inconstant par sa nature, et passant facilement d'un extrême à<br />
l'autre.<br />
Qui empêcherait que la vérité éternelle ne fût elle-même une fois abusée et profanée, jusqu'à<br />
devenir l'idole du jour, c'est-à-dire jusqu'à voir les hommes prosternés devant sa forme<br />
apparente ? Car ce n'est qu'après cette image extérieure que peut courir l'esprit du siècle, qui<br />
décennies 1830_1839<br />
116
jamais ne retiendra son essence intérieure et sa [376] vertu vivifiante. Mais quels que soient à<br />
tout moment les objets successifs de son idolâtrie du jour ou de sa rhétorique passionnée, dans<br />
sa nature et dans son être propre, il reste toujours le même ; il est toujours absolu ; toujours il<br />
tue l'esprit et détruit la vie.<br />
Dans la science, l'absolu est la divinité des systèmes rationnels, vains et vides ; c'est une<br />
conception morale ; une abstraction qu'ils reconnaissent et adorent. Or le Dieu des chrétiens<br />
est un Dieu vivant, qui se révèle, et leur foi est cette révélation même; et c'est pourquoi le<br />
divin, dans quelque sphère que ce soit, dérivé de cette source, de cette origine commune, est<br />
vivant et positif.<br />
Le combat de la vérité contre les erreurs de l'esprit du siècle ne peut conséquemment avoir<br />
d'issue heureuse et durable, qu'autant que le positif divin, à quelque domaine qu'il<br />
appartienne, soit d'une part compris comme vivant, exposé avec toute la force de la vie<br />
spirituelle; et de l'autre, soit parfaitement approfondi dans ses rapports avec l'histoire, dont il<br />
ne faut d'ailleurs ni négliger ni injustement apprécier les autres côtés réels, les autres éléments<br />
positifs.<br />
Ce jugement calme, cet approfondissement sincère tant des faits matériels que des<br />
phénomènes intellectuels, sont les compagnons inséparables de la vérité, et l'indispensable<br />
condition de sa connaissance pleine et entière ; et l'esprit [388] religieux, base de toute vérité,<br />
nécessaire à sa connaissance, se sent naturellement porté à suivre d'un œil attentif, à travers ce<br />
labyrinthe de l'erreur, le fil de la permission et de la providence divine, au milieu même des<br />
plus grandes aberrations humaines; soit dans la science, soit dans la pratique et la vie. L'erreur<br />
au contraire s'écarte partout de l'histoire ; presque toujours l'esprit du siècle est passionné, et<br />
c'est pourquoi l'un et l'autre pèchent contre la vérité.<br />
Aussi quand on veut combattre l'erreur dans le domaine de la science on no peut jamais le<br />
faire avec plus de succès, ni en triompher plus vite qu'en séparant, d'après la règle divine de la<br />
connaissance intérieure, dans chaque système d'erreur pratique ou scientifique, l'absolu, qui en<br />
fait la base, le centre ou le but, en deux éléments qui le composent toujours, le vrai et le faux.<br />
A-t-on reconnu et distingué le vrai d'une hypothèse, le reste, vide en soi, tombe de lui-même,<br />
sans qu'on ait beaucoup de peine et sans qu'on soit obligé de faire de grands efforts, et de<br />
perdre beaucoup de temps à en prouver la nullité.<br />
Dans la vie réelle, la lutte cesse bientôt d'être purement spirituelle, les partis inquiets et agités<br />
ont recours à la force matérielle ; et plus ils deviennent absolus, plus la guerre qu'ils se font<br />
ressemble à la guerre des éléments qui se détruisent ; [378] et de là naît l'obstacle le plus<br />
fâcheux à l'œuvre de la restauration religieuse et véritable, cette grande tâche imposée à nos<br />
temps ; mais qui est loin d'être accomplie.<br />
C'est sous ce rapport qu'on peut voir avec peine et comme un phénomène dangereux, dans<br />
certaines régions de la vie européenne, et même dans quelques pays entiers, tous les partis et<br />
toutes les affaires publiques, prendre un caractère absolu. Il s'entend de soi-même que ce n'est<br />
pas le nom qui fait la chose ; et que les autres partis sont souvent bien plus absolus en réalité,<br />
que ceux qui se donnent ou auxquels on donne cette dénomination ; selon ce qui est ordinaire<br />
aux époques d'une lutte violente des partis, que les appellations commencent à être le fruit<br />
d'un caprice souvent étrange, qu'elles, prêtent à des bévues et à des méprises; qu'alors on<br />
brouille toutes les idées, et qu'il s'introduit une nouvelle confusion babylonienne dans les<br />
langues et même dans celles qui se distinguaient auparavant par leur clarté et leur précision.<br />
L'attachement inébranlable à son opinion, une façon de penser conséquente, la fermeté dans le<br />
caractère, la persévérance dogmatiquement exprimée en une croyance positive ; qualités qui<br />
recommandent le plus l'homme pendant toute sa vie et dans toutes ses actions, peuvent fort<br />
bien se concilier avec une appréciation des choses fondées …<br />
(…) Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
117
1837<br />
Arthur Page 102 de Ulric Guttinguer 1837 426 pages<br />
… [100] … La femme du fermier passa en ce moment, et s'arrêtant : « Pardon, monsieur; je<br />
crois que ma fille a laissé dans cette chambre mon Imitation de Jésus-Christ : oui, la voilà près<br />
de cette cheminée. » Effectivement, j'aperçus un vieux livre bien propre encore, avec de<br />
nombreux [101] signets... J'avançai la main pour le prendre et le donner. « Si monsieur veut le<br />
lire, dit la fermière en regardant mes yeux qui étaient humides c'est bien consolant! quand j'ai<br />
perdu ma fille aînée et mon frère curé, j'ai trouvé là ce qu'il me fallait pour ne pas mourir...<br />
peut-être que monsieur... » Et ses regards m'interrogèrent.<br />
La pensée de cette fille aînée et de ce frère morts me brisa le cœur de tristesse et de honte.<br />
Qu'avais -je dans mes chagrins, a opposer à ces irréparables pertes ? ... les angoisses d'un<br />
indigne amour... Je regardai ce livre qui guérissait de si grandes afflictions. « Voulez-vous me<br />
le laisser? dis-je. — Oh! bien volontiers.» Et, seul, j'ouvris au hasard : j'y tombai d'abord sur<br />
ces paroles : « C'est un bien, Seigneur, que vous m'ayiez humilié afin que je m'instruise de<br />
votre justice. »<br />
La soirée de la veille se présenta m moi plus vivement, et je restai longtemps en méditation<br />
sur le sens profond que renfermaient ces deux lignes.<br />
Oui, c'est un bien, me répétais- je. Je n'aurais [103] pas su, sans cette humiliation, toute la<br />
misère des choses de ce monde et de ses distractions ; je n'aurais pas su que ce n'est pas la<br />
société qui peut nous consoler.<br />
Je continuai, je lus quelques chapitres; qui me rappelèrent un mot charmant du philosophe<br />
inconnu : « De tout ce que j'ai rencontré en ce monde, je n'ai trouvé que Dieu qui eût de<br />
l'esprit. » J'allai moi-même remercier la bonne fermière du bonheur qu'elle m'avait donné. Il<br />
est certain que ce que j'avais senti pénétrer dans mon cœur à cette courte lecture faite au<br />
matin, à l'odeur de ces plantes saines, en présence de ces arbres de la ferme, me semblait tenir<br />
du prodige.<br />
Mon cheval était prêt, je le poussai à toute bride hors des avenues du château ; il me tardait de<br />
sortir de son atmosphère ; arrivé au chemin du village, je me crus délivré, et je rentrai dans la<br />
ville au pas lent des coursiers d'Hippolyte.<br />
Page 379 …<br />
VII.<br />
Je n'ai garde de t'oublier dans ce livre, ô toi que je regarde comme le plus beau de main<br />
d'homme qui nous ait été accordé.<br />
<strong>Saint</strong> livre de l’Imitation, paraphrase divine du divin Evangile, encore si remplie de tendresse<br />
et de clarté ! tout a été dit sur toi. C'est mon souvenir seul que je te veux donner, livre audessus<br />
de toute louange humaine, livre mystérieux, [376] ouvrage des anges et des saints,<br />
tombé du ciel, et trouvé, sans doute, sous quelque arbre en fleurs à la clarté des étoiles.<br />
Je t'ai lu après beaucoup d’autres, et tu as tout résumé en mon âme, tout complété, tout<br />
agrandi, tout expliqué : les mystères, la morale, la philosophie, la sagesse, tout ce qu'il y a de<br />
noble, de tendre, de profond, de divin dans notre nature, dans son état d'expiation et<br />
décennies 1830_1839<br />
118
d'espérance. Tu m'as appris, entre tant de choses, celles-ci : « Laissez au monde ses curiosités,<br />
et lisez toujours des livres qui servent plus à toucher le cœur qu'à divertir l'esprit. »<br />
…<br />
[379] « Écrivez, lisez, chantez mes louanges ; gémissez, priez dans le silence, et supportez<br />
courageusement tout ce qui vous arrive de pénible et de contraire. »<br />
« L'homme a deux ailes pour s'élever au-dessus des choses de la terre : la simplicité et la<br />
pureté. »<br />
« La simplicité doit régler ses intentions, et la pureté ses affections. » (Ce peu de paroles nous<br />
paraît pouvoir suffire à l'enseignement et a la règle de la vie la plus sainte.)<br />
« Si vous aviez le cœur droit, toutes les créatures seraient autant de miroirs et de livres ouverts<br />
où vous verriez des modèles pour régler saintement votre vie. »<br />
« Si vous étiez intérieurement bon et pur, rien ne vous empêcherait de voir et de comprendre<br />
toutes choses. Un cœur net et sans tache pénètre jusque dans le ciel et dans les enfers. » (Nous<br />
ne connaissons que quelques traits de saint François de Sales et de <strong>Saint</strong>-Martin, qui se<br />
puissent comparer à de telles célestes beautés, [380] et peut-être est-ce parce qu'ils les avaient<br />
beaucoup contemplées ; nous les trouvons sous nos yeux en ce moment, et nous nous pressons<br />
de les y joindre : « Le moyen d'être simple gît à tenir son cœur proche de Dieu, lequel est un<br />
esprit très pur et très simple. »<br />
« II faut, pourtant, exercer le jugement et la prudence ; mais, en la conversation et aux<br />
rencontres, ce précepte est important : « Ami de tous et familier de peu. »<br />
« <strong>Les</strong> tentations, telles qu'elles soient, nous troublent, parce que nous y pensons trop et que<br />
nous les craignons trop. Nous sommes trop sensibles ; car, sitôt que nous avons la moindre<br />
pensée contraire à nos résolutions, il nous semble que tout est gâté. Laissons courir le vent, et<br />
ne croyons pas que les frifillis des feuilles soient le cliquetis des armes. » (A. combien peu<br />
ceci convient, mon Dieu, et combien prennent le cliquetis des armes pour le frifillis des<br />
feuilles !) « L'amour de la mort et passion de Notre Seigneur donne la mort à toutes nos<br />
passions !<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
1<strong>19</strong>
Vorlesungen über Glauben und wissen als Einleitung in die Dogmatik und ... Page 116 de Johann<br />
Eduard Erdmann 1837 276 pages<br />
Ecriture « gothique »<br />
St. Martin (le philosophe inconnu), ...<br />
Affichage du livre entier<br />
Catalogue of the Books Belonging to the Loganian Library: To which is ... Page 26 de<br />
Loganian Library, William Mackenzie 1837 450 pages<br />
Behmen, 871, O. The Epistles of Jacob Behmen, aliter Teutonicus Philosophus : very useful<br />
and necessary for those that read his writings, and are very full of excellent and plaine<br />
instructions how to attaine to the life of Christ. Translated from the German. London, 1649.<br />
M.<br />
1504, O. L'Aurore Naissante, ou la Racine de la Philosophie, de l’Astrologie et de la<br />
Théologie, ouvrage traduit de 1'Allemand de Jacob Behme, &c. par le Philosophe inconnu. 2<br />
tomes. A Paris, 1801.<br />
966, O. Miroir temporel de l'Eternité : traduit de l'Allemand de Jacob Boem, par le Sr. Jean<br />
Macle. 1787. M.<br />
Page 7<br />
<strong>Saint</strong> Martin, 1530, O. Tableau Naturel des Rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et<br />
l'Univers. Par M. de <strong>Saint</strong> Martin. 2 tomes. A Edimbourg, 1782. ...<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
120
Revue de Paris Page 207 publié par <strong>Louis</strong> Désiré Véron 1837<br />
[205]<br />
Madame DE VARNHAGEN.<br />
“Full many a gem of purest ray serene,<br />
The dark unfathomed caves of ocean bear;<br />
Full many a flower is born lo blush unseen,<br />
And waste its sweetness on the desert air. »<br />
(Elegy written in a country church yard, by Thomas Gray.)<br />
Je n'ai jamais arrêté ma pensée sur le spectacle de la nature sans éprouver un sentiment<br />
d'effroi mêlé d'admiration. Le luxe des existences perdues plaît au régulateur de notre univers.<br />
Que de germes avortés, que de richesses inconnues !... Quelle dépense de spectacle sans<br />
spectateurs !... Que de problèmes insolubles pour l'intelligence du soi-disant roi de la nature<br />
!... En vain lui répète-t-on que l'indifférence du créateur pour l'individu ne s'étend pas jusqu'à<br />
la race.... Il y avait parmi les animaux des espèces qui ont disparu comme des nations parmi<br />
les hommes. Si la terrible influence du hasard s'arrête quelque part sur la terre, c'est au bord<br />
de la tombe. Là est écrit le mot de toutes les énigmes ; là, tout blasphème reçoit sa réponse.<br />
La transformation de notre être est si brusque et si complète, que nous la prenons pour<br />
l'anéantissement ; mais si la mort était la cessation de la vie, ou ce qui me parait synonyme, la<br />
perte du sentiment individuel, l'iniquité, la déraison, seraient Dieu, le seul Dieu du moins avec<br />
lequel l'esprit humain pourrait communiquer.<br />
Des réflexions analogues à celles que fait naître la contemplation de la nature sont inspirées<br />
au philosophe par l'étude des sociétés. Que de destinées manquées, que de force infructueuse<br />
et même souvent [206] aussi pernicieuse aux autres que nuisible à qui la possède ! quelle<br />
amère ironie dans la répartition des dons les plus rares et du succès, plus rarement encore<br />
proportionné au mérite ! que d'injustice dans les renommées, que de génie inconnu, de<br />
médiocrité illustre, que de talents avortés, de vertu calomniée, de vice déifié ! Et tout cela au<br />
profit de qui? Au profit de la mort. La mort hérite de toutes les vérités perdues dans le<br />
désordre de la vie de ce monde, elle recueille, elle classe, comme des semences précieuses,<br />
tous les moyens négligés, tous les dons étouffés, toutes les affections méconnues, tous les<br />
mérites obscurcis, tous les desseins de Die» trompés par les démons de la terre ; et c'est avec<br />
cette moisson de nobles débris, que la mort, c'est-à-dire l'esprit de vie par excellence, refait<br />
des palais aux gloires injuriées, jette des voiles sur les fronts injustement couronnés, entoure<br />
d'auréoles des têtes de héros insultés par le silence de la terre; en un mot, la mort, c'est la<br />
justice dégagée de toute entrave. La porte de la tombe est la seule ouverture par laquelle le<br />
saint jour de la vérité toute puissante pénètre du ciel jusqu'au cœur de l'homme.<br />
Le 7 mai 1833, il y a quatre ans et demi, Rachel, âgée de soixante-deux ans, est morte à<br />
Berlin, où elle était née. Je l'ai connue en 1816. C'était une femme aussi extraordinaire que<br />
Mme de Staël, par les facultés de l'esprit, par l'abondance des idées, la lumière de l'âme et la<br />
bonté du cœur : elle avait de plus que l'auteur de Corinne le dédain de l'éloquence; elle<br />
n'écrivait pas. Le silence des esprits comme le sien est une force. Avec plus de vanité, une<br />
personne aussi supérieure aurait cherché à se faire un public; Rachel n'a voulu que des amis.<br />
Elle parlait pour communiquer la vie qui était en elle ; jamais elle ne parlait pour être admirée.<br />
Je laisse aux esprits doués de plus de sagacité que je n'en ai à décider si l'obscurité dont elle<br />
n'a jamais essayé de sortir, était la conséquence inévitable de l'excès de vivacité qui<br />
l'empêchait quelquefois de coordonner ses idées de manière à les faire adopter par la foule, ou<br />
décennies 1830_1839<br />
121
si sa foi, dans la spiritualité de l'âme, lui montrait d'un coup d'œil l'inutilité de toutes les<br />
créations de l'art humain, où la forme entre toujours pour beaucoup, et la retenait<br />
volontairement dans le quiétisme. La contemplation de la nature et de la providence qui la<br />
dirige était pour elle une jouissance si vive, que ce spectacle, considéré du point de vue élevé<br />
où elle était placée, suffisait à son activité. La vie, pour elle, était un travail continuel; mais<br />
elle n'en a pas fait d'autre. Ses lectures même devenaient des conversations : [207] elle vivait,<br />
elle discutait avec les livres comme avec des personnes. L'intensité de sa vie était telle qu'elle<br />
animait tout sans le vouloir; elle faisait plus que percevoir, elle personnifiait les idées; son<br />
intelligence était un monde où tout avait son emploi, comme dans le monde de Dieu. Jamais<br />
esprit plus productif ne fut moins connu de la foule; dans des sociétés dont les forces seraient<br />
autrement combinées que celles du monde où nous vivons, Rachel aurait été pour les nations<br />
ce qu'elle était pour un petit cercle d'amis intimes : la lumière des esprits, le guide des âmes.<br />
Ses lettres, recueillies et publiées depuis sa mort, n'étaient point des œuvres; c'étaient des<br />
éclairs qui partaient de son cœur et de son brillant esprit pour toucher le cœur de ses amis 17<br />
(1). Pour elle, écrire, ce n'était pas briguer la gloire, c'était chercher un remède à l'absence. Il<br />
me semble qu'on peut la définir d'un mot : elle avait l'esprit d'un philosophe avec le cœur d'un<br />
apôtre; et malgré cela elle était enfant et femme autant qu'on peut l'être. Son esprit pénétrait<br />
dans les obscurités les plus profondes de la nature; elle pensait avec autant de force et plus de<br />
clarté que notre théosophe <strong>Saint</strong>-Martin, qu'elle comprenait et admirait, et elle sentait comme<br />
un artiste. Ses perceptions étaient toujours doubles; elle atteignait aux vérités les plus<br />
sublimes par deux facultés qui s'excluent chez les hommes ordinaires : par le sentiment et par<br />
la réflexion. Ses amis se demandaient d'où sortaient les éclairs de génie qu'elle lançait dans la<br />
conversation.<br />
Était-ce le résultat de longues études? Était-ce l'effet d'inspirations soudaines? C'était<br />
l'intuition accordée pour récompense, par le ciel, aux âmes vraies; ces âmes martyres luttent<br />
pour la vérité qu'elles pressentent, souffrent pour le Dieu qu'elles aiment, et leur vie entière est<br />
l'école de l'éternité.<br />
Voici comment celle-ci se rendait témoignage à elle-même, dans une lettre écrite le 5<br />
novembre 1808, à M. de Varnhagen d'Ense, qu'elle épousa depuis :<br />
Berlin, ce 3 novembre 1808. « Enfin je suis chagrine ! Sais-tu tout ce que ce mot signifie?<br />
Mais aussi quelle complication !... Le temps même devient fou... Depuis le mois de juillet<br />
(cela te paraîtra risible), l'hiver, en convulsion, lutte contre l'été. Voilà deux jours que je me<br />
tourmente pour savoir si j'écrirai ou non ; je ne puis pas mentir, surtout avec toi, avec toi pour<br />
[208] qui la vérité m'arrive tout entière, et pourtant j'ai de jolies choses à t'écrire !... Oh ! les<br />
dons que je possède, on ne les a pas en vain ! Il faut souffrir pour eux. Ma science des choses,<br />
ma sagacité, mon discernement : ce sentiment de l'infini qui est en moi, le rapport intime qui<br />
existe entre ma vie et la vie de la nature, enfin le quelque peu de conscience que j'ai de tout<br />
cela (et ce peu veut ici dire beaucoup), cela coûte quelque chose. Quelle souffrance, quelle<br />
inquiétude, quel abandon pendant le développement !... Quelle lutte intérieure n'ai-je pas à<br />
soutenir? Je doute que toi-même tu en aies une idée. Et comme mes entours sont dégoûtants,<br />
rabaissants, impatientants, offensants, insensés, misérables ! comme ils sont bas ! pourtant je<br />
ne puis leur échapper; et tant que je ne le puis pas, ils me poursuivent. <strong>Les</strong> éviter doucement,<br />
il n'y faut pas penser; le moindre contact, le moindre rapport me souille, me fait déroger, et ce<br />
combat n'a pas de fin; il a commencé avec moi, il durera tant que je vivrai. Où se terminera-til?<br />
Cette conviction (non que le combat est inévitable, mais que mes efforts sont sans but et ne<br />
peuvent cesser qu'avec la perte de mes facultés) me met dans une rage qui approche de la<br />
déraison. Tout ce que je rencontre de beau, dans la vie, passe étranger devant moi, comme une<br />
17 (1) Ce livre a paru à Berlin, en 3 volumes, sons le titre de Rachel à ses amis. Il a été publié<br />
en allemand par Dunker et Humblot. Berlin, 1834.<br />
décennies 1830_1839<br />
122
visite, et il faut que je vive méconnue parmi des êtres indignes. Ils usent et abusent de moi.<br />
Nous sommes liés par des rapports réciproques : eux parce qu'ils se servent de moi, moi parce<br />
qu'une lutte corps à corps, une lutte sanglante ne me délivrerait pas d'eux. Tu le vois, je suis<br />
hors de moi !... C'est ce qu'on dit quand la vraie voix du cœur parle. <strong>Les</strong> sots et les menteurs<br />
se protègent entre eux ; mais moi, point de loi, point de proches, point d'amis, rien... Et ce<br />
qu'il y a de pis, c'est que, vivant au milieu de l'injustice, le blâme m'irrite comme une<br />
nouveauté. Il n'y a pas un seul de ceux qui me condamnent qui, dans sa propre opinion, n'ait<br />
manqué à tout. Personne ne prend ma défense; ils me persécutent, parce que j'ai toujours parlé<br />
à chacun en faveur de l'autre. Je te fais grâce des misérables histoires qui m'arrachent ces<br />
réflexions pendant ton absence. Oh ! comme je leur échapperais par ta seule présence, par la<br />
présence d'un ami, d'une créature sympathique ! « <strong>Les</strong> femmes que je vois m'anéantissent:<br />
c'est un effet physique, leur présence agit sur mes nerfs; elles m'abattent la pensée, tant je les<br />
trouve dénuées d'énergie; imprudentes sans excuse, car c'est par pure inconséquence; et elles<br />
établissent leur parallèle entre elles et moi avec une sécurité si complète, que je n'ai d'autre<br />
refuge que de quitter la chambre. Elles mentent aussi.... elles en ont si souvent [209] besoin<br />
!... C'est qu'il faut de l'esprit pour dire la vérité. Aussi le mensonge m'ennuie comme une<br />
maladie, comme la bêtise...<br />
« L'après-midi, le soleil, caché depuis bien des jours, parut au moment où je sortais. <strong>Les</strong><br />
arbres diaprés m'attirèrent plus loin. C'était comme un printemps, et aussi comme un soir de<br />
janvier, calme, pur, quand la neige, déjà battue, n'est point fondante. Des saisons diverses<br />
avec le souvenir de tout ce qu'on a senti traversaient ma pensée; toutes les promenades que j'ai<br />
jamais faites avec leurs images, et les innocentés dispositions de mon cœur, repassaient<br />
rapidement, mais très distinctement, dans mon esprit, et tout cela à la fois, comme un cortège<br />
qu'on aperçoit de loin tout entier d'un coup d'œil. Je savais bien ce que je sentais, et pourtant<br />
je m'étonnais ; mon passé revivait tout entier; l'avenir seul m'était fermé... L'air doux<br />
favorisait ma vue : je découvris au loin le jardin du Prince 18 (1), véritable cimetière; j'étais<br />
attirée là. Le jardin était déjà brillant et assez semblable au printemps avec ses promesses et<br />
l'inquiétude qu'il verse dans les veines; c'était comme s'il dansait avec l'automne à l'instar des<br />
grands personnages qui se donnent des fêtes après les combats et les guerres.<br />
J'eus envie de traverser le pont; l'eau était limpide, le soleil chaud ; je m'acheminai vers la<br />
digue. Là je pensai : C'est le chemin de Varnhagen, et la tristesse me revint. Je continuai au<br />
grand soleil; près du jardin d'Éphraïm, il fallut revenir sur mes pas; il est trop solitaire, et je ne<br />
pouvais pourtant traverser le parc toute seule. Je revis encore ton chemin, et m'en revins<br />
doucement. J'avais alors le soleil derrière moi, et devant moi, un arbre magnifique éclairé par<br />
lui, vert, touffu ; il se trouve à l'entrée du jardin d'Éphraïm ; je ne pus résister au désir d'aller à<br />
cet arbre; il aurait pu me réjouir le cœur; mais quand je m'approchai, les branches étaient bien<br />
plus hautes qu'elles ne m'avaient paru. J'étais absolument seule; un bourgeois vint à passer au<br />
sortir du parc, il avait un bâton sous le bras, un habit gris, un chapeau à trois cornes : — Oh !<br />
Monsieur, vous êtes plus grand que moi !... Cet arbre a encore une si belle verdure, ne<br />
pourriez-vous m'en cueillir une feuille? — L'homme, avec beaucoup d'intérêt et de soin, me<br />
choisit la plus verte et me la donna d'un air content. Quand je le quittai après l'avoir remercié,<br />
il me regarda encore avec satisfaction ; il paraissait charmé de voir qu'une personne en<br />
douillette, avec un chapeau et un châle, s'amusât d'une<br />
[210]<br />
Affichage du livre entier<br />
18 (1) Le prince <strong>Louis</strong> de Prusse, tué deux ans auparavant dans la campagne d'Iéna.<br />
décennies 1830_1839<br />
123
Économie politique chrétienne, ou Recherches sur la nature et les causes du ... Page 60 de<br />
Alban Villeneuve-Bargemont 1837<br />
… [60] « Un abîme sépare ceux qui se conduisent par le calcul, de ceux qui sont guidés par le<br />
sentiment. »<br />
« Quand on veut s'en tenir aux intérêts, aux convenances, aux lois du monde, le génie, la<br />
sensibilité, l'enthousiasme agitent péniblement notre âme. »<br />
« Ce n'est pas assurément pour les avantages de cette vie, pour assurer quelques jouissances<br />
de plus à quelques jours d'existence, et retarder un peu la mort de quelques moments, que la<br />
conscience et la religion nous ont été données. C'est pour que les créatures en possession du<br />
libre arbitre choisissent ce qui est juste, en sacrifiant ce qui est probable, préfèrent l'avenir au<br />
présent, l'invisible au visible, et la dignité de l'espèce humaine à la conservation même des<br />
individus.<br />
« La morale fondée sur l'intérêt serait aussi évidente qu'une vérité mathématique, qu'elle<br />
n'exercerait pas plus d'empire sur les passions qui foulent aux pieds tous les calculs. Il n'y a<br />
qu'un sentiment qui puisse juger d'un sentiment. Quand l'homme se plaît à dégrader la nature<br />
humaine, qui donc en profitera ?<br />
« Quelque effort que l'on fasse, il faut en revenir par reconnaître que la religion est le véritable<br />
fondement de la morale. C'est l'objet sensible et réel au dedans de nous qui seul peut<br />
détourner nos regards des objets extérieurs. »<br />
Un philosophe spiritualiste, moins connu qu'il ne mériterait de l'être (2), a, ce semble, jeté à<br />
son tour de grandes lumières sur ces hautes questions qui intéressent si vivement l’ordre<br />
social.<br />
« II y a des êtres, dit-il, qui ne sont qu'intelligents; il y en a qui ne sont que sensibles.<br />
L'homme est à la fois l'un et l’autre : voilà le mot de l'énigme. Ces différentes classes ont<br />
chacune un principe d'action différent. L'homme seul les réunit tous les deux, et quiconque<br />
voudra ne les pas confondre sera sur de trouver la solution de toutes les difficultés.<br />
« Depuis la dégradation primitive, l'homme s'est trouvé revêtu d'une enveloppe corruptible,<br />
parce qu'étant composée, elle est sujette aux différentes actions du sensible qui n'opèrent que<br />
sensiblement, et qui, par conséquent, se détruisent les unes les autres. Mais, par cet<br />
assujettissement au sensible, il n'a point perdu sa qualité d'être intelligent; en sorte qu'il est à<br />
la fois grand et petit, mortel et immortel. Toujours libre dans l'intellectuel, mais lié dans le<br />
corporel par des circonstances indépendantes de sa volonté, en un mot, étant un assemblage<br />
de deux natures diamétralement opposées, il en démontre alternativement les effets d'une<br />
manière si distincte, qu'il est impossible de s'y tromper. Si l'homme actuel n'avait que des<br />
sens, ainsi que des systèmes humains le voudraient établir, on verrait toujours le même<br />
caractère dans toutes ses actions, et ce serait celui des sens, c'est-à-dire qu'à l'égal de la bête,<br />
toutes les fois qu'il serait excité par ses besoins corporels, il tendrait avec effort à les<br />
satisfaire, sans jamais résister à aucune de leurs impulsions, si ce n'est pour céder à une<br />
impulsion plus forte provenant d'une source analogue.<br />
« Pourquoi donc l'homme peut-il s'écarter de la loi des sens ? Pourquoi peut-il se refuser à ce<br />
qu'ils lui demandent ? Pourquoi, pressé par la faim, est- il néanmoins le maître de refuser les<br />
mets les plus exquis qu'on lui présente ? de se laisser tourmenter, dévorer, anéantir même par<br />
le besoin, et cela, à la vue de ce qui serait le plus propre à le calmer ? Pourquoi, dis-je, y a-t-il<br />
dans l'homme une volonté qu'il peut mettre en opposition avec nos sens, s'il n'y a pas en lui<br />
plus d'un être ? Et deux actions si contraires peuvent-elles tenir à la même source ?<br />
« En vain on m'objecterait à présent que quand la volonté agit ainsi, c'est qu'elle est<br />
déterminée par quelque motif. J'ai assez fait entendre, en parlant de liberté, que la volonté de<br />
l'homme, étant cause elle-même, devait avoir le privilège de se déterminer seule et sans motif,<br />
autrement elle ne devrait pas prendre le nom de volonté. Mais en supposant que, dans le cas<br />
décennies 1830_1839<br />
124
dont il s'agit, sa volonté se déterminât en effet par un motif, l'existence des deux natures de<br />
l'homme n'en serait pas moins évidente, car il faudrait toujours chercher ce motif ailleurs que<br />
dans l'action de ses sens, puisque sa volonté la contrarie ; puisque lors même que son corps<br />
cherche toujours à exister et à vivre, il peut vouloir le laisser souffrir, s'épuiser et s'éteindre.<br />
Cette double action de l'homme est donc une preuve convaincante qu'il y en a en lui plus d'un<br />
principe. »<br />
…<br />
(2) S. Martin, auteur des Erreurs et de la Vérité, ou les hommes rappelés au principe universel<br />
de la science, par un philosophe inconnu ; de l’Ecce homo, du Tableau naturel qui existent<br />
entre Dieu, l'homme et l'univers ; des rapports de l'Homme de désir, etc. S. Martin pensait que<br />
les hommes sont naturellement bons ; mais il entendait, par la nature, celle qu'ils avaient<br />
originairement perdue, et qu'ils pouvaient recouvrer par leur bonne volonté ; car il les jugeait,<br />
dans le monde, plutôt entraînés par l'habitude vicieuse que par la méchanceté. Ce philosophe<br />
reconnut les desseins terribles de la Providence [61] dans la révolution française, et crut voir<br />
un grand instrument temporel dans l'homme qui vint plus tard la comprimer. Il prit la défense<br />
de la cause du sens moral contre Garat, professeur de la doctrine du sens physique, ou de<br />
l'analyse de l'entendement humain. Son but était d'expliquer la nature par l'homme, et de<br />
ramener toutes nos connaissances au principe dont l’esprit humain peut être le centre. La<br />
nature actuelle, dit-il, déchue et divisée d'avec elle-même, et d'avec l'homme, conserve dans<br />
ses lois comme dans plusieurs de ses facultés, une disposition à rentrer dans l'unité originelle.<br />
Par ce double rapport, la nature se met en harmonie avec l'homme, de même que la nature se<br />
coordonne à son principe. » II pensait qu'il y a une raison à tout ce qui existe, et que l'œil<br />
interne de l'observateur en est le juge : il considérait l'homme comme ayant en lui un miroir<br />
vivant qui lui réfléchit tous les objets, et qui le porte à tout voir et à tout connaître. Mais ce<br />
miroir vivant étant lui-même un reflet de la Divinité, c'est par celte lumière que l'homme<br />
acquiert des idées saines, et découvre l'éternelle lumière dont parle Jacob Bœhm.<br />
L’objet de son ouvrage intitulé Ecce homo, est de montrer à quel degré d'abaissement<br />
l'homme infirme est déchu. On y trouve celle belle expression : « l'âme de l'homme est<br />
primitivement une pensée de Dieu. »<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
125
Le Christianisme considéré dans ses rapports avec la civilisation moderne Page 92 de<br />
Augustin Sénac 1837<br />
… [87] Dans une autre tige de l'antiquité tout aussi importante, la tige juive, une tradition<br />
semblable se transmet imperturbablement de génération en génération depuis les temps<br />
primitifs ; je veux parler du dogme de la chute. Il y a identité dans le principe; et l'on peut<br />
même, sans forcer en aucune manière les rapprochements, reconnaître dans les formes dont<br />
cette idée est revêtue des points généraux de ressemblance. Dans la version de Moïse, la<br />
théorie du genre humain n'est pas coupée en sections aussi distinctes que celles qui forment<br />
les âges dans celles d'Hésiode et de Manou; mais des divisions analogues s'y laissent<br />
cependant apercevoir [88] voir. D'abord, c'est l'âge du Paradis : la terre est fertile, et produit<br />
d'elle-même tous les fruits; l'homme est tranquille, pur de toute souillure, ami de Dieu. A la<br />
suite de cet âge bienheureux, la déchéance commence ; et par une moralité bien supérieure à<br />
celle des récits de la Grèce et de l'Inde, la cause essentielle de la mutation provient de<br />
l'homme lui-même, et non pas de l'aveugle volonté de Dieu ou du destin. Alors se produit<br />
l'époque d'Adam jusqu'à Noé, comprenant un espace de deux mille ans; la justice et le culte de<br />
l'Éternel se soutiennent dans la descendance de Seth, et la vie y jouit d'une durée dix à douze<br />
fois supérieure à la nôtre; les hommes ne commencent à engendrer qu'à l'âge de cent ans. Sur<br />
la fin de cet âge, une troisième race paraît ; nous sommes comme malgré nous frappés de<br />
l'étonnant rapport qu'elle présente avec la race impie et redoutable des hommes d'airain.<br />
« En ce temps-là, dit la Genèse, lorsque les fils de Dieu se furent joints avec les filles des<br />
hommes, et qu'elles eurent enfanté, il y eut sur la terre des géants (Néphitims); ce furent les<br />
robustes du siècle, les gens de renom. Mais Dieu voyant que la méchanceté des hommes sur la<br />
terre était grande, et que le fond des pensées de leur cœur n'était jamais que le mal, il se<br />
repentit d'avoir fait l'homme et s'en affligea dans son cœur. » Dieu arrête donc cette<br />
génération maudite; [89] le déluge l'engloutit, et la terre la recouvre. Après elle vint la<br />
génération des patriarches, qui, dans l'écriture du peuple juif, occupe le même rang que la<br />
génération héroïque dans les chants de la Grèce. Puis enfin l'époque courante, qui, depuis le<br />
veau d'or jusqu'à Baal, depuis les famines du désert jusqu'à la captivité de Babylone, depuis<br />
Moïse jusqu'aux Prophètes, demeure opiniâtrement perdue dans le même opprobre, le même<br />
châtiment, la même impiété. Ezéchiel, Jérémie, et tous ces poètes sacrés de la Judée, unissent<br />
leurs voix à celle de la Grèce du fond de l'abîme, et ce beau vers d'Hésiode, si plein<br />
d'amertume et de douleur, se trouve dans tous les cœurs et dans toutes les langues : « Oh !<br />
pourquoi ai-je été mêlé à la cinquième race ! Que ne suis-je mort avant elle, ou que ne suis-je<br />
né plus tard ! »<br />
« Le germe d'avenir déposé dans cette dernière parole est en effet commun à la Judée et à la<br />
Grèce. Lorsque Prométhée dérobe le feu dans le ciel, Jupiter le maudit, ainsi que toute sa race<br />
: « Fils de Japhet, le plus versé dans la science des choses, tu te réjouis d'avoir dérobé le feu et<br />
trompé mon dessein, mais cela sera la cause du mal pour toi et pour tes descendants. Pour ce<br />
feu, je leur donnerai le mal, dans lequel ils viendront tous tremper leur âme, chérissant ainsi<br />
eux-mêmes leur [90] propre mal (1) <strong>19</strong> . » La réprobation de Jupiter n'est cependant pas<br />
absolue. Il ordonne à Pandore d'entrouvrir son urne; mais il lui ordonne en même temps d'y<br />
retenir l'espérance, faculté céleste et compagne sacrée de l'intelligence, qui donne à l'âme<br />
l'entrée de l'avenir, et lui permet d'oublier dans cet asile la marque douloureuse des épreuves<br />
par où elle passe. Jéhovah, chassant l'homme du paradis, ne lui refuse pas non plus la douce<br />
espérance; elle repose au fond même de sa menace, et, dans son juste arrêt, il prédit au serpent<br />
qu'un jour la postérité de la femme lui brisera la tête. L'espérance, cette élévation si spontanée<br />
et si pure, était donc dans le cœur et dans la prière de tous les justes; on la retrouve dans la<br />
<strong>19</strong> (1) Hésiode, Travaux et Jours.<br />
décennies 1830_1839<br />
126
tradition d’Abraham, dans celle de Moïse, dans les chants de tous les prophètes. C'est à elle<br />
seule que remonte cette unanime et indistincte prédiction de la venue, du Christ; et la partie la<br />
plus divine et la plus inspirée des livres saints en est aussi la moins miraculeuse et la moins<br />
surnaturelle (2) 20 . »<br />
Quand même la chute originelle n'aurait pas laissé dans l'homme des traces indélébiles, qui en<br />
sont, je l'ai assez prouvé, un témoignage permanent, l'accord unanime des peuples, se<br />
transmettent [91] d'âge en âge cet événement, dont ils font une des bases de leur culte, car<br />
tous le consacrent par des rites expiatoires, ainsi que l'ont clairement montré, après tant<br />
d'autres écrivains, MM. de Maistre et B. Constant, cet accord suffirait seul pour le placer audessus<br />
de toute contestation. Quel autre moyen de s'instruire des événements, que l'histoire,<br />
ou la tradition, qui n'est que l'histoire parlée ? La récuser, lorsqu'elle réunit tous les caractères<br />
de certitude exigés par la critique, n'est-ce pas renverser l'histoire elle-même, rompre la<br />
communication entre les époques, les rendre étrangères les unes aux autres, et faire<br />
recommencer le monde avec chacune d'elles ? Qu'est-ce qui élève un fait à la certitude, sinon<br />
la multitude des autorités qui le rapportent, leur désintéressement, le petit nombre et surtout<br />
l'absence de celles qui le contredisent ? Dès lors, quel fait égale en certitude la chute<br />
originelle, que proclame la voix imperturbable des peuples et des générations, si peu<br />
intéressés à la transmettre, que le souvenir en est toujours effrayant et douloureux, et les<br />
condamne souvent à de terribles pratiques ? Et qu'on n'allègue pas ici les fables du paganisme;<br />
car la mythologie païenne n'est universelle, ni quant aux lieux, puisque chaque peuple avait la<br />
sienne, ni quant aux temps, car elle a commencé et elle a péri. La chute primitive au contraire,<br />
sous un nom ou sous un [92] autre, se rencontre dans tous les systèmes de religion, dans tous<br />
les états de civilisation ; elle retentit dans les quatre coins du monde, chez les modernes,<br />
comme chez les anciens. Et aujourd'hui même, si elle perd son crédit dans certains esprits que<br />
le besoin d'innover tourmente et que le dédain des opinions communes agite, elle subsiste<br />
dans les autres, et trouve toujours des écrivains, des philosophes, qui la défendent contre les<br />
attaques qu'on lui livre. Personne n'ignore les points de vue nouveaux sous lesquels l'a<br />
présentée M. de Maistre, comme avant lui <strong>Saint</strong>-Martin et toute l'école théosophique; et ils<br />
n'ont eu d'autre tort que de l'exagérer. Mais cette école, malgré ses erreurs, a bien autant de<br />
poids que l'école sensualiste et l'école écossaise-allemande, qui seules favorisent l'opinion<br />
contraire.<br />
A cette voix souveraine des temps et des lieux qu'opposent les auteurs de l'Encyclopédie<br />
nouvelle ?<br />
Ils opposent le siècle : Une doctrine toute différente, disent-ils, a commencé à se faire jour<br />
distinctement parmi les hommes sur la fin du dernier siècle. Cette doctrine est celle de<br />
l'imperfection primitive de l'homme et de son progrès continu, que nous avons réfutée dans<br />
son application aux temps anciens, et que nous poursuivrons plus tard dans son application<br />
aux temps modernes. En attendant, leur argumentation revient à dire : Le [93] siècle ne croit<br />
pas à la chute primitive; elle n'est donc qu'une fable.<br />
Argumentation singulière, qui, subordonnant la vérité aux mobiles caprices des hommes,<br />
détruit son essence immuable, la change avec les temps ainsi qu'avec les lieux, la fait païenne<br />
dans l'Europe antique, chrétienne dans l'Europe moderne, Bouddhiste dans l'Inde, musulmane<br />
dans une autre partie de l'Asie ! N'est-ce pas une argumentation pareille que foudroyait M.<br />
Royer-Collard (1) 21 ? Et en changeant quelques noms, ne peut-on pas dire de l'opinion<br />
publique ce qu'il disait des religions légales ? « Si aujourd'hui l'opinion publique est<br />
nécessairement la vérité, il en a toujours été ainsi; et le Paganisme, cru divin par les Grecs et<br />
les Romains, a été la vraie religion. Entre lui et Socrate ou Platon, nul doute que l'erreur n'ait<br />
20 (2) Encyclopédie nouvelle, tome 1, page 142 article Age par J. Reynaud.<br />
21 (1) Discours contre la Loi du Sacrilège, 1815.<br />
décennies 1830_1839<br />
127
été du côté de ceux-ci, la vérité du côté du Paganisme. Depuis l'établissement de la religion<br />
chrétienne, le dogme de la divinité de Jésus-Christ n'est vrai qu'en deçà du détroit des<br />
Dardanelles, il est faux et idolâtre au-delà. La vérité est bornée par les mers, les fleuves et les<br />
montagnes; un méridien, comme l'a dit Pascal, en décide. Il y a autant de vérités que<br />
d'opinions publiques; bien plus, si, dans chaque peuple, et sous le même méridien, [94]<br />
l'opinion publique change, la vérité, compagne docile, change avec elle. Et toutes ces vérités,<br />
contradictoires entre elles, sont la vérité au même titre, la vérité immuable, absolue On ne<br />
saurait pousser plus loin le mépris de la vérité. » Cette absurde prétention, qu'ils prêtent au<br />
siècle, ils la consacrent par un principe dont ils font la base de la philosophie. « Le principe<br />
général de certitude dans l'ordre de la vie humaine, disent-ils, est le consentement actuel<br />
manifesté par la tradition actuelle de l'humanité (1) 22 ». Qui ne reconnaît là le principe de<br />
l'autorité, prôné au XVIIe siècle par Huet, évêque d'Avranches, dans son Traité de la faiblesse<br />
de l'esprit humain, remis au jour par M. de Bonald, et tant exalté par M. de Lamennais.<br />
Auteurs de l’Encyclopédie nouvelle, on ne devrait guère s'attendre à vous voir puiser à une<br />
telle source. Mais enfin, puisque vous y empruntez ce principe fondamental, pourquoi le<br />
mutilez-vous ? Il est facile de pénétrer vos motifs. Ce long consentement de l'humanité sur la<br />
chute primitive, qui soulève tous les âges contre votre doctrine d'hier, vous épouvante et vous<br />
accable; vous voudriez le retrancher des éléments de la certitude : abolissez donc sa colossale<br />
autorité dans la conscience du genre humain. Hommes à doctrine d'un jour! [95] songez-vous<br />
qu'en le tronquant ainsi, ce principe devient encore plus erroné qu'il ne l'était dans sa source,<br />
et que sa fausseté ressort davantage ? Si le système de M. de Lamennais détruit la vérité par<br />
rapport à l'homme, puisque l'homme ne la connaît que par sa raison individuelle, et ne peut la<br />
dire sienne qu'autant qu'elle y réside; du moins il ne la détruit pas en elle-même, puisque,<br />
exigeant l'unanimité des temps et des pays, comme marque de la vérité, il lui laisse le triple<br />
caractère de généralité, d'unité, d'immutabilité, qui lui est propre ; et par là ce système a un<br />
côté spécieux, capable d'en imposer. Or, c'est ce côté que vous lui enlevez. Enfermant la<br />
certitude dans l'opinion d'un jour et d'un lieu, vous rendez la vérité changeante, circonscrite,<br />
fugitive, et l'anéantissez non plus seulement par rapporta l'homme, mais en elle-même.<br />
Spectacle curieux et instructif! tandis que des hommes qui veulent renverser le Christianisme,<br />
pour lui substituer la philosophie, qu'ils appellent la religion de l'avenir, annulent la<br />
philosophie, en lui faisant déclarer que la raison, ou comme ils parlent, la raison individuelle,<br />
est incapable par elle-même d'arriver à la vérité, un évêque(1) 23 établit, et exhausse la<br />
philosophie, en maintenant contre elle, et au nom du Christianisme la faculté et le droit [96]<br />
qu'a la raison d'acquérir la vérité. Il plaide si bien sa cause, qu'il la fait triompher dans l'esprit<br />
même du prêtre de talent et de conscience qu'avait égaré le Kantisme, et l'amène à renoncer<br />
un système qui, comme on sait, abaisse la raison à l'impuissance d'atteindre les vérités<br />
religieuses de l'ordre naturel, et de se prouver celles de l'ordre surnaturel, système qui au<br />
surplus n'est que le sensualisme déguisé, puisqu'il ne reconnaît de vérités que celles qu'on peut<br />
vérifier par l'expérience.<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
22<br />
(1) Revue Encycl., t. LX, p. 58.<br />
23<br />
(1) Lettre pastorale de M. de Tréversn, évêque de Strasbourg, au sujet de l’enseignement de M.<br />
Bautin.<br />
décennies 1830_1839<br />
128
Histoire philosophique, politique et critique du christianisme et des ... Page 315 de <strong>Louis</strong><br />
Joseph Antoine de Potter 1837<br />
CHAPITRE IV.<br />
<strong>Les</strong> martinistes. — La soeur de la Nativité. — Amour qu'elle inspire. — Ses visions.<br />
— Ses prédictions. — Société des victimes. — Jung Stilling. — <strong>Les</strong> peschélites. —<br />
Madame Krudner. — Ses publications. — Ses relations avec l'empereur Alexandre.<br />
A la fin du dix-huitième siècle, Martinez Paschalis et, après lui, <strong>Saint</strong>-Martin fondèrent une<br />
secte de théosophes ou martinistes, espèce de fous, qui ne savent pas encore assez bien ce<br />
qu'ils sont eux-mêmes pour que nous cherchions à le savoir, Martinez disserte sur ce qu'était<br />
l'homme avant d'exister, aussi sérieusement et aussi savamment que bien d'autres ont disserté<br />
sur ce qu'il sera lorsqu'il n'existera plus. <strong>Saint</strong>-Martin se déclara surtout l'ennemi des<br />
philosophes qui ne s'occupent ordinairement de l'homme que pendant qu'il existe : il soutint<br />
que les déistes, par exemple, s'ils étaient réunis, s'entredévoreraient comme des araignées;<br />
c'est ce que Pie VI avait dit avant lui, en parlant de l'assemblée des constituants français, qui,<br />
cependant, n'était pas toute composée de déistes. Nous jugerons plus charitablement des<br />
théosophes : seulement nous nous permettrons de croire qu'une société de ces mystiques ne<br />
serait pas fondée sur des principes bien cohérents et bien solides.<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
129
<strong>Les</strong> soirées de <strong>Saint</strong>-Pétersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel ... Page 208 de Joseph de Maistre 1837 458<br />
pages<br />
Voir l’ouvrage et ci-dessus.<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
130
1838<br />
décennies 1830_1839<br />
131
1839<br />
Journal of the Rev. Josepf Wolff ...In a Series of Letters to Sir Thomas ... - Page 292 de<br />
Joseph Wolff - 1839 - 402 pages<br />
On the 26th of January we arrived in the harbour of Alexandria, at ten in the morning, and I<br />
found my old friends, the Gliddons, well. I called on Colonel Campbell, who received me<br />
kindly, and invited me to dinner. In the evening I went to the celebrated Antiquarian, Captain<br />
Caviglia, so frequently mentioned in my former Journals. He is still occupied in the<br />
disquisition of mystical philosophy. He informed me that he was reading the Bible more than<br />
ever, and that he perceived, in reading the Book of Joshua, that men have to expel from their<br />
hearts the same rebel nations against whom Joshua had fought. He connects strangely<br />
Zechariah XIII. 5, "But he shall say, I am no Prophet, I am an husbandman, for man taught<br />
me to keep cattle from my youth," with Genesis II, and attempts to prove by the connection of<br />
both texts, the renovation of the earth, which shall be purified by fire ; citing for this, Luke<br />
XII. 49, " I am come to send fire on the earth; and what will I if it be already kindled?" What I<br />
invariably observe to be the case with mystical philosophers is that they are averse to engage<br />
in a close argument. He reads with great eagerness "Le Nouvel Homme," of the famous<br />
mystic philosopher, <strong>Louis</strong> <strong>Claude</strong> de <strong>Saint</strong> Martin.<br />
Mysticism like that of St. Martin and Jacob Boehme leads to nothing but to rationalism and<br />
infidelity clothed in hieroglyphics and emblems — and mysticism is actually nothing else. It<br />
is more dangerous to Church and State than open Jacobinism: that it led to liberalism and to a<br />
spirit of rebellion St. Martin's History shows, for he himself approved of the French<br />
Revolution in the year 1793. All the mystical philosophers I have met with are like Sooffees<br />
in Persia, Pantheists, denying the necessity, and asserting the indifference of all external<br />
Cultus. They profess at the same time the art of withholding from the inquirer their real<br />
sentiments until they have sufficiently entangled him, exactly as the [292] Neologists in<br />
Germany deceive often the orthodox Christians by terms borrowed from Moravians, as<br />
Schleiermacher at Berlin, and Dr. Channing at Boston. In all they say there is some mental<br />
reservation. The Mystics are, by far, worse than Unitarians, for Unitarians speak, after all,<br />
about the Creator, but the mystical philosophers idolize man and the inanimate creation. They<br />
are subtle and refined idolators. Caviglia is followed by St. Simonians and filthy French and<br />
Italian infidels. Caviglia, for instance, says he does not believe but understands the Trinity. He<br />
explains the words in Genesis I. 1, 2. In the intention of the three attributes of God the<br />
heavens and the earth were created, and the active power of the three attributes of God was<br />
brooding upon the face of the waters. I told him that I knew this mystical interpretation<br />
before. He got very angry about it; and Gen. VI. 6, he translates — "And the Lord suspended<br />
his usual love of preserving men whom he had created!" The acquisition of such mystical<br />
knowledge as these mystics possess, or profess to possess, is with them regeneration.<br />
Knowledge of animal magnetism or phrenology, and Homoeopathy, is with them the means<br />
of obtaining regeneration.<br />
(…)<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
132
Histoire du règne de <strong>Louis</strong> XVIpendant les années ou l'on pouvait prévenir ou ... - Page 153<br />
de Joseph Droz - 1839 - 416 pages<br />
… [152]<br />
Mesmer refusa de telles offres ; il écrivait à la reine : « Aux yeux de votre [153] Majesté,<br />
quatre ou cinq cent mille livres de plus ou de moins, employées à propos, ne sont rien; le<br />
bonheur du peuple est tout. Ma découverte doit être accueillie, et moi récompensé avec une<br />
munificence digne du monarque auquel je m'attacherai. » II chercha cent souscripteurs qui<br />
voulussent, à raison de cent louis par tête, se faire initier à sa doctrine; 340,000 livres furent<br />
versées dans ses mains ; et, peu satisfait encore, il prétendit à la fin des leçons, n'avoir vendu<br />
son secret aux souscripteurs que pour eux seuls, et s'être exclusivement réservé le droit de le<br />
transmettre ; il voulait ouvrir, à son bénéfice, une souscription dans chaque province. Si cet<br />
homme a mis sur la voie pour arriver à des découvertes utiles, ce fut certainement à son insu,<br />
car il ne songeait qu'à se gorger d'argent. Ses élèves prouvèrent qu'ils avaient acheté le droit<br />
de secourir l'humanité ; et les sociétés de l'harmonie, destinées à répandre le mesmérisme, se<br />
formèrent dans toutes les provinces. Le gouvernement nomma des commissaires pour<br />
observer les expériences magnétiques. On remarquait parmi eux Lavoisier, Franklin, Bailly.<br />
Ce dernier fit un rapport facile à résumer dans ce peu de mots : les magnétiseurs opèrent des<br />
effets singuliers ; ces effets ne résultent point d'un fluide, dont rien n'annonce l'existence, ils<br />
sont produits par les moyens mis en œuvre pour exalter l'imagination des personnes<br />
magnétisées (1) 24 . Ce rapport causa une vive sensation ; mais la plupart des partisans de<br />
Mesmer conservèrent leur foi à l'existence du fluide. Plusieurs étaient distingués par leur<br />
esprit, leurs talents, leur position dans le monde : on citait l'avocat général Servan, le marquis<br />
de Chastellux, Bergasse, Duport, d'Espréménil, disposé en tout à l'exaltation. Ce magistrat qui<br />
disait, M. de Cagliostro, dont l'amitié m'honore, indigné de la représentation des Docteurs<br />
modernes, vaudeville où le mesmérisme était tourné en ridicule, publia une brochure où il<br />
comparait Mesmer à Socrate en butte aux traits d'Aristophane.<br />
Des milliers de voix parlaient de détruire les préjugés, d'anéantir la superstition; et, à la même<br />
époque, une mysticité bizarre enfantait des ouvrages recherchés, étudiés, commentés, dans un<br />
cercle plus étendu qu'on ne le croit communément. Le Philosophe inconnu publiait ses<br />
inintelligibles écrits, qui exerçaient toutes les facultés rêveuses et patientes de ses adeptes. Ce<br />
philosophe était <strong>Saint</strong>-Martin, homme de mœurs douces et d'une tendre piété. Boufflers qui<br />
l'avait connu, disait : En l'écoutant, on partageait ses sentiments, sans comprendre ses idées.<br />
Un livre, dont le titre annonce de la folie, fut traduit en 1783, et trouva des lecteurs<br />
enthousiastes. Ce livre est intitulé : <strong>Les</strong> Merveilles dit ciel et de l'enfer, et des terres<br />
planétaires et australes, par Swedenborg, d'après le témoignage de ses yeux et de ses oreilles.<br />
Tandis qu'une nombreuse classe d'oisifs se montrait avide de rêveries, de prodiges, d'émotions<br />
nouvelles, une de ces grandes découvertes dont le genre humain s'honore, vint offrir un<br />
argument à ceux qui jugeaient timide et vulgaire le mot impossible : cette découverte est celle<br />
24 (1) Déjà Berthollet, après avoir suivi pendant un mois les leçons de Mesmer, s'était retiré, en<br />
déclarant par écrit que 1a doctrine du magnétisme est une chimère, que les effets obtenus doivent être<br />
attribués à l'imagination, aux frictions sur des parties nerveuses, a la loi d'imitation.<br />
Le docteur Dcslon que son zèle pour le magnétisme fit repousser durement par ses confrères, pensait<br />
aussi que l'Imagination joue un très grand rôle dans les opérations magnétiques, qu'il n'était même pas<br />
Impossible que cette faculté mi la source unique des effets produits : « Mais, disait-Il , ces effets n'en<br />
sont pas moins certains, observons-les, quel qu'en soit le principe; et si la médecine d'Imagination est<br />
bonne, faisons la médecine d'Imagination.»<br />
décennies 1830_1839<br />
133
des ballons. L'envie a voulu en faire hommage au hasard, mais qu'Etienne Montgolfier ait<br />
trouvé la solution d'un grand problème, soit en méditant l'ouvrage de Priestley sur les<br />
différentes espèces d'air, soit en voyant s'élever un linge gonflé par l'air raréfié, on doit cette<br />
solution à son génie observateur. Pour arriver de l'idée première à l'exécution, il confia ses<br />
espérances à son frère Joseph Montgolfier ; et, liés d'une tendre amitié, ils donnèrent la<br />
découverte, dont ils allaient étonner le monde, comme une propriété glorieuse qui appartenait<br />
à tous deux.<br />
…<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
134
Bibliographie françaiserecueil de catalogues des éditeurs français ... - Page 51 de Henri Le<br />
Soudier - 1896<br />
28 Matter. Swedenborg.<br />
28 — Le mysticisme en France au temps de Fénelon. 1 in-12.<br />
28 — <strong>Saint</strong>-Martin. Le philosophe inconnu. 1 in-12. ...<br />
Affichage d'extraits<br />
Le lys dans la vallée - Page 242 de Honoré de Balzac - 1839 - 394 pages<br />
Cf années précédentes, et suivantes, même texte<br />
Editions multiples<br />
Affichage du livre entier<br />
décennies 1830_1839<br />
135
Mariette <strong>Cyvard</strong><br />
Aux éditions Jean Planquart rue des moulins de garance 59000 Lille<br />
« l’initiation par le rêve » <strong>19</strong>90<br />
Aux éditions du dauphin blanc Québec avec Pierrette Dotrice<br />
Oser la vie 2004<br />
Aux éditions Grancher Paris<br />
ABC de la Voyance 2006<br />
Aux éditions initiatis avec Geoffray d’A<br />
Grand manuel de franc-maçonnerie 2007<br />
Aux cahiers du C R P 13, rue la Pérouse 62290 Noeux les mines<br />
<strong>Les</strong> masques <strong>19</strong>93<br />
Le martinisme de Papus <strong>19</strong>93<br />
Le tarot <strong>19</strong>94<br />
Le mage Le théurge <strong>19</strong>94<br />
Reïki degré 1 <strong>19</strong>95<br />
Reïki degré 2 <strong>19</strong>95<br />
La kabbale du Zohar <strong>19</strong>96<br />
La quête du Graal <strong>19</strong>96<br />
L’ordre de l'eggregore <strong>19</strong>97<br />
Argo Documents maçonniques <strong>19</strong>98<br />
Le langage maçonnique <strong>19</strong>99<br />
<strong>Les</strong> 33 degrés du R E A & A <strong>19</strong>99<br />
Etude d’un rituel maçonnique <strong>19</strong>99<br />
Le gardien du seuil <strong>19</strong>99<br />
La Franc-maçonnerie étude sociologique 2000<br />
Reïki degré 3 2000<br />
<strong>Les</strong> Ordres de Magiciens 2000<br />
Madame Irma Voyance et plus 2000<br />
<strong>Les</strong> décennies <strong>Saint</strong>-Martin 1800_1810 2008<br />
<strong>Les</strong> décennies <strong>Saint</strong>-Martin 1810-18<strong>19</strong> 2008<br />
<strong>Les</strong> décennies <strong>Saint</strong>-Martin 1820-1829 2008<br />
<strong>Les</strong> décennies <strong>Saint</strong>-Martin 1830—1839 2008<br />
<strong>Les</strong> décennies <strong>Saint</strong>-Martin 1840-1849 2008<br />
<strong>Les</strong> décennies <strong>Saint</strong>-Martin 1850-1859 2008<br />
Tiphaine et <strong>Cyvard</strong> Mariette épuisés<br />
Courriel avec Outlook <strong>19</strong>99<br />
Windows 95/98 <strong>19</strong>99<br />
S-D et Mariette <strong>Cyvard</strong> épuisé<br />
<strong>Les</strong> chakras <strong>19</strong>98<br />
C-P-F et Mariette <strong>Cyvard</strong> épuisé<br />
1 volume en 3 parties<br />
Le temple <strong>19</strong>94<br />
Le maillet <strong>19</strong>95<br />
Le cierge <strong>19</strong>96<br />
Cd de textes divers « ésotérisme, Martinisme… » 2005<br />
Cd audio - Dvd Vidéo<br />
La quête du Graal <strong>19</strong>85<br />
Le gardien de la santé <strong>19</strong>86<br />
Conférences : voyance – l’initiation par le rêve – Reïki <strong>19</strong>91<br />
décennies 1830_1839<br />
136