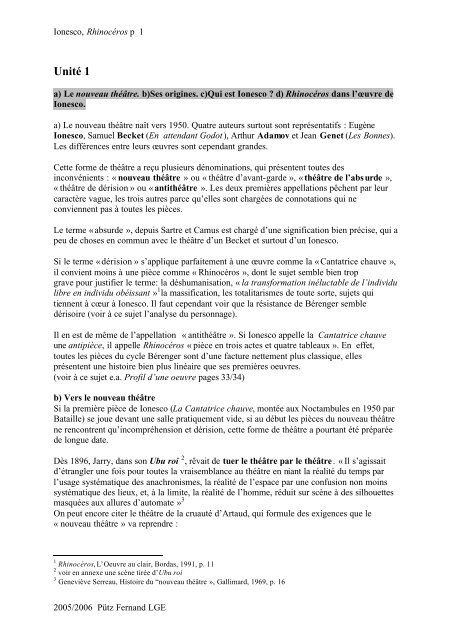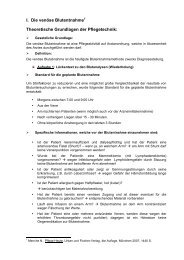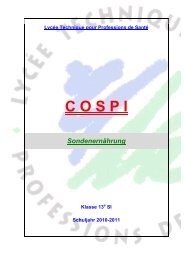Unité 1 - Uploads
Unité 1 - Uploads
Unité 1 - Uploads
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ionesco, Rhinocéros p 1<br />
<strong>Unité</strong> 1<br />
a) Le nouveau théâtre. b)Ses origines. c)Qui est Ionesco ? d) Rhinocéros dans l’œuvre de<br />
Ionesco.<br />
a) Le nouveau théâtre naît vers 1950. Quatre auteurs surtout sont représentatifs : Eugène<br />
Ionesco, Samuel Becket (En attendant Godot), Arthur Adamov et Jean Genet (Les Bonnes).<br />
Les différences entre leurs œuvres sont cependant grandes.<br />
Cette forme de théâtre a reçu plusieurs dénominations, qui présentent toutes des<br />
inconvénients : « nouveau théâtre » ou « théâtre d’avant-garde », « théâtre de l’absurde »,<br />
« théâtre de dérision » ou « antithéâtre ». Les deux premières appellations pêchent par leur<br />
caractère vague, les trois autres parce qu’elles sont chargées de connotations qui ne<br />
conviennent pas à toutes les pièces.<br />
Le terme « absurde », depuis Sartre et Camus est chargé d’une signification bien précise, qui a<br />
peu de choses en commun avec le théâtre d’un Becket et surtout d’un Ionesco.<br />
Si le terme « dérision » s’applique parfaitement à une œuvre comme la « Cantatrice chauve »,<br />
il convient moins à une pièce comme « Rhinocéros », dont le sujet semble bien trop<br />
grave pour justifier le terme: la déshumanisation, « la transformation inéluctable de l’individu<br />
libre en individu obéissant » 1 la massification, les totalitarismes de toute sorte, sujets qui<br />
tiennent à cœur à Ionesco. Il faut cependant voir que la résistance de Bérenger semble<br />
dérisoire (voir à ce sujet l’analyse du personnage).<br />
Il en est de même de l’appellation « antithéâtre ». Si Ionesco appelle la Cantatrice chauve<br />
une antipièce, il appelle Rhinocéros « pièce en trois actes et quatre tableaux ». En effet,<br />
toutes les pièces du cycle Bérenger sont d’une facture nettement plus classique, elles<br />
présentent une histoire bien plus linéaire que ses premières oeuvres.<br />
(voir à ce sujet e.a. Profil d’une oeuvre pages 33/34)<br />
b) Vers le nouveau théâtre<br />
Si la première pièce de Ionesco (La Cantatrice chauve, montée aux Noctambules en 1950 par<br />
Bataille) se joue devant une salle pratiquement vide, si au début les pièces du nouveau théâtre<br />
ne rencontrent qu’incompréhension et dérision, cette forme de théâtre a pourtant été préparée<br />
de longue date.<br />
Dès 1896, Jarry, dans son Ubu roi 2 , rêvait de tuer le théâtre par le théâtre. « Il s’agissait<br />
d’étrangler une fois pour toutes la vraisemblance au théâtre en niant la réalité du temps par<br />
l’usage systématique des anachronismes, la réalité de l’espace par une confusion non moins<br />
systématique des lieux, et, à la limite, la réalité de l’homme, réduit sur scène à des silhouettes<br />
masquées aux allures d’automate » 3<br />
On peut encore citer le théâtre de la cruauté d’Artaud, qui formule des exigences que le<br />
« nouveau théâtre » va reprendre :<br />
1 Rhinocéros, L’Oeuvre au clair, Bordas, 1991, p. 11<br />
2 voir en annexe une scène tirée d’Ubu roi<br />
3 Geneviève Serreau, Histoire du “nouveau théâtre », Gallimard, 1969, p. 16<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 2<br />
refus d’un théâtre psychologique<br />
rejet du naturalisme<br />
retour au mythe, à l’onirique<br />
importance donnée au langage des gestes, du mouvement<br />
Les auteurs du nouveau théâtre ont aussi été inspirés par des écrivains étrangers comme<br />
Kafka, Strindberg, Pirandello.<br />
En outre, le démantèlement des formes classiques s’est opéré depuis la fin du XIXe siècle :<br />
En art par exemple par le cubisme<br />
En art et en littérature par le dadaïsme et le surréalisme 4<br />
L’influence du cinéma muet (Chaplin) n’est pas négligeable<br />
Parallèlement au « nouveau théâtre » est né le « nouveau roman », qui lui aussi renouvelle<br />
les structures du récit (Butor, La Modification)<br />
Après les horreurs de la Seconde guerre mondiale, des camps de concentration, d’Hiroshima<br />
et de Nagasaki, les valeurs traditionnelles sont fortement ébranlées. Sur les ruines de ces<br />
valeurs, deux tendances vont s’opposer au théâtre: le théâtre populaire, humaniste et optimiste<br />
de Jean Villar et le théâtre destructeur, pessimiste et d’avant-garde d’un Ionesco ou d’un<br />
Becket.<br />
(voir à ce sujet Profil d’une Œuvre, page 32)<br />
c) Faits biographiques intéressants<br />
Ionesco est né en 1912 en Roumanie, dès 1913, sa famille habite en France.<br />
En 1925 il retourne à Bucarest et y apprend le roumain. Il y assiste à la naissance du<br />
mouvement fasciste de la Garde de Fer. Il constate quelle attraction cette idéologie exerce sur<br />
les intellectuels. Il apporte des témoignages comment certains de ses amis, tout en exprimant<br />
leur hostilité face à la Garde de Fer, se sentent attirés par certaines attitudes intellectuelles et<br />
morales du fascisme. Cette expérience l’a certainement inspiré dans la création du caractère<br />
de Dudard 5 et dans le monologue final de Bérenger.<br />
En 1938 il reçoit une bourse pour écrire en France une dissertation sur Baudelaire. Il vit<br />
d’abord à Marseille. Il travaille entre autres comme correcteur pour un éditeur de textes<br />
juridiques. Le bureau de cet éditeur lui a servi d’exemple pour le bureau du 2 ème acte.<br />
En 1950 il écrit la Cantatrice chauve. Un seul régisseur, Nicolas Bataille, croit que la pièce<br />
est jouable et il la monte au Théâtre des Noctambules. C’est l’insuccès le plus total, tout<br />
comme pour la pièce suivante La leçon.<br />
Ses pièces, comme celles de Becket, d’Adamov, sont montées dans de petits théâtres, les<br />
grandes salles les refusent.<br />
Mais lentement la valeur de cette nouvelle forme de théâtre déroutante est reconnue, et,<br />
depuis 1954, la Cantatrice chauve a été jouée chaque soir, sans interruption, dans le petit<br />
théâtre de la Huchette, dans le Quartier Latin (plus de 15 000 représentations)<br />
Ionesco sera élu à l’Académie Française, il meurt en 1994.<br />
d) Les pièces avant Rhinocéros.<br />
La Cantatrice Chauve. Quatre personnages se rencontrent dans un living-room anglais et se<br />
parlent en phrases stéréotypées, dénuées de sens dans le contexte dans lequel elles se disent.<br />
4 voir en annexe documents sur le dadaïsme et le surréalisme<br />
5 voir en annexe des extraits de Aujourd’hui et hier.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 3<br />
Interviennent un pompier et une bonne.<br />
Pour écrire cette pièce, Ionesco s’est largement inspiré des phrases de la méthode Assimil. Il<br />
dit que, après avoir terminé la rédaction de la pièce, il pensait avoir écrit quelque chose<br />
comme « la tragédie du langage ». C’est la mort du langage et ainsi la mort de toute<br />
communication.<br />
La Leçon : un professeur donne des leçons particulières, en particulier en mathématiques et<br />
en langues, à une élève qui prépare son doctorat total. Il finit par l’assassiner. Par<br />
l’intermédiaire de la bonne nous apprenons que c’est son quarantième meurtre de la journée.<br />
Comme dans Rhinocéros, l’histoire passe du burlesque au tragique. Ionesco demande à ce<br />
sujet que le jeu des acteurs rétablisse la balance :<br />
»Sur un texte burlesque, un jeu dramatique.<br />
Sur un texte dramatique, un jeu burlesque » 6<br />
Jacques ou la Soumission (rédigé en 1950, mis en scène en 1955) : Une famille petitebourgeoise<br />
exige du fils Jacques soumission et progéniture. Après une longue résistance<br />
Jacques prononce la phrase « J’adore les pommes de terre au lard », phrase par laquelle il<br />
accepte « de rentrer dans la communauté familiale et de s’accommoder du monde tel qu’il<br />
est » 7 . Il est évident que cette thématique de l’acceptation, de la résistance et de la<br />
soumission à l’ordre apparaît également dans Rhinocéros.<br />
Les Chaises (1951) est souvent ressenti comme le chef-d’œuvre de Ionesco. Un couple de<br />
vieillards, après une vie remplie d’échecs et de désillusions ; a organisé une réception au<br />
cours de laquelle un orateur doit venir révéler la vérité ultime. Progressivement, tout en<br />
bavardant, ils remplissent la scène de chaises, saluent des invités invisibles. Lorsque l’Orateur<br />
apparaît, leur mission accomplie, ils se suicident en sautant par la fenêtre. Mais l’Orateur est<br />
muet et lorsqu’il veut écrire son message sur un tableau, il le fait avec des signes<br />
incompréhensibles.<br />
Victimes du devoir : Choubert, plein de bonne volonté de bien faire et d’aider les autorités,<br />
mais incapable de faire ce qu’on demande de lui, se trouve face à face avec un policier. Il<br />
ressemble à Bérenger<br />
“Denn Choubert ist wie spätere « Ichs » Ionescos nicht Rebell, sondern nur Opfer, er ist<br />
eingekreist, hilflos, passiv …Er kann nicht, was von ihm gefordert wird, so wenig wie<br />
Berenger sich in ein Nashorn verwandeln kann… Choubert wie jede weitere “erste Person”<br />
ist der Nicht-Mitmacher-malgré lui, wider Willen”. 8<br />
Amédée ou comment s’en débarrasser: Dans une chambre deux personnes et un cadavre (le<br />
cadavre de l’amour ?), qui n’en finit pas de grandir et qui finit par s’envoler.<br />
Commence ensuite le cycle « Bérenger ». Un personnage appelé Bérenger (le « moi » de<br />
Ionesco ?) apparaît dans quatre pièces, mais chaque fois sous des traits différents, il ne s’agit<br />
pas du même personnage.<br />
Tueur sans gages. Dans une ville, un tueur a fait d’innombrables victimes. Face à la passivité<br />
des habitants, Bérenger est le seul à exiger l’arrestation du tueur. Dans une dernière scène, il<br />
6 Notes et Contre-notes, Callimard, 1962, p. 162<br />
7 Genevieve Serreau, op.cit., p. 42.<br />
8 Bondy François, Ionesco, Rowohlt, 1975, p.77<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 4<br />
est opposé seul à l’assassin, qu’il essaie de convaincre d’arrêter de tuer, mais dont il ne<br />
parvient qu’à susciter les ricanements.<br />
Ionesco écrit : « En fait, Bérenger trouve en lui-même, malgré lui-même, contre lui-même,<br />
des arguments en faveur du Tueur. » Cette même attitude ambiguë se retrouve dans<br />
Rhinocéros, la pièce suivante.<br />
Le Roi se meurt. Pièce en un acte. Le roi Bérenger, qui a régné depuis des centaines d’années,<br />
apprend qu’il va mourir dans les 90 minutes ( ! durée de la pièce) qui suivent. Sujet :<br />
l’angoisse, le refus de mourir. Avec le roi d’ailleurs disparaît tout le royaume, tout l’univers<br />
qui l’entoure.<br />
La dernière pièce du cycle Bérenger s’intitule Le piéton de l’air.<br />
<strong>Unité</strong> 2 :<br />
Le sens général de Rhinocéros. Le titre. L’importance des didascalies. Des marionnettes.<br />
Ionesco écrit : « Le propos de la pièce a bien été de décrire le processus de la nazification<br />
d’un pays » 9<br />
L’idée de la pièce remonte en effet à l’époque où il a vu ses amis roumains séduits par<br />
l’idéologie de la Garde de Fer (voir ci-dessus). Mais au moment où la pièce est rédigée, on<br />
assiste à l’oppression stalinienne. Il est donc certain que Ionesco ne vise pas seulement la<br />
montée du nazisme, mais aussi le stalinisme et, de plus, toutes les idéologies de<br />
massification.<br />
La première représentation de la pièce a eu lieu en Allemagne (Schauspielhaus de Düsseldorf,<br />
novembre 1959) , elle a rencontré un succès foudroyant. Plus tard, elle devait aussi être<br />
montée à Moscou. Les responsables politiques soviétiques ont à ce moment exigé de Ionesco<br />
qu’il modifie certains passages de telle façon que la pièce désigne clairement et exclusivement<br />
le nazisme, preuve que les dirigeants étaient conscients qu’elle allait aussi être comprise<br />
comme un réquisitoire contre le stalinisme. Ionesco refusa et la pièce ne fut pas jouée à<br />
Moscou.<br />
Devant le succès international (Allemagne, E.U., Italie, Pologne, Japon, Scandinavie,<br />
Yougoslavie, etc.) Ionesco s’inquiéta :<br />
« Les gens la comprennent-ils comme il faut ? Y voient-ils le phénomène monstrueux de la<br />
« massification » ? En même temps qu’ils sont « massifiables », sont-ils aussi, et<br />
essentiellement, au fond d’eux-mêmes, tous, des individualistes, des âmes uniques » ? 10<br />
Voici quelques brèves interprétations de la pièce :<br />
"…tout totalitarisme, de droite comme de gauche, s’y trouve impliqué, et, plus généralement,<br />
tout conformisme » 11<br />
« Ionesco hat die Ausbreitung des politischen Fanatismus wie die einer Epidemie in seinen<br />
Tagebüchern der Bukarester Zeit verzeichnet und dort schon das Bild von den Nashörnern<br />
gebraucht, das ihm zu den zoologischen Begriffen der Eisernen Garde, der Befreiung des<br />
Instinkts, des Vitalen passte. » 12<br />
9 Notes et Contre-notes, op.cit., p. 183.<br />
10 Ibidem, op.cit., p.188.<br />
11 Serreau Geneviève, op.cit., p.56<br />
12 Bondy François, op.cit., p.90<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 5<br />
« …l’image de l’animal grotesque est, de façon plus générale, le symbole d’une tendance plus<br />
universelle : le désir profond de se laisser dominer par la force » 13<br />
»…une parabole philosophique et politique. La rhinocérisation générale doit se lire comme<br />
une allégorie : elle symbolise l’irrésistible ascension des dictatures du XXe siècle. Ionesco ne<br />
dénonce pas seulement le fanatisme politique, mais toutes les formes de conformisme,<br />
intellectuel, philosophique, moral, qui se trahissent par le langage. » 14<br />
Les didascalies,<br />
encore appelées « indications scéniques ».<br />
dans le théâtre classique, les didascalies occupent relativement peu de place. Elles servent à<br />
planter le décor, à fournir des indications sur le jeu de l’acteur.<br />
Dans Rhinocéros, ces didascalies deviennent souvent envahissantes, au point d’occuper<br />
davantage de place que les répliques. Les raisons en sont multiples :<br />
Ionesco pense que le jeu de l’acteur est aussi important que les phrases qu’il dit. Dans<br />
le nouveau théâtre, les conditions matérielles de la représentation, la mise en scène sont fixées<br />
par l’auteur.<br />
Ionesco se méfie des metteurs en scène, qui risquent de défigurer le sens de ses pièces.<br />
Aussi veut-il, en quelque sorte, imposer ses idées par des indications scéniques très précises.<br />
Les premières représentations de Rhinocéros ont cependant montré que les mises en scène<br />
peuvent être fort différentes et changer totalement l’atmosphère de la pièce. Ainsi en<br />
Allemagne le metteur en scène passait du burlesque du premier acte vers le tragique, en<br />
France la vision tragique est souvent privilégiée, alors que la mise en scène du Broadway<br />
insistait sur le comique et le « slapstik »<br />
L’influence du cinéma est indéniable, certaines scènes font penser aux films de<br />
Charlot ou de Laurel et Hardy (gestes désordonnés, personnages qui tombent, etc.). Cet aspect<br />
est surtout apparent dans une pièce comme En attendant Godot de Becket.<br />
Analyse de quelques indications scéniques :<br />
Les indications scéniques du début plantent le décor du premier acte : une petite ville<br />
ordinaire, avec son épicerie, son café, l’église. La lumière crue, la couleur du ciel font penser<br />
à une ville méridionale. Le carillon souligne que le temps est compté (penser à la pendule de<br />
la Cantatrice). Il s’agit d’un lieu de rencontre, un lieu de la parole échangée, ouvert vers<br />
l’extérieur. (progressivement, les lieux seront de plus en plus fermés).<br />
Lors de la première apparition de Jean et de Bérenger, leurs costumes sont minutieusement<br />
décrits. Jean est très soigné, le faux col amidonné souligne la raideur de son caractère, la<br />
cravate rouge met une fausse note dans son costume, tout comme il y a des contradictions<br />
dans son caractère. Bérenger se laisse aller, il ne soigne pas son apparence, il est fatigué, les<br />
choses ne semblent pas le concerner.<br />
Lorsque Jean fait disparaître la poussière du costume de Bérenger, les didascalies situent cette<br />
scène dans le registre de la farce telle que l’utilise le cinéma muet.<br />
A ce registre appartiennent aussi beaucoup de personnages du premier acte ; ce sont des<br />
marionnettes. Ils ne portent pas de nom, ils sont désignés par leurs fonctions (l’épicier, la<br />
13 Rougeon Jacques, op.cit., p. 12<br />
14 Profil d’une oeuvre, op.cit., p.5.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 6<br />
serveuse, etc.). Dans les premières pièces de Ionesco (Cantatrice, La Leçon), tous les<br />
personnages sont de telles marionnettes sans individualité. Dans Rhinocéros, cet aspect des<br />
personnages va disparaître progressivement ; alors qu’un Papillon est encore la marionnette<br />
du parfait chef de bureau, que Botard est la caricature de l’intellectuel de gauche, les<br />
personnages s’individualisent progressivement (Daisy, Dudard et surtout Bérenger)<br />
<strong>Unité</strong> 3. Acte 1. Bérenger et Jean. Le Logicien. Le langage et le comique<br />
Bérenger et Jean : Dès leur première apparition, Jean et Bérenger s’opposent par leur<br />
physique, leur comportement, leur caractère.<br />
Leurs noms sont codés : « Jean » est parfaitement homophone avec « gens », il représente les<br />
« gens », la majorité, le « on » indifférencié, il incarne le conformisme. Dans le deuxième<br />
tableau du deuxième acte apparaît un « Monsieur Jean », ce qui crée un quiproquo lorsque<br />
Bérenger frappe à la porte de son ami :<br />
LE PETIT VIEUX<br />
Je croyais que c’était pour moi. Moi aussi, je m’appelle Jean, alors c’est l’autre.<br />
De même, dans le premier tableau, Bérenger dit : « J’étais à côté d emon ami Jean !… Il y<br />
avait d’autres gens ». Ce qui fait dire à Botard « Vous bafouillez, ma parole. »<br />
Le nom de Bérenger réapparaît, comme nous l’avons vu, dans trois autres pièces de Ionesco.<br />
Il représente l’homme angoissé, par paronymie il est l’homme « dérangé ». Contrairement<br />
aux autres personnages, qui restent identiques à eux-mêmes à travers toute la pièce, il va<br />
connaître une évolution. Dans le premier acte il paraît passif, les événements ne le concernent<br />
pas, même l’apparition du rhinocéros ne parvient pas à le sortir de son indifférence. A la fin<br />
de la pièce il se révoltera face à l’acceptation de la « rhinocérite ».<br />
« D’abord apathique, et comme étranger au monde qui l’entoure, ensuite complexé et<br />
culpabilisé face à l’amour, à l’amitié, au travail, il se transforme à partir de sa visite chez<br />
Jean 15 .<br />
Voici les principaux traits de Jean :<br />
Il fait preuve d’une dignité raide, symbolisée par son col amidonné et sa cravate.<br />
Il veut être l’image de la perfection, il a l’air soigné, il a sur soi cravate de rechange, peigne,<br />
miroir, il donne à Bérenger des conseils hautains comment se cultiver.<br />
Il est strict et exigeant au point de devenir maniaque (« Vos vêtements sont tout chiffonnés,<br />
c’est lamentable »)<br />
Il est prétentieux, se croit supérieur à Bérenger (« Je vaux mieux que vous ») qu’il a tendance<br />
à rabaisser (« Regardez la tête que vous faites »). Il est également têtu, il insiste sur son idée<br />
qu’il s’agissait de deux rhinocéros. En manque d’arguments , il devient agressif et colérique<br />
(« Je ne parie pas avec vous. Les deux cornes, c’est vous qui les avez ! »)<br />
Il semble ambitieux dans son travail, mais sa force principale semble être la ponctualité, la<br />
discipline et l’absence d’imagination. En général d’ailleurs il se trahit souvent : toute cette<br />
perfection n’est que façade.<br />
Ainsi il argumente en se référant à la « science populaire » (« Plus on boit, plus on a soif dit<br />
la science populaire »). Lui, qui demande à Bérenger de se cultiver, d’aller visiter les musées<br />
et d’aller voir les pièces d’avant-garde, trouve immédiatement des subterfuges lorsque son<br />
ami lui demande de l’accompagner. Ainsi il n’ira pas au musée cet après-midi parce qu’il a<br />
l’habitude de faire la sieste (ce qui montre sa raideur, il est incapable de changer quoi que ce<br />
15 Profil d’une Oeuvre, p.54.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 7<br />
soit à ses habitudes). Quant au théâtre, lui qui reproche à Bérenger d’être porté sur l’alcool, a<br />
un rendez-vous dans une brasserie.<br />
Lorsqu’il doit fonder ses affirmations, il commence à bafouiller et à utiliser des tautologies :<br />
il a de la force parce qu’il a de la force.<br />
Enfin, il est plein de mauvaise-foi, détournant la vérité à son profit afin de rabaisser Bérenger.<br />
Il excuse son propre retard par le reproche fait à Bérenger de ne jamais arriver à temps.<br />
Cette contradiction entre les apparences et la réalité se remarque déjà dans son costume trop<br />
voyant, surtout à cause de la cravate rouge.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE<br />
L’image de Bérenger dans le premier acte<br />
Quant à Bérenger, , il « incarne un individu moyen, faible, confronté à une réalité<br />
extraordinaire. Or ces faiblesses, qui l’inscrivent dans l’humanité banale, sont l’ultime<br />
défense de l’individu contre les monstres. Au cours de la pièce, il ne devient pas un héros, il<br />
reste un homme dans sa simplicité. C’est sa grandeur paradoxale. » 16<br />
Les faiblesses :<br />
Son penchant pour l’alcool. Sans être un alcoolique, en effet il garde toujours la maîtrise de<br />
soi et sa lucidité, il est porté sur l’alcool, qui lui permet de supporter son « mal de vivre » Son<br />
corps, dit-il, lui pèse, c’est comme s’il portait quelqu’un sur ses épaules : « Dès que je bois un<br />
peu, le fardeau disparaît ».<br />
Sa paresse. Il n’aime pas le travail, il arrive en retard au bureau, il profite de la destruction de<br />
l’escalier pour rendre visite à Jean. « Je ne suis pas fait pour le travail que je fais. »<br />
Son manque de soins : il néglige, contrairement à Jean, son apparence, il est mal peigné, sa<br />
veste est poussiéreuse.<br />
Son manque de culture. Il n’a pas fait d’études et ressent ainsi de l’admiration pour Dudard.<br />
Jean, qui l’appelle un « médiocre », lui conseille d’aller visiter des musées et d’aller voir des<br />
pièces de théâtre. Or la suite de la pièce montre que la culture(Jean, Dudard) est sans défense<br />
contre la force brute (les rhinocéros).<br />
Les incapacités :<br />
Bérenger est un individualiste, il a des problèmes a nouer des relations durables.<br />
L’amitié. Jean semble être son seul ami. Or ils se querellent dès le début. Cette querelle n’est<br />
pas uniquement suscitée par les remarques hautaines de Jean, mais aussi par les réponses<br />
agressives, par ses dénégations et ses refus systématiques. Or il faut voir que par la suite il<br />
regrettera son comportement, il ira trouver Jean, Il essaie de s’ecuser et de renouer leurs liens.<br />
L’amour. Il n’ose pas aborder Daisy, il se sent inférieur à Dudard qui, lui aussi s’intéresse à la<br />
jeune secrétaire. Leur idylle de l’acte trois ne durera guère ; Daisy comprend qu’il cherhe en<br />
elle moins la femme qu’une protection et un soutien, elle se sent attirée par la force brute.<br />
Son incapacité de vivre en groupe et de nouer des relations est certes une faiblesse, mais le<br />
prémunira finalement contre la transformation enrhinocéros.<br />
L’inadaptation.<br />
Le refus de l’ordre. Ce refus se remarque déjà dans son apparence physique et dans son<br />
manque de ponctualité. Il est individualiste et passéiste, il préfère le statu-quo au renouveau.<br />
Il se distingue de Jean qui croit au devoir (même s’il ne sait pas bien le définir) du citoyen.<br />
16 L’Oeuvre au Claire, op.cit., page 40
Ionesco, Rhinocéros p 8<br />
Le refus du cliché. Il se distingue de Jean et de Botard qui parlent souvent en phrases toutes<br />
faites et en clichés.<br />
Cette apparente faiblesse le prémunit contre la transformation : « Lalcoolique, le paresseux,<br />
l’amoureux maladroit, est impropre à devenir le citoyen parfait d’une dictature. » 17<br />
Bérenger peut être vu, non pas comme le porte-parole, mais comme une sorte de double de<br />
Ionesco : « Le mal d’exister, le sentiment de culpabilité, l’esprit d’enfance, la faculté<br />
d’étonnement, l’individualisme : ces caractéristiques font l’unité profonde de ce personnage<br />
récurrent. » 18<br />
La mort de la logique<br />
Dès sa première pièce, la Cantatrice chauve, Ionesco joue avec le langage et détruit les<br />
formules stéréotypées en les faisant utiliser par ses personnages dans des situations auxquelles<br />
elles ne sont pas adaptées. De même, il utilise des déductions logiques qui sont réduites à<br />
l’absurde.<br />
Cette « mort par réification » du langage est moins importante dans Rhinocéros, mais en reste<br />
pourtant un aspect majeur .<br />
La figure du logicien est représentative à ce sujet. Il part d’un syllogisme faux et, à partir de<br />
cette erreur initiale, construit tout un raisonnement sur les chats qui devient de plus en plus<br />
farfelu : donc votre chien est un chat/ donc Socrate était un chat.<br />
Quelle est l’erreur initiale ? La structure d’un syllogisme est telle que la majeure a la plus<br />
grande extension (Tous les hommes sont mortels). La mineure relève un cas plus particulier<br />
et le met en rapport avec le premier terme de la majeure ( Socrate est un homme). La<br />
conclusion en tire la conséquence (Donc Socrate est mortel).<br />
Or le logicien se trompe de terme dans la mineure (« Isidore et Fricot ont chacun quatre<br />
pattes », au lieu de « Isidore et Fricot sont des chats ») Il arrive a la conclusion absurde que<br />
tous les êtres à quatre pattes sont des chats.<br />
Plus tard, toute sa longue réflexion logique sur les rhinocéros bi- ou unicornus n’arrive pas à<br />
une solution du problème, mais, comme il dit « de cette façon, le problème est correctement<br />
posé ».<br />
L’inanité de ses réflexions, l’incapacité de la logique de nous prémunir contre la rhinocérite,<br />
se montre dans le troisième acte lorsqu’il devient lui-même rhinocéros- au grand étonnement<br />
de Bérenger, qui en est scandalisé.<br />
Le discours du logicien est donc une parodie du discours socratique. Au lieu de rechercher la<br />
vérité par un jeu de questions et de réponses, il l’embrouille définitivement. C’est surtout<br />
faute à ses raisonenments que « la question essentielle (pourquoi y a-t-il un rhinocéros ?) est<br />
transformée en question de pure forme : y en a-t-il un ou deux ? » 19<br />
Langage et comique.<br />
Le décalage entre les faits et la parole est un des aspects fondamentaux du comique de<br />
Rhinocéros. En fait, ce décalage correspond à la définition de l’absurde dans le nouveau<br />
théâtre : « Nous essayons désespérément de donner une signification à quelque chose qui n’en<br />
a pas, ou plutôt qui nous dépasse : la vie. »<br />
Les personnages réagissent de façon mécanique et inadaptée à l’apparition de la menace. Ils<br />
continuent à se préoccuper des petits soucis domestiques (l’épicier, la ménagère), de la bonne<br />
17 ibidem, page 43.<br />
18 Profil d’une oeuvre, p. 54.<br />
19 L’oeuvre au Clair, op.cit., p.53.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 9<br />
marche du bureau (M. Papillon), ils font des discussions oiseuses sur l’origine des rhinocéros.<br />
Cette « raideur », cette incapacité de s’adapter à des situations nouvelles et changeantes,<br />
constitue pour Bergson le point commun de toutes les formes du comique. Il l’appelle « du<br />
mécanique plaqué sur du réel » 20<br />
Notre étude sur les différents aspects du comique dans Rhinocéros suit la classification<br />
usuelle en comique de caractère, comique de situation, comique des gestes et comique de<br />
mots.<br />
Le comique de caractère :<br />
L’aspect le plus moliéresque du comique de Ionesco réside dans la création de caractères qui<br />
deviennent des archétypes 21 déformés : ainsi l’épicier est plus radin, plus commerçant, plus<br />
porté sur les questions de bénéfice et de perte que nature ; sa femme est l’aigreur même ; la<br />
ménagère est fixée de façon monomane sur son chat, elle est geignarde, elle pleurniche ; le<br />
logicien fait penser au maître de philosophie du Bourgeois Gentilhomme 22 , il enseigne au<br />
vieux monsieur une science pour le moins aussi vide de sens (« au moins le problème est<br />
correctement posé) que l’alphabet enseigné à Monsieur Jourdain par son maître de<br />
philosophie ; Monsieur Papillon, dans la situation dramatique engendrée par la transformation<br />
de Monsieur Bœuf et la prolifération des rhinocéros ne pense qu’à la bonne marche de sa<br />
maison d’édition et aux heures de travail perdues ; Bottard est une caricature de l’intellectuel<br />
de gauche, et ainsi de suite.<br />
Ainsi Ionesco est-il parvenu à créer toute une panoplie de caractères caricaturaux et figés,<br />
représentatifs pour des comportements typiques de son (et de notre) époque.<br />
Ces caractères sont poussés parfois jusqu’au grotesque 23 . Il en est par exemple ainsi de la<br />
grosse Madame Bœuf, qui saute sur le dos de son mari-rhinocéros et qui part avec lui au<br />
galop. « C’est une amazone » commente Botard admirativement.<br />
Une autre source de comique réside dans le contraste, contraste entre les caractères (Jean,<br />
très soigné et méticuleux/ Bérenger, mal soigné, chaotique) et contraste entre la situation et<br />
les réactions des personnages (ex. : M. Papillon met à la porte Bœuf, qui est arrivé en retard et<br />
a démoli l’escalier ; Botard ne s’occupe pas de la transformation de son collègue mais de<br />
questions syndicales).<br />
Parfois les personnages deviennent pratiquement clownesques, sans pour autant pouvoir être<br />
comparés à Vladimir et à Estragon dans En attendant Godot de Becket (voir extrait ci-joint).<br />
Ce comique de caractère, surtout dans la figure de Bérenger, mais aussi , à un degré moindre,<br />
dans celle de Jean et de Dudard, prend cependant des aspects dramatiques, voire tragiques.<br />
Aussi certains critiques ont-ils utilisé l’expression de « guignols tragiques » pour parler des<br />
personnages de Rhinocéros.<br />
Le comique de situation et de gestes.<br />
L’aspect clownesque des personnages apparaît surtout dans la première partie de la pièce.<br />
Bérenger tombe ; Jean, en se sentant « léger, léger » fait des gestes désordonnés, heurte le<br />
vieux Monsieur qui tombe dans les bras du logicien ; Mme Bœuf s’évanouit et risque<br />
20 henri Bergson, Le Rire, 1959.<br />
21 Archetype: type primitif ou idéal, original qui sert de modèle<br />
22 Histoire d’un bourgeois enrichi qui, dans sa tentative d’imiter la noblesse, se fait enseigner toutes sortes d’arts.<br />
Le philosophe lui apprend entre autres comment prononcer les voyelles.<br />
23 Figures fantasques, caricatures extrêmes, à l’apparence bizarre<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 10<br />
d’entraîner dans sa chute Bérenger ; lorsque les pompiers sauvent les employés en les faisant<br />
passer par la fenêtre, il y a une scène rocambolesque entre Bérenger et Dudard qui, par une<br />
politesse toute conventionnelle, veulent laisser la préséance à l’autre. Ils finissent par sortir en<br />
même temps et par rester coincés dans la fenêtre.<br />
Le quiproquo entre les deux « Jean » (début du tableau 2 de l’acte II) fait partie du même<br />
registre de comique.<br />
Nous sommes ici en présence de ce qu’on appelle aussi le « comique de coups de bâton »,<br />
donc de la farce. C’est la forme de comique la plus simpliste, la plus primaire.<br />
Le comique de situation va jusqu’au burlesque et à l’héroï-comique, une autre forme<br />
d’inadéquation entre la situation et le comportement ou le langage : un fait anodin est<br />
transfiguré par un langage ou un symbolisme relevé en fait exceptionnel. Il en est ainsi de<br />
l’enterrement du chat écrasé, qui donne lieu à un véritable cortège funèbre.<br />
Le comique de mots<br />
C’est la forme de comique la plus fréquente et aussi la plus élaborée de Rhinocéros. Sans en<br />
arriver aux délires verbaux de la Cantatrice Chauve, Ionesco réduit souvent le langage à<br />
l’absurde, il joue avec les mots et les sens.<br />
Voici une liste non limitative des procédés :<br />
La synonymie : les rhinocéros sont appelés « pachyderme », terme scientifique insistant sur<br />
leur peau épaisse, « fauves » (terme plutôt mal adapté à un rhinocéros) et « périssodactyles »,<br />
terme très rare insistant sur la forme des pattes d’un animal. Ce dernier terme surtout est<br />
inattendu et déplacé dans le contexte.<br />
Le détournement d’expressions familières : l’expression « revenons à nos moutons » est<br />
transformée (le contexte l’impose) en « revenons à nos chats ». De façon similaire, la<br />
« rubrique des chiens écrasés » devient la « rubrique des chats écrasés ». Dans la bouche de<br />
Botard l’expression « la montagne a accouché d’une souris » est scindée en deux et devient<br />
« C’était peut-être tout simplement une puce écrasée par une souris. On en fait une<br />
montagne. »<br />
Le calembour : (jeu de mots fondé sur la différence de sens entre mots similaires/ mauvais<br />
jeu de mots). Penser au jeu de mots sur la question « assis ou debout, c’est la même chose »<br />
(acte I). « De quelle race. Je ne suis pas raciste . » (Botard). Les noms des personnages eux<br />
aussi prêtent au calembour. Ainsi M Bœuf semblait prédestiné à devenir rhinocéros, alors que<br />
M. Papillon (nom dont la légèreté contraste avec la lourdeur du personnage) semblait de par<br />
son nomdéjà être à l’abri. En poussant plus loin notre verve interprétatrice on pourrait voir le<br />
sort du chat préfiguré par les noms de Mitsou (mis d’sous) et de Fricot (mot qui signifie<br />
« ragoût »).<br />
Lorsque Jean dit : « Je déteste qu’on se paye ma tête », Bérenger joue involontairement sur les<br />
mots en disant : »Vraiment, vous êtes têtu ».De tels malentendus sont fréquents (acte II,<br />
tableau 2, le jeu sur le mot « malheureux » appliqué aux rhinocéros, ou la réaction de Jean<br />
(« J’y vivrai ») à l’expression « la loi de la jungle ».<br />
Tout un ensemble de passages mettent en œuvre la répétition, souvent sous forme d’écholalie<br />
(répétition automatique de phrases de l’interlocuteur), pensons au « pauvre bête » par<br />
exemple. Ces répétitions, dites à un rythme rapide, vont jusqu’à la cacophonie, par exemple<br />
lors du passage des rhinocéros lorsque les « oh » et les « ah » se chevauchent.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 11<br />
Les personnages souffrent pratiquement tous de logorrhée (ils accumulent les mots,<br />
n’arrêtent pas leurs bavardages), il en est ainsi du logicien, de Botard et de Dudard<br />
notamment. Cette logorrhée mène à des discussions stériles et récurrentes, ainsi sur<br />
l’unicornuïté ou la bicornuïté des rhinocéros.<br />
Chez le logicien et chez Botard ce langage devient une parodie, dans le premier cas du<br />
discours socratique, dans le deuxième cas du vocabulaire du militant de la gauche.<br />
Relevons encore le clin d’œil de l’auteur à son public, la connivence qu’il établit ainsi. Jean<br />
recommande à Bérenger de se cultiver et d’aller voir des pièces du théâtre d’avant-garde,<br />
notamment une pièce de Ionesco qui se donne à ce moment. Il s’agit en l’occurrence de<br />
Rhinocéros. Or Jean, qui semble connaître l’œuvre, n’en devient pas moins rhinocéros.<br />
Ionesco nous ferait-il ainsi connaître son peu de confiance dans l’impact de son oeuvre : il sait<br />
que sa pièce ne prémunira pas contre l’apparition de nouvelles rhinocérites.<br />
<strong>Unité</strong> 4 : deux totalitarisme : de gauche et de droite, Botard et Jean.<br />
Nazisme, national-socialisme, doctrine<br />
du parti fondé en 1920 par Adolf Hitler<br />
(N.S.D.A.P). Le programme fut formulé<br />
en 25 points, dont :<br />
- réunion de tous les Allemands dans<br />
une Grande Allemagne<br />
- racisme, les « non-ariens » exclus de la<br />
vie politique<br />
- obligation du travail, étatisation de<br />
toutes les sociétés et trusts<br />
- gouvernement autoritaire et centralisé<br />
Botard<br />
Il est en tout premier lieu une représentation caricaturale du<br />
militant de la gauche, mais il ne faut pas négliger d’autres<br />
aspects :<br />
Le pédant : ancien instituteur de la Troisième République, il<br />
a gardé sa manie de l’explication et de ce qu’il appelle la<br />
précision. Monsieur Papillon le lui rappelle en disant « Nous<br />
ne sommes pas à l’école ». Il se fait le champion de la<br />
précision : « En tant qu’ancien instituteur, j’aime la chose<br />
précise, scientifiquement prouvée, je suis un esprit<br />
méthodique, exact. » Il se voit en rationaliste qui combat<br />
l’obscurantisme et la superstition(il ne croit pas en<br />
l’apparition de rhinocéros « votre rhinocéros est un mythe »,<br />
il se méfie de la presse et de ses prétendus mensonges, il dit<br />
qu’il lutte contre l’ignorance, peu importe où elle se<br />
rencontre, « dans les palais, dans les chaumières »).<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE<br />
Il faut rappeler que, si Rhinocéros vise avant tout le<br />
nazisme, les dirigeants de l’URSS, en demandant à<br />
Ionesco de remanier certains passages avant la<br />
représentation de la pièce à Moscou, étaient conscients<br />
que l’auteur visait aussi le stalinisme. Or, au-delà de ces<br />
deux totalitarismes, Rhinocéros décrit toute sorte de<br />
massification, d’embrigadement, toute perte<br />
d’individualité et d’humanité.<br />
Stalinisme : nom donné au<br />
communisme tel qu’il était pratiqué<br />
en URSS par Staline (1879-1953)<br />
Régime caractérisé entre autres par<br />
- oppression et déportation de<br />
minorités<br />
- collectivisation forcée de<br />
l’agriculture<br />
- régime dictatorial et policier<br />
- élimination physique de toute<br />
opposition<br />
- camps d’internement (goulags)<br />
- anticléricalisme<br />
Les terribles crimes contre<br />
l’humanité de ce régime (des<br />
dizaines de millions de morts) ont<br />
été dévoilés et reconnus e.a. par<br />
Khrouchtchev)<br />
Mais sa pédanterie l’entraîne dans des définitions absurdes « Qu’entend-il par chat ?». La<br />
réponse de Dudard reflète le bon sens : « Tout le monde sait ce qu’est un chat ». Alors Botard<br />
commence à ergoter, à couper les cheveux en quatre, en demandant s’il s’agit d’un chat ou<br />
d’une chatte, quelles sont sa couleur et sa race.<br />
Il fait ensuite un coq-à-l’âne, que Monsieur Papillon lui reproche d’ailleurs, pour en arriver à
Ionesco, Rhinocéros p 12<br />
un des ses sujets préférés : il n’est pas raciste. Il se pose ainsi en représentation des<br />
philosophes éclairés du XVIIIe siècle « On ne doit perdre aucune occasion de le dénoncer ».<br />
Il faut aussi voir qu’il souffre d’un complexe d’infériorité face à ceux qui ont fait des études<br />
universitaires, notamment Dudard (qui est juriste) : « Les universitaires sont des esprits<br />
abstraits qui ne connaissent rien à la vie ». C’est ce qui explique l’animosité qui règne entre<br />
les deux hommes. Bérenger a bien compris que Botard souffre de ce sentiment d’infériorité.<br />
Lorsqu’il apprend que celui-ci s’est transformé en rhinocéros, il voit l’explication dans sa<br />
haine des chefs et dans un complexe d’infériorité.<br />
Mais Dudard a compris que la véritable raison est « son esprit communautaire qui l’a emporté<br />
sur ses impulsions anarchiques ».<br />
En effet, Botard est une caricature du militant de la gauche et du marxiste. Très rapidement, il<br />
se comporte en syndicaliste et en militant borné.<br />
Il exprime son anticléricalisme en recourant à une caricature du langage marxiste : « Je<br />
n’écoute pas les curés qui vous font venir à l’église pour vous empêcher de faire votre boulot,<br />
et de gagner votre pain à la sueur de votre front. » Il appelle, selon une expression marxiste<br />
consacrée, le religion « l’opium du peuple ». Face à l’indignation de Papillon, il se perd<br />
d’ailleurs dans la contradiction la plus totale en disant que le fait qu’il méprise les religions ne<br />
signifie pas qu’il ne les estime pas.<br />
Il se pose en défenseur du prolétariat opprimé par la bourgeoisie. Ironiquement il dit à<br />
Papillon qu’ils doivent tous obéir puisque celui-ci est le chef. Il affirme que c’est « toujours<br />
sur les petits que ça retombe ». Face aux ordres du chef de bureau il se sent exploité<br />
« jusqu’au sang. » Il est syndicalisé et, face au licenciement de Monsieur Bœuf (Papillon<br />
profite de sa transformation en rhinocéros pour le mettre à la porte), il n’a –au lieu de<br />
l’étonnement ou de l’effroi face à cette métamorphose- que le éflexe du syndicaliste qui veut<br />
que le licenciement se fasse dans les formes légales « Notre délégation s’oppose à ce que vous<br />
renvoyiez M. Bœuf sans préavis. » Il essaye d’embrigader Mme Bœuf comme nouveau<br />
membre de son syndicat.<br />
Représentant des tensions entre capitalisme et communisme lors de la guerre froide, il flaire<br />
l’ennemi du peuple partout.Pour lui, les nouvelles sur l’apparition de rhinocéros ne sont rien<br />
d’autre qu’un coup de la propagande de l’adversaire. Cet adversaire reste d’ailleurs brumeux,<br />
il correspond à un « ils » un « eux » qui peut désigner quiconque n’est pas de son avis : « Je<br />
sais d’où cela vient. » affirme-t-il vaguement. Il devient pratiquement paranoïaque.<br />
Le stalinisme avait installé un système de surveillance étroite de toute la population, le KGB<br />
recrutait des espions en masse, personne ne pouvait être sûr de ne pas être observé,<br />
cataloguisé, fiché à tout moment, dans ses activités les plus anodines. Tous les propos hostiles<br />
au régime étaient immédiatement dénoncés, tout le monde risquait la déportation et pire.<br />
Botard lui aussi se dit au courant de ce qui se passe « J’ai la clé des événements, un système<br />
d’interprétation infaillible ». Il affirme détenir des preuves de la « félonie » de ses collègues<br />
de bureau et détenir tous les noms des « traîtres » à la cause. Il dit connaître les « dessous » de<br />
l’affaire (ce qui fait naïvement demander à Daisy « Quels dessous ? »- elle comprenait sans<br />
doute le mot dans un autre sens )<br />
Botard brandit la menace : « cela ne se passera pas comme cela », « Je démasquerai les<br />
instigateurs ». On peut faire le lien entre ses propos et les purges sous le stalinisme.<br />
Ce personnage est plein d de mauvaise foi. Lui, qui au début se faisait le champion du<br />
rationalisme, qui veut dénoncer les nouvelles sur l’apparition des rhinocéros comme une<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 13<br />
mystification, affirmera, au moment où il doit accepter leur existence, ne jamais avoir nié<br />
« l’évidence rhinocérique ». Lorsqu’il affirme pouvoir expliquer le phénomène, ses collègues<br />
lui demandent de le faire ; à ce moment il se rétracte (puisqu’en fait il ne dispose d’aucune<br />
explication) et pour cacher sa confusion, il en revient aux menaces.<br />
Botard apparaît donc comme une caricature de l’idéologie marxiste, il utilise tous les clichés<br />
du système, mais sa paranoïa, sa conviction de détenir une vérité qui lui permet d’éliminer ce<br />
qui est contraire à son idéologie, en font un personnage extrêmement inquiétant et dangereux.<br />
Jean et les idéologies de l’extrême-droite.<br />
Alors que, dans les répliques de Botard, les références au stalinisme sont claires, les<br />
références aux idéologies de droite, notamment le nazisme, sont bien moins évidentes dans<br />
celles de Jean. Ici encore, il ne faut en aucun cas réduire Jean à un nazi, le personnage est bien<br />
plus complexe.<br />
Cependant les références fréquentes à des valeurs telles que l’ordre, à la force, à la régularité,<br />
à l’hygiène corporelle, dénotent une attirance pour des idées nazies. Il en est de même de sa<br />
confiance dans son hérédité : « Je suis sain d’esprit et de corps. Mon hérédité… ». C’est lui<br />
d’ailleurs qui lance la discussion sur la « nationalité » des rhinocéros, de leur origine asiatique<br />
ou africaine.<br />
Il fait l’apologie de l’homme supérieur et de<br />
l’obéissance aveugle, il affirme valoir mieux que<br />
Bérenger : « Je vous vaux bien ; et même, sans fausse<br />
modestie, je vaux mieux que vous. L’homme supérieur<br />
est celui qui remplit son devoir. »<br />
Contrairement à Bérenger, qui se fait dans le tableau 2<br />
du deuxième acte le champion de la civilisation et de<br />
l’humanisme, Jean dit son mépris de l’homme et de la<br />
morale : « A vrai dire, je ne déteste pas les hommes, ils<br />
me sont indifférents, ou bien ils me dégoûtent ». C’est<br />
un pareil mépris de l’homme qui a en partie rendu<br />
possibles les exactions des SS.<br />
Sa peau qui durcit rapidement, sa déshumanisation<br />
progressive, son passage du « vous » au « tu », sa brutalité « je te piétinerai », le réduisent<br />
progressivement en une machine implacable, qui finit par foncer, tête baissée, sur son ami.<br />
KDF, abréviation pour « Kraft durch<br />
Freude », organisation dont le but<br />
était d’augmenter la capacité de<br />
travail des ouvriers grâce à des<br />
activités culturelles, au sport et aux<br />
excursions dans la nature.<br />
Le sport, l’hygiène corporelle<br />
occupaient une place de choix dans<br />
les AHS (Adolf-Hitler-Schulen), dans<br />
les Napola (écoles pour l’élite nazie)<br />
dans la HJ (Hitlerjugend) et dans le<br />
BDM (Bund Deutscher Mädchen).<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE<br />
Extraits de Mein Kampf :<br />
« C’est ainsi que tous les hommes, sans<br />
exception, se promènent dans le jardin<br />
de la nature, et se comportent comme<br />
des aveugles à peu d’exceptions près<br />
vis-à-vis de l’un des principes les plus<br />
saillants de son action : celui de<br />
l’existence de caractères organiques<br />
distinguant les espèces entre lesquelles<br />
se répartissent tous les êtres vivants sur<br />
cette terre. …<br />
La nature soumet les faibles à des<br />
conditions d’existence rigoureuses qui<br />
limitent leur nombre »<br />
Dans le contexte du nazisme, l’attirance que Jean ressent<br />
pour la nature, est sans doute son aspect le plus significatif.<br />
Les références à la nature sont fréquentes dans Mein Kampf<br />
de Hitler, qui trouve en elle une preuve de sa théorie des<br />
races supérieures et de son refus du mélange des races.<br />
Dans l’éducation, le nazisme accordait une place<br />
prépondérante au sport, destiné à endurcir les corps,la<br />
« Leistungsfähigkeit » était promue par ce qu’on appelait la<br />
« körperliche Ertüchtigung .»<br />
« Dans Mein Kampf, Hitler dit que le sport doit « den<br />
Körper stählen, le rendre semblable à l’acier (« hart wie
Ionesco, Rhinocéros p 14<br />
Kruppstahl »), cet acier de la machine et de l’homme transformé en machine d’acier,<br />
métaphore contemporaine la plus évidente de la force et de l’obéissance. » 24<br />
Jean prône les mêmes vertus et il se transforme progressivement en cette machine de guerre<br />
insensible et impassible qu’est le rhinocéros qui fonce aveuglément. Lorsque Bérenger lui<br />
parle de la morale, Jean affirme qu’il faut la remplacer par la nature : « La morale est<br />
antinaturelle ». Pour lui, le retour à la nature est un retour à « l’intégrité primordiale ». Il<br />
proclame la fin de l’humanisme.<br />
<strong>Unité</strong> 5 : Une tragédie moderne<br />
La tragédie classique (XVIIe siècle, Corneille, Racine), met en scène des êtres d’exception,<br />
héros mythologiques, grandes figures historiques, qui se débattent contre la fatalité qui<br />
pèse sur eux, c’est à dire « l’obstacle posé par le destin devant la liberté de l’homme » 25 Elle<br />
propose à l’homme, qui est placé au centre, des exemples de conduite. Elle obéit à des règles<br />
strictes (unités du lieu, du temps, de l’action, du ton et respect des bienséances). La structure<br />
est la suivante : exposition, le nœud se forme, dans l’acte 4 le héros a une dernière illusion de<br />
salut, dans l’acte 5 la chute est rapide et mène inéluctablement au malheur, le plus souvent à<br />
la mort du héros.<br />
Or, dans le théâtre de l’absurde, le combat de l’homme apparaît comme dérisoire et ainsi<br />
l’héroïsme n’a pas de place (ne faisons pas de Bérenger un héros, un champion de<br />
l’humanité qui défendrait l’individualisme contre la massification).<br />
La structure de Rhinocéros correspond à un resserrement progressif et à un sentiment<br />
d’étouffement, et parallèlement à une prolifération de l’inhumain (les rhinocéros)<br />
Ce rétrécissement se fait à plusieurs niveaux :<br />
1. L’espace. Le premier acte a lieu sur une place publique, un lieu d’échange (l’épicerie<br />
où l’on va faire ses achats, la terrasse du café où l’on se rencontre pour bavarder). La<br />
perspective s’ouvre vers le fond de la scène (une rue qui mène vers un clocher et une<br />
petite ville) et vers le devant (les spectateurs prolongent le lieu public qu’est la<br />
terrasse). Le premier (ou les deux premiers ?) rhinocéros apparaît.<br />
Dans le premier tableau du second acte, l’espace est clos : un bureau à l’atmosphère<br />
plutôt étouffante où les relations humaines sont régies par la routine (arriver à l’heure,<br />
pointer, faire un travail abrutissant –corriger des fautes d’impression- sous un chef qui<br />
ne fait que débiter des phrases stéréotypées). Les portes sont nombreuses, elles<br />
représentent une illusoire possibilité de s’échapper, surtout à partir du moment où<br />
l’escalier est détruit. Ionesco ferme également l’espace vers la salle en faisant<br />
descendre, entre la scène et les spectateurs un cadre de fenêtre, par laquelle les<br />
personnages observent l’espace extérieur. Bœuf transformé en rhinocéros arrive<br />
jusque dans l’escalier, nous apprenons que d’autres rhinocéros ont fait leur apparition<br />
dans la ville.<br />
Le deuxième tableau resserre encore l’espace : la chambre de Jean, mais il existe<br />
encore une ouverture vers le monde extérieur par la cage d’escalier, des contacts<br />
subsistent avec d’autres locataires (d’autres Jeans). Mais les rhinocéros entrent jusque<br />
dans la sphère privée. (Bérenger : » Vous avez un rhinocéros dans la maison »).<br />
24 www.sens-public.org/article_paru3.php3?id_article=171<br />
25 L’oeuvre au clair, op.cit., page 29.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 15<br />
Dans le troisième acte, l’espace humain finit par se limiter à la chambre de Bérenger.<br />
Le contact avec un extérieur humain est rompu (au téléphone, à la radio on n’entend<br />
plus que des barrissements). Les rhinocéros envahissent la ville (« Nous n’avons plus<br />
le nombre pour nous »).<br />
2. Les personnages. Parallélement à la prolifération des rhinocéros, le nombre de<br />
personnages sur scène diminue jusqu’à se réduire au seul Bérenger. Acte 1 : 9<br />
personnes, acte II, tableau 1 : 6 et le pompier, tableau 2 : 4 personnes, acte III : 2,<br />
ensuite 3, ensuite 2 et finalement une seule personne.<br />
3. Le langage. Déjà dans l’espace de communication du premier acte, le langage se<br />
réduit souvent à des clichés, à des absurdités logiques et à des discussions stériles (le<br />
logicien, la discussion sur l’origine et le nombre de rhinocéros). Le langage semble<br />
incapable de s’adapter à la gravité de la situation. Même Jean, qui se veut le<br />
représentant de l’ordre et de la raison, ne parvient pas à argumenter (voir p.ex. ce qu’il<br />
dit sur la force) et son raisonnement se limite à une accumulation de connecteurs<br />
logiques (d’abord, ensuite, aussi), mais ses arguments sont singulièrement vides de<br />
sens.<br />
Dans le deuxième acte, les discussions sont encore davantage déphasées (Papillon et<br />
ses rappels à l’ordre, Botard, ses tirades et ses vagues menaces).<br />
Dans le troisième acte, le langage devient un élément subversif : l’argumentation de<br />
Dudard semble motivée par la raison et la tolérance, alors qu’en fait il en arrive à faire<br />
l’apologie 26 de la rhinocérite (voir unité suivante). Daisy, au début, ne fait que jacasser<br />
sur leur dîner, des barrissements sortent du téléphone et de la radio, Bérenger,<br />
demeuré seul, constate que toute discussion est devenue impossible :<br />
»D’abord, pour les convaincre, il faut leur parler. Pour leur parler, il faut que j’apprenne<br />
leur langue. Ou qu’ils apprennent la mienne ? Mais quelle langue est-ce que je parle ? Quelle<br />
est ma langue ? est-ce du français, ça ? Ce doit bien être du français ? Mais qu’est-ce que du<br />
français ? On peut appeler ça du français, si on veut, personne ne peut le contester, je suis<br />
seul à le parler. Qu’est-ce que je dis ? »<br />
Il se retrouve dans un espace d’incommunication, une langue qui n’est parlée que par<br />
une seule personne n’est plus un instrument de communication. Dans le même<br />
contexte, Bérenger se demande si ce n’est pas lui maintenant le monstre. La normalité<br />
étant définie par le plus grand nombre, être rhinocéros et barrir est devenu la norme ;<br />
rester homme et parler une langue humaine est devenu extraordinaire, voire<br />
monstrueux.<br />
4. L’espoir. L’espoir de vaincre la rhinocérite va<br />
également en s’amenuisant, toutes les armes dont<br />
l’homme semble disposer se montrent inopérantes : la<br />
normalité, la logique, l’amitié, les idéologies, la<br />
tolérance et l’amour. Même l’individualisme de<br />
Bérenger n’est pas une arme puisqu’il est le seul à ne<br />
pas devenir rhinocéros, qu’il n’a pas pu aider les<br />
autres et qu’il se demande si sa résistance n’est pas<br />
une défaite.<br />
26 Apologie : éloge excessif<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE<br />
Il faut remarquer que la religion<br />
n’intervient guère, les seules<br />
références que Ionesco y fait sont<br />
la diatribe de Botard « Je n’écoute<br />
pas les curés qui vous font venir à<br />
l’église pour vous empêcher de<br />
faire votre boulot », ainsi que les<br />
anachronismes sur le cardinal de<br />
Retz, le célèbre mémorialiste du<br />
XVIIe siècle, et Mazarin, qui eux<br />
aussi sont devenus rhinocéros (acte<br />
III)
Ionesco, Rhinocéros p 16<br />
<strong>Unité</strong> 6 : l’échec de la tolérance et de l’amour, Dudard et Daisy<br />
Dudard<br />
L’inanité de la formation universitaire :<br />
Alors que les arguments de Jean et, plus encore, ceux de Botard, apparaissent tout de suite<br />
comme des clichés, ceux de Dudard sont bien plus dangereux et plus difficiles à infirmer<br />
puisqu’il met le masque de la tolérance et de la compréhension.<br />
Face à Dudard, Bérenger est sur un poste perdu, il le dit lui-même, il n’a pas l’éducation ni les<br />
facilités rhétoriques de son collègue de travail. Celui-ci le lui fait sentir en le traitant avec une<br />
certaine désinvolture (« mon cher ») et en l’acculant dans des contradictions ou en lui<br />
demandant des définitions : « Encore faut-il savoir ce que c’est que la folie… » Bérenger :<br />
« La folie, c’est la folie, na ! La folie, c’est la folie tout court ! Tout le monde sait ce que<br />
c’est, la folie. » Mais ni cette apparente supériorité intellectuelle ni la formation universitaire<br />
ne le prémunissent contre la<br />
transformation. Ionesco n’a<br />
d’ailleurs guère confiance dans<br />
les « intellectuels », peut-être<br />
parce que, à Bucarest, il a vu<br />
avec quelle facilité ses amis<br />
académiciens étaient attirés dans<br />
les rangs de la Garde de Fer, en<br />
dépit de leurs protestations de ne<br />
pas partager l’idéologie<br />
d’extrême droite (Dudard : « Je<br />
ne dis certainement pas que c’est<br />
un bien. Et ne croyez pas que je<br />
prenne parti à fond pour les<br />
rhinocéros… »)<br />
La soumission à l’autorité :<br />
Dudard était prédisposé à<br />
succomber, vu sa soumission à<br />
l’autorité, qui se manifeste déjà<br />
dans son attitude face à Papillon<br />
(dont il aurait certainement été le<br />
successeur). C’est finalement cet<br />
esprit d’obédience 27 qui<br />
l’entraîne finalement : « Mon<br />
devoir m’impose de suivre mes<br />
chefs et mes camarades, pour le<br />
meilleur et pour le pire ».<br />
Le discours lénifiant 28 :<br />
Dès son entrée dans la chambre de Bérenger, Dudard tranquillise son collègue, lui demande<br />
de s’asseoir et de ne pas exagérer les faits. Il est convaincu que les rhinocéros ne gènent pas<br />
27 Obédience: sens premier: obeisance à un supérieur ecclésiastique, lien entre une puissance spirituelle, politique<br />
et ceux qui lui sont soumis. Dans un nsens plus large : obéissance ou soumission.<br />
28 Lénifiant: calmant, apaisant/ un climat lénifiant: un climat qui ôte toute énergie.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE<br />
L’obéissance aux ordres reçus a souvent été l’excuse alléguée par<br />
d’anciens nazis et par des officiers et soldats qui étaient accusés pour<br />
crimes de guerre : ils n’avaient fait qu’obéir aux ordres de leurs chefs<br />
Or l’obéissance aux supérieurs est-elle une excuse valable ? Que faut-il<br />
en penser de ce qui arriva à certains nazis après la Seconde guerre<br />
mondiale ?<br />
Des procès eurent lieu en Allemagne de l’Ouest, plusieurs Nazis furent<br />
condamnés à des peines légères, sous prétexte qu’ils avaient obéi aux<br />
ordres de leurs supérieurs, ce qui fut considéré comme une circonstance<br />
atténuante.<br />
(http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=fr&ModuleId=10)<br />
On peut comparer à l’attitude de la justice face aux garde-frontière estallemands,<br />
accusés après la chute du mur de Berlin d’avoir, en suivant<br />
les ordres reçus, ouvert le feu sur ceux qui essayaient de passer la<br />
frontière : Les deux premiers procès de gardes-frontières<br />
(Mauerschützenprozesse) ont été l'occasion de préciser les bases<br />
juridiques incertaines des procès pour meurtres à la frontière. Leurs<br />
conclusions contradictoires dessinent nettement deux options<br />
argumentatives. Le premier de ces procès, présidé par le juge Theodor<br />
Seidel, s'est conclu par une condamnation sur une base fortement<br />
« naturaliste » : suivant les attendus du verdict, les gardes-frontières<br />
ayant ouvert le feu sur Chris Gueffroy, la dernière victime du Mur de<br />
Berlin (5 février 1989) ne pouvaient qu'être conscients de<br />
« l'immoralité » de leur action. « Tirer avec l'intention de tuer ceux qui<br />
voulaient simplement quitter le territoire de l'ancienne RDA était une<br />
violation des normes éthiques élémentaires ». Les accusés ne pouvaient<br />
s'abriter en aucune manière derrière une disposition légale (notamment la<br />
loi sur la frontière de 1982, qui autorisait l'usage des armes à feu) car,<br />
selon le verdict, on ne pouvait respecter les lois d'un régime - qualifié<br />
d'État de non droit (Unrechtsstaat) - dont les responsables ne<br />
bénéficiaient « d'aucune forme de légitimation ». Citant explicitement le<br />
fameux principe énoncé par Radbruch en 1946, le verdict constatait que<br />
les lois est-allemandes étaient « en contradiction insupportable avec les<br />
fondements juridiques universellement reconnus ». Ce verdict fut<br />
aussitôt critiqué par de nombreux juristes …<br />
(http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_justice/justice_mouralis.html)
Ionesco, Rhinocéros p 17<br />
On a souvent vu dans les discours<br />
lénifiants des hommes politiques anglais et<br />
français une des raisons pour lesquelles<br />
Hitler a pu commencer sa mainmise sur<br />
l’Europe :<br />
La Grande-Bretagne pratique la politique<br />
de "l'appeasement". Le Premier Ministre Sir<br />
Neville Chamberlain est en effet convaincu<br />
que l'on peut arrêter Hitler par des<br />
concessions et des bonnes paroles. Quant<br />
à la France, elle se soumet aux opinions du<br />
Cabinet de Londres, en vertu de ses choix<br />
diplomatiques des années 20. Politique<br />
justifiée tant par la volonté de ne pas<br />
répéter les horreurs de la guerre que par<br />
un net affaiblissement politico-militaire des<br />
démocraties. (http://www.1939-<br />
45.org/chronik/1938.htm)<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE<br />
celui qui les laisse tranquilles ; il est convaincu qu’il<br />
s’agit d’un « mal passager ». Selon lui, Bérenger se<br />
crée des problèmes et devrait moins se poser des<br />
questions « saugrenues ».<br />
De cette façon, il se fait le complice des rhinocéros<br />
sans le savoir, comparable de cette façon à tous ceux<br />
qui, face aux grandes injustices historiques, se sont<br />
tus, qui ont minimisé le danger et qui ont laissé faire<br />
pour ne pas avoir eux-mêmes des ennuis..<br />
Dudard : « Ils ne vous attaquent pas. Si on les laisse<br />
tranquilles, ils vous ignorent. Dans le fond ils ne<br />
sont pas méchants. Il y a même chez eux une<br />
certaine innocence naturelle… »<br />
Son attitude est symptomatique pour la grande masse des gens. Daisy dit que « les gens<br />
s’écartent sur leur passage, puis reprennent leur promenade, vaquent à leurs affaires, comme<br />
si de rien n’était. »<br />
L’indistinction intellectuelle : Dans son souci de ne pas faire des déductions hâtives ou de se<br />
lancer dans des affirmations péremptoires 29 , Dudard en arrive à mettre tout sur un même<br />
plan. Lorsque Bérenger refuse les rhinocéros au nom de concepts éthiques, comme le mal,<br />
son collègue, avec un scepticisme qui se veut philosophique mais qui traduit seulement son<br />
incapacité de prendre des positions claires, se demande si de tels termes recouvrent une<br />
signification précise : « Le mal, le mal ! Parole creuse ! Peut-on savoir où est le mal, où est le<br />
bien ? » Lorsque Bérenger se réfère à la normalité, il met en doute la possibilité de définir ce<br />
terme et demande s’il y a rien de plus naturel qu’un rhinocéros.<br />
Face à l’insistance de Bérenger, il lui recommande de prendre des somnifères ; ainsi il ne<br />
réfléchira plus aux problèmes ; il lui reproche également d’être un Don Quichotte, c’est-à-dire<br />
de se battre contre des dangers imaginaires.<br />
Il utilise également un vocabulaire qui tire la situation vers le ridicule, il utilise à deux reprises<br />
le terme « drôle » et il reproche à Bérenger de manquer d’humour.<br />
Le philosophe de la « raison suffisante » : Dudard<br />
affirme approcher le problème avec la raison et<br />
d’analyser clairement les causes. Même s’il n’a pas<br />
encore trouvé une explication, il a commencé par<br />
observer les faits : « Pour le moment, je ne trouve pas<br />
encore une explication satisfaisante. Je constate les faits,<br />
je les enregistre. ». De toute façon, il est certain qu’il<br />
existe une explication rationelle des faits les plus étranges<br />
parce que, si une chose est, il existe bien une raison pour<br />
qu’elle soit : « Puisqu’il en est ainsi, c’est qu’il ne peut en être autrement. » Il fait penser au<br />
philosophe Pangloss dans Candide. A travers ce personnage, Voltaire se moque de la<br />
philosophie de Leibniz et de sa raison suffisante.(Si les choses sont ainsi, c’est qu’elles ne<br />
peuvent être autrement)<br />
La tolérance : De même, Dudard se veut le champion de la compréhension et de la tolérance.<br />
Comme un leitmotiv revient son exhortation d efaire un effort de compréhension : « Mon<br />
cher Bérenger, il faut toujours essayer de comprendre. » Lorsque son collègue condamne<br />
29 Rapides, sans preuve<br />
Leibniz : philosophe et savant<br />
allemand, 1646-1716). Il a travaillé<br />
dans de de nombreux domaines,<br />
enmathématiques (calcul différentiel<br />
et intégral), théologie, logique. Il<br />
réduisit les principes de nos<br />
rqisonnements à ceux de<br />
contradiction (possibilité logique) et<br />
de raison suffisante (possibilité<br />
suffisante)
Ionesco, Rhinocéros p 18<br />
Papillon pour ne pas avoir su résister, il lui reproche son intolérance.<br />
Dudard recourt à un vocabulaire biblique « Ne jugez pas les autres, si vous ne voulez pas être<br />
jugé » et, reprenant l’argumentation de Jean, il affirme que rien de ce qui est naturel (donc le<br />
rhinocéros) ne peut être vraiment mauvais. Il finit par accuser Bérenger de voir le mal partout,<br />
d’être intolérant envers ce qui est différent et de s’aventurer ainsi sur la pente dangereuse qui<br />
mène vers une attitude d’inquisiteur : « Malheur à celui qui voit le vice partout. C’est le<br />
propre des inquisiteurs ».<br />
Or, il faut se demander s’il faut pousser la compréhension jusqu’au point de tolérer<br />
l’intolérable, c’est-à-dire la perte de l’humanité. Faut-il, au nom de la liberté de penser<br />
accepter les idéologies qui nient les valeurs humaines ?<br />
La sublimation : Bérenger ne comprend pas comment<br />
un caractère apparemment aussi solide que Papillon<br />
peut se transformer en rhinocéros. Utilisant un jargon<br />
de psychologue, Dudard s’interroge sur les raisons<br />
secrètes de cette métamorphose, et il y voit la<br />
possibilité d’un transfert freudien, d’une sublimation.<br />
Finalement, Dudard succombe à ses propres principes. Botard a été victime de son « esprit<br />
communautaire », Dudard sera la victime d’une tolérance poussée jusqu’à son extrême limite,<br />
dans laquelle toutes les actions, tous les comportements se valent. De plus, son humanisme le<br />
pousse à suivre la foule : « J’ai renoncé au mariage, je préfère la grande famille universelle à<br />
la petite. » Il trouve même dans son esprit critique une raison, propre aux intellectuels, de<br />
suivre les rhinocéros : « S’il y a à critiquer, il vaut mieux critiquer du dedans que du dehors. »<br />
Daisy ou l’échec de l’amour.<br />
Daisy pourrait apparaître comme une petite sotte, une femme niaise, sans cervelle. Elle<br />
affirme croire aux soucoupes volantes, elle donne une définition enfantine du rhinocéros<br />
« C’est un… c’est un très gros animal, vilain. », face au danger de la rhinocérisation, elle ne<br />
pense qu’à mettre la table.<br />
Mais ce personnage est bien plus complexe. Tout d’abord ses remarques, qui pourraient<br />
paraître sottes, son incapacité à voir la gravité de la situation, peuvent être lues comme une<br />
réaction du bon sens très terre à terre, comme la tentative, dans un monde qui part à la dérive,<br />
de sauvegarder la normalité.<br />
Ensuite, elle montre de la force de caractère, aussi bien face aux avances maladroites de<br />
Papillon « Ne mettez pas sur ma figure votre main rugueuse, espèce de pachyderme ! » que<br />
face aux insinuations de Dudard à qui elle fait comprendre, sans le dire directement, qu’il ne<br />
l’intéresse pas et qu’il n’est qu’un gêneur.<br />
Elle représente la promesse de l’amour et, à travers lui, la promesse du salut « Tant que nous<br />
sommes ensemble, je ne crains rien » (Bérenger). Daisy revendique le droit au<br />
bonheur égoïste: « …, nous avons le droit de vivre. Nous avons même le devoir, vis-à-vis de<br />
nous-mêmes, d’être heureux, indépendamment de tout. »<br />
Cependant, très rapidement, cet amour s’effondre. Bérenger : « Hélas ! En quelques minutes,<br />
nous avons donc vécu vingt-cinq années de mariage. ». Daisy : « La vie en commun n’est plus<br />
possible ».<br />
A quoi est due cette impossibilité ?<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE<br />
Sublimation : 1. Action d e purifier, de<br />
transformer en élevant.<br />
2. Processus par lequel la pulsion<br />
sexuelle déplace son but sexuel vers un<br />
autre but, visant des objets socialement<br />
valorisés. (Le Petit Robert)
Ionesco, Rhinocéros p 19<br />
En fait, Daisy se sent attirée, presque exclusivement, par la force : « Ils sont beaux / ce sont<br />
des dieux » Elle découvre en eux « l’ardeur, l’énergie extraordinaire ».Face à cette force<br />
brute, l’amour même semble à Daisy une manifestation de la faiblesse humaine : « J’en ai un<br />
peu honte, de ce que tu appelles l’amour, ce sentiment morbide, cette faiblesse de l’homme. Et<br />
de la femme. » (Face à cette affirmation de celle qu’il aime, Bérenger ne se maîtrise plus et il<br />
gifle Daisy, ce qu’il regrette aussitôt).<br />
Elle cherche auprès de Bérenger une protection que celui-ce ne peut pas lui offrir, malgré ses<br />
affirmations d’avoir tout prévu, d’être fort et courageux et de la défendre. Elle lui reproche au<br />
contraire de ne jamais rien prévoir, lorsqu’il lui demande si elle croit que les rhinocéros sont<br />
plus forts que lui et que leur union, elle répond « Sûrement ».<br />
De plus, Bérenger est un idéaliste, ce que Daisy n’est pas. Lui, il veut sauver le monde,<br />
recommencer l’humanité, il se voit lui et Daisy comme nos premiers ancêtres (Adam et Eve).<br />
Or elle ne veut pas avoir d’enfants, ils l’ennuient.<br />
Elle se demande si ce ne sont pas eux deux les monstres (idée reprise dans le monologue final<br />
par Bérenger), alors que les rhinocéros sont la normalité : « C’est ça, les gens. Ils ont l’air<br />
gais. Ils se sentent bien dans leur peau. Ils n’ont pas l’air d’être fous. »<br />
L’incapacité finale de communiquer se marque dans le fait que Daisy semble comprendre le<br />
langage des rhinocéros et affirme qu’ils chantent, alors que Bérenger ne sait y reconnaître que<br />
d’horribles barrissements.<br />
Cette attirance que Daisy sent pour la force brute a inspiré à Jean-Paul Sartre cette critique<br />
acerbe : « Il est absolument impossible de tirer un mot de la pièce sinon pour nous dire qu’un<br />
grand malheur, un grand péril d’abrutissement, menace le monde, que, ma foi, le danger de<br />
contamination est très grave et que les femmes sont toutes fascinées par ces gros imbéciles à<br />
cornes que sont les rhinocéros. 30 »<br />
Le monologue final : héros ou anti-héros ?<br />
Comment interpréter le fait que Bérenger soit le seul à résister à l’attraction que les rhinocéros<br />
exercent sur tous les autres personnages ?<br />
Il faut éviter de faire de lui un héros de l’humanité, un exemple à suivre, de chercher dans son<br />
attitude une solution face au danger que représentent les totalitarismes. Sa « victoire » toute<br />
relative le laisse en effet seul, il n’a su retenir personne, ni Dudard, ni Daisy, il ne nous offre<br />
aucune solution, il ne sait pas lui-même pourquoi il a résisté, il le regrette même, il souffre de<br />
sa solitude.<br />
Son monologue final est rythmé par ses hésitations, entrecoupées par des velléités de<br />
résistance. (« Vous ne m’aurez pas, moi ! »). Daisy lui a reproché sa faiblesse : elle apparaît<br />
ici : il se sent seul, il se fait des reproches, il se culpabilise pour ne pas avoir su retenir la<br />
femme aimée,(« encore quelqu’un sur la conscience »). Il se regarde dans le miroir, cherchant<br />
dans son reflet une preuve que l’homme n’est pas monstrueux, qu’il a de la dignité et de la<br />
beauté (« Un homme n’est pas laid, un homme n’est pas laid ») contrairement aux<br />
affirmations de Daisy.<br />
Un instant il a l’idée d’essayer de raisonner les rhinocéros, de<br />
leur montrer qu’ils sont dans leur tort. Mais tout d’abord, il a<br />
30 Jean Paul Sartre, Un théâtre de situations, Gallimard, 1973, p. 140.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE<br />
On peut interpréter cette<br />
incommunicabilité comme<br />
l’impossibilité de discuter<br />
avec un fanatique, avec<br />
quelqu’un qui adhère<br />
inconditionnellement à une<br />
idéologie (nazie, stalinienne,<br />
islamiste, une secte, etc.) : en<br />
effet il réfléchit dans un autre<br />
registre de langue que nous et<br />
sera imperméable à notre<br />
argumentation.
Ionesco, Rhinocéros p 20<br />
l’impression que c’est une tâche qui le dépasse (« un travail d’Hercule »). Ensuite il est<br />
conscient de la barrière de la langue : il ne comprend pas leurs barrissements et eux ils ne<br />
comprennent plus la langue humaine. Il en arrive même à douter de la langue qu’il parle<br />
(« est-ce du français ? »). En effet, la langue étant essentiellement un moyen de<br />
communication, elle perd toute fonction du moment qu’une seule personne la comprend. Le<br />
français (et toute autre langue), de cette façon, ne mourrait pas avec la dernière personne qui<br />
le comprend, mais avec l’avant-dernière. Ces réflexions rejoignent toutes celles que Ionesco a<br />
faites sur la langue dans Rhinocéros (voir ce point) : de la perte de la logique, à travers toutes<br />
les « langues de bois » des idéologies (Botard en particulier).<br />
Bérenger arrive à la conclusion (en contemplant des portraits d’hommes) que ce sont les<br />
rhinocéros qui représentent la beauté alors que l’homme a la peau flasque, les traits tombants,<br />
un corps trop blanc et poilu. Il en arrive a souhaiter devenir rhinocéros, à avoir leur force, leur<br />
corps glabre et vigoureux. L’homme apparaît comme le monstre. Or, il se sent incapable de<br />
changer, tout comme il se sentait incapable de changer de vie lorsque Jean le lui demandait (il<br />
promet bien de se cultiver, mais il n’en fait rien) : « Je voudrais tellement, mais je ne peux<br />
pas ».<br />
Et quand même, le seul qui résiste à l’attraction de la force (donc de l’idéologie, des<br />
totalitarismes, de la déshumanisation), c’est cet homme apparemment faible, hésitant,<br />
incapable de retenir la femme aimée, relativement peu éduqué, pas très soigneux au travail,<br />
porté sur la boisson.<br />
C’est cette faiblesse même qui lui permet de ne pas se transformer. Tous les autres, en effet,<br />
menaient une vie bien réglée, ils avaient leurs principes : Jean représente la croyance en<br />
l’ordre et la force, Bottard le militantisme de gauche, Papillon l’obéissance et la vie<br />
strictement rythmée, Dudard l’humanisme et la tolérance, Daisy la recherche de la sécurité et<br />
de la force masculine. Ainsi, puisqu’ils avaient des opinions bien tranchées, ils étaient plus<br />
facilement attirés par la nature brutale, saine et forte des rhinocéros, qu’un homme toujours<br />
harcelé par les doutes et peu enclin aux actions rapides, tranchées et nécessitant un<br />
investissement total.<br />
Ce n’est que dans les dernières phrases que Bérenger se révolte contre la rhinocérisation, non<br />
en affirmant qu’il va la combattre, mais qu’il va résister, lui, individuellement « Contre tout le<br />
monde, je me défendrai ! …Je ne capitule pas !» Il est d’ailleurs remarquable que la première<br />
partie du monologue final est constituée presque exclusivement de questions et la deuxième<br />
moitié d’exclamations.<br />
Donc, Bérenger résiste un peu malgré lui et ne nous fournit aucune solution. Cet aspect de<br />
Rhinocéros a valu bien des critiques à son auteur. Sartre écrit :<br />
« Et pourquoi y en a-t-il un qui résiste ? Au moins pourrions-nous le savoir, mais nous<br />
n’en savons rien du tout. Il résiste parce qu’il est là, il représente Ionesco, alors il<br />
dit : »Je résiste » et il reste là au milieu des rhinocéros, seul à défendre l’homme, sans<br />
que nous sachions très bien après tout s’il ne vaut pas mieux être rhinocéros… » 31<br />
Ionesco a répondu en disant que s’il avait donné une solution claire et unique, s’il avait fourni<br />
des indications précises et pris une position tranchée, il n’aurait fait qu’ajouter ou défendre<br />
31 Sartre, Un Théâtre de situations, p.140<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE
Ionesco, Rhinocéros p 21<br />
une idéologie et il aurait créé un nouveau risque de rhinocérisation en enlevant la liberté de<br />
penser à l’homme :Au reproche d’avoir laissé le spectateur dans le vide, il répond :<br />
« C’est bien ce que j’ai voulu faire. C’est de ce vide qu’un homme libre doit se tirer tout<br />
seul, par ses propres forces et non par la force des autres. » 32<br />
Voilà sans doute l’aspect qui distingue le plus fondamentalement le théâtre de Ionesco et du<br />
Nouveau théâtre en général des autres formes de théâtre qui connaissent du succès vers la<br />
même époque. Aussi bien le théâtre de Brecht que le théâtre engagé d’un Sartre par exemple,<br />
ont des opinions bien précises sur les dangers qui nous menacent (en général les idéologies<br />
fascistes) et ils nous offrent des solutions ou des modèles de comportement ( fournies souvent<br />
par le communisme et l’humanisme). Or le Nouveau théâtre n’est pas un théâtre engagé mais<br />
un théâtre situationnel (il décrit, il montre, il n’enseigne pas).<br />
32 Notes et contre-notes, p.288.<br />
2005/2006 Pütz Fernand LGE