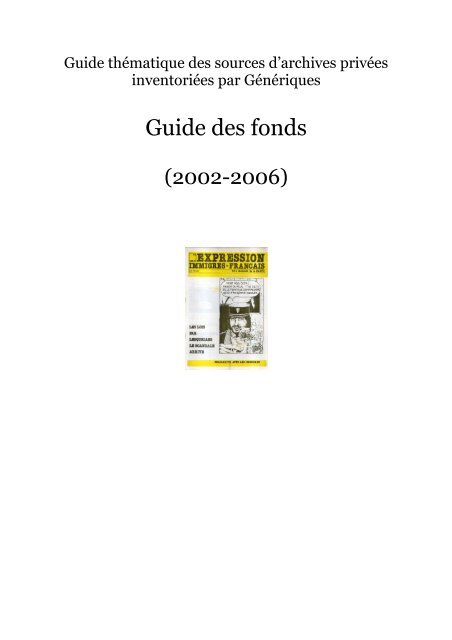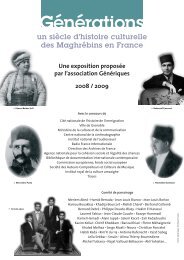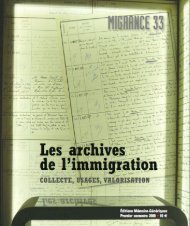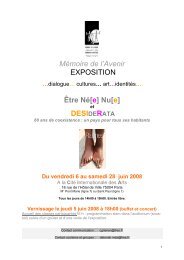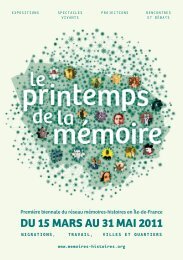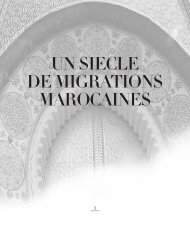Guide des fonds - Génériques
Guide des fonds - Génériques
Guide des fonds - Génériques
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Guide</strong> thématique <strong>des</strong> sources d’archives privées<br />
inventoriées par <strong>Génériques</strong><br />
<strong>Guide</strong> <strong>des</strong> <strong>fonds</strong><br />
(2002-2006)
GÉNÉRIQUES<br />
<strong>Guide</strong> <strong>des</strong> <strong>fonds</strong><br />
d’archives privées<br />
Inventoriés en 2002-2006<br />
par Virginie BEAUJOUAN<br />
chargée de mission<br />
Paris<br />
2006<br />
3
<strong>Génériques</strong><br />
L’association <strong>Génériques</strong> a été créée fin 1987 avec pour objectif d’entreprendre et de soutenir<br />
toute action permettant d’améliorer la connaissance <strong>des</strong> phénomènes migratoires en France et<br />
dans le monde, par <strong>des</strong> activités tant scientifiques que culturelles.<br />
Nous présentons dans ce guide les <strong>fonds</strong> inventoriés entre 2002 et 2005, en présentant pour<br />
chacun une notice historique et la typologie <strong>des</strong> documents qui le compose ainsi que les<br />
principaux thèmes. Pour prendre connaissance du détail de ces <strong>fonds</strong>, il convient de se<br />
reporter aux instruments de recherche élaborés par <strong>Génériques</strong>.<br />
Sauf mention contraire, tous les <strong>fonds</strong> d’associations sont composés de manuscrits et<br />
tapuscrits (rapports d’activités, correspondance…), tracts, livres et périodiques produits par<br />
l’association. Tous les <strong>fonds</strong> d’associations conservent également <strong>des</strong> affiches, très souvent<br />
<strong>des</strong> photos et plus rarement <strong>des</strong> films de leurs activités.<br />
Les <strong>fonds</strong> ne sont pas tous conservés à <strong>Génériques</strong>. La plupart demeurent chez les détenteurs,<br />
qu’ils s’agissent d’associations ou de particuliers. Pour les consulter, il convient de nous<br />
contacter afin que nous puissions vous orienter.<br />
Les archives : au cœur du métier de <strong>Génériques</strong><br />
Particulièrement sensible à la question de la préservation <strong>des</strong> archives, <strong>Génériques</strong> s’est<br />
attachée depuis 1992 à inventorier les documents relatifs aux étrangers et à valoriser les<br />
sources d’archives publiques sur les étrangers en France. Cette action s’est concrétisée par la<br />
publication de la collection Les Étrangers en France – <strong>Guide</strong> <strong>des</strong> sources d’archives<br />
publiques et privées – XIXe-XXe siècles. Cet ouvrage en plusieurs volumes a fait l’objet d’une<br />
mise en ligne sous forme de base de données, permettant une recherche multicritères.<br />
Les archives privées<br />
Dans cette même perspective, l’association œuvre pour la sauvegarde et la préservation <strong>des</strong><br />
archives privées de l’immigration et leur mise à disposition auprès de tous publics. Cette<br />
activité passe par la réalisation d’un instrument de recherche, en lien étroit avec leurs<br />
détenteurs, et par un encouragement à leur dépôt dans les services publics d’archives<br />
appropriés.<br />
Le patrimoine d’archives privées provient d’organismes d’hébergement, de structures<br />
d’accueil et de solidarité, d’associations communautaires, de services cultuels, de syndicats,<br />
de militants, de chercheurs... et couvre l’ensemble du XXe siècle. Ces archives constituent de<br />
nouvelles sources originales pour l’histoire <strong>des</strong> migrations, et permettent également de<br />
reconstituer certains mouvements de l’immigration dont le patrimoine est aujourd’hui<br />
dispersé ou disparu.<br />
La revue Migrance<br />
D’autre part, <strong>Génériques</strong> édite la revue Migrance, première revue européenne spécialisée dans<br />
l’histoire de l’immigration. À raison de deux numéros par an, elle aborde cette histoire à la<br />
fois sous l’angle d’un pays européen spécifique (« Luxembourg : histoires croisées <strong>des</strong><br />
migrations », « Le Portugal entre émigration et immigration »…) et selon <strong>des</strong> axes<br />
5
thématiques divers (« La participation <strong>des</strong> étrangers aux combats pour la libération de la<br />
France », « Histoire et archives <strong>des</strong> migrations en France et en Europe »…).<br />
Le site Internet<br />
En outre, le site Internet de <strong>Génériques</strong> propose de nombreuses informations scientifiques et<br />
culturelles liées à l’histoire de l’immigration. Ainsi, plusieurs bases de données permettent<br />
d’effectuer <strong>des</strong> recherches sur les affiches et journaux de l’immigration, sur les sources<br />
d’archives sur les étrangers en France ou sur <strong>des</strong> notices biographiques d’étrangers ayant<br />
séjourné en France. Il propose aussi <strong>des</strong> informations sur <strong>des</strong> ouvrages traitant de l’histoire de<br />
l’immigration, sur <strong>des</strong> manifestations culturelles en cours et présente les actes de plusieurs<br />
colloques organisés par l’association.<br />
6
Sommaire<br />
Fonds de particuliers<br />
Abdelmalek Sayad<br />
Saad Abssi<br />
Olivier Aubert<br />
Farouk Belkeddar<br />
Béatrice Bonneau<br />
Saïd Bouziri<br />
Hamoudi Djataou<br />
Simone Lellouche-Ben Othman<br />
Fonds d’associations<br />
Association de culture berbère (ACB)<br />
Association Culturelle <strong>des</strong> Maghrébins de Sarcelles (ACMS)<br />
Assemblée citoyenne <strong>des</strong> originaires de Turquie (ACORT)<br />
Association <strong>des</strong> Marocains de France (AMF)<br />
Service <strong>des</strong> communautés étrangères et <strong>des</strong> prêtres étudiants étrangers<br />
Association de solidarité avec les travailleurs immigrés de Bordeaux (ASTI)<br />
Association <strong>des</strong> Tunisiens de France (ATF)<br />
Association <strong>des</strong> travailleurs maghrébins de France (ATMF)<br />
Collectif <strong>des</strong> accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité <strong>des</strong> droits (CATRED)<br />
Centre pour la communication et la formation dans l’espace local (CCFEL)<br />
Centre France-Asie (CFA)<br />
Comité de liaison pour la promotion <strong>des</strong> migrants et <strong>des</strong> publics en difficulté d’insertion<br />
(CLP)<br />
Coordination pour le droit <strong>des</strong> étrangers à vivre en famille<br />
Fédération <strong>des</strong> Tunisiens pour une citoyenneté <strong>des</strong> deux rives (FTCR)<br />
Interaction France Portugal<br />
Maison <strong>des</strong> femmes de Paris<br />
Association franco-chinoise Pierre-Ducerf<br />
7
Troisième collectif de sans-papiers<br />
Fédération <strong>des</strong> associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)<br />
Rapports et états sommaires<br />
Association Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale (ARALIS)<br />
Cimade<br />
Service social d’aide aux émigrants (SSAE)<br />
Comité de liaison et d'action <strong>des</strong> étrangers (CLAE)<br />
Fonds Pierre Boisgontier et Geneviève Baudino (éditions Vérité Rhône-alpes puis Ateliers du<br />
Vercors)<br />
Les républicains espagnols, déportés et travailleurs forcés pendant la seconde guerre<br />
mondiale : archives privées et orales<br />
Fonds en cours en 2006 (p.81)<br />
CLAP Ile-de-France (Comité de liaison <strong>des</strong> acteurs de la promotion)<br />
La Coordination <strong>des</strong> collectivités portugaises en France (CCPF)<br />
Association <strong>des</strong> parents d’élèves, amis et familles espagnoles (APAFE) - PARIS XV<br />
Asociaçion de padres de familias con hijos minusvalidos espanoles emigrantes en Francia<br />
(APFMEEF, association de parents d’enfants handicapés espagnols)<br />
Génération-femmes<br />
Soleil en Essonne<br />
Fonds en cours d’inventaire en 2006 et dont l’instrument de recherche n’est pas encore<br />
disponible :<br />
Elele<br />
Migrations et Cultures de Turquie mène depuis 1984 <strong>des</strong> actions favorisant l'intégration <strong>des</strong><br />
personnes originaires de Turquie. Si cette intégration repose sur un désir <strong>des</strong> personnes de<br />
participer à la vie du pays d'accueil, ce dernier ne peut cependant faire l'économie de la<br />
connaissance de l'autre, de son histoire, de sa culture et de son projet migratoire.<br />
Fonds Vasco Martins<br />
Collection de journaux édités par <strong>des</strong> associations portugaises en France<br />
8
Casa Valencia<br />
Association espagnole fondée en 1947.<br />
AEFTI (Association pour l'Enseignement et la Formation <strong>des</strong> Travailleurs Immigrés et leurs<br />
familles)<br />
Association de formation créée en 1971. Nous avons débuté l’inventaire <strong>des</strong> archives de la<br />
fédération AEFTI et de l’AEFTI-93 (Bobigny)<br />
9
Abdelmalek Sayad<br />
Dates extrêmes : années 1940-2000 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 30 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : état du <strong>fonds</strong><br />
Ce <strong>fonds</strong> est constitué <strong>des</strong> notes et travaux de recherche, <strong>des</strong> écrits, <strong>des</strong> cours, <strong>des</strong> enquêtes<br />
sociologiques et dossiers thématiques élaborés par Abdelmalek Sayad, tout au long de sa<br />
carrière de sociologue de l’immigration et d’enseignant. Il se compose également de<br />
correspondance échangée avec <strong>des</strong> chercheurs, <strong>des</strong> étudiants, <strong>des</strong> universités, <strong>des</strong> groupes et<br />
centres de recherche, en France comme à l’étranger (en particulier l’Algérie, la Suisse et le<br />
Brésil). Dans la plupart <strong>des</strong> dossiers figurent <strong>des</strong> travaux universitaires (mémoires, thèses) et<br />
<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> commanditées par les pouvoirs publics ou par <strong>des</strong> centres de recherche. Cette<br />
documentation doit être considérée comme partie intégrante du <strong>fonds</strong>, dans la mesure où la<br />
plupart est annotée ou s’inscrit dans <strong>des</strong> dossiers plus larges.<br />
Les archives contenues dans ce <strong>fonds</strong> témoignent aussi de l’engagement d’A. Sayad dans la<br />
vie associative, notamment auprès d’ABRIDA (Association berbère de recherche,<br />
d'information, de documentation et d'animation) ou auprès d’Inter-migrants pour qui il a<br />
animé une émission à la Maison de la Radio.<br />
Quatre-vingt-quinze pour cent du <strong>fonds</strong> sont composés d’archives papier, le reste étant<br />
constitué de documents iconographiques ou sonores.<br />
Les documents les plus anciens datent <strong>des</strong> années 1960, époque à laquelle A. Sayad suivait les<br />
cours à l’université d’Alger, où il fait la connaissance de Pierre Bourdieu. A cet égard, il faut<br />
souligner que nombre de documents concernent la collaboration entre ces deux sociologues .<br />
Le <strong>fonds</strong> comporte quelques documents antérieurs aux années 1960, collectés par A. Sayad au<br />
cours de ses recherches : registres de logeurs et d’hôteliers de la ville de Puteaux (années<br />
1940), reproductions d’ouvrages rares. Enfin, les documents les plus récents, postérieurs à la<br />
mort d’A. Sayad, ont été réunis par Rebecca Sayad, à l’occasion d’hommages et de rééditions.<br />
Les thèmes centraux de ce <strong>fonds</strong> reflètent, bien évidemment, les sujets qu’A. Sayad a<br />
développés dans ses publications, les premiers ayant servis à l’élaboration <strong>des</strong> seconds. Citons<br />
pour mémoire : conditions sociales en Algérie, émigration algérienne, logement (bidonvilles,<br />
foyers, …), racisme, nationalité, exil, enseignement, altérité, etc.<br />
Etat du <strong>fonds</strong> et déroulement de l’inventaire<br />
Nos différents déplacements au domicile de Rebecca Sayad, nous ont permis de prendre<br />
connaissance de l’état général du <strong>fonds</strong> et de mettre en œuvre un programme de travail,<br />
échelonné sur plusieurs mois, avec deux étapes distinctes.<br />
La première, technique, a permis de procéder au dépoussiérage et au reconditionnement <strong>des</strong><br />
documents, qui étaient particulièrement menacés par l’humidité et les insectes.<br />
11
La seconde étape, archivistique, toujours en cours, consiste à trier, organiser et inventorier les<br />
archives, en :<br />
• respectant différentes logiques, inhérentes à la chronologie, aux thèmes, aux types de<br />
supports, etc. ;<br />
• cherchant à comprendre si l’ordre initial <strong>des</strong> documents correspond à un classement mis<br />
en place par A. Sayad ;<br />
• en essayant de contextualiser les documents dans l’œuvre et la pensée d’A. Sayad.<br />
• La troisième étape, scientifique, consistera à travers ce <strong>fonds</strong> d’archives, à mettre en<br />
perspective l’œuvre d’A. Sayad, dans l’historiographie et la sociologie de l’immigration.<br />
L’état du <strong>fonds</strong> est le document qui servira de base à l’élaboration d’un plan de classement,<br />
qui permettra la réalisation d’un inventaire restituant toute la complexité et la richesse de ce<br />
<strong>fonds</strong> unique pour l’histoire de l’émigration et de l’immigration dans la seconde moitié du 20 e<br />
siècle, particulièrement entre la France et l’Algérie.<br />
12
Fonds Sayad<br />
Des supports variés<br />
13
Saad Abssi<br />
Dates extrêmes : années 1970-1990 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 2 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : répertoire détaillé<br />
Ce <strong>fonds</strong> d’archives a été constitué par M. Saad Abssi dans le cadre de ses activités<br />
associatives locales, dans le secteur de Gennevilliers, et de son engagement militant dans les<br />
réseaux de défense <strong>des</strong> droits humains et <strong>des</strong> immigrés. Le <strong>fonds</strong> représente 2 mètres linéaires<br />
de documents, répartis dans 20 cartons. Un quart <strong>des</strong> documents concerne les années 1970-<br />
1980, les trois autres quarts sont postérieurs à 1990 (les papiers les plus récents datent de<br />
2002).<br />
Quatre thèmes majeurs se dégagent : Mouvement associatif de solidarité dans les Hauts-de-<br />
Seine ; Dialogue Islamo-Chrétien : Algérie et Algériens ; Droits humains.<br />
Intérêt<br />
Ce <strong>fonds</strong> d’archives propose de suivre, sur plus de deux décennies, l’itinéraire et<br />
l’engagement d’un homme dans la vie publique, associative et militante (logement, santé,<br />
immigration, droits humains, dialogue inter religions…) : chaque document est un<br />
témoignage de l’ouverture vers l’autre pour laquelle M. Saad Abssi œuvre, depuis <strong>des</strong> années,<br />
au cœur de réseaux locaux, nationaux et internationaux.<br />
Ce <strong>fonds</strong> dresse un panorama de la vie associative, dans toute sa diversité, au cœur d’un<br />
secteur géographique bien délimité de la région parisienne, où l’immigration, depuis plus d’un<br />
siècle, occupe une place de premier plan et joue un rôle essentiel dans la société.<br />
Au delà <strong>des</strong> archives à caractère local, la présence de documents portant sur l’actualité<br />
internationale (Proche-Orient, Irak, Maghreb, Sénégal…), et sur les droits humains dans le<br />
monde, montre l’intérêt que porte M. Abssi pour ces questions et témoigne de son<br />
engagement intellectuel au cœur <strong>des</strong> débats contemporains.<br />
Composition<br />
Collectifs et associations de solidarité dans les Hauts-de-Seine<br />
Les cartons 1 à 6 contiennent <strong>des</strong> documents sur l’organisation et l’activité de collectifs et<br />
d’associations de solidarité <strong>des</strong> Hauts-de-Seine, en particulier à Gennevilliers, auxquels<br />
participe Monsieur Saad Abssi au titre de représentant de Solidarité algérienne en Europe. Ces<br />
papiers ont été ordonnés par organismes selon le même plan de classement (vie interne,<br />
activités, correspondance, publications). Les documents restituent notamment les actions<br />
menées à <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> populations immigrées dans les différents collectifs.<br />
14
La Coordination solidarité logement est créée en 1992 à Colombes par un collectif<br />
d’associations du département <strong>des</strong> Hauts-de-Seine pour aider « les personnes et les familles<br />
françaises ou immigrées mal logées ou sans toit ». Parmi les associations signataires figurent<br />
Ville-Univers, Solidarité Algérienne en Europe, la Confédération syndicale <strong>des</strong> familles, le<br />
Secours catholique, l’Association de Soutien aux travailleurs immigrés… Le collectif<br />
intervient notamment auprès <strong>des</strong> pouvoirs publics sur les questions du logement et apporte<br />
une aide individualisée aux personnes. Plusieurs dossiers concernent <strong>des</strong> immigrés et leurs<br />
familles, surtout <strong>des</strong> Algériens. D’autres affaires ont un caractère plus collectif. En 1992, par<br />
exemple, la coordination est saisie du problème du relogement de travailleurs immigrés<br />
hébergés dans un café-hôtel meublé de Levallois-Perret ; deux ans plus tard, la coordination<br />
prend part au Comité de soutien actif aux familles africaines évacuées de Vincennes et<br />
conduites au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.<br />
Le Collectif solidarité de Gennevilliers a été créé en février 1992 autour de 15 puis 22<br />
associations de la commune, parmi lesquelles Solidarité algérienne en Europe, Solidarité<br />
musulmane et Ville-Univers. Le collectif conduit <strong>des</strong> actions de solidarité auprès <strong>des</strong> plus<br />
démunis, notamment les SDF et les résidents de foyers, et organise chaque année le « forum<br />
de la solidarité ». Il est aussi à l’origine de la création de la Maison de la Solidarité.<br />
Le Comité local de promotion de la santé à Gennevilliers, formé en 1984, est un « lieu de<br />
rencontre, d’information mutuelle et de réflexion <strong>des</strong> professionnels de santé, <strong>des</strong> travailleurs<br />
sociaux, <strong>des</strong> usagers et <strong>des</strong> représentants de la collectivité en vue de proposer <strong>des</strong> actions de<br />
prévention, de dépistage ou d’éducation sanitaire et sociale, de coordonner les actions<br />
sanitaires et sociales, de prendre en compte les problèmes de santé de la population […] ».<br />
Le Collectif gennevillois de soutien aux sans-papiers, constitué en 1996, mène <strong>des</strong> actions de<br />
parrainage, intervient auprès <strong>des</strong> pouvoirs publics et travaille en relation avec la Maison <strong>des</strong><br />
sans-papiers de Colombes.<br />
La découverte de la détresse de personnes hospitalisées, ou en maisons de retraite, venant du<br />
Maghreb et se trouvant isolées, conduit à la création en 1996 à Argenteuil de l’Association<br />
Visiteurs pour les personnes hospitalisées. Destinée à rendre visite aux personnes<br />
hospitalisées, à les soutenir moralement et à leur apporter une aide matérielle, elle fonctionne<br />
grâce au concours de bénévoles. L’association Ibn Sina, de création antérieure, poursuit les<br />
mêmes buts à <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> hospitalisés musulmans.<br />
Créée en 1995 à l’initiative <strong>des</strong> membres du Collectif Solidarité et avec le soutien de la<br />
Fondation Abbé Pierre, la Maison de la solidarité de Gennevilliers est un lieu d’accueil pour<br />
toute personne en difficulté. Elle développe également avec les personnes hébergées <strong>des</strong><br />
initiatives et <strong>des</strong> ateliers culturels.<br />
Asnières-Univers, devenue ensuite Villes-Univers, est constitué en 1990, mais ses actions<br />
remontent à 1985 ; un document de 1992 précise « qu’il s’agissait pour quelques Français et<br />
étrangers de ne pas rester à une simple cohabitation obligée dans les quartiers, mais de<br />
favoriser la rencontre et l’enrichissement mutuel, notamment par <strong>des</strong> fêtes ». Par la suite, le<br />
dialogue a progressivement ouvert l’association aux besoins <strong>des</strong> étrangers en matière de<br />
séjour, logement, école, travail… Par une implication active dans les réseaux associatifs<br />
existants, Ville-Univers développe <strong>des</strong> activités <strong>des</strong>tinées à favoriser la rencontre et la<br />
reconnaissance mutuelle entre Français et étrangers.<br />
15
Les cartons 7 et 8 contiennent <strong>des</strong> documents sur la lutte contre les exclusions (chômage,<br />
racisme…), sur l’immigration et sur l’action syndicale en faveur <strong>des</strong> retraités dans le<br />
département <strong>des</strong> Hauts-de-Seine. Ces archives proviennent du Comité AC de Gennevilliers,<br />
de la section CFDT retraités d’Asnières-Gennevilliers-Villeneuve-la-Garenne et<br />
d’associations de l’immigration comme Stop racisme à Asnières ou le Mouvement de<br />
l’immigration et <strong>des</strong> banlieues.<br />
Dialogue islamo-chrétien dans les Hauts-de-Seine<br />
Les cartons 9 à 11 présentent <strong>des</strong> documents relatifs au dialogue islamo-chrétien. La plupart<br />
de ces archives émanent de l’association Approches 92, mouvement d’approche entre<br />
chrétiens et musulmans auquel participe activement Monsieur Saad Abssi. Il s’agit de papiers<br />
sur la vie et les activités de l’association et de correspondance échangée avec d’autres<br />
organismes catholiques ou musulmans, en France comme à l’étranger.<br />
16
Olivier Aubert<br />
Dates extrêmes : années 1990 – 2000 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 2 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : répertoire numérique<br />
Olivier Aubert est photographe-reporter et journaliste indépendant. Suite à un reportage photo<br />
à la maison d’arrêt de la Santé en 1990, son travail s’oriente en grande partie sur<br />
l’immigration. Auteur de nombreux articles sur l’immigration chinoise, son <strong>fonds</strong> se compose<br />
principalement de photos et de documentation sur la communauté chinoise, tant en France<br />
qu’à l’étranger (Europe, Afrique, Pays de l’Est, ...).<br />
Nous avons mis en exergue uniquement les aspects de son travail concernant les étrangers en<br />
France et dans le monde, ce qui concerne au total huit cartons de documentation et plusieurs<br />
centaines de photos.<br />
Documentation sur la diaspora chinoise, de 1991 à nos jours (8 cartons)<br />
Ces dossiers thématiques sont composés de pages Internet, rapports, coupures de presse et<br />
brochures en français et en anglais.<br />
Nous les avons classés par thèmes :<br />
• Généralités : flux migratoires, quartiers chinois à Paris, rapports diplomatiques,<br />
restauration, touristes chinois, … ;<br />
• Nouvel an chinois et année de la Chine en France (2003-2004) ;<br />
• Etudiants, jeunes ;<br />
• Religion ;<br />
• Travail, boutiques de textile dans le 11 e arrondissement de Paris ;<br />
• Santé : prévention, VIH, médecine chinoise ;<br />
• Criminalité, mafia, contrefaçon ;<br />
• Sans-papiers, clan<strong>des</strong>tins ;<br />
• Histoire et portraits, présence <strong>des</strong> Chinois en France pendant la Première Guerre<br />
mondiale ;<br />
• Vie associative : brochures d’associations, carnets de notes ;<br />
• Vie locale : associations et municipalités parisiennes ;<br />
• Communauté Dong Bei ;<br />
17
• Journaux et brochures en chinois, <strong>des</strong>tinées aux Chinois de Paris ;<br />
• « Migrants chinois de France », projet de livre-guide de M. Aubert : maquette, pièces<br />
comptables, etc. ;<br />
• Chinois dans le monde ;<br />
• Rapports et étu<strong>des</strong> en français et en anglais.<br />
Photos<br />
Les clichés sont également consultables sur le site Internet : http://www.1d-photo.org/.<br />
Chaque boîte thématique contient une centaine de photos :<br />
• Africains d’Afrique Noire dans huit pays européens ;<br />
• Cimade, droit d’asile, réfugiés ;<br />
• Communauté malienne (au Mali et en France) ;<br />
• Communauté tamoule (temples, fêtes, manifestations, vie quotidienne) ;<br />
• Communautés chinoises en France (une vingtaine de boîtes) ;<br />
• Exilés (Sangatte, Paris) ;<br />
• Expulsions, police aux frontières, centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) ;<br />
• Marins abandonnés et marins étrangers en France et en Europe ;<br />
• Religions en France : bouddhisme, Islam, sikhisme, catholicisme ;<br />
• Roms roumains tchèques et bulgares (1989 à aujourd’hui) ;<br />
• Sans-papiers depuis 1995 ;<br />
• Zones d’attentes, centres de rétention administratifs ;<br />
• Foyers de travailleurs migrants, hôtels meublés.<br />
18
Farouk Belkeddar<br />
Dates extrêmes : 1933-1976 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 1 mètre linéaire<br />
Instrument de recherche : répertoire méthodique<br />
Fondée en 1912 à Alger, l’Association <strong>des</strong> étudiants musulmans d’Afrique du Nord<br />
(AEMNA) s’étend en 1927 aux différentes villes universitaires françaises où sont créées <strong>des</strong><br />
sections locales. Jusqu’aux années cinquante, l’AEMNA continue à se développer <strong>des</strong> deux<br />
côtés de la Méditerranée. En juillet 1952, une rencontre <strong>des</strong> responsables <strong>des</strong> différentes<br />
sections de l’AEMNA a lieu à Alger : un appel est lancé pour la constitution d’une Union<br />
musulmane <strong>des</strong> étudiants maghrébins qui réunirait trois fédérations nationales. Mais<br />
l’accélération du processus de libération nationale au Maghreb entraîne la création de<br />
mouvements autonomes : ainsi, l’Union générale <strong>des</strong> étudiants tunisiens (UGET) tient son 1 er<br />
congrès tandis qu’à Paris la création de l’Union générale <strong>des</strong> étudiants musulmans algériens<br />
(UGEMA) est officialisée lors de son 1 er congrès du 7 avril 1955 ; le 2 e congrès entérine le<br />
ralliement de l’UGEMA à la politique du FLN. En janvier 1958, après l’arrestation <strong>des</strong><br />
principaux dirigeants du mouvement, le gouvernement français décrète la dissolution de<br />
l’UGEMA. La direction de l’UGEMA s’installe alors à Tunis où elle poursuit son combat<br />
pour l’indépendance. De 1959 à 1962, l’UGEMA traverse une période de crise et de tensions<br />
qui aboutissent à un changement de son organisation, de ses statuts, et de sa dénomination<br />
lors du 5 e congrès de 1963 à Alger : elle devient l’Union nationale <strong>des</strong> étudiants algériens<br />
(UNEA).<br />
19
Béatrice Bonneau<br />
Dates extrêmes : 1972-2001 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 7 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : répertoire numérique<br />
Ce <strong>fonds</strong>, déposé en juin 2001 à l’association <strong>Génériques</strong> par Mme Béatrice BONNEAU, se<br />
compose de soixante-huit classeurs et de quatre cartons ayant pour thème l'immigration de<br />
1972 à 2001.<br />
L’originalité de ce <strong>fonds</strong> est sa richesse en coupures de presse qui proviennent en majorité du<br />
Monde et de Libération, mais aussi de journaux d’extrême gauche (Rouge) ou d’associations<br />
(MRAP, SOS Racisme…). Outre ces dossiers de presse, les classeurs et les cartons<br />
contiennent <strong>des</strong> tracts, <strong>des</strong> brochures, <strong>des</strong> revues (originales ou photocopiées), <strong>des</strong> courriers,<br />
<strong>des</strong> textes législatifs (extraits du Journal Officiel, LAMY droit de l’immigration, etc.), ainsi<br />
que <strong>des</strong> documents produits par diverses associations (bulletins d’information, rapports<br />
d’activité, etc.).<br />
A Politiques d'immigration. Polémiques, réactions <strong>des</strong> associations et <strong>des</strong> partis<br />
politiques. 1972-1995<br />
B Crimes et agressions racistes. Chronologies diverses et dossiers de presse. 1980-1998<br />
C Mouvement <strong>des</strong> sans-papierss. 1996-2001<br />
D Droit de vote <strong>des</strong> résidents étrangers. 1985-1995<br />
E Banlieues : restructuration de l'Ile de France. 1989-1998<br />
F Foulards islamiques. 1989-1994<br />
G Lois Pasqua. 1984-1996<br />
H Droit d’asile. 1977-1997<br />
I Europe. 1985-1998<br />
J Code de la nationalité. 1986-1998<br />
K Législation. 1994-1995<br />
20
L Associations. 1981-1997<br />
M Discriminations 1981-1998<br />
N Manifestations diverses. 1982-1994<br />
O Statistiques. 1983-1997<br />
P Mémoire. 1989-1999<br />
Q Pays d'origine. 1981-1999<br />
21
Saïd Bouziri<br />
Dates extrêmes : 1969-1976 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 7 cartons<br />
Ce <strong>fonds</strong>, reproduit sur microfilm par la BDIC, concerne les mouvements issus de<br />
l’immigration entre 1969-1976. Il est composé de tracts, notes et journaux provenant <strong>des</strong><br />
Comités Palestine, du Mouvement <strong>des</strong> travailleurs arabes (MTA), <strong>des</strong> comités de défense <strong>des</strong><br />
droits et de la vie <strong>des</strong> travailleurs immigrés et de divers dossiers sur les luttes <strong>des</strong> travailleurs<br />
immigrés (carte de travail, crimes racistes, logement, etc.).<br />
Comités Palestine. 1969-1973<br />
Mouvement <strong>des</strong> travailleurs arabes (MTA). 1973-1977<br />
Luttes pour l’égalité <strong>des</strong> droits. 1972-1975<br />
Comités de défense de la vie et <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> travailleurs immigrés. 1973-1974<br />
Luttes <strong>des</strong> travailleurs sans-papierss. 1974-1975<br />
Mouvement <strong>des</strong> travailleurs mauriciens. 1973-1976<br />
Lutte <strong>des</strong> mal-logés. 1971-1977<br />
Lutte contre les expulsions. 1977<br />
Grèves de la faim pour la carte de travail. 1973-1975<br />
Lutte contre les crimes racistes. 1971-1974<br />
Textes politiques divers.1972<br />
22
Hamoudi Djataou<br />
Dates extrêmes : années 1970 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Le <strong>fonds</strong> d’Hamoudi Djataou est composé de photographies prises en 1975 à Grenoble, dans<br />
l’Isère et au Maghreb (essentiellement en Algérie) dans le cadre de la de la conception d’un<br />
diaporama intitulé « Pourquoi l’immigration ? ». Réalisée par Hamoudi Djataou avec l’équipe<br />
du « Foyer maghrébin de Saint-Laurent », l’opération a reçu le soutien financier de la ville de<br />
Grenoble. C’est en juillet 1976, dans le contexte de « Ville en fête », manifestation culturelle<br />
grenobloise, que cette production est présentée au public. Intégré à un spectacle plus large de<br />
théâtre et de concert, qui attire 3 à 4 000 spectateurs à chaque représentation, le diaporama se<br />
présente sous la forme d’un mur d’images projetées en plein air : 3 000 diapositives sur 7<br />
écrans de 3x5 mètres, avec synchronisation sur la bande-son qui donne un aperçu historique<br />
de l’immigration. Deux projections publiques sont faites à Grenoble dans la version originale,<br />
puis une production simplifiée avec 2 ou 3 écrans est réalisée pour les tournées (Cité <strong>des</strong><br />
3 000, Vénissieux, Marseille, Centre culturel français d’Alger…). À chaque projection, le<br />
diaporama sert de support à un débat sur l’immigration.<br />
Hamoudi Djataou conserve une partie <strong>des</strong> 3 000 diapositives de ce diaporama et la bande-son,<br />
d’une durée de 25 minutes.<br />
Intérêt du <strong>fonds</strong><br />
Ce <strong>fonds</strong> est particulièrement précieux pour l’histoire de l’immigration et <strong>des</strong> mouvements<br />
sociaux en région grenobloise dans la première moitié <strong>des</strong> années 1970. Les photographies du<br />
diaporama sont à mettre en relation avec les autres <strong>fonds</strong> d’archives relatifs à l’Isère et à<br />
Grenoble, comme celui <strong>des</strong> Imprimeries Vérité Rhône-alpes et Ateliers du Vercors.<br />
Thèmes du <strong>fonds</strong> :<br />
Maghreb<br />
Ports, émigration<br />
Chantiers, usines, travail<br />
Logement et vie quotidienne <strong>des</strong> travailleurs immigrés à Grenoble<br />
Organisations syndicales et défense <strong>des</strong> travailleurs immigrés<br />
Reproduction photographique de documents d’archives<br />
23
Simone Lellouche-Ben Othman<br />
Dates extrêmes : 1960-1988 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 2 mètres linéaires<br />
Présentation, par Simone Lellouche-Ben Othman<br />
Il s’agit d’un <strong>fonds</strong> comprenant essentiellement <strong>des</strong> documents (tracts, affiches, revues,<br />
brochures, etc) de l’opposition tunisienne politique et syndicale du début <strong>des</strong> années 1960 aux<br />
années 1980, aussi bien en France qu’en Tunisie. Certains documents provenaient en effet de<br />
Tunis pour être imprimés en France puis ré-acheminés vers la Tunisie.<br />
Le <strong>fonds</strong> témoigne <strong>des</strong> différents courants de l’opposition dans le milieu étudiant et de leurs<br />
relations avec les mouvements français ou internationaux et comprend au total près de 50<br />
cartons. La période qu’il couvre correspond à <strong>des</strong> événements particulièrement importants. La<br />
fin de la guerre d’Algérie ; la guerre Israélo-arabe de juin 67 avec ses répercussions dans tout<br />
le monde arabe ; les mouvements étudiants en France comme dans d’autres pays en1968.<br />
Ainsi,, c’est le 15 mars 1968 que les étudiants organisent en Tunisie une journée d’action<br />
pour la libération de l’étudiant Ben Jennet (condamné à 20 ans de travaux forcés à la suite <strong>des</strong><br />
manifestations de juin 1967). il s’en suit une répression féroce contre toute l’opposition : le<br />
Groupe d’étu<strong>des</strong> et d’action Socialiste Tunisien (GEAST), le Parti Communiste Tunisien et le<br />
Baath.<br />
Février 1972 correspond à une période de grande mobilisation pour les libertés en Tunisie. Le<br />
mouvement étudiant connaît une nouvelle répression, les arrestations sans jugement se<br />
succèdent durant de longs mois, et de nombreux procès s’en suivent, 1974 ; 1975 …..<br />
En 1978, le syndicat ouvrier tunisien (UGTT) connaît à son tour une violente répression. De<br />
nombreux documents témoignent de tous événements, ainsi que <strong>des</strong> multiples mobilisations<br />
estudiantines, <strong>des</strong> activités et de la vie interne de nombreux groupes de l’opposition et <strong>des</strong><br />
actions pour la libération <strong>des</strong> détenus d’opinion, menés notamment en France par <strong>des</strong> comités<br />
successifs militant pour les droits de l’Homme.<br />
Simone Lellouche a été amenée à séjourner à trois reprises à Paris. La première, entre 1961 et<br />
1963, pour terminer ses étu<strong>des</strong> scientifiques ; la seconde entre 1967 et 1970 et enfin à partir<br />
de 1972 .<br />
Au début <strong>des</strong> années 1960, elle milite dans l’Union générale <strong>des</strong> Étudiants de Tunisie (UGET)<br />
et à l’Union Nationale <strong>des</strong> Femmes de Tunisie (UNFT). Elle devient très proche <strong>des</strong> militants<br />
du Groupe d’Etu<strong>des</strong> et d’Action Socialiste Tunisien (GEAST). À partir de 1968, elle est<br />
victime d’une série de mesures arbitraires en même temps que son mari Ahmed Ben Othman<br />
et de centaines de militants politiques tunisiens. Elle fait l’objet de deux expulsions de Tunisie<br />
(en 1968 et en 1972) suivies de condamnations par contumace (6 et 12 ans de prison).<br />
Le mouvement de février 1972 se déclenche en même temps qu’un <strong>des</strong> procès qui lui sont<br />
intentés (le 1 er février 1972) ; l’UGET organise le 3 février un congrès extraordinaire pour<br />
une « UGET démocratique et représentative ». Expulsée à nouveau vers la France le 5 février<br />
1972, Simone Lellouche s’engage dans la lutte contre la répression en Tunisie et participe à<br />
24
tous les comités de défense qui se sont constitués à Paris entre 1968 et 1978 1 : Comité<br />
International pour la sauvegarde <strong>des</strong> Droits de l’homme en Tunisie ; Comité Tunisien pour la<br />
Défense <strong>des</strong> Droits de l’Homme en Tunisie ; Comité de « Groix » ; Collectif du 26 Janvier ,<br />
Aujourd’hui encore elle participe au Comité pour le Respect <strong>des</strong> Libertés et <strong>des</strong> Droits de<br />
l’Homme en Tunisie et milite à Amnesty International.<br />
Intérêt du <strong>fonds</strong><br />
Les documents n’ont pas été recueillis de façon tout à fait systématique durant toute la<br />
période concernée (61-80). On ne trouve que quelques documents sur la première période 61-<br />
63. C’est à partir de 1968 que les documents sont plus systématiquement conservés : revues,<br />
brochures, tracts, affiches, ainsi que quelques photos et cassettes.<br />
Le <strong>fonds</strong> est lacunaire pour la période 1970-71 et redevient d’une grande richesse à partir de<br />
février 1972.<br />
Le <strong>fonds</strong> Simone Lellouche-Ben Othman complète les <strong>fonds</strong> de l’UTIT-FTCR et de l’ATF,<br />
inventoriés par <strong>Génériques</strong>. À trois, ils permettent de suivre la vie politique et syndicale<br />
tunisienne sur près de quarante ans.<br />
A - Organisations politiques. 1963-1979<br />
Groupe d’Etu<strong>des</strong> et d’Action Socialiste<br />
Tunisien (Geast), Perspectives tunisiennes,<br />
El Amel Tounsi (Le travailleur tunisien).<br />
1963-1979<br />
Parti communiste tunisien (PCT). 1968-<br />
1979<br />
An Niddhal (La Lutte), Mouvement<br />
démocratique de masse (MDM). 1969-<br />
1972<br />
Cercle marxiste léniniste tunisien (CMLT)-<br />
Groupe marxiste léniniste tunisien<br />
(GMLT)- groupe Ech-choola. 1972-1977<br />
Mouvement d'unité populaire (MUP) et<br />
Affaire Ben Salah. 1973-1979<br />
B - Organisations estudiantines. 1963-<br />
1979<br />
Association <strong>des</strong> étudiants musulmans nord<br />
africains en France (AEMNAF). 1963-<br />
1973<br />
Union générale <strong>des</strong> étudiants de Tunisie<br />
(UGET). 1968-1979<br />
C – Tunisie : Libertés publiques et<br />
droits humains (LTDH, …). 1968-1989<br />
D - France : comités et campagnes<br />
contre la répression en Tunisie. 1968-<br />
1980<br />
Comité international pour la sauvegarde<br />
<strong>des</strong> droits de l'homme en Tunisie<br />
(CISDHT). 1968-1973<br />
Comité tunisien d'information et de<br />
défense <strong>des</strong> victimes de la répression<br />
(CTIDVR). 1972-1979<br />
Comité de Groix. 1974-1976<br />
Collectif tunisien du 26 janvier 1978.<br />
1978-1980<br />
Procès de 1972-1974. 1971-1975<br />
Documentation. 1972-1974<br />
1 En Juillet et Août 1979 la majorité <strong>des</strong> prisonniers politiques et syndicalistes sont libérés.<br />
25
E - Immigration tunisienne en France :<br />
mouvements politiques et associatifs<br />
(UTIT, …). 1972-1979<br />
F – Documentation sur la Tunisie après<br />
19801981-1988<br />
G – Publications sur le Maghreb, le<br />
Moyen-Orient et la Palestine 1960-1978<br />
H – Affiches. 1968-1974<br />
26
Association de culture berbère (ACB)<br />
Dates extrêmes : 1980-2004 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 15 mètres linéaires<br />
Les premières activités de l’ACB remontent à 1979, alors qu’elle se nommait encore les<br />
Ateliers de culture berbère. C’est au moment de sa constitution officielle, en 1981, qu’elle<br />
prend le nom d’Association de culture berbère. Elle se fixe dès 1984 au cœur du quartier de<br />
Belleville-Ménilmontant, où elle demeure depuis.<br />
Ses activités se concentrent autour d’ateliers culturels berbères, dont l’importance varie au<br />
cours de son existence : langue, danse, théâtre, musique, chant, histoire et civilisation,<br />
alphabétisation. L’association tient également <strong>des</strong> permanences sociales et juridiques et<br />
organise <strong>des</strong> cours de soutien scolaire.<br />
Etat du <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
Le <strong>fonds</strong> de l’ACB se compose de 15 mètres linéaires d’archives, rédigées essentiellement en<br />
français, reflétant la vie de l’association depuis sa constitution officielle en 1981.<br />
Les archives <strong>des</strong> réunions internes (assemblées générales, conseil d’administration, …) sont<br />
peu nombreuses, contrairement à celles <strong>des</strong> activités culturelles, pierre angulaire de<br />
l’association. Pour comprendre la vie culturelle berbère en France, le chercheur consultera<br />
avec profit les dossiers documentaires composés de brochures et de « book » d’artistes, ainsi<br />
que les rapports d’activité de l’ACB.<br />
L’association publie depuis 1982 une revue, intitulée tout d’abord « Tiddukla », puis « La<br />
lettre de Tiddukla », « Actualités et culture berbère » et enfin « La lettre d’actualités et culture<br />
berbère ». L’ACB édite régulièrement <strong>des</strong> affiches, en cours de classement, mais dont une<br />
partie est d’ores et déjà consultable sur notre site.<br />
A1-3 Vie interne. 1981-2001<br />
B1-2 Journal de l’ACB. 1982-2000<br />
C1-12 Relations avec d’autres organismes. 1983-2002<br />
D1-35 Activités. 1981-2004<br />
E1-33 Comptabilité, salariés et gestion du local. 1982-2004<br />
F1-25 Documentation. 1980-2002
Fonds ACB<br />
Fonds ACORT
Association Culturelle <strong>des</strong> Maghrébins de Sarcelles<br />
(ACMS)<br />
Dates extrêmes : 1983-1990 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 2 cartons<br />
L’Association Culturelle <strong>des</strong> Maghrébins de Sarcelles (ACMS) a été fondée le 26 juin 1982<br />
afin de créer un espace de rencontre pour la communauté maghrébine de Sarcelles. Les<br />
fondateurs de l'ACMS souhaitaient permettre aux enfants d’origine arabe d'apprendre leur<br />
langue à Sarcelles. De 1982 à 1992, elle a participé à l'insertion <strong>des</strong> femmes immigrées<br />
(alphabétisation, gymnastique, projets de création d'entreprise, rencontres parents<br />
/enseignants,…). Elle a accueilli différents groupes de jeunes pour <strong>des</strong> projets autonomes<br />
autour de la danse, de la musique, du sport, etc. Pendant plus de 8 ans, elle a également<br />
participé à la vie associative de Sarcelles : elle a été membre du conseil d'administration du<br />
centre social «Les Vignes Blanches» en 1984 et a fait partie en 1989 du premier comité de<br />
pilotage «Prévention été».<br />
Elle a en outre organisé l'accueil de « Convergence 84 » et <strong>des</strong> participants <strong>des</strong> «Etats<br />
Généraux de l'Immigration 88». Il est à noter qu’un de ces membres à participer aux travaux<br />
du «Conseil National <strong>des</strong> Populations Immigrées» de 1988 à 1994.<br />
Vie interne. 1983-1990<br />
Activités. 1983-1990<br />
Documentation. 1984-1990
Assemblée citoyenne <strong>des</strong> originaires de Turquie<br />
(Acort)<br />
Dates extrêmes : 1960-2001 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 36 mètres linéaires<br />
L’Acort (assemblée citoyenne <strong>des</strong> originaires de Turquie), anciennement l’ATT (Association<br />
<strong>des</strong> Travailleurs de Turquie), a été fondée en octobre 1981.<br />
L’Acort s’est constituée à la suite <strong>des</strong> grèves de la faim <strong>des</strong> travailleurs de la confection en<br />
1980. Préoccupée à ses débuts par le retour au pays, l’Acort rompt son lien organisationnel<br />
avec la Turquie en 1985. Elle se concentre alors sur la lutte contre les discriminations, en<br />
participant notamment aux marches <strong>des</strong> années 1980. Cofondatrice du CAIF (conseil <strong>des</strong><br />
associations immigrées en France) et de Mémoire fertile, l’Acort participe activement aux<br />
débats sur le droit de vote et sur le code de la nationalité. Elle est très présente localement,<br />
dans le 10 e arrondissement, et œuvre à l’insertion <strong>des</strong> habitants d’origine étrangère.<br />
L’association est divisée en groupes de réflexion et d’action, afin de favoriser les initiatives,<br />
ce qui lui permet notamment de ne pas couper le lien avec les plus jeunes. Ces groupes sont<br />
au nombre de trois : l’Union <strong>des</strong> parents d’élèves originaires de Turquie, les Femmes de<br />
Turquie et Arc-en-ciel, « la voix <strong>des</strong> jeunes ». Ce <strong>fonds</strong> rend bien compte de la composition<br />
originale de l’ACORT, divisée en commissions, qui permettent de saisir les évolutions <strong>des</strong><br />
actions et <strong>des</strong> réflexions de l’ACORT.<br />
1- Vie interne. 1960-1998<br />
2- Subvention, rapports et projets d’activité. 1981-2001<br />
3- Activités. 1981-2001<br />
4- Turquie. 1981-1999<br />
5- Relations avec d’autres mouvements ou associations. 1978-1997<br />
6- Relations avec les pouvoirs publics. 1982-2000<br />
7- Correspondance. 1988-2000<br />
8- Publications. 1985-2000<br />
9- Divers. 1980-1992
Association <strong>des</strong> Maghrébins de France (AMF)<br />
Dates extrêmes : 1951-2004 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 18 mètres linéaires<br />
L’AMF est active depuis les années 1950 afin de soutenir les luttes pour l’accès à la<br />
démocratie au Maroc et dans le monde arabe ainsi que la représentation et la défense <strong>des</strong><br />
immigrés en France. Elle a été créée officiellement en 1961 par <strong>des</strong> membres de l’Union<br />
nationale <strong>des</strong> forces populaires (UNFP) et Mehdi Ben Barka y est présenté comme l’un de ses<br />
membres fondateurs.<br />
En 1961, ses statuts mentionnent qu’elle a été fondée afin de « grouper les Marocains établis<br />
en France en vue de renforcer leurs relations mutuelles, de maintenir et sauvegarder l’amitié<br />
traditionnelle entre le peuple français et le peuple marocain ». Dans les années 1960-1970 elle<br />
fournit essentiellement un soutien pratique à ses adhérents, au moyen d’un fond de solidarité<br />
et d’aide au logement. Par la suite, ses actions s’étendent à d’autres régions par le biais de la<br />
création de sections locales.<br />
Dans les années 1970-1980, elle compte parmi les associations fondatrices de la Maison <strong>des</strong><br />
travailleurs immigrés (MTI), de la Coordination d’associations immigrées (CAIF, issue de la<br />
MTI), et de Mémoire fertile. Elle participe ainsi aux cinq festivals organisés par la MTI entre<br />
1975 et 1982. Elle a également fait partie du Conseil <strong>des</strong> associations d'immigrés en Europe<br />
(CAIE), de Migr’Europe et participe toujours aux activités du Conseil <strong>des</strong> associations<br />
démocratiques marocaines en Europe (CEDAM).<br />
Suite à une scission dans les années 1970, l’AMF donne naissance à une nouvelle association,<br />
l’ATMF, dont l’inventaire est également consultable sur notre site.<br />
Etat du <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
Le <strong>fonds</strong> de l’AMF se compose de 18 mètres linéaires d’archives remontant pour les plus<br />
anciennes à 1957. Il a fait l’objet d’un premier travail de classement par Sandra Barrot, lors de<br />
son mémoire de maîtrise portant sur l’histoire de l’AMF.<br />
On peut noter dans ce <strong>fonds</strong> la présence de cartes de membres datant <strong>des</strong> années 1950, ainsi<br />
que de photos <strong>des</strong> différentes activités de l’association (prises aussi bien lors de<br />
manifestations pour l’égalité <strong>des</strong> droits que lors de spectacles) et <strong>des</strong> affiches. Les archives<br />
sont rédigées en partie en arabe, principalement pendant les premières décennies d’activités<br />
de l’association.<br />
Pour plus de commodités, les cartons sont classés par thème et non par cote. Nous avons<br />
numéroté chaque notice et indiqué en fin d’inventaire leur correspondance avec les numéros<br />
de cote.
A (1-15) - Vie Interne, 1951-2004.<br />
B (16-30) - Sections locales, 1971-2004.<br />
C (31-54) - Publications, 1961-2004.<br />
D (55-82) - Activités, 1955-2004.<br />
E (83-95) - Correspondance, 1974-2004.<br />
F (96-137) - Relations avec d’autres organismes, 1964-2004.<br />
G (138-199) - Comptabilité, gestion du personnel et du local, 1961-2004.<br />
H (200-214) - Documentation, 1965-2004.
Vicariat de la Solidarité<br />
Dates extrêmes : 1966-2000 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 13 mètres linéaires<br />
Le « Vicariat de la Solidarité » est un service diocésain créé en 2001 à partir de services<br />
préexistants (notamment le Service inter diocésain pour les travailleurs immigrés) avec pour<br />
mission de participer aux actions de solidarité dans le diocèse et d’en assurer la coordination.<br />
Les <strong>fonds</strong> se composent <strong>des</strong> archives du Vicariat de la solidarité depuis sa création et de<br />
quelques documents plus anciens (en particulier du SITI). Les archives représentent près de<br />
80 cartons (y compris de la documentation mélangée aux archives), 2 meubles de classeurs<br />
suspendus (environ 6 mètres linéaires de classeurs), 4 albums de diapositives et<br />
photographies, 6 cassettes vidéo.
ASTI-Bordeaux<br />
Dates extrêmes : 1968-2001 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 6 mètres linéaires<br />
Dénommée à sa création en 1968 « Association Jeunes au service <strong>des</strong> analphabètes », l’ASTI-<br />
Bordeaux devient en 1971 l’Association de solidarité avec les travailleurs immigrés.<br />
Elle a été créée afin de « répondre à un besoin d’apprentissage du français, par <strong>des</strong> militants<br />
français qui s’étaient rendu compte de l’importance de l’analphabétisme parmi les travailleurs<br />
immigrés » (publication non datée de l’ASTI-Bordeaux). Installée à ses débuts dans le<br />
quartier Notre-Dame Au départ, elle déménage ensuite dans le quartier Saint-Michel à la fin<br />
<strong>des</strong> années soixante-dix, après avoir rejoint la FASTI, fédération créée en 1967. L’essentiel<br />
<strong>des</strong> activités reposait sur les cours d’alphabétisation et visait à permettre la promotion <strong>des</strong><br />
étrangers.<br />
Intérêt du <strong>fonds</strong><br />
Les archives de l’ASTI s’organisent autour de quatre axes principaux : vie interne (réunions,<br />
congrès, …), relations avec d’autres organismes, activités (festivals, cours d’alphabétisation,<br />
…) et comptabilité.<br />
La série concernant les activités permet de retracer les évolutions locales de l’immigration,<br />
tant au niveau de la ville de Bordeaux que de l’Aquitaine, tout en mettant ces évolutions en<br />
perspective sur un plan national, au travers <strong>des</strong> relations de l’ASTI de Bordeaux avec la<br />
FASTI.<br />
A (1 à 9) - Vie Interne. 1968-2000<br />
B (1 à 3) - Relations avec d’autres organismes. 1989-2001<br />
C (1 à 39) - Activités. Années 1970-2000<br />
Dossiers individuels, régularisations, grèves de la faim. 1976-1987<br />
Logement. 1972-1994<br />
Projets et rapports d’activités. 1978-2000<br />
Alphabétisation. 1986-1991<br />
Autres activités. Années 1970-2000<br />
D (1 à 7) - Comptabilité, salariés et gestion du local. 1983-1995
Association <strong>des</strong> Tunisiens de France (ATF)<br />
Dates extrêmes : 1983-1990 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 36 mètres linéaires<br />
Le bureau national constitutif de l’ATF s’est réuni le 17 novembre 1987. Les membres<br />
fondateurs de l’association sont issus en majorité <strong>des</strong> associations de lutte pour les droits<br />
humains en Tunisie (UGET 2 , Collectif du 26 janvier 1978 3 , etc.), <strong>des</strong> comités de soutien aux<br />
luttes <strong>des</strong> travailleurs immigrés (grèves, régularisation <strong>des</strong> sans-papierss, etc.) et <strong>des</strong><br />
mouvements de soutien aux « luttes <strong>des</strong> peuples pour leur libération ».<br />
Intérêt du <strong>fonds</strong><br />
A ses débuts, l’ATF a pour objectif de « veiller aux intérêts matériels et moraux <strong>des</strong> Tunisiens<br />
en France, de sauvegarder leur identité culturelle et de créer pour eux en France une référence<br />
culturelle dont l’absence handicape l’épanouissement de leur personnalité » (statuts, 17<br />
novembre 1981). Afin de mener à bien ses objectifs, l’ATF s’organise en fédération, elle se<br />
compose de 10 sections réparties dans 13 départements : en région parisienne (Paris, Essonne<br />
et Seine-Saint-Denis) et en Rhône-Alpes (Isère et Haute-Savoie), en Gironde (ALIFS,<br />
association du lien interculturel familial et social), dans le Var (ATF-Var et Avenir sportif<br />
toulonnais), le Nord et le Bas-Rhin.<br />
« Comme tous les immigrés, comme toutes les associations issues de l’immigration, les yeux<br />
de l’ATF étaient au début rivés au pays d’origine » 4 . Face à l’évolution du phénomène<br />
migratoire, qui devient une immigration d’installation, les objectifs de l’association se<br />
modifient sensiblement : l’ATF, « association laïque, a pour objet de regrouper les Tunisiens,<br />
les originaires de Tunisie et leurs familles et toute personne adhérant aux présents Statuts,<br />
résident en France » (statuts d’avril 1993). L’association se donne alors comme credo le<br />
travail de proximité, l’égalité <strong>des</strong> droits et l’égalité d’accès aux droits, ainsi que la lutte contre<br />
les discriminations en France et en Europe. Pour cela, elle développe ses activités de<br />
médiation juridique et sociale, ainsi que la médiation interculturelle (avec les soirées « Poésie<br />
<strong>des</strong> deux rives », les semaines culturelles et les expositions, par exemple). Elle met également<br />
en oeuvre <strong>des</strong> actions de solidarités nationales et internationales, notamment envers les pays<br />
du Maghreb.<br />
En outre, consciente de l’importance d’une plus grande coopération entre associations issues<br />
de l’immigration, l’ATF participe à la création du Conseil <strong>des</strong> associations d'immigrés en<br />
France (CAIF) et participe aux tentatives d’organisation <strong>des</strong> associations au niveau européen<br />
(Conseil <strong>des</strong> associations d'immigrés en Europe, Migreurope, Forum <strong>des</strong> migrants). A<br />
l’échelle nationale, l’ATF et la FTCR 5 entreprennent depuis 1985 <strong>des</strong> actions communes afin<br />
2Union générale <strong>des</strong> étudiants tunisiens<br />
3Collectif créé pour la défense <strong>des</strong> prisonniers politiques tunisiens arrêtés le 26 janvier 1978 suite à une grève<br />
générale en Tunisie.<br />
4Cahiers de l’ATF, spécial 20 ans, n°3, novembre 2001<br />
5 Fédération <strong>des</strong> Tunisiens pour une citoyenneté <strong>des</strong> deux rives
de parvenir à la création d’une confédération. L’ATF privilégie donc les échanges interassociatifs,<br />
mais en ne se limitant pas aux seules associations issues de l’immigration.<br />
Le <strong>fonds</strong> de l’ATF se caractérise en outre par une importante documentation sur le SIDA et<br />
sur les actions de prévention/sensibilisation mises en œuvre par l'ATF en direction <strong>des</strong><br />
populations immigrées. L’ATF intervient notamment dans les foyers de travailleurs migrants<br />
et sur les marchés, et les comptes-rendus de ces actions apportent un éclairage original sur un<br />
aspect peu étudiés jusqu’à présent. Outre ces activités de prévention sanitaire et sociale, elle<br />
participe à la réflexion sur la problématique de vieillissement <strong>des</strong> populations immigrées<br />
(habitat, droits sociaux, santé, exclusion, etc.) et propose <strong>des</strong> réponses intermédiaires comme<br />
les centres d’accueil et de loisir pour les migrants âgés.<br />
Archives à consulter<br />
Fonds de la FTCR et de Mme Othmani, archives <strong>des</strong> membres du CAIF.
Association <strong>des</strong> travailleurs maghrébins de France<br />
(ATMF)<br />
Dates extrêmes : 1980-2000(<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 27 mètres linéaires<br />
A l’origine, l'Association <strong>des</strong> travailleurs maghrébins de France (ATMF) faisait partie de<br />
l'Association <strong>des</strong> Marocains en France (AMF), créée en 1961 par <strong>des</strong> militants politiques<br />
appartenant à l’Union nationale <strong>des</strong> forces populaires (UNFP) dont le leader était Medhi<br />
Benbarka.<br />
Dans les années 70, l'AMF se scinde en deux groupes : l’AMF-bureau national et l’AMFcoordination<br />
<strong>des</strong> sections, devenue ensuite l’Association <strong>des</strong> travailleurs marocains de France<br />
(ATMF) en janvier 1982.<br />
Le développement de l'ATMF a été marqué, comme la majorité <strong>des</strong> associations issues de<br />
l'immigration, par le changement du rapport au pays d'origine. Au fil <strong>des</strong> années, il ne s'agit<br />
plus en effet de préparer son devenir "là-bas", mais son statut "ici".<br />
Perspectives de recherche<br />
Les archives de l'ATMF permettent de suivre l’évolution et les activités de l’association et<br />
mettent en perspective les débats qui la traversent comme ses rapports avec les autres<br />
organisations.<br />
Ses activités reflètent la tension qui existe chez les immigrés entre ici et là-bas, entre le désir<br />
de retour "là-bas" et la réalité de l'enracinement "ici". Ainsi, prenant conscience que la vie en<br />
France n'est plus une transition avant le retour "au pays", les membres de l'association<br />
s'engagent de plus en plus dans les luttes citoyennes pour défendre leurs droits. Dans le même<br />
temps, il s'agit de faciliter l'intégration et de tisser <strong>des</strong> liens au sein de la communauté et à<br />
l'extérieur, au travers de cours d'alphabétisation, de permanences d'accueil et d'orientation,<br />
mais aussi d'animations culturelles et sportives. L'enjeu est en effet de faciliter l'intégration<br />
<strong>des</strong> nouveaux résidents, qui ne sont plus "de passage", mais aussi de préserver la richesse de<br />
sa culture d'origine, de la développer dans un autre milieu. L'ATMF a ainsi créé un centre de<br />
documentation et adapté les moussems (fêtes traditionnelles marocaines) en France et en<br />
Europe avec les moussems de l’immigration. S’intégrer « ici » ne signifie pas oublier la<br />
situation « là-bas » : l’ATMF se préoccupe également de la situation <strong>des</strong> droits humains au<br />
Maroc et relaie de nombreuses actions.<br />
L'ATMF est une fédération qui a regroupé une trentaine d'associations départementales,<br />
disparues ou toujours en activité. Elle conserve sur les différentes sections ou antennes <strong>des</strong><br />
dossiers permettant de saisir les diversités locales et les réponses apportées aux problèmes<br />
spécifiques qui peuvent surgir.<br />
En outre, conscientes du caractère définitif de l'installation en France, les associations<br />
d'immigrés s'organisent pour la défense de leurs droits, notamment dans un cadre plus général<br />
européen. C'est ainsi que sont nés la Conseil <strong>des</strong> associations d'immigrés en France (CAIF),
puis la Coordination <strong>des</strong> associations démocratiques immigrées marocaines en Europe<br />
(CADIME) et le Forum <strong>des</strong> migrants de la communauté européenne.<br />
Sources annexes<br />
On consultera avec profit les archives <strong>des</strong> associations co-fondatrices avec l'ATMF <strong>des</strong><br />
coordinations et collectifs auxquels elle a appartenu ou appartient encore : par exemple le<br />
collectif « Mémoire fertile » qui a cessé toute activité et dont les archives sont dispersées dans<br />
les <strong>fonds</strong> <strong>des</strong> associations fondatrices.<br />
D'autre part, une partie <strong>des</strong> archives de M. Abdallah Zniber, déposées à <strong>Génériques</strong> à la fin de<br />
l'année 2002, porte sur l'ATMF. M. Zniber a en effet été membre de l'ATMF et chargé de<br />
mission au centre de documentation culturelle de 1990 à 1991.
Collectif <strong>des</strong> accidentés du travail, handicapés et<br />
retraités pour l’égalité <strong>des</strong> droits (CATRED)<br />
Dates extrêmes : 1985-2005 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 26 mètres linéaires<br />
Le Collectif <strong>des</strong> accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité <strong>des</strong> droits<br />
(CATRED) a été fondé en 1985, « sur le vide juridique, né de la présence de travailleurs<br />
migrants sur le territoire français, qui se trouvaient dans l’incapacité temporaire ou définitive<br />
de travailler (handicapés, invali<strong>des</strong>, chômeurs de longue durée, …) » (« Des droits à votre<br />
portée », CATRED, octobre 2001) . Les activités du CATRED s’orientent autour de deux<br />
axes principaux : d’une part, l’information et l’accompagnement <strong>des</strong> travailleurs accidentés<br />
du travail, handicapés, retraités et de leur famille afin de permettre l’accès aux droits, d’autre<br />
part un travail sur les jurisprudences afin de garantir une égalité <strong>des</strong> droits sans distinction de<br />
nationalité.<br />
Le principal champ d’action du CATRED est la protection sociale, avec pour prolongement le<br />
séjour et le logement, pour les personnes invali<strong>des</strong> et handicapées.<br />
Etat du <strong>fonds</strong><br />
Ce <strong>fonds</strong> de 240 cartons est essentiellement composé de dossiers individuels (186 cartons),<br />
archivés au sous-sol. Chaque carton contient entre 10 et 20 dossiers individuels, composés<br />
d’originaux ou de photocopies <strong>des</strong> papiers d’identité <strong>des</strong> usagers, <strong>des</strong> notifications <strong>des</strong><br />
décisions du tribunal <strong>des</strong> affaires de sécurité sociale, de la correspondance échangée avec les<br />
caisses d’assurances sociales, tribunaux, etc.<br />
Les dossiers sont parfois partagés entre ceux « gagnés », pour les affaires résolues et dont le<br />
dossier devient inactif, et ceux « archivés », c’est-à-dire classés sans suite. Les dossiers <strong>des</strong><br />
anciens combattants concernent principalement les deman<strong>des</strong> de « décristallisation » et de<br />
revalorisation de la pension militaire d’invalidité. Il est également à signaler que, suite à la<br />
fermeture d’Accueil et promotion, une partie <strong>des</strong> dossiers individuels constitués par cette<br />
association par ont été rapatriés au CATRED à la fin <strong>des</strong> années 1990.<br />
1- Vie interne (9 cartons). 1985-2005<br />
2- Activités (7 cartons). 1988-2005<br />
3- Partenaires (6 cartons). 1996-2005<br />
4- Comptabilité et personnel (24 cartons). 1987-2005<br />
5- Documentation (5 cartons). 1995-2005<br />
6- Cahiers <strong>des</strong> permanences et correspondance (3 cartons). 1987-2003<br />
7- Dossiers <strong>des</strong> usagers (186 cartons). 1993-2003
Logement (17 cartons). 1998-2002<br />
Protection sociale (85 cartons). 1993-2003<br />
Séjour (73 cartons). 1996-2003<br />
Dossiers individuels divers (6 cartons). 1996-2003<br />
Feuilles individuelles de renseignement (3 cartons). 1996-1998<br />
Anciens combattants (2 cartons). 2002
Centre pour la communication et la formation dans<br />
l’espace local (CCFEL)<br />
Dates extrêmes : 1988-2003 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 25 mètres linéaires<br />
Le Centre pour la communication et la formation dans l’espace local (CCFEL) est en 1988<br />
par Karim Abboub, souvent décrit comme un « psychanalyste <strong>des</strong> banlieues ». L’équipe<br />
d’animateurs qu’il réunie se déplace dans les cités de Seine-saint-Denis grâce au<br />
« préserv’bus », un bus équipé pour se rendre dans les banlieues, afin de renouer le dialogue<br />
avec les toxicomanes.<br />
Le CCFEL distribue <strong>des</strong> kits de prévention (seringue, eau de javel, préservatif), écoute et<br />
oriente. Des fiches d’intervention décrivent les actions menées dans les cités de Seine-et-<br />
Marne (Chelles) et de Seine-saint-Denis, à Bondy, Pantin (cité <strong>des</strong> Courtillères), Clichy,<br />
Villemonble (cité <strong>des</strong> Marnau<strong>des</strong>), Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Coubron, Noisy-le-Sec<br />
(cité du Londeau), Villepinte. En parallèle, l’association intervient régulièrement auprès<br />
d’établissements scolaires, d’organismes et d’associations afin de sensibiliser et/ou former,<br />
principalement sur la toxicomanie et le Sida, mais également sur le travail en réseau, un <strong>des</strong><br />
axes majeurs de réflexion du CCFEL. En outre, au travers <strong>des</strong> rapports d’activité et <strong>des</strong><br />
dossiers de partenariat se <strong>des</strong>sinent les évolutions <strong>des</strong> politiques locales de prévention,<br />
l’implication <strong>des</strong> pouvoirs publics et l’émergence (ou non) d’un travail en réseau.<br />
Etat du <strong>fonds</strong><br />
Les 25 mètres linéaires d’archives du CCFEL retracent l’histoire de l’association depuis sa<br />
création en 1988 jusqu’à sa disparition en 2003. Le <strong>fonds</strong> se compose essentiellement de<br />
rapports d’activités et de dossiers documentaires constitués sur la toxicomanie et le Sida. A<br />
noter que certaines fiches d’intervention, ainsi que quelques autres documents, ne sont pas<br />
systématiquement datés (nd).
A – Vie Interne (5 cartons). 1992-1998<br />
B- Activités (42 cartons). 1988-2003<br />
Actions de terrain (6 cartons). 1995-1998<br />
Rapports d’activités (26 cartons). 1988-2003<br />
Formation (10 cartons). 1988-2003<br />
C- Documentation (50 cartons). 1986-2000<br />
D- Relations avec d’autres organismes (14 cartons). 1990-2000<br />
E- Correspondance (9 cartons). 1995-1998<br />
F- Salariés et comptabilité (4 cartons). 1992-199
Centre France-Asie<br />
Dates extrêmes : 1954-2003 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 21 mètres linéaires<br />
Le Centre France-Asie a été fondé par Mgr de Guébriant au début du 20 e siècle. Mgr de<br />
Guébriant a été missionnaire, vicaire apostolique au Setchuan, puis vicaire apostolique de<br />
Canton, avant d’être nommé supérieur général de la société <strong>des</strong> Missions étrangères de Paris.<br />
Il se trouvait en Chine en 1919 pour une visite officielle de toutes les missions catholiques, à<br />
la demande du Vatican, lorsqu’il prit conscience de l’importance de former « les nouveaux<br />
cadres et les élites de la Chine nouvelle » (rapport d’assemblée générale, 1979). Il fait donc<br />
venir à Paris en 1920 le père Lebbe et quatre jeunes étudiants chinois.<br />
Accueilli dans une école à Paris, le père Lebbe crée une « amicale <strong>des</strong> étudiants libres » et<br />
ouvre en 1922 un foyer à Bécon-les-Bruyères. En 1923 il lance l’Association catholique de la<br />
jeunesse chinoise, qui publie un « Bulletin de la jeunesse chinoise ».<br />
En 1925, avec le soutien de Rome, Mgr Guébriant envoie le père Mollet à Bourg-la-Reine<br />
afin de fonder le « foyer <strong>des</strong> étudiants d’extrême-Orient ». Ce foyer comptait une quarantaine<br />
de lits et était ouvert aux étudiants chinois et japonais. Après guerre, de nombreux réfugiés<br />
chinois arrivent en France, suivis par ceux en provenance de l’ancienne Indochine. Le foyer<br />
étend donc ses activités au service de tous les asiatiques. En 1975, l’association modifie ses<br />
statuts afin de pouvoir s’adapter à cette nouvelle situation et le « Foyer <strong>des</strong> étudiants<br />
d’extrême-Orient » devient le Centre France-Asie.<br />
Aujourd’hui, le CFA accueil à pour mission d’accueillir les étudiants asiatiques, en leur<br />
dispensant <strong>des</strong> cours de langue et une aide administrative.<br />
Etat du <strong>fonds</strong><br />
Les archives les plus anciennes conservées au siège datent de 1954 et se composent pour<br />
l’essentiel de dossiers d’étudiants, classés par pays d’origine. Outre ces 12 mètres linéaires de<br />
dossiers individuels, les archives comprennent également 9 mètres linéaires d’archives de<br />
fonctionnement dont les comptes-rendus de réunions (assemblées générales, conseil<br />
d’administration, …) et la comptabilité constituent l’essentiel.<br />
Vie interne (9 cartons). 1954-1999<br />
Cours de langue (34 cartons et 12 mètres linéaires de fiches). 1974-2003<br />
Dossiers individuels (12 mètres linéaires de fiches). 1985-2000<br />
Boursiers (23 cartons). 1979-2003<br />
Rapports et divers (11 cartons). 1974-1994
Comité de liaison pour la promotion <strong>des</strong> migrants et<br />
<strong>des</strong> publics en difficulté d’insertion (CLP)<br />
Dates extrêmes : années 1970- 2000 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 77 mètres linéaires<br />
Créé en 1980, le Comité de liaison pour la promotion <strong>des</strong> migrants et <strong>des</strong> publics en difficulté<br />
d’insertion (CLP) est une association regroupant un réseau national de 80 organismes de<br />
formation. Celui-ci intervient dans le champ de la formation et de l’insertion <strong>des</strong> publics en<br />
difficulté.<br />
Le CLP a pour objectif l’élaboration de politiques de formation et d’actions innovantes, la<br />
professionnalisation <strong>des</strong> acteurs et le développement de partenariat. A cette fin, il organise<br />
<strong>des</strong> rencontres entre les différents acteurs, formalise et capitalise les expériences du réseau<br />
sous forme de publications et anime un conseil technique et pédagogique. Il gère par ailleurs<br />
la diffusion de l’information à travers une mission de veille informatique et de documentation<br />
permanente.<br />
Intérêt du <strong>fonds</strong><br />
C’est en 1919, via la loi Astier, que L’Etat français commence à se soucier de la formation<br />
professionnelle. Celle-ci institue <strong>des</strong> cours obligatoires pour les apprentis et <strong>des</strong> cours de<br />
perfectionnement facultatifs pour les salariés. « Mais c’est surtout au cours <strong>des</strong> années 1950-<br />
1960 que se construisent les principes modernes d’intervention de l’Etat. (…) La création en<br />
1949 de l’Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main<br />
d’œuvre (ANIFRMO), qui deviendra l’Association pour la formation professionnelle <strong>des</strong><br />
adultes (AFPA), donne à l’Etat <strong>des</strong> moyens directs d’intervention pour développer la<br />
qualification <strong>des</strong> personnes dont la nation a besoin pour assurer la reconstruction du pays. » 6<br />
A la même période, l’alphabétisation <strong>des</strong> migrants commence à entrer dans le champ <strong>des</strong><br />
revendications <strong>des</strong> syndicats, avec la mise en place, par exemple, de cours du soir en 1963 par<br />
la CGT. Les actions en matière d’alphabétisation sont essentiellement menées par <strong>des</strong><br />
bénévoles issus <strong>des</strong> milieux militants chrétiens, syndicaux ou laïques (<strong>des</strong> instituteurs). Au<br />
début <strong>des</strong> années 1980, conséquence de la crise économique, les besoins en matière de<br />
formation <strong>des</strong> migrants évoluent : un virage de l’alphabétisation vers la préformation s’opère.<br />
L’AFPA n’est pas adaptée aux besoins <strong>des</strong> bas niveaux de qualification (BNQ), constitués de<br />
migrants, qui sont les premières victimes de cette crise. Auparavant, les tâches qui leur étaient<br />
assignées ne nécessitaient pas de formation préalable et, excepté le milieu militant, peu se<br />
souciaient de leur intégration et de leur promotion professionnelle. Mais ce nouveau contexte<br />
économique éclaire d’un jour nouveau leurs besoins en matière de formation, besoins<br />
auxquels la préformation professionnelle doit répondre en permettant aux travailleurs<br />
6 Lindeperg G., Les Acteurs de la Formation professionnelle : pour une nouvelle donne, Rapport au Premier<br />
ministre, septembre 1999
immigrés d’entrer dans <strong>des</strong> cursus de qualification. Il faut alors tout construire, car il n’y a ni<br />
outils pédagogiques ni cadre professionnel pour les formateurs<br />
Au côté du Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP), fondé en 1968 et<br />
chargé principalement de l’alphabétisation et de la formation linguistique de base, se crée en<br />
1980 une association plus centrée sur la préformation professionnelle : le Comité de liaison<br />
pour la préformation <strong>des</strong> migrants (CLP), qui deviendra ensuite le Comité de liaison pour la<br />
promotion <strong>des</strong> migrants et <strong>des</strong> publics en difficulté d’insertion. Cet organisme regroupe de<br />
nombreuses associations qui se sont rencontrées lors d’assemblées tenues à la fin <strong>des</strong> années<br />
1970 à Metz (1976), Dunkerque (1978), Reims (1979) et Dijon (1980). Elles se sont fédérées<br />
afin de faire valoir auprès <strong>des</strong> pouvoirs publics leurs besoins, mais également afin de se faire<br />
reconnaître en tant que professionnels. Le CLP travaille alors autour de ce nouveau concept<br />
de préformation. Il a pour mission d’équiper les membres du réseau en outils pédagogiques,<br />
de répondre aux appels d’offre <strong>des</strong> pouvoirs publics et au besoin de qualification<br />
professionnelle <strong>des</strong> formateurs.<br />
Les archives du CLP retracent l’histoire de la formation <strong>des</strong> migrants depuis la fin <strong>des</strong> années<br />
1970 avec les premières rencontres inter-organisations (RIO) (Metz, 1976), où la question de<br />
l’alphabétisation était prédominante, jusqu’aux années 2000, où le concept de préformation<br />
<strong>des</strong> migrants a cédé la place à celui de la réinsertion et de l’aide aux publics en difficulté. Ces<br />
archives sont une source précieuse pour retracer ces évolutions : les bilans financiers<br />
témoignent de l’engagement <strong>des</strong> pouvoirs publics et de ses priorités. Quant aux comptesrendus<br />
<strong>des</strong> RIO, ils reflètent parfaitement les interrogations <strong>des</strong> associations d’alphabétisation<br />
et de formation. Les fichiers <strong>des</strong> adhérents constituent également une source à ne pas négliger,<br />
car ils renseignent sur le dynamisme associatif à l’échelle nationale et sur l’évolution du<br />
réseau du CLP. Ces fichiers étant parfois constitués de dossiers sur les activités de<br />
l’association adhérente, ils permettent de retracer l’histoire d’associations aujourd’hui<br />
disparues. Retracer celle d’associations telles que le CLP, le CLAP ou, avant elles, l’Amicale<br />
pour l’enseignement <strong>des</strong> étrangers (AEE) et le collectif <strong>des</strong> 45 7 permettrait de jeter les<br />
premiers jalons de l’histoire de la formation <strong>des</strong> migrants.<br />
Etat du <strong>fonds</strong><br />
Le CLP conserve environ 77 mètres linéaires d’archives, depuis les années 1970 jusqu’à nos<br />
jours. Nous avons dressé un état du <strong>fonds</strong>, par échantillonnage, en indiquant les cotes et dates<br />
extrêmes de chaque série et sous-série, ainsi que le détail de certains cartons, entre crochets.<br />
A (1 – 73). Vie interne. 1980-2002<br />
Assemblées générales et conseil d’administration.<br />
Adhérents et cotisation.<br />
B (1 – 96). Comptabilité et personnel. 1980-2002<br />
Bilans annuels, dossiers du personnel.<br />
Conventions.<br />
C (1-21). Rencontres et colloques. 1987-1996<br />
7 collectif regroupant 45 associations, dont le CLAP et l’Association pour l’enseignement et la formation <strong>des</strong><br />
travailleurs migrants (AEFTI).
Conseil technique et pédagogique, rencontres inter-associatives.<br />
Echanges avec le FAS.<br />
D (1-30). Rencontres inter-organisations (RIO). 1976-1995<br />
E (1-33). Formation de formateur. 1977-1997<br />
F (1-113). Programmes d’activités, partenariat. 1975-2001<br />
G (1-78). Diffusion de l’information. Années 1980-1990<br />
Archives du service documentation.<br />
Documentation et archives du CLAP.<br />
H (1-32). Publications du CLP. Années 1980-1990
Coordination pour le droit <strong>des</strong> étranges à vivre en<br />
famille<br />
Dates extrêmes : 1993-2003 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 7 mètres linéaires<br />
Créée en 1994 pour animer <strong>des</strong> campagnes d’information et produire toutes initiatives en<br />
faveur du droit de vivre en famille <strong>des</strong> étrangers ressortissants <strong>des</strong> pays tiers résidant dans un<br />
<strong>des</strong> états de l’Union européenne. »<br />
La Cimade, le CCFD, le GISTI, le CIEMI et le forum <strong>des</strong> migrants ont fait partie <strong>des</strong><br />
associations fondatrices, et nous pouvons retrouver <strong>des</strong> traces <strong>des</strong> activités de la coordination<br />
européenne dans les archives de ces différents organismes.
Fédération <strong>des</strong> Tunisiens pour une citoyenneté <strong>des</strong><br />
deux rives (FTCR)<br />
Dates extrêmes : 1970-1999 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 20 mètres linéaires<br />
Le 14 février 1974 a lieu l’assemblée générale (AG) constitutive de l’UTIT. Cette AG fait<br />
suite à trois mois de discussions marquées par les premières mesures anti-immigration et par<br />
le bilan de l’action du MTA (mouvement <strong>des</strong> travailleurs arabes).<br />
A ses débuts, la question syndicale est une <strong>des</strong> activités principales de l’UTIT, à laquelle vient<br />
s’ajouter progressivement l’ouverture vers les questions posées par l’immigration. Elle est<br />
ainsi de plus en plus active sur les questions <strong>des</strong> sans-papiers et organise ou co-organise de<br />
nombreuses grèves de la faim. Dès 1974 l’UTIT publie un bulletin d’information, El-Ittihad.<br />
L'UTIT devient la fédération <strong>des</strong> Tunisiens pour une citoyenneté <strong>des</strong> deux rives (FTCR) le 19<br />
février 1994.<br />
État du <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
Le fond a été classé selon le plan établi après la reconnaissance du <strong>fonds</strong>. Le premier<br />
versement, constitué en majorité par les archives les plus anciennes, a été entièrement classé,<br />
et la seconde moitié a fait l'objet d'un inventaire sommaire.
Interaction France-Portugal<br />
Dates extrêmes : années 1970 – 2000 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 3 mètres linéaires<br />
L’idée d’une association franco-portugaise a germé dans l’esprit de Hugues et Béatrice de<br />
Varine lors de leur arrivée au Portugal en 1982. M. de Varine avait été affecté au Portugal en<br />
tant que directeur de l’Institut franco-portugais de Lisbonne et voulait créer une association<br />
qui complèterait le travail effectué par l’Institut. Interacção França-Portugal est alors créée<br />
en 1983 au Portugal et son action sera prolongée en France à partir de 1985 avec Interaction<br />
France-Portugal. Les activités de l’association consistent principalement en l’organisation de<br />
stages, voyages éducatifs ou professionnels, conférences et colloques, aide à la gestion<br />
d'entreprises. Elle s'est particulièrement intéressée aux thèmes suivants:<br />
• équivalences <strong>des</strong> diplômes ;<br />
• coopération entre services sociaux ;<br />
• problèmes rencontrés par les familles portugaises en émigration et de retour au pays ;<br />
• retour <strong>des</strong> jeunes adultes au pays d'origine ;<br />
• formation d'agents de développement local (projet JADE) ;<br />
• promotion et commercialisation de l'artisanat ;<br />
• vieillissement <strong>des</strong> portugais de France.<br />
L'association était composée de Portugais et de Français de toutes origines sociales et<br />
professionnelles. Elle n'a eu qu'épisodiquement une salariée à temps partiel.<br />
Ses publications incluent trois ouvrages, actes de ses colloques, un bulletin trimestriel devenu<br />
au cours <strong>des</strong> années une lettre d'information, une collaboration à la revue interculturelle<br />
"Latitu<strong>des</strong>".<br />
Le financement de l'association, toujours précaire, provenait essentiellement du Fonds<br />
d’Action Sociale (FAS), du Secrétariat d'Etat portugais aux communautés, de l'UNESCO et<br />
de la Commission Européenne.<br />
L'association a suspendu ses activités en 2002.<br />
Etat du fond et condition de consultation<br />
Ce <strong>fonds</strong> a été déposé à <strong>Génériques</strong> par Mme et M. de Varine. Les archives de Interacção<br />
França-Portugal se trouvent au Portugal, elles seront déposées auprès d'un centre d'archives<br />
de l'émigration en cours de création. Il sera donc possible dans l’avenir de consulter ce <strong>fonds</strong><br />
comme source annexe.
Maison <strong>des</strong> femmes, Archives recherches et cultures<br />
lesbiennes (ARCL) et Réseau pour l'autonomie <strong>des</strong><br />
femmes immigrées et réfugiées (RAJFIRE)<br />
Dates extrêmes : années 1970- 2000 (<strong>fonds</strong> ouverts)<br />
Volume : 77 mètres linéaires<br />
Cette association féministe créée en 1981 possède un centre de documentation et d'archives<br />
sur les mouvements féministes. « Le centre de documentation de la Maison <strong>des</strong> femmes de<br />
Paris est constitué d'un <strong>fonds</strong> documentaire féministe pluriel, national et international, collecté<br />
<strong>des</strong> années 1970 à nos jours. L'ensemble de ces ressources provient d'associations de femmes,<br />
d'associations féministes et/ou lesbiennes, de groupes politiques, d'archives personnelles, ou<br />
encore d'institutions (ministère ou service du droits <strong>des</strong> femmes, Parlement européen, etc.). Il<br />
comprend deux <strong>fonds</strong> principaux : celui de la Maison <strong>des</strong> femmes proprement dit, et celui <strong>des</strong><br />
Archives recherches et cultures lesbiennes (ARCL). »<br />
Intérêt <strong>des</strong> <strong>fonds</strong><br />
Les femmes ont toujours représenté une part importante de la population migrante, oscillant<br />
entre 149 hommes pour 100 femmes en 1931, époque où les hommes ont été les plus<br />
nombreux, et 108 hommes pour 100 femmes en 1990. Toujours présentes et cependant<br />
invisibles, elles ont du mal à lutter contre l'archétype de l'homme migrant célibataire. Quasi<br />
absentes de l'espace social et du champ intellectuel de la recherche, elles acquièrent une<br />
visibilité progressive depuis les années 1970, mais elles sont alors perçues comme pauvres,<br />
analphabètes et dépendantes de leur mari.<br />
Les visages <strong>des</strong> migrantes sont multiples, mais, à <strong>des</strong> degrés divers, elles doivent lutter contre<br />
une « imbrication de dominations : de genre, de classe et d'ethnicité » (Laure Teulières 8 ). En<br />
outre, si la situation <strong>des</strong> femmes et <strong>des</strong> hommes immigrés est égale face à la législation<br />
française, celle-ci entérine, voire aggrave, les situations de dépendance en définissant la place<br />
<strong>des</strong> migrantes uniquement dans le cadre familial (par exemple, la carte de séjour n'est pas<br />
renouvelée en cas de séparation). D'autre part, ce ne sont pas les lois françaises qui<br />
s'appliquent en matière de statut matrimonial, mais celles du pays d’origine, en vertu <strong>des</strong><br />
conventions bilatérales passées entre la France et celui-ci.<br />
Actrices ou victimes, sujets ou objets, la représentation <strong>des</strong> immigrées évolue peu à peu et les<br />
archives de la Maison <strong>des</strong> femmes apportent un élément qui fait souvent défaut : celui de la<br />
voix <strong>des</strong> immigrées elles-mêmes. Ces voix de femmes, d'ici ou d'ailleurs, nous disent le<br />
quotidien <strong>des</strong> immigrées, leurs interrogations et leurs combats, leurs passions aussi.<br />
8 in Femmes étrangères et immigrées en France, colloque, Assemblée nationale, 3 juin 2000
Femmes d'ailleurs … et d'ici, car il ne faut pas oublier le rôle <strong>des</strong> solidarités féminines,<br />
comme l'illustrent les exemples du Service social d’aide aux émigrants (SSAE) et de la<br />
Cimade, associations d'aide aux migrants toutes deux fondées par <strong>des</strong> femmes 9 . Les archives<br />
de ces deux associations, ainsi que celles <strong>des</strong> associations de femmes immigrées ou<br />
d'immigrés possédant une section femmes, sont un nécessaire complément aux <strong>fonds</strong> de la<br />
Maison <strong>des</strong> femmes.<br />
État du <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
Il n’existe pas d’instrument de recherche du <strong>fonds</strong>, mais les 70 mètres linéaires d'archives sont<br />
bien classés, par thèmes et chronologiquement. Notre rôle a consisté à réaliser un état <strong>des</strong><br />
<strong>fonds</strong> et à mettre en exergue ce qui concerne l'immigration.<br />
Fonds de la Maison <strong>des</strong> Femmes et de l’ARCL<br />
Le <strong>fonds</strong> se compose de dossiers documentaires et thématiques. Quand le nombre de cartons<br />
(c) n'est pas indiqué, il s'agit d'un carton unique. Certains cartons concernent spécifiquement<br />
l’immigration, mais <strong>des</strong> dossiers plus généraux, tels ceux sur le travail par exemple,<br />
contiennent bien sûr <strong>des</strong> informations sur l'immigration.<br />
Les parties numérotées I et II sont les archives constituées par la maison <strong>des</strong> femmes, et celles<br />
numérotées II, III et IV sont celles de l’ARCL.<br />
Les archives s'articulent autour de 6 axes :<br />
- Travail<br />
- Réfugiées<br />
- Violence<br />
- Racisme<br />
- Réflexion sur les luttes contre le sexisme et le sexisme<br />
- Associations : activités, réseaux, publications, productions culturelles<br />
Fonds d’autres associations<br />
La Maison <strong>des</strong> femmes recueille aussi <strong>des</strong> archives d’associations ayant cessé leurs activités,<br />
comme celles de l’Agence Femme Information, agence de presse créée dans les années 1980.<br />
Ces archives sont regroupées dans le couloir extérieur au local archives et sont conservées<br />
avec d’autres <strong>fonds</strong> non classés.<br />
Fonds du RAJFIRE<br />
Claudie Lesselier, membre du Réseau pour l'autonomie <strong>des</strong> femmes immigrées et réfugiées<br />
(RAJFIRE), a établi une liste <strong>des</strong> associations d'immigrées existantes ou ayant existé. Elle a<br />
en outre participé à la rédaction de Femmes étrangères et immigrées en France, actes du<br />
colloque organisé par le Comité de suivi <strong>des</strong> lois sur l'immigration, Assemblée nationale,<br />
2000.<br />
9 Se reporter aux inventaires du SSAE et de la Cimade, consultables sur notre site.
Elle a en outre regroupé par ordre chronologique <strong>des</strong> brochures, <strong>des</strong> tracts et <strong>des</strong> coupures de<br />
presse, stockés dans six classeurs intitulés "femmes, immigration" (1976-2000), organisés par<br />
thèmes et associations.
Association franco-chinoise Pierre Ducerf<br />
Dates extrêmes : 1993- 2003 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 7 mètres linéaires<br />
L’association franco-chinoise Pierre Ducerf a été fondée en 1993 afin de créer <strong>des</strong> passerelles<br />
entre les populations chinoise et française en France. Les activités de l’association ont donc<br />
pour objectif de favoriser la rencontre et l’échange, à travers <strong>des</strong> actions franco-chinoises<br />
(cuisine chinoise, nouvel an chinois, calligraphie) et auprès <strong>des</strong> familles et <strong>des</strong> jeunes chinois<br />
(cours de langue et soutien scolaire, permanence juridique). Sensible aux difficultés<br />
rencontrées par les jeunes chinois de la deuxième génération, l’association organise pour eux<br />
<strong>des</strong> activités sportives et <strong>des</strong> ateliers informatique.<br />
Présentation du <strong>fonds</strong><br />
Le <strong>fonds</strong> se divise en trois parties :<br />
1- Archives du fonctionnement de l’association.<br />
2- Fonds Véronique Poisson : documentation et travaux recueillis dans le cadre de son<br />
doctorat sur « L’émigration chinoise en France, 1890-1960 » (sur les frontières, culturelles et<br />
géographiques, dans l’espace de la diaspora chinoise, surtout de la frontière interne Fujian/<br />
Zhejiang, EHESS, sous la direction de Nancy Green).<br />
3- Documentation, dont une partie a été recueillie à l’occasion <strong>des</strong> travaux de Mme Poisson :<br />
Documentation FLE (français langue étrangère), documentation sur la Chine (romans, gui<strong>des</strong><br />
touristiques, etc.)<br />
Histoire locale <strong>des</strong> régions d’origine <strong>des</strong> immigrés chinois, coupures de presse, diapos et<br />
photos prises en France et en Chine, entretiens et transcription de Chinois retournés en Chine<br />
(archives rassemblées dans le cadre du doctorat de Mme Poisson).
Troisième collectif de sans-papiers<br />
Dates extrêmes : 1996- 2003 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 5 mètres linéaires<br />
Le Troisième collectif de sans-papiers a été créé en août 1996, par <strong>des</strong> sans-papiers qui se<br />
sont présentés aux collectifs de la rue Pajol et de l’église St Bernard et à qui ces derniers ont<br />
conseillés de former un nouveau collectif. Le 3 e collectif se constitue alors et tient sa première<br />
assemblée générale le 17 août 1996.<br />
Le collectif représente environ un millier de personnes, de 27 nationalités différentes, avec<br />
une majorité de personnes originaires de Chine et de Turquie. Il a désigné pour le représenter<br />
une quinzaine de délégués, assistés d’un groupe de soutien composé d’individus et<br />
d’associations (Association <strong>des</strong> Travailleurs Maghrébins de France, Associations <strong>des</strong><br />
Tunisiens de France, Association <strong>des</strong> Travailleurs de Turquie, Ligue <strong>des</strong> Droits de l’Homme,<br />
Collectif « Des papiers pour tous », CNT, etc.). Le collectif appartient aux coordinations<br />
régionale et nationale <strong>des</strong> collectifs de sans-papiers. Il a pour but la régularisation globale de<br />
tous les sans-papiers et l’abrogation <strong>des</strong> lois défavorables au séjour <strong>des</strong> étrangers. Il assure<br />
également au quotidien la défense de ses membres face à la justice et à la police et aide à la<br />
constitution de dossier de régularisation.<br />
La première action de grande ampleur organisée par le Troisième collectif a lieu le 12<br />
septembre 1996 avec l’occupation du centre de réception <strong>des</strong> étrangers de la Préfecture de<br />
police de Paris (rue d’Aubervilliers, 19 e arrondissement). Le sous-directeur de la police<br />
générale, reçoit alors une délégation et suggère que le collectif lui soumette par écrit <strong>des</strong><br />
propositions de régularisation et une méthode de travail pour l’étude <strong>des</strong> dossiers. Puis, le 22<br />
février 1997, le 3 e collectif occupe l’église St Jean-Baptiste de Belleville (Paris, 20 e ), évacuée<br />
par la police le lendemain matin. Le 16 mai 1998, plus d’une centaine de sans-papiers<br />
occupent la Mission évangélique (Paris, 15 e ) avec l’accord de l’Eglise protestante. Le 31 mai<br />
1998, ils occupent le temple de Béthanie (Paris, 20 e ), puis le temple <strong>des</strong> Batignolles (Paris,<br />
17 e ) le 14 juin 1998 où ils mènent une grève de la faim du 16 juin au 16 juillet 1998.<br />
Sans-papiers, mais pas sans histoire<br />
La lutte du Troisième collectif est l’héritière <strong>des</strong> luttes passées <strong>des</strong> sans-papiers. L’histoire du<br />
Troisième collectif se situe dans la continuité <strong>des</strong> grèves de la faim <strong>des</strong> années 70, qui ont vu<br />
les premières mobilisations <strong>des</strong> sans-papiers contre les circulaires Fontanet-Marcellin en<br />
1972-73. En 1980, ce sont les Turcs travaillant dans la confection qui se mobilisent, puis en<br />
1991-1995 les déboutés du droit d’asile et les candidats au droit de vivre en famille.<br />
Comme le souligne Catherine Wihtol de Wenden 10 , la mobilisation <strong>des</strong> sans-papiers du<br />
Troisième collectif utilise <strong>des</strong> ressources traditionnelles (Eglise, intellectuels) et nouvelles<br />
(artistes, réseaux internationaux de solidarité), ainsi que <strong>des</strong> formes de médiatisation peu<br />
utilisées jusque là par les mouvements de sans-papiers (appel aux médias, recours à <strong>des</strong><br />
médiateurs, solidarités festives, sites web).<br />
10 « Comment les papiers ou leur absence façonnent les statuts et les identités », pp. 6-8, Ecarts d’identité, n°93,<br />
automne 2000
Qu’est-ce qu’un sans-papier ?<br />
Ce terme ne désigne pas une catégorie juridique, il a été introduit par <strong>des</strong> militants puis il est<br />
passé dans le vocabulaire commun. Il regroupe les étrangers en situation irrégulière, c’est-àdire<br />
qui ne possèdent pas les titres de séjour nécessaires à leur résidence en France. Ce sont<br />
<strong>des</strong> étrangers, donc sans droits politiques et qui n’ont pas les inscriptions et enregistrements<br />
légaux demandés aux étrangers venant résider en France. Ils sont donc exclus du politique et<br />
du juridique, ils sont sans droit, ce qui les expose aux sanctions <strong>des</strong> tribunaux administratifs,<br />
qui juge les irrégularités de séjour. Les sans-papiers peuvent tomber sous le coup d’une<br />
injonction à quitter la France (IQF) ou d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière<br />
(APRF).<br />
Un étranger peut devenir sans-papier après être entré en France sans visa, s’il demeure en<br />
France malgré un refus d’asile politique, à la suite de l’expiration d’un visa de court séjour ou<br />
à cause du non-renouvellement d’une carte de séjour (suite aux lois Pasqua notamment). Les<br />
sans-papiers ne sont pas <strong>des</strong> clan<strong>des</strong>tins, car la majorité d’entre eux ne sont pas entrés<br />
clan<strong>des</strong>tinement et ne vivent pas clan<strong>des</strong>tinement en France (ils ont un domicile, leurs enfants<br />
sont inscrits à l’école, etc.).<br />
Etat du <strong>fonds</strong><br />
Ce <strong>fonds</strong> est composé par les dossiers individuels de sans-papiers et documents de travail <strong>des</strong><br />
membres du 3 e collectif de sans-papiers. Les <strong>fonds</strong> sont pour le moment inventoriés par<br />
dépositaire.<br />
Dépositaire : M. Terray<br />
Emmanuel Terray est anthropologue et directeur d'étu<strong>des</strong> à l'EHESS (Ecole <strong>des</strong> hautes étu<strong>des</strong><br />
en sciences sociales). Il a été animateur du « troisième collectif » et ancien gréviste de la faim.<br />
<strong>Génériques</strong> à reçu son <strong>fonds</strong> en dépôt au printemps 2003.<br />
Ce <strong>fonds</strong> se compose de 17 cartons constitués de documents produits par le 3 e collectif<br />
(journaux, comptes-rendus, tracts, etc.) et de documentation sur les sans-papiers (journaux,<br />
coupures de presse).<br />
Dépositaire : Mme Elisabeth Allès<br />
Chercheuse à l'EHESS et sinophone, Mme Elisabeth Allès a contribué a fédéré les sanspapiers<br />
Chinois. C'est dans le cadre de ses activités en tant qu'animatrice du 3 e collectif <strong>des</strong><br />
sans-papiers, créé suite à l'occupation de l'église de St Ambroise en mars 1996, qu'elle a remis<br />
son <strong>fonds</strong> à <strong>Génériques</strong>.<br />
Ce <strong>fonds</strong> de 32 cartons, soit environ 4 mètres linéaires, est constitué presque exclusivement de<br />
dossiers individuels de sans-papiers constitués entre août 1996 et 1999. Les dossiers, dont<br />
certains ont souffert de l'humidité, ont été reconditionnés par ordre alphabétique.<br />
Venant s'ajouter aux autres <strong>fonds</strong> ayant trait au 3 e collectif, le fond Allès permet d'effectuer<br />
<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de trajectoires de sans-papiers. Chaque dossier comporte en effet <strong>des</strong><br />
renseignements précis sur les sans-papiers. Les dossiers individuels comporte une fiche de<br />
renseignement, établie au collectif. Elle comporte l'état civil du demandeur et,
éventuellement, de sa conjointe 11 . Cette fiche comporte également la date d'entrée en France<br />
et la date du mariage ainsi que les conditions d'arrivée en France : pays traversé(s) et par quels<br />
moyens. Elle récapitule les démarches de régularisation entreprises ultérieurement et les<br />
décisions administratives consécutives à ces dernières.<br />
La majeure partie du dossier est composée <strong>des</strong> documents nécessaires à l'établissement de la<br />
preuve de séjour en France, de la bonne "intégration" et aux démarches entreprises pour<br />
régulariser le séjour : fiches de paie, factures, courrier adressés à la préfecture et à l'OFPRA,<br />
etc.<br />
Conditions de consultation<br />
La consultation du <strong>fonds</strong> se fait au siège de <strong>Génériques</strong>, sur rendez-vous et après obtention<br />
d'une dérogation auprès <strong>des</strong> dépositaires pour la consultation <strong>des</strong> dossiers individuels.<br />
Sources complémentaires<br />
Les archives de la préfecture de police de Paris sont un complément utile à toute étude sur les<br />
sans-papiers ainsi que les archives <strong>des</strong> personnes ou associations ayant appartenu au groupe<br />
de soutien du 3 e collectif ; notamment l’ATMF, l’ATF et l’ACORT (ex-ATT) dont les<br />
inventaires sont disponibles sur notre site.<br />
11 Il est à noter que dans les couples chinois, la femme garde son nom, donc les dossiers comportent le<br />
patronyme et le matronyme. Pour les couples mariés, les dossiers sont classés par ordre alphabétique du<br />
patronyme.
Fédération <strong>des</strong> associations de solidarité avec les<br />
travailleurs immigrés (FASTI)<br />
Dates extrêmes : 1964-2001 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 100 mètres linéaires<br />
Présentation de l’association, par Antoine Chassin, coordinateur de la FASTI<br />
La FASTI (fédération <strong>des</strong> associations de solidarité avec les travailleurs immigrés) que l’on<br />
peut, plus justement, appeler « mouvement <strong>des</strong> ASTI », est une fédération d’associations<br />
autonomes réparties sur l’ensemble du territoire français, et caractérisées par leur travail<br />
quotidien de solidarité et de lutte avec les immigré-es sur le terrain, ici et là-bas.<br />
La FASTI s’est créée en 1966 autour <strong>des</strong> luttes <strong>des</strong> immigré-es dans les bidonvilles de la<br />
région parisienne. Dès 1967, lors du premier congrès, la fédération compte une soixantaine<br />
d’associations, implantées partout dans l’hexagone, qui s’unissent dans la lutte pour l’égalité<br />
<strong>des</strong> droits entre immigrées et françaises.<br />
Orienté au départ sur l’aide quotidienne, l’amélioration <strong>des</strong> conditions de vie, la résolution<br />
<strong>des</strong> tracasseries administratives, etc., le travail <strong>des</strong> ASTI a pris une nouvelle forme avec la<br />
fermeture officielle <strong>des</strong> frontières en 1974, puis l’officialisation <strong>des</strong> pratiques de la rétention<br />
et <strong>des</strong> expulsions. Actuellement la diversité <strong>des</strong> quelques 80 ASTI et de leurs activités est à<br />
l’image de l’ampleur du travail à accomplir sur le terrain, ainsi, fonction <strong>des</strong> réalités locales,<br />
on trouvera : cours d’alphabétisation, soutien scolaire, aide juridique au séjour et aux droits<br />
sociaux, animation socioculturelle, logement et foyers, activités interculturelles (cuisine,<br />
cinéma, radio, fêtes, concerts, …), soutien aux femmes immigrées, etc., et maintiennent un<br />
rapport de force dans la lutte politique locale et nationale pour la liberté de circuler et de<br />
s’installer, en s’investissant dans le soutien aux collectifs de Sans-Papiers, dans la lutte contre<br />
les expulsions, pour l’annulation de la dette du Tiers-monde, pour la reconnaissance du statut<br />
de réfugié aux femmes persécutées en raison de leur sexe, ….<br />
Les orientations « historiques » du mouvement sont axées autour <strong>des</strong> principes de solidarité<br />
entre immigrées et françaises, d’égalité <strong>des</strong> droits pour toutes et tous, de développement de<br />
nouveaux rapports Nord / Sud axés sur le partage <strong>des</strong> richesses, de lutte contre le racisme.<br />
Actuellement le mot d’ordre principal de la FASTI est la liberté de circulation et d’installation<br />
<strong>des</strong> personnes.<br />
La volonté du mouvement est de travailler de manière décentralisée, avec un partage et une<br />
répartition large <strong>des</strong> pouvoirs et <strong>des</strong> responsabilités, d’orienter son action pour favoriser<br />
l’auto-organisation <strong>des</strong> personnes immigrées, et d’une manière générale la lutte contre toutes<br />
les discriminations qu’elles soient sociales, raciales ou sexuelles, et pour une société<br />
interculturelle.<br />
Intérêt du <strong>fonds</strong>
Les activités de la FASTI s’organisent depuis 1966 autour de commissions, dont les créations<br />
et disparitions sont révélatrices <strong>des</strong> évolutions qui traversent la vie de l’association :<br />
commissions logement, anti-racisme, femmes, jeunes, séjour-Europe, alphabétisation, pour ne<br />
citer que les principales.<br />
Le siège national conserve également les courriers, rapports et publications échangés avec les<br />
ASTI (sections locales, organisées au niveau départemental et régional), qui en quarante ans<br />
se sont répartis sur 218 villes de France, soit toutes les régions françaises (à l’exception de la<br />
Corse), ainsi qu’au Luxembourg. Les archives ont souffert de peu de pertes : congrès,<br />
rapports d’activités et publications permettent de suivre précisément l’évolution <strong>des</strong><br />
orientations <strong>des</strong> ASTI et de son siège national.<br />
Etat du <strong>fonds</strong><br />
Il se compose d’archives papier, d’affiches, de cassettes audios et vidéos, de banderoles et de<br />
badges.<br />
Réunions nationales, vie interne. 1966-<br />
2001 (A1-114)<br />
Congrès<br />
Réunions du bureau national<br />
Réunions du conseil national<br />
Rencontres nationales<br />
Activités<br />
Commission séjour-Europe. 1977-2001<br />
(B1-96)<br />
Activités<br />
Sans-papiers<br />
Permanence juridique<br />
Documentation<br />
Commission jeunes. 1970-2001 (C 1-46,<br />
E9-11, E21, E33)<br />
Anti-racisme<br />
Publications : « Besoin d’R »<br />
Police-Justice<br />
Rencontres<br />
Autres activités<br />
Commission femmes. 1981-2001 (D1-<br />
D14)<br />
Autres commissions. 1957-2001 (E1-49)<br />
Alphabétisation et formation<br />
Algérie<br />
Portugal<br />
Foyers et logement<br />
Commissions diverses<br />
Sections locales. 1964-2001 (F1-112)<br />
Table chronologique<br />
Table typologique<br />
Tables géographiques<br />
Publications. 1967-2001 (G1-45)<br />
Brochures<br />
Périodiques<br />
Comptabilité et gestion du personnel.<br />
1970-2001 (H1-188)<br />
Comptes annuels<br />
Cotisations et dons<br />
Salariés et réunions <strong>des</strong><br />
commissions finances et<br />
personnel<br />
Subventions<br />
Banques, livres de comptes et<br />
factures<br />
Correspondance. 1968-2001 (I1-110)
Association Rhône-Alpes pour le logement et<br />
l’insertion sociale (ARALIS)<br />
Dates extrêmes : années 1950-2000 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 350 mètres linéaires<br />
L’Association Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale (ARALIS) est une<br />
association loi 1901. Elle a pour objet d’apporter son soutien et son aide psychologique et<br />
matérielle aux personnes isolées et aux familles, notamment aux ressortissants étrangers, en<br />
portant une attention particulière aux personnes en difficulté d’insertion et d’adaptation.<br />
Fondée en 1951 sous le nom de "Maison du travailleur étranger" (MTE), l’association a<br />
particulièrement développé depuis un demi-siècle la création, l’aménagement ou la gestion<br />
d’établissements d’hébergement et de logements pour les travailleurs et leurs familles dans le<br />
Rhône et la Loire.<br />
Etat <strong>des</strong> <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
Les <strong>fonds</strong> d’ARALIS ne sont pas classés : l’inventaire sommaire présenté ici a été réalisé par<br />
<strong>Génériques</strong> dans le cadre d’un "diagnostic archives" de deux jours. Cet inventaire concerne<br />
les Archives de la direction générale et <strong>des</strong> différents services de l’Association (Patrimoine,<br />
Affaires sociales, Personnel, Comptabilité, Mission Accueil Information Orientation). Ces<br />
<strong>fonds</strong> représentent plus de 260 mètres linéaires. D’autres documents conservés dans les<br />
différentes résidences (notamment les archives <strong>des</strong> services d’animation <strong>des</strong> foyers) ne sont<br />
pas mentionnés dans l’inventaire actuel. Les dates extrêmes et le métrage linéaire ne sont pas<br />
indiqués pour tous les documents.<br />
Intérêt <strong>des</strong> <strong>fonds</strong><br />
L’intérêt <strong>des</strong> archives d’ARALIS dépasse largement le cadre de l’histoire de l’Association et<br />
de ses structures. D’une exceptionnelle richesse, le <strong>fonds</strong> présente une dimension de première<br />
importance pour l’histoire et la mémoire de l’immigration en Rhône-Alpes depuis la fin de la<br />
Seconde Guerre mondiale. D’ores et déjà, la lecture de ce premier inventaire augure du<br />
potentiel <strong>des</strong> <strong>fonds</strong> pour les recherches futures, en particulier autour <strong>des</strong> thèmes suivants :<br />
• Histoire de l’action sociale : <strong>des</strong> origines de la MTE, où la création <strong>des</strong> structures<br />
d’hébergement est impulsée par les pouvoirs publics, jusqu’au développement actuel<br />
d’ARALIS en tant qu’entreprise d’économie sociale fonctionnant sur un mode associatif,<br />
les archives témoignent de l’évolution <strong>des</strong> formes d’assistance et de solidarité depuis<br />
1945. Elles sont aussi une source de renseignements sur l’accueil et l’insertion sociale, sur<br />
les groupes de travail et partenariats constitués autour de l’intégration <strong>des</strong> populations<br />
immigrées.
• Histoire régionale de l’immigration : ces archives se présentent comme un "observatoire"<br />
de l’histoire régionale de l’immigration dans la seconde moitié du XXe siècle. Une<br />
histoire qui débute en 1951, à la charnière de l’immigration <strong>des</strong> années 1920-1950 à<br />
dominante italienne et espagnole, et <strong>des</strong> nouvelles formes d’immigration, masculine,<br />
urbaine et périurbaine, développées pendant les Trente Glorieuses. Une histoire qui se<br />
poursuit avec la politique du regroupement familial et l’arrivée <strong>des</strong> réfugiés du Sud-Est<br />
asiatique au milieu <strong>des</strong> années 1970, puis plus récemment avec l’accueil d’immigrés<br />
d’Afrique ou d’Europe de l’Est.<br />
• Trajectoires sociales <strong>des</strong> immigrés et espaces de vie : les documents apportent <strong>des</strong><br />
éclairages sur les itinéraires individuels ou familiaux, sur la sociabilité à l’intérieur <strong>des</strong><br />
résidences, sur les espaces identitaires, et même sur l’intimité. L’engagement militant est<br />
également perceptible, notamment lors de la Guerre d’Algérie ou par rapport à la question<br />
palestinienne.<br />
• Urbanisme et immigration : en matière d’urbanisme, en dehors de l’aspect strictement<br />
architectural, les archives restituent les différentes formes d’insertion <strong>des</strong> logements dans<br />
l’espace urbain. L’installation <strong>des</strong> foyers à proximité <strong>des</strong> sites industriels (la Ricamarie<br />
dans la Loire, Meyzieu à Saint-Priest) dans les années cinquante ; la création <strong>des</strong> cités à<br />
vocation familiale qui contribuent à former l’embryon <strong>des</strong> villes nouvelles (Vaulx-en-<br />
Velin…) durant les décennies 1960-1970; la construction <strong>des</strong> résidences et logements<br />
sociaux en centre-ville pour favoriser l’insertion sociale depuis les années 1980…<br />
Les archives sont repérées sont celles du siège social d’ARALIS (Espace Brotteaux) et du<br />
Centre du Dauphiné.<br />
Siège social :<br />
Les archives sont réparties dans cinq pièces différentes selon le service producteur (Direction<br />
générale, Personnel, Comptabilité et Finances, Patrimoine, Affaires sociales).<br />
Quantité : environ 260 mètres linéaires (Direction générale : 54 ml/Personnel : 34<br />
ml/Finances et Comptabilité : 100 ml/Patrimoine : 35 ml/Affaires sociales : 30 ml).<br />
Présentation <strong>des</strong> services versants :<br />
Patrimoine. Raison d’être d’Aralis, le logement se situe au cœur de ses actions, qu’il s’agisse<br />
d’acquisitions de terrains, de restructuration de foyers ou d’aménagement de logements<br />
sociaux en secteur diffus. La section Patrimoine <strong>des</strong> archives est donc très riche et fournit de<br />
précieuses indications quant au fonctionnement d’Aralis.<br />
Personnel. Aralis emploie <strong>des</strong> salariés aux compétences diverses : intervenants sociaux,<br />
chargés d’opérations immobilières, surveillants de foyer... Le service du personnel est donc<br />
chargé de gérer les statuts <strong>des</strong> différentes catégories de salariés et de négocier avec les<br />
instances représentatives du personnel (CHSCT, délégués du personnel, comité d’entreprise).<br />
Action sociale. L’action sociale englobe les différents moyens mis en œuvre auprès de publics<br />
spécifiques afin de lutter contre les problèmes d’insertion et de logement. Ces actions peuvent<br />
prendre la forme d’animations de loisirs, socio-éducatives ou de suivi individualisé. Afin de<br />
gagner en efficacité, les membres de l’UNAFO se sont constitués en “ commission<br />
d’accompagnement social ”, chargée d’harmoniser et de labelliser les actions <strong>des</strong> différents
gestionnaires de foyers. La volonté d’Aralis de participer et de répondre aux besoins sociaux<br />
se traduit également dans la Loire, par sa collaboration au groupe de travail départemental<br />
élaborant <strong>des</strong> propositions d’accueil de populations en difficulté.<br />
Archives du Centre du Dauphiné<br />
Quantité : environ 50 mètres linéaires en dehors de la documentation et <strong>des</strong> documents<br />
audiovisuels (30 ml pour les dossiers du CAIO).<br />
Lieux : quelques archives administratives et <strong>des</strong> documents du service animation du foyer<br />
sont entreposés au sous-sol du bâtiment administratif (Lyon 3 e ) ; les dossiers <strong>des</strong> usagers du<br />
Centre d’accueil, d’information et d’orientation <strong>des</strong> étrangers sont conservés dans les bureaux<br />
du rez-de-chaussée du même bâtiment.<br />
Organisation : les dossiers du CAIO sont archivés par numéro d’ordre dans <strong>des</strong> meubles à<br />
classeurs suspendus. Les documents répertoriés au sous-sol ne sont pas classés.
LIEUX DE MÉMOIRE<br />
Monument à la mémoire de tous les Espagnols<br />
morts pour la liberté, 1939-1945.<br />
Cimetière du Père Lachaise, Paris, 2005
Cimade<br />
Dates extrêmes : années 1940-2000 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 200 mètres linéaires<br />
A l’origine “ Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués ”, formellement constitué le 3<br />
avril 1940, la Cimade est une association œcuménique d’entraide. Créée par <strong>des</strong> responsables<br />
de mouvements de jeunesse protestants pour venir en aide aux Alsaciens et Lorrains<br />
“ évacués ” et aux personnes regroupées et internées dans les premiers camps du sud de la<br />
France, elle s’est ensuite lancée dans la Résistance et l’organisation de filières d’évasion <strong>des</strong><br />
Juifs d’Europe, pourchassés et déportés durant la Seconde Guerre mondiale. A la Libération,<br />
elle a travaillé à la réconciliation, notamment en Allemagne. Par la suite, à la fin <strong>des</strong> années<br />
50, elle a eu une présence forte auprès <strong>des</strong> Algériens en France et en Algérie. Dans les années<br />
70, <strong>des</strong> réfugiés d’Amérique Latine et du Sud-Est asiatique sont venus en grand nombre.<br />
Aujourd’hui, elle travaille en collaboration avec d’autres organismes, catholiques et laïcs, à la<br />
défense <strong>des</strong> étrangers en France (réfugiés et demandeurs d’asile) et poursuit ses actions de<br />
développement solidaire avec <strong>des</strong> pays du Sud et de l’Est.<br />
Les services de la Cimade n’ont cessé d’évoluer selon le contexte géopolitique ; ils se<br />
concentrent aujourd’hui autour de cinq axes : le service d’accueil et de domiciliation <strong>des</strong><br />
étrangers; le service de défense <strong>des</strong> étrangers reconduits (DER) ; le Centre international ; la<br />
formation ; les solidarités internationales. Le service d’accueil reçoit, conseille, oriente et<br />
domicilie les étrangers venus chercher asile en France. Le service de défense <strong>des</strong> étrangers<br />
reconduits défend les étrangers placés en centre de rétention dans l'attente de l'expulsion du<br />
territoire ; le centre international héberge <strong>des</strong> étudiants et accueille <strong>des</strong> réfugiés statutaires; le<br />
service formation s'occupe de la formation linguistique <strong>des</strong> réfugiés et le service <strong>des</strong><br />
solidarités internationales élabore <strong>des</strong> actions internationales de solidarité et <strong>des</strong> campagnes<br />
de solidarité en France. Ces activités se répartissent en France en six "régions" : Alsace-<br />
Moselle, Est, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Nord-Picardie, Provence-Côté d'Azur,<br />
Rhône-Alpes, Sud-Ouest.<br />
Dans une brochure de la Cimade publiée en juin 1960, les services de la Cimade sont répartis<br />
en six domaines, classés par ordre d'importance du nombre d'équipiers mobilisés :<br />
• Le service <strong>des</strong> réfugiés se répartissait en sept principaux services : les services d’aide à<br />
l’immigration et à l’émigration, le vestiaire, les centres d’hébergement, l’artisanat, les<br />
cours de langue et le ciné-club, les distributions de vivres. La Cimade disposait d’un<br />
centre d’accueil à Sucy-en-Brie depuis 1948 et de maisons de retraite pour réfugiés russes<br />
à Cannes, Saint Raphaël et Le Perreux.<br />
• Dans le secteur Nord-Africain, les activités au bénéfice <strong>des</strong> Algériens pendant la guerre<br />
d’indépendance, se répartissaient, entre la France (service nord-africain et camps<br />
d’assignation à résidence, postes de Marseille, Paris 14 ème -15 ème , puis Lyon au lendemain<br />
de l’indépendance ) et l’Algérie (Alger, Médéa, Sidi Nahmane, Belkitane et centres de<br />
regroupement).<br />
• Coudekerque : action sociale et éducative dans un quartier ouvrier de Dunkerque.
• Dakar : en 1956, la Cimade a mis en place une équipe permanente dans la Médina de<br />
Dakar, où elle a ouvert un dispensaire.<br />
• La maison internationale <strong>des</strong> étudiants de Sèvres accueillait une soixantaine d'étudiants<br />
d'origine et de niveaux divers.<br />
• Le service <strong>des</strong> prisons et libérés est né pendant la dernière guerre et a été associé aux<br />
réformes pénitentiaires.<br />
• Le service <strong>des</strong> sinistrés d'urgence répondait à la mission d'œuvre de secours d'urgence que<br />
la Cimade s'est fixée dès ses débuts.<br />
Le <strong>fonds</strong> de la Cimade présente <strong>des</strong> pistes de recherche variées :<br />
Histoire de la Cimade : comme toutes les associations, la Cimade trouve un intérêt direct dans<br />
l'exploitation de ses archives, les militants étant toujours curieux du passé de leur association.<br />
Quelles ont été les motivations <strong>des</strong> équipiers au fil <strong>des</strong> années et <strong>des</strong> événements, à quelles<br />
difficultés ont-ils dû faire face ? les activités répondent-elles toujours aux motivations<br />
premières ? Voilà <strong>des</strong> questionnements qui reviennent souvent. En outre, savoir ce qui été fait<br />
auparavant permet de ne pas recommencer inutilement les mêmes travaux ou alors de les<br />
approfondir.<br />
Histoire du protestantisme : fondée par <strong>des</strong> protestant/es, la Cimade est traversée par <strong>des</strong><br />
questionnements sur son engagement, sur l'actualité de sa foi. Interrogation sur la fidélité au<br />
message évangélique, rapports avec les différentes églises chrétiennes et les communautés<br />
rattachées aux autres religions, mais aussi rapports avec les églises protestantes étrangères et<br />
tout particulièrement avec le Conseil Œcuménique <strong>des</strong> Eglises, sont <strong>des</strong> exemples de thèmes à<br />
développer.<br />
Flux migratoires : les services de la Cimade sont le reflet <strong>des</strong> flux de populations étrangères<br />
arrivant en France (réfugiés et migrants). En outre, les dossiers individuels ou plus généraux<br />
constitués par la Cimade permettent d'éclairer les conditions de vies <strong>des</strong> migrants : degrés de<br />
formation, emplois, situation matérielle, alphabétisation, processus d'intégration, etc. Les<br />
fiches de renseignement établis par la Cimade (pièce 4 armoire 2, par exemple) permettent<br />
ainsi de reconstituer <strong>des</strong> trajectoires de migrants : elles indiquent la date et le lieu de naissance<br />
<strong>des</strong> migrants, ainsi que leur parcours professionnel, leurs aptitu<strong>des</strong> et leur niveau de langue.<br />
Ces fiches ont été constituées par pays d'origine, par <strong>des</strong> services différents, tels ceux du<br />
Portugal ou <strong>des</strong> pays de l'Est.<br />
Histoire <strong>des</strong> associations et de la vie associative : Les dossiers contenant <strong>des</strong> courriers<br />
échangés avec d'autres associations ou <strong>des</strong> rapports d'activités menées conjointement<br />
permettent de retrouver les traces d'associations aujourd'hui disparues, mais aussi de mettre en<br />
exergue les dynamiques interassociatives.<br />
État du <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
La Cimade conserve au siège national environ 200 mètres linéaires d'archives remontant au<br />
début <strong>des</strong> années 40. Il s’agit aussi bien d’archives papiers, que d’affiches, de vidéo et de<br />
photos. Ces archives se répartissent entre la cave, qui regroupe environ 175 mètres linéaires<br />
(ml) d'archives et le local de l'équipe archive, qui en contient environ 12 ml. Ces dernières<br />
concernent la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation France -Allemagne et la guerre<br />
d'Algérie. Le guide de recherche présente tout d'abord un état sommaire, constitué par<br />
échantillonnage, du <strong>fonds</strong> entreposé au sous-sol, puis les <strong>fonds</strong> classés par l'équipe de la
Cimade, dont les notices ont été rédigées par Denise Duboscq, en collaboration avec<br />
<strong>Génériques</strong>.<br />
Les archives concernant la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation franco-allemande et la<br />
guerre d'Algérie sont classées par une équipe de la Cimade. Mmes Mireille Desrez et Denise<br />
Duboscq (qui a rédigé les notices de ces répertoires) ont ainsi activement collaboré à la<br />
rédaction du présent guide de recherche. Les archives dont nous présentons ici un état<br />
sommaire sont consultables sous réserve.<br />
1- Etat sommaire.<br />
Activités de l’association. Fin <strong>des</strong> années 1960 à nos jours<br />
2- Seconde Guerre mondiale (archives et documentation).<br />
Aide aux réfugiés, internés, évadés, prisonniers et sinistrés. 1939-1954<br />
Autres activités. 1932-1950<br />
Eglises protestantes. 1941-1944<br />
Relations avec d’autres associations. 1941<br />
3- Guerre d’Algérie et période post-indépendance.<br />
Actions en France : services prisons et Nord-Africain, postes Cimade en France. 1956-1969<br />
Actions en Algérie. 1956-1975
Service social d’aide aux émigrants (SSAE)<br />
Dates extrêmes : années 1920-2000 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 300 mètres linéaires<br />
Les membres de la Young women’s christian association (YWCA) 12 s’intéressaient aux<br />
problèmes posés aux femmes rejoignant leur famille aux USA. Dans les années 20, devant<br />
l’aggravation de la situation au niveau international, elles se rendent compte de la nécessité de<br />
rassembler <strong>des</strong> éléments d’information et d’initier une action internationale. Leur première<br />
étude, The Welfare of migrants, porte sur 18 pays, dont l’Allemagne, la Pologne et la<br />
Tchécoslovaquie comme pays d’origine, la France et la Suisse comme pays de transit. Leurs<br />
étu<strong>des</strong> sont ensuite transmises à la Société <strong>des</strong> nations (SDN) et au Bureau international du<br />
travail (BIT). Elles établissent <strong>des</strong> services sociaux <strong>des</strong> migrants dans <strong>des</strong> endroits clés<br />
(Athènes, Constantinople, Prague, Varsovie, Paris, Marseille, Cherbourg, Le Havre, Anvers)<br />
et le siège central londonien fournit la documentation nécessaire pour une mise à jour<br />
constante <strong>des</strong> lois et <strong>des</strong> réglementations. Le personnel de la direction effectue aussi<br />
régulièrement <strong>des</strong> visites aux différentes branches.<br />
En réaction à la volonté de restriction <strong>des</strong> flux migratoires, qui concerne un large public, la<br />
YWCA décide en 1921 de créer un service pour la famille et non pour les femmes seules,<br />
consciente que ce service ne serait efficace qu’avec une envergure internationale. La YWCA<br />
constitue donc un comité de patronage et obtient une subvention du Laura Spelman<br />
Rockefeller memorial afin de créer un organisme international, apolitique et nonconfessionnel<br />
: l’international social service (ISS ou SSI). Les services sociaux <strong>des</strong> migrants<br />
déjà existants sont alors réorganisés en branches du service social international.<br />
À la cessation <strong>des</strong> subventions américaines, les branches continuèrent à se développer avec<br />
l’aide de leur comité national. Genève s’impose à cette époque comme le siège central <strong>des</strong><br />
activités internationales. La première réunion de l’organisme à lieu à Genève en 1924.<br />
La branche française du SSI, nommée le SSAE, s’occupe dès 1921 de l’installation en France<br />
<strong>des</strong> migrants qui n’ont pas réussi à rejoindre les USA. Par la suite, avec la baisse du flot de<br />
“ transmigrants ”, le SSAE se penche sur la question <strong>des</strong> travailleurs étrangers recrutés par la<br />
France et, en 1939, il est chargé d’organiser le Service social de la main d’œuvre étrangère<br />
(SSMOE), afin d’étendre son action aux départements. Le SSMOE devient une section du<br />
SSAE, il facilite localement l’adaptation et l’implantation <strong>des</strong> immigrés.<br />
Parallèlement au développement <strong>des</strong> sections nationales, le siège étend les relations du SSI à<br />
d’autres organismes dans les pays où il n’est pas représenté, notamment en Yougoslavie,<br />
12 Les Unions Chrétiennes de jeunes Gens sont un mouvement de jeunesse, fondées à Londres en 1844 par<br />
George Williams et en 1895 pour les Unions Chrétiennes de jeunes Filles (YWCA en anglais). Les deux<br />
Alliances mondiales ont leur siège à Genève, où la première UCJG s'est crée en 1852 sous l'impulsion de<br />
personnalités de premier plan telles que Henri Dunant, Maximilien Perrot, etc. Et c'est grâce à Henri Dunant,<br />
dont le rôle a été décisif dans la création du mouvement mondial, que Genève a été désignée comme siège de<br />
l'Alliance universelle <strong>des</strong> UCJG, deuxième institution internationale à s'y établir après la Croix-Rouge.<br />
La section américaine du YWCA, dont il est question ici, voit ses premières activités débuter aux alentour de<br />
1858, soit trois ans après la section anglaise.
Syrie, Italie, Estonie, Lituanie, Danemark, Finlande, Norvège et Suède. Pendant la Deuxième<br />
guerre mondiale, les actions du SSI se maintiennent difficilement, les relations entre les pays<br />
sont parfois rompues. Au lendemain du conflit, il se consacre aux problèmes <strong>des</strong> déplacés et<br />
<strong>des</strong> réfugiés, en ayant toujours comme principal rôle, celui d’expert.<br />
Etat du <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
Les archives du SSAE, par leur richesse, peuvent permettre, en premier lieu, de reconstituer<br />
l’histoire de l’association et de ses actions. Mais leur exploitation augure, plus largement, une<br />
lecture pluridisciplinaire de l’histoire et de la sociologie de l’immigration nationale, dans le<br />
sens de l’historiographie actuelle (histoire <strong>des</strong> représentations, <strong>des</strong> dynamiques sociales, <strong>des</strong><br />
pratiques identitaires, <strong>des</strong> espaces migratoires, de l’intimité et de la vie privée, <strong>des</strong><br />
solidarités…). En effet, la grande variété de documents, la présence de l’association sur<br />
l’ensemble du territoire français, ainsi qu’à l’étranger, la répartition - sans trop de lacunes -<br />
sur une longue période (depuis 1921) donnent à ce <strong>fonds</strong> une dimension historique de<br />
première importance. L’étude <strong>des</strong> archives du SSAE permet de retracer l’itinéraire de milliers<br />
d’étrangers, d’interpréter et de faire vivre une histoire parfois aride ; c’est encore<br />
l’opportunité qu’elles offrent de reconstituer l’évolution <strong>des</strong> formes associatives d’assistance<br />
et de solidarité depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Cette étude ne se limite pas au<br />
niveau national, car comme le souligne le paragraphe sur les sources annexes, le SSAE est<br />
bien implanté sur le territoire et les archives <strong>des</strong> bureaux locaux sont consultables aux sièges<br />
<strong>des</strong> bureaux toujours en activité ou dans les centres d’archives publiques.<br />
La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a créé l'Agence<br />
Nationale de l'accueil <strong>des</strong> étrangers et <strong>des</strong> migrations (ANAE). Ce nouvel opérateur réunit les<br />
moyens de l'Office <strong>des</strong> migrations internationales (OMI) établissement public administratif, et<br />
du Service social d'aide aux émigrants (SSAE) association reconnue d'utilité publique. Le<br />
SSAE existe toujours en tant que "association SSAE". Les archives du siège nationale sont en<br />
cours de dépôt au Centre <strong>des</strong> archives contemporaines (CAC) de Fontainebleau et les archives<br />
<strong>des</strong> sections locales dans les centres d'archives départementaux.<br />
Méthodologie de l’inventaire<br />
Lors de notre mission, nous avons ouvert de nombreux cartons afin d’effectuer <strong>des</strong> sondages,<br />
mais cette première évaluation est infime par rapport à la quantité d’archives conservées. Il ne<br />
nous est donc pas possible d’indiquer ici, de façon exhaustive et affirmative, toutes les<br />
potentialités d’exploitation du <strong>fonds</strong> ; il s’agit simplement d’esquisser, à travers quelques<br />
thèmes, <strong>des</strong> pistes de recherche.<br />
Bien entendu, l’exploitation devra se faire en croisant les archives avec d’autres sources, en<br />
l’enrichissant de la sensibilité et de l’humanité qu’offrent la mémoire, les écrits ou les objets<br />
personnels <strong>des</strong> femmes et <strong>des</strong> hommes acteurs de cette aventure.<br />
Cet état sommaire est une photographie générale <strong>des</strong> archives, avec <strong>des</strong> notices courtes et<br />
quelques mises en exergue de documents significatifs : c’est ce premier niveau d’analyse que<br />
nous proposons dans ce rapport, avec <strong>des</strong> choix méthodologiques qu’il convient<br />
préalablement d’expliquer pour rendre la lecture plus facile.<br />
Présentation de l’inventaire
Nous avons choisi de répertorier les archives selon une logique thématique qui permet de<br />
comprendre la nature, l’articulation et l’importance <strong>des</strong> <strong>fonds</strong>, plutôt que d’en faire une<br />
présentation linéaire (suivant l’ordre de rangement). Cette formule permet de donner un<br />
aperçu synthétique et concis, tout en permettant la localisation <strong>des</strong> documents au moyen du<br />
plan de la salle. L’inventaire décrit également le conditionnement <strong>des</strong> documents afin de<br />
pouvoir de pouvoir les identifier physiquement (chemises, cartons, classeurs, “ vrac ”,<br />
fichier…).<br />
Rédaction <strong>des</strong> notices<br />
Pour certains dossiers, nous avons repris littéralement l’intitulé inscrit par le service<br />
producteur sur la tranche du carton ou de la chemise, après vérification rapide de la<br />
concordance entre cet intitulé et les documents contenu dans le carton. Pour les autres, lorsque<br />
l’intitulé ne restituait que partiellement le contenu, nous avons opté pour la rédaction d’une<br />
notice plus précise. Enfin, dans la mesure du possible, nous avons essayé de donner les dates<br />
extrêmes <strong>des</strong> dossiers.
ARCHIVES DU SIÈGE NATIONAL<br />
1. Création et développement du Service<br />
social international (SSI) et du SSAE.<br />
1921-1976<br />
SSI<br />
SSAE et SSMOE<br />
2. SSI : fonctionnement et activités.<br />
1928-1997<br />
3. SSAE. 1921-1998<br />
Direction nationale<br />
Bureaux régionaux, départementaux et<br />
bureaux d’accueil<br />
4. Actions sociales. 1944-1999<br />
Migrants et réfugiés<br />
Dossiers thématiques<br />
Dossiers individuels<br />
5. Equipes et chargés de mission à<br />
caractère européen et international.<br />
1967-1994<br />
6. Étu<strong>des</strong> et publications du SSAE,<br />
séminaires et colloques. 1951-1996<br />
7. Relations publiques. 1946-1996<br />
Relations internationales et européennes<br />
Relations nationales : organismes privés et<br />
publics<br />
8. Organisation interne du SSAE. 1958-<br />
1990<br />
Comptabilité<br />
Locaux et matériel<br />
Ressources humaines<br />
9. Documentation. 1991-1997<br />
ARCHIVES DES BUREAUX. 1950-1985<br />
Bureaux régionaux<br />
Bureaux départementaux<br />
ARCHIVES COURANTES. 1926-2004<br />
Direction et attaché de direction<br />
Action sociale<br />
Secrétariat<br />
Action internationale
Comité de liaison et d'action <strong>des</strong> étrangers (CLAE)<br />
Dates extrêmes : années 1980- 2000 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 50 mètres linéaires<br />
Le Comité de liaison et d'action <strong>des</strong> immigrés (CLAI) est créé en 1985, suite à un congrès de<br />
69 associations d'immigrés au Luxembourg, regroupées en comité de coordination au sein de<br />
l'Associations de Soutien aux Travailleurs Immigrés (Asti). A partir de 1987, le CLAI dispose<br />
de CLAI locaux pour relayer ses activités, essentiellement de type politique. Le CLAI<br />
conserve <strong>des</strong> liens étroits avec l'ASTI qui assure le secrétariat de l'association et avec qui elle<br />
organise le Festival de l'immigration, dont les recettes financent le fonctionnement du CLAI.<br />
Lors du 2 e congrès de 1990, le CLAI devient le CLAE (Comité de liaison et d'action <strong>des</strong><br />
étrangers) le terme "immigré" semblant trop connoté, tourné vers les populations du sud de<br />
l'Europe. Ce 2 e congrès met en place une structure de service afin de supporter l'action<br />
politique du CLAE. Cette structure a également pour but de fournir <strong>des</strong> services aux<br />
associations et aux organes consultatifs <strong>des</strong> étrangers. Le CLAE-service est subventionné par<br />
les ministères de la famille et de la culture et a <strong>des</strong> activités de formation, d’information,<br />
d’aide à la vie associative et de développement de projets culturels.<br />
Méthodologie de l’inventaire<br />
Les archives du CLAE sont réparties entre le sous-sol, où sont entreposées environ 45 mètres<br />
linéaires d'archives, et les bureaux. Les archives sont cotées selon un plan de classement établi<br />
par le CLAE, cote indiquée sur chaque carton ou classeur. Nous avons établi un inventaire<br />
sommaire <strong>des</strong> archives, c’est-à-dire un état <strong>des</strong>criptif du <strong>fonds</strong> dans lequel nous avons analysé<br />
certaines pièces à titre d’exemple.
Imprimerie Vérité-Rhône-Alpes (Pierre Boisgontier -<br />
Geneviève Baudino)<br />
Dates extrêmes : années 1970-1980 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 10 mètres linéaires<br />
Dans les années 1950-1960 Pierre Boisgontier milite contre la Guerre d’Algérie. En 1966, il<br />
rencontre, dans les Comités Vietnam, Michel de Bernardy de Sigoyer, étudiant en<br />
informatique. Engagés dans la recherche comme dans les comités d’action issus de l’UNEF et<br />
les mouvements de jeunesse d’inspiration maoïste leur soutien s’étend <strong>des</strong> Comités de<br />
quartier à la lutte du peuple palestinien. L’expérience de l’imprimerie Vérité-Rhône-Alpes 13<br />
trouve son origine dans ces engagements et dans le mouvement post-1968. Le journal Vérité<br />
Rhône-Alpes, parrainé par Jean-Paul Sartre 14 , est conçu comme un journal de contre<br />
information régionale. Afin de pouvoir imprimer le journal sans entrave, Michel et Pierre<br />
rachètent les machines de l’imprimerie. En créant la Sarl Editions Vérité Rhône-Alpes, à<br />
laquelle participe aussi Geneviève Baudino, ils viennent de constituer le principal outil<br />
régional de contre-information 15 , offrant « un lieu d’expression à ceux auxquels on en refuse<br />
les moyens ». Durant toutes la décennie 1970, les ateliers VRA impriment journaux, tracts,<br />
brochures, affiches pour les mouvements étudiants, immigrés, écologistes, féministes…<br />
L’imprimerie est instalée à la Monta (Saint-Egrève), dans une propriété qui accueille une<br />
expérience de vie communautaire de 1973 à 1983 16 . Au milieu <strong>des</strong> années 1980, l’imprimerie<br />
VRA change de nom pour devenir les Ateliers du Vercors. L’activité de l’atelier cesse en<br />
1996.<br />
Etat <strong>des</strong> <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
L’inventaire sommaire présenté ici a été réalisé par <strong>Génériques</strong> dans le cadre d’un<br />
« diagnostic archives » de deux jours en région grenobloise.<br />
Intérêt <strong>des</strong> <strong>fonds</strong><br />
Le courant de contre information, qui émerge à la fin <strong>des</strong> années 1960 et au début <strong>des</strong> années<br />
1970 dans les milieux d’extrême gauche de Grenoble, s’appuie sur un ensemble de journaux<br />
publiés en réaction au monopole <strong>des</strong> médias régionaux. Le Journal Vérité Rhône-Alpes et les<br />
archives <strong>des</strong> imprimeries VRA puis Ateliers du Vercors reflètent l’activité et les prises de<br />
positions <strong>des</strong> mouvements politiques, syndicaux, écologistes, féministes, immigrés,<br />
étudiants… Les facturiers de l’entreprise permettent de reconstituer la liste <strong>des</strong> « clients »<br />
13 Sur Vérité Rhône-Alpes, cf. l’article de Pierre Boisgontier, in Silence, n°285-286, été 2002, p. 18.<br />
14 Jean-Paul Sartre est le premier directeur de la publication.<br />
15 Cf. Université <strong>des</strong> sciences sociales de Grenoble CEPS-CERER, Michel de Bernardy de Sigoyer, La Contreinformation<br />
dans les luttes urbaines : un système d’expression, le cas de Grenoble, avec la participation de R.<br />
Avrillier, P. Boisgontier, sous la direction de J. Dessau, ATP-CNRS Information, mai 1980.<br />
16 Sur la communauté de la Monta, cf. l’article de Madeleine Nutchey, in Silence, n°285-286, été 2002, p. 16.
ayant fait appel à l’imprimerie pour l’édition de leurs publications, de leurs tracts ou de leurs<br />
affiches (cette liste est présentée ci-<strong>des</strong>sous). Les journaux, les maquettes de journaux, les<br />
<strong>fonds</strong> photographiques, et tous les documents imprimés par VRA-Ateliers du Vercors<br />
présentent <strong>des</strong> informations sur une actualité souvent ignorée de la presse régionale ou traitée<br />
sous un angle très différent. Dans ce contexte, les immigrés bénéficient, pour la première fois,<br />
de moyens d’expression à forte visibilité. Ainsi, ce <strong>fonds</strong> d’archives est particulièrement riche<br />
en informations sur les mouvements immigrés, sur la solidarité avec les travailleurs immigrés<br />
(grève de la faim…), sur la lutte contre le racisme et sur les comités de soutien aux peuples<br />
oppressés, comités souvent constitués autour de groupes de réfugiés à Grenoble.<br />
Liste <strong>des</strong> « clients » <strong>des</strong> imprimeries Vérité Rhône-Alpes et Ateliers du Vercors<br />
Action syndicale (notamment contre les licenciements, les conditions de travail…) : sections<br />
du syndicat CFDT dans les entreprises régionales (Air liquide, Cescos puis Thomson à Saint-<br />
Egrève, Sescosem…), dans les services publics (hôpital de Grenoble, postiers-PTT, employés<br />
communaux…) ; Comité d’entreprise Rhône Poulenc ; Confédération nationale du travail…<br />
Partis politiques : Parti socialiste unifié ; Parti socialiste (section de Meylan-la Tronche) ;<br />
candidats écologistes (listes et programmes) ; Journal Gauche ouvrière ; Ligue communiste<br />
révolutionnaire 17 (tracts de meetings) ; Union prolétarienne démocratique…<br />
Actions d’initiative locale (éducation populaire, vie de quartiers…) : Collectif d’information<br />
école ; associations de quartiers ; Club Léo Lagrange ; Maison pour Tous (Semaine de<br />
l’enfance, Maison de Claix, Maison Léon-Blum à Grenoble) ; Maison <strong>des</strong> jeunes et de la<br />
culture (MJC Pont-de-Claix, Prédieu 18 , Saint-Egrève…).<br />
Presse locale et radios de contre information : Casse-noix, journal satirique ; Mégaphone ;<br />
Interpeller la presse (53, rue Thiers à Grenoble) ; Radio Sud…<br />
Associations de femmes et groupes pro- légalisation de l’avortement : groupes de femmes<br />
(par exemple, femmes de Villeurbanne), maison médicale, Oiseau bleu (aide aux mères en<br />
difficulté), Planning familial, Marie Colère (journal du groupe femmes à Grenoble)…<br />
Mouvements étudiants, lycéens et soutien aux appelés du contingent : Union générale <strong>des</strong><br />
étudiants tunisiens (UGET) ; Union <strong>des</strong> étudiants iraniens en France ; Objecteurs de<br />
conscience, comités de soldats…<br />
Organismes et Comités contre la répression dans le monde et de soutien aux peuples<br />
oppressés : en particulier en Amérique centrale (Nicaragua, Salvador…), Maghreb (Algérie,<br />
Maroc, Tunisie), Moyen-Orient (Oman, Iran), Afrique (Erythrée), Europe (Espagne, Irlande).<br />
Il s’agit par exemple de : Collectif Iran (soutien aux grévistes de la faim), Groupe Irlande,<br />
Amnisty international, Rencontre avec le peuple palestinien, Comité pour le boycott de<br />
l’organisation par l’Argentine de la coupe du monde de football en 1978 (COBA) 19 …<br />
17 La Ligue communiste est dissoute le 28 juin 1973 après les affrontements avec le mouvement d’extrême droite<br />
Ordre nouveau. La Ligue communiste révolutionnaire qui lui succède est créée le 10 avril 1974.<br />
18 Quartier de Saint-Egrève.<br />
19 En 1968, plusieurs mouvements avaient déjà protesté contre l’organisation <strong>des</strong> Jeux olympiques par le<br />
Mexique.
Solidarité avec les travailleurs immigrés et lutte contre le racisme : Portugais (journal O<br />
Alarm de l’Association franco-portugaise), Italiens (notamment dans le quartier Saint-Laurent<br />
à Grenoble), Turcs (comité Stop-racisme de Fontaine et groupe turc de la rue Marcel-Perotto<br />
à Grenoble) ; journal Travailleur français-immigrés ; Comité franco-immigré ; Comité Ben<br />
Diaf 20 ; Comité de soutien festival immigrés ; journal El Mouhajer…<br />
Aide au développement et associations tiers-mondistes : Comité Catholique contre la Faim<br />
et pour le développement (CCFD de Grenoble) ; Opération Esperanza ; groupe Mayllku ;<br />
Association <strong>des</strong> Amitiés franco-chinoises (très active <strong>des</strong> années 1960 aux années 1980)…<br />
Mouvements écologistes et collectifs antinucléaires : comités contre la construction <strong>des</strong><br />
centrales nucléaires de Malville – Super Phénix 21 (comités de Grenoble et de Saint-Egrève),<br />
de Plogoff 22 (Festnoz et Ker Vreizh, cercles celtiques régionalistes) ; comité écologiste de<br />
Romans ; Arlequin atomique 23 ; mouvement contre le camp de Valbonne et la centrale du<br />
Bugey 24 ; association écologiste pour le développement <strong>des</strong> transports en commun ;<br />
Convergence autogestionnaire et écologique de Saint-Egrève ; Comités Larzac de Grenoble ;<br />
les Amis de la terre ; comités anti-marée noire (constitués après le naufrage de l’Amoco<br />
Cadiz 25 )…<br />
Mouvements ruraux : Centre départemental <strong>des</strong> jeunes agriculteurs (CDJA) ; Jeunes<br />
paysans ; journal Transhumance.<br />
Groupes régionalistes : Comité de soutien au peuple Kanak ; Front occitan ; Groupement<br />
pour l’avenir de la Corse.<br />
20 Sur cette affaire cf. note n°14.<br />
21 Site de Creys-Malville.<br />
22 Projet de centrale nucléaire dans le Finistère.<br />
23 Arlequin : quartier de Grenoble.<br />
24 Le camp militaire de la Valbonne est situé à Bélignieux (Ain), la centrale nucléaire du Bugey se trouve dans la<br />
commune de Saint-Vulbas (Ain).<br />
25 Le pétrolier libérien Amoco Cadiz, appartenant à la société américaine Amoco et affrété par Shell, s’est échoué<br />
sur les rochers de Men Gouvern (Finistère), le 16 mars 1978. La marée noire souille la côte septentrionale de la<br />
Bretagne de Portsall à l’île de Bréhat.
Les Républicains espagnols, déportés et travailleurs<br />
forcés pendant la seconde guerre mondiale<br />
Dates extrêmes : années 1930-2000 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 5 mètres linéaires<br />
Réfugiés en France à la fin de la guerre civile, ce sont 450 000 26 Espagnols républicains<br />
(militaires et civils) qui passent la frontière entre janvier et février 1939. Mais cet exil a<br />
débuté dès le déclenchement de la guerre civile en 1936, au moment où les franquistes ont<br />
fermé la frontière française à l’ouest <strong>des</strong> Pyrénées. Pour faire face à cet exode massif et<br />
précipité, les autorités françaises les placent dans <strong>des</strong> camps dans le sud de la France, appelés<br />
“ camps de concentration ”. “ Le terme camp de concentration peut choquer ; il est<br />
couramment utilisé dans les documents administratifs de l’époque, et le ministre de<br />
l’Intérieur, Albert Sarraut, l’emploie dans un sens “ lénifiant ” lors de sa conférence de presse<br />
au début de février 1939 : Le camp d’Argelès-sur-Mer ne sera pas un lieu pénitentiaire, mais<br />
un camp de concentration. Ce n’est pas la même chose. ” 27<br />
Le gouvernement est également favorable aux départs pour d’autres pays, mais qu’ils<br />
s’agissent de l’URSS, de la Grande-Bretagne ou <strong>des</strong> pays d’Amérique latine, ils doivent<br />
passer au travers de quotas et de sélections souvent très stricts. Au total, ce sont environ<br />
20.000 Espagnols qui choisissent de quitter la France, dont plus de 15.000 pour l’Amérique<br />
latine. Pour sortir <strong>des</strong> camps, les autorités françaises proposent également aux internés le<br />
retour dans l’Espagne franquiste. Ceux-ci lui sont dans la plupart <strong>des</strong> cas enrôlés dans la<br />
Légion, puis plus tard, dans les bataillons de marche ou les Compagnies de travailleurs<br />
étrangers (CTE), pour édifier <strong>des</strong> fortifications du front, comme sur la ligne Maginot.<br />
Faits prisonniers par la Wehrmacht en 1940, ils sont déportés en majorité dès la deuxième<br />
moitié de 1940 dans le camp de Mauthausen 28 . D’autres Espagnols sont encore livrés par la<br />
police de Vichy, arrêtés comme résistants, et ils sont répartis après 1942 entre différents<br />
camps nationaux-socialistes, les femmes étant déportées essentiellement à Ravensbrück 29 .<br />
Nous savons que plus de 7.000 Espagnols sont déportés à Mauthausen 30 (2.000 survivront),<br />
car ils sont comptabilisés par nationalité. Déchus de leur nationalité espagnole par Franco, ils<br />
portent le triangle bleu <strong>des</strong> apatri<strong>des</strong>, avec en son centre un S pour Rot Spanier (rouge<br />
espagnol). Cependant, tous les Espagnols ne sont pas recensés comme tels, que ce soit à<br />
26Estimation de l’ambassade d’Espagne à Paris.<br />
27Cité par Dreyfus-Armand, Emile Témime, in Les camps sur la plage, un exil espagnol, Autrement, 1995, p.20-<br />
21.<br />
28Localisé en Autriche, à 20 km de Linz, le camp de Mauthausen est créé le 8 août 1938 et libéré le 5 mai 1945<br />
par la 11ème division blindée US, avec la collaboration de la résistance organisée à l’intérieur du camp. Il compte<br />
49 camps annexes permanents (comme Gusen) et 10 kommandos ayant existé pour quelques semaines<br />
seulement.<br />
29Situé près de Furstenberg, dans le Nord de l'Allemagne, le camp de Ravensbrück est créé en 1938 et libéré le<br />
30 avril 1945, par l'Armée Russe. Il compte 31 camps annexes et kommandos extérieurs.<br />
30Fabréguet, Michel, Mauthausen. Camp de concentration national-socialiste en Autriche rattachée (1938-<br />
1945), Honoré Champion, 1999. La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) recense 6.737<br />
républicains espagnols déportés à Mauthausen en tant que « triangle bleu ».
Mauthausen ou dans d’autres camps. Ainsi, les Espagnoles déportées à Ravensbrück portent<br />
le triangle rouge <strong>des</strong> prisonniers politiques. Elles sont en effet considérées comme <strong>des</strong><br />
résistantes françaises, ce qui rend difficile toute estimation.<br />
D’autres Espagnols sont également enrôlés comme travailleurs forcés par l’organisation Todt,<br />
entreprise publique du III e Reich 31 . On estime qu’en 1944, 191.000 étrangers travaillaient en<br />
France à la construction du Mur de l’Atlantique pour l’organisation Todt. Au total, 15.000<br />
Espagnols réfugiés en France et livrés par la police française ont été internés dans <strong>des</strong> camps<br />
de travail Todt.<br />
Les évaluations actuelles <strong>des</strong> historiens espagnols tournent autour de ces deux chiffres :<br />
40.000 Espagnols capturés, 30.000 déportés.<br />
Faire connaître l’histoire <strong>des</strong> déportés républicains espagnols<br />
En 2004, <strong>Génériques</strong> et Triangle Bleu ont décidé de travailler en partenariat afin de<br />
reconstituer l’histoire <strong>des</strong> républicains espagnols déportés de France vers les camps de<br />
concentration nazis. Afin de faciliter le travail <strong>des</strong> chercheurs et la diffusion de cette histoire<br />
auprès d’un public plus large, nous avons entrepris le recensement et la sauvegarde <strong>des</strong><br />
archives privées <strong>des</strong> républicains espagnols déportés et travailleurs forcés. Nous avons<br />
également recueilli les témoignages oraux d’anciens déportés et de leur famille, qui ont été<br />
retranscrits et analysés dans un rapport, disponible sur demande. Outre l’édition d’une<br />
plaquette d’information sur la trajectoire <strong>des</strong> déportés espagnols, nous avons réalisé la<br />
traduction de Els Catalans als camps nazis, livre pionnier de Montserrat Roig, romancière et<br />
journaliste. Publié en 1977 en catalan et l’année suivante en espagnol, ce livre fait depuis<br />
l’objet de nombreuses rééditions en catalan et en espagnol, mais il n’avait jamais été publié en<br />
français. Ce livre a été écrit à partir d’une cinquantaine de témoignages recueillis entre 1974<br />
et 1976.<br />
Qu’est-ce qu’un ancien déporté peut posséder comme archives ?<br />
Libérés en avril et mai 1945, les déportés de Ravensbrück et de Mauthausen regagnent<br />
progressivement leur pays, leur vie. Sauf les Espagnols, dont le retour en Espagne est rendu<br />
impossible par la dictature franquiste. Que peuvent-t-ils rapporter de plus de leur captivité que<br />
leur nouvelle liberté, chèrement acquise ? Des vêtements, quelques objets, voilà tout ce qu’il<br />
leur reste comme traces tangibles, en dehors de leurs séquelles physiques. Le cas <strong>des</strong> photos<br />
de Mauthausen soustraites aux nazis par les Espagnols est un cas unique, que nous<br />
développons plus loin.<br />
Le parcours singulier <strong>des</strong> républicains espagnols transparaît dans la nature de leurs archives.<br />
En effet, acteurs <strong>des</strong> événements, que ce soit pendant la guerre d’Espagne, à la libération du<br />
camp ou lors de leur retour en France, ils produisent et possèdent <strong>des</strong> archives. Au contraire,<br />
prisonniers, enfermés dans <strong>des</strong> camps en France et en Allemagne, tout leur est confisqué, ils<br />
ne possèdent plus rien (exception faite de la “ presse <strong>des</strong> sables ” 32 diffusée dans les camps<br />
français). Or sans archives, pas d’histoire. Dès lors, comment étudier la déportation <strong>des</strong><br />
républicains espagnols, sur quels matériaux appuyer les travaux de recherche ?<br />
31 En 1942, après la mort de Fritz Todt, fondateur de l’entreprise, le groupe est retiré du contrôle militaire et<br />
devient une partie du gouvernement central , sous la direction d'Albert Speer.<br />
32 Geneviève Dreyfus-Armand, Emile Témime, Les camps sur la plage, un exil espagnol, Autrement, 1995,<br />
p.103.
Archives privées, archives orales et sources complémentaires<br />
Cette question a sous-tendu tout le travail de <strong>Génériques</strong> et Triangle bleu, dont l’essentiel a<br />
consisté à repérer et à inventorier les <strong>fonds</strong> d’archives d’anciens déportés espagnols et de leur<br />
famille, ainsi que de documentaristes ayant travaillé sur cette thématique. Nécessaire<br />
complément à tout travail sur l’histoire du temps présent, nous avons également procédé à la<br />
constitution d’un <strong>fonds</strong> d’archives orales. Afin d’orienter les recherches du public, nous<br />
proposons en outre une liste <strong>des</strong> sources conservées dans <strong>des</strong> centres d’archives publiques et<br />
privées.<br />
Un contexte tendu : l’affaire Marco<br />
Les témoins directs sont de plus en plus rares et un climat de méfiance et de prudence règne<br />
depuis l’affaire Marco, qui a provoqué un scandale international à la suite duquel nous avons<br />
dû annuler notre projet de partenariat avec l’Amicale espagnole du camp de Mauthausen et<br />
autres camps nazis, dont Enric Marco était président. “ Pendant un quart de siècle, Enric<br />
Marco a porté la parole <strong>des</strong> anciens déportés espagnols. Jusqu'à ce que l'imposture éclate au<br />
grand jour : il n'a jamais connu les camps nazis. Un scandale qui secoue un pays où la<br />
mémoire de la Seconde Guerre mondiale est largement occultée. ” 33<br />
Si ce scandale a ralenti nos travaux pendant une courte période, il a cependant permis de<br />
mettre en lumière l’importance <strong>des</strong> sources d’archives et de leur nécessaire confrontation.<br />
Dans chaque <strong>fonds</strong> de déportés, les photos, les certificats et les courriers ne laissent pas planer<br />
de doutes sur la réalité de l’exil et de la déportation <strong>des</strong> témoins. Ces sources, croisées avec<br />
celles conservées dans les centres d’archives publiques et les témoignages oraux que nous<br />
avons recueillis apportent les matériaux nécessaires à l’écriture d’une histoire qui est encore à<br />
faire. Conscients <strong>des</strong> enjeux révélés par l’affaire Marco, nous avons ouvert un <strong>fonds</strong><br />
d’archives sur l’affaire Marco, alimenté par les échanges entre deux anciens dirigeants de<br />
l’Amicale espagnole.<br />
La question <strong>des</strong> témoignages oraux<br />
Ainsi, le contexte de cette recherche doit être lui-même source d’interrogation, d’analyse.<br />
“ Le témoin porteur d’une expérience, fût-elle unique, n’existe pas en soi. Il n’existe que dans<br />
la situation de témoignage dans laquelle il est placé ” 34 . A ce titre, le <strong>fonds</strong> de Llibert Tarrago,<br />
en tant que fondateur de Triangle bleu, apporte un éclairage précieux sur les origines du<br />
présent projet. Une réflexion sur la production même <strong>des</strong> différents témoignages est<br />
nécessaire : certains déportés ont témoigné lors d’émission à la radio ou la télévision, dans <strong>des</strong><br />
livres, ou ont parfois écrit leur histoire. Des différences peuvent apparaître, par exemple,<br />
selon que l’entretien se déroule en français ou en espagnol. Il serait donc intéressant d’étudier<br />
la langue de l’échange entre témoins et amis de déportation, avec leur famille, les historiens,<br />
dans quelle(s) langue(s) ils tiennent leurs journaux intimes et cahiers de notes.<br />
Il est également nécessaire de s’interroger sur le but de leur témoignage. Il n’est pas inutile de<br />
rappeler que témoin et martyr proviennent de la même racine grecque “ martur ”. Un martyr<br />
est celui qui “ porte témoignage ”, il porte jusque dans sa chair la preuve de son récit. Il ne<br />
33 François Musseau, Libération, 17 juin 2005<br />
34 Annette Wiervorka, L’ère du témoin, Pluriel histoire, Hachette, 2002, p.111
faut pas négliger qu’aujourd’hui, “ ce n’est plus la nécessité interne seule, même si elle existe<br />
toujours, qui pousse le survivant de la déportation à raconter son histoire devant la caméra,<br />
c’est un véritable impératif social qui fait du témoin un apôtre et un prophète ” 35 .<br />
Le chercheur doit user de toute sa rigueur scientifique pour faire l’analyse <strong>des</strong> archives orales,<br />
mais en ne perdant jamais de vue qu’il ne travaille pas sur un document, fut-il “ document<br />
vivant ”, mais avec <strong>des</strong> personnes, à qui il doit un grand respect, car leur plus grande<br />
inquiétude est “ celle d’être dépossédé de [leur] histoire par quelqu’un d’extérieur à<br />
l’expérience et qui prétend précisément la raconter ” 36 . Il ne faut pas tomber dans le travers de<br />
“ cette catégorie d’historiens qui traque les migrations du témoignage, mesure les écarts avec<br />
la “ vérité ”, sans jamais essayer de comprendre à quoi ils correspondent dans l’évolution<br />
psychologique du témoin et dans celle de la conscience collective ” 37 .<br />
Archives privées<br />
Nous avons inventorié neuf <strong>fonds</strong> d’archives privées :<br />
Fonds de déporté-es : Neus Catala, Juan de Diego, José Perlado, Manuel Razola, Joan<br />
Tarrago ;<br />
Fonds de documentaristes : Mariannick Bellot, Patrick Coupechoux ;<br />
Fonds documentaires : Llibert Tarrago et affaire Marco.<br />
Les <strong>fonds</strong> <strong>des</strong> déportés sont composés <strong>des</strong> documents qu’ils conservent depuis la guerre<br />
d’Espagne, qu’il s’agisse de photos, de courriers échangés lors de leur retour en France avec<br />
leur famille et d’anciens déportés, de leurs écrits sur leur expérience de la déportation ou<br />
encore d’objets rapportés de leurs “ pèlerinages ” 38 à Mauthausen.<br />
Les <strong>fonds</strong> de documentaristes comprennent les notes, les rushs d’entretiens et parfois la<br />
documentation rassemblée au cours de leur enquête. Le <strong>fonds</strong> de Mariannick Bellot comprend<br />
ainsi une importante documentation, constituée dans le cadre du reportage Les Travailleurs<br />
forcés du Mur de l’Atlantique 39 . Cette enquête a pour origine l’expérience de la journaliste<br />
dont le grand-père, Juan Somarriba, a été interné dans un camp Todt. Ses interrogations sur<br />
les difficultés rencontrées par son grand-père lors de ses deman<strong>des</strong> de réparation pour son<br />
internement dans <strong>des</strong> prisons et camps de punition de l’organisation Todt (OT) ont été à<br />
l’origine de ce travail. Patrick Coupechoux, journaliste également, a publié en 2003 Mémoires<br />
de déportés : histoires singulières de la déportation 40 . Au cours de ses recherches, il a<br />
rencontré deux Espagnols déportés (Vicente Torres Ruiz déporté à Buchenwald, Mariano<br />
Constante à Mauthausen). Il a déposé dans les locaux de <strong>Génériques</strong> les enregistrements,<br />
synthèses et notes <strong>des</strong> entretiens qu’il a réalisés.<br />
Il nous a paru nécessaire d’offrir aux chercheurs la possibilité de consulter un <strong>fonds</strong><br />
documentaire dédié à la question de la déportation <strong>des</strong> Espagnols. C’est pourquoi nous avons<br />
inventorié les archives de Llibert Tarrago, fils de déporté et initiateur de Triangle bleu. Ce<br />
<strong>fonds</strong> présente un double intérêt, car il ne s’agit pas uniquement d’un <strong>fonds</strong> documentaire,<br />
mais également du <strong>fonds</strong> d’un fils de déporté, comportant ses souvenirs, ses interrogations sur<br />
son héritage.<br />
35 Idem, p.171<br />
36 Idem, p.132<br />
37 Idem, p.66<br />
38 Expression employée par les anciens déportés et leur famille<br />
39 Radiodiffusé en juin 2003 sur France Culture, dans l’émission “ La fabrique de l’histoire ”<br />
40 Editions La Découverte, 2003.
Fonds Neus Catala<br />
Déporté-es espagnol-es : retour en France<br />
Fonds José Perlado
Archives orales<br />
“ Bien qu’il n’existe pas de définition légale, les chercheurs en sciences sociales s’accordent à<br />
constater que l’appellation “ archives orales ” désigne les témoignages recueillis dans un but<br />
de documentation scientifique et/ou dans un souci patrimonial ” 41 . Afin de répondre à cette<br />
exigence de rigueur scientifique dans la constitution d’un <strong>fonds</strong> d’archives orales, nous avons<br />
défini une problématique, puis sélectionné un échantillon de témoins.<br />
Nous avons souhaité les interroger sur le retour en France <strong>des</strong> déportés espagnols, leur<br />
intégration dans la société française, leurs itinéraires familiaux, le lien qu’ils conservent ou<br />
non avec le pays d’origine et la transmission de cette histoire. Nous avons préféré ces<br />
thématiques à un simple récit de leur déportation, car si certains ont déjà livré le récit de leur<br />
déportation dans différents ouvrages et reportages 42 , aucune étude n’avait été entreprise jusque<br />
là sur leur parcours global, de la guerre d’Espagne à leur installation en France.<br />
Cet angle de recherche a étonné, parfois même déconcerté, les témoins. Pourquoi interroger<br />
les épouses ? Pourquoi se pencher sur leur vie en France ? Si nous ne nous sommes pas<br />
limités à leur déportation, c’est que nous pensons que faire le contraire reviendrait à estimer<br />
que “ toute l’expérience de l’individu se trouve ainsi nouée autour <strong>des</strong> années de sa vie qu’il<br />
passa en camp ou dans les ghettos, en vertu d’un pur postulat : que cette expérience a été<br />
l’expérience décisive d’une vie ” 43 . Or, nous ne pouvons pas préjuger de cela. Ce sera aux<br />
historiens justement de débattre de cette question.<br />
Ici, c’est à la globalité de leur itinéraire que nous nous intéressons, ne serait-ce qu’en raison<br />
de l’impossibilité de comprendre leur déportation si les épiso<strong>des</strong> précédents sont occultés.<br />
Citons pour exemple les luttes communes menées avant la déportation, les liens tissés lors de<br />
congrès politiques et qui ont facilité l’organisation de la résistance espagnole à Mauthausen.<br />
L’essentiel de nos entretiens (excepté celui de Neus Catala) porte sur d’anciens déportés à<br />
Mauthausen, ayant fait partie de l’organisation de solidarité et de résistance du camp. Cela<br />
donne une cohérence indéniable aux témoignages oraux que nous avons recueillies, mais en<br />
constitue également une limite, car nous ne pouvons pas déterminer à ce stade si leur parcours<br />
est représentatif de celui de la majorité <strong>des</strong> déportés espagnols. Il serait donc judicieux de<br />
poursuivre ce travail en élargissant notre échantillon, aussi bien pour les témoignages oraux<br />
que les archives privées.<br />
Nous avons recueilli dix témoignages oraux :<br />
Neus Catala et Mariano Constante, déportés espagnols, respectivement à Ravensbrück et<br />
Mauthausen.<br />
Pierre Daix, déporté français à Mauthausen en 1944, qui a fait parti de l’organisation de<br />
résistance, aux côtés <strong>des</strong> Espagnols. Il a préfacé le livre Triangle bleu, écrit par Constante et<br />
Razola et édité en 1969.<br />
Henriette Razola, Marie-Thérèse Constante et Louise Serra, épouses de déportés espagnols.<br />
Maggie Perlado, Llibert Tarrago, Yves et Nathalie Serra, enfants de déportés espagnols.<br />
41 Les “ archives orales ” : rôle et statut, Georgette Elgey, avis et rapports du Conseil économique et social,<br />
éditions <strong>des</strong> Journaux officiels, Paris, 2001.<br />
42 Cf. bibliographie<br />
43 Annette Wiervorka, op.cit, p.174
Pistes de recherche<br />
Certains <strong>des</strong> <strong>fonds</strong> privés que nous avons inventoriés ont déjà été exploités en partie pour <strong>des</strong><br />
expositions 44 , <strong>des</strong> reportages ou <strong>des</strong> livres, mais leur utilisation est restée pour le moment<br />
partielle, se limitant à la mise en valeur de certaines photos et de certains aspects de la<br />
déportation. Jamais un inventaire n’avait été réalisé. Très peu d’historiens français et<br />
espagnols se sont intéressés à la déportation <strong>des</strong> Espagnols et nous espérons que le présent<br />
guide suscitera <strong>des</strong> vocations, car comme l’a démontré l’affaire Marco, il est nécessaire qu’un<br />
véritable travail scientifique, synonyme de confrontation entre différents travaux et sources,<br />
se fasse.<br />
Certains points particuliers du parcours <strong>des</strong> déportés espagnols mériteraient à eux seuls <strong>des</strong><br />
monographies : le convoi d’Angoulême 45 , les itinéraires familiaux <strong>des</strong> déportés, le lien avec le<br />
pays d’origine, .…<br />
Les historiens pourraient également se pencher sur l’organisation Todt en tant que partie<br />
intégrante du système concentrationnaire nazi, ainsi que sur l’histoire de l’élaboration, de la<br />
parution et de l’impact <strong>des</strong> livres Triangle bleu 46 et Els Catalans als camps nazis, tandis que<br />
les sociologues et les historiens pourraient étudier la problématique de la transmission de la<br />
mémoire au sein <strong>des</strong> familles de déportés, mais également au sein <strong>des</strong> sociétés françaises et<br />
espagnoles (au travers <strong>des</strong> monuments commémoratifs, par exemple).<br />
Conservation<br />
Le recensement <strong>des</strong> <strong>fonds</strong> d’archives doit s’accompagner d’une réflexion sur leurs conditions<br />
de conservation et d’accessibilité. Ainsi, le <strong>fonds</strong> de Neus Catala a été déposé en novembre<br />
2004 à la BDIC et un tiers <strong>des</strong> dépositaires <strong>des</strong> autres <strong>fonds</strong> envisage également de les<br />
déposer dans ce centre. Une convention est en cours de finalisation entre cet organisme et<br />
Triangle bleu. La majorité <strong>des</strong> familles préfèrent pour le moment conserver leurs archives afin<br />
de les transmettre à leurs enfants, mais une convention a été signée entre les témoins,<br />
<strong>Génériques</strong> et Triangle bleu afin de les rendre accessibles aux chercheurs.<br />
44 Par exemple pour l’exposition La Part visible <strong>des</strong> camps, Paris, 2005.<br />
45 Le 20 août 1940, 927 Espagnols réfugiés à Angoulême sont arrêtés et envoyés par train à Mauthausen. Les<br />
hommes restent dans le camp, tandis que les personnes non sélectionnées sont renvoyées en France avant d’être<br />
livrées à Irun à la police franquiste. Les plus jeunes hommes de ce convoi ont formé à Mauthausen “ le<br />
commando Poschacher ” du nom de l’entreprise qui les exploitait. Grâce à eux, les clichés volés au laboratoire<br />
<strong>des</strong> SS par les membres de la résistance espagnole du camp ont pu être cachés jusqu’à la libération dans la<br />
maison de Madame Poitner, résistante autrichienne.<br />
46 Au travers notamment du témoignages de Mariano Constante et de la correspondance conservée dans les<br />
archives de Joan Tarrago et Manuel Razola.
Fonds en cours d’inventaire en 2006<br />
CLAP Ile-de-France (Comité de liaison <strong>des</strong> acteurs de la promotion)<br />
La Coordination <strong>des</strong> collectivités portugaises en France (CCPF)<br />
Association <strong>des</strong> parents d’élèves, amis et familles espagnoles (APAFE) - PARIS XV<br />
Asociaçion de padres de familias con hijos minusvalidos espanoles emigrantes en Francia<br />
(APFMEEF, association de parents d’enfants handicapés espagnols)<br />
Génération-femmes<br />
Soleil en Essonne<br />
Fonds en cours d’inventaire en 2006 et dont l’instrument de recherche n’est pas encore<br />
disponible :<br />
Elele<br />
Migrations et Cultures de Turquie mène depuis 1984 <strong>des</strong> actions favorisant l'intégration <strong>des</strong><br />
personnes originaires de Turquie. Si cette intégration repose sur un désir <strong>des</strong> personnes de<br />
participer à la vie du pays d'accueil, ce dernier ne peut cependant faire l'économie de la<br />
connaissance de l'autre, de son histoire, de sa culture et de son projet migratoire.<br />
Fonds Vasco Martins<br />
Collection de journaux édités par <strong>des</strong> associations portugaises en France<br />
Casa Valencia<br />
Association espagnole fondée en 1947.<br />
AEFTI (Association pour l'Enseignement et la Formation <strong>des</strong> Travailleurs Immigrés et leurs<br />
familles)<br />
Association de formation créée en 1971. Nous avons débuté l’inventaire <strong>des</strong> archives de la<br />
fédération AEFTI et de l’AEFTI-93 (Bobigny)
CLAP Ile-de-France<br />
Dates extrêmes : 1978-2001 (<strong>fonds</strong> clos)<br />
Volume : 70 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : état du <strong>fonds</strong><br />
En 1966, un petit groupe de réunion <strong>des</strong> commissions alphabétisation de la FASTI a engagé une réflexion pour une meilleure collaboration<br />
entre les organismes d’alpha et les associations. En juin 1966, les représentants de plus de 30 associations réunis lors d’une réunion<br />
d’information décident de faire quelques actions avant de définir une politique commune. Ils lancent donc une campagne de presse afin de<br />
recruter <strong>des</strong> moniteurs, ainsi qu’un recensement <strong>des</strong> cours existant en région parisienne et les métho<strong>des</strong> utilisées. 47<br />
6 décembre 1967 : assemblée générale constitutive du Comité de liaison <strong>des</strong> acteurs de la<br />
promotion (CLAP), qui est une fédération d’associations. Elle se fixe comme objectifs :<br />
• Regrouper et coordonner les efforts <strong>des</strong> associations adhérentes ;<br />
• Faciliter les échanges d’information et d’expérience entre tous les groupes poursuivant les<br />
mêmes buts : susciter partout où le besoin se faire sentir <strong>des</strong> centres d’alpha et de<br />
promotion.<br />
• Etre un centre de recherche et d’information sur les métho<strong>des</strong> pédagogiques et les moyens<br />
didactiques appropriés : commissions de travail, publications, stages de formation de<br />
formateur.<br />
• Contribuer à une meilleure connaissance <strong>des</strong> problèmes socio-culturels <strong>des</strong> migrants et<br />
éveiller l’opinion publique à leurs problèmes ;<br />
• Démarcher les pouvoirs publics et autres partenaires ;<br />
• Inciter à la création de comités régionaux.<br />
Le CLAP a fait parti du “ collectif <strong>des</strong> 45 ” qui est à l’origine de la réflexion sur<br />
l’alphabétisation. Contrairement au CLP, il regroupait <strong>des</strong> associations plus petites. Le CLAP<br />
était adhérent au CLP et s’occupait plus d’alphabétisation tandis que le CLP est plus tourné<br />
vers la pré-formation. Il était plus marqué idéologiquement, plus militant.<br />
Etat du <strong>fonds</strong><br />
Le <strong>fonds</strong> du CLAP-Ile-de-France est volumineux (70 ml) et a été sauvé de la <strong>des</strong>truction au<br />
moment de la fermeture du CLAP-IDF. Le CLAP-IDF a cessé ses activités en 2003, mais<br />
certains groupes locaux, comme le CLAP-Sud ouest existent toujours.<br />
47 Source :“ En France, un million d’analphabètes ”, Hommes et migrations, supplément<br />
n°1065, 1984
Publications du CLAP<br />
CLAP I Alphabétisation et promotion, bulletin du CLAP national, 1971-1976<br />
CLAP II Idem, 1977-1979<br />
CLAP III Idem, 1980-1981 + suppléments divers (1980)<br />
CLAP IV Idem, 1982-1985<br />
CLAP V Idem, Nouvelle série (1986-1987) ; La Lettre du CLAP, Alphabétisation et<br />
promotion Hebdo, et hors série 1988-1995 + Suppléments “ Concours écriture ” et guide<br />
“ Ateliers écriture ” (1990-1995) + L’Oreille, supplément à Alpha hebdo (1992-1994)<br />
CLAP VI à VIII Publications périodiques du CLAP IDF (à classer après tri)<br />
CLAP IX Publications périodiques du CLAP Alsace-Lorraine (à classer après tri)<br />
CLAP X Publications périodiques <strong>des</strong> délégations CLAP en Provence-Alpes-Côted’Azur,<br />
Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées (à classer après tri)
CCPF<br />
Dates extrêmes : années 1980-2000 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 57 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : état du <strong>fonds</strong><br />
La Coordination <strong>des</strong> collectivités portugaises en France (CCPF) a été créée au début <strong>des</strong><br />
années 1980 afin de rassembler les associations de Portugais en France. Elle est avant tout un<br />
centre d'accueil et de soutien aux associations. Elle apporte son aide aux dirigeants associatifs<br />
qui veulent monter et concevoir <strong>des</strong> projets, trouver <strong>des</strong> financements, établir <strong>des</strong> contacts<br />
avec d'autres associations, <strong>des</strong> artistes, <strong>des</strong> municipalités, <strong>des</strong> institutions...<br />
Les objectifs principaux de la CCPF sont :<br />
- Développer un réseau associatif<br />
- Contribuer à une meilleure insertion sociale <strong>des</strong> portugais en France<br />
- Promouvoir la langue et la culture portugaises en France<br />
- Dynamiser <strong>des</strong> actions dans le domaine de la jeunesse<br />
Le <strong>fonds</strong> est en cours de classement. Nous sommes d’abord intéressés à la collection de<br />
journaux du CCPF a fait l’objet d’un premier travail. En effet, dans les sièges <strong>des</strong> associations<br />
portugaises se trouvent <strong>des</strong> journaux et toute une presse régionale publiée au Portugal et qui<br />
arrive à l’association, en générale par l’intermédiaire d’un <strong>des</strong> adhérents. Outre la presse<br />
portugaise, nous trouvons dans cette collection les publications de quelques associations, qui<br />
ont créé leurs propres instruments de communication.<br />
Collection de journaux<br />
Edités au Portugal<br />
Almada Press/ França press, para portugueses no mundo<br />
Etat de la collection : 1991, 1993-1996 (collection incomplète). França press est un<br />
supplément de Almada press.<br />
Caravela<br />
Etat de la collection : n°57, 63 (1988), 70 (1989), 103 (1992)<br />
Info migraçoes, dedicado as communida<strong>des</strong> migrantes, aos refugiados e minoas etnicas<br />
Lusitano, communida<strong>des</strong> portuguesas (puis jornal dos portugueses residentes no estrangeiro)<br />
Etat de la collection : 1987 (n°24), 1992 (n°104, 109), 1988-1989, 1992-2001<br />
O Emigrante, vos de Portugal, o jornal intercomunitario portugues independente de maior<br />
circulaçao no mundo<br />
Etat de la collection : 1983 (2 numéros), 1984-1995.<br />
Portugal das comunida<strong>des</strong>, jornal para a emigraçao<br />
Etat de la collection : n°12, 14 (1987), 15 (1988)
Portugal<br />
Etat de la collection : n104 (1998), 106, 107 (1999)<br />
Portucalense, o jornal das communida<strong>des</strong> portuguesas na Europa<br />
Etat de la collection : n° 118-120, 127, 128 (1998).<br />
Mundo portugues<br />
Etat de la collection : 1995-2000 (collection complète), 2001 (collection incomplète).<br />
Successeur de O Emigrante.<br />
Edités en France<br />
A luz portuguesa<br />
Etat de la collection : 1993-1995<br />
Aqui Portugal<br />
Encontro, das communida<strong>des</strong> portuguesas (à partir de 2000 Das communida<strong>des</strong> de lingue<br />
portuguesa). Imprimé au Portugal, distribué en France.<br />
Etat de la collection : 1992-1997, 1999-2001.<br />
Opiniao, Luso informaçao de França<br />
Etat de la collection : 200-2001.<br />
Portugal sempre, O jornal da communidade Portuguesa de França<br />
Etat de la collection : 1999-2000.<br />
Portugal no mundo<br />
Presença portuguesa, a voz dos portugueses na Europa<br />
Publi Portugal, mensuel bilingue de la communauté portugaise et de l’espace lusophone<br />
Etat de la collection : 1983-1992 (collection incomplète)<br />
Edités ailleurs<br />
Contacto, O primeiro jornal de lingua portuguesa no luxemburgo<br />
Etat de la collection : 2001
Association <strong>des</strong> parents d’élèves, amis et familles espagnoles<br />
(APAFE) - PARIS XV<br />
Dates extrêmes : 1976-2005 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 4 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : répertoire numérique<br />
L’association <strong>des</strong> parents d’élèves, amis et familles espagnoles (APAFE) est une association<br />
espagnole fondée en 1976 et officiellement déclarée en 1981 48 . Elle est implantée dans le<br />
quinzième arrondissement de Paris, à la maison paroissiale. Elle a pour objectif premier de<br />
permettre aux membres de l’association et leurs familles de faire face aux difficultés liées à<br />
l’émigration et à réussir, par la suite, leur intégration.<br />
Pour cela, l’association constitue <strong>des</strong> réseaux de solidarité afin de permettre à ses membres de<br />
trouver un travail, un logement, etc., et elle crée <strong>des</strong> espaces de rencontre entre compatriotes<br />
afin de rompre leur isolement. Parmi les moyens mis en œuvre par l’association, on compte<br />
l’obtention de cours de langue et culture espagnoles pour les enfants, aussi bien pour<br />
préserver leurs liens avec leur culture d’origine, que pour faciliter leur intégration dans le<br />
système scolaire espagnol, en cas de retour retour en Espagne.<br />
Pour mieux atteindre ce but, l’association anime elle-même <strong>des</strong> actions <strong>des</strong>tinées à la<br />
promotion et à la connaissance de la langue et de la culture espagnoles (géographie, histoire et<br />
langue écrite). Dans les années 1980, elle œuvre également à l’obtention d’une classe de BUP<br />
(Bachillerato unificado y polivalente, équivalent du BAC) dans les locaux de la rue Grenelle.<br />
En 1991, lorsque la FAEEF 49 et l’APFEEF s’unissent pour donner naissance à la FACEEF 50 ,<br />
l’association adhère à cette nouvelle fédération. Elle participe alors à <strong>des</strong> campagnes pour les<br />
droits civiques et pour une citoyenneté européenne ouverte aux résidents. Dès la fin <strong>des</strong><br />
années 1980 l’association participe également aux concours et aux festivals organisés par sa<br />
fédération.<br />
Au cours de ces dernières années, l’association a mis en place <strong>des</strong> activités culturelles, telles<br />
que <strong>des</strong> réunions d’information et <strong>des</strong> cours de danse et de guitare, afin notamment de faire<br />
connaître la culture espagnole. Elle organise également <strong>des</strong> sorties, tant en France (châteaux<br />
de la Loire, Etretat et Normandie), qu’à l’étranger (Autriche, Belgique), et au moins cinq fêtes<br />
au cours de l’année, qui sont autant de moment d’échanges culturels, étoffant ceux pris lors<br />
du Forum <strong>des</strong> associations organisé par la mairie du XVe arrondissement.<br />
L’association s’implique aussi dans <strong>des</strong> actions sociales, en collectant par exemple de dons<br />
pour le téléthon ou en faveur du Nicaragua, suite au passage de l’ouragan Mitch en 1998.<br />
48 La loi du 9 octobre 1981 abroge les discriminations à l'encontre <strong>des</strong> étrangers introduites par le décret-loi de<br />
1939 et rétablit ainsi la liberté d'association dans sa plénitude de principe et sa généralité.<br />
49 Fédération d’Associations d’Emigrants Espagnols en France (FAEEF), constituée en 1968.<br />
50 Fédération <strong>des</strong> Associations et <strong>des</strong> Centres d’Emigrés Espagnols en France.
Depuis quelques années, comme dans d’autres associations d’Espagnols, la présidente est une<br />
femme, ce qui témoigne de l’implication de plus en plus grande <strong>des</strong> femmes dans ces<br />
organismes.<br />
Etat du <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
Les archives de l’APAFE sont rédigées en espagnol et en français et comprennent aussi bien<br />
<strong>des</strong> rapports et projets d’activités que <strong>des</strong> affiches, <strong>des</strong> notes, <strong>des</strong> factures et <strong>des</strong> tracts. Il est à<br />
noter qu’une partie <strong>des</strong> archives est conservée chez les membres du conseil d’administration.
I/ VIE INTERNE<br />
Boîte 2 : PREFECTURE DE POLICE (1982-2002)<br />
- Déclaration et Récépissé<br />
- Courrier<br />
Boîte 3 : Statuts (1976-2000)<br />
Boîte 4 : liste <strong>des</strong> adhérents (1989-2005)<br />
Boîte 14 : Assemblées et Informations (1978-2005)<br />
- Lettres d’informations français / espagnol<br />
- Convocations Assemblées français / espagnol<br />
- Procuration de vote<br />
II/ COMPTABILITE<br />
Boîte 11 : Assurances<br />
- Plaquettes<br />
- Contrats<br />
- Relevés et Avis d’échéance<br />
Boîte 12<br />
: Factures (1981-2005)<br />
Boîte 15 : Comptabilité Générale (1976-2001)<br />
+ 3 classeurs<br />
- Balance Comptable<br />
- Courrier bancaire<br />
- livre de compte (1976-1996)<br />
- remise de chèque et souches<br />
- Relevé bancaire (1990-2000)<br />
Boîte 16 : Subventions (1994-2002)<br />
- Imprimés et demande<br />
- Courrier<br />
III/ COURRIER<br />
Boîte 8 : Correspondances Paroisse (1993-2004)<br />
- Courrier<br />
Boîte 9<br />
Boîte 10<br />
: Correspondances doléances (1988-2002)<br />
: Correspondances Commerciales (1983-1999)<br />
- Courrier demande de Cadeaux
IV/ F.A.C.E.E.F<br />
Boîte 1 : Congrès de l’Emigration (1982-2000)<br />
- Bulletins d’informations<br />
- Courrier<br />
- Brochures<br />
Boîte 7 : FACEEF<br />
- Courrier<br />
- Bulletin<br />
- Brochure<br />
- Appel de cotisation<br />
V/ RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISMES<br />
Relations avec d’autres associations<br />
Boîte 13 : Autres associations<br />
- Plaquettes<br />
- Brochures<br />
Tracts<br />
Relations avec les institutions françaises et espagnoles<br />
Boîte 18 : Ministères (1994-1997)<br />
- Bulletins<br />
Boîte 19 : Ambassade (1977-2002)<br />
- Circulaire<br />
- Attestations <strong>des</strong> subventions<br />
- Courrier<br />
- Bulletin d’informations<br />
Boîte 20 : Consulat (1986-2002)<br />
- Circulaire<br />
- Courrier<br />
Boîte 22 : Mairie XV<br />
- Brochures<br />
- Courrier<br />
- Affiches et plaquettes<br />
VI / ACTIVITES<br />
Activités scolaires<br />
Boîte 6 : Cours d’espagnol<br />
- Documents sur l’enseignement <strong>des</strong> enfants émigrés
- Liste <strong>des</strong> élèves / <strong>des</strong> salles / <strong>des</strong> parents<br />
- Concours littéraire et artistiques<br />
Les documents ci-après sont conservés chez les membres du Conseil D’administration :<br />
Documents administratifs<br />
Vice-secrétairee<br />
Secrétaire<br />
Présidente<br />
Documents comptables<br />
Trésorière<br />
Vice-trésorière<br />
Documents relatifs au cours<br />
Trésorière<br />
Vice-trésorièree<br />
Documents relatifs au Fête<br />
Vice-trésorière (CD, photos)<br />
Activités festives<br />
Boîte 17 : programmes et tracts de l’association<br />
Boîte 21 : Excursions (1980-2005)<br />
- Bulletin d’inscription<br />
- Description voyages / program
Asociaçion de padres de familias con hijos minusvalidos espanoles<br />
emigrantes en Francia (APFMEEF, association de parents<br />
d’enfants handicapés espagnols)<br />
Dates extrêmes : 1978-2005 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 2 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : répertoire méthodique<br />
L’ Asociaçion de padres de familias con hijos minusvalidos espanoles emigrantes en Francia<br />
(APFMEEF, association de parents d’enfants handicapés, appelée également « Minusválidos<br />
Paris ») a été créée en 1976 sous la présidence de Pilar Garcia, six ans avant la déclaration<br />
officielle qui eut lieu en mai 1982.<br />
Elle est aidée à ses débuts par l’association <strong>des</strong> pères de familles espagnols émigrés en France<br />
(APFEEF), et fonctionne grâce au porte-à-porte et aux rencontres faites dans les centres pour<br />
enfants handicapés. L’association se fixe comme objectif d’obtenir l’égalité <strong>des</strong> droits, aussi<br />
bien auprès de l’administration espagnole que française, pour les enfants handicapés issus de<br />
l’immigration.<br />
Un autre but premier de l’association est de sensibiliser les familles au handicap, de briser le<br />
silence et d’aider les parents et les familles de handicapés à assumer, sans culpabilité, la<br />
responsabilité qui leur incombe, dans le contexte particulier de l’émigration.<br />
L’association obtient en 1979 la création de deux classes complémentaires en espagnol. En<br />
effet, les <strong>des</strong>cendants d’immigrés espagnols bénéficiaient déjà d’un apprentissage de la langue<br />
et de la culture d’origine, dans le cadre de l’ELCO (école linguistique de corpus oraux), mais<br />
il n’existait pas encore d’enseignement spécialisé.<br />
L’APFMEEF organise également <strong>des</strong> moments de rassemblements conviviaux (fêtes, sorties,<br />
repas) et elle tient ses membres informés de leurs droits, tout en s’impliquant dans les luttes<br />
pour la reconnaissance <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> handicapés et <strong>des</strong> immigrés.<br />
En 1991, lorsque la FAEEF 51 et l’APFEEF s’unissent pour donner naissance à la FACEEF 52 ,<br />
l’association adhère à cette nouvelle fédération, dans laquelle elle continue aujourd’hui de<br />
jouer un rôle important. En effet, elle est présente à tous les congrès et réunions importantes<br />
de la FACEEF dont les thèmes touchent les personnes handicapées. La fédération, de son<br />
côté, se charge de les représenter et de défendre leurs droits devant toutes les institutions<br />
compétentes.<br />
En 1982 et 1983, <strong>des</strong> journées d’étude placées sous le patronage du IEE (institut espagnol<br />
d’émigration) et du INSERSO (institution nationale du service social) se sont tenues à Madrid<br />
sur « la problématique <strong>des</strong> handicapés dans l’émigration ». Ces journées ont été organisées en<br />
partie par l’association, qui a ensuite participé à la création d’une fédération européenne de<br />
parents d’enfants handicapés espagnols en 1982. Même, si la fédération n’a existé que deux<br />
51 Fédération d’Associations d’Emigrants Espagnols en France (FAEEF), constituée en 1968.<br />
52 Fédération <strong>des</strong> Associations et <strong>des</strong> Centres d’Emigrés Espagnols en France.
ans, elle a établit <strong>des</strong> contacts permettant que les expériences de chacun puissent circuler d’un<br />
pays à un autre.<br />
En 1984, l’administration décide, de manière unilatérale, de supprimer les deux classes<br />
spécialisées en invoquant comme motif l’ouverture d’une section non spécialisée dans une<br />
autre école. L’association est cependant parvenue à maintenir les deux classes dans les mêmes<br />
conditions.<br />
En 1995, la présidence est reprise par Aureliano Martin à qui succède trois ans plus tard<br />
Patrocinio Campillo, sans que les objectifs de l’association soient modifiés en profondeur.<br />
En 2005, et après avoir rencontré plusieurs difficultés dans la décennie 1990 dans le maintien<br />
<strong>des</strong> classes, l’association a rencontré l’un de ces plus grands succès : la reconnaissance<br />
comme APA (association de parents d’élèves). Ce statut leur permet de bénéficier de tous les<br />
droits inhérents à ces organismes et en particulier d’accéder à un local et à toutes les<br />
installations de l’école espagnole de Paris, où sont donnés les cours.<br />
Etat du <strong>fonds</strong> et conditions de consultation<br />
Le <strong>fonds</strong> d’archives de l’APFMEEF est composé d’une vingtaine de cartons et classeurs qui<br />
permettent de retracer les évolutions de l’association depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.
Répertoire méthodique<br />
Les archives non cotées correspondent à <strong>des</strong> liasses.<br />
Vie interne et activités<br />
09 Convocations aux assemblées générales. Statuts.<br />
12 Comptes-rendus de réunions.<br />
Liste <strong>des</strong> adhérents.<br />
Convocations aux assemblées générales.<br />
Programmes de fête de l’association.<br />
13 « Textos definitivos de las normas de los consejos de residentes<br />
Comptabilité<br />
espanoles en el exterior »<br />
« Consejo de residentes espanoles. Comision de asuntos<br />
sociales del CRE de Paris »<br />
Livre de comptabilité.<br />
08 Livres de compte.<br />
1978-1996<br />
1982-1993<br />
1985<br />
1986<br />
1978-2004<br />
1978-2004
01 Factures, bilans.<br />
05 Factures, relevés de banque, bilan.<br />
14 Comptabilité.<br />
15 Comptabilité.<br />
07 Factures, relevés de compte, bilans.<br />
02 Relevés de compte.<br />
10 Deman<strong>des</strong> de subvention.<br />
Correspondance<br />
18<br />
03<br />
17<br />
06<br />
11<br />
Cahier de comptabilité.<br />
1978-1985<br />
1980-1993<br />
1981-1993<br />
1988-1992<br />
1993-1999<br />
04 Correspondance avec la FAEEF.<br />
Correspondance avec l’APFEEF.<br />
1980-1986<br />
1986<br />
1986-1988<br />
1986-1999<br />
1990-1996<br />
1997-1999<br />
1999-2005<br />
2000-2005<br />
1990-1996
Divers<br />
19<br />
20<br />
1980-1999<br />
1997-1999
Génération-femmes<br />
Dates extrêmes : 1992-2005 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 8 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : répertoire méthodique<br />
Génération-femmes est créée le 11 mars 1992, afin de former <strong>des</strong> médiatrices capables d’aider<br />
les familles en difficulté et pour favoriser leur autonomie, principalement celle <strong>des</strong> femmes et<br />
<strong>des</strong> jeunes. Les actions de l’association s’étendent à Evry, Courcouronnes, Ris-Orangis et<br />
Juvisy (Essonne).<br />
La fondatrice de l’association travaille au début de manière informelle, sans structure<br />
officielle ni formation, partant de son expérience de terrain acquise en aidant les familles.<br />
Face à la multiplication <strong>des</strong> deman<strong>des</strong>, elle rencontre <strong>des</strong> femmes participant déjà à <strong>des</strong><br />
activités socio-éducatives dans <strong>des</strong> associations. Ensemble, elles constituent un groupe de<br />
travail pour mener une réflexion sur les besoins <strong>des</strong> familles et en particuliers <strong>des</strong> femmes<br />
immigrées.<br />
De leurs premières enquêtes, elles concluent qu’en premier lieu ces femmes souhaitent<br />
disposer d’un espace d’information et de convivialité. Dans le même temps, elles soulignent<br />
que si <strong>des</strong> lieux de rencontre existent déjà, ils ne répondent pas à leurs attentes, car ces<br />
femmes se heurtent à <strong>des</strong> difficultés de communication et ne se sentent pas toujours en<br />
confiance dans ces lieux.<br />
Lorsque que Génération-femmes est officiellement créée, l’association se fixe comme mission<br />
d’être un espace de communication plus qu’une structure d’activités, tout en soulignant que<br />
« le propre de la médiation socio-culturelle est de s’effacer quand les personnes ont trouvé les<br />
moyens de leur intégration » (rapport d’activités, 1996).<br />
L’association, qui doit son nom à la volonté d’agir comme passerelle entre les générations,<br />
afin de rompre l’isolement <strong>des</strong> personnes âgées, structure ses actions autour de trois axes :<br />
- la médiation socio-culturelle (médiation scolaire et accompagnement social <strong>des</strong> familles),<br />
- les rencontres, qu’elles soient thématiques (excision, santé, logement…) ou conviviales,<br />
- l’apprentissage de la gestion du quotidien, pour permettre une meilleure intégration.<br />
Génération-femmes est fondée par <strong>des</strong> femmes originaires du Togo, qui souhaitent ouvrir<br />
l’association à toutes les communautés. Cette volonté d’échange transparaît également dans<br />
les contacts pris avec les enseignants, pour leur proposer de s’impliquer dans les activités de<br />
l’association. C’est ainsi que rapidement <strong>des</strong> enseignantes rejoignent le conseil<br />
d’administration de l’association.<br />
Ensemble, elles repèrent les besoins <strong>des</strong> femmes immigrées, afin de comprendre pourquoi la<br />
plupart ne fréquentent pas les Maisons de quartier et ne s’impliquent pas plus dans la scolarité<br />
de leurs enfants. Après avoir mis en évidence ces freins, Génération-femmes décide : « on ne<br />
ferait pas d’activités du genre cours d’alphabétisation, mais de la médiation, à savoir mettre<br />
les personnes en communication, en lien, et petit à petit nous, on s’effacerait, parce que ce qui<br />
manque, en fait, c’est la communication. » (Andolé Ankrah dans un entretien pour la « Lettre<br />
de maison du monde », mars 1996)<br />
Ainsi, tout en leur expliquant le fonctionnement du système scolaire français, l’association<br />
leur apprend à participer à la scolarité de leurs enfants, sans que le fait de ne pas savoir lire ou<br />
écrire soit un handicap.
Archives<br />
Les archives, en cours de classement, comprennent la comptabilité, les rapports d’activités et<br />
les comptes-rendus <strong>des</strong> missions <strong>des</strong> médiatrices (souvent manuscrits, racontant leurs<br />
expériences).
Soleil en Essonne<br />
Dates extrêmes : 2000-2005 (<strong>fonds</strong> ouvert)<br />
Volume : 2 mètres linéaires<br />
Instrument de recherche : répertoire numérique<br />
Soleil en Essonne est une association loi de 1901 ; simple regroupement informel, le Cercle<br />
<strong>des</strong> Amis du Maghreb, au départ (2001), elle est créée en janvier 2002, sous le nom de Coup<br />
de Soleil en Essonne, liée à l’association franco-maghrébine Coup de Soleil (Paris). Elle s’en<br />
est détachée par décision en A.G. statutaire, prenant le nom de Soleil en Essonne (publication<br />
au J.O. du 16 juillet 2005).<br />
La réflexion sur les questions de société relatives à la place et au sort <strong>des</strong> personnes et<br />
groupes arrivés en France dans les dernières décennies a conduit les membres de l’association<br />
à préciser leurs objectifs et leur démarche pour contribuer à renforcer la cohésion de notre<br />
société.<br />
L’association a progressivement donné la priorité au travail de connaissance réciproque et de<br />
rapprochement par le moyen de l’échange interculturel. Nous prenons la culture comme un<br />
levier fondamental pour faire bouger les représentations et les comportements, dans le but de<br />
favoriser une plus grande autonomie et une plus grande affirmation citoyenne, individuelle et<br />
collective.<br />
Logiquement, nous essayons d’appliquer à ces visées une démarche de travail de proximité.<br />
Dans l’Essonne, nous nous limitons à <strong>des</strong> actions dans les villes et quartiers de la partie est<br />
(de Corbeil-Evry à Montgeron-Crosne). Nos actions sont accompagnées de travaux d’étu<strong>des</strong><br />
en ateliers et séminaires internes ; ils nous permettent d’articuler réflexion et action. Nous<br />
travaillons sur projets répondant ordinairement à <strong>des</strong> sollicitations extérieures d’organismes<br />
publics ou semi-publics (Mairies, Maisons de quartiers, Réseau d’éducation prioritaire,<br />
Sonacotra…), ce qui nous permet d’avoir <strong>des</strong> financements publics et privés (FASILD,<br />
Politique de la Ville, Conseil Général, Communes, Fondation Aéroport de Paris…).<br />
Quelques exemples d’actions :<br />
Mois du Maghreb à Montgeron (ensemble de manifestations culturelles, mars 2003) ;<br />
conduite d’une médiation dans un groupe de parole de femmes de quartier (La Forêt,<br />
Montgeron, 2004-2005) ; animation d’un atelier « Relations Ecole et familles, approche<br />
interculturelle et communicationnelle » (REP Vigneux-Draveil-Montgeron, 2004-2005) ;<br />
Organisation de la Semaine de solidarité internationale avec le Maghreb (Crosne, 2005) ;<br />
Séminaire « Expériences de la communication interculturelle (interculturalité, spatialisations<br />
et dynamiques sociales) », (en direction d’acteurs de terrains, Essonne, 2004-2005) ;<br />
animation d’un groupe « Femmes » (quartier <strong>des</strong> Aunettes, Evry, 2004 à 2006) ; « Un foyer<br />
dans la ville » (actions d’insertion citoyenne dans la ville du Foyer Sonacotra de Montgeron,<br />
2006) ; publication de la revue AZRAK-Bleu (depuis 2003)…
Etat du <strong>fonds</strong><br />
Nos <strong>fonds</strong> associatifs comprennent 5 gran<strong>des</strong> parties<br />
1. Historique<br />
2. Archives administratives<br />
3. Actions<br />
4. Productions<br />
5. Documentation<br />
Les parties 2 et 3 sont divisées en Dossiers d’affaires en cours (classés D1) et dossiers<br />
d’affaires passées (classés D2).<br />
Certains dossiers et documents (marqués d’un astérisque) sont soumis à autorisation de<br />
consultation de notre part.<br />
L’association dispose aussi d’un <strong>fonds</strong> d’archives photographique non encore répertoriées.
1. HISTORIQUE/ HIS<br />
Cercle <strong>des</strong> Amis du Maghreb.<br />
Section de l’Essonne de l’association Coup de Soleil (certains documents *)<br />
Sortie de Coup de Soleil *.<br />
2. ADMINISTRATION/ ADM<br />
- ADM/ D1<br />
Administration, organisation (statuts, adhérents *, CR de réunions *), finances, comptabilité,<br />
assurance, communication interne et externe<br />
- ADM/ D2<br />
I. Administration et organisation, communication, relations avec autres associations<br />
II. Finances, comptabilité, locaux, assurances.<br />
3. ACTIONS/ ACT<br />
- ACT/ D1<br />
I. Atelier Histoire et Mémoire<br />
Notes de réunions<br />
Harkis<br />
Histoire et mémoire : D. Assouline (Association Au nom de la mémoire) à l’AGECA<br />
II. Atelier Religion et société<br />
Laïcité<br />
III. Atelier lecture<br />
Notes de réunions<br />
Plaquette de présentation.<br />
Fiches de lecture pour l’atelier lecture (lectures publiques)<br />
IV. Partenariats<br />
Notes <strong>des</strong> rencontres, courriers, projets communs :<br />
Compagnie de l’Eygurande (quartier Champtier du Coq, Evry)<br />
Association <strong>des</strong> Jeunes Vigneusiens (certains documents *)<br />
Œuvrer en Essonne pour une Europe fraternelle (certains documents *)<br />
V. Groupes Projets<br />
« Un foyer dans la ville », SONACOTRA, Montgeron ; comprend notamment : notes de<br />
réunions *, Journal de bord de l’atelier-conte * (printemps 2006), contes et récits de résidents
• ACT/ D2<br />
I. Dossiers 2002-2005 : divers 2002 ; solidarité Algérie, Bab el Oued ; cours d’arabe<br />
St Exupery ; mois du Maghreb à Montgeron (mars 2003) ; solidarité Algérie,<br />
Boumerdès, 2003 ; solidarité Maroc, 2004 ; actions sur Evry, 2004 ; groupe de<br />
parole « Femmes » de St Exupéry, 2004 ; conférences-débats Montgeron (Habib<br />
Tengour, Paul Balta, Leïla Sebbar) ; semaine de la solidarité internationale<br />
(Maghreb, Crosne, 2005) ; Séminaire interne (Rencontre de Corbeil, 2005) :<br />
Mythes et écritures de l’Histoire (avec Suzanne Citron)<br />
II. Atelier Réseau d’Education Prioritaire (REP) Vigneux-Draveil-Montgeron, 2004-<br />
2005 : « Relations Ecole/Familles, approche interculturelle et<br />
communicationnelle » (certains documents *)<br />
III. Séminaire externe 2004 : Approche culturelle et pluridisciplinaire <strong>des</strong> mo<strong>des</strong><br />
d’action en milieux urbains sensibles<br />
IV. Séminaire 2005 : Expériences de la communication interculturelle (interculturalité,<br />
spatialisations et dynamiques sociales)<br />
4. PRODUCTION/ PROD<br />
PROD/ D2<br />
I. Le Lien (Bulletin interne) ; cassette audio Gilles Manceron (1962-2002 : pourquoi<br />
commémorer le cessez-le-feu en Algérie ?) ; Extraits <strong>des</strong> Actes du séminaire<br />
2004 :; affichettes et flyers divers ; plaquette actions les Aunettes, Evry, 2005 ;<br />
Plaquette Relations Ecole/Familles (paroles d’enseignants, parents,élèves), 2004 ;<br />
Cahiers <strong>des</strong> contributions au séminaire 2005 ; Entretiens « Histoires de<br />
migrants » ;<br />
II. AZRAK 2000-2006 dont : AZRAK 6 (Actes séminaire 2004) ; AZRAK 7 (Actes<br />
séminaire 2005) ; AZRAK 8 (L’Hospitalité) ; AZRAK 9 (à paraître 2006) : Actes<br />
du séminaire interne (Rencontres de Corbeil, 2005) : Mythes et écritures de<br />
l’histoire + Dossier Harkis (Travaux du Groupe Histoire et mémoire, 2006) ;<br />
5. DOCUMENTATION/ DOC<br />
I. Islam ; monde musulman<br />
Divers dossiers dont : Tarik Ramadan<br />
II. Islam ; monde musulman<br />
Vide<br />
III. Immigration, intégration<br />
Divers dossiers dont : La Gauche et les Harkis * . Raouf Benyaghlane. 20 ème printemps<br />
berbère. Politique de l’immigration<br />
IV. Immigration ; intégration<br />
Divers dossiers, dont : Loi CEDESA
V. Immigration ; intégration<br />
Vide<br />
VI. Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI)<br />
VII. Interculturalité ; intercultualité<br />
Rencontre avec J-P. Nave, Délégation diocésaine aux relations avec l’Islam, Evry * ; affaire<br />
<strong>des</strong> caricatures du Prophète ;<br />
VIII. Interculturalité ; intercultualité<br />
Vide<br />
IX. Laïcité<br />
Divers dossiers dont : textes fondamentaux<br />
X. Laïcité<br />
Vide<br />
XI. Colonisation ; esclavage.<br />
Divers dossiers<br />
XII. Colonisation ; esclavage<br />
Vide<br />
XIII. Guerre d’Algérie<br />
Divers dossiers.<br />
XIV. Guerre d’Algérie<br />
Vide<br />
XV. Banlieues<br />
Divers dossiers dont : banlieues, grands ensembles<br />
XVI. Crise <strong>des</strong> banlieues novembre 2005.<br />
XVII. Pieds-Noirs<br />
Divers dossiers dont : Pieds-Noirs et OAS.
Table <strong>des</strong> matières<br />
ABDELMALEK SAYAD..............................................................................................................................................11<br />
SAAD ABSSI...........................................................................................................................................................14<br />
OLIVIER AUBERT....................................................................................................................................................17<br />
FAROUK BELKEDDAR...............................................................................................................................................19<br />
BÉATRICE BONNEAU...............................................................................................................................................20<br />
SAÏD BOUZIRI.........................................................................................................................................................22<br />
HAMOUDI DJATAOU................................................................................................................................................23<br />
SIMONE LELLOUCHE-BEN OTHMAN...........................................................................................................................24<br />
ASSOCIATION DE CULTURE BERBÈRE (ACB)...............................................................................................................27<br />
ASSOCIATION CULTURELLE DES MAGHRÉBINS DE SARCELLES (ACMS).........................................................................29<br />
ASSEMBLÉE CITOYENNE DES ORIGINAIRES DE TURQUIE (ACORT)....................................................................................30<br />
ASSOCIATION DES MAGHRÉBINS DE FRANCE (AMF)...................................................................................................31<br />
VICARIAT DE LA SOLIDARITÉ ...................................................................................................................................33<br />
ASTI-BORDEAUX..................................................................................................................................................34<br />
ASSOCIATION DES TUNISIENS DE FRANCE (ATF)........................................................................................................35<br />
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS MAGHRÉBINS DE FRANCE (ATMF).............................................................................37<br />
COLLECTIF DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL, HANDICAPÉS ET RETRAITÉS POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS (CATRED)...................39<br />
CENTRE POUR LA COMMUNICATION ET LA FORMATION DANS L’ESPACE LOCAL (CCFEL)...................................................41<br />
CENTRE FRANCE-ASIE.............................................................................................................................................43<br />
COMITÉ DE LIAISON POUR LA PROMOTION DES MIGRANTS ET DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ D’INSERTION (CLP).......................44<br />
COORDINATION POUR LE DROIT DES ÉTRANGES À VIVRE EN FAMILLE................................................................................47<br />
FÉDÉRATION DES TUNISIENS POUR UNE CITOYENNETÉ DES DEUX RIVES (FTCR)...............................................................48<br />
INTERACTION FRANCE-PORTUGAL..............................................................................................................................49<br />
MAISON DES FEMMES, ARCHIVES RECHERCHES ET CULTURES LESBIENNES (ARCL) ET RÉSEAU POUR L'AUTONOMIE DES FEMMES<br />
IMMIGRÉES ET RÉFUGIÉES (RAJFIRE)......................................................................................................................50<br />
ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE PIERRE DUCERF.........................................................................................................53<br />
TROISIÈME COLLECTIF DE SANS-PAPIERS......................................................................................................................54<br />
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS (FASTI)............................................57<br />
ASSOCIATION RHÔNE-ALPES POUR LE LOGEMENT ET L’INSERTION SOCIALE (ARALIS)....................................................59<br />
CIMADE.................................................................................................................................................................63<br />
SERVICE SOCIAL D’AIDE AUX ÉMIGRANTS (SSAE).......................................................................................................66<br />
COMITÉ DE LIAISON ET D'ACTION DES ÉTRANGERS (CLAE)...........................................................................................70<br />
IMPRIMERIE VÉRITÉ-RHÔNE-ALPES (PIERRE BOISGONTIER - GENEVIÈVE BAUDINO).........................................................71<br />
LES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS, DÉPORTÉS ET TRAVAILLEURS FORCÉS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE....................74<br />
FONDS EN COURS D’INVENTAIRE EN 2006...................................................................................................................81<br />
CLAP ILE-DE-FRANCE...........................................................................................................................................82<br />
CCPF..................................................................................................................................................................84<br />
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES, AMIS ET FAMILLES ESPAGNOLES (APAFE) - PARIS XV......................................86<br />
ASOCIAÇION DE PADRES DE FAMILIAS CON HIJOS MINUSVALIDOS ESPANOLES EMIGRANTES EN FRANCIA (APFMEEF,<br />
ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS ESPAGNOLS)......................................................................................91<br />
GÉNÉRATION-FEMMES..............................................................................................................................................96<br />
SOLEIL EN ESSONNE................................................................................................................................................98<br />
1. HISTORIQUE/ HIS........................................................................................................................................100<br />
2. ADMINISTRATION/ ADM...........................................................................................................................100<br />
ADM/ D1..............................................................................................................................................................100<br />
ADM/ D2..............................................................................................................................................................100<br />
3. ACTIONS/ ACT..............................................................................................................................................100<br />
4. PRODUCTION/ PROD..................................................................................................................................101<br />
PROD/ D2.............................................................................................................................................................101
Contact :<br />
<strong>Génériques</strong><br />
34 rue de Cîteaux<br />
75012 Paris<br />
01 49 28 57 75<br />
www.generiques.org<br />
2 e édition
Cette collection de gui<strong>des</strong> <strong>des</strong> sources d’archives privées de l’immigration<br />
est soutenue par<br />
le Fonds d’action et de soutien<br />
pour l’intégration et la lutte contre les discriminations<br />
La Direction de la population et <strong>des</strong> migrations<br />
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement<br />
La Ville de Paris – mission Intégration<br />
Le Conseil régional Ile-de-France<br />
La Commission européenne – projet Equal