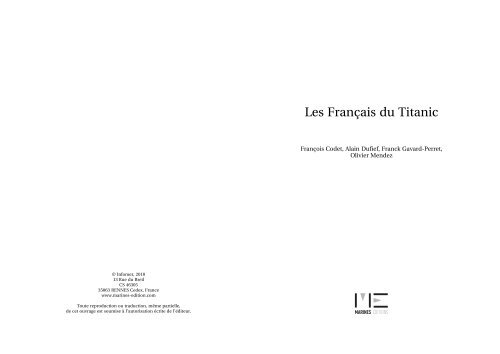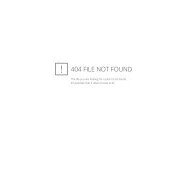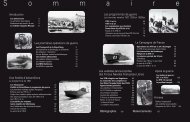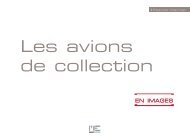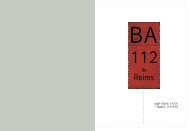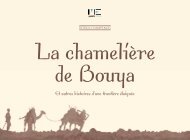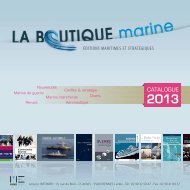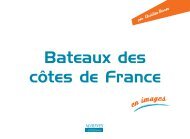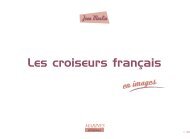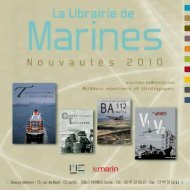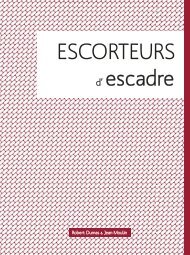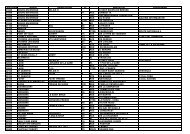Les Français du Titanic - Marines-editions.
Les Français du Titanic - Marines-editions.
Les Français du Titanic - Marines-editions.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
© Infomer, 2010<br />
13þRue <strong>du</strong> Breil<br />
CS 46305<br />
35063 RENNES Cedex, France<br />
www.marines-edition.com<br />
Toute repro<strong>du</strong>ction ou tra<strong>du</strong>ction, même partielle,<br />
de cet ouvrage est soumise à l’autorisation écrite de l’éditeur.<br />
<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
François Codet, Alain Dufief, Franck Gavard-Perret,<br />
Olivier Mendez
SOMMAIRE<br />
Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
ChapitreÞI<br />
Travailler sur l’Atlantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
ChapitreÞII<br />
Voyager au loin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
ChapitreÞIII<br />
Embarquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />
ChapitreÞIV<br />
Faire face au danger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />
ChapitreÞV<br />
Revenir au port et tenter de comprendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131<br />
ChapitreÞVI<br />
Essayer de revivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165<br />
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197<br />
7
REMERCIEMENTS<br />
<strong>Les</strong> auteurs remercient les membres de l’Association française <strong>du</strong><br />
<strong>Titanic</strong> dans leur ensemble et plus particulièrement Gérard Piouffre et<br />
Daniel Dupont, qui ont participé à la totalité des travaux préparatoires à<br />
la publication de l’ouvrage, ainsi que ceux de nos membres qui ont<br />
apporté leur contribution personnelle à la rédaction de cet ouvrageÞ:<br />
Thierry Dufournaud, Christian Gorrée-Wery, Nicole Gorrée-Wery,<br />
Claudine Laroche, Annick Latil-Douglas, Michel Leroy, Jean-Philippe<br />
Marre, François Omont, Annie Panier-Eliet et Robert Shotton.<br />
<strong>Les</strong> auteurs remercient également les opérateurs des sites amisÞ: le<br />
blog de Nadine Cherubini sur «ÞJackÞ» Philips et son forum, celui de<br />
Jean-Philippe Marre sur Thomas Andrews et le forum d’Anne-Aymone<br />
Rossin sur les divers aspects de l’histoire <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>.<br />
<strong>Les</strong> auteurs remercient enfinÞ:<br />
—ÞToutes les familles ayant accepté de partager la mémoire de ceux<br />
de leurs proches qui ont voyagé sur le <strong>Titanic</strong>Þ: outre celles citées ci-dessus,<br />
Marie-Thérèse Boidin, Anny Boquet, Lucette Boutot, Angèle Bricoux,<br />
Jacques Bricoux, Paul et Olivier Chaboisson, Odile et François<br />
Chentrier, Max Crubezy, M me Daumont, Gilbert Dherbier, Cyril de la<br />
Fare, Paulette Macheret, Olivier et Pierre Malachard, Françoise Mallet,<br />
Christian Maréchal, Élisabeth Navratil, André Pachéra, Claude Roulet,<br />
Marcel et Françoise Van Nieuwenberg, Terry Zakine-Cerf et toutes les<br />
personnes dont nous aurions malencontreusement pu oublier de citer le<br />
nom ou la participation au travail d’archivage et de mémoireþ;<br />
—ÞLa Cité de la mer et la Communauté urbaine de Cherbourg, pour<br />
leur contribution significative au maintien de la mémoire <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> en<br />
Franceþ;<br />
—Þ<strong>Les</strong> villes de Solesmes (Nord), Liévin (Pas-de-Calais) et Cosne-<br />
Cours-sur-Loire (Nièvre), pour avoir honoré la mémoire de ceux de leurs<br />
enfants qui sont morts en mer le 15Þavril 1912þ;<br />
—ÞEdward et Karen Kamuda de la <strong>Titanic</strong> Historical Society qui, les<br />
premiers, nous ont confié le soin de conserver la mémoire des <strong>Français</strong><br />
<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>þ;<br />
—Þ<strong>Les</strong> autres associations qui, comme la nôtre, œuvrent pour maintenir<br />
vivante la mémoire <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>Þ: la British <strong>Titanic</strong> Society et nos<br />
9
<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
homologues <strong>du</strong> Canada, d’Irlande, de Scandinavie, d’Allemagne, de Belgique<br />
et de Suisseþ;<br />
—ÞPhilip Hind, dont le site Encyclopedia <strong>Titanic</strong>a constitue une mine<br />
presque inépuisable d’informations – parfois à vérifier – et de contactsþ;<br />
—ÞBrian Ticehurst, de la British <strong>Titanic</strong> Society, pour ses travaux sur le<br />
restaurant À la carte et son personnel, publiés en 2005þ;<br />
—ÞL’historien canadien Alan Hustak, le norvégien Per Kristian Sebak<br />
et le journaliste investigateur Senan Molony pour leurs travaux sur les<br />
Canadiens, les Norvégiens et les Irlandais <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>þ;<br />
—ÞGünter Bäbler, pour ses recherches détaillées sur les Suisses à bord<br />
<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>þ;<br />
—ÞRoger Pelard et l’Association française des amis des chemins de<br />
fer, pour l’historique de la ligne ferroviaire Paris-Cherbourg (Latitudeþ41Þn°36).<br />
—ÞLuc Fournier et l’Ajecta, pour l’historique des trains transatlantiques.<br />
—ÞToutes les personnes, malheureusement trop nombreuses à citer,<br />
en France et à l’étranger, qui ont accepté de nous aider lors de nos<br />
recherches en mairies, aux archives, en bibliothèques, sur l’Internet, qui<br />
ont partagé leur savoir, leurs informations, leurs illustrations, qui ont<br />
généreusement donné leur temps sans compter, au fil des années, pour<br />
que la mémoire des <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> ne s’éteigne pas.<br />
D’un continent à l’autre<br />
AVANT-PROPOS<br />
En Grande-Bretagne, le roi George V avait accédé au trône le 22Þjuin<br />
1911, succédant à son père ÉdouardÞVII. Adopté dans des conditions<br />
orageuses, début 1912, le Parliament Bill avait accentué l’antagonisme<br />
entre partis politiques. Le pays semblait alors être à la veille d’une révolution<br />
sociale et économique. <strong>Les</strong> hommes de la City commentaient la<br />
forte progression de la Bourse, les nouveaux impôts <strong>du</strong> budget présenté<br />
par Lloyd George pour financer les dépenses d’armement et les pensions<br />
de vieillesse, le projet de Home Rule pour l’Irlande, auquel s’opposaient<br />
les protestants d’Ulster. Ils déploraient la grève des mineurs qui,<br />
depuis le 1 er Þmars, affectait un million de travailleurs de ce secteur et des<br />
millions d’autres dans différents domaines économiques. L’on parlait<br />
aussi d’une éclipse de soleil, annoncée pour le 17Þavril, ou de l’accident<br />
d’avion de Claude Grahame-White, survenu alors qu’il volait par mauvais<br />
temps à Hendon. Londres avait vu avec enthousiasme l’arrivée<br />
des ballets russes de Diaghilev et ses théâtres enchaînaient les pièces à<br />
succès.<br />
Jusqu’à la fin <strong>du</strong> XIX e Þsiècle, la marine marchande britannique avait<br />
largement dominé le trafic passagers sur l’Atlantique nord, notamment<br />
grâce à la Cunard Line, fondée en 1840 et à la White Star Line, fondée en<br />
1845. Néanmoins, à l’aube <strong>du</strong> XX e Þsiècle, cette suprématie allait être<br />
remise en cause. En 1897, le Norddeutscher Lloyd de Brême mit en effet<br />
en service le Kaiser Wilhelm der Grosse, paquebot de 14Þ500 tonnes,<br />
lequel conquit le Ruban bleu. Sa construction, aux chantiers de Stettin,<br />
fut suivie par celles <strong>du</strong> Kronprinz Wilhem en 1901 et <strong>du</strong> Kaiser WilhemÞII<br />
l’année suivante. Par ailleurs, rivalisant d’audace, la Hamburg Amerika<br />
mit en service le Deutschland, un élégant paquebot de 16Þ500 tonnes et<br />
de plus 200 mètres de long. Ces remarquables vaisseaux conférèrent à<br />
l’Allemagne une prépondérance grandissante sur l’Atlantique nord. La<br />
réplique anglaise à ce défi germanique sans précédent se tra<strong>du</strong>isit, pour<br />
la compagnie Cunard, par la décision ambitieuse de faire construire<br />
deux paquebots rapides de 32Þ000 tonnes, le Lusitania et le Mauretania,<br />
mis en service en 1907. Amalgamée depuis 1902 au sein <strong>du</strong> consortium<br />
nord-américain International Mercantile Marine (IMM) la compagnie<br />
White Star entreprit à son tour la construction de trois paquebots de<br />
11
<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
46Þ000 tonnes, dont l’opulence serait inégalée mais dont les dimensions<br />
seraient telles que seuls les quais et les bassins <strong>du</strong> port de Southampton<br />
seraient capables de les accueillir. Ils allaient s’appeler Olympic, <strong>Titanic</strong><br />
et Britannic.<br />
Aux États-Unis, William Howard Taft était président depuis 1908. En<br />
1909, un traité dit de réciprocité avait été envisagé avec le Canada, pour<br />
la pro<strong>du</strong>ction d’énergie dans la région <strong>du</strong> Niagara, mais l’application de<br />
ce traité aurait mis en péril la situation de certains fermiers de la région<br />
et, depuis 1911, les débats parlementaires étaient marqués par une violente<br />
opposition entre les sénateurs de l’est et ceux de l’ouest. Taft, dont<br />
la réélection était sérieusement menacée par ces dissensions, attendait<br />
avec impatience le retour de son conseiller Archibald Butt, qui revenait<br />
d’un long séjour en Europe à bord <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>. Celui-ci devait malheureusement<br />
périr dans la catastrophe. À l’automne 1912, c’est le démocrate<br />
Woodrow Wilson qui remporta l’élection présidentielle.<br />
Dès 1894, l’in<strong>du</strong>strie américaine était devenue la première <strong>du</strong> monde<br />
en raison de l’abondance des matières premières sur le territoire et de<br />
l’efficacité atteinte dans les techniques de mécanisation de la pro<strong>du</strong>ction.<br />
La gestion de cette puissance in<strong>du</strong>strielle s’effectuait par l’intermédiaire<br />
de trusts, grands ensembles regroupant sous une direction unique<br />
des entreprises distinctes, dans lesquels les in<strong>du</strong>striels se trouvaient placés<br />
sous la coupe de financiers dont John Pierpont Morgan, fondateur<br />
de l’IMM, était un représentant éminent.<br />
<strong>Les</strong> échanges commerciaux et culturels entre les États-Unis et<br />
l’Europe entraînaient un va-et-vient d’hommes d’affaires et d’ingénieurs,<br />
d’hommes de lettres et d’artistes, de journalistes et de sportifs<br />
entre les deux continents. <strong>Les</strong> ports de la côte est des États-Unis constituaient<br />
des pôles économiques majeurs de l’activité commerciale américaine<br />
mais celui de New York éclipsait les autres par l’ampleur de son<br />
trafic, son activité culturelle, son architecture futuriste et le caractère<br />
cosmopolite des populations qui y résidaient. C’était également le principal<br />
point d’entrée sur le territoire des dizaines de milliers d’immigrants<br />
qui arrivaient chaque année en provenance d’Europe. En 1904,<br />
selon l’historien américain Edward O’Donnell, 75Þ% de la population<br />
new yorkaise était elle-même composée d’immigrants ou d’enfants<br />
d’immigrants. Pour accroître les capacités d’accueil <strong>du</strong> port de New<br />
York le chenal d’Ambrose avait dû être creusé, en 1907, pour permettre<br />
l’accès au port <strong>du</strong> Lusitania et les bassins avaient dû être agrandis pour<br />
permettre l’accostage de l’Olympic en 1911.<br />
En France, un gouvernement de gauche modérée avait été investi en<br />
févrierÞ1911 sous la présidence <strong>du</strong> radical-socialiste Ernest Monis. Le<br />
21Þmai, une course aérienne, organisée entre Paris et Madrid, fut remportée<br />
par Jules Védrines sur un Morane-Saulnier mais, au départ<br />
d’Issy-les-Moulineaux, l’un des avions s’écrasa sur la tribune officielle,<br />
tuant le ministre de la Guerre Berteaux et blessant grièvement Monis. À<br />
la mi-juin, Joseph Caillaux succéda à Monis. Le 1 erÞ juillet survint une<br />
12<br />
Avant-propos<br />
crise internationale entre la France et l’Allemagne, déclenchée par l’arrivée<br />
de la canonnière SMS Panther sur rade d’Agadir, au Maroc. Le<br />
28Þjuillet, dans la perspective d’un conflit possible, le général Joseph<br />
Joffre fut nommé chef de l’état-major général de l’armée de Terre. Le<br />
25Þseptembre, le cuirassé Liberté avait explosé accidentellement en rade<br />
de Toulon, faisant 110Þmorts et 236 blessés graves. Le 4Þnovembre un<br />
accord sur le Maroc était signé entre la France et l’Allemagne. Le 15Þjanvier<br />
1912, Henri Poincaré devint chef <strong>du</strong> gouvernement. Du 15 au<br />
17Þavril, les mutineries de Fez, déclenchées contre l’instauration d’un<br />
protectorat français au Maroc, s’étaient soldées par plusieurs centaines<br />
de morts, avec pour conséquence la nomination <strong>du</strong> général Lyautey<br />
comme Résident général le 27Þavril. <strong>Les</strong> expéditions polaires de l’explorateur<br />
Jean Charcot fascinaient les chercheurs scientifiques. <strong>Les</strong> cercles<br />
littéraires découvraient l’immensité <strong>du</strong> talent de Paul Claudel dans<br />
L’Annonce faite à Marie et Claude Debussy terminait l’adaptation chorégraphique<br />
de L’Après-midi d’un faune.<br />
Aux chantiers de Saint-Nazaire, le paquebot France (deuxième <strong>du</strong><br />
nom) avait été mis sur cale le 20Þavril 1909, sur commande de la Compagnie<br />
générale transatlantique et lancé le 20Þseptembre 1910. Long de<br />
217Þm, déplaçant 27Þ200 tonnes, capable d’embarquer 1Þ885 passagers et<br />
631 membres d’équipage, il effectua ses essais à la mer les 12 et 13Þavril<br />
1912, atteignant la vitesse de 24 nœuds et demi. Premier grand paquebot<br />
à effectuer la traversée de l’Atlantique après le naufrage <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>,<br />
il quitta LeÞHavre le samedi 20Þavril en début d’après-midi et arriva à<br />
New York le vendredi 26Þavril à 10Þh, après une traversée inaugurale<br />
dont l’ambiance avait été fortement assombrie par les conséquences de<br />
la catastrophe maritime.<br />
Enfin, en ce mois d’avrilÞ1912, le public français suivait par la presse<br />
l’épopée de la bande à Bonnot «Þles bandits en automobileÞ» lesquels<br />
avaient commis plusieurs délits spectaculaires et venaient d’abattre le<br />
chef adjoint de la Sûreté. La plupart de ses membres furent arrêtés le<br />
24Þavril et la police parvint à cerner et à abattre leur chef le 28Þavril.<br />
Cependant, à la une des journaux, les «ÞexploitsÞ» de ces malfaiteurs<br />
devaient être un temps éclipsés par un fait divers dramatiquement coûteux<br />
en vies humainesÞ: le naufrage <strong>du</strong> paquebot <strong>Titanic</strong>.<br />
Un <strong>Titanic</strong> françaisÞ?<br />
Bien qu’appartenant à un consortium américain et naviguant sous le<br />
pavillon d’une compagnie anglaise, on aurait pu dire <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> qu’il<br />
était <strong>Français</strong> sous certains aspects. Énumérons quelques faits précisÞ:<br />
trente-et-un des passagers étaient français et l’équipage comptait le<br />
steward Paul Lefebvre, affecté à la première classe. Le chef de cuisine<br />
Pierre Rousseau et quinze jeunes hommes, originaires de toutes les provinces<br />
françaises, travaillaient au restaurant À la carte. Enfin, le jeune<br />
violoncelliste Roger Bricoux faisait partie de la formation musicale<br />
embarquée. Au total, quarante-neuf <strong>Français</strong>, passagers ou membres<br />
13
<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
d’équipage, se trouvaient ainsi parmi les quelque 2Þ200Þpersonnes<br />
embarquées pour la traversée inaugurale. En outre, plusieurs passagers<br />
éminents étaient établis en France, où ils avaient souvent acquis une<br />
résidence. Après le naufrage, quelques-uns des survivants s’installèrent<br />
en France, où l’on peut encore trouver leur trace. L’entreprise Citroën<br />
avait conçu et réalisé les embrayages des moteurs de l’appareil à gouverner<br />
de cinq navires de la White Star Line, parmi lesquels les trois paquebots<br />
de la classe Olympic. Ce fut une équipe de Besançon qui vint<br />
assurer la finition des dorures sur bois <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> à Southampton. La<br />
tapisserie représentant une scène des «Þchasses <strong>du</strong> Duc de GuiseÞ», qui<br />
décorait l’un des paliers <strong>du</strong> grand escalier arrière 1 en première classe,<br />
fut spécialement tissée à Aubusson pour le navire. La White Star Line<br />
gérait des agences commerciales à Paris, Nice mais aussi à Cherbourg<br />
où le navire fit une courte escale sur rade le 10Þavril. Le transbordeur<br />
Nomadic, qui assura à cette occasion le transfert des passagers de première<br />
et deuxième classes, a pu être admiré sur la Seine à Paris, face à la<br />
tour Eiffel, de 1974 à 2003 2 . La voiture que William Carter, passager de<br />
première classe, ramenait aux États-Unis était une Renault 1911. John<br />
Pierpont Morgan, propriétaire de la compagnie maritime, se rendait<br />
régulièrement en cure à Aix-les-Bains, où il se trouvait d’ailleurs au<br />
moment <strong>du</strong> naufrage. John Pierpont Morgan était un personnage très<br />
influent dans cette ville, dont une rue porte d’ailleurs son nom, et il est<br />
à l’origine de l’ouverture de l’hôpital, qu’il inaugura en personne après<br />
avoir fait sceller des effets personnels dans l’un des piliers <strong>du</strong> bâtiment.<br />
En 1985, c’est une mission océanographique franco-américaine qui<br />
découvrit l’épave par 3Þ800 mètres de fond, dans l’océan Atlantique.<br />
C’est dans les laboratoires de la direction des études et de la recherche<br />
d’EDF à Saint-Denis que les objets remontés <strong>du</strong> site <strong>du</strong> naufrage, lors<br />
d’expéditions archéologiques très discutables, ont été «ÞtraitésÞ» avant<br />
d’être livrés à la curiosité <strong>du</strong> public, puis c’est au laboratoire LP3 de<br />
Semur-en-Auxois, en Bourgogne, lequel avait développé une technologie<br />
de pointe adaptée aux objets <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, que revint l’honneur et le<br />
privilège de «ÞsoignerÞ» la mémoire de l’épave jusqu’au récent rapatriement<br />
de la collection complète aux États-Unis.<br />
La course au Ruban bleu et au gigantisme<br />
Traverser l’Atlantique était, en 1912, chose relativement aisée. De<br />
nombreux paquebots, grands ou moyens, quittaient régulièrement les<br />
principaux ports d’Europe <strong>du</strong> Nord ou <strong>du</strong> Sud à destination de New<br />
York, Boston, Halifax ou Montréal, effectuant les traversées en cinq à<br />
1. Il n’y a pas, en principe, d’escalier à bord d’un navire mais tout était fait pour faire<br />
oublier au passager qu’il était en merÞ: le terme maritime correspondant est «ÞdescenteÞ».<br />
2. Depuis juillet 2006, il se trouve à Belfast.<br />
14<br />
Avant-propos<br />
neuf jours suivant leurs performances. Mus par des machines à vapeur<br />
et propulsés par des hélices, armés par des équipages expérimentés, ces<br />
transatlantiques étaient, pour la plupart, des navires fiables dont seuls le<br />
gros mauvais temps ou la brume parvenaient à perturber la régularité<br />
des rotations.<br />
Depuis l’automne 1907, les paquebots Lusitania et Mauretania<br />
s’étaient imposés comme étant les plus rapides et le record établi par le<br />
second de ces lévriers des mers, à 26,06 nœuds en septembreÞ1909,<br />
devait tenir jusqu’en 1929. Pourtant, dans cette course effrénée à la performance,<br />
la White Star affichait un détachement apparent vis-à-vis <strong>du</strong><br />
fameux «ÞRuban bleuÞ» et ses navires étaient traditionnellement réputés<br />
pour leur confort plutôt que pour leur vitesse. À cette période, les armateurs<br />
ne cessaient de solliciter l’ingéniosité des architectes navals afin<br />
qu’ils conçoivent des paquebots de fort tonnage, mais aux lignes élégantes,<br />
à bord desquels tout devait concourir à assurer aux passagers le maximum<br />
de confort et d’agrément. Afin de sé<strong>du</strong>ire et de conserver une<br />
clientèle exigeante, les compagnies recherchaient une décoration élaborée<br />
des locaux publics et veillaient à organiser à bord des activités<br />
récréatives. Lorsque l’Olympic entra en service en juinÞ1911, suivi par le<br />
<strong>Titanic</strong> en avrilÞ1912, l’armateur y avait privilégié le luxe et l’espace et les<br />
deux nouvelles unités étaient sans conteste les plus grands navires à<br />
passagers à flot. Avant la Première Guerre mondiale, seuls les trois<br />
paquebots allemands de la classe Imperator ainsi que l’Aquitania de la<br />
Cunard Line viendraient les surclasser par la taille.<br />
Bienvenue à bord<br />
En embarquant sur rade à bord de l’un des deux paquebots géants de<br />
la White Star, une fois franchis les portelones situés au pont D 1 , le passager<br />
était dirigé vers les halls d’accès et de là vers les cabines. Aux ponts<br />
D, E, F et G étaient réparties les 297 cabines des passagers de troisième<br />
classe ainsi que les locaux de l’équipage, desservis, de l’avant à l’arrière,<br />
par une large coursive centrale baptisée «ÞScotland RoadÞ» par les<br />
membres d’équipage <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>. La clientèle de troisième classe disposait<br />
d’une salle à manger (au pont F) ainsi que d’une salle commune. Au<br />
pont D étaient situées les salles à manger et les cuisines de première et<br />
de deuxième classe. <strong>Les</strong> locaux publics et les logements des passagers de<br />
deuxième classe – comprenant 207 cabines – étaient situés sur les ponts<br />
D, E, F et G et occupaient en gros le tiers arrière <strong>du</strong> navire, à hauteur des<br />
troisième et quatrième cheminées, tandis que ceux de première classe,<br />
installés aux ponts A, B, C, D et E, occupaient l’essentiel de l’espace restant<br />
jusqu’à l’avant des superstructures. Chacune de ces deux classes<br />
disposait d’un hall d’accès, d’une salle à manger, de plusieurs salons ou<br />
1. A quai, l’embarquement s’effectuait par des portières distinctes, situées au pont C<br />
pour les passagers de deuxième classe et au pont B pour ceux de première classe.<br />
15
<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
fumoirs, d’une bibliothèque et d’un pont-promenade. La première<br />
classe bénéficiait en plus d’un gymnase, d’une piscine, d’un jardin<br />
d’hiver, d’un restaurant À la carte et d’un «ÞCafé parisienÞ» avec une terrasse,<br />
situé à tribord arrière. Plus bas, les ponts inférieurs abritaient les<br />
cales à marchandises (sur l’avant) et surtout les vastes compartiments<br />
où étaient implantées les six chaufferies et les deux salles des machines.<br />
Enfin, tout en haut des superstructures, le pont des embarcations constituait<br />
une vaste promenade, ouverte au vent marin, où l’on n’accordait le<br />
plus souvent qu’un regard machinal aux seize canots de sauvetage suspen<strong>du</strong>s<br />
à leurs bossoirs.<br />
Tel est, sommairement planté, le décor somptueux dans lequel quarante-neuf<br />
de nos compatriotes allaient vivre quatre journées éblouissantes<br />
suivies d’une nuit de cauchemar.<br />
CHAPITREÞI<br />
Travailler sur l’Atlantique<br />
Le paquebot RMS Olympic – Mise en service –<br />
Comparaison avec le RMS Mauretania<br />
Conséquences des accidents survenus en mer<br />
pendant la période 1911-1912<br />
La mise en œuvre d’un grand transatlantique au début <strong>du</strong> XX e Þsiècle<br />
Le Restaurant À la carte à bord de l’Olympic et <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
Auguste Louis Coutin, cuisinier de paquebot<br />
Roger Bricoux, musicien de paquebot
Southampton High Street. (Collection Robert Shotton)<br />
Le paquebot RMS Olympic. (Collection Olivier Mendez)<br />
Le paquebot RMS Olympic – Mise en service<br />
– Comparaison avec le RMS Mauretania<br />
Tête de série des trois nouveaux paquebots de la White Star Line,<br />
l’Olympic fut lancé par les chantiers navals Harland et Wolff le<br />
20Þoctobre 1910. Le 29Þmai 1911, il appareilla de Belfast pour deux<br />
jours d’essais en mer. Le 31Þmai au soir il quitta ce port, pour Liverpool<br />
et Southampton. Le 14Þjuin en soirée, il entreprit son voyage<br />
inaugural et arriva à New York le 21Þjuin.<br />
La silhouette des nouveaux géants avait été très étudiéeÞ: limitées à<br />
trois étages, les superstructures équilibrées n’écrasaient pas l’ensemble<br />
<strong>du</strong> navire. Peints en blanc, les ponts supérieurs se détachaient avec bonheur<br />
sur la coque noire. <strong>Les</strong> quatre hautes cheminées, de couleur chamois<br />
rehaussées d’une manchette noire, étaient régulièrement espacées<br />
et légèrement inclinées vers l’arrière.<br />
Comparaison RMS Olympic – RMS Mauretania<br />
Caractéristiques Olympic Mauretania<br />
Longueur HT 260 m (882 pieds 9 pouces) 240,8Þm (790 pieds)<br />
Largeur 28,2Þm (92 pieds 6 pouces) 26,8Þm (88 pieds)<br />
Tirant d’eau 10,5Þm (34,5 pieds) 10,21Þm (33 pieds 6 pouces)<br />
Déplacement p.c. 52Þ300 tonnes 38Þ000 tonnes<br />
Propulsion Deux machines alternatives, Quatre turbines<br />
une turbine centrale,<br />
3 hélices<br />
à engrenages, 4 hélices<br />
Puissance 46Þ000 chevaux-vapeur 68Þ000 chevaux-vapeur<br />
Vitesse en service/maximum 21,5 nœuds/23 nœuds 24,5 nœuds/27 nœuds<br />
Meilleure traversée<br />
Daunt’s Rock – Ambrose<br />
1911Þ: 5Þj 13ÞhÞ6Þmin 1909Þ: 4Þj 10ÞhÞ51Þmin<br />
Équipage 890 938<br />
Nombre de passagers<br />
transportés par classe<br />
735/674/1Þ026 =Þ2Þ435 563/464/1Þ138 =Þ2Þ165<br />
Canots de sauvetage 2/14/4 : 16 canots<br />
4 groupes de 4,<br />
et 4 canots pliables<br />
soit 16 canots<br />
19
<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
Leur dotation en canots de sauvetage était conforme aux dispositions<br />
en vigueur au Royaume-Uni depuis 1894. Le règlement <strong>du</strong> Board of<br />
Trade prescrivait que «Þles navires de 10Þ000 tonnes et plusÞ» soient équipés<br />
de 16 canots de sauvetage, capables d’accueillir 962 passagers en cas<br />
de sinistre. Appliquée à des navires de 46Þ000 tonnes, cette norme<br />
paraissait tout à fait inappropriée. Aussi l’architecte naval Alexandre<br />
Carlisle, constatant l’important espace laissé disponible sur le pont des<br />
embarcations, formula-t-il des propositions visant à doter ces navires de<br />
64, 48 ou 32 canots, suggestions que l’armateur ne retint pas.<br />
Conséquences des accidents survenus en mer<br />
pendant la période 1911-1912<br />
L’Olympic effectua ses quatre premières traversées avec succès et sans<br />
encombre. Mais le 20Þseptembre 1911, dans le chenal d’accès à<br />
Southampton, le paquebot fut abordé sur son flanc tribord par le croiseur<br />
léger HMS Hawke. Le choc provoqua deux brèches importantes<br />
dans la coque, à hauteur des locaux de deuxième classe à l’arrière ainsi<br />
que des dégâts sérieux à la ligne d’arbre tribord. En conséquence, le<br />
navire arriva à Belfast le 6Þoctobre pour y effectuer les réparations nécessaires,<br />
dont le coût s’élèverait à 250Þ000Þlivres sterling. <strong>Les</strong> six semaines<br />
et demi nécessaires à cette intervention imprévue retardèrent le programme<br />
des travaux à bord <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>. Et la White Star allait devoir faire<br />
face à une nouvelle perte de ressourcesÞ: le 24Þfévrier 1912, alors qu’il faisait<br />
route vers l’Europe, l’Olympic perdit une pale de son hélice latérale<br />
bâbord et, n’étant plus propulsé que par l’hélice tribord, entra avec difficultés<br />
à Southampton quatre jours plus tard. L’avarie nécessita un<br />
nouveau passage aux chantiers HarlandÞ&ÞWolff, <strong>du</strong> 2 au 7Þmars. C’est<br />
<strong>du</strong>rant cette période que le pont A <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> fut fermé sur la moitié de<br />
sa longueur pour éviter les courants d’air et les embruns constatés lors<br />
des premiers voyages de l’Olympic. Pour la dernière fois, l’Olympic et le<br />
<strong>Titanic</strong> se trouvèrent ainsi côte à côte à Belfast. Tandis que le paquebot<br />
endommagé reprenait son service normal le 13Þmars, les travaux d’achèvement<br />
de son frère jumeau s’en trouvaient à nouveau retardés et ce<br />
sont bien les divers dommages subis par l’Olympic qui eurent pour<br />
conséquence le report au mois d’avril de la date <strong>du</strong> voyage inaugural <strong>du</strong><br />
<strong>Titanic</strong>, initialement fixée au 20Þmars.<br />
Le 10Þavril 1912, l’Olympic était en partance de New York pour<br />
Southampton, avec un état-major profondément renouveléÞ: de nombreux<br />
membres de son équipage avaient en effet été désignés pour<br />
embarquer sur le <strong>Titanic</strong>. Ces affectations concernaient notamment le<br />
commodore Edward Smith et deux officiers de quart expérimentésÞ:<br />
Henry Wilde et William Murdoch. C’était aussi le cas de 15 membres <strong>du</strong><br />
personnel équipage pont ainsi que de 14 officiers et de 28Þhommes <strong>du</strong><br />
service machines. Au total, 246 personnes furent transférées de l’Olympic.<br />
Immobilisé à Southampton, le paquebot Oceanic fournit également<br />
un important contingentÞ: 3 officiers (Charles Lightoller, Herbert Pitman<br />
20<br />
Travailler sur l’Atlantique<br />
et James Moody) et 11 matelots de pont, 4 officiers (dont William<br />
Farquharson, le chef mécanicien adjoint) et 21Þhommes <strong>du</strong> service<br />
machines. Au total, 48 hommes furent transférés de l’Oceanic. Enfin,<br />
3þofficiers, 3þmatelots, 6þofficiers mécaniciens, 12þmécaniciens, 1þcommissaire<br />
et 12 stewards provenaient d’autres paquebots de la White Star.<br />
Deux mois après la perte <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, à l’issue d’une traversée de<br />
l’Atlantique en juinÞ1912, l’Olympic se trouvait à proximité de Land’s<br />
End, en Cornouailles. En raison d’une navigation imprécise, il manqua<br />
de peu de s’échouer sur des récifs, aperçus au dernier moment, qu’il<br />
parvint à éviter de justesse en battant énergiquement en arrière. Lors<br />
des traversées suivantes, le capitaine Herbert Haddock se vit infliger la<br />
présence d’un contrôleur désigné par la compagnie. Ces faits ne devaient<br />
être ren<strong>du</strong>s publics que 75Þans plus tard. En octobreÞ1912, consécutivement<br />
à la perte <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, le navire <strong>du</strong>t retourner une fois de plus à Belfast,<br />
cette fois jusqu’en avrilÞ1913, pour y subir diverses modifications,<br />
dont le renforcement de la structure de coque et l’installation de canots<br />
de sauvetage supplémentaires. Utilisé comme transport de troupes pendant<br />
la Première Guerre mondiale, l’Olympic poursuivra une longue et<br />
heureuse carrière jusqu’en 1935, date à laquelle il sera remis aux chantiers<br />
écossais de Jarrow puis d’Inverkeithing pour y être démantelé.<br />
La mise en œuvre d’un grand transatlantique au début <strong>du</strong> XX e Þsiècle<br />
Un grand paquebot est tout à la fois un grand hôtel et un grand<br />
navireÞ: lorsque tout s’effectue dans le calme, les passagers peuvent parfois<br />
avoir l’illusion de ne pas être en mer mais, lorsque les éléments<br />
manifestent leur puissance, l’illusion est vite dissipée et le rôle de l’équipage<br />
dans la con<strong>du</strong>ite <strong>du</strong> navire redevient vite évident aux yeux de ceux<br />
qu’il transporte. C’est pourquoi le récit qui va suivre comportera divers<br />
aperçus sur les particularités, les contraintes et les risques de la navigation<br />
océanique. Le fonctionnement des grands paquebots de cette époque<br />
était assuré par trois services principauxÞ: le pont, la machine et le<br />
commissariat (Victualling). À bord des deux géants de la White StarÞ:<br />
—Þ62 officiers et matelots composaient l’effectif «ÞpontÞ». Leurs tâches<br />
essentielles étaient d’assurer la con<strong>du</strong>ite <strong>du</strong> navire et la veille optique, la<br />
détermination de la position en mer, d’effectuer les manœuvres de port<br />
et de participer à l’entretien courant <strong>du</strong> navireþ;<br />
—Þ325Þhommes étaient affectés à la mise en œuvre et à l’entretien de<br />
l’appareil propulsif et des équipements auxiliaires, ainsi qu’à la pro<strong>du</strong>ction<br />
d’énergie électrique. Ils devaient également procéder, à chaque<br />
rotation <strong>du</strong> navire, à l’embarquement et à la mise en soute d’environ<br />
6Þ000 tonnes de briquettes de charbon, amenées le long <strong>du</strong> bord dans<br />
des wagons ou des chalandsþ;<br />
—Þ409Þhommes et 22Þfemmes appartenaient au service hôtelier <strong>du</strong><br />
bord et assuraient le service des cuisines et offices, des salles à manger,<br />
des salons et bars ainsi que celui des cabines.<br />
21
<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
Deux médecins, disposant de locaux à usage médical complétaient cet<br />
effectif et étaient rattachés au service pont. Hors effectif se situaient le<br />
personnel <strong>du</strong> restaurant À la Carte, rémunéré par son employeur Luigi<br />
Gatti, les musiciens de l’orchestre, les employés <strong>du</strong> tri postal, travaillant<br />
pour le Sea Post Service et les deux opérateurs radio, rémunérés partie<br />
par leur société et partie par la compagnie maritime. À bord <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>,<br />
ces derniers s’appelaient John Philips et Harold Bride, ils étaient âgés de<br />
25 et 22Þans.<br />
La radiotélégraphie constituait, en 1912, une prestation commerciale<br />
séparée, assurée à bord par des entreprises spécialisées (Marconi, Telefunken<br />
ou De Forest). Installé par Marconi, l’équipement radio des deux<br />
paquebots constituait le dernier cri de la technique embarquée dans ce<br />
domaine, capable d’émettre et de recevoir des messages en graphie à<br />
plusieurs centaines de milles. Ainsi, le 2Þavril, les appels émis par le <strong>Titanic</strong><br />
depuis Belfast furent-ils captés par les stations de Tenerife aux îles<br />
Canaries et de Port-Saïd en Égypte, respectivement situées à plus de<br />
2Þ000Þet 3Þ000 milles <strong>du</strong> navire.<br />
<strong>Les</strong> machines, dont la puissance permettait de propulser à plus de<br />
22þnœuds une masse de 45Þ000 tonnes, nécessitaient un effectif nombreux.<br />
<strong>Les</strong> astreintes liées au fonctionnement des chaufferies au charbon<br />
d’un paquebot similaire ont notamment été décrites par Jean<br />
Hazard, ancien chef mécanicien <strong>du</strong> Normandie, et Maurice Coquin,<br />
ingénieur de marine, dans l’ouvrage «ÞL’Atlantique nord, dix mètres sous<br />
la flottaisonÞ»Þ:<br />
«ÞLa chaufferie <strong>du</strong> paquebot France comptait 120 foyers. Il y avait un<br />
effectif de 206 chauffeurs et soutiers… <strong>Les</strong> navires possédaient un système<br />
de chauffe méthodique composé d’une horloge régulatrice installée<br />
dans le compartiment des machines et, dans chaque rue de chauffe,<br />
une boîte avec des numéros lumineux indiquant quels étaient les fourneaux<br />
qu’il y avait lieu de charger.<br />
L’opération comportait trois phasesÞ: le chargement à la pelle, l’étalement<br />
<strong>du</strong> charbon incandescent sur les grilles <strong>du</strong> foyer à l’aide <strong>du</strong> ringard<br />
et le passage de la lance sur les grilles pour décoller les plaques de<br />
mâchefer. Chaque chauffeur devait s’occuper de trois foyers. <strong>Les</strong> soutiers<br />
avaient pour mission d’apporter près des chaudières le combustible<br />
soit à la pelle, soit avec un wagonnet ou une brouette si la soute était<br />
éloignée. De plus, les soutiers évacuaient les escarbilles après le décrassage<br />
<strong>du</strong> foyer. Chaque chauffeur devait décrasser un foyer au début de<br />
son quart tout en continuant à entretenir les deux autres dont il avait la<br />
charge. Cette opération <strong>du</strong>rait environ vingt minutes. En hiver, lorsque<br />
le paquebot roulait et tanguait et que les gens <strong>du</strong> service hôtelier et les<br />
matelots de pont ré<strong>du</strong>isaient leur travail, ayant <strong>du</strong> mal à tenir debout,<br />
les chauffeurs n’en brûlaient pas moins leurs 800 tonnes de charbon par<br />
jour et les soutiers devaient extraire cent tonnes d’escarbilles.Þ»<br />
Bien loin des chaufferies, les stewards avaient eux aussi de très<br />
longues journées, au travail dès 6Þh, se débrouillant pour avaler à la vavite<br />
un repas rapide dans le coin d’un office envahi par la vapeur et ne<br />
pouvant guère prendre de repos avant minuit.<br />
22<br />
Travailler sur l’Atlantique<br />
Le restaurant À la carte à bord de l’Olympic et <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
Selon Brian Ticehurst, de la British <strong>Titanic</strong> Society, le restaurant À la<br />
carte <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> aurait mérité l’appellation de «Þplus somptueux restaurant<br />
au mondeÞ» tant pour son décor que pour sa cuisine. Incontestablement,<br />
il impressionnait par sa grandeur et sa beauté. Bon nombre de<br />
passagers le comparaient d’ailleurs au Ritz parisien, ouvert en 1898.<br />
Contrairement aux déclarations faites à la presse en 1912 le restaurant<br />
<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> n’était pas une innovation récente. Selon John Maxtone-Graham,<br />
l’idée de création d’un restaurant À la carte émanait d’Albert Ballin,<br />
directeur général de la Hamburg Amerika Linie, de concert avec la<br />
chaîne Ritz-CarltonÞ: «ÞLe premier restaurant fut installé à bord de l’Amerika<br />
en 1905. La compagnie les baptisait de noms américains de manière<br />
à cultiver l’image de l’accueil de l’immigrantÞ».<br />
Le 7Þjuin et le 16Þnovembre 1907, la Cunard Line avait mis en service<br />
ses nouveaux paquebots, Lusitania et Mauretania, dotés tous deux d’un<br />
Ritz. Depuis quelques années il existait à Londres deux Ritz très en<br />
vogue nommés Gatti’s Adelphi et Gatti’s Strand. Ils avaient été fondés<br />
par des émigrés italiens d’une même famille, les Gatti. Un membre de<br />
cette famille Gaspare Antonio, dit «ÞLuigiÞ», travaillait au très prestigieux<br />
Oddenino’s Imperial, près de Trafalgar Square où il s’était rapidement<br />
hissé à un poste de responsabilité. Il parvint à obtenir l’autorisation de<br />
gérer un restaurant À la carte sur le paquebot Olympic, ce dont il<br />
rêvait depuis longtemps. Il tenait sous ses ordres Pierre Rousseau,<br />
grand chef cuisinier français émigré en Angleterre depuis quelques<br />
années (à l’âge de trente ans selon certaines archives, depuis 1908 ou<br />
1909 pour d’autres). <strong>Les</strong> deux hommes entretenant des relations professionnelles<br />
depuis plusieurs années, Gatti n’hésita pas à l’engager<br />
comme chef cuisinier sur l’Olympic. Rousseau constitua une équipe de<br />
cuisiniers réputés travailleurs et sérieux, majoritairement italiens et<br />
français, déjà employés dans des restaurants parisiens ou ceux de Gatti<br />
et c’est ainsi qu’Auguste Coutin, Louis Dornier, Claude Janin, Georges<br />
Jouannault et Pierre Villvarlange embarquèrent en 1911 sur l’Olympic.<br />
Ils se trouvaient tous à bord le 20Þseptembre, lorsque le navire entra en<br />
collision avec le croiseur Hawke. Le restaurant de l’Olympic jouissait<br />
également d’un succès avéré se tra<strong>du</strong>isant par une fréquentation soutenue,<br />
mais la salle ne comptait que 25 tables. 137 couverts, disposés sur<br />
49 tables, furent donc prévus pour le frère jumeau. L’accès à ce restaurant<br />
était exclusivement réservé aux passagers de première classe. Le<br />
prix des repas était élevé mais une ré<strong>du</strong>ction de 15 ou 25Þdollars sur le<br />
prix <strong>du</strong> billet d’embarquement était consentie aux passagers souhaitant<br />
y prendre la totalité de leurs repas. Telle était, à bord <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, l’intention<br />
manifestée par la passagère Léontine Aubart.<br />
À proximité de la salle, située au pont B, se trouvaient divers locaux<br />
auxquels les passagers n’avaient pas accèsÞ: la cave à vins, plusieurs celliers<br />
contenant viandes, poissons, fruits et fleurs et, bien enten<strong>du</strong>, les<br />
cuisines. Le Restaurant et son personnel fonctionnaient presque indé-<br />
23
<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />
pendamment des autres services <strong>du</strong> navireÞ: seuls le pain et les pâtisseries<br />
devaient être confectionnés dans les installations <strong>du</strong> pontÞD.<br />
Pour accéder au restaurant, il suffisait d’emprunter le grand escalier à<br />
l’arrière des locaux de première classe. Au bas de celui-ci, les passagers<br />
trouvaient sur leur gauche le Café parisien, où les serveurs parlaient<br />
français et où l’on servait <strong>du</strong> pastis. L’accès au restaurant À la Carte était<br />
situé en faceÞ: il fallait traverser la salle de réception, de style géorgien,<br />
puis emprunter un somptueux couloir avant de pénétrer dans le restaurant.<br />
On se serait vraiment cru dans l’un des hôtels de luxe où les passagers<br />
américains séjournaient encore quelques jours plus tôt. <strong>Les</strong> fleurs<br />
de serre qui décoraient les tables, les fauteuils de style LouisÞXVI et le<br />
service hors pair contribuaient à créer une ambiance opulente et raffinée.<br />
La salle – dont la couleur prédominante était le Rose <strong>du</strong> Barry –<br />
mesurait 18 mètres de long sur 14 mètres de large. «ÞLa pièce était très<br />
bien éclairée par de larges baies vitrées, une caractéristique originale qui<br />
créait une impression de grandes dimensions. Côté bâbord, ses larges<br />
baies vitrées donnaient directement sur le pont, tandis qu’à tribord le<br />
Café parisien lui était adjacent et donnait également sur le pont. Le palier<br />
de l’escalier arrière était aménagé en salle de réception, ce qui permettait<br />
aux passagers clients <strong>du</strong> restaurant de se réunir et de converser avant<br />
d’aller prendre leur repasÞ». Enfin, un emplacement permettait<br />
d’accueillir l’orchestre <strong>du</strong> bord.<br />
La décoration de la pièce, choisie par les architectes navals Thomas<br />
Andrews et Edward Wilding, fut réalisée par la compagnie A.ÞHeatonÞ&ÞCo.<br />
<strong>Les</strong> historiens John Eaton et Charles Haas rapportent que c’est à la<br />
société StonierÞ&ÞCo, de Liverpool, que la White Star passa commande<br />
de la vaisselle et de la porcelaine pour toutes les salles à manger, à<br />
l’exception de celle <strong>du</strong> Restaurant dont la réalisation fut confiée à la<br />
Royal Crown Derby. En première classe, les services de porcelaine<br />
étaient décorés de motifs turquoise et beige tandis qu’en deuxième<br />
classe les motifs étaient en Delft bleu et blanc. En troisième classe il y<br />
avait de la faïence blanche, rehaussée, comme dans les autres classes,<br />
<strong>du</strong> logo rouge de la White Star. Néanmoins, si l’on connaît bien la description<br />
des ustensiles et de la vaisselle de chacune des salles à manger<br />
<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, il n’existe malheureusement que très peu d’informations sur<br />
les ustensiles et la porcelaine <strong>du</strong> Restaurant À la Carte, qui devait être<br />
blanche avec un motif vert tilleul et une bor<strong>du</strong>re or ou peut-être également<br />
bleu cobalt et or. Une collection privée en Angleterre en comporte<br />
quelques pièces, seul et ultime témoignage de la somptuosité <strong>du</strong> Restaurant<br />
<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>.<br />
À bord, le personnel <strong>du</strong> Restaurant À La Carte représentait un effectif<br />
«ÞspécialÞ» quasi privé, aux ordres de Luigi Gatti, qui les rémunérait et<br />
gérait également les achats de vivres. Par conséquent, ils n’étaient<br />
considérés ni comme passagers, ni comme employés de la White Star<br />
Line, bien que la compagnie versât un shilling à chaque membre <strong>du</strong> personnel<br />
par traversée.<br />
Pour plusieurs raisons, le travail <strong>du</strong> personnel <strong>du</strong> Restaurant À la carte<br />
n’avait rien d’une sinécure, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord,<br />
24<br />
Travailler sur l’Atlantique<br />
les horaires s’avéraient particulièrement astreignants. Le Restaurant<br />
ouvrait à huit heures pour ne fermer qu’à vingt-trois heures. <strong>Les</strong><br />
employés devaient de surcroît préparer les petits-déjeuners avant<br />
l’ouverture et remettre la salle en ordre après la fermeture. De plus, la<br />
notoriété et le prestige <strong>du</strong> restaurant À la carte lui valaient une fréquentation<br />
importante. La réservation était obligatoire car le restaurant affichait<br />
complet pratiquement chaque soir. Un tel succès laisse présager<br />
de la fatigue que le personnel devait éprouver à la fin de la journée et<br />
leur repos nocturne ne pouvait être que bref.<br />
À bord, l’heure des repas était l’un des moments les plus atten<strong>du</strong>s de<br />
la journée, permettant les regroupements et interrompant un moment<br />
la monotonie de la traversée. Par beau temps, les salles à manger étaient<br />
donc souvent bien remplies. En 1911, la marine marchande britannique<br />
s’appliquait à concurrencer la gastronomie des paquebots français et<br />
jouait la carte de l’abondance, en tablant sur la gourmandise des passagersÞ:<br />
la composition des menus servis à bord des navires était largement<br />
diffusée.<br />
Selon une édition de l’été 1911 <strong>du</strong> magazine The ShipbuilderÞ: «ÞAucun<br />
secteur d’un navire de transport de passagers n’avait plus d’importance<br />
pour les passagers que celui associé à la préparation et au service de la<br />
nourriture, et aucun n’avait reçu de plus grandes améliorations <strong>du</strong>rant<br />
les dernières annéesÞ».<br />
Chaque passager désireux de se restaurer au Restaurant À la carte<br />
était pris en charge par l’un des dix-huit membres <strong>du</strong> personnel dont la<br />
tâche consistait à prendre les commandes puis d’assurer le service<br />
jusqu’à la présentation, à la fin <strong>du</strong> repas, de la «Þpetite noteÞ» encaissée<br />
par Mesdemoiselles Mabel Martin et Ruth Bowker, deux Britanniques<br />
âgées de 27 et 20Þans. <strong>Les</strong> reçus devaient être visés soit par le commissaire<br />
de bord, Hugh McElroy, soit par son adjoint Reginald Barker. <strong>Les</strong><br />
menus présentés aux passagers mariaient l’opulence et la finesse. Tous<br />
ces raffinements correspondaient aux attentes des passagers de première<br />
classe. Parmi les boissons proposées, une bouteille de champagne<br />
Veuve Clicquot 1900 coûtait 3,50Þdollars, un Sauternes 1 dollar, une<br />
Chartreuse Verte 3,75Þdollars et une eau Perrier 0,07 dollar. Une boîte de<br />
cigarettes était ven<strong>du</strong>e 1 shilling ou 0,25 dollar.<br />
Couturière de renommée internationale, Lady Lucy Duff-Gordon,<br />
voyageant avec son mari Sir Cosmo Duff-Gordon, sous le pseudonyme<br />
de Morgan, livra dans Discretions and indiscretions 1 son impression<br />
d’un dîner au restaurant À la CarteÞ: «ÞImaginez des fraises en avril, et au<br />
beau milieu de l’océan de surcroît. C’est proprement extravagantÞ! Vraiment,<br />
vous vous seriez cru au Ritz.Þ»<br />
1. Ouvrage qu’elle publia en 1932.<br />
25