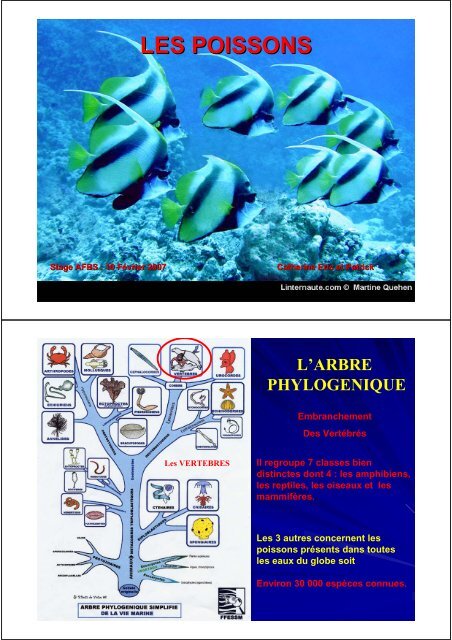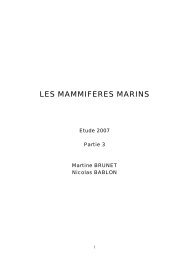LES POISSONS LES POISSONS - AquaGazel - Free
LES POISSONS LES POISSONS - AquaGazel - Free
LES POISSONS LES POISSONS - AquaGazel - Free
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>LES</strong> <strong>POISSONS</strong><br />
<strong>LES</strong> <strong>POISSONS</strong><br />
Stage AFBS : 10 Février F vrier 2007 Catherine Catherine<br />
Eric et Patrick<br />
Stage AFBS : 10 Février F vrier 2007 Catherine Catherine<br />
Eric et Patrick<br />
Les VERTEBRES<br />
L’ARBRE<br />
PHYLOGENIQUE<br />
Embranchement<br />
Des Vertébrés<br />
Il regroupe 7 classes bien<br />
distinctes dont 4 : les amphibiens,<br />
les reptiles, les oiseaux et les<br />
mammifères.<br />
Les 3 autres concernent les<br />
poissons présents dans toutes<br />
les eaux du globe soit<br />
Environ 30 000 espèces connues.
classification<br />
Dans la vie de tous les jours, on appelle poisson presque tous<br />
les Vertébrés aquatiques à sang froid.<br />
Ce vocable de poisson regroupe cependant 3 classes bien<br />
distinctes de Vertébrés:<br />
Agnathes (sans mâchoire) ou<br />
Cyclostomes (bouches circulaires)<br />
Chondrichtyens (cartilagineux )<br />
Ostéichtyens (osseux)<br />
Cyclostomes<br />
Ce sont les premiers poissons qui se développèrent au<br />
Cambrien (Ère primaire)<br />
Les seules espèces qui vivent encore actuellement sont les<br />
myxines et les lamproies.
Cyclostomes<br />
Très primitives, les lamproies sont des poissons sans<br />
mâchoire. Elles ne possèdent, ni écaille, ni nageoire paire,<br />
ni colonne vertébrale osseuse.<br />
Leur bouche dépourvue de mâchoire est conformée pour la<br />
succion. C’est une sorte d’entonnoir tapissé intérieurement<br />
de dents cornées.<br />
L’acquisition d’une mâchoire et de nageoires pectorales et<br />
pelviennes leur permettent d’exploiter une nouvelle niche<br />
écologique en abandonnant le mode de vie de filtreur pour<br />
celui plus actif, de prédateur de proies mobiles et plus<br />
grosses.
2 classes :<br />
Chondrichtyens (cartilagineux)<br />
Ostéichtyens (osseux)<br />
Chondrichtyens ou cartilagineux<br />
Ce sont des poissons à squelette plus développé, et fait presque<br />
entièrement de cartilage (sauf le crâne).<br />
C’est le début d’un squelette appendiculaire<br />
(846 espèces environs)<br />
2 sous-classes :<br />
- Brayodontes : chimères (holocéphales)<br />
- Élasmobranches (fentes branchiales latérales ou ventrales<br />
Requins, raies, torpilles
Chondrichtyens ou cartilagineux<br />
Photos<br />
Chondrichtyens ou cartilagineux
Ostéichtyens ou osseux<br />
Ce sont les poissons les plus évolués et les plus diversifiés<br />
(23 000 espèces environ).<br />
Leur squelette axial et appendiculaire est rendus plus robuste<br />
par les dépôts de calcium qui transforment les cartilages en<br />
os.<br />
Ostéichtyens ou osseux
Hydrozoaires : Siphonophores<br />
Siphonophores : essentiellement pélagiques et souvent pris pour des<br />
méduses, ils sont en fait des assemblages de polypes spécialisés<br />
suspendus à un ou plusieurs flotteurs remplis d’azote.<br />
Physalie ou galère portugaise, espèce connue pour la<br />
toxicité de son venin (peut être mortelle).<br />
Quelques repères sur les nageoires<br />
Une grande variabilité (présence/absence, nombre, répartition,<br />
structure) utilisée pour caractériser et classifier les poissons<br />
Nageoires impaires : Dans le plan de symétrie<br />
Dorsale, Anale et Caudale<br />
Nageoires paires : Equivalents des membres des tétrapodes<br />
Pectorales et Pelviennes (ou ventrales)<br />
Deux types de rayons :<br />
Epineux : pièce rigide unique (alcanthoptérygiens)<br />
Mous : éléments simples ou ramifiés, bout-à-bout<br />
(malacoptérygiens)
Les nageoires dorsales<br />
1, 2 ou 3 nageoires dorsales :<br />
Thon, maquereau : 1 épineuse, 1 molle + série de pinnules<br />
Morue : 3 molles Merlu : 2<br />
Saumon, truite : 1 molle + 1 adipeuse<br />
Labre : 1 ers rayons épineux puis mous<br />
La plupart des poissons d'eau douce : 1 molle<br />
Rarement absente (gymnnote d'Amérique du Sud)<br />
Chez les chondrichtyens :<br />
Presque toujours 2<br />
Hautes du requin, petites de la raie, absentes de la pastenague<br />
Les nageoires dorsales (suite)<br />
Adaptation :<br />
Motelle : 1 ère dorsale vibratile<br />
Espèces de grands fonds : filaments pêcheurs<br />
Rémora : ventouse<br />
Vive : en relation avec des glandes à venin
Les nageoires anales<br />
Rarement absente (poisson ruban, régalu)<br />
Parfois 2 nageoires anales (2 molles chez la morue)<br />
Le plus souvent : 1 seule nageoire anale<br />
Le 1 er rayon peut s'ossifier<br />
Très peu d'adaptation<br />
La nageoire caudale<br />
Toujours présente et unique (sauf nérophis qui n'a qu'une dorsale)<br />
Comporte le plus souvent deux lobes<br />
Formes classiques :<br />
Pointue Arrondie Tronquée Echancrée En croissant Fourchue<br />
Très peu d'adaptation (réduction jusqu'à disparition chez la raie)
Les nageoires paires<br />
Rayons solidaires d'une pièce squelettique formant une ceinture<br />
Ceinture pectorale souvent en relation avec le crâne<br />
-> position constante des nageoires pectorales<br />
Ceinture pelvienne non reliée à la colonne vertébrale<br />
-> position très variable des nageoires pelviennes<br />
Les nageoires pectorales<br />
Manquent exceptionnellement (murène, quelques anguilles et<br />
syngnathidés)<br />
Adaptation :<br />
ailes (exocet, poisson volant)<br />
pédonculée : moignons fouilleurs (baudroie), béquilles<br />
(périophtalme)<br />
poils sensoriels (gobie)<br />
filaments tactiles (polynemus)<br />
rayons articulés mobiles (grondin)
Les nageoires pelviennes (ou ventrales)<br />
Caractérisent les poissons :<br />
abdominaux : pelviennes loin en arrière (position<br />
primitive, plupart des malacoptérygiens)<br />
thoraciques : ceintures reliées par un ligament<br />
jugulaires : pelviennes sous la gorge (morue, blennie)<br />
apodes : dépourvus de pelviennes (anguilles, hippocampe,<br />
lançon, poisson lune)<br />
Adaptation :<br />
organes tactiles (régalecus, poissons abyssaux)<br />
2 doigts rigides (blennie)<br />
organe copulateur (condricthyens)<br />
ventouse (gobie, périophtalme)
Respiration<br />
Les poissons se procurent de l'oxygène dissous dans l’eau.<br />
Celle-ci pénètre par la bouche, aspirée par des mouvements<br />
volontaires ou réflexes de l’animal, ou par le courant généré par<br />
son déplacement (squale).<br />
L’eau passe ensuite sur les branchies, sortes de lamelles<br />
fortement vascularisées qui permettent au sang de se charger en<br />
oxygène et de se débarrasser du dioxyde de carbone issu du<br />
métabolisme.<br />
L’eau ressort par les ouies, ouverture protégée par un opercule<br />
rigide chez les poissons osseux ou par les fentes branchiales<br />
chez les poissons cartilagineux<br />
Respiration - Circulation<br />
Le cœur doté d’une seule oreillette et d’un seul ventricule, pompe le sang<br />
veineux pour l’envoyer vers les branchies. Une fois les échanges gazeux effectués<br />
le sang artériel repart vers les organes et les muscles.
Organes des sens<br />
L'olfaction est un sens très développé<br />
chez les poissons.<br />
Ils possèdent des sacs olfactifs qui<br />
communiquent avec l’eau extérieure<br />
par les narines.<br />
• Les yeux des poissons coralliens vivant à<br />
faibles profondeur ont des cellules en cônes<br />
et en bâtonnets permettant de voir en couleur.<br />
Les yeux disposés latéralement confèrent un<br />
champ de vision très large aux poissons.<br />
Organes des sens<br />
Chez les osseux :<br />
la ligne latérale est dotée de capteurs qui détectent les vibrations<br />
(basses fréquences) et les ondes de pression.<br />
Ce système leur permet de repérer les déplacements de leurs<br />
prédateurs et de leurs proies.<br />
Les poissons benthiques compensent leur vue médiocre par une<br />
panoplie d’organes sensoriels complémentaires : barbillons,<br />
antennes, tentacules olfactifs, etc.…<br />
Chez les cartilagineux :<br />
les ampoules de Lorenzini, petites ouvertures autour de la bouche<br />
dont on pense qu’elles permettent la perception de faibles champs<br />
électriques générées par les contractions musculaires des proies<br />
même enfouies dans le sol.
Les organes<br />
L’appareil digestif est constitué d’un œsophage court, d’un<br />
estomac en forme d’U, d’un intestin droit et court chez la<br />
plupart des espèces carnivores, parfois très long chez les<br />
omnivores et les herbivores.<br />
Le foie est souvent volumineux (chez les cartilagineux = 1/3<br />
du poids du corps.<br />
Le pancréas est peu développé.<br />
Beaucoup de poissons possèdent une vessie natatoire remplie<br />
de gaz et reliée à l’œsophage, ce qui les aide à varier leur<br />
flottabilité. Les poissons de fonds ( blennies, gobies, rascasses<br />
en sont généralement dépourvus).<br />
Les deux reins sont situés le long de l’épine dorsale.
La nutrition<br />
La plupart d’entre eux sont carnivores, quelques centaines<br />
d’espèces sont herbivores.<br />
Le mot d'ordre dans le milieu récifal comme dans tout milieu, est<br />
"manger sans être mangé".<br />
Pour cela "mangeurs" et "mangés" ont développé une multitude<br />
de stratégies anatomiques, physiologiques ou comportementales.<br />
Se camoufler /attaquer<br />
Le camouflage leur permet de se protéger de leur prédateur mais c’est aussi un<br />
moyen de se cacher pour mieux surprendre leurs proies
La reproduction<br />
Tous les poissons sont munis de glandes génitales<br />
(ovaires ou testicules)<br />
Ils possèdent au moins un sexe.<br />
Beaucoup de poissons osseux sont hermaphrodites et changent de sexe en<br />
fonction de l’age et de la composition du groupe au sein duquel ils vivent.<br />
Sexes séparés<br />
Hermaphrodisme successif<br />
Hermaphrodisme simultané<br />
ou synchrone<br />
Sexes séparés<br />
Les individus naissent mâle ou femelle et le restent jusqu’à la mort.<br />
Ils leur faut un certain temps de croissance pour être apte à se<br />
reproduire (maturité sexuelle).<br />
La fécondation est en général externe et les œufs sont déposés dans<br />
des nids d’algues, des anfractuosités dans le sable ou collés sur des<br />
rochers, des coquillages etc..<br />
Le mâle vient féconder les œufs par la suite.
Hermaphrodisme successif<br />
Les protogynes : certains individus naissent femelles et<br />
deviennent mâles au cours de leur croissance (Mérous, labres)<br />
Les protandres : font l’inverse il naissent mâles et deviennent<br />
Femelles (dorades, saupes et beaucoup de sparidés)<br />
Chez ces hermaphrodites successifs, certains individus resteront<br />
avec le sexe de leur naissance, en fonction du besoin du groupe au<br />
sein duquel ils vivent.<br />
Chez le poisson clown (amphriprion),<br />
Plusieurs spécimens vivent ensemble près d’une même anémone. Le spécimen<br />
le plus gros est toujours une femelle et le deuxième par ordre de grandeur est<br />
toujours le mâle reproducteur. Tous les autres poissons sont des mâles à des<br />
stades de maturité différents. Si on tue la femelle le mâle se transforme en femelle<br />
Et le deuxième poisson clown le plus grand devient le mâle reproducteur.
Hermaphrodisme simultané<br />
ou synchrone<br />
Ils sont à la fois mâle et femelle.<br />
Ils produisent simultanément œufs et spermatozoïdes et<br />
pratiquent une fécondation croisée avec un autre partenaire<br />
Fécondation chez les osseux<br />
Chez les poissons benthiques :<br />
la fécondation est en général externe et les œufs sont déposés dans<br />
des nids d’algues, des anfractuosités dans le sable ou collés sur des<br />
rochers, des coquillages etc..<br />
Chez les poissons pélagiques :<br />
les œufs ainsi que le sperme sont lâchés en pleine eau, en général<br />
à proximité des partenaires ou au fond, pour limiter une trop<br />
grande dispersion.
Fécondation chez les Osseux<br />
D’autres espèces sont incubateurs buccaux :<br />
Après que les œufs soient fécondés, un des deux partenaires<br />
les prends en bouche pendant le temps d’incubation.<br />
Cas particuliers<br />
Famille des Cichlidés vivants dans les grands lacs de l’est africain<br />
Après la ponte, la femelle prend les œufs en bouche et se dirige vers<br />
la nageoire anale du mâle pour recueillir le sperme<br />
(Ceci permet d’optimiser la fécondation et d’enrayer la prédation).<br />
Elle les gardent en bouche pendant la durée de l’incubation.<br />
Fécondation chez les osseux
Chez les hippocampes<br />
Je suis un poisson pas comme les autres. Dans la famille, il est habituel que ce soit<br />
les mâles qui prennent soin de la progéniture.<br />
Madame confie les ovules que Monsieur féconde.<br />
Les œufs sont gardés dans la poche ventrale du mâle jusqu’à ce que naissent les<br />
petits hippocampes. C’est donc le mâle qui accouche !<br />
Les hippocampes sont fidèles et vivent en couple toute leur vie.<br />
Sur la photo la poche<br />
ventrale du mâle<br />
est pleine de petits.<br />
Fécondation chez les Cartilagineux<br />
Le mâle présente deux organes copulateurs issus d’une<br />
Modification des nageoires pelviennes, les ptérygopodes (un<br />
seul est utilisé à la fois)<br />
L’accouplement a lieu de façon saisonnière et la fécondation<br />
interne donne lieu à deux modes de gestation : interne ou externe.<br />
Gestation externe : ovipare<br />
Certains œufs sont enfermés dans des capsules en forme de<br />
vis ou munis de filaments qui se fixent aux algues ou<br />
aux gorgones (roussettes, raies etc..)
Fécondation chez les Cartilagineux<br />
Fécondation chez les Cartilagineux<br />
Gestation interne : vivipare ou ovovivipare<br />
La femelle accouche de jeunes parfaitement autonomes qui<br />
quittent aussitôt leurs parents pour chasser.<br />
Le cannibalisme intra utérin existe chez de nombreux requins,<br />
y compris chez des espèces non agressive comme le requin pellerin.
Références<br />
Que sais-je : Les poissons, R. et M.L. Bauchot, ed. PUF<br />
La vie des poissons, M.L. et R. Bauchot, ed. Stock<br />
La vie des poissons, N.B. Marshall<br />
Dictionnaire étymologique de zoologie, B. Le Garf, ed.<br />
Delachaux et Niestlé<br />
http://www.fishbase.org/<br />
http://perso.orange.fr/christian.coudre/<br />
http://www.univ-ubs.fr/ecologie/poissons.html<br />
http://www.dinosoria.com/monde_marin.htm<br />
http://educ.csmv.qc.ca/MgrParent/vieanimale/vert.htm<br />
http://doris.ffessm.fr/<br />
http://simulium.bio.uottawa.ca/bio2525/Notes/Les_Poissons.htm<br />
http://vieoceane.free.fr/paf/fichef4f.html<br />
FIN